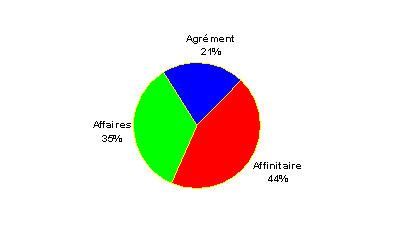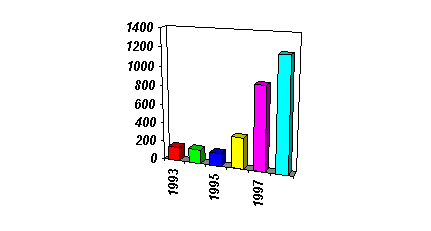N° 1866 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2000 (n° 1805), TOME XVI OUTRE–MER PAR M. CLAUDE HOARAU, Député. —— (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir le numéro : 1861 (annexes 36 et 37) Lois de finances. La commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; MM. Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Ducout, Jean Proriol, vice-présidents ; MM. Léonce Deprez, Christian Jacob, Daniel Paul, Patrick Rimbert, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Yvon Abiven, Jean-Claude Abrioux, Stéphane Alaize, Damien Alary, André Angot, François Asensi, Jean-Marie Aubron, Pierre Aubry, Jean Auclair, Jean-Pierre Balduyck, Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, MM. Christian Bataille, Jean Besson, Gilbert Biessy, Claude Billard, Claude Birraux, Jean-Pierre Blazy, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Franck Borotra, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. François Brottes, Vincent Burroni, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Dominique Caillaud, André Capet, Jean-Paul Chanteguet, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Pierre Cohen, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Daniel, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Decaudin, Mme Monique Denise, MM. Jacques Desallangre, Eric Doligé, François Dosé, Jean-Pierre Dufau, Marc Dumoulin, Dominique Dupilet, Philippe Duron, Jean-Claude Etienne, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Alain Ferry, Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Nicolas Forissier, Roland Francisci, Claude Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, André Godin, Alain Gouriou, Joël Goyheneix, Michel Grégoire, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Patrick Herr, Claude Hoarau, Robert Honde, Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, MM. Aimé Kergueris, Jean Launay, Thierry Lazaro, Jean-Yves Le Déaut, Patrick Lemasle, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, René Leroux, Roger Lestas, Alain Le Vern, Félix Leyzour, Michel Liebgott, Lionnel Luca, Jean-Michel Marchand, Daniel Marcovitch, Alfred Marie-Jeanne, Alain Marleix, Daniel Marsin, Philippe Martin, Jacques Masdeu-Arus, Marius Masse, Roger Meï, Roland Metzinger, Pierre Micaux, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Jean-Marie Morisset, Bernard Nayral, Jean-Marc Nudant, Jean-Paul Nunzi, Patrick Ollier, Joseph Parrenin, Paul Patriarche, François Patriat, Germinal Peiro, Jacques Pélissard, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Annette Peulvast-Bergeal, MM. Serge Poignant, Bernard Pons, Jacques Rebillard, Jean-Luc Reitzer, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean Roatta, André Santini, Joël Sarlot, François Sauvadet, Michel Tamaya, Jean-Claude Thomas, Léon Vachet, Daniel Vachez, François Vannson, Michel Vaxès, Michel Vergnier, Gérard Voisin, Roland Vuillaume.
I.— LES PRIORITÉS DU GOUVERNEMENT 7 A.— L’EMPLOI 7 B.— LA CULTURE ET L’ACTION SOCIALE 8 C.— LE LOGEMENT 9
EXAMEN EN COMMISSION 66 MESDAMES, MESSIEURS, L’examen du budget de l’Outre-mer pour 2000 s’inscrit dans un contexte particulier marqué par l’élaboration et l’adoption de plusieurs textes qui doivent engager l’avenir de l’Outre-mer pendant la prochaine décennie. Le vote de la loi d’orientation pour les départements d’outre-mer, la signature des Contrats de plan pour la période 2000-2006, celle des documents de programmation en matière de fonds structurels européens (DOCUP), la définition du contenu de l’article 299-2 du traité d’Amsterdam, constituent les principales échéances qui vont rythmer la prochain année. Le projet de loi d’orientation devrait être examiné au cours du premier semestre, la première version du texte étant transmise aux collectivités et aux responsables locaux le 15 novembre. A l’issue de cette consultation, un avant-projet sera élaboré. Votre rapporteur ne dispose donc d’aucune indication sur le contenu de ce texte. Il peut simplement noter que ce projet de loi, annoncé par le ministre le 23 octobre 1998, a suscité d’emblée une forte attente au sein des populations des régions concernées. Cette attente a été renforcée par les propositions contenues dans les rapports préparatoires, notamment celles qui sont destinées à favoriser le développement économique. Cette forte attente ne surprend pourtant pas, étant donné la situation des départements d’outre-mer. Partout les mêmes difficultés, partout le même malaise. Si l’expression en est différente (conflits sociaux longs et fréquents aux Antilles, augmentation de la délinquance à la Réunion), ce malaise doit être avant tout analysé au regard d’une situation socio-économique marquée par un chômage chronique élevé et des inégalités persistantes voire croissantes. Pour la deuxième année consécutive, le budget de l’Outre-mer, qui s’élève à 6,3 milliards de francs dans le projet de loi de finances, est en augmentation (+ 13,6 %), ce qui, sur l’ensemble des deux années, représente une hausse de plus de 20 %. Comme l’année dernière, cette hausse est supérieure à celle des dépenses du budget général (0,9 %). Il faut toutefois considérer, dans ces augmentations successives, la part non négligeable des transferts opérés des autres ministères vers celui de l’Outre-mer. L’emploi demeure la priorité, et représente 40 % du budget global. 58 000 nouvelles solutions d’insertion pourront être financées. Il est vrai que l’Outre-mer, malgré des taux de création d’emplois dynamiques, ne connaît guère d’améliorations dans ce domaine. Contrairement à la France métropolitaine, et du fait d’une évolution démographique totalement opposée, le taux de chômage ne diminue pas. Avec le transfert du financement des contrats emplois consolidés, jusqu’ici inscrits au ministère de l’emploi et de la solidarité, tous les contrats aidés se trouvent désormais dans le budget de l’Outre-mer qui, en 2000, financera 79 000 emplois. Jamais atteint, un tel chiffre mérite d’être souligné. Quant au logement, secteur où les besoins sont importants dans l’ensemble des départements d’outre-mer, sa progression est moins forte qu’en 1999 ; elle s’explique surtout par la hausse de la créance de proratisation. Le budget de l’Outre-mer représente 10 % des interventions de l’Etat dans les départements, collectivités et territoires ultra-marins. Il ne s’agit là que d’une partie des crédits transférés, lesquels viennent surtout de différents ministères, et d’abord de l’éducation nationale et de l’intérieur. L’ensemble des interventions qui, en 1999, s’élevait à 50,172 milliards de francs se situera, en 2000, à 51,481 milliards de francs, soit une progression de 2,6 %. Là encore, l’augmentation est supérieure à celle du budget général. Ce budget traduit par ailleurs, pour la première fois, les réformes instituées par la loi organique du 19 mars 1999 pour la Nouvelle-Calédonie. Un nouveau chapitre budgétaire a été créé pour accompagner le transfert des compétences de l’Etat à la Nouvelle-Calédonie. Il comprend une dotation globale de compensation et une dotation globale de fonctionnement. Pour tenir compte des délais d’élaboration, de discussion et d’application de la loi d’orientation, il avait été annoncé que le projet de loi de finances pour 2000 comporterait un certain nombre d’anticipations devant refléter, sous l’angle budgétaire, les projets du Gouvernement. Tel ne semble pas être le cas. L’attente vis-à-vis de la loi d’orientation ne peut se trouver que renforcée. I.— LES PRIORITÉS DU GOUVERNEMENT Le projet de loi de finances pour 2000 fixe le budget du secrétariat d’État à l’outre-mer à 6,36 milliards de francs en dépenses ordinaires et crédits de paiement. Ce budget augmente les moyens d’intervention du secrétariat d’État dans les domaines prioritaires que sont l’emploi, la solidarité et la culture. Il soutiendra l’activité par des investissements renforcés pour la solidarité et le développement économique et accompagnera les évolutions institutionnelles engagées. A.— L’EMPLOI Le projet de budget pour 2000 fixe la dotation du fonds pour l’emploi dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon à 2 101,7 millions de francs, soit une augmentation de 16,24 % par rapport à 1999 provenant essentiellement du transfert depuis le ministère de l’emploi et de la solidarité. Par ailleurs, les dispositifs spécifiques en faveur des TOM et de Mayotte sont reconduits. 1. Le FEDOM permettra le financement de solutions d’insertion Dans le secteur de l’unité collective, les solutions d’insertion sont portées à 50 000 dont 35 000 nouveaux contrats emploi-solidarité (pour un coût de 631,5 millions de francs) et 15 000 contrats d’insertion par l’activité, destinés à des bénéficiaires du RMI (186 millions de francs). Dans le secteur marchand, l’effort budgétaire représente 7 500 contrats d’accès à l’emploi et 500 primes à la création d’emplois versées aux employeurs (354 millions de francs). Afin d’affirmer la responsabilité du secrétariat d’État à l’outre-mer dans la politique de l’emploi outre-mer, les 7 000 contrats emplois-consolidés, prolongement des C.E.S. jusque là financés sur le budget du ministère de l’emploi, sont inscrits au sein du budget de l’outre-mer. Ils représentent une dotation de 291,7 millions de francs imputés sur le FEDOM et une dotation de 44,75 millions de francs sur un crédit nouveau consacré à l’emploi et la formation professionnelle à Mayotte. 2. Le FEDOM financera également la poursuite de la mise en œuvre des emplois-jeunes La loi relative à l’emploi des jeunes, entrée en application dès 1998, sera financée à hauteur de 615,5 millions de francs. Ces crédits, inscrits aussi dans le FEDOM, permettront le financement des emplois-jeunes lancés dès 1997 et créés en 1998 et 1999, ainsi que les nouveaux emplois créés en 2000, soit un total d’environ 11 000 sur trois ans (hors aides éducateurs et adjoints de sécurité, financés respectivement sur les budgets des ministères de l’éducation nationale et de l’intérieur). Au 31 août, les conventions signées portaient sur plus de 9 525 emplois, dont 2 591 au titre de l’éducation nationale et 134 au titre de l’intérieur. En 1999, hors aides éducateurs et adjoints de sécurité, la prévision pour l’année oscille entre 3 500 et 4 000 créations d’emplois. B.— LA CULTURE ET L’ACTION SOCIALE Le projet de loi de finances pour 2000 marquera une volonté forte du secrétariat d’État à l’outre-mer : la mise en valeur de la richesse culturelle de l’outre-mer, en tant que composante à part entière de la culture nationale. Il en résulte une augmentation sensible des crédits consacrés à l’action culturelle et à la formation. Les crédits du chapitre d’action sociale et culturelle passent de 145 millions de francs à 185,6 millions de francs, soit près de 30 % d’augmentation. Concernant l’action culturelle proprement dite, l’objectif est de favoriser les échanges entre l’outre-mer et la métropole et dans l’environnement régional des collectivités, départements et territoires d’outre-mer. C’est dans ce sens que le fonds d’aide aux échanges artistiques et culturels pour l’outre-mer a été créé. Il sera financé à parité avec le ministère de la culture. Le secrétariat d’État à l’outre-mer a plus que doublé les crédits consacrés à ce domaine, puisqu’ils passent de 4 millions de francs en 1999 à 9 millions de francs dans le projet de loi de finances pour 2000. C.— LE LOGEMENT Le logement constitue, avec l’emploi, l’une des priorités de développement de l’outre-mer français dès lors que les problèmes liés à l’habitat s’y déclinent encore en termes de pénurie, de précarité et d’insalubrité. Cette situation s’explique par une conjonction de facteurs bien connus : croissance démographique vigoureuse (quatre fois supérieure à celle observée en métropole), taux de chômage élevé (30 % en moyenne), forte proportion de salariés à revenus modestes, insuffisance et surpeuplement relatif du parc de logement, défaillance des infrastructures urbaines, niveau du coût de la vie, etc… LE LOGEMENT DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER - ELÉMENTS STATISTIQUES
Source : secrétariat d’Etat à l’outre-mer Ces régions monodépartementales se caractérisent par la nécessité de trouver un équilibre sur des territoires réduits, où la rareté du foncier et les difficultés d’approvisionnement renchérissent les coûts de construction alors que l’endettement des collectivités locales limite leur capacité d’endettement dans le domaine des équipements et des infrastructures urbaines. Si la vigueur des réseaux de solidarité traditionnelle a permis d’éviter l’apparition du phénomène des personnes sans domicile, elle a inversement accentué un surpeuplement relatif et contribué à l’extension de la précarité et de l’insalubrité dans les logements. 1. Les instruments de la politique du logement dans les DOM a) Les principaux dispositifs de financement La réforme du financement du logement dans les départements d'outre-mer intervenue en 1986 repose sur des mécanismes d’aide à la pierre, permettant concomitamment d’accroître la production de logements neufs et de mieux les adapter aux spécificités de l’outre-mer. Accession à la propriété. – Il existe aujourd’hui deux principaux dispositifs. Le Logement évolutif social (LES) bénéficie aux ménages dont les revenus ne dépassent pas des plafonds de ressources annuelles, qui varient en fonction de la composition du ménage. L’aide est constituée par une subvention de 50 % de l’investissement. Le prêt à 0 %-ministère du logement finance l’accession sociale à hauteur de 40 % du coût du logement. Les plafonds de ressources sont fixés à 70 % du plafond de ressources du prêt à 0 % – soit, par exemple, 91 000 francs pour un ménage de deux personnes. Il finance également l’accession intermédiaire à la propriété : sa quotité est alors ramenée à 25 % du coût du logement, sur la base de plafonds de ressources fixés par arrêté interministériel. Construction locative. – Les principaux dispositifs sont ceux du Logement locatif social (LLS), du Logement locatif très social (LL-TS) et du prêt locatif intermédiaire (PLI). Le prêt locatif aidé (PLA) utilisé en métropole – prêt aidé par l’État, servi par la Caisse des dépôts et consignations et d’une durée de 32 ans avec un préfinancement possible – prend la forme du LLS dans les départements d’outre-mer. Il est actuellement rémunéré à 2,25 % par an (2 % en Guyane) et peut être complété par des subventions de couverture des surcharges foncières. Le LL-TS est l’équivalent du PLA-TS. Il vise à rendre possible des opérations de construction locative sociale, au bénéfice de locataires aux ressources modestes (loyers inférieurs à 80 % des loyers plafonds LLS). Le prêt locatif intermédiaire est destiné à financer les logements dont le loyer se situe entre celui pratiqué dans le secteur locatif social et celui observé sur le marché libre. Amélioration et réhabilitation. – S’agissant de la réhabilitation du parc locatif social, les procédures et les financements sont alignés sur ceux de la PALULOS en métropole, réserve faite d’un pouvoir dérogatoire plus étendu reconnu au représentant de l’État. L’application tardive de la taxe pour l’amélioration du patrimoine bâti dans les DOM (TAPB) n’a permis qu’une intervention récente de l’Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Les règles qui lui sont applicables sont proches de celles de la métropole, mais l’absence de conventionnement modifie marginalement certains dispositifs (subventions à taux majoré). b) Les perspectives budgétaires Les crédits d’aides à la pierre, totalement fongibles, sont regroupés sur une ligne budgétaire unique. Ce mécanisme, qui laisse des marges d’adaptation très substantielles au niveau local, ne peut que susciter une appréciation nuancée sur le plan strictement budgétaire dans la mesure où il introduit une opacité préjudiciable au contrôle de la dépense publique
En 1999, la ligne budgétaire unique a été arrêté à 1 096 millions de francs en loi de finances initiale, dont 96 millions de francs au titre de la résorption de l’habitat insalubre, que sont venus abonder 541 millions de francs en provenance de la créance de proratisation du RMI. Le projet de loi de finances pour 2000 prévoit une ligne budgétaire de 1 100 millions de francs (dont 96 millions de francs réservés à l’habitat insalubre) et un abondement de 650 millions de francs au titre de la créance de proratisation, 2. Les opérations de résorption de l’habitat insalubre Les besoins en matière de résorption de l’habitat insalubre (RHI) sont encore importants, puisqu’on estime que 26 % des logements revêtent un caractère précaire ou sont dépourvus d’éléments de confort et que 13 % peuvent être qualifiés d’insalubres, Comme en matière de logement, les crédits spécifiques sont abondés par des crédits en provenance de la créance de proratisation du RMI, Les crédits consacrés à la résorption de l’habitat insalubre ont été transférés depuis le 1er janvier 1998 du secrétariat d’État au logement au secrétariat d’État à l’outre-mer, En 1998, 96 millions de francs ont été consacrés aux opérations de RHI, auxquels il faut ajouter 66 millions de francs au titre de la créance de proratisation, Le Gouvernement estime que ces moyens se monteront respectivement en 1999 à 96 millions de francs et 81 millions de francs, Votre rapporteur insiste tout particulièrement sur l’importance économique et sociale de ce secteur, essentiel en termes de qualité de vie et de création d’emplois. II.— LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER L’année économique 1998 s’est achevée plutôt favorablement pour la Martinique, la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans une moindre mesure pour la Guyane. Seule la Guadeloupe affectée par une succession de conflits sociaux prolongés a vu son économie fortement perturbée. Dans ce contexte, les données officielles relatives à l’emploi et au RMI ont cependant affiché, dans l’ensemble, une nouvelle dégradation de la situation sociale, alors que la consommation continue de croître. Le tourisme demeure partout une activité porteuse d’espérances alors que les activités agricoles traditionnelles ont connu des fortunes diverses. Enfin, le niveau soutenu de la commande publique en matière de BTP a largement contribué à la bonne tenue d’ensemble des économies domiennes. A.— LA GUADELOUPE Après une année 1997 marquée par l’amorce d’un retournement conjoncturel de l’économie de l’île, liée au dynamisme de la consommation des ménages, l’année 1998 a enregistré un retournement de tendance au deuxième trimestre. Cette inflexion est notamment imputable à une multiplication des conflits sociaux qui ont touché directement ou indirectement l’ensemble des secteurs de l’économie guadeloupéenne, entraînant une certaine morosité des investisseurs. 1. L’agriculture Bien que disposant de conditions naturelles propices à l’agriculture (sols volcaniques sur la Basse-Terre, climat tropical humide), la Guadeloupe, à cause d’un équilibre écologique fragile, d’aléas climatiques fréquents et d’un relief accidenté entraînant des coûts de production élevés, voit le développement de ses cultures fortement entravé. En 1998, les conditions climatiques et sociales ont perturbé les productions du département. Il convient de déplorer une diminution continue de la surface agricole utilisée (elle ne représentait plus, en 1997, que 29,24% de la superficie totale de l’île), une population agricole de moins en moins nombreuse (36 657 personnes en 1997 contre 86 174 en 1981), un âge moyen des chefs d’exploitation en constante augmentation (54,5 ans lors de l’enquête réalisée par la direction de l’agriculture et de la forêt en 1995) et une diminution importante du nombre d’exploitations (chute de plus de 37% depuis 1981). a) La banane La banane, premier produit d’exportation en volume depuis de nombreuses années, demeure un des piliers de l’économie agricole locale, malgré quelques années difficiles depuis une décennie. Après les années 1995 et 1996 où le département a été fortement touché par l’ouragan « Luis » et le cyclone « Marylin », l’exercice 1997 s’est déroulé dans des conditions relativement satisfaisantes. La bananeraie guadeloupéenne a été entièrement replantée et les professionnels s’attendaient à une production de plus de 140 000 tonnes, mais après la sécheresse du premier semestre et les multiples conflits sociaux pénalisant l’expédition des bananes, les efforts de la profession ont été anéantis par le cyclone « Georges » en septembre 1998 qui a détruit 85% de la bananeraie. Les exportations de bananes se sont ainsi établies à 78 658 tonnes pour l’année 1998 et les pertes de production sont estimées à environ 45 000 tonnes pour 1999. En Guadeloupe, l’enjeu est actuellement de conserver avec une production de qualité, une place significative sur un marché international de plus en plus concurrentiel en raison de la pression exercée par les Etats-Unis pour démanteler l’Organisation commune des marchés de la banane et imposer les règles de l’Organisation mondiale du commerce. EXPORTATIONS (tonnes nettes)
Source : SICA. Jusqu’en 1993, chaque État pouvait imposer des mesures discriminatoires à l’entrée des bananes sur son territoire afin d’accorder un accès préférentiel à certaines zones productrices. Il était urgent de mettre un terme à la coexistence de divers systèmes juridiques relatifs au marché de la banane. C’est pourquoi la communauté s’est dotée, depuis le 1er juillet 1993, d’une organisation commune des marchés (OCM) spécifique aux bananes. Elle offre aux planteurs guadeloupéens une garantie de commercialisation et de revenus. L’OCM banane () a engendré une forte contestation qui a suscité une des plus importantes batailles juridique, économique et politique de l’histoire des Communautés dans ses relations avec les États tiers. Les dispositions de l’OCM banane sont, en effet, régulièrement contestées et font l’objet de plaintes de la part de sociétés de commercialisation américaines pour qui l'OCM est contraire au principe de libre-échange. Cette contestation est en outre relayée au sein même de l’Union européenne par certains membres non producteurs, notamment l’Allemagne, qui privilégient l’aspect prix à la consommation et souhaiteraient donc une ouverture aussi large que possible du marché. L’OCM ainsi mise en place s’articulait autour des principales dispositions suivantes : – un contingentement assorti d’un droit de douane pour les bananes en provenance d’Amérique latine (bananes « dollar ») et des pays ACP non-fournisseurs traditionnels. Ce contingent tarifaire a pour but de limiter le volume des bananes des pays tiers autorisés à entrer dans l’Union européenne. Établi à 2 millions de tonnes en 1993, ce contingent a été porté à 2,1 millions en 1994 et 2,2 millions en 1995. Un contingent annuel complémentaire de 353 000 tonnes a été ouvert par la Commission européenne depuis 1996, dans le cadre de ses pouvoirs de gestion et dans l’attente d’un accord du Conseil, afin de prendre en compte la consommation des nouveaux États membres de l’Union européenne (Autriche, Finlande et Suède). La fixation de ce contingent a une influence déterminante sur les cours par la pression qu’exerce la banane « dollar » sur le marché ; – des licences d’importation délivrées au titre du contingent tarifaire sur la base des quantités de bananes commercialisées durant trois années de référence. Elles se répartissaient à hauteur de 30 % pour les opérateurs traditionnels communautaires et ACP (), 66,5 % pour les opérateurs ayant déjà commercialisé des bananes « dollar » ou ACP non traditionnels et 3,5 % destinés aux nouveaux opérateurs afin de maintenir un minimum de souplesse au système ; – un régime d’aide compensatoire accordée aux producteurs communautaires qui commercialisent des bananes fraîches répondant aux normes de qualité européennes, selon lequel la Communauté s’engage à compenser la perte de revenu subie par les producteurs communautaires. La quantité maximale annuelle de bananes commercialisées pouvant donner droit à l’octroi de l’aide compensatoire a été fixée pour la Guadeloupe à 150 000 tonnes par an. Un nouveau régime communautaire pour le secteur de la banane a été approuvé formellement par le Conseil le 20 juillet 1998 : – un contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes est ouvert chaque année pour les importations venant des États tiers (droit de douane de 75 écus par tonne) et des États traditionnels ACP (droit de douane nul) ; – un contingent tarifaire additionnel de 353 000 tonnes est ouvert chaque année pour les importations de bananes venant des États tiers (droit de douane de 75 écus par tonne) et des États traditionnels ACP (droit de douane nul). Ce contingent tarifaire additionnel peut-être augmenté lorsque la demande de la Communauté s’accroît, sur la base d’un bilan de la production, de la consommation, des importations et des exportations ; – les importations des bananes traditionnelles ACP (quantité globale de 857 700 tonnes) sont soumises à droit nul. D’autre part, l’allocation de licences d’importation aux opérateurs de la catégorie B a été supprimée de façon à être en conformité avec certaines règles du commerce international. Les certificats d’importation sont répartis entre opérateurs traditionnels pour 92% (opérateurs ayant effectivement importé au moins 100 tonnes au cours de la période 1994-1996) et « nouveaux arrivés » pour 8%. Selon la nouvelle version de l’OCM, tous les pays fournisseurs « ayant un intérêt substantiel sur le marché communautaire » se sont vu attribuer par la commission des quotas d’exportation : 26,17% pour l’Équateur, 25,61% pour le Costa-Rica, 22,03% pour la Colombie et 15,76% pour le Panama, les pays tiers utilisant les 10,43% restants. Ce nouveau régime est applicable depuis le 1er janvier 1999. Il est contesté par les États-Unis et par certains pays latino-américains qui ont demandé la réactivation immédiate du panel de l’OMC qui avait déjà examiné et partiellement condamné le régime précédent. L’Union européenne estime en revanche que le nouveau régime est conforme aux règles de l’OMC et aux conclusions du panel. Les États-Unis ont réactivé le dossier devant l’OMC, estimant que l’Europe n’avait pas mis en conformité son régime d’importation de bananes. L’OMC a, en avril 1999, condamné le système d’attribution des licences et autorisé les États-Unis à appliquer des droits de douane de 100% sur des importations européennes d’une valeur de 191 millions de dollars, afin de compenser le manque à gagner des sociétés bananières américaines. Les Quinze ont décidé de ne pas faire appel et ont entamé des discussions afin d’adopter un système conforme aux règles de l’OMC qui, tout en ne portant pas atteinte aux importations de bananes d’Amérique Centrale et Latine, prenne en compte les intérêts des importateurs communautaires, ceux des pays producteurs communautaires, ainsi que ceux des pays producteurs de l’ACP. Il convient de souligner que les revenus tirés de l’exportation des bananes forment souvent une part considérable des recettes globales à l’exportation des États producteurs (60 % pour la Guadeloupe). Cette dépendance économique est d’autant plus accentuée qu’elle concerne une main-d’oeuvre importante dont l’emploi est constamment menacé tant par les aléas du marché que par les caprices climatiques. La banane antillaise a un coût de production représentant pratiquement deux fois celui de la banane « dollar ». La pérennité de la banane antillaise dépendra vraisemblablement de la restructuration de l’OCM banane, en vue d’en faire une aide à la production et non plus à la commercialisation. b) Le sucre La filière canne-sucre, deuxième activité agricole du département, est en déclin depuis 1970, pour de multiples raisons : forte diminution des surfaces cultivées, urbanisation des terres agricoles, atomisation des exploitations, mauvaises conditions climatiques, irrigation insuffisante et sous-utilisée, vieillissement des planteurs, manque d’encadrement et d’améliorations techniques, et enfin, conflits sociaux. Toutefois, la campagne cannière 1998-1999 a permis d’obtenir un résultat satisfaisant avec 717 460 tonnes de cannes broyées et une production sucrière progressant de 71 %, soit 65 000 tonnes contre 38 000 en 1997 (chiffres inférieurs au quota annuel d’exportation de 116 000 tonnes attribué par l’Union européenne aux producteurs guadeloupéens dans le cadre de l’OCM sucre. ()). Ce bon résultat est notamment dû aux conditions climatiques favorables en 1999. Il ne saurait cependant occulter les facteurs conjoncturels et structurels qui ont marqué la filière au cours de la dernière décennie. - facteurs conjoncturels : il s’agit des événements climatiques désastreux (cyclones Hugo, puis Georges suivis de périodes de sécheresses) qui ont provoqué des chutes de la production de cannes et des rendements ; - facteurs structurels : en dépit des importants efforts engagés depuis la mise en place d’un plan de relance en 1983 et de la réalisation de la réforme foncière, le tissu agricole reste émietté et fragile. Les rendements restent faibles et le recours aux techniques modernes de production est insuffisant. c) Le rhum Le rhum est le troisième spiritueux consommé dans le monde (11 % du marché) et le cinquième en europe (7 % du marché). La filière canne-sucre-rhum constitue un pôle d’activités traditionnelles dans les DOM. Elle repose sur un produit de base clé, la canne à sucre, indispensable pour la production, d’une part du sucre de canne, et d’autre part du rhum qui se répartit en rhums agricoles et en rhums industriels. Le rhum fournit l’élément de valorisation à l’ensemble de l’activité cannière et lui permet d’atteindre la rentabilité, mais dans un contexte de soutiens publics, soit d’ordre financier (subventions et exonérations), soit d’ordre législatif ou réglementaire. Après deux années consécutives de forte hausse (21,2 % en 1995 et 33,5 % en 1996) et une baisse de 13 % en 1997, la production globale de rhum (rhum agricole, rhum industriel et rhum léger) a affiché une nouvelle hausse de 8,4% en 1998. Le nombre d’hectolitres d’alcool pur est passé de 57 827 en 1997 à 62 679 en 1998. Le principal débouché de la production locale reste la métropole. Afin d’être compétitif face au rhum importé des pays tiers, le rhum traditionnel vendu dans l’hexagone sous contingent (31 000 hectolitres d’alcool pur pour la Guadeloupe) bénéficie d’une protection fiscale. Les rhums des DOM ne paient le droit d’accise qu’à un taux minoré dans la limite d’un contingent. Le système de contingentement permet la régulation du marché grâce à des déblocages par tranches successives sur l’année, en fonction des besoins du marché. Pour les producteurs de rhum, ce système constitue un véritable outil de régulation du marché. d) Les autres productions végétales Dominée par la banane et la canne à sucre, l’agriculture guadeloupéenne connaît cependant, depuis quelques années, des tentatives de diversification (cultures maraîchères, fruitières et florales). Toutefois, cette évolution se heurte à de nombreuses difficultés et la pérennité des nouvelles productions est loin d’être assurée. Les principaux handicaps résident dans le faible degré d’organisation des filières, l’étroitesse des exploitations, l’absence de système de conservation des semences et des rythmes de production irréguliers et peu maîtrisés. De plus, les performances demeurent trop soumises à des aléas extérieurs (sécheresse, infestations parasitaires). e) L’élevage Deux formes d’élevage sont pratiquées dans l’île : un élevage traditionnel de type familial (bovins, cabris, porcs, volailles) et une production semi-industrielle (porcs, volailles et poules pondeuses). L’encadrement technique insuffisant, le coût élevé des structures d’abattage déficientes expliquent la faiblesse de la production locale et les performances médiocres du cheptel. Malgré les différentes aides à ce secteur (), les premiers résultats tangibles ne sont attendus qu’à long terme. 2. La pêche La profession de marin-pêcheur reste, malgré des efforts de structuration, encore peu formalisée et dispose souvent de moyens archaïques. La flottille est majoritairement composée de petites unités et les techniques de pêche ont peu évolué depuis leur introduction en Guadeloupe. Situation qui peut paraître paradoxale pour une île ou la consommation moyenne par habitant (environ 33 kg) se situe parmi les plus fortes du monde, juste après le Japon, mais les différentes tentatives de structuration de la filière se heurtent aux habitudes des pêcheurs et à une commercialisation inadaptée aux circuits modernes de distribution. La structuration de la filière s’avère difficile en raison notamment du poids important des pêcheurs clandestins. La pêche compte 1 392 marins enrôlés et environ autant de marins non déclarés. Cette concurrence déloyale est source de conflits à l’intérieur de la profession et nuit à l’organisation et au professionnalisme du secteur. La production locale reste relativement stable. Elle est estimée à 9 084 tonnes en 1998 (environ 470 millions de francs), dont plus de 92 % de poissons, et ne couvre que les deux tiers de la consommation locale. Elle a, par ailleurs, baissé de 15% par rapport à 1997, perturbée par les conditions climatiques et des conflits avec les îles voisines. L’offre locale est partiellement concurrencée par les importations de produits congelés. La Guadeloupe importe une grande quantité de poissons d’Europe, du Venezuela, de Guyane ainsi que des îles voisines de la Caraïbe. Dans un contexte où les zones de pêche sont limitées et où la ressource en poissons de fond se raréfie, les perspectives pour l’an 2000 sont liées aux possibilités d’accès à la ressource des États voisins. Des négociations doivent avoir lieu afin de délimiter des frontières maritimes et de conclure des accords de pêche. 3. Le tourisme Le tourisme est un secteur d’activité jeune dont le développement a commencé il y a une vingtaine d’années. Depuis 1986, il a connu un net regain d’activité lié à la baisse des tarifs aériens mais aussi à l’expansion du parc d’hébergement, grâce à la défiscalisation. Appréciés sur les dix dernières années, les indicateurs de résultats de l’activité touristique en Guadeloupe, en termes d’accroissement du nombre de touristes et de croisiéristes accueillis, d’augmentation et de diversification des capacités d’hébergement et de produits, de créations d’activités et d’emplois supplémentaires, sont à la fois incontestables et positifs. En 1998, le nombre de visiteurs s’est élevé à 693 000 personnes, contre 660 000 en 1997 et 625 000 en 1996. La fréquentation a progressé de 140% en 12 ans. Le secteur est devenu essentiel à l’équilibre de l’économie locale en termes de valeur ajoutée et de création d’emplois. Le chiffre d’affaires serait d’environ 3 milliards de F en 1998. La capacité hôtelière a fortement progressé depuis 11 ans (+80%), toutefois, en 1998, malgré deux ouvertures, la capacité d’accueil des hôtels a légèrement diminué alors qu’en revanche les gîtes et chambres d’hôtes connaissent un développement rapide et continu (la demande est forte du côté de la clientèle familiale et des amateurs du tourisme vert). A ces touristes de séjour, il convient d’ajouter les croisiéristes qui ont choisi la Guadeloupe pour la qualité de ses infrastructures portuaires et aéroportuaires, pour la diversité de ses escales, pour ses équipements sanitaires et hospitaliers ou pour son réseau routier. Conscients de ce potentiel, les différents intervenants financiers ont multiplié les projets d’investissement ces dernières années. Mais, alors que le marché de la croisière en transit est en augmentation dans le bassin Caraïbe pour l’année 1998, le trafic à la Guadeloupe connaît un recul par rapport à 1997 (-16% pour les mouvements de passagers et -7% pour le nombre d’escales). Cette évolution défavorable serait liée à la dégradation de l’image de la Guadeloupe en raison de la multiplication des conflits et à l’absence de maîtrise de la langue anglaise. 4. Le B.T.P. Le secteur du bâtiment et des travaux publics, troisième secteur d’activité en termes d’effectifs (après les services marchands et le commerce), essentiellement composé d’une multitude de petites entreprises et de quelques sociétés de taille importante, affronte depuis sept ans une conjoncture difficile imputable à la baisse des commandes publiques et à des retards de paiement des collectivités locales qui entraînent des besoins énormes de trésorerie. L’année 1998 a enregistré un fléchissement d’activité dû à des conflits sociaux, à de mauvaises conditions climatiques et au faible nombre d’ouvertures de chantiers significatifs. Le logement reste avec l’emploi une priorité pour la Guadeloupe où les problèmes de l’habitat se posent encore en termes de pénurie, de précarité et d’insalubrité. En effet, la croissance démographique est trois fois supérieure à celle de l’hexagone, le taux de chômage avoisine 30 %, le parc de logement locatif social reste insuffisant, les coûts de construction sont majorés du fait de conditions techniques extrêmement exigeantes (humidité, cyclones, séismes, sols instables), et certaines collectivités locales ont une situation budgétaire difficile qui limite considérablement leur capacité d’investissement. Dans le département, les besoins en matière de logement restent importants. Pour régler la crise du logement dans des délais raisonnables, il serait nécessaire de construire environ 7 000 logements neufs par an dont 2 800 logements sociaux. Les efforts déployés en faveur de la construction de logements sociaux ne doivent pas occulter les besoins considérables en réparation, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre. Chaque année ce sont 1 800 logements qui doivent être achevés pour remplacer d’ici dix ans les logements précaires, 2 800 logements pour faire face à la croissance démographique, 1 700 logements pour répondre aux désirs des jeunes et enfin 2 000 logements existants qui devraient être réhabilités. DOTATIONS DE LA LBU (millions de francs)
Source : DDE. L’aide de l’État est globalisée dans une ligne budgétaire unique (LBU) destinée à financer les primes aux particuliers, les logements HLM, les logements évolutifs sociaux, les logements locatifs sociaux et les prêts à taux zéro. * * * Si on avait pu noter une amélioration de la conjoncture économique guadeloupéenne durant l’année 1997 et au début de l’année 1998, les conflits sociaux du second trimestre ont touché un grand nombre d’activités et la dynamique de la consommation semble avoir été enrayée. La dureté de certaines grèves a contribué a créer un environnement guère favorable à la modernisation de l’économie, qui, ajouté à l’insécurité, a dégradé l’image de l’île, notamment auprès des croisiéristes. Il est à craindre que la baisse d’activité de cette branche du tourisme ne constitue un indicateur avancé de l’évolution de tout le secteur touristique. Les premiers mois de 1999 se sont inscrits dans le prolongement de cette tendance. B.— LA GUYANE La situation économique de la Guyane a été mitigée en 1998. Le département n’est pas encore sorti de la phase de stagnation économique qu’il traverse depuis quelques années et la reprise attendue ne s’est pas encore manifestée. Le nombre de demandeurs d’emploi a continué sa progression (+ 4,1% en 1998) et les perspectives d’évolution de la population active sont inquiétantes. 1. L’activité spatiale Principal secteur économique du département, l’activité spatiale a connu, en 1998, une année exceptionnelle malgré un contexte difficile lié aux retards de livraison des satellites. Le Centre spatial guyanais, implanté à Kourou sur décision du gouvernement français en 1964, bénéficie d’une situation géographique idéale (position proche de l’équateur optimale pour les lancements, zone à l’abri des cyclones et des tremblements de terre, faible densité de la population permettant d’attribuer au centre les facilités foncières nécessaires à son développement). Arianespace, société anonyme de droit français, assure le financement et la direction de la production d’Ariane, elle commercialise le lanceur et effectue les lancements. La France est maître d’oeuvre du programme Ariane, elle est à l’origine du projet, finance 53 % du budget d’Ariane 4 et 47 % du budget d’Ariane 5. En 1998, malgré 4 mois sans tir en raison de retards dans les livraisons de satellites, 10 lancements ont été effectués, mettant sur orbites 14 satellites. De plus, le programme de qualification d’Ariane 5 s’est poursuivi par le succès du troisième tir réalisé le 21 octobre 1998. Arianespace dispose à présent d’une gamme de lanceur lui permettant d’être présente sur tous les marchés. Arianespace a confirmé sa place de leader sur le marché commercial des lancements, plaçant sur orbite 14 des 26 satellites commerciaux lancés dans le monde en 1998, soit 54 % de part de marché. Sa réussite s’explique par la précision de ses mises en orbite géostationnaire, par des délais « commande-lancement » réduits, mais surtout par un taux de réussite élevé (en 117 lancements, Ariane n’a échoué qu’à 7 reprises, soit un taux global de réussite de 94,02 %). S’agissant d’Ariane 4, le taux de réussite atteint 96,55 % (3 échecs sur 87 tirs effectués au 30 avril 1999). La fiabilité attendue d’Ariane 5 est de 98,5 %, elle a conduit Arianespace à garantir à ses clients un nouveau lancement gratuit en cas de perte d’un satellite dans sa phase de lancement. Toutefois, il est à craindre une diminution des retombées économiques du secteur à l’horizon 2000-2002, avec la baisse des besoins de lancements de satellites venant s’ajouter à la concurrence internationale qui se fait de plus en plus rude. 2. Le B.T.P. Le début de reprise des chantiers enregistré à la fin de l’année 1997 s’est confirmé en 1998 grâce aux commandes publiques et à l’augmentation des autorisations de logements collectifs et individuels. Il convient de préciser qu’une proportion importante de ces autorisations concerne le logement social. Pour 1998, le montant de la dotation globale sur la LBU (ligne budgétaire unique) s’élève à 169,3 millions de francs. La LBU a concerné 997 logements. L’État poursuit son effort pour la résorption de l’habitat insalubre (RHI) en prenant en charge le financement (à hauteur de 80% pour les zones insalubres et en totalité pour les bidonvilles) du déficit du bilan d’opérations. En 1999, les engagements de la commande publique sont également en progression ; ils sont estimés à 1 510 millions de francs (1 070 millions de francs concernant le bâtiment et 440 millions de francs de travaux publics). 3. La pêche La pêche constitue l’une des principales activités de la Guyane. Le département dispose, en effet, d’une façade maritime de 350 km et d’une zone économique exclusive d’environ 130 000 km². Le secteur constitue, après les activités spatiales et aurifères, la troisième activité exportatrice de la Guyane. Deux types de ressources exploitables sont présentes dans ses eaux : les crevettes, qui concentrent l’essentiel de l’effort de pêche du département, et les poissons. CREVETTES (tonnes)
Source : Direction départementale des affaires maritimes. La production mondiale de crevettes sauvages était évaluée à 2,5 millions de tonnes en 1996. La production de crevettes d’aquaculture est estimée, en 1998, à 737 000 tonnes. Le marché mondial de la crevette se caractérise par une croissance de la demande mais aussi par un développement rapide de la production de crevettes d’aquaculture. Essentiellement situées en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud, les fermes aquacoles profitent de coûts de production relativement faibles. Dans ces conditions, les prix de vente sur le marché mondial ont tendance à diminuer, obligeant les armements de Guyane à réduire leurs marges pour continuer à écouler leur production. La France a obtenu de l’Union européenne que soit reconduit, de 1998 à 2001, le régime d’aide à la production (1 102 euros pour une quantité maximale de 4 200 tonnes). La production primable de l’année 1998 a été de 4 178 tonnes, représentant une aide d’un montant de 30,8 millions de francs. La France (57% du volume exporté en 1998), l’Espagne (25,4%) et les Antilles (12,4%) sont les principaux débouchés de la crevette guyanaise. La pêche de poissons fait, elle, l’objet de deux types de régime : une pêche sous licence de l’Union européenne (dont l’essentiel est exporté vers les Antilles car les différentes espèces guyanaises sont peu connues en Europe et le coût du transport élevé) et une exploitation artisanale sous licence professionnelle dans les eaux territoriales, qui alimente le marché local. 4. Les activités forestières La forêt couvre 92 % du territoire guyanais mais ses caractéristiques () ne facilitent pas son exploitation. De ce fait, la qualité des bois locaux permet une production qui, à 60 % est destinée au marché local. Le développement de ce marché local apparaît comme la condition sine qua non du développement des exportations. L’exploitation forestière a produit 71 857 m3 de grumes en 1998, soit une augmentation d’environ 34 % par rapport à 1997 (année durant laquelle de mauvaises conditions météorologiques avaient dégradé les 500 km de routes d’accès aux parcelles). Cette progression s’explique également par les nouvelles méthodes d’attribution d’exploitation de la forêt. PRODUCTION (mètres cubes)
Source : Office national des forêts. Le commerce du bois guyanais ne représente qu’une infime partie du commerce mondial. Selon les exploitants, seulement 40 % de la production peuvent être exportés en raison de la qualité des bois. L’augmentation de la production, au-delà d’un certain seuil, ferait rapidement apparaître un stock d’invendus sur le marché local, ce qui obérerait la rentabilité des entreprises. La création d’un centre technique du bois, financé par la région, le FEOGA et le CIRAD entre pleinement dans les projets des collectivités territoriales et constituera un pôle d’excellence en matière de connaissance des bois, de leurs caractéristiques et de leurs qualités afin de les valoriser au mieux. 5. L’or Durant vingt ans, de 1975 à 1995, un inventaire des richesses du sous-sol guyanais a été réalisé. Il a confirmé que, parmi les minerais recensés, l’or était le seul à avoir une dimension industrielle. L’exploration aurifère et la création d’une exploitation industrielle exigent une technicité et des capitaux que ne possèdent pas les entreprises locales, ni les entreprises nationales. C’est pourquoi l’exploration menée actuellement en Guyane est principalement le fait de filiales françaises créées à cet effet par des compagnies internationales spécialisées. Une dizaine de sociétés internationales parmi les 23 premières mondiales sont maintenant en opération en Guyane. Durant l’année 1998, 82 millions de francs ont été investis dans la recherche de gisements par les opérateurs privés, contre 169 millions de francs en 1997 (la baisse étant essentiellement due à la faiblesse du cours de l’or). Les retombées locales de ces dépenses correspondent pour partie à des salaires versés aux salariés employés en Guyane, à l’utilisation d’entreprises locales pour transporter du matériel ou effectuer des travaux de déboisement, de terrassement... L’or est devenu le premier poste à l’exportation de la Guyane devant le secteur de la pêche. La demande mondiale, en 1998, s’élevait à 3 925 tonnes et la Guyane, avec environ 2,44 tonnes produites (), se situait aux environs du 50ème rang mondial. La part de l’or dans le total des exportations (hors activité spatiale) continue de progresser : 23,3 % en 1996, 36,3 % en 1997 et 37 % en 1998. PRODUCTION (kilos bruts)
Source : Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE). * * * Au terme du premier semestre 1999, la conjoncture économique du département marque quelques signes d’amélioration. Sans pouvoir véritablement encore parler de reprise, le second semestre devrait permettre de confirmer cette tendance. C.— LA MARTINIQUE Le département a bénéficié en 1998 d’un environnement national porteur. L’économie du département s’inscrit dans un cycle apparent de croissance. En dépit de conflits sociaux relativement nombreux, la demande est restée nourrie, ce qui a alimenté principalement l’activité du commerce. A contrario, le comportement des chefs d’entreprise s’est distingué par une plus grande prudence. Les résultats ont été contrastés selon les filières. Si on relève une activité en léger repli dans le BTP, on note une activité touristique relativement soutenue. Les entreprises industrielles sont celles qui ont le plus souffert du blocage du port car elles ont fini par être privées de matières premières ou de produits semi-finis. L’agriculture a, quand à elle, enregistré de meilleurs résultats en 1998. 1. L’agriculture Bien qu’en diminution quasi-constante depuis vingt ans, le secteur primaire demeure la principale source de recettes à l’exportation de l’île. a) La banane Le marché bananier est caractérisé par sa concentration au niveau mondial, avec une dizaine de gros producteurs seulement et environ vingt importateurs notables. La taille des principaux opérateurs mondiaux défavorise les producteurs communautaires, petits à l'échelle internationale. En Martinique, la culture bananière reste une des principales ressources économiques et la première recette à l’exportation. Elle concentre près de 80 % de la population active agricole, soit environ 7 200 personnes. L’organisation commune de marché (), en vigueur depuis le 1er juillet 1993, offre aux planteurs locaux la garantie d’écouler leur production à un prix indexé sur une recette forfaitaire de référence. Ce système est complété par un dispositif particulier d’attribution de certificats d’importation (« licences ») remis en cause depuis 1997 et modifié à compter du 1er janvier 1999. SURFACES PLANTÉES (hectares)
Source : Direction de l’agriculture et de la forêt. Depuis 1993, on a noté une augmentation continue de la surface bananière, notamment dans les zones irriguées de l’île, favorisée par des perspectives économiques et financières plus satisfaisantes. Face à la concurrence des pays producteurs d’Amérique latine et des pays ACP, la production locale souffre de nombreux handicaps parmi lesquels notamment le relief accidenté de l’île qui limite les possibilités de mécanisation, de fortes variations pluviométriques saisonnières à l’origine du développement de champignons sur les fruits ou qui imposent le recours à l’irrigation. Toutefois, le principal frein au développement de cette spéculation est le niveau très bas des coûts salariaux, 10 à 15 fois inférieurs, en cours dans les autres zones de production. Afin de compenser la concurrence déloyale qui en découle et que, malheureusement, valide par son silence l’organisation mondiale du marché, les groupements professionnels ont entrepris d’améliorer la qualité de la production par des actions de formation, une assistance technique renforcée, la multiplication des traitements phytosanitaires et la mécanisation de certaines tâches. EXPORTATIONS DE BANANES (tonnes nettes)
Source : Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Contrairement aux trois dernières années, les exportations de bananes ont diminué de 13 % en 1998. Si les ventes en métropole ont augmenté (+ 13 %), les exportations sur les autres marchés européens se sont contractées très sensiblement (- 43 %). La principale raison de cette baisse résulte de l’absence d’expéditions en décembre, en raison du blocage du port de Fort-de-France par les ouvriers de la banane. Environ 30 000 tonnes de bananes ont été perdues à la vente, les plantations et le circuit de distribution ont été désorganisés sur une longue période et l’impact de ce conflit a été également ressenti dans l’ensemble de l’économie. b) Le sucre La culture de la canne à sucre reste la deuxième activité agricole du département mais les surfaces plantées sont en régression constante et ne représentent aujourd’hui que 3 000 hectares environ. La récolte de cannes, supérieure à 1 million de tonnes dans les années 60, a fortement diminué pour se stabiliser, trente ans plus tard, autour de 200 000 tonnes par an (188 785 tonnes en 1998). La campagne 1998 a, une nouvelle fois, été caractérisée par la sécheresse qui a perturbé la pousse de la canne à sucre. Si le tonnage produit est en légère progression (+ 4 %), il demeure inférieur à la moyenne décennale. La production est toujours largement soutenue par les pouvoirs publics et l’Union européenne en raison de l’importance économique de la filière canne-rhum. Ces aides sont destinées aux planteurs mais aussi au financement de programmes spécifiques. L’Union européenne finance des montants importants pour la transformation de la canne en rhum agricole (24 494 millions de francs en 1998) et contribue également aux améliorations foncières et à certains travaux de recherche-développement. LIVRAISON DE CANNES (tonnes)
Source : CODERUM. c) Le rhum Le rhum agricole est le résultat de la fermentation directe du jus de canne, du rhum industriel et du rhum grand arôme préparés à partir de la mélasse. Cette activité demeure aujourd’hui rentable en Martinique, malgré la faiblesse des marges, grâce au maintien d’un régime fiscal dérogatoire et de dispositions contingentaires privilégiées qui compensent le niveau élevé de ses coûts de production comparativement à ceux de ses principaux concurrents. Depuis la fin de l’année 1996, le rhum agricole de la Martinique s’est vu attribuer l’appellation d’origine contrôlée (AOC), qui reconnaît sa qualité et constitue un atout important auprès des autorités compétentes et des marchés. Dès 1922, l’application d’une fiscalité réduite a été autorisée dans les DOM en tant que soutien économique et fiscal de la filière canne/rhum. Les directives européennes 1992/83 et 1992/84 du 19 octobre 1992, qui définissaient des taux d’accises harmonisés frappant les alcools dans l’Union européenne, ont autorisé les États membres à appliquer des taux réduits aux produits régionaux ou traditionnels, ce qui a permis de maintenir le régime fiscal dérogatoire dont bénéficiaient les rhums traditionnels des DOM consommés sur le marché français à l’ouverture du grand marché européen. Une décision formelle des autorités communautaires sur l’application d’une fiscalité réduite a été prise par le Conseil des ministres de l’Union européenne le 30 octobre 1995. Le nouveau dispositif prévoit, outre l’application du droit d’accises minoré pour les rhums traditionnels des DOM écoulés sur le marché français dans la limite de 90 000 hectolitres d’alcool pur (HAP) par an jusqu’en l’an 2002 (32 645 HAP de rhum traditionnel agricole et 9 205 HAP de rhum de sucrerie pour la Martinique), la suppression du contingent tarifaire sur le marché communautaire pour le rhum léger originaire des pays ACP et des PTOM, ainsi que le maintien d’un contingent tarifaire avec exemption de droit de douane jusqu’en l’an 2000 pour les rhums dits traditionnels des ACP. Ces mesures devraient permettre de préserver la production locale sur son marché traditionnel, en limitant le risque de concurrence des pays ACP qui pourront désormais accroître leurs exportations sur le marché du rhum léger, qui concerne peu la Martinique. PRODUCTION DE RHUM (hectolitres d’alcool pur)
Source : Direction interrégionale des douanes - CODERUM. La production totale de rhum a été, en 1998, inférieure à celle de la campagne précédente (- 1,9 %), alors que le volume de cannes livrées aux distilleries s’est inscrit en hausse de 4 %. Toutefois, les ventes de rhum ont légèrement progressé en 1998 (+ 1,5 %), après une année 1997 moyenne. 2. La pêche La production locale de produits de la mer (entre 5 000 et 6 000 tonnes par an) reste relativement faible par rapport à la consommation (de l’ordre de 16 000 tonnes). Ce niveau important de la consommation, ajouté à une relative raréfaction de la ressource, a conduit à l’augmentation de la part des importations sur le marché local. La faible concentration de la ressource explique la pratique d’une pêche à caractère principalement artisanal jusqu’à présent. La flottille de pêche est principalement composée de petites embarcations. Toutefois, la vocation maritime du département et le poids de la population familiale concernée (11 000 personnes environ) expliquent l’importance donnée aux actions de structuration de ce secteur. Des mesures incitatives ont ainsi été préconisées pour favoriser l’exploitation des grands pélagiques. Par ailleurs, des financements ont été débloqués pour moderniser les infrastructures de débarquement. 3. Le tourisme L’activité touristique à la Martinique a progressé très rapidement au cours des dix dernières années, sous l’action conjuguée des nouvelles conditions du transport aérien, de la croissance des capacités d’hébergement, des actions de promotion et d’information sur les différents marchés, et du développement de nouveaux produits touristiques. Toutefois, si le secteur du tourisme est en forte croissance sans la zone Caraïbe, il convient de noter, qu’à elles seules, quatre îles (Porto Rico, République Dominicaine, Bahamas et Jamaïque) accueillent plus de 50 % des touristes de séjour. En 1998, l’image de la destination Martinique s’est ternie (rapport critique sur la gestion de l’office du tourisme, conflits sociaux médiatisés, etc.) et le département a été défavorisé face à la concurrence des autres îles de la région, souvent plus compétitives en termes de rapport qualité/prix. Pour la deuxième année consécutive, la fréquentation hôtelière a progressé de manière significative (386 516 clients en 1996, 454 932 en 1997 et 540 800 en 1998) mais le net recul de la durée moyenne de séjour (3,6 jours en 1998 contre 4 jours en 1997) a entraîné une progression plus modérée du nombre de nuitées (+ 11 %). L’activité de croisière pâtit, elle aussi, de la concurrence des autres îles des Caraïbes. Toutefois, après une année 1997 où le nombre de croisiéristes s’était inscrit en diminution de 5,58 % sur l’ensemble de l’année, représentant le plus faible total enregistré depuis 1989, la Martinique a accueilli 414 588 croisiéristes en 1998 (soit une augmentation de 7,2 %) malgré un nombre d’escales de paquebots en diminution. La mise en service de navires de plus grande capacité explique cette tendance. La dépendance vis-à-vis de quelques unités (les deux principaux paquebots totalisent plus de la moitié du nombre total de croisiéristes) représente un facteur de vulnérabilité pour l’escale Martinique. 4. Le B.T.P. L’amélioration constatée en 1997 dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, qui occupe une place importante dans l’économie locale, ne se confirme que partiellement en 1998. Les ventes de ciment, qui constituent un indicateur significatif de l’activité du secteur, ont diminué de 3,2 % par rapport à 1997. L’encours des crédits à l’habitat a enregistré une augmentation de 7 %. On note également une poursuite de l’intensification de la commande publique, qui constitue un moteur essentiel de l’activité des travaux publics. Plusieurs grands chantiers ont été lancés ou achevés en 1998. A l’horizon 2006, la population martiniquaise devrait atteindre 441 000 personnes et le besoin global en logements est évalué à 4 650 par an. Après la hausse considérable des crédits consacrés aux investissements routiers en 1996 (+ 97,52 %), l’année 1997 avait vu la ligne consacrée à ces crédits poursuivre sa progression (+ 10,46 %), passant ainsi de 121 millions de francs en 1995 à 239 millions en 1996 et 264 millions en 1997. Le montant des opérations réalisées en 1998 s’est élevé à 244 millions de francs, soit une baisse de 7,58 %. Ce budget a concerné pour environ 229 millions de francs l’investissement sur les grands chantiers, le solde étant consacré aux travaux d’entretien et de grosses réparations. * * * Le système économique du département est marqué par une demande toujours importante émanant principalement des ménages et financée par les revenus directs, qui augmentent en raison notamment de l’importance et de la hausse des transferts publics, mais aussi du fait du recours au crédit. Le développement économique et la richesse du département, encore relatifs si l’on rapproche le produit intérieur brut par habitant de celui de la métropole, apparaissent évidents à la lecture d’un grand nombre d’indicateurs. Cependant, la répartition des revenus, de la consommation, de l’investissement et de l’épargne ne concerne pas toute la population, tous les secteurs et toutes les régions de l’île de façon homogène. Trois outils en cours d’élaboration en 1999 participeront au rééquilibrage du développement local : · le Document unique de programmation en matière de fonds structurels européens, dont la période s’étendra de 2000 à 2006 ; · le nouveau contrat de plan Etat-région, qui couvrira pour la première fois une période de sept ans entre 2000 et 2006, soit la même périodicité que le DOCUP avec lequel les articulations seront renforcées ; · la loi d’orientation relative aux départements d’outre-mer, qui devrait être examinée par le Parlement l’année prochaine, et qui a fait l’objet d’importants travaux préparatoires sur le terrain (rapport Mossé, missions Lise-Tamaya et Fragonard notamment). D.— LA RÉUNION L’année 1998 s’est achevée sur un bilan meilleur qu’en 1997. Cette évolution favorable s’est traduite par un retour de la confiance des agents économiques. L’inflation est restée faible, le pouvoir d’achat des ménages s’est globalement amélioré et, en dépit d’une pression démographique qui reste forte, la situation du marché du travail s’est améliorée en 1998 après plusieurs années marquées par de fortes augmentations du nombre de demandeurs d’emploi. Il convient de noter que ces bons résultats résultent pour l’essentiel de la création de 3 430 emplois-jeunes dans le secteur public. Au 1er janvier 1999, les demandes d’emplois non satisfaites s’élèvent à 95 769 contre 100 055 un an plus tôt, soit une diminution de 4,3 %. Grâce à la création de nombreux emplois-jeunes, la hausse du chômage des jeunes de moins de 25 ans qui avait marqué les deux dernières années a fait place à une baisse de 10,1 % en 1998. Le chômage de longue durée (supérieur à un an) s’accroît toujours à la Réunion. Il touchait 45 653 personnes au début de l’année 1999. L’indicateur de chômage publié par le ministère du travail et des affaires sociales s’établit à 35,7 %. Le taux de chômage de La Réunion reste le plus élevé de France, loin devant les autres DOM.
Nombre de demandeurs d’emplois (fin d’année) 1. L’agriculture Si l’agriculture a modelé l’île de La Réunion, ses hommes, ses paysages, son histoire et son développement, elle a perdu aujourd’hui sa prépondérance économique, au profit des activités du secteur secondaire, des services et de la fonction publique. Elle n’en demeure pas moins un fondement de la société insulaire. a) La canne à sucre La filière canne-sucre-rhum conserve sa place prépondérante dans l’économie agricole, contribuant à assurer le maintien de 7 000 emplois d’agriculteurs exploitants, de 4 000 salariés agricoles et d’environ 15 000 emplois directs et dérivés. Elle réalise un chiffre d’affaires global d’un milliard de francs, dont 80 % à l’exportation. La canne à sucre couvre 55,01 % de la surface agricole utilisée. Les résultats de la campagne sucrière 1998-1999 ont été décevants, en raison de son démarrage précoce, de conditions climatiques très défavorables lors des six premiers mois de l’année et de la baisse des surfaces plantées sous l’effet de l’urbanisation. Enfin, la faiblesse structurelle des exploitations (les trois quarts des planteurs exploitent moins de 5 ha) est un frein à la modernisation et à l’accroissement des rendements. Avec 1,676 million de tonnes de cannes manipulées par les deux usines de l’île, la récolte apparaît comme l’une des plus médiocres de la décennie, après celle de 1994. Par rapport à 1997, on note une baisse de 12,2 %. En outre, le taux moyen de richesse saccharimétrique des différents bassins de production s’est situé, en fin de campagne, à 13,64 %, soit le plus mauvais résultat depuis 1989. La Réunion ne parvient toujours pas à atteindre le quota sucrier de 296 000 tonnes à prix garanti qui lui a été attribué par l’Union européenne. RÉSULTATS DES CAMPAGNES SUCRIÈRES (milliers de tonnes)
Source : Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre. Enfin, la production de rhum de la Réunion a également diminué, passant de 71 822 HAP en 1997 à 68 169 en 1998. On note toutefois une forte croissance des exportations (+ 10,5 %) et une reprise du niveau des ventes sur le marché local (+ 15,7 %). b) Les fruits et légumes Au cours des dernières années, la filière fruits et légumes a connu un développement important en raison notamment de la croissance régulière du marché local. La production de fruits et légumes frais du département couvre environ 80 % des besoins de la consommation locale et représente, en valeur, 31,6 % de la production agricole totale, soit un niveau comparable à ceux de la canne à sucre (32,4 %) et de l’élevage (32,5 %). La production réunionnaise de légumes (50 254 tonnes en 1997) a satisfait plus de 77 % des besoins de la population. La production fruitière couvre, elle, 81 % de la consommation locale. Elle a atteint 46 063 tonnes en 1997 pour une surface totale de plus de 2 700 hectares exploités.
Production de fruits Les importations de fruits frais (10 635 tonnes en 1998) sont essentiellement composées de produits des régions tempérées. c) L’élevage L’aviculture réunionnaise dispose actuellement de l’ensemble des infrastructures nécessaires à son développement. Dans la production locale (12 382 tonnes), le secteur coopératif représente aujourd’hui près de 75 %. Parallèlement, les abattages (+ 4,6 %) et dans une moindre mesure les importations (+ 0,5 %) de volailles ont continué de progresser durant l’année 1998 et contrastent avec une stabilisation de la production d’œufs. La crise de surproduction porcine de 1996 s’est progressivement résorbée. En 1998, la tendance s’est inversée sous les effets conjugués de l’arrêt d’activité de plusieurs éleveurs indépendants et de la fermeture d’une exploitation illégale de 4 000 places. La consommation de viande bovine a timidement repris mais ce renversement de tendance a surtout bénéficié à la viande importée (+ 10,9 %) qui satisfait près des trois quarts de la demande locale. D’autre part, en 1997, a été mise en place l’identification permanente et généralisée (IGP) chez les éleveurs qui rend obligatoire l’enregistrement des animaux dans les 48 heures qui suivent leur naissance (le versement des aides européennes est conditionné à sa bonne application). Cette obligation devrait contribuer à lutter contre les abattages clandestins qui demeurent importants dans le département. Le développement de la filière lait s’est confirmé avec un volume total de plus de 15 millions de litres (+ 9 % par rapport à 1997), conséquence d’une nouvelle amélioration de la productivité moyenne des exploitations encouragée par diverses aides européennes, de conditions climatiques qui ont permis d’assurer une production fourragère satisfaisante, de l’absence de problèmes sanitaires et surtout de l’augmentation de 9,38 % du cheptel. La qualité bactériologique s’est également accrue. Parallèlement, les entrées de lait et de produits laitiers ont peu progressé en 1998 avec une croissance limitée à 1,4 %. 2. La pêche L’activité de la filière pêche se partage entre la pêche artisanale, la pêche au large et la grande pêche industrielle. La pêche artisanale, dont les prises sont destinées en quasi-totalité à l’approvisionnement du marché local, demeure prédominante en termes de flottille et d’effectifs. Elle manque toutefois de professionnalisme pour répondre aux exigences de la distribution moderne. Une zone de 12 milles le long des côtes est réservée à ce type de pêche. PRODUITS DE LA PÊCHE ET EXPORTATIONS
Source : Direction départementale des affaires maritimes - Douanes. La pêche au large, effectuée en dehors de la zone des 12 milles, est pratiquée par des bateaux d’une taille comprise entre 12 et 25 mètres. En 1998, la reconduction des mesures de défiscalisation et la croissance de la demande mondiale de pélagiques, qui composent l’essentiel des captures de ce type de pêche, ont eu pour conséquence d’accroître le parc de navires de cette catégorie et donc le tonnage des captures (+39,3 %). La pêche industrielle s’exerce principalement dans les zones économiques exclusives (ZEE) des Terres Australes et Antarctiques françaises (). Des quotas sont fixés, chaque année, par l’administration des TAAF (pour la campagne 1998-1999, quatre catégories de quotas ont été déterminées par zone de pêche, se répartissant entre les trois armements réunionnais et deux palangriers ukrainiens ()). Toutefois, en dépit de la mise en place de ces quotas, l’avenir de la pêche industrielle reste en permanence menacé par l’exploitation massive et illégale des ressources halieutiques des TAAF. Au cours de l’année 1998, neuf navires étrangers ont été arraisonnés par la Marine nationale et ramenés à la Réunion. Le renforcement de la lutte contre la pêche illégale dans les TAAF est donc une priorité pour la France, car ses conséquences apparaissent d’ores et déjà graves pour les intérêts français. Bien que cette pêche illégale n’ait pu encore être totalement éradiquée, le renforcement du dispositif national de contrôle et de la coopération internationale a permis de constater une diminution de la présence de navires pirates sur la zone. La présence de navires de pêche français autorisés participe également à la prévention de la pêche illégale. Aux termes de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966, modifiée par la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, il est ainsi désormais prévu : – que les navires entrant dans la zone économique des TAAF doivent signaler leur présence et déclarer le tonnage de poissons détenus à bord ; – que les amendes pour pêche sans autorisation ou en infraction aux règles prescrites peuvent atteindre un montant de 1 million de francs (contre 500 000 francs auparavant) auquel pourra s’ajouter une somme de 500 000 francs par tonne pêchée au-delà de 2 tonnes ; – que le recel des produits pêchés frauduleusement sera puni des mêmes peines ; – et que, pour les personnes morales, le montant des amendes appliquées pourra être multiplié par cinq. Depuis mars 1997, seize navires braconniers, battant pavillon du Bélize, de l’Argentine, du Chili, du Panama, du Portugal et du Vanuatu, ont été arraisonnés par les bâtiments de la marine nationale et déroutés sur la Réunion afin d’y juger les contrevenants. Il apparaît ainsi que les cautions demandées pour obtenir la mainlevée des navires saisis sont beaucoup plus élevées que par le passé (jusqu’à 75 millions de francs en 1998 contre 500 000 francs en 1997) et que les jugements de première instance (dont six ont été confirmés de manière définitive) sont également bien plus dissuasifs que précédemment (entre 1 et 8 millions de francs d’amendes en 1998 contre 400 000 francs en 1997). Parallèlement aux efforts français de développement de la surveillance, la lutte contre le pillage des ressources halieutiques de notre zone économique est poursuivie en recherchant toutes les possibilités de coopération internationale susceptibles d’être mises en œuvre : – coopération régionale dans le cadre de la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) ; – coopération bilatérale avec l’Australie et l’Afrique du Sud (échanges d’informations entre marines, portant sur la situation des bâtiments de contrôle, le trafic des navires marchands et de pêche, …). Les dernières informations et réunions permettent de confirmer le grand intérêt de l’Australie pour une coopération en la matière entre nos deux pays (projet de traité de coopération à l’étude), un navire australien ayant d’ores et déjà effectué une mission dans les eaux françaises. Les prises de la pêche industrielle ont également augmenté de 5,8 % en 1998. 3. Le B.T.P. En dépit des mauvais résultats enregistrés dans le domaine du logement social, la situation du bâtiment s’est dans l’ensemble améliorée en 1998. L’activité est restée soutenue dans les secteurs de la construction de logements privés, des constructions publiques et des investissements routiers. Le logement social demeure le principal marché du secteur puisqu’il représente environ un tiers du volume d’affaires annuel de l’ensemble bâtiment et travaux publics. La ligne budgétaire unique (LBU) est en baisse de 19,2 % par rapport à 1997, passant de 602,6 millions de francs à 487,1 millions de francs, après une diminution de 11,5 % déjà observée l’année précédente. LIGNE BUDGÉTAIRE UNIQUE ET LOGEMENTS NEUFS
Source : Direction départementale de l’équipement. Les difficultés à consommer l’enveloppe annuelle de la LBU, malgré l’ampleur des besoins, illustrent les incohérences auxquelles le secteur est confronté. Le montant total de la LBU dépensé en 1998 s’élève à 377,9 millions de francs pour une dotation annuelle de 487,1 millions de francs, soit un taux d’engagement de 77,5 %. Dans le secteur de la construction privée, le nombre de logements neufs a de nouveau très fortement progressé en 1998 (+ 40,8 %). 4. Le tourisme Le secteur touristique présente, une nouvelle fois, des résultats en progression. Les recettes estimées générées par le tourisme (1,563 milliard de francs) sont désormais sensiblement supérieures à la valeur totale des exportations de marchandises produites dans l’île (1,214 milliard de francs).
Entrées de touristes sur le sol réunionnais Avec plus de 390 000 touristes, La Réunion occupe la deuxième place (il est vrai, loin derrière l’île Maurice qui a accueilli 558 195 touristes en 1998, mais devant les Seychelles) des destinations de la zone sud de l’océan indien. La France métropolitaine arrive largement en tête des pays de résidence de ces touristes avec 318 642 entrées (chiffre en progression de 5,1 % par rapport à 1997). Les pouvoirs publics s’emploient à améliorer la qualité de l’offre touristique. Celle-ci bénéficie d’aides, notamment au travers du Fonds européen de développement régional (FEDER). Les interventions de l’Europe sont effectuées en cofinancement avec des subventions nationales. Les crédits mandatés, en forte hausse de plus de 75 %, se sont élevés à 16,5 millions de francs en 1998, ce qui porte à 43,3 millions de francs le total des financements publics depuis 1995, dont 60 % ont été apportés par l’Union européenne et 40 % par la région et le département. 5. Le commerce extérieur En 1998, les importations ont fortement augmenté en volume (+ 16,5 %) et en valeur (+ 6,9 %) reflet d’une hausse des entrées de produits énergétiques (41,2 % du total des entrées). Les pays du Golfe (Arabie Saoudite, Afrique du Sud et Bahreïn) sont les premiers fournisseurs de l’île, en volume, devant la métropole. BALANCE COMMERCIALE (millions de francs)
Source : Direction régionale des douanes. Le déficit de la balance commerciale s’est accru en 1998 sous l’effet conjugué d’une hausse des importations et d’un fléchissement des exportations, entraînant une détérioration du taux de couverture de 0,9 point. * * * L’année 1998 peut être considérée comme un exercice de croissance régulière et équilibrée. Même si quelques aspects négatifs peuvent être mis en évidence, comme par exemple la mauvaise récolte de canne, entraînant une production sucrière limitée à 190 000 tonnes, un symbole aussi fort que celui du recul du chômage (- 4,4 %) ,témoigne d’une évolution dont il convient de se féliciter au-delà des mesures sociales du type emplois-jeunes, qui bien entendu ont contribué à ce résultat. La plupart des indicateurs de branches, le niveau des échanges, l’accroissement du pouvoir d’achat se conjuguent pour justifier une appréciation positive de l’activité économique dans le département. Ces bons résultats de l’économie réunionnaise apparaissent opportuns pour faire face à une situation démographique et sociale qui demeure un enjeu majeur. La société réunionnaise rassemble une population de plus de 700 000 habitants, sur un territoire exigu. Or, si l’ouverture à la modernité ou le dynamisme de ses entrepreneurs ne font pas de doute, ceci ne saurait masquer l’importance des laissés-pour-compte de la croissance de l’île, qui se retrouvent parmi les 57 718 allocataires du revenu minimum d’insertion. Au-delà, de l’accroissement des richesses dans le département, c’est bien évidemment la question fondamentale du dualisme des situations individuelles qui demeure, où le problème des inégalités est dû, à la fois, au niveau des écarts de revenus et à l’existence d’une ligne de démarcation qui sépare ceux qui disposent d’un emplois ou d’un salaire des autres citoyens. Ce très difficile problème trouvera d’autant plus d’amorces de solutions que l’environnement économique sera prospère, comme en 1998. III.— LES TERRITOIRES D’OUTRE-MER En 1998, la conjoncture économique des Territoires d’outre-mer a été marquée par d’assez fortes divergences entre les différentes entités territoriales concernées. En Nouvelle-Calédonie, la crise sévissant sur le marché mondial du nickel a affecté la situation des entreprises liées directement ou indirectement à ce secteur, et occulté les évolutions relativement favorables enregistrées par ailleurs. En Polynésie française, en revanche, l’économie locale reste marquée par le dynamisme de la consommation et de l’investissement. La baisse sensible des cours de la perle semble avoir été gérée de manière positive par la profession, qui prospecte de nouveaux marchés. A Wallis-et-Futuna, le niveau satisfaisant de la commande publique a permis de maintenir l’activité. A.— LA NOUVELLE-CALÉDONIE La situation économique de la Nouvelle-Calédonie a souffert, en 1998, de la mauvaise conjoncture du nickel. Si les autres indicateurs étaient orientés positivement, la baisse très significative des cours du nickel amorcée début 1997 a ramené le cours du nickel à des niveaux historiquement très faibles. De plus, si la tendance baissière du nickel s’est manifestée avant le déclenchement de la crise asiatique, cette dernière l’a incontestablement amplifiée. La crise asiatique a entraîné une baisse de la valeur de la quasi-totalité des monnaies du Pacifique sud, entre 20 et 50 % pour certaines, ce qui a affecté la position concurrentielle de la Nouvelle-Calédonie, notamment sur les activités du tourisme ; mais l’économie calédonienne reste dans l’ensemble peu dépendante de ses voisins asiatiques. 1. Le nickel Le secteur reste prépondérant dans l’économie néo-calédonienne. Au cours des dernières années, le nickel a représenté en moyenne plus de 90 % des exportations du Territoire. Avec désormais 12 % de la production mondiale et 20 % des réserves identifiées en 1995, il constitue un atout majeur pour le développement du Territoire. En contrepartie, l’économie locale est extrêmement dépendante de son exploitation qui est, elle-même, tributaire des fluctuations du marché mondial. Par rapport aux pays concurrents (Canada, Russie, Indonésie...), la Nouvelle-Calédonie est handicapée par des coûts de production plus élevés mais dispose, en revanche, d’un minerai à forte teneur en nickel. La production de minerai qui avait été, en 1997, la plus importante jamais réalisée (8 152 193 tonnes) a régressé de 8 % en 1998, mettant fin à la progression enregistrée les années précédentes. Sous l’effet conjugué de la diminution du volume exporté (- 24,7 %) et d’une dépréciation du dollar par rapport au franc CFP (- 5,9 %), la valeur totale des exportations a reculé, en 1998, de 39,1 %. PRODUCTION ET EXPORTATION (tonnes)
Source : Service des mines et de l’énergie. La transformation locale s’est maintenue. En revanche, les exportations ont baissé sensiblement (- 21 %). Les débuts de l’année 1999 ont encore été faibles mais l’amélioration des cours s’est traduite dès le deuxième semestre de manière très sensible. 2. Le tourisme Le tourisme aurait pu constituer l’axe principal de diversification économique d’un tissu productif trop dépendant des fluctuations du marché mondial du nickel, mais les troubles politiques et sociaux des années 1985-1988 ont interrompu une période de dix années de progression continue de la fréquentation touristique. L’année 1984 a permis d’atteindre le record historique de 91 512 touristes. Il aura fallu attendre 13 ans pour que ce chiffre soit dépassé et qu’un nouveau record s’établisse, en 1997, à 105 137 touristes recensés dans l’année. En 1998, 103 835 touristes ont été recensés, ce qui représente une légère baisse de la fréquentation annuelle (- 1,2 %).
Flux touristique depuis 1985 Le Japon a conforté, en 1998, sa première place des marchés émetteurs avec 34,1 % des arrivées touristiques du Territoire (clientèle très jeune et dont les séjours ne dépassent pas une semaine), devant le marché métropolitain, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. RÉPARTITION DES TOURISTES PAR PAYS DE RÉSIDENCE
Sources : ITSEE, Police de l’air et des frontières, Port autonome. 3. Le B.T.P. C’est à partir du milieu des années 1960, avec l’expansion rapide de l’activité minière, que se sont développées de nombreuses entreprises du bâtiment en raison des demandes importantes de logements. Le secteur du B.T.P. emploie 13,7 % de la population salariée du Territoire et compte un nombre particulièrement important d’entreprises artisanales ou commerciales. Son activité a été soutenue en 1998, notamment grâce aux mesures fiscales en faveur de la construction (votées par le Congrès), aux opérations de défiscalisation de type loi Pons et au lancement des quelques grandes opérations. Les ventes de ciment, indicateur traditionnel de la santé du secteur, ont confirmé ces bons résultats puisque la production a augmenté de 6,4 %, l’encours des prêts bancaires à l’habitat ayant pour sa part augmenté de 18,4 %. 4. L’industrie et l’artisanat Le tissu productif néo-calédonien se compose de 16 433 entreprises (dont 7 344 personnes morales et 9 089 personnes physiques). Mais, malgré une progression constante en volume, la valeur ajoutée par les différentes industries du territoire reste faible par rapport à celle des services. Les pouvoirs publics locaux, pour favoriser la survie ou le développement des entreprises d’un secteur donné, ont élaboré des protections réglementaires afin de limiter l’entrée des produits concurrents (un système de contingentement associé à une fiscalité différenciée). Les Provinces, responsables de l’action économique, ont instauré des aides financières multiples pour les investissements et l’exploitation des entreprises. ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES ARTISANALES
Source : Chambre de métiers de Nouvelle-Calédonie. Au niveau artisanal, la densité du réseau d’entreprises est trois fois plus élevée que celle observée en métropole. 5. L’agriculture Traditionnellement l’agriculture occupe une place prépondérante dans la société néo-calédonienne, où la terre constitue non seulement un moyen de subsister mais aussi le fondement de la communauté mélanésienne. Toutefois, la superficie agricole utilisée ne représente qu’une faible partie de la surface totale du Territoire (à peine plus de 10 %) car elle subit la contrainte d’une géographie souvent peu propice (relief montagneux de la côte Est, grandes plaines peu fertiles et sèches de la côte Ouest). Le secteur se caractérise par une faible rentabilité générale malgré une politique volontariste d’aides des pouvoirs publics. Depuis 1965, on observe une baisse constante de la part du secteur agricole dans la formation du produit intérieur brut (PIB). De 11 % en 1965, et après avoir régulièrement diminué, elle est passée à 1,7 % en 1996. Parallèlement, le PIB ne cesse de progresser. La production agricole finale marchande a progressé de 9,2 % en 1998. Cette progression est essentiellement due aux bons résultats des filières fruits et légumes (+ 11,5 %). Le secteur bénéficie d’aides, tant de la part de l’État que du Territoire ou des Provinces avec un double objectif : – assurer la couverture de la majeure partie des besoins intérieurs ; – participer au rééquilibrage de la répartition des richesses et renforcer ainsi l’harmonie sociale et géographique. 6. La pêche et l’aquaculture Ces deux secteurs font preuve d’un dynamisme incontestable. L’archipel permet trois formes de pêche : la pêche lagonaire (destinée au marché local et à l’exportation), la pêche côtière (essentiellement commercialisée sur le marché local) et la pêche industrielle. Cette dernière a enregistré une nette augmentation en volume en 1998 (environ 70 %), la valeur des prises progressant, quand à elle, de 90 %. Le secteur de l’aquaculture a maintenu son dynamisme en 1998 avec notamment une production de crevettes en hausse sensible à 1569 tonnes et constitue, depuis trois ans, la seconde activité exportatrice du territoire, loin toutefois derrière le nickel. * * * Si la Nouvelle Calédonie donne l’image d’un territoire au dynamisme retrouvé, le risque de développement inégalitaire est réel. La mise en place des nouvelles institutions est l’occasion pour les divers groupes socio-économiques de se positionner et conduit de ce fait à un certain trouble local. Les difficultés du secteur minier ont exacerbé la compétition pour l’emploi entre les personnes intéressées, conduisant jusqu’à la violence. L’enjeu majeur des prochaines années va être notamment le maintien d’une cohésion sociale et d’une solidarité entre les différents partenaires, que ce soit au niveau des micro-sociétés locales, entre les provinces, entre les secteurs d’activité. B.— LA POLYNÉSIE FRANÇAISE Confirmant les résultats de l’année 1997, caractérisée par une vive reprise de l’activité, la conjoncture économique est demeurée bien orientée en 1998. La poursuite de la croissance a contribué à l’amélioration de la situation de l’emploi. Sur la même période, la masse salariale a progressé de 9 %, avec pour conséquence une augmentation du pouvoir d’achat des ménages favorisée par une croissance de l’indice des prix de 0,8 %, inférieure à la revalorisation des salaires. 1. Le tourisme Ce secteur occupe une place centrale dans l’économie polynésienne, assurant plus de 75 % des recettes à l’exportation du Territoire. Après un exercice difficile en 1996, les années 1997 et 1998 ont été marquées par une activité soutenue dans le secteur du tourisme, bien qu’en deçà des prévisions du GIE Tahiti Tourisme.
Fréquentation touristique En 1998, le Territoire a accueilli 188 933 touristes contre 180 440 en 1997, soit une progression de 4,7 % qui n’a pas complètement répondu aux attentes des professionnels du secteur qui escomptaient un résultat nettement supérieur (20 %). La médiatisation des cyclones de la fin de l’année 1997 et surtout la crise financière asiatique sont à l’origine de ces résultats mitigés. Une forte progression de la fréquentation nord-américaine (+ 19 %) a été relevée. Les Etats-Unis ont ainsi conforté leur position de deuxième marché émetteur du Territoire. La hausse de la fréquentation métropolitaine n’a pas été démentie en 1998, la France conservant son statut de premier marché émetteur, grâce à une hausse de 4 %. La fréquentation italienne a poursuivi sa progression et s’inscrit en hausse de 34 % en 1998 (+ 60 % en 1997), représentant désormais près d’un tiers des touristes européens (hors France). L’Italie s’affirme ainsi comme l’un des marchés porteurs pour le tourisme polynésien. En revanche, la fréquentation japonaise a reculé de 6 % en 1998. Ce résultat est d’autant plus important pour le Territoire que les Japonais constituent la clientèle dont les dépenses touristiques par tête et par jour sont les plus élevées ().
Corrélativement à la hausse du nombre de touristes, on a relevé une augmentation du coefficient moyen de remplissage de l’hôtellerie classée et une poursuite du développement des pensions de famille. La poursuite des efforts de promotion sur les principaux marchés émetteurs s’accompagne d’une action de promotion pour les îles au niveau local. On a, par ailleurs, assisté à un renouvellement de la flotte de paquebots en 1998, le paquebot « Paul Gauguin » venant remplacer le « Windsong » et le « Club Med II » et surtout au lancement de la compagnie aérienne locale, Air Tahiti Nui, qui assure désormais trois fréquences hebdomadaires sur Los Angeles et une rotation vers le Japon. 2. La pêche, l’aquaculture et la perliculture Le secteur de la pêche est demeuré longtemps au stade artisanal avant de connaître une profonde mutation à partir des années 90. La pêche polynésienne s’organise aujourd’hui autour de deux pôles complémentaires : – une pêche de type semi-industriel dont la vocation est tournée vars les marchés extérieurs ; – une pêche artisanale, côtière ou lagunaire, de type familial qui satisfait correctement la demande locale, à Tahiti comme dans les archipels éloignés. ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION
Source : Service de la mer et de l’aquaculture Le Territoire a mis en œuvre un programme stratégique pour le développement du secteur qui fixe comme objectif, à l’horizon 2003, la production de 11 000 tonnes de poissons, dont la majeure partie serait destinée aux marchés extérieurs. Ce programme s’appuie sur une série de mesures et d’actions incitatives, dont notamment l’attribution d’aides financières pour l’acquisition et l’exploitation de navires de pêche. A cela s’ajoutent le développement de la recherche appliquée, la formation des acteurs de la filière aux techniques modernes de pêche et l’organisation des circuits de commercialisation. Les professionnels de la pêche et de la perliculture ont rencontré des difficultés liées à la diminution des cours internationaux qui ont pénalisé leurs exportations. Afin d’atténuer les effets de la baisse des cours sur leurs résultats, les pêcheurs ont privilégié la filière locale pour l’écoulement de leur production, ce qui s’est traduit par une diminution des exportations de poissons. La vigueur de la consommation des ménages polynésiens a cependant permis d’absorber l’augmentation de la production et a soutenu les prix de vente. Le bilan de la filière perlière apparaît également contrasté. Bien que les volumes exportés aient progressé de 24 %, les recettes de la branche sont restées au niveau de 1997 en raison de la diminution de plus de 20 % des prix de négociation des perles sur le marché international. Les effets de la crise financière asiatique sur les prix, associés à la demande importante de perles de petite taille émanant des négociants japonais, expliquent en partie le tassement des exportations en valeur. La baisse des cours résulte également de l’augmentation des ventes de perles de qualité inférieure, dont l’exportation est désormais interdite depuis le 1er janvier 1999. 3. Le B.T.P. La part du bâtiment et des travaux publics dans l’économie polynésienne ne représente que 9,7 % de la valeur ajoutée marchande mais le poids de ce secteur est beaucoup plus élevé en termes d’emplois, puisqu’avec 2 366 entreprises de construction et 31 entreprises de travaux publics, il concentre un effectif d’environ 4 200 personnes. En 1998, un rythme d’activité soutenu s’est poursuivi dans le bâtiment, lié à la bonne tenue de la demande privée et de la commande publique (+ 30 %). * * * Après deux années de forte croissance économique, la poursuite du programme pour le renforcement de l’autonomie économique devrait continuer à exercer un effet d’entraînement sur l’activité du Territoire. C.— WALLIS ET FUTUNA Le territoire des îles Wallis et Futuna comprend trois îles : Wallis, et à 240 km au sud-ouest, Futuna et Alofi. En 1998, les aides financières allouées dans le cadre de la convention de développement et du contrat de plan avec l’État ont permis l’engagement ou la poursuite de chantiers intéressant essentiellement l’enseignement et les travaux routiers. 1. L’agriculture Wallis est une île vallonnée dont une partie des sols est altérée et lessivée donc impropre à la culture. Futuna, qui culmine à 524 m ne permet que des cultures côtières. Alofi, non peuplée de manière permanente, est utilisée comme réserve forestière et, dans une mesure encore limitée, pour l’agriculture. Les activités agricoles demeurent marginales, permettant cependant l’autosuffisance alimentaire. Ce sous-développement tient essentiellement au régime foncier, qui est celui de l’indivision du patrimoine familial, et au système instauré d’échange de denrées. Cette structure est de plus en plus contestée et une agriculture marchande tend aujourd’hui à se développer. Les cultures vivrières du Territoire procurent les éléments de base de l’alimentation de la population qui repose sur la production de taro, d’igname, de kapé, de manioc et de fruits de l’arbre à pain. Les cultures maraîchères correspondent à une demande de métropolitains résidant sur le Territoire mais elles pourraient devenir la source de revenus familiaux réguliers. Il existe de nombreuses variétés fruitières locales mais qui sont peu exploitées. L’élevage concerne presque exclusivement les porcs même si une production locale de poulets se développe de manière encore timide. 2. La pêche De la même manière, la pêche est peu développée car elle se cantonne essentiellement à l’intérieur d’un lagon surexploité et reste pratiquée de façon artisanale pour une production autoconsommée. L’archipel n’a pas d’infrastructures de pêche. Le territoire dispose pourtant d’une zone économique exclusive importante (environ 300 000 km2) qui n’est exploitée que par des navires de pêche japonais et coréens. Le service de l’économie rurale et de la pêche envisage un développement des secteurs de la pêche et de l’aquaculture orienté autour de quatre axes principaux : – études complémentaires nécessaires à la définition d’un programme territorial coordonné de l’exploitation des ressources marines ; – formation des hommes ; – aide à l’investissement ; – création d’infrastructures publiques nécessaires à la pêche. 3. Le B.T.P. Le BTP a pu maintenir son activité en 1998 grâce à la commande publique et à la demande de particuliers pour la construction de logements. Pour l’année 1999, plusieurs projets ont vu le jour et ont permis de préserver le nombre d’emplois dans ce secteur. Par ailleurs, les travaux entrepris en 1998 pour l’amélioration des infrastructures routières du Territoire se sont poursuivis en 1999. 4. Le tourisme Wallis et Futuna sont des îles isolées, peu connues et très éloignées des marchés émetteurs. Fidji, à 800 km, Nouméa à 2 100 km et Papeete à 2 800 km sont les territoires les plus proches. Le tourisme est encore peu développé. Les atouts du Territoire ne sont pas mis en valeur. Les infrastructures existantes ne permettent qu’un tourisme culturel et de découverte, individuel ou de petits groupes. La capacité hôtelière est très limitée et correspond à une clientèle essentiellement constituée d’hommes d’affaires ou de techniciens en mission sur le Territoire. Malgré la baisse du prix des billets d’avion des principales destinations observée depuis 1994, les tarifs pratiqués par la compagnie Air Calédonie constituent un obstacle important à l’essor de ce secteur. * * * Le Territoire des îles Wallis et Futuna se développe progressivement et s’équipe en infrastructures publiques nécessaires à son essor de demain. Les conditions de vie s’améliorent régulièrement. Mais cette évolution met en exergue une certaine dualité de la société avec, d’une part, une frange de l’économie monétarisée, d’autre part, le maintien en parallèle d’une économie traditionnelle reposant encore largement sur le troc et l’autoconsommation, et dont les acteurs accèdent difficilement aux commodités de la vie moderne. De plus, le problème de l’emploi se pose avec une acuité croissante, en l’absence de développement d’activités novatrices qui permettraient de réaliser des embauches. La priorité pour le développement économique et social du Territoire demeure son désenclavement. Sur ce plan, les importants chantiers portuaires et aéroportuaires qui se profilent devraient améliorer sensiblement la desserte de l’île de Wallis, faisant davantage encore ressortir la nécessité d’améliorer celle de l’île de Futuna. Il est à espérer que ces infrastructures, par delà l’activité temporairement induite dans le secteur du BTP, suscitent le développement d’activités nouvelles pérennes dans des secteurs jusque là inexploités ou sous-exploités par les entreprises locales mais d’avenir, la pêche côtière ainsi que le tourisme. IV.— LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES A.— MAYOTTE L’année 1998 aura été marquée par une nouvelle croissance de l’économie mahoraise sous l’effet conjugué de l’importance des transferts publics, du développement du secteur privé et du regain d’activité du marché de l’emploi. L’activité locale, demeure dominée par le secteur du bâtiment et des travaux publics. Il est important de souligner la forte pression démographique que connaît Mayotte. Un recensement réalisé en 1997 dénombre 132 420 habitants et, sans un infléchissement du rythme moyen annuel de croissance démographique (5,8 %), la population mahoraise pourrait atteindre 270 000 habitants en 2010. 1. L’agriculture Même si la part de la population agricole au sein de la population active a fortement régressé, l’activité agricole, bien que confrontée à de graves handicaps qui tiennent en grande partie à la géomorphologie de l’archipel, demeure extrêmement répandue dans l’île. Les surfaces cultivées représentent 27 % de la surface totale de l’île. L’agriculture locale, fortement attachée à la cellule familiale, tente peu à peu d’évoluer vers une agriculture marchande et productive. Bien souvent, l’exploitation agricole constitue un moyen d’autosubsistance alimentaire (57 % des ménages exerçant une activité agricole ne produisent que pour leurs besoins propres, avec éventuellement du troc ou des ventes épisodiques procurant un complément de revenu en nature ou en argent). La collectivité a poursuivi sa politique d’aide aux agriculteurs. La banane, avec 30 200 tonnes, et le manioc, avec près de 10 000 tonnes, constituent les principales productions vivrières de Mayotte. Les cultures d’exportation, ylang-ylang et vanille, bien que délaissées par les jeunes agriculteurs, représentent cependant un atout économique certain. a) L’ylang-ylang L’ylang-ylang est un arbre de la famille des annonacées dont les fleurs jaunes donnent, après traitement, un distillat très apprécié de l’industrie de la parfumerie. Il s’agit d’une activité à forte intensité de main-d’oeuvre. Il est en effet nécessaire de traiter 50 kilogrammes de fleurs cueillies à la main pour obtenir un litre d’essence dont la qualité varie selon la durée de la distillation. Constituant 78 % des ressources à l’exportation de l’île, la culture de l’ylang-ylang est menacée par divers facteurs : manque de compétitivité des essences mahoraises en raison du coût relativement élevé de la main-d’œuvre, vieillissement des techniques de préparation et des plantations, et étroitesse du marché. Un marché morose et une concurrence accrue des produits de synthèse moins coûteux ont provoqué un tassement des ventes et les stocks invendus se sont amplifiés depuis quelques années. De plus, cette baisse de la demande s’accompagne d’une chute des cours mondiaux depuis 1994. EXPORTATIONS D’YLANG-YLANG
Source : Service des douanes. Les résultats enregistrés en 1998 n’ont guère été encourageants : les exportations d’ylang-ylang ont chuté de 20 % en volume et de 28 % en valeur par rapport à 1997. b) La vanille La seconde culture de rente, la vanille, voit ses exportations progresser en valeur bien que les quantités aient diminué de 25 %. Ce résultat vient du fait que le marché mondial de la vanille noire, très spéculatif, est dominé à 85 % par les productions de Madagascar et de l’Indonésie. Ces deux pays, à très faibles coûts de main-d’œuvre, fixent les prix. EXPORTATIONS DE VANILLE (en francs)
Source : Service des douanes. 2. La pêche Bien que disposant d’un des plus grands lagons du monde, la population mahoraise s’est très peu tournée vers la mer pour assurer son développement économique. Principalement concentrée sur l’exploitation des eaux lagonaires ou limitrophes, la pêche est assurée par deux grandes catégories d’intervenants : les artisans-pêcheurs, propriétaires de leur embarcation (environ 20 %), et les « armateurs », qui travaillent par ailleurs, et qui confient des bateaux à des tiers (environ 80 %). Les méthodes de pêche restent encore traditionnelles. L’exploitation intensive du lagon a entraîné une diminution sensible des rendements. Pour remédier à cette baisse des ressources concomitante à un accroissement des besoins, une des solutions retenues consiste à développer de petites fermes aquacoles. Un nouvel essor de cette activité passe par le développement de la pêche en haute mer et implique une amélioration des techniques et du matériel. 3. Le B.T.P. L’activité du secteur du bâtiment et des travaux publics a été soutenue grâce à la commande publique qui, bien qu’en baisse par rapport à 1996, a permis la réalisation de 256 millions de francs de travaux. La commande publique s’est poursuivie au début de l’année 1998. Après le secteur du commerce, le BTP vient au second rang des activités de l’archipel. Son essor résulte de la croissance des besoins en logements, écoles et autres infrastructures, suscités par la forte pression démographique. La structure du secteur du BTP reste très déséquilibrée et s’articule essentiellement autour de deux pôles : d’une part, quelques rares entreprises fortement capitalistiques qui réalisent les grands travaux d’infrastructure et, d’autre part, de nombreuses petites entreprises, le plus souvent artisanales, intervenant sur les petits marchés ou en sous-traitance des grosses entreprises. Bien que la commande privée tende à se développer, les entreprises de ce secteur sont largement dépendantes des collectivités publiques et de la société immobilière. L’une des manifestations les plus éclatantes du retard de développement de Mayotte est l’état médiocre de son parc de logements. Une large partie de la population mahoraise est hébergée dans des conditions précaires, dans des logements exigus qui ne comportent aucune connexion aux réseaux électrique ou hydraulique, et qui ne disposent de ce fait d’aucun confort. C’est dire l’importance des efforts que l’État et la collectivité territoriale doivent déployer pour répondre aux besoins croissants de la population. 4. Le tourisme En dépit de son immense lagon (1 500 km²) et d’un climat favorable, Mayotte reste une destination touristique confidentielle. Le tourisme reste à l’état embryonnaire. Le coût élevé des liaisons aériennes, l’insuffisance du parc hôtelier et la concurrence régionale en sont les principales raisons. Le nombre de touristes d’agrément est très largement inférieur à celui des personnes venues rendre visite à des amis ou à de la famille.
Fréquentation touristique de juillet 1996 à juin 1997 Plus de la moitié des personnes visitant Mayotte est originaire de la métropole, alors que près de 40 % résident à la Réunion. Le souhait de la Collectivité est de développer une politique touristique en proposant des produits communs avec la Réunion. * * * La Collectivité territoriale de Mayotte s’est longtemps caractérisée par une agriculture archaïque, des infrastructures sommaires et une économie basée sur deux secteurs prédominants : le bâtiment et l’administration. Depuis quelques années, la Collectivité a modifié l’organisation de son activité économique en se dotant d’infrastructures et d’équipements publics qui ont permis d’amorcer le développement et la diversification du secteur privé. Au cours de ces dernières années, l’Etat et la Collectivité territoriale ont accentué leurs investissements dans les secteurs de l’enseignement, de la santé, de l’habitat et de l’adduction d’eau. Parallèlement, les conditions de vie de la population salariée se sont rapidement améliorées. L’augmentation du pouvoir d’achat a eu un effet positif immédiat sur la consommation, favorisant ainsi la création ou le développement d’entreprises dans les secteurs secondaire et tertiaire. B.— SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON Depuis le début du moratoire sur la pêche à la morue en 1992 où les quotas de pêche alloués à l’archipel par le Canada ont été réduits dans des proportions considérables, l’économie de l’archipel a connu de sérieuses difficultés. De très gros efforts ont été faits pour tenter de reconvertir et diversifier l’économie tout en maintenant le niveau de l’emploi, ce qui n’a été possible que grâce à des efforts financiers très importants de l’État et de la Collectivité territoriale. 1. La pêche L’année 1998 a été marquée par la fin du moratoire sur la pêche à la morue. Le secteur de la pêche tout entier, dans des proportions plus ou moins grandes, aura profité de cette reprise. La pêche industrielle a présenté, en 1998, des résultats en nette progression. Le cumul des poissons pêchés dans l’année s’est élevé à 3 008 tonnes, soit une hausse de 83 %, armements locaux et étrangers confondus.
Pêche artisanale (en tonnes) En ce qui concerne la pêche artisanale, les bons résultats font apparaître, en 1998, une progression substantielle (+ 35 %) des prises des artisans-pêcheurs mais on remarque une raréfaction de la morue, qui tend à s’éloigner progressivement des côtes. 2. Le tourisme Après une saison 1997 moyenne, la saison touristique 1998 a retrouvé un meilleur niveau. Ce secteur représente toujours pour l’archipel un réel potentiel de développement. RÉPARTITION DES TOURISTES
Source : Agence régionale de tourisme. Le nombre de touristes de croisière est en forte hausse. Le bilan sur l’année fait ainsi ressortir 2 233 touristes de croisière, contre 785 l’année précédente. Le tourisme contribue en pleine saison à l’amélioration de la situation de l’emploi, ce secteur générant près de 150 emplois. La forte dépréciation des devises canadienne et américaine a probablement incité les ressortissants de ces pays à des séjours plus lointains, et n’a pas profité à la Collectivité. 3. Le B.T.P. Le secteur du bâtiment et des travaux publics, vital sur le plan de l’emploi, a continué, comme en 1997, à connaître, grâce aux travaux de construction du nouvel aéroport et à l’extension du port de Miquelon, une forte activité, malheureusement réduite en hiver. * * * L’évolution de la conjoncture au cours de l’année 1998 s’est inscrite, à l’image des années précédentes, dans la recherche d’une reconversion et d’une diversification de l’économie locale. Le maintien de l’emploi et la régression du chômage ont constitué, comme en 1997, l’une des préoccupations majeures des autorités et de la population de l’archipel. La politique de grands travaux financée par l’Etat et les collectivités locales de l’archipel s’est poursuivie en 1998. Conjugués au bon niveau des investissements privés en matière d’habitat, les grands chantiers ont permis de maintenir à un niveau élevé l’activité du BTP. L’économie de l’archipel apparaît encore très fragile et reste très dépendante des aides publiques. EXAMEN EN COMMISSION Lors de sa réunion du jeudi 21 octobre 1999, la commission a entendu M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d’Etat à l’outre-mer, sur les crédits de son département pour 2000. M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d’Etat à l’outre-mer, a indiqué que le projet de budget du secrétariat d’Etat à l’outre-mer pour 2000 s’élevait à 6,36 milliards de francs en dépenses ordinaires et crédits de paiement, correspondant à une progression de 13,6 % par rapport à la loi de finances initiale pour 1999 et à une hausse de 2 % à structure constante (en tenant compte des dotations concernant les emplois-consolidés et des conséquences des réformes institutionnelles relatives à la Nouvelle-Calédonie). Il a rappelé que l’emploi demeurait la principale priorité de l’action du secrétariat d’Etat. De fait, les crédits qui y sont consacrés s’élèvent à près de 2,5 milliards de francs et représentent près de 40 % du budget total. Sur cette somme, 2,1 milliards de francs sont affectés au Fonds pour l’emploi dans les départements d’outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon (FEDOM). Grâce à cette augmentation de 16,2 %, le FEDOM pourra financer 35 000 contrats emploi-solidarité, 15 000 contrats d’insertion par l’activité, 7 500 contrats d’accès à l’emploi et 500 primes à la création d’emplois. 7 000 contrats emplois-consolidés, prolongement des contrats emploi-solidarité, sont également financés par le budget de l’outre-mer. Ils représentent une dotation nouvelle de 292 millions de francs. Le FEDOM permettra aussi de financer 3 000 emplois-jeunes supplémentaires, ce qui portera le nombre d’emplois-jeunes outre-mer à environ 11 000 à la fin de l’année 2000. S’y ajoutent les emplois d’adjoints de sécurité (134 postes) et d’aides éducateurs (2 600 postes) créés respectivement par les ministères de l’intérieur et de l’éducation nationale. Les crédits pour l’emploi et la formation professionnelle à Mayotte représentent une dotation nouvelle de 55,25 millions de francs, permettant d’améliorer la gestion des contrats emploi-solidarité, des contrats emplois-consolidés, des chantiers de développement local et des actions de formation professionnelle. 2,5 millions de francs seront affectés à la création du centre de formation professionnelle des adultes de Sada. Les crédits du service militaire adapté (SMA) s’élèvent à 440 millions de francs (auxquels s’ajoutent 67 millions de francs de dotations provenant de l’Union européenne). Le service militaire adapté poursuit sa professionnalisation commencée en 1999. Aux 500 emplois de volontaires créés cette année, s’ajouteront 600 emplois nouveaux en 2000, représentant un coût de 43 millions de francs, répartis entre 65 % de stagiaires et 35 % de techniciens. En contrepartie, 1 000 postes d’appelés sont supprimés ainsi que 80 postes d’encadrement. Sur deux ans, le budget de l’outre-mer financera ainsi 1 100 emplois de volontaires. Quant aux crédits consacrés à la culture et à l’action sociale, ils augmentent de près de 30 %, passant de 145 millions de francs à 185,6 millions de francs. S’agissant de l’action culturelle proprement dite, l’objectif est de favoriser les échanges entre l’outre-mer et la métropole. C’est dans ce sens que le Fonds d’aide aux échanges artistiques et culturels pour l’outre-mer, financé à parité avec le ministère de la culture (à hauteur de 9 millions de francs pour chacun des départements ministériels), a été créé. Un système analogue pourrait être prochainement mis en place avec le ministère de la jeunesse et des sports, afin d’encourager les échanges de clubs sportifs. Le logement constitue le deuxième poste de dépenses du budget. 1,1 milliard de francs sont inscrits en autorisations de programme et 918 millions de francs en crédits de paiement. Ces crédits seront complétés par ceux de la créance de proratisation, qui est elle-même en progression de 5,7 %. Le total des moyens consacrés au logement social sera ainsi en hausse de 3,7 %. La ligne d’aide au logement dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, permettra de soutenir la réhabilitation de 2 400 logements et la construction de 11 000 logements neufs. La résorption de l’habitat insalubre sera financée à hauteur de 96 millions de francs sur le budget de l’outre-mer, permettant ainsi d’aider 2 000 familles. A ces mesures, il convient d’ajouter deux dispositions importantes qui figurent dans le projet de loi de finances : la baisse de la TVA sur les travaux d’entretien à partir du 15 septembre 1999 dans les départements d’outre-mer qui passe de 9,5 % à 2,1 %, au lieu de 5,5 % en métropole et la mise en place du mécanisme financier qui permettra d’appliquer le dispositif d’aide exceptionnelle aux ménages pour l’acquisition de terrains situés dans la zone des cinquante pas géométriques. La part des départements d’outre-mer dans la première enveloppe des contrats de plan Etat-régions s’élève à 4,527 milliards de francs sur un total de 95 milliards de francs. Les quatre régions d’outre-mer sont parmi les mieux pourvues du pays, comme le montre le volume de crédits alloués par habitant. La Guyane, avec un ratio de 5 607 francs par habitant, est la première région française, la Guadeloupe (2 687 francs par habitant) vient au troisième rang, la Martinique (2 545 francs par habitant) au quatrième et La Réunion occupe la sixième place avec 2 185 francs par habitant. La seconde répartition des crédits inscrits dans le cadre des contrats de plan Etat-régions est actuellement en cours de discussion. Pour les territoires d’outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, le contenu des contrats de développement n’a pas encore été arrêté ; ces contrats porteront sur la période 2000-2004 (sauf pour la Polynésie française dont le contrat de développement couvrira la période 2000-2003). Le budget de l’outre-mer traduit le respect des engagements pris par le Gouvernement vis-à-vis des partenaires calédoniens, formalisés dans la loi organique du 19 mars 1999, et la volonté politique du Gouvernement de donner à la Nouvelle-Calédonie les moyens de son développement. Les compétences nouvelles sont considérables et les transferts, en application de la loi organique, se réaliseront par étapes. Le budget a été élaboré afin que soient dégagés les moyens nécessaires aux transferts prévus à compter du 1er janvier 2000. A cette fin, un nouveau chapitre budgétaire a été créé, comprenant une dotation globale de fonctionnement et une dotation globale de compensation. La dotation globale de fonctionnement, destinée aux provinces, est dotée de 394 millions de francs. Elle donnera à celles-ci les moyens de leur action dans le domaine sanitaire et social (aide médicale gratuite, aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux enfants secourus) et dans le domaine de l’enseignement (enseignement primaire, fonctionnement des collèges). La dotation globale de compensation accompagnant le transfert des compétences de l’Etat à la Nouvelle-Calédonie est dotée en 2000 de 11,7 millions de francs qui permettront à la Nouvelle-Calédonie d’exercer ses compétences nouvelles en matière de commerce extérieur, de droit du travail, d’enseignement scolaire, de jeunesse et sports, de mines et d’énergie. Enfin, l’administration du secrétariat d’Etat à l’outre-mer se réforme. Le projet de budget pour 2000 doit permettre la poursuite de l’amélioration des carrières des agents et accompagner la restructuration des services de l’Etat en Nouvelle-Calédonie, qui se traduira par un important transfert de personnels (87 créations d’emplois de fonctionnaires et suppression de 66 emplois d’agents contractuels). M. Claude Hoarau, rapporteur pour avis des crédits de l’outre-mer, s’est déclaré satisfait de l’augmentation du budget de l’outre-mer. Il a toutefois regretté que ces efforts soient insuffisants vu la gravité de la situation que connaissent les départements d’outre-mer, notamment à cause du chômage. Actuellement, les efforts portent sur le traitement social du chômage alors que des mesures susceptibles de générer un développement économique important, seul susceptible de faire reculer ce fléau, n’ont pas été trouvées. M. Claude Hoarau s’est félicité que le budget de l’outre-mer traduise également le respect des engagements pris par le Gouvernement en Nouvelle-Calédonie et que les crédits du service militaire adapté viennent renforcer l’effort pour l’emploi et la formation professionnelle. Il n’y aura malheureusement pas plus de logements construits en 2000 qu’en 1999, les crédits correspondants n’augmentant que très faiblement (moins de 1 %). Or, il s’agit d’un poste essentiel pour des raisons démographiques, trop de logements sont surpeuplés, et parce que ce secteur est créateur d’emplois. On annonce, par exemple pour la Réunion, 4300 logements réalisés en 1999, alors qu’il en faudrait le double. Les difficultés qu’éprouvent les collectivités à aménager les terrains, l’insuffisance de la dotation du Fonds d’aménagement foncier urbain et le retard pris pour pérenniser la créance de privatisation sont autant de freins à la construction de logements. M. Claude Hoarau a insisté sur le fait qu’un logement construit, c’est 1,5 ouvrier au travail ; relancer la politique du logement serait donc un moyen efficace de réduire le niveau du chômage d’une population qui veut travailler. Il a également posé le problème des conditions d’attribution de l’allocation logement. Enfin, M. Claude Hoarau a fait part de son désappointement face aux retards pris pour l’élaboration du projet de loi d’orientation. Dans ce cadre, des rapports politiques et techniques ont été effectués. Parmi ceux-ci, le rapport Fragonard a suscité beaucoup d’espoir, en proposant d’encourager l’emploi dans les PME et en préconisant des mesures pour réduire le nombre de RMistes. Il semblerait très important que la loi d’orientation tienne compte de ces études. M. Philippe Chaulet a exprimé son accord avec l’analyse présentée par le rapporteur pour avis. Il a demandé que le contenu du rapport « Fragonard » soit rapidement rendu public, puis il a fait remarquer que Saint Martin connaissait une situation financière particulièrement difficile, notamment après le passage de l’ouragan « Luis » et du cyclone « Marylin ». M. Philippe Chaulet a également indiqué que les habitants de Saint Martin et de Saint Barthélémy étaient depuis juillet en attente des suites données au rapport Seners consacré à ce problème. Il a insisté sur l’importance du logement social, tout particulièrement pour les chômeurs. Les familles se heurtent, par ailleurs, à un problème précis : comptant beaucoup d’enfants, elles devraient habiter des logements plus grands, mais ne peuvent le faire, par manque de moyens et le nombre d’enfants les prive précisément, compte tenu de l’exiguïté de leurs habitations, du droit à l’allocation logement. M. Michel Tamaya a estimé positives les orientations contenues dans le budget des départements et territoires d’outre-mer pour 2000. Rappelant que les collectivités locales des départements d’outre-mer avaient été déclarées en 1998 éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) et que le Premier ministre avait récemment annoncé l’abondement de la DSU à hauteur de 500 millions de francs, il a souhaité savoir si les départements d’outre-mer pourraient continuer à bénéficier effectivement de cette dotation et de l’abondement annoncé par le Premier ministre. En réponse aux intervenants, le ministre a tout d’abord indiqué son accord avec les analyses qui ont été présentées sur la situation économique et sociale de l’outre-mer. Deux facteurs expliquent le paradoxe d’une activité globale en croissance et d’une progression concomitante du nombre de demandeurs d’emplois. D’une part, certains secteurs économiques apparaissent fragiles : par exemple, celui de la banane connaît une décroissance significative des prix rendus en Europe, en dépit du mécanisme de l’aide compensatrice. Le Premier ministre devrait d’ailleurs annoncer prochainement une série de mesures en faveur des petits planteurs. D’autre part, l’outre-mer se singularise par la vigueur de sa démographie puisque 35 % de la population y a aujourd’hui moins de 20 ans, contre 25 % en métropole. Dès lors, les mesures d’insertion trouvent rapidement leurs limites face à l’étendue des besoins. Le ministre a ensuite apporté les éléments d’information suivants : – s’agissant du projet de loi d’orientation relatif à l’outre-mer, le Gouvernement espère pouvoir transmettre un avant-projet aux assemblées délibérantes d’ici au 15 novembre, afin que des discussions approfondies puissent être entamées au premier semestre de l’année prochaine. Ce texte ne se bornera pas à présenter des réformes institutionnelles, mais doit également permettre la mise en place de politiques volontaristes en faveur du développement économique et social de l’outre-mer : aide au retour à l’emploi des bénéficiaires du RMI, soutien aux PME, aménagement de la fiscalité en faveur de l’investissement etc. ; – le dispositif sectoriel d’exonération de charges sociales introduit par la loi Perben, dont l’échéance est prévue en mars 2000, sera prolongé d’une année. Le Gouvernement dresse actuellement son bilan : s’il est vrai que les secteurs aidés ont connu entre 1995 et 1997 une croissance de l’emploi quatre fois supérieure à celle des secteurs non exonérés, il est probable que cette progression s’explique en partie par un effet de légalisation d’activités auparavant non déclarées. Par ailleurs, 30 % des entreprises des secteurs exonérés (couvrant 20 % des salariés) ne peuvent bénéficier de ces avantages car ceux-ci supposent au préalable la présentation d’un plan d’apurement des dettes. Le dispositif est appelé à être révisé dans le cadre de la future loi d’orientation. A cette occasion, les questions du maintien des exonérations sectorielles et du renforcement de l’aide spécifique aux entreprises exportatrices seront posées ; – les crédits de paiement en faveur du logement progressent de 3,7 %. En regard de besoins dont chacun reconnaît l’importance, il faut rappeler que d’autres mesures d’aide ont été présentées : baisse du taux des prêts aidés, allongement de leur durée à 50 ans, réduction de la TVA sur les travaux d’entretien et généralisation du cadre d’intervention du FRAFU. Des discussions interministérielles sont en cours sur l’harmonisation des barèmes des aides personnelles au logement, qui devraient permettre une extension du nombre de leurs bénéficiaires ; – la situation économique difficile de Saint-Barthélémy a fait l’objet du rapport Seners présenté en juillet 1999. Elle s’explique par l’action destructrice du cyclone mais également par le surinvestissement touristique qui y a été effectué dans le cadre de la loi Pons. Le ministre a conclu son intervention en présentant les dernières informations en sa possession sur l’impact du cyclone « José ». Il a indiqué que seuls des dégâts matériels sont actuellement à déplorer et que des moyens d’intervention de la protection civile sont en cours de déploiement pour aider à la restauration rapide d’une situation normale. Conformément aux conclusions de M. Claude Hoarau, rapporteur pour avis, la commission a ensuite donné un avis favorable à l’adoption des crédits de l’outre-mer pour 2000. _____________ N°1866-XVI. - Avis de M. Claude Hoarau, au nom de la commission de la production, sur le projet de loi de finances pour 2000. - Outre-mer. - Cliquer ici pour retourner au sommaire général - Cliquez ici pour retourner à la liste des rapports et avis budgétaires - Cliquez ici pour retourner à la liste des discussions budgétaires
() Voir également : OCM banane p 30 () Belize (40 000 tonnes), Cameroun (155 000), Cap Vert (4 800), Côte d’Ivoire (155 500), Dominique (71 000), Grenade (14 000), Jamaïque (105 000), Madagascar (5 900), Sainte-Lucie (127 000), Saint-Vincent et les Grenadines (82 000), Somalie (60 000), Surinam (38 000). () L’OCM sucre prévoit un prix garanti et une aide à l’écoulement de la production dans le cadre de quotas. En 1998, l’aide versée aux planteurs au titre de la garantie de prix a représenté 67,5 MF. () L’ODEADOM a engagé un programme de 7 millions de francs sur la période 1993-1998, 30 millions sont inscrits dans le contrat de plan État-région 1994-1998 et 74,5 millions sont prévus dans le cadre des programmes opérationnels intégrés DOCUP 1994-1999 et REGIS II 1995-1999. () - l’extrême diversité de la ressource ne permet pas d’exploiter de façon intensive une espèce déterminée. En outre, la dispersion des variétés impose des surfaces d’exploitation importantes ; - 60 % du volume en forêt sont constitués de bois en densité supérieure à 800 kg/m3. Les bois guyanais sont donc lourds et intransportables par voie fluviale ; - les arbres guyanais ont un diamètre peu important, d’où un rendement faible à l’hectare. () Les chiffres officiels font état de 2,44 tonnes d’or extraites mais la profession considère que la production réelle serait actuellement plus proche des 5 tonnes. En effet, les quantités exportées en 1998 (4,3 tonnes) sont supérieures à la production déclarée. () La ZEE française est délimitée par une ligne tracée à 200 milles nautiques autour des côtes des trois îles des TAAF (Crozet, Kerguelen et Amsterdam). Elle représente une superficie totale de 1,7 million de km2, soit plus de trois fois celle de l’hexagone. () Compte tenu du pillage des ressources de pêche, les autorités françaises n’ont pas souhaité reconduire l’accord de coopération franco-ukrainien qui a expiré le 31 décembre 1998. Toutefois, à titre transitoire, un quota de 500 tonnes de légine a été attribué à l’ukraine jusqu’au 31 juillet 1999, avec une redevance de 1,5 MF. () En 1995, elles s’établissaient à 30 000 F CFP contre une moyenne de 16 400 F CFP toutes nationalités confondues. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
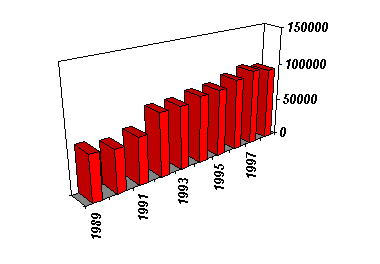
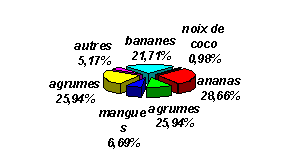
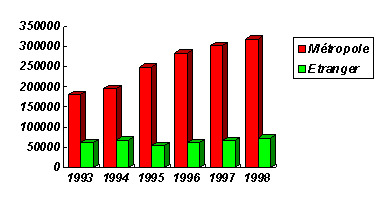
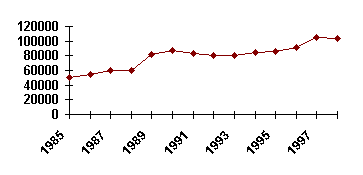
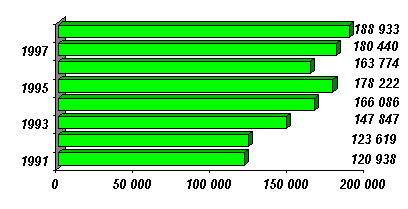
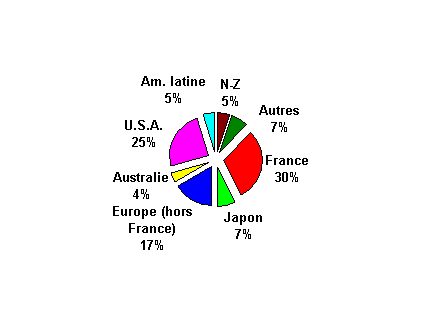 Pays de résidence des touristes ayant visité la Polynésie en 1998
Pays de résidence des touristes ayant visité la Polynésie en 1998