Document mis en distribution le 3 novembre 1999 N° 1861 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) SUR PAR M. DIDIER MIGAUD, Rapporteur Général, Député. —— ANNEXE N° 9 CULTURE Rapporteur spécial : M. Raymond DOUYÈRE Député ____ (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Lois de finances. La commission des finances, de l’économie générale et du plan est composée de : M. Augustin Bonrepaux, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Michel Bouvard, Jean-Pierre Brard, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM. Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Eric Besson, Alain Bocquet, Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Raymond Douyère, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Guy Lengagne, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Georges Tron, Philippe Vasseur, Jean Vila.
EXAMEN EN COMMISSION 135 OBSERVATIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION 139 ANNEXE 141 introduction Après la progression sensible de 3,7 % enregistrée l’an passé, le budget du ministère de la Culture atteindra 16,03 milliards de francs en 2000 au lieu de 15,71 milliards de francs inscrits dans la loi de finances initiale pour 1999. Il s’agit, de nouveau, d’une augmentation significative, puisque elle atteint, par rapport au budget voté de 1999, 320 millions de francs en valeur absolue, soit 2,1 % en valeur relative. Les crédits de la Culture avoisineront ainsi 0,98 % du budget de l’État (). Cet effort supplémentaire est d’autant plus remarquable que les dépenses de l’État sont stabilisées et qu’il s’accompagne de la création de 295 emplois, destinés à résorber l’emploi précaire dans les musées et les monuments nationaux (263 emplois) et à stabiliser des personnels associatifs dans les directions régionales des affaires culturelles (). Des emplois précaires vont disparaître dans les établissements concernés, ce qui se traduit par une réduction des crédits de vacation accordés à ces organismes. Des emplois publics vont être ainsi créés, d’où une augmentation conséquente des crédits de rémunérations. Parallèlement, un important mouvement de transformations d’emplois interviendra, puisqu’il concernera plus de 205 postes. Ces évolutions confirment les engagements pris en 1997, devant les Français, d’inverser la tendance observée au cours des exercices précédents et de rendre à la Culture son caractère de priorité gouvernementale. En effet, si l’on examine le budget de la Culture entre 1994 et 1997 à structure constante, c’est-à-dire abstraction faite des transferts de compétences effectués en 1996 (architecture, Cité des sciences et de l’industrie, audiovisuel) et en 1997 (dotation générale de décentralisation des bibliothèques), on observe une tendance continue à la baisse, les crédits passant de 13,506 milliards de francs en 1994 à 12,34 milliards de francs en 1997. Sans compter les efforts importants réalisés en faveur de l’audiovisuel et des aides à la presse, l’année 2000 marque, ainsi, la troisième étape dans la reconstitution d’un vrai budget et la reprise de la marche vers l’objectif symbolique du « 1 % », annoncé par le Premier ministre lors de son discours de politique générale de juin 1997. L’année 1999 a été la première année de mise en œuvre de la charte en faveur du spectacle vivant. Il s’agissait d’accorder des subventions à un nombre légèrement moindre de compagnies, mais de financer mieux la très grande majorité d’entre elles. Un deuxième grand chantier a été poursuivi, et la création de nombreux emplois pour 2000 le confirme, celui de la réduction de l’emploi précaire au ministère de la Culture et dans les établissements qui en dépendent. La démocratisation de la vie culturelle, leitmotiv de cette législature, a franchi une étape supplémentaire avec la mise en œuvre de mesures tarifaires destinées à élargir l’accès aux cinq théâtres nationaux, aux musées nationaux, aux monuments historiques et nationaux, mesures intégralement compensées par le budget de l’État pour les organismes concernés. Annoncé déjà l’an dernier, l’effort en faveur des enseignements artistiques se concrétise par plusieurs mesures importantes dans le projet de loi de finances pour 2000 : alignement du régime des bourses des étudiants des écoles d’art et d’architecture sur celui de l’Éducation nationale, mise en place d’une nouvelle carte des écoles d’architecture en Île-de-France, mise en place d’ateliers de pratiques artistiques dans les lycées... Parallèlement, une charte sur les enseignements spécialisés est en cours de préparation. En outre, la continuité du développement des grands équipements est assurée avec le lancement de la Cité de l’architecture et du patrimoine au Palais de Chaillot, du Centre de la jeune création au Palais de Tokyo, de la Maison du cinéma dans les locaux de l’ancien institut culturel américain, ainsi qu’en coopération avec l’Éducation nationale, de l’Institut national d’histoire de l’art. S’y ajoutent la réouverture du Centre national d’art et de culture Georges Pompidou et l’avancement du projet du musée des arts premiers du quai Branly. Le rattrapage de la programmation entreprise en 1998 et en 1999 dans le domaine du patrimoine sera consolidé en 2000. Le budget 1999 avait été également l’occasion du rattrapage d’un autre retard, qui s’était creusé entre 1993 et 1997, celui du paiement par l’État de ses obligations contractées à l’égard des collectivités territoriales en matière d’équipement. Le projet de budget pour 2000 achève de combler ce retard. Au-delà de la présentation générale des crédits demandés par le ministère de la Culture pour 2000, votre rapporteur spécial s’attachera à esquisser, comme l’an passé, un bilan de quelques grandes opérations culturelles : l’accent sera mis, cette année, sur le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou et sur la mise en place de l’Établissement public du musée du quai Branly. Enfin, en parallèle à la réforme de l’audiovisuel, un développement sera consacré à la politique de soutien à l’industrie cinématographique mise en œuvre, notamment, par le Centre national de la cinématographie. Avoir un budget de la Culture en progression est d’autant plus important que le contexte est marqué par la défense de la diversité culturelle, dans le cadre des prochaines négociations, au sein de l’organisation mondiale du commerce (OMC), qui se tiendront à Seattle, aux Etats-Unis, du 30 novembre au 3 décembre 1999. À ce propos, le Premier ministre, lors d’une réponse à une question orale de notre collègue Béatrice Marre, le 12 octobre 1999, a rappelé que « nous voulons que l’Union européenne se donne un mandat qui reconnaisse à nouveau la spécificité de ce secteur comme cela a été admis à Marrakech et nous veillerons à ce que l’Union européenne et la France puissent continuer à définir et à mettre en œuvre des politiques de culture et audiovisuelle librement ». Enfin, à l’heure où le Parlement examine un projet de loi portant réforme des ventes publiques, au moment où l’harmonisation européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur les objets d’art et de droit de suite est en passe franchir un nouveau pas, et alors que le projet de loi de finances pour 2000 propose quelques aménagements dans ce domaine, il est apparu nécessaire de dresser un bilan des mesures fiscales applicables au marché de l’art. Votre Rapporteur, dans la deuxième partie du présent rapport, s’est donc attaché à analyser les données actuelles de l’équilibre du marché de l’art, les perspectives de développement de ce marché, ainsi que l’incidence de chaque disposition fiscale sur cet équilibre et ces perspectives. PREMIÈre partie LES crÉdits de la culture POUR 2000 Après un bilan de la gestion des crédits en 1998 et 1999, un deuxième chapitre présentera les grandes lignes du budget de la Culture pour 2000, tandis qu’un troisième offrira des développements particuliers sur deux opérations culturelles d’envergure : la réouverture du Centre national d’art et de culture Georges Pompidou et la mise en place de l’Établissement public du musée du quai Branly (projet « arts premiers »). Il fera le point également sur la politique publique menée en faveur du cinéma. I.– UNE INVERSION DE TENDANCE EN 1998 L’exécution en 1997 avait été particulièrement défavorable. En effet, les crédits ouverts s’étaient élevés à 14.894,89 millions de francs pour une dotation en loi de finances initiale de 15.126,26 millions de francs, soit une réduction en exécution de 1,53 %. Le solde positif de 211,77 millions de francs résulte, notamment, d’importants reports (644,77 millions de francs) et crédits de fonds de concours (506,94 millions de francs). Après des années d’exécution défavorable, l’année 1998 a été marquée par de nouveaux changements de nomenclature et par une inversion de tendance significative du montant des crédits disponibles. Le budget 1998 a enregistré un changement de nomenclature notable avec la distinction entre services centraux et services déconcentrés. Ainsi, le libellé du chapitre 34-97 avait été modifié pour devenir « Moyens de fonctionnement des services centraux », tandis qu’était créé un chapitre 34-98 (nouveau) correspondant aux « Moyens de fonctionnement des services déconcentrés ». Parallèlement, le chapitre 43-50 – Développement culturel – a été scindé en deux chapitres, 43-20 – Interventions culturelles d’intérêt national, et 43-30 – Interventions culturelles déconcentrées. Les crédits ouverts ont atteint 15.357,34 millions de francs au lieu de 14.894,88 millions de francs en 1997, soit une progression significative de 3,1 %. La dotation en loi de finances initiale augmentait, sur la même période, de seulement 0,13 %. La comparaison de ces deux taux suffit à fonder le caractère relativement favorable de l’exercice 1998 pour le budget de la culture. Contrairement à 1997, le solde des mouvements intervenus en cours de gestion est positif, grâce notamment à l’absence de mesures de régulation budgétaire, dont les crédits de la Culture ont souvent fait l’objet. Ainsi, dans son rapport 1997, le contrôleur financier faisait observer que « comme en 1996, la mise en œuvre de la régulation budgétaire a été opérée dans un contexte d’arbitrages systématiques qui ne font que retarder la mise en place des crédits et de la possibilité de les utiliser dans les délais ». Cette augmentation des crédits ouverts explique, en partie, la diminution du taux global de consommation, qui s’établit à 92,9 % en 1998, au lieu de 95,34 % en 1997. De facto, les crédits disponibles en fin d’exercice ont augmenté, passant de 693,72 millions de francs en 1997 à 1.090,40 millions de francs en 1998. Les crédits du titre III ont progressé par rapport à la loi de finances initiale de 536,73 millions de francs. Le contrôleur financier relève que l’exécution du chapitre 31-01 relatif aux rémunérations principales « a atteint sa limite extrême », ne laissant subsister que 0,52 % de crédits disponibles. Il regrette également que « le ministère de la Culture (n’a) toujours pas la capacité d’assurer directement la gestion des quelques 700 agents qui sont toujours rémunérés par le ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement ». Par ailleurs, tout en reconnaissant que le ministère a réalisé des efforts importants pour recenser les effectifs, clarifier les situations juridiques et harmoniser les bases de recrutements, y compris dans les nombreux établissements publics placés sous sa tutelle, le contrôleur financier souligne que cette opération s’est faite « au prix toutefois d’un empilement de circulaires qui suscite des difficultés d’application, lorsque ces dernières ne sont pas elles-mêmes rapidement dépassées par l’actualité », allusion au protocole de fin de grève signé le 8 juin 1999. De la même façon, il souligne l’impossibilité de connaître en temps réel le nombre exact de vacataires ainsi que leur répartition entre travailleurs occasionnels, saisonniers, à temps complet ou incomplet, etc. La gestion des crédits du titre IV a fait l’objet, en 1998, d’un rapport de la Cour des comptes, qui s’est intéressée aux relations entre le ministère et les multiples organismes qui relayent son action sur le terrain. Deux critiques principales sont faites, aussi bien sur l’exercice 1998 que sur les exercices antérieurs : · les « services votés de fait » ont un poids excessif. En effet, les décisions de subventions sont rarement remises en cause d’un exercice à l’autre ; · le dispositif administratif et de suivi comptable est l’objet d’importantes faiblesses. La Cour relève ainsi que « l’attribution des subventions s’effectue (…) dans des conditions peu satisfaisantes. Le ministère, exploitant mal la masse d’informations administratives et financières reçues, ne suit guère l’activité de ses partenaires, et l’attribution des subventions ne s’opère pas selon un processus transparent reposant sur des informations vérifiées et des procédures d’évaluation sérieuses. L’autorité de l’administration en est amoindrie, et la clarification des relations voulue par le ministre rendue plus difficile. » C’est pourquoi il est préconisé de mettre en place, notamment au sein de la nouvelle direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles (DMDTS), une cellule de contrôle de gestion. Avec raison, le contrôleur financier juge anormal « qu’il revienne, une nouvelle fois, au seul contrôle financier de disséquer les statuts, les bilans et les comptes de résultat ou encore d’alerter le cabinet du ministre sur l’addition, par un même dirigeant, de rémunérations largement excessives à partir de deux structures subventionnées ()». Dans le même ordre de critique, la Cour des comptes relève, dans le rapport précité, que la « DMDTS ne tient, ni au niveau central ni de manière globale, un état des rémunérations versées aux principaux salariés des compagnies. Les fiches de renseignement adressées annuellement aux compagnies gérées en centrale contiennent certes des demandes d’information sur les salaires, mais celles-ci ne sont que très partiellement renseignées et ne font pas l’objet d’une synthèse. » C’est pourquoi le contrôleur financier recommande de mettre en place une structure collégiale chargée de donner sur avis pour tout dossier de subvention qui engage l’État sur plusieurs années. Le graphique ci-après retrace l’évolution des crédits ouverts en gestion entre 1990 et 1998 pour les dépenses ordinaires : ÉVOLUTION DES DOTATIONS EN DÉPENSES ORDINAIRES
Source : Rapport du contrôleur financier. Le taux global de consommation des crédits de paiement ouverts (2.607,24 millions de francs) au titre V a connu, en 1998, une baisse sensible par rapport à l’exercice précédent. En effet, il a atteint 70,78 % au lieu de 80,05 % l’année précédente. Les raisons de cette évolution sont à rechercher, notamment, dans le blocage, sur l’exercice 1998, de 100 millions de francs destinés au règlement des deux tiers du prix d’acquisition de l’immeuble dit « American Center », destiné à abriter la future Maison du cinéma, dont le coût global d’acquisition est évalué à 154,13 millions de francs. Les moyens supplémentaires ont été réservés sur les crédits adoptés dans la loi de finances initiale pour 1999. In fine, les reports sur la gestion suivante passent de 466,28 millions de francs à 761,78 millions de francs. Le contrôleur financier signale, une nouvelle fois, les difficultés que pose le chantier du Palais de Tokyo, pour lequel l’essentiel des 82 millions de francs mis en place à ce jour, auprès de trois maîtrises d’ouvrage successives (), « n’auront débouché sur aucune réalisation immédiatement utilisable ». Les crédits ouverts, en 1998, sur le titre VI ont atteint 2.035,70 millions de francs, soit un solde positif de 134,93 millions de francs. Comme pour les crédits du titre V, le taux global de consommation a également diminué, sur l’exercice, passant de 93,54 % en 1997 à 88,61 % en 1998. Le graphique ci-après retrace l’évolution des crédits de paiement pour dépenses en capital disponibles entre 1990 et 1998.
Source : Rapport du contrôleur financier. Conformément aux engagements pris par le Premier ministre, lors de son discours de politique générale, la progression des crédits de la Culture, amorcée en 1998, s’est poursuivie en 1999. Les reports dont a bénéficié le titre V provenaient en grande partie du transfert intervenu dans la loi de finances initiale entre le chapitre 66-91 et le chapitre 56-91 d’une part, et entre le chapitre 66-20 et le chapitre 56-20 d’autre part. Hors crédits d’origine parlementaire, 524 millions de francs de mesures nouvelles ont ainsi été dégagés en 1999, tous titres confondus. S’agissant du fonctionnement du ministère, priorité a été donnée aux moyens des directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et des services départementaux de l’architecture et du patrimoine (SDAP). À structure constante, c’est-à-dire hors dotation globale de décentralisation, concernant les bibliothèques, et hors crédits d’acquisitions, l’augmentation nette () des moyens d’intervention s’élèvera à 139,8 millions de francs. Les crédits de paiement pour dépenses en capital croissent de 3,13 % sur le titre V et de 3,96 % sur le titre VI. Les changements de nomenclature ont conduit à isoler les crédits de rémunérations des personnels des écoles d’architecture, tandis que ceux des autres personnels relevant de l’ancienne direction de l’architecture ont été fusionnés avec les crédits de rémunération de l’administration centrale et des services déconcentrés. Les crédits relatifs à l’Institut national d’histoire de l’art ont été transférés sur un article nouveau du chapitre 36-60 réservé au nouvel Établissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels (EPMOTC). Les bourses d’études d’enseignement supérieur ont été isolées (chapitre 43-20, article 90). Un article réservé au Musée des civilisations et arts premiers a été créé sur le titre VI (chapitre 66-91, article 62). Au 15 septembre 1999, les crédits disponibles s’élevaient à 15.929,66 millions de francs, à comparer avec les 15.710,11 millions de francs adoptés dans la loi de finances initiale. 242,24 millions de francs avaient été apportés par fonds de concours et 1.052,34 millions de francs par reports de crédits. Le taux de consommation (paiement total/crédits ouverts) s’établissait, à la même date, à 60,29 %. II.– UN BUDGET POUR 2000 PRIORITAIRE Le projet de budget du ministère de la Culture atteindra, en 2000, un montant de 16.039,21 millions de francs, soit une augmentation de 329,1 millions de francs par rapport à la loi de finances initiale pour 1999, ce qui traduit les prolongements des efforts entrepris depuis 1997. En effet, alors que le budget de l’État progresse de 0,9 %, les moyens du ministère de la Culture exprimés en dépenses ordinaires et crédits de paiement croissent de 2,1 %. Cette augmentation est moins sensible si l’on tient compte des crédits réellement disponibles en 1999, qui s’élevaient au 31 août à 15.915,24 millions de francs. En effet, sur cette base, la progression n’atteint que 0,78 %. Les transferts entre sections sont limités à 0,7 million de francs (transfert de 3 emplois sur les crédits des services généraux du Premier ministre et transfert de crédits relatifs à l’impression et à la diffusion des documents budgétaires en direction de la section Économie, finances et industrie). L’inversion de tendance, inaugurée en 1998, se poursuit donc cette année, de manière significative, même s’il demeure établi que les crédits de la Culture représentent une part relativement faible du budget général de l’État. À structure constante du budget de l’État, le budget de la Culture représentera 0,98 % des charges nettes de l’État en 2000, au lieu de 0,95 % en 1998. Les crédits de la Culture se rapprochent donc du seuil symbolique de 1 %, que le Premier ministre s’est engagé à atteindre d’ici la fin de la législature. Votre Rapporteur saluera d’autant plus l’effort accompli pour 2000 qu’il succède à un effort substantiel réalisé les deux années précédentes, après une baisse de 20 %, à périmètre constant, des crédits du ministère de la Culture entre 1993 et 1997. A.– DES MOYENS MIS AU SERVICE D’OBJECTIFS CULTURELS L’année 2000 marquera une troisième étape dans la reconquête des moyens indispensables à la mise en œuvre d’une politique culturelle ouverte aux aspirations et aux besoins des Français. Les 329 millions de francs de crédits supplémentaires, auxquels s’ajoutent les crédits dégagés grâce aux redéploiements, seront mis au service de trois objectifs principaux. 1.– La démocratisation culturelle Conformément aux réformes annoncées le 26 février 1998, la priorité est accordée à la démocratisation des pratiques culturelles. Les mesures sur les pratiques amateurs et relatives à la mise en œuvre de la charte des missions de service public pour les spectacles vivants ont été engagées en 1999. L’exercice 2000 sera l’occasion de développer les mesures relatives à l’éducation et à la formation artistiques, mais aussi à la tarification des grands établissements. Une charte sur les enseignements spécialisés est en cours de préparation, tandis que le caractère sélectif des concours de l’État aux écoles nationales et municipales d’art sera renforcé. Par ailleurs, une série de décisions ayant une incidence financière importante font l’objet d’ouvertures de crédits dans le présent projet de budget : alignement du régime des bourses des étudiants des écoles d’art et d’architecture sur celui de l’Éducation nationale, mise en place d’une nouvelle carte des écoles d’architecture en Île-de-France, création d’ateliers de pratiques artistiques dans les lycées. Ainsi, le budget consacré aux enseignements artistiques, à structure constante, augmente de 1999 à 2000 de 97 millions de francs (104,5 millions de francs sans neutralisation des transferts). Par ailleurs, une politique tarifaire offensive permettra d’élargir l’accès à d’importants lieux de culture. Un tarif unique à 50 francs sera pratiqué le jeudi dans les cinq théâtres nationaux (Comédie française, Théâtre national de Chaillot, Théâtre national de l’Odéon, Théâtre national de la Colline, Théâtre national de Strasbourg) (). La gratuité de l’entrée sera assurée, comme cela existe déjà pour le musée du Louvre, le premier dimanche de chaque mois dans les trente-trois musées nationaux (Musée et domaine du château de Versailles, Musée Rodin, Galeries nationales du Grand Palais, Musée Adrien Dubouché de Limoges, Musée Fernand Léger de Biot, etc.) (). Par ailleurs, la limite d’âge permettant d’entrer gratuitement dans un monument historique est relevée de 12 à 18 ans, tandis que la gratuité est instituée pour tous les monuments nationaux (abbaye du Mont-Saint-Michel, château d’Angers, monastère de Brou, site archéologique de Glanum, etc.) un dimanche par mois, hors saison touristique (). 2.– La consolidation des moyens L’année 1999 a vu fonctionner un ministère réorganisé : la direction de l’architecture et celle du patrimoine ont fusionné dans une direction de l’architecture et du patrimoine, tandis que la direction de la musique et de la danse et la direction du théâtre et des spectacles ont été intégrées dans une direction unique de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles. ORGANIGRAMME DU MINISTÈRE DE LA CULTURE
Pour 2000, au niveau déconcentré, la part des crédits gérés directement par les directions régionales de l’action culturelle (DRAC) () sera encore accrue. Ainsi, les interventions déconcentrées du titre IV progresseront de 5,7 % à 2.492,47 millions de francs sur la base d’une loi de finances pour 1999, hors « réserve parlementaire », tandis que, dans le même temps, les interventions des administrations centrales n’évolueront que de 2,9 % à 1.237,45 milliards de francs. 266,2 millions de francs ont été redéployés vers des actions déconcentrées, à partir du chapitre des interventions centrales. Par ailleurs, et pour la première fois depuis des années, le ministère de la Culture bénéficie de la création d’un nombre important d’emplois et de la réduction de la situation de précarité dans laquelle se trouvaient nombre de ses agents. En effet, les 295 emplois créés seront destinés, notamment, à résorber l’emploi précaire dans les musées et les monuments nationaux. Des emplois précaires vont disparaître dans les établissements concernés, ce qui se traduit par une réduction des crédits de vacation accordés à ces organismes. En contrepartie et grâce à une augmentation conséquente des crédits de rémunérations, des emplois publics vont être créés. Parallèlement, un important mouvement de transformations d’emplois interviendra, puisqu’il concernera plus de 205 postes.
3.– Le développement des partenariats De manière traditionnelle, le ministère de la Culture agit en concertation et en collaboration avec de très nombreux acteurs, qu’ils soient institutionnels ou non. Il suffit de relever l’importance du nombre d’organismes subventionnés par le ministère ou encore le nombre d’établissements publics relais de son action pour corroborer ce constat. Le développement de la mise en œuvre de la charte du spectacle vivant et le lancement de la charte sur les enseignements spécialisés témoignent de la volonté gouvernementale de nouer des liens plus responsables et plus efficaces dans la diffusion culturelle avec les partenaires associatifs. Le bilan d’application de la charte du spectacle en termes de compagnies aidées montre que le reflux de l’aide publique, redouté par de nombreuses compagnies, n’a pas eu lieu. Au contraire, les compagnies ont reçu individuellement et globalement plus d’aide, sans que le nombre des structures aidées ait beaucoup baissé, ainsi que le montre le tableau infra.
Le ministère de la Culture a obtenu au titre des contrats de plan État-régions, sur la première enveloppe de 90 milliards de francs, une dotation de 2 milliards de francs, ce qui va permettre de développer les actions d’aménagement des espaces et de restauration des monuments historiques. Ces crédits seront répartis entre les chapitres 43-30 – Interventions culturelles déconcentrées, 56-20 – Patrimoine monumental et 66-20 – Patrimoine monumental. Il convient de relever qu’en 1997 les opérations d’équipements à Paris et en Île-de-France représentaient 74 % des dépenses d’équipement du ministère, alors que, pour 2000, cette proportion tombe à 51 %. Le rééquilibrage annoncé entre Paris et la province est bien en marche. Ce partenariat avec les régions s’accompagne d’une déconcentration importante des crédits, démarche inhérente à la démocratisation culturelle engagée. Ainsi, depuis trois ans, la part des crédits déconcentrés dans le total des crédits du ministère sera passée de 30% à 43 %, alors même que ces derniers ont connu une croissance significative. La volonté du ministère de clarifier ses relations avec les collectivités locales et de respecter ses engagements s’était traduite, l’an passé, par un apurement largement engagé des dettes de l’État à l’égard de celles-ci. À cette fin, entre 1998 et 1999, 350 millions de francs de crédits de paiement auront été dégagés par redéploiement interne au budget de la Culture ou par ouvertures en loi de finances. B.– LES MOYENS DES SERVICES 1.– Les crédits de personnel Les dotations des chapitres finançant les rémunérations et les charges sociales augmentent de 65,2 millions de francs (+ 2,05 %), passant de 3.178,5 millions de francs en loi de finances initiale pour 1999 à 3.243,7 millions de francs dans le cadre du présent projet loi de finances. Le ministère de la Culture bénéficie d’une création brute de 100 emplois, pour une création nette d’emplois de 97 postes (32 emplois contractuels dans les directions régionales des affaires culturelles, 57 emplois d’agents administratifs), au lieu de 2, l’an passé. 3 emplois sont transférés sur les crédits des services généraux du Premier ministre. Par ailleurs, 195 emplois de personnels non titulaires (notamment les professeurs des écoles d’art) rémunérés auparavant sur les crédits du ministère seront transférés sur le budget de certains établissements publics d’enseignement, ce qui explique l’augmentation forte des subventions en sixième partie du titre III accordées à ces derniers (). En conséquence, les crédits dégagés par ce transfert, la réduction des crédits de vacations et de subventions aux établissements publics et les 100 créations brutes évoquées supra vont permettre de financer la stabilisation totale de 295 emplois sur crédits budgétaires. Ainsi de nombreux postes de « vacataires permanents » dans les musées seront transformés en emplois publics. En outre, 79 assises budgétaires dans les établissements publics seront destinées à accompagner leur développement. Elles permettront de transformer des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ou encore à stabiliser des vacataires permanents.
À l’intérieur même des emplois publics, de nombreuses mesures de transformation d’emplois et de pyramidage interviennent également. Le total des mesures catégorielles atteint 10,4 millions de francs, dont 1,35 million de francs au titre de l’accord salarial de 1998. Les effectifs propres du musée du Louvre, du musée du domaine national de Versailles, seront augmentés, de même que ceux du Centre national d’art et de culture Georges Pompidou qui doit rouvrir ses portes. Les 1.913 emplois d’État de la Bibliothèque nationale de France seront préservés, et ses emplois propres seront renforcés, passant de 506 à 514 personnes. Les tableaux suivants présentent la répartition des emplois de l’État entre l’administration centrale, les services extérieurs, les établissements publics administratifs, et les établissements publics à caractère industriel et commercial. Sont également présentés les emplois propres des établissements publics administratifs.
2.– Les moyens de fonctionnement Les crédits consacrés aux dépenses de fonctionnement courant, qui regroupent les moyens de l’administration centrale, des DRAC, des directions départementales de l’architecture et du patrimoine, des centres départementaux d’archives et des musées n’ayant pas le statut d’établissement public augmentent d’environ 30 millions de francs à 587,44 millions de francs, soit une hausse de 5,34 %. Les crédits ouverts au titre des frais de justice et de réparations civiles et des dépenses de formation continue resteront strictement les mêmes. Les crédits de travaux d’entretien immobilier connaissent une progression limitée à 3,8 %. C.– LES SUBVENTIONS AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Les subventions de fonctionnement versées aux établissements publics sous tutelle du ministère de la Culture augmentent de 139,37 millions de francs (+ 4 % par rapport à la loi de finances initiale pour 1999). L’effort de rationalisation de la maîtrise d’ouvrage culturelle, qui est passé notamment par la création d’un établissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels (EPTMOC), se poursuit en 2000, comme en 1999, par la majoration des crédits de personnel de cet établissement : 0,75 million de francs pour la création de trois emplois non budgétaires. Par ailleurs, 3,57 millions de francs sont transférés sur les crédits de fonctionnement de l’établissement (article 28 du chapitre 36-60) correspondant aux crédits de fonctionnement des affectataires du Grand Palais et aux crédits destinés aux travaux de climatisation des Galeries nationales du Grand Palais. Bénéficient également de mesures nouvelles significatives les théâtres nationaux, afin de compenser les mesures de baisse des tarifs, mais également le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou (3 millions de francs sur l’article 91 du chapitre 36-60) et plusieurs établissements d’enseignement qui voient augmenter leur subvention de fonctionnement pour financer la création d’emplois non budgétaires ou bien la prise en charge, sur leur propre budget, d’emplois d’enseignants contractuels. Il convient de relever, enfin, que le changement de nomenclature permet désormais de distinguer par un article 48 (nouveau) du chapitre 36-60 les subventions de fonctionnement destinées à financer les caisses de retraite des personnels de l’Opéra national de Paris (70,36 millions de francs) et de la Comédie française (12,21 millions de francs). Le fonctionnement des grands établissements demeure une source de dépenses importantes pour le ministère de la Culture comme le montre le tableau infra.
D.– LES CRÉDITS D’INTERVENTION En 2000, les crédits d’intervention, passant de 4.808,24 millions de francs à 4.932,66 millions de francs, progressent de 2,59 % par rapport à la loi de finances initiale pour 1999, après une croissance de 3,58 % l’an passé. À structure constante 1999 (), les crédits d’intervention en 2000 atteignent 4.943,3 millions de francs, soit une progression de 2,82 %. Les interventions en faveur du spectacle vivant et du cinéma bénéficient d’une progression très substantielle des crédits destinés à les financer : 72 millions de francs supplémentaires pour 2000, après 103,5 millions de francs de mesures nouvelles en 1999. Pour les structures permanentes intervenant dans le domaine du spectacle vivant, l’entrée en application effective de la charte de service public a privilégié – on l’a vu supra – celles qui assument pleinement le soutien à la création et leurs responsabilités en matière de renouvellement des publics ou d’ouverture aux pratiques amateurs. Les crédits pour 2000 permettront de poursuivre cette politique. La dotation générale de décentralisation des bibliothèques bénéficie de 7,27 millions de francs d’actualisation à 948,91 millions de francs, soit une progression de 0,82 %. Les augmentations sont également significatives en ce qui concerne les enseignements artistiques : 14,5 millions de francs viennent assurer l’alignement du niveau des bourses des étudiants des écoles d’art et d’architecture sur celui des bourses distribuées par l’Éducation nationale (plan social étudiant). Le renforcement sélectif des concours de l’État aux écoles d’arts plastiques et aux écoles d’art entraîne l’ouverture de 8 millions de francs, tandis que l’éducation artistique dans les lycées et collèges bénéficiera de 17,3 millions de francs de mesures nouvelles. Les crédits d’acquisition baissent légèrement de 1,34 % à 253,82 millions de francs, tandis que les musées bénéficient de mesures nouvelles au titre de la politique de gratuité. La diffusion et la formation dans le domaine de l’architecture et du patrimoine enregistrent une progression de 21 millions de francs. Le tableau ci-après retrace l’évolution des dotations d’intervention des principales directions du ministère.
E.– LES DÉPENSES EN CAPITAL Avec l’achèvement du Grand Louvre, 2000 marquera la fin des ouvertures de crédits pour les Grands Travaux. Entre 1991 et 1999, 7,96 milliards de francs d’autorisations de programme et de crédits de paiement auront été accordés à la Bibliothèque nationale de France. Pour la Villette, entre 1980 et 1998, le chiffre atteint 6,6 milliards de francs. S’agissant du Grand Louvre, la première tranche a été soldée à 2,16 milliards de francs, tandis que la seconde tranche a coûté (entre 1987 et 1999) 3,6 milliards de francs. Les opérations annexes (travaux mobiliers et immobiliers de l’Union centrale des arts décoratifs, ateliers de restauration du pavillon de Flore, musée de l’Orangerie, antenne des Arts premiers) seront soldées en 2000 pour un total de 0,9 milliard de francs. Dans le projet de loi de finances pour 2000, les autorisations de programme, à 3.702,5 millions de francs sont en augmentation de 164,25 millions de francs par rapport à la loi de finances pour 1999, après une diminution de 4,9 %, l’an passé. En revanche, les crédits de paiement pour dépenses en capital baissent très légèrement de 2,84 millions de francs (– 0,08), après une augmentation, l’an dernier, de 3,6 %. Ces mouvements ne rendent pas compte de mouvements internes importants. Ainsi, s’agissant des crédits gérés par la direction de l’architecture et du patrimoine (DAPA), les autorisations de programme restent strictement au même niveau à 1.566,5 millions de francs, mais la structure interne de l’enveloppe connaît des changements de taille : le poids de deux grandes opérations – Palais de Chaillot et Grand Palais – diminue fortement. Les crédits nécessaires à la restauration de la partie sud et de la nef du Grand Palais ayant été ouverts dès les lois de finances pour 1998 et 1999, seul un montant limité de nouveaux crédits est prévu pour 2000 au titre du Grand Palais (30 millions de francs). En dépit d’un effort accru en faveur du château et du domaine de Versailles (90 millions de francs en autorisations de programme au lieu de 69 millions de francs en 1999 sur l’ensemble des chapitres d’investissement du budget de la Culture), destiné à traiter en priorité les réseaux et la sécurité, le montant global des crédits d’investissement relatifs aux grandes opérations est ainsi en forte réduction (229 millions de francs en autorisations de programme en 2000 au lieu 288,5 millions de francs en 1999). La réduction des dotations destinées aux grandes opérations, imputées sur les crédits du patrimoine, va permettre d’accroître très significativement le montant de l’enveloppe budgétaire consacrée aux subventions à la restauration des monuments historiques (propriété des collectivités territoriales notamment) n’appartenant pas à l’État. Cette augmentation va atteindre 24,9 % par rapport à la loi de finances pour 1999, soit 59,6 millions de francs supplémentaires, pour un total de 894,5 millions de francs qui se répartissent comme suit : · 660,5 millions de francs sur l’article 50 – Travaux sur les monuments historiques de l’État du chapitre 56-60 – Patrimoine monumental – · 234 millions de francs sur l’article 60 – Opérations déconcentrées de restauration du patrimoine du chapitre 66-20 – Patrimoine monumental – Subventions d’investissement. La qualité architecturale, les études, les abords, les secteurs sauvegardés et les espaces protégés bénéficient de 11 millions de francs d’augmentation et passent à 81 millions de francs, soit une progression de 15,7 % par rapport à la loi de finances initiale pour 1999 (35 % sur le chapitre 56-20, article 20, et 8 % sur le chapitre 66-20, article 30).
III.– BEAUBOURG, LES ARTS PREMIERS, LE CINÉMA
A.– LE CENTRE NATIONAL D’ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU 1.– Les missions et l’organisation du Centre et de ses composantes Le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou (CNAC-GP) est un établissement public national à caractère culturel doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il a été créé par la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 et placé par celle-ci sous la tutelle du ministre chargé des affaires culturelles. Son statut a été fixé par le décret n° 76-83 du 27 janvier 1976, modifié par le décret n° 88-542 en date du 4 mai 1988 et par le décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992. Il a pour mission de contribuer à l’enrichissement du patrimoine culturel de la nation, de favoriser et diffuser la création artistique, d’informer et de former le public. Il assure le fonctionnement et l’animation, en liaison avec les organismes publics et privés qui lui sont associés, d’un ensemble culturel consacré à toutes les formes de la création artistique – notamment dans le domaine des arts plastiques, de l’esthétique industrielle, de l’architecture, de l’art cinématographique, de la recherche acoustique et musicale — ainsi qu’à la lecture publique. Les activités du Centre sont axées sur la présentation des collections permanentes du Musée national d’art moderne-Centre de création industrielle (MNAM-CCI), les expositions, la lecture publique, le spectacle vivant (théâtre, danse, musique), le cinéma, les colloques et débats, les éditions, et un centre de documentation spécialisé. Le Centre Georges Pompidou comprend deux départements – le MNAM-CCI et le département du développement culturel –, deux organismes associés et des directions et services culturels et administratifs. Les domaines de compétence du Musée national d’art moderne-Centre de création industrielle recouvrent la peinture et la sculpture historiques et contemporaines, le dessin, la photographie, le design et la communication visuelle, l’architecture, le cinéma expérimental, la vidéo et les nouvelles technologies. Il est chargé de la garde des collections d’œuvres d’art de 1905 à nos jours appartenant à l’État ainsi que des nouvelles collections de design et d’architecture. Il a pour mission de développer les collections, de concevoir des manifestations, de valoriser la dimension historique de la création dans ses diverses disciplines, d’assurer une prospection sur leurs aspects les plus novateurs et de mettre à la disposition du public une documentation spécialisée. Le département du développement culturel regroupe et développe les activités du Centre dans les domaines du spectacle vivant, du cinéma et des revues parlées, pour offrir à tous les publics un meilleur accès à l’art et à la culture modernes et contemporains. Par ailleurs, des directions et services sont chargés de l’action éducative, des relations avec les publics, de la mise à disposition des départements et organismes associés d’un ensemble de moyens tels que l’informatique, les prestations audiovisuelles, la communication ; ils assurent également la gestion administrative et financière, la gestion des personnels, la sécurité du public et des œuvres, l’entretien du bâtiment. Les deux organismes associés sont la Bibliothèque publique d’information (BPI) et l’Institut de recherche et coordination acoustique-musique (IRCAM). La première est un établissement public autonome créé par un décret du 26 janvier 1976, et dont la mission est d’offrir à tous, sans aucune formalité et dans toute la mesure du possible en libre accès, un choix constamment tenu à jour de collections encyclopédiques françaises et étrangères sur tous supports. Sa dissociation du Centre résulte du fait que les bibliothèques étaient historiquement rattachées au ministère chargé de l’éducation. L’accès à la Bibliothèque est gratuit. L’IRCAM est une association à but non lucratif, régie par la loi de 1901, et dont la mission est d’assurer le fonctionnement d’un ensemble culturel consacré à toutes les formes de la création dans le domaine de la recherche acoustique et musicale, d’inventorier les possibilités nouvelles qu’offrent aux compositeurs et interprètes les techniques scientifiques modernes et de diffuser auprès du public les résultats des recherches qu’il poursuit. Le Centre Georges Pompidou est administré par un président nommé pour trois ans par décret en Conseil des ministres et par un conseil de direction de neuf membres : le président, le directeur général, les directeurs des départements et organismes associés, le commissaire du gouvernement représentant le ministre de la Culture, le contrôleur financier et l’agent comptable. Un conseil d’orientation de vingt-cinq membres, dont notamment trois représentants de l’Assemblée Nationale, trois représentants du Sénat, cinq représentants du ministère de la Culture, un représentant de la Ville de Paris, trois représentants du personnel du Centre, donne son avis sur les orientations culturelles ainsi que sur le projet de budget de l’établissement public. 2.– Le calendrier des travaux et les conditions de la réouverture du Centre · La création du Centre Georges Pompidou En 1970, sur la base du programme répondant aux objectifs du président Georges Pompidou, le concours international d’architecture est lancé. Le jury, placé sous la présidence de Jean Prouvé, constructeur de réputation internationale, choisit pour lauréats Renzo Piano, Richard Rogers et Gianfranco Franchini. La délégation pour la réalisation du Centre Beaubourg est créée fin 1971, puis prend le titre, par décret du ministère des Affaires culturelles, d’Établissement public constructeur du Centre Beaubourg. Les travaux débutent en avril 1972, la construction de la charpente métallique en septembre 1974. Parallèlement, les institutions futures du Centre se définissent. Dès juillet 1972, le Centre de création industrielle est intégré au Centre Beaubourg. En 1974, le transfert des collections du Musée national d’art moderne, situé avenue du Président Wilson, est organisé. Après presque cinq années de travaux, le 31 janvier 1977, le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou est inauguré. De 1977 à 1995, le Centre Georges Pompidou a reçu environ 145 millions de visiteurs. · La nécessité de réaliser des travaux et leur mise en œuvre L’ouverture du Centre s’était faite dans l’urgence et le manque de moyens. La dégradation des bâtiments était patente. Plus de 20.000 visiteurs quotidiens ont arpenté ses espaces. Les nouvelles normes de sécurité n’étaient pas respectées. Certaines fonctions du Centre, en plein développement, ne disposaient plus de locaux adaptés, à l’exemple de la présentation de collections en croissance très forte, l’accueil d’un nombre sans cesse en augmentation d’usagers de la lecture publique ou encore l’activité d’expositions. Initialement prévus pour cinq ans, les travaux de réaménagement ont été ramenés à trois ans (de janvier 1997 à décembre 1999). Les surfaces d’exposition du cinquième étage ont été étendues avec deux espaces distincts, afin de favoriser une présence plus forte de l’art contemporain. Les collections du musée seront installées sur la totalité de deux niveaux, au lieu d’un seul auparavant. Les espaces de la bibliothèque ont été rénovés et le nombre de places passera grosso modo de 1.800 à 2.000. Au niveau moins un, ont été créées de nouvelles salles consacrées au spectacle vivant, au cinéma et à l’audiovisuel. Le bâtiment a été mis aux normes de sécurité. Des accès pour les personnes handicapées ont été organisés. Des espaces ont été gagnés par le déménagement de services administratifs en dehors du Centre lui-même. La réouverture interviendra le 1er janvier 2000. Les conditions d’accès seront modifiées. Les horaires changeront, en particulier pour le musée. Les billets d’entrée du musée seront moins chers. Mais, il ne sera plus possible de pénétrer dans le bâtiment sans payer et pratiquer une activité culturelle. 3.– Les moyens financiers et leur imputation budgétaire Le programme de travaux avait été chiffré à 440 millions de francs en valeur 1994. Il a été actualisé à 482 millions de francs en valeur 1999. Des crédits d’équipement courant pour un montant global de 54 millions de francs ont été intégrés dans le budget. La négociation de partenariats et de mécénats ont permis au Centre d’obtenir 40 millions de francs de recettes propres supplémentaires, qui ont été intégrées dans le budget de l’opération. En conséquence le budget global de l’opération s’est monté à 576 millions de francs en valeur 1999. Le mécénat se traduira par des mentions, négociées pour des périodes limitées. S’agissant du fonctionnement, la situation du Centre est, de façon chronique, relativement délicate. Aujourd’hui, grosso modo, la subvention de fonctionnement ne couvre que la masse salariale et l’exploitation des installations. Tout ce que l’établissement consacre à l’activité culturelle est équilibré par les recettes propres, ce qui ne constitue pas une base suffisante pour le développement de celle-ci. Ainsi, les 370 millions de francs de subvention inscrits au chapitre 36-60 – Subventions aux établissements publics, article 91, du budget de la Culture, ont permis d’assurer les charges de personnel (environ 260 millions de francs) et l’entretien (100 millions de francs), tandis que la masse des recettes propres, pouvant être estimée à environ 80 millions de francs, couvrait le budget des productions culturelles. Le budget 2000 devrait, en partie, améliorer la situation : la subvention de fonctionnement augmente de 24,4 millions de francs, pour atteindre 396,4 millions de francs. Cette hausse permettra de compenser la progression d’une masse salariale, marquée par une pyramide des âges qui est le résultat de recrutements massifs opérés à l’ouverture du Centre, c’est-à-dire à la fin des années soixante-dix. Par ailleurs, des économies de gestion ont été réalisées, par le biais, notamment, de la renégociation des concessions commerciales, et de la stabilisation des loyers des immeubles abritant les services administratifs (environ 25 millions de francs). Des tensions pourraient cependant apparaître, et votre rapporteur spécial souhaite qu’un besoin de crédits supplémentaires en cours d’année ne se traduise pas, comme cela s’est produit dans le passé, par des redéploiements en gestion, qui seraient réalisés au détriment d’autres actions. De ce point de vue, la sincérité de la présentation budgétaire mériterait plus d’attention. En outre, 43 millions de francs d’autorisations de programme et 121,4 millions de francs de crédits de paiement, inscrits sur le chapitre 66-91 – Autres équipements, article 80, viendront soutenir les dépenses traditionnellement liées à l’aménagement intérieur du Centre, à sa maintenance et à l’équipement de l’IRCAM.
Les subventions accordées en 1998 et 1999 sur les crédits d’interventions culturelles (chapitre 43-20), soit 19 millions de francs au total, avaient un caractère exceptionnel. Traditionnellement, compte tenu de la programmation pluriannuelle de ses expositions et de l’annualité budgétaire, le Centre est amené à préfinancer sur ses recettes propres de l’année n–1 certaines des manifestations de l’année n. En raison de sa fermeture pour travaux, l’établissement n’a pu dégager de recettes propres et donc n’a pu faire l’avance des fonds nécessaires à l’organisation de grandes expositions. En conséquence, des crédits d’intervention supplémentaires, ont été accordés, à titre exceptionnel, dans la loi de finances initiale. Il convient de relever qu’une grande partie des moyens nouveaux inscrits en subventions pour 2000 (24,4 millions de francs) provient d’un transfert interne : 10 millions de francs proviennent du chapitre 43-20 – Interventions culturelles d’intérêt national, article 10 – Patrimoine culturel, et 1,82 million sont issus du chapitre 43-92 – Commandes artistiques et achats d’œuvres d’art, article 90 – Centre national d’art et de culture Georges Pompidou – Collections d’art moderne. Par ailleurs, 7 emplois non budgétaires seront, pour 2000, créés et financés par redéploiement des crédits de l’établissement. Il est indéniable que les fonctions du « Centre Beaubourg » ont considérablement évolué et que son activité s’est de plus en plus diversifiée. L’ensemble est extrêmement composite, les relations entre les différentes composantes (Centre national, Bibliothèque publique d’information, IRCAM) sont devenues plus compliquées. Les tensions sont inévitables. La répartition des charges financières entre les différents partenaires n’est pas clarifiée. Il conviendra d’actualiser le statut de l’institution pour une remise en cohérence globale de l’utilisation du bâtiment rénové. Enfin, votre rapporteur spécial insiste sur la nécessité de prolonger les expériences de partenariat menées avec des acteurs régionaux durant la période de fermeture du bâtiment. B.– LE MUSÉE DU QUAI BRANLY 1.– Du projet « Arts premiers » à l’Établissement public du musée du quai Branly Le projet de construction d’un musée consacré aux arts primitifs baptisés « Arts premiers » lancé par le Président de la République en 1996, a donné lieu à diverses propositions qui ont été faites par une association de préfiguration présidée par M. Jacques Friedmann. Le projet consiste à rassembler et à valoriser au sein d’une même institution, sous la double tutelle du ministère de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie et du ministère de la Culture et de la Communication, les collections actuelles de la section ethnologique du Muséum national d’histoire naturelle (Musée de l’Homme) et celles du Musée national des arts africains et océaniens (MAAO). Une association dite « Mission de préfiguration du musée de l’Homme, des arts et des civilisations » a été chargée en 1998 de mener, avec le concours d’un conseil scientifique, une large concertation avec les milieux scientifiques et culturels, de fournir au Gouvernement et au Président de la République, en collaboration avec les services de l’État et de la Ville de Paris, des éléments d’appréciation sur le site possible du futur musée, ainsi que de lancer le concours d’architecture du pavillon des Sessions du Louvre en vue de l’installation de l’antenne du futur musée qui présentera une centaine de chefs-d’œuvre d’art primitif. Une étude comparative des différents sites possibles a conduit la mission de préfiguration à proposer le site du quai Branly qui a été retenu par le Président de la République et le Gouvernement. 2.– La mission et l’organisation de l’Établissement public du musée du quai Branly L’Établissement public du musée du quai Branly, créé par le décret n° 98-1191 du 23 décembre 1998, a pris le relais de la mission de préfiguration et son conseil d’administration a entériné les choix proposés par elle. L’originalité de cette institution réside dans le fait qu’elle constitue à la fois un établissement constructeur, maître d’œuvre, et un musée. En effet, c’est la première fois que, dans le cadre de Grands Travaux, la réunion des deux fonctions est opérée au sein d’une même personne juridique. Cette solution aura l’avantage d’éviter des structures bicéphales, sources de conflits dans les processus décisionnels. Il « a pour mission de concevoir et de réaliser ou faire réaliser un ensemble culturel original à caractère muséologique et scientifique, chargé de conserver et de présenter au public des collections appartenant à l’État représentatives des arts et des civilisations d’Afrique, d’Océanie, des Amériques et de l’Asie, ainsi que de permettre l’insertion de cet ensemble dans son environnement. « À cette fin, l’établissement : « 1° Réalise ou coordonne les études, consultations ou concours à caractère national ou international, nécessaires à l’installation de l’ensemble précité sur le terrain sis 29 à 55, quai Branly, dans le 7ème arrondissement de Paris ; « 2° Réalise ou coordonne le programme de l’ensemble des travaux nécessaires à cette fin ; « 3° Propose aux ministres chargés de la tutelle le schéma d’aménagement, d’organisation et de fonctionnement de la future institution ; « 4° Assure la tenue d’un inventaire sur lequel il inscrit les œuvres qui sont destinées à figurer dans les collections du futur musée et conserve les collections inscrites sur cet inventaire ; « 5° Peut organiser des manifestations culturelles, notamment des expositions, destinées à préfigurer et à présenter au public les activités culturelles de la future institution ; « 6° Gère, conserve, protège et assure la présentation des collections qui seront exposées dans le pavillon des Sessions du musée du Louvre. « En application des dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, il conclut avec l’établissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels une convention pour l’exécution des missions indiquées aux 1° et 2° ci-dessus. « Il peut conclure avec l’Établissement public du musée du Louvre, avec d’autres musées nationaux, avec le Muséum national d’histoire naturelle et la Réunion des musées nationaux toutes conventions utiles à l’exécution des missions indiquées aux 4° à 6° ci-dessus. « Il assure l’information du public sur le projet pendant la durée de réalisation de celui-ci.() » Comme de tradition, l’établissement est organisé autour d’un conseil d’administration, qui comprend quatorze membres, dont le président (), six membres de droit (), un représentant de la Ville de Paris, quatre personnalités qualifiées, et deux représentants du personnel. La définition du projet dans sa diversité est assurée, notamment, par deux directeurs de projet : le directeur du projet muséologique () et le directeur du projet pour l’enseignement supérieur et la recherche (), tous deux nommés en mars 1999. Un conseil d’orientation, présidé par M. Jacques Friedman, propose au conseil d’administration les orientations muséologiques et scientifiques du projet, ainsi que le schéma d’organisation et de fonctionnement de la future institution. Il regroupe, à parité des personnalités scientifiques françaises et des personnalités qualifiées, françaises ou étrangères. Par ailleurs, un comité de présélection des acquisitions propose une sélection d’objets à acquérir et donne son avis sur les restaurations et les mesures de conservation préventive. Il donne également son avis sur l’acceptation des dons et legs ; il est consulté sur l’organisation et le financement par l’établissement de missions ethnographiques ou archéologiques concourant à la politique d’acquisition. 3.– Le projet et le calendrier des opérations Aujourd’hui, il existe trois sortes de musées qui s’intéressent aux arts primitifs ou premiers. Les premiers sont des musées « généralistes », à l’exemple du Metropolitan Museum of Art de New York, dans lesquels une partie est réservée à ce type d’art. Cette catégorie tend à disparaître. Un deuxième type de musée est lié à l’aventure scientifique et à l’ère coloniale. C’est le modèle du Musée de l’Homme qui dépend du Muséum national d’histoire naturelle ou bien du Musée national des arts africains et océaniens, mais aussi du musée de Bâle. Enfin, nous avons assisté au développement récent de musées dédiés aux « premières nations », en particulier aux États-Unis, au Canada et en Australie. Ces derniers s’appuient en général sur des courants politiques tendant à affirmer, par la valorisation de leur passé, le caractère ancien mais toujours vivant de certaines cultures. Par rapport à cette typologie, le futur musée du quai Branly s’affirme comme un projet original. Selon le président de l’Établissement public du musée du quai Branly, il est né du constat de l’existence d’une différence fondamentale de traitement entre œuvres occidentales et œuvres non occidentales dans les musées français. Dans le cas des œuvres occidentales, et le Grand Louvre est là pour le prouver, l’œuvre est proposée en tant que telle au public. Elle précède tout discours sur son contexte de création. Dans le cas des objets non occidentaux, l’œuvre dans sa présentation muséographique est, en générale, prisonnière d’un discours ; et celui-ci se trouve partagé entre deux écoles : une école « positive » pour laquelle l’œuvre est au service de la démonstration d’une thèse ; dans ce cadre, on nie l’histoire ; on ne reconnaît aux cultures présentées aucune autonomie ; l’autre école, que l’on pourrait qualifier d’« artistique » glorifie l’influence des œuvres non occidentales sur les œuvres occidentales ; cette idée a prévalu lors de la création du Musée national des arts africains et océaniens. Or, une société ne peut être réduite à un objet, et l’objet ne saurait avoir de vie absolument autonome. Le projet du futur musée du quai Branly a pour objectif de concilier ces différents points de vue, de rapprocher ethnologie et esthétisme, sauvegarde du patrimoine et activités d’enseignement et de recherche. La présentation des collections donnera aux visiteurs la possibilité d’avoir des regards croisés et divergents, sans monopole démonstratif de la manière dont doivent être interprétées ces collections. Les décisions définitives de construction d’un nouveau bâtiment, situé quai Branly, et d’établissement d’une « ambassade » du futur musée, sur une surface de 1.400 mètres carrés au sein du palais du Louvre ont été prises à l’été 1998. 120 objets ont été sélectionnés, non pas en vue de présenter une maquette du futur musée, mais pour offrir à un public par définition non spécialisé un ensemble spectaculaire et attractif. L’antenne installée dans le musée du Louvre ouvrira début 2000. Une enveloppe totale de 30 millions de francs a été consacrée à la réalisation, confiée à l’architecte Jean-Michel Wilmotte sous la maîtrise d’ouvrage de l’Établissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels (EPMOTC). Le programme de réalisation des travaux a été voté par le conseil d’administration de l’établissement en juin 1999. À cette occasion, le concours d’architecte a été lancé. La maîtrise d’ouvrage est entièrement assurée par l’établissement. Un jury a été constitué, présidé par le président de l’établissement ; il comprend un tiers d’architectes, un tiers de représentants des tutelles, et un tiers de personnalités internationales. Le concours proprement dit aura lieu dans les premiers jours du mois de décembre 1999. Le choix de l’architecte interviendra alors. Un long travail de dialogue entre celui-ci et les responsables de l’établissement prendra place en 2000. Le début des travaux devrait avoir lieu en 2001 et leur fin intervenir en 2003. L’année 2004 devrait voir se dérouler les travaux d’aménagement intérieur pour une ouverture du musée à l’automne de cette même année. Tel que voté par le conseil d’administration, le programme prévoit la construction d’un bâtiment de 35.000 mètres carrés sur un terrain de 25.000 mètres carrés, marqué par l’expérience calamiteuse du projet de Centre de conférences internationales qui devait atteindre entre 100.000 et 120.000 mètres carrés de surface, alors que la surface pouvant être construite est limitée sur ce terrain à 70.000 mètres carrés. Par ses dimensions, le projet de musée est relativement modeste. Un vaste jardin de 7.500 mètres carrés sera réservé sur le terrain. Le futur musée aura 9.000 mètres carrés de surface d’exposition nette, dont grosso modo 2.000 mètres carrés consacrés aux expositions temporaires et 7.000 mètres carrés destinés à des expositions permanentes. Ces dernières seront divisées en cinq zones : quatre zones géographiques – Asie, Amérique, Afrique, et Océanie –, et une zone d’exposition « transversale » accueillant des expositions thématiques – par exemple, sur la mort dans les sociétés non occidentales. Chaque zone géographique sera elle-même divisée en quatre espaces différents : une zone de contact ou espace d’appel et d’introduction, une zone centrale permettant l’approfondissement des connaissances, un espace multimédia, et un espace « dossier » d’exposition temporaire. Le reste du bâtiment accueillera la conservation et les services administratifs, les réserves, mais aussi des cycles de formation ethnologique appliquée aux objets. Il devrait y avoir de quatre à six expositions temporaires à la fois. Le musée devra également prêter ses œuvres, et fournir de la substance à l’extérieur. Il sera un centre d’études et de fourniture d’informations aux chercheurs. Parallèlement au chantier de construction lui-même, l’établissement devra mener celui des collections, qui implique information et inventaire, numérisation, rénovation et restauration. En effet, en dehors d’importantes acquisitions, l’établissement est chargé de réunir les collections ethnographiques du Muséum national d’histoire naturelle conservées au Musée de l’Homme et celles du Musée national des arts africains et océaniens. Il lui faut ainsi explorer les immenses réserves qui existent dans les deux établissements, soit 300.000 objets pour le premier et 20.000 pièces pour le second. Ce « chantier » des collections sera mené sur trois ans, afin de transformer ces réserves largement inutilisées aujourd’hui en de véritables instruments de savoir. La première étape débutera dans le courant de l’an 2000. D’ores et déjà, une étude méthodologique est conduite pour déterminer si le travail sur les collections existantes se fera dans chacun des deux bâtiments, ou bien dans un seul, ou encore dans un bâtiment loué à l’extérieur. Ce « chantier » des collections sera également le moyen de mettre en place une coopération nationale et internationale intéressante, notamment par un appel à la participation de nombreux stagiaires. 4.– Les moyens financiers du projet et leur imputation budgétaire Le projet a été fixé par la Mission de préfiguration et par le Gouvernement pour un coût total de 1,1 milliard de francs, compte non tenu du budget des acquisitions réalisées pour l’antenne implantée au sein du musée du Louvre. Les premières estimations avaient été réalisées par l’ancien Établissement public du Grand Louvre (EPGL), établissement constructeur. La validation de ces hypothèses est en cours. Le coût du bâtiment est estimé à 600 millions de francs. Le reste de l’enveloppe correspondra au « chantier » des collections. Le coût futur de fonctionnement est estimé à environ 150 millions de francs par an. Un premier crédit d’investissement, à hauteur de 20 millions de francs, figurait dans le budget de 1998 du ministère de la Culture. En 1999, à parité avec le budget de l’Enseignement supérieur, le budget de la Culture a accueilli les crédits de fonctionnement destinés à l’établissement public de préfiguration à hauteur de 7,5 millions de francs, des crédits d’acquisition pour 25 millions de francs, ainsi que des crédits d’équipement de 62 millions de francs en autorisations de programme et de 15,5 millions de francs en crédits de paiement. Pour 2000, pour la subvention de fonctionnement, 7,5 millions de francs sont inscrits sur le chapitre 36-11 – Enseignement supérieur et recherche. La même somme est inscrite au budget de la Culture, sur le chapitre 36-60 – Subventions aux établissements publics, article 83. Le redéploiement des crédits inscrits sur ce chapitre a permis de dégager des moyens pour financer 12 créations d’emplois non budgétaires. 15 millions de francs de crédits d’acquisition sont inscrits sur le budget de la Culture (chapitre 43-92 – Commandes artistiques et achats d’œuvres d’art), et 25 millions de francs sur les crédits de l’Enseignement supérieur (article 43-11 – Enseignements supérieurs – Encouragements divers). S’agissant des dépenses en capital, 85 millions de francs d’autorisations de programme sont inscrits sur le budget de l’Enseignement supérieur (chapitre 66-73 – Construction et équipement – Enseignement supérieur et recherche, article 10), tandis que 32 millions de francs d’autorisation de programme et 26 millions de francs de crédits de paiement sont inscrits sur le budget de la Culture (chapitre 66-91 – Autres équipements, article 62). Une question plus générale se pose : l’enveloppe fixée est-elle suffisante ? N’assisterons-nous pas à une dérive des coûts semblable à celle constatée pour la réalisation de nombreux grands travaux ? D’une part, les 500 millions de francs qui seront consacrés aux collections paraissent suffisants. Le coût total va dépendre largement des conditions de réalisation des collections. Si, par exemple, l’ensemble de la constitution des collections se fait dans les locaux du Musée national des arts africains et océaniens, ce qui impliquerait leur fermeture temporaire au public, le coût du « chantier » des collections pourra baisser de manière substantielle. D’autre part, il faut souligner les différences fondamentales qui existent entre ce projet et d’autres expériences. En premier lieu, le futur musée des arts et civilisations, quel que soit son nom définitif, aura bénéficié de travaux de préparation relativement longs, grâce à la mise en place d’une mission de préfiguration. En second lieu, il n’aura pas vocation à devenir un musée universel, dont la vocation est de montrer tout ce qu’il possède en réserve, au contraire de l’expérience du Grand Louvre. Ses surfaces d’exposition seront à peine supérieures à celles cumulées du Musée national des arts africains et océaniens et du Musée de l’Homme. Ce ne sera donc pas la cité universelle des arts primitifs, avec force restaurants, boutiques, salles de spectacles. De fait, les délais ont été respectés, aucune querelle de personnes ne paraît devoir entraver la mise en œuvre du programme. En revanche, pour la seule année 2000, des difficultés de fonctionnement pourraient apparaître, compte tenu d’un niveau de subvention insuffisant qui ne tient pas compte du lancement d’une campagne multimédia (création d’un espace d’interrogation dans l’antenne du Louvre, de consultation d’un cédérom donnant des informations sur les sociétés primitives) et qui reflète l’absence de prise en compte par les tutelles du coût réel de fonctionnement de l’établissement, qui s’établirait à 18 millions de francs sur l’année 1999. En effet, désormais, tous les personnels, soit environ 30 personnes, sont à la charge de l’établissement. Le choix de la reconduction d’une subvention totale de fonctionnement de 15 millions de francs en 2000 a été biaisé par le fait que, pendant la période de préfiguration, une partie du personnel était mise à disposition du projet. 5.– Des questions en suspens La première question qui n’a pas encore trouvé de réponse est celle de l’avenir du Musée national des arts africains et océaniens et du Musée de l’Homme. Leur situation n’est pas tranchée, et M. Jean-Claude Moreno, nommé administrateur provisoire, a été chargé d’une mission sur l’avenir du Musée de l’Homme, compte tenu notamment du fait que ses locaux abritent des laboratoires de recherche du Muséum (évolution du génome humain, sida, …). La question de la dévolution de la bibliothèque du Musée de l’Homme n’a pas été réglée non plus. La deuxième série de questions a trait à la politique d’acquisition. Ne va-t-on pas faire payer à l’État l’acquisition d’œuvres au prix fort ? Il faut, tout d’abord, souligner que la politique menée dans ce domaine n’a pas pour objet de transformer les collections du futur musée en ressources encyclopédiques. La création d’un comité de présélection des acquisitions a précisément pour objet d’éviter toute dérive dans cette matière. Il existe dans les collections actuelles des lacunes importantes, par exemple en art précolombien. Pour les combler, l’établissement doit acquérir certaines œuvres majeures sur un marché qui est extrêmement restreint et qui tend à le devenir de plus en plus. En dehors des dons et legs, il s’agit de la dernière chance pour le futur musée de présenter au public des œuvres inédites dans les musées français, voire européens. C.– LA POLITIQUE DE SOUTIEN AU CINÉMA ET À L’AUDIOVISUEL Le cinéma et l’audiovisuel constituent un secteur économique en relative bonne santé. La production connaît son chiffre le plus élevé depuis 1985 (180 productions en 1998 au lieu de 158 en 1997). Les investissements ont enregistré une hausse très importante et la fréquentation connaît son meilleur résultat depuis treize ans : 149,02 millions de spectateurs en 1997 ont procuré une recette de 5,17 milliards de francs ; en 1998, 170,11 millions de spectateurs ont généré une recette de 5,99 milliards de francs. En 1999, selon les prévisions, la fréquentation pourrait atteindre160 millions de spectateurs. La part de marché du film français, qui a perdu 5 millions de spectateurs, a baissé cependant à 27,4 % (au lieu de 34,5 % en 1997), en raison notamment de la sortie, cette année, du film américain Titanic, qui a réalisé 20,5 millions d’entrées. L’action du ministère de la Culture dans le domaine du cinéma est principalement conduite par le Centre national de la cinématographie (CNC), établissement public placé sous le contrôle du ministère, créé en 1946. C’est l’organisme de tutelle des professions cinématographiques. À ce titre, il gère les différents régimes d’aide à l’industrie cinématographique et à l’industrie des programmes audiovisuels, et, en particulier, le compte de soutien à l’industrie cinématographique et audiovisuelle. Il a ainsi été chargé, à titre principal, de mettre en œuvre les différentes mesures présentées en Conseil des ministres, le 6 mai 1998, mesures destinées, notamment, à aider le cinéma dit « indépendant » face au mouvement de concentration et d’intégration de la production par les diffuseurs constaté ces dernières années. Cette politique reposera plus précisément sur la création d’une commission d’experts qui sera nommée pour mieux soutenir les indépendants, tandis que les complexes cinématographiques de plus de dix salles (« multiplexes ») seront placés sous une surveillance accrue et se verront imposer une programmation faisant place au film européen et à l’art et essai. 1.– Les moyens budgétaires en faveur du cinéma a) L’évolution des dotations budgétaires Les dotations de fonctionnement du CNC sont en légère baisse de 13,1 millions de francs en 1999 à 12,7 millions de francs pour 2000 (chapitre 36-60, article 60 ancien, article 65 nouveau). Cette dotation résulte d’un ajustement des crédits de rémunération de 0,1 million de francs et d’un transfert négatif de 0,5 million de francs en direction de l’article 10 du chapitre 34-97 – Moyens de fonctionnement des services centraux et déconcentrés, correspondant aux frais de fonctionnement des conseillers cinéma des directions régionales des affaires culturelles. Au total, le budget de fonctionnement du CNC s’élève à 210 millions de francs dans le projet de loi de finances, ce qui représente une augmentation modérée par rapport à 1999. Les crédits d’origine budgétaire assurent 6 % du financement de ce budget. Le solde est financé par un prélèvement sur le fonds de soutien à hauteur de 4,6 % des recettes. Les crédits d’intervention du CNC inscrits au titre IV bénéficient en 2000 de 4 millions de francs de mesures nouvelles. La moitié abondera les crédits déconcentrés, l’autre les besoins liés à la création de la Maison du cinéma. Au total, pour 2000, sur le titre IV, le CNC disposera de 218,9 millions de francs de crédits d’intervention, soit une augmentation de 2,2 % par rapport à 1999 (214,2 millions de francs). La répartition des autorisations de programme est retracée dans le tableau ci-après.
Les prévisions d’affectation des crédits d’intervention, au profit du CNC en 2000, sont récapitulées dans le tableau ci-après.
b) Les priorités affichées – Le patrimoine cinématographique et la création de la Maison du Des crédits d’équipement et d’intervention permettront de réaliser la Maison du cinéma et de relancer la politique patrimoniale dans le domaine du cinéma. · La nécessité d’une maison du cinéma S’agissant de la sauvegarde du patrimoine cinématographique, votre rapporteur spécial voudrait souligner la profusion des institutions qui, si elle reflète la vie créative, nuit à la définition d’une politique globale et cohérente, soucieuse d’économies d’échelle. Le travail du service des archives du film qui dépend directement de l’État est ainsi complété ou concurrencé par celui effectué par la Cinémathèque française, la Cinémathèque de Toulouse, l’Institut Lumière de Lyon, qui sont des associations régies par la loi de 1901, mais également par celui d’un important réseau de cinémathèques régionales. Il convient d’ajouter à la liste de ces nombreuses institutions la Bibliothèque du film (BIFI), créée en 1992, à partir de la réunion des archives « non-film » de la Cinémathèque française, de l’École nationale supérieure des métiers de l’image et du son (ENSMIS, ex-FEMIS) et des archives du film. Face à cette dispersion et après la mise en place d’un plan important de sauvegarde des films anciens, dit « plan nitrate », une action d’envergure s’imposait. Un rapport a été remis sur ce sujet, en juin 1998, à la ministre de la Culture, par M. Marc Nicolas, directeur général adjoint du Centre national de la cinématographie, chargé du patrimoine. Ce rapport a fixé les grandes lignes de la création d’une Maison du cinéma. Cette Maison du cinéma a été annoncée par six ministres successifs en quatorze ans. Entre 1992 et 1999, 30,3 millions de francs ont été accordés par l’État aux différentes associations chargées de la préfiguration de cette institution. Votre Rapporteur se félicite que ce projet voit enfin le jour, avec le choix de son emplacement dans le 12ème arrondissement de Paris. Dépassant la simple addition de la Cinémathèque française et de la Bibliothèque du film (BIFI) qui doivent y développer leurs activités, grand centre national et international de la culture cinématographique et de la cinéphilie, cet établissement public sera doté de trois salles de cinéma, d’une bibliothèque-vidéothèque, d’espaces d’expositions, et d’espaces consacrés à des activités pédagogiques. Elle abritera les collections du Musée du cinéma et un centre de ressources sur le cinéma destiné au grand public et aux chercheurs. Légers, les travaux d’aménagement intérieur pourront être réalisés rapidement et la Maison du cinéma devrait ouvrir ses portes avant la fin de l’an 2000. Le coût d’achat et des travaux a été évalué à 230 millions de francs. Par ailleurs, sur la base du rapport précité, de nouvelles pistes sont explorées, en tenant compte des avancées déjà accomplies ainsi que des éléments nouveaux comme la révolution numérique (chaînes thématiques, DVD, etc.), l’augmentation de la valeur économique du patrimoine cinématographique, la concentration du secteur en de grands catalogues de films ou les nouvelles difficultés techniques liées à la conservation des films sur support « acétate » (syndrome du vinaigre). · Des crédits importants En 1999, 5,6 millions de francs de crédits d’équipement ont été consacrés à la poursuite des travaux de sécurité sur les bâtiments du service des archives du film et du dépôt légal du CNC. 10 millions de francs ont servi à financer la création de nouveaux espaces de conservation au CNC et à la Cinémathèque, tandis que 43,5 millions de francs sont venus assurer la poursuite du plan de restauration des films anciens. 2,5 millions de francs ont autorisé l’enrichissement des collections de films, de documents ou d’objets relatifs au cinéma. 1999 a été également l’année de l’acquisition des locaux de l’ancien Centre culturel américain destinés à accueillir la Maison du cinéma. Ainsi, 2,5 millions de francs de crédits d’intervention ont permis la mise en œuvre des actions de préfiguration de la Maison du cinéma et de nouvelles initiatives dans le domaine de la politique patrimoniale et de la diffusion de la cinéphilie. En 2000, 2 millions de francs sur crédits d’intervention financeront la préfiguration de l’établissement. 102 millions de francs d’autorisations de programme inscrits sur le chapitre 56-91 seront destinés à financer le réaménagement du bâtiment de la Maison du cinéma (). Grosso modo comme en 1999 (43,5 millions de francs), 44 millions de francs d’autorisation de programme et de crédits de paiement, sur le chapitre 66-91 article 65 (nouveau), attribués au CNC, permettront de financer la poursuite du plan de restauration des films anciens, tandis qu’un million de francs favoriseront l’enrichissement des collections des cinémathèques d’intérêt national. – L’action en régions : démocratisation culturelle et éducation à L’action en régions du CNC repose sur des conventions de développement cinématographique signées avec les collectivités locales : accords annuels avec les régions, nouvelle démarche contractuelle avec les agglomérations et les villes, élargissements des axes prioritaires des conventions (formation professionnelle, production...). 147 conventions ont été passées de juin 1989 à juin 1999. Dans le cadre de la réforme des interventions économiques des collectivités territoriales, plusieurs dispositions pourraient leur permettre d’intervenir dans les domaines de l’industrie cinématographique, y compris la production. La déconcentration sera poursuivie. Les directions régionales des affaires culturelles verront leurs compétences augmenter, en particulier en direction des jeunes pour la mise en œuvre de la création en région d’un réseau de centre-ressources pour l’éducation à l’image et la mise en place de l’opération « Ciné Ville », qui complétera l’opération « Un été au ciné ». Elles ont bénéficié à ce titre de mesures nouvelles à hauteur de 3,5 millions de francs en 1999. En 2000, le montant des interventions déconcentrées progresse fortement de 24,3 millions de francs à 38,7 millions de francs, en partie grâce à des transferts en provenance des crédits centraux. Cette déconcentration accrue s’accompagne de la mise en place de conseillers spécialisés en cinéma et audiovisuel dans les directions régionales. Par ailleurs, les dispositifs scolaires « Lycéens au cinéma », « Collège au cinéma » et « École et cinéma » ont été développés en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale. Le CNC a consacré, en 1999, 14,7 millions de francs à cette action. En 2000, le dispositif concernant les écoles sera mis en œuvre dans 60 départements, celui concernant les collèges dans 80 départements, et celui relatif aux lycées dans 15 régions. En outre, ont été mis en place cinq pôles régionaux pour l’éducation au cinéma et à l’audiovisuel (1,25 million de francs en 1999, 2,25 millions de francs pour 2000). – Les industries techniques du cinéma et de l’audiovisuel Le CNC devra s’attacher à aider l’investissement des industries techniques, compte tenu de l’obsolescence rapide des équipements. Il soutiendra la recherche-développement. Une concertation avec le secrétariat à l’Industrie vise à monter une opération destinée à encourager les programmes de recherche et à favoriser les liens entre les laboratoires de recherche publique et les entreprises. À travers le programme PRIAMM, le CNC favorisera la recherche multimédia en matière audiovisuelle et cinématographique, en collaboration avec le secrétariat d’État. Ce programme bénéficiera d’une enveloppe de 45 millions de francs, issus d’une part des crédits « autoroutes de l’information » gérés par le secrétariat d’État, et d’autre part des crédits du CNC. Enfin, la formation sera aidée en liaison avec le fonds d’assurance formation du secteur, l’AFDAS. Il s’agira en particulier pour le CNC de financer des programmes permettant aux techniciens de l’image et du son, permanents et intermittents, de s’adapter aux technologies numériques. 2.– Le compte de soutien à l’industrie cinématographique et audiovisuelle Le compte de soutien à l’industrie cinématographique et audiovisuelle est un compte spécial du Trésor, créé par l’article 76 de la loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959. Il est alimenté par des taxes fiscales : · taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques dite « taxe spéciale additionnelle » (TSA) () ; · prélèvement spécial sur le bénéfice résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d’incitation à la violence ; · taxe spéciale sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence produits par des entreprises hors de France ; · taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes ; · recettes diverses accidentelles (reversement de subventions non utilisées, remboursement, etc.) ; · taxe sur les chiffres d’affaires des services de télévision privée et un prélèvement sur celles des chaînes publiques. Du côté des dépenses, il convient de distinguer les aides automatiques (subventions d’investissement, garanties de prêt) et les aides sélectives (avance sur recettes et investissements dans les salles de cinéma). Il est possible de noter, depuis plusieurs années, une multiplication de ce dernier type d’aides : aides directes sur décision du ministre, aides au développement de projet, à la production de cinématographies étrangères, à la coproduction avec les pays de l’Est, au court métrage ou encore à la musique de film, aides aux salles d’art et essai, aux salles d’édition, à l’édition de copies, à la création et à la modernisation de salles dans les zones insuffisamment occupées. En 1997, l’ensemble de ces aides a contribué à financer 13 % de la production cinématographique à comparer avec 33 % d’apport producteur, 36 % d’investissements des chaînes, et 10 % d’apports étrangers. En 1999, les crédits du compte de soutien ont atteint 2.485,2 millions de francs, soit une augmentation de 2,5 % par rapport aux crédits 1998. La forte hausse de la fréquentation en salles, depuis deux ans a en effet permis l’accroissement du produit de la « taxe spéciale ». Les crédits supplémentaires ont été principalement affectés aux actions automatiques en faveur de la production et de l’exploitation cinématographique et audiovisuelle (+ 3,6 %). Cette progression a permis de maintenir à un niveau constant le retour du soutien automatique aux producteurs, distributeurs et exploitants et sera confortée par les incidences de la réforme du soutien automatique à l’exploitation et à la réforme de l’agrément. Grâce, notamment, à l’augmentation du produit de la taxe spéciale sur le prix des places, 137 millions de francs de crédits supplémentaires par rapport à 1999 ont été obtenus. Le compte de soutien atteindra, selon les prévisions, 2.622,2 millions de francs, en hausse de 5,5 % par rapport à 1999 (2.485,2 millions de francs). Les crédits pour l’audiovisuel augmenteront de 7,2 %, passant de 1.141,4 millions de francs dans le budget voté de 1999 à 1.223,1 millions de francs dans le projet de loi de finances. Ceux réservés au cinéma passeront de 1.343,8 millions de francs en 1999 à 1.399,1 millions de francs pour 2000, soit une progression importante de 4,1 %. Les producteurs audiovisuels auront un bon budget. La valeur du « point minute » qui permet de déterminer le niveau des subventions qui sont accordées pourrait être augmentée. Sur quatre ans, cette unité de valeur a baissé de 11 %. En 1999, elle a été stabilisé. En 2000, elle pourrait être revalorisée. Mais, si les crédits progressent et si les programmes d’animation et de documentaire s’exportent très bien, la faiblesse relative de la production de fictions demeure : les producteurs restent très dépendants des diffuseurs et ont du mal à exploiter leurs droits, qui sont retenus largement par les chaînes. Par ailleurs, tous les maillons de la chaîne de l’industrie cinématographique vont bénéficier de cette hausse : production, distribution, exploitation. La production sera aidée dans les volets « compte de soutien automatique » et « aide sélective ». Avec l’augmentation du nombre de multiplexes, le secteur de l’exploitation croît, de la même façon que la production. En revanche, la distribution est le maillon le plus faible de la chaîne cinématographique. Les productions sont de plus en plus nombreuses, mais la part du cinéma français en France a tendance à décroître. Elle était de 27,4 % en 1998, en tenant compte de l’effet « Titanic ». Il existe donc un problème d’exposition des films français. L’appareil de distribution américain est d’une puissance considérable par rapport au système français : les États-Unis dépensent autant d’argent pour distribuer un film que pour le produire. Sans craindre d’être caricatural, on peut affirmer qu’un mauvais film américain a plus de chance d’être distribué en France qu’un film français moyen. Pour que les films français bénéficient d’une plus large audience, il faut leur assurer un nombre suffisant de salles, de copies, de moyens de promotion. Les aides existent : aide à la modernisation des salles ; aide pour la sortie des films l’été – un seul est sorti cet été, soit un relatif échec de l’aide, instituée en 1999, renouvelée pour deux ans cette année – aide à la programmation des films instituée en septembre 1999. Il est prévu que chaque groupement d’exploitants qui détiendra au moins 5 % de part de marché sur le plan national ou une part de marché importante sur le plan régional soit tenu de prendre des engagements de diversité et de pluralisme de programmation. Mais, d’ores et déjà, la distribution va bénéficier de 40 millions de francs supplémentaires. L’enveloppe des aides automatiques à la distribution va passer à 100 millions de francs (). Il convient, notamment, de conforter les distributeurs indépendants, c’est-à-dire non adossés à de grands groupes. Une étude va être lancée sur l’exploitation, et plus particulièrement sur le secteur des multiplexes. Ainsi, en septembre 1999, la ministre de la Culture a décidé de confier un rapport à M. Daniel Goudineau, directeur général adjoint chargé du cinéma au Centre national de la cinématographie, sur les conditions de diffusion du cinéma français. Il s’agira d’évaluer précisément les données économiques de l’activité de distribution des films français, leur évolution prévisible et les conséquences qui en résultent pour l’exposition des films français. Des mesures devraient être proposées pour améliorer l’équilibre économique de l’activité des distributeurs et de renforcer les moyens de promotion du cinéma français.
Les crédits finançant les aides sélectives avaient augmenté en 1998. Ils ont été maintenus en 1999 au même niveau. Ils progresseront en 2000 (+ 1,3 % pour les aides au cinéma, + 7,3 % pour les aides audiovisuelles). Votre Rapporteur se félicite de la récente modification de la réglementation intervenue par les décrets n° 98-498 du 22 juin 1998 modifiant les décrets n° 59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’État à l’industrie cinématographique, n° 67-356 du 21 avril 1967 relatif au soutien financier de l’État à la création et à la modernisation des théâtres cinématographiques, et n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l’exploitation cinématographique, qui abroge le décret du 21 avril 1967. Ces décrets ont été accompagnés par un arrêté du 24 août 1998. Ces modifications ont été complétées par le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique. Diverses commissions sont créées. Elles seront chargées respectivement des agréments d’investissements, de la production et de la préparation des œuvres ; du soutien sélectif à la production, à la distribution d’œuvres réalisées en langue française ; et des industries techniques et des prix de qualité pour les œuvres de courte durée. Le processus de coopération étatique et professionnelle est renforcé. En effet, pour bénéficier du soutien financier à la production et à la préparation des œuvres, de longue ou de courte durée, celles-ci doivent être réalisées avec le concours de professionnels (auteurs, acteurs principaux, techniciens et collaborateurs de création) français ou européens ou de pays ayant conclu un accord intergouvernemental de coproduction avec la France. Ensuite, le soutien porte sur la préservation de la dimension culturelle et identitaire du cinéma français. À cette fin, des avances peuvent être accordées pour la production ou la distribution d’œuvres réalisées intégralement ou principalement en langue française ou régionale. Il s’agit là de l’affirmation d’une exception culturelle « ouverte » car le décret permet d’octroyer des avances pour la production d’œuvres réalisées en langue étrangère présentant des qualités artistiques incontestables. Enfin, les nouvelles technologies sont appréhendées comme un nouveau vecteur du dynamisme des industries cinématographiques. Le décret confirme, par ailleurs, les mesures favorables à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques adoptées en 1998. Il met également l’accent sur les aides en faveur de l’utilisation des nouvelles techniques de l’image et du son et la création de musiques originales d’œuvres cinématographiques, et sur la nécessité d’aider pour un montant couvrant au plus 50 % du coût des travaux la modernisation de l’outil cinématographique (studios de cinéma, laboratoires de développement, ateliers de trucages et d’effets spéciaux). Ce nouveau dispositif devrait donc permettre aux entreprises cinématographiques de concilier la commercialisation croissante du secteur et la lutte contre la marginalisation des démarches créatrices, encore vivaces dans le cinéma français et européen. 3.– L’Institut national de l’audiovisuel L’Institut national de l’audiovisuel (INA) est un établissement public né en 1974 de l’éclatement de l’ORTF. Il a pour mission de concilier service public et fonctions commerciales dans la préservation du patrimoine audiovisuel, la recherche sur les modes de production et de diffusion et la formation professionnelle. L’INA est financé par la redevance audiovisuelle, par des crédits budgétaires (services généraux du Premier ministre) et par des ressources propres (publicité, parrainage...). En 1999, le budget de l’INA était en diminution légère de 0,8 % par rapport à la loi de finances pour 1998 et s’établissait à 658,2 millions de francs. Dans un rapport remis à la ministre de la Culture et de la Communication, en août 1998, le chef du service juridique et technique de l’information et de la communication du gouvernement (SJTIC), M. Brun-Buisson, souligne la nécessité de réorganiser l’Institut et le « nombre anormalement élevé » de salariés affectés à des fonctions de direction ou de représentation. L’auteur du rapport précise également que les stocks non encore archivés sont très importants. Le manque de productivité de l’organisme a poussé France 2 et France 3 à se doter de leurs propres systèmes de documentation. En vue de pallier une partie de ces difficultés, une mesure nouvelle de 13,8 millions de francs a permis en 1999 d’amplifier la numérisation de la chaîne d’exploitation des archives, améliorant le service rendu aux diffuseurs et confortant ses ressources commerciales. Un plan de sauvegarde et de restauration des archives a été lancé. En 2000, le budget de l’Institut est reconduit à un niveau identique à ce qu’il était dans la loi de finances pour 1999, soit 658,2 millions de francs. La numérisation et l’informatisation de la chaîne d’exploitation des archives seront poursuivies. Le plan de sauvetage des archives sera renforcé. L’année 1998 aura vu l’ouverture de l’Inathèque, centre de consultation des archives audiovisuelles de l’Institut situé au sein de la Bibliothèque nationale de France. À cette occasion, nous rappellerons que depuis le 1er janvier 1995, l’INA a en charge le dépôt légal audiovisuel. Sont soumises à l’obligation de dépôt les sept chaînes de télévision hertziennes (TF1, France 2, France 3, La Cinquième, Arte, M6 et Canal+) et cinq stations de Radio France (France Inter, France Culture, France Musique, France Info et Radio Bleue). DeuxiÈME PARTIE FiscalitÉ et œuvres d’art : · La nécessité d’un panorama de la fiscalité des œuvres d’art Les débats, lors de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2000, ont été, de nouveau, l’occasion d’évoquer la fiscalité relative aux œuvres d’art. En effet, un amendement accepté par votre commission des Finances tendait à inclure les objets d’art dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune sur la base d’un forfait égal à 3 % de l’actif net. Les œuvres présentées au public et celles des artistes vivants seraient restées hors de l’assiette. Une disposition similaire avait déjà été débattue l’an dernier. Cette solution déjà proposée par M. Didier Migaud, Rapporteur général, dans son rapport sur la fiscalité du patrimoine de 1998 (), avait le mérite de résoudre de manière équilibrée les problèmes d’évaluation indissolublement liés aux objets d’art. Les discussions ont montré que ce dispositif, équitable en soi, pouvait poser question au regard de la conservation du patrimoine sur notre sol et de l’encouragement à la création plastique. C’est pourquoi, le Gouvernement, suivi par l’Assemblée nationale, a demandé que l’amendement ne soit pas adopté, sous bénéfice d’inventaire de l’ensemble de la fiscalité relative aux œuvres d’art. Votre commission des Finances avait confié à votre rapporteur spécial une mission, dont les conclusions font l’objet du présent rapport. Il n’a pas pour objectif de refaire l’ensemble des rapports réalisés ces dernières années et concernant le monde de l’art : rapports Chandernagor (), rapport Aicardi (), rapport Gaillard ()… Il n’a pour ambition que de donner des éléments précis sur les charges pesant sur les opérateurs du marché de l’art dans la perspective d’une harmonisation européenne croissante et de l’ouverture du marché des ventes publiques à la concurrence. · Le contexte de la fiscalité des œuvres d’art : le marché et les artistes La fiscalité ne constitue qu’un des déterminants du prix des œuvres et de l’équilibre du marché de l’art. En effet, la valeur d’une œuvre d’art et la santé du marché dépendent de l’ensemble des conditions de la vente : le lieu de la transaction, l’organisme qui organise la vente, la législation en vigueur sur le patrimoine, la stratégie du vendeur, la personnalité de celui qui tient le marteau, la présence ou l’absence des grands acheteurs, l’importance du marché. Ainsi, avant de se pencher sur le paysage fiscal du marché de l’art français, il est utile d’analyser les évolutions, la situation actuelle de ce marché, et ses perspectives de développement. Il convient, dans cette analyse, de ne pas se focaliser sur les seules transactions et de réserver une place à la création, les deux étant indissociables. Les œuvres originales alimentent le marché, qui, lui-même, assure la reconnaissance des artistes. · L’« exception fiscale culturelle » Plus les crédits budgétaires dévolus à la culture tendent à se réduire, plus la pression à la mise en œuvre de nouvelles mesures d’exonérations fiscales est forte (cf. rapport « Aicardi »). Or, le système fiscal applicable aux œuvres d’art est loin de l’ascétisme abstrait. Elle forme un ensemble plus proche d’un pointillisme mal maîtrisé. Cette « exception fiscale culturelle » ne saurait surprendre. La relation spécifique entre la fiscalité et les œuvres d’art est, en effet, ancienne. Il suffit de rappeler l’existence des lois somptuaires athéniennes ou vénitiennes ou encore la multiplication des discours sur les relations entre l’art et la richesse. L’approche fiscale des œuvres d’art a fréquemment été accompagnée d’un souci moral ou moralisateur (Bodin, Vauban, Lanjuinais, Rousseau, Necker, etc.). Mais, paradoxalement, la pratique a souvent été timide. Au contraire, avec la naissance de la notion de patrimoine national (), la préservation et la conservation des œuvres d’art sur le territoire ont fondé la création de mesures fiscales favorables à leur détention. De ce point de vue, la naissance de l’inventaire et l’adoption de lois de protection du patrimoine immobilier ont constitué des étapes fondamentales dans la naissance d’une politique de protection, assortie de mesures fiscales incitatives. Les mesures en faveur du mécénat par l’intermédiaire de déductions d’impôt sur les sociétés ou de l’importation d’œuvres d’art par le biais de l’application d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée suivent la même logique. Il en résulte un ensemble compliqué de dispositions fiscales, sans réelle cohérence. Modifier l’une d’entre elles, par exemple l’exclusion des œuvres d’art de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, ne peut se faire qu’au regard de l’équilibre général du marché de l’art. LAISSER CETTE PAGE BLANCHE SANS NUMÉROTATION CHAPITRE PREMIER Le MARCHÉ DE L’ART rÉorganisÉ : Le marché de l’art fait régulièrement la première page des journaux. La situation sociale et fiscale de l’artiste est moins souvent évoquée. La visibilité plus forte des soubresauts du marché masque souvent, non seulement les réalisations artistiques actuelles et les efforts opérés par les galeries d’art, mais également, et surtout, la condition des artistes. Il a semblé utile à votre rapporteur spécial de faire le point sur la situation du marché de l’art, et de se pencher sur le statut de l’artiste. Les deux domaines sont fortement imbriqués ; évoquer l’un sans étudier l’autre ne permettrait pas de saisir l’ensemble des enjeux de la fiscalité applicable à l’art. I.– LE MARCHÉ DE L’ART : ÉVOLUTION ET RÉORGANISATION Sur moyenne période, le marché de l’art a connu une croissance très importante, liée, notamment, à la multiplication et à la facilitation des échanges internationaux, à l’élargissement de la surface financière des principaux intervenants, et au décloisonnement des différents marchés entraînant une concurrence de plus en plus prégnante. Dans ce large mouvement, la place de la France a eu tendance à se restreindre. C’est pourquoi une réorganisation du marché français s’est avérée incontournable. A.– UN MARCHÉ FRANÇAIS EN PERTE DE VITESSE La nature des biens échangés sur le marché de l’art en fait un marché spécifique, où les raisonnements traditionnels concernant l’équilibre de l’offre et de la demande doivent être relativisés. Le marché de l’art est devenu international et intégré. Faute de s’être adaptée à ces évolutions, la place de Paris a perdu le premier rang qu’elle occupait au sortir de la dernière guerre. 1.– Les caractéristiques du marché de l’art Le marché de l’art est segmenté. Il existe autant de marchés qu’il y a de catégories d’arts et d’artistes. Ainsi, l’art contemporain constitue en lui-même un marché particulier. Encore faut-il pouvoir le définir. La législation douanière, pour la procédure simplifiée de l’attestation pour l’exportation, considère comme contemporaines les œuvres d’artistes vivants ou, dans le cas d’artistes décédés, les œuvres datant de moins de vingt ans. Les historiens de l’art, quant à eux, désignent comme « art contemporain » les œuvres postérieures à 1945. Les grandes maisons de vente retiennent la même définition, l’art moderne se situant entre l’impressionnisme et 1945. Quant aux conservateurs de musées, ils font souvent démarrer l’art contemporain au début des années 1960. Les différentes définitions qui sont admises montrent à elles seules combien il est difficile de cerner un seul marché dans un domaine aussi mouvant que l’art contemporain. De fait, l’art contemporain, du point de vue du marché, est formé d’un renouvellement permanent des mouvements artistiques qui implique des opérations commerciales à court terme, fortement « spéculatives », en ce sens que la valeur des œuvres n’est pas fixée et peut connaître de très fortes fluctuations. À l’intérieur même de ce marché, il convient de distinguer les « œuvres contemporaines classiques » et les « œuvres contemporaines nouvelles ». Le marché de l’art contemporain, au niveau le plus élevé, est un marché très étroit, construit sur des réseaux d’information extrêmement précis, et dont l’unité de compte est le million de dollars. Cette démarche de flux contraste avec le marché des œuvres impressionnistes et modernes, et encore plus avec celui des œuvres antérieures à l’impressionnisme, qui constitue un marché de stock, sur lequel les valeurs varient beaucoup moins. Le marché de l’art porte sur un bien particulier. En effet, l’œuvre d’art est un bien qui est caractérisé par : l’unicité, l’exécution à la main, la signature, l’originalité dans la pluralité de ses significations. Ainsi, le marché de l’art met en jeu des « marchandises » extrêmement hétérogènes, avec des valeurs très variables, allant de quelques milliers à plusieurs dizaines de millions de francs. De David Ricardo à Karl Marx, en passant par John Stuart Mill, les fondateurs de la science économique ont reconnu un statut économique particulier à l’œuvre d’art. Elle constitue le parangon du bien rare. Sa différenciation extrême confère à son propriétaire un monopole absolu. Ainsi, David Ricardo affirme : « Il y a des choses dont la valeur ne dépend que de leur rareté. Nul travail ne pouvant en augmenter la quantité, leur valeur ne peut baisser par suite d’une plus grande abondance. Tels sont les tableaux précieux, les statues, les livres et les médailles rares (…). Cette valeur dépend uniquement de la fortune, des goûts et du caprice de ceux qui ont envie de posséder de tels objets » (). De la même façon, John Stuart Mill souligne que « la difficulté de se procurer un objet, qui contribue à en déterminer la valeur, n’est pas toujours du même genre. Quelquefois, elle résulte de la limitation absolue de l’offre. Ainsi, il est des objets dont il est matériellement impossible d’augmenter la quantité au-delà de certaines limites qui sont fort étroites. (…) Telles sont (…) les statues antiques, les tableaux des vieux maîtres, les livres et médailles rares et autres articles recherchés par la curiosité des antiquaires » (). Le vendeur est un monopoleur et le prix de l’œuvre est le résultat de la concurrence qui s’instaure entre un nombre très limité d’acheteurs. Les œuvres d’art constituent des biens très mobiles. Cette particularité explique le caractère international du marché de l’art. Il ne peut être assimilé à une bourse des valeurs, qui constitue un marché où offres et demandes se rencontrent et s’ajustent pour aboutir à un prix représentatif de l’état du marché. Une telle définition implique que, sur un marché donné, pour une marchandise donnée, il n’existe qu’un seul prix, autrement dit que toutes les unités de la marchandise sont substituables. Les titres d’une société sont semblables les uns aux autres. Le marché de l’art, au contraire, se caractérise par une absence d’homogénéité en raison du caractère singulier de chaque œuvre. La plupart des analyses économétriques ont montré que les œuvres d’art constituent des placements plutôt médiocres sur le long terme (). Pour la même raison, les transactions portant sur une même œuvre sont relativement rares. Les caractéristiques de chaque œuvre ne font pas l’objet d’une information largement diffusée. Le marché de l’art, pour cette raison, n’est pas un marché transparent. Seuls sont bien connus les prix des ventes publiques. L’indivisibilité des œuvres et le principe de la vente au plus offrant conduisent à un prix supérieur à ce que serait le prix d’équilibre. Le marché de l’art est un marché très réactif. Au risque lié à l’authenticité pour les tableaux anciens s’ajoutent les incertitudes liées à l’instabilité inhérente au mouvement continu de la hiérarchie des valeurs esthétiques. Ce constat est particulièrement vrai pour les œuvres contemporaines, mais il peut être fait également pour les tableaux impressionnistes. Les intervenants sur le marché de l’art sont très divers, leurs logiques souvent différentes : marchands et commissaires-priseurs, administrateurs, conservateurs, critiques, agents d’art, spectateurs, collectionneurs et investisseurs. Le marché de l’art est un marché intégré dans le monde de l’art. Il constitue le passage quasi obligé de toute œuvre. La reconnaissance d’un artiste se fait grâce à lui. En aval, le mode d’emploi du marché est désormais partie intégrante de l’enseignement des écoles d’art. En amont, les musées et institutions culturelles prennent le relais. L’examen du processus de valorisation des œuvres et des artistes contemporains montre combien le réseau international des galeries et celui des institutions culturelles interagissent. L’ensemble de ces éléments conduit à concevoir une fiscalité spécifique, adaptée à ce secteur. 2.– Naissance et évolution du marché de l’art a) L’évolution du marché international de l’art Jusque dans les années d’après-guerre, la vente publique associée aux ventes après décès, divorce ou banqueroute, était cantonnée dans quelques salles poussiéreuses. Les ventes aux enchères ont pris le dessus sur les ventes dans les galeries et chez les antiquaires, sous l’influence des grandes maisons de vente, Sotheby’s et Christie’s. Le goût de certains collectionneurs très riches, au premier rang desquels figuraient les armateurs grecs, a accompagné le mouvement, en particulier pour la peinture impressionniste et ses suites. Le nombre annuel de tableaux passés en vente publique, de 1800 à 1970, a stagné entre 5.000 et 6.000. Depuis 1970, le chiffre est passé à 50.000 tableaux par an. Les techniques de vente utilisées par les auctioneers, Christie’s et Sotheby’s, ont favorisé ce développement : avances sur le produit de la vente, fixation d’un prix de réserve, garantie minimale de prix pour une œuvre ou un groupe d’œuvres, quel que soit le résultat de la vente, flexibilité des frais de commission. Le marché de l’art est devenu international. La concurrence est mondiale. Une compétition s’est ainsi instaurée entre les musées d’une part, les collectionneurs d’autre part, entre les premiers et les seconds enfin, pour obtenir une représentation exhaustive de l’histoire de l’art, y compris, et nous serions tentés de dire surtout, en matière d’art contemporain. Le marché de l’art consacré et le marché de l’art actuel sont fortement interdépendants. Au cours des années quatre-vingts, les prix ont connu une ascension très rapide et très forte, ce qui a conduit à multiplier les ventes et à accélérer les mouvements d’œuvres d’une place à l’autre, conduisant les grandes maisons de vente à monter les mises à prix. Le début des années quatre-vingt-dix a marqué celui de la crise. Sur la saison 1990-1991, le chiffre d’affaires de Sotheby’s baissait de 59 % par rapport à l’année précédente, celui de Christie’s chutait de 49 % et celui de l’hôtel Drouot de 43 %. Depuis, le marché s’est redressé, avant de connaître de nouveau des difficultés en liaison avec le retrait du marché des grands investisseurs asiatiques. Néanmoins, la tendance à la reprise se confirme, comme en témoignent les plus récentes enchères relatives à des tableaux impressionnistes. De fait, le marché américain reste vigoureux. À côté du grand marché international, reste le marché local ou national, qui est le plus étendu en termes de volume et de clientèle : il concerne des objets d’art dont le prix est inférieur aux coûts de transport et d’assurance afférents à leur exportation éventuelle. Il réunit, selon une analyse de Sotheby’s, à la fois les œuvres des artistes nationaux inconnus à l’étranger, et les œuvres d’intérêt local qui ne présentent pas d’intérêt à l’étranger pour différentes raisons comme la mode (pour certains types de meubles, par exemple), la langue (pour les livres, par exemple) ou le sujet (pour certains tableaux). Or, la France est caractérisée par l’existence d’un important marché local. b) La place du marché français de l’art La question est de savoir quelle a été l’évolution de la place du marché de l’art français dans l’ensemble de ces mouvements. Lors de la saison des ventes 1951-1952, Paris se situait au premier rang pour le montant global des affaires. Dix ans après, la première place revenait à Londres. L’acquisition, en 1964, de la firme new-yorkaise Parke Bernet par l’entreprise britannique Sotheby’s consolida la supériorité du marché anglo-saxon. L’écart s’est accru à partir des années soixante-dix, entre Paris d’une part, Londres et New York d’autre part, avec la très forte ascension des deux principales maisons de vente internationales, Sotheby’s et Christie’s, cependant que Monaco, Genève et Tokyo prenaient des parts importantes du marché. La structure des prix, aussi bien que l’évasion des œuvres à vendre, organisée par les grandes maisons de vente, reflètent ce phénomène. La place relative de la France au sein de l’ensemble européen s’est elle-même réduite. Le Royaume-Uni est le plus grand marché de l’Union européenne avec 48 % des ventes, suivi par la France avec 26 %, et l’Allemagne avec 7 %. De 1993-1994 à 1997-1998, la valeur des ventes réalisées a progressé de 50 % au Royaume-Uni et de 7 % en Allemagne, tandis qu’elle diminuait de 23 % en France. S’agissant des ventes aux enchères, le principal marché communautaire est, là aussi, le Royaume-Uni, avec 61 % des ventes de tableaux réalisées dans les États membres, suivi, loin derrière, par la France, avec 12 %, et l’Allemagne, avec 7 %. Sur la même période, les ventes ont augmenté de 51 % au Royaume-Uni et de 13 % en Allemagne, tandis que la France connaissait une baisse forte de 28 %. Les chiffres fournis par les services douaniers sur les importations et les exportations d’objets d’art, de collection ou d’antiquité montrent, entre 1995 et 1998, une accentuation du déséquilibre entre importations et exportations. Les importations représentaient, en valeur, environ 43 % du chiffre des exportations en 1995, et seulement 37 % en 1998. Sur la même période, les exportations ont augmenté en valeur de 30 %. Cette progression a atteint 54 % en direction des États-Unis. Les exportations en direction du Royaume-Uni ont été stables. Il conviendrait, à ce propos, d’améliorer l’information statistique sur l’activité des opérateurs, en particulier des négociants en antiquités. Le marché français n’a pas été ruiné, mais il s’est réduit par rapport au marché britannique et encore plus par rapport au marché américain. Le regain que le marché de l’art a connu en 1998, et qui se confirme en 1999, ne saurait masquer, sur moyen terme, l’affaiblissement de la place de Paris. Mais la cause du déclin français n’est pas d’origine purement fiscale. Outre la faiblesse de la demande intérieure, il convient de relever les problèmes d’organisation du marché de l’art en France. B.– UN MARCHÉ RÉORGANISÉ Depuis le milieu des années quatre-vingts, la nécessité d’une réorganisation du marché de l’art français s’est faite de plus en plus pressante. Le marché de l’art, et celui des ventes publiques en particulier, repose sur une organisation quasi antédiluvienne, centrée sur l’existence d’un monopole conféré aux commissaires-priseurs, ayant statut d’officier public et ministériel. Le rapport « Aicardi », en juillet 1995, notait que le monopole d’officiers ministériels était « radicalement inefficace à l’extérieur de nos frontières ». Plus loin les auteurs du rapport soulignaient que : « Le marché international est (…) dominé solidement par de grandes maisons d’origine britannique. Si certains professionnels français s’y sont taillés un rang et un rôle, ils le doivent exclusivement à leur compétence et à leur dynamisme, nullement à leur statut de commissaires-priseurs qui par sa nature même les prive des capitaux nécessaires à l’activité internationale » (). Il existe aujourd’hui 456 commissaires-priseurs, répartis en 9 compagnies régionales et 328 offices, employant environ 1.500 personnes, pour un chiffre d’affaires total de 10 milliards de francs. De fait, en comparaison, Christie’s ou Sotheby’s sont des entreprises capables de soutenir financièrement le vendeur et de produire une expertise globale. Elles font des ventes à thème. Elles font circuler l’œuvre en vente dans le monde entier : beaucoup plus d’acheteurs potentiels seront contactés. Ces maisons conservent l’œuvre et font des avances. Le commissaire-priseur français en général est tout seul ; ce manque de surface financière en relais fait que le marché français n’a pas encore permis à ces maisons de vente de s’établir. Le problème de l’organisation des professions françaises est fondamental. Devant les insuffisances du marché français, plusieurs rapports, après le premier rapport « Chandernagor » et le rapport « Aicardi », ont souligné la nécessité de prendre des mesures : c’est le cas du second rapport « Chandernagor », et également du récent rapport « Gaillard ».
La commission des Finances du Sénat s’est, dans le cadre de l’examen du projet de loi portant réforme des ventes aux enchères publiques, penchée sur la situation du marché de l’art français et a fait quelques propositions résumées ci-après.
La réforme de l’organisation du marché français, souhaitée par tous, a été, en partie, motivée par la législation européenne. En effet, la Commission des Communautés européennes avait adressé à la France une mise en demeure, le 10 mars 1995, pour qu’elle rende sa législation compatible avec les articles 59 et suivants du traité sur l’Union européenne relatifs à la libre prestation de services. Cette mise en demeure fut suivie d’un avis motivé adressé le 10 août 1998. Après une longue gestation, un projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a été déposé sur le bureau du Sénat, et discuté le 10 juin 1999. Un premier projet avait été déposé en avril 1997 sur le bureau de l’Assemblée nationale, que la dissolution de celle-ci avait rendu caduc. Le monopole des commissaires-priseurs, institué en 1556 par Henri II, prendra fin, permettant aux maisons de vente internationales d’opérer sur notre territoire. Le projet de loi prévoit la création d’un conseil des ventes volontaires aux enchères publiques, doté de la personnalité morale, chargé d’agréer les sociétés de ventes, de les contrôler et de les sanctionner le cas échéant. Ce conseil devra jouer le rôle d’une autorité indépendante de surveillance déontologique du marché, comparable au Conseil des bourses de valeurs. Les commissaires-priseurs pourront se constituer en sociétés commerciales susceptibles, par exemple, de s’ouvrir au marché financier. Ils conserveront le monopole des ventes judiciaires. Ils pourront, comme leurs homologues étrangers, réaliser des ventes de gré à gré à l’issue d’enchères infructueuses ou des avances au vendeur sur le prix d’adjudication. Passée la réorganisation de la place, il conviendra d’assurer aux artistes des conditions d’exercice de leur activité de manière plus satisfaisante. II.– LES ARTISTES : UN STATUT INCERTAIN Appréhender la situation sociale des artistes, c’est aborder la question de l’environnement de la création. Il existe différentes procédures d’identification et de recensement des artistes plasticiens. La revendication, l’attribution et l’homologation de la qualité d’artiste sont sources permanentes de luttes. Néanmoins l’existence de dispositions sociales et fiscales particulières tend à offrir quelques éléments stables de définition du statut de l’artiste. A.– UN STATUT FISCAL DÉROGATOIRE D’un point de vue fiscal, les artistes relèvent du régime applicable aux professions libérales, à quelques exceptions près : l’exonération de taxe professionnelle, l’application d’un taux réduit de TVA… L’article 182 C du code général des impôts permet aux auteurs d’œuvres de l’esprit (au sens de l’article 111-1 du code de la propriété intellectuelle) d’opter pour une retenue à la source de 15 % sur leurs revenus, cette retenue étant déductible des acomptes provisionnels de l’impôt sur le revenu. Il convient de noter, par ailleurs, que les principales professions de nature culturelle sont imposables aux bénéfices non commerciaux (artistes, peintres, sculpteurs, dessinateurs). En vertu de l’article 100 bis du code général des impôts, les bénéfices imposables provenant de la production artistique peuvent être, à la demande de l’artiste soumis au régime de la déclaration contrôlée, déterminés en retranchant de la moyenne des recettes de l’année de l’imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années. Comme ils l’avaient été des contributions de la patente, les artistes sont exonérés de la taxe professionnelle, en vertu de l’article 1460 du code général des impôts. Cette disposition s’applique dès lors qu’ils ne vendent que le produit de leur art. Elle est d’autant plus appréciable qu’une grande partie de la population des artistes dispose de revenus annuels inférieurs à 100.000 francs. D’autre part, les artistes bénéficient d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils vendent leur production (cf. infra). Mais, il est avéré que ce taux de TVA est prélevé sur les ressources mêmes de l’artiste. Lorsqu’il vend son œuvre à un marchand ou à un collectionneur, il intègre le montant de la TVA dans le prix qu’il propose. Et peu d’artistes travaillent avec des sociétés, solution qui leur permettrait de répercuter la TVA. C’est pourquoi votre rapporteur spécial tient à souligner le caractère relatif de cet « avantage » fiscal. B.– UN RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE PERFECTIBLE L’entrée des artistes dans le secteur protégé s’est faite en deux étapes. La loi n° 64-1338 du 26 décembre 1964 sur l’assurance maladie, maternité et décès des artistes concernait exclusivement les peintres, graveurs et sculpteurs, conformément aux catégories classiques des beaux-arts. Le critère retenu pour le droit de l’affiliation est d’ordre fiscal : l’artiste doit faire la preuve que plus de 50 % de ses revenus professionnels proviennent de la vente de ses œuvres et des droits accessoires de suite et de reproduction. La législation, prenant acte du déclin du système académique et de la prédominance du marché dans l’organisation de la vie artistique, accepte, comme critère univoque du droit à la protection sociale, le résultat des appréciations émises par le marché, marginalisant ainsi les exclus du succès commercial. Depuis la loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 relative à la sécurité sociale des artistes, auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, et en vertu de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, les artistes-auteurs d’œuvres graphiques et plastiques (), ainsi que photographiques, relèvent de manière obligatoire du régime général des salariés. Le principe du revenu comme critère de base de l’exercice professionnel, juridiquement imposé par l’affiliation au régime général de la sécurité sociale, ne pouvait pas ne pas être maintenu, mais les conditions ont été assouplies ; il n’est plus nécessaire de justifier d’au moins 50 % de revenus artistiques. Plusieurs particularités méritent cependant d’être relevées. Bien qu’assujettis au régime général, les artistes relèvent d’un organisme spécial, la Maison des Artistes, constituée sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901, agréée par arrêté interministériel du 30 mars 1978 pour la gestion des assurances sociales des artistes (article R. 382-6 du code de la sécurité sociale). L’affiliation à cet organisme est obligatoire. Les artistes-auteurs bénéficient des prestations en espèces et en nature de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, des prestations vieillesse et des prestations famille. En revanche, ils ne sont pas couverts par la législation sur les accidents du travail. Comme nous l’avons déjà évoqué, l’affiliation fait l’objet d’une particularité. En effet, en vertu de l’article R. 382-1 du code de la sécurité sociale, sont affiliés les artistes qui ont tiré, au cours d’une année civile, un revenu d’un montant au moins égal à 1.200 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance, soit, depuis le 1er juillet 1998, 48.264 francs. L’artiste qui ne remplit pas cette condition de ressources peut être affilié, s’il fait la preuve devant la commission compétente () qu’il a exercé une activité artistique durant les deux dernières années civiles. Le maintien de cette affiliation ne peut durer que cinq ans lorsque l’artiste a tiré, chaque année, de son activité un montant de ressources inférieur à 600 fois la valeur horaire moyenne du SMIC. Au-delà la radiation est automatique, ce qui ne laisse de poser des problèmes à certains artistes âgés, à moins que le directeur de la Maison des Artistes ou le médecin-conseil propose un prolongement exceptionnel de l’affiliation. Il serait sans doute souhaitable de supprimer le caractère automatique de la radiation. Le régime de sécurité sociale des artistes est financé par le biais de deux sources. La première est constituée par une cotisation personnelle des artistes, calculée au taux de la part salariale des cotisations maladie, veuvage et vieillesse du régime général. La deuxième est formée de la contribution des diffuseurs, c’est-à-dire à titre principal les galeries. Pour l’année 1996, 11.900 artistes bénéficiaient de la sécurité sociale. 1.411 commerces d’art ont été recensés et ont contribué pour une somme de 16,6 millions de francs au financement de la part employeur. 554 commerces acquittent une contribution comprise entre 10.000 et 3.000 francs. 310 acquittent une contribution supérieure à 10.000 francs. En conséquence, 310 galeries d’art ont payé pour 1996 l’équivalent de 12 millions de francs contre 4 millions de francs payés par 1.100 autres commerces, qui compte tenu de leurs chiffres d’affaires, sont des commerces mixtes. 310 galeries assurent à elles seules 72 % de la contribution totale de la sécurité sociale des artistes. À ce propos, il est regrettable que des non-professionnels, au premier rang desquels figurent certains restaurateurs, puissent vendre des œuvres d’art et venir concurrencer les galeries, sans opérer aucun choix esthétique ni prendre de risque, en se contentant d’offrir un lieu d’exposition et d’encaisser, le cas échéant, une partie du montant des ventes. Ce marché parallèle représenterait plus de 50 % des transactions effectuées en France. Dans ces conditions, votre rapporteur spécial estime qu’il serait utile de soumettre ces non-professionnels au paiement d’une contribution au régime de sécurité sociale en pourcentage du montant des ventes réalisées par l’artiste. La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), versées à la Maison des Artistes, sont assises sur une base identique à celle de la cotisation personnelle de sécurité sociale, sous réserve de la déduction forfaitaire de 5 % pour frais professionnels (). En vertu de l’article L. 382-7 du code de la sécurité sociale (), la Maison des Artistes exerce une action sociale en faveur de ses ressortissants, en vue de prendre en charge tout ou partie des cotisations dues par ceux qui connaissent des difficultés économiques, c’est-à-dire ayant un revenu annuel inférieur à 1.200 fois la valeur horaire moyenne du SMIC. Cette action sociale est financée par l’affectation d’une fraction de la contribution des diffuseurs et exploitants des œuvres originales des artistes concernés. Les écarts de cotisations entre artistes sont très importants. Certains artistes reconnus payent plusieurs millions de francs de cotisations sociales par an. Cet état de fait peut être dissuasif et inciter quelques artistes à s’installer à l’étranger. C’est pourquoi certains opérateurs ont émis l’idée d’un plafonnement des cotisations. Cette mesure pourrait cependant constituer une atteinte au système de redistribution au profit des artistes les moins favorisés. En outre, les artistes ne peuvent demander leur affiliation au régime qu’au bout d’un an d’activité. En conséquence, nombreux sont ceux qui demandent un alignement sur le régime commun des salariés pour lesquels la période minimale d’activité permettant une affiliation est limitée à trois mois. Enfin, il faut rappeler que les artistes, ainsi que leurs ayants droit, sont susceptibles de bénéficier d’un droit de suite sur la revente de leurs œuvres (cf. supra Chapitre II, V). En tout état de cause, la revendication exprimée par certaines organisations professionnelles de créer un statut législatif et réglementaire de créateur professionnel en arts graphiques, plastiques et photographiques se heurterait, dans la réalité, à la nécessaire souplesse de l’activité de création. Être artiste constitue une condition et non un statut. En effet, la diversité des situations, la pluralité des modes de diffusion, la nature même de la création artistique interdisent de faire entrer les artistes dans un cadre législatif, quand bien même l’appartenance à ce cadre commanderait de manière automatique l’application de dispositions fiscales ou sociales privilégiées. LAISSER CETTE PAGE BLANCHE SANS NUMÉROTATION CHAPITRE II la fiscalitÉ des œuvres d’art : Nous avons déjà souligné, à plusieurs reprises, combien le paysage de la fiscalité applicable au marché de l’art et aux œuvres d’art était compliqué et manquait de cohérence. Justifiées par le caractère spécifique du bien que constitue l’œuvre d’art, les exceptions au droit fiscal commun prévues dans le domaine culturel touchent aussi bien l’imposition des plus-values (taxe forfaitaire sur les objets précieux), les transactions (régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux ventes et importations d’œuvres d’art), le patrimoine (exclusion des œuvres d’art de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune), que les droits d’enregistrement (donations, dations) ou l’imposition des bénéfices (mécénat). Pour être complet et prendre en compte l’ensemble des charges pesant sur les opérateurs, il convient d’évoquer également le droit de suite, qui, s’il ne constitue pas à proprement parler une règle fiscale, s’impose comme une obligation légale ayant une traduction financière. I.– LA TAXE FORFAITAIRE SUR LES OBJETS PRÉCIEUX Représentative de la taxation de droit commun des plus-values, la taxe forfaitaire sur les objets d’art, de collection et d’antiquité constitue un élément bien identifié des charges afférentes au marché français de l’art. Elle est relativement simple dans son mécanisme. Elle mériterait cependant quelques aménagements, en particulier en ce qui concerne son taux. A.– L’ORIGINE DE LA TAXE : PALLIER LES DIFFICULTÉS D’ÉVALUATION La loi n° 76-660 du 16 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d’une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité, a institué un régime d’imposition généralisée des plus-values de cession de meubles ou d’immeubles réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. La taxe forfaitaire est représentative de cette imposition des plus-values à laquelle elle se substitue. Elle a été inspirée, à l’origine, par des motifs de commodité : il s’agissait d’éviter les difficultés liées à la justification de la date et du prix d’acquisition des objets vendus. Néanmoins, lorsque la vente porte sur des objets autres que les métaux précieux, le vendeur peut opter pour le régime d’imposition de droit commun des plus-values sur biens meubles sous réserve de pouvoir justifier des dates et prix d’acquisition. Cette taxe a trouvé également sa justification dans l’exonération de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dont bénéficie le détenteur d’objets d’art. Le lien entre l’exonération de l’assiette de l’ISF et l’existence de la taxe a été souligné, dès 1982, lors de l’adoption du principe d’exonération contenu dans la loi créant l’ISF, puisqu’il fut accompagné d’un doublement du taux de la taxe. En vertu de l’article 150 A du code général des impôts, le régime de droit commun soumet les plus-values sur biens meubles réalisées par les particuliers, personnes physiques et sociétés de personnes, à l’impôt sur le revenu, selon un régime sensiblement identique à celui prévu pour l’imposition des plus-values immobilières. B.– LE CHAMP D’APPLICATION : DES PROBLÈMES DE DÉFINITION Sont soumis à la taxe, en application des articles 150 V bis et suivants du code général des impôts, les particuliers qui vendent des métaux précieux quel que soit le montant de la vente, ainsi que des bijoux, des objets d’art, de collection ou d’antiquité, lorsque le prix de vente excède 20.000 francs. Il convient, d’ores et déjà, de relever que ce seuil n’a pas été actualisé depuis 1976. Votre Rapporteur propose de remonter ce seuil à 100.000 francs en vue d’adapter le dispositif, créé en 1976, au marché actuel. Sont assimilables aux ventes, conformément aux principes généraux du droit et de la jurisprudence, les échanges (à considérer comme des ventes croisées) et les apports, et conformément à une disposition expresse de la loi, les exportations, sous réserve du cas des exportations temporaires. Outre les métaux précieux, les objets soumis à la taxe sont les bijoux, les objets d’art, de collection ou d’antiquité. Ces catégories correspondent, en pratique, à ceux désignés par le tarif extérieur commun de la Communauté européenne dans les rubriques suivantes : tapis et tapisseries, bijoux (perles, diamants…, y compris l’or et l’argent travaillé), montres, bracelets, tableaux, peintures, gravures, estampes, lithographies originales, statues, sculptures, émaux, céramiques, timbres-poste, objets de collection (zoologiques, botaniques, minéralogiques, historiques, archéologiques, paléontologiques, ethnographiques, numismatiques, etc.), objets d’antiquité de plus de cent ans. S’agissant de ces définitions, il convient de faire quatre remarques. En premier lieu, seules les monnaies datant d’avant 1800 et celles qui sont vendues aux enchères publiques sont considérées comme des objets de collection. Les autres appartiennent aux rubriques des métaux précieux. En deuxième lieu, les meubles meublants s’ils ont plus de cent ans sont inclus parmi les objets d’antiquité. S’ils ont moins de cent ans et si leur prix excède 20.000 francs, la taxe n’est due que si le bien revêt le caractère d’objet de collection. En troisième lieu, les livres et manuscrits de moins de cent d’âge sont considérés comme des objets de collection, si leur valeur unitaire est supérieure à 20.000 francs. Enfin, d’une manière générale, le point de savoir si un bien constitue un objet de collection est une question de fait qui est appréciée par l’administration au cas par cas, sous le contrôle du juge de l’impôt. À cet égard, divers éléments peuvent être pris en considération : l’ancienneté, la rareté, l’importance de son prix qui doit excéder sensiblement la valeur du même bien destiné à un usage courant, l’arrêt de la fabrication du bien, la provenance ou la destination, l’intérêt historique qu’il présente, ou encore le fait qu’il ait appartenu à un personnage célèbre. La qualification d’objets de collection découle de l’application d’un ou plusieurs des critères ainsi définis. Ces derniers doivent également être remplis pour caractériser un véhicule de collection. Ainsi, l’ancienneté du véhicule vendu est un caractère suffisant sans être un élément nécessaire. De même, un véhicule, même récent, peut être considéré comme un objet de collection, dès lors qu’il présente l’une ou l’autre des caractéristiques susvisées. Lorsqu’elles ne constituent pas des véhicules de collection, les voitures automobiles sont expressément exclues de l’imposition des plus-values sur biens meubles (article 150 D 1° du code général des impôts). La limite de 20.000 francs s’applique à chaque vente. En pratique, il convient de l’apprécier objet par objet, sauf lorsque les objets vendus ou exportés forment un ensemble. La taxe est due en cas de vente réalisée en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne et en cas d’exportation, autre que temporaire, hors du territoire des États membres de la Communauté européenne. Elle est calculée sur le prix de vente, s’il s’agit d’une vente, ou sur la valeur en douane, s’il s’agit d’une exportation. Elle est réputée tenir compte, de manière forfaitaire, de l’ensemble des éléments qui concourent à la détermination d’une plus-value et, notamment, des charges supportées par le vendeur, telles que les commissions versées à des intermédiaires (antiquaires, galeries d’art, etc.). Pour les bijoux, objets d’art, de collection et d’antiquité, une décote est prévue lorsque le prix ou la valeur est compris entre 20.000 francs et 30.000 francs. La décote est égale à la différence entre 30.000 francs et le prix ou la valeur. Elle est déduite de la cotisation d’impôt brut. C.– LES TAUX : UNE HÉTÉROGÉNÉITÉ PEU JUSTIFIÉE Trois taux sont aujourd’hui applicables : · 7,5 % pour les métaux précieux ; · 4,5 % pour les bijoux, objets d’art, de collection et d’antiquité vendus aux enchères publiques réalisées en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne ; · 7 % pour les bijoux, objets d’art, de collection et d’antiquité vendus autrement qu’aux enchères publiques ou exportées. Enfin, il faut souligner que, depuis le 1er février 1996 et jusqu’au 31 janvier 2009, la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) () s’ajoute à ces taux, à hauteur de 0,5 % (articles 1600 OK et 1600 OL du code général des impôts). La différence de taux entre les ventes publiques et les autres types de ventes s’explique, à l’origine, par deux séries de considérations : les ventes publiques ont été privilégiées par les pouvoirs publics, un taux réduit leur a donc été appliqué ; en outre, les possibilités de fraude étant plus aisées en matière de ventes privées et les transactions pouvant présenter un moindre degré de transparence, les services fiscaux ont pu estimer opportun de compenser cette moindre fiabilité par un taux plus élevé. Or, aujourd’hui, le marché des ventes publiques va être réorganisé. Il n’est plus justifié d’opérer une différence entre des ventes organisées par des groupes multinationaux, qui bénéficieraient d’un taux réduit, et des ventes réalisées par des galeries ou des antiquaires, qui contribuent autant que les grandes maisons de vente à la vitalité du marché et au caractère attractif de la place de Paris. Il n’est plus fondé, non plus, d’estimer a priori que les ventes privées font l’objet d’une plus grande fraude. En effet, les professions d’antiquaire et de galeriste se sont organisées, et le marché français est devenu l’un des plus transparents. Dans ces conditions, votre rapporteur spécial se réjouit de l’unification à 4,5 % des taux proposée dans l’article 23 du présent projet de loi de finances, mesure dont le coût est estimé à 10 millions de francs. Par ailleurs, il estime qu’il serait utile que le seuil d’application de la taxe soit relevé de 20.000 francs à 100.000 francs. Il convient de faire en sorte que cette somme soit supérieure à la simple actualisation réalisée sur la base de la progression de l’indice des prix à la consommation, tel que calculé par l’OCDE (). La baisse du taux applicable aux galeries leur permettra de jouer à plein leur rôle de soutien à la jeune création : en effet, nombreuses sont les galeries qui peuvent soutenir de jeunes artistes grâce aux excédents de trésorerie qu’elles dégagent de la vente d’œuvres d’artistes reconnus acquises de seconde main. D.– LE PAIEMENT ET LE RECOUVREMENT DE LA TAXE Selon qu’il s’agit d’une vente ou d’une exportation, la taxe est supportée par le vendeur ou l’exportateur. Toutefois, les responsables du versement de la taxe au Trésor sont, en vertu des articles 150 V ter et quater du code général des impôts : · en cas de vente en France, soit l’intermédiaire (courtier, commissaire-priseur, antiquaire, bijoutier) participant à la transaction s’il y en a un, soit l’acheteur (particulier ou professionnel), à défaut d’intermédiaire ; · en cas de vente dans un autre État membre de la Communauté européenne, le vendeur ; · en cas d’exportation, l’exportateur. Le versement de la taxe, conformément à l’article 382 bis E de l’annexe II du code général des impôts, est opéré selon quatre modes différents, selon la nature de la transaction ou la qualité des intervenants. Il est réalisé à la recette des impôts compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d’affaires, si la taxe forfaitaire est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle. Il se fait à la recette des impôts dont relève le domicile de l’acheteur et dans les trente jours, en cas d’achat direct par un particulier, ou à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre État membre de la Communauté européenne. Enfin, il s’effectue à la recette des douanes s’il s’agit d’une exportation. En cas de vente, le versement est accompagné d’une déclaration qui mentionne la nature de l’objet, la date de la vente et le prix de vente. Le recouvrement de la taxe s’opère sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière de taxes sur le chiffre d’affaires pour les ventes et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière douanière pour les exportations (article 1770 octies et annexe II de l’article 383 bis E du code général des impôts). De même, la procédure applicable aux réclamations est celle des taxes sur le chiffre d’affaires ou celle des droits de douane, suivant le comptable compétent. E.– LES EXONÉRATIONS ET L’OPTION POUR LE RÉGIME DES PLUS-VALUES SUR BIENS MEUBLES Certaines personnes sont exonérées du paiement de la taxe forfaitaire. Il s’agit des entreprises industrielles et commerciales qui vendent des métaux ou objets précieux, des personnes qui n’ont pas de résidence habituelle en France et qui exportent un objet précieux ou qui, après avoir acquitté, le cas échéant, les droits de douane, cèdent un objet précieux au cours d’une vente aux enchères publiques. Ce sont enfin les artistes qui vendent ou exportent leurs propres œuvres, à condition d’en avoir conservé la propriété depuis leur création. Pour ces derniers, le profit réalisé constitue un bénéfice professionnel imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En revanche, en cas de vente ou d’exportation par l’artiste d’une œuvre qu’il avait au préalable cédée puis rachetée, la vente ou l’exportation entre dans le champ d’application de la taxe et éventuellement des exonérations (exportations temporaires, artiste n’ayant pas en France son domicile fiscal, entreprises industrielles et commerciales…). Par ailleurs, l’exonération est étendue à certaines opérations (articles 150 V bis II et V quater), à savoir les cessions aux musées nationaux, aux bibliothèques publiques ainsi qu’aux services d’archives de l’État, d’une collectivité locale ou d’une collectivité publique française, et certaines dations d’œuvres d’art en paiement de droits de succession sur agrément (article 1716 bis du code général des impôts). Cette exonération constitue un élément important d’incitation des collectionneurs à vendre à l’État. Sont exonérées également les exportations temporaires d’objets précieux d’une valeur unitaire supérieure à 20.000 francs. Ainsi qu’il a été mentionné supra, les personnes physiques ou sociétés de personnes qui résident en France peuvent opter pour le régime de droit commun des plus-values sur biens meubles lorsque, à l’exclusion des métaux précieux, elles cèdent ou exportent des bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité, et qu’elles sont en mesure d’établir, de manière certaine, les dates et prix d’acquisition. La plus-value est alors déterminée suivant les règles prévues aux articles 150 A et suivants du code général des impôts. Elle est calculée par différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition. Pour les biens cédés au-delà d’un an de détention, il est tenu compte de l’érosion monétaire et de la durée de détention (abattement de 5 % par année de détention au-delà de la première). La plus-value est ainsi exonérée à l’expiration d’un délai de détention de vingt et un ans. Cette option n’est pas possible pour les ventes de métaux précieux. En résumé, le vendeur aura intérêt à faire jouer l’option si, depuis la dernière acquisition, la valeur de l’objet n’a pas suivi l’augmentation générale des prix et si la durée écoulée depuis la dernière acquisition est trop brève pour qu’une plus-value substantielle ait pu se former. F.– LE PRODUIT BUDGÉTAIRE DE LA TAXE : UN RENDEMENT IMPORTANT CONCENTRÉ SUR LES MÉTAUX PRÉCIEUX Le produit budgétaire de la taxe a été de 255 millions de francs en 1992, 291 millions de francs en 1993, 272 millions de francs en 1994, 237 millions de francs en 1995, 270 millions de francs en 1996 et 268 millions de francs en 1997.
En conclusion, votre rapporteur spécial souhaiterait souligner que, si pour éviter les distorsions sur les conditions de ventes de métaux précieux entre la France et Monaco, une taxe forfaitaire a été instituée dans la législation monégasque, elle ne concerne pas les ventes d’objets précieux, ce qui constitue, compte tenu de la vitalité du marché monégasque, un handicap pour le marché français. Néanmoins, dans la mesure où les non-résidents ne sont pas assujettis à cette taxe, elle ne constitue pas une atteinte au rayonnement international du marché de l’art français. Une harmonisation de ses taux serait pourtant souhaitable. Rien ne justifie, à l’heure où une réorganisation du marché s’opère, que les ventes aux enchères publiques soient traitées de manière différente des autres ventes. Le système de la taxe forfaitaire ne doit pas être remis en cause, et ce d’autant moins que la taxation de la plus-value peut atteindre, par exemple, près de 40 % au Royaume-Uni. II.– LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE En principe, en matière de prestations de services, la plupart des activités ou transactions culturelles réalisées en France y sont imposables. Ce qui compte, c’est le lieu où elles sont matériellement exécutées. Ainsi, sont imposables les prestations réalisées à l’occasion des foires, salons, expositions et des opérations d’expertise portant sur les biens meubles situés en France. Néanmoins, des règles particulières sont prévues, en matière de TVA, à l’égard des opérations portant sur les biens d’occasion, œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité. Ces règles sont inscrites dans les articles 297 A à 297 F du code général des impôts (), qui reprennent en droit interne le dispositif de la septième directive du Conseil (), entrée en vigueur le 1er janvier 1995. Les biens d’occasion, œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité suivent le même régime, avec toutefois quelques particularités sur les œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité. Il est à noter que leur vente par de simples particuliers n’est pas imposable, dès lors qu’elle ne constitue pas une activité économique. Sont également exonérés de TVA les objets d’art, de collection et d’antiquité importés par les établissements agréés par le ministre chargé des affaires culturelles (). A.– LES BIENS VISÉS La première catégorie est constituée des œuvres d’art. En vertu du paragraphe II de l’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts (), cette catégorie comprend les tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l’artiste, à l’exclusion des dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtre, fond d’ateliers ou usages analogues. Elle inclut également les gravures, estampes, et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste quelle que soit la technique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique. Les productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture en toutes matières, dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l’artiste, et les fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires contrôlés par l’artiste ou ses ayants droit, font également partie des œuvres d’art au sens fiscal du terme. S’y ajoutent les tapisseries et textiles muraux faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu’il n’existe pas plus de huit exemplaires de chacun d’eux, de même que les exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l’artiste et signés par lui, et les émaux sur cuivre entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art. Enfin, et cette catégorie tend à prendre une place de plus en plus importante sur le marché de l’art comme l’ont montré les transactions réalisées lors de la dernière foire de Bâle, sont comprises comme des œuvres d’art les photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. Les objets de collection, tels que définis par l’article 3 du décret 17 février 1995, entrent également dans le cadre de la septième directive. Il s’agit des timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés, mais n’ayant pas cours et n’étant pas destinés à avoir cours, ainsi que des collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique. Les objets de collection qui constituent des biens neufs ne sont pas concernés. Enfin, les objets d’antiquité sont les biens autres que les œuvres d’art et objets de collection ayant plus de cent ans d’âge. Les pendules, bronzes, et vases ne sont pas compris dans les biens pouvant bénéficier d’un régime particulier de TVA. B.– UNE IMPOSITION SUR LA MARGE Le système de marge est ancien en France. Il a été progressivement étendu à toute l’Europe. En effet, aujourd’hui, le système TVA est harmonisé et le régime français actuel découle d’un accord européen. 1.– Le système actuel a fait l’objet d’une longue gestation Courant 1992, les partenaires européens, sous présidence portugaise, sont parvenus à une définition d’un régime, après dix-sept ans de négociations, commencées en 1978 et marquées par l’opposition quasi continue du Royaume-Uni. L’élaboration de la septième directive a été amorcée dès l’adoption de la sixième directive du 17 mai 1977 d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires. Elle a donné lieu à un véritable feuilleton fiscal à multiples rebondissements, les diverses parties concernées, essentiellement la France et le Royaume-Uni, faisant régulièrement monter les enchères, notamment sous la pression des opérateurs nationaux concernés. Ainsi, un premier projet de septième directive a été présenté par la Commission le 11 juillet 1978. Pendant près de dix ans, les débats autour de ce texte ont mis en évidence les divergences entre États membres. Pour l’essentiel, ceux-ci se distinguaient entre partisans de la taxation sur la marge et partisans de la taxation sur le prix total. Cette première mouture a été finalement retirée en 1987, la Commission présentant, début 1989, un nouveau projet. Prenant en compte l’objectif de suppression des frontières fiscales, celui-ci reposait sur le principe de la marge pour les objets d’occasion, œuvres d’art et biens d’antiquité ou de collection. En outre, les objets d’art bénéficiaient d’un régime tout à fait particulier destiné à tenir compte de la spécificité des opérations portant sur ce type de biens dans la Communauté, en particulier les ventes publiques, reposant sur l’exonération des importations et la taxation des exportations. Curieusement, cette dernière disposition, qui satisfaisait la délégation britannique, avait reçu un accueil plus que réservé dans les autres États membres, en particulier en France (). Ce projet a permis de relancer le débat, l’attention des délégations étant focalisée sur l’élaboration de ce qui allait devenir la directive du 16 décembre 1991 organisant le régime général intracommunautaire transitoire. Ce n’est qu’à la fin de l’année 1992 qu’un accord a pu être trouvé sur la base de la taxation sur la marge et de l’imposition dans le pays de départ. Parallèlement, certains régimes spécifiques ont fait l’objet d’un accord de principe, qu’il s’agisse de l’application d’un taux réduit à l’importation et aux livraisons par l’artiste ou du dispositif applicable aux ventes publiques. Pendant un an, les négociations se sont cristallisées sur la question du régime des importations, la délégation britannique, contre l’avis général, maintenant sa préférence pour une exonération. En définitive, l’accord s’est réalisé autour d’un compromis, le Royaume-Uni rejoignant le principe de la taxation à l’importation moyennant la possibilité d’appliquer un taux « super-réduit » pendant une période transitoire (). 2.– L’œuvre d’art n’est pas un bien comme un autre En principe, les transactions sur l’objet d’art doivent être soumises à la TVA. Les objets d’art présentent néanmoins certaines particularités qui ont nécessité d’aménager le système TVA qui leur est applicable. En effet, traditionnellement, la TVA est un impôt sur des objets qui se consomment. Or, les objets d’art se transmettent, mais ne se consomment pas. Toute la difficulté était de mettre en place un régime communautaire qui puisse prendre en compte l’ensemble des transactions : opération réalisée par des antiquaires, des marchands d’art, entre particuliers, entre un particulier et un marchand, avec vente publique ou non... Si le régime normal de TVA était appliqué, le marché serait bloqué. En effet, un bien ordinaire soumis à la TVA est consommé et disparaît. L’œuvre d’art, par définition, peut passer, de main en main, sur très longue période. Par exemple, un particulier achète un tableau avec 20,6 % de TVA. Lorsqu’il souhaite revendre, il peut avoir la volonté de récupérer l’ensemble des droits payés, y compris la TVA facturée par le marchand. Or, le particulier n’est pas un assujetti et ne peut facturer la TVA au marchand. Si le marchand tente de revendre le même objet d’art, il va revendre avec une TVA : la TVA nouvelle va s’appliquer sur un prix qui comprenait déjà une part de TVA, d’où un empilement successif de droits indirects et un risque d’explosion du marché de l’art, occultant la valeur initiale de l’objet. Compte tenu de ces éléments, il était nécessaire d’envisager un régime particulier pour ces biens qui ont pour caractéristique d’avoir une durée de vie extrêmement longue. Le régime des œuvres d’art rejoint de ce fait le régime des biens d’occasion, semi-durables (automobiles), qui sont susceptibles d’échanges successifs et font des va-et-vient entre les assujettis et les particuliers, qui ne peuvent facturer la TVA. Il s’agissait de trouver un système qui permette de faire porter la TVA sur les transactions (valeur ajoutée spéculative de l’échange) et sur sa valeur ajoutée (restauration éventuelle), plutôt que sur l’œuvre elle-même. 3.– Le système de la marge permet de prendre en compte la nature spécifique de l’œuvre d’art Le principe auquel les négociations européennes sont parvenues est le suivant : la TVA peut s’appliquer sur la marge (article 297 A du code général des impôts) ; en contrepartie, ce système exclut toute déduction de la TVA afférente à l’achat, l’acquisition intracommunautaire () ou l’importation des biens. Seule peut être déduite la TVA portant sur les éléments qui ont grevé le coût de l’intervention du négociateur, telles les matières utilisées pour la remise en état du bien (). Ce système est réservé aux ventes réalisées par des « assujettis revendeurs ». Il s’agit des assujettis qui achètent en vue de les revendre des œuvres d’art, des biens de collection ou d’antiquité : antiquaires, brocanteurs, galeristes, négociants en timbres-poste ou monnaies anciennes, etc. Les commissionnaires agissant en leur nom propre pour le compte d’autrui, qui s’entremettent dans une opération portant sur des œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité, suivent le même régime que les assujettis revendeurs. Entrent dans cette catégorie, en général, les officiers ministériels qui procèdent à des ventes aux enchères publiques. Par exemple, un antiquaire achète un tableau 100. S’il le revend 150, alors la liquidation de la TVA s’appliquera sur 50, soit la différence entre prix d’achat et prix de vente : cette marge représente l’attrait du marché. En cas de revente à perte, la TVA ne s’applique pas. Les marchands sont soumis à des obligations de livres d’achat (tenue d’un « livre de police »), des obligations comptables : la fiabilité des informations est difficile à évaluer ; lorsque les œuvres sont anciennes et pistées, la fiabilité est beaucoup plus grande. Le taux qui s’applique est le taux normal, soit 20,6 %. Le principal problème à résoudre est celui de l’entrée sur le marché d’œuvres d’art nouvelles. Faut-il appliquer le taux normal à l’œuvre d’art ? Pour raisonner de manière satisfaisante, il convient de se référer à la charge fiscale globale pesant sur l’œuvre d’art. Avec la TVA sur la marge, le poids global est plus faible. D’après les enquêtes, grosso modo, en moyenne, le marchand d’art peut obtenir une marge de 30 %. Lorsqu’on applique le taux normal à une marge de 30 %, on arrive globalement à une charge fiscale de 6,18 %, ce qui met les marchands français dans la moyenne des pays concurrents, hors Union européenne (6,5 % en Suisse, 8,5 % de sales tax à New York). Il faut que l’œuvre d’art nouvelle (production de l’artiste, première entrée dans l’espace communautaire) ne supporte pas une charge fiscale supérieure à cette charge moyenne sur le marché. Enfin, il convient de relever que la TVA sur les ventes n’est due que par les résidents européens et non par les acheteurs des pays tiers. Dès lors que ceux-ci, comme c’est le cas pour les résidents aux États-Unis n’ont pas à payer de TVA à l’importation dans leur pays, l’achat en Europe et notamment en France est pour eux, de ce point de vue, attractif. 4.– Le régime des ventes aux enchères publiques reprend le régime particulier de la marge bénéficiaire Les ventes aux enchères publiques sont effectuées par un officier ministériel (commissaire-priseur le plus souvent) qui intervient en qualité d’intermédiaire à la vente. Le commissaire-priseur propose le bien aux enchères publiques pour le compte de son commettant et il remet le bien, toujours pour le compte de son commettant, au mieux-disant des enchérisseurs. Le plus souvent, le commissaire-priseur agit en son nom propre. Il est donc réputé, pour l’application de la TVA, avoir personnellement acquis les biens qu’il propose à la vente aux enchères de son commettant et revendu ces biens à un tiers acquéreur. Chacune des opérations suit un régime fiscal propre. Soit le commettant n’est pas redevable de la TVA (particulier, personne morale non assujettie) ou est assujetti à la TVA, mais n’est pas autorisé à facturer la taxe (cas des assujettis bénéficiant de la franchise en base, des assujettis revendeurs soumis au régime de la marge), et alors la vente publique est soumise à la taxation sur la marge bénéficiaire du commissaire-priseur. Soit le commettant est un assujetti à la TVA qui a exercé son droit à déduction sur le bien vendu, alors la vente publique est soumise, en principe, à la TVA sur le prix de vente total. Dans ce cas, le commissaire-priseur peut exercer une option pour soumettre ses propres livraisons au régime de la marge et renoncer à son droit à déduction (article 297 B du code général des impôts). Il peut arriver que l’intermédiaire agisse au nom et pour le compte d’autrui. Dans cette situation, le commissaire-priseur n’est taxé que sur sa rémunération en tant que prestataire de services, et la vente est soumise ou non à la TVA selon la qualité du commettant. Si celui-ci est un particulier, la vente publique est hors du champ de la TVA ; mais, en contrepartie, la transaction donne lieu en principe à la perception de droits d’enregistrement au taux de 1,10 % (article 733 du code général des impôts). La livraison qui intervient entre le commettant et le commissaire-priseur est considérée comme effectuée au moment où la vente aux enchères publiques est elle-même effectuée (quatrième alinéa de l’article 269 du code général des impôts). Les livraisons de biens à destination de personnes situées en France ou établies dans un autre État membre de la Communauté européenne peuvent être soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire. Lorsque les livraisons sont destinées à des acquéreurs situés hors de la Communauté européenne, elles sont exonérées de la TVA au titre de l’article 262 du code général des impôts (régime de droit commun). Les commissaires-priseurs, prestataires de services, soumettent leurs prestations au taux de TVA sur la commission qu’ils perçoivent. Cette commission est, essentiellement, la marge imposable constituée de la différence entre le prix total payé par l’adjudicataire des biens et le montant net payé par le commissaire-priseur à son commettant. Le prix total payé par l’adjudicataire est le prix d’adjudication des biens, augmenté des impôts, droits, prélèvements et autres taxes dus au titre de cette opération, et des frais accessoires, demandés par le commissaire-priseur à l’acquéreur des biens. Cette marge atteint 9 % en moyenne. Ainsi le taux normal de 20,6 % est liquidé sur ces 9 %. 5.– L’option pour l’imposition sur le prix de vente total est toujours possible En vertu de l’article 297 C du code général des impôts, pour chaque livraison d’œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité relevant normalement du régime de la marge, les assujettis revendeurs peuvent appliquer le régime général de la TVA, c’est-à-dire appliquer la TVA sur le prix de vente total, sous réserve des exonérations accordées lorsque les conditions sont réunies pour les livraisons intracommunautaires et les exportations. Cette option s’exerce sans formalité particulière, opération par opération. Elle ouvre droit pour l’assujetti revendeur à la déduction de la TVA ayant grevé les biens en cause. 6.– L’application d’un taux réduit vient compléter la spécificité du régime fiscal de certaines œuvres d’art ù Les artistes bénéficient d’un taux réduit et d’une franchise de base. On peut rappeler qu’avant le 1er octobre 1991, étaient exonérés de TVA les auteurs d’œuvres de l’esprit lorsqu’ils pratiquaient des ventes desdites œuvres dans le cadre d’une activité libérale ou fournissaient à ce titre des prestations de service. Cette disposition a été abrogée dans le cadre de la politique européenne d’harmonisation fiscale. Désormais, ces ventes sont soumises à la TVA. Les livraisons d’œuvres d’art effectuées par les artistes, définis comme auteurs d’œuvres de l’esprit (), et par leurs ayants droit, sont imposables à la TVA au taux réduit de 5,5 %. Ce taux réduit est également applicable aux cessions des droits reconnus aux auteurs des œuvres. Mais, les artistes sont susceptibles de bénéficier de la franchise en base prévue pour les auteurs d’œuvres de l’esprit (article 293 B du code général des impôts). Cette franchise de TVA dispense les artistes de la déclaration et du paiement de la TVA. En contrepartie, ils ne peuvent pratiquer aucune déduction de TVA, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures. Cette franchise s’applique aux artistes qui n’ont pas réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires supérieur à 245.000 francs hors taxes. ù Les livres bénéficient de l’application du taux réduit en vertu du 6° de l’article 278 bis du code général des impôts. ù Les acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art en France qui ont fait l’objet d’une livraison dans un autre État membre par d’autres assujettis que les assujettis revendeurs sont également soumises au taux réduit. Il s’agit des livraisons effectuées dans un autre État membre par un artiste ou un ayant droit, non exonéré de TVA, ou par un assujetti à la TVA pour lequel l’œuvre d’art avait le caractère d’immobilisation. ù Le taux réduit est applicable, en outre, aux livraisons d’œuvres d’art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations ou chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la TVA. Il s’agit des cessions d’œuvres d’art effectuées par des entreprises qui les ont acquises ou importées dans le cadre du mécénat. ù Sont également soumises au taux réduit les importations. C.– LES PARTICULARITÉS DE LA TVA À L’IMPORTATION Le régime de la TVA des œuvres d’art à l’importation se caractérise par la possibilité d’appliquer un taux réduit, et par la naissance, avec la fin de l’exception britannique au 30 juin 1999, d’un régime européen totalement harmonisé. 1.– L’application d’un taux réduit La septième directive – adoptée rappelons-le après presque vingt ans de discussion –, lorsqu’elle a généralisé la TVA à l’importation à l’intérieur de l’Union européenne en même temps que la TVA sur les ventes, a prévu une mesure de faveur pour les objets d’art : les États membres sont autorisés à appliquer à ceux de ces objets qui sont définis par la directive, un taux réduit qui ne peut être inférieur à 5 % et qui est applicable à la marge. Ainsi, en France, les importations d’œuvres d’art bénéficient du taux réduit de TVA, soit 5,5 %, quelle que soit la qualité de l’importateur (article 278 septies du code général des impôts). Il en est de même des acquisitions intercommunautaires, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie, d’œuvres d’art importées sur le territoire d’un autre État membre. Telle quelle, cette TVA à l’importation des objets d’art est à l’origine d’importantes distorsions de concurrence qui pénalisent le marché français par rapport à ses principaux rivaux. En premier lieu, certains objets – la plupart des bijoux, manuscrits et meubles de moins de cent ans d’âge – n’entrent dans aucune des définitions prévues par la directive et sont donc exclus du bénéfice du taux réduit, subissant alors une TVA à 20,6 %. Cet état de fait a pu nuire au marché français, à l’exemple du marché des bijoux qui s’est largement délocalisé vers la Suisse, et Genève en particulier, où s’applique un taux de 6,6 %. En deuxième lieu, la Grande-Bretagne bénéficie d’un régime dérogatoire. En effet, elle a, pendant longtemps, exonéré de TVA les œuvres produites avant le 1er avril 1973, date de son entrée dans le Marché commun, mais taxait au taux de 17,5 % les œuvres produites après le 1er avril 1973 (). Avec un marché très puissant et relais linguistique des États-Unis, les Britanniques ont refusé d’entrer dans le système européen. Ils ont bloqué la négociation pendant dix-sept ans. Un compromis a été obtenu : le Royaume-Uni a pu appliquer un taux de 2,5 % à l’importation d’œuvres antérieures au 1er avril 1973, cette exception étant valable jusqu’au 30 juin 1999. Par ailleurs, s’agissant de la taxation des ventes, l’Allemagne a obtenu une dérogation lui permettant d’appliquer, jusqu’au 30 juin 1999, un taux réduit de 7 % sur la valeur entière des biens vendus par des revendeurs assujettis allemands. Dans les faits, ils l’ont peu utilisé. Cependant, de nombreux marchands d’art estiment qu’en matière numismatique, notamment, cette dérogation a été préjudiciable au développement du marché français. Enfin, et c’est sans doute ce point qui pose aujourd’hui le plus de problème, les États-Unis et le Japon n’ont aucune TVA à l’importation. 2.– La mise en place d’un marché européen harmonisé L’exception britannique, dans une moindre mesure la dérogation dont bénéficient les galeristes allemands, fait l’objet, de la part de tous les intervenants du marché français, de vives critiques. Elle a pu contribuer à la délocalisation d’une partie du marché de Paris vers Londres ou l’Allemagne. Néanmoins, il semble que ces dérogations n’aient pas créé de distorsions de concurrence significatives. D’une part, s’agissant des œuvres d’art provenant de pays tiers, vendues aux enchères en Europe à destination d’acquéreurs également établis dans des pays tiers, les différentiels de taux de TVA à l’importation entre la France et le Royaume-Uni ne jouent pas dès lors que ces opérations sont réalisées en exonération de taxe sous le régime de l’admission temporaire (article 291.I.2.b du code général des impôts). L’application, en Allemagne, du taux réduit sur le prix total ne semble ni plus ni moins favorable que l’application du taux normal sur une base de 30 % comme c’est le plus souvent le cas en France, si ce n’est qu’outre-Rhin le revendeur assujetti peut récupérer la TVA que le vendeur, s’il est assujetti, lui a facturée. Si ces dérogations n’ont pu avoir des effets que de manière subsidiaire, elles étaient, en tout état de cause, temporaires. En effet, la septième directive prévoit que l’ensemble des États membres appliqueront un taux au moins égal à 5 % après le 30 juin 1999. La Commission devait remettre au Conseil, avant le 31 décembre 1998, un rapport sur l’impact de la septième directive sur la compétitivité du marché de l’art communautaire par rapport à celui des pays tiers. La Commission vient de publier son rapport () dans lequel elle explique comment elle apprécie le fonctionnement de ce mécanisme : le marché de l’art a explosé depuis 1993, ce qui tendrait à prouver que l’institution de la TVA n’a pas été un obstacle au développement des transactions. Elle prend l’exemple des États-Unis, qui n’ont pas de TVA, mais des taxes à la vente. Le marché de New York est le principal marché, malgré l’existence d’une sales tax de 8,5 %. Pour qu’il soit plus avantageux d’acheter à New York qu’en Europe, malgré la taxe sur les ventes, il faut que le bénéfice à New York soit approximativement de 50 %. Le rapport de la Commission montre que le marché anglais s’est décuplé malgré la nouvelle taxe de 2,5 % à l’importation et a progressé plus que le marché mondial. À l’inverse, un rapport britannique récent () affirmait que le marché de l’art en Grande-Bretagne avait perdu 45 % de son activité au profit des États-Unis et de la Suisse depuis l’instauration d’une TVA à l’importation. Néanmoins, la Commission, dans une décision en date du 28 avril 1999, n’a pas jugé utile de prolonger le régime dérogatoire britannique au-delà du 30 juin 1999 et l’ensemble des pays de la Communauté devront appliquer le même taux de TVA à l’importation, ce qui supprimerait toute distorsion interne en Europe en matière de TVA. 3.– Le produit budgétaire de la TVA à l’importation est faible La taxe rapporte en moyenne annuelle environ 40 millions de francs au budget de l’État. L’importance du produit budgétaire d’un impôt, aussi faible soit-elle, ne saurait remettre en cause la légitimité du prélèvement. D.– DES LOGIQUES DIFFÉRENTES Sur le marché de l’art, de nombreuses logiques s’affrontent. La logique de l’antiquaire repose sur le grand fonds du marché de l’art français, allant du XVIIIème siècle jusqu’à l’« Art déco ». C’est une logique de circulation : il faut que le marché soit fluide, que les échanges se fassent facilement. Le système de la marge est particulièrement bien adapté à ce marché. La logique du galeriste est fondée essentiellement sur l’art contemporain. Son objectif est de faire entrer des objets sur le marché, de faire des paris sur un artiste, de le faire vendre et de soutenir sa cote. Pour ce faire, il investit, loue un studio à l’artiste, lui offre un soutien financier régulier, sur la base, le plus souvent, d’un contrat sur deux ans qui garantit au galeriste la propriété de la production de l’artiste. Pour un galeriste qui essaie de promouvoir un jeune artiste, s’il réalise un bon prix de vente, la marge est importante et peut atteindre jusqu’à 60-70 %. Cette marge correspond parfois à des frais engagés, ramenant la marge réelle à des niveaux inférieurs. Lorsque le marchand est vraiment engagé dans une opération de promotion (édition d’affiches, catalogues, cartons d’invitation, location de stand dans des foires internationales, etc.), il est admis que l’ensemble des œuvres a permis de réaliser une marge forfaitaire de 30 %. De la même façon, a été admis un assouplissement sur les ventes d’œuvres invendues et restées en stock depuis plus de six ans () : dans ce cas, le régime déclaratif de la marge forfaitaire est applicable. Cependant, les galeristes tendent à demander l’application du taux réduit de TVA sur le prix total, selon une logique de mise sur le marché. Lorsque l’œuvre est importée ou mise sur le marché par un artiste assujetti, une TVA est facturée en amont au taux de 5,5 %. La galerie va revendre cette œuvre sur sa marge au taux normal, sans pouvoir déduire les 5,5 % qui lui ont été facturés. Cependant, instituer un taux réduit sur le prix total assorti d’un droit à déduction lorsque l’achat par la galerie a fait l’objet d’une facturation de TVA (vente par un artiste assujetti ou bien œuvre importée) introduirait un nouveau régime dans un système dont nous avons pu déjà constater l’extrême complexité. Le système de la marge est un bon compromis, qui permet de concilier, dans la mesure du possible, les logiques de l’antiquaire et du galeriste. Dès lors que le régime allemand est aligné sur le régime européen et que la dérogation dont il bénéficiait tombe au 30 juin 1999, il est possible de considérer comme satisfaisant le dispositif actuel.
Enfin, il convient de mentionner la logique des collectionneurs et des musées, fondée sur l’accumulation ; il faut défendre le patrimoine ; tout ce qui sort est un appauvrissement, à tel point qu’en Europe, certains défendaient une logique inverse au système mis en place : taxer à l’exportation, exonérer à l’importation pour enrichir le patrimoine. La circulation des œuvres reste très importante, même si les États-Unis restent le centre du marché. Certaines œuvres semblent aujourd’hui revenir en Europe. De fait, les TVA répondent encore à des logiques budgétaires nationales, d’où des complications inhérentes à ce système (exemple d’un antiquaire français vendant en Allemagne qui doit liquider en Allemagne). Une harmonisation des taux applicables en Europe faciliterait l’homogénéisation des conditions de concurrence sur le marché de l’art. Il semble que la négociation européenne se focalisant sur la fiscalité directe, dans le cadre du « paquet Monti » (du nom du commissaire responsable du dossier), a marqué le pas en matière de fiscalité indirecte, et notamment en matière de TVA, alors même que le taux normal de taxation, fixé par la sixième directive, est applicable jusqu’au 31 décembre 2000. Parallèlement, le nouveau système commun de TVA, adopté en juillet 1996 par le Conseil européen, et qui devait entrer en vigueur à la fin de l’année 1999 sur la base d’une taxation à l’origine afin d’assurer un espace communautaire cohérent, reste dans sa phase préparatoire. Compte tenu des éléments qui précède et, notamment, de l’harmonisation, au 30 juin 1999, du système de la TVA sur les œuvres d’art au sein de l’Union européenne, votre rapporteur spécial estime inutile et dommageable de modifier le système actuel, sous peine de créer de nouvelles incertitudes fiscales, à l’heure où la pérennisation des dispositifs fiscaux apparaît comme la condition sine qua non de la stabilité de l’environnement économique des différents opérateurs. III.– L’IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE Avant d’aborder la question de l’inclusion ou de l’exclusion des œuvres d’art dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), votre rapporteur spécial souhaiterait présenter le dispositif actuel. A.– LE DISPOSITIF ACTUEL L’impôt sur la fortune constitue à la fois un moyen de discrimination des revenus, un moyen d’appréhension des facultés contributives et enfin un moyen de contrôle des autres impôts. Le régime actuel de l’ISF permet de répondre à ces trois fondements. 1.– Les fondements de l’impôt sur la fortune En effet, il autorise une surimposition des revenus du capital, doublement frappés par l’impôt sur le revenu et l’impôt sur le capital. Cette surimposition se justifie par le fait que le détenteur de capital se trouve dans une situation plus avantageuse que celui qui perçoit seulement un revenu du travail. Ce dernier épuise ses forces productives par l’utilisation de sa force travail, tandis que le propriétaire de capitaux peut se créer une source de revenus supplémentaires, au-delà de sa seule force de travail. M. Alain Richard, alors Rapporteur général de la commission des Finances, l’avait souligné en 1988 : « À revenu égal, le détenteur d’un patrimoine important a moins besoin d’épargner, la constitution d’une épargne de précaution étant rendue superflue du fait de la possibilité de réaliser en cas de besoin, un élément de patrimoine » (). Rappelons que l’institution de l’ISF en 1988 a servi à financer, en partie, la création du revenu minimum d’insertion (RMI). La surimposition du capital peut être fondée également sur le fait que le propriétaire de capitaux n’est imposé pour les revenus qu’il en tire que sur leur valeur nette, c’est-à-dire après déduction des dépenses engagées pour l’entretien et la préservation du capital. Au contraire, le titulaire de revenus du travail est imposé sans qu’il soit tenu compte des dépenses de maintenance du « capital humain ». À ce stade, la question est de savoir si les œuvres d’art peuvent entrer dans la définition d’un capital productif de revenus. La réponse est négative, à moins que la détention d’œuvres d’art serve à des buts de spéculation. Dans ce cas, elle sera taxée au moment de la transaction. L’impôt de solidarité de la fortune est également un moyen d’appréhension des facultés contributives. Il incite à la productivité dans la mesure où le détenteur d’un capital a intérêt à affecter ses ressources à des fins productives de façon à être en mesure de couvrir au moins le paiement de l’impôt avec les revenus du capital frappé. Sont donc favorisés les placements actifs, les investissements directs, les actions, les obligations. Votre Rapporteur, lors du débat en 1988, le constatait déjà : « L’impôt de solidarité sur la fortune a une fonction importante qui est de rentabiliser le capital. En effet, il favorise une gestion plus productive des patrimoines. Nous avons pu le constater entre 1982 et 1985. Auparavant immobilisés en grande partie dans des bas de laine, ils ont été réintroduits dans le circuit économique » (). De ce point de vue, le caractère improductif des œuvres d’art ne semble pas en faire le meilleur placement. Les satisfactions apportées par la détention de tels biens n’ont pas de traduction pécuniaire. Enfin, l’impôt sur la fortune, par l’établissement par chaque contribuable d’une déclaration de l’ensemble de ses biens, fournit des « recoupements » permettant de découvrir soit des revenus du capital qu’il n’aurait pas ou insuffisamment déclarés, soit d’autres revenus dissimulables lui ayant permis d’acquérir des actifs moins aisément dissimulables. Or, les œuvres d’art, plus que d’autres biens, sont facilement dissimulables. L’exposé des motifs de la loi du 30 décembre 1981 reprenait ces trois fondements : il était justifié d’imposer la fortune qui donnait ceux qui la possèdent une faculté contributive supplémentaire ; l’impôt sur la fortune était un moyen de réduire des inégalités de patrimoine jugées excessives ; enfin, l’existence d’un impôt annuel devait compenser les insuffisances des taxes existantes qui imposaient peu les revenus du capital et fournir un moyen de contrôle des autres impôts. 2.– Le régime de l’impôt de solidarité sur la fortune L’ISF, tel qu’il existe aujourd’hui, est né de l’article 26 de la loi de finances pour 1989 n° 88-1149 du 23 décembre 1988. Il s’agit d’un impôt annuel sur les patrimoines les plus importants. Le fait générateur réside dans la détention, par une personne physique, d’un patrimoine supérieur au seuil de la première tranche. L’impôt est dû par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de tous leurs biens, qu’ils soient situés sur le territoire national ou en dehors. Pour les personnes domiciliées fiscalement hors de France, seuls les biens situés en France, à l’exception des placements financiers, sont assujettis. En 1999 (), le barème n’a pas été réévalué ; le seuil de déclenchement de l’impôt est resté fixé à 4,7 millions de francs (0,7 million d’euros), correspondant à la contre-valeur des biens détenus déduction faite des dettes. Le passif est notamment composé des emprunts, des découverts bancaires, des dettes envers des prestataires de services ou entrepreneurs de travaux. Les pensions alimentaires résultant d’une décision judiciaire et le capital constitutif d’une rente viagère dont le paiement incombe au redevable sont également déductibles. Les impôts doivent être retranchés, ISF compris. Les personnes à charge, et notamment les enfants de moins de dix-huit ans, permettent de réduire l’impôt à payer. Une nouvelle tranche d’imposition au taux de 1,8 % a été créée en 1999 pour les patrimoines supérieurs à 100 millions de francs. La majoration de 10 % instituée en 1996 a été intégrée au barème. Le patrimoine doit être estimé au 1er janvier de l’année sur le fondement de sa valeur vénale. Cette expertise est laissée à l’appréciation du contribuable. L’assiette comprend l’ensemble des biens, droits et valeurs : immeubles, terrains, actions, créances, liquidités, bijoux, bateaux… Certains actifs sont exonérés : · les biens professionnels, considérés comme tels parce qu’ils sont nécessaires à l’exercice d’une profession principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; la notion de profession suppose l’existence d’une activité effectivement exercée à titre habituel et constant dans un but lucratif ; · les droits de la propriété littéraire et artistique ; · les droits de la propriété industrielle : brevets, marques, dessins et modèles ; · les bois, forêts et parts de groupements forestiers, même lorsqu’ils ne constituent pas des biens professionnels ; · les biens ruraux et parts de groupements fonciers agricoles, à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 500.000 francs et de la moitié au-delà ; · la résidence principale, qui bénéficie d’un abattement de 20 % ; · les objets d’art, d’antiquité ayant plus de cent ans, les tapis et tapisseries, tableaux et peintures, gravures, timbres-poste, estampes, statues, sculptures, bijoux et pierreries lorsqu’il s’agit d’objets de collection ou d’antiquités, en vertu de l’article 885 I du code général des impôts ; la définition des œuvres d’art, d’antiquité et de collection reprend celle utilisée pour asseoir la taxe forfaitaire sur les objets et métaux précieux et découlant des rubriques du tarif extérieur commun. L’exonération des œuvres d’art n’est pas caractéristique du régime français d’impôt sur l’actif net. Parmi les onze pays de l’OCDE disposant, lors de l’institution de l’ISF en 1988, d’un tel impôt, deux pays pratiquaient une telle exonération totale, à savoir le Danemark et la Suède. La République fédérale d’Allemagne et l’Autriche avaient instauré un système intermédiaire dans lequel les œuvres étaient exonérées si leur valeur totale était inférieure à un certain montant (). La portée de l’exonération pouvait être modulée en fonction de l’intérêt de l’œuvre. En Allemagne, au-delà du seuil d’imposition, les œuvres pouvaient être exonérées si elles présentaient un intérêt pour la culture, l’histoire et la science et si elles étaient dans la famille du propriétaire depuis plus de vingt ans. L’accessibilité des œuvres pouvait également être prise en compte : ainsi, en Autriche, les œuvres n’étaient imposées qu’à 20 % de leur valeur si elles étaient exposées au public. L’Allemagne a supprimé son impôt sur la fortune au 1er janvier 1997, à la suite de la décision en date du 22 juin 1995 du tribunal constitutionnel de Karlsruhe. Au Danemark, qui a renoncé également en 1997 à son impôt sur la fortune, les biens d’intérêt national étaient exonérés. En Espagne, sont exonérés les biens culturels et les œuvres d’art possédées par le créateur. Aux Pays-Bas, l’impôt sur la fortune ne touche pas les objets d’art et de collection, ni l’argenterie, ni les pierres précieuses, si leur valeur n’excède pas un certain seuil. B.– INCLURE LES ŒUVRES D’ART DANS L’ASSIETTE DE L’IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE ? Depuis la création de l’impôt sur les grandes fortunes (IGF), devenu entre-temps ISF, la question de l’inclusion des œuvres d’art dans la base de l’imposition des grands patrimoines est quasi permanente. Y répondre positivement implique de résoudre au préalable un certain nombre de problèmes techniques, liés notamment à l’évaluation des biens taxés. Par ailleurs, l’impératif de préservation et d’enrichissement du patrimoine national suppose de ne pas décourager la constitution de collections privées. C’est pourquoi, une telle solution ne pourrait être envisagée que dans le cadre d’un ISF totalement rénové. 1.– Une spécificité économique qui a fait l’objet de débats récurrents Les débats qui ont eu lieu sur le lien entre œuvres d’art et ISF ont toujours buté sur une forme d’aporie : concilier, d’une part, la justice fiscale, qui nécessite une certaine redistribution des richesses, et d’autre, part, la préservation et la constitution de collections, qui supposent que certains particuliers dégagent suffisamment de revenus pour investir dans l’acquisition d’œuvres d’art. a) Justice fiscale, préservation du patrimoine, et soutien à la création Nous l’avons déjà évoqué à propos du marché de l’art : l’œuvre d’art ne peut être appréhendée comme un bien ordinaire. L’œuvre d’art n’est pas un bien substituable. Chaque catégorie d’œuvre d’art fait l’objet d’un marché particulier : les bronzes de Giacometti n’entrent pas en concurrence avec une commode Riesener ; un Delacroix des débuts n’a pas la même valeur qu’un tableau de la maturité. Par ailleurs, l’œuvre d’art n’est pas un bien consomptible ; elle est susceptible d’être conservée dans un patrimoine pendant plusieurs générations ; sa valeur peut fluctuer très rapidement ou très lentement. L’œuvre d’art, sauf lorsqu’elle fait l’objet d’une transaction, n’est pas productive de revenus. Or, toute transaction est soumise à l’impôt (taxe forfaitaire sur les plus-values). Enfin, elle fait l’objet d’un investissement particulier, qui n’est pas forcément gouverné par la volonté de réaliser une plus-value. Sa valeur artistique ne peut pas être traduite, strictement et nécessairement, en unités monétaires. Combien pour Les Noces de Cana ? Rappeler ces évidences permet de souligner l’extrême difficulté à laquelle se heurte inévitablement l’application d’un dispositif fiscal uniforme et aveugle. Il est difficile d’évaluer les objets d’art, il est facile de les dissimuler ; en cas d’imposition, les risques de fraude et d’évasion vers l’étranger s’accroissent ; les propriétaires privés seront plus réticents à continuer de participer à la politique culturelle de l’État et des collectivités territoriales par les expositions et le mécénat. Face à ces considérations, sur lesquelles nous reviendrons plus en détail dans la suite de notre rapport, s’impose l’impératif de justice sociale et fiscale : est-il normal que quelques très grandes fortunes « placées » en partie en œuvres d’art échappent à l’impôt ? b) Impôt sur les grandes fortunes et œuvres d’art Il est significatif qu’un seul amendement d’importance, déposé par le Gouvernement lui–même (), fut adopté lors de la discussion sur le projet de loi de finances pour 1982 () concernant l’impôt sur les grandes fortunes (IGF), celui concernant l’exonération des œuvres d’art. Cette exonération était compensée par une majoration de la taxation liée à la commercialisation des œuvres d’art, par le biais d’une augmentation des taux de la taxe forfaitaire sur les plus-values. M. Christian Pierret, alors Rapporteur général, précisait : « La nécessité de protéger le marché de l’art motive également le soutien que la commission des Finances apporte à l’amendement du Gouvernement. Il nous est, en effet, apparu indispensable de lier l’encouragement à la politique de création culturelle et le maintien du patrimoine culturel français sur le territoire national à l’instauration d’une taxation plus efficace sur les transactions des œuvres d’art » (). L’IGF fut supprimé, à l’occasion du changement de majorité, par la loi de finances rectificative du 11 juillet 1986, à l’exception du prélèvement sur les titres et bons anonymes. Un impôt sur la fortune, rebaptisé impôt de solidarité sur la fortune (ISF), fut de nouveau mis en place, par la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988. Les débats en 1988 avaient également fait ressortir le problème de la détection des œuvres d’art. Le Gouvernement avait précisé que « dans le souci de rechercher la sérénité pour l’application de cette nouvelle imposition, le risque d’inquisition fiscale, de contrôle quelque peu vexatoire du domicile même des assujettis pour vérifier s’ils sont ou non détenteurs d’œuvres d’art, a paru également un inconvénient appréciable à l’encontre de l’imposition des œuvres d’art » (). c) Le rapport du Conseil des impôts, le « rapport Migaud » et leurs suites · Le rapport du Conseil des impôts Le Conseil des impôts dans son seizième rapport au Président de la République, L’imposition du patrimoine, publié en 1998, a proposé de revenir sur l’exonération d’ISF prévue actuellement en faveur des œuvres d’art et des objets de collection en incluant ceux-ci dans le forfait mobilier fixé à 5 % de la valeur globale du patrimoine. En pratique, il s’agirait d’inclure dans le forfait mobilier tous les meubles meublants, quelles que soient leur nature et leur ancienneté, et par conséquent d’y comprendre les œuvres d’art ainsi que les objets de collections, les assujettis à l’ISF continuant à pouvoir administrer la preuve d’une valeur inférieure en produisant un inventaire assorti d’estimations. · Le rapport Migaud La proposition du Conseil des impôts a été reprise en partie par M. Didier Migaud, Rapporteur général, dans son récent rapport sur la fiscalité du patrimoine (). Il « considère, comme le Conseil des impôts, que l’inclusion des œuvres d’art dans le forfait mobilier permettra de mieux tenir compte de la capacité contributive supplémentaire dont les collections d’objets d’antiquité ou d’art sont l’indéniable expression. Le choix de la méthode du forfait garantira toutefois aux collectionneurs qu’ils ne seront pas en butte aux procédures tatillonnes d’un inventaire forcé. » En revanche, la proposition de loi portant réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune déposée par le groupe communiste et apparentés () maintenait l’exonération. M. André Chandernagor, président de l’Observatoire des mouvements internationaux d’œuvres d’art, dans son rapport d’avril 1998 (), s’était déclaré pour le maintien de l’exonération. Mme Catherine Trautmann, ministre de la Culture et de la Communication, lors de son audition devant la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale, le 16 septembre 1998, a, pour sa part, annoncé qu’un ensemble de mesures, notamment de nature fiscale, étaient à l'étude, à la demande du Premier ministre, visant à dynamiser le marché de l’art français. · Les propositions de la commission des Finances lors des projets de loi de finances pour 1999 et pour 2000 Lors du débat sur le projet de loi de finances pour 1999, la commission des Finances, sur proposition de son Rapporteur général, a adopté un amendement tendant à instituer un mécanisme équilibré, fondée sur une taxation forfaitaire des œuvres d’art au titre de l’ISF. Il s’agissait de mettre en place un dispositif permettant de prendre en compte la forte capacité contributive dont la possession de certaines œuvres d’art pourrait être l’indéniable indice. Ce dispositif était délimité par exclusions successives d’œuvres, soit en raison de leur présentation au public, soit du fait que leur auteur est vivant au 1er janvier de l’année d’imposition. Les autres œuvres d’antiquité, d’art ou de collection auraient été assujetties à une taxation forfaitaire, fixée à 3 % de l’actif net. L’application du forfait aurait été obligatoire. L’administration ne pouvait l’écarter, même si elle apportait la preuve que la valeur des œuvres d’art dépassât le chiffre du forfait. Les modalités de l’imposition étaient simplifiées, pour ne pas obliger les propriétaires à procéder à un inventaire. L’estimation de leurs œuvres n’aurait été rendue nécessaire que s’ils avaient estimé que leurs biens eussent une valeur inférieure à 3 % de leur actif net. Comme le Conseil des impôts, votre commission des Finances proposait d’inclure dans l’assiette de l’ISF les droits de la propriété littéraire et artistique détenus par les ayants droit de l’auteur. Adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (), il a été rejeté en seconde délibération à la demande du Gouvernement, compte tenu de la nécessité de prévoir une telle mesure dans une réforme globale de la fiscalité des œuvres d’art. Le ministre de l’Économie l’a rappelé : « Le Gouvernement est soucieux de ne pas déséquilibrer la fiscalité des œuvres d’art, qui, à d’autres égards, notamment les transactions sur ces œuvres, est plus lourde que celle de nos voisins. Dans ces conditions, il lui semble judicieux de réfléchir à l’ensemble de la fiscalité sur les œuvres d’art, aussi bien sur la détention, pour l’ISF, que pour les transactions » (). Le cas de figure s’est reproduit, avec un amendement identique qui a, de nouveau, fait l’objet d’une seconde délibération, le 22 octobre 1999. 2.– Des difficultés techniques Le Conseil des impôts, dans son seizième rapport (), soulignait déjà les difficultés inhérentes à l’imposition des œuvres d’art : « l’exposition publique régulière des œuvres présentant un intérêt culturel national est difficilement envisageable ; la définition même de ces œuvres ne peut être effectuée sans une part d’arbitraire manifestement excessive, difficilement réductible et trop soumise au caprice des modes ; l’identification des biens en question ne peut être conçue que soit en acceptant le principe d’une imposition sur des bases purement déclaratives comportant la quasi-certitude de très substantielles omissions, soit en recourant à des méthodes inquisitoriales dont l’acceptation serait plus que douteuse et les résultats moins qu'aléatoires. Enfin, la gestion de l’impôt elle-même poserait aux services fiscaux des problèmes pratiquement insolubles, inévitablement générateurs d’un dangereux scepticisme, sans exclure d’importants risques de contentieux. » a) Des difficultés d’évaluation Le patrimoine soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune pose d’ores et déjà des problèmes d’évaluation. Il est évalué sur le fondement de sa « valeur vénale réelle » qui doit être appréciée au 1er janvier de chaque année. Si certains actifs ne posent pas de problème d’évaluation, car ils sont cotés sur un marché officiel, il n’en est pas de même pour d’autres, et, en particulier, les biens immobiliers ou bien les valeurs mobilières non cotées. En effet, dans ces domaines, il n’existe pas de cours opposables aux tiers et il est impossible de trouver deux biens ayant exactement les mêmes caractéristiques. La valeur des titres non cotés doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande, ce qui revient à faire référence, notamment, aux bénéfices réalisés par la société, ses perspectives, le rendement des titres, leur valeur mathématique, etc. Pour procéder à l’expertise de la valeur d’un bien immobilier, deux méthodes de calcul peuvent être retenues : la méthode par le revenu et la méthode par comparaison. La première méthode prend en compte le revenu annuel dégagé et la rentabilité moyenne du secteur. La seconde, plus couramment utilisée, consiste à évaluer les immeubles en fonction des transactions réalisées dans un périmètre restreint et sur des biens relativement similaires (surface de l’appartement, qualité de l’immeuble, date de construction, etc.). Des bases de données, à l’exemple de celle créée par les notaires de Paris qui regroupe 90 % des transactions réalisées, permettent de donner à ces comparaisons une base solide. Les contribuables peuvent également s’inspirer de l’étude annuelle menée par le Crédit foncier qui porte sur l’ensemble de la France et qui fournit des fourchettes de prix en fonction de la qualité des biens. Dans le cas d’œuvres d’art, la première méthode d’évaluation ne peut s’appliquer. Par nature, elles ne sont pas productives de revenus. La seconde méthode semble encore plus délicate à manier que dans le cas de biens immobiliers. En effet, les œuvres d’art, à quelques très rares exceptions près (dans le domaine de la photographie ou de la sculpture en bronze notamment), sont des pièces uniques. Il est quasiment impossible pour telle œuvre, créée par tel artiste à telle période de sa vie, de se référer à une autre œuvre, vendue récemment sur le marché, qui soit si proche qu’elle permette de fonder sans erreur l’évaluation de la première œuvre. En revanche, l’utilisation des nombreuses bases de données qui regroupent l’ensemble des transactions sur le marché de l’art pourrait constituer une aide à l’évaluation sans que celle-ci ait un caractère aussi sûr que celle réalisée dans le domaine immobilier. Cependant, l’objectivité des estimations pourrait toujours être remise en cause. b) Des problèmes de contrôle Le système de l’ISF est déclaratif. Un tel dispositif implique d’instituer des contrôles. Quand bien même un contrôle inquisitorial serait mis en place pour vérifier la réalité des collections d’objets d’art détenues par les redevables, les services fiscaux ne disposeraient pas des moyens suffisants. Les moyens quantitatifs manqueraient assurément. En outre, d’un point de vue qualitatif, la formation des agents des impôts ne les prépare pas à évaluer, de manière précise, les objets d’art. Toute procédure de contrôle impliquerait inévitablement que soient mises en place des commissions particulières susceptibles, en cas de litige, de trancher entre l’évaluation présentée par le propriétaire et celle réalisée par l’administration. La procédure mise en place serait particulièrement lourde. Il est probable que la mise en œuvre des moyens que nécessiterait un contrôle efficace compenserait en grande partie le rendement budgétaire attendu de l’extension de l’assiette de l’ISF aux œuvres d’art. c) Un rendement budgétaire incertain Compte tenu du caractère déclaratif du système de l’ISF, il est extrêmement difficile de connaître a priori le rendement de l’inclusion éventuelle des œuvres d’art dans son assiette. La détermination de son rendement serait d’autant plus difficile à réaliser que seraient maintenues des exonérations pour certains types d’œuvres (œuvres d’artistes vivants, œuvres d’intérêt national, etc.), et, ce même si un système de forfait était créé. 3.– Préserver les collections privées pour enrichir les institutions publiques M. Didier Migaud, Rapporteur général, le rappelait dans son rapport sur la fiscalité du patrimoine : « Il faut (…) savoir situer la frontière entre un impôt efficace et un impôt de confiscation, entre un impôt de cohésion sociale et nationale et un impôt qui décourage l’initiative, entre un impôt qui égalise au prix de l’appauvrissement de la collectivité et un impôt qui contribue à rétablir l’égalité des chances au bénéfice de tous » (). a) Éviter les risques de fraude et de création d’un marché clandestin L’effet psychologique de l’institution d’une imposition sous quelque forme que ce soit des œuvres d’art à l’impôt sur la fortune est certain. Le problème posé par l’aspect déclaratif de l’ISF est de ce point de vue crucial. L’institution d’un quelconque inventaire conduirait à favoriser la dissimulation et à créer un marché parallèle. Il faut, en effet, tenir compte du caractère spécifique du collectionneur : dans la plupart des cas, il réalise dans l’acquisition d’une œuvre d’art un investissement affectif. Le but spéculatif est souvent subsidiaire. Les fluctuations du marché de l’art sont telles que le placement dans une œuvre d’art est extrêmement risqué, hormis quelques cas rarissimes (impressionnistes notamment). C’est encore plus vrai dans le cas d’œuvres contemporaines. L’obligation de déclaration emportera la levée de l’anonymat. Acheter une œuvre d’art a quelque chose de très intime ; le lien n’est pas le même qu’avec une valeur mobilière. Peu d’affect est attaché à l’acquisition d’une part de SICAV. Par ailleurs, la possession d’œuvres d’art n’est pas assimilable de manière automatique à la possession de très grandes fortunes, même si elle peut en être un indice. De nombreux collectionneurs ne disposent pas de grandes fortunes. La communauté des propriétaires d’œuvres d’art en France comprend un grand nombre de personnes qui possèdent des œuvres d’art du fait d’héritage, et ce, depuis des générations. Ainsi, le risque de la création d’un marché clandestin n’est pas à écarter, et ce d’autant plus que les contraintes concurrentielles du marché de l’art sont réelles. Transactions entre particuliers, courtage mondain, où prolifèrent les faux et les œuvres volées, se développeraient. b) Assurer une réappropriation démocratique des œuvres d’art Nous ne sommes pas dans un système américain, qui permet le deacessioning. Cette procédure offre aux directeurs de musée, approuvés par leur conseil d’administration, la possibilité de prélever des œuvres dans leur stock et de les vendre aux enchères pour financer de nouvelles acquisitions. Ainsi, ils peuvent disperser leurs actifs pour réaliser de nouveaux investissements. Cette politique a conduit souvent certains musées à opérer des choix préjudiciables à l’intérêt de leur collection et à fonder la constitution de collections sur des intérêts financiers. Parce que la France dispose d’une autre culture et mène une politique active d’ouverture des musées au public, une telle pratique n’est pas envisageable. Les collections nationales conservées dans les musées ont été constituées pour l’essentiel des dons, legs et dations réalisés par des collectionneurs privés. Les collections privées permettent de soutenir la création et, à terme, drainent des œuvres vers les institutions publiques. Elles contribuent, par ce biais, à l’enrichissement du patrimoine futur. M. Didier Migaud, Rapporteur général, l’a souligné récemment : « Il est tout à fait légitime de préférer, voire favoriser, en France, l’enrichissement des collections et des expositions, plutôt que l’organisation de colloques sur les législations propices à la fuite des œuvres d’art » (). Le déplacement d’œuvres clandestin n’est pas à omettre, alors même que l’État protège ses exportations. Hors de l’hypothèse, la plus probable, de possession d’œuvres d’art à des fins de collection, de deux choses l’une : ou bien, l’intéressé achète des œuvres d’art en vue d’en tirer un bénéfice pécuniaire, et alors il sera taxé au moment de la transaction ; ou bien, l’intéressé acquiert des œuvres d’art en vue d’échapper à l’ISF, et alors il convient de renforcer les moyens de lutte contre la fraude. En outre, le rendement espéré serait, dans toutes les hypothèses, relativement faible. Lorsqu’elles sont productives de revenus, c’est-à-dire lorsqu’elles sont vendues et achetées, les œuvres d’art sont taxées par le biais d’une taxation forfaitaire représentative de la plus-value réalisée. Toute réforme de l’ISF impliquerait de revoir le mécanisme de la taxation forfaitaire. Tant que le système actuel de l’ISF n’est pas revu dans son ensemble, votre rapporteur spécial juge inutile et dangereux pour la préservation de notre patrimoine et pour le développement de la création d’inclure les œuvres d’art dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune. IV.– LES MÉCANISMES FISCAUX D’ENRICHISSEMENT DU PATRIMOINE : DONATIONS, DATIONS ET MÉCÉNAT Les œuvres d’art sont soumises aux droits de mutation. Cependant, il existe des mécanismes permettant de les utiliser pour payer ces mêmes droits, selon la procédure de la donation ou de la dation. Donation, dation mais aussi mesures fiscales en faveur du mécénat sont trois formes importantes d’enrichissement des collections des musées. Si les unes découlent d’une obligation de payer ses impôts, l’autre obéit à une démarche volontaire, qui peut être soutenue fiscalement. A.– LES DONATIONS 1.– Œuvres d’art et droits d’enregistrement À la différence de la législation applicable en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, les objets d’art ou de collection sont imposables lors de leur transmission à titre gratuit. Mais, par exception au principe de l’évaluation des biens à leur valeur vénale, la loi a fixé pour ces biens des bases légales d’évaluation. a) Les droits de mutation par décès De la combinaison des paragraphes I et II de l’article 764 du code général des impôts, il résulte que la valeur des objets d’art ou de collection est constituée dans l’ordre de préférence par : · le prix net de la vente publique intervenue dans les deux ans du décès ; · en l’absence de vente publique, la plus élevée des valeurs figurant soit dans un acte estimatif de la valeur des biens à la date du décès (inventaire, même non conforme aux dispositions de l’article 943 du code de procédure civile, délivrance de legs, partage…) dressé dans les cinq ans du décès, soit dans un contrat d’assurance, s’il en existe, concernant ces biens ; · ou à défaut des bases d’évaluation indiquées ci-dessus, la déclaration détaillée et estimative des parties. Conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation (), certains objets d’art peuvent être considérés comme des meubles meublants du défunt, c’est-à-dire des meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements. Ainsi, les tableaux et les statues qui font partie des meubles d’un appartement sont considérés comme des meubles meublants, mais non les collections de tableaux qui peuvent être exposés dans des galeries ou des pièces particulières. Dans cette hypothèse, l’évaluation est effectuée conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 764 du code général des impôts qui dispose que la déclaration estimative des parties ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres biens héréditaires. b) Le droit de mutation à titre gratuit entre vifs En matière de donations, il résulte des dispositions de l’article 776 du code général des impôts qu’à défaut de vente publique dans les deux ans de la donation, les objets d’art ou de collection doivent faire l’objet d’une déclaration estimative des parties qui ne peut être inférieure à 60 % de l’évaluation faite dans les contrats ou conventions d’assurances contre le vol ou l’incendie en cours à la date de la donation et conclu par le donateur, son conjoint ou ses auteurs, depuis moins de dix ans. S’il existe plusieurs polices susceptibles d’être retenues pour l’application du forfait, celui-ci est calculé sur la moyenne des évaluations figurant dans ces polices. Nous rappellerons, enfin, que l’article 795 A du code général des impôts exonère totalement de droits de mutation à titre gratuit non seulement les immeubles classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, mais aussi les meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors qu’une convention prévoyant l’ouverture du monument au public est passée avec les ministres chargés de la culture et du budget. Par ailleurs, les transmissions d’objets d’art peuvent bénéficier des avantages liés aux donations et donations-partages (de 15 % à 35 % de réduction d’impôt selon le cas), à la réserve d’usufruit (abattement sur l’assiette en fonction de l’âge du donateur, 10 % si le donateur a soixante-dix ans, 20 % s’il a soixante ans, etc.), à la prise en charge des droits par le donateur (l’avantage croît avec le taux marginal d’imposition) et au non-rappel des donations passées depuis plus de dix ans qui permet de bénéficier des abattements et des tranches les plus basses du barème, tous les dix ans. 2.– Les donations En vertu de l’article premier de la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique nationale, les œuvres d’art peuvent servir à financer les droits de mutation et taxes annexes afférents à la transmission de ces biens, lorsque l’acquéreur, le donataire, l’héritier ou le légataire offre ces biens à l’État dans le délai prévu pour l’enregistrement de l’acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession. En vertu de l’article 1131 du code général des impôts, sont ainsi exonérées de droits de mutation à titre gratuit les œuvres d’art dont il est fait don à l’État avec son agrément. L’article 7 de la loi du 19 août 1986 () et l’article 6 de la loi du 30 décembre 1991 () prévoient la même possibilité lorsque l’œuvre est donnée à un musée municipal, d’une part, à un musée géré par les collectivités locales, d’autre part. La procédure d’agrément est réglée par l’article 310 G de l’annexe II du code général des impôts. Elle est proche de celle prévue pour la procédure de dation (cf. infra B.1.). Il faut constater que ce type de donation n’a jusqu’ici connu qu’un succès assez limité. Ce n’est pas le cas pour le mécanisme de dation. B.– LA DATION 1.– Le principe de la dation La dation constitue l’une des deux sources d’enrichissement du patrimoine culturel national mises en place par la loi du 31 décembre 1968 précitée tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national. La dation est une forme de paiement de certains impôts : les droits de succession et de donation, y compris ceux suscités par les partages de succession, mais aussi l’impôt de solidarité sur la fortune. Il ne s’agit pas d’une dépense fiscale, ni d’une dépense budgétaire véritable – car elle s’effectue sans décaissement. Le montant des dations en paiement est constaté dans la loi de règlement tant en recettes, au titre des impôts dont elles permettent de s’acquitter, qu’en dépenses, sur le chapitre 43-94 du budget de la culture, afin de traduire de manière comptable le fait que l’État n’a, par définition, pas de liberté d’emploi de la somme correspondante, à la différence d’un règlement en espèces. Le principe en droit fiscal est que les droits d’enregistrement ne peuvent être payés qu’en numéraire ou en valeurs d’État. Par exception à ce principe général, l’article 1716 bis du code général des impôts permet de s’acquitter de certains droits de mutation en remettant à l’État des œuvres d’art tant à l’occasion de successions ou donations causa mortis qu’à l’occasion de mutations à titre gratuit entre vifs ou de donations-partages. Les objets proposés sont le plus souvent choisis parmi ceux dont la mutation a donné naissance à la dette d’impôt, mais il ne s’agit pas d’une condition imposée. Il est possible d’avoir hérité d’une propriété à la campagne et de proposer une œuvre d’art sans rapport avec elle. En revanche, on ne peut proposer que des biens mobiliers. La possibilité d’offrir des immeubles même d’intérêt historique a été expressément écartée au cours des débats préparatoires en raison des frais qu’entraîne pour l’État la gestion d’un patrimoine culturel immobilier déjà considérable. La notion est évidemment imprécise, mais elle correspond à une intention nette du législateur de faire de la dation en paiement une procédure exceptionnelle destinée à faire entrer des pièces de tout premier rang dans les collections publiques. 2.– La procédure de dation L’offre de dation est soumise aux règles fixées par l’article 384 A de l’annexe II du code général des impôts (). Le redevable doit proposer des œuvres d’art, des objets de collection ou tous documents présentant une haute valeur artistique ou historique. Le redevable qui souhaite faire une dation dépose une demande à la recette des impôts ou à la conservation des hypothèques compétente pour enregistrer l’acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession. L’offre du redevable, qui doit être formulée dans un délai de six mois, est soumise à l’avis d’une commission interministérielle pour la conservation du patrimoine artistique national. Celle-ci, composée d’un représentant du Premier ministre, de deux représentants du ministre du Budget et de deux représentants du ministre de la Culture, émet un avis sur la valeur artistique ou historique des biens proposés en dation. Le président de la commission, en fonction de la spécialité dont relève la ou les œuvres proposées, prend contact avec la direction de tel ou tel ministère. Lorsqu’il s’agit d’œuvres d’art relevant de la direction des musées de France, le président de la commission interministérielle d’agrément pour la conservation du patrimoine artistique national saisit le directeur, en qualité de représentant du ministre de la culture, en vue d’expertiser les biens proposés. La proposition est alors présentée devant une première commission d’acquisition, le comité consultatif des musées nationaux, par l’un des quatorze conservateurs patrimoniaux – suivant la spécialité dont relève l’objet – et soumise à l’examen de ses collègues, chefs des principaux établissements. Les membres du comité ne donnent qu’un avis scientifique sur la proposition. Le niveau patrimonial de la ou des œuvres est alors apprécié. Ensuite, la proposition est soumise à l’examen du conseil artistique des musées nationaux, composé de spécialistes, historiens d’art, professeurs et collectionneurs, qui donnent également un avis scientifique. Ayant pris connaissance des avis des deux commissions, le président de la commission interministérielle d’agrément organise la réunion de celle-ci. La commission émet un avis sur l’intérêt patrimonial des biens proposés et doit également apprécier la valeur libératoire des biens offerts sans procéder à leur évaluation directe. Elle doit seulement indiquer si les biens offerts couvrent la dette fiscale. Cette dation ne peut porter que sur des meubles. L’avis de la commission est transmis aux autorités fiscales qui doivent décider de l’admission en paiement desdits biens. En cas d’acceptation, le ministre des Finances notifie à l’auteur de l’offre la décision d’agrément fixant la valeur libératoire qu’il reconnaît aux biens offerts en paiement. Le contribuable en accuse réception. La dation n’est d’ailleurs parfaite que par l’acceptation par l’intéressé de ladite valeur. Ce dernier fait connaître, dans les délais fixés par l’agrément, son acceptation au ministère des Finances, par pli recommandé avec demande d’avis de réception. C’est le ministre concerné par l’offre qui décide de l’affectation des œuvres et de leur éventuel dépôt. En cas de refus de l’agrément, le contribuable dispose d’un délai d’un mois pour régler ses droits. 3.– L’utilité de la dation Le système de dation permet ainsi l’enrichissement des musées français. Il suffit d’évoquer la dation du Portrait de Diderot peint par Jean-Honoré Fragonard ou encore La marquise de Santa Cruz de Goya, ou, plus récemment encore, les dations de L’Enfant au chat d’Auguste Renoir et de Berthe Morisot à l’éventail d’Édouard Manet, acceptées en mai 1999, pour souligner à quel point cette procédure permet d’enrichir, non pas les réserves des musées, mais les salles les plus prestigieuses. La dation vient utilement pallier les manques de la politique d’acquisition des musées, fondées sur une masse de crédits budgétaires insuffisante. Ces crédits budgétaires atteignaient, tous types de commandes artistiques et achats d’œuvres d’art confondus, hors commandes de spectacles, environ 250 millions de francs pour 1999. Les dations en paiement en 1997 équivalaient à elles seules à 164 millions de francs. 4.– La création d’un nouveau type de dation Dans le but d’inciter à la constitution de collections privées et d’en assurer une réappropriation démocratique, il serait sans doute souhaitable d’instituer un système de dation du vivant du propriétaire. Ce dispositif permettrait à ce dernier d’offrir en paiement de son impôt, y compris son impôt sur le revenu, des œuvres d’art, qui feraient l’objet, comme pour le système actuel de dation, d’une expertise par une commission spécialisée, qui pourrait elle-même s’appuyer sur l’avis d’experts indépendants. Un tel mécanisme offrirait à l’État les moyens d’acquérir des œuvres en dehors des variations inéluctables des crédits budgétaires d’acquisition. C.– L’ACTION EN FAVEUR DU MÉCÉNAT 1.– La mise en place d’avantages fiscaux Le mécénat, pratique ancienne comprise comme l’aide apportée, sous diverses formes, par une personne physique ou morale, à des activités artistiques ou culturelles, fait l’objet d’un traitement fiscal relativement récent. Deux rapports avaient été remis pour préparer cette politique : le rapport de M. Alain Perrin, président de Cartier, commandé par le ministre de la Culture en 1986, et qui avait développé l’idée que le mécénat s’apparentait à un « acte de gestion » dont le développement durable supposait qu’il s’inscrivât en dehors du cadre juridique et fiscal de l’époque ; le rapport rédigé, en 1987 à la demande du ministre des Finances, par un groupe de travail dirigé par M. Georges Pébereau, alors président de la Compagnie générale d’électricité, qui procéda à un recensement exhaustif des obstacles d’ordre juridique et fiscal à l’essor du mécénat. La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat a synthétisé et systématisé les dispositions d’aide à l’expression artistique, au travers notamment de leur volet fiscal, intégrant – là se situe une large part de l’originalité de la manifestation contemporaine du phénomène – à la notion de mécénat l’aide « intéressée » de l’entreprise, laquelle peut attendre, des initiatives prises en faveur de telle ou telle œuvre, de tel ou tel artiste, des retombées en termes de notoriété… association de cette notion de mécénat à une démarche publicitaire. En 1994, M. Alain Grangé-Cabane, président de la commission création-diffusion du Conseil supérieur du mécénat culturel, à la demande du ministre de la Culture, remettait un rapport (Donner au mécénat un nouvel essor) dans le but de relancer le mécénat. 2.– Les mécanismes de déductions L’avantage fiscal en faveur des œuvres d’art peut prendre la forme d’une charge déductible. En vertu de l’article 238 bis du code général des impôts, les entreprises sont autorisées à déduire de leur bénéfice imposable les versements effectués par elles au profit d’œuvres ou d’organismes de caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique ou à la diffusion de la culture. Ces déductions sont limitées cependant à 3,25 ‰ de leur chiffre d’affaires. Cette limite conduirait les entreprises à préférer imputer ces versements sur leurs frais généraux. Il reste que la part des versements excédant le plafond autorisé est reportable pendant les cinq années suivantes. Selon le rapport « Grangé-Cabane » de 1994, il faudrait cesser d’apprécier le caractère général que doivent présenter les organismes bénéficiaires du mécénat à partir de leur non-lucrativité. En revanche, l’augmentation du plafond demandée par ce même rapport a été accomplie par la loi du 24 juin 1996 (). Selon un mécanisme similaire, les entreprises qui ont acheté, entre le 1er juillet 1987 et le 31 décembre 1993, des œuvres d’artistes vivants pour les exposer au public, peuvent déduire sur vingt ans le coût d’acquisition de ces œuvres (y compris les frais accessoires, les frais d’acquisition et la TVA non déductible). Pour les acquisitions à partir du 1er janvier 1994, la déduction s’opère sur dix années. Toutefois, la déduction ne peut excéder, pour chaque exercice, 3 ‰ du chiffre d’affaires pour les exercices antérieurs au 1er janvier 1996 et 3,25 ‰ pour les exercices ultérieurs (article 238 bis AB du code général des impôts). Pour bénéficier de cette déduction, l’entreprise doit inscrire une somme égale au montant de celle-ci à un compte de réserve spéciale au passif du bilan. Cette déduction est largement inspirée des propositions du rapport « Perrin », qui s’était efforcé de démontrer le caractère inéluctable de la dépréciation subie par les œuvres d’art contemporain, en raison de la nouveauté et du nombre de matières intégrées qui en rendaient la durée de vie incertaine, mais également à cause de l’impact de l’obsolescence du goût individuel et collectif qui les frapperait de manière tout à fait spécifique. En aucun cas, le total des déductions ne peut excéder 3,25 ‰ du chiffre d’affaires. La durée d’exposition est beaucoup trop longue. Les gains pour l’entreprise sont faibles. 3.– Un régime spécifique de provisions Les sociétés peuvent constituer des provisions destinées à constater la dépréciation d’œuvres d’art originales exécutées par l’artiste figurant à l’actif de celles-ci. Cette dépréciation, lorsque le coût d’acquisition de l’œuvre est supérieur à 50.000 francs, doit être constatée et estimée par un expert agréé par le ministère de la Culture (article 39-1-5° du code général des impôts). Cette règle ne s’applique pas aux œuvres acquises pour être données aux œuvres acquises pour être données à l’État, qui relèvent d’un régime particulier de provision (article 238 bis-0 A du code général des impôts). En ce cas, l’entreprise doit faire à l’État une offre de don qui est soumise à l’examen de la Réunion des musées nationaux. À compter de l’acceptation de l’offre par l’État, qui se fait selon la procédure applicable aux dations (article 1716 bis du code général des impôts) ou de l’acceptation par la société des conditions mises par l’État pour accepter le don, la société dispose de dix années maximum pour remettre le bien à l’État. La société pourra constituer une provision spéciale établie sur la base du coût de l’œuvre – conventionnellement établie lors de l’acceptation de l’offre de don. Cette provision est déductible par annuités égales pendant toute la période de détention du bien par la société jusqu’à sa remise à l’État sans pouvoir excéder 3,25 ‰ du chiffre d’affaires annuel. En revanche, la partie de la déduction excédant ce plafond peut être reportée sur les cinq exercices suivants. Il doit s’agir d’une œuvre d’art, de livres, d’objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique. À ce jour, le ministre chargé de la culture, qui accepte ou refuse la donation, n’a été saisi que de deux offres de donation sur la base de l’article 238 bis-0 A du code général des impôts. Les possibilités ouvertes aux entreprises sont très peu utilisées, faute pour elles d’un gain suffisant. Les contraintes étant plus fortes que les avantages, l’incitation apparaît trop faible pour être véritablement opérante. Votre Rapporteur souhaiterait que les plafonds soient augmentés, que la période de provision soit raccourcie, et que les règles d’« homologation » soient assouplies. On peut noter que le secrétaire d’État au Budget, M. Christian Sautter, à l’occasion de la dernière réunion de l’Association pour le développement du mécénat industriel et commercial (ADMICAL), le 5 mai 1999, s’est engagé à organiser avec les professionnels une table ronde sur la réforme de la fiscalité appliquée au mécénat d’entreprise, réforme qui a été intégrée dans le projet de loi de finances pour 2000. 4.– Les propositions du projet de loi de finances L’article 9 du présent projet de loi de finances répond en partie aux préoccupations de votre rapporteur spécial. En effet, s’agissant du mécanisme inscrit à l’article 238 bis du code général des impôts, il est proposé d’admettre désormais les versements concernés comme des charges déductibles du résultat de l’entreprise versante dans les conditions de droit commun, qui, le cas échéant, majoreront le déficit constaté par celle-ci et de permettre l’application du régime du mécénat aux versements effectués par les entreprises, même si leur nom est associé aux opérations réalisées, autorisation qui n’était autrefois permise que si les versements bénéficiaient à la Fondation du patrimoine. À titre de rappel, il convient d’évoquer la possibilité offerte aux entreprises par la loi du 4 juillet 1990 de créer des fondations, susceptibles de soutenir une politique de mécénat, notamment dans le domaine de l’art contemporain (fondations Colas, Pfizer, Hewlett Packard France, etc.). En outre, votre rapporteur spécial est très favorable à la proposition émise par M. André Chandernagor d’affecter une part des recettes de la Française des Jeux, qui pourrait constituer une solution adaptée au renforcement des capacités d’achat des musées français (). V.– LE DROIT DE SUITE Même s’il ne constitue pas à proprement parler un impôt, le droit de suite rentre dans les charges que supportent les opérateurs du marché de l’art. C’est à ce titre qu’il convient de l’évoquer. Il est d’ailleurs perçu par les professionnels du marché de l’art comme une charge fiscale ou parafiscale. Institué au début du XXème siècle, le droit de suite était conçu comme permettant aux artistes et à leurs ayants droit de bénéficier du fruit de leurs œuvres, lorsque celles-ci font l’objet d’une transaction. Ce droit a fait l’objet d’une proposition de directive actuellement en cours de négociation. Cette perspective aura indubitablement une influence sur la situation relative du marché français et du marché européen. A.– UN DROIT ANCIEN AUQUEL LES ARTISTES SONT ATTACHÉS Créé par la loi du 20 mai 1920, à une époque où les artistes ne bénéficiaient pas de la sécurité sociale, le droit de suite s’apparente au droit d’auteur, dont il revêt le même caractère patrimonial. L’idée qui sous-tend le droit de suite est simple : les peintres et sculpteurs, encore méconnus, cèdent leurs œuvres pour des sommes dérisoires ; lorsqu’ils accèdent à la notoriété, par le biais du droit de suite, ils peuvent bénéficier des hauts prix atteints lorsque leurs œuvres font l’objet d’une revente. Et, mis à part, les artistes reconnus, les auteurs d’œuvres d’art graphiques et plastiques bénéficient peu des modes classiques d’exploitation des œuvres de l’esprit, qu’il s’agisse du droit de reproduction () – limité dans le cas des artistes aux livres d’art, aux cartes postales et aux affiches –, ou du droit de représentation – le droit d’exposition pour les artistes. Le droit de suite a été repris par la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, avant d’être codifié dans le code de la propriété intellectuelle, à l’article L. 122-8. Son taux est devenu uniforme. Il donne lieu à un prélèvement de 3 % à la charge du vendeur, sur les ventes publiques des œuvres. Ce droit peut être perçu pendant la vie de l’artiste et cinquante ans après sa mort, soixante-dix ans depuis 1997 (). Il est réservé à l’artiste ou à ses ayants droit. Il ne bénéficie plus, comme dans le passé, aux légataires de l’artiste. Réservé à l’origine aux ventes publiques, il a été étendu aux ventes en galerie. Dans les faits, les galeries n’ont jamais versé de droit de suite. Cette « exemption », qui résulte d’un protocole d’accord signé entre le Comité des galeries d’art et les représentants des artistes en 1954, est justifiée par le fait que les galeries contribuent à la sécurité sociale des artistes en prenant en charge l’équivalent des cotisations employeurs. Par ce protocole d’accord, les galeries s’étaient engagées à créer une Caisse mutuelle des arts. On peut rappeler ainsi qu’elles versent au régime de sécurité sociale 3,3 % sur 30 % de leur chiffre d’affaires toutes taxes comprises réalisé sur les ventes d’œuvres d’art originales. Les artistes sont très attachés au droit de suite, même s’il bénéficie, dans une proportion considérable, aux plus célèbres et aux plus riches d’entre eux, ainsi qu’à des ayants droit parfois lointains et qui ne sont pas toujours dans le besoin. C’est un sujet passionnel. Il représente pour eux l’espoir de bénéficier le plus possible d’une reconnaissance future et symbolise le lien permanent avec leurs œuvres, quand bien même elles changeraient sans cesse de main. B.– UN SYSTÈME PÉNALISANT ET PEU REDISTRIBUTIF Le droit de suite impose des contraintes sur les transactions futures. Ces contraintes peuvent se traduire par une réduction du prix des œuvres lorsqu’elles sont vendues pour la première fois. Les premiers acheteurs anticipent le droit futur et sont tentés, en conséquence, de demander une réduction du prix de vente. Ce biais est particulièrement fort sur les œuvres d’artistes bénéficiant déjà d’une notoriété satisfaisante. En tant que coût de transaction, le droit de suite rend moins fluides les échanges et risque, s’il est trop élevé, de peser sur le nombre de transactions dont une œuvre est susceptible de faire l’objet. Par ailleurs, sa répartition fait l’objet de critiques. L’efficacité sociale et redistributive du droit de suite est limitée. Une partie importante, 20 % selon la majorité des estimations, sert à rémunérer les sociétés chargées de collecter les droits d’auteur, et le droit de suite en particulier. In fine, si un artiste souhaite protéger ses héritiers, il pourrait tout aussi bien léguer un nombre très réduit de tableaux. La vente directe de ces tableaux leur rapporterait plus que les résultats du droit de suite pendant soixante-dix ans. De 1993 à 1995, 2 à 3 % des 2.000 artistes qui perçoivent des droits de suite touchent 43 % du montant total des droits. Chacun des 1.950 artistes suivants touche approximativement 3.000 francs, dont il faut déduire ce qui est prélevé par la société qui gère les droits. Les distributions de la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP), pour 1995, montrent par exemple que sur 2.500 bénéficiaires, 288 ont perçu 60 % du droit, 2.200 n’en ont perçu que 40 %. Par ailleurs, les artistes les moins favorisés, ceux dont les œuvres ne font l’objet d’aucune revente, sont aussi ceux qui ne perçoivent rien par le biais du droit de suite. Le droit de suite peut constituer, en outre, un élément de délocalisation des ventes. Avant l’harmonisation européenne programmée, un vendeur préférera assurer la transaction dans un pays qui n’a pas de droit de suite, au Royaume-Uni par exemple. Ceci est particulièrement vrai pour les tableaux impressionnistes, modernes et contemporains, dont les prix peuvent atteindre des niveaux très importants et pour lesquels 3 % constituent une somme considérable. Or, lorsqu’il est établi que l’emballage et l’expédition d’une œuvre à New York coûtent environ 5.000 francs, acquitter un droit de suite en France de plus de 20.000 francs sur un tableau qui est vendu 700.000 francs est dissuasif. Cet inconvénient existe essentiellement pour les œuvres dont les prix sont les plus élevés. Or 55,4 % du marché des tableaux de plus de 700.000 francs se trouvent à New York et 23,7 % à Londres. La France ne représente que 7,6 % de ce marché. Pour les tableaux de plus de 10 millions de francs, New York dispose d’un quasi-monopole avec 75 % du marché, tandis que Londres redescend à 12 % et Paris à 4 %. Il n’est pas possible d’exclure totalement la responsabilité du droit de suite dans cette évolution. Les grandes entreprises de vente, notamment pour échapper au droit de suite, recueilleraient des œuvres d’art pour les exporter en vue de revente. Les estimations font état de plusieurs centaines de millions de francs d’œuvres d’art exportées de France dans ce but. Selon une source OCDE, les œuvres d’art provenant des pays pratiquant le droit de suite, tels que la France, l’Allemagne, l’Espagne ou la Belgique, se vendent de manière prioritaire au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Suisse. C.– UNE POLITIQUE D’HARMONISATION EUROPÉENNE Les taux du droit de suite varient sensiblement d’un pays à l’autre, parmi ceux qui l’appliquent. Neuf États sur quinze dans l’Union européenne ont un droit de suite. D’autres ne lui ont pas donné de réalité () ou s’y sont refusés, comme le Royaume-Uni. Ni les États-Unis, ni la Suisse ne possèdent un tel droit. 1.– Égaliser les conditions de concurrence dans l’Union européenne La réglementation des activités culturelles relève en principe de la compétence des États membres, le traité de Maastricht précisant que « la Communauté ne fait que contribuer à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale ». Cette disposition n’a pas empêché la Communauté de s’intéresser abondamment au droit de la propriété intellectuelle. Dans la même optique de parachèvement du marché intérieur, en mars 1996, la Commission des Communautés européennes a adopté une proposition de directive, qui prévoit l’égalisation de la protection dont bénéficient les artistes plasticiens par l’extension du droit de suite à l’ensemble des pays de l’Union européenne. La diversité des régimes appliqués dans les différents États membres est née en partie du caractère souple des fondements juridiques internationaux du droit de suite. En effet, la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques a laissé aux États parties la faculté d’introduire le droit de suite dans leur législation. Le tableau reproduit aux pages suivantes montre à quel point le régime du droit de suite est différent d’un pays à l’autre. À la suite de la Commission, le Parlement européen et le Conseil ont proposé une directive. Cette proposition, d’une part, dispose que ce droit s’applique tant aux ventes aux galeries qu’aux ventes publiques et, d’autre part, institue un taux dégressif variant de 4 % à 1 % en fonction du prix de l’œuvre. L’opposition britannique est particulièrement forte. Selon une étude du ministère du Commerce de Grande-Bretagne, l’élargissement du droit de suite coûterait 5.000 emplois et correspondrait à 600 millions de francs de droits réglés. Or, il est plus probable que le montant des droits résultant de l’élargissement atteigne seulement 20 millions de francs.
2.– Ne pas aliéner le développement du marché Il reste que la proposition de directive peut faire l’objet de critiques importantes. Elle doit être soumise à un examen attentif, et certains aménagements doivent absolument être réalisés, sous peine de réduire les chances de développement du marché de l’art français et européen. a) Assurer une juste répartition des charges entre galeries d’art et maisons de vente Les logiques des galeries et des organismes de ventes publiques sont différentes, mais les interconnexions sont fortes entre les deux secteurs : en effet, il n’y a pas de marché de vente publique important sans galeries en bonne santé. Les propositions européennes se sont fondées sur des études portant sur les œuvres cédées en vente publique, c’est-à-dire sur un marché en rotation rapide où les risques financiers sont moindres que sur le marché des galeries d’art. Il conviendrait, pour assurer un certain équilibre entre les opérateurs, que les galeries puissent, non seulement acquérir les œuvres directement auprès des artistes, mais également racheter ces œuvres auprès de particuliers ou dans les ventes publiques sans charge supplémentaire excessive. Or, le système proposé par la directive imposera aux galeries d’acquitter le droit de suite, alors même qu’elles doivent assurer la charge employeur de la sécurité sociale des artistes. Cette charge ne saurait être sous-estimée. Le tableau ci-dessous montre qu’elle est plus importante que les recettes tirées du droit de suite.
Notre collègue, Mme Nicole Ameline, dans son rapport d’information déposé en 1997, avait invité « le Gouvernement à engager une réflexion sur la mise en œuvre de mesures permettant de prendre en compte, à l’échelon national, le surcroît de charges qui résulterait de l’application du droit de suite aux ventes réalisées par les galeries et les marchands d’art, qui cotisent déjà à la sécurité sociale des artistes, et lui demande, pour le cas où aucune solution ne pourrait être trouvée, d’obtenir que la directive ne vise que les ventes aux enchères publiques » (). b) S’inspirer du modèle allemand L’exemple allemand est particulièrement intéressant. En effet, l’Allemagne est, avec la France, le seul pays de l’Union où coexistent droit de suite et participation des commerçants à la sécurité sociale des artistes. En Allemagne, les commerçants paient la sécurité sociale uniquement sur les œuvres d'artistes vivants qu’ils vendent, tandis qu’en France, l’assiette est constituée par l’ensemble du chiffre d’affaires. Le système allemand a permis de créer une caisse commune au droit de suite et à la sécurité sociale, gérée par une société de gestion, la Bild-Kunst, à laquelle les galeries peuvent adhérer. Cette réunion du droit de suite et de la contribution des galeries à la sécurité sociale des artistes permet d’assurer la cohérence entre la législation de 1972 sur le droit de suite, fixé en Allemagne à 5 % pour chaque vente dans les galeries d’art et à l’hôtel des ventes, et celle sur la sécurité sociale qui impose aux galeries qui achètent des œuvres aux artistes vivants de contribuer à la sécurité sociale sur la base d’un certain pourcentage du prix d’achat. Les galeries qui revendent sont exonérées de cette contribution à la sécurité sociale, parce qu’elles doivent s’acquitter du droit de suite. Au lieu de ces deux obligations législatives, les galeries peuvent payer un forfait sur le chiffre d’affaires de 1,2 % par an. Les commissaires-priseurs, qui ne sont pas soumis à l’obligation de contribution à la sécurité sociale, payent un forfait de 2,5 % de leur chiffre d’affaires. Chaque année, le forfait peut varier en fonction des besoins de la caisse sociale ; le reliquat est distribué aux artistes et aux ayants droit en fonction de la législation sur le droit de suite, et selon laquelle chaque artiste a le droit de demander une rémunération de 5 % du prix de vente individuel. Contrairement à ce qui se passe en France, l’artiste n’est pas automatiquement rémunéré par le droit de suite. Il doit en faire la demande expresse. L’ensemble du mécanisme ne peut fonctionner que grâce à une coopération étroite entre les associations d’artistes et les galeries. La Commission des Communautés européennes acceptera que des accords interprofessionnels soient conclus pour éviter aux galeries un cumul des charges. Au-delà de cette solution pragmatique qui implique une révision du code de la sécurité sociale, votre rapporteur spécial estime que concevoir le droit de suite comme un droit de caractère social permettrait d’en limiter le nombre des bénéficiaires à la parenté directe et d’instaurer une solidarité plus grande entre ceux-ci, au profit des plus démunis. On pourrait espérer que son harmonisation par l’Union européenne soit l’occasion d’en changer la nature. Mais, jusqu’à présent, les discussions d’harmonisation en cours n’ont porté que sur les taux et la durée. EXAMEN EN COMMISSION Dans sa séance du 25 octobre 1999, la commission des Finances, de l’Économie générale et du Plan a examiné les crédits de la Culture. Après l’exposé de votre rapporteur spécial, M. Laurent Dominati l’a interrogé sur les raisons de la relative faiblesse des taux de consommation concernant les opérations liées aux monuments historiques, notamment au Grand Palais ainsi que sur le montant des dotations affectées aux enseignements artistiques dans les écoles, collèges et lycées. Puis, il a demandé des éclaircissements sur les suites données aux remarques formulées par le Rapporteur spécial, l’an passé, à propos des dysfonctionnements de la Bibliothèque nationale de France, ainsi que sur les suites données au rapport de l’Office d’évaluation des politiques publiques sur la politique de soutien au cinéma. Enfin, il a requis l’avis du Rapporteur spécial sur la position adoptée par l’Union européenne dans le cadre des négociations qui s’ouvraient à l’Organisation mondiale du commerce. En réponse, votre rapporteur spécial a notamment apporté les précisions suivantes : · il n’y a pas de désengagement de l’État s’agissant de grands travaux ; · les autorisations de programme relatives à la restauration du Grand Palais sont inscrites pour un montant de 400 millions de francs ; · les crédits de l’Enseignement scolaire réservés aux enseignements artistiques augmentent de 17 millions de francs. La ventilation détaillée fait en particulier apparaître 10 millions de francs pour le primaire, 21 millions de francs pour les collèges, 23 millions de francs pour les lycées ; · la gestion de la Bibliothèque nationale de France est incontestablement en nette amélioration. En particulier, les délais de fourniture des ouvrages ont sensiblement diminué, notamment avec la possibilité de réserver à partir d’Internet ; · le coût de fonctionnement de la Bibliothèque nationale de France est, certes, important (1,1 milliard de francs), cependant il doit être comparé avec celui des autres bibliothèques, 1,5 milliard de francs pour la Bibliothèque nationale de Grande-Bretagne et 3 milliards de francs pour la Bibliothèque du Congrès. · la politique du cinéma est, effectivement, une priorité de l’action du Gouvernement. Puis, la Commission a adopté quatre observations, présentées par le Rapporteur spécial, tendant : · à ouvrir 200 millions de francs de crédits, dans la prochaine loi de finances rectificative, sur le chapitre de la dotation générale de décentralisation, afin de résoudre les difficultés actuelles des bibliothèques municipales, compte tenu de la multiplication des projets constatée ; · à demander que le traitement des dossiers de financement des opérations touchant des monuments historiques soit accéléré, de manière à assurer un rythme de consommation des crédits plus satisfaisant que celui qui prévaut aujourd’hui (entre 50 et 80 %) ; · à souhaiter que le projet de loi relatif à l’archéologie préventive, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, soit examiné au premier semestre 2000 ; · à faire examiner, par l’Assemblée nationale, le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, adopté en première lecture par le Sénat, le plus rapidement possible. Après que M. Laurent Dominati ait fait part de son accord sur la seconde observation et se soit interrogé sur la liaison entre la mise en œuvre de la première observation et le calendrier des élections municipales, la Commission a adopté, sur la proposition du Rapporteur spécial, les crédits de la Culture, et vous demande d’émettre un vote favorable à leur adoption. OBSERVATIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION 1.– La commission des Finances, de l’Économie générale et du Plan demande que 200 millions de francs de crédits soient ouverts, dans la prochaine loi de finances rectificative, sur le chapitre 41-10 – Dotation générale de décentralisation – compensation des transferts de compétence dans le domaine culturel, afin de résoudre les difficultés actuelles des bibliothèques municipales, compte tenu de la multiplication des projets constatée. 2.– La commission des Finances, de l’Économie générale et du Plan demande que le traitement des dossiers de financement des opérations touchant des monuments historiques soit accéléré, de manière à assurer un rythme de consommation des crédits y afférents plus satisfaisant. 3.– La commission des Finances, de l’Économie générale et du Plan demande que le projet de loi relatif à l’archéologie préventive, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, soit examiné au premier semestre 2000. 4.– La commission des Finances, de l’Économie générale et du Plan demande que le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, adopté en première lecture par le Sénat, soit examiné par l’Assemblée nationale le plus rapidement possible. Laisser la page blanche sans numérotation ANNEXE LAISSER CETTE PAGE BLANCHE SANS NUMÉROTATION. A N N E X E LISTE DES PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES MINISTÈRE DE LA CULTURE * M. André CHANDERNAGOR, président de l’Observatoire des mouvements internationaux d’œuvres d’art * M. François BARRÉ, directeur de l’architecture et du patrimoine * M. Dominique WALLON, directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles * Mme François CACHIN, directrice des Musées de France * M. Bernard SCHOTTER, directeur adjoint des Musées de France * Mme Thérèse LAVAL, chargée de mission sur les questions fiscales, sous-direction des affaires juridiques de la direction de l’administration générale MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE Direction de la législation fiscale * M. Jean-Louis JOURNET, sous-directeur * M. Denis ROGER, chef de section TVA * M. Jean-Pierre LIEB, sous-directeur B * M. Pascal SAINT-AMANS, chargé du bureau B2 (droits de mutation à titre gratuit, impôt de solidarité sur la fortune) * Mme Pascale BARBET, inspecteur principal, bureau B2 * Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU, inspecteur, bureau B2 * M. Claude BADRONE, sous directeur, bureau C 2 Direction générale des douanes et des droits indirects * M. Alain CAZARRÉ, chef du bureau E3 (procédures, régimes économiques et réglementations techniques) * M. Guillaume ADELLE, inspecteur du bureau E3, chargé du secteur de la culture * Mme Francette TEBOUL, chef du bureau F1 (fiscalité et transports) * M. Eric FISITZKY, adjoint au chef du bureau F1 * M. Olivier PEUZIAT, inspecteur des impôts chargé de la fiscalité au bureau F1 ÉTABLISSEMENTS PUBLICS * M. Jean-Jacques AILLAGON, président du Centre national d’art et de culture Georges Pompidou * M. Jean-Pierre HOSS, directeur général du Centre national de la cinématographie * M. Stéphane MARTIN, président de l’Établissement public du musée du quai Branly OPÉRATEURS * M. Antoine BERNHEIM, président de la Maison des Artistes * M. Serge COLIN, Syndicat national unifié des impôts * Mme Marie-Claire MARSAN, déléguée générale du Comité des galeries d’art * M. Philippe KRAEMER, président honoraire du Syndicat national des antiquaires * M. Claude BLAIZOT, président honoraire du Syndicat national des antiquaires * M. Yannick GUILLOU, commissaire-priseur, vice-président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs * M. Fabrice ALEXANDRE, consultant * M. Hervé POULAIN, commissaire-priseur * Mme Françoise MAEGHT, directrice de galerie * M. Daniel TEMPLON, directeur de galerie * Mme Laure de BEAUVEAU-CRAON, présidente de Sotheby’s France * M. Hugues JOFFRE, président du directoire de Christie’s France * M. Bertrand du VIGNAUD, membre du directoire de Christie’s France * Mme Isabelle de WAVRIN, responsable de la rubrique « marché » de Beaux-Arts Magazine * M. Jean-Claude BEIGUILMAN, responsable dommages biens des particuliers chez Generali France N°1861-09. - Rapport de M. Raymond Douyère, au nom de la commission des finances, sur le projet de loi de finances pour 2000. - Culture et communication : culture - Cliquer ici pour retourner au sommaire général - Cliquez ici pour retourner à la liste des rapports et avis budgétaires - Cliquez ici pour retourner à la liste des discussions budgétaires
() Charges nettes du budget de l’État à structure 1998. () Certaines directions régionales emploient aujourd’hui du personnel rémunéré par des associations para-administratives qui bénéficient de subventions du ministère de la Culture. Les créations d’emploi prévues dans le présent projet de loi de finances permettront de remédier aux situations susceptibles de faire l’objet des plus vives critiques. () Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence et Centre international de créations théâtrales. () Mission interministérielle des grands travaux, (MIGT), Service national des travaux (SNT), Établissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels (EPMOTC). () Solde des mesures acquises négatives et des mesures nouvelles positives. () Cette mesure est financée par l’ouverture de 7 millions de francs de crédits nouveaux sur le chapitre 36-60 – Subventions aux établissements publics, sur les articles correspondant aux différents théâtres concernés. () 5 millions de francs de mesures nouvelles ont été ouvertes pour ce faire (chapitre 43-92 – Commandes artistiques et achats d’œuvres d’art), grâce à une diminution des crédits destinés aux acquisitions du musée du quai Branly. () 15 millions de mesures nouvelles vont permettre de financer cette disposition (chapitre 43-20 –Interventions culturelles d’intérêt national). () L’érection de l’ensemble des DRAC, créées en 1977, en centres de responsabilité en 1992 a marqué une avancée fondamentale dans le processus de déconcentration du ministère. () Ainsi, la subvention au Conservatoire national supérieur de musique de Paris passe de 74,09 millions de francs dans le budget voté de 1999 à 110,23 dans le présent projet de loi de finances. () Hors transfert net du titre IV vers le titre III, mais y compris les crédits d’origine parlementaire inscrits dans la loi de finances initiale pour 1999. () Article 2 du décret n° 98-1191 du 23 décembre 1998 portant création de l’Établissement public du musée du quai Branly. () M. Stéphane Martin, ancien directeur de la musique et de la danse et ancien directeur de cabinet du ministre de la Culture (1995-1997). () Le directeur de l’enseignement supérieur au ministère chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant, le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant, le directeur des musées de France au ministère chargé de la culture ou son représentant, le directeur de l’architecture et du patrimoine au ministère chargé de la culture ou son représentant, le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant, le directeur général de la coopération internationale et du développement au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant. () M. Germain Viatte, conservateur général du patrimoine, ancien directeur du Musée national d’art moderne et ancien directeur de la Mission de préfiguration pour la création du Musée de l’homme, des arts et civilisations. () M. Maurice Godelier, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales. () Le coût total des réaménagements est estimé à 160 millions de francs. () Article 1609 duovicies du code général des impôts. () L’aide automatique à la distribution a été réformée par un arrêté en date du 19 juillet 1999. () M. Didier Migaud, Rapporteur général, Fiscalité du patrimoine : pour plus de justice et d’efficacité, Assemblée nationale, onzième législature, document n° 1065, 16 juillet 1998. () Observatoire des mouvements internationaux d’œuvres d’art présidé par M. André Chandernagor, Les conditions de développement du marché de l’art en France. Analyse et propositions, 1994. Ibidem, Les conditions de développement du marché de l’art en France. Analyse et propositions – second rapport, avril 1998. () Commission d’études pour la défense et l’enrichissement du patrimoine national et le développement du marché de l’art présidée par M. Maurice Aicardi, Rapport au Premier ministre, juillet 1995. () M. Yann Gaillard, Sénateur, Marché de l’art : les chances de la France, Les rapports du Sénat, 1998-1999, n° 330, avril 1999. () Le 27 juillet 1998, le ministre de l’Intérieur du Directoire, Nicolas François de Neufchâteau accueillait les peintures et sculptures ramenées par l’armée d’Italie par ces mots : « Français ! Gardez religieusement cette propriété qu’ont léguée à la République les grands hommes de tous les siècles ; ce dépôt qui vous est remis par l’estime de l’univers, ce trésor dont vous devez compte à toutes les postérités. » () David Ricardo, Principes de l’économie politique et de l’impôt, chapitre premier, section première, 1821. () John Stuart Mill, Principes d’économie politique avec quelques-unes de leurs applications à l’économie sociale, tome I, livre III, chapitre II, 1848. () Cf. études de Robert C. Anderson (1974), J.-P. Stein (1977), Baumol (1986), de Frey et Pommerehne (1988), ou encore de Chanel, Gérard-Varet et Ginsburgh, (1990), citées par Raymonde Moulin, L’artiste, l’institution et le marché, Paris, 1992. () Commission d’études pour la défense et l’enrichissement du patrimoine national et le développement du marché de l’art présidée par M. Maurice Aicardi, Rapport au Premier ministre, juillet 1995. () Observatoire des mouvements internationaux d’œuvres d’art présidé par M. André Chandernagor, Les conditions de développement du marché de l’art en France. Analyse et propositions – second rapport, avril 1998. () M. Yann Gaillard, Sénateur, Marché de l’art : les chances de la France, Les rapports du Sénat, 1998-1999, n° 330, avril 1999. () L’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 15 juillet 1987, M. Pawlok, précise la notion d’artiste : seule la caisse primaire peut se prononcer après consultation de la commission compétente sur cet état, sur la base, notamment, de la « beauté et de l’expressivité des œuvres » ; la notoriété ne peut constituer un élément d’appréciation. () La composition et le fonctionnement de la commission compétente pour les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques est réglée par les articles R. 382-3 à R. 382-15 du code de la sécurité sociale. Cette commission intervient également lorsque la nature artistique des revenus est incertaine. Elle rejette, en moyenne, de 20 % à 25 % des demandes. () Cette déduction forfaitaire de 5 % pour frais professionnels s’applique de plein droit, sans justification, au montant brut des revenus de l’artiste. () Article 61 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d’ordre social. () Article 17 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996. () Sur cette base, 20.000 francs base 1976 correspondent environ à 65.000 francs base 1998. () Article 16 de la loi de finances rectificative n° 94-1162 du 29 décembre 1994. () Directive 94/5/CE du Conseil en date du 14 février 1994 relative au régime particulier applicable aux biens d’occasion, œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité. Ce régime particulier de la septième directive a été intégré à la sixième directive du 17 mai 1977. () Article 291-II-8° du code général des impôts. Les principaux établissements visés sont la Réunion des musées nationaux, les musées de l’État, des départements et des communes, les fondations, associations et autres établissements justifiant leur agrément par le ministre chargé des affaires culturelles. L’exonération est subordonnée à la production, à l’appui de la déclaration d’importation, d’une attestation signée par le directeur de l’établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement (article 50 decies de l’annexe IV du code général des impôts). () La rédaction de cet article reproduit celle de l’article 2 du décret n° 95-172 du 17 février 1995 relatif à la définition des biens d’occasion, des œuvres d’art, des objets de collection et d’antiquité pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, rédaction elle-même issue du a de l’annexe à la directive du 14 février 1994. () Cf. M. Alain Richard, Rapporteur général, Rapport d’information sur la proposition de septième directive concernant le régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux biens d’occasion, objets d’art, d’antiquité et de collection, Assemblée nationale, neuvième législature, document n° 2906, 9 juillet 1992. () D’autres pays ont obtenu certains aménagements : taxation des objets d’art et de collection sur le prix total en Allemagne ; exclusion des bijoux du champ de la directive à la demande de l’Espagne ; taxation, dans certains cas, des œuvres d’art sur une marge forfaitaire pour la France. () L’acquisition intracommunautaire est constituée par la vente par un assujetti d’un État membre d’un bien meuble corporel qui est expédié ou transporté en France, par le vendeur, l’acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur. () L’interdiction de déduire la TVA figurant sur les factures ou documents en tenant lieu ou acquittée lors de l’importation ou de l’acquisition intracommunautaire du bien s’applique dans tous les cas où l’option pour le régime de la marge a été exercée par l’assujetti revendeur. C’est, notamment, le cas lors de la revente d’une œuvre d’art acquise auprès d’un artiste assujetti à la TVA lorsque le négociant a opté pour la taxation à la marge. C’est également le cas pour la revente d’une œuvre d’art par un négociant qui l’a importé préalablement et qui applique la taxe sur sa marge bénéficiaire. () Aux termes de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, entrent dans cette catégorie, notamment, les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie, les œuvres graphiques. () Ce système pouvait paraître absurde. Par exemple, une œuvre de Francis Bacon réalisée avant 1973 était exonérée de TVA alors même qu’une œuvre du même auteur produite depuis y était assujettie. () Commission des Communautés européennes, Rapport de la Commission au Conseil sur l’examen de l’incidence des dispositions de la directive 94/5/CE sur la compétitivité du marché communautaire de l’art par rapport à ceux des pays tiers, 28 avril 1999. () Market Trading International Ltd for British Art Market Federation, The British Art Market 1997, A study of the value of the Art and Antique Market in Britain and the implications of EU Harmonisation of Import VAT and Artist Resale Rights, 1997. () Ce fut le cas, notamment, d’œuvres de Kees Van Dongen ou de Louis-Ernest Meissonier. () M. Alain Richard, Rapporteur général, Rapport sur le projet de loi relatif à l’impôt de solidarité sur la fortune, Assemblée nationale, neuvième législature, document n° 158, 3 octobre 1988. () Journal Officiel – Débats de l’Assemblée nationale, 19 octobre 1988, page 1022. () Loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998, articles 13 à 18. () 200.000 francs en Allemagne (valeur 1997), 120.000 francs en Autriche (valeur 1988).
() Journal officiel – Débats de l’Assemblée nationale, deuxième séance du 29 octobre 1991, () Loi de finances pour 1982 n° 81-1160 du 30 décembre 1981. () Journal officiel – Débats de l’Assemblée nationale, deuxième séance du 29 octobre 1991, page 2748. () Journal Officiel – Débats de l’Assemblée nationale, 21 octobre 1988, page 1181. () M. Didier Migaud, Rapporteur général, Fiscalité du patrimoine : pour plus de justice et d’efficacité, Assemblée nationale, onzième législature, document n° 1065, 16 juillet 1998. () Assemblée nationale, onzième législature, document n° 1053, 7 juillet 1998. () M. André Chandernagor, Les conditions de développement du marché de l’art en France, analyses et propositions – second rapport, avril 1998.
() Journal officiel – Débats de l’Assemblée nationale, première séance du 16 octobre 1998, () Ibidem, deuxième séance du 17 octobre 1998, page 6994. () Conseil des impôts, L’imposition du patrimoine, Seizième rapport au Président de la République, 1998, pages 165-166. () M. Didier Migaud, Rapporteur général, Rapport sur le projet de loi de finances pour 1999, tome II, volume I, Assemblée nationale, onzième législature, document n° 1111, 8 octobre 1998, page 200. () Cour de cassation, chambre commerciale, 17 octobre 1995, Tenoudji. () Loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales. () Loi de finances pour 1992 n° 91-1322 du 30 décembre 1991. () Décret n° 70-1046 du 10 novembre 1970 fixant les conditions dans lesquelles sont donnés les agréments prévus par la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique. () Loi n° 96-559 du 24 juin 1996 portant diverses mesures en faveur des associations, article 2. () On peut rappeler qu’en 1998 le résultat net de la Française des Jeux, société anonyme d’économie mixte détenue à 72 % par l’État, devrait atteindre 300 millions de francs après impôt, pour un chiffre d’affaires d’environ 15 milliards de francs. () Le rapport Chandernagor (avril 1998), tout comme le rapport Gaillard (avril 1999), préconisent d’exonérer de droit de reproduction (article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle) les catalogues réalisés par les galeries, qui y sont aujourd’hui soumises, contrairement aux maisons de vente et aux commissaires-priseurs (article L. 122-5 du code précité, tel que modifié par l’article 17 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n° 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993). () Article 9 de la loi du 27 mars 1997 précitée, codifié à l’article L. 123–7 du code de la propriété intellectuelle. () Le droit de suite n’a pas de portée pratique en Italie et au Luxembourg. () Mme Nicole Ameline, Rapport d’information déposé par la Délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale (COM [96] 97 final/n° E 641), Assemblée nationale, dixième législature, document ° 3305, 21 janvier 1997, page 80. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
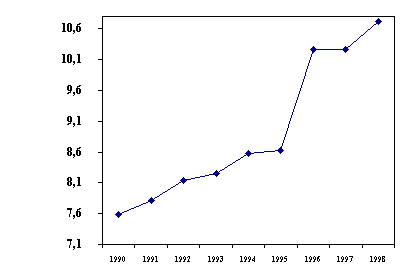 (en milliards de francs)
(en milliards de francs)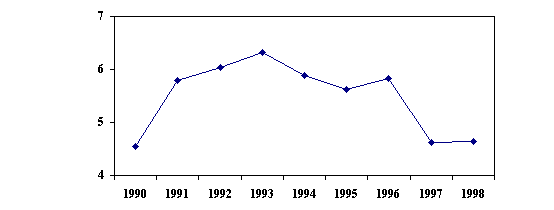 ÉVOLUTION DES DOTATIONS EN DÉPENSES EN CAPITAL
ÉVOLUTION DES DOTATIONS EN DÉPENSES EN CAPITAL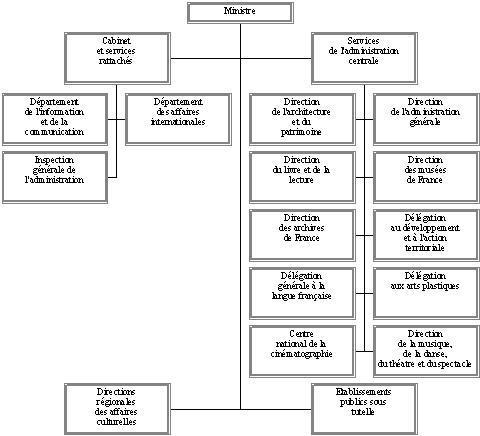
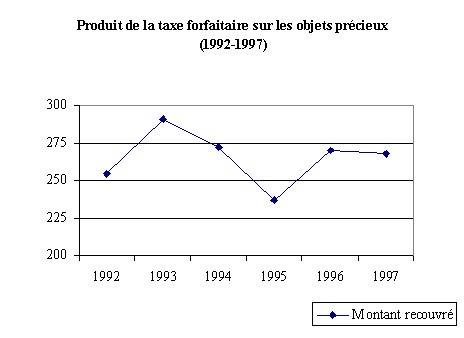 Pour 1997, sur 251 millions de francs recouvrés par la direction générale des impôts (94 % du total), 151 millions de francs (60 %) proviennent de transactions portant sur les métaux précieux, 68 millions de francs (27 %) des ventes aux enchères publiques, 30 millions de francs (12 %) des autres ventes d’objets précieux. Cette répartition est relativement stable sur les dernières années (respectivement 59 %, 31 %, 9 % en 1996). Par ailleurs, 17 millions de francs étaient recouvrés par les services des douanes sur les exportations (6 % du total).
Pour 1997, sur 251 millions de francs recouvrés par la direction générale des impôts (94 % du total), 151 millions de francs (60 %) proviennent de transactions portant sur les métaux précieux, 68 millions de francs (27 %) des ventes aux enchères publiques, 30 millions de francs (12 %) des autres ventes d’objets précieux. Cette répartition est relativement stable sur les dernières années (respectivement 59 %, 31 %, 9 % en 1996). Par ailleurs, 17 millions de francs étaient recouvrés par les services des douanes sur les exportations (6 % du total).