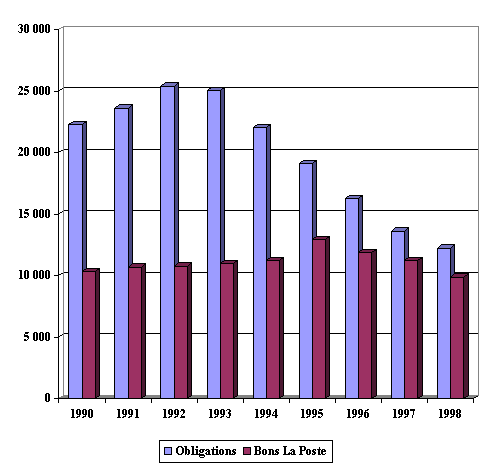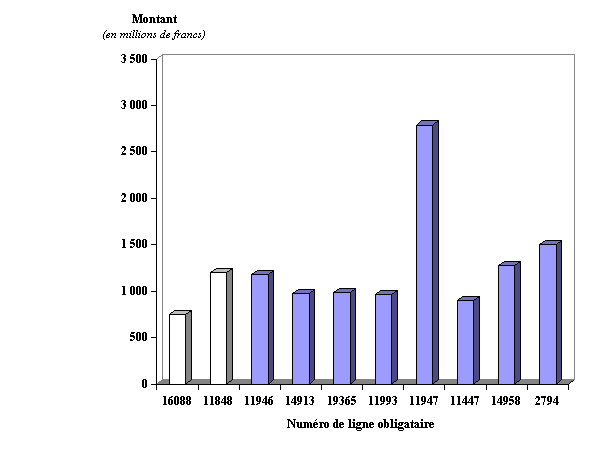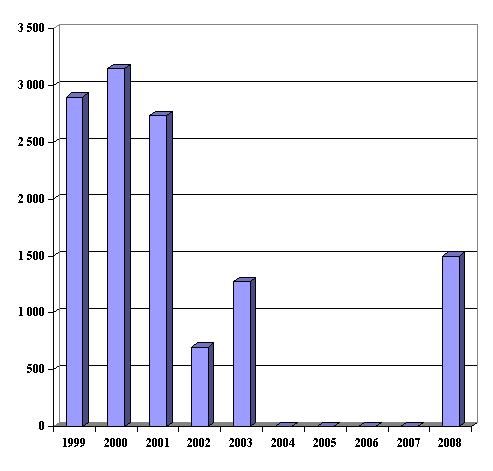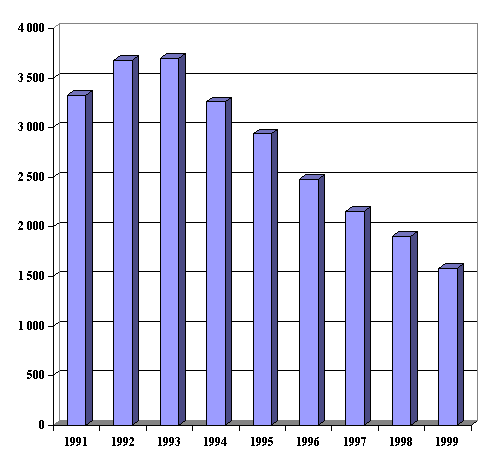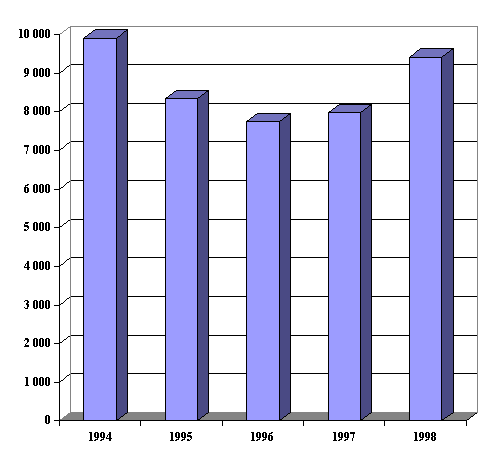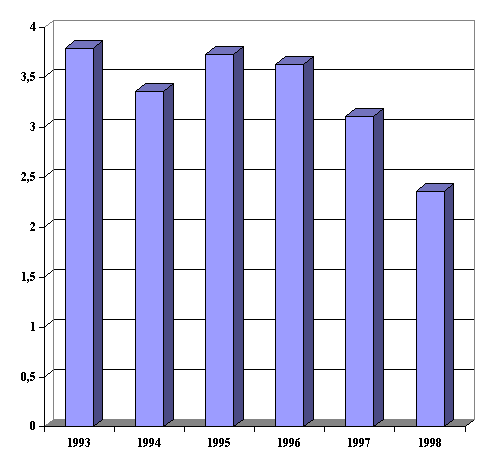Document mis en distribution le 19 novembre 1999 N° 1861 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) SUR PAR M. DIDIER MIGAUD, Rapporteur Général, Député. —— ANNEXE N° 15 Rapporteur spécial : M. Edmond HERVÉ Député ____ (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Lois de finances. La commission des finances, de l’économie générale et du plan est composée de M. Augustin Bonrepaux, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Michel Bouvard, Jean-Pierre Brard, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM. Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Eric Besson, Alain Bocquet, Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Raymond Douyère, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Guy Lengagne, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Georges Tron, Philippe Vasseur, Jean Vila.
Les crédits de la Poste et des Télécommunications concernent à titre principal : · les crédits de rémunération du personnel et de fonctionnement de l’Autorité de régulation des télécommunications ; · les moyens de fonctionnement de la Commission supérieure du service public des postes et des télécommunications ; · les dotations de fonctionnement et d’investissement de l’Agence nationale des fréquences ; · la subvention de l’État à l’enseignement supérieur des télécommunications ; · les subventions à divers organismes (dont La Poste, au titre du transport de la presse). Dans le présent projet de loi de finances, ces crédits ne font plus l’objet d’aucune identification particulière, alors même qu’ils constituaient, dans la loi de finances initiale pour 1999, un agrégat à part entière (agrégat 05 – Poste et télécommunications). La section Industrie disparaissant, ils figurent désormais dans la nouvelle section Économie, Finances et Industrie, pour partie, au sein de l’agrégat 01 – Administration générale et dotations communes, et pour une autre partie, au sein de l’agrégat 11 – Actions sur l’environnement des entreprises et modernisation des petites et moyennes entreprises. Il convient, par ailleurs, de relever que les crédits d’études dans les domaines des postes et télécommunications, qui étaient identifiables dans la loi de finances initiale pour 1999 (section Industrie, chapitre 54-93, article 70), ne le sont plus dans le projet de loi de finances pour 2000. L’analyse de ce dernier permet de constater une augmentation de 4,12 % des crédits de la Poste et des Télécommunications. Un tableau récapitulatif, dans le chapitre premier, les présente de manière exhaustive. Ils sont mis en œuvre sous la responsabilité du secrétariat d’État à l’Industrie et, en particulier, de la direction générale de l’industrie, des technologies de l’information et des postes (DGITIP). LAISSER CETTE PAGE SANS NUMÉROTATIONCHAPITRE PREMIER : UNE PROGRESSION SENSIBLE DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES Les dotations budgétaires destinées aux actions relevant de la Poste et des Télécommunications s’élèvent, dans le projet de loi de finances, à 2.775,87 millions de francs, soit une progression de 4,12 % par rapport à 1999. Selon la structure du projet de loi de finances pour 2000, l’évolution entre 1998 et 1999 avait été limitée à 1,35 %. Les moyens des organismes mis en place le 1er janvier 1997 La même tendance à la hausse touche les interventions traditionnelles de l’État dans ce domaine : la contribution aux organismes des postes et télécommunications dans les territoires d’outre-mer, ainsi que le transport de la presse. · L’Autorité de régulation des télécommunications, dont les crédits sont désormais réunis sur un seul chapitre 37-06, verra son budget passer de 87,51 millions de francs en 1999 à 91,03 millions de francs en 2000, soit une progression de 4,03 %. Les crédits de personnel s’élèvent à 48,67 millions de francs contre 47,06 millions de francs en 1999 et 44,7 millions de francs en 1998. Si les rémunérations principales croissent de 4,34 %, nous notons que l’enveloppe des indemnités et allocations diverses passe de 13,62 millions de francs en 1999 à 13,83 millions de francs en 2000, soit une augmentation de 1,53 %. Sur ce point, il a été tenu compte des observations que nous avions formulées l’an dernier (pour 1999, cette augmentation était de 7,07 %). Cette progression des crédits de personnel correspond à des mesures d’ajustement des rémunérations, à la transformation de 10 emplois, ainsi qu’à la création de 2 emplois (un ingénieur en chef des télécommunications et un administrateur des postes et des télécommunications). Les dépenses de fonctionnement de l’Autorité atteignent 42,36 millions de francs contre 40,45 milliards de francs en 1999, soit une augmentation de 4,72 %. Cette hausse est le résultat d’une mesure nouvelle de 1,91 million de francs. · La dotation de fonctionnement de l’Agence nationale des fréquences est en forte augmentation de 21 millions de francs par rapport à 1999 (171 millions de francs) : ceci doit prendre en compte, d’une part, la création de 41 emplois non budgétaires de contractuels, qui viendront s’ajouter aux 297 emplois actuels, et, d’autre part, l’augmentation de la subvention liée au transfert des activités radiomaritimes exercées aujourd’hui par France Télécom (correspondant aux 41 emplois susvisés). La dotation en crédits de paiement reste stable à 57 millions de francs, permettant la poursuite des opérations de contrôle et de réaménagement du spectre. La baisse des autorisations de programme se poursuit, passant de 62 millions de francs en 1999 à 59 millions de francs en 2000. Cette réduction est motivée par la fin des besoins liés à la mise en place de l’Agence. · Le Groupe des écoles des télécommunications recevra une dotation de 494,5 millions de francs contre 459,5 millions de francs en 1999 (soit + 7,62 %). Cette augmentation prend en compte le transfert de 26 chercheurs du Centre national d’études en télécommunications, ainsi que le renforcement des moyens de fonctionnement de l’établissement. · La contribution de l’État au transport et à la distribution de la presse est augmentée à 1.900 millions de francs conformément aux stipulations du contrat d’objectifs et de progrès signé avec La Poste (). · La contribution de l’État aux organismes des postes et télécommunications des territoires d’outre-mer augmente de manière significative, passant de 2,7 millions de francs en 1999 à 5,43 millions de francs pour 2000, soit plus qu’un doublement. L’ensemble de cette progression est motivé par la création d’une mission permanente auprès du Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, résultant du transfert de l’État au territoire de la responsabilité de l’Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie () ; l’État restera compétent pour la réglementation des fréquences radioélectriques, ainsi que pour les liaisons gouvernementales, de sécurité et de défense. Inversement, la Cellule Polynésie française fait l’objet d’une mesure négative d’ajustement de 0,57 million de francs. · Les dotations de fonctionnement de la Commission supérieure du service public des postes et des télécommunications sont reconduites à l’identique à 1,58 million de francs. Il convient de rappeler que les crédits de la commission supérieure avaient été transférés en 1999 sur la section « Services communs et finances » du budget. · Les crédits au titre de la participation de la France aux organismes internationaux dans le secteur des postes et télécommunications (), baissent légèrement de 55 millions de francs à 52,88 millions de francs, soit une réduction de 3,86 %. Cette diminution est liée à la prise en compte d’une économie réalisée sur les taux de change. · Les subventions versées aux associations d’usagers du service public des postes et télécommunications sont provisionnées pour 2000 à 0,34 million de francs (somme identique à 1999 et à 1998). Les versements ont évolué à la baisse depuis 1994 (0,425 million de francs reconduits en 1995, 0,365 million de francs en 1996 et 0,361 million de francs en 1997). TABLEAU RÉCAPITULATIF DE L’ÉVOLUTION DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES
CHAPITRE II : LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS Dans notre précédent rapport (), nous avons présenté l’organisation de France Télécom. Celle-ci demeure inchangée depuis. Cette année, nous voudrions décrire, de manière plus précise, la place du personnel dans cette société anonyme. I.– LES GARANTIES DU PERSONNEL Elles sont statutaires et prennent tout leur sens grâce à la politique de gestion du personnel. La loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l’entreprise nationale France Télécom garantit l’application, pour les personnels concernés, des titres I et II du statut général des fonctionnaires de l’État (lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984). Elle maintient en vigueur l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public des postes et des télécommunications, qui prévoyait déjà cette garantie dans le précédent statut de France Télécom. Il est également prévu que les recrutements de fonctionnaires pourront continuer jusqu’au 1er janvier 2002. Il est institué un comité paritaire dont les compétences se rapprochent de celles dévolues au comité d’entreprise. Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives ; les contractuels (les personnels non fonctionnaires) y disposent d’une représentation spécifique, elle aussi désignée par les organisations syndicales représentatives. Un décret n° 96-1179 du 26 décembre 1996 est venu préciser les compétences et les modalités de fonctionnement du comité paritaire. La loi prévoit que France Télécom « recherche par la négociation et la concertation la conclusion d’accords avec les organisations syndicales » dans certains domaines (emploi, formation, conditions de travail...). Dans ce cadre, un accord cadre national a été signé le 9 janvier 1997 avec la CFDT, la CFTC, la CGC et FO. Il a permis un enrichissement du dialogue social à tous les niveaux de l’entreprise et a débouché sur la signature de 70 accords locaux dans les services nationaux et régionaux, expression d’un changement culturel fort au sein de France Télécom. Cet accord porte sur l’insertion professionnelle des jeunes, la promotion, la réduction et l’aménagement du temps de travail. Il prévoit des horaires de travail à temps convenu entre l’agent et sa hiérarchie, l’ouverture des agences le samedi et en soirée, et plus généralement, une meilleure adaptation des horaires de travail aux besoins des clients de France Télécom et de ses agents. Par un avenant du 21 décembre 1998, cet accord a été prorogé pour une durée indéterminée. La loi de 1996 autorise désormais France Télécom à recruter librement des contractuels sous le régime des conventions collectives. Elle assujettit expressément l’ensemble du personnel de France Télécom au régime de l’intéressement, de la participation et du plan d’épargne d’entreprise. L’entreprise a signé un nouvel accord d’intéressement, le 26 mai 1997, avec les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGC et FO. Cet accord est applicable pour les années 1997, 1998 et 1999. Il comprend une part nationale, fondée sur la croissance du trafic en minutes et le résultat opérationnel courant, et une part négociée localement sur des critères de qualité de service et de performance économique. En 1998, France Télécom a servi un intéressement à ses personnels à hauteur de 1,83 % de la masse salariale. En application de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, France Télécom se trouve soumise, à compter de 1997, aux dispositions du code du travail relatives à la participation et au plan d’épargne entreprise. En vertu des dispositions relatives à la participation, et de l’accord de groupe conclu avec la CFDT, la CFTC, la CGC et FO, le 19 novembre 1997, France Télécom a constitué au profit du personnel du groupe une réserve de participation calculée sur les bénéfices et dont le montant résulte d’une formule légale. Au 31 décembre 1998, la charge correspondante s’élevait à 946 millions de francs. En vertu de l’article 8 de la loi du 26 juillet 1996, précisé par le décret n° 96-1226 du 27 décembre 1996, une commission paritaire de conciliation chargée de donner un avis sur les différends pouvant surgir dans l’interprétation des accords signés a été créée. S’agissant des recrutés locaux, est mis en place un congé de fin de carrière à 55 ans, assorti d’une rémunération égale à 70 % de la rémunération d’activité. Le droit à ce congé est ouvert jusqu’au 31 décembre 2006. Il a fait l’objet d’un accord d’entreprise signé le 2 juillet 1996. Les droits à retraite des bénéficiaires sont calculés sur la base d’un traitement complet. Cet accord répond aux souhaits de certains salariés d’anticiper leur cessation d’activité, favorise le rajeunissement de la pyramide des âges en ouvrant le recrutement de jeunes, permet de mieux satisfaire les demandes de mobilité des salariés et améliore les perspectives de promotion. La séparation de La Poste et de France Télécom pour la gestion des œuvres sociales a été réalisée en janvier 1998 ; la gestion commune pour les activités culturelles et certaines activités de solidarité et de loisir est, néanmoins, maintenue au sein d’un groupement d’intérêt public, dénommé « Gestion des activités communes à La Poste et à France Télécom ». Les statistiques fournies par l’opérateur témoignent de l’importance, dans les années récentes, des mouvements de personnel.
Avec l’accord social du 9 janvier 1997, prorogé pour une durée indéterminée par un avenant de décembre 1998, France Télécom, qui s’était engagée à accueillir en permanence 1.000 jeunes en formation en alternance, a passé 1.543 contrats d’apprentissage et d’alternance, au 31 décembre 1998. Il participe ainsi, de façon active, à l’effort national d’insertion professionnelle des jeunes. En complément de cette politique d’insertion professionnelle des jeunes, France Télécom a poursuivi sa politique de recrutement de jeunes de moins de 25 ans à hauteur de 45 % de l’ensemble des recrutements. Cette politique a été rendue possible par le départ de 2.749 fonctionnaires en congé de fin de carrière en 1998. L’entreprise a également renforcé sa politique de redéploiements et d’adaptation en mettant en place un dispositif de reconversion professionnelle, qui offrira, à 10.000 personnes en trois ans, la possibilité de changer de métier ou de s’adapter aux fortes mutations de leur métier actuel, afin d’accompagner l’indispensable évolution économique du groupe dans le cadre du maintien de l’emploi. En 1998, 9.063 personnes ont changé soit de poste, soit de métier. En 1999, France Télécom a prévu de recruter près de 2.000 personnes sous statut de droit privé. Les recrutements pour les années suivantes interviendront en fonction de l’évolution du marché, et du rythme des départs en congé de fin de carrière. Ils se feront sous statut de droit privé. Dans les années à venir, elle entend accentuer sa politique active en matière d’insertion professionnelle des jeunes, de mobilité interne, de développement des compétences, de rajeunissement de la pyramide des âges. Toutefois, l’entreprise, qui se situe dans un secteur fortement concurrentiel, doit avoir le souci de la compétitivité, de l’amélioration de la productivité et de l’adaptation permanente de son organisation au service des clients. Ces préoccupations essentielles sont et seront, en permanence, prises en compte dans la politique de gestion des salariés de l’entreprise, définie à court et moyen terme. France Télécom a la volonté de développer une politique de rémunération pour l’ensemble des salariés, en favorisant une plus grande cohérence. La mise en conformité du système indemnitaire avec la politique des ressources humaines de l’entreprise constitue une étape préalable pour répondre à cette ambition. Dans ce cadre, l’entreprise a réformé le « coutumier », dont l’attribution n’était ni transparente ni équitable et qui avait perdu sa justification historique. En 1999, elle a donc décidé d’actualiser sa politique indemnitaire, d’une part, en proposant des options de remplacement du « coutumier », à ses bénéficiaires, d’autre part, en élargissant le système de remboursement des frais professionnels au réel à l’ensemble des salariés. Un accord salarial pour les salariés régis par la convention collective a été signé, le 8 avril 1999, par les organisations syndicales CFDT, CFTC, SNC-CGC, et FO. Deux accords, en date du 18 décembre 1997, ont institué, à compter du 1er février 1998, une couverture prévoyance obligatoire en faveur des salariés de droit privé de France Télécom. La protection proposée est étendue et répond à deux objectifs : · couvrir de façon complète les risques lourds : décès, incapacité, invalidité ; · proposer un régime de remboursement de frais médicaux. La mise en place de ces garanties permet d’assurer la compétitivité de la couverture prévoyance de France Télécom et, par l’alignement des garanties avec celles en vigueur dans les filiales, de faciliter la mobilité au sein du groupe. Conformément à la loi du 2 juillet 1990 modifiée, 25 millions d’actions (représentant 10 % de l’offre de marché) ont été proposées au personnel et à certains anciens salariés de France Télécom à travers le monde. S’appuyant sur des conditions préférentielles attractives par rapport à celles prévues pour l’offre à prix fermé et le placement global garanti, la mise en place d’une logistique importante et une communication de proximité, l’offre réservée au personnel a rencontré un grand succès auprès de l’ensemble des catégories socioprofessionnelles de la société. Avec 128.890 souscripteurs, représentant 70 % des membres du personnel en activité, la demande s’est élevée à 37,5 millions d’actions, soit 12,5 millions d’actions de plus que les actions offertes. En application des modalités de réduction décidées par l’État, 50 % des souscripteurs ont été servis intégralement et 75 % d’entre eux ont été servis à hauteur des trois quarts de leur demande. En novembre 1998, dans le cadre de la cession d’actions au marché par l’État, une seconde offre d’achat d’actions réservée au personnel a été mise en place. Elle a attiré 86.000 souscripteurs au sein du groupe. Parmi eux, 13.000 sont de nouveaux actionnaires. À l’issue des deux mises sur le marché successives, qui ont eu lieu en octobre 1997 et en novembre 1998, trois salariés sur quatre détiennent des actions de leur entreprise, soit 3,6 % du capital social (). Dès 1996, des négociations ont été ouvertes avec l’ensemble des organisations syndicales et ont abouti à l’accord social signé le 9 janvier 1997, qui s’applique à l’ensemble des salariés, et porte notamment sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. Cet accord a permis le passage à un horaire hebdomadaire se situant entre 34 et 36 heures pour les salariés en contact avec le public, en contrepartie de l’ouverture des agences commerciales le soir et le samedi. Afin de prendre en compte, d’une part, la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail et, d’autre part, l’accord de branche signé au sein de l’Union des entreprises de télécommunications (UNETEL), France Télécom poursuit une démarche négociée sur l’aménagement et la réduction du temps de travail qui permette de concilier les aspirations du personnel et les équilibres économiques et financiers de l’entreprise, dont toutes les activités sont aujourd’hui ouvertes à la concurrence. La recherche d’un accord sur les 35 heures doit prendre en compte le fait que, pour 80 % de ses personnels, la politique salariale intègre les mesures de la fonction publique, notamment celles relatives à la rémunération des fonctionnaires. France Télécom n’a donc pas entièrement la maîtrise de sa masse salariale, ce qui constitue une spécificité. Par ailleurs, l’entreprise, contrairement à tous les opérateurs historiques européens qui ont procédé à des suppressions massives d’emplois, a fait le choix de réaliser des gains de productivité imposés par l’évolution des techniques et le développement de la concurrence par une politique de redéploiement de ses effectifs et la mise en place d’un dispositif de congé de fin de carrière. Ce choix implique une maîtrise des charges salariales limitant les recrutements externes aux seuls besoins qui ne peuvent être satisfaits par des ressources internes. II.– LES RÉMUNÉRATIONS ET LES RETRAITES
Ces rémunérations intègrent les primes. Les fonctionnaires de France Télécom relèvent du régime de la fonction publique et bénéficient, à ce titre, du régime spécial de retraite, conformément aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite fixées par la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964. Jusqu’à la fin 1996, conformément à l’article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 portant création de l’établissement autonome de droit public France Télécom, l’État était responsable du versement des pensions des agents de France Télécom comme de celles de tous les fonctionnaires. En contrepartie, l’établissement devait verser annuellement, au Trésor public, le montant de la retenue effectuée sur le traitement des agents, au titre des pensions, ainsi qu’une contribution complémentaire permettant d’assurer la prise en charge intégrale du montant des pensions payées par l’État aux agents de France Télécom. À partir de 1997, la loi précitée a pour effet de mettre les cotisations de retraites et autres charges sociales payées par France Télécom à un niveau comparable à celui supporté par les autres entreprises de télécommunications en France, sans modifier les avantages reçus par les fonctionnaires, y compris leurs retraites. Depuis lors, France Télécom verse une contribution libératoire mensuelle. Celle-ci est égale à un certain pourcentage du montant total du traitement de base versé aux agents fonctionnaires. Ce pourcentage est calculé selon les modalités arrêtées par le décret n° 97-139 du 13 février 1997. Ce pourcentage est fixé chaque année, afin d’égaliser le niveau général des charges sociales entre France Télécom et les opérateurs privés de télécommunications en France. Pour 1997, le taux avait été fixé à 36,2 %. Pour 1998, le taux était de 35,4 %. Il est de 36,7 % en 1999. Dans le cadre du passage au système de contribution libératoire, la loi du 2 juillet 1990 impose, en outre, à France Télécom de verser une contribution forfaitaire exceptionnelle de 37,5 milliards de francs à l’État en 1997, qui a été payée en plusieurs fois jusqu’au mois d’octobre 1997. Cette contribution n’est pas déductible des bénéfices de la société pour le calcul de l’impôt sur les sociétés. Son montant a été comptabilisé dans le bilan d’ouverture de la société au 1er janvier 1996 et imputé sur la situation nette. Les provisions réalisées pour les retraites des fonctionnaires par France Télécom depuis 1994 ont été les suivantes :
Le nouveau système de la contribution libératoire a mis fin à la constitution de ces provisions. Elle s’insère dans le cadre défini par le programme d’action gouvernemental pour l’entrée de la France dans la société de l’information (PAGSI), présenté en janvier 1998. Il comporte six priorités : 1. Développer l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement pour, d’une part, permettre aux futurs citoyens de maîtriser ces outils et, d’autre part, moderniser les méthodes d’enseignement grâce au multimédia. 2. Renforcer la présence culturelle française sur Internet, avec notamment l’aide à la création de programmes et de produits multimédia, la numérisation du patrimoine culturel français, etc. 3. Moderniser l’administration grâce aux nouvelles technologies, d’une part, en s’appuyant sur l’utilisation d’Internet pour l’information des citoyens, la diffusion de données publiques, la dématérialisation des démarches administratives (téléprocédures), d’autre part, en utilisant Internet et les technologies associées pour moderniser le fonctionnement interne des administrations. 4. Encourager la diffusion des technologies de l’information dans les entreprises, favoriser le développement du commerce électronique, encourager l’utilisation active d’Internet par les PME. 5. Encourager l’innovation technologique en agissant sur l’environnement financier des sociétés innovantes au travers de mesures fiscales favorables à la création d’entreprise (bon de souscription de parts de créateurs d’entreprises, report d’imposition pour les plus-values des créateurs d’entreprises réinvesties dans une entreprise en création), la création de fonds de capital d’amorçage (exemple du fonds « I-Source » mis en place par l’Institut national de la recherche en informatique et en automatique et des sociétés de capital-risque), de l’orientation de l’épargne (assurance-vie) vers le capital-risque, du renforcement des fonds privés de capital-risque par des capitaux publics issus de l’ouverture du capital de France Télécom (création d’un fonds, porté à 900 millions de francs) en soutenant directement des projets de recherche-développement, comme dans le cadre du Réseau national de recherche en télécommunications ou à travers le programme « société de l’information ». 6. Adapter le cadre juridique et assurer la régulation d’Internet, avec, par exemple, la libéralisation de l’usage de la cryptologie, la clarification de la responsabilité des intermédiaires techniques sur Internet, la protection de la vie privée, etc. Le bilan effectué pour le comité interministériel du 19 janvier 1999 a permis de constater qu’une large majorité des mesures préconisées ont été mises en place au cours de l’année passée ou sont en cours de réalisation. La politique du Gouvernement vise notamment à encourager la diffusion des nouvelles technologies dans le secteur public, pour accroître son efficacité et améliorer les services rendus aux citoyens et aux entreprises, mais aussi dans le secteur concurrentiel, pour permettre aux entreprises d’accroître leur compétitivité et d’offrir de nouveaux services, autour du commerce électronique, par exemple. Cette politique se traduit, d’abord, par des mesures d’adaptation du cadre juridique pour favoriser l’utilisation de ces technologies, notamment le développement du réseau Internet et du commerce électronique, et renforcer la confiance des acteurs du commerce électronique et des consommateurs. Le Gouvernement participe activement à de nombreux travaux au niveau européen et international : adoption d’une directive sur la signature électronique, préparation d’une directive sur le commerce électronique, participation à la réforme de la gestion des noms de domaines sur Internet, etc. Au niveau national, des évolutions réglementaires ont déjà été adoptées, tel le relèvement du seuil d’usage libre pour les produits de cryptologie. Des travaux importants ont été conduits pour l’adaptation du cadre législatif : signature électronique, cryptologie, responsabilité des intermédiaires techniques sur Internet, convergence des réseaux de télécommunications et des réseaux audiovisuels, etc. Par ailleurs, la consultation organisée, à la demande du Gouvernement, par l’Association française pour le nommage d’Internet en coopération (AFNIC) a permis d’adapter la gestion des noms de domaines sur Internet. Le 26 août 1999, le Premier ministre a annoncé un projet de loi porté par le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie avec le secrétaire d’État à l’Industrie sur la société de l’information, qui permettra de doter la France d’un cadre juridique clair et stable sur l’Internet. Dans le cadre des orientations du programme gouvernemental, les investissements réalisés par les ministères sur les nouvelles technologies ont déjà permis d’obtenir des résultats importants : diffusion gratuite des principaux rapports administratifs et parlementaires, ouverture du portail administratif « Admifrance », mise en ligne de 300 formulaires couvrant 50 % du volume des procédures, lancement de services à distance comme le paiement des impôts. La télédéclaration et le télépaiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour toutes les entreprises seront opérationnels au premier trimestre 2000. Dans le domaine de l’enseignement, la formation des enseignants aux nouvelles technologies a fait l’objet d’efforts importants, de même que l’équipement et le raccordement des établissements (85 % des lycées et 55 % des collèges étaient connectés à Internet début 1999, contre 40 % et 20 % un an auparavant) ; enfin, le Gouvernement a encouragé les opérateurs à proposer des offres spécifiques pour les établissements scolaires. Pour encourager un plus grand nombre de petites et moyennes entreprises à exploiter les opportunités offertes par Internet et les nouvelles technologies de l’information et de la communication, le secrétariat d’État à l’Industrie a mis en place un programme reposant sur des actions de sensibilisation et de formation, une adaptation des procédures d’aide à la diffusion des technologies (ATOUT) et un appel à projets pour l’utilisation collective d’Internet par les PME (UCIP). En 1998, le secrétariat d’État à l’Industrie a lancé le Programme pour l’innovation dans l’audiovisuel et le multimédia (PRIAMM), en association avec le Centre national de la cinématographie, pour soutenir des projets permettant d’associer laboratoires de recherche et entreprises de communication autour de réalisations concrètes. La politique du Gouvernement vise également à soutenir le développement et l’offre de nouvelles technologies ou de nouveaux services, afin que la France soit utilisatrice de ces technologies, et qu’elle profite de la croissance et des emplois pouvant être créés par le secteur industriel des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Les mesures annoncées dans le programme gouvernemental en faveur de la création et du développement des entreprises de haute technologie ont été mises en œuvre dans les lois de finances pour 1998 et pour 1999 et complétées par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche. Les crédits de recherche industrielle du secrétariat d’État à l’Industrie sont utilisés de manière à soutenir, prioritairement, les différents secteurs des technologies de l’information : composants, équipements informatiques, nouvelles technologies logicielles (ingénierie logistique, moteurs de recherche, technologies Internet, outils de sécurité, etc.), équipements et services de télécommunications et technologies concourant à produire, à distribuer et à recevoir les contenus multimédia. Les nouvelles actions menées dans ce cadre comportent notamment : · le programme « société de l’information », destiné à aider le développement et l’expérimentation des nouveaux services de la société de l’information, qui comprend des volets importants dédiés au développement des outils de production audiovisuelle et multimédia et aux produits et services de sécurité ; · le Réseau national de recherche en télécommunications qui soutient les projets coopératifs associant industriels et laboratoires publics ; · le soutien au nouveau programme Eurêka sur les logiciels médiateurs. La loi du 12 juillet 1999 sur l’innovation permettra d’encourager la création d’entreprises de haute technologie, notamment à partir des organismes publics de recherche (en facilitant la mobilité entre la recherche publique et les entreprises, en créant des incubateurs, etc.). Le nouveau réseau pour la technologie, l’enseignement et la recherche – Renater 2 –, s’appuyant sur des liaisons nationales et internationales à hauts débits et la technologie ATM, autorisera des usages innovants du réseau, en particulier, pour les recherches en informatique et télécommunications. Enfin, les sciences et technologies de l’information constituent, avec les biotechnologies, un des domaines prioritaires pour la recherche publique. Rappelons que France Télécom n’est plus un établissement public depuis le 31 décembre 1996. La stratégie de France Télécom consiste à stimuler la croissance du marché global du téléphone, à consolider sa position de leader sur le marché des mobiles, à devenir une des premières entreprises européennes de l’Internet, à améliorer sa productivité et à exploiter son potentiel de développement à l’international. Alors que le volume du trafic téléphonique progressait en moyenne de 3 % par an entre 1990 et 1995, la croissance a atteint 6,6 % en 1997, puis 9,2 % en 1998. Pour 1999, le nouvel objectif de croissance, établi ici sur la base des minutes transportées de bout en bout par France Télécom, est fixé à 7,5 %. Sur cette même base, la croissance avait atteint 6,4 % en 1998. Le processus de rééquilibrage tarifaire s’est poursuivi avec, en mars 1999, un relèvement de l’abonnement téléphonique et une baisse du prix des communications nationales et internationales, respectivement à hauteur de France Télécom mise aussi sur l’enrichissement et le développement de ses options tarifaires pour stimuler les usages téléphoniques et les usages liés à l’Internet. Le 1er juillet 1999, l’entreprise a ouvert la voie à la baisse de ses tarifs « fixe vers mobile », avec une première réduction de 20 %. Enfin, l’entreprise prévoit que la multiplication des canaux de collecte et de vente de trafic (vente indirecte, vente en gros) donnera une impulsion supplémentaire à la croissance de la consommation téléphonique. Avec 96 % de croissance en un an et un parc de 11 millions d’abonnés au 31 décembre 1998, le marché français des mobiles a poursuivi, l’an passé, sa forte progression. Leader sur ce marché depuis le lancement des services, France Télécom comptait, en fin d’année, 5,6 millions d’abonnés, soit 49,5 % du marché. L’année 1998 a vu le formidable succès des formules sans abonnement, ou formules dites « prépayées », qui permettent de bénéficier du service sans engagement du client sur la durée. Ces formules seront amenées à se développer encore et accompagneront le mouvement général de baisse tarifaire engagé depuis plusieurs années. La France est aujourd’hui parmi les pays d’Europe où le service de téléphonie mobile est le moins cher. Le développement du marché français, entamé plus tard que chez nos voisins, rattrape rapidement son retard. Opérateur de référence sur ce marché, France Télécom ambitionne de contribuer encore à son développement. Plusieurs solutions de convergence entre les liaisons fixes et les liaisons mobiles sont à l’étude ou en expérimentation ; les évolutions de la norme GSM, vers davantage de débit et une meilleure qualité de transmission, sont en préparation et l’opérateur public français présentera sa candidature pour l’obtention d’une licence de troisième génération (UMTS). Le marché de la transmission de données est incontestablement tiré par le développement de l’Internet et par celui des transmissions en Internet Protocol, en général. Le nombre d’Internautes devrait doubler entre 1998 et 1999 pour atteindre 9 millions. Cette croissance devrait se poursuivre en 2000 pour dépasser les 15 millions d’Internautes. Dans ce contexte, France Télécom poursuit son action de développement du marché en introduisant notamment le forfait Internet « 100 francs – 20 heures », ainsi que des offres de raccordement pour les écoles et le secteur de la santé. Pour répondre à la demande croissante pour des accès à hauts débits, l’entreprise prévoit l’ouverture d’un service d’accès « ADSL » pour la fin 1999. Le développement de France Télécom continue à l’international, avec, en 1998, un chiffre d’affaires consolidé de 15 milliards de francs, soit une croissance de plus de 40 % par rapport à l’exercice précédent. La stratégie de France Télécom répond à trois objectifs : devenir un opérateur européen majeur, proposer aux entreprises des services mondiaux, et s’implanter sur des marchés émergents à fort potentiel. La première échéance est constituée par le réexamen des directives dites « ONP » (), relatives à la réglementation sectorielle pour un accès ouvert aux réseaux et services de télécommunications des opérateurs puissants. Fin 1999, seront définies les orientations de la révision du cadre réglementaire des télécommunications. Au premier semestre 2000, le rapport au Conseil et au Parlement européens sur les résultats du processus de consultation sera rendu. Au second semestre, le Conseil et le Parlement européens feront des propositions sur des mesures d’adaptation du futur cadre réglementaire. Pour France Télécom, il s’agit d’assurer une application homogène de la réglementation communautaire dans l’Union européenne, de définir les modalités de passage de la phase transitoire de réglementation spécifique des télécommunications à une régulation du marché par les règles de droit commun du droit de la concurrence. La deuxième échéance est celle de la révision de la directive concernant la suppression des restrictions à l’utilisation des réseaux câblés pour la fourniture de services de télécommunications déjà libéralisés (directive n° 99/64/CE adoptée le 23 juin 1999). Cette révision imposera aux opérateurs l’obligation de séparer juridiquement, par filialisation, les activités liées aux réseaux câblés et, notamment, la fourniture du réseau, des activités de télécommunications. Or, France Télécom a déjà filialisé cette activité. Le projet de directive sur certains aspects juridiques du commerce électronique, en date du 18 novembre 1998, marque une troisième échéance. À la suite de la première lecture du Parlement européen, achevée le 6 mai 1999, une position commune devait être adoptée par le Conseil au troisième trimestre 1999. France Télécom devra clarifier les rôles et responsabilités des acteurs de l’Internet, en évitant que la responsabilité des fournisseurs de services puisse être engagée de façon infondée. La future directive impliquera de limiter les obligations de contrôle et de surveillance a priori. Le projet de directive du 10 décembre 1997 sur l’adaptation du droit d’auteur à l’environnement numérique constitue également une échéance importante. Suite à la première lecture du Parlement européen, achevée le 10 février 1999, la Commission a adopté une proposition révisée le 21 mai 1999. Une position commune du Conseil devrait être adoptée au troisième trimestre 1999. Il s’agit de permettre les reproductions des œuvres protégées nécessaires à leur transmission sur les réseaux et au fonctionnement efficace des services d’accès. La réglementation européenne organisant la protection légitime des droits des auteurs ne doit pas conduire à la création d’obligations technologiquement irréalisables, mettant en péril l’économie même de l’Internet. Le projet de directive sur les signatures numériques a abouti à une position commune formelle du Conseil, arrêtée le 28 juin 1999. La deuxième lecture du Parlement européen est en cours. Le texte doit permettre de développer le commerce électronique, en assurant la sécurité juridique aux utilisateurs de signatures électroniques. La directive sur la numérotation a été adoptée le 24 septembre 1998 et sa transposition devra entrer en application dans les États membres le 1er janvier 2000 au plus tard. France Télécom sera attentive à ce que cette directive soit transposée dans tous les États membres et qu’elle aboutisse à une mise en œuvre harmonisée et synchronisée de la présélection en Europe, afin d’éviter toute distorsion de concurrence sur le plan européen. Le projet de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l’introduction coordonnée des systèmes de télécommunications mobiles et sans fil (UMTS) dans la Communauté est avancé. En effet, la décision n° 128/98, adoptée le 14 décembre 1998, vise l’adoption, pour la troisième génération de mobiles, d’un standard UMTS harmonisé dans les États membres. Le calendrier, défini par l’Union européenne dans sa décision, prévoit deux dates butoir : · au plus tard le 1er janvier 2000, devra intervenir la mise en œuvre par les États membres d’un processus d’attribution des autorisations pour l’UMTS ; · au plus tard le 1er janvier 2002, devra commencer l’introduction coordonnée et progressive de services UMTS dans les États membres. Suite à cette décision, les États-Unis menacent l’Europe d’une action dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, pour obtenir la reconnaissance sur le territoire européen de la technologie américaine lors de l’attribution des licences UMTS. Les autorités américaines demandent, en particulier, l’inclusion dans le standard UMTS de composantes technologiques alternatives, dont la norme américaine CDMA 2000, au détriment des objectifs essentiels de performance, d’« itinérance » et d’« interopérabilité » des systèmes mobiles de troisième génération en Europe. Pour France Télécom, l’attribution précoce des licences et l’introduction progressive du système dans les États membres, conformément aux attentes du marché, permettront d’aborder une nouvelle étape dans l’offre de services mobiles, laquelle représente un véritable saut technologique pour l’utilisateur, tout en capitalisant sur les investissements de la génération existante. L’entreprise française engage, dès à présent, des tests pour des services multimédia novateurs sur du matériel prototype UMTS, en collaboration avec Nortel et Panasonic. La mise en place d’un cadre réglementaire favorable au développement de réels services mobiles à large bande doit offrir la possibilité pour les acteurs en place de devenir opérateurs de réseaux de troisième génération. Les développements nécessitent une affectation rapide de fréquences complémentaires pour les services UMTS. La directive sur les terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes, le 7 avril 1999. Elle fixe pour échéance une transposition par les États membres avant le 7 avril 2000, mais avec la possibilité de demander un délai pour maintenir durant 30 mois l’exigence essentielle « Interfonctionnement du terminal avec le réseau ». Ce temps est nécessaire pour régler les problèmes de régulation de courant de ligne des terminaux connectés au réseau. Sans adaptation préalable, il existe, en effet, un risque de détérioration inacceptable du service de téléphonie vocale accessible dans le cadre du service universel. France Télécom souhaite obtenir le bénéfice d’une période de transition de 30 mois, temps nécessaire pour prendre les mesures de protection du réseau téléphonique. Enfin, il convient de rappeler que la proposition de directive modifiant la directive n° 93/38/CEE sur les marchés publics et visant à exclure, comme les services de transport aérien, le secteur des télécommunications du champ d’application de cette directive devrait être adoptée par la Commission européenne et communiquée au Parlement européen avant la fin de 1999. En 1998, le Gouvernement a mis en place le Réseau national de recherche en télécommunications (RNRT). Deux objectifs président à sa création : · dynamiser l’innovation en favorisant la confrontation entre les avancées technologiques et les besoins du marché et en facilitant le transfert technologique vers les entreprises ; · accompagner l’ouverture des marchés à la concurrence et l’évolution du rôle du Centre national d’études en télécommunications (CNET) dans la recherche publique. Le RNRT offre ainsi à la recherche en amont un espace ouvert, créé pour inciter les laboratoires publics, les grands groupes, qu’ils soient industriels ou opérateurs de télécommunications, et les PME à se mobiliser et à coopérer autour de priorités clairement définies, pour conduire des projets avec le soutien des pouvoirs publics. En favorisant l’émergence de produits et services nouveaux, le RNRT anticipe le développement de la société de l’information. Pour ses différentes actions, il s’est largement appuyé sur les nouveaux outils de communication : site Internet, courrier électronique... Il s’intéresse, entre autres, à l’avenir d’Internet (hauts débits, qualité garantie, accès à tous les citoyens), aux prochaines générations de téléphones mobiles multimédia, aux constellations de satellites, à la convergence de l’audiovisuel, des télécommunications et de l’informatique, etc. Le RNRT entreprend trois sortes d’actions : · Des appels à projets lancés, chaque année, selon des priorités clairement définies pour susciter de nouvelles actions de recherche coopératives, qui pourront recevoir un soutien financier des pouvoirs publics après labellisation par le comité d’orientation. Depuis sa création, deux appels à projets ont été lancés, ainsi qu’un appel commun entre le Réseau et l’Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), spécifiquement destiné aux projets d’innovation portés par une petite ou moyenne entreprise. 97 projets ont ainsi été labellisés depuis la création du RNRT, 57 en 1998 et 40 en 1999. Parmi ces 97 projets, 61 sont de type pré-compétitif, instruits par le secrétariat d’État à l’Industrie, et 35 sont de type exploratoire, instruits par le ministère de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie. Un projet est commun aux deux ministères et porte sur les effets biologiques des micro-ondes. L’appel à projets RNRT-ANVAR a également rencontré un vif succès : 119 projets portés par une PME ont été présentés, et 50 ont été retenus par le comité de présélection. Leur instruction est en cours. · Des journées d’information et des colloques sont organisés, afin de préparer les thèmes prioritaires, de présenter l’avancement des projets en cours et d’ouvrir le dialogue au sein de la communauté de recherche en technologies de l’information. Le premier colloque RNRT a été organisé les 28 et 29 janvier 1999 et a réuni plus de 350 personnes à Sophia-Antipolis. Au cours de ce colloque, des exposés de prospective ont couvert l’ensemble des domaines liés aux télécommunications, des composants aux nouveaux usages, en passant par le logiciel. Ces exposés ont permis d’ouvrir le débat sur les orientations futures du RNRT. Le colloque a également été l’occasion de présenter la moitié des projets labellisés en 1998. À partir de l’automne 1999, le RNRT organisera périodiquement des journées thématiques portant sur des sujets importants pour la recherche amont en télécommunications : nouveaux usages émergents, sécurité des systèmes de télécommunications, qualité de services, etc. · L’animation du réseau de recherche est, en effet, une des missions importantes du RNRT : diffuser l’information, faciliter les rencontres et les débats, se faire le relais d’initiatives intéressant l’ensemble de la communauté de recherche, etc. Ainsi, en 1999, le Gouvernement a confié au RNRT la responsabilité d’une initiative « Internet du futur » pour coordonner les efforts de recherche des acteurs français et prendre des initiatives dans l’Internet du futur. Dans le cadre du RNRT, les différents projets sont soutenus au travers des procédures existantes au sein de l’administration, c’est-à-dire par le secrétariat d’État à l’Industrie, le ministère de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie et l’ANVAR. Les crédits affectés au soutien de projets de recherche en télécommunications labellisés par le RNRT sont les suivants : · 1998 : 200 millions de francs ont été engagés pour soutenir les projets labellisés par le RNRT. 150 millions de francs ont été engagés par le secrétariat d’État à l’Industrie et 50 millions de francs par le ministère de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie ; · 1999 : 270 millions de francs sont prévus pour soutenir les projets labellisés par le RNRT en 1998 (seconde série) et 1999. 150 millions de francs sont prévus pour le secrétariat d’État à l’Industrie et 120 millions de francs pour le ministère chargé de la recherche (55 millions de francs pour les projets labellisés en 1998 et 65 millions de francs pour les projets labellisés en 1999) ; · 2000 : l’effort sera poursuivi en 2000. Le secrétariat d’État à l’Industrie soutiendra les projets RNRT sur la base des labels délivrés en 1999 et 2000. Parmi ces projets, figurent, notamment, ceux issus de l’initiative Internet du futur. Le ministère chargé de la recherche poursuivra également l’effort entrepris. En outre, l’ANVAR participe aux actions du RNRT en soutenant des projets d’innovation portés par des PME. Une mesure de 50 millions de francs a ainsi été annoncée. RÉPARTITION DES FINANCEMENTS ACCORDÉS POUR LES PROJETS LABELLISÉS EN 1998 ENTRE LES OPÉRATEURS (Financements sur les budgets 1998 et 1999)
PARTICIPATION DES OPÉRATEURS DANS L’ENSEMBLE DES PROJETS LABELLISÉS 2.– Le Centre national d’études en télécommunications Le CNET est chargé de conduire des actions de recherche et développement pour le compte de France Télécom, qui peut également contracter des programmes de recherche et développement avec des partenaires privés et mener en interne des expérimentations, concevoir et développer de nouvelles applications informatiques. Indépendamment des modifications de l’organigramme de France Télécom (suppression de la direction recherche et développement et des partenaires externes – DRPE –, de la direction innovation et des nouveaux usages – DINU –, création d’une direction de l’innovation), le CNET a une mission précise : « développer des avantages compétitifs de France Télécom, tout en ayant le souci d’éclairer le moyen et le long terme ». D’un récent rapport particulier de la Cour des comptes sur le CNET, portant sur les exercices 1994-1997, nous retirons les conclusions suivantes : · il est difficile de connaître le pourcentage du chiffre d’affaires de France Télécom consacré à la recherche-développement. Ceci est malsain. Il lui faut parachever le regroupement de ses activités de recherche-développement ; · le CNET a, depuis ses origines, fonctionné sur un mode dans lequel les progrès de la science et de la technique ont plus guidé ses actions que la satisfaction des besoins d’un marché ; · dans un souci de recentrage, le CNET doit rapprocher certaines de ses activités (en optoélectronique et en microélectronique) soit du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), soit d’Alcatel ou du Commissariat à l’énergie atomique (CEA). Il appartient donc à France Télécom de négocier avec les organismes publics (CNRS, CEA, Groupe des écoles des télécommunications) l’accueil des chercheurs concernés ; · la pratique d’études contractualisées entre le CNET et France Télécom constitue une démarche positive, sous réserve que les chercheurs du CNET disposent du temps nécessaire pour poursuivre des études à moyen terme et à la recherche en amont ; · le Réseau national de recherche en télécommunications fonctionne correctement. Le CNET y participe activement. Il a étendu ses contrats avec l’industrie. Encore faut-il poursuivre cet effort. La Cour des comptes regrette que « sur ce point important, France Télécom continue à ne manifester que peu d’intérêt ». En 1998, France Télécom a poursuivi ses efforts de recherche-développement avec l’ambition d’apporter à ses clients les meilleures innovations, en maîtrisant les multiples sources de progrès permettant de créer de nouveaux services et de bâtir de nouveaux réseaux plus performants. Dans le domaine des communications avec les mobiles, grâce au support du CNET, Itineris réagit à l’expansion effrénée du trafic, tout en maintenant des coûts compétitifs et un rythme soutenu d’innovations propres à fidéliser la clientèle. Le CNET a développé des techniques d’algorithmes d’attribution de fréquences et d’ingénierie de réseau qui permettent d’optimiser l’utilisation du spectre hertzien en combinant, en zone urbaine, des cellules de tailles différentes à des fréquences de 900 et de 1.800 mégahertz, ou encore en attribuant, à chaque instant, les fréquences disponibles entre les différents utilisateurs. Ce savoir constitue également un atout pour France Télécom à l’international. De plus, le CNET a mené un vaste programme de recherche-développement sur les systèmes mobiles de troisième génération (UMTS), qui préparent la mobilité personnelle et universelle du siècle prochain. Appuyé sur son centre de recherche-développement, France Télécom innove au service des entreprises. Grâce à Global Intranet, les entreprises clientes de Global One peuvent interconnecter les réseaux Intranet et Extranet de leurs différents établissements à travers le monde, et cela sans discontinuité et en toute sécurité. L’âge de la globalisation est aussi celui du virtuel, où l’on voit les entreprises s’organiser en réseaux rassemblant, par télétravail, leurs établissements à travers le monde, leurs commerciaux en déplacement, et leurs partenaires et sous-traitants. En France, une offre de liaisons louées flexibles est maintenant disponible grâce aux techniques de transfert de données à hauts débits. Et avec la visioconférence haute qualité, c’est un nouveau confort qui est offert aux entreprises pour limiter les déplacements physiques de leurs collaborateurs, tout en augmentant les échanges et réunions entre leurs différentes localisations. Enfin, France Télécom optimise les services d’accueil téléphonique au sens large, avec le succès des Numéros d’Accueil et l’essor des centres d’appel à acheminement dynamique. Elle expérimente les services de « numéro d’entreprise » permettant de joindre le collaborateur d’une société où qu’il se trouve, au même numéro. Elle innove aussi pour le grand public. Même le classique service téléphonique s’enrichit de nouvelles fonctions. L’emploi des techniques de synthèse et de reconnaissance vocale contribue à faciliter la vie quotidienne. Ainsi, avec les progrès des messageries vocales, le téléphone a vocation à devenir une véritable « boîte aux lettres » universelle. Au service de tous, l’opérateur public se doit aussi d’aider ses clients à maîtriser leur consommation, avec la possibilité de placer leur ligne en service restreint et de téléphoner à l’aide d’un ticket prépayé, et également de connaître leur consommation en direct avec le service « Allofact ». Comme les mobiles, les services en ligne et multimédia ont encore beaucoup défrayé la chronique en 1998. Précurseur de l’information en ligne et du commerce électronique, France Télécom est désormais leader pour le développement d’Internet. Avec un demi million de clients pour Wanadoo à la fin 1998, l’entreprise s’affirme comme la « Net Compagnie ». Pour une vraie démocratisation de cet outil, le CNET étudie de nouvelles techniques de navigation qui apportent rapidement un maximum de réponses pertinentesà des demandes faites directement, en français courant. L’accès à ces services Internet est facilité avec le portail « Voilà », développé par le CNET en coopération avec la start-up française Echo. De plus, avec Internet, le commerce de détail acquiert une nouvelle dimension. France Télécom a confié à son centre de recherche-développement l’étude et la mise en œuvre d’une plate-forme permettant de parcourir une galerie marchande virtuelle, appelée « Télécommerce », et de payer en toute sécurité. Par delà ces évolutions, le groupe de télécommunications a lancé une série d’expérimentations et de démonstrations de services Internet à hauts débits. Parallèlement, il a poursuivi ses travaux techniques et économiques sur les réseaux, avec comme objectif de baisser le coût de transport de chaque information en explorant deux voies : augmenter les débits de transmission et baisser les coûts des nouveaux services grâce aux structures de réseau intelligent. Traitant séparément l’aiguillage des informations et la gestion des services, les réseaux intelligents permettent de créer de nouveaux services plus vite et à moindre coût. France Télécom dispose d’un des réseaux les plus avancés du monde à cet égard. Des plates-formes opérationnelles y prennent en charge les services de libre appel, la gestion des cartes téléphoniques, les réseaux virtuels d’entreprise ou les services liés aux mobiles. La recherche-développement de France Télécom prépare la deuxième génération de réseau intelligent. Encore plus puissant, il incorporera des « ateliers de création de services », qui permettront de réduire fortement le délai de mise au point. Par son activité de recherche de base, la recherche-développement de France Télécom possède une compétence de pointe dans les microcircuits qui sont intégrés dans les terminaux, tout comme dans les réseaux devenus « intelligents ». Aujourd’hui, sur les composants qui sortent des usines de Crolles, centre commun du CNET et de SGS-Thomson, l’épaisseur des traits qui ne dépasse pas 0,35 micromètre permet d’intégrer plusieurs millions de transistors sur un même processeur. De même, la recherche-développement de France Télécom participe, dans le domaine de l’optoélectronique, à l’explosion des capacités de transmission, avec cette année, la démonstration en laboratoire du multiplexage de plus de 100 couleurs à 10 gigabits par seconde (milliards d’informations par seconde), soit un débit supérieur au térabit par seconde, équivalent de 1.000 gigabits par seconde, transmis sur 1.000 kilomètres. Enfin, la recherche-développement de France Télécom dispose de compétences de pointe dans les techniques logicielles les plus avancées : techniques objets, langage JAVA, informatique distribuée... Le programme 1999 a pour objectif de fournir aux branches opérationnelles de France Télécom les prestations de développement de services, dont elles ont besoin pour faire face à la concurrence et anticiper les futurs besoins en terme de services et d’infrastructures. Le CNET conduit ainsi des travaux visant à satisfaire les objectifs stratégiques de France Télécom, comme le développement de services contribuant à l’augmentation globale du trafic, ainsi que des actions s’inscrivant dans une perspective de marché concurrentiel, en particulier à l’international. En 2000, l’activité de recherche-développement du CNET se poursuivra dans la ligne des orientations stratégiques du groupe. Les évolutions principales porteront sur la fin du recentrage des études entamé depuis 1993 au CNET sur le cœur de métier de l’opérateur France Télécom, ainsi que sur le transfert aux services opérationnels du groupe d’activités conduites au CNET, mais qui n’ont plus d’apport innovant fondamental, du fait de l’évolution rapide des techniques. Le coût du CNET est constitué de dépenses liées à son fonctionnement, incluant les prestations fournies par les autres entités du groupe et la masse salariale, ainsi qu’à ses investissements (matériels pour la recherche-développement ou plates-formes diverses d’expérimentation). Début 1999, une nouvelle organisation interne de la branche « développement » a permis de regrouper les développements externes de la direction recherche et développement et des partenaires externes au CNET, qui détient désormais les ressources de développement interne et externe, permettant ainsi une plus grande flexibilité et réactivité pour le développement rapide d’innovations sur le marché concurrentiel. Les dépenses du CNET sont, pour 1999, de 3.471 millions de francs. Ces dépenses sont entièrement couvertes par France Télécom, à l’exception de 221 millions de francs résultant de la valorisation à l’extérieur du groupe de résultats de recherche-développement ou de la participation à des projets financés en partie par la Commission européenne ou le gouvernement français dans le cadre du RNRT. Par un jeu de prestations internes au groupe, 75 % de ces dépenses sont financées par les unités d’affaires de France Télécom. Le financement du CNET étant assuré dans sa quasi-totalité par France Télécom, la plupart des résultats issus des travaux sont destinés à ses nouveaux produits et services, et éléments de réseaux. Le CNET dispose d’un portefeuille de 3.287 brevets internationaux, qu’il valorise par des cessions de brevets ou des licences. Le transfert de technologie à destination des sociétés privées porte sur environ 100 millions de francs par an dans des domaines très variés touchant aux télécommunications. En particulier, les transferts dans les domaines de la microélectronique et de l’optoélectronique se font à travers les groupements d’intérêt économique (GIE), avec SGS-Thomson, avec le Commissariat à l’énergie atomique ou avec Alcatel. Le Centre commun d’études de télédiffusion et télécommunications, GIE commun avec Télédiffusion de France (TDF), valorise, pour sa part, les résultats issus des travaux du CNET sur le site de Rennes, pour environ 24 millions de francs par an. L’élément important de ses recherches est constitué actuellement par la technologie sur le contrôle d’accès « Viaccess ». De plus, le CNET réalise des études pour le compte des Armées et de La Poste à hauteur de 22 millions de francs par an. Par ailleurs, le CNET favorise la création de start-up créées par les ingénieurs provenant de ses laboratoires, pour s’entourer de jeunes PME innovantes. Grâce à son fonds d’amorçage « Technocom », lancé fin 1997, quatre start-up ont ainsi été créées en 1998, générant une cinquantaine d’emplois nouveaux : Mob’Activ (solutions multimédia), High Wave Technologies (composants optiques avancés), Probion (analyse de matériaux) et COG-Net (conseil et édition de logiciels de groupware). Enfin, le CNET participe activement aux travaux lancés par le RNRT, en étant présent dans les deux tiers des projets du RNRT en 1998. La loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications dispose que l’enseignement supérieur dans le domaine des télécommunications relève de la responsabilité de l’État, sous la tutelle du ministre chargé des télécommunications. Dans ce cadre, le décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 a confié, à compter du 1er janvier 1997, au Groupe des écoles des télécommunications (GET), établissement public doté de l’autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé des télécommunications, la mission de service public d’enseignement supérieur des télécommunications, auparavant exercée par l’opérateur public France Télécom. Le GET est composé d’un service d’administration générale (SAG) et de trois écoles : · l’École nationale supérieure des télécommunications (ENST), située à Paris ; · l’École nationale supérieure des télécommunications de Bretagne (ENSTB), située à Brest et disposant d’une antenne à Rennes ; · l’Institut national des télécommunications (INT), situé à Évry, qui comprend une école d’ingénieurs et une école de gestion spécialisée dans le domaine des télécommunications. Chaque école délivre, sous son appellation propre, les diplômes et titres pour lesquels elle est habilitée. Elle a pour missions principales, dans les domaines relevant des télécommunications et des technologies de l’information : · la formation initiale d’ingénieurs possédant des compétences scientifiques, techniques, économiques et générales de haut niveau, qui les rendent aptes à exercer des fonctions de responsabilité dans le monde industriel et économique et dans l’administration ; · la formation continue d’anciens élèves diplômés de l’école et de cadres qualifiés des secteurs public et privé ; · la formation postscolaire, qui peut comporter notamment une préparation au doctorat et une initiation à la recherche ; · la formation par la recherche ; · la diffusion des connaissances scientifiques, techniques et économiques ; · la conduite des actions de recherche, notamment dans ses laboratoires et en liaison avec des universités, d’autres centres de recherches ou entreprises ; · le développement des relations avec le monde industriel et économique, notamment par la conduite d’actions de conseil d’expertise. Chaque école reçoit des élèves français ou étrangers, fonctionnaires ou non, notamment des élèves-ingénieurs, admis par voie de concours en première année ou sur titre en deuxième année, des élèves en mastère, en doctorat, des élèves chercheurs, des stagiaires, et des auditeurs libres. L’ENST reçoit des ingénieurs-élèves ayant vocation à appartenir à des corps d’ingénieurs de l’État et notamment au corps interministériel des ingénieurs des télécommunications. L’ENST de Bretagne dispense, en particulier, des formations orientées vers les métiers des opérateurs des télécommunications fixes et mobiles et vers l’innovation et la création d’entreprises. Elle dispose d’une filière promotionnelle. Le GET est également membre de deux GIE : l’École nouvelle d’ingénieurs en communication (ENIC) et l’Institut EURECOM. Les effectifs autorisés pour 1999 sont de 926 agents et se décomposent de la manière suivante : 909 emplois permanents autorisés et 17 emplois en contrat à durée déterminée, sous un régime de droit privé. Au 31 décembre 1998, il y avait 750 agents de France Télécom mis à la disposition du Groupe des écoles, 95 agents propres au groupement, sous statut de droit public, et 46 agents sous statut de droit privé. NOMBRE D’ÉLÈVES ET EFFECTIFS DU CORPS ENSEIGNANT
BUDGET DU GROUPE DES ÉCOLES DES TÉLÉCOMMUNICATIONS POUR 1999 (en millions de francs)
Une enquête, menée auprès des diplômés de l’ENST de la promotion 1998, fait apparaître que, sur 73 % de réponses reçues, 6 % des diplômés se sont dirigés vers France Télécom et 10 % vers les autres opérateurs. Enfin, votre rapporteur spécial souhaiterait rappeler les conditions de financement de l’École nationale supérieure des postes et télécommunications (ENSPTT), chargée de former les administrateurs des postes et télécommunications. Ainsi qu’il est prévu dans le contrat constitutif et dans le règlement intérieur de ce GIE, les ressources de l’école sont constituées du produit de la facturation de toutes ses prestations. Les enseignements dispensés aux élèves sont facturés aux membres du groupement, à savoir La Poste, France Télécom, et le secrétariat d’État à l’Industrie. Les enseignements dispensés en formation complémentaire sont facturés soit aux élèves, soit aux entreprises ou institutions dont ils sont issus. L’évolution des réseaux ira vers les hauts débits. Toutefois, les investissements en jeu rendent nécessaire, avant tout déploiement massif d’infrastructures sur l’ensemble du territoire, d’apprécier la réalité et la solvabilité de la demande en nouveaux services, d’autant plus que la technologie est en avance sur la formulation de la demande des utilisateurs. France Télécom, en 1998, a quadruplé la capacité de ses réseaux, national et international. Le groupe a ainsi investi 12 milliards de francs dans son réseau, cherchant à répondre aux besoins des particuliers et des entreprises. Date charnière, 1998 marque en effet l’entrée de l’Internet Protocol (IP) au cœur de la stratégie réseau, sur le fondement d’un effort très important pour la mise en service de nouveaux points accès Internet Protocol par Numéris et par modem et grâce au lancement d’un projet de réseau destiné à acheminer le trafic d’accès Wanadoo, le service d’accès à Internet de France Télécom. L’objectif est de basculer l’essentiel du trafic Wanadoo sur le réseau Internet Protocol, d’ici à la fin de l’année. Le 2 avril dernier a été inauguré, à Rennes, le Centre d’exploitation des services Internet, qui a pour mission de concevoir, déployer et administrer le réseau Internet Protocol. D’une manière générale, l’État a retenu une démarche pragmatique, fondée sur le lancement d’expérimentations concrètes. L’appel à propositions relatif aux expérimentations sur les autoroutes et services de l’information, lancé en novembre 1994, a permis la mobilisation de l’ensemble des forces économiques de notre pays : 635 dossiers ont été déposés et 244 projets ont été labellisés en 1995 et 1996 comme « projets d’intérêt public ». Les projets labellisés portaient sur des thèmes variés : 90 sur des services marchands (commerce électronique, presse, transport, tourisme, téléservices), 84 projets sur des services d’intérêt général (enseignement, santé, culture, recherche, administration), 70 sur des plates-formes, dont 30 grandes plates-formes régionales d’infrastructures et 3 grands projets nationaux. D’une façon générale, les innovations ont porté plus sur les services et les contenus que sur les infrastructures ; les projets d’infrastructures à hauts débits sont restés peu nombreux, à l’exception notable des propositions de France Télécom et de l’ouverture de services de communications sur les réseaux câblés, notamment pour l’accès à Internet. Outre l’attribution d’un label « d’expérimentation d’intérêt public », le ministère chargé des télécommunications a accordé son soutien aux actions de recherche-développement présentées par les projets les plus innovants. 84 projets ont pu être ainsi soutenus pour un montant de 194 millions de francs. L’aide à la recherche-développement s’est avérée un soutien efficace, le taux d’abandon des projets concernés ayant été très faible. Une nouvelle procédure de soutien pour les expérimentations sur les autoroutes de l’information a été lancée en 1997, suivant des modalités analogues à celles de l’appel à propositions, mais sur une base continue. Un « guichet permanent » d’accueil et d’analyse des projets a été mis en place au sein de la direction générale des stratégies industrielles (DGSI). Cette nouvelle démarche a permis, en s’appuyant sur l’expérience des dossiers déjà labellisés lors du premier appel à propositions, de continuer à structurer et regrouper l’offre de nouveaux services, d’en évaluer la viabilité économique, de réaliser des tests commerciaux et d’acquérir le savoir-faire de la gestion opérationnelle des nouveaux réseaux de communication. Elle a également permis de prendre en compte les évolutions technologiques les plus récentes, en particulier celles relatives à Internet. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, 55 projets ont été labellisés, les aides à la recherche-développement accordées à ces projets représentant environ 270 millions de francs. Pour compléter ces actions en faveur du développement de nouveaux services, l’ANVAR, avec le soutien du secrétariat d’État à l’Industrie, a lancé un appel à propositions « nouvelles technologies de l’information et innovation dans les services » au printemps 1998. Il comportait quatre thèmes : logistique et transport, enseignement, santé et tourisme-culture. 428 déclarations d’intention ont été déposées et 153 ont été jugées recevables à cet appel à propositions, les porteurs des projets ayant été invités à déposer un dossier auprès des délégations régionales de l’ANVAR. À titre indicatif, le montant cumulé des projets correspondant aux déclarations d’intention retenues s’élève à 520 millions de francs. Par ailleurs, 96 déclarations d’intention, jugées intéressantes bien que non éligibles à cet appel à propositions, ont été réorientées vers d’autres procédures gérées par l’ANVAR ou les ministères concernés. En raison de l’évolution constante de ces technologies et de leur impact croissant sur l’économie et la société, et du temps nécessaire à leur assimilation par les acteurs économiques et sociaux, la poursuite du soutien à l’innovation industrielle et technologique, dans ce domaine, a été décidée, dans le cadre du programme d’action gouvernemental pour préparer l’entrée de la France dans la société de l’information. Ainsi, le secrétariat d’État à l’Industrie a mis en place un programme « société de l’information » (PROGSI), destiné à encourager le développement de nouveaux services en soutenant deux types de projets : · des projets d’expérimentation de nouveaux services, qui permettront de tester la viabilité, notamment économique, de nouvelles applications et offres de contenus ; · des projets d’innovation technologique, plus en amont, dont la finalité est de contribuer à la création et au développement de nouveaux usages des technologies de l’information et de la communication. Ce programme permet de favoriser en particulier de nouveaux modes d’accès à la connaissance et à la culture, de moderniser les services publics, de développer le commerce électronique, d’accroître la compétitivité des entreprises, d’aider à la numérisation des réseaux hertziens terrestres de télévision. Dans le cadre de ce programme, deux actions spécifiques ont été identifiées : · le « Programme pour la recherche et l’innovation dans l’audiovisuel et le multimédia » (PRIAMM), déjà évoqué supra, lancé en juin 1999, est centré sur deux axes : la diffusion des technologies numériques de l’image et du son, développées dans les laboratoires, vers le tissu industriel de la production audiovisuelle, cinématographique et multimédia, ainsi que l’expérimentation de plates-formes de production destinées aux nouvelles formes de services et à leurs nouveaux modes de diffusion que sont Internet, la télévision et la radio numériques ; · le programme « Offre de procédés et de produits de sécurisation pour la mise en œuvre des autoroutes de l’information » (OPPIDUM) a pour objectif de favoriser le développement de solutions commerciales de sécurité et de qualité, conformes au nouveau cadre réglementant la cryptologie. Depuis la mise en place du programme « société de l’information », 24 projets ont été labellisés (dont 9 projets OPPIDUM et 2 projets PRIAMM) pour un montant d’aide décidé d’environ 120 millions de francs. Comme précédemment, le soutien de l’État prendra la forme de l’attribution d’un label et, pour les projets labellisés s’accompagnant de développements technologiques innovants, d’une aide à la recherche-développement. Dans le cadre de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l’information, ont été accordées huit autorisations d’établissement ou d’exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public en vue d’offrir tous services de télécommunications, y compris le service téléphonique au public. Le tableau infra les récapitule :
La loi du 10 avril 1996 a donc permis la mise en œuvre de projets expérimentaux très divers, tant par leur nature même et celle des infrastructures supports autorisées (réseaux filaires et radioélectriques, câblo-téléphonie, réseau par satellite, ...), que par la taille et le type des porteurs de projets (chambre de commerce et d’industrie, collectivités locales, investisseurs privés français et étrangers) ou par la localisation géographique des expérimentations. Ces expérimentations prévoient le plus souvent la mise en place d’infrastructures performantes, à hauts débits et flexibles, mettant en œuvre des technologies innovantes et permettant de faire bénéficier les habitants et les entreprises situées dans les zones visées de services avancés de télécommunications, notamment l’accès aux réseaux de type Internet. Trois de ces licences, celles accordées à la CGRP, à BELGACOM et à Cegetel Entreprises, ont été, à la demande de leurs bénéficiaires, abrogées et de nouvelles autorisations élargies leur ont été accordées dans le cadre des dispositifs mis en place par la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996. En complément du soutien à l’expérimentation des nouveaux services, évoqué précédemment, le programme d’action gouvernemental pour préparer l’entrée de la France dans la société de l’information comporte différentes mesures favorables au développement des autoroutes de l’information : adaptation du cadre juridique, soutien à l’utilisation d’Internet par les administrations et les PME, etc. France Télécom a atteint, en 1998, l’objectif qu’elle s’était fixé de quadrupler la capacité de ses réseaux, national et international. Ainsi, elle a investi 12 milliards de francs dans son réseau. Le réseau de France Télécom évolue constamment pour répondre aux besoins des particuliers et des entreprises. En 1997, l’offre « Service multisite hauts débits » (SMHD) a été mise en place. Ce service est un réseau dédié à très hauts débits, allant jusqu’à 622 megabits par seconde, hautement sécurisé, particulièrement adapté pour relier des sites au niveau d’une agglomération. S’appuyant sur 1,5 million de kilomètres de fibres optiques, ce réseau permet de déployer des boucles locales hauts débits sur l’ensemble de l’hexagone. 500 sites d’entreprises ont d’ores et déjà été équipés avec ce système. Après homologation de sa décision tarifaire relative au système « Asymmetric Digital Subscriber Line » (ADSL), l’objectif poursuivi par France Télécom est le déploiement de ce service innovant, permettant l’accès à l’Internet rapide pour les clients les plus exigeants, en utilisant le réseau filaire de l’opérateur public. Cette extension fait suite à une série d’expérimentations déjà menées sur plusieurs sites, en accord avec l’Autorité de régulation des télécommunications. Elle portera, en 1999, sur les six premiers arrondissements de Paris et trois villes de la région Île-de-France et se poursuivra ensuite sur de nouvelles zones. L’homologation, ainsi obtenue, fournit les bases d’un véritable déploiement de l’ADSL en France, en donnant à France Télécom la visibilité nécessaire pour lui permettre d’envisager un investissement pouvant atteindre 2 milliards de francs en trois ans, en fonction des demandes du marché. Le succès de cette démarche repose à la fois sur l’action de France Télécom et sur le dynamisme de l’ensemble des fournisseurs d’accès à l’Internet. Depuis le mois de juin 1999, France Télécom a lancé à Toulouse et en région parisienne l’expérimentation d’un nouveau concept, Internet Services Intégrés, pour permettre une plus large diffusion des services en ligne, auprès d’utilisateurs qui ne sont pas forcément familiers de l’environnement de la micro-informatique. Cette catégorie de services se trouve à la croisée du monde Minitel et du monde Internet pour des usages plutôt guidés et à des prix peu élevés. La plate-forme Internet Services Intégrés est co-développée par IBM et France Télécom. Un premier bilan sera dressé à la fin du mois de septembre 1999. Avec cette expérimentation, France Télécom entend populariser l’usage de tous les services en ligne. Le programme d’action gouvernemental pour préparer l’entrée de la France dans la société de l’information préconisait l’expérimentation de la télévision numérique de terre en 1998. À ce titre, le groupe France Télécom, via sa filiale Télédiffusion de France, a obtenu une autorisation du Conseil supérieur de l’audiovisuel pour une diffusion expérimentale de la télévision numérique de terre en Bretagne, sur un ensemble de trois sites de diffusion : Rennes, Vannes, Lorient. En 1999, le groupe France Télécom a transmis une demande de renouvellement de l’autorisation initiale auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui a donné son accord en mars 1999. Il a accordé, en avril 1999, à Télédiffusion de France une extension pour un deuxième multiplex. En juin 1999, France Télécom via Télédiffusion de France a fait une demande auprès du Conseil pour un troisième multiplex, afin d’augmenter la ressource qui pourrait être mise à la disposition des différents opérateurs. Les rapports sur les premiers résultats de la plate-forme expérimentale de Bretagne ont été communiqués au secrétariat d’État à l’Industrie, au service juridique et technique de l’information et de la communication (Premier ministre), au Conseil supérieur de l’audiovisuel, et à l’Agence nationale des fréquences. Au mois de juillet, France Télécom, via Télédiffusion de France, a demandé une autorisation au Conseil pour mener une expérimentation technique d’une durée de deux mois de télévision numérique terrestre dans les Vosges. Enfin, Télédiffusion de France s’apprête à répondre à la consultation lancée en juin 1999 par le Gouvernement dans le cadre du Livre Blanc sur « la numérisation de la diffusion terrestre de la télévision et de la radio ». S’appuyant sur le CNET, premier centre européen de recherche et développement en télécommunications, France Télécom est un opérateur de télécommunications pouvant proposer à ses clients une gamme complète de services Internet Protocol (IP), couvrant l’accès à tous débits et par tout type de réseau, la téléphonie sur les Intranet, des services mariant téléphonie et Web (Webphone). Deux dossiers mis en œuvre par le CNET illustrent plus particulièrement l’engagement de France Télécom dans la recherche et le développement. Fortement impliquées dans la course aux très hauts débits, les équipes du CENT, comme nous l’avons déjà relevé, sont parvenues à faire passer un débit d’un térabit par seconde (1012 bits par seconde) sur une distance de 1.000 kilomètres en utilisant une fibre optique conventionnelle. À titre d’illustration, avec un tel débit, il est possible de transmettre le contenu de 100 encyclopédies de 28.000 pages chacune en une seconde. Il s’agit d’une technologie compatible avec le réseau de fibre optique de France Télécom. Cette réussite offre des perspectives prometteuses. Les technologies qui vont en découler permettront d’accroître la capacité des réseaux et de les optimiser pour répondre au développement très rapide d’Internet et du multimédia. Le projet VTHD a pour objectif de développer et d’expérimenter les technologies de l’Internet de nouvelle génération. Le dossier a été validé par le Réseau national de la recherche en télécommunications (RNRT), le 7 juillet 1999. Le projet fait l’objet de deux actions combinées : · déploiement d’un réseau Internet Protocol à très hauts débits de couverture géographique étendue ; · mise en place d’un partenariat visant à fédérer les efforts pour un Internet de nouvelle génération : France Télécom, l’Institut national de la recherche en informatique et en automatique (INRIA), à travers les centres de Rennes, les écoles du Groupe des écoles des télécommunications et l’Institut EURECOM localisé à Sophia-Antipolis. Les applications déployées sur la plate-forme d’expérimentation au cours du projet concernent des applications multimédia interactives dans le domaine de l’enseignement à distance et dans le domaine de la télémédecine. Sur ce dernier point, l’hôpital européen Georges Pompidou est partenaire associé à l’INRIA. Acteur majeur des télécommunications mondiales, France Télécom est présente dans près de 50 pays. Sa gamme complète de services répond aux attentes des entreprises, des particuliers et des autres opérateurs : téléphonie locale et longue distance, transmission de données, téléphonie mobile, multimédia, accès Internet, télévision câblée, diffusion audiovisuelle et services à valeur ajoutée. Le développement de France Télécom à l’international constitue l’une des priorités stratégiques de l’entreprise. Avec une progression de 39,3 % en 1998, le chiffre d’affaires réalisé à l’étranger atteint désormais 15 milliards de francs et représente 9,3 % du chiffre d’affaires global de l’entreprise. L’expansion de l’activité de France Télécom à l’international constitue, d’ailleurs, l’une des principales raisons de l’accélération de la croissance du groupe en 1998. Le chiffre d’affaires consolidé des activités réalisées à l’international au premier semestre 1999 s’élève à 1,4 milliard d’euros (8,9 milliards de francs), soit une augmentation de 41,2 % par rapport au premier semestre 1998. Cette progression résulte, pour une large part, du développement des activités de téléphonie fixe : au 30 juin 1999, le nombre de lignes téléphoniques d’abonnés hors de France s’établit à 1,6 million de lignes. Parallèlement, la forte croissance des activités mobiles se poursuit. Le nombre des abonnés aux réseaux mobiles des filiales consolidées s’élève à 2,3 millions au 30 juin 1999, soit une progression de près de 50 % au cours du premier semestre 1999. La stratégie internationale de France Télécom répond à trois objectifs : · devenir un opérateur européen majeur ; · proposer aux entreprises des services mondiaux ; · s’implanter sur les marchés émergents à fort potentiel. Dans le cadre de la libéralisation européenne du marché des télécommunications, France Télécom poursuit une stratégie de croissance en s’associant à des partenaires locaux pour développer des offres fixes, mobiles et Internet sur les marchés nationaux. L’entreprise française est aujourd’hui présente dans 15 pays européens. Depuis 1997, de nouvelles entreprises ont ainsi été créées en Belgique (Mobistar), au Danemark (Mobilix), en Espagne (Uni2), en Italie (Wind), en Norvège (partenariat avec ElTele Öst), aux Pays-Bas (Dutchtone Group), au Portugal (Optimus), au Royaume-Uni (Metroholdings) et en Suisse (Multilink). En juillet 1999, un accord de partenariat a été signé avec Sonae, le premier groupe de distribution portugais, en prévision de la libéralisation de la téléphonie fixe dans ce pays, le 1er janvier 2000. Un investissement majeur a également été réalisé, en juillet 1999, en Grande-Bretagne, dans le capital du câblo-opérateur NTL, facilitant ainsi la création du plus important réseau à large bande du pays. En ce qui concerne le marché allemand, délaissé du fait du partenariat avec Deutsche Telekom, toutes les possibilités d’y reprendre pied sont actuellement à l’étude. Pour répondre aux besoins des clients multinationaux, France Télécom a développé des services de voix et de données en investissant dans Global One aux côtés de Deutsche Telekom et de Sprint. Grâce à 1.400 points de présence à travers le monde, Global One offre des services de transport de voix et de données, ainsi que des solutions Internet Protocol, à plus de 30.000 entreprises. Le premier objectif de France Télécom est de s’implanter sur des marchés à forte croissance. Elle exploite ses compétences sur les marchés à fort potentiel de développement, comme l’Argentine (Telecom Argentina, Personal et Miniphone), le Brésil, le Mexique (Telcel et Telmex), le Salvador (CTE et Telecom Personal Salvador), la Chine (Rapidlink, Easylink), l’Indonésie (Pramindo), la Côte-d’Ivoire (Côte-d’Ivoire Télécom), l’Égypte (Menatel, MobiNil), le Sénégal (Sonatel), le Liban (France TélécomML) et le Cameroun (SCM). Dans ces pays, le groupe apporte son expertise à travers des partenariats dans le domaine de la téléphonie fixe et mobile. L’entreprise dispose de réseaux à l’échelle du monde. En effet, France Télécom est un acteur majeur des réseaux internationaux. Le groupe propose ainsi des capacités de transmission et des solutions pour opérateurs, à travers sa ligne de produits Open Transit. Il constitue un partenaire privilégié des réseaux de câbles sous-marins les plus importants : Sea-Me-We 2 et Sea-Me-We 3, qui est le câble sous-marin le plus long, avec 40.000 kilomètres de long et des connexions dans 33 pays, Eurafrica, Tagide 2, Ariane 2, Atlantis 2, Americas 2 et TAT. France Télécom a lancé ses propres satellites (Telecom 2) et a investi dans des consortiums de satellites, tels que Eutelsat et Intelsat pour acheminer du trafic international de téléphonie et de télédiffusion. France Télécom est un des principaux fournisseurs internationaux de services de diffusion d’images par satellite. Sa filiale Télédiffusion de France est le leader européen de la diffusion radio et audiovisuelle et son autre filiale, GlobeCast, offre un service vidéo international par satellite faisant appel à la technologie de compression numérique la plus avancée. France Télécom propose également des services mobiles mondiaux au travers d’Inmarsat et distribuera bientôt les services de Globalstar, un système satellitaire en orbite basse qui permettra de satisfaire les besoins de communication mobile à l’échelle mondiale. Pour accompagner sa politique d’implantation du groupe à l’étranger, France Télécom et ses filiales disposent de bureaux permanents à l’étranger, localisés sur plusieurs continents : · en Europe, le groupe possède des bureaux en Belgique, Espagne, Italie, Pologne, au Portugal, au Royaume-Uni et en Russie ; · en Afrique du Nord, France Télécom possède un bureau au Maroc ; · en Amérique, les bureaux sont situés aux États-Unis et au Brésil ; · en Asie, les bureaux sont localisés en Chine, Inde, Indonésie et au Japon. Les bureaux à l’étranger participent au développement international de l’ensemble du groupe, et assurent essentiellement la veille économique et commerciale. Certains bureaux vendent également des produits et services du groupe France Télécom. L’entreprise est également présente à l’international de façon opérationnelle, par le biais de participations majoritaires ou minoritaires dans des opérateurs ou des créations de sociétés. Les investissements financiers du groupe comprennent principalement l’acquisition, dans le cadre d’un échange de participations croisées, de 2 % de Deutsche Telekom, soit près de 8,2 milliards de francs, et la prise de participation fin juillet 1998 via le consortium Estel, dont France Télécom détient 75,5 % du capital, de 51 % du capital de l’opérateur national des télécommunications salvadorien CTE, soit 1,1 milliard de francs. La part des investissements des filiales internationales représente 27 % du total des investissements corporels et incorporels du groupe en 1998 (13,5 milliards de francs), au lieu de 15 % en 1997. La forte croissance de 85 % entre les exercices 1997 et 1998 s’explique par : · l’extension des réseaux mobiles à l’étranger, liée notamment à la construction et au développement de réseaux en Roumanie, au Danemark, en Moldavie et à l’acquisition par France Télécom d’une licence de téléphonie mobile aux Pays-Bas à travers sa filiale Dutchtone ; · l’entrée en 1998 de nouvelles filiales dans le périmètre de consolidation comme Casema (Pays-Bas) et Sonatel (Sénégal) ; · le déploiement des infrastructures de Uni2 (Espagne) et de CI Télécom (Côte-d’Ivoire). Parmi les investissements effectués en 1999, l’un des plus importants est celui réalisé dans NTL au Royaume-Uni pour un montant qui s’élèvera à 5,5 milliards de dollars. France Télécom participera avec ce câblo-opérateur à la consolidation du secteur du câble britannique et facilitera la création du plus important réseau alternatif à large bande du pays. France Télécom et Deutsche Telekom avaient établi une coopération stratégique au niveau international depuis plusieurs années. Ces liens déjà anciens (création commune de Eucom en 1987) ont pris une nouvelle dimension en décembre 1993, avec le lancement d’une alliance stratégique concrétisée par la création de la co-entreprise Atlas. Ce partenariat a été élargi lors de la création, en janvier 1996, de Global One, détenu par France Télécom et Deutsche Telekom avec l’opérateur américain Sprint, dont ils ont alors acquis chacun 10 % du capital. Récemment, France Télécom et Deutsche Telekom ont procédé à des investissements communs importants. En premier lieu, chacun d’entre eux a acquis 24,5 % du nouvel opérateur italien de téléphonie fixe et mobile Wind en novembre 1997. Ils ont également pris une participation de 25 % chacun, en avril 1998, dans Metroholdings, société créée au Royaume-Uni avec l’opérateur britannique Energis. Ils ont créé, en Suisse, la société commune « Multilink » qui a obtenu une licence de téléphonie fixe en 1998. Le 1er décembre 1998, leur partenariat stratégique a franchi une nouvelle étape : France Télécom a acquis, auprès du Kreditanstalt für Wiederauf, institut financier allemand chargé du portage des actions de Deusche Telekom, 2 % du capital de Deutsche Telekom, pour une valeur de 8,2 milliards de francs. En contrepartie, Deutsche Telekom a acquis, auprès de l’État français, 2 % du capital de France Télécom. Cette prise de participation croisée venait à la suite de la nomination du président du directoire de Deutsche Telekom au conseil d’administration de France Télécom en mai 1998. Symétriquement, le président du conseil d’administration de France Télécom avait été nommé au conseil de surveillance de Deutsche Telekom. Les deux sociétés avaient, lors de cet échange de postes d’administrateurs, souligné leur volonté d’accentuer le développement de leur coopération stratégique internationale et de développer des synergies opérationnelles dans plusieurs domaines spécifiques. Ce renforcement de la coopération industrielle entre France Télécom et Deutsche Telekom, conjugué à une prise de participation croisée entre les deux opérateurs, devait sceller l’alliance et constituer le cadre de l’opération dite « Lorelei », programme commun dans huit domaines des télécommunications : international, mobiles, multimédia, recherche-développement… Cette opération, finalisée le 1er décembre 1998, avait reçu l’aval du conseil de surveillance de Deutsche Telekom et du conseil d’administration de France Télécom, les 16 et 17 septembre 1998. L’existence d’un projet de fusion entre Deutsche Telekom et Telecom Italia fut annoncée par un communiqué de presse, le dimanche 18 avril 1999. Dès le lundi 19 avril, un accord de fusion était approuvé par le conseil de surveillance de Deusche Telekom. Cet accord a été présenté au public le 22 avril 1999. Sa réalisation éventuelle était liée au résultat de l’offre publique d’achat, lancée sur Telecom Italia, le 20 février 1999, par Olivetti, qui devait être clôturée le 21 mai 1999, ainsi qu’à des discussions délicates entre les gouvernements italien et allemand sur la place de l’actionnaire public allemand. France Télécom considère que ce projet d’accord de fusion a constitué une violation caractérisée de l’accord signé entre France Télécom et Deusche Telekom, le 1er décembre 1998. Celui-ci prévoit, en effet, le cas de figure où l’un des partenaires veut s’allier à un autre partenaire stratégique. Dans ce cas, il est prévu, d’abord, une consultation écrite préalable, ce qui n’a pas été fait, et, dans un second tend, celui qui envisage un tel mouvement doit proposer à l’autre de s’y associer, ce qui n’a pas été fait non plus. Le 17 mai 1999, France Télécom a résilié les accords d’actionnariat et de coopération et déclenché une procédure d’arbitrage contre Deusche Telekom, à la suite de cette rupture caractérisée des contrats de partenariat stratégique. Les recours de France Télécom ont été déposés auprès de la Cour internationale d’arbitrage de la chambre de commerce internationale. France Télécom réclame des dédommagements, dont le montant fera l’objet d’une évaluation précise au cours de la procédure. Les estimations préliminaires s’élèvent à plusieurs milliards d’euros. Les motifs de dédommagement invoqués sont multiples, parmi lesquels, tout particulièrement, le retrait de France Télécom du marché allemand, alors qu’elle détenait à partir de 1992 les éléments de base pour une pénétration rapide et réussie de ce marché essentiel au cœur de l’Europe. Finalement, le 21 mai 1999, l’offre publique d’achat d’Olivetti sur Telecom Italia réussissait, souscrite par plus de 50 % des actionnaires, et sa réussite rendait caduc le projet de fusion de Telecom Italia avec Deutsche Telekom, non repris à son compte par la nouvelle direction de l’entreprise italienne. Le partenariat entre France Télécom, Deutsche Telekom et Sprint, dans le cadre de l’entreprise commune Global One, est complété, depuis le 31 janvier 1996, par une prise de participation directe de France Télécom et de Deutsche Telekom dans Sprint, à hauteur de 20 %, soit 10 % pour France Télécom et 10 % pour Deusche Telekom. En contrepartie, France Télécom et Deutsche Telekom désignent deux membres de droit au sein du conseil d’administration de Sprint. Le président de France Télécom siège parmi les treize membres de ce conseil d’administration. L’investissement réalisé par France Télécom dans Sprint s’est élevé à 1,8 milliard de dollars, les actions ayant été acquises pour un montant unitaire de 42,4 dollars, y compris la prime d’acquisition. En 1998, Sprint a racheté la participation majoritaire de 60 % de différents câblo-opérateurs dans sa filiale mobiles Sprint PCS, maintenant une société distincte, dont les actions sont cotées séparément de celles de Sprint FON. Cette opération a représenté un investissement de 160 millions de dollars pour France Télécom, qui possède également 10 % du capital de Sprint PCS. Depuis cette opération, le cours boursier de l’action PCS s’est apprécié d’environ 50 %. Les résultats financiers de Sprint sont, dans l’ensemble, très satisfaisants, avec, en 1998, un chiffre d’affaires en progression annuelle de 7,7 %, à 16 milliards de dollars, et un résultat net de 1,5 milliard de dollars, soit 3,6 dollars par action. Ces bonnes performances, combinées à la santé générale du marché financier américain, ont entraîné une appréciation quasi continue du cours de Sprint, qui a doublé depuis l’acquisition par France Télécom de sa participation de 10 %. S’agissant du cadre réglementaire de ce partenariat, force est de reconnaître que les conditions, imposées par la Commission européenne pour la création de Global One et détaillées dans sa décision d’exemption de juillet 1996, sont beaucoup plus contraignantes pour Global One et pour ses trois maisons mères que les conditions posées aux autres alliances et en particulier celle d’ATT-BT. C’est pourquoi Global One a officiellement demandé un allégement de ces contraintes réglementaires à la Commission européenne, qui s’est prononcée favorablement à cet égard. Pour ne s’en tenir qu’à certains aspects financiers principaux de France Télécom, votre rapporteur spécial souhaiterait faire cinq observations finales : · En 1998, le chiffre d’affaires de France Télécom a atteint 161,7 millions de francs, contre 153 millions de francs en 1998. Au cours du premier semestre 1999, son chiffre d’affaires continue de croître (+9,2 %). · Si les produits des services de téléphonie fixe enregistrent une baisse de 5,5 %, le chiffre d’affaires des mobiles a augmenté de 48,6 % entre 1997 et 1998 ; ceci s’explique par la très forte hausse du nombre des abonnés à Itineris. · En 1998, France Télécom a procédé à un rééquilibrage de ses tarifs pour des raisons de stratégie commerciale. · La croissance des frais commerciaux traduit la poursuite du redéploiement des effectifs vers les fonctions commerciales, dans un contexte de pression concurrentielle généralisée. · L’évolution du cours de l’action (France Télécom est la première capitalisation boursière de la place de Paris) ne doit pas faire oublier les investissements importants, nationaux et internationaux, à réaliser. La Poste demeure l’un de nos fleurons. Elle est armée pour s’imposer dans un marché concurrentiel et pour jouer pleinement son rôle de service public exemplaire. Son environnement est connu : évolution rapide des technologies de télécommunication (du courrier traditionnel à Internet, en passant par la télécopie et les portables) et internationalisation des acteurs. Ce sont là des opportunités : faut-il d’ailleurs rappeler que la poste française se situe au deuxième rang européen en chiffre d’affaires et au premier rang en termes de trafic, avec plus d’un quart de trafic total de l’Union européenne ? Une nouvelle dynamique s’est développée : · en 1995, La Poste perdait 1,5 milliard de francs, après une perte de 660 millions de francs en 1996. En 1998, son résultat est positif, à hauteur de 337 millions de francs ; · ses flux annuels d’investissements ont augmenté de 2 milliards de francs depuis 1996 ; · la situation sociale s’est améliorée ; · la transposition de la directive postale n° 97/67/CE du 15 décembre 1997 n’a pas amoindri notre service public ; la part de marché de La Poste ouverte à la concurrence par cette directive représente 2,2 % des courriers postaux. Ces acquis permettent à La Poste de regarder avec ambition l’avenir, tout en sachant qu’une juste répartition entre tous les acteurs, y compris l’État, de la participation à l’effort conditionne le succès espéré. I.– LES MISSIONS ET L’ORGANISATION DE LA POSTE Elles ont été définies par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, précisées par le décret n° 90–1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste, et modifiées par la loi n° 99–533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. La loi du 2 juillet 1990 précitée fixe, dans son article 2, les missions fondamentales de La Poste : · assurer, dans les relations intérieures et internationales, le service public des envois postaux, ainsi que celui du transport et de la distribution de la presse bénéficiant du régime spécifique prévu par le code des postes et télécommunications ; · assurer, dans le respect des règles de la concurrence, tout autre service de collecte, de transport et de distribution d’envois postaux, d’objets et de marchandises ; · offrir, dans le respect des règles de la concurrence, des prestations relatives aux moyens de paiement et de transfert de fonds, aux produits de placement et d’épargne, à la gestion des patrimoines, à des prêts d’épargne-logement et à tous produits d’assurance. Ces missions ont été précisées par la loi du 25 juin 1999, qui transpose la directive européenne (). Cette loi prévoit : · un service universel, correspondant à une offre de services postaux de qualité déterminée, fournie, de manière permanente, en tout point du territoire, à des prix abordables pour tous les utilisateurs. Il comprend des offres de services nationaux et transfrontaliers d’envois postaux d’un poids inférieur ou égal à 2 kilogrammes de colis postaux jusqu’à 20 kilogrammes d’envois recommandés et d’envois avec valeur déclarée ; · des services réservés, nécessaires pour assurer le fonctionnement du service universel dans des conditions d’équilibre financier. Ils comprennent les services nationaux et transfrontaliers d’envois de correspondances, par voie accélérée ou non, y compris le publipostage, d’un poids inférieur à 350 grammes, et dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide. Le cahier des charges précise l’étendue des autres missions confiées à La Poste : contribuer aux missions de défense et de sécurité publique (article 17), aux missions de réglementation et de normalisation (article 18), à la promotion de l’innovation et de la technologie française à l’étranger (article 19), à la coopération technique internationale et à l’aide au développement (article 20) et participer à l’aménagement du territoire (article 21). Ils sont exposés dans le contrat d’objectifs et de progrès 1998-2001, portant contrat de plan entre l’État et La Poste, et précisés dans le plan stratégique de La Poste. Le contrat de plan fait du développement international de La Poste une priorité. Dans les prochaines années, elle étendra ses activités sur les marchés européens et internationaux. Cette ambition prendra diverses formes : partenariats, alliances, prises de participation… Aujourd’hui, le client de La Poste n’est plus « hexagonal » mais européen, voire international. Il est donc essentiel qu’elle propose une offre complète, avec un système d’information le plus intégré possible, pour répondre aux besoins de ses clients en quelque point du territoire national, d’Europe ou du monde. La Poste s’attache à renforcer ses positions sur le courrier international en développant le courrier à l’exportation et en améliorant la qualité de service du courrier à l’importation. Afin d’être présente sur le marché du courrier international, elle développe un réseau commercial spécifique, une présence physique à l’étranger par partenariat ou croissance externe et des activités de conseils auprès d’autres opérateurs postaux, tout en refusant de pratiquer le repostage. La Poste a fait le choix de la constitution d’un réseau européen, qui lui permettra d’être l’un des quelques grands groupes qui domineront le marché européen du colis. Pour ce faire, elle s’est fixée comme objectif de détenir 10 % des parts de marché en Europe à l’horizon 2002. L’effet de taille est, en effet, déterminant, compte tenu des caractéristiques du secteur : fortes économies d’échelle sur l’acheminement, les infrastructures d’exploitation, les systèmes d’information et la livraison, forte pression concurrentielle sur les prix. La spécificité de la stratégie internationale du groupe La Poste, par rapport à ses concurrents, réside dans le choix de l’équilibre entre acquisitions et partenariats internationaux : ni stratégie de conglomérat, ni acquisitions à tout va et au prix fort. Le groupe La Poste s’appuiera, d’une part, sur le développement en interne de ses différents opérateurs déjà présents en Europe (Chronopost, Tatex, l’Aéropostale), d’autre part, sur le développement de partenariats entre ces opérateurs et, par exemple, des postes européennes. Elle réalisera également des acquisitions en Europe, telles que la prise de contrôle de plusieurs membres du réseau Deutscher Packet Dienst (DPD). Il n’y a donc pas de schéma unique de développement à l’international. En fonction des marchés, des zones géographiques et des opportunités qui se présenteront, La Poste sera amenée à réaliser : · des accords opérationnels ou commerciaux ; · des partenariats avec des organismes postaux étrangers ou des sociétés privées. Par exemple, La Poste a signé avec la poste espagnole un accord débouchant, notamment, sur la création d’une filiale d’express sur le marché espagnol, ou encore plus récemment, Chronopost et la poste ivoirienne sur le marché de l’express ont créé une filiale commune ; · des prises de participation ou des acquisitions de sociétés à l’étranger. Par exemple, La Poste a acquis 51 % de la société de transport de monocolis Denkaus opérant sur le territoire allemand et membre du réseau DPD. La Poste et ses filiales développeront de nouveaux services intégrant les nouvelles technologies. Ces nouveaux services, utilisant toutes les technologies de l’information et de la communication (courrier électronique, Internet, suivi des objets, paiement à distance, etc.), s’appuieront sur la complémentarité des métiers de La Poste, pour compléter l’offre du groupe et donner à l’opérateur français un véritable rôle de prestataire de services sur les marchés de la communication. La Poste jouera également un rôle majeur dans la diffusion de nouveaux services à destination de l’ensemble des Français : l’euro, « 1.000 accès à Internet » dans les bureaux de poste et, prochainement, le porte-monnaie électronique, qui permettra de régler les petites dépenses de la vie courante. Nous allons assister à un transfert progressif à La Poste de la gestion des fonds collectés sur les comptes chèques postaux (CCP) et à la possibilité pour celle-ci de se développer sur le marché de l’assurance de personnes. À partir de 1999, La Poste ne déposera plus l’ensemble des fonds collectés sur les CCP au Trésor public. À échéance de cinq ans, la totalité des avoirs créditeurs des CCP seront gérés par La Poste. Le contrat de plan prévoit, en outre, la possibilité pour l’exploitant public de développer une activité dans les assurances de personnes. Dans le secteur réservé, La Poste garantit la péréquation tarifaire géographique et vise la baisse de ses tarifs en francs constants. Elle assure une évolution de l’indice de prix des services postaux réservés inférieure à celle des prix à la consommation (hors tabac) et à fiscalité inchangée. La Poste doit adapter son réseau de points de contact aux besoins des populations en tenant compte, notamment, des évolutions démographiques, sociales et économiques et des projets d’aménagement envisagés tout en recherchant l’équilibre financier de ses activités. Ces orientations expliquent un renforcement de la présence postale dans les zones urbaines et les zones urbaines sensibles et l’adaptation du réseau en zone rurale, en concertation avec les élus. La politique de ressources humaines suivie par La Poste répond à un double enjeu : adapter les ressources humaines aux besoins de l’entreprise, en répondant aux aspirations de développement professionnel des postiers, d’une part, favoriser la motivation de tous les agents, et leur adhésion aux évolutions de l’entreprise, d’autre part. Pour répondre à ces enjeux, La Poste oriente son action autour de plusieurs grands axes. L’adaptation des ressources à l’évolution des besoins, notamment en termes de qualité de service et d’accroissement de la compétitivité, se traduit par un développement de l’emploi interne et une confirmation de la responsabilité sociale de La Poste. Ainsi, la politique de promotion et de mobilité permet de favoriser le redéploiement vers des activités en contact avec le public, tout en répondant aux aspirations de mobilité géographique et de progression professionnelle des agents. Une attention particulière est portée à l’amélioration de l’emploi et des conditions d’utilisation des agents contractuels. La politique de recrutement favorise l’insertion des jeunes, principalement sur des fonctions en contact avec le public, au moyen, en particulier, de la formation par alternance. Pour assurer ses missions, La Poste, au 31 décembre 1998, détient directement quatre filiales : · Sofipost, société holding des filiales de La Poste, dont elle possède 100 % du capital ; · Immobilière Poste, société civile immobilière, dont elle détient 99 % du capital (Sofipost 1 %) ; · Immobilière Réseau, société civile immobilière, dont elle détient 99 % du capital (Sofipost 1 %) ; · Assurposte Vie, détenue à parité avec la Caisse nationale de prévoyance. La Poste possède également deux participations importantes : · 20 % de la Caisse nationale de prévoyance ; · 5 % de Toit et Joie. Indirectement, via Sofipost, La Poste détient un nombre important de filiales
Au 31 décembre 1998, le chiffre d’affaires consolidé du groupe Sofipost, société holding des filiales de La Poste, est de 5,8 milliards de francs. Il est en progression de plus de 16 % par rapport à l’année précédente. Le résultat net consolidé est de 77 millions de francs. En 1998, l’effectif moyen du groupe est de 8.061 personnes. Les principaux faits intervenus en 1998 sont les suivants : · création de Sérès Espagne par la société Sérès ; · acquisition de 100 % de la société Sogerco par Sofipost ; · acquisition de 51 % de la société ORE par Sofipost ; · acquisition de 65 % de la société Jet Worlwide par Chronopost, qui détient désormais cette société à 100 % ; · acquisition de 15 % de la société Publitrans par Sofipost, qui détient ainsi 50 % de cette société ; · acquisition de 28 % de la société Datapost par Sofipost, qui possède désormais 100 % de cette société ; · Sofipost a cédé sa participation de 49,7 % d’Ardial SA à la société EuroFidès. Sofipost a pris, en contrepartie, 16,79 % de EuroFidès ; · Sofipost a cédé à Médiapost la participation qu’elle détenait dans la société IMC. Désormais, Médiapost détient 51 % d’IMC ; · en fin d’exercice, Sofipost a acquis respectivement 29,7 % et 11,2 % des sociétés allemandes Denkhaus AG et DPD GmbH, spécialisées dans le transport express. En 1999, le chiffre d’affaires consolidé devrait croître de plus de 5 %. Dans le prolongement des projets initiés en 1998, la rentabilité dégagée en 1999 sera utilisée en partie pour financer les investissements destinés à conforter la position des filiales sur leurs marchés et pour répondre aux objectifs stratégiques du groupe. Au 31 décembre 1998, le réseau de La Poste comptait 17.058 points de contact qui se répartissaient de la façon suivante : · 14.056 établissements de plein exercice (bureaux, guichets annexes rattachés, recettes rurales) ; · 3.002 autres points de contact (agences postales essentiellement). Si on examine cette situation à travers une répartition entre les communes rurales et les communes urbaines, on recense, dans les communes de plus de 2.000 habitants, 6.758 points de contact, dont 6.093 bureaux de plein exercice, contre 10.300 points de contact dans les communes de moins de 2.000 habitants, dont 7.953 bureaux de plein exercice. L’ensemble de ces éléments fait ressortir deux constats : · le réseau de La Poste n’a pas suivi les transferts démographiques vers les zones urbaines ; · ce réseau évolue peu d’une année sur l’autre. Dans le cadre des orientations du plan stratégique de La Poste, un effort particulier d’optimisation du réseau postal dans les zones urbaines est prévu. En 1998, 80 opérations de création ou de délocalisation de bureaux de poste ont été lancées ou achevées. Parallèlement à ce programme, des actions de rénovation lourde ou légère, tant en zone urbaine que rurale, se sont poursuivies, représentant un investissement de plus de 200 millions de francs. Celles-ci ne s’inscrivent pas dans la logique du « sursaut commercial immobilier », mais relèvent de la politique d’entretien du patrimoine de La Poste, qui vise à améliorer la qualité de l’accueil et des conditions de travail, tout en luttant contre le vieillissement du parc immobilier, générateur de coûts d’entretien importants. Sur la période 1998-2002, l’exploitant prévoit de créer 600 nouveaux bureaux, dont 10 % dans les quartiers déclarées « zones urbaines sensibles ». C’est le contrat d’objectifs et de progrès entre l’État et La Poste pour 1998-2001 qui définit les conditions dans lesquelles cette dernière peut faire évoluer son réseau de points de contact. Il réaffirme le rôle de la concertation locale comme moyen privilégié d’adaptation du réseau, notamment à travers les conseils postaux locaux et les commissions départementales de présence postale territoriale. Le moratoire des services publics avait conduit La Poste à ne fermer aucun bureau en milieu rural. Elle s’était également engagée à n’opérer aucune réduction d'effectif dans les bureaux ayant moins de quatre emplois dans les fonctions guichet-développement. S’agissant des charges liées aux obligations imposées à La Poste au titre de l’aménagement du territoire, le coût de la présence postale en milieu rural, lié à la sous-activité des bureaux, constitue de loin la principale contribution de l’exploitant public en la matière. Il a été évalué par une mission conjointe de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des postes et télécommunications à 4 milliards de francs en 1995. Selon une estimation faite par La Poste, en 1998, il est de 3,8 milliards de francs. Il est compensé à hauteur de 1,7 milliard de francs par l’abattement de 85 % de l’assiette de la taxe foncière et de la taxe professionnelle, prévu par la loi de 1990 et reconduit dans le contrat d'objectifs et de progrès. Par ailleurs, plus de 1.000 établissements sont en contact direct avec une ou plusieurs zones urbaines sensibles, dans lesquelles La Poste joue un rôle social très actif. À l’inverse des bureaux situés en milieu rural, le surcoût, estimé à 329 millions de francs en 1995, de l’activité des bureaux de poste implantés dans ces zones ne résulte pas de la sous-activité de ces bureaux, mais de leurs conditions d’exploitation et de la difficulté, pour La Poste, d’y exercer son activité : durée moyenne plus longue et nombre plus élevé des opérations, demandes de renseignements, aide fournie par les préposés aux guichets pour remplir les formulaires, recours à des interprètes. L’examen des dossiers postaux, dans le respect de l'autonomie de gestion confiée à La Poste en 1990, s’intègre naturellement dans le cadre des réflexions menées par les préfets pour élaborer les schémas départementaux des services publics. Les représentants de l’État assureront la cohérence entre les travaux des commissions départementales de présence postale territoriale (CDPPT), dont ils sont membres, et ceux des commissions d’organisation et d’amélioration des services publics. La polyvalence administrative, portant sur les services publics, et la diversification des activités, portant plutôt sur des services de nature privée non fournis localement par le secteur privé, font l’objet de nombreux partenariats locaux pour des montants financiers modestes. La première peut être un moyen d’offrir certains services aux populations rurales, en particulier au travers des maisons des services publics, offrant aux usagers un accès simple, en un lieu unique, à plusieurs services publics. Mais, elle ne peut pas permettre le maintien des bureaux de poste les moins actifs, compte tenu de la modicité de la demande locale. Il en est de même de la diversification de l’activité qui peut se heurter à des difficultés d’ordre juridique, telles que la responsabilité de La Poste ou de ses agents dans le transport de médicaments, de repas ou de personnes, et la nécessité pour La Poste de ne pas porter préjudice aux petites entreprises locales et de n’intervenir qu’en fonction de contextes locaux très divers. Les principales illustrations de ce mouvement de polyvalence et de diversification sont les suivantes : · la vente de vignettes automobiles, opération importante mais limitée dans le temps, la vente de timbres fiscaux ; la délivrance d’imprimés et collecte de dossiers pour cartes d’identité, passeports, cartes grises ; la vente de billets de train ; l’affichage des annonces de l’Agence nationale pour l’emploi ; la mise à disposition de documents de la préfecture, des caisses d’allocations familiales, de la mutualité sociale agricole, de France Télécom, d’EDF-GDF, la prise de rendez-vous pour ces organismes ; · le transport de médicaments, ou le transport de repas à domicile, pour lequel se pose un problème réglementaire d’hygiène. Ils intéressent les activités courrier, colis et finances. La comparaison sur la période 1995-1997 est difficile, notamment entre 1995 et 1996. En effet, plusieurs faits marquants ont eu un impact sur le chiffre d’affaires du courrier en 1996 : · un démarrage difficile pour La Poste dans la reconquête de ses clients, après une fin d’année 1995 préjudiciable aux intérêts de La Poste ; · une activité économique peu dynamique, due à une baisse de la consommation des ménages et des investissements des entreprises aux deuxième et quatrième trimestres 1996 ; · une concurrence accrue sur les services annexes à l’activité de transport du courrier. Le chiffre d’affaires 1996 résultant de l’activité « courrier et colis » s’élevait à 63,5 milliards de francs, dont 5,8 milliards de francs pour l’activité Coliposte. L’objectif annuel de l’état prévisionnel des ressources et des dépenses de 1998 était fixé à 66,955 milliards de francs. LES RÉSULTATS DES SERVICES « COURRIER ET COLIS » (Fin décembre) (en millions de francs)
En 1998, le chiffre d’affaires « courrier et colis » a progressé de 3 %. L’amélioration du chiffre d’affaires « courrier » s’explique par le développement des produits Postimpact et Catalogues, la progression des produits presse et le succès des produits liés à la coupe du monde de football. Le chiffre d’affaires des correspondances connaît une croissance significative. Par ailleurs, le chiffre d’affaires des grands comptes nationaux et routeurs pour les produits en tarif général a enregistré une progression de 2,1 % par rapport à 1997, montrant ainsi une bonne résistance des produits courrier à la substitution technologique et à la rationalisation de l’utilisation du courrier par les clients publics et les grands facturiers. Le Postcontact enregistre, en cumul à la fin décembre 1998, une progression de 1,3 %, ce qui permet d’atteindre un chiffre d’affaires de 1,6 milliard de francs. À la même date, le chiffre d’affaires Catalogues est en hausse de 7,5 %, par rapport à décembre 1997. Le chiffre d’affaires total est donc de 8,9 milliards de francs. Celui de la presse (affranchissements hors contribution de l’État) s’élève à 2,6 milliards de francs, soit une progression de 6,8 % (300 millions de francs), par rapport à la fin décembre 1997. L’année 1998 a vu la poursuite du développement de l’offre de services dans le domaine du colis et de la logistique. Une adaptation aux besoins du marché a porté ses fruits en termes de ventes, tant sur le segment de Dilipack, monocolis rapide d’entreprise à entreprise, que sur l’activité Coliposte, colis à destination des particuliers. Grâce à la montée en charge de réseaux dédiés aux différents segments du colis (colis entreprises, vente par correspondance et grand public), l’offre de La Poste est conforme aux nouveaux standards du marché, notamment pour ce qui concerne les délais de livraison et le suivi informatique centralisé des colis. Au terme de sept mois d’activité, le chiffre d’affaires « courrier et colis » affiche une avance sur le niveau attendu et présente un développement cumulé supérieur à 2 %. La direction du courrier de La Poste espère une progression annuelle moyenne du chiffre d’affaires d’environ 2,2 % sur la période 1998-2002. Cette croissance devrait être essentiellement tirée par celle du chiffre d’affaires « courrier publicitaire », avec un taux moyen de croissance supérieur à 5 % par an. Les dernières données de trafic consolidées dont dispose La Poste actuellement se limitent à la composition des flux de trafic au titre de l’exercice 1998. En cours d’année, aucune statistique de trafic ne fait l’objet d’une publication, compte tenu, notamment, des délais nécessaires à la remontée et au traitement des données. L’observation de certains trafics, par ailleurs, n’est significative que sur une année entière, en raison des intervalles de confiance plus ou moins importants liés au suivi de trafics de faible « envergure ». Il est plus intéressant de se fonder sur un historique assez long, afin de dresser un bilan des principales évolutions et les perspectives d’avenir. Sur longue période, l’évolution est la suivante : · une croissance du trafic global non négligeable, puisque l’Union postale universelle (UPU), qui regroupe les opérateurs postaux du monde entier, fait état d’une croissance moyenne en Europe de l’Ouest et Amérique du Nord de 2,6 %, sur la période 1985-1995 ; · une croissance tirée par la prospection commerciale, dont le volume, adressé et non adressé, égale presque le trafic des correspondances, mais selon un rythme de croissance bien supérieur : 6,8 % par an en moyenne, contre 1,4 % pour la correspondance. Ce dernier constat mérite que l’on s’attarde sur le trafic de la prospection commerciale, lequel connaît aujourd’hui, à l’intérieur de ses composantes, une modification importante pour l’appréciation des futurs trafics du courrier, moteurs de croissance de demain pour La Poste. Longtemps dynamisé par la publicité non adressée « Postcontact », dont le taux de croissance était supérieur à 10 % jusqu’en 1995, le trafic de la prospection commerciale connaît aujourd’hui une évolution contrastée, qui résulte de l’arrivée à maturité de ce marché. Ceci s’explique, d’une part, par l’évolution des stratégies de communication des grands clients « traditionnels » (grands annonceurs, grande distribution) vers des stratégies de fidélisation plutôt que de conquête, d’autre part, par la probable levée de l’interdiction pour ces clients de procéder à des campagnes de publicité télévisées, ce qui devrait se traduire par une « cannibalisation » d’une partie du budget actuellement consacré à la publicité non adressée. Inversement, l’essentiel du trafic de courrier publicitaire adressé « Postimpact », après avoir connu un ralentissement de croissance sur la période 1990-1997 (de 7 % à 2 %), enregistre en 1998 un regain d’intérêt, qui se traduit une croissance supérieure à celle du Postcontact. Cette inversion de tendance est significative des évolutions attendues pour les prochaines années, car l’on considère que le marketing direct adressé, média cible des stratégies de fidélisation des annonceurs, constituera le moteur de croissance du courrier. Ainsi, La Poste table sur une croissance moyenne du chiffre d’affaires d’environ 2,2 % sur la période 1998-2002, à conditions inchangées, et s’attend à ce que cette croissance provienne essentiellement du courrier publicitaire adressé, avec un taux moyen de 5 % par an. La rémunération sur la collecte des comptes chèques courants correspond à la rémunération accordée à La Poste par l’État pour la collecte des fonds et la tenue des CCP. La rémunération sur la collecte de la Caisse nationale d’épargne correspond à la rémunération versée à La Poste par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion des produits de la Caisse nationale (livrets A et B). La rémunération sur les autres produits d’épargne correspond : · à la rémunération accordée par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion des produits d’épargne-logement, d’épargne populaire, du Codevi et du livret Jeunes (depuis 1996) ; · aux rémunérations des activités OPCVM, c’est-à-dire aux rémunérations accordées par les organismes tiers pour la gestion des opérations de clientèle ; · aux rémunérations des activités d’assurance réalisées avec la Caisse nationale de prévoyance, et qui font l’objet d’un engagement contractuel. La rémunération des services rendus à l’État correspond à la rémunération accordée à La Poste pour la gestion des CCP des comptables publics. LES RÉSULTATS DES SERVICES FINANCIERS (Fin décembre) (en millions de francs)
Le taux de rémunération des CCP s’est élevé à 5,8 % en 1995, puis, compte tenu de la baisse des taux courts, et sans prendre en compte les opérations d’échange de taux réalisées par La Poste, ce taux s’est stabilisé au taux plancher de 4,75 % sur les années 1996, 1997 et 1998. En 1998, la rémunération des CCP représente 37 % du chiffre d’affaires des services financiers de La Poste. Elle est en augmentation de 0,4 % par rapport à 1997, à cause d’un comportement d’encaisse élevé de la part des ménages. Le contrat d’objectifs et de progrès, signé entre La Poste et l’État, prévoit que l’établissement assurera progressivement la gestion financière des avoirs créditeurs des titulaires de CCP. Ce transfert doit s’effectuer sur une période de cinq ans. Pendant cette période, le taux et le mode de rémunération pour les fonds restant à la disposition du Trésor restent identiques à la période précédente, soit une rémunération minimale de 4,75 %. Le contrat a reconduit le taux de rémunération de 1,5 % servi à La Poste par la Caisse des dépôts et consignations au titre des livrets A et B. L’évolution de la rémunération perçue par La Poste est exclusivement liée à celle des encours moyens. En 1998, la rémunération des livrets A et B a progressé de 3,9 % par rapport au niveau atteint en 1997. La rémunération sur les autres produits d’épargne a augmenté de 5,8 % en raison de la progression des encours, notamment sur l’épargne-logement, les produits d’assurance et les livrets d’épargne populaire. Afin de mesurer l’évolution des rémunérations de l’ensemble de la fonction publique, sont pris en considération l’évolution de la valeur du point d’indice, l’attribution de points d’indice, et le relèvement des échelles au titre de la revalorisation des bas salaires.
Concernant les charges de compensation et de surcompensation, le contrat d’objectifs et de progrès de La Poste, portant sur les années 1998 à 2001, a prévu une stabilisation en francs constants des charges de retraites de La Poste au niveau des charges dues au titre de 1997.
IV.– LA POSTE ET LA CONCURRENCE Les parts de marché de La Poste dans le domaine du courrier sont difficiles à évaluer dans la mesure où la concurrence se manifeste sous différentes formes selon les marchés considérés : concurrence directe (pour le transport des colis notamment), existence de produits de substitution (notamment avec le développement des nouvelles technologies, qui tendent à limiter le recours au courrier sous forme de papier).
La directive européenne de décembre 1997, qui prévoit l’ouverture à la concurrence des plis de plus de 350 grammes et de plus de cinq fois le tarif de base, soit 15 francs, a été transposée en droit national, en juin 1999, dans le cadre de la loi sur l’aménagement du territoire. Il en résulte, au moins jusqu’en 2003, date de révision programmée de la directive, une ouverture à la concurrence d’environ 2 % du chiffre d’affaires anciennement sous monopole. Toutefois, il est délicat d’appréhender certains flux, tels que le courrier transfrontalier, par exemple, dont les mouvements sont difficiles à contrôler par l’opérateur postal national (cf. activité en France de Royal Mail dans le Nord et en Île-de-France, de la poste suisse sur Lyon, de la poste hollandaise, etc.).
Le volet social de la réforme des statuts de la Poste prévoyant une nouvelle classification des personnels constituait un important défi de la loi du 2 juillet 1990. Il s’agit d’une réforme d’ampleur, puisque La Poste est le premier employeur du secteur marchand, le troisième employeur du pays après l’Éducation nationale et la Défense. Juridiquement, l’objectif est de concilier la logique d’entreprise et le maintien des garanties statutaires, en passant d’une grille de 111 grades, correspondant aux catégories A, B, et C de la fonction publique, à une nouvelle grille de 11 grades et de 500 fonctions opérationnelles (). Afin de faire le point, nous reproduirons ci-dessous un bilan de la réforme des classifications, extrait d’un rapport particulier de la Cour des comptes (). À la suite de ce bilan, nous en présenterons une appréciation synthétique. Sur la population présente au 30 septembre 1997, plus de 86 % des agents sont d’ores et déjà reclassifiés ou en voie de l’être et, à l’issue des procédures en cours de réalisation et du processus d’attente pour service actif, le personnel fonctionnaire de La Poste devrait être placé à plus de 92 % sur les grades de reclassification. Compte tenu du niveau réel de fonction déterminé à l’issue du processus de reclassification, 50.388 agents ont fait l’objet d’une reclassification sur un grade de cadre ou d’agent de maîtrise avec un gain indiciaire moyen de 16,75 points par agent et 158.317 agents ont fait l’objet d’une reclassification sur un grade d’exécution avec un gain moyen de 10,34 points par agent. Pour l’ensemble des personnels de La Poste, le gain indiciaire moyen par agent s’est établi à 11,89 points d’indice.
On constate que les éléments réalisés au 31 décembre 1996 s’avèrent, en définitive, très proches des éléments prévisionnels pris en compte pour l’établissement des esquisses demandées par la Commission interministérielle de coordination des salaires (CICS) en 1993 et 1994. Outre l’effet de lissage dû au report d’intégration dans la nouvelle grille des personnels classés en service actif, autorisé par le décret du 9 août 1995, La Poste a étalé dans le temps le traitement financier de la réforme des classifications. Ce traitement a été réalisé progressivement, entre octobre 1993 et décembre 1994, pour les cadres supérieurs, cadres et agents de maîtrise et, entre avril 1994 et septembre 1995, pour les personnels d’exécution. Par ailleurs, et à la différence d’une réforme statutaire classique, le bénéfice des reclassifications n’a pas été étendu aux agents retraités de La Poste, en application de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires. Enfin, La Poste a mis en place des mécanismes complexes de plafonnement et d’étalement du gain indiciaire et d’écrêtement sur le complément indemnitaire, afin de limiter l’impact financier de la réforme. Ces différents mécanismes peuvent être résumés de la manière suivante : û Le plafonnement du gain indiciaire La reclassification induit un gain indiciaire pour chaque agent, qui se traduit, au minimum, par l’application du principe de nomination à l’indice égal ou immédiatement supérieur. Le gain indiciaire résultant du tableau de conversion entre les anciens et les nouveaux grades est intégralement répercuté dans le calcul du traitement. Cependant, la répercussion financière de ce gain indiciaire sur la rémunération globale (traitement plus complément indemnitaire) fait l’objet d’un plafonnement. À titre d’exemple, ce plafond correspond à la valeur de 20 points d’indices réels pour les agents professionnels qualifiés des niveaux 2 ou 3 et de 10 points d’indices réels pour les agents professionnels. En dessous de ce plafond, il y a une répercussion financière intégrale du gain indiciaire sur la rémunération globale. Au-delà de ce plafond, il existe une compensation sur la rémunération globale des agents concernés, par voie d’écrêtement du complément indemnitaire. û L’étalement du gain indiciaire La répercussion de la réforme des classifications est réalisée en deux étapes, selon le dispositif suivant : · le gain indiciaire est traduit immédiatement sur le traitement de base des agents concernés lors de leur reclassification ; · un tiers du gain financier est versé aux agents concernés au moment de leur reclassification, le reste, à savoir les deux tiers restants du gain financier augmenté du gain excédant le plafond, étant déduit du complément indemnitaire ; · les deux tiers restants sont globalement versés au 1er décembre 1994 pour les cadres supérieurs, cadres et agents de maîtrise, et au 1er décembre 1995 pour les agents d’exécution, par augmentation correspondante du complément indemnitaire à concurrence des deux tiers du gain financier plafonné. û L’écrêtement du complément indemnitaire L’écrêtement du gain indiciaire et l’étalement du gain financier sont réalisés par ajustement du complément indemnitaire du traitement. Si le gain indiciaire est supérieur au plafond, la partie du gain indiciaire supérieure au plafond est déduite définitivement du complément indemnitaire. Pour illustrer les mécanismes de plafonnement et d’étalement du gain indiciaire et d’écrêtement du complément indemnitaire, il est proposé les deux exemples théoriques suivants :
Le mécanisme de plafonnement apparaît, en première analyse, pénalisant pour les agents concernés. Il modifie cependant la part relative du traitement et celle du complément indemnitaire dans la rémunération globale des intéressés et les place dans une situation aussi avantageuse que les agents non soumis à plafonnement en ce qui concerne les modalités de calcul des retraites. La réforme des classifications implique donc, pour l’ensemble des agents de La Poste, un coût différé de charges de pensions qu’il convient de prendre en considération lorsque l’on calcule le coût de la réforme. Compte tenu des effets de lissage et des mécanismes exposés ci-dessus, le coût direct de la réforme des classifications des personnels de La Poste peut être estimé de la manière suivante sur la période 1993-1996 :
L’effet combiné du plafonnement et de l’étalement des gains indiciaires et de l’écrêtement définitif des gains supérieurs au plafond a permis de réduire la masse indemnitaire de plus de 142 millions de francs sur la période 1993 à 1996. Au total, le surcoût direct pour La Poste consécutif à la réforme des classifications peut être évalué à 622 millions de francs. L’effet de la reclassification sur l’évolution de la rémunération moyenne des personnels de La Poste est relativement modéré : 0,08 % en 1993, 0,75 % en 1994, 0,63 % en 1995 et 0,40 % en 1996. Sans doute, cette modération répond-elle aux recommandations de la CICS, après les fortes augmentations de pouvoir d’achat accordées aux agents de La Poste dans le cadre des mesures de reclassement opérées sur la période 1990-1992. Les responsables de La Poste mettent l’accent sur trois incidences significatives. Au même titre que celle relative aux fonctionnaires de l’État, la grille statutaire des personnels de La Poste applicable avant la réforme des classifications datait, sous réserve de quelques aménagements, de la période de la Libération et apparaissait, cinquante ans plus tard, à bien des égards, vétuste et peu compatible avec les règles d’organisation et de fonctionnement d’un exploitant autonome de droit public, s’ouvrant de plus en plus, sur certains segments de son activité, aux règles de concurrence nationale ou internationale. Selon La Poste, en divisant par dix le nombre de grades applicables aux agents de La Poste et en adaptant aux fonctions réellement occupées les statuts des six nouveaux corps créés par les décrets du 25 mars 1993, la réforme a permis une modernisation et une simplification réelles de la gestion des ressources humaines de l’exploitant. Sous réserve des dispositions du décret du 9 août 1995, permettant aux agents classés en service actif de reporter leur intégration dans les nouvelles échelles de classification jusqu’à l’obtention de quinze ans d’activité en service actif leur donnant droit de partir en retraite à 55 ans, les décrets statutaires du 25 mars 1993 ont supprimé, pour l'avenir, cet avantage. Désormais, la date minimale de départ à la retraite est fixée à 60 ans pour l’ensemble des catégories de personnel de l’exploitant. La suppression de cet avantage apparaît justifiée car il est peu compatible avec l’allongement de l’espérance de vie et les contraintes de financement du régime des pensions civiles et militaires de retraite. Au surplus, cet avantage pouvait être générateur d’inégalité de traitement, certains emplois pouvant être classés ou non en service actif, malgré des conditions d’exercice de la profession pratiquement identiques. Par ailleurs, La Poste est tenue, en application de l’article 30 de la loi du 2 juillet 1990, de verser au budget de l’État, qui assure le paiement des pensions, le produit de la retenue pour pensions prélevée sur le traitement de ses agents, mais aussi une contribution complémentaire couvrant la charge intégrale des pensions concédées ou à concéder relatives au personnel qu’elle a employé. La suppression du service actif, en différant de cinq ans le départ à la retraite de certains agents, devrait donc conduire progressivement, toutes choses égales par ailleurs, à modérer à moyen ou long terme les charges de pensions supportées par La Poste. La direction des ressources humaines de La Poste a fait procéder à une enquête d’opinion sur l’état d’esprit de ses personnels auprès de 15.500 agents, entre le 14 avril et le 12 mai 1997. Les résultats de cette enquête ont été publiés dans un document intitulé « Le socioscope 1997 –Résultats généraux ». Au regard des opinions émises par les personnels, il ressort que : · la reclassification a été, dans l’ensemble, plutôt bien acceptée ; · l’adhésion à la réforme a été plus élevée chez les cadres et agents de maîtrise que chez les personnels d’exécution ou chez les jeunes récemment embauchés, en raison, pour ces derniers, d’une répercussion financière moindre de la réforme sur leur niveau de rémunération. La situation sociale de La Poste se caractérise aujourd’hui par trois points. Le nombre de jours de grève en 1998 est le plus bas constaté depuis 1992. Ce constat conforte celui effectué début 1998, qui marquait une baisse extrêmement forte de la conflictualité à partir de juin 1997. Les conflits constatés sont essentiellement locaux, ce qui traduit l’absence d’inquiétudes majeures sur des problèmes globaux et nationaux. La Poste a engagé une action très approfondie et très large de communication et d’écoute auprès des personnels sur les enjeux stratégiques de l’entreprise. Le nombre de contrats à durée déterminée baisse de façon significative, par consolidation des contrats. Ainsi, en 1997, 4.800 contrats à durée déterminée ont été transformés en contrats à durée indéterminée. En 1998, leur nombre est passé à 6.500 contrats. Le nombre d’heures travaillées figurant dans les contrats de travail s’accroît. En 1996, 31,5% des agents contractuels étaient employés pour une durée inférieure à 40 % de la durée légale du travail, contre seulement 18,4 % en décembre 1998. A contrario, ceux employés pour une durée supérieure à 80 % de la durée légale sont passés, sur la même période, de 31,3 % à 42,9 %. Un accord, signé par les partenaires sociaux en avril 1998, organise la promotion et le développement de carrière de ces personnels pour mieux assurer leur intégration dans l’entreprise. Le développement d’un dialogue social de qualité a débouché sur la signature d’accords importants, tel celui concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT), le 17 février 1999. Cet accord, qui se déclinera en négociations d’accords locaux dans les établissements, donne une inflexion significative à la politique de l’emploi de l’entreprise. Il permet 20.000 recrutements à temps plein sur deux ans, soit une stabilisation de l’emploi. Ces emplois seront prioritairement affectés aux services en contact avec le public. Les créations d’emplois résultant des réorganisations liées à l’ARTT seront affectées, en priorité, à l’augmentation de la durée d’emploi des agents contractuels permanents à temps partiel. Les salariés en contrat à durée indéterminée verront leur durée de travail portée à 800 heures annuelles au minimum, ce qui permet un accès à la couverture sociale. 50 % au minimum des agents contractuels en contrat de ce type seront employés à temps complet. Le nombre de contrats à durée déterminée et d’avenants sera diminué de 20 % d’ici la fin de l’an 2000. Par ailleurs, 2.000 jeunes sous contrat d’apprentissage seront accueillis et formés à La Poste. Des accords spécifiques doivent être négociés pour préciser, notamment, la situation des cadres et les conditions d’emploi des personnels contractuels. Concernant ces personnels, un accord d’entreprise a été signé le 17 juin 1999. Cette situation sociale s’inscrit dans le contexte de la consolidation économique et financière de l’entreprise permise par le contrat d’objectifs et de progrès, grâce, en particulier, à la réponse apportée à la dérive des charges de retraite, et à un effort de l’État de l’ordre de 3 milliards de francs. Les bons résultats de l’entreprise, soit 337 millions de francs en 1998, liés à la croissance et aux efforts des postiers, doivent également être mis en rapport avec cet équilibre social retrouvé. VI.– LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT LES INVESTISSEMENTS PAR DOMAINE
La programmation 1999 s’inscrit, pour l'ensemble des domaines d'activité, dans la problématique du contrat d’objectifs et de progrès portant contrat de plan entre l’État et La Poste, à savoir : · les marchés de La Poste connaissent des évolutions rapides ; · ces évolutions créent pour La Poste des opportunités ; · l’ambition est de faire durablement de La Poste l’un des meilleurs services publics postaux en Europe et une entreprise parmi les plus performantes sur ses marchés. Avec 1.457 millions de francs, les projets déployés dans le domaine du courrier s’efforcent d’apporter une réponse aux enjeux suivants : affronter la concurrence, renouveler l’offre de services en intégrant les technologies nouvelles et sortir des frontières. La Poste mène une politique de compétitivité sur le plan des coûts et de la qualité de service au travers de quatre projets fédérateurs. Le projet de « modernisation des acheminements à l'horizon 2000 » (MACH 2000) consiste, sur une période de cinq ans (1997-2001), en la relocalisation de centres de tri, l’implantation de machines de tri des objets plats et des petits formats, la réorganisation du réseau aérien et la mise en place d’une nouvelle « conteneurisation ». Le « schéma directeur de traitement du courrier international » est un projet de massification des flux de courrier international et d’implantation des bureaux d’échange au plus près des zones aéroportuaires. Le « réseau de production et de distribution du courrier » vise à restructurer le réseau de la distribution autour d’un nombre plus réduit de bureaux distributeurs, implantés de façon plus rationnelle et dotés de locaux et d’équipements plus fonctionnels. Le déploiement du système d’information des acheminements « Magistère » a pour but la connaissance plus rapide et plus fiable des flux de courrier traités et transportés, ceci afin d’adapter en temps réel les moyens à la production. La Poste mène une politique de recherche et développement qui doit permettre, au-delà de l’amélioration des processus de production, de valoriser des compétences pour concevoir des produits et des services nouveaux. Le « suivi informatisé des objets » permettra de répondre aux exigences du marché en matière de restitution d’information sur l’avancement de la distribution des objets et sur la responsabilisation des opérateurs. Le projet de « lecture automatique de documents » concrétise l’expertise de La Poste dans le domaine de la reconnaissance des caractères manuscrits par lecture optique. Il permet l’offre d’un service consistant en la prise en charge de supports papier pour les restituer sous forme électronique, après leur scannérisation. Le projet de « clé électronique » est un système électronique de contrôle d’accès multiservices pour les immeubles d’habitation. Pour satisfaire des clients dont la politique d’achats est conçue à l’échelon européen ou mondial, La Poste a identifié le développement à l’international comme l’une de ses priorités. Ces clients formulent des exigences nouvelles en termes de tarifs (donc de coûts) et de qualité de service. C’est pourquoi La Poste a mis au point un schéma directeur du courrier international pour améliorer la qualité du service et rationaliser le traitement. Elle développe actuellement une stratégie de développement à l’international fondée sur l’élargissement de la présence commerciale et la mise en place d’une force de vente spécialisée. Acteur sur un marché hautement concurrentiel, le colis, avec 100 millions de francs d’investissement, doit trouver des réponses aux enjeux suivants : acquérir le standard du marché pour le suivi et l’information des clients ; devenir européen ; développer les activités logistiques. En termes d’investissements internes, les budgets programmés correspondent, pour l’essentiel, à la mise en place d’un système d’information intégré pour aller vers la saisie de l’ensemble des colis d’ici l’an 2000. Pour faire face à la concurrence que connaît le domaine bancaire, La Poste doit maximiser le contact avec le public et élargir l’offre de produits et de services. Les grandes actions des services financiers, financées à hauteur de 463 millions de francs, sont les suivantes : · le projet SOFI, programme de modernisation de la chaîne des chèques dans les centres financiers, utilise la technique du traitement de l’image, génératrice de gains de productivité ; · le projet SIROCCO permet une meilleure connaissance du client et de ses contrats à partir d’une vision globale de celui-ci et de son portefeuille ; · l’équipement des centres financiers en postes de travail multi-fonctionnels pour une migration vers une architecture de type client/serveur est en cours ; · le projet RCF met à la disposition des conseillers financiers et des assistants commerciaux un poste de travail adapté à leur métier, et permettant d’accéder facilement, en toute sécurité, aux différentes applications. La Poste doit être capable de répondre aux enjeux suivants : adapter les formes de présence postale aux besoins locaux et faire des bureaux de véritables lieux de services. L’investissement est de taille, puisqu’il atteint 963 millions de francs. Le réseau doit mettre à niveau son parc informatique, afin de le rendre homogène, performant et capable de supporter le déploiement des nouvelles applications des différents métiers. Le projet « sursaut commercial en zones urbaines et périurbaines » vise à réorienter l'implantation des bureaux vers des zones de chalandise porteuses où La Poste est insuffisamment présente, ainsi qu’à adapter les locaux en zone urbaine et en zone sensible aux besoins des clientèles. Le projet de « sursaut rénovation » consiste en la rénovation, l’extension ou l’aménagement des bureaux ne s’inscrivant pas dans le cadre du sursaut commercial. Il s’agit, surtout, de lutter contre le vieillissement du parc immobilier qui est générateur de coûts d’entretien importants. Le projet d’« informatisation du réseau grand public » consiste à doter l’ensemble des bureaux, d’ici l’an 2000, d’un parc informatique homogène à même de supporter le déploiement des nouvelles applications du courrier, du colis et des services financiers. Les principaux investissements de modernisation atteindront 742 millions de francs et intègrent : · le projet d’accroissement de capacité du réseau multiservices (Muse), initié en 1998. Il s’agit de faire face aux besoins en matière de transmission d’informations générés par le déploiement des systèmes d’information, sans ralentir la vitesse de circulation des données ; · l’informatisation des services territoriaux, selon l’architecture labellisée par La Poste, qui est étendue, dans un souci d’homogénéisation, à l’ensemble des entités ; · le système d’informatisation des ressources humaines relancé après la pause observée en 1998 dans son déploiement. On notera également la mise en place du service de traitement des archives comptables à Verdun, ainsi que le renforcement des investissements liés à la trésorerie d’exploitation et au système d’information des achats. Les investissements de maintien comprennent les actions relatives à l’appareil de production des centres de traitement informatique, ainsi que les opérations immobilières indivises de gros entretien et de mise en conformité. Le bilan des investissements se présente comme suit :
L’année 1998 a été marquée par le retour de La Poste sur le marché obligataire, après une absence de presque cinq ans, avec le double objectif de refinancer une partie des remboursements de dette de l’année et de se positionner avant la mise en place de l’euro et la création d’un marché européen plus compétitif. Une émission obligataire d’une maturité de dix ans a été réalisée en juin 1998. L’emprunt a été contracté au taux nominal de 4,90 % et pour un montant de 1.500 millions de francs. Une deuxième émission de ce type a été réalisée en février 1999. Elle s’est effectuée au taux nominal de 4 %, pour un montant de 400 millions d’euros. La dette à long terme émise par La Poste a été réalisée exclusivement en francs et en euros. En 1998, la politique de désendettement de La Poste, initiée en 1993, s’est poursuivie. Au 31 décembre 1998, l’endettement brut () de La Poste est de 22,2 milliards de francs, en diminution de 2,5 milliards de francs depuis la fin de 1997, et de 14 milliards de francs depuis le 1er janvier 1993. ÉVOLUTION DE LA DETTE BRUTE (En décembre de chaque année)
Source : La Poste. La dette financière de La Poste est constituée de deux familles de produits : · une dette obligataire classique, résultat des émissions passées de La Poste sur le marché obligataire. L’encours de cette dette, au 31 décembre 1998, est de 12,2 milliards de francs ; · les bons La Poste, qui sont des produits de financement à cinq ans proposés à la clientèle. L’encours de bons La Poste est de 10 milliards de francs au 31 décembre 1998. Ces émissions se font au fil de l’eau et La Poste en contrôle le volume par une mise à jour régulière des taux d’intérêt en fonction des taux de marché. En 1998, les remboursements de bons La Poste ont porté sur environ 2,3 milliards de francs pour des émissions de 1,2 milliard de francs. ENCOURS PAR LIGNE OBLIGATAIRE
Source : La Poste. AMORTISSEMENT DE LA DETTE OBLIGATAIRE
Source : La Poste. La durée de vie moyenne de la dette de La Poste au 31 décembre 1998 est courte. Elle est de 2,9 ans pour la dette obligataire et d’environ 2,2 ans pour les bons La Poste. En 1999, c’est un montant de 2,9 milliards de francs de dette obligataire qui vient à échéance. Quant aux bons La Poste, l’excédent de remboursement sur les émissions est estimé à 1,2 milliard de francs en 1999. La Poste doit donc couvrir un minimum de 4,1 milliards de francs en 1999 (hors éléments exceptionnels). La diminution régulière de la dette, conjuguée à la baisse des taux, a eu pour effet une réduction des charges financières brutes, qui passent de 3,7 milliards de francs en 1993 à 1,6 milliard de francs en 1999. Cependant, le coût moyen de la dette reste élevé, puisqu’il est estimé à 8,5 % en 1999 pour la dette obligataire, et à 5,33 % pour les bons La Poste. ÉVOLUTION DES CHARGES FINANCIÈRES
Les capitaux propres ont varié sur la période en fonction des résultats nets de La Poste. Ils atteignent 7,1 milliards de francs au 31 décembre 1998. Le niveau des fonds propres est obtenu en additionnant les capitaux propres et les provisions pour risques et charges portées au passif du bilan. Il est de 9,4 milliards de francs au 31 décembre 1998. ÉVOLUTION DES FONDS PROPRES
Source : La Poste. Entre le 31 décembre 1993 et le 31 décembre 1998, le ratio dette brute / fonds propres est ainsi passé de 3,8 à 2,36. ÉVOLUTION DU RATIO DETTE BRUTE / FONDS PROPRES
Le contrat d’objectifs et de progrès demande à La Poste de veiller à la maîtrise de son endettement net. Il fixe également des objectifs de développement ambitieux pour l’entreprise (présence à l’international, nouvelles technologies…). Ces orientations se sont traduites en 1998 et 1999 par une augmentation des investissements internes de La Poste. Ces investissements demeurent toutefois inférieurs aux ressources dégagées par l’entreprise, par une capacité accrue d’autofinancement et par des cessions d’immobilisations. Les avancées incontestables de La Poste appellent une poursuite de l’effort. Les objectifs de qualité de service assignés à La Poste ont été contractualisés entre La Poste et l’État, en juin 1998, dans le cadre de la signature du contrat d’objectifs et de progrès pour la période 1998-2001. En 2001, 84 % du courrier prioritaire doit être acheminé en J+1 et moins de 2 % en J+2. Pour atteindre les objectifs du contrat de plan, La Poste développe des actions dans le domaine de la qualité et, à ce titre, a programmé la certification de tous les établissements courrier à l’horizon 2002. Par ailleurs, un plan d’investissements pour moderniser les outils de production a été prioritairement mis en œuvre et la démarche d’aménagement et de réduction du temps de travail devrait permettre de revoir toutes les organisations pour les orienter davantage vers les clients et renforcer la fiabilité de la chaîne d’acheminement et de distribution du courrier. La Commission supérieure du service public des postes et des télécommunications estime que la qualité du service « courrier » ne s’est pas améliorée sur l’ensemble du territoire et plus particulièrement dans certaines régions : « Si cette impression devait être confirmée par les résultats réels attendus, le risque sera grand, par exemple, que l’objectif pour 2001, terme du contrat de plan, et fixé à 84 % de lettres distribuées en J+1, ne soit pas atteint. Rappelons qu’il était de 77,2 % en 1997. On sait que, avec cet indice, la France est nettement en retard par rapport aux pays industrialisés de l’Europe occidentale ; dans la concurrence que se livrent déjà, entre elles, les postes publiques, La Poste française a un handicap évident à surmonter. En l’état actuel de son information technique, la Commission est conduite à penser que le système postal – l’acheminement tout particulièrement – relève d’une organisation trop « tendue » et parfois, pour les liaisons terminales, de relais de transport qui, le plus souvent choisis parce qu’ils sont les moins-disant dans les appels d’offres, ne répondent pas avec la fiabilité nécessaire aux obligations qui sont les leurs. » () L’équilibre budgétaire de La Poste mérite beaucoup d’attention. N’a-t-on pas écrit qu’il n’était qu’un équilibre de survie, limitant le montant des investissements nécessaires ? () À cet égard, il faut rappeler aux autorités européennes qu’une juste politique des tarifs doit permettre de dégager des marges pour l’investissement de développement. La réduction de la dette, si elle se fait au détriment d’emprunts utiles à des investissements de bonne rentabilité, n’a pas systématiquement, dans cette hypothèse, les effets positifs escomptés. La Poste doit maintenir, renouveler, et équiper son patrimoine. Il est de la responsabilité du Gouvernement d’honorer les obligations de service public qu’il impose. Si l’on additionne le coût dû à la présence territoriale avec le déficit du transport de la presse restant à charge, nous arrivons à un total de 5,2 milliards de francs (). Ajoutons que les activités en concurrence de l’opérateur devraient ouvrir droit aux même règles que celles applicables aux autres opérateurs. Il y a là une discrimination négative pouvant être dommageable pour le service public. Nous sommes en droit de nous interroger sur la présentation d’un rapport budgétaire conjoint « Poste et Télécommunications ». Des considérations historiques l’expliquent, tout comme l’appartenance de ces deux secteurs à la société de l’information. Force est de constater que ces deux composantes essentielles de cette société posent des problèmes institutionnels que l’on ne saurait oublier. · Poste et Télécommunications sont concernées par des obligations de service public caractérisées par des principes d’égalité, de continuité et d’accessibilité ; · la multiplicité d’intervenants, tant postaux que téléphoniques, font que la réglementation doit avoir un caractère général favorisant les évolutions et garantissant le libre accès de tous ; · il faut un ministère chef de file qui coordonne l’action des pouvoirs publics dans ces domaines. Si ceci est vrai pour les télécommunications, cet impératif l’est encore plus pour La Poste. Le contrôle de l’activité de cette dernière est, en efffet, divisée en quatre ministères : Finances, Transport, Industrie, Aménagement du territoire. C’est là une source de dysfonctionnement. LAISSER CETTE PAGE SANS NUMÉROTATIONEXAMEN EN COMMISSION Dans sa séance du 2 novembre 1999, la commission des Finances, de l’Économie générale et du Plan a examiné les crédits de la Poste et des Télécommunications. Après la présentation des principales orientations du budget, votre rapporteur spécial a souhaité faire deux séries d’observations. En premier lieu, s’agissant du secteur postal, les autorités européennes, lorsqu’elles délibèrent d’une politique tarifaire, devraient avoir le souci de permettre aux autorités postales de dégager les investissements nécessaires au développement de l’activité de leur opérateur. Si la réduction de la dette de La Poste peut apparaître comme positive, il conviendrait qu’elle ne se fasse pas au détriment d’emprunts finançant des investissements très importants d’un point de vue technologique. Par ailleurs, l’État ne peut imposer des obligations à La Poste sans en prendre à sa charge les conséquences financières. Ainsi, la seule obligation de présence postale entraîne, pour La Poste, une dépense non compensée estimée à 2,1 milliards de francs. Cette présence est importante en milieu rural, mais également en milieu urbain. Le moratoire sur les services publics en zone rurale a été respecté, et La Poste n’a fermé aucun bureau. Mais son réseau n’a pas suivi le transfert démographique vers les zones urbaines, ce qui l’obligera à ouvrir, sur la période 1998-2002, 600 nouveaux bureaux, dont 10 % dans les zones urbaines difficiles. Enfin, puisque la concurrence à laquelle La Poste est soumise s’avère de plus en plus rude, il convient que l’exploitant public soit dans la même situation fiscale et réglementaire que ses concurrents privés. En second lieu, s’agissant du secteur des télécommunications, le rapporteur spécial a fait remarquer que les succès boursiers de France Télécom ne devaient pas l’exonérer des investissements nationaux et internationaux nécessaires à son développement. La politique commerciale active, qui a nécessité de nombreux redéploiements, ne doit pas faire oublier les impératifs d’une politique de recherche avancée. Enfin, il conviendrait qu’un ministère soit désigné comme chef de file dans ces deux secteurs, notamment dans le secteur postal, qui voit s’affronter divers départements, au premier rang desquels figurent l’Industrie et les Transports. Un effort de coordination est nécessaire. Après s’être déclaré en accord avec votre rapporteur spécial sur les orientations que doivent suivre les autorités européennes en matière postale, M. Alain Barrau a estimé que la réglementation européenne tendait systématiquement à pénaliser les opérateurs nationaux. Puis, il a interrogé votre rapporteur spécial sur l’évolution des relations entre opérateurs publics et opérateurs privés, sur la concurrence de ces derniers et sur la nécessité et les modalités d’une action, en amont des négociations européennes. Constatant que de nombreuses entreprises publiques françaises investissaient dans le capital d’opérateurs européens privés, M. Jean-Louis Dumont a demandé à votre rapporteur spécial quelle était la stratégie européenne d’alliances de La Poste. En outre, quelle analyse fait-il de l’action de l’Autorité de régulation des télécommunications (ART), en tant qu’autorité de régulation, à l’heure où se multiplie ce type d’instances, dont le nombre atteint aujourd’hui la quinzaine, au risque d’un manque de cohérence de notre système administratif ? Votre rapporteur spécial a estimé qu’avec l’ART, la France avait adopté un modèle institutionnel qui n’appartenait pas à sa culture et qui contrevenait au principe d’unité de l’administration. Il a rappelé, à cet égard, que la distinction, faite par Edgard Pisani, dans un numéro de la Revue française de science politique, en 1956, entre administration de mission et administration de gestion, n’avait jamais été appliquée. L’ART dispose de véritables moyens, et devient sans aucun doute un véritable pouvoir. La Poste est entrée dans le champ de la concurrence, mais elle est soumise à un régime réglementaire et fiscal pénalisant par rapport à ses concurrents privés. C’est pourquoi, il est souhaitable que le texte autorisant La Poste à développer des activités d’assurance soit réellement appliqué. En outre, il serait sain que l’État puisse honorer ses engagements. Il faut, ainsi, rappeler que la Commission supérieure du service public des postes et des télécommunications chiffre entre 5,2 milliards de francs et 8 milliards de francs le coût non compensé, pour La Poste, des charges résultant de l’obligation de présence postale et du transport de la presse. Il a salué le dynamisme dont La Poste fait preuve en matière d’alliances. Cette stratégie est le chemin le plus court pour préserver les acquis de compétences de l’exploitant public. La Commission a ensuite adopté, sur la proposition de votre rapporteur spécial, les crédits de la Poste et des Télécommunications, et vous demande d’émettre un vote favorable à leur adoption. N°1861-15. - Rapport de M. Edmond Hervé, au nom de la commission des finances, sur le projet de loi de finances pour 2000. - économie, finances et industrie : poste et télécommunications - Cliquer ici pour retourner au sommaire général - Cliquez ici pour retourner à la liste des rapports et avis budgétaires - Cliquez ici pour retourner à la liste des discussions budgétaires
() La contribution annuelle de l’État au titre de l’aide a été fixée à 1.850 millions de francs pour 1998 et 1999 ; elle est portée à 1.900 millions de francs en 2000 et 2001. () Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. () Union internationale des télécommunications (UIT), Union postale universelle (UPU), Bureau européen des radiocommunications (BER), Institut européen des services des télécommunications (ETSI), Conférence européenne des postes et télécommunications (CEPT), Office européen des télécommunications (ETO). () Rapport n° 1111, annexe n° 15, pages 27 et suivantes. () Fin mars 1999, la répartition du capital social était la suivante : 63,6 % étaient détenus par l’État, 23,9 % par les investisseurs institutionnels, 7,3 % par les particuliers, 3,6 % par les salariés et 2 % par Deutsche Telekom. () Open Network Provision : fourniture d’un réseau ouvert. () Directive n° 97/67 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux et l’amélioration de la qualité du service. () Le droit de la poste établit une correspondance entre le grade et la fonction, alors que, dans la fonction publique, une distinction se fait entre le grade et l’emploi. () Première chambre, présidée par M. François Logerot, Rapport particulier sur la reclassification des personnels de La Poste, daté du 28 avril 1999, pages 37 à 42. () L’endettement brut est constitué du montant de la dette obligataire partie à moins d’un an incluse et par le stock des bons La Poste et PTT. Les intérêts courus non échus ne sont pas compris dans l’endettement brut. () Rapport de la Commission supérieure du service public des postes et des télécommunications, 1999, page 41. () Le rapport précité estime le coût total non compensé des obligations de service public imposé à La Poste à 8 milliards de francs (page 43). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
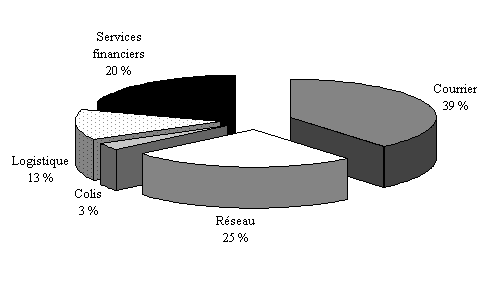 Source : La Poste.
Source : La Poste.