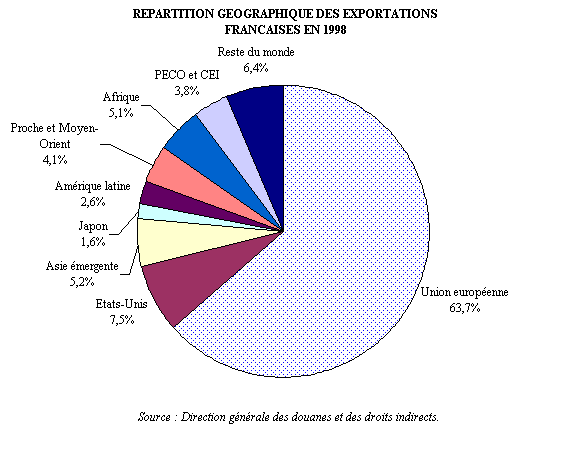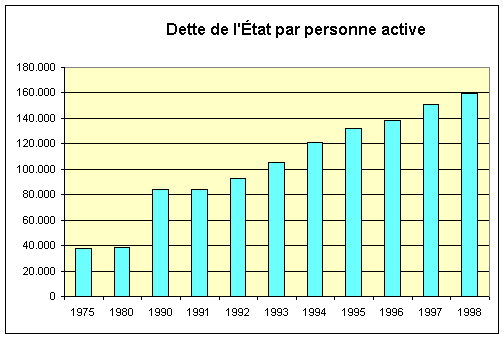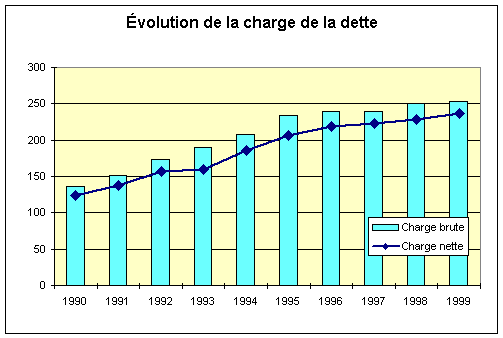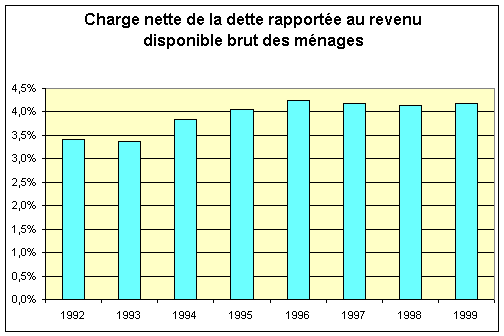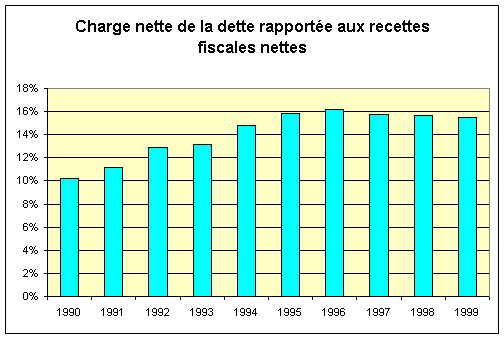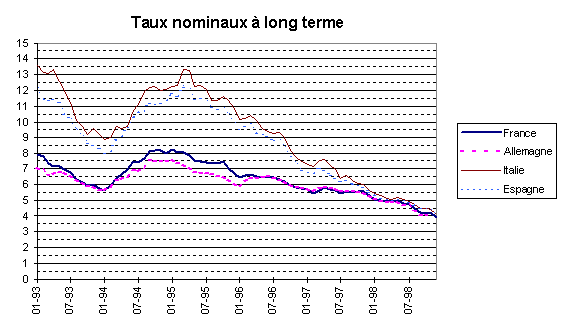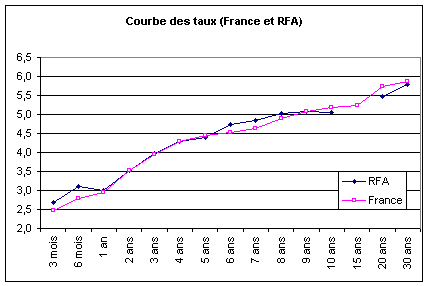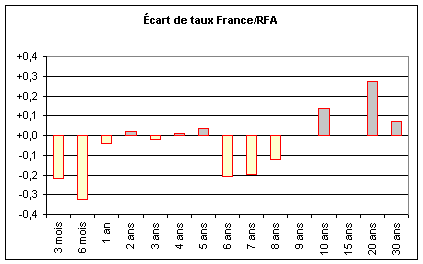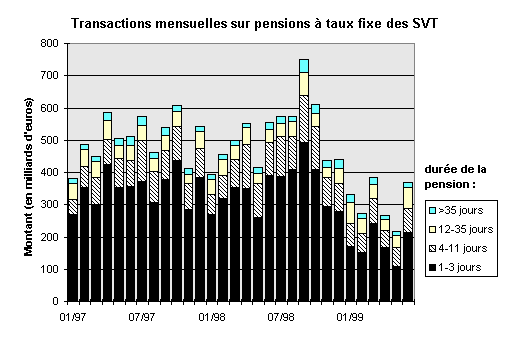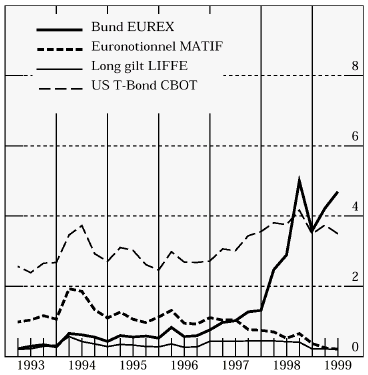Document mis en distribution le 18 octobre 1999
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 octobre 1999. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2000 (n° 1805), TOME I PAR M. DIDIER MIGAUD Rapporteur général, Député (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Lois de finances. La commission des finances, de l’économie générale et du plan est composée de : M. Augustin Bonrepaux, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Michel Bouvard, Jean-Pierre Brard, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM. Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Eric Besson, Alain Bocquet, Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Raymond Douyère, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Guy Lengagne, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Georges Tron, Philippe Vasseur, Jean Vila. SOMMAIRE ____ Pages ___ PRÉSENTATION GÉNÉRALE 9 PREMIÈRE PARTIE : GARDER LE CAP POUR UNE CROISSANCE SOLIDAIRE 9 CHAPITRE PREMIER : DES CONDITIONS TOUJOURS FAVORABLES POUR L’ÉCONOMIE FRANÇAISE 13 A.- UN ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL FAVORABLE À LA CROISSANCE ET À UN RÉÉQUILIBRAGE AU PROFIT DES PAYS DE LA ZONE EURO, MALGRÉ QUELQUES ÉLÉMENTS D’INCERTITUDE 13 1.- L’amélioration des perspectives de la croissance mondiale 14 2.- L’économie américaine : un ralentissement probable, mais incertain quant à son moment et ses modalités 18 3.- Une reprise de l’expansion des pays de la zone euro, mais des conjonctures décalées en Allemagne et en Italie 22 4.- Une situation encore très difficile au Japon 28 5.- Le retour inégal de la croissance dans les pays émergents 30 B.- UN DOSAGE ÉQUILIBRÉ DES POLITIQUES BUDGÉTAIRE ET MONÉTAIRE 35 1.- Une poursuite de l’assainissement financier qui ne doit pas contrarier la croissance 35 2.- Des perspectives d’inflation modérées qui laissent espérer la poursuite d’une politique monétaire accommodante 41 C.- LES BUDGETS ÉCONOMIQUES POUR 2000 47 1.- Un scénario international « peint de couleurs plus vives » 48 2.- La zone euro : une accélération confirmée 57 CHAPITRE II : UNE ÉCONOMIE PORTÉE PAR LE CERCLE VERTUEUX EMPLOI-REVENU-CONSOMMATION 67 A.- LA POLITIQUE DE L’EMPLOI, UN ADJUVANT PUISSANT AU DYNAMISME DU MARCHÉ DU TRAVAIL 67 1.- La politique de l’emploi : aspects quantitatifs et qualitatifs 69 2.- L’amélioration de la situation de l’emploi et du chômage 86 B.- LES MÉNAGES RESTENT LE PIVOT D’UN RETOUR DURABLE DE LA CROISSANCE 95 1.- Une consommation toujours bien orientée, malgré un léger tassement 96 2.- Une forte reprise de l’investissement des ménages 101 3.- Soutenir ce processus en allant plus loin dans l’allégement des prélèvements pesant sur les ménages 102 C.- UNE OPPORTUNITÉ POUR FAIRE RECULER LES DÉSÉQUILIBRES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 106 1.- Exclusion, précarité et Etat providence 107 2.- L’avenir des retraites 114 3.- Inégalités et territoires 121 CHAPITRE III : LA PÉRENNITÉ DE LA CROISSANCE : UN LIEN ÉTROIT AVEC LA VITALITÉ DE L’OFFRE 135 A.- UN EXCÉDENT COURANT, SYMBOLISANT L’EFFICACITÉ DE L’APPAREIL PRODUCTIF NATIONAL 135 1.- Des échanges extérieurs structurellement excédentaires 135 2.- Un infléchissement conjoncturel du solde commercial français 147 B.- LA « MAISON FRANCE » DANS LE « VILLAGE PLANÉTAIRE » : COMPÉTITIVITÉ ET ATTRACTIVITÉ 154 1.- La France s’inscrit dans une économie mondiale globalisée 154 2.- La compétitivité et l’attractivité sont les conditions d’une insertion réussie dans l’économie mondiale 159 C.- UNE DYNAMIQUE DE L’INVESTISSEMENT ET DE L’INNOVATION ENCORE TROP HÉSITANTE 167 1.- L’investissement des entreprises : ombres et lumières 168 2.- Le renforcement de la politique favorable à l’innovation 172 D.- LE TISSU PRODUCTIF : DES ÉVOLUTIONS STRUCTURELLES DONT LES EFFETS CONTRASTÉS APPELLENT À LA VIGILANCE 175 1.- Un nombre croissant de fusions-acquisitions 175 2.- Les motivations diverses des fusions-acquisitions 177 3.- Un environnement favorable aux concentrations 179 4.- Des effets financiers, économiques et sociaux inégaux 180 DEUXIÈME PARTIE : LA GESTION DE LA DETTE DE L’ETAT DANS LE CONTEXTE NOUVEAU DE L’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE 185 CHAPITRE PREMIER : L’UNION MONÉTAIRE A BANALISÉ LES ÉMETTEURS SOUVERAINS DE LA ZONE EURO DANS UN MARCHÉ EUROPÉEN DES CAPITAUX QUASIMENT UNIFIÉ 193 A.- L’AVÈNEMENT DE L’EURO, POINT D’ORGUE DE L’INTÉGRATION DES MARCHÉS EUROPÉENS DE CAPITAUX 195 1.- Une dynamique d’intégration déjà ancienne 195 2.- L’euro, accélérateur de la recomposition du paysage financier en Europe 198 B.- UN CONTEXTE CONCURRENTIEL PLUS VIF ENTRE ÉMETTEURS SOUVERAINS, OÙ LA FRANCE ET L’ALLEMAGNE PRÉTENDENT TOUTES DEUX ASSUMER LE RÔLE D’« ÉMETTEUR DE RÉFÉRENCE » 201 1.- L’euro ouvre une ère de concurrence accrue entre Etats émetteurs 202 2.- Signature française, signature allemande : l’équivalence imparfaite 208 CHAPITRE II : LA QUALITÉ DE LA DETTE FRANÇAISE ET DE SA GESTION EST UNANIMEMENT RECONNUE ET APPRÉCIÉE DES MARCHÉS 217 A.- LA MODERNISATION DE LA DETTE DE L’ETAT, UNE ENTREPRISE RÉUSSIE 218 1.- Un ensemble performant d’outils et de procédures 218 2.- Un modèle français vers lequel convergent les Etats de la zone euro 225 B.- LA LIQUIDITÉ DE LA DETTE DE L’ETAT, PIERRE DE TOUCHE DE LA COMPÉTITIVITÉ INTERNATIONALE DU TRÉSOR FRANÇAIS 231 1.- Un marché secondaire de la dette très liquide et très sûr 232 2.- La gestion active de la dette au service de la liquidité du marché 240 3.- La léthargie du Matif, handicap indolore pour les valeurs du Trésor ? 249 ANNEXE À LA DEUXIÈME PARTIE : CADRE LÉGAL, INSTITUTIONS COMPÉTENTES, INSTRUMENTS ET TECHNIQUES DE GESTION DE LA DETTE AUX ETATS-UNIS, EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, AU JAPON ET AU ROYAUME-UNI 267 CONCLUSION 275 TRAVAUX DE LA COMMISSION 277 I.- AUDITION DE MM. DOMINIQUE STRAUSS-KAHN, MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, ET CHRISTIAN SAUTTER, SECRÉTAIRE D’ETAT AU BUDGET 277 II.- AUDITION DE M. CHRISTIAN SAUTTER, SECRÉTAIRE D’ETAT AU BUDGET 291
PREMIÈRE PARTIE GARDER LE CAP POUR UNE CROISSANCE SOLIDAIRE Le projet de loi de finances pour 2000 s’inscrit dans un contexte incontestablement favorable. En dépit des incertitudes conjoncturelles de la fin de l’année 1998, liées aux turbulences ayant affecté l’économie mondiale, il apparaît que la stratégie économique définie au début de la législature a porté ses fruits. Cassée en 1995-1996 par une politique économique et fiscale brutale et inadaptée, la croissance semble désormais bien installée. Ainsi, la croissance française, qui était à la traîne par rapport à nos partenaires européens, est désormais plus forte que celle constatée dans la zone euro, devançant significativement les performances de l’Allemagne et de l’Italie. Après la progression de 3,2% du PIB en 1998, l’année 1999 serait marquée, selon les prévisions du Gouvernement, par une croissance, encore ferme, de 2,3% (2,5% selon le FMI), un rebond étant attendu pour 2000, avec un taux compris entre 2,6% et 3%, le FMI retenant, pour sa part, le haut de cette « fourchette ». Fidèle à sa tradition historique comme à ses engagements électoraux du printemps 1997, la gauche plurielle, autour du leitmotiv de la priorité à l’emploi, a, en effet, défini une politique de croissance solidaire et mis en œuvre les moyens de sa concrétisation. Faisant le pari que l’offre répondrait nécessairement aux stimulations de la demande, le Gouvernement a engagé une démarche qui place chaque français au cœur de la croissance : stabilisant la part –précédemment décroissante – des revenus du travail dans la valeur ajoutée, assurant une progression réelle du pouvoir d’achat des salaires, et particulièrement des plus modestes (+ 6% de pouvoir d’achat en deux ans pour les « smicards »), offrant aux jeunes exclus de l’emploi les voies d’une entrée dans la vie active avec les emplois-jeunes, nous avons pu stimuler la consommation et la demande intérieure. Nos entreprises ne s’y sont pas trompées. Faisant fi d’un catastrophisme convenu, elles ont saisi la chance que leur offraient la relance de la consommation et l’établissement de la confiance, si bien que l’investissement et l’emploi sont au rendez-vous. Le taux de chômage a ainsi significativement diminué en deux ans (– 1,4 point), même si l’on ne peut se satisfaire d’une situation où l’on compte encore 2,8 millions de chômeurs, tandis que l’investissement des entreprises, « arlésienne » du début de la décennie, s’est inscrit en hausse de plus de 6% en 1998. Quelques éléments d’incertitude ou d’insatisfaction demeurent. Il est certain que l’« atterrissage » longtemps annoncé de l’économie américaine, marquée par un décalage croissant entre l’économie réelle et la « sphère financière », pourrait affecter le dynamisme de l’économie française, dont l’environnement européen n’est d’ailleurs pas non plus sans zone d’ombre, avec notamment le ralentissement allemand. Des impatiences se font également jour concernant la réduction des déficits publics et des prélèvements obligatoires. Il faut, à cet égard, être lucides et vigilants. D’abord, votre Rapporteur général relèvera que ceux qui, de 1993 à 1996, n’ont pu réduire les déficits que de 1,8 point de PIB, et ce malgré un alourdissement de 1,9 point des prélèvements obligatoires, sont – et ils le savent – disqualifiés pour émettre des critiques sur ce point. Il faut aussi mesurer objectivement l’acquis. Nul ne saurait contester que, depuis la mi-1997(), les déficits publics auront été réduits de 1,7 point de PIB, soit un effort plus significatif que celui réalisé, en moyenne, par nos partenaires de la zone euro (- 0,8 point). L’effort devra naturellement se poursuivre. De même, l’année 2000, après deux décennies de croissance continue de la charge de la dette, verra s’inverser la spirale de la dette : le poids de celle-ci dans le PIB, d’ailleurs resté très inférieur à ce qu’il était chez nos principaux partenaires – y compris ceux réputés les plus vertueux –, va enfin commencer à décroître. S’agissant des prélèvements obligatoires, il est vrai qu’après la forte progression enregistrée sous la précédente législature, ils se maintiennent à un niveau très largement jugé excessif. Il ne faut cependant pas oublier que, sous le vocable abstrait de prélèvements obligatoires, on trouve la contrepartie des prestations offertes aux citoyens par la « puissance publique » : sécurité, équipements, éducation, santé, etc… Cette nécessaire mise au point ne doit toutefois pas occulter la réalité d’un prélèvement global qui excède la moyenne de ce qui est prélevé dans les pays comparables au nôtre. Globalement, le projet de loi de finances pour 2000 garde le cap défini en début de législature, celui d’une croissance solidaire, avec, dans les arbitrages, les inflexions que l’évolution économique et budgétaire rendent possibles. Pour 1999, les « fruits de la croissance », c’est-à-dire les marges budgétaires, avaient, grosso modo, été répartis en trois tiers : financement des priorités de la Nation, avec une progression de 1% en volume de dépenses, réduction du déficit budgétaire et baisses d’impôts. Pour 2000, la répartition sera différente : dans un contexte qui n’appelle a priori pas de soutien conjoncturel, les économies sur le service de la dette, ainsi que les efforts de redéploiement et de gestion, permettent de stabiliser la dépense en volume (+0,9% en valeur, soit le même rythme que les prix), tout en assurant une nouvelle fois une réelle progression des moyens consacrés au financement des priorités définies l’an passé : emploi et solidarité, éducation, justice et sécurité, environnement, culture. Les marges qu’autorise cet effort pour contenir globalement la dépense sont consacrées aux baisses d’impôts, qui, avec près d’une quarantaine de milliards de francs, soit les deux tiers des marges budgétaires, devraient permettre de tenir l’objectif d’une indispensable décrue des prélèvements obligatoires. Votre Rapporteur général, qui a beaucoup milité en faveur de cette mesure, se réjouit que le Gouvernement ait pu lever le verrou communautaire et retenir la baisse de la TVA sur les travaux dans le logement : avec un coût de près de 20 milliards, cette mesure concrétise de façon massive et lisible l’engagement pris devant le pays de réduire les prélèvements indirects. Enfin, comme l’an passé, 21,2 milliards de francs, soit le tiers des marges disponibles, sont consacrés à la réduction du déficit budgétaire : sa diminution, qui devrait, en 2000, représenter 0,3 point de PIB, avec un besoin de financement de l’Etat de 2,4%, contribuera largement à la baisse du besoin de financement de l’ensemble des administrations publiques (1,8%, en diminution de 0,4 point de PIB) (). Il apparaît ainsi que les choix opérés, raisonnables et équilibrés, sont de nature à conforter le « cercle vertueux » à l’œuvre depuis maintenant deux ans : la croissance retrouvée, recentrée sur les composantes internes de la demande, permet enfin d’engager la résorption du chômage ; cette amélioration de la situation de l’emploi génère des revenus soutenant la consommation, qui elle-même alimente l’investissement. * * * CHAPITRE PREMIER DES CONDITIONS TOUJOURS FAVORABLES Sous réserve de l’incertitude liée à l’ampleur d’un éventuel ralentissement de l’économie américaine, l’environnement international paraît favorable à la croissance. Il en va de même du dosage actuel des politiques budgétaire et monétaire dans la zone euro. Aussi les budgets économiques de la Nation peuvent-ils présenter une vision sereine des perspectives pour l’an 2000. A.- UN ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL FAVORABLE À LA CROISSANCE ET À UN RÉÉQUILIBRAGE AU PROFIT DES PAYS DE LA ZONE EURO, MALGRÉ QUELQUES ÉLÉMENTS D’INCERTITUDE Les crises financières qui se sont succédé depuis 1997, d’abord en Asie du Sud-Est, puis en Russie, et, en janvier dernier, au Brésil, ont obscurci les perspectives de développement de l’économie mondiale. Elles n’ont cependant pas eu les conséquences dépressives que certains avaient pu craindre. Ainsi, l’activité productive n’a été profondément perturbée que dans les seules économies émergentes des trois zones géographiques concernées, le Sud-Est asiatique, l’Europe orientale et l’Amérique latine. Ailleurs, si l’on excepte le cas du Japon, très spécifique, seule la sphère financière a été affectée, et uniquement de manière temporaire. Dans l’ensemble des Etats européens, la croissance a seulement été moindre que prévu et, dans les pays, tels que l’Allemagne, qui ont connu une récession, celle-ci a été temporaire et limitée. Pour les pays de l’Union européenne, l’expression de « trou d’air » retenue par le ministre français de l’économie, des finances et de l’industrie, M. Dominique Strauss-Kahn, au début du printemps, était ainsi particulièrement adaptée. Les perpectives de croissance pour le deuxième semestre de l’année 1999 et pour l’année 2000 sont donc satisfaisantes et permettent d’anticiper un rééquilibrage de la croissance mondiale au profit de l’Europe. Cependant, il subsiste encore quelques éléments d’incertitude. Certains semblent susceptibles de n’avoir que des conséquences très limitées et de n’affecter que modérément la croissance des pays industrialisés : l’endettement de quelques pays d’Amérique latine et les suites de la crise brésilienne, les aléas susceptibles d’affecter la situation de la Russie et un ralentissement de l’économie chinoise s’accompagnant d’une dévaluation du yuan-renmimbi et du dollar de Hong Kong. En revanche, l’évolution économique des Etats-Unis est susceptible d’avoir des conséquences importantes sur la croissance mondiale. Selon la majorité des économistes, l’économie américaine devrait connaître une phase de ralentissement après plusieurs années d’une croissance vigoureuse et d’une durée particulièrement exceptionnelle. Une décélération en douceur ne provoquerait pas de difficulté. En revanche, un scénario plus brutal s’accompagnant d’une brusque correction des cours boursiers, souvent jugés surévalués, serait susceptible de provoquer des perturbations plus importantes. 1.- L’amélioration des perspectives de la croissance mondiale a) Une gestion satisfaisante de la crise russe et de la crise financière de l’été et de l’automne 1998 « Le calme et la confiance sont revenus sur les marchés mondiaux ». La première phrase de la première partie des « Perspectives économiques de l’OCDE », publiées en juin dernier (n° 65), prend acte du fait que la crise russe et la crise financière qui a suivi ont été convenablement gérées, permettant ainsi de déjouer les prévisions les plus pessimistes, lesquelles n’étaient pourtant pas infondées. Diverses initiatives ont permis de rassurer l’ensemble des marchés sur la possibilité d’éviter des conséquences en chaîne de l’effondrement de certains d’entre eux : les interventions du Fonds monétaire international (FMI) et des autorités monétaires nationales ; l’assouplissement de la politique monétaire américaine, à l’initiative de la Réserve fédérale ; la réduction des taux d’intérêt dans la plupart des pays de l’OCDE, qui a permis une forte expansion du crédit ; le renflouement par des établissements privés, sous l’impulsion des autorités monétaires américaines, d’un fonds d’arbitrage, le LTCM (Long–Term Capital Management), qui était presque en cessation de paiement. Pour endiguer la crise des pays émergents, le FMI a accordé, au cours de l’exercice 1998/1999, une enveloppe de 38,4 milliards de dollars de crédits, sur lesquels 30 milliards ont été décaissés. A la fin du mois d’avril 1999, le total des encours était de 90,8 milliards de dollars contre 75,4 milliards de dollars un an plus tôt. Les engagements les plus élevés ont été pris en faveur du Brésil (17,6 milliards de dollars), de l’Indonésie (8,6 milliards de dollars) et de la Russie (11,5 milliards de dollars). Par ailleurs, les marchés boursiers se sont redressés et sont restés bien orientés au cours du premier semestre de l’année 1999, tout risque systémique susceptible de conduire à une déflation généralisée ayant été considéré comme écarté. Dans ce contexte, la crise brésilienne, en janvier 1999, avec la dépréciation de 45% du real par rapport au dollar, a eu des effets très limités. Il est vrai que les mesures de soutien préventivement arrêtées par le FMI en faveur du Brésil, dès novembre 1998, ont eu un effet de retardement très précieux et ont permis aux institutions financières de procéder à un désengagement vis–à–vis du risque des pays émergents. De même, ainsi que le note l’OCDE, la crise au Kosovo n’a pas bouleversé les marchés financiers mondiaux. Ses conséquences économiques, pour dramatiques qu’elles soient, à des degrés divers, pour les populations concernées, sont donc limitées aux seuls pays voisins. b) Un commerce mondial à nouveau bien orienté Après plusieurs années de forte croissance, avec une augmentation moyenne de 7% sur la période 1985–1996, le dynamisme du commerce mondial a été affecté par la crise asiatique. Le taux de croissance des échanges de marchandises en volume, mesurés par la moyenne arithmétique des importations et exportations mondiales, qui s’établissait à +10% en 1997, a ainsi chuté à +4,5% en 1998. Ce ralentissement s’explique d’abord par la récession au Japon et dans les principaux pays émergents d’Asie, dont les importations représentent le quart des importations mondiales de marchandises. Le volume de ces dernières a, en effet, diminué de 8,5% en 1998. Il provient également de la réduction des recettes d’exportation des régions productrices de matières premières. Il devrait encore être sensible cette année, puisque la progression de l’indicateur précité devrait s’établir à 3,9%, selon les prévisions de l’OCDE et à 3,2% selon le rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances. Aux phénomènes déjà évoqués, il faut en effet ajouter la réduction des importations des pays d’Amérique latine et de la demande intérieure provenant d’Amérique du Nord et d’Europe, qui n’ont pas été totalement compensées par le début de reprise en Asie. Pour 2000, le taux de croissance du commerce mondial devrait s’établir à un niveau supérieur, de 5,6% selon l’OCDE et de 5,8% selon le rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances, traduisant une réorientation favorable des courants d’échanges internationaux. Pour l’essentiel, cette évolution serait la conséquence de la poursuite de la reprise des importations des seules économies émergentes d’Asie du Sud–Est, la situation encore passablement dégradée en Russie et au Brésil faisant que les régions concernées resteraient à l’écart de ce mouvement de reprise. c) Un marché des matières premières toujours déprimé, à l’exception du pétrole et de certaines matières premières spécifiques Au cours de l’année 1998, les prix des matières premières ont fortement chuté sous l’effet tant d’un gonflement de l’offre que d’une réduction des importations des pays émergents d’Asie. Selon Rexecode, l’indice d’ensemble des matières premières (), exprimé en dollars, a diminué de 25% en 1998. Ce mouvement a été particulièrement sensible dans le cas du pétrole, dont le prix a baissé de 50% par rapport à 1997, le cours du baril de brent (qualité de référence de la Mer du Nord) chutant à 11 dollars à la fin de l’année dernière, cours qu’il a d’ailleurs conservé au premier trimestre de cette année. En moyenne annuelle, la chute des cours est moins spectaculaire, certes, mais tout aussi significative : pour cette même référence, le cours moyen s’est établi à 13 dollars en 1998 contre 19 dollars en 1997. Une même évolution a également affecté les autres matières premières, notamment le cuivre. Seuls les cours des métaux précieux (or, platine, argent), également orientés à la baisse, ont mieux résisté. Pour l’année 1999, on observe une remontée des cours du pétrole, alors que les autres marchés des matières premières demeurent déprimés, à l’exception de quelques matières spécifiques qui font l’objet de mouvements spéculatifs, comme l’alumine. Le cours du baril de brent sur la place de Londres est, en effet, remonté au-dessus de 20 dollars depuis le début de l’été et continue à croître. Il était de 23 dollars le 13 septembre dernier. Il faut y voir la conséquence de l’accord de réduction de la production conclu le 23 mars 1999 entre l’OPEP et certains autres grands pays producteurs. Contrairement aux accords précédents, celui–ci a acquis rapidement une certaine crédibilité compte tenu de la normalisation des relations entre l’Iran et l’Arabie saoudite ainsi que d’un changement de gouvernement au Venezuela. En outre, la demande s’avère cette année plus dynamique que l’an passé, grâce à une reprise de la demande dans les pays de l’OCDE après une période de stagnation de la consommation. L’ampleur de la remontée des prix semble cependant devoir être limitée, à terme, en raison de l’importance des stocks mondiaux et du comportement de certains producteurs qui risquent de ne pas respecter l’accord précité dès lors que les cours auraient atteint un niveau jugé suffisant pour assurer la stabilité de leurs ressources sans pour autant provoquer la mise en exploitation de gisements supplémentaires. Le rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances retient l'hypothèse d’une stabilisation des cours autour de 18 dollars le baril. S’agissant des autres matières premières, l’OCDE envisage, dans ses Perspectives économiques de juin dernier, une baisse de 10% pour cette année, dans l’ensemble, suivie d’une stabilisation des prix en 2000. d) Des perspectives de croissance certaines Selon l’OCDE, l’économie mondiale, dont la croissance ne s’est établie qu’à 2,3% en 1998, contre 4% en 1996 et 1997, ne donnerait des signes de reprise que très modestes cette année, avec une progression de 2,5% de la production. Cependant, la reprise serait plus ferme en 2000 et la croissance s’établirait à 2,9%. Le FMI anticipe également une amélioration du climat économique d’ensemble, dès cette année, et une reprise de la croissance mondiale en 2000, avec des taux de progression de 3% pour 1999 et de 3,5% en 2000, selon les estimations rendues publiques en septembre 1999. On ne manquera pas d’observer que l’institution fait preuve d’un plus grand optimisme qu’en avril, puisque chacune de ces deux perspectives a été réévaluée, celles-ci étaient respectivement, au printemps, d’une croissance de +2,3% pour cette année et de +3,3% pour l’année prochaine. Cette accélération serait principalement due à un retour de la croissance dans les pays émergents d’Asie et d’Europe centrale, ainsi qu’au dynamisme des économies des pays de l’Union européenne. En revanche, l’économie du Japon resterait, dans l’ensemble, atone, la stagnation actuelle se poursuivant en 2000 malgré le rebond du premier trimestre et la stabilisation du deuxième trimestre. La principale incertitude est celle affectant la croissance des Etats-Unis, dont la durée et la vigueur exceptionnelles ne cessent d’étonner, et sur l’issue de laquelle les experts divergent sensiblement. On observera que le rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances retient l’hypothèse d’un simple rééquilibrage, avec une croissance mondiale de 2,8% en 1999 et de 2,9% en 2000. 2.- L’économie américaine : un ralentissement probable, mais incertain quant à son moment et ses modalités Selon les termes de l’agence financière de l’ambassade de France à Washington (), depuis presque trois ans maintenant, l’économie américaine « défie les lois de la pesanteur ». L’actuel cycle de croissance, qui a débuté au printemps de l’année 1991, s’avère d’une durée particulièrement longue et d’un dynamisme remarquable, avec un taux d’expansion d’environ 4 % l’an, en moyenne. Ce cycle a permis la résorption du chômage, lequel s’est établi à 4,3% en août, niveau inconnu depuis 1970, et s’est accompagné d’un assainissement des finances fédérales, caractérisées par un excédent de 0,8% du PIB en 1998 qui contraste avec le déficit de 4,7 % du PIB de l’exercice 1992. On observera qu’il ne s’est pas accompagné d’un regain d’inflation, celle–ci ayant même régulièrement diminué, puisqu’elle s’établit actuellement à 1,5%, contre 5% en 1991. La vivacité de la demande intérieure sur une période aussi longue étant jugée insoutenable, la très grande majorité des observateurs annonce chaque année, depuis 1997, un ralentissement et un retour à une croissance plus sobre, de l’ordre de 2% à 2,5% par an. On observera cependant que, dans un contexte de modération salariale, la vigueur de la consommation s’explique en grande partie par les effets de richesse provenant de la faible augmentation des prix et de la progression continue des valeurs boursières, largement diffusées au sein de l’importante classe moyenne américaine. Ce ralentissement annoncé, qui ne s’est pas encore produit, est au cœur du débat économique. D’un coté, certains économistes considèrent que cette anticipation est erronée et que l’économie américaine devrait rester sur un sentier de croissance dynamique. L’explication la plus étayée est celle des tenants de la « nouvelle économie » ou du « nouvel âge » selon lesquels les effets combinés de la globalisation, du développement du commerce international, qui représente le quart de l’économie mondiale, et du développement de l’informatique, qui a accru la capacité d’échange d’information et entraîné la construction d’une économie de réseaux autour d’Internet, ont engendré un nouveau système économique. Cette nouvelle économie serait caractérisée par l’absence d’inflation, excluant ainsi toute tension sur les taux d’intérêt susceptible de provoquer une baisse du marché boursier et d’affecter le rythme des investissements. L’absence de tension sur les prix est expliquée par deux facteurs : d’une part, la fluidité du marché du travail, laquelle a, jusqu’à présent, empêché le développement des revendications salariales malgré le plein emploi et provoque une réduction du niveau du taux de chômage non accélérateur de l’inflation, ou NAIRU () ; d’autre part, la mondialisation de la concurrence, les entreprises étant contraintes d’accroître leur productivité et d’innover pour maintenir ou augmenter leur profitabilité, puisqu’elles ne peuvent plus librement augmenter leurs prix comme elles le feraient sur un marché protégé. Dans sa version la plus hardie, la thèse de la nouvelle économie est couplée avec l’hypothèse de la fin des cycles économiques et accrédite le pronostic d’une croissance stable et durable jusqu’en 2020. Selon les tenants de cette théorie de la « fin des cycles », le recentrage de l’activité sur les services, secteurs que l’absence de stocks et la plus grande stabilité de la demande mettent à l’abri des aléas, l’amélioration de la gestion des entreprises, notamment l’adoption de la technique des flux tendus, qui réduit les risques de surproduction, l’ouverture des économies sur l’extérieur et le développement de la consommation dans les pays émergents, devraient supprimer les fluctuations et permettre ainsi une expansion importante et durable. Certes, la thèse de la « nouvelle économie » a le mérite de tenter d’expliquer les performances étonnantes de l’économie américaine, mais force est d’admettre que ses détracteurs n’ont pas nécessairement tort quand ils avancent qu’il pourrait s’agir d’une explication de circonstance et non d’un véritable corpus théorique dûment éprouvé. Les économistes qui considèrent, au contraire, que l’économie américaine devrait faire l’objet d’un ralentissement constatent que cinq facteurs, dont les effets des trois premiers sont déjà perceptibles, devraient entraîner une atténuation du rythme de croissance : – restées très dynamiques jusqu’au premier semestre 1999, la consommation privée et la construction de logements, qui a été favorisée par la détente des taux d’intérêt, devraient connaître un certain ralentissement ; – l’investissement des entreprises, qui est resté très soutenu en 1998, grâce à l’équipement informatique (+ 65% en volume), et a contribué à la croissance d’un tiers du PIB, devrait revenir à un taux de croissance plus modéré, compte tenu du fait que l’investissement hors informatique diminue depuis 1997, en raison de la baisse des profits des entreprises, de la remontée des taux d’intérêt et de l’absence de tension sur les capacités de production ; – le redressement de l’inflation devrait entraîner une modération de la progression du pouvoir d’achat des ménages en termes réels ; – la réorientation, dans un sens restrictif, du dosage des politiques budgétaire et monétaire, la parenthèse de l’assouplissement monétaire décidé à l’automne dernier pour juguler les effets négatifs de la crise russe et de la crise financière qui lui a fait suite étant refermée, après la décision du comité monétaire de la Réserve fédérale de relever d’un quart de point ses taux directeurs (), le 24 août dernier ; – l’arrêt de la progression des valeurs boursières, qui devrait intervenir ne serait-ce qu’en raison de la remontée des taux longs et de la baisse des perspectives de profit des sociétés américaines. En revanche, en s’inversant, l’effet contracyclique de la demande extérieure pourrait jouer un rôle stabilisateur, grâce à une amélioration des exportations, en raison notamment de la diminution des difficultés des pays émergents d’Amérique latine et de la reprise en Asie. A l’inverse, le solde extérieur avait contribué négativement à la croissance ces dernières années. Par ailleurs, le ralentissement de la demande intérieure devrait peser sur les importations, sans que la contribution du commerce extérieur à la croissance ne redevienne positive pour autant. Les tenants d’un ralentissement de l’économie américaine divergent quant aux modalités et à l’ampleur de ce phénomène. Deux hypothèses sont en effet envisageables : celle d’une modération progressive du rythme de croissance ou « atterrissage en douceur » ; celle d’un retournement brutal de la conjoncture. Cette différence d’appréciation repose en fait sur la manière dont on anticipe l’évolution boursière américaine. Si le niveau des valeurs boursières reste stable ou subit une correction modeste, l’hypothèse de l’atterrissage en douceur devrait se réaliser. En revanche, en cas de forte correction, deux éléments pourraient provoquer une diminution sévère de l’activité : la réduction des projets d’investissements des entreprises, en raison de l’accroissement de la rentabilité exigée par les actionnaires ; la baisse de la consommation, en raison de la fin de l’« effet de richesse » conduisant les ménages à reconstituer leur épargne ou à financer dans des conditions beaucoup plus délicates le remboursement des importants crédits qu’ils ont contractés ces dernières années. On rappellera que l’endettement des ménages et des entreprises représente environ 140% du PIB total. Ceux qui penchent pour l’hypothèse d’une forte correction des cours boursiers ne manquent pas d’arguments, car ils observent que l’appréciation des cours depuis l’automne dernier est contradictoire avec la tendance haussière des taux d’intérêt à long terme et que les perspectives de dividendes pourraient justifier un ajustement de près de 30%. Dans une perspective à plus long terme, il faut également mentionner que, selon l’OFCE, le PIB américain a cru en valeur de 5% l’an depuis 1991, les profits des entreprises de 10% et le cours des actions de 17%, chaque année. Il faut néanmoins relever que les comportements d’investissement boursier ne sont pas toujours strictement attachés au respect de ces critères rationnels. Enfin, il ne faut pas totalement exclure l’hypothèse d’une augmentation des principales valeurs boursières, ce qui retarderait à la fin de l’année 2000 ou même à 2001 la correction annoncée. S’il est aussi difficile de prévoir avec exactitude ce que sera l’évolution de l’économie américaine dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, on observera cependant que les principales analyses retiennent la thèse de l’atterrissage en douceur. En septembre 1999, le FMI a d’ailleurs prévu, pour l’économie américaine, une croissance de 3,7% pour 1999 et de 2,6% pour 2000. Dans les Perspectives économiques publiées en juin dernier, l’OCDE a été moins optimiste avec respectivement 3,6% et 2%, soit un ralentissement plus sévère. Le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2000 retient une hypothèse similaire, avec un rythme de croissance divisé par deux à partir de la fin de l’année 1999. Compte tenu de l’acquis des trois premiers trimestres, la croissance du PIB devrait être de 3,8% en 1999. Elle devrait revenir à 2,1% en 2000. En pratique, l’avenir immédiat de l’économie américaine dépend de la manière dont sera conduite par la FED, et perçue par les marchés, la remontée des taux d’intérêt, qui paraît probable, ne serait-ce que pour éviter que l’augmentation du crédit ne gonfle artificiellement les achats d’actifs financiers et n’alimente encore plus ce que l’on peut appeler une « inflation financière ». 3.- Une reprise de l’expansion des pays de la zone euro, mais des conjonctures décalées en Allemagne et en Italie Dans l’ensemble, au-delà de certaines spécificités conjoncturelles dont les plus notables concernent le Royaume-Uni, les pays de l’Union européenne ont progressivement renoué, depuis 1997, avec la croissance, et ce d’une manière d’autant plus remarquable que les contraintes nécessaires à la transition vers la troisième phase de l’Union économique et monétaire et à la réussite du processus de convergence étaient peu favorables, à court terme, à la croissance. L’inflation a été maîtrisée, les situations budgétaires ont été assainies, les taux d’intérêt nominaux et réels, très élevés au début de la décennie, ont été considérablement réduits, les hausses de salaires ont été modérées dans le cadre d’un recul des anticipations inflationnistes. D’abord imputable à la demande extérieure, en raison du dynamisme du commerce mondial de l’époque et de la compétitivité des exportateurs communautaires, cette reprise a ensuite été étayée par la hausse de la demande intérieure (consommation et investissement), grâce à la décrue des taux d’intérêt, à la hausse du revenu disponible et à un retour de la confiance. Cependant, les effets conjugués de la crise asiatique intervenue au deuxième semestre de l’année 1997, dont on peut estimer qu’elle s’est traduite par une perte de croissance d’un demi point, puis de la crise russe en 1998, ont entraîné un ralentissement économique. Dans la zone euro (), la croissance est passée, en rythme annualisé, de 2,5% au premier semestre 1998 à un rythme proche de 1% au cours du quatrième semestre 1998 et du premier trimestre 1999. Il ne s’agit cependant pas d’un ralentissement durable, mais, comme on l’a vu, d’un « trou d’air » conjoncturel. D’une durée variable selon les pays, il est surtout marqué au deuxième semestre de 1998 et au premier semestre de 1999. Le deuxième semestre de 1999 et l’année 2000 devraient être caractérisés par un retour général à la tendance antérieure d’une accélération de la croissance. Si le ralentissement industriel a été important, la production passant, en valeur annualisée, d’un rythme de + 6% l’an au début de l’année 1998 à + 1,2% en 1999, essentiellement en raison de la restriction des débouchés extérieurs, le scénario que l’on avait pu craindre d’une contagion aux autres secteurs par le biais d’une réduction de l’emploi, de l’affaiblissement de la confiance des ménages et d’une baisse de la consommation, ne s’est pas réalisé. En outre, ce ralentissement est concentré sur la fin de l’année 1998 et le début de l’année 1999. La demande interne s’est, en effet, bien comportée. La consommation a bénéficié de l’attrait des nouvelles technologies et la construction de la baisse des taux d’intérêt, qui a amélioré les conditions de financement. On observe également que le taux de chômage a diminué de 11,3% à 10,3% entre le début de l’année 1998 et le mois de mai 1999, en partie en raison des mesures ciblées pour l’emploi en France et en Allemagne et de la perspective des 35 heures dans notre pays, ainsi que des créations d’emplois notamment dans les services, en France, en Italie et en Espagne. Parmi les autres facteurs qui ont facilité le maintien du potentiel de croissance des pays de la zone, il faut d’abord observer que la mise en œuvre, au 1er janvier 1999, de la monnaie unique a placé les différentes économies à l’abri d’éventuelles tensions sur les taux de change et a définitivement clarifié les perspectives d’investissement et d’accroissement des échanges mutuels. La politique monétaire a également été favorable. La Banque centrale européenne a procédé, le 8 avril dernier, à un assouplissement monétaire favorisant la croissance des principaux Etats, l’Allemagne, la France et l’Italie, même si cet assouplissement a pu être regretté par les pays bénéficiant d’une conjoncture plus dynamique, parmi lesquels l’Irlande et l’Espagne. Enfin, la dépréciation de l’euro par rapport au dollar tout au long du premier semestre a indéniablement favorisé le maintien de la compétitivité externe. En conséquence, en l’absence de facteur exogène venant perturber cette évolution, c’est une nouvelle accélération de la croissance qui est attendue pour la zone euro, avec, selon le FMI un taux de 2,1% pour cette année et de 2,8% en 2000. Selon les Perspectives économiques publiées par l’OCDE en juin dernier, la croissance devrait être également de 2,1% cette année, chiffre assez faible en raison du « trou d’air » des premiers mois, et de 2,6% l’année prochaine. La consommation des ménages devrait rester relativement soutenue, progressant de 2,7% en 1999 et de 2,6% en 2000. Après une phase de ralentissement en 1998, puisque leur progression a été de 4,4% seulement en 1998 contre 11,1% en 1997, les exportations devraient retrouver leur dynamisme antérieur, avec une progression de 5,3% en 2000, en raison de l’amélioration de l’environnement international, après une croissance plus modeste de 3% en 1999. Le faible niveau des taux d’intérêt, l’amélioration de l’activité industrielle, le dynamisme des demandes interne et externe devraient soutenir l’investissement, qui devrait ainsi rester assez dynamique, malgré un tassement conjoncturel cette année, avec une croissance de la formation brute de capital fixe (FBCF) de 3,1% en 1999 et 4% en 2000. Le rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances retient, pour la zone euro, l’hypothèse d’une croissance de 2% en 1999 et 2,7% en 2000, l’activité connaissant un rebond dès le second semestre de 1999. Dans leur communiqué du 9 septembre dernier, les dirigeants de la Banque centrale européenne ont montré qu’ils partageaient cet optimisme. Pour justifier le maintien à 2,5% du taux d’intérêt des opérations principales de refinancement, ainsi que la stabilité des deux autres taux d’intervention, la facilité de prêt marginal (3,5%) et celle de dépôt (1,5%), le président de la banque, M. Wim Duisenberg, a rappelé qu’il estimait que la croissance devrait être, cette année, supérieure aux prévisions établies en avril (2% pour 1999 et 2,25% à 2,5% pour 2000). Le ralentissement économique constaté n’a pas eu des conséquences uniformes sur l’ensemble des pays de la zone et a mis en évidence des divergences conjoncturelles. L’activité est restée assez soutenue en France, aux Pays–Bas et en Espagne. A l’opposé, l’Allemagne et surtout l’Italie et la Belgique ont connu une récession au dernier trimestre de 1998. Le tableau suivant mesure l’importance de l’écart conjoncturel des cinq principaux pays de la zone euro, la France exceptée.
Ce décalage conjoncturel affecte donc deux des trois principaux Etats de la zone euro : l’Allemagne et l’Italie. L’Allemagne, supporte les conséquences d’un plus grand degré d’exposition au risque des pays émergents, compte tenu de l’importance de ses relations avec les pays d’Europe centrale et orientale et avec la Russie. Etablies en mai dernier, les prévisions de la direction de la prévision publiées dans le cadre de la note de conjoncture internationale de juin considéraient que le « trou d’air » ne concernait que le seul quatrième trimestre 1998, avec une récession de 0,1% et que le léger rebond d’activité enregistré au premier trimestre 1999, avec une croissance de 0,4%, devait être confirmé au deuxième trimestre. A l’appui de cette analyse, il était constaté que la consommation privée, qui s’est maintenue pendant le « trou d’air » avec une croissance de 0,5% au dernier trimestre 1998, et les exportations, soutenues par la reprise du commerce mondial et l’amélioration de la compétitivité, viendraient accélérer la croissance. Il était relevé que l’impact des finances publiques serait neutre et que les conditions monétaires resteraient accommodantes, du fait de leur composante de change, notamment. L’OCDE partageait cette analyse. Ce scénario ne s’est pas concrétisé. La croissance attendue au deuxième trimestre de cette année, estimée à 0,2% ou 0,4% selon les sources, ne s’est pas réalisée. On a, au contraire, enregistré une stagnation, qui s’explique essentiellement par un recul de la consommation de 0,5%, après une progression de 0,7% au premier trimestre (chiffre révisé) et par une augmentation des importations, qui a ainsi réduit la contribution du solde extérieur au dynamisme de l’activité. Simultanément, les autres postes ont évolué faiblement : les dépenses publiques ont diminué de 0,4% et la construction de 1,9% ; l’investissement des entreprises n’a crû que de 0,4%. On ne peut pas exclure pour autant que la prévision de croissance généralement retenue par les experts pour 1999, autour de 1,5% (1,6% pour le Gouvernement et 1,7% pour l’OCDE), soit hors de portée si une reprise s’affirme au deuxième semestre. Néanmoins, il est prématuré d’attribuer la contre-performance du deuxième trimestre à une simple prolongation des conséquences du « trou d’air » ou, ainsi que l’avait noté l’OCDE, au climat d’incertitude relatif à la politique fiscale et aux orientations des réformes structurelles. Dans cette deuxième hypothèse, la perspective de croissance pour 2000, de 2,3% pour le PIB et de 3,5% pour la production industrielle, selon l’OCDE, pécherait par optimisme. Les prévisions du rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances sont prudentes pour cette année (+ 1,3%), mais plus optimistes pour 2000 (+ 2,4%). En ce qui concerne l’Italie, on avance, pour expliquer la sensibilité de son économie à la crise asiatique, la fragilité de la position concurrentielle de l’appareil productif, ainsi que l’orientation géographique et sectorielle du pays, très présent dans les secteurs où les économies émergentes disposent d’avantages de compétitivité importants. Le secteur du textile–habillement est le plus souvent cité. La crise conjoncturelle du dernier trimestre 1998, avec une récession de 0,3%, et du premier trimestre 1999, lequel a été marqué par une stagnation, le PIB ayant augmenté de 0,1% seulement, a été d’autant plus sévère que l’économie était très peu dynamique depuis de nombreuses années, en raison des contraintes liées à la perspective de l’euro, avec une croissance réduite, de 0,9% en 1996, 1,5% en 1997 et 1,4% en 1998. Même si l’activité devait progresser au deuxième semestre, la croissance devrait rester modeste et s’établir à 1,4% cette année, la demande restant déprimée. La demande extérieure, notamment en provenance des autres pays d’Europe, s’est réduite en raison de la crise asiatique et de la réduction de la demande des pays européens dont la croissance a été moindre que prévu. En outre, l’OCDE observe que la faiblesse de l’augmentation de la productivité entraîne une élévation des coûts unitaires de main d’œuvre. A l’opposé, la réduction des taux d’intérêt liée à la mise en place de l’euro et l’assouplissement de la politique budgétaire, l’objectif d’un déficit des administrations publiques égal à 2% du PIB, prévu par la loi budgétaire, ayant été révisé à 2,4%, constituent certes des facteurs favorables, mais ne permettent pas d’envisager une reprise ferme. L’OCDE prévoit ainsi une croissance du PIB italien de 1,4% cette année et de 2,2% l’année prochaine. Cette accélération serait imputable à la seule consommation privée, soutenue par la progression du revenu disponible. Le rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances retient l’hypothèse d’une croissance de 1,3% pour 1999 et 2,3% pour 2000. Le niveau du redémarrage en Allemagne et en Italie est considéré comme un facteur d’incertitude susceptible d’affecter le cœur de la zone euro pour le deuxième semestre de 1999 et pour l’année 2000. Un autre élément d’incertitude est celui du taux de change de l’euro. Certains observateurs suggèrent que la baisse de son cours depuis le 1er janvier 1999, de 1,17 dollar à presque 1 dollar en septembre, pourrait avoir provoqué, auprès des investisseurs internationaux, une certaine défiance et entraîner, de la part de la Banque centrale européenne, un relèvement de ses taux plus rapide que celui qui devrait normalement être opéré au vu de la reprise de la croissance et donc dans le cadre d’un retour à une politique monétaire moins souple. Il n’est pas inintéressant de noter que cette défiance provient en partie de l’inquiétude des milieux économiques internationaux vis–à–vis du rétablissement de la situation en Allemagne. Enfin, il ne faut pas, naturellement, mésestimer les conséquences d’une éventuelle correction boursière aux Etats-Unis, qui affecterait la demande extérieure. Cependant, d’une manière symétrique, un redressement plus rapide de l’économie britannique ou des économies asiatiques apporterait un soutien supplémentaire à la reprise de l’activité. Si le cas des économies asiatiques sera examiné ci-après, votre Rapporteur général se doit de rappeler ici que l’économie du Royaume–Uni, qui n’appartient pas à la zone euro, a connu un fort ralentissement en 1998, puisque le taux de croissance est passé de 3,5% en 1997 à 2,1%. Ce ralentissement a été très marqué à la fin de l’année 1998. Il faut y voir non seulement l’effet de la crise asiatique et de la crise russe, ainsi que de la forte appréciation de la livre sterling à partir de l’année 1998, mais également la conséquence du dosage restrictif des politiques monétaire et budgétaire progressivement mis en œuvre dès le milieu de l’année 1997. L’investissement est cependant resté soutenu, tandis que la consommation privée s’est légèrement ralentie. Pour la fin de l’année 1999, l’assouplissement de la politique monétaire, progressivement opéré par la Banque d’Angleterre, qui a graduellement ramené le taux des prises de pension de 7,5% à 5%, d’octobre 1998 à mai 1999, et celui de la politique budgétaire, avec le retour à un léger déficit public pour le budget 1999/2000 après un exercice excédentaire, devraient favoriser le redémarrage de la croissance. Après la publication de plusieurs résultats favorables à la fin du mois d’août et au début du mois de septembre, notamment une progression de la consommation des ménages de 4%, l’objectif de croissance avancé par le Gouvernement britannique pour cette année, compris entre 1,5% et 2%, est jugé réalisable, malgré la stagnation constatée au début de l’année. Aussi, la Banque d’Angleterre, jugeant la reprise suffisamment ferme, a-t-elle relevé de 0,25% son taux directeur, revenu à son niveau d’avril, soit 5,25%. On observera que les dernières prévisions de l’OCDE pour le Royaume-Uni tablent sur une croissance de 0,7% en 1999 et 1,6% en 2000, estimations qui semblent maintenant quelque peu pessimistes. Celles retenues par le rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances sont plus optimistes, avec une croissance de 1,3% en 1999 et 2,4% en 2000. 4.- Une situation encore très difficile au Japon Depuis le début de la décennie, l’économie du Japon est atone, à l’exception d’un rebond en 1996 (+5,1%). Après une croissance modeste en 1997 (1,4%) le pays s’est enfoncé dans la récession en 1998, le PIB ayant diminué de 2,8%. L’ensemble de la demande s’est contractée, la consommation privée diminuant de 1,1% et la formation brute de capital fixe de 8,8%, en raison notamment d’une baisse de 13,7% pour les investissements résidentiels, avec une tendance déflationniste. Le chômage a augmenté, pour s’établir à 4,1% de la population active, et le taux d’utilisation des capacités de production s’est dégradé. Cette récession a essentiellement affecté la production industrielle, qui a chuté de 6,8%, comme le rappellent les Perspectives économiques de l’OCDE publiées en juin 1999. Cette situation est généralement expliquée par le pessimisme des agents économiques, l’ampleur des surinvestissements passés et le tarissement de l’offre de crédit par les banques dans le cadre d’une politique de sélection rigoureuse des signatures, en réaction contre les comportements passés, qui se sont traduits, après l’éclatement des bulles financières et immobilières et, ultérieurement, la crise asiatique, par un gonflement considérable des créances douteuses. Les faillites spectaculaires de trois grandes institutions financières à l’automne 1997 ont, en effet, débouché sur une crise de liquidité, un mouvement de défiance à l’égard des banques et l’apparition d’une prime de risque, le « Japan premium » pour les emprunts des opérateurs japonais sur le marché interbancaire national et international. Au chapitre des facteurs externes, il faut également mentionner qu’en raison de la récession dans les pays émergents d’Asie, les exportations ont chuté de 1,2% en 1998. C’est au cours du second semestre de 1998 que la situation a été la plus difficile : on estime que l’économie japonaise a alors « touché le fond ». Les pouvoirs publics ont mené, en réaction, des politiques budgétaire et monétaire expansionnistes. D’une part, les deux plans de relance budgétaire lancés en 1998 ont porté sur des montants considérables, à raison de 17.000 milliards de yens, soit 3,3% du PIB, pour celui d’avril, et de 24.000 milliards de yens, soit 4,7% du PIB, pour celui de novembre. On considère que les premiers effets positifs de cette politique expansionniste se sont manifestés dès l’automne 1998. Le budget pour l’exercice 1999 est lui aussi expansionniste. Selon l’OCDE, le déficit des administrations publiques se serait établi à 6% l’an dernier et pourrait dépasser 8,75% cette année. Le rapport de la dette publique au PIB est ainsi passé de 60% en 1993 à plus de 110% cette année, en raison des différents plans de relance. D’autre part, la politique monétaire a été conduite de manière à lutter contre les tendances récessionnistes. Les taux d’intérêts ont été réduits le plus possible, la Banque du Japon ayant décidé, au mois de février 1999, de porter le taux interbancaire au jour le jour au-dessous de 0,1%. Ce taux est actuellement de 0,03%. Les modalités de refinancement des banques auprès de la Banque du Japon ont également été assouplies. Enfin, pour lutter contre le rationnement du crédit, un nouveau dispositif public de stabilisation du système bancaire a été adopté au début du mois d’octobre 1998, en complément des mesures prises antérieurement. Ce plan est articulé autour de trois axes : un dispositif de traitement des banques au bord de la faillite, une recapitalisation publique des banques en fonction de leur situation financière, un renforcement des règles de supervision du secteur financier. Une enveloppe de 60.000 milliards de yens, soit l’équivalent de 12% du PIB, a été prévue, dont un peu moins de la moitié pour renforcer les fonds propres des banques. Néanmoins, malgré un rebond de l’activité au premier trimestre, avec un taux de progression du PIB de 2%, la croissance redémarre difficilement au Japon. Le deuxième trimestre a été marqué par une très faible croissance (0,2%). Celle-ci pourrait, selon le rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances, s’établir à 1% pour 1999 et l’année 2000 ne devrait pas voir de reprise significative de l’activité (+ 0,1%), notamment en raison de la fin des effets des actions de relance budgétaire. Le FMI, pour sa part, a prévu en septembre 1999 une croissance de 1% cette année et de 1,5% l’an prochain. Cependant, malgré ces divergences, on constate un consensus sur le fait que l’économie japonaise resterait déprimée dans les prochains mois. La demande privée demeure, en effet, peu dynamique, notamment les investissements, en raison de surcapacités de production importantes, l’Agence de planification économique estimant que les capacités excédentaires représentent l’équivalent d’une année entière d’investissements. Par ailleurs, la politique monétaire s’est heurtée au contexte de baisse de prix, ce qui fait que les taux réels ont gardé un niveau non négligeable. En outre, on a observé une légère tension sur les taux longs, qui sont remontés à 2%, alors qu’ils s’établissaient à 0,7% à l’automne dernier, en raison de l’inquiétude sur les conséquences à terme de l’ampleur de l’effort budgétaire. Enfin, le haut niveau du yen, à raison de 110 yens pour un dollar, nuit à la compétitivité de l’économie japonaise, qui reste cependant très fortement exportatrice. En dépit de ces difficultés, l’avenir économique du Japon s’éclaircit pour le moyen terme, l’absorption des conséquences des « bulles » spéculatives étant pour l’essentiel réalisée et les restructurations en cours devant contribuer à redynamiser non seulement le système financier, mais également l’industrie de l’archipel. 5.- Le retour inégal de la croissance dans les pays émergents La crise des pays émergents, dont le premier symptôme s’est manifesté en juillet 1997 en Thaïlande, s’est largement diffusée à l’Asie en 1997, puis à la Russie en 1998, ce qui a provoqué la chute généralisée des marchés financiers à l’automne dernier. Elle a ensuite gagné l’Amérique latine, atteignant son paroxysme lors de la crise du Brésil en janvier 1999 avec la dévaluation du real. Partout, le scénario a été le même : la défiance des opérateurs, fondée sur une révision à la baisse des anticipations de croissance des pays concernés, a provoqué un retrait massif des capitaux, et, ainsi, un effondrement des marchés financiers puis, par transmission de ces effets dépressifs de la sphère financière à la sphère réelle, une forte récession. La gestion de ces crises, notamment, l’action du FMI, ayant été efficace, on peut considérer, ainsi que l’a précisé la Note de conjoncture internationale établie par la direction de la prévision en juin dernier, que « pour une bonne part, la crise des pays émergents semble passée ». Néanmoins, ce diagnostic ne s’applique pas uniformément à l’ensemble des économies émergentes. Si les pronostics relatifs aux pays de l’Asie du Sud–Est et d’Europe centrale peuvent être assez optimistes, il convient de rester plus réservé, à des degrés divers, pour la Chine, l’Amérique du Sud et, naturellement, la Russie. En outre, il faut tenir compte de ce qu’un éventuel échec des restructurations industrielles et financières en cours pourrait remettre en cause les perspectives favorables de chacun des Etats concernés. a) La reprise de l’activité dans les pays émergents d’Asie La phase la plus aiguë de la crise asiatique a été maîtrisée avec l’aide de la communauté internationale, et notamment du FMI. Les moyens mis en œuvre ont été considérables et se sont élevés à plus de 110 milliards de dollars. Les plans de redressement ont certes été d’une architecture classique, fondés sur un durcissement des politiques budgétaire et monétaire, plus ou moins prononcé selon les pays dans un premier temps et sur une flexibilité des changes. Ils ont cependant eu le grand mérite de traiter également les faiblesses structurelles du « modèle asiatique » en prévoyant, notamment, une restructuration et une recapitalisation du système financier, un durcissement du cadre prudentiel et un renforcement des contrôles, une modernisation comptable, ainsi qu’une libéralisation de l’économie. L’effet de ces plans est très encourageant. Il a d’ailleurs conduit à restaurer la confiance des investisseurs internationaux, puisque l’on a constaté un certain retour des capitaux vers ces pays. Pour cette année, la perspective d’évolution de l’économie des pays émergents d’Asie a pu être rectifiée de manière significative par la direction de la prévision dans le cadre de la Note de conjoncture internationale de juin dernier, passant d’une récession de 0,3% à une croissance de 2% (). En Corée, l’année 1998 a été marquée par une forte récession : le recul du PIB a été de 5,8%, en raison de la raréfaction du crédit et de la contraction de 19% de la demande intérieure, avec un vaste mouvement de déstockage. Pour 1999, les perspectives de croissance s’établissent à 4,8% selon la Note de conjoncture internationale de la direction de la prévision () et 4,5% d’après l’OCDE, l’économie connaissant en effet une reprise pour des raisons en partie techniques, par le seul effet d’un ralentissement du déstockage, alors même que la consommation reste stable. Pour 2000, l’OCDE prévoit une croissance de l’ordre de 4,3%. Il est difficile de se prononcer avec sûreté sur la valeur de cette estimation, tant l’importance de la reprise de l’économie coréenne dépendra de la consommation et de l’investissement privés, de la restructuration du système bancaire et de l’absorption des créances douteuses. La situation de la Corée apparaît très vulnérable, car elle dépend aussi de la manière dont la restructuration des conglomérats (les « chaebols ») pourra être menée à terme. Le principal dossier est celui de Daewoo, dont la dette représente quelque 50 milliards de dollars et qui ne semblait pas encore réglé à la mi–septembre. Le schéma est sensiblement le même pour l’ensemble des économies émergentes du Sud-Est asiatique, mais avec un rythme variable. La croissance devrait ainsi reprendre de manière assez forte à Singapour et aux Philippines. Les perspectives sont relativement encourageantes pour la Malaisie. Toute hypothèse de reprise paraît, en revanche, éloignée en Indonésie. L’évolution des différents pays d’Asie du Sud–Est dépend en outre d’un facteur externe : la situation en Chine, et une éventuelle dévaluation de la monnaie de Chine continentale, le renmimbi, et du dollar de Hong Kong. b) L’évolution incertaine des économies chinoises : Chine continentale et Hong Kong La situation de la République populaire de Chine apparaît contrastée : la croissance, qui s’est fortement ralentie, est soutenue par l’investissement public en Chine continentale ; Hong Kong est en récession. L’économie de la Chine continentale est soutenue par l’investissement public, ainsi que par une politique monétaire souple. Ce dosage a assuré le redressement de la croissance en 1998, (+7,8%), alors que celle-ci avait fléchi à 7% en 1997. On rappellera que les taux antérieurs étaient de l’ordre de 9% à 10%. Pour 1999, la dépense publique constitue encore le moteur essentiel de la croissance. La consommation est atone, dans un contexte où les restructurations de l’appareil productif engendrent un chômage important et où certaines réformes sociales favorisent la constitution d’une abondante épargne de précaution. Le développement des exportations est handicapé par les pertes de compétitivité intervenues à la suite des réajustements monétaires opérés, pendant la crise asiatique, dans les pays voisins. L’investissement n’est guère dynamique compte tenu de l’ampleur des surcapacités actuelles. Les investissements étrangers sont en net recul. Les effets directs du programme de relance budgétaire devant cesser en 2000, la croissance sera alors plus dépendante d’une reprise de la consommation privée et de l’investissement, ce qui montre l’ampleur de l’incertitude actuelle sur l’avenir de l’économie chinoise. A Hong Kong, la récession a été marquée en 1998, avec une réduction du PIB de 5,1%, alors que la croissance avait été de 6,7% en 1997. Les économistes anticipent pour cette année une prolongation de la récession, avec une évolution négative du PIB de 1%. Si le secteur financier demeure solide, les perspectives de reprise sont très aléatoires compte tenu de l’incertitude pesant sur la situation économique de la Chine continentale, ainsi que de l’absence de contrôle des autorités sur les taux d’intérêt (le dollar de Hong Kong est en effet ancré au dollar américain dans le cadre d’un système de caisse d’émission) et de la perte de compétitivité liée à la dépréciation des monnaies des pays voisins. Ce dernier élément est pénalisant dans un contexte où la baisse des prix provoque, d’une manière mécanique, une progression des taux d’intérêt réels. Une éventuelle dévaluation des monnaies chinoises, le renmimbi et le dollar de Hong Kong, représente un facteur d’incertitude pour la croissance des économies des pays émergents voisins. Cependant, selon la simulation présentée par l’OCDE dans le cadre des Perspectives économiques de juin 1999, un réajustement de 20% des deux monnaies aurait une incidence faible ou modérée sur la croissance des économies de la zone OCDE, même dans l’hypothèse où il serait accompagné de dévaluations de 10% dans les autres économies dynamiques d’Asie et en Corée, ce qui tempère l’opinion selon laquelle l’affaiblissement de l’économie chinoise devrait être considéré comme un risque majeur pour l’économie mondiale. c) Des possibilités de reprise dès 2000 en Amérique latine En 1998, la crise des pays émergents a gagné l’Amérique latine, et la croissance s’est fortement ralentie, passant de 5,4% en 1997 à seulement 2,3%, en moyenne. Pour 1999, la zone devrait connaître une récession, de l’ordre de – 1,3% selon le rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances. Il faut d’abord y voir les conséquences de la crise financière qui a affecté le Brésil au mois de janvier, avec une dépréciation de 30% du real entre la mi–janvier et la mi–mars, ce qui a aggravé la récession déjà latente depuis l’été 1998. On observera que cette crise est intervenue malgré l’intervention d’un plan préventif, sous l’égide du FMI, d’un montant de 41,5 milliards de dollars en novembre 1998. L’OCDE a ainsi prévu une récession de 3% cette année. Cette situation a beaucoup affecté l’Argentine, principal partenaire commercial du Brésil, qui devrait subir une récession de 3% cette année après une croissance de 4,2% en 1998 et 8,6% en 1997. Cette conjoncture alimente d’ailleurs la réflexion sur une éventuelle « dollarisation » de l’économie du pays, dans le cadre d’un traité spécifique. Une reprise pourrait cependant intervenir dès 2000, avec un retour à la croissance au Brésil (+2%) et en Argentine (+2,5%). Le rapport économique, social et financier précité anticipe une croissance de 2,2% pour l’ensemble du continent. d) Les difficultés de l’économie russe L’économie russe a connu une forte contraction en 1998, de 4,6% selon l’OCDE, la crise financière du mois d’août s’étant accompagnée d’une paralysie presque totale du système des paiements. Pour 1999 comme pour 2000, les perspectives restent incertaines même si la production donne quelques signes de reprise. L’OCDE envisage une réduction du PIB de 1% cette année et une reprise de la croissance avec 2% l’an prochain. Moins optimiste, le FMI anticipe une récession de l’ordre de 2% cette année et n’a pas fait de prévision pour l’an prochain. On ne peut qu’être prudent tant la situation du pays demeure incertaine. Si l’inflation s’est ralentie, après la phase d’hyperinflation qui a accompagné la crise financière de l’année dernière, la Russie ne semble pas s’orienter vers les réformes structurelles qui seraient nécessaires pour qu’une croissance robuste puisse être attendue, au premier rang desquelles figure la capacité de l’Etat fédéral à percevoir les impôts, à équilibrer le budget, à contenir l’augmentation de la dette extérieure, en grande partie libellée en devises, et à assurer à l’initiative économique la sécurité permettant à des véritables entrepreneurs d’exercer leurs talents. * * * Tandis que l’investissement international paraît s’éclaircir, sous réserve de l’incertitude majeure affectant l’évolution de l’économie des Etats-Unis d’Amérique, l’Europe qui, avec la mise en place de l’euro, se réapproprie son destin, assure un dosage équilibré, favorable à la croissance, des politiques budgétaire et monétaire. B.- UN DOSAGE ÉQUILIBRÉ DES POLITIQUES BUDGÉTAIRE ET MONÉTAIRE Avec l’avènement de l’euro, l’Europe – à onze pour l’instant – redécouvre les moyens d’une autonomie et d’une maîtrise de son évolution économique qu’elle avait largement perdues. Les progrès en matière de déficits publics, qui n’étaient pas acquis d’avance il y a seulement deux ans, sont réalisés le plus souvent dans le cadre de la mise en œuvre de politiques budgétaires évitant tout traumatisme ; ces progrès, de même que les succès obtenus dans la lutte contre l’inflation doivent écarter, au moins dans l’immédiat, la perspective d’un « tour de vis » monétaire. 1.- Une poursuite de l’assainissement financier qui ne doit pas contrarier la croissance a) Une réduction des déficits publics plus progressive… Depuis le milieu des années 1990, les Etats membres de l’Union européenne ont considérablement accentué leurs politiques d’assainissement budgétaire, principalement dans la perspective de la réalisation de la monnaie unique. Après avoir culminé à 6,1% du PIB en 1993, le besoin de financement moyen au sein de l’Union a été réduit de 4,1% à 2,3% du PIB entre 1996 et 1997, les efforts ayant été particulièrement marqués à ce moment, puis à 1,5% en 1998.
Selon la Commission européenne, alors que jusqu’en 1996-1997, l’assainissement résultait avant tout de mesures structurelles, l’essentiel des progrès enregistrés l’an dernier est imputable à une croissance plus forte que prévu et à la baisse des paiements d’intérêts liés à la dette publique. Par ailleurs, on peut constater que, par rapport à l’ensemble de l’Union, le déficit moyen des pays de la zone euro est plus important (2,1% du PIB en 1998) et qu’il a diminué plus lentement l’année dernière. La Banque centrale européenne (BCE) effectue la même analyse des évolutions en notant qu’ « en 1998, seule une croissance économique vigoureuse – qui s’est traduite par un taux de croissance du PIB réel significativement supérieur au taux de croissance tendanciel – a contribué à une baisse supplémentaire du déficit, tandis que la composante structurelle du ratio de déficit marquait même une légère dégradation » (). En ce qui concerne les prévisions pour 1999, la Commission européenne relève une croissance plus lente et des efforts d’ajustement budgétaire relativement modestes, qui devraient se solder, au niveau de l’Union, par le maintien du déficit moyen à 1,5% du PIB (). Les données présentées pour 2000, selon le scénario dit des « politiques inchangées », permettent d’escompter une contraction du déficit moyen, aussi bien dans l’Union européenne (à 1,3% du PIB) que dans la zone euro (à 1,7% du PIB contre 1,9% en 1999). Le solde budgétaire devrait rester excédentaire dans cinq Etats membres (Danemark, Irlande, Luxembourg, Finlande, Suède) et proche de zéro au Royaume-Uni. La BCE estime, pour sa part, que le ratio d’excédent primaire devrait se stabiliser ou s’améliorer de façon marginale en 1999 et en l’an 2000, après s’être légèrement dégradé en 1998.
On remarquera que le rythme d’assainissement prévu pour la France en 1999 et en 2000 est nettement plus rapide que la moyenne communautaire ou de la zone euro, même si le déficit public français reste à un niveau moyen relativement plus élevé. Ainsi, en 1999, les déficits publics devraient être légèrement inférieurs aux 2,3% initialement prévus par la loi de finances et s’établir, en définitive, à 2,2% . En 2000, ils seraient de 1,8%, traduisant la régularité de l’effort de réduction engagé depuis 1997. Le ratio dette publique/PIB au sein de l’Union européenne, qui a culminé à 72,8% du PIB en 1996, devrait continuer à décliner régulièrement pour s’établir à 67% en 2000. En 1998, sept Etats membres, dont la France, présentaient un ratio de dette inférieur à la valeur de référence de 60% du PIB. L’évolution de la dette publique française présente néanmoins certaines particularités. Si elle a toujours été contenue en-dessous des 60% du PIB, sa croissance n’en a pas moins été importante ces dernières années () . De 1994 à 1997, elle est, en effet, passée de 48,6% à 58,1% du PIB. Cette très forte progression est désormais nettement ralentie, avec un niveau estimé à 58,5% en 1998. Le niveau de la dette devrait atteindre un point haut en 1999, même s’il résulte d’une croissance de l’endettement beaucoup plus faible qu’auparavant (+0,8 point de PIB contre +4,2 points de PIB en 1995, par exemple), puis décroître légèrement en 2000, traduisant le retour à la maîtrise de la dette publique, après les dérapages préoccupants observés précédemment.
b) …afin de ne pas remettre en question la reprise économique Aussi bien la Commission européenne que la BCE déplorent les évolutions récentes en matière de déficits publics, qu’elles considèrent comme un ralentissement non souhaitable de l’assainissement budgétaire. Pourtant, si la réduction des déficits et de l’endettement publics sont évidemment nécessaires, afin de restaurer les marges de manœuvre nécessaires en cas de retournement de la conjoncture, il importe aussi de ne pas considérer la réduction des déficits publics comme le seul but de la politique budgétaire. Cet objectif – aussi important soit-il – ne saurait être poursuivi sans prendre en considération la conjoncture économique. Rien ne serait plus contre-productif, au bout du compte, qu’une politique à marche forcée, risquant de remettre en question la reprise, et, par là même, la croissance de l’emploi. Le programme français pluriannuel de finances publiques à l’horizon 2002, notifié à la Commission européenne début janvier 1999, répond donc à un double impératif : assainir les finances publiques sans pour autant brider la croissance économique ni renoncer au financement des priorités politiques. Ce programme constitue, en quelque sorte, le cadre pluriannuel dans lequel s’inscrit le présent projet de loi de finances. Le tableau ci-après rappelle l’ensemble des hypothèses et prévisions de cette programmation.
En matière de croissance, deux hypothèses ont été retenues. La première est la plus favorable, avec une progression du PIB de 3% par an de 2000 à 2002. La seconde se fonde sur une croissance de 2,5% par an en moyenne, du fait du déficit d’activité accumulé précédemment. Ainsi, la croissance cumulée des dépenses de l’Etat s’établirait à 1% en volume sur la période considérée. L’effet de la baisse des taux d’intérêt et la stabilisation, puis la décrue, du ratio dette/PIB permettront d’enregistrer des économies substantielles sur la charge de la dette. Répondant aux objectifs fixés dès juin 1997, ce cadre permet la mise en place et la montée en charge des grands chantiers de la législature que sont les emplois jeunes, la lutte contre les exclusions et la réduction du temps de travail. L’exécution de ce plan suppose que soit maîtrisée l’évolution des dépenses de sécurité sociale, et tout particulièrement des dépenses d’assurance maladie, afin de dégager des marges de manœuvre suffisantes en vue de faire face aux conséquences du choc démographique des années 2005-2010 sur les régimes de retraite. Enfin, selon les projections du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, les administrations publiques locales devraient conserver une capacité de financement comprise entre 0,2 et 0,3 point de PIB entre 1999 et 2002. S’agissant des déficits publics, l’objectif affiché est de passer des 2,3% du PIB prévus pour 1999 à un niveau compris entre 1,2% (hypothèse prudente) et 0,8% du PIB (hypothèse favorable) en 2002. Cette réduction progressive bien en deçà du niveau maximum de déficits publics autorisés (3%) est indispensable pour disposer des marges de manœuvre nécessaires en cas de dégradation de la conjoncture. Enfin, la dette publique devrait être ramenée à 57,6% ou 55,6% () du PIB, selon les hypothèses retenues, soit un niveau inférieur au ratio de 60% dette publique/PIB prévu par le traité de Maastricht. On rappellera que, si ces dernières années, ce ratio a toujours été respecté, il n’en reste pas moins que la dette a progressé de façon significative de 1993 à 1997. Les objectifs du programme pluriannuel marquent donc une véritable rupture. Cette politique budgétaire nationale ne peut cependant obtenir tous ces effets que dans la mesure où la politique monétaire, désormais définie par la BCE, maintienne la nécessaire souplesse que la faiblesse de l’inflation rend possible. 2.- Des perspectives d’inflation modérées qui laissent espérer la poursuite d’une politique monétaire accommodante a) Une inflation historiquement basse · Amorcé depuis déjà de nombreuses années, le processus de désinflation en Europe a connu une nouvelle étape en 1998. Comme l’indique le tableau ci-dessous, l’inflation au sein de l’Union européenne, mesurée par le déflateur de la consommation privée, est passée de 2,1% en 1997 à 1,5% en 1998.
La baisse des prix des biens importés a été particulièrement importante (- 2,1%) et a tiré l’inflation davantage vers le bas que ce qui avait été initialement prévu. Cette évolution explique d’ailleurs l’ampleur de l’écart observé entre les prix à la consommation et le déflateur du PIB, ce dernier n’incorporant pas les importations. La faiblesse de l’inflation a été très marquée sur la fin de 1998 et le début de 1999. En janvier 1999, le glissement annuel des prix à la consommation au sein de l’Union européenne était tombé à 0,9%, voire au-dessous de 0,5% dans plusieurs Etats membres. Ces évolutions avaient engendré débats et inquiétudes sur la possibilité d’une entrée dans une phase déflationniste. Toutefois, les très faibles niveaux d’inflation alors observés étaient directement liés à la faiblesse des prix des biens importés, cette dernière résultant à la fois de la crise asiatique et du niveau très bas des prix des matières premières et de l’énergie. Au sein de l’Union, l’inflation sous-jacente (c’est-à-dire sans tenir compte des produits à prix volatils et des tarifs publics) a été estimée à environ 1,2% en 1998. Parmi les Etats membres, la France a enregistré l’un des résultats les plus performants. La hausse moyenne des prix à la consommation, hors tabac, s’est établie à 0,6% (1% hors énergie). La fin de l’année 1998 a constitué un point bas, avec un indice des prix hors tabac en glissement annuel ne s’élevant qu’à 0,3%. Le rapport sur les comptes de la Nation de l’année 1998 note ainsi qu’il faut remonter 45 ans en arrière pour retrouver une hausse plus faible entre deux mois de décembre. Cette faible inflation s’inscrit dans un mouvement de long terme, puisque depuis trois ans, les prix sont restés en deçà d’un rythme annuel de 2%. Toutefois, l’inflation sous-jacente reste globalement stable avec + 0,7% en 1997 et + 0,8% en 1998. Ainsi, le ralentissement observé s’explique principalement par des facteurs externes, la baisse du dollar s’ajoutant à la chute des prix des matières premières consécutive à la faiblesse de la croissance mondiale. S’agissant des prix des produits intermédiaires, leur baisse s’explique par une accentuation de la concurrence internationale. · Pour 1999, les prévisions font apparaître une poursuite du mouvement de désinflation. La Commission européenne estime, dans ses prévisions économiques du printemps dernier, que l’inflation devrait s’acheminer vers le niveau historiquement bas de 1,3%. En ce qui concerne 2000, la prévision a été rectifiée à la baisse par rapport aux prévisions d’automne 1998, avec un niveau ramené à 1,6% au lieu de 1,8%. Ces chiffres illustrent la convergence des mouvements affectant les prix dans l’Union. Par delà les mouvements plus ou moins erratiques pouvant affecter les prix pétroliers, ce haut degré de stabilité des prix semble destiné à perdurer, sous l’effet de plusieurs facteurs. Ainsi, après avoir fortement contribué à la désinflation, les augmentations nominales de salaires dans la zone euro devraient rester contenues aux alentours de 3% en 1999 et 2000. Le chômage, malgré sa diminution progressive, reste, en effet, élevé et il existe encore une marge importante avant que sa réduction ne provoque des tensions sur les coûts salariaux unitaires et sur les prix. De plus, les réserves de productivité que recèlent les nouvelles technologies ne laissent guère entrevoir, dans un avenir proche, de possibilités d’inflation salariale. Le régime actuel d’inflation se caractérise par ailleurs, notamment, par la baisse des prix relatifs de l’industrie. Le décrochage des prix industriels par rapport à l’indice général des prix est net dans la zone euro depuis la fin de 1997. Un certain nombre de facteurs structurels, tels que la concurrence aiguë au niveau mondial et l’accentuation de cette concurrence au sein de la zone euro du fait de la monnaie unique, laissent entrevoir une persistance de ce mouvement. Soumise à ces facteurs, la France constitue l’un des pays de la zone euro ayant le plus faible taux d’inflation observé et attendu. En effet, si le glissement annuel de l’ensemble des prix à la consommation s’est légèrement accru dans la première moitié de l’année 1999, leur niveau reste faible. Ainsi, en glissement annuel, la progression de l’indice des prix hors tabac a été de 0,3% en juillet et d’un rythme identique pour l’ensemble des prix à la consommation hors énergie. Sur les trois derniers mois précédant juillet, ces prix ont même respectivement baissé de 0,3 et 0,4%. Selon l’INSEE, l’inflation sous-jacente reste stable, autour de 0,8%. Au second semestre, l’accroissement des prix de l’énergie devrait ramener le glissement annuel d’ensemble au niveau de cette inflation sous-jacente. La hausse des prix de l’énergie est, en effet, tirée par les cours du pétrole, qui, comme on l’a vu ci-avant, ont fortement progressé. Au second semestre, les effets différés de l’augmentation des cours du pétrole se traduiraient par une poursuite de l’augmentation du prix des produits pétroliers, dont le glissement annuel s’établirait à 5,2% en fin d’année. Ainsi, le glissement annuel des prix de l’ensemble de l’énergie s’établirait à + 0,7% en décembre, alors qu’il était de – 1,7% en mai. Dans l’ensemble, aussi bien au sein de la zone euro qu’en France, un consensus se manifeste, concluant à une poursuite de la désinflation. Ces évolutions passées et anticipées sont bien entendu déterminantes pour les fluctuations des taux d’intérêt. b) Une évolution jusqu’à présent favorable du niveau des taux d’intérêt En 1998, les marchés financiers avaient été fortement influencés par les turbulences en provenance d’Asie, de Russie et d’Amérique latine. L’année 1999 s’est engagée sous des auspices plus favorables, qui ont permis à la détente des taux d’intérêt de se poursuivre en Europe, et plus particulièrement au sein de la zone euro. · S’agissant des taux d’intérêt à court terme au sein de la zone euro, leur convergence aux alentours de 3% en décembre 1998 a représenté une diminution substantielle par rapport aux niveaux observés un an plus tôt. Lors de sa prise de fonction début janvier dernier, la BCE a décidé de fixer à 3% le taux applicable à ses opérations de refinancement, ce qui conduit à des taux de marché monétaire à trois mois d’un montant équivalent. Hors de la zone euro, les taux courts ont également baissé en Europe, même si ceux du Royaume-Uni se sont maintenus à un niveau sensiblement supérieur à celui de la zone euro. Enfin, la Réserve fédérale a procédé à trois baisses successives de 25 points de base à chaque fois, ramenant un peu au-dessous de 5% le niveau des taux à trois mois. Dans la zone euro, les taux d’intérêt à long terme ont suivi le même mouvement de baisse, les rendements des obligations d’Etat à dix ans atteignant des points bas historiques proches de 3,75% début 1999. Parmi les facteurs expliquant cette évolution, l’un est d’origine externe. La crise financière en Asie a, en effet, déclenché un phénomène de « fuite vers la qualité » qui a profité aux marchés européens. Un facteur institutionnel a également joué un rôle non négligeable : la perspective de réalisation de l’euro a progressivement éliminé les primes de risque liées à l’incertitude sur les taux de change. Enfin, l’assainissement budgétaire et la stabilité avérée des prix ont nettement réduit les anticipations inflationnistes. Ce mouvement à la baisse des taux longs a pu être observé en 1998 dans l’ensemble des économies européennes, mais aussi aux Etats-Unis et au Japon. Toutefois, depuis le début de 1999, un certain découplage des situations entre ces trois zones économiques et monétaires est à l’œuvre. · Au sein de la zone euro, le mouvement de diminution des taux courts s’est poursuivi en 1999. En effet, le 8 avril dernier, la BCE a procédé à une réduction de ses trois taux directeurs. Le taux des principales opérations de refinancement a été ramené de 3% à 2,5%, celui du prêt marginal de 4,5% à 3,5% et, enfin, le taux de facilité de dépôts a été diminué de 0,5 point, passant ainsi à 2,5%. L’ampleur de cette souplesse monétaire, peu anticipée, a permis une détente des rendements courts. La BCE a ainsi souhaité éviter tout retournement de la croissance en Europe, craignant qu’un choc extérieur ne débouche sur une chute des investissements et de la confiance des agents économiques. Cette décision a contribué efficacement à soutenir l'activité et à conforter les anticipations de « sortie du trou d’air ». Inversement, la détente des taux à long terme s’est interrompue, principalement en raison de la moindre importance des facteurs externes, tels que les crises asiatique et brésilienne. La remontée des taux longs est cependant restée limitée en Europe au premier semestre. Ainsi, le taux à dix ans a progressé de 0,2 point de décembre 1998 à mai dernier. Cette relative stabilité contraste nettement avec les évolutions constatées aux Etats-Unis, où le taux à dix ans a progressé de près d’un point au premier semestre de 1999. Les marchés ont, en effet, anticipé un resserrement de la politique monétaire causé par une possible résurgence de l’inflation. De fait, une première hausse d’un quart de point des taux par la Réserve fédérale est intervenue fin juin. Fin août, celle-ci a, pour la seconde fois, décidé de relever d’encore un quart de point son taux interbancaire (porté à 5,25%), mais aussi le taux d’escompte, qui est passé de 4,5% à 4,75%, alors qu’il était resté inchangé depuis le 17 novembre 1998. Cette politique résulte des inquiétudes vis-à-vis d’une surchauffe éventuelle de l’économie américaine, entraînant une reprise de l’inflation. Les tensions sur le marché du travail et la possibilité d’une inflation par le biais de la hausse des actifs financiers ont été mises en avant pour justifier le relèvement des taux décidé fin août 1999. Alors qu’un troisième resserrement monétaire était anticipé début septembre, la croissance, moins élevée que prévu, des créations d’emploi semble éloigner (temporairement ?) la perspective d’une nouvelle hausse des taux. Dans ses perspectives économiques pour 1999-2000, présentées en mars dernier, REXECODE retenait un ralentissement spontané et progressif de l’activité aux Etats-Unis permettant de réamorcer une baisse des taux longs et évitant une correction forte de Wall Street. L’institut précisait cependant qu’ « un autre scénario est à peine moins probable ». On ne saurait mieux souligner combien l’évolution future de la politique monétaire américaine reste incertaine. Cela est d’autant plus préoccupant que les évolutions susceptibles d’intervenir outre-Atlantique pourraient influencer les décisions de politique monétaire en Europe. Certes, malgré les tensions sur les taux américains, la BCE a annoncé le 26 août dernier qu’elle maintenait inchangés ses taux d’intérêt. Le taux de refinancement est donc resté fixé à 2,5%, soit le même niveau depuis la baisse d’avril. Le 9 septembre dernier, ce statu quo s’est prolongé, M. Wim Duisenberg déclarant qu’une tendance a un resserrement « se fait jour et continue de se faire jour à une vitesse d’escargot ». Si rien n’est donc exclu, il convient de souligner que les taux d’inflation restent particulièrement bas au sein de la zone euro et que la reprise actuelle nécessite d’être soutenue par une politique monétaire ne faisant pas de toute perspective d’inflation, aussi ténue soit-elle, un prétexte à une hausse des taux, préjudiciable en définitive à la croissance et à l’emploi. Lors de sa réunion du 7 octobre dernier, la BCE a maintenu le statu quo en matière de taux, afin de préserver la reprise de la croissance, tout en annonçant un possible resserrement monétaire dans les prochains moins si des tensions inflationnistes venaient à se manifester. On rappellera à cet égard qu’outre ces effets positifs sur les possibilités d’investissement, la détente des taux d’intérêts explique pour partie l’évolution des taux de change depuis le lancement de l’euro. En effet, alors que l’euro s’échangeait aux alentours de 1,17 dollar en janvier 1999, la monnaie européenne s’est affaiblie tout au long de l’exercice. Après avoir atteint un point bas aux alentours de 1,03 dollar en juin et en juillet dernier, elle a amorcé une remontée à des niveaux compris entre 1,05 et 1,1 dollar, mais marquée par une grande volatilité. Cette évolution de la parité de l’euro est liée à plusieurs facteurs : l’écart important et persistant de conjoncture entre les Etats-Unis et l’Europe, celui entre les taux d’intérêts à long terme favorisant le dollar et l’effet des incertitudes liées à la guerre du Kosovo. Selon la Banque centrale européenne, début juin 1999, le taux de change effectif nominal s’établissait à environ 8% en dessous de son niveau au moment de l’introduction de l’euro. La compétitivité des produits et services européens sur le marché mondial a donc été confortée, ce qui plaide, une fois encore, pour le maintien d’une politique monétaire prenant en compte les véritables besoins de la zone euro. C.- LES BUDGETS ÉCONOMIQUES POUR 2000 La Conférence économique annuelle s’est réunie le lundi 11 octobre 1999, afin d’examiner les budgets économiques pour 2000. Cette séance a été précédée, selon l’usage, par la réunion d’un « groupe technique » destinée à confronter les prévisions du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie à celles des principaux instituts de conjoncture et d’importantes institutions financières. En septembre 1998, lors de la précédente édition de cet exercice annuel, l’opinion des économistes était assombrie par la crise russe (août 1998) et la « génération spontanée » de scénarios plus ou moins pessimistes qui envisageaient l’apparition d’une nouvelle crise en Asie et sa diffusion à l’économie mondiale par le biais d’une récession passagère, d’une dépression durable ou d’un effondrement dévastateur. En septembre 1999, l’heure est plutôt à l’optimisme. L’économie mondiale a fait la preuve de sa résistance à la grave crise financière du second semestre de 1997. Les pays industriels n’ont été affectés que de façon passagère, à l’hiver 1998 et au printemps 1999, par les répercussions de la crise en Asie. Enfin, si l’avènement de la monnaie unique européenne a été légèrement terni par une dépréciation continue de l’euro au cours du premier semestre de 1999, celle-ci tient avant tout au différentiel de conjoncture entre l’Europe et les États-Unis – phénomène éminemment passager – et non à une quelconque faiblesse structurelle de l’euro. Ce sont donc des échanges assez dépassionnés qui ont animé la réunion du groupe technique : les lignes de force de l’année 2000 ne suscitent pas grand débat, même si des appréciations divergentes peuvent parfois distinguer, sur des points particuliers, des analyses globalement similaires. 1.- Un scénario international « peint de couleurs plus vives » Qualifié de « gris et constrasté » par la direction de la prévision lors de l’exercice conduit en septembre 1998, le scénario international apparaît en septembre 1999 « peint de couleurs plus vives ». La prévision de croissance de l’économie mondiale en 1999, qui s’établissait à 2% au début de l’année, a été révisée en hausse à 2,5%, sous l’effet du dynamisme persistant de l’économie américaine, du rebond observé au Japon et de la confirmation d’une sortie de crise accélérée dans certains pays d’Asie. De même, la prévision de croissance relative à l’année 2000 a été relevée de 2,5% à 3%, ce mouvement traduisant essentiellement, pour la direction de la prévision, le retour de la demande mondiale sur sa trajectoire de long terme. Cependant, plusieurs points d’interrogation subsistent, qui touchent à l’évolution future des économies américaine et japonaise et – question plus nouvelle – au comportement des prix pétroliers. a) Remous sur le brent : le retour de la question pétrolière ? Le scénario macro-économique de la direction de la prévision table sur un prix du pétrole de 16,5 dollars par baril en 1999 et de 18 dollars par baril en 2000. Ces prévisions sont confirmées par les analyses des instituts de conjoncture et des institutions financières : le décalage observable entre les prévisions du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et les valeurs moyennes calculées sur l’ensemble du panel (19,5 dollars par baril en 1999 et 20,3 dollars par baril en 2000) sont, en fait, imputables au Crédit Lyonnais, au Crédit agricole, au Centre de prévision de L’Expansion et à l’Association française des économistes d’entreprise (AFEDE), qui expriment leur prévision en termes de prix constatés en fin d’année et non en termes de prix moyens sur l’année. En effet, l’année 1999 a vu une remontée significative des prix du pétrole. « Nous nous sommes tous trompés » reconnaissait M. P. Chalmin, représentant la Société française d’assurance et de crédit (SFAC) mais surtout spécialiste des marchés de matières premières. Le prix du pétrole s’établissait à environ 10 dollars par baril au début de 1999, niveau jugé déprécié par la quasi-totalité des analystes. En conséquence, les prévisions de prix tablaient sur un niveau de 15 dollars par baril environ en fin d’année. Or le prix du baril atteint près de 24 dollars par baril à la fin du mois de septembre 1999. « On a sous-estimé la capacité de l’OPEP à diminuer sa production et ses exportations » estime M. P. Chalmin. Les réductions de quotas annoncées ont été respectées à près de 90%, ce qui a entraîné une diminution de l’offre de près de 3,5 millions de barils par jour. Parallèlement, la reprise mondiale a suscité une augmentation de la demande de pétrole de plus de 2% au premier semestre de 1999, soit une demande supplémentaire de 2 millions de barils par jour. Or, rappelle M. P. Chalmin, « ces mouvements d’offre et demande concernent un marché de matières premières ; ces marchés sont toujours très instables ». Cependant, les niveaux actuels ne paraissent pas, de l’avis général, pouvoir être soutenus pendant de longs mois. Le Bureau d’informations et de prévisions économiques (BIPE) a présenté les prix prévisionnels les moins élevés : 14,9 dollars par baril en 1999 et 16,3 dollars par baril en 2000. « Ces prévisions reposent sur l’évaluation de prix d’équilibre à long terme », précise le BIPE, qui situe ce prix dans une large fourchette allant de 15 à 20 dollars par baril. L’analyse en termes de prix d’équilibre est partagée par la SFAC, qui place celui-ci à l’intérieur d’une fourchette de 15 à 18 dollars par baril. Pour autant, les déterminants à court terme du prix du pétrole ne permettent pas, pour la SFAC, d’envisager un retour au prix d’équilibre dès l’année 2000. En effet, le succès de la politique de réduction de l’offre décidée par l’OPEP renforce la crédibilité de ce cartel et sa capacité à encadrer mieux que par le passé ses membres les plus indisciplinés. Par ailleurs, un assouplissement de la politique des quotas est peu probable à l’horizon de la prochaine réunion des ministres de l’OPEP, programmée pour le 22 mars 2000. L’une des clefs d’un éventuel assouplissement réside aux États-Unis, qui entreront en année électorale en 2000. Or les États pétroliers américains, notamment le Texas, ont un poids électoral important et s’accommodent fort bien d’un prix du pétrole soutenu. La SFAC estime, en conséquence, que le prix du baril devrait rester aux environs de 25 dollars par baril jusqu’à la réunion du 22 mars 2000 au moins, puis décliner par la suite, mais modérément. Le prix en fin d’année pourrait s’établir, dans ces conditions à 20 dollars par baril. Le Crédit agricole, pour sa part, avance une hypothèse très différente : il voit le prix du pétrole s’établir à 30 dollars par baril à la fin de l’année 2000, après s’être situé sur une tendance haussière tout au long de l’année. Cette évaluation singulière se fonde sur les perspectives de croissance de l’économie mondiale en 2000, qui devraient susciter des tensions sur le marché du pétrole par le biais d’un accroissement significatif de la demande. En effet, selon les termes employés par M. G. Maarek, la conjoncture se caractérisera, en 2000, par la « mise en résonance des trois grandes zones d’activité de l’économie mondiale – les États-Unis, l’Europe et l’Asie – pour la première fois depuis 1990 ». Cette argumentation n’est, en définitive, pas partagée par la majorité des participants au groupe technique. On observera que le Crédit agricole est également l’auteur de la prévision de loin la plus optimiste pour la croissance japonaise en 2000. b) Le pays du Soleil levant, point obscur des prévisions La majeure partie des analystes ne croit pas à la reprise de l’économie japonaise. Tous s’accordent à penser que les performances remarquables mesurées au premier trimestre de 1999 ne sont qu’un feu de paille, d’ailleurs ramené à de plus justes proportions au vu des premiers résultats relatifs au second semestre de 1999. D’aucuns s’interrogent même sur la fiabilité des statistiques publiées au Japon. · En tout état de cause, l’ampleur des incertitudes relatives à la situation économique japonaise transparaît au vu de la dispersion des chiffres relatifs aux taux de croissance pour les années 1999 et 2000 fournis par les participants au panel. Déjà, l’opinion « moyenne » du panel s’écarte sensiblement des prévisions du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie : le panel envisage un taux de croissance de 0,75% en 1999 et 0,55% en 2000 ; la direction de la prévision évalue à 1% et 0,1% les taux de croissance pour ces mêmes années. Pour le premier, l’économie japonaise ralentit, mais modérément ; pour le second, le freinage est plus marqué. Les divergences d’appréciation s’accroissent lorsque les participants au panel sont répartis entre les « instituts de conjoncture », qui tablent sur une quasi-stabilité entre 1999 (un peu plus de 0,6% de croissance pour le PIB) et 2000 (un peu moins de 0,6% de croissance), et les « institutions financières » : plus optimistes sur 1999 (croissance de 0,9%), elles sont plus pessimistes sur 2000, avec un taux de croissance ramené à 0,5%. Mais la répartition des membres du panel en deux catégories est encore trop globalisante. Qu’y a-t-il de commun, en effet, entre l’analyse effectuée par le Service des études et recherches de la Caisse des dépôts et consignations – qui prévoit une évolution de + 0,6% en 1999 et – 0,8% en 2000 – et celle du Centre d’observation économique de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris – qui voit au contraire une accélération de la croissance entre 1999 (+ 1%) et 2000 (+ 1,4%) ? Le BIPE, pour sa part, présente un schéma encore différent : à une récession en 1999 (– 1%) succéderait une croissance « molle » en 2000 (+1%). Les mêmes divergences apparaissent entre les banques et institutions financières. La BNP, le Crédit Lyonnais ou encore Paribas prévoient une stabilisation de la croissance : 1% en 1999 et 2000 pour la première, 0,8% en 1999 et 2000 pour la deuxième, 0,6% en 1999 et 0,8% en 2000 pour la troisème. En revanche, la Société générale et JP Morgan envisagent un ralentissement sévère (de 0,9% en 1999 à 0,2% en 2000 pour la première, de 1,3% en 1999 à 0,4% en 2000 pour la seconde). Enfin, Morgan Stanley et le Crédit agricole s’opposent radicalement : la banque française prévoit une accélération sensible de 1% en 1999 à 1,5% en 2000 ; l’institution américaine prévoit une lourde rechute, le taux d’évolution du PIB passant de + 0,6% en 1999 à – 1,2% en 2000. Cette dispersion des évaluations recouvre, en fait, une dispersion équivalente sur les trois questions principales relatives à l’économie japonaise : l’impact des réformes structurelles, les causes et conséquences de la récente hausse du yen, la possibilité d’enclencher enfin un processus de croissance auto-entretenu. · Nul ne doute que le Japon s’est, enfin, engagé sur le chemin difficile des réformes structurelles. M. H. Monet, pour la Société générale, estime que « la volonté est bien là, de supprimer les rigidités de l’économie japonaise ». Le Crédit agricole fait de la restructuration du secteur bancaire le fondement de son optimisme sur le Japon. Bien que les résultats ne soient pas encore visibles dans les statistiques macro-économiques, la restructuration du secteur bancaire permet de traiter le vrai problème : l’accumulation des créances douteuses dont la résorption difficile met sous le boisseau la distribution de crédits nouveaux. Sans négliger le rôle du plan de recapitalisation mis en œuvre par le gouvernement japonais, le Crédit agricole souligne, à cet égard, la contribution essentielle des institutions financières étrangères qui recapitalisent également les établissements japonais dans lesquels elles ont des participations. Une analyse similaire est développée par le Centre d’observation économique de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (COE), qui voit dans la revitalisation des banques japonaises la clef du redémarrage futur de l’économie. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que les prévisions de ces deux organismes se rejoignent si étroitement (cf. supra). Cependant, rappelle l’AFEDE, la restructuration bancaire est une condition nécessaire mais pas suffisante du retour de l’économie japonaise vers un rythme de croissance plus durablement soutenu. Il est très difficile, selon cet organisme, d’évaluer le délai qui pourrait séparer le rétablissement définitif des banques et la remise en route des mécanismes normaux de distribution du crédit. Pour autant, la politique de réduction progressive des capacités excédentaires, notamment dans l’industrie, est encourageante. Pour la SFAC, ces analyses sont peut-être « trop économiques et bancaires ». On oublie que la société japonaise est confrontée à une profonde crise d’identité, qui pèse sur les comportements des agents et paralyse les mécanismes d’ajustement purement économiques. Doit-on se limiter, comme l’économiste américain P. Krugman, à voir dans un petit supplément d’inflation la planche de salut du Japon dans les prochaines années, ou bien faudra-t-il à ce pays l’arrivée d’un nouveau commodore Peary pour sortir de l’enlisement ? Ce à quoi M. G. Maarek (Crédit agricole) répond que « lorsque les analyses quittent le champ de l’économie pour aborder celui de la psychologie, c’est le moment que choisissent les boursiers pour acheter ! » · Faut-il donc « acheter du Japon » aujourd’hui ? « La hausse du yen rend du pouvoir d’achat international aux ménages japonais » estime le Crédit agricole. Cette appréciation est contestée par la Société générale, qui préfère voir, plus classiquement, dans la hausse du yen un facteur de diminution de la compétitivité des entreprises implantées au Japon : il s’agit d’un « coup sévère » porté à l’économie. Le COE émet un jugement plus nuancé : l’environnement extérieur asiatique du Japon est aujourd’hui beaucoup plus favorable qu’il y a un an, ce qui se traduit d’ailleurs par une augmentation des exportations retracées dans les plus récentes statistiques. En fait, la hausse du yen ne devrait avoir que peu d’impact sur les échanges intra-asiatiques. Tout en admettant que la force du yen est un problème dans les relations du Japon avec les blocs américain et européen, l’AFEDE estime également que les relations Asie-Japon ne devraient pas en être très affectées : « Aujourd’hui, ce sont surtout les économies asiatiques qui vendent au Japon. Le Japon tire l’Asie et non l’inverse ». L’OFCE remarque, à cet égard, que la crise en Asie avait causé grand tort aux banques japonaises, mais que la reprise enregistrée en 1998 et 1999 devrait leur rendre des marges de manœuvre. Peut-être assistera-t-on alors à un rééquilibrage des flux de capitaux entrant et sortant du Japon. La BNP souligne que, depuis la fin des années quatre-vingt et pendant la quasi-totalité de la décennie quatre-vingt-dix, l’excédent courant japonais s’est accompagné d’une augmentation des sorties nettes de capitaux. Au contraire, depuis 1998, l’augmentation de l’excédent courant doit être mise en parallèle avec une diminution très sensible des sorties nettes de capitaux, qui explique la récente hausse du yen. Les acteurs de ces mouvements sont les banques japonaises et les investisseurs étrangers, notamment les fonds de pension anglo-saxons. Le mouvement d’appréciation du yen peut-il se prolonger ? Non, estime la BNP, qui envisage une stabilisation de la parité yen-dollar aux environs de 115 yens pour un dollar. En effet, la confiance nouvelle des investisseurs s’est déjà traduite par des réallocations de portefeuille importantes, tandis que les rapatriements de capitaux par les banques japonaises devraient se tarir à l’horizon de quelques trimestres, lorsque les bilans des établissements seront complètement consolidés et reconstitués. L’AFEDE estime que l’engouement actuel pour le yen est un pari des investisseurs internationaux sur l’orientation de la politique économique du gouvernement, favorisé par un certain attentisme des investisseurs japonais qui s’inquiètent peut-être des risques encourus par l’économie américaine et ont été vraisemblablement échaudés par les moins-values provoquées par la diminution de la parité de l’euro au cours du premier semestre de 1999. Pour l’AFEDE, le niveau actuel du yen est difficilement compatible avec un redressement rapide de l’économie : les exportations commencent à « patiner ». D’ailleurs, l’Agence de planification économique du gouvernement japonais évalue la parité de « point mort » pour les entreprises japonaise à 115-120 yens pour un dollar. · C’est donc sur les facteurs internes que doit reposer le redémarrage ou la stagnation du Japon en 2000. Pour la direction de la prévision, le retour à la stagnation en 2000 résulte du manque de dynamisme de la demande privée et de l’ajustement encore inachevé du stock de capital. Avec des formes d’expression variées, cette analyse convient à la plupart des membres du panel. Ainsi, l’AFEDE juge que le processus de restructuration, positif à moyen terme, va peser sur la demande interne et justifie la mise en œuvre par le gouvernement japonais d’un nouveau plan de relance. Pour les autres membres du panel, également, la question n’est pas de savoir si un plan de relance est nécessaire, mais si son financement pourra être assuré dans de bonnes conditions et si son impact sur l’économie sera autre chose qu’une impulsion ponctuelle. Émettant un avis dissident, la SFAC s’interroge sur un mode volontairement provocateur : « un plan de relance de 1% du PIB… Pour quoi faire ? » Le pays est déjà sur-doté en équipements collectifs et un nouveau programme de travaux publics n’aurait qu’un effet d’entraînement modéré. En fait, bien peu d’organismes croient que le prochain plan de relance aura la capacité de remettre enfin l’économie sur un sentier de croissance auto-entretenue. Car c’est bien là la question sous-jacente à l’ensemble des membres du panel : jusqu’à quand le Japon aura-t-il besoin d’être maintenu sous la perfusion des dépenses publiques pour réamorcer enfin la demande privée ? Le déficit public a atteint un « niveau abyssal », l’endettement des administrations s’accroît de façon vertigineuse et le gouvernement a engagé avec la Banque du Japon un « bras de fer » pour que celle-ci contribue à l’effort de soutien macro-économique, en monétisant la majeure partie de la dette publique nouvellement émise, selon l’AFEDE. « Il n’y aura pas de reprise durable au Japon malgré un probable plan de relance » estime, pour sa part, la Caisse des dépôts et consignations. L’avenir de l’économie japonaise reste donc aujourd’hui entouré d’un épais halo d’incertitudes, lié en grande partie à l’étroite imbrication des phénomènes structurels et conjoncturels et à la persistance de facteurs de blocage dont il est bien malaisé de prévoir la levée. « Incertitude » est également le mot qui vient à l’esprit lorsqu’il s’agit de caractériser les perspectives de croissance des États-Unis à l’horizon 1999-2000. c) L’énigme américaine Dans son rapport général sur le projet de loi de finances pour 1999, votre Rapporteur général avait écrit « en un sens, pas plus que l’on n’a su expliquer la vigueur surprenante de la croissance américaine durant les derniers semestres, pas plus on ne semble savoir, aujourd’hui, exprimer précisément les déterminants et les répercussions des phénomènes économiques qui gouvernent le ralentissement programmé de la première puissance mondiale » (). Cette phrase pourrait être reproduite à l’identique aujourd’hui. Au fil des réunions semestrielles du groupe technique, les mêmes questions sont posées, qui ne reçoivent toujours pas de réponse satisfaisante ou dont les réponses sont, jusqu’ici, toujours démenties par les faits. L’idée centrale du scénario américain présenté par la direction de la prévision est, comme les années précédentes, un « atterrissage en douceur » de l’économie américaine. La stabilisation boursière au troisième trimestre de 1999 réduirait l’ « effet de richesse » dont bénéficient les ménages. Parallèlement, l’arrêt de la désinflation importée contribuerait aussi à ralentir la progression de la demande intérieure finale, notamment de la consommation des ménages. La croissance du PIB, évaluée à 4% en glissement en début d’année, reviendrait peu à peu à 2% en glissement en fin d’année. Ce scénario, souligne la direction de la prévision, met l’accent sur la stabilité et rejette, à ce titre, l’hypothèse d’un ajustement boursier sévère à Wall Street. Cependant, il conduit à un ralentissement marqué du taux de croissance du PIB, qui revient de 3,8% en moyenne en 1999 à 2,1% en moyenne en 2000. Ce ralentissement est moins brutal dans les estimations du panel : les instituts de conjoncture jugent que le taux de croissance du PIB pourrait revenir de 3,8% en 1999 à 2,6% en 2000, alors que les banques et institutions financières estiment que le taux de croissance en 2000 pourrait même atteindre 2,9%. · Une fois encore, les analyses s’accordent à considérer que la Bourse américaine est très nettement surévaluée et que la croissance est fondée sur des déséquilibres majeurs. Tous les indicateurs sont, peu ou prou, positifs et on ne décèle aujourd’hui aucun signe de ralentissement, rappelle l’AFEDE : « Un rythme de croissance du PIB de 4% par an suppose une croissance de la demande intérieure d’environ 5 à 6% par an, ce qui est excessif. Mais comment freiner le système ? » La BNP estime, pour sa part, que « le financement pernicieux de l’économie américaine a franchi un pas supplémentaire à la fin du premier semestre de 1998. On a vu à partir de cette date se multiplier les rachats d’actions et exploser l’endettement, sous la forme d’émissions obligataires ou de crédits bancaires ». Pour les ménages, également, l’année 1998 marque un tournant, avec le financement d’une part plus importante des dépenses de consommation grâce aux ventes d’actions et à la réalisation des plus-values latentes sur portefeuilles boursiers. « Jusqu’en 1996-1997, la hausse de Wall Street reposait sur l’anticipation d’une amélioration de certains indicateurs fondamentaux. Depuis 1998, des phénomènes pervers se sont installés, qui se traduisent d’ailleurs par une augmentation des spreads () entre les émissions d’obligations privées et publiques ». Ces mécanismes, qui portent sur des masses financières importantes, ne sont pas tenables très longtemps, estime la BNP. Le Crédit agricole préfère mettre l’accent sur les aspects internationaux du financement de l’économie américaine. « Actuellement, la zone euro n’est pas en compétition avec les États-Unis sur le marché international des capitaux ». L’Europe est, d’ailleurs, exportatrice nette de capitaux. Qu’adviendra-t-il, cependant, si la croissance européenne s’installe de façon durable sur un sentier plus élevé que celui enregistré les années passées ? L’ « harmonie de la croissance mondiale » est le phénomène majeur des années 1999-2000 et fait peser à ce titre une épée de Damoclès sur le financement de l’économie américaine. Entre un ajustement continu ou une rupture brutale de la valeur des actifs, l’effet d’un rééquilibrage des flux mondiaux de capitaux reste incertain, donc potentiellement dangereux. Peut-être faut-il alors se pencher, comme le Centre de prévision de L’Expansion, sur les explications possibles de la hausse spectaculaire de la bourse américaine ces dernières années. « La « nouvelle économie » est l’alibi de la hausse de Wall Street ». Quels qu’en soient les fondements, cette « nouvelle économie » ne peut être qu’une appellation circonstancielle d’un phénomène très classique : une augmentation soutenue et durable des gains de productivité. Or l’étude des déterminants de la productivité américaine suggère qu’il y a une très légère augmentation de la productivité du travail, mais qu’aucune tendance manifeste ne se dégage en matière de « productivité globale des facteurs » – où devraient s’exprimer le plus clairement les mécanismes prétendûment nouveaux sous-jacents à la « nouvelle économie ». Selon la direction de la prévision, une récente étude des déterminants de la productivité américaine () ne montre pas d’inflexion de tendance sur la productivité globale des facteurs. En revanche, elle met en évidence une diminution du NAIRU () qui pourrait se traduire par une augmentation provisoire de la croissance potentielle de l’économie. · Les investigations effectuées par la direction de la prévision ne peuvent donc pas amener à considérer que les niveaux de capitalisation boursière atteints par les sociétés américaines sont justifiés au regard des fondamentaux économiques. Deux scénarios d’ajustement sont alors envisageables. Le premier de ces scénarios se fonde sur un ajustement modéré de la valeur des actifs financiers aux États-Unis, qui ramène le taux de croissance du PIB au niveau moyen de 2,5% à 3% en 2000. Ce scénario recueille l’assentiment de la plupart des participants au panel. Ceux-ci, cependant, n’ont pas été amenés à détailler précisément les déterminants de ce scénario « doux » au cours de la réunion du groupe technique. Seul le Centre de prévision de L’Expansion a indiqué que le besoin de financement croissant des agents privés provoquerait une augmentation des tensions sur les taux à long terme, facteur considéré comme stabilisateur. Le second scénario repose sur l’apparition d’un choc brutal dans la sphère financière. La principale inconnue relève donc de la réponse de la Réserve fédérale à ce choc et de sa capacité à épargner un ajustement trop brutal à l’économie réelle. Pour l’AFEDE, la Réserve fédérale est convaincue qu’il faut réduire au plus tôt les risques inhérents à la bulle financière actuelle. Mais l’absence d’inflation amène les gouverneurs de la Réserve fédérale à « chercher des prétextes » pour relever peu à peu leurs taux d’intervention. Pour autant, le faible niveau d’inflation procurerait justement à la Réserve fédérale des marges de manœuvre importantes pour gérer un éventuel krach boursier. Le Centre de prévision de l’Expansion estime, pour sa part, que « la Réserve fédérale ne peut pas crever la bulle financière ». Il s’interroge même sur sa capacité à gérer au mieux la « marche arrière ». En effet, en cas de krach, la politique monétaire américaine lui apparaît prise dans un réseau de forces contradictoires. La diminution de la demande intérieure appellerait une diminution des taux d’intérêt pour ranimer l’activité. Cependant, la diminution de la parité du dollar consécutive au ralentissement de l’activité nécessiterait une remontée des taux d’intérêt pour combattre l’inflation importée. Ainsi, l’économie américaine apparaît toujours aussi difficile à cerner que les années précédentes. Il ne fait pas de doute, cependant, que le contexte international est, à l’horizon 2000 beaucoup plus favorable qu’auparavant pour la zone euro dans son ensemble et pour la France en particulier. 2.- La zone euro : une accélération confirmée Selon la direction de la prévision, la zone euro devrait voir la fin des turbulences observées au cours de l’hiver 1998-1999. Les indicateurs de confiance des ménages et des entreprises, qui s’étaient écartés sensiblement pendant plusieurs mois, ont convergé vers le haut : le choc externe n’a pas été amplifié par une contraction de la demande des entreprises. a) Une croissance plus homogène · L’année 1999 est marquée par une certaine aggravation du contraste entre les économies européennes dynamiques et les économies allemande et italienne, plus languissantes. Pour la direction de la prévision, l’année 2000 devrait voir une réduction de ces contrastes, qui se traduirait notamment par une accélération de la croissance en Allemagne supérieure à celle prévue pour l’ensemble de la zone euro. Le taux de croissance du PIB en Allemagne passerait ainsi de 1,3% à 2,4% entre 1999 et 2000, soit une augmentation équivalente à 1,1 point de PIB alors que le taux de croissance de la zone euro n’augmenterait que de 0,7 point de PIB, passant de 2% à 2,7%. Les membres du panel envisagent également un rattrapage relatif de l’économie allemande : le taux de croissance s’améliorerait à hauteur de 1,3 point de PIB alors que celui de la zone euro n’augmenterait que de 0,9 point de PIB. Le panel est, par ailleurs, plus optimiste que la direction de la prévision, puisqu’il estime que le taux de croissance pourrait atteindre, en valeur absolue, 2,9% pour la zone euro et 2,7% pour l’Allemagne. Pourtant, la persistance d’écarts de croissance amène la direction de la prévision à s’interroger sur l’impact sous-jacent de phénomènes plus structurels, touchant au fonctionnement des marchés et aux conditions de formation de leur équilibre, notamment sur le marché du travail. L’OFCE souligne la différence entre une France dynamique et une Allemagne et une Italie « empêtrées dans leurs problèmes structurels ». Selon l’OFCE, la France bénéficie plus fortement de l’assouplissement monétaire engagé en décembre 1998 et en avril 1999, car elle avait davantage souffert de la détérioration des conditions monétaires au cours de la décennie quatre-vingt-dix. Marquée par les dévaluations compétitives de la livre sterling britannique et de la lire italienne en septembre 1992, ainsi que par le maintien de taux d’intérêt élevés dû au mode de financement de la réunification allemande, « la France a été contrainte à l’ajustement structurel plus tôt que ses deux principaux partenaires ». L’Allemagne souffre d’un problème de compétitivité, la surévaluation du mark au moment de l’entrée dans l’euro ne pouvant plus être corrigée aujourd’hui. En revanche, selon l’OFCE, la politique d’accompagnement de l’emploi conduite en France – notamment avec les emplois jeunes et la réduction de la durée du travail – a notablement amélioré les conditions macro-économiques d’ensemble. Par ailleurs, l’augmentation soutenue de la population active en France se distingue clairement des évolutions enregistrées à cet égard en Allemagne et peut expliquer une partie de l’écart actuel de croissance. Le Centre de prévision de L’Expansion valide dans ses grandes lignes la thèse du rattrapage français. « La France a été obligée de croître au-dessous de son potentiel de croissance pendant toute la décennie quatre-vingt-dix. La période actuelle voit un rattrapage bienvenu du déficit de croissance ». Cependant, le Centre de prévision de L’Expansion souligne que le potentiel de croissance de l’économie a pu être diminué du fait du sous-investissement provoqué par les années de croissance ralentie. In fine, la zone euro pourrait connaître, en 2000, une normalisation partielle de ses conditions générales de croissance. L’ajustement de la politique monétaire devrait alors conduire à une augmentation des taux directeurs de la Banque centrale européenne. Une augmentation des taux directeurs de 50 à 75 points de base est envisageable. · « La politique de la Banque centrale européenne au regard de la croissance est assez claire » estime l’OFCE. L’évaluation du risque inflationniste est, cependant, conditionnée à une appréciation fiable du taux de chômage d’équilibre. Or, justement, souligne l’AFEDE, la Banque centrale européenne souhaite que l’amélioration de la conjoncture et le retour de la croissance accélèrent l’ajustement structurel des finances publiques, mais, surtout, améliorent le fonctionnement du marché du travail et réduisent les rigidités qui empêchent un bon fonctionnement de ce marché. Alors que la Banque centrale européenne (BCE) recherche la neutralité, c’est la mesure même de cette neutralité qui peut être brouillée par les modifications structurelles à venir du marché du travail. Cependant, souligne l’AFEDE, les marchés financiers n’ont pas apprécié les propos du président de la BCE en juillet 1999, qu’ils ont interprété comme une réactivité excessive à la conjoncture. Il y a « un vrai problème de dialogue avec les marchés, mais aussi un véritable effort pour surmonter ces difficultés depuis le mois de septembre 1999 ». Or une bonne compréhension entre la BCE et le marché est essentielle si l’on veut une transmission efficace des impulsions de politique monétaire à l’ensemble de l’économie. La zone euro ne ressemble pas aux États-Unis : de l’autre côté de l’Atlantique, l’écrasement de la courbe des taux – qui est quasiment plate – provoque une bonne sensibilité des taux longs aux ajustements de taux directeurs de la Réserve fédérale. Par ailleurs, un certain doute subsiste encore sur le caractère achevé ou inachevé de la convergence entre les États membres de la zone euro. Le Crédit agricole estime, à cet égard, que la persistance d’un différentiel de conjoncture entre les trois principales économies de la zone (l’Allemagne, la France et l’Italie) est « la conséquence directe et amplifiée de l’introduction de l’euro ». En effet, une politique monétaire fondée sur une analyse de la situation moyenne de la zone a nécessairement un impact accélérateur sur les économies les plus dynamiques – puisque les conditions monétaires ne sont pas assez restrictives, pour celles-ci – et un impact dépressif sur les économies les moins avancées dans le cycle. Les seules forces de rappel sont, selon le Crédit agricole, les tensions sur le marché du travail ou l’apparition de crises bancaires. Sur le premier point, il semble que seule l’Irlande soit actuellement confrontée à de véritables tensions. D’ailleurs, l’influence stabilisatrice des tensions sur le marché du travail doit obéir à certains délais sur l’on ne connaît pas très bien, pour l’heure. L’apparition de crises bancaires nécessiterait la combinaison de nombreux facteurs défavorables, mais le Crédit agricole remarque l’augmentation sensible du crédit dans certains pays (25 à 30% parfois) – sans pour autant que ces pays aient été mentionnés explicitement lors de la réunion du groupe technique. La vision de l’union monétaire développée par le Crédit agricole s’oppose à celle de la direction de la prévision. Pour le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, « la politique monétaire doit contribuer à la resynchronisation des conjonctures ». Dans le scénario développé pour 1999 et 2000, cette resynchronisation s’effectue dans le cadre d’une appréciation prudente des perspectives macro-économiques, pour l’Allemagne comme pour la France. b) L’économie française en 2000 : une croissance équilibrée En septembre 1998, le colloque des conjoncturistes jugeait la direction de la prévision trop optimiste pour les perspectives françaises en 1999. En septembre 1999, la situation est inversée et certains, comme la Société générale, n’hésitent pas à demander si le scénario de la direction n’est pas « trop prudent ». Avec un taux de croissance du PIB évalué à 3% en moyenne, les instituts de conjoncture comme les banques et institutions financières se détachent quelque peu du chiffre de 2,8% retenu comme valeur centrale par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, qui constitue en fait le milieu de la fourchette officielle de prévision, fixée à l’intervalle 2,6% – 3%. Les membres du panel se partagent assez nettement entre les optimistes – qui envisagent des taux de croissance supérieurs à 3% – et les sereins, qui se situent à l’intérieur de la fourchette officielle. Si Paribas se montre le plus circonspect, avec un taux de croissance limité à 2,6% en 2000, JP Morgan étonne avec un taux « record » de 3,6%, suivi de près par l’OFCE qui juge que le PIB français augmentera d’environ 3,5% l’an prochain. En fait, les déterminants de la croissance français n’ont pas suscité de débats très nourris au sein du groupe technique. Votre Rapporteur général ne sait s’il faut y voir la conséquence d’un accord largement partagé sur les contributions respectives des différents secteurs à l’économie nationale ou, au contraire, la marque d’une perplexité génératrice de retenue. Il est vrai que les scénarios proposés par les différents membres du panel s’écartent parfois sensiblement. En matière d’emploi, par exemple, il est clair que des différences d’appréciation importantes séparent l’OFCE du BIPE ou de la direction de la prévision : – l’OFCE prévoit une accélération vigoureuse de l’emploi total (+ 1,4% en 1999 et + 1,8% en 2000) et de l’emploi salarié (+ 1,8% en 1999 et + 2,1% en 2000). En revanche, aucune évaluation n’est faite de l’évolution du pouvoir d’achat de la masse salariale comme du pouvoir d’achat du revenu disponible brut des ménages. Il aurait pourtant été intéressant de pouvoir « boucler » les prévisions relatives à l’emploi avec le taux de croissance de la consommation des ménages et de l’investissement des ménages, qui sont respectivement égal et inférieur aux évaluations de la direction de la prévision ; – le BIPE envisage le maintien à un niveau modéré du taux de croissance de l’emploi total (+ 0,9% en 1999 comme en 2000). La légère diminution du pouvoir d’achat de la masse salariale comme du pouvoir d’achat du revenu disponible brut des ménages explique peut-être la progression très légère du taux de croissance de la consommation des ménages, qui passerait de 2,5% en 1999 à 2,6% en 2000 ; – la direction de la prévision est également prudente en matière d’emploi total, qu’elle juge cependant dynamique, son taux de croissance s’établissant à 1,5% en 1999 comme en 2000. Dans ce contexte, la stabilité du pouvoir d’achat du revenu disponible brut des ménages explique alors, peut-être, l’accélération des dépenses de consommation, qui passeraient de 2,4% en 1999 à 2,7% en 2000. Les facteurs d’évolution de la principale composante de la demande intérieure restent donc quelque peu obscurs à l’issue de la réunion du groupe technique. Tout au plus, certains participants se sont-ils interrogés sur la vigueur probable de l’investissement des entreprises et des ménages. Pour ces derniers, la BNP souligne que les évaluations relatives à 1999 reposent quasiment aujourd’hui sur de « l’acquis » et que la stabilité des délivrances de permis de construire comme les délais de construction permettent de cadrer dès aujourd’hui avec une faible marge d’erreur les prévisions sur l’investissement des ménages en logement en 2000. Pour autant, la Société générale s’est interrogée sur l’intégration dans le scénario officiel des 19 milliards de francs d’allégement de TVA sur les travaux de rénovation, proposés dans le présent projet de loi de finances. La direction de la prévision a précisé que ces 19 milliards de francs avaient été répartis à hauteur des deux tiers sur la formation brute de capital fixe des ménages et à hauteur d’un tiers sur la consommation des ménages. 10 000 emplois seraient créés du fait de la mesure en 2000, sous réserve, souligne l’INSEE, d’une élasticité favorable de la demande au prix des prestations. En effet, rappelle l’INSEE, le bâtiment est aujourd’hui le seul secteur où sont perceptibles des tensions sur les capacités de production. Il subsiste donc un risque que l’effet positif de la mesure de baisse de la TVA soit absorbé par des réajustements de prix de la part des professionnels. Les tensions sur les capacités de production ne sont certainement pas, selon l’INSEE, la raison principale du dynamisme relatif de l’investissement envisagé pour 2000. En effet, le taux d’utilisation des capacités de production est, globalement, supérieur à sa moyenne de long terme à l’heure actuelle, mais il n’apparaît pas de réel goulot d’étranglement dans l’industrie. Les industriels ont intériorisé, semble-t-il, la thèse du « trou d’air » développée au printemps dernier par le Gouvernement, et n’ont pas ralenti de façon significative leurs programmes d’investissement. Dans ces conditions, le phénomène classique de l’« accélérateur d’investissement » peut jouer à la marge, mais, remarque le Centre de prévision de L’Expansion, les deux motivations essentielles de l’investissement aujourd’hui sont peut-être plutôt l’intégration des nouvelles technologies au sein de l’appareil de production, d’une part, et l’amélioration de la productivité du travail nécessitée par l’introduction des « 35 heures ». Ainsi s’explique la prévision particulièrement élevée pour la croissance de l’investissement des entreprises, qui s’établit à 8,8% en 2000, à comparer à 5% pour la direction de la prévision (après 6% en 1999). Au demeurant, la direction de la prévision estime que sa prévision d’investissement est très prudente, fondée sur l’absence de tensions dans l’appareil de production et l’augmentation de la productivité du capital depuis 1993. L’OFCE affirme, cependant, que la productivité du capital est un concept aux implications complexes et que, par exemple, il paraît difficile d’extrapoler pour les années à venir une poursuite de l’augmentation de la durée d’utilisation du capital semblable à celle observée ces dernières années, qui a ramené cet indicateur au niveau enregistré en 1973. Les budgets économiques prévoient une diminution sensible du besoin de financement des administrations publiques, qui reviendrait de – 2,2% en 1999 à – 1,8% en 2000. Hormis Morgan Stanley, qui prévoit un besoin de financement égal à 2% du PIB en 2000, les prévisions de tous les membres du panel s’accordent, à 0,1 point près, avec celles de la direction de la prévision. Cette harmonie peu fréquente relativise les écarts qui peuvent émailler, par ailleurs, les scénarios d’ensemble développés par les membres du panel. Elle conforte votre Rapporteur général dans la confiance qu’il accorde au cadrage macro-économique associé par le Gouvernement au projet de loi de finances pour 2000.
EXTRAITS DES SCÉNARIOS MACRO-ÉCONOMIQUES PRÉSENTÉS PAR LES PRINCIPAUX ORGANISMES DE PRÉVISION (septembre 1999)
(a) Taux de croissance annuelle, en %. (c) RDB : revenu disponible brut des ménages. Taux de croissance, en %. (b) Contribution à la croissance du PIB, en point de PIB. (d) En % du PIB. B.I.P.E. : Bureau d’informations et de prévisions économiques. REXECODE : Centre de recherches pour l’expansion de l’économie et le développement des entreprises. C.D.C : Caisse des dépôts et consignations. G.A.M.A. : Groupe d’analyse macro-économique appliquée (CNRS et Université de Paris-Nanterre). O.F.C.E. : Observatoire français des conjonctures économiques. C.O.E. : Centre d’observation économique (Chambre de commerce et d’industrie de Paris). A.F.E.D.E : Association française des économistes d’entreprises. Expansion : Centre de prévision de L’Expansion
EXTRAITS DES SCÉNARIOS MACRO-ÉCONOMIQUES PRÉSENTÉS PAR LES PRINCIPALES INSTITUTIONS FINANCIÈRES (septembre 1999)
(a) Taux de croissance annuelle, en %. (b) Contribution à la croissance du PIB, en point de PIB. (c) RDB : revenu disponible brut des ménages. Taux de croissance, en %. (d) En % du PIB. CHAPITRE II UNE ÉCONOMIE PORTÉE PAR LE CERCLE VERTUEUX Au-delà des performances enregistrées en matière de croissance, les données relatives à l’emploi– avec les créations d’emplois et l’amorce, enfin, d’une résorption du chômage – concrétisent pleinement la notion de croissance solidaire qui est au cœur de la politique mise en œuvre depuis la mi-1997. Le climat de confiance et la croissance des revenus qui en résultent alimentent la croissance, enclenchant un cercle vertueux qui ne doit cependant pas conduire à oublier la nécessité d’une action soutenue pour réduire les déséquilibres et les inégalités qui demeurent dans la société française. A.- LA POLITIQUE DE L’EMPLOI, UN ADJUVANT PUISSANT AU DYNAMISME DU MARCHÉ DU TRAVAIL Dans son rapport pour 1998, la Banque centrale européenne souligne que : « l’ampleur du chômage et la faiblesse de l’emploi constituent les principaux défis auxquels est actuellement confrontée l’Union européenne ». Ce défi, il appartient d’abord aux gouvernements de le relever et tous ont fait de la lutte contre le chômage la priorité de leur action. Mais tous n’ont pas réussi à traduire leurs intentions en résultats tangibles. Ce fut naguère le cas en France, où la relative amélioration de l’emploi que certains ont pu obtenir n’a pas été suffisante pour entamer le sentiment diffus d’une situation qui allait s’aggravant – bref d’une certaine impuissance à répondre aux inquiétudes des Français. Or, la stratégie ambitieuse suivie par le Gouvernement et sa majorité – une croissance plus forte, une croissance plus riche en emplois, une croissance qui profite à tous – gagne en crédibilité à mesure que les résultats s’ajoutent les uns aux autres. Le tableau suivant en apporte la démonstration.
Il ressort de ce tableau qu’en termes d’emploi et de chômage, la période mi 1995-mi 1997 correspond à une détérioration de la situation, à un « creux de la courbe ». En termes de variation de l’emploi, la diminution des créations d’emplois au deuxième semestre de 1995 par rapport au premier semestre de la même année a été suivie d’une diminution nette au premier semestre 1996 et d’une stagnation au deuxième semestre de 1996. La remontée du premier semestre de 1997 ne correspond qu’à la moitié du niveau du premier semestre 1995. En termes de chômage, à une diminution au premier semestre de 1995, ont succédé quatre semestres successifs de hausse. Par contraste, depuis la mi-1997, l’emploi augmente fortement (trois fois plus en moyenne chaque semestre par rapport au premier semestre de 1997) et le chômage diminue, ces résultats ayant, de surcroît, été obtenus alors que la population active était fortement croissante par rapport au premier semestre de 1997. L’emploi s’améliore. Le chômage recule à un rythme inconnu depuis longtemps. L’actuel gouvernement réussit donc là où le précédent a échoué. Si certains soulignent à l’envi la fragilité des résultats obtenus depuis 1997, l’échec de 1995-1996 est, lui, avéré. Les Français ne s’y trompent d’ailleurs pas. Leurs anticipations en matière de chômage, telles qu’elles sont suivies par la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l’emploi et de la solidarité (DARES), témoignent, au début de 1999, d’une sensible amélioration par rapport au début de 1997. En janvier 1997, le pessimisme l’emportait : 74 % des personnes interrogées estimaient que le nombre de chômeurs allaient augmenter pendant plusieurs années. Ce sentiment d’une détérioration probable de l’emploi s’était ainsi accru de 13 points entre 1995 et 1997. En janvier 1999, en revanche, à peine un Français sur deux considérait encore que le chômage allait augmenter pendant plusieurs années. Ce résultat correspond au niveau le plus faible observé depuis que l’enquête sur les attitudes des Français à l’égard du chômage existe (1985). 1.- La politique de l’emploi : aspects quantitatifs et qualitatifs Si tout gouvernement fait de l’emploi sa priorité, c’est avant tout au contenu concret donné à cette affirmation générale qu’il convient de s’attacher. a) L’objectif du plein emploi Quel sens donner à l’objectif de plein emploi ? Une première approche concerne le niveau global du chômage. Une observatrice attentive des évolutions sociales a ainsi pu souligner combien le « verdict des chiffres du chômage » avait pu influencer l’élaboration des politiques de l’emploi depuis le milieu des années 1970 (). L’objectif quantitatif de la politique de l’emploi constitue bien sûr une donnée essentielle. De ce point de vue, diviser par deux un taux de chômage à deux chiffres constitue un objectif ambitieux, qui, pour être atteint, suppose de mobiliser d’importants moyens au service de la politique de l’emploi. Cinq pays de l’Union européenne ont un taux de chômage inférieur à 5% (Danemark, Portugal, Autriche, Pays-Bas, Luxembourg). On peut d’abord y trouver des raisons d’entreprendre, car ce qui a été réussi ailleurs peut l’être ici. Mais se fixer un objectif des 5% n’épuise pas la question, qui se pose en termes de souffrance sociale. La politique de l’emploi comporte aussi une importante dimension « qualitative ». Un taux de chômage ramené à 5% de la population active n’a pas la même signification selon qu’il correspond, pour l’essentiel, à des situations provisoires ou qu’il s’agit, pour une part importante, de situations de chômage de longue durée, c’est-à-dire engageant une frange de la population dans un processus d’exclusion sociale. De ce point de vue, l’évolution de la structure du chômage en France, telle qu’elle ressort du tableau suivant, peut aider à fixer des repères.
Ce tableau montre que, si l’on considère la situation prévalant avant le milieu des années 1970, rétrospectivement perçue, par l’opinion courante, comme l’époque du plein emploi, il faut lutter à la fois contre une aggravation du risque de chômage et contre l’existence d’inégalités face au à ce risque, déjà présentes à l’époque, que l’aggravation du chômage a elle-même accentuées. La durée moyenne du chômage serait à diviser par deux, la proportion des chômeurs de longue durée dans le chômage total à réduire de deux tiers. Le chômage des jeunes - dont il faut prendre conscience qu’il exprime le taux de chômage des jeunes actifs (rapport du total des jeunes actifs sur le total des jeunes ayant un emploi ou au chômage), notion distincte de celle de la part de jeunes de 15 à 24 ans au chômage par rapport à l’ensemble des jeunes de 15 à 24 ans qui est, elle, de l’ordre de 8% - indique que la probabilité de devenir chômeur est plus élevée pour les jeunes. Les inégalités devant le chômage tenant à la catégorie socioprofessionnelle se sont aussi accentuées : la différence des taux de chômage entre la catégorie des cadres supérieurs et celle des ouvriers est passée de 1,5 point en 1968 à 10,7 points en 1997. On peut cependant relever que le mouvement de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes s’est poursuivi, malgré un contexte de dégradation de l’emploi (de plus du double de celui des hommes en 1968, le taux de chômage des femmes en représente moins du tiers en 1997). b) Quelle stratégie pour l’emploi ? Si la comparaison des taux de chômage globaux ne peut donc être faite indépendamment de l’analyse du contenu des politiques de l’emploi, cela vaut aussi pour les données de l’OCDE qui sont présentées à l’appui de la stratégie pour l’emploi, préconisée par cette organisation depuis 1994 et qui, selon ses termes mêmes « contient un vaste ensemble équilibré de mesures visant à renforcer la croissance de l’emploi, à réduire le chômage et à accroître la prospérité ». L’encadré suivant, établi par l’OCDE, récapitule les principaux axes de la stratégie ainsi prônée.
Source : OCDE, La mise en œuvre de la stratégie de l’OCDE pour l’emploi : Évaluation des performances et des politiques, 1999. Si l’on s’attachait à établir un tableau de concordance en droit du travail de certains objectifs formulés en termes économiques, le contenu de ce comparatif consisterait en un constat de décès du modèle du contrat de travail à durée indéterminée avec une carrière longue dans l’entreprise. La flexibilité en constitue le maître mot. Par exemple : – le point 3 sur flexibilité du temps de travail se traduirait par une remise en cause de la protection collective pour laisser le salarié négocier ses conditions de travail dans une relation prétendument égale avec son employeur ; – le point 5 sur la flexibilité des coûts salariaux se traduirait par une remise en cause de la rémunération minimum ; – le point 9 sur la révision de l’indemnisation des chômeurs rappelle désagréablement cette vieille antienne qu’un filet de secours social entretient dans leurs défauts les « classes paresseuses ». Il ne s’agit pas de refuser à l’OCDE le droit de porter les jugements qu’elle estime appropriés : si cette organisation n’existait pas, tout État doté d’une économie moderne souhaiterait sa création pour disposer d’indicateurs lui permettant de se situer par rapport aux autres. On peut en effet raisonnablement douter qu’à long terme, une société, un État ou un groupement d’États comme l’Union européenne qui verrait ses performances relatives se dégrader puisse continuer à s’affirmer sur la scène politique ou économique mondiale. Mais il est tout aussi raisonnable de penser que, pour être pertinente, cette comparaison doit, aussi, englober des aspects traditionnellement qualifiés de sociaux. Dès lors qu’on dispose de ces indicateurs, trois attitudes sont possibles. La première consiste à informer. Mais il faut se garder, en ce domaine comme dans d’autres, de la prétendue neutralité des données d’évaluation. Les travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle que votre Commission des finances a conduits sur les aides à l’emploi ont mis en évidence combien la terminologie des « évaluateurs » était entrée dans le langage des décideurs politiques et influait sur leur façon de poser les problèmes (). La deuxième attitude consiste à prévoir. Elle traduit trop souvent une forme de déterminisme économique et politique. Il faut toutefois se méfier des évaluations à long terme. Si les chiffres du chômage des années 1960 peuvent nous faire rêver, certaines prédictions des experts d’alors pour les années que nous vivons, comme le souhait d’une « croissance zéro » pourraient, elles, nous faire sourire. Il n’en demeure pas moins qu’à court terme, les conséquences des choix immédiats de politique économique peuvent en être éclairés, car des erreurs de « pilotage » peuvent être à l’origine d’écarts de croissance qui, à la longue, ne peuvent qu’éroder la puissance économique et politique et l’équilibre social à long terme. La dernière attitude consiste à prescrire de suivre ou refuser certaines stratégies. Elle pose la question du rôle des décideurs politiques. Les choix économiques sont aussi des choix de société. Le rôle des décideurs politiques ne se réduit pas à « donner un habillage » aux expertises économiques. S’en tenir à ces dernières risquerait de conduire à un « découplage » de l’économique et du politique. Or, seule la légitimité de ce dernier lui permet d’organiser la conciliation d’impératifs contradictoires lorsqu’ils sont poussés à l’extrême et, par là, d’aménager les transitions nécessaires. A trop donner à penser que toute réforme peut se réaliser comme l’analyse l’économiste, c’est-à-dire « toutes choses égales par ailleurs », la capacité d’adaptation finit par s’éroder. Le précédent Gouvernement en a fait l’expérience. c) Le modèle français n’ignore pas la flexibilité Il est indéniable que la politique de l’emploi a déjà considérablement évolué en France. Pour juger du rythme suffisant ou insuffisant de cette évolution, il importe de déterminer quel est le terme de comparaison par rapport auquel on va mesurer les résultats obtenus. La question qui se pose aujourd’hui est de savoir si ce terme de comparaison peut encore être recherché dans la situation proprement française « d’avant la crise ». En clair, le progrès social tel qu’on l’entendait alors est-il compatible avec la compétition économique d’aujourd’hui ? Dans son intervention aux « Entretiens de l’emploi » organisés par l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE), les 30 et 31 mars 1999, le directeur de la DARES, M. Claude Seibel, a estimé qu’une spécificité française ressortait surtout de son modèle d’activité qui continuait à privilégier les travailleurs qualifiés et expérimentés, au détriment des jeunes débutants ou des salariés âgés. La France se situe parmi les pays où les taux d’activité juvénile sont les plus faibles de même que les taux d’activité des hommes de 55 ans à 64 ans. « Il s’agirait d’un système à la fois spontané, au niveau des comportements individuels et de la politique d’embauche des entreprises, et organisé par les pouvoirs publics, à travers les mesures concernant la formation initiale ou les processus de cessation d’activité » (). D’autres modèles de politique de l’emploi, comme le modèle britannique ou le modèle néerlandais, sont volontiers mis en avant, en particulier par l’OCDE. Il faut faire l’effort de les apprécier au-delà des résultats globaux. Devant les membres de la Mission d’évaluation et de contrôle de votre Commission des finances, le directeur de la prévision a, par exemple, fait remarquer que la prise en compte, pour le Royaume-Uni, d’un taux de chômage des couples, c’est-à-dire ceux au sein desquels personne ne travaille et ceux au sein desquels l’un seulement travaille, donne à conclure que ce pays enregistre le taux de chômage le plus élevé d’Europe (20%). Et lors des entretiens de l’emploi précités, le directeur de la DARES a souligné qu’une partie de la population active potentielle des Pays-Bas était considérée comme affectée de « handicaps sociaux » et donc exclue de la population active. · L’enrichissement de la croissance en emplois Une première évolution tient à l’enrichissement de la croissance en emplois.
(a) Cette évolution, qui se traduit toujours par un accroissement des effectifs, à croissance donnée, ne conduit pas à une augmentation du nombre d’heures travaillées lorsqu’elle est obtenue par un recours accru au temps partiel. Source : DARES-INSEE-Direction de la prévision, préparation de la conférence nationale sur l’emploi, les salaires et le temps de travail, Fiches de diagnostic, septembre 1997. Selon une étude de l’UNEDIC (), « dans les années 70, il fallait une augmentation d’au moins 2,6 % du PIB marchand pour qu’il y ait création nette d’emplois. Ce rythme est tombé à 2,2 % dans les années 80 et à 1,2 % depuis 1990. De même, à croissance donnée, ces créations nettes d’emplois sont beaucoup plus nombreuses qu’auparavant ». La même étude estime que l’enrichissement de la croissance en emplois est, sur la dernière décennie, expliqué pour 10% par la déformation sectorielle de l’économie, c’est-à-dire le développement des activités tertiaires, pour 40% par le développement du travail à temps partiel, pour 20 à 30% par le développement des emplois courts ou précaires et pour 20 à 30% par la politique d’allégement des charges sociales. Au total, « le fait que la croissance française soit plus riche en emplois repose en grande partie sur la montée en puissance du travail à temps partiel ». Le nombre des salariés travaillant à temps partiel a augmenté de plus de 1 million entre 1992 et 1997, un nombre important d’entre eux étant dans cette situation à défaut de pouvoir occuper un emploi à temps plein comme ils le souhaiteraient. En 1997, près de 40% des travailleurs à temps partiel déclaraient souhaiter travailler davantage, contre 30% en 1990. La France est ainsi, en Europe, le pays où la part de l’emploi à temps partiel contraint dans l’emploi total est la plus élevée, alors que le taux de travail à temps partiel y est plutôt proche de la moyenne. Les experts entendus par les membres de la Mission d’études et de contrôle de votre Commission des finances ont exprimé des divergences sur l’interprétation à donner du point de savoir ce qui avait été le facteur ayant incité à un tel développement. Ainsi, l’INSEE, la direction de la prévision et la DARES ont estimé qu’il était difficile de séparer dans l’accélération de ce développement, observée à partir de 1992, ce qui relèverait des mesures spécifiques d’abattement, des allégements de charges sur les bas salaires et des autres facteurs structurels et tendanciels. En revanche, les auteurs d’une étude réalisée pour l’Office parlementaire d’évaluation des politiques publiques ont, pour leur part, souligné que dès que l’Etat a encouragé cette forme d’emploi, les créations se sont multipliées, appréciation proche de celle du Centre d’observation économique de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris qui relève d’ailleurs qu’en l’absence de nouvelles mesures, l’élasticité de l’emploi à la croissance pourrait de nouveau se rapprocher de ses valeurs antérieures, la mise en place des trente-cinq heures pouvant toutefois, à court terme, aller dans le sens d’un nouvel enrichissement en emplois de la croissance (). · Une flexibilité déjà pratiquée La flexibilité peut prendre diverses formes. L’un de ses principaux aspects consiste dans l’aménagement des horaires et des rythmes de travail des salariés. L’enquête sur les conditions de travail de 1998 témoigne d’une extension des contraintes d’horaires et de rythme de travail par rapport à ce que les mêmes enquêtes faisaient apparaître en 1984 et en 1991. En ce qui concerne les contraintes horaires, on peut relever une progression du travail dominical : la proportion des salariés ayant travaillé le dimanche de manière occasionnelle ou fréquente est ainsi passée de 18,5% en 1991 à 22% en 1998. De même, le travail de nuit a progressé, notamment chez les ouvrières, en liaison probablement avec la suppression de l’interdiction du travail de nuit des femmes imposée par la Cour de justice des Communautés européennes (). Sur les 800 000 femmes travaillant de nuit, de façon habituelle ou occasionnelle, en 1997, plus des trois cinquièmes exerçaient leur activité dans les métiers de la santé et de l’action sociale, dans les services aux particuliers et dans l’industrie. Enfin, la dispersion des horaires se renforce dans les métiers de la vente, tandis que le travail à temps partiel y a fortement augmenté (21% des employés de commerce en 1984, 29% en 1991 et 41% en 1998). La DARES souligne d’ailleurs que cela contribue presque mécaniquement à l’inégalité des conditions de travail entre les hommes et les femmes. En effet, « si les femmes travaillent moins souvent de nuit que les hommes, elles travaillent plus souvent le samedi ou le dimanche de façon régulière et sont plus nombreuses à ne pas bénéficier du repos de 48 heures consécutives. Tout ceci tient largement aux professions qu’elles exercent : employées des commerces ou des services aux particuliers, métiers de la santé, ouvrières non qualifiées de l’industrie agro-alimentaire ». En ce qui concerne les rythme de travail, de plus en plus de salariés ont des normes ou des délais à respecter ou doivent satisfaire une demande qui leur est présentée de manière immédiate : 23% des salariés se déclaraient dans cette situation en 1998 contre 16% en 1991. Une deuxième forme de flexibilité tient au recours à des emplois précaires. Selon des données de la DARES, de l’INSEE et de la direction de la prévision, la part des emplois temporaires non aidés a crû, entre 1985 et 1997, de 3,5% à 7,5% de l’emploi salarié total, cette part étant respectivement passée de 4% à 8% pour les hommes et de 3% à 7% pour les femmes. Par rapport au seul emploi salarié du secteur privé, cette part dépassait 10% en 1997 contre moins de 5% en 1985. Désormais, les entreprises utilisent ces emplois de façon habituelle pour adapter leur volume d’emploi aux variations de l’activité. La flexibilité est d’ailleurs largement imposée à l’entreprise de l’extérieur, par l’évolution des conditions de la demande : « la flexibilité du travail est ainsi, en quelque sorte, imposée au salarié par le consommateur » . Présentant les résultats de son enquête sur les conditions de travail de 1998, la DARES observe que si la pression de la demande demeure un déterminant fort des rythmes de travail des salariés du tertiaire, « c’est surtout dans l’industrie que la pression de la demande progresse. La prise en compte de la demande des clients dès le stade de la conception des produits, le raccourcissement des séries et des délais de production se traduisent par la diffusion des impératifs liés à la demande extérieure en amont des processus de production » (). Selon le terme de comparaison que l’on adopte - soit les conditions générales d’emploi qui prévalaient avant les chocs pétroliers, soit le niveau de chômage postérieurs à ces chocs - ces formes de flexibilité peuvent être considérées, dans le premier cas, comme l’indice d’un affaiblissement de la cohésion sociale, s’agissant de l’affaiblissement du modèle de l’emploi à temps complet « à vie » dans la même entreprise, dans le second cas, comme l’indice de nouvelles formes de régulation : l’apparition du chômage de masse ne pouvant que conduire à développer, aux marges de l’emploi, des formes précaires d’embauche jouant le rôle d’amortisseurs qui permettent d’éviter une détérioration du chômage. Cette vision est celle qui a été consacrée par ce que l’on a appelé le « manifeste Blair-Schroeder » selon lequel le travail à temps partiel et les « petits emplois » sont préférables au chômage car ils facilitent le passage du chômage à l’emploi. Il faut nuancer ce jugement. D’observations faites par l’INSEE (), on peut retenir, sur la base du constat de la forte progression tant du nombre de demandeurs d’emploi exerçant une activité réduite depuis le début des années 90, que des salariés travaillant à temps partiel : – en premier lieu, que l’exercice d’une activité réduite peut surtout aider à diminuer les facteurs d’exclusion des chômeurs de longue durée, comme la perte de capital humain ou le manque croissant de socialisation, « l’activité réduite semble finalement influencer assez peu les perspectives de sortie immédiate du chômage, en revanche son influence sur la probabilité future de sortie du chômage s’avère significativement positive [...] si la pratique d’une activité réduite ne s’accompagne pas toujours d’une probabilité d’embauche immédiate plus importante, elle constitue le gage d’une insertion différée plus favorable » ; – en second lieu, et à l’inverse, que plus le temps de travail diffère durablement du temps plein, plus les chances d’accéder à ce dernier diminuent : « les personnes à temps partiel long depuis un an accèdent plus facilement au temps complet que ceux dont la durée du travail est très réduite depuis deux ans. [...] L’emploi à temps partiel ne semble pas obéir à une logique de file d’attente [...] plutôt à un modèle de sélection : certains salariés sont dirigés vers le temps partiel [...] et rencontrent dès lors des difficultés à obtenir un emploi à temps plein ». d) Une approche européenne perfectible La Banque centrale européenne, dans son rapport annuel pour 1998, estime que le chômage de la zone euro est de nature largement structurelle. Elle met en cause la générosité des allocations de chômage et des autres prestations, la durée de la période d’indemnisation, le niveau élevé de l’imposition marginale sur le revenu et des cotisations sociales, le niveau élevé des cotisations patronales, les niveaux de salaires minimum, notamment pour les travailleurs jeunes ou peu qualifiés, les réglementations contraignantes protégeant l’emploi. Elle souligne la nécessité d’une plus grande flexibilité du temps de travail pour prendre en compte les besoins spécifiques des entreprises et celle de supprimer les freins à une plus grande extension du temps partiel. La politique de flexibilité reste donc une antienne des banquiers centraux. Pour sa part, la coordination politique européenne organisée par le traité d’Amsterdam, et appliquée de façon anticipée à la suite du Conseil européen de Luxembourg, passe par la mise en place d’une surveillance multilatérale. Ce processus en est à ses débuts. Le pacte européen pour l’emploi et le processus de coordination décidés lors du Conseil européen de Luxembourg (12-13 décembre 1997) ont défini une stratégie autour d’objectifs à atteindre au travers de plans nationaux d’action articulés suivant « quatre piliers » : – améliorer la capacité d’insertion professionnelle ; – développer l’esprit d’entreprise ; – encourager la capacité d’adaptation des entreprises et de leurs travailleurs ; – renforcer les politiques d’égalité des chances. Le Conseil européen de Cardiff (15-16 juin 1998) a ajouté un deuxième volet portant sur la nécessité d’engager des réformes améliorant la capacité concurrentielle et le fonctionnement des marchés des biens, des services et des capitaux (les réformes structurelles). Au Conseil européen de Cologne (3-4 juin 1999) a été ajouté un troisième volet organisant, au niveau de l’Union, un dialogue macro-économique régulier entre les acteurs concernés : gouvernements, Commission, Banque centrale européenne et partenaires sociaux. Les conclusions de la présidence du Conseil européen de Cologne sur le « Pacte européen pour l’emploi en vue de réduire durablement le chômage » indiquent qu’il s’agit d’intégrer dans un concept global toutes les mesures de l’Union dans le domaine de l’emploi : la coordination en matière de politique économique et l’amélioration de l’interaction entre l’évolution des salaires et la politique monétaire, budgétaire et financière grâce à un dialogue macro-économique afin de libérer une dynamique de croissance durable et non inflationniste (processus de Cologne), la poursuite du développement et l’amélioration de la mise en œuvre de la stratégie coordonnée en faveur de l’emploi (processus de Luxembourg) et la réforme et la modernisation en profondeur des structures économiques afin d’améliorer la capacité d’innovation et l’efficacité des marchés des biens, des services et des capitaux (processus de Cardiff). Des enseignements importants peuvent être tirés d’échanges de vues sur les différentes expériences nationales. Le Conseil européen de Cologne a donc invité la Commission à formuler, à partir de la comparaison des meilleures pratiques réalisées jusqu’à présent, des recommandations concrètes pour des mesures nationales dans le domaine de l’emploi. Cette stratégie repose donc sur la conception que les économies européennes et les marchés du travail nationaux se transforment profondément et rapidement, selon des voies qui sont communes à toutes les régions et à tous les bassins d’emploi. On peut s’interroger sur le point de savoir si les spécificités de chaque marché du travail, reflets de fortes pratiques sociales, ont été suffisamment prises en compte. En effet, la stratégie de la Commission européenne semble être de prôner la généralisation du modèle anglais ou néerlandais. Ce dispositif passe par la définition d’indicateurs de performances, au nombre de neuf visant : – l’emploi (croissance de l’emploi total, taux d’emploi total, taux d’emploi total en équivalent temps plein) ; – le chômage (taux de chômage global, part des jeunes chômeurs dans la population totale des jeunes ; taux de chômage de longue durée) ; – les performances économiques (croissance du PIB, évolution de la productivité apparente du travail, coût unitaire de main d’œuvre en termes réels). En pratique, la surveillance multilatérale consiste à sélectionner les trois meilleurs pays parmi les États membres, les autres devant s’efforcer de se rapprocher de ces « chiffres modèles ». Lors des Entretiens de l’emploi, la DARES a pu relever que « par rapport aux neuf critères, on est obligé de constater que ce sont toujours les mêmes pays qui sont les plus performants. Six pays ne sont en revanche jamais cités : il s’agit de pays d’Europe du Sud dont la France et la Belgique. Le modèle érigé en référence pour tous les États membres de la Communauté européenne est celui des marchés de travail des pays du Nord ou des pays anglo-saxons [...] Les pays bien placés à l’origine peuvent le rester sans faire trop d’efforts, tandis que d’autres pays qui partent de très loin seront toujours considérés comme mauvais ». Et cet intervenant a pu observer : « nous sommes aujourd’hui très éloignés des scrupules que nous pouvions éprouver hier avec la comparabilité des taux de chômage d’un pays à l’autre » (). Or l’exemplarité du modèle anglais ou celle du « miracle » hollandais demandent encore à être démontrées. Les contreparties du modèle anglais de lutte contre le chômage sont lourdes en termes d’inégalités et de pauvreté. Par ailleurs, la prise en compte du travail à temps partiel pour le calcul du taux d’emploi en équivalent temps plein aboutit à ce que les Pays-Bas présentent l’un des plus bas taux d’activité de l’Union européenne, sans parler de leur conception extensive de l’inadaptation sociale. Que, jusqu’à présent, ces modèles aient été vantés dans des colloques ou des revues pour « patrons de choc » est une chose. Qu’ils deviennent désormais la référence du dispositif de surveillance multilatérale et soient élevés au rang de recommandations adressées aux différents États membres en est une autre. Certes, les recommandations de la Commission européenne, comme elle l’indique elle-même, ne devront pas être considérées comme une sorte de sanction, mais comme l’occasion d’accomplir des progrès plus décisifs. Sur le fond, cela ne change pas grand chose, en particulier à la nécessité de mieux s’entendre sur la notion de progrès. Propositions de la Commission européenne au Conseil en vue de formuler des recommandations sur la politique de l’emploi de chaque État membre - 1999
Source : Commission européenne, Dossier Emploi, Volet III, 1999. e) Des politiques ciblées indispensables au maintien de la cohésion sociale A l’occasion des travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle que votre Commission des finances a choisi de faire porter, dès sa première session, sur la question de l’efficacité des aides à l’emploi, s’est posée la question de déterminer quel devait être l’objectif assigné à ces aides. Malgré les imperfections certaines dans la définition des agrégats disponibles, que la Mission a constatées, il est apparu que la tendance significative a été celle d’une augmentation de la dépense pour l’emploi, parallèlement à l’augmentation du chômage (394.000 demandeurs d’emplois en 1973 et 3 millions et demi en 1997). La part de cette dépense dans le produit intérieur brut est ainsi passée de 0,90% en 1973, à 2,31% en 1980, 3,37% en 1990 et se situe autour de 4% depuis 1993, sans tenir compte du coût des baisses générales de cotisations sociales sur les bas salaires introduites en 1993, lesquels ont porté ce pourcentage à 4,48% en 1997, soit son plus niveau. Le tableau suivant retrace l’évolution de cet agrégat depuis 1990. Sur cette période, le nombre des chômeurs a crû d’un million (de 2,5 millions à 3,5 millions) et la dépense pour l’emploi de près de 100 milliards de francs (de 219,3 milliards de francs à 318,1 milliards) hors exonérations générales de cotisations sociales et de près de 145 milliards en incluant ces dernières. La structure de la dépense pour l’emploi a évolué dans le sens de « l’activation » des dépenses. Les dépenses dites passives (indemnisation du chômage et incitation au retrait d’activité) sont passées de 56,8% du total en 1990 à 49,2% en 1997. Si cette part a progressé de 6% par rapport à 1996, alors qu’elle avait diminué en 1995 et 1996, c’est en raison de l’augmentation des dépenses d’indemnisation du chômage. En revanche, le coût des préretraites a diminué de - 21,5% depuis 1990. Les dépenses dites actives représentent 50,8% de la dépense pour l’emploi en 1997, alors qu’elles n’en représentaient que 43,2% en 1990. La formation professionnelle demeure la principale composante, des dépenses actives avec un total de crédits de 83,8 milliards de francs contre 67,37 milliards de francs en 1990.
Les membres de la Mission d’évaluation et de contrôle de votre Commission des finances ont considéré que la création nette d’emplois ne pouvait constituer l’unique critère pour juger de l’efficacité d’une aide à l’emploi. S’agissant en particulier des aides visant des publics spécifiques, elle a admis que leur efficacité devait s’apprécier en fonction de leur contribution à la réduction de la sélectivité du marché du travail à l’égard des salariés les moins qualifiés et des chômeurs de longue durée. Le tableau suivant présente une estimation des effets sur l’emploi et sur le chômage des dispositifs de politique de l’emploi. Pour la DARES, des effets nets positifs sur l’emploi et le chômage résultant des politiques de l’emploi apparaissent lorsque le nombre de bénéficiaires présents dans les dispositifs en fin de période est supérieur à celui des bénéficiaires du début de période. Les effets nets sont égaux à la variation du nombre de personnes présentes dans chaque dispositif diminuée de l’impact des effets de substitution entre travailleurs et des effets d’aubaine pour les employeurs.
En 1998, les dispositifs spécifiques ont permis la création de 37.000 emplois nets, soit un quasi doublement par rapport à l’année précédente. Une inflexion importante concerne les dispositifs non marchands. Leur effet sur l’emploi, qui était négatif à partir du second semestre 1995, redevient positif à compter du second semestre 1997. Il faut y voir l’effet de la mise en œuvre des emplois jeunes, dont la montée en puissance du dispositif succède à la baisse des entrées en contrats emploi solidarité (CES), dont le recentrage a été engagé dès 1995 et poursuivi depuis. La diminution du « stock » de bénéficiaires du contrat initiative emploi (CIE) explique la moindre progression des effets nets sur l’emploi des dispositifs spécifiques à l’emploi marchand. En ce qui concerne la faible contribution, en 1998, à la diminution du chômage de l’ensemble des dispositifs spécifiques de la politique de l’emploi (- 8.000), cette évolution est due à la réduction du nombre de bénéficiaires de stages, de conventions de conversion ou de préretraites. A cet égard, la DARES souligne le caractère « classique » de l’ampleur limitée des effets des dispositifs spécifiques sur le chômage en période de forte croissance de l’emploi. En outre, il convient de tenir compte des conséquences de la réorientation des politiques de l’emploi consécutives à l’abaissement général des cotisations sociales sur les bas salaires. Son effet sur le chômage a été estimé par la DARES à – 28.000 en 1998. La politique de réduction du temps de travail aura, à son tour, pour conséquence de limiter les effets des politiques spécifiques. Dans sa Note de conjoncture de juin 1999, l’INSEE indique qu’en 1999, les effets de la politique d’aide à l’emploi marchand sur les créations nettes d’emplois salariés devraient sensiblement dépasser ceux observés en 1998. Il est indiqué qu’outre les effets de l’allégement de cotisations sociales sur les bas salaires et de l’allégement de la taxe professionnelle, la réduction du temps de travail deviendrait le principal dispositif de la politique d’aide à l’emploi marchand, dont les effets les plus importants apparaîtraient à partir de l’été. 2.- L’amélioration de la situation de l’emploi et du chômage Divers indicateurs traduisent cette amélioration de la situation de l’emploi : l’importance des créations d’emplois, leur diffusion sur l’ensemble du territoire, le fait que les femmes ne restent pas à l’écart, et, in fine, la diminution significative du chômage. a) De significatives créations d’emplois La croissance de l’emploi, sensible dès 1997, s’est accentuée en 1998. Selon l’INSEE, l’emploi intérieur total est passé, en moyenne annuelle de 22.752.200 en 1996 à 22.821.600 en 1997 (+ 69.400, soit + 0,3%), puis à 23.086.800 en 1998 (+ 265.200, soit + 1,16%) (). Pour l’UNEDIC, dont les statistiques portent sur toutes les entreprises qui cotisent aux ASSEDIC, près de 300.018 emplois supplémentaires ont été créés en 1998. Ce sont les établissements de 200 à 499 salariés qui ont contribué le plus à la croissance de l’emploi. L’amélioration de l’emploi s’est confirmée au premier semestre 1999. Selon les résultats provisoires de la DARES, sur les six premiers mois de l’année, l’emploi salarié marchand a crû de 130.600 postes, c’est-à-dire suivant un rythme légèrement supérieur à celui observé en 1998 (hausse semestrielle de + 0,9% au lieu de + 0,8%). La DARES anticipe aussi une poursuite de l’amélioration de l’emploi au second semestre, qui pourrait permettre de créer plus d’emplois qu’en 1998. b) Des secteurs d’activité bien orientés Si l’on compare les niveaux atteints par l’emploi total à la fin des années 1997, 1998 et les prévisions pour 1999 dans l’ensemble de l’économie et ses différents secteurs d’activité, on observe les évolutions suivantes :
Dans sa note de conjoncture du mois de juin 1999, l’INSEE prévoyait environ 200 000 créations nettes d’emplois pour 1999, l’emploi manufacturier devant diminuer (- 25 000 postes), tandis que l’emploi dans le secteur tertiaire marchand augmenterait d’environ 220 000 postes et que le secteur de la construction créerait 10 000 emplois. L’INSEE prévoyait alors un léger ralentissement de la progression de l’emploi en 1999 par rapport à l’année précédente (+ 1,4 % en glissement annuel après + 1,8 %). Si l’on retient les résultats provisoires publiés par la DARES, dans son enquête trimestrielle sur l’activité et les conditions d’emploi de la main d’œuvre (ACEMO), pour le deuxième trimestre de 1999, l’emploi salarié aurait crû de 130 600 postes au cours des six premiers mois de l’année, c’est-à-dire selon un rythme légèrement plus rapide qu’en 1998. En faisant l’hypothèse d’un maintien du niveau de l’activité économique, la DARES prévoit une possibilité de dépasser, en 1999, le nombre de créations d’emplois de 1998. Pour cette dernière année, l’INSEE estime à +2,2 % en glissement annuel, l’évolution de l’emploi salarié dans les secteurs concurrentiels (soit une création de 313 000 emplois). En 1998, l’emploi salarié du secteur tertiaire non marchand a maintenu sa forte progression (+ 3,5 %, après + 2,9 % en 1997). Pour leur part, les effectifs de l’industrie ont crû de 14 000 emplois (soit une augmentation de 0,5 % en glissement annuel, après une diminution de 0,7 % en 1997). L’INSEE prévoyait une contraction de l’emploi industriel au premier semestre de 1999, confirmée par l’enquête ACEMO de la DARES, ce qui devrait conduire à une diminution de l’emploi industriel de l’ordre de 25 000 postes selon l’INSEE. Les effectifs du secteur de la construction sont stables en 1998, ils devraient, selon l’INSEE, connaître une création de près de 10 000 emplois. La croissance de l’emploi dans le secteur tertiaire non marchand a trouvé son origine dans la mise en œuvre des dispositifs de la politique de l’emploi (accroissement du rythme des emplois jeunes et des emplois consolidés venant plus que compenser les effets du recentrage des contrats emplois solidarité). En 1999, près des trois quarts des 138 000 emplois dont la création devrait intervenir dans ce secteur seraient des emplois aidés. c) Une amélioration dans toutes les régions En ce qui concerne les évolutions régionales, le bilan de l’année 1998, tel qu’il a été établi par l’UNEDIC, fait apparaître, pour la deuxième année consécutive, une progression des effectifs dans toutes les régions de France métropolitaine. Certaines régions demeurent en dessous de la moyenne nationale (+ 2,1%). C’est le cas de la Bourgogne (+ 1%), de la région Champagne-Ardenne (+ 1,2%), de la Picardie et de la Haute-Normandie (+ 1,3% chacune). L’emploi dans la région Ile de France, première région d’emplois comptant 25,3% des salariés, progresse de + 1,9%, cette progression résultant essentiellement du secteur tertiaire (+ 3,3%), alors qu’elle perd le plus d’emplois dans l’industrie (- 2,1%) et la construction (- 3,7%). Les régions dont l’emploi progresse le plus sont la Corse (+ 6,7%), le Languedoc-Roussillon (+ 3,5%) et la région Midi-Pyrénées (+ 3,5%). La Bretagne progresse également à un rythme soutenu (+ 2,8%) ainsi que la région Rhône-Alpes (+ 2,5%), la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (+ 2,4%) et la Basse-Normandie (+ 2,2%). d) Une progression plus forte de l’emploi féminin Selon l’enquête annuelle de l’INSEE, les emplois créés entre mars 1988 et janvier 1999 () se sont élevés à 218.000 dont 72.000 occupés par des hommes et 146.000 par des femmes. Une part de cette « féminisation » doit sans doute trouver son origine dans le fait qu’en période de reprise, les emplois à temps partiel ou intermittents, traditionnellement occupés de façon majoritaire par des femmes, sont les premiers concernés.
Selon l’enquête emploi, le nombre des personnes ayant un emploi a atteint 22 983 000, soit un taux d’emploi de 48,2 %, en très légère augmentation par rapport à mars 1998 (48,1 %). L’emploi salarié explique, à lui seul, l’augmentation du nombre des actifs occupés, alors que la diminution du nombre d’emplois non salariés s’est infléchie par rapport aux années antérieures (- 32 000 depuis mars 1998, alors que la diminution se situait entre – 60 000 et – 75 000 emplois par an de 1995 à 1998). L’emploi salarié a crû de 249 000 personnes, la hausse étant forte pour les emplois permanents du secteur privé (+ 302 000). La progression des emplois à durée limitée (intérim, apprentissage, contrats aidés et contrats à durée déterminée) se ralentit (+ 58 000 personnes depuis mars 1998, au lieu de + 151 000 personnes entre mars 1997 et mars 1998). Au début de l’année 1999, « ces emplois (expliquaient) un quart de la hausse de l’emploi intervenue depuis dix mois contre plus de la moitié de celle enregistrée de mars 1997 à mars 1998 ». Pour la première fois depuis mars 1995, le nombre des contrats à durée déterminée a diminué (- 14 000 par rapport à mars 1998). Enfin, le travail à temps partiel a ralenti sa progression : 17,2 % des actifs occupés travaillaient à temps partiel en janvier 1999, contre 17,1 % en mars 1998). e) Une nouvelle diminution du chômage Le chômage a continué sa décrue en 1998. Le nombre des demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM inscrits à l’ANPE dans la catégorie 1, c’est-à-dire les personnes à la recherche d’un emploi à durée indéterminée et à plein temps, immédiatement disponibles) a retrouvé son niveau du début 1993 : 2 917 000 demandeurs inscrits, soit une diminution de 4,4 % par rapport l’année précédente (- 13 500 inscrits). La diminution du nombre des demandeurs d’emploi des catégories 1 + 6 (la catégorie 6 comprend les personnes à la recherche d’un emploi sous contrat à durée indéterminée et à plein temps non immédiatement disponibles, car ayant travaillé plus de 78 heures dans le mois de référence) a diminué de 3 %. Le taux de chômage au sens du BIT a été ramené de 12,3 % à la fin de 1997 à 11,5 % à la fin de 1998. De janvier à juillet 1999, la diminution du nombre des demandeurs d’emploi de la catégorie 1 a atteint 146 800 (123 800 pour les demandeurs d’emploi des catégories 1 + 6). Ces chiffres témoignent d’une accélération de la diminution du nombre des demandeurs d’emploi par rapport à 1998 (le rythme mensuel de diminution du nombre des demandeurs d’emploi de catégorie 1 était de 12 600 en 1998, depuis le commencement de l’année, ce rythme s’établit à 21 000). Il faut toutefois relever que de nouvelles dispositions ont étendu le régime de la dispense de recherche d’emploi aux demandeurs âgés de 55 à 57 ans et demi bénéficiaires de l’allocation de chômeur âgé, soit environ 14 000 demandeurs d’emploi de catégories 1 et 6. Toutefois, la DARES souligne que « le sens des évolutions précitées et en particulier la poursuite de la baisse du chômage ne sont pas remis en cause ». Le chômage de longue durée (demandeur d’emploi depuis inscrit un an et plus) a diminué de 9 % entre juillet 1998 et juillet 1999. Il s’élevait à 1 022 276 en données brutes au mois de juillet 1999. Un fléchissement du niveau du chômage n’est pas nécessairement accompagné d’un recul du chômage de longue durée par rapport au chômage total. Le premier augmentait fortement depuis 1996. Il s’est stabilisé au premier semestre de 1998 et a commencé à décroître au second semestre. Ce recul se poursuit. · Les résultats de nos principaux partenaires En termes de comparaisons internationales, la situation de la France peut être vue de deux façons. En termes de situation relative, notre pays reste dans une situation défavorable par rapport à la moyenne de l’Union européenne (7,1% en 1998, soit 4,7 points de moins que le résultat français), des pays européens de l’OCDE (9,7% en 1998, soit 2,1 points de moins que le résultat français) ou de l’OCDE (7,1%, soit 4,7 points de moins que le résultat français).
Avec un taux de chômage de 11,8% selon les chiffres de l’OCDE, la France enregistre en 1998 le résultat le plus défavorable après l’Italie (12,2%). En outre, il convient de noter que, sur la période 1996-1998, son taux de chômage n’a baissé que de 0,5 point dans le temps où il baissait de 2,5 points aux Pays-Bas, 1,3 point au Royaume-Uni et 0,9 point pour l’ensemble de l’Union européenne et aux Etats-Unis. Ces chiffres ne doivent pas être perçus comme trop décevants, car alors que le taux français avait augmenté de 0,8 point en 1996, il diminue désormais et il se trouve sur une pente descendante. Dans la même période, le chômage a augmenté, par exemple, en Allemagne et en Italie, les deux autres économies comparables de la zone euro. En outre, en 1998, ce taux a baissé de 0,6 point en France, c’est-à-dire presque autant que pour l’ensemble de l’Union européenne (baisse de 0,7 point), ce qui signifie que l’écart avec la moyenne européenne se réduit.
Le taux de croissance de la population active française se rapproche beaucoup de celui de l’Union européenne. En revanche, l’autre enseignement de ce tableau est qu’une augmentation de la population active n’est pas nécessairement synonyme de difficultés supplémentaires en matières de chômage, puisque des pays qui connaissent un taux d’augmentation de leur population active supérieur à la moyenne de l’OCDE (comme les Etats-Unis) ou de l’Union européenne (comme les Pays-Bas) obtiennent pourtant des résultats, en matière de chômage, meilleurs que la moyenne de l’OCDE ou que celle de l’Union européenne. A l’inverse, des pays comme l’Allemagne ou l’Italie dont la population active a crû moins vite que la moyenne de l’OCDE ou de l’Union européenne présentent des taux de chômage moins favorables que la moyenne de l’OCDE ou de l’Union européenne. · Le chômage a reculé dans toutes les régions entre 1997 et 1998 De décembre 1997 à décembre 1998, le chômage a reculé dans toutes les régions. En moyenne, cette réduction a été d’un point. Des disparités selon les régions ont marqué cette réduction, liées, selon l’INSEE aux mesures de politiques de l’emploi.
Cette diminution a été largement supérieure à la moyenne nationale en Auvergne et en Franche-Comté (- 1,8 point), en Champagne-Ardennes et dans la région Centre (- 1,7 point). La baisse a été inférieure à la moyenne nationale dans la région Ile de France (- 0,8 point) ainsi que dans la région Midi-Pyrénées (- 0,6 point) et dans la région Rhône-Alpes (- 0,9 point). L’INSEE souligne que « depuis le milieu des années quatre-vingt, les zones les plus touchées par le chômage restent le Languedoc Roussillon, la Provence-Alpes-Côte-d’Azur, qui bénéficient d’un excédent migratoire d’actifs, le Nord-Pas-de-Calais et la Haute-Normandie, régions en reconversion industrielle difficile ». B.– LES MÉNAGES RESTENT LE PIVOT D’UN RETOUR DURABLE DE LA CROISSANCE La consommation des ménages constitue un facteur primordial de l’évolution de la croissance : elle représente environ 60% du produit intérieur brut, près du double des exportations et plus de trois fois le montant des investissements. Dès lors, la très forte progression de la consommation enregistrée en 1998 a permis à la demande intérieure de devenir le moteur de l’expansion, alors qu’en 1997 la croissance était tirée par la demande extérieure. La croissance de 1998 a ainsi été « vertueuse », car elle a gagné en autonomie.
La demande des ménages devrait toujours constituer le premier soutien de la croissance en 1999 et 2000, même si un léger infléchissement a pu être constaté lors du premier semestre de cette année. Toutefois, l’investissement en logement des ménages demeure vigoureux et la consommation devrait être encore fortifiée par l’allégement des impôts programmé par le Gouvernement. 1.– Une consommation toujours bien orientée, malgré un léger tassement a) Une progression sensiblement supérieure à la moyenne de ces dernières années La consommation des ménages a connu une croissance exceptionnelle en 1998, avec une progression de + 3,6% en moyenne annuelle, soit l’évolution la plus forte depuis plus de dix ans.
Le premier semestre 1999 a été marqué par un fléchissement des dépenses de consommation des ménages : elles n’ont progressé que de 0,2% au premier trimestre et de 0,6% au trimestre suivant, soit un acquis de croissance pour l’année 1999 de + 1,8%, correspondant à la moitié de la progression de ces dépenses l’année précédente. Il convient, cependant, d’observer que : – tout d’abord, la consommation des ménages contribue encore fortement à la croissance du PIB ; au deuxième trimestre 1999 le PIB a augmenté de 0,6% et les dépenses de consommation ont contribué positivement pour 0,3 point à cette croissance ; – ensuite, l’évolution enregistrée ces derniers mois est encore supérieure à celle constatée avant 1998 : entre 1979 et 1997, le volume de la consommation des ménages a cru de 1% par an en moyenne (). – enfin, dans sa Note de conjoncture de juin dernier, l’INSEE considère que ce fléchissement est en grande partie imputable à des facteurs exceptionnels (baisse des dépenses de tabac à la suite d’augmentations importantes de prix ; repli des dépenses énergétiques après les conditions climatiques rigoureuses du quatrième trimestre 1998) et que les dépenses de consommation des ménages devraient de nouveau progresser vivement au second semestre (2,2% en rythme annualisé) et ainsi augmenter de 2,1% en moyenne annuelle. La bonne tenue des dépenses de consommation des ménages est particulièrement perceptible dans le domaine des produits manufacturés, et, en particulier, dans le secteur de l’automobile et dans celui des matériels informatiques et téléphoniques. Les achats de véhicules automobiles ont connu en 1998 une progression spectaculaire (+ 14,4% en volume). Il s’agissait, en fait, pour une grande part, d’une conséquence indirecte des primes à l’achat instaurées par les gouvernements de MM. Edouard Balladur et Alain Juppé. Ces mesures avaient provoqué des achats anticipés, suivis d’une chute des ventes après leur suppression. La situation revenant progressivement à la normale, il en est résulté, par un simple effet mécanique, une croissance plus forte des achats. Dès lors, le ralentissement observé pendant les deux premiers trimestres de 1999 (+ 0,4% pour le premier et – 1,2% pour le deuxième) peut être relativisé, d’autant que les dépenses de consommation des ménages relatives aux véhicules automobiles ont progressé de 5,4% en volume de juin 1998 à juin 1999. En outre, les derniers chiffres publiés par l’INSEE indiquent que les achats des ménages en automobiles ont augmenté de 22,5% en juillet dernier et sont demeurés quasiment à ce niveau en août (-0,4%). La diffusion de l’équipement micro-informatique et téléphonique, ainsi que des services liés à ces produits, en particulier les télécommunications mobiles, est un autre facteur du dynamisme de la consommation. Les ventes de micro-ordinateurs auprès des ménages ont pratiquement quintuplé en volume en quatre ans et, au 31 décembre 1998, le marché français du téléphone mobile comptait 11,2 millions de clients, contre 5,8 millions un an plus tôt. L’INSEE observe toutefois que « ces produits innovants représentent une part relativement faible de la consommation et ne rendent donc pas compte de toute l’ampleur des progressions passées. En 1998, par exemple, ils contribuent pour environ 0,4 point à la progression de la consommation totale () ».
En 1998, le dynamisme des dépenses de consommation a été permis par la vive progression du revenu disponible brut des ménages et par une réduction du taux d’épargne, cette réduction étant encouragée par la confiance retrouvée, elle-même liée au redressement de l’emploi. Il est probable qu’en 1999, ces mêmes facteurs continueront à influer positivement sur la consommation des ménages, même si le ralentissement des créations d’emplois et la reprise modérée de l’inflation devraient peser sur l’évolution du revenu réel. · Une croissance soutenue du revenu disponible brut des ménages Le revenu est le déterminant principal de la consommation. Or, le revenu disponible brut des ménages devrait progresser de 3,2% en 1999, après une croissance de 3,6% en 1998.
Globalement, cette évolution serait imputable à un ralentissement des revenus d’activité, à une légère accélération des prestations sociales en espèces, et à une stabilité d’ensemble des prélèvements obligatoires. – Les revenus d’activité progresseraient de 3,2% en 1999, contre 3,7% en 1998. En effet, la progression de la masse salariale reçue par les ménages devrait ralentir en 1999 : + 3,3% en moyenne annuelle, après + 3,9% en 1998, en raison principalement du fléchissement des créations d’emploi. Toutefois, le salaire horaire de base ouvrier (SHBO) devrait augmenter à un rythme un peu supérieur à celui observé en 1998, même si le léger redressement des prix à la consommation devrait se traduire par une stabilité de la progression du pouvoir d’achat du SHBO. Les revenus des non-salariés subiraient également le ralentissement de l’activité. La croissance de l’excédent brut d’exploitation des entreprises individuelles s’établirait ainsi à + 2,6% en 1999, après + 3% en 1998. En revanche, l’indice des traitements de la fonction publique devrait progresser de 1,4% contre 1,3% en 1998, soit une augmentation du pouvoir d’achat de 0,8% contre 0,6% en 1998. – Les prestations sociales en espèces () devraient s’accroître légèrement en 1999 : + 3,3%, après + 2,8% en 1998. Cette évolution serait en partie due à la forte progression des prestations familiales en 1999, dont la croissance devrait atteindre 4,3%, après une diminution de 0,4% l’année précédente. Toutefois, si l’universalité des allocations familiales a été rétablie au 1er janvier 1999, cette augmentation des versements est compensée par la baisse du plafond du quotient familial, si bien qu’au total, l’ensemble des mesures ayant effet en 1999 n’affecte pas le revenu des ménages. Les prestations chômage devraient également connaître une augmentation en 1999. Cette évolution s’expliquerait, d’une part, par la reconduction de l’ARPE (Allocation de remplacement pour l’emploi) et, d’autre part, par le vieillissement de la population des chômeurs. En effet, malgré le recul du chômage, le nombre de chômeurs âgés, qui touchent des indemnités plus élevées, augmenterait en 1999. Les prestations vieillesse devraient progresser au même rythme que l’année précédente. En revanche, les prestations en espèces versées par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), en majeure partie constituées des indemnités journalières, devraient ralentir en 1999. Les « autres prestations sociales » () versées par les administrations publiques ne devraient pas connaître de changements par rapport à l’année précédente. – Enfin, comme cela sera indiqué de façon plus détaillée ci-après, le poids des prélèvements obligatoires devrait s’accroître, malgré les baisses d’impôt arrêtées en lois de finances. · Une inflation toujours maîtrisée permettant des gains de pouvoir d’achat Comme cela a été indiqué précédemment, l’augmentation des prix reste faible et les prix à la consommation hors tabac ne devraient progresser que de 0,6% en moyenne annuelle, contre 0,7% en 1998, année où la hausse des prix avait pourtant été la plus faible constatée depuis 1953. Compte tenu de cette faible inflation, le pouvoir d’achat des ménages progresserait de 2,7% en moyenne annuelle, soit une croissance proche de celle enregistrée en 1998 (+2,8%). · Une confiance retrouvée permettant une réduction de l’épargne L’indicateur résumé d’opinion des ménages, calculé chaque mois par l’INSEE, atteint des niveaux historiquement élevés depuis juillet 1998. L’optimisme des ménages résulte manifestement de la croissance de leur pouvoir d’achat, ainsi que de la croissance de l’emploi et de la baisse du chômage. Il est notable que cette confiance n’ait été affectée ni par la crise asiatique, ni par la crise financière en Russie et au Brésil, ni par les événements du Kosovo, et que le solde d’opinion relatif à l’opportunité d’acheter, qui présente une corrélation importante avec l’évolution des dépenses des ménages, continue d’afficher des niveaux importants. Dès lors, on a assisté en 1998 à un relâchement progressif du comportement de précaution des ménages, qui s’est traduit par une baisse de 0,7 point du taux d’épargne (15,4% en 1998, contre 16,1% en 1997). Ce dernier est brusquement remonté à 16% au tout début de 1999, mais tend de nouveau à diminuer, ce qui permet notamment de soutenir l’investissement des ménages. 2.- Une forte reprise de l’investissement des ménages L’investissement des ménages correspond essentiellement à l’investissement en logement. Ce dernier avait reculé depuis le début des années quatre-vingt-dix : lors de l’enquête « budget de famille » de l’INSEE de 1984, l’investissement en logement représentait près de 90% de l’épargne mesurée ; il n’était plus que des deux tiers lors de l’enquête similaire de 1995 (cette modification de structure avait pour contrepartie un fort développement des assurances-vie et retraite). L’investissement des ménages en logement a toutefois progressé de manière soutenue depuis 1998. Ainsi, à Paris, les ventes de logements neufs ont augmenté de 50% par rapport à 1997 et les ventes de logements anciens de 19% (). Ce mouvement se poursuit en 1999. Sur l’ensemble du territoire métropolitain, les autorisations de construire ont ainsi connu une progression de 21,3% au cours du premier trimestre 1999 par rapport au même trimestre de 1998. Au cours de cette période, les mises en chantier ont progressé de 22,4% (). La maison individuelle comme le logement collectif ont bénéficié de cette conjoncture favorable. Au total, l’investissement des ménages en logement devrait évoluer en 1999 à un rythme bien supérieur à 5%. Plusieurs facteurs expliquent cette hausse sensible : la volonté des investisseurs de bénéficier de « l’amortissement Périssol » avant la cessation de ce dispositif ; l’arrêt de la baisse des prix des logements anciens et l’augmentation de ceux des logements neufs, ce qui met fin aux comportements attentistes ; la baisse des taux d’intérêt (entre le premier trimestre de 1998 et le premier trimestre de 1999, la baisse du coût des crédits aux particuliers a atteint 0,5 point environ pour les crédits immobiliers à taux variables et 1,1 point pour ceux à taux fixes), qui favorise la progression de l’endettement intérieur des ménages (en avril 1999, les crédits à l’habitat ont augmenté de 6,5%) ; enfin, la baisse des droits de mutation décidée dans le cadre de la loi de finances pour 1999. Les nombreuses mesures en faveur du logement figurant dans le projet de loi de finances pour 2000 devraient conforter cette évolution favorable. 3.- Soutenir ce processus en allant plus loin dans l’allégement des prélèvements pesant sur les ménages Les prélèvements obligatoires, après une forte progression ces dernières années, sont stabilisés à un niveau élevé, correspondant – en grande partie – au niveau et à la qualité des prestations fournies à la Nation. Le soutien de la croissance exige néanmoins une réduction de ces prélèvements. a) Des prélèvements obligatoires à un niveau élevé En 1998, l’ensemble des prélèvements obligatoires, calculés selon la nouvelle base 95 de comptabilité nationale, représentait 44,9% du produit intérieur brut, soit un ratio identique à celui constaté en 1997. S’agissant de 1999, une hausse devrait être constatée, puisque le taux des prélèvements obligatoires serait de 45,3%. Cette évolution est en grande partie liée à une conjoncture moins bonne que prévu (une croissance et une inflation inférieures aux prévisions figurant dans le projet de loi de finances pour 1999 vont mécaniquement provoquer une hausse des prélèvements obligatoires). Cette hausse a été confortée par les bonnes rentrées de l’impôt sur les sociétés et par l’augmentation du montant global des cotisations sociales imputable à la croissance de la masse salariale. Cette stabilisation doit être appréciée au regard de l’évolution des années précédentes. En effet, de 1993 à 1995, les prélèvements obligatoires avaient progressé de 0,6 point de PIB, tandis que cette augmentation a atteint 1,2 point de PIB entre 1995 et 1996, sous l’effet notamment de la majoration du taux normal de TVA, porté de 18,6% à 20,6%. Le tableau ci-après présente l’évolution des prélèvements obligatoires depuis 1995.
b) Une importance à relativiser Les comparaisons établies avec nos principaux partenaires économiques sembleraient prouver que les prélèvements obligatoires sont particulièrement élevés dans notre pays.
Il convient, cependant, de noter que ces comparaisons doivent être effectuées avec prudence, tant la notion de prélèvements obligatoires est conventionnelle. A titre d’illustration, il suffit de rappeler que l’adoption par l’INSEE du nouveau système européen de comptabilité SEC 95 a conduit à diminuer le taux des prélèvements obligatoires pour 1995 de 0,5 point par rapport au calcul effectué dans l’ancienne base 80. En outre, pour les comparaisons de prélèvements obligatoires, seuls sont pris en compte les régimes d’assurance obligatoires. Cette méthodologie introduit un biais important s’agissant de la situation française caractérisée par l’importance des régimes obligatoires de sécurité sociale. La structure des recettes montre une fiscalité légèrement supérieure, mais tout à fait comparable à la moyenne européenne. Comme l’observe un rapport de notre poste d’expansion économique de Londres () le poids réel des charges sociales du Royaume-Uni ne se limite pas au poids des charges obligatoires, car ceux qui le peuvent souscrivent systématiquement des retraites et des assurances sociales complémentaires. Or, « l’addition de ces taux facultatifs maximum avec les taux obligatoires aboutit à des taux globaux supérieurs aux taux pratiqués en France, pour une protection inférieure ou égale ». En effet, pour porter une juste appréciation sur le niveau des prélèvements obligatoires, il convient également de tenir compte de la nature et de l’importance des services rendus en contrepartie. Or, on peut affirmer sans grand risque de se tromper que la France a visiblement un niveau de service public élevé et que ses habitants y sont attachés. Il n’en est pas moins vrai que les prélèvements obligatoires sont plus élevés que chez nombre de nos partenaires et que cela conduit à un excès de taxation du travail nuisible, à la fois, à l’offre et à la demande de travail. C’est pourquoi, il apparaît souhaitable d’affecter, comme le prévoit le présent projet, une large part des surplus générés par la croissance à la baisse des prélèvements obligatoires. c) Poursuivre un mouvement engagé en 1997 Corsetée par des déficits publics et des taux d’intérêt excessifs, ainsi que par les décisions successives de relèvement des prélèvements obligatoires, la demande intérieure, entre 1993 et 1997, a contribué à la stagnation de la croissance durant cette période. Contrairement à son prédécesseur, qui avait décidé de mettre fortement les ménages à contribution par un relèvement de la TVA en 1995, le Gouvernement a su mener, depuis l’été 1997, une politique de soutien de la consommation : revalorisations du SMIC au 1er juillet 1997 et 1998 supérieures au minimum légal ; création d’un crédit d’impôt sur le revenu, remboursable pour les personnes non imposables, pour les dépenses d’entretien afférentes à l’habitation principale ; plafonnement à 1.500 francs de la taxe d’habitation pour les redevables aux ressources très faibles ; maintien de la réduction d’impôt pour frais de scolarité que la loi de finances pour 1997 prévoyait de supprimer ; baisses ciblées de la TVA (en particulier sur les travaux dans les logements sociaux) ; basculement des cotisations maladie sur la CSG… Le rapport économique, social et financier associé au projet de loi de finances pour 1999 montrait ainsi que les mesures décidées depuis juin 1997 ont entraîné un allégement sensible de la charge fiscale et sociale pour 90% des ménages. Cet effort sera poursuivi en 2000 grâce, en particulier, à la baisse de la TVA sur les travaux dans les logements, à la nouvelle diminution des droits de mutation à titre onéreux et à la suppression progressive du droit de bail pesant sur les locataires. Ainsi, les prélèvements obligatoires devraient s’établir à 44,8% en 2000. La stabilisation serait ainsi confirmée et une décrue pourrait être mise en œuvre pour satisfaire aux engagements figurant dans le programme pluriannuel de finances publiques, notifié à la Commission européenne en janvier dernier et qui a pour objectif, à l’horizon 2002, une diminution comprise entre 0,5 et 0,8 point de PIB. Il convient, dès lors, de s’interroger sur les modalités futures de répartition de l’allégement de la charge. Après avoir mis l’accent sur l’allégement de la fiscalité indirecte en 2000, le Gouvernement a déjà annoncé qu’il travaillait, pour 2001, à une réforme de la fiscalité directe sur les ménages. Votre Rapporteur général approuve cette orientation et souhaite que soit particulièrement privilégiée la diminution de la taxation des ménages les plus modestes, par exemple par un élargissement du champ d’application de la décote. Comme le soulignent les auteurs d’un récent rapport du Conseil d’analyse économique (), un effort particulier doit fait en vue de la réduction des taux marginaux élevés au bas de l’échelle de la distribution des revenus, qui constituent des « trappes à pauvreté ou à inactivité », puisque les ménages concernés ne pourraient prétendre qu’à des revenus d’activité inférieurs aux transferts dont ils bénéficient en étant inactifs. Il convient, en particulier, de s’interroger sur l’opportunité de mettre en œuvre un dispositif d’impôt négatif ou d’allocation compensatrice des revenus, de manière à éviter ces effets pervers. Par ailleurs, il serait souhaitable d’alléger la CSG des contribuables modestes en cherchant à moduler sa perception de façon très ciblée. Ces mesures s’inséreraient dans une politique globale visant à réduire les déséquilibres de la société française. C.- UNE OPPORTUNITÉ POUR FAIRE RECULER LES DÉSÉQUILIBRES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE Parmi les mutations, souvent saluées, de l’économie française, il en est une, préoccupante, qui concerne les grands mécanismes de la répartition du travail et des revenus. Le chômage de masse, la crise du modèle salarial et un rapport de force devenu défavorable aux salariés au sein des entreprises, semblent bien avoir engendré exclusion, accélération des inégalités et violences urbaines. Un point mérite d’être fait sur certains de ces déséquilibres économiques et sociaux, à travers le niveau de la pauvreté, l’avenir des retraites, les inégalités entre les territoires et les perspectives ouvertes par la réduction du temps de travail. 1.- Exclusion, précarité et Etat providence A l’heure où le chômage recule, où le taux de croissance reste soutenu, où les recettes fiscales dépassent assez sensiblement les prévisions pour 1999 et où les excédents commerciaux sont historiquement élevés, il est légitime de s'interroger sur l'évolution de la pauvreté. Pauvreté et exclusion peuvent-elles régresser du seul fait de la bonne santé de l’économie? Quel est l’impact des transferts et des impôts résultant de l’Etat providence ? a) Une pauvreté persistante Le lien entre taux de croissance et taux de pauvreté est plutôt lâche. Malgré la croissance économique aux États-Unis, les ménages qui touchent moins de la moitié du revenu médian (selon la définition conventionnelle du seuil de pauvreté) représentent toujours, dans ce pays, plus de 20% de la population. Au Royaume-Uni, la politique de réduction des transferts sociaux (indemnités de chômage non proportionnelles au salaire et d’une durée limitée à six mois, baisse relative du pouvoir d’achat des retraites…) introduite par les conservateurs au milieu des années 1980, a provoqué une forte et persistante hausse de la pauvreté malgré des résultats économiques et de niveau d’emploi plus favorables que dans le reste de l’Europe jusqu’à ces dernières années. A l’inverse, en Allemagne, dans les Länder occidentaux, à haut niveau de protection sociale, le taux de chômage est passé de 1% en 1973 à 8% en 1995, alors que, dans le même temps, le taux de pauvreté progressait de seulement trois points. En France, le RMI et la revalorisation des retraites ont permis d’éviter la progression du taux de pauvreté. Néanmoins, ce taux de pauvreté se maintient à un niveau inacceptable. Si l’on s’en tient, en effet, à la définition monétaire du seuil de pauvreté, déjà évoquée dans mon précédent rapport général sur le projet de loi de finances pour 1999 (), depuis quinze ans, invariablement, 10% des ménages vivent en France dans la pauvreté, même si ses manifestations ont pu évoluer. En réponse aux principales manifestations de la pauvreté, exclusion du logement, de l’éducation, du crédit ou de la santé, le pays s’est doté au cours des deux dernières années de nouveaux instruments de protection sociale. b) Des nouveaux instruments de lutte contre l'exclusion Le système français des minima sociaux (voir tableau ci-dessous) apparaît complexe et diversifié, avec huit prestations différentes, dont le niveau répond clairement à la volonté de préserver l’attractivité de l’emploi et, à l’exception du RMI, dépourvues de règles de revalorisation. Ces minima sont des allocations différentielles et, en conséquence, tout revenu perçu en deçà du plafond de ressources entraîne une réduction à due proportion du montant de l’allocation, mécanisme qui décourage l’emploi, en raison de son automatisme et de sa brutalité, et contribue à générer de véritables « trappes à pauvreté ». Cette situation, à laquelle s'ajoutent les difficultés des jeunes qui ne perçoivent pas le RMI et sont largement exclus de l’indemnisation du chômage, a engendré de graves phénomènes d’exclusion auxquels il était temps d’apporter des remèdes.
Le 4 mars 1998, le Gouvernement a présenté un important programme de « prévention et de lutte contre les exclusions » portant sur trois années (1998-2000) et représentant un engagement de 51,4 milliards de francs, dont 38,4 milliards à la charge de l’Etat. Plusieurs projets de loi étaient directement associés à ce programme. Les deux textes piliers sont la loi d’orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions et la loi n° 99-641 portant création d’une couverture maladie universelle (CMU) du 27 juillet 1999. La loi d’orientation contre les exclusions, qui contient des lignes d’action générale mais aussi des dispositions précises et particulières, ne vise pas tant à reconnaître des nouveaux droits qu’à garantir l’accès à ceux existant. L’accès à l’emploi figure évidemment en tête des dispositions de la loi avec des mesures favorisant l’accompagnement personnalisé pour toute personne écartée du marché du travail et d’autres incitant financièrement à la reprise d’activité pour les bénéficiaires de minima sociaux. Ainsi, le dispositif TRACE offre aux jeunes de seize à vingt-cinq ans en grande difficulté, sans emploi et sans qualification, un parcours d’insertion personnalisé pouvant durer dix-huit mois et ouvrant droit à rémunération, articulant des actions de bilan, de mise en situation professionnelle, des formations préqualifiantes et qualifiantes et, éventuellement, des mesures d’accompagnement concernant, par exemple, le logement. Ce programme, piloté par les missions locales pour l’insertion des jeunes, a été lancé dès 1998 et devrait concerner 40.000 jeunes en 1999 et 60.000 l’an prochain. Le coût du programme TRACE est évalué à 5,1 milliards de francs pour la période 1998-2000, dont 4 milliards de francs au titre des contrats aidés et des stages et 1,1 milliard de francs pour les moyens d’accompagnement (700 millions de francs en 2000, dont 566 millions de francs pour le renforcement des missions locales). Un rapport d’évaluation de l’application de la loi sera établi tous les deux ans et le premier avant la fin de l'an 2000. Il s’appuiera notamment sur les travaux de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale que la loi a créé. La portée de la loi d’orientation sera, bien entendu, conditionnée par le maintien durable d’un effort financier significatif. Une bonne coordination sur le terrain, impulsée par la loi, entre les intervenants, notamment, entre les représentants de l’Etat et ceux du département devrait permettre une cohérence meilleure que par le passé de l’action publique. Le principe de l’accompagnement personnalisé des personnes en grande difficulté, axe majeur de la loi, devrait induire de réels décloisonnements entre les différents intervenants (emploi, logement, santé, endettement…) La loi créant la CMU entrera, pour sa part, en vigueur le 1er janvier 2000, de nombreux décrets d’application devant encore intervenir. Toute personne résidant en métropole ou dans les DOM et qui ne bénéficie, à aucun titre, des prestations d’un régime d'assurance maladie, sera affiliée au régime général du fait de sa résidence « stable et régulière » en France. Cette affiliation se fera sans contrepartie contributive et ouvrira un droit à une couverture complémentaire, pour les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret et révisé chaque année (ce plafond devrait être fixé, dans un premier temps, à 3.500 francs pour une personne seule). Six millions de personnes sont concernées par ce dispositif. Par ailleurs, le programme triennal de prévention et de lutte contre les exclusions, évoqué ci-dessus, a prévu d’importants moyens pour les actions de santé (soins et prévention) en direction des personnes aux revenus les plus faibles : 590 millions de francs y seront consacrés en trois ans. c) Prévenir la pauvreté par le recul de la précarité sur le marché du travail Le programme d’action et la loi contre les exclusions représentent une avancée importante. Il s’agit cependant d’un ensemble de mesures « curatives » qui, par nature, n’apportent pas directement de solution au problème de la montée de la précarité sur le marché du travail. Dans son rapport au Conseil d’analyse économique sur « La pauvreté, sa mesure et son évolution » (), M. Michel Glaude, directeur des statistiques démographiques et sociales à l'INSEE, attire l’attention sur ce point. Selon M. Michel Glaude, la stabilité globale du taux de pauvreté au cours des dix dernières années, masque des évolutions profondes : « Depuis dix ans, la pauvreté s’est considérablement rajeunie, elle est devenue plus urbaine, elle concerne davantage les salariés et de plus en plus les familles monoparentales ». Cette évolution est le résultat d’une dégradation dans le domaine de l’emploi et des conditions de travail. Des franges de plus en plus larges de la population alternent, sans parvenir à se sortir de cette situation, travail insuffisamment rémunérateur et chômage non indemnisé. Ce phénomène, souvent évoqué sous le vocable anglo-saxon de « working poors », prend en France une réelle et inquiétante extension qu’il va falloir enrayer. Un débat public doit s’ouvrir sur les limites à apporter à la progression de la part relative des bas salaires (moins de 4.800 francs par mois) et des très bas salaires (moins de 3.600 francs), qui concernent aujourd’hui 3,2 millions de salariés. L’INSEE relève, dans une étude de juillet 1999, () qu'entre 1993 et 1997, la part des travailleurs à bas salaire est passée de 11% à 15,1% du total des salariés et que la progression des très bas salaires est encore plus rapide, puisque cette catégorie de salariés a doublé en quinze ans. Les trois quarts des emplois à bas salaires sont des emplois à temps partiel « subis », majoritairement occupés par des femmes (78%). Si 60% des allocataires du RMI sortent du dispositif grâce à un emploi, il s’agit le plus souvent d’emplois instables et d’une durée de moins de six mois. Un ancien allocataire embauché sur trois occupe un emploi aidé (CES ou CEC) du secteur public ou associatif. Ceux qui retrouvent un emploi dans le secteur marchand ont presque toujours un emploi à temps partiel et à durée déterminée. Les trois tableaux ci-dessous rendent bien compte de cet enfermement dans la précarité.
Le Parlement devrait saisir prochainement l’occasion de se pencher sur ces questions dans le cadre de la transposition de la directive européenne sur les contrats de travail à durée déterminée (CDD) du 28 juin 1999 (), adoptée à la suite d’un accord-cadre conclu par les partenaires sociaux européens. Cette directive prévoit que les Etats membres devront fixer la durée maximale et le nombre de renouvellements autorisés pour les CDD et que les législations nationales devront faire obligation aux employeurs d’informer des postes vacants les salariés titulaires d'un CDD, afin de leur faciliter l’accès à des postes permanents, ce que ne prévoit pas le code français du travail. 2.- L’avenir des retraites La gravité du débat actuel sur l’avenir du système de retraites français ne devrait pas occulter le phénomène a priori positif qui se trouve à son origine : l’allongement continu de la durée de la vie. Mais ce bouleversement démographique ne doit pas engendrer de nouvelles inégalités ni mettre à mal l’un des piliers de la cohésion sociale qui est la solidarité entre les générations. De nombreuses solutions sont avancées, mais avant d’en examiner quelques-unes, il convient de préciser que le débat sur l’avenir des retraites n’est pas seulement technique. Il sous-tend des choix de société : Quelle répartition des richesses produites ? Quels arbitrages entre court, moyen et long terme ? Quelles solidarités ? Un élément fondamental du débat doit également être rappelé : actuellement, compte tenu de la crise de l’emploi, le taux d'activité des 55-60 ans n'est que de 52,6% et de 15,4% pour les 60-65 ans. Reculer l'âge de la retraite, dans ce contexte, reviendrait à aggraver les difficultés des jeunes à trouver un emploi et à augmenter le nombre de préretraites (fort coûteuses) et de chômeurs âgés. Il semble que, dans l’immédiat, la priorité doit rester à l’insertion des jeunes sur le marché du travail et à la réduction du chômage. Dans son rapport au Premier ministre, M. Jean-Michel Charpin, commissaire au Plan (), établit un diagnostic qui comporte un état des lieux et des projections financières à long terme. Plusieurs simulations de scénarios ont été effectuées en fonction de diverses hypothèses, portant notamment sur les taux de chômage de long terme (3,6 ou 9%). Globalement, à partir des années 2006, sous l’effet conjugué de l’allongement de l’espérance de vie et de l’arrivée à la retraite des générations nombreuses d’après-guerre, le système va être soumis à un choc démographique sans précédent. Même dans l’hypothèse d’une décrue rapide du chômage (par l’effet, en particulier, du ralentissement de l’augmentation de la population active), les régimes de retraites connaîtront, selon ce rapport, des difficultés financières à plus ou moins long terme. Les deux tableaux ci-dessous opèrent une synthèse de ces prévisions.
Même si le diagnostic du commissaire au Plan n’est pas partagé par tous les partenaires sociaux, ni sur la méthodologie, ni sur les hypothèses retenues en matière d’augmentation de la productivité du travail et de la productivité globale et, a fortiori, sur les pistes de réformes avancées, il conduit à conclure à l’existence d’un réel défi démographique, mais non d’un péril imminent. Quatre pistes principales de réformes sont proposées dans le rapport. · L’allongement progressif de la durée de cotisation. En allongeant d’un trimestre par génération la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein, la réforme aboutirait en 2019 à une durée de cotisations de 170 trimestres (42,5 années), dans la limite de 65 ans. La durée de cotisation est actuellement de 40 ans dans le secteur privé et 37 ans et demi dans le public. Cette mesure devrait être associée à l’amélioration des conditions d’abattement en cas de retraite anticipée et concerner l’ensemble des régimes. Enfin, la réforme devrait introduire une certaine prise en compte dans le calcul de la durée de cotisation de périodes d’inactivité (chômage) ou de formation, qui, à l'heure actuelle, ne sont pas toujours validées. · Le renforcement considérable du fonds de réserve. A l’instar de la démarche suivie par plusieurs autres pays, un fonds de réserve a été créé, en 1998, par la loi de financement de la sécurité sociale, afin de constituer une épargne qui sera utilisée par les régimes de retraite lorsqu’ils seront confrontés au choc du vieillissement. Mais les modalités de fonctionnement de ce fonds, pour lequel est déjà prévue une dotation de 2 milliards de francs () , restent à définir. Le rapport ne se prononce pas sur les objectifs d'un tel fonds. Il constate simplement qu’un fonds destiné uniquement à amortir le choc démographique, donc provisoire, nécessite d’accumuler des sommes représentant au moins 3 points de PIB. Un fonds permanent et destiné, non seulement à amortir le choc, mais aussi à réduire le taux des cotisations à long terme, nécessite d’accumuler des sommes beaucoup plus importantes, de l’ordre d'au moins 10 points de PIB. Dans le cas d’un fonds permanent, le problème des taux de rendement des placements et donc celui de la gestion du fonds est crucial. L’épargne doit pouvoir générer des rendements suffisants pour financer une partie des retraites et assurer la pérennité du fonds. Cet impératif de rendement élevé impliquerait, selon les auteurs du rapport, que le fonds soit investi en partie en actions. · L'élargissement de l’assiette de financement à d’autres revenus des ménages. Cette piste rejoint la question récurrente d’un financement des retraites et plus généralement de la protection sociale par des moyens moins pénalisants pour la croissance et l'emploi. Le rapport énumère, sans les approfondir, diverses modifications visant à élargir l’assiette des cotisations vieillesse. Il pourrait s'agir de l’intégration dans l’assiette des cotisations d'éléments de rémunérations actuellement non soumis à cotisation (primes des fonctionnaires) et surtout du déplafonnement de la part patronale des cotisations vieillesse, ce qui aurait l’avantage de ne pas accroître à terme la charge des retraites. La solution la plus globale consisterait à substituer l’assiette de la CSG sur les revenus d’activité à celle des cotisations vieillesse, ce basculement ayant pour effet d’accroître la charge sur les revenus des retraités et sur les revenus du capital. · La modification des règles d’indexation des pensions. Tout en soulignant que la comparaison des différents régimes de retraite et de leur évolution sur le long terme soulève de nombreuses difficultés méthodologiques, le rapport du commissaire au Plan constate que les écarts s'accentuent. Les inégalités majeures constatées proviennent des règles d’indexation des revenus de remplacement. Les règles actuelles de constitution et de liquidation des droits dans les régimes spéciaux (fonction publique et entreprises publiques) garantissent, approximativement, aux salariés du public le maintien des taux de remplacement d’ici à 2040 (57,8% pour la fonction publique, aux environs de 60% pour la RATP et la SNCF). Les pensions sont, en effet, proportionnelles au dernier salaire d'activité et croissent donc au même rythme que les salaires. Il en va tout autrement pour les salariés du privé et pour les professions libérales, pour lesquels le taux de remplacement brut global (régime général de base et régimes complémentaires) diminue significativement à l’horizon 2040. Le taux de remplacement offert par les régimes complémentaires est divisé par deux sur la période 1996-2040, comme le montrent les tableaux ci-après :
Cette baisse résulte de l’effort d'ajustement entrepris en 1993 avec le calcul progressif des pensions du régime général sur la base des 25 meilleures années de carrière et l’indexation des pensions sur les prix et non plus sur les salaires. En ce qui concerne les régimes complémentaires, la valeur d’achat du point est indexée sur les salaires et la valeur de liquidation du point sur les prix à l’ARRCO et à l’AGIRC. Il en résulte une baisse constante du taux de rendement de ces régimes. Il faut toutefois souligner que l’accord des partenaires sociaux sur l’évolution de ces régimes s'arrête en 2000. La baisse du taux de remplacement conduit à une perte progressive du niveau de vie relatif de la période de retraite par rapport à la période d’activité, pour les salariés du secteur privé et pour les professions libérales. Un tel écart pourrait être, selon les auteurs du rapport, contraire à la cohésion sociale de l’ensemble du système. En guise de réponse, le rapport évalue quel serait le coût budgétaire à long terme du maintien des taux de remplacement pour les salariés du secteur privé. Indexer à nouveau les retraites du régime général sur les salaires, sans modifier les règles d’indexation des pensions liquidées, entraînerait une hausse des dépenses du régime général d’environ 20% en 2040, soit 200 milliards de francs 1998 ou un peu plus de 1 point de PIB. Maintenir le rendement des retraites complémentaires, sans augmenter la valeur des pensions liquidées, entraînerait une hausse de 0,6 point de PIB dans les dépenses des régimes de retraite. Il est exclu de trancher ici entre ces diverses orientations. Toutefois, il semble bien que l’une des clés du débat soit le maintien du rapport actifs/inactifs aux environs de son niveau actuel. Or, si aujourd’hui le nombre de personnes en âge de travailler (35,3 millions de 15-60 ans) est trois fois plus élevé que le nombre des plus de 60 ans (12 millions), le rapport entre les actifs occupés (22,7 millions), d’une part, et, d’autre part, l’addition des retraités, préretraités et des chômeurs (16,3 millions) tombe à 1,4 (). On est ainsi conduit à relativiser le choc démographique annoncé pour 2040, où le rapport entre les personnes d’âge actif et les personnes de plus de 60 ans devrait être, selon les simulations du rapport du commissaire au Plan, de 10 pour 7 (soit 1,42). En fait, c’est la remontée de l’emploi, par l’effet de la croissance et d’une autre répartition du travail tout au long de la vie, qui permettrait d’avancer considérablement dans la problématique des retraites. Des ajustements seraient néanmoins nécessaires pour maintenir la parité des niveaux de vie entre actifs et retraités. Ils passeraient, selon le commissaire au Plan, par un alourdissement des prélèvements sur les richesses produites sous forme d’épargne ou de cotisations et par un rapprochement entre les régimes spéciaux et le régime général. L’allongement de la durée d’activité est également envisagé par le rapport, dans un contexte de plein emploi, en tenant compte de la pénibilité de certaines tâches et en introduisant de la souplesse dans les modalités de départ à la retraite. Toutefois, reculer l’âge du départ à la retraite supposerait, en particulier, que les entreprises renoncent à la stratégie d’exclusion précoce des travailleurs vieillissants et les salariés aux avancements automatiques liés à l’âge. C’est aussi l’une des conclusions du rapport que notre ancien collègue, M. Dominique Taddéi, a remis au Premier ministre le 1er octobre 1999. Rejetant tout alarmisme et toute précipitation, sans masquer la réalité d’une évolution démographique qui verra le nombre des retraités potentiels augmenter de 60% en un peu moins de quatre décennies, M. Dominique Taddéi appelle à une solution pragmatique et progressive, prônant la « retraite à la carte » qui, selon lui, doit se substituer à la « retraite guillotine ». Il s’agirait ainsi d’amortir les effets d’une évolution qui reste lente, en modifiant « en douceur » l’âge moyen de la cessation d’activité. En tout état de cause, la retraite est, et doit rester, un salaire différé, garanti par l’Etat et les entreprises publiques pour le secteur public, mutualisé entre les entreprises dans le cas du secteur privé. Dans les deux cas le droit à la retraite est un droit du travail découlant des relations entre les employeurs et les salariés, il n’est pas un droit financier garanti par le droit des affaires. Le Premier ministre, dans son discours de Strasbourg du 27 septembre dernier, a clairement défini les orientations du Gouvernement en vue d’affirmer la solidarité entre les générations par la consolidation de notre régime de retraite. L’objectif est de consolider les régimes par répartition et d’agir pour assurer l’équilibre des retraites à l’horizon 2020. S’agissant du calendrier, après la phase de diagnostic, une concertation est en cours. Les orientations générales du Gouvernement devraient être annoncées au début de l’année 2000. Le Premier ministre a d’ores et déjà indiqué qu’elles s’inscriront dans une vision plus large : celle de la place et des problèmes des personnes âgées dans notre société, une attention particulière devant être portée à leur insertion dans la vie sociale et à leur accompagnement lorsqu’elles sont en situation de dépendance. Quant au problème de l’éventuelle création de fonds partenariaux de retraite, il faut dire clairement qu’elle ne devra pas se faire au détriment du régime par répartition. 3.- Inégalités et territoires D’après les classifications de l’INSEE, la France métropolitaine compte environ 2.256.000 entreprises dans les secteurs de l’industrie, de la construction, du commerce et des services pour 36.500 communes, 348 zones d’emploi (périmètres dans lesquels la population réside et travaille à la fois) et 22 régions. Chaque commune pourrait donc avoir sur son territoire près de 62 entreprises ! La répartition de la population et des unités économiques ne répond évidemment pas à ce schéma égalitaire, mais à des logiques économiques qui peuvent faire varier d'une période à l’autre l’attractivité d’un territoire. La concentration spatiale répond à des critères différents suivant la nature de l’activité (présence de ressources naturelles, activités portuaires, proximité des marchés, faible coût ou qualité de la main d'œuvre…). L’histoire économique a profondément marqué les territoires, dont certains sont dans l’obligation d’entreprendre une reconversion totale de leurs activités. Le phénomène de concentration des activités dans certaines zones ou grandes agglomérations semble difficile à enrayer. L’évolution de la concentration géographique des sièges sociaux des grandes entreprises constitue un indicateur intéressant. Une entreprise de 100 salariés et plus sur trois a son siège en Ile-de-France et la concentration est encore plus prononcée pour les entreprises de 500 salariés et plus qui ont leur siège social en Ile-de-France pour deux sur trois d’entre elles. A l’inverse, deux zones d'emploi sur trois n’ont aucun siège social pour des entreprises de cette taille. Par ailleurs, on constate en Europe qu’il n'y a pas de lien entre le niveau de revenu par habitant d’un pays et l’ampleur des inégalités régionales. En France, les communes rurales ont un niveau de vie de 20% inférieur au niveau de vie moyen. A l’opposé, dans les quartiers les plus aisés (essentiellement concentrés sur Paris et certaines communes d’Ile-de-France), le niveau de vie est de 40% supérieur à la moyenne. Dernier phénomène à souligner, les niveaux de vie sont d’autant plus inégaux que l’espace considéré est plus riche. En effet, les niveaux de vie des communes agricoles ou ouvrières sont moins dispersés que ceux des communes où résident des populations très qualifiées et où les ménages à très bas revenus sont également surreprésentés. Toutefois, on constate un resserrement des revenus disponibles bruts des ménages entre l’Ile-de-France et les autres régions. En 1982, un francilien disposait en moyenne d’un revenu supérieur de 33% à celui d’un provincial. En 1996, l’écart n’est plus que de 23%. Entre les régions, hors Ile-de-France, l’écart des revenus entre la plus riche et la plus pauvre est passé de 22% à 19%. Ce rapprochement semble s’expliquer principalement par l’amélioration des niveaux de retraites. Cette évolution favorable a davantage profité à la province, où la part des personnes de 65 ans et plus est passée de 14% à 16% entre 1982 et 1996, alors qu’elle est restée stable en Ile-de-France (11%). Mais en terme de PIB par habitant, l’accentuation de l’écart entre l'Ile-de-France et le reste des régions métropolitaines perdure, comme le montrent les deux tableaux ci-après.
Face à cette situation, la loi d’orientation n° 99-533 du 25 juin 1999 pour l’aménagement et le développement durable du territoire, a pour objectif de faciliter le retour à un meilleur équilibre entre les territoires et une affectation des richesses plus soucieuse de cohésion nationale et européenne. Sur le plan de la méthode, on retiendra que la loi situe clairement l’action de l’Etat dans l’évolution mondiale de l’économie et des échanges et surtout en phase avec la politique structurelle européenne. Elle s’attache à rompre avec la multiplication des lieux de conception et de mise en œuvre des politiques territoriales qui a caractérisé la période précédente du fait de la décentralisation et de la construction européenne. La loi d’orientation met en place, pour la première fois, une stratégie unique pour les fonds structurels européens et les contrats de plan Etat-régions (CPER), reposant sur une logique de projet et visant à améliorer l’efficacité globale des transferts effectués ainsi qu’à rompre avec une sous-consommation chronique de ces aides financières par les régions françaises. Cette stratégie globale de l’aménagement du territoire est facilitée par la concomitance des calendriers de mise en œuvre des CPER et des programmes communautaires de développement régional (fonds structurels). Par ailleurs, l’article 10 de la loi a créé, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à l’aménagement et au développement durable du territoire. Enfin, la loi fait obligation au Gouvernement, au plus tard deux ans avant l’échéance des CPER, de soumettre au Parlement un projet de loi redéfinissant les orientations stratégiques de la politique territoriale pour la période suivante. · Institués par la loi n° 82-653 du 30 juillet 1982, les contrats de plan établissent un partenariat entre les régions, chefs de file en matière d'aménagement du territoire, et l’Etat. Les pouvoirs publics (les ministères) et les collectivités locales s’engagent réciproquement à financer des actions de long terme en matière d’aménagement du territoire. Les précédents CPER, conclus en 1994, arrivent à échéance le 31 décembre 1999. Les contrats de plan pour les années 2000-2006, quatrième génération depuis les lois de décentralisation, sont axés sur la défense de l’emploi, l’impact sur l’environnement, la solidarité territoriale et le développement durable qui devrait induire pour toutes les actions la recherche du meilleur rapport coût-bénéfice. Le Comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire (CIADT), réuni le 23 juillet 1999, a arrêté les données financières concernant cette prochaine génération de CPER. Sur le montant total de 105 milliards de francs annoncé par le Premier Ministre le 15 avril dernier, le CIADT a réparti, dans un premier temps, 95 milliards de francs (y compris la part des TOM non encore répartie), ventilés, par région et par ministère. Cette première enveloppe est à comparer aux 88 milliards de francs de la génération précédente. La répartition des crédits entre les régions a été opérée suivant des critères relatifs au potentiel fiscal, au taux de chômage et à l’emploi. La fourchette des écarts entre les régions passe de 1 à 2 contre 1 à 3 dans les précédents contrats, en dehors du cas particulier de la Corse et sans tenir compte des 10 milliards de francs supplémentaires de la deuxième étape. Six régions avaient été particulièrement sous-dotées dans la programmation précédente et bénéficient d’un effort de rattrapage (Aquitaine, Pays-de-Loire, Centre, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Ile-de-France). Par ailleurs, les retards structurels de développement dans les départements d’outre-mer, qui connaissent des taux de chômage deux à trois fois supérieurs à la moyenne nationale parallèlement à une forte poussée démographique, justifient des engagements financiers de l’Etat, par habitant, nettement supérieurs à ceux des autres régions. Les deux tableaux ci-après présentent la répartition des crédits de la première enveloppe selon les régions et les ministères.
On retiendra que l’impératif de solidarité se traduit par une enveloppe pour le ministère de la ville multipliée par deux, ce qui devrait permettre d’accroître le nombre de sites sous contrat de ville et d’intensifier les actions dans les quartiers ou résident les populations les plus en difficulté. Forts de cette répartition, les préfets de région ont lancé depuis la fin du mois de juillet, avec les acteurs locaux, les négociations qui doivent, dans le respect des objectifs fixés à chaque région, aboutir aux grands projets d’aménagement du territoire qui se dérouleront sur six ans. Les contrats de plan, contenant les projets et les dotations correspondantes, doivent être signés à la fin de l’année 1999. Selon votre Rapporteur général, il conviendra pour ce faire que l’Etat accepte d’augmenter très sensiblement le montant prévu pour la seconde enveloppe, aujourd’hui clairement insuffisante. S’il convient d’être exigeant sur la maîtrise de la dépense publique, il est à noter qu’il s’agit là de dépenses correspondant à des investissements utiles et contribuant à la croissance, au développement et à l’aménagement de nos territoires. L’agenda des prochains mois s’annonce d’autant plus chargé pour les acteurs locaux que la nouvelle programmation des fonds structurels pour la période 2000-2006 va également se mettre en place. · La politique régionale européenne n’est apparue que tardivement et c’est l'Acte unique européen de 1986 qui lui a conféré sa dimension actuelle. Plusieurs réformes depuis cette date ont renforcé l’effort de cohésion régionale européenne. Les fonds structurels sont le principal outil financier de cette politique. Ils viennent une nouvelle fois de faire l’objet d’une réforme importante. Le Règlement du Conseil () du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels a profondément modifié leur fonctionnement dans un but de concentration des interventions pour plus d’efficacité, de maîtrise des dépenses et de simplification des procédures. En vertu de ce texte, l’action de la Communauté européenne en matière de développement régional sera désormais axée autour de 3 objectifs : – promouvoir le développement et l’ajustement structurel des régions en retard de développement (objectif 1) ; – soutenir la reconversion économique et sociale des zones en difficulté structurelle (objectif 2) ; – soutenir l’adaptation et la modernisation des politiques et systèmes d’éducation, de formation et d’emploi (objectif 3). Cet objectif ne peut intervenir financièrement qu’en dehors des régions éligibles à l'objectif 1, mais contrairement à l’objectif 2, il n’est pas territorialisé. Les principales innovations portent sur la réduction de cinq à trois du nombre d’objectifs, une forte diminution des populations éligibles, l’accent mis sur certaines catégories de zones telles que les zones urbaines en difficulté. Pour une analyse plus approfondie de cette réforme importante, ses aspects positifs mais aussi ses faiblesses, on se reportera au rapport de notre collègue M. Alain Barrau () présenté à la Délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne et à la résolution adoptée (TA n° 267 du 18 mars 1999). L’objectif 1, le plus fortement doté, ne s’appliquera plus en France qu’aux DOM. La Corse et le Hainaut, qui en relevaient précédemment, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75% de la moyenne communautaire, bénéficieront d’un dispositif transitoire de soutien. Afin de concentrer les aides, pour chaque Etat membre, la population totale bénéficiant du nouvel objectif 2 ne devra pas représenter plus de 18% de la population totale de la Communauté. Ce quota de population entraîne pour la France une réduction de 25% par rapport à la population qui était éligible aux objectifs 2 et 5b dans le cadre de la précédente programmation. Ce nouvel objectif 2, qui concernera, en France, des zones totalisant 18,77 millions d’habitants, a vocation à aider des zones en reconversion industrielle et tertiaire ayant un taux de chômage supérieur à la moyenne communautaire ; des zones rurales en déclin à faible densité de population et à fort taux de chômage ; des zones urbaines caractérisées par un fort taux de chômage, un niveau élevé de pauvreté, une situation environnementale particulièrement dégradée ou encore un faible niveau d'éducation de la population ; enfin des zones dépendantes de la pêche. La première étape de la mise en place de ces nouveaux programmes a consisté à déterminer l’effort de concentration de l’intervention communautaire, et donc à définir la population éligible au niveau de chaque région. Cette répartition a été effectuée par le Gouvernement conformément au tableau ci-dessous. La réduction de la population éligible n’a pas été répartie de façon identique pour toutes les régions, mais en tenant compte de l’évolution socio-économique de chacune d’elle depuis 1994 et des priorités conjointes de la Communauté et du Gouvernement (problématiques urbaines, massifs montagneux par exemple).
L’enveloppe attribuée à la France au titre de l'objectif 2 a été réduite et passe pour la période 2000-2006, à 45,7 milliards de francs (6,9 milliards d'euros), au lieu de 60,6 milliards pour la période précédente. Compte tenu des critères prévus par les règlements communautaires et rappelés ci-dessus, les préfets de région ont été invités à engager les consultations qui conduiront à des propositions de zonage sur la base desquelles le Gouvernement français et la Commission européenne établiront la carte des zones éligibles à l'objectif 2 en France. Ces propositions de zonage devront s’appuyer sur des statistiques détaillées pour chaque région et harmonisées au plan national ainsi que sur des argumentations plus qualitatives relatives au contexte régional ou local. Pour chaque territoire proposé à l’éligibilité, il devra être fait référence au type de zone auquel il se rattache dans la législation communautaire et à son articulation avec les autres zonages nationaux. Ces propositions devront être élaborées dans le cadre d’un partenariat le plus étroit possible, comme cela est d’ailleurs exigé par le règlement communautaire, associant notamment les collectivités régionales et départementales et les parlementaires nationaux et européens. Pour la répartition de l’enveloppe des fonds structurels, il n’y aura pas « d'avantages territoriaux acquis ». Toutefois, la clé de répartition devra garantir à chaque région le maintien au minimum de 50% du montant des fonds perçus durant la période précédente. L’ensemble des transferts financiers qui viennent d’être évoqués prend en compte les déséquilibres graves, et persistants qui affectent tout particulièrement certaines zones urbaines et rurales très sensibles. Mais l’effort de l’Etat en direction de ces territoires défavorisés doit être accentué si l’on veut véritablement réduire ces disparités. C’est pourquoi votre Rapporteur général considère que la dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR) dans sa première fraction devront être majorées de manière significative au cours des prochaines années. Par ailleurs, la dotation globale de fonctionnement (DGF) devra prendre en compte les résultats du dernier recensement, dès lors qu’il fait apparaître, pour certaines communes, une hausse importante de leur population. Le taux de progression de l’effort financier de l’Etat au profit des collectivités locales doit, en effet, tenir compte de leur rôle, devenu essentiel, pour le développement des investissements publics. CHAPITRE III LA PÉRENNITÉ DE LA CROISSANCE : UN LIEN ÉTROIT AVEC LA VITALITÉ DE L’OFFRE La croissance retrouvée doit beaucoup aux orientations mises en œuvre par la puissance publique. Le rôle de celle-ci a été important pour l’essor de la demande, qui « tire » la croissance depuis 1997. Mais la croissance est aussi tributaire de la vitalité de l’offre. A cet égard, il apparaît que contrairement au discours défaitiste convenu, notre pays, grâce aux efforts de tous – chercheurs, investisseurs, chefs d’entreprise, cadres, employés et ouvriers – est compétitif. Les bons résultats durables de notre commerce extérieur en sont la première illustration, mais d’autres éléments, plus structurels, traduisent l’attractivité de notre pays au sein d’une économie mondiale globalisée. Il ne faut cependant pas relâcher l’effort : l’innovation et l’investissement sont la clé de l’avenir et il faut, à cet égard, rompre avec une certaine frilosité, au moment où de vastes mouvements de restructuration affectant l'appareil productif doivent nous inciter à la vigilance. A.- UN EXCÉDENT COURANT, SYMBOLISANT L’EFFICACITÉ DE L’APPAREIL PRODUCTIF NATIONAL Grâce à un excédent commercial de près de 148 milliards de francs, la France a enregistré, en 1998, un excédent du solde des transactions courantes record de 236 milliards de francs (2,7% du PIB), contre 227 milliards de francs en 1997, ce qui la situe au deuxième rang mondial. 1.- Des échanges extérieurs structurellement excédentaires a) Un excédent commercial substantiel Poursuivant la tendance observée depuis 1993, la balance commerciale française a enregistré, en 1998, pour la sixième année consécutive, un excédent atteignant 147,9 milliards de francs (), contre 163,3 milliards de francs en 1997. Certes, cette performance s’inscrit en baisse (-9,4%) par rapport aux résultats enregistrés en 1997, laquelle constituait une année record. Cependant, le solde de la balance commerciale, constaté en 1998, constitue un succès à plus d’un titre. L’excédent commercial réalisé en 1998 constitue, en effet, la seconde meilleure performance obtenue depuis 1993. Il est, ainsi, deux fois supérieur à celui dégagé en 1996. Par ailleurs, les performances enregistrées au titre de la balance commerciale ont été obtenues dans un contexte international extrêmement défavorable, marqué par la crise asiatique et celle de la Russie. Soulignons, enfin, que l’excédent de 1998 est profondément sain, puisqu’il ne repose pas, contrairement à la situation observée jusqu’en 1996, sur une faiblesse relative des importations, consécutive à l’atonie de la demande interne. Ce succès a, cependant, une contrepartie : compte tenu du dynamisme de la demande intérieure, la contribution des échanges extérieurs à la croissance est, en 1998, négative (-0,4%). Il convient, cependant, d’indiquer que le dynamisme du commerce extérieur observé en 1998 semble marquer un net recul au premier semestre 1999. Le solde des échanges FAB-FAB s’élève, pour les six premiers mois de l’année, à 51,2 milliards de francs, contre 68,2 milliards de francs au premier semestre 1998, soit une baisse de 25%. Bien qu’un rebond des échanges ait été observé en mai et juin derniers, le solde du commerce extérieur pourrait se situer, en l’état actuel des informations dont dispose votre Rapporteur général, autour de 75 à 80 milliards de francs en 1999.
· L’évolution des soldes par branche, observée au cours de l’année 1998, contraste vivement avec les performances réalisées en 1997 : si le déficit énergétique est en nette diminution, les soldes des autres branches, en revanche, subissent tous une dégradation. Soulignons, cependant, que les niveaux des trois principaux soldes excédentaires de la balance commerciale demeurent, en 1998, largement supérieurs aux niveaux atteints en 1996. Le fléchissement de 1998 doit donc être interprété avec prudence. – La facture énergétique a reculé, en 1998, de 25 milliards de francs, soit une baisse de près de 30%. Elle retrouve ainsi son niveau de 1995, pour s’établir à 61 milliards de francs. Cette baisse est imputable à la chute des cours mondiaux du pétrole brut, le prix du baril exprimé en dollars s’étant effondré de 30% en un an. Soulignons, cependant, qu’au cours du premier semestre de 1999, la facture énergétique est de nouveau en hausse par rapport aux six derniers mois de 1998. – La branche agro-alimentaire enregistre un excédent de plus de 58 milliards de francs en 1998, ce qui représente un recul de 7 milliards de francs par rapport au record exceptionnel de 1997. Le chiffre de 1998 constitue, toutefois, le second plus fort excédent agro-alimentaire depuis dix ans. L’excédent des produits agricoles reste stable, la forte hausse des exportations de vins venant compenser la baisse de celles de céréales. En revanche, les exportations des produits des industries agricoles et alimentaires reculent de 6 milliards de francs en raison de la crise russe et asiatique. Les exportations vers la Russie ont, ainsi, chuté de 27% de 1997 à 1998, tandis que les ventes d’alcools vers l’Asie subissaient une forte baisse. Au cours du premier semestre 1999, et bien que le solde du secteur agro-alimentaire dans son ensemble reste relativement stable par rapport aux résultats enregistrés au premier semestre 1998, les flux d’échanges au sein de l’industrie agro-alimentaire poursuivent leur érosion. – L’excédent des biens intermédiaires chute, en 1998, de près de 80% par rapport à l’année précédente : il est désormais réduit à 3,8 milliards de francs, soit le plus faible niveau enregistré depuis 1996. Cette dégradation s’explique essentiellement par le dynamisme des importations, notamment dans les secteurs de la sidérurgie, du papier-carton et des composants électroniques. Au premier semestre 1999, les échanges de biens intermédiaires ont poursuivi leur décrue, le ralentissement étant nettement plus marqué à l’importation qu’à l’exportation. Le solde est cependant positif et un rebond des échanges est observé depuis le mois de mai dernier. – L’excédent du secteur des équipements professionnels est, en 1998, en très légère baisse (–9%) par rapport au record historique de 1997 : il s’établit à 42 milliards de francs, représentant ainsi le deuxième excédent industriel, derrière l’automobile. Cette performance est, pour l’essentiel, imputable aux performances obtenues dans les branches aéronautique et navale. Cet excédent est d’autant plus remarquable qu’il est intervenu dans un contexte international peu favorable. La part des exportations françaises vers l’Union européenne est, en effet, particulièrement faible dans ce secteur (48%) alors que le poids des pays émergents d’Asie () est élevé (11%). Mais, malgré un contexte fragile, les exportations sont demeurées, en 1998, extrêmement dynamiques. Cette tendance a, cependant, subi un retournement au cours du premier semestre 1999 : les exportations fléchissent, alors que les importations progressent. Le solde se dégrade donc, passant de 27 milliards de francs au second semestre 1998 à 10 milliards de francs au premier semestre 1999. L’industrie des transports est particulièrement touchée. – Marquant un léger recul par rapport à 1997, de 4,5 milliards de francs, l’excédent de la branche automobile et transport terrestre demeure, avec 59 milliards de francs, le premier poste de la balance commerciale française. Cet excédent est particulièrement remarquable puisque, contrairement à la situation prévalant en 1997, il s’inscrit dans un contexte de forte croissance des importations (+22,5% en 1998). La vigueur des exportations (+13,2%) s’explique, quant à elle, par la bonne santé du marché européen, témoignant ainsi de la compétitivité des produits français. Au cours du premier semestre 1999, le solde de la branche automobile a subi un recul de 20% par rapport aux six derniers mois de 1998. Attestant de la bonne santé de l’économie française, les importations sont à la hausse, mais les exportations reculent. – Le déficit des biens de consommation s’accroît, en 1998, de 45%, pour s’élever à plus de 27 milliards de francs. Les échanges dans cette branche ont été particulièrement dynamiques, les exportations et importations augmentant respectivement de 8% et 11%. Le solde de la branche a, toutefois, pâti d’un « effet Mondial », à l’origine d’une forte poussée des achats de matériel électronique. S’élevant à 10 milliards de francs, le déficit des biens de consommation est en réduction au cours du premier semestre 1999. L’amélioration est particulièrement sensible sur deux postes : le cuir et l’habillement, d’une part, la pharmacie et la parapharmacie, d’autre part.
· Le poids de la France dans le commerce international, ainsi que la répartition géographique de ses échanges, ont été relativement stables en 1998. Cependant, le ralentissement de la conjoncture internationale n’a pas été sans conséquence sur ses exportations. D’après les informations fournies par la direction des relations économiques extérieures (DREE), la part du marché mondial en valeur de la France s’est élevée, en 1998, à 5,4%, soit le même niveau qu’en 1997. – L’Union européenne reste le premier partenaire commercial de la France, représentant près des deux tiers de ses exportations. Le commerce extérieur français avec l’Union européenne dégage un solde positif de 64 milliards de francs, lequel, bien qu’en réduction de 21% (soit 17 milliards de francs) par rapport à 1997, représente deux fois et demi l’excédent dégagé en 1996. Cette baisse est imputable à une forte croissance des importations (+9,6%), notamment celles en provenance d’Allemagne, d’Italie, d’Espagne et d’Irlande, et à une forte décélération des exportations (+7,2% en 1998 contre +12,4% en 1997), notamment celles à destination du Royaume-Uni, de l’Italie et des pays du Bénélux. La baisse de l’excédent commercial est particulièrement accusée avec les pays de la zone euro : il chute de 64% pour s’établir à 11 milliards de francs. Soulignons, toutefois, que les échanges de la France avec cette zone ont été plus dynamiques que pour l’Union européenne prise dans son ensemble, les exportations et les importations progressant respectivement de 7,7% et 10,6%. Les exportations françaises dirigées sur la zone euro ont ainsi crû de 64 milliards de francs en 1998. Au cours du premier semestre 1999, les échanges avec l’Union européenne, et notamment avec la zone euro, subissent une dégradation en termes de flux. Les importations françaises chutent de 3,4%, tandis que les exportations reculent de 1,8% par rapport au dernier semestre 1998. Mais, compte tenu de ce décalage, le solde enregistre l’un de ses excédents semestriels les plus élevés (près de 44 milliards de francs). – L’évolution des échanges avec les pays de l’Est reste favorable, le solde avec les pays d’Europe centrale et orientale (PECO) et la Communauté des Etats indépendants (CEI) représentant un excédent de 12 milliards de francs, en progression de 9% par rapport à l’année précédente. Ce chiffre couvre, cependant, de fortes disparités. Les échanges avec les PECO dégagent, en effet, un solde positif de près de 16 milliards de francs, les exportations françaises ayant été particulièrement dynamiques en 1998 (+19%), notamment vers la Pologne, devenue, en 1998, le premier client de la France en Europe de l’Est et le sixième excédent bilatéral. En revanche, les échanges avec la CEI se soldent par un déficit de 3,4 milliards de francs, en augmentation de plus de 16% par rapport à l’année 1997. Ce phénomène est essentiellement imputable à la chute des exportations françaises vers la Russie (-25%) qui ont cependant repris leur progression au premier semestre 1999. – Le déficit commercial français avec les pays de l’OCDE, hors Union européenne, fait l’objet d’une forte réduction. Le déficit commercial avec les Etats-Unis, de 16 milliards de francs, est, en effet, en diminution de plus de 30% en 1998 par rapport à l’année précédente. Il s’agit du plus faible déficit commercial enregistré depuis dix ans. Stimulées par l’appréciation du dollar et l’écart de conjoncture positif avec les Etats-Unis, les exportations françaises ont, en effet, augmenté de 20% sur cette zone. Au premier semestre 1999, le recul du déficit commercial avec les Etats-Unis se poursuit, en raison du rythme soutenu de la croissance des achats américains à l’étranger. En revanche, le déficit avec le Japon s’accroît, en 1998, de 21% (soit 5 milliards de francs) pour s’établir à 29 milliards de francs. Il s’agit du plus important déficit bilatéral enregistré depuis 1993. Au premier semestre 1999, le déficit continue de s’accroître par rapport au dernier semestre 1998 (+20%). – Les échanges commerciaux de la France avec l’Asie subissent également un repli sensible. Cette détérioration est particulièrement significative pour les pays d’Asie à économie en développement rapide. Le solde commercial français chute de 25 milliards de francs, en raison d’une forte baisse des exportations françaises sur cette zone (-16% entre 1997 et 1998). Cette baisse a concerné tous les secteurs : matériel de transport terrestre (-30%), biens de consommation (-25%), biens intermédiaires (-24%), secteur agro-alimentaire (-24%). Indiquons, cependant, que la décélération des exportations françaises de biens d’équipement professionnels (-12%) a été moins marquée, des commandes d’Airbus ayant été conclues en 1997 et dénouées en 1998. Le repli des exportations françaises a été très sensible vers les pays de l’ASEAN (-31%), notamment l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et Singapour, ainsi qu’en direction de la Corée du Sud. Au premier semestre 1999, les exportations françaises vers l’Asie émergente poursuivent leur baisse (-26%) par rapport au dernier semestre 1998, ce phénomène était imputable à une forte chute des ventes d’Airbus. – L’excédent commercial de la France avec le Proche et Moyen Orient progresse, en 1998, de 50% (+ 4 milliards de francs) pour s’établir à 12 milliards de francs, cette évolution s’expliquant par la forte baisse du prix du pétrole brut importé. Les importations françaises ont ainsi chuté de 14%. Notons que les exportations françaises ont subi un léger recul (-1,6%), lequel résulte également de la faiblesse des livraisons d’Airbus. Au premier semestre 1999, l’excédent commercial français est à la hausse, même si les importations tendent à s’accroître. – Le solde des échanges avec l’Afrique progresse également. L’excédent français, en augmentation de 67% par rapport à l’année précédente, s’établit à près de 34 milliards de francs. Les exportations françaises vers la zone ont, en effet, été très dynamiques en 1998 (+16%) : l’Afrique est redevenue, en 1998, la troisième destination des produits français, après l’Union européenne et les autres pays de l’OCDE. Au premier semestre 1999, les ventes françaises vers l’Afrique reculent, mais, compte tenu des moindres importations françaises, l’excédent se maintient à un niveau élevé.
b) Un solde des transactions courantes sans précédent En dépit du ralentissement de la demande étrangère adressée à la France et du dynamisme de la demande intérieure, le solde des transactions courantes a enregistré, en 1998, et ce pour la septième année consécutive, un excédent record de 236 milliards de francs, contre 227 milliards de francs en 1997 et 105 milliards de francs en 1996. Ce chiffre de 236 milliards de francs équivaut, comme en 1997, à 2,8% du PIB. La France occupe ainsi le deuxième rang mondial, derrière le Japon. L’année 1998 marque ainsi l’apogée d’un mouvement, amorcé en 1992, marqué par une montée croissante de l’excédent du solde des transactions courantes. Pour le premier semestre de 1999, le solde du compte des transactions courantes a enregistré un excédent de 106,1 milliards de francs en données brutes, contre 96 milliards de francs sur la même période au cours de l’année précédente.
· Ce résultat s’explique essentiellement par le solde des échanges de biens (), lequel, malgré un léger fléchissement par rapport à 1997, s’est élevé, en 1998, à 154 milliards de francs. Le solde de la balance des biens est lui-même essentiellement imputable à l’excédent du commerce extérieur. Le solde des échanges de marchandises, exprimé selon la méthodologie balance des paiements, s’est, en effet, élevé à 145 milliards de francs en 1998, contre 148 milliards de francs en 1997. · Continuant de progresser, le solde des services s’élève, en 1998, à près de 110 milliards de francs, contre 106 milliards de francs en 1997, contribuant ainsi à hauteur de 46% à l’excédent du solde des transactions courantes. Rappelons que les échanges de services sont traditionnellement excédentaires, la France ayant été, jusqu’en 1996, le deuxième exportateur mondial de services, jusqu’à ce qu’elle cède cette place au Royaume-Uni en 1997. L’accroissement des échanges ayant été moins vigoureux en 1998 que l’année précédente (+ 6,5% contre + 8,1%), la France demeure, en 1998, le troisième exportateur mondial de services, avec une part de marché de 6,1%, contre 18,1% pour les Etats-Unis et 7,7% pour le Royaume-Uni. Premier poste de l’excédent de la balance des services, le solde des voyages a continué, en 1998, sa progression, pour s’établir à un niveau record de 72 milliards de francs, contre 67 milliards en 1997 et 54 milliards en 1996. Rappelons, à cet égard, que l’excédent touristique avait subi, de 1992 à 1996, une baisse continue. Forte de ses soixante-dix millions de touristes, la France occupe ainsi le troisième rang mondial en termes de recettes touristiques. Ce succès s’explique notamment par l’organisation de la coupe du monde de football, ainsi que par des phénomènes monétaires liés à l’appréciation du dollar et au dynamisme de l’économie américaine. · Poursuivant la tendance amorcée en 1997, le solde des revenus est de nouveau excédentaire en 1998 et s’élève à près de 30 milliards de francs, contre 19 milliards de francs en 1997. Cette évolution s’explique essentiellement par le solde des revenus des investissements, lui-même imputable à la montée des excédents courants enregistrée depuis 1992. · Le déficit structurel des transferts courants s’est légèrement accentué en 1998, pour atteindre 56,4 milliards de francs, contre 56 milliards en 1997. Mais, derrière cette apparente stabilité, se cache une légère augmentation du déficit des transferts courants des administrations publiques, essentiellement imputable à un alourdissement de la contribution française au budget européen (92,6 milliards de francs en 1998, contre 88,2 milliards de francs en 1997).
2.- Un infléchissement conjoncturel du solde commercial français L’infléchissement, en 1998, du solde commercial national apparaît comme un phénomène purement conjoncturel, imputable à un ralentissement du commerce international. a) Des exportations encore vigoureuses · Les exportations françaises ont, en 1998, progressé deux fois moins vite (+ 6,4%) qu’en 1997 (+ 15,0%). La France a, en effet, été confrontée à un contexte international de moindre progression des échanges internationaux. Le taux de croissance annuel moyen des échanges mondiaux en volume n’a été, en 1998, selon l’Organisation mondiale du commerce (OMC), que de 3,5%, contre 10,5% en 1997 et 7% en moyenne sur la période 1985-1996. La croissance du commerce mondial a même été négative en valeur (baisse de 2%), ce qui représente la plus forte baisse enregistrée depuis 1982. Dans ce contexte, la demande mondiale adressée à la France s’est ralentie en 1998, même si cet infléchissement est moindre que celui observé sur le plan mondial : le taux de croissance de la demande mondiale de produits manufacturés adressée à la France est, ainsi, passé de 9,5% en 1997 à 6,3% en 1998.
· Le ralentissement du commerce international est largement imputable à la crise asiatique, laquelle s’est étendue à la Russie et au Brésil. On rappellera, en effet, que la crise financière qui a touché, en juillet 1997, l’Asie du Sud-Est a débouché, dès la fin 1997, sur une sévère récession dans la zone, elle-même à l’origine d’un brutal ralentissement du commerce international. Ainsi, alors que l’Asie à économie en développement rapide (« l’Asie émergente ») avait largement contribué au dynamisme des échanges mondiaux, le taux de croissance moyen de ses importations en volume progressant de 13% sur la période 1985-1996, celui-ci a chuté à 3,6% en 1998. En valeur, les importations de la zone asiatique, en tenant compte du Japon, ont baissé de 17,5% entre 1997 et 1998. Cette contraction de la demande asiatique a réduit les importations mondiales de 240 milliards de dollars en 1998, ce qui correspond à une ponction de 4% sur le commerce mondial (de 3% si l’on exclut le Japon). Comme votre Rapporteur général l’a précédemment souligné, la France a été touchée par l’impact de la crise asiatique. Ses exportations vers l’Asie émergente ont baissé de 17 milliards de francs, soit une diminution de 16%. Au total, le solde avec l’Asie émergente a subi un recul de 25 milliards de francs, passant d’un excédent de 4,6 milliards de francs en 1997 à un déficit de 20,2 milliards de francs en 1998. La crise asiatique s’est ensuite étendue, à la mi-1998, à la Russie et à l’Amérique latine. Une onde de choc commerciale s’est, ainsi, diffusée sur le plan international, provoquant une contraction drastique des importations des zones concernées. Comme l’a précédemment indiqué votre Rapporteur général, les exportations françaises vers la Russie ont, de ce fait, chuté de plus de 25%, passant de 14,8 milliards de francs en 1997 à 11,1 milliards de francs en 1998. · L’impact de la crise asiatique sur le commerce extérieur français doit, cependant, être relativisé. Comme l’a souligné l’OCDE dans ses Perspectives économiques de juin 1999, « de tous les pays de la zone euro, la France paraît être celui qui a le moins souffert des crises des économies émergentes. [...]. La part relativement importante des services a [...] contribué à limiter les risques directs que les crises des pays émergents auraient pu faire peser sur l’économie française. En conséquence, la balance des opérations courantes n’a pratiquement pas été affectée en 1998 [...] ». Il est vrai que les exportations françaises vers l’Asie émergente ou la Russie ne représentent qu’une part marginale des échanges nationaux. Le poids des exportations françaises vers l’Asie émergente s’élève, en effet, en 1998, à 5,2% de ses exportations totales et celui de la Russie à 0,63%. Soulignons, par ailleurs, de manière plus générale, que le niveau de l’excédent commercial dégagé en 1997 octroyait à la France des marges de manœuvre, lui permettant de supporter une légère inflexion du solde. Cet infléchissement était d’autant plus supportable que la conjoncture internationale s’est traduite par une chute brutale de la facture énergétique, laquelle a intégralement compensé la « facture asiatique ». En réalité, si la France a été touchée par la crise asiatique, elle le fut de manière indirecte. Deux de ses principaux partenaires commerciaux européens, à savoir l’Allemagne et l’Italie, ont des exportations particulièrement exposées au risque asiatique. La crise de l’Asie émergente a, ainsi, eu, en 1998, des répercussions précoces et notables sur l’activité en Italie, ce qui explique que la croissance des exportations françaises vers ce pays (+ 5,4%) y soit inférieure à la moyenne communautaire (+ 7,2%). · Il convient, à cet égard, de se réjouir de la structure géographique du commerce extérieur français, essentiellement tourné vers l’Union européenne (). Celle-ci a, en effet, constitué, en 1998, un pôle économique dynamique, du fait de la reprise de la demande intérieure. Ce dynamisme explique que, globalement, l’Union européenne est restée relativement à l’abri de la crise asiatique. Comme le souligne la direction de la prévision du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, dans une note de conjoncture internationale publiée en décembre 1998, « il est remarquable de noter qu’alors que le commerce mondial ralentit de plus de cinq points, les importations des six plus gros pays de la zone euro ne fléchissent que d’à peine plus d’un point en 1998 ». Bien que le rythme de progression des exportations françaises vers l’Union européenne se soit réduit de moitié, celles-ci ont néanmoins connu une croissance de 7,2% en 1998, voire de 7,7% pour la seule zone euro. Par ce biais, 64% des exportations françaises ont connu un taux de croissance deux fois supérieur au rythme de croissance observé sur le plan mondial. C’est donc bien la solidité des échanges avec l’Union européenne et le dynamisme économique de cette zone qui ont permis à la France de maintenir à un niveau exceptionnellement élevé son solde commercial. Il convient donc de relativiser l’impact à court terme de la crise asiatique sur les échanges extérieurs français. En revanche, les répercussions à long terme sont plus préoccupantes. L’Asie émergente, ainsi que la Russie, représentent, en effet, des zones à fort potentiel de développement. Or, devant les risques qu’elles représentent, il y a fort à parier que les exportateurs français, déjà fort peu présents sur ces marchés, ne s’en détournent encore davantage. b) Des importations dynamiques Les importations françaises ont crû, en 1998, à un rythme soutenu (+ 8,1%), comparable à celui de 1997 (+ 9,5%). Plus que par le ralentissement des exportations, l’infléchissement du solde commercial français s’explique par le dynamisme des importations. · La vigueur du marché intérieur est, en effet, à l’origine de la forte poussée des importations enregistrée depuis 1990. Il convient, à cet égard, de rappeler que la croissance de la demande, amorcée à la mi-1996 et amplifiée en 1997, s’est poursuivie en 1998 : avec un taux de 3,6% en moyenne annuelle, elle est la plus élevée de la décennie. Comparativement aux autres Etats membres de l’Union européenne, la France a, ainsi, bénéficié d’un « différentiel de conjoncture », qui ne pouvait pas être sans conséquence sur l’ampleur des importations nationales. · Votre Rapporteur général tient à souligner que cette reprise économique n’a, en rien, entaché la pérennité de l’excédent commercial national, ce qui témoigne de la bonne santé de l’économie française. On rappellera, en effet, que depuis 1992, l’amélioration du solde commercial français a d’abord résulté d’un différentiel de conjoncture « inversé » : devant l’atonie de la demande interne, les entreprises se tournaient vers les marchés extérieurs. L’excédent commercial ne reflétait donc nullement la bonne santé de l’économie nationale, mais bien la faiblesse de la consommation des ménages et des investissements des entreprises. Il n’était donc nullement acquis que cet excédent commercial résisterait à une reprise des importations. Or, tel est pourtant bien le cas actuellement. Depuis 1997, la reprise économique, tout en se traduisant par une vive croissance des importations, s’est accompagnée d’une montée en puissance des exportations. Dès lors, cette reprise n’a pas remis en cause l’excédent commercial. C’est notamment le cas pour l’excédent du secteur industriel, qui, malgré un recul en 1998 par rapport à 1997, reste presque deux fois supérieur au niveau de 1996. Votre Rapporteur général se réjouira, en particulier, de la consolidation des excédents dégagés par les branches des biens d’équipements professionnels et du secteur automobile, consolidation obtenue en dépit d’une nette progression des importations. Cette évolution témoigne de la bonne compétitivité des produits français, elle-même imputable aux efforts de modernisation de l’industrie. · Il est vrai, cependant, que le maintien, en 1998, d’un solde commercial élevé s’explique également par l’allégement, de l’ordre de 25 milliards de francs, de la facture énergétique, résultant de la chute précédemment évoquée des cours du pétrole. Cet allégement équivaut, pour la France, à l’impact de la crise asiatique sur le solde commercial. Autrement dit, la réduction de la facture pétrolière a compensé les effets de la crise asiatique. Relevons, cependant, que la chute des prix des matières premières a fortement réduit les revenus des pays producteurs. La baisse de leurs importations a, ainsi, par ricochet, grevé les exportations françaises en 1998. La conjonction de ces différents facteurs a permis à la France de conserver, en 1998, un solde commercial exceptionnellement élevé. Tel ne devrait pas être le cas, toutefois, en 1999. * * * Une détérioration des échanges commerciaux a, en effet, été observée dès la fin de l’année 1998 et s’est poursuivie au premier semestre 1999. Malgré un regain attendu de dynamisme des échanges au second semestre 1999, et plus précisément depuis mai dernier, le solde commercial français pourrait se situer autour de 75 à 80 milliards de francs seulement en 1999. Cette détérioration pèserait, notamment, sur le solde industriel et toucherait les secteurs des biens d’équipement professionnels et de l’automobile. La détérioration du solde commercial pour 1999 est imputable à un moindre dynamisme des exportations, conjugué à une consolidation des importations. Selon la direction de la prévision du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (), le commerce international s’accélérerait, certes, en 1999 (+4,7% contre +3,5% en 1998), mais la demande mondiale adressée à la France ralentirait, passant de +5,9% à +3,8% en moyenne annuelle, en raison de la faiblesse de la demande d’origine européenne. L’année 1999 devrait être marquée par une reprise de l’activité sur le continent asiatique et en Europe émergente. Mais, outre le fait que la France est encore peu présente sur ces marchés, les effets escomptés d’une accélération de la demande dans ces zones devraient être contrebalancés par une détérioration de la conjoncture en Amérique latine. Ainsi, la demande adressée à la France par les « zones émergentes » resterait peu soutenue. L’année 1999 devrait également être marquée, sauf accident majeur, par la poursuite de l’expansion américaine. Celle-ci a, d’ores et déjà, servi de « locomotive » au commerce international au premier semestre 1999. Mais, encore une fois, les exportations françaises demeurent relativement mal placées sur ce marché pourtant porteur. Surtout, le ralentissement économique observé sur la zone euro à partir du dernier trimestre 1998 jusqu’au premier semestre 1999 devrait peser sur les échanges extérieurs nationaux. Rappelons, en effet, que l’Europe, notamment l’Allemagne et l’Italie, a traversé, au cours de cette période, un « trou d’air industriel », si bien que les échanges en valeur entre la France et la zone euro se sont repliés de 4,1% à l’importation et de 3,7% à l’exportation par rapport au précédent semestre. La zone euro a donc cessé de jouer le rôle de « tampon » qui fut le sien en 1998, lorsqu’elle permit de préserver le commerce extérieur français des effets de la crise asiatique. Ainsi, en raison de la structure géographique de ses échanges, la France devrait peu tirer parti, en 1999, de la reprise du commerce mondial. Or, parallèlement, les importations devraient rester particulièrement dynamiques. Le caractère soutenu de la production industrielle et de la consommation des ménages vont, en effet, jouer dans ce sens. La demande intérieure française devrait d’ailleurs probablement rester plus dynamique que celle des principaux pays européens, ce différentiel de conjoncture contribuant à la consolidation des importations. Par ailleurs, comme on l’a vu précédemment, le mouvement de baisse des cours du pétrole et des matières premières observé en 1998 semble être arrivé à son terme, si bien que la facture énergétique pourrait atteindre, en 1999, 90 milliards de francs, contre 61 milliards de francs en 1998. Ces différents éléments, s’ils vont indéniablement contribuer à réduire le solde commercial français, doivent cependant être relativisés. Le maintien de l’excédent de 80 milliards de francs constituerait la troisième meilleure performance de la décennie. Mais, surtout, les résultats récents témoignent de l’excellente compétitivité des produits de notre pays, qui, en dépit d’une conjoncture internationale défavorable (crise asiatique en 1998, ralentissement de la zone euro en 1999), conserve la capacité de dégager un solde commercial positif et donc de contribuer à la création d’emplois. B.- LA « MAISON FRANCE » DANS LE « VILLAGE PLANÉTAIRE » : COMPÉTITIVITÉ ET ATTRACTIVITÉ Le haut niveau des exportations et des investissements français à l’étranger, mais également l’importance des importations de notre pays et des investissements étrangers sur son sol, montrent combien la France évolue désormais dans une économie ouverte et mondialisée. La compétitivité et l’internationalisation croissante des entreprises françaises, ainsi que l’attractivité du territoire national, permettent à la France de profiter de ce phénomène qui suscite, néanmoins, des interrogations légitimes auxquelles les Etats se doivent de répondre en développant des stratégies plus coopératives. 1.- La France s’inscrit dans une économie mondiale globalisée Les résultats, précédemment analysés, de notre commerce extérieur et, plus globalement, des échanges de biens et services, témoignent d’une forte intégration de la France dans l’économie mondiale, et plus particulièrement dans ses espaces de croissance. Toutefois, alors que les investissements à l’étranger (), qui constituent l’une des manifestations de la mondialisation, ont longtemps été considérés comme une alternative aux exportations de biens et services pour la pénétration des marchés, de nombreuses études mettent désormais l’accent sur leur complémentarité (). L’investissement direct est parfois indispensable pour accéder à certains marchés (l’automobile en Chine, par exemple, ou le secteur des industries des produits minéraux du fait de la difficulté à exporter de façon économique et compétitive des produits très pondéreux) et il exerce des effets d’entraînement évidents sur les exportations d’un pays (flux d’échanges internationaux internes aux groupes, effets de notoriété, etc.). Cette complémentarité serait même particulièrement forte dans le cas de la France, dont la répartition géographique et sectorielle des investissements à l’étranger recouvre celle de son commerce extérieur. Une étude publiée en mai 1998 évaluait ainsi à 70 milliards de francs, en 1994, les exportations nettes annuelles imputables à la présence française à l’étranger, contre 40 à 50 milliards de francs d’importations nettes associées à la présence étrangère en France (). Plus récemment, l’OCDE estimait qu’à chaque dollar d’investissement direct à l’étranger correspondent environ deux dollars d’exportations supplémentaires, et un excédent commercial de 1,70 dollar. · La mise en place de l’euro, le 1er janvier 1999, au sein de onze pays de l’Union européenne, incite à analyser, en premier lieu, les investissements directs étrangers au niveau de cette nouvelle zone économique de première importance dans laquelle la France évolue désormais. Il ressort d’une récente étude () les éléments suivants : – entre 1995 et 1997, les flux d’investissements directs à destination de la zone euro se sont élevés à environ 30 milliards d’écus par an (40 milliards d’écus pour l’ensemble de l’Union européenne), en provenance, notamment, d’Amérique du Nord et des pays de l’Union européenne hors zone euro. Le montant des flux entrant aux Etats-Unis était comparable en 1995, mais a davantage progressé par la suite (60 milliards d’écus en 1996, 80 milliards d’écus en 1997) ; – s’agissant des flux sortants, les trois zones précitées ont investi chacune près de 60 milliards d’écus à l’étranger en 1996. Cependant, en 1997, les flux sortant des Etats-Unis ont atteint 100 milliards d’écus, soit davantage que l’Union européenne, qui s’est néanmoins approchée de ce niveau, et que la zone euro, dont les flux sortants se sont élevés, cette année là, à 77 milliards d’écus. Les destinations privilégiées par les investisseurs de la zone euro sont également l’Amérique du Nord (15 milliards d’écus en 1995, 20 milliards d’écus en 1996 et 1997) et les pays de l’Union européenne hors zone euro (environ 20 milliards d’écus par an). Les pays d’Amérique du Sud semblent néanmoins de plus en plus attractifs (11 milliards d’écus en 1997). Mis à part le cas des Etats-Unis en 1996, les investissements à destination de l’extérieur ont donc été plus importants, s’agissant des trois entités précitées, que les investissements reçus de l’extérieur. Il en a été de même pour le Japon qui n’a bénéficié, au cours de la période observée, que de flux entrants marginaux. A la fin de 1996, les pays de la zone euro détenaient des avoirs d’investissements directs à l’étranger (hors zone euro) pour un montant de 435 milliards d’écus (543 milliards d’écus en ce qui concerne l’Union européenne, 620 milliards d’écus pour les Etats-Unis), leurs engagements vis-à-vis de pays extérieurs s’élevant, à la même date, à 384 milliards d’écus (422 milliards d’écus pour l’Union européenne, 474 milliards d’écus pour les Etats-Unis). La zone euro est donc celle qui enregistre l’écart le plus faible entre ses avoirs et ses engagements, mais elle est également exportatrice nette d’investissements directs à l’étranger, du fait, notamment, de puissants courants d’investissement vers l’Amérique du Nord. A l’inverse, elle est importatrice nette vis-à-vis des pays de l’Union européenne hors zone euro. La mise en place du marché unique, la libéralisation des mouvements de capitaux et, désormais, la monnaie unique, ont fortement favorisé cette internationalisation des économies européennes ainsi que le développement des investissements intra-zone. La France, dont l’ancrage européen est, à cet égard, particulièrement marqué, a profité de ce mouvement. · Comme chaque année, la Banque de France a récemment recensé le stock des investissements directs étrangers en France et celui des investissements directs de la France à l’étranger () : – au 31 décembre 1997, le stock des investissements directs étrangers en France était de 845,1 milliards de francs, contre 753,8 milliards de francs un an plus tôt. Notre pays se situait ainsi, comme en 1996, au troisième rang des pays industrialisés, derrière les Etats-Unis (4.081,8 milliards de francs) et le Royaume-Uni (1.691,8 milliards de francs). En rapportant ces stocks d’investissements directs étrangers aux PIB des différents pays, la France, avec un taux de 10,4%, occupe une position médiane, entre des économies structurellement très « investies », à l’image des Pays-Bas (35,7%), lieu d’accueil de nombreux sièges de holdings, et, dans une moindre mesure, du Royaume-Uni, du Canada et de l’Espagne (environ 20%), et des pays plus faiblement pénétrés par les capitaux étrangers, tels que l’Italie (7,5%), l’Allemagne (4,4%) ou le Japon (0,7%). La part de l’OCDE dans le total du stock des investissements étrangers en France est proche de 97%, les deux tiers provenant de pays de l’Union européenne. L’implantation étrangère en France s’organise autour de trois grands pôles d’activité qui reçoivent 45% des investissements directs étrangers : le secteur des holdings (18,2% du stock), du crédit (16,4%) et des industries chimiques (10,3%) ; – à la même date, la France détenait un stock d’investissements directs à l’étranger de 1.135,8 milliards de francs, en hausse de 12,4% par rapport à 1996. Elle figurait toujours parmi les premiers investisseurs au monde, derrière les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, l’Allemagne et les Pays-Bas. Ces investissements français à l’étranger sont également fortement concentrés sur l’OCDE (83% de l’encours total). Les Etats-Unis sont leur principal pays d’accueil (24% du stock). Toutefois, ils sont nettement devancés, en stock et en flux, malgré un tassement régulier depuis trois ans, par l’Union européenne considérée dans son ensemble, qui constitue, de très loin, la première destination des exportations (67% en 1997, comme en 1998) et des investissements (49% de l’encours et 46% des flux en 1998) français à l’étranger. Le Royaume-Uni et les Pays-Bas concentrent près de 44% de l’encours des investissements français dans l’Union européenne. Les industries manufacturières, les holdings et le secteur du commerce sont les principaux bénéficiaires de ces investissements. Ces résultats font de la France un « pays carrefour » des investissements directs (à la fois pays d’accueil et pays investisseur), comme la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, mais à la différence de l’Allemagne et du Japon qui sont des pays investisseurs (). Cela étant, la France fait partie des pays qui, depuis 1985 (à l’exception de 1995), sont constamment exportateurs nets de capitaux destinés à des investissements directs. Sur les dix dernières années, ses placements nets à l’étranger dus aux investissements directs s’élèvent à plus de 500 milliards de francs.
Comme l’atteste également ce tableau, les flux enregistrés en 1998 confirment les tendances observées les années précédentes () : – les investissements directs français à l’étranger ont réalisé leur meilleur résultat en valeur (239,4 milliards de francs) et le deuxième en pourcentage du PIB (2,9%). La reprise intervenue à partir de 1996, après un repli tendanciel entre 1991 et 1995, est donc confirmée ; – les investissements directs étrangers en France ont enregistré un nouveau record en 1998 (165,4 milliards de francs, soit 2% du PIB). Le solde net des investissements directs s’élève donc, en 1998, à 74 milliards de francs. 2. La compétitivité et l’attractivité sont les conditions d’une insertion réussie dans l’économie mondiale La globalisation s’impose largement à la France, et dans ces conditions, seule une stratégie d’insertion volontaire dans l’économie mondiale pouvait permettre à notre pays d’en profiter pleinement : – l’exportation est un facteur de croissance incontournable et, comme on l’a vu, l’investissement direct est complémentaire, notamment dans le cas français, des échanges de biens et services ; – être une terre d’excellence pour l’accueil des investissements étrangers constitue également un facteur favorable à l’emploi : la délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (DATAR) a ainsi recensé, en 1998, 445 nouveaux projets d’investissements (362 en 1997), assurant la création ou le maintien de 29.411 emplois directs sur les trois prochaines années (contre 24.212 emplois en 1997). Ce bilan conforte donc la politique d’ouverture de notre pays, où, depuis février 1996, les investissements directs étrangers sont libres de toute procédure préalable (). Dans le même temps, ce choix impose au Gouvernement de favoriser, à l’échelon international, notamment sur le terrain de la fiscalité, la recherche des coopérations nécessaires pour l’élaboration et le respect de règles de bonne conduite entre les Etats. a) La compétitivité des entreprises françaises : une position encore médiane La plasticité du concept de « compétitivité » ressort clairement de cette définition proposée par le Centre de recherches pour l’expansion de l’économie et le développement des entreprises : « La compétitivité est la capacité d’une entreprise, d’une région ou d’une nation à conserver ou à améliorer sa position face à la concurrence des autres unités économiques comparables. De façon plus précise, la compétitivité d’une nation est selon une définition classique son aptitude à produire des biens et des services qui satisfont au test de la concurrence sur les marchés internationaux, et à augmenter simultanément et de façon durable le niveau de vie de la population » (). Bien que ce concept intègre, de toute évidence, des éléments difficilement quantifiables, il est néanmoins d’usage, pour juger de la compétitivité d’une région par rapport à une autre, de comparer les prix et les coûts pratiqués dans ces deux régions. Le Rapport sur les comptes de la Nation reprend cette méthodologie :
Les organismes internationaux ont recours à des indicateurs de compétitivité plus élaborés et, à cet égard, plusieurs approches sont possibles : – une première approche consiste à comparer le niveau courant du taux de change à celui qui égalise les niveaux de prix ou de coûts entre les deux régions considérées. Ce dernier est appelé « taux de parité de pouvoir d’achat » (PPA), qui assure l’égalité des pouvoirs d’achat d’une unité monétaire dans chacune des régions. Il est ainsi possible de conclure quant à leur position compétitive respective. Une monnaie sous-évaluée ou surévaluée traduit un avantage ou un désavantage de compétitivité en niveau ; – une autre approche, plus souvent retenue car moins complexe, consiste à comparer l’évolution des prix lorsqu’ils sont convertis, au taux de change courant, dans une même unité monétaire. Bien sûr, ces deux approches sont parfois conjuguées. La direction de la prévision s’est récemment livrée à cet exercice dans une étude consacrée à la compétitivité relative des Etats-Unis, du Japon et de la zone euro (). Fondée, en conséquence, sur les parités des trois monnaies qui constituent le nouveau socle du système monétaire international (le dollar, le yen et l’euro), cette étude justifiait, implicitement, mais avec prudence compte tenu de la multiplicité des périodes de référence et de la diversité des indices de prix ou de coûts, la dépréciation de l’euro depuis sa naissance et tout au long du 1er semestre de 1999 : au vu des parités au 15 juin 1999 (1,04 dollar pour un euro et 120 yens pour un dollar), « les indicateurs traditionnels de compétitivité-prix et de compétitivité-coût attestent que les Etats-Unis ne souffriraient pas, avec le dollar à son niveau actuel, d’une position compétitive défavorable ». A l’intérieur de l’Union européenne, la situation française, sur la période 1987-1998, s’est « modérément améliorée » : à la veille de l’union monétaire, notre pays était, selon l’OFCE, « proche du centre de gravité européen », à un niveau de compétitivité situé à mi-chemin entre le point bas qui était le sien en 1987 et le point haut atteint cinq ans plus tard. A compter de 1992, en effet, les gains induits par cinq années de désinflation compétitive ont été partiellement effacés par les crises successives du SME qui se sont prolongées jusqu’en 1995. Par la suite, en 1996-1997, la normalisation monétaire en Europe et la poursuite de la désinflation compétitive en France ont rendu à notre pays un léger avantage de compétitivité (). En 1998, toutefois, selon la Banque de France, le franc s’est apprécié (+1,8% en moyenne annuelle), du fait, notamment, de la chute des monnaies des pays asiatiques, et, dans une moindre mesure, de la dépréciation du yen (deuxième et troisième trimestres), de la baisse du dollar (dès le second trimestre) et de la livre sterling (quatrième trimestre), ainsi que la dépréciation du rouble (quatrième trimestre). Cela étant, vis-à-vis des principaux pays de l’OCDE, le taux de change ne s’est apprécié que de 0,5% en termes nominaux (dépréciation du yen), et a même perdu 0,3% en termes réels (inflation plus faible en France) : – à l’égard des pays du mécanisme de change européen, le taux de change effectif nominal du franc s’inscrit en hausse modérée. En termes réels, il est demeuré stable. A l’intérieur du système, la compétitivité de la France n’a guère varié par rapport à l’Allemagne ou à l’Italie, elle s’est légèrement améliorée vis-à-vis du Danemark et des Pays-Bas, et dégradée à l’égard de l’Irlande et de la Grèce ; – par rapport à l’ensemble de l’Union européenne, la France a enregistré des gains de compétitivité (+0,6%), grâce à la nette amélioration observée à l’égard du Royaume-Uni ; – vis-à-vis de l’ensemble de l’OCDE, la compétitivité française s’est maintenue au niveau atteint l’année précédente. Les gains enregistrés par rapport aux Etats-Unis et à la Suisse ont été effacés par une dégradation à l’égard des autres partenaires, notamment le Japon (). Pour sa part, le rapport sur les comptes de la Nation considère que, dans ce contexte de change moins favorable, la compétitivité-coût de la France a cessé de progresser en 1998, voire a reculé, par rapport à ses huit principaux partenaires de l’OCDE, notamment les Etats-Unis. Quant à la compétitivité-prix, sa dégradation remonterait au début de l’année 1997. « Cette évolution laisse penser que l’effort de marge des entreprises françaises a été relativement moins soutenu que celui de leurs concurrentes étrangères en 1998 » (). Toutefois, ce phénomène reste mesuré. Le degré de compétitivité des entreprises françaises doit sans doute être amélioré, mais, dans l’ensemble, il semble se maintenir à un niveau médian. Il est possible qu’après une année 1997 de reconstitution des marges, la vigueur de la demande interne, en 1998, n’ait pas incité les entreprises françaises à consentir des efforts de marge importants. Mais le Gouvernement est résolu, comme il l’a fait l’année dernière avec les dispositions fiscales favorables à l’innovation et la suppression progressive de la part salariale de la taxe professionnelle, à soutenir la compétitivité des entreprises françaises. En outre, comme on l’a vu, l’évolution de l’euro par rapport au dollar et au yen au cours du premier semestre de 1999 confère aux entreprises des Etats qui participent à l’Union monétaire des gains de compétitivité face à leurs principaux compétiteurs. Toutefois, il conviendra d’être vigilant, d’autant que la France n’est pas plus à l’abri aujourd’hui qu’hier de stratégies de dévaluations compétitives hors de la zone euro. Et à l’intérieur de celle-ci, malgré le gel, au 1er janvier 1999, des parités nominales entre les monnaies des Etats concernés, les parités réelles (c’est-à-dire les niveaux comparés des prix) pourront continuer à manifester des différences, et ces différences évoluer sous l’effet des inflations respectives. L’observation de ces phénomènes sera importante : ils influeront sur le degré de compétitivité des entreprises françaises et, plus largement, sur la dynamique de l’Union européenne. b) L’attractivité du territoire français : des avantages structurels incontestables Trop souvent, le degré d’attractivité d’un territoire a été réduit au coût de la main-d’œuvre locale et au niveau des prélèvements obligatoires dans le pays considéré. Ces critères ne doivent pas être négligés : le phénomène de la délocalisation à destination de pays à bas coûts salariaux recouvre une réalité dans certains secteurs, le textile-habillement notamment. Mais l’observation empirique des flux d’investissement permet déjà de relativiser leur importance : comme on l’a vu, les pays industrialisés sont le lieu de destination ou d’origine de l’essentiel des investissements français à l’étranger et étrangers en France. A contrario, les pays à bas salaires accueillent une part très faible des investissements français à l’étranger. De toute évidence, la réalité est donc plus complexe. A cet égard, l’exemple de Toyota bat en brèche bien des idées reçues. L’importance de ses investissements directs en Europe au cours des dernières années illustre la nécessité de produire près des marchés, pour vendre des biens adaptés aux attentes des consommateurs. Et, en 1997, lors du choix de Valenciennes comme lieu d’implantation pour sa deuxième usine européenne de production d’automobiles (investissement de 4 milliards de francs, 2.000 emplois directs), ses dirigeants ont avancé des explications significatives pour justifier leur décision : la situation géographique de Valenciennes (proximité avec les autres unités européennes du groupe, facilités d’accès, position stratégique sur les principaux marchés européens) (), la qualité des infrastructures existantes (autoroutes, voies ferrées et fluviales, etc.), la disponibilité d’équipementiers automobiles et de sociétés de service, la présence d’une main-d’œuvre abondante et qualifiée dans une région dotée d’un fort héritage industriel, notamment. De même, en choisissant d’implanter sur le parc international scientifique de Sophia-Antipolis, dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, son nouveau centre de design, dont la première pierre a été posée le 8 mars dernier (investissement de l’ordre de 90 millions de francs), Toyota a mis en avant l’existence d’un excellent tissu de recherche et développement, d’une desserte aérienne internationale, la proximité de Turin et du pôle des designers italiens de l’automobile, ainsi que la créativité de la région et la qualité de son environnement. Au-delà, les dirigeants d’entreprises avancent, le plus souvent, à l’appui de leurs décisions d’investissement, la taille du marché (qui, dans le cas de la France, peut être considérée à l’échelle de l’Union européenne), la stabilité et la performance de l’environnement politique, le cadre législatif et réglementaire, la croissance interne et ses perspectives. Dès lors, il apparaît que la France possède de nombreux atouts structurels, que les deux événements suivants devraient d’ailleurs conforter : – selon les indications fournies par la DATAR, la répartition sectorielle des investissements étrangers en France en 1998 révèle que, pour la première fois, le secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication figure en première position, devant l’automobile. Le secteur qui connaît la plus forte croissance est celui du conseil et des services (logistique, centres d’appel, centres de services en temps partagé, etc.). De façon générale, les firmes étrangères en France se portent de plus en plus sur les activités où les enjeux sont intensément technologiques (électronique, informatique, télécommunications) et à haute valeur ajoutée, secteurs qui sont considérés comme les gisements d’emplois de demain ; – la mise en place de l’euro crée, par ailleurs, un climat favorable aux investissements en provenance des autres régions du monde, surtout dans un contexte de défiance financière à l’égard des marchés émergents. Au total, il n’est pas étonnant que, selon l’enquête semestrielle réalisée par le centre de recherche et de statistiques américain A.T. Kearney (FDI Confidence Index) auprès des dirigeants des 1000 plus importantes entreprises mondiales, la France ait gagné neuf places, entre juin et décembre 1998, au classement des pays attractifs, atteignant ainsi le dixième rang mondial. Et notre pays parvient à conserver cette confiance puisqu’il se situait toujours à ce rang dans l’indice de juin 1999 : il se place en très bonne position pour la plupart des critères de référence retenus par les investisseurs internationaux : taille du marché (du fait de l’accès au marché européen), stabilité et performance de l’environnement politique et du cadre législatif et réglementaire, perspectives de croissance, qualité des infrastructures, du potentiel technologique et de la main d’œuvre, etc.
Cette position doit être préservée. Les avantages structurels de la France devraient le permettre, qui compensent le niveau encore relativement élevé des coûts et des charges : la dramatisation du discours sur les délocalisations, trop centré sur le coût de la main-d’œuvre, est trompeuse. Celui-ci est loin d’être le seul critère pour une décision d’investissement direct à l’étranger et, au demeurant, notre pays ne se distingue pas, de manière générale, des autres économies industrialisées, par des coûts salariaux plus élevés : le problème n’est réel que pour les bas salaires et, à cet égard, les propositions du Gouvernement concernant la réforme des cotisations sociales patronales vont dans le bon sens. Le rôle de la fiscalité ne doit pas davantage être négligé, mais simplement relativisé. La disparité des systèmes fiscaux nationaux, y compris à l’intérieur de l’Union européenne, rend les comparaisons malaisées : au-delà des taux d’imposition qui sont aisément identifiables, il convient de tenir compte de l’ensemble des règles fiscales en vigueur (base imposable notamment), des multiples régimes particuliers ou dérogatoires et de la fiabilité inégale des données (). Ainsi, s’agissant de l’imposition sur les bénéfices, la France est, avec l’Italie, un des pays d’Europe où le taux apparent (40% en 1999) est le plus élevé. Mais la détermination du résultat net imposable est très différente selon les pays : les règles applicables aux provisions ne sont pas les mêmes (non-déductibilité des provisions pour risques et litiges au Danemark, en Espagne, en Grèce et en Allemagne, des provisions pour dépréciation de stock en Grèce et au Portugal ou de titres en Belgique et aux Pays-Bas, possibilités très diverses s’agissant des provisions pour les retraites, etc.), ainsi que les règles d’amortissement ou le traitement des plus-values de cession. Chaque entreprise, ou chaque investissement, tend à devenir un cas particulier. En outre, comme votre Rapporteur général l’a déjà souligné, une comparaison du niveau des prélèvements obligatoires sans prise en compte des services rendus en contrepartie n’a guère de sens : ces prélèvements assurent le financement d’infrastructures et de services collectifs qui sont nécessaires à la croissance et qui constituent, d’ailleurs, des critères importants pour les investisseurs internationaux. Or, leur qualité est certainement sensiblement supérieure en France par rapport à bien d’autres pays. Les investisseurs prennent en compte l’ensemble de ces facteurs, leurs décisions résultent d’un large faisceau de critères, et l’intensification, ainsi que la provenance ou la destination des investissements directs étrangers en France et français à l’étranger, témoignent, encore une fois, qu’en termes d’attractivité, notre pays occupe une place éminente. Pour autant, il est incontestable que la globalisation impose aux Etats d’œuvrer, en particulier au niveau de l’OCDE, dans le sens d’un démantèlement des paradis fiscaux et des régimes préférentiels destinés à attirer les investissements étrangers : la concurrence fiscale appauvrit les Etats, affaiblit leur capacité à mettre en œuvre des politiques de redistribution, favorise les investissements les plus mobiles (ceux des multinationales, au détriment des PME), et conduit à une taxation relativement plus forte des facteurs de production les plus statiques (le travail par rapport au capital). Ce risque est renforcé, à l’intérieur de la zone euro, par l’achèvement de l’union monétaire : faute de pouvoir dévaluer leur monnaie, certains gouvernements pourraient être tentés de recourir à l’« arme fiscale » pour améliorer leur avantage compétitif. A cet égard, on constate que la Commission européenne, sous la pression de certains Etats et notamment de la France, adopte sur ce sujet une position plus pragmatique que par le passé : l’accent est mis, davantage, sur le caractère dommageable d’une concurrence fiscale non maîtrisée. En témoignent les discussions en cours, qui se sont poursuivies à l’occasion du Conseil des ministres des finances de Turku le 11 septembre dernier, à propos de l’adoption d’un code de conduite sur la fiscalité des entreprises ou de la proposition de directive concernant l’instauration d’une retenue à la source pour les revenus de l’épargne. Le Gouvernement devra également s’inspirer des réflexions parlementaires menées sur ce sujet : on pensera, en particulier, aux réflexions présentées par notre collègue M. Jean-Pierre Brard, dans son rapport d’information (n° 1802) sur la fraude et l’évasion fiscales examiné par la Commission des finances le 8 septembre dernier. C.- UNE DYNAMIQUE DE L’INVESTISSEMENT ET DE L’INNOVATION ENCORE TROP HÉSITANTE La croissance globalement soutenue depuis le deuxième semestre de 1997 s’explique principalement par le dynamisme de la demande interne, la consommation des ménages étant notamment stimulée par la politique sociale du Gouvernement et les bons résultats en matière d’emploi, alors que l’investissement des entreprises reste élevé. Pour autant, le moindre dynamisme des exportations dans une économie globalisée rappelle que la pérennité de la croissance dépend également de la vitalité de l’offre. 1.- L’investissement des entreprises : ombres et lumières La mise en place du nouveau système de comptabilité nationale en base 1995 avec une nouvelle séquence des comptes des secteurs et la révision des agrégats bouleverse les comptes nationaux : le volume des indicateurs économiques annexé au projet de loi de finances dans le rapport sur les comptes de la Nation a été réduit, du projet de loi de finances pour 1999 au projet de loi de finances pour 2000, de 413 pages à 104 pages. Dans l’attente des compléments annoncés par ce document, votre Rapporteur général a souhaité présenter, dans le tableau ci-dessous, l’évolution d’une année sur l’autre de la formation brute de capital fixe (FBCF) des sociétés non financières et des entreprises individuelles (SNF-EI), en francs courants.
La publication des principaux indicateurs trimestriels par l’INSEE, en francs constants, permet de mettre en évidence, mieux que le tableau précédent, le retournement de conjoncture du deuxième trimestre de 1997, pour ce qui concerne l’investissement.
Les dernières statistiques, en date du 7 septembre 1999, confirment que la croissance de l’investissement a été particulièrement soutenue depuis le deuxième trimestre de 1997. La croissance de la FBCF des seules SNF-EI a été en 1998 de 6,83% en francs courants et de 7,3% en francs constants et données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables. La baisse de 0,8% au deuxième trimestre 1999, prévue par l’INSEE en juin, n’a pas été confirmée, puisque la croissance constatée aurait atteint 0,7%. L’acquis de croissance est, pour la FBCF des SNF-EI, de 4,9%, à comparer avec une prévision de 4,2% en juin 1999. Le dynamisme de l’investissement est inégal selon les secteurs () : il est particulièrement élevé dans les services marchands et l’industrie, mais plus faible dans les transports et télécommunications et le commerce. Les PME-PMI auraient particulièrement intensifié leur effort d’équipement en 1998, notamment dans le domaine informatique. La Banque de France () confirme cette analyse et estime qu’en 1999, l’investissement serait favorablement orienté dans tous les secteurs ; après la forte hausse observée en 1998, il ne progresserait que modérément dans les biens intermédiaires et se replierait légèrement dans les entreprises de 100 à 500 salariés. Plusieurs facteurs laissent à espérer qu’un retournement de conjoncture, en matière d’investissement, n’est probablement pas à craindre. En premier lieu, les principaux ratios des sociétés non financières et entreprises industrielles, dans le nouveau système de comptabilité nationale, mettent en évidence la bonne santé financière persistante des entreprises.
Pour la première fois depuis 1990, le taux d’investissement des SNF-EI, descendu à un niveau très bas, s’est redressé en 1998. Le taux de marge progresse et le fléchissement du taux d’autofinancement s’explique, non pas par la faiblesse de l’épargne, mais par la reprise de l’investissement. En deuxième lieu, les variations de stocks contribuent négativement à la croissance depuis cinq trimestres : l’INSEE observe dans sa Note de conjoncture de juin 1999 qu’à la suite du ralentissement de l’activité industrielle observé depuis l’été 1998, le mouvement de déstockage de produits manufacturés amorcé à l’automne de 1998 s’est poursuivi au début de 1999. Elle annonce que le redressement de l’activité en 1999 devrait conduire les entreprises françaises à adopter un comportement de stockage plus porteur. En troisième lieu, le taux d’utilisation des capacités de production, dans l’ensemble de l’industrie, qui avait relativement fléchi depuis avril 1998, revenant de 84,3% à 83,8% en avril 1999, s’est redressé en juillet 1999 à 84,1%. Enfin, alors que la construction de logements (sauf dans le secteur social) et l’activité du bâtiment en général sont élevées, la production augmentant de 2% et l’excédent brut d’exploitation de 23% en 1998, l’investissement a régressé de 5% cette même année dans le secteur du bâtiment et du génie civil. On peut s’interroger sur la poursuite de cette tendance, alors que le Gouvernement et sa majorité ont pris des mesures puissantes pour stimuler aussi bien la construction de logements sociaux (réforme du prêt locatif aidé, réaménagement de la dette des organismes, baisse des taux des prêts) que les travaux dans le secteur privé (application du taux réduit de TVA aux travaux d’entretien). Cependant, même si des éléments significatifs laissent à penser que la croissance de l’investissement devrait se poursuivre et ne pourrait être affectée que par un retournement global de conjoncture, votre Rapporteur général, tout en se réjouissant de ce dynamisme, reste prudent pour l’avenir. Le rapport sur les comptes de la Nation annexé au présent projet de loi de finances, cherchant à expliquer, à l’aide de modèles mathématiques, pourquoi les prévisions ont surestimé systématiquement l’investissement entre 1993 et 1997, ne peut que conclure que la faiblesse de l’investissement pendant cette période « reste en partie inexpliquée ». La croissance de l’investissement ne semble donc pas devoir faiblir en 2000 (), alors que se pose toujours la question de son orientation : la croissance interne de l’entreprise dans les secteurs concurrentiels dépend dans une importante mesure de sa politique de recherche-développement et de sa capacité à innover, alors que le mouvement de croissance externe, et particulièrement celui des fusions-acquisitions, n’a jamais été aussi puissant à l’échelle mondiale. 2.- Le renforcement de la politique favorable à l’innovation La clé de la survie et du développement des entreprises est aujourd’hui bien identifiée, il s’agit de la capacité à innover dans les produits ou dans les procédés. Selon l’INSEE, la valeur ajoutée des petites entreprises industrielles et de l'artisanat de production (PEIA) innovantes, a crû de 8,5% en 1996 et 1997, contre 3,4% pour les non innovantes. Cette capacité à innover découle directement d’un mécanisme de mieux en mieux perçu, qui est le transfert de technologie, véritable moteur de l’innovation. Le lien entre innovation et croissance est bien mis en relief dans le rapport établi par MM. Robert Boyer et Michel Didier dans le cadre des travaux du Conseil d'analyse économique (). Le processus interactif d’innovation suppose un ensemble d’initiatives pour qu’une invention ou une innovation technologique passe du stade de la recherche (le laboratoire), au stade industriel (l’entreprise). Si la recherche constitue bien une base essentielle de la croissance économique, l’appropriation par les agents économiques des résultats de cette recherche en est le pendant indispensable. Or la France, comme l’Europe, a pris du retard dans les investissements publics et privés en matière de recherche et surtout diffuse moins qu’ailleurs ses connaissances et ses découvertes au tissu économique. On pourra se reporter, en ce qui concerne l’Europe, au rapport d’information présenté à la Délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne par notre collègue Mme Michèle Rivasi (), à propos du Vème programme-cadre de recherche et de développement de la Communauté européenne (PCRD). Ce n’est pas tant le niveau des dépenses de la recherche française qui est préoccupant que la répartition des moyens entre la recherche scientifique et la stimulation de l'innovation. Les crédits affectés à la valorisation de la recherche (L’Agence nationale de valorisation de la recherche et les centres techniques industriels) sont actuellement de l'ordre de 4 à 5 milliards de francs alors que l’ensemble des crédits publics de recherche est de l’ordre de 80 milliards de francs (dont 26 milliards de francs au titre de l’effort militaire). Le transfert de technologie requiert l’existence d’interfaces, réels ou virtuels, entre les organismes de recherche ou les universités et l’industrie, mais aussi des formes de financement adaptées aux besoins des entreprises innovantes ou à leur création (capital-risque, capital-développement). L’incitation fiscale à la recherche et à l’innovation, par l’élargissement du crédit d’impôt-recherche et la mise en œuvre d’un crédit d’impôt-innovation performant, mérite également d’être envisagée. Cette démarche nécessite une transformation du rôle de l’Etat et de l’action publique, vers moins de dirigisme, plus de coordination et de décentralisation. Les résultats contrastés des technopoles (Sophia Antipolis par exemple) qui se sont multipliées sur le territoire, montrent qu’à l’implantation d’un centre de recherche ou d’un centre universitaire, même avec un potentiel critique, il est indispensable d’associer une véritable dynamique de collaboration recherche-entreprise. Le rapport « Innovation et croissance » précité, relève la faiblesse du rôle des sources publiques (laboratoires et universités) dans les processus d’innovation des entreprises. La recherche interne et la stimulation du marché en constituent les sources principales. Il faut également préciser que 60% de la dépense consacrée par les entreprises françaises à la recherche est réalisée dans moins de 200 grandes entreprises, la part des PME industrielles dans cette dépense représentant moins de 20%. La loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche, modifiant la loi du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique, entend accompagner cette mutation de la recherche publique, afin qu’elle contribue davantage à la création de richesses. Le processus d'innovation a vocation à se diffuser dans l’ensemble de l’économie. Toutefois c'est dans les domaines des technologies de l’information et de la communication ainsi que des biotechnologies (les technologies-clés), que l’effort en matière de recherche et de diffusion des résultats doit principalement porter. Dans la présentation du projet de loi à l’Assemblée nationale, le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie, a d’ailleurs rappelé l’exemple des Etats-Unis où ces nouvelles technologies constituent un facteur explicatif très important de la croissance soutenue et durable. La loi a ainsi prévu plusieurs dispositifs pour impulser la recherche et la mise en œuvre des implications industrielles. Elle ouvre d’abord la possibilité aux chercheurs de quitter, pour une durée de six ans, le service public, afin de participer à la création d’une entreprise qui valorise leurs travaux. Ils pourront également apporter leur concours scientifique à une entreprise sans quitter le service public. D’autre part, les universités et les organismes de recherche vont pouvoir créer des services d’activités industrielles et commerciales, afin de gérer avec les entreprises des contrats de recherche dans un cadre juridique et budgétaire plus souple. Ils pourront également constituer des « incubateurs » afin de faciliter l’accès des entreprises innovantes aux résultats de leurs travaux. Une somme de 200 millions de francs a d'ores et déjà été débloquée pour financer une vingtaine de projets de ce type. Afin d’assouplir les règles de leurs statuts, la loi ouvre aux entreprises innovantes l’accès au régime des sociétés par actions simplifiées (SAS), jusqu’alors réservé aux filiales de grandes sociétés. Enfin, le cadre fiscal favorable aux entreprises innovantes introduit par la loi de finances pour 1998 a été renforcé. Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), soumis à un traitement fiscal et social favorable (article 163 bis G II du CGI) pourront être accordés dans les entreprises dont le capital social est détenu à hauteur de 25 %, et non plus 75%, par des personnes physiques. Nul doute que cet effort devra être prolongé. La réflexion dont l’engagement a été annoncé par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, sur l’épargne salariale, fournira un cadre adéquat. D.- LE TISSU PRODUCTIF : DES ÉVOLUTIONS STRUCTURELLES DONT LES EFFETS CONTRASTÉS APPELLENT À LA VIGILANCE La dynamique de la recherche-développement et de l’innovation reste globalement insuffisante pour assurer la croissance interne des entreprises par la création de valeur. Leurs dirigeants peuvent également s’orienter vers la croissance externe des entreprises : cette tendance se traduit à l’échelle mondiale par la vogue des fusions-acquisitions ou M &A (Mergers and acquisitions). Pour la France, l’été 1999 restera dans les mémoires de la communauté financière comme celui des offres publiques d’échange concurrentes de la BNP et de la Société générale dans le secteur bancaire, d’Elf-Aquitaine et de TotalFina dans celui des pétroles et du projet de fusion de Carrefour et de Promodès dans la distribution. Cependant, la question de l’intérêt financier, économique et social des fusions-acquisitions est controversée. Toutes ne se traduisent pas par la création de valeur, ce qui a une incidence sur la valorisation boursière des sociétés concernées, alors que, d’une façon générale, les nuisances sociales qu’elles entraînent sont mésestimées. La restructuration du tissu productif français en accompagnement de la mondialisation de l’économie doit donc être menée avec discernement. 1.- Un nombre croissant de fusions-acquisitions Le mouvement des fusions-acquisitions s’accélère sans nul doute, aussi bien dans le monde qu’en Europe, même si l’appréhension statistique de ces restructurations semble encore balbutiante. Au plan mondial, ces opérations ont augmenté de 50% en 1998 par rapport à l’année précédente pour atteindre un montant de 2.450 milliards de dollars. Aux Etats-Unis, le montant total des transactions a représenté, au premier semestre 1999, 570 milliards de dollars, à comparer aux 528 milliards de dollars du premier semestre 1998. Sur la même période du premier semestre 1999, les fusions-acquisitions en Europe ont représenté 346 milliards de dollars (). L’Europe se situe donc très en-deçà des Etats-Unis, qui ont enregistré environ 1.500 milliards de dollars de fusions-acquisitions en 1998 (20% du PIB), contre 900 milliards de dollars en 1997. Ces opérations auraient représenté en Europe occidentale environ 700 milliards de dollars en 1998 (8% du PIB).
En France, une première vague de fusions-acquisitions était intervenue au cours des années 1966-1972, encadrée par l’Etat, et intéressant notamment les chantiers navals et la sidérurgie. L’erreur stratégique que ces concentrations ont représentée a entraîné un coût supporté par la collectivité au cours des décennies suivantes. Une deuxième vague importante est survenue dans la période 1980-1992. Elle a été caractérisée par le recentrage de nombreuses sociétés sur leur métier de base et par le développement des opérations transfrontalières ainsi que par l’introduction en France de méthodes de prédation boursière sur des sociétés anciennes au capital dispersé. Nous sommes donc dans le cadre d’une troisième vague déjà engagée avec, par exemple, les fusions Axa-UAP, Suez-Lyonnaise ou Lyonnaise-Dumez, qui ont précédé les opérations de l’été 1999. Le marché des seules fusions-acquisitions transfrontalières, qui vient de faire l’objet d’une étude du cabinet KPMG Corporate Finance, est, lui aussi, en forte expansion (). Alors que la baisse du nombre de transactions est constante, si l’on compare les résultats de chaque premier semestre depuis 1996 (3.114 fusions-acquisitions transfrontalières au premier semestre 1996 et 2.415 au premier semestre 1999), la valeur de ces opérations augmente très fortement (119 milliards de dollars au premier semestre 1996, 243 milliards de dollars au premier semestre 1998 et 411 milliards de dollars au premier semestre 1999). La valeur moyenne des fusions-acquisitions transfrontalières est donc de plus en plus élevée. Les Etats-Unis sont, au premier semestre 1999, le principal pays vendeur (183 milliards de dollars) et seulement le deuxième acheteur (75 milliards de dollars) après le Royaume-Uni (151 milliards de dollars). Les acquisitions et prises de participation des entreprises françaises à l’étranger augmentent fortement depuis 1996 (35 milliards de dollars au premier semestre 1999) et sont très supérieures aux acquisitions et prises de participations étrangères en France (9 milliards de dollars au premier semestre de 1999). Enfin, encore moins perceptible au plan statistique que les opérations des grands groupes, le marché des fusions-acquisitions intéresse également les PME. Certaines entreprises innovantes en plein essor sont rachetées par des groupes importants dans le cadre de leur politique de recherche et d’innovation. Pour d’autres PME, le positionnement et les perspectives de croissance conduisent également à des fusions-acquisitions. 2.- Les motivations diverses des fusions-acquisitions La croissance externe de l’entreprise a pour but, en principe, non pas d’augmenter optiquement sa valeur par un coup de bourse, mais de créer réellement de la valeur en améliorant son fonctionnement, soit au stade de la production (économies d’échelle, coûts salariaux, recherche-développement), soit au plan de la commercialisation (économies de gamme, de marketing, pouvoir de marché). La réalisation d’économies d’échelle est recherchée, notamment dans les industries traditionnelles comme la sidérurgie ou dans le cadre d’opérations de restructuration. S’agissant des fusions les plus récentes, opérées au premier semestre 1999, Exxon et Mobil attendaient de leur rapprochement une réduction des coûts de près de 4 milliards de dollars par an, Deutsche Bank et Bankers Trust 1,6 milliards de dollars et Zeneca et Astra 1 milliard de dollars en trois ans. Dans les secteurs où les frais de recherche et de marketing sont élevés, les fusions-acquisitions permettent d’atteindre la taille indispensable à la rentabilisation d’investissements lourds. C’est le cas, en particulier, dans la pharmacie, où la recherche de nouvelles molécules est extrêmement onéreuse pour un résultat des plus aléatoires. La commercialisation des nouveaux médicaments, d’abord aux Etats-Unis (36% du marché mondial) et en Europe (29% du même marché) suppose, à défaut d’une fusion, la création d’un partenariat entre groupes, afin de conforter les structures de marketing. Des économies de gamme, des synergies, par exemple en cas de fusion d’un fournisseur avec un client, des préoccupations de diversification des risques peuvent, de même, motiver une fusion-acquisition. Il est également patent que la constitution de groupes extrêmement importants s’explique par la volonté de peser sur la concurrence, grâce à un pouvoir de marché accru. La fusion d’Exxon et Mobil a abouti à la constitution de la plus grande entreprise du monde (186 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 1997), celle de BP et Amoco, en août 1998, à la 11ème entreprise du monde. A une moindre échelle, la fusion annoncée Carrefour-Promodès ne pourrait manquer de transformer les relations du nouveau groupe aussi bien avec ses fournisseurs qu'avec ses clients, dans certaines zones de chalandise. Enfin, le développement des fusions-acquisitions s’explique par une transformation des relations entre les dirigeants et les actionnaires des entreprises. Le capitalisme traditionnel, « à la française », reposait, dans une grande mesure, sur un héritage historique souvent familial à faire fructifier par des dirigeants d’autant plus favorisés dans leurs relations avec l’Etat qu’ils étaient fréquemment issus de la fonction publique. La mondialisation des financements, l’intervention d’actionnaires étrangers, par exemple des fonds de pension anglo-saxons ou japonais, a modifié la donne. En septembre 1998, la chute vertigineuse des cours d’Alcatel, à la suite de l’annonce de résultats jugés décevants par les fonds de pension étrangers, illustre l’irruption d’un actionnariat qui impose des critères de rentabilité très exigeants aux dirigeants. Si l’on ajoute qu’en cas de fusion, il ne peut y avoir de dyarchie à la tête des nouvelles structures, il est facile de comprendre que la croissance externe des sociétés s’explique, bien sûr, par la volonté de création de valeur, mais aussi par le choc des ego ou l’instinct de conservation des dirigeants. 3.- Un environnement favorable aux concentrations Trois catégories de facteurs ont contribué au contexte favorable à la vague actuelle de rapprochements d’entreprises : d’abord, la mondialisation de l’économie, qu’elle se manifeste par la libéralisation du commerce et des mouvements de capitaux, la constitution de sous-ensembles économiques ou monétaires supérieurs aux Etats comme l’Union européenne, ou la déréglementation dans certains secteurs ; en deuxième lieu, la croissance économique ; enfin, le contexte particulier de financements rendus aisés par la baisse des taux d’intérêt. La libéralisation du commerce international a, depuis l’entrée en vigueur du GATT en 1948, été jalonnée par les grands cycles de négociations internationales avec le Dillon round (1961), le Kennedy round (achevé en 1967), le Tokyo round (1979), le cycle d’Uruguay et la création de l’Organisation mondiale du commerce en 1995. Le développement des pays émergents et la création de zones d’échanges privilégiés (Alena pour l’Amérique du Nord et le Mexique, Mercosur pour l’Amérique du sud, Communauté économique européenne) ont facilité l’expansion des grandes entreprises au delà des frontières. S’agissant de l’Europe, la création du marché unique en 1993, puis celle de l’euro, contribuent à accélérer les concentrations d’entreprises. La libéralisation des mouvements de capitaux est une autre condition indispensable à la réalisation de fusions-acquisitions transnationales. En 1980, 70% des Etats opéraient un contrôle sur les flux de capitaux et 60% d’entre eux un contrôle sur les devises reçues des exportations. Ces taux avaient été abaissés à respectivement 18% et 2% en 1996. La déréglementation a, dans certains secteurs, joué un rôle essentiel pour favoriser des restructurations. Ainsi, dans celui des télécommunications, le démantèlement d’ATT imposé aux Etats-Unis par une décision de justice en 1984, a été suivi par la privatisation, en Europe et dans des pays émergents, de nombreux opérateurs nationaux. Les révolutions technologiques ont favorisé des opérations très importantes comme l’alliance de British Telecom avec ATT (été 1998) ou la prise de contrôle d’Olivetti sur Telecom Italia (mai 1999), en dépit d’un projet de fusion de Deutsche Telecom avec cette dernière société. Une déréglementation comparable affecte plus récemment le secteur postal avec un enjeu particulier pour le marché du transport express et des fusions menées notamment par la poste néerlandaise (TNT Post group) et la Deutsche Post. Dans ce contexte, La Poste française est contrainte de s’adapter. Au plan conjoncturel, on considère habituellement qu’une croissance soutenue favorise le marché des fusions-acquisitions. Dans les périodes de moindre croissance, comme en France de 1973 à 1985, le positionnement extérieur des grandes entreprises se traduit plutôt par une politique défensive de restructurations, avec notamment la cession des activités annexes, que par une politique offensive de croissance au moyen de fusions-acquisitions. En effet, cette dernière forme de croissance externe a pour objectif essentiel le développement des parts de marché, ce qui suppose que le marché soit porteur. Enfin, la bonne tenue des marchés financiers contribue au dynamisme des fusions-acquisitions. Les actionnaires, qui peuvent être sollicités par des offres concurrentes, comme on l’a vu cet été en France, sont sensibles aux anticipations de croissance et de valorisation des titres des sociétés concernées. S’agissant des entreprises absorbantes, leurs offres, nécessairement attractives, peuvent nécessiter des financements extérieurs : ils sont rendus plus aisés en périodes de taux d’intérêt bas. Ces deux dernières années sont caractérisées, aux Etats-Unis et en Europe, par la conjonction de marchés d’actions dynamiques avec des taux d’intérêt très peu élevés. La multiplication des rapprochements favorise d’autres fusions-acquisitions par une sorte d’effet « boule de neige » : les offres concurrentes d’Elf-Aquitaine et de TotalFina s’analysent ainsi dans le contexte d’une concentration accrue de l’industrie pétrolière (Exxon-Mobil, BP-Amoco). 4.- Des effets financiers, économiques et sociaux inégaux Tous les rapprochements ne réussissent pas et les effets des fusions-acquisitions sont pour le moins contrastés, qu’il s’agisse de la valorisation boursière des sociétés concernées, de l’impact économique ou des conséquences sociales de ces opérations. Sur le plan financier, les opérations de fusion-acquisition font intervenir fréquemment des offres publiques d’achat ou d’échange adressées aux actionnaires de la société cible. L’offre devant être attractive, la plupart du temps, le cours de bourse de cette société s’élève, pendant l’opération, de 20% à 35%. Le cours de bourse de la société à l’origine de l’offre connaît, pour sa part, une évolution peu significative, voire dans certain cas négative. En effet, les offres réussies, en cas d’acquisition hostile, sont généralement des offres trop élevées, phénomène que le jargon boursier appelle la « malédiction du vainqueur ». En phase de croissance boursière, la société acheteuse propose fréquemment une rémunération constituée partiellement par ses actions et par des liquidités. Selon la valorisation du cours de ses actions elle aura un intérêt inégal à proposer des actions ou des espèces. Dans la plupart des cas, les actions du nouveau groupe affichent des performances inférieures à celles des entreprises comparables du même secteur. Sur le plan économique, les effets des opérations de concentration sont également controversés et posent des problèmes spécifiques en matière d’innovation et de concurrence. La taille des opérations contribue à la difficulté de leur réussite, puisque les transactions d’un montant supérieur à 30% du chiffre d’affaires de l’acquéreur ne débouchent sur des succès que dans 25% des cas. La destruction de valeur, mesurée notamment par la baisse de la profitabilité (), est plus fréquente que la création de valeur. La croissance externe des sociétés est également dénoncée comme un facteur de stérilisation de l’innovation et, d’une manière plus générale, de la dynamique de croissance interne. La recherche-développement et l’innovation nécessitent des moyens importants détournés par la croissance externe. A contrario, certaines sociétés industrielles françaises, comme L’Oréal, connaissent une croissance interne forte générant une réussite industrielle et boursière, sans avoir besoin de réaliser des acquisitions extérieures importantes. Les mécanismes de concentration posent également problème car ils peuvent porter atteinte à la concurrence dans les secteurs économiques concernés. L’Organisation mondiale du commerce s’est interrogée () sur l’opportunité de transposer au niveau international les législations nationales en matière de concurrence. L’action des autorités a déjà fait échouer certains rapprochements (par exemple les éditeurs Wolters Kluwer et Reed Elsevier dans l’Union européenne, au début de 1998) ou fusions comme celle de Bell Atlantic et de TCI en 1994, dans le secteur du câble aux Etats-Unis. Cette action a pu sembler parfois paradoxale lorsque, en 1991, le projet d’achat du fabricant canadien d’avions de transport régional DeHavilland par Alenia et Aérospatiale a été mis en échec, non pas par le Bureau de la concurrence du Canada, qui avait décidé de ne pas s’y opposer, mais par la Commission européenne. Cet été, le projet de fusion de Promodès et de Carrefour a donc suscité une intervention très pertinente du Gouvernement afin que le dossier soit examiné par le Conseil de la concurrence pour déceler les zones où la part de marché du nouveau groupe le placerait en position dominante. La recherche d’un pouvoir de marché peut donc quelquefois difficilement se conjuguer avec les règles applicables en matière de concurrence. Indépendamment de cette réglementation, on peut reprocher à la dynamique de croissance externe des sociétés un même effet stérilisant pour l’innovation que celui résultant de la mobilisation financière qui la soutient : lorsqu’une fusion est motivée par le souci d’éliminer un concurrent plus performant, il ne peut y avoir de création de richesse. Enfin, les conséquences sociales des fusions-acquisitions sont souvent négatives, au moins dans un premier temps, avec des suppressions d’emplois, comme dans le cas des rapprochements BP-Amoco (6000 suppressions d’emplois), Deutsche Bank-Bankers trust (5500 emplois), ou Zeneca-Astra (6000 emplois supprimés soit 13% des effectifs). Certes, lorsque la fusion est effectivement un succès, son impact sur l’emploi peut être représenté par une courbe « en J » car, à moyen ou long terme, l’amélioration de la situation de l’entreprise permet des créations d’emplois. Indépendamment de ses effets sur l’emploi, la méconnaissance de la gestion des ressources humaines lors d’une fusion-acquisition peut conduire à un échec lorsque les différences de culture d’entreprise sont trop fortes, par exemple dans le secteur de la pharmacie. On se souvient qu’après le rachat de Marion Merrel Dow, Hoechst a connu quelque difficulté à réaliser l’intégration de Hoescht Pharma, Roussel-Uclaf et Marion. Selon Mercer Management Consulting (), trois critères sont déterminants pour la réussite ou l’échec d’une fusion : le prix d’acquisition, l’intention stratégique et la gestion de l’intégration de l’entreprise absorbée. Selon Elie Cohen (), « les bonnes fusions sont celles où il existe un intérêt économique à marier deux entreprises et où l’union permet de réaliser d’importantes économies d’échelle ou de gamme ainsi que des complémentarités géographiques dans les réseaux. La fusion réussie tient compte des cultures managériales et de gestion et répond aux évolutions des structures de marchés. A l’inverse, en fonction de ces cinq critères, dès lors qu’il y a mariage hostile dans un contexte où l’actif essentiel de l’entreprise est le capital humain et où il y a choc des cultures, le risque d’échec est sérieux ». Il n’est pas douteux que les entreprises françaises, prenant en compte la mondialisation de l’économie, doivent s’y adapter en se renforçant. Cependant, la croissance externe n’est pas une solution miracle et les expériences passées suffisent à démontrer qu’il faut la conduire de façon pertinente, faute de quoi le coût économique et social risque d’être très supérieur au gain escompté. DEUXIÈME PARTIE Curieusement, le débat sur la dette publique en général et sur la dette de l’Etat en particulier ne fait pas recette en France. Il se différencie en cela très nettement du débat sur le déficit. Repoussoir absolu pour les uns – au nom d’une prétendue orthodoxie dont on ne connaît que trop les limites – ou mal nécessaire pour les autres – en raison de ses effets stabilisateurs sur des économies capitalistes fondamentalement instables – le déficit budgétaire reste un point d’ancrage fort des argumentations, voire des passions politiques. La relative discrétion dans laquelle évolue la dette publique résulte-t-elle pour autant d’une quelconque indifférence, ou bien d’une certaine difficulté à appréhender tous les éléments d’une question complexe et – il faut le reconnaître – assez aride ? Peut-être doit-on y voir plutôt la conjugaison de deux facteurs, l’un structurel, l’autre plus « conjoncturel ». Conjoncturellement, depuis la conclusion du traité de Maastricht, les gouvernements de toutes tendances politiques n’ont pas ménagé leurs efforts (avec des méthodes diverses et des résultats pour le moins contrastés) pour que la France puisse participer dès l’origine à la troisième phase de l’Union économique et monétaire. Or, parmi les quatre principaux critères de convergence, notre pays était relativement bien placé au regard du critère portant sur le taux d’endettement public. Aujourd’hui encore, le taux d’endettement public de la France (58,5% du PIB selon l’ancien système de comptabilité nationale SEC 79) est largement en deçà de la moyenne des pays de la zone euro. En revanche, en 1997, l’équation était moins claire s’agissant du respect du critère relatif au déficit des administrations publiques. Si peu claire, d’ailleurs, qu’il a été décidé de consulter les électeurs de façon anticipée… Au-delà de ces considérations très directement liées à un moment particulier de notre histoire – la marche vers la monnaie unique –, la dette peut structurellement apparaître comme le « résidu fatal » des déficits passés, comme la cristallisation définitive des décalages successifs entre dépenses et recettes, phénomène sur lesquels le gestionnaire public d’aujourd’hui n’a plus de prise. A contrario, la crise de la dette qu’ont connue certaines collectivités territoriales au début des années quatre-vingt-dix a souvent rétabli le niveau d’endettement au rang des indicateurs privilégiés de la politique budgétaire locale. C’est dire que les questions liées à la dette ne sauraient être négligées dans le cadre de la réflexion et de l’action concernant la conduite des finances publiques, y compris pour l’Etat. La charge nette de la dette accumulée depuis une vingtaine d’années pèse aujourd’hui près de 235 milliards de francs au sein du budget général et la légère réduction de cette charge prévue dans le projet de budget pour 2000, de l’ordre de 2,5 milliards de francs, ne doit pas masquer que, sur vingt ans, une croissance trop dynamique des dépenses d’intérêts a largement préempté l’augmentation des recettes fiscales. Pourtant, le Parlement n’a encore qu’une vision tronquée de la dette de l’Etat, sans même parler de celle des autres administrations publiques. En opérant la distinction fondamentale entre « opérations permanentes » et « opérations de trésorerie » et en plaçant les émissions et remboursements d’emprunts dans cette dernière catégorie, l’ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances a singulièrement réduit l’horizon parlementaire en matière d’approbation et de contrôle de l’endettement de l’Etat. Ainsi, les ressources et remboursements d’emprunt ne figurent pas en tant que tels dans la définition de l’équilibre général du budget, au contraire de ce qui est exigé pour les collectivités locales par les règles comptables qui leur sont applicables. Les budgets annexes, à l’inverse, intègrent en recettes et en dépenses le produit et l’amortissement de leurs emprunts. En gardant à l’esprit la modestie de ceux-ci par rapport au montant total du déficit, la différence de traitement entre budget général et budgets annexes confère ainsi une cohérence intellectuelle toute relative au tableau d’équilibre qui conclut la première partie des projets de loi de finances. On pourrait disserter longuement sur le fait que l’article 2 de l’ordonnance organique de 1959 dispose que « la loi de finances de l’année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat », que l’article 31 de la même ordonnance dispose que « le projet de loi de finances de l’année […] évalue le montant des ressources d’emprunt et de trésorerie », mais que, dans le cadre d’une pratique constante s’appuyant opportunément sur la rédaction de l’article 15 de la même ordonnance (), l’article définissant les conditions générales de l’équilibre financier n’a jamais accordé au ministre chargé des finances qu’une autorisation générale d’emprunt. Dans son ouvrage sur Le budget de l’Etat sous la Ve République, un spécialiste des finances publiques aussi éminent que P. Amselek a pu écrire : « Dans la mesure […] où ces ressources [de trésorerie] sont destinées à financer une partie des dépenses permanentes inscrites dans la loi de finances, dans la mesure où elles constituent ainsi un mode de couverture des dépenses budgétaire, elles s’identifient en fait à de véritables ressources budgétaires, au même titre que des ressources permanentes ; par suite, le caractère très général de l’autorisation dont elles font l’objet doit s’analyser comme une forme de dégradation de l’autorisation budgétaire elle-même : en ce qui concerne le financement d’un certain montant des dépenses, les parlementaires s’en remettent dans une très large mesure au Gouvernement pour qu’il se procure l’argent nécessaire » (). Le groupe de travail sur l’efficacité de la dépense publique et le contrôle parlementaire, créé en octobre 1998 à l’initiative du Président de l’Assemblée nationale, M. Laurent Fabius, s’est naturellement saisi de ces questions et a formulé des propositions fortes. Parallèlement, l’intérêt manifesté par de nombreux membres du groupe de travail a amené votre Rapporteur général à décider de réaliser, dans le cadre du présent rapport, une étude approfondie sur les méthodes de gestion de la dette de l’Etat. Votre Rapporteur général a, tout d’abord, voulu éviter de réitérer l’exercice maintes fois accompli, qui consiste à dresser un panorama Cette étude s’attachait, pour l’essentiel, à analyser les interactions entre déficits publics, endettement des administrations publiques et évolution de leur patrimoine. Elle se plaçait donc d’emblée sur un terrain différent des préoccupations qui animaient, pour leur part, les membres du groupe de travail précité de l’Assemblée nationale. En centrant leur intérêt sur la gestion de la dette de l’Etat, ceux-ci souhaitaient s’abstraire de toute considération sur les « faits générateurs » de la dette. Pour autant, l’analyse de la gestion de la dette ne pouvait s’inscrire, aux yeux de la représentation nationale, dans une optique purement financière. C’est pourquoi votre Rapporteur général s’est mis à l’œuvre en choisissant d’analyser la gestion de la dette dans ses interactions avec les conditions de formation des taux d’intérêt servis sur les titres d’Etat. La « bataille de la dette » est globale. Elle se déroule principalement sur le front du déficit budgétaire, mais on ne saurait en négliger les déterminants financiers. De plus, une présentation de la gestion de la dette de l’Etat au sein même du Rapport général participe de l’impératif de transparence qui est l’une des raisons d’être de l’institution parlementaire. Il est rapidement apparu qu’il convenait d’inscrire cette étude dans une problématique à la fois plus large et plus circonstancielle : une réflexion sur la politique d’endettement de l’Etat dans le contexte nouveau créé par l’introduction de l’euro, monnaie unique européenne. En effet, le rapport spécial sur le budget des Charges communes, sous les signatures successives de MM Jean-Marc Ayrault, Yves Fréville et Thierry Carcenac, notamment, s’est enrichi au fil des ans et contient aujourd’hui des développements conséquents sur la dette de l’Etat. En effet, il a progressivement intégré, à côté de l’approche budgétaire classique visant à présenter et expliquer la charge de la dette inscrite au titre Ier des dépenses du budget général, une approche financière de plus en plus approfondie. C’est donc à partir de ces fondements déjà solides que se sont orientées les investigations de votre Rapporteur général. Elles montrent a posteriori combien étaient justifiées les transformations profondes qu’a connues la dette de l’Etat depuis le milieu des années quatre-vingt. En effet, l’union monétaire réalisée le 1er janvier 1999 a contribué à « banaliser » les émetteurs souverains de la zone euro, dans un marché des capitaux quasiment unifié. Pour autant, la qualité de la dette française et de sa gestion devrait lui conférer une place de choix au sein des portefeuilles des investisseurs, réduisant ainsi son coût pour le contribuable. LA DETTE DE L’ETAT EN CHIFFRES ENCOURS DE LA DETTE DE L’ETAT AU 31 DÉCEMBRE (a) (en milliards de francs)
(a) Hors titres émis au profit du Fonds de soutien des rentes (FSR). (en milliards de francs)
(b) Hors titres émis au profit du Fonds de soutien des rentes (FSR). Source : Compte de la dette publique, Situation résumée des opérations du Trésor.
1999 : prévision LFI
1999 : prévision LFI Note : les comptes nationaux en base 1995 ne sont pas disponibles, pour l’heure, pour les années antérieures à 1992.
1999 : prévision LFI CHAPITRE PREMIER Le 1er janvier 1999, le remplacement de onze monnaies nationales par une monnaie unique, l’euro, a fait des pays participant à la troisième phase de l’union économique et monétaire un ensemble très spécifique au sein de l’économie mondiale. Ayant confié leur souveraineté monétaire à une institution supranationale unique, ils constituent une « zone euro » dont l’importance rivalise avec celle des deux principales économies, les Etats-Unis et le Japon. LES GRANDES ZONES ÉCONOMIQUES (données relatives à l’année 1996)
(a) aux prix et taux de change courants (b) aux prix et parités de pouvoir d’achat courants Source : OCDE, UEM. Faits, défis et politiques (février 1999) Pour autant, le volume et les structures des marchés de capitaux, notamment des marchés obligataires, restent très différents et reflètent des modes de financement particuliers pour chacun de ces trois ensembles économiques. LES MARCHÉS OBLIGATAIRES : UNE COMPARAISON (au 30 juin 1997, en milliards de dollars)
Source : Deutsche Bank, The Euro Capital Markets, avril 1998. La dette publique émise aux Etats-Unis, sous forme de titres obligataires, est proportionnellement plus importante qu’au Japon ou dans la zone euro ; en effet, les collectivités locales utilisent le marché obligataire comme source de financement importante. La zone euro domine en matière d’émissions au profit du secteur bancaire, à la fois en valeur absolue par rapport aux Etats-Unis ou au Japon et en proportion de son endettement obligataire total. Enfin, les entreprises du secteur non bancaire constituent moins de 5% du marché en zone euro, alors qu’elles comptent pour près de 20% aux Etats-Unis, le Japon occupant une position intermédiaire avec un peu plus de 10% des émissions relevant du secteur non bancaire. En tout état de cause, le marché obligataire de la zone euro, simplement considéré comme la somme de ses composantes individuelles, apparaît très comparable aux marchés américain et japonais. Cette similarité des volumes ne doit pas masquer une différence essentielle entre les États-Unis et le Japon d’une part, la zone euro d’autre part. Le marché obligataire de celle-ci reste fragmenté en ce sens qu’il n’accueille pas un émetteur souverain unique, proposant au marché une seule signature, mais onze émetteurs souverains – assurément d’importance variable – ayant chacun leurs traditions et spécificités en matière de couverture de leur besoin de financement et d’appel au marché obligataire. Avant l’introduction de l’euro, chaque État constituait une référence naturelle dans l’aire territoriale où s’exerçait son pouvoir monétaire. Depuis l’introduction de l’euro, le « paravent monétaire » national s’est effacé et, désormais, l’Etat se trouve mis potentiellement sur le même plan que les autres signatures souveraines de la zone ou que certaines signatures supranationales de grande qualité telles que celle de la Banque européenne d’investissement. L’euro a banalisé les émetteurs souverains. S’inscrivant dans la suite logique du long processus de libéralisation des mouvements de capitaux au sein de la Communauté européenne, l’avènement de la monnaie unique crée les conditions d’une mutation profonde pour l’intermédiation financière et amorce une concurrence d’un nouveau genre entre les Etats. Les titres de la dette allemande et de la dette française sont ainsi amenés à rivaliser pour s’imposer comme la référence européenne des marchés de taux. A.- L’AVÈNEMENT DE L’EURO, POINT D’ORGUE DE L’INTÉGRATION 1.- Une dynamique d’intégration déjà ancienne a) Les espaces ouverts par le traité de Rome : espoirs et enlisement L’intégration des marchés financiers européens – l’un des éléments permettant de parvenir à un véritable marché commun – supposait la liberté des mouvements de capitaux, mais ne pouvait s’y limiter : la réalisation d’un véritable marché sans frontières supposait également la liberté d’établissement et la liberté de prestation de services au sein des Etats membres. Ces trois dimensions sont indissociables. « A quoi servirait-il d’harmoniser les réglementations nationales régissant les activités financières, de reconnaître aux intermédiaires financiers le droit de fournir leurs services dans l’ensemble de l’Union si les résidents des Etats membres se trouvent privés de la faculté de conclure et d’exécuter des opérations financières au-delà du territoire national ? Dans une telle situation, la libre prestation de services apparaîtrait comme une façade : elle ne pourrait guère s’effectuer que par le biais du droit d’établissement ou devrait se limiter aux services n’impliquant pas de mouvement de capital » (). C’est pourquoi, dès l’origine, la libre circulation des capitaux constitue l’une des quatre libertés fondamentales de la Communauté européenne, inscrites dans le traité de Rome, avec la libre circulation des biens, des marchandises et des personnes. Cependant, les dispositions essentielles régissant les mouvements de capitaux étaient placées dans une situation subordonnée, n’étant pas d’application directe dans les Etats membres et devant s’effacer, le cas échéant, derrière la réalisation des autres objectifs de la construction européenne, notamment le bon fonctionnement du marché commun. Les conceptions économiques générales de l’époque, comme les mécanismes de changes fixes relevant du système de Bretton Woods, la volonté des Etats membres de conserver l’autonomie de leur politique économique, la priorité donnée à la stabilité des taux de changes ou la faiblesse de l’intégration économique des Etats membres sont autant de facteurs qui ont concouru à laisser en jachère les dispositions du traité de Rome et à s’en remettre à la bonne volonté des Etats membres pour libéraliser, à leur gré et à leur rythme, leurs relations financières extérieures. Il convient de noter que le traité de Rome prévoyait expressément une clause d’exception pour les emprunts d’Etat, certains ayant craint que leur marché des capitaux ne soit envahi par les emprunts d’autres Etats membres. L’article 68, paragraphe 3, du traité disposait ainsi que « les emprunts destinés à financer directement ou indirectement un Etat membre ou ses collectivités publiques territoriales ne peuvent être émis ou placés dans les autres Etats membres que lorsque les Etats intéressés se sont mis d’accord à ce sujet ». Les premières obligations faites aux Etats membres de libéraliser les mouvements de capitaux ont été imposées par une directive du Conseil du 11 mai 1960, modifiée et consolidée par une directive du Conseil du 18 décembre 1962. Ces deux directives ensemble ont établi une nomenclature des transactions de capitaux en les regroupant en quatre listes (A à D) et ont imposé aux Etats membres l’obligation de libéraliser inconditionnellement les transactions relevant de la liste A (investissements directs, investissements immobiliers, crédits commerciaux à court terme, mouvements de capitaux individuels, transferts en exécution de contrats d’assurance) et dans la liste B (opérations portant sur des titres faisant l’objet de transactions en Bourse). Elles ont, par ailleurs, invité les Etats membres à libéraliser les transactions mentionnées dans la liste C (émission et placement d’obligations ou d’actions, opérations sur titres non négociés en Bourse, opérations sur parts de fonds communs de placement négociés en Bourse, crédits à long terme liés à des transactions commerciales). Elles n’imposaient aucune obligation de libéralisation aux transactions incluses dans la liste D, qui regroupait les transactions en capital non comprises dans les listes précédentes. La détérioration de l’environnement financier due à l’effritement, puis à l’effondrement, du système de Bretton Woods et l’instabilité consécutive des relations monétaires internationales ont non seulement stoppé, mais fait reculer le mouvement de libéralisation engagé sous la houlette de la Communauté européenne. En application des clauses de sauvegarde prévues par le traité de Rome, plusieurs Etats membres ont réintroduit des restrictions aux mouvements de capitaux dont la libéralisation était prévue. b) De l’Acte unique européen au traité de Maastricht, Il a fallu attendre 1983 pour que le thème de la libéralisation des mouvements de capitaux soit à nouveau à l’ordre du jour des travaux menés par la Commission européenne. Mais la véritable impulsion est venue des travaux préparatoires à l’Acte unique européen, adopté en 1986 et entré en vigueur en février 1987. Dans l’exercice consistant à évaluer le « coût de la non-Europe », la réduction du prix de services financiers qui devait résulter d’une intégration financière des Etats membres était estimée à 0,7% du PIB. L’ampleur de ces baisses de prix devait être très variable selon les pays concernés : – 21% en Espagne, entre – 15% et – 10% pour une catégorie « intermédiaire » (Italie, France, Belgique, Allemagne) et – 8% à – 4% pour une dernière catégorie qui regroupait le Luxembourg, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Par ailleurs, ces baisses de prix devaient avoir des effets induits importants sur l’ensemble de l’économie, l’effet multiplicateur provenant en grande partie de la baisse du coût du crédit. Au total, l’augmentation du PIB communautaire était estimée à 1,5%, la désinflation induite s’élevait à 1,4% et l’amélioration des soldes budgétaires était évaluée à 1,1%. L’Acte unique n’ayant en lui-même modifié qu’à la marge les dispositions du traité relatives aux mouvements de capitaux, c’est la directive du Conseil du 17 novembre 1986 qui relance la dynamique de la libéralisation : elle étend les obligations des Etats membres à la majeure partie des transactions visées par la liste C. Enfin, la directive du Conseil du 24 juin 1988 instaure la liberté complète de tous les mouvements de capitaux à compter du 1er juillet 1990. Dès cette époque, la perspective est clairement l’instauration de mécanismes permettant d’envisager, à terme, la création d’une monnaie unique. Cette démarche s’articule d’ailleurs sans difficulté avec les efforts tendant à l’achèvement du marché intérieur dans le domaine des services financiers. Le traité sur l’Union européenne, entré en vigueur en novembre 1993, instaure un nouveau régime de circulation des capitaux à compter du 1er janvier 1994. Contrairement au précédent, ce régime est d’application directe et ne nécessite pas l’adoption de directives par le Conseil. Pierre angulaire de ce dispositif, l’article 73B du traité dispose que « […] toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ». Mis à part une exception déterminée dans le domaine de la taxation, le principe de non-discrimination entre nationaux, résidents, non nationaux et non-résidents doit aussi être respecté. Les Etats membres conservent cependant le droit d’établir des règles nationales en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers. Le panorama rapidement brossé de cette longue marche vers la libre circulation des capitaux doit être complété par la mention des autres initiatives communautaires visant à la réalisation d’un grand marché unifié des services financiers. Près de vingt directives bancaires et autant de directives sur les assurances ont engagé l’harmonisation des réglementations nationales dans leur domaine respectif. Le cadre légal d’activité des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) a également fait l’objet de plusieurs textes communautaires. Enfin, le 11 mai 1999, la Commission européenne a présenté un « plan d’action pour le marché financier unique », qui contient une série d’objectifs politiques et de mesures spécifiques visant à améliorer le marché unique des services financiers au cours des cinq prochaines années. Il ne serait donc pas approprié d’affirmer que l’introduction de l’euro entraîne, à elle seule, un bouleversement fondamental dans les déterminants de l’intégration financière européenne. La dynamique d’intégration obéit, depuis longtemps, à des forces autres, qui recouvrent partiellement le champ d’influence de la monnaie unique, mais ne s’y laissent pas enfermer. C’est pourquoi l’euro doit plutôt être considéré comme un élément d’accélération de tendances déjà existantes ou perceptibles. 2.- L’euro, accélérateur de la recomposition
L’opinion communément admise dans les milieux économiques est que l’élargissement des marchés financiers ainsi que l’amélioration de la liquidité des échanges consécutifs à l’avènement de la monnaie unique doivent exercer un effet d’attraction sur les emprunteurs privés et favoriser le développement des mécanismes d’endettement fondé sur l’émission de titres, au détriment des prêts bancaires. Selon la Banque centrale européenne, « il est également probable que l’élargissement de la zone monétaire va attirer de nouveaux investisseurs et émetteurs vers les marchés de capitaux de la zone euro. Le caractère durable du bas niveau d’inflation, actuelle et anticipée, et la baisse des besoins de financement du secteur public pourraient constituer d’autres facteurs susceptibles de favoriser l’activité privée sur les marchés de capitaux » (). L’euro renforcerait alors le processus de désintermédiation observé depuis plusieurs années, qui se traduit par la diminution relative des financements bancaires vis-à-vis des financements directs sur les marchés. Bien que le total de bilan des établissements de crédit ait continué à progresser en pourcentage du PIB – de 177% du PIB en 1985 à 244% du PIB en 1997 – la croissance des actifs gérés par les fonds de placement (notamment les OPCVM) a été supérieure à cette progression. Les banques ont perdu du terrain par rapport aux investisseurs institutionnels, compagnies d’assurance et fonds de pension (). Cette évolution se trouve illustrée, pour ce qui concerne les emprunteurs (sociétés privées non financières), par l’exemple d’Éridania Béghin-Say, présenté dans l’édition du 23 décembre 1998 de l’hebdomadaire CreditWeek, publication de Standard & Poors. En 1992, les deux tiers de ses dettes étaient constituées d’emprunts bancaires, les obligations et les titres de créances négociables ne représentant respectivement que 20% et 13%. En 1997, les crédits bancaires ne comptaient plus que pour 20% des dettes du groupe, l’essentiel de celles-ci se composant de bons de trésorerie, d’obligations et de billets à moyen terme. Par ailleurs, la société a diversifié ses sources géographiques de financement, puisque 40% de ses obligations sont placées hors de France ainsi que près de 15% de ses bons de trésorerie ; de même, la totalité de ses billets à moyen terme est placée à l’étranger. Standard & Poors estimait qu’après l’euro, de nombreuses autres sociétés de taille inférieure pourraient suivre l’exemple d’Éridania Béghin-Say. Par ailleurs, l’essor des restructurations en Europe devrait également favoriser l’activité des marchés de capitaux, les ressources désintermédiées étant le mode privilégié de financement des opérations de fusions-acquisitions, qui se développent, comme on l’a vu précédemment dans la première partie du présent volume. Il est vrai que le phénomène déborde largement de la zone euro au sens strict, d’une part, parce que nombre de fusions-acquisitions s’inscrivent dans la perspective d’un développement mondial plutôt qu’européen, d’autre part, parce que certaines de ces opérations peuvent concerner des entreprises implantées dans des Etats membres de la Communauté européenne n’appartenant pas à la zone euro mais susceptibles d’y entrer à plus ou moins brève échéance. Enfin, la recherche de rendements plus élevés devrait amener les investisseurs à s’intéresser à des produits plus rémunérateurs que les emprunts d’Etat. La dette obligataire privée représente, à cet égard, un substitut naturel de la dette d’Etat. La plupart des analystes s’accordent à prédire une forte augmentation, dans les années à venir, des investissements dans les obligations à fort rendement et le développement d’une certaine appétence pour le risque – ou plutôt pour la rémunération supplémentaire qu’il procure par rapport aux investissements les plus sûrs… Cependant, la désintermédiation prendra du temps, estime J.P. Betbèze, directeur des études du Crédit Lyonnais. Les taux d’intérêt sont relativement bas et les conditions bancaires sont, selon lui, plus accomodantes en Europe qu’aux Etats-Unis, notamment pour les petites et moyennes entreprises. De plus, il faut du temps pour modifier les habitudes : selon les statistiques de la Banque d’Angleterre, les crédits bancaires représentaient 74% des dettes des sociétés non financières, contre 26% pour les titres mobiliers ; aux Etats-Unis, les proportions sont quasiment inverses, puisque les dettes bancaires ne constituent que 32% de l’endettement total des sociétés non financières contre 68% pour les titres mobiliers (). Il faut également du temps pour rassembler les compétences et les informations nécessaires à une bonne évaluation des titres proposés par les émetteurs. Dans son Rapport mensuel d’avril 1998, la Bundesbank était encore plus réservée, estimant qu’il « est très peu vraisemblable que [l’appétence nouvelle pour le risque-crédit] conduira effectivement à une expansion rapide du marché obligataire privé au détriment des prêts bancaires. La faible participation des entreprises au marché des capitaux reflète un certain nombre de caractéristiques inhérentes aux systèmes économiques et financiers européens, comme l’importance mineure du financement par actions […], la structure du secteur non financier, les questions fiscales et, en définitive, les avantages spécifiques de l’emprunt bancaire. […] Sans des changements structurels au sein de l’économie réelle, une expansion abrupte [du marché obligataire privé] nourrie par le secteur financier seulement rencontrerait probablement très vite ses limites ». Pourtant, l’activité du marché financier de la zone euro peut donner à croire que l’euro a vigoureusement relancé le processus de désintermédiation. Les premières évaluations relatives aux émissions de dette obligataire privée au cours du premier semestre 1999 montrent une croissance significative des émissions internationales libellées en euro (42,6% du total), qui semblent se situer de façon durable à un niveau comparable aux émissions libellées en dollars (46,1% du total). En 1998, ces proportions étaient de 36% () et 46,5% respectivement. Selon les analystes de Lehman Brothers, l’euro s’est développé au détriment de la livre sterling et des autres monnaies (dont on peut penser qu’il s’agit, pour l’essentiel, du franc suisse). Dans leur note trimestrielle sur les marchés obligataires en euro, les services de la direction générale II de la Commission européenne mettent en avant que ces chiffres, déjà remarquables en eux-mêmes, doivent être analysés à l’aune des évolutions de la parité euro-dollar au cours du semestre écoulé. Le renforcement quasi continu du dollar sur la période a pu limiter l’attrait des placements en euro pour les investisseurs (). Les statistiques du second semestre seront donc intéressantes, puisque l’euro semble parvenu à un plancher vis-à-vis du dollar depuis le milieu de l’été, aidé par les bonnes perspectives de la croissance en Europe et par les inquiétudes croissantes sur la santé future de l’économie américaine. Par ailleurs, plus en amont, un nombre croissant de sociétés ont demandé aux agences de notation de les évaluer, signe qu’elles envisagent de se présenter dans les mois qui viennent sur le marché des capitaux. En remplaçant les signes monétaires nationaux par la monnaie unique européenne, la troisième phase de l’union économique et monétaire a levé la dernière barrière qui protégeait les Etats emprunteurs. Dans le cadre général d’un profond remodelage des mécanismes financiers au sein de la zone euro, ceux-ci sont désormais, formellement, mis sur pied d’égalité pour se procurer les capitaux nécessaires à la couverture de leur besoin de financement. B.- UN CONTEXTE CONCURRENTIEL PLUS VIF ENTRE ÉMETTEURS SOUVERAINS, OÙ LA FRANCE ET L’ALLEMAGNE PRÉTENDENT TOUTES DEUX ASSUMER LE RÔLE D’« ÉMETTEUR DE RÉFÉRENCE » Les marchés obligataires se structurent en deux segments : le segment des émissions « de référence », occupé par les emprunteurs de la plus grande qualité, et le segment des émissions portant un risque de crédit. Bien évidemment, le risque exige une sur-rémunération : les émissions à risque de crédit portent un taux d’intérêt plus élevé que les émissions de référence et sont plus coûteuses pour l’emprunteur. On conçoit aisément l’avantage que peut représenter la capacité d’émettre des titres de référence, pour les emprunteurs importants que sont devenus la quasi-totalité des Trésors publics des pays de l’Union européenne depuis une vingtaine d’années. Cet avantage est encore accru du fait que, dans les périodes de tension ou de crise, les écarts de taux ont, en général, tendance à s’accroître. La situation des émissions à risque-crédit se dégrade plus que celle des émissions de référence. Or, dans le cadre de marchés nationaux cloisonnés par la barrière des changes, l’Etat était tout naturellement l’émetteur de référence, dans son pré carré. L’euro bouleverse la donne en supprimant les réserves « captives » d’épargne nationale : plus directement qu’auparavant, il expose chaque signature souveraine aux fluctuations de l’opinion des marchés et aux arbitrages de portefeuille. Les Etats doivent désormais convaincre de la qualité de leur signature, y compris vis-à-vis des autres Etats. 1.- L’euro ouvre une ère de concurrence accrue a) Les lieux de la concurrence entre émetteurs publics La première conséquence, la plus évidente, de l’introduction de l’euro est la suppression de tout risque de change pour les transactions financières à l’intérieur de la zone euro. Certes, le processus de convergence préalable à la réalisation de l’union économique monétaire, encadré par le régime de parités ajustables du Système monétaire européen, avait déjà contribué à crédibiliser les cours-pivot et à donner une quasi-garantie de leur maintien jusqu’au 1er janvier 1999. Cependant, les deux plus récentes crises, survenues en septembre 1992 (sortie de la livre sterling et de la lire italienne) et en août 1993 (élargissement à ± 15% des marges de fluctuations des monnaies autour des cours-pivot) rappelaient à tous que des dérèglements macro-économiques suffisamment forts pouvaient se révéler destructeurs. L’euro consacre définitivement la stabilité des changes intra-européens () – en supprimant la notion même de change – et favorise donc la fluidité des mouvements de capitaux intra-zone. En inversant la perspective – on pourrait dire qu’il s’agit en quelque sorte des deux faces d’une même monnaie… – l’euro supprime aussi toute possibilité d’effectuer des arbitrages entre devises européennes (), pour les pays participant à la troisième phase de l’union économique et monétaire. Or, ces toutes dernières années, cette activité d’arbitrage a été largement pratiquée par les gestionnaires de fonds, notamment de certains OPCVM () de taux. Ceux-ci ont cherché à tirer parti des opportunités que pouvait représenter la participation supposée, incertaine, possible ou probable, avec des degrés de confiance fluctuants, de certains pays qui n’étaient pas assurés de respecter les critères de déficit public ou de dette publique conditionnant l’entrée dans la zone euro. Or, pour l’arbitragiste, le support naturel de ces produits de taux participant d’une stratégie d’« achat d’un pays » était l’emprunt d’Etat. L’investisseur jouant le risque-pays avait, en effet, vocation à limiter au maximum les autres risques, donc à diriger ses placements vers la signature étatique. L’achèvement de la convergence et l’introduction de la monnaie unique supprime l’un des facteurs de l’appétence des investisseurs internationaux pour les titres publics de la zone euro. Les informations recueillies par votre Rapporteur général montrent que le franc faisait partie de ces monnaies « arbitrées ». Ceci en dit long sur la capacité de nos gouvernants, entre 1993 et 1997, à donner aux marchés les gages d’une vertu financière dont ils se disaient pourtant les meilleurs garants. Au contraire, en affirmant des options politiques différentes, le Gouvernement actuel a ranimé la croissance, maîtrisé le déficit public au niveau requis, assuré la qualification de la France pour la monnaie unique et brisé ainsi la spéculation internationale. En dernier lieu, l’euro a pour corollaire la disparition des « marchés captifs » que pouvaient constituer pour les Etats une base locale d’investisseurs soumise à des règles prudentielles strictes. Les assurances et les caisses de retraite ou fonds de pension sont les deux principales catégories représentatives de tels investisseurs. Ces organismes prennent vis-à-vis de leur clientèle des engagements qu’il convient de couvrir par des actifs procurant à la fois rendement et sécurité. La réglementation impose, en général, à l’organisme des règles précises pour évaluer ses engagements et pose des limites strictes aux placements qu’il lui est loisible d’effectuer. Ainsi, en France, le code des assurances et le code de la sécurité sociale posent, respectivement pour les compagnies d’assurance et pour les institutions de prévoyance, des règles équivalentes : – une détermination précise des actifs réglementés, que l’on peut classer en cinq catégories : obligations, actions, immobilier, prêts et dépôts ; – une règle dite « de répartition » des placements entre ces catégories d’actifs : la valeur de bilan de chaque catégorie ne peut dépasser certains plafonds exprimés en pourcentage du total des engagements réglementés (65% pour les actions, 40% pour l’immobilier et 10% pour les prêts) ; – une règle dite « de dispersion », qui impose de ne pas concentrer ses placements sur une seule signature (valeurs émises ou prêts obtenus d’un même organisme, immeuble défini, parts ou actions d’une même société immobilière ou foncière, etc.) ; – une règle dite « de congruence », qui oblige à ce que les engagements pris dans une monnaie soient couverts par des actifs libellés dans cette même monnaie à hauteur de 80% au minimum. Cette règle de congruence était particulièrement importante jusqu’en 1998 : elle empêchait un assureur français, dont les engagements étaient principalement libellés en francs, de détenir des placements à l’étranger pour plus de 20% de la valeur de ces engagements. L’épargne drainée par l’assureur restait ainsi « captive » sur le territoire national. Cette règle des 80% découlant d’une directive européenne, un fonds de pension britannique, une caisse de retraite hollandaise ou un assureur allemand étaient pareillement bridés dans leurs possibilités de placement à l’étranger. L’introduction de l’euro entraîne ipso facto l’élargissement de l’horizon de placement à l’ensemble des pays de la zone euro, qui partagent désormais une même unité de compte. Cet élargissement ne remet aucunement en cause le fondement prudentiel de la règle de congruence, qui consiste à empêcher l’organisme porteur d’engagements de supporter un risque de change. En revanche, les valeurs mobilières émises par l’Etat national ne sont plus le support unique du « fonds de portefeuille » à risque minimal : tous les Etats peuvent, a priori, postuler à remplir ce rôle. Un certain nombre de facteurs modérateurs peuvent, cependant, venir tempérer l’aiguillon concurrentiel que constitue l’euro. Tout d’abord, la diminution des déficits prévisible dans les prochaines années devrait raréfier peu à peu l’offre de titres publics à destination des marchés et contribuer ainsi, par un classique effet de rareté relative, à renforcer le crédit des Etats membres, pris dans leur ensemble, vis-à-vis des émetteurs privés. Ensuite, la généralisation des gestions indicielles, découlant de l’influence croissante des modèles anglo-saxons de gestion d’actifs, devrait avoir tendance à limiter les pressions concurrentielles. En pratiquant une gestion indicielle, le gérant s’astreint à composer un portefeuille représentatif d’un indice publié par un intermédiaire de premier plan et à accomplir une performance aussi bonne, sinon meilleure, que celle de cet indice, dont le prix est en général calculé chaque jour. La composition des indices étant le plus souvent calquée sur la capitalisation globale des valeurs composant le « panier » de l’indice, la gestion indicielle tend plus à reproduire les situations acquises qu’à s’appuyer sur des arbitrages opportunistes (). Enfin, il convient de remarquer que l’octroi d’une liberté ne signifie pas nécessairement l’utilisation de cette liberté. Il suffit de constater le décalage entre le montant maximum d’investissements autorisés en actions pour les compagnies d’assurance françaises (65%, en vertu de la règle de répartition) et la structure effective des portefeuilles de ces compagnies. Le tableau ci-après illustre par ailleurs la diversité de cette structure selon les pays. PLACEMENTS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE EN EUROPE (1997) (en % du total des placements)
Source : Fédération française des sociétés d’assurance, Rapport annuel 1998. b) La réallocation des portefeuilles : des rythmes différenciés L’exemple des compagnies d’assurance suggère que la mise en place de la monnaie unique a vocation à s’accompagner de transferts de capitaux intra-européens. Votre Rapporteur général s’est interrogé sur le rythme vraisemblable de ces mouvements, conscient de ce que des réallocations de portefeuilles trop brutales pouvaient ou pourraient exercer des pressions déstabilisatrices sur certains marchés et entraîner des tensions sur les taux, en particulier ceux des emprunts d’Etat. La réponse à cette question doit faire apparaître les différences essentielles entre les investisseurs « liquides » et ceux qui portent des engagements de long terme. Les premiers sont, pour l’essentiel, les OPCVM. L’horizon de positionnement des gérants sur les titres du portefeuille est assez court (quelques semaines ou quelques mois) et permet des rotations rapides du portefeuille. Le tableau suivant récapitule, à titre d’exemple, les modifications de structure apportées à ses deux principaux portefeuilles obligataires « zone euro » par BNP Gestions. ÉVOLUTION DES DEUX PLUS IMPORTANTS PORTEFEUILLES OBLIGATAIRES « ZONE EURO » DE BNP GESTIONS
(a) obligations allemandes adossées à des actifs fonciers ou à des prêts aux administrations publiques Source : BNP Gestions. L’ampleur du redéploiement apparaît clairement. Pour autant, elle ne doit pas nécessairement être tenue pour représentative de l’ensemble des flux occasionnés par le passage à l’euro. En effet, certains investisseurs, comme par exemple les assurances, devraient opérer le remodelage de leurs portefeuilles essentiellement par la réallocation des flux de placements nouveaux et non des stocks de titres déjà en portefeuille. A cet égard, votre Rapporteur général se doit de noter que la notion de réallocation va bien au-delà du choix entre obligations d’Etat émises par plusieurs émetteurs souverains. La première ligne de partage semble devoir passer entre les trois grandes catégories d’actifs que sont les actions, les obligations et l’immobilier. Le rapport annuel pour 1998 de la Fédération française des sociétés d’assurance montre ainsi que dès avant l’introduction de l’euro, la stratégie de placement des assureurs s’est ajustée de façon sensible. Si les placements en obligations et titres de créances négociables représentaient toujours, sur l’année 1998, la part la plus importante des placements nouveaux des assureurs (317 milliards de francs), la part investie sous forme d’actions a représenté 37,5% de l’ensemble des placements nouveaux en 1998 (soit 192 milliards de francs environ) au lieu de 22,5% en 1997, 10,6% en 1996 et 8,4% en 1995. L’allègement géographique de la contrainte issue de la règle de congruence inscrira cette tendance à la diversification des actifs au sein d’une tendance à la diversification des nationalités d’actifs. Une mention particulière doit être réservée à la gestion d’actifs sous mandat, qui représente, en France, un volume de capitaux gérés légèrement supérieur à celui des OPCVM. L’ampleur et la vitesse de la réallocation des actifs gérés dépend pour une large part de la diligence avec laquelle les mandats se sont ajustés ou doivent encore s’ajuster à l’introduction de la monnaie unique, et de l’ampleur que souhaiteront donner à cet ajustement les propriétaires des actifs gérés. Il est difficile de tirer à ce stade des conclusions quantitatives de ces remarques générales. Quelque ampleur que puisse avoir le réaménagement des portefeuilles de placement, il s’appuie avant tout sur l’évaluation des qualités comparées des différents supports d’investissement. Les stratégies de diversification intra-européenne ne peuvent plus être géographiques () et ne sont plus motivées que par les différences de crédit que le gestionnaire de fonds accorde à telle ou telle signature. Force est de constater que l’euro n’a pas uniformisé les appréciations du risque crédit des différents Etats souverains de la zone euro et que les obligations d’Etats françaises et allemandes sont au coude à coude pour obtenir, au sein de la zone euro, le statut privilégié d’« émission de référence ». 2.- Signature française, signature allemande : a) La convergence des taux longs n’a pas supprimé toute distinction A la lumière de l’évolution des taux longs enregistrée jusqu’à la fin de l’année 1998, on aurait pu penser que la convergence réussie vers la monnaie unique allait se traduire par une annulation des écarts de taux entre émetteurs souverains de la zone euro. Il n’en est rien et les onze Etats restent différenciés par de légers écarts, généralement compris dans une fourchette de 0 à 40 points de base () au-dessus du taux de l’obligation d’Etat allemande, papier de référence à l’échéance dix ans, le Bund. A l’évidence, la situation de 1999 a peu à voir avec celle qui prévalait au début de 1995. Les taux à dix ans des obligations d’Etat espagnoles se situaient alors environ 450 points de base au-dessus du titre allemand, alors que les obligations italiennes se situaient plus de 550 points de base au-dessus de ce même titre. L’obligation de référence française se traitait, pour sa part avec un décalage d’environ 60 points de base à son détriment. L’engagement des Etats en faveur de l’union économique et monétaire et les décisions budgétaires qui étaient associées à cet engagement ont placé ces taux d’intérêt sur une pente fortement descendante, qui les a conduits à se rapprocher peu à peu du taux de l’obligation allemande de référence.
Une analyse plus fine de l’année 1998 montrerait, d’ailleurs, que les écarts de taux Espagne-Allemagne et Italie-Allemagne ont atteint un minimum au mois d’avril 1998, c’est-à-dire juste avant la décision du Conseil européen extraordinaire de Bruxelles du 2 mai 1998, qui a arrêté la liste des Etats pouvant participer à la troisième phase de l’union économique et monétaire. Pour les deux pays méditerranéens, les écarts de taux se sont légèrement tendus par la suite, confirmant ainsi l’adage bien connu selon lequel « on achète la rumeur et on vend l’information ». L’année 1998 a été fertile en débats sur les critères qu’il conviendrait d’appliquer pour juger de la valeur relative des titres souverains. Car s’il était un point qui faisait consensus, c’était bien la nécessité de considérer que les Etats ne constituaient pas un risque moins important après l’avènement de l’euro qu’avant. D’ailleurs les notes délivrées par les deux principales agences anglo-saxonnes aux onze Etats qualifiés pour l’euro s’étagent toujours, à l’heure actuelle, sur trois ou quatre « graduations » de leur échelle d’évaluation, de Aaa jusqu’à Aa3 pour Moody’s et de AAA jusqu’à AA pour Standard & Poors. LES ETATS DE LA ZONE EURO JUGÉS PAR
Source : Deutsche Bank, A Guide to Euroland Bond Markets, mai 1999. Les deux agences ont considéré différemment les conséquences du passage à l’euro sur le risque attribuable à chaque Etat. L’opinion la plus largement répandue au sein de la communauté financière était que l’abandon des monnaies nationales contribuait à aggraver le risque souverain des pays en monnaie nationale (l’euro) et à le rendre équivalent au risque souverain en devises, toujours supérieur, au mieux égal au premier. Ainsi, en mai 1998, Standard & Poors a annoncé que la notation de la dette domestique des Etats de la zone euro serait alignée sur celle de la dette extérieure. Moody’s a préféré adopter une attitude au cas par cas, qui a conduit, en règle générale à aligner la notation de la dette extérieure sur celle de la dette domestique. Ces notes sont certainement utiles aux investisseurs pour se forger une opinion sur la composition souhaitable de leur portefeuille, en fonction du couple risque-rémunération qu’ils souhaitent assumer. Mais elles semblent impuissantes à expliquer – encore moins à quantifier – un phénomène surprenant après neuf mois de fonctionnement des marchés euros : la faiblesse des écarts de taux entre pays de la zone euro. Sur l’échéance dix ans, la plus représentative, on observe péniblement, à la date du 17 septembre 1999, un écart de 36 points de base entre l’émission la moins chère (Portugal) () et l’émission allemande. Encore faudrait-il tenir compte du fait que l’obligation portugaise arrive à échéance légèrement après l’obligation allemande (juillet contre janvier), ce qui contribue à « tendre » légèrement l’écart de taux. La quasi-totalité des interlocuteurs qu’a rencontrés votre Rapporteur général ont jugé que le niveau actuel des écarts de taux était anormalement bas et ne reflétait pas les écarts réels de valeur entre les titres de référence de chaque émetteur, pour des échéances déterminées. Myopie des marchés ? Effet résiduel du mouvement de « fuite vers la qualité » observé au plus fort de la crise russe (août 1998), dans un premier temps, de la crise des marchés américains (octobre 1998), dans un deuxième temps ? Indifférence structurelle des investisseurs vis-à-vis de la signature souveraine proposée à l’achat ? Cette anomalie ne se laisse pas clairement expliquer, pour l’heure. Peut-être le lent mouvement de réappréciation des taux longs européens, engagé au printemps dernier, contribuera à faire ressortir des différences de prix plus significatives ou, tout au moins, jugées plus réalistes par les spécialistes. b) Les titres allemands et français se disputent la prééminence C’est une toute autre problématique qui est abordée lorsqu’on cherche à comparer les performances des emprunts français et allemands. Les risques souverains sont notés de façon identique et, d’ailleurs, les écarts de taux sont réduits sur la quasi-totalité de la courbe des taux. On observe pourtant des décalages récurrents entre rendements allemands et rendements français sur certaines échéances, même si l’allure générale de la courbe des taux est identique pour les deux pays.
Les deux parties extrêmes de la courbe sont relativement aisées à commenter. Sur la partie gauche (échéances courtes), les titres français sont plus performants du fait de leur marché plus large et plus efficace. Sur la partie droite (échéances longues, essentiellement le trente ans), les taux allemands sont alternativement supérieurs ou inférieurs aux taux français selon les dates auxquelles on trace la courbe des taux. La partie médiane de la courbe (de un an à dix ans) attire plus l’attention. Le graphique ci-après retrace, en fonction de la maturité des emprunts, l’écart de taux entre la France et l’Allemagne pour chaque échéance.
– sur la période un an / cinq ans, les deux émetteurs font jeu égal, avec des écarts de taux de l’ordre de quelques points de base tout au plus, dans un sens ou dans l’autre ; – sur la partie comprise entre six et neuf ans, les emprunts français sont plus performants (plus chers, donc à rendement inférieur) que les emprunts allemands ; – en revanche, sur l’échéance dix ans, l’emprunt allemand est plus recherché que l’emprunt français et le prix s’en ressent puisque l’obligation française cote environ 15 points de base au-dessus de l’obligation allemande. L’explication la plus immédiate, qui consisterait à mettre en avant une différence de crédit (au sens de confiance) au bénéfice de l’Allemagne, paraît peu pertinente. S’il existait réellement, un meilleur crédit de l’Allemagne se traduirait par un décalage sinon uniforme, du moins de même sens sur l’ensemble de la courbe des taux, ce qui n’est pas le cas. Il faut attribuer à d’autres causes le décalage ponctuel enregistré sur l’échéance à dix ans entre le titre français et le titre allemand. Quel est donc, parmi ces deux emprunts, celui qui présente une singularité ? L’examen de la forme de la courbe des taux aux environs de l’échéance 10 ans suggère que c’est le rendement de l’emprunt allemand qui est affecté d’un biais favorable et non l’emprunt français qui pâtit d’un biais défavorable. En effet, la courbe allemande est pratiquement plate sur les échéances 8, 9 et 10 ans, alors que la pente de la courbe française paraît plus régulière, donc plus conforme aux configurations résultant des règles théoriques de valorisation des titres à revenu fixe. La signature allemande dispose donc d’un avantage indéniable, bénéfique pour les finances de l’Etat fédéral puisque les émissions bénéficient d’une « ristourne » d’environ 15 points de base par rapport aux émissions similaires réalisées par le Trésor français. Certainement, des phénomènes de nature technique, touchant au fonctionnement des marchés, peuvent expliquer au moins en partie le décalage de cours entre emprunt de référence allemand et emprunt de référence français, sur l’échéance 10 ans. Mais il faut bien constater que l’Allemagne continue de profiter de sa tradition d’orthodoxie financière et de son aversion historique pour l’inflation depuis 1945. Par ailleurs, l’examen des appréciations portées par les deux agences américaines de notation à l’appui de la note accordée à l’Allemagne montre l’importance de l’état des finances publiques et des indicateurs classiques relatifs à la compétitivité et à la flexibilité, que l’on est naturellement en droit d’attendre de la part de ces organismes. Au rang des causes qui se situent à mi-chemin entre la technique financière et la psychologie, l’attention de votre Rapporteur général a plusieurs fois été attirée par le fait que le remplacement des monnaies nationales par l’euro avait concouru à un certain effacement des émetteurs souverains non allemands dans la « culture d’investissement » des investisseurs internationaux. Ceux-ci ont tendance à assimiler, de façon asssurément simpliste, la monnaie (l’euro) et le support d’investissement (l’emprunt allemand de référence, à l’échéance souhaitée). Les spécialistes de valeurs à revenu fixe de JP Morgan y voient d’ailleurs l’un des intérêts de l’indice obligataire EMU Bond Index évoqué ci-avant : en individualisant les poids de chacune des composantes nationales de la zone euro, l’indice de JP Morgan contribuerait à « éduquer » les investisseurs extérieurs à la zone et à réduire les écarts de prix. Plusieurs interlocuteurs ont évoqué la possibilité que le mode de fonctionnement du marché de la pension () soit à l’origine de l’écart de taux favorable que l’on observe au profit de l’emprunt de référence allemand. Selon eux, la difficulté à trouver des titres sur le marché de la pension provoquerait un besoin de « sur-couverture » sur le marché classique (achats-ventes fermes de titres), donc une pénurie relative de titres de référence, d’où une élévation de leur coût, c’est-à-dire une diminution de leur taux d’intérêt. Au contraire, en France, l’efficacité reconnue du marché de la pension inciterait les opérateurs à ne pas détenir de blocs importants de titres, étant assurés qu’ils pourront toujours trouver, grâce aux pensions, les titres dont ils pourraient être redevables envers d’autres institutions. Par ailleurs, la direction du Trésor rappelle que « le second élément pour évaluer le statut de benchmark [référence] d’une dette concerne les choix des références effectués par les émetteurs autres que l’Etat lors de leurs émissions. Ces émetteurs déterminent le prix de leur émission par comparaison aux émissions des Etats souverains, et disposent pour ce faire de plusieurs choix au sein de la zone euro. Les statistiques de référencement des émissions privées montrent que les dettes françaises et allemandes constituent les deux références incontestables de la zone. Sur le premier semestre 1999, 50% des émissions internationales libellées en euros ont été référencées sur la courbe des taux française ou avec mention de la courbe française. Sur les maturités à 5 ans, les émissions internationales sont en majorité référencées par rapport aux titres d’Etat français à 5 ans. La situation est inversée en faveur de l’Allemagne sur la maturité dix ans ». L’analyse directe des faits et les nombreuses consultations qu’a entreprises votre Rapporteur général sur cette délicate question de l’écart de taux France-Allemagne sur l’échéance dix ans laissent penser que, pour le moins, les facteurs « psychologiques » de la prime accordée à l’Allemagne sont aussi importants que les facteurs techniques. Il est vrai que le Trésor français a construit depuis quinze ans un outil et des méthodes d’endettement dont les qualités techniques ne sont pas contestées. Il convient de capitaliser sur ce travail opiniâtre et souvent obscur, afin de renforcer le crédit international de la République française et d’alléger la charge de sa dette d’Etat pour le contribuable. CHAPITRE II L’examen du tableau ci-après permet de mesurer l’ampleur du changement intervenu dans la politique d’endettement de l’Etat depuis vingt-cinq ans. Pour faire face à ses besoins (excédant les ressources de nature budgétaire), le Trésor avait recours, traditionnellement, à trois formes de financement : – la collecte de dépôts, notamment à travers les dépôts obligatoires de ses « correspondants » (soit plus de 90% du total). Afin de limiter le recours à l’emprunt, le Trésor s’était constitué un réseau de « correspondants », c’est-à-dire d’organismes auxquels furent imposés le dépôt de tout ou partie de leurs liquidités auprès du Trésor, sur des comptes rémunérés ou non. En contrepartie, le Trésor s’engageait à leur consentir des avances en cas de difficultés de trésorerie. Les dépôts des « particuliers » (dépôts à vue ou à court terme) étaient essentiellement le fait d’entreprises soumissionnaires de marchés publics ayant des relations régulières avec le Trésor. L’importance dans l’économie nationale des deux principaux correspondants du Trésor, la Caisse des dépôts et consignations d’une part, la Poste d’autre part (du fait de son activité de collecte sur les comptes courants postaux), qui recyclaient vers le Trésor une grande partie des placements liquides des ménages, a d’ailleurs justifié l’apparition d’une appellation particulièrement adaptée : le « circuit du Trésor ». – l’approvisionnement en liquidités, grâce à l’émission de bons du Trésor en compte courant émis auprès des banques et des entreprises non bancaires admises au marché monétaire, et aux concours qui étaient consentis par la Banque de France ; – l’appel public à l’épargne, qui faisait appel à plusieurs techniques. Les bons du Trésor sur formule à destination des ménages ou des entreprises représentaient en 1960 le tiers de l’épargne liquide ou à court terme. Après une utilisation régulière et massive dans l’immédiat après-guerre pour faire face aux besoins de la reconstruction, les emprunts à long terme s’étaient faits particulièrement rares de la fin des années cinquante à la deuxième moitié des années soixante-dix. Enfin, quelques emprunts extérieurs visaient à renforcer, ponctuellement, le niveau des réserves de changes. In fine, en 1970, la dette non négociable (bons sur formule et dépôts des correspondants) représentait 72% de la dette totale de l’Etat, alors que la dette négociable (bons du Trésor en compte courant et emprunts à long terme) ne comptait que pour 28%. Tout autre est la structure de l’endettement de l’Etat au 31 décembre 1998. La part de la dette négociable dans la dette totale dépasse 90% et le financement de la dette est asssuré à hauteur de 83,7% par des titres à moyen et long terme. En s’appuyant sur la modernisation générale des marchés financiers français engagée au milieu des années quatre-vingt, le Trésor a construit un outil de financement dont la technicité et la fiabilité sont remarquables, tout en développant les mécanismes permettant de réguler et d’animer le marché secondaire de la dette. Pour autant, l’avenir incertain de la place financière de Paris pourrait handicaper les ambitions européennes et internationales du Trésor et nécessite une attention soutenue de la part des pouvoirs publics. A.- LA MODERNISATION DE LA DETTE DE L’ETAT, 1.- Un ensemble performant d’outils et de procédures L’émission de titres négociables n’est pas une entreprise facile : il faut concevoir le produit de façon à répondre aux attentes des investisseurs, tant au moment de l’émission qu’au regard des échanges ultérieurs sur le marché, tout en veillant à la sauvegarde des intérêts financiers bien compris de l’émetteur. Quand s’ajoute à ces impératifs ponctuels la perspective de devoir faire appel aux marchés pendant plusieurs années, pour des volumes élevés, en devenant progressivement l’un des principaux emprunteurs de la place, c’est à la définition d’une véritable stratégie de l’endettement qu’il faut s’atteler. Pour l’Etat, cette stratégie est passée par la mise en place progressive d’une gamme de produits (obligations et bons) intelligemment diversifiée, par la définition d’une procédure transparente et efficace de mise sur le marché et par une politique d’assimilation des titres qui se traduit par la constitution de gisements homogènes importants. a) Une panoplie simple et étendue de produits financiers · La dette négociable de l’Etat s’est, en premier lieu, réorientée vers un ensemble de produits standardisés, conçus pour offrir à la souscription des investisseurs les instruments les plus simples. Les « valeurs du Trésor » sont réparties en trois catégories de produits, qui se distinguent par leurs échéances à l’émission : – les bons du Trésor à taux fixe et intérêt précompté (BTF) couvrent les besoins à court terme : leur durée de vie à l’émission s’étage entre treize semaines (bons dits « à trois mois ») et cinquante-deux semaines. Ces bons financent les décalages temporaires de trésorerie entre les encaissements et les décaissements de l’Etat. Par ailleurs, les BTF constituent aussi la principale variable d’ajustement dans le programme de financement de l’Etat. Ainsi, l’encours moyen des BTF peut varier fortement d’un trimestre à l’autre, d’une année à l’autre ; – les bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel (BTAN) ont une durée de vie à l’émission de deux ou cinq ans : ils assurent une capacité de financement à moyen terme ; – les obligations assimilables du Trésor (OAT) sont l’instrument du financement à long terme du Trésor : leur durée de vie à l’émission peut aller jusqu’à trente ans. Une ou deux nouvelles lignes d’OAT à dix ans sont émises chaque année et servent d’emprunt de référence sur le marché français. Elles sont en concurrence avec les Bunds allemands – qui présentent des caractéristiques similaires – pour constituer les émissions de référence dans la zone euro. La simplicité a également prévalu dans la définition des principaux paramètres financiers afférents à ces titres. Du fait de leur durée de vie inférieure à un an, les BTF portent un intérêt précompté, c’est-à-dire que l’intérêt est versé au souscripteur dès l’émission. Au contraire des emprunts à moyen ou long terme émis précédemment, les BTAN et les OAT sont, dans leur quasi-totalité, des titres à intérêt annuel, amortissable au pair () et in fine (). · La majeure partie des titres proposés par le Trésor sont à taux fixe. Cependant, les fluctuations de taux sur les marchés provoquent, en miroir, des fluctuations de la valeur des titres détenus en portefeuille. Afin de se protéger contre ces fluctuations de portefeuille, certains investisseurs souhaitent pouvoir disposer de titres à revenu variable. Pendant plusieurs années, le Trésor a proposé des obligations indexées : – sur une référence courte : une moyenne de taux mensuels de BTF à treize semaines (taux dit « TMB »), un taux révisable à périodicité trimestrielle fondé sur le taux de rendement des BTF (taux dit « TRB ») ; – une référence longue : taux révisable en fonction des taux de rendement moyens mensuels des emprunts d’Etat à taux fixe d’échéance supérieure à sept ans (taux dit « TRA ») ou taux de rendement d’un échantillon d’emprunts d’Etat sur le marché secondaire (taux dit « TME »). Vers la fin des années quatre-vingt, ces produits se sont révélés ne plus correspondre aux attentes des investisseurs. Le Trésor a interrompu ses émissions d’OAT à taux variable à la fin de l’année 1990. Pourtant, le besoin de disposer d’un titre à taux variable très représentatif des conditions instantanées observées sur le marché des taux à long terme a incité le Trésor à rouvrir le chantier des OAT à taux variable. En avril 1996, une nouvelle OAT à taux variable a été proposée au marché : l’OAT TEC 10 (« taux de l’échéance constante à dix ans »). Techniquement, le taux TEC 10 est calculé par interpolation linéaire entre les taux de marché observés sur les deux OAT encadrant au plus près la maturité exacte de dix ans, dont l’encours est supérieur à 20 milliards de francs. Calculé et diffusé chaque jour, le TEC 10 est donc le taux de rendement d’une OAT fictive de maturité exactement égale à dix ans. Cette définition est homogène à d’autres références internationalement connues, comme les Constant Maturities Treasuries aux Etats-Unis. Le produit ainsi proposé par le Trésor français est immédiatement accessible à tous les investisseurs. L’année 1998 a vu une nouvelle innovation, avec la mise au point d’une obligation indexée sur l’inflation (OATi). L’article 19 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier a autorisé l’indexation sur le niveau général des prix, dans des conditions fixées par décret, des titres de créances et des instruments financiers à terme mentionnés au 2° et au 4° de l’article premier de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. L’émission de titres indexés sur l’inflation a pour but de proposer aux investisseurs un support qui leur garantisse un rendement réel déterminé, assorti d’une part variable de rémunération visant à compenser le plus exactement possible l’érosion du capital due à la hausse générale des prix. Cette formule présente des avantages tant pour l’investisseur que pour l’émetteur : – le premier bénéficie d’une garantie sur la valeur réelle de son capital, ce qui est essentiel pour des investisseurs dont les placements doivent couvrir des engagements à long terme (caisses de retraite, assureurs, etc.) ; – le second évite d’intégrer au taux d’intérêt servi sur son titre la « prime de risque » généralement exigée des souscripteurs pour se protéger contre le risque d’erreur dans la prévision d’inflation sous-jacente à la formation des taux. Très concrètement, l’émetteur allège sa charge des intérêts dus sur cette catégorie de titres. Sous le bénéfice de l’autorisation parlementaire accordée en juillet 1998, le Trésor a conçu une première ligne d’OATi, émise en septembre 1998, arrivant à échéance en avril 2009. Le succès rencontré par ce produit a amené le Trésor à proposer, en septembre 1999, une seconde ligne d’OATi, calée cette fois sur une échéance à trente ans. Conformément à un engagement constant du Trésor, les OATi n’ont pas vocation à devenir un instrument essentiel du financement de l’Etat. Elles doivent être considérées comme un élément de la gamme diversifiée de titres négociables que la République française est susceptible de proposer aux investisseurs. L’ensemble des OAT à taux variable représente environ 7% du total de la dette négociable. · Enfin, le Trésor est le premier emprunteur souverain en Europe à avoir autorisé, en 1991, le démembrement de ses titres. Le démembrement consiste à séparer les différents flux financiers d’une obligation, à savoir le principal et les coupons, en plusieurs titres négociables séparément, qui deviennent, chacun pour ce qui le concerne, des titres dits « à zéro coupon ». Les raisons de l’acquisition d’une obligation démembrée sont essentiellement la couverture d’un engagement à un horizon déterminé, par un actif de même duration () et sans risque de réinvestissement d’un coupon annuel. Par ailleurs, en raison de la duration plus élevée de l’obligation démembrée par rapport à l’obligation « complète » sous-jacente, les investisseurs peuvent augmenter la sensibilité de leur portefeuille obligataire aux variations de taux d’intérêt, donc améliorer leur performance – au risque de pertes supérieures si les évolutions du marché sont contraires aux anticipations desdits investisseurs. Depuis janvier 1994, toutes les OAT d’échéance avril et octobre sont démembrables. En moyenne, l’encours des titres démembrés s’établit à 11,5% de l’encours de la ligne sous-jacente, mais ces proportions peuvent varier de 0% à 74,8% selon les lignes considérées (). b) Une politique d’émission transparente et efficace Le Trésor a organisé des procédures permettant d’assurer la plus grande transparence et la meilleure prévisibilité autour de ses émissions. · La prévisibilité s’appuie sur la publication, dans les tout premiers jours de l’année, d’un programme prévisionnel de financement de l’Etat qui fixe de façon quasi intangible le volume prévu des appels au marché pour les OAT, les BTAN et les BTF, compte tenu du besoin de financement évalué pour l’année calendaire. Ce programme prévisionnel est complété, chaque trimestre, par un calendrier des émissions de BTF précisant les lignes sur lesquelles le Trésor émettra pendant la période sous revue. Les émissions de BTAN obéissent aux mêmes règles, dans le cadre d’un calendrier semestriel. Enfin, la régularité des appels au marché découle du choix de fixer des rendez-vous réguliers avec les investisseurs, avec une indication prévisionnelle du montant recherché par le Trésor : – les émissions de BTF ont lieu chaque lundi (une ligne de BTF à treize semaines est toujours proposée au marché, accompagnée d’une ligne à vingt-six ou cinquante-deux semaines selon le cas) ; le règlement des titres intervient le jeudi suivant ; – les émissions de BTAN ont lieu le troisième jeudi de chaque mois, le règlement des titres ayant lieu le jeudi suivant ; – les émissions d’OAT se déroulent le premier jeudi de chaque mois, le règlement des titres intervenant le jeudi suivant. Depuis 1986, la République française n’a jamais annulé, reporté ou même diminué le montant d’une émission prévue. Ce n’est pas le cas d’autres pays européens, y compris dans les années les plus récentes. En 1998, l’Autriche a annulé une adjudication quelques jours avant sa tenue. De même, en juillet 1999, le gouvernement fédéral allemand a annulé avec une semaine de « préavis » une adjudication de titres à trente ans qui avait été annoncée dans le programme d’émission trimestriel. · La transparence résulte du choix d’une procédure d’adjudication pour procéder au placement des titres, en lieu et place de la formule plus classique de la « prise ferme » des titres assurée par un syndicat d’émission, charge à celui-ci de replacer les titres ainsi acquis auprès de leur clientèle d’investisseurs finaux. L’adjudication consiste à mettre en concurrence, par le biais d’un appel d’offres, les établissements soumissionnaires qui proposent leur prix d’achat pour les titres émis par le Trésor. Les offres sont recueillies et classées par la Banque de France, qui les transmet au Trésor en conservant l’anonymat des soumissionnaires. L’adjudication se fait selon la technique dite « à la hollandaise » : les titres sont servis au prix demandé par le soumissionnaire, en commençant par celui qui propose le prix le plus élevé. Au vu des prix et des volumes offerts pour chaque mise en adjudication, le Trésor arrête le montant des soumissions qu’il retient sur chacune des lignes, le total se situant à l’intérieur de la fourchette globale annoncée pour les BTAN et les OAT et respectant, aux arrondis près, le montant exact annoncé pour les BTF. Les offres passées à des prix supérieurs au prix limite sont servies intégralement ; les offres passées au prix limite se voient affectées d’un coefficient de réduction de façon à servir les soumissionnaires concernés proportionnellement au volume de leur offre. La France est aujourd’hui, parmi les grands émetteurs souverains, celui dont les délais d’adjudication sont les plus courts. Moins de dix minutes s’écoulent entre la clôture des offres et l’annonce des résultats par la Banque de France. La procédure de syndication reste cependant utilisée pour la première émission de titres innovants (OAT TEC 10 en avril 1996, OATi avril 2009 en septembre 1998 et OATi juillet 2029 en septembre 1999, pour les plus récentes). · Cette politique d’émission s’appuie, depuis 1986, sur un réseau d’établissements chargés d’assurer le placement des valeur du Trésor et la liquidité du marché secondaire de la dette. Directement inspiré du système américain des Primary Dealers, les « spécialistes en valeurs du Trésor » (SVT) s’engagent à respecter les termes d’un cahier des charges spécifique. Au nombre des obligations auxquelles doivent satisfaire les SVT, il y a la participation à la formation de prix représentatifs sur l’ensemble des valeurs du Trésor négociées, la réalisation d’un pourcentage minimum de transactions et l’affichage en tout temps, pour des montants déterminés, de prix d’achats et ventes fermes, la promotion de la dette de l’Etat à l’étranger, l’information régulière du Trésor sur l’état des marchés et le conseil pour sa politique d’émission, etc. En contrepartie de ces engagements, les SVT disposent de deux droits spécifiques par rapport aux autres intervenants de marché : ils peuvent présenter des offres non compétitives () lors des adjudications, avant ou après la séance ; ils peuvent démembrer et remembrer les OAT. La composition du groupe des SVT s’est rapidement élargie pour refléter la volonté du Trésor d’augmenter le placement international de ses emprunts : lors de la sélection effectuée par le Trésor en avril 1998, ont été retenus dix établissements français et dix établissements étrangers, dont cinq américains. c) L’assimilation des titres au service de la constitution La définition des produits standardisés que sont les OAT, les BTAN et les BTF s’est accompagnée de la mise en œuvre d’une technique connue sous le nom d’« assimilation ».L’assimilation consiste à rattacher les titres nouvellement émis à un ligne déjà existante qui présente les mêmes caractéristiques (date d’échéance, taux facial, etc.). Les titres nouvellement émis deviennent, après le versement du premier coupon, totalement indiscernables des titres plus anciens composant la ligne. Cette technique permet la constitution progressive d’encours importants sur des lignes déterminées, ce qui favorise la liquidité des échanges. A la date du 30 juin 1999, treize lignes d’OAT ont un encours supérieur à 15 milliards d’euros, trois d’entre elles dépassant même 20 milliards d’euros. Plusieurs autres lignes avoisinent les 10 milliards d’euros. L’encours moyen d’une ligne de BTAN s’établit à 11,5 milliards d’euros, deux lignes atteignant respectivement 18,8 et 21,3 milliards d’euros. La constitution d’un gisement important de titres élargit les possibilités de transaction sur la ligne considérée et contribue à améliorer la liquidité du titre, c’est-à-dire la capacité d’un investisseur à se procurer ou à vendre un titre sur le marché pour des volumes importants sans s’exposer de ce seul fait à un déséquilibre de marché susceptible de provoquer des fluctuations de prix. Ainsi, l’assimilation des titres accroît la souplesse de gestion des lignes d’emprunts d’Etat dans les portefeuilles des investisseurs et contribue à les rendre plus attractives. « La dette française est, au plan technique, proche de la perfection » déclarait à votre Rapporteur général M. Benito Babini, président de l’Association des spécialistes en valeurs du Trésor. Cette appréciation plus que positive – que d’aucuns pourraient trouver surfaite, puisque provenant des institutions chargées de placer les valeurs du Trésor auprès des investisseurs finaux – est en fait largement partagée par ces mêmes investisseurs, si votre Rapporteur général peut en juger aux propos tenus par certains de leurs représentants dans le cadre d’une réunion de travail organisée par l’Association française de la gestion financière. La perfection suscite l’imitation. C’est pourquoi on doit constater, depuis quelques années, une tendance générale des émetteurs souverains de la Communauté européenne à aligner leur politique d’endettement sur les grands principes mis en œuvre par le Trésor français. Ceci ne veut pas dire que le Trésor a été l’initiateur européen de toutes les réformes. Bien plutôt, cette forme particulière de « convergence » montre avant tout la capacité d’attraction des lignes de force qui structurent aujourd’hui les relations des Etats avec les marchés. 2.- Un modèle français vers lequel convergent Assurément, et hormis peut-être pour les OAT TEC 10, le Trésor n’a pas inventé les éléments divers qui ordonnent aujourd’hui sa stratégie de la dette. Le 9 septembre dernier, au cours d’un entretien, M. Jean Lemierre, directeur du Trésor, reconnaissait volontiers que les efforts français de modernisation avaient été fréquemment guidés par des sources d’inspiration américaines. Pour autant, il faut reconnaître au Trésor la vertu d’une mise en œuvre systématique et constante de cette démarche de modernisation, qui confère aujourd’hui au « modèle français » un caractère exemplaire. a) L’Allemagne, un rattrapage à marche forcée Le cas de l’Allemagne est significatif des efforts entrepris par l’ensemble des Trésors publics européens pour rénover leur politique financière. Il est légitime de reconnaître que l’origine de la modernisation des marchés financiers allemands est antérieure aux perspectives d’introduction de l’euro : elle résulte essentiellement de l’augmentation des déficits publics consécutive à la réunification du pays en octobre 1990. Ainsi, alors que le solde des administrations publiques était excédentaire à hauteur de 0,1% du PIB en 1989, il s’est dégradé à – 2,1% du PIB dès 1990 puis a atteint – 3,3% du PIB en 1993 et encore – 3,5% du PIB en 1995, après une rémission passagère en 1994 (– 2,8% du PIB). Indépendamment de sa politique d’émission en son nom propre, le gouvernement fédéral a également fait appel aux marchés financiers par le biais de « fonds » dédiés, comme le Fonds pour l’unité allemande ou le Treuhand. Le gouvernement fédéral a également placé dans le public des bons du Trésor à quatre ans. · La persistance de déficits publics élevés et la levée progressive des incertitudes relatives à l’achèvement du processus d’union économique et monétaire ont amené le gouvernement allemand, en liaison avec la Bundesbank, bras séculier de l’Etat pour l’émission et la gestion de la dette, à annoncer en juillet 1996 un plan d’action destiné à revitaliser le marché financier et à l’aligner un peu plus sur les standards européens. Ainsi, la taille moyenne des lignes a été augmentée, dès la mise initiale sur le marché et par une utilisation plus fréquente de la réouverture d’une ligne déjà existante, sur le principe de l’assimilation présenté ci-avant. La Bundesbank a donné son accord à l’émission régulière de titres à six mois (les « Bubills »), émis sur appels d’offres tous les trimestres. Le montant des émissions de Bubills reste cependant modéré en raison de la crainte d’une interférence avec les objectifs de la politique monétaire qui était alors définie par la Bundesbank. Par ailleurs, afin de renforcer la présence des titres gouvernementaux sur les échéances courtes, la Bundesbank procède à l’émission de bons du Trésor à deux ans, sur une base trimestrielle. A l’autre extrémité du spectre des maturités, l’Etat fédéral a manifesté son intention d’alimenter de façon plus régulière et plus significative le compartiment des échéances à trente ans, par le biais de lignes nouvelles ou en abondant des lignes existantes. Le Gouvernement fédéral s’est également converti aux nouveautés en autorisant, à partir de juillet 1997, le démembrement des obligations. Enfin, la loi de finances pour 1998 a autorisé le gouvernement fédéral à se procurer ses ressources d’emprunt sous une seule signature, indépendamment du destinataire final de ces ressources, le gouvernement au sens propre ou les divers fonds spéciaux fédéraux et autres entités incluses dans la structure fédérale (Fonds d’amortissement des engagements hérités de la réunification, Fonds pour l’unité allemande, Fonds pour l’infrastructure ferroviaire, Fonds de péréquation pour l’utilisation du charbon, etc.). · Deux changements importants sont intervenus en matière de procédure de mise sur le marché . Tout d’abord, le calendrier prévisionnel des émissions, publié depuis 1993 sur une périodicité trimestrielle, intègre désormais les titres à court terme (à échéance de six mois ou deux ans), en sus des titres à cinq ans et des Bunds. Par ailleurs, une certaine régularité de fait – les autorités n’ont jamais affiché de politique déterminée en ce sens – a été constatée quant aux dates d’émission : les bons à six mois sont proposés à la souscription pendant le premier mois du trimestre, les bons à cinq ans sont proposés le deuxième mois et les bons à deux ans sont émis le troisième mois. La Bundesbank se réserve une plus grande liberté pour les émissions de Bunds. Par ailleurs, depuis 1952, date de lancement du premier emprunt de la République fédérale d’Allemagne, le placement initial des Bunds se faisait par l’intermédiaire d’un consortium rassemblant quelques dizaines d’institutions financières et bancaires domestiques, élargi depuis 1992 aux banques étrangères ayant une succursale en Allemagne. En 1997, les institutions de crédit membres du consortium ont souscrit aux obligations fédérales pour 51,4 milliards de deutsche mark, dont 13 milliards de deutsche mark par voie de prises fermes et 38,4 milliards de deutsche mark par voie d’adjudication. Ce consortium a été remplacé, à partir de 1998, par un « groupement pour les adjudications de titres publics », ouvert aux institutions de crédit résidentes et aux branches domestiques des institutions étrangères, disposant d’une capacité suffisante de placement des titres auprès des clients finaux. La liste des membres du groupement a vocation à être révisée chaque année à la lumière des statistiques de placement établies par la Bundesbank. Les institutions membres du groupement ont souscrit, en 1998, 180,6 milliards de DM de bons et obligations fédérales, au cours de 22 adjudications. Au début de 1999, le groupement comportait soixante-douze membres, après l’admission de sept nouveaux établissements, le retrait de sept autres et la radiation de six membres pour cause de résultats insuffisants en matière de placement. A côté de ces dispositions désormais relativement standardisées, les autorités fédérales conservent, pour l’heure, la pratique peu usuelle de mettre en réserve une proportion non négligeable des montants émis lors des adjudications, afin d’effectuer ultérieurement une « gestion de marché ». Cette proportion atteint couramment 10% du montant total de la ligne émis, y compris lors des réouvertures de lignes antérieures. Les volumes ainsi mis en réserve ne sont pas négligeables : le rapport annuel pour 1998 de la Bundesbank indique ainsi que 59,5 milliards de DM, au total, ont été mis en réserve pour des ventes ultérieures sur le marché boursier. Les ventes effectives se sont élevées à 60,5 milliards de DM en 1998. b) Une érosion de l’« avantage compétitif » français ? Le cas de l’Allemagne n'est pas unique. Même si, en la matière, les sources sont multiples et dispersées – ce qui ne facilite pas la collation des informations nécessaires à une synthèse exhaustive – votre Rapporteur général a pu prendre connaissance de quelques développements intervenus sur le marché des obligations d’Etat de certains Etats membres de la zone euro. Ils montrent que les années quatre-vingt-dix ont été l’occasion de réformes importantes et convergentes, sans pour autant empêcher la persistance de particularités nationales. En Autriche (), la réforme a commencé vers 1986, lorsque le Gouvernement a décidé de ne plus émettre que des obligations remboursables in fine et non plus amortissables par tranche. En 1988, les autorités ont abandonné le système de double endettement à long terme qui distinguait d’une part les obligations classiques, ouvertes à tous les investisseurs, et d’autre part les « certificats d’obligations » () réservés à des investisseurs institutionnels sélectionnés. En 1989, une double procédure de mise sur le marché a été expérimentée, les prises fermes par un syndicat bancaire étant remplacées par des adjudications accompagnées, pour une part résiduelle, de prises fermes syndiquées. Ayant manifestement tenu ses promesses, la technique de l’adjudication a été retenue à titre exclusif à partir de février 1991, assortie de la formalisation d’un cercle local de « SVT ». Vingt-six institutions financières participent aujourd’hui aux adjudications, dont les institutions étrangères ne sont plus exclues depuis 1994. En 1991 également, le gouvernement autrichien a commencé à standardiser ses émissions en les concentrant sur des titres à échéance cinq ans et dix ans, avec la possibilité de rouvrir des lignes existantes de façon à augmenter progressivement leur encours, par assimilation. En octobre 1996, le démembrement des titres d’Etat a été autorisé et les premières obligations à trente ans ont été émises en juillet 1997. La Finlande n'a pas encore, pour l’heure, trouvé un intérêt suffisant au démembrement de ses titres d’Etat. Ses émissions à moyen et long terme se concentrent sur les échéances cinq ans, dix ans et quinze ans, avec la mise en œuvre de la technique de l’assimilation ; cependant, les titres soumis au régime juridique des obligations peuvent avoir une maturité aussi courte qu’un an (). Les procédures d’émission utilisées par le Trésor public conservent une originalité certaines par rapport au modèle français : – les obligations (« serial bonds ») peuvent être émises indifféremment par adjudication ou par syndication, le Trésor constituant alors le syndicat, pour chaque émission concernée, en fonction de son activité sur le marché secondaire et de sa capacité de placement auprès des investisseurs finaux. Le Trésor peut effectuer une offre supplémentaire d’obligations au moment où sont annoncés les résultats de l’adjudication ; – les bons du Trésor ont une durée de vie à l’émission qui s’étage entre un jour et un an. Ils peuvent être émis par adjudication ou par syndication, la méthode de détermination du prix lors d’une adjudication de bons étant différente de celle qui est appliquée lors d’une adjudication d'obligations ; – un canal de vente directe de titres d’Etat aux particuliers est réservé à une autre catégorie de titres obligataires, les yield bonds, dont la valeur nominale peut aller jusqu'à 10.000 euros et dont la maturité est comprise entre deux et quatre ans. Les yield bonds sont proposés au public aux guichets des banques, des bureaux de poste et du Trésor ; – depuis janvier 1999, le gouvernement procède également à l’émission de bons du Trésor « à guichet ouvert », en fonction des besoins manifestés directement auprès du Trésor par les investisseurs finaux. Le succès de cette formule est tel que le gouvernement finlandais s'interroge actuellement sur la nécessité de conserver la procédure d’adjudication pour les bons du Trésor ; – enfin, depuis janvier 1999, le Trésor public envisage d’utiliser, si la demande en titres obligataires se révèle trop faible, une procédure rapide de financement à moyen terme par le biais du système bien connu des Euro Medium Term Notes. Par ailleurs, un dispositif de SVT a été institué en 1992, qui confère aux SVT l’exclusivité de l’accès aux appels d’offres (à l’inverse de la solution retenue en France), en contrepartie d'une obligation d’animation du marché secondaire. Il serait possible d’illustrer par de nombreux autres exemples cette convergence financière entre les Etats émetteur de la zone euro. C’est ainsi que le système des SVT a été instauré successivement en Espagne et en Italie (1988), en Belgique (1990), en Irlande (1995), mais seulement en 1999 aux Pays-Bas, et que les démembrements de titres d’Etat sont possibles depuis 1993 aux Pays-Bas et depuis juillet 1997 en Espagne. Faut-il craindre, alors, une « dilution » des spécificités du modèle français et, corrélativement, une réduction de l’avantage comparatif qui distingue le Trésor français de ses homologues ? Assurément, les effets de nouveauté dont le Trésor a pu bénéficier et qu’il s’est efforcé de valoriser, ces dernières années, auprès des investisseurs étrangers, tendent inéluctablement à s’estomper. Mais l’essentiel n’est pas là : s’il est un atout que peu de marchés de titres d’Etat peuvent disputer au marché français, c’est celui de la taille, globale ou pour chaque catégorie de lignes. DETTE OBLIGATAIRE DES ETATS DE LA ZONE EURO (fin janvier 1999)
(a) Dette de l’Etat hors bons à court terme (b) Données relatives au mois de décembre 1998 Source : Deutsche Bank, A Guide to the Euroland bond markets, mai 1999. Par sa taille, le marché français des obligations d’Etat se situe aux tout premiers rangs en Europe. Grâce à la technique de l’assimilation, le Trésor a constitué des lignes de titres dont le gisement est important. Au niveau de l’ensemble du marché comme de chaque ligne, un investisseur est ainsi assuré de pouvoir, si le besoin s’en fait sentir, trouver rapidement une contrepartie et acheter ou vendre des titres sans risquer de causer (et subir) un décalage de cours préjudiciable. La liquidité du marché, c’est-à-dire la faculté de pouvoir y entrer et en sortir librement avec un risque financier minimum, constitue un « appel d’air » pour les capitaux disponibles et facilite ainsi, par contrecoup, le placement des nouvelles émissions. L’effet de taille est plus important qu’il n’y paraît. Pour les émetteurs de moindre surface financière, la relative dilution de leurs émissions dans l’ensemble des mouvements de capitaux de la zone euro pourrait conduire, à plus ou moins longue échéance, à une certaine marginalisation par rapport aux émetteurs de premier plan que sont l’Allemagne, la France et, dans une moindre mesure, l’Italie. Plusieurs personnes ont estimé, devant votre Rapporteur général, que le Trésor public des Pays-Bas était l’un des « perdants » de l’euro. Avant l’euro, la politique d’accrochage étroit entre le florin néerlandais et le deutsche mark jouait au bénéfice des titres hollandais, jugés « aussi bons que les Bunds » – au moins sur le plan de la protection contre la dépréciation monétaire. L’introduction de la monnaie unique a fait disparaître de facto cet avantage comparatif. Par ailleurs, l’augmentation de l’encours moyen des lignes, conséquence directe de l’assimilation des titres, ne présente pas que des avantages. Pour un volume donné de titres à placer sur le marché, la concentration des émissions sur un nombre réduit de lignes pourrait amener l’émetteur à déséquilibrer son positionnement sur la courbe des taux, à négliger certaines catégories d’échéances, à offrir des produits qui ne correspondent pas nécessairement à tous les besoins de leur base traditionnelle d’investisseurs. Dans le nouveau contexte de la zone euro, les techniques de modernisation de la dette peuvent donc avoir des effets collatéraux qu’il convient d’évaluer avec rigueur. Grâce à la taille de son marché, la France se trouve à l’abri de tels effets. B.- LA LIQUIDITÉ DE LA DETTE DE L’ETAT, PIERRE DE TOUCHE DE LA COMPÉTITIVITÉ INTERNATIONALE DU TRÉSOR FRANÇAIS La liquidité de la dette française a bénéficié de l’essor spectaculaire des opérations de pension depuis 1993. Pour autant, le Trésor veille à éliminer les « poches d’illiquidité » potentielles, grâce à la gestion active de la dette. Cependant, la marginalisation du Marché à terme d’instruments financiers (Matif) depuis 1998 constitue un facteur de préoccupation. 1.- Un marché secondaire de la dette très liquide et très sûr a) Les échanges de valeurs du Trésor bénéficient d’un environnement technique performant Les statistiques de transactions compilées par le Trésor montrent qu’après une diminution sensible enregistrée tout au long de l’année 1994 TAUX DE ROTATION SUR LES MARCHÉS DE TITRES D’ETAT
(a) Les chiffres d’échanges annuels peuvent inclure des transactions telles que les pensions ou les opérations d’achat-vente. (b) Les volumes d’échanges annuels sont calculés sur une base double : quant un intermédiaire A vend pour 100 $ à un intermédiaire B, le chiffre de 200 $ est retenu pour évaluer le montant de la transaction. n.d. : non disponible Source : H. Inoue, « The Structure of Government Securities Markets in G 10 Countries : Summary of Questionnaire Results », in Market Liquidity : Research Findings and Selected Policy Implications, Banque des règlements internationaux, mai 1999. Cette approche, fondée sur le volume brut des transactions, est confirmée par une analyse comparative des taux de rotation, qui rapportent le volume des échanges annuels au montant total des titres disponibles sur le marché. Le tableau ci-avant, extrait d’une contribution au groupe de travail, établi par la Banque des règlements internationaux, sur la liquidité des marchés, suggère que la France occupe effectivement une position privilégiée à cet égard. Pour autant, il convient de ne pas prendre au pied de la lettre les évaluations numériques portées dans le tableau. En effet, les indications méthodologiques relatives au recueil des données auprès des différents Etats membres sont relativement imprécises. On peut dire, cependant, que les Etats étudiés se divisent en deux groupes bien distincts : la France, la Suède, les Etats-Unis et le Canada se caractérisant par une grande liquidité de leur marché, les autres montrant des taux de rotation estimés beaucoup plus faibles. Il est regrettable que les données recueillies par le groupe de travail n’aient pas permis de placer l’Allemagne dans l’un ou l’autre groupe. Une analyse temporelle plus détaillée des transactions de titres français peut être effectuée sur la base des statistiques établies mensuellement par la Sicovam (Société intercompensatoire des valeurs mobilières), dépositaire central des titres. Malheureusement, les informations publiées dans la revue Sicoflash portent sur l’ensemble des mouvements d’OAT et de bons du Trésor (BTF et BTAN rassemblés), sans que l’on puisse y distinguer entre les mouvements qui relèvent des différentes catégories de transactions (). Le volume total des échanges, qui avait tendance à se stabiliser au printemps 1998, est vigoureusement reparti à la hausse après la décision du Conseil européen extraordinaire de Bruxelles, le 2 mai 1998, qui a arrêté la liste des Etats admis à participer à la troisième phase de l’union économique et monétaire. Le ralentissement des transactions observable aux mois de novembre et décembre 1998 est peut-être attribuable à l’approche du basculement du franc vers l’euro et à l’ajustement nécessaire des positions des opérateurs. En revanche, l’explosion des échanges observée en janvier 1999 et confirmée jusqu’en avril montre l’effet puissamment stimulant exercé par l’introduction de l’euro sur la fluidité du marché. La diminution continue des transactions depuis le mois de mai 1999 est notable ; cependant, elle ne fait que ramener la moyenne mensuelle du mois d’août au niveau le plus fréquemment enregistré au cours de l’année 1998.
211.548 milliards de francs ont été dénoués en 1998 par la Sicovam (32.250 milliards d’euros), dont 172.333 milliards de francs de titres d’Etat (26.272 milliards d’euros). 21,6 millions de mouvements ont été traités et 99,86% des capitaux ont été dénoués à la bonne date, ce qui constitue une des meilleures performances au plan mondial, sinon un record (). Ces performances s’appuient sur un outil technique remarquable, Relit grande vitesse (RGV), qui confère aux procédures de règlement/livraison de titres sur la place de Paris une sécurité exceptionnelle. LES PROCÉDURES DE RÈGLEMENT/LIVRAISON La sécurité et la fiabilité des procédures de règlement/livraison sont l’un des atouts maîtres de la place de Paris, qui a beaucoup investi dans ces domaines ces dernières années. Le dénouement des opérations sur valeurs du Trésor a bénéficié de la dématérialisation des titres opérée à Paris dès 1984 et de la mise en place de systèmes de règlement/livraison performants. Les opérations sur valeurs du Trésor ont été traitées à partir de 1988 dans les systèmes Saturne (bons du Trésor) de la Banque de France et Relit (OAT) de Sicovam SA, qui assuraient la livraison automatique et simultanée des titres contre le paiement des espèces. Elles sont aujourd’hui dénouées par Relit grande vitesse (RGV), le nouveau système de règlement/livraison pour les opérations de gros montants sur titres de taux, développé par Sicovam SA et fruit du partenariat institutionnel avec la Banque de France. RGV est devenu opérationnel le 9 février 1998 pour les OAT et le 30 juin 1998 pour les bons du Trésor (BTAN et BTF). RGV apporte des atouts décisifs aux intermédiaires actifs à Paris dans le cadre de l’euro grâce à plusieurs nouveautés : – irrévocabilité instantanée des dénouements ; – traitements en temps réel ; – règlements en monnaie banque centrale ; – échanges d’espèces en temps réel avec TBF et TARGET, dans les deux sens ; – ségrégation des avoirs par types de titre ou de clients. De plus, la technique de la collatéralisation permet à chaque participant RGV de disposer d’une souplesse accrue pour gérer au mieux ses positions : il peut, en effet, choisir d’utiliser tout ou partie des titres inscrits sur son compte ou des titres dont il se porte acquéreur pour garantir son opération d’achat. La combinaison de l’irrévocabilité instantanée et du temps réel permet le dénouement des transactions sur valeurs du Trésor sur les marchés primaire et secondaire à même date comptable dans RGV et dans les systèmes des centrales de clearing internationales Cedel et Euroclear. Par ailleurs, les liens développés par Sicovam SA avec les autres dépositaires centraux européens dans le cadre de l’European Central Securities Depositories Association (ECDSA), créée en 1997, permettent également d’effectuer des livraisons vers ces derniers. RGV s’inscrit dans le cadre du dispositif mis en place à Paris pour le traitement des espèces dans la perspective de l’euro, avec le développement des systèmes de règlement de gros montants TBF (Transferts Banque de France) et SNP (Système net protégé) gérés par la Centrale des règlements interbancaires (CRI). En effet, grâce à ses liens avec TBF, le point d’accès français à TARGET – qui relie depuis le 1er janvier 1999 les systèmes de règlement en espèces des banques centrales européennes – RGV est devenu, depuis le 4 janvier 1999, l’outil central de la mise en œuvre de la politique monétaire et de la gestion de la liquidité intrajournalière en euros au moyen de la mobilisation de titres en faveur de la Banque de France. Les participants RGV disposent ainsi d’un cadre entièrement sécurisé pour les titres comme pour les espèces, dans leurs échanges avec l’ensemble des établissements de l’espace européen. Source : Rapport d’activité 1998-1999. Les valeurs du Trésor, direction du Trésor. b) Les pensions livrées sur valeurs du Trésor, un instrument très souple Le marché secondaire des valeurs du Trésor bénéficie aussi du développement des opérations temporaires sur titres, notamment de la pension livrée. Les avantages de la pension livrée sur les prêts-emprunts en blanc ont amené à l’encadrer par un véritable statut juridique en 1994 (), alors que les opérations de pension étaient auparavant régies par une simple convention de place. LE RÉGIME JURIDIQUE DES PENSIONS LIVRÉES L’essentiel de ce régime juridique découle des dispositions de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1994. La mise en pension est l’opération par laquelle une personne, le cédant, vend à une autre personne, le cessionnaire, des valeurs, titres ou effets, ces deux personnes s’engageant respectivement et irrévocablement, l’une à reprendre les titres et la seconde à les rétrocéder, pour un prix et à une date convenus à l’avance. Il s’agit donc d’une cession temporaire de créances, accompagnée d’un transfert intégral de propriété des titres (transfert des droits de vote et des droits financiers). Les opérations de pension peuvent être effectuées non seulement par les établissements de crédit, mais également par toutes les personnes morales aines que par les fonds communs de créances et les fonds communs de placement. Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent mettre ou prendre en pension des effets privés. La loi précise également la nature des titres susceptibles de faire l’objet d’une pension et les régimes comptables et fiscaux de ces opérations. La loi du 8 août 1994 a autorisé la compensation des pensions « réciproques » entre deux contreparties. Une nouvelle convention de place, approuvée par le gouverneur de la Banque de France le 15 décembre 1994, apporte des précisions complémentaires, notamment sur la possibilité de substitution de titres pendant la durée de la pension, sur les conditions de résiliation de l’opération, sur le régime des appels de marge mis en œuvre par les cessionnaires pour se couvrir contre les fluctuations quotidiennes du marchés. La loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier a encore renforcé la sécurité juridique des opérations de pension livrée : la loi bancaire garantit désormais l’irrévocabilité des transactions effectuées sur les systèmes de règlement/livraison d’instruments financiers et prévoit le transfert intégral au créancier de la propriété des titres remis en garantie via ces systèmes et son opposabilité aux tiers sans formalités. Source originelle : Rapport d’activité 1998-1999. Les valeurs du Trésor, Assortie de la mise en place par le Trésor d’un réseau de spécialistes en pensions sur valeurs du Trésor (SPVT) la même année, cette clarification du régime juridique de la pension a conduit à un essor considérable des échanges temporaires de titres et espèces effectués dans ce cadre (). Le montant mensuel des pensions à taux fixe traitées par les SVT, qui s’élevait à l’équivalent de 100 milliards d’euros au milieu de 1994, a atteint environ 300 milliards d’euros en décembre 1994. Le cap des 500 milliards d’euros mensuels a été franchi en août 1995. Après, la tendance se révèle irrégulière, certains mois étant l’occasion d’échanges soutenus, jusqu’à 600 milliards d’euros, d’autres enregistrant une baisse à 400 milliards d’euros.
Après un record absolu au mois de septembre 1998, où les opérations de pension ont porté sur plus de 750 milliards d’euros, le dernier trimestre de 1998 et le premier semestre de 1999 voient un repli assez marqué de l’utilisation des pensions livrées, dont l’interprétation est difficile. Le Trésor est lui-même un intervenant usuel sur le marché de la pension livrée. Il utilise cet outil pour réguler sa trésorerie et lisser le niveau de son compte courant auprès de la Banque de France, en s’efforçant de placer ses liquidités à un taux supérieur à celui offert par la Banque. En 1997, le Trésor a réalisé 280 opérations de pension livrée et 296 en 1998. L’encours des titres pris en pension en fin de mois est publié dans l’arrêté mensuel récapitulatif des émissions de valeurs du Trésor, publié au Journal officiel, ainsi que l’encours moyen pendant le mois. Toutes ces pensions s’effectuent à taux fixe. En 1997, le total des prises en pension enregistré dans les écritures du Compte général de l’administration des finances s’élevait à 1.547,2 milliards de francs (pour les pensions en francs) ; il était de 1.709,3 milliards de francs pour 1998. Le total des intérêts créditeurs s’est élevé à 2 milliards de francs environ en 1997 et à 2,5 milliards de francs en 1998, desquels il convient de déduire certains intérêts débiteurs occasionnés par les opérations de mise en pension que peut pratiquer le Trésor pour se procurer des liquidités de façon ponctuelle (1 million de francs en 1997 et 10 millions de francs en 1998), et les frais de gestion (30 millions de francs en 1997 et 43 millions de francs en 1998). Le solde, très largement créditeur, vient donc en déduction de la charge de la dette de l’Etat. Votre Rapporteur général s’est posé la question de savoir comment le Trésor gérait le risque de défaut de ses contreparties lors des prises en pension qu’il pratique. La première garantie est, évidemment, les titres eux-mêmes, qui deviennent la propriété du cessionnaire en cas de défaut. Indépendamment du risque de défaut, il importe de se couvrir contre les fluctuations des titres pris en pension du fait des fluctuations des taux du marché. En effet, les variations de prix des titres pris en pension entraînent un décalage entre la valeur du portefeuille de titres et le montant des espèces prêtées en contrepartie de ces titres. Conformément aux usages de la place, le Trésor a commencé à mettre en œuvre un système d’appels de marge quotidien sur les pensions conclues avec les SVT ; ce système est actuellement opérationnel pour une quinzaine de SVT et il sera étendu à la totalité vers la fin de l’année 1999. Pour les pensions n’étant pas encore couvertes par les appels de marge, le Trésor applique, comme c’est également l’usage, une décote sur la valeur des titres pris en pension : il encaisse en quelque sorte une prime d’assurance. Enfin, une bonne maîtrise des risques suppose de répartir ceux-ci sur plusieurs intervenants et de sélectionner ces derniers avec soin. Selon les informations fournies à votre Rapporteur général par la direction du Trésor, celle-ci s’impose des limites différenciées d’exposition au risque en fonction de ses contreparties, selon la taille et la surface financière de celles-ci, qui sont, en ordre de grandeur de quelques milliards d’euros par établissement. Votre Rapporteur général tient également à signaler que le Trésor peut être amené à se procurer des liquidités par l’intermédiaire de mises en pension. L’utilisation de cette procédure appelle quelques précisions : – le besoin en liquidités et le recours à la mise en pension de titres détenus par le Trésor ne surviennent qu’en cas de décalage entre la prévision d’encaisse sur le compte courant à la Banque de France et sa réalisation effective ; il s’agit donc d’une situation très rare car les méthodes de prévision de son encaisse par le Trésor sont très fiables ; – le Trésor n’étant pas habilité à détenir un « fonds de portefeuille » de titres publics, la mise en pension ne peut que reposer sur la mobilisation de titres auparavant pris en pension par le Trésor auprès des SVT. Un bon fonctionnement du marché de la pension livrée, notamment à travers le maintien d’un volume d’échanges suffisant, exerce un effet attractif sur la dette de l’Etat. Les portefeuilles de titres peuvent, éventuellement, être refinancés dans des conditions de transparence () et de souplesse intéressantes. Selon les informations disponibles, le marché de la pension est plus développé en France que dans les autres pays de la zone euro, sans pour autant atteindre les niveaux observés aux Etats-Unis. L’efficacité remarquable du marché de la pension livrée est désormais avérée : seul un incident sérieux a été enregistré, en décembre 1996, par défaut de livraison des titres dus par une contrepartie. Selon les informations fournies par la direction du Trésor à votre Rapporteur général, aucun autre incident n’a eu lieu depuis cette date. En particulier, la transition monétaire entre le franc et l’euro, au cours du premier week-end de janvier 1999, s’est déroulée sans problème. Cependant, le Trésor ne peut pas se désintéresser de ses titres une fois l’émission passée. D’une part, parce qu’il convient de maintenir ouverte la possibilité de réémettre ultérieurement sur une ligne existante, grâce à la technique de l’assimilation, d’autre part, parce que la création de « poches d’illiquidité » serait préjudiciable à la réputation de la dette de l’Etat. En mettant en œuvre diverses méthodes pour gérer sa dette de façon active, le Trésor veille à prévenir l’apparition d’éventuels phénomènes d’illiquidité. 2.- La gestion active de la dette au service de la liquidité du marché a) Les rachats et échanges de titres, des instruments désormais classiques Depuis 1991, l’article d’équilibre de la loi de finances autorise le ministre chargé des finances à utiliser diverses procédures pour intervenir sur le marché secondaire de la dette de l’Etat. Ces autorisations ont été complétées et précisées par décret en 1995. En intervenant sur le marché, le Trésor ne cherche pas à saisir des opportunités de taux. Sa position dominante de principal émetteur en France l’a conduit à adopter une « doctrine » faite de prudence et de pondération. Les opérations conduites par le Trésor ont essentiellement deux vocations : lisser l’échéancier de la charge de trésorerie occasionnée par le service financier et le remboursement de certaines lignes de titres importantes Ces opérations sont ensuite retracées dans les arrêtés mensuels récapitulatifs des émissions de valeurs du Trésor évoqués ci-avant. Si une certaine confidentialité est évidemment nécessaire préalablement aux opérations de rachat, leur publication ultérieure au Journal officiel assure une publicité tout aussi nécessaire, dans le cadre d’un contrôle démocratique sur l’activité de l’administration. · Les rachats de titres peuvent prendre la forme d’adjudications dites « à l’envers », dont la procédure est identique à celle des adjudications classiques. Au lieu de proposer un prix d’achat pour des titres qui seraient mis par l’Etat sur le marché, les SVT proposent un prix de vente pour les titres dont ils souhaitent se défaire. Le Trésor annonce à l’avance les lignes qu’il se propose de racheter et indique, sous forme de fourchette, le volume de l’opération. La première adjudication à l’envers a été réalisée en mars 1991 et portait sur trois ligne de BTAN pour un montant total de 3,5 milliards de francs environ. Les rachats ont été refinancés par des émissions de titres à deux ans et cinq ans qui présentaient des caractéristiques plus adaptées à l’état contemporain du marché (encours et taux d’intérêt facial). En novembre 1992, le Trésor a procédé au rachat par adjudication à l’envers d’une OAT à taux variable (TRB), pour un montant de 7,5 milliards de francs qu’il convient de rapprocher d’un encours total de 36 milliards de francs. En 1993, deux adjudications à l’envers ont porté, l’une sur une ligne de BTAN à hauteur de 2,7 milliards de francs, l’autre sur une ligne d’OAT à hauteur de 3,2 milliards de francs. Aucune adjudication à l’envers n’a eu lieu depuis 1993. · Les interventions du Trésor prennent aujourd’hui la forme d’achats directs sur le marché. Jusqu’en 1999, la règle que s’était fixée le Trésor consistait à attendre les mois de novembre et décembre – en général – afin de disposer d’une meilleure visibilité sur l’exécution budgétaire et les conditions de réalisation du programme de financement arrêté en début d’année. Le rapprochement des entrées en trésorerie déjà comptabilisées – pour les émissions accomplies – ou calées sur le programme de financement – pour les émissions restant à venir – avec les perspectives des besoins de trésorerie permettent de dégager des marges de manœuvre pour procéder au rachat de certaines lignes décotées ou souffrant d’un manque de liquidité signalé par les SVT. Depuis 1999, le Trésor a décidé de ne plus limiter ses interventions au dernier trimestre mais d’y procéder tout au long de l’année, en fonction des besoins. Ainsi, en mars dernier, le Trésor a procédé au rachat de l’OAT 8,125% 25 mai 1999 à hauteur de 500 millions d’euros. Les obligations ont été annulées à la date de règlement, soit le 18 mars 1999. En effet, les rachats sur le marché ont trois conséquences : – ils sont suivis de l’annulation des titres rachetés, qui intervient à la date de règlement ; ces titres « disparaissent » ainsi définitivement de la dette de l’Etat : le Trésor ne dispose pas d’un portefeuille de titres ; – ils donnent lieu à la constatation de pertes et profits, selon que les titres sont rachetés respectivement au-dessus ou au-dessous de leur valeur nominale. Ces pertes et profits ne sont pas retracés dans les documents budgétaires, puisqu’ils constituent des opérations de trésorerie au sens de l’article 15 de l’ordonnance organique. Le Parlement ne peut officiellement en prendre connaissance qu’à l’occasion de l’examen du projet de loi de règlement, sous une forme agrégée. Cependant, la publication par la direction de la comptabilité publique dans les Notes bleues de la Situation mensuelle des opérations du Trésor permet aux initiés de découvrir chaque mois le montant des pertes et profits dus aux opérations de tous ordres faites sur la dette. La Situation résumée des opérations du Trésor, publiée chaque mois au Journal officiel et qui a donc seule valeur probante, ne comporte, pour sa part, pas d’indications très précises sur les pertes et profits supportées par l’Etat du fait de la gestion active de la dette. Peut-être conviendrait-il de remédier à cette obscurité ; – ils donnent lieu à une dépense budgétaire correspondant au paiement par l’Etat du coupon ayant couru depuis la date du dernier versement de coupon. Les rachats effectués en 1998 ont porté sur deux lignes de BTAN et deux lignes d’OAT, pour un montant total de 11 milliards de francs en valeur nominale et de 11,3 milliards de francs en valeur de marché (hors coupon couru). Ils ont occasionné 262,3 millions de francs de pertes de trésorerie et 369,4 millions de francs de dépenses budgétaires au titre du paiement des coupons courus (). Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des rachats effectués. CONSÉQUENCES BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES DES RACHATS DE TITRES EFFECTUÉS EN 1998 (en millions de francs)
Source : direction du Trésor. · Les offres d’échange visent à retirer certains titres de la cote pour leur en substituer de nouveaux, mieux adaptés aux conditions prévalentes du marché. Il s’agit donc, là encore, de favoriser la liquidité d’ensemble de la dette. Des opérations d’échange avaient déjà eu lieu en 1988 et 1989, portant sur l’emprunt 7% 1973 et sur les « obligations renouvelables du Trésor ». L’opération d’échange qui s’est déroulée du 16 avril au 10 mai 1991, portait sur l’OAT 8,5% mai 1997 en francs, au profit de l’OAT 8,5% mars 2002 en écus, pour un montant de 1 milliard d’écus. Elle poursuivait un triple objectif : – allonger la durée de vie moyenne de la dette de l’Etat, en remplaçant un titre venant à échéance six ans après par un titre venant à échéance onze ans après ; – constituer un marché des valeurs du Trésor en écus sur un plus large éventail de maturité ; en effet, le Trésor, qui avait commencé à émettre des OAT en écus à partir de 1989, souhaitait compléter son positionnement sur la courbe des taux dans cette devise, qui se limitait auparavant à trois dates d’échéance ; – ouvrir une nouvelle ligne d’OAT en écus à 11 ans, dont le taux d’intérêt facial reflétait mieux les niveaux observés alors sur le marché et qui pourrait plus facilement être abondée au cours d’émissions ultérieures. Du 23 juin au 8 juillet 1992, une opération plus importante était destinée à allonger la durée de vie de la dette de l’Etat mais, surtout, à permettre à certains investisseurs détenteurs d’emprunts d’Etat anciens ou d’emprunts émis par certains organismes dont la dette était prise en charge par l’Etat de se séparer de titres devenus peu liquides. L’offre a remporté un réel succès, puisque 48 milliards de francs ont été présentés à l’échange, soit plus de 34% du volume échangeable. En contrepartie, 52 milliards de francs de titres nouveaux ont été émis, ce décalage entre les valeurs nominales reprises et les valeurs nominales émises ne reflétant que la différence moyenne des taux d’intérêt servis par les anciens et les nouveaux titres. Du 27 avril au 3 mai 1994, le Trésor a procédé à l’échange d’une partie de sa dette libellée en écus, qui souffrait d’une décote sensible sur le marché. Ainsi, le Trésor a non seulement renforcé la liquidité de sa dette mais aussi profité d’une opportunité en tirant profit du désintérêt des investisseurs pour les titres apportés à l’échange. Enfin, du 31 mars au 9 avril 1998, le Trésor a proposé aux investisseurs d’échanger huit lignes anciennes en écus (soit potentiellement 17 milliards d’écus) contre quatre lignes nouvelles fongibles avec des lignes en francs existantes, donc destinées à avoir une bien meilleure liquidité une fois les monnaies nationales et l’écu remplacés par l’euro. Là encore, cette offre d’échange a été un succès incontestable puisque 61% de l’encours concerné par l’offre a été effectivement apporté à l’échange, soit 10,5 milliards d’écus. b) Le Fonds de soutien des rentes, un outil discret Le Trésor peut intervenir directement sur le marché ou faire appel à un « bras séculier » plus discret, le Fonds de soutien des rentes (FSR). Juridiquement, le FSR n’a pas la personnalité morale et ne constitue donc qu’un « service non personnalisé de l’Etat ». PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU FONDS DE SOUTIEN DES RENTES Le Fonds de soutien des rentes (FSR) a été créé en 1937 pour succéder à l’ancienne caisse d’amortissement. Le FSR avait à l’origine pour vocation « d’éviter les écarts de cours hors de proportion avec le volume des offres qui les provoquerait », dans des conjonctures financières délicates. Mais les dotations qu’il avait reçues n’ont pas permis d’en faire l’instrument d’une gestion très active de la dette. Alors que l’activité du FSR était devenue nulle, il est apparu, à l’occasion de la modernisation des supports d’endettement de l’Etat, que ce fonds pouvait être, avec quelques évolutions réglementaires, un instrument utile d’intervention de l’Etat sur le marché secondaire de ses titres : soutien des cours des titres décotés, contrepartie du marché à l’achat ou à la vente en cas de besoin. Le décret du 27 janvier 1986 a donc élargi les capacités d’intervention du FSR, tout en conservant l’organisation juridique de départ. Il peut désormais recevoir des avances du budget de l’Etat, charge à lui de les rémunérer. Il peut intervenir sur les titres de toute nature émis par l’Etat et sur tous le marchés où ils sont négociables. De plus, le FSR peut « effectuer toutes opérations en vue de gérer la dette de l’Etat, notamment opérer sur les titres garantis par l’Etat ou émis par des établissements ou entreprises publics, ainsi que sur les marchés de contrats négociés et sur les marchés de taux d’intérêt ». Le FSR peut ainsi procéder à des opérations d’achat-vente de titres au comptant, de pension ou de prêt de titres, comme réaliser des swaps de taux d’intérêt. Enfin, depuis 1992, le FSR est doté d’une réserve de titres destinée à faire l’objet de cessions temporaires pour de courtes périodes avec les SVT qui le demandent, notamment en cas de tension sur le marché de la pension. Concrètement, le FSR est un compte de l’Etat géré par le Trésor dans le cadre des instructions données par son comité de direction, composé du directeur du Trésor, du gouverneur de la Banque de France et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Ses résultats, pertes et bénéfices, sont retracés semestriellement au budget de l’Etat, qui prend en charge ses frais de gestion. Le secrétariat est assuré par la direction du Trésor, qui décide des interventions du FSR et effectue un suivi régulier de ses résultats. Source : Rapport d’activité 1998-1999. Les valeurs du Trésor, direction du Trésor. · Les titres émis au profit du FSR, qui constitue sa « réserve », ne peuvent jamais faire l’objet de ventes et d’achats fermes. Ils sont uniquement destinés à faire l’objet de cession temporaires, dans le cadre de tensions ponctuelles et limitées du marché. A ce titre, ils ne sont généralement pas inclus dans l’évaluation du montant de la dette de l’Etat : il s’agit d’une dette « pour ordre ». Les émissions de titres au profit de la réserve du FSR ont lieu, en général, lors de la première mise sur le marché d’une ligne nouvelle, au moment où la liquidité potentielle de cette ligne est la plus faible. Cependant, la réserve peut également être abondée pour faciliter la conduite d’opérations exceptionnelles, comme une offre d’échange. Les annulations de titres sont décidées lorsque la liquidité des lignes concernées semble bien assurée. Comme l’indique la direction du Trésor, « la composition de la réserve de titres n’est pas figée et doit correspondre en permanence aux risques d’illiquidité du marché ». Toutes les émissions et annulations sont recensées dans les arrêtés mensuels relatifs aux émissions de valeurs du Trésor, publiés au Journal officiel. Afin de garantir une bonne liquidité du marché au cours de l’opération d’échange effectuée en mars-avril 1998, le Trésor a émis au profit du FSR près de 7,4 milliards d’écus répartis entre onze des quinze lignes composant la réserve à cette date. Ces émissions ont été annulées dans le courant du premier semestre. Au second semestre de 1998, une émission d’OATi a été effectuée, pour un montant d’un milliard de francs, au moment de la première mise sur le marché de ce titre novateur. Ces titres, qui ont désormais une valeur de 152,4 millions d’euros environ, sont encore présents dans la réserve au 30 juin 1999. A la fin du premier semestre 1999, le seul mouvement enregistré consiste en l’annulation de 50 millions d’euros sur une ligne de BTAN arrivée à échéance en mars. Le montant des autres lignes subsistant dans la réserve a été fixé uniformément à 50 millions d’euros (hormis la ligne d’OATi déjà citée). La réserve de titres du FSR n’a pas vocation à être intensément utilisée. En effet, un recours trop fréquent des SVT aux titres de la réserve reviendrait à faire du Trésor une sorte de « prêteur de titres en dernier ressort », favorisant peut-être des comportements moins sécurisés de la part des intermédiaires financiers. Pour autant, la réserve a été mise à contribution pour favoriser le dénouement de l’opération d’échange de titres de mars-avril 1998, dans la journée du 23 avril. Selon la direction du Trésor, les pensions livrées se sont négociées aux conditions suivantes : 50 points de base lorsque le SVT offrait du collatéral (c’est-à-dire des titres en échange) ; 150 points de base en l’absence de collatéral ; 300 points de base pour les opérations intervenues après le 27 avril 1998. Ces informations montrent que le recours à la réserve du FSR hors conditions exceptionnelles telles que l’opération d’échange peuvent être très coûteuses pour les SVT. Il n’est donc pas étonnant que les SVT n’aient que rarement recours à cette facilité. Le FSR n’est intervenu que quatre fois entre le second semestre de 1998 et le premier semestre de 1999, à la demande motivée des SVT, pour des montants limités et de courtes périodes : – 36,4 millions d’écus du 4 novembre au 6 novembre 1998 ; – 9,2 millions d’écus du 17 novembre au 18 novembre 1998 ; – 8 millions d’euros du 25 au 26 janvier 1999 ; – 18 millions d’euros du 5 au 7 mai 1999. Parfois, les SVT en quête d’un titre déterminé s’adressent au Trésor comme à n’importe quelle autre contrepartie sur le marché. Si le titre demandé est déjà présent dans le stock de titres détenus en pension par le Trésor (cf. ci-avant au point 1.b), celui-ci accepte généralement la transaction, sous réserve d’y trouver un intérêt financier. La mise à disposition du titre est, en revanche, effectuée à titre gratuit lorsque celui-ci provient d’une pension conclue auparavant avec le SVT demandeur. Le Trésor considère en effet que celui-ci a toute légitimité à demander la restitution anticipée de son titre, moyennant dépôt d’espèces ou remise d’un autre titre, dans le cadre du droit de substitution reconnu par la convention de place. · Le FSR reçoit également des avances du Trésor, dont le montant apparaît dans les dépenses budgétaires, puisqu’il est imputé sur le compte spécial du Trésor n° 903-58 « Avances à divers services de l’Etat ou organismes gérant des services publics ». Tant qu’elles ne sont pas consommées, les avances ne sont pas rémunérées, puisqu’elles constituent de simples écritures d’ordre entre deux comptes de l’Etat. En revanche, les avances consommées portent intérêt, ceux-ci étant portés en recettes de la ligne 411 « Intérêts versés par diverses services de l’Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances ». Les avances budgétaires sont remboursables avant le 31 décembre de chaque année, par crédit du compte spécial n° 903-58. L’utilisation des avances consenties par le Trésor au FSR ne fait pas l’objet de documents détaillés. Le Rapport d’activité publié chaque année par la direction du Trésor est muet sur cette question. Il est vrai que le FSR a quelquefois servi de support à des opérations dont la confidentialité conditionnait le succès. Il en fut ainsi, par exemple, de l’opération d’échange de taux conclue en 1990-1991, au moment des perturbations provoquées par la guerre du Golfe sur les taux d’intérêt. La confidentialité découlait de la nécessité pour les établissements qui s’étaient portés contrepartie du Trésor de se retourner vers le marché pour couvrir leur position. Le FSR a pu, certaines années, détenir un portefeuille de titres. Ce portefeuille a été entièrement liquidé en 1997. Selon les informations fournies par la direction du Trésor, le FSR s’était porté acquéreur d’un fonds de portefeuille de titres en écus à une époque où de véritables anomalies de marché justifiaient, aux yeux des responsables d’alors, une intervention sous forme d’achats fermes. Pour éviter tout risque de marché, le FSR avait couvert ce portefeuille de titres en vendant des contrats de taux sur le Matif. Conformément au principe de gestion très prudente consistant à minimiser l’exposition du portefeuille, ces contrats ont été progressivement rachetés au fur et à mesure que le FSR vendait les titres composant le fonds de portefeuille. En revanche, les comptes du FSR portent encore les traces d’opérations retournées ou « bloquées » par des opérations inverses. Il en est ainsi des échanges de taux susmentionnés, qui génèrent des flux d’intérêt pendant toute la durée de vie des titres sous-jacents mais traduisent une exposition totale nulle du FSR sur le marché des contrats d’échange de taux. Aujourd’hui, le FSR a surtout vocation à servir de « flotteur de trésorerie » pour le compte courant de l’Etat à la Banque de France, selon le mécanisme décrit ci-après. Le FSR, service non personnalisé de l’Etat, dispose de deux comptes : le premier est un « compte de tiers » auprès de l’agent comptable central du Trésor (ACCT), le second est un compte « classique » ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Les développements suivants retracent les différents événements (écritures, mouvements de numéraires) qui scandent l’exemple particulier d’un rachat de titres sur le marché avec intervention du FSR : Constitution de l’avance ¨ Compte spécial n° 903-58 : débité du montant de l’avance (dépense budgétaire) ¨ Compte FSR auprès de l’ACCT : crédité du montant de l’avance ¨ Compte courant du Trésor à la Banque de France : aucun mouvement de numéraire ¨ Compte du FSR auprès de la CDC : aucun mouvement de numéraire Consommation de l’avance ¨ Compte spécial n° 903-58 : aucun mouvement ¨ Compte FSR auprès de l’ACCT : débité du montant de l’avance (solde nul) ¨ Compte courant du Trésor à la Banque de France : débité du montant de l’avance ¨ Compte du FSR auprès de la CDC : crédité du montant de l’avance Achat des titres sur le marché par le Trésor ¨ Compte spécial n° 903-58 : aucun mouvement ¨ Compte FSR auprès de l’ACCT : aucun mouvement ¨ Compte courant du Trésor à la Banque de France : débité du montant de l’achat ¨ Compte du FSR auprès de la CDC : aucun mouvement Remboursement simultané par le FSR du montant de l’achat ¨ Compte spécial n° 903-58 : aucun mouvement ¨ Compte FSR auprès de l’ACCT : crédité du montant du remboursement ¨ Compte courant du Trésor à la Banque de France : crédité du montant du remboursement ¨ Compte du FSR auprès de la CDC : débité du montant du remboursement Reversement du solde de l’avance ¨ Compte spécial n° 903-58 : aucun mouvement ¨ Compte FSR auprès de l’ACCT : crédité du montant du solde d’avance ; solde = montant total de l’avance ¨ Compte courant du Trésor à la Banque de France : crédité du montant du solde d’avance ; solde = montant de l’achat ¨ Compte du FSR auprès de la CDC : débité du montant du solde d’avance ; solde nul Remboursement de l’avance (apurement des comptes) ¨ Compte spécial n° 903-58 : crédité du montant total de l’avance (recette budgétaire) ; solde nul ¨ Compte FSR auprès de l’ACCT : débité du montant total de l’avance ; solde nul ¨ Compte courant du Trésor à la Banque de France : aucun mouvement de numéraire ¨ Compte du FSR auprès de la CDC : aucun mouvement de numéraire La constitution de l’avance est opérée par imputation d’une dépense budgétaire sur le compte spécial n° 903-58. Elle ne donne lieu à aucun mouvement en numéraire. La consommation de l’avance se traduit par l’alimentation en numéraire du compte du FSR auprès de la Caisse des dépôts et consignations, à partir des liquidités déposées sur le compte courant du Trésor à la Banque de France. Les achats de titres sur le marché sont effectués directement par le Trésor, ces opérations donnant lieu à un tirage de liquidités sur le compte courant du Trésor à la Banque de France. Simultanément, le FSR verse une somme équivalente sur ce compte courant à partir du compte ouvert auprès de la CDC. Ainsi, quel que soit le rythme et le volume des rachats effectués par le Trésor, le niveau de son compte courant auprès de la Banque de France reste inchangé – dans la limite de l’avance qui a été déposée au préalable auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce dispositif donne au Trésor toute souplesse pour procéder aux rachats de titres en fonction des impératifs de marché uniquement et non sous la contrainte des paramètres multiples qui peuvent affecter par ailleurs le niveau de son compte courant auprès de la Banque de France. Lorsque le programme de rachats est achevé, le solde de l’avance du FSR est reversé au compte courant du Trésor auprès de la Banque de France. Le remboursement de l’avance s’effectue par imputation d’une recette budgétaire sur le compte spécial n° 903-58. · Enfin, le FSR dispose également de « fonds propres », pour un montant d’environ 200 millions d’euros. Ces « fonds propres » sont placés sur le marché, soit auprès de la Caisse des dépôts et consignations, où ils sont rémunérés à un taux calé sur le marché monétaire, soit par le biais d’opérations de pension. Ainsi, le FSR peut disposer en compte de titres pris en pension et se comporter à cet égard comme n’importe quelle contrepartie « banale » sur le marché de la pension. Les titres pris en pension sont à cet égard totalement distincts des titres de la réserve et peuvent être utilisés en toute liberté, dans le cadre des possibilités offertes par la convention de place sur les pensions livrées. 3.- La léthargie du Matif, handicap indolore a) Le Matif, instrument de gestion du risque de taux sur la France Le Matif (Marché à terme d’instruments financiers) a été créé par l’article 8 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, afin de répondre aux besoins de couverture du risque financier inhérent à la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. Le Matif a, dès l’origine, concentré son offre sur la couverture du risque de taux. Puis la loi n°87-1158 du 31 décembre 1987 relative au marché à terme a unifié les Bourses de commerce et le Matif, ce sigle changeant alors de signification pour prendre celle de « Marché à terme international de France ». La couverture contre le risque de taux repose sur l’achat ou la vente de contrats à terme. Votre Rapporteur général évoquera ici les seuls contrats à terme ferme, la problématique des contrats optionnels ne concernant que de très loin celle qui motive le présent rapport. Un contrat à terme ferme est un engagement d’acheter ou de vendre à une date déterminée (échéance) et à un prix fixé à l’avance (le jour de négociation) un actif dont les spécifications sont standardisées. En matière de couverture contre le risque de taux, les contrats à terme ferme portent sur un emprunt fictif d’échéance donnée et portant un taux facial déterminé. Cet emprunt fictif est assis sur un panier d’emprunts réels, appelé « gisement », dont les caractéristiques sont le plus proche possible de celles de l’emprunt fictif. Les emprunts du gisement ont vocation à être échangés entre les parties au contrat lorsque celui-ci arrive à échéance sans avoir été dénoué par une transaction inverse. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, cette situation ne concerne cependant qu’environ 5% des contrats. Le Matif a tout d’abord mis au point le contrat « Notionnel » (février 1986), qui permettait de se couvrir contre le risque de taux à échéance 10 ans. Le contrat portait à l’origine sur un emprunt fictif (d’où l’appellation de « notionnel ») d’échéance dix ans et de coupon égal à 10%. Le gisement était constitué d’emprunts d’Etat obligataires de maturité résiduelle s’étalant entre sept et dix ans. A compter de l’échéance décembre 1997 (), le coupon du notionnel a été ramené à 5,5% afin d’être plus en accord avec les conditions de taux prévalant alors sur le marché (). Dans le même temps, la composition du gisement a été ajustée de façon que la maturité résiduelle des titres le composant soit comprise entre huit ans et demi et dix ans et demi, fourchette encadrant l’échéance exacte de dix ans et répondant ainsi au souhait manifesté par les investisseurs. Un an après la première émission du Trésor libellée en écus, le Matif a proposé, en octobre 1990, un contrat visant à couvrir le risque de taux en écu à échéance de huit ans. Le gisement était constitué de titres émis par des gouvernements ou des organisations supranationales européennes disposant de signatures de qualité supérieure, dont la maturité résiduelle était comprise entre six et dix ans. Enfin, à partir de septembre 1997, le contrat « Matif – cinq ans » a étendu la panoplie des outils de couverture à l’échéance cinq ans grâce à un contrat fictif de coupon égal à 4,5% assis sur un gisement de BTAN à cinq ans et d’OAT de maturité résiduelle comprise entre quatre et cinq ans et demi. Pendant onze ans, grâce à ces instruments et à l’appétence des investisseurs pour le « risque » français, le Matif a occupé la deuxième place au classement des marchés à terme de taux longs, derrière le prestigieux contrat T-Bond du Chicago Board of Trade (CBoT), portant sur les obligations fédérales américaines. Mais en 1997, les perspectives de réalisation de l’union monétaire étant déjà plus claires, même si subsistaient encore quelques doutes sur le périmètre de la future zone euro, les places financières, notamment les marchés à terme en Europe, ont engagé un processus complexe de concurrence et de coopération qui a bouleversé les positions acquises et assis peu à peu, sur le segment des contrats de taux à long terme, la suprématie du contrat Bund à dix ans proposé par le consortium germano-suisse Eurex. b) La rationalisation du réseau des marchés à terme européens à l’approche de l’union monétaire Au tournant des années 1996-1997, la réalisation de plus en plus probable de l’union monétaire a relancé la course à l’innovation entre marchés à terme. Les étapes de cette course sont multiples, mais peuvent être ordonnées autour de quelques tendances fortes. · On a, tout d’abord, assisté au développement de stratégies de place fondées sur la mise au point de produits liés à la future union monétaire – indépendamment des produits nouveaux relatifs notamment aux actions (contrats à terme sur indices boursiers), qui n’entrent pas dans le champ d’investigation de votre Rapporteur général. Les organismes de marché ont, pour une part, procédé à l’amélioration de contrats existants. Ainsi, dans le courant du dernier trimestre de 1997, le Matif a pris plusieurs dispositions pour améliorer la fonctionnalité de ses contrats PIBOR () : extension de trois à cinq ans de l’horizon de cotation, ajout de deux échéances mensuelles, lancement d’options à brève échéance sur ce contrat (qui offraient aux investisseurs une protection peu coûteuse contre les variations de taux en courte période), cotation de stratégies dites de marge (spread) () et de bande (strip) (), etc. De même, au dernier trimestre 1997, le Liffe londonien a pris un ensemble de mesures visant à renforcer sa position en anticipation de l’union monétaire : il a décidé, par exemple, de convertir gratuitement en euros toutes les positions ouvertes sur ses contrats de taux courts en monnaies de pays participant à l’Union économique et monétaire ; en décembre 1997, il a mis en service une facilité permettant aux investisseurs de mettre en œuvre des stratégies d’écart de taux entre échéances identiques ou courbes de taux sur une large gamme d’instruments. Par ailleurs, les marchés à terme ont également cherché à élargir leur offre en matière de contrats, par la mise au point de nouveaux produits. En février 1998, le Liffe a annoncé le lancement d’un contrat à cinq ans sur les obligations du Trésor britannique. Vers le milieu du mois de juin 1998, le Matif a annoncé le lancement de deux contrats concurrents de ceux proposés par le Liffe, portant sur les emprunts d’Etat britanniques pour les échéances cinq ans et dix ans ; cette expérience s’est achevée quelques semaines après, sur un constat d’échec. En juillet 1998, le Matif et Eurex ont lancé séparément des contrats Euribor () à un mois et trois mois. Sur le compartiment du très long terme, Matif a démarré la cotation d’un contrat à trente ans au début de l’automne 1998, marqué de près par Eurex, qui a lancé au même moment son propre contrat à trente ans. Enfin, le Matif a conçu des contrats couvrant les échéances dix ans, cinq ans et deux ans et censés prendre le relais, pour les deux premiers d’entre eux, respectivement du contrat notionnel et du contrat « Matif – cinq ans ». · Les marchés à terme se sont également lancés, avec plus ou moins d’enthousiasme, dans l’aventure de la négociation électronique. Cette évolution n’a pas posé de problème majeur chez Eurex, dont les deux fondateurs, Deutsche Termin Börse (DTB) et Stoffex, avaient depuis longtemps pris le virage de l’informatique. Pour le Matif, la transition, réalisée entre avril et septembre 1998 (), a été plus douloureuse. Non pas que les principaux opérateurs institutionnels de la place aient été réticents : les informations rassemblées par votre Rapporteur général suggèrent que les coûts des transactions informatiques étaient plusieurs fois inférieurs au coût de maintien d’une équipe de négociation sur le parquet de la Bourse de Paris. En revanche, les négociateurs individuels de parquet (NIP), indépendants opérant en compte propre, ont lutté, y compris au moyen de plusieurs grèves, contre l’introduction de la négociation électronique qui signifiait la disparition de leur métier. Certains d’entre eux ont accepté les offres de reconversion électronique proposées par Matif, d’autres sont partis à Londres ou à Francfort. Pendant longtemps, Londres a jugé pouvoir faire cavalier seul et conserver ses procédures de cotations à la criée. Ce n’est qu’au début du mois de mars 1998 que le marché à terme londonien a annoncé, pour le quatrième trimestre de 1999, la mise en place d’un double système de cotation, à la criée et électronique. Mais, dès la fin du mois de mars, une importante maison de titres britannique a préféré quitter le Liffe pour opérer sur les écrans « allemands » d’Eurex installés à Londres. Dès lors, le Liffe a décidé d’accélérer l’introduction de la cotation électronique, mais a choisi de développer son propre système de négociation, repoussant ainsi de quelques trimestres la perspective des premières cotations informatisées. Enfin, l’intérêt manifesté par les membres du Liffe pour la négociation électronique a conduit l’organisme à basculer ses principaux contrats sur une cotation duale dès le mois d’août 1998. La Banque des règlements internationaux juge, à cet égard, que « la culture du consensus en vigueur sur la place londonienne a retardé la mise au point de nouvelles technologies » (). · La pénétration croissante de l’informatique donne un nouveau souffle à la coopération entre les places financières. En septembre 1997, à la suite du rachat du Matif par la Société des bourses françaises (SBF), un projet de coopération avec Eurex avait été conclu, sous l’appellation d’Euro-alliance. Le programme dressé au début de l’année 1998 prévoyait, dans un premier temps, l’affiliation automatique de chaque membre d’un marché à l’autre marché (cross membership), rendue possible par la conversion prévue du Matif à l’électronique. Dans un deuxième temps, un lien entre les chambres de compensation de titres devait être établi et une « clause de non concurrence » devait conduire à répartir entre les deux les différents contrats négociés par l’ensemble. Enfin, il était prévu qu’en 2002, les systèmes informatiques utilisés par les partenaires de l’alliance (négociation, compensation, réseau, stations utilisateurs) soient identiques, pour permettre aux membres des différents marchés concernés d’avoir un accès direct aux transactions sur les actions ou sur les indices boursiers ainsi que sur les produits dérivés s’y rattachant et les contrats à terme de taux (). Cette alliance n’a en fait débouché sur aucune réalisation concrète. Deux accords de partenariat sont cependant entrés dans les faits : dans un premier temps, le Matif et le Chicago Mercantile Exchange (CME), le deuxième grand marché à terme américain, ont scellé un échange de technologie allant au-delà d’un premier accord conclu en septembre 1997. Le CME acquiert la technologie française de négociation électronique, baptisée pour l’occasion Globex 2 (qui n’est autre que le système alors en cours de déploiement sur le Matif). En contrepartie, la SBF adopte la technologie américaine de compensation, dénommée Clearing 21. Enfin, chaque partenaire a vocation à obtenir un accès aux produits électroniques de l’autre partenaire, à l’horizon du troisième trimestre 1999. Par ailleurs, le Matif a conclu une stratégie d’alliance avec deux marchés à terme méditerranéens. A la fin du mois de juin 1998, le Matif et le Monep () ont signé avec le Meff espagnol un accord prévoyant l’interconnexion de leurs marchés et l’accès réciproque aux produits de chaque partenaire. Ce projet, répondant au nom d’Euroglobex, a été étendu, le 11 décembre 1998, au MIF italien. Pendant ce temps, Eurex n’est pas resté inactif, visant surtout « le grand large ». En mars 1998, il avait décidé avec le CBoT un accès réciproque hors séance, le CBoT ne voulant pas abandonner la procédure de cotation à la criée. A la fin du mois de juillet 1998, les plages d’accès ont été étendues à l’ensemble de la journée ouvrable. En septembre 1998, les deux marchés ont annoncé le développement d’un système électronique de transaction. Cependant, le processus a reçu un coup d’arrêt en janvier 1999, lorsque le président du CBoT a pris argument de coûts trop élevés pour les membres du marché et mis un terme aux discussions. Parallèlement, tout en s’affirmant acquis à la cotation à la criée, le CBoT envisageait d’étendre son réseau de distribution en Europe, ce qui ne pouvait se faire que par le biais d’écrans délocalisés fonctionnant sur la base du système électronique utilisé par le CBoT, jugé lent et peu convivial par ses utilisateurs. Eurex ayant manifesté entre temps quelque ambition de créer sur le continent américain un concurrent direct du CBoT (), il a été jugé que le temps était venu d’un compromis profitable à tous et dommageable pour personne. Au début du mois de septembre 1999, les deux parties ont annoncé l’achat prochain par le CBoT du système de négociation d’Eurex. Ainsi, le réaménagement des marchés à terme européens se poursuit à marche forcée. La pression concurrentielle se fait de plus en plus forte ; les capacités d’innovation par de nouveaux types de produit se font plus rares au fur et à mesure que les marchés de dérivés et les marchés de sous-jacents sont plus matures ; l’informatisation transforme les métiers et ouvre de nouvelles opportunités de développement en même temps qu’elle fragilise les positions acquises. Qui aurait pu prévoir, il y a encore quelques années, la convergence manifeste entre les marchés de gré à gré et les marchés organisés, ou bien entre les marchés à terme et les marchés au comptant ? Pour les premiers, par exemple, la Banque des règlements internationaux a pu faire valoir « une convergence des pratiques entre marchés organisés et gré à gré. Les premiers conservent des atouts comme liquidité, sécurité et transparence, mais ces avantages sont rognés par la standardisation des produits et une meilleure gestion des risques de contrepartie sur le gré à gré. Symétriquement, les marchés organisés instaurent des facilités pour la gestion des garanties sur le gré à gré » (). Les marchés semblent se caractériser aujourd’hui moins par leur localisation géographique (et ses implications en termes de structures de coûts, de fiscalité et de réglementation) qu’en termes de fonctions financières : la fonction de négociation, dont les discriminants reposent sur la technologie et la nature des contrats proposés ; la fonction de compensation, qui améliore la fluidité du marché et, dans un certain sens, sa sécurité. A l’heure des transactions informatisées et délocalisées, la notion même de bourse perd beaucoup de sa substance. De ce grand bouleversement émerge une réussite incontestable, qui confine d’ailleurs à un quasi-monopole : la captation des opérations sur taux longs par le contrat Bund d’Eurex. c) Le contrat Bund d’Eurex, une position dominante en Europe Le graphique ci-après suffit à prendre la mesure de la domination sans faille qu’exerce le contrat Bund proposé par Eurex sur les marchés de taux longs européens. Depuis la mi-1998, ce contrat a même dépassé (en montant notionnel traité) le contrat phare de l’histoire des marchés à terme de taux longs, le T-Bond proposé par le CBoT. La comparaison avec le Matif est cruelle, puisque le graphique montre sans ambiguïté qu’après avoir fait jeu égal avec le contrat Notionnel du Matif à la mi-1997, le contrat Bund a connu une explosion des échanges et qu’il s’y traitait, en moyenne sur le deuxième trimestre de 1999, plus de vingt fois le montant notionnel observé sur le contrat Matif équivalent ! · Comment expliquer une domination si écrasante ? Il est bien sûr possible, dans un premier temps, d’évoquer les faiblesses propres du Matif, notamment une transition vers l’électronique qui ne s’est pas déroulée dans les meilleures conditions sociales – ce qui a peut-être contribué à brouiller l’image de la place – et qui a donné lieu à des incidents techniques fréquents, dans une première phase de sa mise en œuvre. L’un de ces incidents a pu causer des pertes de plusieurs millions de francs à certains donneurs d’ordre, ce qui – on en conviendra aisément – ne constitue pas un argument publicitaire des plus convaincants.
Par ailleurs, la dynamique de la convergence des taux d’intérêt et l’avènement de la zone euro ont supprimé définitivement le petit « zeste » de spéculation qui pouvait subsister d’une position sur le franc et ont ainsi réduit singulièrement l’intérêt que pouvaient avoir certains opérateurs à prendre position à terme sur le taux français à dix ans. L’explication ne peut s’arrêter là. En effet, le succès du contrat Bund d’Eurex s’est construit en quasi-totalité sur la ruine du contrat Bund proposé par le Liffe. Les statistiques mensuelles d’activité des marchés à terme, telles qu’on peut les consulter régulièrement dans l’Agefi, ont égrené au fil des mois le grignotage régulier de la position dominante tenue par le Liffe et le triomphe de la place allemande. Celle-ci disposait d’atouts techniques et commerciaux réels : son positionnement totalement électronique l’a amenée à déployer des centaines d’écrans de négociation sur toutes les places, y compris à Londres ; de plus une politique tarifaire agressive et des horaires de cotation beaucoup plus larges que ceux des autres places – notamment celles qui cotaient à la criée, comme Londres – ont également procuré un avantage compétitif. Mais deux autres facteurs ont dû jouer, dont il difficile d’apprécier l’importance relative. Votre Rapporteur général estime, au préalable, que l’explication qui met en avant la profondeur du marché des obligations d’Etat allemandes ne peut être considérée comme satisfaisante. En effet, elle ne peut, à la rigueur, concerner que la rivalité entre le contrat Notionnel du Matif et un contrat Bund, mais elle ne fournit pas à elle seule la clef de l’affrontement qui a opposé les contrats Bund respectifs d’Eurex et du Liffe. En premier lieu, la solidarité des établissements de place allemands a été signalée à votre Rapporteur général par tous ses interlocuteurs, qui s’est traduite par une forte tendance, ces dernières années, à un redéploiement au profit de Francfort des équipes de négociation de marché, notamment obligataire ; la localisation à Francfort n’a pu que susciter un tropisme en faveur du contrat proposé par l’organisme de place, Eurex. Le deuxième facteur, plus terrible peut-être par son aspect mécanique, vient de ce que la liquidité attire la liquidité et que, en miroir, l’illiquidité provoque l’illiquidité. Pourquoi, aujourd’hui, abandonner le contrat Bund dès lors que sa liquidité permet tous les mouvements sans grand risque de provoquer de décalage de cours ? Pourquoi, au contraire, aller prendre position sur un marché à terme peu liquide – par exemple l’Euro-notionnel du Matif – si l’on n’est pas certain de pouvoir y mener des stratégies actives d’ajustement de sa position en fonction des fluctuations du marché ? Le Matif est aujourd’hui enfermé dans un « piège d’illiquidité » dont il ne sera possible de sortir que par le biais d’une action très volontariste tendant à animer le marché, à en assurer une bonne tenue par l’intermédiaire d’établissements qui s’engageraient à afficher des cours d’achat et de vente pour des volumes significatifs, et, peut-être, à inciter certains établissements à rapatrier sur le contrat français leurs opérations de gestion du risque de portefeuille que, par effet de mode plus que par réelle nécessité, ils ont pu vouloir délocaliser, à Londres ou à Francfort… · Mais, peut-on s’interroger, est-il bien nécessaire de faire vivre le contrat Matif ? Un seul contrat à terme ne pourrait-il suffire à couvrir le risque de taux dans l’ensemble de la zone euro ? Pour répondre à la première question, il suffit de se souvenir que les stratégies d’intervention sur un contrat à terme repose, la plupart du temps, sur les stratégies de gestion de titres au comptant. Par exemple, l’une des principales motivations d’une intervention sur le marché à terme consiste à gérer la sensibilité d’un portefeuille aux taux d’intérêt : l’achat de contrats augmentera la sensibilité du portefeuille, la vente de contrats la diminuera. L’incitation à détenir des OAT en fonds de portefeuille ne peut que pâtir de l’absence d’un instrument de gestion de la sensibilité. De même, le travail de « teneur de marché » auquel sont assujettis les SVT ne peut être rendu que plus difficile par l’impossibilité de couvrir les positions nombreuses et fluctuantes engagées sur les titres d’Etat par un instrument à terme en parfaite adéquation avec le sous-jacent à couvrir. A plus ou moins longue échéance, la désaffection pour l’instrument financier à terme ne peut que se décliner en désaffection pour le titre sous-jacent. Le Trésor a donc un intérêt objectif à la revitalisation du Matif, notamment sur les contrats visant les échéances jugées particulièrement significatives, à savoir les échéances cinq ans, dix ans et trente ans. D’ailleurs, la position dominante du contrat Bund n’est pas sans poser quelques problèmes. La couverture du risque de taux supporté par un portefeuille de titres français au moyen d’un instrument financier à terme relatif à un sous-jacent allemand suppose implicitement que l’écart de taux entre un titre allemand et un titre français de même échéance est figé ou que ses fluctuations sont faibles par rapport aux frais de transaction qu’occasionnerait une éventuelle opération visant à s’en couvrir. Or la plupart des gestionnaires ou des intermédiaires, pour autant qu’a pu en juger votre Rapporteur général, se disent persuadés que l’équivalence objective entre dette d’Etat française et dette d’Etat allemande devra se traduire un jour par un alignement plus étroit entre les taux d’intérêt servis sur l’échéance phare qu’est le dix ans et qu’on peut même envisager de voir les taux allemands et français se « croiser » régulièrement. Cette analyse valable pour les titres de taux français l’est peut-être encore plus pour les titres de taux des autres pays de la zone euro. Est-il concevable, alors, qu’une seule dette d’Etat, qu’un seul contrat à terme, soient représentatifs de l’ensemble de la zone euro ? Or, le volume des contrats sur titres de taux longs étant quasi nul sur les autres marchés à terme européens, tout se passe actuellement comme si, effectivement, le contrat Bund remplissait à lui seul les fonctions que remplissaient auparavant tous les instruments de couverture des différents Etats de la zone. Il n’est pas certain que cette situation soit particulièrement saine. De plus, au plan technique, le volume des échanges et des positions ouvertes () traditionnellement relevés sur le contrat Bund est susceptible d’entraîner une pénurie de titres à l’approche de l’échéance des contrats. C’est ainsi qu’une situation de pénurie a été observée quelques jours avant l’échéance de septembre 1998, obligeant les opérateurs soit à se procurer des titres sur le marché au comptant, à un prix élevé, soit à reporter leur position de l’échéance septembre vers l’échéance décembre, moyennant un prix conséquent, également. Depuis cette date, le contrat Bund vit sous la rumeur permanente d’une pénurie de titres pour la prochaine échéance… Il est vrai que le gisement est, de l’avis unanime des opérateurs, d’une taille insuffisante pour couvrir efficacement les opérations conduites sur le contrat à terme, notamment les positions ouvertes. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, cette difficulté serait susceptible de conduire la Bundesbank à augmenter le volume de ses émissions de titres à échéance dix ans. Conscientes du problème, les autorités de marché allemandes ont convoqué des réunions d’experts pour se pencher sur les caractéristiques du contrat Bund et examiner s’il ne convenait pas de le faire évoluer. Les membres du comité d’experts ont jugé que, compte tenu du caractère international du contrat Bund, il convenait de le laisser inchangé. Cette décision pourrait donner au Matif l’opportunité de proposer une solution aux déficiences techniques objectives qu’entraîne une utilisation excessive du contrat Bund par les opérateurs internationaux. Depuis janvier 1999, le Matif propose, en substitut à l’ancien Notionnel français un Euro-notionnel dont le gisement est constitué d’obligations françaises et allemandes (). De même, le contrat Matif « E-note 2 ans » propose comme gisement des titres allemands et français, celui-ci étant susceptible d’être élargi à d’autres émetteurs souverains ultérieurement. L’offre du Matif se fonde sur un gisement d’environ 100 milliards d’euros, deux fois plus important que le gisement de l’ancien Notionnel ou que le contrat Bund actuel. Par ailleurs, les responsables du Matif estiment que la bonne substituabilité des titres allemands et français confère au contrat une pertinence réelle dans la couverture d’un risque de taux. Les détracteurs de cette solution présentent plusieurs objections. Tout d’abord, le fait que le gisement ne soit pas homogène – y compris au regard de différences alléguées de qualité des émetteurs concernés – nuirait à sa liquidité et à sa représentativité. Par ailleurs, l’histoire récente montre que les contrats bi- ou multi-émetteurs ont toujours été des échecs. En effet, il s’avère que l’une des obligations sous-jacentes est, structurellement, l’« obligation la moins chère à livrer » (). Dans ces conditions, le contrat ne porte plus sur un taux moyen représentatif de l’ensemble des émetteurs représentés dans le gisement, mais uniquement sur le taux d’intérêt de l’émission constituant l’« obligation la moins chère à livrer ». En définitive, la finalité même du contrat multi-émetteur disparaît ! L’introduction du contrat Euro-notionnel bi-émetteur n’a pas suffi jusqu’ici au Matif pour diriger à nouveau vers lui un flux d’ordres significatif. Dès lors que, comme votre Rapporteur général, on pense que la situation actuelle du marché allemand sur le comptant et à terme est peu soutenable sur longue période et qu’un réajustement des positions des investisseurs doit nécessairement survenir, il est clair que le contrat Euro-notionnel bi-émetteur représente potentiellement, par rapport au contrat Bund d’Eurex, une solution élégante et mutuellement profitable pour la couverture du risque de taux en zone euro. Un effort de la place de Paris pour réanimer le Matif et lui redonner la liquidité qui lui fait défaut, par exemple en instaurant des mécanismes de tenue de marché, pourrait provoquer rapidement un « appel d’air » en direction des produits proposés par le Matif. Ceci ne manquerait pas de rejaillir sur l’intérêt porté par les investisseurs au sous-jacent, savoir la dette de l’Etat. · Cependant, force est de reconnaître que les difficultés du Matif n’ont pas eu de conséquences sur l’attrait de la dette française sur les non-résidents. Les qualités intrinsèques de la dette, comme les efforts de promotion de celle-ci à l’étranger par les SVT, ont contribué au retour des investisseurs non-résidents sur la dette de l’Etat depuis le printemps de 1997. L’encours de la dette de l’Etat détenu par les non-résidents s’était élevé à 780 milliards de francs en 1994, soit plus de 31% de la dette négociable. De 1994 à 1997, on a pu observer une baisse quasi continue de l’encours et de la proportion de dette détenue par les non-résidents, qui s’expliquait par trois facteurs : – en 1994 se sont conjugués deux mouvements : un repli des investisseurs internationaux sur leur base nationale de placement, consécutivement à la hausse progressive des taux d’intérêt engagée par la Réserve fédérale des Etat-Unis et alimentée par le retour d’anticipations inflationnistes défavorables ; une diminution de l’exposition des investisseurs non-résident sur la France, qui était sur-pondérée dans les portefeuilles internationaux à la suite d’achats massifs d’obligations françaises entre 1989 et 1993 ; – en 1995-1996, l’essor de l’assurance-vie en France s’est traduit par des flux d’épargne particulièrement importants dirigés vers le compartiment des emprunts d’Etat, qui a conduit à une diminution sensible des taux d’intérêt et à une désaffection des investisseurs internationaux envers des titres français qui n’étaient plus assez rémunérateurs par rapport à leur grille d’évaluation de la situation économique française ; – en 1996-1997, le redressement de l’économie mexicaine après la grave crise de l’hiver 1994-1995, ainsi que les perspectives jugées très favorables des pays émergents (Asie du sud-est, Amérique latine et Europe de l’est) ont dirigé préférentiellement les flux internationaux de capitaux vers ces économies. L’année 1998 marque un retournement de tendance significatif. La crise dans les pays émergents a suscité un mouvement – parfois précipité – dit « de fuite vers la qualité ». Par ailleurs, la mise en œuvre désormais certaine de la monnaie unique, dans un périmètre large et équilibré, a provoqué le début d’un mouvement international de réallocation des capitaux, dont a bénéficié la dette de l’Etat. Enfin, le décloisonnement des bases locales d’investisseurs, déjà évoqué ci-avant, a donné lieu à des mouvements intra-zone euro qui doivent cependant être comptabilisés, au sens de la balance des paiements, comme des investissements de non-résidents. Dans le Rapport d’activité 1998/1999, la direction du Trésor estime que « selon les chiffres de la balance des paiements, l’encours des OAT, des BTAN et des BTF détenus par [les non-résidents] est passé de 496 milliards de francs à 774 milliards de francs entre décembre 1997 et décembre 1998, et représentait, fin 1998, 16,8% de l’encours de la dette négociable contre 12,8% fin 1997 ». Selon les évaluations communiquées à votre Rapporteur général par M. Jean Lemierre, directeur du Trésor, lors de l’entretien du 9 septembre dernier, le taux d’internationalisation de la dette de l’Etat serait aujourd’hui d’environ 22%. Le tableau présenté à la page 230 permet de comparer la performance française à celle de ses partenaires de la zone euro (à l’exception du Luxembourg). Une telle internationalisation est heureuse. En effet, selon les critères communément admis par les économistes de marché, une forte détention de titres par des non-résidents est l’un des facteurs de la liquidité globale de la dette (). Au-delà de cet aspect technique, elle est aussi le signe d’une confiance dans la signature de la République, dans la solidité des fondamentaux économiques de notre pays et dans la politique économique conduite par son Gouvernement. * * * Engagée dans des conditions difficiles, la « bataille de la dette » est bien conduite et votre Rapporteur général est plus que jamais convaincu qu’elle sera gagnée. Pour autant cette bataille n’est pas encore gagnée. La confiance des investisseurs est une denrée volatile et les mouvements de capitaux, dans un monde où la plupart des barrières ont été abattues, peuvent surprendre par leur brutalité. L’internationalisation de la dette n’est pas un risque en tant que telle, puisqu’elle ne fait que refléter, de plus en plus, la similarité des raisonnements tenus par les gestionnaires de fonds. Elle est surtout l’une des mesures grâce auxquelles on peut juger de la pertinence d’une stratégie et de l’efficacité d’une démarche. Il faut continuer d’agir sur plusieurs fronts : – la continuité des performances macro-économiques et la poursuite des réformes visant à adapter notre pays à la nouvelle donne de l’économie mondiale et à lui donner un rôle moteur. Assurément, cela ne signifie pas qu’il faudrait céder aux sirènes de l’ultralibéralisme qui, sous couvert de modernisation et de flexibilité, distend le lien social et délite la vie publique. La réforme n’est pas incompatible avec le respect des femmes et des hommes ; – le maintien d’une parfaite adéquation entre la dette de l’Etat et les attentes des investisseurs. Cela implique, selon l’heureuse expression de M. Jean Lemierre, de « savoir innover quand il le faut », donc d’être à l’écoute des investisseurs finaux comme des intermédiaires, même si « l’innovation doit être parfaitement mesurée ». L’expérience désastreuse de l’emprunt 7% 1973 – une catastrophe pour les finances de l’Etat – ne doit pas être reproduite. On doit noter, à cet égard, que le « faux pas » des obligations renouvelables du Trésor, émises de juin 1983 à juin 1986, a été beaucoup mieux contenu. Enfin, la bonne adéquation entre l’offre de titres d’Etat et les besoins des investisseurs suppose de tout mettre œuvre pour ranimer la liquidité du Matif ; – la valorisation des qualités de la dette proposée par l’Etat, qui nécessite également une présence patiente auprès des gestionnaires de capitaux. « La France occupe une très forte position sur certains segments de marché, comme les titres démembrés, mais on n’en voit pas les échos ! » déplorait M. Benito Babini, président de l’Association des spécialistes en valeurs du Trésor. « Le problème n’est pas cantonné à la dette de l’Etat, reprenait M. Dominique Barbet, économiste de marché chez Paribas, l’image économique et financière de la France reste mauvaise ». Votre Rapporteur général accueille donc avec satisfaction la création récente de France Trésor par M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. France Trésor regroupe sur une même « plate-forme », au sein de la direction du Trésor, les activités de gestion de la dette et de gestion de la trésorerie de l’Etat (bureau A1 « Financement de l’Etat et affaires monétaires », direction du Trésor) ainsi que les activités post-marchés (bureau E 1A « Émission et gestion des valeurs du Trésor », direction de la comptabilité publique). France Trésor est aussi une bannière qui « permettra aux investisseurs et au grand public de mieux identifier les valeurs du Trésor comme les titres de référence du marché obligataire de l’euro » (). Parallèlement, le Trésor va constituer deux comités qui, aux côtés des spécialistes en valeurs du Trésor, le conseilleront sur les grands axes de la politique d’émission de l’Etat : – un comité de marché, composé des responsables au plus haut niveau de l’activité obligataire des SVT français et étrangers. Ce comité aura vocation à s’interroger sur des orientations stratégiques de marché, par exemple l’évolution structurelle de la demande des investisseurs sur le compartiment de très long terme, ou bien encore la profondeur respective des marchés de l’euro, du dollar et du yen. Indépendamment même des idées et suggestions qui pourront émerger des réunions de ce comité, le Trésor et les membres du comité pourront trouver un intérêt mutuel de connaissance réciproque à ce grand rassemblement périodique ; – un comité stratégique, qui réunira des personnalités venant d’horizons divers, comme des professionnels du monde bancaire et financier, des investisseurs, des économistes ou des universitaires, l’objectif étant ici de rassembler des experts n’ayant aucune relation directe avec le marché. Ce comité devrait avoir vocation à évoquer des sujets relatifs à la dette d’un point de vue plus « interne » que les préoccupations de marché ; on peut envisager, par exemple, que des analyses sur les modes de financement de l’Etat en fonction de leurs conséquences sur les finances publiques et l’économie générale aient leur place dans les débats du comité stratégique. Ce comité est une véritable innovation : les Etats-Unis, comme la plupart des autres Etats ne consultent qu’un comité de marché. L’effort de transparence est remarquable, puisque l’institution du comité stratégique revient à instaurer un espace de débat sur l’un des « noyaux durs » de la compétence ministérielle en matière de politique d’endettement de l’Etat. Votre Rapporteur général tient à saluer comme il convient cette avancée significative. L’importance de ces comités ne doit pas être minimisée, alors qu’on pourrait a priori s’interroger sur leur utilité : les réformes mises en œuvre depuis quinze ans ne sont-elles pas une incontestable réussite ? Mais l’environnement de l’émetteur souverain s’est fait plus rude et la nécessité d’un positionnement stratégique en phase avec les préoccupations du marché s’impose clairement. Cette nécessité est d’autant plus affirmée que la réduction tendancielle des déficits publics et l’acheminement vers une norme de stabilité budgétaire à moyen terme renforcent le crédit de l’Etat, allègent la charge de la dette et améliorent sa solvabilité, mais peuvent rendre moins aisée la tâche du gestionnaire de la dette. Cette perspective était encore lointaine il n’y a pas si longtemps. Mais après avoir ranimé la croissance, le Gouvernement a placé les comptes publics sur la voie du redressement. Il fallait en finir avec l’« effet boule de neige », cette dynamique infernale de la dette publique qui accroît mécaniquement le poids de celle-ci dans le PIB, par le simple fait que le taux d’intérêt servi à la rente est supérieur au taux de croissance de l’économie productive. En réduisant peu à peu les déficits publics et en maîtrisant la charge de la dette, le Gouvernement libère des marges de manœuvre pour la politique budgétaire. Le redéploiement des dépenses au détriment des intérêts de la dette et au profit des dépenses actives traduit un rééquilibrage de l’intervention étatique et de ses effets redistributeurs. Comment justifier, en effet, que sur le long terme, une petite catégorie de privilégiés – ceux qui peuvent prêter à l’Etat – accapare le bénéfice de la rente et détourne une partie de plus en plus importante de la richesse nationale à son profit ? Bien peu prêtent, mais tous remboursent ! La réduction des déficits publics conduite par l’actuel Gouvernement, avec des méthodes bien différentes de ses prédécesseurs, n’est pas une concession à de médiocres « orthodoxies », mais une importante mesure de redistribution en faveur de ceux pour qui l’épargne reste un luxe. Le ratio de la dette publique était à peine supérieur à 20% en 1980. Il devrait culminer à environ 60,5% du PIB en 1999 avant de décliner en 2000, pour la première fois depuis plus de vingt-cinq ans. Cette rupture historique doit être saluée. Elle montre que le renoncement ne peut tenir lieu de politique et que la confiance et la solidarité sont des moteurs bien plus puissants que l’individualisme. Elle montre qu’il n’est pas d’obstacle qu’on ne puisse surmonter. Sur le chômage et la justice sociale, les Français attendent beaucoup de la majorité qui gouverne le pays depuis 1997. Cette majorité peut leur montrer des résultats, elle peut s’engager sur ses objectifs. Elle peut surtout leur offrir un bien précieux : l’espoir. ANNEXE À LA DEUXIÈME PARTIE Source : direction du Trésor · Etats Unis 1.- Le cadre légal du financement aux Etats Unis Le financement de l’Etat central américain est régi par le « Second Liberty Bond Act » du 24 septembre 1917 (modifié depuis cette date). L‘article 21 de cette loi dispose qu’il revient au Congrès de fixer la limite maximale de l’encours de la dette émise en vertu de cette loi ou garantie en intérêt et principal par le pays. L’encours maximal de la dette a été relevé à de nombreuses reprises. Le « Public Debt Act » de 1942 donne au Trésor une très grande liberté dans le choix des caractéristiques des titres négociables qu’il émet ainsi que sur les techniques de placement. Le Trésor n’est soumis à aucune limite légale sur le niveau des « discounts » ou des taux d’intérêt qu’il propose sur ses titres. Il en est de même aujourd’hui pour les obligations à long terme, soumises jusqu’en 1988, à une limite de 4,25%. La Fed est chargée, pour le compte du Trésor, de l’organisation matérielle des enchères. Les offres peuvent néanmoins être déposées directement au Trésor. 2.- Les titres d’Etat La dette publique négociable se compose de trois catégories de titres : les Treasury Bills, les Treasury Notes et les Treasury Bonds. Les Treasury Bills sont des titres à taux précomptés dont la maturité à l’émission est inférieure ou égale à un an. Les T.Bills à trois et six mois sont émis chaque semaine (annonce le mardi, adjudication le lundi suivant, règlement le jeudi). Les T.Bills à un an sont émis mensuellement (annonce le vendredi, émission le lundi, règlement le jeudi). L’émission de ces titres se fait sur la base d’offres à prix multiples (« multiple price auction ») portant sur le taux de rendement exprimé avec deux décimales. Les Treasury Notes sont des titres dont la maturité est comprise entre deux et dix ans. Ils portent intérêt fixe et donnent lieu à un détachement de coupon semestriel. Les T.Notes à deux et cinq ans sont émis mensuellement (l’annonce a lieu, en général, en milieu de mois et l’adjudication une semaine plus tard ; le règlement intervient le dernier jour du mois ou le premier jour ouvrable suivant). L’émission se fait selon la formule du prix unique (« single price auction »), exprimé par un taux à trois décimales. Ce prix s’applique également aux offres non compétitives. Les émissions de T.Notes à trois ans ont été supprimées en 1999 à la suite de la diminution du programme de financement liée aux excédents budgétaires. Les émissions de T.Notes à dix ans sont bimensuelles. L’annonce est effectuée le premier mercredi de février, mai, juillet, août, octobre et novembre ; l’annonce a lieu le premier mercredi, l’adjudication, le deuxième mercredi et le règlement des titres intervient le quinzième jour du mois. Les Treasury Bonds (« T. Bonds ») sont des titres dont la maturité est supérieure à dix ans. Ils portent intérêt fixe et donnent lieu à un détachement de coupon semestriel. Une émission de T.Bonds à trente ans a lieu deux fois par an () (annonce le premier mercredi des mois de février et août adjudication la semaine suivante et règlement le quinzième jour de chacun des mois). A ces trois catégories, s’ajoutent les « cash management Bills », titres à très court terme utilisés par le Trésor pour gérer plus finement sa trésorerie. Il s’écoule habituellement entre un et sept jours entre l’annonce et l’émission de ces titres. Le Trésor émet également des titres non négociables destinés aux particuliers (sous forme de bons d’épargne), aux banques centrales, aux agences fédérales ainsi qu’aux collectivités locales américaines. 3.- Les modalités d’émission Depuis le début des années soixante-dix, la dette fédérale est émise par voie d’adjudication. Les modalités (soumissions en prix ou en taux) varient selon la catégorie de titres vendus. Jusqu’en 1992, les enchères reposaient sur le principe des prix multiples. Cette même année, le Trésor a mis en place un système d’adjudication à prix unique pour les T.Notes à deux et cinq ans afin d’inciter les participants à soumissionner des taux plus faibles (le prix de l’adjudication résultant du plus élevé des taux demandés sur les soumissions servies). Depuis 1998, l’adjudication à prix unique a été étendue à tous les titres (T.Notes et T.Bonds). Outre les soumissions compétitives, il existe un système d’offres non compétitives servies au taux moyen des titres adjugés (10% des titres sont en général adjugés suivant cette procédure). Les adjudications sont réalisées via un système automatisé de transmission et de traitement des ordres (« Treasury Automated Auction Processing System »). Un système des primary dealers a été institué en 1960 par la Fed. Les primary dealers sont les correspondants attitrés de la Réserve Fédérale pour l’exécution de sa politique monétaire (achats et ventes de titres gouvernementaux sur le marché secondaire). L’accès au marché primaire n’est pas exclusivement réservé aux primary dealers. Depuis 1991, tous les investisseurs peuvent participer aux adjudications du Trésor. Ils s’engagent, en contrepartie, à respecter les obligations liées au statut (présence sur le marché primaire, animation du marché secondaire, présentation de rapports d’activité). · République Fédérale d’Allemagne 1.- Le cadre légal du financement en RFA Les interventions de l’Etat fédéral sur les marchés financiers sont liées au respect de deux dispositions de l’article 115 de la Constitution (« Grundgesetz -GG »). Celui-ci soumet le financement du budget fédéral par emprunt à une autorisation préalable du Parlement. Elle est conférée chaque année lors du vote de la loi de finances et porte sur un montant fixe. Les besoins supplémentaires sont également liés à un vote préalable du pouvoir législatif. Le ministre des finances est libre de décider des instruments financiers et de leur maturité. L’article 115 dispose, en outre, que le montant annuel emprunté sur le marché ne peut être supérieur aux dépenses en capital inscrites au budget (ce principe peut bien évidemment être enfreint pour assurer l’équilibre économique général du pays). Une grande partie des besoins de financement du gouvernement fédéral et de ses fonds spéciaux sont couverts par émission de titres. Depuis 1995, outre les émissions de l’Etat fédéral, cinq fonds spéciaux émettent des titres sur le marché. 2.- Les titres d’Etat Les titres de l’Etat fédéral sont généralement à taux fixe, coupon annuel et échéance unique. Ils sont dématérialisés et donnent lieu à une inscription au « Wertrechte », le registre de la dette l’Etat fédéral et du secteur public. On distingue plusieurs catégories de titres. Les obligations allemandes « Bundesanleihen » sont émises depuis 1952 ; elles correspondent à la fois aux obligations du gouvernement fédéral et à celles de ses différents fonds spéciaux. Ces titres sont émis par syndication (jour J) suivie d’une adjudication (J+1). Des émissions de « Bunds » sont réalisées plusieurs fois dans l’année selon une périodicité irrégulière. Depuis 1995, la Bundesbank procède, en fonction des conditions de marché, à la réouverture de certaines lignes de « Bunds ». La procédure de réabondement est identique à celle utilisée pour une première émission (syndication-adjudication). Ce sont principalement des titres de maturité dix ans. Des « Bunds » d’échéance douze, quinze et trente ans ont également été émis par le gouvernement fédéral. Les « Bundesschatzanweisungen » sont émis avec une maturité de quatre ans ; ces titres ont été délaissés, au milieu de l’année 1995, au profit d’émissions de « Bobls ». Depuis septembre 1996, l’Etat fédéral émet à nouveau des « Schätzes » à deux ans. Ils sont émis en une seule fois, par adjudication. Seuls les établissements disposant d’un compte à la Banque centrale peuvent soumissionner. Ils ont fait place, au milieu de l’année 1995, à des émissions de titres à cinq ans : les « Bobls » (« Bundesobligationen »). La procédure d’émission est la suivante : les « Bobls » font l’objet, pendant deux à trois mois, d’une prévente à laquelle les personnes physiques, organismes sans but lucratif et associations caritatives ou religieuses peuvent seules souscrire. La souscription s’effectue dans les guichets bancaires, à prix fixe (ajustable, à la marge, par la Bundesbank). Lorsque les conditions de marché évoluent, la Banque centrale clôture la série par une adjudication accessible à tous les investisseurs. Les titres sont introduits et cotés en Bourse. En pratique, une « série » n’est jamais émise plus de trois mois. Les titres d’Etat destinés aux personnes physiques (« Bundesschatzbriefe ») : destinés aux particuliers ainsi qu’aux organismes sans but lucratif, ces titres sont émis depuis 1969. Deux catégories existent sur le marché : les bons de maturité six ans et de coupon annuel (type A), remboursés au pair ; les bons de maturité sept ans à intérêts capitalisés (type B) dont le remboursement s’effectue au pair plus les intérêts. Les « Finanzierungsschätze des Bundes » constituent la partie à court terme de l’endettement fédéral (leur maturité s’étale de douze à vingt-quatre mois). Ils sont « émis au robinet » tous les mois et les souscriptions ouvertes à tous (exceptés les établissements de crédit). Non cotés en Bourse, ils sont remboursés au pair. Les « Bundesbank Liquiditäts Unverzinsliche Schatzanweisungen » (Bulis) d’échéance six mois ont été émis, jusqu’en septembre 1994. Ces titres, d’une valeur nominale de 500 000 DM, étaient adjugés sur la base d’un taux précompté. Craignant un effet négatif de ces titres sur la politique monétaire allemande, la Bundesbank a demandé l’arrêt de ces émissions. Depuis juillet 1996, des « Bu-Bills » de maturité six mois sont émis par adjudication trimestrielle. Les « U-Schätzes » sont des bons à deux ans à intérêts précomptés ; ils sont émis en une seule fois par adjudication ; ils sont accessibles à tous les investisseurs. Depuis septembre 1994, l’Etat fédéral a relancé ses émissions à taux flottants – FRNs (les dernières émissions sur ce type de papier remontaient à 1990). Certains fonds spéciaux (la Poste allemande, le Fonds en charge des transports ferroviaires) émettent eux aussi des flotteurs. De maturité dix ans, ces bons sont indexés sur les taux interbancaires à trois mois. Depuis 1998, le Parlement allemand a autorisé le Gouvernement à émettre des titres indexés sur l’inflation. Les marchés financiers considèrent que la non-utilisation de cette possibilité provient d’un désaccord de la Bundesbank. 3.-Les modalités d’émission La couverture du besoin de financement de l’Etat fédéral allemand sur les marchés fait appel au placement de différents titres, pour lesquels les procédures d’émission varient en fonction des investisseurs auxquels l’émetteur s’adresse (épargnants privés, investisseurs institutionnels). ¨ La procédure de syndication : L’émission des « Bunds » est réalisée à travers un consortium bancaire sous la direction de la Bundesbank. Ce « Federal Bond Consortium » a été mis en place en 1952, à l’occasion du lancement du premier emprunt de la République Fédérale d’Allemagne. Juridiquement, le Consortium est une association régie par la loi civile. Il a les caractéristiques d’un syndicat de placement bancaire, chaque membre souscrivant la part d’émission qui lui revient. Depuis 1991, l’attribution de ces parts fait, chaque année, l’objet d’un nouveau calcul par la Bundesbank (après prise en compte des capacités de placement de chaque membre). La Bundesbank dirige l’émission (elle ne souscrit pas au montant placé). Les membres du Consortium sont des établissements de crédit allemands et, depuis 1992, les banques étrangères disposant d’une succursale en Allemagne. A chaque syndication, les caractéristiques de l’émission (volume, maturité, coupon, prix d’émission) sont déterminées par un comité restreint qui réunit la Bundesbank, l’émetteur (l’Administration fédérale de la dette) et le syndicat. Les caractéristiques arrêtées, un quota est offert à chacun des membres qui s’engage à placer sa part. L’émetteur règle une commission aux membres du syndicat. Depuis août 1990, une procédure combinant les techniques de syndication et d’adjudication a été introduite pour les Bunds. Depuis 1999, les montants alloués au consortium sont devenus très faibles et sont réservés à la clientèle des particuliers; En conséquence, la quasi totalité de l’émission se fait par adjudication. ¨ La procédure d’adjudication : Elle constitue le support d’émission des « Bunds » (en combinaison avec la syndication), des « Schätzes » et des « U-Schätzes » ainsi que d’une partie des « Bobls ». Dans le cas des « Bunds », seuls les membres du syndicat sont autorisés à soumissionner. Les émissions de « Schätzes », « U-Schätzes » et « Bobls » sont, quant à elles, réservées aux établissements disposant d’un compte à la Banque centrale (ou dans une de ses succursales régionales). ¨ Les ventes de gré à gré : Les « émissions au robinet » du gouvernement fédéral (« Bobls », titres destinés aux personnes physiques, « Schätzes ») sont faites, en continu et pour une période illimitée, par l’intermédiaire des établissements de crédit et des succursales régionales de la Bundesbank. Ce procédé permet au gouvernement fédéral de se financer discrètement sans surcharger le marché financier. · Japon 1.- Le cadre légal du financement au Japon L’article 85 de la Constitution japonaise subordonne le financement du gouvernement sur le marché à une autorisation préalable du Parlement. Annuelle, celle-ci fixe un montant global d’emprunt (à l’exception des « constructions bonds » et « deficit coverings bonds » qui font l’objet d’une loi particulière et d’un volume d’émission spécifique). L’exercice s’étend sur la période avril à mai. La responsabilité de la politique d’émission relève du gouvernement japonais qui en délègue la gestion matérielle à la Banque du Japon. Outre la réalisation des émissions, la Banque centrale assure la conservation des titres, le règlement-livraison des titres (système central automatisé « BOJ net »), le paiement des intérêts (réalisé par les agences locales de la banque) ainsi que la gestion des amortissements. Pour placer sa dette, le gouvernement japonais fait appel à un syndicat bancaire. Ce syndicat est constitué de la plupart des institutions financières du marché des capitaux japonais. Les établissements susceptibles d’y participer sont les banques certifiées par l’article 1-2 du « Cabinet Order for Enforcement of the Securities and Exchange Law », les compagnies financières japonaises ou étrangères licenciées en vue d’opérations de syndication. 2.- Les titres d’Etat Au Japon, la classification des titres de la dette publique est réalisée en fonction de l’utilisation des fonds obtenus par les émissions. On distingue ainsi trois catégories de valeurs : – les titres utilisés pour la couverture les dépenses du gouvernement, connus sous le terme de « revenue bonds » ou « straight bonds » : l’émission de ces titres est prévue par trois textes, le « Public Finance Law », le « Deficit-Covering Bond Law » et le « Special Account Law of the Government Debt Consolidation Fund » (dont les émissions financent l’amortissement des titres) ; – les titres utilisés pour le financement des dépenses courantes : les difficultés temporaires de trésorerie de l’Etat (compte général ou comptes spéciaux) sont couvertes par l’émission de titres à court terme, les « financing bills » (« Fbs »). Ces titres sont, dans un premier temps, offerts au public à prix fixe. Le solde est ensuite réparti entre les membres du syndicat. Il existe trois types de financing bills : les KURA KEN (émis en cas d’insuffisances temporaires de trésorerie ) ; les RYOU KEN (dont l’émission est directement liée à l’évolution des prix du riz dans le pays) et les TAME KEN (dont les fonds financent les ventes de yen sur le marché des changes) ; – les titres se substituant aux paiement en espèces du gouvernement (deux catégories de titres) : les « subsidy bonds » sont affectés à l’aide financière des familles des victimes de guerre (titres au porteur dont la vente est limitée) ; les bons de souscription ou de contribution aux organismes internationaux (FMI, Banque Mondiale). 3.- Les modalités d’émission L’émission des titres de la dette publique japonaise fait appel à trois techniques : l’adjudication, la syndication et la syndication réservée au « Trust Fund Bureau » du ministère des finances japonais. La syndication est utilisée pour l’émission des titres de maturité cinq et dix ans. Les titres à cinq ans sont alloués en globalité au syndicat sur une base de répartition fixe. Ceux à échéance dix ans sont, pour 60% du montant émis mensuellement, adjugés sur le marché, le reste se répartissant entre les membres du syndicat le jour ouvré suivant l’adjudication. Les montants annuels pris en syndication sont fixés par le ministère des finances après consultation des intervenants de marché. L’adjudication est utilisée pour l’émission des titres à deux, quatre, six et vingt ans ainsi que pour les titres à court terme. Les émissions de titres à moyen terme (deux, quatre et six ans), réalisées sur la base d’adjudication à prix compétitifs, ont la particularité d’être accessibles au public. Les titres présentent les mêmes caractéristiques que ceux destinés aux institutionnels (taux facial, date d’échéance). Seul le prix change : il est fixé en fonction du prix moyen pondéré ou des prix retenus lors de l’adjudication, la veille. Enfin, la syndication réservée au « Trust Fund Bureau » du ministère des finances regroupe les fonds de La Poste et de divers organismes gouvernementaux. · Royaume Uni 1.-Le cadre légal du financement au Royaume Uni Au Royaume-Uni, le financement des besoins de l’Etat est régi par trois textes : le « National Loans Act » (1968), le « National Savings Bank Act » (1971) et le « National Debt Act » (1972). Les principes actuels de la politique d’émission datent de 1985, année de la réforme du secteur financier (« the Big Bang Reform »). D’un point de vue institutionnel, les responsabilités en matière d’émission et de gestion de la dette publique ont été profondément réformées en mai 1997. La gestion de la dette et de la trésorerie ont été transférés de la Banque d’Angleterre au Debt Management Office (DMO), mis en place le 1er avril 1998. Le DMO fait partie institutionnellement et constitutionnellement du Trésor, mais en tant qu’agence exécutive, il exerce sa mission de manière autonome, dans la cadre d’un mandat déterminé par le Chancelier de l’Echiquier. La politique d’émission est sous la responsabilité du Treasury qui l’exerce au nom du gouvernement britannique. Il exerce un rôle de conception, puisqu’il est chargé d’élaborer les décisions stratégiques en matière de politique d’émission et de répondre aux questions structurelles et institutionnelles ayant trait à la dette publique. Chaque année, le Treasury confère par mandat (« the Remit ») la gestion de la dette au Debt Management Office. Ce dernier se voit confier les émissions de titres, la gestion du marché secondaire, la supervision des intervenants de marché (en particulier celle des primary dealers). La gestion de la trésorerie devrait également être transférée de la Banque d’Angleterre au DMO à l’horizon 2000. Les émissions de titres au profit des particuliers sont, pour leur part, dirigées par le « Department of National Savings » (qui a acquis, à compter du 1er juillet 1996, le statut d’agence). Les besoins de financement sont déterminés par le déficit du secteur public ou CGBR (Central Government Borrowing Requirement), la charge d’amortissement pour l’année, la variation des réserves de change et l’éventuel « reliquat » d’emprunt (positif ou négatif) de l’année précédente. Ces besoins sont couverts par l’émission d’obligations au secteur bancaire, la vente de titres au profit des particuliers à travers les « National Savings Products » et la vente de « certificats of tax deposits ». 2.- Les titres d’Etat Il existe trois catégories de titres : – les Gilts Edged (ou Gilts) divisés en deux catégories : les « conventionals stocks» (obligations à taux fixe dont la maturité peut aller jusqu’à vingt-cinq ans. L’intérêt est versé deux fois par an. Elles sont remboursées à date fixe à l’exception d’un petit nombre qui ne présente pas de date d’échéance) et les «Index-linked stocks »(obligations à taux indexé, capital et intérêt évoluant en fonction de l’indice des prix). Certaines obligations offrent des options de convertibilité (« convertible stocks ») selon des dates et des termes spécifiques. Il existe également des titres présentant deux dates d’échéance (« double-dated »). Le gouvernement peut alors décider de rembourser la ligne à n’importe quel moment lorsque la première maturité est atteinte. S’il n’exerce pas cette option, l’amortissement aura lieu à la deuxième date. – les Treasury Bills : ils constituent l’endettement à court terme de l’Etat. Ces émissions sont destinées à financer les variations infra-annuelles de trésorerie. – les National Savings Bonds : destinés aux personnes physiques, ils sont disponibles dans la plupart des bureaux de poste et inscrits au National Savings Stock Register. Les particuliers acquittent une commission. Ces titres peuvent être des obligations à taux fixe, variable ou à taux indexé. 3.- Les modalités d’émission Trois modes d’émission sont utilisés au Royaume-Uni : l’adjudication, la méthode dite des « tap issues » et la vente « occasionnelle » de titres. La technique de l’adjudication a été introduite en 1987. Elle est devenue, avec le développement du marché obligataire, le principal mode d’émission. Les adjudications ont lieu à dates fixes publiées avant le début de chaque année budgétaire dans le rapport annuel du Treasury et de la Banque d’Angleterre (« Debt Management Report »). Huit jours avant l’émission, la Banque d’Angleterre précise la (ou les) ligne(s) ainsi que le(s) montant(s) adjugé(s). La méthode des « tap issues » : les autorités de marché britanniques voient dans ce mode d’émission plus un mécanisme de régulation du marché qu’un moyen de financement à proprement parler. Il est utilisé pour pallier les tensions temporaires survenant sur un titre, un segment de marché particulier ou lorsqu’apparaît une montée exceptionnelle des prix sur le marché. Cette méthode a par ailleurs été la seule utilisée jusqu’à la fin 1998 pour l’émission de titres indexés sur l’inflation, pour être progressivement remplacée par des adjudications depuis. Seuls les primary dealers ont accès aux tap issues. Aucune « émission au robinet » d’obligation conventionnelles n’a été effectuée en 1998-1999. CONCLUSION Les orientations que traduit le projet de loi de finances pour 2000 s’inscrivent dans la continuité de la politique économique et budgétaire qui a permis à notre pays de renouer avec la croissance en 1997-1998, puis de la conforter en 1999, malgré les aléas extérieurs. Le choix majeur de l’emploi est ainsi confirmé : il s’agit, pour 2000, d’installer une croissance forte dans la durée, tout en veillant à une répartition équitable de ses « dividendes », la solidarité étant à la base de la confiance nécessaire à la poursuite du cycle vertueux emploi-revenu-consommation-investissements. Les trois orientations majeures définies il y a deux ans restent donc à l’ordre du jour, sous réserve d’un « réglage » qu’autorisent les perspectives de croissance, celle-ci ne nécessitant pas de renouveler la stimulation exercée en 1999 par l’augmentation en volume de la dépense. Le financement des priorités précédemment définies sera donc assuré grâce aux fruits du désendettement, aux efforts de redéploiement ainsi qu’à la modernisation de la gestion budgétaire, qui devra être activement poursuivie dans la ligne des conclusions adoptées en janvier dernier par le groupe de travail sur l’efficacité de la dépense publique et le contrôle parlementaire, constitué à l’initiative du Président Laurent Fabius. La maîtrise des comptes publics sera poursuivie dans les mêmes conditions qu’en 1999, à raison d’une réduction du déficit de 21 milliards de francs, soit environ le tiers des marges budgétaires disponibles. Les deux tiers de ces marges seront consacrés à la nécessaire décrue des prélèvements obligatoires, avec des réductions d’impôts de l’ordre de 39 milliards de francs, dans des secteurs qui concernent un grand nombre de nos concitoyens et où les effets sont les plus favorables à l’emploi (travaux d’entretien dans les logements, services de proximité, mutations immobilières, suppression du droit de bail pour la grande majorité des locataires). Cet effort sans précédent doit être souligné. Il n’en devra pas moins être poursuivi, voire amplifié, au fur et à mesure que des marges supplémentaires pourront être dégagées. TRAVAUX DE LA COMMISSION I.- AUDITION DE MM. DOMINIQUE STRAUSS-KAHN, MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, ET La Commission a procédé, le mercredi 15 septembre 1999, à 11 heures 30, à l’audition de MM. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, et Christian Sautter, secrétaire d’Etat au budget, sur le projet de loi de finances pour 1999. Le Président Augustin Bonrepaux a remercié les ministres de venir présenter le projet de loi de finances immédiatement après son adoption en conseil des ministres. M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, a indiqué que le présent projet de loi de finances s’inscrivait dans la stratégie économique d’ensemble mise en œuvre depuis 1997, laquelle a permis, avec la création de l’euro, d’obtenir de bons résultats, meilleurs que ceux de nos partenaires. La crise survenue à la fin de 1998 est désormais surmontée et après ce « trou d’air », l’économie est assez fortement repartie : la pente de croissance est peut-être actuellement d’environ 3 %, ce qui se traduira, en moyenne annuelle pour 1999, par un résultat de l’ordre de 2,3 %. La prévision pour 2000, compte tenu des incertitudes qui subsistent encore, se situe dans une fourchette comprise entre 2,6 et 3 %, le projet de loi de finances se fondant sur le chiffre de 2,8 %. Les trois principales caractéristiques de la conjoncture actuelle autorisent à parler de « nouvelle croissance » : une progression soutenue de la demande intérieure, non seulement des ménages, mais désormais également des entreprises, de fortes créations d’emplois et un contenu élevé en innovation et en nouvelles technologies. Le ministre a ensuite précisé que malgré le ralentissement de la croissance enregistré au début de 1999, la marge budgétaire disponible en 2000 serait identique à celle de cette année, soit 60 milliards de francs en volume. En 1999, cette marge avait permis, pour un tiers, de réduire le déficit budgétaire, pour un autre tiers, de baisser les impôts et, pour le dernier tiers, d’augmenter les dépenses publiques d’1 %. En 2000, un tiers de la marge sera également affecté à la réduction du déficit tandis que les deux tiers restants seront exclusivement consacrés à des baisses d’impôts, soit 39 milliards de francs, ce qui représente la diminution la plus importante enregistrée depuis dix ans. En 2000, conformément aux engagements pris dans le cadre du programme pluriannuel transmis à nos partenaires européens, les dépenses resteront stables en termes réels. Au demeurant, il faut convenir que le soutien conjoncturel nécessaire en 1999, ne se justifiera plus en 2000. M. Dominique Strauss-Kahn a ensuite présenté les allégements d’impôts contenus dans le projet de loi de finances pour 2000. Il s’agit d’abord de la baisse de la TVA sur les travaux dans les logements, qui constitue à la fois le respect d’un engagement politique, la satisfaction d’un souhait exprimé par l’Assemblée nationale et un instrument particulièrement efficace de développement de l’emploi, comme le montrent les études qui ont été récemment effectuées sur le sujet. Cette baisse bénéficiera aux 10 millions de ménages qui, chaque année, pour effectuer des réparations importantes ou non, recourent aux 263.000 artisans ou entreprises que compte ce secteur, lequel emploie 1.100.000 personnes. Outre l’effet sur l’emploi, il faut en attendre une réduction de l’économie souterraine, car une telle mesure permet de diminuer, ou même d’inverser, la rentabilité du travail au noir. Par ailleurs, une nouvelle baisse de 20 % des droits de mutation, visant à accroître la mobilité des personnes, interviendra en 2000 : ramenés de 6 % à 4,8 %, ils seront ainsi au niveau moyen constaté dans les pays voisins. Enfin, à l’initiative de M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’Équipement, des Transports et du Logement, le droit de bail sera supprimé dès le 1er janvier 2000 pour tous les loyers inférieurs à 2.500 francs par mois, ce qui concerne immédiatement 80 % des locataires et 90 % des locataires de HLM. Les autres locataires bénéficieront de la suppression de ce droit à compter de 2001. Au total, ces trois mesures de justice fiscale, qui visent principalement à rééquilibrer la charge pesant sur les ménages, pourraient entraîner en même temps la création de 30.000 à 50.000 emplois. Le ministre a souligné que le projet de loi de finances pour 2000 entendait également soutenir une croissance plus innovante, mentionnant à cet égard la suppression des impôts sur les créations d’entreprises, et marque une nouvelle étape dans la mise en place d’une fiscalité écologique, avec la stabilisation des taxes sur l’essence sans plomb, à la différence de ce que l’on constate chez nos partenaires et malgré la hausse des prix du pétrole, la poursuite du rattrapage sur le gazole, soit une hausse de 7 centimes, et l’extension de la TGAP par une écotaxe qui, destinée à financer les allégements de charges sur les bas salaires, figurera dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il a annoncé que le projet de loi de finances pour 2000 traduit en outre un effort en faveur de l’emploi, avec la poursuite de la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle, qui bénéficiera à 200.000 entreprises supplémentaires, ce qui portera à 90 % la proportion d’entreprises désormais exonérées de cette part, et la fin du démantèlement de la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés, qui avait été instaurée afin d’assurer le respect des critères de convergence requis pour participer au lancement de l’euro. Enfin, 49 impôts seront supprimés, ainsi que 40 articles du code général des impôts et 5.200.000 formulaires. 1,5 million de familles bénéficieront ainsi de la suppression des frais d’inscription aux examens du second degré. Les prélèvements obligatoires d’Etat seront ramenés de 17,5 % à 16,9 % du PIB, mais les finances publiques doivent encore être considérées comme convalescentes. Le déficit budgétaire, réduit de 21 milliards de francs, soit 0,3 % du PIB, s’élèvera à 215 milliards de francs. Le concept d’excédent apparaît donc comme un objectif encore lointain et il faudra attendre plusieurs années de croissance pour que la France connaisse, comme les Etats-Unis, un excédent budgétaire. En 1999, le déficit des administrations publiques atteindra 2,2 %, pour une prévision initiale de 2,3 %, tandis qu’en 2000, conformément à la projection triennale, il devrait être ramené à 1,8 %. D’autres indicateurs permettent de montrer que le garrot se desserre : entre 1997 et 2000, la part de la dépense publique dans le PIB est passée de 54,9 % à 53,1 %, et il faudra poursuivre dans ce sens. Enfin, comme cela avait été annoncé dès 1997, c’est en 2000 que le ratio dette/PIB commencera à diminuer, pour la première fois depuis vingt ans. M. Christian Sautter, secrétaire d’Etat au budget, a d’abord rappelé que les dépenses du projet de loi de finances pour 2000 resteraient stables en volume. Cette rigueur est tempérée de deux manières : d’abord par l’allégement des charges financières à hauteur de 4 milliards de francs, et par des efforts d’économies et de redéploiements d’un montant total de 30 milliards de francs. En ce qui concerne la méthode adoptée, on soulignera un effort pour moderniser la gestion budgétaire, notamment par la passation de contrats de gestion pluriannuels, par la globalisation des crédits et par l’institution d’indicateurs de performance, de manière exemplaire en ce qui concerne le budget de l’environnement. Le Gouvernement prend, en outre, en compte les travaux de la mission d’évaluation et de contrôle. La croissance des budgets prioritaires est nettement plus rapide que celle des autres budgets. Les budgets de l’emploi et de la solidarité, de l’éducation, de la justice, de la sécurité, de l’environnement et de la culture progressent, globalement, quatre fois plus vite que l’ensemble des dépenses de l’Etat. Le budget de l’emploi et de la solidarité connaît une hausse de 4,3 % et devient ainsi le deuxième budget de l’Etat. Il finance 100.000 emplois-jeunes supplémentaires afin d’atteindre à la fin de l’an 2000 l’objectif de 350.000 emplois-jeunes. Il finance également la réduction du temps de travail à hauteur de 7 milliards de francs, les actions menées par l’ANPE et l’AFPA, et la création de la couverture maladie universelle, à hauteur de 7 milliards de francs. En particulier, les crédits de la politique de la ville progressent très sensiblement. Le budget de l’éducation s’élève à 361 milliards de francs et progresse de 3,3 %. L’augmentation du premier budget de l’Etat permet de créer 3.300 emplois d’enseignants du second degré, d’assurer la montée en charge du « plan social étudiant » et de réaliser le plan d’« universités du troisième millénaire ». Les crédits de la justice augmentent de 4 %. Ces crédits permettront notamment de renforcer la protection judiciaire de la jeunesse et d’augmenter les moyens de l’administration pénitentiaire. Les crédits de la sécurité publique se montent à 54,2 milliards de francs et augmentent de 3 %, ce qui contribuera à mettre en place une véritable police de proximité. Les crédits de fonctionnement de la police augmentent, pour leur part, de 5 %, et les crédits d’équipement de 38 %. Il faut également noter que le budget de l’environnement croît de 8 % et que le budget de la culture (+ 2 %) pourra atteindre le seuil d’1 % du budget de l’Etat d’ici la fin de la législature. En ce qui concerne le budget de la défense, si l’effort d’économie est marqué, les moyens d’engagements militaires s’élèveront à 87,5 milliards de francs. Les crédits attribués au ministère des Affaires étrangères sont en hausse, ainsi que les crédits destinés au ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement, tandis que les moyens de la sécurité routière progressent de 18 %. Le projet de loi de finances modifie le périmètre technique de présentation du budget de l’Etat. En 1998, 46 milliards de francs ont été réintégrés, pour tenir compte d’une décision du Conseil constitutionnel. En 2000, 10 milliards de francs seront réintégrés, cette somme comprenant notamment le financement de la couverture maladie universelle et du « fonds amiante ». Quatre comptes spéciaux du Trésor sont par ailleurs supprimés. Le Président Augustin Bonrepaux a félicité les ministres pour la réduction du déficit et de l’endettement de l’Etat, résultats conformes aux dernières orientations triennales et qui devraient recueillir un large assentiment. Les dépenses connaissent une croissance nulle en volume, tout en autorisant la progression des moyens destinés aux budgets prioritaires. En ce qui concerne la police, on ne peut que souligner le fait que le Gouvernement ait repris une suggestion lancée par le Rapporteur spécial des crédits de la sécurité, M. Tony Dreyfus, dans le cadre des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle : le redéploiement des agents de police sur le terrain. Enfin, il s’est déclaré particulièrement heureux de la baisse du taux de TVA applicable aux travaux dans les logements alors qu’un certain scepticisme avait accueilli cette proposition, formulée au sein de la Commission au mois de juin. On ne peut donc que se féliciter de l’aboutissement de cette demande. Votre Rapporteur général s’est associé à la satisfaction du Président Augustin Bonrepaux, s’agissant de la baisse du taux de TVA sur les travaux dans les logements et de la reprise de propositions de la mission d’évaluation et de contrôle. L’effort de maîtrise des dépenses, qui n’est pas incompatible avec le financement des priorités du Gouvernement, est positif. Il faut en effet souligner l’important redéploiement des crédits effectué par le projet de loi de finances. On peut néanmoins s’interroger sur les suites données à la volonté exprimée par le Gouvernement de remettre à niveau les dépenses d’investissement de l’Etat, alors que la montée en puissance des grands programmes de la législature conduit à augmenter les dépenses d’intervention. La question est de savoir si l’on pourra compter uniquement sur la modération de la charge de la dette pour tenir les engagements en matière de croissance des dépenses de l’Etat, ou s’il faudra agir sur les dépenses de fonctionnement de l’Etat. En ce qui concerne la conjoncture, il convient de ne pas mésestimer les facteurs de risque qui pourraient peser sur le niveau de la croissance économique. S’agissant de la prétendue « cagnotte » de recettes fiscales pour 1999, un débat surréaliste s’est engagé. Il convient donc de faire un point précis sur les plus-values de recettes en 1999, et sur leurs conséquences sur l’année en cours et l’année à venir. Même si l’on peut s’interroger sur la pertinence de cet indicateur, il serait intéressant de connaître le montant des prélèvements obligatoires pour 1999 et la différence avec le chiffre qui a été prévu à la fin de l’année 1998. La baisse du taux de TVA sur les travaux dans le bâtiment est une bonne mesure, large et visible, mais un doute peut subsister sur les éventuels compromis intervenus lors du dernier conseil européen et sur les conditions dans lesquelles cet accord pourra être parachevé le 8 octobre prochain. Une extension de la mesure à d’autres secteurs est-elle envisageable, par exemple au secteur de la restauration ? En ce qui concerne les prélèvements directs, un chantier fiscal sur les prélèvements sur les ménages, dans lequel la Commission accompagne l’action du Gouvernement, a été ouvert. Deux questions sont cependant particulièrement préoccupantes : celle de la nécessité de réduire la charge des contribuables modestes dont la cotisation d’impôt se révèle trop lourde et celle de la coordination entre le système fiscal et les transferts sociaux, afin d’éviter la création de « pièges à pauvreté », décourageant la reprise d’activité. M. Dominique Strauss-Kahn a reconnu que les facteurs de risque pesant sur la conjoncture demeuraient, mais qu’ils étaient moins importants qu’en 1999, en raison du retour de la croissance en Asie et de la stabilisation – certes à un niveau bas – de la situation économique russe. Le principal facteur de risque est constitué par l’évolution de l’économie américaine, la durée exceptionnellement longue de son cycle de croissance justifiant une grande prudence. La prévision de croissance pour l’économie française prend en compte un ralentissement assez sensible de la croissance aux Etats-Unis, soit une croissance deux fois plus faible en 2000 qu’en 1999 – prévision qui peut paraître pessimiste en cas d’atterrissage en douceur de l’économie américaine. Le débat, apparu cet été, sur l’existence d’une éventuelle « cagnotte » est surréaliste. En effet, la comparaison entre les recettes perçues en 1999 et celles qui l’ont été en 1998 n’a aucune pertinence, puisque seule la comparaison entre les recettes effectives de 1999 et les prévisions de la loi de finances initiale est correcte. L’évolution des recettes de l’Etat n’est pas tenue secrète puisque des statistiques sont publiées chaque mois. Les rentrées de TVA et d’impôts sur le revenu sont globalement en phase avec les prévisions, le léger retard des premières étant compensé par la légère avance des secondes. Par contre, les recettes liées à l’impôt sur les sociétés dépassent les prévisions initiales, puisque les bénéfices des entreprises constatés en 1998 ont été plus élevés que prévu, grâce à une croissance plus soutenue. Cependant, pour établir une prévision annuelle, il ne faut pas multiplier par deux les résultats constatés à la fin du mois de juin, puisque le troisième versement d’impôt sur les sociétés, intervenant à l’automne, est ajustable, les entreprises pouvant en reporter une partie sur le solde qui sera acquitté en 2000. Compte tenu de cette incertitude, il est possible de tabler sur un excédent de recettes d’impôt sur les sociétés d’environ 12 milliards de francs. La moitié de cette somme servira à financer l’application, dès 1999, de la baisse de la TVA et des droits de mutation. Quant au solde, il ne sera en aucun cas utilisé à augmenter les dépenses et l’engagement pris par le Gouvernement, en 1999, de limiter l’augmentation de celles-ci à 1 % en volume sera tenu. Le ministre a indiqué s’attendre à des débats sur le niveau du taux de prélèvements obligatoires en 1999. Pourtant, son augmentation s’explique aisément par trois causes mécaniques. D’une part, la croissance du dénominateur est plus faible que prévu en raison du non respect des prévisions de croissance et de hausse des prix (on s’attend respectivement à un retard de 0,4 point et de 0,7 point). A l’inverse, l’excédent de recettes lié à l’impôt sur les sociétés vient augmenter le numérateur. Enfin, la forte croissance des salaires entraîne une augmentation des recettes de cotisations sociales, même sans modification des taux. Donc, le taux des prélèvements obligatoires ne sera pas stabilisé en 1999, mais il diminuera en 2000. S’agissant de la baisse de la TVA, la France a obtenu le réexamen de l’annexe H alors qu’initialement la plupart des autres Etats membres de l’Union y était hostile, ne souhaitant pas rouvrir chez eux un débat sur cette question. Cependant, la discussion a abouti en juillet à l’élaboration d’une liste d’une dizaine d’items, chaque Etat membre ayant la possibilité d’en retenir deux. Elle a rebondi au début du mois lorsque le Portugal a souhaité rajouter le secteur de la restauration à cette liste, cherchant ainsi à régulariser la baisse de la TVA que ce pays avait, en fait, mise en œuvre dès 1996. Le refus initial des Allemands a été à l’origine d’un blocage qui a pu être levé ce week-end et la liste établie en juillet a été adoptée, son éventuel élargissement étant renvoyé à une prochaine réunion, programmée le 8 octobre. La mesure prévue dans le présent projet de loi de finances n’encoure donc aucun risque juridique. Le Premier ministre a souhaité que la réflexion sur une baisse des impôts directs en 2001 fasse l’objet d’une concertation la plus large possible. Le système français présente en effet de nombreux inconvénients et comporte un grand nombre d’effets de seuil. Ces derniers peuvent avoir des conséquences lourdes, en rendant par exemple plus difficile le retour à l’emploi de personnes défavorisées qui deviennent brutalement imposables. S’agissant d’un sujet à la fois vaste, compliqué et sensible, le Gouvernement sera ouvert à toutes les suggestions avant d’arrêter ses décisions pour l’élaboration du projet de loi de finances pour 2001. Le débat sera donc ouvert au début de l’année prochaine. M. Christian Sautter a indiqué que les crédits d’investissements de l’Etat augmenteront de 2 % en 2000, alors qu’ils avaient reculé de 20 % entre 1993 et 1997. Le Gouvernement prend en considération les futurs contrats de plan puisque, tous financements confondus, les crédits consacrés aux transports collectifs progresseront de 6 % et ceux destinés aux investissements routiers de 15 %. S’il a admis une certaine amélioration de la situation de l’emploi, M. Philippe Auberger a cependant noté qu’il faudrait, à ce rythme, quatre années pour revenir au taux de chômage moyen de l’Union européenne et que le travail temporaire est à l’origine du tiers des emplois créés. S’agissant des 35 heures, les crédits inscrits dans le budget de 1999 étaient destinés à financer la création de 40.000 emplois supplémentaires. Ces prévisions seront-elles atteintes ? Quelles sont celles retenues pour la fixation des crédits inscrits pour 2000 ? Les premiers résultats de la diminution progressive de la part salariale de la taxe professionnelle sont-ils en phase avec les prévisions initiales, à savoir 40.000 emplois créés la première année et 100.000 sur cinq ans ? Il a regretté que la proposition de supprimer les préretraites FNE, formulée par la mission d’évaluation et de contrôle, n’ait pas été retenue par le Gouvernement. Il s’est également demandé si l’augmentation de 3,5 milliards de francs, par le récent décret d’avance, des crédits destinés au RMI ne s’expliquait que par l’augmentation du nombre de ses bénéficiaires, ce qui représenterait 100.000 personnes de plus, et témoignerait d’un malaise social inquiétant. Enfin, l’utilité de la création d’un fonds spécial pour les allégements de charges sociales est tout à fait contestable, d’autant que les informations relatives à ses dépenses et à ses recettes ne sont guère précises. De plus, l’existence d’un tel fonds spécial ne témoigne pas d’une bonne coordination entre loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale, alors que la réforme de 1996 vise précisément à la cohérence des deux textes. Rappelant que le Gouvernement avait renoncé à réformer l’impôt sur le revenu en raison du caractère injuste d’une telle réforme, M. Philippe Auberger s’est enfin interrogé sur le caractère social de la baisse de la TVA sur les travaux dans le logement, contesté, y compris dans des rapports officiels. En effet, il est évident qu’elle bénéficiera avant tout aux propriétaires. Quelles seront ses incidences sociales et son coût, estimé à 19 milliards de francs, n’est-il pas exagéré ? Après avoir exprimé sa satisfaction sur le contenu de la loi de finances et sur les résultats économiques, sociaux et budgétaires, M. Jean-Louis Idiart a estimé que la réduction du taux de TVA sur les travaux de restauration de logements aura certainement une portée sociale réelle : elle favorisera l’emploi et la lutte contre le travail au noir et ne profitera pas seulement aux couches les plus aisées de la population, puisque ce sont surtout les personnes vivant dans des conditions de logement difficiles qui en bénéficieront. La réduction des droits de mutation semble une mesure juste, tandis que l’impact positif de l’abaissement de la TVA sur les services à domicile dépendra de la définition retenue pour ces derniers, le danger étant de pénaliser les services rendus par des collectivités territoriales ou des associations. La poursuite de la modification de l’assiette de la taxe professionnelle et la mise en place d’une fiscalité écologique sont indéniablement positives. Pour ce qui est des dépenses, trois points doivent retenir l’attention : les transferts financiers au profit des collectivités locales, qui jouent un rôle important en matière d’investissement, les négociations relatives aux nouveaux contrats de plan et la réalisation des engagements pris en faveur des anciens combattants et des retraités agricoles. M. Pierre Méhaignerie a insisté sur le caractère convalescent de l’économie française dont le taux de chômage demeure parmi les plus élevés d’Europe, le niveau des prélèvements obligatoires considérable et la croissance de long terme inférieure à celle de nos voisins européens. Si le projet de budget peut donc apparaître satisfaisant à court terme, de mauvaises surprises peuvent, à plus long terme, apparaître. Des omissions, dont certaines contradictions témoignent déjà, risquent rapidement de se faire jour, comme ce fut le cas en 1999. Le projet recèle, en effet, beaucoup d’omissions, comme le fait que l’augmentation des crédits d’équipement routier sera partiellement financée par une augmentation des péages. On ne peut non plus être satisfait de l’articulation des dépenses de l’Etat et de celles de la sécurité sociale s’agissant du financement des 35 heures, sujet sur lequel une audition du ministre des finances devant la Commission est réclamée par l’opposition. Les ressources des collectivités locales représentent un autre sujet d’inquiétude, dans la mesure où l’Etat remet en cause droits de mutation et taxe professionnelle, deux de leurs recettes dont la croissance sera désormais liée au taux d’inflation. Ne serait-il pas logique, dans ce contexte, de proportionner les dépenses que l’Etat impose aux collectivités locales au niveau de leurs ressources ? Enfin, les petits salaires constituent un véritable problème, en particulier dans l’industrie : il pourrait être résolu par un système de franchise sur les charges sociales que des conventions de branche pourraient permettre de répercuter sur les bas salaires. Après s’être félicité de la clarté des priorités du Gouvernement, en particulier en matière d’éducation et de politique de la ville, qui traduisent une rupture par rapport à la politique de régression précédemment menée, M. Jean-Pierre Brard a proposé d’utiliser les marges de manœuvre budgétaires en faveur des minima sociaux, des collectivités locales, dont les finances n’ont guère bénéficié de la reprise économique, et de la modification de certains impôts directs. La fiscalité doit en effet être avant tout un levier pour l’emploi. Ainsi faudrait-il pénaliser les entreprises qui licencient tout en dégageant des bénéfices, en les assujettissant à un taux de 50 % d’impôt sur les sociétés. Les réflexions relatives à la taxation des mouvements de capitaux spéculatifs et à la taxe « Tobin » doivent être poursuivies, tandis qu’il convient d’engager une discussion sur la création d’un impôt négatif afin de ne pas décourager le retour à l’emploi. La marge budgétaire doit être utilisée en ce sens. M. Gilbert Gantier a regretté que, dans une situation similaire à celle de 1988 où les recettes fiscales étaient plus fortes que prévues, le Gouvernement ne profite pas de l’amélioration de la conjoncture pour faire des économies et élaborer des réformes de structure. Les dépenses de l’Etat sont présentées comme stables mais les moyens des services augmentent, ce qui laisse supposer une réduction, mal venue, des investissements. Indépendamment des baisses ponctuelles de taux de TVA, cette dernière souffre de problèmes structurels dus au trop grand écart qui sépare taux normal et taux réduit, ce qui est particulièrement ressenti dans le secteur de la restauration, pourtant potentiellement très créateur d’emplois. D’autre part, des risques conjoncturels demeurent : si les Etats-Unis ont atteint l’équilibre de leurs finances publiques, l’importance de leur déficit commercial ne manquera pas d’avoir des conséquences internationales. La prudence commanderait donc de réduire réellement les charges de l’Etat, de travailler à une diminution, et pas seulement à une stabilisation de la dette, et de réduire un déficit qui reste trop élevé et supérieur aux critères de Maastricht. M. Gérard Saumade a jugé le projet de loi de finances intéressant, même s’il suscite quelques réserves. Le soutien à la consommation est insuffisant ainsi que les crédits en faveur de la police et de la sécurité. Il paraît par ailleurs nécessaire de se livrer à une « défense et une illustration de l’impôt ». Il est, certes, possible d’abaisser les prélèvements obligatoires mais un tel thème, démagogique ne doit pas masquer que ce serait alors au détriment de dépenses d’éducation, de sécurité ou de santé, comme on le constate, par exemple, aux Etats-Unis. Un discours fondé sur la baisse des impôts rencontre évidemment toujours le succès, mais nombre de nos concitoyens sont parfaitement en mesure de payer facilement leurs impôts. L’Etat ne doit pas augmenter les charges des collectivités locales, lesquelles doivent faire face à des problèmes de civilisation, comme l’enseignement ou l’élimination des déchets ménagers. Or, les contrats de plan traduisent une forme de désengagement de l’Etat, dans la mesure où ils impliquent un apport des collectivités locales aux routes nationales. S’agissant des déchets ménagers, une baisse de la TVA permettrait de respecter la loi qui prévoit l’élimination des décharges en 2002, mais il faudrait accompagner leur suppression d’une campagne auprès de nos concitoyens, pour les sensibiliser à la question du coût de telles opérations. En réponse, M. Dominique Strauss-Kahn a insisté sur les points suivants : – Le nombre d’emplois par point de croissance supplémentaire s’établit à environ 100.000, ce qui montre un enrichissement en emplois de la croissance. – L’allégement des charges sociales résultant de la deuxième loi relative à la réduction du temps de travail sera retracé dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, avec lequel le projet de loi de finances est en parfaite cohésion. Les sommes nécessaires à cet allégement s’élèvent de 6 à 8 milliards de francs, qui seront financés par une cotisation sociale sur les bénéfices des entreprises et par une « écotaxe ». L’effet sur les prélèvements obligatoires sera donc nul, puisque l’allégement de charges est équivalent au financement ainsi dégagé. Il n’y a donc pas de doubles comptes. Répondant à M. Pierre Méhaignerie, le Président Augustin Bonrepaux a souligné qu’il n’avait été saisi d’aucune demande d’audition sur ce projet de loi. En revanche, il y a eu une demande de saisine pour avis de la Commission. Cependant, une réponse négative doit être faite à cette demande d’avis dans la mesure où aucun article du projet de loi ne relève à proprement parler du champ de compétence de la Commission et que le fonds de compensation, qui doit financer les allégements de charges sera prévu par la loi de financement de la sécurité sociale, dont la Commission est saisie pour avis. M. Dominique Strauss-Kahn a poursuivi ses réponses : – en ce qui concerne la baisse de la TVA sur les travaux, près de 10 millions de ménages bénéficieront chaque année de cette mesure. Ces ménages se retrouvent dans toutes les catégories assujetties à l’impôt sur le revenu. L’effet sur l’emploi sera indéniable. Il est en tout cas paradoxal d’affirmer à la fois que la TVA est en elle-même injuste mais que sa baisse ne profiterait, en l’espèce, qu’aux ménages les plus favorisés ; – le produit des droits de mutation pourrait augmenter de 20 % pour les collectivités locales grâce à la diminution de leur taux, qui entraînera une augmentation corrélative du volume des transactions. M. Pierre Méhaignerie a alors estimé que les effets positifs de la croissance économique pourraient être consacrés à des actions diminuant les charges sur les bas salaires et d’augmenter ceux-ci, alors que le projet de loi sur la réduction du temps de travail ne permettra pas d’atteindre un tel résultat. M. Dominique Strauss-Kahn, rappelant qu’il était personnellement favorable, dans son principe, à la création d’une « taxe Tobin », a toutefois souligné les difficultés concrètes que les modalités de sa mise en place pourraient poser. Il a ensuite fourni les réponses suivantes : – le projet de loi de finances pour 2000 est l’un des rares, ces dernières années, qui prévoit la stabilisation de la dépense publique. En effet, le budget pour 1993 se caractérisait par leur augmentation de 2 %. Pour les années suivantes, les chiffres s’établissent à : 1994, + 3 % ; 1995, + 1 % ; 1996, + 3 % ; 1997 et 1998, 0 % ; 1999, + 1 % ; – ce n’est pas parce que nous connaissons une période de croissance économique qu’il faut obligatoirement diminuer la dépense publique, ni qu’il est plus facile de la diminuer. Celle-ci, si elle est moins indispensable au soutien de la croissance, demeure cependant nécessaire ; – il est certain que l’écart entre le taux de TVA de 20,6 % et le taux de 5,5 % est trop important mais il est très difficile de le réduire. Il convient d’ajouter que le taux de 20,6 % n’a pas été mis en place par l’actuel Gouvernement ; – la croissance soutenue en l’an 2000 devrait permettre d’envisager de nouvelles baisses d’impôts. Après avoir précisé que le taux de chômage avait baissé deux fois plus en France que chez nos partenaires, M. Christian Sautter a fourni les réponses suivantes : – 3 milliards de francs dans la loi de finances pour 1999 et 7 milliards de francs dans le projet de loi de finances pour 2000 seront consacrés à la réduction du temps de travail ; – le rapport sur la taxe professionnelle sera fourni au Parlement, comme prévu, avant le début du débat budgétaire ; – le décret d’avances majore les dépenses de 8 milliards de francs, dont 4 milliards traduisent les opérations au Kosovo et 3 milliards de francs sont affectés au revenu minimum d’insertion du fait d’une augmentation du niveau des minima sociaux ; – les travaux de la mission d’évaluation et de contrôle ont eu des répercussions, notamment en ce qui concerne la police ; – s’agissant des préretraites, la dépense budgétaire porte principalement sur le « stock » des préretraités, le flux annuel se réduisant depuis deux ans parallèlement à des plans sociaux et des licenciements collectifs ; – la non-taxation des associations, qui constituent les principales structures de services à domicile, doit être préservée et la mesure d’allégement de TVA ne portera que sur les quelques entreprises qui œuvrent dans ce secteur ; – les autorisations de programme sur crédits d’Etat pour les routes vont passer de 2,9 milliards de francs à 3,5 milliards de francs ; – les autorisations de programme de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) vont croître de 8 %, ce qui permettra à l’Agence de financer un programme de 19 milliards de francs d’ici 2003 et d’apporter des réponses à la question du traitement des déchets. II.- AUDITION DE M. CHRISTIAN SAUTTER, La Commission a procédé, le jeudi 30 septembre 1999, à 17 heures, à l’audition de M. Christian Sautter, secrétaire d’Etat au budget, sur le projet de loi de finances pour 2000. Le Président Augustin Bonrepaux a d’abord évoqué l’article 29 du projet de loi de finances pour 2000. Cette disposition, qui affecte à la sécurité sociale les droits de consommation sur les tabacs, n’aura pas d’incidences immédiates sur la possibilité, à laquelle recourent traditionnellement les députés, de gager des amendements ayant pour effet de réduire les ressources publiques par une augmentation de ces droits. En effet, jusqu’à l’adoption définitive du projet de loi de finances, c’est le droit en vigueur qui continuera à s’appliquer ; ensuite, si l’article 29 est adopté en l’état, la situation demeurera inchangée, dans la mesure où les produits résultant d’une augmentation des droits sur les tabacs continueront à bénéficier au budget général, l’affectation prévue par le dispositif étant faite « dans la limite » de sommes qui correspondent à peu près à celles du produit actuel de ces droits. Rappelant que le Ministre revenait devant la Commission, notamment pour présenter les ressources affectées à la loi de financement de la sécurité sociale, le Président Augustin Bonrepaux a observé qu’à la différence du transfert des droits sur les tabacs, celui de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) ne figurait pas dans le projet de loi de finances. Il s’est interrogé sur l’identité du ministre appelé à soutenir la discussion des articles fiscaux du projet de loi de financement de la sécurité sociale et a souhaité obtenir un chiffrage précis de l’extension de la TGAP. Estimant que les modifications structurelles proposées tant pour le budget de l’Etat que pour les comptes sociaux avait éveillé un certain trouble au sein de la commission, votre Rapporteur général s’est félicité de ce que les documents remis avec le projet de loi de finances permettent de raisonner à structures constantes. En l’absence, à ce stade, du rapport économique, social et financier, il est impossible d’établir la même cohérence pour les comptes sociaux et il serait donc souhaitable que le Gouvernement puisse fournir des indications, en termes consolidés, sur la dépense publique globale, les prélèvements obligatoires ainsi que les charges nettes pesant sur les ménages et sur les entreprises. La mission d’évaluation et de contrôle (MEC) de la Commission des finances a réfléchi sur la mise en place d’une comptabilité patrimoniale de l’Etat, tandis que le récent rapport de M. Jean-Jacques François, présenté, à tort, comme confidentiel, illustre la volonté du Gouvernement d’en savoir davantage sur la situation financière et la gestion de nos administrations. De quelle manière le Gouvernement entend-il donner un prolongement concret à ces réflexions ? Par ailleurs, la situation financière de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) se dégradant, quelles sont les orientations et les solutions envisagées par le Gouvernement pour y remédier ? Enfin, quels seront précisément les moyens affectés au fonds de réserve des retraites l’année prochaine ? M. Christian Sautter, secrétaire d’Etat au Budget, a d’abord rappelé que 43,5 milliards de francs de droits sur les tabacs, dont le produit total est estimé pour 2000 à 46,2 milliards de francs, allaient être transférés à la sécurité sociale, afin de compenser, principalement, le transfert de la ristourne dégressive au fonds de compensation créé en loi de financement, mais aussi les mesures relatives à la couverture maladie universelle (CMU) et au fonds amiante. Dès l’adoption définitive de la loi de financement, la TGAP, ressource du fonds de compensation, sera affectée et ne fera plus partie, de ce fait, du périmètre des finances de l’Etat. Une disposition en loi de finances ne paraît pas nécessaire. Cette analyse est partagée par le secrétariat général du Gouvernement, et par le Conseil d’Etat qui a examiné le projet de loi de finances, mais si la représentation nationale ne se déclarait pas convaincue, le Gouvernement pourrait déposer un amendement au projet de loi de finances prévoyant expressément l’affectation de cette taxe au fonds de compensation. C’est la ministre de l’emploi et de la solidarité qui, au nom du Gouvernement tout entier, soutiendra la discussion de ces dispositions devant le Parlement, comme cela a déjà été le cas pour la CSG. Les précisions sur l’assiette et le taux de la TGAP ne pourront être fournies que lorsque le Conseil des ministres aura adopté le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, étant précisé qu’il est prévu que son assiette connaisse une nouvelle évolution en 2001, dans le cadre de la taxation communautaire sur l’énergie. Mme Nicole Bricq a rappelé que Mme Martine Aubry, entendue le matin même par la Commission, s’était, à sa grande surprise, déclarée « incompétente s’agissant des dispositions fiscales de la loi de financement ». La TGAP ne peut être comparée à la CSG, dans la mesure où elle a été inscrite, l’année dernière, en loi de finances et qu’elle est transférée, cette année, en loi de financement. Même si cette taxation est, sur le fond, pertinente, il y a un indéniable défaut d’articulation entre les deux ministères concernés et entre les textes. Soulignant sa volonté de coopérer avec la commission, M. Christian Sautter a indiqué qu’il se tenait à la disposition des commissaires pour venir commenter, le cas échéant avec la ministre de l’emploi et de la solidarité, les dispositions fiscales du projet de loi de financement de la sécurité sociale, dès son adoption par le Conseil des ministres. De nombreux projets de loi comportent également des dispositions fiscales, mais ne soulèvent d’ailleurs pas de difficultés. Le projet de loi de finances pour 2000 adopte une présentation claire, à la fois synthétique et détaillée, à structures constantes et intégrant les changements de périmètre. Ainsi, côté dépenses, les exigences de transparence et les recommandations de la Cour des comptes ont été respectées, avec la rebudgétisation de trente-neuf fonds de concours représentant 8,6 milliards de francs, la suppression de quatre comptes spéciaux du Trésor pour un montant de 1,1 milliard de francs, la compensation de la baisse des droits de mutation à titre onéreux et le transfert de la ristourne dégressive. Côté recettes, le transfert des droits sur les tabacs et de la TGAP se fait dans la clarté. De toute façon, le rapport économique, social et financier sera transmis au Parlement dès le 4 octobre, permettant ainsi aux commissaires de disposer d’une vision synthétique des comptes publics. Le rapport de M. Jean-Jacques François sur la comptabilité patrimoniale de l’Etat n’est en rien secret et le Gouvernement va s’en inspirer en ouvrant plusieurs chantiers : la rénovation du cadre de la procédure budgétaire et l’amélioration de l’efficacité de la gestion publique, en harmonie avec les travaux de la MEC, l’enrichissement du système d’information budgétaire et comptable, notamment pour la gestion du parc immobilier de l’Etat, l’évolution, grâce au logiciel ACCORD, vers une comptabilité en droits constatés, la présentation de comptes de charges en cours d’année et l’amélioration de la présentation des participations et des garanties de l’Etat. Plusieurs commissaires ont alors fait remarquer que le rapport de M. François n’avait pas été transmis à la Commission. M. Christian Sautter a souligné que le groupe de travail réunissant l’Etat et les élus locaux a conclu, en mai dernier, à la nécessité d’un effort partagé entre les employeurs et l’Etat, afin de ramener les comptes de la CNRACL à une meilleure situation. Le plafond de besoins de trésorerie de cette caisse, fixé à 2,5 milliards de francs, ne pourra pas être tenu, et il convient donc, par un effort partagé, de retourner à l’équilibre en plusieurs exercices. M. Philippe Auberger s’est interrogé sur les points suivants : – En premier lieu, les prévisions de recettes, pour 1999 portent sur un excédent de 6 milliards de francs en intégrant la mesure d’allégement de la TVA qui doit, en principe, avoir un effet considérable, de l’ordre de 30 à 40 milliards de francs. Par ailleurs, les prévisions pour 2000 font état d’une croissance des recettes de 30 milliards de francs auxquels s’ajoutent 39 milliards de francs, au titre de l’allégement de la TVA, soit un montant total de 70 milliards de francs. Or, sur la période 1998-1999, on constate une croissance des recettes de 100 milliards de francs, en incluant la mesure d’allégement à hauteur de 20 milliards de francs. Dès lors que la conjoncture économique est favorable, la croissance prévue des recettes est, pour le moins, paradoxale. - S’agissant de la règle d’affectation des recettes, il a rappelé qu’elle se justifie par l’existence d’un lien entre la recette concernée et la dépense à financer. Or, le lien entre l’écotaxe et l’allégement des charges sur les bas salaires ne relève pas d’une évidence, ce qui conduit à considérer les transferts constatés comme sortant du champ de l’ordonnance du 2 janvier 1959. - La création d’un établissement public pour gérer les allégements de charges, financé par des recettes fiscales telles que les droits sur les tabacs ou l’écotaxe, qui représentent en tout plus de 50 milliards de francs, les recettes non fiscales n’abondant ledit fonds que pour un montant de 11 à 16 milliards de francs, est irrégulier et contestable et s’apparente à un véritable démembrement du budget de l’Etat. - On ne peut pas comparer impôts, taxes et contributions de toute nature, en indiquant comme l’a fait le Secrétaire d’Etat que le transfert de la TGAP s’inspire de celui de la CSG, dont la nature juridique est différente. – En matière de dépenses, l’intégration de la « ristourne dégressive », évaluée à 40 milliards de francs, dans les comparaisons effectuées entre les dépenses pour 2000 et celles de 1999 mérite d’être éclaircie : la progression des dépenses de l’Etat ne peut, en effet, atteindre 0,9 % si cette ristourne ne figure plus dans le projet de budget pour 2000. - Des précisions sont, en outre, souhaitables sur la contribution du budget de l’emploi au financement de la mise en place des 35 heures, en particulier sur son montant, plusieurs chiffres (4,3 ou 7 milliards de francs) ayant été mentionnés. - De la même manière, la taxe de 10 % sur les heures supplémentaires sera-t-elle imputée sur le fonds d’allégement des charges sociales ou sur le budget de l’Etat et quel sera son montant prévisionnel ? – Les modalités de financement de la CMU, dont le coût est évalué à environ 10 milliards de francs, ne sont pas clairement précisées. – Enfin, l’évaluation des crédits affectés au financement du revenu minimum d’insertion (RMI) ne semble pas pertinente, si l’on prend en compte la réévaluation de 3,5 milliards de francs qui s’est imposée en cours d’année, réalisée par le dernier décret d’avances. Cette hausse de 13 % de la dotation ne s’explique pas par celle des minima sociaux (+ 3 %). Dans ces conditions, les crédits prévus pour 2000, d’un montant de 28,7 milliards de francs, paraissaient être largement sous-estimés. – Quelles seront les recettes et les dépenses prévisibles du compte d’affectation des cessions d’actifs ? - On peut difficilement considérer que la diminution de 20 milliards de francs du déficit de l’Etat en 2000 permettra de diminuer le ratio dette publique sur PIB. M. Jean-Jacques Jégou a exprimé le souhait qu’une présentation conjointe du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale puisse être effectuée l’année prochaine devant la Commission des finances. Il a ensuite regretté la faible prise en compte des travaux de la MEC, mise en place cette année, dans les propositions du Gouvernement, par exemple dans le domaine des autoroutes et dans celui de la police où le constat d’un nécessaire redéploiement des effectifs n’a pas orienté les axes du budget du ministère de l’Intérieur pour 2000. Puis, il a déploré la faible lisibilité du périmètre du budget pour 2000, indiquant être parvenu, pour sa part, à une augmentation de 3,3 % des dépenses publiques contre 0,9 % dans les prévisions du Gouvernement. Ce manque de lisibilité peut être illustré par l’examen des crédits du titre III, qui connaissent une augmentation de 3,7 % correspondant à plus de 20 milliards de francs pour les dépenses civiles et 10 milliards de francs pour les dépenses militaires. Rappelant sa qualité de membre du conseil de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, M. Jean-Jacques Jégou a également évoqué la situation alarmante de la CNRACL dont les bénéficiaires ne sont pas dans une situation paritaire avec les autres salariés de la fonction publique. Enfin, il a souhaité obtenir des précisions sur l’alimentation du fonds de réserve pour les retraites en indiquant qu’avant de se réjouir de la dotation de 15 à 18 milliards de francs annoncée par la Ministre des Affaires sociales, il convient de s’assurer que le décret lui apportant 2 milliards de francs soit bien signé, ce qui n’est pas actuellement le cas. En tout état de cause, ces montants sont bien inférieurs aux besoins qui apparaîtront après 2005, environ dix fois supérieurs. M. Gilbert Gantier a considéré que les grands principes budgétaires sont mis à mal par la présentation faite, cette année, du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale et a souhaité qu’une discussion commune des deux textes puisse avoir lieu. Rejoignant des observations déjà formulées, il a estimé que les dépenses augmentent en réalité de plus de 0,9 %, soulignant, par ailleurs, que les dépenses de fonctionnement augmentent alors que les dépenses d’investissement diminuent. De même, il n’est pas possible de dire que les impôts baissent de 40 milliards de francs, sans tenir compte de ce qui se passe en dehors de la loi de finances. Il a enfin abordé la question de la taxe sur les entrepôts en Ile-de-France en faisant part d’un recensement qui démontre une perte d’activité en Ile-de-France et a demandé si la révision de cette taxe serait évoquée au cours de la discussion budgétaire. En réponse, M. Christian Sautter a apporté les précisions suivantes : – Pour l’an 2000, la hausse prévisionnelle des recettes, hors changement de législation, est de + 4,1 %, ce qui suit l’évolution prévue pour le PIB. – Le lien entre les droits sur les tabacs et l’allégement des cotisations sociales n’est pas moins évident que celui qui unit les droits sur les alcools et l’allocation vieillesse dans le fonds de solidarité vieillesse ; pour ce qui concerne la CSG, la jurisprudence du conseil constitutionnel a posé le principe qu’elle constituait une « imposition de toutes natures ». – La « ristourne Juppé » est incluse dans le tableau d’équilibre du projet de loi de finances pour 2000. La hausse des dépenses de 0,9 % à structure constante en tient donc compte. Il n’est pas possible, de ce fait, d’affirmer que la présentation de ce budget ne serait pas sincère. – S’agissant du financement de la réduction du temps de travail, la première part est constituée par la ristourne de 40 milliards de francs précitée, la seconde part étant constituée par l’allégement structurel de charges, financé par le « recyclage », soit pour la part de l’Etat 4,3 milliards de francs de crédits inscrits au budget de l’emploi sur un total à financer de 15 milliards de francs. Enfin, l’allégement supplémentaire de charges, correspondant au troisième étage, représente en 2000 une charge de 7,5 milliards de francs couverte par le produit de la TGAP qui sera relevé de 2,1 milliards de francs actuellement à 3,2 milliards de francs en 2000 et celui de la contribution sociale sur les bénéfices qui représentera 4,3 milliards de francs en 2000. M. Philippe Auberger a alors observé que, selon ce propos, les aides à la réduction du temps de travail atteignent bien 7 milliards de francs de la part de l’Etat, alors que le dossier de presse du ministère porte mention d’un chiffre de 4,3 milliards de francs. M. Christian Sautter a indiqué que le chiffre total de 7 milliards de francs incluait cette dernière somme, à laquelle il convient d’ajouter 2,7 milliards de francs au titre de la compensation due à la loi dite « Robien ». – Le financement de la CMU bénéficiera d’apports de 3,5 milliards de francs correspondant au transfert d’une tranche supplémentaire de droits sur les tabacs, ainsi que de ressources complémentaires de 7 milliards de francs en provenance de l’Etat pour financer la couverture complémentaire maladie des exclus, également financée par une contribution des mutuelles. – Les différences de chiffres relatives au service du RMI proviennent de la non reconduction en 2000 de la prime de Noël versée en 1999 (1,8 milliard de francs). – En ce qui concerne les effectifs de police, ceux-ci ont connu un redéploiement, l’Etat ayant renforcé leur présence sur le terrain en leur adjoignant 4.000 adjoints de sécurité. A cet égard, le Ministre a réaffirmé le caractère très positif des travaux de la MEC, dont il pense et dont il dit du bien. – S’agissant du nécessaire redressement de la CNRACL, il convient de ne pas faire porter exclusivement l’effort sur les employeurs. M. Francis Delattre a rappelé que l’Etat avait prélevé dans les années passées 10 milliards de francs sur les réserves de cette caisse. M. Christian Sautter a enfin indiqué que le Gouvernement n’était pas hostile à un réexamen de la taxe sur les entrepôts et commerces en Ile-de-France dans le cadre du débat budgétaire. Cette région ne bénéficie pas, globalement, d’un traitement défavorable, s’agissant notamment des contrats de plan. Son éligibilité aux fonds européens sera de nature à lui apporter des ressources supplémentaires. En outre, il faut bien insister sur la forte inégalité existant entre les collectivités territoriales de cette région, ce qui rend nécessaire la mise en place de mécanismes de péréquation. N°1861 - RAPPORT de M. Didier Migaud, rapporteur général (au nom de la commission des Finances, de l’Economie générale et du Plan) sur le projet de loi de finances pour 2000 (n° 1805) : Tome I - Rapport général - Volume 1. Pour une croissance solidaire plus forte, une gestion dynamique et maîtrisée - Cliquer ici pour retourner au sommaire général - Cliquez ici pour retourner à la liste des rapports et avis budgétaires - Cliquez ici pour retourner à la liste des discussions budgétaires
() Hors soulte de France Telecom. () La capacité (+)/besoin (–) de financement des administrations publiques en pourcentage du PIB évoluerait comme suit :
() On rappellera que cet indice concerne toutes les matières premières (pétrole, métaux, métaux précieux, produits alimentaires et autres matières premières agricoles). () « Les perspectives économiques et financières de Etats-Unis pour 1999 », in Les notes bleues de Bercy, n° 158 du 1er au 15 mai 1999. () Sigle signifiant, en anglais, « Non accelerating inflation rate of unemployment ». () L’objectif sur le taux des fonds fédéraux est ainsi fixé à 5,25% et le taux d’escompte à 4,75%. () La zone euro regroupe onze Etats : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal. () Cette prévision est confirmée par le rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances. () Cette prévision est confirmée par le rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances. () Bulletin mensuel de la BCE, juin 1999, page 32. () Les chiffres utilisés par la Commission européenne pour ses prévisions de printemps 1999 reposent sur l’ancien système européen de comptabilité nationale (SEC 79). Ce n’est qu’à compter de l’automne 1999 que ces prévisions seront établies à partir de la nouvelle norme SEC 95. Pour un aperçu des changements de conventions comptables sur les comptes publics français, on se reportera à la présentation de votre Rapporteur général dans son rapport d’information préalable au débat d’orientation budgétaire (n° 1695, pages 61 et suivantes). () S’agissant de procéder à des comparaisons internationales, le ratio concernant la France est ici présenté selon l’ancien système européen de comptabilité nationale (SEC 79) en raison du fait que les données relatives à nos partenaires ne sont pas toutes disponibles selon la nouvelle norme SEC 95. Dans ce nouveau cadre, l’endettement public de la France, en pourcentage du PIB s’établit à 55,6% en 1995, 57,9% en 1996, 60% en 1997 et 60,3% en 1998. () Selon l’ancien système européen de comptabilité nationale (SEC 79). () Rapport général sur le projet de loi de finances pour 1999, Assemblée nationale, n° 1111, 8 octobre 1998 (tome I, volume 1, p. 57). () On trouvera une présentation détaillée de cette étude dans le Rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour 2000. () NAIRU : Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment. Le NAIRU est censé mesurer un taux de chômage « d’équilibre », c’est-à-dire qui ne provoque pas d’accélération de l’inflation. () Christine Daniel, Les politiques de l’emploi : une révolution silencieuse, Droit social, janvier 1998. () Rapport d’information n° 1781 et annexe 3 présentée par M. Gérard Bapt. () Les premiers Entretiens de l’emploi, 30 et 31 mars1999, Les cahiers de l’Observatoire de l’ANPE. () Arnaud Gérardin, Croissance et emplois : quelques remarques, Droit social, mai 1999. () Centre d’observation économique, Lettre mensuelle de conjoncture, n° 416, juillet 1999. () En 1991, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que l’article L 213-1 du code du travail interdisant le travail de nuit des femmes dans l’industrie était contraire au droit communautaire. En 1992, la France a dénoncé la convention n° 89 de l’OIT qu’elle avait signée en 1953. Le 13 mars 1997, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que l’absence d’abrogation expresse de l’article précité du code du travail contrevenait au droit communautaire. Le 21 avril 1999, la Commission européenne a demandé à la Cour de Justice de condamner la France au paiement d’une astreinte journalière jusqu’à ce que l’article précité soit abrogé. () DARES, L’organisation des horaires : un état des lieux en mars 1998, Premières informations et premières synthèses, n° 30.1, juillet 1999 et L’organisation du travail entre contrainte et initiative, résultats de l’enquête Conditions de travail de 1998, Premières informations et premières synthèses, n° 32.1, août 1999. () Liaisons sociales, n° 45/99, 26 mai 1999 et n° 52/99, 11 juin 1999. () Olivier Marchand, Mise en place d’indicateurs européens, Les Premiers entretiens de l’Emploi, Les Cahiers de l’observatoire de l’ANPE, 1999. () Rapport sur les comptes de la Nation de l’année 1998, Tome II, Tableau 2.204 page 34. () Cette année, l’enquête Emploi a eu lieu en janvier au lieu de mars en raison du recensement. () Nicolas Harpin et Daniel Verger : « Consommation, un lent bouleversement de 1979 à 1997 », Economie et statistique, n° 324-325, 1999. () Note de conjoncture de juin 1999, p. 70. () Le nouveau système de comptabilité nationale (SEC 95) répartit les anciens « transferts sociaux » entre prestations sociales en espèces, d’une part, et transferts sociaux en nature, d’autre part. Ces derniers correspondent essentiellement aux remboursements maladie et aux services d’éducation pris en charge par l’administration. () Revenu minimum d’insertion, pré-retraites Etat, aides à la scolarité,… () Lettre économique de la Caisse des dépôts et consignations, n° 112 – juillet-août 1999. () Ces chiffres sont fournis par l’Observatoire du BTP de juin 1999. () Le shopping fiscal et social : du mythe à la réalité, décembre 1997. () François Bourguignon et Dominique Bureau, « L’architecture des prélèvements en France – état des lieux et voies de réforme », 1999. () Rapport général n°1111, tome I, volume I, page 118. () Pauvreté et exclusion, La documentation française, 1998. () L’évolution des salaires jusqu’en 1997. () Directive 99/70/CE, publiée au JOCE, n° L. 175 du 7 juillet 1999, page 43. () L'avenir de nos retraites, La documentation française, 1999. () Un abondement progressif va intervenir. Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 une dotation minimale de l’ordre d’une douzaine de milliards de francs a été annoncée. Dans son discours à Strasbourg, du 27 septembre 1999, le Premier ministre a indiqué que « d’autres abondements seront décidés dans les mois qui viennent ». () Ces chiffres sont calculés sur la base des données de l'enquête emploi de l'INSEE de mars 1998. () Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999, JOCE, n° L. 161 du 26 juin 1999. () Alain Barrau, Réforme des fonds structurels, rapport n°1280 du 17 décembre 1998. () Les données relatives au commerce extérieur proviennent de la direction générale des douanes et droits indirects. Elles sont établies sur une base FAB-FAB (franco à bord) pour les synthèses, ce qui signifie qu’elles comprennent le coût départ-usine et le coût du transport du lieu de production au poste frontière. Les résultats par produit et par pays sont calculés CAF (coût, assurance, fret). La valeur FAB des marchandises est majorée du coût du transport et des assurances à l’importation. On rappellera, par ailleurs, que, depuis le 1er janvier 1997, la balance commerciale, à l’instar de la méthodologie balance des paiements, ne comprend plus les échanges de la métropole avec les DOM, mais intègre les opérations de ces derniers avec le reste du monde. Il convient également de souligner que, depuis le 1er janvier 1999, les services des douanes ont procédé à de nouvelles modifications dans l’élaboration des statistiques du commerce extérieur, afin d’affiner la prise en compte des activités de la base spatiale de Kourou. Alors qu’auparavant, chaque mise en orbite correspondait à une exportation, indépendamment de la nationalité du propriétaire du satellite, désormais seules sont prises en compte, au titre de la balance commerciale, les opérations correspondant à un transfert de propriété entre un résident et un non-résident. Ainsi, seuls les satellites mis en orbite pour le compte d’un non-résident sont considérés comme une exportation. Indiquons que les données antérieures à cette réforme ont été mises en conformité avec la nouvelle présentation. Selon la direction générale des douanes, cette réforme a eu pour effet de réduire le solde commercial, en 1998, de 9,5 milliards de francs. () L’Asie à économie en développement rapide comprend les pays suivants : Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Chine, Taiwan, Hong-Kong, Corée du Sud. (1) Rappelons, à cet égard, que le solde des biens comprend, d’une part, le solde des marchandises présenté en méthodologie balance des paiements, c’est-à-dire après retraitement des données FAB-FAB fournies par la direction générale des douanes, retraitement essentiellement destiné à exclure certaines opérations ne donnant pas lieu à paiement, et d’autre part, le solde résultant des opérations d’avitaillement et de travail à façon. () Rappelons, à cet égard, que 64% des exportations françaises sont dirigées vers l’Union européenne. () Note de conjoncture internationale sur le commerce mondial, juin 1999. () Selon la définition retenue par les instances internationales (FMI, OCDE) et européennes, l’investissement direct désigne l’opération effectuée par un investisseur résident d’une économie, afin d’acquérir ou d’accroître un intérêt durable dans une entité résidente d’une autre économie et de détenir une influence dans sa gestion. La notion d’investissement direct est donc plus large que celle de contrôle. Par convention, une relation d’investissement direct est établie dès lors qu’un investisseur acquiert au moins 10% du capital social de l’entreprise investie. En deçà de ce seuil, les acquisitions ou cessions de titres sont classées dans les investissements de portefeuille. Toutefois, cette définition n’est pas toujours appliquée : le seuil se situe toujours entre 10% et 50% selon les pays (20% en Allemagne). () Voir Christine Ferer, « La localisation des filiales industrielles dans les régions européennes », SESSI, n° 109, mai 1999. On pourra également se reporter aux études de Lionel Fontagné, « En attendant l’AMI : un bilan des relations entre investissement direct à l’étranger et commerce », La lettre du CEPII, n° 168, mai 1998, et de E. Mathieu et M. Quélennec, « Implantations industrielles à l’étranger et exportation », in : « Industrie française et mondialisation », Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, SESSI, 1998, pages 73 et suivantes. () Lionel Fontagné, Michaël Pajot, « Investissement direct à l’étranger et commerce international : le cas français », Revue économique, volume 49, numéro 3, mai 1998, Presses de Sciences Po, pages 593-606. () Ursula Schmidt, « Zone euro : les investissements directs étrangers », in : Les Notes bleues de Bercy, n° 164, 1er - 15 août 1999. () Bulletin de la Banque de France, n° 67, juillet 1999.
() Jean-Raphaël Chaponnière, « La France, pays carrefour des investissements directs », () Bulletin de la Banque de France, n° 66, juin 1999. () Loi n° 96-109 du 14 février 1996 relative aux relations financières avec l’étranger en ce qui concerne les investissements étrangers en France, décret n° 96-117 et arrêté du même jour. Ce principe ne souffre que quelques rares exceptions, dans le cas d’investissements susceptibles d’affecter des intérêts publics essentiels, qui restent soumis à autorisation préalable. () Revue de Rexecode, n° 60, 3ème trimestre 1998, « La compétitivité industrielle de la France à la veille de l’euro », page 1. () Direction de la prévision, Note de conjoncture internationale, juin 1999, page 19. () Jacky Fayolle et Catherine Mathieu, « Les positions compétitives en Europe à la veille de l’Union monétaire », Lettre de l’OFCE, n° 176, 22 juin 1998. () Rapport annuel 1998 de la Banque de France, page 39. () Rapport sur les comptes de la Nation annexé au projet de loi de finances pour 2000, page 152. () L’importance du critère géographique est confirmée par l’inégale répartition des investissements étrangers sur le territoire français : les régions les plus intégrées à l’Europe sont clairement favorisées. L’Alsace est ainsi la plus concernée (44% des salariés de l’industrie alsacienne travaillent dans des entreprises contrôlées par l’étranger), et la Bretagne la moins recherchée (12% de ses effectifs industriels, seulement, travaillent dans des filiales de groupes étrangers). () Sur ce sujet, on pourra se reporter au rapport annuel 1998 L’état de l’industrie française, Commission permanente de concertation pour l’industrie, in : Problèmes économiques, n° 2606, 3 mars 1999, ainsi qu’au travail de Réjane Hugounenq, Jacques Le Cacheux et Thierry Madiès, « Diversité des fiscalités européennes et risques de concurrence fiscale », Revue de l’OFCE, n° 70, juillet 1999. () « Investissement et situation financière des entreprises », Lettre mensuelle de conjoncture, n° 412, mars 1999, Centre d’observation économique de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris. () Enquête sur le comportement des entreprises en 1998, Bulletin de la Banque de France, n° 64, avril 1999. () L’INSEE, Informations rapides, n° 256, 14 septembre 1999, expose les résultats de l’enquête semestrielle sur les facteurs de production de juillet 1999 auprès de 2000 entreprises. La croissance de l’investissement dans l’industrie manufacturière atteindrait 7% en 1999. () « Innovation et croissance », La documentation française, 1998. () « Les enjeux de la recherche communautaire », Rapport n° 685, 5 février 1998. () Sources : Rapport sur les comptes de la Nation annexé au présent projet de loi de finances et MTF l’Agefi, juillet-août 1999. (1) « Le marché des fusions et acquisitions transfrontalières au 1er semestre 1999 », KPMG Corporate Finance, juillet 1999. (1) Définie habituellement comme le taux de rentabilité financière du capital (excédent net d’exploitation/actif net) diminué du taux d’intérêt. (2) Rapport annuel 1997 de l’OMC, chapitre IV : « Le commerce, la politique de la concurrence ». (1) « Fusions-acquisitions : comment croître et créer de la valeur », Mercer Management Consulting, 1999. (2) MTF L’Agefi, juillet-août 1999, n° 109, page 30. () Le quatrième alinéa de cet article dispose que « les émissions d’emprunts sont faites conformément aux autorisations générales données chaque année par les lois de finances ». () P. Amselek, Le budget de l’État sous la Ve République, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1967 (p. 277-278). () P. Marini, L’évolution de la dette publique en France entre 1980 et 1997. Les leçons d’une dérive, Sénat, rapport n° 413, 9 juin 1999. () D. Servais, Un espace financier européen, Commission européenne, décembre 1995. () Banque centrale européenne, « L’activité bancaire dans la zone euro : les caractéristiques et les tendances structurelles », in Bulletin mensuel, avril 1999. () Il convient de remarquer, cependant, que de nombreux OPCVM sont contrôlés par les banques. En se diversifiant vers ce secteur, les banques ont, en quelque sorte, « internalisé » les changements intervenus dans les comportements d’épargne et de placement. () Source : Lehman Brothers, Euro Market Update, juin 1999. () Ce pourcentage est calculé en sommant les contributions des émissions libellées dans l’une des onze monnaies remplacées par l’euro. () Commission européenne, direction générale II – Affaires économiques et financières, Quaterly note on the euro-denominated bond markets, n° 4, juillet 1999. () A l’exclusion, bien entendu, des pays ne participant pas à la troisième phase de l’union économique et monétaire. () En toute rigueur, il s’agit de l’achat d’obligations ou autres produits de taux, compte tenu de la fixité des parités au sein du SME. () OPCVM : organisme de placement collectif en valeurs mobilières. () A titre d’exemple, la firme américaine JP Morgan a composé un indice obligataire de la zone euro, EMU Bond Index, fondé (au 30 novembre 1998) sur la compilation d’informations relatives à 256 obligations d’État, totalisant une valeur de marché de 2.000 milliards d’euros. Les pondérations respectives sont les suivantes : 25,5% pour les obligations allemandes, 24,6% pour les obligations françaises, 19,4% pour les obligations italiennes, 9,3% pour les obligations espagnoles, 8,6% pour les obligations néerlandaises, 8% pour les obligations belges, 2,3% pour les obligations finlandaises, 1,3% pour les obligations portugaises et 1% pour les obligations irlandaises. Selon les termes mêmes employés par les analystes de JP Morgan dans la note de présentation du produit, « l’EMU Bond Index est un indicateur central de la performance des titres européens à revenu fixe, une référence explicite [de prix] et un véhicule d’investissement passif évident pour les investisseurs en obligations d’État européennes ». () A l’intérieur de la zone euro, bien entendu. Les stratégies de diversification géographique sont toujours pertinentes et peuvent amener à se positionner sur la CEE hors zone euro, sur les pays émergents européens susceptibles d’entrer, à terme plus ou moins éloigné, dans la Communauté, ou plus largement sur les autres pays extérieurs à l’Europe. () Le point de base est le centième de %. () Le titre le moins cher a le rendement le plus élevé. () Une pension est une opération par laquelle une personne détentrice de titres vend ceux-ci à une autre personne, le vendeur et l’acheteur s’engageant irrévocablement, l’un à reprendre les titres, l’autre à les rétrocéder, pour un prix et à une date convenus. Ainsi, grâce à la pension, un détenteur de titres qui éprouve un besoin temporaire de liquidités peut se procurer celles-ci en « gageant », à titre temporaire une partie de son portefeuille titres. Réciproquement, un détenteur de liquidités excédentaires peut obtenir de celles-ci une rémunération en les échangeant, à titre temporaire, contre un bloc de titres. Le marché de la pension est l’un des instruments de l’ajustement quotidien des portefeuilles titres et des trésorerie de certains opérateurs financiers. () C’est-à-dire à la valeur faciale du titre. () L’amortissement in fine offre une plus grande visibilité à la trésorerie du souscripteur puisque celui-ci sait que le remboursement du titre n’interviendra qu’à son échéance et non, comme cela était le cas antérieurement, par le biais d’un tirage au sort par tranches annuelles. () La duration d’une obligation est la valeur moyenne, exprimée en année, des flux (coupons et remboursement du principal) actualisés au taux du marché et pondérés par leur durée. La duration permet de mesurer la rapidité avec laquelle l’investisseur « récupère » son capital et de comparer, à cet égard, des titres de caractéristiques différentes (taux d’intérêt, échéance, remboursement in fine ou par tranche, remboursement au pair ou avec une prime, etc.). () Encours déterminés au 31 août 1999 ; source : Sicovam, 8 septembre 1999. () Les offres « non compétitives » s’entendent des offres qui sont présentées par les SVT en dehors de la procédure d’adjudication, en fin de séance. Ne participant pas au processus concurrentiel de détermination du prix des titres placés par le Trésor, elles interviennent en surnombre du volume plafond d’émission annoncé par celui-ci et sont servies au taux moyen pondéré des titres de même nature qui résulte de l’adjudication achevée. () Les informations relatives à l’Autriche sont extraites du rapport annuel pour 1998 de la Banque nationale d’Autriche. () Il est difficile pour votre Rapporteur général de rendre différemment, au regard des nécessités de la traduction, l’indispensable nuance entre « Bundesobligationen » d'une part (certificats d’obligations) et « Bundesanleihen » d'autre part (obligations classiques). () Votre Rapporteur général rappelle qu’en France, les obligations émises par le Trésor s’entendent des titres dont la durée de vie à l’émission est supérieure ou égale à sept ans. En deçà de cette valeur, il s’agit de bons du Trésor. () Au demeurant, l’ensemble des opérations réalisées sur le marché secondaire par les participants sont traitées par la Sicovam au moyen d’instructions reprenant les caractéristiques propres à chaque type de transaction : achat/vente ; livraison franco de titres ; cessions temporaires (pensions livrées, prêt de titres) ; opérations transfrontières ; démembrement/remembrement d'OAT, réservés aux spécialistes en valeurs du Trésor ; opérations avec la Banque de France : pensions sur appel d'offres, opérations bilatérales ou facilités permanentes de prêt marginal, pensions livrées intrajournalières. Il serait donc possible, en théorie, d’extraire des journaux de la Sicovam les informations relatives à chaque type de transaction et de construire des statistiques porteuses de sens. () Le taux de 99,81% enregistré en 1997 constituait, cette année là , le record mondial de fiabilité dans les dénouements de transactions. () Cette clarification du régime juridique a été opérée par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l’assurance, au crédit et aux marchés financiers. () Le statut des spécialistes en pensions sur valeurs du trésor a ensuite été fusionné, en 1996, avec celui des SVT, sur la base de la maturité constatée des mécanismes de marché. () S’agissant d’un marché de gré à gré, qui ne bénéficie donc pas de la transparence « suprême » que constitue une cotation sur le marché organisé, la transparence s’entend de l’affichage par les SVT, en permanence, de fourchettes de prix pour des durées et montants déterminés. Par ailleurs, la Banque de France publie quotidiennement des taux de référence à partir des cotations affichées par les SVT sur chaque échéance, ce qui permet à tout investisseur de connaître à tout moment l’état du marché. Ces taux de référence sont relatifs aux pensions dites « en vrac », c’est-à-dire aux opérations de pension dans lesquelles le cessionnaire, prêteur d’espèces, accepte de recevoir tous les types de valeurs du Trésor mis en pension par le cédant. Ces opérations « en vrac », motivées par un besoin de trésorerie chez le cédant, se distinguent des opérations dite « spécifiques », motivées par le besoin de couvrir une position vendeuse chez le cessionnaire. Celui-ci cherche alors à se procurer sur le marché un titre bien déterminé, sur lequel il a pris par ailleurs une position vendeuse, en contrepartie d’espèces dont il accepte de se défaire. On peut noter que ces espèces peuvent éventuellement provenir d’une autre opération de pension, le cessionnaire de la première étant simultanément cédant de la seconde et se procurant ainsi les liquidités souhaitées en contrepartie de l’abandon temporaire d’un « vrac » de titres ; in fine, à travers une prise en pension et une mise en pension de même échéance, l’intermédiaire échange de façon temporaire des titres « en vrac » contre un titre bien déterminé. () Les informations fournies par la direction du Trésor ne permettent pas de connaître les frais de gestion occasionnés par les opérations de rachat. En tout état de cause, leur montant ne peut être que très sensiblement inférieur aux dépenses budgétaires de coupons courus. () Il s’agit bien évidemment de l’échéance des contrats notionnels et non de l’échéance des emprunts composant le gisement. () L’analyse quantitative des contrats à terme montre que la couverture contre le risque est d’autant plus efficace et les distorsions potentielles sont d’autant plus faibles que les caractéristiques du contrat fictif sont plus proches de celles prévalant sur le marché. Tous les marchés à terme procèdent régulièrement au réexamen de la bonne adéquation entre les caractéristiques de leurs contrats et celles des marchés dont ils assurent la couverture. () PIBOR : taux interbancaire offert à Paris. Il s’agissait, avant le 1er janvier 1999, d’un taux représentatif des taux d’intérêt à court terme (1 moi ou 3 mois, en général) constatés par un panel de grandes banques françaises. Les fluctuations du PIBOR, qui servait de base d’indexation à certains prêts à court terme, pouvaient être couvertes par un contrat Matif portant sur ce taux. () Un opérateur met en œuvre une stratégie de spread lorsqu’il prend une position à l’achat ou à la vente sur une échéance de contrat à terme, suivie d’une position inverse sur une échéance différente du même contrat. () Une stratégie de strip consiste à acheter (ou vendre) les quatre échéances trimestrielles consécutives d’un contrat à terme. () L’Euribor est le taux interbancaire européen de référence qui remplace, après réalisation de la troisième phase de l’Union économique et monétaire, les anciens taux PIBOR (taux interbancaire offert à Paris) et FIBOR (taux interbancaire offert à Francfort). () Début des cotations électroniques sur les contrats de produits de taux en avril 1998, fin des cotations à la criée sur ces mêmes contrats au début du mois de juin 1998, sur les contrats de marchandises à la fin du mois de juin 1998, sur les contrats d’options en septembre 1998. () Banque des règlements internationaux, Activité bancaire et financière internationale, août 1998 (p.24). () Voir L’Agefi, « Paris et Eurex annoncent une coopération en trois actes », mercredi 11 février 1998. () MONEP : Marché d’options négociable à Paris. () Le projet consistait pour Eurex à créer un marché à terme, le North American Derivatives Exchange, qui aurait eu vocation à coter des contrats à terme sur les indices boursiers et sur les contrats de taux américains. () Banque des règlements internationaux, Activité bancaire et financière internationale, février 1998 (p.26). () Une position ouverte est une position (achat ou vente) qui n’a pas été compensée par une opération inverse. Elle est donc susceptible de donner lieu à une livraison des titres du gisement au jour de l’échéance du contrat. () L’Euro-notionnel est un contrat bi-émetteur à compter du contrat arrivé à échéance en juin 1999. () Le concept d’« obligation la moins chère à livrer » repose sur le mécanisme de dénouement du contrat arrivé à échéance. Le vendeur du contrat doit, à cette date d’échéance, se procurer sur le marché les titres composant le gisement afin de les remettre à l’acheteur. Dans le cas d’un contrat multi-émetteur, le vendeur a le choix entre les différentes obligations composant le gisement. L’obligation la moins chère à livrer est celle qui maximise son gain ou minimise sa perte entre le prix de livraison de l’obligation et le montant dû par l’acheteur (qui a été fixé au moment où le contrat a été conclu). () Voir par exemple Deutsche Bank, « The Euroland Yield Curve », in Fixed Income Weekly, 4 décembre 1998 (pp.30-34). () Cité dans le bulletin mensuel des valeurs du Trésor, n° 110, juillet 1999. () Les adjudications de trente ans de novembre ont été supprimées à partir d’août 1999 en raison de la diminution du programme de financement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||