|
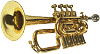
|
Fête de la musique
|

|
Concert à l’Assemblée Nationale le 21 juin 2003,
de 19 heures à 21 heures
devant le péristyle du Palais Bourbon, face au pont de la Concorde
|
La
Fanfare de la Garde Républicaine de Paris : un peu d'histoire

|
La Fanfare de
Cavalerie de la Garde Républicaine
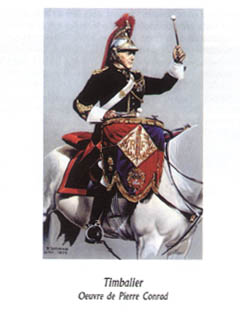
La fanfare de
cavalerie assure la pérennité des fanfares montées et fait revivre au cœur
des Français le panache et le souvenir des prestigieux régiments de l'armée
française. Elle compte 40 exécutants.
Les trompettes de la garde remontent à la garde municipale, créées par le
décret du 4 octobre 1802. Les effectifs ont été plus ou moins étoffés selon
les règlements en vigueur aux différentes époques.
En 1848, Paulus est nommé chef trompette à la garde républicaine. Il dispose
alors de 12 trompettes, 1 trompette-major - 2 timbaliers - 5 trompettes cor - 3
trompettes contre-basse - 2 trompettes alto - 5 trompettes basse - 22 trompettes
d'ordonnance.
Remontée en chevaux alezan pour ses trompettes, en chevaux gris pour ses
timbaliers, la fanfare prend part, en tête du régiment de cavalerie, aux
escortes présidentielles et des chefs d'État étrangers, aux défilés et aux
prises d'Armes. Avant 1937, il n'existait pas de timbales à la fanfare mais
une caisse claire et une paire de cymbales pour les défilés à cheval.
Les timbales
furent offertes en 1937 par la ligue hippique d'Ile de France. Les tabliers
de grande tenue ont été dessinés par le peintre militaire Lucien Rousselot.
Le répertoire de la Fanfare de cavalerie comporte les "Ordonnances des
trompettes" (sonneries réglementaires) composées par David Buhl en 1803
et toujours en vigueur de nos jours.
Le
répertoire comporte également de très nombreuses marches régimentaires d'artillerie
et de cavalerie évoquant les artilleurs, les cuirassiers, les dragons, les
hussards, les chasseurs, les spahis, les chasseurs d'Afrique...et bien sûr
différentes marches de la garde composées par ses trompettes-majors
successifs.
|
BICENTENAIRE DE LA FANFARE DE CAVALERIE DE LA GARDE
RÉPULICAINE
( octobre 2002 )
La fanfare de la garde
républicaine reste l’ornement obligé des grandes cérémonies de la
capitale, où les beaux défilés militaires perdraient de leur éclat aux yeux
des Parisiens et des étrangers sans l’apparat et le martial entrain qu’ils
apportent. Les trompettes dont les notes éclatantes précèdent tout défilé
de cavalerie dans Paris, forment la première fanfare de France. Leur histoire
est intiment liée à celle des troupes d’honneur et de sûreté de la
capitale qui, sous différentes dénominations, remontent par filiation
officiellement admise à la " garde municipale de Paris "
créée le 12 vendémiaire de l’an XI (4 octobre 1802).
(Citation du lieutenant-colonel Schilte).
Les archives des différentes
administrations militaires ne possèdent que très peu d’éléments sur les
périodes couvrant la création de la fanfare jusqu’au début du XIXe siècle.
En revanche, les registres régimentaires laissent apparaître les qualités de
chacun des trompettes-majors alors nommés.
Il convient de noter que durant
toute l’histoire de la fanfare de cavalerie de la garde, et ce sous toutes les
appellations ou régimes en vigueur, il sera fait mention de trompettes, et par
la suite de timbaliers pour désigner les musiciens de cette formation musicale.
LA NAISSANCE DE LA FANFARE, LE
TROMPETTE-MAÎTRE JEAN-LOUIS GRASSE
Les archives du ministère de la
Défense n’ont pas permis de situer nommément le trompette-maître (il n’est
pas encore fait mention du titre de trompette-major dans l’organigramme du
corps en 1802, mais bien de trompette-maître), en place à la création du
corps de la garde municipale, le 12 vendémiaire de l’an XI. Le
14 juin 1803, soit neuf mois après la création du corps, le
brigadier-trompette Jean-Louis Grasse est nommé à la direction de la fanfare,
qui est à cette époque un embryon musical puisque les trompettes se trouvaient
alors répartis dans les différents escadrons de la Garde municipale de Paris.
Il restera à la tête de la fanfare jusqu’au 7 mars 1807, date à
laquelle il sera muté au régiment des dragons de la garde impériale. On peut
supposer que le répertoire de la fanfare d’alors se composait principalement
des sonneries de quartier ainsi que de quelques marches pour trois et quatre
parties de trompettes comme celles écrites par David Buhl ou Georges Frédéric
Fuchs.
LA FANFARE, DE L’EMPIRE À LA RÉVOLUTION
DE 1848
Alors que l’Empire est en place
depuis deux ans, le brigadier-trompette Nicolas Hein, née le 21 octobre
1762 à Neustadt (Allemagne), est nommé le 25 juillet 1807 en qualité de
trompette-major à la garde municipale de Paris, après avoir servi au 11e chasseurs
à cheval comme musicien, à la 3e demi-brigade auxiliaire comme
artiste musicien, à la 110e demi-brigade de ligne comme musicien
gagiste, au 6e hussards en qualité de chef de musique, et au 19e
de ligne comme musicien gagiste. Il conservera ses fonctions à la garde
municipale de Paris jusqu’au 11 mai 1811, date à laquelle il rejoint le
1er régiment de chevau-légers lanciers de la garde impériale.
En 1811, le 6 août, Henry
Gérard, lui-même né le 24 octobre 1784 à Sedan, prend en main les destinées
de la fanfare après avoir servi comme musicien au 2e hussards et à
la compagnie des Guides. Un décret impérial porte à huit le nombre des
trompettes à cheval pour les quatre compagnies du corps. C’est seulement en
1820 que cet effectif sera porté à douze trompettes. Il variera ensuite de
huit à seize, selon les époques.
Généralement, l’histoire de
la fanfare reste intimement liée à celle de la France puisque le changement du
trompette major est souvent concomitant à la chute d’un régime.
Ainsi, après les évènements de
juillet 1830, François-Nicolas-Chrysostome Jacqmin est nommé le 1er
septembre 1830 à la tête de la fanfare dont il quittera la direction le
6 janvier 1847, quelques mois avant la chute de la monarchie de juillet.
Jacqmin avait lui aussi un passé militaire et musical des plus impressionnants
puisqu’il s’était engagé comme brigadier-trompette dans les dragons de la
garde impériale, dans les mousquetaires en 1815, à la musique des escadrons de
service des ex-gardes du corps du Roi en 1821 avant de rejoindre la garde
municipale en 1830. S’il était un musicien talentueux, il fut aussi un
valeureux soldat car on trouve sa trace lors de la campagne de Russie en 1812,
de Saxe en 1813 ou de Belgique en 1815. Insigne distinction, il fut nommé
chevalier de la Légion d’honneur.
LA FANFARE SOUS LA IIe
REPUBLIQUE ET LE SECOND EMPIRE : JEAN-GEORGES PAULUS
Jean Usse, ancien du 6e
de ligne, du 1er dragons et du 8e hussards, lui succédera
le 10 février 1847. Il assurera un passage assez bref à la tête de la
formation puisqu’il quittera ses fonctions l’année suivante, le
16 mars 1848.
Jean Barrière fut à son tour
nommé trompette-major le 1er juillet 1848. Il n’exercera ses
fonctions qu’un mois et sera remplacé le 13 août par Jean-Georges
Paulus.
Jean-Georges Paulus, né le
5 août 1816 à Haguenau, a commencé très jeune sa carrière militaire
comme clarinettiste gagiste au 10e chasseurs à cheval. En 1835,
il obtient un premier prix de clarinette au conservatoire de Paris. Il devient
par la suite chef de musique sur les navires Hercule et La Belle
Paule, où il participe aux cérémonies du transfert des cendres de
Napoléon. Il est officiellement nommé chef de musique du Prince de Joinville.
En 1848, à son arrivée à la
garde républicaine, il trouve les douze trompettes du régiment de cavalerie
disséminés dans les escadrons de marche. C’est sans nul doute de ce noyau
musical dont il se servira pour constituer le prestigieux orchestre d’harmonie.
Par ailleurs, la même année, l’administration préfectorale de Paris confie
à la garde républicaine un lot de trente-six instruments pour la constitution
d’une musique. La nomenclature instrumentale de ce don laisse supposer que c’est
bien pour la constitution d’un orchestre, et non pour la fanfare elle-même
qui continue, d’ailleurs à œuvrer sur ses propres instruments et son répertoire
spécifique.
Le brigadier-trompette
Frédéric-Thomas Fillaire, strasbourgeois né le 21 juin 1832, trompette
au 9e d’artillerie, prendra en 1864 la succession de Paulus.
Il restera à la direction de la fanfare jusqu’au 4 novembre 1874.
Nous pouvons noter que la fanfare
s’illustre par des innovations techniques. En effet, le trompette Lecomte
dépose, en 1871, auprès du ministère de la guerre un brevet d’invention
permettant aux trompettes de cavalerie de passer de la tonalité Mi bémol à
celle de Si bémol. Il est fort probable qu’il s’agit du système de
transposition à barillet encore employé par les musiques de l’armée belge.
LA FANFARE AU DÉBUT DE LA IIIe RÉPUBLIQUE
En 1874, lors du départ de
Fillaire, les différentes archives des services consultés laissent un doute
sur le nom du, ou des trompette(s)-major(s) successif(s) jusqu’en 1885. Il ne
subsiste pas de trace des activités ou événements auxquels prend part la
fanfare durant cette période, mais il ne fait nul doute qu’elle participe à
la grande cérémonie du 14 juillet 1880 à Longchamp où le président
Grévy et la Chambre des députés viennent de décréter le 14 juillet
comme jour de fête nationale.
Les trompettes du régiment de
cavalerie de la garde républicaine avaient la particularité d’être
remontés en chevaux gris, afin d’être immédiatement distingués sur le
champ de bataille par les officiers auprès desquels ils étaient affectés. L’inconvénient
majeur de cette distinction était que l’ennemi les identifiait tout aussi
facilement, et pouvait interrompre ainsi la chaîne de transmission des ordres.
Pour mettre fin à cette vulnérabilité, une réforme adoptée en 1885 permet
la remonte des trompettes en chevaux alezans.
LA FANFARE AU DÉBUT DE LA IIIe RÉPUBLIQUE
Son petit-fils, âgé à ce jour
de 84 ans, nous a fait part de souvenirs d’enfance qui ont permis d’aller
un peu au-delà des renseignements contenus dans les archives militaires. Ainsi,
nous savons que Causy est né le 3 juin 1851 à Aumetz. Cette petite ville
lorraine est alors soumise aux vicissitudes de la politique et des guerres.
Tantôt elle se trouve en France, tantôt en Allemagne. En 1871, Aumetz est une
ville alors française, mais qui doit être annexée à l’Allemagne dans les
jours à venir. Pour éviter de revêtir l’uniforme allemand, Causy quitte sa
famille pour s’engager dans un régiment de cuirassiers. Après cet engagement
de cinq ans, il retourne à la vie civile et travaille chez un facteur de piano.
Lorsque l’opportunité se présente, il souscrit un nouvel engagement auprès
de la garde républicaine dont il devient le trompette-major en juillet 1885.
Causy semble avoir été le
premier trompette-major à avoir écrit des œuvres pour sa fanfare. Récemment
encore, il était convenu de dire que la polka La Sentinelle était la
pièce la plus ancienne du répertoire puisque les archives de la fanfare ne
possédaient que cette seule composition de lui. En 1999, contactés par ses
descendants, nous découvrons un patrimoine musical jusqu’alors ignoré de
tous. Un recueil de partitions manuscrites, dont certaines n’ont pas encore de
titre ou demeurent inachevées, met en évidence un compositeur fécond. En
effet, il a laissé un répertoire d’une soixantaine de pièces dont certaines
sont d’une très belle teneur musicale. Il est aussi l’auteur d’un Traité
complet du coup de langue, méthode de trompette qui a sûrement servi de
base à des générations d’instrumentistes.
Les compositions de Causy furent
écrites pour la nomenclature instrumentale que possédait la fanfare de
cavalerie à cette époque. Pour cette raison, un important travail de
réorchestration est nécessaire afin que ces œuvres correspondent à la
diversité actuelle des pupitres instrumentaux.
En effet, les trompettes-cors,
les contrebasses, à système chromatique ainsi qu’un pupitre de percussions
des plus complets, sont venus, au fil du temps, enrichir la palette sonore de la
fanfare de cavalerie.
Il n’en reste pas moins que ce
trompette-major fut un compositeur reconnu et un chef de formation de grande
valeur qui sut innover.
Un rapport établi en 1903 par
Gabriel Parès, chef de la musique de la garde républicaine, évalue l’action
de Jean-Baptiste Causy en ces termes : " le maréchal des logis
trompette-major Causy a formé un corps de trompettes remarquables comme il n’en
existe dans aucun régiment de cavalerie ". C’est aussi sous sa
direction que les premiers enregistrements sur disque firent leur apparition.
Sur un des tout premiers disques 78 tours, il enregistre avec la fanfare La
sentinelle et Simplette pour la déjà célèbre marque phonographique
Pathé. De nombreux autres enregistrements de la fanfare vont suivre sous des
labels aussi prestigieux que Columbia ou Saphyr.
Il faut remarquer qu’à cette
époque, il n’est encore jamais fait état du terme
" fanfare ", mais du corps des trompettes de garde
républicaine ou encore des trompettes de la garde républicaine. Il est certain
que c’est bien sous la direction de Causy que la fanfare a véritablement
commencé son existence propre en terme de formation musicale constituée. Jusqu’alors,
les trompettes devaient assurer un service musical principalement basé sur les
servitudes et vie des quartiers du régiment de cavalerie. Causy a été le
premier trompette-major à rassembler les trompettes des différents escadrons
pour en faire une formation homogène, et adopter un répertoire nouveau pour
elle, tout en maintenant celui des sonneries d’ordonnance.
Il est permis de penser que le
trompette-major possédait une personnalité affirmée, comme ce fut souvent le
cas par la suite. Les circonstances dans lesquelles il a quitté la direction de
la fanfare sont assez significatives. En 1905, il devait être décoré de la
Légion d’honneur, fait alors rarissime pour un sous-officier. Le commandant
du régiment de cavalerie ne souhaitant pas la lui remettre devant le front des
troupes lors d’une cérémonie officielle, mais plutôt en comité restreint
dans son bureau, il refuse et présente sa démission.

LA FANFARE, DE LA BELLE ÉPOQUE AU DÉFILÉ
DE LA VICTOIRE
A la suite de ce départ
précipité, Alfred-Jean-Baptiste Munier, né le 8 novembre 1863 à
Dampierre, prend à son tour le poste de trompette-major de la fanfare qu’il
occupe du 20 août 1905 au 26 août 1911. Notons que, mis à part un
passage d’une année au 1er d’artillerie, il semble être le
premier trompette-major à avoir effectué l’ensemble de sa carrière à la
garde républicaine, sous les différentes appellations en vigueur au cours de
sa période.
La fanfare fut fortement
sollicitée durant la Belle époque, les grands fêtes demeuraient toujours
très populaires. Ainsi, le 7 décembre 1907, un grand spectacle de
musiques militaires est organisé au grand palais des Champs Elysées, sous le
nom de " grande fête de nuit ". A cette occasion, le chef
de musique de la garde républicaine, Gabriel Parès est appelé à diriger pour
un grand concert militaire les neuf musiques de la garnison de Paris.
L’adjudant Munier, quant à
lui, prend la direction des fanfares des 1er et 2e régiments
de cuirassiers, des 12e et 13e régiments d’artillerie,
du 27e régiment de dragons, du 19e escadron du
train et de la garde républicaine. Sous la baguette avisée de Munier, les
fanfares interprètent de concert Le chevalier garde et Le
spahi.
Lorsqu'il prend sa retraite en
1911, Munier, devenu adjudant, est distingué par la médaille militaire et une
promotion au rang d’officier d’Académie.
Louis-Pierre Prodhomme devient à
son tour trompette-major de la fanfare le 7 novembre 1911. Il le restera
vingt-six ans. C’est un Mayennais né le 21 août 1883 qui possède
déjà un riche passé militaire lorsqu’il prend la direction de la fanfare.
Il a ainsi servi au 25e dragons, à l’école de cavalerie de
Saumur, au 1er cuirassiers avant d’arriver à la garde en
1911.
Il fait figure de novateur puisqu’il
équipe les trompettes de systèmes à deux pistons. Cette innovation permet d’enrichir
le répertoire car les instrumentistes sont alors en mesure d’interpréter la
gamme chromatique. Louis Prodhomme est d’ailleurs un compositeur de talent,
qui a laissé un catalogue d’une quarantaine de pièces pour la fanfare.
Certaines partitions laissent penser qu’il devait nourrir un goût certain
pour l’opéra et l’opérette. En effet, il a réalisé des arrangements sur
Carmen ou La fille de Madame Angot, ces œuvres tranchant avec l’ordinaire
en vigueur dans les fanfares de cavalerie. Rappelons cependant que la fanfare se
produisait fréquemment sous les kiosques des squares parisiens. Lors de ces
concerts Louis Prodhomme semblait mettre un point d’honneur à ce qu’une de
ses œuvres y soit interprétée.
Durant la première guerre
mondiale, les trompettes ne sont pas affectés dans des régiments de corps de
troupe. La fanfare assure des activités restreintes sur le plan musical, mais
aussi avec des effectifs amoindris. Du fait de la guerre, elle apporte malgré
tout son concours au service général de la garnison de Paris.
C’est pourtant en 1914 que la
garde républicaine reçoit définitivement la mission d’assurer, fanfare en
tête, les escortes des chefs d’Etat en visite officielle en France. Après l’armistice,
le 11 novembre 1918, la fanfare reprend ses missions puisqu’elle escorte
en trois semaines, respectivement : le roi d’Angleterre, le roi de
Belgique, le roi d’Italie, ainsi que le président des Etats-Unis d’Amérique.
En 1919, elle participe au
défilé de la Victoire, alignant vingt-quatre trompettes sur les rangs. Par la
suite, il sera fait appel aux fanfares des corps de troupe pour étoffer les
effectifs, puisqu’à cette époque, les candidats ne sont pas astreints à un
stage en école de sous-officiers de gendarmerie.
L’ENTRE-DEUX GUERRES
En 1922, la ville de Paris fait
don à la fanfare de ses premières flammes de trompettes. Ces flammes,
richement brodées de fils d’or, sont ornées des armoiries de la ville de
Paris, de sa devise latine Fluctuat Nec Mergitur, et des décorations
décernées au titre de la ville de Paris, la Légion d’honneur, la Croix de
guerre 1914-1918. Après la seconde guerre mondiale, la Croix de la Libération
sera ajoutée et les lettres " GR " entrelacées, brodées
au revers.
En 1924, les archives musicales
de la fanfare, alors situées dans un local au-dessus de l’actuel mess du
quartier des Célestins, vont être entièrement détruites à la suite d’un
incendie provoqué par l’inadvertance d’un trompette chargé des partitions.
Cet épisode explique qu’actuellement le patrimoine musical de la fanfare ne
comporte que très peu de partitions antérieures à cette époque et que la
découverte récente du recueil de Causy fait figure d’évènement.
Cette même année, un programme
de la " matinée familiale organisée pour Noël " laisse
transparaître une autre facette de la fanfare. Lors de la soirée qui suivit
cette manifestation, un orchestre de danse est constitué, sous la direction de
Louis Prodhomme, avec les chefs trompettes Leroy et Couffignal, les trompettes
Millan, Gauthier, Renaud, Lordey et Hurelle.
Il est fort probable que cet
orchestre, qui avait à son répertoire un programme de " danses
nouvelles et anciennes " ait non seulement évolué dans les diverses
soirées du régiment mais aussi au profit des autres quartiers du corps de la
garde républicaine.
En 1937, à l’occasion d’un
concours hippique au grand palais de Paris, un carrousel est présenté au
public. C’est la première fois que la fanfare se produit avec deux timbaliers
remontés en chevaux alezans. Les timbales sont ornées de somptueux tabliers
aux armes de la République française et de la ville de Paris. Dessinés par le
peintre des armées, Lucien Rousselot, ils font encore aujourd’hui la fierté
de la fanfare. Jusqu’alors, une caisse claire et une paire de cymbales
assuraient la partie de percussion à cheval. Le cymballier dirigeait, tout
comme les timbaliers actuellement, le cheval à l’aide de rênes reliées à l’étrier
du cavalier. Il rangeait les cymbales dans une sacoche fixée sur le côté
gauche de la selle. Une grosse caisse était adjointe pour les défilés à
pied.
Le 22 mai 1938, la fanfare
est à Château-Gontier, en Mayenne. Elle présente à cette occasion un
programme fort varié en interprétant sous le kiosque de la ville des œuvres
telles que Le Trompette en cuivre de Prodhomme, La Fête au village,
fantaisie de Fiquet, L’Angevine, polka pour trompette solo de
Prodhomme, Légende capricieuse, fantaisie de Gadenne, Les Bords du Rhin
de Prodhomme, Thème et variations de Reynault et la valse Parisette de
Prodhomme. L’ensemble du concert est placé sous la direction de son
trompette-major, l’adjudant-chef Prodhomme.
Le 31 août 1938, l’adjudant-chef
Louis Prodhomme fait valoir ses droits à la retraite. Il est alors le premier
trompette-major à quitter la fanfare avec le grade d’adjudant-chef.
Le 1er septembre
1938, Raoul Ponsen est nommé par décision ministérielle au poste de
trompette-major. Engagé en 1912 au 1er cuirassiers, au titre de
la fanfare régimentaire, il en prend la direction en 1918, après quatre
années de guerre. La même année, il réussit brillamment le concours d’admission
à la garde républicaine, et rejoint la fanfare du régiment de cavalerie pour
laquelle il nourrissait quelques ambitions. Il en assume la direction à partir
de 1938. Titulaire de la médaille militaire et de la croix de guerre, il s’efforce
de maintenir un certain niveau d’activité pour sa formation durant les
années sombres.
C’est à partir de cette
époque, et pour une assez longue période, que la fanfare de cavalerie partage
sa salle de répétition du quartier des Célestins avec la musique des gardiens
de la paix de Paris.
LA FANFARE DE 1939 A LA LIBÉRATION
Durant la seconde guerre
mondiale, la garde républicaine reste la seule force militaire française en
activité pour la garnison de Paris et, par conséquent, sa fanfare reste aussi
en place. Ses activités musicales vont se réduire car les trompettes sont
commandés de service au bénéfice des escadrons de marche et parfois en
renfort dans les commissariats parisiens pour des missions de police générale,
mais aussi pour des missions de sécurité dans les théâtres ou grandes salles
de spectacles de Paris.
La fanfare assure malgré tout
des services pour les diverses forces mises en place par le gouvernement. Ainsi,
le 27 août 1941, elle prête son concours pour une prise d’armes à
Versailles au profit de la Légion des Volontaires Français. Alors qu’elle
interprète sa célèbre marche Aïda, Paul Colette commet un attentat
contre les représentants Pierre Laval et Marcel Déat. Une radio de l’époque
qualifiera Aïda de " marche nazillone " !
Le 1er juin 1943
la fanfare participe, à Pantin, à une cérémonie solennelle de remise du
fanion du corps des gardiens de la paix. Le 10 juin de la même année, elle est
à Compiègne, avec la fanfare d’infanterie (qui deviendra par la suite la
célèbre batterie-fanfare), pour, semble-t-il, le seul déplacement en province
durant la seconde guerre mondiale.
Pendant l’occupation allemande,
Paris continue certaines activités artistiques, notamment cinématographiques.
Lors du tournage de films historiques, la fanfare est sollicitée. Ainsi, elle
apparaît dans Pontcaral, colonel d’Empire, et sort en tenue
napoléonienne du quartier Monge, ancien cantonnement du régiment de
cavalerie, en sonnant Les Hussards de Lassalle. On la voit également
dans la première version du Colonel Chabert aux côtés de Raimu.
1944 : Paris est libéré et
le 26 août, le trompette Hott est désigné pour jouer la sonnerie du cessez
le feu place de l’hôtel de Ville. Ce jour-là a lieu le dernier
bombardement de Paris.
Le quartier Schomberg, où
réside la plupart des trompettes, est pris pour cible. L’alerte retentit vers
23 heures. Une bombe tombe sur le bâtiment du poste de police, faisant
quatorze morts dont le trompette Violeau. Ce dernier avait participé l’après-midi,
avec la fanfare en grande tenue, à l’escorte du général de Gaulle entre la
place de l’Etoile et l’hôtel de ville.
Après la libération, la fanfare
voit l’effectif de son encadrement porté à un adjudant-chef, un adjudant et
six maréchaux des logis chefs, alors qu’auparavant le trompette-major et sont
adjoint étaient les seuls gradés de la formation. Raoul Ponsen dirige alors,
parallèlement à la fanfare, la fanfare des Halles de Paris, qui est une
formation civile similaire à celle de la garde républicaine. Il va mener cette
formation musicale aux plus hauts sommets des concours musicaux mettant en lice
les meilleures formations civiles. Le nom de Raoul Ponsen, s’il reste attaché
à celui de la fanfare des Halles et à celui de l’Union des fanfares de
France dont il fut le président du comité technique. Par tradition, et à
titre privé, de nombreux trompettes de la fanfare ont rejoint les rangs de
cette formation, pour renforcer les différents pupitres. Le trompette-major Ponsen a laissé une cinquantaine de pièces pour fanfare de cavalerie, mais
aussi pour formations avec clairons.
En 1947, pour la dernière fois
sous la direction de Raoul Ponsen, la fanfare fréquente à nouveau les
coulisses du cinéma pour Le Silence est d’or avec Maurice Chevalier.
Le 12 février 1948, il quitte à
son tour la fanfare et c’est son adjoint, l’adjudant François Lordey, qui
va assurer la suppléance dans l’attente de la prise de fonction officielle de
l’adjudant Gossez.

L’ÈRE DU TROMPETTE-MAJOR GOSSEZ
Albert Gossez, originaire de
Roisin en Belgique, est né le 10 février 1916. En 1934, il s’engage au
titre de la fanfare du 11e cuirassiers, alors stationné à Paris. Il
y côtoie Raoul Ponsen, trompette-major de cette autre fanfare parisienne qui
est, avant guerre, un véritable vivier en ressource musicale pour la fanfare de
la garde.
En 1938, à la suite du départ
de Raoul Ponsen pour le poste de trompette-major à la garde républicaine, il
prend à son tour, la direction du 11e cuirassiers. En juin
1940, il est fait prisonnier et envoyé en captivité en Allemagne où il reste
jusqu’à la libération des camps en mai 1945.
Il reprend ses fonctions de
trompette-major du 12e cuirassiers jusqu’à sa mutation à la
fanfare de la garde noire du sultan du Maroc en 1946. Lorsque Raoul Ponsen fait
valoir ses droits à la retraite, le poste de trompette-major est remis en
concours, lequel dure trois jours et, c’est tout naturellement qu’Albert
Gossez préside aux destinées de la fanfare le 1er septembre
1948.
Durant vingt années passées à
la direction de la fanfare, Albert Gossez écrivit 124 œuvres dont de très
nombreuses marches régimentaires. Les nombreux déplacements de la fanfare en
province, furent prétextes à la composition. Ainsi, de Perles de Médous
mis en musique après un séjour à Bagnère de Bigorre, à Retour de Nantes
après un déplacement dans cette ville, les exemples sont nombreux. Dans le
cadre des festivités du bimillénaire de Paris, il crée une suite de pièces, Les
Appels échos, qui ont la particularité d’être composées sur la base
sonore des bourdons de Notre Dame de Paris. Ainsi, durant une quinzaine de
représentations, la fanfare apporte son concours musical en illustration des
scènes pour " les fêtes du vrai mystère de la Passion ".
Le taux de fréquentation de chacune de ces soirées est de
10 000 spectateurs environ. Plus d’une centaine de ses marches ont
été enregistrées dans les séries de disques consacrées à la musique
militaire et produites par la maison Decca.
Les séances d’enregistrement
avaient alors lieu au manège des Célestins dont l’acoustique reste
exceptionnelle. C’est principalement la rencontre avec un des directeurs
artistiques de la firme, lui-même passionné de musique militaire, qui permit
cette abondance d’enregistrements. La discographie de la fanfare s’avère
des plus prolifiques puisqu’elle a enregistré près d’une cinquantaine de
disques 78 tours, dont la fameuse série d’anthologie de musique
militaire.
On compte aussi des pièces de
collection comme le disque-carte postale avec la batterie-fanfare de la garde
républicaine, et des enregistrements en public lors des " nuits de l’Armée ",
de "la grande parade de la gendarmerie " ou encore à Berne
en 1970.
Mettant fin à une circulaire
établissant la robe alezane pour les chevaux des trompettes, en 1955, une
prérogative fut établie en autorisant des chevaux à robe grise pour les deux
timbaliers défilant légèrement en retrait, de part et d’autre du
trompette-major. Cette décision officialise en fait une pratique déjà
coutumière puisque le trompette-major Ponsen avait déjà défilé encadré par
deux chevaux gris. Les chevaux des timbaliers deviennent l’objet de la plus
grande attention du commandement et des trompettes. Certains de ces chevaux,
comme Fils à Papa (un des deux premiers chevaux gris timbaliers), Ianina,
Ulysse, File Partout, vont passer à la postérité au travers de l’imagerie
populaire, symbolisant ainsi la fanfare.
LES GRANDES HEURES DE LA FANFARE JUSQU’EN
MAI 1968
Pendant les guerres d’Indochine
et d’Algérie, la fanfare n’est pas déplacée en " théâtre d’opérations
extérieur ", comme son homologue la musique de la gendarmerie mobile.
Elle fournit cependant des trompettes qui partent en opération à titre
individuel.
A cette époque, la fanfare est
alors fréquemment sollicitée pour des scènes cinématographiques. Elle
apparaît, sous a direction de l’adjudant-chef Gossez, dans des films de
légende comme les grandes manœuvres, aux côtés de Gérard Philippe et
Michèle Morgan, et Les trois mousquetaires. Pour Sacha Guitry, elle
joue, en juillet 1953, dans Si Versailles m’était conté, Si Paris m’était
conté. Elle prend aussi part à son célèbre Napoléon. Pour les
besoins des différents tournages, elle est souvent contrainte de revêtir des
tenues autres que l’uniforme national.
Ainsi, les trompettes
apparaissent en dragons autrichiens dans Christine avec Alain Delon, en
dragons de 1914-1918 pour Les grandes manœuvres avec Gérard Philippe,
ou en trompette de chasseurs à cheval de la garde du premier empire pour Napoléon
de Sacha Guitry. A de nombreuses autres occasions, elle est aussi costumée
pour les besoins de spectacles tels les " nuits de l’Armée ".
En dragons de l’époque de Louis XV ou en trompette de hussards du
premier empire lors de la visite du roi de Suède a général de Gaulle au
palais de l’Elysée. Elle participe également à l’illustration sonore de
la charge des dauphins dans Le monde du silence du commandant Cousteau,
avec une composition d’Albert Gossez.
Jean Vilar qui dirigeait alors le
théâtre national populaire, sollicite lui aussi les services de la fanfare
dans le cadre de pièces comme Le prince de Hombourg ou Lorenzaccio.
Tous les grands spectacles
militaires parisiens font appel à la fanfare. C’est vrai pour les mythiques
" nuits de l’armée ", présentées entre 1952 et 1955,
mais aussi lors des " grandes parades de la gendarmerie " en
1964 et 1966, ou encore pour les " fêtes
franco-britanniques " au Vel d’hiv en 1957, avec seize
représentations publiques dont une présence de la reine Elizabeth II d’Angleterre.
Ces spectacles militaires ont
conduit à la création, au sein de la fanfare, de certaines des
" formations spéciales " du régiment de cavalerie.
Celles-ci, qui existent toujours, sont des ensembles instrumentaux tels que les
trompes de chasse, les tambours et hautbois et le quintette de cuivres du
régiment de cavalerie, anciennement " trompettes Jeanne d’Arc ".
Ces formations sont généralement employées en tenues d’époque
Louis XV pour faire revivre le panache des fêtes royales.
Au-delà de ce contexte
particulier, les trompes de chasse et le quintette de cuivres prêtent leurs
concours lors de cérémonies religieuses ou animations au profit des plus
hautes instances de la gendarmerie nationale et de l’Etat.
En 1952, la fanfare participait
au prestigieux Tattoo d’Edimbourg en Ecosse. C’était la première fois
que la fanfare quittait aussi longuement ses quartiers parisiens, puisqu’elle
était l’invitée d’honneur, avec la " Koninklijke Militaire Kapel "
des Pays-Bas, de ce spectacle militaire qui a duré plus d’un mois. Grande
première, les chevaux de la fanfare prirent le bateau de Boulogne à
Folkestone.
En 1967, la gendarmerie nationale
exporte la grande parade de la gendarmerie à Montréal dans le cadre de
l’exposition universelle. C’est une véritable caravane qui traverse l’Atlantique,
puisque toutes les formations spéciales de la garde républicaine (la
batterie-fanfare, le carrousel, les motards, les gymnastes et la fanfare)
participent à ce spectacle. Les 150 chevaux, dont ceux de la fanfare,
prennent le bateau au Havre avec quelques trompettes alors que la grande
majorité rejoint Montréal par avion.
MAI 1968, LA FANFARE SE MET AU ROCK’N ROLL
Pendant les évènements sociaux
que connaît la France en mai 1968, la fanfare stoppe ses activités musicales
et reçoit des missions de garde dans les postes de sécurité. Elle participe
également aux opérations de maintien de l’ordre, dans le cadre d’une
instruction interministérielle qui prévoit qu’un trompette doit, avant toute
intervention faisant appel à la force, interpréter une sonnerie spécifique.
Les trompettes de la fanfare assurent donc cette mission auprès des escadrons
de marche qui maintiennent ou rétablissent l’ordre public.
L’adjudant-chef Gossez quitte
la fanfare le 7 novembre 1968. Dans l’attente du successeur, c’est l’adjudant
Elisée Buffat, alors trompette-major adjoint, qui prend la tête de la fanfare.
Pendant les quelques mois d’intérim de l’adjudant Buffat, un fait marquant
vient enrichir la discographie de la fanfare.
En effet, en 1968, la France
vibre car Sylvie Vartan et Johnny Halliday fêtent la naissance de leur fils
David. Pour célébrer cet événement, Sylvie Vartan lui dédie la chanson Le
Roi David. Pour l’enregistrement phonographique de ce disque, la
production fait appel à une dizaine de trompettes pour accompagner la
légendaire chanteuse dans un style nouveau pour la fanfare, peu habituée à
fréquenter les coulisses de variété française.
LE TROMPETTE-MAJOR MOREAU
Au départ d’Albert Gossez, le
poste de trompette-major est mis en concours. C’est l’adjudant-chef Marc
Moreau qui est nommé le 1er mars 1969. Ce sera le dernier
trompette-major à être nommé sur décision ministérielle, et à provenir d’une
formation musicale des armées extérieure à la garde républicaine. Son père,
Henri Moreau, était lui-même trompette-major à la fanfare de la garde
chérifienne du sultan du Maroc. C’est tout naturellement que son fils Marc s’engage
en 1947. Reçu major du cours des trompettes-majors de Saumur, il prend la
direction de la fanfare du 7e spahis de Senlis.
Cette nomination suit de près un
important changement dans l’administration de la fanfare de cavalerie.
En 1969, pour des commodités de
gestion du personnel, les trompettes, alors disséminés dans les escadrons de
marche, sont regroupés au sein d’un peloton hors-rang, lui-même rattaché au
1er escadron. Par la suite, en 1971, la fanfare est directement
administrée par l’état-major du régiment de cavalerie. Une restructuration
plus complète intervient en 1978, avec la création d’un escadron hors-rang
qui regroupe et administre les unités de soutien telles que l’infirmerie-vétérinaire,
le mess, les ateliers du casernement, etc. La fanfare y trouve tout
naturellement sa place. Cette organisation prévaut encore à ce jour.
C’est à Berne, en Suisse, que
le nouveau trompette-major fait ses premières armes à la tête de la fanfare.
A la suite de ce festival, par ailleurs enregistré sur disque, la musique de la
marine royale des Pays-Bas, présente elle aussi à ce rassemblement des
meilleures formations musicales militaires, va adopter quelques pièces du
répertoire de la fanfare et en particulier Salut aux alliés qu’ elle
enregistrera quelques mois après.
Sous la direction du
trompette-major Moreau, la fanfare prend un nouvelle orientation en
privilégiant l’équitation. Il met ainsi en scène une série d’évolutions
à cheval qui sont toujours en vigueur. Ces évolutions, appelées
" ailes de moulin ", sont une série d’enchaînements de
figures équestres, qui permettent à la fanfare d’allier l’évolutif au
musical.
En 1980, un évènement
exceptionnel marque la fanfare et plus particulièrement son trompette-major
puisqu’il est honoré par les services des postes, télégraphes et
télécommunications. En effet, il figure, avec son cheval Beauséjour, sur un
timbre d’une valeur faciale de 1,70 F. Une enveloppe premier jour sera
même émise à l’occasion du lancement de ce timbre, qui apportera un nouvel
essor à la renommée de la fanfare.
Le 10 janvier 1983, il fait
savoir ses droits à la retraite. Il laisse un répertoire d’une quarantaine d’œuvres.
A son départ, le poste de
trompette-major n’est pas remis en concours. C’est son adjoint, l’adjudant-chef
Jean-Baptiste Laborde, qui prend la décision de la fanfare jusqu’au
7 octobre 1984.
LE TROMPETTE-MAJOR HANNOT ET LE CENTENAIRE
DE LA STATUE DE LA LIBERTE A NEW-YORK
A cette date, l’adjudant
Jean-Jacques Hannot est nommé par le commandement de la garde républicaine
trompette-major de la fanfare. Il était entré en gendarmerie en 1968, après
son service militaire effectué au 156e centre d’instruction
du Train à Toul. En 1969, il est affecté à la fanfare et nommé maréchal des
logis-chef en 1973, date à laquelle il rejoint Dakar pour un séjour de six ans
au titre de la coopération française et au bénéfice de la fanfare de la
garde rouge du Sénégal. A son retour, il retrouve la fanfare et, en 1983, en
devient le trompette-major adjoint.
La fanfare s’envole, sous sa
direction, en juillet 1986 pour New York dans le cadre des festivités du
centenaire de la statue de la Liberté. Les chevaux partent en avion quelques
jours plus tôt pour une mise en quarantaine obligatoire. La fanfare, logée à
la prestigieuse académie de West Point, retrouve ses montures et prend la
direction du " Giant Stadium " où elle va présenter les
fameuses évolutions équestres mises au point par le major Moreau. Cette
représentation se déroule devant 80 000 spectateurs. Elle est
retransmise en Mondiovision.
A cette occasion, les trompettes
arborent une particularité instaurée en 1985. En effet, les grenades de col
qui symbolisent la gendarmerie cèdent la place à la lyre spécifique des
musiciens. Jusqu’alors, ils étaient reconnaissables à la crinière rouge de
leur casque, contrairement aux cavaliers du rang pour lesquels elle est noire,
ainsi qu’au galon or qui borde le col et le bas des manches de leurs tuniques.
LE BICENTENAIRE DE LA REVOLUTION ET L’ARRIVÉE
DU TROMPETTE-MAJOR BESNIER
En septembre 1989, à l’occasion
du bicentenaire de la révolution française, la fanfare de cavalerie est
invitée à participer aux grandioses cérémonies de Valmy. Durant une dizaine
de jours, la fanfare installe son bivouac sur le site historique, au pied du
fameux moulin. C’est à cette occasion que l’adjudant Paul Besnier effectue
sa prise officielle de fonction. En effet, l’adjudant Jean-Jacques Hannot,
trompette-major en titre est hospitalisé quelques heures seulement avant le
départ de la fanfare pour Valmy. Nommé adjudant-chef, ce dernier décédera à
l’hôpital du Val de Grâce, à Paris, le 27 juillet 1990.
Le parcours de Paul Besnier jusqu’à
son accession au rang de trompette-major mérite d’être souligné. En effet,
c’est au 11e cuirassiers qu’il commence en mai 1963 une
longue carrière comme deux de ses prédécesseurs, Ponsen et Gossez. Il est
ensuite affecté au 1er régiment de spahis algériens pendant
les évènements de la guerre d’Algérie et, de retour en métropole, il
rejoint le 9e régiment de hussards. Il retrouve la vie civile
pendant deux ans avant de postuler pour la gendarmerie.
Il est admis à la fanfare en
décembre 1966 et va gravir tous les échelons de la hiérarchie des
sous-officiers pour accéder au grade de major et à la fonction de
trompette-major en 1990. Avec le major Moreau, il est le deuxième
trompette-major à avoir eu le privilège d’accéder, jusqu’à présent, à
ce grade.
Sous sa direction, la fanfare va
poursuivre son action et participer à quelques déplacements qui deviennent
légendaires comme La Baule, Berne, Lucerne, Cannes pour le 50e anniversaire
du festival du cinéma en 1997.
Il quitte la fanfare et son
cheval Potiron le 30 novembre 1998, pour laisser la direction à son
adjoint, l’adjudant-chef Jean-Marcel Faccioli qui a déjà un long passé
musical et militaire.
LE TROMPETTE-MAJOR FACCIOLI

Après des études au
conservatoire de Toulouse, Jean-Marcel Faccioli s’engage à la musique de la
11e division parachutiste le 2 février 1977. Il sert en
qualité de chef de pupitre des trompettes d’harmonie jusqu’en 1982. En
1983, il est retenu pour servir en gendarmerie au titre de la fanfare du
régiment de cavalerie de la garde républicaine.
Après huit ans en qualité de
trompette-major adjoint, il accède au poste que lui laisse le major Besnier le
1er décembre 1998. Il met au service de la fanfare ses talents
de compositeur en renouvelant son style, principalement dans des pièces de
concert ou à l’occasion d’accompagnements de reprises équestres du
régiment de cavalerie.
A l’occasion des cérémonies
du 8 mai 2000, l’adjudant-chef Facccioli va apporter une innovation dans
sa présentation à cheval en adoptant une trompette en argent massif, avec une
incrustation en vermeil des armoiries de la ville de Paris.
Cette trompette, plus longue qu’une
trompette de cavalerie traditionnelle, répond essentiellement à un souci d’ergonomie
dans l’exécution des commandements qui sont tous donnés, à vue, à l’aide
de cet instrument.
INNOVATION DANS LE RÉPERTOIRE DE LA FANFARE
DE CAVALERIE
La grande majorité des archives
de la fanfare était composée de pièces des différents trompettes-majors ou
de musiciens de la formation. Les années quatre-vingt-dix ont vu une nouvelle
tendance dans le répertoire puisque des compositeurs extérieurs à la fanfare
furent sollicités afin de proposer des compositions qui utilisent des
sonorités jusque là inexploitées. Ce répertoire donne une dimension nouvelle
à la fanfare, lui permettant de présenter des concerts en salle,
généralement avec une partie consacrée aux pièces de tradition et une
seconde partie avec des œuvres plus légères et variées. Des compositeurs de
renoms tels que Marc Steckar, André Brouet, Daniel Tassa ou Roger Boutry, sont
séduits par l’expérience d’écrire pour une formation telle que la
fanfare, avec les sonorités et les particularités qui lui sont propres.
L’an 2000 marque, outre le
changement de millénaire, un renouveau dans le répertoire de la fanfare. En
effet, une rencontre, dans le cadre du travail de recherche pour le livre du 150e anniversaire
des orchestres de la garde républicaine en 1998, avait permis de lier
connaissance avec une jeune compositrice, titulaire de nombreux prix du
conservatoire national supérieur de musique de Paris, et qui avait bien voulu,
par la suite, relever le défi d’être la première femme à composer pour la
fanfare. C’est avec bonheur qu’Anne Virginie Marchiol a écrit une œuvre, Hymne,
interprétée pour la première fois en décembre 2000, lors de la messe de
Sainte Geneviève (patronne de la gendarmerie) en l’église
Saint-Paul-Saint-Louis de Paris.
LA FANFARE DE CAVALERIE, PRÉSENTE À
TRAVERS LE MONDE
2001 reste une année riche en
prestations de prestige. La fanfare participe à l’exposition universelle qui
se tient à Hanovre, en Allemagne. C’est la seconde fois qu’elle est
sollicitée pour rehausser le panache du pavillon français, puisqu’elle avait
franchi l’Atlantique en 1967 à l’occasion de l’exposition universelle de
Montréal. La fanfare a d’ailleurs retrouvé le Canada, en août 2001, dans le
cadre du 2e festival international de musiques militaires de
Québec.
Elle a représenté la France,
avec grand succès, dans les sites québécois les plus prestigieux. Cette
" touche française " fit forte impression auprès d’un
public francophone, avide de ses origines.
Dans le passé, la fanfare
apportait son concours à l’orchestre de la garde, alors appelé Musique de
la garde républicaine, pour assurer les parties de trompette de cavalerie
dans les œuvres du répertoire militaire. En 2000, elle a renoué avec cette
tradition en intervenant dans une œuvre de Jules Massenet, Hérodiade,
et en 2001 dans l’ouverture 1812 de Piotr Ilitch Tchaïkovsky. Ces
interventions, dans le cadre des concerts annuels de la garde républicaine,
eurent un éclat particulier puisque le plateau musical regroupait l’orchestre
d’harmonie, le chœur de l’armée française et la fanfare.
Il est indéniable que la fanfare
jouit d’une grande popularité auprès du public. Il suffit de voir l’attention
qui lui est portée à chacune de ses prestations, ou encore au travers de l’image
qu’elle véhicule. En effet, les exemples ne se comptent plus où elle figure
dans des livres, revues, cartes postales, affiches ou pochettes de disques qui
lui sont totalement étrangers et donc bien représentatifs de l’aura qu’elle
porte. On la trouve ainsi que des pochettes de disque de la musique des gardiens
de la paix de Paris, de la Luftwaffenmusikkorps n° 1 de Munich ou encore
de la musique centrale populaire de Chine !
Elle demeure aujourd’hui encore
un modèle et nombreuses sont les formations militaires et civiles, françaises
ou étrangères qui s’inspirent de son organisation. Elle entretient, depuis
de nombreuses années, des relations d’amitié et de coopération avec la
fanfare de la garde rouge du Sénégal, où l’adjudant Le Blay, actuel
trompette-major adjoint, a effectué un récent séjour en vue de renforcer les
liens musicaux.
La fanfare franchit le cap du
nouveau millénaire dans la pérennité puisque dans le cadre de son
bicentenaire, elle reste toujours sollicitée, tant en France qu’à l’étranger,
pour rehausser l’éclat des grandes cérémonies françaises, les escortes des
grands de ce monde ou plus simplement pour apporter sa renommée dans des lieux
aussi divers qu’une salle de concert ou le terrain d’un jumping
international.
Mais c’est principalement à
Paris, la ville lumière, que le public a le plaisir de la voir quitter le
quartier des Célestins, sa résidence près de la place de la Bastille, seule
ou précédant le commandant du régiment de cavalerie, suivi de son étendard
et des trois escadrons à cheval de la garde républicaine.
Maréchal des logis-chef Jean-Marc
Lanois
|