|
RAPPORT
sur
De la connaissance des gEnes a leur utilisation
Première partie (suite) : L'utilisation des
organismes génétiquement modifiés
dans l'agriculture et dans l'alimentation
PAR M. JEAN-YVES LE DÉAUT,
Député
SOMMAIRE
Chapitre IV : Comment informer le
consommateur ?
A - L’attitude des consommateurs français
B - Conserver le libre choix. Le consommateur veut choisir
ce qu’il mange
Conclusion
CHAPITRE IV
Comment informer le consommateur ?
L’information des consommateurs apparaît certainement dans les
pays européens et en France, comme le point nodal des biotechnologies appliquées à
l’alimentation. Elle n’est pas évoquée par exemple aux Etats-Unis où les
consommateurs ne semblent pas souhaiter connaître ou pouvoir choisir les procédés de
fabrication de leur alimentation. Le panel des citoyens a bien insisté sur cette
nécessité d’informer mieux pour que le consommateur puisse choisir en toute
connaissance de cause. Tout en regrettant que le débat soit tardif, et en notant que leur
" réflexion ne prétend pas à l’exhaustivité sur les O.G.M. ",
la Conférence de citoyens a eu pour vocation d’être un catalyseur du débat public,
permettant à chacun de préciser ses opinions et au gouvernement de prendre des
décisions que " le panel estime très importante pour l’avenir de notre
société ".
A - L’attitude des consommateurs français
Evoquer cette attitude doit nous amener d’abord à examiner quel
est le degré de connaissance des organismes génétiquement modifiés.
a - Quelle connaissance des organismes génétiquement modifiés ?
En deçà de la connaissance des organismes génétiquement modifiés,
j’ai le sentiment qu’on se trouve dans un domaine, celui de la biologie ou des
sciences de la vie, qui est non seulement assez massivement ignoré mais qui entraîne la
propagation d’un assez grand nombre d’idées parfaitement fausses.
Au cours de ma mission aux Etats-Unis, j’ai pu rencontrer M.
Thomas J. Hoban, professeur de sociologie de l’alimentation à l’Université
d’Etat de Caroline du Nord, à Raleigh. Celui-ci étudie les comportements des
personnes dans le domaine de l’alimentation et a dernièrement porté son intérêt
sur les comportements vis-à-vis des biotechnologies dans l’alimentation.
Un certain nombre de ses plus récents résultats ont été obtenus par
ses propres enquêtes complétées par les résultats d’un certain nombre
d’études comme Eurobaromètre, effectuée de façon périodique au sein de
l’Union européenne. J’ai d’ailleurs auditionné Mme Suzanne de Cheveigné,
chargée de recherche au C.N.R.S., qui collabore à ces études.
Certains de ces résultats sont assez étonnants.
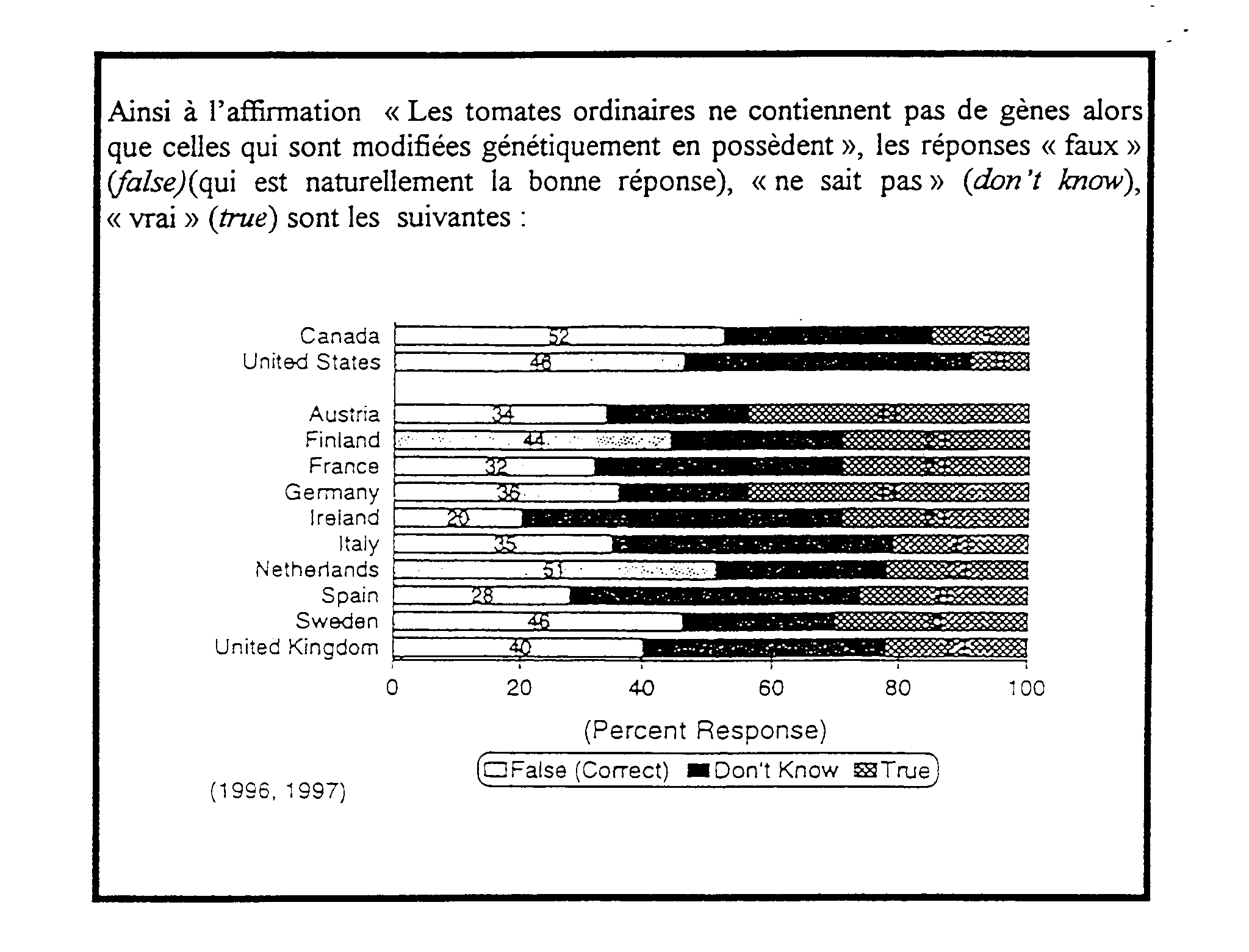
On voit que les meilleures réponses sont obtenues aux Etats-Unis, au
Canada et aux Pays-Bas, meilleurs européens. Les plus mauvaises en Irlande et en Espagne.
La France ne donne que 32 % de réponses bonnes et se trouve en compagnie de
l’Autriche, de la République fédérale d’Allemagne et de l’Italie.
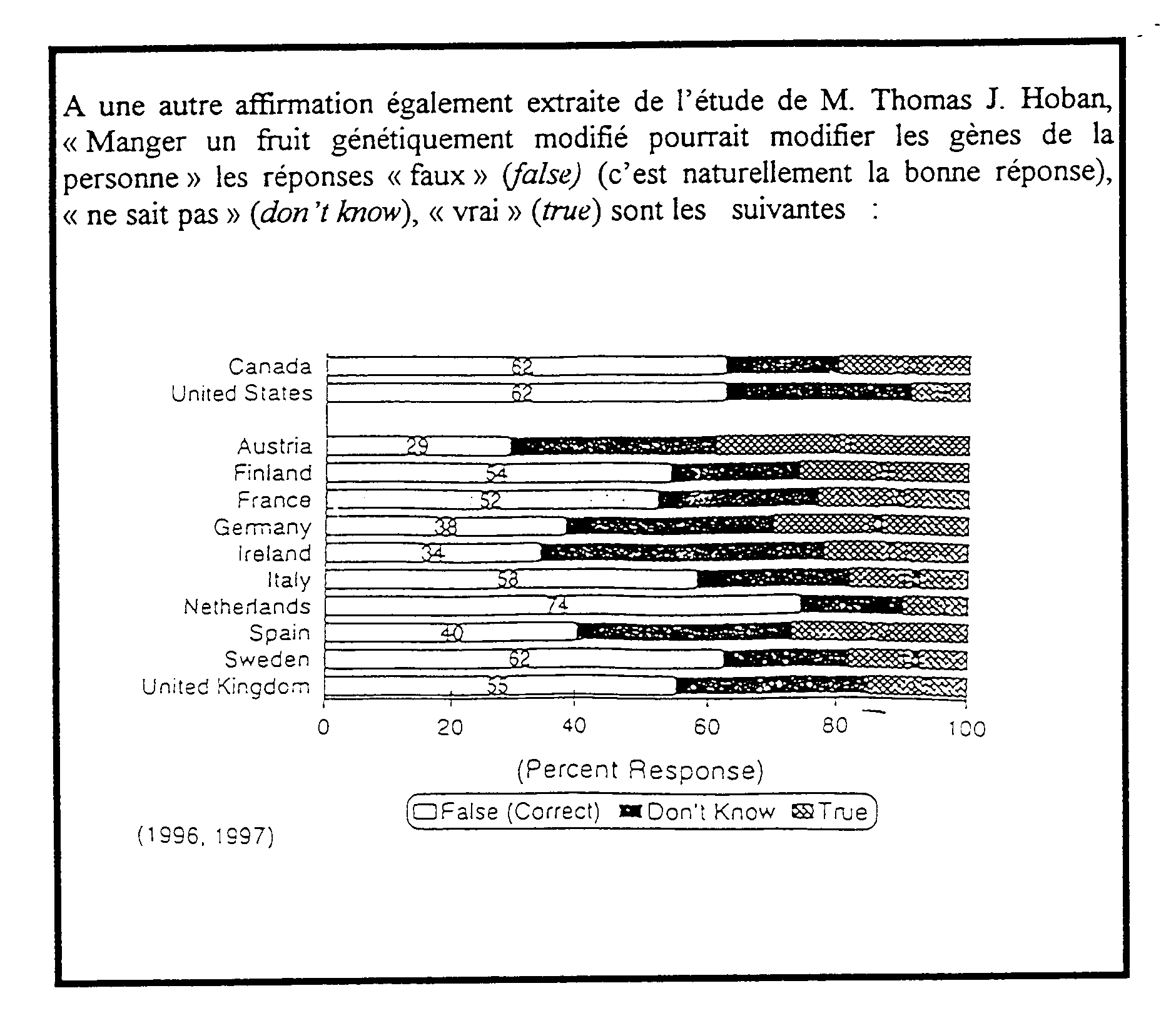
De nouveau les meilleures réponses sont données aux Etats-Unis, au
Canada et aux Pays-Bas, ces derniers atteignant un taux record de 74 % de réponses
correctes. Une fois encore l’Autriche se distingue par un bas taux de réponses
correctes. La France occupe une position intermédiaire, plutôt dans le haut de la
moyenne.
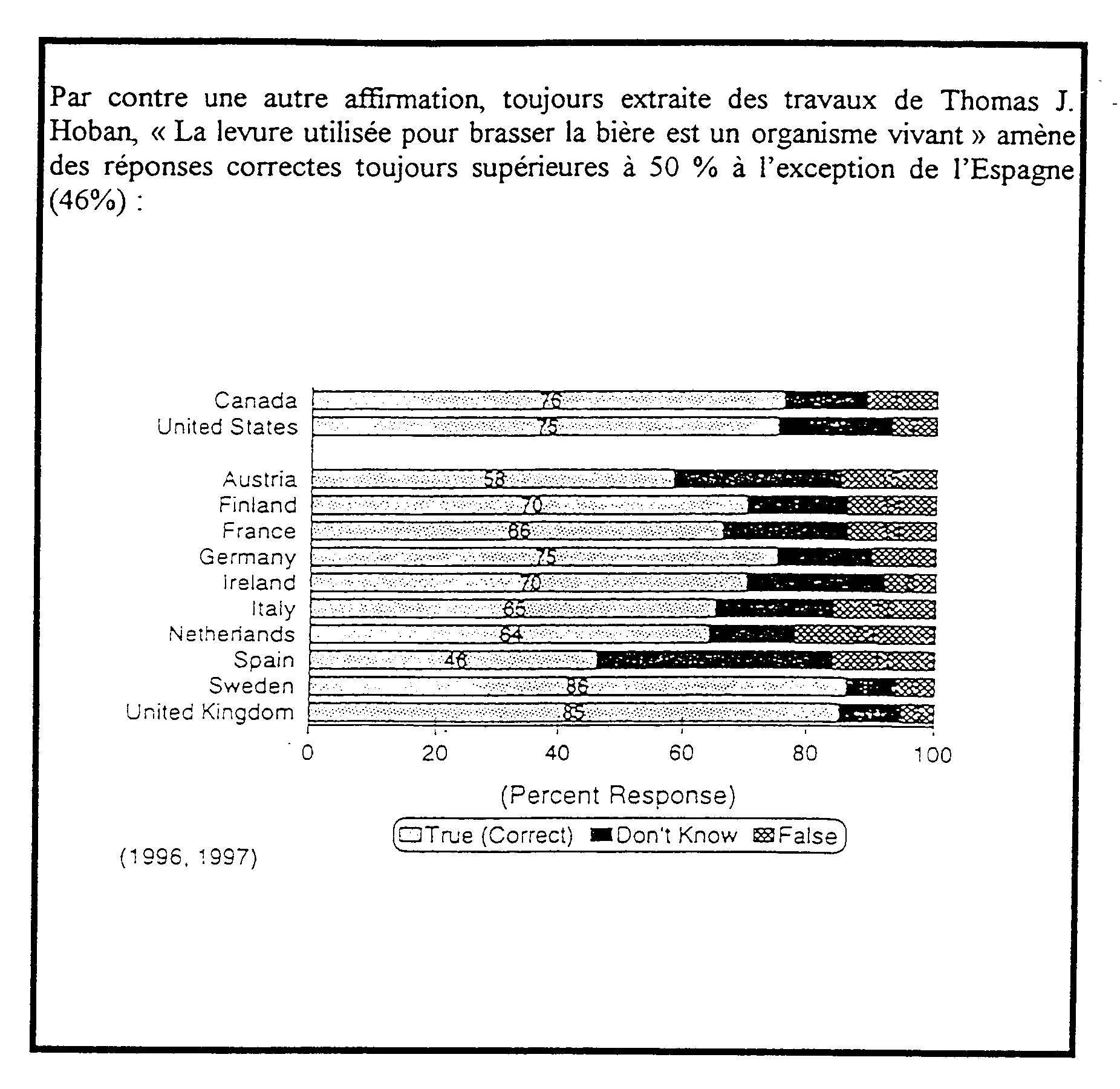
On peut se demander si le taux élevé de réponses correctes
n’est pas dû au fait que la bière est un produit des biotechnologies
traditionnelles dont l’existence est plurimillénaire. On peut penser que cela
n’émeut personne de savoir que des organismes vivants interviennent dans sa
fabrication. On aurait sans doute des réponses de même qualité, en France tout du
moins, concernant les fromages au lait cru qui contiennent, rappelons-le, un milliard de
micro-organismes par gramme.
A part ces réponses concernant la bière, on ne peut qu’être
surpris par le degré d’ignorance sur ces sujets de biologie.
Enfin on mentionnera que selon un sondage récent publié le 20 mai
dernier, 46 % des personnes interrogées n’ont pas entendu parler ou ne connaissent
pas, ne serait ce que de nom, des aliments transgéniques.
Ce chiffre corrobore les informations fournies par un certain nombre
d’enquêtes faites dernièrement en Europe et en France sur le niveau de connaissance
des organismes génétiquement modifiés.
Celles-ci font ressortir en général :
- un niveau de connaissances scientifiques plutôt insuffisant pour
comprendre et appréhender l’univers des biotechnologies, et notamment des
modifications génétiques,
- une ignorance des problèmes posés par les organismes
génétiquement modifiés du point de vue de la législation en France et en Europe,
- une connaissance floue quant à la nature des produits alimentaires
pouvant être concernés par cette technique.
Cette dernière méconnaissance paraît d’autant plus grave
qu’actuellement, de façon tout à fait légale, sont commercialisés en France un
certain nombre d’enzymes, d’additifs alimentaires et d’auxiliaires de
fabrication d’aliments issus d’organismes génétiquement modifiés utilisés
dans les industries agro-alimentaires.
La liste non exhaustive de ceux-ci est la suivante :
- pour l’hydrolyse de l’amidon, de la bière et de
l’alcool :
· a -amylase de Bacillus
licheformis modifiée par recombinaison homologue,
· a -amylase de Bacillus
licheformis contenant le gène de Bacillus steraothermophilus
- pour la panification et les sirops de maltose :
· exo-a -amylase
maltogène de Bacillus subtilis contenant le gène de Bacillus
steraothermophilus
- pour la bière et l’alcool :
· a
-acétolactate décarboxylase de Bacillus subtilis contenant le gène de
Bacillus brevis
- pour les hydrolysats de protéines :
· chymosines recombinées produites par Kluyveromyces
lactis, Aspergillus niger et Escherichia coli.
Nonobstant ces auxiliaires technologiques utilisés pour la production
de produits alimentaires, il est notoire que de nombreuses spécialités pharmaceutiques
sont fabriquées par des micro-organismes recombinants. On peut ainsi citer :
l’insuline, l’hormone de croissance, l’érythropoïétine, les
interférons, le vaccin contre l’hépatite B. Le vaccin antirabique à usage
vétérinaire est produit de la même façon.
On notera qu’un certain nombre d’additifs à usage
alimentaire pour les animaux, thréonine, tryptophane et lysine, sont d’ores et
déjà produits par des bactéries recombinantes.
Enfin, la lécithine de soja disponible actuellement provient pour
l’essentiel de soja modifié génétiquement aux Etats-Unis, ce qui conduit certains
industriels de l’agro-alimentaire l’utilisant comme Nestlé, à étiqueter
" contient des O.G.M. ".
b - Les consommateurs français sont réservés sur les produits
alimentaires transgéniques. Quel bénéfice pour le consommateur ?
Toutes les études dont on peut disposer montrent que nos compatriotes
sont plutôt réservés quant à l’achat de produits alimentaires issus de procédés
mettant en œuvre des techniques de trangenèse. " Les consommateurs
n’ont jamais été demandeurs d’O.G.M. " indique le panel.
Par contre, l’utilisation des produits pharmaceutiques obtenus par
génie génétique ne trouble absolument personne. Il semble bien que nous sommes là
devant une appréciation très différenciée de ces deux situations. Lorsque sa vie est
en danger chaque être humain est prêt à utiliser toutes les ressources possibles pour
recouvrer une bonne santé. Par contre l’alimentation, porteuse, au moins en Europe
et en France, de plaisir et de joie de vivre fait partie de notre tradition et de notre
culture. Elle ne doit pas être soupçonnée de pouvoir nuire à la santé. Les
" nourritures artificielles " sont à proscrire.
Cette dernière attitude peut aussi être mise au passif des
industriels de l’agro-alimentaire qui utilisent les matières premières pour
fabriquer les produits finaux.
En effet ceux-ci ne semblent pas disposés à faire preuve
d’esprit d’initiative. A l’exception notable de la firme Nestlé qui vient
de commercialiser un plat cuisiné contenant des protéines de soja génétiquement
transformé, les autres industriels de l’agro-alimentaire refusent de mettre sur le
marché de tels produits arguant du refus par la clientèle de ces produits.
Il est vrai que j’ai eu connaissance par un fabricant de semoule
de maïs des conditions mises à la conclusion de contrats de livraison de ce produit.
Comme on peut le voir en annexe, les clients exigeaient la garantie que la semoule de
maïs livrée serait non transgénique. La conséquence est que ce fabricant a reconnu
devant moi avoir alors averti ses fournisseurs agriculteurs qu’il n’accepterait
pas la livraison de maïs génétiquement modifié. En conséquence ces agriculteurs ont
renoncé à planter du maïs Bt de Novartis. C’est ce qui explique qu’il
n’y ait que 2 000 hectares de maïs transgénique de planté en France en 1998.
Si l’on peut comprendre ces réticences des industriels situés
tout au long de la chaîne de production des denrées alimentaires, il n’en reste pas
moins que ceux-ci, par ailleurs, s’affirment convaincus des qualités intrinsèques
des techniques de transgénèse. Le problème est qu’une sorte de cercle vicieux peut
avoir tendance de ce fait à se mettre en place. On a ainsi l’impression
d’assister à une épreuve de vitesse cycliste où les concurrents font du surplace
avant de se lancer éperdument dans le sprint final.
En effet, la frilosité, pour ne pas dire plus, des industriels de
l’agro-alimentaire a certainement pour conséquence d’aviver les soupçons des
consommateurs quant à l’innocuité des aliments transgéniques.
Il conviendrait à mon sens que, à l’instar de Nestlé, ceux-ci
proposent de tels produits aux consommateurs. Cela constituerait une sorte de test en
vraie grandeur sur les réactions du public.
Je pense à ce propos que les entreprises qui ont pris
l’initiative de mettre sur le marché les premières plantes transgéniques
n’ont pas fait preuve de beaucoup d’habileté.
Car il faut bien reconnaître que les actuels végétaux
génétiquement transformés ne possèdent rien qui puissent séduire les consommateurs.
En effet l’auto-protection du maïs contre la pyrale ne dit certainement pas grand
chose à bon nombre de nos concitoyens qui, certainement, ignoraient et ignorent sans
doute tout de cet insecte.
Il paraît évident qu’on ne séduira pas le grand public si
celui-ci ne bénéficie pas d’un quelconque avantage, que cela soit en termes de prix
ou encore de qualités gustatives, organoleptiques ou nutritionnelles. C’est le
chemin emprunté par la firme Calgene en mettant au point la fameuse tomate
" FlavrSavr " à pourrissement retardé. Lancée en 1994, cette
dernière avait eu de prime abord un certain succès qui ne s’est pas confirmé
compte tenu de sa très médiocre qualité intrinsèque.
Par contre un contre-exemple est fourni dans ce domaine par la
politique de la firme britannique Sainsbury qui a mis sur le marché en Grande-Bretagne
une boîte de purée de tomates génétiquement modifiées fabriquée aux Etats-Unis et
indiquée comme telle sur l’étiquette. Sainsbury a eu comme politique commerciale de
baisser le prix de ce produit et de le proposer à la vente au côté d’une autre
boîte de purée de tomates, cette fois non génétiquement modifiées, mais vendue plus
chère. Le succès a été au rendez-vous.
Les réserves plus importantes en Europe envers les produits
alimentaires issus de plantes génétiquement modifiées peuvent aussi s’expliquer
par la place différente de l’alimentation dans la psychologie collective.
En effet, comme le souligne avec beaucoup de pertinence M. Axel Kahn,
l’alimentation a un statut culturel symbolique très particulier. Celui-ci note que
" l’aliment est appréhendé par le consommateur, au même titre que
l’air que l’on respire, comme ce produit naturel que l’on doit consommer
pour continuer à vivre. De plus, l’aliment véhicule un mode de vie, des traditions
et une culture. De ce fait, au delà même des questions d’innocuité, existe une
réaction a priori défavorable aux aliments " non naturels ".
En quelque sorte, l’alimentation est vue comme ce produit de nature que la Terre
offre à ses enfants pour leur permettre de vivre et de s’épanouir. "
Je suis tout à fait en accord avec cette opinion lorsqu’il
considère que ce sentiment de l’aspect naturel de la nourriture actuelle est "
[...] aujourd’hui largement mythique [dans la mesure où] près de 80% de
l’alimentation des citoyens des pays développés correspond à des produits plus ou
moins transformés par l’industrie agro-alimentaire. "
En fait les attentes fondamentales des consommateurs vis-à-vis de
leurs aliments peuvent être regroupées en six sous-ensembles : l’attrait sensoriel,
la sécurité, la santé, la disponibilité, la commodité et l’acceptabilité
sociale.
On ne commentera pas toutes ces motivations mais je ne
m’attarderai que sur deux d’entre elles : la sécurité et l’acceptabilité
sociale.
La sécurité concerne l’innocuité d’un aliment.
Il faut noter que le moindre doute dans ce domaine, qu’il soit
lié à l’aspect, aux conditions de stockage, à des risques de contamination, à
l’absence d’information ou de garantie est une condition suffisante de rejet
d’un produit quel qu’il soit.
De ce point de vue il faut déplorer, comme la quasi totalité de mes
interlocuteurs l’a fait, qu’une succession d’affaires
dramatiques, complètement dépourvues de liens avec les plantes génétiquement
modifiées, se soient produites dans un passé récent : affaire du sang contaminé, de
l’hormone de croissance et de l’encéphalopathie spongiforme bovine et,
aujourd’hui celle de la dioxine dans la viande. Il est indéniable que celles-ci ont
certainement très fortement influencé négativement nos concitoyens. Ceux-ci ont
certainement dans leur grande majorité assimilé de façon tout à fait abusive, les
techniques de transgénèse à ces malheureuses et dramatiques affaires.
L’acceptabilité sociale d’un aliment résulte de nombreux
facteurs d’ordre culturel et éthique. Selon la nature et la force de la contrainte
correspondante, un produit pourra être activement recherché, facilement accepté ou au
contraire totalement exclu du registre alimentaire d’une population ou d’un
groupe social particulier. L’expérience montre que les produits alimentaires issus
de plantes transgéniques ne posent pas de problème d’acceptabilité particulière
aux Etats-Unis mais qu’elles en posent beaucoup de ce point de vue en France et en
Europe en général.
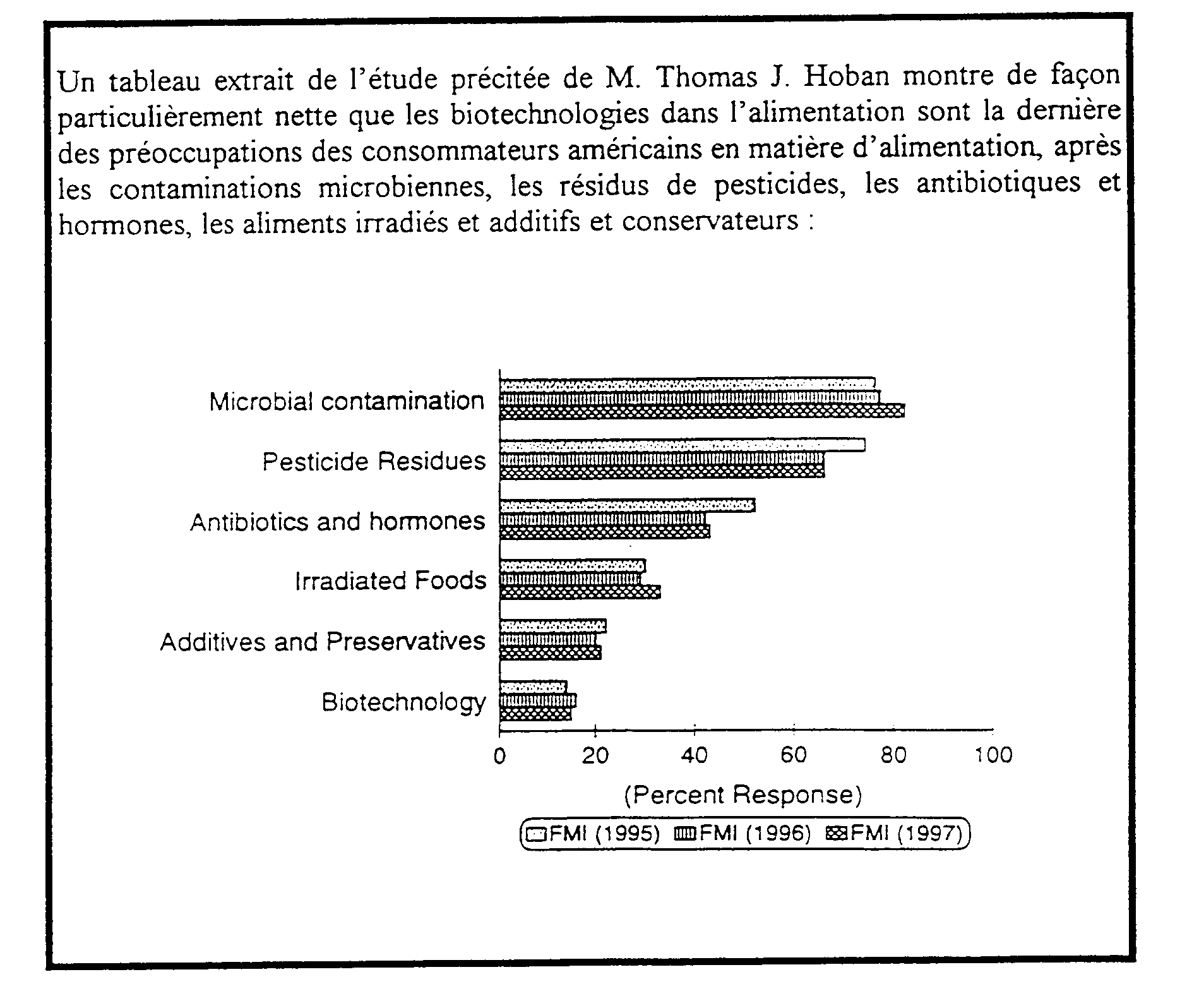
Il semble que l’une des exigences très importantes des
consommateurs est de pouvoir conserver le libre choix en la matière.
B - Conserver le libre choix. Le consommateur veut
choisir ce qu’il mange
Assurer le libre choix des consommateurs apparaît tout à fait
indispensable car il appartient à chacun de disposer de toutes les informations possibles
afin que le choix majeur qu’est la nourriture puisse être effectué avec le maximum
de transparence. C’est en tout cas le vœu de Mme Marie-José Nicoli, Présidente
de l’U.F.C.-Que Choisir qui a déclaré lors des tables rondes que les consommateurs
souhaitaient " [...] obtenir un maximum d’information et une bonne
traçabilité pour exercer nos droits fondamentaux [...] qui sont des droits à
l’information et au libre choix ".
Pour que ce choix puisse être fait, il est nécessaire d’assurer
l’information de consommateurs, celle-ci se faisant de façon privilégiée par
l’étiquetage. Celui-ci entraîne dans ce domaine un certain nombre de difficultés,
la situation européenne ayant été marquée par un certain nombre de tergiversations
avant la décision du 26 mai dernier, cette dernière n’ayant pas cependant aplani
toutes les difficultés.
a - L’étiquetage
L’étiquetage de ces produits est une revendication récurrente
des mouvements de défense des consommateurs.
Il convient de rappeler de ce point de vue que les Pouvoirs publics ne
sont pas restés inactifs dans ce domaine. En effet l’exigence de transparence avait
été rappelée par deux avis publiés au Journal Officiel du 2 février 1997. Le respect
de ces exigences avait d’ailleurs fait immédiatement l’objet de contrôles tout
au long de la filière de l’alimentation animale où ces produits étaient déjà
utilisés.
Le débat sur l’étiquetage allait durer tout au long de
l’année 1997.
Comme le note M. Egizio Valceschini, économiste à l’I.N.R.A., la
difficulté du débat sur l’étiquetage est dû à la confusion de deux questions :
- la première concerne la protection de la santé des
consommateurs : il s’agit là de la sécurité hygiénique et sanitaire,
l’exigence fondamentale étant naturellement la préservation de la santé,
considérée avec raison comme un bien inaliénable et constituant in fine une
responsabilité de la puissance publique;
- la seconde a trait à l’information des consommateurs : il
s’agit là de la connaissance du produit par l’acheteur dans une économie
marchande. L’objectif est la loyauté des transactions et la garantie donnée au
consommateur que l’information donnée par le vendeur est honnête, exacte et
complète. Cette connaissance des produits facilite l’appréciation, la comparaison
et le choix des produits. Les pouvoirs publics interviennent également dans ce domaine,
par l’intermédiaire de la réglementation de l’étiquetage, pour assurer la
véracité des informations délivrées.
Je me suis rendu compte au cours de mes auditions qu’il y avait
parfois une tendance à la confusion entre ces deux questions.
Ma position sur ce problème est dictée par les considérations
suivantes :
- il est extrêmement clair que si un produit est avéré comme
étant dangereux, le problème de l’étiquetage ne se pose pas : ce produit doit
être interdit à la vente;
- s’il n’est pas dangereux et ne pose pas de problèmes
éthiques particuliers, il n’y a aucune raison qu’il soit interdit : il doit
donc être autorisé à la vente, l’étiquetage étant alors une modalité de
l’information des consommateurs.
Cet étiquetage doit être très clair et non pas, comme je l’ai
vu en Suisse, écrit en caractères minuscules quasiment illisibles. Il doit à mon sens
ressembler peu ou prou à l’étiquette sur fond jaune apposée sur la boîte de
purée de tomates transgéniques commercialisée en Grande-Bretagne par Sainsbury dont je
donne ci-après un fac simile :
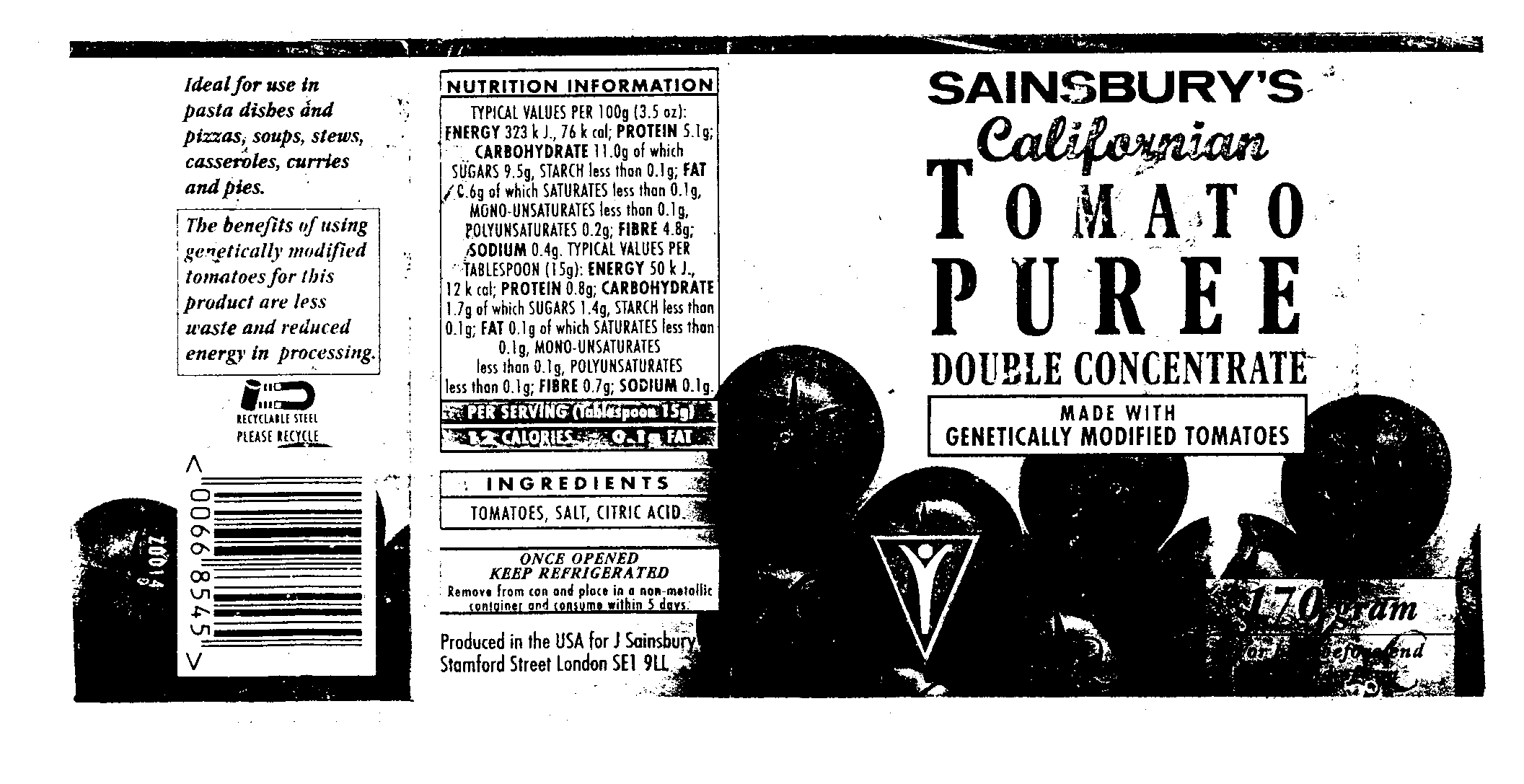
Cet exemple me semble devoir être celui qui doit être suivi en
matière d’étiquetage clair.
La liberté de choix des consommateurs entraînera aussi la nécessité
de créer des filières séparées spécialisées dans la production
d’aliments non génétiquement modifiés. Celles-ci pourraient
bénéficier d’un label comme il en est délivré un pour les produits respectant
le cahier des charges de l’agriculture biologique.
Mais l’étiquetage implique de connaître exactement la
composition du produit. La présence d’organismes génétiquement domaine modifiés
peut être difficile à mettre en évidence.
b - Les difficultés entraînées par l’étiquetage
Comme nous l’évoquerons de nouveau par la suite, il convient
d’indiquer si un produit contient ou ne contient pas d’organismes
génétiquement modifiés, toutes autres mentions n’étant en définitive que
trompeuses. Cependant le problème est de connaître et de contrôler la présence desdits
organismes génétiquement modifiés. L’étiquetage implique donc l’organisation
de la traçabilité afin de connaître le " circuit commercial du produit de la
fourche à la fourchette ".
Pour effectuer cette détection il est fait habituellement recours à
une méthode connue sous ses initiales : P.C.R. pour Polymerase chain reaction, en
français : réaction de polymérisation en chaîne.
La réaction de polymérisation en chaîne est une technique
d’amplification in vitro. Elle permet d’obtenir, à partir d’un
échantillon complexe et peu abondant, d’importantes quantités d’un fragment
d’A.D.N spécifiques de séquence et de longueur définies. Cette méthode a été
mise au point en 1985.
La mise en œuvre des techniques de détection se fait en utilisant
des sondes représentant une petite partie des séquences présentes dans les
constructions, le contrôle précis de la présence d’un organisme génétiquement
modifié particulier ne pouvant se faire que si l’on dispose de la sonde spécifique.
Le contrôle de la présence d’un organisme génétiquement
modifié peut se faire de façon assez facile compte tenu du fait que les obtenteurs ont
utilisé jusqu’à maintenant à peu près tous les mêmes gènes et les mêmes
outils.
Par contre, si on évoque les plantes transgéniques qui seront mises
au point d’ici deux ou trois ans la situation est bien plus complexe. " Un
très grand nombre de plantes sont concernées avec un très grand nombre de combinaisons
toutes spécifiques. Si la détection d’un transgène connu ne posera pas de
problème, la mise en évidence d’un éventuel transgène inconnu ne sera pas
possible de manière certaine du fait de l’absence de gènes marqueurs de sélection
et de l’existence de promoteurs et gènes d’intérêt d’origine végétale
souvent issus dorénavant de la même espèce que celle transformée [...] "
(Alain Coléno, rapport au ministre de l’agriculture).
Outre ces difficultés, cette technique est la propriété d’une
société, Perkin-Elmer, qui l’a brevetée. Ainsi chaque emploi de la P.C.R.
implique-t-il le versement de redevance à cette société.
Cette technique a donc un coût qui n’est pas du tout
négligeable. Elle est évaluée à 1 600 F hors taxe par analyse, prix coûtant pour un
laboratoire public. D’autres chiffres m’ont été cités par des laboratoires
privés et s’établissent entre 2 400 F et 5 600 F par opération, selon le degré de
rapidité exigé pour disposer des résultats.
C’est donc une opération onéreuse.
Un séminaire européen I.L.S.I. sur les méthodes analytiques
applicables pour la mise en œuvre de la directive " Aliments
nouveaux " s’est tenu récemment à Bruxelles du 3 au 8 juin dernier sur
les difficultés de généralisation des techniques quantitatives de PCR. Tous les
participants ont reconnu que ces méthodes étaient indispensables pour doser les
éléments dont la teneur en O.G.M. est supérieure à un seuil réglementaire. Comme
l’a indiqué M. Jean-François Molle, l’université de Berne, et la société
allemande Gene Scor ont développé cette technique. J’ai l’impression que du
côté des commissions, on a mis la charrue devant les bœufs. Je recommande donc
qu’une prochaine réunion européenne soit consacrée à ces techniques pour décider
comment imposer à des industriels l’étiquetage pour mieux informer le consommateur
si le mode d’emploi n’est pas clairement expliqué.
Le problème se posera donc de savoir qui supportera le coût de ces
analyses. Les mouvements de consommateurs, et notamment Mme Marie-José Nicoli, estiment
que ce sont les industriels utilisant les techniques de transgénèse qui doivent
intégrer ces coûts dans le prix des produits élaborés par trangénèse, Ces derniers
jugent au contraire que ce seront les aliments non produits par génie génétique qui
devront en quelque sorte " payer " pour leur originalité, de la même
façon qu’un produit de l’agriculture biologique est sensiblement plus
dispendieux qu’un aliment courant.
Un autre problème soulevé est la sensibilité de cette technique. Le
seuil de détection est d’environ de 10-3, ce qui permet de détecter une
graine génétiquement modifiée sur 1 000 graines normales. Il faut aussi considérer que
la finesse de détection croît de façon importante. Cela risque à terme de rendre
mensongère la mention " ne contient pas d’O.G.M. "dans la mesure
où la séparation totale des filières ne pourra jamais être parfaite. Mais, comme je
l’ai indiqué plus haut, autant les analyses qualitatives sont-elles devenues
possibles, autant les analyses quantitatives sont-elles encore très difficiles.
Une autre méthode de détection consiste à rechercher la protéine
exprimée par le transgène. On utilise alors des tests classiques, comme par exemple
ELISA, qui ne donnent cependant pas des résultats aussi sensibles que la P.C.R.
Une grave difficulté présentée par la méthode de P.C.R. est
qu’il faut savoir ce que l’on cherche pour pouvoir le trouver.
Il est en effet indispensable de disposer des amorces servant à
amplifier le transgène cherché. Je préconise, comme le panel de citoyens, de rendre
obligatoire la fourniture des amorces nécessaires au contrôle. Cela pourrait constituer
une solution à court terme mais ne supprimerait pas les difficultés de l’arrivée
de plantes génétiquement modifiées en provenance de certains pays où la fraude peut
être facile. Les mélanges au cours des opérations de transport compliqueront encore
fortement ce problème. Enfin le problème risque de devenir insoluble lorsque des
centaines d’amorces différentes auront pu être introduites dans des plantes. La
complexité sera telle que les analyses systématiques seront impossibles. Il faudrait
donc se fier aux déclarations de différents intervenants tout au long de la filière
commerciale. C’est ce qui fait dire à M. Michel Edouard-Leclerc, lors des auditions
publiques, " [...] sur mes produits, dès qu’il y aura une trace, je
mettrai l’étiquetage O.G.M. [...] Aujourd’hui je préfère prendre les devants
et dire O.G.M. ".
Une autre difficulté réside dans l’absence de toute trace de
transgène dans un certain nombre de produits issus de plantes transgéniques.
Il en est par exemple ainsi dans l’huile obtenue à partir de soja
transgénique dans la mesure où le processus de purification a éliminé toute trace de
transgène. Cette huile est ainsi strictement semblable à une huile issus de soja
classique. Cependant lors du séminaire I.L.S.I. déjà cité, un intervenant de la
société néerlandaise Rikilt a assuré que la technique qu’il utilisait avait
permis de détecter de l’A.D.N. transgénique dans de l’huile de soja, alors que
la société Nestlé estime que les préparations enzymatiques purifiées, l’huile
végétale raffinée, les dérivés d’amidon, les saccharoses, les produits ayant
subi des traitements thermiques élevés ne contiennent pas d’amidon amplifiable.
Contrairement à certains, je suis d’avis qu’il n’est pas nécessaire
d’étiqueter ce type de produit comme contenant des organismes
génétiquement modifiés, puisqu’il n’y en a pas, ou des quantités
infinitésimales. Ils devraient donc apparaître sur la liste négative dispensée
d’étiquetage.
Les filières de production séparées dont j’ai préconisé plus
haut la création devraient être complètement étanches, ce qui est bien entendu
impossible. Car il y aura inévitablement des " contaminations "
engendrées par les méthodes de récolte et de transport. Ce qui aura pour conséquence
que des produits présentés comme ne contenant pas d’organismes génétiquement
modifiés en contiendront.
Le résultat de ce type de difficultés est que l’étiquetage
" ne contient pas " finira pas ne pas représenter la réalité de la
situation, ce qui pourra engendrer des conflits juridiques pour tromperie sur la
marchandise.
Il convient donc de prévoir qu’il y aura un seuil de tolérance
sur le produit de base (grains et graines) que je préconise comme devant être fixé à
2%.
Il faut bien insister sur le fait que ce seuil est recommandé aux
seules fins de l’étiquetage afin de prévenir les conflits juridiques, compte tenu
des aléas des modes de production et de transport et des difficultés de détection. Il
ne constitue en aucune façon une information de caractère sanitaire.
c - Les tergiversations européennes en matière d’étiquetage qui
ont mis " la charrue avant les bœufs.
Les principes de l’étiquetage ont été définis au niveau
communautaire par le réglement n° 258/97 sur les " nouveaux aliments et
nouveaux ingrédients alimentaires " du 27 janvier 1997 et entré en vigueur le
15 mai 1997. Selon cette réglementation, tous les produits alimentaires bruts issus du
génie génétique doivent être étiquetés. Il en va de même pour les produits
alimentaires reconnus comme " non équivalents ". Il convient de
rappeler qu’en étaient exclus les additifs alimentaires, les arômes destinés à
être employés dans les denrées alimentaires, les solvants d’extraction utilisés
pour la production des denrées alimentaires ainsi que les aliments et ingrédients
alimentaires traités par rayonnements ionisants.
Le problème est que les critères permettant de classer les divers
produits en entre " équivalents " et " non
équivalents " n’ont pas été déterminés. Il en est résulté une grande
confusion, personne ne sachant comment il fallait procéder pour rédiger les étiquettes,
la Commission européenne renvoyant à des précisions jamais élaborées.
Certains industriels en vinrent à élaborer leurs propres critères,
comme Nestlé aux Pays-Bas. D’autres se sont retranchés derrière ces imprécisions
pour refuser de mettre sur le marché des produits alimentaires génétiquement modifiés.
Cette situation a duré beaucoup trop longtemps dans la mesure où un
accord entre pays européens n’a pu se faire que le 26 mai dernier.
c - La décision du 26 mai 1998
Les décisions prises sont les suivantes :
- Suppression dans les modalités d’étiquetage de l’option
" peut contenir des organismes génétiquement modifiés ", seules les
mentions " contient " ou, facultativement quand la preuve scientifique
est faite, " ne contient pas " étant prévues. La Commission
prévoyait de rendre obligatoire cette option en cas d’incertitude sur la présence
d’organismes génétiquement modifiés dans le produit final compte tenu de
l’absence de ségrégation entre les plantes transgéniques et conventionnelles au
moment de la récolte. Il apparaît que dans l’esprit du Conseil, cette suppression
contraindra le producteur final à procéder, dans tous les cas, à une analyse du produit
fini pour déterminer s’il existe ou non des traces de protéines ou d’A.D.N.
modifié. La question du seuil de détection reste toujours posée.
- Introduction du principe d’une liste d’aliments et
ingrédients alimentaires à base de soja ou de maïs transgénique exemptés de
l’obligation d’étiquetage spécifique que la Commission sera chargée
d’établir sur la base d’avis scientifiques.
Il convient de noter que c’est uniquement le principe de cette
liste qui a été posé, celle-ci étant à l’heure actuelle vide.
- Allongement du délai d’entrée en vigueur du réglement porté
à 90 jours après sa publication au Journal Officiel au lieu de 20 jours.
La position de principe est satisfaisante. Certes cela risque
d’alourdir les obligations des producteurs finaux à qui incombera l’obligation
d’étiqueter. Il faut néanmoins faire attention au fait que certains de ces petits
producteurs finaux seront peut-être parfois tentés de faire figurer la mention
" contient des organismes génétiquement modifiés " sans faire
vérifier la réalité de cette affirmation. Ils pourraient de ce fait être poursuivis
pour tromperie sur la marchandise. Une telle attitude, si elle se généralisait,
aboutirait à l’apposition universelle de la mention " contient des
O.G.M. ". Cela reviendrait à enlever tout caractère informatif réel à
l’étiquetage.
Une solution à ce problème est la liste d’exemptions qui est le
moyen trouvé par certains Etats pour alléger les coûts de ces producteurs finaux.
Il serait également possible de faire figurer dans cette liste des
produits comme l’huile de soja transgénique à laquelle nous avons déjà fait
allusion. Il conviendra aussi que cette liste ne reste pas vide. Il sera donc important de
voir quand et comment elle sera précisée et sur quels critères seront définis les
produits exempts d’étiquetage.
Enfin on notera que l’étiquetage n’est certainement pas la
seule façon d’informer les consommateurs et les citoyens. Une autre voie peut être
trouvée dans le débat informatif. La Conférence de citoyens qui vient de s’achever
en est un exemple.
Il ne faut pas que cette forme de débat reste centralisée à Paris.
Il doit être démultiplié dans toute la France. On pourrait ainsi organiser des
Conférences régionales sur ce thème qui devraient débuter à l’automne prochain.
d - Les difficultés internationales à venir
Il faut être conscient du fait que le choix européen en faveur de
l’étiquetage risque d’entraîner des difficultés avec les Etats-Unis, le
Canada et l’Argentine. Comme j’ai pu le constater lors de ma mission dans ce
pays, les responsables de ce pays ne comprennent pas les raisons pour lesquelles les
consommateurs européens souhaitent cet étiquetage. Cette mesure leur apparaît comme un
obstacle non tarifaire opposé au libre commerce des produits transgéniques.
Il faut cependant noter la récente déclaration à la revue La
Recherche de M. Hendrick A. Verfaillie, Président de Monsanto, que j’ai
rencontré aux Etats-Unis.
Après avoir réaffirmé que l’étiquetage des produits issus de
plantes transgéniques n’était nécessaire que dans le cas de valeur nutritionnelle
différente d’avec les aliments classiques, il a admis que si tel était le souhait
des consommateurs, il l’accepterait " à condition qu’il soit
transparent, basé sur une bonne science et sérieux. "
Il convient de prendre acte de cette déclaration en demeurant
conscient que certains de ces propos sont de nature à porter facilement controverse...
Malgré ces réticences, je reste partisan d’un étiquetage clair
car le consommateur doit pouvoir choisir ce qu’il mange et de disposer de tous les
éléments informatifs : composition de l’aliment, valeur nutritionnelle, pouvoir
calorique, origine, modification par transgénèse, ... L’exemple concernant la
composition d’un produit surgelé (des "cannelloni ") vendu en
France est à ce titre très intéressante. Je ne suis pas sûr que le consommateur a pris
clairement conscience de l’évolution actuelle de l’agro-alimentaire où
beaucoup d’aliments deviennent des recompositions associant des produits de base et
d’additifs.
CONCLUSION
A l’issue de ces réflexions sur l’utilisation des organismes
génétiquement modifiés en agriculture et en alimentation, je reste frappé par le
refus, de la part de nombre de nos concitoyens, de l’utilisation des techniques du
génie génétique pour l’élaboration des aliments alors qu’elles sont tout à
fait acceptées pour la fabrication des médicaments ou par la thérapie génique.
Certes, comme on l’a vu, l’être humain est prêt, à juste
titre, à beaucoup de choses pour sauver sa vie. Mais il y a là ce que je ressens comme
une contradiction difficile à comprendre au fond.
J’estime donc que ces techniques, acceptées pour sauver la vie,
ne doivent pas être suspectées de menacer l’intégrité de cette vie, dès lors
qu’elles sont employées pour élaborer des aliments.
Plus profondément, je redoute en effet, à entendre ou à lire
certaines déclarations sur la transgénèse, une montée de l’obscurantisme. A cet
égard on ne peut que se féliciter du refus du texte soumis à la
" votation " suisse. Il est hors de doute que nos voisins ont refusé
celui-ci car allant trop loin en supprimant toutes possibilités de recherches, y compris
dans le domaine médical. Or tout le monde sait parfaitement que les progrès en matière
de lutte contre les maladies passeront nécessairement par les techniques du génie
génétique.
La science et la technique ne sont pas toutes blanches ou toutes noires
: il faut se départir de cette vision manichéenne car elles ne sont que ce qu’en
font les êtres humains.
De ce point de vue ces controverses auront peut-être été utiles dans
la mesure où les scientifiques et les industriels en tireront sans doute quelques
enseignements et, notamment, celui d’apprendre à mieux tenir compte des réactions
de la société face à leurs travaux.
En effet science et technique sont devenues des enjeux majeurs des
sociétés contemporaines. En démocratie, la conscience de ceux-ci ne concerne plus
seulement ses acteurs directs mais le corps social tout entier. Ceci est dû au fait que
les avancées scientifiques deviennent proprement vertigineuses, notamment quand on
considère ces possibilités croissantes de transférer à n’importe quel organisme
vivant n’importe quel gène d’un autre organisme vivant.
J’ai peine à imaginer que la France, qui a été, dans tant de
domaines, à l’avant garde de la recherche scientifique et technique, rejette ces
technologies qui sont celles du futur.
Le panel de citoyens l’a bien compris lorsqu’il déclare :
" Chacun a pu se rendre compte à travers cette expérience qu’il était
extrêmement difficile d’émettre des avis tranchés sur un sujet aussi
important " et alors qu’une partie du panel pense que si certaines
solutions ne sont pas résolues " il sera donc dans ce cas obligatoire
d’instaurer un moratoire pour la mise en culture des plantes
transgéniques ", une autre partie estime que " dans la
situation actuelle de l’agriculture, les O.G.M. pourraient représenter un atout, car
ils peuvent permettre un développement agricole qui serait intégré au niveau
local. ". Ceux-ci préconisent donc l’analyse au cas par cas en la
replaçant " dans l’ensemble des décisions déjà accordées et en tenant
" compte des expériences accumulées dans l’ensemble
agro-alimentaire ".
Je souhaite aussi très vivement qu’après la Conférence de
citoyens, la réflexion et le débat continuent dans le pays, à un niveau décentralisé,
comme je l’ai proposé.
Il faudra aussi nécessairement déboucher sur des décisions. Car je
m’alarme réellement quand je considère le retard que non seulement la France, mais
aussi l’Europe, accumulent vis-à-vis des Etats-Unis. Ainsi les entreprises
européennes n’emploient-elles qu’environ 30 000 personnes dans ce secteur alors
que le chiffre correspondant pour les Etats-Unis est de l’ordre de 120 000.
S’il faut refuser l’obscurantisme, il faut aussi accepter les
très légitimes demandes de sécurité de la part de nos concitoyens. C’est pour
cette raison que j’ai spécialement abordé dans ce travail la question des
éventuelles conséquences du développement et de la dissémination de ces plantes
transgéniques pour la sécurité aussi bien sanitaire que pour l’environnement.
C’est aussi pour répondre à la demande d’information que
j’estime très légitime que je préconise l’étiquetage des produits
alimentaires issus de ces plantes tout en préconisant la fixation d’un seuil afin de
tenir compte des problèmes de détection et de transports.
L’Europe possède un très important potentiel en matière de
biotechnologies. Elle ne doit pas laisser passer la chance de le développer sous peine de
prendre un retard qui deviendra vite complètement irrattrapable, sauf peut-être sur
certaines niches. A cet égard, l’exemple de la micro-informatique devrait très
fortement inciter à la réflexion sur les occasions perdues.
Pour avoir le soutien des citoyens européens, il faudra que soient mis
en place :
- une législation transparente dans le domaine des produits des
biotechnologies;
- un cadre juridique clair et accepté par tous concernant les
conditions d’importations et d’étiquetage des produits génétiquement
modifiés;
- un cadre juridique clair permettant de prendre des décisions rapides
et efficaces dans toutes les questions relatives à la sécurité des produits.
Un certain nombre de recommandations faites à l’issue de ce
travail peuvent s’intégrer dans ces domaines.
Puissent-elles favoriser la dissipation de la méfiance de nos
concitoyens envers les plantes transgéniques qui s’inscrivent dans la continuité de
l’œuvre humaine de maîtrise de la nature ! C’est le destin de l’Homme
de progresser sans cesse sur le chemin de la connaissance.
© Assemblée nationale |