PREMIÈRE PARTIE A LA RECHERCHE D'UNE NÉCESSAIRE CLARIFICATION (SUITE) II. - LES AIDES 2
2. - Un recours généralisé aux aides au sein de l'Union européenne et de l'OCDE 42 A. - La complexite du systeme francais On trouvera ci-dessous la liste des aides attribuées en France par la puissance publique en fonction des objectifs qu'elle souhaite atteindre. L'effort financier de l'État en faveur de l'aménagement du territoire représente des sommes très élevées qui ne se résument pas, loin s'en faut, aux seules aides aux entreprises, ce dont atteste le tableau récapitulatif ci-dessous, extrait de l'état des crédits affectés à l'aménagement du territoire annexé à la loi de finances pour 1999.
A cette liste de dispositifs, il faut ajouter plusieurs gammes d'aides spécifiques nombreuses, en faveur de zones particulières : elles visent des zones circonscrites du territoire national, qui souffrent de retards de développement particuliers. En bénéficient les DOM-TOM, la Corse, des villes et quartiers en difficulté dans le cadre du pacte de relance pour la ville. Les dispositions relevant de cette dernière loi sont réservées aux PME mais la majeure partie des autres sont ouvertes à toutes les entreprises. Si l'État n'est pas la seule source de financement, il détermine le zonage qui est suivi par l'ensemble des autres collectivités dans leurs attributions d'aides à l'aménagement du territoire. La PAT est le dispositif privilégié, mais les sommes en jeu sont modestes : 315 millions de francs en crédits de paiement pour 1999. Il ne faut donc pas exagérer son impact. Pourtant les entreprises situées en zone PAT peuvent bénéficier d'une série d'autres aides, financées par la DATAR ou dans le cadre de la loi d'orientation sur l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 (LOADT). Le zonage constitue donc un enjeu essentiel, l'appartenance d'un terrain à telle ou telle zone pouvant être un élément important pour un choix de localisation d'entreprise. Or le zonage demeure particulièrement complexe. Il existe quatre types de zone PAT industrie : partiellement éligible, à taux normal, à taux majoré et à taux dérogatoire -pour la Corse et la région de Longwy-. S'y ajoutent les zones de PAT tertiaire. La loi d'orientation sur l'aménagement et le développement du territoire prévoit dans son article 42 la définition des grandes zones, supports de politiques différenciées. Elle distingue les zones PAT (dites zones d'aménagement du territoire), les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP), les zones de revitalisation rurale (ZRR), les zones urbaines sensibles (ZUS), les zones de redynamisation urbaine (ZRU). Le pacte de relance pour la ville crée pour sa part des zones franches urbaines (ZFU). Enfin, la Commission européenne détermine les zones susceptibles de bénéficier des différents fonds structurels. On peut ainsi compter onze types de zonages d'intervention sur l'ensemble du territoire français, les entreprises de chaque zone étant éligibles à des aides différentes - on notera d'ailleurs qu'il n'y a que rarement deux aides destinées aux mêmes zones.
Si ce zonage complexe rend difficile la connaissance des aides pour les entreprises, se pose aussi le problème de son efficacité économique. Dans son rapport au Premier ministre relatif à la réforme du zonage et à l'aménagement du territoire, Jean Auroux en donne une appréciation nuancée. Il insiste en particulier sur la neutralisation des effets incitatifs attachés aux différentes aides juxtaposées. A propos des effets des aides sur l'investissement, il écrit : « Même si dans les discussions avec les élus les questions de taxe professionnelle et les aides sont souvent mis en avant par les investisseurs potentiels, il semble bien que dans la très grande majorité des cas, ces considérations ne soient pas les plus déterminantes ». Mais il ajoute aussitôt : « Cependant, et les expériences étrangères le montrent également, il est évident que l'absence d'aides zonées spécifiques auraient condamné a priori des implantations d'activités dans des régions disposant de moins d'atouts ou connaissant des crises économiques lourdes comme le Nord-Pas de Calais ou la Lorraine ». Il en conclut que l'efficacité d'une concentration des aides dépend moins de la pertinence du découpage géographique des zones que de la volonté politique d'aménagement. Il n'en demeure pas moins qu'une réforme doit être engagée, en cohérence avec la réforme des fonds structurels et la révision de la carte PAT. L'essentiel des aides a des formes fiscales, qu'elles soient financées par le budget de l'État ou par les collectivités locales. Cela garantit une certaine souplesse mais peut aussi conduire à un manque de transparence. La portée de diverses mesures fiscales semble extrêmement variable et une évaluation d'ensemble manque. Les aides à l'aménagement du territoire devraient pourtant - c'est leur raison d'être -, exercer une influence sur le choix du lieu d'implantation des entreprises. Si les aides visant d'autres objectifs peuvent avoir un rôle dans l'attractivité du territoire national, la politique d'aménagement du territoire est destinée à améliorer cette dernière dans les zones défavorisées du territoire national. Elles sont donc susceptibles de déterminer un certain nombre de localisations, et éventuellement de délocalisations, d'entreprises, en particulier lorsque leurs métiers n'exigent pas de sites précis. 2. - Stimuler l'investissement Une grande partie des aides à l'aménagement du territoire sont des aides à l'investissement. C'est dans de cadre, et dans celui de l'aide à la recherche et au développement, que l'État intervient pour soutenir l'investissement. Des stimulations directes à l'investissement existent hors de ces cas, mais sont le fait des seules collectivités locales. Leurs interventions sont régies par les lois de décentralisation qui distinguent les aides directes des aides indirectes. Les premières sont essentiellement les subventions, les bonifications d'intérêt et les prêts et avances accordés à des conditions plus favorables que le taux moyen des obligations -les Primes régionales à l'emploi et les Primes régionales à la création d'entreprise appartiennent à la catégorie des aides directes mais ne représentent que 1,4 % de leur montant, nous en parlerons à propos des aides à l'emploi-. Les rabais sur les ventes et locations immobilières font partie des aides indirectes. Enfin, les collectivités locales peuvent offrir garanties d'emprunt et cautionnements au titre des aides générales. Selon les informations de la direction générale de la comptabilité publique, parues dans les Notes Bleues de Bercy du 16 au 31 octobre 1998, les aides directes représentaient, en 1996, 11,283 milliards de francs, soit 80 % des aides totales, malgré une diminution de 2,2 %. En leur sein, les subventions atteignaient 8,2 milliards de francs, en hausse de 13,5 % : elles constituent la forme d'aide directe la plus utilisée. Les communes en ont versé plus du tiers, contre 25 % pour les départements et 40 % pour les régions. Les prêts et avances ont chuté de plus de 35 % entre 1995 et 1996, mais dépassent toujours deux milliards de francs. Le volume des achats de bâtiments et de terrains diminue de 11,3 % par rapport à 1995, à 639,4 millions de francs : ils ne représentent plus que 5,7 % des aides directes, 75 % des aides sous cette forme émanant des communes. Les bonifications d'intérêt ne dépassent pas 1,7 %. Montant et structure des aides directes par nature, en 1996 (en millions de francs)
Cette diminution des aides directes est compensée par l'augmentation des aides indirectes dont le volume total est de 2,554 milliards de francs. L'investissement a été stimulé par une hausse de 7 % des aménagements de zones industrielles, qui représentent près de 30 % des aides indirectes, par une augmentation des ventes à paiement échelonné (8,8 % du total) et par le développement des fonds de garantie. L'énorme volume des aides prenant d'autres formes montre l'imagination des élus locaux pour répondre aux désirs des entreprises susceptibles d'investir dans leur territoire, et la pression qui s'exerce sur eux. Montant et structure des aides indirectes par nature, en 1996 (en millions de francs)
On été accordés, en 1996, 11,192 milliards de francs de garanties d'emprunts et cautionnements à d'autres entreprises que les sociétés d'économie mixte : plus des deux tiers proviennent des communes, le reste des départements. Garanties d'emprunts accordées aux entreprises en 1996 (en millions de francs)
Les sommes consacrées par les collectivités locales aux aides à l'investissements des entreprises sont donc considérables : elles constituent en effet le moyen estimé prioritaire par des collectivités locales qui veulent attirer des investisseurs sur leur territoire. Les collectivités locales disposent aussi d'un instrument fiscal pour attirer les entreprises. Dans le cadre posé par la loi, elles fixent le taux de taxe professionnelle auquel les entreprises installées sur leur territoire sont soumises. Cette liberté est dans les faits limitée par la taille de la base : une collectivité locale abritant peu d'entreprises peut se trouver contrainte de fixer des taux élevés pour s'assurer des ressources suffisantes. Ce sont donc surtout les collectivités qui sont déjà les plus riches qui peuvent se permettre d'attirer les entreprises par des taux attrayants. Le problème se pose à chaque niveau de collectivité et est accru par l'existence de regroupements de communes bénéficiant d'une fiscalité propre. Ces derniers répondent parfois essentiellement à une volonté d'attractivité. Le Quinzième rapport au Président de la République du Conseil des Impôts est consacré à le taxe professionnelle et aborde ce problème à travers l'exemple de plusieurs groupes, parmi lesquels IBM France. Si M. Dufau, son président directeur général, se plaint d'avoir dû payer 250 millions de francs de taxe professionnelle en 1998, il n'en bénéficie pas moins d'un taux réduit dans le cadre d'une zone intercommunale. Le Conseil des Impôts présente ainsi la situation de cette entreprise : « Dans son implantation située en même temps sur deux communes à Corbeil et à Coudray, IBM doit faire face à de très forts écarts de taux qui vont du simple au double. S'il est difficile techniquement pour IBM de jouer sur la localisation des bases afin d'en faire basculer le plus possible dans la partie de son établissement située sur la commune la moins imposée, la décision d'investir dans la nouvelle ligne de production n'a été obtenue qu'avec l'assurance de la part des collectivités concernées de la création d'une zone intercommunale à taux réduit ». La direction du groupe IBM France l'a confirmé devant la commission d'enquête. M. Gilles Ragueneau, directeur des relations extérieures, a expliqué le fonctionnement de cette zone et mis l'accent sur son ouverture à d'autres entreprises : « Nous n'avons pas obtenu à proprement parler un abaissement de la taxe professionnelle mais la création d'une zone intercommunale qui est ouverte à toutes les entreprises désireuses de s'y implanter, entre le Coudray et Corbeil-Essonnes. C'est une zone qui est ouverte à qui veut bien venir y travailler et à laquelle s'applique un taux bas, de 5 % ». La fixation d'un taux de taxe professionnelle peu élevé, dans une partie du territoire, a en fait les mêmes effets que l'octroi direct d'une aide à l'entreprise concernée, et devient un enjeu de négociation entre les collectivités locales et les entreprises susceptibles d'investir sur leur territoire : la pression qu'elles exercent est très forte. Le thème de la défense de l'emploi a été largement traité dans de nombreux rapports, et en particulier dans celui de la commission d'enquête présidée en 1996 par M. Michel Péricard et dans le très récent rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques dirigé par M. Gérard Bapt et intitulé Les aides publiques aux entreprises en matière d'emploi : bilan et perspectives. Parmi les aides à l'emploi, on peut distinguer les dispositifs généraux des aides visant la prévention et l'aménagement du territoire et des mesures d'aide à la réduction du temps de travail. Comme l'illustre le tableau simplifié présentant les dispositifs généraux, deux dispositifs créés dans le cadre du Pacte de relance pour la ville consistent en des allégements de charges sociales. Les allégements spécifiques concernent les premiers salariés de PME situées dans certaines zones. Tous suivent une logique comparable à celle qui a abouti aux exonérations de charges sur les bas salaires. Cette réduction dégressive de cotisations sociales patronales sur les bas salaires, jusqu'à 1,3 SMIC, communément appelée « ristourne dégressive », représente 42,725 milliards de francs de crédits de paiement dans la loi de finances pour 1999 (ch.44-77, art.30). Outre l'effet de seuil à 1,3 SMIC, en partie gommé par sa dégressivité, la ristourne crée le risque d'un resserrement volontaire des rémunérations à proximité du salaire minimum, ce qui revient à « tirer les salaires vers le bas ».
Deux dispositifs sont à relever : le crédit d'impôt pour création d'emplois, créé par l'article 81 de la loi de finances pour 1998 et dont la dépense fiscale est évaluée à 3 milliards de francs pour 1999, et le recentrage des aides à l'emploi au bénéfice des publics prioritaires. Le contrat initiative-emploi (CIE), créé par la loi de finances rectificative du 4 avril 1995, est à la disposition des entreprises qui embauchent des chômeurs de longue durée. Sur le 9,499 milliards de francs figurant en loi de finances pour 1999, 3,498 milliards consistent en primes (chapitre 44-70 art.31 nouveau), c'est-à-dire en aides forfaitaires de l'État, à la formation et au tutorat, et 6,001 milliards en exonération de charges sociales (chapitre 44-70 art.32 nouveau). Le bilan du CIE pour 1997 réalisé par la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle souligne la forte participation des très petites entreprises (moins de 10 salariés) à ce dispositif, alors que moins de 10 % des établissements ayant conclu de tels contrats sont des PME plus importantes ou des grandes entreprises. Ces deux dispositifs, d'un coût budgétaire très élevé, visent à exercer une influence immédiate sur le marché du travail en facilitant la création d'emplois ou en favorisant l'embauche de personnes menacées par l'exclusion ; le second grand axe d'intervention de l'État en matière d'emploi s'oriente vers la sauvegarde de l'emploi et l'aide au retrait d'activité. Il s'agit donc de limiter les effets des difficultés économiques et des licenciements. Le volet des actions de prévention des licenciements et d'accompagnement des restructurations correspond à des sommes qui peuvent sembler modestes, 1,167 milliard au total, sous forme essentiellement d'aides au chômage partiel et aux restructurations, tandis que la participation de l'État au financement des retraits d'activité s'élève à des sommes très supérieures. Aides d'État pour l'emploi : prévention et accompagnement des restructurations
Ce rôle de financier est aujourd'hui contesté par la Cour de Justice des Communautés européennes qui a estimé que, par sa finalité et son économie générale, le système de participation du Fonds National pour l'Emploi (FNE) à l'accompagnement des licenciements économiques est susceptible de placer certaines entreprises dans une situation plus favorable que d'autres (arrêt de la CJCE du 26 septembre 1996, France c/ Commission). C'est ainsi le procès des aides d'État qui a été instruit : il est susceptible de remettre en cause l'ensemble des politiques d'emploi, au nom de la concurrence. Le montant considérable des aides versées dans ce cadre a certainement joué un rôle important dans cette condamnation : l'AS-FNE atteint presque 5 milliards de francs et l'État contribue au financement des préretraites progressives à hauteur de 2 milliards. Or ces aides profitent en priorité aux entreprises qui licencient un grand nombre de salariés âgés et qui ont échoué à leur trouver un poste de remplacement.
Une nouvelle série de dispositifs apparaît progressivement depuis la fin des années 1980 : elle concerne la réduction du temps de travail (RTT), et les aides variées que l'État accorde aux entreprises, dans un premier temps, pour favoriser le choix de la réduction du temps de travail, depuis les lois Aubry, pour que le partage du travail soit effectué dans les plus brefs délais. Aides d'État pour l'emploi : réduction du temps de travail
Le tableau ci-dessus permet de mesurer le coût budgétaire que représente la réduction du temps de travail : si aucune convention nouvelle ne peut être signée dans le cadre de la loi Robien, les conventions qui l'ont été avant la fin février 1998 demeurent valides et les exonérations sont toujours versées, ce qui explique l'importance de la somme prévue pour ce titre. La loi Aubry du 13 juin 1998 prévoit un dispositif d'aide destiné aux employeurs (dans une définition plus large que les seules entreprises) qui réduisent la durée du temps de travail par la négociation avant le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés et avant le 1er janvier 2002 pour les plus petites. Pour ouvrir droit à l'aide, la réduction doit être d'au moins 10 % de la durée initiale et porter le nouvel horaire collectif à un niveau ne dépassant pas 35 heures hebdomadaires. Elle doit donner lieu à des embauches correspondant au moins à 6 % de l'effectif concerné par la RTT, l'aide étant majorée quand RTT et embauches sont plus importantes. Selon la date de conclusion de la convention, l'aide de départ varie entre 9 000 et 7 000 francs dans le premier cas et l'aide finale est de 5 000 francs. L'aide est attribuée pour chacun des salariés auxquels s'applique la RTT et vient en déduction du montant global de cotisations sociales à la charge de l'employeur. Ce dispositif présente aussi un volet défensif : des conventions de RTT peuvent être conclues par des entreprises afin d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'un plan social. Il est prévu de créer, à partir du 1er janvier 2000, une aide moins élevée permanente pour les entreprises n'appliquant la nouvelle durée légale qu'à cette date et qui prendrait le relais de l'aide dégressive pour ceux qui en ont bénéficié. L'aide au conseil, destinée aux PME, permet à l'État de prendre en charge une partie des frais liés aux études préalables à la RTT. Les aides à l'emploi mises en place par l'État sont nombreuses et variées mais les plus importantes, tant en nombre d'entreprises concernées qu'en volume financier, prennent la forme de dispositifs d'exonération. L'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale en a présenté un bilan au 31 décembre 1997 à son conseil d'administration réuni le 24 avril 1998 : 62,668 milliards de francs de cotisations ont été pris en charge par l'État et 10,437 milliards d'exonération n'ont pas été compensés. Les entreprises ont ainsi bénéficié en 1997 de plus de 73 milliards de francs d'exonérations. ce chiffre est amené à croître dans un avenir proche étant donnés les dispositifs d'allégements des charges envisagés pour faciliter le passage aux 35 heures : les entreprises ayant signé un accord de réduction du temps de travail pourraient bénéficier d'une ristourne jusqu'à 1,8 SMIC, ce qui entraînerait un coût supplémentaire pour l'État de 25 milliards de francs. Face à un engagement de l'État aussi important, les collectivités locales ne semblent jouer qu'un rôle modeste dans l'octroi d'aides à l'emploi. L'essentiel des aides qu'elles accordent sont des mesures en faveur de l'investissement, qui ont des effets indirects sur l'emploi. La Prime régionale à l'emploi (PRE) et la Prime régionale à la création d'entreprises (PRCE) ont en revanche un objectif plus immédiat en terme d'emplois. La première peut être accordée sans limitation de zonage, mais le montant en est plafonné en fonction de la localisation : 51 947 ont été accordées en 1995. Le nombre de PRCE (51 653) est équivalent. L'ensemble ne dépassait pas 88 millions de francs en 1995. Enfin, le Fonds social européen (FSE) prévoyait pour 1994-1999 le versement à la France de 14,939 milliards d'écus (soit 97,85 milliards de francs), au titre des différents objectifs et à celui des programmes d'initiative communautaire (PIC) qui les complètent. En 1996, le montant des retours pour la France s'élevait à 650,7 millions d'écus (4,26 milliards de francs). Le FSE intervient pour la France en complément du FEDER et du FEOGA pour le financement des objectifs 1 (région en retard de développement) et 5b (développement et ajustement structurel des zones rurales). Il est associé au FEDER en ce qui concerne l'objectif 2 (régions en déclin industriel) et finance seul les objectifs 3 (lutte contre le chômage de longue durée et l'exclusion du marché du travail) et 4 (adaptation des travailleurs aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production). Pour la période 1994-1999, la France doit bénéficier ainsi de 16 milliards de francs du FSE au titre de l'objectif 3, et d'environ 20 milliards au titre de l'objectif 4. Les aides à emploi proprement dites visent à favoriser la création d'emploi et l'embauche de personnes en difficulté ou à limiter les conséquences sociales de grands licenciements. Elles sont complétées par des dispositifs concernant le domaine particulier de la formation professionnelle, initiale comme continue : il s'agit par là d'améliorer l' « employabilité » des salariés, quel que soit leur âge, le concept d' « employabilité », aujourd'hui volontiers utilisé, se définissant comme la « capacité d'un individu à s'insérer sur le marché du travail ou à garder son emploi » selon Mme Isabelle MOURES, sous-directrice à la Délégation générale à l'emploi et la formation professionnelle. La formation est ainsi présentée comme un moyen de prévenir, voire d'éviter, d'éventuelles difficultés futures. L'accent est mis sur la formation professionnelle avec d'autant plus de force qu'apparaît aujourd'hui un manque de main d'_uvre qualifiée dans certains secteurs, ce qui est paradoxal étant donné le volume du chômage. Or il semble que la formation professionnelle ne puisse nullement se passer de la collaboration active des entreprises. S'inspirant du modèle allemand, qui se traduit par un taux de chômage des jeunes inférieur à la moyenne nationale - dans un contexte démographique très différent, il est vrai, de la situation française -, la France tente, non sans un certain succès, depuis plusieurs années, de développer la formation en alternance. La participation des entreprises étant une condition sine qua non, l'État a mis en place des mesures destinées à encourager les entreprises à assurer de la formation. Elles bénéficient ainsi, selon les dispositifs, de primes et/ou d'exonérations de charges. Les dispositifs de formation en alternance et les aides qui les accompagnent
La pluralité des dispositifs rend complexe leur utilisation et l'évaluation de leur efficacité. La différence de traitement entre les entreprises ayant des apprentis et celles accueillant des jeunes gens en contrat de qualification s'explique par la différence de gestionnaire - l'apprentissage est sous la responsabilité de l'État, le contrat de qualification sous celle des partenaires sociaux -, mais ne se justifie pas. L'inégalité a encore été accrue par la loi du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, qui a institué une indemnité compensatrice forfaitaire composée d'une aide à l'embauche et d'une aide à la formation. Cette aide à l'embauche n'existe pas dans le cadre des autres contrats d'alternance et la prime forfaitaire y est plus élevée. Les heures de formation sont l'objet d'un financement de l'État à partir d'un certain seuil, alors qu'elle sont compensées dès la première pour la contrat d'adaptation et le contrat de qualification, et sur des fonds mutualisés. L'absence de rémunération des heures de formation du contrat d'orientation est liée au faible nombre d'heures prévues. En effet, l'aide à l'entreprise est en principe d'autant plus élevée que le contenu de formation est important : cela explique le régime moins favorable des contrats d'adaptation et d'orientation qui ne comprennent respectivement que 200 heures de formation au total et 52 heures pendant les trois premiers mois, puis 104 pendant les trois suivants. Cette logique n'intervient donc pas entre apprentissage et contrat de qualification, les différences formelles de l'aide rendant difficile la comparaison réelle des avantages financiers que l'entreprise en tire. Sauf pour le contrat d'adaptation, les bénéficiaires sont rémunérés en-deça du SMIC, ce qui constitue un attrait supplémentaire pour l'entreprise. Les conséquences de l'existence de dispositifs attractifs ne doivent pas être sous-estimées : le rapporteur de la Commission d'enquête de 1996 consacrée aux aides à l'emploi, M. Hervé Novelli, citait ainsi une remarque de M. Gandois, alors président du CNPF : « le contrat d'adaptation est sans intérêt. Il ne coûte rien d'ailleurs, puisqu'il ne donne lieu à aucune exonération. Il va disparaître au cours des ans, car son utilité est discutable ». Cette remarque peut surprendre lorsque l'on sait combien M. le Vice-président délégué du MEDEF a affirmé devant la commission d'enquête son désir de voir supprimer toute aide publique. Il ne faut néanmoins négliger ni les contraintes qui accompagnent l'embauche d'un jeune sans qualification ni le bénéfice certain que tire l'ensemble de la société d'un système de formation adapté aux besoins des entreprises. Pour ce qui est de la formation des adultes, mis à part le récent contrat de qualification destiné aux adultes, celle-ci est peu confiée aux entreprises. Le stage d'insertion et de formation à l'emploi ne se déroule qu'en partie en entreprise, et le stagiaire est rémunéré exclusivement par l'État et les ASSEDIC. Le CIE possède un contenu en formation beaucoup trop faible, et aléatoire, pour mériter la qualification de mesure de formation. Dans les faits, la formation en entreprise est essentiellement destinée aux jeunes : les aides doivent accroître l'intérêt des employeurs pour les tâches de formation. L'embauche des jeunes issus de ces formations n'en est pas moins rendue difficile par le coût de l'embauche d'un jeune diplômé, qui ne fait pour sa part l'objet d'aucune aide. C'est pour tenter de résoudre le problème de la formation continue, au-delà de l'obligation légale de financement prévue par le code du travail (articles 951-1 et 952-1), qu'ont été mis en place les « engagements de développement de la formation » (EDDF). Ils visent à ce que les entreprises développent une stratégie de gestion des ressources humaines, et donc de formation, permettant à la fois de qualifier les salariés et d'améliorer leur compétitivité. Dans le cadre d'accords, nationaux ou régionaux, de branche ou interprofessionnels, les EDDF apportent une aide sous forme de subvention, soldée au prorata des réalisations effectives. L'enveloppe (chapitre 43-70, article 51) pour 1999 est de 335 millions de francs. Si des mesures de soutien à la recherche et au développement existent dans chaque pays européen, et dans la quasi totalité des États membres de l'OCDE, c'est que tous ont compris à quel point leur influence sur la compétitivité de l'économie et sur la croissance était décisive. En France, il existe un grand nombre de dispositifs et des sommes considérables y sont consacrées : l'intervention publique vise à dynamiser des dépenses dont la tendance est à la baisse depuis 1991. Après une période de forte croissance des dépenses de recherche et développement effectuées par les grandes entreprises, la décennie 1990 est marquée par une décroissance de ces dépenses, l'amélioration de 1996 n'ayant pas eu de suite malgré l'embellie du contexte économique. Elles sont donc inférieures à 1,4 % du PIB, contre 1,51 % en 1992 : en 1996, 4650 entreprises et organismes professionnels ont exécuté 112,4 milliards de francs en travaux de recherche et de développement. 75 % ont été financés par les entreprises elles-mêmes, les administrations publiques y ont contribué pour 13 % sous forme de contrats de recherche ou de subventions, le complément étant assuré par des flux financiers provenant pour l'essentiel de l'étranger et des organisations internationales. La participation de l'État prend la forme de diverses aides. Les aides d'État à la recherche et au développement
Comme souvent, les dispositifs sont nombreux, mais ils ont fréquemment des objectifs redondants. Les sources de financement semblent être moins dispersées, la catégorie des aides nationales l'emportant de beaucoup. Pourtant, même lorsque l'État est le seul financeur, différents ministères peuvent intervenir : le secrétariat d'État à l'industrie, le ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie, et l'ANVAR qui relève de leur tutelle commune. De plus, une part notable des aides est l'objet de cofinancements : le FEDER y participe souvent, ainsi que les collectivités locales. Cité devant la commission d'enquête par M. Richard Zisswiller, représentant la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, le rapport de Henri Guillaume au Premier ministre Innovation et technologie évalue à environ 1,5 milliard de francs le montant du budget des régions en recherche et développement pour 1996, mais ce chiffre inclut, outre le financement des structures d'appui technologique aux entreprises, l'appui à des laboratoires publics de recherche et les bourses technologiques accordés aux étudiants. Il estime que 10 % de ces budgets annuels sont consacrés à la technologie, soit 150 millions de francs, mais avoue son incapacité à rendre compte des aides à la recherche et la technologie provenant des conseils généraux et des villes. Les formes des aides sont toutefois assez homogènes : mis à part le crédit d'impôt, les autres aides sont des subventions ou des avances, remboursables pour la plupart. En revanche, la liste des catégories d'entreprises éligibles à ces dispositifs sont incohérentes : seules les aides du FD-PMI sont réservées à certaines PME ; d'autres sont ouvertes aux entreprises, quelle que soit leur taille ; certaines enfin retiennent des seuils de taille différents, dont la justification apparaît peu claire et qui ne sont pas utilisés ailleurs : moins de 500 salariés « de préférence » pour « ATOUT-PUMA » , moins de 2 000 salariés pour « ATOUT-DROP » et le régime ANVAR, dont sont exclus, depuis 1989, les « grands groupes » définis comme ceux ayant plus de 2 000 salariés et/ou plus de 10 milliards de chiffre d'affaire. Ces différences de seuil -résolues au sein de la procédure ATOUT désormais unifiée après avoir présenté quatre techniques (PUCE, PUMA, DROP, LOGIC)- entraînent la même complexité que le brouillage des zonages dans les dispositifs d'aménagement du territoire. Le positionnement des aides les unes par rapport aux autres apparaît incertain étant donné le recoupement des catégories d'entreprises. M. Henri Guillaume cite dans son rapport une lettre du Premier Président de la Cour des comptes au Ministre de l'Industrie en date du 26 janvier 1994 dans laquelle est soulignée « la confusion dans l'esprit des bénéficiaires tant sur la nature de l'aide que sur les critères de décision ». Le dispositif le plus coûteux en faveur de la recherche et du développement est le crédit d'impôt-recherche, institué par la loi de finances pour 1983 : l'évaluation pour 1998 s'élève à 2,7 milliards, après 3,6 milliards pour 1997 et 4 milliards pour 1996. Le montant du crédit d'impôt est égal à 50 % de la différence entre le montant des dépenses de recherche de l'année et la moyenne des dépenses exposées au cours des deux années précédentes, revalorisées de la hausse des prix, dans la limite de 40 millions de francs. Le CIR est imputé sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle elle a accru ses dépenses de recherche. Parmi les dépenses ouvrant droit au CIR figurent les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement affectés aux opérations de recherche, les dépenses exposées pour la réalisation de recherche confiée à des organismes de recherche, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'utilité en France et à l'étranger, certaines dépenses de normalisation... Étant donné le coût élevé du dispositif, une enquête du ministère chargé de la recherche et le rapport remis par M. Henri Guillaume évaluent son impact. Une répartition par type de dépenses peut être dégagée :
Le CIR constitue une incitation en faveur de l'embauche de chercheurs et techniciens. Il est perçu comme un dispositif simple et efficace, qui présente l'avantage de la neutralité par apport à la taille, nous y reviendrons, et au secteur d'intervention des entreprises, ainsi qu'au regard de la nature des dépenses financées. L'article 64 de la loi de finances pour 1999 reconduit le CIR pour la période 1999-2003 tout en y apportant certaines améliorations. Les entreprises nouvelles bénéficieront désormais d'une restitution immédiate du CIR pendant leurs trois premières années d'activité, quelle que soit leur implantation géographique. La substitution d'un taux uniforme sur l'ensemble du territoire au taux préférentiel modulé en fonction de la localisation du personnel de recherche confirme l'orientation du dispositif vers le soutien à la compétitivité des entreprises innovantes, alors qu'il était auparavant aussi un outil de la politique d'aménagement du territoire. Depuis 1979, l'acteur central de l'aide à la recherche est l'ANVAR (Agence nationale de valorisation), créée en 1967. Elle offre plusieurs aides : Détail et montants pour 1996 des aides de l'ANVAR (en millions de francs)
Source : ANVAR, repris dans Rapport de mission sur la technologie et l'innovation, Henri Guillaume (mars 1998) Les avances sont effectivement remboursées aux deux tiers, selon le rapport de M. Henri Guillaume. Ce dernier estime que ce chiffre est « très satisfaisant » et qu'il montre « que l'ANVAR a atteint son rythme de croisière et maîtrise bien le niveau des risques pris ». Les conseil régionaux peuvent abonder l'aide de l'ANVAR : ils y ajoutent généralement des conditions supplémentaires et appliquent des assiettes différentes. La politique en faveur de la recherche et du développement trouve un complément dans les aides à finalité d'environnement. Elles sont soit nationales, gérées par l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), soit régionales. L'ADEME bénéficie traditionnellement de deux sources de financement : la première consiste en crédits budgétaires provenant des budgets du secrétariat d'État à l'Industrie, du ministère de la Recherche et du ministère de l'Environnement et de ressources externes, crédits qui s'élevaient à 364,3 millions de francs au titre des interventions et 199,5 millions pour le fonctionnement dans le budget de 1998. La seconde reposait jusqu'en 1998 sur la perception par l'ADEME de cinq taxes parafiscales. Depuis la loi de finances pour 1999, ces dernières ont été remplacées par la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : il s'agit d'un impôt d'État, dont le produit alimente le budget général. Le ministère de l'environnement versera donc à l'ADEME une subvention d'un montant équivalent aux recettes attendues de ces taxes, qui ont rapporté 1,322 milliard de francs selon les évaluations pour 1998. L'ensemble des crédits budgétaires au profit de l'ADEME pour 1999 doivent s'élever à 1,834 milliard de francs, chiffre total qui inclut fonctionnement et interventions. Les interventions de l'ADEME poursuivent plusieurs objectifs. C'est essentiellement dans le cadre de deux d'entre eux que l'agence accorde des aides aux entreprises : la recherche et le développement et l'industrie. Dans le cadre de ce premier objectif, sont élaborés des programmes de recherche et développement soutenus par des aides financées dans la budget de l'ADEME, jusqu'en 1998, sur des fonds du ministère de la Recherche et sur le produit des taxes. Le rapport d'activité de 1997 de l'agence précise que 191,8 millions de francs ont été attribués à de tels programmes, dont 43,5 % directement à des entreprises, 27 % des bénéficiaires étaient des PME, 16,5 % de grandes entreprises. Cinq programmes ont été mis en _uvre par l'ADEME en direction de l'industrie et des entreprises (énergie-environnement, qualité écologique des produits, déchets dans l'industrie, sites pollués, réduction des émissions atmosphériques des sources fixes), qui couvrent 686 opérations et l'engagement de 361 millions de francs. Les aides régionales à l'environnement relève d'un régime cadre qui permet de les accorder à toutes les entreprises afin de favoriser une meilleure prise en compte de l'environnement. Des taux d'aide admissibles sont fixés : ils varient selon la zone d'aménagement du territoire considérée (zone PAT ou hors PAT) et sont plus élevés pour les PME que pour les grandes entreprises. L'État et l'Union européenne assurent un cofinancement. 6. - Aider le commerce extérieur Les aides au commerce extérieur présentent deux volets : le premier est qualifié par la direction des relations économiques extérieures qui gère l'ensemble du dispositif de « soutien au commerce courant » ; le second est destiné aux « grands contrats ». Le premier volet, destiné à résoudre les difficultés rencontrées par les PME, comporte deux instruments : la partie Commerce extérieur des contrats de plan État-régions et l'assurance prospection. Les contrats de plan État-régions prévoient l'octroi d'aides pour les plus petites entreprises qui disposent de produits compétitifs mais qui ont besoin d'un soutien public pour engager une démarche de développement international. Ces aides remplissent cinq objectifs et remportent un grand succès : en 1997, 1 200 aides ont été accordées et 89 % des autorisation de programme ont été consommées. La moitié des entreprises bénéficiaires comptaient moins de cinquante salariés. Dans la loi de finances pour 1999, ont été ouverts des autorisations de programmes à hauteur de 32 millions de francs alors que dépenses ordinaires et crédits de paiement s'élèvent à 47 millions de francs (chapitre 64-00 du budget du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie). Ces sommes sont en principe doublées par le cofinancement régional. Hors du cadre des contrats de plan, l'assurance prospection aide l'exportateur à faire face à ses dépenses de prospection sur les marchés étrangers et l'indemnise en cas d'insuccès commercial. Trois produits sont proposés, en échange du versement à la COFACE par l'entreprise d'une prime égale à 3 % du budget garanti : l'assurance foire, l'assurance prospection simplifiée et l'assurance prospection normale. 2 100 nouveaux contrats ont été souscrits par des sociétés de taille souvent modeste en 1997. 6 400 sont actuellement en cours. Mais, outre ces dispositifs orientés vers les besoins des PME, l'essentiel des aides accordées au commerce extérieur l'est dans le cadre de l'aide aux grands projets, qui compte cinq volets. · l'assurance-crédit gérée par la COFACE : elle recouvre les activités de couverture par la COFACE, avec la garantie de l'État, du risque politique et commercial sur les opérations d'exportation. Sont concernés le risque politique et commercial sur les opérations d'exportation financées à plus de trois ans et le risque politique hors OCDE ainsi que sur le Mexique, la Hongrie, la République tchèque, la Pologne et la Turquie pour les opérations d'exportation financées à moins de trois ans ; · la stabilisation du taux d'intérêt : cette procédure permet aux exportateurs et aux banques françaises de proposer à leur client-emprunteur un financement à taux fixe en francs français ou en devises. Son gestionnaire, NATEXIS, compense (ou reçoit des banques) la différence entre le taux fixe du crédit et un taux représentatif des conditions de refinancement à court terme des banques, majoré de la marge bancaire autorisée : l'impact budgétaire de ce mécanisme, actuellement positif, est retracé au chapitre 44-98 du budget des charges communes ; · la garantie de change : gérée par la COFACE, elle couvre le risque des grands contrats d'exportation libellés en devises : elle garantit aux entreprises un cours de conversion constant avec le franc et l'euro et les fait bénéficier d'une partie de la hausse de la devise le cas échéant ; · les protocoles financiers (compte spécial du Trésor 903-07, chapitre 01) : désormais gérés au sein de la Réserve Pays Émergents, ils soutiennent les entreprises dans leur stratégie d'exportation vers les pays appartenant aux zones concernées par l'accord de crédits (1,7 milliards de francs en 1998) ou la garantie de crédits privés (1 milliard) ; · le FASEP constitue le dispositif central en matière de financement d'études et de coopération institutionnelle, en amont des projets. Favorisant la promotion d'opérations porteuses de retombées pour l'offre française, et dont les perspectives de financement ultérieur paraissent favorables, elle participe à la politique de soutien aux grands contrats. En 1997, 202 millions de francs ont été engagés à ce titre. La loi de finances pour 1999 prévoit que 100 millions de francs (en autorisation de programmes comme en dépenses ordinaires et crédits de paiement), sur un total de 300 millions (ch.68-00, art.10 du budget des charges communes), seront ouverts pour les PME dans le cadre du FASEP. Il est intéressant de noter que l'ensemble de ces dispositifs sont d'un coût budgétaire actuellement limité. En effet, pour ce qui est de l'assurance-crédit géré par la COFACE, les récupérations et les primes sont depuis plusieurs années supérieures aux indemnités versées, grâce à une réorientation des exportations vers des marchés solvables et dynamiques. La stabilisation des changes assure aussi des gains, de 30 millions de francs en prévision pour 1998 tandis que 15,8 millions de francs ont été reversés au budget de l'État en 1997 dans le cadre de la procédure de garantie de change. Le coût de ces mesures d'aides en est diminué d'autant. Dans le cadre communautaire, existe un système d'aide à l'exportation très particulier qui concerne le seul secteur agricole. Il s'agit de celui des restitutions, prévu par la Politique agricole commune. La restitution à l'exportation est une aide qui permet de compenser en principe la différence entre le prix mondial et le prix communautaire, plus élevé, afin de rendre les produits européens compétitifs sur le marché mondial. Les entreprises exportatrices du secteur agro-alimentaire utilisant certains produits agricoles français (notamment sucre, produits laitiers, viande bovine, céréales) touchent ainsi des montants de restitutions considérables. Les crédits consommés à ce titre, en France, étaient de 1 141,7 millions d'euros, soit plus de 7 milliards de francs, en 1996, et de 1 329,8 millions d'euros, 8,72 milliards de francs, en 1997. 7. - Résoudre des problèmes sectoriels L'ensemble des aides que nous venons de présenter visait un objectif particulier identifié, justifié par des considérations macroéconomiques. Mais les pouvoirs publics, et singulièrement l'État, accordent des aides sectorielles, destinées à permettre à un secteur économique de résoudre une crise, ou d'en limiter les conséquences. Le Fonds pour les restructurations de la défense (FRED) en est un exemple : il est destiné à atténuer, sur les zones d'emploi concernées, l'impact du désengagement local de l'État et des réductions d'activités liées soit à la réorganisation des armées, soit à la diminution d'activité industrielle en découlant. Il est alimenté par l'État et le FEDER et ses subventions peuvent bénéficier à des entreprises de toute taille. La circulaire du 27 mai 1997 précise néanmoins que le FRED ne peut intervenir en faveur d'entreprises autres que des PME que dans la limite de 10 % des autorisations de programme annuelles, et en complément d'autres aides publiques. L'aide concerne aussi bien l'investissement que le conseil, l'emploi ou la formation. 202 millions de francs lui sont destinés au chapitre 66-50, article 40 du budget de la Défense. La nécessité de ce dispositif ne fait guère de doute étant donné l'importance des entreprises ayant un lien avec la défense dans certaines régions françaises. M. Palma Andres, chef de l'unité interventions France à la DG XV, nous a fait part de la préoccupation européenne sur ce problème : « Je suis un peu inquiet pour certaines régions françaises vu le programme de restructuration des industries de défense. Alors que les casernes quittent de nombreuses communes, il va être très difficile de trouver des emplois alternatifs. Le problème est grave dans les zones rurales et dans les zones qui ont vécu de l'industrie militaire, surtout grâce aux sous-traitants. Il y avait beaucoup de petites et moyennes entreprises qui étaient vouées exclusivement à cette sous-traitance : j'ai vu cela en Bretagne, à Brest, où les difficultés sont réelles. Notre intention est de proposer aux autorités françaises un renforcement du soutien à leur reconversion ». Le ministère de l'Industrie mène des politiques d'aides spécifiques destinées à trois secteurs en grandes difficultés, géographiquement concentrés et riches en main d'oeuvre : les chantiers navals, les bassins miniers et l'industrie textile, auxquels il faut ajouter le cas particulier de Charbonnages de France. Les aides sectorielles accordées par le ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
Ces aides témoignent d'une volonté politique très marquée, qui se traduit par des ouvertures de crédits supérieures à celles prévues en loi de finances. Les aides aux chantiers navals ont atteint un montant de deux fois supérieur aux crédits ouverts pour 1998. Cette même année, le FIBM a bénéficié de 181,97 millions de francs de crédits disponibles, contre seulement 158,4 en loi de finances : ces dépassements, résultat de reports, de la régulation budgétaire et de mouvements figurant en loi de finances rectificative, sont systématiques depuis plusieurs années, alors que les crédits engagés varient beaucoup selon les années et sont souvent très inférieurs, ce qui est probablement lié à un mode de gestion complexe et décentralisé. L'ensemble des crédits ne profite d'ailleurs pas aux entreprises : le fonds mis en place par une lettre du ministre de 1984, revue par une circulaire du 26 février 1997, a en effet pour objectif principal la recomposition du tissu industriel des bassins miniers. Ses interventions sont donc orientées au profit de l'ensemble des secteurs industriels et des services propres à l'industrie et prennent la forme de subventions de fonctionnement, susceptibles de bénéficier aux entreprises, mais aussi aux collectivités locales, aux associations professionnelles et organismes consulaires, aux sociétés d'économie mixte et à tous les organisme dont le rôle est de concourir au développement économique local. Les crédits ne sont donc pas destinés dans leur totalité à des entreprises. Les aides à l'industrie textile visent à maintenir la compétitivité d'un secteur que les coûts salariaux élevés placent dans une situation désavantageuse face à la concurrence internationale. La France souhaitait donc obtenir une maîtrise des coûts de production par une baisse des charges sociales dans le secteur : cet allégement consistait en une exonération quasi-totale au niveau du SMIC et dégressive jusqu'à 1,5 SMIC, ce qui était plus favorable que l'allégement général jusqu'à 1,3 SMIC. La Commission européenne a condamné ce dispositif. Le Gouvernement a donc dû renoncer à poursuivre l'application du plan au-delà du 31 décembre 1997 pour toutes les entreprises ayant reçu un montant d'aide supérieur au seuil de minimis et à accepter le principe du remboursement des aides perçues au-delà de ce seuil. Mais ses modalités sont complexes dans la mesure où le remboursement ne doit pas mettre en cause la survie ou la santé financière des entreprises. Une mesure d'étalement dans le temps, aussi longue que possible (10 ans), est actuellement en cours de négociation entre le Gouvernement français et la Commission européenne. Les aides au secteur textile sont donc désormais celles de droit commun, dans le cadre du soutien à l'effort de formation, de la modernisation des entreprises - par le FDPMI - et de l'aide au développement de la création et à l'innovation : le textile bénéficie prioritairement des différents dispositifs existants. S'y ajoute, dans le cadre de la loi Aubry sur la réduction du temps de travail, l'abattement de charges spécifique applicable aux industries de main-d'_uvre : pour les accords signés en 1998 - et qui étaient nombreux dans le textile : 135 à la fin mars 1999 -, l'allégement était de 4 000 francs, en plus des 9 000 francs par emploi prévus par le dispositif général. Le ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement accorde lui aussi des aides à plusieurs secteurs, parmi lesquelles les principaux sont le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), très riche en emplois peu qualifiés, celui de la marine marchande, confrontée à une concurrence internationale qui menace sa pérennité, et celui du tourisme, dont les potentialités de développement sont fortes. Les principales aides sont présentées ci-après : Principales aides sectorielles accordées par le ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement
Les aides publiques répondent ainsi à des préoccupations variées, mais légitimes, de l'État et des collectivités locales. Elles représentent des sommes considérables distribuées aux entreprises en fonction de leur situation ou de leurs engagements. Si la décision de les créer, puis de les accorder à telle ou telle entreprise, est le fait des collectivités publiques, ces dernières n'exercent pas de contrainte sur les entreprises pour qu'elles les demandent ou les acceptent : les entreprises qui bénéficient des aides se sont portées candidates ; pour certaines aides à l'investissement émanant des collectivités locales, elles ont même exigé une intervention, faisant de telle subvention par exemple une condition de leur implantation, un élément décisif de leur choix ; il arrive fréquemment qu'elles fassent jouer la concurrence entre plusieurs localisations. Il est donc très difficile d'affirmer, comme le font certains responsables de syndicats patronaux et de nombreux chefs d'entreprise, que les entreprises ne souhaitent pas recevoir d'aides. Les dispositifs d'aides sont donc doublement stratifiés, par niveau administratif et par objectif. Ils présentent une grande complexité, source d'une opacité certaine. Cette situation est porteuse d'effets pervers dans la mesure où ils profitent ainsi d'abord à ceux qui ont les moyens de les connaître et d'en maîtriser les méandres, qui ne sont en général pas de ceux qui ont besoin d'être soutenus par la puissance publique. De plus, si les aides sont initialement conçues pour répondre à un objectif relevant de l'intérêt général, elles profitent à des entreprises qui, légitimement, poursuivent avant tout leurs propres intérêts et leurs propres stratégies. Les dispositifs ne remplissent donc leurs objectifs que si les pouvoirs publics qui les gèrent contrôlent régulièrement leur utilisation afin d'éviter que seule l'entreprise y trouve son bénéfice au détriment de l'intérêt général. Les systèmes d'aides français sont très nombreux et complexes mais la comparaison avec les pratiques des principaux partenaires de la France, au sein de l'OCDE et de l'Union européenne, montre que ces difficultés ne sont pas propres à notre pays. b. - quelques éléments de comparaison avec nos partenaires de l'union europeenne et de l'ocde 1. - L'ultralibéralisme dominant
L'un des objectifs premiers de la construction européenne étant la création d'une zone de libre-échange dans laquelle les entreprises de chaque pays seraient en concurrence, l'article 92 du Traité sur l'Union européenne interdit les aides qui faussent ou menacent de fausser la concurrence, en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Pourtant cette interdiction est immédiatement nuancée par la mention « sauf dérogations prévues par le présent traité ». Ces dérogations concernent principalement les mesures destinées à aider le développement économique des régions en difficulté, mais aussi celles qui soutiennent le développement des petites et moyennes entreprises ou encore les aides à l'environnement, à la recherche et au développement. Le pouvoir d'apprécier si les projets d'aides notifiés par les États peuvent être autorisés au regard de l'une de ces exceptions appartient exclusivement à la Commission européenne, sous le contrôle du juge communautaire. La notion d'aide recouvre, indépendamment de leur régularité en droit interne, l'ensemble des avantages directs ou indirects, que les pouvoirs publics peuvent allouer à une entreprise ou un groupe d'entreprises, que ce soit notamment sous forme de subvention, d'exonération fiscale ou sociale, de remise de dette, d'abandon de créance, d'octroi de garantie, de prise de participation en capital, de prêts à des conditions différentes de celles du marché, d'avance remboursable, de prêt ou de mise à disposition de biens meubles ou immeubles, de personnel, de rabais sur les prix de vente ou de location, de réalisation d'infrastructures ou de travaux sur le site de l'entreprise. C'est ainsi l'ensemble des formes d'aides, directes ou indirectes, la distinction n'existant pas en tant que telle au niveau européen, qui est visé par le régime du traité. L'ensemble des distributeurs potentiels d'aides publiques est également concerné. En effet, l'aide est dite « publique », voire « d'État », dès qu'elle est financée sur des fonds d'origine publique, qu'ils proviennent directement ou indirectement de l'État, des collectivités locales, de l'Union européenne, d'organismes ou établissements publics, ou d'organisme autorisés à prélever des fonds et à les redistribuer auprès des entreprises. De même, toutes les entreprises sont visées par la réglementation des aides, quel que soit leur statut juridique, dans la mesure où elles sont susceptibles d'être en situation de concurrence. Au regard du régime des dérogations prévues par le Traité, trois catégories d'aides peuvent être distinguées : les aides systématiquement compatibles avec le Traité, les aides potentiellement compatibles et les aides sectorielles. Les cas dans lesquels les aides versées par les pouvoirs publics sont systématiquement compatibles avec le Traité de Rome sont limitativement énumérés et ne concernent qu'exceptionnellement les entreprises. La plupart des aides aux entreprises relève en fait de la catégorie des aides potentiellement compatibles avec le Traité. Après examen de la Commission, peuvent ainsi être déclarées compatibles avec le marché commun des aides destinées à la réalisation d'un projet d'intérêt européen, visant à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, ainsi que les aides au développement de certaines régions ou de certaines activités (environnement, culture, recherche et développement...). Pour chaque catégorie, la Commission européenne précise les conditions de conformité, notamment dans le cadre d'un zonage pour les aides régionales et de seuils plafonds. Enfin, dans certains secteurs surcapacitaires, les règles d'autorisation des aides sont plus strictes. C'est le cas notamment des aides au secteur de l'automobile, à la sidérurgie et au charbon, aux fibres synthétiques, aux transports ou à la construction navale. Dans ces domaines, comme pour l'agriculture, des textes spécifiques qui réglementent étroitement les possibilités d'attribution d'aide, sont adoptés par la Commission européenne ou le Conseil de l'Union.
Pour bénéficier des dérogations au principe d'interdiction, l'État a l'obligation de notifier à la Commission européenne toutes les aides publiques, préalablement à leur mise en place, afin d'obtenir son autorisation. L'État est ainsi responsable de la notification de l'ensemble des aides publiques, y compris de celles qu'il ne finance pas directement. Cette obligation de notification ne s'applique pas aux aides allouées au titre de la règle de minimis qui identifie un seuil en dessous duquel les aides allouées à une entreprise sont présumées compatibles avec le marché commun sans autorisation préalable de la Commission. Cette règle ne s'applique pas aux secteurs surcapacitaires, mais aux aides destinées aux autres secteurs, et qui n'ont donc, du fait de leur faible montant, ni à être préalablement notifiées, ni à respecter les conditions d'un régime notifié. Le plafond est fixé à 100 000 écus (655 970 francs) sur trois ans. Cette règle, destinée à faciliter l'octroi d'aides de faibles montants, peut continuer à être invoquée pour les dispositifs pour lesquels elle a déjà été retenue, mais elle devra à l'avenir faire l'objet d'une avalisation préalable des départements ministériels concernés, avant d'être inscrite dans les documents uniques de programmation des programmes européens (DOCUP). Ce renforcement de l'encadrement complexifie certes un régime dont l'objectif premier était la souplesse, mais il a été rendu nécessaire par le détournement de la règle de minimis. Cette dernière a en effet souvent été utilisée pour contourner les règles de légalité interne, en particulier celles relatives à l'intervention économique des collectivités locales. Mis à part les cas d'application de la règle de minimis, le principe communautaire est celui de la notification et de l'autorisation préalables. La responsabilité de l'application des politiques communautaires revenant à l'État, il appartient aux autorités nationales d'effectuer toutes les notifications à la Commission, que les aides soient financées sur des fonds d'origine nationale, locale ou européenne. Elles doivent également produire un rapport annuel d'exécution des régimes autorisés et répondre à toutes les demandes de la Commission. Si la procédure de notification et les règles d'autorisation apparaissent complexes, leur respect n'en est pas moins impératif. En effet, leur non respect peut avoir des conséquences économiques importantes pour l'entreprise bénéficiaire. En application du Traité sur l'Union européenne et conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice, toute aide versée sans autorisation préalable de la Commission - à l'exception des aides inférieures au seuil de minimis -, est illégale. Dans ce cas, si la Commission constate que l'aide indûment versée est incompatible avec le Traité, elle peut demander à l'État membre de procéder à sa récupération auprès de l'entreprise bénéficiaire, avec le paiement des intérêts calculés à partir d'un taux déterminé par la Commission (soit 4,94 % au 1er novembre 1998). Ainsi, la Commission adopte régulièrement des décisions interdisant les aides illégalement versées et ordonnant à l'État de procéder à leur récupération auprès des entreprises bénéficiaires. A titre provisoire, la Commission peut également ordonner la suspension du versement d'une aide ou de la mise en _uvre d'un régime d'aide non autorisé. De même, le juge national, saisi par un concurrent de l'entreprise bénéficiaire de l'aide non notifiée doit tirer toutes les conséquences de l'illégalité de cette aide. Dans ce cadre, il peut prononcer des mesures provisoires - de suspension ou de récupération - et doit constater l'illégalité de la mesure et ordonner, le cas échéant, la récupération de l'aide indûment versée. Les commissaires et hauts fonctionnaires européens que la commission d'enquête a rencontrés ont tous souligné les limites de cette procédure de contrôle de la légalité des aides. L'accent est mis surtout sur deux problèmes essentiels : le premier concerne les moyens d'information à la disposition de la Commission et de son administration, le second est relatif à l'efficacité des sanctions. Les informations que reçoit la Commission en matière d'aides accordées aux entreprises dans les différents États sont en principe limitées : une fois qu'un régime d'aide a été notifiée par l'État et autorisé par la Commission, l'État ou les collectivités locales accordent des aides dans le cadre ainsi établi sans informer les instances européennes de l'octroi de chacune d'entre elles. Étant donné le nombre d'entreprises bénéficiant d'une aide à un titre ou à un autre dans chaque État membre, la transmission d'une liste exhaustive n'aurait guère d'intérêt, les administrations bruxelloises n'ayant pas les moyens matériels de les contrôler. Ce sont en fait les États qui sont chargés de veiller au respect des dispositifs en vigueur dans leur territoire. La Commission, voire, en cas de demande d'annulation de sa décision, la Cour de Justice des Communautés européennes sont pourtant saisies lorsque des doutes apparaissent concernant la régularité d'une aide accordée à une entreprise, et ce par les deux voies que nous avons évoquées : la plainte d'un concurrent ou la découverte dans la presse d'une affaire. Le caractère aléatoire de ces procédures ne semble pas faire de doute, et a été reconnu par les interlocuteurs de la commission d'enquête. Mme Marianne Barbat-Layani, attaché financier à la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, met clairement ce point en lumière : « Se pose donc la question de savoir quelle est la part des infractions dont la Commission a connaissance. Vu de Bruxelles, il est plus facile de lire les journaux français et de savoir ce qui se passe en France, y compris dans les collectivités locales, que de savoir ce qu'il en est en Grèce, en Finlande ou ailleurs ». La proximité géographique et culturelle se traduit ainsi par une plus grande vigilance. L'autre voie, plus officielle, prend la forme de plaintes. Celles-ci émanent de concurrents évincés, entreprises ou État. Ainsi le Commissaire Van Miert a-t-il fait allusion à une plainte qui provenait du ministère français des Affaires sociales : « Mme Aubry m'a envoyé un dossier disant qu'un investisseur avait renoncé à s'implanter en France parce qu'ailleurs M. José Palma Andres, chef de l'unité Interventions France, à la direction générale chargée de la politique régionale et de la cohésion, cite l'un de ces cas : « nous venons d'être saisi par un député du Bundestag qui a demandé à la Commission de l'aider à éviter qu'une entreprise ne quitte sa circonscription pour s'installer en Picardie. C'est une entreprise appartenant à un groupe américain, implantée en Rhénanie-Palatinat et qui veut aller à Amiens parce que cette dernière est dans une zone éligible au titre de l'objectif 2.(...) si l'aide va créer des conditions plus intéressantes à Amiens, des difficultés vont surgir en Allemagne ». Les entreprises s'adressent parfois directement à la Commission, comme le souligne le Commissaire Van Miert dans le cas d'aides accordées par le Pays Basque espagnol : « Il y a des plaintes justifiées de plusieurs entreprises. Ce cas n `a pas été notifié par les autorités basques. Nous l'avons découvert parce que des concurrents nous ont écrit : ce sont des voisins catalans qui ont attiré notre attention. Voilà comment les choses se passent très fréquemment ». Ces méthodes pour le moins surprenantes ne semblent pas pour autant dénuées d'efficacité. M. Van Miert souligne la forte augmentation du nombre de décisions négatives prises par la Commission : limitées à six ou sept par an voici quelques années, elles se sont élevées à près de quarante en 1998. Si le nombre de cas examinés n'a pas été mentionné, il ne fait guère de doute qu'il est également en augmentation, même si la Commission s'avère visiblement plus sévère qu'auparavant. Pourtant, la complexité accrue des dossiers pose des problèmes nouveaux : M. Van Miert qualifie ainsi de « horriblement » complexes les dossiers du Crédit Lyonnais, en France, ou de Elf, en Allemagne. Les décisions prises par la Commission concernent des aides, accordées par un État, et non les entreprises qui les ont reçues. C'est donc à l'État qu'elles sont destinées, et c'est lui qui doit prendre les dispositions nécessaires à l'effacement des conséquences de l'octroi illégal d'une aide. Les décisions comportent ainsi deux éléments : d'une part, l'État doit mettre fin sans délai à l'octroi de l'aide concernée ; d'autre part, il doit récupérer les aides illégalement versées. Dans tous les cas, le remboursement s'effectue conformément aux procédures et aux dispositions de la loi nationale, ce qui implique la possibilité pour l'entreprise de contester la procédure de remboursement devant le juge national. Conforme à l'État de droit, cette faculté se traduit par un allongement considérable des délais d'application effective des décisions de la Commission, ce que Mme Barbat-Layani a fait remarquer lors de son audition, affirmant que la Commission se plaignait souvent du fait que « dans un certain nombre d'États membres, l'Allemagne par exemple, ces décisions mettent dix à quinze ans à être mises en _uvre, le rétablissement de la situation de concurrence initiale n'est donc pas assez rapide, ce qui pose des problèmes d'équité ». La mauvaise volonté des États, ou des considérations de politique interne, contribuent parfois à accroître les difficultés : même s'ils ne sont pas les seuls, les exemples allemand et espagnol sont souvent cités, M. Van Miert reconnaissant que les problèmes sont souvent plus difficiles à résoudre dans les États fédéraux, à la fois parce que les informations y sont éparses et parce que les régions se livrent à une réelle surenchère, ce qui se produit notamment pour les régions autonomes belges à propose desquelles il parle de « compétition » entre elles et avec les autres États membres. Les limites certaines des dispositif de contrôle conduisent incontestablement à un jeu de « pas vu, pas pris », dénoncé par les fonctionnaires auditionnés comme par les membres de la commission d'enquête. Le non respect des obligations de notification et d'autorisation préalables à la mise en _uvre est donc à l'origine d'une insécurité juridique pour les entreprises, une aide qui leur a été présentée comme légale pouvant s'avérer irrégulière au regard du Traité. Il fait peser sur elles un risque considérable susceptible de mettre en cause leurs projets d'investissement, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur le développement du territoire et la situation de l'emploi. D'autre part, l'octroi d'une aide non autorisée par la Commission pourrait constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'État ou de la collectivité locale concernée.
L'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a succédé en 1961 à l'OECE, créée en 1948 pour mettre en _uvre le plan Marshall. La mission de reconstruction des économies d'Europe occidentale au lendemain de la seconde guerre mondiale achevée, le besoin d'une coopération sur une base permanente demeurait en effet inchangé. L'article premier de la convention fondatrice du 14 décembre 1960 dispose ainsi que l'Organisation « a pour objectif de promouvoir des politiques visant a) à réaliser la plus forte expansion possible de l'économie et de l'emploi et une progression du niveau de vie dans les pays membres, tout en maintenant la stabilité financière et à contribuer ainsi au développement de l'économie mondiale ; b) à contribuer à une saine expansion économique dans les pays membres, ainsi que non membres, en voie de développement économique ; c) à contribuer à l'expansion du commerce mondial sur une base multilatérale et non discriminatoire, conformément aux obligations internationales ». Les tâches et le rôle qui découlent de ces définitions pour l'O.C.D.E. sont divers et nombreux. L'institution effectue un travail essentiel de collecte et de traitement des données statistiques, sur la base des éléments fournis par les Gouvernements des pays membres. Elle a donc été conduite à élaborer des normes et des classifications en coopération avec d'autres organismes statistiques internationaux tels que l'Office statistique des communautés européennes (EUROSTAT) et la Commission statistique des Nations Unies (CSNU). Elle procède également à l'analyse, le plus généralement sur une base annuelle, tant sur un plan horizontal que sectoriel et par pays, des situations et évolutions économiques en cours et élabore des prévisions à court-moyen terme. Ces travaux - Perspectives économiques semestrielles et examens annuels de la situation économique de chacun des pays membres - font l'objet de publications qui sont, avec les statistiques, sa contribution publique principale. Elle est surtout un forum intergouvernemental où se rencontrent et apprennent à se connaître les responsables des politiques économiques des États membres et de nombreux experts, à l'occasion de conseils généraux annuels (affaires étrangères, finances, économie et commerce international) ou de conseils spécialisés (éducation, environnement, énergie, développement, affaires sociales etc.). Après avoir été keynésienne comme la plupart des économistes au cours des années soixante, l'O.C.D.E. a pris le virage du monétarisme anglo-saxon au cours des années quatre-vingt. Elle constitue aujourd'hui une enceinte d'expression de la pensée ultralibérale. Ses publications viennent défendre les politiques d'ouverture systématique et de libéralisation des marchés, illustrer la thèse selon laquelle le jeu concurrentiel est un régulateur satisfaisant, souple et adapté à la complexité de la vie économique et stigmatiser au contraire les carences de l'intervention étatique. 2. - Un recours généralisé aux aides au sein de l'Union européenne et de l'OCDE
Pour l'Union européenne, le problème des aides publiques présente deux aspects : il s'agit, d'une part, de contrôler et d'évaluer le montant des aides accordées dans les États membres par les autorités nationales ou locales ; d'autre part, de suivre l'utilisation des fonds structurels communautaires dans les pays qui en bénéficient. C'est la première de ces tâches que la Commission remplit par l'élaboration de rapports sur les aides d'État. Le premier couvrait la période 1981-1986, les suivants des périodes de deux à trois ans. Le dernier en date de ces rapports, qui est le sixième, a été transmis au Conseil en juillet 1998 et couvre la période 1994-1996. Ces rapports doivent, à partir des informations fournies par les États membres, permettre une quantification systématique des aides afin de veiller au respect de la politique de concurrence. Le sixième rapport souligne la nécessité de la mise en place d'un contrôle toujours plus efficace des aides, dans la mesure où ces dernières peuvent, avec l'achèvement du marché intérieur et la réalisation de l'Union économique et monétaire, servir à remplacer les barrières douanières qui ont été démantelées dans la cadre du processus d'intégration. Il est ainsi utile à la Commission de prouver aux États membres, à travers ce rapport, qu'elle surveille de près les interventions publiques, aussi bien au niveau de l'Union dans son ensemble que dans chacun des États membres. Le sixième rapport, le premier à prendre en compte l'Autriche, la Suède et la Finlande, couvre le secteur manufacturier, l'agriculture, la pêche, les transports (ferroviaires et aériens), les services financiers et l'énergie (charbon). Son introduction nous met en garde contre l'inexactitude probable des chiffres relatifs à la Grèce, pour laquelle il a dû être fait appel à un consultant privé, et à l'Irlande, qui ne fournit que des estimations lorsqu'elle doit distinguer financement national et fonds communautaires. L'étude repose sur la séparation entre aides au secteur manufacturier et aides à d'autres secteurs. Il est précisé que les données apportées par les États membres ont été vérifiées et au besoin modifiées, tout comme les chiffres pour 1992-1994. Cette remarque montre le caractère parfois incertain des informations fournies par les États membres, qui ne souhaitent pas être stigmatisés, au niveau communautaire, comme les pays les plus généreux en matière d'aides publiques, même s'ils informent en revanche volontiers les entreprises candidates à l'installation sur leur territoire de l'existence de nombreuses possibilités d'aides. Le rapport conclut certes que « cette procédure garantit un degré de fiabilité élevé », mais il est permis d'émettre quelques doutes. Nous verrons, dans le cas de l'Allemagne notamment, que les informations officielles émanant des États membres sont contredites par d'autres sources. Ces différences ne résultent pas nécessairement d'ailleurs de la mauvaise volonté des États, mais de l'imprécision réelle des définitions et des instruments de mesure.
Volume global des aides nationales dans les États membres,
Cette légère baisse globale correspond à une diminution des aides, généralement peu marquée, dans la quasi totalité des États membres. A l'exception du Royaume-Uni et des Pays-Bas, où le montant des aides est peu élevé, et de l'Espagne, tous les autres États connaissent, entre 1992-1994 et 1994-1996, une diminution de leurs aides, mesurées en pourcentage du PIB. Cette baisse est néanmoins modeste, surtout si l'on tient compte de l'augmentation des PIB entre les deux périodes. Globalement, les aides se situent entre 1,5 % et 1,4 % du PIB communautaire. Volume global des aides nationales dans les États membres, en pourcentage
Le meilleur indicateur du niveau d'aide par pays n'est ni le montant des aides, ni leur part dans le PIB, mais le montant d'aides publiques par salarié. Il permet de distinguer clairement le groupe des États les plus généreux, qui sont souvent aussi les plus riches. Volume global des aides nationales dans les États membres, par salarié
Le pays le plus généreux accorde ainsi six fois plus d'aides, en moyenne par salarié, à ses entreprises, que le moins généreux. Ce n'est pas un hasard si le premier est l'Allemagne, le plus riche des pays européens, et le dernier le Portugal, l'un des plus pauvres à l'exception de l'Irlande et de la Grèce, dont les chiffres sont incertains. Par ordre décroissant de générosité, l'Allemagne est suivie par l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et la France. Ce lien avec la richesse des États n'est guère étonnant dans la mesure où ne sont comptabilisées ici que les aides nationales. Si l'on y ajoute les fonds structurels européens, les conclusions devraient être différentes, puisque ces aides visent à compenser les différences de richesse et de développement entre membres de l'Union. La comparaison des aides par secteur et par objectif met aussi à jour de fortes différences entre les pays, ainsi que le démontre le tableau ci-dessus. Ces contrastes sont encore plus marqués en ce qui concerne les aides aux secteurs particuliers et celles visant des objectifs régionaux. Aides d'État au secteur manufacturier, 1994-1996. Ventilation des aides (en pourcentage)
(en pourcentage)
Étant exécutés sur plusieurs années - la programmation en cours s'étale sur la période 1994-1999 -, leur engagement s'effectue progressivement. Il est donc à la fois difficile et peu significatif d'analyser des chiffres annuels, ceux-ci apparaissant logiquement faibles en début de période, alors que les projets sont en cours d'élaboration. Le décalage entre engagements et paiements contribuent également à priver d'intérêt les montants annuels. Ces deux éléments sont illustrés par les graphiques ci-dessous : Exécution des CCA et DOCUP de 1994 à 1997, tous objectifs confondus (en millions d'écus) 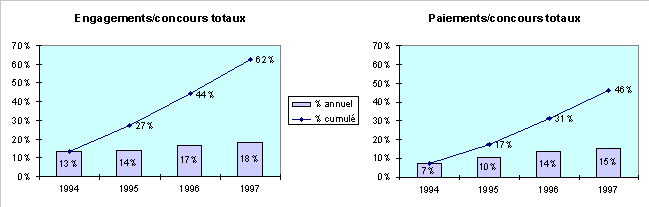
Dans tous les cas, l'Europe n'accorde pas directement une aide, mais cofinance certaines des aides accordées par les États ou les collectivités locales. Il n'y a donc pas de dispositifs spécifiquement européens qui interviendraient en tant que tels, à l'exception du FEOGA-Garantie, partie du FEOGA destinée au financement des restitutions agricoles, c'est-à-dire à la compensation de la différence entre prix européen et prix mondial des produits agricoles. Pour le reste, l'Europe se contente d'abonder certaines aides accordées dans les États membres par l'intervention du cofinancement par l'un ou l'autre des fonds communautaires, selon l'objectif poursuivi. La complexité, voire l'opacité, du mécanisme est accrue par le fait qu'il n'y a pas de correspondance entre un objectif et un fonds : la règle est au contraire qu'un fonds puisse intervenir dans plusieurs, sinon dans tous les objectifs. Ces interventions sont de plus tantôt spécifiques, tantôt partagées avec le cofinancement apporté par d'autres fonds structurels. Le tableau précédent illustre cette complexité : on voit que l'IFOP contribue à trois objectifs, le FEOGA et le FEDER à quatre objectifs chacun, le FSE à six d'entre eux. Les orientations présentées dans le cadre de « l'Agenda 2000 » en juillet 1997 témoignent d'un certain effort de simplification, dans la mesure où les six objectifs ne seront plus que trois, mais ne résout que partiellement le problème des cofinancements entre fonds. Les trois nouveaux objectifs sont les suivants : - le nouvel objectif 1 sera identique à l'objectif 1 actuel mais les régions actuellement éligibles à l'objectif 6 seront automatiquement incluses dans ce nouvel objectif 1 : les quatre fonds structurels soutiendront ainsi le développement des régions concernées ; - le nouvel objectif 2 concernera les régions en reconversion économique et sociale subissant un chômage important (c'est-à-dire les zones industrielles en déclin, les zones rurales fragiles, les zones dépendantes de la pêche, ainsi que les zones urbaines en crise) : y contribueront le FEDER, le FSE, l'IFOP et le FEOGA-Garantie ; - le nouvel objectif 3 relatif au développement des ressources humaines aura pour but de soutenir l'adaptation et la modernisation des politiques et systèmes d'éducation, de formation et d'emploi. Il interviendra en dehors des régions et zones des objectifs 1 et 2. Seul le FSE cofinancera des actions dans ce cadre. Seul le troisième objectif relève du financement d'un fonds unique, ce dernier n'en finançant pas moins les deux autres objectifs. Il ne devrait en outre intervenir que dans des zones qui ne bénéficieront d'aucun autre financement structurel européen. Les entreprises dont les aides seront abondées dans le cadre de cet objectif sauront qu'elles proviennent du FSE ; pour les autres, le flou demeurera. Cela ne facilite pas le contrôle dans la mesure où il s'effectue essentiellement par fonds. Si les fonds structurels sont à l'origine de la plus grande partie des cofinancements européens d'aides aux entreprises, ils interviennent fréquemment en coordination avec d'autres fonds ou organes de la Communauté : Fonds de cohésion, Banque européenne d'investissement (BEI), Fonds européen d'investissement (FEI) et Communauté européenne du charbon et de l'acier. Instrument au service de la cohésion économique et sociale, le Fonds de cohésion intervient parallèlement aux fonds structurels : aucune dépense ne peut bénéficier en même temps d'aides de ces deux fonds, mais ils peuvent contribuer à des stades de projets qui sont financièrement et techniquement indépendants. Des financements du FEDER s'ajoutent ainsi fréquemment à ceux du Fonds de cohésion. Les interventions du Fonds de cohésion atteignaient 1,56 milliards d'écus en 1993 et 2,44 milliards en 1996. La Banque européenne d'investissement accorde en autre des prêts dans tous les États membres. Son activité a progressé de 12,6 % entre 1996 et 1997, l'accroissement des concours étant particulièrement net dans le domaine des réseaux transeuropéens, l'industrie, les services et la téléphonie mobile. Le tableau qui suit montre la diminution de l'activité de la BEI dans les zones de développement régional ou bénéficiant du Fonds de cohésion.
Ce sont surtout les concours au profit des infrastructures qui progressent. Quoique les projets retenus par la BEI soient l'objet de certaines critiques. C'est ainsi que M. Yves-Thibault de Silguy reproche à la Banque de faire le choix de la facilité, au détriment de son objectif premier : « la BEI se met désormais à accorder des prêts globaux à des entreprises, ce qui me semble une dérive regrettable. En effet, à quoi bon prêter des fonds à un grand groupe qui n'a pas besoin de la BEI pour obtenir un prêt, même si, en contrepartie, il s'est engagé à faire des investissements dans certaines zones en retard de développement... Il est vrai que les prêts globaux sont plus facile à gérer que les prêts par projet ». D'une part, il est plus aisé d'assurer le suivi de prêts globaux, dans la mesure où ils ont un bénéficiaire unique et peuvent être librement utilisés ; d'autre part, cette facilité de gestion permet d'en accorder un volume plus important, et donc d'offrir des taux d'intérêt plus bas. Dans la pratique - et c'est ce que dénonce le Commissaire européen -, ces prêts sont accordés à des grands groupes, leur évitant d'avoir à se financer sur le marché des capitaux, et non à des projets auxquels peuvent participer des PME, qui accèdent beaucoup plus difficilement à d'autres sources de financement. Mme Édith Cresson partage le même sentiment et a estimé que « le problème tient à ce que les établissements soi-disant de capital risque en Europe, et notamment en France, ne financent pas le risque en général, mais des secteurs plus traditionnels, des rachats plus que des créations d'entreprises », tout en reconnaissant que la BEI commence à s'adapter à ce qu'elle considère comme des besoins nouveaux : « j'ai débloqué un milliard d'euros à la banque européenne d'investissements au Luxembourg, qui ne finançait jusqu'ici que des infrastructures, comme les autoroute au Portugal par exemple, et qui va désormais financer des entreprises petites et naissantes dans les nouvelles technologies, à travers des organismes de capital risque ». La BEI serait ainsi recentrée vers le soutien aux entreprises, alors qu'au travers de l'aide aux infrastructures, elle s'adressait jusque là d'abord aux pouvoirs publics. Il faut aussi mentionner ici le Fonds européen d'investissement (FEI), spécialisé dans l'octroi de garanties et les opérations en capital. Son objectif est de promouvoir l'investissement à moyen et long terme dans deux domaines vitaux pour l'Union : les réseaux trans-européens, où il vise à faciliter le partenariat entre les secteurs public et privé, et les PME, auxquelles il facilite l'accès à des moyens de financement au coût raisonnable. En 1997, sur les 769 millions d'écus de garanties accordées par les FEI, 434 millions ont été destinés aux PME ; cette part devrait encore croître dans l'avenir puisque à la suite du Conseil européen extraordinaire sur l'emploi de Luxembourg, le FEI et la Commission préparent des propositions sur de nouveaux instruments financiers visant à soutenir les PME innovantes et créatrices d'emplois. La Communauté économique du charbon et de l'acier (CECA) disposait d'un instrument de prêts assortis de bonifications d'intérêts en faveur d'investissements de reconversion créateurs d'emplois. Comme le traité CECA expire en 2002, cet instrument a été définitivement clos le 30 juin 1997. Un dernier prêt global de 8,9 millions d'écus a été accordé pour un projet prévoyant la création de 670 emplois. En ce qui concerne les bonifications d'intérêts sur les prêts en cours, 2 millions d'écus ont été engagés au titre du budget CECA relatif à l'exercice 1997. La Commission a versé 50 tranches de prêts de reconversion aux intermédiaires financiers pour un montant de 206,8 millions d'écus. Afin d'évaluer la part respective des aides nationales et des aides communautaires dans les différentes économies nationales, il est intéressant de comparer des chiffres correspondants à des périodes similaires. Le sixième rapport sur les aides d'État dans le secteur des produits manufacturés et certains autres secteurs de l'Union européenne nous fournit de telles données. Nous obtenons le tableau suivant, pour ce qui est des moyennes annuelles sur la période 1994-1996, étant comptées comme interventions communautaires les sommes versées au titre du FEOGA (Garantie et Orientation, agriculture et pêche), de l'IFOP, du Fonds social, du FEDER et du Fonds de cohésion : Aides d'État et aides communautaires dans les différents États membres : moyennes annuelles 1994-1996 (en millions d'écus)
Mais il ne faut pas accorder à ce tableau plus de signification qu'il en a. En effet, sont comparées ici les aides octroyées par les États et les collectivités locales aux aides communautaires aux différents États. Or toutes les aides communautaires ne sont pas destinées aux entreprises : dans de nombreux cas, il est très difficile, voire impossible, de déterminer l'élément d'aide que contient l'intervention communautaire, qui n'est pas versée directement à des entreprises comme c'est le cas pour les aides d'État. Dans le secteur agricole, les bénéficiaires des interventions communautaires ne sont généralement pas des entreprises. De plus, les dépenses communautaires sont fortement influencées par les différences entre prix mondiaux, qui sont fluctuants, et prix communautaires des produits agricoles, ce qui n'est pas le cas de la plupart des dépenses nationales.
Les interventions communautaires correspondent ainsi à des sommes considérables, destinées à des objectifs nombreux et réparties de manière inégale entre les États membres. Pour ce qui est des entreprises, elles complètent les aides nationales, et ne peuvent donc être accordées que si des dispositifs nationaux existent et si l'État ou les collectivités locales apportent un premier financement. Même si les plafonds sont plus élevés pour les aides concernant les zones les plus en retard de développement, permettant un cofinancement européen plus important dans ce cas, la nécessité d'une première intervention nationale limite la capacité d'intervention de l'Union, et explique qu'elle ne puisse pas toujours compenser les différences de traitement résultant des contrastes de richesse entre États. Les travaux de la commission d'enquête confirment l'ampleur et la diversité de ces pratiques. Si de grandes orientations apparaissent dans les systèmes d'aide des États membres, des contrastes réels existent quant aux objectifs et aux formes d'aides, comme le rapport de la Commission européenne l'a montré. Nous avons en outre constaté une extrême diversité des dispositifs au cours de notre enquête. La première ligne de fracture correspond à la structure de l'État : les aides dans un État fédéral sont organisées selon un autre modèle que dans les États plus centralisés. Dans un cas comme dans l'autre, les aides de l'État national se distinguent de celles des collectivités locales. Les relations entre ces deux sphères dépendent du modèle de l'organisation des interventions économiques. Au sein de l'Union européenne, on peut en distinguer deux, comme le fait M. Marc Laffineur dans son rapport au Premier ministre de février 1997, consacré aux interventions économiques des collectivités locales dans l'Union européenne : - en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Espagne, en Belgique, une compétence économique principale est clairement attribuée à un niveau décentralisé régional, Länder ou régions, ce qui ne signifie pas que l'État national ne soit pas en mesure de jouer un rôle essentiel, ni que les collectivités inférieures soient absentes de ce secteur d'activité ; - dans la plupart des autres pays, les collectivités locales n'ont pas de compétences particulières dans ce domaine, ce qui n'implique ni qu'elles ne jouent aucun rôle, ni que ces responsabilités sont exercées de manière purement administrative. Cette distinction, pratique pour la présentation, reflète une différence d'organisation interne mais correspond aussi à un certain volume d'aides. Il apparaît ainsi, d'après les informations données par la Commission européenne, que les États membres dont le rapport des aides aux PIB est proche de la moyenne communautaire ou supérieur à cette moyenne sont les États décentralisés : pour une moyenne de 1,4 % sur la période 1994-1996, l'Espagne se situe à 1,2 %, la Belgique à 1,3 %, l'Allemagne à 1,9 % et l'Italie à 2 %. La coexistence de niveaux d'autorité dotés de compétences économiques et de moyens financiers joue un rôle certain dans le niveau élevé de ces aides. On trouvera en annexe une étude des aides aux entreprises accordées en Europe par les États et les collectivités locales, l'accent étant mis sur la différence d'organisation entre les pays à compétence économique répartie et les pays à compétence économique concentrée. Elle met en évidence le fait que les dispositifs d'aides aux entreprises présentent partout une grande complexité, liée à la fois à la multiplicité des organes à l'origine des aides, aux niveaux local, national et, le cas échéant, communautaire, et à la pluralité de leurs objectifs et des critères d'attribution. Dans ce domaine, le cas des pays de l'Union européenne n'est qu'un reflet accentué de la situation de l'ensemble des membres de l'OCDE.
Si l'OCDE affiche ouvertement son libéralisme, la quasi totalité de ses membres s'est dotée de dispositifs d'aides aux entreprises. Seule la Nouvelle-Zélande en est dépourvue depuis le milieu des années 1980, mais cette situation exceptionnelle est sur le point d'être remise en cause. L'ensemble des systèmes d'aides des pays de l'OCDE présente d'une part des points communs, d'autre part un certain nombre de singularités nationales. Dans tous les cas, et quelle que soit la forme d'organisation des États, les aides sont données à différents niveaux. Outre les niveaux national et local, ils existent souvent des niveaux intermédiaires, celui des États fédérés ou des régions notamment. Ces différents niveaux rendent complexes les systèmes d'aides et contribuent à accroître les difficultés de contrôle, qui sont, dans tous les États, d'autant moins rigoureux qu'ils portent sur des financements décentralisés. Des lignes directrices apparaissent, qui ne sont pas toujours à l'origine des aides mais apparaissent au moins a posteriori. Les autorités poursuivent un certains nombre d'objectifs, dont les principaux sont communs aux différents États, même si tous n'insistent pas nécessairement sur les mêmes points, comme le tableau de synthèse infra le montre. Les objectifs qui reviennent le plus souvent concernent les PME, l'emploi, la recherche et le développement, l'investissement, l'exportation. Il est également de pratique assez courante, quoique les règles du commerce international y soient défavorables, d'accorder des conditions particulières à des secteurs ou des zones particulières : il s'agit tantôt de soutenir des secteurs en difficultés ou d'aider leur reconversion, tantôt de réduire les décalages de développement entre régions. Les différents membres de l'OCDE ont ainsi recours à des méthodes similaires pour résoudre le même type de difficultés. Les aides se distinguent néanmoins par leur volume et par leurs formes. S'il est toujours difficile d'obtenir des évaluations fiables en matière d'aides - étant donnés les définitions variables de la notion d'aide et leur caractère souvent décentralisé et mal contrôlé, de nombreux pays s'avèrent incapables de chiffrer le montant des aides accordées -, il n'en apparaît pas moins que tous les États n'aident pas leurs entreprises dans les mêmes proportions. Cela dépend des moyens dont elles disposent et de leur stratégie, libérale ou interventionniste. Il faut d'ailleurs noter qu'aucun État de l'OCDE, quel que soit son discours officiel, ne pousse le respect du libre-échange jusqu'à se refuser à accorder la moindre aide aux entreprises installées sur son territoire. L'interventionnisme existe donc partout, mais à des degrés divers. Dans tous les pays, les aides accordées aux entreprises par les pouvoirs publics peuvent prendre deux formes : elles sont soit fiscales, soit budgétaires. La distinction entre aides directes et indirectes, présente dans la législation française mais sujette à des interprétations divergentes et sources de difficultés, n'est pas retenue dans les autres pays. Tout comme il est difficile de chiffrer le montant des aides dans les différents pays, déterminer leur forme, et la proportion de chacune, est une véritable gageure. Il faut souvent se contenter de dire quelle est la forme dominante, sans pouvoir entrer dans plus de précisions. Chaque pays de l'OCDE offre ainsi une gamme d'aides plus ou moins larges aux entreprises présentes sur son territoire. Le principe est que les aides puissent être accordées à toute entreprise répondant aux critères légaux ou réglementaires, mais sans que soit prise en compte la nationalité de ses capitaux - si tant est que cette notion ait encore un sens dans une économie mondialisée où il est difficile de suivre précisément l'évolution de la structure, du périmètre et de l'actionnariat des groupes. Les régimes appliqués dans les différents pays peuvent donc constituer un critère du choix d'implantation d'une filiale, au même titre que les différentiels de fiscalité.
Cliquer
ici pour revenir au sommaire du tome I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||