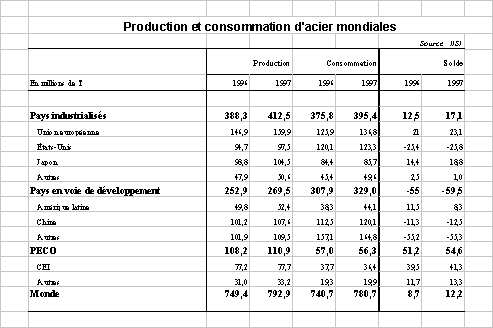DEUXIÈME PARTIE: DES STRATÉGIES MONDIALISÉES QUI LAISSENT LES II. - LA STRATÉGIE DES GRANDS GROUPES 1
Rappelant que notre pays constitue le troisième site d'accueil des investissements étrangers au sein de l'Union européenne après le Royaume-Uni et l'Allemagne (données 1996), le dernier rapport Cartes sur table (1999) du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) souligne que les entreprises et groupes français disposent d'atouts nombreux. L'attractivité de la France s'exprime ainsi à travers une main d'_uvre qualifiée - 170 étudiants pour 1 000 jeunes de 15 à 29 ans (1996) contre 151 au Royaume-Uni, 146 dans la zone euro et 135 en Allemagne - ou le dynamisme de la création d'entreprises. Du point de vue industriel, la France apparaît également en situation favorable, si l'on en juge par le tableau suivant.
En d'autres termes, alors que le PIB allemand était supérieur de 41,9 % au PIB français en 1996 (source : Eurostat-INSEE, Rapport sur les comptes de la Nation 1997), le chiffre d'affaires cumulé des groupes allemands appartenant aux cents premiers groupes européens n'était supérieur que de 36,1 % au chiffre d'affaires cumulé de leurs homologues français. Inversement, le PIB français représentait en 1996 119,8 % du PIB du Royaume-Uni mais le chiffre d'affaires cumulé des groupes français 146 % du chiffre d'affaires cumulé des groupes britanniques. De même, le tableau des quinze premières entreprises mondiales par type d'activité (tableau ci-après) atteste des positions favorables des groupes français dans le pétrole, l'automobile, les télécommunications ou les services collectifs. Les auditions effectuées par la commission d'enquête permettent d'affiner le constat effectué au niveau macro-économique par l'étude de stratégies particulières. Les brillants résultats constatés, qui bénéficient en premier lieu aux actionnaires, sont souvent obtenus au prix d'une réduction de l'emploi et d'externalisations ou délocalisations que seule la quête de profitabilité paraît inspirer. A. - les groupes soumis à l'examen de la commission Il convient de présenter brièvement les dix groupes auditionnés par la commission d'enquête, dont le tableau suivant résume les caractéristiques principales. les dix groupes auditionnés par la commission d'enquête 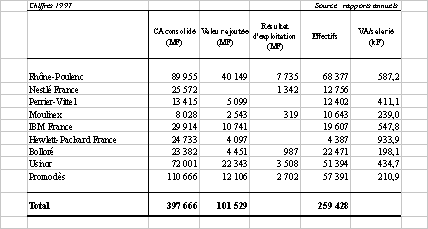 Le groupe Rhône-Poulenc, qui totalisait 90 milliards de francs de chiffre d'affaires en 1997, est un groupe intégré reposant sur deux piliers principaux : les sciences de la vie (57,7 % du chiffre d'affaires en 1997) et la chimie (41,6 %). La présence dans les sciences de la vie s'exprime à travers le contrôle de filiales spécialisées. Dans la pharmacie, le groupe est présent à travers Pasteur-Mérieux-Connaught (vaccins), Rhône-Poulenc-Rorer (oncologie, maladies respiratoires, allergies et cardiologie), Rhône-Poulenc-Gencell (thérapies géniques) et Centeon (protéines plasmatiques). Dans le secteur de la santé animale et végétale, le groupe détient Rhône-Poulenc-Agro (herbicides, insecticides, fongicides et régulateurs de croissance), Rhône-Poulenc-Jardin (produits grand public), Rhône-Poulenc-Animal Nutrition (additifs nutritionnels pour l'alimentation animale) et Merial (vaccins et médicaments vétérinaires). L'ensemble des activités dans la chimie ont été placées au sein de la filiale Rhodia présente sur un gamme élargie de produits : peintures, intermédiaires organiques et pharmaceutiques, cosmétiques, détergents, silicones etc. M. Jean-René Fourtou, président-directeur général du groupe, en a présenté la situation actuelle : « l'année 1998 a été une année très importante du point de vue économique. Rhône-Poulenc a réalisé des résultats de 4,2 milliards de F, c'est-à-dire les plus importants de son histoire (en progression de 23 % par rapport à l'année précédente). La transformation du portefeuille d'activités et l'innovation ont commencé à se révéler payants, puisque nous avons mis sur le marché des produits nouveaux qui se vendent très bien (...). Au terme d'un mouvement entamé au début des années quatre-vingt, le groupe s'est profondément transformé. Quelques chiffres : nous représentions 2 milliards de F en 1982 ; en 1986, nous mobilisions à peu près 2,5 milliards de F pour la seule recherche et développement (R&D) ; l'année dernière, la R&D a atteint 9 milliards de F. Le groupe Rhône-Poulenc est aujourd'hui complètement internationalisé, puisque le chiffre d'affaires (CA) réalisé aux États-Unis en 1998 était de 27 % du CA global du groupe (contre moins de 2 % en 1986) et que l'Asie en représente 10 % ». Le groupe Usinor (72 milliards de francs de chiffre d'affaires consolidé et 51 394 salariés en moyenne en 1997) constitue le principal opérateur sidérurgique français, particulièrement présent dans trois gammes de produits : · les aciers plats au carbone (37,8 milliards de francs de chiffre d'affaires en 1997) à travers notamment sa filiale Sollac (tôles minces en aciers au carbone laminées à chaud ou à froid, nues ou revêtues) ; · les aciers inoxydables et alliages rassemblés dans la division industrielle Ugine (17,2 milliards de francs de chiffre d'affaires en 1997, soit 23,1 % du total du groupe), c'est-à-dire les tôles magnétiques, tôles plombées et tôles en acier inoxydables laminées à chaud ou à froid sous forme de bobines, feuilles et feuillards ; · les aciers spéciaux (14,4 milliards de francs de chiffre d'affaires en 1997), c'est-à-dire les barres et fils en aciers alliés spéciaux utilisés dans les roulements, amortisseurs, ressorts, roues et essieux ferroviaires, câbles, haubans etc. L'intervention de Mme Viviane Claux (CGT) a souligné l'évolution récente de sa stratégie : « Usinor développe actuellement une stratégie nouvelle. Groupe industriel doté de savoir-faire, il s'est en effet recentré selon des critères financiers dans le but de devenir le leader mondial des spécialités à forte valeur ajoutée. Dans un contexte marqué par la crise asiatique et la baisse des prix, Usinor réalise des profits confortables depuis sa privatisation : plus de 2 milliards de francs en 1997, puis en 1998, malgré l'existence de provisions et le versement de dividendes élevés aux actionnaires ». Le poids économique du groupe Moulinex (8 milliards de francs de chiffre d'affaires en 1997) est très inférieur à celui d'Usinor ou de Rhône-Poulenc. Deuxième fournisseur mondial de petit électroménager après Seb mais devant Philips ou Braun, le groupe est un acteur généraliste présent dans six gammes de produits à usage domestique : la cuisson (fours conventionnels, fours à micro-ondes et friteuses), le petit déjeuner (cafetières, bouilloires, centrifugeuses et grille-pain), la préparation alimentaire (robots multifonctions, hachoirs et mixers), le linge (fers à repasser), l'entretien des sols (aspirateurs) et la santé (brosses à dents et sèche-cheveux). M. Daniel Fauvel (CFTC) a rappelé à la commission d'enquête les principaux jalons de l'histoire récente du groupe : « la première étape correspond à "l'époque Mantelet», celle de l'entreprise familiale, caractérisée par la montée en puissance d'une petite entreprise profitant pleinement des effets des Trente Glorieuses, devenue rapidement une entreprise plus que respectable, riche et implantée harmonieusement en Basse-Normandie et dans les pays de Loire. L'entreprise était fondamentalement industrielle, source de nombreuses créations d'emplois, élément souvent unique et toujours prépondérant de la richesse des communes sur le sol desquelles elle était implantée. La facilité de l'époque n'évite pas quelques déboires financiers, souvent dus à l'inexistence de prévision, à la réalisation de projets quelquefois fantaisistes, décidés par un patron "de droit divin». Peu importent les déboires financiers, ils sont systématiquement renfloués par la fortune personnelle accumulée par le patron fondateur, et le personnel est toujours épargné de tout souci (...). La seconde étape s'étend sur une décennie, pendant laquelle un président diminué physiquement laisse la direction des opérations à quelques collaborateurs : « Cette époque a d'abord été marquée par un combat pour la "reconnaissance exclusive» du patriarche, une lutte de pouvoir, puis une prise de pouvoir à la disparition de M. Mantelet. Elle a été aussi une longue période d'enrichissement personnel. Elle correspond à la fin des Trente Glorieuses, élément qui, visiblement, échappe aux dirigeants et plonge le groupe dans un marasme industriel et financier qui faillit entraîner la disparition pure et simple de Moulinex de l'échiquier du petit électroménager européen. Cette période n'en reste pas moins celle de la croissance externe de Moulinex, qui se place en leader européen et affiche une ambition mondiale. La troisième étape débute avec le départ à la retraite de M. Roland Darneau, l'arrivée de M. Jules Coulon, l'audit du groupe par le cabinet anglo-saxon Arthur Mac-Kinsey, la fin anticipée du rachat par les salariés (RES), l'arrivée de nouveaux partenaires financiers - en particulier des fonds anglo-saxons, MM . Jean-Charles Naouri et Georges Soros -, un premier plan social d'urgence, le départ précipité de M. Jules Coulon et enfin la remise de la direction à l'actuel président-directeur général, M. Pierre Blayau. Nestlé France regroupe l'ensemble des activités alimentaires et boissons du groupe en France, à l'exception des eaux minérales et de source et des produits pharmaceutiques. Les 26,1 milliards de francs de chiffre d'affaires réalisés en 1997 le situent à la quatrième place en France après Danone (88,5), Eridania-Beghin-Say (63,6) et Besnier (27,9). M. Lars Olofsson, président-directeur général du groupe Nestlé France SA, en a fait une présentation rapide : « Nestlé est la première entreprise alimentaire dans le monde, elle est présente dans plus de 180 pays, son chiffre d'affaires atteint 260 milliards de francs français, avec 500 usines réparties sur les cinq continents et 225 000 collaborateurs. « L'activité alimentaire de Nestlé en France est structurée en trois pôles : Nestlé France (...), Perrier-Vittel et Friskies France qui regroupe les activités aliments et accessoires pour les animaux familiers, avec des marques comme Friskies, Gourmet, Fido et Félix. Nestlé est présent en France depuis la fin du siècle dernier, la première usine y a été construite en 1916. Aujourd'hui, nous avons 27 usines, hors eaux minérales, et 6 pour les aliments pour animaux, avec, au total, près de 13 000 collaborateurs. Ces usines sont réparties sur tout le territoire et principalement en zone rurale, près de nos fournisseurs. « Notre chiffre d'affaires est de plus de 26 milliards de francs, ce qui nous situe en deuxième position, derrière le groupe Danone (...) Nous achetons et transformons 1 milliard de litres de lait, 170 000 tonnes de pommes de terre, 75 000 tonnes de tomates et nous exportons 17 % de notre production ». 5. - Perrier-Vittel SA Perrier-Vittel SA est l'entreprise qui coiffe l'activité mondiale Eaux et sources du groupe Nestlé (filiale à 95 % de Neslé entreprise SA, société holding à la tête de l'ensemble des activités du groupe en France). En 1997, Vittel, Quézac, Nestlé Source France (NSF) et la Générale de grands sources (GGS) ont fusionné avec effet rétroactif au 1er janvier 1997 pour donner naissance à Perrier-Vittel France, qui détient également des participations dans différentes filiales présentes dans le thermalisme, l'hôtellerie et l'emballage. M. Alain Dorfner, directeur général de Perrier-Vittel SA, a souligné cette diversité de métiers au sein du groupe et résumé les principaux éléments de sa stratégie : « Perrier-Vittel France, qui emploie près de 4 000 personnes, a obtenu en 1998 un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de francs, dont environ 20 % réalisés à l'export. « Son activité essentielle consiste à gérer des ressources d'eaux minérales naturelles, à les embouteiller et les commercialiser. En 1998, les ventes totales en France et à l'export ont représenté 2,3 milliards de bouteilles, dont 1,7 ont été vendues en France via huit marques, toutes distribuées sur le territoire français et qui offrent un portefeuille complet à nos consommateurs et à nos clients. « Comme les eaux minérales naturelles, les eaux de source sont soumises à une obligation d'embouteillage sur le lieu d'émergence. Les marques de Perrier-Vittel France sont réparties sur quatre sites d'embouteillage : l'usine de Vittel, qui embouteille les marques Vittel, Hépar et l'eau de source Vitelloise ; l'usine de Contrexéville qui embouteille la marque Contrex ; l'usine de Vergèze qui embouteille la marque Perrier ; l'usine de Quézac, en Lozère, inaugurée en 1995, qui embouteille une eau minérale naturelle gazeuse, lancée nationalement la même année ». 6. - IBM France Le groupe IBM France présente un profil d'acteur généraliste de l'informatique atypique dans ce secteur, puisqu'il couvre l'industrie dans toutes ses composantes. M. Bernard Dufau, président-directeur général, a ainsi rappelé que « [le chiffre d'affaires du groupe], de 32 milliards de francs, se décompose en deux parties. La première, réalisée avec des clients français, s'élève à 19 milliards de francs. La seconde correspond aux produits que nous vendons à nos filiales, en Italie, en Espagne, qui les revendent au client final. Le montant total est la somme des chiffres d'affaires, qui se consolident pour constituer celui de la société (...). « [Il] se décompose en trois grandes activités : premièrement, la vente de matériels, allant du poste de travail de type PC jusqu'aux systèmes informatiques et serveurs importants : elle représente 42 % du total ; deuxièmement, les logiciels qui représentent 21 % ; troisièmement, les services, la maintenance, l'entretien, la mise en place d'écriture de programmes, la gestion des parcs informatiques représentent près de 37 %. En conséquence, le matériel représente 42 % et le "non-matériel» 58 % ». Il est intéressant d'observer le remodelage progressif de ce profil global, en lien avec le repli des plates-formes propriétaires : la part du matériel (hardware) recule sur longue période (de 52,3 % de l'activité en 1992 à 46,1 % en 1997), au profit des services (de 11,4 % des ventes en 1992 à 24,6 % en 1997). Filiale du groupe américain Hewlett-Packard Corp., la société Hewlett-Packard France est aujourd'hui organisée autour de deux pôles distincts de compétences : d'une part, une entité commerciale qui gère l'administration et la vente des produits relevant de la microinformatique, des systèmes d'information, des services clients, des tests et mesure, des composants, du secteur Santé et de l'analyse chimique ; d'autres part, une entité industrielle qui recouvre les grands sites français de Grenoble et l'Isle d'Abeau. En volume d'activité sur le marché national, Hewlett-Packard France est le quatrième fournisseur de matériels informatiques (7,3 milliards de francs de chiffre d'affaires en 1997) et le sixième prestataire de services (1,7 milliard de francs en 1997). Avec un produit net bancaire de 81,5 milliards de francs et un total de bilan de 2 515 milliards de francs en 1997, le Crédit agricole constitue le premier groupe bancaire français devant la Société générale, le Crédit lyonnais et la BNP. Le développement de sa présence sur des segments spécialisés du marché - crédit à la consommation (banque Sofinco), assurance vie et assurance dommages (Predica et Pacifica), financement des entreprises (Transfact et CAI), banque d'investissement (Crédit agricole Indosuez et Crédit agricole Cheuvreux de Virieu) ou gestion d'actifs et la gestion privée - résulte d'une inflexion stratégique récente, que Mme Marie-France Scelles (Sudcam) a rappelée à la commission d'enquête : « Avant sa privatisation, le Crédit Agricole était un établissement semi-public soumis à la tutelle de deux ministères (celui de l'agriculture et celui de l'économie et des finances), disposant d'une structure nationale (la Caisse nationale du Crédit Agricole) et d'une structure régionale (caisses départementales et parfois régionales) complétée par des caisses locales ayant pour champ d'activité la commune ou le canton. Ces entités avaient, et elles conservent, un statut coopératif relevant du code rural. Elles étaient politiquement gérées par des administrateurs-sociétaires issus, pour la plupart, de l'agriculture et du monde rural ainsi que par des professionnels et des gens du terroir avant que les technocrates ne leur confisquent le pouvoir. « Cette structure et la répartition du pouvoir qui en découle faisaient du Crédit Agricole l'outil efficace d'une politique agricole et économique pragmatique menée sur l'ensemble du territoire. C'est ainsi que les pouvoirs publics pouvaient aider les jeunes agriculteurs ou les jeunes artisans ruraux à s'installer ; il suffisait pour cela que l'État prévoie une enveloppe prenant en charge une partie des taux d'intérêt des prêts bonifiés que le Crédit Agricole distribuait pour l'achat de terres, de locaux professionnels ou de matériel (...). « Sa privatisation a marqué un changement de cap lourd de conséquences. Structurellement, nous assistons à des fusions de caisses régionales : 95 il y a quelques années, elles ne sont plus que 53 aujourd'hui, avec les effets que cela entraîne sur le tissu économique et la vie sociale des départements concernés. Selon Mme Marie-France Scelles, cette évolution prive de plus en plus le Crédit Agricole de son rôle de levier sur l'économie locale : « Devenu entreprise capitalistique, il gère ses affaires avec pour principal objectif de faire des profits. Il faut reconnaître que, dans ce domaine, il est très efficace puisqu'il a dégagé plus de 35 milliards de bénéfices nets ces quatre dernières années et 12,3 milliards en 1998 (...). Enfin, le Crédit Agricole assure une partie de son résultat par le placement de la collecte monétaire sur le marché financier à court terme à hauteur de 30 % environ. Cela en dit long sur son rôle politique (...). « Pour l'avenir, les dirigeants de la Caisse nationale du Crédit Agricole affichent clairement leur volonté de trouver une solution qui leur permette d'être présents sur le marché financier, ce qui conduira nécessairement à la recherche de toujours plus de bénéfices qui seront versés en dividendes aux actionnaires. Cette évolution signera la fin du Crédit Agricole mutualiste et des valeurs qui lui étaient attachées, si toutefois elles sont encore d'actualité ». Créé en 1961 en Normandie à la suite du rapprochement de plusieurs sociétés de distribution de gros, Promodès est un groupe familial de distribution à dominante alimentaire. Selon M. Paul-Louis Halley, président-directeur général du groupe, sa particularité est d'opérer concomitamment sur plusieurs métiers différents : « Promodès présente une certaine originalité par rapport aux autres groupes dits de la "grande distribution». Nous ne sommes pas spécialisés sur un seul format de magasins car, pour des raisons historiques, nous couvrons toute la gamme, depuis le commerce rural de campagne ou de proximité de centre ville jusqu'aux hypermarchés. Par ailleurs, les magasins qui portent l'une de nos enseignes - car chaque surface de vente a une enseigne différente - sont exploités par des entreprises indépendantes (familiales) liées à Promodès par des contrats de franchise. Promodès assume la responsabilité de leur proposer l'offre commerciale, l'organisation des achats, la logistique et la communication auprès des consommateurs (...). « Le chiffre d'affaires de 213 milliards de francs est réalisé pour une moitié en France et le reste à l'étranger. La répartition est la suivante : hypermarchés : 44 % ; supermarchés : 32 % ; commerces de proximité : 9 % ; maxi discount : 8 % et distribution aux professionnels (restaurants, collectivités, etc. qui ne commercialisent pas les produits) : 7 % (...). Le chiffre d'affaires 1998 consolidé, comparé à celui des quatre années précédentes, marque une progression assez sensible en termes de chiffre d'affaires, de résultats, d'autofinancement ou de résultats nets. Ceci provient notamment d'acquisitions faites au début de l'année 1998 en France, en Espagne et au Portugal ». Aux frontières des logiques industrielles et financières, la commission d'enquête a souhaité comprendre les pratiques d'un groupe atypique comme le groupe Bolloré. Il est revenu à son président-directeur général, M. Vincent Bolloré, d'en présenter les axes structurants : « Bolloré est une entreprise très ancienne puisqu'elle a été fondée en 1822 à côté de Quimper (...). Lorsque j'en est pris la direction en 1981, cette entreprise faisait un peu moins de 200 millions de francs français de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que, dans le classement de l'Expansion, elle ne figurait pas parmi les 5 000 premières entreprises françaises. Aujourd'hui, le groupe Bolloré représente plus de 25 milliards de francs de chiffre d'affaires et fait donc partie des 150 premiers groupes européens (...) « J'ai souhaité dès le premier jour le diversifier, ce qui est également un phénomène atypique puisque vous savez que la plupart des groupes, en tout cas dans les pays occidentaux, ont aujourd'hui tendance à souhaiter être sur un métier et sur un seul (...). La particularité de cette diversification, c'est que nous ne sommes allés et que nous n'allons que vers des métiers dans lesquels nous pensons pouvoir occuper une position forte ».
M. Élie Cohen (CNRS) a bien résumé les enjeux de cette recherche constante de productivité : « Les entreprises multinationales sont en train de s'appliquer à elles-mêmes un certain nombre de principes qu'elles appliquent à la sélection de leurs activités. Le premier est le principe de spécialisation, de "refocusing» ou de recentrage (...) On assiste en effet à la disparition progressive des conglomérats qui multipliaient des activités disparates et dont l'objet essentiel était de constituer un portefeuille d'activités à cycles suffisamment différents pour lisser à moyen terme les rentabilités. On assiste, au contraire, à l'émergence d'entreprises multinationales qui acquièrent une part de marché mondial de plus en plus importante sur un ou deux métiers. Vous en avez des manifestations tous les jours dans la presse : on voit se constituer des entreprises mondiales particulièrement puissantes, représentant des parts significatives du marché mondial, souvent triadiques, c'est-à-dire présentes dans les trois grandes régions mondiales et qui, par la spécialisation dans quelques métiers, essaient de tirer le maximum d'avantages ». Les groupes auditionnés par la commission d'enquête constituent autant d'illustrations à cette observation. On n'en retiendra ici que quelques exemples. Rhône-Poulenc, ou la compétitivité par la spécialisation. - Les groupes chimiques détenant des activités pharmaceutiques peuvent faire appel à deux grandes logiques stratégiques, exclusives l'une de l'autre. La première est celle du maintien et de l'intégration des activités chimiques et pharmaceutiques au sein du groupe : Bayer (Allemagne) et DuPont (États-Unis) ont ainsi choisi de se renforcer tant dans la chimie de spécialités que dans les sciences de la vie. La seconde est celle de la scission des pôles chimique et pharmaceutique : les groupes Ciba et Sandoz (Suisse) ont fusionné leurs activités pharmaceutiques respectives au sein de Novartis alors qu'ICI (Royaume-Uni) se séparait de Zeneca. En décembre 1998, les groupes Rhône-Poulenc et Hoechst ont choisi cette seconde option, les activités « Sciences de la vie » des deux parties étant apportées à la joint-venture Aventis. ENCADRÉ Au cours des années récentes, le groupe Rhône-Poulenc a poursuivi une politique volontaire de réorganisation de ses structures et d'isolement des activités identifiées, afin notamment de préparer d'éventuelles scissions. C'est ainsi que les activités Chimie et Fibres-polymères autrefois distinctes ont été placées en raison de leur complémentarité au sein de Rhodia, filiale à 100 % de Rhône-Poulenc en charge de six activités (chimie organique fine, spécialités pour produits industriels, spécialités pour produits de consommation, polyamides, polyesters et services). La cession ultérieure de cette dernière est par ailleurs annoncée. De même, les pôles Agro-alimentaire, Jardin et Animal-nutrition deviennent autant de filiales à 100 % de Rhône-Poulenc Santé végétale et animale, elle-même détenu à 100 % par Rhône-Poulenc SA. Le schéma radial ci-dessous décrit l'évolution de la structure du chiffre d'affaires de Rhône-Poulenc entre 1988 et 1996 : le développement du pôle santé (de 24,3 % du chiffre d'affaires en 1988 à 45,7 % en 1996, soit une progression de + 21,4 points) fait écho au recul de la chimie de 16,8 points (de 44,7 % à 27,9 %), les pôles fibres et agronomie connaissant une décroissance de moindre ampleur (de 15,0 à 12,7 % et de 14,3 % à 13,0 % respectivement). 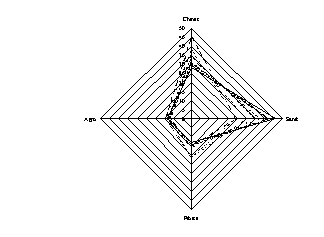 Dans le cadre de sa stratégie de redéploiement, Rhône-Poulenc a donc cédé les activités les moins rentables et les moins stratégiques.
Les activités de chimie de base, fibres et polymères sont caractérisées par une forte intensité capitalistique et des frais de recherche et développement relativement faibles. Le maintien de la compétitivité impose de détenir un outil industriel permettant l'extraction d'économies d'échelle et des prix modérés par le jeu de l'abaissement des coûts unitaires. Le secteur est très fortement concurrentiel : le nombre important d'acteurs a pour corollaire l'apparition de surcapacités récurrentes et les résultats dépendent d'effets de seuil sur les volumes, compte tenu de l'importance des frais fixes engagés. Le choix de Rhône-Poulenc de se retirer des polyesters est cohérent avec les choix de la plupart des chimistes européens, également confrontés à un marché fortement cyclique, une concurrence asiatique très vive et une rentabilité médiocre liée à l'absence de barrières technologiques à l'entrée et à des structures oligopolistiques en amont (compagnies pétrolières). Inversement, le groupe a opéré d'importantes acquisitions dans l'agrochimie et la pharmacie. Ces activités imposent des investissements importants en recherche et développement et comportent des risques élevés - le rythme de découverte des molécules ayant des propriétés réellement innovantes étant aléatoire. En revanche, ces secteurs bénéficient d'une forte rentabilité et sont moins exposés aux retournements cycliques. Acquisitions et cessions du groupe Rhône-Poulenc 1989-1998
De fait, le résultat d'exploitation de Rhône-Poulenc passe de 5,7 milliards de francs en 1988 à 9,4 milliards de francs dix ans plus tard - soit un taux de croissance annuel moyen de 5,2 % - alors que le résultat courant avant impôts et la valeur ajoutée par tête progressent respectivement de 3,7 milliards de francs à 6,9 milliards de francs (1988-1998) et de 347,7 à 587,1 milliers de francs (1988-1997). Résultats du groupe Rhône-Poulenc, 1988-1997 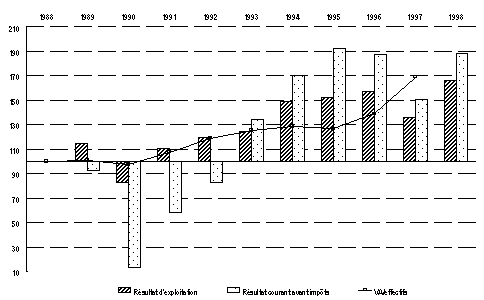 Bolloré, ou la spécialisation par la multipolarisation. - Le groupe Bolloré, à la différence des autres groupes auditionnés par la commission d'enquête, a fondé son développement sur la segmentation de ses activités. Sa structure atypique correspond en effet à la superposition d'un groupe financier, d'un groupe industriel et d'un groupe de transport : · le groupe financier acquiert des actifs sous-valorisés et les revend avec plus value. Ces produits permettent au groupe de se constituer des réserves utilisables pour racheter des participations minoritaires ou étendre et renforcer ses activités. Selon un article récent des Échos (16-17 avril 1999), Albatros Investissement (qui coiffe Bolloré technologies, Saga et les sociétés de l'ancien groupe Rivaud), le résultat net après survaleurs a atteint 1,5 milliard de francs en 1998 pour un résultat d'exploitation de 1,27 milliard de francs - en hausse de 5 % par rapport à 1997. Si l'on défalque la reprise de provisions réalisée à titre exceptionnel en 1997, la hausse du profit net part du groupe est de 95 %. La même source, qui observe que l'endettement net est revenu à zéro (contre 6,4 milliards de francs fin 1998, c'est-à-dire avant encaissement de la créance correspondant à la cession des titres Bouygues et la vente des actions Pathé) pour des fonds propres totalisant 7,78 milliards de francs, situe la trésorerie disponible entre 4 et 5 milliards de francs ; · le groupe industriel développe principalement une stratégie de niches ; · le groupe de transport correspond au métier de base du groupe et a été renforcé par la prise de contrôle de Saga et la présence au capital de TAT-Air Liberté. Le portefeuille d'activités du groupe Bolloré technologies (hors Saga et groupe Rivaud) peut être résumé par le tableau suivant. Portefeuille d'activité du groupe Bolloré technologies 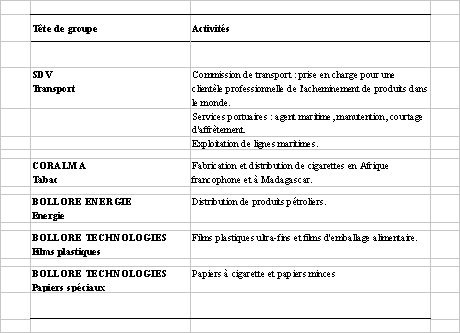 Le groupe a entrepris depuis deux ans une politique de retrait des secteurs industriels jugés trop concurrentiels. La nécessité d'atteindre une taille critique pour chacun des métiers du portefeuille est en effet un enjeu difficile à relever sur le plan financier, en raison de la forte intensité capitalistique des activités considérées. La stratégie s'oriente donc vers une spécialisation sur des niches profitables : papiers minces pigmentés-couchés pour la papeterie (Papeteries du Léman), emballages à forte valeur ajoutée (emballages bulle), films pour condensateurs, films plats et films métallisés. Confronté à une concurrence exacerbée sur l'axe est-ouest (Europe-Amérique-Asie) qui s'est traduite par plusieurs opérations de concentration en 1996-1997 (CGM et CMA, P&O et Nedlloyd), le groupe a décidé de positionner son pôle transport SCAC-Delmas-Vieljeux sur la niche de marché qu'est l'axe nord-sud. Cette stratégie vise l'activité de transport maritime mais intègre également le réseau de transitaires dans le but de proposer une offre globale aux clients du groupe : c'est ainsi que la SCAC fusionne en 1996 avec six filiales (Malouin et Gravillaises, Magasins généraux de Saint-Malo, Cherbourg maritime, AMD Cofigem, ESB et Cofigem) et que les sociétés Notco Nairobi, Notco Kenya et SDV Kenya sont regroupées au sein d'une entité unique au Kenya en matière de transport terrestre et de commission de transport. Dernière illustration de la stratégie de niche du groupe Bolloré : la distribution de fuel. La division Energie étant jugée non stratégique en 1996, une cession des différentes activités de ce secteur avait été mise à l'étude1. Le groupe a depuis revu ses objectifs et orienté son développement vers la distribution en reprenant des fonds de commerce de distribution de fuel domestique et de charbon ou en signant des contrats de location-gérance. Ce recentrage sur la distribution de fuel aux particuliers s'explique par le caractère moins concurrentiel de ce marché, qui n'appartient pas aux axes de développement retenus par les groupes pétroliers : la part de marché de 5,2 % détenue en 1997 devrait progresser à environ 7 % après la prise de contrôle de Perrin le 1er juillet 1998. IBM France : le retour d'un opérateur dominant. - Au premier rang de l'industrie électronique mondiale, le groupe IBM a réalisé en 1997 un volume d'affaires de 75,5 milliards de dollars, dix-huit fois supérieur à celui de Bull. Le montant alloué par IBM à sa seule recherche et développement (4,9 milliards de dollars) est supérieur au volume d'activité du groupe française (4,2 milliards de dollars). Sur le marché français, IBM occupe le premier rang sur les segments des matériels, des logiciels et des services informatiques. M. Bernard Dufau, président-directeur général d'IBM France, a rappelé à la commission d'enquête les conséquences pour son groupe de la révolution de l'informatique individuelle et décentralisée : « [L'apparition de l'ordinateur personnel a représenté une évolution considérable]. IBM n'a pas immédiatement intégré dans son action commerciale l'impact que représente le poste de travail et le fait que les individus souhaitaient s'en équiper. Nous avions toujours une approche centralisée autour des directions informatiques et ceci nous a conduits, petit à petit, à nous couper de la demande du marché. « Notre gestion était bonne, nous réalisions des résultats et les clients nous faisaient confiance sur le plan des prix. Mais notre compétitivité a commencé à s'éroder. Les prix des équipements microinformatiques sont devenus particulièrement attractifs par rapport à ceux des offres centralisées et traditionnelles. Nous avons donc été confrontés au cours des années quatre-vingt-dix à une perte sensible de marché et à une érosion de notre compétitivité. En termes de prix, nous étions trop chers, en termes d'organisation trop lourds et pas assez dynamiques ». Le déclin des systèmes propriétaires et la crise de 1992-1993 se sont traduits pour IBM France par d'importantes mesures de restructuration. Le groupe a désormais retrouvé les voies d'une stratégie beaucoup plus agressive, articulant réponses défensives et offensives, qui constitue la déclinaison nationale des orientations définies par la maison mère. Les réponses défensives reposent sur la mise en place de partenariats commerciaux afin d'accroître les ventes et la pénétration des marchés, à rebours des modèles de vente privilégiés par des acteurs comme Dell ou Compaq. Les réponses offensives s'appuient en premier lieu sur la mise en place d'une stratégie d'offre globale, c'est-à-dire sur une position d'intégrateur de systèmes en rupture avec l'ancienne politique propriétaire. Le groupe se met ainsi en mesure de proposer des solutions techniques utilisant des produits IBM comme des produits concurrents. Le renforcement dans les services s'est traduit en 1997 par la création d'IBM Global services (IGS), qui fédère l'ensemble des opérations dans ce domaine. IGS constitue le support de la stratégie d'offre globale du groupe, puisqu'il permet l'accompagnement des solutions techniques par des offres en matière de conseil, infogérance, intégration, formation ou gestion des réseaux. IBM apparaît surtout très présent aujourd'hui sur le marché de l'informatique en réseau. Les produits propriétaires ont fait place à des systèmes acceptant les technologies Internet, c'est-à-dire au protocole TCP-IP : les mini-ordinateurs et les serveurs de réseau peuvent être utilisés comme serveurs Internet et l'alliance avec Sun Microsystems permet de présenter une offre flexible à partir de technologies Java. Usinor : une stratégie de recentrage sur des marchés saturés. - Les regroupements intervenus en 1997 avaient rétrogradé Usinor de deux places dans les classements mondial et européen des producteurs d'acier brut, au profit d'Aberd (Luxembourg) et de Thyssen-Krupp (Allemagne). Sur la base du chiffre d'affaires consolidé, le groupe demeurait en revanche le troisième sidérurgiste mondial et le deuxième européen. Dix premiers producteurs mondiaux d'acier brut (1997) Source : IISI
En Europe occidentale, Usinor est le principal opérateur en matière d'aciers spéciaux (à travers sa filiale Ascométal), le premier producteur d'acier pour emballages, le second pour les tôles revêtues, le troisième pour les tôles laminées à froid non revêtues et le quatrième pour les produits à chaud (Sollac). Il occupe le premier rang mondial pour les produits longs inoxydables et le deuxième pour les produits plats inoxydables derrière Thyssen-Krupp. L'acquisition de Cockerill-Sambre (1998) devrait de nouveau modifier cette hiérarchie en faisant d'Usinor le troisième sidérurgiste mondial et le premier européen, avec une production de près de 21 millions de tonnes d'acier brut et des ventes totales de 97 milliards de francs. Le groupe a opté depuis plusieurs années pour la stratégie du « tout acier », contrairement à des concurrents comme Thyssen-Krupp également présents dans les biens d'équipement et le négoce. Aujourd'hui, il concentre encore son portefeuille d'activités en se développant par priorité sur les segments des aciers plats au carbone et des aciers inoxydables, au prix d'un désengagement de la fabrication des aciers spéciaux et activités annexes : entre 1991 et 1996, le périmètre d'Usinor a enregistré 44 sorties nettes (dont 23 cessions pour les seules filiales nationales). Ce choix a pour conséquence de réduire le nombre des débouchés et de privilégier l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage, qui ont représenté en 1997 85 % des marchés avals européens de produits sidérurgiques. En 1998, Usinor a réalisé 78 % de son chiffre d'affaires en Europe alors que le pôle géographique américain ne représente que 12 %, à travers la filiale J&L spécialisée dans les aciers inoxydables. Compte tenu de l'échec de la reprise de CSI (Espagne), qui ouvrait des voies d'expansion vers l'Amérique du sud, la reprise de Cockerill-Sambre (Belgique) ne peut que renforcer le poids géographique de l'Europe puisque cette entreprise commerce essentiellement avec l'Europe du nord et les länder de l'est de l'Allemagne. En l'espèce, le choix d'une double spécialisation technique et géographique soulève quelques interrogations. La zone européenne souffre en effet de surcapacités substantielles qui pèsent sur les prix et imposent aux producteurs de trouver des débouchés à l'exportation, que le groupe apparaît peu préparé à capter : en 1997, l'Union européenne est surproductrice de 23,1 millions de tonnes d'acier - c'est-à-dire 14,4 % de sa production et 16,9 % de sa consommation à cette même date.
Les groupes jouent également un rôle majeur dans les succès rencontrés par les entreprises françaises sur les marchés extérieurs, qui ont placés notre pays au quatrième rang mondial des exportateurs de marchandises (Notes bleues Bercy, n° 150, 1er-15 janvier 1999). La concentration de l'appareil exportateur sur un petit nombre d'intervenants est un phénomène connu, mais qui doit être rappelé. Les quatre opérateurs les plus importants (Renault, Peugeot, Airbus industries et Citroën) assurent ainsi à eux seuls près de 10 % des exportations françaises, un montant que n'atteignent pas collectivement les cent mille plus petits exportateurs. Les dix premiers exportateurs réalisent plus de 15 % des exportations, les cent premiers 35 % et trois cents entreprises suffisent à en assurer la moitié. ENCADRÉ La contribution relative des entreprises et des groupes à l'effort d'exportation national peut être déduite de la courbe de concentration ci-dessous. Le premier point de chaque courbe est relatif aux dix premiers opérateurs (groupes ou entreprises) : il a pour abscisse le poids de ces dix opérateurs au sein de l'ensemble des opérateurs qui exportent et pour ordonnée leur part dans l'ensemble des exportations. Ainsi, les dix premiers groupes français, qui représentent 0,01 % des groupes exportateurs, réalisent 21,09 % des exportations totales. 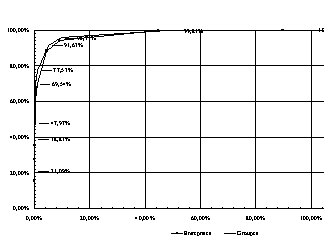 Les points suivants sont respectivement relatifs aux 50, 100, 500, 1 000, 5 000, 10 000, 50 000 et 100 000 premiers opérateurs. On constate l'extrême concentration des contributions, puisque moins de 10 % (9,64 %) des groupes exportateurs réalisent à eux seuls 95,71 % des exportations. Inversement, la contribution cumulée de 90 000 groupes de taille moyenne ou petite n'excède pas 5 % de l'effort d'exportation national. Les auditions des groupes auxquelles la commission d'enquête a procédé lui ont toutefois permis de mettre à jour des pratiques regrettables, que la seule recherche d'un profit immédiat paraît inspirer : stratégies financières à court terme, réorganisations industrielles déstabilisantes, désinvolture vis-à-vis de l'emploi et des conditions sociales sont autant de travers qu'il convient de dénoncer. 2. - Un coût prohibitif pour la collectivité
L'économie politique classique faisait du travail humain la seule source de création de valeur : en 1776, Adam Smith écrivait au chapitre V du livre Ier de sa Richesse des Nations : « ce que l'on achète avec de l'argent ou des marchandises est acheté par du travail (...) Le travail a été le premier prix, la monnaie payée pour l'achat primitif de toute chose. Ce n'est point avec de l'or ou de l'argent, c'est avec du travail que toutes les richesses du monde ont été achetées originairement ». Désormais, la globalisation financière fait au contraire passer le facteur travail de la colonne des produits à celle des charges. C'est ce que résume M. Jacques Ferrer (CFE-CGC) : « les salariés des sites sont de plus en plus considérés comme sources de contraintes sociales, et donc comme des charges, plutôt que comme des partenaires sociaux, c'est-à-dire des ressources, et cela bien qu'un certain discours privilégie la ressource humaine. Il y a donc tout un champ de contradictions entre la façon dont il est de bon ton de considérer l'homme individuellement et le fait de le traiter, d'un point de vue collectif, comme une charge. On oublie alors volontiers la notion de ressource humaine. Les grands groupes témoignent en fait d'un excès de calcul économique à trop court terme ».
Confrontés à un mouvement de restructuration constant, les groupes tentent parfois de mettre en place des dispositifs de reconversion de l'emploi. Le bilan que dresse M. Bernard Rucquoy (CFDT) des pratiques de Rhône-Poulenc à travers la SOPRAN est mitigé : « la sopran intervient très souvent en cas de fermeture de site ou d'atelier, selon des modalités variables en fonction des lieux et des bassins d'emploi. Sa responsabilité première est d'essayer d'implanter des activités ; il ne s'agit pas d'intéresser le seul personnel concerné, mais l'ensemble du tissu d'activités dans le bassin d'emploi. Dans le cas de la fermeture de Lille, les interventions se sont appuyées sur une coopération avec les trois communes limitrophes. « La difficulté est de dresser un bilan, après quelques années, des emplois restants. Nous reprochons au groupe de ne pas prendre suffisamment de précautions contre les chasseurs de primes qui s'implantent à un moment donné dans un secteur, récupèrent cinq ans d'exonération de charges puis recherchent une nouvelle implantation dans un autre secteur ». Ce point de vue est partagé par M. Martial Guitton (CFTC) : « dans le cadre de l'aménagement du territoire, nous devons reconnaître que chaque fois que des propositions ont été présentées visant à créer des emplois à l'extérieur de Rhône-Poulenc, le groupe a mis à disposition des moyens financiers et humains réels. Il reste que lorsqu'il ferme une entreprise, l'extrême attention qu'il dit prendre à l'évolution de l'environnement trouve assez rapidement ses limites : s'il est exact que la sopran intervient quand il existe des possibilités de créer de l'emploi, il est tout aussi vrai que Rhône-Poulenc plie bagage même si ces possibilités sont inexistantes. Tout cela contribue à la destruction sociale et humaine de petits pays comme le mien à Avranches : quand Rhône-Poulenc y ferme ses portes, les quatre cents emplois supprimés ont fait grand bruit et laissé place à un grand vide... » Chez Nestlé, Mme Jacqueline Banfi (CFDT) indique que la direction a dégagé des moyens spécifiques pour accompagner la restructuration de la filiale France Glace Findus : « dans le cadre des restructurations, [la direction] a mis en place un fonds d'insertion au moment du troisième plan social chez France Glace Findus (...), doté de 10 millions de francs, (...) géré par un salarié du groupe [et] destiné à développer les emplois sur les deux sites qui étaient touchés par les restructurations, Beauvais et Boulogne ». Concrètement « il va, par exemple, aider dans les petites campagnes un commerçant ambulant qui vendait du pain, à acheter son camion et à embaucher un artisan ».. Pour elle, le bilan est globalement positif puisque « les entreprises locales ont été aidées, (...) des implantations ont été favorisées dans les (...) localités sinistrées et qu'ont aussi été soutenues les entreprises qui reprenaient d'anciens salariés de l'usine, en finançant pendant trois ou quatre mois les charges sociales. Cela a permis de participer à la reconversion de ce personnel ». Plus généralement, « il est très important de mettre en place [des dispositifs de la nature du] fonds d'insertion parce que, lorsque des entreprises ferment alors qu'elles sont dans un tissu économique déjà assez sinistré (...), il est absolument essentiel et vital qu'elles participent au reclassement. (...) Il faudrait que ce soit considéré comme une créance privilégiée au même titre que les salaires dus aux salariés et que l'on oblige les entreprises à mettre en place ce type de dispositif ». Ces exemples demeurent des cas isolés. Les auditions auxquelles la commission d'enquête a procédé renvoient, pour l'essentiel, l'image de destructions d'emploi massives. A partir de 1991, les opérations de rationalisation menées par le groupe Moulinex conduisent à une diminution régulière des effectifs : les 14 800 salariés dans le monde à cette date ne sont plus que 10 643 en 1998 (- 28,1 %) ; en France, la baisse atteint même 32,9 % (de 9 209 salariés en 1991 à 6 183 en 1998). En 1994-1995, le groupe met en place un plan emploi en France, ferme ses usines de Birmingham et de Pologne, se désengage des activités de climatisation, cède Girmi et Krups en Italie, Krups Mexicana et Moulinex appliances aux États-Unis. En 1995-1996, la société de production de cordons et faisceaux électriques de Domfront est cédée, l'usine de Granville est fermée et ses activités transférées pour l'essentiel à Saint-Lô. Le plan de reconquête de la performance se traduit par 900 transferts de postes, la fermeture des usines de Mamers et Argentan et 180 départs en préretraite AS-FNE. Les effectifs du groupe Bolloré passent de 24 252 personnes en 1992 à 22 471 en 1997 : en six ans, ce sont donc près de deux mille postes qui ont été supprimés. Sous l'effet des cessions de sociétés et des réorganisations, la réduction de l'emploi approche donc les 7 % - voire les 9 % à périmètre constant. M. Philippe Creno (FO) se fait le porte-parole d'évolutions préoccupantes chez Nestlé : « les effectifs du groupe Nestlé se sont nettement dégradés en Europe entre 1992 et 1997. Ce recul est dû à des cessions, des restructurations et des fermetures de sites. Si nous prenons en compte l'année 1997, il y a eu disparition de 60 % des effectifs au niveau de la production et de 40 % au niveau de l'administration et des ventes, ce qui fait 6 495 personnes au total sur 1997 : 3 897 en production et 2 598 en administration et vente. C'est assez impressionnant au niveau européen. Les effectifs totaux du groupe Nestlé France ont reculé de 12,3 % de 1993 à 1998, et on peut constater sur la même période une baisse pour les usines de 11,6 %, un peu moins que sur l'ensemble administration et ventes ». L'emploi est en chute constante chez Usinor depuis le début de la décennie : le groupe passe de 93 006 salariés en moyenne en 1990 à 51 394 en 1997, c'est-à-dire 41 612 salariés de moins et une diminution de 44,7 % en sept ans. Au cours de cette même période, le chiffre d'affaires du groupe ne diminue que de 25 %. La baisse de l'effectif moyen a principalement concerné les salariés du groupe à l'étranger, puisque les effectifs français ont reculé de 29 % depuis 1990 alors qu'ils sont divisés par douze dans le reste de l'Europe. Évolution des effectifs d'Usinor inscrits en fin de période, 1989-1997 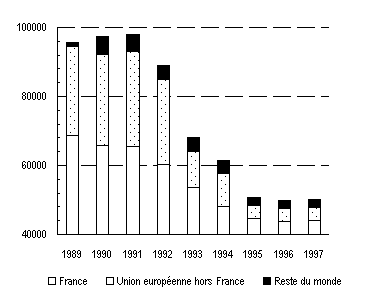 L'importance de l'effet de périmètre est variable : les réductions organiques expliquent ainsi la totalité de l'évolution constatée en 1996 mais seulement 15,9 % en 1997. Globalement, l'évolution de la géométrie du groupe explique 70 % des réductions d'effectifs moyens entre 1993 et 1997 et ne joue positivement qu'en France en 1993 et 1994. Décomposition de la variation des effectifs d'Usinor, 1993-1997 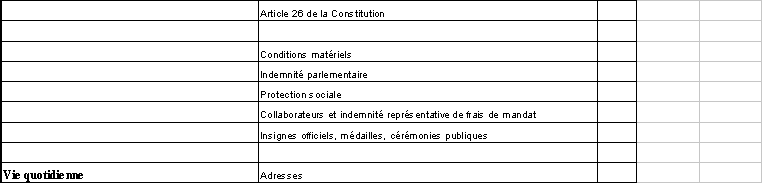 M. Emile Rols (FO) dresse un constat pessimiste des évolutions chez IBM France : « Si j'examine [l'évolution des] effectifs depuis 1991, je remarque que nous étions 20 747 salariés permanents à cette date. Depuis lors, chaque année, ces effectifs sont en baisse constante : nous en arrivons en 1997 à 11 218 personnes, et l'estimation pour 1998 se situe aux environs de 11 000 personnes ». Ce constat doit toutefois être nuancé par la prise en considération des modifications de périmètre. Sur longue période, le poids relatif des filiales dans la structure d'emploi du groupe a été considérablement rehaussé par rapport à IBM France SA : les 17 522 salariés d'IBM France SA, qui représentaient 75,9 % de l'effectif moyen d'IBM France en 1993 (23 100 personnes), sont devenus 12 537 en 1997 (59,1 %). En d'autres termes, le poids des filiales est passé de 24,1 % des effectifs totaux en 1993 à 40,9 % en 1997, c'est-à-dire une progression de 16,8 points en quatre ans. Corrigée des variations de structure, l'évolution de l'effectif moyen apparaît moins spectaculaire, en décroissance de 11,5 % sur l'ensemble de la période (de 23 987 salariés en 1991 à 21 221 en 1997). Il est d'ailleurs intéressant d'observer que cette évolution n'est pas corrélée aux évolutions du groupe IBM Corp. Alors que les effectifs mondiaux décroissaient fortement en 1993 (- 15,0 %), ils augmentaient au contraire en France (+ 12,8 %) ; IBM France n'a été touché par la réduction des effectifs qu'à partir de 1994 (- 4,2 %), sans qu'elle atteigne au demeurant l'ampleur des ajustements réalisés au plan mondial (- 14,2 %). Inversement, la baisse des effectifs s'est poursuivie dans notre pays en 1995 (- 2,8 %) et 1996 (- 1,6 %) alors qu'une reprise de l'emploi était perceptible pour l'ensemble du groupe (+ 6,8 %). Si la progression de l'effectif est réelle en France en 1997 (+ 0,2 %), elle demeure très inférieure à celle qu'on enregistre pour IBM dans son ensemble (+ 12,0 %). Chez Rhône-Poulenc, M. Jean-Claude Revy (FO) observe que « la privatisation de 1993 a été l'occasion d'un redressement économique gagé sur des pertes d'emplois, des cessions et des transferts d'activités. Ces réductions d'effectifs sont engagées avec des aides de l'État, sous forme de FNE ou de plans sociaux. Que sont devenues la Drôme et l'Ardèche, où le groupe a supprimé tous ses sites industriels ? Que reste-t-il de l'industrie à La Voulte - alors que 75 % du potentiel industriel de la chimie de Rhône-Poulenc était dans le bassin Rhône-alpin ? Combien reste-t-il d'emplois, de sites industriels viables dans ce bassin ? Parlons encore de la Manche ou d'Albi, devenu un désert. Les conséquences sont terribles pour les communes, les régions, le tissu économique local et les emplois induits. Nous avons perdu plus de 50 000 emplois directs, mais combien d'emplois induits ? »
La recherche d'économie prend souvent la forme d'une flexibilisation accrue de la main d'_uvre, c'est-à-dire d'un appel massif à ces formes d'emploi précaires que sont l'intérim et les contrats à durée déterminée (CDD). Les flux nets d'entrées-sorties de personnel chez Rhône-Poulenc en France ont été globalement négatifs sur la période 1988-1997, à l'exception de l'année 1995 : 1 972 suppressions de postes en 1991, 2 291 en 1992, 3 151 en 1993, 1 882 en 1996 et 4 375 en 1997 - soit 17 294 suppressions nettes en dix ans. Il faut toutefois noter que ce recul des effectifs n'est pas uniquement lié à des destructions d'emploi : les 2 115 emplois perdus en France entre le 31 décembre 1995 et le 31 décembre 1996 s'expliquent à hauteur de 57,4 % par un effet de périmètre contre 42,6 % par une réduction organique ; entre 1996 et 1997, ce sont 3 611 des 4 385 emplois disparus (82,3 %) qui doivent être imputés au seul effet de périmètre. Mouvements de personnel chez Rhône-Poulenc (France) 1988-1997 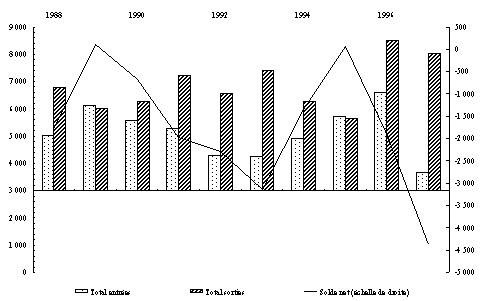 Lorsque l'on analyse la structure des entrées, on constate que les contrats à durée déterminée représentent la première modalité d'entrée dans le groupe au cours de la période étudiée puisque leur part ne fléchit en deçà de 40 % qu'une fois en dix ans (1991). La précarisation de l'emploi est également une réalité chez Nestlé et au sein de ses filiales, si l'on en juge par la déposition de M. Philippe Creno (FO) : « de 1990 à 1996, les CDD sont passés de 0,9 % à 4,5 % chez Herta, une des sociétés du groupe particulièrement touchée par ce phénomène. La moyenne pour le groupe était de 3,7 % en 1994 et 9,2 % en 1996. On constate donc que l'emploi précaire chez Nestlé est un phénomène de plus en plus marqué. De même, le nombre d'intérimaires était, en 1990, de 182 pour onze jours moyens de mission ; en 1996, il est de 423 sur six jours en moyenne. Les durées de mission sont donc très faibles. L'analyse de l'effectif de Nestlé France conduit à retenir deux chiffres : en 1996, il était de 13 293 personnes ; en 1997, il passe à 13 000 personnes, sachant qu'à l'intérieur de ces chiffres, étaient incluses environ 600 personnes en CDD en 1996, ce qui est énorme par rapport à la proportion antérieure. On constate donc, d'année en année, une perte d'effectif ». Les effectifs de Hewlett-Packard France ont progressé de 3 888 en 1989 à 4 854 en 1998 - soit près de mille personnes en neuf ans. En analysant plus finement la structure de l'emploi au sein de l'entité industrielle de l'entreprise, souvent citée comme un modèle de dialogue social, on remarque toutefois que le nombre mensuel moyen d'intérimaires passe de 362 en 1993 à 843 en 1997 - c'est-à-dire une croissance de 133 % en 4 ans. Cette progression de l'intérim est confirmée par M. Nowak (CGC) : « Hewlett-Packard fait aujourd'hui un appel massif aux formes d'emploi précaires. Le taux d'intérim dans l'entreprise est au-dessus de la moyenne autorisée par la loi, comme le prouve l'exemple de l'Isle d'Abeau - 827 intérimaires sur un effectif de 1000 (et 600 dans la seule entité industrielle) ». M. Pilichowski (CGT) précise que « ce sont surtout des agents de production, qui effectuent un nombre limité de missions et sont affectés d'un taux de rotation très élevé. Nous avons essayé de comprendre les raisons de ces mouvements : elles paraissent liées aux conditions de travail et de salaire. Mais comme ce ne sont pas des salariés de Hewlett-Packard, ils n'apparaissent pas au bilan social ou dans les documents d'étude des experts au comité d'entreprise ». De même, la durée moyenne des contrats à durée déterminée sur les sites de Grenoble et L'Isle d'Abeau passe entre 1996 et 1997 de 141 à 287 jours et 118 à 221 jours, respectivement (+ 103,5 % et + 87,3 %). Au sein de l'entité commerciale, la durée des missions d'intérim passe de 22 jours ouvrés en moyenne en 1995 à 82 jours en 1997. Interrogée par le rapporteur de la commission d'enquête, la direction de l'entreprise a indiqué que cette progression de l'emploi précaire constitue la seule réponse possible à un environnement économique exceptionnellement instable : « Notre production est confrontée à un triple niveau d'incertitude. « Le premier tient au niveau élevé du taux de renouvellement des produits informatiques. Pour vous donner un exemple, le chiffre d'affaires de HP dans le monde se fait chaque année à plus de 60 % avec des produits qui ont moins de deux ans : cela signifie que l'ensemble de la gamme a été renouvelé tous les cinq ans et que nous sommes donc une société différente tous les cinq ans. S'y ajoutent les problèmes de saisonnalité de l'activité - à l'instar de l'industrie du jouet, des légumes ou des fruits. Il faut savoir que le rapport entre mois creux et mois élevés se situe de 1 à 2, alors qu'il était encore de 1 à 3 il y a trois ou quatre ans ; les mois de ventes fortes sont les mois de fin d'année (novembre et décembre) et les mois faibles sont mai et juin. « Deuxième niveau d'incertitude : les changements hebdomadaires de production. Nous avons signé en 1995 un accord de flexibilité annualisée qui permet d'ajuster les volumes de production à la semaine. Or les techniques utilisées d'une ligne de produits à l'autre sont très variables : on n'utilise pas pour une ligne de portables la même main d'_uvre que lorsqu'on fabrique des stations de travail haut de gamme, des terminaux ou des calculatrices de poche. Comme nous avons une très large gamme de produits, le programme est modifié toutes les semaines en fonction de la demande puisque nous ne fabriquons qu'en fonction de nos débouchés. « Le troisième facteur d'incertitude réside dans l'introduction des produits nouveaux. Un produit nouveau appelle une gamme de production ad hoc et donc une utilisation de la main-d'_uvre différente par rapport à l'existant ». Chez IBM France, le développement du travail à temps partiel est continu de 1991 à 1996, avant qu'un léger repli ne soit enregistré. Entre 1991 et 1997, le nombre des salariés à temps partiel passe de 1 431 à 2 192, c'est-à-dire de 6,9 % à 11,2 % des effectifs au 31 décembre. Les effectifs intérimaires sont en croissance spectaculaire de 464,3 % sur l'ensemble de la période, de 28 en 1991 à 158 en 1997 en moyenne mensuelle. Les 158 intérimaires de 1997 se répartissent entre Seprim (99), LLO (49), IBM SA (9) et Lyd Informatique (1). Aucun intérimaire n'est en revanche recensé pour les autres filiales, et notamment Axone et CGI. Ces deux filiales concentrant une part relative de cadres particulièrement importante (67,6 % et 90,6 % contre 60,6 % en moyenne chez IBM France), il faut en déduire que l'appel à l'intérim correspond à des postes à qualification intermédiaire ou faible. Les salariés sont déplacés sans ménagement ni préservation de leurs acquis sociaux. Évoquant le site de Saran entre 1993 et 1994, M. Émile Rols (FO) indique que « cent personnes environ ont été envoyées chez Donneley et ont perdu le bénéfice de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne et ont été soumises à la convention Syntec. De Donneley, elles sont parties chez Modus Média et sont actuellement chez Stream ». Rapprochant la succession de plans sociaux chez Perrier-Vittel et la progression concomitante de l'emploi précaire, M. André Ollier (CGT) dénonce la logique financière sous-jacente : « dans [le plan] que nous avons connu en 1995, tous les salariés de 53 ans ont été placés en dispense d'activité, l'entreprise leur assurant jusqu'à 56 ans une préretraite d'attente à hauteur de 70 % de leur salaire. Mais, dans le même temps, du personnel saisonnier a été embauché tous les ans pour une période qui variait de quatre à six mois. « Si on calcule bien le coût, payer 70 % de leur salaire à des personnes qui restent chez elles et, parallèlement, embaucher en CDD dans le cadre d'emplois saisonniers, ne me semble pas présenter d'intérêt économique. Je crois que c'est plus la volonté de recourir à tout prix à des emplois précaires qu'une raison financière. C'est une aberration. « On assiste là à des dérives qui nous conduisent à penser qu'une entreprise comme la nôtre use et abuse de plans sociaux et que c'est devenu, chez elle, une stratégie de management. Elle le fait ensuite payer à la collectivité tout entière dans la mesure où, d'une part, les FNE sont en partie financés sur des fonds publics et que, d'autre part, s'y ajoutent ensuite des coûts sociaux dans la mesure où l'on voit aujourd'hui les gens privés d'emploi demander à bénéficier des aides sociales de nos communes et de nos conseils généraux. Sans être excessif, je crois qu'il y a lieu d'évaluer l'opportunité d'un plan de restructuration, avant de donner des fonds pour le financer. Cela nous paraît être une demande extrêmement importante ». Les organisations syndicales ont confirmé à la commission d'enquête que le recours aux formes d'emploi précaires constitue souvent pour l'entreprise le moyen d'introduire un degré de flexibilité supplémentaire dans la gestion de l'emploi, dans la mesure où les salariés en contrat à durée déterminée ou en intérim occupent, dans une proportion parfois très importante, un emploi stable sur le plan fonctionnel. Pourtant, l'article L. 122-3-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, dispose qu'un contrat conclu en méconnaissance des dispositions applicables aux contrats déterminés est réputé à durée indéterminée. Le deuxième alinéa du même article introduit un dispositif de requalification accélérée des contrats par le conseil de prud'hommes : l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement, qui doit statuer au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, et la décision du conseil est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Selon M. Arthur Staub (CFDT), ces dispositions sont dépourvues de toute portée pratique : « les conséquences de la requalification obtenue par cette voie sont nulles. Elles consistent, pour l'entreprise, à se dédouaner de ses obligations en payant un mois de salaire au titre de la procédure, et éventuellement un mois ou deux mois de salaire au titre d'une rupture du contrat de travail qui pourrait être considérée comme abusive ainsi que des dommages et intérêts, mais ce n'est en aucune façon une obligation de réintégrer le salarié dans l'emploi. « Quand des salariés travaillent depuis des années dans le cadre des emplois précaires et qu'ils ne souhaitent qu'être embauchés, il est évident qu'ils ne peuvent en aucune façon prendre le risque d'une action devant le conseil des prud'hommes. S'ils obtiennent gain de cause, Nestlé leur paiera le mois de salaire et les dommages et intérêts que le conseil des prud'hommes aura éventuellement bien voulu leur allouer, mais il ne les embauchera jamais plus. « A Vittel, je suis actuellement en mesure d'accompagner plusieurs dizaines de salariés dont je suis quasiment certain de la décision de requalification de leur contrat de la part du juge, et pourtant je ne le fais pas et j'essaie de calmer leur démarche à cause de ce risque ». D'autres évolutions apparaissent encore plus pernicieuses. Selon une information récemment publiée par la presse économique (La Tribune, 20 avril 1999), la société informatique américaine Unisys se dispose à généraliser le recrutement de ses salariés européens dans le cadre de contrats « offshore ». En d'autres termes, un cadre français signera avec la firme un contrat luxembourgeois pour travailler en Allemagne. Cette innovation juridique permettra une complète déconnexion entre la législation du travail, la nationalité de l'entreprise, celle du salarié et le lieu de travail : « confrontée au problème de la rigidité des contrats de travail actuels de tous les grands pays européens », l'entreprise cherche un pays « qui devra offrir une souplesse de législation et une flexibilité aux échanges bilatéraux avec les autres États ». Cette « souplesse » est évidemment problématique en matière de protection sociale, puisque c'est la législation du pays où a été signé le contrat de travail qui a vocation à s'appliquer - tant pour les charges sociales de l'entreprise que pour la couverture du salarié. La faiblesse des dispositifs existants au Royaume-Uni ou au Luxembourg risque alors d'obliger les salariés à souscrire des assurances complémentaires, toujours coûteuses et génératrices d'une protection sociale à deux vitesses. En matière de droit du travail, le filet de sécurité applicable en France apparaît bien modeste : il est constitué par l'obligation d'ordre public de rémunérer l'emploi au niveau du salaire minimum conventionnel (ou du SMIC) et par les dispositions de l'article L. 341-5 du code du travail étendant cette obligation aux durée et conditions de travail, quel que soit le cadre législatif dans lequel le contrat est conclu.
Le président-directeur général de Hewlett-Packard France a donné le sentiment que les relations sociales au sein de son entreprise se déroulent dans un climat dépassionné, si l'on en juge par l'appréciation positive qu'il porte sur ses salariés et l'hommage qu'il rend à leur esprit de responsabilité : « le territoire national bénéficie d'une main d'_uvre de haute qualité, innovante, créative, loyale vis-à-vis de son employeur - ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres pays comme les États-Unis - et persévérante sur les dossiers et sujets lourds ». Ce constat satisfait de M. Yves Couillard ne semble pas partagé par M. Gilles Eymery (CFDT), qui décrit au contraire une situation que chacun appréciera : « Cette entreprise a été bâtie autour d'une idéologie attachée aux opinions, croyances et idées du système économique capitaliste. Ses fondateurs ont construit cette idéologie pour s'adapter et répondre aux situations économiques et sociales existantes à une certaine période aux États-Unis. « Afin d'imprégner l'entreprise de cette idéologie, ils ont élaboré une liste de règles de base qu'on appelle le "HP way». Cette liste a été reprise et interprétée insidieusement depuis quelques années, et même en partie détournée de son sens premier afin de satisfaire aux ambitions de ces nouveaux dirigeants que sont les principaux actionnaires actuels de la société. "Way» se traduit par "chemin» mais par aussi "sens, direction» : les employés doivent suivre le chemin, la direction que la société leur impose. Cette liste précise les valeurs et principes de gestion à utiliser dans l'entreprise et à l'extérieur. Cet ensemble de règles de conduite a force de loi et est jugé conforme à un idéal auquel le personnel est tenu de se plier, « au point que lorsque les lois régissant le travail dans un pays sont contradictoires avec ou divergentes des règles de base de la société, on ne s'adapte pas aux lois du pays mais on essaye par tous moyens de trouver des solutions pour que la loi du pays s'adapte aux règles de Hewlett-Packard. Tout a été conçu, dans les différents établissements, pour créer une ambiance bon enfant : tutoiement, pause-café gratuite, esprit de famille etc. Le revers de la médaille renvoie plutôt une ambiance de caste et de manipulation. L'employé qui n'adhère pas ou plus à cet esprit est rapidement mis en difficulté : harcèlement moral de la part de ses responsables - parfois de ses propres camarades -, charge de travail alourdie pour le mettre dans des situations intenables, disparition du poste de travail etc. Dans le meilleur des cas, la personne est invitée à se redéployer au sein de la société, où elle doit retrouver du travail seule en postulant comme un candidat extérieur à des postes ouverts sur Internet. C'est le concept de "l'intrapreneur», qui consiste à faire croire aux salariés qu'ils sont acteurs de leur carrière alors que leur condition de subordination à l'employeur reste inchangée ; par ce système, la société tente de se soustraire à ses devoirs et responsabilités légales comme l'obligation de proposer un poste de reclassement. L'individualisme et l'élitisme sont cultivés jusqu'à l'extrême, afin de faire disparaître l'esprit collectif et bloquer la représentativité des organisations syndicales ; ainsi, le système de rémunération repose sur un classement des individus au sein de leur équipe ». Évoquant l'exercice de l'activité syndicale chez Promodès, M. Alain Le Benoist (CGC) fait état d'améliorations récentes après des années difficiles : « Il y a quelques années, c'était difficile. Depuis 18 mois, cela a changé ; peut-être est-ce parce que j'ai récemment tapé du poing sur la table. Aujourd'hui, je peux aller voir des collègues dans les autres magasins, en cas de besoin. Il y a deux ans cela n'aurait pas été possible et j'aurais été obligé de le faire durant mes congés ». Mais il ajoute aussitôt : « Quelque chose a changé mais ce n'est pas suffisant. Dans une entreprise, il y a un directeur, un directeur des ressources humaines, un chef d'entretien et un chef de sécurité, mais il faudrait aussi toujours un militant syndical qui reste vigilant. Pour nos patrons, le statut du militant syndical existe au niveau du droit, c'est-à-dire en théorie, mais pas dans l'entreprise ».
Le passage d'une économie intermédiée, dans laquelle les établissements de crédit assurent le financement des entreprises par la transformation de ressources à court terme en prêts à long terme, à une économie de fonds propres, où les ressources sont trouvées par appel aux marchés des capitaux, n'est pas resté sans incidence sur les structures capitalistiques de la France. La vague de privatisations des années 1986-1987 avait été l'occasion de constituer des groupes d'actionnaires stables (GAS) - ou « noyaux durs » - afin de protéger les entreprises revenues au secteur privé d'attaques éventuelles. Il en était résulté un développement des participations croisées associant les grands investisseurs institutionnels (Caisse des dépôts), les assureurs (UAP, AGF, AXA et GAN), les banques (BNP et Société générale) et d'éventuels partenaires industriels. Depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, ce système a volé en éclat. La montée en puissance des investisseurs étrangers anglo-saxons dans le capital de la plupart des grandes sociétés françaises s'est traduit par le souci devenu prioritaire de créer de la valeur pour l'actionnaire, par des efforts incessants pour améliorer le retour sur fonds propres, par des politiques systématiques de recentrage sur les métiers stratégiques. L'évolution de l'actionnariat de Rhône-Poulenc est, de ce point de vue spectaculaire. Entre le 30 juin 1994 et le 31 décembre 1997, la part de capital détenue par le groupe d'actionnaires stables (à l'origine le Crédit lyonnais, les AGF, la Société générale, la BNP, AXA, le Crédit suisse et Fiat France) chute de près de dix points (de 19,0 % à 9,3 %) et celle des actionnaires individuels de vingt points (de 33,4 % à 12,7 %). Ce mouvement est compensé par le renforcement des institutionnels français (de 16,0 % à 23,4 %) mais surtout par la montée en puissance spectaculaire des institutionnels étrangers (de 24,0 % à 51,6 %) au sein desquels les fonds de pension américains sont très fortement représentés (30 % du capital au 31 décembre 1997). Le groupe est donc soumis à une pression croissante des marchés financiers internationaux en raison de l'effritement régulier du noyau dur constitué en 1993. L'explication de cet effritement tient, selon M. Jean-René Fourtou, à l'âpreté de la concurrence à laquelle les actionnaires sont eux-mêmes soumis : « Pourquoi le noyau dur ne tient-il pas ? Parce que les différents partenaires autrefois présents dans le capital ont désormais besoin de fonds propres. Volens nolens, tous mes actionnaires ont été conduits à prendre leurs plus-values parce qu'il leur faut des fonds propres à consacrer à leur métier et à leur effort d'investissement sur le long terme ». ENCADRÉ Selon le dernier rapport de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) sur les tendances des marchés des capitaux (Le Monde, 5 déc. 1998), le montant total des encours gérés par les fonds de pension représentent aujourd'hui 38 % du PIB des pays de l'OCDE contre 29 % en 1987. Ces statistiques masquent toutefois des réalités différentes, puisque l'encours des fonds de pension représente 60 % du PIB aux États-Unis contre moins de 5 % en France. Les fonds de pension et les mutual funds, nouveaux investisseurs institutionnels Le terme général « fonds de pension » recouvre en réalité deux catégories distinctes d'investisseurs institutionnels : d'une part, celle des fonds de pension au sens strict et, d'autre part, celle des mutual funds. Les fonds de pension gèrent des sommes destinées à financer les retraites par capitalisation de leurs cotisants. Leur stratégie s'appuie sur des règles de bonne gestion (vote obligatoire aux assemblées des sociétés dans lesquelles ils ont des participations) et des règles prudentielles de répartition des risques. En théorie, ils prennent des participations à long terme, mais ils ne s'interdisent pas d'intervenir à plus court terme pour défendre les intérêts de leurs cotisants. Ces institutions prospèrent aux États-Unis, mais aussi en Europe. Les « Scottish widows » (veuves écossaises), fonds de pension créé par les commerçants écossais enrôlés pour aller combattre les troupes de l'Empereur, gèrent aujourd'hui à Edimbourg près de 200 milliards de francs pour le compte de plus de 1,5 million d'épargnants. Le fonds de pension de British Telecom brasse 164 milliards de francs, celui de Post-Office 109 milliards, celui de Shell 61,8 milliards. En Grande-Bretagne, ces fonds représentent au total 3 500 milliards de francs - alors que leurs homologues américains représenteraient près de 30 000 milliards de francs d'actifs gérés (Le Monde, 12 mai 1998). Les mutual funds comme Fidelity, Templeton ou Mercury sont l'équivalent anglo-saxon des Sicav et gèrent l'épargne des ménages. Souvent spécialisés par secteur ou par région, leur horizon de placement est en principe plus court que celui des fonds de pension. Fonds de pension, rentabilité et emploi L'influence des fonds de pension et des mutual funds est difficile à apprécier. Officiellement, les responsables des grandes entreprises estiment que cette influence est globalement positive. Ces investisseurs institutionnels contraignent en effet les entreprises à jouer la transparence et à se spécialiser dans les métiers qu'elles font le mieux. Leur poids a fait de la communication financière une fonction très importante. Le poids des principaux fonds étrangers en France Source : Les Echos et Thomson financial services, 9 déc. 1998 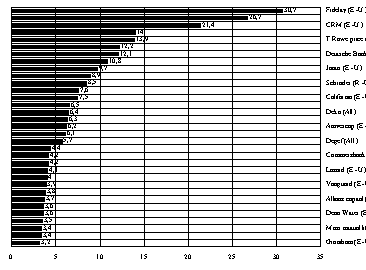 Toutefois, ces investisseurs sont des financiers exigeants qui exigent des taux de rentabilité sur fonds propres élevés - de l'ordre de 10 à 15 %, voire plus. La question fondamentale est alors de savoir si un fonds de pension peut être un partenaire financier sur le long terme, sans qu'une sanction ne tombe au moindre aléa conjoncturel. Surtout, leur stratégie d'investissement va parfois à l'encontre de l'emploi, car leurs cibles, pour les satisfaire, peuvent décider de restructurations, toujours bien accueillies à la Bourse. Un recentrage des activités qui se traduit par la scission de branches ou une vente par appartements et un plan social drastique - y compris s'il touche des milliers de personnes - peuvent être salués comme autant de bonnes nouvelles par les opérateurs. Selon M. François Charpentier, auteur de Retraites et fonds de pension. L'état de la question en France et à l'étranger (cité par Le Monde, 11 févr. 1998) « aux États-Unis, certains fonds de pension pratiquent aujourd'hui la corporate governance. Autrement dit, ils n'hésitent plus à intervenir dans les assemblées générales des entreprises dont ils sont actionnaires et à exercer leur droit de vote pour obtenir des changements de stratégie conformes à leurs intérêts ». La pratique de Calpers est, de ce point de vue, assez révélatrice. Ce fonds de pension décerne chaque année son « prix citron » aux cinquante sociétés de son portefeuille les plus mal gérées et met tout en _uvre pour obtenir des dirigeants le redressement de la situation. « Et le résultat est là, relève M. Charpentier. Selon une étude réalisée entre 1990 et 1992, les entreprises clouées au pilori pour avoir affiché des performances en moyenne inférieures de 85 % à l'indice boursier sur les cinq années précédente, battaient l'indice l'année suivante de 75 % ! » Le paradoxe est alors que de telles exigences de gestion sacrifient l'emploi immédiat au bien-être des retraités actuels et futurs, les salariés étant tout à la fois, ou tour à tour, victimes et bénéficiaires du mécanisme. Chez Hewlett-Packard France, M. Pilichowski (CGT) observe également la montée en puissance de logiques purement financières : « le début des années quatre-vingt marque une inflexion majeure dans la stratégie de l'entreprise, très liée à l'entrée des fonds de pension dans son capital. Hasard ou coïncidence : les dispositions fiscales sur les fonds de pension aux États-Unis remontent également à cette période. « L'objectif devient de maximiser la valeur de l'action. Le groupe se recentre sur certaines activités et externalise les autres. La conséquence de ces externalisations est la suivante : la richesse créée dans l'entreprise et la valeur ajoutée diminuent du fait de la volonté de maximiser le cours de l'action et d'augmenter le rendement des actionnaires. « On ne peut se satisfaire de cette situation et il faut faire pression sur l'un des éléments. Si la richesse créée diminue mais qu'un bénéficiaire accroît ses exigences, la portion des autres (c'est-à-dire celle des salariés) se réduit. L'entreprise est désormais pilotée par la pression sur ou la baisse de la masse salariale ». Ces propos font écho à ceux que tiennent d'autres organisations syndicales du même groupe, comme Force ouvrière (M. Demoulin) : « l'histoire industrielle de Hewlett-Packard est marquée d'une série de jalons : le partenariat au début des années 80, puis la sous-traitance, les cessions d'activités et aujourd'hui l'assemblage. Hewlett-Packard ne fabrique plus, mais assemble des composants montés par des intérimaires plus nombreux que les salariés en CDI. « L'étape ultime, en cours de préparation, est la désintégration. La technique nous a été expliquée : en amont les sous-traitants et les fournisseurs de pièces détachées, en aval les partenaires qui vendent les produits Hewlett-Packard. Dans un avenir très proche, ces derniers commanderont des ordinateurs Hewlett-Packard et HP fera appel à ses sous-traitants et fournisseurs pour les livrer directement. Les partenaires assembleront eux-mêmes les machines - leur bâtiment est déjà en construction à l'Isle d'Abeau. Plus un seul ordinateur personnel ne sortira des usines de Hewlett-Packard, qui ne verra que les transferts d'argent. « La politique financière de la filiale Hewlett-Packard France est très simple. Tous les fonds sont transférés à Londres, qui assure leur gestion au niveau européen, voire mondial. C'est tellement vrai qu'il n'y a même plus de directeur financier dans l'entreprise : il a été licencié fin décembre, puisqu'il ne sert plus à rien sinon à transférer des fonds de Paris vers Londres... » Ces stratégies financières ont des effets destructeurs sur l'emploi. M. Serge Doucet (CFDT) établit un parallèle brutal entre les évolutions des cours boursiers et des effectifs chez Rhône-Poulenc : « nous avons repris un petit comparatif du cours de l'action Rhône-Poulenc aux 31 décembre 1995, 1996 et 1997 par rapport à l'évolution des effectifs en France : un principe général de l'économie vérifié aux niveaux mondial et national, veut en effet que lorsque l'action monte, l'emploi descend. Fin 1995, le cours de l'action Rhône-Poulenc était à 105 F et les effectifs français à 35 547 personnes. Un an plus tard (fin 1996), le cours de l'action était à 177 F (soit plus de 70 % d'augmentation). Fin 1997, le cours de l'action était à 263 F - soit une multiplication par 2,5 - et les effectifs étaient de 29 047 - soit -6 000 en deux ans ». Dès lors, la recherche d'économies d'échelle conduit à des regroupements d'activité sur quelques sites hautement spécialisés. M. Gérard Liger (CFTC) explique les mécanismes existants chez IBM France : « Au niveau des services administratifs, un certain nombre d'activités sont européanisées, voire mondialisées (...) Au centre administratif de la région orléanaise sont implantées des activités qui concernent l'ensemble de l'Europe, une partie de l'Afrique et une partie de l'Amérique. Nous avons retiré à ces pays une partie de leur activité, mais inversement des activités comptables ont été retirées de France pour être effectuées en Allemagne. IBM France tente de répartir ses activités en fonction des synergies et concentre ses fonctions par pôle. Tantôt elles arrivent en France, tantôt elles quittent la France pour rejoindre un autre pays. [Autre exemple] : la trésorerie de l'entreprise. Elle était, il y a quelques années encore, gérée au niveau de chacun des pays ; actuellement, tous les excédents sont gérés en Irlande dans un centre créé pour l'ensemble de l'Europe, les pays apportant leur contribution et bénéficiant des fonds disponibles quand ils en ont besoin ». La recherche de rentabilité est poussée au point de traverser les groupes eux-mêmes et de mettre les unités de production internes en concurrence. A une question du rapporteur demandant si IBM Corp. met en concurrence les sites dont il dispose dans différents pays, M. Bernard Dufau, président d'IBM France, répond par l'affirmative : « Oui, nous le faisons systématiquement. Pour cela, il faut décider d'avoir en Europe, en Asie et aux États-Unis le même type d'usine. La tendance, aujourd'hui, est d'en avoir une ou deux seulement, mais pas trois ». C'est à la lumière de cette recherche de rentabilité exacerbée qu'il faut comprendre les récentes opérations d'IBM France à Corbeil. Le 16 mars 1999, son président-directeur général déclarait à la commission d'enquête : « Nous estimons que cette usine demeure compétitive en dépit de son environnement (...). Il n'y a pas un seul endroit où il y a autant de compétences, de savoir-faire, de rendement qu'à Corbeil-Essonnes. Il faudrait des différentiels très importants pour ne plus les utiliser », mais il ajoutait aussitôt que « [la prise de décision relative à l'investissement] dépend des activités. Quand il s'agit de couvrir le marché commercialement, les décisions sont locales. Pour les investissements lourds industriels, la décision est mondiale. Pour le développement des nouveaux produits, aussi. Quand une implantation géographique est concernée, son patron est fortement associé à la décision mais ne se prononcera pas in fine ». Interrogé le 4 mai 1999 par le rapporteur sur les mécanismes de prise de décision, M. Bernard Dufau a de nouveau indiqué : « Il [s'agissait] d'un investissement important qui [devait] être approuvé par le board de la Corporation. Je ne pouvais pas prendre une décision sur ce sujet ; on ne fabrique pas pour le marché français, mais pour le marché mondial. Lors de mon audition [du 16 mars], je ne savais donc pas quelle décision le board allait prendre : il en était à l'étude [des] trois scénarios [possibles] ». Il est probable que les politiques de maximisation du ROE (return on equity, c'est-à-dire le rapport résultat net/fonds propres) résultent moins de la volonté des directions d'entreprise, fréquemment plus soucieuses d'investissements que de dividendes, que du rôle devenu dominant des actionnaires et de conceptions anglo-saxonnes de la gestion, qui font de la rentabilité du capital le seul étalon des allocations de ressources entre entreprises et au sein de celles-ci. En toute hypothèse, observe M. René Valladon (FO), « l'objectif de rendement entre 13 et 15 % est quasiment imposé à toutes les entreprises. Or, si en période de croissance ce taux peut rester supportable, en période de stagnation ces 15 % ne peuvent être obtenus que par la voie des restructurations ». De ce point de vue, le groupe Bolloré apparaît assez atypique en raison du poids qu'il accorde aux opérations de nature purement financière. Auditionné par la commission d'enquête, M. Vincent Bolloré a ainsi déclaré « [que son groupe] est profondément industriel. D'ailleurs, un groupe industriel se caractérise d'abord en fixant des stratégies, ce que nous faisons dans nos métiers. Les métiers que nous pratiquons ne sont par nature pas de court terme. Nous n'avons malheureusement jamais, et dans aucun de nos secteurs, la capacité d'investir de l'argent et de le reprendre tout de suite. Notre métier génère des pay back de quatre à six ans. C'est-à-dire que, quand nous mettons de l'argent, nous commençons par en perdre la première année, nous retrouvons l'équilibre généralement la troisième année et nous commençons à récupérer de l'argent la quatrième année. C'est donc au cours de la cinquième ou de la sixième années que nous engageons le remboursement de notre investissement ». Pourtant, le rapprochement des investissements financiers et des investissements corporels réalisés par le groupe au cours des années récentes tend à montrer le contraire, les premiers bénéficiant d'un avantage moyen sur les seconds de 45,8 % au cours de la période récente. Investissements corporels et financiers du groupe Bolloré, 1993-1997 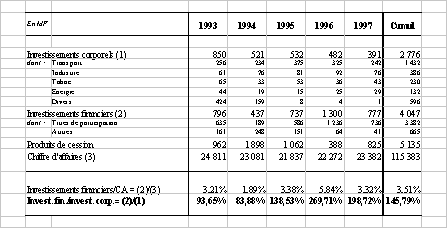
Les politiques de maîtrise des coûts ne rencontrent guère de limites : les stratégies de délocalisation sont en effet complétées par des mouvements d'externalisation souvent coûteux voire par des opérations de fusion plus ambitieuses encore.
Les stratégies de délocalisation visant à exploiter les différentiels de coût du travail contribuent de façon significative à la destruction de l'emploi dans notre pays. Tel est la conclusion, appuyée d'exemples nombreux, à laquelle les auditions de votre commission d'enquête permettent d'aboutir. M. Michel Coquillion (CFTC) en a dressé une longue typologie pour la commission d'enquête : « [Il faut distinguer] celles qui visent à accroître les profits sans qu'il y ait pour autant menace sur l'entreprise, celles auxquelles les entreprises sont contraintes de procéder sauf à disparaître, celles qui résultent de stratégies où la contrainte qui pèse sur l'entreprise n'est que la conséquence de ses propres choix. « Dans le premier cas, les groupes ferment des sites sans qu'il y ait d'impératifs économiques majeurs, alors même que ces sites pourraient être développés, mais parce que leur délocalisation est source de rentabilité accrue. « Je pense en l'occurrence au groupe Levi-Strauss qui ferme son usine de la Bassée et provoque 641 licenciements sous prétexte de surproduction en Europe au moment même où il s'installe en Turquie. En fait, seule la recherche de profits accrus motive cette délocalisation. D'ailleurs le président du groupe, visitant le site quelques jours avant d'annoncer sa fermeture, le présentait lui-même comme un site très souple, très flexible, ayant de l'avenir. Il suffit d'ailleurs de noter que le coût du travail par «jean» était de 28 F pour un prix de vente qui se situe entre 300 et 400 F (...) Le coût total peut être estimé à 149 F sachant que les coûts autres que ceux du travail sont difficiles à cerner dans la mesure où tout dépend de la façon dont la maison-mère facture à ses filiales les coûts de structure et comment sont faites les répartitions des charges au sein du groupe. En tout cas ce premier exemple démontre que le seul souci des dirigeants a été d'avoir recours à une main d'oeuvre meilleur marché. « La fermeture du site Vidéocolor de Villeurbanne qui, au sein du groupe Thomson, était spécialisé dans la production de tubes de télévision est un second exemple puisque ce site qui était bénéficiaire au moment de sa fermeture a disparu alors que Thomson construisait une usine au Brésil. C'était l'époque où Thomson pourtant entièrement nationalisé délocalisait ses activités vers l'Amérique Latine. A ce sujet on ne peut pas dire que les groupes nationalisés aient toujours montré l'exemple. « Ce type de délocalisations ne concerne pas exclusivement des pays à bas salaires mais peut intervenir en Europe lorsqu'un groupe étranger qui a acquis un site en France en rapatrie les activités dans le pays où il a son siège social. Il s'agit moins alors, à l'échelle européenne, d'une délocalisation que d'une relocalisation mais qui ne va pas sans créer un traumatisme à l'endroit où cesse l'activité. Je citerai ici le cas de Texunion du groupe DMC situé dans le Haut-Rhin pour lequel l'inquiétude est grande dans la mesure où les sites allemands plus performants, du fait d'investissements beaucoup plus importants, risquent de conduire à la fermeture du site alsacien. Même si, pour l'instant, les suppressions de postes se sont limitées au nombre de 150 sur 1000 emplois, les organisations syndicales craignent une fermeture définitive. Je rappellerai le cas Hoover. Je mentionnerai également la politique de l'Irlande qui attire les activités, d'informatique notamment, en jouant sur des différentiels de coûts importants. « Il est vrai qu'aux côtés des entreprises qui délocalisent pour accroître leurs profits il en est d'autres qui y sont contraintes sauf à ne pouvoir résister à la concurrence. Je pense ici à une usine de textile de Royan qui n'a pu résister à la concurrence d'entreprises qui avaient elles-mêmes été délocalisées. Le pire c'est que sa cessation d'activité a été due à la perte des marchés de la Marine nationale qui a renoncé à lui passer ses commandes au profit d'entreprises étrangères, l'État prêtant en l'espèce la main à une délocalisation dont les effets ont été immédiats pour la localité. La ville de Royan est aujourd'hui sinistrée comme le sera demain la région de la Bassée déjà très touchée par la fermeture d'autres usines textiles. Je pense de même à la guerre féroce que se livrent les grands groupes dans le domaine des pneumatiques dont certains se délocalisent dans les pays de l'Est ou dans des pays où la main d'oeuvre est moins chère encore et deviennent sur le marché français des concurrents redoutables pour ceux qui continuent à jouer le jeu. « On en arrive même à voir des groupes se concurrencer eux-mêmes ; ainsi de Péchiney qui inaugure à la fois une usine en Amérique Latine et annonce des sureffectifs en France qui exigeront des plans sociaux ». Selon M. Élie Cohen (CNRS), ces délocalisations révèlent un changement profond dans les modes d'organisation de l'entreprise. L'entreprise intégrée verticalement selon un modèle fordiste, fait progressivement place à une organisation décentralisée en réseau : « [L'entreprise] aura une stratégie de localisation pour ses fonctions commerciales, ses fonctions financières, ses fonctions de production, ses fonctions logistiques, etc. L'entreprise moderne se conçoit de plus en plus comme un réseau intégrant des activités différentes localisées aux quatre coins du monde ou, en tout cas pour ce qui nous concerne, aux quatre coins de l'Europe en fonction de principes d'optimum économiques repérés par les avantages différentiels des différents espaces économiques, notamment en terme de concurrence entre territoires ». Ces évolutions de structure se comprennent à la lumière de la nouvelle division internationale du travail : « Un certain nombre d'activités fortement intensives en travail qui avaient persisté malgré tout au niveau européen sont en train de disparaître et de réapparaître dans des pays à faible coût de main d'_uvre. Dans une série de secteurs l'évolution est déjà ancienne mais elle s'est accélérée. C'est le cas des textiles, de la chaussure, des chantiers navals. Ces activités sont en train de disparaître dans les pays développés ». Les auditions des groupes ont permis d'alimenter ces réflexions par une série d'exemples concrets. S'agissant du groupe Nestlé, M. Jean-Pierre Ribout (CGT) observe que « les délocalisations se font essentiellement vers l'hémisphère sud, c'est-à-dire que Nestlé quitte la France et, parallèlement, réinvestit, toujours dans le lait, mais, dans l'hémisphère sud. C'est là un problème énorme puisque l'avenir de toute l'industrie laitière est menacé. On constate le désengagement de Nestlé de cette industrie, notamment en France. Le groupe ne cesse de racheter des sociétés dans l'hémisphère sud [i.e., Australie, Amérique du Sud et Afrique du Sud] parce qu'il y trouve du lait à des prix défiants toute concurrence et une main d'_uvre bien évidemment dépourvues de droits sociaux ».
A défaut d'engager des opérations de délocalisations que seules des différences majeures de protection sociale ou de pression fiscale justifient, les groupes recourent à l'externalisation des activités qu'ils estiment périphériques par rapport à leur c_ur de métier. Ces politiques d'externalisation ne se résument pas au transfert nominal d'activités autrefois assurées par des services intérieurs, c'est-à-dire à un simple changement d'employeur au sein d'un volume d'emploi demeuré constant. M. André Ollier (CGT) a dénoncé devant la commission d'enquête la fausseté de certaines idées reçues : « on prétend volontiers que l'opération est finalement neutre car des PME et PMI récupèrent les emplois perdus. Je dirais, premièrement, qu'on arrache à un corps social des salariés qui ont une histoire dans une entreprise ; deuxièmement, qu'ils sont repris par des petites entreprises sous-traitantes qui, pour obéir à la loi du marché, pratiquent des salaires qui sont de 30 % inférieurs à ceux que recevaient auparavant les salariés. S'ajoute à cela une fragilisation des situations parce qu'on sait très bien que si, dans un premier temps, le groupe confie le marché à la nouvelle entreprise, cette dernière devra ensuite répondre à des appels d'offre et offrir les prix les plus bas, faute de quoi elle perdra son client ». « Les grandes entreprises ne créent pas aujourd'hui d'emplois et ce sont les PME-PMI qui en créent, mais elles le font sur les décombres des restructurations des grandes entreprises et ce n'est pas neutre ». M. Yves Couillard, président-directeur général de Hewlett-Packard France, s'est au contraire posé en défenseur de ces externalisations. Il observe qu'elles constituent une source de compétitivité très appréciable pour l'entreprise et qu'elles gagent ainsi sa pérennité même : « L'externalisation des activités s'inscrit (...) dans le cadre normal du recentrage sur les meilleurs savoir-faire, compte tenu de la nécessité de conserver à l'entreprise une taille raisonnable. Si nous intégrions l'ensemble des activités de nos partenaires en amont et en aval, la société compterait peut-être trois cents ou quatre cents milles personnes. Nous ne sommes pas convaincus que nous saurions gérer un groupe de cette taille : chacun a observé ce qui est arrivé à IBM quand la société a franchi le seuil des 400 000 personnes dans le monde. Dans notre secteur, les savoir-faire n'existent pas pour que de tels géants se développent. Un constat différent s'imposerait dans des mondes plus traditionnels où certains groupes dépassent les 500 000 personnes : ils constituent néanmoins des exceptions et leur réussite nécessite beaucoup de talents en matière de gestion (...). « La sous-traitance (...) correspond à l'apparition de groupes spécialisés dans certaines activités très particulières. Nous n'avons aucune raison de nous priver de leur savoir-faire puisqu'ils développent des masses critiques allant bien au-delà des nôtres et sont capables d'exécuter pour différentes sociétés des tâches similaires à des coûts extrêmement compétitifs. « SCI est à ce titre un bon exemple. Il s'agit d'une grande société internationale avec laquelle HP développe de nombreuses activités en partenariat. Comme le Wall Street Journal vient de le publier, SCI a de meilleures performances financières que Hewlett-Packard, ce qui montre que ce groupe se porte bien dans sa spécialité. « Plus généralement, nous assistons à l'émergence constante dans le monde de l'informatique de nouvelles compétences du fait de la segmentation des marchés et des volumes considérables qui s'y traitent. Des sociétés se spécialisent et sollicitent un groupe comme le nôtre pour obtenir des fabrications : c'est le jeu de l'offre et de la demande. Nous avons inversement décidé de développer notre site de production de L'Isle d'Abeau, alors même que nous avons à Singapour un autre site de production de PC. « Il n'existe pas d'offres compétitives dans tous les secteurs. Nous estimons qu'il est souhaitable d'avoir dans tel ou tel pays une fabrication qui soit sous notre contrôle, même si progressivement la segmentation des marchés permet d'externaliser une ou plusieurs phases de la production chez des fournisseurs spécialisés. A partir du moment où le marché offre une alternative plus compétitive que la production interne, il n'y a aucune raison de s'interdire d'y faire appel. De toutes façons, la concurrence le fera immédiatement ; rester passif conduirait au contraire à perdre des parts de marché, parce que les produits sont devenus trop chers ». Les externalisations sont largement pratiquées au sein du groupe Nestlé. M. Jean-Pierre Burdin (CFTC) a pris l'exemple du désengagement d'une activité annexe comme la distribution : « il y a quinze ans environ, la distribution représentait en France huit établissements-entrepôts pour un effectif d'environ 800 personnes. On a commencé par supprimer le parc automobile, c'est-à-dire des chauffeurs et des camions, sous prétexte de rentabilité. Cette activité a donc été confiée à des transporteurs et les chauffeurs de Nestlé ont disparu peu à peu. Il y a eu ensuite un regroupement des activités dans trois centres sur les huit, ce qui a donc entraîné cinq fermetures. Suite à ce regroupement des centres, Nestlé a décidé, il y a maintenant quatre ans, de regrouper tous les services administratifs dans deux sites, l'un situé à Noisiel et l'autre à Lyon, et de confier le reste de l'activité, qui représentait une activité de commande, à des prestataires de service, si bien qu'il ne reste plus qu'une quarantaine de personnes appartenant au groupe Nestlé, dont 19 sont détachées chez le prestataire et 20 à Lyon qui ne vont certainement pas y rester longtemps ». M. François Sanson (CGC) a souligné les conséquences dommageables de cette politique : « l'externalisation et le développement de la sous-traitance conduisent, par exemple par des services d'entretien informatique et de nettoyage, assurés par des sociétés extérieures qui travaillent pour Nestlé France, à diminuer la qualité assurée par les conventions collectives du groupe et permettent aussi de précariser les emplois, de mettre des salariés sous des conventions moins favorables, de surcharger finalement ces salariés qui sont alors dans des PMI ou des PME à faibles marges et, enfin, par voie de conséquence, de supprimer encore des emplois ». M. Jean-Pierre Ribout (CGT) généralise le constat en soulignant la convergence destructrice entre une logique de profit, une politique d'investissement et des choix industriels : « Comme tous les grandes groupes, nous vivons un certain nombre d'externalisations dans le domaine de la logistique, qui vont entraîner des fermetures d'établissements - la dernière en date a eu lieu à Rennes - et conduire à des compressions d'effectifs majeures, ainsi qu'à des transferts de personnel avec des changements de statuts sociaux. « Le problème de l'insuffisante modernisation des filiales, dans le domaine de l'agro-alimentaire, concerne certes le produit et l'outil industriel mais aussi la marque. Le métier de Nestlé, c'est bien le marketing, la publicité, et cela lui donne un pouvoir considérable sur l'abandon de produit. Il y a quelques années, Nestlé a choisi de sacrifier la marque Gloria et n'a pas fait de publicité pendant sept à huit ans, si bien qu'aujourd'hui, le consommateur n'en achète plus ; l'usine doit être fermée. « Un désinvestissement est donc réalisé sur tel et tel produit : au nom d'une politique mondiale complètement ignorée des instances représentatives, qu'elles soient d'ailleurs européennes ou nationales, Nestlé a le pouvoir de se retirer de certaines parties du marché. Même si c'est un produit qui se vend bien en France, le groupe peut choisir de se désengager de ce marché uniquement en ne modernisant pas suffisamment certaines marques. Nestlé en possède en effet 8 000 et sa stratégie actuelle de globalisation mondiale le conduit justement à ne se recentrer que sur quelques marques qui peuvent être développées dans tous les pays du monde ». Le constat n'est pas sensiblement différent chez Perrier-Vittel, où M. Arthur Staub (CFDT) souligne que ces externalisations sont un moyen de tourner les dispositions impératives du code du travail : « pour éviter d'avoir à respecter les contraintes liées aux plans sociaux, les grands groupes préfèrent ne pas licencier et externaliser certaines activités ; le groupe Nestlé ne licencie donc personne, mais le souci de se concentrer sur le c_ur de son métier le conduit simplement à se séparer de la gestion des palettes, de la charge du ménage, de l'activité gardiennage, de l'entretien du golf, etc. et le salarié suit tout simplement cette activité, en vertu de l'article L.122-12 [du code du travail] puisqu'il serait considéré juridiquement comme démissionnaire s'il refusait, et c'est le repreneur, qui n'a pas la surface financière que peut avoir un groupe comme Nestlé, qui doit se charger d'effectuer les licenciements jugés nécessaires, et on ne pourra pas mettre à la charge de ce repreneur qui est souvent une PME ce que les pouvoirs publics pourraient exiger de la part d'un groupe comme Nestlé dans le cadre d'un plan social (...). « Certes les magistrats sont de moins en moins dupes des agissements des sociétés et, dans le cas de Contrexéville où la direction de Nestlé a décidé d'externaliser une activité palettes en utilisant le L.122-12, la cour d'appel de Nancy a pris (...) une décision qui rejoint celle de la cour d'appel de Nîmes, et les magistrats dans leur motivation ont déclaré que "l'entité permettant la mise en _uvre de l'article L.122-12, alinéa 2, du code du travail, qui, appliqué en l'espèce (à l'activité de transport palettes), servirait plutôt à externaliser des contrats de travail qu'une activité». Cela constitue une avancée énorme ». M. Élie Cohen (CNRS) a cité l'exemple de Sara Lee, « grand groupe américain qui contrôle notamment en France les bas Dim. Il a décidé, l'année dernière, que sa vraie spécialisation n'était pas la fabrication des bas ou d'autres produits textiles - il contrôle également la marque Playtex - mais la conception, le marketing et la distribution. Il a donc rassemblé les activités de production dans une filiale et les a vendues. Au départ, il a pris des engagements d'achats pour les sites existants mais son objectif est à terme d'acheter au meilleur prix sans se préoccuper des sites de production ». Les relations entre le donneur d'ordre et le sous-traitant apparaissent marquées par une prégnance des rapports de force bien éloignée de l'équilibre des volontés cher au droit des contrats synallagmatiques, où la recherche de gains de toutes natures s'accompagne du souci presque avoué de tourner les dispositions protectrices de la loi. Le témoignage de M. Gilles Eymery (CFDT) chez Hewlett-Packard France apparaît, de ce point de vue, particulièrement éclairant : « le souci du gain le plus élevé pour un moindre investissement conduit Hewlett-Packard à refuser de développer certains secteurs pourtant rentables ; cette situation survient en général au moment où le marché est propice à la "mutualisation". Lorsque la société s'aperçoit qu'une activité a la possibilité de récupérer un marché extérieur tout en ne voulant ni investir ni embaucher, elle choisit d'externaliser : le repreneur va en effet recevoir pour s'établir des aides de l'État et des communes (terrains ou bâtiments cédés pour le franc symbolique etc.) ; il y a aussi des perspectives de gain sur les salaires, puisque le repreneur rémunère sa main-d'_uvre moins cher. L'avantage en investissement évité est donc significatif ; en contrepartie, Hewlett-Packard s'engage généralement à fournir du travail pour une durée prédéfinie (2 ans) afin d'aider la nouvelle entreprise à démarrer. « L'externalisation présente un autre intérêt : la relation de dominant à dominé permet de faire pression sur le repreneur et ses employés pour forcer la baisse des coûts de fabrication et augmenter la flexibilité. Des emplois sont certes créés, mais ce sont en général des emplois précaires à salaire minimum. Les anciens salariés de Hewlett-Packard, avec plusieurs années d'ancienneté, se retrouvent rapidement en porte-à-faux par rapport aux nouveaux embauchés - souvent plus jeunes, donc plus malléables et plus flexibles. « Comme Hewlett-Packard ne pouvait pas baisser les salaires lorsque l'activité était au sein de la société, il se trouve également sous-traiter la gestion sociale au repreneur. A moyen terme, les anciens salariés risquent de perdre leur qualification. Les plus méritants verront leur salaire bloqué pendant plusieurs années ; des pressions pousseront les autres à la démission, à moins qu'ils ne se trouvent licenciés pour diverses raisons (...) « Qu'on ne s'y trompe pas : la sous-traitance est une position dominant- dominé, loin de la position de partenariat. Il n'y a aucun souci de fidélisation : Hewlett-Packard met les entreprises en concurrence afin de diminuer les prix, gagner en efficacité et accroître la flexibilité. Celles-ci sont soumises à des pressions parfois intenables : pour rester compétitives, elles emploient du personnel malléable à souhait avec des niveaux de salaires très faibles ; pour pallier les problèmes d'irrégularité des commandes, elles utilisent beaucoup de main-d'_uvre temporaire ou transfèrent à d'autres sous-traitants. Les conditions de travail sont à la limite de l'acceptable : le personnel travaille dans des locaux loués et mal adaptés aux besoins ; des impasses sont faites sur la sécurité, le temps de travail effectif etc ».
Votre commission d'enquête ne s'est penchée sur les regroupements et fusions de groupes qu'à travers la fusion de Hoechst (Allemagne) et Rhône-Poulenc au sein d'Aventis. La fusion Hoechst-Rhône-Poulenc rapproche deux groupes de taille inégale. Le tableau ci-dessous, extrait de L'Expansion (1er-14 avril 1999), rappelle en effet l'existence d'un écart de capitalisation de près de 50 milliards de francs entre les deux partenaires : Hoechst et Rhône-Poulenc : données comparées Source : L'Expansion, 1er - 14 avril 1999
La fusion suscite une grande inquiétude sur le plan social, puisque M. Martial Guitton (CFTC) indique que celle-ci « va provoquer une baisse de 10 à 15 % de l'effectif en France, soit entre 2 500 et 3 000 emplois ». Ce chiffre n'est d'ailleurs pas démenti par M. Jean-René Fourtou, président du groupe Rhône-Poulenc : « Il faudra se réorganiser et donc éliminer toute une série de postes redondants. C'est là un grand chantier (...) Le chiffre d'une réduction des effectifs de 10 %, qui circule ici ou là, n'est pas un chiffres faux : cela peut être moins, cela peut être plus, mais il est exact que c'est dans cette zone que la contraction se situe. C'est important en termes économiques puisque les économies attendues de cette opération représenteront 1,2 milliard de dollars au bout de trois ans ». Se faisant l'écho d'études de plusieurs cabinets anglo-saxons (AT Kearney, Arthur D. Little et Mercer management consulting) a priori peu suspects d'anticapitalisme sommaire, L'Expansion (1er-14 avril 1999) observe d'ailleurs que l'aptitude d'une opération de fusion ou d'acquisition à créer de la valeur est en fait très incertaine. Selon AT Kearney, 58 % des fusions volontaires entre groupes de taille proche sont des échecs si l'on en juge à l'aune du cours boursier - le seul étalon que connaît l'actionnaire. L'étude du cabinet Arthur D. Little révèle que deux ans après leur union, 60 % des entreprises présentent une performance boursière inférieure à la moyenne de leur secteur... Par ailleurs, la fusion défavorise la croissance interne : pendant qu'elles règlent leur rapprochement, les sociétés innovent moins ou ne sont pas en train de conquérir de nouveaux marchés. Si la logique financière pousse aux rapprochements, il n'est pas rare qu'elle invite également aux séparations. La scission des pôles Informatique et Mesure de Hewlett-Packard France constitue pour M. Pilichowski (CGT) le terme logique du recentrage opéré par le groupe sur un objectif de croissance du titre boursier. En effet, selon M. Breton (CFTC), le pôle Mesure « qui est à l'origine de la fondation de Hewlett-Packard et constituait la totalité de son activité, n'en représente plus aujourd'hui que 15 % et emploie 35 000 personnes. [Or] Hewlett-Packard souhaite se comparer à ses compétiteurs dans le secteur informatique. Mais lorsque les analystes financiers divisent le chiffre d'affaires total par le nombre de personnes qui le réalisent, ces trente-cinq mille postes pèsent lourdement sur le résultat final ». Comme l'indique M. Demoulin (FO), cette partition ne devrait affecter que marginalement les résultats d'un groupe désormais délesté d'une activité à forte intensité relative en travail : « les 78 000 employés du nouveau pôle Informatique réaliseront 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires, alors que les 45 000 salariés du pôle Mesure ne représenteront que moins de 8 milliards de dollars. En d'autres termes, Hewlett-Packard se sépare de 45 000 emplois mais seulement de 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. La croissance du groupe étant de l'ordre de 20 % par an, les 40 milliards de dollars d'aujourd'hui sont 48 milliards demain : en se séparant de 45 000 employés, Hewlett-Packard ne perd que la variation de son chiffre d'affaires en un an ». L'analyse de la direction de l'entreprise diverge de celle des organisations syndicales. Ses responsables font ainsi valoir que la cohabitation d'activités très différentes constitue un élément d'opacité et introduit des contraintes que seule une partition en deux entités distinctes apparaît susceptible de lever : « Les années récentes nous ont fait entrer dans le monde de l'informatique et de l'imagerie. Cela a d'ailleurs tellement bien fonctionné que nous sommes aujourd'hui la deuxième société d'informatique du monde et que l'informatique représente 84 % de notre chiffre d'affaires. Dans ces conditions, les personnes du monde de la mesure, qui n'ont jamais démérité et sont toujours restées au premier rang sur leur marché, se retrouvent de plus en plus assises sur un strapontin. Leur position est très inconfortable car la direction de la société se préoccupe prioritairement de ce qui génère 84 % de son chiffre d'affaires et non du reste. « Par ailleurs la communication externe du groupe HP, dans tous les pays y compris en France, s'exprime essentiellement autour du pôle Informatique et non du pôle Mesure. Ce dernier souffre donc d'un désavantage comparatif vis-à-vis de concurrents qui ont la mesure physique pour seule activité et sont parfois spécialisés dans certains types de mesures uniquement. « Il faut enfin savoir que le "business model» de chaque activité est totalement différent. « Le pôle Mesure réalise 16 % du chiffre d'affaires pour 37 % des emplois de Hewlett-Packard ; plus d'un salarié sur trois travaille pour lui. Pourquoi un tel écart ? Parce que le pôle Mesure est beaucoup plus propriétaire sur le plan technologique, qu'il compte moins de partenaires en amont et en aval, qu'il fait peu appel à des fabricants de sous-ensembles et qu'il s'illustre dans la vente directe par projet - et non dans la vente de masse avec une multitude de partenaires, comme cela se passe actuellement dans l'informatique. « La différence entre ces deux univers est très perceptible et rend délicate la cohabitation de mondes aux intérêts et modèles de fonctionnement totalement différents. Nous sommes cependant obligés, pour des raisons d'intégration et d'harmonisation, d'appliquer un minimum de règles communes à tous, qui consomment un temps et des énergies plus utiles ailleurs ».
Afin de préserver leur liberté de gestion, les groupes mettent en place des stratégies d'optimisation fiscale. Votre commission d'enquête n'a pas eu l'occasion de rencontrer des pratiques délictueuses au cours des auditions auxquelles elle a procédé, mais n'a pas non plus pas souhaité pousser très avant ses investigations sur ce sujet. Les observations présentées par les directions de groupe et les organisations syndicales conduisent à devoir rappeler que les différences de structures d'imposition sont aujourd'hui largement exploitées par les opérateurs économiques en vue de minimiser leur charge fiscale. Ces stratégies agissent au détriment des États, qui voient une fraction importante de leur assiette imposable s'évader. Elles agissent surtout au détriment des contribuables, sur lesquels les pertes de recettes se trouvent in fine reportées.
Exonération de l'impôt sur les bénéfices. - Les possibilités d'exonération définitive de l'impôt sur les bénéfices apparaissent assez limitées, puisque les structures fiscalement transparentes (GIE et sociétés d'investissement de type SICOMI) transfèrent l'acquittement de l'impôt aux détenteurs de parts de la structure exonérée. Seuls les régimes destinés aux sociétés implantées dans les zones d'entreprises aux entreprises nouvelles ouvrent droit à une exonération temporaire, mais définitive, de l'impôt. Les opérations litigieuses ayant pour objet de permettre à des contribuables de bénéficier indûment du régime de faveur peuvent relever de la fraude fiscale. Dans un arrêt Baudrillard du 28 octobre 1991, la chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi estimé qu'un dirigeant qui constitue une entreprise prétendument nouvelle qu'il place sous le régime fiscal de faveur, comme le délit de fraude fiscale dès lors que cette entreprise ne fait que reprendre l'activité d'une autre société, qu'il avait antérieurement créée et qu'il gérait. C'est pour lutter contre cette forme d'évasion que les pouvoirs publics ont voulu que l'article 44 sexies détermine plus précisément que l'ancien dispositif de l'article 44 quater les conditions que ces entités nouvelles doivent satisfaire pour bénéficier du régime de faveur. Changements d'activité, filialisation et utilisation litigieuse du mécanisme du report déficitaire. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui subissent un déficit, ont la possibilité en application de l'article 209 du code général des impôts d'en faire l'imputation sur le bénéfice de l'exercice suivant, voire sur les bénéfices des exercices ultérieurs. Des limites à cette possibilité de report ont été posées par la jurisprudence (Conseil d'État, 6 juin 1990, Inno France et Cour de Cassation, Chambre commerciale, 7 mars 1984, Société Beauvallet) et par le législateur en cas de changements dans la composition de l'actionnariat des sociétés ou dans la nature même de leur activité, en vue notamment d'éviter la reprise à des fins purement fiscales d'entreprises déficitaires dont l'activité initiale sera en fait abandonnée au profit d'une activité plus rentable, qui n'a aucune vocation à bénéficier du report des déficits nés de l'activité antérieure. Mais la pratique fait apparaître des difficultés d'application. La transformation d'une entreprise en groupe dont les activités sont filialisées sous la direction d'une société holding peut ainsi donner lieu à des mécanismes d'évasion fiscale. Le Conseil national des impôts (op. cit., I, p. 297) donne l'exemple suivant. La société X, connaissant des difficultés économiques et disposant d'importants déficits ordinaires reportables, décide de se rapprocher de son partenaire industriel la société Y. Ces deux sociétés apportent leurs activités industrielles à des filiales communes constituées sous forme de sociétés en nom collectif (SNC). Afin d'éponger ses déficits, la société X acquiert massivement des parts de SNC bénéficiaires : ce mécanisme permet grâce à la transparence fiscale des SNC de faire remonter les bénéfices des activités filialisées des sociétés X et Y vers la holding et par suite d'imputer sur ses bénéfices les reports déficitaires de la société X. L'administration a toutefois considéré qu'il s'agissait d'une utilisation abusive des dispositions de l'article 209 du code général des impôts, puisque l'opération cumulait les deux critères exigés par la jurisprudence pour conclure au changement d'identité de l'entreprise : modification de la composition de l'actionnariat et changement de la nature de l'activité (la société X a abandonné ses activités de production pour se borner à gérer un portefeuille de sociétés). L'appréciation à porter est ambiguë. Si la perte de recettes fiscales pour l'État est incontestable, considérer inversement la filialisation comme un changement d'activité conduit à pénaliser les entreprises déficitaires qui cherchent par des restructurations internes à s'adapter à leur environnement : interdire l'imputation après une telle réorganisation porte en effet atteinte à leur flexibilité. Régime de faveur des fusions. - L'évolution d'une société peut conduire celle-ci à envisager des restructurations internes se traduisant par la filialisation d'activités. Les sociétés nouvellement créées bénéficient en règle générale de l'apport d'une partie des actifs de la société d'origine, tandis que cette dernière reçoit en contrepartie les titres émis par la société bénéficiaire de l'apport. Il peut être intéressant pour les sociétés envisageant une telle opération de sa placer sous le régime de faveur des fusions prévu par l'article 210 A du code général des impôts. Ce dernier est obtenu par agrément ministériel mais l'agrément n'est pas exigé lorsque l'apport porte sur une branche complète d'activité ou sur une participation de plus de 50 % de la société apporteuse. En outre, cette dernière s'engage à conserver pendant cinq ans les titres reçus en contrepartie de l'apport et devra ultérieurement acquitter l'éventuelle plus-value de cession de ces titres par rapport à la valeur que les biens apportés avaient dans ses écritures. Pour elle, le régime de faveur présente principalement l'avantage de reporter le versement de l'impôt sur les sociétés pour les plus-values résultant de l'apport ou de ne taxer immédiatement certaines plus-values à long terme qu'à un taux réduit. De son côté, la société bénéficiaire de l'apport peut utiliser des facultés d'amortissement plus importantes, la durée de celui-ci étant déterminée à partir de la date de la fusion. Il est dès lors possible de détourner ce régime de sa finalité propre, en l'utilisant à seule fin de réaliser une réévaluation libre des actifs d'une entreprise à un coût fiscal inférieur (taxation à taux réduit de la plus-value dégagée) à celui d'une réévaluation libre dans les conditions du droit commun. Fiscalité applicable aux groupes. - La fiscalité propre aux groupes et notamment le régime d'intégration peut également susciter la critique en raison de la rupture d'égalité introduite vis-à-vis des entreprises insusceptibles d'en bénéficier. M. Jean-Pierre Ribout (CGT) chez Nestlé explique ainsi « qu'une intégration fiscale qui a pour but d'apporter une aide fiscale à un industriel qui veut investir est acceptable, mais [que] le mécanisme actuel est anti-concurrentiel ; il fausse le jeu de la concurrence parce que l'ensemble des PME n'a pas, par définition, accès à ces avantages alors que ce sont souvent elles qui innovent, créent de nouveaux produits et devraient donc être aidées. L'organisation de Nestlé en France est complètement organisée autour de l'intégration fiscale. « Il est acceptable qu'on puisse déduire des pertes et des charges d'exploitation dans un compte de résultat, mais pourquoi vouloir déduire des charges financières qui servent à racheter des sociétés si ce n'est pour en faire profiter justement les grands groupes ? « Il y a donc là un mécanisme pervers qui pénalise finalement l'emploi puisqu'on sait justement que le secteur des PME est créateur d'emplois. Il nous semble aberrant que l'intégration fiscale soit maintenue sous sa forme actuelle ».
Ces montages mettent en jeu plusieurs entreprises appartenant à un même groupe de sociétés. Leur objectif est de maximiser le bénéfice mondial du groupe en transférant ses bénéfices vers les filiales situées dans les pays à faible imposition, à travers la manipulation des prix de transfert de biens ou de services ou à travers le jeu des relations financières entre entreprises du groupe. Optimisation à partir des prix de transfert. - Le problème posé est celui de la répartition des produits et charges entre filiales situées dans des pays différents : en application du principe de territorialité, c'est en effet le prix des transactions courantes qui détermine le niveau de l'impôt perçu en France. L'opération la plus simple consiste à vendre à un prix délibérément minoré les produits d'une filiale A située dans un pays X à fort taux d'imposition, à une autre filiale B localisée dans un pays Y à taux d'imposition moins élevé. Le bénéfice que A aurait dû retirer de la vente de ses produits à un prix normal est ainsi transféré à B et supportera une taxation moins forte du fait de l'existence d'un différentiel de taux d'imposition sur les bénéfices entre X et Y. La modification de la répartition des bénéfices entre A et B aboutit pour le groupe à une économie d'impôt globale mais a des conséquences divergentes sur les recettes fiscales de X, qui sont affaiblies, et celles de Y, qui se trouvent au contraire augmentées. M. Hervé Le Floc'h-Louboutin (DGI-SLF) a présenté à la commission d'enquête les instruments à la disposition de l'administration pour lutter contre ce type d'évasion fiscale : « [les] mesures unilatérales que nous avons prises [se] retrouvent chez la plupart de nos partenaires, ce qui est assez logique puisqu'ils sont confrontés aux mêmes difficultés. « [Nous avons] mis en place des dispositifs qui permettent de corriger les prix internes de transfert et l'article 57 du Code général des impôts permet à l'administration fiscale, en tant que de besoin, de corriger ou de réintégrer dans les résultats d'une entreprise résidente les pertes ou bénéfices résultant de manipulation des prix de transfert et ce dispositif a été renforcé, comme les autres d'ailleurs, au cours des années récentes, notamment par l'allongement du délai de reprise de l'administration dans le cadre d'une procédure qui fait souvent appel à l'assistance fiscale internationale ». « Des entreprises peuvent également délocaliser leurs bénéfices vers des pays à fiscalité privilégiée. Or, l'article 209 B du code général des impôts permet à l'administration fiscale - lorsqu'elle s'aperçoit qu'une entreprise possède une filiale localisée dans un pays où l'impôt sur les sociétés est un tiers inférieur au moins à celui de la France - de rapatrier, nonobstant les règles de territorialité, la quote-part des résultats de cette filiale au prorata de sa participation dans ladite société. Ce dispositif est extrêmement utile puisqu'il s'applique non seulement aux paradis fiscaux mais aussi, le cas échéant, à des pays qui pratiquent des régimes fiscaux privilégiés - en clair, il peut être utilisé pour taxer une holding située aux Pays-Bas ou au Luxembourg - mais, un jour ou l'autre, on "butera» sur des problèmes de compatibilité juridique entre ce légitime emploi des instruments fiscaux de lutte contre des pratiques fiscales dommageables et d'autres principes généraux du droit communautaire tels que la liberté d'établissement. A titre d'exemple, l'article 209 B a été utilisé 119 fois en 1995 et 219 fois en 1997. « Enfin, l'article 238 bis permet de rapatrier les résultats d'une entreprise qui confie à un trust, situé en n'importe quel point de la planète, une partie de ses actifs à charge de les faire fructifier, les fruits étant destinés à couvrir, à terme, ses engagements ». En toute hypothèse, la lutte contre la fraude apparaît ici délicate. Suivant les recommandations de l'OCDE, l'administration doit s'appuyer sur diverses techniques de correction et notamment sur la méthode des prix comparables sur un marché de pleine concurrence (comparable uncontrolled price method). M. Michel Coquillion (CFTC) a rappelé que ces comportements ne se résument pas à une perte de recettes fiscales pour l'État. Ils portent un véritable préjudice aux intérêts des salariés : « certaines holdings ou entreprises étrangères minimisent volontairement les résultats qu'ils réalisent en France par le biais des coûts de cession ou de la répartition des charges du groupe et font apparaître les bénéfices ailleurs soit dans le pays de la holding soit, dit-on, dans des paradis fiscaux. Ces pratiques sont malheureusement très dommageables pour la France et pour les français dans la mesure où cette disparition de bénéfices se traduit non seulement par de moindres rentrées fiscales mais encore par l'impossibilité pour les salariés de bénéficier de dispositions légales comme la participation ou l'intéressement aux résultats et c'est ainsi qu'un délégué syndical de Hoechst me disait que les salariés de l'entreprise ne bénéficiait d'aucune participation dans la mesure où tous les bénéfices sont rapatriés en Allemagne ». Les responsables de filiales de groupes multinationaux auditionnés ont, quant à eux, souligné leur volonté de transparence dans les relations avec les sociétés mères et le contrôle attentif dont les filiales font l'objet de la part des pouvoirs publics. M. Yves Couillard, président-directeur général de Hewlett-Packard France, a ainsi rappelé « qu'entre sociétés du groupe Hewlett-Packard, il est de règle que les relations doivent être établies comme si les parties contractantes appartenaient à des mondes différents afin d'éviter toute distorsion de compétitivité. On appelle cela le "arm length principle» - maintenir entre les partenaires "la distance d'un bras» (...) Les prix de transfert sont étudiés de très près par la direction générale des impôts et observés également par la Commission des communautés européennes. Nous travaillons en toute transparence avec ces administrations et n'avons jamais fait l'objet de remarques particulières sur nos pratiques ». Optimisation à partir des dépenses communes. - Selon les règles définies par l'OCDE, les dépenses engagées par le siège et les frais de recherche ne sont déductibles dans le pays d'implantation que si elles sont effectuées uniquement à son profit. Si elles concernent l'ensemble du groupe, elles doivent être divisées selon une clé de répartition comme le chiffre d'affaires. Des stratégies d'optimisation peuvent se déployer à partir du périmètre plus ou moins large retenu pour ces dépenses engagées pour compte d'autrui et du niveau du taux de marge éventuel ajouté au prix de revient. La détermination d'un prix de marché des prestations immatérielles (redevances) pose des problèmes identiques (mais en termes plus complexes) à ceux relatifs aux prix de transfert de biens et au partage des dépenses réalisées par le siège pour le compte de ses filiales. Optimisation à partir des relations financières. - Au sein d'un groupe de sociétés, les conditions dans lesquelles une entreprise du groupe prête ou emprunte de l'argent à une autre filiale du même groupe peuvent être définies dans l'intention de réaliser un transfert de bénéfices, que le prêteur soit rémunéré à un taux excessif ou que l'emprunteur verse un taux d'intérêt inférieur à la normale. Le mécanisme est ici très proche de celui de la manipulation du prix des biens, le taux d'intérêt s'assimilant alors à un prix de transfert financier. Il est même possible d'envisager que la filiale située dans un pays à faible taux d'imposition bénéficiant d'un prêt à taux peu élevé ou nul joue un rôle d'intermédiation financière en prêtant à nouveau cet argent à une troisième filiale, résidant dans un pays à fort taux d'imposition. La sous-capitalisation est une forme plus élaborée de transfert des bénéfices. Le schéma consiste à créer une filiale implantée dans un pays à fort taux d'imposition et dotée d'un capital social très inférieur au niveau normal compte tenu de ses activités. Le fonctionnement de cette dernière est alors financé par un prêt à long terme ou une succession de prêts à court terme consentis par la société mère, générateurs d'intérêts qui viennent diminuer le bénéfice de la filiale et accroître le résultat plus faiblement imposé de la société mère. Ce type de montage n'est intéressant pour le groupe que si le régime fiscal des intérêts est plus avantageux que celui des dividendes, soit que ces derniers ne soient pas déductibles du bénéfice (régime de droit commun en France ainsi que dans la plupart des pays développés), soit que la taxation des intérêts versés aux résidents du pays de la société mère soit plus faible que celle des dividendes. M. Élie Cohen (CNRS) estime que les entreprises appliquent à la question fiscale les principes de concurrence et d'optimisation habituellement réservés aux marchés : « A partir du moment où, par la pratique des prix de transfert, la segmentation des activités, la spécialisation des usines dans certains composants, l'assemblage final se fait dans le pays le mieux-disant fiscal ou même au travers des sociétés offshore, des entreprises localisent discrétionnairement leurs bénéfices là où elles l'entendent et détournent de la matière fiscale ». Confronté à l'ingéniosité sans cesse renouvelée des fiscalistes, M. Hervé Le Floc'h-Louboutin (DGI-SLF) s'est félicité de la prise de conscience progressive par les États de la nécessité de lutter contre la compétition fiscale dommageable : « Au milieu des années quatre-vingt-dix est apparu une espèce de consensus entre des pays de sensibilités très différentes sur l'impossibilité de jouer la logique de moins-disant fiscal, au risque d'avoir une déformation des systèmes fiscaux conduisant à alléger l'impôt sur ce qui est mobile et à l'accroître sur ce qui ne l'est pas. « C'est ainsi que l'on a vu, au sein de l'Union européenne (...) la fiscalité sur le capital s'alléger sensiblement au cours des années quatre vingt et corrélativement celle sur le travail augmenter quoique - phénomène beaucoup plus subtil - il y ait aussi le risque de délocalisation du travail hautement qualifié. « Tout le monde est plus ou moins conscient de ces difficultés. Certains réagissent plutôt en termes d'équité, d'autres en termes de neutralité des systèmes fiscaux mais il existe une espèce de consensus sur l'impossibilité d'aller jusqu'au bout de la logique du moins-disant fiscal entre des États de sensibilités fort différentes. Ce consensus réunit, en effet, au sein de l'OCDE des pays comme le Japon, le Canada, l'Australie. Il n'est pas absent des préoccupations de l'Union européenne où le débat sur la compétition fiscale dommageable intervient comme une espèce de succédané à celui de l'harmonisation fiscale. Il en a été question pendant vingt ans sans grand résultat, pour diverses raisons, et curieusement, le débat sur la compétition fiscale dommageable redonne vie à celui sur l'harmonisation fiscale, parce que c'est sans doute aujourd'hui l'angle le plus opérationnel. « Ce consensus a commencé à donner des résultats. L'OCDE a établi un rapport sur la compétition fiscale dommageable et a fait des recommandations. Elle a constitué sur le sujet un forum qui se réunit régulièrement, qui recense les paradis fiscaux, les régimes de compétition fiscale et qui doit faire des propositions aux États. Simultanément et parallèlement, de manière un peu compétitive, l'Union européenne agit de même [et élabore un code de conduite entre les États membres] ». Le contenu des travaux sur le code de conduite a été précisé à la commission d'enquête par M. Mario Monti, commissaire européen chargé de la fiscalité : « [le code de conduite constitue l'un] des trois éléments composant le paquet adopté par le conseil Ecofin, le 1er décembre 1997, contre la concurrence fiscale dommageable. « Il existe trois éléments dans ce paquet : le code de conduite sur la fiscalité des entreprises et des principes agréés par les États membres sur la base desquels la Commission a formulé, ensuite, deux propositions de directive : l'une pour éliminer la double imposition sur les paiements d'intérêts et redevances entre les entreprises associées, et l'autre, plus importante, la directive sur la fiscalité de l'épargne. S'agissant de l'Irlande, le code de conduite sur la fiscalité des entreprises a établi qu'il ne fallait pas combattre le fait qu'un État membre puisse avoir un taux d'imposition bas - voire très bas - sur les sociétés, mais lutter contre le fait qu'il y ait des traitements préférentiels concernant, par exemple, les entreprises en provenance de l'étranger par rapport aux entreprises du pays concerné. A la suite d'un grand débat, il a été décidé de ne pas considérer comme contraire au code de bonne conduite le fait qu'un État membre pratique une imposition très basse, pourvu qu'elle soit généralisée. En Irlande, traditionnellement, le taux d'imposition sur les entreprises n'était pas particulièrement bas, mais il existait des régimes préférentiels pour les Dublin's Docks et l'industrie manufacturière, au taux de 10 %. « Ce régime irlandais, ainsi que quelque 85 autres régimes appartenant à tous les autres États membres de l'Union, ont été identifiés comme devant être examinés par le groupe chargé au Conseil d'appliquer ce code de conduite sur la fiscalité des entreprises. Ce groupe, dans lequel la France est représentée par M. Sauter, procède de façon déterminée en vue d'obtenir des résultats intérimaires pour le conseil Ecofin de mai et un résultat définitif pour celui de novembre (...). « Lors d'une phase ultérieure du débat au sein de l'Union européenne, il faudra décider si les États membres souhaitent, ou non, aller plus loin, c'est-à-dire fixer un taux minimum au-dessous duquel aucun d'entre eux ne soit autorisé à baisser sa fiscalité sur les entreprises. L'accord actuel parmi les États membres est ne pas aller aussi loin et ne pas combattre la concurrence fiscale en tant que telle, mais seulement les formes dommageables ou déloyales de concurrence fiscale, identifiées dans les régimes préférentiels ». ENCADRÉ La prospérité actuelle de l'économie irlandaise vaut à ce pays le qualificatif de « tigre celtique » et suscite en Europe des interrogations sur ces causes. Beaucoup estiment que la principale est le régime fiscal, très favorable aux entreprises et qui parvient à attirer de nombreux groupes étrangers sur le territoire irlandais. Il apparaît en fait que cette fiscalité s'intègre dans un système d'aides plus vaste. Une fiscalité très favorable aux investissements étrangers L'impôt sur les sociétés Il y a peu, le taux était de 28 % pour l'ensemble des secteurs, à l'exception de deux d'entre eux, qui bénéficiaient d'un régime particulièrement avantageux : le secteur manufacturier situé en zone franche et celui des services et de la finance. Le taux d'impôt sur les sociétés qui s'appliquait à eux était de 10 %. Condamné par la Commission européenne, ce système va rapidement disparaître pour être remplacé par un régime à taux unique. A la suite de négociations avec la Commission, le gouvernement irlandais a fixé le taux de l'impôt sur les sociétés à 12,5% pour l'ensemble des secteurs et a organisé un régime transitoire assurant la sécurité juridique des entreprises bénéficiant du système antérieur. Les entreprises ayant conclu l'accord donnant droit au taux réduit avant le 1er juillet 1998 y seront encore soumises jusqu'en 2010 pour le secteur manufacturier, jusqu'en 2005 pour celui des finances et des services. Celles qui l'ont conclu après le 1er juillet 1998 continueront d'en bénéficier jusqu'en 2002. Le taux réduit d'impôt sur les sociétés a connu un succès particulièrement important dans le cadre de la plate-forme financière de Dublin, l'International Finance Center, qui permet des placements off shore à des conditions plus favorables encore qu'au Luxembourg et où l'impôt sur les sociétés est de 10 %. Dans le secteur de la finance, l'élément fiscal joue un rôle essentiel. L'impôt sur le capital Depuis 1998, le taux standard qui s'applique aux ventes immobilières de tous types est passé de 40 % à 20 %, à l'exception des terrains à bâtir pour lesquels il est resté inchangé. Les droits de timbre Ils sont perçus sur les transactions, au taux de 1 % pour celles concernant les actions, obligations et autres produits négociables, à des taux compris entre 0 et 9 % selon le montant de la transaction pour les propriétés immobilières non résidentielles. Un système d'aides plus vaste 1. Au niveau national a) Aides de l'Industrial Development Agency (IDA) Créé en 1967, l'IDA est chargée des activités de prospection et de promotion des entreprises à capitaux étrangers. Son assistance prend la forme d'allégements fiscaux et d'aides financières. Allégements fiscaux : · Impôt sur les bénéfices des sociétés réduit à 10 % garanti jusqu'au 31 décembre 2010. · Exemption d'impôts locaux et double déduction des frais de loyer pendant 10 ans pour les entreprises implantées dans l'International Financial Services Center (IFSC) de Dublin. · Amortissement accéléré des acquisistions de bâtiments et équipements neufs dans l'IFSC de Dublin et la zone franche de Shannon (jusqu'à 100 % la première année). · Dans certaines zones, situées principalement dans l'Ouest du pays, les impôts locaux peuvent être réduits de 2/3 pendant 10 ans. Dans les zones de développement urbain, les entreprises ont même la possibilité de se faire exempter en totalité des impôts locaux, comme c'est la cas à l'IFSC de Dublin. Aides financières : · Subventions en capital (modulées selon le nombre d'emplois créés, la localisation géographique, le degré de valeur ajoutée, le niveau d'exportation envisagé). Jusqu'à une période récente, le taux moyen d'aides était de 45 % et pouvait même atteindre 60 % du capital investi dans certaines régions défavorisées de l'Ouest du pays. De 26,5 % en 1987, le taux moyen est passé à 20 % en 1992, compte tenu des difficultés budgétaires du pays. · L'IDA peut également accorder des subventions pour la formation du personnel (jusqu'à 100 % s'il s'agit d'entreprises nouvelles, et jusqu'à 50 % s'il s'agit d'entreprises existantes) ; des subventions pour l'emploi (aide au titre des effectifs supplémentaires pouvant aller jusqu'à 24 semaines de rémunération) ; des subventions à la recherche et au développement (50 % des coûts directs du projet, avec un plafond) ; une subvention pour étude de faisabilité pour la conception de nouveaux produits ou la recherche de nouveaux marchés (50 % des coûts avec un maximum). Hormis les dispositions fiscales, qui sont de droit, l'IDA jouit d'une entière liberté (les aides font l'objet d'un accord bilatéral confidentiel avec chaque investisseur étranger) pour moduler ses aides en fonction de secteurs cibles prioritaires : industrie de haute technologie (électronique, informatique) et plus récemment services d'assistance téléphonique (call centers) et quartiers généraux européens de multinationales. Constatant une concentration des investissements dans la région de Dublin, l'IDA accorde maintenant une aide supérieure aux projets situés dans l'Ouest du pays. A cet égard, elle n'impose jamais de localisation et, autant qu'on le sache, laisse l'interlocuteur étranger devant des sites alternatifs. b) Forbairt Forbairt s'adresse quasi-exclusivement aux PME à capitaux irlandais. Ses activités sont celles d'une agence de développement classique : programmes de formation, transferts de technologie, accès aux marchés internationaux. Cet appui technique s'accompagne d'incitations financières. 2. Au niveau régional a) La Shannon Free Airport Development Company Cette agence, mandatée par l'État, assure la promotion et le développement industriel dans la région de Shannon où l'IDA n'intervient pas. Elle a mis en place différents programmes d'aides financières pour les entreprises s'y implantant : impôt sur les entreprises de 10 % jusqu'en 2010 pour les sociétés manufacturières, jusqu'en 2005 pour les sociétés de services (finance, distribution et conseil) ; aucune restriction sur le rapatriement des profits ; subventions pour les coûts de main d'_uvre, l'investissement, le loyer, la formation, la recherche et le développement. b) Udaras Na Gaeltachta (UNG) Cette agence est responsable de l'établissement et du développement de l'industrie dans la région de langue gaélique. L'IDA étant également compétente sur cette zone, l'UNG intervient dans les faits pour bonifier les conditions d'établissement. Elle participe au financement des bâtiments industriels, des machines, de la formation des capacités de gestion, de la recherche et développement et des études de faisabilité. En outre, l'UNG met à disposition des locaux à loyer subventionné (voire avec un période initiale sans loyer) et peut les adapter aux besoins particuliers d'une industrie Cliquer
ici pour revenir au sommaire du tome I En définitive, seul le désengagement des installations de stockage a effectivement eu lieu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||