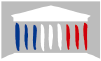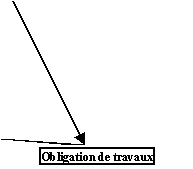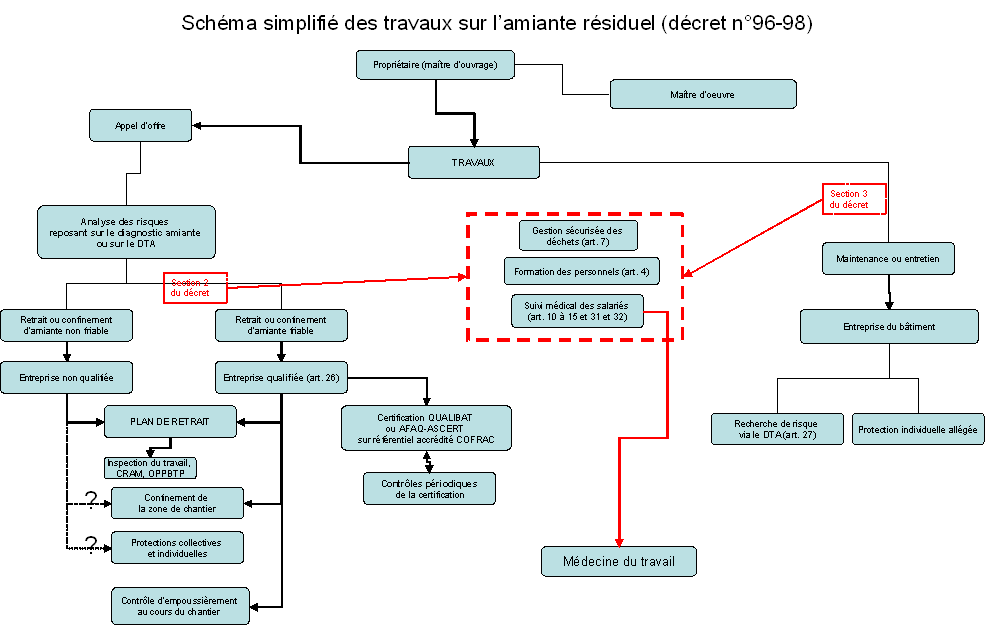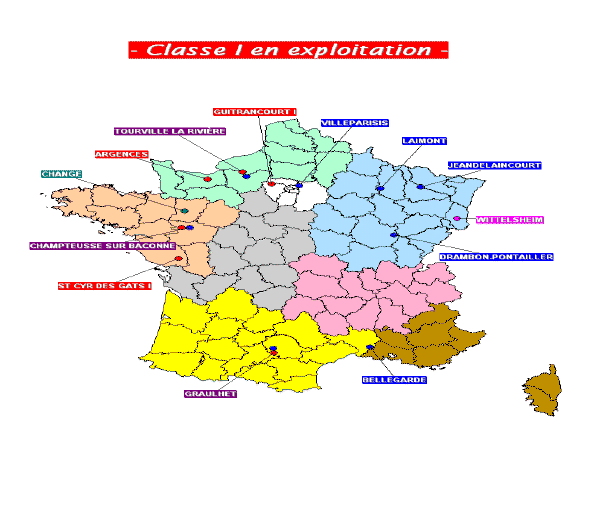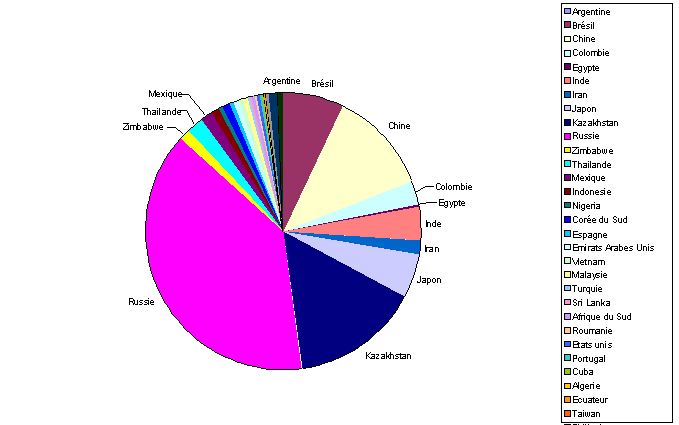_______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 février 2006 RAPPORT FAIT AU NOM DE LA MISSION D'INFORMATION (1) SUR LES RISQUES ET LES CONSÉQUENCES
Président M. Jean LE GARREC, Rapporteur M. Jean LEMIÈRE, Députés. -- TOME I RAPPORT (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. La mission d'information sur les risques et les conséquences de l'exposition à l'amiante, est composée de : M. Jean LE GARREC, Président ; MM. Jean-Marie GEVEAUX, Francis VERCAMER, Vice-présidents ; MM. Daniel PAUL, Patrick ROY, Secrétaires ; M. Jean LEMIÈRE, Rapporteur ; M. Gérard BAPT, Mme Sylvia BASSOT, MM. Ghislain BRAY, Antoine CARRÉ, Gérard CHARASSE, Roland CHASSAIN, Dino CINIERI, Alain CLAEYS, Louis COSYNS, Jean-Yves COUSIN, Mme Martine DAVID, M. Jean-Pierre DECOOL, Mme Catherine GÉNISSON, MM. Maurice GIRO, Maxime GREMETZ, Mme Marguerite LAMOUR, MM. Jean-Marie LE GUEN, Michel LIEBGOTT, Pascal MÉNAGE, Frédéric REISS, André SANTINI, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Philippe VITEL, Gérard WEBER et Michel ZUMKELLER. S O M M A I R E _____ Pages AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT 15 INTRODUCTION 19 REGARD SUR L'HISTOIRE DE L'AMIANTE EN FRANCE 23 A.- Une chronologie désormais bien établie 24 B.- Les grandes leçons de l'histoire de l'amiante 44 1.- Les dangers de l'amiante étaient connus de longue date 44 2.- L'amiante n'a fait l'objet d'une réglementation spécifique que très tardivement 45 3.- Les lacunes du contrôle de la réglementation relative à l'amiante étaient patentes 47 4.- Malgré la connaissance de la nocivité de l'amiante, la politique d'« usage contrôlé » n'était pas à l'époque une pratique anormale 48 5.- Le dossier de l'amiante a mis en évidence les faiblesses de l'épidémiologie en France 50 6.- L'amiante a démontré la nécessité d'une structure institutionnelle indépendante de veille et d'expertise 51 7.- La catastrophe de l'amiante a été trop souvent abordée en France sous le seul angle de la réparation 55 8.- L'interdiction de l'amiante a été tardive dans l'ensemble des États européens 56 9.- L'exemplarité de la gestion pragmatique du dossier de l'amiante par les pays anglo-saxons doit être relativisée 58 10.- L'amiante est un révélateur des difficultés de notre système judiciaire à examiner les responsabilités pénales lorsqu'il s'agit de problèmes de santé publique 60 11.- L'interdiction de l'amiante en France n'a pas réglé tous les problèmes 60 12.- L'interdiction de l'amiante au niveau international reste un enjeu pour le futur 61 PREMIÈRE PARTIE - L'HÉRITAGE DE L'AMIANTE EN FRANCE 63 I.- L'amiante en place dans les bâtiments doit être mieux traité 63 A.- Le cadre réglementaire du traitement de l'amiante en place : une organisation complexe mettant en jeu des acteurs nombreux et diversifiés 65 1.- Les règles de protection des populations 65 a) La diversité des diagnostics prévus par la réglementation 65 b) Les acteurs du diagnostic 70 2.- Les règles de protection des travailleurs 72 a) Toutes les interventions sur l'amiante sont réglementées 72 b) La protection des travailleurs varie selon la nature des travaux exécutés 73 B.- Un système de diagnostic coûteux, mal encadré, et sous-contrôlé 79 1.- Le diagnostic fait l'objet de nombreuses critiques 79 a) Les critiques tenant à l'absence de diagnostics 79 b) Les critiques tenant à la qualité des diagnostics 81 c) Le cas du repérage avant démolition d'immeuble 82 2.- La réglementation présente des faiblesses préoccupantes 84 a) La formation des opérateurs de repérage est insuffisante 84 b) Les modalités de réalisation des différents types de diagnostics présentent des lacunes. 88 3.- L'application de la réglementation est source de difficultés 95 a) L'application de la réglementation est mal contrôlée 96 b) L'évaluation de l'application de la réglementation a été trop tardive 98 C.- Le secteur du désamiantage est bien encadré, mais subit des coûts qui fragilisent le respect des contraintes réglementaires 100 1.- Une distinction discutable entre amiante friable et non friable 100 a) La distinction a des répercussions regrettables sur le marché du traitement de l'amiante en place 100 b) Une distinction à revoir 104 2.- Une prise en compte aléatoire et insuffisante des risques 108 a) La compétence et la qualification du maître d'ouvrage ou de son maître d'œuvre 109 b) La qualité des mesures d'empoussièrement 111 3.- La relative inefficacité des contrôles publics sur le secteur du traitement de l'amiante en place 113 a) Le contrôle par l'inspection du travail. 114 b) Le contrôle par la médecine du travail. 115 c) Le contrôle par la CNAMTS et les CRAM. 115 d) Les enquêtes de la Direction des relations du travail menées en 2004 et 2005 116 D.- LE secteur du bâtiment et de la maintenance est insuffisamment formé et en danger de contamination « inopinée » 119 1.- Une rencontre inopinée qui laisse peu de chance à la sécurité du travailleur : les différentes hypothèses 120 a) L'absence de diagnostic ou le diagnostic de mauvaise qualité 120 b) Le diagnostic de qualité standard 121 c) Le diagnostic de bonne qualité 123 2.- Une zone « grise » où les contrôles sont impossibles 125 a) Les obligations sont nombreuses 125 b) Mais le contrôle est impossible 126 E.- Les grandes difficultés des propriétaires publics à respecter leurs obligations réglementaires appellent un dispositif de soutien spécifique de la part de l'état. 129 1.- L'absence de vision d'ensemble du respect par les propriétaires publics de leurs obligations règlementaires. 129 2.- Le patrimoine géré par les collectivités territoriales appelle un dispositif national de soutien 132 F.- Une gestion des déchets défectueuse 137 1.- Le cadre règlementaire 137 a) Les différentes catégories de déchets 137 b) Le sort des déchets amiantés 138 c) Le transport des déchets amiantés 139 2.- Une situation qui n'est pas satisfaisante 140 a) Une réglementation qui n'est pas correctement appliquée 140 b) Une inadéquation entre la structure actuelle des centres de stockage et les besoins manifestés par les particuliers et les entreprises 141 c) Une innovation insuffisamment encouragée 147 d) Des élus locaux insuffisamment informés 148 e) Des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre à sensibiliser 149 G.- L'amiante à l'état naturel dans l'environnement : le cas de la nouvelle-calédonie 150 II.- La France doit agir au niveau international pour que cessent la production, la transformation et le commerce de l'amiante dans le monde 155 A.- L'amiante en Europe : un produit interdit 155 1.- La difficile interdiction de toutes les formes d'amiante en Europe 155 a) Les mesures nationales d'interdiction 155 b) La prudence des institutions communautaires 159 2.- Une législation communautaire globalement satisfaisante malgré certaines lacunes 161 a) La directive de 1999 sur l'interdiction de la mise sur le marché et de l'emploi de l'amiante et des produits en contenant 161 b) La directive de 2003 sur la protection des travailleurs face aux dangers de l'amiante 163 c) Un éparpillement administratif du traitement communautaire de l'amiante 167 B.- L'amiante dans le monde : des transferts massifs de risques vers les pays en voie de développement 169 1.- L'amiante est encore utilisé dans de nombreux pays 169 a) Aucun instrument juridique n'interdit l'amiante au plan mondial 169 b) Le marché mondial de l'amiante 174 2.- L'approche inquiétante du Canada et du Québec 177 a) L'amiante au Canada : un poids économique très faible... 177 b) ... mais un poids symbolique majeur 178 c) La promotion de l'usage sécuritaire de l'amiante 179 d) Une situation encore figée malgré certaines études préoccupantes sur la santé des Québécois 181 e) Un comportement critiquable 182 3.- Interdire l'amiante au niveau international 183 a) L'amiante dans le monde : une « bombe à retardement » 183 b) Les risques liés au démantèlement des navires : l'exemple du Clemenceau 185 b) Comment interdire l'amiante dans le monde ? 194 III.- La prise en charge des victimes de l'amiante 201 A.- Les maladies causées par l'inhalation de l'amiante sont aujourd'hui mieux connues et les malades médicalement mieux suivis. 201 1.- Les pathologies de l'amiante 202 a) Les pathologies bénignes 202 b) Les pathologies malignes 206 c) Mortalité associée à ces pathologies 211 2.- Le suivi médical des victimes 212 a) La surveillance médicale des salariés exposés 212 b) Le suivi médical post-professionnel 214 B.- Les mécanismes traditionnels de prise en charge des victimes ont montré leurs insuffisances dans le cas de l'amiante 220 1.- La réparation forfaitaire de droit commun des maladies professionnelles était trop faible 220 2.- Les recours juridictionnels vers lesquels se sont tournées les victimes les exposaient à des délais de procédure très longs 221 C.- Les dispositifs de préretraite destinés aux travailleurs de l'amiante 223 1.- Le dispositif du FCAATA 223 a) La vocation du FCAATA 224 b) Le montant de l'ACAATA 224 c) Le financement du FCAATA 225 d) L'organisation du FCAATA 225 e) L'expansion continue du FCAATA 227 2.- Les dispositifs spéciaux de préretraite liés à l'amiante 229 3.- Soumis à des exigences contradictoires, les mécanismes de préretraites liés à l'amiante suscitent de nombreuses critiques qui appellent des réformes substantielles 231 a) Le système du FCAATA souffre d'une organisation institutionnelle complexe 231 b) Le montant de l'ACAATA est faible 232 c) Le FCAATA a été souvent détourné de son objet et utilisé comme un instrument de gestion de l'emploi 233 d) Les dispositifs de préretraite sont mal coordonnés 233 e) Les dispositifs de préretraites sont particulièrement inégalitaires 234 f) Le coût global du FCAATA est exponentiel 237 g) La mission refuse de réserver le bénéfice de la cessation anticipée d'activité aux seules personnes malades 237 h) Les négociations autour de la pénibilité au travail ne sont pas le cadre approprié pour examiner la situation des personnes ayant été professionnellement exposées à l'amiante 238 i) Le système actuel des listes est une procédure lourde qui a montré ses limites 239 D.- L'indemnisation des victimes par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) 243 1.- Le législateur a fait le choix d'un dispositif spécifique et autonome 243 a) L'organisation du FIVA 243 b) La mise en place du FIVA 246 c) Modalités de fonctionnement 247 d) Les ressources du FIVA 250 2.- Le FIVA est chargé de la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes de l'amiante 251 a) Le principe de la réparation intégrale 251 b) Les procédures d'indemnisation 253 3.- Le FIVA connaît une réussite indéniable 255 a) Il indemnise de façon équitable l'ensemble des victimes de l'amiante et leurs ayants droits 255 b) La procédure est simple, rapide et peu coûteuse 259 c) Les risques de double indemnisation par le FIVA et la sécurité sociale sont aujourd'hui limités 260 d) Les dotations ont permis jusqu'ici de faire face aux dépenses d'indemnisation 260 4.- Le FIVA n'échappe pas à certaines critiques 261 a) Le FIVA n'a pas tari les recours contentieux 261 b) Les disparités d'indemnisation entre le FIVA et les tribunaux sont trop importantes 262 c) Le FIVA ne remplit pas ses obligations concernant les recours subrogatoires 269 d) Les dépenses du FIVA croissent à un rythme rapide et les réserves seront bientôt épuisées 272 DEUXIÈME PARTIE - LES LEÇONS À TIRER DE l'AMIANTE 275 I.- Le système de réparation des at-mp n'est plus adapté 276 A.- L'indemnisation des victimes de l'amiante affecte l'équilibre Financier de la branche at-mp 279 1.- La contamination par l'amiante s'inscrit dans un contexte général d'augmentation du nombre des maladies professionnelles 279 a) Le nombre d'accidents du travail diminue globalement 280 b) Le nombre des maladies professionnelles reconnues augmente rapidement 280 2.- Les fonds destinés à la prise en charge des victimes de l'amiante contribuent pour une part importante au déficit de la branche. 281 3.- La charge assurée par la branche AT-MP doit être révisée 282 a) Une partie du financement du FCAATA apparaît comme une charge indue 282 b) La part de l'Etat devrait être réévaluée et mieux définie 283 B.- La catastrophe sanitaire de l'amiante a été l'occasion d'une remise en cause des grands principes qui structurent la branche at-mp 285 1.- Le drame de l'amiante est à l'origine d'une remise en cause jurisprudentielle de l'immunité civile de l'employeur 287 2.- L'indemnisation des victimes de l'amiante a renforcé la contestation des modalités de réparation forfaitaire des AT-MP 287 a) Les modalités législatives et jurisprudentielles de l'indemnisation de l'amiante remettent en cause le principe de la réparation forfaitaire des AT-MP 287 b) La remise en question du compromis de 1898 à l'occasion du drame de l'amiante s'inscrit dans un contexte plus général 289 c) Au regard de ces évolutions, l'indemnisation des AT-MP apparaît de plus en plus injuste 290 C.- un constat unanime se dégage sur la nécessité de faire évoluer la réparation des at-mp vers une réparation intégrale 291 1.- Un accord de principe sur la nécessité d'évoluer vers la réparation intégrale malgré l'ambiguïté de la notion 291 a) Un accord unanime sur le principe de la réparation intégrale 292 b) Une notion ambiguë 292 c) L'évolution vers la réparation intégrale peut se faire selon des modalités variables 293 2.- Les limites de la réparation intégrale ne doivent pas être négligées 297 a) La réparation intégrale est susceptible de générer des inégalités 297 b) La réparation intégrale ne prend qu'imparfaitement en compte l'objectif de réinsertion 298 c) Il est nécessaire de maintenir une « pression » avec la faute inexcusable 298 e) Aucun pays en Europe n'accorde la réparation intégrale 300 f) Le coût de la réparation intégrale serait très élevé 300 3.- Un accord pourrait se faire sur une réparation forfaitaire améliorée au sein de la branche AT-MP et qui préserve les grandes lignes du compromis social de 1898 300 D.- Le système de la branche at-mp paraît excessivement mutualisé 301 a) Le financement de la branche AT-MP par la tarification est fortement mutualisé. 302 b) Les mécanismes de mise en œuvre de la faute inexcusable nuisent à la prévention et à la responsabilisation. 307 II.- l'affaire de l'amiante a soulevé le problème du droit de la responsabilité en matière de risques professionnels 309 A.- La question des « responsables de l'amiante » devant la justice 309 1.- Le procès de l'amiante a été porté devant tous les ordres de juridictions 309 a) L'indemnisation des victimes devant la justice sociale et civile. 309 b) La question de la responsabilité pénale des employeurs 310 c) La condamnation de l'Etat par la justice administrative. 313 2.- Les procès de l'amiante ont soulevé plusieurs questions juridiques de portée générale 315 B.- Une définition jurisprudentielle pragmatique mais déséquilibrée de la faute inexcusable 317 1.- Le régime légal de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles : un régime juridique dérogatoire aux principes généraux de la responsabilité civile 317 a) Un régime non contentieux 317 b) La définition de la faute inexcusable par le juge 318 c) La portée de la faute inexcusable. 319 2.- La redéfinition jurisprudentielle de la faute inexcusable : le manquement à « l'obligation de sécurité de résultat » de l'employeur 321 a) Un objectif de meilleure indemnisation des préjudices liés à l'amiante 321 b) L'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. 322 3.- Le rééquilibrage de la faute inexcusable et de l'immunité civile de l'employeur : une intervention souhaitable du législateur 325 a) Une jurisprudence d'opportunité dont les justifications indemnitaires devraient disparaître. 325 b) Distinguer le manquement à l'obligation de sécurité de résultat de la faute inexcusable de l'employeur 326 c) Requalifier la faute inexcusable de l'employeur : un impératif d'équité 327 d) La responsabilisation des acteurs par la sanction 330 C.- La place des parties civiles dans la recherche des responsabilités pénales en matière de risques professionnels 333 1.- La recherche croissante de la responsabilité pénale : une démarche compréhensible et nécessaire 334 a) Les régimes modernes de réparation incitent les victimes à rechercher la responsabilité pénale 334 b) Une action pénale nécessaire et fondée 336 c) Le droit à un recours juridictionnel effectif des victimes 338 2.- La recherche de responsabilités pénales se heurte aux règles et aux acteurs de la procédure pénale 340 a) L'incompréhension des victimes de l'amiante face à l'absence de jugement au fond tient en partie aux règles de la procédure pénale 340 b) L'action insuffisante des parquets, peu soucieux de santé publique 342 3.- Accroître le rôle des parquets et les moyens d'action des parties civiles 344 a) Une réponse de portée générale : la révision de l'article 575 du code de procédure pénale 344 b) Une réponse pragmatique et immédiate : un meilleur investissement des parquets dans les dossiers de santé publique, en général, et dans ceux de l'amiante, en particulier 350 D.- L'amiante pose la question du droit pénal applicable aux risques professionnels 357 1.- Les poursuites et les instructions en matière de risques professionnels s'inscrivent dans le cadre général issu de la « loi Fauchon » 358 a) La problématique générale des poursuites pénales dans les affaires concernant les risques professionnels 358 b) La difficile gestation du régime de responsabilité pénale issu de la loi Fauchon 362 c) Les difficultés d'application de la loi Fauchon 368 2.- La loi du 10 juillet 2000 doit être révisée 375 a) La révision ne doit pas remettre en cause le principe selon lequel la loi pénale est la même pour tous 376 b) La révision doit affirmer l'obligation de respecter les règles fixées par la loi ou le règlement 380 c) Une proposition équilibrée : sanctionner les manquements aux obligations particulières de prudence ou de sécurité 382 III.- La prévention des risques professionnels doit devenir une priorité de santé publique 389 A.- La fin d'un système de prévention depuis longtemps obsolète 390 1.- L'affaire de l'amiante : une sanction lourde du système français de prévention 390 a) Le drame de l'amiante traduit l'insuffisance des moyens classiques de prévention 390 b) La condamnation de l'Etat a confirmé le diagnostic connu d'une carence de la politique de santé au travail 395 2.- La faillite d'un système gouverné par l'objectif de réparation 400 a) Une logique de réparation qui a montré ses limites 401 b) Des acteurs, aux missions limitées, qui n'ont pas pu prévenir les risques 405 B.- Les principes modernes de prévention des risques professionnels exigent une responsabilisation de l'Etat 411 1.- Le passage d'une logique de réparation à une logique de la prévention du risque impose une nouvelle répartition des responsabilités 412 a) Éviter que le risque professionnel ne se réalise : une démarche nouvelle 412 b) Les décisions de justice tracent un nouveau partage des responsabilités de l'Etat et des acteurs privés 416 2.- L'Etat doit être responsable de l'expertise des risques et garant de leur gestion 419 a) Séparer l'expertise et la gestion des risques 419 b) Consacrer la santé au travail comme une responsabilité de santé publique 423 C.- Quels outils pour améliorer la prévention des risques professionnels ? 428 1.- La construction européenne d'une doctrine de la prévention oblige l'Etat à se doter d'outils performants 428 a) Des principes aux modalités : le dispositif REACH 428 b) La priorité : être au rendez-vous des enjeux sanitaires fixés par l'Europe 432 2.- Le Plan santé au travail : une réponse adaptée mais encore incomplète 438 a) Une évaluation des risques indépendante mais atrophiée 438 b) Une articulation trop théorique entre acteurs public et privés dans la gestion des risques professionnels 451 CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS 461 CONTRIBUTIONS 483 GLOSSAIRE 497 ANNEXES 505 « Aux victimes de l'amiante et des autres maladies professionnelles Tout au long de ses travaux, la mission a gardé en tête les termes de M. Sargos, président de la chambre sociale de la Cour de Cassation qui a parlé de « crime sociétal » pour désigner le drame de l'amiante. Pour comprendre et tirer les leçons de ce drame, la mission a eu le souci de regarder l'histoire de l'amiante, non pas avec les connaissances d'aujourd'hui, mais avec le regard « hésitant » qui a été celui de toute l'Europe, y compris de la France. Il a fallu beaucoup de temps - même si les dangers de l'amiante étaient déjà connus - pour mettre en place un « usage contrôlé » de l'amiante. Partout, cet usage contrôlé a été la première réponse des autorités aux dangers du « produit miracle » et c'est aujourd'hui encore la seule réponse dans beaucoup de pays, y compris dans certains États développés, comme le Canada. Dans des pays comme l'Angleterre ou les États-Unis qui ont installé l'usage contrôlé de l'amiante avant la France, la courbe des malades tend maintenant à descendre. Dans notre pays, cette politique n'a été mise en place qu'en 1977 et il nous est encore impossible aujourd'hui d'en mesurer les conséquences. Au contraire, la courbe croissante des cas de contamination correspond actuellement, en France, à l'utilisation massive qui a précédé les premières mesures de protection. On sait maintenant que l'arme absolue est bien l'interdiction. Mais ce n'est que face au développement du nombre des malades que les pays ont pris la mesure de la catastrophe et se sont dirigés, en ordre dispersé, vers des mesures d'interdiction. Dans ce « crime sociétal », la dimension psychologique n'a pas été suffisamment prise en compte. Le mésothéliome, dont le lien exclusif avec l'amiante est établi, est une maladie terrible. Une fois que le cancer s'est déclaré, la durée de vie est courte À travers ses travaux, la mission a pu mesurer la pression psychologique qui en résulte chez les salariés exposés. Ils voient tomber leurs compagnons et parfois même leur famille et ceux qui sont atteints de plaques pleurales, dont on sait pourtant qu'elles ne conduisent pas nécessairement à un cancer, vivent cette affection comme une épée de Damoclès. C'est en partant de ce regard sur l'histoire et sur les victimes que notre mission a voulu examiner tous les aspects du drame de l'amiante, tels qu'ils résultent de l'utilisation massive du produit après la deuxième Guerre mondiale, au moment de la reconstruction et du développement du pays. Premier souci : éviter de nouvelles victimes. La mission s'est donc d'abord intéressée à l'amiante en place - environ 80 kilos par personne, si l'on tient compte des importations jusqu'en 1997 - qu'il faut repérer et gérer, car c'est un risque de santé au travail et de santé publique. La mission a également fait le point des connaissances scientifiques sur les maladies liées à l'amiante et a évalué le dispositif de prise en charge des victimes, tant du point de vue de la réparation des dommages que du point de vue du suivi médical pour les victimes potentielles. Elle a aussi voulu savoir comment l'amiante est géré au niveau international car l'usage intensif qui se poursuit ailleurs est une « bombe à retardement ». À cet égard, les péripéties du Clemenceau, qui ont marqué la fin des travaux de notre mission, se sont inscrites à double titre dans la logique de notre démarche : gérer l'amiante qu'on a utilisé et agir au niveau international pour éviter de nouvelles victimes. Au-delà du problème de l'amiante, et pour le nécessaire hommage à la mémoire des victimes, la mission a voulu prendre en compte ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait pour se projeter dans un avenir qui est caractérisé par l'accélération des rythmes technologiques et où la dominante est désormais la multiplication des maladies professionnelles. De ce point de vue, le drame de l'amiante a révélé que le système de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est inadapté car injuste et qu'il doit évoluer vers une meilleure indemnisation. De même, il est évident qu'à l'analyse, les besoins de la recherche, de la prévention, de la médecine du travail - structure fondamentale et particulière à la France -, ne sont pas à la hauteur des besoins. Le constat de la mission est qu'il faut placer la santé au travail au cœur de la santé publique. C'est dans ce sens que la mission a travaillé et c'est aussi l'objectif de ses propositions. Il était aussi indispensable d'aborder le problème difficile de la dimension pénale du dossier de l'amiante. Beaucoup de ceux que la mission a entendus ont clairement déclaré qu'ils ne voulaient pas « que les têtes tombent », mais qu'ils voulaient comprendre pour éviter que d'autres drames ne se produisent. C'est à cette attente que doivent répondre les propositions de la mission sur l'amélioration et la simplification des procédures pénales. Cette recherche a moins pour objet de désigner des coupables que de mieux cerner les difficultés auxquelles se heurtent les victimes et les juges : temps de latence des maladies, manque de traçabilité, irrégularité des carrières. Cette dimension est très importante pour ceux qui souffrent mais aussi pour faire face au problème du développement des maladies professionnelles. La mission aurait pu continuer à travailler beaucoup plus longtemps, et ses travaux devront être relayés par ceux du groupe d'études de l'Assemblée nationale sur l'amiante. De même, il existe une multitude de textes, de rapports, d'ouvrages divers sur l'histoire de l'amiante et la mission a la modestie de penser que ses travaux ne suffiront pas à résoudre tous les problèmes. Mais si, grâce à la rigueur et à la volonté de tous ses membres, elle a réussi à cerner l'ensemble des problèmes, à développer un regard le plus objectif possible sur ce dossier, et à mieux préparer l'avenir, elle aura répondu à la nature de sa mission. « Nous ne connaissons pas le vrai Le champ d'investigation de la mission a été défini à l'unanimité par le Bureau de la mission autour de six thèmes : - la gestion de l'amiante en place, - l'état des connaissances scientifiques sur les risques et les maladies liés à l'amiante, - la prise en charge des victimes, - la prévention des risques, - la question de la responsabilité civile et pénale - et la gestion internationale du dossier. Les travaux de la mission ont été organisés sur cette base mais ils ont très rapidement permis de constater que le drame de l'amiante avait été le révélateur d'un certain nombre de problèmes dépassant la seule problématique de l'amiante. Dans la logique de sa démarche, davantage axée sur l'avenir que sur le passé, l'objectif de la mission a été non seulement d'éviter que l'amiante ne fasse d'autres victimes mais aussi d'en tirer des leçons, principalement dans le domaine de la santé au travail. Après un regard préliminaire sur l'histoire de l'amiante, le plan du présent rapport répond à cette logique en développant dans une première partie ce que la mission a appelé « l'héritage de l'amiante » et dans une seconde partie les leçons à tirer de ce drame. Par « héritage », il faut en premier lieu entendre la gestion de l'amiante en place : celui qui résulte de l'utilisation massive du produit « miracle » avant son interdiction en 1997. Dans ce chapitre, la mission a souhaité évaluer l'ensemble de la réglementation mise en place dans notre pays pour encadrer toute la chaîne de gestion de l'amiante - repérage, traitement de l'amiante et gestion des déchets - aussi bien dans le privé que dans le public, notamment, pour ce dernier, à partir de deux tables rondes et d'un questionnaire adressé aux collectivités locales (I). L'« héritage », c'est aussi l'analyse de la situation au niveau international. Si l'amiante est désormais interdit au sein de l'Union européenne L'héritage de l'amiante, c'est enfin, bien entendu, la prise en charge des victimes de l'amiante. La connaissance des risques liés à l'amiante a-t-elle évolué depuis le rapport de l'INSERM de 1996 ? Les caractéristiques des maladies de l'amiante sont-elles parfaitement connues ? Les populations exposées sont-elles bien identifiées et bien suivies sur le plan médical ? Le fonctionnement des dispositifs spécifiques de prise en charge des victimes - FIVA et FCAATA - La seconde partie du rapport a été consacrée aux leçons à tirer du drame de l'amiante. L'affaire de l'amiante semble avoir remis en cause le compromis social de 1898 sur lequel repose le dispositif de réparation des dommages liés au travail. D'abord en créant des fonds d'indemnisation spécifiques pour sortir du principe de la réparation forfaitaire et améliorer la prise en charge des victimes. Ensuite en remettant en cause le principe de l'immunité civile des employeurs par l'élargissant du champ de la « faute inexcusable » de l'employeur avec les arrêts de la Cour de cassation de 2002. Désormais, l'indemnisation forfaitaire de la branche AT-MP se révèle beaucoup moins intéressante que les indemnisations susceptibles d'être obtenues par la voie judiciaire. Elle parait également injuste par rapport au mode d'indemnisation de tous les autres dommages. D'où le risque d'une multiplication des recours judiciaires et l'idée qu'il faudrait peut-être réviser le mode d'indemnisation des maladies professionnelles. En même temps, une généralisation de la réparation intégrale des risques professionnels dans un cadre mutualisé aurait un coût considérable et pourrait déresponsabiliser à outrance les employeurs, surtout dans un contexte marqué par le développement des maladies professionnelles. À partir de ce constat, la mission s'est posée la double question de savoir comment faire évoluer la branche AT-MP et le régime de responsabilité civile des employeurs. Par ailleurs, la mission a très vite constaté que les procédures pénales engagées par les victimes de l'amiante posaient problème. Elle a cherché à savoir pourquoi les parquets avaient tant de mal à instruire le dossier, pourquoi toutes les procédures débouchaient sur des non lieux. Ces travaux l'ont conduite à examiner les difficultés d'application de la loi « Fauchon » sur les délits non intentionnels, la place des victimes dans les procédures pénales. Les chapitres I - relatif à l'avenir du système de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles - et II - relatif au régime de responsabilité en matière de risques professionnels - de la seconde partie du rapport retracent les travaux de la mission sur ces différents points. Enfin, l'histoire de l'amiante pose bien entendu le problème de la prévention des risques professionnels dans notre pays. La mission s'est appuyée sur les enseignements de l'affaire de l'amiante pour analyser la capacité du dispositif actuel à éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Ces travaux qui sont intervenus dans un contexte de changement marqué, notamment, par la mise en place du « Plan santé au travail 2005-2009 » et par le programme européen REACH, font l'objet du chapitre III de la seconde partie du présent rapport. REGARD SUR L'HISTOIRE DE L'AMIANTE EN FRANCE L'historique précis des différentes étapes de ce drame en France est désormais bien connu, notamment grâce aux nombreux rapports et publications qui lui ont été consacrés1 et qui se sont penchés avec force de détails sur le passé et l'examen rétrospectif des erreurs dans ce dossier de santé publique. Chacun sait désormais qu'à une utilisation croissante de l'amiante dès le début du vingtième siècle en raison de ses qualités exceptionnelles - qui culmine en 1973 - succède, à partir de 1977, une phase « d'usage contrôlé » qui marque une prise de conscience de ses conséquences en matière de santé publique mais dont on ne tire pourtant toutes les conséquences qu'avec la décision d'interdiction totale à partir du 1er janvier 1997. L'histoire de l'amiante n'est donc plus une zone d'ombre. C'est la raison pour laquelle la mission, dès le début de ses travaux, n'a pas souhaité concentrer prioritairement ses travaux sur l'aspect historique du dossier, sans, bien entendu, l'ignorer car l'histoire est ici, comme toujours, riche d'enseignements. Habitée par le souci de resituer de la façon la plus objective possible les faits dans toute leur complexité, sans occulter pour autant la réalité des souffrances liées aux conséquences de l'exposition à l'amiante, ni atténuer les multiples responsabilités, la mission a souhaité mettre en relief ce que doivent être, selon elle, les grandes leçons de l'histoire de l'amiante. L'examen du passé doit s'efforcer d'éviter tout anachronisme - « le péché des péchés » selon Lucien Febvre - qui consisterait, par exemple, à considérer que la prise en compte de la maladie au travail n'a pas évolué au cours des siècles, que la perception des risques environnementaux a de tout temps été celle, particulièrement aiguë, qui nous habite aujourd'hui ou que le principe de précaution, qui n'a pourtant été introduit dans notre Constitution qu'en 2005, a toujours imprégné la conscience des décideurs publics. L'examen du passé doit également écarter toute vision simplificatrice du dossier selon laquelle tous les acteurs - publics comme privés - seraient mystérieusement restés des décennies durant silencieux et sans réponse face à un danger mortel pourtant avéré de longue date, ou selon laquelle l'amiante serait l'« idéal-type » d'une manipulation industrielle particulièrement bien orchestrée par un lobby efficace. À s'en tenir à de tels raccourcis, on risquerait en définitive de faire de ce drame un précédent tellement extraordinaire et hors norme qu'on pourrait le croire unique et qu'on oublierait d'en tirer des leçons pour l'avenir. Il est donc essentiel de ne pas se fonder sur un diagnostic erroné ou réducteur qui pourrait compromettre l'objectif que s'est fixé la mission de contribuer à éviter la reproduction d'un tel drame. Or, comme l'a souligné avec force M. Marcel Goldberg2 « le scénario de l'amiante peut parfaitement se reproduire demain avec un autre produit ». C'est sur la base d'une analyse objective du passé que l'on pourra utilement en tirer les leçons pour l'avenir mais c'est également ainsi que l'on rendra le meilleur hommage aux victimes3. A.- UNE CHRONOLOGIE DÉSORMAIS BIEN ÉTABLIE Les graves conséquences de la contamination par l'amiante en matière de santé publique ne s'appréhendent qu'imparfaitement au travers d'une chronologie, aussi complète soit-elle, car l'enchaînement des dates ne peut, à lui seul, rendre compte de la somme de souffrances personnelles, familiales et collectives qui scandent l'histoire des victimes de l'amiante, qu'il s'agisse des milliers de victimes passées ou des 50 000 à 100 000 morts4 annoncés pour les vingt-cinq ans à venir. Pourtant, l'utilité de la chronologie est évidente, ne serait-ce que pour mettre les évènements en perspective dans un dossier où le temps joue un rôle tout particulier. L'amiante s'inscrit dans le temps « long », en raison de l'ancienneté des connaissances concernant sa dangerosité mais aussi en raison de la spécificité des temps de latence, extrêmement élevés, de certaines des pathologies qui y sont associées : de 30 à 40 ans entre l'exposition aux fibres et l'apparition des premiers signes cliniques. Temps « long », mais aussi temps « court », car l'amiante est dramatiquement associé à l'extrême brièveté de l'espérance de vie de certaines de ses victimes, souvent limitée à quelques mois lorsqu'une maladie comme le mésothéliome est diagnostiquée. C'est pourquoi la mission a souhaité joindre à ses travaux un tableau synoptique présentant à la fois les principaux événements de l'histoire de l'amiante, l'évolution de la connaissance du risque et les principales mesures de prévention et d'indemnisation du risque amiante, tant en France qu'à l'étranger. L'objectif est d'en tirer un enseignement aussi objectif que possible pour l'avenir.
- 43 - B.- LES GRANDES LEÇONS DE L'HISTOIRE DE L'AMIANTE Sur la base d'une analyse aussi objective que possible du passé, la mission a souhaité dégager pour l'avenir les grandes leçons de l'amiante. 1.- Les dangers de l'amiante étaient connus de longue date La chronologie met en lumière avec une force particulière l'ancienneté de la connaissance scientifique relative aux risques afférents à l'inhalation des poussières d'amiante. Pour s'en tenir à la France, on fait généralement remonter la prise de conscience des dangers de l'amiante à la note publiée en 1906 dans le Bulletin de l'Inspection du travail par M. Denis Auribault, inspecteur départemental du travail à Caen, sur l'hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filages et tissages d'amiante. Dès cette époque, les dangers de l'amiante étaient donc connus. Toutefois, la lecture attentive de ce rapport précurseur permet de relativiser quelque peu le caractère alarmiste qu'on lui prête habituellement puisqu'il se termine par l'affirmation, presque rassurante, selon laquelle « ce rapide exposé a montré le danger des poussières d'amiante et la possibilité de les évacuer totalement dans les filatures et tissages » et se limite à prescrire que « cette catégorie d'industrie devrait être inscrite au tableau C annexé au décret du 13 mai 18935 ; les enfants au dessous de 18 ans ne pourraient être employés dans lesdits ateliers que sous la condition expresse d'une captation des poussières ». Il n'en demeure pas moins, comme l'a rappelé6 Mme Emmanuelle Prada-Bordenave, que l'amiante est un produit « dont les caractéristiques et les dangers étaient connus de longue date » [...] « d'une façon assez certaine dès le début du vingtième siècle ». En effet, médicalement, le lien entre amiante et cancer est scientifiquement connu depuis 1935, et le lien entre amiante et mésothéliome depuis 1960. Toutes ces dates montrent que les risques sanitaires associés à l'amiante étaient connus depuis longtemps et qu'il aurait certainement été possible d'agir plus rapidement afin d'en prévenir les désastreuses conséquences. 2.- L'amiante n'a fait l'objet d'une réglementation spécifique que très tardivement Jusqu'à la publication du décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la France a tardé à mettre en œuvre des mesures réglementaires de prévention propres aux dangers de l'amiante. Ainsi, Mme Emmanuelle Prada-Bordenave a bien mis en évidence7 le fait que « l'État n'a pris aucune réglementation des usines d'amiante, alors même - et c'est le fait le plus troublant - qu'il en prenait beaucoup d'autres dans nombre d'autres secteurs ! Les anciennes éditions du code du travail fourmillent de réglementations, anciennes et très précises, applicables à certains métiers réputés dangereux. On connaît la réglementation des mines, établie par le service des Mines chargé depuis une loi de 1810 de protéger les mineurs, mais il en existe également une, particulièrement détaillée, sur le travail des ouvriers de la porcelaine de Limoges, qui remonte à un arrêté ancien, ou encore celle, à peine plus récente, applicable aux ateliers utilisant de l'arsenic et susceptibles de diffuser des poussières d'arsénieux... Dans tous ces cas extrêmement particuliers, l'État a su prendre une réglementation précise, peu volumineuse du reste, affichée dans les locaux et obligatoirement communiquée au travailleur dont la vigilance est donc attirée sur le fait qu'il travaille dans un milieu présentant un risque et qu'il doit se plier à des mesures de prévention simples ». Pourtant, les premières règles limitant l'empoussièrement étaient intervenues en Grande-Bretagne dès 1931 et aux États-unis dès 1946. Ce retard apparaît d'autant plus étonnant que les modifications successives du tableau n° 30 des maladies professionnelles en 19458 (apparition d'une nouvelle forme de silicose : « la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant (...) de l'amiante »), en 19509 (cette nouvelle forme de silicose reçoit le nom d'asbestose) et en 197610 (le tableau s'enrichit de deux nouvelles maladies liées à l'amiante, le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire) montraient qu'il y avait bien un danger particulier de l'amiante que l'Etat, lui-même, mettait en relief. Il serait toutefois erroné d'en conclure qu'aucune réglementation n'existait avant 1977 pour prévenir les dangers des poussières d'amiante. Dès 189311, une loi fut en effet votée pour protéger les travailleurs contre les poussières industrielles. Ces dispositions n'étaient pas, il est vrai, spécifiques à l'amiante mais il n'en demeure pas moins qu'elles avaient vocation à s'appliquer à ses poussières. Le fameux rapport Auribault de 1906 sur l'usine de filature et de tissage d'amiante établie dans le voisinage de Condé-sur-Noireau (Calvados) observe que les nombreux décès - une cinquantaine d'ouvriers et d'ouvrières de l'ouverture de l'usine en 1890 à 1895 - imputables à l'amiante ont eu lieu au cours des cinq premières années de marche où « aucune ventilation artificielle n'assurait l'évacuation directe des poussières siliceuses produites par les divers métiers » et impute ces décès à une « inobservation totale des règles d'hygiène », règles que la loi de 1893 avait justement pour objet de mettre en oeuvre. À ce sujet, le président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, M. Pierre Sargos, a d'ailleurs déclaré12 que l'« on peut penser que la tragédie de l'amiante aurait fait moins de victimes si ces textes avaient été scrupuleusement appliqués par les industriels », mettant ainsi en lumière l'ancienneté du problème de l'application des réglementations relatives à l'amiante. 3.- Les lacunes du contrôle de la réglementation relative à l'amiante étaient patentes Il est évident que tant la réglementation du 12 juin 1893 sur l'évacuation des poussières industrielles que celle de 1977 sur les mesures particulières d'hygiène applicables aux personnels exposés aux poussières d'amiante n'ont pas fait l'objet d'un contrôle efficace de la part de l'Etat. C'est ce qu'a encore rappelé Mme Prada-Bordenave13 « non seulement l'État a une obligation de réglementation des conditions de travail, mais il est également tenu de vérifier l'application de sa réglementation. Cette deuxième obligation avait déjà été explicitée par la loi de 1874 qui a créé un corps d'inspecteurs du travail, bras armé doté par les textes de pouvoirs considérables - ils peuvent entrer dans les usines de jour comme de nuit -, afin que l'État puisse surveiller l'application de sa réglementation de protection des travailleurs » pour immédiatement constater que « l'État n'a jamais utilisé les moyens dont il disposait pour vérifier que la réglementation qu'il avait prise garantissait une protection suffisante des travailleurs ». Cette « culture » d'absence de contrôles, soit par excès de confiance dans la capacité de la loi ou du règlement à prohiber, à eux seuls, certains comportements, soit par manque des moyens de contrôle, n'a peut-être pas totalement disparu. Il suffit de constater qu'il a fallu attendre 200414 et 2005 pour que soient lancées des campagnes nationales de contrôle des chantiers de désamiantage. Ces enquêtes ont d'ailleurs mis en évidence de graves lacunes dans le respect des règles de sécurité sur les chantiers de désamiantage. Lors de son audition du 24 janvier 2006, M. Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, a d'ailleurs confirmé qu'il importait de « mener une réflexion en profondeur sur les moyens de contrôle que l'État peut engager pour s'assurer du respect des règles de sécurité dans les entreprises ». 4.- Malgré la connaissance de la nocivité de l'amiante, la politique d'« usage contrôlé » n'était pas à l'époque une pratique anormale Il est peut-être un peu simpliste ou réducteur d'aborder le dossier de l'amiante sous le seul angle de la question de savoir « si on connaissait ou non » de longue date la nocivité de l'amiante ou de condamner l'usage contrôlé à partir du moment où les dangers du produit étaient connus. En effet, l'usage contrôlé, accompagné de mesures de fixation de seuils limites appropriés aux risques, est un principe couramment appliqué aux produits et substances dangereux. Au cours de son audition, M. Jean-Luc Pasquier, ancien ingénieur de sécurité de la Direction des relations du travail (DRT) dont il a dirigé le bureau santé au travail de 1984 à 1994, représentant de la DRT au Comité permanent amiante et actuellement directeur délégué à la formation à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), a interpellé15 les membres de la mission en ces termes : « nous sommes tous, et vous êtes tous, mesdames, messieurs les députés, des défenseurs de l'usage contrôlé : vous tolérez que l'on continue d'utiliser le chlorure de vinyle monomère pour fabriquer vos bouteilles d'eau minérale ; vous tolérez que l'on mette du benzène dans l'essence, alors que ce produit est hautement cancérogène ; vous êtes pour l'usage contrôlé des hydrocarbures insaturés, qui constituent l'essentiel des produits chimiques que nous utilisons. De même, personne ne remet en cause l'utilisation du nucléaire pour produire de l'électricité. Certains s'y opposent certes, mais globalement, l'utilisation des rayonnements ionisants a l'assentiment de notre corps social. Nous sommes donc tous favorables à l'usage contrôlé d'un certain nombre de produits qui sont des cancérogènes avérés ». De la même façon, M. Patrick Brochard16, pneumologue, professeur de médecine du travail et responsable de l'unité de pathologie professionnelle du CHU de Bordeaux, a souligné que « la question posée était d'accompagner l'utilisation de ces matériaux - dont on savait, depuis 1977 au moins, qu'ils étaient classés comme cancérogènes certains - dans une logique de développement de l'industrie au sens large, de la même façon que l'on continue aujourd'hui à utiliser du benzène ou des radiations ionisantes, eux aussi cancérogènes certains, la société ayant décidé qu'elle acceptait de les utiliser en s'entourant des précautions ad hoc ». La question est donc moins celle de la connaissance de la nocivité que celle des conséquences qu'on en tire. Force est de constater que les alertes d'experts français n'ont pas été si nombreuses avant l'expertise collective de l'INSERM de 1996 sur les « effets sur la santé des principaux types d'exposition à l'amiante » et que les recommandations d'interdiction de l'amiante n'ont vu le jour en France que très tardivement, peu de temps en définitive avant l'interdiction totale de janvier 1997. Le professeur Jean Bignon par exemple, qui a pourtant été le premier à alerter le Premier ministre de l'époque, Raymond Barre, par lettre en date du 5 avril 1977 pour appeler son attention sur le fait qu'« actuellement, la France est le seul pays du monde occidental à ne pas avoir de réglementation pour l'utilisation industrielle de l'amiante » et pour souligner que « l'amiante est un cancérigène physique dont l'étendue des méfaits chez l'homme est actuellement bien connue », n'en a pas pour autant tiré la conséquence qu'il fallait interdire l'amiante. Il s'est limité à recommander dans la même lettre que « seule, une prévention efficace, contrôlant toutes les sources d'émission des fibres d'amiante, devrait permettre de réduire cette pollution et d'éviter des conséquences plus graves sur la santé publique pour les trente années à venir ». Dans son audition du 27 septembre 2005, M. Jean-Luc Pasquier a également fait valoir que « c'est récrire l'histoire que d'affirmer que les scientifiques ont alerté les pouvoirs publics et demandé l'interdiction de l'amiante ». Il a encore indiqué que, lorsqu'il a pris connaissance en novembre 1994 d'un article signé sur l'amiante d'un expert britannique17, il a demandé au directeur des relations du travail de réunir les meilleurs spécialistes, ce qui a été fait le 20 décembre 1994 : des membres de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), M. Pézerat, M. Ameille, M. Fournier, M. Goldberg. Or, « les conclusions de cette réunion n'étaient pas la recommandation d'interdire l'amiante, mais celle de renforcer la réglementation et de demander à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) de procéder à une évaluation collective ». C'est dire que si la nocivité de l'amiante était effectivement bien connue, et de longue date, les conséquences à en tirer ne s'imposaient peut-être pas à l'époque avec une évidence aussi flagrante que certains l'affirment aujourd'hui. Ce n'est que lorsque l'épidémiologie a mis en évidence la gravité et le nombre des pathologies liées à l'amiante que l'idée de l'interdiction de l'amiante a pu s'imposer avec force. 5.- Le dossier de l'amiante a mis en évidence les faiblesses de l'épidémiologie en France Le professeur Goldberg a souligné18 les faiblesses de l'épidémiologie des risques professionnels en France, en rappelant que le constat est accablant : « Rapportée à la population, la production scientifique française dans le domaine de l'épidémiologie est quinze fois plus faible que celle des Pays-Bas... Autrement dit, les Hollandais publient quinze fois plus que les Français en épidémiologie dans les journaux internationaux. Nous sommes très en retard d'une façon générale ; et dans le domaine plus particulier de l'épidémiologie des risques professionnels, nous avons été très mauvais, en tout cas pendant très longtemps. Lorsque l'expertise collective concernant l'amiante a été réalisée par l'INSERM en 1996, nous avons relu l'ensemble de la littérature consacrée à l'épidémiologie ; sur les centaines d'études analysées, nous n'avons trouvé qu'une seule étude française publiée sur l'exposition aux risques professionnels... ». De son côté, Mme Emmanuelle Prada-Bordenave a fait le même constat19 : « notre pays est coupable de n'avoir pas suffisamment honoré les personnes qui s'occupaient de santé publique, pourtant considérée comme un problème majeur pendant toute la première moitié du XXe siècle - du temps où sévissait la tuberculose ». Pourtant, l'épidémiologie est fondamentale pour détecter l'émergence d'un problème de santé publique. C'est, par exemple, l'étude de l'épidémiologiste britannique Julian Peto, publiée en mars 1995 dans The Lancet qui a permis de mettre en évidence l'importance du nombre de mésothéliomes en Grande-Bretagne (« 3000 morts par an au Royaume Uni ») et l'extension du phénomène, bien au-delà des seuls ouvriers des usines de transformation, à des dizaines d'autres professions, notamment les ouvriers du bâtiment. Il a pourtant fallu attendre 1998 pour que soit mis en place le Programme national de surveillance du mésothéliome (PNSM), alors qu'un registre spécial des mésothéliomes existait depuis 1968. Ce PNSM constitue le premier véritable programme de surveillance épidémiologique d'un risque professionnel à l'échelle du pays. De même, l'Institut national de veille sanitaire (IVS), chargé de renforcer la veille sanitaire et le contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, n'a été créé qu'en 1998. 6.- L'amiante a démontré la nécessité d'une structure institutionnelle indépendante de veille et d'expertise Le Comité permanent amiante (CPA), officiellement créé en 1982 à l'initiative de M. Dominique Moyen, directeur général de l'Institut national de recherche et de sécurité, a longtemps été la seule structure informelle d'expertise au sein de laquelle étaient examinées les diverses thématiques relatives à l'amiante. Il a souvent été présenté comme le « lobby des industriels de l'amiante ». Pourtant, s'il n'est pas douteux que les industriels de l'amiante ont bien essayé d'utiliser le CPA pour faire valoir leurs intérêts et tout aussi vraisemblable qu'« il y a bien eu, au début, des personnes de mauvaise foi qui ont sciemment manipulé le Comité permanent amiante20 », il faut rappeler que le CPA était loin d'être composé uniquement d'industriels de l'amiante. Il regroupait également des représentants de l'Institut de la consommation, du ministère du travail, du ministère de la santé, du ministère de l'environnement, de la CFDT, de la CGT, de la CGC et de l'INSERM. Tant le professeur Got que Mme Emmanuelle Prada-Bordenave ont d'ailleurs souligné la présence, parmi ses membres, de personnes de « bonne foi ». S'agissant du syndicat FO, qui est souvent présenté comme le seul syndicat à n'avoir jamais souhaité participer au CPA, on peut noter que le procès-verbal de la réunion du CPA en date du 15 mars 85 compte M. Olivier au nombre des présents et mentionne que « le Comité se déclare très heureux de la demande formulée par la CGT-FO de prendre part à ses travaux et accueille M. Roger Olivier de la Fédération de la céramique qui représentera FO ». Il est vrai en revanche que le procès-verbal du 9 décembre 1986 indique que « depuis de nombreux mois, M. Olivier n'a pas participé aux réunions et ne s'est manifesté d'aucune façon ». Par ailleurs, on notera que lors du retrait de la CGT du CPA (le 25 septembre 1995), ses deux représentants ont souligné « la qualité du travail accompli depuis 1987 et souhaitent que ce qui a été fait ne soit pas perdu ». En prenant connaissance des comptes-rendus du CPA21, la mission a effectivement été surprise de constater que le bilan de ses travaux était objectivement plus mitigé que la présentation qui en est faite habituellement. Le CPA a en effet contribué d'une certaine manière à l'information et à la mise en œuvre de mesures concrètes destinées à minimiser les conséquences dramatiques de l'amiante. Certaines de ses prises de position en matière de prévention des risques étaient même assez novatrices, anticipant parfois la future réglementation officielle, voire préconisant des recommandations qui sont apparues, des années après, au cours des auditions de la mission, comme particulièrement indispensables pour régler des problématiques qui ne sont toujours pas prises en compte aujourd'hui. On citera à titre d'exemples : - les recommandations en matière de formation des médecins du travail et des radiologues pour le diagnostic précoce dans un but de prévention ; - la réalisation d'analyses des contrôles d'empoussièrement dans les entreprises - par exemple en liaison avec les chantiers navals - dès 1985. Dans le même souci de l'application de la réglementation de 1977, le groupe de travail « perspectives » se fixait comme objectif « d'analyser les moyens de faire progresser la prévention au-delà des critères réglementaires. Il a été décidé avant toute chose d'examiner la situation actuelle dans les entreprises françaises concernées, de comprendre la politique de mesure de l'empoussièrement et les moyens mis en place pour la contrôler » ; - le souci, dès 1988, d'une procédure de qualification des entreprises qui traitent et enlèvent les flocages, ainsi que la nécessité pour elles de solliciter un agrément administratif ; - l'idée de « faire intégrer dans les appels d'offre et les adjudications les éléments de maîtrise du risque nécessaire » (1989) ; - la mise en évidence du problème de la maintenance et du bricolage ; - l'attention portée au danger de l'utilisation non contrôlée de fibres de substitution ; - le problème des démolitions sans contrôle adapté qui présentent des risques pour les personnels et l'environnement (1989) ; - la nécessité d'obtenir « l'établissement obligatoire d'un diagnostic » (1989) ; - la réalisation, en 1989, d'une campagne de sensibilisation des directeurs d'établissement scolaires (1989), l'envoi en janvier 1992 d'un mailing aux 1600 maires des villes de plus de 3000 habitants sur les flocages et un courrier aux collectivités locales responsables de l'entretien des établissements d'enseignements en 1994 ; - la préconisation d'une opération de recensement/diagnostic des locaux floqués en France, idée que reprendra le professeur Got dans son rapport22 de 1998; - le souci de la surveillance post-professionnelle, puisque le CPA déclare dès 1994 que : « le décret de mars 1993 prévoit que cette surveillance est à l'initiative du retraité, cependant, il est nécessaire de l'organiser afin que les anciens salariés connaissent la possibilité qui leur est offerte et que ceux qui souhaite en profiter puisse le faire dans les meilleures conditions » ; - le souci que la non ratification par la France de la convention amiante du BIT ne serve de prétexte aux nations du tiers monde pour poursuivre l'utilisation sans contrôle de l'amiante et ne nuise à la prévention au niveau international. Il n'en demeure pas moins que le CPA a toujours inscrit ses travaux dans le cadre de l'usage contrôlé de l'amiante, qu'il ne s'est donc jamais prononcé en faveur de son interdiction et qu'à ce titre il a été accusé d'avoir contribué à retarder la date de l'interdiction de l'amiante en France. Sur le point de savoir qu'elle a été l'influence exacte du CPA sur l'interdiction de l'amiante, la mission a constaté que les opinions étaient variées. Si Mme Emmanuelle Prada-Bordenave, maître des requêtes au Conseil d'État, a estimé que le CPA avait joué comme23 « un phénomène d'anesthésie », Mme Martine Aubry a au contraire déclaré, s'agissant précisément de l'influence du CPA sur le ministère du travail24 « je n'ai jamais, de près ni de loin, senti une pression des entreprises en la matière et ce qui pouvait se dire au CPA n'avait aucun effet sur nos décisions. Le CPA n'était qu'une commission d'experts, parmi une centaine d'autres. Imaginer qu'en le supprimant on aurait supprimé le problème montre que l'on n'a rien compris. Il faut chercher ailleurs d'éventuelles responsabilités ». Il est tout à fait légitime de s'interroger sur le fait de savoir si l'existence du CPA a pu freiner l'interdiction de l'amiante. Mais le retard mis par la France à interdire l'amiante ne saurait être imputable au seul rôle joué par le CPA. En premier lieu, la création du CPA ne date que de 1982 et l'on voit donc mal comment lui attribuer un rôle déterminant dans le retard de l'interdiction de l'amiante avant cette date, alors qu'on insiste souvent, et à juste titre, sur l'ancienneté de la connaissance des effets nocifs de l'amiante. Il convient d'ailleurs de remarquer que la condamnation de l'Etat pour « carences (fautives) dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante » par les 4 arrêts du Conseil d'État du 3 mars 2004, couvre une période longue et en très grande partie bien antérieure à la création du CPA, puisque la carence à réglementer concerne en particulier la période antérieure à 1977. Par ailleurs, l'usage contrôlé de l'amiante n'est pas défendu à cette époque par le seul CPA mais par la majorité des pays voisins et même par l'Union européenne. Enfin, on a parfois attribué le manque de lucidité du CPA sur la nécessité d'une interdiction au fait qu'il ne comptait parmi ses scientifiques que de jeunes chercheurs abusés et tenus dans l'ignorance des produits de substitution. Mme Prada-Bordenave a pourtant confirmé qu'il comptait parmi ses membres « des savants de renom », comme le professeur Bignon, et il apparaît au contraire que le problème des produits de substitution y a été abordé à plusieurs reprises comme en témoignent les procès-verbaux du CPA25. L'une des raisons principales invoquée par le CPA pour ne pas interdire l'amiante était, en effet, l'incertitude de l'époque sur la dangerosité des produits de substitution. Cet argument répondait peut-être aux intérêts des industriels de l'amiante mais on ne peut aujourd'hui manquer de se demander si cette prudence n'était pas fondée, puisque par exemple la dangerosité des fibres céramiques est aujourd'hui avérée. En revanche, ce qui est certain, c'est que le CPA a répondu à l'absence de structure institutionnelle indépendante de veille, d'expertise et d'alerte. Mme Emmanuelle Prada-Bordenave a confirmé26 qu'« au début des années 80, (...) la veille scientifique n'existait plus ». Le CPA a donc, dans des conditions discutables, occupé une place laissée vacante, à tort. La nécessité d'une structure institutionnelle indépendante de veille et d'expertise apparaît ainsi comme l'une des grandes leçons de l'amiante. Lors de son audition du 24 janvier 2006, M. Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, en a même fait la « première leçon à tirer du drame de l'amiante : l'État doit disposer d'une expertise publique forte et indépendante pour évaluer scientifiquement et rigoureusement les risques et organiser la veille scientifique ». 7.- La catastrophe de l'amiante a été trop souvent abordée en France sous le seul angle de la réparation Comme l'a déclaré maître Teissonnière, avocat des victimes de l'amiante27, « paradoxalement, les victimes de l'amiante en France, tous systèmes d'indemnisation confondus, sont probablement celles qui, dans le monde, bénéficient des meilleurs conditions d'indemnisation, alors même que nous sommes le pays dans lequel la catastrophe de l'amiante a coûté le moins cher à ses responsables, la sécurité sociale ayant finalement servi d'amortisseur ». Si la réparation due aux victimes est en effet une priorité indiscutable, la responsabilisation des acteurs, tant par la prévention que par la sanction, ne doit pas être négligée. M. François Martin, président de l'ALDEVA de Condé-sur-Noireau a même appelé de ses vœux28 « que le principe « empoisonneur/payeur » entre dans les faits ». C'est pourquoi les questions liées à la prévention et à l'examen des responsabilités ont été placées au cœur des réflexions de la mission. C'est dans ce domaine que les plus grandes leçons doivent être tirées. 8.- L'interdiction de l'amiante a été tardive dans l'ensemble des États européens Jusqu'au 1er janvier 1997, date de l'entrée en vigueur de l'interdiction totale de l'amiante, la France, à la différence d'autres pays qui ont pris cette mesure plus tôt, a préféré recourir à une politique dite d'« usage contrôlé ». Si la date de 1997 apparaît extrêmement tardive au regard de l'ancienneté de la connaissance du risque, il faut noter que la France fait partie des 8 premiers pays parmi les 15 de l'Union européenne à avoir banni totalement l'amiante. Le professeur Claude Got a ainsi indiqué29 que « la France a certes réagi tardivement pour interdire l'amiante par rapport à certains pays européens, mais n'oublions pas qu'une majorité de pays dans le monde continue à l'utiliser». M. Dominique Moyen, ingénieur général du corps national des Mines, ancien directeur général de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), a indiqué30, en évoquant les divers pays qui ont interdit l'amiante avant la France (le Danemark dès 1980 mais avec des exceptions, la Suède en 1992, l'Italie et les Pays-Bas en 1993, la Finlande, l'Autriche et l'Allemagne en 1994) : « oui, il est vrai que nous avons perdu cinq ans. Il eût été préférable de ne pas perdre cinq ans. Mais il reste que cela n'aurait pas changé l'ampleur du scandale ». L'Union européenne est souvent citée en exemple pour la précocité de son combat contre l'amiante, notamment à cause de la résolution du Parlement européen de janvier 1978 sur les risques sanitaires de l'amiante qui rappelait qu'« il existe suffisamment de preuves permettant de démontrer que l'amiante présente un danger tant pour les travailleurs de l'industrie de l'amiante que pour les personnes mises en contact avec l'amiante dans d'autres situations et qu'il est temps d'en tirer les conclusions qui s'imposent » et demandait « l'interdiction de la crocidolite dans tous les États-membres ». Pourtant, il ne faut pas oublier que le Conseil des Communautés européennes reconnaissait encore en 198331 « que les connaissances scientifiques actuellement disponibles ne permettent pas d'établir un niveau au dessous duquel les risques pour la santé n'existent plus, mais qu'en réduisant l'exposition à l'amiante, on diminuera le risque de produire des maladies liées à l'amiante ». S'agissant de la transposition des directives relatives à l'amiante, le retard de la France n'est pas non plus si important. Le retard principal de la France concerne la directive n° 83/477/CEE du Conseil du 19 septembre 1983. La directive fixait au 1er janvier 1987 le terme du délai de transposition laissé aux Etats membres. La directive n'a, il est vrai, été transposée que quelques semaines seulement après la date prévue, par le décret n° 87-232 du 27 mars 1987 publié au Journal officiel du 3 avril 1987. S'agissant de la directive n° 91-382 du 25 juin 1991 modifiant la directive n° 83-477 du 19 septembre 1983 en abaissant les limites d'exposition, le délai de transposition, fixé au 1er janvier 1993, a été respecté, puisque la transposition a été assurée dans les délais par le décret n° 92-634 du 6 juillet 1992 modifiant le décret de 1977. Principalement, l'Union européenne n'a décidé l'interdiction de l'amiante à compter du 1er janvier 2006 que par une directive 1999/77/CE du 26 juillet 1999. Il est important de noter, comme l'a rappelé M. Laurent Vogel32, chargé de recherche à l'Observatoire sur l'application des directives européennes, Institut syndical européen pour la recherche, la formation, la santé et la sécurité, qu'« au niveau communautaire, la décision française d'interdiction, en 1996-97, a joué un rôle moteur dans le processus conduisant à interdire toutes les formes d'amiante. Auparavant, la Commission européenne ne voulait pas froisser certains Etats et adoptait une position prudente : elle semblait attendre qu'une majorité nette se dessine au sein des Etats. Dans un rapport de 1996, sur la mise en œuvre de la directive de 1983 sur la protection des travailleurs, la Commission avait d'ailleurs encore une position prudente vis-à-vis du chrysotile ! Il est du reste significatif que la Commission a intenté un recours contre l'Italie en 1994 lorsque celle-ci a interdit l'amiante (voir l'arrêt de la Cour de Justice du 16 septembre 1997) ». Il convient enfin de ne pas oublier que, sans parler des nombreux pays en voie de développement qui utilisent encore l'amiante, certains pays développés n'ont interdit celui-ci que postérieurement à la décision française : la Belgique en 1997, la Nouvelle-Zélande en 1998 et la Grande Bretagne en 1999. Le BIT n'a, pour sa part, recommandé de bannir l'amiante qu'en juillet 2005, tandis que le Japon a décidé de ne le bannir qu'à partir de janvier 2006. Les États-unis et le Canada n'ont, quant à eux, toujours pas interdit l'amiante. 9.- L'exemplarité de la gestion pragmatique du dossier de l'amiante par les pays anglo-saxons doit être relativisée Les pays anglo-saxons sont souvent cités en exemple pour leur gestion plus pragmatique et, en définitive, plus efficace des problèmes de l'amiante. Comme déjà indiqué, la première réglementation en Grande-Bretagne pour la protection des travailleurs contre l'amiante, prévoyant des mesures de limitation de l'empoussièrement et un suivi médical, date de 1931 et les premières recommandations faites aux États-unis par « l'American College of Gouvernemental Industrial Hygienists » (ACGIH) visant à limiter l'inhalation d'amiante datent de 1946. De la même façon, si les États-unis n'ont toujours pas officiellement interdit l'amiante, le rôle des assurances et les procès qui s'y sont déroulés ont abouti à une efficacité paradoxalement supérieure à celle de l'interdiction, puisque le nombre des victimes de l'amiante a déjà commencé à diminuer aux Etats-Unis. Certaines personnalités auditionnées ont également pu33, comme M. Marcel Royez, secrétaire général de la FNATH, accréditer l'idée d'une supériorité des modèles anglo-saxons en remarquant, par exemple, que « le système français de tarification est beaucoup moins efficace que le système américain, lequel repose sur les compagnies d'assurance. Celles-ci ont le souci de tarifer leurs entreprises en fonction du risque réel. Le système est beaucoup plus pertinent en ceci qu'il impute à l'entreprise la réalité des coûts qu'elle représente pour la compagnie d'assurance ». Il convient toutefois de relativiser ces appréciations. En premier lieu, les mesures de 1931 sur la protection des travailleurs contre l'amiante, prévoyant des mesures de limitation de l'empoussièrement et un suivi médical, n'ont guère été appliquées, sauf dans les usines traitant de l'amiante brut. L'étude publiée en mars 1937 dans The Lancet et réalisée par l'épidémiologiste britannique Julian Peto révélait d'ailleurs que le mésothéliome provoquait 3 000 morts par an au Royaume Uni et « probablement autant en France ». L'avance des États-unis en matière d'inflexion du nombre des victimes liées à l'amiante tient également au fait que son utilisation industrielle, et donc la découverte de ses méfaits, ont été plus précoces. Surtout que, comme il a déjà été rappelé, la Nouvelle-Zélande n'a interdit l'amiante qu'en 1998, le Royaume uni qu'en 1999 et que les États-unis et le Canada ne l'ont toujours pas fait. 10.- L'amiante est un révélateur des difficultés de notre système judiciaire à examiner les responsabilités pénales lorsqu'il s'agit de problèmes de santé publique Alors que la responsabilité civile des entrepreneurs est désormais largement reconnue par les tribunaux, au travers de la « faute inexcusable », depuis les arrêts de la Cour de cassation du 28 février 2002 et que la responsabilité administrative de l'Etat a été admise par les quatre décisions du Conseil d'Etat du 4 mars 2004, le drame de l'amiante reste toujours en attente d'un procès pénal au fond, dont nombre de personnes auditionnées ont pourtant souligné l'effet de « catharsis » qui pourrait en résulter. Il est en particulier regrettable que l'arrêt du 15 novembre 2005 de la chambre criminelle de la Cour de cassation ait rejeté, pour des motifs de procédure, le pourvoi formé par différentes parties civiles contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai qui confirmait une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Dunkerque34. La Cour de cassation n'a ainsi pas pu se prononcer sur le fond de l'affaire. À cet égard, la création par la loi dite « Kouchner » du 4 mars 200235 de deux pôles de santé publique constitués au sein des tribunaux de grande instance de Paris et de Marseille, encore dotés de faibles moyens, ne semble pas avoir répondu, pour l'instant, à l'attente que les victimes placent dans la justice pénale. 11.- L'interdiction de l'amiante en France n'a pas réglé tous les problèmes Le drame que représente l'amiante pour des milliers de salariés contaminés ne s'est pas clos avec l'interdiction générale de ce produit le 1er janvier 1997. Il s'inscrit au contraire dans la durée ne serait-ce que parce qu'il est désormais clair, comme l'a notamment montré en 2003 le Rapport du gouvernement au Parlement présentant l'impact financier de l'indemnisation des victimes de l'amiante pour l'année en cours et pour les vingt années suivantes, que ses conséquences dommageables en terme de santé publique vont largement déborder la date de son interdiction en France. C'est pourquoi le problème de l'amiante dit « amiante résiduel » et celui de l'indemnisation des victimes a tout particulièrement retenu l'attention des travaux de la mission. 12.- L'interdiction de l'amiante au niveau international reste un enjeu pour le futur Il est de la plus haute importance pour la mission que la France s'engage désormais dans une action diplomatique d'envergure pour interdire l'amiante au niveau international. Si la France a tardé à réagir efficacement aux dommages causés par l'amiante, sa décision de l'interdire sous toutes ses formes à compter du 1er janvier 1997 a accéléré l'adoption d'une mesure analogue au niveau communautaire. De la même façon, c'est également la France qui a été à l'origine de la plainte du Canada devant l'Organisation mondiale du commerce, laquelle a finalement donné raison à notre pays et, dès lors, renforcé la position de tous ceux qui, dans le monde, militent pour une interdiction de l'amiante. PREMIÈRE PARTIE - L'HÉRITAGE DE L'AMIANTE EN FRANCE L'usage massif de l'amiante dans de nombreux secteurs industriels ou du bâtiment pendant près d'un siècle a laissé des séquelles sanitaires que l'interdiction du produit n'a pas suffi à gommer. En premier lieu, l'amiante « en place » représente un risque de pollution environnementale pour les habitants, et un risque d'exposition professionnelle dangereuse pour les travailleurs spécialisés ou non du bâtiment. En second lieu, l'amiante est toujours commercialisé et transformé dans la plupart des pays, et représente un enjeu de santé publique à l'échelle mondiale. Enfin, les personnes exposées aux fibres d'amiante par le passé constituent aujourd'hui des victimes avérées ou potentielles, dont la prise en charge doit être améliorée. Cette situation fait de l'amiante une question sensible pour la population, laquelle s'interroge légitimement sur les risques qui subsistent dix ans après l'interdiction totale du produit. C'est pourquoi il convient d'être parfaitement transparent sur ce point. Proposition : Organiser une campagne nationale d'information de la population sur l'amiante, les risques qui y sont liés et les moyens de les éviter. I.- L'AMIANTE EN PLACE DANS LES BÂTIMENTS DOIT ÊTRE MIEUX TRAITÉ Les propriétés exceptionnelles de l'amiante ont naturellement conduit à en faire une utilisation massive, notamment dans les domaines où la résistance au feu ou aux très hautes températures était capitale : bâtiments à architecture métallique, fonderies et entreprises sidérurgiques, industrie automobile, industries navales, etc. Dans sa forme « liée » à d'autres matériaux36, et donc moins friable, l'amiante a également été fortement utilisé (canalisations, plaques de toitures, dalles en vinyle, tressages de combinaisons, etc.), en particulier grâce à la présence sur le sol français d'industries de transformation de l'amiante. Lors de l'interdiction de l'amiante en 1997, sa présence considérable dans l'environnement représentait donc un enjeu majeur pour le Gouvernement : - dans sa forme friable, la dégradation de la fibre dans le temps en fait un danger atmosphérique réel ; - dans sa forme liée, l'amiante impose une grande prudence pour éviter que lors de travaux (maintenance, destruction, etc.) la fibre ne soit à nouveau libérée dans l'air. Cet enjeu n'est pas moins fort aujourd'hui, et les travaux de la mission ont clairement montré que les dangers liés à la fibre d'amiante se sont reportés depuis l'interdiction sur le secteur du bâtiment, où sont concentrés les risques de nouvelles victimes pour l'avenir. En 1996, l'interdiction de l'amiante a été assortie d'une réponse des pouvoirs publics au problème de l'amiante dit « résiduel » (terme impropre au regard des tonnages de fibres présents en France, auquel on préfèrera l'expression d'amiante « en place »37). Cette réponse s'est effectuée à travers deux dispositifs réglementaires : l'obligation de diagnostic de l'amiante par les propriétaires et les professionnels (réglementation du ministère de la santé tendant à protéger les populations) et les mesures de protection des travailleurs de l'amiante en place (réglementation du ministère du travail). La réponse des pouvoirs publics a été rapide, puisque les prescriptions de l'Etat sur le traitement de l'amiante en place se sont appliquées dès 1997, tout comme l'interdiction de la fibre elle-même. Mais pour être pragmatique, cette réglementation n'en révèle pas moins des schémas d'organisation complexes faisant intervenir des acteurs nombreux et diversifiés. En effet, depuis l'interdiction de l'amiante en 1997, la dangerosité de la fibre a suscité la mise en place d'une protection très sévère, dont résultent de nombreuses contraintes pesant tour à tour sur les propriétaires, les diagnostiqueurs, les laboratoires, les professionnels du désamiantage, les ouvriers du bâtiment et les filières d'élimination des déchets. Ces contraintes posent une double question, qui traverse l'ensemble de la filière : - un délicat contrôle de l'application de la réglementation, qui requiert des moyens importants et une technicité particulière ; - une difficulté générale de diffusion et d'application des règles, dans un secteur où les petites et très petites entreprises représentent une grande part des acteurs concernés. A.- LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DU TRAITEMENT DE L'AMIANTE EN PLACE : UNE ORGANISATION COMPLEXE METTANT EN JEU DES ACTEURS NOMBREUX ET DIVERSIFIÉS 1.- Les règles de protection des populations Le décret n°96-97 du 7 février 1996, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, complété par plusieurs textes ultérieurs, a imposé une obligation de repérage de la présence d'amiante dans les immeubles bâtis. Cette obligation est cruciale, car elle conditionne tout traitement de l'amiante en place : du diagnostic dépend la nécessité ou non d'effectuer des travaux sur l'amiante, le degré de sécurité nécessaire aux travaux réalisés, et l'évaluation du risque encouru si l'amiante n'est pas retiré. Cette réglementation complexe prévoit plusieurs types de diagnostics, assortis de délais variables et elle concerne plusieurs catégories d'acteurs, aux contraintes différentes. a) La diversité des diagnostics prévus par la réglementation Il existe quatre obligations de repérage et de diagnostic des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les bâtiments. ● Le diagnostic des flocages, calorifugeages et faux plafonds Les pouvoirs publics ont initialement souhaité repérer et traiter les situations les plus dangereuses en obligeant les propriétaires, publics ou privés, de la plupart des immeubles bâtis - seules les maisons individuelles ne sont pas concernées - à rechercher la présence d'amiante dans les flocages et calorifugeages (décret n° 96-97 du 7 février 1996) puis dans les faux plafonds (décret n° 97-855 du 12 septembre 1997). Les règles de gestion des flocages, calorifugeages et faux plafonds ont été renforcées par le décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001. Les flocages, calorifugeages et faux plafonds sont en effet des procédés susceptibles, sous l'effet du vieillissement naturel ou en cas de travaux, de libérer des fibres d'amiante dans l'atmosphère et d'exposer de manière passive les occupants de l'immeuble à l'inhalation de poussières d'amiante. Il s'agissait donc d'assurer la protection de la population qui réside, circule ou travaille dans des immeubles bâtis comportant de tels matériaux. Si le repérage a fait apparaître de l'amiante38, l'opérateur de repérage vérifie l'état de conservation des matériaux en fonction d'une grille d'évaluation définie par arrêté ministériel : - N=1 : bon état de conservation ne nécessitant pas de nouveau contrôle avant 3 ans ; - N=2 : état intermédiaire de conservation nécessitant des mesures d'empoussièrement (analyse de l'air)39 ; - N=3 matériaux dégradés entraînant des mesures conservatoires avant travaux obligatoires40. Les propriétaires publics ou privés disposent, en principe, d'un délai de 36 mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle pour achever les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante. Ceux-ci sont obligatoires lorsque - selon la grille d'évaluation - soit l'état de conservation est jugé intermédiaire (N=2) et le niveau d'empoussièrement relevé est supérieur à 5 fibres/litre, soit les matériaux sont clairement dégradés (N=3). Par dérogation et à la demande du propriétaire, le délai d'achèvement des travaux peut être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur (IGH) et les établissements recevant du public classés de la première à la troisième catégorie (capacité supérieure à 300 personnes), lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements41. La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés. À ce jour, seuls l'établissement universitaire de Jussieu et le musée des sciences de l'homme ont demandé une telle dérogation. Si des travaux ont dû être exécutés, le propriétaire doit faire procéder, par un opérateur de repérage, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées et à une mesure du niveau d'empoussièrement après travaux. Le niveau d'empoussièrement après travaux doit être inférieur ou égal à 5 fibres/litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, le propriétaire doit faire procéder à un nouveau contrôle périodique de l'état de conservation dans un délai de 3 ans ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La recherche d'amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds devait être effectuée avant le 31 décembre 1999, mais des diagnostics continuent à être faits dans le cadre du contrôle périodique de l'état de conservation. Les résultats des diagnostics relatifs aux flocages, calorifugeages et faux plafonds sont consignés dans un dossier technique qui est désormais intégré au « dossier technique amiante ». Bien entendu, les propriétaires n'ayant pas réalisé leur diagnostic sont toujours tenus de le faire. En cas de manquement à ces obligations, le propriétaire peut se voir appliquer des sanctions pénales. Pour une personne physique, l'amende est une contravention relevant de la cinquième classe (1 500 euros au plus). Pour une personne morale, le taux maximum de l'amende applicable est égal au quintuple de celui prévu pour une personne physique. ● Repérage étendu pour la constitution du dossier technique amiante Le décret du 13 septembre 200142 a introduit une nouvelle obligation de repérage élargi à d'autres produits susceptibles de contenir de l'amiante. Le programme de repérage énumère les produits à rechercher, mais l'opérateur de repérage doit signaler tous les autres produits, ou matériaux, réputés contenir de l'amiante, dont il a connaissance. Normalement, ces autres matériaux ne libèrent pas spontanément des fibres car l'amiante y est plus fortement lié, mais ils sont susceptibles de générer des expositions à l'amiante lors des opérations d'entretien et de maintenance des bâtiments. Il s'agit donc surtout de renforcer la protection des travailleurs appelés à y intervenir, en développant une démarche d'identification et de gestion des matériaux contenant de l'amiante. Ce repérage étendu sert de base à la constitution d'un « dossier technique amiante » (DTA) regroupant l'ensemble des informations relatives aux matériaux contenant de l'amiante (localisation, signalisation, état de conservation) et décrivant les consignes générales de sécurité (procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets). Ce DTA doit être tenu à disposition d'un large public, parmi lesquels les agents des services sanitaires, de l'inspection du travail ou encore toute entreprise réalisant des travaux dans l'immeuble. Pour réaliser ce repérage étendu, les propriétaires doivent faire appel à un opérateur de repérage. Celui-ci consulte les archives, inspecte les locaux et procède en tant que de besoin, à des prélèvements de matériaux afin d'identifier la présence d'amiante. Les analyses de matériaux sont confiées à un organisme accrédité. En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante autre que les flocages, calorifugeages et faux plafonds, il n'y a pas de grille d'évaluation de l'état de conservation et pas d'obligation de retrait, contrairement aux dispositions instaurées pour ces derniers. L'opérateur de repérage qui détecte des matériaux dégradés doit simplement conseiller le propriétaire en lui préconisant des mesures générales, sans qu'il s'agisse pour autant de prescription de travaux. Ces mesures de précaution consistent essentiellement à limiter tout risque d'émission de fibres en évitant, par exemple, toute sollicitation des matériaux, mais il peut s'agir également de restreindre l'accès à un local ou de procéder au remplacement d'un élément dégradé. Le DTA devait être établi avant le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grandes hauteurs (IGH) et les établissements recevant du public de capacité supérieure à 300 personnes et avant le 31 décembre 2005 pour les autres immeubles bâtis. Les appartements et les maisons individuelles ne sont pas concernés. Des sanctions pénales sont également prévues en cas de carence des propriétaires. ● Recherche d'amiante préalable à la démolition d'un immeuble Le décret du 13 septembre 2001 impose, à compter du 1er janvier 2002 pour les propriétaires de tous types d'immeubles bâtis construits avant le 1er juillet 1997, y compris les maisons individuelles et les appartements, de procéder à une recherche encore plus complète d'amiante avant toute opération de démolition de leur immeuble. Les catégories de matériaux à rechercher sont en effet plus importantes que pour la constitution du DTA et les modalités du repérage sont différentes puisque l'on peut procéder à des sondages « destructifs » (par exemple, casser une cloison de protection pour identifier le matériau isolant de canalisations dissimulées derrière). Il s'agit ici de protéger l'environnement et les riverains des chantiers de démolition contre l'émission inopinée de fibres dans l'air, mais également de permettre une meilleure gestion des déchets. Cette mesure vise aussi à prendre en compte la présence d'amiante dès la conception d'une opération, afin de limiter les modifications, avenants et surcoûts. Des sanctions pénales sont, également, prévues en cas de carence des propriétaires. ● Constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti Un repérage mentionnant la présence, ou le cas échéant l'absence, de matériaux ou produits de construction contenant de l'amiante, doit être annexé à toute promesse de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente des immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 - y compris les maisons individuelles -, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques. Cette disposition43 est applicable depuis le 1er septembre 2002. Le constat doit indiquer la localisation et l'état de conservation des matériaux et produits. Les matériaux et produits à repérer sont les mêmes que ceux concernés par le DTA. Cette disposition n'est pas assortie de sanctions pénales. Le défaut de production de l'état relatif à l'amiante est seulement sanctionné par l'impossibilité pour le vendeur de s'exonérer de la garantie des vices cachés. La réglementation identifie deux catégories d'intervenants dans le processus de diagnostic : l'opérateur de repérage, qui constitue la véritable « cheville ouvrière » du diagnostic, et les laboratoires accrédités qui procèdent aux mesures de l'empoussièrement de l'air et qui interviennent de façon indirecte. ● Les opérateurs de repérage Pour satisfaire à leurs obligations de repérage, les propriétaires doivent systématiquement faire appel à un opérateur de repérage, c'est-à-dire soit à un contrôleur technique (au sens du Code de la construction et de l'habitation44), soit à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission. Depuis le 1er janvier 2003, seuls les opérateurs de repérage titulaires d'une attestation de compétence peuvent exercer leurs missions de diagnostic. Cette attestation est délivrée, à l'issue d'une formation et d'un contrôle de capacité, par des organismes dispensant une formation certifiée45. Les organismes de formation adressent la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence au ministre chargé de la construction. Outre cette obligation, le Conseil supérieur du notariat a mis en place une démarche de certification des opérateurs de repérage pour leur intervention dans le cadre des ventes. De plus, d'autres organismes peuvent développer des labels volontaires pour les diagnostiqueurs (par exemple le CEBTP46 a instauré le label APTE pour les diagnostiqueurs « amiante »), mais ces démarches n'ont pas la valeur réglementaire de l'attestation de compétence. Enfin, le technicien de la construction ne doit avoir aucun lien de quelque nature que ce soit avec les propriétaires ou avec toute entreprise chargée d'organiser ou d'effectuer les travaux de retrait ou de confinement des matériaux. Les techniciens effectuant les diagnostics doivent transmettre un rapport annuel d'activités au préfet du département du siège du prestataire. Une enquête a été menée en 2005 par le Gouvernement sur la base de ces rapports, mais les résultats n'en sont pas encore disponibles. La mission a regretté que le délai initial d'achèvement de cette enquête, prévu en novembre 2005, n'ait pu être respecté. ● Les laboratoires La réglementation distingue deux types de laboratoires pouvant intervenir pour affiner l'opération de diagnostic. L'identification de la présence d'amiante dans un matériau prélevé doit être réalisée par un laboratoire accrédité pour cette prestation par le Comité français d'accréditation - le COFRAC47 - (ou par tout autre organisme d'accréditation européen). Ce type de laboratoire ne requiert pas d'agrément ministériel. En revanche, si des mesures du taux de fibres d'amiante dans l'atmosphère sont réalisées, les opérations de prélèvement d'air et les opérations de comptage doivent être effectués par des organismes qui doivent avoir obtenu une accréditation par le COFRAC, c'est-à-dire répondre à des normes de qualité, et un agrément par arrêté du ministre chargé de la santé, après avoir satisfait aux campagnes d'intercomparaisons organisées tous les ans par l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS). L'arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée. 2.- Les règles de protection des travailleurs Le décret n°96-98 du 7 février 1996, relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante, prévoit plusieurs dispositifs de protection couvrant les deux hypothèses où des travailleurs sont amenés à intervenir au contact de l'amiante en place : une intervention délibérée sur l'amiante, résultant de la demande d'un propriétaire ou d'une obligation consécutive au diagnostic et une intervention inopinée sur de l'amiante, à l'occasion de travaux de maintenance. Cette réglementation prévoit deux types d'obligations : - un tronc commun relatif à la gestion des déchets, à la formation et au suivi médical des travailleurs, - des obligations variables pesant sur les entreprises exécutant les travaux. a) Toutes les interventions sur l'amiante sont réglementées Le décret n° 96-98 a prévu trois mesures s'appliquant à toute intervention sur des matériaux amiantés. En premier lieu, il impose une formation spécifique des travailleurs, incluant une démarche de prévention sur les risques liés à l'amiante. On notera que cette disposition s'applique aux travailleurs du secteur du bâtiment amenés à intervenir de façon inopinée ou occasionnelle sur des matériaux contenant des fibres d'amiante. En second lieu, tout travailleur susceptible d'intervenir sur de l'amiante doit faire l'objet d'un suivi médical minimal, incluant notamment une traçabilité de ses expositions aux fibres, de leurs durées et de leurs contextes. Ce suivi incombe à la médecine du travail, sur la base des informations que l'employeur est tenu de fournir. Enfin, le décret impose un traitement spécifique des déchets susceptibles de libérer des fibres d'amiante. Ces dispositions sont distinctes de la réglementation propre à l'élimination de ces déchets48, et concernent surtout leur transport et la garantie de leur innocuité : « Les déchets de toute nature et les emballages vides susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussière pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage. Ils doivent être transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par la réglementation relative aux produits contenant de l'amiante. » b) La protection des travailleurs varie selon la nature des travaux exécutés Le décret n° 96-98 opère deux distinctions. La première sépare les mesures protégeant les travailleurs dont l'intervention sur l'amiante résulte d'une activité de maintenance classique, de celles protégeant les travailleurs des établissement dont l'activité est « le retrait ou le confinement » de l'amiante en place, c'est-à-dire ceux dont le « métier » est le désamiantage. Au sein de cette dernière catégorie, la réglementation distingue également selon que les travailleurs interviennent sur de l'amiante dit « friable », ou de l'amiante dit « lié ». ● Les règles applicables aux acteurs spécifiques du désamiantage Pour tous les travaux de traitement de l'amiante résiduel, il convient de faire appel à une société spécialisée. Le degré de spécialisation correspond essentiellement aux mesures de protection des travailleurs, lesquelles dépendent de la nature de l'amiante traité. On notera que la réglementation n'impose aucune forme de travaux. Cette question est laissée à l'appréciation de la maîtrise d'ouvrage. L'entreprise peut procéder au retrait des matériaux amiantés, à leur encoffrement, ou encore à leur fixation par des produits isolants et résistants, la seule contrainte réglementaire étant le respect des valeurs maximales d'empoussièrement à l'issue des travaux. La réglementation prévoit en premier lieu un socle commun de mesures pour l'ensemble des activités de traitement de matériaux amiantés. Il s'agit notamment : - de l'interdiction d'employer des mineurs, - de l'intensification du dispositif de suivi médical des salariés, - d'une procédure d'urgence en cas d'incident conduisant à une exposition anormale, - de l'utilisation de mesures de protection collectives adaptées. Ce socle applicable à toutes les activités de traitement de l'amiante prévoit surtout l'établissement d'un plan de retrait ou de confinement. Ce document, qui est la mesure phare du décret, doit préciser : - la nature et la durée probable des travaux ; - le lieu où les travaux sont effectués ; - les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ; - les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux ou à proximité ; - la fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier. Le plan est soumis à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est transmis un mois avant le démarrage des travaux à l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics. L'obligation faite aux entreprises revêt donc deux aspects : une obligation d'établissement et de transmission, et une obligation de contenu. Il convient également de préciser que ces deux obligations s'appliquent aux travaux de démolition d'immeubles, lorsque le diagnostic réglementaire fait état de présence d'amiante. La réglementation prévoit en second lieu un durcissement des obligations pesant sur les entreprises faisant intervenir des travailleurs sur de l'amiante friable. En effet, le Gouvernement, soucieux de prévenir prioritairement les expositions qu'il jugeait les plus dangereuses, a estimé devoir distinguer les matériaux contenant de l'amiante en fonction de leur « dégradabilité » dans le temps. L'amiante friable est défini par l'arrêté d'application du décret, comme49 : « tout matériau susceptible d'émettre des fibres sous l'effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d'air. » Le « durcissement » de la réglementation repose sur deux éléments : - les sociétés concernées doivent obtenir une certification de la part d'organisme de qualification (Qualibat ou Afaq-Ascert) sur la base d'un référentiel validé par le ministère de la santé et le COFRAC. Cette certification garantit la capacité de l'entreprise à respecter la réglementation en matière de sécurité et de protection des travailleurs et de l'environnement. Elle représente à la fois un coût durable pour ces entreprises, d'abord pour obtenir puis pour conserver leur certification, mais aussi une solide garantie en matière d'application des règles sanitaires, les organismes certificateurs étant tenus d'exercer un contrôle quasi permanent sur les entreprises qualifiées ; - les entreprises intervenant sur de l'amiante friable doivent également respecter des règles techniques spécifiques, détaillées par l'arrêté du 14 mai 1996 précité. On peut en mesurer la rigueur par comparaison avec les règles applicables aux entreprises intervenant sur de l'amiante lié :
● Les règles applicables aux travailleurs intervenant sur des matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante Il convient enfin de relever que la réglementation traite différemment les sociétés qui sont confrontées à l'amiante à l'occasion de chantiers n'ayant pas pour objet son retrait ou son traitement. Celles-ci sont normalement tenues informées du risque par le DTA de l'immeuble, mais, en tout état de cause, l'employeur a l'obligation de s'en informer. Ces sociétés, qui ne relèvent pas du secteur de l'amiante, sont soumises à des obligations qui peuvent être considérées comme « allégées » et distinguent deux types de travaux : - les travaux de maintenance portant sur les flocages, calorifugeages et faux plafonds font l'objet de dispositions spécifiques, dès lors que la présence d'amiante dans ces matériaux, si elle est avérée, ne peut être ignorée ni du propriétaire des lieux, ni de l'entreprise. Le port de vêtements de protection et d'un masque est obligatoire, mais la mise en place de mesures de protection collective n'est pas imposée « si c'est techniquement impossible ». L'emploi de mineurs est également interdit pour ces travaux ; - à l'occasion des autres travaux, la présence d'amiante peut ne pas avoir été révélée par les diagnostics obligatoires. Si elle est découverte à l'occasion du chantier, le chef d'entreprise est tenu d'en informer le propriétaire. Si la présence d'amiante est connue, la réglementation prévoit le signalement de la zone de chantier, la mise à disposition de vêtements et masques « appropriés », ainsi que le nettoyage du chantier. Les travaux de la mission de l'Assemblée nationale consacrés au traitement de l'amiante en place ont fait apparaître un double constat d'insatisfaction : - si la réglementation paraît globalement satisfaisante pour prévenir les risques, certains de ses pans laissent manifestement à désirer, au point de remettre en cause l'efficacité de l'ensemble du dispositif lorsque les lacunes affectent le début de la chaîne - avec le problème de la compétence des diagnostiqueurs - ou son extrémité - avec le problème de la maintenance ; - plus généralement, les acteurs de l'amiante résiduel sont presque unanimes à considérer que cette réglementation, si bonne ou perfectible soit-elle, n'est pas convenablement ou suffisamment appliquée, notamment parce que les modes de contrôle de son application ne sont pas satisfaisants. Propriétaires DIAGNOSTICS DE L'AMIANTE RÉSIDUEL 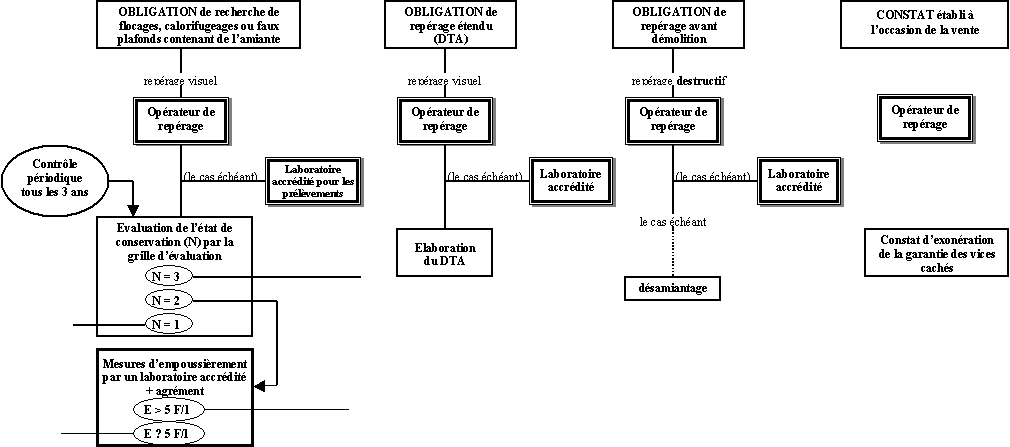 - 78 - B.- UN SYSTÈME DE DIAGNOSTIC COÛTEUX, MAL ENCADRÉ, ET SOUS-CONTRÔLÉ De façon générale, la mission a constaté le paradoxe suivant : les exigences réglementaires de la filière sont assez fortes et satisfaisantes en amont de l'activité de diagnostic (accréditation des laboratoires d'analyse de prélèvements, accréditation et agrément ministériel des laboratoires de mesures de l'empoussièrement) et en aval de celle-ci (certification des sociétés de désamiantage en matière d'amiante friable) mais elles sont finalement assez restreintes - bien que complexes - pour le diagnostic lui-même, alors que ce dernier conditionne la bonne qualité de l'ensemble de la chaîne. 1.- Le diagnostic fait l'objet de nombreuses critiques L'ensemble des témoins entendus par la mission a jugé que le diagnostic constituait le maillon le plus faible de la chaîne du traitement de l'amiante en place. La mauvaise qualité des diagnostics, et parfois leur absence, obèrent considérablement l'efficacité de la réglementation tendant à protéger les travailleurs. a) Les critiques tenant à l'absence de diagnostics Si les décrets de 1996 et 1997 qui posent l'obligation de repérer les matériaux présentant le plus de risques (flocages, calorifugeages et faux plafonds) semblent avoir été appliqués correctement, la mission s'inquiète du retard manifeste dans la phase de réalisation du DTA, alors que ce document est une référence indispensable. Malgré l'échéance du 31 décembre 2005, les propriétaires ne semblent toujours pas avoir pris la mesure de leur responsabilité à l'égard du traitement de l'amiante, une fois accompli - quand il l'est - le diagnostic réglementaire sur les flocages, calorifugeages et faux plafonds. En tout état de cause, l'absence de contrôle de l'application des obligations réglementaires empêche quiconque de disposer d'informations fiables sur leur respect50. L'enquête diligentée par le ministère de la santé en 2005 sur la base des rapports d'activité des opérateurs du repérage n'est pas achevée à ce jour et les professionnels du diagnostic immobilier contactés n'ont finalement pas souhaité être entendus. Si l'on s'en tient aux commentaires unanimes effectués devant la mission, il y aurait un problème général de respect des obligations de diagnostic, ce qui met en cause la qualité de l'ensemble de la chaîne de traitement de l'amiante en place. Ce problème a notamment été souligné par M. Bernard Peyrat, président du Syndicat de retrait et de traitement de l'amiante et des autres polluants (SYRTA)51 : « (...) les propriétaires immobiliers étaient censés effectuer, avant fin 1999, un diagnostic amiante des matériaux considérés comme les plus dangereux, à savoir les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds. Or nous constatons qu'un grand nombre de ces diagnostics n'ont pas été faits. » La mission préconise donc une action de sensibilisation des propriétaires d'immeubles bâtis sur leurs obligations, étant donné l'expiration du dernier délai de réalisation des DTA le 31 décembre 2005. Pour favoriser le respect de la réglementation relative aux diverses obligations de repérage de l'amiante, des communiqués de presse52 ou des campagnes d'information à destination du public, des copropriétés et des élus pourraient utilement être organisées pour rappeler les propriétaires à leurs obligations en matière de diagnostic. Ainsi, les usagers des immeubles bâtis seraient en mesure de demander des comptes aux propriétaires et de les obliger à respecter leurs obligations de diagnostic. Dans le même esprit, pourrait être entreprise la rédaction de documents de vulgarisation sur l'ensemble de la réglementation relative à l'amiante. Propositions : Concevoir et diffuser rapidement un document simple rappelant aux propriétaires leurs obligations de diagnostics et organiser une campagne d'information, par l'intermédiaire des organismes de gestion de l'habitat collectif, comme les syndics de copropriété. b) Les critiques tenant à la qualité des diagnostics Selon l'ensemble des témoins, la qualité des diagnostics est souvent préoccupante. Ainsi, M. Alain Leseigneur, directeur général de la société de désamiantage SOBATEN, a souligné53 : « Lorsque nous prenons en compte un chantier, nous nous apercevons trop souvent que le diagnostic est incomplet ou ancien et nous découvrons des matériaux auxquels nous ne nous attendions pas. Récemment, dans une grande institution, on a découvert que tous les planchers étaient revêtus de matériaux amiantés, alors que le diagnostic ne relevait que quelques traces d'amiante. » Deux facteurs semblent expliquer la mauvaise qualité des diagnostics : - les faiblesses du dispositif réglementaire, qui font l'objet de développements approfondis plus loin. - l'insuffisante sensibilisation des professionnels chargés de prévoir, planifier et coordonner les travaux dans les immeubles bâtis. Cela concerne d'abord les maîtres d'œuvre, chargés d'élaborer le cahier des charges des travaux, pour lesquels le diagnostic est un préalable. Peu soucieux de la sécurité des travailleurs, ils exercent des pressions économiques pour limiter les investigations nécessaires au diagnostic. Plusieurs exemples ont été portés à la connaissance de la mission, notamment par M. Philippe Dubuc, contrôleur du travail dans le Var, et M. Michel Gaul, inspecteur du travail dans la Manche, qui ont fait état de véritables négociations entre certains maîtres d'œuvre et les diagnostiqueurs sur le temps nécessaire au repérage, voire sur le nombre de prélèvements et d'analyse autorisés. La mauvaise formation des maîtres d'œuvre sur les risques liés à l'amiante a également été soulignée54. Cela concerne ensuite les coordonnateurs SPS55, dont la nomination est impérative lorsqu'un chantier doit faire intervenir plusieurs entreprises. Ces coordonnateurs peuvent le cas échéant assurer les fonctions de diagnostiqueurs, mais, en tout état de cause, il paraît anormal que de grands chantiers soient conduits avec une société de désamiantage qui découvre en cours de travaux que le diagnostic initial est à refaire. Dans sa contribution aux travaux de la mission, M. Michel Gaul essaie d'expliquer cet état de fait : « La logique économique de la coordination SPS, où la concurrence est féroce, est l'une des explications. Elle n'est pas la seule. La difficulté pour les coordonnateurs SPS, finalement peu formés aux risques liés à l'amiante et d'une manière générale aux risques à effets différés, d'être sensibilisés à ces risques et de les prendre en compte dans le cadre de leur mission, est également une raison. » Sur ce point, la mission recommande : - d'une part, une révision du Code de la santé publique, afin de faire peser une responsabilité civile et pénale plus dissuasive, et plus claire sur la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'œuvre déléguée et l'assistance à maîtrise d'ouvrage, en matière d'insuffisance de diagnostic amiante ; - d'autre part, d'envisager une obligation de qualification ou de certification pour ces mêmes acteurs, car ils ont une mission générale de conseil. Le rapport reviendra sur cette proposition qui concerne également le rôle des maîtres d'œuvre dans la définition des conditions d'intervention des entreprises. Proposition : Renforcer les sanctions pesant sur les propriétaires ou leurs maîtres d'œuvre, pour les contraindre à respecter les impératifs de sécurité dans la planification et la commande de leurs travaux immobiliers. c) Le cas du repérage avant démolition d'immeuble La mission s'est intéressée à la question des diagnostics obligatoires avant toute opération de démolition d'immeubles. En effet, la politique de la ville menée depuis l'entrée en vigueur de la loi SRU56 suscite de plus en plus de destructions ou de réhabilitations de grands ensembles immobiliers construits pendant les périodes d'utilisation massive de l'amiante. Le diagnostic prévu par la réglementation en cas de démolition est plus complet que les autres ; il prévoit, notamment, la possibilité de sondages « destructifs ». Dans ce cas, le respect des obligations paraît encore plus problématique que pour les autres obligations de repérage. La mission a eu connaissance de plusieurs exemples démontrant que la prise de conscience des propriétaires publics57 et privés laisse beaucoup à désirer. Ainsi, la contribution que M. Gaul a remise à la mission fait état de statistiques inquiétantes sur les chantiers de réhabilitation et de démolition, conduits durant le premier semestre 2005, dans la Manche : - dans 29 % des cas, aucun repérage amiante n'a été effectué avant le contrôle de l'inspection du travail. Les diagnostics opérés ultérieurement ont fait apparaître une présence d'amiante dans 78 % des bâtiments concernés ; - dans les autres cas, 58 % des repérages amiante effectués avant contrôle se sont révélés insuffisants. La démolition d'immeuble génère évidemment un risque atmosphérique important. Aussi est-elle subordonnée à l'obtention d'un permis de démolir. Cette procédure a donné lieu à des expérimentations intéressantes, dont les résultats sont assez préoccupants. M. Jacques Le Marc, inspecteur du travail, a relaté une de ces expériences58 : « Notre direction départementale a demandé aux mairies de la Loire-Atlantique de bien vouloir l'informer des permis de démolir portant, selon toute vraisemblance, sur des toitures en fibrociment ou aux autres matériaux contenant de l'amiante, afin que nous puissions adresser systématiquement au propriétaire un courrier lui rappelant ses obligations, en termes de repérage, de diagnostic et de remise de ces informations à l'entreprise intervenante. Par la suite, nous devrions logiquement recevoir les plans de retrait. Le problème est que nous constatons un écart énorme entre le nombre de permis de démolir et le nombre de plans de retrait. » La mission préconise donc d'instaurer un mécanisme de contrôle du respect de l'obligation de diagnostic avant démolition. Il pourrait prendre la forme d'une transmission par les mairies des permis de démolir aux services déconcentrés du ministère du travail, lorsqu'il y a lieu de penser qu'ils concernent des immeubles bâtis contenant de l'amiante (toitures en fibrociments par exemple). Un courrier rappelant aux propriétaires leurs obligations en termes de repérage, de diagnostic et de remise de ces informations à l'entreprise intervenante, serait systématiquement adressé aux propriétaires. Les services déconcentrés du ministère du travail pourraient s'assurer du respect des obligations réglementaires à l'occasion de l'examen des plans de retrait. Propositions : Organiser la transmission aux Directions départementales de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle des permis de démolir, et y inclure l'obligation de repérage de l'amiante. Les DDTEFP devront contrôler l'établissement des plans de retrait correspondant aux repérages attestant la présence d'amiante. 2.- La réglementation présente des faiblesses préoccupantes La critique de la réglementation par les témoins s'est portée sur deux points : le contrôle de la qualité des opérateurs de repérage, premier maillon, fondamental, de la chaîne de traitement de l'amiante en place et le degré d'exigence réglementaire pesant sur la qualité des diagnostics. a) La formation des opérateurs de repérage est insuffisante Il convient d'abord de retracer l'évolution de la réglementation. De 1997 à 2003, le décret n° 96-97 prévoyait que l'opérateur devait être un « contrôleur technique ou un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission ». Cette obligation faisait largement peser le contrôle de la qualité de l'opérateur sur les compagnies d'assurance, comme l'ont fait remarquer certains témoins59. La qualité très inégale des opérateurs qui se sont positionnés sur le marché du diagnostic amiante dès 199760 a d'ailleurs rapidement conduit les compagnies d'assurance à se retirer du marché. M. Stéphane Penet, directeur adjoint de la direction des assurances de biens et des responsabilités à la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA), a ainsi décrit le risque que les assureurs devaient couvrir61 : « Prenons l'exemple d'un diagnostiqueur qui intervient sur un chantier. Il remet un rapport selon lequel il n'y a pas d'amiante, mais au cours des travaux, on découvre qu'il y en a. Cela entraîne l'arrêt du chantier, ainsi que des surcoûts. Dans ce cas, la responsabilité civile du diagnostiqueur est en jeu. Son assurance peut couvrir les surcoûts. Voilà les risques que nous couvrons, liés à une erreur professionnelle du spécialiste. » M. Penet a également indiqué que si le refus de plusieurs compagnies d'assurance de continuer à assurer ce risque pouvait venir de consignes expresses des réassureurs, en tout état de cause il traduisait de réelles incertitudes sur les moyens d'évaluation de la compétence des personnes à assurer62. Depuis le 1er janvier 2003, les diagnostiqueurs doivent être titulaires d'une attestation de compétence, spécifique au repérage de l'amiante, obtenue à l'issue d'une formation obligatoire de 2 à 4 jours. Cette formation, très courte, a été jugée insuffisante par la plupart des témoins, ainsi que par les assureurs qui sont restés très prudent vis-à-vis du marché du diagnostic amiante. Comme l'a souligné M. Roger Piotto, la durée de la formation n'est en rien une garantie de qualité en elle-même, car elle est « calibrée » pour des opérateurs déjà compétents63. Or les prérequis demandés par les organismes formateurs ne sont pas toujours les mêmes et certains opérateurs peuvent ne disposer d'aucune connaissance effective du monde du bâtiment. Par ailleurs, une fois acquise, la qualité d'opérateur de repérage n'est plus jamais remise en cause. L'évaluation et le contrôle de la compétence des opérateurs de repérages - dont le nombre est évalué à 6 000 - sont donc des sujets de réflexion déjà anciens, qui n'ont pas encore reçu de réponse satisfaisante. Toutefois, l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction réformant le dispositif général des diagnostics au moment des ventes d'immeubles devrait être l'occasion de rehausser le niveau d'exigence dans ce domaine. Un décret d'application est d'ailleurs en préparation sur ce point et le conseil général des Ponts et chaussées a rendu un rapport proposant des critères élevés de diplôme. La mission a cependant estimé qu'il conviendrait de ne pas limiter cette réforme aux diagnostics avant vente, mais d'étendre le renforcement de la formation à l'ensemble des opérations de repérage de matériaux amiantés. La mission s'est même interrogée sur la possibilité d'élargir aux opérateurs de repérage l'obligation de certification, afin de mieux garantir la qualité des intervenants sur le terrain. Système plus lourd que la simple formation, la certification - à l'image de celle qui est requise pour les entreprises traitant l'amiante friable - est un système à trois étages : - le premier relève de l'Etat, il s'agit d'un référentiel retraçant les exigences de qualité souhaitées, qui peuvent relever de la formation, de l'expérience, de la compétence, voire de tout critère jugé utile par l'administration. Ce référentiel peut s'appuyer sur des normes européennes ou internationales reconnues ; - le deuxième étage relève d'organismes privés souhaitant organiser une certification réglementaire et qui, dans ce but, requièrent l'accréditation du COFRAC. Celui-ci évalue les projets concrets des organismes par rapport au référentiel public ; - le dernier étage est constitué des opérateurs qui, souhaitant acquérir une certification, montent un dossier auprès d'un des organismes accrédités : l'ensemble des critères du référentiel sont vérifiés. En cas de succès, une certification est délivrée à titre probatoire, qui doit être confirmée et attribuée pour une durée limitée. Elle fait l'objet de contrôles réguliers et inopinés durant toute sa durée de validité. Un tel dispositif, certes lourd et contraignant, peut produire des effets vertueux dans les pratiques professionnelles, et il offre des garanties très importantes aux compagnies d'assurance64. En outre, il présente l'avantage de remettre en cause régulièrement le statut de l'opérateur. La menace de sanction offre, aussi, de meilleures garanties que la seule exigence de formation, quelle que soit la qualité de cette dernière. En effet, l'opérateur, même bien formé, agit dans un réseau de contraintes, notamment financières et concurrentielles, qui n'incitent pas toujours à prendre toutes les mesures de précaution nécessaires, compte tenu de leur coût pour le propriétaire65. La mission recommande donc que le projet de décret d'application de l'ordonnance du 8 juin 2005, en cours de préparation, prévoie une certification des opérateurs de repérage de l'amiante. La réglementation doit fixer un référentiel et une accréditation par le COFRAC, dont l'intérêt serait que les compétences soient évaluées de la même manière par les organismes certificateurs. Le référentiel devrait prévoir soit une formation initiale, soit une expérience dans le bâtiment, et une formation spécifique aux risques. Le décret devrait également définir la fréquence de la surveillance et du renouvellement de la certification. Ce système génèrerait certainement un surcoût pour les propriétaires. Mais il comporterait aussi un gain manifeste en termes de santé des travailleurs et en termes de prévisibilité et de continuité des travaux pour les maîtres d'œuvre de grands chantiers. Proposition : Créer une certification obligatoire : « opérateurs de repérage de l'amiante », exigeant une formation améliorée, une expérience obligatoire dans les métiers du bâtiment ou du diagnostic, et le respect de pratiques professionnelles rigoureuses. b) Les modalités de réalisation des différents types de diagnostics présentent des lacunes. La mission a constaté que le relatif échec de la réglementation sur la protection des populations tenait à certaines faiblesses du dispositif lui-même. Il convient à cet égard de distinguer le diagnostic des flocages, calorifugeages et faux plafonds et la constitution des DTA. ● Pour le diagnostic des flocages, calorifugeages et faux plafonds Les auditions de la mission ont fait apparaître trois difficultés : - La grille d'évaluation des flocages, calorifugeages et faux plafonds n'est pas un outil suffisamment rigoureux. La grille d'évaluation de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante (MCA) ne comporte que quatre critères qui sont définis de façon très succincte. Par exemple, la grille d'évaluation ne tient pas compte du critère d'activité et d'occupation du local. Par ailleurs, pour chacun de ces critères les trois niveaux de cotation - faible, moyen, fort - sont jugés rudimentaires, de sorte que la subjectivité de l'opérateur peut être lourde de conséquences sur les obligations du propriétaire. Cette grille a d'ailleurs fait l'objet de critiques très vives de la part des témoins qui ont généralement considéré qu'elle n'était pas à la hauteur des enjeux liés aux diagnostics. Mme Marie-Annick Billond-Galland, chef du laboratoire d'étude des particules inhalées (LEPI) de la Ville de Paris a notamment fortement critiqué son absence de rigueur scientifique, en la comparant avec celle du système américain d'évaluation du risque. Elle a notamment estimé que ces critères avaient été choisis pour leur facilité de mise en œuvre, plutôt que pour leur pertinence en termes d'évaluation des risques encourus par les populations66. La mission préconise par conséquent que les modalités d'évaluation de l'état de dégradation des flocages, calorifugeages et faux plafonds soient révisées, au profit de critères plus pertinents, comme l'occupation des locaux ou la friabilité potentielle du matériau, dont la difficulté ne devrait plus freiner des opérateurs certifiés et compétents. Au contraire, la mission considère que de tels critères seraient de nature à structurer le marché du diagnostic, qui ne fait pas état d'une pénurie d'opérateurs : il y en a au moins 6000. La mission recommande également que le ministère de la santé mette en place des campagnes d'intercomparaisons de diagnostics, analogues à celles réalisées tous les ans par l'INRS pour les laboratoires d'analyse des mesures d'empoussièrement. Ces comparaisons permettraient de s'assurer statistiquement de la bonne qualité des pratiques des opérateurs de repérage. Propositions : - Réviser la grille d'évaluation de l'état de conservation de l'amiante en place, en ajoutant des critères plus précis d'estimation du risque. - Mettre en place des campagnes d'intercomparaison des diagnostics - Le seuil de déclenchement des travaux peut paraître élevé. Le seuil de 5 fibres par litre a été défini en référence à la présence d'amiante dans l'air ambiant à Paris dans les années 70. Or, une étude du Laboratoire des particules inhalées de Paris (LEPI) de 1994 montre que ce taux serait aujourd'hui de 0,5 fibre par litre d'air. On peut dès lors se demander si le seuil de 5 fibres par litre est encore pertinent. Au vu des moyens dont disposent les laboratoires actuels, la difficulté d'établir des mesures fiables au fur et à mesure que l'on se rapproche de la valeur limite zéro ne devrait pas empêcher de revoir ce seuil à un niveau plus protecteur des populations. La mission a relevé, en outre, qu'une modification du seuil déclencheur peut ne remettre en cause aucun diagnostic déjà réalisé, ni créer de nouvelle obligation à l'encontre des propriétaires, contrairement aux ajouts successifs de nouveaux diagnostics dans la réglementation depuis 1996. La mission suggère que le ministère de la santé étudie la possibilité de fixer un nouveau seuil déclencheur de travaux obligatoires, au regard notamment du degré de pollution atmosphérique moyen constaté à l'air libre. Devraient également être prise en compte la possibilité d'établir un double critère, qui tiendrait compte de la fréquentation du local empoussiéré. Toutefois, si un nouveau seuil, unique ou complémentaire, était établi, il conviendrait de ne le rendre applicable qu'aux nouvelles mesures réalisées à compter de la révision de la réglementation, qu'elles soient le fait d'un repérage nouveau, ou nouvellement justifiées par la dégradation des matériaux, ou encore organisées dans le cadre de la surveillance régulière des matériaux moyennement dégradés. Proposition : Abaisser, pour les mesures d'empoussièrement effectuées à l'avenir, le seuil réglementaire de déclenchement des travaux à 0,0005 f/ml, ce qui correspond au niveau actuel de pollution environnementale ambiante. - Le choix des travaux à réaliser en cas de dégradation est libre. Comme cela a été dit, le choix des méthodes de travail propres à réduire les risques (confinement / retrait) est laissé à la libre appréciation du propriétaire. Pourtant, en cas de confinement, le risque de dégradation demeure et, surtout, le risque d'exposition à l'amiante est élevé lors des travaux de maintenance. Plus grave encore, il semblerait, selon certains témoins, que le choix soit souvent opéré en fonction de critères financiers. Il ressort des auditions que les démarches précipitées de retrait systématique, effectuées pendant la période consécutive à l'interdiction, souvent mal encadrées, ont constitué les pires solutions. Mais en définitive, le choix du confinement, par encoffrement ou fixation, ne serait par le meilleur, comme l'a expliqué M. Bruno Chevallier, vice-président du SYRTA67 : « Le problème, est que l'enlèvement est considéré plus cher que l'encoffrement avec du placoplâtre ou un faux plafond étanche, ou que l'imprégnation avec une colle ou une résine. En réalité, les frais fixes du chantier sont identiques dans les deux cas, car la réglementation impose un confinement statique de la zone pour travailler l'amiante. Le coût du traitement par imprégnation ou coffrage revient par conséquent aux deux tiers ou à 70 % d'un enlèvement pur et simple. Et l'économie est d'autant plus maigre que dans ce cas s'ajoutent des contrôles nécessaires de l'empoussièrement dans le temps : sur dix ans, les 30 % gagnés seront largement perdus. » Selon le SYRTA, le confinement ne serait avantageux que comme mesure conservatoire, permettant de repousser en toute sécurité des travaux de retraits, qui sont plus coûteux sur le court terme68. La mission a cependant eu du mal à apprécier l'exacte portée du raisonnement financier, car le raisonnement de M. Chevallier ne semble pas inclure le coût du traitement des déchets, qui peut s'avérer sensiblement plus élevé dans l'hypothèse du retrait que dans celle du confinement, ainsi que le coût du remplacement de l'amiante là où il est retiré. En l'absence de certitude sur le comparatif financier, la mission a considéré que la préoccupation sanitaire devait être privilégiée. Deux facteurs liés à la protection des populations militent pour la solution du retrait : - le confinement pose un problème de garantie de sécurité, notamment vis-à-vis des règles de protection contre l'incendie69 ; - le confinement pose surtout un problème de gestion de l'amiante en place dans le temps. En effet, outre la surveillance de la dégradation du nouveau revêtement imposée par la réglementation, la persistance d'un matériau amianté dans le bâtiment déplace le risque vers les travailleurs chargés de la maintenance, de l'entretien, ou de la réhabilitation, qui devront l'intégrer dans leurs préoccupations de sécurité. La mission propose en conséquence que soit envisagée une action d'encouragement en faveur du retrait de l'amiante, plutôt que du confinement, tout en laissant une souplesse permettant de gérer des bâtiments aux contraintes spécifiques. Afin de pallier les problèmes de trésorerie liés au surcoût de cette solution sur le court terme, l'Etat pourrait envisager, avec l'ANAH70, un système d'avance, remboursable. Propositions : - Encourager le retrait de l'amiante en place lorsque son traitement est nécessaire plutôt que son confinement, qui multiplie les mesures de l'état de conservation et accroît donc les coûts à long terme. - Envisager une avance de fonds remboursable pour inciter les propriétaires à choisir le retrait plutôt que le confinement. Cette avance pourrait être versée par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui octroie déjà des aides financières pour les diagnostics. ● Pour la constitution du dossier technique amiante (DTA) Trois limites à l'efficacité du dossier technique amiante ont été relevées par la mission : il est peu contraignant, incomplet et insuffisamment exploité. - Aucun critère d'évaluation et aucune obligation de travaux n'existe pour les autres matériaux contenant de l'amiante En cas de repérage d'un matériau ou d'un produit dégradé contenant de l'amiante, il n'y a ni grille d'évaluation de l'état de conservation, ni d'obligation de mesure de l'empoussièrement de l'air et pas d'obligation de travaux, contrairement aux dispositions applicables aux flocages, calorifugeages et faux plafonds. L'opérateur de repérage doit simplement conseiller le propriétaire en lui préconisant des mesures générales, sans qu'il s'agisse pour autant de prescription de travaux. Une norme NFX 46 020 a, certes, été publiée en novembre 2002 pour encadrer ces activités, mais cette norme n'est imposée par aucun texte réglementaire. Le DTA reste donc aujourd'hui un document obligatoire, mais dont le contenu ne crée aucune obligation à l'encontre du propriétaire. Pourtant, le risque de contamination des populations ne réside pas uniquement dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds, qui sont les matériaux les plus friables et les plus amiantés. Cette limite du DTA est particulièrement critiquable dans les ensembles immobiliers professionnels, publics ou privés, dans lesquels des équipes de maintenance ou d'entretien peuvent intervenir sur, ou à proximité, d'autres matériaux libérant des fibres d'amiante s'ils sont dégradés (colles, joints, etc.). Enfin, l'absence d'évaluation de l'état de dégradation pose la question de la sécurité des travailleurs qui pourront intervenir dans des locaux amiantés, sans information tangible sur le risque encouru du fait de la dégradation des matériaux contenant de l'amiante. - Le repérage réglementaire du DTA est insuffisant car limité à ce qui est directement accessible La constitution d'un DTA complet, obligatoire depuis 2001, est une garantie pour l'information et la protection ultérieure des travailleurs amenés à réaliser des travaux d'entretien ou de maintenance dans les immeubles bâtis. Pourtant, le repérage imposé pour la constitution du DTA se limite à ce qui est directement accessible et n'est donc pas toujours à même de remplir son rôle de prévention pour les travailleurs de la maintenance, qui par définition peuvent être amenés à déstructurer l'existant. Ce risque est, en théorie, limité par les dispositions obligeant un opérateur de travaux à s'informer de tous les risques liés à son chantier. Ainsi, les maîtres d'ouvrage ou donneurs d'ordre ont l'obligation de procéder à un diagnostic complet, non limité aux matériaux accessibles, en application des règles de sécurité des travailleurs71. Toutefois, l'application de cette obligation est loin d'être certaine. En tout état de cause, le but du DTA étant de fournir une information aux intervenants72, il semble contestable que cette information soit tronquée et oblige les opérateurs de travaux ultérieurs à conduire de nouveaux diagnostics, dont le prix sera de toute façon répercuté sur le propriétaire. - Les informations issues des DTA ne sont pas centralisées dans un registre facilement accessible On ne dispose toujours pas aujourd'hui d'une cartographie de l'amiante résiduel ou d'un registre des bâtiments amiantés. Le principe même du DTA est d'être un support d'information communiqué le plus largement possible, dans une perspective de prévention des expositions des populations et des travailleurs. Or il ressort de certains témoignages que cette communication fait problème, dans les cas mêmes où elle est la plus indispensable, c'est-à-dire à l'occasion de travaux conduits dans l'immeuble par une société extérieure73. Des propositions pourtant anciennes avaient été faites dans le sens d'une meilleure communication des diagnostics par le Professeur Claude Got, dans son rapport de 1997 sur « la gestion du risque et des problèmes de santé publique posés par l'amiante en France ». Il les a rappelées au cours de son audition : « Enfin, mon grand regret est de ne pas avoir convaincu les décideurs administratifs et politiques de la nécessité de mettre les diagnostics à disposition de tous, des habitants comme des entreprises qui sont amenées à intervenir. Car quand un client demande un devis pour des travaux, il est difficile pour l'entreprise de demander le diagnostic amiante. Si elle est trop curieuse, elle n'aura pas le marché. Il faudrait donc qu'elle ait accès aux renseignements sans avoir besoin de les demander. Il eût été très simple d'utiliser l'outil informatique existant, celui qui est utilisé par l'administration fiscale pour la taxe foncière et la taxe d'habitation. Il suffisait d'intégrer aux fichiers les données relatives au diagnostic amiante. Cela ne s'est pas fait. Certains prétendent que la CNIL s'y serait opposée et il est vrai qu'elle n'aime pas que les fichiers soient affectés à d'autres usages que ceux pour lesquels ils ont été autorisés. Il me semble pourtant que l'argument est bien léger car la CNIL a été créée par le Parlement et il appartient à celui-ci d'apprécier ce qui relève de la sécurité sanitaire pour en tirer les conséquences sur l'extension de l'usage d'un fichier.74 » La mission préconise donc, comme pour les diagnostics des flocages, calorifugeages et faux plafonds, qu'une réforme du DTA soit conduite pour améliorer le repérage et centraliser les informations. Propositions : - Compléter les obligations de repérage de matériaux contenant de l'amiante lors d'interventions de travaux et de réhabilitation, en prévoyant, par exemple, une obligation de recherche plus approfondie d'amiante (avec sondage) avant tous travaux conduits par une société extérieure. Le propriétaire serait bien sûr libre de procéder dès le DTA initial à un repérage approfondi. - Compléter le repérage visuel figurant dans le DTA par une évaluation plus précise de la dangerosité des matériaux, comme c'est le cas pour les diagnostics portant sur les flocages, calorifugeages et faux plafonds. Une meilleure formation des opérateurs de repérage leur permettra d'apprécier ce risque en fonction des situations (travaux, déplacements, nettoyages, entretien, etc.). - Créer un outil de centralisation et de consultation des diagnostics effectués. Ce registre centralisé des DTA, facilement accessible, serait un élément central de prévention. Une réflexion doit être engagée sur la possibilité d'exploiter à cette fin les bases de données fiscales, ou du cadastre75. 3.- L'application de la réglementation est source de difficultés Une des principales sources des difficultés concernant le diagnostic de l'amiante dans les immeubles bâtis tient à l'absence de contrôle de l'application de la réglementation. Cette réglementation relevant du ministère de la santé, le contrôle de son application incombe logiquement aux services déconcentrés de ce ministère : Directions départementales de l'action sanitaire et sociale (DDASS) et Directions régionales de l'action sanitaire et sociale (DRASS). La mission a dressé un double constat : d'une part, les contrôles menés par le ministère de la santé n'ont touché que les établissements de santé ; d'autre part, l'application de la réglementation n'a été évaluée que tardivement et de façon incomplète. a) L'application de la réglementation est mal contrôlée Il n'existe aucun mécanisme efficace de contrôle de l'application de la réglementation par le ministère de la santé et ses services déconcentrés, DDASS et DRASS. A la suite du rapport du professeur Claude Got, en 1998, l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) avait pourtant préconisé la mise en place de moyens importants pour assurer un contrôle aléatoire du respect des obligations par les propriétaires, les infractions devant être assorties de sanctions sévères. Mais il ne semble pas que ces préconisations aient été suivies d'effet. Il convient toutefois de noter que ce contrôle de la réglementation est délicat. Celle-ci concerne en effet tous les propriétaires publics ou privés, et impose plusieurs types de diagnostics, à l'encontre desquels des délais différents s'appliquent. Les services sanitaires ne peuvent consacrer leur action au contrôle de l'ensemble du patrimoine immobilier bâti. La mission a cependant relevé que la réglementation elle-même n'avait pas organisé de moyen de contrôle pertinent. Au contraire, l'absence de centralisation des informations contenues dans les DTA, déjà critiquée, ne créée pas les conditions nécessaires d'un contrôle déconcentré. Le Gouvernement a bien cherché à vérifier le respect des obligations incombant au propriétaire, par exemple en imposant aux opérateurs de repérage la remise d'un rapport annuel d'activité76. Mais ces informations agrégées ne permettent qu'une évaluation imparfaite de la réglementation, comme on le verra plus loin. Dans une circulaire du 10 décembre 200377, le ministre de la santé a également demandé à ses services de contrôler l'application de la réglementation, mais la portée de ce contrôle doit être relativisée, dans la mesure où seuls les établissements recevant du public sont véritablement concernés78. Par ailleurs, les modalités du contrôle proposées aux services sanitaires sont discutables. Écartant l'hypothèse d'un contrôle exhaustif, la circulaire propose d'effectuer par sondages, ou encore de contrôler les DTA à l'occasion de visites portant sur un tout autre objet79. En définitive, le bilan de ce contrôle est conforme à ce qui pouvait en être attendu. La priorité donnée aux établissements sanitaires et sociaux s'est traduite par des enquêtes approfondies et itératives, permettant, en 2005, de disposer d'informations précises sur le diagnostic amiante de ces établissements, et même sur la part des travaux effectifs de traitement de l'amiante en place. En revanche, sans préjuger des éventuelles actions menées par les services déconcentrées sur les autres types d'établissements, la mission a constaté qu'aucune information n'était disponible sur les contrôles des obligations incombant aux propriétaires. Comme le présageait déjà M. Bernard Peyrat, au cours de son audition du 22 juin 2005 : « Nous nous retrouverons donc au 1er janvier prochain avec des obligations réglementaires dont il sera impossible de vérifier le respect. Ce document devient pourtant la référence en matière d'analyse du risque encouru par les populations habitant les immeubles et les entreprises de travaux. » La mission ne peut malheureusement que donner raison au président du SYRTA. La mission recommande par conséquent au ministère de la santé de mettre en place une politique ambitieuse de contrôle des obligations relatives aux diagnostics amiante. Ce contrôle doit emprunter un double canal : - Premièrement, une action en direction des syndics de copropriété, qui gèrent une grande part de l'immobilier privé français soumis aux obligations de diagnostic (les maisons individuelles étant exclues du dispositif, sauf en cas de vente). Il conviendrait de demander communication des fiches récapitulatives obligatoires des DTA des immeubles gérés par les syndics. Par ailleurs, une action visant les principales sociétés de gestion immobilière aurait déjà un impact significatif en termes de contrôle. Cette communication ne peut être refusée aux fonctionnaires et agents du ministère de la santé, en application de l'article R. 1334-28 du code de la santé publique80. Un tel dispositif ne permettrait sans doute pas de contrôler complètement la qualité des DTA, mais au moins d'en vérifier l'existence, les délais de réalisation étant clos. - Deuxièmement, le ministère de la santé doit imposer un échantillonnage de contrôles qualitatifs aléatoires aux services déconcentrés. Ces contrôles pourraient être établis en fonction de la transmission des fiches récapitulatives, rappelée ci-dessus. Une telle campagne de contrôle doit surtout faire l'objet d'une communication importante à destination des propriétaires privés et des gestionnaires de copropriétés afin de les sensibiliser au risque de sanction encouru. Ces sanctions, prévues par l'article R 1336-3 du code de la santé publique, peuvent en effet être prononcées par la justice sur procès verbal établi par les services sanitaires (article L. 1312-1 du même code). Propositions : - Demander aux syndics de copropriété de transmettre aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales les fiches récapitulatives des DTA, pour que celles-ci puissent vérifier que les obligations sont respectées. - Établir un plan de contrôle sélectif de la qualité des DTA en fonction des données transmises dans les fiches. - Sensibiliser les propriétaires sur les risques de sanction encourus si les DTA ne sont pas, ou mal, réalisés. b) L'évaluation de l'application de la réglementation a été trop tardive La transmission des rapports d'activité annuels des opérateurs de repérage à l'administration, en application de l'arrêté du 2 décembre 2002, devait permettre une évaluation de l'application de la réglementation de protection des populations contre l'exposition à l'amiante. Jusqu'en 2005, ces informations sont restées inutilisées. En 2005, le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) a lancé, à la demande et grâce aux financements du ministère de la santé, une évaluation de l'application de la réglementation relative à la protection de la population contre l'exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. Menée en coordination avec son ministère de tutelle (ministère du logement), cette enquête se fonde non seulement sur les rapports annuels des opérateurs de repérages transmis en 2003 mais aussi sur les données du bilan réalisé sur les établissements sanitaires et sociaux et les informations en cours de constitution sur les établissements scolaires. Il était prévu que les conclusions de l'étude soient rendues fin 2005, mais ce délai n'a pu - semble-t-il - être respecté, la mission n'ayant obtenu communication d'aucun résultat. Cette étude approfondie doit déterminer la proportion de bâtiments contenant de l'amiante, le taux de réalisation des dossiers techniques amiante (DTA) pour chaque catégorie de bâtiments, les types de matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments, la proportion de travaux réalisés, la qualité des opérateurs de repérages et le comportement des acteurs du dispositif. Mais, comme l'a indiqué M. Christian Cochet du CSTB, l'intérêt de cette étude risque d'être affaibli par le fait que les rapports d'activité des diagnostiqueurs traitent de données qui sont déjà agrégées : par exemple, elles n'indiquent pas la quantité d'amiante contenue dans les bâtiments. Par ailleurs, sur environ 6 000 diagnostiqueurs recensés, seuls 1 000 auraient fait parvenir leur rapport d'activité (Source DGUHC81). Enfin, cette enquête ne permettra pas de mesurer l'exposition de la population car elle ne comporte aucune indication sur les populations fréquentant les locaux concernés.82 Alors que l'interdiction de l'amiante et les obligations de diagnostic datent de 1997, la mission a regretté que ces évaluations soient si tardives et si proches des échéances des obligations réglementaires. C.- LE SECTEUR DU DÉSAMIANTAGE EST BIEN ENCADRÉ, MAIS SUBIT DES COÛTS QUI FRAGILISENT LE RESPECT DES CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES L'objectif de la règlementation du traitement de l'amiante en place est aussi de protéger les travailleurs chargés des opérations de retrait ou de confinement. Trois constats se sont imposés à la mission : ces travailleurs ne sont pas bien identifiés et leur protection est variable en raison d'une distinction réglementaire discutable entre amiante friable et non friable. Par ailleurs, la réglementation ne permet pas une appréciation satisfaisante du risque. Enfin, les contrôles indispensables sur ce secteur se révèlent inefficaces. 1.- Une distinction discutable entre amiante friable et non friable La réglementation a organisé le secteur du traitement de l'amiante en place autour d'une distinction fondamentale entre le traitement de l'amiante friable (de type flocage au plâtre) et celui de l'amiante lié à un produit inerte, dit « non friable » (amiante-ciment, ou dalles en vinyle/amiante, par exemple). Il faut ici rappeler les propos de M. Goldberg au sujet de l'amiante lié : « Le simple fait de côtoyer ce matériau n'est pas en soi dangereux. Le risque apparaît quand les fibres d'amiante se répandent dans l'atmosphère 83 ». L'amiante lié appelle donc une application du principe de précaution, mais n'impose pas en lui-même de traitement particulier, contrairement à l'amiante friable. Pourtant, la distinction a été remise en cause par de nombreux témoignages en raison des risques sanitaires qu'elle comporte. a) La distinction a des répercussions regrettables sur le marché du traitement de l'amiante en place L'article 26 du décret n° 96-98 distingue le traitement de l'amiante friable de celui de l'amiante lié sur deux points : la qualification des intervenants et les « règles de l'art »84. Les travaux de la mission ont fait apparaître que cette distinction a sans doute contribué à ce que les obligations réglementaires de traitement de l'amiante lié soient moins bien respectées. ● Des acteurs inégalement qualifiés, dont les métiers diffèrent La distinction a pour effet de limiter aux seules entreprises traitant l'amiante friable l'obligation d'obtenir une qualification. Cette qualification est obtenue auprès d'organismes certificateurs et se fonde sur des critères et des contrôles très rigoureux, notamment la vérification du respect des nombreuses contraintes réglementaires (recrutement et formation des personnels, suivi médical, équipements de protection, analyse des risques, gestion des déchets, méthodes de travail, etc.). Pour les entreprises du secteur de l'amiante friable, cette obligation engendre des coûts particuliers, auxquels s'ajoutent les contraintes matérielles inhérentes à la pratique d'un métier dangereux. La mission a d'ailleurs pu vérifier la difficulté du métier de « désamianteur » à l'occasion d'une visite d'un chantier à Paris et M. Guy Jean, président de la société Sobaten, a présenté certaines particularités du métier85 : « Sur un chantier type, un agent entre trois fois deux heures ou deux heures et demie en zone, selon la nature et la pénibilité des travaux. Au-delà de vingt-quatre degrés, la durée d'intervention est réduite graduellement en fonction de la température. L'agent est équipé d'un « panoramasque » alimenté en adduction d'air ou en ventilation assistée. Chaque cartouche coûte un peu plus de 18 euros, une cartouche par entrée en zone étant nécessaire pour l'adduction d'air et deux pour la ventilation assistée. Tous les vêtements - la combinaison, mais aussi les chaussettes, le slip et le maillot de corps, plus deux paires de gants - ne servant qu'une fois, soit plus d'une centaine d'euros par opérateur et par jour, rien qu'en équipement jetable. C'est le seul moyen de se protéger efficacement. C'est pourquoi une entreprise qui propose d'intervenir pour 250 à 300 euros la journée n'est pas crédible : dans certaines d'entre elles, on travaille toute la semaine avec la même cartouche. Pour couronner le tout, après chaque intervention, l'opérateur doit prendre deux douches : la première avec son équipement, pour se dépoussiérer - l'ensemble du matériel et de vêtements étant ensuite envoyé vers une décharge de classe 1 ou le centre d'inertage -, et la seconde sans aucun vêtement. En fin de journée, celui qui est entré trois fois en zone sera donc passé six fois sous la douche ! » Les témoins ont unanimement salué l'efficacité du système de qualification applicable au traitement de l'amiante friable. Si des contraventions subsistent dans ce secteur, tous considèrent que le contrôle exercé par les organismes est suffisamment rigoureux86. À l'inverse, les interventions sur l'amiante lié sont soumises à des obligations de qualification beaucoup moins fortes - et donc moins coûteuses. Il en résulte un partage du marché entre deux catégories d'acteurs dont l'activité n'est pas encadrée et contrôlée de la même façon et qui sont soumis à des contraintes financières différentes, alors même que la réglementation relative à la protection des travailleurs leur impose des obligations identiques. Ces différences se traduisent par un moindre respect de la réglementation dans le traitement de l'amiante lié. ● Des obligations réglementaires communes, mais moins bien respectées dans les secteur de l'amiante lié À l'exception de celles inscrites à l'article 26 précité, les obligations de la section 2 (traitement de l'amiante) du décret du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs valent quelle que soit la nature du matériau encoffré ou retiré, et donc quel que soit l'acteur. Il s'agit notamment de la production de plans de retrait ou de confinement destinés à l'inspection du travail, mais également de la formation des personnels, de la mise à disposition d'équipements de protection, ou encore des suivis médicaux par la production de fiches d'exposition à l'amiante. L'inobservation de la réglementation constatée dans le secteur de l'amiante lié concerne notamment la réalisation elle-même des plans de retrait ou de confinement, alors que ces documents constituent le socle du contrôle des obligations réglementaires. C'est le constat établi par M. Jacques Le Marc, inspecteur du travail qui a parlé de « chantiers inconnus »87. Plus encore, il a contesté la qualité des plans de traitement quand ils existent : « Le plan de retrait est obligatoire pour le retrait des matériaux friables comme non friables. Mais, si pour les matériaux friables la réglementation est globalement respectée, pour les non friables, nous recevons des plans de retrait qui sont bien souvent formels et pas vraiment adaptés au chantier : le copier/coller a fonctionné, seules changent les références du chantier. En pratique, la procédure et les techniques à respecter seront ignorées. » Cette critique n'est pas isolée. Elle a été confirmée par un autre inspecteur du travail, M. Éric Jany88, et par le bilan de la campagne nationale de contrôles menée par l'inspection du travail en 2005. La mission a d'ailleurs constaté que l'obligation du plan de retrait dans le cas de matériaux non friables était appréciée diversement par les spécialistes89. Au-delà des plans de retrait, il ressort des résultats de la campagne de 2005 que les infractions à la réglementation sont globalement plus nombreuses dans le secteur de l'amiante lié. Comme M. Alain Fraisse, secrétaire régional Sud-est de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), l'a indiqué à la mission90 : « Le traitement des matériaux non friables est effectué correctement à 50 % et, pour le reste, de façon anarchique, sans plan de retrait ni évacuation des déchets en décharge. » La distinction entre amiante friable et amiante lié conduit donc à un partage regrettable des acteurs du traitement de l'amiante résiduel en deux catégories : - les acteurs très bien identifiés de l'amiante friable, qui assument le coût de leur qualification, qui sont facilement contrôlables et qui sont globalement respectueux de la réglementation ; - les acteurs moins identifiés de l'amiante non friable, qui ne sont pas certifiés - ce qui réduit le coût des interventions -, alors qu'ils sont soumis à des obligations réglementaires très importantes, dont le respect est très difficile à contrôler - surtout en l'absence de plan de retrait. La mission a pu constater que, sur le plan technique, la distinction entre amiante friable et amiante lié pouvait se justifier mais que son maintien est source de dangers pour les travailleurs et les populations. ● Une distinction pragmatique dont la pertinence est aujourd'hui discutable La distinction a une origine purement pragmatique : il s'agissait de répondre convenablement, et dans l'urgence, aux préconisations nées de l'interdiction de l'amiante en 1997. Tout comme pour le diagnostic, la réglementation a hiérarchisé le traitement des produits et matériaux en fonction de critères de dangerosité établis in abstracto. Les matériaux que l'expertise de l'INSERM de 1996 avait classés comme les plus risqués pour les populations et les personnels ont tout simplement fait l'objet d'une réglementation plus stricte que les autres. C'est ce que M. Michel Ricochon, chef de la mission d'animation des services déconcentrés au ministère du travail, a expliqué à la mission91 : « Pour revenir à la distinction entre amiante friable et non friable, il convient de rappeler la réalité à laquelle nous avons été confrontés en 1996-1997, lorsque nous avons commencé à travailler sous le régime de la nouvelle réglementation. Premièrement, si la même exigence avait été posée pour l'amiante friable et non friable, il aurait été impossible de répondre à la demande, eu égard au faible nombre d'entreprises dotées de personnel qualifié. Face à un risque difficile à appréhender dans sa globalité, une montée en charge des entreprises qualifiées a été nécessaire. Deuxièmement, la mise en œuvre de tout l'arsenal de protection, très contraignante, génère des surcoûts importants. Dès lors, une question se pose : le risque peut-il être jugulé sans que tous ces moyens soient mobilisés ? Troisièmement - mais cet argument peut paraître spécieux -, si, en toutes circonstances, des contraintes individuelles trop lourdes sont imposées aux salariés au regard du risque qu'ils perçoivent, ils prendront eux-mêmes des libertés avec la sécurité et perdront leurs réflexes face au friable. » Mais ces exigences de sécurité ont évolué en même temps que le rapport au risque. Dans un contexte marqué par l'amélioration technique des diagnostics et par l'émergence d'un marché volumineux et lucratif du traitement de l'amiante en place, la distinction entre amiante friable et amiante non friable pose problème. Conséquence de l'absence de qualification rigoureuse, c'est sur les chantiers des entreprises non certifiées que les services de contrôles ont détecté le plus grand nombre d'irrégularités. Or si des différences entre le traitement de l'amiante friable et de l'amiante non friable peuvent se justifier dans les méthodes employées sur le chantier (par exemple : un moindre confinement de la zone)92, le risque sanitaire ne doit en aucun cas être sous-estimé. Questionnées sur ce point, les personnes auditionnées ont unanimement confirmé que le matériau d'amiante lié ne libère pas de fibres spontanément, mais que toutes les opérations de retrait ou de transformation qu'il subit sont de nature à en libérer en très grand nombre, de sorte qu'il peut être aussi dangereux que l'amiante friable. C'est ce que M. Bruno Chevallier, vice-président du SYRTA, a rappelé93. Ce constat a été repris par plusieurs témoins, par exemple M. Guy Jean de la société Sobaten94 ou encore l'inspecteur du travail M. Jacques Le Marc95 : « Avec mes collègues, nous nous demandons s'il ne faudrait pas exiger que toutes les entreprises soient certifiées, qu'elles retirent de l'amiante friable ou non friable, car de l'amiante non friable peut devenir friable : quand une toiture est retirée, des plaques usées et dégradées tombent au sol et sont sciées. Le chef d'entreprise du bâtiment est-il en mesure, tout seul, d'évaluer convenablement les risques ? Je m'interroge. » ● Réduire la distinction en harmonisant les critères de qualité des intervenants sur l'amiante La mission s'est donc interrogée sur la valeur réelle d'une distinction qui n'a pas de sens sur le plan sanitaire, qui fait peser des exigences de qualité très différentes sur les intervenants et qui engendre des coûts très inégaux pour le propriétaire. Cette situation nuit assurément à la lisibilité du secteur professionnel pour les clients, dans un contexte où l'action publique devrait au contraire décourager tout désamiantage opéré hors des règles de l'art. Pourtant, plusieurs témoins ont insisté sur la nécessité de conserver une proportionnalité entre les risques sanitaires réels et les contraintes pesant sur les acteurs pour éviter que ne se développent des comportements illicites. Comme l'ont rappelé M. Michel Héry de l'INRS96, mais également M. Michel Parigot (ANDEVA), président du Comité anti-amiante de Jussieu97 : « Est-il préférable d'élaborer une réglementation théoriquement parfaite mais qui ne sera pas appliquée, ou bien une réglementation moins parfaite mais applicable ? Certaines interventions sur les matériaux non friables doivent relever de la même réglementation que les opérations sur les friables mais il serait injustifié et inefficace d'imposer les mêmes exigences pour n'importe quel travail au contact de l'amiante. » La mission s'est finalement ralliée à la proposition équilibrée de M. Guy Jean, président de SOBATEN98 : « Il serait souhaitable d'aller vers une qualification par catégories car le retrait de matériaux friables entraîne incontestablement un risque potentiel plus élevé que le retrait de fibrociment ou de dalles de sol, même si ces prestations provoquent aussi une pollution. Les couvreurs ou les sociétés de revêtement de sol, par exemple, seraient qualifiés uniquement pour le retrait de matériaux les concernant. Une qualification unique, sans distinction entre catégories, découragerait tout le monde. Même si le nombre de désamianteurs de friables n'augmentera jamais, il faut encourager les entreprises du bâtiment à suivre une formation spécifique. C'est essentiel pour la régulation du secteur et le suivi des déchets. ». La mission préconise donc de renforcer les exigences de qualification des entreprises intervenant sur l'amiante non friable en leur imposant l'obtention d'une qualification auprès d'organismes certificateurs, sur la base d'un référentiel validé par le COFRAC, pour leurs activités de désamiantage. Ce référentiel devrait cependant différer de celui concernant l'amiante friable, notamment en fonction des différences méthodologiques répertoriées dans la circulaire DRT de 1998, qui pourraient être réévaluées à cette occasion. Ce nouveau dispositif doterait le secteur de véritables outils pour le contrôle que les services de l'Etat ne peuvent actuellement effectuer. Il serait équitable puisque la majorité des contraintes réglementaires s'applique à l'amiante friable comme à l'amiante non friable. Enfin, cette qualification « non friable » éviterait que des entreprises, dont la qualification « friable » a été retirée en raison d'un comportement fautif, ne « fuient » vers le secteur lucratif, actuellement moins encadré, du non friable. Proposition : Prévoir une qualification obligatoire des entreprises traitant l'amiante lié. Le référentiel choisi doit être distinct de celui s'appliquant au traitement de l'amiante friable, car le risque est différent. Ce référentiel doit donc tenir compte d'une réelle capacité à évaluer et à prévenir les risques. 2.- Une prise en compte aléatoire et insuffisante des risques Les auditions et tables rondes de la mission ont permis de constater que de nombreux acteurs placent l'analyse des risques au centre de la sécurité sanitaire et de la protection des travailleurs99. Cette analyse procède de deux idées convergentes : - une appréciation intelligente du risque permet de proportionner la protection et donc les coûts d'intervention ; - une prise en compte plus rigoureuse du risque permet aux travailleurs d'adopter les équipements et les procédures qui leur assurent une garantie durable de protection sur le chantier, sans « mauvaise surprise » susceptible de mettre en cause leur santé. Mais l'analyse du risque ne relève pas exclusivement des professionnels du traitement de l'amiante. En effet, ceux-ci interviennent en aval d'un processus où tous les acteurs portent une part de responsabilité dans l'évaluation des travaux à réaliser et des risques qu'ils engendrent : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, diagnostiqueurs, laboratoires... L'analyse des risques repose donc sur plusieurs dispositifs, que la mission a déjà présentés, et qui concernent - outre la qualité du diagnostic, et particulièrement du DTA100 -, la compétence et la qualification du maître d'ouvrage - ou de son maître d'œuvre -, et la qualité des mesures d'empoussièrement. a) La compétence et la qualification du maître d'ouvrage ou de son maître d'œuvre La compétence des donneurs d'ordres a, bien entendu, une conséquence directe sur la qualité du cahier des charges établi en vue de la passation du marché, puisque les « désamianteurs » sont dépendants des appels d'offre auxquels ils répondent. Ainsi, la passation d'un marché exclusivement fondée sur le critère financier du « moins disant », sans prise en compte des critères qualitatifs liés à la sécurité ou à la protection, conduit inévitablement à retenir des offres peu soucieuses du respect - contraignant et coûteux - de la réglementation. Elle incite également les entreprises à rogner abusivement sur leurs coûts101. Ce point a été soulevé à de multiples reprises au cours des auditions de la mission, notamment par M. Jean102, de la société SOBATEN, M. Piotto103, de l'école supérieure des travaux publics, ou encore M. Héry104 de l'INRS : « des entreprises sont retenues parce qu'elles sont les moins-disantes, alors qu'elles sont loin d'être les mieux-disantes. Le fait de recevoir un devis à 70 % de la moyenne des autres entreprises devrait faire prendre conscience au donneur d'ordre qu'on ne peut pas faire n'importe quoi à n'importe quel prix, ou plutôt qu'à n'importe quel prix on risque de faire n'importe quoi. » Plusieurs témoins ont donc soulevé la question de la formation des maîtres d'œuvre, voire de leur qualification. C'est le cas notamment de M. Cochet105, et de M. Piotto106 : « Je pense que dans la formation des maîtres d'œuvre, des ingénieurs ou des techniciens supérieurs, on pourrait imaginer que soit créée une option amiante. Aujourd'hui, lorsqu'un étudiant sort de l'école, tout juste connaît-il l'existence de l'amiante. ». M. Michel Parigot, président du « Comité anti-amiante de Jussieu », a, quant à lui, posé la question de la cohérence globale de la chaîne de traitement de l'amiante en place2 : « Alors que l'entreprise qui mène le chantier a une obligation de compétence et de qualification, celui qui conçoit le chantier n'y est aucunement soumis. Dès lors, pour un certain nombre de chantiers complexes, les maîtres d'oeuvre mettent les entreprises en grande difficulté. Il faudrait imposer une qualification. ». La mission a en effet considéré que le payeur, public ou privé, qui passe commande auprès des entreprises de désamiantage ou de maintenance a un rôle à jouer dans le bon fonctionnement du marché. Il semble donc indispensable d'obliger les commanditaires à être plus vigilants sur le respect des principes de sécurité : qualité du diagnostic, communication des documents aux entreprises, analyse préalable et sérieuse du risque, établissement de cahiers des charges réalistes tenant compte des risques analysés. Pour atteindre cet objectif, la mission recommande un certain nombre de mesures relatives à la passation des marchés de désamiantage : - responsabiliser par la loi ou le règlement le commanditaire de travaux mettant en jeu l'amiante de façon explicite, ou - surtout - lorsque de l'amiante est rencontré en cours de chantier ; - réformer les procédures de passation des marchés, afin que le traitement de l'amiante fasse systématiquement l'objet d'un lot spécifique, dès lors que sa présence est avérée. S'agissant de la commande publique, l'Etat et les collectivités territoriales pourraient se voir adjoindre le conseil obligatoire des services de la Direction des relations du travail pour l'attribution de marchés liés à l'amiante ; - introduire expressément des préoccupations de sécurité, en particulier liées à l'amiante, dans la formation ou la qualification des acteurs jouant un rôle dans la définition de la commande de travaux, ou dans la coordination des entreprises intervenantes (coordonnateurs SPS notamment) ; - organiser la certification des maîtres d'œuvre. Cette proposition, déjà évoquée pour améliorer l'exigence de diagnostic, s'impose également pour le marché du traitement de l'amiante afin de mieux prendre en compte la sécurité des travailleurs et des populations. Les maîtres d'œuvre remplissent en effet un rôle essentiel - au premier rang duquel l'élaboration du cahier des charges107. Le système de la certification - extrêmement précis - faciliterait également les contrôles systématiques. Propositions : - Réformer les procédures de passation des marchés, afin que le traitement de l'amiante fasse systématiquement l'objet d'un lot spécifique. - Prévoir pour les coordinateurs Sécurité et protection de la santé une formation sur les risques liés à l'amiante. - Créer une certification des maîtres d'œuvre, sur la base de référentiels incluant les obligations de repérage, mais aussi la capacité à évaluer les chantiers de traitement de l'amiante, friable ou non, et à éliminer convenablement les déchets. b) La qualité des mesures d'empoussièrement Des mesures d'empoussièrement doivent obligatoirement être réalisées sur le chantier afin de garantir l'efficacité des mesures de protection collective de la population et des travailleurs. Toutefois, l'absence de prescriptions réglementaires précises sur ces mesures a été présentée lors des auditions comme une source de confusion, et donc de coûts ou de risques. Si sur le chantier, sans doute exemplaire, que la mission a visité, l'air était mesuré en continu, au travers des analyses effectuées 5 fois par jour dans un laboratoire agréé, la réglementation ne prévoit ni la fréquence de ces contrôles, ni la qualification du laboratoire qui procède à la métrologie. Ce point a été en particulier critiqué par M. Laurent Martinon, chef adjoint du laboratoire d'étude des particules inhalées (LEPI) de la ville de Paris108 : « En 2002, nous avons fait une étude pour le ministère de la recherche et constaté sur deux chantiers de désamiantage un grand déficit de métrologie. À ce jour, les seuls contrôles obligatoires sont le contrôle libératoire de fin de chantier en microscopie électronique et, parfois, des mesures dans le sas où les ouvriers enlèvent leurs protections respiratoires, ici en microscopie optique. Mais ces derniers contrôles sont des mesures d'hygiène du travail qui peuvent être réalisées sans qu'il soit besoin d'agrément. Pendant deux ans, nous avons voulu multiplier les mesures avant, pendant et après le chantier - y compris après le contrôle obligatoire de restitution - et nous avons constaté que dans de nombreuses situations des salariés étaient exposés, alors qu'ils pensaient ne pas l'être. » Cette grande latitude d'action paraît décalée par rapport aux normes de protection en vigueur sur les chantiers de désamiantage. Ainsi M. Florio a-t-il indiqué avoir régulièrement reçu des propositions de gratification en nature de la part de laboratoires, partenaires indispensables de son entreprise, mais dont l'indépendance devrait être une ligne de conduite irréprochable109 . La mission recommande donc de préciser la réglementation sur les mesures d'empoussièrement effectuées pendant et après un chantier. L'absence de préconisation claire nuit aujourd'hui à l'homogénéité des coûts obligatoires supportés par les entreprises, et autorise un certain laxisme. Les laboratoires procédant à ces contrôles ne sont pas non plus contrôlés, et cela parait contraire au système d'agréments qui prévaut tout au long de la chaîne de traitement de l'amiante. Propositions : - Préciser la réglementation sur les mesures d'empoussièrement effectuées pendant et après un chantier, notamment leurs modalités et leur fréquence, afin de réguler des pratiques actuellement très hétérogènes. - Soumettre les laboratoires effectuant des mesures d'empoussièrement sur les chantiers à une procédure d'agrément similaire à celle des laboratoires intervenant pour les diagnostics. 3.- La relative inefficacité des contrôles publics sur le secteur du traitement de l'amiante en place Au cours de ses auditions, la mission a pu recueillir un grand nombre de propos, souvent très libres, laissant entendre que le secteur du traitement de l'amiante résiduel fait intervenir une très grande diversité d'acteurs dont le souci de respecter les contraintes réglementaires est très inégal. Les comportements sont souvent peu rigoureux ou parfois même clairement illicites. La réglementation qui encadre ce marché pourrait même, comme la mission a pu le constater, créer des discriminations entre les entreprises : les plus soucieuses de sécurité sont en effet les plus chères. Alors que le respect des règles de protection des travailleurs devrait être un critère de choix pour l'acheteur ou le maître d'œuvre, ce dernier Dans un tel contexte, où le marché « favorise », dans une certaine mesure, les manquements à la réglementation, et où le contrôle des prescriptions règlementaires devrait jouer un rôle capital, les auditions n'ont pas rassuré la mission sur l'efficacité de ce contrôle. Plusieurs constats d'insuffisance ont ainsi pu être dressés. a) Le contrôle par l'inspection du travail. Le contrôle exercé par l'inspection du travail repose sur une procédure essentielle : l'établissement par l'entreprise d'un plan de retrait ou de confinement de l'amiante détaillant les méthodes, procédures et contrôles qui seront mis en œuvre par l'entreprise, à l'exception - et la mission n'a pu que le regretter - de la gestion des déchets qui échappe ainsi au contrôle de l'Etat. Les auditions ont permis de constater que ces plans ne sont pas systématiquement établis ou transmis aux services de l'Etat ou de la sécurité sociale, privant ainsi l'Inspection du travail de l'outil indispensable à l'accomplissement de son travail de contrôle. Les représentants de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) et du Syndicat de retrait et de traitement de l'amiante et des autres polluants (SYRTA) ont fourni un premier élément d'explication à cette situation : l'entreprise qui transmet un plan de retrait s'expose à un contrôle - certain sur le plan lui-même, potentiel sur le chantier ultérieur -, et n'est donc pas toujours incitée à la plus grande transparence111. Une autre insuffisance du processus de contrôle tient au fait que l'inspection du travail souffre structurellement de deux faiblesses, reconnues par ses représentants à tous ses échelons jusqu'à celui du ministère de tutelle lui-même112 : - il s'agit d'un corps qui manque de personnel au regard des effectifs constatés dans les autres pays de l'Union européenne ; - il s'agit d'un corps à vocation généraliste, qui ne peut se spécialiser sur des métiers aussi techniques que ceux du traitement de l'amiante résiduel. Ces faiblesses empêchent l'inspection du travail de déployer un contrôle d'une qualité équivalente à celle des organismes certificateurs, par exemple. Dans ce contexte, une meilleure transmission des plans de retrait offrirait à l'inspection du travail la possibilité de travailler en amont en collaboration avec les entreprises de l'amiante, ce qui réduirait les risques sanitaires par des moyens moins coûteux que les contrôles sur place nécessaires à des arrêts de chantier. La mission a été convaincue de la nécessité d'encourager la transmission de ces documents. b) Le contrôle par la médecine du travail. Tout comme l'inspection du travail, la médecine du travail exerce son action de contrôle sur la base des informations qui lui sont transmises par les entreprises. Destinataire pour avis des plans de retrait ou de confinement, le médecin du travail peut conseiller l'entreprise sur la protection de ses personnels, ou émettre des réserves allant jusqu'au refus du plan. La médecine du travail est également dépositaire des documents retraçant l'exposition avérée ou potentielle des travailleurs de l'amiante113. Les auditions de la mission, notamment celle du médecin conseil de l'OPPBTP (organisme également destinataire des plans et fiches d'exposition) ont permis de constater, comme pour l'inspection du travail, un problème de transmission des documents réglementaires à la médecine du travail. Il en résulte pour celle-ci une réelle difficulté d'exercice de sa mission : tant celle de suivi médical des salariés exposés à l'amiante, que celle de prévention et d'information à destination des personnels et des établissements travaillant sur l'amiante résiduel. Le problème du rôle et des moyens de la médecine du travail fera l'objet d'un développement dans la seconde partie du présent rapport. c) Le contrôle par la CNAMTS et les CRAM. Associés à l'inspection du travail et à la médecine du travail lors des campagnes de contrôles réalisées en 2004 et 2005 (voir ci-après), les organismes de la sécurité sociale ont également un rôle à jouer dans le contrôle du secteur du traitement de l'amiante résiduel. En effet, le défaut de protection des travailleurs - c'est-à-dire les manquements aux prescriptions du décret n° 96-98 - peut engendrer une multiplication de pathologies liées à l'amiante (plaques pleurales, asbestose, cancer), comme a pu le vérifier l'OPPBTP114. Ces pathologies professionnelles sont prises en charge par la branche « accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) » de la CNAMTS, elle-même financée par les cotisations patronales. Au-delà des aspects strictement sanitaires, la sécurité sociale a donc un intérêt économique immédiat à l'amélioration du contrôle de la réglementation du travail en matière d'amiante résiduel. Destinataire, elle aussi, des plans établis par les entreprises, son pouvoir se limite toutefois à la possibilité d'infliger une surcotisation à une entreprise contrôlée dont le chantier ne respecterait pas la réglementation. Dans ce cas, la CRAM peut bien entendu également saisir l'inspection du travail pour tenter de faire cesser l'irrégularité. d) Les enquêtes de la Direction des relations du travail menées en 2004 et 2005 Ces campagnes ont été organisées par la Direction des relations du travail autour de cellules opérationnelles interrégionales regroupant notamment l'inspection et la médecine du travail, les organismes de sécurité sociale, l'INRS et l'OPPBTP. Un bilan mitigé des « opérations coup de poing » menées en 2004 et 2005 sur les chantiers de retrait ou confinement de l'amiante résiduel a été dressé devant la mission, en particulier par M. Gérard Larcher, ministre délégué au travail115. S'agissant de la seule enquête 2004, les personnes interrogées par la mission ont considéré que les chiffres avancés, selon lesquels 75 % environ des chantiers seraient en infraction, devaient être relativisés : d'abord cette enquête n'a concerné que 72 chantiers, ensuite, même si dans un certain nombre de cas des manquements graves, voire très graves, ont été constatés, les infractions touchent davantage le traitement de l'amiante non friable. Enfin, les infractions sont d'inégales importances. Les chiffres issus de la campagne 2005 sont plus significatifs. 67% des chantiers visités - qui incluaient ceux de l'amiante lié ainsi que les chantiers de démolition - présentaient des infractions à la réglementation concernant : - des manquements à l'obligation de signalisation des chantiers ; - des absences répétées et injustifiées de confinement de la zone de chantier en matière d'amiante lié ; - des manquements aux règles de formation du personnel116. Certains témoins ont considéré que ces campagnes apportaient une solution intéressante aux problèmes soulevés par les lacunes du contrôle117, mais d'autres ont également souligné la difficulté concrète à focaliser tout au long de l'année l'attention des services sur la question de l'amiante118. Sur l'ensemble de la problématique du contrôle de la réglementation relative à la protection des travailleurs du traitement de l'amiante résiduel, la mission souhaite que l'action de l'Etat soit plus efficace. En effet, les organismes certificateurs qui délivrent ou retirent les qualifications « amiante friable » exercent aujourd'hui un contrôle sévère mais difficile, faute d'obtenir communication des plans de retrait ou de confinement. Par ailleurs, une plus grande implication de l'Etat permettrait d'orienter le travail de contrôle. Il convient donc de faciliter ce travail de contrôle par une collaboration approfondie avec les services de l'Etat. Les effectifs de contrôles de la Direction des relations du travail, et en particulier de l'inspection du travail, sont la première cause de la faiblesse du contrôle et doivent impérativement être augmentés. La deuxième faiblesse a trait à la technicité du traitement de l'amiante. Pour pallier le manque de compétence technique des corps de contrôles - Etat et sécurité sociale -, il conviendrait de généraliser le système des cellules opérationnelles régionales d'appui permettant d'associer les compétences des acteurs - notamment l'INRS - sur le terrain. Ces propositions doivent être rapprochées de celles de la mission concernant la prévention des risques professionnels119. Les contrôles publics doivent également être pérennisés dans l'année. L'efficacité des campagnes menées en 2004 et 2005 devrait encourager les pouvoirs publics à maintenir une plus grande attention au fil de l'année. La transmission incomplète, ou l'absence de transmission des plans de retrait ou de confinement de l'amiante constitue un véritable problème. D'une part, elle conduit l'inspection du travail à orienter ses contrôles vers les « bons élèves » bien identifiés et, d'autre part, elle empêche une bonne collaboration entre les services publics et les entreprises. Il conviendrait donc de sanctionner beaucoup plus sévèrement le manquement à l'obligation de transmission des plans de retrait ou de confinement, tant du côté de la sécurité sociale - par des cotisations à la branche AT-MP - que sous la forme d'amendes, afin de dissuader plus franchement des comportements frauduleux, qui peuvent parfois se révéler économiquement rentables pour le contrevenant mais qui sont toujours désastreux sur le plan sanitaire. Une démarche similaire doit être entreprise pour les fiches d'exposition à l'amiante des travailleurs qui ne sont pas - ou trop peu - transmises à la médecine du travail. Ce dispositif, qui date de 1977, a échoué dans le cas des entreprises de production ou de transformation d'amiante, ce qui empêche de bien identifier les victimes actuelles120. Étant donné le risque d'une augmentation des maladies liées à l'exposition à l'amiante dans le BTP, un meilleur suivi est indispensable. Propositions : - Renforcer les effectifs de contrôle de l'inspection du travail. - Généraliser le réseau des cellules régionales opérationnelles capables d'assister techniquement les services de contrôle (CRAM et inspection du travail). - Instaurer dans le cadre du contrôle des chantiers de désamiantage une collaboration entre les organismes certificateurs et les services de l'Etat. - Sanctionner plus lourdement le défaut d'établissement de plan de retrait ou de fiche d'exposition des travailleurs, car ces manquements empêchent en pratique tout contrôle de l'application de la réglementation. D.- LE SECTEUR DU BÂTIMENT ET DE LA MAINTENANCE EST INSUFFISAMMENT FORMÉ ET EN DANGER DE CONTAMINATION « INOPINÉE » Tout au long du cycle d'auditions sur l'amiante résiduel, les témoignages ont systématiquement désigné le secteur de la maintenance comme celui d'où proviendrait l'essentiel des infractions, et où les risques seraient les plus importants. Il n'a pas été possible, bien sûr, d'approcher les innombrables acteurs de ce secteur qui peuvent appartenir à tous les corps de métiers du bâtiment, et même se compter parmi les nombreux bricoleurs occasionnels. Néanmoins, la teneur globale des témoignages révèle une situation pour le moins préoccupante. Le risque occasionné par les activités de maintenance ou d'entretien provient principalement de l' empoussièrement né de la manipulation ou de l'altération de matériaux amiantés, à l'occasion de travaux dont le but n'est pas le traitement de l'amiante résiduel en tant que tel (par exemple : menuiserie, électricité, pose de chauffage, plomberie, etc.). Cet empoussièrement, généralement inévitable121, provoque une pollution atmosphérique accidentelle très importante, dont la première victime est souvent le travailleur. Dans ce domaine, le pouvoir réglementaire n'a pas prévu d'encadrement aussi rigoureux que pour les activités de retrait ou de confinement, et de nombreux témoins ont expliqué à la mission que ce secteur constitue une zone « grise », où n'importe quel professionnel peut agir à sa guise. Pourtant, les activités décrites à la section 3 du décret 96-98 sont justiciables d'obligations particulières, notamment en termes de protection individuelle ou collective des travailleurs, mais également de suivi médical approprié. La teneur globale des discours tenus devant la mission sur ce secteur, dit de la maintenance, a donc été globalement inquiétante, et dessine un paysage fortement décalé par rapport aux exigences de la réglementation. Plusieurs facteurs de décalage ont pu être identifiés, qui tiennent, on l'a vu, à la mauvaise qualité ou à l'absence de communication des DTA, mais également à une certaine culture des entreprises et des travailleurs intervenant sur les bâtiments. Afin de se faire une idée concrète des dangers nés d'une maintenance effectuée en contravention avec la réglementation, on peut détailler - tels qu'ils sont apparus au fil des auditions - les scenarii possibles de « rencontre inopinée » entre un ouvrier et l'amiante résiduel. 1.- Une rencontre inopinée qui laisse peu de chance à la sécurité du travailleur : les différentes hypothèses La prise en compte des risques liés à l'amiante par les intervenants de la maintenance ou de l'entretien dépend en grande partie de la qualité du diagnostic effectué dans le bâtiment, et de sa communication. Mais la qualité du diagnostic ne doit pas masquer l'ignorance générale des entreprises du BTP relative aux risques liés à l'amiante, ni la propension des ouvriers à travailler sans vraiment tenir compte des risques encourus pour leur santé. Les hypothèses suivantes ont toutes été évoquées par des témoins entendus par la mission. a) L'absence de diagnostic ou le diagnostic de mauvaise qualité L'absence ou la mauvaise qualité du diagnostic ne permet ni au propriétaire, ni au professionnel de la maintenance d'évaluer correctement le risque amiante. En l'absence d'une compétence d'évaluation sur le chantier (et pourquoi y en aurait-il une puisque la présence d'amiante n'est pas identifiée par le diagnostic ?), les ouvriers interviendront dans les conditions habituelles de leur travail, alors qu'ils subiront une pollution dangereuse pour leur santé122. M. Philippe Bourges, ingénieur conseil à la direction des risques professionnels de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, a souligné l'impossibilité pour les professionnels de se substituer aux responsables du repérage123 : « Le cœur du problème est une méconnaissance du risque, de la part des propriétaires comme des entreprises, en particulier de petite taille. Une entreprise de trois ou quatre salariés n'a même pas, bien souvent, les compétences nécessaires pour évaluer les risques ». b) Le diagnostic de qualité standard ● Même si le diagnostic fait état d'un risque potentiel lié à l'amiante, il arrive que le professionnel n'en tienne pas compte : - Soit parce qu'il n'est pas formé ou informé de l'obligation qui lui est faite d'évaluer le risque auquel il exposera ses travailleurs. M. Jean-François Boulat, médecin-conseil de l'OPPBTP a rappelé le contenu de cette obligation124 : « Le chef d'entreprise doit obligatoirement s'informer de la présence d'amiante dans les bâtiments auprès de leur propriétaire. En l'absence de diagnostic, plusieurs obligations lui incombent : il doit évaluer lui-même le risque de présence, ce qui lui est assez difficile. Il doit fournir les équipements de protection individuelle appropriés, ce qui est rarement le cas. Il doit aussi établir une fiche d'exposition et la transmettre au médecin du travail, ce qu'il fait exceptionnellement. L'an dernier, 98 % des médecins n'avaient jamais reçu de fiche d'exposition de la part de la moindre entreprise de maintenance. » - Soit parce que ce diagnostic ne lui est pas communiqué par un propriétaire, qui estime que son seul devoir est de l'avoir fait réaliser. Comme l'a souligné M. Alain Fraisse125, secrétaire régional Sud-est pour l'OPPBTP : « Le maître d'ouvrage, dès lors qu'il a commandé un diagnostic, a l'impression de répondre à toutes ses obligations. Or, s'il entreprend des travaux, il a aussi pour devoir d'informer les entreprises, et cet aspect reste très parcellaire. » - Soit parce que le professionnel ne croit pas, de bonne foi, à la dangerosité de l'inhalation de fibres d'amiante, ou bien ne voit pas en quoi cette fibre concernerait son corps de métier126. ● Le diagnostic standard fait état d'un risque lié à l'amiante dans certaines parties de la construction, ou dans certains matériaux, qui ne sont pas directement concernés par l'opération de maintenance. Le professionnel compétent peut avoir pris connaissance du diagnostic, mais estimer : - soit, que ce repérage est exhaustif, ce qui n'est pas le cas en général, comme l'a rappelé M. Alain Fraisse127 : « Les études étant non destructives, les diagnostiqueurs n'identifient que ce qui est apparent. Ils négligent généralement de gratter les murs et d'effectuer des prélèvements d'enduits, d'autant qu'ils ne sont pas invités à le faire », et comme en témoignent les « découvertes » de matériaux amiantés en cours de chantier128 ; - soit que ses ouvriers n'auront pas à intervenir sur ces zones ou matériaux, ce qui n'est pas toujours prévisible malheureusement. Il peut également décider de protéger ses ouvriers contre le risque amiante pour leurs activités les plus exposées au risque apparu dans le DTA. Mais, les travailleurs peuvent être amenés, par exemple, à abattre des cloisons contenant de l'amiante non repéré et ne pas prendre conscience de la présence d'amiante ainsi libéré, celui-ci ne se distinguant pas de la poussière de plâtre auquel il est lié. c) Le diagnostic de bonne qualité ● Le diagnostic fait état d'un risque amiante indéniable : soit des travaux de traitement sont prévus, soit ils ont été réalisés, soit l'état de conservation des matériaux est correct et ne justifie pas encore de travaux. L'intervention - par exemple sur une canalisation de chauffage calorifugée à l'amiante - représente alors un danger évaluable pour le professionnel. Mais cette évaluation et ses conséquences en termes de protection des travailleurs ont un coût pour son entreprise, qui ne sera peut-être pas accepté par le client. M. Éric Jany, inspecteur du travail, a rappelé l'impact de ces aspects financiers sur la prise en compte des règles sanitaires129 : « Quant aux petites entreprises, qui sont très nombreuses, elles n'ont souvent aucune conscience du danger. Il y a un réel déficit de formation et l'inspection du travail a le plus grand mal à les contacter. On peut évidemment leur envoyer une lettre, mais le mieux est de se déplacer pour leur expliquer le problème de vive voix. Elles aussi, du reste, sont soumises à la concurrence, de sorte que celles qui respectent la réglementation se trouvent finalement pénalisées. » ● Le diagnostic fait état d'un risque amiante que le professionnel ne peut contourner. Le professionnel doit alors prévenir son client et : - soit prendre des mesures de protection individuelle et collective afin de poursuivre son chantier dans le respect de la réglementation (article 28 à 30 du décret n°96-98) ; - soit interrompre son chantier dans le cas où celui-ci ne peut se poursuivre sans le retrait ou le traitement préalable de l'amiante repéré. Dans ce dernier cas, l'entreprise va procéder elle-même au retrait (scénario plus que vraisemblable, comme cela a été confirmé à de nombreuses reprises par les personnes auditionnées130) : il devrait alors obéir aux prescriptions de la section 2 du décret n° 96-98 concernant le retrait ou le traitement de l'amiante (voir précédemment). La mission a tenu à souligner que ces hypothèses, dans lesquelles l'exacte prise en considération du risque reste peu probable, s'appliquent également aux agents de maintenance employés dans de grandes structures privées ou dans les administrations publiques, ainsi que l'ont confirmé certaines personnes auditionnées131. Il est possible de résumer le descriptif des risques du secteur de la maintenance en constatant que : - les professionnels ne peuvent parfois pas éviter le contact de l'amiante : ils ne le voient pas, et ne le reconnaissent pas. La présence est parfois diagnostiquée après coup ; - les professionnels n'ont pas toujours le réflexe de fuir l'amiante, qui est une composante historique de leurs métiers, dont les travailleurs eux-mêmes relativisent depuis toujours la gravité ; - les professionnels ne savent pas faire face à la présence d'amiante : ils ne se protègent pas, ils ne s'interrompent pas, ils ne se forment pas ; - d'une manière plus générale, les professionnels ne font pas de l'amiante une question à soulever sur leur chantier : ils ne mettent pas en place de procédure particulière et n'informent pas la médecine du travail. 2.- Une zone « grise » où les contrôles sont impossibles Le secteur de la maintenance ou de l'entretien est un vaste ensemble d'activités, dont la liste est impossible à tenir. La souplesse d'exercice retenue pour ces activités dans le décret n° 96-98, relatif à la protection des travailleurs, repose essentiellement sur un motif de bon sens : aucun dispositif ne peut encadrer strictement autant d'activités qui reposent par ailleurs sur un nombre importants d'acteurs, en majorité des petites structures. Pourtant la réglementation sanitaire est stricte. C'est pourquoi la mission a considéré que l'extension des obligations de diagnostics proposées précédemment se justifiait tout particulièrement, dès lors que la santé des nombreux travailleurs de la maintenance dépend de la qualité du repérage initial. a) Les obligations sont nombreuses Les dangers mis en évidence dans les hypothèses précédemment évoquées résultent exclusivement du non respect des obligations particulières faites aux professionnels de la maintenance. Or certaines obligations générales prévues par le décret n°96-98 pèsent également sur les professionnels de la maintenance, et revêtent une importance comparable : - Obligation d'évaluation des risques : ce qui pose la question de la qualification des acteurs. - Obligation de formation et d'information des personnels : la mission s'est interrogée sur la place qui pouvait être réservée à l'amiante dans le cursus de formation initiale ou continue des métiers du bâtiment. En effet, le coût qu'une entreprise peut supporter, par exemple, pour former un plombier au risque amiante lui a paru susceptible de décourager de toute initiative privée de formation. - Obligations liées à la gestion sécurisée des déchets (voir ci-après). - Obligation liée au suivi médical des expositions à l'amiante des personnels, qui suppose au préalable que l'exposition soit connue, et assumée par les professionnels intervenus. Le respect de ces prescriptions, ainsi que des dispositions relatives à l'évaluation du confinement nécessaire au chantier et aux équipements de protection individuels ou collectifs à mettre en place, sont de nature à protéger en grande partie les travailleurs de la maintenance, mais son contrôle est difficile, voire impossible. b) Mais le contrôle est impossible Dans le domaine de la maintenance, les infractions sont d'autant plus nombreuses que les contrôles sont impossibles. Ainsi que l'ont notamment signalé les représentants de l'inspection du travail, en l'absence de plans de retraits ou de confinement, ou de tout autre signalement qui serait prévu par la réglementation, l'inspection n'a aucune chance de contrôler officiellement ces activités de maintenance. Si elle le fait, c'est par hasard. De fait, les rares informations recueillies par la mission sur la réalité du risque lié à la maintenance ont été données non pas par les organismes de contrôle, mais par les entreprises du traitement de l'amiante - c'est-à-dire d'une certaine manière par la concurrence -, ou par l'OPPBTP, pour lequel l'application de la section 3 du décret représente un véritable « casse-tête ». Ainsi, malgré la mise à disposition d'une base d'évaluation des risques (EVALUTIL) à destination des métiers du bâtiment et la conduite de formations et de campagnes de prévention, les représentants de l'organisme ont reconnu l'absence de maîtrise du secteur de la maintenance, et l'existence de risques très fort de maladies professionnelles liées à l'amiante dans le BTP pour les vingt prochaines années132. De même, M. Michel Héry a relaté la difficulté posée à l'INRS par les risques amiante dans les activités de maintenance en dépit de la publication de brochures, plaquettes, affiches et autres supports, qui se comptent par dizaines133 : « Il est très difficile de former et d'informer les TPE et les artisans. L'INRS mène des actions préliminaires en procédant à des interviews pour essayer de déterminer les médias par lesquels l'information passerait le mieux et quelle doit être sa teneur. » Pourtant, la mission a considéré, comme beaucoup de témoins134, que la problématique posée par la maintenance ne pouvait être résolue, outre l'amélioration des DTA, que par la voie de la formation et de l'information. Dans un tout autre domaine, la mission a été séduite par l'expérience conduite par la CNAMTS en matière de conduite d'engins dangereux (grues, chariots autoporteurs, etc.) : mobilisée par la parution d'obligations réglementaires en la matière, la CNAMTS a mis en place un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES). Ce dispositif a été décrit à la mission par M. Philippe Bourges, ingénieur conseil à la direction des risques professionnels de la CNAMTS, en ces termes135 : « Le CACES a pour but de répondre à l'obligation de formation des salariés sur les équipements de travail, en application du décret de 1998. Nous avons émis des recommandations relatives à la définition du CACES, en collaboration avec le COFRAC, le Comité français d'accréditation, qui délivre une certification aux organismes qui font passer les tests. L'intérêt du CACES est qu'il répond à la fois aux obligations réglementaires des entreprises et à nos obligations de prévention. Pour mémoire, plus d'un million de salariés ont subi ces tests en moins de trois ans. » Le succès de cette initiative (850 000 CACES délivrés entre 2002 et 2004), et son indéniable apport en termes de sécurité ont ouvert à la mission des perspectives concernant la formation des travailleurs de la maintenance intervenants sur des matériaux amiantés. La mécanique simple du CACES (des recommandations, un référentiel bâti par le COFRAC, une formation souple dont les entreprises ont la maîtrise, des organismes « testeurs » de l'aptitude du travailleur) a paru pouvoir se transposer aux préoccupations des professionnels du bâtiment relatives au risque amiante, d'autant que ces professionnels ont déjà été concernés par un tel dispositif. À défaut de pouvoir exiger de tous les métiers du bâtiment une qualification « amiante », la mission préconise que les pouvoirs publics « disciplinent » l'intervention inopinée sur l'amiante, pour éviter de nouveaux foyers de victimes dans ces corps de métiers. Deux pistes peuvent être explorées : - une démarche de label «qualité » facultatif. L'Etat et le COFRAC pourraient proposer aux entreprises une démarche de qualification « sécurité amiante », légère et peu coûteuse, permettant de former employés et cadres aux « attitudes préventives » du risque. En contrepartie, ces entreprises pourraient valoriser cette démarche sur le marché du bâtiment en promouvant leur label (comme par exemple les professionnels du gaz). Un propriétaire dont le DTA fait état de risques pourrait ainsi choisir - notamment sous la pression d'habitants informés des risques - un professionnel sécurisant, même pour une intervention de maintenance. - une étape obligatoire de formation continue ou initiale sur le risque amiante peut être mise en place par les partenaires sociaux, la sécurité sociale et l'Etat à destination des travailleurs, ou futurs travailleurs, du secteur du bâtiment. S'agissant de la formation continue, la mission recommande d'envisager la réplique du dispositif mis en place pour le CACES, afin de toucher, rapidement mais efficacement, un maximum de travailleurs exposés. Propositions : - Créer, avec l'appui du COFRAC, un label public de qualité sur la prise en compte des risques liés à l'amiante dans les interventions du secteur du bâtiment. Ce label serait facultatif, mais sécurisant pour les propriétaires soucieux de tels risques. - - Inclure, à tous les échelons de la formation initiale, dans la filière technologique, un enseignement de sensibilisation aux risques de l'amiante. - Organiser une formation de sensibilisation, simple mais de grande envergure, à destination des travailleurs du bâtiment, sur les risques liés à l'amiante et les gestes de prévention. Le dispositif de cette formation pourrait être calqué sur celui mis en place par la CNAMTS pour le Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, afin de prendre en compte les spécificités des TPE et des PME. E.- LES GRANDES DIFFICULTÉS DES PROPRIÉTAIRES PUBLICS À RESPECTER LEURS OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES APPELLENT UN DISPOSITIF DE SOUTIEN SPÉCIFIQUE DE LA PART DE L'ÉTAT. La réglementation applicable au traitement de l'amiante en place ne réserve pas un sort spécifique aux propriétaires publics, s'agissant des obligations de diagnostics et de travaux. Toutefois, la mission a relevé deux problématiques spécifiques aux propriétaires publics dans le traitement de l'amiante résiduel : l'inventaire et le repérage de l'amiante dans le patrimoine immobilier public, et la questions de la répartition des coûts induits par la présence d'amiante dans les bâtiments. 1.- L'absence de vision d'ensemble du respect par les propriétaires publics de leurs obligations règlementaires. La mission s'est préoccupée du respect par l'Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales des obligations qui leur incombent en vertu de la réglementation de protection des populations, des travailleurs et de l'environnement. Le patrimoine immobilier public est en effet considérable. Il est soumis à un regard particulièrement attentif et critique de l'opinion publique, surtout depuis l'apparition de maladies liées à l'exposition à l'amiante chez des fonctionnaires, du fait de leurs activités professionnelles dans des locaux amiantés. Le décès par mésothéliome de plusieurs enseignants du lycée professionnel de Gérardmer est d'ailleurs une des causes indirectes, par l'émotion qu'il a suscitée dans l'opinion publique, de l'interdiction de l'amiante136. La mission a éprouvé les plus grandes difficultés à réunir des informations sur le diagnostic du patrimoine public. S'agissant du patrimoine de l'Etat, la vision qui ressort des auditions menées par la mission est assez « impressionniste ». Dans certains secteurs, comme les établissements médicaux ou médico-sociaux, une mobilisation du ministère a permis de collecter des données de synthèse à l'échelle nationale. L'expérience du ministère de la santé a déjà été évoquée. En revanche, aucune vision d'ensemble n'a été dégagée jusqu'à présent : les représentants de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ont en effet expliqué à la mission que la réglementation du diagnostic relevait du ministère de la santé. Toutefois, depuis 2005, la centralisation et l'archivage de l'inventaire sont en cours d'exécution à l'initiative du ministère de la fonction publique, par les différents départements ministériels. M. Jean-Pierre Jourdain, sous-directeur de la gestion des ressources humaines au ministère de la fonction publique a exposé les conditions de cette enquête : « Nous sommes partis du constat qu'il appartenait à chaque ministère d'appliquer la réglementation. Néanmoins il est apparu indispensable d'avoir une vision interministérielle, panoramique, de cette application, afin que le Premier ministre connaisse les difficultés ponctuelles et puisse prendre les mesures correctives nécessaires. Pour cela, nous avons décidé de réaliser, dès le début de 2005, auprès de tous les ministères une enquête portant à la fois sur le bâtiment et sur le personnel. Pour les bâtiments, l'objectif était de recenser le parc immobilier concerné en distinguant les niveaux de risque établis par le décret et d'identifier les mesures de protection mises en œuvre. Pour le personnel, il s'agissait d'identifier les agents selon les risques d'exposition, active comme passive. Une évaluation grossière permettait de dire qu'entre 100 000 et 200 000 agents de la fonction publique d'État pouvaient être concernés. (...) Vous le voyez, il s'agit d'un travail extrêmement ambitieux, élaboré avec les directions de la santé et du travail. Pour le mener à bien, nous avons mis en place un réseau, avec un correspondant amiante dans chaque ministère. Nous nous sommes également appuyés sur un comité d'experts qui s'est réuni périodiquement pour guider la direction générale de la fonction publique sur le plan méthodologique. Nous comptons aussi beaucoup sur lui pour interpréter les résultats que nous obtiendrons. Nous avions fixé la date de réponse des ministères au 15 mars 2005 pour les bâtiments et au 16 mai 2005 pour les personnels. Nous les avons collectées, mais je ne suis pas en mesure de vous communiquer les résultats car le travail d'analyse et d'expertise est en cours. Notre objectif est de publier un rapport à la fin de l'année. Nous souhaitons prendre toutes les précautions méthodologiques et bien interpréter ce que disent les ministères, avant de livrer les résultats. (...) Le cabinet du Premier ministre a demandé que l'enquête soit étendue aux collectivités locales et à la fonction publique hospitalière. Pour les premières, un contact a été pris entre la Direction générale de la fonction publique et la Direction générale des collectivités locales, qui vient de lancer, par l'intermédiaire des préfets, une enquête identique auprès de toutes les collectivités locales. L'enquête n'est pas encore lancée, en revanche, dans la fonction publique hospitalière. Une concertation est en cours entre nos services pour bien en adapter le cadre à la spécificité de ce secteur.137 » Les résultats de cette enquête menée par le ministère de la fonction publique ne sont pas connus à ce jour. Toutefois, au cours d'une table ronde organisée le 6 juillet 2005, la mission a pu prendre connaissance de plusieurs exemples de gestion du dossier de l'amiante par certains propriétaires publics. C'est le cas notamment d'établissements comme l'AP-HP et la RATP, qui ont été placés devant leurs obligations par des personnels138 inquiets ou victimes des conséquences de l'exposition à l'amiante. La mission souhaite souligner la qualité des démarches entreprises dans ces deux établissements, qui pourraient guider d'autres grands établissements recevant du public dans leur gestion du dossier amiante. La mission a particulièrement retenu : - la planification des diagnostics et travaux menée au sein de l'AP-HP, compte tenu de la nécessité de vider certains bâtiments, ou de les isoler, tout en maintenant un accès suffisant aux soins ; - le travail de communication et de concertation entrepris par la direction de l'AP-HP avec le comité central d'hygiène et de sécurité, mais également des CHSCT de chaque établissement, en partenariats avec des personnalités qualifiées ; - la qualité des investigations et des repérages conduits par la RATP sur un patrimoine malaisé à diagnostiquer ; - la mise en place d'une base de données très approfondie par la RATP, incluant une cartographie circonstanciée de l'ensemble du patrimoine, à destination des équipes de maintenance et d'entretien. Plus globalement, les témoignages recueillis lors de cette table ronde montrent que le souci de transparence, qui a animé les propriétaires publics les plus vertueux, a contribué à « désamorcer » les angoisses parfois excessives qui entourent la question de l'amiante139. 2.- Le patrimoine géré par les collectivités territoriales appelle un dispositif national de soutien S'agissant du patrimoine des collectivités territoriales, l'exposé de M. Jourdain, sous-directeur de la gestion des ressources humaines au ministère de la fonction publique, montre que le Gouvernement a mesuré le risque de non respect de la réglementation que fait courir l'éclatement territorial des propriétaires et des immeubles. Cette question a été soulevée avec force à l'occasion de la présentation de l'expérience de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, qui a été décrite par M. Jean-Marie Schléret, son président : « Dès la création de l'Observatoire, en 1995, nous avons été confrontés aux retombées de l'affaire du lycée professionnel de Gérardmer, dans les Vosges, où des enseignants ont été victimes de mésothéliome. Cela a été très douloureusement ressenti dans la communauté scolaire. Nos premières enquêtes ont porté sur les collèges et les lycées, en lien avec les collectivités. Elles ont fait apparaître que 5 % des collèges déclaraient avoir des surfaces amiantées. Mais seuls les flocages et les calorifugeages étaient concernés, en vertu des textes de février 1996. Pour ce qui est des lycées, 13 % des établissements déclaraient des surfaces amiantées. S'agissant des universités, mis à part Jussieu et Censier, les chiffres étaient d'un tout autre ordre. Sur environ 13 millions de mètres carrés, le flocage concernait 126 000 mètres carrés, et le calorifugeage 47 000 mètres carrés, soit un total inférieur aux surfaces floquées de Jussieu, alors estimées à 200 000 mètres carrés.140 » M. Schléret a également insisté sur la difficulté des collectivités territoriales à s'adapter aux changements successifs intervenus en matière de diagnostics, s'agissant d'un patrimoine très important1 : « Les collectivités ont déploré, à juste titre, que les règles du jeu changent. Elles se sont engagées dans un diagnostic des collèges et lycées. Un an après, la règle avait changé : il fallait contrôler les faux plafonds. C'est ce qu'elles ont fait. Puis, on leur a dit qu'il fallait vérifier les revêtements de sols. J'attends de voir comment elles vont réagir à l'enquête détaillée que préconise aujourd'hui le ministère de la fonction publique. » ● Les initiatives de la mission Soucieuse d'améliorer son information sur la situation des collectivités territoriales face à l'amiante en place dans leurs bâtiments, la mission a, dans un premier temps, cherché à rencontrer les associations regroupant les structures ou les exécutifs locaux au cours d'une table ronde organisée le 28 septembre 2005. Celle-ci n'a rencontré que peu de succès auprès des associations, qui se sont globalement déclarées incompétentes sur la question et se sont abstenues d'y participer en tant que telles. À la demande de la mission, elles ont quand même fait connaître l'organisation de la table ronde à leurs adhérents. C'est ainsi que la mission a pu entendre plusieurs élus locaux, ou fonctionnaires territoriaux, qui ont exposé les situations et difficultés de leur propre collectivité. Dans un deuxième temps, la mission a donc cherché à connaître la situation des collectivités territoriales en leur adressant, par l'intermédiaire de leurs associations, un questionnaire sur le respect de leurs obligations en matière de diagnostic amiante, de travaux et de traitement des déchets. Le taux de réponse a été assez décevant, et le contenu des réponses est préoccupant. La mission a recueilli 269 réponses au questionnaire adressé aux collectivités141, parmi lesquelles : - 7 concernent des régions jugées représentatives par l'Association des régions de France, qui a établi, elle-même, une synthèse ; - 260 concernent des communes142. Étant donné le caractère tout à fait « artisanal » de cette démarche, la mission n'accorde aucune valeur statistique aux résultats obtenus. Pourtant, les réponses sont riches d'enseignements : ● Un manque d'information 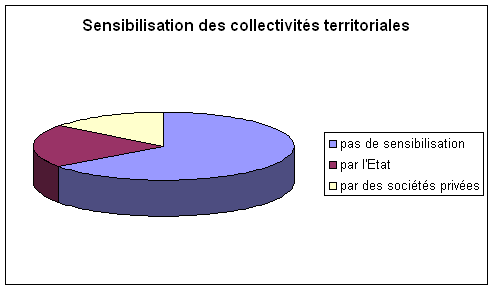 La mission constate que les collectivités interrogées font état d'un manque fréquent d'information sur les obligations en matière de repérage de l'amiante et de travaux. Au-delà des chiffres, de nombreux commentaires indiquent que le problème est mal connu. Plusieurs se félicitent ouvertement d'avoir rempli leurs devoirs dès 1997... soit deux ans avant l'obligation de repérage des flocages, calorifugeages et faux plafonds et quatre ans avant l'instauration du DTA obligatoire. ● Des difficultés dans le respect des obligations de diagnostic 36 % des collectivités ayant répondu affirment n'avoir pas réalisé les diagnostics réglementaires, ou ne pas les avoir achevés, ou encore n'avoir réalisé que les diagnostics de flocages, calorifugeages et faux plafonds. La mission est préoccupée par ces chiffres, qui peuvent paraître choquants, au regard non seulement des sanctions encourues par les propriétaires privés en cas de manquement, mais surtout du risque sanitaire que fait courir l'ampleur du patrimoine concerné. La complexité de la réglementation, et le coût des opérations sont les deux facteurs invoqués le plus souvent par les responsables locaux, y compris lorsque les diagnostics ont été correctement réalisés. Parmi les propos recueillis, on relève une certaine aigreur de la part des exécutifs locaux à l'encontre d'un dossier n'ayant fait l'objet d'aucun démarche de soutien ou de communication : « S'il existe une réglementation claire, me la faire parvenir » ou encore « Comme si l'on voulait nous faire payer des décennies de silence et de laxisme sur la question de l'amiante ! Et dans le même temps on envoie le Clemenceau se faire désamianter en Inde ! ». L'examen des réponses au questionnaire montre également que beaucoup de responsables locaux confondent clairement les diagnostic des flocages, calorifugeages et faux plafonds et la réalisation du dossier technique amiante. La mission s'en est bien sûr tenue aux propos des maires eux-mêmes pour établir les chiffres ci-dessus, mais elle craint que de nombreux responsables croient avoir respecté la réglementation, alors que seul le diagnostic des flocages, calorifugeages et faux plafonds a été réalisé. Une appréciation difficile de la proportion de bâtiments publics contenant de l'amiante. L'exploitation des réponses des collectivités est sur ce point difficile. La plupart des réponses établissent une liste des constructions contenant de l'amiante. La mission n'a pas souhaité essayer de quantifier grossièrement les situations décrites. Pour s'en tenir aux résultats certains et rigoureux, deux chiffres peuvent être retenus. - 40 % des réponses indiquent que les diagnostics montrent qu'aucun bâtiment de la collectivité ne contient de matériau amianté ; - 35 % des collectivités indiquent ne pas pouvoir estimer la proportion de leur patrimoine concernée par l'amiante, faute de diagnostic. S'agissant des régions, une distinction doit être faite selon l'Association des régions de France entre les lycées et le reste des bâtiments régionaux. Deux régions relèvent que plus de 90 % des lycées contiennent des matériaux amiantés. Toutefois, ce taux doit être rapproché de l'enquête de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, qui faisait apparaître que seulement 13 % des lycées contenaient de l'amiante friable (flocages, calorifugeages et faux plafonds). Deux conclusions peuvent être tirées de ces chiffres : d'une part, les régions ont réalisé des dossiers techniques amiante approfondis ; d'autre part, l'amiante contenu dans les lycées est majoritairement non-friable, c'est-à-dire inoffensif en l'état, mais appelant à une certaine vigilance en cas de travaux. L'importance du problème du coût de la gestion des déchets 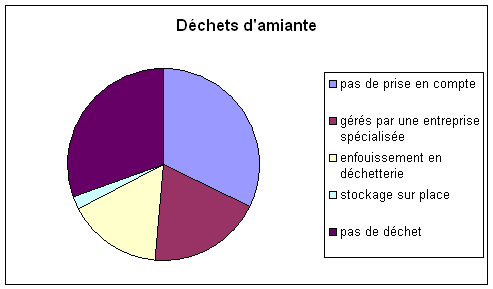 Beaucoup de collectivités ne peuvent se prononcer sur le traitement d'éventuels déchets d'amiante, faute de diagnostic et de travaux. Le nombre important de réponses indiquant une absence de déchets est sans doute lié au fait que les bâtiments contenant de l'amiante sont peu nombreux (voir ci-dessus), et que lorsqu'ils en contiennent des travaux ne sont, le plus souvent, pas nécessaires. La mission a toutefois relevé dans les propos des responsables locaux une préoccupation réelle concernant le coût du traitement des déchets d'amiante. Certains ont d'ailleurs eu le courage d'indiquer que face à ce coût, qualifié de « prohibitif », leur commune a choisi de stocker ces déchets sous une bâche ou encore dans un garage communal... Bien entendu, l'objet de la mission n'a pas été, au travers de ce questionnaire, de chercher à stigmatiser la gestion du dossier par telle ou telle collectivité territoriale, mais de confirmer - ou d'infirmer - les doutes sérieux exprimés par de nombreux témoins sur le respect de la réglementation par les propriétaires publics. Au regard des réponses exposées ci-dessus, et dans l'attente des conclusions de l'enquête du ministère de la fonction publique, la mission n'a pu que confirmer ces doutes. Mais elle propose d'en tirer de façon urgente les leçons. Ainsi, il ressort des réponses au questionnaire, comme des auditions menées par la mission, que les charges occasionnées par les diagnostics et travaux concernant l'amiante sont décourageantes pour les gestionnaires locaux, et parfois hors de la portée de leur budget. Ce problème n'est pas nouveau. Dans le cas particuliers des établissements scolaires, M. Schléret, déjà cité, a rappelé les difficultés financières auxquelles s'est heurté l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur : « Les collectivités se sont prêtées au jeu dans un premier temps. L'État leur a apporté son aide, puisqu'une partie du plan quinquennal de 1994 pour la mise en sécurité des écoles - 2,5 milliards de francs - a été détournée de sa destination pour financer les diagnostics des collèges et des lycées. Cela n'a pas été suffisant. Nous avons tenté de lancer une enquête systématique pour les écoles. Nous n'y sommes pas parvenus.143 » Ce cas particulier appelle une interrogation plus générale sur le patrimoine des collectivités territoriales. Celui-ci résulte pour une grande part de transferts de compétences de l'Etat liées aux réformes successives de la décentralisation depuis 1982. Les collectivités territoriales, et dorénavant les établissements publics de coopération, sont donc placés dans la situation de devoir gérer les choix d'une maîtrise d'ouvrage antérieure : celle de l'Etat. Devant la difficulté des collectivités territoriales à respecter leurs obligations réglementaires, et compte tenu de la responsabilité importante de l'Etat dans l'acquisition et la construction de ce patrimoine, il a semblé à la mission qu'un dispositif national de soutien s'imposait pour le repérage de l'amiante résiduel, et, le cas échéant, des travaux qui en découlent. En tout état de cause, la situation actuelle d'opacité relative au diagnostic et au traitement de l'amiante en place par les collectivités territoriales a paru totalement insatisfaisante. Propositions : - Instaurer une aide financière et technique de l'Etat à destination des collectivités territoriales pour la prise en charge des repérages et travaux liés à l'amiante, notamment dans des bâtiments construits par l'Etat. - Lancer une campagne de sensibilisation des collectivités territoriales à leurs obligations réglementaires en matière de repérage, de travaux et de gestion des déchets, comparable à celle proposée par la mission à destination des propriétaires privés. - Fixer aux collectivités territoriales un nouveau délai maximal d'accomplissement des obligations réglementaires, assorti d'une sanction. - Organiser la transmission et la centralisation des diagnostics de flocages, calorifugeages et faux plafonds et des fiches récapitulatives des DTA des collectivités territoriales, afin de contrôler le respect des obligations en la matière. F.- UNE GESTION DES DÉCHETS DÉFECTUEUSE a) Les différentes catégories de déchets La loi définit précisément la notion de déchets : est considéré comme un déchet « tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou, plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon » (art. L. 541-1 du Code de l'environnement). S'agissant plus spécifiquement des déchets amiantés, on distingue traditionnellement deux grandes catégories : les déchets d'amiante dit « libre » et les déchets d'amiante dit « lié ». - L'amiante libre (ou friable), susceptible d'émettre des fibres, se retrouve dans tous les déchets de flocages enlevés dans le cadre d'un chantier de retrait, mais également dans le matériel et les vêtements des personnels. - L'amiante lié (ou non friable) correspond essentiellement à l'amiante-ciment où l'amiante est noyé dans un support et dont l'usage est très diversifié. Le décret 2002-540 du 18 avril 2002 classe l'ensemble des déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante dans la catégorie des déchets dangereux. b) Le sort des déchets amiantés ● Les déchets d'amiante libre Ils peuvent être éliminés de différentes façons. La plus courante est l'admission en centres de stockage pour déchets dangereux (centres de classe 1). Ils y sont enfermés dans des big bags (grands sacs) et entreposés dans des alvéoles spécifiques. Les centres de classe 1 sont des sites très bien suivis, dont l'exploitation est très différente de celle des décharges pour déchets ménagers. Une deuxième solution consiste à vitrifier les déchets. Une seule installation en France est capable de réaliser ce traitement, située à Morcenx dans les Landes. L'opération consiste à porter les déchets à très haute température afin de produire un vitrifiat qui ne présente plus aucun risque d'émission de fibres d'amiante. Les auditions auxquelles la mission a procédé ont permis d'obtenir des précisions sur ces deux modes de traitement des déchets d'amiante libre et de dresser les avantages et les inconvénients de chacun d'eux. La vitrification est obtenue par le biais d'une torche à plasma, outil industriel de conception française permettant de produire de très hautes températures, jusqu'à 4 000 degrés. Cette température est nécessaire car les divers types de fibre d'amiante ne fondent qu'entre 1 380 et 1 760 degrés. L'installation de Morcenx peut traiter jusqu'à 8 000 tonnes de déchets d'amiante par an mais n'en reçoit que 4 000 à 5 000 tonnes, dont plus de 60 % d'amiante libre. Le produit obtenu - le vitrifiat - est sans danger pour la santé. Toutefois, le coût d'un tel procédé est élevé, puisqu'il faut compter 1 200 euros par tonne de déchets traités. De même, cette technique nécessite d'ouvrir les bigs bags pour trier leur contenu. Cette opération délicate d'ouverture des sacs est menée par des professionnels, ce qui accroît bien sûr le prix final. Les alvéoles de stockage des big bags fonctionnent sur le mode du sarcophage : sur une dalle en béton, avec des voiles de béton sur les côtés, les big bags sont disposés les uns à côté des autres. Chaque soir, on les recouvre de terre afin de les bloquer dans une matrice de matériaux inertes. À la fin de l'exploitation de l'alvéole, une dalle de béton est à nouveau installée par-dessus, empêchant les fibres d'amiante de revenir à l'air libre. Le coût est inférieur au procédé de vitrification, puisque le stockage en centre de classe 1 coûte de 400 à 450 euros la tonne (flocages) ou entre 100 et 110 euros (amiante-ciment). Il est prévu un suivi dans le temps de ces centres de stockage : comme l'ont déclaré les représentants de SITA France Déchets à propos de leur site de Villeparisis, une fois ce dernier « fermé et réaménagé, nous devons un suivi post-exploitation d'un minimum de trente ans. Autrement dit, nous suivrons l'évolution du site et des déchets que nous y avons enfouis au moins jusqu'en 2050. Dès l'instant où nous réceptionnons un déchet, nous en assumons la pleine responsabilité »144. ● Les déchets d'amiante lié Les déchets ne contenant pas d'amiante libérable peuvent être dirigés, comme l'indique une circulaire du 22 février 2005145, en décharges de classe 2 (centres de stockage pour les déchets banals, les déchets ménagers et assimilés) ou en décharges de classe 3 (centres de stockage pour les déchets inertes), dans un casier dédié. c) Le transport des déchets amiantés S'agissant des déchets dangereux, il importe de prendre des mesures particulières pour assurer la traçabilité des déchets amiantés. Le producteur des déchets doit être en mesure de savoir à quel endroit ils ont été éliminés. Cela se traduit concrètement par l'émission d'un bordereau de suivi de déchets amiantés Les travaux de la mission ont permis de constater que le transport des déchets amiantés ne s'effectue pas toujours dans des conditions de sécurité suffisantes. Il convient donc d'engager une réflexion sur la sécurisation du transport de ces déchets. Proposition : Engager une réflexion sur la sécurisation du transport des déchets amiantés. 2.- Une situation qui n'est pas satisfaisante a) Une réglementation qui n'est pas correctement appliquée Les moyens du ministère de l'écologie et du développement durable pour contrôler l'application de la réglementation relative aux déchets amiantés sont ceux de l'inspection des installations classées qui est assurée principalement par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Ils sont jugés globalement insuffisants par les services du ministère, lesquels ont précisé à la mission qu'un programme pluriannuel de renforcement des effectifs est en cours. En effet, à la suite de l'accident d'AZF, le Gouvernement a lancé un plan de renforcement de 400 agents sur la période 2004-2007 pour accroître les moyens relatifs aux risques industriels. Toutefois, ces derniers mois, outre la mise en œuvre de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, deux nouveaux plans sont venus accroître la charge de l'inspection : le plan « légionellose » et le plan national « santé-environnement ». Dans ce contexte, selon le ministère de l'écologie et du développement durable, l'élimination des déchets amiantés ne peut faire l'objet d'un contrôle renforcé, même si dans le cadre des priorités 2006 de l'inspection des installations classées, figure la traçabilité des déchets dangereux, parmi lesquels ceux comprenant de l'amiante. Ce manque de moyens a une conséquence concrète : la réglementation n'est pas correctement appliquée. Par exemple, s'agissant de l'amiante-ciment, les chiffres donnés par le ministère de l'écologie sont significatifs : en 1997, alors que les pouvoirs publics prévoyaient que 400 000 tonnes d'amiante-ciment seraient enlevées chaque année, ce ne sont que 100 000 à 150 000 tonnes qui sont admises en décharge chaque année ! L'efficacité des contrôles est donc clairement remise en question. Eu égard à la « déperdition » constatée, ces contrôles sont indéniablement insuffisants. De plus, ils relèvent de tutelles différentes : les centres de stockage de classe 1 sont régis par le code de l'environnement et, dans les faits, c'est l'inspection des installations classées qui y assure la « police ». Par contre, les centres de classe 3 relèvent du code de l'urbanisme. La mission a interrogé le ministère de l'écologie et du développement durable sur les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles des centres de stockage : « Il est (...) fréquent de prendre rendez-vous avec l'exploitant, ne serait-ce que pour s'assurer qu'il sera là. Cela dit, le but du contrôle n'est pas seulement de prendre en flagrant délit ; c'est également l'occasion de mettre les procédures à plat, de voir comment les choses se passent. Mais les contrôles inopinés sont parfaitement possibles et se pratiquent couramment, surtout lorsqu'une exploitation pose problème »146. Il paraît donc nécessaire de renforcer les moyens dont dispose le ministère de l'écologie et du développement durable pour assurer le contrôle de l'application de la réglementation relative aux déchets amiantés. Proposition : Inscrire la question de l'amiante résiduel comme une des priorités du ministère de l'écologie et du développement durable. b) Une inadéquation entre la structure actuelle des centres de stockage et les besoins manifestés par les particuliers et les entreprises ● Favoriser la proximité au détriment du respect du droit communautaire ? L'objectif premier de la réglementation relative aux déchets amiantés est la sécurité. Tous les déchets amiantés, y compris ceux d'amiante lié, étant des déchets dangereux, ils doivent être traités comme tels. Toutefois, les exemples recueillis par la mission laissent entendre que des règles trop strictes risquent d'être contreproductives parce qu'elles peuvent favoriser des comportements peu vertueux. La mission a entendu beaucoup de témoignages faisant état de dépôts « sauvages », dans la nature, de plaques de fibrociment dont l'envoi en centre de stockage avait sans doute été jugé trop coûteux ou mal aisé par leurs propriétaires. Un des soucis majeurs du ministère de l'écologie et du développement durable lors de l'élaboration de la circulaire de 2005 précitée a donc été de mettre en place des filières relativement simples d'élimination des déchets amiantés. Il n'est pas toutefois certain que cette solution soit pleinement compatible avec nos engagements européens. Au niveau communautaire, une directive-cadre, prise en 1975 et modifiée en dernier lieu en 1996147, fixe les principes généraux s'appliquant au traitement des déchets en exigeant, par exemple, que leur élimination soit sans danger sur l'environnement. Mais il n'y a pas de réglementation spécifique aux déchets amiantés. Le traitement des déchets amiantés relève, en fait, d'une directive spécifique aux traitements des déchets dangereux148 qui établit la liste des déchets classés dangereux, parmi lesquels les déchets d'amiante. Aujourd'hui, tous les déchets d'amiante entrent dans cette catégorie alors qu'avant 2001, les déchets d'amiante-ciment n'étaient pas classés déchets dangereux. Cette « unification » a été le fait d'une décision de la Commission européenne du 3 mai 2000 qui n'a pas été prise sans difficultés, puisque treize États membres sur quinze l'avaient jugée non justifiée. En 1999, une directive est venue préciser les conditions de mise en décharge des déchets149 en définissant les trois catégories de décharges : pour déchets dangereux, pour déchets non dangereux et pour déchets inertes, c'est-à-dire, s'agissant des derniers, ceux « qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante ». Elle impose, par ailleurs, des règles strictes de fonctionnement, notamment l'obligation de demander une autorisation avant toute mise en exploitation. Aux termes de ce texte, tous les déchets amiantés devaient donc partir en décharge pour déchets dangereux. Une décision du Conseil, prise le 19 décembre 2002, apporte néanmoins une certaine flexibilité en permettant que « les matériaux de construction contenant de l'amiante et les autres déchets d'amiante appropriés », c'est-à-dire les déchets d'amiante lié, puissent être admis en décharges pour déchets non dangereux, à condition de respecter des conditions strictes comme le recouvrement quotidien de la zone de stockage ou l'arrosage régulier des déchets. Parmi les trois classes réglementaires de décharges en France, seules les décharges de classe 1 et 2 s'inscrivent dans le cadre de la transposition de la directive de 1999. Celles de classe 3 n'étant pas soumises à autorisation préfectorale, elles ne peuvent en aucun cas, au sens de la législation communautaire, accueillir les déchets amiantés. Malgré l'assouplissement des contraintes entourant le traitement des déchets d'amiante lié par la décision du Conseil européen du 19 décembre 2002, ils ne peuvent tout au plus être dirigés qu'en décharge de classe 2. La circulaire du 22 février 2005 n'est donc pas compatible avec le droit communautaire lorsqu'elle interprète la définition des déchets inertes, au sens de la directive de 1999, comme permettant « de considérer que les déchets de construction contenant de l'amiante présentent les caractéristiques des déchets inertes dès lors que les fibres d'amiante sont contenues dans un support inerte qui n'a pas perdu son intégrité et que les déchets sont manipulés et stockés dans [certaines] conditions » et lorsqu'elle autorise le stockage de ces déchets dans des alvéoles spécifiques situées à l'intérieur de décharges pour déchets inertes (décharges de classe 3). Aussi, la Commission européenne a-t-elle indiqué à la mission qu'elle est sur le point d'entamer une procédure d'infraction contre la France pour transposition incomplète de la directive 1999/31/CE en ce qui concerne les déchets inertes. Dans un premier temps, la possibilité offerte par le droit français, tel qu'il résulte de la circulaire, a heurté les membres de la mission. En effet, si le qualificatif « inerte » peut se concevoir lorsque le produit est neuf, il devient de moins en moins approprié au fur et à mesure que celui-ci vieillit. Surtout, le choix opéré par la circulaire crée un réel décalage entre la classification de tous les déchets amiantés comme produit dangereux et la banalisation du traitement des déchets d'amiante lié dans des sites librement ouverts à tous publics. Pourtant, le ministère de l'écologie et du développement a ainsi justifié sa position : « l'esprit de la circulaire de février 2005 était de bien rappeler, à la suite du classement de l'amiante-ciment en déchet dangereux, l'existence de possibilités relativement simples d'élimination de ces déchets. Trop d'exigences, entraînant des coûts trop élevés, n'auraient fait qu'accentuer davantage encore le phénomène de pertes. Les dispositions préconisées en concertation avec les autres administrations nous ont paru suffisantes car un durcissement de la réglementation se serait traduit par une augmentation des quantités non contrôlables, sachant que l'amiante-ciment était un produit très largement diffusé. Un inventaire, déjà peu aisé pour l'amiante-flocage, deviendrait particulièrement complexe à réaliser dans le cas de l'amiante-ciment »150. La mission, après réflexion, a jugé que les arguments de proximité et de facilité qui fondent la position française n'étaient pas infondés et que cette solution, en tout état de cause, était préférable à un traitement sauvage des déchets. Néanmoins, l'éventuelle incompatibilité du dispositif français avec la législation communautaire pose problème. Il semble, à vrai dire, qu'il y ait un réel déficit de dialogue entre le ministère français de l'écologie et du développement durable et la Direction générale environnement de la Commission européenne. En effet, les auditions menées à Bruxelles ont montré que les services de la Commission ne sont pas insensibles aux arguments français. Mais elles ont aussi montré que des initiatives sont parfois prises de part et d'autres, sans réelle concertation ni information réciproque. Une telle situation est regrettable, car non seulement elle place notre pays dans une position délicate par rapport aux exigences du droit communautaire - comme en témoigne la procédure sur le point d'être engagée contre la France -, mais elle empêche également toute réflexion constructive sur les améliorations qui pourraient être apportées à la situation. Proposition : Engager un dialogue constructif avec la Commission européenne pour mettre en place une réglementation facilitant l'envoi en toute sécurité des déchets amiantés vers leur lieu d'élimination. ● Améliorer le réseau actuel de centres de stockage Parallèlement à ce nécessaire effort de coordination avec les autorités communautaires, la mission d'information considère que les pouvoirs publics doivent engager une réflexion sur la répartition, sur le territoire français, des centres de stockage susceptibles d'accueillir des déchets amiantés. Tout d'abord, les auditions de la mission ont permis de constater l'inégale répartition des centres de stockage de classe 1 sur le territoire national. Ceux-ci sont, en effet, essentiellement concentrés au nord de la Loire. Répartition des centres de stockage de classe 1
Cette inégale répartition géographique peut poser de sérieux problèmes, comme l'a indiqué un témoin qui a donné l'exemple d'une opération de désamiantage ayant lieu à Nice, pour laquelle le centre de classe 1 le plus proche se trouve dans le Gard. Une telle distance implique des coûts élevés de traitement des déchets dans des conditions conformes à la réglementation et peut expliquer - sans le justifier - que cette dernière ne soit pas toujours respectée. Par ailleurs, même dans la moitié nord de la France, il a été précisé que « l'identification des sites de classe 1 dans le cadre des différents plans régionaux d'élimination des déchets dangereux - celui de l'Île-de-France est en cours de révision - a permis d'établir que le parc existant était suffisant au regard de la demande »151. Il en va de même pour les sites de classe 2 qui sont également clairement en déficit. Selon le ministère de l'écologie et du développement durable, sur les 200 sites les plus significatifs, c'est-à-dire ceux qui accueillent plus de 20 000 tonnes par an, seuls trente-sept acceptent l'amiante-ciment152 ! Il faut donc beaucoup de chance ou une très grande motivation pour se mettre en totale conformité avec la réglementation ! Le véritable enjeu consiste alors à trouver un compromis satisfaisant entre sécurité et proximité. La mission considère que le très grand nombre de déchetteries réparties sur l'ensemble du territoire constitue un atout. Ce ne sont pas des endroits de stockage mais de transit. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, comme cela a été indiqué, « un particulier qui se présente dans une déchetterie avec des déchets d'amiante - fibrociment ou amiante libre - trouvera différentes bennes à sa disposition. Sans se poser de questions, il mettra le fibrociment avec les matériaux inertes et son four comportant un joint amiantifère avec la ferraille... Du fait de ces mélanges, la traçabilité n'est évidemment pas assurée. En revanche, la déchetterie sait exactement où elle envoie ses bennes et tout cela sera notifié sur des bordereaux de suivi »1. Certaines déchetteries ont donc mis en place des bennes spécifiques à l'amiante, vers lesquelles le gardien guide les déposants de fibrociment (...). Ces bennes dédiées sont prééquipées d'un grand « big bag » identifié amiante, refermé par le collecteur qui le transporte vers des sites de stockage de classe 1. Malgré l'intérêt de ces initiatives, il a été indiqué à la mission qu'elles étaient encore peu nombreuses. C'est pour cette raison que la mission invite le ministère de l'écologie et du développement durable - en coordination avec la Commission européenne - à étudier la possibilité de généraliser ces plateformes de regroupements sécurisées, les seules à même d'assurer l'efficacité de la réglementation en vigueur. Proposition : Utiliser le réseau des déchetteries existantes pour mettre en place des plateformes de regroupements de déchets amiantés préalablement à leur élimination. Bien évidemment, une telle opération aura un coût important lié, notamment, à l'entretien des plateformes de regroupement et au paiement du transport vers les sites d'accueil des déchets. Une réflexion doit donc s'engager pour définir les modalités de prise en charge de ces dépenses dont l'intérêt environnemental ne saurait être nié. c) Une innovation insuffisamment encouragée Aujourd'hui, deux voies sont possibles pour traiter les déchets amiantés : l'envoi en centre de stockage de classe 1 ou la vitrification. Une des conditions fondamentales à la bonne gestion de ces déchets est d'éviter l'exposition des populations actuelles et futures à l'amiante. Dans cette optique, et comme l'a précisé le rapport du professeur Got de 1998, le stockage en centre d'enfouissement est parfaitement acceptable eu égard à l'insolubilité et à la stabilité de l'amiante. Chacune de ces solutions a ses propres avantages et inconvénients, en termes de coûts ou d'intérêt pratique. S'agissant de la vitrification, par exemple, il a été indiqué que cette filière consomme une énergie considérable mais qu'elle permet « de résoudre totalement la question des fibres d'amiante ». De même, comme la mission l'a constaté, le placement en centre de stockage revient nettement moins cher que l'inertage mais il nécessite un suivi coûteux sur plusieurs décennies. Aussi, la mission d'information n'a pas souhaité privilégier, dans l'immédiat, une de ces deux voies. Toutefois, sur le long terme, l'inertage présente l'avantage, pour une entreprise qui veut se débarrasser de ses déchets, d'être « libérée totalement et définitivement, sans contestation possible, de sa responsabilité »153. En effet, « il n'est pas certain que le concept de réversibilité ne s'applique pas un jour. Confier à une décharge ses déchets d'amiante non traités, c'est prendre le risque que dix, vingt ou trente ans plus tard, ils ne soient plus considérés comme des déchets ultimes, et que l'entreprise se voie priée de procéder à leur traitement ». La mission d'information recommande donc que la recherche, dans le domaine du traitement des déchets amiantés, soit soutenue. Les pouvoirs publics doivent encourager l'innovation dans ce domaine. L'exemple de la société Inertam-Europlasma est, à cet égard significatif. Les auditions que nous avons menées ont montré que cette société a parfois manqué de soutien, notamment de la part du ministère de l'écologie et du développement durable. M. Didier Pineau, président-directeur général d'Europlasma, a ainsi déclaré154 que la société « a eu des subventions de la région Aquitaine. C'est la seule région européenne qui vitrifie ses déchets, qu'il s'agisse des cendres d'incinération ou de l'amiante. La DRIRE d'Aquitaine connaît très bien notre technologie. Mais à Paris, au ministère de l'environnement, nous sommes perçus comme des empêcheurs de mettre en décharge en rond ». La mission a été informée des succès rencontrés au cours des derniers mois par Inertam : à l'automne dernier, cette société a réalisé une levée de fonds de plus de 25 millions d'euros et envisage la création d'une nouvelle unité de production, en France ou à l'étranger. Bien entendu, l'implantation de ce futur centre d'inertage en France a les faveurs de la mission, puisqu'il réduirait en partie le déséquilibre géographique actuel. De même, Inertam a obtenu de la préfecture des Landes, l'autorisation de réutiliser le vitrifiat produit à l'issue du processus d'inertage dans des ouvrages publics tels que les routes. Ce recyclage s'était jusqu'à présent heurté à des difficultés liées aux risques environnementaux d'une telle réutilisation. Cet exemple montre qu'il peut être intéressant d'accompagner les efforts de recherche et de développement dans le domaine des déchets amiantés. Si des investisseurs privés peuvent y trouver leur compte155, il en va de même pour les pouvoirs publics car cela peut être l'occasion de voir apparaître, à terme, de nouvelles filières de traitement, moins onéreuses et encore plus protectrices pour l'environnement. Proposition : Encourager la recherche et le développement dans le domaine des déchets amiantés, notamment pour rendre plus accessible la vitrification et demander aux pouvoirs publics qu'ils facilitent l'installation en France d'un deuxième centre d'inertage. d) Des élus locaux insuffisamment informés Les travaux de la mission ont montré que les élus locaux sont rarement correctement informés des enjeux liés au traitement des déchets amiantés. Le ministère de l'écologie a cependant indiqué que la circulaire du 22 février 2005 relative aux conditions d'élimination des déchets d'amiante lié et prise conjointement avec le ministère délégué au logement et à la ville, a été envoyée à tous les préfets, lesquels ont été invités à faire une large communication de cette circulaire dans leur département. Par ailleurs, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a publié, dans sa lettre mensuelle d'octobre 2005, un dossier sur les conditions d'élimination des déchets d'amiante lié, reprenant les points principaux de la circulaire précitée. La mission d'information tient cependant à rappeler que la compatibilité de cette circulaire avec le droit communautaire n'est pas assurée et qu'il lui paraît étrange de se prévaloir d'un texte qui est sur le point de faire l'objet d'une procédure contentieuse à l'initiative de la Commission européenne. En tout état de cause, l'enquête menée par la mission auprès de plus de 200 collectivités locales a montré qu'il existe un réel déficit d'information de celles-ci, en particulier les plus petites d'entre elles, quant à la question du devenir des déchets issus des travaux de désamiantage opérés sur leurs bâtiments. Proposition : Sensibiliser les élus locaux au problème de la gestion des déchets amiantés, en particulier par le biais de leurs associations. e) Des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre à sensibiliser Enfin, le problème des déchets doit être mieux pris en compte par le client. Les auditions de la mission ont montré que, bien souvent, le traitement des déchets - qui représente en moyenne 3 % d'un budget de désamiantage156 - est davantage perçu comme un surcoût gênant que comme une opération nécessaire et sensible. Plusieurs solutions ont été suggérées à la mission comme celle d'imposer directement la prise en charge des déchets par le maître d'ouvrage avec, éventuellement, l'assistance opérationnelle de l'entreprise de désamiantage ou d'instaurer des aides financières à leur élimination dans de bonnes conditions. Ces propositions constituent des pistes de réflexion intéressantes qu'il convient d'examiner. L'attitude des pouvoirs publics lors de la passation de marchés publics a également été parfois critiquée. Ainsi, le cas a été cité d'un organisme d'État qui avait attribué un marché dans lequel la quantité de déchets d'amiante à diriger vers l'inertage avait été sous-estimée à hauteur de 80 tonnes. Toutefois, les auditions ont montré que les grandes administrations et entreprises publiques ont pleinement intégré la problématique des déchets dans leurs opérations de désamiantage. Elles n'hésitent pas à recourir à l'inertage même si, comme a pu le déclarer la RATP, elles privilégient souvent le prix157. Surtout, la mission a eu l'occasion de constater que - faute d'obligation réglementaire sur ce point - les plans de retrait rédigés par les entreprises de désamiantage ne mentionnent pas le sort des déchets. Pourtant, le décret n° 96-98 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, qui prévoit ces plans, est très strict. Ils doivent indiquer la nature et la durée probable des travaux, le lieu où ces derniers seront effectués, les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de produits amiantés, les caractéristiques des équipements de protection et, enfin, la fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier. Par ailleurs, les plans de retrait sont soumis à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité (ou, à défaut, des délégués du personnel) et transmis à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention de la sécurité sociale. Il serait donc logique que cette réglementation, très rigoureuse, s'étende au traitement des déchets. Cette mesure permettrait d'organiser un suivi efficace des déchets par l'utilisation d'un « bordereau de suivi des déchets amiantés » jusqu'à l'installation finale de traitement. Proposition : Compléter la réglementation pour rendre obligatoire la mention du sort des déchets dans les plans de retrait préalables aux travaux de désamiantage. G.- L'AMIANTE À L'ÉTAT NATUREL DANS L'ENVIRONNEMENT : LE CAS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE La nocivité de la fibre d'amiante n'est pas le fait des seules activités humaines. Les gisements d'amiante sont présents à l'état naturel dans de nombreuses régions du monde, et si les activités d'extraction de la roche ont évidemment suscité des pollutions importantes et dangereuses - comme à Canari en Haute-Corse, ou dans les mines québécoises d'Asbestos ou de Thetford Mines - les sites amiantifères peuvent également se révéler dangereux sans aucune manipulation géologique. Tel est le problème particulier auquel est confrontée, par exemple, la France sur l'île de la Nouvelle-Calédonie. Dans son rapport publié en octobre 2005158, la mission d'information du Sénat a consacré un chapitre très documenté aux problèmes posés par les gisements amiantifères de Haute-Corse, en particulier le suivi du traitement du site de Canari qu'elle a visité. La mission de l'Assemblée nationale partage ses analyses et conclusions, notamment les mesures de prudence dont doivent faire preuve les professionnels du bâtiment vis-à-vis des poussières des chantiers et des déblais, dans les zones que le BRGM159 a repérées comme amiantifères. La mission du Sénat a également décrit la situation problématique et spécifique de la Nouvelle-Calédonie et les travaux de notre mission permettent aujourd'hui de compléter sur certains points l'étude menée par le Sénat. De nombreux gisements amiantifères sont présents dans le sous-sol de la Nouvelle-Calédonie. Deux types de fibres ont été retrouvées dans l'île : du chrysotile (variété de serpentine), et de la trémolite (variété d'amphibole). La présence de ces fibres à l'état naturel a déjà provoqué l'apparition de maladies typiques de l'amiante, et le problème est ici posé sous un angle environnemental. En effet, il n'y a pas eu en Nouvelle-Calédonie d'industrie de production, de transformation, ni même d'utilisation de l'amiante en tant que tel. Trois problèmes ont été évoqués devant la mission par l'ANDEVA160, qui ont été confirmés par un échange avec M. André Fabre, géologue et membre de l'association des victimes de l'amiante de Nouvelle-Calédonie. Premièrement, la prise en charge des victimes néo-calédoniennes de l'amiante pose problème. En effet, des incertitudes pèsent sur l'applicabilité du système du FIVA à ces victimes, étant donné le régime juridique particulier lié au statut d'autonomie du territoire néo-calédonien. Cette question est traitée dans la partie consacrée à la prise en charge des victimes161. Deuxièmement, l'amiante a été utilisé de longue date par les habitants mélanésiens pour isoler les constructions de l'habitat local, au moyen d'un enduit artisanal appelé « Pö », contenant une forte proportion de fibres de trémolite. La pollution importante qui résulte de ces constructions a été relevée dès 1994 par des chercheurs de l'INSERM. Elle a fait l'objet d'une campagne importante de reconstruction de l'habitat mélanésien, dans le but d'éradiquer la trémolite des logements. Ce programme, auquel 17 millions d'euros ont été consacrés, s'est achevé à la fin de l'année 2005. Il a suscité de la part de M. Fabre une appréciation mitigée. Il semblerait que le programme soit un succès incontestable sur le plan de l'habitat lui-même et de la pollution liée au « Pö ». En revanche, M. Fabre a critiqué le fait que le programme se soit limité aux constructions. En effet, hormis le problème de l'habitat, les mesures effectuées en 1994 par l'INSERM faisaient état d'un taux de poussières d'amiante sur les pistes proche des 2 fibres/ml d'air. Cette source de pollution semble toujours d'actualité. Enfin, la question du rôle joué par l'industrie du nickel a été évoquée devant la mission, mais elle reste pour l'heure sans réponse. En effet, nickel et amiante sont étroitement liés au plan géologique, car les serpentines proviennent de l'altération de la roche mère du nickel : la péridotite. La présence conjuguée sur le sol néo-calédonien d'importants gisements amiantifères et de 30 % de la réserve mondiale en nickel ne doit donc rien au hasard. À l'instar de M. André Fabre, certaines personnes s'interrogent sur la pollution à l'amiante qui pourrait être générée accidentellement par l'activité de production de nickel dans l'île, et sur ses conséquences notamment sur la santé des travailleurs. Le constat est cependant difficile à établir sans une véritable analyse métrologique de l'île. Selon les informations publiées par la mission du Sénat, le ministère de l'Outre-mer aurait engagé 15 000 euros pour diligenter une expertise de l'Institut Pasteur et du BRGM en ce sens. Une telle expertise ne semble pas suffisante, notamment en comparaison avec les expertises menées en Haute-Corse pour évaluer la pollution issue des gisements amiantifères. Aucun argument ne justifie que la situation néo-calédonienne ne fasse pas l'objet d'une attention similaire des pouvoirs publics. Les incertitudes pesant sur la pollution en fibres d'amiante dans l'ensemble de l'île - tant sur les pistes empoussiérées qu'à proximité des mines de nickel - appellent une expertise de grande ampleur que les moyens dégagés par le seul ministère de l'Outre-mer ne suffiront pas à mener. Cette expertise est particulièrement importante pour la Nouvelle-Calédonie, compte tenu de l'enjeu capital que représente la production de nickel162 pour les populations. Pour la mission, il ne serait pas acceptable que le schéma bien connu consistant à occulter les risques pour satisfaire les besoins économiques de tous se reproduise aujourd'hui, alors qu'une expertise précise pourrait conduire à des mesures de prévention simples garantissant à la fois le maintien de l'activité et la santé des travailleurs et des populations. C'est une des principales leçons que le présent rapport entend d'ailleurs tirer de l'histoire de l'amiante163 : que cela ne se reproduise pas. Proposition : Engager une expertise environnementale et métrologique de grande ampleur sur la pollution aux fibres d'amiante en Nouvelle-Calédonie, pour mettre en place, le cas échéant, des mesures de protection appropriées. II.- LA FRANCE DOIT AGIR AU NIVEAU INTERNATIONAL POUR QUE CESSENT LA PRODUCTION, LA TRANSFORMATION ET LE COMMERCE DE L'AMIANTE DANS LE MONDE A.- L'AMIANTE EN EUROPE : UN PRODUIT INTERDIT 1.- La difficile interdiction de toutes les formes d'amiante en Europe a) Les mesures nationales d'interdiction Avant d'aborder la législation communautaire qui interdit, depuis le 1er janvier 2005, la mise sur le marché et l'emploi de tous les types de fibres d'amiante, la mission d'information a souhaité connaître l'attitude de nos partenaires européens dans les années précédant cette interdiction. En effet, cette comparaison peut permettre de mieux appréhender les questions soulevées par l'amiante dans notre propre pays. Que s'est il passé ailleurs ? Comment nos voisins ont-ils procédé ? Quand ont-ils agi ? Pour répondre à ces interrogations, le Président et le Rapporteur de la mission ont demandé au ministère des affaires étrangères une étude sollicitant nos postes diplomatiques dans tous les États-membres de l'Union européenne. Ce travail a été réalisé au mois de novembre 2005 par le biais de contributions de nos missions économiques dans dix-huit pays européens164 qui ont été collectées par la Direction générale du trésor et de la politique économique. Ces nombreuses et très intéressantes données ont pu être recoupées avec celles fournies par le réseau international Ban Asbestos et M. Alain Destexhe, sénateur fédéral de Belgique, au cours d'un entretien avec les membres de la mission, le 2 décembre dernier, à Bruxelles. Deux constats doivent être faits. D'une part, les interdictions nationales ne sont pas toutes intervenues au même moment, certains pays s'avérant plus réactifs que les autres face aux dangers de l'amiante. D'autre part, ces interdictions se sont bien souvent heurtées à des obstacles qui ont pu en limiter la portée, voire retarder la mise en œuvre. ● La lente et progressive diffusion de l'interdiction : Il n'est pas évident de déterminer avec précision la date à laquelle un pays a interdit l'amiante. Tout d'abord, dans chaque Etat, les mesures prises ont été très étalées dans le temps : l'emploi des fibres les plus dangereuses a toujours été prohibé en premier et l'interdiction du chrysotile n'est, en général, intervenue qu'ultérieurement pour parachever le processus d'interdiction. Ensuite, il ressort de l'étude fournie à la mission que tous les dispositifs nationaux ont systématiquement prévu des dérogations. Par exemple, en Allemagne, où la production de toutes les formes d'amiante a été interdite à compter du 1er janvier 1991 et leur utilisation à partir du 1er janvier 1992, plusieurs produits comportant de l'amiante ont bénéficié d'un délai supplémentaire jusqu'au 31 décembre 1993 pour leur production et jusqu'au 31 décembre 1994 pour leur utilisation, voire jusqu'à la fin 2010 pour les diaphragmes utilisés pour l'électrolyse alcaline au chlore. Malgré cette difficulté méthodologique, la mission a considéré que les décisions nationales concernant le chrysotile, puisqu'elles viennent clore le processus d'interdiction propre à chaque pays, peuvent servir de repère pour déterminer la date d'interdiction. Sur cette base, on distingue trois groupes d'États parmi les vingt-cinq membres de l'Union européenne : Les pays scandinaves, précurseurs. Un premier groupe, essentiellement les pays nordiques, a réagi dès les années 80. Deux pays n'ayant pas adhéré à l'Union européenne, l'Islande et la Norvège, ont interdit toutes les formes d'amiante dès 1983 et 1984 (avec quelques exceptions revues dans les années 90). Parmi les États-membres, le Danemark a décidé, dès 1986, de prononcer l'interdiction de produire, d'utiliser et de travailler l'amiante ou tout produit contenant de l'amiante. Ce pays avait déjà été précurseur puisqu'il avait, en 1972, proscrit l'amiante en tant que matériel isolant. La Suède, elle aussi, a très tôt pris conscience de la nécessité d'agir puisque la première réglementation relative à l'utilisation de l'amiante y remonte à 1964. Elle avait pour but de réduire la poussière générée et à remplacer l'amiante par d'autres substances lorsque cela était possible. L'Europe continentale où s'est produite la vague d'interdiction des années 90. Après l'Europe du Nord, une « vague » d'interdiction atteint plusieurs pays de l'Union européenne au cours des années 90 : l'Autriche (1990), les Pays-Bas (1992), l'Italie (1992), l'Allemagne (1992), la France (1996), la Belgique (1998). Le Royaume-Uni et l'Irlande font de même en 1999 et en 2000. Comme indiqué précédemment, ces interdictions suivaient d'autres mesures préalables et venaient, en fait, clore un processus plus long. Le Royaume-Uni, par exemple, avait interdit l'amosite et la crocidolite dès 1985. Toutefois, ces décisions ont parfois été assorties, comme cela a été souligné, de dérogations temporaires. Ainsi, aux Pays-Bas, l'application professionnelle et la commercialisation de tous types d'amiante ont été prohibées à partir du 1er juillet 1993 mais il a fallu attendre 1998 pour que soit supprimée la possibilité d'employer de l'amiante à des fins d'entretien ou de réparation de matériaux contenant eux-mêmes de l'amiante et présents dans des bâtiments. L'Europe du Sud et les nouveaux États-membres de l'Union qui ont connu un grand retard. La « vague » d'interdiction n'atteint que tardivement l'Europe du Sud, en tout cas après que le législateur communautaire ait adopté, en 1999, la directive n° 1999/77/CE du 26 mars 1999 qui prohibe, au sein de l'Union européenne, la mise sur le marché et l'emploi des fibres d'amiante chrysotile et de l'ensemble des produits qui en contiennent. En Espagne, l'interdiction intervient en 2002. Au Portugal, à Malte, à Chypre et en Grèce, elle n'a lieu qu'en 2005, à l'expiration du délai de transposition de la directive n° 1999/77/CE. Le cas de cette dernière est d'ailleurs intéressant : alors que peu de pays européens ont été de grands producteurs d'amiante, en 1995, la Grèce en était le 7ème producteur dans le monde avec une production d'environ 100 000 tonnes par an. L'exploitation de la principale mine de chrysolite, à Kozani, n'a commencé qu'en 1981 et a produit, jusqu'en 2000, 905 388 tonnes d'amiante. La majeure partie (97 %) de cette production était destinée à l'exportation et le solde était destiné aux quatre usines grecques fabriquant des produits d'amiante-ciment. Ce n'est qu'en mars 2000 que l'extraction et l'exploitation de la mine ont cessé définitivement. S'agissant de l'Europe centrale et orientale, la directive de 1999 a, elle aussi, permis d'imposer la mise « hors-la-loi » de l'amiante dans ces États. La question est d'autant plus sensible que bon nombre d'entre eux ont longtemps été des débouchés obligés de la production des mines kazakhs et russes, à l'époque où l'Union soviétique dominait la région. En Lettonie, par exemple, le chrysotile, a été particulièrement utilisé à partir de 1940. Aujourd'hui, compte tenu de l'utilisation très fréquente de ce produit, le volume des matériaux contenant de l'amiante y est évalué à 2,24 millions de tonnes et le stock d'amiante pur à 235 000 tonnes. En Lituanie, pays qui n'a jamais été producteur, l'étude fournie à la mission indique que les importations ont été relativement significatives jusqu'en 2001. En Pologne, le programme gouvernemental d'élimination de l'amiante estime qu'il y a, dans ce pays, 15,5 millions de tonnes de produits contenant de l'amiante et que ce produit est présent dans plus d'un million et demi de bâtiments soit 24 % des constructions polonaises. On estime qu'environ 6,65 millions de tonnes de déchets amiantés seront produits, d'ici 2014, dans ce pays. Bien entendu, cette répartition des États comporte des exceptions qui montrent une diffusion de l'interdiction « en tâche d'huile » à partir de la Scandinavie. La Finlande, par exemple, sans doute parce qu'elle a été un pays producteur, n'a interdit l'amiante qu'en 1992, bien plus tard que ses voisins nordiques. À l'inverse, il faut souligner que tous les pays d'Europe centrale et orientale ayant adhéré à l'Union en 2004 n'ont pas attendu le dernier moment pour prendre des mesures d'interdiction. En Pologne, par exemple, le premier texte portant sur l'amiante - quoique de portée très limitée - date de 1981. Après plusieurs années de silence du législateur, protégeant de fait les fabricants de panneaux en amiante-ciment, le changement de régime politique a conduit à la diffusion d'analyses démontrant l'effet cancérigène de l'amiante et celles-ci ont contraint les autorités polonaises à légiférer à nouveau. Après un arrêté ministériel de 1994 posant plusieurs interdictions, une loi, votée le 19 juin 1997 est venue interdire, par étapes successives, la production, l'importation et l'utilisation des produits contenant de l'amiante. En dépit de ces cas particuliers, on peut dire que l'Europe du Nord a clairement initié cette « vague » d'interdiction. Le reste du continent a, peu à peu, adopté des décisions similaires et, à cet égard, la France ne se démarque pas excessivement de ses voisins. Elle a même agi avant certains d'entre eux, comme la Belgique ou le Royaume-Uni et a joué un rôle important dans l'adoption d'une mesure d'interdiction générale au niveau communautaire. Par ailleurs, ce processus d'interdiction, quelque peu hétérogène en ce qu'il s'est étendu sur deux décennies, s'est heurté, dans la plupart des pays, à de nombreuses difficultés. ● Des interdictions nationales contestées : La mission d'information a relevé que très peu de nos partenaires européens ont réussi à interdire l'amiante sans se heurter à certains obstacles ou susciter de vives polémiques. C'est pourtant le cas du Luxembourg où l'utilisation de l'amiante n'a pas semblé constituer un sujet de préoccupation prioritaire : selon les responsables interrogés dans le cadre de l'étude fournie à la mission, son impact n'a jamais causé de préjudice majeur au sein de la population. Ailleurs, plusieurs difficultés ont, au contraire, pu être constatées. Le lobbying des industriels n'a pas été l'apanage de la France. Au-delà du cas d'Eternit, qui sera examiné plus loin, les entreprises qui participaient à l'extraction ou employaient de l'amiante dans leur production ont parfois cherché à freiner le processus d'interdiction de ce matériau. Par exemple, en Suède, les industriels du secteur ont tenté, au cours des années 70, de faire admettre qu'il n'était pas possible de remplacer l'amiante mais ce discours a été abandonné au fur et à mesure qu'étaient démontrées les possibilités de substitution. Au nom de la protection de l'emploi, les syndicats ont également été un obstacle à une interdiction rapide de l'amiante dans certains pays. Cela fut le cas dans des États comme la France, l'Espagne ou la Grèce, mais aussi aux Pays-Bas où, lors de l'interdiction officielle de l'application professionnelle et la commercialisation de tous types d'amiante, en 1993, le syndicat des salariés FNV a tenté, en vain, de prolonger les processus de fabrication d'amiante en cours. Cependant, l'attitude des syndicats fut parfois diamétralement opposée comme en Italie où l'objectif d'interdiction de l'extraction et de l'utilisation de l'amiante a fait l'objet de nombreuses revendications syndicales, dès les années 70. Paradoxalement, chez certains membres de l'Union européenne, l'opposition à la réglementation a pu être le fait de la population elle-même. Ainsi, en Lettonie, un règlement édicté en avril 2001 imposait le retrait, à l'échéance 2010, de l'amiante dans tous les bâtiments mis en exploitation avant 2001, aux frais des propriétaires. Face à la pression publique et à la vive polémique causée par cette disposition, l'obligation a été annulée en août 2005 pas les autorités lettonnes. b) La prudence des institutions communautaires Progressif et sur certains points dérogatoire, le processus communautaire d'interdiction de l'amiante ressemble à ceux des États-membres. Dans le domaine de la vie professionnelle, la nécessaire protection des travailleurs contre les dangers de l'amiante a été prise en compte par la Communauté économique européenne en 1983, avec la directive 83/477/CEE du Conseil du 19 septembre 1983. Outre l'interdiction du flocage, ce texte imposait, entre autres, des valeurs-limites d'exposition et un système de notification aux autorités publiques en cas d'exposition des travailleurs. Comme il sera précisé plus loin, la directive 2003/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 mars 2003 est venue renforcer ce dispositif en élargissant les mesures de précaution obligatoires et en réduisant les possibilités de contact avec l'amiante. S'agissant de la commercialisation et de l'utilisation de l'amiante ou de produits amiantés, la directive servant de base à la règlementation dans ce domaine est la directive 76/769/CEE du 27 juillet 1976 destinée à rapprocher les législations des États-membres « relatives à la mise sur le marché et à l'emploi de certaines substances dangereuses ». Ce sont, en fait, les adaptations successives de ce texte au « progrès technique », elles-mêmes intervenues par voie de directive, qui ont progressivement pris en compte le risque lié à l'amiante. Ainsi, le crocidolite (amiante bleu) et les amiantes amphiboles ont respectivement été interdits en 1983 et 1991 par la directive 83/478/CEE du Conseil du 19 septembre 1983 et la directive 91/659/CEE de la Commission du 3 décembre 1991. De même, la directive 85/610/CEE du Conseil du 20 décembre 1985, prise elle aussi dans le cadre de la directive de 1976, a spécifié que les fibres d'amiante ne pouvaient plus être mises sur le marché ni utilisées dans les jouets et pour divers autres produits comme les articles pour fumeurs, les peintures... Cependant, au milieu des années 90, alors que la question d'interdire toutes les formes d'amiante se posait dans de nombreux États et avait donné lieu à plusieurs décisions en ce sens, la Communauté européenne n'avait toujours pas agi. Selon M. Laurent Vogel165 de la CES166, la décision française prise en 1996 a joué un rôle moteur dans le processus conduisant à l'interdiction communautaire. En effet, pendant longtemps, la Commission européenne a paru ne pas vouloir froisser certains États en adoptant des positions prudentes et en semblant attendre qu'une majorité nette se dessine en faveur de l'interdiction. Par exemple, dans une communication du 5 septembre 1996 concernant l'application de la directive du 19 septembre 1983 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l'amiante, la Commission indiquait qu'elle avait organisé deux réunions avec les représentants des États-membres, en 1993 et 1994, au cours de laquelle la question d'une éventuelle interdiction communautaire avait été posée. Les États ne s'étant pas mis d'accord sur une telle mesure, elle n'envisageait aucun changement avant la fin du siècle. Il est, par ailleurs, significatif que la Commission ait intenté un recours contre l'Italie, en 1994, lorsque celle-ci a interdit l'amiante. Ce recours était fondé sur l'argument, purement formel167, de l'absence de notification du projet de loi dans le cadre de la procédure d'information sur les normes et réglementations techniques, mais, dans le contexte politique de l'époque, cette action devant la CJCE168 constituait un appui indirect au lobby pro-amiante, lequel avait mené une campagne très active contre l'interdiction italienne. La décision française a donc permis de lever les blocages en donnant un signal fort en faveur de l'interdiction totale de l'amiante qui a permis l'adoption de la directive 1999/77/CE. D'ailleurs, le type d'instrument juridique choisi par la Commission est, lui-même, révélateur du souci d'aller vite, puisque ce texte est une directive « de la Commission » et non une directive du Conseil ou du Parlement, pour laquelle la procédure aurait été beaucoup plus longue. La « bataille » fut donc rapidement gagnée, en dépit de la résistance de certains États, en particulier ceux de l'Europe du Sud qui étaient encore loin d'avoir été touchés par la « vague » d'interdiction née quinze ans plus tôt. 2.- Une législation communautaire globalement satisfaisante malgré certaines lacunes La législation communautaire relative à l'amiante concerne trois domaines : outre le sort des déchets amiantés examiné précédemment, elle vise la protection des travailleurs et interdit sa mise sur le marché. a) La directive de 1999 sur l'interdiction de la mise sur le marché et de l'emploi de l'amiante et des produits en contenant Cette interdiction résulte de la directive 1999/77/CE qui interdit « la mise sur le marché et l'emploi » de toutes les fibres d'amiante « et des produits auxquels elles ont été délibérément ajoutées », même si l'utilisation de ces derniers, lorsqu'ils étaient installés ou en service avant le 1er janvier 2005, est « autorisée jusqu'à leur élimination ou leur fin de vie utile » à moins que « pour des raisons de protection de la santé », les États n'en décident autrement. Surtout, sont exemptés de l'interdiction « les diaphragmes des cellules d'électrolyse existantes » qui servent à la production du chlore et peuvent, dans certains cas, contenir des fibres de chrysotile. Il ressort des auditions menées par la mission que cette technique est désormais très peu utilisée et qu'il existe des procédés de substitution. En fait, cette dérogation a été demandée par l'Allemagne dont l'industrie nationale tenait fermement au maintien de cette technique. Cependant, la directive 1999/77/CE prévoit expressément que cette dérogation devra être réexaminée par la Commission avant le 1er janvier 2008, celle-ci devant se prononcer après avoir recueilli l'avis du Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux. Celui-ci devrait rendre ses conclusions vers la fin 2006 ou au début de l'année 2007. La mission d'information souhaite vivement que cette exception ne soit pas prolongée car les motifs de sécurité invoqués lors de la négociation de la directive paraissent beaucoup moins déterminants que les considérations financières qui ont pu la motiver. Le Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux Le Comité SCHER (« Scientific Committee on Health and Environment Risks ») a succédé, en 2004, au Comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement, créé sept ans plus tôt. Il fait partie d'un ensemble de trois comités chargés de fournir des avis scientifiques à la Commission dans leurs domaines respectifs. Ils interviennent soit en cas de consultation par la Commission, soit en attirant son attention sur un problème spécifique et leurs membres sont désignés sur la base de leurs compétences et de leur expérience et, dans le respect de ce critère, d' « une répartition géographique qui reflète la diversité des problèmes et approches scientifiques dans l'Union européenne ». Le Comité SCHER se compose de 18 membres nommés pour trois ans renouvelables au maximum trois fois consécutivement. Proposition : Veiller au non renouvellement, en 2008, de la dérogation en faveur des « diaphragmes des cellules d'électrolyse existantes » servant à la production du chlore. Cette dérogation est contenue dans la directive 1999/77/CE qui interdit la mise sur le marché et l'emploi de toutes les fibres d'amiante et des produits en contenant. Par ailleurs, la mission a interrogé la Commission européenne sur la mise en œuvre de la directive 1999/77/CE, dont le délai de transposition était le 1er janvier 2005. Responsable du suivi de ce texte, la Direction générale entreprises et industrie a indiqué que tous les États-membres ont pris les dispositions nécessaires et qu'aucun recours en manquement n'est pendant devant la CJCE. Toutefois, si les législations nationales ont toutes intégré les exigences de la directive, les autorités nationales rencontrent encore parfois des difficultés pour assurer leur respect, en particulier dans les nouveaux États-membres169. En tout état de cause, si un produit contenant de l'amiante est mis sur le marché, il peut se voir appliquer la procédure prévue par le système d'alerte rapide pour les produits à risque grave mise en place par l'Union européenne (Système RAPEX), pour coordonner et faciliter le retrait du marché des produits susceptibles de menacer la santé et la sécurité des consommateurs. b) La directive de 2003 sur la protection des travailleurs face aux dangers de l'amiante ● Un dispositif adopté à l'unanimité Celle-ci résulte de la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 mars 2003 (directive 2003/18/CE) modifiant celle du Conseil du 19 septembre 1983 (directive 83/477/CEE). Dès la fin des années 90, dans la perspective d'une interdiction communautaire de l'utilisation de l'amiante chrysotile à partir de 2005, la Commission a considéré qu'il était nécessaire de perfectionner les mesures en vigueur. En effet, la prohibition de toutes les formes d'amiante ne signifiait pas, pour autant, la fin des problèmes. La Commission était consciente du risque encouru par les travailleurs opérant dans le secteur du désamiantage ou dans la maintenance de constructions amiantées. À l'invitation du Conseil des ministres170, et encouragée en ce sens par un avis du Comité économique et social de l'Union européenne171, elle a donc proposé un dispositif qui a été adopté à l'unanimité des États-membres. Ce dernier, tout d'abord, abaisse la valeur-limite d'exposition professionnelle à 0,1 fibre/ml par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (auparavant, les normes allaient de 0,3 fibres/ml pour le crocidolite et les autres formes d'amiante à 0,6 fibres/ml pour le chrysotile). Ensuite, la directive 2003/18/CE prohibe l'exposition des travailleurs aux fibres d'amiante lors de l'extraction, la fabrication et la transformation de produits qui en contiennent, à l'exception des activités de désamiantage et de la mise en décharge des déchets qui en résultent. Le texte introduit, par ailleurs, l'obligation pour l'employeur de constater, avant la mise en œuvre d'un projet de désamiantage, la présence ou la présomption de la présence d'amiante dans les bâtiments et d'adopter les mesures de protection appropriées. Il prévoit également qu'avant de réaliser des travaux de démolition ou de désamiantage, les entreprises doivent fournir les preuves de leurs capacités dans ce domaine (ces preuves doivent être établies en conformité avec les législations nationales). Enfin, la directive entend mettre à jour les recommandations pratiques pour la surveillance clinique des travailleurs exposés, à la lumière des connaissances médicales les plus récentes, en vue d'un dépistage précoce des pathologies liées à l'amiante. ● Des lacunes et des oublis Toutefois, le contenu de certaines dispositions de même que certains oublis sont regrettables. - Les « expositions sporadiques » En premier lieu, son article 1.3 assouplit les obligations de l'employeur en cas d'« expositions sporadiques » et de faible intensité sans dépassement de la valeur limite d'exposition. Il s'agit de certaines activités considérées à bas risques, comme de courtes activités d'entretien sur des matériaux non friables ou le prélèvement d'échantillons destiné à déceler la présence d'amiante. Dans ce cas, l'employeur peut être exempté des obligations systématiques de notification, d'enregistrement et d'évaluation préalable et régulière de la santé des travailleurs. Il ne s'agit pas d'une véritable dérogation mais de la simplification d'une procédure jugée trop bureaucratique. La Direction générale emploi et protection sociale a indiqué que lors de l'adoption du texte, tous les États ont considéré que le dispositif retenu constituait « un bon point d'équilibre entre les strictes mesures de protection nécessaires dans la matière et la simplification administrative des procédures sans une grande valeur ajoutée en termes de protection en cas d'expositions très faibles et sporadiques ne constituant pas un risque significatif ». Toutefois, si l'objectif de l'assouplissement est compréhensible, celui-ci peut se révéler dangereux a posteriori. En effet, les aléas d'une intervention peuvent rapidement transformer une exposition sporadique en une exposition prolongée. De même, rien n'assure que le non dépassement de la valeur limite d'exposition puisse être garanti ab initio. Cela illustre clairement le dilemme auquel doivent faire face les pouvoirs publics lorsqu'ils tentent de concilier santé publique et activité économique : une réglementation trop dense nuit à son efficacité mais l'assouplissement des normes n'est pas, pour autant, pleinement satisfaisant au regard des objectifs de protection sanitaire. - La qualité des entreprises En deuxième lieu, la directive n'impose pas que les travaux de démolition de bâtiments ou installations contenant de l'amiante ou que les travaux de désamiantage soient effectués par des entreprises agréées sur la base de critères adéquats comme la formation des travailleurs, les équipements de protection de qualité, l'expérience de ce type de chantier... Les dispositions de la directive sont trop vagues sur ce point et se situent en retrait par rapport à la Convention n° 162 de l'Organisation internationale du travail de 1986 qui prévoit que ces travaux ne doivent être entrepris que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l'autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux et ayant été habilités à cet effet (article 17 de la Convention). - Les travailleurs indépendants Enfin, la directive 2003/18/CE ne s'applique qu'aux seuls travailleurs salariés et non aux travailleurs indépendants, alors que les risques sont tout aussi importants dans ce domaine. Un employeur voulant s'affranchir des précautions prévues par la directive pourra donc faire réaliser des travaux par un indépendant, sans avoir adopté les mesures prescrites. La Direction générale emploi et protection sociale a expliqué qu'il manquait une base juridique spécifique permettant d'étendre le champ d'application de la directive aux travailleurs indépendants. En effet, selon la Commission, l'article 137 du Traité CEE visé par la directive de 2003, n'autorise pas cette extension. Interrogé par la délégation de la mission d'information qui s'est rendue à Bruxelles, les 1er et 2 décembre 2005, M. Laurent Vogel, de la Confédération européenne des syndicats, a pourtant contesté cette interprétation restrictive en soulignant que certains textes comme la directive sur les chantiers mobiles172 visent expressément les travailleurs indépendants, alors qu'ils ont la même base juridique173. Il convient toutefois de noter que le Conseil a adopté, début 2003, une recommandation spécifiquement consacrée aux travailleurs indépendants174. Ce texte, entre autres dispositions, invite les États membres à prendre toute une série de mesures tenant compte des risques particuliers de certains secteurs et de la nature spécifique de la relation entre les entreprises contractantes et les travailleurs indépendants. Proposition : Inclure, comme le souhaitent les organisations syndicales européennes, les travailleurs indépendants dans le champ de la directive 2003/18/CE sur la protection des travailleurs face aux dangers de l'amiante. On rappellera que les États-membres de l'Union européenne ont jusqu'au 14 avril 2006 pour transposer la directive 2003/18/CE. Ce délai n'étant pas arrivé à échéance, aucune procédure d'infraction n'est en cours. En outre, en réponse à une question de la mission, la Commission a indiqué qu'elle n'a pas connaissance de difficultés particulières dans les dix nouveaux adhérents pour la mise en œuvre des dispositions de cette directive. S'agissant de la France, la réglementation, telle qu'elle résulte, notamment, du décret n° 96-98 du 7 février 1996, est plus protectrice que le dispositif de la directive 2003/18/CE et la question de sa transposition en droit interne ne devrait pas se poser. * * * En dépit des lacunes précédemment relevées, la législation communautaire relative à l'amiante et aux produits en contenant est, sur plusieurs points, pleinement satisfaisante. D'une part, en étendant à l'ensemble du territoire de l'Union l'interdiction de produire et d'utiliser toutes les formes d'amiante, elle a obligé certains États à abandonner une attitude attentiste et figée. La mission d'information est convaincue que sans l'Europe, le chrysotile serait encore produit et en circulation dans certains pays et pas uniquement ceux ayant adhéré à l'Union européenne en 2004. Si la réaction des institutions communautaires peut, sous certains aspects, être jugée quelque peu tardive, il n'en demeure pas moins que l'intégration communautaire a pleinement démontré, ici, son utilité et la « valeur ajoutée » qu'elle apporte à tous les citoyens européens. De même, cette législation donne un signal fort à la communauté internationale, au sein de laquelle - la mission d'information aura l'occasion de le déplorer - très peu d'États ont adopté des normes comparables. Concrètement, il est désormais interdit de continuer à fabriquer, en Europe, des matériaux ou produits contenant de l'amiante qui seraient destinés à l'exportation et la mission ne peut que se féliciter du comportement très responsable de l'Union européenne dans ce domaine. D'autre part, la mission d'information se félicite du lancement prochain d'une « campagne d'inspection amiante » dans l'ensemble des États-membres à l'initiative du Comité des hauts responsables de l'inspection du travail. Le Comité des hauts responsables de l'inspection du travail Fonctionnant, de manière informelle depuis 1982, le Comité des hauts responsables de l'inspection du travail a été officiellement créé par une décision de la commission européenne du 12 juillet 1995. Ce comité est composé de représentants des services de l'inspection du travail des États-membres, à hauteur de deux membres par État. Leur mandat est de trois ans renouvelables. S'agissant de ses missions, le Comité des hauts responsables de l'inspection du travail fournit des avis à la Commission, soit à la demande de celle-ci, soit de sa propre initiative, sur tout problème lié à l'application par les États-membres du droit communautaire en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail. Il arrête un programme triennal dans le cadre duquel les différentes activités à entreprendre sont définies chaque année en tenant compte de l'évaluation des actions de l'année précédente. Dans la perspective de cette enquête, le Comité des hauts responsables de l'inspection du travail a mis au point des protocoles d'inspection spécifiques pour les différentes activités comportant un risque (maintenance, désamiantage, démolition...) et un guide de bonnes pratiques est en cours d'élaboration. Préparé à l'attention des travailleurs, des employeurs et des inspecteurs du travail, ce document sera diffusé dans vingt langues avant le démarrage de la campagne qui devrait commencer en septembre 2006 dans l'ensemble des États-membres. Les inspecteurs du travail disposeront des mêmes documents ; ils poseront les mêmes questions et vérifieront les mêmes aspects partout en Europe. La Direction générale emploi et protection sociale a, en outre, indiqué que la campagne tiendra compte de la filière d'évacuation des déchets amiantés afin, là aussi, d'œuvrer à la diminution des risques d'exposition. c) Un éparpillement administratif du traitement communautaire de l'amiante La mission s'est étonnée de l'approche qui semble parfois prévaloir au sein de la Commission européenne concernant les problèmes soulevés par l'amiante voire l'ensemble des risques professionnels. Ainsi, la délégation de la mission qui s'est rendue à Bruxelles les 1er et 2 décembre 2005 a dû constater que le traitement du dossier de l'amiante était éparpillé entre quatre directions générales. Ses interlocuteurs l'ont assuré que les méthodes de travail de la « gardienne des traités » assurent une réelle collégialité et permettent d'apporter des réponses efficaces aux questions auxquelles elle doit faire face. Mais il semble que chaque service ait tendance à adopter une approche centrée sur son propre secteur sans faire preuve d'une réflexion plus générale, qu'impose pourtant, aujourd'hui encore, le problème de l'amiante175. Surtout, la mission a eu parfois le désagréable sentiment qu'aux yeux de certains, l'adoption de deux textes importants, en 1999 et 2003, ne faisait plus de l'amiante un sujet d'actualité et qu'il y avait, désormais, d'autres difficultés plus importantes à traiter. Bien évidemment, la mission ne nie pas l'intérêt et l'urgence d'autres questions. Tel est le cas, par exemple, du système REACH qui a mobilisé d'importants moyens humains au cours des dernières années et dont on ne peut qu'accueillir favorablement l'adoption, en novembre et décembre dernier, par le Parlement européen et le Conseil des ministres. Pour autant, le dossier de l'amiante ne doit pas être négligé. Face aux risques encourus aujourd'hui par la population et les travailleurs, la mise en œuvre des normes existantes doit être une préoccupation constante. À ce titre, le prochain lancement de la « campagne d'inspection du travail » est une initiative qui dément, fort heureusement, le sentiment de certains que l'amiante serait une affaire réglée. Proposition : Inviter les institutions communautaires à adopter une approche plus transversale des questions soulevées par l'amiante en Europe. La réflexion doit également être engagée sur les lacunes de la législation actuelle. Par exemple, le droit communautaire n'impose pas des obligations de diagnostics semblables à celles en vigueur, en France, pour les bâtiments à usage public ou privé lors des transactions. La mission n'a pas manqué d'interroger ses interlocuteurs bruxellois sur les raisons de cet « oubli ». La plupart du temps, il lui a été répondu de s'adresser à une autre direction générale ou bien il lui a été expliqué que le principe de subsidiarité pouvait empêcher d'agir en ce sens176. La mission estime qu'une telle interprétation est restrictive et considère, au contraire, que face à un problème grave et commun à tous les États membres, une action plus poussée de l'Union européenne ne serait pas injustifiée. Proposition : Créer, dans le droit communautaire, une obligation de repérage de l'amiante pour les bâtiments. B.- L'AMIANTE DANS LE MONDE : DES TRANSFERTS MASSIFS DE RISQUES VERS LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT 1.- L'amiante est encore utilisé dans de nombreux pays a) Aucun instrument juridique n'interdit l'amiante au plan mondial ● Les conventions internationales et l'amiante : Trois conventions internationales sont susceptibles de concerner le problème de l'amiante au niveau mondial : - La Convention de Bâle (1989) La « Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination » impose des restrictions aux mouvements internationaux de déchets dangereux. Ainsi, aux termes de cette convention, est prohibée l'exportation de déchets dangereux vers un État qui en a interdit l'importation sur son territoire ou bien qui n'a pas les moyens de les gérer « selon des méthodes écologiquement rationnelles ». L'exportation ne peut être autorisée, pour l'essentiel, que lorsque l'État d'exportation ne dispose pas des moyens d'éliminer les déchets ou lorsque l'État d'importation envisage de les recycler. Tout mouvement de déchets dangereux doit alors donner lieu à une procédure de notification et à l'établissement d'un document accompagnant les matières transportées depuis le lieu d'origine jusqu'au lieu d'élimination. La Convention de Bâle inclut l'« amiante (poussières et fibres) » dans son champ d'application. Par ailleurs, elle interdit tout mouvement de déchets dangereux des pays membres de l'OCDE vers des pays ne faisant pas partie de cette organisation. Le suivi de la mise en œuvre du traité est assuré par un secrétariat, notamment chargé d'organiser les réunions d'une Conférence des parties et d'assurer une assistance technique. Dans ce cadre, le secrétariat de la Convention de Bâle a contribué à la réalisation de deux documents relatifs aux déchets amiantés : un « code de bonne pratique pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante dans la zone Caraïbes » (1999) et une étude sur la problématique de l'importation de déchets amiantés dans les véhicules d'occasion en Afrique de l'Ouest, en particulier au Bénin et au Sénégal (2004). Au sein de l'Union européenne, la Convention de Bâle a été mise en œuvre par le règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993, qui est l'application directe pour les États-membres. - La Convention de Rotterdam (1998) Adoptée en 1998 et entrée en vigueur en 2004, la « Convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international » rend la « procédure d'information et de consentement préalable » (PIC) juridiquement contraignante. En vertu de cette procédure, les exportateurs faisant commerce de certains produits chimiques inscrits sur une liste spéciale sont tenus d'obtenir le consentement préalable - en « connaissance de cause » - de l'importateur avant de procéder à l'expédition. Au moment de son entrée en vigueur, la Convention de Rotterdam concernait 27 produits chimiques. Très rapidement, des négociations ont débuté pour élargir cette liste, en particulier en y incluant 5 formes supplémentaires d'amiante dont le chrysotile qui représente 90 % de l'amiante commercialisé. Cependant le lobby de l'amiante, dirigé par le Canada, est parvenu à bloquer l'inclusion du chrysotile dans la liste des produits soumis à la Convention. L'opposition du Canada a reçu l'appui de la Russie, du Kazakhstan, du Zimbabwe, du Mexique, de la Chine et de l'Inde. Au contraire, une majorité d'États a appuyé l'inclusion du chrysotile dans la liste, en particulier les membres de l'Union européenne, l'Australie, les États-Unis, le Brésil, l'Argentine et le Chili. Il est intéressant de relever que la Tanzanie, l'Egypte, la Gambie, le Congo et la Guinée ont eux aussi émis le souhait que la procédure PIC s'applique au chrysotile en insistant sur le besoin urgent des pays en développement d'obtenir plus d'informations sur les dangers de l'amiante. - La Convention sur l'amiante de l'Organisation Internationale du Travail (1986) La Convention n° 162 de l'OIT est le seul instrument international traitant spécifiquement de l'amiante. Elle a été adoptée le 24 juin 1986 et concerne la sécurité dans l'utilisation de l'amiante. Elle est entrée en vigueur en juin 1989 et a été ratifiée à ce jour par 27 États, dont 9 appartenant à l'Union européenne. La convention oblige les États parties à adopter des législations adéquates pour la prévention et le contrôle liés à l'exposition professionnelle à l'amiante. Elle interdit le flocage de l'amiante, ainsi que l'usage de la crocidolite. La convention limite également l'usage du chrysotile, et stipule que lorsque cela est nécessaire à la protection de la santé des travailleurs et techniquement possible, les États parties doivent adopter des normes visant à remplacer l'amiante par des produits de substitution inoffensifs et interdire partiellement ou totalement l'usage d'amiante ou de certains types de produits à base d'amiante dans certaines circonstances. C'est en se fondant sur ce texte que le Chili a, en 2001, décidé d'interdire à son tour l'usage de toutes les formes d'amiante sur son territoire. L'amiante n'est donc pas absent du droit international. Cependant, les instruments de portée mondiale qui viennent d'être rappelés ne s'appliquent qu'à son utilisation ou à son élimination. En aucun cas ils ne visent sa mise « hors-la-loi ». Il n'est donc pas surprenant de constater qu'aujourd'hui encore, très peu d'États ont interdit toutes les formes d'amiante. ● Très peu d'États ont interdit l'amiante Selon les informations fournies à la mission par le sénateur belge Alain Destexhe et les données recueillies sur le site internet de l'organisation non gouvernementale International Ban Asbestos Secretariat177, 37 États seulement ont, aujourd'hui, interdit la production et l'utilisation de toutes les formes d'amiante sur leur territoire. Outre les membres de l'Union européenne, ce sont l'Argentine, l'Australie, le Chili, le Gabon, le Honduras, l'Islande, le Koweït, la Norvège, l'Arabie Saoudite, les Seychelles, la Suisse et l'Uruguay. À cette liste s'ajouteront prochainement la Roumanie et la Bulgarie, du fait de leur adhésion prochaine à l'Union européenne, mais aussi l'Afrique du Sud et le Japon, puisque ce dernier devrait avoir prononcé l'interdiction d'ici 2008. Par ailleurs, si certains États fédéraux ne l'ont pas fait, quelques unes de leurs entités fédérées ont, elles aussi, déclaré « hors-la-loi » toutes les formes d'amiante. C'est le cas, au Brésil, des États de Rio de Janeiro et du Rio Grande do Sul. ● Une interdiction prochaine aux États-unis ? Le cas des États-Unis est particulier. À notre demande, la mission économique de notre ambassade à Washington a précisé l'état de la législation et de la gestion de l'amiante dans ce pays. Il apparaît, tout d'abord, que les États-Unis n'ont pas encore totalement interdit ce produit. Une tentative a été faite en 1989 lorsque l'EPA (US Environmental Protection Agency) a adopté une réglementation prohibant l'utilisation de l'amiante à l'exception de quelques rares usages. Toutefois, cette réglementation a été annulée, en appel, par la « Fifth court of appeal » de la Nouvelle-Orléans. Par conséquent, il est encore possible d'employer de l'amiante aux États-Unis, en particulier sous la forme de plaques d'amiante-ciment, de dalles de revêtement de sols, de cartons, d'éléments de transmission ou de freinage mais aussi pour assurer l'étanchéité des toits ou le revêtement de tuyauteries. Cependant, la consommation américaine a considérablement baissé au cours des trente dernières années. En 1973, année record, la consommation d'amiante s'est élevée à 719 000 tonnes. En 2000, elle n'était plus que de 15 000 tonnes et avait même atteint 2 880 tonnes en 2004. Désormais, et depuis 2003, il n'y a plus d'extraction d'amiante aux États-Unis : la totalité de l'amiante consommé est importée, quasi-exclusivement (98 %) du voisin canadien. Pourquoi une telle désaffection en l'absence d'interdiction formelle ? Comme en Europe, des études scientifiques - et notamment celle du Professeur Irving Selikoff, en 1964, qui a eu un grand retentissement - ont révélé les dangers de l'amiante. Surtout, la peur des poursuites judiciaires a incité de nombreux utilisateurs à se tourner vers les produits de substitution. Sur ce point, les informations de notre mission économique à Washington sont très intéressantes : « Depuis la fin des années 90, un nombre croissant de victimes de l'amiante ont attaqué devant les tribunaux des sociétés potentiellement responsables (par exemple, anciens employeurs). Des montants record d'indemnisation des victimes de l'amiante ont été atteints et plus d'une vingtaine de sociétés américaines ont fait faillite. Un nombre bien plus important de sociétés (notamment françaises) s'est vu sanctionné par les marchés boursiers. Actuellement, 85 % de l'industrie américaine (par le jeu des filiales détenues même momentanément) pourrait être concerné, peu ou prou, par des demandes d'indemnisations. Bien qu'il n'existe pas de données centralisées sur le sujet, on estime le nombre de demandes d'indemnisations concernant l'amiante à environ 600 000 depuis la prise de conscience des dangers liés à l'amiante dans les années 70. La plupart concerne des montants modestes (entre 2 000 et 10 000 dollars), mais les coûts administratifs et légaux peuvent multiplier la facture pour les entreprises par dix. De plus, des jurys ont attribué des indemnisations record (jusqu'à 25 millions de dollars) et, dans certains cas, les plaignants n'ont même pas apporté la preuve d'une atteinte à la santé. En réalité, près de 90 % des demandes d'indemnisations concernent des personnes qui ont été exposées à l'amiante mais qui ne présentent aucun signe malin (asbestose, cancer des poumons, mésothéliome). C'est ce type de demande qui est à l'origine de l'explosion récente des indemnisations, les cas de maladies déclarées n'ayant pas dépassé les prévisions depuis plus de 20 ans. Récemment, la Cour Suprême a toutefois décidé de réagir en révisant un jugement d'un tribunal du comté de Kanawha, en Virginie occidentale. Ce dernier, connu pour sa bienveillance à l'égard des plaignants de l'amiante, avait accordé plusieurs millions de dollars à des plaignants exposés à l'amiante mais qui n'avaient développé consécutivement aucune maladie (Norfolk & Western v. Ayers). Mais seule une réforme de la législation semble pouvoir éloigner durablement la menace de nouveaux procès. Les sociétés, mais aussi les malades de l'amiante, souhaiteraient donc que le législateur intervienne pour limiter les possibilités d'indemnisations aux « vraies » victimes (maladies déclarées) et non plus aux simples expositions à l'amiante. Ce faisant, plus de 80 % des demandes deviendraient irrecevables. Le débat entre fabricants, assureurs, avocats et syndicats dure depuis des années mais aucun compromis n'a encore pu être trouvé ». Ce sont donc les conséquences financières de l'utilisation passée de l'amiante qui, aujourd'hui, conduisent, de facto, à un abandon progressif de ce matériau par l'industrie américaine. Le Congrès des États-Unis a tenté de réagir à la « dérive » des contentieux, en essayant de mettre en place un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui, administré au niveau fédéral, serait doté de près de 140 milliards de dollars financés principalement par les entreprises à l'origine de la contamination et par les compagnies d'assurances. Pour le moment, la discussion du projet semble enlisée car, au-delà des débats sur son montant et ses modalités de fonctionnement, il est évident que pour certains avocats, l'adoption d'un tel fonds pourrait signifier la disparition de contentieux très rémunérateurs... La seconde crise de l'amiante que traverse actuellement les États-Unis pourrait très bien déboucher, à terme, sur une interdiction totale de ce minerai dans ce pays. Au cours de la législature actuelle, des parlementaires fédéraux se sont déjà engagés dans cette voie en déposant des propositions de loi visant à bannir l'amiante du territoire américain. b) Le marché mondial de l'amiante ● Les pays producteurs Le tableau suivant présente une estimation de la production mondiale d'amiante (en tonnes), répartie, entre les principaux pays producteurs, entre 1999 et 2003178.
La concentration des pays producteurs est frappante : six d'entre eux, à peine, contribuent à plus de 95 % de la production mondiale ! Il est logique de retrouver dans ce groupe deux anciennes républiques soviétiques et le Canada puisque la production mondiale d'amiante, tout au long du XXème siècle, provient pour plus des deux tiers de ces deux républiques179. Les positions se sont cependant inversées car, dans les années 60, le Canada assurait à lui seul la moitié de la production mondiale. La Chine est elle aussi devenue un important producteur du minerai, alors que les conditions de travail sur les sites d'extraction sont particulièrement dramatiques. Quant au Brésil et au Zimbabwe, ils sont légèrement en retrait par rapport au quatuor de tête. Néanmoins, leur situation est très différente. Au Brésil, l'interdiction de l'amiante est réclamée depuis plus de dix ans par les organisations syndicales mais le lobby des industriels est parvenu jusqu'à présent à empêcher toute prise de décision. Au Zimbabwe, la production se maintient à un niveau relativement stable en dépit d'un contexte politique chaotique, peu favorable à un débat sur l'interdiction. ● Les pays importateurs Les méfaits mondiaux de l'amiante seraient moins dramatiques si la consommation de ce minerai restait cantonnée aux seuls pays producteurs. Malheureusement, l'amiante est une marchandise... presque comme les autres : aujourd'hui encore, elle fait l'objet d'un véritable commerce international. En 2003, la répartition du marché mondial des importations d'amiante se présentait ainsi180 :
Alors que la consommation d'amiante a longtemps été fortement concentrée dans les pays industrialisés, ce n'est qu'au cours du dernier quart du XXème siècle que la donne s'est inversée. Désormais, et comme le prouvent ces données, les principaux importateurs, hormis le Japon, sont des pays en voie de développement, en particulier en Asie. Ce continent constitue aujourd'hui le marché privilégié par les industriels de l'amiante, alors qu'il y a à peine quinze ans, il n'atteignait même pas le quart de la consommation mondiale. Rappelons que le Japon, seul pays développé, avec la Corée du Sud, parmi les dix premiers importateurs mondiaux, devrait bientôt sortir du tableau en raison de l'interdiction de l'amiante édictée par cet Etat à l'horizon de 2008. De même, la lecture de ce tableau vient confirmer l'urgence qu'il y avait à prohiber toutes les formes d'amiante au sein de l'Union européenne : l'Espagne et le Portugal figuraient aux 11ème et 22ème rangs mondiaux en 2003. ● Les pays exportateurs S'agissant des pays exportateurs, on retrouve, en tête, les mêmes États que dans le tableau des pays importateurs avec, cependant, cette différence que le Canada représente, à lui seul, plus de 40 % des exportations dans le monde. Les dix premiers exportateurs mondiaux se présentaient comme suit en 2003181 :
La première place du Canada s'explique par le fait que la consommation d'amiante est très réduite dans ce pays. En fait, plus de 95 % de la production canadienne est exportée et la mission a rapidement appris que ce pays fait, aujourd'hui encore, la promotion active d'un usage contrôlé de l'amiante. Cette situation, qui témoigne d'un écart étonnant entre une « doctrine » prônée pour les autres et la pratique intérieure du pays, justifiait que la mission s'informe plus avant sur l'approche canadienne de l'amiante. 2.- L'approche inquiétante du Canada et du Québec La mission a officiellement émis le souhait d'entendre, à Paris, des représentants de l'ambassade du Canada et de la délégation générale du Québec pour obtenir des précisions sur les positions des deux gouvernements vis-à-vis de l'amiante. Dans ce but, un questionnaire a été adressé et la mission a même proposé d'organiser une visioconférence pour permettre un échange avec les personnalités compétentes outre-Atlantique. Dans un premier temps, le Gouvernement fédéral, invoquant la dissolution de la Chambre des communes du Canada, le 29 novembre dernier et la tenue d'une campagne électorale jusqu'aux élections du 23 janvier 2006, n'a pas souhaité donner suite à l'invitation de la mission d'information. Dans un second temps, il a envoyé à la mission une note expliquant brièvement les fondements de la politique canadienne sur le chrysotile (annexe n° 4). Le Gouvernement du Québec, quant à lui, a fait parvenir quelques documents généraux sur sa ligne officielle mais n'a pas non plus souhaité approfondir ses échanges avec les membres de la mission d'information. a) L'amiante au Canada : un poids économique très faible... C'est en 1876 qu'est découverte la présence de gisements d'amiante au Québec. Très vite, l'économie de zones jusqu'alors essentiellement agricoles est transformée et va faire de l'amiante le principal employeur de plusieurs régions de la province. Des gisements sont également mis en exploitation ailleurs au Canada et on estime que les mines du Québec, de Terre-Neuve, de Colombie-Britannique et du Yukon ont produit près de 1 million de tonnes de chrysotile entre 1900 et 2000182. Aujourd'hui, deux mines canadiennes sont encore en activité, à Asbestos183 et à Black Lake, au Québec. Elles travaillent en moyenne deux à trois mois par an, en été, quand le coût de l'électricité est au plus bas. La mine Jeffrey (à ciel ouvert) emploie encore 280 personnes et celle de Black Lake (extraction souterraine) environ 500. Elles génèrent également 1 000 emplois indirects. Les employés travaillent environ trois mois et peuvent ensuite bénéficier de l'assurance chômage le reste de l'année. Dans les années 80, plus de 7 000 personnes travaillaient dans les mines d'amiante. En 1978, le Gouvernement du Québec a racheté les mines d'amiante de la province et a créé la Société nationale de l'amiante (SNA) dont le but était, entre autres, de rechercher, de développer et d'exploiter des gisements de ce minerai - y compris pour la mise sur le marché de la production - mais aussi de travailler sur de nouveaux usages ou procédés de transformation de l'amiante. L'ensemble des actifs de la SNA a été privatisé au cours des dernières années, de telle sorte que son rôle actuel, alors qu'elle ne compte plus que trois employés, se limite à assurer le suivi des transactions des ventes de ses filiales, à gérer le règlement des engagements contractés directement par la Société. Comme l'indiquent ces quelques informations fournies par notre mission économique d'Ottawa, le poids de l'amiante est maintenant très réduit dans l'économie canadienne, même s'il est encore très important dans les deux régions encore concernées, zones sinistrées qui ont longtemps vécu de la seule exploitation du « magic mineral ». b) ... mais un poids symbolique majeur La mission a été surprise par la très forte dimension symbolique de l'amiante au Canada, en particulier au Québec. Des liens étroits unissent cette province au minerai. Outre son poids économique passé, l'amiante est un symbole fort de la culture québécoise. Par exemple, la zone où se sont longtemps concentrées les exploitations minières s'appelle officiellement « Région de l'Amiante ». De même, au cours de l'hiver 1949, Asbestos et Thetford Mines, les deux centres de cette région, furent les foyers d'un des plus sérieux conflits ouvriers d'après-guerre au Québec, une crise qui a duré quatre mois et demi et qui a eu des conséquences importantes sur les plans social, politique et religieux et qui est encore connue sous le nom de « grève de l'amiante ». Au-delà de ces aspects historiques et culturels, l'amiante est aussi un enjeu du débat sur l'avenir du Québec, entre souverainistes et fédéralistes : le camp qui, le premier, prendra position pour fermer les mines d'amiante se verra immédiatement accusé par le camp adverse de porter atteinte aux intérêts du Québec. c) La promotion de l'usage sécuritaire de l'amiante Les gouvernements du Canada et du Québec sont tous les deux partisans d'un usage sécuritaire et accru de l'amiante. S'agissant du Gouvernement fédéral, sa plus récente prise de position sur le sujet est consultable dans les réponses qu'il a apportées, le 17 octobre 2005, au 13ème rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international de la Chambre des Communes184. On peut y lire que « le Principe d'utilisation sécuritaire est un des piliers de la politique sur les minéraux et les métaux du Canada » et que ce dernier « reconnaît la valeur du chrysotile en tant que produit industriel utile pouvant être utilisé de façon sécuritaire lorsqu'il est bien contrôlé. Par ailleurs, cette même position réfléchie du gouvernement à l'égard de cette substance s'étend à la réputation du Canada en tant qu'exportateur responsable de chrysotile ». Il en va de même au Québec où la ligne officielle du Gouvernement provincial et des organisations syndicales est axée sur un accroissement de l'utilisation de l'amiante chrysotile185 au motif que cette fibre, la seule produite au Québec, quand elle est correctement utilisée, est moins dangereuse et moins chère que les produits de substitution186 . Un organisme, l'« Institut du Chrysotile », financé à parts égales par l'industrie et les gouvernements du Canada et du Québec, assure la promotion de ce minerai, en particulier au niveau international. Pour l'année 2004-2005, il a mené une quinzaine de missions dans dix pays et accueilli plusieurs délégations pour les informer sur l'utilisation sécuritaire du chrysotile. Les 23 et 24 mai 2006, cet institut organisera, à Montréal, une conférence internationale sur « les recherches récentes, les données solides et la réalité actuelle sur le chrysotile ». L'annonce de cette manifestation, sur le site internet www.chrysotile.com, précise qu'« avec les techniques industrielles d'aujourd'hui, l'usage du chrysotile dans des produits à haute densité ne représente pas de risque significatif pour la santé humaine. Cette fibre rend des services considérables dans les pays émergents, notamment dans la construction d'infrastructures sanitaires et dans la rénovation ». Bien évidemment, l'attitude de l'Union européenne est inadmissible pour les pouvoirs publics et les industriels québécois. L'interdiction prononcée par la France en 1996 a, d'ailleurs, été très mal vécue et a conduit au dépôt d'une plainte devant l'OMC, laquelle, en 2001, a donné raison à l'Union européenne, qui représentait les intérêts de notre pays. L'Union européenne et le Canada devant l'OMC Après la décision prise par la France, en 1996, d'interdire toutes les formes d'amiante, le Canada a introduit une plainte auprès des instances juridictionnelles de l'OMC au motif que le décret d'interdiction contrevenait à un certain nombre d'accords commerciaux internationaux. Le 18 septembre 2000, un jugement de l'organe de règlement des différends de l'OMC déboute le Canada sur la base de l'inapplicabilité, au cas d'espèce des différentes conventions visées par la plainte. Le 12 mars 2001, l'organe d'appel se prononce également en faveur de la l'Union européenne. Il estime, en effet, que les conventions s'appliquent mais que l'amiante ne peut être comparé aux produits de substitution en raison du danger qu'il représente pour la santé. Selon l'organe d'appel, la mesure prise par la France est donc en accord avec les stipulations du GATT. Il est même allé plus loin en estimant qu'une telle mesure peut être considérée comme « nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes ». Cette décision a été interprétée par certains, et notamment par l'Union Européenne, comme une reconnaissance du principe de précaution qui commande que des mesures soient prises s'il ressort d'évaluations scientifiques objectives qu'il est raisonnable de craindre que les effets dangereux du produit ne soient pas compatibles avec le niveau de protection souhaité. Aujourd'hui encore, l'argument principal avancé par le lobby pro-amiante est que les pays « prohibitionnistes » sont en fait parmi les principaux producteurs de matières de substitution. Leur attitude ne serait pas motivée par un impératif de santé publique mais par des raisons purement commerciales faisant du « dénigrement du chrysotile » une « entreprise très fructueuse » qui, « en plus de donner un coup de pouce aux fabricants de matériaux de remplacement », alimenterait « efficacement la lucrative industrie du désamiantage »187. Le sujet est donc sensible : les termes employés au Québec sont parfois très durs et trahissent une forte incompréhension vis-à-vis de la position européenne188. d) Une situation encore figée malgré certaines études préoccupantes sur la santé des Québécois Si l'amiante n'était pas si « vital » aux yeux de bon nombre de Québécois, le Canada n'aurait sans doute pas la position qu'on lui connaît. Il y a d'ailleurs un hiatus entre la politique environnementale du Canada et sa position officielle concernant l'amiante. Il semble que le Canada anglais soit prêt à arrêter la production d'amiante mais ne le fait pas pour éviter la colère de l'opinion publique québécoise et, in fine, le soutien de l'idée souverainiste. Il est d'ailleurs intéressant de relever que dans ses récentes réponses au 13ème rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international de la Chambre des Communes, lorsqu'on lui demande d'entreprendre « une campagne de sensibilisation auprès du public, faisant ainsi la promotion de l'usage sécuritaire du chrysotile sur le plan national et international » et de privilégier « l'utilisation du chrysotile dans sa propre infrastructure », le gouvernement fédéral ne s'engage pas pleinement. Il souligne que, si « tous les gouvernements, à tous les niveaux, ont clairement la responsabilité de protéger la sécurité des travailleurs et des consommateurs, c'est à l'industrie elle même qu'il appartient de faire connaître l'utilité du produit et ses applications ». Les partis politiques qui agissent sur la scène politique québécoise, tels le Parti québécois - souverainiste - et le Parti libéral du Québec - fédéraliste -, soutiennent tous fermement la position officielle d'une utilisation accrue et sécuritaire de l'amiante. Et la situation au niveau fédéral est à peu près semblable d'autant que les électeurs québécois sont majoritairement représentés, à Ottawa, au sein d'une formation souverainiste, le Bloc Québécois, dont le seul but est de défendre les intérêts du Québec à travers le soutien de la politique d'usage sécuritaire et accru de l'amiante. Seul un petit parti, le NPD (Nouveau parti démocratique - centre gauche) souhaite remettre en cause cette ligne officielle. Le 21 octobre dernier, un député de cette formation ayant travaillé dans une mine d'amiante au cours des années 70 a officiellement demandé l'ouverture d'un débat à la Chambre des communes en insistant, notamment, sur la responsabilité du Canada vis-à-vis des pays en voie de développement vers lesquels est exporté l'amiante canadien. Cette prise de conscience est cependant limitée ; elle demeure, pour l'instant, le fait de parlementaires isolés ou de formations politiques mineures. Les mouvements opposés à la poursuite de l'extraction et de l'utilisation du chrysotile, tels Ban Asbestos Canada/Bannir l'amiante au Canada et l'AVAQ (Association des victimes de l'amiante du Québec) sont peu nombreux et souvent décriés par le lobby pro-amiante. Le réseau international Ban Asbestos a organisé une conférence à Ottawa, en septembre 2003, sur le thème « l'amiante canadien : une préoccupation mondiale ». Cette manifestation a suscité des réactions parmi la population locale qui se sont traduites par la création et la première réunion de l'AVAQ. Par ailleurs, et malgré les pressions, des familles de malades sont venues y témoigner de leur expérience. Les participants se sont toutefois plaints du boycott des médias qui n'ont communiqué que sur une manifestation de mineurs hostiles à la réunion. Des parlementaires québécois ont également émis des doutes sur l'indépendance des organisateurs vis-à-vis de « l'industrie des fibres alternatives en Europe ». Pourtant, au cours de cette conférence a été présentée une étude épidémiologique indépendante de l'industrie réalisée par l'Institut national de santé publique du Québec dont les conclusions sont très préoccupantes. Par exemple, les Québécois et les Québécoises montrent des taux significativement plus élevés de mésothéliome de la plèvre que les hommes et les femmes du reste du Canada et que ceux d'autres pays. Plus récemment, en juin 2005, ce même institut a émis un avis sur « L'utilisation de l'amiante chrysotile au Québec » dans lequel on peut lire que « l'utilisation accrue de l'amiante chrysotile dans ses formes traditionnelles ne devrait pas être soutenue par le ministère de la santé et les services sociaux » et que « l'utilisation sécuritaire de l'amiante est difficile, voire impossible, dans les secteurs tels que la construction, la rénovation et la transformation de l'amiante ». e) Un comportement critiquable La mission n'entend pas donner de leçons aux autorités canadiennes. Notre pays, comme tant d'autres, n'a d'ailleurs pas toujours eu un comportement satisfaisant face aux dangers de l'amiante et a certainement tardé à prendre les mesures nécessaires au moment opportun. Cependant, il est de notre devoir, alors que la France a vécu des moments identiques, de mettre en garde le Canada contre les risques que comporte son refus de modifier sa politique officielle vis-à-vis du chrysotile. Cela est d'autant plus indispensable que, comme la mission d'information l'a noté, le Canada exporte la quasi-totalité de sa production. Par ailleurs, il faut savoir que l'amiante canadien est essentiellement exporté sous forme brute : des sacs de fibres sont exportés - le Mexique est un des principaux destinataires en Amérique latine - et une partie revient au Canada sous forme de produits finis. Cette pratique contredit la politique définie par les autorités fédérales concernant les ressources minières qui consiste à promouvoir la transformation, sur place, de la production et l'exportation de produits avec une haute valeur ajoutée. Mais, la valeur ajoutée impliquerait l'exposition à l'amiante de travailleurs canadiens dans les industries de transformation. C'est certainement l'aspect le plus choquant de la position canadienne : l'essentiel des exportations se font vers des pays beaucoup plus pauvres où toute idée d'usage contrôlé est illusoire. De même, la mission déplore le combat que mène le Canada contre l'inclusion du chrysotile dans la liste des produits soumis à information préalable avant leur exportation en vertu de la Convention de Rotterdam de 1998. Il y a là un vrai paradoxe : l'objet de ce traité n'est pas l'interdiction de substances mais la mise en place d'une procédure d'information et de consentement préalables aux exportations. Si les autorités canadiennes et québécoises et le lobby pro-amiante croyaient sérieusement à la possibilité d'un usage contrôlé, elles devraient logiquement soutenir toute mesure d'information permettant de mettre en œuvre des mesures de contrôle. 3.- Interdire l'amiante au niveau international a) L'amiante dans le monde : une « bombe à retardement » ● La délocalisation des risques vers les pays émergents L'interdiction de l'amiante dans de nombreux pays industrialisés a provoqué une réorientation globale du marché mondial de l'amiante : les pays industrialisés sont parvenus à se passer de la totalité des utilisations de ce produit et ce sont désormais les pays en voie de développement qui sont les plus gros consommateurs de ce minerai. Le graphique suivant est, à cet égard, révélateur. Estimation de la répartition, par pays,
Il ressort de ces données que les pays les plus utilisateurs d'amiante sont principalement des pays de l'ex-Union soviétique, qui représentent plus de 50 % de la consommation mondiale, mais aussi des pays d'Asie, qui en représentent plus de 25 %, ainsi que d'Amérique du Sud pour près de 16 %. Les conditions de travail dans ces pays sont évidemment très éloignées de celles d'Europe ou d'Amérique du Nord. En Chine, par exemple189, « la situation est catastrophique, notamment dans l'industrie des matériaux de friction et dans l'industrie textile. Cette dernière continue d'utiliser des matériaux incluant de l'amiante pour fabriquer des équipements de sécurité. En Europe, on utilise pour cela des fibres synthétiques, plus chères, mais ce n'est pas le cas dans d'autres pays, en Inde par exemple ». En outre, il est parfois difficile de déterminer précisément les conséquences sanitaires de ces expositions démesurées à l'amiante, les autorités de ces pays n'engageant aucune étude épidémiologique ni aucun suivi sérieux des maladies professionnelles. Pourtant, dans un pays comme l'Inde, on peut observer globalement une corrélation entre l'utilisation croissante de l'amiante et l'aggravation de problèmes de santé respiratoire dans la population. De même, « au Pakistan, une chercheuse de l'Université de Peshawar, Noor Jehan, a entrepris un travail systématique pour relever les cas de mésothéliome dans la province frontalière du Nord-Ouest. Son enquête a permis d'observer 601 cas survenus entre 1995 et 2003. Une des caractéristiques de la situation est la très forte prévalence du mésothéliome parmi les ménagères (autour de 200 cas) et les fermiers (autour de 100 cas). Ce phénomène est lié à l'organisation artisanale du travail dans la fabrication de l'amiante-ciment. Les sacs d'amiante, généralement en provenance du Canada, sont ouverts, sans la moindre précaution, dans des lieux publics ou dans les fermes. Les fibres sont parfois utilisées dans les mêmes moulins qui servent à la préparation de la farine. Elles sont mélangées au ciment et à l'eau par l'ensemble de la famille ». 190 Ces quelques exemples devraient faire réfléchir ceux qui, aujourd'hui encore, prônent un usage sécuritaire de l'amiante. Cette méthode a échoué dans les pays développés, lesquels, outre le fait d'être confrontés à une crise sanitaire importante, doivent désormais gérer une énorme quantité d'amiante résiduel, source d'inquiétudes et de contaminations supplémentaires dans les années à venir. Comment demander à des populations moins privilégiées de faire mieux dans un domaine où la plupart des pays industrialisés ont échoué ? La mission considère que la poursuite de la promotion, auprès des pays émergents, de l'usage de l'amiante, même sous sa forme la « moins » dangereuse, est pour le moins cynique191. b) Les risques liés au démantèlement des navires : l'exemple du Clemenceau L'amiante, on l'a vu, n'est pas seulement dangereux lors de son extraction ou lorsqu'il est employé dans un processus de fabrication ou utilisé dans une construction. Dans certains pays, en Asie principalement, la démolition de navires en provenance d'Europe du Nord ou d'Europe constitue une source de pollution croissante. « S'agissant des navires en fin de vie, qui sont très contaminés, on a choisi de transférer le risque vers des pays qui n'ont ni les mêmes réglementations ni les mêmes systèmes de protection sociale que la France. Une telle stratégie n'est pas propre à la France. Un grand nombre de navires sont envoyés sur des chantiers en Inde, au Bangladesh, en Chine, au Pakistan ou en Turquie. Il faut savoir que l'Inde et le Bangladesh sont les premiers destinataires de ce marché du démantèlement des navires »192. Un récent rapport élaboré conjointement par la Fédération internationale des droits de l'homme et Greenpeace International décrit précisément les conditions déplorables dans lesquelles ont lieu l'accueil et le traitement des navires ainsi que les conséquences sanitaires actuelles et prévisibles de l'exposition des travailleurs à toutes sortes de polluants193, en Inde et au Bengladesh. Nombreux sont ceux qui meurent ou deviennent handicapés du fait d'accidents sur les chantiers. D'autres sont victimes des fumées toxiques des nuages de poussières diverses et à plus long terme, de l'amiante contenu dans les bateaux. Il faut dire que les ouvriers qui participent au démantèlement des bateaux ne sont pas protégés. La destruction se fait au chalumeau et les tenues de désamiantage ne sont pas utilisées - d'ailleurs, la chaleur ambiante rendrait leur utilisation insupportable -, alors que l'amiante est partout, dans l'air comme dans l'eau. Au cours de son audition par la mission, Mme Annie Thébaud-Mony, de l'association Ban Asbestos France, a indiqué194 qu' « entre mai 2001 et mai 2002, 264 bâtiments ont été vendus aux ferrailleurs indiens » et qu' « il y a actuellement 300 ferries scandinaves qui attendent de partir vers les chantiers de désamiantage asiatiques. Il y a 44 bâtiments en Angleterre, qui est sur le point d'adopter une autre politique. La plage d'Alang est divisée en 184 parcelles d'à peu près 30 mètres de large. Il y a entre 25 000 et 40 000 travailleurs ». Consulté par la mission, le ministère de l'écologie et du développement durable a indiqué que la Convention de Bâle est, jusqu'à présent, et sur le plan international, le seul instrument juridique susceptible de s'appliquer à l'envoi de navires vers des chantiers de démantèlement situés dans des pays émergents. Comme indiqué précédemment, la « Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination » s'applique aux déchets amiantés et en interdit l'exportation vers un État qui en a interdit l'importation sur son territoire, ou bien s'il n'a pas les moyens de les gérer « selon des méthodes écologiquement rationnelles ». Ainsi qu'en a décidé la 7ème Conférence des parties à la Convention de Bâle, organisée en octobre 2004, les navires ne sont pas exclus du champ d'application de ce traité quand bien même ils peuvent être encore définis comme « navires » par d'autres règles internationales. En effet, le droit international de la mer applicable aux navires est élaboré et adopté dans le cadre de l'Organisation maritime internationale (OMI). Cette organisation peut, dans certains cas, privilégier ses propres qualifications juridiques sur celles de la Convention de Bâle. Pour cette dernière, par exemple, l'autorité compétente d'exportation - dans le cas des navires - est l'État du port de départ alors que le droit maritime fait appel à des notions telles que « l'État du pavillon » ou « l'État du port », difficilement assimilables à la notion d'« État exportateur ». Face à cette difficulté, le secrétariat de la Convention de Bâle et l'OMI, rejoints par l'OIT, ont constitué un groupe de travail mixte chargé d'identifier les compétences et les responsabilités de chacun et de remédier aux lacunes, aux chevauchements et aux ambiguïtés éventuelles. La première réunion de ce groupe, à laquelle la France a participé en tant qu'observatrice, s'est tenue à Londres en février 2005. À la suite, la 24ème session de l'assemblée de l'OMI a voté une résolution favorable à l'adoption d'un nouvel instrument juridique contraignant encadrant le démantèlement des navires. La seconde réunion du groupe de travail conjoint OMI-OIT-Convention de Bâle, qui s'est tenue en décembre 2005, a permis d'esquisser le contenu du futur texte qui devrait prévoir, par exemple, une procédure d'information et de consentement préalables avant tout mouvement de navire et aborder la répartition des rôles entre l'État du pavillon, l'État du Port et l'État où a lieu le démantèlement. En attendant que soit mis en place un instrument juridique plus pertinent, plusieurs actions judiciaires sont en cours, ou ont été menées, pour empêcher le transfert de navires vétustes et amiantés des pays industrialisés vers des pays émergents. L'affaire la plus célèbre concerne le Clemenceau dont les péripéties ont été suivies par la mission tout au long de ses travaux. ● La chronologie - 1997 : Le Clemenceau est désarmé. - 2003 : Le 16 juin, le porte-avions est vendu à la société espagnole Gijonesda. Il quitte la France le 13 octobre mais, contrairement à ce que prévoit le contrat de vente, il ne se dirige pas vers l'Espagne mais vers la Turquie. Le 23 octobre, la France résilie le contrat et récupère le navire. - 2004 : Le 23 juin, l'État (par l'intermédiaire du ministère de l'économie et des finances - Direction nationale d'interventions domaniales) passe un contrat de désamiantage et de démantèlement de la coque du navire avec un consortium étranger, SDI (Ship Decomissionning Industries), filiale du groupe allemand Thyssen. Ce contrat prévoit une première phase de désamiantage en France, puis l'acheminement du bateau en Inde afin d'enlever le reliquat d'amiante et de démanteler définitivement le navire. Les travaux débutent le 22 novembre. - 2005 : Constatant, à la suite d'un échange de courriers avec le directeur de cabinet de la ministre de la défense, qu'il restait au moins 22 tonnes d'amiante dans le navire, l'association Ban Abestos France et l'ANDEVA saisissent, le 10 mars, le tribunal de grande instance de Paris (TGI) afin d'interdire le départ vers l'Inde du porte-avions. Le TGI rend son jugement le 5 juillet et déclare le juge judiciaire incompétent car le litige concerne un contrat administratif (il contient des « clauses exorbitantes du droit commun »). La Cour d'appel de Paris confirme ce jugement le 11 octobre. Les associations requérantes saisissent alors le juge administratif pour faire annuler la décision de l'État de transférer le Clemenceau en Inde pour le démanteler. Dans deux ordonnances du 30 décembre 2005, le juge des référés rejette les demandes de suspension de l'exécution de la décision au motif qu'« aucun des moyens présentés par les associations requérantes n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». - 2006 : Au niveau international, les organisations de défense de l'environnement s'emploient à freiner la progression du navire, comme le montre l'action de deux membres de Greenpeace qui, le 12 janvier dernier, parviennent, en pleine mer, à monter sur le porte-avions. Le 6 janvier, la « Commission de contrôle des déchets toxiques de la Cour suprême de l'Inde » rend un avis négatif à propos du désamiantage et du démantèlement du porte-avions Clemenceau sur le sol indien. La Commission européenne, dès le 11 janvier, exige du Gouvernement français qu'il fournisse des explications sur la situation du Clemenceau et décide l'ouverture d'une enquête sur la légalité du démantèlement en Inde du porte-avions, notamment vis-à-vis du règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993 qui applique, dans l'ordre juridique communautaire, les stipulations de la Convention de Bâle. Il convient également de souligner que l'Egypte a, dans un premier temps, refusé l'accès du Clemenceau au canal de Suez et que plusieurs contacts diplomatiques de haut niveau ont été nécessaires pour parvenir à ce que les autorités égyptiennes abandonnent leur position initiale. Le 13 février, la Cour Suprême de l'Inde confirme l'interdiction faite un mois plus tôt au navire de pénétrer dans les eaux territoriales indiennes et demande des expertises supplémentaires à effectuer sur l'ancien porte-avions. Parallèlement à ces développements « internationaux », le 11 janvier, le juge des référés du TGI de Versailles ordonne une expertise indépendante sur la quantité d'amiante effectivement présente à bord du Clemenceau et cette décision est confirmée en appel le 2 février, en dépit d'un recours de l'Etat exigeant que la Cour Suprême de l'Inde se prononce d'abord sur la question. Surtout, le Conseil d'Etat, saisi en appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 30 décembre 2005, suspend, le 15 février 2006, l'exécution de la décision d'envoyer le Clemenceau dans la Baie d'Alang. Le Président de la République ordonne alors le retour, en France, du porte-avions, lequel devrait atteindre Brest via le cap de Bonne-Espérance. La mission d'information a souhaité entendre les arguments des opposants au transfert du porte-avions en Inde et du Gouvernement. ● Un projet critiqué Dans un premier temps, la mission a auditionné Mme Annie Thébaud-Mony, membre de Ban Asbestos France, l'une des associations qui contestent le traitement du Clemenceau en Inde. Mme Thébaud-Mony a indiqué195 que le départ du bateau violait quatre textes : le décret français sur l'interdiction de l'amiante ● Un projet présenté comme novateur Dans un second temps, le Président et le Rapporteur de la mission ont écrit au Premier ministre, le 10 janvier 2006, pour lui faire part de leurs préoccupations concernant les difficultés rencontrées par notre ancien porte-avions et les conséquences à en tirer (annexe n° 5). La réponse du Premier ministre ayant renvoyé la mission vers le ministre de la défense pour obtenir des précisions sur les modalités du démantèlement du Clemenceau en Inde, la mission a entendu, le 8 février 2006, l'Amiral Alain Oudot de Dainville, chef d'État-major de la Marine. Ce dernier a pu exposer, en détail, les arguments du Gouvernement196 qui reposent sur le fait qu'aucun chantier en Europe n'est, aujourd'hui, capable d'accueillir un bâtiment de la taille de l'ex-Clemenceau et sur le caractère « exemplaire » de l'attitude des pouvoirs publics français197. En effet, le chef d'État-major de la Marine a insisté sur le souci de l'Etat français de veiller à ce que le site indien choisi pour procéder à la « déconstruction » du bateau applique les normes en vigueur dans notre pays198. À cet égard, il a apporté des précisions intéressantes sur la teneur du contrat passé entre l'Etat et le consortium SDI. En fait, ce contrat n'avait pas opéré un transfert de propriété : celui-ci ne devait intervenir qu'une fois la démolition du navire établie par procès verbal de l'ambassade de France en Inde. Jusque là, le porte-avions devait demeurer la propriété de l'État français bien que le risque de la vente de l'acier à récupérer soit supporté par la société contractante. Celle-ci avait acquis le Clemenceau pour 100 000 euros et devait assumer tous les frais199. En contrepartie, la société devait se rémunérer en procédant à la vente des 25 000 tonnes d'acier de la coque (estimées, au cours actuel de l'acier, à 8 millions d'euros). La mission a pris connaissance avec intérêt des explications très précises du chef d'État-major de la Marine. Il lui a néanmoins semblé qu'elles auraient été de nature à éclairer le débat national si elles avaient été présentées plus tôt et en toute transparence. En effet, il apparaît que le Gouvernement s'était entouré de toutes les précautions et que les conditions de l'envoi du porte-avions en Inde étaient novatrices : « jamais, jusqu'à cette opération, autant de précautions n'avaient été prises par aucun Etat, par aucun armateur »200. ● Un cadre juridique incertain Le projet du Gouvernement a cependant échoué pour des motifs juridiques qui pouvaient être en partie anticipés. En effet, le problème de la nature juridique de la coque du Clemenceau est complexe et n'a pas encore été définitivement tranché par la justice201. Pour le ministère de la défense, notre ancien porte-avions est un matériel de guerre202 : « il peut être remorqué et il conserve son blindage, son pont d'envol, dont le blindage, renforcé, lui permet d'accueillir des aéronefs de toute nature et des hélicoptères militaires. Il peut ainsi être utilisé comme plateforme pour recevoir des aéronefs, avec possibilité de maintenance, dans les entre-ponts ou comme plateforme pouvant servir de base de soutien pour une opération militaire d'envergure, avec la possibilité d'installer des batteries de missiles ». Dès lors, le ministère considère que la Convention de Bâle ne s'applique pas au Clemenceau, et soutient par ailleurs que celle-ci ne peut être invoquée par les associations requérantes en raison de son absence d'effet direct en droit interne. Cette analyse est cependant contestée car le navire a perdu toute autonomie, est destiné à être démantelé, et pourrait, à ce titre, être considéré comme un déchet. Le Conseil d'Etat ne l'a d'ailleurs pas exclu dans sa décision du 15 février dernier. Le démantèlement du Clemenceau pourrait donc entrer dans le champ d'application de la réglementation internationale relative aux mouvements de déchets et, notamment, le règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993 qui applique la Convention de Bâle dans l'ordre juridique communautaire et qui a un effet direct dans tous les États-membres de l'Union européenne. Dans ce cadre incertain, l'envoi du Clemenceau en Inde représentait manifestement un risque juridique d'autant plus regrettable que le problème des navires en fin de vie fait actuellement l'objet d'une réflexion au niveau de la Convention de Bâle, de l'OMI et de l'OIT. La mission d'information ne peut donc que déplorer les péripéties auxquelles a donné lieu le transfert du Clemenceau en Inde au détriment de l'image de notre pays. ● L'affaire du Clemenceau pose la question du démantèlement des navires en fin de vie Au-delà du sort de notre ancien porte-avions et quelle que soit l'issue des procédures en cours, il apparaît donc urgent d'examiner le problème de la « déconstruction » des bateaux civils et militaires en fin de vie. La France n'est pas le seul pays concerné par ce problème. Les Etats-Unis, par exemple, stockent plusieurs de leurs navires désarmés dans leurs eaux territoriales et, en 2005, ils ont coulé le porte-avions géant USS America dans le golfe du Mexique. De telles solutions ne sont pas satisfaisantes et doivent laisser place à des filières « propres » de démantèlement. Suite à la décision de rapatrier le Clemenceau en France, le Premier ministre a annoncé la création d'une mission interministérielle autour des ministères de l'écologie et du développement durable, de la défense, des transports, du travail, de l'économie et des finances, de l'industrie, des affaires étrangères et des affaires européennes. Cette mission « devra établir une coordination étroite avec nos partenaires européens, ainsi qu'avec des pays comme l'Inde, avec qui un partenariat a été noué sur ces sujets. Elle devra étudier des conditions technologiques acceptables et industrielles viables pour procéder dès que possible au démantèlement de ces épaves, dans le respect absolu des règles de sécurité des personnes et de l'environnement »203. Selon l'Amiral Oudot de Dainville « actuellement plus de 700 navires de commerce sont détruits dans le monde tous les ans, en Asie pour la majorité d'entre eux. Ce chiffre devrait doubler d'ici 2008, sous l'effet de l'interdiction des pétroliers à simple coque »204 . Le marché du démantèlement est donc potentiellement très important. Par ailleurs, sur le plan sanitaire, l'envoi de ces bateaux et des anciens matériels de guerre dans le sud-est asiatique n'est pas non plus satisfaisant. Si le chantier retenu pour le Clemenceau semblait présenter des garanties quant au bon déroulement de son démantèlement, il n'en demeure pas moins que la majorité des lieux de « déconstruction » de la Baie d'Alang et de zones comparables ne répondent pas aux exigences sanitaires les plus élémentaires. Si des progrès peuvent être faits, en particulier par le biais de transferts de technologies, ils seront trop lents et insuffisants face aux besoins qui seront de plus en plus importants. La mission souhaite donc que la France se dote d'une capacité de démantèlement des navires en fin de vie, y compris les plus grands205. Ce qui a été possible pour le traitement des déchets nucléaires à l'usine COGEMA de La Hague doit pouvoir l'être également pour les bateaux ! Il convient donc que la mission interministérielle qu'entend mettre en place le Premier ministre considère avec attention cette solution dont l'urgence est désormais évidente. Proposition : Développer une filière technologique française de démantèlement des navires en fin de vie. En tout état de cause, une discussion doit rapidement s'engager, au niveau communautaire, pour que l'Union européenne puisse trouver une solution respectueuse de l'environnement et porteuse en matière d'emplois. Nos partenaires sont confrontés aux mêmes difficultés et ont eux aussi intérêt à ce qu'une réponse soit rapidement apportée à la question des navires civils et militaires en fin de vie206. b) Comment interdire l'amiante dans le monde ? Face aux risques sanitaires liés au maintien de l'extraction et de l'utilisation de l'amiante, la mission est favorable à l'interdiction pure et simple de ce produit au niveau mondial, sur le modèle de ce qui a été décidé en Europe. Les auditions et les données que la mission a pu recueillir convergent toutes vers un constat irréfutable : la voie de l'usage sécuritaire ne peut être, aujourd'hui, sérieusement défendue lorsqu'on sait que les principaux utilisateurs sont des pays émergents qui n'ont pas les moyens de protéger efficacement leurs populations. Plusieurs mesures pourraient être prises afin de tendre vers une mesure internationale d'interdiction de l'amiante. ● Accompagner financièrement et matériellement le processus d'interdiction Si l'amiante est aujourd'hui encore massivement utilisé, c'est avant tout parce qu'il est toujours perçu comme un matériau efficace, peu cher et incontournable. Exiger des consommateurs actuels que, du jour au lendemain, ils se passent de ce « magic mineral » serait inutile. La transition vers une interdiction mondiale ne pourra se faire que progressivement et avec l'aide financière et technique des pays industrialisés, qui ont la connaissance du risque et savent comment substituer à ce produit des substances non nocives. Par exemple, la mission estime que, pour favoriser l'interdiction de l'amiante par le plus grand nombre de pays, il serait très utile de traduire en langues locales - ou tout au moins en anglais - les législations nationales les plus favorables. Certaines organisations syndicales, en Egypte notamment, sont particulièrement intéressées par cette forme d'appui technique destiné à étayer leurs revendications pour des normes plus strictes. ● Exercer des pressions sur les pays producteurs Comme le sénateur belge Alain Destexhe l'a souligné lors de son audition à Bruxelles, le fait que l'essentiel de la production mondiale soit concentré sur une dizaine de pays est un atout. En effet, le travail de « lobbying » n'en est que plus réduit puisqu'il suffirait de convaincre quelques uns de ces pays de mettre fin à l'extraction d'amiante sur leur sol pour que la production mondiale soit sérieusement réduite. Selon la mission, deux pays, parmi les plus gros producteurs, devraient faire l'objet d'une attention toute particulière. En premier lieu, le Canada, de par la proximité culturelle qu'il peut entretenir avec les États qui ont déjà interdit toutes les formes d'amiante, doit être une « cible » prioritaire. Le Parlement a un rôle important à jouer car il existe de nombreuses occasions où députés et sénateurs français sont amenés à rencontrer leurs homologues canadiens comme, par exemple, les groupes d'amitiés France-Canada et France-Québec ou l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les réunions de ces organes pourraient être le lieu de débats sur les positions respectives des deux pays. Le Canada et le Québec, souvent exemplaires en matière de défense de l'environnement et des droits de la personne, ne pourront pas rester éternellement insensibles aux conséquences désastreuses de leur politique et devraient pouvoir entendre les arguments avancés par la communauté internationale. La Russie doit également faire l'objet d'un travail de persuasion pour convaincre ce pays du danger qu'il fait courir, en tant que premier producteur mondial d'amiante, à sa population mais aussi aux populations des pays vers lesquels il exporte le produit207. On rappellera que la Russie est membre du Conseil de l'Europe et que celui-ci s'est prononcé en faveur d'une interdiction complète de l'amiante à l'occasion d'une résolution d'octobre 2000 du Comité des ministres208. « La Cour européenne des droits de l'homme pourrait également se révéler un instrument utile dans une lutte mondiale contre l'amiante. Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour relative à l'article 2 (le droit à la vie) et à l'article 8 (le droit à la vie privée et familiale) que l'inaction des États en ce qui concerne la protection contre l'exposition à l'amiante pourrait être considérée comme une violation de l'un ou l'autre des droits fondamentaux ci-dessus »209. Il faudrait sensibiliser les États parties à la Convention européenne des droits de l'homme qui, comme la Russie, tardent à réagir aux dommages sanitaires causés par l'amiante. Un précédent existe concernant l'exposition d'un village italien à des fertilisants et à d'autres produits toxiques (CEDH, 19 février 1998, Guerra c/ Italie). Proposition : Promouvoir l'interdiction totale de l'amiante lors des rencontres avec les parlementaires d'Etats producteurs ou importateurs. ● Empêcher les comportements « duaux » Par comportement « dual », la mission vise l'attitude de certaines entreprises qui, aujourd'hui encore, respectent la réglementation communautaire en Europe mais profitent des lacunes des législations étrangères pour continuer à produire ou utiliser de l'amiante dans des pays tiers. En effet, « la réduction drastique de l'utilisation de l'amiante dans les pays industrialisés a provoqué une réorientation globale de l'industrie sur la base d'un « double standard ». Dans les pays industrialisés, des procédés de substitution ont permis de se passer d'amiante pour la totalité de ses utilisations (...) Par contre, dans les pays « en voie de développement », l'amiante continue à être présenté comme une ressource naturelle irremplaçable et dont l'utilisation pourrait se faire dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Il arrive souvent qu'un même groupe industriel, comme par exemple le groupe Eternit, diversifie sa production en fonction des pays et se range sous la bannière du lobby pro-amiante dans certaines parties du monde tout en développant des alternatives moins dangereuses dans les pays les plus développés »210. Le nom d'« Eternit » est revenu plusieurs fois au cours des auditions de la mission. L'origine de cette entreprise remonte à 1900, année où un industriel autrichien, Ludwig Hatschek, mit au point un procédé nouveau pour renforcer le ciment avec des fibres d'amiante. Baptisée « Eternit », du latin « aeternus » (éternel ou immortel), la technique fit l'objet d'un brevet et fut rapidement diffusée dans le monde entier. Eternit est aujourd'hui une sorte de nébuleuse constituée de participations croisées ou de filialisations qui rendent difficile la compréhension du fonctionnement de la société au cours du XXème siècle211. Toutefois, les branches belge et suisse se distinguent par leur taille et leur importance au sein d'Eternit, rebaptisé Etex Group en 1995. Ces « deux entités distinctes du groupe Etex (...) continuent d'exploiter l'amiante dans différents pays, en Amérique latine par exemple, et en particulier au Pérou. Dans ce pays, les autorités, qui commencent à envisager l'interdiction, se heurtent à une campagne très offensive du groupe. Etex poursuit aussi ses activités en Inde par le biais de filialisation, de restructuration ou de sous-traitance (...). Le groupe Etex continue de produire du fibrociment en Inde et dans le Sud-est asiatique. Le Japon a tout récemment interdit l'amiante mais, cette année encore, des accords avaient été passés entre des sociétés japonaises et Eternit Belgique. Quant à Eternit Suisse, elle opère au Nicaragua et elle opérait au Brésil. Il existe une étanchéité parfaite entre Erternit Belgique et Eternit Suisse, mais l'hypothèse est forte qu'Eternit Suisse continue des activités d'extractions et de commercialisation d'amiante au travers de sociétés écran »212. De tels comportements sont inacceptables et contribuent à accroître massivement le transfert des risques des pays développés vers les pays émergents. La mission considère que l'Union européenne est le niveau le plus pertinent pour agir afin de supprimer de telles pratiques et que les standards en vigueur dans l'espace communautaire soient étendus ailleurs lorsqu'ils sont plus protecteurs. Ne pourrait-on pas envisager, par exemple, que, sur la base de sa directive de 1999/77/CE, la Commission exige des États-membres qu'ils fournissent des informations sur les entreprises qui continuent à produire ou à utiliser de l'amiante dans les pays tiers ? Ce moyen de pression permettrait d'attendre l'adoption éventuelle de normes plus contraignantes en la matière. Proposition : Empêcher les entreprises européennes d'exporter vers les pays tiers des pratiques désormais interdites dans l'Union européenne. Par ailleurs, l'abandon de l'amiante est techniquement faisable et les exemples abondent en ce sens213. « De façon spectaculaire, la filiale brésilienne de la société Saint-Gobain, Brasilit, s'est entièrement reconvertie à une production sans amiante. Elle a investi 100 millions de reais dans une usine fabriquant un substitut de l'amiante, du polypropylène, à Jacareí dans l'Etat de São Paulo. Cette entreprise compte 850 travailleurs et réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 200 millions de reais par an, un peu moins de la moitié du chiffre d'affaires d'Eternit pour la production d'amiante-ciment. Des chercheurs brésiliens ont mis au point de nouveaux procédés permettant notamment l'utilisation de fibres végétales pour la production de matériaux de construction. Eternit, pour sa part, maintient une attitude très agressive de défense à outrance de l'amiante. Mais, de façon plus discrète, elle n'exclut pas une reconversion. Tandis que la presse générale contient ses vibrantes proclamations de fidélité à l'amiante, la presse économique spécialisée informe qu'Eternit envisage de se séparer de sa filiale, la société SAMA qui exploite la mine de Minaçu, et qu'elle se prépare à une diversification de sa production. En somme, les conditions d'une sortie rapide de l'amiante existent ». ● Organiser un colloque international Comme il a été indiqué précédemment, les organes de coopération parlementaire, en particulier les groupes d'amitié France-Canada et France-Québec, pourraient être les lieux d'un débat constructif sur les positions officielles des deux côtés de l'Atlantique et, si possible, permettre un changement d'attitude des gouvernements canadien et québécois. Mais l'Assemblée nationale peut faire plus en donnant une impulsion à un processus d'interdiction mondial de l'amiante. À l'étranger, les parlementaires ont parfois la possibilité de voter des résolutions invitant expressément l'exécutif à agir dans une direction donnée ou exprimant un vœu de l'ensemble de l'assemblée. C'est le cas en Belgique où le Sénat fédéral a récemment adopté une résolution « visant à une interdiction mondiale de la production mondiale et de l'utilisation de l'amiante ». Notre droit parlementaire ne permet pas une telle initiative, puisque les résolutions des assemblées ne peuvent porter sur « un objet différent de celui qui leur est propre, à savoir la formulation de mesures et décisions relevant de [leur] compétence exclusive »214 ou qui ne sont pas expressément prévues par une disposition constitutionnelle, par exemple, les résolutions sur les actes communautaires prévues par l'article 88-4 de la Constitution. La mission propose donc que soit organisé prochainement, à l'Assemblée nationale, un colloque international sur la question de l'interdiction mondiale de l'amiante. Cette manifestation pourrait permettre l'adoption d'une déclaration appelant les États à prendre conscience des problèmes posés par l'amiante au plan mondial et donner un signal fort en faveur de l'interdiction du « magic mineral » sur tous les continents. Surtout, elle pourrait être le point de départ d'un processus conduisant à la conclusion d'une convention internationale entièrement consacrée à l'amiante. Proposition : Organiser, à l'Assemblée nationale, un colloque sur l'interdiction mondiale de l'amiante. ● Adopter une convention internationale sur l'amiante Aucun instrument international ne traitant spécifiquement de l'ensemble des questions liées à l'amiante, la mission d'information considère qu'il serait opportun que soit adopté un traité posant, en priorité, l'interdiction, dans les États parties, de la production, de la commercialisation et de l'utilisation de toutes les formes d'amiante. Cette convention pourrait également aborder d'autres problématiques comme l'exportation des déchets ou la protection des travailleurs même si, dans ces deux derniers cas, des cadres juridiques existent déjà avec, notamment, l'OMI, la convention de Bâle et l'OIT. Comme l'a fait remarquer le sénateur belge Alain Destexhe lors de son audition le 2 décembre dernier à Bruxelles, la France - ou tout autre État déjà « prohibitionniste » - pourrait prendre la responsabilité d'organiser une conférence diplomatique internationale sur le modèle de celles qui ont abouti à la signature du traité de Rome sur la Cour pénale internationale (CPI) ou de la convention d'Ottawa de 1997 sur les mines anti-personnel. De la même façon, l'accord qui naîtrait d'une telle conférence ne rencontrerait sans doute pas l'unanimité mais il servirait de fondation solide au processus d'interdiction de l'amiante dans le monde. Ce n'est pas parce que certains États comme les États-Unis, la Russie, la République populaire de Chine ou Israël n'ont pas signé et ratifié le traité instituant la CPI que la notion de justice internationale est aujourd'hui caduque. Au contraire, l'adoption de ce texte a donné lieu à de nombreux débats et a permis de diffuser l'idée que la communauté internationale n'est plus disposée à accepter l'impunité dont ont pu se prévaloir, pendant longtemps, de nombreux criminels. Il pourrait en être de même avec l'amiante et l'adhésion à un traité mondial d'interdiction apparaîtrait comme un signe de modernité, voire comme un « label de bonne gouvernance ». La mission propose que le Gouvernement, par l'intermédiaire des services du ministère des affaires étrangères, réfléchisse au rôle moteur que pourrait jouer la France dans l'élaboration d'une convention internationale interdisant l'amiante. Proposition : Adopter une convention internationale d'interdiction mondiale de l'amiante. III.- LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES DE L'AMIANTE Le nombre des victimes, leur souffrance, qui s'est exprimée avec force au travers de leurs associations, et l'attente d'une réparation rapide à la mesure des préjudices subis, ont conduit les pouvoirs publics à mettre en place des mécanismes originaux de prise en charge des victimes de l'amiante. Dans un contexte pourtant marqué par la restriction de l'accès aux préretraites et par le principe du caractère forfaitaire de la réparation des maladies professionnelles, la prise en charge des victimes de l'amiante s'est principalement traduite par la création de deux fonds spécifiques, le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA), en 1999215, pour financer les départs en préretraite des travailleurs de l'amiante et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), en 2001216, pour réparer intégralement les préjudices subis par les victimes de l'amiante. Afin de mieux identifier les victimes de l'amiante qui souffrent de pathologies diverses et plus ou moins malignes, des procédures de suivi médical ont également été mises en place, tant pour chercher à soigner les malades que pour faciliter l'accès des victimes aux dispositifs d'indemnisation. A.- LES MALADIES CAUSÉES PAR L'INHALATION DE L'AMIANTE SONT AUJOURD'HUI MIEUX CONNUES ET LES MALADES MÉDICALEMENT MIEUX SUIVIS. Les connaissances scientifiques et médicales relatives aux pathologies de l'amiante continuent de progresser depuis l'étude collective de l'INSERM217 sur les effets de l'amiante en 1996, même si le professeur Claude Got a tenu à souligner218 que le compte rendu de 700 pages de la réunion de l'Académie des sciences de New York, rédigé il y a quarante ans, contenait déjà toutes les connaissances nécessaires à la gestion du problème. Selon lui, l'amiante posait moins un problème de connaissances qu'un problème de gestion des connaissances par les décideurs, comme c'est souvent le cas en matière de santé publique. Les questions relatives aux aspects scientifiques et médicaux ont été évoquées et étudiées tout au long des travaux de la mission et surtout à l'occasion de la table ronde scientifique qu'elle a organisée le 14 septembre 2005. 1.- Les pathologies de l'amiante Les maladies de l'amiante ont souvent pour caractéristiques communes de ne se développer qu'après un temps de latence important - qui peut se chiffrer en dizaines d'années entre l'exposition et les premières manifestations cliniques - et de ne pas comporter de traitement curatif efficace. Elles présentent également des degrés de dangerosité très variables. Si certaines, comme le mésothéliome, sont souvent mortelles dans l'année qui suit la découverte des premiers symptômes et s'accompagnent de souffrances extrêmes, d'autres, comme les plaques pleurales, ne mettent généralement pas en cause le pronostic vital. ● Les plaques pleurales et épaississements pleuraux Les plaques pleurales sont de loin les pathologies les plus fréquentes, puisqu'elles représentent environ 70 % des maladies professionnelles liées à l'amiante reconnues en France. Une plaque pleurale est une sorte de tissu cicatriciel situé au niveau du collier externe de la plèvre que les progrès des techniques d'imagerie médicale permettent d'identifier de façon de plus en plus précoce, dès les premiers petits épaississements. Les plaques pleurales ne résultent pas toujours d'une exposition professionnelle. Comme Mme Marie-Annick Billon-Galland, responsable du LEPI219, l'a indiqué à la mission lors de son audition220, le LEPI a constaté en 1982 la prévalence élevée de plaques pleurales dans le Nord-est de la Corse, zone géologique amiantifère, au sein d'une population qui n'avait jamais été exposée professionnellement à l'amiante. Par ailleurs, le professeur Christophe Paris a souligné qu'elles pouvaient avoir d'autres causes que l'amiante221 : « l'étiologie principale est maintenant l'amiante mais d'autres causes existent (...) lorsque leur présence est unilatérale, le diagnostic, assez facile, est celui d'une séquelle de traumatisme ou de pleurésie. Lorsque les plaques sont bilatérales et dispersées, l'étiologie est celle de l'amiante ». C'est également ce qu'indique une communication du professeur D. Choudat du service de pathologie professionnelle de l'hôpital Cochin222 qui précise que les plaques pleurales « ne sont absolument pas spécifiques de l'amiante et [que] l'on peut observer des plaques pleurales en dehors de toute exposition à l'amiante ». Par ailleurs, la mission a été surprise de constater que la question du retentissement des plaques pleurales sur la fonction respiratoire, et plus globalement sur la santé, est encore assez controversée. Elle a, en effet, recueilli des informations très divergentes sur ce point. Certaines victimes auditionnées ou rencontrées ont parlé des difficultés respiratoires que leur occasionnent les plaques pleurales223, confirmant ainsi les témoignages restitués dans différents ouvrages. Au contraire, l'étude déjà citée du professeur Choudat souligne que « ces pathologies, d'apparition tardive, sont asymptomatiques. Elles n'entraînent pas d'altération fonctionnelle respiratoire significative. Elles ne nécessitent aucun traitement. Elles ne justifient aucune restriction d'aptitude. Elles ne se cancérisent pas. Elles ne sont pas à l'origine de mésothéliomes. Elles ne témoignent pas d'un sur-risque de cancer bronchique : le risque relatif de cancer bronchique est fonction de l'intensité de l'exposition à l'amiante mais pas de l'existence ou non de plaques pleurales» et précise que « au total, la découverte de plaques pleurales n'entraîne aucune conséquence médicale ». Étant donné les incertitudes sur le lien exclusif entre plaques pleurales et l'exposition à l'amiante, les divergences d'appréciation sur leurs conséquences médicales réelles et compte tenu de l'enjeu qu'elles représentent par leur nombre dans l'ensemble des pathologies de l'amiante, la mission recommande l'organisation rapide d'une conférence de consensus médical sur les plaques pleurales afin d'obtenir un état scientifique objectif de la question. Proposition : Organiser une conférence de consensus médical sur les plaques pleurales afin d'obtenir un état scientifique objectif des connaissances sur cette pathologie. En outre, la mission a eu l'occasion de constater à travers ses auditions que les plaques pleurales sont à l'origine de grandes angoisses chez ceux qui en sont victimes, souvent en raison « d'idées fausses largement répandues » comme l'a souligné le professeur Jacques Ameille, lors de la table ronde scientifique du 14 septembre 2005. C'est pourquoi, et sans attendre les résultats de la conférence de consensus préconisée par la mission, il apparaît indispensable de dissiper un certain nombre de ces idées fausses. Les personnes qui ont été exposées à l'amiante s'interrogent en premier lieu sur le fait de savoir si leurs plaques pleurales sont une première étape vers le cancer. Il est possible de les rassurer sur ce point en répondant, sans la moindre hésitation, que plaques pleurales et cancer sont deux maladies complètement distinctes. Elles craignent également souvent que la présence de plaques pleurales n'augmente le risque d'un cancer du poumon ou de la plèvre. Si la littérature scientifique comporte assez peu de données sur ce point, le professeur Jacques Ameille a néanmoins estimé224 qu'« au stade actuel des connaissances, on n'a pas de raison de penser que, à exposition identique, le fait d'avoir des plaques pleurales augmente le risque de cancer ». Le professeur Claude Got a confirmé ce point en indiquant que lorsque des ouvriers ont travaillé dans la même usine et ont été exposés de la même façon à l'amiante, le risque de voir survenir un cancer bronchique ou un mésothéliome n'est pas très différent entre ceux qui ont des plaques pleurales et ceux qui n'en ont pas. Le rapport d'information de la Cour des comptes sur la gestion des fonds de l'amiante225, réalisé à la demande de la commission des affaires sociales du Sénat, constate également que la présence de plaques pleurales « ne semble pas indiquer un niveau d'exposition particulier, ni constituer un facteur de risque supplémentaire d'asbestose, de cancer broncho-pulmonaire ou de mésothéliome. L'existence de plaques pleurales calcifiées ne correspond pas à un risque accru de dégénérescence maligne si on compare ce risque à celui que court une personne exposée dans les mêmes conditions et qui ne présente pas de plaques pleurales ». Enfin, dans un article publié par l'Encyclopédie médicale et chirurgicale, il est indiqué qu'il n'existe aucune démonstration d'une quelconque filiation entre plaques pleurales et mésothéliomes226. Les plaques pleurales ne sont mentionnées que depuis le décret n° 85-630 du 19 juin 1985 dans le tableau n° 30 des maladies professionnelles indemnisables dans le cadre du régime général de sécurité sociale. On notera également que la prise en charge des plaques pleurales est une exception française, la quasi-totalité des autres pays de l'Union européenne - à l'exception de l'Irlande - ne la considérant pas comme une pathologie indemnisable. ● L'asbestose L'asbestose est une fibrose du poumon qui apparaît chez des sujets ayant été soumis à des expositions massives à l'amiante, notamment autour des chantiers navals. Le nombre de cas est aujourd'hui relativement restreint et devrait très probablement décroître dans les prochaines années. Selon Mme Ellen Imbernon, responsable du département « santé-travail » de l'Institut de veille sanitaire (IVS)227 « On peut dire que, pour l'essentiel, l'asbestose est derrière nous parce qu'elle est associée à des niveaux d'empoussièrement très importants. On a relevé, en 2000 ou 2001, environ 200 asbestoses. Il me semble donc que les risques d'asbestose sont aujourd'hui relativement limités. Cela dit, il faut être vigilants, notamment en ce qui concerne les personnes les plus exposées, c'est-à-dire celles qui procèdent au retrait ou au confinement de l'amiante ». Le professeur Michel Fournier a, quant à lui, précisé, lors de la table ronde scientifique du 14 septembre 2005, que dans un tiers des cas, cette maladie évolue vers une insuffisance respiratoire grave et une espérance de vie réduite, tandis que dans deux tiers des cas, elle reste à peu près stable. S'agissant des seuils de nocivité, le professeur Goldberg a rappelé à la mission que, selon le consensus scientifique, le risque de développer un cancer du fait de l'exposition à l'amiante correspond à un « modèle linéaire sans seuil », ce qui signifie que le risque augmente de façon strictement proportionnelle à la dose totale d'amiante inhalée, sans qu'il soit possible de définir un seuil inférieur au-dessous duquel il n'y aurait aucun effet toxique. En théorie, l'inhalation d'une seule fibre d'amiante peut donc déclencher un cancer. Mais le risque est bien entendu proportionnel : l'augmentation du risque du fait d'avoir été exposé à de très faibles doses d'amiante est donc elle-même très faible et, selon les experts, on ne pourra sans doute jamais l'observer par aucune méthode. ● Les cancers broncho-pulmonaires D'après les évaluations épidémiologiques réalisées par l'INSERM et l'IVS, les cancers représentent la première cause de mortalité des sujets ayant été exposés à l'amiante. Le professeur Goldberg a indiqué que228 « les cancers du poumon provoqués par l'amiante n'ont aucune caractéristique particulière permettant de les distinguer de ceux provoqués par d'autres causes », comme le tabac par exemple. C'est la raison pour laquelle certains pays ont mis en œuvre une recherche systématique des fibres dans toutes les tumeurs primitives du poumon, et n'imputent le cancer bronchique à l'amiante qu'à partir d'un certain seuil. Le professeur Jean-Claude Pairon a fait savoir qu'en Belgique, par exemple, le fait d'avoir plus de 5 000 corps asbestosiques par gramme de poumon est associé à une reconnaissance automatique du lien entre l'exposition à l'amiante et le cancer du poumon. Il convient toutefois de souligner qu'une telle disposition est susceptible d'entraîner des injustices, puisque certaines fibres d'amiante, comme les chrysotiles, disparaissent plus vite que d'autres et ne peuvent donc plus être mises en évidence lorsque le cancer survient longtemps après l'exposition du sujet à l'amiante. Sur ce point, Mme Marie-Annick Billon-Galland a indiqué229 que le Laboratoire des particules inhalées (LEPI) avait mis au point en 1979 des méthodes analytiques d'identification par microscopie optique de traceurs de l'exposition à l'amiante dans les échantillons biologiques pulmonaires. À partir de prélèvements biologiques de trois sources - parenchyme pulmonaire, liquide de lavage broncho-alvéolaire, expectorations - le LEPI est capable de mettre en évidence - plus de trente ans après l'exposition - les traceurs d'exposition à l'amiante que sont les corps asbestosiques (par microscopie optique) et les fibres d'amiante (par microscopie électronique à transmission analytique). Toutefois, elle a considéré que l'amiante chrysotile - qui a été de très loin le plus utilisé en France - est moins bio-persistant que l'amiante amphibole. Ainsi, le FIVA et les CRRMP230 peuvent s'appuyer sur un résultat positif de la recherche pour reconnaître l'exposition à l'amiante, mais pour autant un résultat négatif ne signifie pas qu'il n'y a pas eu exposition. L'analyse du LEPI n'est donc qu'une simple aide au diagnostic. S'agissant des facteurs aggravants, le rapport de l'INSERM de 1996 a montré que si le risque d'avoir un cancer bronchique est de 1 dans la population générale, il est de 11 si l'on fume, de 5,6 si l'on est exposé à l'amiante et qu'on ne fume pas, et de 56 si l'on est exposé à l'amiante et que l'on fume. Il y a donc un réel effet multiplicateur de l'exposition à l'amiante cumulée avec la consommation de tabac. La plus faible bio-persistance dans les tissus pulmonaires des fibres d'amiante chrysotile par rapport aux fibres amphiboles a parfois pu être invoquée pour « innocenter » le chrysotile. C'est d'ailleurs sur cet argument que se fondent certains Etats, comme le Canada, pour promouvoir un usage contrôlé de l'amiante. Mais il est désormais tranché que le chrysotile est tout aussi cancérigène, même s'il est attesté que les fibres sont d'autant plus toxiques qu'elles sont longues. Selon le professeur Jacques Ameille, il existe un traitement efficace pour le cancer broncho-pulmonaire, à condition que la tumeur ait été identifiée suffisamment tôt : la chirurgie. Il a toutefois été extrêmement prudent en faisant valoir qu'« on n'a pas encore la preuve - ce n'est pour le moment qu'un espoir - qu'un dépistage systématique par scanner apportera un bénéfice en termes de survie ». M. Jean Pierre Grignet a confirmé cette analyse en faisant remarquer qu'en matière de cancer bronchique « seule la chirurgie rend possible la survie. Plus le dépistage est précoce, plus il est possible de proposer un traitement chirurgical, plus les chances de survie sont élevées ». ● Les cancers du larynx et du colon Mme Ellen Imbernon a indiqué que le lien entre l'exposition à l'amiante et la survenue d'un cancer du larynx a été très longtemps discuté par la communauté scientifique. On peut considérer que ce lien existe, le risque étant environ 1,2 fois plus élevé chez les personnes qui ont été exposées à l'amiante que chez celles qui ne l'ont pas été. D'ailleurs, l'Allemagne a déjà inscrit le cancer du larynx dans la liste des maladies indemnisables, sous certaines réserves liées au niveau d'exposition. Par ailleurs, on s'interroge encore, au sein de la communauté scientifique, sur le rôle de l'amiante dans le cancer du côlon. ● Les mésothéliomes Le mésothéliome est, selon le professeur Marcel Goldberg, une pathologie presque exclusivement liée à l'amiante, puisque dans une population qui n'a pas été exposée à l'amiante, il y a moins d'un cas annuel par million d'habitants. Le professeur Claude Got a confirmé ce propos en soulignant231 qu'« il n'y a pratiquement pas de mésothéliome sans amiante et donc que la quasi-totalité des tumeurs primitives de la plèvre doivent être imputées à l'amiante. Quand on diagnostique un cancer de la plèvre et qu'il n'y a pas d'autre tumeur ailleurs, il faut l'imputer à l'amiante et les risques d'erreur sont très faibles ». D'après Mme Ellen Imbernon232, « cette maladie est due à 90 % à une exposition professionnelle à l'amiante ». Une des particularités de ce cancer est que le temps de latence, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre le moment où un sujet est exposé à l'amiante et celui où le mésothéliome survient, est extrêmement long, entre trente et quarante ans en moyenne. Lors du symposium « Amiante et risque professionnelles : études épidémiologiques récentes » (17 novembre 2003), il a été indiqué que « le diagnostic anatomopathologique est réputé pour être extrêmement difficile car cette tumeur est une grande simulatrice d'autres lésions. Le diagnostic du mésothéliome peut se poser aussi bien avec celui d'une pathologie inflammatoire bénigne réactionnelle qu'avec celui d'une métastase d'un cancer, cause de loin la plus fréquente de la pathologie pleurale tumorale. Cette difficulté diagnostique représente une cause d'erreur potentielle fréquente ». De son côté, Mme Ellen Imbernon a souligné que233 « le mésothéliome est une tumeur tellement rare que si le pneumologue, ou même l'anatomo-pathologiste, n'a pas l'habitude d'en voir, il peut se tromper, par excès ou par défaut ». Ces risques d'erreurs de diagnostics ont été mis en avant avec force par le docteur Michel Diss et par M. Jean-Claude Muller, directeur Santé et sécurité chez Arcelor234, pour estimer que les cas de mésothéliomes étaient surestimés en France. Mais ces propos n'ont pas convaincu la mission, d'autant plus que le professeur Michel Fournier a indiqué235 qu'un consensus s'est désormais fait sur le diagnostic anatomopathologique du mésothéliome. S'il a certes reconnu que des erreurs de diagnostic ont pu être faites par le passé parce qu'il s'agit d'un problème difficile, il a souligné que des progrès ont été réalisés dans la précision des critères de diagnostic du mésothéliome. D'après le professeur Michel Fournier, la connaissance des étapes du mésothéliome a également bien progressé. Le rôle, par exemple, des espèces réactives de l'oxygène a été beaucoup mieux précisé, ce qui a débouché sur de nouveaux moyens pour orienter les recherches thérapeutiques. Le profil cytogénétique tumoral du mésothéliome est désormais mieux connu, ce qui ouvre la voie à des avancées thérapeutiques expérimentales. De même, il est désormais établi que la transformation des cellules mésothéliales aboutit à la libération dans l'organisme et dans le sang d'une protéine - la mésothéline - qu'il est possible de doser. Cette protéine est plus élevée chez les sujets porteurs d'un mésothéliome que chez ceux qui, tout en ayant été exposés à l'amiante, n'en sont pas porteurs, et plus encore que chez ceux qui n'ont pas du tout été exposés à l'amiante. La question est donc posée de savoir si la mésothéline est un marqueur du mésothéliome, ce qui permettrait peut être de repérer l'apparition d'un mésothéliome et de prévoir un traitement, mais cela reste encore en débat. En tout état de cause, le professeur Michel Fournier a indiqué que la relation entre mésothéline et la présence de la maladie est loin d'être aussi simple que celle existant, par exemple, entre le taux de PSA236 et le cancer de la prostate. S'agissant des avancées thérapeutiques, le professeur Fournier a indiqué que l'association du Pemetrexed, molécule mise au point par le laboratoire Lilly, à un sel de platine est devenu l'association de référence pour le traitement du mésothéliome en chimiothérapie, même si elle ne modifie que très faiblement l'espérance de vie du sujet, puisque le gain est de l'ordre d'un mois par rapport à la médiane de survie. Le professeur Jacques Ameille a estimé que s'agissant du mésothéliome, les progrès thérapeutiques existent mais qu'ils sont faibles et qu'en conséquence, une généralisation du dépistage n'apporterait pas nécessairement un bénéfice pour les patients. M. Jean-Pierre Grignet, chef du service de pneumologie de l'hôpital de Denain (Nord) et expert auprès des caisses d'assurance maladie, a indiqué que, parmi les malades qu'il a eu à soigner atteints de mésothéliome pleural, seuls ont pu survivre plus de cinq ans ceux qui étaient jeunes et avaient pu subir une pleuro-pneumonectomie. Mais il s'agit d'une opération chirurgicale très lourde qui n'est possible que dans un petit nombre de cas et qui suppose un diagnostic précoce. Par ailleurs, il a reconnu que la cohorte n'était pas suffisamment importante pour en tirer des conclusions valables. L'attention de la mission a été appelée par le professeur Marcel Goldberg sur les mésothéliomes liés aux expositions « environnementales ». Ce dernier a informé la mission qu'un article va prochainement paraître dans une grande revue internationale démontrant qu'on observe encore, à plusieurs dizaines de kilomètres des sources industrielles d'amiante, une augmentation des risques de mésothéliomes. Des doses faibles peuvent donc, au niveau collectif, générer un certain nombre de cas de cancer. Il a aussi confirmé qu'il y a également en France des sources géologiques naturelles d'amiante, en Corse et en Nouvelle-Calédonie où l'on observe « des augmentations énormes de risques de développement du mésothéliome ». c) Mortalité associée à ces pathologies Dans le cadre de l'expertise collective qu'il a conduite en 1996, l'INSERM a estimé à 750 le nombre de décès annuels dus à un mésothéliome et à 1 200 le nombre de décès par cancer du poumon imputables à l'amiante, soit 1 950 décès annuels résultant, en France, d'une exposition à l'amiante. S'agissant des chiffres de mortalité associés à ces pathologies, le professeur Goldberg a, de son côté, indiqué que jusqu'en 2030, on sait qu'entre 30 000 et 40 000 mésothéliomes surviendront dans la population française, et qu'« ils continueront à augmenter pendant au moins vingt ou trente ans ». Le chiffre d'environ 750 mésothéliomes annuels est fondé sur l'observation directe de la survenue de ces cancers, comme l'a indiqué Mme Ellen Imbernon de l'IVS237. Toutefois, il faut noter que le PNSM238 surveille l'évolution de l'incidence nationale mais n'enregistre pas tous les cas survenant sur le territoire français. Il ne le fait que dans 21 départements, qui seront prochainement portés à 24. À partir de ces données, une projection est réalisée pour la France entière en comparant les nouveaux cas enregistrés avec la mortalité. Les cartographies de la mortalité par mésothéliome montrent une surmortalité dans le nord de la France et dans les régions industrielles. Au chiffre des mésothéliomes, il faut ajouter le nombre des cancers du poumon provoqués par l'exposition à l'amiante. Celui-ci n'est pas connu avec précision car ces cancers sont beaucoup plus difficiles à identifier étant donné la possibilité d'une origine multifactorielle. Mais il est supérieur à celui des mésothéliomes. Mme Ellen Imbernon a ainsi indiqué à la mission que1 « le nombre attendu de cancers du poumon associés à l'exposition à l'amiante est de 2 000 à 3 000 par an chez les hommes, sur un total de 25 000 [cancers du poumon], soit environ 10 %. Pour l'exposition féminine, les estimations sont encore difficiles car on connaît très mal l'exposition à l'amiante des populations féminines ». Une modélisation mathématique à partir des données concernant le mésothéliome dans les décennies passées aboutit à un nombre annuel de 50 000 à 100 000 morts jusqu'en 2030. C'est ce chiffre haut de la fourchette qui a été retenu par les médias et notamment par le journaliste François Malye dans son livre Amiante : 100 000 morts à venir. De son côté, M. Michel Cretin, président de la sixième chambre de la Cour des comptes, a indiqué au cours de son audition du 9 novembre 2005 qu'« on estime que 2 500 décès professionnels par an sont associés à l'amiante » même s'il a reconnu que « ce chiffre est susceptible d'évoluer ». Pour compléter ces données relatives à la mortalité, recueillies principalement au cours de la table ronde du 14 septembre 2005, la mission de l'Assemblée nationale a souhaité demander à l'IVS un état statistique complet et récent de la mortalité associée à chaque pathologie de l'amiante. La réponse circonstanciée de l'IVS, qui met en évidence la difficulté de décrire de manière exhaustive l'impact de l'amiante dans la santé publique, figure en annexe n° 6 de ce rapport. 2.- Le suivi médical des victimes Le suivi médical a pour objectif de repérer efficacement les pathologies dues à l'amiante pendant et après l'activité professionnelle. a) La surveillance médicale des salariés exposés Les salariés exposés aux poussières d'amiante font l'objet d'une surveillance médicale spéciale (SMS) prévue par la réglementation. Outre l'initiation de traitements lorsque ceux-ci existent, le dépistage prévu par ce suivi favorise les démarches de reconnaissance des maladies professionnelles et l'accès aux mesures de réparation (indemnisation, retraite anticipée ...). Le régime juridique relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante, déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail, a été fixé par l'arrêté du 13 décembre 1996 portant application du décret n° 96-98 du 7 février 1996. Les salariés exposés à l'inhalation des poussières d'amiante au titre des sections II (activités de confinement et de retrait de l'amiante) et III239 (activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante) sont en surveillance médicale spéciale au sens de l'article R. 241-32 du code du travail et de l'article 32 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié. Le temps réglementaire minimum dont doit disposer le médecin du travail pour effectuer le suivi de ces salariés est de une heure par mois pour dix salariés. Cette surveillance a pour objet : - de sensibiliser le salarié au risque amiante ; - de dépister précocement une maladie professionnelle liée à l'amiante ; - d'évaluer le port des équipements de protection individuelle. De plus, la surveillance médicale des salariés exposés diffère selon les périodes. ● Avant l'exposition à l'amiante : Le médecin du travail doit établir une attestation de non contre-indication médicale aux travaux de la section II du décret n° 96-98 du 7 février 1996, avant affectation au poste exposé. Un bilan médical initial doit comporter au moins une radio pulmonaire standard de face datant de moins d'un an et des épreuves fonctionnelles respiratoires. Ce bilan sert de référence pour le suivi ultérieur du salarié. ● En cours d'exposition : Le médecin du travail doit effectuer un examen clinique au minimum annuel (destiné à dépister des douleurs thoraciques par exemple), une radiographie standard de face, tous les deux ans, et des explorations fonctionnelles (évaluation de la capacité respiratoire) au minimum à la même fréquence que les radiographies pulmonaires. Le médecin du travail peut aussi prescrire des examens complémentaires à une fréquence accrue et orienter le salarié vers un spécialiste quand il a connaissance d'un risque d'exposition, actuel ou ancien, pouvant entraîner une asbestose ou quand une symptomatologie spécifique apparaît. ● Lors du départ du salarié de l'entreprise : L'employeur doit remplir une attestation d'exposition précisant les conditions et la durée de l'exposition, ainsi que les résultats de ses examens complémentaires. Il adresse le salarié, muni de cette attestation, au médecin du travail qui la complète et fournit, après accord de celui-ci, au médecin de son choix, les éléments médicaux en sa possession. ● Après l'exposition : Les pathologies liées à l'amiante pouvant survenir tardivement après le début de l'exposition, la surveillance médicale doit être poursuivie après l'exposition. Deux situations peuvent se présenter : soit le salarié demeure en activité mais n'est plus exposé et le médecin du travail du salarié doit alors lui prescrire les mêmes examens que ceux précédemment décrits, soit il n'est plus en activité et il entre alors dans le champ du suivi post-professionnel. b) Le suivi médical post-professionnel ● La réglementation Lorsque le salarié n'est plus en activité (chômage, retraite ou cessation d'activité), l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale240, qui concerne le suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents cancérogènes, lui est applicable. Les modalités de ce dernier ont été précisées dans l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et complété par le décret n° 96-98 du 7 février 1996. Elles reposent sur un examen clinique médical effectué tous les deux ans, complété par un examen radiologique du thorax et éventuellement par une épreuve fonctionnelle respiratoire. En fait, il est vite apparu que peu de personnes bénéficiaient du suivi médical post-professionnel parce que la majorité des retraités ignore l'existence de ce suivi et n'est pas toujours consciente d'avoir été exposée professionnellement. M. Alain Bobbio de l'ANDEVA a estimé que le suivi n'était pas satisfaisant en signalant que241 « 1 700 examens ont été budgétisés en 2002 pour l'ensemble du territoire national, ce qui représente une goutte d'eau par rapport à ce qu'il faudrait faire ». C'est pourquoi plusieurs démarches de recherche active des retraités ayant été exposés à l'amiante ont récemment été expérimentées pour les informer de leur droit à un suivi médical post-professionnel et à la prise en charge de leur éventuelle pathologie. ● Les expériences pilotes Une expérience pilote242 nommée « Espaces243 » a été menée en 1998 par le département santé-travail de l'Institut de veille sanitaire (IVS) et les centres d'examen de santé des Caisses primaires d'assurance maladie de six départements (Côtes-d'Armor, Haut-Rhin, Loiret, Nord, Paris, Vienne). Cette expérimentation concernant 6 000 nouveaux retraités du régime général a permis de retracer chaque parcours professionnel - au moyen d'entretiens et de matrice emplois/exposition - afin de déterminer la probabilité d'une exposition à l'amiante. Au sein de ce groupe, le nombre de prises en charge médicale a pu être multiplié par 17 par rapport à un groupe témoin, ce qui témoigne de l'intérêt de l'opération. De plus, l'échantillon Espaces étant suffisamment proche de la population de référence, il a permis d'estimer l'exposition à l'amiante dans la population des hommes français du même âge. On a ainsi pu évaluer que 27,7 % des retraités de 1994, 1995 et 1996 avaient été exposés au moins une fois à l'amiante au cours de leur carrière professionnelle. En 2003, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a décidé la généralisation de l'enquête Espaces auprès des retraités du régime général de la sécurité sociale en lançant le projet Spirale244. Concernant, dans un premier temps, l'ensemble des nouveaux retraités masculins de 13 départements, la généralisation à l'ensemble du territoire devrait être effective en 2007 et viser désormais 250 000 nouveaux retraités chaque année. Constatant que les professions indépendantes - et en particulier les artisans - ne bénéficiaient pas du suivi post-professionnel actuel applicable aux seuls anciens salariés du régime général et que l'absence de médecine du travail pour ces catégories de travailleurs empêchait un bon suivi de leurs maladies professionnelles, la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes (CANAM) et l'IVS ont mis en place, à l'automne 2005, une surveillance médicale et épidémiologique des professions indépendantes ayant été exposées à des cancérigènes - en priorité l'amiante. Baptisé « Espri245 », ce programme reprend la méthodologie développée pour l'enquête Espaces et commence par une phase pilote dans trois régions (Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes). Elle concernera 1 200 artisans récemment retraités et aura pour objectifs, d'une part, d'identifier les artisans ayant été exposés à l'amiante au cours de leur carrière afin de les faire bénéficier d'un suivi médical et d'autre part de mieux décrire la prévalence des pathologies imputables à l'amiante au sein de cette population. Ses premiers résultats sont attendus pour le printemps 2006. Parallèlement, un dispositif expérimental de suivi post-professionnel (SPP) des salariés de l'amiante a été mis en œuvre en Aquitaine, en Normandie et en Rhône-Alpes, à la demande conjointe de la direction des relations du travail du ministère de l'emploi et de la direction des risques professionnels de la CNAMTS. Cette expérimentation poursuivait deux objectifs principaux. Il s'agissait en premier lieu d'expérimenter les moyens les plus efficaces d'informer les personnes ayant été exposées professionnellement à l'amiante de la possibilité de bénéficier d'un suivi médical spécifique gratuit. Plusieurs voies ont été explorées. En Aquitaine, les expérimentateurs ont choisi de s'appuyer sur les médecins libéraux, par le biais de leur union régionale (URLM). Cette première voie rejoint les actions menées par l'association des professions portuaires CGT du port de Dunkerque (APDACGT) qui envoie régulièrement des lettres aux médecins pour qu'ils orientent les patients vers les associations de défense de victimes246, en cas de suspicion. En Normandie, ce sont les médias locaux qui ont été sollicités et en Rhône-Alpes, des courriers ciblés ont été adressés en fonction des établissements où les salariés avaient pu être exposés à l'amiante au cours de leurs carrières professionnelles. L'expérimentation visait en second lieu à améliorer les conditions dans lesquelles se déroule le bilan médical gratuit sur la base des enseignements de la conférence de consensus du 15 janvier 1999. Selon cette conférence, l'examen « radiologique » du thorax prévu par la réglementation - qui est généralement entendu comme une simple radiographie -, et les explorations fonctionnelles respiratoires, prévues tous les deux ans, n'étaient plus adaptés à leur objet. Ils devaient être remplacés par un recours systématique au scanner thoracique, technique diagnostique de meilleure qualité scientifique que la radiographie pulmonaire simple, à condition que les conséquences sanitaires éventuelles de l'irradiation soient mieux surveillées. Les recommandations de cette conférence de consensus n'ont pas encore été intégrées dans la réglementation mais ont, d'ores et déjà, fait l'objet d'une phase expérimentale dans trois régions françaises. Les professeurs Marc Letourneux et Christophe Paris, ainsi que Mme Evelyne Schorlé ont présenté à la mission247 les premiers résultats de cette expérimentation qui a déjà fait l'objet d'un rapport remis au gouvernement le 7 septembre 2005, en attendant un bilan complet qui devrait être achevé en juin 2006. La mission a pris connaissance avec le plus grand intérêt des conclusions provisoires de cette expérimentation. Elles démontrent qu'en matière d'information sur les suivis post-professionnels, la meilleure méthode est le courrier individualisé adressé à une population ciblée, en particulier lorsqu'il s'agit de retraités présélectionnés en fonction d'une exposition estimée a priori, selon la carrière professionnelle et après un repérage effectué par les Caisses régionales d'assurance maladie (CRAM). Les conclusions prouvent également l'intérêt incontestable du scanner thoracique dans le dépistage des pathologies liées à l'exposition à l'amiante car cet outil va bien au-delà de la radiographie pulmonaire, qu'il s'agisse de diagnostiquer la présence de plaques pleurales ou une asbestose. La généralisation du scanner thoracique pour le dépistage doit cependant toujours être réalisée dans le respect d'un protocole technique destiné à éviter toute irradiation excessive. La mission a également pris acte du mauvais fonctionnement du dispositif d'entrée dans le suivi post-professionnel. L'accès est, en effet, actuellement subordonné à la fourniture d'une attestation d'exposition à l'amiante cosignée par l'employeur et par le médecin du travail. Il est fréquent que les employeurs se refusent à délivrer cette attestation, de peur notamment qu'elle puisse être utilisée dans le cadre d'un procès pénal. Un processus d'« entrée libre » dans le dispositif, indépendant de toute attestation d'exposition serait donc préférable. La sélection des salariés éligibles au SPP pourrait se faire, comme ce fut le cas lors de l'expérimentation, par des cellules d'hygiène industrielle spécialement constituées, qui s'appuieraient sur les enquêteurs des Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et sur le personnel de la prévention des risques professionnels au sein des CRAM. Enfin, il serait souhaitable que les actes médicaux réalisés dans le cadre du SPP fassent l'objet d'une « cotation traçante » au sein du système de la carte Vitale. Cela permettrait que les dépenses afférentes soient automatiquement imputées à la branche AT-MP et non à la branche maladie, comme c'est trop souvent le cas actuellement, du fait de la lourdeur actuelle des modalités de facturation du suivi pour les médecins (comptabilité séparée et paiement différé). Malgré les résultats prometteurs de cette expérimentation de suivi post-professionnel, l'utilité de tels suivis médicaux et dépistages a plusieurs fois été mise en cause devant la mission, notamment parce que l'on ne dispose pas, une fois la pathologie diagnostiquée, de traitement réellement efficace. Le professeur Got a ainsi déclaré lors de son audition du 27 septembre 2005 : « je pense que le dépistage systématique n'a aucun intérêt, aucune efficacité et même qu'il est pervers. (...) Les espoirs de guérison sont actuellement faibles. Ce n'est pas rendre service aux gens que de les exposer à l'anxiété du dépistage régulier. On compense les erreurs du passé en donnant l'impression qu'on s'intéresse aux victimes ». Mme Evelyne Schorlé a également souligné que248 « les individus sont habituellement confrontés à des traumatismes, et se construisent des défenses pour y résister » mais que « ces défenses peuvent s'effondrer lorsqu'on apprend que l'on est confronté à un risque méconnu et l'on court, alors, le risque de développer certaines maladies ». La mission ne sous-estime pas les effets pervers du suivi et l'inquiétude qu'il peut engendrer chez des personnes qui n'avaient pas le sentiment d'être en danger. Pourtant, elle n'estime pas que ce risque doive remettre en cause le principe du suivi médical. En effet, l'entrée dans le dispositif de suivi restera entièrement facultative et ne s'imposera en aucun cas aux personnes qui préfèrent ne pas subir un examen dont ils ne souhaitent pas nécessairement connaître les résultats. Et l'on peut d'ailleurs les comprendre, dans la mesure où, comme l'avait déjà fait remarquer la conférence de consensus de 1999, le bénéfice médical actuel du suivi « se pose malheureusement davantage en termes de suivi et d'accompagnement qu'en termes de guérison »249. En réalité, comme l'a souligné notamment Mme Evelyne Schorlé250, il est clair « que tout l'intérêt de ce dépistage est d'ordre médico-social : c'est l'indemnisation ». La mission recommande donc en définitive de conserver le principe du suivi médical mais en l'assortissant - pour ceux qui en ressentent le besoin - d'un accompagnement psychologique pour éviter un impact négatif sur le patient. La mission recommande également que les épouses qui le souhaitent puissent bénéficier de modalités de suivi atténuées qui pourraient prendre la forme de visites médicales gratuites. Propositions sur le suivi post-professionnel : - Envoyer des courriers à des populations ciblées - Instaurer une « entrée libre » dans le dispositif de suivi - Généraliser, dans le respect d'un protocole médical, le recours au scanner thoracique - Alléger les modalités de facturation du suivi par les médecins - Prévoir un accompagnement psychologique - Instaurer un suivi pour les épouses La mission a pris acte de la déclaration de M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités, selon laquelle ses services travaillent à la rédaction du décret d'application de la disposition législative de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2006 introduite par amendement parlementaire et qui oblige les CPAM à informer les personnes anciennement exposées de leur droit à un suivi médical. Toutefois, ce suivi médical ne se réalisera dans de bonnes conditions que si la conservation des données médicales est bien assurée. C'est pourquoi il importe que la chaîne de conservation des dossiers fonctionne correctement et garantisse une traçabilité suffisante en cas de pathologie différée. Or, comme M. Xavier Bertrand l'a rappelé251, l'« archivage continue de se heurter à certaines difficultés : les directions régionales du travail et de l'emploi n'ont pas toujours les moyens d'en assurer le suivi. L'objectif pour 2006 est de parvenir à une certitude en matière de traçabilité tout au long des quarante années suivant la cessation de l'exposition ». La mission appelle donc de ses vœux la réalisation de cet objectif indispensable au succès du suivi médical. Proposition : Assurer une traçabilité fiable des dossiers médicaux après la cessation de l'exposition Le bénéfice social des dispositifs de suivi est d'autant important qu'il permet le recours aux mécanismes de réparation. B.- LES MÉCANISMES TRADITIONNELS DE PRISE EN CHARGE DES VICTIMES ONT MONTRÉ LEURS INSUFFISANCES DANS LE CAS DE L'AMIANTE 1.- La réparation forfaitaire de droit commun des maladies professionnelles était trop faible Les premières victimes de l'amiante souffrant de pathologies contractées dans le milieu professionnel ont d'abord été indemnisées au titre de la réparation de droit commun des maladies professionnelles via les tableaux 30 et 30 bis de la sécurité sociale. Celle-ci résulte des lois du 9 avril 1898 et du 25 octobre 1919 sur les accidents du travail et maladies professionnelles qui prévoient une indemnisation forfaitaire de plein droit du préjudice patrimonial - la perte de capacité en gains. Or, comme M. Pierre Sargos, président de la chambre sociale de la Cour de Cassation, l'a indiqué252 « l'indemnité forfaitaire est beaucoup trop faible. La réparation de plein droit est satisfaisante pour les frais médicaux ou les frais de réadaptation. Mais elle est manifestement insuffisante au regard de tous les autres préjudices que peut causer un accident du travail ou une maladie professionnelle ». Pour obtenir une meilleure indemnisation des préjudices subis, les victimes ont donc tenté d'utiliser des voies de recours juridictionnels. 2.- Les recours juridictionnels vers lesquels se sont tournées les victimes les exposaient à des délais de procédure très longs Les victimes de l'amiante ont exploré plusieurs voies de recours de type juridictionnel pour compléter l'indemnisation forfaitaire de droit commun des maladies professionnelles du régime de sécurité sociale. ● Les recours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) Certaines victimes ont décidé d'intenter au civil des actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur pour obtenir une meilleure indemnisation. La reconnaissance par un TASS de la faute inexcusable de l'employeur entraîne en effet le versement d'une réparation majorée par rapport à la rente ou au capital accordés dans le cadre du régime forfaitaire de droit commun. Mais elle étend aussi la réparation à d'autres préjudices patrimoniaux - par exemple, la perte d'une chance de promotion - et l'ouvre aux préjudices extrapatrimoniaux, tels les préjudices moraux de souffrances et d'agrément, y compris, le cas échéant, pour les ayants droits. Par ailleurs, la reconnaissance de la faute inexcusable recouvre, aux yeux de nombreuses victimes, une dimension de sanction personnelle et morale à l'encontre de celui qui est à l'origine de leur maladie. C'est une dimension qui a souvent trouvé à s'exprimer au cours des auditions et qui sera développée dans la seconde partie du rapport (chapitre relatif au régime de responsabilité en matière de risques professionnels). On notera toutefois que certaines catégories de victimes de l'amiante restaient privées de la possibilité d'engager une procédure en faute inexcusable : les victimes environnementales ou domestiques, les artisans non indemnisés sur le risque « accidents du travail », les épouses de victimes de l'amiante ou les fonctionnaires et militaires auxquels le principe du forfait de pension interdisait toute autre forme d'indemnisation. Il fallait donc trouver d'autres modes d'indemnisation. ● Les recours devant les juridictions pénales Certaines victimes de l'amiante ont souhaité déposer plainte au pénal contre leur ancien employeur tout en se portant partie civile pour obtenir une indemnité réparatrice. Cet aspect sera également développé plus loin. ● Les recours devant les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) près les TGI Les avocats des victimes de l'amiante ont eu l'idée, en 1999, de saisir les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) qui sont des tribunaux placés auprès des tribunaux de grande instance (TGI), présidés par un magistrat professionnel, chargé d'indemniser les victimes d'infractions lorsque l'auteur est inconnu ou insolvable et que le dommage résulte de faits présentant les éléments matériels d'une infraction pénale. Ces actions ont débouché sur deux victoires importantes253 et, pourtant, le principe de la saisie des CIVI dans le cadre de maladies professionnelles n'était pas évident. Il posait, en outre, un problème d'équité dans la mesure où l'indemnisation des victimes s'effectue, dans ce cadre, par le truchement du FGA (fonds de garantie automobile), organisme de droit privé qui indemnise les victimes au titre de la solidarité nationale quand aucune assurance ne peut intervenir. Or, le financement du FGA provient d'un prélèvement sur les contrats d'assurance, ce qui revenait en quelque sorte à faire cotiser les victimes de l'amiante pour financer leurs propres dommages et intérêts254 ! * * * Surtout, ces trois types de recours juridictionnels présentaient l'inconvénient majeur d'exposer les victimes à des délais de procédures souvent très longs. C'est pourquoi les pouvoirs publics se sont orientés vers de nouvelles formes de prise en charge des victimes de l'amiante qui reposent sur deux piliers principaux : les dispositifs de préretraite pour les travailleurs de l'amiante - FCAATA et dispositifs spécifiques de certains régimes spéciaux de sécurité sociale - et la réparation intégrale des préjudices subis par l'ensemble des victimes de l'amiante par l'intermédiaire du FIVA. C.- LES DISPOSITIFS DE PRÉRETRAITE DESTINÉS AUX TRAVAILLEURS DE L'AMIANTE La mise en place du Fonds de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) a été la première réponse institutionnelle des pouvoirs publics à destination des victimes professionnelles de l'amiante. Par ailleurs, d'autres dispositifs spécifiques de cessation anticipée d'activité ont été mis ultérieurement en place. Le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante a été instauré par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999255 et le décret d'application n° 99-247 du 29 mars 1999 en a permis une mise en œuvre très rapide. La vocation du FCAATA est d'accorder une période de retraite plus longue à certains salariés dont l'espérance de vie est potentiellement réduite par leur exposition à l'amiante. Il est destiné à financer, pour ses bénéficiaires : - l'allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA). L'ACAATA est une préretraite destinée, sous certaines conditions256, aux personnes qui ont été exposées professionnellement à l'amiante et qui sont âgées de plus de 50 ans. Pour bénéficier de l'ACAATA, les salariés doivent démissionner de leur poste. Le versement de l'allocation s'interrompt lorsque son bénéficiaire remplit les conditions pour percevoir une retraite à taux plein. Stricto sensu, l'ACAATA ne constitue donc pas une indemnisation mais un revenu de substitution. C'est une extension particulière des mécanismes de cessation anticipée d'activité, aujourd'hui largement en voie de disparition. - les cotisations d'assurance vieillesse volontaire ; - les cotisations de retraite complémentaire. Il est fixé par l'article 2 du décret n° 99-241 du 29 mars 1999 et correspond à : - 65 % du salaire de référence dans la limite du plafond de la sécurité sociale ; - 50 % de ce salaire pour la fraction comprise entre une et deux fois ce plafond. Le salaire de référence est calculé en faisant la moyenne des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois d'activité salariée. Ces rémunérations sont prises en compte dans la limite du double du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date d'ouverture du droit à l'allocation. Le montant de l'ACAATA ne peut être inférieur au montant journalier de l'allocation chômage, ni excéder 85 % du salaire de référence. L'ACAATA n'est pas une prestation du régime général. C'est néanmoins la branche accident du travail - maladie professionnelle (AT-MP) du régime général de la sécurité sociale qui en est le principal financeur, puisque le FCAATA est abondé par une contribution de cette branche dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Le financement du FCAATA est également abondé par : - une fraction du produit des droits de consommation sur les tabacs, dont le taux est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ; - une contribution, depuis 2003, de la mutualité sociale agricole (MSA) au titre du régime AT-MP des salariés agricoles dont le montant est fixé par arrêté ; - une contribution, depuis le 5 octobre 2004, à la charge des entreprises dont les salariés ont été exposés à l'amiante, définie à l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005. Évolution des recettes du Fonds de cessation anticipée d'activité (en millions d'euros)
* 0,31% de la fraction du produit des droits de consommation sur le tabac Les modalités de fonctionnement du FCAATA, fonds sans personnalité juridique, sont fixées par le décret du 29 mars 1999 dont l'article 6 confie la gestion du fonds à la Caisse des dépôts et des consignations (CDC) tout en affectant aux caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) l'attribution et le service de l'allocation. Au terme d'une organisation que la Cour des comptes a jugé complexe257, on aboutit à une répartition des tâches entre la CDC et la branche AT-MP. L'établissement de Bordeaux de la Caisse des dépôts et consignations assure les missions suivantes : - il perçoit la rétrocession annuelle de droits sur les tabacs faite par l'Etat au FCAATA au titre de sa participation financière au fonctionnement du fonds ; - il verse les cotisations dues par les bénéficiaires de l'ACAATA aux différents régimes de retraite complémentaire (ARRCO, AGIRC, IRCANTEC) ; - il verse deux fois par an à la branche AT-MP de la CNAMTS son solde semestriel des opérations sur le FCAATA s'il est positif, ou procède le cas échéant à un appel de fonds auprès d'elle ; - il centralise les comptes de la CNAMTS, de la CCMSA258 et de la CDC, - il assure le secrétariat du conseil de surveillance dont le rôle est de veiller au respect des décisions prévues par la loi pour l'ACAATA, d'examiner les comptes au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de l'exercice concerné et de transmettre avant le 15 juillet au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel retraçant l'activité du Fonds et formulant toutes observations relatives à son fonctionnement. Contrairement au conseil d'administration du FIVA, ce conseil de surveillance, composé de représentants de l'Etat, des organisations siégeant à la commission des AT-MP, du conseil central d'administration de la MSA, ainsi que de personnes qualifiées, n'a « aucun pouvoir de décision », comme l'a rappelé sa présidente, Mme Marianne Lévy-Rosenwald259. De son côté, la branche AT- MP : - gère, via les CRAM, les dossiers d'admission et verse l'ACAATA aux bénéficiaires après en avoir retranché les cotisations sociales (CSG et CRDS) ; - verse à la CNAV les cotisations d'assurance volontaire vieillesse dues par les salariés non agricoles bénéficiaires de l'ACAATA ; - avance au FCAATA le financement nécessaire dans la limite de la contribution prévue en loi de financement de la sécurité sociale. e) L'expansion continue du FCAATA Le champ du FCAATA était à l'origine essentiellement limité aux secteurs dans lesquels les salariés avaient été massivement exposés. Comme l'a rappelé M. Michel Parigot260, président du Comité anti-amiante de Jussieu, on a d'abord pensé que le dispositif du FCAATA serait limité à l'industrie de l'amiante. Mais, le législateur a souhaité étendre le bénéfice du FCAATA à des populations de plus en plus importantes. De moins de 3 800 en 1999, on a atteint près de 27 500 bénéficiaires fin 2004. Le nombre d'allocataires présents dans le dispositif a évolué comme suit : Allocataires en cours du FCAATA
En dépit de sa décélération, le rythme de croissance du nombre d'allocataires reste donc élevé. ● Les catégories de bénéficiaires de l'ACAATA sont en augmentation croissante. Le dispositif de l'ACAATA avait été initialement conçu pour les salariés ou anciens salariés du régime général de la sécurité sociale reconnus atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante ou ayant travaillé dans certains établissements reconnus par arrêté. Il a été progressivement étendu à de nouvelles catégories de bénéficiaires (dockers professionnels, personnels portuaires de manutention, salariés agricoles atteints de maladies professionnelles liées à l'amiante). Lors de sa mise en place, le dispositif de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 concernait précisément : - les salariés ou anciens salariés du régime général reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. Mais, l'arrêté initial ne comprenait pas les plaques pleurales ; - les salariés ou anciens salariés d'établissements figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget et reconnus comme ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000261 a étendu le champ des bénéficiaires en y ajoutant : - les salariés ou anciens salariés d'établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ; - les salariés ou anciens salariés ayant exercé certains métiers (déterminés par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget) d'établissements (déterminés par le même arrêté) de la réparation et construction navale et les ouvriers dockers professionnels de certains ports (déterminés par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget). L'arrêté du 3 décembre 2001 a ouvert le bénéfice de l'ACAATA aux malades souffrant de plaques pleurales. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002262 a encore étendu le champ des bénéficiaires en y ajoutant : - les personnels portuaires assurant la manutention, - et en autorisant le cumul partiel de l'ACAATA avec une pension de réversion, un avantage d'invalidité ou un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial sous forme d'une indemnité différentielle263. Enfin, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003264 a étendu le bénéfice de l'ACAATA aux salariés ou anciens salariés du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. ● Le nombre d'établissements concernés et les périodes prises en compte ont également augmenté Le dispositif du FCAATA permet de modifier, à tout moment - par ajout, radiation, correction de raison sociale ou de période -, les listes ouvrant droit au bénéfice du FCAATA et d'inscrire de nouveaux établissements ou secteur d'activités. La liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA a ainsi connu un accroissement régulier. D'après le rapport de la Cour des comptes relatif à l'indemnisation des conséquences de l'utilisation de l'amiante de mars 2005, le nombre des établissements concernés atteint aujourd'hui le chiffre de 1442. La Cour des comptes souligne également que « les périodes d'activité ont été progressivement étendues sans qu'il soit toujours possible de distinguer les motifs ayant conduit à retenir telle période ou telle autre ». 2.- Les dispositifs spéciaux de préretraite liés à l'amiante Des dispositifs spécifiques, financés par des mécanismes distincts de l'ACAATA, ont été créés par certains régimes spéciaux pour les personnes ne pouvant pas bénéficier du FCAATA, qui est réservé aux salariés du régime général ou du régime agricole. La SNCF a ainsi instauré un dispositif spécifique de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante à la fin de l'année 2001. Les ouvriers d'Etat relevant du ministère de la défense, dès lors qu'ils sont - ou ont été - employés dans des établissements de construction et de réparation navales dépendant de la direction des constructions navales (DCN) bénéficient d'un dispositif particulier de cessation anticipée en vertu du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001. L'établissement national des invalides de la marine (ENIM) a également mis en place par le décret n° 2002-1272 du 18 octobre 2002 un dispositif spécifique de cessation anticipée d'activité au bénéfice des marins dépendant du régime d'assurance géré par l'ENIM. Enfin, l'article 96 de la loi de finances rectificative pour 2003265 disposait que « les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère de la défense pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante, peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité ». Un décret en Conseil d'Etat devait fixer les conditions d'application de ces dernières dispositions, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension. Mais ce décret d'application n'a toujours pas été publié. Proposition : Publier le décret d'application prévu par la loi de finances rectificative pour 2003 et nécessaire à l'extension du FCAATA aux fonctionnaires et agents non titulaires exerçant, ou ayant exercé, certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère de la défense. 3.- Soumis à des exigences contradictoires, les mécanismes de préretraites liés à l'amiante suscitent de nombreuses critiques qui appellent des réformes substantielles Les critiques concernent essentiellement le dispositif du FCAATA mais également les défauts de coordination et d'harmonisation entre les divers dispositifs de cessation anticipée d'activités pour les travailleurs de l'amiante. L'ensemble de ces nombreuses critiques pose indéniablement la question du recentrage du FCAATA et les réflexions sur l'aménagement des dispositifs de préretraite liés à l'amiante ont constitué sans doute un des points les plus délicats des travaux de la mission. En effet, d'un côté, et pour des raisons d'équité, il faudrait étendre le champ d'application des préretraites à des catégories de personnes actuellement injustement exclues de tout dispositif. De l'autre, l'énorme coût financier de la cessation anticipée d'activité et la volonté de centrer l'effort sur les victimes avérées justifierait, à l'inverse, un resserrement des dispositifs de préretraite. Les recommandations de la mission s'organisent autour des constats et des propositions suivants. a) Le système du FCAATA souffre d'une organisation institutionnelle complexe Le service et la gestion de l'allocation sont assurés à la fois par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et par les caisses régionales d'assurance maladie (CRAM). Initialement, l'intermédiation de la Caisse des dépôts avait été introduite afin que l'allocation anticipée d'activité ne soit pas confondue avec une prestation sociale, mais l'organisation retenue entraîne une complexité qui ne répond pas à une exigence de meilleur service pour les victimes. Mme Marianne Lévy-Rosenwald a ainsi indiqué266 à la mission qu'elle trouvait l'intermédiation de la Caisse des dépôts « parfaitement inutile (...) le service rendu par la Caisse des dépôts n'est pas en cause, mais n'apporte pas de réelle valeur ajoutée. Le législateur l'avait introduite dans le circuit pour que cette allocation ne soit pas confondue avec une prestation sociale, mais les régimes versent déjà des allocations qui ne sont pas des prestations sociales ». C'est pourquoi il est apparu à la mission que l'intermédiation de la Caisse des dépôts et consignations devait être supprimée. Proposition : Supprimer l'intermédiation de la Caisse des dépôts et consignations dans l'attribution de l'ACAATA qui pourrait être servie directement par les CRAM. b) Le montant de l'ACAATA est faible L'interdiction du cumul de l'ACAATA avec une pension de réversion, une pension d'invalidité ou un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial a été levée par l'article 54 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, qui autorise un cumul partiel sous forme de versement d'une indemnité différentielle. Il n'en demeure pas moins que son montant reste peu élevé. Mme Lévy-Rosenwald a nuancé ce propos en faisant remarquer que, selon la CNAM, les entreprises augmentent souvent le salaire de référence des bénéficiaires pendant leurs dernières années d'activité, afin de réduire la perte de revenu supportée par ceux-ci une fois qu'ils toucheront la préretraite amiante. L'ANDEVA a informé la mission que « si les dispositions relatives au montant de l'allocation issues de la circulaire DRP de la CNAMTS n° 81/2004 définissent un plancher de 1 196€ au 1er juillet 2004, de nombreux allocataires sont en dessous : c'est le cas des travailleurs ayant touché un salaire équivalent au SMIC soit 1 154,18€ qui se retrouvent avec une allocation de 981,05€. Ce sont souvent les personnes qui ont effectué les travaux les plus pénibles et les plus exposés, comme les calorifugeurs par exemple, qui ne peuvent pas opter pour l'allocation amiante car son montant ne leur permet pas de vivre décemment ». Proposition : Relever le montant de l'ACAATA pour les bas salaires. Maître Ledoux, avocat des victimes, a indiqué267 d'autre part que beaucoup de bénéficiaires de l'ACAATA, du fait qu'ils touchent un salaire réduit en attendant d'avoir l'âge de la retraite, se sont estimés victimes d'un préjudice économique et ont en conséquence réclamé une indemnisation au FIVA. Or le FIVA considère qu'un bénéficiaire de l'ACAATA a, par définition, demandé l'indemnité et qu'on ne peut pas s'imposer un préjudice à soi-même. Toutefois, la mission a été informée d'un précédent selon lequel, après négociation, le FIVA a admis qu'un malade gravement atteint et contraint, en raison de son état, de solliciter le bénéfice de l'ACAATA, était en droit d'obtenir une compensation de salaire. c) Le FCAATA a été souvent détourné de son objet et utilisé comme un instrument de gestion de l'emploi La mission a entendu à plusieurs reprises des propos elliptiques mais concordants selon lesquels le mécanisme de préretraite du FCAATA avait davantage été utilisé comme outil de reconversion industrielle destiné à accompagner des restructurations économiques que comme un dispositif de réparation. Si Mme Marianne Lévy-Rosenwald, présidente du conseil de surveillance du FCAATA, a indiqué à la mission ne pas avoir eu directement connaissance dans le cadre de ses fonctions d'utilisation du FCAATA comme d'un outil de restructuration industrielle de certains bassins d'emploi, elle a indiqué268 que « cet outil de restructuration fonctionne grâce à l'extension des listes d'établissements dont les salariés et anciens salariés sont admis au bénéfice de l'allocation. D'une part, ces listes peuvent être complétées et, d'autre part, les dates d'activité ouvrant droit à l'allocation peuvent être élargies. Le système est dans la main du ministre du travail. Par exemple, quand on veut étendre les droits des salariés des Chantiers de l'Atlantique, on étend les dates à des périodes plus larges. Pour Moulinex, il suffit de considérer que les cables amiantés des fers à repasser sont des éléments de calorifugeage ». Ce détournement a également été relevé par la Cour des Comptes dans sa communication à la commission des affaires sociales du Sénat. d) Les dispositifs de préretraite sont mal coordonnés Le Médiateur de la République a appelé l'attention de la mission sur « le défaut de coordination et d'harmonisation » entre le FCAATA et les autres dispositifs spécifiques de cessation anticipée d'activité liée à l'amiante. Il a notamment cité l'exemple particulièrement éclairant d'un ancien ouvrier de l'Etat, ayant été exposé à l'amiante au titre de cette ancienne activité et travaillant aujourd'hui dans un établissement ouvrant droit au bénéfice de l'ACATAA. Cette personne ne peut prétendre ni à l'allocation spécifique réservée aux anciens ouvriers de l'Etat - car elle n'est versée qu'à ceux qui « relèvent encore de ce régime à la date de la demande » -, ni à l'ACATAA - parce que la caisse régionale d'assurance maladie qui gère les dossiers d'admission ne prend pas en compte la période d'exposition à l'amiante liée à l'ancienne activité à la DCN et que sa seconde activité n'a pas été exercée pendant une période au cours de laquelle l'amiante était encore traité. C'est pourquoi il convient d'améliorer dans les meilleurs délais la coordination entre les différents dispositifs de cessation anticipée d'activité Aujourd'hui, toute coordination n'est certes pas exclue. Les ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense peuvent, par exemple, faire prendre en compte, pour l'attribution de l'allocation spécifique, la durée d'exercice de leur activité antérieure dans des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'ACAATA. En revanche, la réciproque n'est pas prévue pour les ouvriers de l'Etat qui exercent postérieurement une activité relevant d'un autre régime. Il conviendrait donc de permettre aux allocataires ayant travaillé dans les établissements classés au titre du régime général de tenir compte des périodes effectuées dans un des établissements - ou parties d'établissements - de construction et de réparation navale du ministère de la défense. La mission appuie en conséquence la suggestion du Médiateur de la République d'instaurer des mesures de réciprocité entre les différents régimes Proposition : Instaurer des mesures de réciprocité entre les différents régimes de façon à ce que chacun d'eux puisse opérer le cumul de toutes les périodes d'activité susceptibles d'ouvrir droit à une allocation de préretraite, sans considération du régime sous lequel ces périodes d'activité ont été exercées. e) Les dispositifs de préretraites sont particulièrement inégalitaires ● Certains régimes spéciaux ne prévoient aucun dispositif de cessation anticipée pour les personnes ayant été exposées à l'amiante C'est le cas des fonctionnaires - hormis les ouvriers d'Etat employés par le ministère de la défense -, des salariés dépendant des régimes miniers et des professions indépendantes. L'association de défense des fonctionnaires territoriaux du Languedoc Roussillon victimes de l'amiante (AFDT) a par exemple dénoncé, devant la mission269 : « la situation inique dans laquelle se trouvent les fonctionnaires face à la catastrophe de l'amiante ». Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Philippe Bas, au cours de la deuxième séance du vendredi 28 octobre 2005 consacrée à l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, a lui-même indiqué qu'« il n'est pas acceptable que les victimes de l'amiante soient traitées différemment selon qu'elles travaillent dans le secteur privé ou dans le secteur public ». La mission a considéré que le cas particulier des fonctionnaires devait être traité par un dispositif spécifique. Pour résoudre l'exclusion des fonctionnaires de tout dispositif de cessation anticipée, qu'il s'agisse de fonctionnaires de l'Etat, de fonctionnaires territoriaux ou de fonctionnaires de la fonction publique hospitalières, la mission estime en effet qu'il n'est pas opportun de prévoir leur intégration dans le dispositif du FCAATA. Pour les fonctionnaires actuellement exclus, la mission propose la création de systèmes spécifiques avec financement propre, comme cela a déjà été fait dans le cadre des régimes spéciaux d'EDF, de la SNCF ou de la marine marchande. Des mécanismes de réciprocité avec les autres dispositifs devront également mis en place. Sur ce point, la mission a été particulièrement intéressée par le protocole d'accord proposé aux fonctionnaires territoriaux de la mairie de Montpellier qui pourrait servir d'exemple. ● Les modalités d'attribution de la préretraite varient selon les dispositifs Certains régimes limitent l'entrée dans le dispositif aux travailleurs reconnus atteints d'une maladie professionnelle causée par l'amiante - la Mutualité sociale agricole, par exemple - tandis que d'autres l'étendent à ceux qui ont simplement été exposés au risque, sans pour autant avoir développé une maladie. Certains régimes retiennent toutes les périodes d'activité ayant donné lieu à une exposition, sans tenir compte du régime d'affiliation - l'établissement national des invalides de la Marine, par exemple - alors que d'autres ne retiennent que les périodes d'activité relevant de leur régime - le régime général de la sécurité sociale, par exemple. ● Les injustices entre les salariés sont nombreuses Ce point a été évoqué à de nombreuses reprises et certains ont même parlé de « distorsion flagrante du traitement social »270. En effet, certains salariés qui ont travaillé dans des entreprises traitant de l'amiante mais qui n'ont pas, eux-mêmes, été exposés peuvent bénéficier de ce dispositif, alors que d'autres qui ont travaillé dans des entreprises non inscrites sur la liste mais ont été exposés, ne bénéficient pas de la préretraite. M. François Desriaux de l'ANDEVA a indiqué271 qu'il était nécessaire de compléter la liste « qui n'intègre pas certains secteurs où de nombreuses personnes ont pourtant été exposées, je pense en particulier aux fonderies ». De plus, les salariés des grandes entreprises sont surreprésentés parmi les bénéficiaires des préretraites liées à l'amiante. Cette inégalité, renforcée par le poids des médias, a été soulignée par M. Marcel Royez, secrétaire général de la FNATH, qui distingue « les victimes individuelles, anonymes, que l'on ne connaît pas et que l'on n'informe pas et les victimes collectives »2 comme les grands bataillons de la construction navale. Un même constat avait été établi par la Cour des comptes. Enfin, les travailleurs de l'amiante qui ont exercé une partie de leur activité dans des établissements figurant sur les listes définies par arrêtés ministériels mais qui étaient, alors, employés par des entreprises sous-traitantes se heurtent au refus de prendre en compte ces périodes, du fait que l'entreprise sous-traitante n'est pas, elle-même, inscrite sur les listes. M. André Letouzé, de l'Andeva, a par exemple ainsi expliqué272 qu'« il y a des inégalités de traitement étonnantes entre deux salariés ayant travaillé au même poste de travail : celui qui appartient à l'établissement cité dans la liste peut avoir accès à l'allocation amiante, l'autre qui appartient à une entreprise sous-traitante n'a pas de droit et ne peut donc avoir accès à celle-ci ». D'après les informations communiquées par Mme Lévy-Rosenwald, le conseil de surveillance réfléchirait déjà aux moyens de faire admettre les intérimaires aux mêmes droits que les titulaires d'un contrat à durée indéterminée. Quelle que soit l'avancée de ces réflexions, la mission estime que les catégories des intérimaires ou des salariés employés en sous-traitance ne doivent pas être pénalisées. Proposition : Ouvrir le bénéfice du FCAATA, sous les mêmes conditions, aux travailleurs de l'amiante employés en intérim ou en sous-traitance dans des établissements figurant déjà sur les listes. f) Le coût global du FCAATA est exponentiel Évolution des dépenses du FCAATA de 2001 à 2005 (en millions d'euros)
Source : direction de la sécurité sociale g) La mission refuse de réserver le bénéfice de la cessation anticipée d'activité aux seules personnes malades La mission considère en premier lieu que le chiffre de 10% des bénéficiaires de l'ACAATA effectivement atteints d'une pathologie associée à l'amiante, qui figure dans le rapport précité de la Cour des comptes, doit être examiné avec prudence. En effet, ce chiffre a été établi à partir des statistiques d'entrées dans le dispositif du FCAATA - indiquant que 10 % des bénéficiaires sont entrés au titre d'une maladie liée à l'amiante - alors que 90 % y sont entrés pour avoir travaillé dans un des établissements listés mais sans que l'on sache combien, parmi eux, ont effectivement développé une pathologie par la suite. En second lieu, la mission estime que la proposition de la Cour des comptes de réserver le bénéfice de la cessation anticipée d'activité aux seules personnes malades n'a pas beaucoup de sens pour toutes les victimes de l'amiante qui souffrent d'un mésothéliome, puisque celui-ci entraîne normalement le décès à très brève échéance - dans un délai de l'ordre de dix-huit mois - et que, même si l'allocation de cessation anticipée d'activité est versée dans les meilleurs délais, la victime ne pourra pas, contrairement à la philosophie générale qui a présidé à la mise en place du FCAATA, bénéficier d'une période de retraite beaucoup plus longue. Enfin, le critère de la maladie ne semble pas non plus très adapté à d'autres maladies de l'amiante qui ne réduisent pas, à elles seules, l'espérance de vie comme c'est, par exemple, le cas pour les plaques pleurales. h) Les négociations autour de la pénibilité au travail ne sont pas le cadre approprié pour examiner la situation des personnes ayant été professionnellement exposées à l'amiante La mission ne se rallie pas non plus à la proposition de la Cour des comptes d'intégrer le traitement des personnes ayant été professionnellement exposées à l'amiante dans les négociations prévues par l'article 12 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui prévoit que dans un délai de trois ans, les partenaires sociaux négocieront un dispositif de prise en charge de la pénibilité dans les conditions de départ à la retraite. Elle estime en effet que l'exposition à l'amiante n'est pas forcément liée à la pénibilité du travail qui a donné lieu à l'exposition. La mission est également sensible à la remarque de Mme Lévy-Rosenwald selon laquelle273 « cet amalgame tendrait à nier le caractère exceptionnel de l'amiante ». i) Le système actuel des listes est une procédure lourde qui a montré ses limites Le système actuel des listes d'établissements ouvrant droit au bénéfice du FCAATA est une procédure relativement lourde. Les enquêtes destinées à l'établissement des listes sont d'abord réalisées par les directions régionales du travail274. La liste est ensuite transmise au ministère du travail. Les arrêtés d'inscription des établissements sur la liste sont alors transmis, pour consultation, à la Commission accidents du travail et maladies professionnelles de la CNAMTS (CATMP) dans laquelle siègent des représentants des partenaires sociaux. Cet avis de la CATMP n'est que consultatif. Le dispositif actuel de listes d'établissements manque également de souplesse. En effet, il ne prévoit aucune possibilité d'inscrire sur les listes uniquement une zone géographique limitée au sein d'un établissement. Il ne permet pas plus, en dehors du cas des salariés ou anciens salariés reconnus atteints d'une maladie liée à l'amiante, d'accéder à titre individuel au bénéfice FCAATA. Ces rigidités expliquent sans aucun doute le fait que les extensions des listes interviennent désormais de plus en plus rarement. Ce blocage (fort ralentissement des inscriptions nouvelles et accroissement du nombre des refus) génère automatiquement un fort sentiment d'injustice chez ceux qui se sentent exclus du dispositif mais s'explique facilement par les conséquences financières considérables attachées à son extension obligatoire à l'ensemble des salariés de l'établissement. Ces éléments ont amenés la mission à faire le constat des limites du système des listes d'établissements pris dans leur ensemble. Tout comme le professeur Marc Letourneux275, la mission est d'avis que « s'en tenir, comme c'est le cas actuellement, à une liste d'entreprises est un compromis qui n'est pas satisfaisant ». D'un côté, le dispositif est susceptible de bénéficier à des personnes pour lesquels l'exposition à l'amiante n'est pas avérée et qui ne développeront pas de pathologies. Mme Martine Aubry a toutefois fait remarquer276 que « même si quelques uns ont pu profiter de la cessation anticipée d'activité et ne déclencheront pas la maladie, ils n'en ont pas moins été victimes », puisqu'ils vivent avec la crainte perpétuelle de la maladie. D'un autre côté, et de façon encore plus contestable, ce système de listes laisse en dehors du dispositif de nombreuses personnes qui ont pourtant pu être exposées à l'amiante, en particulier certaines professions du bâtiment fortement concernées comme les tuyauteurs, les chaudronniers, les plombiers chauffagistes, les maçons fumistes, les ouvriers de l'isolation ou les électriciens. M. Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, a résumé les difficultés contradictoires du système des listes en déclarant277 « j'ai, je vous l'avoue, le sentiment d'être parfois injuste en prenant certaines décisions, lorsque je refuse par exemple l'accès au FCAATA au motif que l'entreprise ne figure pas sur la liste arrêtée par le Parlement, mais également lorsque je me vois l'accorder à des gens qui n'ont jamais été exposés ». La mission a ainsi clairement pris conscience qu'au fur et à mesure de l'extension du nombre des établissements ouvrant droit au bénéfice du FCAATA, la détermination des sites éligibles se heurtait à la difficulté croissante de trouver un critère équitable pour l'ouverture du droit à bénéficier du FCAATA. Elle estime que si l'ouverture du bénéfice du FCAATA à l'ensemble des salariés ayant travaillé dans un établissement inscrit sur une liste pouvait avoir un sens lors de la mise en place du dispositif - lorsque les établissements inscrits sur les listes étaient majoritairement ceux où l'exposition à l'amiante avait été massive -, la poursuite de l'extension de ces listes à des établissements pris dans leur globalité n'est désormais plus pertinente, dès lors que l'essentiel des établissements massivement exposés y ont déjà été intégrés au cours des années. C'est pourquoi, la mission propose qu'après un délai, qui pourrait être d'un an, il ne soit plus possible de déposer une demande d'ajout d'établissements sur les listes ouvrant droit au bénéfice du FCAATA. Elle propose également que lors de l'instruction des dernières demandes, il soit possible de faire droit à une inscription limitée seulement à une ou plusieurs parties géographiques de l'établissement. Des établissements qui se seraient déjà vus refuser en globalité leur inscription pourraient ainsi, en pratique, voir leur cas réexaminé, le cas échéant dans un sens favorable, mais pour une partie seulement du site. Passé le délai d'un an, l'instruction des dossiers continuerait mais toute nouvelle demande d'inscription de site ne serait plus possible. Afin de déconcentrer la gestion du système des listes, celle-ci pourrait être effectuée par des commissions locales dont l'échelon approprié pourrait être la région. Ces commissions devraient au minimum comporter un ingénieur de la CRAM, un médecin du travail, un inspecteur du travail et un représentant de la DRASS mais il est évident qu'elles pourraient être plus étoffées et s'entourer d'experts. Proposition : Créer, au niveau régional, des commissions chargées de recevoir, pendant un délai limité à un an, puis d'instruire les demandes d'inscription sur les listes ouvrant droit au bénéfice du FCAATA de tout ou partie d'établissement Parallèlement, la mission préconise l'ouverture d'une nouvelle voie d'accès, individualisée, au bénéfice du FCAATA. Elle s'est inspirée du système français de réparation des AT-MP qui prévoit - à côté d'un ensemble de tableaux de maladies bien définies -, un système complémentaire permettant, sur examen individuel confié à des commissions régionales, de réparer des pathologies professionnelles non répertoriées dans les tableaux. Il s'agirait ainsi de créer, parallèlement au système de listes d'établissement désormais clos, un nouveau mode d'accès individualisé au FCAATA au profit des personnes non encore malades mais qui ont été particulièrement exposées à l'amiante, bien que ne travaillant pas dans un des établissements ou dans un des secteurs figurant sur les listes. En effet, la mission considère que plus que le fait d'avoir travaillé au sein d'un établissement donné, c'est sans doute le critère de l'exposition à l'amiante qui apparaît le plus adapté. Le professeur Marc Letourneux a ainsi indiqué à la mission278 qu'« il serait légitime d'indemniser l'exposition, puisque le fait d'être porteur de plaques pleurales ne signifie pas un risque à long terme » et que l'idéal serait de pouvoir disposer d'une « cellule efficace d'authentification des niveaux d'exposition ». L'examen des demandes individuelles serait effectué par les nouvelles commissions locales préconisées pour la gestion des listes. Procéder à une telle authentification des niveaux d'exposition n'est certes pas facile, mais les moyens d'examiner pour chaque postulant individuel au FCAATA la réalité de son exposition passée à l'amiante ne sont toutefois pas inexistants. Les auditions réalisées par la mission, notamment celle de Mme Marie-Annick Billon-Galland279, chef du laboratoire d'étude des particules inhalées (LEPI) de la ville de Paris et M. Laurent Martinon, son adjoint, comme celle de Mme Annie Thébaud-Mony280, directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), coordinatrice du Réseau international Ban Asbestos et membre de Ban Asbestos France, ont montré la possibilité de retracer l'exposition individuelle à l'amiante, que ce soit aux moyens d'analyses par microscopie ou par des entretiens individuels et des matrices emplois/exposition. Proposition : Créer un mode d'accès permanent individualisé au FCAATA au profit des personnes qui ont été exposées à l'amiante à l'occasion de leurs activités professionnelles et qui sont les plus susceptibles de développer des pathologies liées à l'amiante. * * * Tous les dispositifs de préretraites liées à l'amiante visent à compenser la diminution potentielle de l'espérance de vie des personnes qui ont été professionnellement exposées à l'amiante. Toutefois, les victimes professionnelles de l'amiante souffrent également d'autres préjudices importants qui ne sont pas pris en compte par les dispositifs de préretraite et qui ne le sont qu'imparfaitement par la réparation forfaitaire offerte par la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale. Par ailleurs, les victimes de l'amiante ne sont pas toutes des victimes professionnelles. C'est pourquoi il a été jugé nécessaire de créer un fonds spécifique d'indemnisation permettant d'assurer à toutes les victimes de l'amiante une réparation intégrale de leur préjudice, dans des délais rapides. D.- L'INDEMNISATION DES VICTIMES PAR LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) 1.- Le législateur a fait le choix d'un dispositif spécifique et autonome L'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001281 a créé un établissement public administratif spécifique, le FIVA, pour gérer un dispositif d'indemnisation alternatif à la voie contentieuse visant la réparation intégrale des préjudices subis par l'ensemble des victimes de l'amiante. Trois catégories de victimes peuvent désormais obtenir, aux termes de la loi, réparation intégrale de leur préjudice : - les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ; - les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française, ce qui englobe également les étrangers ; - les ayants droits des deux premières catégories. La loi a opté pour la création d'un établissement public autonome spécifique, sous tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. D'autres solutions auraient été possibles - comme le traitement de l'ensemble de l'indemnisation par les organismes de sécurité sociale - mais M. Roger Beauvois, président du conseil d'administration du FIVA, a fait remarquer que282 « les caisses éprouveraient des difficultés majeures à abandonner le système forfaitaire actuel pour passer à la réparation intégrale ». Certains, comme le professeur Got, auraient préféré283 « un organisme unique dont la vocation aurait été, en général, de réparer les fautes commises par l'Etat » mais M. Marcel Royez, secrétaire général de la FNATH, a fait remarquer qu'« étant donné que la très grande majorité des victimes de l'amiante sont des victimes d'exposition professionnelles, il nous paraissait souhaitable de rester dans le cadre de la branche accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP) ». Il aurait aussi pu être envisagé de confier au Fonds de garantie automobile (FGA284) l'indemnisation des victimes de l'amiante. En effet, ce fonds s'était déjà vu confier la gestion de nombreux fonds spécifiques, qu'il s'agisse du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme créé par la loi du 9 septembre 1986, du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions mis en place par la loi du 6 juillet 1990 (FGTI) ou du Fonds des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (FITH) issu de la loi du 31 décembre 1991. Toutefois, cette solution n'aurait pas recueilli l'approbation des associations de victimes. En effet, antérieurement à la mise en place du FIVA, les services du FGA, agissant pour le compte du FGTI, étaient déjà, comme on l'a vu, intervenus entre 1999 et 2001 pour gérer plusieurs centaines de dossiers que les victimes de l'amiante avaient présentés aux CIVI. Or le FGA, agissant pour le compte du FGTI, s'était doublement heurté à l'opposition des associations de victimes. En premier lieu, M. Alain Bourdelat, directeur général du FGAO, a rappelé qu'étant donné les multiples possibilités d'indemnisation dont jouissaient les victimes de l'exposition à l'amiante, le fait de demander au FGA d'intervenir dans ce champ n'allait pas de soi. Le FGA avait donc cherché à connaître la position de la Cour de cassation à ce sujet et cette hésitation a pu choquer les associations285. Par ailleurs, M. Alain Bourdelat a indiqué qu'en 1999, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Cherbourg s'était montrée particulièrement bienveillante dans ses évaluations. La Cour d'appel de Caen les avaient revues à la baisse, mais les décisions de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) étant exécutoires, il avait fallu, par la suite, récupérer l'argent auprès des victimes, « ce qui est une situation terrifiante pour elles et désastreuse pour l'image du FGTI » 286. Il ne fait pas de doute que ces deux éléments ont contribué à disqualifier le FGA aux yeux des associations de victimes et M. Michel Cretin, président de la sixième chambre de la Cour des comptes, a effectivement confirmé, lors de son audition287, que « les associations étaient très hostiles à l'idée que l'indemnisation des conséquences de l'amiante soit prise en charge par un organisme auquel elles s'étaient heurtées à l'occasion de maintes procédures. C'est la principale raison qui a conduit à la création d'un fonds spécial ». M. Michel Parigot, président du Comité anti-amiante de Jussieu, a également affirmé288 que « si l'indemnisation avait été confiée au FGAO, des conflits majeurs seraient survenus ». Si le choix d'un établissement public autonome a fait l'objet de critiques relatives au caractère spécifique du dispositif, il a également été critiqué sur le choix de la nature administrative de cet établissement public. La Cour des comptes a estimé dans sa communication à la commission des affaires sociales du Sénat289 que ce « choix institutionnel s'explique mal » et que « les modalités de fonctionnement d'un établissement public administratif, relativement rigides, ne paraissent pas être le gage d'une efficacité maximale en matière d'indemnisation, alors que la souplesse et la réactivité sont des atouts ». M. Roger Beauvois, président du conseil d'administration du FIVA, a pourtant tenu à justifier auprès de la mission le choix d'un établissement autonome en déclarant que lorsqu'un phénomène est aussi important et généralisé que celui des victimes de l'amiante, l'existence d'un établissement public autonome chargé de l'indemnisation est justifiée. Il s'agissait d'une marque de reconnaissance particulière par la communauté nationale envers les victimes d'une catastrophe nationale. M. Roger Beauvois a également défendu le recours à un établissement public administratif en faisant valoir que les relations avec la branche accidents du travail - maladies professionnelles auraient été moins familières pour une structure privée. La mission remarque aussi que l'origine publique des fonds finançant le FIVA justifie également le statut d'établissement public administratif. En matière d'organisation, la mission se félicite que la mutualisation des moyens avec l'ONIAM290 se poursuive, en matière de logistique, d'informatique et de comptabilité et qu'elle ait été étendue au service de l'accueil dans les locaux partagés à Bagnolet dans la tour Gallieni II. Les personnels des deux établissements sont désormais rattachés au statut des personnels des agences de santé, ce qui relativise les critiques de la Cour des comptes291 relatives aux « perspectives de carrières qui pourront être offertes au personnel ». La mise en place du FIVA a été lente, avec une phase de transition pendant laquelle le FGA est intervenu « en qualité de prestataires de services pour le FIVA »292. Alors que le FIVA a été créé par la loi du 23 décembre 2000, les modalités d'application de la loi n'ont été définies que par décret d'octobre 2001, le conseil d'administration n'a pu se réunir pour la première fois qu'après la nomination de ses membres fin mars 2002, les formulaires d'instruction des demandes n'ont été disponibles qu'en juillet 2002, l'adoption par le conseil d'administration du barème indicatif n'a eu lieu que le 21 janvier 2003 et les premiers versements ne sont intervenus qu'en avril 2003. La mission regrette, bien entendu, la lenteur de la mise en place d'un dispositif d'indemnisation dont la réactivité doit être le premier objectif parce qu'il concerne des personnes dont l'espérance de vie peut être comptée, mais elle remarque que des provisions ont pu être versées avant même l'adoption d'un barème définitif par le FIVA. Dans une première étape, l'instruction des dossiers a été effectuée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), en application d'une convention conclue avec le FGA, pour gérer pendant un an « l'instruction des dossiers de demandes, la préparation des offres et toute autre mission notamment d'assistance juridique au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ». Cette convention organisant le partage des compétences entre le FGA et le FIVA a été signée pour un an le 7 juin 2002. L'instruction des dossiers, la préparation des décisions sur les provisions à verser et sur les offres et la préparation des règlements incombaient au Fonds de garantie. La décision sur l'offre appartenait au directeur du FIVA, le règlement des provisions et des offres à l'agent comptable du FIVA. Cette convention a fait l'objet d'un avenant permettant sa prorogation au-delà du 7 juin 2003, mais le président du conseil d'administration du FIVA a fait savoir au FGA que la collaboration cesserait et qu'aucun nouveau dossier ne devait être ouvert à partir du 1er juin 2003. Le FGA a toutefois continué de suivre les dossiers ouverts jusqu'à leur règlement définitif, le 31 décembre 2004. D'après les éléments communiqués à la mission293, le bilan de l'implication du Fonds de garantie dans l'indemnisation des victimes de l'amiante n'est pas négligeable : - 6 623 dossiers ouverts ; - 6 141 dossiers pour lesquels 10 500 offres environ ont été préparées ; - 4 308 dossiers qui ont entraîné près de 6 000 provisions sur la période de juillet 2002 à décembre 2003, représentant 47 millions d'euros réglés. La mission a pris acte de divergences d'appréciation entre le FGO et le FIVA sur le coût de gestion des dossiers traités respectivement par les deux organismes, le FIVA estimant que la gestion directe est plus efficace et moins coûteuse. D'après le FIVA, le coût de gestion par le fonds de garantie automobile était beaucoup plus élevé - de l'ordre d'environ 200 euros de plus par dossier - que le coût de fonctionnement du FIVA avec son organisation et ses propres équipes. c) Modalités de fonctionnement Elles sont décrites par le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001. Le FIVA est administré par un conseil d'administration composé de cinq représentants de l'État, de huit partenaires sociaux, représentants des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et maladies professionnelles de la CNAMTS (3 représentants des employeurs et 5 représentants des salariés), de quatre représentants des associations nationales d'aide aux victimes de l'amiante - deux de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), et deux de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante (ANDEVA) - ainsi que de quatre personnalités qualifiées, dont le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et un inspecteur général des affaires sociales. Le conseil d'administration est présidé par un magistrat, qui appartient actuellement à la Cour de cassation. Le conseil d'administration exerce des missions étendues puisqu'il a pour rôle, selon le décret du 23 octobre 2001, de « définir la politique d'indemnisation du fonds en fixant les orientations relatives aux procédures, aux conditions de reconnaissance de l'exposition à l'amiante, d'indemnisation et de versement des provisions aux victimes et aux conditions d'action en justice du fonds ». M. Roger Beauvois a déclaré devant la mission que294 « Le conseil d'administration du FIVA ne ressemble ni à celui de la plupart des autres établissements publics nationaux, ni à celui des caisses de sécurité sociale, par sa composition comme par ses prérogatives. C'est une sorte de mini-parlement, en raison de ses effectifs - vingt-deux membres - et de l'absence de majorité de gestion, l'État y détenant moins de la moitié des sièges ». Cette absence de majorité de gestion n'est pas sans poser problème, comme cela a été indiqué plusieurs fois au cours des auditions. Les débats peuvent être parfois difficiles et ce fut notamment le cas au moment de l'élaboration du barème d'indemnisation. M. Roger Beauvois, lui-même, a d'ailleurs souligné au cours de la même audition que « chacune des décisions mettant en jeu des intérêts contraires, il n'est pas facile de trouver un équilibre et nous nous sommes trouvés au bord du blocage à plusieurs reprises ». Toutefois, M. François Romaneix, ancien directeur du FIVA, a tenu à faire remarquer qu'« en dépit du fonctionnement délicat de son conseil d'administration, le FIVA est quand même parvenu à trouver des équilibres, sous le contrôle des tutelles, qui peuvent toujours rejeter une décision si elles la jugent illégale ou porteuse de risques financiers ». En fait, le refus d'approbation des délibérations du conseil d'administration par les tutelles est assez rare. On peut citer, à titre d'exemple, le refus d'approuver une délibération du 16 septembre 2003 qui permettait au FIVA d'engager des recours subrogatoires contre l'Etat employeur pour faire établir sa responsabilité dans le cadre de son pouvoir réglementaire. Il convient toutefois de souligner que les recours que le FIVA souhaitait engager sur ce fondement n'auraient de toute façon procuré aucun avantage supplémentaire aux victimes. La mission estime que la composition du conseil d'administration, et l'absence de majorité de gestion qui en découle, ne sont pas forcément un inconvénient. Comme M. Parigot l'a indiqué295 « ce n'est pas un handicap, car cela permet que toutes les questions soient effectivement débattues, chacun des acteurs essayant de convaincre les personnes qualifiées ». De même, M. Roger Beauvois a reconnu que296 « la confrontation des financeurs et des représentants des victimes aide à tendre vers un résultat acceptable par le plus grand nombre au regard de la sensibilité particulière du dossier ». Pourtant, il serait peut-être utile de donner plus de poids aux personnalités qualifiées, qui ne sont que quatre actuellement, pour faciliter la prise de décision et éviter des situations proches du blocage, lorsque le bloc de l'Etat et celui des organisations syndicales et des associations de victimes s'opposent. On rappellera que le conseil d'administration comprend cinq représentants de l'État - le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur du Trésor, le directeur général de la santé et le directeur des relations du travail. En revanche, le ministère de la justice n'est pas représenté, ce qui est regrettable étant donné, notamment, l'obligation pour le FIVA d'intenter des procédures judiciaires dans le cadre des recours subrogatoires. C'est pourquoi la mission reprend à son compte la suggestion de l'ANDEVA de remplacer le représentant du Trésor par un représentant du ministère de la justice, compte tenu des missions du Fonds. Par ailleurs, le conseil d'administration du FIVA comprend, bien entendu, des représentants d'associations de victimes qui permettent, comme l'a souligné M. Roger Beauvois, d'enrichir la réflexion en apportant beaucoup d'informations et de « vécu». Mais la mission s'est étonnée de leur faible diversification. En effet, seules l'ANDEVA et la FNATH sont représentées. Pourtant, le Président et le Rapporteur ont eu l'occasion de rencontrer d'autres associations très actives, comme l'Association des professions portuaires CGT du Port de Dunkerque, présidée par M. Marcel Suszwalak, qui compte plus de 2 382 adhérents. C'est pourquoi la mission propose de diversifier la représentation des associations de victimes au sein du conseil d'administration du FIVA en introduisant d'autres associations représentatives des victimes de l'amiante. Proposition : Remplacer, au sein du conseil d'administration du FIVA, le représentant du Trésor par un représentant du ministère de la justice, diversifier la représentation des associations de victimes de l'amiante et renforcer le poids du corps intermédiaire de personnalités qualifiées. Les ressources du FIVA proviennent essentiellement d'une dotation de la branche AT-MP dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement pour la sécurité sociale (LFSS). L'Etat contribue également - mais plus marginalement - au financement par le biais d'une dotation dont le montant est fixé par la loi de finances. La troisième source de ressources provient du montant des sommes récupérées à l'occasion des recours subrogatoires effectués par le FIVA. En effet, l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 prévoit que le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage. Dans ce but, le fonds intervient devant les juridictions civiles - y compris celles du contentieux de la sécurité sociale - notamment pour y porter les actions en faute inexcusable mais aussi devant les juridictions de jugement en matière répressive, en cas de constitution de partie civile des victimes contre le ou les responsables des préjudices. Le FIVA est subrogé dans tous les droits des victimes et, à ce titre, il est précisé qu'il intervient à titre principal et qu'il peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. L'intention du législateur était clairement de faire reposer le plus possible la charge de l'indemnisation sur les responsables quand ils peuvent être identifiés. Dans le cas des victimes d'une exposition environnementale, le recours subrogatoire peut être engagé dans les mêmes conditions contre le responsable, s'il est identifié. Bien qu'en forte croissance, ces ressources demeurent très minoritaires, à l'image de ce qu'elles sont pour des fonds tels que le FGAO297. Le FIVA n'ayant pas fait des recours subrogatoires une priorité, il n'existe pas encore de prévisions relatives aux recettes attendues pour les années à venir, comme l'indique le tableau récapitulatif des ressources. Ressources du FIVA (en millions d'euros)
Source : FIVA 2.- Le FIVA est chargé de la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes de l'amiante a) Le principe de la réparation intégrale L'objectif idéal de la réparation intégrale est de réparer l'ensemble des préjudices subis par la victime de façon à la replacer, dans toute la mesure du possible, dans la situation qui aurait été la sienne si aucun dommage ne s'était produit. Deux grandes catégories de chefs de préjudices sont habituellement distinguées : - les préjudices patrimoniaux, ou préjudices « économiques » qui peuvent être liés à une incapacité fonctionnelle - représentée par un taux d'incapacité établi en fonction d'un barème médical -, un préjudice professionnel - une perte de gains - ou un préjudice lié à diverses dépenses consécutives à la maladie et qui restent à la charge de la victime - aménagement du véhicule ou du logement par exemple ; - les préjudices extrapatrimoniaux, ou préjudices « personnels », c'est-à-dire le préjudice moral, le préjudice physique, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique. Le montant de l'indemnisation versée est calculé en fonction d'un barème qui a été adopté lors de la séance du conseil d'administration du FIVA du 21 janvier 2003 et qui a pour fonction de garantir l'équité des indemnisations versées. Conformément à la logique de la réparation intégrale qui est de prendre en compte la situation spécifique de chaque individu, ce barème n'a qu'une valeur indicative et le Conseil d'Etat a jugé298 qu'aucun recours pour excès de pouvoir n'était possible à son encontre. Le montant de l'offre d'indemnisation dépend principalement de la maladie qui affecte la victime et de sa gravité. Celle-ci est mesurée en fonction d'un barème médical d'incapacité et de l'âge de la victime lors de la constatation de la maladie. Le montant de l'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle est calculé en multipliant le taux d'incapacité - déterminé en fonction d'un barème médical - par une valeur de point - qui est progressive par rapport au taux d'incapacité. Le principe de la progressivité consiste à majorer la valeur de l'indemnisation du point d'incapacité pour les maladies graves. Ce principe correspond, pour le FIVA, au souci d'assurer une meilleure indemnisation des situations les plus graves. L'indemnisation est en règle générale versée sous forme de rente, dès que son montant annuel est supérieur à 500 euros. Sont également indemnisés les préjudices extrapatrimoniaux, qu'il s'agisse du préjudice moral - impact psychologique de la maladie -, du préjudice physique - douleur -, du préjudice d'agrément - retentissement sur la vie courante - ou du préjudice esthétique. En cas d'aggravation de la maladie de la victime, l'indemnisation peut toujours être revue à la hausse et en cas de décès, les ayants droits de la victime sont également indemnisés au titre du préjudice économique et du préjudice moral. Les indemnisations versées tant aux victimes qu'à leurs héritiers font l'objet, depuis la loi de finances pour 2005, d'une exonération fiscale. b) Les procédures d'indemnisation L'indemnisation de la victime par le FIVA résulte du cumul de deux versements : - un versement par la sécurité sociale correspondant aux frais de soins, à l'indemnisation de l'incapacité - permanente ou partielle - lorsque la maladie est reconnue d'origine professionnelle et, en cas de décès, à la rente d'ayant droit ; - un versement complémentaire par le FIVA, lorsque ce complément est nécessaire pour réparer intégralement le préjudice subi. Il convient, à cet égard, de faire une distinction entre les victimes couvertes pour le risque accidents du travail - maladies professionnelles par les différents régimes de sécurité sociale et celles qui ne le sont pas : artisans, professions libérales ou victimes de l'amiante environnemental. ● Pour les victimes couvertes par les différents régimes de sécurité sociale, l'intervention du FIVA ne se substitue pas aux prestations relatives aux maladies professionnelles mais intervient en complément de celles-ci. Si la victime a déclaré sa maladie professionnelle et obtenu la reconnaissance de celle-ci par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), le régime de sécurité sociale lui alloue directement les prestations dues au titre de la législation sur les maladies professionnelles et le FIVA n'intervient alors qu'en complément pour verser le solde destiné à aboutir à l'indemnisation intégrale. Si la victime n'a pas déclaré la maladie susceptible d'avoir une origine professionnelle, le FIVA se charge de transmettre le dossier à l'organisme concerné. Une personne à qui a été refusée la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie par la CPAM peut néanmoins déposer un dossier au FIVA. Dans ce cas « vaut justification de l'exposition à l'amiante (...) le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale ». Enfin, si la pathologie de la victime n'a pas été reconnue comme maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation de sécurité sociale ou si elle ne figure pas sur la liste mentionnée ci-dessus, l'indemnisation de la victime dépend de la décision d'une Commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante (CECEA), institué par l'article 7 du décret du 23 octobre 2001. Celle-ci se prononce sur le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante. ● Pour les victimes non couvertes par les régimes de sécurité sociale, le FIVA verse l'intégralité des sommes nécessaires à la réparation intégrale des préjudices. Dans ce cas, vaut également justification de l'exposition à l'amiante le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale ou la reconnaissance par une décision de la CECEA. Quelle que soit la situation de la victime, l'acceptation de l'offre du FIVA vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Le Conseil constitutionnel n'a validé la constitutionnalité de cette loi que par une interprétation constructive selon laquelle l'irrecevabilité de toute action juridictionnelle future ne s'étendait pas au recours pénal. La victime conserve toutefois la possibilité de contester l'offre du FIVA dans les deux mois de sa réception devant la cour d'appel de son domicile. Bien que l'article 31 du décret du 23 octobre 2001 mette à la charge du FIVA les dépenses de procédure, le taux d'acceptation des offres est très élevé (environ 95 % des offres) et témoigne de l'adhésion des demandeurs aux niveaux des indemnisations proposés, qu'ils soient accompagnés dans leur démarche par une association d'aide aux victimes (97 % d'acceptation), d'un avocat (92 % d'acceptation) ou qu'ils effectuent seuls la démarche (96 % d'acceptation). 3.- Le FIVA connaît une réussite indéniable Le taux d'acceptation des offres d'indemnisation prouve que le FIVA a désormais consolidé son activité et qu'il répond dans de bonnes conditions à sa mission d'indemnisation. a) Il indemnise de façon équitable l'ensemble des victimes de l'amiante et leurs ayants droits Depuis le 31 décembre 2004, tous les dossiers qui avaient été ouverts par le FGAO sont réglés et désormais le FGAO n'intervient plus que par la mise à disposition du FIVA du responsable qui gérait auparavant l'ensemble du pôle « indemnisation des victimes de l'amiante » du FGAO. Le critère d'indemnisation est celui de la maladie liée à l'amiante, quel que soit le statut de la victime. Comme on l'a vu, le FIVA indemnise à la fois les victimes pour qui la maladie a été contractée dans le cadre de leur profession et celles pour qui la maladie résulte d'une exposition à l'amiante en dehors du cadre professionnel - victimes dites « extra professionnelles » ou « environnementales ». De plus, grâce au barème indicatif, toutes les victimes sont indemnisées selon les mêmes critères, ce qui est un gage d'équité. La notion d'ayants droits est entendue de façon extrêmement large, puisqu'elle est étendue aux collatéraux et même aux petits enfants, selon certaines conditions. Alors que la procédure contentieuse est aléatoire et que la reconnaissance de la faute inexcusable n'est pas automatique, malgré la nouvelle jurisprudence de 2002 de la Cour de cassation, les victimes de l'amiante sont toujours certaines d'être indemnisées par le FIVA. C'est pourquoi le FIVA indemnise aujourd'hui beaucoup plus de victimes que les juridictions. En 2003, le FIVA indemnisait 84 % des victimes et il en a indemnisé 87 % en 2004. Cette même année, le FIVA a fait 8 500 offres d'indemnisation, alors que les juridictions n'ont indemnisé que 1348 victimes299. Enregistrement des dossiers (FIVA et FGA)
* Fonds de garantie des assurances Source : FIVA Enregistrement des dossiers (FIVA et FGA) 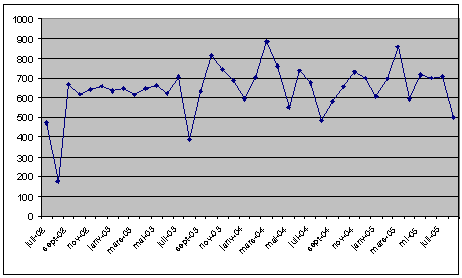 Source : FIVA 97 % des victimes indemnisées par le FIVA sont des victimes professionnelles dont plus de 80 % sont affiliées au régime général. La part des affections bénignes, déjà prépondérantes s'accroît. D'après M. Roger Beauvois, 80 % des victimes déposant un dossier devant le FIVA souffrent uniquement d'affections bénignes. ● Le problème de la Nouvelle-Calédonie M. Alain Bobbio de l'ANDEVA a évoqué le problème de la Nouvelle-Calédonie, lors de son audition du 25 octobre 2005 en rappelant que, selon le principe de spécialité législative consacré par la loi organique du 19 mars 1999, la législation métropolitaine, et notamment les textes de la sécurité sociale, ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, sauf mention expresse d'applicabilité. Or, aucune mention expresse ne figurant dans la loi du 23 décembre 2000 relative au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, il n'aurait pas, selon lui, été donné suite aux premiers dossiers déposés au FIVA pour les victimes de la Nouvelle Calédonie. Interrogé par la mission sur le cas spécifique de la Nouvelle-Calédonie, M. Eric Pardineille, directeur du FIVA, a de son côté affirmé que trois dossiers de victimes de l'amiante en Nouvelle Calédonie avaient déjà été jugés recevables mais que les victimes n'avaient pas encore été indemnisées. Il a toutefois confirmé qu'il existait bien une incertitude sur le champ d'application géographique du FIVA et indiqué qu'à la suite des demandes de précision de la mission de l'Assemblée, il avait saisi ses tutelles (directeur du budget et directeur de la sécurité sociale) par lettre en date du 3 février 2006, afin de disposer de leur analyse juridique avant d'en saisir, le cas échéant, le conseil d'administration du FIVA. L'attention de la mission ayant, par ailleurs, été appelée sur l'importance du nombre potentiel de victimes environnementales en Nouvelle-Calédonie, il lui semble nécessaire de préciser, sans attendre, le champ d'application géographique du FIVA. En conséquence, la mission préconise l'extension de l'application de l'ensemble des textes relatifs au FIVA à la Nouvelle-Calédonie. Proposition : Modifier la loi du 23 décembre 2000 relative au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante pour en prévoir expressément l'application en Nouvelle-Calédonie. b) La procédure est simple, rapide et peu coûteuse La demande d'indemnisation s'effectue par le simple dépôt d'un formulaire auquel doivent être joints les documents nécessaires de l'instruction et notamment les pièces médicales permettant d'attester la maladie. Le FIVA assure également une indemnisation rapide. En principe, il est tenu de présenter une offre dans les 6 mois qui suivent la demande. En pratique, les délais de traitement des dossiers avant la proposition d'une offre seraient de mieux en mieux respectés malgré le nombre de dossiers nouveaux qui ne cesse d'augmenter - moyenne 2004 : 677 ; moyenne prévisible 2005 :718 -, et de l'accroissement important des demandes faites pour aggravation. Le nombre de dossiers en instance a diminué pour s'établir à moins de 4500 dossiers à la fin novembre 2005 et l'amélioration des délais de traitement des dossiers a permis une forte réduction des délais de décision - 5,5 mois en moyenne - et de paiement Enfin, la procédure est peu coûteuse. Elle est suffisamment simple pour pouvoir s'effectuer sans aide particulière et 60 % des demandeurs agissent seuls, sans recours à un avocat ou à l'aide d'une association. Dans ce cas, le coût se limite aux frais d'envoi du dossier. Mais 25 % des demandeurs passent quand même par une association de victimes et 15 % par un avocat. c) Les risques de double indemnisation par le FIVA et la sécurité sociale sont aujourd'hui limités L'indemnisation de la victime étant souvent composée du cumul d'une indemnisation par la sécurité sociale et de l'indemnisation servie par le FIVA, une mauvaise articulation entre les deux systèmes pourrait aboutir à une double indemnisation. Ce dysfonctionnement a sans doute constitué un réel problème au moment du lancement du fond, mais il est maintenant en forte régression grâce aux mécanismes d'information systématique qui ont été mis en place. Pour chaque dossier, les services du FIVA envoient un courrier informant l'organisme de sécurité sociale concerné du versement des indemnités et le décret du 23 octobre 2001 fait obligation aux juridictions d'adresser copie des actes de procédure les saisissant de toute demande en réparation de préjudices résultant de l'exposition à l'amiante. Par ailleurs, des interlocuteurs ont été désignés au sein des caisses de sécurité sociale pour assurer la communication avec le FIVA. d) Les dotations ont permis jusqu'ici de faire face aux dépenses d'indemnisation Depuis sa mise en place, le FIVA a reçu des dotations importantes qui ont permis de couvrir les besoins en matière d'indemnisation des victimes et de fonctionnement du fonds. Les dotations au FIVA inscrites en loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale représentent, en cumulé, plus de 1,2 milliards d'euros. Il a même été possible, en 2004, de ne pas prévoir de dotation du budget de l'Etat. * * * Le FIVA répond donc à sa mission d'indemnisation dans des conditions qui semblent, dans l'ensemble, satisfaisantes. Il a même étendu son action en participant à l'évaluation des pathologies dues à l'amiante. En effet, la mission a été particulièrement intéressée d'apprendre que, parallèlement à sa mission d'indemnisation, le FIVA avait signé une convention avec l'IVS pour étudier la faisabilité d'une enquête épidémiologique à partir des données recueillies par le FIVA à travers ses dossiers. Elle encourage donc fortement la collaboration qui s'esquisse entre le FIVA et les services de l'IVS pour développer les enquêtes épidémiologiques. Proposition : S'appuyer sur les données épidémiologiques recueillies par le FIVA pour développer la connaissance des maladies liées à l'exposition à l'amiante. 4.- Le FIVA n'échappe pas à certaines critiques a) Le FIVA n'a pas tari les recours contentieux L'intention initiale du législateur était de limiter les procédures contentieuses directes devant les juridictions, sans pour autant faire du recours au FIVA un recours obligatoire. Mais cet objectif n'a été qu'imparfaitement atteint. Un contentieux non négligeable persiste qui tient, d'une part, au dispositif lui-même qui autorise la contestation en appel des décisions du FIVA, mais surtout aux actions portées par les victimes et leurs avocats devant les tribunaux administratifs pour responsabilité de l'Etat et devant les tribunaux civils pour faute inexcusable de l'employeur. Ces actions sont d'autant plus nombreuses qu'une évolution jurisprudentielle inattendue a rendu ces contentieux civils très attractifs, comme on le verra plus loin. ● Devant les cours d'appel La loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 créant le FIVA prévoit explicitement un droit d'action en justice contre le fonds pour la victime si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai de six mois ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. ● Devant les tribunaux administratifs La reconnaissance de la responsabilité de l'Etat par le Conseil d'Etat, dans ses arrêts du 3 mars 2004, a également ouvert une nouvelle voie contentieuse devant les tribunaux administratifs. Toutefois, les délais de la procédure administrative, comme les niveaux d'indemnisation nettement moins favorables que ceux des juridictions judiciaires, en diminuent largement l'intérêt. ● Devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale C'est surtout l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation qui est à l'origine directe de la forte croissance des recours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS). En effet, ses arrêts du 28 février 2002 permettant aux victimes d'obtenir plus facilement la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les victimes sont désormais plus nombreuses à préférer la voie contentieuse pour obtenir leur indemnisation. Le nombre des contentieux en faute inexcusable300 connaît une forte croissance : environ 300 en 2002, 900 en 2003 et plus de 1500 en 2004. Cette progression est sans doute liée aux succès des contentieux : en moyenne, seuls 2 % de jugements ne reconnaissent pas la faute inexcusable de l'employeur. Le maintien d'un important contentieux en reconnaissance de faute inexcusable peut également s'expliquer par le fait que les victimes sont très attachées à la condamnation, même symbolique, d'un responsable. Toutefois, la persistance d'un fort recours aux tribunaux s'explique principalement par le fait que les niveaux d'indemnisation restent très hétérogènes et que les victimes recherchent le meilleur niveau d'indemnisation possible. b) Les disparités d'indemnisation entre le FIVA et les tribunaux sont trop importantes Au regard de l'objectif du législateur qui était d'assurer une plus grande homogénéité de l'indemnisation des victimes de l'amiante, on constate encore de nombreuses inégalités entre les niveaux d'indemnisation. ● Entre les cours d'appel Les décisions des cours d'appel sur les indemnisations proposées par le FIVA sont encore très divergentes. Certaines victimes ont donc intérêt à contester les offres du FIVA lorsqu'elles sont situées dans le ressort d'une cour d'appel particulièrement généreuse qui accorde des indemnités supérieures à celles proposées par le FIVA. D'après le 4ème rapport d'activité du FIVA au Parlement et au Gouvernement (juin 2004/mai 2005), une légère majorité des cours d'appel - 15 - serait plutôt favorable301 au barème du FIVA : Amiens, Angers, Besançon, Bourges, Chambéry, Colmar, Dijon, Grenoble, Lyon, Montpellier, Reims, Rennes, Riom, Rouen et Toulouse. Au contraire, 9 cours d'appel seraient plutôt défavorables au barème du FIVA : Aix-en-Provence, Bastia, Bordeaux, Douai, Nancy, Orléans, Paris, Pau et Versailles. La cour d'appel de Caen est favorable au barème du FIVA sur le montant des préjudices extrapatrimoniaux mais défavorable sur l'application du principe de « progressivité ». Le principe de « progressivité » consiste à majorer la valeur de l'indemnisation du point d'incapacité pour les maladies graves ; il s'agit d'un principe de droit commun de la réparation intégrale (accidents de la route par exemple) qui correspond pour le FIVA au souci d'assurer une meilleure indemnisation des situations les plus graves. À ce principe est opposé celui de la « linéarité » de la valeur du point qui vise à ne privilégier aucune situation par rapport à une autre en dépit de la différence de gravité des maladies liées à l'amiante. Sur cette question, les cours apparaissent fortement divisées, même si une majorité est favorable au principe retenu par le FIVA : - la « progressivité » de la valeur du point a été retenue par 11 cours : Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Besançon, Bourges, Chambéry, Dijon, Grenoble, Montpellier, Rennes et Toulouse ; - la « linéarité » a été adoptée par 7 cours : Bordeaux, Caen, Douai, Nancy, Paris, Pau et Versailles ; - les autres cours d'appel ne se sont pas encore prononcées sur ce point. Par ailleurs, la Cour de cassation n'entend pas jouer un rôle de régulation. En rejetant les pourvois déposés tant par le FIVA que par les victimes, elle considère que l'appréciation du quantum d'indemnisation est une compétence souveraine du juge du fond. Ces divergences ont conduit la Cour des comptes à proposer de centraliser le contentieux d'appel des offres d'indemnisations auprès d'une Cour d'appel unique. Cette proposition se heurte néanmoins à l'objection des associations de victimes selon lesquelles cette mesure irait à l'encontre de l'objectif de proximité de la Justice avec les plaignants. Par ailleurs, M. Roger Beauvois, président du conseil d'administration du FIVA, s'est également montré plutôt réservé302 en soulignant qu'une telle centralisation poserait un problème de principe, la cour d'appel devenant d'une certaine manière « une sorte d'ordonnateur des dépenses publiques », à moins que les critères d'évaluation soient encadrés par un texte normatif. De plus, il est clair que le choix de la cour d'appel sera déterminant sur le niveau des indemnisations. En plaidant pour le choix de la 1ère chambre civile de la Cour d'appel de Paris, les associations et leurs avocats savent qu'elles font un choix très favorable aux victimes... ● Entre les tribunaux des affaires de sécurité sociale Les indemnisations proposées par les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable restent marquées par des écarts importants. Pour expliquer ces divergences, M. Roger Beauvois a fait valoir1 que « ni les tribunaux des affaires de sécurité sociale ni les chambres sociales des cours d'appel ne sont des juridictions spécialisées dans la réparation intégrale des préjudices ». Il a donc estimé que « la meilleure voie pour garantir l'homogénéisation des indemnisations semble être celle du législateur et du pouvoir réglementaire, mais les associations de victimes - sans parler des magistrats - y seraient très hostiles ». De même, la Cour des comptes a remarqué qu'« en l'absence de barème s'imposant aux tribunaux, les décisions divergent sans qu'il soit toujours possible de distinguer les raisons objectives de ces divergences » et que « les différences paraissent plus dépendantes des tribunaux que de la situation des victimes ». ● Entre le FIVA et les tribunaux Ce sont essentiellement les différences entre les indemnisations proposées par le FIVA et celles obtenues dans le cadre des indemnisations judiciaires sur le fondement de la faute inexcusable devant les TASS qui expliquent la persistance d'un nombre élevé de contentieux. M. François Martin, président de l'ALDEVA a ainsi clairement indiqué303 que « si l'indemnisation consentie par le fonds était meilleure, nous encombrerions moins les prétoires ». Il convient donc de comparer les niveaux d'indemnisations entre le FIVA et les TASS. Mais, comme le souligne la Cour des comptes304, « la réponse à cette question n'est pas simple car de multiples paramètres sont à prendre en compte, ce qui explique que tous les acteurs n'arrivent pas aux mêmes conclusions ». À partir du moment où la faute inexcusable est de plus en plus facilement reconnue par les tribunaux, il apparaît nécessaire d'en tenir compte dans la comparaison des niveaux d'indemnisation entre le FIVA et les TASS. En toute logique - et si l'on fait abstraction des différences d'appréciation entre les tribunaux et le FIVA sur l'évaluation du montant de chacun des préjudices en cause -, le doublement de la rente dans le cas de la reconnaissance de la faute inexcusable ne devrait pas aboutir à un niveau de réparation supérieur à celui issu de l'application du principe de la réparation intégrale. En effet, la liste des préjudices indemnisables dans le cadre de la faute inexcusable de l'employeur - souffrances physiques et morales, préjudices esthétiques et d'agrément, perte ou limitation des possibilités de promotion professionnelle -, est limitative. Elle ne couvre pas, malgré l'interprétation extensive qu'en fait la jurisprudence, l'ensemble des préjudices indemnisables en droit commun de la réparation, qu'il s'agisse par exemple, comme le rappelle la Cour des comptes2 : « du préjudice professionnel au-delà de la seule diminution des possibilités de promotion personnelle, des frais d'aménagement du local d'habitation ou du véhicule, de l'assistance par une tierce personne, du préjudice par ricochet concernant des personnes qui ne sont pas des ayants droit au sens du code de la sécurité sociale mais qui le seraient au sens du droit commun ». Pourtant, la comparaison entre les niveaux d'indemnisations du FIVA et des TASS fait apparaître des situations dans lesquelles l'indemnisation par les TASS est supérieure à celle obtenue auprès du FIVA. Le premier cas concerne les plaques pleurales avec une incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %. Dans ce cas, la comparaison est facilitée par le fait que le montant versé par le TASS au titre de la majoration s'effectue en capital et non en rente. L'indemnisation du FIVA est, alors, moins favorable que celle obtenue devant les TASS et cet écart non négligeable (de 40 % environ) s'expliquerait, en partie, par la possibilité d'obtenir ultérieurement devant le FIVA une indemnisation complémentaire en cas d'aggravation, ce qui n'est pas possible devant les tribunaux. Comme l'indique le FIVA305 « Les juridictions de sécurité sociale sont tenues dans un cadre juridique beaucoup plus strict que le FIVA dans leur approche indemnitaire. En effet, alors que les textes ayant créé le Fonds ont explicitement prévu la possibilité pour une victime présentant une aggravation de ses préjudices, de présenter un nouveau dossier (art. 53-IV de la loi du 23 décembre 2000), le juge ayant à apprécier les conséquences indemnitaires découlant de la caractérisation d'une faute inexcusable de l'employeur a parfois tendance à anticiper ce qu'on pourrait appeler une « aggravation statistique » des préjudices des victimes de l'amiante ». Pour les IPP supérieures à 9 %, les comparaisons sont beaucoup plus délicates. Mais on trouve une deuxième possibilité de majoration de la rente accordée en cas de reconnaissance de la faute inexcusable lorsqu'une victime dont l'IPP est supérieure à 9 % décède. Dans ce cas, le conjoint survivant bénéficie normalement d'une rente égale à 40 % du salaire de la victime si ce conjoint a moins de 50 ans et de 60 % au-delà de cet âge. Mais la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur permet de porter la rente à 100 % du salaire de la victime. Comme le soulignent la Cour des comptes et le FIVA, il s'agit alors « d'une disposition plus favorable que la réparation intégrale qui n'indemnise que le seul préjudice économique du conjoint survivant (en réparation intégrale, l'indemnisation vise à ce que le revenu après décès soit au moins égal au revenu avant décès moins la part de consommation de la victime décédée) ». On peut alors parler en quelque sorte d'une réparation « super intégrale ». L'indemnisation issue de la majoration de rente étant supérieure à la réparation intégrale, il est dans l'intérêt des victimes que la faute inexcusable soit recherchée et reconnue dans ce cas. C'est pourquoi un amendement parlementaire a introduit dans la loi306 l'obligation pour le FIVA d'agir en justice dans le cadre d'un recours subrogatoire pour rechercher la faute inexcusable de l'employeur dans tous les cas où l'indemnisation par le FIVA, selon le principe de la réparation intégrale, est moins favorable que celle que la victime aurait obtenue si elle avait acquis la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur directement devant un TASS. Dans ce cadre, le recours subrogatoire du FIVA perd son caractère classique de récupération auprès de l'employeur responsable pour acquérir une dimension de complément indemnitaire. Pour les victimes, c'est une garantie que l'indemnisation du FIVA apportera une indemnisation au moins égale à celle résultant de la procédure en faute inexcusable. Ce dispositif légal devrait logiquement limiter les recours juridictionnels directs devant les TASS. Il oblige toutefois le FIVA à multiplier les recours subrogatoires nécessaires au bénéfice des victimes, y compris dans des situations où le recours subrogatoire ne présente pas d'intérêt pour les finances publiques, par exemple quand le responsable de l'exposition à l'amiante ne peut pas être mis en cause directement (cf. ci-dessous). Il trouve surtout ses limites dans le fait que le FIVA n'est pas aujourd'hui en mesure d'exercer l'ensemble des recours au bénéfice des victimes. Comme M. Roger Beauvois l'a déclaré à la mission307 « le maintien du système actuel réserverait (...) à un nombre limité de victimes le bénéfice d'un complément d'indemnisation au titre de la faute inexcusable ». Dans ces conditions, les victimes conservent un intérêt à saisir les juridictions. Pour remédier à cet inconvénient qui engendre un surcroît de recours contentieux, il faudrait bien sûr augmenter les moyens matériels et humains du FIVA pour exercer les recours subrogatoires dans l'intérêt des victimes. Mais serait-ce suffisant ? La mission estime encore plus efficace d'introduire, comme le préconise la Cour des comptes, une présomption de faute inexcusable qui libère le FIVA de l'obligation d'intenter une action judiciaire dans le seul intérêt de la victime. Mais, alors que la Cour des comptes en fait une règle générale, la mission estime qu'il faut limiter la présomption aux seuls cas où la reconnaissance de la faute inexcusable représente un avantage supérieur à la réparation intégrale du préjudice servie par le FIVA. En effet, la mission estime que la recommandation d'ordre général préconisée par la Cour des comptes308 d'aligner les offres du FIVA sur le niveau atteint en cas de faute inexcusable (complément indemnitaire automatique), justifié par le fait que la faute inexcusable est quasiment devenue la norme devant les tribunaux, n'a guère de sens étant donné l'hétérogénéité des indemnisations accordées par les TASS dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable. On ne voit pas en effet sur quelle base le FIVA pourrait s'aligner sur la jurisprudence extrêmement hétérogène des TASS. De plus, même à imaginer que le FIVA s'aligne sur les plus hautes indemnisations servies par les TASS, rien n'empêcherait qu'un effet de concurrence entre le FIVA et les juridictions continue de jouer. La solution parfois proposée de mieux informer les TASS sur le barème d'indemnisation du FIVA pour harmoniser les indemnisations accordées par la justice ne répondrait vraisemblablement qu'imparfaitement à l'objectif d'harmonisation, non seulement parce que FIVA s'est déjà chargé - sans grand résultat - de diffuser ses rapports d'activité dans toutes les juridictions mais principalement et, comme le souligne M. Roger Beauvois, parce que « certains magistrats refusent de valider cette référence ». Dans l'optique de limiter les recours contentieux devant les TASS pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, la mission propose donc de compléter la présomption limitée de faute inexcusable par une amélioration du barème du FIVA. Proposition : - Supprimer pour le FIVA l'obligation de recours contentieux lorsqu'il y a lieu de verser aux victimes un complément à la réparation intégrale. - Compléter cette mesure par une amélioration du barème du FIVA. La mission tient enfin à souligner que les comparaisons entre les niveaux d'indemnisations du FIVA et des TASS doivent intégrer des facteurs annexes au seul niveau des indemnisations. En effet, il ne faut pas oublier les avantages considérables du recours au FIVA en termes de simplicité, de rapidité et de faible coût de procédure, même si M. François Martin de l'ALDEVA indique que309 « les honoraires des avocats ne peuvent dépasser 10 %. Et même en ce cas, la réparation obtenue du tribunal, déduction faite de ces honoraires, demeure supérieure à l'indemnisation accordée par le FIVA ». c) Le FIVA ne remplit pas ses obligations concernant les recours subrogatoires L'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 confie au FIVA l'obligation d'exercer une action subrogatoire qui doit s'effectuer « dès l'acceptation de l'offre par le demandeur ». Pourtant, le nombre de recours subrogatoires demeure très faible. Et l'on peut d'autant plus le regretter que, comme l'a souligné M. Michel Parigot310, « deux actions subrogatoires permettraient le versement d'une somme correspondant au salaire annuel d'un juriste ». Cette situation s'explique largement par l'insuffisance des moyens humains du service juridique limités à cinq juristes et un responsable, et c'est pourquoi la mission préconise un renforcement des effectifs du service juridique du FIVA. Proposition : Augmenter le nombre des juristes du FIVA pour lui permettre d'intenter le plus grand nombre de recours subrogatoires, dont l'objet est de faire reposer le plus possible la charge de l'indemnisation sur les responsables quand ils peuvent être identifiés. Il convient de faire une distinction entre deux types de recours subrogatoires : ● Ceux qui ne présentent pas d'intérêt pour les finances publiques Il s'agit en premier lieu des recours contre les employeurs publics ou les recours qui pourraient être envisagés contre l'Etat sur le fondement de sa responsabilité de puissance publique. Il s'agit en second lieu de ceux qui opposent le FIVA à la branche AT-MP, son principal financeur. En effet, en raison des mécanismes de mutualisation du système d'indemnisation des AT-MP, beaucoup des recours envisageables n'emportent aucune conséquence financière pour les responsables. La disparition de l'employeur ou son insolvabilité supprime, de fait, toute possibilité de rechercher la condamnation pour faute inexcusable de l'employeur. Par ailleurs, l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999311 lève les règles de la prescription de droit commun en permettant d'engager un recours pour faute inexcusable dès lors qu'une première constatation médicale a eu lieu entre le 1er janvier 1947 et le 29 décembre 1998. Pour éviter que les entreprises ne soient trop affectées dans leur activité par l'afflux massif de recours fondés sur ces dispositions, la loi prévoit que les dépenses afférentes aux condamnations sont, alors, supportées par la branche AT-MP, sauf pour les employeurs rattachés à un système spécial de sécurité sociale. Le dernier cas où un recours en faute inexcusable n'emporte aucune conséquence financière pour les responsables est celui où la caisse n'a pas conduit l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dans le respect des règles de la procédure contradictoire vis-à-vis de l'employeur312. Quand ces règles ne sont pas respectées, la victime, et donc le FIVA qui est subrogé dans ses droits, sont privés de la possibilité de rechercher la faute inexcusable et l'employeur peut donc échapper à la condamnation. Dans tous ces cas, les recours subrogatoires du FIVA sont en fait dirigés contre les seules CPAM financées par le compte spécial de la branche AT-MP qui finance, lui-même, le FIVA. ● Ceux qui sont dans l'intérêt du demandeur (complément indemnitaire) Comme on l'a déjà vu, le FIVA peut accorder un complément d'indemnisation lorsque la faute inexcusable est reconnue à l'issue d'un contentieux subrogatoire. Le nombre de dossiers pour lesquels il faudrait engager un recours subrogatoire dans l'intérêt des victimes est considérable - de l'ordre de 2500 en flux annuel313 - et sans commune mesure avec les moyens du FIVA pour engager ces recours. Lorsque les mécanismes de mutualisation du système d'assurance des maladies professionnelles et des accidents du travail font que le recours subrogatoire ne peut aboutir qu'à une condamnation morale sans conséquence financière pour le responsable, le recours subrogatoire n'a plus comme enjeu que l'attribution d'un complément d'indemnisation. Les conséquences négatives d'une telle situation ont bien été mises en lumière par M. Roger Beauvois314 : « le FIVA est contraint d'engager des recours sans autre issue possible que le versement d'un complément d'indemnisation ; des frais de procédures pèsent sur le Fonds ainsi que sur les caisses de sécurité sociale, et les juridictions sont inutilement mobilisées ». De plus, le FIVA n'a « pas les moyens de mener à bien l'ensemble des recours nécessaires, le nombre de dossiers avoisinant les 2 500 par an ». M. Roger Beauvois a informé la mission que le conseil d'administration du FIVA, dans une délibération du 16 septembre 2003, a déjà décidé que le FIVA n'engagerait pas d'action subrogatoire dans tous les cas où le recours ne présente assez d'intérêt ni pour la victime, ni vis à vis du responsable en raison de l'imputabilité au compte spécial du coût de la maladie. La mission estime donc nécessaire de mettre le droit en conformité avec les pratiques du FIVA. Proposition : Simplifier les procédures relatives aux recours subrogatoires du FIVA en supprimant l'obligation légale d'intenter des recours subrogatoires dans tous les cas, pour la limiter aux cas où le recours présente un intérêt pour la victime ou pour les finances publiques. d) Les dépenses du FIVA croissent à un rythme rapide et les réserves seront bientôt épuisées Évolution des dépenses d'indemnisation 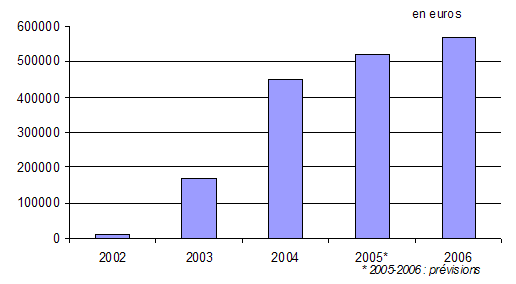 Source : FIVA Fin 2006, les réserves seront pratiquement épuisée et ne couvriront plus qu'un mois d'activité Le FIVA et le FCAATA posent donc un problème de financement et d'équité, vis-à-vis des victimes d'autres risques professionnels et, plus globalement, ces dispositifs spécifiques soulèvent la question de l'avenir de la réparation des AT/MP. Éléments de comparaison avec les dispositifs étrangers La mission d'information a souhaité savoir si d'autres pays en Europe ont, comme la France, choisi d'extraire les pathologies liées à l'amiante du droit commun de la prise en charge des maladies professionnelles en créant des dispositifs semblables au FIVA ou au FCAATA. Les données fournies par nos missions économiques dans dix-huit Etats européens membres de l'Union européenne montrent que la mise en place de dispositifs spécifiques est plutôt rare. Aux Pays-Bas, par exemple, le Gouvernement a été à l'origine de la création, en 2000, de l'Institut pour les victimes de l'amiante (« Instituut Asbestslachtoffers - IAS ») dont une des missions est de servir de médiateur entre les victimes et leurs employeurs. Outre cette médiation, l'IAS est également chargé de conseiller la Banque de sécurité sociale (« Sociale Verzekeringsbank - SVB ») pour le versement d'indemnités aux victimes qui ne sont plus en mesure de recevoir une indemnisation de la part de leur ancien employeur. Depuis 2003 est également offerte la possibilité d'une indemnisation anticipée (« voorschotregeling »). Sous certaines conditions, les victimes peuvent bénéficier de deux types d'indemnisation : une avance à hauteur de 16.376 € et une prestation unique du même montant destinée aux proches parents de la victime décédée. En Italie, la loi de 1992 interdisant l'utilisation de toutes les formes d'amiante a aussi prévu la possibilité de départs en préretraite pour les personnes exposées à l'amiante. Désormais, les bénéficiaires en sont les travailleurs ayant subi une exposition pendant au moins dix ans et supérieure à 100 fibres/litre. A cette fin, des certificats sont délivrés par l'INAIL (« Istituto Nazionele per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ») et c'est ce même organisme qui assure le contrôle des lieux de travail et relève la présence et la concentration d'amiante. En octobre 2004, l'INAIL recensait 254.703 demandes de certificats d'exposition. En Autriche, la loi reconnaît aux personnes ayant été exposées à l'amiante le droit de percevoir des pensions de retraite complémentaires au régime de droit commun. Le cas de la Slovénie s'apparente à celui de notre pays puisque cet Etat permet aux personnes ayant travaillé dans l'industrie de l'amiante et ayant été exposées à ce produit de bénéficier de retraites anticipées et d'indemnités spécifiques. Au-delà de ces quelques exemples, il semble que la plupart de nos voisins européens n'aient pas voulu traiter spécifiquement la prise en charge des maladies liées à l'amiante. Cependant, des réflexions ont actuellement lieu, dans certains pays, pour quitter la voie du droit commun. C'est le cas, en particulier, en Belgique, où plusieurs parlementaires fédéraux ont pris des initiatives tendant à la création d'un Fonds d'indemnisation comparable au FIVA. Au cours de son déplacement à Bruxelles les 1er et 2 décembre dernier, une délégation de la mission d'information a eu l'occasion de rencontrer deux d'entre eux, Mme Muriel Gerkens, Députée et M. Alain Destexhe, Sénateur, et de débattre des avantages et des inconvénients d'un tel mécanisme. DEUXIÈME PARTIE - LES LEÇONS À TIRER DE L'AMIANTE L'usage intensif de l'amiante pendant des décennies lègue aujourd'hui à la collectivité nationale un héritage lourd à gérer. Il y a - on l'a vu - encore beaucoup à faire pour que les victimes de cette fibre soient correctement prises en charge et pour que l'amiante présent dans notre environnement n'occasionne pas de nouvelles maladies. Mais au-delà de ces préoccupations, la mission de l'Assemblée nationale a eu le souci constant de tirer de l'affaire de l'amiante toutes les leçons permettant d'éviter qu'un drame comparable ne se reproduise. C'est une nécessité au regard des conséquences humaines et financières désastreuses. C'est aussi un devoir moral à l'égard des victimes. L'affaire de l'amiante est un catalyseur de changements. Sous sa pression, des mutations jusqu'alors en gestation ont été accomplies dans un laps de temps très court : remise en cause de la réparation des AT-MP, mise en cause de la responsabilité de l'Etat dans les échecs de la prévention, revirement de jurisprudence sur la faute inexcusable de l'employeur. À cet égard, l'amiante peut être regardé comme le pendant, en matière de risques professionnels, des grandes crises sanitaires qui ont secoué la France depuis la fin des années 80 : sang contaminé, hormone de croissance, « vache folle », etc. Le champ du travail, jusqu'ici écarté des préoccupations de santé publique, a été comme rattrapé par l'affaire de l'amiante. Celle-ci a été le révélateur des lacunes flagrantes qui persistaient dans ce domaine (pas de veille sanitaire, pas d'épidémiologie, pas d'expertise indépendante...). Face à une société toujours plus soucieuse de la protection des personnes, et qui s'interroge sur les risques auxquels elle est soumise, le dispositif actuel de prise en charge sanitaire des dangers nés des mutations industrielles ne devrait pas résister à l'ampleur de l'affaire de l'amiante. En fait, c'est l'ensemble du rapport au travail qui est actuellement en mutation dans nos sociétés. La vision traditionnelle du « dur labeur » a cédé la place à la recherche de l'ergonomie. La construction de l'identité de l'homme autour des conditions de son travail est remplacée peu à peu par la théorie du « capital humain », que les conditions de travail doivent préserver. Cette évolution affecte logiquement le regard porté sur les risques professionnels. Entièrement tournés, pendant des décennies, vers des préoccupations d'emploi, parfois au détriment de la santé des travailleurs, comme en témoignent non seulement les victimes de l'amiante mais également celles de tant d'autres maladies telles que la silicose et l'anthracose, les partenaires sociaux n'ignorent plus aujourd'hui l'importance de la santé au travail. Comment la société française du XXIème siècle peut-elle encore comprendre qu'un même préjudice corporel, entièrement indemnisé, sans même de coupable, s'il résulte d'un accident de la route, soit deux fois moins indemnisé quand il est provoqué par le travail ? Comment justifier aujourd'hui qu'un système de prévention s'attache d'abord à réparer des dommages plutôt qu'à les éviter ? Autant de décalages que l'affaire de l'amiante a révélés, qu'elle a déjà parfois contribué à combler et dont la mission a cherché à tirer les leçons : - en préconisant une évolution du système de réparation des AT-MP, - en étudiant le régime de la responsabilité dans le domaine de la santé au travail, - et en proposant un renforcement de la prévention des risques professionnels. I.- LE SYSTÈME DE RÉPARATION DES AT-MP N'EST PLUS ADAPTÉ L'amiante est un révélateur de la nécessité de faire évoluer la branche accidents du travail - maladies professionnelles (AT-MP). Il est en effet vite apparu à la mission que le système qui s'est mis en place pour prendre en charge les victimes de l'amiante, tant sur le plan légal - création du FCAATA et surtout du FIVA - que jurisprudentiel - évolution des critères de la faute inexcusable -, aura des conséquences déterminantes sur l'avenir de la branche accidents du travail - maladies professionnelles (AT-MP). C'est un constat unanime des débats qui se sont déroulés au sein de la mission, notamment à l'occasion de la table ronde qu'elle a organisée le 23 novembre 2005. M. Pierre Sargos, président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, a parfaitement résumé les enjeux en estimant que le drame de l'amiante « introduit dans le système de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles un effet de masse extraordinaire, sur le plan quantitatif comme sur le plan qualitatif». En effet, l'amiante a : - mis en évidence la tendance générale à l'augmentation des maladies professionnelles ; - affecté l'équilibre financier de la branche AT-MP qui est en déficit depuis 2002 ; - entraîné, dans le souci d'assurer une meilleure indemnisation des victimes professionnelles, une remise en cause jurisprudentielle de l'immunité civile de l'employeur par la redéfinition de la faute inexcusable ; - renforcé la contestation des modalités de réparation forfaitaire des AT-MP, car les victimes de l'amiante sont les seules victimes professionnelles à bénéficier, grâce au FIVA, d'une réparation intégrale ; - fait enfin apparaître que le système de la branche AT-MP était excessivement mutualisé. De nombreux rapports administratifs ont déjà abordé les grandes problématiques de la révision des modalités de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et préconisé des améliorations du dispositif en vigueur. Parmi lesquels : - le rapport de MM. Dorion et Lenoir315, membres de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) en 1991, qui a conduit à la possibilité de reconnaître les maladies professionnelles, même en l'absence d'inscription sur un tableau ; - le rapport du professeur Masse316, président de la commission spécialisée en matière de maladies professionnelles du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, en 2001, qui s'est explicitement prononcé en faveur d'une réparation intégrale des accidents du travail et maladies professionnelles ; - le rapport de Michel Yahiel317, inspecteur général des affaires sociales, de 2002, qui s'est montré plus nuancé sur le passage à la réparation intégrale des AT-MP ; - le rapport de Michel Laroque318, inspecteur général des affaires sociales, en 2004, tout aussi nuancé, qui envisage trois principaux scenarii de réforme dont un « vise à assurer l'indemnisation qui, en droit commun dans le cas de la faute d'un employeur, pourrait être obtenue devant un juge et couvrirait tous les préjudices, y compris le pretium doloris ». De plus, aux termes de l'article 54 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, les partenaires sociaux sont invités « dans un délai d'un an après la publication de la présente loi, à soumettre au Gouvernement et au Parlement des propositions de réforme de la gouvernance de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que, le cas échéant, d'évolution des conditions de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ». La mission n'entend donc nullement se substituer aux partenaires sociaux. Mais, dans un contexte de réflexion sur l'avenir du régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, elle ne pouvait se désintéresser de ce débat et elle a souhaité réfléchir aux conséquences à tirer, dans ce domaine, du dispositif spécifique de réparation mis en place pour les victimes de l'amiante. Les développements qui suivent font état des pistes de réflexion et des points d'accord sur les modalités d'une amélioration de la réparation des AT-MP tels qu'ils se sont dégagés des nombreuses auditions auxquelles la mission a procédé. Celle-ci entend ainsi apporter sa contribution aux négociations qui viennent de s'ouvrir. Il convient de resituer l'indemnisation des victimes de l'amiante dans la problématique d'ensemble des modalités de réparation des accidents du travail et, surtout, des maladies professionnelles. Cet exercice est particulièrement difficile car le souci d'améliorer et de moderniser le dispositif AT-MP se heurte inexorablement au problème du financement. A.- L'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE AFFECTE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA BRANCHE AT-MP Quel que soit le bien-fondé de leur mise en place, les mécanismes légaux d'indemnisation des victimes de l'amiante, qu'il s'agisse du FCAATA ou du FIVA, risquent indéniablement de compromettre, à terme, l'équilibre financier de la branche AT-MP. Comme M. Marcel Royez, secrétaire général de la FNATH, l'a reconnu, lors de son audition du 25 octobre 2005, « l'indemnisation des victimes de l'amiante pèse très lourdement sur la branche AT-MP ce qui obère ses perspectives d'évolution ». 1.- La contamination par l'amiante s'inscrit dans un contexte général d'augmentation du nombre des maladies professionnelles Les risques relatifs d'un côté aux accidents du travail et de l'autre aux maladies professionnelles évoluent de façon de plus en plus divergente. Comme l'a souligné M. Franck Gambelli, président de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) lors de son audition du 15 novembre 2005, l'attention de la branche AT-MP a longtemps été concentrée sur « le risque dur », qui était une réalité forte de l'économie industrielle de la fin du XIXème siècle et qui a conduit à une action efficace afin de faire diminuer le nombre des accidents du travail, tandis que « le risque diffus », qui se manifeste par excellence au travers des maladies professionnelles, est longtemps passé au second plan. La mission a effectivement constaté à de nombreuses occasions que la distinction entre les accidents du travail et les maladies professionnelles était de plus en plus nette. Contrairement aux accidents du travail, qui sont facilement identifiables et dont le nombre est aujourd'hui en régression, la notion de maladie professionnelle, qui s'étend désormais aux affections psychologiques, autrefois non prises en compte, possède un dynamisme et un potentiel de développement très important, que confirme l'analyse statistique des deux phénomènes. a) Le nombre d'accidents du travail diminue globalement Sous l'effet d'importantes évolutions structurelles de la population active, qui comporte notamment de moins en moins de salariés et de personnes travaillant dans les industries lourdes ou l'agriculture, le nombre d'accidents du travail déclarés et reconnus a fortement décru au cours des trente dernières années. Il a diminué de plus d'un tiers entre 1970 et 2000 et la baisse du nombre d'accidents du travail survenus en 2000 s'est constamment confirmée de 2001 à 2005. b) Le nombre des maladies professionnelles reconnues augmente rapidement Une maladie est dite professionnelle lorsqu'elle est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque physique, chimique, biologique ou si elle résulte des conditions dans lesquelles il exerce d'une façon habituelle son activité professionnelle. Le nombre de maladies reconnues et indemnisées à ce titre augmente régulièrement (34 642 en 2003 - dont 15 713 ont entraîné une incapacité permanente et 485 le décès - contre 31 461 en 2002). La hausse est due en grande partie à une meilleure reconnaissance des droits du salarié qui s'est traduite par l'inscription de nouvelles pathologies au tableau des maladies professionnelles et par une plus grande sensibilisation du corps médical à l'origine, éventuellement professionnelle, de certaines pathologies. Ainsi, les affections péri-articulaires causées par certains gestes et postures de travail (23 672 en 2003 contre 13 104 en 2000) et celles provoquées par les poussières d'amiante (4 366 en 2003 contre 2 564 en 2000) constituent désormais les deux premières causes de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans cette croissance globale des maladies professionnelles, celles qui sont dues à l'amiante représentent une part non négligeable, évaluée à environ 14 %, de toutes les maladies professionnelles, en deuxième place, juste après les troubles musculo-squelettiques (TMS). Face à ce constat, M. Franck Gambelli a fait valoir qu'« il est clair que l'explosion des tableaux va conduire à une évolution telle que la branche AT-MP ne pourra rester ce qu'elle est aujourd'hui ». 2.- Les fonds destinés à la prise en charge des victimes de l'amiante contribuent pour une part importante au déficit de la branche. Equilibrée jusqu'en 2001, la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) dégage depuis 2002 un résultat déficitaire. Évolution du résultat net de la cnamts / at-mp depuis 1995 (en millions d'euros)
Le Rapport du Gouvernement au Parlement présentant l'impact financier de l'indemnisation des victimes de l'amiante pour l'année en cours et pour les vingt années suivantes (2003) a mis en évidence une explosion des coûts de la prise en charge des victimes. Les allocations servies par le FCAATA et le FIVA n'entrent pas dans le champ des prestations du régime général mais la branche AT-MP en est le principal financeur et elles pèsent ainsi de plus en plus lourdement sur l'équilibre de celle-ci. Comme l'indique le tableau ci-dessous, le poids du financement des deux fonds connaît une tendance persistante à la hausse, qui confirme les prévisions du rapport du Gouvernement de 2003 selon lesquelles les besoins de financement devraient continuer de croître au cours des prochaines années.
Les dotations de la branche AT-MP au FIVA et au FCAATA sont ainsi passées de 103 millions d'euros en 2000 à 600 millions d'euros en 2004, 800 millions d'euros en 2005 et 1015 millions d'euros en 2006. Le poids du financement de ces deux fonds pèse globalement sur la branche AT-MP qui supporte environ 90 % des dépenses. Les financements que la branche AT-MP a consacrés au FCAATA sont depuis 2002, année d'apparition du déficit, en cumulé, supérieurs au déficit de la branche. 3.- La charge assurée par la branche AT-MP doit être révisée a) Une partie du financement du FCAATA apparaît comme une charge indue Le dispositif du FCAATA, largement financé par la branche AT-MP, bénéficie à des salariés dont une fraction ne développera peut-être jamais de pathologie liée à l'amiante. Il y a là un problème d'allocation des ressources, que la Cour des comptes a relevé dans son rapport320, et qui est une vraie question puisque la branche AT-MP dépense en définitive, pour les dispositifs de préretraites, près de deux fois plus que pour l'indemnisation des victimes. Comme le rapport annuel de la Cour des comptes sur la sécurité sociale publié en septembre 2005 l'a indiqué, le financement du FCAATA « apparaît à bien des égards une charge indûment supportée par la branche AT-MP et contribuant pour une part importante à son déficit. » Les propositions formulées par la mission sur l'avenir du FCAATA sont toutefois de nature à atténuer cette critique. b) La part de l'Etat devrait être réévaluée et mieux définie La répartition des financements des dispositifs de prise en charge des victimes de l'amiante montre que la participation de l'Etat au financement des deux fonds est très faible. Dotations de l'État et de la branche at-mp au fiva et au fcaata (en millions d'euros)
Source : Cour des comptes M. Michel Cretin, président de la sixième chambre de la Cour des comptes a ainsi indiqué321 qu'« entre 1999, année de création du FCAATA, et 2004, dernière année complète connue, le financement des deux fonds aura été assuré à hauteur de 2,6 milliards d'euros par la branche « accidents du travail » et à hauteur de 294 millions d'euros par l'État. Autrement dit, la branche AT-MP aura supporté environ 90 % du financement et l'État les 10 % restants ». Les 10 % de la charge de l'indemnisation des victimes jusqu'à présent supportés par l'Etat correspondent, certes, au poids de la fonction publique d'Etat dans la population active. Mais cette prise en charge par l'Etat n'intègre pas ce qui, dans le drame de l'amiante, est imputable à la responsabilité de l'Etat, en tant que puissance publique, alors que le Conseil d'Etat, par ses quatre arrêts en date du 3 mars 2004, a estimé que l'Etat avait failli à sa mission de prévention des risques professionnels et donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour carence fautive. Il conviendrait donc d'essayer de différencier la charge qui correspond à l'Etat employeur de celle qui incombe à la responsabilité générale des pouvoirs publics ainsi reconnue. Comme M. Jean-Michel Belorgey, président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, l'a souligné devant la mission322 « s'agissant de la répartition des coûts entre l'État et l'assurance maladie, je ne crois pas que la question de la répartition des financements dépende de critères objectifs. Elle dépend essentiellement de choix politiques et d'opportunités d'affichage ». Le Sénat a proposé de doubler la participation de l'Etat et la mission d'information de l'Assemblée reprend cette proposition. Proposition : Doubler, au minimum, la participation de l'Etat aux deux fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. En plus de son faible montant, la participation de l'Etat est souvent critiquée pour son instabilité. Il est par exemple regrettable qu'une partie de la contribution de l'Etat au financement du FCAATA provienne de droits sur le tabac, alors que le contexte de diminution de la consommation renforce le caractère aléatoire de la recette. M. Franck Gambelli, président de la commission AT-MP de la CNAMTS a regretté cette instabilité des contributions de l'Etat, tant pour le FIVA que pour le FCAATA, en faisant valoir que la branche accidents du travail - maladies professionnelles avait besoin de visibilité à moyen terme sur la couverture de son risque. La mission d'information de l'Assemblée recommande en conséquence une stabilité des contributions de l'Etat, qui pourrait passer par la fixation d'un pourcentage constant du financement des fonds. Proposition : Stabiliser les contributions de l'Etat en fixant un pourcentage constant du financement des fonds. En définitive, le poids financier de l'amiante sur la branche AT-MP risque d'hypothéquer toute amélioration de l'indemnisation des autres victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui ne bénéficient toujours pas de la réparation intégrale de leur préjudice. Or, un consensus semble pourtant se dégager pour faire évoluer le compromis social de 1898. B.- LA CATASTROPHE SANITAIRE DE L'AMIANTE A ÉTÉ L'OCCASION D'UNE REMISE EN CAUSE DES GRANDS PRINCIPES QUI STRUCTURENT LA BRANCHE AT-MP La loi du 9 avril 1898 sur « les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail » était le fruit de ce que Jean-Jacques Dupeyroux a appelé un « deal »323, intervenu au terme d'un long débat parlementaire engagé dès 1880 sur une proposition de loi déposée par M. Martin Nadaud, député de la Creuse. Avant cette loi, les accidents du travail étaient appréhendés dans le cadre d'une responsabilité pour faute qui était individuellement appréciée par le juge. Face à un accident du travail, celui-ci examinait les responsabilités respectives de l'employeur et du travailleur, en fonction des éléments de preuves apportés par les deux parties et sur la base de l'article 1382 du code civil. Ce système n'était pas sans présenter de graves inconvénients, tant pour les salariés - sur qui reposait la charge de la preuve et qui étaient confrontés aux délais et aux coûts d'un procès - que pour les employeurs qui étaient traînés par leurs salariés devant les tribunaux et exposés aux aléas de l'indemnisation. La loi de 1898 marque le passage d'une approche individuelle à une approche plus collective, fondée sur la solidarité. L'idée était de substituer à l'incertitude du droit un dispositif qui assure à la fois la sécurité du patron et de l'ouvrier. L'ouvrier abandonnait certes son droit à obtenir la réparation intégrale du dommage subi dans les cas où la faute du patron pouvait être prouvée mais il obtenait en contrepartie la certitude d'être indemnisé dans tous les cas de figure. De son côté, le patron devenait juridiquement responsable de tout accident du travail mais sa responsabilité étant en revanche fortement limitée dans sa quotité. Ainsi, dans la mesure où tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail est présumé d'origine professionnelle, les victimes bénéficient d'une réparation automatique dont le montant est fixé par avance et sans que la victime n'ait à prouver une faute de l'employeur en saisissant un tribunal. En contrepartie, les préjudices subis par la victime sont réparés sur une base forfaitaire et les employeurs bénéficient d'une immunité civile, sauf en cas de faute inexcusable. La loi de 1898 repose au final sur trois piliers : - une présomption d'imputabilité pour l'employeur, - une réparation forfaitaire, à demi tarif, fondée sur le principe d'un partage des responsabilités ; - une immunité civile de l'employeur, sauf faute intentionnelle ou inexcusable. La loi du 25 octobre 1919 a étendu ces principes aux maladies professionnelles inscrites dans un tableau et le système actuel de réparation reste très largement dans la logique du compromis social de 1898. Lors de la table ronde du 23 novembre 2005 sur l'avenir de la branche AT-MP, M. Pierre Sargos, président de la Chambre sociale de la Cour de cassation a constaté que « le système issu de la loi de 1898, de la création de la sécurité sociale et des réformes successives de celle-ci ne permettait guère de gérer les conséquences de ce drame [celui de l'amiante] ». Avec le drame de l'amiante, ont effectivement été remis en cause le principe d'immunité civile de l'employeur et celui de l'indemnisation forfaitaire des accidents du travail et des maladies professionnelles. 1.- Le drame de l'amiante est à l'origine d'une remise en cause jurisprudentielle de l'immunité civile de l'employeur Par plusieurs arrêts rendus en 2002 dans des affaires concernant l'amiante, la Cour de cassation a été amenée à redéfinir la notion de faute inexcusable. Elle a estimé qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui à une obligation de sécurité qui est une obligation de résultat tant pour les maladies professionnelles (arrêts du 28 février 2002324 ) que pour les accidents du travail (arrêts des 11 et 23 mai 2002). Cette décision de principe, qui ne concerne donc pas que les victimes de l'amiante, a marqué un renversement de la situation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, puisque la faute inexcusable, jusqu'alors exception assez rare, est devenue pratiquement la règle. Elle a ainsi remis en cause le principe de l'immunité civile de l'employeur dans des conditions dont les conséquences seront examinées plus loin et qui imposeront sans doute un réinvestissement du champ normatif par le législateur. 2.- L'indemnisation des victimes de l'amiante a renforcé la contestation des modalités de réparation forfaitaire des AT-MP Les difficultés rencontrées pour indemniser correctement les victimes de l'amiante ont révélé les insuffisances du système de réparation forfaitaire des maladies professionnelles et l'instauration, par le FIVA, d'un dispositif d'indemnisation spécifique n'a fait que les mettre davantage en évidence. a) Les modalités législatives et jurisprudentielles de l'indemnisation de l'amiante remettent en cause le principe de la réparation forfaitaire des AT-MP ● La création du FIVA a remis en cause l'indemnisation forfaitaire L'ampleur du drame de l'amiante, la détresse des victimes de même que les circonstances politiques et médiatiques ne permettaient pas de se limiter au régime de droit commun de réparation des AT-MP pour dédommager les victimes de l'amiante. Le FIVA a été créé pour compléter l'indemnisation versée par le régime des AT-MP aux victimes de l'amiante et cette législation est maintenant perçue comme l'exemple de ce que devrait être une véritable réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. ● L'extension jurisprudentielle de la faute inexcusable a également fragilisé l'indemnisation forfaitaire En consacrant le caractère quasi automatique de la faute inexcusable, la jurisprudence issue des arrêts du 28 février 2002 a ouvert une voie parallèle à celle du FIVA pour obtenir une réparation plus importante que la réparation forfaitaire versée au titre du régime des AT-MP, puisque la victime - ou ses ayants droit en cas de décès - bénéficie d'une indemnisation complémentaire lorsque la « faute inexcusable » de l'employeur est reconnue. À défaut d'accord amiable entre la caisse d'assurance et la victime d'une part et l'employeur d'autre part, le montant de ce complément est fixé par les tribunaux des affaires de sécurité sociales (TASS). La loi prévoit dans ce cas une majoration de la rente dont le montant est fonction de la gravité de la faute. Cette majoration est plafonnée à la fraction du salaire réel correspondant à la réduction de capacité, ou au montant de ce salaire en cas d'incapacité totale ou de décès de la victime. Par ailleurs, si la victime est atteinte d'incapacité permanente totale, elle se voit attribuer, en plus de sa rente majorée, une indemnité forfaitaire versée en capital dont le montant est égal au salaire minimum légal annuel à la date de sa consolidation. Enfin, la victime peut toujours demander à son employeur devant le TASS réparation des préjudices non pris en charge par le régime accident du travail de la sécurité sociale, c'est-à-dire des préjudices extrapatrimoniaux. La majoration de la rente, ainsi que l'indemnité forfaitaire et l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux sont versés par la caisse de sécurité sociale qui en récupère le montant auprès de l'employeur, sous la forme d'une cotisation supplémentaire et, pour la réparation des autres préjudices, sur le patrimoine de l'employeur. Désormais, l'indemnisation forfaitaire de la branche AT-MP se révèle donc beaucoup moins intéressante que les indemnisations du FIVA ou celles susceptibles d'être obtenues par voie judiciaire dans le cadre d'un contentieux pour faute inexcusable. L'inégalité de traitement qui en résulte pour toutes les autres victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles a très naturellement conduit à penser que le principe de l'indemnisation forfaitaire, tel qu'il a été accepté dans le cadre du compromis de 1898, est dépassé et qu'il faudrait revoir l'entier dispositif afin que la « réparation intégrale » soit le principe de base pour l'ensemble des victimes. M. Marcel Royez, secrétaire général de la FNATH, a ainsi indiqué325 que « le principe de la réparation forfaitaire par les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles était dépassé et que la réparation intégrale devait être le principe de base pour l'ensemble des victimes ». b) La remise en question du compromis de 1898 à l'occasion du drame de l'amiante s'inscrit dans un contexte plus général Il convient de souligner que, dès les années 80, le législateur a développé des systèmes d'indemnisation qui, dans certains cas, permettent aux victimes de bénéficier d'une réparation de droit commun, sans qu'elles aient à faire la preuve d'une faute. Ces régimes de réparation, fondés sur la présomption, ont mis en porte-à-faux la législation de l'assurance accident du travail. La grande rupture législative résulte de la loi dite « Badinter » du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, qui a développé un système de présomption, tout en maintenant, à la différence de la loi de 1898, les principes de réparation de droit commun qui permettent une réparation intégrale. À la loi Badinter s'est ajoutée une série de textes visant des situations plus spécifiques : la loi du 3 janvier 1977, modifiée par la loi du 6 juillet 1990, mettant en place les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI), la loi du 9 septembre 1986 relative aux actes de terrorisme et la loi du 31 décembre 1991 relative aux victimes de transfusions sanguines. Désormais, l'indemnisation n'est quasiment plus jamais subordonnée à la preuve d'une faute, et encore moins d'une faute inexcusable. Comme dans le cas du FIVA, ces textes utilisent parfois la notion de « réparation intégrale ». M. Michel Laroque, inspecteur de l'IGAS, a indiqué lors de son audition du 15 novembre 2005 que « jusqu'à il y a quelques années, la réparation des accidents du travail était considérée comme un exemple. Aujourd'hui, elle apparaît insuffisante comparée à la réparation de droit commun, à laquelle elle est souvent inférieure. » c) Au regard de ces évolutions, l'indemnisation des AT-MP apparaît de plus en plus injuste L'unanimité a rassemblé les participants à la table ronde pour considérer que le système de réparation mis en place au sein du FIVA s'inscrivait dans une tendance lourde d'amélioration de la réparation des dommages corporels et que, dans ce contexte, le régime actuel d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles était tout à fait obsolète, M. Marcel Royez, secrétaire général de la FNATH indiquant326, par exemple, que « le principe de réparation forfaitaire pour les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles était dépassé ». Dès février 2002, les conclusions générales du rapport de la Cour des comptes sur la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles soulignaient que les dispositifs dérogatoires et exceptionnels de réparation des maladies de l'amiante n'allaient pas sans soulever des problèmes d'égalité de traitement à l'égard des victimes d'autres maladies professionnelles. Ces problèmes d'égalité ont été mis en évidence à plusieurs reprises au cours des auditions de la mission. M. Marcel Royez a par exemple déclaré327 : « nous déplorons une profonde inégalité dans le traitement des victimes, puisque les personnes atteintes d'accident du travail ou d'autres maladies professionnelles que l'amiante ne sont toujours pas indemnisées sur le principe de la réparation intégrale ». Si le dispositif d'indemnisation des victimes de l'amiante est un système dérogatoire par rapport au système d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, parfois décrit comme une injustice, toutes les personnalités auditionnées par la mission, notamment lors de la table ronde du 23 novembre 2005 sur l'avenir du régime AT-MP, se sont accordées à reconnaître, à l'instar de M. Michel Parigot328, que « c'est exactement le contraire » et que « l'injustice réside dans le fait que les accidents du travail et les maladies professionnelles sont indemnisés dans le cadre d'un régime dérogatoire, dont l'effet est l'absence de réparation intégrale. La création du FIVA a permis de corriger cette injustice fondamentale, mais pour les seules victimes de l'amiante. Il s'agit donc d'étendre la correction de cette injustice à l'ensemble des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ». À l'exception des victimes de l'amiante, les seules victimes à ne pas encore bénéficier aujourd'hui d'une réparation intégrale sont donc les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ce qui est maintenant ressenti comme une injustice inacceptable, surtout dans un contexte où la notion de « partage de responsabilités » n'a plus sa raison d'être. Le dossier de l'amiante a donc été un révélateur qui a permis de réfléchir à un aménagement de l'indemnisation de l'ensemble des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. C.- UN CONSTAT UNANIME SE DÉGAGE SUR LA NÉCESSITÉ DE FAIRE ÉVOLUER LA RÉPARATION DES AT-MP VERS UNE RÉPARATION INTÉGRALE 1.- Un accord de principe sur la nécessité d'évoluer vers la réparation intégrale malgré l'ambiguïté de la notion Le régime particulier d'indemnisation des victimes de l'amiante étant souvent cité en exemple, ne faut-il pas s'en inspirer pour introduire une réparation intégrale des préjudices causés par les accidents du travail ou des maladies professionnelles ? a) Un accord unanime sur le principe de la réparation intégrale La nécessité d'améliorer les conditions de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles fait l'objet d'un véritable consensus. M. Marcel Royez, secrétaire général de la FNATH, a résumé le consensus général qui s'est dégagé de la table ronde du 23 novembre 2005 en déclarant que « la réparation intégrale devait être le principe de base pour l'ensemble des victimes ». Pour beaucoup de personnes auditionnées, le dispositif d'indemnisation des victimes de l'amiante a été une réponse à un « crime sociétal »329, effectuée dans l'urgence, et qui avait vocation à être ultérieurement étendue. Mme Pascale Fromenteau, sous-directrice de l'accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail à la Direction de la sécurité sociale, a admis330 que le caractère dérogatoire du dispositif « a été conçu en attendant que l'on puisse faire mieux pour les autres victimes d'autres maladies professionnelles » et a précisé que « lors de la mise en place du FIVA, ce système de réparation a été conçu comme un système exceptionnel. Mais c'est au cours de la même conférence de presse que furent annoncés la création du fonds et le lancement de la mission Masse. L'idée du ministère était que l'idéal était une réparation intégrale pour l'ensemble des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Cela n'a pas pu se faire, pour différentes raisons ». Pourtant, la notion de réparation intégrale est ambiguë. À plusieurs reprises, les personnalités invitées à la table ronde de la mission ont fait remarquer qu'au-delà de la problématique « réparation intégrale - réparation forfaitaire », l'essentiel pour la victime était le quantum de l'indemnisation et qu'une indemnisation dite « intégrale » pouvait être inférieure à une indemnisation forfaitaire. M. Michel Laroque a aussi souligné que « la notion de réparation intégrale n'est pas claire ». En effet, si le terme de réparation intégrale signifie que tous les préjudices sont pris en compte, il ne fournit pas en lui-même d'indication sur la manière dont chacun des préjudices est pris en compte. De plus, M. Michel Laroque a indiqué que « la réparation forfaitaire n'a jamais signifié que l'on écartait l'idée d'une réparation intégrale ». Pour lui, le principe de la réparation forfaitaire, qui visait à obtenir une réparation égalitaire entre les victimes sur la base d'un barème, n'est pas forcément à proscrire, dès lors que la réparation est juste, ce qui n'est toutefois pas le cas actuellement. c) L'évolution vers la réparation intégrale peut se faire selon des modalités variables ● La présomption d'imputabilité doit-elle être conservée ? La réparation forfaitaire du préjudice de la victime étant, au niveau du principe, la contrepartie de la présomption d'imputabilité, c'est-à-dire l'existence d'un lien de causalité entre le travail et le préjudice sans qu'il soit nécessaire de le prouver, il serait logique que le passage à la réparation intégrale s'accompagne d'un durcissement de la charge de la preuve pour la victime. Dans ces conditions, un des piliers du compromis de 1898 serait abandonné et l'introduction d'une réparation intégrale pourrait se révéler défavorable à la victime en supprimant la présomption d'imputabilité de l'accident à l'employeur. Certains, comme M. Marcel Royez, ont pourtant défendu l'idée que « la réparation intégrale est tout à fait compatible avec la présomption d'imputabilité » comme le prouve déjà beaucoup de systèmes de réparation qui « associent à la réparation intégrale une responsabilité sans recherche de faute ». Tel est le cas de la loi de 1985 relative aux accidents de circulation. Le principe de réparation intégrale n'est donc pas exclusif d'une présomption de causalité. ● L'indemnisation doit-elle être accordée par les tribunaux ? La notion même de réparation intégrale, réparation de droit commun, nécessairement individualisée, semble s'opposer à un système de nature réglementaire fixant les préjudices indemnisés et le montant des indemnisations. Elle laisserait supposer que le recours à une indemnisation par les tribunaux est nécessaire. Une telle situation, qui supposerait un abandon total du dispositif actuel, présenterait beaucoup d'inconvénients. M. Pierre Sargos a notamment souligné les risques d'engorgement d'un tel transfert en déclarant331 qu'« il est délicat d'exiger la réparation intégrale en évoquant le recours aux tribunaux. Ceux-ci sont déjà victimes de l'effet de masse ». Mais à l'engorgement des tribunaux s'ajouteraient surtout les risques d'inéquité liés à la nature et au montant des indemnisations. Ce serait également une remise en cause de la paix sociale. Une solution serait, alors, de réfléchir à l'instauration de barèmes indicatifs qui resteraient sous le contrôle des tribunaux. M. Michel Parigot a fait remarquer1 qu'il fallait distinguer « l'indemnisation « par » les tribunaux de l'indemnisation « sous » le contrôle des tribunaux », cette dernière consistant à ouvrir la possibilité de faire appel d'une décision d'indemnisation de l'organisme qui en est chargé tandis que M. Marcel Royez a déclaré1 dans le même sens que « la garantie du droit au recours aux tribunaux existant dans le système actuel doit demeurer ». Le maintien d'un système de barème a recueilli un fort consensus. Comme l'a souligné M. Royez1, il s'agirait de mettre en place « une réparation intégrale mais pas intégriste ». Lors de la table ronde du 28 septembre 2005 regroupant des partenaires sociaux sur les risques professionnels liés à l'amiante, M. Dominique Olivier, secrétaire permanent de la CFDT, responsable des risques professionnels et de la santé au travail, a de la même façon insisté sur la nécessité de mettre « à l'écart la réparation « intégrale intégriste » : non seulement la sécurité sociale ne sait pas faire, mais le souci d'assurer une certaine rapidité au versement de la prestation à la victime pousse à privilégier des cotes mal taillées. Il devrait y avoir une base pour avancer ensemble sur cette question entre partenaires sociaux - avec sans doute un arbitrage des pouvoirs publics dans la mesure où le traitement équitable des victimes du travail est aussi un problème de société » et annoncé que la CFDT avait fait le choix « de défendre le principe d'une réparation intégrale sur la base de forfaits améliorés. On peut évidemment le dire autrement et parler d'une réparation forfaitaire optimisée... » L'analyse des perspectives d'évolution de la branche pourra également s'enrichir des réflexions qui se développent, dans un autre cadre, autour de l'indemnisation du préjudice corporel, qu'il s'agisse du rapport, commandé par le précédent ministre de la justice à Mme le professeur Lambert-Faivre332, et qui préconise un référentiel revu chaque année et communiqué à tous les tribunaux de France pour essayer d'uniformiser l'indemnisation sur tout le territoire, du rapport de M. Dintilhac, président de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation, ou des travaux de la Chancellerie qui réfléchit actuellement aux formes que pourrait revêtir un effort d'homogénéisation de l'indemnisation du préjudice corporel. Sur ce dernier point, le garde des sceaux, M. Pascal Clément a déclaré, lors de son audition du 18 janvier 2006, que « les magistrats, mais pas seulement eux, gagneront à avoir une liste indicative des chefs de préjudice, une grille de lecture commune leur permettant de fonder leur raisonnement sans entraver leur liberté d'appréciation. Jean-Pierre Dintilhac, président de la 2e chambre civile de la Cour de cassation, m'a remis au mois d'octobre dernier un rapport à cette fin. Il contient une nomenclature des chefs de préjudice à la fois plus claire et plus complète que celle qui est utilisée actuellement. Elle est désormais en ligne sur le site du ministère de la justice. Elle appelle au préalable une réforme législative pour mieux définir la nature des préjudices pour lesquels les caisses de sécurité sociale peuvent demander le remboursement des frais qu'elles ont avancés à la victime. Je m'emploie à faire examiner cette réforme dans des délais que je souhaite brefs ». Maître Jean-Paul Teissonnière a remarqué333 que l'ensemble de ces rapports et les réflexions qui les accompagnaient constituaient « une pierre de plus sur le chemin d'un progrès substantiel dans l'appréciation de la réalité des préjudices. La réparation intégrale n'appartient donc plus à un domaine marqué par l'incertitude » ● Le FIVA peut-il servir de « laboratoire » ? De nombreuses personnes auditionnées ont fait valoir que « l'expérience du FIVA pourra être utile »334 pour servir de point de départ à une réforme d'ampleur de la réparation AT-MP, sachant que le FIVA est « un formidable laboratoire de la réparation intégrale »335. En effet, le système mis en place avec le FIVA préserve une partie du compromis de 1898 - présomption d'imputabilité et immunité civile de l'employeur -, tout en procédant à une extension considérable des préjudices indemnisés, mais selon un système quasi-forfaitaire. M. François Desriaux a toutefois nuancé le caractère exemplaire du FIVA336 : « il ne faudrait pas mesurer l'indemnisation de l'ensemble des accidents du travail et des maladies professionnelles à l'aune de l'indemnisation des victimes de l'amiante. Pour les faibles taux d'IPP337 - je pense en particulier aux plaques pleurales donnant lieu à un taux d'IPP de 5 % -, on voit apparaître des indemnisations liées au préjudice moral. Mais une personne victime d'un trouble musculo-squelettique (TMS) donnant lieu à un taux d'IPP de 5 % ne se verra pas reconnaître un préjudice moral comparable à celui qu'on reconnaît en cas de plaque pleurale ». De même, M. François Romaneix, ancien directeur du FIVA, a indiqué338 que si le FIVA peut constituer une sorte de laboratoire de la réparation intégrale, « l'angle d'indemnisation qu'il a choisi est très spécifique aux maladies professionnelles et ne saurait être appliqué aux accidents du travail du bâtiment, par exemple ». L'exemple du FIVA n'est donc pas entièrement transposable à toutes les autres victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Inversement, la mise en place de la réparation intégrale conduira à poser la question de l'intégration du système d'indemnisation des victimes de l'amiante dans le cadre plus général de l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. M. Roger Beauvois a reconnu3 qu'« il est certain qu'une réforme du système d'indemnisation des AT-MP dans le sens de la réparation intégrale ferait perdre leur raison d'être aux fonds d'indemnisation autonomes ». Toutefois, une intégration du FIVA au régime général risquerait de heurter les associations de victimes qui sont attachées à leur dispositif particulier. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que certaines victimes de l'amiante, comme les victimes environnementales, ne relèvent pas du système d'indemnisation des risques professionnels et ne pourraient donc pas être traitées dans ce nouveau cadre. En conséquence, la mission estime que, même dans l'hypothèse d'une réforme du système d'indemnisation des AT-MP dans le sens de la réparation intégrale, la spécificité d'un fonds autonome pour les victimes de l'amiante garde toute sa justification. Proposition : Maintenir l'autonomie du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, quels que soient les résultats de la négociation sur l'avenir de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, afin de prendre en compte les victimes environnementales. 2.- Les limites de la réparation intégrale ne doivent pas être négligées Parallèlement au constat unanime sur la nécessité de faire évoluer la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles vers une réparation intégrale, les auditions ont progressivement fait apparaître des freins ou des correctifs à ce mouvement. a) La réparation intégrale est susceptible de générer des inégalités M. Michel Laroque a rappelé339 que si la réparation intégrale est souvent invoquée en référence à la réparation de droit commun, cette dernière résulte « d'une procédure au cours de laquelle interviennent des assurances, des avocats et des tribunaux. Or, le résultat n'est pas le même, on le sait, selon la compagnie d'assurance qui aura traité du dossier, selon l'avocat qui aura défendu les intérêts de la personne concernée et selon la juridiction qui aura tranché. Le système est inégalitaire et aléatoire ». De plus, l'instauration d'un système de réparation intégrale créerait des perdants par rapport au système existant, ce qui serait notamment paradoxalement le cas des personnes qui ont été exposées à l'amiante, comme le souligne le rapport Laroque de 2004 selon lequel « pour ces victimes, l'application de la réparation intégrale serait significativement moins avantageuse. En effet la valeur du point d'IP en droit commun étant décroissante avec l'âge, l'indemnisation du préjudice physiologique dans cette hypothèse serait nettement inférieure à celle dont bénéficie la victime avec le barème actuel. Cette différence ne pourrait être compensée par l'indemnisation d'autres préjudices : la valorisation des préjudices personnels est relativement faible pour ces victimes et elles ne sont pas indemnisables au titre du préjudice professionnel puisqu'elles sont pour la plupart à la retraite ». Une raison de plus, sans doute, de maintenir l'autonomie du système de réparation des victimes de l'amiante, parmi lesquelles il importe de ne pas créer d'inégalité de traitement. b) La réparation intégrale ne prend qu'imparfaitement en compte l'objectif de réinsertion La réparation intégrale de droit commun privilégiant l'indemnisation, ne prend peut-être pas suffisamment en compte l'objectif de réinsertion professionnelle et sociale. M. Michel Laroque a insisté, à juste titre, sur le fait qu'il fallait absolument éviter qu'une réparation financière trop généreuse ou trop rapide s'effectue au détriment de l'objectif de réinsertion professionnelle des intéressés, qui demeure le principe essentiel de la réparation. D'après lui340, « il existe aujourd'hui un vrai problème de réinsertion des accidentés du travail et des personnes atteintes de maladies professionnelles. La sécurité sociale ne s'occupe plus suffisamment de cet aspect des choses ». Il ne faudrait donc pas que l'objectif louable de mieux indemniser les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles finisse par nuire à leur réinsertion dans le monde du travail. c) Il est nécessaire de maintenir une « pression » avec la faute inexcusable Une autre objection a été formulée contre la réparation intégrale : dès lors qu'une réparation intégrale des préjudices est assurée, il n'y a plus lieu de prévoir une indemnisation complémentaire en fonction de la gravité de la faute. M. Pierre Sargos a indiqué ne pas très bien percevoir la possibilité d'un mécanisme pur de réparation intégrale en matière d'accidents du travail en soulignant que1 « si l'on veut maintenir une pression sur l'employeur au moyen de la notion de faute inexcusable, il faut bien que cette faute inexcusable, nouvellement définie, permette d'aboutir à un complément de réparation. Si la réparation est déjà intégrale, on ne peut pas ajouter une réparation supplémentaire, à moins d'avoir recours aux dommages punitifs, ce qui n'est pas dans la tradition du droit français ». M. Marcel Royez, secrétaire général de la FNATH, estime pourtant de son côté qu'« on peut fort bien imaginer que la faute inexcusable ne donne pas lieu à un complément d'indemnisation mais à une sanction financière de l'entreprise, sanction qui pourrait alimenter le système ». Cette position est intéressante, surtout si elle a des répercussions en terme de prévention, comme on le verra. d) La réparation intégrale comporte un risque de sortie du système de la sécurité sociale M. Franck Gambelli, président de la commission AT-MP de la CNAMTS, a fait remarquer qu'« il y a une économie de la réparation intégrale qui, en renvoyant au droit commun, tend à faire sortir la branche de la sécurité sociale ». Or, cette évolution n'est pas souhaitée par les personnes auditionnées. Au contraire, un très fort consensus s'est dégagé en faveur du maintien du dispositif de réparation des AT-MP au sein de la sécurité sociale. On peut même dire qu'aucun n'a envisagé qu'il puisse en être autrement. Comme M. Gambelli, M. Royez a indiqué341 que « le système doit rester intégré à la sécurité sociale » et a ajouté qu'on « n'imagine pas qu'il soit complètement transféré au droit commun, ou au champ de l'assurance privée. Cela nous ramènerait à la situation d'avant 1947, ce qu'il convient d'éviter, ne serait-ce que parce que l'un des avantages essentiels d'une gestion intégrée à la sécurité sociale est d'articuler prévention et réparation ». De la même façon, M. Marcel Royez a rappelé1 que « la FNATH est très attachée à une gestion du système par la sécurité sociale, pas seulement parce que ce système a constitué un progrès considérable au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, mais aussi parce que le système de réparation touche aux relations sociales. On n'imagine pas un système dans lequel tous les salariés qui subiraient un accident du travail ou une maladie professionnelle devraient le régler devant les tribunaux ». M. André Hoguet, vice-président de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la CNAMTS, a même averti que « si demain, l'approche de la réforme de la branche AT-MP se plaçait sous le signe d'une sortie de cette branche de la sécurité sociale, il n'y aurait aucune organisation syndicale autour de la table ». e) Aucun pays en Europe n'accorde la réparation intégrale M. Franck Gambelli a fait remarquer en s'appuyant sur les conclusions de l'enquête d'Eurogip342 de juin 2005 qu'« il n'existe au sein de l'Union européenne aucun pays ayant un système légal de type AT-MP qui prévoie la réparation intégrale ». Dans le même sens, le rapport Laroque sur la rénovation des accidents du travail fait également bien apparaître que les pays de l'Union européenne encadrent tous la réparation des AT-MP dans un régime légal. f) Le coût de la réparation intégrale serait très élevé Le groupe de travail présidé par M. Michel Laroque (mars 2004) a mis en évidence le surcoût annuel élevé d'une telle réforme globale, de l'ordre de 2,9 milliards d'euros pour le seul régime général. Il n'est pas certain que la collectivité soit prête à assumer un tel effort pour assurer une meilleure indemnisation des risques professionnels. Mme Pascale Fromenteau, sous-directrice de l'accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail à la Direction de la sécurité sociale, a d'ailleurs signalé343 qu'« aujourd'hui, la branche AT-MP étant déficitaire, il est clair qu'à financement constant, il n'est pas possible de généraliser la réparation intégrale dans le cadre de la sécurité sociale » et M. Pierre Sargos, président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, a également douté de « la possibilité pour la collectivité nationale de faire exploser le coût de la réparation ». 3.- Un accord pourrait se faire sur une réparation forfaitaire améliorée au sein de la branche AT-MP et qui préserve les grandes lignes du compromis social de 1898 Face à ces nombreuses critiques, et à la constatation que « le compromis de 1898 avait tout de même ses mérites », car, comme l'a fait remarquer M. Franck Gambelli344 « la facilité d'accès à la réparation, l'absence de contentieux, l'automaticité, ce n'est tout de même pas rien », un consensus sur une réparation forfaitaire améliorée s'est dessiné. Il s'agirait d'améliorer les modes de réparation existants en intégrant le cas échéant l'indemnisation de nouveaux chefs de préjudice - préjudice esthétique et d'agrément par exemple - sans pour autant opter pour une réparation intégrale dont les débats ont montré les limites et inconvénients. Nul doute qu'une concertation et une négociation approfondies entre les partenaires sociaux devraient permettre d'aboutir à dégager, sur ces bases, les grandes lignes d'une réforme de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles que tout le monde appelle de ses voeux. Parallèlement à cette indispensable réforme de la branche AT-MP, M. Gambelli a appelé l'attention de la mission sur le fait qu'il « faudrait peut-être qu'une réflexion s'engage pour envisager aussi quelques changements dans un système qui concerne les quelques cinq millions de salariés de la fonction publique », même si M. Jean-Michel Belorgey, président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, a souligné que dans le domaine de l'indemnisation des accidents du travail des agents publics, les choses avaient déjà un peu progressé grâce à l'arrêt Moya-Caville du 4 juillet 2003. Par cette décision, le Conseil d'Etat a, en effet, considéré que le forfait de pension n'indemnisait qu'une fraction des préjudices liés à un accident du travail et que la victime pouvait rechercher des compléments d'indemnisation. D.- LE SYSTÈME DE LA BRANCHE AT-MP PARAÎT EXCESSIVEMENT MUTUALISÉ Les conséquences des contaminations par l'amiante ont également mis en évidence que certaines formes de mutualisation dans le fonctionnement de la branche AT-MP n'encourageaient pas la prévention et la responsabilisation en matière de risques professionnels. En premier lieu, le dispositif de prise en charge des victimes n'incite que faiblement à investir dans la prévention. La Cour des comptes souligne ainsi qu'« une prise en charge des dépenses résultant de l'exposition à des risques professionnels reposant principalement sur la collectivité n'est pas de nature à encourager les entreprises à mettre en œuvre des politiques ambitieuses de prévention ». Pourtant, la prévention était un souci majeur des pères fondateurs de la sécurité sociale. Par ailleurs, les employeurs qui sont à l'origine de la contamination des victimes ne semblent pas contribuer à la hauteur de leur implication réelle. En effet, les mécanismes de mutualisation existant dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable de l'employeur font que les conséquences de celle-ci sont rarement supportées par l'employeur responsable. Il est vrai que certaines dépenses de la branche AT-MP doivent nécessairement être mutualisées et sont imputées au compte spécial de la branche AT-MP. Il s'agit par exemple des dépenses relatives à des maladies contractées dans une entreprise disparue ou à des pathologies susceptibles d'avoir été contractées dans plusieurs entreprises, sans qu'il soit possible d'en identifier une. D'autres règles de mutualisation peuvent, au contraire, apparaître plus contestables. Maître Jean-Paul Teissonnière a ainsi indiqué345 que « paradoxalement, les victimes de l'amiante en France, tous systèmes d'indemnisation confondus, sont probablement celles qui, dans le monde, bénéficient des meilleurs conditions d'indemnisation, alors même que nous sommes le pays dans lequel la catastrophe de l'amiante a coûté le moins cher à ses responsables, la sécurité sociale ayant finalement servi d'amortisseur ». a) Le financement de la branche AT-MP par la tarification est fortement mutualisé. Le système actuel de tarification, qui recouvre l'ensemble des règles et procédures par lesquelles sont déterminées annuellement les cotisations que versent les seuls employeurs au profit de la branche, mutualise fortement les risques entre les entreprises. Lors de son instauration en 1946, le dispositif de tarification cherchait à concilier à la fois mutualisation - une partie des coûts est supportée de manière indifférenciée par l'ensemble des entreprises - et individualisation. La tarification était conçue comme un outil de prévention destiné à diminuer l'incidence et la gravité des accidents et des maladies professionnelles. Elle comporte en effet des modalités de calcul de la cotisation individualisées par établissement qui font varier le montant de la cotisation en fonction du coût, pour la branche AT-MP, des accidents et maladies survenus dans celui-ci. Le calcul du taux global de cotisation - le « taux net » - s'effectue en faisant la somme d'un « taux brut » et de trois majorations : M1, M2, M3. Selon la taille et l'activité des établissements, le taux brut est calculé soit individuellement - en fonction du risque propre à l'établissement -, soit collectivement, soit de manière mixte. La majoration M1 vise à couvrir les dépenses d'accident de trajet. Il s'agit d'un taux unique pour toutes les entreprises. La majoration M2 vise à couvrir les charges générales de la branche AT-MP. La majoration M3 permet de financer les compensations inter régimes, les rentes dues aux victimes des accidents du travail survenus avant 1947 - fonds commun des accidents du travail - et les dépenses relatives à certaines maladies professionnelles. En particulier, la branche AT-MP impute le financement du FIVA à la majoration forfaitaire M3 appliquée aux cotisations, ce qui constitue une atténuation au principe d'individualisation des cotisations des employeurs. C'est la commission AT-MP de la CNAMTS qui est chargée de fixer, avant le 31 janvier de chaque année, les éléments de calcul des cotisations. A défaut, ils sont fixés par arrêté ministériel. Parallèlement à ces règles générales de calcul de la cotisation normale, la possibilité existe pour les caisses d'imposer des cotisations supplémentaires ou d'accorder des « ristournes ». Les CRAM peuvent décider, après injonction demeurée infructueuse à un employeur, de lui imposer une cotisation supplémentaire lorsque l'établissement présente des risques exceptionnels ou qu'a été constatée une inobservation des règles de prévention. Cette cotisation supplémentaire peut aller jusqu'à 25 % et même jusqu'à deux fois la cotisation normale en cas de non réalisation persistante de mesures prescrites. Cet instrument, pourtant fortement incitatif, est cependant très peu utilisé par les CRAM et le montant des majorations prononcées est très faible en moyenne. Par ailleurs, les caisses régionales peuvent accorder des « ristournes » pour une durée d'un an, lorsqu'un établissement a accompli un effort de prévention soutenu. Ces ristournes peuvent atteindre 25 % du taux brut, pour les établissements soumis à tarification collective ou mixte, et certaines ristournes qui peuvent aller de 25 à 87,7 % de la majoration forfaitaire pour accident de trajet. Ces avantages permettent de récompenser des efforts particuliers de prévention. Cet instrument n'est toutefois pas plus fréquemment utilisé que les cotisations supplémentaires. Les critiques de ce système de tarification sont aujourd'hui bien connues. Dans la pratique, l'individualisation reste trop faible. En particulier, les petites entreprises sont protégées : la tarification est collective en deçà de 10 salariés, mixte pour les établissements de 10 à 199 salariés et individuelle pour les établissements de plus de 200 salariés. De plus, la Cour des comptes a mis en évidence dans son rapport sur la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles de février 2002 que certains secteurs d'activités, comme celui du bâtiment et des travaux publics, connaissait une mutualisation encore plus forte, alors même que la mission a eu l'occasion au cours de ses travaux sur « l'amiante résiduel », de constater que ce secteur était un de ceux où le risque amiante demeurait le plus élevé. Cet excès de mutualisation a encore récemment été mis en évidence par un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales IGAS346 et par l'ouvrage de Philippe Askenazy, chercheur au Centre national de recherche scientifique (CNRS), Les désordres du travail, qui souligne par exemple que « de fait, il n'existe dans les petits établissements que peu d'incitations financières directes à se préoccuper de la santé et de la sécurité des employés ». Or, comme l'a souligné M. Marcel Royez, cette mutualisation « a le double inconvénient de ne pas suffisamment pénaliser les entreprises qui négligent la prévention et de ne pas récompenser celles qui font des efforts en la matière347 ». Philippe Askenazy mentionne certes qu'« une commission paritaire régionale peut accorder aux entreprises de moins de 200 salariés une ristourne sur cotisation pour un an, pouvant atteindre 25 % en cas de prévention significative ; un contrat de prévention peut être conclu, qui comprend des aides diverses » mais reconnaît immédiatement que « le budget de ces dispositifs est infinitésimal ». Même si, pour l'amiante, la question de l'incitation à la prévention est, pour l'essentiel, trop tardive, la tarification pourrait à l'avenir être davantage utilisée comme levier. D'après M. Marcel Royez, il faudrait en effet « s'orienter vers une tarification beaucoup plus précise et beaucoup plus individualisée, qui constitue un véritable levier au service de la prévention » 348 . Dans cette optique d'une recherche d'une plus grande responsabilisation, la mission estime que les partenaires sociaux pourront, dans le cadre des propositions de réformes de la branche AT-MP sur la tarification s'interroger sur la réactivation du système des « ristournes » et du dispositif de cotisations supplémentaires. Proposition : Insister auprès des partenaires sociaux pour que, dans le cadre des négociations sur la réforme de la branche AT-MP sur la tarification, ils s'engagent à réactiver un système de modulation des cotisations en fonction des efforts de prévention. Toutefois, ces dispositions ne sont pas, à elles seules, suffisantes. M. Franck Gambelli a ainsi fait valoir349 qu'il n'est « pas sûr que l'instauration d'un système généralisé de bonus/malus soit vraiment un levier efficace. La cotisation AT-MP est, en effet, perçue, dans les entreprises, comme une cotisation sociale et, la plupart du temps, elle est traitée par les services comptables ». D'après lui « une incitation ou une pénalisation financière ne peut être performante que si elle est portée par la branche, par un acte précis de la CRAM en direction de l'entreprise, par exemple un acte répressif. Mais un système automatique de type assuranciel ne me semble pas de nature à être incitatif. Il est plus souhaitable de multiplier les contacts positifs entre la CRAM et les entreprises, quitte à les accompagner d'un système d'incitation ou de répression, que de miser sur un système de tarification automatique dont il est vain d'espérer qu'il influe significativement sur les efforts de prévention des entreprises ». Ces préconisations seront sans doute examinées par les partenaires sociaux dans le cadre des négociations qui s'engagent et qui bénéficieront en outre d'une mission d'appui de l'IGAS présidé par M. Pierre-Louis Bras, inspecteur des affaires sociales et mis à disposition par le Gouvernement. Il convient toutefois de garder à l'esprit qu'une individualisation de la tarification présente également certaines limites. Maître Jean-Paul Teissonnière a par exemple fait remarquer350 que les maladies professionnelles « apparaissent très tard après l'exposition au risque, ce qui pose de redoutables problèmes, en particulier en ce qui concerne la tarification ». En effet, « sur quelle base peut-on tarifer quand on sait que le temps de latence des maladies dues à l'amiante peut être de trente ans ? ». M. Hoguet a, lui aussi, indiqué que1 « la prévention ne peut être entièrement liée à la tarification. Car le risque serait que les entreprises qui ont une forte croissance de production avec peu de salariés préféreraient payer plutôt que d'engager une politique de prévention ». En outre, une certaine forme de mutualisation demeure « absolument indispensable » comme l'a dit M. Franck Gambelli1 en soulignant qu'« il ne (...) paraît pas acceptable de faire peser sur les seules branches qui travaillent la matière l'ensemble du risque économique généré par le cycle de production des biens et services. (...) La métallurgie, le bâtiment, la production de la matière sont des activités beaucoup plus risquées que l'assurance ou la promotion immobilière. Et pourtant, tout le monde habite dans des immeubles, tout le monde utilise des véhicules. Je plaide donc pour une solidarité interprofessionnelle, car d'une certaine façon, tout le monde bénéficie de la sinistralité des secteurs à risques. Il faut absolument conserver la mutualisation. C'est une question de solidarité nationale et de solidarité économique ». b) Les mécanismes de mise en œuvre de la faute inexcusable nuisent à la prévention et à la responsabilisation. Une certaine forme de mutualisation joue également en matière de mise en œuvre de la faute inexcusable. Lorsqu'une entreprise est condamnée pour faute inexcusable, la branche AT-MP intervient comme assureur et prend en charge le montant des dépenses résultant de la condamnation. Ce n'est qu'ensuite que la branche AT-MP peut normalement se retourner contre l'employeur condamné. Or, comme cela a déjà été indiqué, ce type de recours de la branche AT-MP n'est parfois pas possible lorsque l'employeur a disparu ou est insolvable, lorsque la loi a prévu que les dépenses afférentes aux condamnations seront supportées par la branche AT-MP ou lorsque la caisse n'a pas conduit l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dans le respect des règles de la procédure contradictoire vis-à-vis de l'employeur. Dans ces différents cas, les dépenses restent définitivement à la charge de la branche AT-MP. Il paraît donc indispensable de limiter autant que possible les cas de non imputabilité de la charge financière de la faute inexcusable sur les employeurs. La solution serait peut-être de renforcer la discipline de traitement des dossiers des Caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) afin de sécuriser les procédures en matière de maladies professionnelles. D'après les informations recueillies par la mission, des instructions ont déjà été données pour que les caisses ne soient plus prises en défaut sur ce point et des formations sont dispensées dans ce but. Proposition : Poursuivre la sécurisation des procédures en matière de maladies professionnelles afin de limiter au maximum les cas de non imputabilité de la charge financière de la faute inexcusable sur les employeurs. À cet égard, la mission se félicite de l'inscription dans la convention d'objectif et de gestion (COG), signé entre l'Etat et les caisses nationales, d'un objectif de réduction des situations où les dépenses restent à la charge de la branche AT-MP. Dans cette même logique de responsabilisation, la mission se félicite de la création, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, d'une contribution versée par les entreprises dont les salariés bénéficient de l'ACAATA. Il est accessoirement permis d'espérer qu'en remédiant au déséquilibre issu d'une trop grande mutualisation, on freine également la montée en puissance de la demande de sanction pénale. II.- L'AFFAIRE DE L'AMIANTE A SOULEVÉ LE PROBLÈME DU DROIT DE LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE RISQUES PROFESSIONNELS A.- LA QUESTION DES « RESPONSABLES DE L'AMIANTE » DEVANT LA JUSTICE 1.- Le procès de l'amiante a été porté devant tous les ordres de juridictions a) L'indemnisation des victimes devant la justice sociale et civile. Les avocats des victimes de l'amiante expliquent ainsi le développement des contentieux en responsabilité civile dans les affaires de l'amiante : « Les premières victimes de l'amiante étaient considérées comme des victimes du travail et indemnisées dans le cadre des maladies professionnelles. [...] Tenter de faire établir la faute inexcusable de l'employeur était donc le seul moyen d'obtenir une indemnisation un peu moins misérable que ce que l'on offrait à l'époque : une incapacité permanente partielle de 5 % - cas d'environ 60 % des victimes - donnait droit, pour solde de tout compte, à seulement 9 501 francs, les rentes inférieures à 10 % étant capitalisées ! Le problème était qu'à l'époque, on n'avait quasiment jamais vu de faute inexcusable assise sur des maladies professionnelles.351 » Dès 1995 - et dès la création de l'ANDEVA - s'est donc ouverte une période « d'actions de masse » des victimes de l'amiante devant la justice, pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Ces démarches se sont rapidement conclues par des victoires devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, ensuite confirmées en appel. Au cours de son audition, maître Ledoux a ainsi résumé l'issue de ces premiers procès : « Toutes ces procédures ont abouti aux arrêts du 28 février 2002 dans lesquels la Cour de cassation, en rejetant les pourvois, a bouleversé les obligations des employeurs, bien au-delà de l'amiante, en créant une obligation de résultat en matière de sécurité au travail. Dès lors, les procédures pour faute inexcusable dans le domaine de l'amiante sont devenues plus faciles. (...). Au final, nous gagnons en appel, voire en cassation, dans pratiquement 95 à 100 % des cas, mais la bataille est encore rude : certains employeurs se débattent vigoureusement et certains tribunaux persistent à considérer que l'on ne pouvait pas véritablement percevoir les dangers de l'amiante avant les années 80 et que, par conséquent, l'employeur n'a pas commis de faute suffisamment lourde pour être reconnue inexcusable. Toujours est-il que la « bataille de la faute inexcusable » s'est terminée dans un sens relativement favorable pour nous.352 » Dans l'intervalle, le législateur a créé des outils d'indemnisation spécifique pour les victimes de l'amiante, mais la faute inexcusable est restée un véritable « acquis » pour les victimes : « Cette avancée jurisprudentielle, qui ne concerne pas que les victimes de l'amiante, marque un renversement de la situation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la faute inexcusable, jusqu'alors exception rarissime, devenant désormais Le régime juridique qui en découle pour l'employeur est un enjeu de taille car, en facilitant le recours aux tribunaux, ce régime a rompu l'équilibre du compromis de 1898 qui avait organisé un système de réparation non contentieuse. Il est ainsi clairement apparu à la mission au cours de ses auditions que l'affaire de l'amiante avait donné naissance à une situation juridique qui ne pouvait perdurer en droit, ainsi que l'ont rappelé tous les témoins entendus à l'instar de M. Marcel Royez (FNATH) : « Il faut accepter l'idée qu'il conviendrait de requalifier cette notion, pour redonner à la faute inexcusable son caractère exceptionnel, tout en conservant les mérites de cette jurisprudence. Les arrêts de 2002 sont une invitation pressante à légiférer en la matière »354. b) La question de la responsabilité pénale des employeurs Depuis l'interdiction de l'amiante, et l'édiction de la réglementation relative au diagnostic et au désamiantage, plusieurs jugements pénaux ont condamné des employeurs pour « mise en danger de la vie d'autrui »355. Comme l'a précisé M. Alain Saffar356, sous-directeur de la justice pénale spécialisée à la Direction des affaires criminelles et des grâces, « des condamnations pénales - une petite dizaine - ont bien été prononcées en matière d'amiante. Mais elles sont intervenues dans des affaires où il n'était pas question de blessures ou d'homicides involontaires dus à des expositions longues à l'amiante. Il s'agissait d'infractions plus ponctuelles de non respect de la réglementation amiante, notamment dans le domaine professionnel, par exemple sur des chantiers. » En revanche, sur des affaires anciennes concernant des expositions longues et antérieures à l'interdiction, aucune juridiction répressive ne s'est à ce jour prononcée malgré la multiplication des plaintes. Dès 1996, l'action judiciaire des victimes s'est, en effet, orientée vers la justice pénale, par le dépôt de plaintes simples auprès des parquets et de plaintes avec constitution de partie civile. Mais au 12 mai 2005, date à laquelle la Chancellerie a demandé le regroupement des procédures, le bilan des actions des victimes était globalement négatif : aucune des plaintes simples n'avait été suivie d'une saisine du juge d'instruction par les parquets ; quant aux plaintes avec constitution de partie civile, elles avaient toutes abouti à des ordonnances de non-lieu pour des raisons que M. Alain Saffar, a rappelé à la mission357 : « La prescription de l'action publique si, dans le délai de trois ans après le décès ou la consolidation de la maladie, l'action n'a pas été engagée ; l'extinction de l'action publique par le décès des personnes possiblement mises en cause ; l'impossibilité de poursuivre des personnes morales pour des fautes commises avant l'entrée en vigueur de la loi créant la responsabilité pénale des personnes morales, c'est-à-dire avant le 1er mars 1994. Une autre difficulté est également apparue au niveau de la recherche probatoire liée à l'absence de démonstration d'un lien de causalité certain entre la faute et le dommage, ce qui nous rapproche de la loi Fauchon. » Dans l'unique affaire qui a abouti à l'arrêt - attendu et très médiatisé - de la Cour de cassation du 15 novembre 2005, le juge d'instruction de Dunkerque avait rendu, le 16 décembre 2003, une ordonnance de non-lieu, sur une plainte déposée contre X le 27 février 1997, avec constitution de partie civile, de la part de plusieurs anciens salariés ou ayants droits de la société USINOR de Dunkerque. Cette ordonnance, fondée sur l'application de la loi dite « Fauchon » du 10 juillet 2000, a été confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai le 15 juin 2004, puis a fait l'objet d'un pourvoi en cassation des seules parties civiles. La Cour de cassation a jugé le 15 novembre 2005 que ce pourvoi était irrecevable en application de l'article 575 du code de procédure pénale358 , sans se prononcer sur la validité de l'arrêt attaqué, et contre l'avis de l'avocat général qui proposait de recevoir le pourvoi et de casser l'arrêt. Dans un communiqué de presse publié à la suite de cette décision, la Cour a souhaité relativiser la portée de sa décision : « (...) En rejetant ce pourvoi, la Chambre criminelle n'a porté aucune appréciation sur la valeur des charges réunies contre les mis en examen (...). Il n'est pas exclu que la chambre criminelle ait un jour à examiner un pourvoi formé contre une décision d'une juridiction de jugement qui apprécierait la valeur de charges constitutives d'une infraction pénale en matière d'exposition à l'amiante. Son contrôle serait alors d'une autre nature et permettrait de définir les conditions de la responsabilité pénale dans ce domaine. » La mission a pris acte de cette décision dans un communiqué de presse du 16 novembre 2005 en regrettant l'absence d'une décision sur le fond, qui aurait sans doute éclairé - comme le laisse entendre la Cour elle-même - l'ensemble des dossiers liés à des expositions professionnelles à l'amiante antérieures à 1997. Étant donné l'importance du problème, la mission a estimé nécessaire d'approfondir la question de la responsabilité pénale des employeurs dans les dossiers de l'amiante, et de mieux évaluer la portée et les incidences de la loi Fauchon. Par ailleurs, il est très clairement apparu à la mission que les dossiers pénaux de l'amiante faisaient écho au problème général du traitement pénal des affaires sanitaires, tel qu'il s'est déjà posé dans d'autres procès de santé publique (sang contaminé, « vache folle ») et tout particulièrement aux droits des victimes dans ces procédures. Considérant qu'il y avait peut-être un décalage entre les moyens des parties civiles et le rôle moteur qui est le leur dans les affaires de santé publique, elle a souhaité analyser leur place dans la procédure pénale et, notamment, la pertinence des limites posées par l'article 575 du code de procédure pénale. c) La condamnation de l'Etat par la justice administrative. La responsabilité de l'Etat dans les maladies de l'amiante a également été recherchée en raison de l'intérêt évident d'une telle reconnaissance pour les victimes, comme pour les entreprises. Pour les premières, l'affirmation de cette responsabilité, si elle ne permet guère d'espoir en matière d'indemnisation, constitue en revanche une garantie pour l'avenir en termes de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Pour les secondes, la responsabilité de l'Etat atténue, sinon supprime, leur propre responsabilité. Ce raisonnement a d'ailleurs été repris par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Douai pour fonder sa décision du 15 juin 2004359. Il n'est donc pas surprenant que le tribunal administratif de Marseille ait été saisi de quatre dossiers tendant à faire reconnaître la responsabilité de l'Etat. Le tribunal administratif a fait droit à cette demande dans quatre jugements du 30 mai 2000, confirmés par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 octobre 2001, puis par le Conseil d'Etat le 3 mars 2004360. Le motif principal de cette décision tient au rôle que l'Etat aurait dû jouer dans la prévention des risques liés à l'amiante. Comme l'a souligné, lors de son audition361, M. Jean-Michel Belorgey, président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat : « Avant même la décision du Conseil d'État, on a pris conscience, dans les milieux gouvernementaux, que l'État n'avait pas fait face à l'obligation qui est la sienne de réguler et d'encadrer la discipline que doivent observer les entreprises. Lorsque le Conseil d'État a eu à se prononcer, il n'y avait pas l'ombre d'un doute sur les atermoiements des pouvoirs publics. » Cette responsabilité « de principe » est selon le président Belorgey la raison d'être des dispositifs d'indemnisation exceptionnels mis en place en faveur des victimes de l'amiante : « il importait de permettre aux victimes d'être indemnisées sans ménager les efforts de l'État. C'était une question de paix sociale, peut-être. C'était aussi une question d'égalité devant les charges publiques. C'était, enfin, une question de dignité. » Confirmant l'arrêt du tribunal administratif de Marseille qui avait relevé « le retard fautif mis par l'Etat pour édicter des normes plus sévères quant à l'inhalation de fibres d'amiante en milieu professionnel362 », la décision du Conseil d'Etat s'appuie sur les carences de l'Etat dans le respect de ses obligations générales en matière de prévention des risques professionnels, et de surveillance sanitaire des salariés : « il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu'ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d'arrêter, en l'état des connaissances scientifiques, au besoin à l'aide d'études ou d'enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers ». Suivant les conclusions du commissaire du Gouvernement, Mme Prada-Bordenave, le Conseil a ainsi précisé l'étendue des responsabilités incombant à la puissance publique dans ces domaines. Le Président Belorgey, lors de son audition363, en a ainsi résumé l'économie : « [Le Conseil d'Etat] pense qu'il est de la responsabilité de l'État d'organiser des structures de prévention, de guider les entreprises dans l'exercice des disciplines dont elles sont comptables. L'État doit organiser la connaissance par le biais d'une expertise indépendante, l'information, et guider les entreprises réticentes à prendre les mesures nécessaires. » Ce « vaste programme » est essentiel. Il constitue l'une des principales leçons à tirer de l'amiante. C'est pourquoi la mission a consacré une grande part de ses travaux à l'évaluation du rôle et de l'action de l'Etat en matière de prévention des risques professionnels364. 2.- Les procès de l'amiante ont soulevé plusieurs questions juridiques de portée générale La mission a pu relever au fil de ses auditions que l'histoire de l'amiante posait, à bien des égards, des questions semblables à celles soulevées par d'autres drames sanitaires qui ont marqué les deux dernières décennies, tels que celui du sang contaminé, de l'hormone de croissance ou de la « vache folle ». De même que le sang contaminé a modifié en profondeur les perceptions sociales du risque sanitaire, la crise de l'amiante s'inscrit dans une époque où le regard sur le risque professionnel a changé : les méthodes de prévention usuelles paraissent surannées, la réparation du risque semble insuffisante, les mesures les plus rares, comme l'interdiction d'un produit, paraissent tardives et timorées. En même temps, la conscience du citoyen se développe ; il devient plus exigeant sur l'évaluation et sur le contrôle de l'application des règles. Plus généralement, la demande sociale de sécurité et de responsabilité face au risque sanitaire est plus forte. On peut apprécier cette évolution dans le rapport public du Conseil d'Etat pour 2005 : « Si le risque est inhérent à l'activité humaine et si le traitement juridique du risque n'est pas nouveau ainsi qu'en témoigne par exemple l'ancienneté de la législation sur les installations dangereuses, la notion de risque acceptable a changé alors même que dans la vie quotidienne la sécurité est souvent plus grande qu'auparavant. Le sentiment selon lequel tout dommage peut et doit être imputé à une personne, privée ou publique, et doit ouvrir droit à une indemnisation se généralise365. » De fait, le risque professionnel n'est plus perçu aujourd'hui comme une fatalité que la réparation mutualisée et forfaitaire suffit à réparer. Les tribunaux ont été les premiers réceptacles de ces évolutions. Au travers des demandes qui leur ont été adressées, ils ont pu évaluer le refus progressif du risque et de ses conséquences, et finalement y adapter leur jurisprudence. Cette adaptation jurisprudentielle du droit a elle-même suscité des mesures réglementaires ou législatives et, en matière de risques sanitaires, le retard qu'accusait la France au début des années 80 dans l'acquisition d'une culture de précaution, rendait ces « rattrapages » particulièrement indispensables. Le sang contaminé, l'hormone de croissance et la « vache folle » en animant les prétoires de tous les ordres de juridiction, ont ainsi conduit les pouvoirs publics à modifier substantiellement la prise en compte sociale du risque lié aux produits de santé ou aux produits de l'alimentation, notamment en créant des agences nationales pour sécuriser les chaînes de production et en développant une prévention plus précoce des risques. C'est cette même démarche qui a prévalu, et doit prévaloir, dans le dossier de l'amiante. Trois tendances se dégagent des décisions liées à l'amiante. Premièrement, la justice civile a suivi un large mouvement moderne d'amélioration de l'indemnisation des préjudices, en bouleversant sa jurisprudence en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Deuxièmement, le juge administratif a de nouveau contribué à la définition du rôle de l'Etat en matière de santé publique, en condamnant celui-ci pour ses carences dans l'organisation de la prévention. Enfin, la justice pénale s'est, elle aussi, inscrite dans l'évolution actuelle du rôle des victimes au pénal et du jeu des responsabilités en matière de délits non intentionnels. Ainsi, l'amiante a confirmé que le procès pénal en matière sanitaire est surtout le fait des parties civiles, pourtant défavorisées par les règles de la procédure pénale ; de même, l'évolution récente du droit pénal vers une moins grande sévérité en matière de délits non intentionnels a pleinement joué dans les affaires de l'amiante en particulier, et des accidents du travail et des maladies professionnelles en général. Ces solutions jurisprudentielles sont importantes parce qu'elles concernent des questions aussi sensibles que celle du rôle de l'Etat dans la prévention et dans la veille sanitaire - notamment au travail -, celle de la responsabilité civile et pénale de l'employeur et celle du traitement des victimes tant du point de vue de leur indemnisation que de celui de leur place dans la procédure pénale. Elles sont d'autant plus importantes que les régimes de responsabilité qu'elles retiennent s'appliquent désormais à des risques professionnels qui ont changé de nature : les accidents du travail ont quantitativement laissé place aux maladies professionnelles qui peuvent être multifactorielles ou résulter d'expositions à des produits de plus en plus nombreux et dont la dangerosité est mal connue. Si le rôle de l'Etat en matière de prévention trouve progressivement une réponse appropriée - encore insuffisante - à travers les mesures gouvernementales sur la santé au travail, les solutions jurisprudentielles relatives à la responsabilité civile et pénale des employeurs et au traitement des victimes soulèvent pour leur part de nombreuses questions. B.- UNE DÉFINITION JURISPRUDENTIELLE PRAGMATIQUE MAIS DÉSÉQUILIBRÉE DE LA FAUTE INEXCUSABLE Les modalités d'indemnisation des victimes de l'amiante ont bouleversé les règles applicables en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Si le législateur a entendu offrir aux victimes un dispositif d'indemnisation exceptionnel et spécifique366, le juge a, quant à lui, permis de contourner, quasi systématiquement, le régime légal de 1898, en redéfinissant la faute inexcusable de l'employeur. 1.- Le régime légal de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles : un régime juridique dérogatoire aux principes généraux de la responsabilité civile La réparation des préjudices nés du travail obéit à un régime spécifique, construit en marge des règles de droit commun de la responsabilité civile. Ce régime issu de la volonté conjointe des partenaires sociaux et du législateur à la fin du XIXème siècle devait faciliter la réparation et éviter le recours au juge en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle367. Eu égard à la spécificité des accidents du travail et des maladies professionnelles, deux questions traditionnellement posées au juge ont ainsi trouvé une réponse légale constante : Qui est le responsable du préjudice ? Comment ce préjudice doit-il être réparé ? Après avoir fait l'objet d'un compromis syndical en 1898 et d'une loi parallèle sur les accidents du travail - étendue en 1919 aux maladies professionnelles -, les réponses à ces deux questions reposent désormais sur trois piliers : - la présomption d'imputabilité : le lien du préjudice avec le travail n'a pas à être démontré. Le responsable, au sens du code civil, d'un accident survenu sur le lieu de travail, ou d'une maladie inscrite au tableau des maladies professionnelles est toujours réputé être l'employeur, sauf si la faute inexcusable de la victime est démontrée. - l'immunité civile de l'employeur : celui-ci ne peut être poursuivi, sauf s'il a commis une faute inexcusable. L'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale issue de la loi du 9 avril 1898368 prévoit que : « [à l'exception des cas où une faute inexcusable est reconnue] aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ». - la mutualisation de la réparation : en l'absence de faute délibérée d'une des deux parties, c'est l'assureur public qui répare le préjudice par le versement d'une réparation forfaitaire à la charge des caisses de sécurité sociale, elles-mêmes financées par les cotisations des employeurs. Le compromis de 1898 a donc construit un régime de responsabilité original et novateur en droit369, qui échappe largement au juge : les victimes n'agissent pas devant lui pour obtenir réparation de leurs préjudices, sauf lorsque la preuve d'une « faute inexcusable » a pu être établie par l'une ou l'autre partie. b) La définition de la faute inexcusable par le juge Ce régime juridique étant régi par le droit de la sécurité sociale, la juridiction de première instance appelée à connaître d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable est le tribunal des affaires de sécurité sociale370. En appel, puis en cassation, ces décisions sont soumises respectivement aux chambres sociales des cours d'appel et de la Cour de cassation. C'est par un arrêt des chambres réunies du 15 juillet 1941 (Dame Veuve Villa) que la Cour de cassation a défini pour la première fois les critères de la faute inexcusable. Il s'agit d'une « faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative ». Cette définition s'inscrivait dans la logique de la loi de 1898, selon laquelle la faute inexcusable sanctionnait un comportement exceptionnellement fautif devant conduire à une réparation également exceptionnelle. La Cour retenait trois critères cumulatifs de gravité pour caractériser la faute inexcusable : - la faute devait être délibérée, même sans intention de nuire ; - le danger causant le préjudice devait être connu du fautif, ou aurait dû l'être, compte tenu de ses pouvoirs, moyens, et missions ; - rien ne justifiait de prendre le risque encouru. En pratique, compte tenu de la rigueur de cette définition, peu de comportements étaient susceptibles de constituer une faute inexcusable, et pendant des décennies celle-ci est restée très peu utilisée par le juge. Ce constat concerne les accidents du travail, dont le lien avec le travail n'est pas discutable, mais dont la causalité contient souvent une part d'aléa matériel imprévisible. Mais il se vérifie surtout dans la jurisprudence relative aux maladies professionnelles, lorsque la causalité multifactorielle et les délais de latence rendent la gravité de la faute - mais plus encore la conscience du danger que devait avoir le fautif -, difficiles à établir371.
Si la faute inexcusable du salarié est reconnue, ses demandes de réparation sont rejetées. Au contraire, lorsque le juge reconnaît que l'employeur a commis une faute inexcusable, il lui revient d'en tirer les conséquences, telles qu'elles résultent du droit de la sécurité sociale, selon lequel « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire (...) » (article L. 452-1). Cette majoration prend la forme d'un doublement de la réparation forfaitaire des préjudices reconnus (les deux parties n'étant plus présumées responsables à parts égales du dommage), ainsi que la réparation de chefs de préjudice exclus du régime forfaitaire (préjudices extrapatrimoniaux notamment)372. Cette majoration est financée par une surcotisation de l'employeur373. L'appréciation du caractère inexcusable de la faute par le juge revêt donc une importance capitale pour l'indemnisation de la victime : d'une part, elle renoue le lien entre la faute et le dommage, et d'autre part elle permet de rapprocher le montant de la réparation du préjudice de celui des indemnisations de droit commun. Jusqu'en 2002, l'incidence ainsi rétablie entre la responsabilité et l'indemnisation était finement appréciée par le juge, dont la jurisprudence constante prévoyait une minoration de la réparation des préjudices de la victime dans deux hypothèses : - lorsque la gravité de la faute inexcusable, quoique « exceptionnelle » - lorsque la faute inexcusable de l'employeur, bien qu'étant la cause déterminante du dommage, s'accompagnait également d'une faute de la victime. Ces hypothèses confirment que, malgré le caractère volontairement dérogatoire du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles, le lien entre la faute et la réparation des préjudices n'a jamais véritablement disparu des préoccupations du juge. C'est en s'appuyant sur ce lien que la chambre sociale de la Cour de cassation a opéré un revirement en jurisprudence lorsqu'il lui est apparu que la réparation forfaitaire des maladies liées à l'inhalation de fibres d'amiante était en décalage avec les formes modernes de l'indemnisation des préjudices corporels : afin d'améliorer le montant de la réparation, le juge a facilité la mise en cause de la responsabilité de l'employeur par une redéfinition a minima des critères de la faute inexcusable. 2.- La redéfinition jurisprudentielle de la faute inexcusable : le manquement à « l'obligation de sécurité de résultat » de l'employeur a) Un objectif de meilleure indemnisation des préjudices liés à l'amiante « Le système issu de la loi de 1898, de la création de la sécurité sociale et des réformes successives de celle-ci, ne permettait guère de gérer les conséquences de ce drame »374 : tel est le constat qui, selon son président actuel, M. Pierre Sargos, a conduit la Chambre sociale de la Cour de cassation à revoir les critères de la faute inexcusable, dans plusieurs arrêts rendus le 28 février 2002 sur des dossiers relatifs à l'amiante. Ainsi que de nombreux témoins l'ont confirmé, ce revirement de jurisprudence a d'abord été une décision pragmatique, dictée par un objectif de meilleure indemnisation des victimes375. Les malades de l'amiante ou leurs ayants droits ont porté devant la justice sociale un contentieux spécifique que le président Sargos a ainsi décrit2 : « il est rapidement apparu que nous étions face à une situation très différente du contentieux classique des accidents du travail et maladies professionnelles, de par la masse d'affaires, de par l'effet retard dans l'apparition des maladies, et aussi de par le fait que l'ensemble des acteurs du monde du travail - avec une plus grande responsabilité du côté des employeurs - avaient manifestement occulté un risque qui était connu depuis très longtemps. » Par ailleurs, les tribunaux ont été saisis des dossiers de l'amiante à un moment « charnière » dans la prise en compte sociale du risque sanitaire. Ces dossiers étaient portés par des acteurs qui, en dépit des difficultés juridiques soulevées, croyaient la justice capable de corriger ce qu'ils considéraient comme un décalage historique. « Avec l'amiante, alors même que, paradoxalement, les pathologies qui en résultent ne sont pas véritablement visibles, on a amené sous le nez des magistrats des personnes atteintes de mésothéliomes, avec leur bouteille d'oxygène à la main et des tuyaux directement reliés aux poumons, bref, la réalité des souffrances de ces victimes. Cela explique que nous ayons pu gagner en dépit des difficultés juridiques, et même conceptuelles, que pose la notion de faute inexcusable avec la question, fondamentale, de la conscience du danger : connaissait-on tous les dangers de l'amiante dans les années 60 ? (...) Quand vous êtes victime d'un accident de la circulation, vous êtes intégralement indemnisé, alors que quand vous êtes victime d'un accident du travail, vous êtes indemnisé forfaitairement, sauf en cas de faute inexcusable... C'est insensé. Ce qui était une bonne solution il y a cent ans est désormais en total décalage avec la réalité. »376 La chambre sociale de la Cour de cassation a finalement retenu cette approche pragmatique, tout en consacrant une solution juridique qui s'inscrit dans la logique de l'évolution du droit de la responsabilité. b) L'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. Comme l'a encore rappelé le président Sargos377, « les juges se sont rendu compte que cette définition [de la faute inexcusable] était de moins en moins raisonnable au regard de l'insuffisance de la réparation, mais aussi au regard de l'évolution du droit de la responsabilité contractuelle. Celui-ci a vu se dégager (...) le concept d'obligation de sécurité de résultat, qui a abouti à une responsabilité de plein droit en cas d'atteinte à la sécurité, dont il n'est possible de s'exonérer que par la preuve de la force majeure. Le droit commun de la responsabilité contractuelle était donc devenu infiniment plus protecteur que le mécanisme de réparation, également contractuel, de la faute inexcusable en droit des accidents du travail. » La Cour de cassation a ainsi consacré une responsabilité contractuelle étendue de l'employeur, dont le législateur avait déjà affirmé le principe et la portée en application d'une directive européenne, transposée par la loi du 31 décembre 1991378. Ces principes sont aujourd'hui codifiés aux articles L 230-2 et suivants du code du travail. Directive du Conseil de l'Union européenne du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (extraits) Considérant que les employeurs sont tenus de s'informer des progrès techniques et des connaissances scientifiques en matière de conception des postes de travail, compte tenu des risques inhérents à leur entreprise, et d'informer les représentants des travailleurs exerçant leurs fonctions de participation dans le cadre de la présente directive, de façon à pouvoir garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs; (...) Article 5 -Disposition générale 1. L'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail. 2. Si un employeur fait appel, en application de l'article 7 paragraphe 3, à des compétences (personnes ou services) extérieurs à l'entreprise et/ ou à l'établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine. 3. Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de la responsabilité de l'employeur. (...) Article 6 - Obligations générales des employeurs 1. Dans le cadre de ses responsabilités, l'employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens nécessaires. L'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Code du travail français : Art L. 230-2 : I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. [...] Art. L. 230-3 : Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ou le chef d'établissement, dans les conditions prévues, pour les entreprises assujetties à l'article L. 122-33 du présent code, au règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Art L. 230-4 : Les dispositions de l'article L. 230-3 n'affectent pas le principe de la responsabilité des employeurs ou chefs d'établissement. Il appartenait au juge de préciser la nature de cette obligation mais celle-ci « ne faisait pas de doute, dès lors que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail entraîne de plein droit l'indemnisation du salarié, sans que soit recherchée l'éventuelle faute de l'employeur, la seule cause d'exonération étant la preuve de ce que l'accident a eu une cause entièrement étrangère au travail. On reconnaît là la caractéristique de l'obligation de résultat. Et il en va de même en matière de maladie professionnelle, l'indemnisation étant de droit dès lors que celle-ci est reconnue. » 379 Ce raisonnement a été confirmé par le président Sargos380, selon lequel : « nous avons décidé de mettre un terme à la jurisprudence Dame Veuve Villa et de raisonner sur le concept de responsabilité contractuelle en imposant à l'employeur une obligation de sécurité de résultat. Celle-ci ne résulte pas d'une invention de notre part. La directive européenne pose des exigences en matière de prévention qui aboutissent à une véritable obligation de sécurité de résultat, dont il n'est possible de s'exonérer que par la preuve de la force majeure. » La « faute inexcusable » est donc aujourd'hui définie comme le manquement à une obligation de sécurité de résultat. Celle-ci diffère de l'obligation stricto sensu de résultat, dont, seule, la preuve de la force majeure permet de s'exonérer. L'obligation de sécurité de résultat met l'employeur en devoir de prendre toutes les mesures permettant d'éviter la réalisation d'un risque qu'il doit connaître. Ces mesures décrites en termes généraux dans le code du travail doivent faire l'objet de toutes les adaptations nécessaires en fonction du risque. « Pour schématiser, il y a désormais faute inexcusable, dès lors qu'il est établi que l'employeur avait conscience du danger - cette conscience étant appréciée de façon objective par rapport à un employeur normalement diligent - et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité du salarié.381 » Dans ce même mouvement jurisprudentiel, et sur le fondement de la même analyse, la chambre sociale de la Cour de cassation a également mis fin à la possibilité d'invoquer la gravité relative de la faute de l'employeur ou l'existence d'une faute simultanée non déterminante de la victime pour atténuer la portée de la faute inexcusable. Ces circonstances sont en effet désormais sans incidence sur les éléments constitutifs du manquement à l'obligation de sécurité de résultat 3.- Le rééquilibrage de la faute inexcusable et de l'immunité civile de l'employeur : une intervention souhaitable du législateur La jurisprudence de la Cour de cassation a fait l'objet d'un double consensus de la part des témoins383 que la mission a consultés. Ils ont estimé qu'elle avait permis d'améliorer l'indemnisation des victimes de l'amiante - ce qui était indispensable au regard des limites de la réparation forfaitaire - mais ils ont considéré que cette nouvelle définition de la « faute inexcusable » ne pouvait perdurer en droit. a) Une jurisprudence d'opportunité dont les justifications indemnitaires devraient disparaître. Le président Sargos a expliqué à la mission1 dans quel état d'esprit les décisions du 28 février 2002 avaient été prises. Il a notamment souligné la fragilité du revirement jurisprudentiel sur le plan strictement juridique, et encouragé le législateur à redonner sa cohérence au régime applicable aux employeurs : « L'apport essentiel de ce revirement jurisprudentiel est de faciliter la démonstration de la faute inexcusable, mais sur un substrat de responsabilité de plein droit, issu de la reconnaissance de l'obligation de sécurité de résultat, qui est en droit assez artificielle. Cette construction a été acceptée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 24 juin 2005, qui a statué exactement dans les mêmes termes. Mais, sans trahir ce qui a été dit en délibéré, nous avons parfaitement conscience qu'il y a là un certain artifice juridique, qui était nécessaire pour résoudre ce drame épouvantable. Je crois que c'est l'office du juge que d'adapter, avec les armes relativement souples qu'il a à sa disposition, ses interprétations jurisprudentielles au regard de situations dramatiques, telles que celles qui sont issues de l'affaire de l'amiante. (...) la nouvelle jurisprudence a permis de résoudre dans l'urgence les problèmes nés du drame de l'amiante, et a répondu à la nécessité d'assurer une meilleure réparation. Mais il y a une part d'empirisme dans cette construction juridique. Il n'est pas tout à fait normal que pour arriver à une réparation aussi élémentaire que celle des troubles dans les conditions d'existence, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique dans certains cas, du préjudice moral entendu d'une façon large, il faille passer par la démonstration de la faute inexcusable de l'employeur. On peut donc se demander si une intervention du législateur n'est pas nécessaire.» La mission s'est donc interrogée sur la pertinence d'une intervention législative en la matière. En effet, l'objectif initial de la jurisprudence de 2002 L'intervention du législateur est bien entendu subordonnée à un accord des partenaires sociaux sur les modalités d'une réparation plus satisfaisante dans le cadre de la branche AT-MP385, intégrant notamment la réparation des préjudices évoqués par le président Sargos. La loi pourrait alors redéfinir la faute spécifique dont serait justiciable l'employeur devant les tribunaux et restaurer son caractère d'exception face à un régime d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui redeviendrait principalement non contentieux. b) Distinguer le manquement à l'obligation de sécurité de résultat de la faute inexcusable de l'employeur L'intervention du législateur devra également tenir compte des évolutions du droit de la responsabilité contractuelle de l'employeur. Rien ne semble justifier, en effet, de revenir sur des principes modernes qui ont, de surcroît, une valeur communautaire. L'obligation générale de sécurité de résultat de l'employeur dans le domaine de la santé au travail est maintenant acquise, mais les manquements à cette obligation doivent à l'avenir être distingués selon qu'ils engagent individuellement et judiciairement la pleine et entière responsabilité de l'employeur, ou selon qu'ils conduisent à une réparation mutualisée. Maître Jean-Paul Teissonnière a ainsi résumé cet appel au législateur1 : « La Cour de cassation a finalement banalisé la faute inexcusable, afin de rendre la réparation automatique mais en se servant des outils qui sont les siens. Le Parlement en a d'autres, qui permettraient de mieux résoudre le problème. » Ainsi, les accidents du travail et maladies professionnelles, dès lors qu'ils constituent automatiquement des manquements à l'obligation légale de sécurité de résultat des employeurs - c'est-à-dire que la preuve est faite que le risque était connu ou aurait dû l'être, et que toutes les précautions n'ont pas été prises -, doivent conduire à une réparation mutualisée plus complète - et socialement plus acceptable - des préjudices du travailleur, mais non contentieuse, conformément au droit de la sécurité sociale386 : la réparation mutualisée est le principe et le contentieux, fondé sur la faute inexcusable, l'exception. Maître Michel Ledoux en a d'ailleurs attesté le bien fondé387 : « La faute inexcusable est effectivement, en principe, quelque chose d'exceptionnel : elle désigne un cas où l'employeur n'a pas fait son travail d'employeur. Or bon nombre d'accidents du travail ne sont pas provoqués par un mauvais employeur, mais par une méconnaissance de certains risques, par des « angles morts » dans la réglementation ou la prévention, et même parfois par des événements totalement imprévisibles ». c) Requalifier la faute inexcusable de l'employeur : un impératif d'équité La mission a estimé que les manquements à l'obligation de sécurité de résultat388 doivent se distinguer de la faute grave qui doit perdurer et conserver sa force en droit. Comme le souligne le Conseil d'Etat lui-même389 : « la socialisation du risque n'implique pas de fait la disparition de la notion de faute, ni celle de responsabilité. Elle répond, souvent, à un besoin d'indemnisation rapide de la victime, sans exclure les actions récursoires contre les auteurs du dommage. Sous peine de déresponsabilisation, la question se pose plus généralement de la place que doit garder ou reprendre la responsabilité dans les systèmes de couverture de risques. » Comme l'a souligné M. Desriaux, président de l'ANDEVA390, « De la jurisprudence issue des arrêts de février 2002, il ressort que l'on ne sanctionne pas une faute, mais que l'on indemnise une personne qui a subi un dommage. » La mission préconise donc d'établir une distinction dans les comportements fautifs de l'employeur, afin de corriger « une distorsion, qui n'est effectivement pas très heureuse, entre la force du terme « faute inexcusable » et la réalité qu'elle désigne »391. Puisqu'il y a manquement (fautif ou non) à l'obligation de sécurité de résultat dès qu'il y a accident ou maladie professionnelle, mais que ce manquement donne lieu à une réparation mutualisée non contentieuse, il convient de redéfinir les bases d'une faute qui justifierait un retour aux règles de la responsabilité individuelle du droit commun. Ce concept de faute d'une telle gravité qu'elle replace le fautif devant son devoir individuel de réparation des dommages présente plusieurs mérites, dont de nombreux témoins ont souligné l'importance. ● Le maintien d'un lien judiciaire entre les plus fautifs et leurs victimes. L'avocat Jean-Paul Teissonnière a insisté sur le rôle de la faute inexcusable dans le système légal de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles392 « [La faute inexcusable] a incontestablement, à un moment donné, joué un rôle positif dans l'affaire de l'amiante en apportant aux victimes une satisfaction morale, du fait de sa connotation stigmatisante. La réparation intégrale rendant inutile la faute inexcusable, comment, effectivement, retrouver cette compensation morale (...) ? Toute la problématique est là. (...) La notion de faute inexcusable est totalement liée au principe du partage de la responsabilité, dont il nous faut désormais sortir. Tout le problème sera, effectivement, ensuite de « rattraper les bons côtés » de la faute inexcusable... ». Maître Michel Ledoux a également souligné l'importance pour les victimes du lien judiciaire avec le fautif : « Beaucoup de victimes tiennent absolument à faire reconnaître la responsabilité de leur employeur. Or la faute inexcusable présente cette caractéristique d'être à la fois une procédure civile d'indemnisation et une sanction : avant 1976, les entreprises ne pouvaient pas s'assurer contre les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur. Elles devaient payer les dommages et intérêts sur leur trésorerie propre. Autrement dit, la faute inexcusable ne se résume pas à une banale procédure d'indemnisation ; aux yeux de nombre d'employeurs, c'est même un gros mot. Et pour bien des salariés, c'est un moyen d'individualiser, de montrer du doigt l'entreprise fautive, condamnée à indemniser celui qu'elle a rendu malade. Bon nombre de victimes y tiennent absolument, quitte à perdre du temps. » M. Franck Gambelli, président de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la CNAMTS, a également confirmé le rôle de la sanction : « Le terme même de « faute inexcusable » revêt un fort caractère afflictif et moral. Le fait de le banaliser me semble grave. Dans certains cas, il y a coïncidence entre le caractère afflictif de la notion et la réalité des faits. » Ainsi, même si le principe d'indemnisation non contentieuse semble devoir être maintenu, il convient également de conserver la possibilité d'une action en justice pour les victimes de comportements particulièrement fautifs. ● L'équité entre les entreprises. La banalisation de la faute inexcusable est également préjudiciable au respect de l'équité entre les entreprises. Les employeurs financent la branche AT-MP de la sécurité sociale et doivent assurer collectivement non pas la faute mais le risque. L'absence de sanction spécifique des comportements les plus fautifs génèrerait de fortes inéquités, d'une part entre les secteurs les plus porteurs de risques et les autres et, d'autre part, entre les entreprises les plus vertueuses et celles qui le sont moins. Une objection a toutefois été avancée à l'encontre du maintien, en droit, d'un manquement plus grave que celui entraînant l'indemnisation par la branche AT-MP : « si l'on veut maintenir une pression sur l'employeur au moyen de la notion de faute inexcusable, il faut bien que cette faute inexcusable, nouvellement définie, permette d'aboutir à un complément de réparation. Si la réparation est déjà intégrale, on ne peut pas ajouter une réparation supplémentaire (...). »393 En effet, si l'intervention du législateur est subordonnée à l'amélioration de la réparation non contentieuse des préjudices par la sécurité sociale, quelle peut être la conséquence de la condamnation prononcée contre l'employeur coupable d'une « faute inexcusable » redéfinie ? Sur ce point, la mission a été séduite par la proposition de M. Marcel Royez (FNATH)394 : « On peut fort bien imaginer que la faute inexcusable ne donne pas lieu à un complément d'indemnisation mais à une sanction financière de l'entreprise, sanction qui pourrait alimenter le système. » Il lui a semblé que le principal attrait d'une telle sanction - proche de l'amende - serait de contribuer à une meilleure responsabilisation des acteurs. d) La responsabilisation des acteurs par la sanction La sanction peut générer préventivement, chez les employeurs, des comportements individuels vertueux dont la logique de mutualisation tend à minorer les mérites, alors même que la responsabilisation de chacun est capitale au plan collectif. A cet égard, le maintien dans l'édifice de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles d'un « étage contentieux », fondé sur la reconnaissance d'une faute réellement inexcusable, permettrait de corriger l'effet pervers de la mutualisation, que la mission souhaite par ailleurs maintenir, comme tous les témoins entendus. D'abord, le financement de la réparation est un élément important de la responsabilisation préventive des acteurs. En complément d'une modulation de la tarification de la branche AT-MP de la sécurité sociale, la possibilité d'un contentieux comportant un risque financier pour l'entreprise est de nature à responsabiliser l'employeur. Au demeurant, cette dimension, qui figurait dans la logique du système de 1898, a peu ou prou disparu, malgré la nouvelle définition de la faute inexcusable, à cause d'un problème de procédure, ainsi que l'a expliqué maître Jean-Paul Teissonnière395 : « Le problème est que si la Cour de cassation a largement ouvert les portes de l'indemnisation des victimes grâce à la faute inexcusable, elle a, dans le même temps, durci les conditions d'opposabilité de la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles aux entreprises (...) De ce fait, la généralisation de la faute inexcusable n'est pas supportée financièrement par les employeurs responsables, mais par la branche « accidents du travail - maladies professionnelles » (AT-MP). Paradoxalement, les victimes de l'amiante en France, tous systèmes d'indemnisation confondus, sont probablement celles qui, dans le monde, bénéficient des meilleurs conditions d'indemnisation, alors même que nous sommes le pays dans lequel la catastrophe de l'amiante a coûté le moins cher à ses responsables, la sécurité sociale ayant finalement servi d'amortisseur. Cette distorsion des règles a pu donner lieu à des situations regrettables, comme en témoigne l'exemple présenté par maître Teissonnière : « Le cas d'Eternit est à cet égard particulièrement choquant. Les maladies professionnelles en question étant reconnues depuis longtemps, l'entreprise payait des surcotisations assez élevées. Arrivent les procès en faute inexcusable ; Eternit est condamnée, mais en même temps, son avocat (...) va très astucieusement démontrer, dossier après dossier, que la caisse a oublié, à un moment donné, de notifier à l'employeur qu'elle allait, par exemple, prendre sa décision dans les trois jours afin qu'il lui transmette au plus vite ses éventuelles observations... Même si, dans la plupart des cas, il s'agissait de mésothéliomes, d'asbestoses caractérisées ou de plaques pleurales qui n'appelaient rigoureusement aucune observation, la sécurité sociale avait manqué à une obligation formelle. De ce fait, les tribunaux, tout en reconnaissant la faute inexcusable d'Eternit, ont déclaré le jugement non opposable dans la mesure où le processus de reconnaissance de la maladie professionnelle avait été vicié. Au final, après plusieurs centaines de procès en faute inexcusable, Eternit a eu beau jeu, sur cette base, de faire remarquer à la sécurité sociale qu'on l'avait tarifée depuis des années sur des centaines de maladies professionnelles déclarées non opposables, autrement dit qu'on l'avait surtarifée à tort ! Tant et si bien que, l'année dernière ou il y a deux ans, Eternit a reçu de la sécurité sociale un chèque fantastique en remboursement de surcotisations indues... » Afin de maintenir une pression financière, la mission préconise, en conséquence, le maintien d'une procédure contentieuse, dans les cas où la faute de l'employeur le justifie, afin que celui-ci soit le débiteur de la collectivité et le cas échéant de l'assureur public, et non le contraire. Dans le même esprit, il a semblé à la mission que le risque de sanction financière individualisée doit être le complément indispensable de la réparation mutualisée si l'on veut développer la prévention. M. Franck Gambelli a insisté sur cet aspect396 : « Il arrive que des employeurs commettent une vraie faute inexcusable. Mais dans d'autres entreprises, l'automaticité de la faute inexcusable conduit les employeurs à ne plus comprendre l'intérêt de mettre en œuvre des politiques de prévention. Car, quel que soit leur niveau d'engagement dans la prévention, la faute inexcusable est systématiquement au bout de chemin. Il faudra donc bien, un jour, redéfinir cette notion de faute inexcusable, de façon que soient sanctionnés ceux-là seuls qui en ont vraiment commis une. » Il importe donc de maintenir une sanction spécifique des comportements les plus fautifs pour que l'objectif de prévention assigné aux entreprises soit attractif à la fois dans le domaine de la tarification et dans celui de la sanction. Si la condition préalable de l'amélioration sensible de la réparation mutualisée et non contentieuse servie par la branche AT-MP est assurée, la mission préconise que le législateur modifie le code du travail et celui de la sécurité sociale, afin d'y affirmer (ou réaffirmer) trois principes : 1/ La « faute inexcusable » de l'employeur est définie comme une faute d'une gravité particulière, qui se définit par une méconnaissance injustifiée du risque ou par une négligence, une imprudence, ou une absence particulière de mesures de protection adéquates contre ce risque. Cette faute met l'employeur en devoir de rembourser la réparation de ses conséquences dommageables aux caisses de sécurité sociale, et l'oblige à verser une cotisation exceptionnelle proportionnée à la gravité de la faute qu'il a commise. 2/ Les autres manquements, avérés ou réputés, à l'obligation de sécurité de résultat consacrée par le code du travail et le droit communautaire, ouvrent droit à une réparation dans le cadre de la sécurité sociale. Aucune action en réparation des dommages survenus du fait de ces manquements ne peut-être exercée, sauf à démontrer la faute inexcusable de l'employeur dans sa nouvelle définition. 3/ Quelle que soit la cause des prestations servies à une victime par les caisses d'assurance maladie au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles - faute inexcusable de l'employeur ou non -, la caisse a l'obligation d'en rechercher le financement auprès de l'employeur ou du chef d'établissement responsable du dommage. Ce financement est soit une surcotisation, soit - en cas de faute inexcusable - le remboursement des sommes versées en réparation, majoré de la cotisation exceptionnelle. Propositions : - Réaffirmer le principe général d'une indemnisation non contentieuse des accidents du travail et maladies professionnelles et revenir à une immunité civile de principe pour les employeurs afin de restaurer la logique du compromis de 1898. - Redéfinir, en lieu et place de la « faute inexcusable » dans le droit de la sécurité sociale, une faute « d'une particulière gravité », dont l'employeur serait justiciable devant les tribunaux et qui entraînerait une sanction financière complémentaire de la réparation en faveur de la branche AT-MP, afin de conserver la possibilité de poursuivre les employeurs vraiment fautifs. - Renforcer l'obligation faite aux caisses de sécurité sociale de responsabiliser, par la modulation de la cotisation ou la recherche de la sanction individuelle, les établissements générateurs d'accidents ou de maladies professionnels afin de corriger les effets déresponsabilisants de la mutualisation. C.- LA PLACE DES PARTIES CIVILES DANS LA RECHERCHE DES RESPONSABILITÉS PÉNALES EN MATIÈRE DE RISQUES PROFESSIONNELS « Dans l'évolution récente vers une plus grande socialisation du risque, les frontières entre la responsabilité fondée sur la faute et la responsabilité sans faute se sont déplacées. Dans le même temps, on assiste, paradoxalement, à une recherche croissante des responsabilités personnelles, pénales en particulier. À la réparation civile s'ajoute souvent l'action pénale, avec l'idée de punition qu'elle suppose. » Ce constat dressé par le Conseil d'Etat397 se vérifie particulièrement dans les affaires liées à l'amiante à l'occasion desquelles les revendications des victimes et de leurs associations ont été fortement médiatisées, notamment au cours de l'année 2005. Des témoignages reçus par la mission, il ressort que l'incompréhension exprimée, parfois violemment, par les victimes tient en partie aux règles de procédure pénale, qui paraissent mal adaptées à l'accroissement des actions en recherche de responsabilité auxquelles se livrent les victimes, surtout lorsque la réparation de leurs préjudices est « socialisée », comme c'est le cas pour les dommages liés à l'amiante. 1.- La recherche croissante de la responsabilité pénale : une démarche compréhensible et nécessaire a) Les régimes modernes de réparation incitent les victimes à rechercher la responsabilité pénale Comme on l'a déjà indiqué, les auditions de la mission ont très majoritairement souligné le besoin des victimes de nouer un lien avec l'auteur du dommage et de faire la lumière sur les causes d'un préjudice. M. Robert Finielz, avocat général près la Cour de cassation dans l'affaire de Dunkerque, a fait part à la mission de son expérience en ces termes398 : « Dans ce dossier, j'ai été étonné par la retenue des victimes. Elles veulent savoir pourquoi c'est arrivé et s'il y a des fautes, et elles veulent aussi que cela fasse l'objet d'un débat public. De telles demandes ne sont pas scandaleuses. Dans ces affaires, les poursuites pénales constituent un enjeu important dans lequel la justice a un rôle à jouer en termes de politique. Il ne faut pas croire que poursuivre, c'est perdre son temps. C'est, au contraire, affirmer certaines choses qui sont fondamentales pour notre société. » Le sénateur Pierre Fauchon a également insisté sur le rôle de la justice pénale399 : « Les victimes ont un peu tendance à confondre réparation civile et condamnation pénale. Les médias aidant, elles cherchent souvent à ce que les responsables soient marqués au fer rouge, pour l'effet d'exemplarité - de ce point de vue, elles n'ont pas tout à fait tort. (...) Je comprends donc l'exaspération et la douleur des victimes de l'amiante, qui attendent une audience publique sur ce drame, en présence de la presse : cette affaire, peut-être une des plus terribles que notre génération ait connue, doit aller devant une juridiction du fond. » La mission a en effet été attentive aux demandes des victimes qui se sont exprimées dans un contexte social et politique marqué par de graves questions sur le rôle et le fonctionnement de la justice pénale. Au jour de l'adoption du présent rapport, les travaux de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'affaire d'Outreau400 montrent clairement que les interrogations des victimes de l'amiante sur l'instruction de leurs plaintes, ou leur place dans la procédure pénale, sont loin d'être isolées. La mission n'a donc pas sous estimé l'importance de la question pénale, même - et surtout serait-on tenté de dire - sur des sujets où la réparation des dommages échappe aux juridictions. Elle a rejoint en ce sens la position développée par le Conseil d'Etat dans son rapport public pour 2005401, qui s'attache à montrer à quel point la socialisation du risque génère en elle-même un report des enjeux des victimes sur la justice répressive. « La socialisation des risques, et notamment l'extension de la responsabilité sans faute, ne fera pas disparaître la responsabilité pour faute. Certes, on peut, dans une analyse maximaliste, considérer que le maintien de la notion de responsabilité qui suppose un auteur, une victime et un dommage mesurable pendant une période limitée devient problématique quand les dommages sont multiples, les acteurs nombreux, et que le risque de masse se développe. Mais la propension à demander réparation s'accompagne du besoin de trouver un responsable. On assiste même à une recrudescence de la recherche de la responsabilité pénale. (...) Beaucoup ont tendance à considérer que la pleine réparation de leur préjudice exige non seulement l'indemnisation des dommages matériels, corporels ou moraux qu'ils ont subis, mais également la condamnation pénale de l'auteur de l'infraction. L'action pénale, plus que l'action civile, répond au désir de sanctionner le coupable. (...) La voie pénale présente l'avantage déterminant que le juge pénal dispose de pouvoirs d'investigation étendus. » M. Jean-Claude Muller, directeur santé et sécurité de l'entreprise Arcelor a présenté les employeurs poursuivis dans les informations ouvertes à Dunkerque comme des victimes402 : « Les victimes, sont aussi les personnes qui sont traînées en justice sur de faux principes. On est en train d'ouvrir la boîte de Pandore en accusant un grand nombre de personnes d'avoir volontairement contaminé leurs collaborateurs. (...) Aujourd'hui, comme au Far West, il faut trouver quelques personnes à pendre. (...) Je suis heureux qu'il ait été mis un terme à cette procédure [celle qui a abouti à l'arrêt de la Cour de Cassation du 15 novembre 2005] qui aura duré neuf années pendant lesquelles ces braves gens, mis hors de cause en correctionnelle et en appel, ont eu à subir des auditions au tribunal, alors qu'ils sont à la retraite depuis quinze ans. » Ce témoignage reste isolé, et, en tout état de cause, la mission est parfaitement consciente qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence des personnes mises en cause. Aussi s'est-elle ralliée à la position exprimée par M. Finielz concernant les devoirs de la justice envers les victimes403 : « Dans mes réquisitions, je ne cherche pas de coupable. Il faut qu'un processus judiciaire aboutisse à un procès, à l'issue duquel un jugement sera rendu et une décision sera prise. Les personnes seront ou ne seront pas contentes, mais la justice aura fait son travail. On ne peut pas lui demander plus. Mais encore faut-il qu'elle fasse ce travail. » La mission a pu mesurer au cours de ses travaux à quel point le lien contentieux avec le responsable présumé des dommages est effectivement important pour les victimes. À cet égard, le « parcours » indemnitaire d'une victime de l'amiante peut effectivement lui sembler désincarné. La création du FIVA lui offre un guichet dédié, animé par des acteurs compréhensifs, voire compatissants, dont le travail est optimisé pour offrir rapidement à la victime une indemnisation confortable404. Mais dans la logique du fonds, seuls vont compter les préjudices de la victime, leur réalité, et leur gravité. De faute ou de responsable, il ne sera pas question et le financement du FIVA par la branche AT-MP impose une distance entre l'indemnisation et le fautif encore plus importante que dans le schéma classique de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles. Il est certain que l'engagement d'actions récursoires par le fonds serait de nature à satisfaire, par procuration, le besoin des victimes d'identifier un coupable. Mais, ces actions ne sont pas engagées, comme on l'a vu. b) Une action pénale nécessaire et fondée « Je crois qu'une confusion a été faite. De manière inconsciente, on a pu être amené à se dire que, puisque les victimes allaient être indemnisées ou étaient susceptibles de l'être, elles n'avaient plus rien à faire dans un procès pénal. C'est ne pas tenir compte du découplement de la faute pénale et de la faute civile et c'est grave de conséquences. Pourrait-on dire à une personne dont l'enfant a été tué dans un accident de la circulation, que dans la mesure où la compagnie d'assurances a pris en charge le préjudice, elle n'a pas à porter plainte ? » Cette interrogation de l'avocat général Robert Finielz1 témoigne de la légitimité de l'action pénale des victimes, au-delà même de la recherche de la punition. Ainsi de nombreux témoins entendus par la mission ont-ils développé l'idée selon laquelle la justice pénale poursuit des buts qui transcendent la répression. Mme Bertella-Geoffroy, coordonnatrice du pôle santé de Paris pour le siège, a même inscrit l'action répressive dans une démarche de reconstruction des victimes405 : « Lorsque la perte est irréparable, comme le décès d'un proche, la justice a une place certaine, grâce à l'instruction qui peut faire la transparence sur la chaîne des causes ayant abouti aux dommages, même si aucun procès ne s'en suit. [...]L'indemnisation ne peut tenir lieu de justice, et je regrette que nous nous orientions vers une société assurancielle : on indemnise et on oublie la responsabilité ; c'est le problème des fonds d'indemnisations. Il faut, au contraire, que les victimes puissent nouer un lien contentieux avec celui qu'elles accusent. La justice devrait être « reconstructrice » et non « distributive ». Il s'agit moins de distribuer des indemnisations ou des peines que de permettre aux victimes de se reconstruire. » Au-delà même des enjeux individuels de l'action pénale, la mission estime que la justice répressive poursuit des objectifs collectifs sociaux ou moraux, qui justifient la recherche des responsabilités en matière de risques professionnels en général, et dans les affaires de l'amiante en particulier. Certains témoignages ont présenté la justice pénale comme une véritable instance de prévention du risque, grâce à la stigmatisation de la faute. C'est en particulier le cas du sénateur Fauchon406, qui pense que la sanction de l'imprudence incite à la prudence. Mais aussi de l'avocat général Robert Finielz qui place la recherche de la faute au cœur de la maîtrise du risque407 : « Si, parce que les victimes sont indemnisées, on considère que leur prise en charge par la société, ou que la socialisation du risque, constitue un motif de ne pas poursuivre, où va-t-on ? Au contraire, plus on fait prendre en compte, au plan civil, les conséquences du risque par des personnes qui ne sont pas à l'origine de ce risque, plus il faut rechercher, sur le plan pénal, s'il y a eu faute. Sinon chacun pourra tout faire, sans avoir à répondre de ses actes. (...) Voilà pourquoi, dans mes réquisitions orales, j'ai défendu une politique pénale visant à rechercher s'il y a eu faute. C'est en recherchant la faute, qu'in fine, on maîtrisera le risque Au-delà de la sanction, la responsabilité pénale est une manière, pour la société, de maîtriser des comportements générateurs de risques et fautifs. » c) Le droit à un recours juridictionnel effectif des victimes Cette démarche s'est heurtée à la complexité de l'articulation entre les juridictions que les victimes ressentent comme une forme d'incohérence, en contradiction avec leur droit à un recours juridictionnel effectif ● L'acceptation des offres de réparation non contentieuses n'exclut pas un recours devant la justice pénale La question du droit d'accès pour des victimes de l'amiante à un tribunal avait été soulevée à l'occasion de la saisine du Conseil constitutionnel sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 qui a créé le FIVA. Les parlementaires auteurs de la saisine soutenaient que l'acceptation d'une offre du FIVA fermait à la victime les autres voies de recours - notamment la possibilité de se porter partie civile - et que cette disposition était contraire au droit garanti par la Constitution408 à un recours juridictionnel effectif. Le Conseil constitutionnel a rejeté cette argumentation en retenant que sur le plan civil, il ne pouvait effectivement être demandé qu'une seule réparation intégrale des mêmes dommages mais que les voies de recours devant la juridiction pénale restaient ouvertes à la victime409. ● Au pénal, l'irrecevabilité du pourvoi des parties civiles contre les arrêts de la chambre de l'instruction n'exclut pas qu'elles saisissent la justice civile de leurs demandes de réparation L'instruction des dossiers revêt une place prépondérante dans la quête de vérité des victimes et la réponse que lui fait la justice pénale. Aussi la décision de la Cour de cassation de ne pas accueillir le pourvoi des parties civiles contre l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction de Dunkerque n'a-t-elle pas clarifié le paysage juridique. Cette décision a donné aux victimes un sentiment de déni de justice. Pourtant, l'article 575 du code de procédure pénale n'est pas contraire au droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et son interprétation par la Cour de justice européenne des droits de l'homme. En effet, l'accès au pourvoi en cassation n'est pas considéré comme un droit « absolu ». Par ailleurs, la victime peut toujours saisir la juridiction civile de ses demandes de réparation410. C'est ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans le communiqué de presse qu'elle a diffusé à l'appui de sa décision du 15 novembre 2005 : « Le texte en cause [l'article 575 CPP] et l'interprétation qu'en donne la Chambre criminelle ont déjà été examinés par la Cour européenne des droits de l'homme qui les considèrent comme conformes aux droits reconnus par la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, dès lors que les parties civiles ont toujours la possibilité de faire valoir leurs droits devant une juridiction civile. ». La rigueur juridique de l'édifice bâti par les jurisprudences du juge constitutionnel, du juge répressif, et du juge européen des droits de l'homme, est incontestable. Pourtant, la mission comprend aisément que cet état du droit puisse déconcerter les victimes de l'amiante. Leur incompréhension tient pour partie aux conséquences de cette règle sur le jugement et sur le rôle des victimes dans la procédure pénale. 2.- La recherche de responsabilités pénales se heurte aux règles et aux acteurs de la procédure pénale a) L'incompréhension des victimes de l'amiante face à l'absence de jugement au fond tient en partie aux règles de la procédure pénale ● Le décalage entre l'issue des actions civiles et celles des actions pénales Les victimes de l'amiante ont intenté, dès 1995, des actions judiciaires tant pénales que civiles, qui ont donné lieu à des décisions très différentes dans les deux ordres de juridiction. En dix ans, les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les chambres sociales des cours d'appel et celle de la Cour de cassation ont multiplié les décisions sur les affaires liées à l'amiante avec, depuis 2002, des condamnations quasiment systématiques de l'employeur pour faute inexcusable. Au contraire, dans le même laps de temps, aucune juridiction de jugement n'a été saisie d'une affaire liée à l'exposition professionnelle à l'amiante antérieure à 1997 (cf. encadré). Les motifs de ce décalage semblent être de deux ordres : le droit pénal applicable aux délits non intentionnels rend les responsabilités difficiles à établir - comme on le verra plus loin - et la procédure pénale, elle-même, n'accorde aux victimes qu'une place secondaire dans le procès pénal. La procédure pénale est, en effet, une prérogative de l'Etat, structurée autour de l'action publique. C'est la puissance publique qui reçoit les plaintes et qui choisit ou non d'y donner suite. L'absence d'ouverture d'informations judiciaires sur la base des plaintes déposées depuis 1995, dans l'affaire de l'amiante, pose donc la question de l'action des parquets, c'est-à-dire de l'Etat. Les victimes disposent cependant de moyens, constamment accrus depuis vingt ans, pour contourner le principe d'opportunité des poursuites, notamment par la plainte avec constitution de partie civile. Toutefois, cet outil ne garantit pas qu'une personne sera jugée, mais seulement qu'un juge doit instruire le dossier pour évaluer les charges. Dans les affaires de l'amiante, les plaintes avec constitution de partie civile ont conduit à des instructions préparatoires mais sur l'ensemble de ces procédures, soit les juges d'instruction saisis n'ont pas encore clos la phase d'instruction - de nombreuses informations sont ouvertes, dont certaines depuis longtemps -, soit ils ont achevé l'instruction par une décision de non lieu à saisir la juridiction de jugement, pour des raisons de fond ou de procédures. Les non lieux qui ont été contestés en appel ont tous été confirmés. Quant à la Cour de cassation, elle ne peut recevoir de pourvoi des victimes contre de telles décisions que si le parquet s'est lui-même pourvu, ce qui n'a jamais été le cas. Tel est l'état du droit que sa décision du 15 novembre 2005 a rappelé. Le point sur les affaires pénales liées à l'amiante. Une répression efficace de la simple « mise en danger » Depuis l'interdiction de la fibre, et l'entrée en vigueur d'une réglementation stricte encadrant le traitement de l'amiante en place, 7 employeurs ont été condamnés définitivement pour « mise en danger de la vie d'autrui ». En décembre 2005, cinq procédures de citation directe ont même été déclenchées par les parquets pour violation de la réglementation sur le désamiantage. La difficile recherche du responsable de la mort ou de la maladie S'agissant des poursuites demandées par les victimes des expositions longues et anciennes aux fibres d'amiante, on observera en premier lieu que de nombreuses instructions ouvertes sur des plaintes avec constitution de partie civile ont été closes pour des questions de procédure, liées à la prescription de l'action publique ou au décès des responsables poursuivis. En second lieu, on relèvera que deux informations judiciaires ouvertes par le juge de Dunkerque se sont conclues par une décision de non lieu, confirmée par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Douai. Les parquets ne s'étant pas associés à ces poursuites, la Cour de cassation, saisie par les victimes, n'a pas pu statuer sur la validité de ces décisions. Aucune affaire de contamination ancienne par l'amiante n'a donc été portée à ce jour devant un tribunal correctionnel. À la demande du ministre de la justice, la prise en compte de ces affaires a été améliorée depuis 2005. Depuis le mois de mai, les informations - il y en a aujourd'hui 25 - et les enquêtes préliminaires sont regroupées au sein du pôle de santé publique de Paris. On notera enfin qu'au mois de décembre, trois informations judiciaires ont été ouvertes à l'initiative du parquet de Paris - également à la demande du ministre - sur des plaintes simples, ce qui n'était jamais arrivé auparavant, l'action publique ayant toujours été mise en mouvement par les victimes elles-mêmes. ● Un décalage incompris par les victimes La mission est consciente de la spécificité du procès répressif, qui ne se définit pas comme l'arbitrage d'un litige entre personnes privées. Mais elle comprend également que les victimes de l'amiante puissent mal accepter que cette affaire ne soit pas jugée au fond. C'est aussi l'opinion du sénateur Pierre Fauchon411 : « je considère qu'il n'appartient pas à un juge d'instruction ni à une chambre d'instruction, dès lors qu'il y a des éléments qui paraissent sérieux - et c'était le cas - de conclure que les conditions du délit ne sont pas réunies et de confisquer ainsi les prérogatives du juge du fond ; c'est en effet au juge du fond d'examiner les faits et de décider de condamner ou de relaxer ; la transmission d'un dossier du juge d'instruction au juge du fond signifie, non pas qu'il y a certitude et condamnation, mais qu'il y a de fortes présomptions qu'il appartient au juge du fond d'examiner. (...) Une affaire de cette nature, dans un État de droit comme la France, doit venir devant un juge du fond ». La mission d'information du Sénat, elle-même, soutient dans son rapport412 que « certains acteurs de l'affaire de l'amiante pourraient entrer dans le cadre fixé par la loi pour voir leur responsabilité pénale engagée. (...) Dans cette affaire, en effet, il paraît clair à la mission que certaines personnes physiques ont commis une faute caractérisée et qu'elles n'ignoraient pas les dangers de l'amiante. » La mission ne dispose pas, quant à elle, de telles informations. Toutefois, elle a constaté l'existence d'un large consensus sur la nécessité que les plaintes déposées dans des affaires liées à l'exposition professionnelle à l'amiante avant 1997 dépassent le stade de l'instruction et soient jugées par un tribunal correctionnel. Un consensus qui semble même avoir récemment gagné la Chancellerie, puisque celle-ci a demandé que les dossiers soient centralisés au pôle de santé publique de Paris. Depuis le mois de septembre 2005, les transferts concernent tant les plaintes enregistrées et les enquêtes préliminaires menées par les parquets, que les informations déjà ouvertes par des juges d'instruction. Parmi ces dernières, les magistrats du pôle ont noté l'apparition récente - sur instruction ministérielle - d'informations ouvertes sur réquisition du parquet après dépôt de plainte simple. La mission se félicite de cette mobilisation des parquets, que les victimes appellent de leurs vœux depuis 1995. Mais son caractère tardif pose quand même la question de la place respective du parquet et des parties civiles dans la procédure pénale en général. b) L'action insuffisante des parquets, peu soucieux de santé publique Interrogé sur le rôle des parquets, l'avocat général Finielz a tenté d'expliquer, sans l'approuver pour autant, pourquoi les parquets s'étaient aussi peu mobilisé sur les affaires de l'amiante. Son témoignage est saisissant413 : « En tant que parquetier, j'ai été surpris par l'absence du parquet, s'agissant du problème de l'amiante. Il en est d'ailleurs de même tous les problèmes de santé publique. Dans ces domaines particuliers, l'action publique n'est pas menée par le parquet, comme elle le pourrait, mais par des associations. Il en fut exactement de même sur le dossier de l'hormone de croissance. Pourquoi le parquet ne suit-il pas de tels dossiers ? J'ai été procureur de la République, et je dois vous faire l'aveu que si le dossier de l'amiante était parvenu dans mon parquet, je l'aurais peut-être vu d'un mauvais œil, parce que les procureurs de la République ont toujours à faire face à l'urgence et au traitement des flux : dans cette logique là, ce dossier renvoie à des faits anciens, demande des investigations très longues et très approfondies et ne s'intègre pas aux priorités immédiates de l'action publique d'aujourd'hui. Par ailleurs, le parquet - c'est sa faiblesse - est une structure à court rayon d'action. C'est un centre de triage qui n'est pas armé pour suivre les procédures de bout en bout, même si cela lui arrive quand la politique pénale est très forte dans un domaine particulier - affaires de stupéfiants, de travail clandestin ou en matière économique et financière. » Comme la mission l'a observé, ce constat est partagé par de nombreux témoins, qui reprochent aux parquets une inaction généralisée à tout le domaine de la santé au travail414. Ainsi, M. Marcel Royez de la FNATH a indiqué415 que la politique pénale « ignore très largement les problèmes de la santé au travail. La plupart des procès-verbaux de l'inspection du travail sont classés sans suite. Intervenir dans les affaires touchant à la santé au travail n'est à l'évidence pas une priorité pour les parquets. Ceux-ci se mobilisent dans le domaine de la sécurité routière, et ils ont raison de le faire. Nous ne comprenons pas qu'ils ne mettent pas autant d'ardeur à intervenir lorsque la santé des travailleurs est en jeu. » Comme l'a fait remarquer M. Michel Ledoux416 : « Le droit pénal est quelque chose de compliqué. La principale victime d'une infraction pénale est par principe la société, représentée par le parquet. Celui-ci doit faire son travail, y compris dans l'intérêt des victimes - ce qu'il n'a pas fait dans l'affaire de Dunkerque ». La mission regrette l'attitude du parquet en matière de santé publique. Il est vrai que les investigations sont difficiles et que les faits sont souvent très anciens dans les dossiers liés à l'amiante, mais cette attitude tient sans doute également à un certain état d'esprit que l'avocat général Finielz a rappelé devant la mission417 : « Il faut dire que les dossiers de partie civile sont considérés comme étrangers à notre véritable mission. Il appartient au juge du fond, au juge d'instruction de prendre les décisions. » Voilà pourquoi, selon lui, « il est presque naturel que la partie civile se substitue à lui » dans ce genre de dossiers. Voilà également pourquoi la mission a considéré qu'il fallait revoir les modalités d'accès des parties civiles au pourvoi en cassation contre les ordonnances de clôture de l'instruction. 3.- Accroître le rôle des parquets et les moyens d'action des parties civiles a) Une réponse de portée générale : la révision de l'article 575 du code de procédure pénale ● Il s'agit de garantir la cohérence de l'action publique dans les affaires complexes Les dossiers de l'amiante présentent plusieurs particularités : ils sont dispersés sur le territoire national, ils font référence à une histoire commune tout en concernant des acteurs diversifiés et ils soulèvent des interrogations sur le droit applicable. Alors que cette spécificité appellerait une réponse cohérente de la part de la Justice, on constate que toutes les instructions locales ont abouti à des décisions de non-lieu. Il serait nécessaire que la Cour de cassation puisse se prononcer sur la validité de ces non-lieux mais, comme l'indique la récente décision de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, des raisons de procédure ne le permettent pas. Il paraît donc indispensable de lever les obstacles juridiques qui empêchent la Cour de Cassation de statuer sur les principes qui doivent guider les instructions préparatoires sur l'ensemble du territoire. Ces instructions préparatoires sont en effet très complexes, comme l'a rappelé M. Robert Finielz au cours de son audition418 : « Dans de telles affaires, le premier niveau « territorial » est celui de l'entreprise. On y mène une enquête approfondie, portant sur la taille de l'entreprise et ses responsables ; sur l'époque d'exposition à l'amiante et son caractère habituel ou non ; sur la façon dont l'entreprise a appliqué les dispositions réglementaires ; sur la réalité des examens médicaux obligatoires ; sur l'information des salariés ; sur les mesures d'empoussièrement après le texte de 1977 et sur le dispositif de protection. Le deuxième niveau est celui de l'environnement de l'entreprise qui concerne les autorités publiques : quelles sont les informations dont disposait la caisse régionale ? Quelle était la politique de la direction départementale du travail en la matière ? Quel rôle la médecine du travail a-t-elle joué ? Le troisième niveau est beaucoup plus général. Il concerne la connaissance du risque, les études menées et l'évolution de la législation. » Comme l'a également indiqué l'avocat général de la Cour de cassation1, il faut éviter qu'il y ait « d'un côté, des personnes auxquelles on n'aura pas donné raison, parce que l'article 575 rend leur pourvoi irrecevable malgré une instruction critiquable, et de l'autre côté des personnes qui pourront obtenir satisfaction. Je suis gêné par cette éventuelle incohérence de la réponse judiciaire. » La mission a estimé que la possibilité pour les victimes de contester l'instruction devant la Cour de cassation constituait l'outil le plus à même de garantir la cohérence nationale de l'action publique, et donc le plus pertinent. Elle propose donc de réviser l'article 575 du code de procédure pénale qui interdit aux victimes de se pourvoir en cassation si le parquet ne l'a pas fait, sauf dans un certain nombre de cas limitativement énumérés. Code de procédure pénale Article 575 La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public. Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants : 1º Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à informer ; 2º Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ; 3º Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ; 4º Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ; 5º Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen ; 6º Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; 7º En matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du code pénal. ● Une révision de l'article 575 du code de procédure pénale est-elle possible et souhaitable ? Une telle révision - déjà envisagée par les juristes - se heurte, en général, à deux objections. Premièrement, elle crée un risque d'inflation des contentieux devant la Cour de cassation. Comme l'a indiqué M. Alain Saffar, sous-directeur de la justice pénale spécialisée à la Direction des affaires criminelles et des grâces419, « l'ouverture aux parties civiles du droit de saisir la Cour de cassation, à côté du ministère public, augmenterait le risque qu'on utilise la Cour de cassation pour juger une troisième fois l'affaire. Ce n'est pas dans notre tradition juridique et c'est pourquoi il n'est pas d'actualité d'augmenter le nombre de cas où la Cour de cassation peut être saisie directement par les parties civiles. » Cette difficulté a également été relevée par le Garde des Sceaux lors de son audition par la mission420 : « l'ouverture des conditions du pourvoi ne doit pas conduire à inonder la cour et il faut donc trouver un verrou, dans un contexte général d'explosion du nombre de dossiers ». La mission est consciente de ce risque mais elle considère qu'il ne doit pas être surestimé. D'abord, les parties civiles n'ont intérêt à se pourvoir en cassation que contre les décisions de la chambre de l'instruction de la cour d'appel qui confirment une ordonnance de non lieu. Le risque d'augmentation ne concerne donc que les cas où le parquet, ayant requis le non lieu, ne se pourvoit pas lui-même en cassation, ce qui suppose un désaccord entre la partie civile et le parquet sur les charges qui, au terme de l'instruction, semblent peser sur la personne mise en examen. De plus, l'article 575 ne pose de restrictions qu'en matière délictuelle et non criminelle, ce qui relativise d'autant le risque d'inflation contentieuse. Ensuite, ce risque peut être contenu, soit en maintenant dans l'article 575 des limites à l'exercice du pourvoi, soit en aggravant la responsabilité de la partie civile en cas de poursuite abusive. En effet, le droit prévoit déjà que la partie civile peut être condamnée à réparer les préjudices consécutifs à la mise en examen abusive d'une personne à la suite d'une plainte déposée avec constitution de partie civile, si le juge d'instruction prononce in fine le non lieu. Enfin, le risque de pourvoi abusif peut être jugulé en subordonnant l'accès des parties civiles au pourvoi contre les arrêts de la chambre de l'instruction aux seules associations reconnues légitime à agir en application du code de procédure pénale. Cette restriction semble de nature à limiter les pourvois aux seuls cas sérieux. Elle permettrait également, si la Chancellerie le souhaitait, de rendre obligatoire l'assistance d'un avocat au Conseil. Une telle prestation a été présentée à la mission comme indispensable au regard de la procédure complexe devant la Cour, mais son coût serait difficilement supportable par une victime seule. La seconde objection tient à la place des parties civiles dans le procès pénal. Malgré un certain assouplissement issu des réformes pénales depuis 1980, la procédure pénale n'est pas conçue pour l'exercice de l'action privée des victimes mais pour protéger la société à travers l'action publique. La mission n'entend pas bouleverser le droit de la procédure pénale, mais elle souhaite donner aux parties civiles les outils juridiques qui leur permettront de mieux faire valoir leur point de vue. On citera encore M. Finielz421 : « Le dossier de l'amiante est resté à l'instruction pendant quatre ou cinq ans. Une commission rogatoire a permis d'entendre les salariés et quelques médecins, et de travailler du côté de la CRAM. Nous avons alors appris que les archives disparaissaient au bout de dix ans... Pourtant, dans l'arrêt de la chambre de l'instruction, on peut lire cette phrase extraordinaire : « l'instruction a été menée de manière très complète ». Ce n'est pas le cas. Depuis le début, l'instruction a été menée comme si l'on s'attendait à ce qu'elle aboutisse à un non-lieu. » Au-delà de l'appel ainsi exprimé à travers le jugement sévère d'un représentant du ministère public devant la Cour de cassation, la mission a estimé que trois arguments juridiques devaient la conduire à proposer une révision de l'article 575 du code de procédure pénale. - La place des parties civiles dans l'action publique a changé et ne justifie plus l'interdiction d'accès au pourvoi contre les arrêts de la chambre de l'instruction. C'est encore M. Finielz qui s'exprime1 : « On pouvait concevoir cette restriction du droit d'action des parties civiles à une époque où elles agissaient uniquement pour elles-mêmes. Mais aujourd'hui, les parties civiles se substituent au parquet à l'occasion de problématiques très compliquées et remplissent la fonction du ministère public. Je ne vois pas pourquoi on interdirait à ces associations de se pourvoir en cassation. » - L'article 575 pose un principe d'interdiction, pondéré par sept dérogations dont certaines ont trait au fond de l'affaire jugée par la chambre de l'instruction et d'autres à la forme de l'arrêt critiqué. Il est difficile de trouver une cohérence entre les différents motifs pour lesquels la partie civile peut, à bon droit, se pourvoir en cassation contre les décisions de la chambre de l'instruction. Comme l'a souligné l'avocat des victimes422 : « l'article 575 reste une mosaïque de bouts raccrochés les uns aux autres, sans grande cohérence. Pourquoi ne pas ouvrir carrément le droit de recours, à charge pour la Cour de cassation de faire le tri ? Accorder aux parties civiles des droits équivalents à ceux des parquets dans ce domaine ne devrait pas créer d'inflation exagérée du contentieux. » - Enfin, les dérogations de l'article 575 donnent lieu à une interprétation quelque peu aléatoire de la part de la chambre criminelle de la Cour de cassation, comme l'a souligné M. Finielz423 : « L'alinéa 6 de l'article 575 constitue donc une sorte de soupape de sécurité qui permet de corriger les fautes graves qui s'appliquent à des hypothèses extrêmes, où la justice n'a pas rempli sa mission. Il s'agit de maintenir une certaine exigence de qualité de la justice, qui doit se retrouver à travers sa motivation. C'est pourquoi, dans ce dossier, j'ai pris une position d'ouverture de l'article 575. (...) Le 8 novembre 2005, une semaine avant l'arrêt rendu dans l'affaire de l'amiante, un autre arrêt avait été rendu dans des circonstances semblables. A la suite du décès d'un pilote d'avion, une faute avait été soulevée et une décision de non-lieu avait été rendue. La Cour de cassation a rendu une décision contraire à celle de l'amiante. » Dans cette affaire, la Cour avait en effet accepté le pourvoi des victimes. Elle avait estimé qu'un arrêt de la chambre de l'instruction doit toujours répondre au mémoire des parties civiles, et qu'en l'espèce les motifs de la chambre de l'instruction étaient contradictoires. Un tel raisonnement a été défendu par M. Finielz à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai, mais la Cour de cassation ne l'a pas suivi. En définitive, la mission a considéré, avec l'avocat général Robert Finielz, que les impératifs de cohérence et d'équité de la justice pénale devaient l'emporter sur le risque que les parties civiles abusent du droit au pourvoi1 : « il y a une réticence à ouvrir la porte du pourvoi en cassation aux parties civiles. Il est vrai que nous sommes dans un système juridique où l'action de la partie civile est considérée de manière négative par le juge. Certes, la partie civile peut poursuivre des objectifs privés, proches de l'abus de droit. Mais il n'empêche que ce texte débouche sur un certain arbitraire. (...) Tous les ans, on observe deux ou trois arrêts qui « ouvrent » le texte, puis d'autres qui le « ferment ». (...) Je ne supporte pas cet arbitraire et j'appelle à une modification de l'article 575. » Au cours de son audition par la mission, le Garde des Sceaux s'est déclaré ouvert à une telle modification424 : « Il paraît donc nécessaire de disjoindre le pourvoi du parquet de celui de la partie civile. L'idée serait d'ouvrir un huitième cas à l'article 575 du code de procédure pénale, où la partie civile, hors tout pourvoi du ministère public, serait autorisée à saisir la Cour de cassation. » b) Une réponse pragmatique et immédiate : un meilleur investissement des parquets dans les dossiers de santé publique, en général, et dans ceux de l'amiante, en particulier Parallèlement, la mission a estimé qu'un meilleur investissement des parquets était indispensable à l'amélioration du traitement des dossiers de l'amiante et des dossiers de santé publique. Cela suppose une spécialisation des magistrats au sein des pôles santé, mais aussi des moyens. ● Une mobilisation indispensable pour aboutir à une décision juste dans les dossiers de l'amiante Comme l'a souligné maître Ledoux devant la mission, la révision de l'article 575 du code de procédure pénale est nécessaire mais pas suffisant425 : « Le droit pénal est quelque chose de compliqué. La principale victime d'une infraction pénale est par principe la société, représentée par le parquet. Celui-ci doit faire son travail, y compris dans l'intérêt des victimes - ce qu'il n'a pas fait dans l'affaire de Dunkerque. Faut-il revoir l'article 575 du code de procédure pénale ? Peut-être conviendrait-il d'ouvrir quelque peu les possibilités de pourvoi. Mais le vrai problème est ailleurs. » Deux arguments conduisent la mission à proposer de compléter cette solution par un meilleur investissement des parquets : - la révision de l'article 575 n'apportera pas de réponse immédiate dans les dossiers de l'amiante, ou bien - ce qui est regrettable - suscitera au contraire une inégalité entre les parties civiles, certaines s'étant déjà vu opposer la rigueur de cet article ; - la révision de l'article 575 pourrait même être un pis-aller : en permettant de mieux contrôler l'instruction lorsque le parquet ne s'y est pas investi, elle risquerait d'accentuer son immobilisme, alors même qu'il est souhaitable que le parquet s'investisse davantage dans les dossiers de santé publique. La mission a pu constater que l'action du parquet n'était effectivement pas aisément remplaçable. Les parquets sont les premiers rouages judiciaires. Chargés de l'application de la politique pénale, ils sont juges de l'opportunité des poursuites, ce qui explique d'ailleurs, en partie, que les instructions reflètent leurs priorités : la justice répressive hésite, en effet, à consacrer durablement son intervention à des dossiers dont le premier plaignant, l'Etat, se désintéresse. Le parquet est donc le plaignant naturel des affaires pénales. Désintéressé des préoccupations d'ordre privé, il poursuit, il cite à comparaître et il requiert une condamnation. Pour conduire cette mission de « tri » dans l'intérêt de l'Etat, le parquet dispose, en principe, de moyens dont sont dépourvus les juges d'instruction qui n'ont pas à mener des informations judiciaires mais à estimer les charges pesant sur une personne pour justifier des poursuites. L'importance des enquêtes préliminaires conduites par le parquet ne doit donc pas être sous-estimée selon M. Alain Saffar426 : « Les associations de victimes que nous avons reçues avaient le sentiment que l'enquête préliminaire était inutile et qu'il fallait immédiatement enchaîner sur l'instruction. C'est leur opinion, mais le déclenchement d'une enquête préliminaire à la suite d'une plainte simple n'a rien d'exceptionnel et ce n'est pas un « non acte juridique » que de déclencher une procédure qui permet, quand même, de préciser qui est la victime, les périodes où elle a travaillé, les certificats médicaux dont elle peut disposer, etc. (...) Les enquêtes préliminaires permettent souvent de bien cadrer les contours de la saisine du juge d'instruction. N'oublions pas qu'il faut gérer des moyens qui sont contingentés. Grâce à de telles enquêtes, on peut débroussailler le terrain avant de le saisir. » C'est également le point de vue des avocats des victimes de l'amiante, selon lesquels l'accroissement des moyens des parties civiles ne devrait être que le complément d'une action des parquets, elle-même renforcée, qui seule permettra de « sortir par le haut427 ». Comme l'a souligné maître Ledoux, ce n'était pas le cas il y a encore peu de temps428 : « De la même façon que l'on poursuit le moindre étudiant qui télécharge dans des conditions irrégulières sur Internet, les procureurs de la République doivent être appelés à ouvrir des informations judiciaires sur toute affaire ayant trait à l'amiante (...). Par « volonté claire » du ministère de la justice, j'entends des instructions précises et un suivi attentif des affaires d'actualité liées à l'amiante, dont les procureurs se désintéressaient totalement jusqu'à ces dernières semaines (...).Depuis dix ans, je vois toujours les procureurs de la République nous regarder avec un petit sourire en coin : « L'affaire de l'amiante, c'est bien gentil, à la rigueur c'est de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, mais ne venez pas me parler de droit pénal ! » Voilà ce qu'était la situation, et probablement encore aujourd'hui. Avec des moyens et une volonté politique, nous aurons une instruction, des enquêtes. » L'audition du Garde des Sceaux a permis de constater que cet appel avait d'ores et déjà été en partie entendu429 : « Je suis évidemment favorable au renforcement du nombre d'enquêteurs supplémentaires et à la création d'une cellule d'enquête dédiée spécifiquement aux procédures liées à l'amiante. » Cette décision avait d'ailleurs été pressentie lors de l'audition de M. Alain Saffar, sous-directeur de la justice pénale spécialisée à la Direction des affaires criminelles et des grâces1 : « je comprends l'impatience des victimes et je pense qu'on finira logiquement par aboutir à l'ouverture d'informations. » La décision de regrouper les dossiers de l'amiante au pôle de santé de Paris était aussi une première réaction au problème de l'instruction de ces dossiers. ● Le fonctionnement du pôle santé de Paris « De telles affaires devraient naturellement être traitées par le pôle de santé publique. La lourdeur des problèmes techniques qu'elles soulèvent exige, en effet, des personnes compétentes, et le juge de proximité n'est pas armé pour cela. » 430 La mission partage le sentiment de l'avocat général Robert Finielz et se félicite que le ministère de la justice ait ordonné le 12 mai 2005 que les dossiers de l'amiante soient regroupés auprès du pôle santé de Paris. Ce pôle est constitué d'un parquet et d'une juridiction d'instruction. Il est saisi des dossiers de même nature concernant des affaires nationales de santé publique, pour lesquelles les juges affectés au pôle ont développé une expérience et une compétence propres. Comme l'a confirmé Odile Bertella-Geoffroy dans une contribution écrite remise à la mission : « on retrouve dans chacun d'entre eux [les dossiers] les mêmes documents généraux (notamment législation de l'amiante, rapports scientifiques, rapports de comités comme le Comité permanent amiante) donc une multiplication d'investigations parallèles. Seules bien entendu les investigations locales sont différentes selon les usines incriminées. » La juge d'instruction a également précisé les modalités de la centralisation : « Avant la création du pôle santé, les juges d'instruction des autres tribunaux, lorsqu'ils savaient qu'un dossier de santé publique comme l'hormone de croissance ou la vaccination anti-hépatite B était instruit à Paris, demandaient si j'acceptais qu'ils se dessaisissent de leurs propres dossiers individuels sur la même affaire, je répondais affirmativement en leur demandant de terminer leurs investigations locales (notamment saisies des dossiers médicaux et enquête locale sur les faits). C'est ce qui se produit aujourd'hui sur les dossiers d'amiante depuis cette dépêche du 12 mai 2005 du ministre de la justice aux procureurs généraux. (...) En tout état de cause, j'estime que cette cohérence de traitement des différentes plaintes disséminées sur tout le territoire concernant une même origine, soit en l'espèce les conséquences de l'exposition à l'amiante est une bonne chose et confirme la raison d'être de ce pôle santé. » Si maître Teissonnière, avocat des victimes de l'amiante, s'est déclaré attaché à ce que les dossiers soient jugés là où les faits se sont produits, il a cependant reconnu qu'indiscutablement, la lourdeur et la complexité des dossiers de l'amiante rendaient nécessaire un regroupement auprès du pôle de santé publique. » Tous les témoins ont salué cette initiative en regrettant qu'elle n'ait pas été plus précoce. Ainsi, M. Finielz a souligné, s'agissant de l'affaire de Dunkerque, que431 : « Si l'on était passé par le pôle de santé publique, on aurait eu affaire à des magistrats du parquet qui se seraient davantage investis, ce qui aurait peut-être débouché sur un pourvoi du parquet général. » Cet argument a été repris par M. Alain Saffar au cours de son audition1 : « S'agissant de dossiers lourds, complexes, avec de nombreuses victimes et où les responsabilités peuvent être multiples, la réponse judiciaire n'en sera que meilleure, puisqu'on aura affaire à des magistrats spécialisés. » La mission est donc convaincue de la pertinence du regroupement des affaires de l'amiante auprès du pôle santé de Paris, mais elle a également mesuré les difficultés matérielles qui obèrent le bon fonctionnement de ce pôle. Mme Odile Bertella-Geoffroy a fait part de ces difficultés, au cours de son audition432, difficultés qui sont d'ailleurs connues du milieu judiciaire : « Il s'agit de la pénurie catastrophique actuelle en officiers de police judiciaire spécialisés, gendarmes de l'OCLAESP récemment créé (office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique) ou policiers de la BRDP (brigade de répression de la délinquance contre les personnes). Il faut préciser en effet que sur le dossier amiante Jussieu que j'instruis depuis 2 ans en ayant pris la suite de 3 collègues de la section financière du tribunal de Paris auparavant désignés, les policiers qui avaient jusqu'à présent travaillé sur ce dossier sur commission rogatoire de ces juges et de moi-même, coopèrent actuellement avec les gendarmes concernant les investigations sur les responsabilités des décideurs publics qui sont soulevées par les parties civiles de cette procédure. Les gendarmes de cet office national, l'OCLAESP, coordonneront toutes les investigations nécessaires dans les dossiers arrivant au pôle santé qui me sont actuellement confiés ou qui me seront confiés. Mais voilà : les gendarmes ne sont que 4 enquêteurs, alors qu'ils traitent un grand nombre d'autres dossiers du pôle santé et d'autres dossiers également des différents parquets et juges d'instruction du territoire. Quant aux policiers de la BRDP, ils sont encore moins nombreux, soit 3 officiers de police judiciaire pouvant travailler sur ce dossier en même temps que sur des dizaines d'autres. Aucun travail rapide et efficace ne pourra être effectué dans de telles conditions. » Tout en confirmant la demande de moyens supplémentaires, M. Alain Saffar, du ministère de la justice, a souhaité préciser les ressources du pôle mais sans convaincre la mission de leur adéquation aux besoins grandissants du pôle433 : « Les demandes de moyens supplémentaires dont nous avons connaissance proviennent des magistrats du Parquet qui ont été transmises à la direction des services judiciaires. On nous a également demandé d'augmenter le nombre d'enquêteurs.(...) Il y a tout de même 4 OPJ à la section des recherches, auxquels s'ajoute un groupe de travail de quinze personnes qui traite de la pollution au travail au sein de la Brigade de répression de la délinquance à la personne, la BRDP, qui est rattachée à la préfecture de Paris, plus les douze enquêteurs de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, l'OCLAESP. Cette dernière structure se partage entre police et gendarmerie mais elle est commandée par un colonel de gendarmerie et ne comprend, pour le moment, que des gendarmes. (...) Les premières saisines de l'OCLAESP datent d'un peu après mai 2005 et je ne connais pas le plan de charge de cet office central. » Convaincue qu'il faut s'attendre à une recrudescence des actions pénales dans le champ sanitaire, et notamment dans celui des maladies professionnelles, la mission estime qu'il est urgent de garantir au pôle santé des moyens à la hauteur de ses missions, comme cela a été fait pour d'autres juridictions spécialisées, par exemple en matière de lutte contre le terrorisme ou de délinquance financière. Une partie importante des difficultés rencontrées dans le traitement pénal des affaires de l'amiante tient, en effet, certainement au manque de moyens et au manque de volonté. Lors de son audition434, le ministre de la justice n'a pas contesté l'insuffisance des moyens du pôle de santé publique de Paris. Il a annoncé le 30 janvier 2006 un détachement de 6 officiers de police judiciaire au sein d'une cellule « amiante » de l'OCLAESP. En réaction à cette annonce, le mouvement social engagé par les « veuves » de Dunkerque depuis 2005 a été suspendu, dans l'attente de la réponse que la justice pénale ferait aux demandes des victimes. Par ailleurs, la mission s'est étonnée du dépôt d'un dossier amiante au pôle de santé publique de Marseille. Bien que la Chancellerie ne souhaite pas son transfert au pôle de Paris, on peut s'interroger sur la pertinence d'exclure ce dossier des investigations spécialisées qui seront menées de façon centralisées par le pôle parisien. * * * La mission propose d'une part que la Chancellerie revoie les moyens et les priorités de l'action publique en matière sanitaire, et d'autre part que l'article 575 du code de procédure pénale soit révisé. 1/ L'action des parquets en matière sanitaire doit être renforcée. Il importe que la Chancellerie demande aux parquets de considérer avec attention les plaintes enregistrées sur des dossiers de maladies professionnelles ou d'accidents du travail, en particulier les dossiers de contamination à l'amiante. Ces plaintes devraient donner lieu à des enquêtes et instructions approfondies, tant que les principes à retenir en matière d'engagement de la responsabilité pénale dans les dossiers relatifs aux risques sanitaires au travail n'auront pas été soumis au contrôle de la chambre criminelle de la Cour de cassation. 2/ La mission considère que le regroupement de ces affaires auprès du pôle santé de Paris est un progrès, qui impose que les moyens nécessaires soient affectés aux enquêtes et actes d'instruction diligentés par les magistrats. 3/ L'article 575 du code de procédure pénale doit être révisé pour ouvrir aux victimes le pourvoi en cassation contre les arrêts de la chambre d'instruction. La mission estime qu'il est indispensable que la Cour de cassation joue son rôle d'unification des pratiques et de validation des principes directeurs en matière d'instruction. Dans un domaine où les parties civiles sont les véritables moteurs de l'action publique, l'exercice de ces missions par la Cour est subordonné à un accès plus large des parties civiles au pourvoi en cassation contre les arrêts des chambres d'instruction. La mission propose que la Chancellerie étudie une révision de l'article 575 selon l'un des deux principes suivants : - prévoir la recevabilité du pourvoi de certaines associations représentant les parties civiles, à qui est reconnu légalement un intérêt à agir435; - ouvrir le pourvoi aux parties civiles elles-mêmes, cette faculté nouvelle étant assortie d'une aggravation de la sanction de la partie civile dont le pourvoi est jugé abusif ou dilatoire. Cette sanction - prévue à article 177-2 du code de procédure pénale436 - peut être prononcée à l'encontre de la partie civile lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de non lieu et a fortiori lorsque cette ordonnance est confirmée en appel (article 212-2 du même code : mêmes dispositions). Elle pourrait être étendue aux pourvois abusifs ou dilatoires en cassation contre les arrêts confirmant ces mêmes ordonnances, sans préjudice des actions que la personne mise en examen peut par ailleurs intenter soit en dénonciation calomnieuse, soit en dommages intérêts (article 91 du code de procédure pénale). Propositions : - Placer les affaires de santé publique au cœur des priorités des parquets et prévoir que les pôle santé de Paris et Marseille puissent s'en saisir de façon plus rapide et plus souple ; - Renforcer les moyens du pôle de Paris pour permettre aux magistrats de disposer d'enquêteurs spécialisés en nombre suffisant ; - Réviser l'article 575 du code de procédure pénale pour permettre aux parties civiles de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction, afin d'assurer un contrôle sur les règles de l'instruction et le droit applicable aux affaires de santé liées au travail. D.- L'AMIANTE POSE LA QUESTION DU DROIT PÉNAL APPLICABLE AUX RISQUES PROFESSIONNELS Au-delà des instructions et de la tenue d'un procès pénal de l'amiante, la question du droit pénal applicable aux risques professionnels est une préoccupation des victimes de l'amiante que l'ANDEVA a portée devant la mission437 « l'affaire de l'amiante constitue un défi pour la justice, qui n'a jamais été confrontée à un problème de cette ampleur et de cette complexité. Nous sommes persuadés que la justice pénale sortira transformée d'un procès de l'amiante. Le code pénal n'a pas été conçu pour traiter ce type d'affaires ; il l'a été pour des affaires où le lien de causalité était certain et direct. Voilà pourquoi il faudrait engager une réflexion sur les outils juridiques dont nous avons besoin pour analyser les catastrophes de santé publique. » S'agissant des affaires de l'amiante, la mission a relevé une première difficulté, qui n'est pas liée au problème du régime pénal applicable, mais aux caractéristiques des maladies concernées. En effet, le temps de latence qui marque les maladies liées à l'amiante a conduit la justice à rechercher des responsabilités sur des faits datant au minimum de deux décennies. Or, comme le soulignait M. Alain Saffar au cours de son audition438, le procès pénal n'a pas pour objet de « juger l'amiante », mais de rechercher, dans chaque affaire, si une personne s'est rendue coupable de délits justifiant une sanction. Cette recherche passe avant tout par l'établissement d'un lien de causalité certain entre les actes ou omission du fautif présumé et le dommage de la victime. Ce qui peut présenter une réelle difficulté. En effet, la succession éventuelle des expositions et des employeurs, les trajectoires des carrières des victimes, l'évolution de la réglementation et de la connaissance du risque rendent l'établissement rétrospectif de ce lien extrêmement difficile - surtout lorsqu'il s'agit de rechercher le responsable d'un dommage qui s'est déclaré des décennies après l'acte fautif. Cette difficulté pèse sur le traitement pénal des affaires de l'amiante car, même si le procès pénal répond à une quête légitime de la vérité et à un souci d'exemplarité, il peut avoir de graves conséquences pour les mises en examen et impose une extrême rigueur dans l'établissement de la preuve. En tout état de cause, et d'un point de vue général, les procédures pénales ne peuvent servir de palliatif aux carences des systèmes de prévention des risques professionnels. La mission a jugé, au contraire, que cette difficulté de preuve devait conduire les pouvoirs publics à donner au concept de « responsabilité » - sans préjudice de son incidence en termes de sanction - un sens plus préventif, en se donnant notamment les moyens d'évaluer correctement les risques au lieu d'en subir les conséquences439. * * * Sans prétendre épuiser la réflexion sur une question aussi difficile, mais parce que l'affaire de l'amiante a été un révélateur, la mission a jugé nécessaire de s'interroger sur la responsabilité pénale en matière de risques professionnels. Le régime juridique applicable aux maladies professionnelles résulte notamment de la loi du 10 juillet 2000, dite « loi Fauchon »440 - malgré les réserves du législateur sur son application en ce domaine. Les difficultés générales d'interprétation et d'application de ce texte posent la question de sa révision, dont il a été régulièrement fait état devant la mission. 1.- Les poursuites et les instructions en matière de risques professionnels s'inscrivent dans le cadre général issu de la « loi Fauchon » a) La problématique générale des poursuites pénales dans les affaires concernant les risques professionnels Les faits reprochés aux employeurs des victimes de dommages professionnels relèvent, dans la plus grande majorité des cas, de l'imprudence ou de la négligence. En droit pénal, de telles fautes qualifient des délits « non intentionnels » et, compte tenu de la nature du dommage - l'accident ou la maladie -, l'imprudence ou la négligence est considérée comme la cause indirecte du dommage. ● L'imprudence ou la négligence ne constitue pas une intention de nuire En matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, un employeur n'est pas, en principe, poursuivi pour homicide ou blessures volontaires, c'est-à-dire pour des délits commis de façon intentionnelle. Cela supposerait, en effet, que tel employeur aurait délibérément cherché à nuire à son employé en causant sa maladie ou son accident. En droit pénal, les délits « non intentionnels » constituent une exception au principe selon lequel il « n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. »441. Une exception, dont le sénateur Pierre Fauchon a rappelé la justification en ces termes lors de son audition442, au sujet de la loi de juillet 2000: « Pourquoi avons-nous souhaité cette loi de 2000 ? Parce que dans une société civilisée, s'il n'y pas de faute pénale sans volonté de la commettre, il convient quand même de créer des exceptions pour nous contraindre tous à la prudence. La menace d'une amende non couverte par l'assurance, voire la menace de la prison, est une nécessité ». Réprimer des délits commis de façon non intentionnelle permet ainsi au droit pénal de protéger les « valeurs essentielles de la société », comme l'a souligné M. René Dosière443, rapporteur du projet de loi pour l'Assemblée nationale. La répression des délits non intentionnels a été précisée par les lois du 13 mai 1996444 et du 10 juillet 2000, qui ont révisé l'article 121-3 du code pénal (cf. encadré), et prévu deux catégories de délits non intentionnel : - le cas de « mise en danger délibérée de la personne d'autrui », - et le cas de « faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement », à condition que l'auteur des faits n'ait pas accompli les diligences considérées comme « normales » pour éviter le dommage. En matière d'accidents ou de maladies professionnelles avérés, les poursuites s'inscrivent dans cette dernière catégorie, car le stade de la mise en danger est dépassé, et un préjudice a été causé. Code pénal, article 121-3 Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. [loi de 1996] Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. [loi de 1996] Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. [loi Fauchon] Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. ● L'imprudence ou la négligence cause indirectement le dommage Le tort causé par la contraction d'une maladie professionnelle, plus encore que par la survenue d'un accident du travail, soulève également le problème du lien entre l'imprudence de l'employeur et le dommage. En effet, le quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal conduit désormais le juge pénal à distinguer si le délit est constitué par des actes ou des omissions qui sont la cause directe ou indirecte du dommage. Comme cela a été rappelé devant la mission, cette distinction avait pour but initial d'exclure les accidents de la circulation du champ d'application de la nouvelle législation, plus protectrice445. Le législateur a précisé la portée de cette distinction en définissant le caractère indirect du lien de causalité : ont causé indirectement le dommage « les personnes physiques (...) qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ». Les modalités de cette distinction ont été largement débattues lors de la discussion de la loi Fauchon446. Mais sa pertinence et sa portée au plan des principes n'ont pas fait de difficulté : lorsque le lien de causalité entre les faits et le dommage est indirect, la responsabilité de leur auteur ne doit être engagée que pour une faute aggravée. Ce principe a été affirmé avec force tout au long de la navette, comme le résume M. René Dosière dans son rapport en 2ème lecture447 : « lorsque la faute a été la cause indirecte du dommage, ce qui est le cas le plus fréquent en ce qui concerne les décideurs publics, une faute qualifiée doit être exigée. La difficulté à laquelle était confronté le législateur consistait, précisément, à déterminer, dans cette seconde hypothèse, le degré de qualification nécessaire pour qu'une faute puisse faire l'objet d'une incrimination pénale. » Depuis son entrée en vigueur, les conséquences de cette distinction font débat. La loi rendant la condamnation plus difficile pour les auteurs indirects Au contraire, certains considèrent, à l'instar de M. Pierre Fauchon, que la suppression de la distinction est « une fausse piste »449. Sur ce point, le Garde des Sceaux, lors de son audition par la mission450, a rappelé que les condamnations de responsables très indirects dans l'affaire dite « du tunnel du Mont-Blanc » prouvaient que la loi n'interdisait pas de rechercher les responsabilités là où elles se trouvent. La mission n'a pas sous estimé l'importance de ces débats. Cependant, hormis des cas exceptionnels, l'employeur ne peut que créer les conditions du dommage, et non causer directement le dommage. Dans la plupart des cas, la causalité est donc bien indirecte. C'est pourquoi la mission a souhaité concentrer ses travaux sur la nature de la responsabilité pénale des employeurs en matière de risques professionnels, plutôt que sur la pertinence d'une distinction que le législateur a fermement souhaité instaurer. b) La difficile gestation du régime de responsabilité pénale issu de la loi Fauchon L'article 121-3 al. 4 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, distingue deux types de fautes d'imprudence ou de négligence « aggravées » justifiant que la responsabilité pénale soit recherchée en cas de dommage indirect : - soit la personne a violé, de façon manifestement délibérée, une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; - soit la personne a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer. Cette distinction résulte d'un délicat compromis, construit au fil de la navette parlementaire et les travaux préparatoires montrent que l'Assemblée nationale a souhaité que les deux hypothèses soient complémentaires, ce que le Sénat n'a pas remis en cause : « En première lecture, le Sénat avait proposé de ne retenir que la « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence ». L'Assemblée nationale, considérant que cette définition était à la fois insuffisamment précise et trop restrictive, avec un risque de dépénalisation excessif, a proposé le texte suivant : « Toutefois (...), les personnes physiques qui n'ont pas causé elles-mêmes le dommage, mais qui ont créé la situation qui en est à l'origine ou n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute d'une exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger qu'elles ne pouvaient ignorer [ajout de l'Assemblée nationale].451 ». ● La première « branche » de l'article 121-3 al. 4 du code pénal : la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement Cette faute était la seule hypothèse prévue par la proposition de loi initiale de M. Pierre Fauchon. Déjà connue des juges depuis 1996 parce qu'elle caractérise le délit de « mise en danger de la personne d'autrui »452, cette faute comporte trois éléments constitutifs : - l'existence d'une obligation « particulière » à l'encontre du fautif : L'obligation « particulière » de prudence et de sécurité se distingue de l'obligation générale par la précision tant de son champ d'application que des mesures de prévention du risque qu'elle impose de prendre. Cette distinction n'a pas de définition générale, mais relève d'une certaine casuistique à laquelle les juges sont entraînés453.Il en résulte qu'en jurisprudence la notion d'« obligation particulière » s'interprète de façon stricte : c'est l'obligation qui impose un « modèle de conduite circonstancié »454. À l'inverse, l'obligation générale laisse « toute liberté d'appréciation » sur les mesures à prendre455. En matière de santé au travail, par exemple, l'obligation faite à l'employeur de veiller à la santé et à la sécurité des ses salariés est une obligation générale, alors que le port de vêtements étanches et d'un masque ventilé sur un chantier de désamiantage est une obligation particulière. - une désobéissance à la loi ou au règlement : Le législateur a explicitement entendu limiter cette première hypothèse aux cas où la loi ou le règlement a expressément fixé des règles. Alors que le Sénat avait préféré s'en tenir à l'expression « obligation de prudence ou de sécurité », l'Assemblée nationale a décidé de subordonner la faute à l'existence d'une règle textuelle, donc explicite456. Le Sénat s'est par la suite rallié à cette rédaction. - une part d'intentionnalité dans la faute, qui résulte du caractère délibéré de la violation. Le Sénat avait initialement souhaité que l'auteur indirect de faits constitutifs d'un délit non intentionnel ne puisse être poursuivi qu'à raison de son intention, sinon de nuire, du moins de violer une règle. Cette condition stricte respectait le principe selon lequel il n'y a sanction que de la seule « intention coupable ». Celle-ci garantissait de surcroît que la personne responsable pénalement ne puisse prétendre ignorer le risque sanitaire457. Dans son rapport en première lecture, M. René Dosière a rejoint cette position, mais il a précisé que « la violation de cette obligation doit être « manifestement délibérée », ce qui ne signifie pas que son auteur ait eu l'intention de créer un dommage, mais qu'il a violé volontairement la règle, en étant conscient des conséquences potentielles de son indiscipline. L'adjectif « manifestement » impose au juge de faire preuve d'une rigueur particulière quant à l'existence de l'élément moral du délit. »458 ● La seconde « branche » de l'article 121-3 al. 4 du code pénal : une faute caractérisée exposant autrui à un danger d'une particulière gravité, qui ne pouvait être ignoré Ce deuxième type de faute résulte d'un amendement de l'Assemblée nationale au texte du Sénat, motivé par la crainte de trop atténuer la répression dans les domaines les plus sensibles. On peut ainsi lire dans le rapport de M. René Dosière, au sujet du seul critère initialement retenu par le Sénat459 : « Il convient de se demander si le critère retenu par le Sénat n'est pas trop réducteur et, partant, le risque de « dépénalisation » excessif. On rappellera, à cet égard, que cette nouvelle définition s'appliquera également dans des domaines aussi sensibles que la sécurité routière, le droit de l'environnement, du travail et de la santé publique.460 » L'Assemblée nationale a souhaité que les critères de cette seconde hypothèse de faute rejoignent ceux de la « faute inexcusable », tels que la chambre sociale de la Cour de cassation les avait définis dans sa jurisprudence Dame Veuve Villa de 1941461. Cette volonté explique d'ailleurs le choix initial de l'Assemblée de retenir comme rédaction : une faute « d'une exceptionnelle gravité »462. Mais il convient de rappeler que la définition et la portée de cette faute inexcusable ont changé depuis le revirement de jurisprudence intervenu en 2002, qui a consacré une obligation de sécurité de résultat de l'employeur463 . La « faute inexcusable » ne saurait donc plus être retenue comme une référence appropriée. La définition de la faute visée par la deuxième « branche » de l'article 121-3 al. 4 résulte d'un débat qui n'a été ni facile ni parfaitement limpide. Elle a fait l'objet de plusieurs réécritures au cours de la navette avant d'aboutir à une rédaction qui, de nouveau, cumule trois critères. - La faute commise doit être « caractérisée ». La faute « caractérisée » a remplacé au cours de la navette la « faute d'une particulière gravité ». Cette modification s'est faite en deux temps. Elle est d'abord le fruit d'un amendement du Gouvernement déposé au Sénat en 2ème lecture : la faute serait « caractérisée parce qu'elle exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré »464. Mme la Garde des Sceaux a précisé l'objet de cette première modification465 : « L'amendement (...) tend à proposer une définition plus précise et moins ambiguë de la faute caractérisée (...). Il n'est en effet pas possible de conserver une rédaction qui laisserait croire, même à tort, que la responsabilité pénale en cas de causalité indirecte ne pourra être engagée que dans des hypothèses si exceptionnelles qu'il en résulterait dans de nombreux cas des impunités choquantes ». Cette définition résumait ainsi la faute à deux critères : la gravité du danger et la connaissance du risque. Bien que plus claire, cette définition n'a pas été retenue, le Parlement ayant considéré qu'elle liait l'appréciation de la faute à celle des conséquences dommageables. Dans la rédaction finalement issue du débat législatif, la faute doit être « caractérisée » en elle-même. Le sens de cette « caractérisation » est resté flou, malgré des tentatives de précision de l'Assemblée nationale, qui a, semble-t-il voulu exclure les « poussières de faute »466. Il résulte de ce flou que l'appréciation de la faute caractérisée incombe au seul juge, en fonction des cas d'espèce. - Le danger doit être d'une gravité particulière Ce critère, en revanche, a été nettement défini par les travaux préparatoires, et il ressort de la jurisprudence que son interprétation ne soulève pas de difficulté. Il s'agit d'un risque de mort ou de blessures graves, tel qu'il s'analyse déjà pour la constitution des délits d'homicide ou de blessures prévus par le code pénal467. - Le danger ne pouvait être ignoré de l'auteur des faits Dans l'unique branche d'inculpation retenue en première lecture, le Sénat avait considéré que la connaissance du risque était un critère essentiel, et avait estimé que la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prouvait, à elle seule, la réalité de cette connaissance. Pour définir la seconde branche, l'Assemblée s'est également interrogée sur le degré de connaissance du risque pouvant justifier que la responsabilité pénale de l'auteur soit engagée. Il s'agissait de trancher entre le risque dont l'auteur des faits devait avoir conscience - définition « civile » de la faute inexcusable : le risque s'analyse in abstracto -, et le risque qu'il ne pouvait ignorer - appréciation in concreto de la situation du prévenu. Cette dernière solution s'est finalement imposée468, non sans susciter quelques interrogations doctrinales, certains juristes voyant dans ce degré de connaissance la « pierre angulaire du nouveau dispositif législatif » 469. c) Les difficultés d'application de la loi Fauchon En dépit du souhait du législateur que chacune de ces fautes puisse être recherchée indépendamment l'une de l'autre, la mission a relevé une certaine confusion dans l'application jurisprudentielle du nouveau régime de l'article 121-3 aux affaires liées à la santé au travail. Cette difficulté a été illustrée par les décisions concernant les affaires de l'amiante. ● Les enseignements tirés des affaires de l'amiante Aucune procédure pénale relative à une contamination longue et ancienne par l'amiante n'a jusqu'à présent été portée devant une juridiction de jugement. Pour autant, les décisions de non lieu rendues par les juges d'instruction470 ont confirmé les difficultés d'application de la loi Fauchon en matière de risques professionnels. - Une connaissance du risque difficile à établir Le juge pénal a considéré jusqu'à présent que les personnes mises en examen ne disposaient pas, au moment des faits, d'une connaissance des risques suffisante pour établir l'existence d'une « faute caractérisée exposant les victimes à un danger particulièrement grave qu'elles ne pouvaient ignorer ». L'information judiciaire conduite par le juge d'instruction de Dunkerque est représentative de cette démarche. Dans cette affaire, l'instruction a permis de recueillir des témoignages concordants sur les conditions de travail dans les années 70 et 80, ou sur l'absence de mesures de précaution ou de prévention, et même d'établir que l'application de la réglementation avait été « tardive ou incomplète ». Mais le juge a considéré que l'inaction fautive de l'Etat empêchait la véritable connaissance des risques, les personnes mises en examen ayant fait valoir que les risques liés à l'amiante n'avaient fait l'objet d'aucune alerte des pouvoirs publics avant le milieu des années 80471. Cet argument, retenu in fine par la chambre de l'instruction, repose sur l'idée que le risque ne pouvait pas être connu des employeurs puisque les pouvoirs publics avaient fait le choix de l'utilisation contrôlée de l'amiante, et n'avaient changé d'attitude que tardivement en l'interdisant472. Ce raisonnement illustre la nécessité pour un juge, confronté à la mise en œuvre du régime de la loi Fauchon, d'établir des critères fiables pour évaluer la connaissance du risque. - Une violation impunie des règles sanitaires en vigueur Le 17 août 1977 a été pris un décret prévoyant un dispositif détaillé de prévention et, notamment, une obligation de contrôle de l'atmosphère de travail à la charge de l'employeur, afin de vérifier si la concentration moyenne de l'air en fibres d'amiante ne dépasse pas une valeur limite d'exposition. Ce décret constitue donc une véritable obligation particulière de prudence et de sécurité au sens du code du travail. On peut pourtant lire dans la décision de la Cour473 que les manquements à cette réglementation spécifique n'ont pas causé tort aux prévenus474, alors même que l'instruction les avaient établis. En effet, le juge de Dunkerque, en application de la loi Fauchon, a recherché si pouvait être retenue la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Bien que l'illégalité en elle-même ne fit pas de doute, il a considéré que l'application tardive ou incomplète de la réglementation, ou encore l'absence d'application, ne constituait pas une violation manifestement délibérée et que, dès lors, elle n'engageait pas la responsabilité pénale des personnes poursuivies. * * * La mission constate que dans l'affaire de l'amiante la loi Fauchon a donc conduit : - à justifier l'ignorance des risques de l'employeur par l'inaction de l'Etat, - à ne pas sanctionner la violation d'une règle qui a pour objet de protéger la santé, dès lors qu'il n'est pas prouvé que cette violation a été « manifestement délibérée ». ● Une construction jurisprudentielle délicate Après cinq ans de jurisprudence, l'analyse des décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation prises en application de la loi « Fauchon » dans d'autres affaires permet de dire que le juge a globalement intégré les intentions du législateur, sans pouvoir toujours leur donner une portée concrète. Certains critères n'ont posé aucune difficulté. Les juges ont compris la volonté du législateur d'instaurer une hiérarchie entre les deux types de fautes, et ont analysé la faute « délibérée » comme étant plus grave que la faute « caractérisée »475. De même, dans la définition de la faute caractérisée, ils se sont attachés à écarter les « poussières de faute » pour justifier une condamnation476 . Enfin, l'appréciation du double critère de violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité (existence d'un texte normatif et nature particulière de l'obligation) et celle de la gravité du danger n'ont pas soulevé de problème particulier. En revanche, les tribunaux semblent avoir eu beaucoup plus de mal à manier le critère central de chacune des deux branches d'inculpation : le fait que la violation de la règle doive être « manifestement délibérée » et le fait que le risque « ne pouvait être ignoré ». Ils ont, en fait, consacré un seul type de faute, bien défini, à travers une synthèse des deux critères retenus par le législateur. Il est difficile d'établir une faute délibérée sans intention de nuire Certains auteurs ont parlé d'une « force attractive de la faute caractérisée », tant la faute délibérée est délicate à mettre en œuvre. En effet, le bilan tiré en 2002 par le rapport de la Cour de cassation sur la jurisprudence de la chambre criminelle477 ne fait état que de deux affaires dans lesquelles la « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » a pu constituer un délit non intentionnel. Le rapport de la Cour explique que la recherche de l'intention de l'illégalité sans l'intention de ses conséquences est une démarche difficile, sinon impossible. Par exemple, il s'agirait pour le juge de condamner, pour un délit « non intentionnel », un prévenu qui a délibérément roulé à contresens sur une autoroute, mais qui soutient ne pas avoir voulu l'accident et les dommages qui en sont résultés478. De la même manière, il s'agirait, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, de parvenir à condamner un employeur pour délit « non intentionnel », alors qu'il a délibérément violé une obligation particulière légale ou réglementaire de sécurité, mais qu'il soutient ne pas en avoir voulu les conséquences479 480. Il est nécessaire mais difficile d'adopter un critère stable et lisible de la connaissance du risque Les juges ont respecté l'intention du législateur en ne cherchant pas systématiquement une connaissance préalable précise et établie du risque, puisque la faute peut précisément résulter du seul fait de n'avoir pas recherché cette connaissance. Ils ont également essayé de donner corps à la hiérarchie souhaitée par le Parlement entre la conscience que le prévenu aurait dû avoir du risque (définition sévère), et la connaissance qu'il pouvait en avoir (définition plus protectrice). Mais comme l'explique M. Desportes, conseiller référendaire à la Cour de cassation481 : « la traduction concrète de cette hiérarchie ne va pas de soi. Nombre de commentateurs ont relevé que la frontière était floue entre celui qui "devait connaître" et celui qui "ne pouvait ignorer", car il est en réalité des cas dans lesquels le prévenu ne pouvait ignorer... parce qu'il devait impérativement connaître. » En pratique, la connaissance du risque n'obéit donc pas à des critères uniformes, et le juge pénal a bâti une jurisprudence nuancée fondée sur l'appréciation de la situation du fautif, de ses obligations, de ses pouvoirs et de ses moyens482. Cette diversité d'appréciation « explique que l'existence d'une faute caractérisée ne soit pas appréciée de la même façon en la personne d'un maire, responsable de l'ensemble des affaires de la commune, d'un chef d'entreprise ou d'un professionnel auquel est confiée une tâche précisément définie.483 » Dans le domaine de la santé au travail, la mission a estimé que le flou entourant le degré nécessaire de connaissance des risques constituait une limite à l'applicabilité du régime pénal issu de la loi Fauchon. En effet, l'employeur a bien l'obligation légale d'identifier les risques professionnels484 mais, en l'état du dispositif, celle-ci ne trouve pas de traduction en termes de sanction. Ainsi, le régime de la loi « Fauchon » soulève des difficultés que les décisions récentes concernant les affaires liées aux expositions anciennes à l'amiante ont illustrées. La délicate synthèse jurisprudentielle Les juges ont donc cherché à concilier, d'une part, l'intention du législateur d'instaurer une faute résultant de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité - qu'ils ne parviennent pas à mettre en œuvre à cause de critères légaux trop difficiles à réunir - et, d'autre part, la nécessité de trouver un critère fiable pour établir le degré de connaissance du risque. L'étude de la jurisprudence depuis 2000 montre que les juges sont parvenus à une synthèse : le critère fiable de connaissance d'un risque en matière de santé au travail est celui de l'existence d'une règle précise d'hygiène et de sécurité. En effet, en droit du travail, la violation des textes législatifs ou réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité constitue, en soi, une faute incontestable, qui est pénalement sanctionnée485. De plus, on peut considérer que l'existence d'une règle particulière crée une « présomption » de connaissance du risque qui suffit, à elle seule, à caractériser la faute. Quelle que soit sa connaissance réelle du risque, le non respect d'une règle précise est opposable au prévenu, en vertu de son obligation de « veiller personnellement » à l'application d'une telle règle486. Le critère de l'illégalité a donc offert au juge pénal une base solide pour appliquer le régime issu de la loi du 10 juillet 2000. Le conseiller référendaire Desportes parle ainsi d'une « absorption de la faute délibérée par la faute caractérisée »487. Cette synthèse a gagné la jurisprudence, comme le signale le rapport de la Cour de cassation pour 2002 : « Dans de très nombreux arrêts, [la chambre criminelle] a approuvé les juges du fond d'avoir jugé que la méconnaissance, par le chef d'entreprise ou son délégataire, de la réglementation relative à la sécurité des travailleurs constituait une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer. » En droit pénal, il convient donc de considérer aujourd'hui que l'action normative de l'Etat en matière sanitaire constitue un degré d'alerte du prévenu jugé suffisant, car nul contrevenant à la règle ne peut se prévaloir d'une méconnaissance du risque488 489 . La mission a relevé que la délicate synthèse jurisprudentielle des critères opérée par les juges remet en cause la complémentarité des deux branches de l'alinéa 4 de l'article 121-3 du code pénal, tout en respectant « l'esprit de la loi Fauchon », tel qu'il est décrit par le ministère de la justice dans la circulaire d'application490. La mission s'est donc demandée s'il ne fallait pas réviser la rédaction de cet alinéa. 2.- La loi du 10 juillet 2000 doit être révisée La question de la révision de la loi du 10 juillet 2000 est apparue comme cruciale, dès le début des travaux de la mission. Elle constitue, en effet, une revendication constante des associations de victimes, et a fait l'objet de nombreuses pétitions. Elle a également occupé une place importante dans les auditions menées par la mission, sans qu'un véritable consensus ne se dégage entre les témoins entendus sur le principe même d'une modification de l'article 121-3 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi Fauchon. En tout premier lieu, la mission rappelle qu'en vertu du principe de non rétroactivité de la loi pénale la plus sévère, aucune révision durcissant la loi Fauchon ne saurait modifier le droit applicable aux affaires de contamination ancienne par l'amiante. Si la loi Fauchon doit être révisée, c'est pour que les règles changent pour l'avenir, afin que s'applique à tous un régime plus clair, et plus responsabilisant. En s'inscrivant dans le cadre du principe d'égalité devant la règle pénale, cette loi a acquis une autorité, qu'il était délicat de remettre en cause pour des circonstances liées aux « seules » maladies professionnelles. C'est pourquoi la mission, qui ne souhaitait pas remettre en cause le caractère général de la loi, s'est demandé si les difficultés rencontrées à l'occasion des maladies professionnelles ne traduisaient pas un problème plus général d'application. Elle a considéré que la rédaction actuelle pouvait conduite, à tort, à ce que la violation, en soi, d'un texte ne soit pas répréhensible, alors que le respect de la loi est une obligation morale qui doit être affirmée par le droit pénal, surtout lorsqu'il s'agit de respecter une obligation particulière de sécurité. Elle a donc proposé de simplifier, de façon mesurée, la sanction des manquements à cette obligation. a) La révision ne doit pas remettre en cause le principe selon lequel la loi pénale est la même pour tous Malgré certains arguments avancés par les avocats des victimes au cours de leur audition491, la mission n'a pas souhaité remettre en cause l'intention du législateur de ne pas créer de règles pénales spécifiques à telle ou telle situation. Au contraire, elle s'est interrogée sur la pertinence de la loi « Fauchon » à l'égard de l'ensemble des délits non intentionnels. Elle s'est, en particulier, demandé s'il fallait continuer de subordonner la répression de la violation de la règle à une intention « manifestement délibérée ». ● Une intention claire du législateur : la loi pénale est la même pour tous, mais son application doit permettre de différencier les situations La loi Fauchon a été adoptée, on le sait, dans un contexte et dans un but précis. Il s'agissait de canaliser les poursuites dont faisaient l'objet les élus et fonctionnaires locaux, pour des dommages graves, survenus dans l'exercice de leurs fonctions, et dont l'analyse montrait a posteriori qu'ils auraient pu être évités par des mesures de prévention adéquates. Les noyades du Drac, l'incendie des thermes de Barbotan, les inondations de Vaizon-la-romaine ont servi de toile de fond au débat, qui a conduit le Parlement à adopter à l'unanimité la loi du 10 juillet 2000. Cette loi faisait suite au rapport d'un groupe d'étude, dirigé par Jean Massot, sur la responsabilité pénale des décideurs publics, dont l'esprit et les conclusions ont guidé les choix du législateur. Toutefois, conformément au principe d'égalité devant la loi pénale, le législateur a généralisé l'application des nouvelles dispositions plus protectrices à l'ensemble des auteurs de délits non intentionnels. Cette volonté résultait aussi en grande partie d'une crainte que la loi ne soit perçue comme une « loi de privilèges »492. Ce principe doit cependant être apprécié au regard du principe constitutionnel selon lequel l'égalité s'apprécie pour des situations comparables. Ainsi, l'application de la loi pénale par le juge peut différencier des situations appelant des régimes de sanction différents. C'est le cas, par exemple, des délits non intentionnels en matière de circulation routière, auxquels ne s'applique pas le régime prévu par la loi Fauchon, le juge établissant, en général, un lien direct entre la faute du conducteur et le dommage de la victime. On notera également que le Parlement n'a pas souhaité dépénaliser à l'excès l'ensemble du champ des délits non intentionnels493, comme en témoignent tous les travaux préparatoires de la loi. Pour ne citer que Mme la Garde des Sceaux « un accident du travail peut être la résultante indirecte des fautes commises par plusieurs personnes, par exemple le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre, les entreprises sous-traitantes, etc. La responsabilité pénale de ces différents acteurs, même indirecte, doit pouvoir être recherchée et, le cas échéant, engagée 494 » ou encore le rapporteur à l'Assemblée nationale495 « dès lors qu'il ne pouvait être question de réserver un sort particulier à ces décideurs publics, car la loi pénale est devenue et doit rester la même pour tous, il convenait d'éviter qu'une réduction du champ des délits non intentionnels ne se traduise par une atténuation de la répression dans des domaines aussi sensibles que le droit du travail, de l'environnement, de la santé publique ou de la sécurité routière ». Ce principe a été ensuite repris dans la circulaire d'application de la loi496. ● La violation « manifestement délibérée » de la loi ou du règlement peut-elle constituer un délit non intentionnel ? Comme l'indique l'analyse du régime applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, il est presque impossible de démontrer qu'un prévenu est coupable d'un délit « non intentionnel », quand il a « délibérément » violé la loi ou le règlement. En fait, cette conclusion relève de difficultés de principe qui débordent largement la santé au travail. Mme Odile Bertella-Geoffroy, juge d'instruction au pôle de santé publique de Paris, a souligné, au cours de son audition497, la difficulté pour le juge de démontrer la faute prévue par le législateur : « la violation « manifestement délibérée » d'une réglementation est une faute difficile à établir [...] il faut que la personne ait été au courant de la loi et l'ait violée délibérément, ce qui nécessite des témoignages et équivaut presque à transformer l'infraction non intentionnelle qu'est l'homicide involontaire (soit une négligence ou une imprudence grave) en infraction intentionnelle. » La mission s'est demandé comment « l'hostilité498 » à une norme de prudence ou de sécurité résultant de sa violation pouvait être isolée d'une certaine intentionnalité de nuire. Comme l'indique M. Desportes499, « (...) par nature, un tel manquement expose généralement autrui à un risque d'une particulière gravité puisqu'il consiste en la violation de dispositions ayant précisément pour objet de protéger (...)». La mission est ainsi parvenue à la conclusion que l'hypothèse retenue par le législateur recouvre peu de réalités concrètes. L'obligation particulière de prudence ou de sécurité est spécifique à un certain public500, elle est plus précise que la simple obligation générale, et elle tend à prévenir des dommages corporels importants. Si une telle règle est « délibérément violée », il y a lieu de rechercher l'existence d'un délit intentionnel. Si, à l'inverse, un prévenu peut démontrer n'avoir à aucun moment voulu les conséquences de son manquement, c'est que celle-ci n'est pas délibérée (elle peut, par exemple, résulter d'un cas de force majeure). Il paraît vain de chercher à dissocier l'intention de nuire de l'intention de violer une telle règle. Au demeurant, comme cela a déjà été dit, ce commentaire est illustré par l'absence quasi-totale de condamnations reposant sur cette branche de l'article 121-3 dans la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation depuis 2000, qui ne concerne pas que le champ de la santé au travail, mais l'ensemble des délits non intentionnels commis par un auteur indirect. ● L'exigence d'une violation « manifestement délibérée » n'est pas pertinente dans une perspective de prévention Le droit pénal joue un rôle fondamental de protection des valeurs auxquelles la société est attachée. A ce titre, comme l'ont souligné de nombreux témoins, la sanction de l'imprudence est indispensable afin d'encourager les comportement plus vertueux, surtout lorsque les conséquences de la sanction, comme c'est le cas de la sanction pénale, ne peuvent être ni mutualisées, ni regardées comme un coût économique nécessaire. Ainsi, aucun témoin n'a contesté devant la mission le caractère responsabilisant de la faute pénale au regard de la prévention des risques. De ce point de vue, l'absence de sanction d'un délit non intentionnel en cas de violation avérée des obligations particulières de prudence ou de sécurité prévues par la loi ou le règlement est donc un non-sens. Ce constat est aggravé par les critères généralement retenus par la jurisprudence pour qualifier l'infraction « manifestement délibérée ». « De manière générale, la jurisprudence fonde le « caractère manifestement délibéré » de l'infraction sur des indices objectifs : il en est ainsi quand une personne viole à plusieurs reprises une obligation de prudence ou de sécurité, ou qu'elle cumule des violations successives d'obligations de nature diverse501 ». Ces « critères de l'intention » sont donc particulièrement déresponsabilisants, puisqu'ils pourraient impliquer que seule la répétition de la faute est condamnable. Appliquée à des dommages sur la santé des personnes, une telle définition serait désastreuse sur le plan de la prévention des risques. Le même objectif de responsabilisation commande d'ailleurs que l'on puisse rechercher la responsabilité des personnes physiques, même s'il est désormais possible de retenir la responsabilité pénale des personnes morales502. Pour la mission, il est essentiel que la responsabilité des personnes morales n'exclue pas de rechercher celle des acteurs eux-mêmes, qui seuls jouent un rôle dans la prévention des risques. Tel est d'ailleurs l'état du droit puisque le troisième alinéa de l'article 121-2 du code pénal dispose que « la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ». De la même façon, la mission a estimé que la nécessaire responsabilisation de l'Etat dans le domaine de la prévention des risques503 ne devait pas exclure la responsabilité des personnes privées, mais au contraire aider à la définir plus précisément. Elle a considéré que l'équilibre trouvé par la justice pénale dans la définition de la responsabilité de l'employeur, laquelle se déduirait en quelque sorte de l'action ou de l'inaction de l'Etat, n'est pas contraire à l'esprit que le législateur a voulu conférer à la loi pénale. b) La révision doit affirmer l'obligation de respecter les règles fixées par la loi ou le règlement S'il est normal que la violation d'une norme précise de sécurité soit la condition nécessaire de la sanction, il faut également qu'elle en soit une condition suffisante. En matière de prudence et de sécurité, la violation de la règle établie par les pouvoirs publics est en effet cause de dommages importants, et traduit en tout état de cause une intention coupable. ● La violation d'une règle particulière de sécurité est dommageable Contrairement aux obligations générales, le but des obligations particulières de prudence ou de sécurité, fixées par la loi ou le règlement, est d'éviter des dommages importants causés à la personne d'autrui. Les exemples cités au cours de la discussion de la loi 10 juillet 2000 illustrent cette distinction504 : « Ainsi, ont été considérées par la jurisprudence comme des obligations « générales » les dispositions du code de la route qui obligent les conducteurs à rester constamment maîtres de leur vitesse et à régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée et des difficultés de la circulation (article R.11-1), ou celles du code du travail qui prescrivent que les établissements et locaux doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs (article L.233-1). A l'inverse, constituent des obligations « particulières » la limitation de la vitesse à 90 km/h sur les routes et à 130 km/h sur les autoroutes ou les règles précises propres aux diverses catégories de machines et d'équipements de travail et à leurs conditions d'emploi. La Cour de cassation a également approuvé une chambre d'accusation qui avait estimé que l'article L. 131-2-6° du code des communes, qui confie au maire le soin de prévenir et de faire cesser tous les événements survenant dans sa commune et de nature à compromettre la sécurité des personnes, ne crée pas à sa charge d'obligation particulière (Cass. crim., 25 juin 1996). » La violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence doit donc être regardée comme une source potentielle de dommages importants. Il convient de rappeler à cet égard que le législateur a créé, en 1996, un délit spécifique réprimant le risque même de dommages importants, qu'occasionne une telle violation, à travers la « mise en danger de la personne d'autrui ». ● La violation de la règle est, en soi, répréhensible Il est malaisé de défendre l'impunité en cas de violation de la loi. Le législateur a d'ailleurs craint, au cours de l'élaboration de la loi Fauchon, que le critère de l'intentionnalité ne conduise à dépénaliser à l'excès la violation des obligations particulières de prudence et de sécurité. C'est la raison pour laquelle De même, la mission n'a pas entendu de témoin défendre l'idée selon laquelle on pourrait échapper à la sanction tout en ayant violé une obligation légale ou réglementaire de sécurité. Au contraire, au cours de son audition, M. Jean-Claude Muller, directeur santé et sécurité d'Arcelor, a justifié qu'aucune charge pénale ne devrait peser, par principe, sur les anciens industriels de l'amiante, dès lors que ceux-ci avaient respecté la réglementation506. Pour la mission, il ne paraît pas choquant de réprimer la violation proprement dite de la loi. Une telle violation est, en soi, répréhensible, surtout lorsque la règle transgressée découle d'un texte spécifique destiné à un public averti et que sa violation entraîne des dommages importants, comme c'est le cas des obligations particulières de prudence ou de sécurité. Au cours de son audition par la mission, le Garde des Sceaux a d'ailleurs rappelé et soutenu l'intention du législateur d'instaurer une complémentarité dans l'article 121-3 du code pénal entre la faute caractérisée et la violation d'une règle particulière507, confirmant ainsi la nécessité de sanctionner les manquements à de telles règles. c) Une proposition équilibrée : sanctionner les manquements aux obligations particulières de prudence ou de sécurité La mission propose que le législateur supprime, dans le 4ème alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les termes « de façon manifestement délibérée ». Cette solution consiste à supprimer l'exigence d'une intention particulière en complément de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité. On rappellera que ce double critère est requis en droit pénal pour constituer le délit de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, qui sanctionne un risque, mais en l'absence de dommage avéré (cf schéma ci-après). En matière de délits d'homicide ou de blessure involontaire, il importe de sanctionner la personne qui les a causés indirectement par la seule violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, qui précisément visait à les éviter. 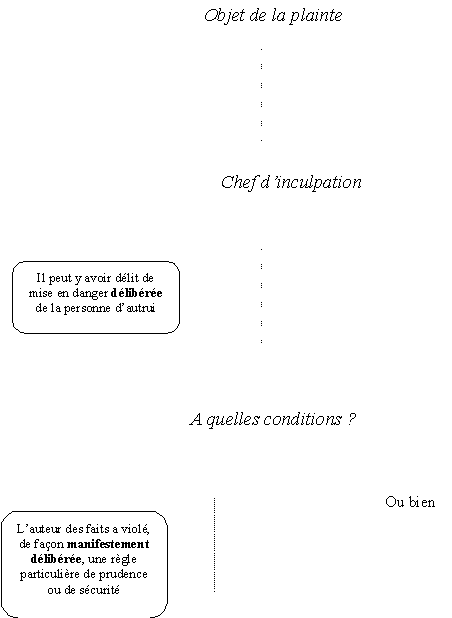  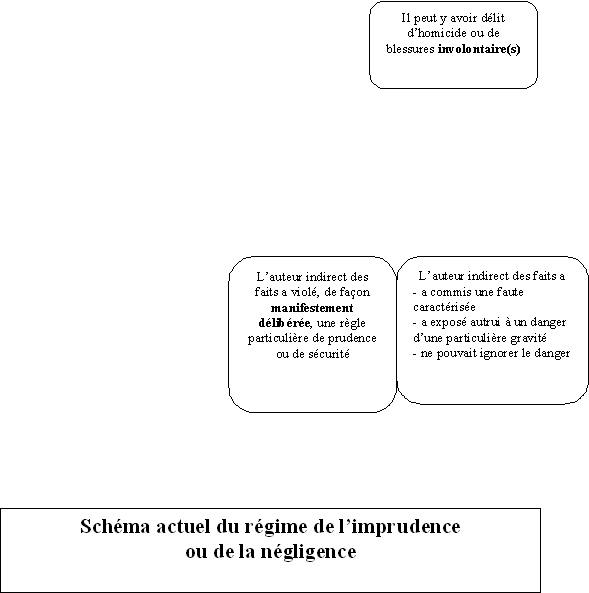 ● Un retour à la complémentarité voulue par le législateur entre deux types de faute Dès la première lecture devant l'Assemblée nationale, le législateur avait perçu l'inconvénient majeur de la proposition initiale du Sénat (l'illégalité manifestement délibérée). Il avait alors cherché à mieux sanctionner en complétant la solution du Sénat par la faute caractérisée, mais n'avait pas mesuré que la difficulté d'application du régime par les juges supprimerait quasiment cette complémentarité. Dans son rapport508, M. René Dosière expliquait ainsi les craintes de la commission des lois que l'absence de sanction du non respect de la loi ne soit en décalage trop flagrant avec les attentes de la société vis-à-vis des règles de la répression. « Le souci du Sénat d'exclure du champ de la répression pénale l'ensemble des fautes non intentionnelles et indirectes, dès lors qu'aucune obligation de sécurité ou de prudence n'a été violée de façon manifestement délibérée, c'est-à-dire « en conscience », peut sembler cohérent par rapport aux principes originels de notre droit. Mais ce choix est aujourd'hui excessivement réducteur. Il s'agirait d'un retour en arrière trop radical par rapport à l'orientation voulue par le législateur, le juge et la société elle-même, qui ne comprendrait pas que certaines inobservations des règles de sécurité et de prudence particulièrement graves ne puissent plus faire l'objet de poursuites pénales. » Mme la Garde des Sceaux devant l'Assemblée nationale509 avait explicitement souhaité que la responsabilité de l'auteur indirect d'un délit non intentionnel ne soit pas limitée à des actes « manifestement délibérés ». Pour le formuler, elle avait d'ailleurs choisi le secteur de la santé au travail, qui était à l'époque au centre de nombreuses inquiétudes à ce sujet : « Certains comportements, même non délibérés, peuvent être la cause indirecte d'un dommage et présenter un caractère particulièrement grave qui justifierait une condamnation pénale. Le droit du travail offre de nombreux exemples de fautes d'une exceptionnelle gravité et qui ne sont pas pour autant délibérées : Par exemple, dans une usine papetière, un ouvrier se tue en changeant les rouleaux alors que la presse qu'ils alimentent tourne encore au ralenti. Les juges condamnent le chef d'entreprise parce « qu'il n'existait ni dispositif de protection, ni panneaux signalant la zone dangereuse, ni dispositif d'éclairage permanent, ni bouton d'arrêt d'urgence ». » La mission a relevé que l'exemple choisi par Mme Elisabeth Guigou constituait précisément la violation non délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité510... La mission propose donc un retour à une solution, plus claire, plus facile à appliquer, et qui aurait également le mérite de mieux responsabiliser les acteurs privés. ● Une conception claire et responsabilisante de la faute Lors de la discussion de la loi Fauchon, le législateur a insisté pour que soit maintenu dans la répression de l'imprudence « l'élément moral du délit »511. La mission a considéré que cet élément moral était suffisamment établi, en cas de violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, édictée par les pouvoirs publics pour prévenir des dommages importants, sans qu'il soit nécessaire de rechercher une intention « manifestement délibérée ». La situation des décideurs publics, cible initiale de la loi Fauchon, est particulière au regard d'une telle faute, puisque le décideur public est régulièrement l'auteur de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité. Il doit, à ce titre, être attaché à son respect. S'il en est en revanche le destinataire, il lui appartient évidemment, plus encore qu'à tout autre, de la respecter ou d'en assumer la responsabilité pénale, dans le cas contraire. On relèvera que cette hypothèse ne s'applique pas à l'exercice des missions générales des décideurs publics, en particulier la mission de police administrative512. Une telle responsabilité pénale offre l'avantage de définir plus précisément et plus clairement la faute de chacun, celle de l'Etat (la carence à réglementer le risque) et celle des acteurs privés (le non respect des normes). Elle répond ainsi aux inquiétudes exprimées devant la mission selon lesquelles la dilution de la faute risque d'affaiblir la responsabilité, et donc la prévention du risque513. Si l'autorité sanitaire a cru devoir réglementer des risques en créant une obligation particulière de prudence ou de sécurité, il appartient aux acteurs privés, susceptibles de créer « les conditions du dommage », de mettre en œuvre cette prévention. Le régime qui résulterait de la proposition de la mission serait à cet égard plus incitatif : - La violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité serait constitutive du délit de mise en danger de la vie d'autrui, en l'absence de dommage, s'il est démontré qu'elle est manifestement délibérée (article 223-1 du code pénal). - Si des dommages résultent de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, celle-ci est constitutive des délits non intentionnels de blessure ou d'homicide involontaire. - En l'absence d'obligation particulière de prudence ou de sécurité, toute personne reste bien sûr justiciable d'une faute caractérisée exposant autrui à un danger d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. * * * La proposition de la mission, équilibrée et responsabilisante, favorise la prévention des risques, et plus encore la prévention des dommages. Bien qu'elle suppose de revenir, à la marge, sur la rédaction du code pénal issue de la loi du 10 juillet 2000, elle répond pleinement aux objectifs du droit pénal tels que Mme la Garde des Sceaux les avait rappelés au cours du débat : « Il n'est plus seulement là pour sanctionner des intentions subjectives coupables, mais pour prévenir objectivement des comportements qui peuvent porter atteinte à la vie et à l'intégrité physique. Cette évolution du droit pénal doit être approuvée, notamment - et nous savons ce que cela a apporté - dans les domaines du droit du travail, du droit de la santé, du droit de l'environnement, du droit de la sécurité routière, domaines dans lesquels, bien évidemment, nul ne songe que la répression puisse faiblir.514 » La mission préconise en conséquence de modifier l'alinéa 4 de l'article 121-3 du code pénal, qui serait ainsi rédigé : « Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé [de façon manifestement délibérée] une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. » Proposition : Dans l'avant dernier alinéa de l'article 121-3 du code pénal, supprimer les mots : « de façon manifestement délibérée » afin que la violation, en soi, d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement suffise à engager la responsabilité de l'auteur indirect du dommage. III.- LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DOIT DEVENIR UNE PRIORITÉ DE SANTÉ PUBLIQUE Dès sa création, la mission a considéré que les leçons à tirer de l'histoire de l'amiante devaient principalement permettre qu'un tel désastre sanitaire ne se reproduise plus. Cet objectif serait facilement atteint si le drame de l'amiante résultait seulement d'une succession d'escroqueries et de mensonges. Au contraire, la mission est convaincue que le drame de l'amiante n'est pas tant le fruit de malversations, que le résultat d'une faillite du système de prévention des risques professionnels. Elle a donc consacré une grande part de ses travaux à comprendre et à évaluer les limites de ce système. Il est apparu que l'affaire de l'amiante avait sanctionné un dispositif de prévention obsolète, dont les défaillances n'étaient pas nouvelles. Conçu pour des risques « durs », accidentels, survenant dans l'exercice de métiers dangereux, le système français de prise en charge des risques professionnels ne correspond plus à ceux que les mutations technologiques font aujourd'hui peser sur la santé des travailleurs. Ce dispositif fondé sur l'impératif de réparation des conséquences des accidents du travail n'est plus aujourd'hui adapté au besoin de prévention des maladies professionnelles, toujours plus nombreuses, et dont les temps de latence sont souvent très longs. Bousculé par les crises sanitaires successives, l'Etat, sous l'impulsion de l'Europe, doit maintenant bâtir un nouveau modèle de prévention dont il doit être le principal responsable. La mission a salué la prise en compte de cette préoccupation par le Gouvernement au plan des principes, mais elle a aussi constaté que les outils concrets d'une meilleure prévention des risques étaient encore insuffisants. A.- LA FIN D'UN SYSTÈME DE PRÉVENTION DEPUIS LONGTEMPS OBSOLÈTE L'affaire de l'amiante marque l'échec du dispositif français de prévention, tel qu'il a été structuré après la seconde guerre mondiale dans le cadre de la sécurité sociale. Des défaillances ponctuelles ou humaines portent sans doute une part indéniable de responsabilité, mais l'ampleur des maladies de l'amiante sanctionne surtout un dispositif d'ensemble, qui faisait depuis longtemps l'objet de critiques. Conçu autour d'une exigence de réparation des victimes, le système de prévention a été délégué à l'assureur social, qui a fait prévaloir l'objectif de réparation des dommages sur celui de la prévention des risques. 1.- L'affaire de l'amiante : une sanction lourde du système français de prévention L'affaire de l'amiante constitue en matière de prévention un révélateur de dysfonctionnements anciens. Comme la mission l'a déjà exposé515, les risques liés à l'inhalation de fibres d'amiante n'étaient pas ignorés, mais ils ont été gérés au sein d'un dispositif qui n'a pas pu empêcher la catastrophe sanitaire. Ces dysfonctionnements, déjà identifiés au sein même de l'Administration, ont conduit la justice à condamner l'Etat pour carence de l'action publique. a) Le drame de l'amiante traduit l'insuffisance des moyens classiques de prévention Face à un risque identifié, une approche préventive doit se traduire par des mesures de protection des populations potentiellement exposées, permettant d'espérer que le risque n'aura pas de conséquences. De ce point de vue, les dégâts causés par l'inhalation professionnelle de l'amiante témoignent d'un échec patent du dispositif. Comme l'a rappelé le professeur Marcel Goldberg, coordonnateur du rapport de l'INSERM de 1996516, cet échec est diversement partagé dans le monde, ce qui souligne la défaillance du dispositif français de prévention517 : « Aux États-Unis, pays dont on ne peut a priori penser que les employeurs ont une fibre particulièrement plus philanthropique que chez nous, on observe en 2005 une diminution des cas de mésothéliome par rapport à 2004 ; en France, nous sommes certains qu'ils continueront à augmenter pendant au moins vingt ou trente ans. Si l'on regarde les risques par génération, on constate que la génération la plus touchée aux États-Unis est celle qui est née dans les années 1920 ; chez nous, les risques continuent à augmenter pour les générations les plus récentes. Traduit en français ordinaire, cela signifie que nous avons au moins trente à quarante ans de retard en matière de protection des travailleurs vis-à-vis de l'amiante. Quelle qu'en soit la cause - employeurs, réglementation, etc. -, le résultat factuel est que le risque et le nombre de cas continueront d'augmenter en France, alors qu'ils baissent aux États-Unis. Ce sont là des données incontestables. » Le retard identifié par le professeur Goldberg est moins le fait d'un aveuglement que d'une banalisation des risques liés à l'amiante. L'Etat, comme la sécurité sociale, n'ont pas réfuté l'existence d'un risque, mais ils l'ont appréhendée à l'aune de leur arsenal classique de prévention des risques professionnels. Plusieurs témoins ont insisté sur l'importance de cette inscription de la crise de l'amiante dans un contexte historique518 : comparés à la plupart des risques professionnels, les risques liés à l'amiante n'ont fait l'objet ni d'un traitement renforcé, ni d'un relâchement particulier des mesures de prévention. Quelques risques spécifiques étaient bien réglementés de longue date, mais ils restaient une exception519. Sans revenir sur les éléments de chronologie dont il a déjà été fait état520, il est remarquable que le premier traitement des risques liés à l'amiante ait été l'inscription des maladies causées par l'inhalation des fibres aux tableaux des maladies professionnelles qui ouvrent droit à réparation. Cette démarche, suffisamment justifiée sur le plan scientifique pour que les partenaires sociaux en aient accepté le coût, n'est en rien exceptionnelle. C'est une démarche classique de traitement des risques professionnels par l'assureur public. Il en va différemment de la réglementation prise en 1977 (cf. encadré) qui, sous la forme de plusieurs décrets, visait à réduire l'usage de l'amiante en France (par l'interdiction des flocages notamment) et à protéger les travailleurs exposés. Il n'est pas contesté aujourd'hui que ce volet de mesures consacrait un « usage contrôlé » de l'amiante. Critiqué à cause de ses dramatiques conséquences, cet usage contrôlé n'en était pas moins, en 1977, l'outil habituel de prévention. Ce que le Gouvernement avait ordonné le 17 août 1977 : - Un contrôle atmosphérique régulier de la concentration moyenne de l'air en fibres d'amiante, afin de vérifier qu'elle ne dépasse pas 2 f/ml. Les résultats doivent être communiqués au médecin du travail et au CHSCT (art. 2 et 6). - Une obligation d'effectuer les travaux sur l'amiante, ou sa manipulation, par voie humide, ou dans des appareils dépressurisés (art. 3). - Une obligation de traitement sécurisé des déchets d'amiante afin de ne pas libérer de nouvelles poussières (art. 5) - Des conditions de mise en place et d'entretien des équipements collectifs et individuels de protection (art. 7 et 8). - Une obligation d'information des salariés par le chef d'entreprise concernant les risques et les moyens de prévention et de protection (art. 9). - L'interdiction du travail des mineurs en présence d'amiante (art. 12) - Pour tous les salariés : une attestation d'aptitude préalable particulière du médecin du travail, qui devra également tenir à jour un suivi d'exposition très complet (clichés radiographiques, durées d'exposition, nature du travail, mesures d'empoussièrement...), et le conserver pendant 30 ans (art. 11, 16 et 17). L'application la plus tardive de ces mesures a été fixée au 1er mars 1978 (contrôles d'empoussièrement) M. Michel Ricochon, chef de la mission d'animation des services déconcentrés de la direction des relations du travail, a estimé qu'il fallait y voir une corrélation avec le caractère progressif et incomplet des connaissances relatives à la dangerosité du produit521. Cet argument n'a pas convaincu la mission : le bannissement d'un produit dangereux n'a jamais été un outil habituel de gestion des risques professionnels, même pour les plus graves. C'est une mesure qui, aujourd'hui encore, est extrêmement difficile à prendre, qui est rare, et à laquelle on préfère le plus souvent une utilisation contrôlée, comme en a témoigné au cours de son audition522 M. Jean-Luc Pasquier, ancien responsable de la Direction des relations du travail (DRT) en charge de la réglementation de 1977 : « Je ne suis pas un défenseur de l'usage contrôlé, je constate les faits. Ou plus exactement, nous sommes tous, et vous êtes tous, mesdames, messieurs les députés, des défenseurs de l'usage contrôlé : vous tolérez que l'on continue d'utiliser le chlorure de vinyle monomère pour fabriquer vos bouteilles d'eau minérale ; vous tolérez que l'on mette du benzène dans l'essence, alors que ce produit est hautement cancérogène ; vous êtes pour l'usage contrôlé des hydrocarbures insaturés, qui constituent l'essentiel des produits chimiques que nous utilisons. » De ce point de vue, l'amiante a donc fait l'objet d'un traitement relativement banal parmi les risques professionnels523. S'il fallait trouver une originalité à la réglementation de 1977, peut-être la trouverait-on dans la réelle volonté politique de réduction des dangers que traduit la sévérité de l'encadrement des établissements utilisant de l'amiante. Mme Martine Aubry, qui travaillait à la DRT en 1977, a d'ailleurs fait part à la mission de la fierté de l'équipe du ministère du travail524 : une réglementation aussi protectrice n'était pas, à l'époque, chose courante. À ce jour, les mérites de la réglementation de 1977 sont encore difficilement évaluables à cause du temps de latence des maladies liées à l'amiante qui ne permettra d'en mesurer l'impact sur l'évolution du nombre de nouveaux malades qu'à partir de 2009. Mais, on sait déjà que cette réglementation a connu - comme c'est souvent le cas - des difficultés d'application et de contrôle, même si l'appréciation des uns et des autres diverge sur ce point525. À ceux qui mettent globalement en cause le dispositif de contrôle des réglementations - y compris celle applicable à l'amiante526 - s'opposent ceux qui soutiennent que des mesures spécifiques et efficaces ont été prises pour veiller à l'application de la réglementation de 1977527. En définitive, il apparaît que l'amiante a sans doute été traité comme un risque parmi d'autres, par les moyens habituels du système « préventif » français de l'époque. Les maladies de l'inhalation professionnelle de l'amiante doivent donc s'analyser, non pas seulement comme un passage douloureux de l'histoire, mais comme l'échec de tout un système pris dans son ensemble. C'est donc très logiquement que ce système a été condamné par la justice administrative pour ses carences générales. b) La condamnation de l'Etat a confirmé le diagnostic connu d'une carence de la politique de santé au travail Chargée en 2003 de remettre un rapport sur la « prévention sanitaire en milieu de travail », une mission de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) avait déjà sévèrement critiqué le dispositif français de prévention des risques professionnels528. Reprises dans le rapport annuel de l'IGAS pour 2003, les conclusions de cette mission relevaient des carences, qui ont conduit à la condamnation par le Conseil d'Etat le 3 mars 2004. ● Un constat déjà bien établi Traduisant en termes généraux l'échec du traitement des risques liés à l'amiante, les inspecteurs généraux critiquaient en 2003 une « division sociale » de la prévention, héritée des fondements de la sécurité sociale, et désormais inefficace. Ils relevaient que le rattachement de la prévention à la Sécurité sociale avait empêché la France de s'adapter aux nouveaux risques professionnels : « Le risque professionnel a profondément évolué, or le système a été conçu pour les accidents du travail, en déconnexion des systèmes de santé publique. Alors que les maladies professionnelles constituent à l'évidence l'avenir du risque sanitaire en milieu de travail, l'application des logiques de négociation collective et de relations du travail est devenue complètement obsolète ; ainsi les méthodes d'inscription des maladies au tableau des maladies professionnelles laissent une part très large à la négociation. Cette greffe insuffisante du système de prévention des risques professionnels sur les logiques de santé publique a empêché ce domaine d'opérer, à l'instar des autres champs de la santé, les mutations nécessaires pour prendre en compte les impératifs de sécurité sanitaire et d'urgence. (...) La santé au travail ne vit pas au même rythme que la santé publique, mais à l'allure beaucoup plus lente de la négociation sociale. » Analysant tour à tour les modalités de la connaissance du risque - « qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu » - et celles de la prévention du risque connu Au terme d'une critique particulièrement sévère, les inspecteurs généraux voyaient dans l'insuffisance du rôle de l'Etat la cause principale de l'échec de la prévention : « Une analyse santé publique de l'ensemble du droit de la prévention des risques professionnels peut conduire à une conclusion assez radicale selon laquelle l'Etat a délégué la surveillance de la santé des travailleurs aux entreprises via le ministère du travail et les CHSCT dans les entreprises. » Plus encore, la mission de l'IGAS estimait que la remise en cause du « désintérêt » de l'Etat était la condition nécessaire d'une amélioration de la prévention : « En définitive, le problème est que la maintenance de la santé n'est pas la principale préoccupation de ceux qui organisent le travail en France. Ce désintérêt finira par poser des questions sur le recul actuel et à venir, semble-t-il, de l'Etat sur ces sujets. » Le constat dressé en 2003 par l'IGAS a trouvé son écho un an plus tard avec la condamnation de l'Etat pour les carences relevées dans l'exercice de ses responsabilités en matière de prévention des risques sanitaires au travail. ● La sanction des carences de l'Etat par la justice administrative Par un arrêt de principe du 3 mars 2004530, le Conseil d'Etat a jugé que la responsabilité de l'Etat était engagée pour ses carences dans le traitement des risques liés à l'inhalation de fibres d'amiante. La mission a souhaité entendre à ce sujet Mme Emmanuelle Prada-Bordenave, commissaire du Gouvernement, dont les conclusions ont été suivies par le Conseil d' Etat dans cette affaire531. Par sa décision, le Conseil d'Etat a d'abord reconnu la spécificité des maladies liées à l'amiante. Relevant la connaissance précise qu'on avait des dangers de l'amiante et la mission de protection qui en résultait pour l'Etat à l'égard des travailleurs et à l'égard de l'usage de l'amiante532, Mme Prada-Bordenave a estimé que les particularités de l'affaire appellaient une réponse spécifique du juge. Deux ans après le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation sur la réparation des victimes de l'amiante, le juge administratif a voulu apporter sa contribution à la prise en compte d'une catastrophe sanitaire sans précédent liée au travail. Cette volonté a été confirmée par M. Jean-Michel Belorgey, président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat au cours de son audition533. Toutefois, la portée de la décision du 3 mars 2004 dépasse l'affaire de l'amiante pour toucher l'ensemble de la problématique de la prévention des risques professionnels. Saisie de quatre affaires correspondant à des expositions différentes de travailleurs à l'amiante - deux avant 1977, deux après -, la Haute juridiction a développé sa conception de la responsabilité de l'Etat en matière de prévention des risques professionnels. Selon Mme Prada-Bordenave, la décision a permis de caractériser deux fautes de l'Etat : une carence dans le devoir de réglementation et une carence dans le devoir de contrôle de l'application et de la pertinence de ses propres règles : « La faute commise à l'époque d'Eternit, c'est-à-dire durant la première période, ressort de la carence (...) l'amiante n'a jamais durant tout ce temps fait l'objet d'une réglementation. Pourquoi ? On ne sait pas. Et pourtant, on savait depuis 1906 que l'amiante était dangereux et que l'on attrapait des maladies mortelles dans les usines. C'est ce « trou » étrange, cette absence de réglementation, alors même que le code du travail l'impose, que le Conseil d'État a considéré comme une faute. Durant la deuxième période, dite de l'usage contrôlé - à partir de 1977 -, l'amiante était soumis à réglementation. La France, comme d'autres pays d'Europe, a alors instauré une politique d'usage contrôlé de l'amiante qui imposait la mise en œuvre de technologies assez fines dans la mesure où la pureté de l'air dans les ateliers devait être surveillée par un système de microscopie à balayage. Huit heures par jour, un outil de mesure très fin vérifiait la teneur de l'air en fibres. Ce n'est évidemment pas cette réglementation que le Conseil d'État a jugée répréhensible, mais le fait qu'elle n'était applicable et appliquée que dans des ateliers manipulant de l'amiante, où le danger était donc connu. (...)La faute de l'État est donc de n'avoir pas vérifié que sa réglementation était appliquée là où elle aurait dû l'être et surtout si elle était adaptée à la réalité des risques. Or l'État n'a jamais utilisé les moyens dont il disposait pour vérifier que la réglementation qu'il avait prise garantissait une protection suffisante des travailleurs. Il pouvait, pourtant, s'informer auprès des inspecteurs du travail et des Caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), chargées de centraliser les informations sur les accidents du travail et des maladies professionnelles et de les faire remonter à la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), afin que celle-ci diffuse les recommandations adéquates. » Au cours de son audition, Mme Prada-Bordenave a insisté sur la portée de la décision du Conseil d'Etat en soulignant que, conformément aux principes généraux de la responsabilité de l'Etat, la législation en matière d'hygiène et de sécurité ne laisse pas à l'Etat les mains libres, mais crée à son encontre une véritable obligation de police, qui s'attache à la sécurité des personnes534. L'Etat est donc justiciable d'obligations importantes dans le champ de la santé au travail. Sa responsabilité, telle qu'elle a été engagée par le Conseil d'Etat, est double : un impératif de protection des travailleurs par la réglementation mais aussi un impératif d'adéquation et d'efficacité de la réglementation. Il ressort de cette condamnation que l'ensemble du dispositif de prévention est en cause, dès lors qu'il n'a pas permis à l'Etat d'assumer ses responsabilités535. Une analyse que M. Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, a confirmée au cours de son audition du 24 janvier 2005536. 2.- La faillite d'un système gouverné par l'objectif de réparation Le constat général établi en 2003 par la mission de l'IGAS montre clairement le mécanisme par lequel l'Etat n'a pas assumé ses responsabilités dans la protection de la santé au travail. Chargé par les grandes législations du travail du XIXème siècle « d'assurer une mission de réglementation », l'Etat a cherché, lors de la création de la sécurité sociale, à consolider la façon dont les travailleurs étaient assurés contre le risque professionnel, le système assurantiel privé en vigueur auparavant ayant montré ses limites. L'idée était de distinguer entre l'Etat, chargé de réglementer les risques, et l'assureur public chargé de réparer les dommages mais aussi de chercher à réduire les coûts, soit en les répercutant sur les entreprises fautives, soit en réduisant les risques par la prévention. Cette démarche a bien fonctionné pour les accidents du travail - risques facilement identifiables et dont le lien avec l'entreprise est aisément établi537. Mais, pour les maladies professionnelles, le lien de causalité est plus délicat surtout lorsque les dommages surviennent 20 ou 30 ans après l'exposition au risque. Dans ce cas, la mutualisation a permis de réparer le dommage, mais elle a déresponsabilisé l'assureur et les entreprises. C'est le constat établi par de nombreux témoins : l'échec de la démarche semble résulter de l'incapacité à s'adapter à l'émergence des maladies professionnelles, dont les causes sont multiples, l'identification difficile, et le temps de latence parfois important. Cette analyse, reprise par la Cour des comptes en 2002538 , a d'ailleurs été partagée par M. Franck Gambelli, président de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)539 : « Le constat d'une évolution du risque des accidents du travail vers les maladies professionnelles est incontestable. Cette évolution est liée, à mon sens, à la fois à la perception du risque et à des développements technologiques. Il me semble que dans l'après-guerre, nous avons continué à organiser la prévention du risque telle qu'elle ressortait de l'économie industrielle de la fin du XIXe siècle. Nous nous sommes polarisés sur le risque dur, qui était une réalité forte à l'époque et un énorme travail a été accompli sur ce plan. Mais le risque diffus passait au second plan (...). » L'affaire de l'amiante, et la décision du Conseil d'Etat, marquent la faillite de cette « mécanique » historique de gestion du risque professionnel qui, dominée par la logique de la réparation, n'a pas su donner naissance à de véritables acteurs de prévention. a) Une logique de réparation qui a montré ses limites La prévalence de l'objectif de réparation sur la logique de prévention a provoqué deux écueils majeurs : un partage trop flou des responsabilités, et une incitation trop faible à la prévention. ● Le problème du partage des responsabilités Toute l'ambiguïté du partage des rôles entre l'Etat et la sécurité sociale est très clairement apparue au cours des auditions. La réparation est une question financière, qui relève naturellement des gestionnaires de la caisse assurantielle du risque professionnel. Les partenaires sociaux en sont responsables à tous les niveaux - depuis la création des tableaux de maladies professionnelles jusqu'à la gestion des fonds de la caisse AT-MP - et la négociation sociale y a toute sa place. La prévention fait aussi partie de la délégation confiée aux partenaires sociaux. Son dispositif a donc également été discuté dans la cadre des négociations qui n'en ont pas fait un enjeu prioritaire, malgré l'attachement exprimé aujourd'hui par les partenaires sociaux - parfois même en termes vifs540 - à leur rôle en matière de prévention. Dans ce domaine, la mission a constaté une véritable confusion des responsabilités et des rôles, très préjudiciable à la prévention. Les discours des partenaires sociaux montrent en effet leur incapacité à prendre suffisamment de recul pour comprendre qu'il est préférable d'éviter les risques professionnels plutôt que d'avoir à en payer les conséquences. Les auditions de la mission témoignent, à de rares exceptions, de la tendance des syndicats à privilégier les questions de financement, de prestations et de gouvernance. Interrogé sur l'expertise des risques nécessaires à la prévention, le Docteur Pierre Thillaud, représentant la CGPME, a fourni une réponse révélatrice541 : « Les partenaires sociaux ont été unanimes à s'élever contre leur exclusion de l'expertise, fondement de l'analyse. N'oublions pas que la réparation est avant tout un compromis social, fondé sur une présomption d'origine, laquelle ne peut être issue que d'un consensus ou, à tout le moins, d'une discussion plurielle contradictoire. La pire des choses serait de s'en remettre à un organisme qui, au motif qu'il serait public et de ce fait présupposé indépendant, écarterait les partenaires sociaux de l'appréhension de la réparation. » Depuis la mise en place du système de protection sociale, en 1945, les partenaires sociaux ont toujours souhaité gérer la prévention, mais pas en assumer les échecs, qu'ils attribuent plutôt à l'indigence de l'Etat. Les témoignages fournis à la mission relatifs à leur participation au Comité permanent amiante montrent bien les limites d'une telle démarche. Ainsi, M. Bernard Salengro, délégué national au pôle protection sociale de la CFE-CGC a tenu à justifier la participation de son syndicat au CPA542 : « Parallèlement à l'évolution, incontestable, des connaissances scientifiques sur l'amiante, il y a eu l'histoire : on a cru un moment à un possible « usage contrôlé » de l'amiante, on a longtemps ignoré que certaines pathologies n'étaient pas liées à un effet de seuil, sans oublier le rôle joué dans cette affaire par le comité permanent de l'amiante, instance de réflexion organisée par les industriels. La CGC n'est en rien gênée d'y avoir participé : nous sommes partisans du dialogue jusqu'au bout, estimant que, dès lors que l'on peut échanger, cela vaut la peine d'essayer, même si c'est difficile, voire dangereux. Il est logique et prévisible que les employeurs aient tenté de tirer la couverture à eux. Ce qui, en revanche, est décevant est que les responsables de l'État n'aient pas joué leur rôle, alors qu'ils représentaient la société civile, et disposaient de moyens que les partenaires sociaux n'avaient pas. Là est le problème de fond. » Cet état d'esprit généralisé imprègne le fonctionnement même de la sécurité sociale, comme en atteste le témoignage de M. Gilles Évrard, directeur des risques professionnels à la CNAMTS543 : « Cet ensemble [le système de prévention de la sécurité sociale] concourt à définir des outils et des recommandations en termes de prévention. Mais je précise que nous sommes là au-delà, ou en deçà, du socle légal et réglementaire. Nous ne nous substituons pas à l'inspection du travail, laquelle peut exercer un pouvoir coercitif que nous n'avons pas. Nos ingénieurs n'établissent pas de procès-verbal. Leur rôle est de conseiller les entreprises. Ils peuvent, le cas échéant, leur signifier des injonctions lorsque le défaut de sécurité met en danger les salariés. (...) Mais le caractère nocif de l'amiante est connu depuis longtemps. Il fait l'objet d'un tableau de maladies professionnelles depuis la création de la branche. L'ensemble de la branche avait fourni des recommandations de prévention bien avant l'interdiction. » M. Évrard n'a d'ailleurs pas nié les conséquences de cette confusion des rôles : « Rétrospectivement, on peut dire que les actions ont été insuffisantes. Peut-être s'est-on trop attaché à éviter les conséquences de l'amiante au lieu de l'interdire purement et simplement ». La mission n'a pu qu'accréditer cette hypothèse, et constater que le fonctionnement même des mécanismes de réparation n'incite pas à la prévention. ● Une faible incitation à la prévention La mission a déjà exposé les limites de la tarification de la branche AT-MP en matière de prévention544. Elle a également constaté que la culture de la sécurité sociale était restée très en deçà des enjeux de la prévention. Une démarche de type assurantiel pourrait sans doute responsabiliser les acteurs en faisant peser le coût financier sur les véritables créateurs de risques, à la manière du système américain. Mais la mutualisation des charges qui caractérise le fonctionnement de l'assureur public français ne permet pas une telle responsabilisation. Celle-ci ne peut résulter que d'une action volontariste de sensibilisation, dont toute la difficulté a été résumée par M. Gilles Evrard545 : « Il faut rappeler que près de 90 % des entreprises de notre pays comptent moins de dix salariés, et qu'elles emploient le quart du total des salariés. La fréquence des accidents du travail donnant lieu à un arrêt de travail est de l'ordre de 4 %. Concrètement, une entreprise de cinq salariés connaît un accident du travail avec arrêt de travail une fois tous les cinq ans. C'est dire que l'accident du travail est un événement rare dans les entreprises, ce qui n'est pas sans conséquence pour la prévention. Il est en effet difficile de convaincre les chefs d'entreprise de l'importance que revêtent des mesures visant à prévenir des accidents qui sont à leurs yeux une chose somme toute assez rare. » C'est pourquoi la mission s'est ralliée à l'analyse de l'IGAS, selon laquelle notre dispositif n'était « pas à la hauteur de l'enjeu546 ». Le témoignage de M. Dominique Moyen, ancien directeur général de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) a également confirmé qu'il était impératif de changer d'approche547 : « (...) il est inacceptable que la sécurité sociale, qui me donnait 500 millions par an pour faire fonctionner l'INRS, ne m'ait pas autorisé à dépenser plus sur les maladies professionnelles et la prévention. Nous aurions pu faire beaucoup de choses, mais les maladies professionnelles ne faisaient pas partie des préoccupations principales de la sécurité sociale. (...) Pour vous donner un exemple, j'avais voulu publier un dossier Santé et travail. J'ai entendu à cette occasion des choses extravagantes, par exemple que le lieu de travail était un lieu où l'on pouvait promouvoir la santé comme le font les entreprises japonaises en faisant faire des exercices aux ouvriers, ou encore que l'entreprise pouvait participer à la prévention de la carie dentaire en invitant les salariés à se brosser les dents. Tout cela est peut-être vrai, mais l'essentiel est ailleurs. Ma préoccupation était de promouvoir une politique de santé au travail. Or, je n'ai jamais pu intéresser le conseil d'administration et la direction de la sécurité sociale à cette approche. » b) Des acteurs, aux missions limitées, qui n'ont pas pu prévenir les risques La prévention impose avant tout une connaissance précise du risque professionnel. Or, en matière de maladies professionnelles, cette connaissance est difficile à établir. Elle suppose une double approche : essayer de connaître le risque avant qu'il ne se réalise - par l'expertise -, identifier le risque quand il se réalise - par la veille sanitaire. C'est dans cette perspective que le dispositif hérité de la création de la sécurité sociale devrait être réformé. ● Une expertise des risques dont l'indépendance fait débat L'expertise des risques ayant eu pour principal objectif l'inscription des maladies aux tableaux ouvrant droit à réparation, elle a fait l'objet d'une appropriation par les partenaires sociaux qui rend son indépendance discutable. Celle-ci a, d'ailleurs, été remise en cause par de très nombreux témoins. C'est le cas notamment de Mme Michèle Froment-Védrine, directrice générale de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET)548 : « Il y a trente ans, je suis entrée à la sécurité sociale ; la culture de la médecine du travail y était relativement forte. Des unités « médecine du travail » étudiaient les dossiers d'accidents du travail, alors extrêmement nombreux, ou de pathologies professionnelles. Il y avait là des gens d'une très grande compétence, auprès desquels j'ai beaucoup appris, et surtout que l'expertise n'était pas indépendante. Lorsqu'un dossier était déposé à propos de l'amiante, l'expertise commençait toujours par chercher une cause ailleurs, de sorte que l'affection ne soit pas reconnue... J'ai ainsi appris très tôt qu'il existait une multitude de moyens de parvenir à une expertise niant la reconnaissance du risque. Trente ans plus tard, les choses n'ont guère évolué. Nous restons d'abord dans une logique de soin, autrement dit de maladie déclarée. » La description par le professeur Goldberg du fonctionnement de la commission des maladies professionnelles du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels va également dans ce sens549 : « N'y siègent que des personnes sans compétences scientifiques, qui représentent des organisations d'employeurs et des organisations de salariés, et tous viennent avec un mandat leur enjoignant de voter une valeur pré-établie, sans avoir entendu l'avis de l'expert. » Enfin, la Cour des comptes elle-même a relevé que les conditions de cette expertise sur les risques n'étaient pas satisfaisantes550. La sécurité sociale s'est pourtant dotée très tôt d'un outil de recherche et d'expertise sur les risques professionnels : l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS). Association de type loi 1901 financée à 97 % par la branche AT-MP de la CNAMTS, l'INRS est effectivement devenu un organe incontournable dans le paysage européen de la recherche appliquée aux risques professionnels, et ses études, comme ses chercheurs, font aujourd'hui autorité dans de nombreux domaines. Mais l'INRS est loin d'être exempt de toute critique, même si la plupart ne sont pas imputables à la qualité du travail qui y est accompli. Sa gestion paritaire par les partenaires sociaux est la principale source des critiques exprimées à son encontre, car elle pose une double question : celle de son indépendance, et celle de son rôle. Son indépendance a été fortement critiquée, tant par de nombreux témoins entendus par la mission551, que par le rapport de l'IGAS sur la prévention sanitaire en milieu professionnel : « S'il occupe une place importante dans le paysage de la prévention du risque sanitaire au travail, l'INRS reste l'instrument de connaissance de l'assurance sociale, dont les modalités de gestion interdisent d'envisager d'en faire le principal acteur de la connaissance du risque, ni a fortiori le lieu d'orientation de la recherche. Les limites de cette institution révèlent surtout l'inertie de l'Etat. Les pouvoirs publics n'ont pas jusqu'ici développé les moyens d'une tutelle scientifique réelle sur l'INRS. En tout état de cause, le fonctionnement de cette institution qui, par construction, mêle étroitement l'évaluation et la gestion du risque interdit d'imaginer en faire le pivot de la recherche scientifique dans le champ de la santé au travail.552 » À ce constat sans appel, se joint la critique du rôle de l'INRS, alors qu'il s'agit d'un organisme dont la capacité d'expertise est sans égale. Sur ce point, le témoignage de M. Moyen553 est édifiant : « Pour vous donner un exemple des ambiguïtés de l'INRS, mon prédécesseur et moi-même avions défini une méthode qui permettait de remonter la chaîne des causes des maladies liées à l'amiante. Le conseil d'administration nous a interdit de publier cette étude. Les syndicats avaient sans doute peur que soient mises au jour des responsabilités ouvrières. Les patrons avaient peur de voir l'INRS s'intéresser de trop près à l'organisation du travail. La leçon que j'en tire est que la cohabitation entre syndicats et patrons n'est pas forcément une bonne chose. Il est nécessaire qu'une autorité de service public puisse faire respecter son point de vue. » La nécessité d'une définition indépendante des missions de l'INRS est encore illustrée en ces termes par M. Moyen : « Notre travail, je le répète, était centré autour de la définition de valeurs limites d'exposition. Nous n'étions pas en mesure de procéder à des études épidémiologiques, ce qui d'ailleurs ne nous était pas demandé. » ● Une médecine du travail qui n'a pas répondu aux attentes Défaillant sur l'expertise, le système français de prévention a également montré ses limites en matière de veille sanitaire. Celle-ci consiste à recueillir et centraliser les informations sur l'état de santé des travailleurs afin d'y déceler, le cas échéant, l'occurrence d'un risque professionnel. La veille sanitaire permet ainsi d'étayer la recherche sur les risques, à partir de données épidémiologiques indispensables. Il serait vain de rechercher dans le dispositif hérité de 1945 un quelconque responsable bien identifiable de la veille sanitaire, nulle instance nationale n'ayant été clairement chargée de « veiller » à la santé de la population au travail. En réalité, chacun s'est accordé à penser que cette tâche incombait au réseau de la médecine du travail, au seul motif que l'obligation de visite médicale des salariés permet d'évaluer la santé de la population au travail. La médecine du travail a donc fait l'objet de vives critiques, notamment dans l'affaire de l'amiante, même si, s'agissant de l'amiante, les temps de latence des maladies ne permettent pas une mise en évidence rapide du risque. La médecine du travail n'est pas sortie indemne du rapport de l'IGAS de 2003 qui a identifié son incapacité à alerter les pouvoirs publics554. Le Dr Monique Larche-Mochel, chef de service de l'inspection médicale du travail, a tenté d'expliquer à la mission que l'échec de la médecine du travail dans l'affaire de l'amiante résultait du rôle attribué au médecin du travail, et que celui-ci avait « souffert » de ne pouvoir faire mieux555 : « En ce qui concerne la question de savoir si le drame de l'amiante a été une leçon pour les médecins du travail, je peux vous répondre en vous parlant de leur vécu et de ce que j'en perçois. Ce drame a mis en alerte leur responsabilité. On leur demande de traduire leur travail par un avis d'aptitude. Or, dire que quelqu'un est apte à être exposé à un risque pose aux médecins du travail un problème éthique fondamental. (...) Il leur est difficile de déclarer qu'une personne est « apte à être exposée à des produits cancérogènes ». La décision d'aptitude qu'ils ont à formuler est pour eux la source d'une grande souffrance. Leur malaise est d'autant plus grand qu'il existe des risques que non seulement ils ne maîtrisent pas, mais même qu'ils ne connaissent pas. C'est le cas des produits qui peuvent produire des effets différés. Le drame de l'amiante reste dans les esprits. (...) Les médecins du travail sont en grande souffrance. » Cette « souffrance » renvoie à la question du rôle que doit jouer la médecine, comme l'a souligné le professeur Goldberg au cours de la table ronde du 19 octobre 2005 : « Ce n'est pas un hasard si ces 7 000 médecins - que j'ai moi aussi peine à considérer comme un réseau dans la mesure où il n'est pas organisé - que le monde entier nous envie, n'ont pas finalement sorti beaucoup de données. On pourrait nous croire les premiers du monde en termes de connaissance de l'état de santé des travailleurs et des expositions, puisque nous sommes les seuls à disposer de ce « réseau ». Or nous n'avons aucune donnée, beaucoup moins en tout cas que d'autres pays qui n'ont pas ce système. Pourquoi ? » En effet, la médecine du travail n'est pas à proprement parler un « réseau », mais plutôt un ensemble de salariés d'entreprises, au statut particulier, dont la mission consiste principalement à rencontrer les travailleurs pour délivrer un certificat d'aptitude à exercer les fonctions confiées par l'employeur. Réformée en 2003 pour assurer une plus grande pluridisciplinarité, puis en 2004 pour regrouper « l'offre » au sein de services interentreprises, la médecine du travail appelle une double critique : d'une part, ses missions ne permettent en rien de prévenir le risque, pas même par une meilleure connaissance ; d'autre part, son indépendance vis-à-vis des employeurs fait problème. La déclaration d'aptitude est une démarche contestée par les médecins du travail eux-mêmes, qui y voient une action trop limitée pour permettre une véritable protection des travailleurs. Cette critique a été reprise par l'IGAS, qui a vu dans la déclaration d'aptitude la marque d'un système guidé par un objectif de réparation et non de prévention556 : « L'aptitude que le médecin évalue s'apparente à l'estimation de la prédisposition à l'indemnisation. Elle est davantage un vestige de la médecine légale qu'un outil de prévention et correspond à la vocation « assurantielle » de la médecine du travail. La visite d'aptitude systématique peut être contestée pour deux raisons, d'ordre tout à fait différent. En premier lieu, sa pertinence sur le plan de la prévention reste à établir. En second lieu, et de manière plus conjoncturelle, la démographie de la profession laisse peu d'espoir à son maintien. Il faudrait véritablement s'interroger sur la pertinence du concept d'aptitude en tant qu'outil de prévention, a fortiori sur le concept récent de non contre-indication. Tous les « intoxiqués » de l'amiante ont en effet été déclarés aptes. Le certificat d'aptitude est vécu comme un permis de travail pour le salarié, comme un blanc-seing « assurantiel » pour l'employeur. » Cette « autolimitation » de la mission du médecin du travail est en grande partie imputable à son lien de subordination à l'employeur. Si le médecin du travail est protégé par des dispositions légales, qui le garantissent, par exemple, contre le licenciement, il reste néanmoins un salarié recruté par un employeur chargé principalement de statuer sur l'aptitude des travailleurs. Ce lien avec l'entreprise, quoique défendu par les organisations patronales, a été présenté par certains témoins comme un obstacle majeur à l'indépendance du médecin dans son travail557. Il est, du reste, surprenant d'attendre d'un tel salarié qu'il se charge d'une mission de service public que son employeur ne lui confie pas, et pour laquelle il n'est pas rémunéré. Il est d'ailleurs établi que le médecin du travail agit dans un cadre qui lui est fixé par son employeur, comme en a attesté le Dr Larche-Mochel558 : « Dans les services autonomes, un budget assez important est affecté au service de santé au travail. Le médecin n'aura pas de problème budgétaire, il pourra procéder aux examens complémentaires qu'il juge utiles. Mais il pourra faire l'objet de pressions autres que budgétaires, en ce qui concerne la gestion du reclassement ou la déclaration de maladie professionnelle. Dans les services interentreprises, la gestion est assurée par des directeurs qui sont souvent des gestionnaires financiers. Le médecin du travail pourra faire l'objet de pressions qui ne toucheront pas le contenu de sa mission mais, par exemple, la prescription d'examens complémentaires ou la gestion de son temps. » La mission a donc considéré que l'organisation de la médecine du travail est une question majeure qui doit être examinée en fonction du rôle que l'on souhaite lui donner dans le dispositif de prévention. En effet, la pauvreté de son apport à la prévention des risques professionnels, rappelée par plusieurs témoins - qui parlent de « gâchis »559 -, n'est pas satisfaisante si la France veut se doter d'une veille sanitaire efficace. À cet égard, la mission a été surprise de l'échec du dispositif d'information prévu par la réglementation elle-même, puisque les articles 11, 16 et 17 du décret de 1977 organisaient un suivi par le médecin du travail des expositions des travailleurs à l'amiante, qui devait être conservé 30 ans. À l'instar du Docteur Ellen Imbernon, épidémiologiste, responsable du département santé/travail à l'IVS, la mission a considéré que cet échec justifiait d'une refonte du rôle de la médecine du travail pour l'intégrer au dispositif de veille sanitaire560 : « Il faut également prendre conscience que les médecins du travail pourraient participer d'une façon plus effective à l'amélioration de la connaissance de la santé des populations au travail, en mettant en commun des informations qu'ils recueillent quotidiennement sur le terrain. Or ce n'est pas le cas aujourd'hui : un médecin du travail fait des études médicales, surveille l'entreprise, contrôle les postes de travail, mais rien ne sort de l'entreprise. Il n'existe aucune traçabilité des expositions auxquelles les salariés ont été soumis : la seule façon de reconstituer ces expositions reste de les interroger. (...) » La mission a donc pris acte de la faillite d'un système de prévention des risques professionnels, dominé par l'objectif de réparation des dommages du travail et dont le mode de gestion doit être revu. Le changement d'approche indispensable à une politique appropriée de prévention appelle avant tout une redéfinition des responsabilités de chacun, et plus spécialement de celle de l'Etat. Celui-ci est dorénavant justiciable des ses carences, et ne peut refuser d'assumer son rôle de garant d'un système, qui devra être gouverné par une distinction entre ceux qui évaluent le risque et ceux qui le gèrent. B.- LES PRINCIPES MODERNES DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS EXIGENT UNE RESPONSABILISATION DE L'ETAT Gérer le risque professionnel ne signifie pas en assumer financièrement les conséquences par la voie de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. « Prévenir plutôt que guérir », telle doit être la priorité d'un système moderne de prévention des risques. Cette priorité appelle en premier lieu un nouveau partage des responsabilités publiques et privées, rendu indispensable par les décisions de justice intervenues dans l'affaire de l'amiante. Dans ce cadre rénové, l'Etat doit prendre toute sa place comme garant de la séparation entre l'évaluation et la gestion des risques qui, seule, permettra d'améliorer la connaissance du risque pour mieux le prévenir. 1.- Le passage d'une logique de réparation à une logique de la prévention du risque impose une nouvelle répartition des responsabilités Chercher à prévenir avant de vouloir réparer est une démarche initiée par l'Europe qui a, depuis 1989, imposé une nouvelle répartition des responsabilités en matière de risques professionnels. Les tribunaux ont pris en compte cette nouvelle donne dans les jugements auxquels l'affaire de l'amiante a donné lieu, imposant ainsi à l'Etat d'assumer pleinement sa responsabilité propre. a) Éviter que le risque professionnel ne se réalise : une démarche nouvelle La succession des crises sanitaires a fait progresser depuis la fin des années 80 une culture de la prévention des risques, qui répond à une demande sociale de protection toujours plus forte. Réparer ne suffit plus, et les retentissements des affaires du sang contaminé, de la « vache folle » - et, désormais, de tout problème de santé publique - témoignent d'une nouvelle perception du risque de la part de la société. Sous l'impulsion communautaire, l'Etat a donc affirmé de nouveaux principes directeurs dont le but est d'éviter que le risque professionnel ne se réalise. Ces principes ont contribué à l'émergence de responsabilités mieux définies. ● L'affirmation de nouveaux principes L'échec du dispositif de prévention témoigne moins d'un manque de moyen que d'une culture particulière de la France vis-à-vis des risques, comme l'a rappelé le professeur Goldberg561 : « L'affaire de l'amiante a montré que des instruments juridiques existent mais qu'ils ne sont pas utilisés. Dois-je rappeler que la France a attendu 1977 pour se doter d'une réglementation visant à protéger les salariés exposés à l'amiante, alors que la Grande-Bretagne avait adopté ce dispositif dès 1931 ? En France, une première réglementation existait bien, mais elle visait à l'indemnisation et non à la prévention : en 1950 déjà, le tableau des maladies professionnelles reconnaissait l'asbestose au point de l'indemniser, mais on a attendu vingt-sept ans la première réglementation visant la prévention. Ainsi, une fois un facteur de risque identifié, il faut réglementer, puis s'assurer que la réglementation est appliquée... et l'on est assez loin du compte en France. (...) Il est manifeste que, comme dans d'autres domaines, on a décidé, faute d'une culture de l'évaluation, une réglementation préventive sans instaurer de manière concomitante le dispositif qui aurait permis d'établir si cette réglementation fonctionne efficacement. » Le défaut de la culture française de prévention est de n'appréhender le risque qu'une fois ses conséquences établies, c'est-à-dire une fois qu'il est « trop tard ». Parmi les témoins entendus par la mission, M. Yves Coquin, chef du service « prévention programme de santé et gestion des risques » de la Direction générale de la santé, a particulièrement insisté sur l'obsolescence d'une telle approche au vu des nouveaux standards de la recherche en santé publique562. La rupture qui a justifié un changement d'approche résulte de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Dans cette directive, l'Union européenne impose aux Etats membres d'intégrer à leur droit plusieurs principes de prévention des risques professionnels. Ces principes - codifiés563 en France au paragraphe II de l'article L. 230-2 du code du travail - sont rappelés dans le tableau ci-dessous : - Éviter les risques; - Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; - Combattre les risques à la source; - Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé; - Tenir compte de l'état d'évolution de la technique; - Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; - Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants; - Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle; - Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Ces principes, qui semblent parfois relever du bon sens, consacrent une place essentielle à l'évaluation des risques. Cette approche, résolument nouvelle, a été saluée par certains témoins. C'est le cas de M. Dominique Olivier, secrétaire permanent de la CFDT, responsable des risques professionnels et de la santé au travail564 : « (...) depuis seulement quelques années, les stratégies de prévention sont fondées sur une évaluation a priori des risques. C'est une totale nouveauté, imposée par les instances européennes le 31 décembre 1991 -(...). Autrement dit, contrairement à ce qui se disait, on ne faisait pas, jusqu'alors, de prévention, ou plus exactement - expression paradoxale et contradictoire - on faisait de la prévention a posteriori : après avoir constaté des dégâts, sous forme d'accidents ou de maladies professionnelles, on se posait la question de savoir ce qu'il faudrait faire pour éviter qu'ils se reproduisent ! C'est parfaitement légitime, mais cela n'a rien à voir avec la prévention. La vraie prévention, c'est l'analyse de l'activité, la recherche des dangers potentiels, puis la définition de stratégies de prévention, à laquelle est venue s'ajouter depuis peu la notion de précaution. » ● L'apparition progressive de responsabilités mieux définies La directive 89-391 n'a pas seulement posé des principes concrets de prévention des risques, elle a également imposé une définition des obligations générales de l'employeur, contribuant ainsi à la clarification progressive du partage des responsabilités. La rupture imposée par l'Europe a favorisé une redistribution plus claire des responsabilités sur des acteurs mieux identifiés, dotés d'une personnalité juridique stable, et comptables devant la justice de leurs erreurs. C'est dans cet esprit que l'article L.230-2 du code du travail transpose le principe inscrit à l'article 5 de la directive : « L'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail », et l'obligation générale qui est détaillée en son article 6 : « Dans le cadre de ses responsabilités, l'employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens nécessaires. L'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » L'Etat, quant à lui est chargé de prendre les réglementations nécessaires, et de les faire appliquer. Mais il est également responsable d'une expertise permettant une prévention du risque, ainsi que d'une véritable veille sanitaire, imposée par l'article 14 de la directive565. La directive a donc déterminé deux degrés pertinents de gestion des risques professionnels : - un degré réglementaire, responsable des mesures de prévention les plus fortes, et chargé de traduire en règles claires les conséquences tirées de l'expertise ; - un degré subsidiaire, au sens européen du terme, chargé d'appliquer les consignes réglementaires dans l'entreprise, et de vérifier leur efficacité. On notera que deux responsabilités fondamentales sont exclues de cette répartition, car elles relèvent d'un exercice sans partage de l'Etat : il s'agit de l'évaluation du risque au moyen d'une expertise indépendante, et du contrôle de l'application effective des règles sanitaires. La question du responsable de la prévention a donc progressé depuis le début des années 90. Bien que l'Etat ait peiné à concrétiser la plupart des principes généraux de la directive, l'esprit des nouvelles normes a, au contraire, été rapidement pris en compte par les juridictions saisies des affaires de l'amiante. b) Les décisions de justice tracent un nouveau partage des responsabilités de l'Etat et des acteurs privés Prenant acte des nouvelles obligations des acteurs public et privés, telles que la directive et la loi les définissent, les juridictions ont pris des décisions qui traduisent la nécessité pour l'Etat d'assumer, aujourd'hui, sa responsabilité dans la prévention des risques professionnels. ● Des acteurs privés qui se retranchent derrière la responsabilité de l'Etat Les juridictions pénales ont trouvé dans la carence ou la faute de l'Etat un facteur d'exonération de la responsabilité propre aux employeurs. Comme l'ont rapporté les juristes entendus par la mission, il s'agit du moyen de défense classique utilisé par les personnes poursuivies dans des affaires d'exposition ancienne à l'amiante566. Par ailleurs, l'examen de la jurisprudence en matière de délits non intentionnels a montré que la caractérisation d'une connaissance suffisante des risques par un prévenu reposait avant tout sur l'existence préalable d'une réglementation nationale567. Dans le cas spécifique des affaires de l'amiante, on relève que l'argument de la faute de l'Etat, par omission ou ignorance du risque, a pesé lourdement dans l'extinction des procédures à l'encontre des employeurs. Ainsi la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Douai a-t-elle relevé pour fonder sa décision de non-lieu568 qu'« on ne saurait reprocher aux personnes mises en examen, qui, pour la plupart, ont cessé leurs activités (...) dans les années 80, d'avoir commis une faute caractérisée exposant autrui à un danger d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré, dans la mesure où, précisément, elles n'ont pas reçu des autorités publiques, sanitaires notamment, l'information nécessaire quant aux conséquences sur la santé des travailleurs d'une exposition à l'amiante, les pouvoirs publics ayant eux-mêmes tardé à prendre conscience de l'extrême dangerosité de l'amiante en interdisant le produit... ». Bien que cet argumentaire soit discutable eu égard aux principes édictés par la loi de 1991 et codifiés à l'article L. 230-2 du code du travail, qui créent une « obligation de sécurité de résultat » à la charge de l'employeur, il n'en a pas moins conduit à une situation où, l'Etat n'ayant pas assumé convenablement ses responsabilités, l'employeur s'est vu exonéré des siennes. Dès lors, la mission a considéré que si, dans le cadre d'un nouveau partage des responsabilités, celle de l'Etat conditionne celle des employeurs, il importe que la puissance publique assume pleinement sa charge. Ce point de vue a été partagé par plusieurs témoins entendus par la mission. Ainsi, M. Marcel Royez (FNATH)569 : « Nous pensons que l'État a toute sa place dans la politique de prévention. C'est si vrai que tout le monde, à commencer par le Conseil d'État, a pointé du doigt la responsabilité de l'État dans le drame de l'amiante. On ne peut pas à la fois dire que l'État est responsable quand survient une crise majeure et ne pas lui reconnaître une responsabilité dans l'organisation et la gestion de la politique de prévention et de veille sanitaire. » ● L'Etat est justiciable de nouvelles responsabilités qu'il doit assumer La juridiction administrative a également tiré en 2004 les enseignements de l'histoire et de la mutation nécessaire du système de prévention. En engageant la responsabilité de l'Etat dans les maladies de l'amiante, le Conseil d'Etat a mis celui-ci en demeure de se conformer à ses nouvelles obligations. Comme l'a expliqué Mme Prada-Bordenave, la décision du Conseil d'Etat s'appuie sur deux facteurs d'engagement de la responsabilité de l'Etat, dont aucun n'est original. Le premier facteur est un régime général de responsabilité de l'Etat désormais classique, qui s'appuie sur une « obligation de faire » en matière de protection des populations. Cette obligation n'intéresse d'ailleurs pas seulement la santé au travail, mais l'ensemble des troubles apportés à l'ordre public, pris dans ses composantes habituelles que sont la sécurité, la tranquillité et la salubrité. L'Etat a donc été condamné pour n'avoir pas assumé une prérogative dite « régalienne », qui constitue une garantie des droits fondamentaux de la personne. Le second facteur est un régime plus spécifique de responsabilité, qui s'attache au respect par l'Etat d'obligations qui lui sont imposées par une autorité supérieure. En l'espèce, il s'agit d'une obligation de réglementer imposée par la loi, et plus spécifiquement par la partie législative du code du travail. Mais la responsabilité de l'Etat peut aussi bien être engagée pour une carence à réglementer dans d'autres domaines où la loi l'oblige, comme par exemple le droit de l'environnement570. L'Etat a donc également été condamné pour une carence « illégale », dont on notera qu'elle s'étend au contrôle de l'application de la réglementation571. Ces deux moyens de condamnation de l'Etat ne sont en rien spécifiques aux affaires de l'amiante, même si en, l'espèce, les fautes ont été caractérisées, comme l'a rappelé Mme Prada-Bordenave : « l'outil juridique utilisé par le Conseil d'État dans les affaires Botella et Xuereff n'a rien d'une innovation jurisprudentielle ; il est manié de façon très habituelle par les formations de jugement de la juridiction administrative. L'État a une obligation de réglementer, de même qu'il a une obligation de police. Dans le cas de l'amiante, on trouve un peu les deux : la réglementation du travail, mais également la police de prévention des risques sanitaires. Or, en droit français, la police est depuis très longtemps une activité obligatoire pour les pouvoirs publics, dont ils ne peuvent s'exonérer. L'État commet une faute qui engage sa responsabilité lorsqu'il tolère un comportement illégal et, a fortiori, lorsqu'il le connaît et l'autorise de manière implicite par ses carences. » Ces mécanismes juridiques sont applicables à tous les risques professionnels, dès lors que le juge considère soit que le risque d'atteinte à la sécurité des personnes est établi mais que l'Etat n'en a pas suffisamment protégé les populations (principe de prévention), soit que le risque n'est pas établi, justement parce que l'Etat n'a pas respecté ses obligations légales en matière d'expertise (principe de précaution), puis de réglementation du risque. Si l'Etat est justiciable de ses carences, son devoir est d'assumer pleinement ses responsabilités en matière de santé au travail. Ces responsabilités, telles qu'elles résultent de l'arrêt du Conseil d'Etat de 2004, lui imposent de revoir sa place dans la prévention des risques professionnels. 2.- L'Etat doit être responsable de l'expertise des risques et garant de leur gestion Le changement d'approche de la prévention des risques professionnels est consacré par la distinction indispensable entre ceux qui évaluent le risque et ceux qui le gèrent. L'expérience montre, en effet, qu'une expertise menée dans un but précis conduit généralement à l'atteindre et non à le remettre en cause. Cette distinction a des conséquences importantes sur la répartition des objectifs et des moyens dans le domaine de la santé au travail. Elle suppose que les partenaires sociaux et la sécurité sociale sortent du champ de l'évaluation des risques professionnels, pour se consacrer uniquement à une gestion - partagée avec l'Etat - de la prévention, puis de la réparation. De la part de la puissance publique, la distinction évaluation/gestion constitue une entrée franche des problématiques de la santé au travail dans le champ plus vaste de la santé publique et permettrait que la santé au travail soit mieux prise en compte par les structures gouvernementales. a) Séparer l'expertise et la gestion des risques L'abandon de l'ancien système de gestion des risques professionnels passe nécessairement par l'affirmation de l'indépendance de l'évaluation des risques, dont l'Etat seul peut être le garant. Cette nouvelle attribution des responsabilités en matière de recherche et d'expertise suppose une évolution « à marche forcée » de l'approche des partenaires sociaux qui n'ont pas manqué de souligner leurs réticences572. ● Un principe indispensable à la prévention Le principe même de la distinction entre évaluation et gestion des risques requiert une séparation totale en une expertise - neutre et exclusivement scientifique - et un décideur socialement et politiquement responsable, dont la première responsabilité est de garantir l'indépendance de l'expert. Mais un tel schéma ne relève pas de l'évidence573 et sa complexité a été développée par le professeur Goldberg au cours de son audition du 11 octobre 2005 : « La séparation des deux fonctions est indispensable. L'évaluation du risque doit impérativement être faite par des gens « irresponsables », c'est-à-dire des scientifiques qui n'ont pas à s'interroger sur les conséquences de leur évaluation sur l'emploi ou sur l'économie, car ce n'est pas leur rôle. Je fais partie du Comité scientifique européen des valeurs limites d'exposition, et je puis vous assurer que nous sommes totalement indépendants. Nous exposons les risques associés à différents niveaux d'exposition à telle substance, nous disons l'incidence qu'aura l'augmentation de ce taux, et la décision de ce qui paraît tolérable est prise par d'autres. Elle peut, d'ailleurs, ne pas être celle que nous avons recommandée, car d'autres critères jouent que les seuls critères scientifiques, mais, dans tous les cas, évaluation et décision sont soigneusement séparées. » L'ambiguïté du système créé en 1945 tenait précisément à ce que l'expertise était conduite pour justifier la prise de décision du gestionnaire574 . Seul l'Etat offre des garanties suffisantes pour entretenir ce délicat dialogue de l'expert et du responsable, comme le relevait déjà l'IGAS en 2003575 : « L'Etat devrait assumer sa responsabilité de maître d'ouvrage dans la connaissance, l'évaluation et l'expertise de la santé au travail pour en garantir l'indépendance, le caractère contradictoire et la transparence. Il lui appartient également de fixer les orientations et les priorités de cette politique, après un débat public, et tout particulièrement, avec les partenaires sociaux. » C'est également ce point de vue qu'a défendu la majeure partie des témoins entendus par la mission - à l'exception des organisations syndicales -, marqués par les vicissitudes de l'évaluation des risques liés à l'amiante576, bien que les représentants de l'INRS aient tenu à défendre une conception partagée de l'évaluation577. Au regard des responsabilités qui lui incombent en application du principe de précaution, l'Etat doit également disposer d'une expertise indépendante que le dispositif de 1945 ne permettait pas de satisfaire, comme l'a rappelé M. Marc Boisnel, sous-directeur des conditions de travail au ministère du travail : « S'agissant du principe de précaution, jusqu'à présent le ministère du travail n'avait pas de moyens propres d'évaluation des risques pour la santé humaine. Il devait s'en remettre, généralement par voie conventionnelle, à des organismes extérieurs. Ce système avait une double limite : d'une part, ces organismes ont une capacité d'expertise assez vite saturée ; d'autre part, ils ne sont absolument pas soumis à l'autorité du ministère, ils ont une gouvernance propre, par exemple celle des partenaires sociaux. Le très gros travail que nous menons en commun permet de faire converger nos priorités, mais ce n'est pas toujours le cas. Il est arrivé à plusieurs reprises que le ministère du travail, souhaitant mener une étude sur un domaine particulier, n'ait pas disposé des outils pour le faire. » ● Une remise en cause difficile de la place des partenaires sociaux Les auditions menées par la mission ont souvent été l'occasion d'échanges très vifs tant sur la place occupée jusqu'ici par les partenaires sociaux578, que sur celle qui devait dorénavant leur revenir. Sur cette dernière, M. Jean-Denis Combrexelle, directeur des relations du travail a ainsi brossé le tableau d'une négociation délicate : « La position des partenaires sociaux est assez ambiguë : les organisations professionnelles, comme les organisations syndicales, considèrent que la santé au travail est leur affaire, que l'État n'est en quelque sorte que le notaire de l'accord qu'elles ont signé en décembre 2000 et qu'il doit se borner à le transposer dans la loi et les décrets. Ainsi, dans le cadre de l'établissement du tableau des maladies professionnelles, nous avions imaginé de confier la première phase de l'expertise à l'IVS ; Gilles Brücker et moi-même avons essuyé au Conseil supérieur un véritable tir croisé de la part des partenaires sociaux. L'articulation est d'autant moins évidente à trouver que, d'un côté, les partenaires sociaux considèrent que c'est eux, et que, de l'autre, l'État estime parfois qu'ils n'en font pas suffisamment... » Ces difficultés ont été soulignées par ceux qui ont eu à discuter du récent « Plan santé au travail » avec les organisations syndicales, comme M. Marc Boisnel579 : « Du côté des partenaires sociaux, les réactions ont beaucoup varié dans le temps. Très négatives au moment de la mise en chantier - et des deux côtés de la table -, elles ont tourné autour du thème de la nationalisation rampante de ce qui normalement revient aux partenaires sociaux à travers la gestion de la sécurité sociale. Le message était clair et net : « Nous avons nos organismes, nos outils, nous travaillons bien, nous n'avons pas besoin de l'État dans cette histoire ». » Les partenaires sociaux ont également eu l'occasion, au cours d'une table ronde et d'entretiens spécifiques, d'exprimer directement leurs réticences vis-à-vis d'une redéfinition de leur place dans la prévention. À cette occasion, la mission a pu juger que les organisations syndicales ne paraissaient pas toujours avoir pris la mesure des leçons qu'il convient de tirer de l'affaire de l'amiante. M. Bernard Caron, directeur de la commission de la protection sociale du MEDEF, a ainsi présenté le risque professionnel comme un élément de l'arbitrage qui préside à toute activité économique, témoignant ainsi de l'esprit qui a pu prévaloir pendant des décennies580 : « N'oublions pas enfin que lorsque l'on s'est mis à utiliser l'amiante, ce n'était pas pour nuire, mais bien pour protéger : on n'a du reste jamais fait le bilan des aspects positifs de l'amiante. L'amiante était par essence une matière de protection. Que l'on en ait abusé et qu'on l'ait par trop éparpillé, c'est sans doute vrai ; nous sommes prêts à renforcer tous les dispositifs nécessaires pour éviter que ce genre d'erreur se reproduise, à défaut de pouvoir réécrire l'histoire. Mais nous avons également une préoccupation : permettre à l'activité de ce pays de se développer. La difficulté tient précisément à la gestion de cette compatibilité entre le développement de l'activité et le respect de règles strictes garantissant l'intégrité physique de ceux qui travaillent. » Au terme de ses travaux, la mission a considéré qu'il fallait établir une distinction très claire entre l'évaluation des risques et leur gestion. Elle a estimé que l'exigence d'indépendance de l'expertise n'enlevait rien à la légitimité des partenaires sociaux à discuter des mesures concrètes de prévention. La mission s'est ralliée en cela à la conclusion que tirait à ce sujet le rapport de l'IGAS dès 2003581 : « L'ensemble de ces perspectives encore inabouties suppose que les partenaires sociaux acceptent un recul de leurs prérogatives dans le champ de la santé au travail. Après l'amiante, le « sens de l'histoire » est bien un réinvestissement par l'Etat de sa compétence dans le champ de la santé au travail, accompagné d'un dialogue renforcé sur les conditions de mise en œuvre. Les partenaires sociaux ne seraient sûrement pas réfractaires à un retour de l'Etat sur ses compétences régaliennes, pour peu que celui-ci mette en ligne les moyens d'une intervention de qualité et qu'il laisse une place à la négociation sur ce qui est négociable. » b) Consacrer la santé au travail comme une responsabilité de santé publique ● Les partenaires sociaux doivent contribuer à la santé au travail, mais ne doivent en être les responsables La prise en considération de son nouveau rôle par l'Etat doit logiquement se traduire par une véritable intégration de la santé au travail dans le champ de la santé publique. Sans qu'il soit utile de revenir sur les déterminants sociaux incontestables de la santé publique, il apparaît que cette démarche est nécessaire à une meilleure appréhension des risques professionnels. Mais, la gestion des risques professionnels se distingue des autres risques sanitaires parce que les mesures préventives doivent y être principalement appliquées par les acteurs privés dans le cadre du contrat de travail. Cette particularité du risque professionnel justifie une collaboration de l'Etat et des partenaires sociaux dans sa gestion. La question du juste degré de collaboration reste encore largement posée, comme les témoins l'ont indiqué. M. Dominique Olivier (CFDT) a décrit le rôle des partenaires sociaux comme un élément indispensable de confrontation des mesures de prévention avec le « terrain », dans le cadre de la responsabilité spécifique de l'employeur582 : « Quelle doit être la place des partenaires sociaux dans les actions préventives ? Nous devons réfléchir à une articulation complexe et la plus intelligente possible entre les initiatives issues du paritarisme, du dialogue social, et les prérogatives de l'autorité publique. Il nous paraît légitime que la puissance publique se dote d'un outil à même d'éclairer certaines problématiques, de produire des connaissances, de développer la recherche et d'aider à l'expertise, puisqu'il lui revient d'édicter les lois et les règlements garantissant la protection de la santé au travail et de la santé tout court. Mais cette connaissance des risques théoriques devant être confrontée aux réalités du terrain et du travail, le paritarisme doit jouer tout son rôle pour créer une dynamique sociale de prévention. Cela suppose que chacun, partie patronale et partie syndicale, motive ses troupes, afin que les acteurs de terrain - management, direction de l'entreprise et salariés - soient réellement impliqués dans l'action préventive, sans pour autant confondre les rôles ni oublier la responsabilité particulière de l'employeur. Voilà pourquoi nous tenons à préserver le paritarisme de la sécurité sociale et particulièrement de la branche AT-MP. » D'autres hypothèses ont été présentées à la mission, variant selon le degré d'implication des acteurs privés dans la définition des règles de prévention. Mais, dans leur majorité, elles reprennent l'idée que les partenaires sociaux sont les « préventeurs » idéaux, forts d'une expérience et d'une écoute du terrain sans équivalent. Cette idée a d'ailleurs été exprimée par des témoins plutôt défavorables, au plan des principes, à l'action des partenaires sociaux dans la prévention583. ● L'Etat doit replacer la santé au travail au centre des ses préoccupations de santé publique La place secondaire de la santé au travail dans les préoccupations de l'Etat, et plus particulièrement dans ses politiques de l'emploi, est clairement résumée dans cette question en forme d'aveu, posée par un rapport de l'IGAS en 1999 (1999-090 Linsolas) : « (...) immergés parfois jusqu'à l'apnée, dans la mise en œuvre des politiques prioritaires de l'emploi, et soumis, à ce titre, à la pression continue de l'administration centrale et des préfets, les directeurs départementaux (...) savent que c'est sur ce terrain qu'ils seront jugés à l'aune de leur résultat. Qui a jamais demandé des comptes à un directeur départemental sur les résultats obtenus par ses services ou sur les actions engagées à son initiative, en matière de prévention des risques professionnels ou en matière de répression des infractions au droit du travail ?... » Cette question, reprise par de nombreux témoins584, résume la nécessité de rattraper un retard dont M. Gilles Brücker, directeur général de l'Institut de veille sanitaire, a détaillé les conséquences devant la mission585 : « La santé au travail doit désormais s'inscrire de manière parfaitement visible dans le champ de la santé publique. La santé ne se morcelant pas, il nous appartient de prendre en compte l'immense dimension des facteurs de risques liés au travail dans une approche globale de la santé. Or tel n'est pas le cas. Du fait de son histoire, la médecine du travail a toujours été une filière à part et (...) un peu en marge de la santé publique : la santé au travail reste l'affaire du médecin du travail et le médecin traitant ne s'en occupe pas. Cela pose un réel problème de fond. De ce fait, les progrès considérables observés en santé publique à partir des années 90 n'ont pas été équitablement répartis. Le nombre d'enseignants (...) dans le domaine de la santé au travail est hautement préoccupant. À l'inverse, les effectifs de professeurs de santé publique sont au plus haut... La santé publique, que l'on a critiquée pendant des années, a pris aujourd'hui une incontestable dimension dans de nombreux secteurs, y compris dans les centres hospitaliers universitaires (CHU) et les universités, et cela se retrouve dans la formation. De ce fait, hormis quelques travaux réalisés par les unités de recherche qui s'étaient engagés sur le sujet, nous ne disposons pas des capacités d'expertise et de production de données dont nous avons véritablement besoin. Le premier rapport que le Haut Comité de santé publique a produit en 1994 ne compte en tout et pour tout qu'une page - sur plusieurs centaines - consacrée à la santé au travail, autrement dit rien ! » La situation décrite par M. Brücker n'a pas été compensée en totalité, même si la mission a pris la mesure des progrès importants réalisés depuis quelques années dans ce domaine. Le Dr Ellen Imbernon a placé la création du département Santé/travail de l'IVS au centre de ces progrès, car il témoigne d'une volonté de faire partager à la santé au travail les moyens et les principes de la veille sanitaire en santé publique en général586. Pourtant, la situation de ce département reste précaire, à en juger par le descriptif qu'en a fourni le Dr Renée Pomarède, responsable de la mission stratégie de l'Institut : « La part du budget de l'Institut consacrée au département santé-travail était de 5 % en 2003 - le budget total était alors de 30 millions d'euros - et de 6,2 % en 2004. Dans le budget prévisionnel 2005, cette part s'élève à 8,7 %. Nos demandes pour 2006 représentent 15 % du budget de l'Institut. Cette évolution est évidemment à rapprocher de la participation active que l'IVS doit avoir dans le « Plan santé au travail ». Mais il est à souligner que nous n'avons à ce jour aucun poste budgétaire dédié aux actions que nous aurons à mener dans le cadre de ce plan. Nous sommes donc dans l'incertitude. » Cette question des moyens de la santé au travail est révélatrice de la place accordée à la prévention des risques professionnels. De ce point de vue, la France n'a pas encore corrigé les écueils de son histoire. Le professeur Goldberg a ainsi présenté un constat alarmant des capacités d'expertise mobilisables en France587 : « Nous nous retrouvons face à un paysage désolé, sans rapport avec les besoins d'expertise exprimés, à très juste titre, dans le « Plan santé au travail ». Mais comment trouverons-nous les experts compétents et en nombre suffisant pour répondre à toutes les sollicitations ? On a déjà évoqué la formation. On me permettra un regret un peu ponctuel : lors de la réforme de l'internat dans les années 80, la médecine du travail et la santé publique étaient ensemble. On les a très vite séparées et il y a tout lieu de le regretter. Mais on n'avait visiblement guère envie de faire entrer la santé au travail dans la santé publique, comme nous le souhaitons tous aujourd'hui. » La mission a constaté que ce bilan ne fait que confirmer celui que dressait l'IGAS en 2003588 : « La faiblesse de la formation en santé publique pose des problèmes de recrutement de spécialistes de la santé au travail, en particulier dans les jeunes générations. Cette faiblesse générale de la santé publique en France est d'autant plus grave dans le champ de la santé au travail que les travaux scientifiques doivent être irréprochables pour surmonter les intérêts industriels. Le retard de la France sur l'amiante s'explique en partie par le fait qu'il y avait très peu de chercheurs capables de faire face aux industriels sans bénéficier de surcroît du soutien des syndicats. Il n'y a dans l'université française qu'une dizaine d'équipes sur les sujets de santé au travail et trois unités de l'INSERM. La dizaine de centres de formation de médecins du travail ne peut remplacer un vrai dispositif de recherche. » Le passage d'une logique de réparation à une démarche de prévention semble aujourd'hui acquis au plan des principes. Pour autant, de nombreux éléments restent concrètement à définir, comme par exemple la place des partenaires sociaux dans la définition des règles de prévention. La mission a cependant jugé prioritaire que l'Etat français se dote avant tout des outils d'expertise et de contrôle, lui permettant d'assumer au quotidien une responsabilité croissante et nécessaire dans la protection de la santé au travail. C.- QUELS OUTILS POUR AMÉLIORER LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ? 1.- La construction européenne d'une doctrine de la prévention oblige l'Etat à se doter d'outils performants L'Union a ouvert, depuis sa directive 89-391, le dossier des risques professionnels en édictant des principes généraux de prévention (évaluation, substitution, formation, information...) qui contraignent les Etats membres à adopter une approche plus moderne de la santé au travail. Ces principes sont actuellement revisités à l'occasion d'un projet de règlement européen sur les substances chimiques dangereuses, qui poussera un peu plus l'Etat français à se doter d'outils plus performants que ceux mis en œuvre depuis 1945. a) Des principes aux modalités : le dispositif REACH La directive 89-391 avait lancé en 1989 une démarche d'harmonisation des législations européennes en matière de santé au travail, afin de parvenir à un socle commun de principes de prévention. Cette démarche, jugée insuffisante, est aujourd'hui complétée par la définition d'un rôle plus ambitieux et plus interventionniste de l'Union dans le domaine des substances dangereuses. ● Un principe d'évaluation préalable des risques et de mutualisation de l'expertise Le principe qui gouverne l'ensemble de l'esprit de prévention, tel que la directive de 1989 le définit, est celui de l'évaluation préalable des risques. Déclinaison du principe de précaution, cette évaluation préalable a pour objectif de qualifier et de quantifier un risque professionnel avant de pouvoir l'accepter Cette double difficulté a été parfaitement résumée par M. Marc Boisnel au cours de son audition589 : « À côté des questions de responsabilités se posent également celles des sources d'expertise. Pratiquement chaque semaine voit une nouvelle molécule arriver sur le marché. Chaque jour voit se créer un nouveau processus industriel. C'est donc bien dans les entreprises que se trouve l'expertise à un moment donné, et il serait totalement irresponsable de s'en priver. Ce qu'il faut en revanche, par le jeu tout à la fois des organismes publics et de méthodes et procédures plurielles et contradictoires, c'est sortir de ce flou que l'on a connu avec l'amiante, où il était difficile de distinguer entre la réalité scientifique et l'expression d'un intérêt. La difficulté de la prise de décision dans l'incertitude scientifique est notre lot quotidien... Ce qui nous ramène à l'énorme problème de la connaissance, diagnostiqué tant par le « Plan national santé environnement » que par le « Plan santé au travail », et à l'impérieuse nécessité de développer la recherche sur ces sujets. Ni la France ni l'ensemble européen ne disposent pour l'heure des moyens d'expertise nécessaires pour savoir ce que nous devrions savoir. » Ce décalage explique la démarche européenne : - faire évaluer le risque par celui qui le crée, afin de mieux supporter une charge d'expertise trop lourde ; - faire encadrer cette évaluation par une expertise nationale indépendante, capable d'offrir aux Etats un savoir fiable sur les risques ; - partager à l'échelle de l'Union les bénéfices des expertises nationales, dès lors qu'elles souscrivent à une charte scientifique acceptable, afin de faciliter l'accès à la connaissance. Cette démarche ne résulte pas d'un texte à proprement parler, mais d'une succession d'initiatives prises par les acteurs nationaux dans le domaine de la santé au travail. Mme Michèle Froment-Védrine a expliqué à la mission cette acquisition progressive d'une culture de mutualisation de l'expertise à l'échelle européenne590 : « Un certain nombre d'actions sont menées par la Commission européenne pour harmoniser les données que l'on peut trouver dans les différents pays. Par exemple, nous participons à une action qui était initialement française, puisqu'elle était prévue dans le « Plan national santé/environnement », mais qui se retrouve au niveau européen : il s'agit de la mise en commun de bases de données. Nous y participons à la fois en France et au niveau européen. Nous essayons d'interconnecter ces bases de données, afin d'alimenter les travaux scientifiques ou les bases des directives européennes. Nous avons également lancé l'idée de la mise en commun de réseaux de chercheurs en santé/environnement. C'est un dossier que nous venons de déposer auprès de la Commission européenne, et qui réunit une dizaine d'acteurs dans les autres pays. Un réseau européen, ERANET591 , existe d'ores et déjà, et dès que nous sommes saisis d'une question, l'une de nos premières réactions est d'interroger nos partenaires européens. Cette aide nous est précieuse, car il s'agit d'établissements très importants. Le RIVM néerlandais, le Rijksinstituut voor Volksgezondheit en Milieu, a une antériorité très importante, et emploie 1 500 personnes. J'ajoute que le contexte européen a permis de partager entre les différents États membres un certain nombre de travaux dont ils ont la responsabilité. Je veux parler de la directive Biocides, qui impose de procéder à une évaluation des diverses substances biocides que nous utilisons. Cette année, la France doit évaluer huit substances. L'année prochaine, elle devra en évaluer vingt, puis quarante l'année suivante. Par la suite, ce sont les produits commerciaux qui devront être évalués. Le dispositif REACH s'inspirera de la même philosophie. » ● Le projet de règlement REACH Dans le domaine préoccupant des substances chimiques dangereuses, l'Union européenne a décidé de franchir un nouveau cap dans l'application des principes de prévention, il s'agit du système « Registration, Evaluation and Authorisation of chemicals » - dit REACH. Ce système repose sur deux textes actuellement en cours de discussion, qui devraient remplacer 40 directives et règlements existants et aboutir à un système global de gestion des substances chimiques dans l'Union européenne592 : - une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 29 octobre 2003, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques et modifiant la directive 1999/45/CE et le règlement (CE) sur les polluants organiques persistants. - une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, du 29 octobre 2003, modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil afin de l'adapter au règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits. L'enjeu de REACH a été précisé par M. Patrick Guyot au cours de son audition du 5 octobre 2005 : « faire en sorte que les stratégies d'évitement de risques soient arrêtées le plus en amont possible, dès le stade de la mise sur le marché, sinon dans les stratégies de recherche elles-mêmes. » Pour atteindre un tel objectif, le système REACH est structuré en trois paliers : - une exigence d'enregistrement du produit dangereux par celui qui entend le commercialiser, qui comprend une évaluation du risque couru et les mesures de prévention adéquates ; - un double contrôle de cet enregistrement par les États-membres : un contrôle juridique - en l'absence d'enregistrement, la commercialisation sera interdite -, et un contrôle scientifique - les critères d'évaluation du risque seront expertisés, au regard notamment des prescriptions de l'Agence européenne des produits chimiques ; - un système d'autorisation préalable à l'utilisation du produit pour les substances les plus dangereuses, qui dépendra directement de l'Agence européenne des produits chimiques. Le projet de règlement est encore en cours de discussion au niveau de l'Union européenne, dont les instances se divisent sur quelques principes, notamment l'obligation de substitution à la charge des industriels, preuve que la France n'est pas le seul lieu d'arbitrage entre les préoccupations économiques et sanitaires. Il devrait s'appliquer pleinement à partir de 2008, et concerner l'évaluation de 30 000 substances dangereuses. Son impact sur les maladies professionnelles des travailleurs a d'ores et déjà été évalué par l'Université de Sheffield (Royaume-Uni), qui juge que REACH permettra d'éviter chaque année, en Europe, 50 000 cas de maladies professionnelles du système respiratoire et 40 000 cas de maladies professionnelles de la peau dus à l'exposition des travailleurs aux substances chimiques dangereuses. Au plan strictement financier, REACH représenterait ainsi au total une économie moyenne de 3,5 milliards d'euros sur 10 ans pour l'Europe des 25593. L'ampleur de cette évaluation ne peut que pousser l'Etat français à mobiliser avant 2008 des outils performants d'expertise des risques professionnels. b) La priorité : être au rendez-vous des enjeux sanitaires fixés par l'Europe La France a saisi dès 1989 l'opportunité que représentait la directive 89-391 pour une approche moderne de la prévention, comme en témoigne sa rapide transposition en droit du travail594. Pourtant, malgré cette consécration rapide des principes, force est de constater que leur mise en œuvre a été lente jusqu'en 2004, freinée en particulier par la résistance culturelle des acteurs sociaux. La mission a toutefois jugé que, depuis la première condamnation de l'Etat pour ses carences en la matière595, la traduction des principes avait été considérablement accélérée par l'entrée en vigueur du « Plan santé au travail 2005-2009 ». ● La lente traduction des principes depuis 1989 Le passage à une culture de prévention depuis la directive 89-391 a été relativement timide. Sur le plan de la recherche et de l'expertise, l'Institut de veille sanitaire n'a été doté qu'en 1998 d'un département santé travail, aucune agence d'expertise n'a été crée avant l'AFSSET en 2005, et les réformes affichées de la médecine du travail n'ont pas substantiellement accru sa capacité d'alerte et de prévention596. Il en va différemment de la définition progressive des obligations générales et spécifiques pesant sur les chefs d'entreprises. Le Gouvernement a en effet cherché les moyens de traduire concrètement l'obligation générale des employeurs transposée à l'article L.230-2 du code du travail, précité, et pris en conséquence le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Ce décret a été analysé par l'IGAS comme porteur d'une véritable logique de prévention. En effet, il597 « oblige l'employeur à matérialiser sur un document unique les résultats de l'évaluation des risques professionnels. Ce document doit faire l'objet d'une mise à jour annuelle ou lors de toute modification importante, et doit être tenu à la disposition des représentants des salariés. Le décret précise en outre, que « le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques dans les conditions prévues (par la réglementation), est puni de la peine d'amende prévue par les contraventions de 5ème classe ». Le support matériel et juridique de la prévention dans l'entreprise est donc exigible à compter du 8 novembre 2002. L'application de cette obligation conduit à mettre en œuvre, dans chaque entreprise, une véritable politique incluant la prévention au même titre que la réparation, et « à affirmer que la santé des salariés est une donnée essentielle de la politique menée dans l'entreprise. L'entreprise doit donc construire une réelle politique coordonnée incluant la prévention des risques tant sur le plan de la sécurité que de la santé des salariés. » La portée actuelle de ce dispositif doit cependant être relativisée, même s'il constitue, de l'avis de tous les témoins, un progrès important598. Deux facteurs amoindrissent en effet son efficacité. Premièrement, le « document unique » ne constitue pas une véritable expertise scientifique des risques. La conduite d'une évaluation au sein de l'entreprise, si elle constitue une démarche louable, manque pour l'instant du formalisme nécessaire à son exploitation, comme l'a expliqué Mme Isabelle Palud-Gouesclou, chef du bureau de la politique de prévention des conditions du travail et de la médecine du travail599 : « Rappelons que le document unique ne constitue pas une évaluation du risque au sens scientifique, mais une analyse du risque à partir de perceptions, de questions liées à l'organisation, aux techniques, aux facteurs humains. Élaboré sous la responsabilité du chef d'entreprise en relation avec le personnel, il n'est pas forcément exploitable : il n'existe pas de document unique type et il ne peut prétendre à déboucher sur des données objectives. Il est évidemment essentiel à la prévention dans l'entreprise, mais le but n'est pas tout à fait le même. » Deuxièmement, l'élaboration du document unique reste aux yeux de beaucoup de chefs d'entreprise une contrainte réglementaire supplémentaire, assimilable à une « corvée ». La réalisation de ce document satisfait en grande part aux obligations de prévention fixées par l'article L. 230-2 du code du travail, et les employeurs devraient être sensibles à ce moyen simple d'assumer leurs responsabilités. Pourtant, force est de constater que les acteurs sociaux restent peu soucieux de santé au travail, et que le document unique nécessite malgré tout une politique nationale de sensibilisation importante de la part des pouvoirs publics. Cette négligence se traduit par un déficit de réalisation du document unique, en particulier dans les petites entreprises, ou par une volonté de contourner l'approche préventive. M. Jean-Luc Marié a ainsi expliqué que l'INRS avait reçu de nombreuses demandes de la part d'employeurs qui cherchaient à déléguer la réalisation du document, ou à le rapprocher d'un simple « questionnaire à choix multiples »600 ! Le directeur des relations du travail, M. Jean-Denis Combrexelle, n'a d'ailleurs pas caché à la mission les « énormes difficultés » que posaient l'obligation de réaliser le document unique pour les entreprises601 : « si les grandes entreprises ont compris qu'il ne se résume pas à une formalité administrative et qu'il peut les aider à progresser dans leur démarche de prévention, les moyennes entreprises ont tendance à se contenter de remplir un formulaire sans s'impliquer dans une démarche de prévention. Quant aux petites entreprises, une bonne part réclame la suppression pure et simple de cette obligation... Le ministère du travail estime quant à lui que l'importance du risque n'est pas proportionnelle à la taille de l'entreprise et que cette démarche de prévention s'impose à tous, ceci tout en prenant en compte les moyens des entreprises qui diffèrent en fonction de leur taille. La présentation du « Plan santé au travail » n'est à cet égard que le point de départ d'une démarche impliquant tous les acteurs, y compris les partenaires sociaux. » ● Le « Plan Santé au travail 2005-2009 » : un document ambitieux au service de la prévention des risques professionnels Comme l'a précisé M. Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, au cours de son audition du 24 janvier 2005, le Plan santé au travail (PST) 2005-2009 (cf. encadré) se veut la réponse directe à la condamnation de l'Etat par la justice administrative le 3 mars 2004, pour ses carences dans la prévention des risques professionnels. Au vu des principes qui animent le « PST », la mission ne peut que se féliciter de l'aboutissement d'une véritable logique de prévention des risques professionnels. Ce constat a été largement partagé par les témoins qui ont considéré, à l'instar de M. Gilles Brücker, que le Plan répondait d'abord à un besoin de changement de culture602 : « La définition du Plan santé au travail a été une excellente chose. Nous avions besoin de nous fixer des objectifs précis et de définir qui fait quoi. Dans ses grandes lignes, les choses sont assez claires. Quant aux conditions du succès, elles reposent d'abord sur la capacité de chacun à mener à bien les actions prévues. » Le PST est structuré autour de quatre objectifs : développer la connaissance, renforcer le contrôle, réformer le pilotage administratif, encourager les entreprises ; eux-mêmes déclinés en 23 actions quantifiables. Le Plan fait sienne la volonté claire de distinguer dorénavant les acteurs de l'expertise sur les risques, et ceux de la gestion des risques. Il crée à cette fin un « pôle santé au travail » qui doit réunir une agence d'expertise - l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, l'AFSSET -, et une cellule de veille sanitaire - le département santé/travail de l'Institut de veille sanitaire -, dont le but sera de rompre avec les pratiques antérieures en matière d'évaluation des risques603 et de fournir à l'Etat une connaissance fiable et indépendante sur laquelle appuyer des mesures de prévention. Le PST propose également de renforcer les effectifs et la technicité des corps de contrôle de l'Etat, chargés notamment de veiller au respect des règles sanitaires. Enfin, le Plan cherche à promouvoir une démarche responsable de la part des acteurs sociaux dans le domaine de la santé au travail, à travers une tarification AT-MP plus incitative, l'encouragement à la substitution, etc. Les actions du Plan santé au travail sont toutes de nature à permettre d'une part de répondre aux objectifs que l'Union européenne fixe aux Etats membres dans le cadre d'une nouvelle approche de la santé au travail, et d'autre part de pallier les carences d'un système de prévention, dont la justice a estimé qu'elles engageaient la responsabilité de l'Etat. Pour autant, la mission a jugé, comme la plupart des témoins entendus, que le Plan santé au travail restait un outil inachevé, dont les moyens n'étaient pas encore à la hauteur des enjeux de la prévention des risques professionnels. PLAN SANTÉ AU TRAVAIL 2005-2009 Les 23 actions du plan santé au travail en 4 objectifs
2.- Le Plan santé au travail : une réponse adaptée mais encore incomplète Au cours de ses auditions, la mission a relevé que le Plan santé au travail présentait des lacunes dans deux secteurs en particulier, pour lesquels la volonté du Gouvernement ne s'est pas encore traduite par des moyens suffisants : l'évaluation et la connaissance des risques, d'une part, et l'articulation des responsabilités publiques et privées dans la gestion des risques d'autre part. a) Une évaluation des risques indépendante mais atrophiée Deux difficultés ont retenu l'attention de la mission en matière d'évaluation des risques. Premièrement, la capacité d'expertise française des risques professionnels reste limitée et difficile à mobiliser. Deuxièmement, la veille sanitaire manque encore cruellement d'un réseau capable de réunir les données et d'alerter les pouvoirs publics. ● Un réseau d'expertise sans expert : quels moyens pour l'AFSSET ? La volonté exprimée par le Plan santé au travail est d'établir un réseau national d'expertise en matière de risques professionnels, animé par une « tête de réseau » chargée de coordonner et de mobiliser tous les acteurs. L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement, récemment devenue, de par ses nouvelles fonctions, l'« AFSSET », a été désignée pour jouer ce rôle de « tête de réseau », au terme de débats animés sur la pertinence des liens entre environnement et travail, ou encore sur l'opportunité d'une greffe de la santé au travail sur une agence existante604. Estimant que rien ne permettait à ce jour de remettre en cause la justesse du choix effectué dans le Plan santé au travail, la mission n'a voulu retenir que les trois questions qui se posent aujourd'hui à l'AFSSET pour exercer la mission que lui confie le Gouvernement : le manque d'experts, sa capacité à mobiliser le réseau existant, sa capacité autonome d'expertise. Premièrement, le Plan santé au travail ne peut résoudre instantanément le déficit français d'experts suffisamment qualifiés pour mener l'évaluation des risques professionnels, qui se révèle souvent d'une grande technicité. Plusieurs témoins ont ainsi porté devant la mission un constat désolant de la capacité globale d'expertise en France. « Il faut savoir que nous souffrons d'un cruel manque d'experts. Pour une quinzaine de grosses saisines sur les substances chimiques, il nous est très difficile de mobiliser le nombre d'experts nécessaire pour avancer au rythme souhaitable. La rareté de l'expertise est un problème qui se pose avec acuité. », a ainsi estimé Mme Michèle Froment-Védrine, directrice générale de l'AFSSET605, lors de la table ronde du 19 octobre 2005, au cours de laquelle le directeur général de l'INRS a confirmé une difficulté qui ne concerne pas que les structures de l'Etat : « je confirme (...) les difficultés à recruter des épidémiologistes : notre poste de chef du département « épidémiologie en entreprise » vient d'être pourvu, mais il était resté vacant pendant deux ans, et deux autres postes le sont toujours. » La pénurie d'experts est sans doute liée à l'isolement des spécialités de santé publique dans la formation médicale depuis plusieurs décennies, qui explique que peu de vocations aient été encouragées dans des domaines tels que l'épidémiologie, la toxicologie, ou encore la médecine du travail. Comme l'a expliqué la directrice générale de l'AFSSET, cette précarité de l'expertise en France prend une ampleur particulière, dans la mesure où le scientifique capable d'expertiser un produit chimique ou naturel, devenu quelqu'un de rare, est attiré dans le secteur marchand, où ses compétences sont mieux rémunérées, sinon mieux reconnues606. Le Plan santé au travail prévoyait au premier semestre 2005 l'élaboration d'un document d'orientation stratégique en la matière, qui n'a pas été publié à ce jour. La mission appelle donc à une ambition plus grande de l'action du PST « Structurer et développer la recherche publique en santé et sécurité au travail » non seulement par la création de postes de chercheurs en santé au travail, mais également par une plus grande sensibilisation des jeunes chercheurs aux priorités de la santé publique, par un programme de recherche spécifique et des appels à projet. Plus généralement, les spécialités touchant à la santé au travail doivent être revalorisées dans la formation médicale, afin de permettre un accroissement à moyen terme de la capacité d'expertise française aujourd'hui inquiétante. Propositions : - Créer des postes de chercheurs en santé au travail, en toxicologie et en épidémiologie pour structurer et développer la recherche publique en santé et sécurité au travail, conformément aux objectifs du Plan santé au travail. - Sensibiliser les jeunes chercheurs aux priorités de la santé publique par un programme de recherche spécifique et des appels à projets. - Revaloriser les spécialités touchant à la santé au travail dans le cadre de la formation médicale pour accroître les capacités d'expertise. Deuxièmement, bien que le décret organisant l'action de l'AFSSET n'ait pas encore été publié, il ressort des travaux de la mission que l'ambition d'en faire une tête de réseau manque en réalité de moyens pour mobiliser l'expertise dans les structures existantes. De ce point de vue, l'éclatement des structures d'expertises en France ne contribue pas à l'efficacité de l'évaluation des risques. D'une part, chaque structure dispose de son propre programme de recherche et de ses propres priorités, au sein desquels les besoins de l'AFSSET ne trouvent pas nécessairement leur place. D'autre part, la multiplication des organismes est une source de doublons regrettables dans la recherche. De nombreuses structures sont ainsi susceptibles de se partager le travail d'évaluation : INSERM, AFSSET, INRS, INERIS, ANACT, etc. La mission craint que l'insuffisance de moyens affectés à l'AFSSET ne lui permette pas de constituer un véritable réseau coordonné, les maîtres mots du Plan santé au travail en la matière étant le « conventionnement » et les « contrats », dont l'absence de caractère contraignant pourrait paralyser le réseau créé par le Gouvernement. Il suffit pour s'en convaincre de consulter l'inextricable réseau de la prévention en France, que la mission a tenté de restituer, sans prétendre à l'exhaustivité. Ces moyens pourraient être de deux ordres, selon la nature de la mission confiée à l'AFSSET, comme l'a indiqué sa directrice générale au cours de la table ronde du 19 octobre 2005 : « Créer une tête de réseau suppose de lui donner des moyens juridiques et des moyens financiers. On ne peut se contenter de lui dire de passer des conventions avec les autres instituts, alors que ceux-ci ont chacun leurs missions... Ou bien l'AFSSET a des priorités, en nombre réduit, et l'on demande à tout le monde de travailler avec elle, ou bien elle a une mission plus générale de coordination, auquel cas cela est prévu dans les contrats d'objectifs et de moyens de chaque établissement et on donne à l'agence des moyens à redistribuer, y compris dans la recherche. » Pour l'heure, force est de constater que le Gouvernement n'a pas véritablement opté pour une des deux alternatives, et, de ce fait, n'a pas attribué les moyens correspondants. Suivant le diagnostic de M. Yves Coquin, la mission a considéré que la recherche de partenariats avec d'autres organismes n'était pas un facteur d'efficacité suffisant, au vu des exigences qui pèseraient bientôt sur l'AFSSET une fois le règlement REACH entré en vigueur607 : « (...) les moyens donnés à l'AFSSET dans les années à venir, quels que soient les efforts déployés par le ministère du travail pour la doter en capacités d'expertise, la condamneront à vivre perpétuellement au crochet d'autres organismes. Cette perspective ruinera toujours sa capacité à faire de la prospective et par le fait à se saisir suffisamment en amont des problèmes. » Cette crainte est largement étayée par l'expérience de l'AFSSE, qui a fonctionné sur le modèle du « partenariat », en rencontrant de véritables difficultés à mobiliser l'expertise, au prix d'une dépense d'énergie et de temps fortement préjudiciable à son efficacité608. Cette question rejoint en grande partie celle des moyens propres à l'AFSSET. Troisièmement, l'AFSSET paraît encore aujourd'hui sous dimensionnée au regard des enjeux qui l'animent. La rareté de l'expertise, comme la nécessité de passer des « commandes » en matière d'évaluation, posent la question de ses moyens humains et financiers. Mme Michèle Froment-Védrine a ainsi montré par une anecdote le décalage entre ces moyens et l'importance de la mission de santé publique qui lui est confiée609 : « (...) les experts qui travaillent pour la Commission européenne sont bien payés et sont correctement indemnisés, aussi bien pour leur transport que pour leur séjour. Nous, nous leur donnons 37 euros ! Je vous souhaite bonne chance pour trouver à Paris un hôtel à 37 euros la nuit ! Je vous assure que c'est un vrai problème. N'oublions pas que ces experts sont des professeurs reconnus au niveau international. Enfin, nous les indemnisons à hauteur de 67 euros la vacation de quatre heures. S'ils travaillent pour la Commission européenne, ils touchent 300 euros net, non imposés. ». Les moyens humains (70 équivalents temps plein administratifs et scientifiques) ne sont pas non plus à la hauteur du volume d'expertise que l'AFSSET aura bientôt en charge. Au cours d'un séminaire organisé à l'INTEFP610 à Lyon en novembre 2005, le ministre délégué au travail, M. Gérard Larcher a rappelé le caractère fondamental des missions de l'AFSSET : « L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) fournira à l'Etat les études et expertises qui lui permettront d'asseoir scientifiquement la gestion des risques, dont il a la responsabilité. Un département spécialisé en santé au travail est d'ores et déjà en cours de constitution au sein de cette agence, qui va organiser un réseau d'évaluation des risques sanitaires en milieu professionnel avec les établissements publics et organismes privés intervenant dans ce domaine. (...) Avec l'AFSSET et le pôle commun formé par l'INERIS et l'INRS, nous aurons aussi les moyens de préparer la mise en œuvre du programme européen REACH, dont vient de débattre le Parlement européen et sur lequel les ministres européens devraient parvenir à un accord politique fin décembre. J'y attache la plus grande importance car il est porteur de progrès considérables en termes de santé notamment pour les travailleurs. Il faut combler le retard de connaissances accumulé sur les 100 000 substances chimiques qui circulent et dont les dangers sont souvent méconnus, parfois ignorés. » La mission a jugé que l'Agence ne disposait pas, en l'état, des moyens nécessaires pour répondre à ces objectifs importants, ni dans sa capacité d'expertise propre, ni par la possibilité de mobiliser véritablement les autres sources d'expertise. Si ces moyens ne sont pas réunis, la mission craint que le « retard » évoqué par le ministre ne soit pas comblé. Elle préconise d'établir clairement l'AFSSET comme la seule agence d'expertise des risques liés au travail ou à l'environnement. Elle devrait disposer en conséquence d'une capacité d'expertise comparable à celle des grandes agences environnementales des voisins européens de la France611. Elle estime également que la richesse en expertise doit donc être regroupée sous la direction de l'AFSSET, plutôt qu'éparpillée et mobilisée par des partenariats. Ce dispositif, qui garantirait le mieux l'efficacité de l'Agence, suppose que le Gouvernement engage une restructuration de l'ensemble des organismes d'expertise et de leurs tutelles, afin de regrouper la capacité d'expertise sous la tutelle spécifique des agences sanitaires existantes. Un tel schéma inclurait les actuelles équipes de l'INRS, qui représentent la plus importante population de scientifiques dans le champ de la santé au travail en France. Si un tel regroupement se révèle impossible, il ne faudrait pas que la complexité de l'offre d'expertise fasse perdre de vue le caractère prioritaire et indispensable de l'évaluation des risques professionnels dont l'AFSSET a la charge, et dont l'Etat français sera bientôt comptable vis-à-vis de l'Union européenne. La mission propose qu'en ce cas les prérogatives de l'AFSSET soient explicitement prévues par décret, et que les concours apportés par les organismes publics ou parapublics dans les expertises de l'Agence aient un caractère contraignant, sinon impératif. Propositions : - Unifier l'expertise des risques professionnels sous la tutelle de l'AFSSET et regrouper les équipes de recherche en son sein pour faire de l'AFSSET l'équivalent des grandes agences européennes, et la doter d'une capacité d'expertise propre comparable à celle des pays voisins de la France ; OU - À défaut, doter l'AFSSET des instruments juridiques lui permettant, conformément à sa mission de « tête de réseau », de faire valoir ses priorités et la cohérence de son action auprès des différents organismes d'expertise des risques professionnels. ● La veille sanitaire en quête d'un réseau de sentinelles : la question de la médecine du travail Deuxième volet de la connaissance des risques professionnels, la veille sanitaire est une méthode moderne de protection de la santé publique. Elle consiste en une surveillance de l'état de santé d'une population, qui peut être spécifique, afin d'en dégager des données de type épidémiologique qui établissent un lien entre une situation à risque et une dégradation de la santé de la population examinée. Comme l'a indiqué le Professeur Claude Got, l'épidémiologie « permet d'agir » sur le risque, en l'absence même de connaissances fondamentales sur la relation biologique entre la cause établie et la santé de la population612. La décision d'instaurer une véritable veille sanitaire en matière de risques professionnels est donc un acte fort de prévention, mais il suppose des moyens importants pour recueillir les données épidémiologiques nécessaires à l'appréciation de ces risques. C'est sur ce point que se sont focalisées les critiques recueillies par la mission. Le Plan santé au travail n'apporte pas de réponse institutionnelle franche à la question du réseau exploitable par le département santé/travail de l'Institut de veille sanitaire qu'il préconise613 : « L'IVS développera des partenariats avec la CNAMTS, créera ou consolidera des réseaux de médecins du travail pour améliorer la surveillance sanitaire en milieu professionnel et développera les compétences de ses structures régionales pour contribuer à la surveillance épidémiologique dans les entreprises. ». Dès lors que la veille sanitaire impose une proximité forte entre un professionnel de santé et la population au travail, il ne fait pas de doute que la médecine du travail est le « réseau » idéal sur lequel l'IVS doit s'appuyer. Les travaux de la mission font apparaître trois facteurs justifiant une telle solution. - Premièrement, cette solution a été confortée par les expérimentations déjà conduites par l'IVS dans ce domaine comme, par exemple, le suivi des troubles musculo-squelettiques en Pays de Loire dont le succès est indéniable614 ; - Deuxièmement, en dépit des critiques dont elle a pu faire l'objet, la majorité des témoins n'a pas remis en cause la capacité de la médecine du travail à suivre la santé des travailleurs, mais a plutôt regretté le « gâchis », en termes d'exploitation, des données sanitaires recueillies615 ; - Troisièmement, cette évolution des missions du médecin du travail est déjà perceptible dans les discours officiels du ministère du travail616 et elle est prévue par la réglementation qui ne crée cependant pas d'obligation de veille617. Ainsi, convaincue par les témoignages recueillis au cours de ses auditions que les médecins du travail pouvaient constituer ce réseau de sentinelles indispensable à l'action de l'IVS, la mission s'est interrogée sur leur capacité réelle à assurer un tel rôle, en l'état de leur statut et de leurs attributions. La médecine du travail fait en effet l'objet de critiques très vives, que la mission a déjà exposées618, et qui tiennent essentiellement à la définition de sa fonction principale - la déclaration d'aptitude du salarié - et à son lien avec l'entreprise. Le Plan santé au travail n'apporte pas de réponse à ces critiques, tout comme les réformes conduites en 2003 et 2004 qui ont surtout consacré la pluridisciplinarité des services de santé au travail. Il appartient au Gouvernement de résoudre ces obstacles pour donner corps à sa volonté d'instaurer une veille sanitaire au travail : ● Le nombre de médecins du travail La démographie des médecins du travail et des professeurs de médecine du travail a été identifiée par de nombreux témoins comme une réelle difficulté, les effectifs des deux catégories étant en forte régression sur les dernières années619. ● Le statut du médecin du travail Le médecin du travail est un salarié direct ou indirect de l'entreprise, dont le statut et les missions sont protégés. Pour autant, le lien qui en découle entre le médecin et le chef d'entreprise a été fortement critiqué par les témoins entendus par la mission, soit qu'il jette un doute sur l'indépendance du médecin620, soit qu'il obère la qualité du « colloque singulier » entre le médecin et le salarié en privilégiant l'objectif strictement professionnel de la visite621. ● Les missions du médecin du travail Il s'agit sans doute d'un des points les plus délicats soulevés par les travaux de la mission, et qui n'est pas sans lien avec le statut du médecin du travail. La fonction première du médecin du travail est en effet la consultation obligatoire des travailleurs, dont la finalité est l'avis d'aptitude. Plusieurs témoins ont insisté sur les limites en termes de prévention de ce dispositif622, qui fait d'ailleurs l'objet d'une action - timide - du PST623. Cette fonction principale du médecin du travail pose en elle-même des difficultés, lorsque le médecin du travail tente une impossible conciliation entre un risque professionnel et la protection de la santé des salariés, comme l'a relevé M. Marc Boisnel624 : « On constate, à travers l'étude des recours contentieux ou hiérarchiques, que des avis d'aptitude sont parfois donnés avec des réserves telles que le salarié est dans l'impossibilité d'occuper le poste. Voilà qui nous fait sortir du droit comme de la logique. » De plus, sans être formellement incompatible avec une fonction d'alerte et de veille sanitaire, cette fonction de déclaration d'aptitude occupe un temps incompressible dans l'exercice régulier du médecin du travail, qui laisse peu de place à d'autres tâches, surtout si celles-ci sont jugées secondaires625. Aujourd'hui, un tiers de son temps doit en théorie être réservé par le médecin du travail au milieu professionnel, alors qu'il en consacre les deux tiers aux visites médicales. Compte tenu de la réduction prévisible de la démographie médicale du travail, un élargissement des missions du médecin du travail à la veille et à l'alerte sanitaires ne pourra être obtenu qu'en revoyant la place accordée à la visite médicale et à la déclaration d'aptitude. ● La culture du médecin du travail Les témoins ont attiré l'attention de la mission sur la culture spécifique des médecins du travail, et notamment sur les principes déontologiques qui les animent. Sans contester la valeur de ces principes, qui ont été rappelés par le Dr Larche-Mochel626, chef du service de l'inspection médicale du travail, force est de constater que la relation médicale tissée avec le travailleur ne permet pas, en l'état, de jouer un rôle de veille ou d'alerte sanitaire, centré avant tout sur la culture du « signalement »627. Pour franchir ces obstacles, la mission a jugé qu'une réforme ambitieuse serait nécessaire, plus efficace qu'une modification à la marge des rôles du médecin du travail, tout en étant consciente de la difficulté d'une telle réforme. Cette réforme doit permettre à l'Etat, pour ce qui concerne la veille sanitaire des risques professionnels, de disposer d'un véritable réseau de « sentinelles » épidémiologistes, indépendantes, et dédiées à leur fonction d'alerte et de prévention. Il ne peut en effet se satisfaire d'acteurs privés, qui ne sont mobilisables que par la « conviction », leur activité première - et rémunératrice - étant ailleurs628. L'Etat doit donc réussir le pari difficile consistant à sortir le médecin du travail de sa relation à l'employeur - afin d'atteindre un degré d'indépendance comparable à celui qui est exigé pour l'expertise629 -, sans pour autant le sortir de l'entreprise où il devra, par définition, exercer ses fonctions. En tout état de cause, si la veille sanitaire en milieu de travail est une véritable priorité gouvernementale, il n'est guère concevable qu'elle continue d'être exercée par des travailleurs privés, financés exclusivement par les employeurs. La mission, consciente de l'ampleur et de la difficulté de la tâche, recommande la création d'un véritable « service public de la santé au travail ». Ce service public, coordonné par les médecins inspecteurs du travail et de la main d'œuvre, serait animé par des médecins du travail, dont le statut public garantirait l'indépendance. La fonction de ces médecins du travail serait double, mais entièrement consacrée au milieu de travail : - d'une part, une fonction de veille et d'alerte sanitaire, assise sur le socle réglementaire existant en matière de collecte des données sur les risques professionnels (article R. 241-41-3 du code du travail630), et pilotée par l'IVS; - d'autre part, un rôle d'accompagnement de l'entreprise dans l'évaluation obligatoire des risques, puis le cas échéant dans la mise en œuvre des mesures de prévention adaptées à ces risques, sous la conduite de la direction des relations du travail. L'obligation de visite médicale préalable à l'embauche, et régulièrement organisée dans le cadre du contrat de travail, serait maintenue. Il convient cependant d'envisager de la confier à la médecine de ville, comme le préconisait l'IGAS en 2003631, et d'en prévoir la prise en charge par la branche AT-MP de la CNAMTS. La fréquence de ces visites médicales, et le cas échéant les examens médicaux complémentaires nécessaires, seraient alors établis par le médecin du travail en fonction de l'évaluation des risques professionnels obligatoirement conduite dans l'entreprise. Cette évaluation serait communiquée au médecin de ville par le travailleur, pour permettre à celui-ci de délivrer un certificat d'aptitude adapté aux risques auxquels le salarié est exposé. Les employeurs seraient redevables d'une contribution spécifique, servant à financer une partie du service public de santé au travail, ainsi que les dépenses nouvelles occasionnées à la branche AT-MP si la médecine de ville venait à assurer les visites médicales obligatoires. Le montant de cette contribution devrait être calculé sur la base des économies réalisées par les employeurs sur le financement - qu'ils assument actuellement - des services de santé au travail. Cette contribution devrait être modulée en fonction du respect par l'employeur de ses obligations au sein du dispositif national de prévention, en particulier à travers l'évaluation préalable des risques professionnels dans son entreprise. Propositions : - Créer un service public de santé au travail, regroupant les médecins du travail et doter ces médecins d'un statut public garantissant leur autonomie, le financement de ce nouveau service public étant assuré par l'Etat et les employeurs. - Charger ce service public d'une mission de veille et d'alerte sanitaires sous la tutelle de l'IVS et d'une mission d'accompagnement des entreprises dans le respect de leurs obligations nouvelles, sous la tutelle de la Direction des relations du travail. - Engager une réflexion sur la possibilité de confier la visite médicale obligatoire et la délivrance de certificats d'aptitudes à la médecine de ville, qui pourrait s'appuyer sur les documents d'évaluation des risques professionnels et du poste de travail, établis par le service public de santé au travail, pour moduler la fréquence de la consultation et prescrire les examens nécessaires. - Instaurer une contribution des employeurs destinée à financer en partie le service public de santé au travail, ainsi que les dépenses nouvelles de la branche AT-MP qui prendrait en charge les visites obligatoires, si celles-ci étaient confiées à la médecine de ville.
La façon dont le PST a organisé la gestion des risques professionnels n'est pas exempte de critiques. En premier lieu, le PST reste flou sur la portée de l'implication indispensable des entreprises dans la prévention des risques. En second lieu, bien qu'ayant fait du renforcement de « l'effectivité du contrôle » un des objectifs du PST, celui-ci n'en n'a pas tiré les conséquences en termes de moyens. ● « Faire des entreprises des acteurs de la santé au travail » : un objectif à renforcer Le quatrième objectif du PST fait figure d'inventaire généraliste, où ont été listées les actions possibles qui ne s'inscrivaient pas dans les trois premiers objectifs632, des services de santé au travail à la tarification de la branche AT-MP, du rôle des CHSCT633 au principe de substitution des produits dangereux. Le constat dressé par la mission porte essentiellement sur le décalage entre le flou qui résulte de cet objectif, et les obligations spécifiques, parfois de valeur législative, qui pèsent déjà sur les acteurs privés dans le domaine de la prévention. En effet, le PST ne prévoit rien concernant les principes de prévention que la loi, en transposant la directive communautaire 89-391, a porté à la charge des employeurs, notamment la réalisation du document unique. Cette absence paraît d'autant plus problématique, que le PST était sans doute l'occasion de parfaire le dispositif prévu en 2001. En premier lieu, l'absence de prise en considération de l'obligation de réalisation du document unique dans l'entreprise, alors même que celui-ci permet de satisfaire plusieurs obligations édictées par la directive634, semble à première vue incompréhensible dans un « Plan santé au travail ». M. Jean-Denis Combrexelle a tenté d'expliquer à la mission les raisons de ce choix délibéré635 : « Nous avons décidé, non sans hésitations, de ne pas mettre le document unique dans le « Plan santé au travail », estimant qu'il fallait commencer par le défendre et par convaincre les entreprises de s'engager dans cette démarche de prévention des risques professionnels, et que la rationalisation et l'exploitation viendraient dans un second temps. L'objectif est évident : le document unique doit être une démarche tout à la fois interne à l'entreprise et, à terme, exploitable au niveau national. Mais pour l'heure, de nombreux ministères réclament purement et simplement sa suppression... » Pourtant, la mission a pu constater que le document unique n'appelait pas de contestation de principe de la part des témoins, qu'il s'agisse des organisations syndicales de travailleurs636, des syndicats d'employeurs, ou même des artisans. Ainsi M. Daniel Boguet, membre de l'Union professionnelles des artisans (UPA), a-t-il soutenu la démarche du législateur au cours de la table ronde du 28 septembre 2005 : « Non seulement le document unique a le mérite d'exister, mais les organisations syndicales - parmi lesquelles je compte nos organisations professionnelles - se sont attachées, sur le terrain, à y sensibiliser les intéressés et, en premier, lieu à dissiper leurs craintes. Jadis, les artisans ne demandaient rien d'autre à Colbert que de les laisser travailler ; cette fois-ci encore, nos collègues redoutaient qu'une nouvelle charge pèse sur leurs épaules. Nous leur avons expliqué qu'il y allait de l'intérêt bien compris de tout le monde. Je crois sincèrement qu'il était bon de leur laisser un délai de réflexion. Ce document unique est une bonne chose, mais il faut aider le chef d'entreprise à comprendre qu'il peut participer à la qualité du dialogue social dans l'entreprise, même s'il n'a qu'un ou deux compagnons. » En définitive, il a semblé à la mission que le document unique pouvait souffrir d'une incompréhension des chefs d'entreprise, liée peut être à une communication et à un accompagnement insuffisants, mais que son principe et son caractère contraignant devaient être maintenus. Dès 2003, l'IGAS reconnaissait les efforts que la démarche d'évaluation des risques imposeraient aux opérateurs et à l'Etat637 : « Une des conditions de la réussite de cette nouvelle approche tient dans le conseil et l'aide qui seront apportés à l'employeur qui a la charge de la réaliser, en particulier dans les petites et très petites entreprises. La publication de guides, élaborés paritairement au sein de chaque branche professionnelle, constitue une des pistes qui devra être adoptée et stimulée au besoin par des aides techniques et financières, parce que, pour l'instant, les initiatives dans ce domaine sont très éparses et limitées. » La mission regrette que l'élaboration du document unique n'ait pas fait l'objet d'une ou plusieurs actions du PST, tendant à encourager et à accompagner sa réalisation, en s'appuyant, par exemple, sur les instances de pilotage régionales en cours de création. En second lieu, le PST aurait pu être le « véhicule » idéal pour améliorer le dispositif prévu en 2001, qui reste limité à plusieurs points de vue. En particulier l'absence totale de cahier des charges, même minimaliste, sur son contenu, est regrettable à plusieurs égards : - certains employeurs ont du mal à appréhender ce document, qui est la « transcription » de l'évaluation obligatoire des risques ; - d'autres en revanche ont voulu en faire une sorte de formulaire « à cocher », loin des ambitions du Gouvernement qui pensait que le document servirait de base à une véritable démarche préventive en entreprise ; - enfin, et surtout, l'absence de formalisme minimal interdit toute exploitation du document unique par les autorités chargées notamment de la veille sanitaire, ce qui est à l'opposé de l'intention du Gouvernement exprimée dans le PST. La mission préconise que l'Etat donne véritablement aux employeurs les outils nécessaires au respect de leurs obligations réglementaires. Ces outils doivent être de deux ordres, et faire l'objet d'une consultation préalable de l'IVS. Premièrement, les médecins du service public de santé au travail doivent initier, auprès des entreprises qui ne l'ont pas déjà menée, une démarche d'évaluation des risques professionnels, au terme de laquelle les données recueillies sont transcrites globalement dans le document unique de synthèse, que les médecins transmettent à l'IVS, et de façon détaillée dans les documents de suivi des expositions des travailleurs aux risques, que les médecins du travail conservent. Deuxièmement, le Gouvernement doit compléter l'article R. 230-1 du code du travail, pour y inscrire les éléments que l'IVS aura jugé indispensable de voir figurer dans les documents uniques, afin de constituer une base de données sanitaire des risques professionnels. Propositions : - Demander au nouveau service public de santé au travail d'assister les entreprises dans la réalisation du document unique, qui est une priorité ; cet accompagnement doit être orienté avant tout vers les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises. - Demander à ce service public de collecter les données de ces documents et les transmettre à l'IVS. - Faire établir par l'IVS le cahier des charges minimal du document unique, afin de constituer une base de données des risques professionnels. ● Renforcer l'autorité de la règle sanitaire par un contrôle plus effectif : l'Etat n'a pas les moyens de ses responsabilités. Le deuxième objectif du PST témoigne de la prise de conscience par l'Etat, déjà ancienne, de l'insuffisante efficacité des corps de contrôle de l'application de la règle sanitaire. Au cœur de la condamnation par le Conseil d'Etat en 2004, l'efficacité du contrôle constitue, en effet, le corollaire indispensable de l'obligation de réglementer, consacrée par le code du travail en matière de protection de la santé des travailleurs. Cette réflexion autour des missions de l'inspection du travail n'est pas nouvelle, et a donné lieu à de nombreuses études et rapports. Dans le domaine spécifique de la santé au travail, la mission a retenu trois limites incontestables à l'action de l'inspection du travail : la technicité requise par le contrôle, les effectifs de contrôle, et les moyens juridiques du contrôle. En premier lieu, pour que le contrôle des règles relatives à la protection de la santé au travail soit effectif, il importe que l'inspection du travail dispose de la technicité suffisante pour appréhender l'étendue et la dangerosité des risques professionnels. Cet impératif doit être mis en rapport avec le caractère généraliste de l'inspection, qui constitue une originalité, mais également une force, comme l'a rappelé M. Jean-Denis Combrexelle638 : « Nous sommes le seul pays de l'Union européenne dont l'inspection du travail soit généraliste. C'est un atout dans la mesure où cela permet à l'inspecteur du travail d'avoir une vue globale de l'entreprise ; il y a, par exemple, un lien étroit entre la qualité du dialogue social et la prise en compte des questions de santé. Mais la préservation de ce caractère généraliste implique une modification des modes de fonctionnement. » Tirant les conséquences de ce constat, le PST a organisé d'une part la formation spécifique des agents de contrôle en matière de santé au travail, et d'autre part la création de 7 cellules d'appuis pluridisciplinaires expérimentales, composées d'ingénieurs, de médecins, et de scientifiques639 . La qualité de cette démarche n'est pas critiquable, mais la mission s'est interrogée sur la possibilité de dépasser la forme généraliste historique de l'inspection. En effet, ce caractère généraliste se traduit également dans la diversité des missions que se voient confier les inspecteurs et contrôleurs du travail. Sans préjuger de l'efficacité des cellules mises en place par le PST, la mission s'est donc demandée s'il ne serait pas utile de dédier une partie des effectifs de contrôle à une fonction exclusive de contrôle de l'application de la réglementation du travail. Les deux inspecteurs du travail entendus par la mission ont en effet souligné que leur temps se partageait entre des préoccupations très diversifiées, incluant une part d'accueil des administrés. Quelle que soit la nécessité de l'ouverture au public des services déconcentrés du ministère du travail, on peut cependant se demander s'il est pertinent d'y affecter des personnels irremplaçables sur le terrain, indispensables au respect de la réglementation, et en faveur desquels un investissement particulier de formation en matière de santé au travail a été engagé. En second lieu, la mission n'a pu que souscrire à la critique exposée par de nombreux témoins sur les effectifs de l'inspection du travail. M. Jean-Denis Combrexelle, en particulier, a tenu à rappeler les conditions dans lesquelles s'effectuait le contrôle de l'application de la réglementation640 : « (...) je me dois de souligner la difficulté permanente à laquelle notre direction doit faire face. Nous sommes sans cesse saisis de demandes plus légitimes les unes que les autres, qu'il s'agisse de la discrimination dans les entreprises ou de l'égalité professionnelle. « Que font donc les inspecteurs et les contrôleurs du travail ? » me demande-t-on. Mais les « inspecteurs inspectant » sont au nombre de 1 300 ! C'est dire qu'une section, composée d'un inspecteur et de deux contrôleurs, couvre 30 000 salariés, et un inspecteur 10 000 salariés à lui seul. Dans le même temps, en Grande-Bretagne, où la préoccupation première n'est sans doute pas l'inspection du travail, un inspecteur couvre 6 000 salariés. Certes, la Loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, a prévu un programme « relations du travail » qui donnera l'occasion de dire quels sont les indicateurs et les objectifs donnés à l'inspection du travail. Mais on pourra toujours fixer des priorités, le corps demeurera globalement insuffisant par rapport aux missions et aux responsabilités qui sont les siennes. » Le directeur des relations du travail n'est pas le seul à souligner la pénurie d'agents de contrôle. En effet, en clôture du séminaire Santé au travail, tenu à Lyon en novembre 2005, le ministre délégué au travail, Gérard Larcher indiquait ainsi : « La nécessité d'une présence accrue des inspecteurs et contrôleurs du travail dans ce domaine est une des conditions de la réussite de ce plan. Il faudra bien combler notre retard quantitatif des moyens d'inspection. » Le comblement de ce retard n'a pas été prévu au PST, qui s'est borné à tenter de mieux déployer la ressource existante en fonction de dominantes territoriales. En troisième lieu, la mission a partagé les critiques relatives à l'arsenal juridique dont dispose l'inspection du travail pour conduire ses contrôles. M. Éric Jany, inspecteur du travail dans les Hauts-de-Seine a décrit la gradation des mesures que le contrôleur peut prendre à l'encontre d'un employeur contrevenant641 : « le conseil prend la forme de lettres d'observations reprenant les constats effectués lors des contrôles sur place, qui font, au besoin, l'objet d'un échange de courrier afin de préciser les choses. La lettre d'observation n'est envoyée qu'en cas de manquements ou d'irrégularités constatés. Le but de ce rappel à la loi est d'obtenir une explication ou la régularisation du problème. (...) Si l'inspecteur du travail constate une infraction très grave, susceptible de mettre en danger les salariés, ou si, malgré ses rappels, l'entreprise n'a pas modifié son attitude, il dressera un procès-verbal qui sera transmis au procureur de la République. À noter que les procès-verbaux ne sont pas l'outil principal de l'inspecteur du travail : seulement 2 % des infractions constatées font l'objet d'un procès-verbal. Un agent de contrôle ne diligente en moyenne annuelle pas plus de cinq à vingt procédures, pour les plus répressifs. (...) Le procès-verbal ne vaut pas obligation de faire. Tout au plus entraînera-t-il pour l'employeur une sanction, pour peu que le procureur veuille bien suivre et que le tribunal le condamne. » À travers ces mesures de contrôle, la mission a pu mesurer que l'inspection du travail était avant tout un corps de « signalement » des infractions, à destination de l'employeur, et en cas d'infraction grave, à destination de la justice pénale par la voie du procès verbal, cette dernière hypothèse jouant autant le rôle de menace que de véritable sanction. En effet, l'inspecteur du travail est réduit, vis-à-vis de l'employeur, à un rapport de force difficile : ne disposant pas des moyens de faire cesser une situation d'infraction642, l'agent de contrôle doit convaincre l'employeur récalcitrant que son comportement fera l'objet d'une sanction pénale. La réalité des poursuites en matière de droit du travail étant ce qu'elle est, ce discours a peu de chance de convaincre, comme l'a rappelé M. Michel Ricochon1 : « Le passage par le procureur, puis en audience, se traduit (...) par un taux de déperdition réellement significatif. Les agents de contrôle en viennent à se demander s'il faut continuer dans la voie pénale, peu productive et peu efficace. » Une réflexion s'est engagée, sur la base d'un rapport remis au ministre du travail en janvier 2005 par M. Jean Bessière, sur les moyens de l'inspection du travail, et plus spécialement sur la possibilité de prendre des sanctions administratives, afin - comme l'indique M. Ricochon643 - « d'être en mesure de faire cesser le plus rapidement possible une situation d'exposition ». Cette question est absente du PST, alors même qu'en santé au travail, la possibilité de faire cesser une infraction à la règle, ou d'obliger l'employeur à s'y conformer, aurait une incidence directe sur la santé des travailleurs. Afin de pallier ces trois difficultés, la mission préconise : - qu'une spécialisation des agents de contrôle en santé au travail, par section, soit envisagée afin d'accroître les possibilités d'intervention de l'inspection dans ce domaine ; - plus généralement, qu'une distinction soit progressivement établie au sein des missions de l'inspection entre les fonctions qui requièrent un véritable savoir faire de contrôle de la réglementation, et celles qui pourraient être menées par les personnels des services déconcentrés du ministère du travail n'appartenant pas à l'inspection ; - qu'un effort budgétaire particulier soit porté en faveur de l'accroissement des effectifs de contrôle de l'inspection du travail, afin d'amener celle-ci à une dimension comparable à celles des corps de contrôle des autres pays européens ; - que le code du travail soit complété pour offrir à l'inspection du travail des mesures administratives contraignantes lui permettant de faire cesser toute infraction à la réglementation en matière sanitaire, dès lors que la santé des travailleurs est en jeu. Propositions : - Former dans chaque section de l'inspection du travail des agents spécialisés en santé au travail. - Chercher à libérer l'inspection du travail de ses fonctions administratives les moins spécifiques. - Combler le retard français en matière d'effectifs de l'inspection du travail, par rapport à la moyenne européenne. - Créer de nouveaux outils juridiques permettant à l'inspection du travail de faire cesser plus facilement les infractions mettant en jeu la santé des travailleurs. À l'issue de ses travaux, les propositions de la mission concernent prioritairement les victimes de l'amiante. Celles qui sont déjà malades et dont il faut améliorer la prise en charge, notamment par un meilleur fonctionnement du FIVA qui doit permettre de tarir les contentieux conformément à l'objectif initial d'un dispositif fondé sur une indemnisation rapide et équitable de toutes les victimes de l'amiante. Celles qui risquent de l'être parce qu'elles ont déjà été exposées, à qui il faut assurer un meilleur suivi médical et pour lesquelles il faut sortir du blocage actuel du FCAATA. Mais aussi les victimes potentielles : - celles qui risquent d'être exposées à l'occasion de travaux sur l'amiante en place car si les règles de prévention et de protection ne sont pas mieux respectées, le secteur du bâtiment risque de générer - en nombre important - les victimes de l'amiante de demain. Sur ce point, qui a été le premier thème d'investigation de la mission, les propositions sont nombreuses car il faut, très concrètement, éviter que le drame ne se prolonge ; - celles de tous les pays qui continuent d'extraire, d'exporter, d'importer et d'utiliser l'amiante et pour lesquelles il faut agir en faveur d'une interdiction généralisée du produit. Les propositions de la mission concernent également toutes les victimes des risques sanitaires liés au travail. En premier lieu, le drame de l'amiante a révélé les insuffisances du régime de réparation des AT-MP : - en soulignant l'importance croissante des maladies professionnelles, - en conduisant à une remise en cause jurisprudentielle de l'immunité civile de l'employeur, - en renforçant la contestation des modalités de réparation forfaitaire des AT-MP car la mise en place du FIVA a assuré aux victimes de l'amiante, et à elles seules, une réparation intégrale. Bien que cette question relève de la négociation sociale, la mission s'est ralliée à l'accord qui s'est progressivement dégagé au cours de ses travaux en faveur d'une réparation forfaitaire « améliorée », au sein de la branche AT-MP. Elle estime, en revanche, que la mutualisation de la branche doit être réduite et qu'il faut davantage responsabiliser les employeurs. Par ailleurs, il n'est pas acceptable, à notre époque, qu'un travailleur victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle soit obligé de prouver la faute inexcusable de son employeur pour obtenir une réparation correcte. Inversement, la banalisation excessive de la faute inexcusable de l'employeur n'est pas du tout responsabilisante, même s'il est nécessaire de conserver la possibilité de poursuivre en justice un employeur véritablement fautif, pour lui demander de réparer les conséquences de ses actes. C'est pourquoi, la mission a voulu rétablir la logique du compromis de 1898 tout en le modernisant. En second lieu, le drame de l'amiante a mis en relief les lacunes du régime pénal applicable aux risques professionnels et aux risques sanitaires en général. Toutes les affaires de santé publique dont la justice pénale française a eu à connaître au cours des deux dernières décennies ont été déclenchées par l'action judiciaire des victimes, les parquets n'ayant pas fait preuve d'une grande sensibilité aux questions sanitaires. Par ailleurs, les instructions de ces affaires sont extrêmement complexes et aboutissent souvent à des non-lieux. Or, la victime n'a pas le droit de contester la clôture de l'instruction auprès de la Cour de Cassation si le parquet ne la conteste pas aussi. C'est pourquoi il faut mobiliser les parquets, donner aux victimes leur juste place dans la procédure pénale et renforcer les moyens des pôles de santé publique. Autre difficulté : le régime pénal résultant de la loi « Fauchon » de juillet 2000 n'a jamais pu s'appliquer conformément à l'intention du législateur. En effet, le premier critère d'engagement de la responsabilité - la violation « manifestement délibérée » d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement - est tellement difficile à prouver en matière de délits d'homicide ou de blessures involontaires que les juges ne l'utilisent pas. Il en résulte que le manquement à une règle, prévue dans un texte, destinée à un public particulier, et dont l'objet est spécifiquement de protéger contre un dommage, n'est pas sanctionné en tant que tel, alors qu'il a pu causer la mort ou la blessure d'autrui. Il faut, au contraire, que l'intention des pouvoirs publics de prévenir un risque spécifique produise tous ses effets, notamment en termes de sanction pénale pour ceux qui contreviennent à ces obligations et causent des dommages importants. C'est pourquoi la mission propose de modifier la loi « Fauchon » pour réaffirmer l'obligation de respecter les règles particulières de sécurité et de prudences fixées par la loi et le règlement, étant précisé que cette modification ne serait pas rétroactive. Enfin, l'histoire de l'amiante a démontré la faillite générale du système de prévention des risques professionnels, comme en témoigne la condamnation de l'État en 2004 pour ses carences dans le drame de l'amiante. L'accélération des cycles technologiques rend aujourd'hui le risque professionnel plus insidieux. Il n'est plus seulement question, au XXIème siècle, d'indemniser l'ouvrier qui chute, mais aussi de le protéger contre un produit qui peut le tuer. Le Gouvernement a d'ores et déjà choisi de relever le défi grâce au « Plan santé au travail 2005-2009 » mais les moyens ne sont pas encore à la hauteur du véritable enjeu de santé publique qu'est la santé au travail. C'est pourquoi il convient de faire de la santé au travail une priorité de santé publique. Tels sont les objectifs des 51 propositions de la mission. I.- GÉRER L'HÉRITAGE DE L'AMIANTE Améliorer la prise en charge des victimes et le suivi médical des personnes exposées 1./ Aménager les dispositifs de prise en charge des victimes de l'amiante En optimisant le fonctionnement administratif du FIVA et en augmentant la représentativité de son conseil d'administration Proposition 1 : - Remplacer au sein du conseil d'administration du FIVA, le représentant du Trésor par un représentant du ministère de la justice, diversifier la représentation des associations de victimes de l'amiante et renforcer le poids du corps intermédiaire des personnalités qualifiées. - Augmenter le nombre des juristes du FIVA pour lui permettre d'intenter un plus grand nombre de recours subrogatoires, dont l'objet est de faire reposer le plus possible la charge de l'indemnisation sur les responsables quand ils peuvent être identifiés. - Simplifier les procédures relatives aux recours subrogatoires du FIVA en supprimant l'obligation légale d'intenter des recours subrogatoires dans tous les cas, pour la limiter aux cas où le recours présente un intérêt pour la victime ou pour les finances publiques. En précisant que le champ d'application géographique du FIVA s'étend à la Nouvelle-Calédonie Proposition 2 : Modifier la loi du 23 décembre 2000 relative au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante pour en prévoir expressément son application en Nouvelle-Calédonie. En allégeant les procédures du FIVA Proposition 3 : - Supprimer pour le FIVA l'obligation de recours contentieux lorsqu'il y a lieu de verser aux victimes un complément à la réparation intégrale. - Compléter cette mesure par une amélioration du barème du FIVA. En préservant l'autonomie du FIVA Proposition 4 : Maintenir l'autonomie du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, quels que soient les résultats de la négociation sur l'avenir de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, afin de prendre en compte les victimes environnementales En simplifiant l'organisation institutionnelle du FCAATA. Proposition 5 : Supprimer l'intermédiation de la Caisse des dépôts et consignations dans l'attribution de l'ACAATA qui pourrait être servie directement par les CRAM. En assurant l'application des dispositions législatives relatives au FCAATA Proposition 6 : Publier le décret d'application prévu par la loi de finances rectificative pour 2003 et nécessaire à l'extension du FCAATA aux fonctionnaires et agents non titulaires exerçant, ou ayant exercé, certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère de la défense. En améliorant le dispositif du FCAATA pour les bas salaires, les intérimaires et les sous-traitants Proposition 7 : - Relever le montant de l'ACAATA pour les bas salaires. - Ouvrir le bénéfice du FCAATA, sous les mêmes conditions, aux travailleurs de l'amiante employés en intérim ou en sous-traitance dans des établissements figurant déjà sur les listes. En assurant la coordination entre les divers dispositifs de cessation anticipée d'activité Proposition 8 : Instaurer des mesures de réciprocité entre les différents régimes de façon à ce que chacun d'eux puisse opérer le cumul de toutes les périodes d'activité susceptibles d'ouvrir droit à une allocation de préretraite, sans considération du régime sous lequel ces périodes d'activité ont été exercées. En débloquant le système actuel des listes du FCAATA. Proposition 9 : Créer, au niveau régional, des commissions chargées de recevoir, pendant un délai d'un an, puis de les instruire, les demandes d'inscription sur les listes ouvrant droit au bénéfice du FCAATA de tout ou partie d'établissement En ouvrant, à titre permanent, pour les personnes non éligibles au système des listes, et qui ont particulièrement été exposées à l'amiante à l'occasion de leurs activités professionnelles, un nouveau mode d'accès individualisé au FCAATA Proposition 10 : Créer un mode d'accès permanent individualisé au FCAATA au profit des personnes qui ont été exposées à l'amiante à l'occasion de leur activité professionnelle et qui sont les plus susceptibles de développer des pathologies liées à l'amiante. En tenant compte, dans le financement de la réparation des dommages liés à l'amiante, des responsabilités de l'Etat Proposition 11 : - Doubler, au minimum, la participation de l'Etat aux deux fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. - Stabiliser les contributions de l'Etat en fixant un pourcentage constant du financement des fonds. 2./ Améliorer le suivi médical des personnes exposées En développant le suivi médical des personnes exposées sur la base des conclusions des expérimentations mises en œuvre dans plusieurs régions Proposition 12 : - Envoyer des courriers à des populations ciblées - Instaurer une « entrée libre » dans le dispositif de suivi - Généraliser, dans le respect d'un protocole médical, le recours au scanner thoracique - Alléger les modalités de facturation du suivi par les médecins - Prévoir un accompagnement psychologique - Instaurer un suivi pour les épouses - Assurer une traçabilité fiable des dossiers médicaux après la cessation de l'exposition En améliorant l'épidémiologie et la connaissance des maladies liées à l'amiante Proposition 13 : - S'appuyer sur les donnés épidémiologiques recueillies par le FIVA pour développer la connaissance des maladies liées à l'exposition à l'amiante. - Organiser une conférence de consensus médical sur les plaques pleurales, afin d'obtenir un état scientifique objectif des connaissances sur cette pathologie. Assurer un traitement sécurisé de l'amiante en place 1./ Améliorer la qualité de tous les acteurs de la chaîne de traitement de l'amiante en place. En premier lieu, ceux qui, par leur implication financière ou hiérarchique, conditionnent le respect des règles de sécurité. Proposition 14 : - Réformer les procédures de passation des marchés, afin que le traitement de l'amiante fasse systématiquement l'objet d'un lot spécifique. - Prévoir pour les coordinateurs « sécurité et protection de la santé » une formation sur les risques liés à l'amiante. - Créer une certification des maîtres d'œuvre, sur la base de référentiels incluant les obligations de repérage, mais aussi la capacité à évaluer les chantiers de traitement de l'amiante, friable ou non, et à éliminer convenablement les déchets. En second lieu, les opérateurs de repérage, dont dépend toute la chaîne de protection des travailleurs et des populations. Proposition 15 : Créer une certification obligatoire d'« opérateur de repérage de l'amiante », exigeant une formation améliorée, une expérience obligatoire dans les métiers du bâtiment ou du diagnostic, et le respect de pratiques professionnelles rigoureuses. Troisièmement, les entreprises traitant de l'amiante non friable, qui créent par leurs interventions mêmes une pollution inévitable. Proposition 16 : Prévoir une qualification obligatoire des entreprises traitant l'amiante lié. Le référentiel choisi doit être distinct de celui s'appliquant au traitement de l'amiante friable, car le risque est différent. Ce référentiel doit donc tenir compte d'une réelle capacité à évaluer et à prévenir les risques. Enfin, les laboratoires qui procèdent aux mesures et dont la qualité des prestations garantit la sécurité des travailleurs et des populations. Proposition 17 : Soumettre les laboratoires effectuant des mesures d'empoussièrement sur les chantiers à une procédure d'agrément similaire à celle des laboratoires intervenant pour les diagnostics. 2./ Tendre vers un meilleur respect de la réglementation par les propriétaires En les informant Proposition 18 : Concevoir et diffuser rapidement un document simple rappelant aux propriétaires leurs obligations de diagnostics et organiser une campagne d'information, par l'intermédiaire des organismes de gestion de l'habitat collectif, comme les syndics de copropriété. En les responsabilisant Proposition 19 : Renforcer les sanctions pesant sur les propriétaires ou leurs maîtres d'œuvre pour les contraindre à respecter les impératifs de sécurité dans la planification et la commande de leurs travaux immobiliers. En les accompagnant Proposition 20 : - Encourager le retrait de l'amiante en place lorsque son traitement est nécessaire plutôt que son confinement, qui multiplie les mesures de l'état de conservation et accroît donc les coûts à long terme. - Envisager une avance de fonds remboursable pour inciter les propriétaires à choisir le retrait plutôt que le confinement. Cette avance pourrait être versée par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui octroie déjà des aides financières pour les diagnostics. En mettant en place un dispositif de soutien pour les propriétaires publics Proposition 21 : - Instaurer une aide financière et technique de l'Etat à destination des collectivités territoriales pour la prise en charge des repérages et travaux liés à l'amiante, notamment dans des bâtiments construits par l'Etat. - Lancer une campagne de sensibilisation des collectivités territoriales à leurs obligations réglementaires en matière de repérage, de travaux et de gestion des déchets, comparable à celle proposée par la mission à destination des propriétaires privés. - Fixer aux collectivités territoriales un nouveau délai maximal d'accomplissement des obligations réglementaires, assorti d'une sanction. - Organiser la transmission et la centralisation des diagnostics de flocages, calorifugeages et faux plafonds et des fiches récapitulatives des DTA des collectivités territoriales, afin de contrôler le respect des obligations en la matière. 3./ Corriger les faiblesses de la réglementation En modernisant la réglementation du diagnostic amiante pour tenir compte des risques décelés depuis 1996. Proposition 22 : - Réviser la grille d'évaluation de l'état de conservation de l'amiante en place, en ajoutant des critères plus précis d'estimation du risque. - Abaisser, pour les mesures d'empoussièrement effectuées à l'avenir, le seuil réglementaire de déclenchement des travaux à 0,0005 f/ml, ce qui correspond au niveau actuel de pollution environnementale ambiante. En améliorant le « dossier technique amiante » pour le rendre plus efficace dans la prévention des risques Proposition 23 : - Compléter les obligations de repérage de matériaux contenant de l'amiante lors d'interventions de travaux et de réhabilitation, en prévoyant, par exemple, une obligation de recherche plus approfondie d'amiante (avec sondage) avant tous travaux conduits par une société extérieure. Le propriétaire serait bien sûr libre de procéder dès le DTA initial à un repérage approfondi. - Compléter le repérage visuel figurant dans le DTA par une évaluation plus précise de la dangerosité des matériaux, comme c'est le cas pour les diagnostics portant sur les flocages, calorifugeages et faux plafonds. Une meilleure formation des opérateurs de repérage leur permettra d'apprécier ce risque en fonction des situations (travaux, déplacements, nettoyages, entretien, etc.). En créant un registre centralisé des « dossiers techniques amiante » Proposition 24 : Créer un outil de centralisation et de consultation des diagnostics effectués. Ce registre centralisé des DTA, facilement accessible, serait un élément central de prévention. Une réflexion doit être engagée sur la possibilité d'exploiter à cette fin les bases de données fiscales, ou du cadastre. En comblant les lacunes de la réglementation sur le désamiantage en matière de contrôles des poussières. Proposition 25 : Préciser la réglementation sur les mesures d'empoussièrement effectuées pendant et après un chantier, notamment leurs modalités et leur fréquence, afin de réguler des pratiques actuellement très hétérogènes. 4./ Améliorer le contrôle de l'application des réglementations En matière de démolition, où le risque de pollution atmosphérique est le plus grand. Proposition 26 : Organiser la transmission aux Directions départementales de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle des permis de démolir, et y inclure l'obligation de repérage de l'amiante. Les DDTEFP devront contrôler l'établissement des plans de retrait correspondant aux repérages attestant la présence d'amiante. En matière de repérage, les obligations étant jusqu'ici incontrôlées dans ce secteur. Proposition 27 : - Demander aux syndics de copropriété de transmettre aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales les fiches récapitulatives des DTA, pour que celles-ci puissent vérifier que les obligations sont respectées. - Établir un plan de contrôle sélectif de la qualité des DTA en fonction des données transmises dans les fiches. - Sensibiliser les propriétaires sur les risques de sanction encourus si les DTA ne sont pas, ou mal, réalisés. - Mettre en place des campagnes d'intercomparaison des diagnostics - analyses comparées des méthodes des opérateurs de repérage - afin de s'assurer de la qualité et de l'homogénéité des repérages. En donnant à l'Etat les moyens d'un contrôle plus efficace. Proposition 28 : - Renforcer les effectifs de contrôle de l'inspection du travail. - Généraliser le réseau des cellules régionales opérationnelles capables d'assister techniquement les services de contrôle (CRAM et inspection du travail). - Instaurer dans le cadre du contrôle des chantiers de désamiantage une collaboration entre les organismes certificateurs et les services de l'Etat. - Sanctionner plus lourdement le défaut d'établissement de plan de retrait ou de fiche d'exposition des travailleurs, car ces manquements empêchent en pratique tout contrôle de l'application de la réglementation. 5./ Agir impérativement pour que les ouvriers de la maintenance se prémunissent contre les risques liés à l'amiante En créant un label de qualité pour les intervenants du secteur du bâtiment Proposition 29 : Créer, avec l'appui du COFRAC, un label public de qualité sur la prise en compte des risques liés à l'amiante dans les interventions du secteur du bâtiment. Ce label serait facultatif, mais sécurisant pour les propriétaires soucieux de tels risques. En prévoyant, dans les formations initiales et continues, une sensibilisation aux dangers de l'amiante Proposition 30 : - Inclure, à tous les échelons de la formation initiale, dans la filière technologique, un enseignement de sensibilisation aux risques de l'amiante. - Organiser une formation de sensibilisation, simple mais de grande envergure, à destination des travailleurs du bâtiment, sur les risques liés à l'amiante et les gestes de prévention. Le dispositif de cette formation pourrait être calqué sur celui mis en place par la CNAMTS pour le Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, afin de prendre en compte les spécificités des TPE et des PME. 6./ Améliorer la gestion des déchets En veillant à ce que la réglementation soit mieux appliquée. Proposition 31 : - Inscrire la question de l'amiante résiduel, et notamment la gestion des déchets, comme une des priorités du ministère de l'écologie et du développement durable. - Compléter la réglementation pour rendre obligatoire la mention du sort des déchets dans les plans de retrait préalables aux travaux de désamiantage. En facilitant la collecte des déchets amiantés pour éviter les éliminations sauvages et en sécurisant le transport. Proposition 32 : - Utiliser le réseau des déchetteries existantes pour mettre en place des plateformes de regroupements de déchets amiantés préalablement à leur élimination. - Engager une réflexion sur la sécurisation du transport des déchets amiantés. - Engager un dialogue constructif avec la Commission européenne pour mettre en place une réglementation facilitant l'envoi en toute sécurité des déchets amiantés vers leur lieu d'élimination. En soutenant la recherche en matière de traitement des déchets et en développant l'inertage Proposition 33 : Encourager la recherche et le développement dans le domaine des déchets amiantés, notamment pour rendre plus accessible la vitrification et demander aux pouvoirs publics qu'ils facilitent l'installation en France d'un deuxième centre d'inertage. 7./ Sortir des incertitudes sur la situation en Nouvelle-Calédonie Proposition 34 : Engager une expertise environnementale et métrologique de grande ampleur sur la pollution aux fibres d'amiante en Nouvelle-Calédonie pour mettre en place, le cas échéant, des mesures de protection appropriées. Agir au niveau international 1./ Améliorer la législation communautaire Proposition 35 : - Veiller au non renouvellement, en 2008, de la dérogation en faveur des « diaphragmes des cellules d'électrolyse existantes » servant à la production du chlore. Cette dérogation est contenue dans la directive 1999/77/CE qui interdit la mise sur le marché et l'emploi de toutes les fibres d'amiante et des produits en contenant. - Inclure, comme le souhaitent les organisations syndicales européennes, les travailleurs indépendants dans le champ de la directive 2003/18/CE sur la protection des travailleurs face aux dangers de l'amiante. - Créer, dans le droit communautaire, une obligation de repérage de l'amiante pour les bâtiments. 2./ Améliorer la pratique communautaire en matière d'élaboration des réglementations relatives à l'amiante Proposition 36 : Inviter les institutions communautaires à adopter une approche plus transversale des questions soulevées par l'amiante en Europe. 3./ Moraliser le comportement des entreprises européennes Proposition 37 : Empêcher les entreprises européennes d'exporter vers les pays tiers des pratiques désormais interdites dans l'Union européenne. 4./ Créer une filière de démantèlement des navires Proposition 38 : Développer une filière technologique française de démantèlement des navires en fin de vie. 5./ Agir pour interdire l'amiante dans le monde entier Proposition 39 : - Adopter une convention internationale d'interdiction mondiale de l'amiante. - Impliquer l'Assemblée nationale française dans le processus d'interdiction de toutes les formes d'amiante dans le monde : - en promouvant l'interdiction totale de l'amiante lors des rencontres avec les parlementaires d'Etats producteurs ou importateurs. - en organisant, à l'Assemblée nationale, un colloque international sur l'interdiction mondiale de l'amiante. II - TIRER LES LECONS DE L'AMIANTE Adapter le régime de réparation des AT-MP 1./ Faire évoluer le régime de la branche AT-MP En liant la tarification à l'effort de prévention. Proposition 40 : Insister auprès des partenaires sociaux pour que, dans le cadre des négociations sur la réforme de la tarification au sein de la branche AT-MP, ils s'engagent à réactiver un système de modulation des cotisations des employeurs en fonction de leurs efforts de prévention. En évitant qu'en cas de condamnation pour faute d'une particulière gravité, les employeurs puissent s'abriter derrière des arguments de procédure pour échapper à leur responsabilité financière. Proposition 41 : Poursuivre la sécurisation des procédures en matière de maladies professionnelles afin d'éviter les cas de non imputabilité sur les employeurs de la charge financière de la faute d'une particulière gravité. 2./ Rétablir la logique du compromis de 1898 tout en le modernisant Proposition 42 : - Réaffirmer le principe général d'une indemnisation non contentieuse des accidents du travail et maladies professionnelles, et revenir à une immunité civile de principe pour les employeurs, afin de restaurer les avantages du compromis de 1898. - Redéfinir, en lieu et place de la « faute inexcusable » dans le droit de la sécurité sociale, une « faute d'une particulière gravité », dont l'employeur serait justiciable devant les tribunaux, et qui entraînerait une sanction financière complémentaire de la réparation en faveur de la branche AT-MP, afin de conserver la possibilité de poursuivre les employeurs vraiment fautifs. - Renforcer l'obligation faite aux caisses de sécurité sociale de responsabiliser, par la modulation de la cotisation ou la recherche de la sanction individuelle, les établissements générateurs d'accidents ou de maladies professionnels, afin de corriger les effets déresponsabilisants de la mutualisation. Préciser le régime pénal applicable aux risques professionnels 1./ Mobiliser les parquets et donner aux victimes leur juste place dans la procédure pénale En renforçant le rôle et les moyens des pôles de santé publique Proposition 43 : - Placer les affaires de santé publique au cœur des priorités des parquets et prévoir que les pôles santé de Paris et Marseille puissent s'en saisir de façon plus rapide et plus souple ; - Renforcer les moyens des pôles pour permettre aux magistrats de disposer d'enquêteurs spécialisés en nombre suffisant ; En révisant l'article 575 du code de procédure pénale afin d'améliorer le rôle accordé aux parties civiles dans la procédure pénale. Proposition 44 : Réviser l'article 575 du code de procédure pénale pour permettre aux parties civiles de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction, afin d'assurer un contrôle sur les règles de l'instruction et le droit applicable aux affaires de santé liées au travail. 2./ Réviser le régime applicable à l'auteur indirect d'un délit non intentionnel d'imprudence. Proposition 45 : Dans l'avant dernier alinéa de l'article 121-3 du code pénal, supprimer les mots : « de façon manifestement délibérée » afin que la violation, en soi, d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement suffise à engager la responsabilité de l'auteur indirect du dommage. Faire de la santé au travail une priorité de santé publique 1./ Développer la recherche en santé au travail, en toxicologie et en épidémiologie Proposition 46 : - Créer des postes de chercheurs en santé au travail, en toxicologie et en épidémiologie pour structurer et développer la recherche publique en santé et sécurité au travail, conformément aux objectifs du Plan santé au travail. - Sensibiliser les jeunes chercheurs aux priorités de la santé publique par un programme de recherche spécifique et des appels à projets. - Revaloriser les spécialités touchant à la santé au travail dans le cadre de la formation médicale pour accroître les capacités d'expertise. 2./ Se doter d'une expertise indépendante et comparable à celle de nos voisins européens Proposition 47 : - Unifier l'expertise des risques professionnels sous la tutelle de l'AFSSET et regrouper les équipes de recherche en son sein pour faire de l'AFSSET l'équivalent des grandes agences européennes, et la doter d'une capacité d'expertise propre comparable à celle des pays voisins de la France ; OU - À défaut, doter l'AFSSET des instruments juridiques lui permettant, conformément à sa mission de « tête de réseau », de faire valoir ses priorités et la cohérence de son action auprès des différents organismes d'expertise des risques professionnels. 3./ Doter l'Etat d'un véritable réseau de veille et d'alerte sanitaires Proposition 48 : - Créer un service public de santé au travail, regroupant les médecins du travail et doter ces médecins d'un statut public garantissant leur autonomie, le financement de ce nouveau service public étant assuré par l'Etat et les employeurs. - Charger ce service public d'une mission de veille et d'alerte sanitaires sous la tutelle de l'IVS et d'une mission d'accompagnement des entreprises dans le respect de leurs obligations nouvelles, sous la tutelle de la Direction des relations du travail. - Engager une réflexion sur la possibilité de confier la visite médicale obligatoire et la délivrance de certificats d'aptitudes à la médecine de ville, qui pourrait s'appuyer sur les documents d'évaluation des risques professionnels et du poste de travail, établis par le service public de santé au travail, pour moduler la fréquence de la consultation et prescrire les examens nécessaires. - Instaurer une contribution des employeurs destinée à financer en partie le service public de santé au travail, ainsi que les dépenses nouvelles de la branche AT-MP qui prendrait en charge les visites obligatoires, si celles-ci étaient confiées à la médecine de ville. 4./ Promouvoir l'évaluation préalable des risques en entreprise Proposition 49 : - Demander au nouveau service public de santé au travail d'assister les entreprises dans la réalisation du document unique, qui est une priorité ; cet accompagnement doit être orienté avant tout vers les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises. - Demander à ce service public de collecter les données de ces documents et de les transmettre à l'IVS. - Faire établir par l'IVS le cahier des charges minimal du document unique, afin de constituer une base de données des risques professionnels. 5./ Exercer un contrôle plus efficace sur les règles protégeant la santé au travail Proposition 50 : - Former dans chaque section de l'inspection du travail des agents spécialisés en santé au travail. - Chercher à libérer l'inspection du travail de ses fonctions administratives les moins spécifiques. - Combler le retard français en matière d'effectifs de l'inspection du travail, par rapport à la moyenne européenne. - Créer de nouveaux outils juridiques permettant à l'inspection du travail de faire cesser plus facilement les infractions mettant en jeu la santé des travailleurs. --____-- Proposition 51 : Organiser une campagne nationale d'information de la population sur l'amiante, les risques qui y sont liés et les moyens de les éviter. * * * La mission a examiné le présent rapport au cours de sa séance du mercredi 22 février 2006 et l'a adopté. Elle a ensuite décidé qu'il serait remis à M. le Président de l'Assemblée nationale afin d'être imprimé et distribué, conformément aux dispositions de l'article 143 du Règlement de l'Assemblée nationale. * * * CONTRIBUTION DE MM. DANIEL PAUL ET MAXIME GREMETZ Comment a-t-on pu en arriver là ? Pourquoi a-t-il fallu attendre 1997 pour que notre pays interdise l'importation et l'utilisation de l'amiante ? Pourquoi aucun réseau n'a-t-il alerté les autorités publiques sur l'ampleur de la catastrophe, alors que la dangerosité du produit était connue ? Pourquoi la Communauté Européenne n'a-t-elle pas interdit l'amiante avant le 1er janvier 2005 ? Pourquoi seulement 37 pays - dont les 25 de la CE - ont-ils prononcé cette interdiction, ce qui permet aux groupes industriels mondiaux de jouer de ces différences ? Pourquoi tant de difficulté pour obtenir une juste indemnisation ? Pourquoi le procès de l'amiante est-il toujours refusé aux victimes ? Pourquoi la misère des outils de santé publique, avec l'insuffisance scandaleuse de médecins et d'inspecteurs du travail ? Pourquoi .... Toutes ces questions, et bien d'autres, justifiaient la création, par l'Assemblée Nationale, d'une véritable « commission d'enquête » sur l'amiante. On sait la réponse reçue... Dans le cadre qui lui était imparti, le travail de la « Mission d'information » a répondu à plusieurs questions et éclairé des aspects nouveaux. Pour autant, certains points soulèvent problème. - :- :- :- :- 1- Ainsi, on ne peut accepter l'idée qui traverse la première partie du rapport, que l'utilisation de l'amiante aurait fait l'objet d'une sorte de « consensus collectif », que l'Etat, le Patronat, les représentants des salariés, les scientifiques partageraient, finalement, une même responsabilité. Car, qui avait - et a toujours - la responsabilité d'attribuer les moyens suffisants à la recherche scientifique, à l'utilisation de tous les éléments qui, à travers le monde, permettaient de tirer la sonnette d'alarme, sinon l'Etat ? Qui aurait dû instaurer, à partir de ces connaissances, des règles strictes, interdire les produits dangereux, imposer et contrôler la mise en place de mesures de protection pour les salariés et les populations environnantes, sinon l'Etat ? Qui a, depuis plus d'un siècle, la responsabilité de mettre en œuvre les mesures assurant la sécurité au travail, sinon le chef d'entreprise ? L'obligation de « dépoussiérer les lieux de travail » n'est-elle pas inscrite dans les textes depuis la fin du 19ème siècle ? Faut-il rappeler que dans le cadre de la mise en œuvre de la directive européenne du 12 juin 1989 (loi du 31 décembre 1991), tous les employeurs sont tenus de réaliser l'évaluation des risques et facteurs de risques professionnels ? Et quand le MEDEF, lors de la table ronde du 28 septembre 2005, indique que, sans risque, il n'y pas de création de richesses, n'est-on pas toujours dans la même logique que celle qui a prévalu tout au long du 20ème siècle ? Ainsi une logique patronale a pu perdurer et s'imposer, tant l'Etat n'a pas su et/ou pas voulu prendre les décisions en termes d'orientations et en termes de moyens, afin d'améliorer la protection des salariés, d'où sa condamnation, en 2004, dans l'affaire de l'amiante. Il n'est pas juste de mettre à égalité les uns et les autres et de faire porter aux salariés la moindre responsabilité dans cette affaire ! 2- D'autant que l'histoire n'est pas finie ! Car cet amalgame entretenu permet au MEDEF de tenter de peser pour accentuer un transfert vers la branche maladie de la Sécurité sociale, c'est-à-dire la solidarité nationale, de ce qui relève de la branche « Accidents du travail - maladies professionnelles », et ainsi de faire oublier que cette cotisation « AT-MP » n'est rien d'autre qu'un salaire différé. Cette volonté permanente procède bien de l'idée que les risques au travail, comme les responsabilités, malgré toutes les avancées obtenues, seraient à partager, par les salariés concernés, mais plus largement par la société tout entière ! Dès lors, la réparation intégrale souhaitée par toutes les victimes est ignorée, 15 milliards d'euros sont transférés de la branche « AT-MP » vers le régime général, MEDEF et Etat s'accompagnant à chaque vote du budget de la Sécurité Sociale, dans ce détournement de responsabilité et de cotisations. Si on peut soutenir l'idée d'un doublement « au minimum » de la participation de l'Etat aux fonds d'indemnisation des victimes, cela ne vaut que si, parallèlement, est exigé et obtenu le respect de la pleine responsabilisation des entreprises dans la prise en charge de la branche AT-MP, sauf à accélérer le transfert de charges. 3- Le rapport évoque à diverses reprises le plan « Santé au travail » qui couvre la période 2005-2009. Or, comment ignorer les limites de ce plan ? Qu'il s'agisse du non respect par l'Etat-employeur et des collectivités locales des règles relatives aux risques et donc à la prévention, ou qu'il s'agisse des moyens nécessaires au corps de l'Inspection du travail pour exercer ses missions, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce plan n'assure ni la volonté, ni les moyens de faire face aux enjeux ! Ainsi, il faudrait une augmentation forte des moyens de l'Inspection du Travail et la pleine reconnaissance de son autorité, par les chefs d'entreprises, mais aussi par l'autorité publique elle-même. Or, au rythme actuel, il faudra plus de 30 ans pour atteindre les effectifs jugés nécessaires aujourd'hui : le rattrapage doit être accéléré pour être visible, efficace et l'indépendance des Inspecteurs du Travail, donc l'arrêt des désaveux par le ministre de leurs décisions, témoignerait de la volonté de l'Etat de tirer enfin les leçons du passé. Dès lors, comment dire que l'Etat doit « renforcer les effectifs de contrôle de l'inspection du travail », alors que le plan « santé au travail », pour 2005-2009, prévoit seulement l'affectation de 30 postes aux services déconcentrés, (18 postes d'ingénieurs et 12 postes d'inspecteurs). 4- Il faut aussi insister sur les conséquences à tirer de la faillite de l'Etat. A juste titre, le rapport rappelle que la santé au travail est partie prenante de la santé publique. On peut, certes, soutenir l'idée de créer un service public de santé au travail, sous la tutelle de l'IVS, mais quelle assurance cela donne-t-il de son indépendance ? Quelle certitude cela apporte-t-il que les moyens suivront, avec la mise en place d'un plan pluriannuel de créations de postes et d'attribution des ressources budgétaires ? Comment ne pas être sceptique devant les conséquences, visibles, du dogme de la réduction de la dépense publique ? 5- Les débats autour du programme REACH ont mis en évidence l'existence de milliers de produits susceptibles d'affecter la santé de leurs utilisateurs, dont les travailleurs figurent au 1er rang. Or, l'affaire de l'amiante nous interdit dorénavant de laisser les intérêts économiques prendre le pas sur la logique de santé publique : dans la gestion du risque chimique, le principe devrait être « pas de données, pas de marché ». Quelles conséquences tirer aussi du développement des nanomatériaux, dont certains se substitueraient à l'amiante, alors que l'on commence à peine à percevoir certaines nuisances ? Comment prétendre que la recherche sera développée dans ces domaines, quand on voit, année après année, la misère du budget consacré à la recherche ? 6- Sans nul doute, nous aurons à gérer, pendant de longues années, le problème de l'amiante captive. La question est donc bien de connaître son existence et d'alerter sur les précautions à prendre en cas, par exemple, de travaux sur les locaux. C'est tout l'enjeu du diagnostic amiante et des travaux de désamiantage. Les auditions ont bien montré l'insuffisance de la réglementation dans ces domaines : 2 entreprises sur 3 ne sont pas aux normes, ne disposent pas des compétences humaines et techniques nécessaires. ! S'il est bien que le traitement de l'amiante fasse systématiquement l'objet d'un lot spécifique dans les procédures de passation des marchés, il convient que les entreprises autorisées à « candidater » pour les opérations de diagnostic amiante et de désamiantage soient obligatoirement agréées par les services de l'Etat, au niveau de chaque préfecture. 7- La question du devenir des déchets demeure, qu'il s'agisse de l'amiante non friable qui ne peut être mis en décharge de classe 3 ou de l'amiante lié que la circulaire du 24 février 2005 considère comme de l'amiante inerte ! Comment laisser perdurer le fait que notre pays n'ait qu'un seul lieu où pratiquer l'inertage. Si les conséquences de l'utilisation de l'amiante pèsent sur les questions de santé publique, sa destruction doit donc interpeller l'autorité publique. L'aménagement d'un second centre d'inertage, au nord de la Loire, est une nécessité publique qui ne saurait être laissée à l'appréciation de critères de rentabilité, si l'on veut que l'obstacle de la distance et donc du coût du transport, soit levé. Il convient aussi de répondre aux questions soulevées par l'existence de terres amiantifères, qu'elles concernent des terrains qui ont reçu des entreprises travaillant l'amiante ou des terrains qui ont produit de l'amiante ! Si les friches industrielles ont été retirées, que fait-on du terrain ? Ne serait-il pas sage d'étendre la réglementation « amiante » à l'utilisation de ces terres ? 8- Le rapport retient l'idée de relever le montant de l'ACAATA pour les bas salaires ! D'accord, mais soyons clairs : l'ACAATA minimum ne saurait être inférieure au SMIC. 9- Or, c'est dans ce contexte que se développe la précarité, dans l'ensemble des entreprises, y compris celles qui sont les plus exposées aux risques. Tout indique que les salariés précaires, les travailleurs intérimaires, les sous-traitants sont plus victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles que les autres : il est bien que l'indemnisation leur soit due, mais cela devrait justifier la surveillance et la pénalisation des entreprises abusant du travail précaire, un rôle accru des CHS-CT et le développement des droits des salariés dans leurs entreprises. Au bénéfice de ces observations, les députés communistes et républicains s'abstiendront sur ce rapport. Liste des propositions de Mr Daniel PAUL et de Mr Maxime GREMETZ et du groupe des députés communistes et républicains. En matière de prévention : 1. Renforcer les moyens financiers et humains de l'IVS, notamment de son département « santé au travail » ; 2. Créer au moins 70 postes de toxicologues ; 3. Garantir l'indépendance et l'expertise de l'AFSSET dans ses missions de sécurité et prévention en santé au travail ; 4. Revoir l'organisation de la médecine au travail en dotant les médecins d'un statut réellement indépendant ; 5. Orienter la méthode de travail des médecins du travail vers une vraie logique de santé, en changeant de paradigme concernant l'aptitude (de la visite médicale à l'entretien médico-professionnel annuel) ; 6. Création sur 5 ans, de 700 postes d'inspecteurs du travail ; 7. Utiliser un volet de la carte vitale pour connaître les risques, permettre la traçabilité des expositions aux produits, assurer la surveillance professionnelle des salariés ; 8. Définir un protocole rigoureux de suivi des salariés atteints de maladies professionnelles de l'amiante, présentées comme bénignes ; 9. Mettre en place des systèmes formalisés d'information et de recherche active des salariés, retraités exposés professionnellement à l'amiante, afin qu'ils puissent bénéficier, à leur demande, d'un suivi post-professionnel ; 10. Droit au scanner pour les anciens travailleurs de l'amiante, selon les recommandations de la conférence de consensus de 1999 ; 11. Sanctionner pénalement et/ou par une sur-cotisation à la caisse AT-MP, le non respect par l'employeur d'établir l'attestation d'exposition aux risques ; 12. Donner à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles une dimension préventive en l'individualisant davantage et en raccourcissant la durée de répercussion des évènements ; 13. Augmenter la structure du budget de la branche AT-MP consacré à la prévention pour notamment dynamiser les contrats d'objectifs ; 14. Sanctionner les employeurs contournant la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles par une sur-cotisation AT-MP ; LA REPARATION DES VICTIMES : 15. améliorer le fonctionnement de l'ACAATA pour que tous les travailleurs (du privé, du public, les intérimaires, les sous-traitants,...) exposés à l'amiante puissent bénéficier du fonds ; 16. confier les décisions de classement des établissements sur la liste ouvrant droit au versement de l'ACAATA à une commission indépendante au niveau de chaque région ; 17. fixer un plancher de l'ACAATA au moins égal au SMIC brut ; 18. relever à 75% du salaire de référence le montant de l'ACAATA et calculer cette allocation sur la base des 12 meilleurs mois de salaire de l'ensemble de la carrière professionnelle du demandeur ; 19. déplafonner la contribution au FCAATA des entreprises ayant exposé leurs salariés à l'amiante ; 20. Autoriser les victimes de l'amiante à intenter des recours en reconnaissance de la faute inexcusable, même lorsqu'elles ont accepté les offres d'indemnisation du FIVA ; 21. Donner au FIVA les moyens humains et financiers pour engager des actions récursoires contre les employeurs ; 22. Augmenter les barèmes d'indemnisation pour une réparation intégrale des préjudices ; 23. Réintégrer les 2 dispositifs spécifiques aux victimes de l'amiante dans la branche AT-MP et baser l'ensemble du système de réparation sur la réparation intégrale du préjudice subi ; RESPONSABILITE PENALE : 24. réviser la Loi Fauchon en liaison avec l'ensemble des acteurs ; 25. injonctions du Garde des Sceaux aux parquets leur enjoignant d'engager des poursuites à l'encontre des responsables identifiés ; PROTECTION CONTRE L'AMIANTE RESIDUEL ET LES AUTRES PRODUITS DANGEREUX : 26. vérifier l'effectivité de la déclaration de reconnaissance de l'amiante dans les bâtiments et l'accessibilité de cette information au public ; 27. soumettre les propriétaires privés à l'obligation d'informer leurs locataires sur les résultats du DTA ; 28. désigner l'administration chargée du contrôle du respect de l'obligation du DTA ; 29. garantir la qualification des entreprises chargées du diagnostic amiante et des opérations de désamiantage par l'établissement d'une liste des entreprises certifiées et agréées au niveau préfectoral, accessible à tous ; 30. élargir la possibilité pour l'inspection du travail d'arrêter des travaux présentant un risque pour les salariés en cas de travaux entrepris sans recherche préalable d'amiante et de travaux d'entretien, de maintenance sans protection ; 31. limiter en temps et à 2 le nombre de vacations en zone de désamiantage, avec maintien intégral du salaire ; 32. sécuriser le transport et le suivi des déchets en rendant obligatoire la délivrance d'une attestation de réception remise au donneur d'ordre ; 33. interdire le stockage en installation de classe 3 des déchets d'amiante non friable, étendre aux terres amiantifères la réglementation amiante 34. réexaminer la décision de traiter l'amiante lié comme de l'amiante inerte; 35. valoriser le vitrifiat et agir pour l'installation d'un second site au nord de la Loire ; 36. lutter contre toute importation de produits manufacturés contenant de l'amiante ; 37. application stricte du principe de précaution pour l'utilisation des fibres de substitution à l'amiante, pour les éthers de glycol, les produits chimiques toxiques et les nanomatériaux; 38. application du principe « pas de données, pas de marché » dans la gestion du risque chimique ; 39. exclure la santé au travail du champ des accords dérogatoires ; 40. développer une filière industrielle française de désamiantage et de déconstruction des navires en fin de vie. CONTRIBUTION DE M. ROLAND CHASSAIN Pour faire suite au rapport présenté ce matin relatif à l'amiante, je remercie le Président et le Rapporteur, ainsi que les services de l'Assemblée Nationale pour le travail réalisé. 1906 : Première publication de l'inspecteur du travail, Denis Auribaut. Cela fait 100 ans que l'on connaissait les méfaits de l'amiante. C'est pour cela que je ne retiendrai dans ce rapport que les mesures nécessaires pour faire oublier les erreurs du passé. Ce rapport interpelle tous les citoyens et donne des pistes très intéressantes pour stopper les ravages causés par l'amiante. Cela va dans le sens du principe de précaution pour une meilleure prévention, mais aussi pour une meilleure communication auprès des citoyens. CONTRIBUTION DE M. JEAN-PIERRE DECOOL, DÉPUTÉ « La plus grande catastrophe sanitaire que la France ait jamais connu n'a toujours pas de responsable. Des instructions judiciaires sont en panne depuis 10 ans. Des magistrats spécialisés manquent de moyens suffisants pour instruire ». Telles sont les observations de l'ANDEVA suite au procès pénal de Dunkerque. 7 ans de procédure, 7 ans de mobilisation, 7 ans de douleurs pour les victimes et leurs familles pour aboutir à un non-lieu du Tribunal de Dunkerque, confirmé par la Cour d'Appel de Douai et dont le pourvoi en cassation a été rejeté. En février 1997, quatre victimes et l'ARDEVA du Nord ont porté plainte contre des entreprises industrielles de l'agglomération dunkerquoise. Le 16 décembre 2004, la justice rend une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre d'instruction de la Cour d'Appel de Douai. La mobilisation a été exemplaire et bouleversante. Plus de deux cents veuves ont régulièrement manifesté devant le Tribunal de Dunkerque afin d'alerter autorité judiciaire, pouvoir politique et médias. Les témoignages de ces femmes qui ont supporté la maladie de leurs maris étaient émouvants et ont permis de rendre publics l'enjeu et les conséquences d'une loi votée en juillet 2000 dite loi « Fauchon ». Drame sanitaire car il ne faut pas cesser de rappeler que chaque année près de 3000 personnes décèdent des conséquences d'une exposition à l'amiante. Les conséquences de la loi sur les délits non intentionnels avaient été largement dénoncées à l'époque du vote par les associations de victimes et autres comités en matière de prévention et de santé publique. Ainsi, pour mettre en examen un responsable indirect d'une catastrophe, il faut prouver que celui-ci à soit « violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » soit « commis une faute caractérisée et qui exposait à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer » (article 1221-3 du Code Pénal). Comme le note l'ANDEVA, cette alternative ouvre la possibilité de mettre en examen un responsable indirect mais il ne faut pas omettre le pouvoir souverain d'appréciation des magistrats. Sur ce point, les associations demandent également plus de moyens aux juges pour instruire les dossiers. Il serait également intéressant de réfléchir à la possibilité de mettre en place des magistrats spécialisés sur les questions sanitaires. Les réflexions actuelles en matière de réforme de la justice doivent mettre en lumière ce point. J'estime donc qu'il faut réviser cette loi afin de permettre des procès rapides, instruits et prenant en compte la faute directe des responsables. Les familles attendent de nous une réforme juste et pragmatique. En outre, je souhaite que la question de la sous-traitance et de l'intérim soit abordée de manière claire. En effet, les établissements reconnus sur la liste des usines ouvrant droit à la cessation anticipée d'activité et à l'indemnisation accueillent souvent des intérimaires pour effectuer des prestations de maintenance. Or, les entreprises sous-traitantes ne peuvent prétendre à ces dispositifs de reconnaissance et d'indemnisation. Il est donc urgent de prendre en compte la situation des employés de ces entreprises au même titre que leurs collègues employés directement par les entreprises reconnues. ACAATA Allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ADEME Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ADEVA Association départementale des victimes de l'amiante AFNOR Association française de normalisation AFSSA Agence française de sécurité sanitaire des aliments AFSSE Agence française de sécurité sanitaire environnementale AFSSET Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ALERT Association pour l'étude des risques au travail ANACT Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ANDEVA Association nationale de défense des victimes de l'amiante ANDRA Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ANR Agence nationale de la recherche ANRU Agence nationale de la rénovation urbaine AP-HP Assistance publique - Hôpitaux de Paris APL Aide personnalisée au logement ARACT Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail ARDEVA Association régionale de défense des victimes de l'amiante AT-MP Accidents du travail - maladies professionnelles AVAQ Association des victimes de l'amiante du Québec BERPC Bureau d'évaluation des risques des produits et agents chimiques BIT Bureau international du travail BPCO Broncho-pneumopathie chronique obstructive BRDP Brigade de répression de la délinquance contre la personne BRGM Bureau de recherche géologique et minière BSDA Bordereau de suivi de déchets amiantés BTP Bâtiment et travaux publics CACES Certificat d'aptitude à conduire en sécurité CANAM Caisse d'assurance maladie des professions indépendantes CAPEB Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment CAPER Comité amiante prévenir et réparer CATMP Commission accidents du travail et maladies professionnelles CCMSA Caisses centrales de la mutualité sociale agricole CEA Commissariat à l'énergie atomique CEC Contrat emploi consolidé CERPAT Centre d'études et de recherche pour la prévention des accidents du travail CES Confédération européenne des syndicats CGPC Conseil général des ponts et chaussées CGSS Caisses générales de sécurité sociale CHSCT Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail CHU Centre hospitalier universitaire CIRC Centre international de recherche sur le cancer CIVI Commission d'indemnisation des victimes d'infractions CJCE Cour de justice des communautés européennes CMI Certificat médical initial CMR Cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction CMU Couverture maladie universelle CNAMTS Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés CNAV Caisse nationale d'assurance vieillesse CNEVA Centre national d'études vétérinaires et alimentaires CNPP Centre national de prévention et de protection CNRS Centre national de recherche scientifique COFRAC Comité français d'accréditation COG Convention d'objectif et de gestion COV Composés organiques volatiles CPA Comité permanent amiante CPAM Caisse primaire d'assurance maladie CRAM Caisse régionale d'assurance maladie CRAMIF Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France CRRMP Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles CSHPF Conseil supérieur d'hygiène publique de France CSPRP Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels CSTB Centre scientifique et technique du bâtiment CU Communauté urbaine DADS Déclaration annuelle des données sociales DARES Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement DCN Direction des chantiers navals DDASS Direction départementale de l'action sanitaire et sociale DDE Direction départementale de l'équipement DGCCRF Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes DGS Direction générale de la santé DGUHC Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction DNID Direction nationale des interventions domaniales DPPR Direction de la prévention des pollutions et des risques DRASS Direction régionale de l'action sanitaire et sociale DRIRE Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement DRP Direction des risques professionnels DRT Direction des relations du travail DTA Dossier technique amiante EFR Épreuves fonctionnelles respiratoires EPI Équipement de protection individuelle EPST Établissement public à caractère scientifique et technologique ESB Encéphalopathie spongiforme bovine ESPRI Épidémiologie et surveillance des professions indépendantes ESTP École spéciale des travaux publics FCAATA Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante FFSA Fédération française des sociétés d'assurance FGA Fonds de garantie automobile FGAO Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages FGTI Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions FIDH Fédération internationale des droits de l'homme FITH Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles FIVA Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante FNASS Fonds national d'action sanitaire et sociale FNATH Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés FNSEA Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles GIE Groupement d'intérêt économique GIP Groupement d'intérêt public HPA Hydrocarbures polycycliques aromatiques IGAS Inspection générale des affaires sociales IGF Inspection générale des finances IGH Immeubles de grande hauteur INERIS Institut national de l'environnement industriel et des risques INRS Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles INS Institut national de sécurité INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale INTEFP Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle IPP Incapacité partielle permanente IRD Institut de recherche pour le développement IRSN Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire IRSST Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail ITGA Institut technique des gaz et de l'air IVS Institut de veille sanitaire LASEM Laboratoire d'analyse et de surveillance des particules inhalées de la marine LEPI Laboratoire d'étude des particules inhalées, de la ville de Paris LFSS Loi de financement de la sécurité sociale LOLF Loi organique relative aux lois de finances MASD Mission d'animation des services déconcentrés MIRTMO Médecins/inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'œuvre OCDE Organisation de coopération et de développement économiques OCLAESP Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique OFDT Observatoire français des drogues et des toxicomanies OIT Organisation internationale du travail OMC Organisation mondiale du commerce OMI Organisation maritime internationale OMS Organisation mondiale de la santé ONAPT Observatoire national de l'asthme professionnel ONIAM Office national d'indemnisation des accidents médicaux OPECST Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques OPPBTP Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics PLFSS Projet de loi de financement de la sécurité sociale PMSI Programme de médicalisation des systèmes d'information PNSE Plan national santé environnement PNSM Programme national de surveillance des mésothéliomes PRAPE Prévention des risques liés à l'activité physique et ergonomie PRP Préretraite progressive PRST Plan régional de santé au travail PST Plan santé au travail PUPH Professeurs des universités/praticiens hospitaliers REACH « Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals » RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheit en Milieu RNVPP Réseau national de vigilance des pathologies professionnelles SCOP Surveiller les cancers d'origine professionnelle SGDG Sans garantie du Gouvernement SME Système de management environnemental SNA Société nationale de l'amiante SNA Sous-marins nucléaires d'attaque SNLE Sous-marins nucléaires lanceurs d'engins SPIRALE Suivi post-professionnel individuel des travailleurs exposés SSF Service de soutien de la flotte SST Santé et sécurité au travail SYRTA Syndicat de retrait et de traitement de l'amiante et des autres polluants TASS Tribunal des affaires de sécurité sociale TDM Tomodensitométriques TGAP Taxe générale sur les activités polluantes TGI Tribunal de grande instance TMS Troubles musculo-squelettiques UIMM Union des industries et métiers de la métallurgie VLE Valeur limite d'exposition ZAC Zone d'aménagement concerté ANNEXES ANNEXE N° 1 Témoignage des victimes de l'amiante M. André MOYAUX J'ai fait mes débuts en 1956 au « broyeur » de l'usine. Ma tâche consistait essentiellement à vider et à écraser des sacs d'amiante à mains nues, sans outils particuliers. Lorsque la machine tombait en panne, il fallait que je rentre à l'intérieur, dans un nuage de poussière, pour le nettoyer et faire en sorte qu'il fonctionne à nouveau. J'ai donc travaillé dans la poussière d'amiante pendant quatre années, avant de devenir cadre au service commercial. Là, j'étais plus particulièrement en charge de démonstrations sur les chantiers, toujours au contact de l'amiante, puisque je devais, avec une tronçonneuse ou une perceuse, travailler par exemple sur des toitures pour montrer leur résistance. Au contact permanent de l'amiante de 1956 à 1960 au broyeur de l'usine, puis de 1960 à 1990 comme démonstrateur sur les chantiers, je n'ai été réellement prévenu de ses dangers qu'en 1985. Et encore, les mises en garde qui nous ont été formulées consistaient à nous demander de mettre un masque. Cette protection n'était absolument pas adaptée, surtout en cas de forte chaleur, et ne nous empêchait pas d'avaler de la poussière d'amiante. Comme démonstrateur sur les chantiers, j'ai été amené à voyager énormément, et c'est dans ce cadre que j'ai commencé à entendre des bruits sur les dangers potentiels de l'amiante ; les gens parlaient beaucoup plus librement qu'à l'usine. Mais officiellement, je n'ai été vraiment alerté qu'en 1985, et encore, on m'a alors prévenu que l'amiante pouvait être dangereux, mais on ne m'a jamais dit qu'il pouvait être mortel. Un de mes pires souvenirs de cette période a été de voir un contremaître manger de l'amiante pour prouver aux ouvriers qu'il n'était pas si dangereux qu'on commençait à le dire. Depuis, cet homme est lui aussi mort de l'amiante. M. Auguste SOUFFLET J'ai travaillé pour l'usine ETERNIT de 1956 à 1996. J'étais plus particulièrement préposé au broyeur, et mon travail consistait à y vider des sacs d'amiante. Le problème est que le broyeur calait souvent, et que pour ne pas trop ralentir la manœuvre, il fallait alors rentrer à l'intérieur pour dégager la meule et la nettoyer. Je me souviens avoir été aveuglé par la poussière en y rentrant, et surtout en être sorti blanc comme neige de la tête aux pieds. Pendant toute cette période, je n'ai jamais vraiment alerté sur les conséquences de cette situation. Toute personne qui commençait à se plaindre, à poser des questions, à tenter de s'informer, risquait d'être déplacée de secteur de travail, et pouvait perdre de l'argent. On ne risquait pas d'être licencié, mais déplacé, avec un salaire diminué. Lorsque j'ai fait ma déclaration de maladie professionnelle, j'ai été convoqué par la direction et licencié. Pour être honnête, je dois dire qu'en 1995 nous disposions de masques et de combinaisons. Mais le stock de masques était souvent en rupture, et il était d'un point de vue pratique impossible de travailler avec les combinaisons : il faisait trop chaud et il était quasiment impossible de se baisser et de marcher. J'ai plusieurs souvenirs d'ingénieurs qui n'hésitaient pas eux aussi à rentrer dans le broyeur, ce qui me fait dire qu'ils n'avaient pas eux non plus été alertés sur les dangers de l'amiante. Par contre, je me souviens parfaitement d'une médecin du travail arrivée à ETERNIT en 1984. Elle a commencé à s'inquiéter de radios anormales avant de s'apercevoir que de nombreux salariés avaient des problèmes aux poumons. Jusque là, nos clichés radiologiques réalisés dans le cadre de l'usine étaient systématiquement bons...mais nous n'en avions jamais de copies. Cette médecin a été remerciée par la direction. M. Jean-Louis NOWAK J'ai été salarié de l'usine ETERNIT de 1961 à 1999, comme électricien au service entretien. Mon travail consistait à me déplacer dans l'usine pour remplacer par exemple des éclairages défectueux. Le samedi, généralement, j'étais chargé de changer les lampes dans la chambre d'amiante, qui avait fonctionné toute la semaine. Je devais y entrer sans protection, de toutes façons il aurait été impossible de travailler avec un masque et des lunettes dans ce nuage de poussière. Seuls les ouvriers parlaient entre eux de l'amiante, parfois certains contremaîtres parlaient plus librement que d'autres de ses dangers. Mais il n'y a jamais eu à ma connaissance de mise en garde de la direction à ce sujet. M. Jacques DELGRANGE J'ai été employé par l'usine ETERNIT de 1973 à 1999, d'abord comme cariste à la fabrication de 1973 à 1987, puis à la réception des matières premières de 1987 à 1999. Dans cette seconde période, mon travail était de décharger les sacs pleins de poussière d'amiante avec un chariot élévateur. Lors des visites importantes d'entrepreneurs, d'industriels ou d'écoles, j'avais pour consigne de tout nettoyer pour faire disparaître les traces de poussière. On me disait qu'une usine propre était une usine sans danger. Mais en temps normal, les sacs crevaient régulièrement et il fallait alors récupérer leur contenu, sans protection. Il n'y a jamais eu d'information véritable sur les dangers de l'amiante. Par exemple, lorsque le Comité d'Entreprise achetait des pommes de terre pour les ouvriers, ces dernières étaient transportées dans des sacs qui avaient servi auparavant à stocker de l'amiante. Pareil pour les colis de Noël du C.E, livrés dans ces mêmes sacs qui avaient été vidés mais pas nettoyés. Tout cela prouve qu'il avait de la part des salariés de base de l'usine une méconnaissance totale des dangers liés à l'amiante, et que la direction n'a jamais cherché à nous informer, à nous mettre en garde, et à prendre les mesures de sécurité nécessaires. M. Michel WILLEMS De 1961 à 1999 j'ai travaillé à ETERNIT au moulage puis à la fabrication. J'ai donc été au contact de l'amiante, puisque une de mes fonctions était de la saupoudrer avec du ciment et de l'oxyde de fer. Le tout partait dans un mélange vidé dans un broyeur. Dans ce type d'opération, il arrivait régulièrement que les courroies des broyeurs se cassent ; il me fallait alors rentrer à l'intérieur plié en deux pour nettoyer la meule en pleine poussière. Le nettoyage pouvait aussi se faire grâce à une grosse soufflerie qui ventilait la poussière un peu partout. A partir de 1982, j'ai été amené à pratiquer le broyage d'amiante humide : il fallait vider les sacs et y mettre de l'eau. Lorsque j'ai dit que j'étais malade, je me suis retrouvé déplacé à un autre poste de travail. Je savais en faisant cela que je risquais au mieux une perte de salaire et au pire le licenciement pur et simple. C'est comme cela que des collègues de travail ont préféré continuer à « manger de l'amiante » plutôt que de reconnaître leur maladie. ANNEXE N° 2 Questionnaire adressé aux collectivités territoriales sur la gestion des bâtiments amiantés relevant de leur responsabilité I. Information concernant la réglementation 1) Comment avez-vous été formellement informés des obligations relatives à la gestion de l'amiante « résiduel » et des délais dans lesquels ces obligations devaient être satisfaites ? 2) Avez-vous fait l'objet d'une action de sensibilisation sur cette question ? Si oui, par qui ? II. Le diagnostic 3) Avez-vous pu réaliser, dans les délais fixés par la réglementation, les diagnostics « amiante » et les dossiers techniques amiante sur les bâtiments dont vous êtes gestionnaire ou propriétaire ? 4) Sinon pourquoi ? Si oui, avez-vous, à cette occasion, rencontré des difficultés particulières (complexité de la réglementation, coût du repérage, qualité des diagnostics...) ? 5) Ces diagnostics sont-ils centralisés ? Si oui, sous quelle forme, dans quel service ? Ces informations sont-elles facilement consultables ? Par qui ? Y a-t-il une transmission au niveau des services déconcentrés (préfecture) ? III. Le traitement de l'amiante diagnostiqué 6) Quelle est la part de vos bâtiments contenant des matériaux amiantés ? De quels types d'établissements s'agit-il ? 7) Quelle est la part de vos bâtiments devant subir des travaux de confinement ou de retrait de matériaux amiantés ? 8) Ces travaux ont-ils rencontré des difficultés (techniques, financières, administratives ou juridiques) particulières ? IV. La maintenance 9) L'entretien de vos bâtiments est-il effectué par des agents publics ou par des entreprises privées ? 10) Ces équipes de maintenance disposent-elles aisément des informations résultant des diagnostics ? 11) Dans l'hypothèse où vous disposeriez d'un service d'entretien et de maintenance des bâtiments publics, ses agents ont-ils été formés et/ou sensibilisés aux risques liés aux opérations sur des matériaux amiantés ? V. La gestion des déchets 12) Comment traitez vous les déchets d'amiante libre (de type flocage) ou lié (de type amiante-ciment) issus des travaux conduits dans vos locaux ? 13) Disposez vous, sur votre commune, d'une décharge de « classe 3 » (centre de stockage pour les déchets inertes) dans laquelle le stockage de déchets d'amiante lié est autorisé dans le cadre de la circulaire du 22 février 2005. Si oui, ces déchets font-ils l'objet d'un traitement sécurisé (alvéole dédiée) ? - Quels commentaires complémentaires souhaitez-vous faire connaître à la mission sur les modalités de gestion de l'amiante « résiduel » ? ANNEXE N° 3 Données étrangères comparatives sur l'amiante collectées par la Direction générale du Trésor Données collectées par la Direction générale du trésor et de la politique économique *** Contributions de nos missions économiques Ce tableau reprend les réponses aux questions suivantes : - quel a été le poids de l'amiante dans l'économie de ce pays ? - existe-t-il un lobby pro-amiante dans ce pays ? - Ce pays a-t-il connu une vive polémique comme cela a pu être le cas en France dans les années 90 ? - quand furent adoptées les principales mesures d'interdiction ? - des associations de victimes se sont-elles constituées dans ce pays ? - existe-t-il un régime spécifique de prise en charge des pathologies liées à l'amiante ? - ce pays a-t-il ratifié les instruments suivants : Convention de Bâle (1), Convention de Rotterdam (2) et Convention n° 162 de l'OIT ? Abréviations :
ANNEXE N° 4 Contribution du Gouvernement canadien Ottawa, Canada, janvier 2006 L'Assemblée nationale française a créé en avril 2005 une mission d'information sur les risques et les conséquences de l'exposition à l'amiante. La mission, souhaitant étendre sa réflexion au-delà de la France, a demandé au Canada des précisions sur sa politique en la matière. L'information ci-dessous constitue la contribution du Canada aux travaux de la mission. Par cette contribution, le Canada souhaite aider à la compréhension de la politique canadienne sur le chrysotile. Le Canada mène une politique d'usage contrôlé et sécuritaire du chrysotile. Au vu des plus récentes évolutions des travaux scientifiques, le Canada poursuit dans cette voie. Le concept d'usage contrôlé et sécuritaire de substance à risque n'a pas été instauré pour le seul cas de l'amiante. Il constitue le fondement même de toute la législation relative à la santé et à l'hygiène du travail, telle qu'elle est notamment développée par l'Organisation internationale du Travail (OIT). Le chrysotile Le terme d'amiante regroupe six substances minérales naturelles, appartenant à deux familles : les amphiboles et les serpentines. Les amphiboles sont au nombre de cinq : amosite, anthophyllite, actinolite, crocidolite et trémolite. Le chrysotile est le seul représentant de la famille des serpentines. Les propriétés physico-chimiques distinctes de ces deux familles d'amiante expliquent les différences significatives observées au niveau de leur toxicité respective. La seule variété d'amiante exploitée et actuellement utilisée au Canada, aussi bien que celle exportée, est le chrysotile. Aujourd'hui, un nombre croissant de scientifiques et d'instances règlementaires reconnaissent et confirment que le chrysotile est manifestement moins dangereux que toutes les autres variétés d'amiante. Le Rapport de la Commission royale d'enquête sur l'amiante de l'Ontario en faisait le constat dès 1984. Depuis la publication de ce rapport, toutes les études scientifiques concluent dans le même sens. Aussi récemment qu'en 2003, un comité d'experts réuni par l'Environmental Protection Agency des États-Unis a conseillé à celle-ci de modifier sa façon d'évaluer le risque lié à l'exposition à l'amiante et d'adopter une approche qui, du point de vue de la nocivité, distingue entre les types de fibre, comme le fait le Canada. La méta-analyse la plus poussée et la plus récente sur des cohortes de travailleurs de l'amiante (Hodgson et al., 2000) estime que le chrysotile est entre 10 et 500 fois moins cancérigène que les amphiboles. Cette étude confirme une évaluation gouvernementale antérieure conduite par l'Australie (NICNAS, 1999). En outre, de nombreux experts estiment maintenant que les mêmes approches et les mêmes évaluations devraient être étendues à l'utilisation de l'ensemble des fibres à usage industriel. En 1998, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) évaluait la toxicité des fibres de verre et de céramique ainsi que des laines de roche, et notait que leur utilisation semblait augmenter les risques de tumeurs. Ainsi, contrairement à ce qui est affirmé dans certains milieux, personne ne peut prétendre que tout est connu sur les effets de l'amiante sur la santé et, a fortiori, dès le début du siècle dernier. Selon cette hypothèse, le niveau de connaissance sur les effets des autres fibres est encore moindre La tendance des travaux scientifiques les plus récents va donc plutôt dans le sens d'une réactualisation de l'évaluation relative des risques liés à l'ensemble des fibres techniques. Dans ce contexte, le Canada juge pertinentes ses requêtes, tant à l'Organisation mondiale de la Santé qu'au Centre International de Recherche sur le Cancer, visant à ce que soient effectuées des évaluations comparatives de risques entre le chrysotile et les autres fibres, et maintient sa politique d'usage strictement contrôlé et sécuritaire du chrysotile. Entre-temps, le chrysotile continue à s'imposer comme la fibre de renforcement la plus performante en termes d'efficacité et d'économie de coûts de production et d'usage, notamment pour les produits de fibrociment, comme les conduites d'eau et les plaques de couverture. Précisons que dans ces applications, qui représentent actuellement plus de 90% des utilisations du chrysotile, les fibres sont très fortement immobilisées dans leur gangue de ciment et donc peu susceptibles de diffusion. Usage contrôlé et sécuritaire Le Canada a près de 30 ans d'expérience dans le domaine de l'usage contrôlé et sécuritaire du chrysotile. Notre politique à cet égard a été adoptée dès 1979, au niveau fédéral et par l'ensemble des provinces et territoires. La création en 1984 de l'Institut de l'amiante, (dénommé par la suite Institut du chrysotile) découle de cette politique. En 1986, à l'OIT, les gouvernements, les fédérations internationales, les syndicats de travailleurs et les industriels de l'amiante ont adopté à l'unanimité la Convention no 162 concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante. Avec le concours de l'Institut du chrysotile, les gouvernements du Canada et du Québec, les syndicats de travailleurs concernés ainsi que l'industrie du chrysotile, se sont engagés dans la mise en œuvre de la politique canadienne et québécoise, y compris dans l'application de la Convention no 162, et se sont dotés des moyens nécessaires pour parvenir aux objectifs fixés. Depuis 20 ans, l'Institut du chrysotile a organisé des séminaires d'information, des missions d'experts et des sessions de formation à l'intention des travailleurs et de leurs syndicats Il a soutenu la création d'associations professionnelles et, dans certains cas, d'organisations tripartites nationales et a développé et mis en place des programmes de transfert de technologies. L'action de l'Institut s'est étendue, jusqu'à maintenant, à plus de 60 pays des Amériques, d'Europe, du Moyen Orient, d'Asie et d'Afrique. Toutes ces initiatives ont permis de favoriser, dans ces pays, producteurs ou importateurs de chrysotile, l'adoption de conditions d'exploitation et d'utilisation conformes aux exigences de la Convention no 162 de l'OIT. Le Canada considère que ces actions ont une efficacité réelle en termes de protection de la santé et de l'environnement. Pour ce qui concerne la Convention de Rotterdam, le Canada ne souscrit pas à la proposition d'ajout du chrysotile à la procédure de consentement préalable parce qu'il considère que les Parties à la Convention doivent explorer plus avant les moyens d'améliorer les procédures et la mise en œuvre de la Convention. Ces procédures doivent reconnaître qu'il existe des substances, comme le chrysotile, qui peuvent être utilisées suivant une approche contrôlée et sécuritaire, telle que préconisée par le Canada. De plus, la Convention ne prévoit pas l'évaluation systématique de la toxicité des autres fibres à usage industriel, ce qui est inacceptable pour le Canada. Réglementation
Au Canada, la règlementation relative à l'utilisation contrôlée et sécuritaire de l'amiante, et plus spécifiquement du chrysotile, est stricte et rigoureuse. Elle porte essentiellement sur cinq domaines : _ l'hygiène et la sécurité au travail en vertu du Code canadien du travail qui fixe, en particulier, à 1,0 f/cm3 le seuil d'exposition au chrysotile dans le milieu de travail; _ la santé et la sécurité des utilisateurs prévues dans la Loi sur les produits dangereux qui interdit l'usage d'un certain nombre de produits ou d'applications, comme certains textiles ou les flocages; _ la protection de l'environnement inscrite dans la Loi canadienne sur la protection de l'environnement qui limite à 2 f/cm3 le niveau de largage de fibres de chrysotile dans l'atmosphère au voisinage des unités de production; _ la sécurité relative au transport de matières et de produits à risque qui est stipulée dans la Loi (de 1992) sur le Transport des marchandises dangereuses; _ le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) qui traite de l'étiquetage des matériaux et produits dangereux et qui comporte également des directives ayant pour objet de veiller à ce que les travailleurs appelés à manipuler des substances dangereuses reçoivent l'information et la formation appropriées. A ce corpus législatif et règlementaire fédéral s'ajoutent les lois et règlements des provinces et territoires relatifs à l'amiante et aux produits contenant du chrysotile. Soulignons d'abord que tous les gouvernements provinciaux et territoriaux ont accepté de se conformer et se conforment à la Convention no 162 de l'OIT. Il serait fastidieux d'entreprendre ici une revue exhaustive des lois et règlements provinciaux et territoriaux en matière d'amiante. Cependant, à titre indicatif et d'exemple, on peut relever que le Québec, en vertu de sa Loi sur la qualité de l'environnement, règlemente très strictement les émissions provenant des mines et des usines de transformation de chrysotile, ainsi que le traitement des déchets d'amiante. De même, en conformité avec la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec, le Code de sécurité sur les lieux de construction et les règlements sur la qualité de l'environnement du travail régissent tous les aspects de l'environnement du travail, sous l'angle de la qualité du milieu ambiant, aussi bien que de la sécurité et de la santé des travailleurs. Production et exportation Certes le Canada était-il le quatrième producteur de chrysotile en 2004 avec 220 000 tonnes métriques mais cela ne représente que 10% de la production mondiale. 95% de la production canadienne de chrysotile est destinée à l'exportation, principalement vers l'Asie. La proportion restante est utilisée dans la fabrication de produits finis, dont 96% sont exportés aux États-unis. Les exportations canadiennes de fibres de chrysotile en 2004 se sont chiffrées à 104 millions de dollars canadiens (M$C) et celles des produits manufacturées à 62 M$C pour un total de 166 M$C, soit 0,0004 % des exportations canadiennes évaluées à 411,802 milliards de dollars canadiens pour la même période. Même si le nombre d'emplois reliés au chrysotile ne représente que 0,005 % de la population canadienne active âgée de plus de 15 ans, la production canadienne de chrysotile a toute son importance pour les 800 personnes qui travaillent dans les mines et les usines de transformation situées dans les régions de l'Estrie et de Chaudière-Appalaches (Province de Québec). Dans ces deux régions limitrophes dont la population excède à peine 670 000 habitants, on estime que près de 1000 autres emplois sont partiellement ou entièrement induits par la production du chrysotile. Conclusion Quoique le chrysotile ne constitue pas un enjeu économique et industriel déterminant pour le Canada, ou même pour le Québec, le Canada continue de suivre de près l'évolution de la filière amiante dans le monde au chapitre de la santé et de la sécurité des travailleurs et des utilisateurs. Il poursuit, notamment par le truchement de l'Institut du chrysotile, les initiatives visant à encourager la mise en place de législations et de règlementations et l'adoption de principes de bonne gouvernance pour un usage responsable, contrôlé et sécuritaire des substances à risque. Pour le Canada, le seul débat pertinent demeure celui de la poursuite de l'amélioration de la protection de la santé des travailleurs et des utilisateurs, aussi bien que de l'hygiène et de la santé publiques. Dans cette perspective, le Canada appuie les échanges d'information constructifs qui reposent sur les meilleures, et les plus récentes, données scientifiques et médicales. RÉFÉRENCES - Dupré, J.S., J.F. Mustard et R.J. Uften. « Rapport de la Commission royale d'enquête sur l'amiante : Vue générale », 1984. Volumes I, II et III. - Hodgson, J. et A. Darnton. « The Quantitative Risk of Mesothelioma and Lung Cancer in Relation to Asbestos Exposure », Annals of Occupational Hygiene, 2000, 44(8), p. 565 à 201. - Eastern Research Group, Inc. « Report on the Peer Consultation Workshop to Discuss a Proposed Protocol to Assess Asbestos-Related Risk », Environmental Protection Agency Contract No. 68-C-148 - Work Assignment 2004-05, 2003. - National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS): Chrysotile Asbestos Priority Existing Chemical No. 9, Full Public Report, 1999. - Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), 1998. ANNEXE N° 5 Courrier au Premier ministre 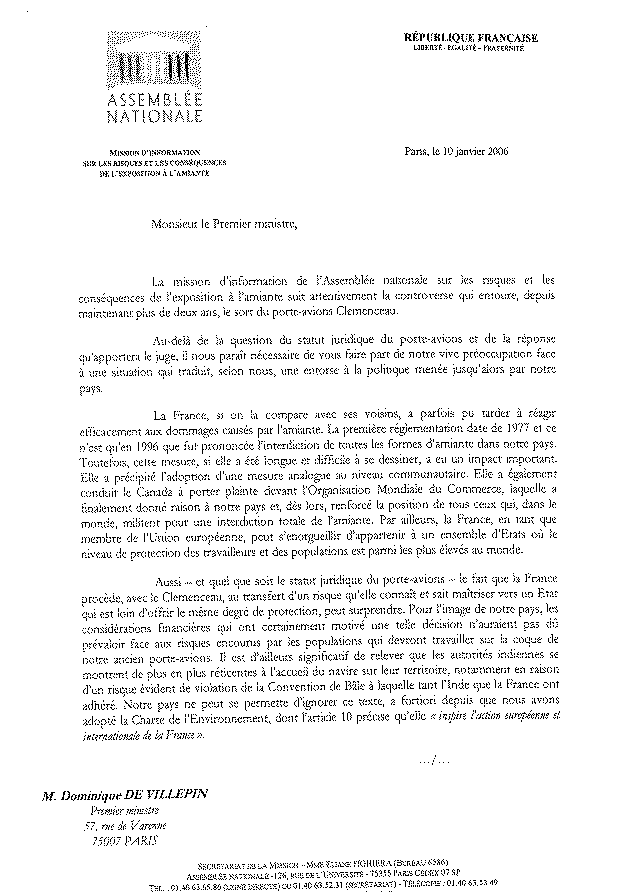 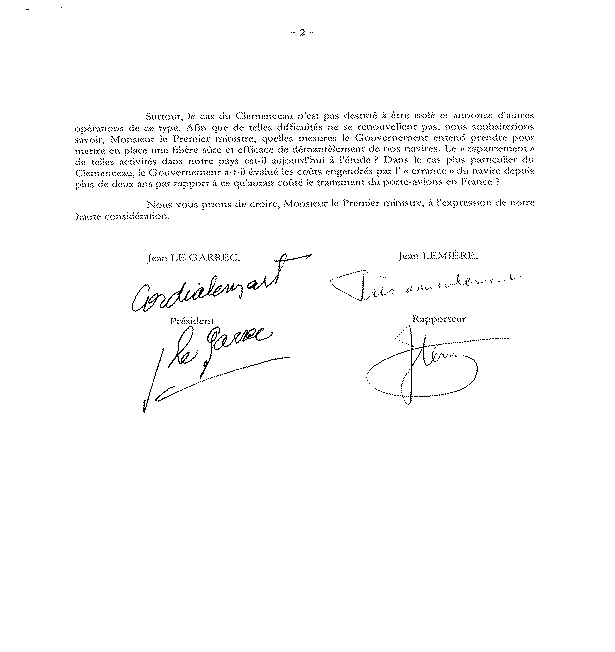 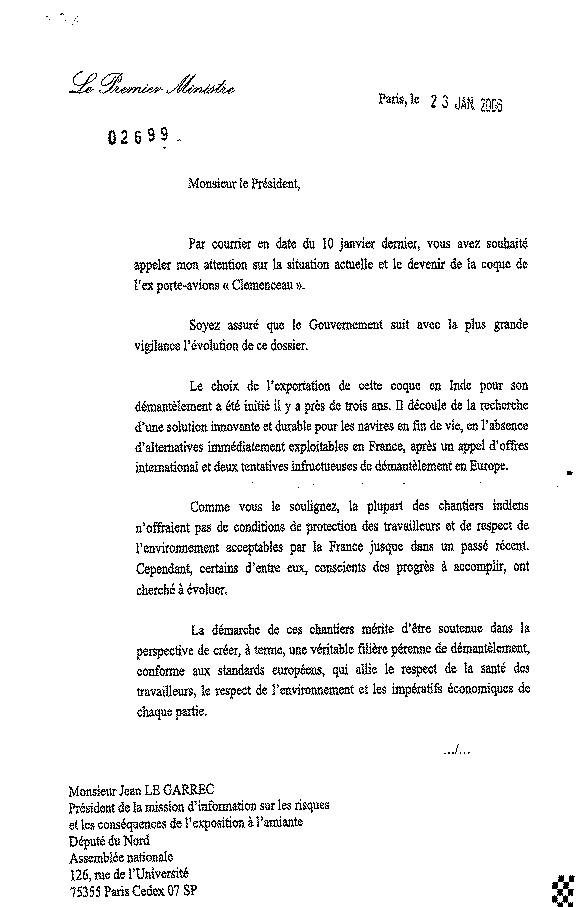 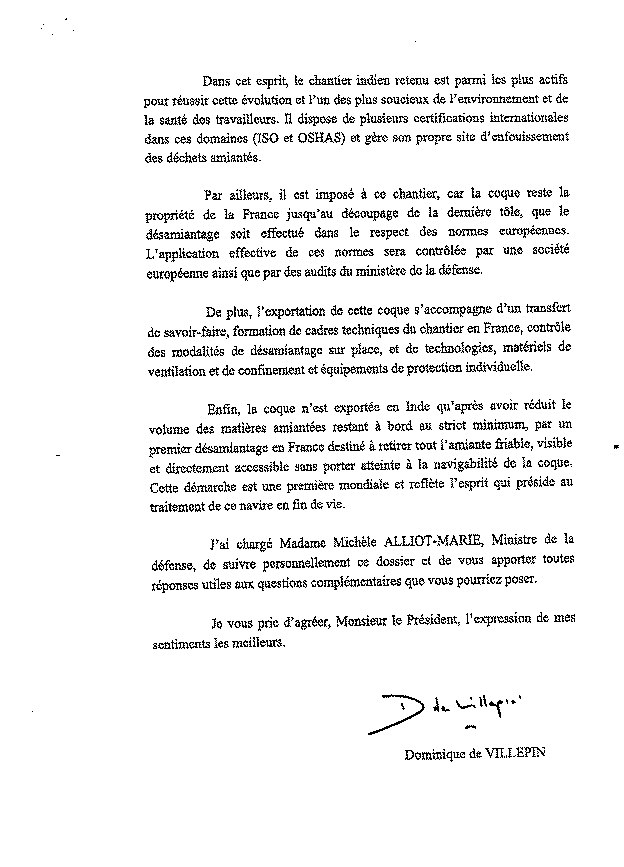 ANNEXE N° 6 Contribution de Mme Ellen Imbernon, 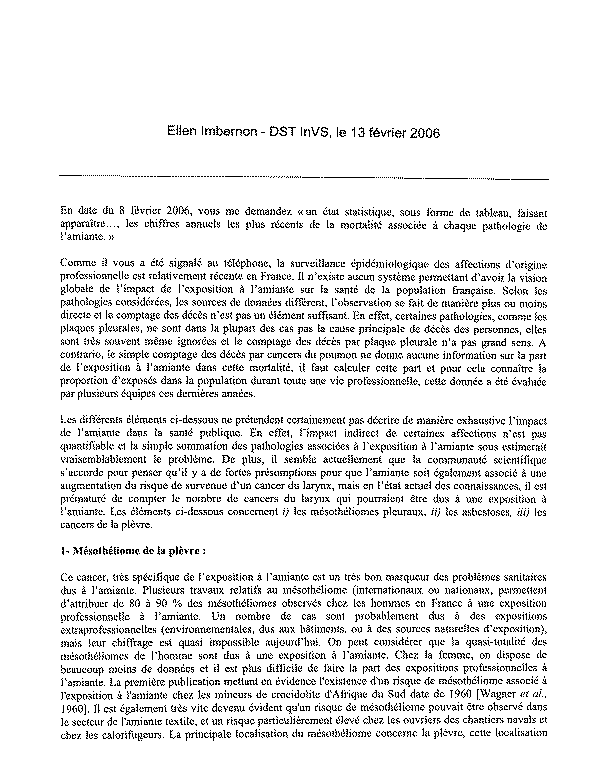 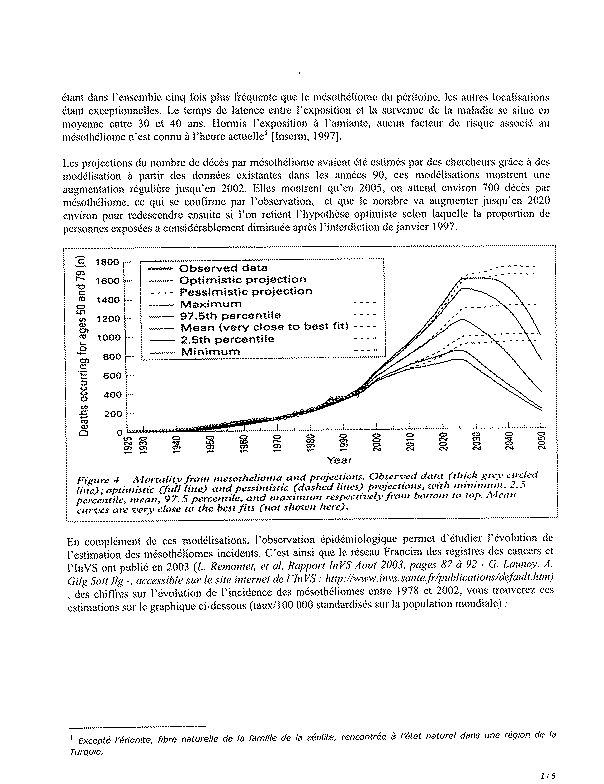 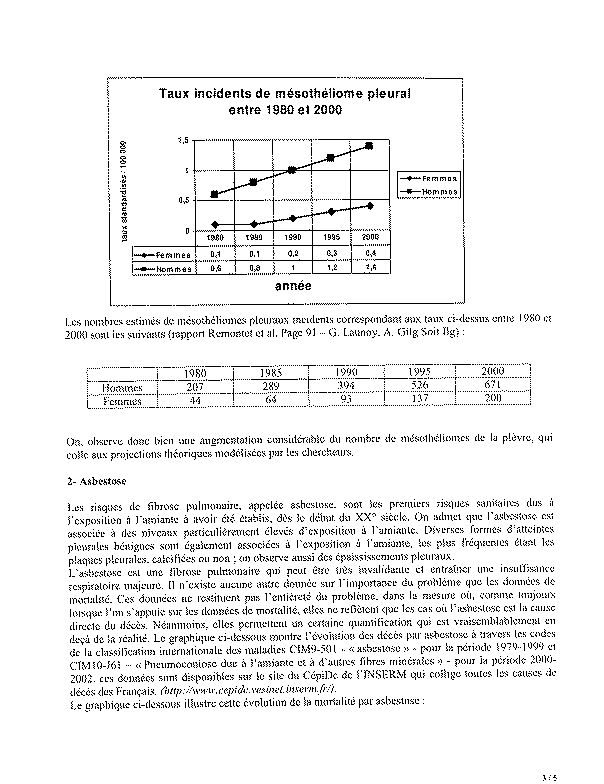 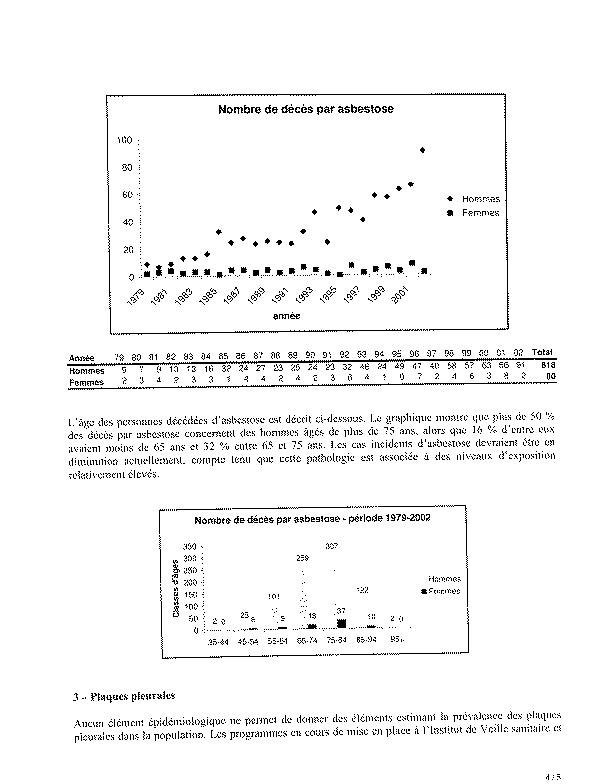 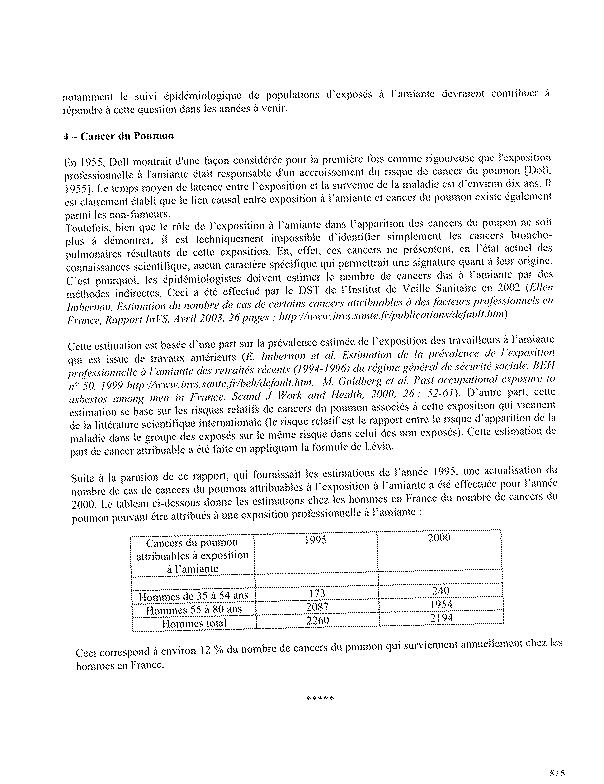 ANNEXE N° 7 Note sur la gestion de l'amiante
Secrétariat général de la Questure Paris, le 7 février 2006 Diagnostics et retraits d'amiante dans les immeubles MM. les Questeurs ont demandé, à la suite d'articles publiés dans la presse, que soit établi un bilan de la politique suivie en ce qui concerne la présence de l'amiante dans les bâtiments de l'Assemblée nationale. Ils ont également souhaité recevoir l'assurance qu'il ne subsisterait aucune trace d'amiante au 101, rue de l'Université et au 32, rue Saint Dominique, à l'issue des travaux de rénovation lourde prévus de juillet 2006 à juin 2008. Le décret n°96-97 du 7 février 1996 a créé l'obligation d'un diagnostic amiante dans tous les bâtiments publics ou privés. Dès mai 1996, l'Assemblée nationale a ainsi fait procéder par l'APAVE à un diagnostic global de tous les immeubles (Palais Bourbon, 233 BSG, 101RU, 32SD). Ce diagnostic a révélé la présence d'amiante confiné en divers endroits, comme c'était le cas dans la plupart des constructions, sans qu'il y ait aucun cas de dissémination et par conséquent aucun danger. Les prélèvements d'air effectués au vu de ce diagnostic ne signalaient, conformément à la réglementation, aucune présence de fibres d'amiante dans l'air. De nouveaux diagnostics réglementaires ont été réalisés, avant travaux du 3, rue Aristide Briand (mars 2003), du 95 RU (décembre 2004), au 101 RU et 32 SD (fin 2004). D'une façon générale, la question de la présence d'amiante est posée de manière systématique avant chaque intervention significative dans les immeubles. Des contrôles incluant l'analyse des matériaux retirés par prélèvements sont effectués dans toutes les zones découvertes lors de sondages avant travaux. Après contrôle du niveau d'empoussièrement et analyse des risques, le démantèlement des produits contenant des fibres d'amiante est régulièrement ordonné et ainsi, plusieurs retraits d'amiante ont été effectués ces dernières années, conformément au décret précité, au fur et à mesure des travaux engagés. La liste des principales opérations de retraits d'amiante effectuées dans l'ensemble des immeubles est jointe en annexe. Les retraits d'amiante sont exécutés par des entreprises qualifiées, désignées par appel d'offres. Dans chaque cas, un plan de retrait est établi par l'entreprise, validé par le coordinateur pour la sécurité et la protection sanitaire (SPS) et soumis à l'Inspection du travail et à la caisse régionale d'assurance maladie. Pendant toute la durée des travaux, un contrôle journalier est effectué pour assurer la sécurité du chantier et de son environnement. Le chantier de désamiantage est bien entendu totalement confiné : aucune personne extérieure au chantier ne peut y pénétrer et aucune poussière émanant du chantier ne peut se disperser vers les zones éventuellement occupées à proximité. En outre, le suivi des déchets amiantés est assuré conformément à la réglementation, jusqu'à l'inertage, puisque l'Assemblée nationale a retenu l'option d'élimination définitive de l'amiante par vitrification et non celle du stockage sécurisé. S'agissant plus particulièrement du 32, rue Saint Dominique, un retrait significatif d'amiante a été effectué en août 2005, pendant la fermeture saisonnière de la Résidence hôtelière. Les contrôles d'air effectués avant et après le retrait ont confirmé l'absence de nocivité. Pour l'essentiel, il reste à désamianter, au début du chantier de rénovation, le sol du local technique de l'autocommutateur téléphonique. Concernant l'immeuble du 101, rue de l'Université, il reste à procéder en début de chantier, dans les zones libérées de tout occupant et selon les règles de confinement des chantiers de désamiantage, au retrait d'amiante repéré à l'intérieur d'une gaine technique fermée, dans certains revêtements de sol, le cas échéant dans des clapets coupe-feu et portes coupe-feu. Cependant, s'agissant d'éléments industriels ou de matériaux non accessibles, la présence ou l'absence d'amiante ne pourra être vérifiée qu'après démontage ou sondages destructifs, dans le cadre du chantier. Mais, en toute hypothèse, il ne subsistera aucune trace d'amiante dans cet ensemble immobilier rénové, en juin 2008. En définitive, la question de l'amiante a fait l'objet de la part des services, depuis 1996, d'une attention et d'un suivi réguliers, notamment grâce à la présence d'un coordinateur SPS en fonction depuis cette date. Cependant, pour apaiser les légitimes interrogations des occupants des immeubles, il est tout à fait possible de faire procéder à un nouveau diagnostic général de présence d'amiante, suivi de la pose, en tous lieux qui seraient recensés comme susceptibles de contenir de l'amiante, même confiné, d'appareils de contrôle d'air. Ces appareils doivent être installés pendant une durée de 24 heures, les locaux étant libres de toute occupation, par exemple le week-end. Des analyses seront ensuite effectuées. Il est donc proposé à MM. les Questeurs de décider la réalisation d'un nouveau diagnostic amiante, avec mise en place de capteurs d'air, dans l'ensemble des bâtiments, à savoir : le Palais Bourbon, l'immeuble Chaban-Delmas, les 32 et 33 rue Saint-Dominique, l'immeuble du 3 rue Aristide Briand, celui du 233-235 boulevard Saint Germain, les locaux loués du 280 et 282 BSG, l'immeuble du 95 RU, celui du 110, rue de l'Université, ainsi que la galerie reliant le Palais et le 101RU. Le montant de ce marché peut être estimé à environ 50 000 euros HT pour le diagnostic proprement dit et de l'ordre de 30.000 euros HT, en sous-traitance, pour l'installation des capteurs d'air (entre 100 et 200 capteurs selon le diagnostic) et les analyses subséquentes. Le cas échéant, une cellule de coordination technique serait constituée pour suivre et piloter le projet, associant le service des Affaires Immobilières et du Patrimoine et la division de l'Accueil, de la Sûreté et de la Sécurité, sous l'autorité de Madame la directrice générale des Services administratifs. Par ailleurs, il a été demandé à UNIMO et GENERALI de fournir tous diagnostics et toutes attestations utiles concernant les deux immeubles du 33, rue Saint Dominique et du 110, rue de l'Université, ce dernier étant encore en travaux. _____________ Annexe : Principaux retraits d'amiante effectués
ANNEXE N° 8 Liste des auditions de la mission auditions et tables rondes de la mission ¬ Audition de M. Jean-Yves LE DÉAUT, député, vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) (15 juin 2005) ¬ Audition conjointe de M. François DELARUE, directeur de la Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (DGUHC) du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, de M. Alain JACQ, chef du service de la qualité et des professions, et de M. Jean-Pierre BARDY, sous-directeur « qualité-construction » (21 juin 2005) ¬ Audition de M. Jean-Denis COMBREXELLE, directeur de la Direction des relations du travail (DRT) du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, accompagné de Mme Mathilde MERLOT, ingénieur à la sous-direction des conditions de travail et de la protection contre les risques du travail (21 juin 2005) ¬ Audition de M. le professeur Didier HOUSSIN, directeur général de la santé (21 juin 2005) ¬ Audition conjointe de MM. Bernard PEYRAT, président, et Bruno CHEVALLIER, vice-président du Syndicat de retrait et de traitement de l'amiante et des autres polluants (SYRTA) (22 juin 2005) ¬ Audition conjointe de MM. Guy JEAN, président, et Alain LESEIGNEUR, directeur général de la société de désamiantage SOBATEN (22 juin 2005) ¬ Audition de représentants de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) : MM. François LIET, responsable du département développement et prestations, Dominique PAYEN, chef de projet chimie et environnement, Jean-François BOULAT, médecin-conseil du comité national, et Alain FRAISSE, secrétaire régional Sud-est (22 juin 2005) ¬ Audition conjointe de M. Serge MARTIN, pharmacien en chef, chef du Laboratoire d'analyse et de surveillance des particules inhalées de la marine (LASEM), et du contre-amiral Jean-Luc ALBERT, chargé des affaires nucléaires et de la protection de l'environnement (28 juin 2005) ¬ Audition de M. Christian COCHET, de la division santé et bâtiments du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) (28 juin 2005) ¬ Audition de Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND, chef du Laboratoire d'étude des particules inhalées (LEPI) de la ville de Paris, accompagnée de M. Laurent MARTINON, son adjoint (28 juin 2005) ¬ Table ronde sur le thème « La certification et le contrôle des entreprises intervenant dans la gestion de l'amiante résiduel » (29 juin 2005) ¬ Audition conjointe de M. Michel RICOCHON, chef de la mission d'animation des services déconcentrés de la Direction des relations du travail, et de M. Jacques LE MARC, inspecteur du travail à Nantes (5 juillet 2005) ¬ Table ronde sur la gestion de l'amiante résiduel dans le patrimoine public (6 juillet 2005) ¬ Audition conjointe de M. Philippe BOURGES, ingénieur conseil à la direction des risques professionnels de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, et de M. Bruno BISSON, ingénieur conseil de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (6 juillet 2005) ¬ Audition de M. Hervé VANLAER, sous-directeur des produits et des déchets au ministère de l'écologie et du développement durable, accompagné de Mme Claudine BOURHIS et de Mme Pascale CLOCHARD (12 juillet 2005) ¬ Audition de représentants de la Fédération française du bâtiment (FFB) : M. Dominique FLORIO, président du groupement national amiante, et M. Gérard du CHESNE, ingénieur à la direction des affaires techniques (12 juillet 2005) ¬ Audition conjointe de Mme Isabelle MARTIN, directrice de la prospective et de la veille réglementaire de la société SITA France Déchets, et de M. Christophe CAUCHI, chef de centre du site de classe 1 de Villeparisis (13 juillet 2005) ¬ Audition conjointe de M. Didier PINEAU, président-directeur général d'Europlasma, et de M. Patrice BLANCHOT, responsable du développement de la société INERTAM-COFAL Europlasma (13 juillet 2005) ¬ Audition de représentants de la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) : M. Stéphane PENET, directeur adjoint de la direction des assurances de biens et des responsabilités, Mme Valérie DUPUY, responsable de la coordination juridique, et M. Jean-Paul LABORDE, conseiller parlementaire (13 juillet 2005) ¬ Table ronde sur l'état des connaissances scientifiques sur les risques sanitaires liés à l'exposition à l'amiante (14 septembre 2005) ¬ Audition de M. Claude GOT, président du collège scientifique de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) (27 septembre 2005) ¬ Audition de M. Dominique MOYEN, ingénieur général du corps national des Mines, ancien directeur général de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), co-fondateur du Comité permanent amiante dans les années 80 (27 septembre 2005) ¬ Audition de M. Jean-Luc PASQUIER, ancien responsable de la Direction des relations du travail (DRT), représentant la DRT au Comité permanent amiante et actuellement directeur délégué à la formation à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) (27 septembre 2005) ¬ Table ronde regroupant des partenaires sociaux sur les risques professionnels liés à l'amiante (28 septembre 2005) ¬ Table ronde regroupant les représentants de collectivités territoriales sur la gestion des bâtiments amiantés (28 septembre 2005 ) ¬ Audition conjointe de M. Gilles EVRARD, directeur des risques professionnels à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), et de M. Pascal JACQUETIN, directeur adjoint (4 octobre 2005) ¬ Audition conjointe de Mme le Dr Monique LARCHE-MOCHEL, chef de service de l'inspection médicale du travail, de M. Marc BOISNEL, sous-directeur des conditions de travail, et de Mme Catherine TINDILLÈRE, chef du pôle médecine du travail à la DRT (4 octobre 2005) ¬ Audition conjointe de M. Michel RICOCHON, chef de la mission d'animation des services déconcentrés de l'inspection du travail, et de M. Éric JANY, inspecteur du travail (5 octobre 2005) ¬ Audition conjointe de M. Marc BOISNEL, sous-directeur des conditions de travail à la DRT, de M. Patrick GUYOT, chef du bureau de protection de la santé en milieu de travail, et de Mme Isabelle PALUD-GOUESCLOU, chef du bureau de la politique de prévention des conditions du travail et de la médecine du travail (5 octobre 2005) ¬ Audition conjointe de M. Jean-Luc MARIÉ, directeur général de l'INRS, et de M. Jean-Claude ANDRÉ, directeur de la recherche scientifique (5 octobre 2005) ¬ Audition conjointe du Dr Renée POMARÈDE, responsable de la mission stratégie de l'Institut de veille sanitaire (IVS), et du Dr Ellen IMBERNON, responsable du département santé-travail de l'IVS (11 octobre 2005) ¬ Audition conjointe du docteur Michèle FROMENT-VÉDRINE, directrice générale de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET), de M. Dominique GOMBERT, directeur du département d'expertise, et de M. Antoine VILLA, toxicologue (11 octobre 2005) ¬ Audition de M. Marcel GOLDBERG, professeur de santé publique à la faculté de médecine, épidémiologiste à l'INSERM, conseiller scientifique à l'Institut de veille sanitaire (IVS) (11 octobre 2005) ¬ Table ronde sur la prévention des risques sanitaires en milieu professionnel (19 octobre 2005) ¬ Audition de M. Jean LEMIÈRE, président du groupe d'étude de l'Assemblée nationale sur l'amiante (25 octobre 2005) ¬ Audition de représentants de la FNATH, association des accidentés de la vie : MM. Marcel ROYEZ, secrétaire général de la FNATH, Philippe Karim FÉLISSI, administrateur du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) pour la FNATH, et Alain PRUNIER, secrétaire général du groupement de la FNATH pour la Sarthe (25 octobre 2005) ¬ Audition de représentants de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante (ANDEVA) : M. François DESRIAUX, président, MM. Michel PARIGOT, Alain BOBBIO et André LETOUZÉ (25 octobre 2005) ¬ Audition conjointe des professeurs Marc LETOURNEUX et Christophe PARIS et de Mme Évelyne SCHORLÉ sur le suivi post-professionnel des salariés de l'amiante (26 octobre 2005) ¬ Audition de M. François MARTIN, président de l'Association de défense des victimes de l'amiante de Condé-sur-Noireau (ALDEVA) (26 octobre 2005) ¬ Audition de M. François DESRIAUX, président de l'Association nationale des victimes de l'amiante (ANDEVA), accompagné de MM. Michel PARIGOT, Alain BOBBIO et André LETOUZÉ (2 novembre 2005) ¬ Audition conjointe de M. Raymond CLAVIER et de Mme Andrée AMAT pour l'Association de défense des fonctionnaires territoriaux du Languedoc-Roussillon victimes de l'amiante (ADFTLRVA) (2 novembre 2005) ¬ Audition conjointe de M. Alain BOURDELAT, directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages (FGAO), et de M. Loïc BOUCHET, directeur adjoint (2 novembre 2005) ¬ Audition conjointe de M. Roger BEAUVOIS, président du conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), et de M. François ROMANEIX, ancien directeur du FIVA (8 novembre 2005) ¬ Audition de Mme Marianne LÉVY-ROSENWALD, présidente du conseil de surveillance du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) (8 novembre 2005) ¬ Audition de représentants de la Cour des comptes : M. Michel CRETIN, président de la sixième chambre, Mme Rolande RUELLAN, Conseiller maître, et M. Frédéric SALAS (9 novembre 2005) ¬ Audition de Maître Michel LEDOUX, avocat (9 novembre 2005) ¬ Audition de Maître Michel Jean-Paul TEISSONNIÈRE, avocat (9 novembre 2005 ¬ Audition de représentants du Conseil d'État sur le rapport annuel relatif à la responsabilité et à la socialisation du risque : M. Jean-Michel BELORGEY, président de la section du rapport et des études, et M. Bernard PIGNEROL, maître des requêtes (15 novembre 2005) ¬ Audition de M. Michel LAROQUE, inspecteur de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) (15 novembre 2005) ¬ Audition conjointe de MM. Franck GAMBELLI, président de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), Pascal JACQUETIN, directeur adjoint à la direction des risques professionnels, et Raphaël HAEFLINGER, responsable du département « assurance des risques professionnels » (15 novembre 2005) ¬ Table ronde sur le thème : « Après l'amiante, quel avenir pour la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ? » (23 novembre 2005) ¬ Audition de M. Pierre FAUCHON, sénateur (29 novembre 2005) ¬ Audition de Mme Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY, coordinatrice du pôle santé publique du tribunal de grande instance de Paris (29 novembre 2005) ¬ Audition de Mme Emmanuelle PRADA-BORDENAVE, maître des requêtes au Conseil d'État (30 novembre 2005) ¬ Audition conjointe de Maîtres Michel LEDOUX et Jean-Paul TEISSONNIÈRE, avocats (30 novembre 2005) ¬ Audition de M. Robert FILNIEZ, avocat général près la Cour de cassation (6 décembre 2005) ¬ Audition de M. Alain SAFFAR, sous-directeur de la justice pénale spécialisée à la Direction des affaires criminelles et des grâces (6 décembre 2005) ¬ Audition de représentants de la Direction santé et sécurité d'Arcelor : M. Jean-Claude MULLER, directeur, et le docteur Michel DISS (13 décembre 2005) ¬ Audition de Mme Annie THÉBAUD-MONY, directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), coordinatrice du Réseau international Ban Asbestos et membre de Ban Asbestos France (14 décembre 2005) ¬ Audition de Mme Martine AUBRY, ancien ministre de l'emploi et de la solidarité (17 janvier 2006) ¬ Audition de M. Pascal CLÉMENT, Garde des Sceaux, ministre de la justice (18 janvier 2006) ¬ Audition conjointe de M. Xavier BERTRAND, ministre de la santé et des solidarités, et de M. Gérard LARCHER, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes (24 janvier 2006) ¬ Audition de M. François LOOS, ministre délégué à l'industrie, accompagné de M. Jean-Jacques DUMONT, directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle (DARQSI) (31 janvier 2006) ¬ Audition de l'amiral Alain OUDOT DE DAINVILLE, chef d'état-major de la Marine (23 février 2006) auditions du Président et du Rapporteur - Audition de représentants de la CGPME : M. Jean-François VEYSSET, vice-président chargé des affaires sociales, M. Georges TISSIÉ, directeur des affaires sociales et M. Pierre THILLAUD, directeur de l'Association médicale interentreprises (16 novembre 2005) - Audition de représentants de la confédération CFDT : M. Dominique OLIVIER, responsable risques professionnels de la santé au travail et Mme Laurence THERY, secrétaire confédérale, chargée de la santé au travail (16 novembre 2005) - Audition de représentants de la confédération CGT : M. Serge DUFOUR, conseiller confédéral de l'activité santé au travail, M. Gilles SEITZ, médecin du travail, et M. Jean BELLIER, expert santé au travail (16 novembre 2005) - Audition de représentants du MEDEF : M. Jean-René BUISSON, président de la commission de la protection sociale et Mme Véronique CAZALS, directrice de la protection sociale (16 novembre 2005) - Audition de M. Bernard SALENGRO, délégué national au pôle protection sociale de la CFE-CGC (22 novembre 2005) - Audition de M. Marcel SUSZWALAK, président de l'APDA (Association portuaire de défense des victimes de l'amiante)- CGT (23 novembre 2005) - Audition de M. André HOGUET, représentant de la CFTC (23 novembre 2005) - Audition de représentants de l'Association européenne représentant l'Industrie des laines d'isolation haute température (ECFIA) : M. Philippe CLASS, directeur santé, sécurité et environnement de Thermal Ceramics et M. André COUYRAS, Unifrax (25 janvier 2006) - Audition de représentantes du CAPER (Comité amiante prévenir et réparer) du Puy-de-Dôme : Mmes Josette ROUDAIRE, Marie-Jeanne OUTURQUIN et Brigitte PECHAR Programme du déplacement à Bruxelles - Jeudi 1er décembre 2005 A 10 h00 : Représentants de la Commission européenne : M. Stéphane Brion, administrateur à la Direction général Entreprises et Industrie M. Stephen Pickering, administrateur à la Direction général Entreprises et Industrie A 11 h 15 : Représentants de la Commission européenne : M. Philippe Brunet, directeur-adjoint du cabinet de M. Markos Kyprianou, Commissaire européen à la santé et la protection des consommateurs Mme Gigliola Fontanesi, administratrice à la Direction générale Santé et protection des consommateurs A 13 h 00 : Déjeuner de travail avec M. Charles-Henri Levaillant, conseiller en charge de l'industrie et Mme Nathalie Nikitenko, conseillère adjointe en charge de la protection sociale, de l'exclusion, de la santé et de la sécurité au travail à la Représentation permanente de la France auprès de l'Union . A 15 h 00 : Représentants de la Commission européenne : Mme Odile Quintin, directrice générale de l'emploi et des affaires sociales M. Bernhard Jansen, directeur de l'adaptabilité, du dialogue social et des droits sociaux à la Direction générale de l'emploi et des affaires sociales M. Francisco Jesús Alvarez, administrateur à la Direction générale de l'emploi et des affaires sociales A 16 h 30 : Représentants de la Commission européenne : M. Alexandre Paquot, administrateur à la Direction générale de l'environnement Mme Anna Karamat, administratrice à la Direction générale de l'environnement - Vendredi 2 décembre 2005 A 10 h 30 : M. Alain Destexhe, sénateur fédéral de Belgique A 11 h 45 : Mme Muriel Gerkens, députée fédérale de Belgique Mme Marie-Christine Lahaye, membre du cabinet de Mme Evelyne Huytebroeck, ministre de l'environnement de la Région bruxelloise Marie-Anne Mengeot, journaliste retraitée à la télévision RTBF, représentante de l'ABEVA Mme Vandenbroucke, représentante de l'ABEVA A 15 h 00 : M. Laurent Vogel, responsable de l'Observatoire syndical de l'application des directives européennes au sein du département santé-sécurité de l'Institut syndical européen pour la recherche, la formation et la santé-sécurité ------- N° 2884 - Rapport fait au nom de la mission d'information sur les risques et conséquences de l'exposition à l'amiante (M. Jean Lemière) 1 Pour se limiter aux rapports parlementaires, on citera notamment le Rapport d'information n° 41 de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques : L'amiante dans l'environnement de l'homme : ses conséquences et son avenir (1997-1998) et le récent rapport n° 37 de la mission commune d'information du Sénat sur le bilan et les conséquences de la contamination par l'amiante : le drame de l'amiante en France ; comprendre, mieux réparer, en tirer des leçons pour l'avenir (2005-2006) 2 Table ronde du 14 septembre 2005 3 Annexe n° 1 4 M. Marcel Goldberg, table ronde du 14 septembre 2005 5 Ce décret concerne le travail des enfants 6 Audition du 30 novembre 2005 7 Audition du 30 novembre 2005 8 Ordonnance n° 45-1724 du 3 août 1945 9 Décret n° 50-1082 du 31 août 1950, complété par le décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951 10 Décret n° 76-37 du 5 janvier 1976 11 Loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels porte sur les poussières industrielles : « Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques, seront évacués directement au dehors de l'atelier, au fur et à mesure de leur production. [...] L'air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers ». Cette loi fut complétée par un décret du 11 mars 1894 relatif à l'évacuation des poussières industrielles en dehors des ateliers 12 P. Sargos, « L'évolution du concept de sécurité au travail et ses conséquences en matière de responsabilité », JCP 2003, I, Doctrine, n° 104, p. 121à 128. 13 Audition du 30 novembre 2005 14 La campagne de 2004 était de moindre ampleur - dix fois moins de chantiers visités - que celle de 2005. Ces campagnes ont été conduites par l'inspection du travail, conjointement avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) 15 Audition du 27 septembre 2005 16 Table ronde du 14 septembre 2005 17 Il s'agit de Julian Peto, épidémiologiste britannique 18 Table ronde du 14 septembre 2005 19 Audition du 30 novembre 2005 20 Mme Emmanuelle Prada-Bordenave, le 30 novembre 2005 21 Comptes-rendus CPA : http://www.sante.gouv.fr/amiante/connaitre/histoire/document/textes.htm) 22 Rapport sur la gestion du risque et des problèmes de santé publique posés par l'amiante en France, juillet 1998 23 Audition du 30 novembre 2005 24 Audition du 17 janvier 2006 25 http://www.sante.gouv.fr/amiante/connaitre/histoire/document/textes.htm). 26 Audition du 30 novembre 2005 27 Audition du 9 novembre 2005 28 Audition du 26 octobre 2005 29 Table ronde du 14 septembre 2005 30 Audition du 27 septembre 2005 31 Directive n° 83/477/CEE 32 Rencontre à Bruxelles du 2 décembre 2005 33 Audition du 25 octobre 2005 34 L'ordonnance de non-lieu du 16 décembre 2003 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Dunkerque clôturait une information ouverte en 1997 des chefs d'homicides et blessures involontaires 35 Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 36 L'amiante n'entre donc que pour une partie dans la composition de ces matériaux. Dans le numéro 62 de la revue Documents pour le médecin du travail (INRS) de 1995, une étude intitulée « Exposition à l'amiante et aux fibres minérales artificielles » rappelait que la part d'amiante dans la composition des matériaux communément appelés « amiante-ciment » pouvait atteindre 20%. 37 Cette expression plus juste est d'ailleurs reprise du rapport de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques : L'amiante dans l'environnement de l'homme : ses conséquences et son avenir (déposé le 16 octobre 1997, et rédigé par M. Christian Daniel - député sous la Xème législature). 38 En cas de présence de flocage, de calorifugeage, ou de faux plafonds mais si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements par l'opérateur de repérage. Ces prélèvements font ensuite l'objet d'une analyse de matériau par un organisme accrédité mais seul l'opérateur de repérage atteste de l'absence ou de la présence d'amiante. 39 En fonction du résultat de l'analyse de l'air, le propriétaire doit, si le niveau d'empoussièrement est inférieur à 5 fibres/litre, procéder à un contrôle périodique de l'état de conservation dans un délai maximal de 3 ans et, si le niveau est supérieur à 5 f/l, procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être en principe achevés dans un délai de 36 mois. 40 Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 f/l. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. 41 La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'établissement concerné, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle de l'empoussièrement, sauf lorsque des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai. La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises en oeuvre. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet. 42 Décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et le décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante 43 Article 176 de la loi SRU du 13 décembre 2000, codifiée à l'article L. 1134-7 du Code de la santé publique 44 Articles L. 111-23 et suivants et R. 111-29 et suivants 45 La liste des organismes dispensant une formation certifiée par Afact-Ascert International, SGS ICS et BSI France peut être obtenue auprès de ces organismes certificateurs. 46 CEBTP : Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics 47 Comité français d'accréditation, association de type loi de 1901 mandatée par l'Etat qui est représenté dans son conseil d'administration 48 Cf infra « C : une gestion des déchets défectueuse » 49 Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante 50 M. François Delarue, directeur de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, a ainsi présenté la situation au cours de son audition du 21 juin 2005 : « Étant donné l'extrême dispersion des immeubles concernés et des acteurs, nous avons une vision impressionniste de l'application de la réglementation. L'évaluation ne peut donc se faire que par le biais des rapports des contrôleurs techniques. On compte 6 000 diagnostiqueurs agréés sur l'ensemble du territoire, ce qui n'est pas mal. » 51 Audition du 22 juin 2005 52 Sur le modèle du communiqué de presse conjoint de la direction générale de la santé et de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction du 16 novembre 1999 53 Audition du 22 juin 2006 54 Par exemple, M. Roger Piotto, de l'école spéciale des travaux publics (ESTP), au cours de la table ronde du 29 juin 2005 : « Certains maîtres d'œuvre ignorent des mesures comme l'examen visuel préalable à la réception de l'ouvrage. Cette prestation doit figurer dans le cahier des charges élaboré par le maître d'œuvre. Dans la réglementation, il est question du propriétaire et de l'entreprise mais jamais du maître d'œuvre d'amiante, alors que ce dernier est responsable de la conception et du contrôle des travaux, en association avec le maître d'ouvrage. C'est l'entreprise qualifiée qui va compenser. » 55 Sécurité et protection de la santé 56 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains 57 « (...) sur le chantier de l'Écluserie, en centre ville de Rennes, les pouvoirs publics, au lieu de montrer l'exemple, ont décrédibilisé le métier de désamianteur et la réglementation. La préfecture a, en effet, expulsé des squatteurs pour démolir - et non pas déconstruire - un petit ensemble immobilier couvert en amiante-ciment sans prendre en considération le diagnostic amiante. Le site est resté en l'état pendant trois mois, constituant une véritable décharge à ciel ouvert avec des débris d'amiante-ciment mélangés à d'autres gravats, alors qu'ils auraient dû être dirigés en centre d'enfouissement technique de classe 1. Les riverains ont organisé une action symbolique : munis de masques et de gants, ils ont chargé des brouettes d'amiante-ciment et les ont vidées devant la préfecture et la mairie. Le lendemain, la préfecture, par l'intermédiaire de la Direction départementale de l'équipement (DDE), a procédé au nettoyage du site au tractopelle, sans précaution, et des déchets d'amiante ont seulement été recouverts par un remblai de trente centimètres. La préfecture, par voie de presse, a cependant fait savoir que le désamiantage avait été opéré dans les règles. L'association de riverains vient logiquement de porter plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. » (M. Dominique Florio, président du groupement national amiante de la Fédération française du bâtiment - FFB ; audition du 12 juillet 2005) 58 Audition du 5 juillet 2005 59 Comme, par exemple, M. Roger Piotto, de l'école spéciale des travaux publics : « Au cours de la première [période], antérieure au 1er janvier 2003, le point de contrôle réglementaire était l'assurance, puisque la réglementation indiquait : « Contrôleur technique ou technicien de construction qualifié muni d'une assurance ». Ce sont donc les assureurs qui se sont les premiers interrogés sur la nécessité de vérifier la compétence des opérateurs de repérage, compte tenu de l'incidence sur leur responsabilité civile. » (table ronde du 29 juin 2005) 60 M. Alain Milliotte, du Laboratoire Aéroports de Paris, Orly sud, a confirmé ce constat : « J'ai vécu une période où il n'y avait pas de formation de diagnostiqueur. Après les premiers décrets, en 1996, n'importe qui ou presque pouvait s'installer comme tel, et nous avons bien sûr eu des gens de qualité très inégale. » (table ronde du 29 juin 2005) 61 Audition du 13 juillet 2005. 62 « Pourquoi le marché de l'assurance compte-t-il peu d'acteurs pour la couverture amiante ? Parce qu'un certain nombre d'acteurs se sont retirés du marché de l'amiante. Soit ils ont purement et simplement interdit à leurs équipes de souscription ou à leurs équipes commerciales de souscrire un quelconque risque lié à l'amiante, soit ils ont exclu le risque amiante de leurs contrats, soit ils ont fixé des plafonds relativement bas, de façon à se protéger en termes d'engagement. S'ils ont fait ce choix, c'est essentiellement sur prescription de leurs réassureurs. Ceux-ci raisonnent à une échelle mondiale, ou au moins européenne. Or, les messages qu'ont reçus les réassureurs sur le problème de l'amiante en France ont été plutôt négatifs. (...) Plus que la réglementation, ce sont les qualifications et les certifications de compétences que nous privilégions dans l'appréciation du risque. Qu'il s'agisse du désamiantage ou du diagnostic immobilier, nous avons constaté des progrès. Ce que nous voulons éviter avant tout, ce sont les entreprises qui, comme je le disais tout à l'heure, s'improvisent désamianteurs ou diagnostiqueurs sans que nous disposions de repères nous permettant d'évaluer leurs compétences réelles. J'insiste, encore une fois, sur le fait que ce problème est soulevé par les réassureurs. C'est là un point fondamental. Nos adhérents peuvent avoir une appréciation positive du risque mais s'abstiennent de le couvrir parce que leurs réassureurs le leur ont interdit. » (audition du 13 juillet 2005) 63 « À partir du 1er janvier 2003, on est passé à la formation certifiée obligatoire. Mais on peut regretter que les pré-requis demandés par les organismes certificateurs ne soient pas les mêmes, ce qui a pu entraîner des difficultés pour les organismes de formation. Bien évidemment, ce n'est pas en quatre jours qu'on forme un opérateur de repérage à tout ce qui concerne le bâtiment. Il faut donc que les intéressés soient déjà dans la partie ou préalablement formés, avant de recevoir une formation certifiée correspondant au programme réglementaire. » (table ronde du 29 juin 2005) 64 « Le système de certification nous semble satisfaisant », a indiqué M. Penet (audition du 13 juillet 2005) 65 Dans sa contribution remise à la mission, M Gaul, inspecteur du travail, pose ainsi la question de la concurrence sur le marché du diagnostic : « Certains opérateurs de repérage (...) reconnaissent se soumettre à une logique économique souvent incompatible avec l'exhaustivité recherchée, uniquement pour obtenir le marché. Il faut avoir conscience du fait qu'outre les missions de repérage, ces opérateurs peuvent également avoir une qualification de coordonnateur SPS et qu'ils rencontrent fréquemment les mêmes donneurs d'ordre publics dans le cadre de réponses à appel d'offres. L'espoir d'être retenu pour d'autres opérations, y compris en coordination SPS, incite beaucoup d'opérateurs à limiter le nombre de prélèvements pour diminuer le coût du repérage. Les rares experts respectant à la lettre les règles d'éthique et la norme NF X46-020 subissent une concurrence déloyale particulièrement dévastatrice. ». M. Gaul a d'ailleurs fourni à l'appui de ses propos un exemple, appuyé par des documents incontestables, mais non publiables, de négociation commerciale entre l'opérateur et le maître d'œuvre : « au prix négocié par le maître d'ouvrage, l'opérateur ne pouvait effectuer qu'un seul prélèvement là où il en aurait fallu une centaine ». Ce chantier de la Manche a d'ailleurs été arrêté par l'inspection qui a demandé 75 prélèvements complémentaires. 66 « La manière de remplir la grille d'évaluation tient sur une demi page d'une circulaire ! En particulier, il n'y a ni critère d'activité, ni critère d'occupation du local. Il n'est pourtant pas indifférent de savoir si le local est vide, cas où la pollution par l'amiante importe moins que s'il s'agit d'une école ou d'une faculté ! Il n'y a pas davantage de critère de surface, et rien non plus sur les personnes qui occupent les locaux. Mais l'on sait que la liste des critères avait, à l'époque, été établie pour pallier les lacunes de la réglementation. (...) En 1980, nous avons procédé à la mesure de la pollution de l'air dans les bâtiments contenant des flocages en la comparant à un algorithme d'évaluation mis au point par l'Environmental Protection Agency (EPA) américaine. Les comparaisons auxquelles nous avons procédé nous ont permis d'établir l'absence de corrélation entre le taux de pollution et le pourcentage d'amiante dans les matériaux ; la pollution varie selon le type de matériau, sa friabilité et sa densité. L'algorithme d'évaluation de l'EPA est beaucoup plus complet que la grille d'évaluation actuellement utilisée en France, qui ne tient compte que de quatre critères. Il arrive en effet que nous soyons appelés à porter une appréciation après qu'un diagnostic a été réalisé en fonction de cette grille, et il peut se trouver que notre appréciation ne soit pas du tout la même que celle du diagnostiqueur, et que là où il porte le score « 2 », nous aurions dit « 3 ». Les critères réglementaires sont trop limités. » (audition du 28 juin 2005) 67 Audition du 22 juin 2005 68 « Il arrive aussi que le maître d'ouvrage ne dispose pas de trésorerie et éprouve des difficultés à emprunter, par exemple une copropriété : il lance alors un programme de provisionnements successifs de cinq ou six ans avant d'entreprendre les travaux. Dans ce cas, l'encapsulage, l'imprégnation ou l'encoffrement est une mesure conservatoire d'urgence assez astucieuse, si ce n'est que le client, en fin de compte, aura payé 1,7 fois le prix de l'enlèvement, comme à Jussieu. » (audition du 22 juin 2005) 69 M. Chevallier a en effet précisé que « dès lors que nous imprégnons un matériau d'un revêtement de surface, nous modifions ses caractéristiques et nous ignorons si la garantie de propriété coupe-feu pendant deux heures reste valable ; en tout cas, la couverture d'assurance liée à la garantie décennale disparaît. » (audition du 22 juin 2005) 70 ANAH : Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui subventionne déjà le diagnostic lorsqu'il est suivi de travaux. 71 En particulier deux dispositifs : - le dispositif de coordination, sécurité et protection de la santé de la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 impose au maître d'ouvrage de procéder à l'évaluation des risques au cours de la phase de conception et d'élaboration du projet. Mais ce dispositif est peu connu et respecté et il ne concerne en outre que les opérations pour lesquelles interviennent au moins deux entreprises. - le décret 92-158 du 20 février 1992 impose des prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure. 72 Code de la santé publique, article R. 1334-28, al.2 : « Les propriétaires communiquent le dossier technique « Amiante » à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication. » 73 M. Éric Jany, inspecteur du travail, résumait ainsi cette difficulté : « (...) le problème n'est pas simple. Si cette entreprise, ou un ascensoriste, par exemple, veut intervenir chez un client, elle est censée lui demander le diagnostic technique amiante (DTA). Mais les clients n'ont pas toujours envie de donner ce document, ou parfois ne l'ont pas fait... Donc, demander le DTA peut souvent conduire à perdre un marché. » (audition du 5 octobre 2005) 74 Audition du 27 septembre 2005 75 Une telle base de données pourrait s'apuyer sur l'expérience conduite par la RATP, et présentée au cours de la table ronde du 6 juillet 2005 par M. Luc Roumazeille, responsable du département Santé/Sécurité du travail de la Régie : « Engagé en 1997, le recensement s'est poursuivi jusqu'en 1999, mais les outils de collation des données faisaient défaut, et c'est seulement en 2001 qu'a été constituée une base de données, avec une arborescence très lourde, qui répertorie l'amiante friable - flocage, calorifugeage et faux plafonds - et non friable présent dans toutes les zones, ainsi que les MCA - matériaux contenant de l'amiante. (...) La base amiante dont je vous parlais peut être utilisée en Intranet par tous les agents de la RATP : lorsqu'ils doivent intervenir sur un site, l'arborescence leur permet de savoir s'il y a de l'amiante à cet endroit. » 76 Arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'exercice de l'activité et à la formation des contrôleurs techniques et techniciens de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié 77 Circulaire n° 2003-73 du 10 décembre 2003 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis 78 « Les DRASS et les DDASS élaboreront des plans de contrôle destinés à vérifier, par le biais d'enquêtes, l'existence des dossiers techniques « amiante » et leur conformité aux exigences réglementaires dans un certain nombre d'établissements recevant du public (référencés dans le fichier des établissements recevant du public du service départemental d'incendie et de secours). Ces actions devront porter en priorité sur les établissements sanitaires et sociaux (en référence au fichier FINESS). L'Etat se devant d'être exemplaire, vous veillerez à ce que l'ensemble des services déconcentrés appliquent strictement les obligations réglementaires qui s'imposent sur leurs bâtiments. » (circulaire 2003-73 précitée) 79 « Dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de l'application de la réglementation, l'administration peut être amenée à vérifier l'existence d'un certain nombre de documents, ainsi que le respect par les propriétaires des obligations qui leur incombent. Par ailleurs, des actions de contrôle doivent être mise en oeuvre. Un contrôle systématique n'étant pas possible, il y a lieu de procéder par sondage, selon des plans de contrôle qui doivent être élaborés au niveau régional. (...) Les services des DDASS mettront également à profit toute opportunité de procéder au même type de vérifications lors des diverses missions d'inspection conduites par les services de l'Etat (visites d'insalubrité...). Les DDASS en se coordonnant avec les commissions de sécurité, pourront mettre à profit toute visite de ces dernières pour rappeler aux propriétaires leurs obligations (rappel de la réglementation, des délais et procédures à respecter, contenu du dossier à déposer...). » (circulaire 2003-73, précitée) 80 Alinéa 1 : « Le dossier technique « Amiante » défini à l'article R. 1334-26 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. » 81 Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. 82 « Les données disponibles ne nous permettront pas de mesurer directement l'exposition de la population. A titre d'exemple, si l'on étudie la catégorie des établissements sanitaires et sociaux, on ne saura pas si, dans tel bâtiment où la présence d'amiante a été repérée, il y a seulement quelques personnes ou quelques centaines de personnes. Pour l'habitat privatif collectif et les maisons individuelles, l'étude donnera quelques pistes pour une estimation grossière - mais même celle-là n'existe pas à ce jour -, mais pas d'idée sur l'exposition potentielle des travailleurs amenés à intervenir dans ces bâtiments. L'une des limites des données qui nous sont transmises est qu'elles ne disent pas la quantité d'amiante contenue dans les bâtiments où il en a été repéré. » (audition du 28 juin 2005) 83 « Amiante : les vrais dangers » ; L'Express daté du 21 mars 2005. 84 Cf. supra A.- 2.- 85 Audition du 22 juin 2005 86 M. Dominique Payen, chef de projet chimie et environnement de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP), a confirmé le bon fonctionnement du dispositif de qualification : « Actuellement, environ quatre-vingts entreprises sont certifiées chez Qualibat et vingt chez AFAQ-ASCERT. Ces deux dernières années, nous avons retiré vingt qualifications chez Qualibat et quelques-unes chez AFAQ-ASCERT. Dès qu'une entreprise sort des rails, elle se fait sanctionner : le niveau de qualification des entreprises ayant pignon sur rue me paraît donc correct. » (audition du 22 juin 2005) 87 « Nous recevons bien des plans de retrait mais nous sommes persuadés que des chantiers restent inconnus de nos services. J'ai notamment le souvenir d'un chantier de retrait de plaques de fibrociment sans plan de retrait ni protection des ouvriers - j'avais d'ailleurs été informé par l'un d'eux. » (audition du 5 juillet 2005) 88 « C'est vraiment un problème. Le premier chantier que j'ai contrôlé sur mon secteur était un plan de retrait d'amiante : il s'agissait de retirer des dalles en vinyle posées avec de la colle amiantée sur deux zones, la première de soixante mètres carrés, la deuxième de trente mètres carrés. En arrivant sur le chantier, j'ai trouvé deux niveaux de 400 mètres carrés chacun recouvert des mêmes dalles ! Les enjeux financiers n'étaient donc pas les mêmes. L'entreprise a été obligée de désamianter de manière correcte, mais que se serait-il passé si je ne m'étais pas rendu sur place ? » (audition du 5 octobre 2005) 89 Par exemple, Dominique Florio, de la Fédération Française du Bâtiment a semblé contester la pertinence de tels plans de retrait : « On ne peut demander à une entreprise de désamiantage d'appréhender le risque comme un petit carreleur qui doit retirer quatre mètres carrés de dalles thermoplastiques contenant de l'amiante : il serait irréaliste d'exiger un plan de retrait pour un matériau qui ne dégage pas spontanément des fibres d'amiante. » M. Du Chesne, ingénieur à la direction des affaires techniques de la FFB, a d'ailleurs conclu son propos sur la distinction friable/non friable par cette phrase révélatrice : « Nous n'en recommandons pas moins aux entreprises de continuer à établir des plans de retrait pour l'amiante non friable. » (audition conjointe du 12 juillet 2005) 90 Audition du 22 juin 2005 91 Audition du 5 juillet 2005 92 Les conséquences complètes de la distinction, ainsi que la définition de celle-ci, résident dans un arrêté du 14 mai 1996 du ministre du travail et dans la circulaire DRT n°98-10 du 5 novembre 1998. 93 « Je vois toutefois un problème fondamental : la distinction entre matériaux friables et non friables. En effet, dès lors qu'un professionnel intervient sur un matériau contenant de l'amiante, celui-ci risque de dégager des fibres, même s'il est naturellement non friable : nous créons nous-mêmes la friabilité en fonction de notre niveau d'intervention. » (audition du 22 juin 2005) 94 « Les entreprises qualifiées ne couvrent que 20 à 30 % du marché, le reste n'étant pas sous contrôle. Pourtant, un matériau non friable est toujours mêlé à des matériaux friables et, une fois manipulé, il peut lui-même devenir ultra-friable. » (table ronde du 29 juin 2005) 95 Audition du 5 juillet 2005 96 « J'estime pour ma part que toutes les entreprises intervenant sur ces chantiers doivent détenir une certification, mais pas forcément la même que celle des entreprises travaillant sur les friables. C'est compliqué car des produits amiantés non friables peuvent être déconstruits très facilement tandis que, pour d'autres, il faut mettre en œuvre des moyens de protection de l'environnement et du personnel du même niveau que pour les matériaux friables. J'ai visité il y a peu un élevage de volailles construit presque entièrement en fibrociment ; il était dans un état déplorable. J'ai signalé à l'agriculteur qu'il serait confronté au problème de la déconstruction et que soixante ou cent vingt heures de travail seraient nécessaires, mais il m'a expliqué qu'il viendrait à bout de son bâtiment en six heures de bulldozer - je vous laisse imaginer ce qu'il compte faire des déchets. Je le comprends : où trouverait-il l'argent pour faire venir une entreprise spécialisée ? Tous les particuliers, voire les chefs de PME ou de TPE, sont confrontés à ce problème. » (table ronde du 29 juin 2005) 97 Table ronde du 29 juin 2005 98 Audition du 22 juin 2005 99 Par exemple, M. Jean : « Nous sommes soumis à la loi du marché et je comprends que les maîtres d'ouvrage lancent des appels d'offres. Il faut néanmoins espérer que ceux-ci ne soient pas induits en erreur. Pour commencer, l'étude technique doit primer et ne pas être subordonnée à des considérations financières : le mémoire technique doit permettre d'éliminer les opérateurs qui proposeraient une intervention au rabais et d'opérer la sélection entre ceux qui ont procédé à une analyse sérieuse. Or toutes les grandes institutions se sont adjoint les services d'« acheteurs », plus que de vrais professionnels. » (audition du 22 juin 2005) ou encore Roger Piotto : « La seule procédure intégrant l'analyse de risque est le repérage avant travaux mais celui-ci n'apporte pas les préconisations que contient le DTA. Il faut par conséquent que tous les documents intègrent l'analyse de risques et les recommandations au propriétaire. Hormis sur les petits chantiers, entre l'entreprise de maintenance et le maître d'ouvrage, intervient toujours le même acteur qui conçoit les travaux et établit le cahier des charges : le maître d'œuvre. En cas de contestation judiciaire, sa responsabilité sera recherchée. » (table ronde du 29 juin 2005) 100 À titre d'exemple : le chantier de désamiantage visité par la mission a été diligenté après la découverte, à l'occasion de travaux bénins, de flocages non repérés par le diagnostic obligatoire. 101 Les représentants du SYRTA ont ainsi indiqué à la mission que la protection des travailleurs constituait un gisement d'économies ou de marges de manœuvre pour les entreprises. (audition du 22 juin 2005) 102 « Je rappelle que 80 % du prix d'un chantier de désamiantage est consacré à la sécurité. Or la priorité va le plus souvent au moins-disant.(...) S'agissant des maîtres d'œuvre, il est vrai qu'il y a un gros problème. Quelques-uns se sont investis et ont acquis cette sensibilité dont je parlais. D'autres vendent un « paquet » aux maîtres d'ouvrage en leur disant qu'ils s'occupent de tout, qu'ils choisissent les entreprises, qu'ils prennent toutes les responsabilités. Mais ces derniers auraient tort de croire qu'ils ne se retrouveront jamais devant le juge... » (table ronde du 29 juin 2005) 103 M. Piotto, représentant de l'École spéciale des travaux publics (ESTP) « Certains maîtres d'œuvre ignorent des mesures comme l'examen visuel préalable à la réception de l'ouvrage. Cette prestation doit figurer dans le cahier des charges élaboré par le maître d'œuvre. Dans la réglementation, il est question du propriétaire et de l'entreprise mais jamais du maître d'œuvre d'amiante, alors que ce dernier est responsable de la conception et du contrôle des travaux, en association avec le maître d'ouvrage. C'est l'entreprise qualifiée qui va compenser. » (table ronde du 29 juin 2005) 104 M. Héry de la direction scientifique de l'INRS, table ronde du 29 juin 2005 105 M. Cochet, représentant du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) « Les maîtres d'œuvre ne sont pas toujours suffisamment qualifiés ; quant aux maîtres d'ouvrage, leurs pratiques ne sont pas non plus toujours idéales. Pour faire progresser le contrôle et le suivi, ne serait-il pas envisageable de s'orienter vers la certification des opérations de traitement et de retrait de l'amiante ? Cette démarche de plus en plus courante, qui prend en considération le cycle de vie, s'inscrit dans l'idée de haute qualité environnementale. » (table ronde du 29 juin 2005) 106 Table ronde du 29 juin 2005 107 Il convient toutefois de noter que l'OPQIPI, organisme de qualification de l'ingénierie délivre déjà une qualification « maîtrise d'œuvre en désamiantage » relative à « la validation du diagnostic amiante, la définition des travaux d'élimination ou de neutralisation de l'amiante présent dans les composants et équipements des bâtiments, la consultation des entreprises, l'analyse des plans de retraits et le suivi des travaux et des marchés jusqu'à la réception finale » 108 Audition du 28 juin 2005 109 « S'il fallait qu'un laboratoire certifié par le COFRAC - le Comité français d'accréditation - accomplisse systématiquement des mesures, il devrait pratiquement être présent à demeure sur le chantier, et, croyez-moi, cela serait difficile à vendre. N'oublions pas qu'un lien de subordination existe entre l'entreprise de désamiantage et les laboratoires, du fait de leurs relations commerciales. J'ai été démarché par des laboratoires agréés COFRAC qui m'offraient des bouteilles de champagne à chaque mesure libératoire conforme. Ils recherchent le volume et ce n'est pas avec l'amiante non friable qu'ils pourraient y parvenir. » (audition du 12 juillet 2005) 110 Les représentants du SYRTA, qui siègent également dans les commissions de certification, tout comme M. Jean, ont ainsi indiqué à la mission que le retrait de la qualification « amiante friable » d'une entreprise (pour manquement à la réglementation) s'accompagnait souvent d'un report de ladite entreprise vers le marché du traitement de l'amiante non friable, activité qui est en exercice « libre ». 111 M. Alain Fraisse de l'OPPBTP a explicitement confirmé cette tendance : « les contrôleurs et inspecteurs du travail sont désormais très mobilisés par la problématique amiante mais ont la fâcheuse tendance de se ruer vers les entreprises qui envoient un plan de retrait, plutôt que de s'intéresser à celles qui ne répondent pas à cette obligation réglementaire. » (audition du 22 juin 2005) 112 Ainsi, M. Jean-Denis Combrexelle, directeur des relations du travail, a-t-il exposé franchement ces problématiques : « Pour ce qui est de la formation spécifique des inspecteurs du travail, on ne peut ignorer le caractère généraliste de l'inspection du travail. Or les inspecteurs sont confrontés à des règlementations de plus en plus techniques. Voilà pourquoi est née l'idée de créer des cellules pluridisciplinaires rassemblant des médecins et des ingénieurs qui pourront les appuyer. Nous sommes le seul pays de l'Union européenne dont l'inspection du travail soit généraliste. C'est un atout dans la mesure où cela permet à l'inspecteur du travail d'avoir une vue globale de l'entreprise ; il y a, par exemple, un lien étroit entre la qualité du dialogue social et la prise en compte des questions de santé. Mais la préservation de ce caractère généraliste implique une modification des modes de fonctionnement. Pour ce qui est du nombre des inspecteurs, nous devrions en avoir 2 000 pour être dans la moyenne européenne. Le ministre ayant pris l'engagement de réduire l'écart avec cette moyenne en quatre à cinq ans, la balle est maintenant dans le camp du Parlement. » (audition du 21 juin 2005) 113 Article 11 du décret 96-98 114 L'organisme a constaté que l'amiante cause 4,4 % des maladies professionnelles du BTP, soit une multiplication par 7 entre 1994 et 2003 (audition du 22 juin 2005). 115 « Sur 750 chantiers de désamiantage contrôlés, 21 % enlevaient de l'amiante friable, qu'il faut distinguer de l'amiante lié, encore que certaines conditions de conservation et de démolition exigent dans les deux cas une haute technicité. Sur deux tiers des chantiers, des infractions ont été relevées, les unes graves, les autres moins : repérage non transmis aux entreprises de démolition, absence de signalétique, accès non interdit au public, absence ou insuffisance de travail en milieu humide, etc. A ce stade, 84 chantiers ont été arrêtés - les arrêter tous, conformément aux instructions, pouvait présenter un danger pour les salariés ou pour l'environnement -, 41 procès-verbaux ont été dressés, auxquels se sont ajoutés six injonctions de changement immédiat et 390 courriers d'observation. » (audition du 24 janvier 2006) 116 Le dossier de synthèse de cette campagne est disponible à l'adresse suivante : http://www.travail.gouv.fr/IMG/pdf/DP_campagne_desamiantage_2005.pdf 117 Par exemple M. Héry de l'INRS ou M. Piotto de l'ESTP, au cours de la table ronde du 29 juin 2005 118 « Soyez rassurés, nous travaillons aussi avec la caisse régionale d'assurance maladie ou l'OPPBTP, l'Office professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Mais la temporalité s'allonge et il n'est guère évident de maintenir la mobilisation de tous : l'essentiel est donc d'agir sur le terrain, quotidiennement, pour limiter l'exposition des salariés, d'autant que, depuis les études de l'INSERM publiées en 1996, il semble que des expositions faibles peuvent être dangereuses. » (audition du 5 juillet 2005) 119 Cf. infra : 2ème Partie - III - C 120 Cf. infra : 2ème Partie - III - A 121 Même les matériaux d'amiante lié libèrent en grand nombre des fibres, dès lors qu'ils sont sciés, meulés, percés, ou cassés 122 On notera cependant que si le chef d'entreprise ou son équipe repère de l'amiante à l'occasion du chantier, il doit en informer le propriétaire (3° de l'article 27 du décret 96-98). 123 Audition du 6 juillet 2005 124 Audition du 22 juin 2005. 125 Audition du 22 juin 2005 126 Cette hypothèse a été évoquée par M. Éric Jany : « Même si l'on en parle dans les journaux et si les gens sont réellement sensibilisés aux dangers liés à l'amiante, ils n'imaginent pas qu'il puisse y en avoir dans leur entreprise et qu'ils pourraient y être exposés. Il m'a été ainsi donné d'aller contrôler une grande entreprise sur un tout autre sujet. À la fin de ma visite, j'ai évoqué la question de l'amiante, mais surtout par acquit de conscience, car il s'agissait d'une entreprise informatique qui, a priori, ne fournissait que des prestations intellectuelles. La directrice des ressources humaines m'a alors demandé s'il leur fallait en faire autant lorsqu'ils intervenaient chez un client. En réalité, cette entreprise, occasionnellement, tirait des câbles dans des faux plafonds... En fait, les salariés étaient bel et bien exposés. Mon intervention était donc parfaitement justifiée et les responsables ont aussitôt engagé les démarches nécessaires 127 Audition du 22 juin 2005 128 Interrogé par le Rapporteur sur la fréquence de telles découvertes, M. Jean a fourni la réponse suivante : « Très souvent ! Mais cela peut se comprendre et ce n'est pas dramatique quand c'est une entreprise spécialisée qui s'en aperçoit. Les conséquences peuvent être beaucoup plus graves si cela se produit à l'occasion de travaux de maintenance. » (table ronde du 29 juin 2005) 129 Audition du 5 octobre 2005 130 M. Dominique Florio a ainsi décrit une situation déséquilibrée pour le propriétaire : « Nous intervenons sur des chantiers de tailles très différentes, du palais de Chaillot au pavillon, pour y enlever des dalles de sol thermoplastiques. Nous sommes sollicités toutes les semaines par des particuliers faisant état d'un problème d'amiante mais nos prix, sur ce marché, ne sont pas compétitifs. En effet, pour enlever trois mètres carrés de dalles thermoplastiques et de colle, avec un ouvrier, une heure de travail suffit. En revanche, en désamiantage, trois personnes au minimum sont nécessaires : un gardien de sas et deux personnes en zone. Nous n'avons d'autre choix que de répercuter le coût financier sur le particulier et ce n'est pas jouable : nous remettons des devis mais nous ne sommes jamais retenus. Soit le particulier opère tout seul en utilisant un masque, après quoi je récupère le sac de déchets et je le traite, soit je fais le travail moi-même. » (audition du 12 juillet 2005) 131 Peuvent en témoigner les 19 agents de maintenance de l'hôpital Saint-Louis à Paris qui souffrent d'une pathologie liée à l'amiante (cf. table ronde du 06.07.2005). 132 Audition du 22 juin 2005 133 Table ronde du 29 juin 2005 134 Par exemple, M. Christian Cochet : « S'agissant des professionnels du bâtiment exposés à de l'amiante au cours de travaux fortuits, nous sommes face à un défi majeur, pour lequel il n'existe pas vraiment de solution pratique. Le même problème se pose, du reste, pour l'exposition au plomb, qui comporte des risques du même ordre. L'information et la formation constituent la base de la réponse, à condition que les programmes soient rigoureux et très volontaristes. Cela doit faire partie de l'apprentissage de la pratique professionnelle dispensée durant la formation initiale. Pour les opérateurs en activité, c'est plus difficile, d'autant que, contrairement aux sociétés agissant en atmosphère confinée, il s'agit le plus souvent d'entreprises unipersonnelles, d'artisans, qui échappent, pour partie, aux programmes de formation. Faire passer ces messages, créer des réflexes constitue un vrai enjeu. » (table ronde du 29 juin 2005) 135 Audition du 6 juillet 2005 136 Mme Rose-Marie Van Lerberghe, directrice générale de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, a insisté sur la dimension émotionnelle de la question de l'amiante dans les locaux destinés à l'usage du public : « Il ne faut donc rien minimiser, mais je crois qu'il y a aussi un risque de dérive émotionnelle : des gens qui passent sous une dalle ont peur d'être contaminés par une maladie qu'ils assimilent au sida. Ce n'est pas bien. » (table ronde du 6 juillet 2005) 137 Table ronde du 6 juillet 2005 138 Dans le cas de l'AP-HP, la direction a dû réagir au développement de pathologies liées à l'amiante au sein de son personnel de maintenance 139 Voir annexe n° 7 pour la gestion de l'amiante à l'Assemblée nationale 140 Table ronde du 6 juillet 2005 141 Annexe n° 2 142 Les réponses se décomposent ainsi : 150 relèvent de l'Association des maires de France, 24 de l'Association des maires des grandes villes, 16 de l'Association des maires des villes moyennes, 10 de l'Association des petites villes de France, mais 60 questionnaires renvoyés directement concernent également des petites ou très petites communes. 143 Table ronde du 6 juillet 2005 144 Audition conjointe de Mme Isabelle Martin, directrice de la prospective et de la veille réglementaire de la société SITA France Déchets, et de M. Christophe Cauchi, chef de centre du site de classe 1 de Villeparisis (13 juillet 2005). 145 Circulaire n° 2005-18 UHC/QC2 du 22 février 2005 relative à l'élimination des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes 146 Audition de M. Hervé Vanlaer, sous-directeur des produits et des déchets au ministère de l'écologie et du développement durable (12 juillet 2005) 147 Directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 148 Directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 149 Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 150 Audition de M. Hervé Vanlaer, sous-directeur des produits et des déchets au ministère de l'écologie et du développement durable (12 juillet 2005) 151 M. Christophe Cauchi, chef de centre du site de classe 1 de Villeparisis (SITA France Déchets), Audition du 13 juillet 2005. 152 Audition de M. Hervé Vanlaer, sous-directeur des produits et des déchets au ministère de l'écologie et du développement durable (12 juillet 2005) 153 Audition de M. Didier Pineau, président-directeur général d'Europlasma, et de M. Patrice Blanchot, responsable du développement de la société Inertam-Cofal Europlasma (13 juillet 2005). 154 Audition du 13 juillet 2005 155 Il convient de rappeler qu'Europlasma est une société cotée en bourse. 156 Mme Isabelle Martin, directrice de la prospective et de la veille réglementaire de la société SITA France Déchets (Audition du 13 juillet 2005). 157 Table ronde sur la gestion de l'amiante résiduel dans le patrimoine public (6 juillet 2005). 158 Le drame de l'amiante en France (rapport n°37, 2005-2006, pp 229 à 241) 159 Bureau de recherche géologique et minière 160 Audition du 25 octobre 2005 161 Cf. infra 1ère partie - III 162 À elle seule, l'île est la cinquième productrice mondiale de nickel. 163 Cf. 2ème partie : Les leçons à tirer de l'amiante 164 Les renseignements collectés par la Direction générale du trésor et de la politique économique prennent également en compte les cas des États-Unis et du Canada. Un tableau résumant les principaux enseignements de cette recherche a été inséré en annexe n° 3 du présent rapport 165 Rencontre du vendredi 2 décembre 2005 à Bruxelles 166 CES : Confédération européenne des syndicats 167 CJCE, 16 sept 97, Commission c/ Italie, C-279/94 168 CJCE : Cour de justice des communautés européennes 169 La Direction générale entreprises et industrie a cependant précisé que, pour les États devenus membres de l'UE en 2004, les instruments de pré-adhésion contenaient tout un dispositif destiné à accompagner la mise en œuvre de la législation communautaire relative à l'amiante. 170 Conclusions du Conseil du 7 avril 1998 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante (98/C 142/01) 171 Avis du Comité économique et social sur l'amiante, 24 mars 1999, JOCE n° C 138 du 18 mai 1999, p. 24 172 Directive 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles 173 La directive sur les chantiers mobiles a été prise en vertu de l'article 118A du Traité, repris, par le Traité d'Amsterdam, dans le dispositif de l'actuel article 137 174 Recommandation n° 2003/134/CE du Conseil du 18 février 2003 portant sur l'amélioration de la protection de la santé et de la sécurité au travail des travailleurs indépendants 175 Pour M. Laurent Vogel (Confédération européenne des syndicats), il est évident que certaines directions générales sont plus influentes que d'autres. A titre d'exemple, en 1998, la Commission s'est opposée à l'adoption en Suède de mesures qui interdisaient la plupart des usages du trichloréthylène. Personne ne niait les risques importants de cette substance pour la santé humaine. Mais les services de la Commission chargés de la santé au travail ne faisaient pas le poids face aux arguments de la DG industrie qui avait décidé d'appuyer les milieux industriels hostiles à une telle mesure. Heureusement, la Cour de justice a donné tort à la Commission et a soutenu la position suédoise (CJCE, 11 juillet 2000, Kemikalieinspektionen c/ Toolex Alpha AB ; C-473/98) 176 Le principe de subsidiarité, inscrit à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne, consiste à réserver à l'échelon supérieur ce que l'échelon inférieur ne pourrait effectuer que de manière moins efficace. 177 http://www.btinternet.com/~ibas/Frames/sf_content_current_bans.htm 178 Les données de ce tableau ont été fournies à la mission d'information par le sénateur belge Alain Destexhe. Elles sont extraites du rapport de Robert L. Vita parue dans US Geological survey minerals yearbook 2003 179 HESA Newsletter, n° 27, juin 2005, dossier spécial « L'amiante dans le monde », p. 9 180 Les données de ce tableau ont été fournies à la mission d'information par le Sénateur belge Alain Destexhe. Elles sont extraites du site www.icongrouponline.com (ICOM Group Ltd., copyright 2003) 181 Les données de ce tableau ont été fournies à la mission d'information par le sénateur belge Alain Destexhe. Elles sont extraites du site www.icongrouponline.com (ICOM Group Ltd., copyright 2003) 182 Laurie Kazan-Allen, "Canadian Asbestos : A Global Concern" in International Journal of Occupational Environmental Health, Vol. 10, n° 2, avril-juin 2004, p. 121 183 Asbestos est la traduction anglaise du mot "amiante". 184 http://www.parl.gc.ca/committee/CommitteePublication.aspx?COM=8979&Lang=2&SourceId=131782 185 Gouvernement du Québec, « Politique d'utilisation accrue et sécuritaire de l'amiante chrysotile au Québec », juin 2002 (http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/ministere/politique/politique-amiante.pdf 186 La note que l'Ambassade du Canada a remise à la mission d'information insiste d'ailleurs sur cet argument : « contrairement à ce qui est affirmé dans certains milieux, personne ne peut prétendre que tout est connu sur les effets de l'amiante sur la santé et, a fortiori, dès le début du siècle dernier. Selon cette hypothèse, le niveau de connaissance sur les effets des autres fibres est encore moindre La tendance des travaux scientifiques les plus récents va donc plutôt dans le sens d'une réactualisation de l'évaluation relative des risques liés à l'ensemble des fibres techniques. Dans ce contexte, le Canada juge pertinentes ses requêtes, tant à l'Organisation mondiale de la Santé qu'au Centre International de Recherche sur le Cancer, visant à ce que soient effectuées des évaluations comparatives de risques entre le chrysotile et les autres fibres, et maintient sa politique d'usage strictement contrôlé et sécuritaire du chrysotile ». 187 Voir la brochure « Quelle logique appliquent ceux qui militent contre l'amiante ? » sur le site de l'Institut du Chrysotile : http://www.chrysotile.com/data/Ban_Asbestos_fr.pdf 188 Le dossier « L'amiante au banc des accusés » consultable dans les archives de Radio-Canada offre un panorama très intéressant des crises liées à l'amiante vues du Québec : http://archives.radio-canada.ca/IDD-0-16-665/sciences_technologies/amiante/ 189 Mme Annie Thébaud-Mony, audition du 14 décembre 2005 190 HESA Newsletter, n° 27, juin 2005, dossier spécial « L'amiante dans le monde », p. 15 191 Un article paru dans l'International Journal of Occupational Environmental Health (vol. 10, n° 2, avril-juin 2004, p. 123) relate qu'en 1982, le Président de la Société Nationale de l'Amiante (Québec) avait déclaré, au cours d'un symposium international à Montréal, que l'espérance de vie dans les pays en développement ne dépassant pas 35 ans, la plupart de leurs habitants seraient morts d'autres causes avant que les maladies liées à l'amiante ne les touchent... 192 Mme Annie Thébaud-Mony, audition du 14 décembre 2005 193 End of life ships, the human cost of breaking ships, décembre 2005 (http://www.fidh.org/IMG/pdf/shipbreaking2005a.pdf, (en anglais seulement). 194 Audition du 14 décembre 2005 195 Audition du 14 décembre 2005 196 Voir le compte rendu de l'audition de l'Amiral Alain Oudot de Dainville dans le second tome du présent rapport (audition du mercredi 8 février 2006). 197 Il est intéressant de relever que les associations écologistes ne sont pas toutes unanimes vis-à-vis de l'envoi du Clemenceau en Inde. Si certaines d'entre elles s'y opposent fermement (Greenpeace, Ban Asbestos, FIDH, Andeva...), l'association Robin des Bois estime qu'« on se trompe de guerre » et qu'attaquer les conditions du démantèlement du Clemenceau n'est pas la bonne stratégie car c'est la première fois qu'un navire est partiellement désamianté avant d'être envoyé en Inde et c'est également la première fois qu'une entreprise supervisant le chantier indien s'engage sur les conditions de travail des ouvriers qui mettront en pièces le bateau. Greenpeace elle-même reconnaît qu'elle avait « besoin d'un symbole pour une vraie remise en cause de la filière de déconstruction des navires » (Le Figaro, lundi 13 février 2006). 198 Il est notamment prévu un suivi médical des cadres et des ouvriers indiens par le biais d'examens médicaux qui interviendront dès le début du chantier et après un an de travaux. La mission d'information a pris acte de cette mesure mais a toutefois rappelé au chef d'État-major de la Marine que les caractéristiques propres aux pathologies de l'amiante rendent nécessaire un allongement de la période au cours de laquelle auront lieu les examens médicaux prévus. 199 C'est donc le consortium SDI qui finance le remorquage du navire, qui a payé son passage dans le canal de Suez (1,5 millions de dollars américains) et qui a la charge du désamiantage et du démantèlement. 200 M. Francis Vallat, président de l'Institut français de la Mer, Le « Clem », démolition exemplaire, Le Monde 21 février 2006 201 Rappelons que la décision que le Conseil d'État a prise le 15 février dernier ne concerne pas le « fond » du dossier, lequel devra être prochainement examiné par le tribunal administratif de Paris. Néanmoins, les débats devant la plus haute juridiction administrative de notre pays, et notamment les conclusions de son commissaire du Gouvernement, ont montré que les arguments s'opposant au transfert, en Inde, du Clemenceau doivent être pris au sérieux et sont loin de rendre improbable une annulation de la décision. 202 Contribution écrite remise par l'Amiral Alain Oudot de Dainville, chef d'État-major de la Marine, à l'issue de son audition du 8 février 2006. 203 Site internet du Premier ministre (www.premier-ministre.gouv.fr) 204 Contribution écrite remise par l'Amiral Alain Oudot de Dainville, chef d'État-major de la Marine, à l'issue de son audition du 8 février 2006. 205 La filière qui sera créée pourra également concerner des matériels militaires autres que les navires. 206 Le chantier Able UK à Hartlepool, au Royaume-Uni, initialement retenu pour accueillir quatre unités de l'US Navy, est actuellement fermé suite aux actions judiciaires menées par plusieurs associations écologistes contestant sala qualification. 207 Rappelons que la Russie représente un peu plus de 20 % des exportations mondiales. 208 Résolution du 5 octobre 2000 sur la prévention des risques dérivés de l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante 209 M. Alain Destexhe, note remise à la mission le 2 décembre 2005. 210 HESA Newsletter, n° 27, juin 2005, dossier spécial « L'amiante dans le monde », p. 9 211 R. Ruers et N. Shouten, The tragedy of asbestos. Eternit and the consequences of a hundred years of asbestos cement, septembre 2005 212 Audition de Mme Annie Thébaud-Mony, mercredi 14 décembre 2005 213 HESA Newsletter, n° 27, juin 2005, dossier spécial « L'amiante dans le monde », p. 21 214 Conseil constitutionnel, décision n° 59-2 DC du 17 juin 1959, Règlement de l'Assemblée nationale 215 Le FCAATA a été mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 1999 216 Le FIVA a été créé par la LFSS pour 2001 217 INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale 218 Table ronde du 14 septembre 2005 219 LEPI : Laboratoire d'études des particules inhalées de la ville de Paris 220 Audition du 28 juin 2005 221 Audition du 26 octobre 2005 222 Archives des Maladies Professionnelles 2003,64 n° 4, p. 282 223 Par exemple l'audition du 2 novembre 2005 de M. Raymond Clavier, président de l'association de défense des fonctionnaires territoriaux du Languedoc-Roussillon victimes de l'amiante 224 Table ronde du 14 septembre 2005 225 Communication de la Cour des comptes à la commission des affaires sociales du Sénat relatif à l'indemnisation des conséquences de l'utilisation de l'amiante (les fonds d'indemnisation et les dépenses de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général, mars 2005) 226 J. Ameille et M. Letourneux, réf. 16-002-A-14, 1997 227 Audition du 11 octobre 2005 228 Table ronde du 14 septembre 2005 229 Audition du 28 juin 2005 230 CRRMP : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles 231 Table ronde du 14 septembre 2005 232 Audition du 11 octobre 2005 233 Audition du 11 octobre 2005 234 Audition du 13 décembre 2005 235 Table ronde du 14 septembre 2005 236 PSA : Prostatic Specific Antigen (antigène spécifique de la prostate en français) 237 Audition du 11 octobre 2005 238 Le programme national de surveillance du mésothéliome, mis en place au sein de l'IVS 239 La section I (activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l'amiante) n'a plus qu'un intérêt historique depuis l'interdiction de l'amiante à compter du 1er janvier 2007. 240 Décret n° 93-644 du 26 mars 1993, modifié par le décret n° 95-16 du 4 janvier 1995 241 Audition du 25 octobre 2005 242 Disponible sur www.invs.sante.fr/publications/rapport_espace/index.htm 243 Espaces : études sur le suivi post-professionnel amiante dans les centres d'examens de santé 244 Spirale : Suivi post-professionnel individuel des travailleurs exposés 245 Espri : Épidémiologie et surveillance des professions indépendantes 246 Entretien avec M. Marcel Suszwalak, président de l'APDACGT 247 Audition du 26 octobre 2005 248 Audition du 26 octobre 249 M. Alain Bobbio, audition du 25 octobre 2005 250 Audition du 26 octobre 251 Audition du 24 janvier 2006 252 Table ronde du 23 novembre 2005 253 La première fois, dans l'affaire Drouet où le TGI de Cherbourg a accordé par jugement en date du 25 mars 1999, "Drouet contre Fonds de garantie", à M. Drouet, mécanicien de la Marine nationale, atteint de mésothéliome, une indemnisation de 980 000 francs qui fut ensuite confirmée par la cour d'appel de Caen, puis par la Cour de cassation le 1er décembre 2000. Par ailleurs, fin 2001, la chambre civile de la cour d'appel de Paris a reconnu que la contamination des agents de Jussieu résultait de faits présentant le caractère matériel d'une infraction pénale et a indemnisé les victimes en conséquence. 254 L'article 53 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2001 mettant en place le FIVA a prévu que les demandes d'indemnisation des préjudices en cours d'instruction devant les CIVI seraient transmises au FIVA. 255 Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 256 Avoir contracté une maladie professionnelle liée à l'amiante ou travailler ou avoir travaillé dans un des établissements figurant sur des listes fixées par arrêtés interministériels pendant une période donnée, la durée d'exposition conditionnant également l'âge de départ en retraite 257 Communication de la Cour des comptes à la commission des affaires sociales du Sénat relatif à l'indemnisation des conséquences de l'utilisation de l'amiante (les fonds d'indemnisation et les dépenses de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général, mars 2005) 258 CCMSA : Caisses centrales de la mutualité sociale agricole 259 Audition du 8 novembre 2005 260 Audition du 25 octobre 2005 261 Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 262 Loi 2001-1246 du 21 décembre 2001 263 Circulaire DSS 2C 369 du 27 juin 2002 264 Loi n° 2002-1487 du 21 décembre 2002 265 Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 266 Audition du 8 novembre 2005 267 Audition du 9 novembre 2005 268 Audition du 8 novembre 2005 269 M. Raymond Clavier, audition du 2 novembre 2005 270 M. Marc Letourneux, audition du 26 octobre 2005 271 Audition du 25 octobre 2005. 272 Audition du 25 octobre 2005 273 Audition du 8 novembre 2005 274 La circulaire de la direction des relations du travail du 6 février 2004 a renforcé l'échelon local lors de la phase d'enquête. 275 Audition du 26 octobre 2005 276 Audition du 17 janvier 2006 277 Audition du 24 janvier 2005 278 Audition du 26 octobre 2005 279 Audition du 28 juin 2006 280 Audition du 14 décembre 2005 281 Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 282 Audition du 8 novembre 2005 283 Audition du 27 septembre 2005 284 La nouvelle dénomination du FGA, issue de la loi du 1er août 2003, est le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) 285 Audition du 2 novembre 2005 286 Audition du 2 novembre 2005 287 Audition du 9 novembre 2005 288 Audition du 25 octobre 2005 289 Rapport d'information n° 301, « Amiante quelle indemnisation pour les victimes » 290 ONIAM : Office national d'indemnisation des accidents médicaux 291 Rapport d'information n° 301, « Amiante quelle indemnisation pour les victimes » 292 M. Alain Bourdelat, audition du 2 novembre 2005 293 Source FGAO 294 Audition du 8 novembre 2005 295 Audition du 2 novembre 2005 296 Audition du 8 novembre 2005 297 M. Alain Bourdelat, directeur général du FGAO, a indiqué lors de son audition, le 2 novembre 2005, que le FGAO parvenait, en se donnant beaucoup de mal, à obtenir le remboursement de 16 à 17 % des sommes versées. 298 Arrêt du 3 mai 2004 299 Source FIVA 300 Source FIVA 301 Une Cour d'Appel est dite favorable au barème du FIVA lorsque ses arrêts confirment l'offre du FIVA 302 Audition du 8 novembre 2005 303 Audition du 26 octobre 2005 304 Rapport d'information n° 301, « Amiante quelle indemnisation pour les victimes » 305 4ème rapport d'activité du FIVA au Parlement et au gouvernement, juin 2004/mai 2005 306 Article 53.IV.2 de la loi du 23 décembre 2000 307 Audition du 8 novembre 2005 308 Recommandation 5 : « Permettre au FIVA d'accorder aux victimes de maladies malignes causées par l'amiante le bénéfice des conséquences qui s'attachent à la faute inexcusable de l'employeur sans qu'il soit nécessaire qu'elles, ou le FIVA, recourent à la voie judiciaire » 309 Audition du 26 octobre 2005 310 Audition du 25 octobre 2005 311 Loi du 23 décembre 1998 modifiée par l'article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale du 29 décembre 1999 312 Cour de cassation, chambre sociale 19 décembre 2002 : la Cour impose aux CPAM de communiquer à l'employeur toute une série d'informations : date de la fin de la procédure, éléments susceptibles de leur faire grief, possibilité de consulter le dossier, date de sa décision, ... 313 Source FIVA 314 Audition du 8 novembre 2005 315 La modernisation de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles 316 Réflexions et propositions relatives à la réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles 317 Vers la réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles 318 La rénovation de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles 319 Prévision 320 Rapport du Gouvernement au Parlement présentant l'impact financier de l'indemnisation des victimes de l'amiante pour l'année en cours et pour les vingt années suivantes (2003) 321 Audition du 9 novembre 2005 322 Audition du 15 novembre 2005 323 JJ. Dupeyroux, un Deal en Béton. Droit social, juillet/août 1998. 324 Maître Arnaud Lyon Caen, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, a qualifié la novation des arrêts du 28 février de « révolution dans le droit des accidents du travail », in : Droit social, n° 4, avril 2002, p. 445-447 325 Table ronde du 23 novembre 2005 326 Table ronde du 23 novembre 2005 327 Audition du 25 octobre 2005 328 Table ronde du 23 novembre 2005 329 M. Pierre Sargos, président de la chambre sociale de la Cour de cassation, table ronde du 23 novembre 2005 330 Table ronde du 23 novembre 2005 331 Table ronde du 23 novembre 2005 332 http://www.justice.gouv.fr/publicat/rapport-dommage-corporel.pdf 333 Table ronde du 23 novembre 2005 334 M. Roger Beauvois, audition du 8 novembre 2005 335 M. Michel Ledoux, audition du 5 novembre 2005 336 Table ronde du 23 novembre 2005 337 IPP : Incapacité permanente partielle 338 Audition du 8 novembre2005 339 Table ronde du 23 novembre 2005 340 Table ronde du 23 novembre 2005 341 Table ronde du 23 novembre 2005 342 Accidents du travail - maladies professionnelles : réparation forfaitaire ou intégrale 343 Table ronde du 23 novembre 2005 344 Audition du 15 novembre 2005 345 Audition du 9 novembre 2005 346 Tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, rapport n° 2004-17 présenté par Pierre-Louis Bras et Valérie Delahaye-Guillocheau, novembre 2004 347 Audition du 25 octobre 2005 348 Table ronde du 23 novembre 2005 349 Audition du 15 novembre 2005 350 Table ronde du 23 novembre 2005 351 Maître Ledoux, audition du 9 novembre 2005 352 Me Ledoux, audition du 9 novembre 2005 353 Me Teissonnière, audition du 9 novembre 2005 354 Table ronde du 23 novembre 2005. On peut également citer par exemple Maître Teissonnière : « Les arrêts de la chambre sociale ne contenaient pas moins qu'un appel, en filigrane, à revoir un mécanisme remontant à la loi sur les accidents du travail du 9 avril 1898, étendue aux maladies professionnelles en 1919. » (audition du 9 novembre 2005) ou encore M. François Desriaux (ANDEVA) « l'évolution de la notion est telle qu'il vaudrait peut-être mieux renoncer au terme de « faute inexcusable » (Table ronde du 23 novembre 2005). 355 Le délit de mise en danger de la vie d'autrui a été introduit dans le nouveau code pénal par la loi de 1993 et est applicable depuis le 1er mars 1994 356 Audition du 6 novembre 2005 357 Audition du 6 novembre 2005 358 L'article 575 du code de procédure pénale pose le principe de l'irrecevabilité du pourvoi de la seule partie civile contre les arrêts de la chambre de l'instruction 359 « Attendu que, malgré une prise de conscience ancienne de la dangerosité de l'amiante dans certains pays anglo-saxons et dans quelques travaux scientifiques français isolés, il ressort de l'information que les pouvoirs publics français ont fait le choix de l'utilisation contrôlée de l'amiante et que ce n'est qu'au milieu des années 90 qu'un changement d'attitude est intervenu ; (...) « qu'il apparaît en effet qu'aucune étude ou enquête d'envergure n'a été demandée aux services de l'Etat ou aux organismes publics ou parapublics ni diligentée par les pouvoirs publics pour vérifier les liens entre l'inhalation d'amiante et les affections cancéreuses jusqu'à celle commandée à l'INSERM en 1995 » (CA Douai, chambre de l'instruction, 15 juin 2004, Michel Betous et autres) 360 CE Contentieux, 03-03-2004, n° 241151, Ministre de l'emploi et de la solidarité c/ consorts Botella 361 Audition du 15 novembre 2005 362 TA Marseille, du 30-05-2000, n° 97-5988, M. et Mme Botella et autres 363 Audition du 15 novembre 2005 364 Cf. infra 2.C. 365 Responsabilité et socialisation du risque, rapport public 2005. 366 Cf. supra 1.C. 367 Pour une description du compromis de 1898, cf. 2.A 368 Loi du 9 avril 1898 relative aux responsabilités dans les accidents du travail 369 Cette avancée du droit du travail, quoique novatrice, n'est pourtant pas isolée à la fin du XIXème siècle. Ainsi dès 1895 (CE, 21 juin 1895, Cames), le Conseil d'Etat a entrepris de bâtir un régime d'indemnisation des dommages causés par l'Etat sans que celui-ci n'ait commis de faute Ce régime connaîtra son aboutissement avec le principe de responsabilité sans faute de l'administration pour rupture de l'égalité devant les charges publiques (CE, 30 novembre 1923, Couiteas). 370 Art. L. 142-1, code de la sécurité sociale 371 Me Ledoux a indiqué qu'avant l'affaire de l'amiante « on n'avait quasiment jamais vu de faute inexcusable assise sur des maladies professionnelles » (audition du 9 novembre 2005) 372 Code de la sécurité sociale, article L. 452-3 : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 p. 100, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » 373 Art. L. 452-2, code de la sécurité sociale 374 Table ronde du 23 novembre 2005 375 « La nouvelle jurisprudence a permis de résoudre dans l'urgence les problèmes nés du drame de l'amiante, et a répondu à la nécessité d'assurer une meilleure réparation. » ; Pierre Sargos ; Table ronde du 23 novembre 2005 376 Me Ledoux, audition du 9 novembre 2005 377 Table ronde du 23 novembre 2005 378 Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail 379 P. Ollier, Rapport annuel de la Cour de cassation - 2002 380 Table ronde du 23 novembre 2005 381 M. Sargos, table ronde du 23 novembre 2005 382 Table ronde du 23 novembre 2005 383 Voir le compte-rendu de la table ronde du 23 novembre 2005. 384 Audition du 9 novembre 2005 385 Afin d'éviter que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets ; cf supra 2.A. 386 Art. L. 451-1 du code de la sécurité sociale 387 Audition du 9 novembre 2005 388 « L'évolution de la notion est telle qu'il vaudrait peut-être mieux renoncer au terme de « faute inexcusable » », a d'ailleurs reconnu M. Desriaux, de l'ANDEVA au cours de la table ronde du 23 novembre 2005 389 Responsabilité et socialisation du risque, précité 390 Table ronde du 23 novembre 2005 391 M. Sargos, table ronde du 23 novembre 2005 392 Audition du 9 novembre 2005 393 M. Sargos, table ronde du 23 novembre 2005 394 Table ronde du 23 novembre 2005 395 Audition du 9 novembre 2005 396 Table ronde du 23 novembre 2005 397 « Responsabilité et socialisation du risque », rapport du Conseil d'Etat précité 398 Audition du 6 décembre 2005 399 Audition du 29 novembre 2005 400 Résolution tendant à la création d'une commission d'enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement, adoptée par l'Assemblée nationale le 7 décembre 2005 401 Responsabilité et socialisation du risque, précité 402 Audition du 13 décembre 2005. On précisera cependant que, contrairement à ce que soutient M. Muller, et comme il a été décrit précédemment (voir supra 2.B.1.), l'affaire n'a pas donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel, le juge d'instruction de Dunkerque ayant rendu une ordonnance de non lieu à saisir celui-ci. 403 Audition du 6 décembre 2005 404 Voir le fonctionnement du FIVA, supra 1ère partie ; 3 405 Audition du 29 novembre 2005. 406 « Parce que dans une société civilisée, s'il n'y pas de faute pénale sans volonté de la commettre, il convient quand même de créer des exceptions pour nous contraindre tous à la prudence. La menace d'une amende non couverte par l'assurance, voire la menace de la prison, est une nécessité. », audition du 29 novembre 2005. 407 Audition du 6 décembre 2005 408 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 16 : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » 409 « Considérant qu'il résulte de l'article 53 de la loi déférée que le législateur a entendu garantir aux victimes « la réparation intégrale de leurs préjudices » tout en instituant une procédure d'indemnisation simple et rapide ; que la personne qui a choisi de présenter une demande d'indemnisation devant le fonds a la possibilité d'introduire un recours devant la cour d'appel si sa demande a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois ou encore si elle a rejeté l'offre qui lui a été faite ; qu'en toute hypothèse, la décision de la cour d'appel pourra faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; que les dispositions du dernier alinéa du IV de l'article 53, relatives au désistement et à l'irrecevabilité des actions en réparation, s'entendent compte tenu de celles de son deuxième alinéa ; que les actions juridictionnelles de droit commun demeurent ouvertes, aux fins de réparation, aux personnes qui ne saisissent pas le fonds ; qu'enfin, la victime conserve la possibilité de saisir la juridiction pénale ; qu'ainsi, les dispositions contestées, qui trouvent leur justification dans la volonté de simplifier les procédures contentieuses, d'éviter qu'un même élément de préjudice ne soit deux fois indemnisé et d'énoncer clairement les droits des victimes, ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen » Décision n° 2000-437 DC - 19 décembre 2000 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2000/2000437/2000437dc.htm) 410 « La Cour relève que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire, ce qui signifie que la Cour de cassation ne rejuge pas les affaires dont elle est saisie au fond, mais ne peut que sanctionner une violation de la loi par l'annulation totale ou partielle de la décision attaquée. Le pourvoi en cassation est ouvert en matière pénale à toutes les personnes parties au procès qui ont un intérêt à la cassation. Si la recevabilité du pourvoi de la partie civile est, en dehors de sept cas limitativement énumérés, subordonnée à l'existence d'un pourvoi formé par le ministère public, cette limitation résulte de la nature des arrêts rendus par les chambres de l'instruction et de la place dévolue à l'action civile dans le procès pénal. La Cour ne saurait admettre que la partie civile doive disposer d'un droit illimité à l'exercice du pourvoi en cassation contre les arrêts de non-lieu (...) Enfin, la Cour relève que la possibilité s'offrait à la requérante de poursuivre devant les juridictions civiles la société contre laquelle elle avait porté plainte. » CEDH, deuxième section, affaire Berger c. France, 3 décembre 2002 411 Audition du 29 novembre 2005 412 Rapport d'information fait au nom de la mission commune d'information sur le bilan et les conséquences de la contamination par l'amiante ; p115-116 413 Audition du 6 décembre 2005 414 Ce constat a été étayé par la contribution écrite communiquée à la mission par Mme Bertella-Geoffroy, juge d'instruction du pôle santé de Paris : « Je dois vous préciser qu'aucun des dossiers de santé publique que j'ai traités ou que je traite actuellement (sang contaminé, hormone de croissance, vache folle, syndrome de la guerre du Golfe, Tchernobyl, vaccin anti-hépatite B, amiante) n'a été ouvert sur initiative du Parquet. Ces ouvertures d'informations avec nomination d'un juge d'instruction ont toujours été effectuées sur initiative des victimes elles-mêmes par le moyen de la constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal du lieu des infractions. » 415 Audition du 25 octobre 2005 416 Audition du 30 novembre 2005 417 Audition du 6 décembre 2005 418 Audition du 6 décembre 2005 419 Audition du 6 décembre 2005 420 Audition du 18 janvier 2006 421 Audition du 6 décembre 2005 422 Me Teissonnière, audition du 30 novembre 2005 423 Audition du 6 décembre 2005 424 Audition du 18 janvier 2006 425 Audition du 30 novembre 2005 426 Audition du 6 décembre 2005 427 Me Teissonnière, audition du 30 novembre 2005 : « Dans les affaires civiles, avec les arrêts du 28 avril 2002 et la redéfinition de la faute inexcusable, nous sommes plutôt sortis par le haut : l'affaire de l'amiante n'aura pas été inutile sur ce plan. Nous souhaiterions qu'il en soit de même dans le domaine pénal et que l'on puisse en tirer les leçons. » 428 Audition du 30 novembre 2005 429 Audition du 18 janvier 2006 430 Audition du 6 décembre 2005 431 Audition du 6 décembre 2005 432 Audition du 29 novembre 2005 433 Audition du 6 décembre 2005 434 Audition du 18 janvier 2006 435 Article 2-18 du code de procédure pénale : « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de défendre ou d'assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal commises à l'occasion d'une activité professionnelle, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. ». 436 « Lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15000 euros. » 437 M. Michel Parigot, audition du 2 novembre 2005 438 « J'ai souvent entendu : « nous voulons un procès pénal "de l'amiante" ». Mais les juges ne jugent pas « l'amiante ». Ils jugent le dommage causé à M. Untel, précisément identifié, qui a travaillé dans telle entreprise, de telle date à telle date. Qui était le responsable pénal de cette entreprise à ce moment-là ? Quelle était la réglementation applicable à ce moment-là ? » (Audition du 6 décembre 2005) 439 cf. infra 2ème partie - III 440 Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels 441 Article 121-3 du code pénal, al. 1 442 Audition du 29 novembre 2005 443 Dans son rapport fait au nom de la commission des lois sur la loi du 10 juillet 2000 (n°2266) : « Sans doute n'est-il pas contestable que l'intention se situe au sommet de la culpabilité : telle est la philosophie du droit pénal, qui oriente la répression vers les comportements procédant d'une détermination marquée et certaine. Mais le législateur a clairement souhaité que la sanction pénale s'applique également à des fautes non intentionnelles, en cas d'atteinte aux valeurs essentielles de la société. Réduire le rôle du droit pénal à la répression des fautes commises volontairement est une vision dépassée (...).» 444 Loi n°96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence 445 M Fauchon a expressément confirmé cette explication lors de son audition du 29 novembre 2005 : « dans la jurisprudence de la Cour de cassation, les accidents de la circulation relèvent toujours de la causalité directe. Le fait de limiter la portée de la loi aux seules causes indirectes du dommage nous permettait donc d'atteindre notre objectif de ne pas toucher au régime des accidents de la circulation. » 446 On citera à cet égard le rapport de M. Dosière, en première lecture à l'Assemblée nationale : « (...) si la distinction entre le lien direct et le lien indirect peut sembler intellectuellement très claire, il sera parfois difficile, en pratique, de tracer une frontière nette entre ces deux types de situations. (...) Il est vrai que la notion de lien direct n'avait pas, jusqu'à présent, de conséquence juridique, et qu'il n'est pas forcément étonnant, dans ces conditions, qu'elle soit utilisée de façon peu précise par les juridictions répressives (...). Dès lors qu'une distinction très nette sera opérée dans la loi entre causalité directe et causalité indirecte, le lien sera sans doute apprécié de façon plus précise par les juridictions, sous le contrôle de la Cour de cassation. Il convient, cependant, afin de limiter de possibles hésitations jurisprudentielles, d'être particulièrement précis quant à l'intention réelle du législateur, ce qui suppose, en premier lieu, de définir clairement la notion d'« auteur indirect ». » 447 N° 2528, 11ème législature 448 C'est notamment le cas des avocats des victimes, Maître Teissonnière citant à l'appui de son propos une affaire étonnante : « Prenez le cas de cet accident survenu à Toul où une grue s'était effondrée sur une école, tuant plusieurs jeunes filles dans la cour. Le vent soufflait très fort, mais, pour des raisons économiques, il n'était pas question d'interrompre le chantier. Le grutier refuse de monter dans sa grue à cause du vent. On l'y oblige, sous peine de le renvoyer ; il monte, la grue tombe, il échappe par miracle à la mort, et se retrouve condamné comme auteur direct au même titre que celui qui l'a contraint à monter ! La loi Fauchon, précisons-le, n'était pas encore adoptée, mais on s'était fondé sur les mêmes critères, et l'on voit bien qu'ils ne sont pas pertinents au regard de telles situations. » (audition du 30 novembre 2005). 449 « Certains voudraient réviser la loi sur la question de la relation indirecte entre l'imprudence et le dommage, en suppriment la distinction entre cause indirecte et cause directe : il me semble que c'est une fausse piste. (...) Il eut mieux valu, selon eux, ne pas distinguer entre causalité directe et indirecte, dans les cas de délits non intentionnels. (...) Un certain M. Guillaume Perrault s'est permis de consacrer un ouvrage entier à expliquer que cette loi avait été conçue pour protéger les dirigeants et faire payer les lampistes, ce qui est parfaitement faux. Mais l'affaire du Tunnel du Mont Blanc a clos la polémique en trouvant les responsabilités là où elles se trouvaient, y compris auprès des responsables plus éloignés du drame que le constructeur du camion. Les juges peuvent interpréter la loi comme ils le souhaitent en fonction des faits. » (audition du 29 novembre 2005) 450 Audition du 18 janvier 2006 451 M. René Dosière, rapport 2266, précité 452 Code pénal, article 223-1 : « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. » 453 Le rapport de M. René Dosière sur la loi en première lecture rappelait ainsi quelques orientations de la jurisprudence : « L'obligation de sécurité ou de prudence méconnue doit être « particulière », et non pas générale, ce qui signifie qu'elle doit être définie avec précision en fonction de situations spécifiques. Ainsi, ont été considérées par la jurisprudence comme des obligations « générales » les dispositions du code de la route qui obligent les conducteurs à rester constamment maîtres de leur vitesse et à régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée et des difficultés de la circulation (article R.11-1), ou celles du code du travail qui prescrivent que les établissements et locaux doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs (article L.233-1). A l'inverse, constituent des obligations « particulières » la limitation de la vitesse à 90 km/h sur les routes et à 130 km/h sur les autoroutes ou les règles précises propres aux diverses catégories de machines et d'équipements de travail et à leurs conditions d'emploi » (rapport AN n°2266 précité) 454 CA Aix-en-Provence, 22 nov. 1995. 455 Cass. crim., 25 juin 1996 456 « La Commission a considéré que la notion de « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence » était à la fois trop vague et trop restrictive. Elle propose que ne soient visées que les obligations « prévues par la loi ou le règlement », (rapport n° 2266 précité) 457 « La violation " manifestement délibérée " d'une obligation de sécurité implique la conscience par l'auteur des faits de violer une obligation de sécurité et donc la conscience de faire courir un risque. En présence de cette rédaction, le juge pénal ne pourra plus condamner un prévenu en indiquant seulement qu'il aurait dû connaître le risque qu'il faisait courir en commettant telle ou telle faute. » (Rapport de Pierre Fauchon en 1ère lecture au Sénat, n° 177 1999-2000) 458 Rapport 2266 précité. 459 La violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité 460 Rapport n°2266, précité 461 Voir supra 2ème partie - II - B 462 « (...) il semble pertinent de retenir, comme étant de nature à engager la responsabilité pénale des auteurs indirects (ou médiats) d'un dommage, les violations d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement commises de façon manifestement délibérée, et les fautes inexcusables. Ce second qualificatif étant nouveau en droit pénal, il paraît également préférable que le législateur indique clairement le sens qu'il entend lui conférer en reprenant ses éléments constitutifs essentiels : une faute d'une exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger que son auteur ne pouvait ignorer. » (rapport de René Dosière n° 2266 précité) 463 La mission a détaillé les motifs et la nature du revirement intervenu dans la partie consacrée à la responsabilité « civile » de l'employeur - cf supra 2ème partie - II - B 464 « Il s'agissait, pour le Gouvernement, de réduire le degré de qualification nécessaire pour qu'une faute puisse engager la responsabilité pénale de son auteur, « afin de prendre en compte les légitimes interrogations exprimées par certaines associations de victimes », explique ainsi M. René Dosière dans son rapport en 2ème lecture (rapport n°2258). 465 J.O. Sénat, séance du 15 juin 2000, page 4119 466 « Que faut-il entendre par faute « caractérisée » ? Dans l'esprit du législateur, ce terme, nouveau en droit pénal, désigne une faute dont les éléments sont bien marqués, affirmés, avec netteté. Elle devra donc être objectivement définie dans chaque cas. Il est évident qu'il ne s'agit pas d'une faute ordinaire, simple, fugace ou fugitive. Elle doit présenter un degré certain de gravité. On rappellera, en outre, que le juge devra toujours apprécier cette faute in concreto, conformément à la loi du 13 mai 1996 précitée. » (Rapport de René Dosière n°2528) 467 Dans son analyse de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour, M. Desportes analyse ainsi ce critère : « Il faut donc démontrer qu'en conséquence de la faute commise, il existait objectivement de fortes probabilités qu'une personne fût exposée à un risque de mort ou de blessures graves. » (rapport annuel de la Cour de cassation pour 2002). 468 « Cette formulation se distingue de la définition de la faute inexcusable par la Cour de cassation en ce qu'elle fait référence à un danger " qu'elle ne pourrait ignorer " et non à " la conscience du danger que devait en avoir son auteur ". Une référence au risque que l'on devait connaître aurait paru insatisfaisante à votre rapporteur, car permettant toutes les interprétations. Le danger qu'on ne pouvait ignorer devra être apprécié en tenant compte du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, qui prévoit que la responsabilité pénale pour des faits non intentionnels n'est engagée que lorsque l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. » (Rapport de Pierre Fauchon, n°177 1999-2000 précité) 469 « Comme l'a relevé la doctrine, c'est à l'évidence cette condition, tenant au degré de conscience du prévenu qui soulève le plus d'interrogations. Elle constitue sans doute la pierre angulaire du nouveau dispositif législatif. » (F. Desportes, rapport annuel de la Cour de cassation pour 2002) 470 En particulier, celle confirmée par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Douai le 12 juin 2004 471 « Entendus, Michel Cordier et Jean Carrere, anciens gérants de la société Weizsacker & Carrere confirmaient que le problème de l'amiante n'avait jamais été posé jusqu'au milieu des années 1980, qu'aucune autorité ne les avait informés sur les dangers de ce produit ... » CA Douai, 15 juin 2004, Betous et autres 472 La mission a cependant considéré que la valeur d'un tel raisonnement mériterait d'être examinée par la Cour de cassation, car en désignant l'interdiction publique d'un produit comme le fait déclencheur de la responsabilité pénale de ceux qui l'utilisent, il conduirait soit à exonérer les employeurs de toute responsabilité, soit à subordonner toute activité économique à un régime fortement encadré d'interdictions et d'autorisations de mises sur le marché. 473 CA Douai, 15 juin 2004, Betous et autres 474 « Attendu qu'il apparaît ainsi que les personnes mis en examen ayant mis en place, notamment au niveau médical, de la prévention et de la protection, des mesures répondant aux prescriptions légales et réglementaires, même de façon incomplète ou tardive, il ne peut leur être reproché une violation manifestement délibérée de ces prescriptions. » 475 Le rapport de René Dosière est sur ce point sans équivoque : « Le souci du Sénat d'exclure du champ de la répression pénale l'ensemble des fautes non intentionnelles et indirectes, dès lors qu'aucune obligation de sécurité ou de prudence n'a été violée de façon manifestement délibérée, c'est-à-dire « en conscience », peut sembler cohérent par rapport aux principes originels de notre droit. Mais ce choix est aujourd'hui excessivement réducteur. Il s'agirait d'un retour en arrière trop radical par rapport à l'orientation voulue par le législateur, le juge et la société elle-même, qui ne comprendrait pas que certaines inobservations des règles de sécurité et de prudence particulièrement graves ne puissent plus faire l'objet de poursuites pénales. » (rapport 2266 précité) 476 « La précision [faute caractérisée] peut apparaître superfétatoire car on ne voit pas, a priori, comment retenir une faute qui ne le serait pas. Il résulte cependant des débats parlementaires qu'il faut entendre par cette expression que la faute doit présenter "un certain degré de gravité", "une particulière évidence", "un caractère affirmé" » (F. Desportes, précité) 477 « A été qualifiée comme telle la décision prise, en connaissance de cause, par le chef d'entreprise de ne pas mettre en place le blindage d'une tranchée imposé par l'article 72 du décret du 8 janvier 1965 (Crim. 12 sept. 2000, Bull. n 268), ou encore la décision du responsable du service technique d'une commune de faire procéder au montage d'un portique sans prévoir l'installation de dispositifs de protection contre les chutes (Crim. 3 déc. 2002, Bull. n 219). » (F. Desportes, précité) 478 Cet exemple prouve d'ailleurs la sagesse du législateur en montrant à quel point il était impératif d'exclure les accidents de la circulation du bénéfice de ce nouveau régime. 479 Cf. rapport annuel de la Cour de cassation pour 2002 précité 480 « Les juridictions pénales, auxquelles le législateur a ouvert un choix, ont en effet naturellement tendance à rechercher la faute dont la définition est la plus large et la démonstration la plus aisée. » (F. Desportes, rapport annuel de la Cour de cassation pour 2002 précité) 481 Rapport annuel de la Cour de cassation pour 2002, précité 482 M. Frédéric Desportes analysait ainsi, dans le rapport annuel de la Cour pour 2002, les décisions rendues par la chambre criminelle de la Cour de cassation en la matière : « les juges du fond doivent démontrer que la personne physique, auteur indirect du dommage, ne peut voir sa responsabilité pénale engagée que si elle a eu connaissance du risque ou si elle disposait d'informations suffisantes pour lui permettre de l'envisager comme probable. » 483 M. Desportes, précité 484 Cf. 2ème partie -B 485 Article L. 263-2 du code du travail : « Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du titre III du présent livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 231-7-1, L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre et des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur exécution sont punis d'une amende de 3750 euros. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-10 et L. 611-13. Conformément à l'article 132-3 du code pénal, le cumul des peines prévues au présent article et à l'article L. 263-4 avec les peines de même nature encourues pour les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée qui est encourue. » 486 Comme l'explique M Desportes dans le rapport de la Cour de cassation précité : « (...) étant personnellement tenu, sous peine de sanction pénale, de faire respecter personnellement de manière stricte et permanente les dispositions législatives et réglementaires en matière de sécurité, de disposer des moyens nécessaires à cette fin et de les mettre en oeuvre, le chef d'entreprise ou son délégataire a bien entendu l'obligation de s'informer des situations concrètes placées sous son contrôle afin de s'acquitter effectivement de son devoir. S'il ne vérifie pas l'état de machines dangereuses, n'assure pas la surveillance efficace d'un chantier, il peut certes ignorer que les dispositifs de protection prévus par la réglementation ne sont pas en place. Mais cette ignorance caractérise en réalité sa faute, car la loi, dont on a dit la rigueur, lui faisait un devoir de procéder aux vérifications nécessaires. » 487 « La faute délibérée étant ainsi plus étroitement définie, et donc plus difficile à établir, il n'est pas surprenant qu'elle ait tendance à être comme absorbée par la faute « caractérisée » (précité) 488 Ce point a été confirmé par la Cour de cassation : une cour d'appel ne peut, sans se contredire, constater qu'un chef d'entreprise a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité en ne veillant pas personnellement au respect de la réglementation relative à la sécurité du travail et relaxer néanmoins celui-ci au motif qu'il pouvait ignorer le risque découlant de son manquement (Crim. 11 février 2003, pourvoi n° 02-85.810). 489 À cet égard, la décision du juge de Dunkerque sur une affaire de contamination par l'amiante fait figure d'exception, puisque l'instruction a établi les manquements au décret de 1977, mais conclu au non lieu sur la base d'une méconnaissance des risques. La mission ne peut que regretter que ce raisonnement n'ait pu être examiné par la chambre criminelle de la Cour de cassation. 490 « S'agissant par ailleurs de la violation de règles de sécurité, il ne sera le plus souvent pas possible, compte tenu de la nature de ces règles, que la personne chargée de les faire respecter puisse valablement soutenir que cette violation n'exposait pas autrui à un danger d'une particulière gravité et qu'elle ne pouvait ignorer. Il en résulte que, dans la plupart des cas, la responsabilité pénale du chef d'entreprise ou de son délégué sera encourue si la faute de ce dernier a indirectement causé un accident du travail ou une maladie professionnelle. » Circulaire criminelle du 11 octobre 2000 précitée 491 « Je m'interroge, au contraire, sur la création d'un délit spécifique concernant les délits non intentionnels des employeurs. Nous sommes dans un contexte très particulier, où le chef d'entreprise est investi de pouvoirs considérables et généralement incontestés. Cela doit avoir une contrepartie en termes de responsabilité, y compris en termes de responsabilité pénale. La loi Fauchon essayait de régler par un même texte des situations radicalement différentes : là est peut-être la cause de toutes nos difficultés. Je n'ai pas encore d'avis définitif, mais la question mériterait d'être posée. » (Maître Teissonnière ) ; « Ajoutons que les critères de la loi Fauchon ont été conçus pour les décideurs publics, les maires des communes. C'est à eux que vous avez pensé en la votant, et c'était parfaitement légitime. (...) Dans l'accident de Toul, le grutier - intérimaire -, a été mis sur le même pied que le chef de chantier qui l'a menacé de le licencier s'il ne montait pas. Or le responsable dans cette affaire est bien (...) l'auteur intellectuel, ou économique. » (Maître Ledoux) 492 On peut par exemple lire dans le rapport de M. René Dosière en première lecture« Sans doute la situation des élus, voire de l'ensemble des décideurs publics comporte-t-elle un certain nombre de spécificités, compte tenu de la nature et de l'ampleur de leurs missions. Mais la loi doit rester la même pour tous. Toute autre solution serait contraire, comme on l'a vu, à l'évolution générale de notre droit, et serait perçue comme un retour en arrière, notamment au régime qui prévalait, entre 1790 et 1870, sur le fondement de l'article 75 de la Constitution de l'an VIII, lorsque les agents publics ne pouvaient pas faire l'objet d'une poursuite devant le juge pénal sans une autorisation du Conseil d'Etat. » 493 M. Desportes, dans le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2002 a ainsi résumé l'exercice difficile auquel s'est livré le législateur : « Soucieux de mettre un frein à la pénalisation, jugée excessive, de la vie publique, le législateur souhaitait alléger la responsabilité pénale des élus locaux et des "décideurs publics" en matière d'infractions non intentionnelles. Mais, dans le même temps, excluant l'élaboration de dispositions spécifiques, qui seraient apparues comme une atteinte au principe d'égalité devant la loi, il voulait une réforme qui fût d'application générale. S'est alors posée à lui la question de savoir comment mettre en oeuvre une telle réforme tout en évitant qu'elle ait en quelque sorte des effets "indésirables", qu'elle affaiblisse la répression là où on ne le souhaitait pas, notamment dans les domaines, très sensibles, de la sécurité du travail et de la sécurité routière. En outre, dans les autres domaines, le législateur ne pouvait relever le seuil de la responsabilité pénale sans prendre en considération les attentes des victimes et du corps social. Il fallait éviter une dépénalisation de trop grande ampleur qui eût entraîné, pour reprendre une expression utilisée par la Garde des Sceaux, une "déresponsabilisation des acteurs sociaux". 494 J.O. Sénat, séance du 15 juin 2000, page 4119 495 R. Dosière ; J.O.A.N., séance du 29 juin 2000 496 « Bien que les nouvelles dispositions soient de portée générale, leurs conséquences pratiques devront tout particulièrement concerner la situation des décideurs publics, ce qui correspond à l'intention clairement affichée du législateur. (...) La volonté du législateur de ne pas affaiblir l'efficacité de la répression dans les domaines sensibles que sont ceux des accidents de la circulation, des accidents du travail et des atteintes à l'environnement ou à la santé publique, qui a été maintes fois affirmée au cours des débats, conduit à préciser la portée de la réforme dans ces domaines, portée qui, sous réserve de l'interprétation des nouveaux textes qui sera faite par les tribunaux, devrait être en pratique relativement limitée s'agissant de la responsabilité pénale des personnes physiques. » Circulaire. Crim-00-9/F1 du 11 octobre 2000, BOMJ, n° 80 497 Audition du 29 novembre 2005 498 Le terme est repris de la contribution de M. Desportes au rapport annuel de la Cour de cassation pour 2002 ([la violation manifestement délibérée] traduit une véritable « hostilité à la norme ») 499 Rapport annuel de la Cour de cassation pour 2002, précité 500 La jurisprudence considérant d'ailleurs sur ce point que le prévenu doit connaître une telle réglementation (cf précédemment dans l'analyse du régime juridique, le critère de connaissance des risques). 501 Rapport n°2266 de M. René Dosière 502 Maître Ledoux a rappelé cet impératif au cours de son audition du 30 novembre 2005 : « De ce fait, ne sont plus condamnées que les personnes morales et non plus les personnes physiques. [...] Tout l'effet d'exemplarité et de prévention des risques est réduit à néant. (...) Certes, des personnes morales sont mises en examen et condamnées : le problème est qu'une personne morale, c'est... personne. Nombre de parquetiers refusaient d'ailleurs pour cette raison de les poursuivre : ce n'est pas l'entreprise qui prend la décision, mais bien le chef d'entreprise. » 503 Qui a fait l'objet de travaux spécifiques ; cf infra 2ème partie III 504 Rapport n°2266 précité 505 « Par ailleurs, certaines fautes, qui résultent d'une violation condamnable, mais pas nécessairement « délibérée », d'une obligation particulière de sécurité, doivent pouvoir faire l'objet de poursuites pénales. » (Rapport 2266, précité) 506 « Tout cela se passe dans un contexte réglementaire. Personne ne conteste aujourd'hui que les entreprises ont respecté la loi française. Aujourd'hui, il est facile de dire que nous étions, ou aurions dû, être conscients du danger. » (audition du 13 décembre 2005) 507 « Si le droit ne prévoit pas d'obligation particulière de sécurité, il faut pouvoir condamner celui qui savait qu'il exposait des individus au risque de l'amiante. Inversement, si la personne négligente n'était pas consciente du risque, il faut une obligation particulière de sécurité pour engager sa responsabilité. Les deux dispositifs sont donc complémentaires et c'est leur articulation qui permet de prévoir toutes les possibilités permettant de protéger les victimes. » (audition du 18 janvier 2006) 508 N° 2266, précité 509 Journal officiel Assemblée nationale, 2ème séance du 5 avril 2000 510 Cass. crim., 8 septembre 1998 511 « L'adjectif « manifestement » impose au juge de faire preuve d'une rigueur particulière quant à l'existence de l'élément moral du délit. » (rapport 2266, précité) 512 Ainsi, l'obligation faite à un maire de prendre toutes les mesures permettant de prévenir un trouble à la sécurité des personnes ou des biens ne revêt qu'un caractère général, et en aucun cas une obligation particulière de prudence ou de sécurité (Cass. crim., 25 juin 1996). En revanche, le décideur public, en tant qu'employeur, doit bien entendu respecter les obligations particulières de prudence ou de sécurité des employeurs privés, si elles s'appliquent à sa situation (Cass. crim., 3 déc.2002) 513 M. Michel Ledoux s'est notamment fait le porte-parole de ce sentiment : « (...) en France, plus on est nombreux à s'être trompés, plus la faute a tendance à disparaître... Lorsqu'on est tout seul à se tromper, on est mort. Lorsqu'on est à cinquante, c'est déjà mieux ; à mille, on peut être tranquille, tout se dilue dans la masse ! C'est d'ailleurs le seul risque de la faute caractérisée : si les auteurs sont trop nombreux, chacun aura beau jeu de dire que ce n'est pas lui, mais l'autre. Il n'y a plus de faute lourde et caractérisée, seulement des erreurs d'appréciation... » (Audition du 30 novembre 2005) 514 Journal officiel Assemblée nationale, 2ème séance du 5 avril 2000 515 Cf. Partie liminaire : Regards sur l'histoire de l'amiante 516 « Effets sur la santé des principaux types d'exposition à l'amiante » 517 Table ronde du 14 septembre 2005 sur l'état des connaissances scientifiques sur les risques sanitaires liés à l'exposition à l'amiante 518 Par exemple, M. Michel Ricochon, chef de la mission d'animation des services déconcentrés de la direction des relations du travail : « Lorsque j'étais inspecteur du travail, dans les année 80, l'amiante était un risque chimique comme un autre et nous ne prenions pas de précautions spécifiques car nous ne disposions ni du recul ni de l'appréciation scientifique aujourd'hui disponibles. Maintenant l'inspection du travail a évidemment une autre approche : nous sommes passés de principes généraux de prévention à une réglementation draconienne tendant à interdire l'utilisation de l'amiante et à assurer le traitement de l'amiante résiduel. Les connaissances, la réglementation et l'approche ont petit à petit été approfondies. Ces éléments de contexte sont importants. » (audition du 5 juillet 2005) 519 Mme Prada-Bordenave a rappelé ces risques que l'Etat a encadré très tôt : « Les anciennes éditions du code du travail fourmillent de réglementations, anciennes et très précises, applicables à certains métiers réputés dangereux. On connaît la réglementation des mines, établie par le service des Mines chargé depuis une loi de 1810 de protéger les mineurs, mais il en existe également une, particulièrement détaillée, sur le travail des ouvriers de la porcelaine de Limoges, qui remonte à un arrêté ancien, ou encore celle, à peine plus récente, applicable aux ateliers utilisant de l'arsenic et susceptibles de diffuser des poussières d'arsénieux... Dans tous ces cas extrêmement particuliers, l'État a su prendre une réglementation précise, peu volumineuse du reste, affichée dans les locaux et obligatoirement communiquée au travailleur dont la vigilance est donc attirée sur le fait qu'il travaille dans un milieu présentant un risque et qu'il doit se plier à des mesures de prévention simples : se laver les mains, changer de vêtements, ne pas se nourrir sur son lieu de travail. De son côté, l'employeur est tenu de prendre des mesures précises d'aération, de ventilation, etc. » (audition du 30 novembre 2005) 520 Cf. Partie liminaire : « Regards sur l'histoire de l'amiante » 521 « La dangerosité de l'amiante, dans un premier temps, était connue mais insuffisamment armée sur le plan scientifique. L'usage contrôlé de l'amiante a donc tout d'abord été la règle. Puis, à partir de la fin des années 1980, la connaissance scientifique a énormément évolué et des mesures radicales se sont imposées : les valeurs limites d'exposition sont passées de 2 fibres à 0,1 fibre par centimètre cube et l'amiante a été interdit. Ces mesures ont été prises à la suite d'un travail énorme de l'INSERM, qui a procédé à l'analyse de 1 200 études scientifiques. » (audition du 5 juillet 2005) 522 Audition du 27 septembre 2005 523 M. Jean-Luc Pasquier a confirmé et justifié cette banalisation : « Le bureau 4 a produit, entre 1982 et 1994, vingt-deux décrets en Conseil d'État dans le domaine des risques chimiques, dont quatorze concernaient le risque cancérogène chimique, 9 décrets en Conseil d'État concernant les risques physiques, en particulier celui portant sur les rayonnements ionisants, un décret sur les risques biologiques et treize décrets relatifs aux maladies professionnelles, qui ont permis de créer plus de trente tableaux de maladies professionnelles, ce qui avait fait dire à un syndicaliste représentant la CFDT au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels que nous avions produit et modifié plus de tableaux entre 1982 et 1994 qu'entre 1918 et 1980. Comme vous le voyez, l'amiante n'était pas distingué par rapport à d'autres cancérogènes chimiques. Je me souviens que l'un des premiers dossiers sur lesquels j'ai eu à travailler était celui du chlorure de vinyle monomère, qui présente à peu près les mêmes caractéristiques que l'amiante. Ce produit, qui sert de base aux PVC, provoque des cancers mortels. » (Audition du 27 septembre 2005) 524 « La France a été l'un des premiers pays à se doter, en 1977, d'une législation spécifique à l'amiante ; les États-Unis l'avaient fait un peu avant en fixant une VLE à cinq fibres par millilitre, puis deux, tout comme nous, bien loin des expositions des années 50 et 60 en Angleterre. La Direction des relations du travail (DRT) croyait réellement être en avance et éprouvait une véritable fierté à avoir sorti un texte qui réduisait aussi fortement le taux de fibres dans l'air. Pour prendre un parallèle, c'est un peu comme si, découvrant les risques pour la santé de fumer plus d'un paquet par jour, on avait interdit de fumer plus de deux cigarettes par jour. » (audition du 17 janvier 2006) 525 On citera par exemple le Professeur Brochard - pneumologue, professeur de médecine du travail et responsable de l'unité de pathologie professionnelle du CHU de Bordeaux, ancien membre du CPA : « il suffit de comparer les textes réglementaires adoptés en France avec ceux dont s'étaient dotés, à l'époque, les autres pays pour s'apercevoir que la réglementation de 1977 était très intéressante. Malheureusement, et il y a eu là une carence manifeste, ces textes n'ont pas été appliqués. La France ne compte pas suffisamment de personnels capables de mener les contrôles qui s'imposent. Les inspecteurs du travail notamment - il y a eu récemment des débats sur l'inspection du travail - ne sont pas en mesure de vérifier si les textes sont appliqués ou non. » (Table ronde du 14 septembre 2005) 526 Ainsi le Pr. Brochard a-t-il mis en cause l'ensemble du contrôle de la réglementation : « Cette fonction de contrôle est totalement défaillante. Et si les informations ne remontent pas au niveau des décideurs, je ne vois pas comment ils pourront s'apercevoir rapidement d'un dysfonctionnement. Cette situation n'est pas spécifique à l'amiante et vaut malheureusement pour nombre d'autres domaines ; si vos travaux permettaient de déboucher sur une solution, nous aurions fait un gros pas. » (Table ronde du 14 septembre 2005) 527 « Contrairement à ce qui a été dit et relayé par la presse, des enquêtes ont été effectuées par l'inspection du travail sur le niveau d'application du décret de 1977. Certaines de ces enquêtes ont d'ailleurs été publiées dans des revues, en particulier la Revue Échange travail en 1981, sous ma propre signature. Une deuxième enquête a été conduite au cours de l'année 1983. Tout montrait à l'époque que les valeurs limites d'exposition qui avaient été fixées étaient en voie d'être appliquées. Je rappelle que la valeur maximale fixée par le décret était de deux fibres par cm3, qu'elle a été ensuite fixée à une fibre puis à 0,5. (...) Je ne dis pas qu'elle était appliquée partout. Je dis que nous avons constaté un début d'application significatif, en tout cas chez les producteurs de produits à base d'amiante. » (M. J-L Pasquier - audition du 27 septembre 2005) 528 « La prévention sanitaire en milieu de travail », rapport présenté par Mme Hayet Zeggar, M. Jacques Roux et M. Pierre de Saintigno, membres de l'Inspection générale des affaires sociales (Rapport n ° 2003 015 - Février 2003) 529 « La santé au travail est animée par des réseaux d'acteurs importants qui pourraient permettre une collecte très large d'informations scientifiques et de terrain. On peut distinguer schématiquement un réseau médical (inspection médicale du travail, médecins du travail, médecine générale...), un réseau technique et social centré sur l'analyse des situations de travail (services prévention des CRAM, des organismes des régimes spéciaux, ARACT, OPPBTP, organisations professionnelles, associations, syndicats, bientôt peut-être les observatoires régionaux de la santé au travail) et le réseau généraliste de l'inspection du travail. Malgré cette multitude d'acteurs, on ne dispose pas de données régulières sur l'évolution du risque, et surtout aucun système d'alerte efficace, c'est-à-dire rapide, ne fonctionne : le temps nécessaire à la prise de conscience d'un risque nouveau est plus long dans le champ professionnel que dans de nombreux autres domaines de la vie sociale. » (op. cit.) 530 CE Contentieux, 03-03-2004, n° 241151, Ministre de l'emploi et de la solidarité c/ consorts Botella 531 Audition du 30 novembre 2005 532 « Autrement dit, dès 1906, l'administration française savait de manière certaine qu'il existait une maladie très grave, comment on l'attrapait et comment elle développait ses effets, ce que plusieurs études ont confirmé par la suite : en 1930, une étude statistique à Lyon, elle aussi réalisée par les services administratifs, plusieurs travaux réalisés à l'étranger, au Royaume-Uni en 1950, en Afrique du Sud en 1960 et aux États-Unis en 1961. Le fait que le ministère du travail ait été prévenu depuis 1906 a constitué aux yeux du Conseil d'État un élément supplémentaire à prendre en compte. » 533 « (...) avant même la décision du Conseil d'État, on a pris conscience, dans les milieux gouvernementaux, que l'État n'avait pas fait face à l'obligation qui est la sienne de réguler et d'encadrer la discipline que doivent observer les entreprises. Lorsque le Conseil d'État a eu à se prononcer, il n'y avait pas l'ombre d'un doute sur les atermoiements des pouvoirs publics. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont pris les premières mesures, respectivement, dans les années 30 et dans les années 40, alors que la France a pris des initiatives dispersées et imparfaites. Le comité qui a été créé en 1982 regroupait des industriels de l'amiante, des syndicats représentatifs des personnels, des médecins, des chercheurs et des représentants de l'administration. Pendant des années, il a marqué le pas, ne rendant pas de conclusions, ou rendant des conclusions extrêmement timides. Les entreprises voulaient continuer à fabriquer leurs produits, les personnels voulaient protéger l'emploi, les chercheurs étaient un peu isolés. Les quelques cris d'alerte qui ont été lancés n'ont pas intéressé les pouvoirs publics. L'inspection du travail n'a pas fait d'enquête pendant trente ans. À partir de là, il importait de permettre aux victimes d'être indemnisées sans ménager les efforts de l'État. C'était une question de paix sociale, peut-être. C'était aussi une question d'égalité devant les charges publiques. C'était, enfin, une question de dignité. » (audition du 15 novembre) 534 « Là est la faute. Non pas la faute de Mme Tartempion, mais la faute de l'État qui, par un choix politique délibéré, a décidé d'assumer une responsabilité particulière de réglementation et de surveillance de son application, mais n'a rien fait. Lorsque vous achetez un moulin à légumes, il est inscrit dessus « breveté SGDG », sans garantie du Gouvernement. Là, c'est l'inverse : il y a une garantie du Gouvernement. Et dès lors que celui-ci s'est engagé, ne rien faire est une faute. (...) Quand l'État est chargé d'une mission de police, il est obligé de la remplir, il a une obligation de résultat. L'État doit au citoyen lambda la tranquillité, la sécurité, la salubrité. La puissance publique, parce que le Parlement en a décidé ainsi, doit apporter sa protection au travailleur. Si elle ne le fait pas, elle est en faute. » (audition du 30 novembre 2005) 535 Mme Prada-Bordenave s'est d'ailleurs montrée explicite à ce sujet : « Les maladies liées à l'amiante ont été inscrites au tableau des maladies professionnelles dès 1945, en 1950 pour l'asbestose, et le comité international du cancer a déclaré l'amiante matériau cancérigène en 1977. Autrement dit, lorsque les statistiques des maladies, systématiquement relevées par les CRAM, ont fait état de l'apparition, dans des endroits bizarres, de pathologies de type mésothéliome, on aurait logiquement dû s'interroger. Que des mésothéliomes surviennent autour des sites Éternit, on pouvait le comprendre ; mais que des cancers commencent à s'y développer dans des proportions importantes en prenant, qui plus est, des formes propres à l'amiante, voilà qui aurait logiquement dû alerter les autorités sanitaires sur la réalité des risques. Or cela n'a provoqué aucune réaction. Pourtant, les chiffres ont été relevés, les déclarations faites à la médecine du travail étant systématiquement reprises par les caisses et centralisées, via les caisses régionales, à la caisse nationale. L'outil d'information n'a pas fonctionné. » (audition du 30 novembre 2005) 536 « Les arrêts « amiante » du Conseil d'État de mars 2004, qui reconnaissent la responsabilité de l'État, ont remis en cause la philosophie d'un système de prévention de la santé au travail conçu au lendemain de la guerre, laquelle plaçait le chef d'entreprise comme responsable de la santé de ses employés, les partenaires sociaux comme responsables de l'édiction des règles opérationnelles au niveau des CHSCT ou de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), et l'État comme concepteur du socle commun de règles d'hygiène et de sécurité, applicable à toutes les entreprises. Ce que réfute le Conseil d'État : pour lui, l'État aurait dû avant 1977 se doter de moyens d'expertise pour évaluer le risque amiante et après 1977 de moyens de contrôle pour s'assurer de la bonne mise en œuvre de la réglementation qu'il édictait ».(audition du 24 janvier 2006) 537 Le rapport particulier de la Cour des comptes sur la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles (2002) fait état de ces réussites : « La fréquence des accidents du travail avec arrêt a diminué de plus de 60 % en 50 ans et celle des accidents mortels a baissé de plus des trois quarts. Sur les 20 dernières années connues, le nombre des accidents du travail avec arrêt a encore baissé de 40 %, alors que le nombre de salariés a augmenté de 6 %. La diminution est encore plus nette, plus de 60 %, pour les accidents ayant entraîné une incapacité permanente. » 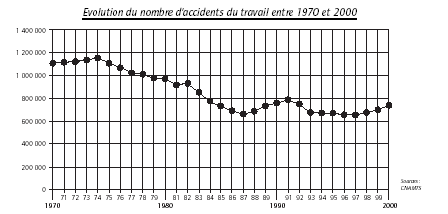 538 « L'organisation actuelle n'a pas permis de traiter dans toute son ampleur le problème des maladies professionnelles, qui constitue déjà et représentera plus encore à l'avenir une composante majeure des risques d'origine professionnelle. Les manifestations en sont multiples : fonctionnement défectueux de la commission des maladies professionnelles, chargée d'adapter les tableaux de maladies professionnelles à l'évolution des connaissances et des risques, connaissance lacunaire de ces risques, écarts très importants dans les taux de reconnaissance des maladies par les caisses, sous-estimation du nombre des victimes, mise en place de systèmes d'indemnisation parallèles à la législation normale pour diverses pathologies. » (Rapport particulier de la Cour des comptes sur la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles - 2002) 539 Audition du 15 novembre 2005 540 On citera par exemple, M. Dominique De Calan, représentant du MEDEF au cours de la table ronde du 28 septembre 2005 : « Je peux donc répondre précisément à votre question sur le rôle des partenaires sociaux dans la prévention : au nom de l'ensemble des signataires de l'accord national sur la santé au travail, je puis vous dire notre conviction qu'il n'y aura pas de prévention sans négociation. » 541 Table ronde du 28 septembre 2005 542 Table ronde du 28 septembre 2005 543 Audition du 4 octobre 2005 544 cf. 2ème partie - I 545 Audition du 4 octobre 2005 546 Rapport 2003-015, précité 547 Audition du 27 septembre 2005 548 Table ronde du 19 octobre 2005 549 Audition du 11 octobre 2005 550 « Les maladies professionnelles sont d'ailleurs le seul domaine sanitaire où le consensus des partenaires sociaux constitue un préalable à la prévention des risques. (...) L'expertise est parfois difficile à réunir. Par exemple, la révision du tableau 6, relatif aux rayonnements ionisants, a été engagée le 6 mai 1999, mais, à la suite de l'indisponibilité de l'expert et du rapporteur, l'expertise n'avait pas encore pu réellement démarrer en septembre 2001. (...) Au plan scientifique et technique, le fait que l'INRS ait concentré ses travaux sur un champ en définitive restreint de pathologies et ne l'ait souvent élargi qu'avec retard, a pour conséquence qu'il n'est pas aussi souvent que souhaitable en mesure d'apporter sa contribution.» (rapport 2002 précité) 551 Par exemple, M. Marcel Royez, représentant de la FNATH : « Loin de moi l'idée de mettre en doute la compétence des chercheurs de l'INRS, mais il est de notoriété publique - un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) l'a d'ailleurs souligné - que l'INRS n'est pas un organisme indépendant. Il est géré paritairement, il a été présidé de manière assez constante par le patronat. On sait d'ailleurs que quelques chercheurs ayant manifesté quelques velléités de chercher là où il ne fallait pas ont été licenciés. » (audition du 25 octobre 2005) 552 Rapport 2003-15 précité 553 Audition du 27 septembre 2005 554 « Le réseau des médecins du travail permet de couvrir une très grande part de la population adulte, pourtant aucune remontée d'informations médicales n'est organisée par les pouvoirs publics. La veille médicale est balbutiante » Rapport 2003-15 précité 555 Audition du 4 octobre 2005 556 Rapport 2003-015 précité 557 Par exemple, M. Royez (FNATH) : « Pourquoi les médecins du travail n'ont-ils pas tiré plus tôt la sonnette d'alarme au sujet de l'amiante ? Tout simplement parce qu'ils dépendaient des entreprises, et qu'ils risquaient de perdre leur place. Il ne faut pas aller chercher plus loin. » (audition du 25 octobre 2005) 558 Audition du 4 octobre 2005 559 Par exemple, le Professeur Goldberg, au cours de son audition du 11 octobre 2005 : « La France dispose de 6 000 à 8 000 médecins du travail sur le terrain. Ce dispositif, probablement unique au monde, devrait être un rêve pour les épidémiologistes. Or, nous ne pouvons travailler avec les médecins du travail et, faute d'une mutualisation des moyens, la médecine du travail fournit très peu de données épidémiologiques. (...) Le coût de la médecine du travail n'est certainement pas négligeable, mais nul ne songe à consacrer ne serait-ce qu'un millième de ce budget à des études épidémiologiques. Il existe quelques petites exceptions dans de très grandes entreprises. (...) Les médecins du travail ont une pratique solitaire, ils ne sont pas organisés, et il n'y a aucune mise en commun des moyens. Un pourcentage des cotisations des employeurs devrait être consacré à la réalisation d'études épidémiologiques. Que cela ne soit pas le cas constitue un véritable gâchis. » 560 Table ronde du 14 septembre 2005 561 Audition du 11 octobre 2005 562 « Les créateurs de la médecine du travail, il y a de cela presque soixante ans, en avaient confié l'organisation et la réglementation à l'administration chargée de faire évoluer les droits du travail ; cette démarche - alors parfaitement logique mais probablement beaucoup moins aujourd'hui - explique que nous ayons une perception des problèmes sanitaires liés aux expositions à des risques professionnels une fois seulement les dégâts commis, par le biais des divers systèmes de surveillance de morbidité mis en place en direction de la population, au sens général du terme. Il en résulte que nous ne pouvons percevoir les problèmes aussi rapidement que certains autres phénomènes qui, eux, font l'objet de dispositifs de surveillance spécifiques. » (table ronde du 19 octobre 2005) 563 Par la loi 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail 564 Table ronde du 28 septembre 2005 565 Article 14 : « Surveillance de santé 1. Pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, des mesures sont fixées conformément aux législations et/ou pratiques nationales. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont telles que chaque travailleur doit pouvoir faire l'objet, s'il le souhaite, d'une surveillance de santé à intervalles réguliers. 3. La surveillance de santé peut faire partie d'un système national de santé. » 566 Par exemple la juge d'instruction, Mme Odile Bertella-Geoffroy a indiqué au cours de son audition du 29 novembre 2005 : « Il est certain que dans tous ces dossiers d'amiante, la responsabilité de l'État, c'est-à-dire des décideurs publics personnes physiques - puisque l'État n'est pas une personne morale sur le plan juridique - et parfois celle des inspecteurs du travail ou des médecins du travail ou des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) ou des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT), est mise en avant par les parties civiles et par certains mis en examen. » 567 cf. 2ème partie -II - D 568 CA Douai, 15 juin 2004, Betous et autres 569 Audition du 25 octobre 2005 570 « Quant au fondement juridique de la décision du Conseil d'État, il n'a rien d'innovant. La mise en cause de la responsabilité de l'État, est habituelle et ne posait aucune difficulté juridique sur le plan conceptuel. Le Conseil d'État considère depuis très longtemps que la responsabilité de l'État est engagée pour carence lorsque, en application d'une loi, il aurait dû prendre une réglementation et qu'il ne l'a pas fait. Une série de décisions plus ponctuelles, et moins solennelles, jalonne la construction de cette appréciation : ainsi, une décision de 1974 a retenu la carence d'un préfet qui ne réglemente pas l'activité d'un établissement industriel portant atteinte à l'environnement. Au moment de l'adoption des textes relatifs aux établissements dangereux, incommodes et insalubres, il avait été prévu que l'État devrait les surveiller et encadrer leur activité en prenant, si nécessaire, des décisions ponctuelles déterminant les conditions dans lesquelles l'industriel devrait fonctionner. Une décision de 1965 assimilait déjà l'inaction d'un préfet dans ce domaine à une faute engageant la responsabilité de l'État. » (Mme Prada-Bordenave - audition du 30 novembre 2005) 571 « À chaque fois que l'inspection du travail détecte dans une usine un dysfonctionnement au regard de la réglementation du travail, elle doit faire remonter l'information et le ministre doit, si besoin est, transformer cette information en réglementation. Ensuite, l'État ne peut pas édicter une réglementation, puis s'en désintéresser. Il est tenu d'en surveiller l'application et, si elle apparaît mauvaise ou inadéquate, la changer. » (Mme Prada-Bordenave - audition du 30 novembre 2005) 572 M. Patrick Guyot, chef du bureau de protection de la santé en milieu de travail à la DRT a ainsi résumé cette problématique : « Je veux insister sur la question de la répartition des rôles en matière d'expertise, question qui ne se pose pas seulement pour le Plan santé au travail. Notre objectif est clair : nous tenons à bien séparer la phase d'expertise scientifique de la phase de concertation sociale - cela n'est pas sans susciter des réactions négatives des partenaires sociaux qui ont le sentiment d'être dépossédés de leur propre expertise. Pour l'État, la priorité est de pouvoir faire appel à une expertise indépendante et déconnectée de tout intérêt particulier. Pour ce faire, la phase d'expertise doit relever exclusivement des agences publiques de sécurité sanitaire et être clairement séparée de la phase de concertation sociale. C'est un point fondamental, mais assez difficile à faire passer... » (audition du 5 octobre 2005) 573 Par exemple, M. Jean-Claude André, directeur de la recherche scientifique de l'INRS : « Il n'existe pas de système où les chercheurs soient totalement indépendants, ne serait-ce que parce qu'ils ont un salaire. Au demeurant, la question de l'indépendance ne se pose pas seulement pour l'INRS, mais à l'occasion de tout choix. En tant que politiques, vous êtes de la même façon amenés à en faire. » (audition du 5 octobre 2005) 574 M. Marcel Goldberg a explicitement décrit le déséquilibre qui en résulte : « les membres du comité scientifique européen chargé de faire les recommandations pour les valeurs limites d'exposition au niveau de l'Union européenne - le SCOEL - sont exclusivement des scientifiques. Il n'y a aucune interférence avec les industriels ni avec les États pendant le travail d'expertise. (...) Ce n'est absolument pas le cas en France, où les textes confient l'expertise scientifique à ceux qui sont les premiers concernés ! (...) Beaucoup d'argent va dans notre système de santé au travail ; mais la quasi-totalité de ces ressources est gérée par ceux-là mêmes qui sont concernés par le problème et qui, dès lors, ne peuvent avoir un jugement et une action indépendants des objectifs de leurs mandants. Un représentant syndical qui siège dans une instance paritaire vient avec un mandat, tout comme le représentant des employeurs, et c'est parfaitement normal. La plupart du temps, il sait ce qu'il va voter avant que le débat n'ait commencé, avant même que l'expert n'ait parlé. » (table ronde du 14 septembre 2005) 575 Rapport 2003-015 précité 576 On citera par exemple M. Royez (FNATH) : « Si le compromis social a sa place dans les relations du travail, il n'a pas sa place dans le domaine de la santé au travail, qui met en jeu l'intégrité physique, voire la vie et la mort des personnes. On ne peut pas laisser les employeurs et les syndicats décider entre eux de ce qui est bon pour la santé de nos concitoyens. Comme le drame de l'amiante l'a d'ailleurs mis en lumière, les employeurs ont un intérêt à produire et les salariés ont un intérêt à continuer à travailler. S'agissant de l'amiante, on n'a pas vu parce qu'on n'a pas voulu voir, ce qui a été à l'origine d'un terrible drame. La responsabilité de l'État est d'avoir laissé faire et de ne pas être intervenu. Il nous faut donc aller vers une séparation très stricte entre, d'une part, l'évaluation des risques, qui doit être indépendante et scientifique, et ne souffrir l'intervention d'aucun lobby, et, d'autre part, la gestion des risques, qui, elle, peut être confiée en partie aux partenaires sociaux, dès lors que les règles ont été posées par le législateur et les pouvoirs publics » (audition du 25 octobre 2005) 577 « On oppose souvent la gestion du risque à l'évaluation en laissant entendre que les partenaires sociaux ne seraient pas nécessairement les mieux placés pour l'évaluation. Or le partenariat social est tout de même la chose la plus efficace qui puisse exister en matière de prévention dans les entreprises. » (Jean-Luc Marié, directeur général de l'INRS, audition du 5 octobre 2005). 578 Par exemple au cours de l'audition de M. Marcel Royez (FNATH) le 5 octobre 2005 : « En matière de risques professionnels, le système de veille sanitaire n'est pas suffisamment indépendant et efficace. Cela tient au fait que la santé au travail a été trop longtemps traitée à la marge de la santé publique, alors que les spécialistes de santé publique soulignent que le travail est l'un des déterminants essentiels de la santé publique, comme le confirme d'ailleurs les écarts d'espérance de vie selon l'appartenance socioprofessionnelle de nos concitoyens. Depuis l'origine, la santé au travail est laissée entre les mains des partenaires sociaux, représentants des employeurs et des salariés. J'ai coutume de dire que l'État s'est souvent comporté comme le notaire des accords, ou absence d'accord, entre partenaires sociaux. » 579 Audition du 5 octobre 2005 580 Table ronde du 28 septembre 2005 581 Rapport 2003-015 précité 582 Table ronde du 28 septembre 583 C'est le cas de M. Royez (FNATH) qui a reconnu une marge de manœuvre en faveur des syndicats : « je ne suis pas absolument convaincu que les partenaires sociaux soient prêts à accepter l'idée que l'État doit beaucoup plus intervenir dans ce domaine. Il me semble qu'ils continuent à considérer que ce dossier leur appartient, et que moins l'État s'en mêlera, mieux cela vaudra. Il y a là entre nous et eux une divergence de fond. (...)Ils doivent pouvoir négocier sur les moyens à mettre en œuvre pour appliquer les règles de prévention définies par la puissance publique. Mais ils ne doivent pas avoir les mains libres pour définir eux-mêmes ces règles. » (audition du 5 octobre 2005) 584 Par exemple, Mme Prada-Bordenave a porté, au cours de son audition du 30 novembre 2005, un regard très négatif sur la place de la veille dans le système sanitaire français : « Certes, il n'est peut-être pas très valorisant pour un chercheur, à l'époque de la biologie moléculaire, de s'échiner dans un laboratoire de l'INSERM à faire des cohortes sur les causes de morbidité en France. Sur ce point, notre pays est coupable de n'avoir pas suffisamment honoré les personnes qui s'occupaient de santé publique, pourtant considérée comme un problème majeur pendant toute la première moitié du XXe siècle - du temps où sévissait la tuberculose. Mais petit à petit, et jusqu'à l'épidémie de sida, les chercheurs en santé publique ont fait l'objet d'un relatif mépris. » 585 Table ronde du 19 octobre 2005 586 « Dès 1998, la volonté du réseau national de santé publique a été d'intégrer la santé au travail dans son champ d'activité. C'était une première en France. Jamais aucun organisme de santé publique sous tutelle du ministère de la santé n'avait intégré dans son champ de compétences la santé des populations en relation avec l'activité professionnelle. Cette évolution était très positive, mais elle posait des difficultés institutionnelles qui ont expliqué en partie la lenteur de la mise en route de notre activité, bien que, dès 1998, nous ayons proposé un programme de travail qui avait reçu l'aval de l'ensemble de la communauté. J'ajoute que n'existait à l'époque aucune culture de santé publique appliquée à la santé des populations au travail. Tout le système était structuré autour d'une approche individuelle mettant l'accent sur la santé des individus au travail. Il a fallu démontrer que nous apportions une dimension importante au champ de la prévention individuelle, comme il a fallu montrer au milieu de la santé publique que la santé au travail faisait partie de la santé des populations. » (audition du 11 octobre 2005) 587 Table ronde du 19 octobre 2005 588 Rapport 2003-015 précité 589 Audition du 5 octobre 2005 590 Audition du 11 octobre 2005 591 ERANET : « European Research area - net » (work) : Outil de structuration de l'espace européen de la recherché inséré dans le 6ème programme cadre européen. 592 Le champ d'application de REACH est considérable. Comme l'explique M. Daniel Garrigue dans son rapport d'information sur le dispositif : « Le règlement prévoit une obligation générale d'enregistrement par les fabricants et les importateurs, auprès de la future Agence européenne des produits chimiques, des substances fabriquées ou importées en quantité de plus d'une tonne par an, ce qui devrait représenter 30 000 substances commercialisées. (...) La notion de substance est ainsi définie dans la proposition de règlement : « un élément chimique et ses composés à l'état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition ». L'obligation d'enregistrement concerne donc aussi en principe les substances naturelles. » (rapport d'information n° 2549 déposé par la délégation de l'assemblée nationale pour l'union européenne sur la modernisation du cadre réglementaire des produits chimiques dans l'Union européenne, dit système Reach (COM [2003] 644 final / E 2433)) 593 L'étude est reprise sur le site internet de l'Institut syndical européen pour la recherche, la formation, la santé et la sécurité : http://hesa.etui-rehs.org/uk/dossiers/files/Sheffield_FINAL.pdf (rapport en anglais uniquement) 594 Par la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 précitée 595 Par la décision du 3 mars 2004 du Conseil d'Etat, précitée 596 cf. infra 2ème partie - III - 2 - a) 597 Rapport 2003-015 précité 598 On citera par exemple M. Jean-Luc Marié au cours de la table ronde du 19 octobre 2005 : « La mise en place du document unique a été un progrès fondamental, un véritable déclencheur dans nombre d'entreprises, y compris de très petites entreprises. Rappelons que le document unique n'est pas un plan de prévention, mais une évaluation des risques dans un établissement, qui oblige ensuite à mettre en place des correctifs nécessaires dans le cadre d'un plan de prévention. Le fait d'avoir laissé un délai d'un an aux entreprises pour le mettre en place et de ne pas avoir imposé un document structuré a été très bénéfique. » 599 Audition du 5 octobre 2005 600 « L'INRS a reçu à peu près 5 000 demandes d'établissement de document unique envoyées par des cabinets d'avocats qui demandaient où il fallait mettre les croix... Ils recevaient, moyennant honoraires, les entreprises et leur donnaient une liste des risques - on peut en trouver partout - en leur expliquant qu'il suffisait de mettre des croix ! Si l'évaluation des risques se limite à ce type de documents, elle ne sert à rien. En revanche, amener un établissement à établir lui-même, au moins dans un premier temps, une véritable évaluation des risques à partir de sa propre réflexion, du regard qu'il porte lui-même sur ses postes de travail notamment, est fondamental. Il faut l'obliger à réfléchir. Le problème est que l'inspection du travail, les CRAM et même l'INRS ont reçu des montagnes de lettres demandant de l'aide. Au contraire, c'est l'employeur qui précisément doit fabriquer le document unique et prendre conscience des risques présents dans son établissement, particulièrement s'il s'agit d'une PME-TPE. » (table ronde du 19 octobre 2005) 601 Table ronde du 19 octobre 2005 602 Table ronde du 19 octobre 2005 603 « La création de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) répond au souci d'éviter que le problème se reproduise avec les fibres céramiques, les éthers de glycol ou autres, en distinguant bien - même si ce n'est pas toujours aisé dans la pratique - ce qui relève de l'évaluation du risque et ce qui relève de sa gestion. Une fois que l'instance d'évaluation se sera prononcée sur un risque donné, il appartiendra à l'État, en concertation avec les partenaires sociaux et les autres acteurs, de définir les mesures de protection nécessaires. » (M. Jean-Denis Combrexelle, table ronde du 19 octobre 2005) 604 Ces débats ont souvent été relayés au cours des auditions. Par exemple par M. Coquin de la Direction générale de la santé : « Après avoir relu le rapport de l'inspection générale sur l'INRS, j'avoue ne pas comprendre pourquoi on a créé une AFSSE, puis une AFSSET. J'ai vécu la création de l'AFSSA, qui s'est opérée exactement dans les mêmes conditions, c'est-à-dire dans un contexte de crise - en l'occurrence, la crise provoquée par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) - et alors qu'il existait déjà un établissement public d'expertise auprès du ministère de l'agriculture, le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires (CNEVA). Or je suis convaincu que l'incontestable réussite de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) tient au fait qu'elle a été créée sur le socle du CNEVA, ce qui lui a permis de bénéficier immédiatement d'un fonds d'expertises considérable et notamment, dans le domaine de l'ESB, d'un laboratoire opérationnel. Dans le domaine de la sécurité en milieu du travail, les conditions étaient à peu près les mêmes avec l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) et l'INRS - même si je ne méconnais pas les difficultés liées au statut particulier du premier et encore plus particulier du second. » (table ronde du 19 octobre 2005) 605 Ce constat posé par Mme Froment-Védrine a été précisé au cours de son audition du 11 octobre 2005 : « Il ne reste plus guère qu'une quarantaine de toxicologues oeuvrant dans le domaine public en France, qui approchent l'âge de la retraite. Un rapport IVS-AFSSE datant de décembre 2004, qui a fait le point sur l'état de la toxicologie en France, fait apparaître une situation de paupérisation. Or, l'ensemble des missions que prévoit le « Plan santé au travail » porte, dans un premier temps, sur la toxicologie. Pour le moment, les toxicologues français travaillent surtout dans l'industrie privée, sur des produits spécifiques, et n'ont pas de connaissance en santé publique. Ceux qui ont des connaissances en santé publique travaillent essentiellement dans les centres antipoison. » 606 « Ces scientifiques de haut niveau sont des ingénieurs chimistes, des médecins du travail, des toxicologues, titulaires d'un doctorat et ayant une expérience de dix ans. Mais ce type de profil ne se trouve pas facilement sur le marché français. (...) On ne trouve pas non plus de toxicologues, alors que la toxicologie a été pendant longtemps une spécialité plutôt industrielle. (...) Or un diplôme de toxicologue n'est pas un BTS : c'est une formation très longue et très compliquée. Et comme ils ne sont pas nombreux, les toxicologues vont là où on les paie le mieux, c'est-à-dire dans l'industrie ou en médecine du travail - on est carrément 30 % au-dessous ! Moi, je ne sais pas faire + 30 %, surtout avec mon contrôleur financier qui m'enjoint de respecter la grille... Au mieux arriverais-je à trouver un toxicologue de vingt-six ans certainement remarquable, mais qui n'a jamais travaillé en dehors de ses études, alors que M. Combrexelle me demande très logiquement de recruter des seniors expérimentés ! Au surplus, à supposer que l'AFSSET puisse recruter en payant 30 % plus cher, les autres spécialistes qui travaillent sur le plan « santé/environnement » ne trouveraient pas cela normal. » (Michèle Froment-Védrine, table ronde du 19 octobre 2005) 607 Table ronde du 19 octobre 2005 608 Cette difficulté a été soulignée par Mme Froment-Védrine au cours de son audition du 11 octobre 2005 : « (...) nous nous heurtons à des difficultés lorsque nous sommes amenés à mobiliser des organismes autres que ceux mentionnés dans le décret du 1er mars 2002. Lorsque nous leur demandons des mesures particulières ou des travaux scientifiques, les délais de mise en œuvre de l'expertise ne sont pas nécessairement compatibles avec les délais que les décideurs demandent de respecter. Il peut également arriver que des organismes nous considèrent comme des nouveaux venus, et ne comprennent pas bien ce que nous venons faire sur le terrain de l'expertise. Cela suppose de notre part un travail de conviction et de diplomatie. » 609 Audition du 11 octobre 2005 610 Institut National du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 611 En Allemagne, le Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) ; 564 personnes. En Grande-Bretagne, le Health and Safety Laboratory ; 350 personnes. Aux Pays-Bas : le Rijksinstituut voor Volksgezondheit en Milieu, 1 500 personnes. 612 « Nous sommes tous d'accord sur ce fait : l'épidémiologie permet d'agir, même si l'on ne comprend pas les mécanismes. Dès lors que l'on a les preuves des relations entre les expositions, les doses, les effets, le fait que l'on ne comprenne pas le mécanisme est peut-être contrariant pour le scientifique qui aimerait savoir ce qui se passe au niveau de la cellule, mais cela n'empêche en rien de prendre une décision. » (table ronde du 14 septembre 2005) 613 Plan santé au travail 2005-2009, p21 614 Yves Roquelaure, Catherine Ha, Marine Sauteron : Réseau expérimental de surveillance épidémiologique des troubles musculo-squelettiques dans les Pays de la Loire - Surveillance en entreprises en 2002, mai 2005. 615 On citera par exemple M. Marcel Royez (FNATH) : « l'ensemble des médecins du travail constitue un formidable réceptacle de données sur la santé au travail, qui est complètement inutilisé. Il est essentiel de connecter les médecins du travail à la veille sanitaire. Imaginez ce qui aurait pu se passer si des centaines de médecins du travail avaient pu alerter les autorités supérieures au sujet des pathologies qu'ils constataient chez les salariés exposés à l'amiante ! » (audition du 25 octobre 2005) 616 M. Marc Boisnel a ainsi traduit le sens des réformes intervenues en 2003 et 2004, bien que celles-ci n'ait pas véritablement modifié les missions du médecin du travail en tant que telles : « L'ensemble de ces réformes nous a fait passer d'une logique institutionnelle à une logique de services vers trois types de destinataires : le salarié, l'entreprise - à travers les conseils en prévention - et la collectivité nationale dans une perspective de santé publique, notamment à travers la veille sanitaire. » (audition du 4 octobre 2005) 617 Il s'agit de l'article R. 241-58 du Code du travail : « Le médecin du travail peut participer, notamment en liaison avec le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre des missions qui lui sont confiées. » 618 Cf. supra 2ème partie - II - A - 2. b) 619 Mme Françoise Conso, professeur émérite des universités, membre du Collège national des hospitalo-universitaires de médecine du travail, a insisté sur cette dimension démographique : « La médecine du travail a bénéficié de la réforme de 1984 qui a inclus la spécialité dans l'internat. Cela a permis de disposer de médecins, certes peu nombreux, mais présents sur le terrain et surtout beaucoup plus impliqués dans l'évaluation des risques en milieu de travail que les praticiens formés jusqu'alors. Ce n'est pas rien, même s'il se pose des problèmes de démographie, auxquels vient s'ajouter un manque de lisibilité qui dissuade les jeunes médecins de s'engager dans cette discipline. Parallèlement, les effectifs de formateurs universitaires diminuent depuis cinq ans, du fait d'un problème de tutelle. Si le ministère du travail nous soutient totalement lorsqu'il s'agit de demander des postes, les suites données ont tendance à se perdre dans les arbitrages qui privilégient les disciplines cliniques au détriment de la médecine du travail. Sur les 32 professeurs de médecine du travail sur tout le territoire en 1998, nous ne sommes plus que 26 aujourd'hui. Pire, le nombre de postes de jeunes, autrement dit le vivier dans lequel se recrutent les futurs hospitalo-universitaires, est d'une pauvreté extrême : de 22 en 1998, ils ne sont plus que 17. » (table ronde du 19 octobre 2005) 620 C'est la position notamment de M. Royez (FNATH) : « À tout le moins, il faut que les médecins cessent d'être subordonnés aux employeurs. Ceux-ci financent la médecine du travail et il n'y a aucune raison que cela change. Mais dans ce domaine, le principe « qui paie, commande » est un très mauvais principe. Car pour l'instant, les médecins, dans leur très grande majorité, sont essentiellement au service de l'employeur. » (audition du 25 octobre 2005) 621 Le Dr Imbernon a expliqué ce risque au cours de la table ronde du 19 octobre 2005 : « Le médecin du travail étant amené à se prononcer sur l'aptitude, la connaissance de certains éléments pourrait avoir des implications sur l'emploi du salarié. Pour l'heure, le médecin du travail décide en fonction de son propre jugement, de ses examens cliniques, éventuellement d'examens extérieurs complémentaires, pour peu que l'employeur soit d'accord pour les payer, et enfin de ce que voudra bien lui dire le patient. Cette suspicion serait à mon avis atténuée - et peut-être même levée - si l'on était allé jusqu'au bout de la réflexion, engagée lors de la préparation de la réforme de la médecine du travail, sur les modalités de rémunération des médecins du travail. Les premières ébauches du PLAN SANTÉ AU TRAVAIL étaient allées relativement loin dans la suppression de la rémunération directement versée par l'entreprise en proposant un système de reversement. Cette piste ne doit pas être abandonnée. » 622 Le Dr Monique Larche-Mochel, chef de service de l'inspection médicale du travail, et Mme Catherine Tindillère, chef du pôle médecine du travail à la Direction des relations du travail ont reconnu que cette faible efficacité dans le domaine de la prévention était une préoccupation des médecins eux-mêmes : « À leurs yeux, dire que quelqu'un est apte ne protège pas sa santé. Dans l'état actuel des choses, seule l'inaptitude, c'est-à-dire l'exclusion du poste, protège sa santé. Or, le meilleur moyen de protéger sa santé est de déclarer qu'un poste est apte à recevoir un salarié, en indiquant les mesures qui sont nécessaires pour qu'il le devienne s'il ne l'est pas. C'est la solution qui est préconisée par beaucoup de médecins du travail. (...) La question de l'aptitude est une question juridique. Actuellement, le médecin du travail a, lorsqu'il reçoit un salarié en surveillance médicale individuelle, l'obligation d'émettre un avis d'aptitude de ce salarié au poste. C'est là une source de malaise, puisque cet avis peut avoir des conséquences, non seulement sur la santé au travail, mais aussi sur la relation contractuelle. » 623 « Repenser l'aptitude et le maintien dans l'emploi », PLAN SANTÉ AU TRAVAIL p. 57 : il s'agit de la mise en place d'un groupe de réflexion. 624 Audition du 4 octobre 2005 625 Ce point a été soulevé dans le rapport 2003-015 précité de l'IGAS : « La priorité donnée à l'évaluation des risques repose la question de la présence effective du médecin du travail en entreprise, la fameuse proportion de temps qu'il doit, en vertu de l'article R 241-7, consacrer à sa mission en milieu de travail. Pour que cette présence soit effective, elle exige une inversion par rapport à la logique en vigueur. La priorité est actuellement donnée à la visite médicale annuelle. Celle-ci, au contraire, devrait avoir une périodicité fixée en fonction des conditions de travail et des risques particuliers à l'entreprise dans laquelle le salarié travaille et à l'activité de laquelle il participe. » 626 « Le problème du médecin du travail est souvent de savoir s'il est en droit de rendre publics les problèmes de santé qu'il aura soulevés auprès de l'employeur, lorsque celui-ci ne répond pas aux conseils qui lui sont donnés. La question a été posée, sur le plan déontologique et sur le plan éthique. L'Ordre des médecins insiste, pour sa part, sur l'obligation de confidentialité. Selon lui, la mission du médecin du travail est de réussir la prévention. Or, s'il dénonce à l'extérieur, par exemple, l'usage de l'amiante, il va certes provoquer une action de la part d'un organisme de contrôle, mais il va perdre la confiance que lui porte l'employeur, lequel ne lui dira pas forcément tout ce qu'il aura à lui dire. Ce problème fait l'objet d'une grande discussion. Il est difficile de définir la limite entre ce que les médecins doivent taire et ce qu'ils doivent dire. » (audition du 4 octobre 2005) 627 Ainsi Gilles Brückner s'est-il interrogé sur cet obstacle formé par le secret médical actuel : « Sont-ils pour autant capables de répondre à l'ensemble des besoins d'information, de fonctionnement, de surveillance ? À l'évidence non. La culture du signalement, l'organisation de la collecte des données et de leur transmission pose toute une série de problèmes non encore résolus. » (table ronde du 19 octobre 2005) 628 Le Dr Larche-Mochel, chef du service de l'inspection médicale du travail, a ainsi expliqué toute la fragilité de son propre service : « L'inspection médicale se compose de deux médecins inspecteurs au niveau de l'administration centrale et de 43 médecins inspecteurs dans les directions régionales du travail. Ces 45 médecins doivent animer un réseau de 7 000 médecins du travail. Ces derniers n'ont aucun lien hiérarchique avec les médecins inspecteurs. Ce sont des médecins du travail de secteur privé, qui « appartiennent » aux entreprises. Les médecins inspecteurs doivent les mobiliser par la conviction. Le seul contrôle est celui qui est exercé par le biais du contrôle des agréments. » (audition du 4 octobre 2005) 629 Cette nécessaire indépendance a d'ailleurs été soulignée par M. Yves Coquin, chef du service « prévention programme de santé et gestion des risques » à la Direction générale de la Santé : « Le renforcement de certaines garanties de sécurité d'emploi reste à mes yeux un palliatif qui ne résout pas véritablement la question. Dans le régime agricole, les médecins du travail sont salariés d'une caisse et n'ont aucun lien de dépendance avec l'employeur. (...) Cet exemple doit être médité. Si nous voulons que la médecine du travail puisse jouer le rôle qui est le sien, il faut, premièrement, former de véritables médecins du travail, deuxièmement, les dégager de tout lien de subordination avec l'employeur. » (table ronde du 19 octobre 2005) 630 Extraits : « Dans chaque entreprise ou établissement qu'il a en charge, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés. (...) Cette fiche est transmise à l'employeur. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 236-4. La fiche d'entreprise peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et par ceux des organismes mentionnés à l'article L. 231-2. Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. » 631 « La visite annuelle était justifiée en 1946, compte tenu du tissu industriel et de l'état sanitaire général. Les conditions sont maintenant très différentes, y compris au niveau de la démographie médicale, ce qui conduit à se concentrer sur les risques actuels, et à venir, et pour le reste, à travailler avec la médecine de ville. » rapport 2003-015 précité 632 Pour rappel : la connaissance des risques, le contrôle, les instances de pilotage. 633 Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 634 Elles sont inscrites à l'article L. 230-2 du code du travail, il s'agit notamment « d'éviter les risques; évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; combattre les risques à la source ; tenir compte de l'état d'évolution de la technique; planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants » 635 Table ronde du 19 octobre 2005. 636 On citera par exemple M. Dominique Olivier (CFDT) : « Ainsi, les documents uniques d'évaluation des risques doivent être élaborés, conformément à l'excellente circulaire du 18 avril 2002 qui décrit sur vingt pages un dispositif participatif mettant à contribution les opérateurs eux-mêmes. » (table ronde du 28 septembre 2005) 637 Rapport 2003-015 précité 638 Audition du 21 juin 2005 639 Selon les informations communiquées par le ministère du travail, le succès de ces expérimentations a conduit le Gouvernement à créer 7 nouvelles cellules en 2006, et de parvenir au total de 22 cellules régionales en 2007. 640 Audition du 21 juin 2005 641 Audition du 5 octobre 2005 642 À l'exception de trois cas : les chantiers de désamiantage, les risques de chute de hauteur, et les risques d'ensevelissement. 643 « L'idée est ainsi progressivement venue, tout en maintenant la voie pénale pour les infractions particulièrement graves - les atteintes à la personne, par exemple -, de suivre l'exemple de l'Angleterre ou de l'Allemagne en envisageant deux types de sanctions administratives : des sanctions financières qui viendraient en substitution des sanctions contraventionnelles, et des obligations de faire dans une série de cas : le bâtiment, mais également le risque chimique - il manque un décret - ou encore les machines - qu'un inspecteur du travail n'a pas pour l'heure le droit d'arrêter, même s'il constate une infraction grave - ou le risque électrique. C'est ce qu'a proposé Jean Bessières dans le cadre de sa mission sur le devenir de l'inspection du travail. Voilà ce qui est sur la table. » (Audition du 5 octobre 2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||