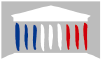N° 2884 _______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 février 2006 RAPPORT FAIT AU NOM DE LA MISSION D'INFORMATION (1) SUR LES RISQUES ET LES CONSÉQUENCES Président M. Jean LE GARREC, Rapporteur M. Jean LEMIÈRE, Députés. -- TOME II AUDITIONS (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. La mission d'information sur les risques et les conséquences de l'exposition à l'amiante, est composée de : M. Jean LE GARREC, Président ; MM. Jean-Marie GEVEAUX, Francis VERCAMER, Vice-présidents ; MM. Daniel PAUL, Patrick ROY, Secrétaires ; M. Jean LEMIÈRE, Rapporteur ; M. Gérard BAPT, Mme Sylvia BASSOT, MM. Ghislain BRAY, Antoine CARRÉ, Gérard CHARASSE, Roland CHASSAIN, Dino CINIERI, Alain CLAEYS, Louis COSYNS, Jean-Yves COUSIN, Mme Martine DAVID, M. Jean-Pierre DECOOL, Mme Catherine GÉNISSON, MM. Maurice GIRO, Maxime GREMETZ, Mme Marguerite LAMOUR, MM. Jean-Marie LE GUEN, Michel LIEBGOTT, Pascal MÉNAGE, Frédéric REISS, André SANTINI, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Philippe VITEL, Gérard WEBER et Michel ZUMKELLER. TOME SECOND SOMMAIRE DES AUDITIONS Les auditions sont présentées dans l'ordre chronologique des séances tenues par la Mission. - Audition de M. Jean-Yves LE DÉAUT, député, vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) (séance du 15 juin 2005) 9 - Audition conjointe de M. François DELARUE, directeur de la Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (DGUHC) du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, de M. Alain JACQ, chef du service de la qualité et des professions, et de M. Jean-Pierre BARDY, sous-directeur « qualité-construction » (séance du 21 juin 2005) 19 - Audition de M. Jean-Denis COMBREXELLE, directeur de la Direction des relations du travail du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, accompagné de Mme Mathilde MERLOT, ingénieur à la sous-direction des conditions de travail et de la protection contre les risques du travail (séance du 21 juin 2005) 27 - Audition de M. le professeur Didier HOUSSIN, directeur général de la santé (séance du 21 juin 2005) 37 - Audition conjointe de MM. Bernard PEYRAT, président, et Bruno CHEVALLIER, vice-président du Syndicat de retrait et de traitement de l'amiante et des autres polluants (SYRTA) (séance du 22 juin 2005) 47 - Audition conjointe de MM. Guy JEAN, président, et Alain LESEIGNEUR, directeur général de la société de désamiantage SOBATEN (séance du 22 juin 2005) 55 - Audition de représentants de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) : MM. François LIET, responsable du département développement et prestations, Dominique PAYEN, chef de projet chimie et environnement, Jean-François BOULAT, médecin-conseil du comité national, et Alain FRAISSE, secrétaire régional Sud-est (séance du 22 juin 2005) 63 - Audition conjointe de M. Serge MARTIN, pharmacien en chef, chef du Laboratoire d'analyse et de surveillance des particules inhalées de la marine (LASEM), et du contre-amiral Jean-Luc ALBERT, chargé des affaires nucléaires et de la protection de l'environnement (séance du 28 juin 2005) 71 - Audition de M. Christian COCHET, de la division santé et bâtiments du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) (séance du 28 juin 2005) 81 - Audition de Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND, chef du Laboratoire d'étude des particules inhalées (LEPI) de la ville de Paris, accompagnée de M. Laurent MARTINON, son adjoint (séance du 28 juin 2005) 89 - Table ronde sur le thème « La certification et le contrôle des entreprises intervenant dans la gestion de l'amiante résiduel » (séance du 29 juin 2005) 99 - Audition conjointe de M. Michel RICOCHON, chef de la mission d'animation des services déconcentrés de la Direction des relations du travail et de M. Jacques LE MARC, inspecteur du travail à Nantes (séance du 5 juillet 2005) 121 - Table ronde sur la gestion de l'amiante résiduel dans le patrimoine public (séance du 6 juillet 2005) 133 - Audition conjointe de M. Philippe BOURGES, ingénieur conseil à la direction des risques professionnels de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, et de M. Bruno BISSON, ingénieur conseil de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (séance du 6 juillet 2005) 157 - Audition de M. Hervé VANLAER, sous-directeur des produits et des déchets au ministère de l'écologie et du développement durable, accompagné de Mme Claudine BOURHIS et de Mme Pascale CLOCHARD (séance du 12 juillet 2005) 169 - Audition de représentants de la Fédération française du bâtiment (FFB) : M. Dominique FLORIO, président du groupement national amiante, et M. Gérard du CHESNE, ingénieur à la direction des affaires techniques (séance du 12 juillet 2005) 179 - Audition conjointe de Mme Isabelle MARTIN, directrice de la prospective et de la veille réglementaire de la société SITA France Déchets, et de M. Christophe CAUCHI, chef de centre du site de classe 1 de Villeparisis (séance du 13 juillet 2005) 187 - Audition conjointe de M. Didier PINEAU, président-directeur général d'Europlasma, et de M. Patrice BLANCHOT, responsable du développement de la société INERTAM-COFAL Europlasma (séance du 13 juillet 2005) 199 - Audition de représentants de la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) : M. Stéphane PENET, directeur adjoint de la direction des assurances de biens et des responsabilités, Mme Valérie DUPUY, responsable de la coordination juridique, et M. Jean-Paul LABORDE, conseiller parlementaire (séance du 13 juillet 2005) 205 - Table ronde sur l'état des connaissances scientifiques sur les risques sanitaires liés à l'exposition à l'amiante (séance du 14 septembre 2005) 213 - Audition de M. Claude GOT, président du collège scientifique de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), auteur du rapport de 1997 sur la gestion du risque et des problèmes de santé publique posés par l'amiante en France (séance du 27 septembre 2005) 239 - Audition de M. Dominique MOYEN, ingénieur général du corps national des Mines, ancien directeur général de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), co-fondateur du Comité permanent amiante dans les années 80 (séance du 27 septembre 2005) 245 - Audition de M. Jean-Luc PASQUIER, ancien responsable de la Direction des relations du travail (DRT), représentant la DRT au Comité permanent amiante et actuellement directeur délégué à la formation à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) (séance du 27 septembre 2005) 251 - Table ronde regroupant des partenaires sociaux sur les risques professionnels liés à l'amiante (séance du 28 septembre 2005) 259 - Table ronde regroupant des représentants de collectivités territoriales sur la gestion des bâtiments amiantés (séance du 28 septembre 2005 ) 287 - Audition conjointe de M. Gilles ÉVRARD, directeur des risques professionnels à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), et de M. Pascal JACQUETIN, directeur adjoint (séance du 4 octobre 2005) 299 - Audition conjointe de Mme le Dr Monique LARCHE-MOCHEL, chef de service de l'inspection médicale du travail, de M. Marc BOISNEL, sous-directeur des conditions de travail, et de Mme Catherine TINDILLÈRE, chef du pôle médecine du travail à la Direction des relations du travail (séance du 4 octobre 2005) 309 - Audition conjointe de M. Michel RICOCHON, chef de la mission d'animation des services déconcentrés de l'inspection du travail, et de M. Éric JANY, inspecteur du travail (séance du 5 octobre 2005) 319 - Audition conjointe de M. Marc BOISNEL, sous-directeur des conditions de travail à la Direction des relations du travail, de M. Patrick GUYOT, chef du bureau de protection de la santé en milieu de travail, et de Mme Isabelle PALUD-GOUESCLOU, chef du bureau de la politique de prévention des conditions du travail et de la médecine du travail (séance du 5 octobre 2005) 329 - Audition conjointe de M. Jean-Luc MARIÉ, directeur général de l'INRS, et de M. Jean-Claude ANDRÉ, directeur de la recherche scientifique (séance du 5 octobre 2005) 339 - Audition conjointe du Dr Renée POMARÈDE, responsable de la mission stratégie de l'Institut de veille sanitaire (IVS), et du Dr Ellen IMBERNON, responsable du département santé-travail de l'IVS (séance du 11 octobre 2005) 349 - Audition conjointe du Dr Michèle FROMENT-VÉDRINE, directrice générale de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET), de M. Dominique GOMBERT, directeur du département 1 d'expertise, et de M. Antoine VILLA, toxicologue (séance du 11 octobre 2005) 355 - Audition de M. Marcel GOLDBERG, professeur de santé publique à la faculté de médecine, épidémiologiste à l'INSERM, conseiller scientifique à l'Institut de veille sanitaire (IVS) (séance du 11 octobre 2005) 363 - Table ronde sur la prévention des risques sanitaires en milieu professionnel (séance du 19 octobre 2005) 369 - Audition de M. Jean LEMIÈRE, président du groupe d'étude de l'Assemblée nationale sur l'amiante (séance du 25 octobre 2005) 397 - Audition de représentants de la FNATH, association des accidentés de la vie : MM. Marcel ROYEZ, secrétaire général de la FNATH, Philippe Karim FÉLISSI, administrateur du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) pour la FNATH, et Alain PRUNIER, secrétaire général du groupement de la FNATH pour la Sarthe (séance du 25 octobre 2005) 405 - Audition de représentants de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante (ANDEVA) : M. François DESRIAUX, président, MM. Michel PARIGOT, Alain BOBBIO et André LETOUZÉ (séance du 25 octobre 2005) 415 - Audition conjointe des professeurs Marc LETOURNEUX et Christophe PARIS et de Mme Évelyne SCHORLÉ sur le suivi post-professionnel des salariés de l'amiante (séance du 26 octobre 2005) 425 - Audition de M. François MARTIN, président de l'Association de défense des victimes de l'amiante de Condé-sur-Noireau (ALDEVA) (séance du 26 octobre 2005) 437 - Audition de M. François DESRIAUX, président de l'Association nationale des victimes de l'amiante (ANDEVA), accompagné de MM. Michel PARIGOT, Alain BOBBIO et André LETOUZÉ (séance du 2 novembre 2005) 445 - Audition conjointe de M. Raymond CLAVIER et de Mme Andrée AMAT pour l'Association de défense des fonctionnaires territoriaux du Languedoc-Roussillon victimes de l'amiante (ADFTLRVA) (séance du 2 novembre 2005) 455 - Audition conjointe de M. Alain BOURDELAT, directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages (FGAO), et de M. Loïc BOUCHET, directeur adjoint (séance du 2 novembre 2005) 465 - Audition conjointe de M. Roger BEAUVOIS, président du conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), et de M. François ROMANEIX, ancien directeur du FIVA (séance du 8 novembre 2005) 473 - Audition de Mme Marianne LÉVY-ROSENWALD, présidente du conseil de surveillance du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) (séance du 8 novembre 2005) 483 - Audition de représentants de la Cour des comptes : M. Michel CRETIN, président de la sixième chambre, Mme Rolande RUELLAN, conseiller maître, et M. Frédéric SALAS (séance du 9 novembre 2005) 491 - Audition de Maître Michel LEDOUX, avocat (séance du 9 novembre 2005) 505 - Audition de Maître Michel Jean-Paul TEISSONNIÈRE, avocat (séance du 9 novembre 2005) 517 - Audition de représentants du Conseil d'État sur le rapport annuel relatif à la responsabilité et à la socialisation du risque : M. Jean-Michel BELORGEY, président de la section du rapport et des études, et M. Bernard PIGNEROL, maître des requêtes (séance du 15 novembre 2005) 527 - Audition de M. Michel LAROQUE, inspecteur de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS), auteur en 2004 d'un rapport sur « la rénovation de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles » (séance du 15 novembre 2005) 535 - Audition conjointe de MM. Franck GAMBELLI, président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), Pascal JACQUETIN, directeur adjoint à la direction des risques professionnels, et Raphaël HAEFLINGER, responsable du département « assurance des risques professionnels » (séance du 15 novembre 2005) 543 - Table ronde sur le thème : « Après l'amiante, quel avenir pour la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ? » (séance du 23 novembre 2005) 551 - Audition de M. Pierre FAUCHON, sénateur (séance du 29 novembre 2005) 573 - Audition de Mme Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY, coordinatrice du pôle santé publique du tribunal de grande instance de Paris (séance du 29 novembre 2005) 583 - Audition de Mme Emmanuelle PRADA-BORDENAVE, maître des requêtes au Conseil d'État (séance du 30 novembre 2005) 593 - Audition conjointe de Maîtres Michel LEDOUX et Jean-Paul TEISSONNIÈRE, avocats (séance du 30 novembre 2005) 605 - Audition de M. Robert FILNIEZ, avocat général près la Cour de cassation (séance du mardi 6 décembre 2005) 621 - Audition de M. Alain SAFFAR, sous-directeur de la justice pénale spécialisée à la Direction des affaires criminelles et des grâces (séance du 6 décembre 2005) 631 - Audition de représentants de la direction santé et sécurité d'Arcelor : M. Jean-Claude MULLER, directeur, et le docteur Michel DISS (séance du 13 décembre 2005) 639 - Audition de Mme Annie THÉBAUD-MONY, directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), coordinatrice du Réseau international Ban Asbestos et membre de Ban Asbestos France (séance du 14 décembre 2005) 653 - Audition de Mme Martine AUBRY, ancien ministre de l'emploi et de la solidarité (séance du 17 janvier 2006) 669 - Audition de M. Pascal CLÉMENT, Garde des Sceaux, ministre de la justice (séance du 18 janvier 2006) 687 - Audition conjointe de M. Xavier BERTRAND, ministre de la santé et des solidarités, et de M. Gérard LARCHER, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes (séance du 24 janvier 2006) 695 - Audition de M. François LOOS, ministre délégué à l'industrie, accompagné de M. Jean-Jacques DUMONT, directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle (DARQSI) (séance du 31 janvier 2006) 715 - Audition de l'amiral Alain OUDOT DE DAINVILLE, chef d'état-major de la Marine (séance du 23 février 2006) 727 - Auditions du Président et du Rapporteur 749 - Programme du déplacement à Bruxelles 751 - Glossaire 753 Audition de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Présidence de M. Jean-Marie GEVEAUX, Vice-président M. Jean-Marie GEVEAUX, Président : Nous sommes réunis pour notre première audition et je dois excuser notre Président, M. Jean Le Garrec, qui nous rejoindra la semaine prochaine et m'a demandé de le remplacer ce matin. Cette première audition nous permet d'accueillir notre collègue Jean-Yves Le Déaut, qui a bien voulu, et je l'en remercie, venir nous parler des travaux très riches menés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) sur l'amiante, et plus précisément du rapport publié par l'Office, en octobre 1997, intitulé : « L'amiante dans l'environnement de l'homme : ses conséquences et son avenir ». Le rapport de l'Office nous fournit un éclairage intéressant sur le problème de l'amiante, tout comme le document publié récemment par la Cour des comptes sur l'indemnisation des victimes de l'amiante. Je rappelle que le rapport de l'Office, dont le rapporteur était M. Christian Daniel, était sur le point d'être adopté lorsque sont intervenus, en avril 1997, les événements que nous savons et que, pour que ce travail considérable ne soit pas perdu, notre collègue Le Déaut, en qualité de président de l'Office, a décidé de reprendre le rapport de son collègue non réélu et de le présenter avec le sénateur Henri Revol. Il a ainsi pu être adopté en octobre 1997 et publié, avec ses nombreuses recommandations. Avant de donner la parole à M. Le Déaut, je voudrais indiquer que nous avons décidé d'adopter une vision prospective du problème de l'amiante et que nous prévoyons d'étudier les questions suivantes : la gestion de l'amiante résiduel à travers la problématique du diagnostic et du désamiantage, la prévention et les risques professionnels, les aspects scientifiques et médicaux, la prise en charge des victimes, le problème de la responsabilité pénale et celui de la gestion du dossier de l'amiante au niveau international. Ce programme doit normalement nous conduire au début de l'année prochaine. Vous connaissez bien la règle de ces auditions : nous allons vous écouter, après quoi nous engagerons la discussion avec les membres de la mission. M. Jean-Yves LE DÉAUT : L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a été saisi par le Bureau de l'Assemblée nationale le 21 juin 1995 et un rapporteur, M. Christian Daniel, alors député RPR des Côtes-d'Armor, a été nommé le 21 février 1996. A l'issue de travaux approfondis - notamment d'expertises publiques et contradictoires, conformément à l'habitude de l'Office -, il était prévu qu'il rende son rapport le 23 avril 1997 mais la dissolution est intervenue deux jours auparavant. Après le renouvellement de l'Assemblée nationale, élu président de l'Office, j'ai décidé de reprendre la plume, d'un commun accord avec le premier vice-président, le sénateur Henri Revol. Nous nous sommes largement inspirés du travail et des conclusions de Christian Daniel mais en tenant compte du décret du gouvernement Jospin qui est venu accélérer le traitement du problème, après une longue période d'inaction politique. Le problème de l'amiante n'est pas nouveau : il en a beaucoup été question de 1995 à 1998 puis on a en moins parlé et il resurgit maintenant au point de susciter la création d'une mission parlementaire. La dangerosité de l'amiante - contrairement à celle des OGM, par exemple, pour lesquels il n'existe qu'un risque potentiel - est scientifiquement établie : ce produit est cancérigène sous toutes ses formes. En outre, le problème est sans commune mesure avec celui, par exemple, de l'encéphalite spongiforme bovine, dont le nombre de victimes est réduit, même si son risque létal est avéré. On évalue actuellement le nombre de décès dus à l'amiante à 3 000 par an, les personnes en sursis étant environ 200 000, alors que seuls six décès imputables à l'ESB ont été comptabilisés en France et 90 en Grande-Bretagne. Les effets cancérigènes de l'amiante sont donc prouvés, une incertitude ne demeurant que sur un point : les risques encourus à la suite d'une exposition à de faibles doses. Une politique de précaution s'est donc révélée nécessaire et les pouvoirs publics, dans les années 1996-1997, ont pris des décisions, notamment avec le décret du 7 février 1996, qui prévoyait l'établissement d'un inventaire de tous les bâtiments amiantés et tendait à protéger les travailleurs de l'amiante. À l'époque, certains pensaient, à tort, que le problème était ainsi réglé. En fait, l'amiante est partout présent dans notre environnement et nous sommes condamnés pour longtemps à vivre avec lui. Il convient donc de nous y préparer en veillant à l'application de la réglementation, en l'évaluant et en l'améliorant, avec des solutions différentes selon les cas. La protection des travailleurs et des populations exposés au risque de l'amiante appelle encore des progrès. Les groupes socialiste et radical de gauche avaient déposé une proposition de loi sur le statut du travailleur de l'amiante qui prévoyait la publication au Journal officiel de la liste des bâtiments de l'État, des établissements publics, des collectivités locales et de leurs groupements dans lesquels l'inventaire réalisé sur la base du décret faisait apparaître un taux d'amiante supérieur à vingt-cinq fibres par litre d'air. De fait, certaines administrations se sont montrées plutôt laxistes et ont mis du temps à réaliser cet inventaire, à l'instar d'ailleurs de bâtiments privés comme la tour Montparnasse. Mais, passé le moment de l'émotion, la mobilisation retombe toujours et les lois ne sont pas appliquées. C'est une constante pour toutes les commissions d'enquête et autres missions parlementaires : les strates législatives et réglementaires s'accumulent car on manque d'énergie pour appliquer les textes en vigueur. La décision de juillet 1996 m'apparaît tardive car l'amiante est reconnu cancérigène depuis 1955 pour le cancer du poumon, depuis 1960 pour le mésothéliome, et la cancérogénicité de tous les types d'amiante est indiscutable, contrairement à ce que prétendent les Canadiens pour minimiser les risques. Sur ce point, je mets à votre disposition le courrier que nous adressa le Syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées en réponse au rapport de l'Office. Ce courrier montre à quel point les lobbys se mobilisent, dès lors que des propositions concrètes interviennent et que des intérêts sont en jeu. L'incertitude scientifique nourrit souvent l'absence de décision. Ce mécanisme est assez bien détaillé dans le rapport, je n'y reviens pas. L'inventaire des bâtiments amiantés est une procédure originale. Les propriétaires sont contraints, en cas de doute, à faire intervenir des techniciens pour procéder à une recherche visuelle et, en cas de présence d'amiante, pour remplir une grille d'évaluation à partir de l'analyse d'échantillons du matériau. Cette mesure doit être consolidée et étendue, au-delà des flocages, des calorifugeages et des faux plafonds, à tous les matériaux amiantés, non pas dans le but de diligenter immédiatement des travaux mais pour alerter les ouvriers. La totalité des produits incriminés sont énumérés dans le rapport de l'Office, mais j'imagine que vous reverrez les industriels de ces secteurs. L'Éducation nationale, contrairement à l'administration pénitentiaire, a été léthargique : à l'époque du rapport, sur 2 208 lycées, on avait trouvé de l'amiante dans 166 établissements et 733 diagnostics étaient en cours. Nous préconisions une extension de l'inventaire aux matériels de la SNCF et de la RATP. Il faut mieux définir, normaliser et contrôler les stratégies de prélèvement. Il convient aussi de prendre en compte le mode d'utilisation des locaux et de garder l'inventaire en mémoire. Votre rôle sera de vérifier que ces mesures ont été bien appliquées. Les travaux de désamiantage nécessitent une grande prudence : choix judicieux des techniques employées, qualification adéquate du maître d'œuvre, agrément des entreprises qui interviennent, respect des bonnes conditions d'exécution des chantiers, établissement de priorités, garantie de la protection des travailleurs et de l'environnement, traitement et traçabilité des déchets de l'amiante, financement des travaux par l'État, notamment dans les collectivités locales. J'en viens à la protection des travailleurs et des personnes vivant avec l'amiante, qu'elles soient en contact occasionnel avec ce produit ou qu'elles habitent dans des lieux amiantés. Les travailleurs des usines de production et de transformation de l'amiante ont été classés dans le secteur 1 ; il n'y en a plus depuis l'interdiction de 1997 mais il reste à traiter le problème de l'indemnisation, au sujet de laquelle nombre d'entre nous sommes interpellés dans nos circonscriptions. Le secteur 2 englobe les travailleurs intervenant dans le traitement et l'enlèvement de l'amiante : ceux-ci bénéficient de protections spécifiques mais nous avons préconisé que celles-ci soient renforcées. Quant au secteur 3, il concerne les personnes employées dans des activités susceptibles de provoquer l'émission de poudre d'amiante. Il s'agit de tous les ouvriers de maintenance et d'entretien ainsi que de certains professionnels du bâtiment comme les plombiers chauffagistes ou les électriciens. L'inventaire de certains grands bâtiments n'étant toujours pas effectué, j'en déduis que bien des travailleurs régulièrement exposés à l'amiante ne bénéficient toujours pas de protection. De fait, la surveillance médicale est subordonnée au recensement des populations exposées et l'idéal serait d'aboutir à un statut du travailleur de l'amiante. Dès lors que nous sommes condamnés à vivre avec l'amiante, il convient d'évaluer le risque de manière optimale et de définir une stratégie de gestion de ce risque adaptée. Je recommande donc que la question soit gérée en fonction de la dissémination de poussières dans l'environnement ou des travaux de destruction à entreprendre. En outre, le risque doit être totalement transparent et affiché, ce qui, jusqu'à présent, n'a pas été le cas. Il faut par ailleurs assurer l'indépendance de l'expertise - ce sujet est également abordé dans notre rapport. L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE) aurait dû jouer ce rôle, mais elle semble connaître de telles difficultés que son directeur scientifique vient de démissionner. Je ne suis pas un adepte des autorités administratives indépendantes car je trouve que le pouvoir politique doit exercer l'intégralité du contrôle relevant du pouvoir régalien de l'État. Toutefois, pour une gestion optimale du problème de l'amiante, la désignation d'une instance précise chargée de rendre compte de ses décisions devant le pouvoir politique me semblerait préférable au système qui a fonctionné jusqu'à présent. C'est ainsi que l'Autorité de sûreté nucléaire travaille : c'est le gendarme du secteur, qui intervient de manière indépendante, l'État lui déléguant une partie de son pouvoir. L'expertise effectuée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) sur le dossier amiante en 1996 est très intéressante. Quand une polémique survient, les experts émettent toujours des avis contradictoires, et même si un seul scientifique, contre tout le reste de la communauté, surestime le risque, sa thèse sera reprise par les médias et le citoyen en déduira que l'inconnu demeure et que les précautions maximales s'imposent. Voilà pourquoi une expertise publique, collective et contradictoire s'impose : le Parlement ne doit pas hésiter à se saisir du dossier afin de faire intervenir en public les experts, les uns face aux autres, et ainsi de se forger sa propre opinion. Les conclusions du rapport de l'INSERM ont suscité une polémique mais j'ai trouvé son travail remarquable. Par ailleurs, un tel problème comme l'amiante ne peut être réglé que si le système épidémiologique est performant. Or, en la matière, nous sommes déficients, comme le dénoncent tous les rapports parlementaires relatifs aux questions sanitaires. C'est sans doute ce qui explique le retard des prises de décisions : après la période de sensibilisation qui s'est écoulée entre 1995 et 1998, nous sommes retombés dans un traitement « mou » du dossier, alors que si nous disposions de bonnes références épidémiologiques, l'alerte aurait été maintenue. Le problème a été pris à bras-le-corps sous les gouvernements Juppé et Jospin - des mesures énergiques ont notamment été prises par Martine Aubry - mais, une fois l'alerte passée, la vigilance est retombée. Nous recevons pourtant, dans nos circonscriptions, beaucoup de victimes de l'amiante et d'organisations syndicales. M. Jean-Marie GEVEAUX, Président : Je vous remercie pour cette analyse extrêmement pertinente et je vous informe que la mission, à la rentrée de septembre, organisera une table ronde sur l'état des connaissances scientifiques relatives aux risques liés à l'amiante et que cette réunion accueillera les plus grands spécialistes français de ce dossier, parmi lesquels des épidémiologistes. J'espère que cela répondra à vos attentes, mon cher collègue. M. le Rapporteur : Je remercie M. Jean-Yves Le Déaut pour son introduction. Ce rapport incontournable, dont il a rappelé les grands axes, constitue la base de notre réflexion collective. Il expose les fondamentaux du sujet et émet des recommandations dont beaucoup n'ont toujours pas été suivies d'effets, s'agissant notamment du statut de travailleur de l'amiante. Vous appelez de vos vœux un débat parlementaire ; peut-être faudra-t-il en effet l'organiser, en toute sérénité, à la suite de nos travaux et de la publication du rapport du Sénat. Président de la commission de surveillance de l'usine COGEMA de la Hague, je puis témoigner d'un bon exemple d'expertise collective : plusieurs laboratoires ayant des colorations idéologiques différentes sont regroupés au sein du GRNC, Groupe radio-écologie du Nord Cotentin, pour travailler sur un sujet d'expérience commun et rendre compte de leurs analyses de manière publique, collective et contradictoire. On constate d'ailleurs qu'ils parviennent souvent à des conclusions identiques. L'usage de cette méthode serait essentiel, en particulier pour évaluer les risques présentés par les fibres de substitution à l'amiante. Les déchets de l'amiante, compte tenu de leur volume, sont plus difficilement contrôlables que les déchets radioactifs : que faire de ces centaines, voire de ces milliers de mètres cubes ? Daniel Paul, lors de la dernière réunion du groupe d'étude sur l'amiante, avait préconisé le développement de l'inertage. Le Québec, comme d'autres pays, continue à extraire, à conditionner, à commercialiser et à exporter l'amiante. Cet aspect - les implications internationales du dossier - constitue l'une de nos préoccupations et, connaissant votre intérêt pour tous les dossiers de santé publique, je suis persuadé que nous pourrons encore faire appel à vous, en temps utile, pour témoigner. M. Jean-Yves LE DÉAUT : L'État redorerait son blason en étant davantage présent sur de grands dossiers qui interpellent notre société. Le contrôle parlementaire à travers les commissions permanentes, les commissions d'enquête, les missions d'information et les offices le permet. C'est ainsi que l'OPECST a récemment tenu une journée d'auditions sur les risques épidémiques et organisera en octobre un débat sur la gouvernance mondiale de l'Internet. Nous devons aussi empêcher les groupes de pression de s'emparer du monopole de l'information et de la parole publique, qu'il s'agisse d'organisations associées à l'industrie ou d'associations. Ils font certes partie du paysage public, mais ne représentent pas la totalité des citoyens. La généralisation de l'expertise publique, collective et contradictoire permettrait de les contrecarrer. C'est du reste tout à l'honneur du Parlement que de jouer pleinement son rôle constitutionnel de contrôle de l'activité gouvernementale. Plus les déchets seront limités, mieux ce sera, mais force est de constater que les tonnages des déchets d'amiante ciment sont énormes, contrairement à ceux du nucléaire. Actuellement, ils sont transportés dans des décharges de déchets industriels spéciaux. Il convient d'explorer la voie de la vitrification, comme pour les autres déchets très dangereux, à l'instar de ce prévoit la loi Bataille de 1991 pour les déchets nucléaires. Mais notre pays n'a malheureusement pas pris le virage des écotechnologies. Il existe en effet quatre grandes technologies d'avenir : la France et l'Europe ont déjà perdu la bataille des nouvelles technologies de l'information et de la communication ; pour les biotechnologies, face à la concentration des grands groupes et aux moyens affectés aux organismes publics américains, nous sommes à la croisée des chemins ; pour les nanotechnologies, c'est un peu la même chose ; enfin, les écotechnologies offrent des débouchés notamment pour la réduction de la taille des déchets, leur élimination grâce aux torches à plasma, leur traçabilité et la réduction de la pollution des sols. Ces problèmes sont majeurs et mondiaux : il s'agit de réparer les dégâts provoqués par le développement des sociétés industrielles. M. Daniel PAUL : Votre rapport, 8 ans après sa publication, reste très pertinent : il soulève les problèmes tels qu'ils existent et pose les bonnes questions. À cet égard, vous avez souligné l'insuffisance des études épidémiologiques en France. Mais une masse d'informations énorme ayant été accumulée depuis une dizaine d'années, ne disposons-nous pas désormais des informations nécessaires aux indispensables décisions politiques qui se réduisent, me semble-t-il, à trois grandes mesures simples : l'indemnisation, la protection des salariés et de la population et l'élimination des déchets, y compris de l'amiante ciment ? Je suis pour ma part favorable à l'inertage, c'est-à-dire à un nettoyage par le vide de l'amiante. Mais la situation géographique du seul centre de France pratiquant l'inertage est un handicap, puisqu'il se trouve dans les Landes, trop loin des zones concernées. Il serait utile d'en construire au moins un autre plus au nord du territoire national. Vis-à-vis des associations et des malades, c'est désormais la question de la crédibilité des pouvoirs publics qui se pose. Des choses ont été faites il y a quatre ou cinq ans mais on a ensuite reculé devant l'obstacle, saisi de vertige devant les enjeux sociaux et financiers : l'indemnisation et l'élimination de l'amiante prendront du temps et coûteront très cher. C'est en nous inscrivant dans un objectif prioritaire de santé publique que nous répondrions aux attentes des malades et que nous satisferions les associations. M. Jean-Yves LE DÉAUT : Je suis assez d'accord avec vous. La capacité de production de l'unité de vitrification de Morcenx, dans les Landes, est inférieure à 10 000 tonnes par an. Or les seuls déchets de flocage et de calorifugeage dépassent ce volume. L'idée d'une deuxième unité de traitement est bonne mais sa capacité doit être calculée en fonction des besoins ; ce sera notamment la tâche de votre mission. Plus généralement, j'insiste sur le nécessaire développement des écotechnologies, qui pourront déboucher sur des solutions aux problèmes d'inertage ou de vitrification. Il faut être conscient que la mise en décharge de classe 1 ne fait que repousser le problème car la traçabilité ne se traduit pas par la suppression des substances dangereuses. Je sais que la différence de coût est élevée : à l'époque du rapport, la mise en décharge de classe 1 revenait à 400 ou 500 euros la tonne, tandis que le coût de la technique de la torche à plasma atteignait 1 000 euros la tonne. Le même problème de coût se pose à propos des effondrements miniers, entre le rachat de la mine et la mise en œuvre de techniques de comblement. Près de dix ans après nos propositions, que reste-t-il des mesures prises sous deux gouvernements ? Ont-elles vraiment été poursuivies ? Outre le problème sanitaire, où en est-on en matière d'indemnisation, de protection des travailleurs et de recensement ? Les bâtiments qui, à l'époque, avaient été jugés non dangereux ne se détériorent-ils pas aujourd'hui et ne méritent-ils pas de changer de statut ? M. Francis VERCAMER : Votre rapport était orienté vers l'indemnisation, la protection des personnes et le traitement des déchets. Mais j'ai relevé votre petit aparté sur l'intervention des lobbys, qui tentent de jeter un écran de fumée sur les matériaux de substitution. Cette mission a aussi pour rôle d'éviter qu'une catastrophe analogue ne se reproduise. Estimez-vous que les matériaux de substitution proposés sont aussi dangereux que l'amiante ou simplement que nous ne sommes sûrs de rien et que l'application du principe de précaution ne s'impose pas ? M. Jean-Yves LE DÉAUT : La question doit être posée aux experts ; ne l'étant pas moi-même, je ne puis vous répondre. Dans le chapitre du rapport intitulé « Mener une politique de précaution vis-à-vis des autres fibres », un tableau apportait toutefois des précisions : « Les fibres céramiques réfractaires provoquent chez l'animal d'expérience des cancers pulmonaires et de la plèvre, et des fibroses pulmonaires. Des plaques pleurales ont été rapportées chez l'homme. Les laines de roche provoquent des fibroses pulmonaires chez l'animal d'expérience, aux forts niveaux d'exposition. Les laines de laitier et les laines de verre ne provoquent pas de fibrose pulmonaire chez l'animal d'expérience, même à forte exposition. » Il incombe à votre mission de déterminer si la science confirme aujourd'hui ces résultats. Si c'est le cas, les fibres céramiques réfractaires doivent évidemment être employées avec prudence. Pourquoi ne pas organiser, sur ce thème, des auditions d'épidémiologistes, de médecins et de fabricants de ces types de matériaux ? En tout cas, la précaution s'impose. M. Philippe VITEL : Les prescriptions qui avaient été édictées en matière de signalisation des engins, de mise en conformité des véhicules et de formation des chauffeurs ont-elles fait disparaître tout risque lors du conditionnement et du transport des déchets ? La sécurité est-elle maximale ou bien la recherche de nouvelles approches s'impose-t-elle ? M. Jean-Yves LE DÉAUT : La question est intéressante mais, honnêtement, n'ayant pas suffisamment suivi le dossier, je ne sais pas y répondre. C'est le problème du suivi des rapports parlementaires. Je vous invite à profiter de la mission pour vérifier si des progrès ont été enregistrés, dans ce domaine comme dans les autres. M. le Rapporteur : Si je vous ai bien compris, il est impossible de s'appuyer sur l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale. M. Jean-Yves LE DÉAUT : Pourquoi son directeur scientifique - le professeur Denis Zmirou-Navier - vient-il de démissionner ? Pourquoi les représentants de l'AFSSE ne se déplacent-ils pas pour exposer leur point de vue sur les problèmes de santé et d'environnement ? La création de cette instance avait été demandée par M. Jean-François Mattei, alors député, soutenu par plusieurs groupes parlementaires, pour suivre les grands dossiers touchant à la santé et à l'environnement. S'agit-il d'un problème de moyens ? Ce que je sais, c'est que, lorsque j'ai invité l'Agence à venir témoigner devant la mission d'information sur les OGM, elle s'est déclarée incompétente ! M. le Rapporteur : C'est un problème. Il serait nécessaire que cette institution évolue. Nous la contacterons pour examiner ses difficultés. M. Patrick ROY : La mission ne doit pas se disperser mais rester centrée sur l'indemnisation, la protection et l'élimination. J'ajouterai cependant un quatrième point d'investigation : bien connaître l'histoire pour que des événements dramatiques d'une telle ampleur ne se reproduisent pas. Par ailleurs, des milliers de travailleurs sont toujours exposés à l'amiante, avec une incertitude préoccupante concernant le degré de risque qu'ils encourent. Enfin, vous avez émis le souhait de voir un débat parlementaire organisé à propos de l'amiante. Eu égard à la diversité des problèmes liés à ce produit - d'ordre technique, financier et sanitaire -, plusieurs débats ne seraient-ils pas nécessaires ? M. Jean-Yves LE DÉAUT : S'agissant des risques actuels, je rappelle que nous demandions, dans le rapport, que soient inventoriés tous les bâtiments publics où le taux d'amiante excédait vingt-cinq fibres par litre d'air, afin de rendre l'information la plus transparente possible. Le décret a été pris et il faut absolument l'appliquer, d'autant que des milliers de travailleurs font aujourd'hui partie de la troisième catégorie, celle des expositions liées à la maintenance des bâtiments. Cela m'amène à parler du statut du travailleur de l'amiante. J'avais déposé une proposition de loi sur ce sujet mais les choses n'ont pas avancé car les mesures préconisées avaient un coût financier : il s'agissait de conférer aux travailleurs de l'amiante un statut similaire à celui des personnes travaillant dans des secteurs professionnels à risques. M. le Rapporteur : À la fin de l'avant-propos du rapport, vous proposiez le lancement d'une campagne d'information intitulée « l'amiante dans l'air, l'amiante dans mes poumons », mais celle-ci ne s'est pas concrétisée. M. Jean-Yves LE DÉAUT : Des campagnes d'information ont tout de même été organisées. Ont-elles été efficaces ? Ont-elles atteint leur cible ? Je l'ignore. Mais combien de temps a-t-il fallu pour faire passer des campagnes contre le tabac ? Combien de réticences a-t-il fallu vaincre ? Le problème de l'amiante est qu'il ne se voit pas et, le risque n'étant pas identique partout, qu'il est difficile de prendre conscience que l'on y est exposé. La gestion du risque doit prendre le coût en considération, et il convient de commencer par ce qui est prioritaire. M. Jean-Marie GEVEAUX, Président : La réglementation en vigueur est-elle suffisante ou faut-il aller plus loin ? M. Jean-Yves LE DÉAUT : Il faut peut-être dépoussiérer les textes mais je ne pense pas, par exemple, que le problème sera résolu en abaissant les seuils de tolérance. Il le sera plutôt en améliorant la transparence et en appliquant des mesures de suivi régulier des bâtiments. Inerter, vitrifier, enserrer les matériaux amiantés permet de régler le problème pour des centaines, voire des milliers d'années. Faut-il créer des décharges spécifiques ou encore dresser des barrières supplémentaires - barrière géologique, inertage et enveloppement dans un autre produit -, comme pour le nucléaire ? Vu la quantité considérée, cela me paraît difficile. Les solutions de traitement préalable ou d'élimination par torche à plasma sont plus adaptées. Par conséquent, au lieu d'adopter une nouvelle loi et d'attendre sa batterie de décrets, il est préférable de préciser les textes existants et d'analyser ce qu'il reste à faire. C'est la piste que nous avions privilégiée, après la catastrophe d'AZF, à propos des risques industriels. Une des mesures adoptées pourrait être étendue à l'amiante : l'indication des risques industriels dans les actes de vente. Je ne crois pas que la réglementation prévoie quoi que ce soit, à cet égard, pour l'amiante. M. Ghislain BRAY : Une analyse est obligatoire préalablement à toute vente immobilière. Mme Martine DAVID : En effet, un certificat doit être présenté à l'acheteur, y compris pour les appartements. M. Jean-Marie GEVEAUX, Président : Dans mon département, nous avons également contrôlé l'ensemble des bâtiments publics, notamment les collèges. M. le Rapporteur : Même si un bâtiment est reconnu sain aujourd'hui, le nombre de fibres par litre est susceptible d'évoluer et de dépasser les normes autorisées si l'on fait tomber un mur dans dix ans. M. Jean-Yves LE DÉAUT : Bien sûr ! M. Frédéric REISS : Je souligne à mon tour la qualité de l'exposé de Jean-Yves Le Déaut, mais je me demande comment améliorer l'information du grand public sans pour autant affoler les foules. Après les années 1995-1997, qui ont été propices à une sensibilisation, l'attention est retombée et nous sommes à la merci de coups médiatiques comme ceux concernant Jussieu ou la tour Montparnasse, sans que cela change quoi que ce soit pour le petit lycée de province. Le système épidémiologique français n'est pas à la hauteur et un effort reste également à accomplir en matière d'écotechnologies. Dans l'affaire Metaleurop, par exemple, ce sont davantage les licenciements que les problèmes environnementaux qui ont sensibilisé l'opinion publique. Sur quels problèmes notre mission, selon vous, doit-elle axer ses efforts pour assurer un traitement serein du dossier ? M. Jean-Yves LE DÉAUT : La création de cette mission est le fruit des pressions exercées sur les parlementaires par les victimes, qui demandent une indemnisation. La gestion du dossier par un fonds d'indemnisation et les procès en cours rendent la situation très incertaine pour ces acteurs : c'est un premier point. Mais l'axe d'intervention principal, aujourd'hui, doit être la protection des travailleurs condamnés à vivre avec l'amiante. Les entreprises spécialisées prennent les précautions nécessaires car c'est leur métier, mais le problème est préoccupant pour les entreprises travaillant occasionnellement dans des bâtiments touchés. Il convient donc de vérifier si l'inventaire est achevé - je pense que non, en dépit des décrets - et de mettre en place un système de mesures dans les locaux présentant un risque, voire, de façon aléatoire, dans ceux où l'amiante est censée ne pas pénétrer dans l'environnement. Et puis l'information doit être transparente pour les personnes y travaillant ou y logeant. Mme Martine DAVID : Dans une édition de la Manche d'Ouest-France du vendredi 10 juin, il est indiqué que, sur vingt-quatre chantiers de réhabilitation ou de démolition contrôlés en l'espace de dix-huit mois, aucun ne répondait à l'obligation de repérer la présence éventuelle d'amiante. Dans ces conditions, les conséquences dramatiques risquent de s'accumuler. La Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle met pourtant des professionnels à la disposition des chefs d'entreprise pour les aider à déceler la présence d'amiante. Quels moyens supplémentaires devons-nous mettre sur pied pour faire appliquer la réglementation et au moins contenir les conséquences de l'amiante ? Le nombre de victimes à venir pourrait être limité mais il faudrait s'en donner les moyens. M. Jean-Marie GEVEAUX, Président : Dans le secteur public, il est impossible de passer à travers l'obligation. M. Jean-Yves LE DÉAUT : Il n'en demeure pas moins que des ouvriers sont exposés au risque et c'est effectivement un grave problème. M. le Rapporteur : Vous n'avez pas réagi à ma remarque sur l'aspect international du dossier. M. Jean-Yves LE DÉAUT : Dans le rapport de l'Office, nous comparons les mesures prises en France et à l'étranger. Les autres pays ont souvent adopté des attitudes plus pragmatiques mais ont attendu très longtemps avant d'en venir à des dispositions obligatoires. Aujourd'hui, la réglementation est à peu près comparable partout, mais il faudrait explorer les contrôles effectués à l'étranger pour les comparer à ceux pratiqués en France. M. Jean-Marie GEVEAUX, Président : Je vous remercie vivement pour votre exposé et vos réponses à nos questions. Audition conjointe de Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Nous avons le plaisir d'accueillir M. François Delarue, directeur de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, accompagné de M. Alain Jacq, chef du service de la qualité et des professions, et de M. Jean-Pierre Bardy, sous-directeur « qualité/construction ». Ils nous expliqueront le rôle de leur direction dans l'encadrement juridique de la gestion de l'amiante résiduel, thème que notre mission a placé en tête de son programme de travail. Le diagnostic, les chantiers de désamiantage et le traitement des déchets étant au cœur du dossier de l'amiante depuis l'interdiction édictée en 1997, il est important de savoir si la réglementation est pertinente et comment elle est appliquée. Nous vous entendrons donc avec intérêt nous exposer vos méthodes et votre approche. Je précise qu'après avoir entendu les administrations compétentes en matière d'encadrement juridique, la mission entendra les acteurs du diagnostic et du désamiantage, puis elle s'intéressera à la manière dont la réglementation est contrôlée. Deux tables rondes sont également prévues, d'une part sur la certification et le contrôle des entreprises, d'autre part sur la gestion de l'amiante résiduel dans le public. Enfin, deux réunions seront consacrées à la gestion des déchets. La mission poursuivra sa réflexion en étudiant la prévention et les risques professionnels, les aspects scientifiques et médicaux des risques liés à l'amiante, la prise en charge des victimes, le problème de la responsabilité pénale et la gestion du dossier de l'amiante au niveau international. M. François DELARUE : Je préciserai en premier lieu que la Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (DGUHC) intervient au titre de ses responsabilités en matière de réglementation de la construction, le volet « santé publique » du dossier étant piloté par la direction générale de la santé. S'agissant de l'habitat existant, le dossier de l'amiante se caractérise par son ampleur, aussi inhabituelle que la complexité des problèmes soulevés. L'amiante a été utilisé tout au long du XXe siècle pour ses qualités en matière de protection contre l'incendie, qui ont conduit à l'employer en flocage, notamment dans les constructions métalliques, et pour ses qualités thermiques mais aussi comme matériau d'usage sous la forme d'amiante-ciment. De par ces usages divers, il y a de l'amiante dans de nombreux bâtiments, sous des formes et avec des caractéristiques très différentes. Parce qu'il est friable lorsqu'il a été floqué et dur lorsqu'il est utilisé sous forme d'amiante-ciment ou de revêtement de sol, le matériau a des comportements dissemblables, soit qu'il libère des fibres spontanément du fait de l'usure, soit qu'il n'en dissémine pas, sauf s'il est perforé au cours de travaux. La doctrine des experts en matière sanitaire a changé au fil de l'évolution des connaissances, ce qui a conduit à des exigences croissantes. Ainsi, le seuil à partir duquel les travaux de désamiantage ont été jugés indispensables est descendu de vingt-cinq à cinq fibres par litre. Enfin, les contraintes opérationnelles sont fortes. En effet, le désamiantage est une opération extrêmement délicate qui, si elle n'est pas conduite selon des procédures de sécurité strictes, peut faire plus de dégâts que de bien. Se pose donc la question de la compétence des entreprises intervenantes. De même, repérage et diagnostic supposent des techniciens suffisamment bien formés pour établir des diagnostics de qualité certaine. Or, on partait de zéro lorsque la politique de prévention a été décidée. Tous ces éléments expliquent que la réglementation a évolué par étapes successives, dont la dernière a été, en 1997, l'interdiction totale d'emploi de matériaux amiantés, imposée progressivement. L'interdiction du flocage date de 1977. L'obligation de désamiantage, soit par confinement, soit par élimination, ayant été posée, il a fallu définir à partir de quel seuil déclencher les travaux. Les décrets de 1996/97 ont fixé à 25 fibres par litre, et celui de 2001 à 5 fibres par litre, le seuil de présence d'amiante au-delà duquel il y a obligation d'intervention. L'obligation de repérage de l'amiante sous forme de calorifugeage, de flocage et dans les faux plafonds, dans l'ensemble des bâtiments, a été instituée en 1997. Elle ciblait l'amiante friable, qui est à l'origine des émissions spontanées de fibres dans l'air. Par la suite, la loi SRU (loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain) a introduit l'obligation de produire un état de présence ou d'absence d'amiante lors de toute vente d'immeuble. Cette mesure d'ordre général, qui vaut pour tout bâtiment, vise à informer le nouveau propriétaire des vices éventuels. Enfin, le dossier technique amiante - DTA - a été institué en 2001. C'est un document destiné à être tenu à jour en permanence et c'est aussi un dispositif plus large que celui prévu dans les décrets de 1996-1997 car il porte sur une liste de produits amiantés assez étendue. Le DTA a notamment pour objectif de protéger les ouvriers qui, à l'occasion de travaux, pourraient libérer des fibres d'amiante qui n'auraient pas été rejetés spontanément dans l'atmosphère. La réglementation a fixé deux échéances pour l'établissement du DTA : fin 2003 pour les établissements recevant du public de catégorie 1 à 4, fin 2005 pour les autres et les parties collectives des immeubles d'habitation. Telle est la réglementation que nous avons contribué à définir, en liaison avec nos collègues de la direction générale de la santé. M. le Rapporteur : Notre mission a entendu parler de centaines de milliers, sinon de millions, de mètres carrés d'immeubles amiantés. Avez-vous les moyens d'évaluer le nombre d'immeubles réellement touchés ? M. le Président : La question se pose aussi bien pour les immeubles privés que pour le parc immobilier de l'Etat et des collectivités territoriales. Il ressort par ailleurs de votre exposé que la réglementation s'est progressivement faite plus drastique et plus contraignante. Pensez-vous que cette évolution se poursuivra, ou la considérez-vous à présent achevée ? M. Alain JACQ : Lorsque les premiers textes sont parus, on a évalué à 1 % de l'ensemble des logements ceux qui contenaient de l'amiante. Quelque 300 000 logements pourraient donc contenir des matériaux dangereux, le plus souvent utilisés pour le calorifugeage des chaudières. Certaines maisons construites de manière industrielle avec des armatures métalliques n'ont pas été floquées, mais on y trouve, dans 10 à 15 % des cas, des dalles amiantées. Nous vous fournirons les chiffres dont nous disposons pour d'autres types d'équipements, que je n'ai pas en tête. Mais il s'agissait de l'évaluation sommaire qui avait été faite à l'époque pour apprécier le risque global. Mme Martine DAVID : Vous avez retracé l'évolution de la réglementation mais vous ne nous avez rien dit de sa mise en oeuvre. Pensez-vous qu'elle soit appliquée de manière satisfaisante ? Les contrôles sont-ils assez nombreux pour permettre de déterminer si la prise de conscience s'est faite de l'importance du dossier ? M. François DELARUE : C'est une question difficile... Mme Martine DAVID : Je le sais, mais notre mission peut être conduite à formuler de nouvelles préconisations. Vos réponses, comme celles des autres personnalités qualifiées que nous entendrons, nous aideront à définir l'évolution réglementaire nécessaire. M. François DELARUE : Les décrets de 1996-1997 qui posaient l'obligation de repérer les matériaux qui présentaient le plus de risques ont été appliqués correctement, même si l'on ne peut savoir si cela a été fait absolument partout. Actuellement, nous sommes dans la phase d'application du DTA, dont l'objet est d'établir un diagnostic plus permanent. Cette phase est encore inachevée, mais l'on constate, ici où là, certains retards manifestes dans la mise en œuvre du dispositif. Le dossier, très médiatisé, de la tour Montparnasse en est un exemple - mais dans ce cas, le propriétaire avait fait le DTA, bien qu'avec retard. Pour 2003, nos collègues de la direction générale de la santé disposent des rapports des contrôleurs techniques, qui sont en cours d'analyse par le CSTB. Les conclusions qui paraîtront dans quelques mois donneront des éléments d'appréciation sur l'état d'avancement du DTA. Cela n'interdit pas de rappeler, par le biais des préfets par exemple, la nécessité du diagnostic technique. M. le Président : Le temps nous manquera vraisemblablement pour aborder toutes les questions qui figurent dans la liste qui vous a été adressée. Je vous serais donc reconnaissant de nous adresser vos réponses par écrit. M. François DELARUE : Nous n'y manquerons pas. M. le Président : J'en reviens aux surfaces amiantées dans les bâtiments publics : qu'en est-il ? Par ailleurs, l'ampleur du dossier ne justifierait-elle pas la création d'une cellule de suivi, composée de membres de votre direction, responsables techniques, et de membres de la DGS ? M. André SANTINI : Existe-t-il des immeubles de grande hauteur qui ne contiennent pas d'amiante ? M. François DELARUE : Beaucoup en contiennent. Si l'amiante a été si massivement utilisé, c'est principalement en raison de ses qualités dans la protection contre l'incendie. Les bâtiments recevant le public et les immeubles de grande hauteur (IGH) étant soumis à une réglementation particulière à ce sujet, le recours à l'amiante y a été très fréquent. C'est pourquoi il y a une forte suspicion de présence d'amiante, notamment dans les bâtiments construits après guerre, surtout lorsqu'ils ont une structure métallique. M. Alain JACQ : Lorsque l'obligation de repérage a été instituée, elle a été couplée avec une obligation de réalisation de travaux si un certain seuil d'amiantage était atteint. Si l'on repérait moins de cinq fibres par litre, il n'était pas besoin de faire de travaux, si bien que des IGH peuvent toujours contenir de l'amiante, mais en faible quantité. Alors que l'on estime à environ 700 le nombre d'IGH en France, à ce jour seulement deux demandes de dérogation au délai réglementaire de désamiantage ont été déposées : une pour Jussieu, l'autre pour le Musée des sciences de l'homme. A l'inverse, il est arrivé qu'un propriétaire devant faire une réhabilitation générale en profite pour traiter le problème, même si le seuil d'intervention légal n'avait pas été atteint. Je pense que les IGH ont été traités. Quelques problèmes peuvent demeurer dans les IGH d'habitation car il s'agit de copropriétés, d'une gestion plus compliquée. Pour celles-là, nous avons demandé à nos services déconcentrés de mener les investigations nécessaires et d'engager des campagnes d'information des élus, des promoteurs et des maîtres d'ouvrage. M. André SANTINI : Nous sommes en train de négocier le rachat de la tour EDF et j'ai été surpris de l'ignorance des syndicats, qui semblent sincèrement persuadés que le bâtiment ne contient pas d'amiante, alors qu'il a été construit en 1972. M. François DELARUE : C'est peut-être le cas si la structure de l'immeuble est entièrement en béton. Pour ce qui est d'une éventuelle cellule de suivi, je n'y vois pas d'objection, bien que nous entretenions des relations étroites avec la DGS. Si elle devait voir le jour, il faudrait y associer la direction des relations du travail. Mme Martine DAVID : Je ne suis pas entièrement satisfaite de la réponse qui m'a été faite. Maintenant que l'on sait le danger que présente l'amiante, on ne peut faire semblant. Il faut prendre toutes les précautions nécessaires, évaluer la réglementation et s'assurer que les résultats obtenus sont toujours meilleurs. Or, pour ce qui est de l'évaluation, vous avez évoqué un rapport de 2003, dont les conclusions ne sont pas encore connues. Le retard est flagrant. Si l'on s'appuie sur des données anciennes, comment avoir une estimation assez fine de la situation présente ? Le Président Le Garrec a évoqué la création d'un observatoire, ce à quoi je ne serais pas hostile, à condition qu'il dispose des moyens nécessaires. Mieux vaudrait, en effet, une instance de ce type que d'attendre un nouveau rapport dont l'analyse demandera beaucoup de temps, à condition que le pouvoir politique s'engage à ce qu'elle permette d'évaluer l'évolution de la réglementation et son incidence. La crainte que suscite l'amiante est patente, et les maladies qu'il induit sont malheureusement bien réelles. M. François DELARUE : À mon sens, il faut distinguer la cellule éventuellement chargée d'animer une politique interministérielle de l'évaluation de l'application de cette politique. Mme Martine DAVID : Cela va de pair. M. François DELARUE : Étant donné l'extrême dispersion des immeubles concernés et des acteurs, nous avons une vision impressionniste de l'application de la réglementation. L'évaluation ne peut donc se faire que par le biais des rapports des contrôleurs techniques. On compte 6 000 diagnostiqueurs agréés sur l'ensemble du territoire, ce qui n'est pas mal. La réglementation relative au DTA a été rédigée avec la volonté de responsabiliser les propriétaires. Ce document est destiné à être communiqué aux occupants des immeubles et aux comités d'entreprise lorsqu'il s'agit de sociétés. On a considéré que les usagers demanderont des comptes et obligeront les gestionnaires d'immeubles à réagir. L'exemple de la tour Montparnasse a montré que la pression des utilisateurs fait bouger les choses. M. le Rapporteur : S'agissant des préconisations, si l'on constate que le seuil fixé est dépassé, quelle solution choisit-on : le retrait, le confinement ou la destruction ? M. Alain JACQ : Toutes sont envisageables. M. François DELARUE : S'il apparaît, au terme d'un repérage, que le taux d'amiante présent dans l'immeuble est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire est tenu de faire des travaux, mais la réglementation ne dit pas lesquels. L'étude doit donc être faite au cas par cas. La réponse spontanée est d'enlever l'amiante, mais cette solution doit être mûrement pesée, car elle suppose des techniques très sophistiquées de protection des ouvriers. Ces techniques sont maintenant bien connues mais, au début, le retrait de l'amiante a été fait dans des conditions qui ont pu avoir eu des conséquences sur la santé des travailleurs concernés. Par ailleurs, le confinement a plutôt mauvaise presse en France, ce qui n'est pas le cas à l'étranger. C'est une des solutions possibles. M. Jean-Pierre BARDY : Le confinement est en effet mal vu dans notre pays. J'ajoute que si un maître d'ouvrage décide le retrait de l'amiante, il s'engage certes dans un gros chantier, mais il a au moins la certitude de ne pas avoir à y revenir dix ans plus tard. Pour les IGH, il arrive fréquemment que, lorsque des travaux doivent être entrepris, le maître d'ouvrage décide le retrait de l'amiante, même si le seuil plafond n'est pas atteint. Mais cela implique un chantier très important, car il faut rétablir le même niveau de sécurité anti-incendie. C'est donc bien de rénovation totale qu'il s'agit. M. André SANTINI : L'expérience de Jussieu est très traumatisante, et mieux aurait valu envisager d'emblée une solution plus expéditive que celle qui a été retenue. La tour EDF sera démolie après confinement, ce qui reviendra beaucoup moins cher qu'un désamiantage à la petite cuiller. M. le Président : Comment expliquer que le seuil d'intervention actuel soit fixé à cinq fibres par litre ? Pourquoi ne pas avoir choisi la tolérance zéro, alors que personne n'est en mesure de calculer la dangerosité de l'amiante à long terme et que nul ne sait comment l'amiante présent sous certaines formes dans un bâtiment va évoluer, aussi réguliers soient les contrôles ? Il est bien d'avoir accru le niveau d'exigence, mais pourquoi ne pas mener la démarche à son terme ? M. François DELARUE : Cette question a trait à des sujets d'ordre médical sur lesquels nous ne sommes pas compétents. En réalité, le seuil de cinq fibres par litre existait déjà dans la réglementation instituée par les décrets de 1996-1997. La règle était la suivante : au-delà de vingt-cinq fibres par litre des travaux de désamiantage sont obligatoires ; entre vingt-cinq et cinq fibres par litre, une surveillance renforcée est nécessaire ; en deçà de cinq fibres par litre, la surveillance est obligatoire tous les trois ans. Cette réglementation n'était pas dénuée d'ambiguïté, puisque l'on pouvait se demander à partir de quand il convenait d'intervenir : à partir de cinq fibres par litre, ou à partir de vingt-cinq ? Selon des études datant de 1974, il ressortait que le taux d'amiante présent dans l'air de Paris était de quelque 4,5 fibres par litre. Voilà pourquoi le seuil de cinq fibres par litre a été retenu : c'était, en quelque sorte, celui de l'air ambiant. Mais les réglementations successives ont fait que le taux d'amiante dans l'air est tombé à 0,5 fibre par litre, si bien que le taux de cinq fibres d'amiante par litre admis dans les bâtiments est désormais nettement supérieur à celui de l'air ambiant... Mais ces questions sont plutôt du ressort des cancérologues. M. Alain JACQ : Il faut savoir que plus on se rapproche de zéro, plus les taux sont difficiles à mesurer. Ce sont les aléas de la métrologie. Fixer le seuil à zéro peut être satisfaisant sur le plan éthique et politique mais la présence d'un petit peu d'amiante est-elle dangereuse ? M. le Président : Les scientifiques sont là pour être bousculés... Vous venez de nous expliquer que, grâce aux mesures prises, la teneur en amiante de l'air à Paris est tombée de 4,5 à 0,5 fibre par litre, si bien que le seuil réglementaire perd de sa signification. En dépit des aléas de la métrologie, il faut tendre au risque zéro. M. le Rapporteur : Votre direction est-elle compétente s'agissant des bâtiments propriétés de l'État ? M. François DELARUE : Notre mission est d'élaborer une réglementation qui s'applique à tous et de la faire vivre, sa mise en œuvre étant de la responsabilité des propriétaires, quels qu'ils soient. Ainsi, le ministère de la fonction publique, parce qu'il se sent responsable de l'application de cette réglementation, a diligenté une enquête tendant à s'assurer que chaque ministère a bien procédé aux travaux nécessaires dans les bâtiments dont il est le gestionnaire. M. le Rapporteur : Vous nous avez expliqué qu'en France la pratique était davantage celle du retrait que celle du confinement. Votre direction a-t-elle une compétence ou une mission de conseil s'agissant du remplacement des produits amiantés ? M. Jean-Pierre BARDY : Nous n'avons pas de mission générale de conseil, au contraire des maîtres d'œuvre. Pour ce qui est de la sécurité anti-incendie, on peut floquer les poutrelle en acier avec d'autres matériaux puis les encoffrer, ce qui donne une résistance supérieure à celle du métal nu. On peut aussi utiliser des peintures intumescentes, ou encore protéger physiquement la structure. M. le Rapporteur : Lorsque le retrait de l'amiante est décidé, les plans de retrait sont soumis à des organismes qui sont généralement sous votre tutelle. Êtes-vous chargés de porter un regard critique sur ces plans ? M. Jean-Pierre BARDY : Nous n'avons pas compétence sur la validation de ces plans, qui sont soumis aux caisses régionales d'assurance maladie. M. François DELARUE : Cela s'explique : il s'agit de la protection des travailleurs. M. le Président : Vous avez cité le nombre de 6 000 « diagnostiqueurs ». Qui sont-ils ? A-t-on plutôt affaire à de petites entreprises ? Existe-t-il des normes relatives au repérage de l'amiante ? Existe-t-il des formations spécifiques ? Comment ces techniciens sont-ils recrutés ? Je sais que ces questions ne sont pas de votre responsabilité directe, mais j'aimerais connaître votre sentiment à ce sujet. M. Daniel PAUL : Considérez-vous que constructeurs et démolisseurs sont suffisamment qualifiés et suffisamment conscients des enjeux sanitaires pour entreprendre des travaux qui impliquent un luxe de précautions aussi bien pour eux-mêmes et leurs salariés que pour le voisinage ? Il y a, dans ma circonscription, des hectomètres d'immeubles en démolition, et j'étais quelque peu surpris par les réponses qui m'étaient faites, il y a quelques mois encore, sur les précautions prises. J'ai donc demandé à la Caisse régionale d'assurance maladie, à l'Association départementale des victimes de l'amiante (ADEVA) et à l'inspection du travail des vérifications complémentaires, car j'avais le sentiment que l'on ne tenait guère compte d'une certaine « neige » qui se dégageait aux abords des chantiers de démolition et qui n'était pas sans rappeler une certaine autre « neige » vue au fond des cales par les dockers du Havre... Est-on certain que le secteur s'est structuré autour d'entreprises sérieuses et compétentes, ou se sont-elles orientées vers cette activité pour profiter de l'aubaine ? M. le Président : Le problème se pose aussi de l'assurance professionnelle de ces entreprises. Les compagnies ne sont-elles pas toujours plus réticentes à garantir ce type de risques ? Avez-vous des moyens de contrôle de la réalité de ces assurances ? M. Alain JACQ : Les diagnostiqueurs doivent être titulaires d'une certification conditionnée par l'attestation obtenue au terme d'une formation de 2 à 4 jours. Nous nous sommes rendu compte que cette formation était parfois insuffisante. Aussi la publication, le 8 juin, de l'ordonnance réformant le dispositif général des diagnostics au moment des ventes d'immeubles a-t-elle été l'occasion de rehausser le niveau d'exigence à ce sujet. Un décret est en préparation qui traduira cette exigence de compétences renforcées. M. le Président : Notre mission aimerait avoir connaissance du contenu de ce décret. Par ailleurs, d'où viennent les diagnostiqueurs ? M. Alain JACQ : Ce sont soit des architectes, soit des contrôleurs techniques, soit des réseaux de franchisés, soit des techniciens qui ajoutent cette activité à leurs activités habituelles. Dans la grande majorité des cas, il s'agit de petites entreprises. M. François DELARUE : La multiplication des diagnostics demandés lors des mutations d'immeubles a fait émerger le métier de diagnostiqueur polyvalent. Un des objets de l'ordonnance est de mieux vérifier leurs qualifications réelles. M. Alain JACQ : Les diagnostiqueurs ont effectivement du mal à contracter une assurance professionnelle car les compagnies jugent le risque trop élevé. Aussi nous sommes-nous rapprochés d'elles dans le cadre de l'élaboration du décret. Il est apparu que si l'Etat renforce ses exigences de compétence, d'indépendance et d'impartialité, les compagnies d'assurance sont prêtes à se replacer sur ce marché. En instaurant des garde-fous, le texte permettra donc aux diagnostiqueurs de se protéger à nouveau et par là de protéger les autres. On estime à 300 000 le nombre des PME du bâtiment en France. Leurs compétences sont très diverses et l'on sait que parmi elles se trouvent des entreprises dont la conception du risque au travail laisse à désirer. Il appartient aux maîtres d'ouvrage de lancer des appels d'offres précis qui appellent des réponses non moins précises, et de ne pas accepter des prix manifestement bradés pour emporter le marché. M. Jean-Pierre BARDY : Les entreprises qui sont titulaires de la certification de qualification 1513 « Traitement de l'amiante en place concernant les matériaux et produits friables » n'ont pas de problèmes avec les compagnies d'assurance. Quant au DTA, il a pour objet de faire connaître la présence d'amiante dans un bâtiment donné dans tous les cas, même si le seuil relevé n'oblige pas à des travaux. Ainsi, tout représentant d'un corps de métier appelé à réaliser des travaux dans l'immeuble saura qu'il lui faut se protéger. M. François DELARUE : La question est assez souvent soulevée actuellement de la sécurité de la démolition. Le problème a pu être ignoré dans certaines opérations, mais les dossiers à présent soumis à l'Agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU) montrent des surcoûts dus aux précautions liées à la présence d'amiante, ce qui témoigne d'une prise de conscience. Par ailleurs, certains chantiers ont été arrêtés par l'inspection du travail. Je ne prétends pas que tout soit parfait, mais la sensibilisation des maîtres d'ouvrage progresse indéniablement. M. le Président : Les chambres des métiers et les branches professionnelles participent-elles à cette sensibilisation en partenariat avec votre direction ? M. François DELARUE : Nous n'avons pas conduit d'opération de ce type, mais peut-être les préfets le font-ils, ou les fédérations professionnelles de leur propre initiative. M. le Président : Il serait de bonne politique d'organiser des séminaires d'information en relation avec les chambres des métiers. Y verriez-vous un inconvénient ? M. François DELARUE : Aucun. M. Daniel PAUL : Vos indications montrent que l'évolution est positive. Mais, étant donné l'importance des chantiers, n'y a-t-il pas un risque de sous-traitance ? Si c'est le cas, les objectifs de qualité risquent de s'étioler. M. François DELARUE : Nous n'avons pas connaissance d'alertes particulières. Le désamiantage est une opération très contrainte et très surveillée par l'inspection du travail. Des dérapages peuvent se produire, mais il n'y a pas de risque manifeste, car la responsabilité pénale des entrepreneurs est engagée, si bien qu'ils sont plus prudents qu'à l'ordinaire. M. le Président : Je vous remercie. Nous attendons les réponses au questionnaire que nous vous avons transmis, ainsi que des informations sur les décrets en cours d'élaboration. Audition de M. Jean-Denis COMBREXELLE, directeur de la Direction des relations du travail du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, accompagné de Mme Mathilde MERLOT, ingénieur à la sous-direction des conditions de travail et de la protection contre les risques du travail Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Nous recevons aujourd'hui M. Jean-Denis Combrexelle, directeur des relations du travail accompagné de Mme Mathilde Merlot, ingénieur à la sous-direction des conditions de travail et de la protection contre les risques du travail, qui vont nous présenter le rôle de leur direction dans l'encadrement juridique de la gestion de l'amiante résiduel. Avant de vous donner la parole, je précise que notre mission a placé le thème de la gestion de l'amiante résiduel en tête de son programme de travail parce que les opérations de diagnostic, les chantiers de désamiantage et le traitement des déchets sont au cœur de la problématique depuis l'interdiction de 1997, notamment en ce qui concerne les risques professionnels. Il est donc important de savoir si la réglementation dans ce domaine est pertinente et comment elle est appliquée. M. Jean-Denis COMBREXELLE : L'amiante est l'un des gros dossiers que doit traiter la direction des relations du travail. Nous avons plusieurs préoccupations, dont la première est l'application de la réglementation sur l'amiante. En ma qualité de directeur, j'ai beaucoup insisté sur l'effectivité du droit, qui est encore plus prégnante lorsqu'il s'agit de l'amiante. Nous souhaitons aussi éviter que ce qui s'est passé avec l'amiante se reproduise avec les éthers de glycol ou les fibres céramiques. Toutefois, aussi bien pour l'amiante que pour les éthers de glycol, on a le sentiment, lorsqu'on lit la presse ou les rapports, que la France est en retard et que les choses y sont mal faites. Certes, tout n'est pas parfait, mais je constate que nous sommes souvent dans une situation difficile lors des négociations avec les pays étrangers, y compris lorsqu'il s'agit de pays membres de l'Union européenne, car nous sommes souvent plus exigeants que d'autres dans le champ de la santé et de la sécurité au travail, si bien que nous avons du mal à obtenir que l'on aille plus avant. Ainsi le ministère a-t-il dû se battre devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) jusqu'en 2002 contre le Canada, pour qui il était tout, sauf évident, qu'il fallait interdire l'amiante. Les Canadiens contestaient l'interdiction de l'amiante par la France en soutenant qu'il s'agissait d'une entrave au commerce. Nous tenons à approfondir nos connaissances sur les risques sanitaires, ce qui explique notre souhait de voir créée l'Agence de santé au travail, c'est-à-dire une instance compétente et légitime dans le domaine de l'évaluation du risque, qui n'existait pas en 1995-1996, le rôle joué par le comité permanent amiante restant à approfondir. Notre souci de contrôle et d'effectivité nous a conduits à lancer l'inspection du travail dans des campagnes sur l'amiante et, fin 2004, j'ai lancé une opération « coup de poing », en demandant aux inspecteurs du travail de cibler les chantiers d'amiante friable et d'exercer leur contrôle avec une sévérité particulière. Nous l'avons réitéré en 2005 en étendant les contrôles à l'ensemble des chantiers d'amiante, qu'il soit friable ou non friable, la circulaire donnant au corps de contrôle une consigne explicite de grande fermeté et de grande sévérité. Mais je me dois de souligner la difficulté permanente à laquelle notre direction doit faire face. Nous sommes sans cesse saisis de demandes plus légitimes les unes que les autres, qu'il s'agisse de la discrimination dans les entreprises ou de l'égalité professionnelle. « Que font donc les inspecteurs et les contrôleurs du travail ? » me demande-t-on. Mais les « inspecteurs inspectant » sont au nombre de 1 300 ! C'est dire qu'une section, composée d'un inspecteur et de deux contrôleurs, couvre 30 000 salariés, et un inspecteur 10 000 salariés à lui seul. Dans le même temps, en Grande-Bretagne, où la préoccupation première n'est sans doute pas l'inspection du travail, un inspecteur couvre 6 000 salariés. Certes, la Loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, a prévu un programme « relations du travail » qui donnera l'occasion de dire quels sont les indicateurs et les objectifs donnés à l'inspection du travail. Mais on pourra toujours fixer des priorités, le corps demeurera globalement insuffisant par rapport aux missions et aux responsabilités qui sont les siennes. Au-delà des problèmes administratifs et budgétaires, les conséquences de l'exposition à l'amiante ont entraîné des drames humains terrifiants. Aussi bien l'administration centrale que les services déconcentrés sont en contact permanent avec les familles des victimes, et nous ne sommes pas satisfaits du système des listes d'établissements dressées pour l'accès à la cessation anticipée d'activité amiante. Les conditions dans lesquelles ceux qui ont été exposés à l'amiante sont suivis sont insatisfaisantes, tant sur le plan administratif que sur le plan humain. M. le Président : Je vous remercie pour la qualité de votre exposé. M. le Rapporteur : Je crois savoir que pour ce qui est de l'établissement des listes de sites amiantés, les administrations concernées diffèrent selon le type de bâtiments. Est-ce exact ? M. Jean-Denis COMBREXELLE : Oui. M. le Rapporteur : Voilà qui ne favorise pas la simplicité. Comment le classement des sites amiantés a-t-il été fait et comment les refus d'inscription sur la liste sont-ils motivés ? M. Jean-Denis COMBREXELLE : Prenons le droit commun, par exemple un établissement qui a fait du calorifugeage. Une demande d'inscription sur la liste est faite, soit par l'entreprise elle-même soit par des salariés. La demande est ensuite instruite, en droit par les services de la direction des relations du travail, mais en réalité par les directions départementales, auxquelles il revient de faire l'historique de l'entreprise et de ses activités en remontant dans un passé lointain. Elles rédigent donc un rapport recensant les activités successives de l'entreprise, mais elles rencontrent des difficultés considérables à remonter dans le temps, sur plusieurs décennies, pour tenter de démêler l'histoire d'une entreprise qui peut avoir été rachetée plusieurs fois, et même avoir disparu. De ce fait, les dossiers constitués sont parfois assez faibles. Au vu du rapport ainsi fourni, notre direction propose l'inscription ou la non inscription à différents cabinets. Il faut dire aussi que des pressions ont souvent été faites en vue de l'inscription ; la « cessation anticipée amiante » étant l'un des rares systèmes de cessation anticipée d'activité qui demeure, le dispositif a souvent été détourné pour faire de la gestion de l'emploi. À ce stade, on passe à la sphère « sécurité sociale » et, plus exactement, à la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Après avis de cette branche, un arrêté ministériel est signé. Je l'ai dit, la situation ne me satisfait pas. D'une part parce que les conditions de l'instruction des demandes ne sont pas bonnes, si bien que le contentieux est de plus en plus fourni et que nous nous retrouvons devant le Conseil d'État avec une masse de dossiers que nous avons beaucoup de mal à défendre. D'autre part, comme il s'agit d'une inscription générale de l'établissement, des salariés qui n'ont jamais été exposés à l'amiante bénéficient de la cessation d'activité. À l'inverse, des personnes viennent nous voir, dont on sait qu'elles ont effectivement été exposées, mais dont l'entreprise ne relève pas de la liste limitative établie dans la loi de 1999. Le ministre a lui-même reconnu hier devant le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels que le système était injuste et une mission a été confiée à l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) pour définir comment le réformer, ce qui n'a rien d'évident. Soit l'on arrête tout, en considérant que la plupart des établissements dans lesquels il y a eu une forte exposition à l'amiante figurent sur la liste et qu'il faut passer à un autre système ; soit l'on entre dans une logique individuelle en reconstituant le parcours du salarié concerné afin de faire une demande d'inscription à titre individuel ; soit l'on institue un système mixte en évitant la procédure d'instruction par l'inspection du travail. Comme on le voit, il n'y pas de solution simple. M. le Rapporteur : Est-il exact que les ouvriers des ports et des docks doivent, pour ce qui les concerne, passer par le ministère de la santé ? M. Jean-Denis COMBREXELLE : Ils dépendent désormais du ministère de l'équipement et des transports. Mais, je le répète, à mon sens, les difficultés ne tiennent pas à ce que plusieurs administrations sont concernées mais à ce qu'il s'agit d'un système collectif qui suppose que l'on dispose de l'historique des entreprises, ce qui n'est pas le cas. Même si l'on s'intéresse à une entreprise comme Renault, il est difficile de savoir ce que faisait tel atelier à tel moment. M. le Président : Vous avez eu raison d'évoquer le très sérieux problème des moyens de l'inspection du travail. S'agissant de la gestion des listes, je pense, comme vous, qu'il est extraordinairement difficile de retracer l'histoire d'entreprises dont les noms ont changé, dont les adresses sont fausses ou qui ont disparu. Il est donc exact que le système n'est pas totalement satisfaisant. D'ailleurs, la loi définissait des critères très restrictifs qui ne résistent pas au temps, car tous les cas n'ont pas été prévus en 1999. Il en est ainsi de ces systèmes de récupération pour la fabrication d'acier à partir de véhicules mis à la démolition et dont les freins contenaient de l'amiante. Il en est également ainsi des lingotières... On compte plusieurs dizaines de décès de salariés de ces entreprises, dont on sait qu'ils résultent de l'exposition à l'amiante, mais qui ne peuvent être reconnus car les activités considérées ne figurent pas, stricto sensu, dans le texte de 1999. Sans doute la cessation d'activité amiante a-t-elle parfois été utilisée pour faciliter des plans sociaux, sans doute des salariés ont-ils bénéficié du système, alors qu'ils n'avaient pas été exposés à l'amiante. Il faudrait refaire le point de la question dans son ensemble. M. Jean-Denis COMBREXELLE : Il faut réfléchir aux critères, mais vient un moment où ils sont difficiles à établir. Si, par exemple, on parle des fonderies, la majeure partie de l'activité industrielle française risquerait d'être couverte par le champ de la loi. On ne peut aller jusque-là et l'on doit donc fixer de nouvelles frontières, en sachant que, même si l'on va au-delà des normes actuelles, il y aura toujours une injustice. L'esprit de la loi était de classer sur la liste les entreprises où l'exposition à l'amiante avait été la plus forte, les autre salariés pouvant bénéficier du dispositif dès lors qu'apparaîtrait une affection liée à l'exposition, mésothéliome ou plaques pleurales. Tel est l'équilibre voulu dans la loi : un système collectif pour les personnes les plus exposées et, pour les autres, une démarche individuelle. M. le Président : Il est donc nécessaire de poursuivre la réflexion sur ce point. Selon vous, le problème ne tient pas à la multiplicité des acteurs dans l'administration centrale. Cependant, étant donné la gravité et la complexité du problème, un lieu unique d'échange d'informations et de coordination ne serait-il pas utile ? M. Jean-Denis COMBREXELLE : Cela pourrait être utile, mais ne résoudrait pas tout, car, à un moment, les administrations sont confrontées à la question des moyens. Ainsi, les contrôles en milieu professionnel ont été faits, même si cela a eu lieu de manière imparfaite, parce que l'inspection du travail était chargée de cela. Mais, faute de moyens suffisants du côté des DDAS, il n'y a pas eu de contrôles suffisants pour les logements. L'amiante étant une priorité nationale, il faut une instance de coordination des administrations. Je ne peux donc que souscrire à votre suggestion, non sans constater qu'il existe de nombreux comités interministériels et d'aussi nombreuses instances de coordination. Il n'est pas très satisfaisant d'imaginer que l'on ne ferait plus que se réunir... Mme Sylvia BASSOT : Cela deviendrait de l'affichage... M. le Président : Avez-vous rencontré des difficultés lorsque l'inspection du travail prend une décision d'arrêt immédiat d'une activité ? Autrement dit, quelles sont les relations entre risques professionnels et emploi ? M. Jean-Denis COMBREXELLE : Je suis directeur des relations du travail depuis janvier 2001, et je puis vous dire que si des questions ont pu se poser depuis cette date sur la relation entre maintien de l'emploi et risque professionnel - cela a été le cas, par exemple, lorsqu'il a fallu fixer certaines valeurs limite -, cela n'a jamais été le cas pour l'amiante. Jamais la question ne m'a été posée de savoir si l'on pouvait arrêter le chantier parce que cela poserait le problème de l'emploi des salariés. Je ne dis pas que la question ne se pose pas, car le risque zéro, c'est l'activité zéro. Mme Martine DAVID : Je vous remercie de la franchise avec laquelle vous avez évoqué les difficultés d'une inspection du travail dont les moyens sont insuffisants. Selon vous, combien faudrait-il d'inspecteurs pour qu'ils puissent faire leur travail correctement ? Par ailleurs, vous avez parlé d'« opération coup de poing » ; mais les inspecteurs du travail ont-ils une formation spécifique pour de telles opérations ? Par ailleurs, avez-vous le sentiment que les chefs d'entreprises ont pris la mesure des risques ou qu'un couvercle très lourd pèse toujours ? Enfin, quel est l'état d'esprit des partenaires sociaux à ce sujet ? Les pensez-vous prêts à s'engager en faveur de la protection des salariés ? M. Jean-Denis COMBREXELLE : Mon plus mauvais souvenir de directeur des relations du travail remonte à ce jour où, représentant le ministre lors d'un colloque relatif à la médecine du travail, j'ai entendu un syndicaliste expliquer, sous un tonnerre d'applaudissements, qu'en matière de santé et de sécurité au travail, l'État est seul responsable et que tout est de sa faute... À la différence de ce qui se passe dans les pays voisins, beaucoup, en France, repose sur l'État dans ce domaine, et les partenaires sociaux, employeurs et salariés confondus, considèrent que c'est à lui d'agir, si bien que si l'Etat ne fait rien, rien ne se fait. Si le « Plan santé au travail » consiste uniquement à ce que l'État crée une agence de santé au travail et des instances de pilotage et qu'il renforce le nombre des inspecteurs du travail, cela ne servira à rien, car il n'y aura pas de prise de conscience. Lorsque je rencontre des directeurs de ressources humaines et que je leur dis qu'ils doivent s'investir dans la santé et la sécurité au travail, j'ai le sentiment d'être compris dans les grandes entreprises, et de moins en moins à mesure que la taille de l'entreprise décroît. Cependant, il reste la crainte du juge, de plus en plus sévère avec les entreprises, et M. Philippe Askenazy explique dans son livre « Les désordres du travail - Enquête sur le nouveau productivisme » qu'il faudrait utiliser le tarif de la branche AT-MP (accidents du travail - maladies professionnelles) pour instituer un système de bonus/malus, de manière que les entreprises aient un intérêt financier à faire un effort. Pour ma part, je considère qu'une entreprise ne peut bien fonctionner et être compétitive que si les conditions de travail y sont bonnes, et les relations de travail normales. C'est là qu'est l'enjeu, mais il faut faire preuve d'une grande pédagogie, et la balle est encore trop souvent dans le camp de l'État. Mme Martine DAVID : Il en est d'ailleurs de même pour ce qui est de la pénibilité au travail. M. Jean-Denis COMBREXELLE : Pour ce qui est de la formation spécifique des inspecteurs du travail, on ne peut ignorer le caractère généraliste de l'inspection du travail. Or les inspecteurs sont confrontés à des règlementations de plus en plus techniques. Voilà pourquoi est née l'idée de créer des cellules pluridisciplinaires rassemblant des médecins et des ingénieurs qui pourront les appuyer. Nous sommes le seul pays de l'Union européenne dont l'inspection du travail soit généraliste. C'est un atout dans la mesure où cela permet à l'inspecteur du travail d'avoir une vue globale de l'entreprise ; il y a, par exemple, un lien étroit entre la qualité du dialogue social et la prise en compte des questions de santé. Mais la préservation de ce caractère généraliste implique une modification des modes de fonctionnement. Pour ce qui est du nombre des inspecteurs, nous devrions en avoir 2 000 pour être dans la moyenne européenne. Le ministre ayant pris l'engagement de réduire l'écart avec cette moyenne en quatre à cinq ans, la balle est maintenant dans le camp du Parlement. Il est parfois difficile de parler d'inspection du travail, dont on dit couramment qu'elle sert à empêcher le fonctionnement normal des entreprises. Il y a un problème d'image de l'inspection du travail dont la mission régalienne doit être défendue mais ceci n'exclut pas des réformes dans l'organisation et le fonctionnement de ce corps dont la mission est essentielle. Mme Sylvia BASSOT : La réforme devrait commencer par la modification de la dénomination du corps, qui véhicule une mauvaise image. M. Jean-Denis COMBREXELLE : À la différence de ce qui se passe dans d'autres pays européens, on a parfois le sentiment qu'en France l'inspection du travail peine à faire percevoir sa légitimité. L'opération « coup de poing » évoquée précédemment tendait aussi à montrer que sa tâche ne se limite pas, comme certains voudraient le faire croire, à dresser des procès-verbaux d'infraction. M. le Président : Vous avez plusieurs fois évoqué la situation comparée des pays européens. Une action conjuguée de protection des travailleurs contre l'amiante est-elle menée ? Des échanges ont-ils lieu ? M. Jean-Denis COMBREXELLE : Le champ de la santé et de la sécurité au travail est l'un des plus intégrés au niveau communautaire. Nous passons d'ailleurs près de la moitié de notre temps à l'élaboration de textes communautaires. L'amiante n'échappe pas à la règle : des directives ont été rédigées et des échanges ont lieu au niveau du comité des hauts responsables pour élaborer la norme et pour la faire appliquer. Toutefois, il n'y a jamais eu, par exemple, d'actions communes des inspections du travail allemande et française dans des entreprises franco-allemandes. Des réunions régulières ont lieu avec les directions du travail des pays membres de l'Union, mais l'élargissement suscite des difficultés nouvelles. En effet, il y avait jusqu'alors une conception commune, celle de la France, du Danemark, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne. Avec l'élargissement, les choses sont devenues un peu moins évidentes. M. le Président : N'y aura-t-il pas un effet d'entraînement ? M. Jean-Denis COMBREXELLE : Je n'en suis pas certain, car l'on perçoit un déplacement du champ de gravité. M. le Président : Existe-t-il un programme européen relatif à l'amiante ? M. Jean-Denis COMBREXELLE : Le programme REACH1, système d'évaluation des produits chimiques, est en cours d'élaboration. Actuellement, rien n'est arrêté, mais les discussions vont être de plus en plus dures car de nombreux pays se posent la question de la légitimité de l'intervention de l'Union dans le champ de la santé et de la sécurité au travail. Mme Mathilde MERLOT : Une campagne européenne conjointe des inspections du travail est prévue en 2006 dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP). Elle vise à accompagner l'entrée en vigueur de la directive de 2003 relative à la protection contre l'amiante, afin d'aider les nouveaux pays membres à s'y conformer. Une campagne semblable a déjà eu lieu en 2004. M. le Président : Il est certain que les membres entrants devront accomplir un effort de rattrapage très important, les niveaux de protection y étant très insuffisants. Mme Mathilde MERLOT : En septembre 2003 s'est tenue la conférence de Dresde qui tendait à expliquer aux pays membres le contenu de la nouvelle directive relative au désamiantage. Y ont participé les représentants de pays membres de l'Union européenne et de pays non membres. On a pu constater un profond fossé entre des pays tels que la France et la Grande-Bretagne, qui ont interdit depuis longtemps la fabrication et l'utilisation de l'amiante et se préoccupent aujourd'hui de l'amiante résiduel, et les membres entrants, qui n'attachaient pas une grande importance à la question. Le fossé était encore plus grand avec les pays non membres qui sont encore à s'inquiéter aujourd'hui d'interdire l'amiante. M. le Président : On nous a indiqué qu'il existe 6 000 diagnostiqueurs en France, dont la formation semble poser problème, puisqu'elle dure de deux à quatre jours, ce qui paraît un peu court. De plus, ils agissent le plus souvent au sein de très petites entreprises. Avez-vous des informations à leur sujet ? M. Jean-Denis COMBREXELLE : L'opération coup de poing a précisément été lancée parce que des informations nous étaient revenues selon lesquelles de graves problèmes se posaient sur les chantiers de désamiantage. M. le Président : Quels ont été les résultats de cette opération ? M. Jean-Denis COMBREXELLE : Il y en a eu, mais ils n'ont pas été suffisants. C'est pourquoi l'opération est reconduite en 2005 et étendue aux chantiers d'amiante non friable, et donc à l'ensemble des chantiers de désamiantage. M. le Président : Vous considérez donc qu'en matière de diagnostic, comme pour ce qui touche au désamiantage, un travail énorme reste à faire ? M. Jean-Denis COMBREXELLE : Oui, mais il faut préciser que le diagnostic dans les bâtiments relève de la compétence de la Direction générale de la santé et de ses services déconcentrés et non de l'inspection du travail, car on touche là à la protection de la population. L'inspection du travail n'a ni les moyens juridiques ni les moyens humains pour intervenir en ce domaine. M. le Rapporteur : Théoriquement, on ne fabrique et on n'utilise plus d'amiante, ni dans les chantiers navals, ni ailleurs. Seulement, il y en a encore sur les sites et dans l'air et, d'autre part, de nouveaux métiers de l'amiante sont apparus, qui sont ceux du désamiantage. M. Jean-Denis COMBREXELLE : Tous les pays sont loin d'avoir interdit l'amiante : ce n'est le cas ni des États-unis ni du Canada, ni de la Chine. Une quarantaine de pays seulement l'ont interdit, sur cent soixante. La dangerosité de l'amiante n'a pas le même caractère d'évidence au-delà de nos frontières si bien que, dans certaines enceintes internationales, nous devons nous battre pour la faire reconnaître. Dans les entreprises canadiennes, les salariés continuent de manipuler de l'amiante. Nous observons d'ailleurs les mêmes difficultés à propos des éthers de glycol. Mme Martine DAVID : Les entreprises françaises sont-elles bien informées de l'interdiction ? M. Jean-Denis COMBREXELLE : L'interdiction décrétée en 1997 s'applique. Il y a eu un accès de fièvre à un moment donné à propos des véhicules d'occasion qui contenaient des paquets de disques amiantés, mais cet accès est passé. Il n'y a donc plus d'amiante dans l'industrie, mais le problème qui se pose désormais est celui des chantiers de désamiantage au sens large, ce qui constitue la section 3 du décret, relative aux interventions pour travaux de maintenance. M. le Rapporteur : On affirme que 70 % des inspections sur les chantiers de désamiantage révèlent des imperfections. Est-ce exact ? M. Jean-Denis COMBREXELLE : L'opération coup de poing a donné des indications, mais ces indications ne constituent pas une vérité statistique, puisque l'on ciblait justement des entreprises spécifiques. Une vigilance particulière s'impose à propos des chantiers de désamiantage, et à propos de la section 3, car les entreprises ne sont pas suffisamment sensibilisées aux précautions nécessaires à la protection de leurs salariés. La situation n'est pas satisfaisante. M. le Rapporteur : Les entreprises qui oeuvrent dans le domaine de la sous-traitance nucléaire font l'objet de contrôles très stricts. Selon moi, le risque potentiel est le même avec l'amiante ; pourtant, on constate un très grand décalage dans la pratique. Dans les arsenaux, on n'utilise plus d'amiante pour protéger les soudeurs, mais est-on vraiment certain que dans tel ou tel atelier industriel où l'on a utilisé beaucoup d'amiante, les salariés peuvent déambuler sans crainte ? Si le ministre a diligenté une enquête de l'IGAS, c'est parce que des salariés travaillent sur des sites où l'on trouve encore de l'amiante. Il faut donc établir de nouveaux critères de classement de ces entreprises. M. Jean-Denis COMBREXELLE : Vous faites allusion à une situation passée et vous ajoutez que certaines entreprises n'entrent pas dans le cadre de la loi. La première question est donc de savoir s'il faut modifier le cadre législatif pour les y intégrer. La seconde est de savoir s'il existe encore en France des entreprises dans lesquelles on manipule de l'amiante. On ne peut avoir de certitude absolue, mais je pense que le problème est derrière nous. La difficulté tient désormais à ce que d'autres produits, telles les fibres céramiques, peuvent présenter également des dangers si on ne prend pas les précautions suffisantes. La vigilance s'impose pour éviter que ne se répète le problème que nous avons connu avec l'amiante. Une instance doit dire quand la prudence s'impose, et pour cela définir la dangerosité des différents produits. M. le Président : Je partage sans réserve votre point de vue : une réflexion est nécessaire sur les fibres nouvelles pour éviter la répétition de ce que nous avons connu avec l'amiante. Votre analyse conforte notre volonté d'agir en ce sens. M. le Rapporteur : Je sais que les partenaires sociaux doivent se rencontrer pour traiter de la pénibilité au travail. Où en sont-ils ? M. Jean-Denis COMBREXELLE : Le dialogue patine. Mme Martine DAVID : Au moins devrait-on proposer une requalification aux salariés qui exercent des métiers pénibles. M. le Rapporteur : Ces questions concernent entre autres les salariés dont il a été question aujourd'hui, ceux qui travaillent au désamiantage et ceux qui travaillent comme sous-traitants dans le secteur nucléaire, sans bénéficier de la protection qu'accordent les grandes entreprises comme AREVA à leurs propres salariés. La direction des relations du travail a-t-elle désigné un correspondant plus particulièrement chargé de l'amiante et de la pénibilité au travail ? M. Jean-Denis COMBREXELLE : Le bureau de Mme Merlot est un bureau difficile, car on y a de grandes responsabilités. On y traite en effet de l'amiante, des éthers de glycol et des produits chimiques. Il a été très renforcé. La difficulté tient à ce que ce bureau a deux missions : la prévention des risques mais aussi une mission administrative par les agents, qui est l'établissement des listes de cessation d'activité anticipée. Il est très difficile d'entendre au téléphone une femme vous insulter parce que son mari est atteint d'un mésothéliome ou qu'il a des plaques pleurales mais que l'établissement dans lequel il travaillait n'est pas inscrit sur la liste limitative définie par la loi de 1999. M. le Président : Le périmètre d'intervention de l'Agence française de sécurité environnementale a-t-il été étendu ? M. Jean-Denis COMBREXELLE : Lorsqu'il s'est agi de créer l'Agence de santé au travail, trois solutions étaient possibles. La première consistait à regrouper les agences existantes pour créer une grande agence, notamment chargée de la santé au travail. La deuxième était de maintenir les agences existantes et de créer une agence spécifique. Finalement, l'arbitrage, qui s'est traduit par un « bleu », s'est fait en faveur du troisième schéma, qui prévoit d'étendre les compétences de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE) à la santé au travail. L'AFSSE va donc devenir l'AFSSET, parce qu'il fallait atteindre une taille critique pour améliorer son efficacité. Toutefois, les partenaires sociaux auraient préféré une agence spécifique. M. le Président : Je vous remercie vivement. Audition de M. le professeur Didier HOUSSIN, Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Nous avons le plaisir d'accueillir M. le professeur Didier Houssin, directeur général de la santé, qui va nous présenter le rôle de sa direction dans l'encadrement juridique de la gestion de l'amiante résiduel. Le diagnostic, les chantiers de désamiantage et le traitement des déchets étant au cœur du dossier de l'amiante depuis l'interdiction édictée en 1997, il est important de savoir si la réglementation est adéquate et comment elle est appliquée. Nous allons vous écouter, puis nous engagerons un débat sur la base des questions du Rapporteur et des membres de la mission. Je précise à mes collègues qu'un questionnaire vous a déjà été adressé. M. Didier HOUSSIN : En effet et je vous adresserai avant la fin du mois de juin l'ensemble des réponses à ce questionnaire. Je souhaite faire le point sur la question de l'encadrement juridique de la gestion de l'amiante résiduel par la Direction générale de la santé (DGS). Dans ce bref exposé, l'accent sera mis exclusivement sur l'encadrement juridique relevant directement de la Direction générale de la santé ou à laquelle celle-ci a été associée. En particulier, il ne sera pas fait référence aux nombreuses mesures d'encadrement touchant à la protection des travailleurs. Les années comprises entre 1977 et 1994 ont vu l'émergence du problème et les premières mesures de gestion. À la suite du classement de l'amiante comme agent cancérigène pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) en 1977, l'encadrement juridique de la gestion de l'amiante par la Direction générale de la santé a débuté par deux textes : l'arrêté du 29 juin 1977 interdisant le flocage à base d'amiante dans les locaux d'habitation et le décret n° 78-394 du 20 mars 1978 relatif à l'emploi de l'amiante pour le flocage des bâtiments avec, notamment, l'interdiction d'utiliser des produits contenant plus de 1 % en masse d'amiante pour le flocage des bâtiments. Outre les mesures relatives à la protection des travailleurs, cette période a par ailleurs été marquée par diverses initiatives auxquelles la DGS a été associée : création du Comité permanent amiante ; publication d'un guide sur le diagnostic et le traitement des flocages à base d'amiante ; vœux du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, le CSHPF, relatifs à la création d'un registre des mésothéliomes, au recensement et à l'évaluation des bâtiments floqués à l'amiante par les collectivités territoriales, à l'intervention par des personnes compétentes et à la déclaration des chantiers ; lancement d'une expérimentation sur le recensement dans le cadre d'une convention avec la ville de Nantes ; avis du CSHPF indiquant, à la suite de la présentation des résultats de Nantes, qu'un recensement exhaustif des locaux floqués n'apparaissait pas réaliste mais qu'une réglementation devrait permettre un suivi des empoussièrements et de la réalisation des travaux, si nécessaire. Cette première période se conclut par une circulaire conjointe de la DGS et de la Direction des relations du travail (DRT) du 15 septembre 1994 relative aux procédures et règles de travail à mettre en œuvre pour procéder au déflocage, au retrait et à l'élimination de l'amiante ou de matériaux friables contenant de l'amiante dans des bâtiments, sur des structures ou des installations. Elle fournit des éléments permettant d'apprécier la dégradation des flocages - seuil d'empoussièrement, notamment -, de sécuriser les chantiers, d'éliminer les déchets et de mesurer l'empoussièrement. La deuxième période, entre 1995 et 1997, a été marquée par l'interdiction de l'amiante et l'intensification des mesures de gestion. Une conférence de presse du Comité permanent amiante déclenche une intensification du processus d'élaboration d'un décret relatif à la protection de la population générale contre les risques liés à une exposition à l'amiante. Un tel projet n'est d'abord pas retenu en réunion interministérielle le 25 mars 1995. À la suite de diverses mesures telles que la saisine de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), par la DGS et la DRT en février 1995 en vue de la réalisation d'une expertise collective sur l'amiante, et le retrait de l'administration du Comité permanent amiante, la production réglementaire reprend. L'année 1995 se conclut par une circulaire du 31 juillet 1995 relative à la prévention des risques liés aux flocages à l'amiante et par la finalisation d'un projet de décret. Le décret n° 96-97 du 7 février 1996 est relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. Il pose une obligation de repérage et d'évaluation de l'état de conservation des flocages et calorifugeages contenant de l'amiante, de travaux en cas de dégradation ou si le taux d'empoussièrement est supérieur à 25 fibres par litre et de surveillance périodique de l'état de dégradation. Une circulaire d'application du 24 avril 1996 est relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. Elle explicite le rôle des agents de l'État et, s'agissant des Directions régionales et départementales de l'action sanitaire et sociale (DRASS et DDASS), leur donne un rôle dans l'information des propriétaires, le traitement des réclamations et quant à la possibilité de dresser des contraventions. L'arrêté du 28 mai 1996 porte agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussière d'amiante dans l'atmosphère des immeubles bâtis. À la suite de la remise du rapport de l'expertise de l'INSERM sur les effets sur la santé des principaux types d'exposition à l'amiante, et alors que deux décrets sont publiés en 1996 relatifs à la protection des travailleurs et aux produits contenant de l'amiante, la décision d'interdire l'amiante sera prise par décret le 24 décembre 1996 en application du code du travail et du code de la consommation. L'arrêté du 12 juillet 1996 crée une commission interministérielle pour la prévention et la protection contre les risques liés à l'amiante. Le décret n° 97-855 du 12 septembre 1997 modifiant le décret de 1996 est relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. Il mentionne le diagnostic des faux plafonds, ainsi que le regroupement dans un dossier des diagnostics et résultats de la surveillance périodique des flocages, calorifugeages et faux plafonds. À la suite immédiate du rapport de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques publié le 16 octobre 1997, une mission est confiée au professeur Claude Got par le ministre de l'emploi et de la solidarité et par le secrétaire d'État à la santé. Une troisième période, entre 1998 et 2002, est marquée par l'évolution de la réglementation. L'arrêté du 15 janvier 1998 modifiant l'arrêté du 7 février 1996 est relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis. L'arrêté du 15 janvier 1998 est relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis. L'arrêté du 21 décembre 1998 est relatif aux conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussière d'amiante des immeubles bâtis. La circulaire du 25 septembre 1998 en application du décret n° 97-855 est relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. Elle demande la création de pôles de compétences, souligne le rôle des DRASS et DDASS dans l'information des propriétaires, le traitement des réclamations, le questionnement des responsables d'établissements sanitaires et sociaux sur l'amiante à l'occasion d'inspections, la surveillance des immeubles dans lesquels ils ont connaissance que plus de 25 fibres par litre sont détectées. Elle indique qu'une réflexion sur le contrôle est engagée. Le 19 novembre 1998, une saisine de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) et du Conseil général des ponts et chaussées (CGPC) est faite sur la mise en œuvre d'un registre des bâtiments amiantés en termes de faisabilité et de modalités de mise en œuvre. Le rapport conclut à la nécessité de l'exhaustivité du registre, à sa faisabilité s'agissant du résultat des diagnostics, mais pas pour l'amiante découverte à l'occasion de travaux. Il juge que la situation n'est pas satisfaisante en termes d'information des occupants et ne dispense pas d'un contrôle aléatoire efficace. Alors que le Canada attaque la France devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à propos de sa décision d'interdiction globale, un communiqué de presse de la Direction générale de la santé (DGS) et de la Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (DGUHC) du 16 novembre 1999 rappelle aux propriétaires les échéances pour remplir leurs obligations en matière de recherche d'amiante. La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 introduit l'article L. 1334-13 dans le code de santé publique, qui impose un état amiante annexé à tout acte de vente. La loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 porte création du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Le décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret de février 1996 est relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. Il renforce les obligations en abaissant le seuil de déclenchement des travaux à 5 fibres par litre, en introduisant un délai de fin de travaux dont la prorogation nécessite une procédure strictement encadrée, en imposant des mesures conservatoires avant le début des travaux, en introduisant un contrôle visuel après travaux en complément de la mesure d'empoussièrement et en imposant une attestation de compétence, délivrée aux opérateurs du repérage après une formation certifiée. Il impose également de nouvelles obligations : le repérage étendu, dont les résultats doivent être consignés dans un dossier technique amiante (DTA), qui doit faire l'objet d'une large diffusion auprès des occupants et des travailleurs ; un repérage avant démolition, qui permet une protection des travailleurs et des riverains des chantiers de démolition. La circulaire DGS du 24 septembre 2001 est relative à la mise en œuvre des dispositions réglementaires relatives aux diagnostics des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante prévues par le décret n° 96-97 modifié. Elle confie aux DRASS et DDASS une enquête auprès des établissements sanitaires et sociaux. Le décret n° 2002-839 du 3 mai 2002 modifiant le décret de 1996 est relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à l'exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et porte sur les constats après vente. L'arrêté du 2 janvier 2002 est relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition. L'arrêté du 22 août 2002 est relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique amiante, au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage. L'arrêté du 2 décembre 2002 est relatif à 1'exercice de l'activité et à la formation des contrôleurs techniques et techniciens de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante. L'arrêté du 6 mars 2003 est relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits. En 2001, une enquête épidémiologique a été lancée sur le site de Jussieu avec le soutien financier de la DGS. La quatrième et dernière phase, entre 2003 et 2005, est celle de l'évaluation du dispositif. La circulaire DGS-DGUHC du 10 décembre 2003 est relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à l'amiante dans les immeubles bâtis. Elle porte sur l'information du public et des professionnels et fait remonter les rapports d'activité des opérateurs de repérage, assure l'instruction des demandes de prorogation de délai de fin de travaux, élabore avec les DRASS / DDASS des plans de contrôle des établissements recevant du public, à commencer par les établissements sanitaires et sociaux. Durant cette période, l'Institut national de veille sanitaire (INVS) est saisi des risques sanitaires liés à la présence d'anciens sites industriels de transformation de l'amiante et d'affleurements naturels et la recherche est conduite d'un organisme susceptible d'effectuer une évaluation du dispositif amiante dans les immeubles bâtis. Une convention est passée dans ce but le 28 octobre 2004 avec le Centre scientifique et technique du bâtiment. L'AFSSE est saisie le 7 février 2005 d'une expertise sur les fibres courtes d'amiante. Enfin, en avril 2005, un appui technique sur la réglementation est fourni aux ministères de l'éducation nationale, de la fonction publique, de l'agriculture, ainsi qu'à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et à la direction générale de l'action sociale au ministère de la santé. M. le Président : Nous vous remercions de cet exposé, qui fait un point précis de l'évolution de la réglementation. M. Le Rapporteur : Pourriez-vous, M. le directeur, nous éclairer sur la mission générale de la DGS ? Nous pourrons ainsi éviter de vous poser des questions dont le rapport avec votre champ de compétences serait trop indirect. M. Didier HOUSSIN : La DGS a une mission générale qui concerne la santé des Français. Mais il est vrai que lorsque des problèmes sanitaires résultent de phénomènes appartenant à des champs qui ne sont pas sous sa responsabilité directe - et c'est le cas des problèmes liés à l'environnement ou au travail -, la question se pose toujours de la limite des capacités de réglementation et de contrôle de la DGS ou des services rattachés au ministère de la santé. Le sujet qui nous occupe est typiquement de nature environnemental. Par ailleurs, la DGS n'est évidemment pas experte en matière de bâtiments. Sa mission ne peut donc se concevoir autrement qu'en conjonction, ou en confrontation, avec les autres ministères concernés. Comme vous avez pu le constater à plusieurs reprises, des décisions ont dû être prises lors de réunions interministérielles où des points de vue différents ont vraisemblablement été avancés. M. le Président : D'où la nécessité d'une coordination interministérielle régulière. Y a-t-il des lieux de coordination et d'échange d'informations ? M. Didier HOUSSIN : Je ne suis directeur général de la santé que depuis un peu plus de deux mois. Mais je peux indiquer, par exemple, que se tiennent régulièrement depuis déjà assez longtemps des réunions où les directeurs de la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et de la Direction générale de l'alimentation examinent ensemble toute une série de questions concernant l'alimentation. L'une des premières propositions que j'ai faites, dès mon arrivée, a été d'organiser des réunions analogues avec mes collègues de la Direction des relations du travail et de la Direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR). Ils ont accepté cette proposition. Nous nous rencontrerons le 1er juillet prochain pour évoquer nos sujets d'intérêts commun, dont l'amiante. M. le Président : Cela veut-il dire qu'un point de contact régulier de ce type n'existe pas à ce jour ? M. Didier HOUSSIN : Des contacts entre la DGS et la DRT, entre la DGS et la DPPR, existent très certainement depuis de nombreuses années. Ils n'ont peut-être pas été formalisés de manière régulière. J'ai l'intention de proposer à mes collègues de la DRT et de la DPPR de mettre à l'ordre du jour de notre première réunion la question des affleurements naturels et des problèmes sanitaires posés par les anciens sites industriels susceptibles de contaminer la population ou de représenter un risque pour elle. Je pense en particulier à un site de la région parisienne où l'on a traité de l'amiante il y a un certain nombre d'années. Des mesures d'empoussièrement y ont été conduites, qui sont négatives. Mais qu'en est-il en cas de grand vent ? N'y a-t-il pas un risque pour la population ? Les riverains sont inquiets. Je crains que le DPPR ait en charge un nombre important de sites de cette nature, pour lesquels les solutions ne sont pas faciles. M. le Rapporteur : Vous avez évoqué les affleurements naturels. Pensez-vous à des sites particuliers ? M. Didier HOUSSIN : Je crois qu'il existe en Haute-Corse un site d'affleurements naturels qui pose des problèmes. Les riverains sont préoccupés. Il s'agit d'un site où l'on a extrait de l'amiante il y a quelques années. M. le Président : Nous souhaitons que vous puissiez nous faire part de ce qui est ressorti de la réunion du 1er juillet. M. Didier HOUSSIN : Je suis à votre disposition. M. le Rapporteur : Vous avez mentionné l'enquête épidémiologique qui a été lancée en 2001 sur le site de Jussieu. Ses résultats ont-ils été publiés ? M. Didier HOUSSIN : Je vous répondrai ultérieurement sur ce point. Je ne sais pas si cette enquête est terminée, ni si ses résultats ont été publiés. M. le Rapporteur : L'établissement de chiffres de mortalité liée à l'amiante relève-t-il de vos compétences ? M. Didier HOUSSIN : Actuellement, les travailleurs de l'amiante, ceux qui ont travaillé le minerai, qui sont intervenus sur des bâtiments floqués ou calorifugés, ou encore sur des faux plafonds, ont été exposés à des risques. Certains ont pu, à l'évidence, en subir des conséquences sanitaires sévères. La forme la plus typique et la plus grave en est le mésothéliome. Par contre, en dehors des travailleurs, en dehors de la population vivant à proximité d'un site industriel ou d'un affleurement, en dehors de ceux qui sont susceptibles d'être en contact régulier avec des structures ayant contenu ou contenant de l'amiante, les conséquences sanitaires ne sont pas démontrées. Le risque apparaît sans commune mesure avec celui auquel ont été exposés les travailleurs de l'amiante. La présence de l'amiante dans les structures de bâtiment est multiforme. Il y a de l'amiante mélangé à des matières plastiques dans les joints, revêtements, ustensiles ménagers, garnitures de frein. Il y en a dans les feutres. Il y en a mélangé à du ciment dans les composés pour la construction de plaques ondulées, éléments de façade, gaines de ventilation, canalisations. Il y en a en tant que charge minérale incorporée à des peintures, des vernis, des housses d'isolation. Il y en a en tant que poudre dans des mortiers à base de plâtre, dans des mortiers colles, des colles, des enduits de finition. Il y en a incorporé au bitume dans l'étanchéité des toitures, contre la corrosion, les revêtements routiers. Il y en a en tant qu'isolant thermique, tissé ou tressé dans les isolations de canalisation, d'équipement de protection individuelle, de câbles électriques. Il y en a en tant que brut en vrac dans les bourrages ou flocages. Il y en a en tant que plaque de papier ou carton dans l'isolation thermique d'équipements chauffants, de faux plafonds, de joints. Et je ne parle ici que de l'amiante présent dans les bâtiments. Vous voyez que sa présence est extrêmement importante et diverse. M. le Rapporteur : L'un de nos soucis est d'approcher au plus près la vérité. Vous savez qu'on annonce des chiffres : 100 000 morts ; 3 000 morts par an. En tant que directeur général de la santé, confirmez-vous ou infirmez-vous ces chiffres ? Quelle est votre position sur ces chiffres, qui sont trop ronds pour nous ? M. Didier HOUSSIN : Je comprends qu'ils vous paraissent trop ronds. Je suis très préoccupé par l'exposition des travailleurs, ceux qui ont travaillé sur le minerai et ceux qui sont intervenus sur des chantiers sans aucune mesure de protection. Ces personnes courent un risque. Certaines d'entre elles l'ont payé par l'émergence d'affections qui ont été la cause de leur décès. S'agissant du mésothéliome, le rôle de l'amiante me paraît tout à fait réel. Par contre, en ce qui concerne les personnes qui ont été en contact avec de l'amiante incorporé dans un bâtiment professionnel ou un établissement accueillant du public, je vous avoue que ce n'est pas la chose qui me préoccupe le plus du point de vue sanitaire, même si je comprends bien que la population soit inquiète ou puisse l'être. Objectivement, je pense qu'il y a des risques plus importants, qui méritent qu'on s'y attache de façon prioritaire. M. le Rapporteur : Quand vous parlez de risques plus importants, ce qui nous permet de relativiser notre réflexion, à quoi pensez-vous ? M. Didier HOUSSIN : Je pense par exemple que des risques sanitaires liés à des comportements - le tabac, l'alcool - sont beaucoup plus importants que ceux liés à l'amiante, en dehors, je le répète, des travailleurs de l'amiante. Dans le domaine environnemental, la situation est sans doute plus délicate à chiffrer. Il convient - et ce sera l'un des enjeux des années à venir - de hiérarchiser les dangers liés à des facteurs environnementaux : exposition à l'amiante, exposition à des produits chimiques, à des éléments qui peuvent être contenus dans l'eau, à la pollution atmosphérique, au bruit. M. le Rapporteur : S'agissant du nombre de décès liés à l'amiante, quelle est selon vous la source la plus fiable ? M. Didier HOUSSIN : Je crois que l'enquête épidémiologique sur les mésothéliomes donne une idée assez précise de l'impact sanitaire. On peut nuancer cette affirmation en soulignant que l'amiante n'est pas seul en cause. Il reste que cette enquête est une bonne source d'information sur l'impact sanitaire de l'amiante. M. le Rapporteur : A-t-on une idée du nombre de mésothéliomes par an en France ? Se donne-t-on les moyens de le connaître ? M. Didier HOUSSIN : Je n'ai pas le chiffre en tête. Ce n'est pas une tumeur aussi fréquente que le sont le cancer du colon, le cancer du poumon, le cancer du sein, le cancer de l'utérus. C'est une tumeur que l'on peut qualifier de rare. Le chiffre doit être de l'ordre de plusieurs centaines, au plus de quelques milliers. Je pourrai vous donner des indications plus précises lorsque que j'aurai interrogé l'Institut national de veille sanitaire. Il existe également un registre spécifique des mésothéliomes. M. le Rapporteur : Des cancers plus traditionnels sont peut-être liés à l'amiante. La question se pose de savoir s'il y a toujours une relation de cause à effet. Qu'en est-il, d'autre part, des plaques pleurales ? M. Didier HOUSSIN : S'agissant du cancer broncho-pulmonaire, un facteur environnemental n'est pas exclu. Il est difficile de départager le rôle de l'amiante et celui d'autres facteurs considérés comme beaucoup plus sérieux, je pense en particulier au tabac. Je vous ferai parvenir ces informations relatives aux connaissances scientifiques actuelles sur l'impact sanitaire de l'amiante. M. le Président : Les méfaits du tabac ne sont pas contestables. Cela dit, dans ma circonscription, les cas de mésothéliome que je connais concernent tous des personnes ayant travaillé dans des entreprises qui utilisaient l'amiante. M. Didier HOUSSIN : C'est là une donnée incontestable. C'est pourquoi, en 1977, l'identification de l'amiante comme produit cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer de Lyon a été déterminante. Les informations scientifiques étaient d'ailleurs déjà antérieures. Pour ma part, j'ai appris le lien entre l'amiante et le mésothéliome à la faculté de médecine. M. Gérard BAPT : Dans le cadre d'une mission d'information sur le cancer, je suis allé à Lille. Deux cohortes de retraités vont être suivies. Cette étude devrait permettre de savoir s'il y a une prévalence supérieure de tel ou tel autre type de cancer dans cette population. Le ministre du travail avait annoncé la création d'une agence pour la santé au travail. Cette agence sera finalement incluse dans l'AFSSE, qui deviendra l'AFSSET. Celle-ci pourra tenter de dégager des facteurs environnementaux. J'ai appris récemment qu'il existait en Nouvelle-Calédonie des massifs rocheux contenant des produits proches de l'amiante pouvant être la cause de cancers. Concernant le travail interministériel, l'AFSSET ne pourrait-elle pas être le lieu de rencontre entre les principaux acteurs de l'État, fonctionnaires ou scientifiques ? M. Alain CLAEYS : Ma question porte sur les aspects juridiques. L'environnement va devenir, s'il ne l'est déjà, un champ de compétences pour la santé publique. Quelle est l'implication de la DGS dans les travaux de désamiantage de Jussieu ? Y participez-vous fonctionnellement ? Êtes-vous consulté ? M. Didier HOUSSIN : L'étude de Lille sur les cohortes d'entreprise sera effectivement très instructive, et permettra peut-être de nous éclairer sur la responsabilité de l'amiante dans d'autres cancers que le mésothéliome. La création de l'AFSSET est très utile. Elle permettra de donner plus d'ampleur à l'actuelle agence et de faire le lien entre environnement et travail. J'ai toujours été frappé, et même choqué, que l'on ait pu admettre que les travailleurs aient été exposés à un risque plus important que le reste de la population. On avançait l'idée que c'était là une nécessité, et qu'ils avaient la possibilité de se protéger. Je pense pour ma part que nous devrions faire en sorte que les travailleurs soient soumis à des règles telles que le risque sanitaire auquel ils sont exposés soit peu différent de celui de la population générale. Le niveau d'exigence qui est le nôtre en matière de sécurité pour l'ensemble de la population doit peu à peu devenir la norme à partir de laquelle on envisage les risques professionnels. La relation entre environnement et santé publique est extrêmement difficile. Les facteurs environnementaux qui ont un impact sanitaire sont innombrables. Par ailleurs, les forces en présence, notamment économiques, sont très fortes. Nous allons devoir adopter des positions intransigeantes lorsque le risque est avéré, tout en évitant une attitude de terrorisme sanitaire ayant pour but de bloquer toute activité. C'est l'esprit dans lequel nous avons commencé à travailler avec les ministères de l'économie et des finances, de l'environnement, du travail et de l'agriculture. Nous essayons d'identifier les points sur lesquels nous devons avoir des exigences sans concession et ceux sur lesquels il convient de rechercher un compromis. La DGS n'a pas en tant que telle un rôle direct dans le désamiantage de Jussieu. Ce sont les services du ministère du travail qui assurent le contrôle de la manière dont est conduit le processus de désamiantage en termes de protection des travailleurs ou des personnes situées dans l'environnement. Cela étant, s'agissant des anciens sites industriels, la question des risques auxquels peuvent être exposés les riverains peut toujours se poser. Dans ce cas, nous serions concernés, à travers les services déconcentrés du ministère de la santé. M. Gérard BAPT : L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail a-t-elle une approche spécifique du cas de l'amiante ? D'autre part, comment est-il possible que l'on continue à extraire et à utiliser l'amiante au Québec ? M. Didier HOUSSIN : Sur le premier point, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Quant au Canada, cet État a attaqué la décision française d'interdiction de l'amiante. C'est effectivement surprenant. Peut-être a-t-il instauré des normes de protection des travailleurs qui sont de nature à diminuer le risque. C'est un point qui mériterait d'être approfondi. M. le Président : M. le directeur général, nous vous remercions de votre contribution aux travaux de notre mission d'information. Audition conjointe de MM. Bernard PEYRAT, président, et Bruno CHEVALLIER, vice-président du Syndicat de retrait et de traitement de l'amiante et des autres polluants (SYRTA) Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Nous recevons ce matin MM. Bernard Peyrat et Bruno Chevallier, respectivement président et vice-président du SYRTA, le Syndicat de retrait et de traitement de l'amiante et des autres polluants. Je précise que le SYRTA est une chambre professionnelle issue du rapprochement de trois organisations regroupant la majeure partie de l'activité du traitement de l'amiante : le Conseil interprofessionnel du désamiantage, le Syndicat du désamiantage et de la décontamination, ainsi que le Syndicat national de l'isolation - Section amiante. M. Bernard PEYRAT : Je vous remercie de recevoir le SYRTA, structure transversale qui fédère tous les professionnels du désamiantage : diagnostiqueurs, maîtres d'œuvre, entreprises de désamiantage, de traitement des déchets et laboratoires. La réglementation de l'amiante repose sur deux textes fondateurs de 1996 : le décret 96-97, consacré à la protection des populations, qui a été intégré au code de la santé publique, et le décret 96-98, relatif à la protection des travailleurs. Dix ans après, nous considérons que cette réglementation est relativement bien aboutie, même si elle requiert quelques toilettages. Elle reste cependant mal connue et, surtout, absolument pas appliquée. D'abord, les propriétaires immobiliers étaient censés effectuer, avant fin 1999, un diagnostic amiante des matériaux considérés comme les plus dangereux, à savoir les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds. Or nous constatons qu'un grand nombre de ces diagnostics n'ont pas été faits. Puis le dispositif a été renforcé, en 2001, par un texte complémentaire créant, en plus du diagnostic initial, un dossier technique amiante (DTA) destiné à recenser l'ensemble des matériaux amiantés présents dans un immeuble, sachant que ces derniers sont potentiellement au nombre de plusieurs milliers. Ce recensement, pour les immeubles de grande hauteur - l'un d'entre eux faisant la une des médias depuis quelques mois -, aurait dû être achevé au 1er janvier 2003. Qu'en est-il en réalité ? Je m'interroge. Pour les autres catégories d'immeubles, hormis les constructions contenant un seul logement, le dossier technique amiante doit être réalisé avant le 1er janvier 2006, c'est-à-dire dans quelques mois. Or, à ce jour, nous ne disposons d'aucune information sur le degré d'avancement du projet. Les diagnostiqueurs devaient déposer les dossiers auprès des préfectures mais, à ma connaissance, celles-ci n'ont pas mis sur pied les structures nécessaires. Nous nous retrouverons donc au 1er janvier prochain avec des obligations réglementaires dont il sera impossible de vérifier le respect. Ce document devient pourtant la référence en matière d'analyse du risque encouru par les populations habitant les immeubles et les entreprises de travaux. Il doit être mis à jour en temps réel, en fonction des travaux réalisés au fil du temps, et être à la disposition des organisations syndicales et des Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ainsi que de toutes les entreprises amenées à intervenir dans les immeubles. À partir du 1er janvier, les entreprises consultées demanderont systématiquement, conformément à la loi, de se voir communiquer ce document technique. En son absence, que se passera-t-il ? Comment les travaux seront-ils réalisés ? S'agissant de la tour Montparnasse, ce ne sont pas les entreprises qui n'ont pas bien fait leur travail - elles ne sont pratiquement pas intervenues -, mais les propriétaires. Le problème est complexe car le nombre de copropriétaires atteint 120 ou 140. Le diagnostic, pour les matériaux considérés comme dangereux, se déroulait en trois phases : recherche de la présence de flocage, de calorifugeage et de faux plafonds ; détermination de présence d'amiante ; étude de l'état de conservation de l'amiante. Le niveau 3 désignait les matériaux très dégradés, mettant en danger les habitants de l'immeuble, et imposait une réalisation de travaux dans un délai de douze mois. Mais, très souvent, le diagnostic n'a pas été fait et, même lorsqu'il l'a été, l'obligation de réaliser les travaux n'a pas été respectée. Les populations concernées peuvent donc légitimement se considérer comme ayant été mises en danger. La réglementation concernant les entreprises, dans le cadre du droit du travail, est relativement bien faite. Je vois toutefois un problème fondamental : la distinction entre matériaux friables et non friables. En effet, dès lors qu'un professionnel intervient sur un matériau contenant de l'amiante, celui-ci risque de dégager des fibres, même s'il est naturellement non friable : nous créons nous-mêmes la friabilité en fonction de notre niveau d'intervention. Le ministère du travail semble désormais disposé à se mettre en règle avec les dispositions européennes en abandonnant cette distinction inappropriée. Les entreprises intervenant sur des matériaux amiantés friables doivent être qualifiées, et il y a deux organismes de qualification : Qualibat, qui délivre la qualification 1513, et l'AFAQ ASCERT, qui délivre une qualification amiante. Ces deux structures ont fait correctement leur travail - j'en parle d'autant mieux que je préside le comité de qualification de l'AFAQ ASCERT - puisque le nombre d'entreprises qualifiées est passé de plus de 500 à la fin des années 1990 à 120 aujourd'hui. Nous aimerions enregistrer le même pourcentage de chute du nombre de propriétaires ne respectant pas les règles - lesquels, je le rappelle, sont maintenant passibles du pénal. Aujourd'hui, nous avons besoin d'aide. Les entreprises qualifiées subissent un audit qui porte sur la procédure de retrait de l'amiante et s'appuie sur des visites de chantier inopinées. Nous demandons chaque mois aux entreprises de nous déclarer leurs chantiers et nous choisissons un site au hasard pour aller l'auditer. Lorsque approche la période d'audit, certaines entreprises peuvent nous faire des déclarations restreintes pour orienter la cible ! Ces pratiques sont assez courantes et nous y parons difficilement car nous ne disposons d'aucune base de données des chantiers de désamiantage ouverts en France. Il serait utile que les données recueillies par l'administration à partir des déclarations de plan de retrait nous soient communiquées, afin de nous permettre de vérifier qu'une entreprise nous a bien déclaré tous ses chantiers. La CRAMIF, Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, essaie actuellement de recenser tous les plans de retrait. Un tel outil serait d'ailleurs utile aux inspecteurs du travail, pour mieux cibler leurs contrôles. M. le Président : Tout à fait. M. Bernard PEYRAT : Les inspecteurs du travail se déplacent en effet souvent sur les très grands chantiers des très grandes entreprises, alors que celles-ci sont bien organisées et respectent les règles du jeu. Les petites entreprises, en revanche, ne sont jamais visitées. Nous souhaiterions que les inspecteurs du travail ciblent mieux leurs contrôles. Par ailleurs, les déchets constituent notre principal sujet de préoccupation car la situation se dégrade d'année en année. Nous avions été sollicités par le ministère de l'environnement, il y a quelques années, pour établir un code de traçabilité des différents déchets, mais celui-ci n'a jamais été intégré à la réglementation, si ce n'est une modification du bordereau de suivi des déchets tirée du code que nous avions proposé. Il s'agit en effet de ne pas en perdre en route. Le problème du traitement des déchets est qu'il coûte très cher et qu'il y a beaucoup d'économies à faire en n'appliquant pas la réglementation. M. le Président : Combien cela coûte-t-il ? M. Bernard PEYRAT : Nous vous communiquerons les prix exacts pour que vous compreniez que contourner la réglementation peut rapporter gros. Par ailleurs, une série de circulaires récentes nous perturbent beaucoup car elles ne sont pas conformes aux directives européennes. L'amiante, déchet dangereux au sens de la loi de 1975, doit suivre une filière d'élimination précise, le caractère du composant le plus dangereux incorporé dans un matériau conditionnant la classification de ce dernier. Or une circulaire du ministère de l'environnement prévoit l'inverse : un déchet dangereux lié à un matériau inerte devient un matériau inerte, ce qui permet d'envoyer de l'amiante dans des centres de classe 3 pour lesquels il n'y a aucun contrôle. Des millions de tonnes sont concernées, l'enjeu économique est considérable, mais ce n'est pas une raison pour céder aux diverses pressions. M. Bruno CHEVALLIER : D'autant que les centres de classe 3 sont censés recycler les déchets. M. Bernard PEYRAT : Les installations de concassage des bétons sont les installations les plus polluées de France en amiante, l'agression du matériau larguant d'innombrables fibres. M. le Président : Merci pour cette présentation extrêmement claire, qui sera de surcroît complétée, si j'ai bien compris, par une note détaillée - elle sera diffusée auprès des membres de la mission. M. le Rapporteur : Le tableau que vous dressez justifie à lui seul l'existence de notre mission. Quand vous intervenez à la suite d'un diagnostic, vous avez le choix entre le confinement, c'est-à-dire l'encapsulage de l'amiante, ou le retrait. Comment s'effectue ce choix ? Jugez-vous nécessaire de construire un centre d'inertage supplémentaire pour se débarrasser définitivement de davantage de fibres dangereuses ? M. Bruno CHEVALLIER : Je m'exprimerai sans langue de bois : le choix entre l'encoffrement et l'encapsulage ou l'enlèvement incombe au maître d'ouvrage, et est le plus souvent fait en fonction de critères financiers. Le problème, est que l'enlèvement est considéré plus cher que l'encoffrement avec du placoplâtre ou un faux plafond étanche, ou que l'imprégnation avec une colle ou une résine. En réalité, les frais fixes du chantier sont identiques dans les deux cas, car la réglementation impose un confinement statique de la zone pour travailler l'amiante. Le coût du traitement par imprégnation ou coffrage revient par conséquent aux deux tiers ou à 70 % d'un enlèvement pur et simple. Et l'économie est d'autant plus maigre que dans ce cas s'ajoutent des contrôles nécessaires de l'empoussièrement dans le temps : sur dix ans, les 30 % gagnés seront largement perdus. Il arrive aussi que le maître d'ouvrage ne dispose pas de trésorerie et éprouve des difficultés à emprunter, par exemple une copropriété : il lance alors un programme de provisionnements successifs de cinq ou six ans avant d'entreprendre les travaux. Dans ce cas, l'encapsulage, l'imprégnation ou l'encoffrement est une mesure conservatoire d'urgence assez astucieuse, si ce n'est que le client, en fin de compte, aura payé 1,7 fois le prix de l'enlèvement, comme à Jussieu. M. Alain CLAEYS : À Jussieu, se posait aussi le problème des normes incendie. M. Bruno CHEVALLIER : Le choix peut aussi être fondé sur des considérations techniques : pour une université ou un hôpital, par exemple, il s'avère problématique d'évacuer l'immeuble et de reloger ses occupants dans un bâtiment relais. Des travaux conservatoires sont alors nécessaires. Le traitement sans enlèvement représente 5 % du chiffre d'affaires des entreprises de désamiantage, et nous tentons d'en dissuader nos clients lorsqu'ils sont motivés par des raisons exclusivement économiques. Au demeurant, dès lors que nous imprégnons un matériau d'un revêtement de surface, nous modifions ses caractéristiques et nous ignorons si la garantie de propriété coupe-feu pendant deux heures reste valable ; en tout cas, la couverture d'assurance liée à la garantie décennale disparaît. Un tel traitement est donc explosif et ne peut être préconisé qu'à titre provisoire. Enfin, la réglementation a changé : les exigences de coupe-feu sont passées à quatre heures dans bien des cas et la moindre intervention contraint le propriétaire à s'aligner sur cette nouvelle norme. M. Bernard PEYRAT : J'ajoute qu'un traitement sur un matériau tend à l'alourdir et donc à augmenter le risque que le flocage se désagrège. Cette solution ne saurait donc être préconisée, si ce n'est dans le cadre de mesures conservatoires, dans l'attente, par exemple, d'un grand projet de réhabilitation. Dans le code de traçabilité, nous avons créé un code rouge et un code jaune. Le code rouge désigne les déchets très dangereux car possédant une capacité naturelle à émettre des fibres. Ils sont obligatoirement orientés vers un centre d'enfouissement technique de classe 1 ou vers la filière inertage. Les fibres sont détruites et on obtient des vitrifiats non réutilisables Le problème de l'inertage est que la seule installation est localisée dans les Landes, tandis que le marché français se situe à 70 % en Île-de-France, d'où un coût de transport considérable. Quand on parle de 1 150 euros la tonne, c'est le prix le plus bas ; en réalité, si l'on consulte le catalogue, on s'aperçoit qu'il coûte entre 1 150 et 2 400 euros la tonne suivant les matériaux, et, curieusement, qu'il est moins cher pour les plus dangereux. INERTAM souhaite récupérer tous les matériaux amiantés. D'un point de vue citoyen, c'est intéressant, car mieux vaut détruire qu'enfouir, mais le coût pose problème, de sorte qu'il est peut-être possible de n'y envoyer que les produits les plus dangereux. Le prix moyen d'inertage est donc de 1 300 euros la tonne, auxquels il faut ajouter le coût de transport, 400 euros la tonne pour des déchets parisiens, soit un total de 1 700 euros la tonne. Un déchet orienté en classe 1, à Villeparisis, par exemple, pour ce qui concerne la région parisienne - et il y en a à peu près partout sur le territoire français -, revient à 150 euros la tonne pour le transport et à une somme comprise entre 200 et 500 euros la tonne pour le traitement, soit une différence totale avoisinant 1 200 euros la tonne. Les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire les propriétaires, ont-ils les moyens de se payer de tels écarts ? Car ce ne sont pas les entreprises de traitement mais les maîtres d'ouvrage qui décident. Cela nous convient très bien. Nous ne demandons pas à nous occuper du traitement des déchets car des écarts entre les entreprises se creusent sur cette question. Nous sommes parfaitement transparents, tandis que c'est une source de trucages pour certains de nos concurrents, qui, sur ce poste, supportent des coûts deux, voire quatre, fois moins élevés que nous, sans raison. M. le Président : Nous reviendrons sur ce sujet. M. Bernard PEYRAT : Quoi qu'il en soit, pour Jussieu, les flocages vont à l'inertage, les matériaux amiantés moins dangereux sont orientés en classe 1 et les matériaux contaminés en classe 2. Il faudrait interroger les responsables de Jussieu. Ils ont construit leur propre code de traçabilité. M. le Président : Faites-nous confiance, nous irons jusqu'au bout. M. Bernard PEYRAT : Un parpaing contaminé peut donc aller en classe 2, qui coûte encore beaucoup moins cher que la classe 1 - entre la classe 1 et l'inertage, le rapport est de un à trois, et de un à neuf pour les déchets contaminés comme les parpaings ou les faïences. Mais, bien entendu, avec l'inertage la fibre est détruite, de même que la traçabilité... Vous conviendrez que je n'use pas de la langue de bois. M. le Président : Je vous en remercie. Il est possible que nous demandions à vous entendre de nouveau. M. Alain CLAEYS : Lorsque le maître d'ouvrage de Jussieu, il y a dix ans, a été confronté au problème, la mise aux normes incendie n'a-t-elle pas constitué un frein au désamiantage ? Le même problème ne risque-t-il pas de se poser pour d'autres équipements ? M. le Président : Vous avez beaucoup parlé du privé. Qu'en est-il du public ? M. Bernard PEYRAT : Je n'ai guère parlé du secteur public, mais c'est le premier à ne pas respecter les lois qu'il édicte lui-même ! Les 14 centres hospitaliers universitaires sont bourrés d'amiante et pas une opération n'y a été entreprise. Tout le monde parle de Jussieu mais il ne faut pas avoir honte de ce chantier : des mesures conservatoires y ont été prises depuis quinze ans et cette université reste une référence de l'application de la réglementation. La difficulté consistait à déplacer une université et à trouver des locaux d'accueil. M. Alain CLAEYS : Je sais tout cela, mais qu'en est-il du risque d'incendie ? M. Bernard PEYRAT : Initialement, il était mal connu ; depuis, la législation a beaucoup évolué. En conduisant le premier chantier de désamiantage de Jussieu, nous avons découvert que des câblages électriques pirates, masqués sous les flocages, avaient été réalisés entre les barres, ce qui représente un risque considérable pour nos salariés, d'autant que nous sommes obligés de travailler à l'humide. M. Alain CLAEYS : Et la structure ? M. Bernard PEYRAT : Elle est d'autant plus fragile que l'amiante a été encoffré. M. Bruno CHEVALLIER : Désamianter, c'est ouvrir la boîte de Pandore : le bâtiment est mis à nu. Il faut donc tout remettre aux normes incendie et aux normes électriques, ce qui coûte infiniment plus cher que le désamiantage en lui-même : la réhabilitation de Jussieu coûte dix fois plus que le désamiantage. M. Alain CLAEYS : C'est évident. M. le Rapporteur : Comme le disait le Président, il faudra sans doute que nous poursuivions ces échanges. M. Bernard PEYRAT : Vous pouvez aussi nous poser d'autres questions par écrit. M. le Rapporteur : Intervenez-vous sur les navires ? Par ailleurs, nous avons compris la rigueur avec laquelle votre chambre professionnelle certifie les entreprises et vérifie sur place le respect des procédures, mais des entreprises échappent-elles à ces exigences ? J'ai cru comprendre que oui. Enfin, quelles sont les conditions de travail de vos salariés ? Comment la pénibilité des tâches - ils travaillent avec des protections, des combinaisons, des masques - est-elle prise en compte ? M. Bernard PEYRAT : Seules les entreprises intervenant sur les matériaux friables doivent être qualifiées, et nombre d'entreprises interprètent cette règle comme cela les arrange. C'est pourquoi nous préconisons la suppression de la distinction entre matériaux friables et non friables. L'année dernière, la presse a prétendu que 70 ou 75 % des entreprises travaillaient n'importe comment ; mais il s'agissait essentiellement d'entreprises non qualifiées. Nos salariés travaillent avec des équipements respiratoires et, dans le calcul du temps de travail, nous tenons compte de cette pénibilité. Notre syndicat souhaite limiter strictement le temps de travail sous équipement : pour les médecins du travail, il « ne devrait pas » dépasser deux heures trente ; nous considérons pour notre part qu'il « ne doit pas » excéder cette limite. Nous avons signé des protocoles expérimentaux avec les caisses régionales d'assurance maladie, concernant en particulier Jussieu, pour bien mesurer ces contraintes de pénibilité et y adapter les temps de travail, comme dans les centrales nucléaires - vous savez, les entreprises compétentes dans le domaine de l'amiante viennent toutes du nucléaire, jamais du bâtiment. M. Bruno CHEVALLIER : Ma société est l'un des principaux intervenants dans le domaine naval, en particulier pour les bateaux militaires. L'obligation incombant aux maîtres d'ouvrage, en vertu de la loi, concerne les immeubles bâtis. Les bateaux sont-ils des immeubles bâtis ? Depuis le départ, certains essaient d'exclure de cette catégorie l'industrie, la raffinerie, le process industriel, ainsi que les moyens de transport, wagons, camions et bateaux. La Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE), assez maladroitement, a apporté des compléments, notamment pour la marine, et, en théorie, la marine militaire échappe à la réglementation amiante. Bref, les bateaux sont très mal protégés, alors qu'ils constituent la première source de contamination pour les ouvriers - ceux qui ont travaillé dans ce secteur sont les plus frappés par le mésothéliome - et le problème n'est toujours pas traité sérieusement. M. le Président. Je vous remercie vivement pour votre franchise. Audition conjointe de Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président. Nous recevons MM. Guy Jean et Alain Leseigneur, respectivement président et directeur général de SOBATEN, société de désamiantage, qui vont nous expliquer la façon dont s'effectue un désamiantage et, plus globalement, les difficultés et contraintes qui s'imposent aux entreprises dans l'application de la réglementation relative à la gestion de l'amiante résiduel. Nous allons maintenant vous écouter, puis nous engagerons la discussion avec les questions du Rapporteur et des membres de la mission. M. Guy JEAN : C'est la première fois que des acteurs de terrain sont entendus par les pouvoirs publics au niveau national et nous y sommes très sensibles. Nous présenterons les activités de notre société en nous appuyant sur un document qui vous sera distribué. Ensuite, nous répondrons à toutes les questions que vous souhaiterez nous poser. Directeur général d'une société spécialisée en hygiène industrielle, j'ai été amené dès 1974, avec des scientifiques de la faculté de Jussieu, du Laboratoire d'étude des particules inhalées de la ville de Paris (LEPI), de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF), à entamer une réflexion sur les risques engendrés par l'amiante dans les bâtiments à usage tertiaire, industriel ou d'habitation. En 1975, j'ai effectué mon premier chantier de retrait de flocage d'amiante. À partir de ce moment, je n'ai plus quitté la filière, animé d'une obsession constante : la protection des opérateurs et de l'environnement, ainsi que l'amélioration des conditions de travail. Notre travail s'est toujours fait et ne peut se faire qu'en partenariat : avec des scientifiques, des représentants du laboratoire du Bureau de recherche géologique et minière (BRGM), quelques inspecteurs du travail, l'organisme de certification Qualibat, les médecins du travail et, clé de voûte du système, le personnel qui m'entoure. Pour information, nous avons mis au point un procédé de retrait des matériaux contenant de l'amiante de type plâtreux par très haute pression, ramassage des déchets par aspiration et pressurisation des déchets par filtre-presse. Cette technique présente l'avantage de diminuer considérablement la pénibilité du travail. Cette technique, mise au point par Alain Leseigneur, qui a fait l'objet d'un brevet européen, constitue une avancée technologique importante en matière de résorption de la pénibilité. Nous avons également accompli une étude conjointe avec notre service de médecine du travail et le centre hospitalier de la Pitié-Salpêtrière à propos de l'évaluation de la pénibilité des opérations de désamiantage et de l'incidence sur les rythmes cardiaques. Cette étude a duré deux ans et fait aujourd'hui référence auprès de la médecine du travail nationale. Le mémoire a fait l'objet d'une présentation devant le colloque des médecins du travail de Grenoble. Nous avons aussi mis en place, pour la première fois au plan national et sans doute européen, une procédure de contrôle permanent de la qualité de l'air respiré. Aujourd'hui, la corporation se contente d'une analyse ponctuelle au démarrage du chantier. Les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre, voire la maîtrise d'œuvre déléguée, sont d'autres partenaires essentiels à notre activité. Je remercie au passage les grandes institutions qui ont fait confiance à SOBATEN, entreprise que j'ai créée en 1992 : EDF, la RATP, Air France, Europe 1, le groupe Lagardère, la SNCF, la SACEM. Enfin, nous avons été sélectionnés pour éradiquer le problème de l'amiante après l'accident du Concorde. J'en viens maintenant, plus concrètement, à la description d'un chantier de désamiantage. Avec l'amiante, vous vous attaquez à un gros problème qui concerne tout le monde. Un chantier débute toujours par une étude, cette phase essentielle se décomposant en cinq étapes. Premièrement, nous analysons le diagnostic et le CCTP - le cahier des clauses techniques particulières -, lorsqu'il existe. Deuxièmement, nous organisons une ou le plus souvent plusieurs visites du site, en fonction de sa configuration, de la nature des matériaux à retirer et de leur qualité. Troisièmement, l'étude technique, toujours préalable à l'étude financière, doit être visionnaire et faire apparaître les points clés du futur chantier afin de déterminer le degré de risque. Cette étape requiert la collaboration du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre. Quatrièmement, nous passons au planning d'intervention. Cinquièmement, l'étude financière est toujours conditionnée par la qualité de l'étude technique. La deuxième phase est celle de la négociation commerciale. Avec de véritables professionnels, ce n'est jamais compliqué. Mais nous vivons malheureusement dans l'ère des acheteurs - c'est un véritable scandale, et je pèse mes mots, car dans le domaine de la sécurité, c'est toujours dramatique. La présence d'un acheteur peut se concevoir, mais obligatoirement après analyse du dossier par un spécialiste technique de terrain. Il faudrait absolument faire quelque chose. Avec la loi du marché, c'est-à-dire les objectifs de résultats financiers, les études erronées ou absentes, une déontologie douteuse, 60 à 70 % des marchés de désamiantage sont traités sous le prix vérité moyen. Vient aussi se greffer le choix du mieux-disant, procédure pour ainsi dire caduque de peur du législateur et du rapport de force à établir : de fait, c'est le moins-disant qui est choisi, avec des impasses flagrantes. C'est ainsi que, récemment, un organisme d'État a attribué un marché à un groupement d'entreprises qui sous-estimait de 80 tonnes les déchets à diriger vers l'inertage. En effet, l'inertage coûte de 1 700 à 1 800 euros la tonne ! Les entreprises prennent souvent en charge ce coût mais certaines font l'impasse. Toutes les décharges publiques de France, vous le savez, sont contaminées par les fibres d'amiante ... M. Alain CLAEYS : Exactement 70 % d'entre elles. M. le Président : C'est déjà beaucoup ! M. Guy JEAN : S'ajoute le problème suivant : la qualification n'est exigée que pour les matériaux friables, ce qui signifie que 80 % du marché nous échappe. Depuis 1994, beaucoup a été fait, beaucoup de bonne volonté a été manifestée Une fois la négociation commerciale achevée, nous établissons un plan de retrait, adressé aux organismes officiels trente jours avant le début du chantier, qui constituera le fil conducteur des opérateurs. Il doit être exhaustif, concis, précis, afin que chaque opérateur puisse l'interpréter. L'analyse des risques doit y être très poussée. Je vous propose de m'arrêter là, puisque je vous ai remis un document, et de répondre maintenant à vos questions. M. le Rapporteur : Que pensez-vous de la distinction entre matériaux friables et non friables ? Doit-on y mettre un terme ? M. Guy JEAN : Les risques sont certes différents selon que le matériau est friable ou non. Toutefois, un matériau lié peut devenir friable après une manipulation, un retrait ou une intervention. Actuellement, 80 % du marché échappe au désamiantage et nous préconisons qu'une qualification soit obligatoire pour les interventions sur l'ensemble des matériaux, friables ou non. Il serait souhaitable d'aller vers une qualification par catégories car le retrait de matériaux friables entraîne incontestablement un risque potentiel plus élevé que le retrait de fibrociment ou de dalles de sol, même si ces prestations provoquent aussi une pollution. Les couvreurs ou les sociétés de revêtement de sol, par exemple, seraient qualifiés uniquement pour le retrait de matériaux les concernant. Une qualification unique, sans distinction entre catégories, découragerait tout le monde. Même si le nombre de désamianteurs de friables n'augmentera jamais, il faut encourager les entreprises du bâtiment à suivre une formation spécifique. C'est essentiel pour la régulation du secteur et le suivi des déchets. M. le Rapporteur : Pouvez-vous développer davantage la thématique des acheteurs et celle du moins-disant ? M. Guy JEAN : Nous sommes soumis à la loi du marché et je comprends que les maîtres d'ouvrage lancent des appels d'offres. Il faut néanmoins espérer que ceux-ci ne soient pas induits en erreur. Pour commencer, l'étude technique doit primer et ne pas être subordonnée à des considérations financières : le mémoire technique doit permettre d'éliminer les opérateurs qui proposeraient une intervention au rabais et d'opérer la sélection entre ceux qui ont procédé à une analyse sérieuse. Or toutes les grandes institutions se sont adjoint les services d'« acheteurs », plus que de vrais professionnels. Objectivement, comment parler de gain, de bénéfice, lorsque la santé humaine est en jeu ? Cela me paraît choquant. Celui qui accepte une affaire, alors qu'on lui demande de faire pour 60 euros ce qui en nécessiterait 100, se montre malhonnête car il devra faire l'impasse sur beaucoup de choses. Le plus grave est que certains acheteurs ne suivent pas l'étude technique. Élus, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, entreprises ou laboratoires, nous sommes tous concernés par l'amiante. S'agit-il de faire des économies ou bien d'éradiquer le problème ? Surtout, n'agissez pas de façon précipitée car nous n'aurons pas plus de personnel compétent demain qu'aujourd'hui. M. le Rapporteur : Qu'avez-vous de plus à nous dire à propos du diagnostic ? M. Guy JEAN : Notre métier consiste à sensibiliser : on ne meurt pas de l'amiante immédiatement, sur une simple inhalation, mais après vingt-cinq ou trente ans d'exposition. Par ailleurs, il existe 3 000 à 4 000 matériaux amiantés. C'est pourquoi les diagnostics sont si importants et nécessitent l'intervention de professionnels. Une entreprise qui n'a jamais conduit de chantier n'est pas compétente pour ce travail. Après trente ans de métier, j'émets encore moi-même des réserves sur mes dossiers. C'est toujours très long - croyez-moi, au bout de deux heures, sur un site industriel, on n'est plus opérationnel car on est envahi par la lassitude - et c'est très cher car il faut y passer du temps. Or, en France, on ne dénombre que 4 000 diagnostiqueurs et il arrive qu'un diagnostic soit accompli par le département électrique de l'organisme. M. Alain LESEIGNEUR : Lorsque nous prenons en compte un chantier, nous nous apercevons trop souvent que le diagnostic est incomplet ou ancien et nous découvrons des matériaux auxquels nous ne nous attendions pas. Récemment, dans une grande institution, on a découvert que tous les planchers étaient revêtus de matériaux amiantés, alors que le diagnostic ne relevait que quelques traces d'amiante. Le problème fondamental est décidément celui de la qualification des entreprises. M. le Président : Nous en avons conscience. Il apparaît donc que les obligations réglementaires ne sont pas respectées, particulièrement pour les bâtiments de grande hauteur. Le dossier technique amiante peut-il constituer la base préalable à la discussion pour que l'offre ne soit pas simplement fondée sur des considérations financières mais aussi sur des éléments techniques ? M. Guy JEAN : Absolument et pas uniquement pour le désamiantage : le dossier technique présente aussi l'avantage d'informer les personnes intervenant dans les travaux de maintenance. Au total, 300 000 morts sont annoncés alors que, globalement, seulement 5 000 à 7 000 personnes auront œuvré dans le désamiantage. Actuellement, il n'y a que 1 700 opérateurs de désamiantage en activité. Cela signifie qu'une majorité de décès toucheront les plombiers, les chauffagistes, les couvreurs, les ascensoristes et les électriciens qui respirent de l'amiante tous les jours ! M. Jean-Yves COUSIN : Je souhaiterais revenir sur les contraintes auxquelles sont confrontés vos opérateurs. Ceux-ci doivent se changer après chaque intervention et les contraintes sont tellement lourdes qu'une qualification par catégorie pourrait être utile, notamment pour le fibrociment - mais je parle avec beaucoup de prudence. M. Guy JEAN : La visite d'un chantier est en effet toujours très spectaculaire et il faut savoir que ces contraintes ont un impact sur le coût de nos prestations. Un travail de désamiantage nécessite un personnel formé et motivé. Nous sommes des hommes de l'ombre mais nous devons être transparents sur notre activité et rassurer la population environnante. Dans le même temps, il s'agit d'assurer la protection de nos opérateurs, qui travaillent habillés « en cosmonautes » dans une zone confinée et fermée. Psychologiquement, ce n'est pas évident, et nous ressentons des changements de comportements très nets entre le matin et le soir. Sur un chantier type, un agent entre trois fois deux heures ou deux heures et demie en zone, selon la nature et la pénibilité des travaux. Au-delà de vingt-quatre degrés, la durée d'intervention est réduite graduellement en fonction de la température. L'agent est équipé d'un « panoramasque » alimenté en adduction d'air ou en ventilation assistée. Chaque cartouche coûte un peu plus de 18 euros, une cartouche par entrée en zone étant nécessaire pour l'adduction d'air et deux pour la ventilation assistée. Tous les vêtements - la combinaison, mais aussi les chaussettes, le slip et le maillot de corps, plus deux paires de gants - ne servant qu'une fois, soit plus d'une centaine d'euros par opérateur et par jour, rien qu'en équipement jetable. C'est le seul moyen de se protéger efficacement. C'est pourquoi une entreprise qui propose d'intervenir pour 250 à 300 euros la journée n'est pas crédible : dans certaines d'entre elles, on travaille toute la semaine avec la même cartouche. Pour couronner le tout, après chaque intervention, l'opérateur doit prendre deux douches : la première avec son équipement, pour se dépoussiérer - l'ensemble du matériel et de vêtements étant ensuite envoyé vers une décharge de classe 1 ou le centre d'inertage -, et la seconde sans aucun vêtement. En fin de journée, celui qui est entré trois fois en zone sera donc passé six fois sous la douche ! Mais toutes ces mesures sont indispensables car il ne s'agit pas de protéger un site pour polluer l'extérieur. Face à ces contraintes, nous vous demandons d'être solidaires et de prendre des mesures concrètes. M. Alain LESEIGNEUR : La procédure est inspirée du nucléaire. Je note au passage qu'il existe un statut du travailleur du nucléaire et que nous devrions le prendre en exemple. M. le Président : J'allais justement vous interroger sur ce point. M. Alain LESEIGNEUR : Chaque travailleur du nucléaire est suivi au travers de son carnet, à tel point que le recours à des travailleurs intérimaires peut se concevoir. Pour les métiers de l'amiante, un tel document clarifierait grandement la situation et éviterait des usages curieux comme les prêts de personnel ou les contrats à durée de chantier, qui ne sont que de l'intérim déguisé. Si le législateur instaurait un tel statut, ce serait un gros progrès. M. Guy JEAN : La possibilité d'embaucher des intérimaires serait moins abusive que le recours aux contrats à durée de chantier. D'autant qu'un intérimaire est complètement déclaré, souvent bien rémunéré et formé pour exercer sa mission. M. le Président : Compte tenu de la pénibilité du travail et des contraintes que vous avez décrites, j'imagine qu'il est rare, voire exceptionnel, qu'un opérateur entre trois fois en zone dans la même journée ? M. Guy JEAN : En général, un agent intervient deux fois deux heures et demie, avec trente à quarante-cinq minutes de repos entre ses deux entrées en zone, mais tout dépend de la nature des travaux. Et chacun est libre d'arrêter quand il se sent épuisé ; nous sommes un peu comme une famille. M. le Président : Je suppose que la plupart de vos salariés sont jeunes. M. Guy JEAN : Certains me suivent depuis le début... et d'autres sont malheureusement déjà partis à la retraite ! M. Alain LESEIGNEUR : Nous employons tout de même beaucoup de jeunes. M. le Président : La filière va certainement se développer mais je suppose que l'on ne peut exercer jusqu'à l'âge de la retraite ? M. Guy JEAN : Au contraire, c'est tout à fait possible, à condition de respecter certains critères car tous les individus n'ont pas les mêmes capacités physiques, psychologiques et ne sont pas égaux devant l'usure. La question se traite conjointement avec eux : jamais nous n'imposons à quiconque d'entrer une troisième fois en zone. Dans notre métier, tout le monde doit avoir une grande sensibilité et un sens des responsabilités très développé car chaque geste peut avoir des conséquences graves pour soi mais aussi pour les collègues et pour l'environnement. Mme Martine DAVID : Quel est le niveau de rémunération moyen des techniciens du désamiantage ? On peut exiger beaucoup des opérateurs, à condition qu'ils reçoivent quelque chose en retour. Si les jeunes n'ont plus envie de se former aux métiers de la restauration ou du bâtiment, c'est aussi parce que, pendant longtemps, les salariés de ces branches n'ont pas été payés convenablement. Compte tenu de l'enjeu, il ne faut pas négliger cet aspect, faute de quoi les entreprises n'attireront pas les jeunes. M. Louis COZYNS : Votre témoignage est fondé sur du vécu et j'ai noté vos remarques sur les problèmes liés à l'approche commerciale. Celle-ci, selon moi, ne peut découler que du diagnostic. Le mieux-disant n'est pas forcément le moins-disant, d'autres paramètres que le prix entrant en compte. Combien de sociétés en France sont-elles qualifiées pour le désamiantage et quelle est leur taille moyenne ? Vous avez évoqué le cas d'un groupement d'entreprises qui avait sous-estimé de 80 tonnes les déchets à diriger vers l'inertage. Est-ce une tricherie ? Le diagnostic était-il mauvais ? M. le Rapporteur : Dans l'industrie nucléaire, cohabitent les salariés directs de COGEMA ou de l'EDF, par exemple, et ceux des entreprises sous-traitantes chargées de la décontamination ou, plus précisément, de l'assainissement, ces derniers ne bénéficiant pas exactement des avantages liés au statut du secteur. J'ajoute cet élément à votre réflexion, en rappelant que les personnes travaillant en milieu hostile sont sujettes aux maladies cardiaques et au vieillissement prématuré. M. Guy JEAN : Les médecins du travail et les professeurs de médecine sont nos partenaires très proches : nous ne faisons rien sans eux. Nous devons non seulement former nos personnels mais aussi les payer correctement pour les encourager. Du reste, les entreprises qualifiées fournissent chaque année le tableau de leurs salaires dans le cadre de leur déclaration annuelle des données sociales (DADS). Il serait d'ailleurs intéressant d'analyser la façon dont chaque entreprise de ce secteur à haut risque rémunère ses employés. En tout cas, à la SOBATEN, il n'y a pas de smicards. M. Alain LESEIGNEUR : La plupart de nos opérateurs sont de niveau bac, voire BTS. Mme Martine DAVID : Il arrive que des bacheliers ou des diplômés de l'enseignement supérieur soient mal payés ! M. Alain LESEIGNEUR : Le niveau de rémunération que nous offrons nous permet de nous attacher des salariés en les valorisant. M. Louis COZYNS : Une convention collective s'impose. M. Alain LESEIGNEUR : Cela permettrait effectivement de remettre à plat beaucoup de choses. M. Guy JEAN : S'agissant de l'écart de 80 tonnes de déchets entre un diagnostic et la réalité, n'oubliez pas que notre activité, comme toute autre, est gérée par des hommes. En l'espèce, l'entreprise s'est « couchée » car elle avait sans doute besoin de travailler mais je suis certain que, au final, l'institution ne fera pas l'impasse. Dans d'autres cas, c'est malheureusement arrivé : je ne dirai pas que la corruption est absente de notre activité. M. le Rapporteur : Quel est le salaire moyen de vos techniciens ? M. Guy JEAN : Les plus jeunes opérateurs sont payés au minimum 1 800 euros nets par mois. M. Alain LESEIGNEUR : Sans compter les primes. M. Guy JEAN : Et certains salaires dépassent 3 000 euros par mois. M. Alain LESEIGNEUR : Nombre d'instances ou d'élus se sentent rassurés lorsqu'ils accordent le marché au moins-disant, alors que devrait primer l'exigence du mieux-disant fondé sur une étude technique sérieuse. M. le Président : Je vous remercie pour ce dialogue extrêmement vivant et intéressant avec les hommes de terrain que vous êtes. Nous prendrons contact pour une visite de chantier, afin d'approfondir ces questions sur place. Audition de représentants de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) : MM. François LIET, responsable du département développement et prestations, Dominique PAYEN, chef de projet chimie et environnement, Jean-François BOULAT, médecin-conseil du comité national, et Alain FRAISSE, secrétaire régional Sud-est Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Nous recevons les représentants de l'OPPBTP, l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics : M. François Liet, responsable du département développement et prestations, M. Dominique Payen, chef de projet chimie et environnement, M. Jean-François Boulat, médecin-conseil du comité national, et M. Alain Fraisse, secrétaire régional Sud-est, qui vont nous parler des difficultés d'application de la réglementation relative à la gestion de l'amiante résiduel et de l'utilisation des fibres de substitution. Je précise que l'OPPBTP est un établissement public créé en 1947, placé sous la tutelle du ministère du travail et géré de façon paritaire par les employeurs et salariés du BTP. Il exerce une mission de prévention, d'information et de conseil auprès des entreprises du secteur mais est dépourvu de pouvoir de contrôle. Son action s'appuie sur des campagnes d'information, des formations et des publications spécialisées. Il agit via un réseau de délégations régionales auxquelles sont associés la direction du travail et des médecins. Notre mission a placé le thème de la gestion de l'amiante résiduel en tête de son programme de travail C'est pourquoi, après avoir entendu les administrations d'État compétentes sur l'encadrement juridique, la mission reçoit maintenant les différents acteurs du diagnostic et du désamiantage, puis s'intéressera à la façon dont la réglementation est contrôlée. Cette méthode se révèle la bonne car les premières auditions ont déjà soulevé de multiples problèmes, parfois inattendus. M. François LIET : Notre délégation est un peu nombreuse, mais le sujet est assez complexe et nous avons souhaité pouvoir balayer tous les aspects nous concernant. L'OPPBTP est un organisme professionnel de branche effectivement placé sous la tutelle du ministère du travail et doté d'un statut complexe sui generis. Sa mission unique est la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles : nous faisons en sorte que le secteur s'approprie un état d'esprit BTP. Nous couvrons donc trois grands domaines d'action : le conseil, la formation et la communication. En matière de conseil, nous proposons aux entreprises une démarche de progrès par le biais de plans d'action. Nous dispensons aussi une formation continue sur l'amiante et nous diffusons de l'information lors de colloques et de campagnes thématiques. Nos 300 personnels, répartis sur l'ensemble du territoire, ont pour spécialité de développer et de diffuser beaucoup d'outils pratiques, logiciels informatiques ou publications. L'essentiel du tissu du secteur des BTP est en effet constitué d'entreprises artisanales qui éprouvent des difficultés à accéder aux textes réglementaires et à les lire. L'amiante constitue l'un des axes principaux de notre formation professionnelle continue. M. Dominique PAYEN : Le risque amiante est l'un des cinquante-huit risques recensés dans le bâtiment et concerne 4,4 % des maladies professionnelles reconnues, toutes activités de la profession confondues. Entre 1994 et 2003, le nombre de cas enregistrés est passé d'une vingtaine à plus de 140. L'amiante est régi par trois textes réglementaires essentiels, portant respectivement sur la santé publique, la santé au travail et l'interdiction de l'amiante. S'agissant du second, le décret 96-98, la première section, relative à la fabrication de l'amiante, est caduque depuis l'interdiction totale du matériau. La deuxième, qui concerne le retrait et la dépose, est particulièrement stricte. La troisième, qui porte sur les travaux de maintenance, intéresse tous les corps de métier. Les salariés du bâtiment sont en effet les plus sujets à des expositions fréquentes, souvent sans le savoir, ce risque élevé appelant par conséquent encore de gros efforts de prévention. Dans l'acte de construire, l'entreprise qui intervient n'est pas seule : le maître d'ouvrage, à l'origine de travaux, ainsi que, le cas échéant, le maître d'œuvre ou l'architecte, ont aussi des obligations : le maître d'ouvrage doit communiquer les diagnostics amiante ; l'entreprise doit respecter le code du travail, mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées et respecter le décret 96-98 sur la santé au travail. Mais les relations commerciales peuvent venir ternir la prise en compte des mesures de prévention. Nos actions de prévention s'orientent vers le conseil de proximité, la formation M. Jean-François BOULAT : Je vous parlerai essentiellement du secteur 3, qui, en tant que médecin du travail du BTP, me préoccupe le plus. Le chef d'entreprise doit obligatoirement s'informer de la présence d'amiante dans les bâtiments auprès de leur propriétaire. En l'absence de diagnostic, plusieurs obligations lui incombent : il doit évaluer lui-même le risque de présence, ce qui lui est assez difficile. Il doit fournir les équipements de protection individuelle appropriés, ce qui est rarement le cas. Il doit aussi établir une fiche d'exposition et la transmettre au médecin du travail, ce qu'il fait exceptionnellement. L'an dernier, 98 % des médecins n'avaient jamais reçu de fiche d'exposition de la part de la moindre entreprise de maintenance. Quelles sont les failles du système ? Premièrement, la présence d'amiante sur les lieux d'intervention est le plus souvent méconnue ou mal localisée : elle est diagnostiquée après coup. Deuxièmement, l'amiante est rarement pris en compte dans la planification des opérations de maintenance. Troisièmement, l'application du décret santé est mal contrôlée pour les opérations lourdes ou de démolition, et pas du tout pour les petites opérations. Il conviendrait donc de mieux contrôler l'application du décret santé, de mieux impliquer les maîtres d'ouvrage, de sensibiliser tous les salariés du BTP au risque amiante, dans le cadre de la formation initiale et continue, et de mobiliser les entreprises et les salariés pour que ceux-ci se protègent en cas de doute. Cela passe par l'utilisation de masques adaptés et d'outils comme les aspirateurs à filtration absolue, qui coûtent assez cher : peut-être faudrait-il prévoir des aides en faveur des petites entreprises pour qu'elles en soient toujours dotées. M. Alain FRAISSE. Je dirige une équipe opérationnelle directement en contact avec les entreprises, qui répond à leurs questions et les aide à bâtir leur plan de retrait. Les diagnostics imposés aux propriétaires immobiliers sont non destructifs, c'est-à-dire qu'ils n'imposent pas la recherche d'amiante dans les endroits cachés. Par contre, dès lors qu'ils enfilent la casquette de maître d'ouvrage et lancent des travaux impliquant plus de deux entreprises, ils sont frappés par le dispositif de coordination, sécurité et protection de la santé de la loi du 31 décembre 1993, et doivent respecter les principes généraux de prévention consistant notamment à évaluer les risques en amont du chantier. À ce stade, les propriétaires immobiliers se révèlent souvent défaillants en ce qui concerne le respect de la réglementation, laquelle suppose d'étendre le diagnostic à des endroits n'ayant pas fait l'objet d'investigations. Cela se traduit par le « silence radio » puis, au pire, par un contrôle de l'inspection du travail : le chantier est alors interrompu pendant environ six mois car la présence de matériaux friables nécessite le recours à une entreprise spécialisée. Le traitement des matériaux friables est bien réglementé : il nécessite l'intervention d'entreprises qualifiées et ne donne pas lieu à trop de dérapages. Le traitement des matériaux non friables est effectué correctement à 50 % et, pour le reste, de façon anarchique, sans plan de retrait ni évacuation des déchets en décharge. Le gros problème porte sur la section 3 du décret, qui fait passer à tort certains travaux comme générateurs de faible risque. C'est la finalité des travaux qui définit l'appartenance à la section 2 ou 3 : en section 2, leur objet est de traiter l'amiante ; en section 3, ils sont susceptibles d'émettre des fibres. Cette distinction ne détermine donc pas une hiérarchie de risques mais une hiérarchie administrative. Or, les opérations de la section 3 peuvent être autant, voire plus, risquées que le traitement d'un matériau friable amianté. Sur le terrain, cela n'est pas bien compris. Si le maître d'ouvrage fait l'impasse sur l'évaluation des risques et l'information des entreprises, celles-ci auront pour préoccupation de réduire leurs coûts et négligeront la prévention. Nous leur recommandons, pour notre part, de soumettre deux offres à leurs clients : la première prévoit une intervention sans présence d'amiante, la seconde incorpore le prix du traitement au cas où des traces de ce matériau seraient trouvées. Mais ils se font alors systématiquement évincer des marchés. M. le Président : Les différents témoignages se recoupent et sont très inquiétants. M. le Rapporteur : La distinction entre matériaux friables et non friables a vraiment constitué l'un des fils rouges de notre matinée d'auditions. Les chantiers de désamiantage relèvent-ils de la Fédération française du bâtiment et des travaux publics ou sont-ils à part ? M. Alain FRAISSE : La FFB étant un syndicat professionnel, il n'est pas obligatoire d'y adhérer. Les employeurs sont aussi représentés par la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), la Fédération des sociétés coopératives du bâtiment et le Syndicat de retrait et de traitement de l'amiante et des autres polluants (SYRTA). Quoi qu'il en soit, parmi les entreprises qui s'intéressent au traitement de l'amiante, 80 % sont classées dans le secteur du BTP et 20 % dans ceux du nettoyage ou des navires. M. le Président : L'OPPBTP est-il lié à ces organisations professionnelles ? M. François LIET : Nous sommes une structure paritaire et certains de nos administrateurs représentent les organisations professionnelles et syndicales. Par ailleurs, nous travaillons en relations étroites avec elles. En somme, nous sommes un outil de la branche. M. le Rapporteur : Les statistiques dont vous nous avez parlé témoignent d'une progression des maladies professionnelles liées à l'amiante. Comment expliquez-vous ce phénomène ? M. Jean-François BOULAT : Cette augmentation, dans le BTP, est due à 80 % au développement des plaques pleurales, affections bénignes - il s'agit de calcifications de la plèvre - mais qui sont signées par l'amiante. C'est donc relativement inquiétant. Le nombre d'affections malignes croît chaque année faiblement, mais nous nous attendons à une explosion des mésothéliomes dans les vingt ans à venir, le temps de latence allant de vingt à quarante ans. Quant au cancer broncho-pulmonaire, sa fréquence est aggravée par l'amiante mais il est difficile de faire la part des choses avec le tabac, les symptômes étant parfaitement identiques. La meilleure connaissance des maladies et des risques d'exposition, qui a conduit à l'interdiction de l'amiante, a fait décoller les statistiques il y a sept ou huit ans. Mais, je le répète, nous craignons surtout une explosion du nombre de mésothéliomes d'ici à vingt ans, due non seulement aux expositions antérieures mais aussi aux expositions actuelles du secteur 3. M. le Président : Seriez-vous en mesure d'effectuer une projection aléatoire à vingt ans ? M. Jean-François BOULAT : Des estimations ont déjà été effectuées par l'Institut de veille sanitaire et dans beaucoup d'articles publiés en Europe et aux États-Unis : le nombre de victimes supplémentaires, d'ici à vingt ans, atteindrait le nombre astronomique de 100 000. Il est néanmoins impossible d'effectuer des projections profession par profession. Je déplore l'insuffisance du plan de surveillance du mésothéliome : seuls dix-sept départements disposent d'un registre du mésothéliome et les résultats nationaux sont extrapolés à partir de leurs statistiques. Ce sujet requiert beaucoup plus de moyens. M. le Président : Il serait intéressant que vous communiquiez votre sentiment au nouveau directeur général de la santé ! M. le Rapporteur : Depuis que le problème a été popularisé, il y a dix ans, on prête davantage attention à l'amiante, alors qu'auparavant, les affections broncho-pulmonaires étaient systématiquement attribuées à l'hérédité ou au tabac. Vous avez parlé de 100 000 morts prévisibles et, dans l'audition précédente, le chiffre de 300 000 a été avancé. Je crois que toute estimation, dans ce domaine, est très aléatoire. Votre organisme est investi d'un rôle d'information et de conseil au profit de tous les corps de métiers du bâtiment. Alors quelles fibres de substitution préconisez-vous, par exemple pour la lutte anti-incendie ? M. Dominique PAYEN : Nous ne sommes pas un organisme de recherche ni d'étude sur les matériaux, mais les instituts de recherche, qui ont travaillé sur ce problème, ont distingué deux grandes familles de produits de substitution. D'une part, les fibres céramiques, classées cancérogènes, sont surtout employées dans les fours industriels, mais aussi un peu dans le bâtiment. D'autre part, dans la catégorie des laines minérales, la laine de roche pourrait poser problème. Cette matière étant irritante, nous conseillons aux entreprises d'utiliser d'autres produits, et, avec toutes les laines minérales, il est essentiel de ventiler les locaux et de porter des masques anti-poussière. Il est pratiquement certain que les laines de verre sont presque inoffensives car elles sont très peu biopersistantes dans l'organisme. Nous ne disposons cependant pas de recul épidémiologique suffisant sur ces produits et, dans vingt ou trente ans, le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, les classera peut-être en catégorie 2a ou en 2b (classification du risque cancérogène), comme l'amiante. En tout cas, il n'existe pas de produit miracle et il nous faut être prudents et vigilants. M. Alain FRAISSE : Ce qui est sûr, c'est qu'aucun produit n'égale les performances techniques de l'amiante. M. le Président : C'est pourquoi il y en avait partout. M. le Rapporteur : Le dossier technique amiante est censé informer les entreprises intervenant sur un chantier. Estimez-vous qu'il est bien établi et qu'il renseigne correctement les entrepreneurs ? M. Alain FRAISSE : Les études étant non destructives, les diagnostiqueurs n'identifient que ce qui est apparent. Ils négligent généralement de gratter les murs et d'effectuer des prélèvements d'enduits, d'autant qu'ils ne sont pas invités à le faire. Le maître d'ouvrage, dès lors qu'il a commandé un diagnostic, a l'impression de répondre à toutes ses obligations. Or, s'il entreprend des travaux, il a aussi pour devoir d'informer les entreprises, et cet aspect reste très parcellaire. M. le Rapporteur : Quel jugement portez-vous sur la qualité moyenne de la certification des entreprises ? Des entreprises non certifiées travaillent-elles encore en contact avec l'amiante ? M. Alain FRAISSE : J'ai représenté notre organisme dans les deux instances qui délivrent des certificats mais je laisserai répondre M. Payen, qui m'y a remplacé. M. Dominique PAYEN : Une qualification n'est requise que pour le retrait d'amiante friable, c'est-à-dire de matériaux susceptibles de larguer des fibres, sous l'effet, par exemple, de vibrations. En 1997, deux organismes certificateurs, Qualibat et AFAQ-ASCERT, se sont positionnés sur ce créneau. Actuellement, environ quatre-vingts entreprises sont certifiées chez Qualibat et vingt chez AFAQ-ASCERT. Ces deux dernières années, nous avons retiré vingt qualifications chez Qualibat et quelques-unes chez AFAQ-ASCERT. Dès qu'une entreprise sort des rails, elle se fait sanctionner : le niveau de qualification des entreprises ayant pignon sur rue me paraît donc correct. Toutefois, la concurrence joue, des entreprises étrangères commencent à entrer sur le marché et les maîtres d'ouvrage exercent une pression commerciale. M. le Président : Nous avons bien compris que la distinction entre matériaux friables et non friables doit être examinée de près. Les entreprises étrangères nouvellement entrantes sur le marché sont-elles concernées par la problématique de la certification ? M. Dominique PAYEN : Elles doivent également passer par la procédure de qualification. M. le Président : Le secteur étant constitué d'une multitude de petits artisans, vous avez recommandé l'usage d'un équipement minimum et préconisé d'aider les entreprises à s'en doter. À combien estimez-vous le coût d'un tel équipement ? M. Alain FRAISSE : Les masques de type FFP3, qui offrent un niveau de protection suffisant, empêchent toutefois de travailler correctement au-delà d'une heure car on y étouffe : chacun sait que les techniciens préfèrent l'ôter pour poursuivre leur tâche. Nous conseillons donc d'utiliser des appareils un peu plus sophistiqués, qui envoient une surpression positive dans les voies respiratoires et assurent une filtration, mais ils sont trop chers : 450 euros pièce environ. Le problème touche aussi les entreprises dont les employés sont exposés occasionnellement. Par ailleurs, les contrôleurs et inspecteurs du travail sont désormais très mobilisés par la problématique amiante mais ont la fâcheuse tendance de se ruer vers les entreprises qui envoient un plan de retrait, plutôt que de s'intéresser à celles qui ne répondent pas à cette obligation réglementaire. M. le Rapporteur : Quel regard portez-vous sur la situation actuelle en matière de traitement des déchets ? M. Alain FRAISSE : Une entreprise intervenant en section 3 qui respecte ses obligations se retrouve avec un masque et une tenue à jeter. Théoriquement, tout cela doit aller en décharge de classe 1. Or, dans le Sud-est, la seule décharge est située dans le Gard. Vous pouvez donc imaginer où finissent les petits sacs contenant de l'amiante. Il semblerait aujourd'hui que les déchetteries acceptent de les collecter mais je ne l'ai pas vérifié. M. Dominique PAYEN : Une circulaire de 2000 prévoyant la promulgation de plans départementaux d'élimination des déchets du BTP, avec un recensement des installations de recyclage et de traitement, devait être appliquée en 2002 mais ne l'est pas encore totalement : à ce jour, ils ne sont entrés en vigueur que dans 70 à 80 % des départements. Un déchet est considéré comme ultime lorsqu'il n'est pas recyclable dans les conditions techniques et économiques du moment : nos déchets d'amiante sont donc ultimes. Il conviendrait que l'État donne davantage de moyens aux initiatives privées débouchant sur la création de déchetteries, d'autant qu'elles sont créatrices d'emplois. M. le Rapporteur : Il n'existe en France qu'un seul centre d'inertage. Qu'en pensez-vous ? Votre organisme préconise-t-il la création d'autres sites ? M. Alain FRAISSE : Le succès de la torche à plasma provient vraisemblablement d'une rumeur infondée selon laquelle le déchet appartiendrait à celui qui l'a généré, c'est-à-dire au propriétaire immobilier qui commande les travaux. Or, juridiquement, le détenteur des déchets est le maître d'ouvrage, puis l'entreprise qui accomplit les travaux, le transporteur, et enfin le propriétaire de la décharge. Il n'est pas nécessaire d'implanter des torches à plasma partout. La création de petites plates-formes de regroupement, en préalable à l'acheminement vers le centre d'inertage ou une décharge classique, résoudrait déjà une grande partie du problème. M. Patrick ROY : Pouvez-vous nous dire clairement où finissent les sacs de déchets qui ne sont pas acheminés en décharge de classe 1 ? M. Alain FRAISSE : Carrément avec les ordures ménagères : ils finissent dans les déchetteries normales. M. le Président : Certains sont enfouis. M. Alain FRAISSE : L'amiante-ciment peut même servir au remblaiement des chemins ! M. Patrick ROY : Les déchets d'amiante ne sont donc pas pris en compte comme ils devraient l'être. M. Alain FRAISSE : Si la totalité de l'amiante extrait finissait en décharges de classe 1, celles-ci annonceraient des quantités beaucoup plus élevées. L'amiante-ciment, à lui seul, représente des volumes énormes. Je note au passage qu'une plaque d'amiante-ciment n'est acceptée en décharge qu'une fois palettisée et filmée : elle ressemble alors terriblement à une palette neuve et, laissée négligemment devant le chantier, elle n'y reste pas trois jours... M. le Président : Nous avons compris ... Messieurs, je vous remercie beaucoup. Cette matinée d'auditions nous a beaucoup éclairés. Audition conjointe de M. Serge MARTIN, pharmacien en chef, chef du Laboratoire d'analyse et de surveillance des particules inhalées de la marine (LASEM), et du contre-amiral Jean-Luc ALBERT, chargé des affaires nucléaires et de la protection de l'environnement Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui M. Serge Martin et le contre-amiral Jean-Luc Albert pour qu'ils nous parlent du problème du traitement de l'amiante résiduel dans la marine. Je précise que le LASEM est un laboratoire militaire, dépendant de l'état-major de la marine, situé à Toulon et agréé par le ministère de la santé pour procéder à tous types de mesures d'empoussièrement amiante et accrédité pour l'identification des matériaux amiantés. Vous comprendrez, Messieurs, que le Rapporteur, qui est député de Cherbourg, et moi-même, qui suis député de Dunkerque, soyons tout particulièrement intéressés par cette audition. M. Jean-Luc ALBERT : Je souhaite tout d'abord vous donner quelques indications générales sur la politique suivie par la marine nationale en matière d'amiante, avant que M. Martin ne vous présente l'activité d'un de nos LASEM - laboratoires d'analyses de surveillance et l'expertise de la marine -, puisque nous en comptons trois, installés à Brest, à Cherbourg et à Toulon. Il n'existe pas de règles dérogatoires spécifiques au ministère de la défense. L'objectif est de garantir durablement aux personnes qui résident ou travaillent dans les bâtiments du ministère contenant de l'amiante, un niveau de sécurité optimal. Il convient toutefois de distinguer les immeubles bâtis des navires car la réglementation ne s'y applique pas de la même façon. Pour les immeubles bâtis, la marine est soumise à la réglementation générale, traduite par une instruction du secrétariat général à l'administration. Le chef d'état-major s'est fixé comme objectif de faire enlever, dès que possible, tout l'amiante friable. Les navires ne sont pas plus couverts par la réglementation que par le code du travail. La marine a toutefois décidé d'appliquer les dispositions du régime général. Cela est d'une importance particulière car, historiquement, les navires contiennent une quantité importante d'amiante. Toutefois, l'éradication totale est extrêmement difficile car elle peut entraîner de tels travaux destructifs qu'ils empêcheraient ensuite le bateau de remplir les fonctions pour lesquelles il a été construit. C'est cette difficulté qu'on rencontre dans le désamiantage du Clemenceau. M. Serge MARTIN : Implantés à Brest, Cherbourg et Toulon, les LASEM ont été créés en 1997, par la lettre n° 122 de l'état-major de la marine, par la fusion de deux entités techniques, le laboratoire de chimie analytique, qui existait depuis 1850 environ, et le laboratoire de surveillance radiologique, qui trouvait son origine dans les essais nucléaires de Mururoa. Leurs missions sont définies par une instruction de l'état-major de la marine de 1998. Il s'agit en premier lieu d'apporter tout concours scientifique et technique aux autorités maritimes, aux formations de la marine basées en région maritime Méditerranée, aux autres armes et aux institutions étatiques. Les LASEM sont ainsi les laboratoires experts chargés des problèmes de pollution marine auprès des tribunaux de grande instance. Il s'agit en second lieu d'assurer le soutien des forces hors de leur base et hors du territoire national. Le LASEM de Toulon est doté de 25 personnes : pharmaciens, ingénieurs, techniciens. L'amiante n'est qu'une des activités des LASEM. Nous avons aussi en commun l'étude des eaux destinées à la consommation humaine ; certaines analyses industrielles, en particulier les contrôles d'alliages ; les analyses environnementales, notamment la surveillance chimique et radio écologique des installations classées pour la protection de l'environnement. Dans le cadre de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, la spécialité de Toulon est l'étude des contaminants atmosphériques, qu'il s'agisse des gaz ou de l'amiante. Cette activité est donc antérieure à l'instruction 102, puisque nous sommes dotés d'un microscope électronique à transmission depuis la fin des années 70. Mon prédécesseur a été un précurseur de la standardisation de l'étude amiante. L'accréditation COFRAC2 du LASEM de Toulon est une obligation si la marine veut respecter le décret 96-98 en ce qui concerne la surveillance de l'environnement et des populations. Le référentiel est donc la norme internationale NF EN ISO/CEI 17 025. En dehors du Programme 144 Amiante concernant la recherche d'amiante dans les matériaux et dans l'air, nous sommes aussi accrédités dans le cadre de la surveillance radiologique du Programme 135 Les personnels de l'unité technique Amiante, qui est une des sept unités du LASEM, sont placés directement sous l'autorité du chef du LASEM. Cette unité se compose d'un pharmacien, d'un ingénieur qualiticien, de deux techniciens préleveurs d'atmosphère, qui vont poser les pompes dans les locaux pour piéger les fibres, et de deux techniciens spécialisés en microscopie électronique et dotés d'au moins six ans d'expérience. Nous mettons en oeuvre les techniques normalisées : identification par microscopie optique à lumière polarisée et microscopie électronique à balayage ; comptage par microscopie électronique à transmission. La base de données informatique ne permet de faire apparaître l'activité que pour les cinq dernières années. On constate que l'instruction 102 de 2001 a entraîné une forte augmentation des demandes d'identification de matériaux et que le comptage de fibres est en légère diminution, puisqu'on est environ à 170 contrôles d'atmosphère par an. M. le Rapporteur : Par rapport aux deux autres laboratoires, je note que l'activité de celui de Toulon est centrée sur l'amiante. J'observe par ailleurs que vous travaillez pour la marine et non pas pour la Direction des chantiers navals (DCN), qui est devenue, depuis son changement de statut, une société anonyme. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets des comptages qui ont lieu à terre et dans les bâtiments ? M. Serge MARTIN : En 2004, 95 % de notre activité a été consacrée à la marine nationale, moitié pour les bâtiments à terre et moitié pour les navires. Les 5 % restants correspondent à des analyses effectuées pour l'armée de l'air, en ex-Yougoslavie pour la KFOR3, ainsi que dans le nord de l'Afghanistan et au Kurdistan. A la suite du changement de statut, nous effectuons quelques analyses pour la DCN. Nous avons ainsi repris, pour les locaux bâtis, la convention qui a été signée il y a environ deux mois. Mais nous n'avons pas d'activité pour la partie réparation navale, pour laquelle la DCN fait appel à un sous-traitant spécifique. M. le Président : Votre compétence est connue et reconnue. Or, il s'agit précisément d'un sujet sur lequel il y a un problème de compétences. N'est-il pas dommage que la vôtre ne soit pas utilisée, par exemple pour la DCN, y compris en la mettant, sous des formes juridiques qui restent à préciser, à la disposition de laboratoires privés ? M. Serge MARTIN : Cette idée ne rencontre pas d'autre obstacle que celui de la réglementation : le LASEM agit dans le cadre de la santé publique (décret 96-97) ; les activités industrielles de la DCN relèvent du Code du travail (décret 96-98). De ce fait, les techniques de prélèvements et d'analyses destinées au comptage des fibres totales diffèrent. En effet, dans le comptage de fibres en phase industrielle, on ne compte pas les seules fibres d'amiante mais la totalité des fibres et la valeur de référence est également différente, puisqu'elle est ici de 100 fibres par mètre cube. Les analyses confiées en sous-traitance par DCN à un autre laboratoire sont donc celles que nous n'effectuons pas. J'ajoute que, dans les missions qui lui sont confiées par l'état-major, la marine ne fait pas de travaux amiante, sauf dans le cas de travaux très localisés et très peu fréquents. Nous ne procédons donc ni au désamiantage ni à la phase industrielle et nous n'avons pas de microscope à contraste de phase. Qui plus est, ces analyses ayant été abandonnées dans les années 1996-1998, à la demande de la DCN, aujourd'hui la question de la formation des personnels se pose. M. le Rapporteur : La situation juridique n'est pas simple, puisque les anciens arsenaux ont vu leur domaine coupé en deux. Ainsi, à Cherbourg, alors que les locaux ont été communs pendant des décennies, le nord de la zone est désormais sous la responsabilité de la marine nationale et le sud sous celle de la DCN. Pouvez-vous nous donner une photographie de l'état de ces locaux dans lesquels, pour la construction comme pour la réparation, on a utilisé de l'amiante ? Les difficultés ne se trouvent-elles pas accrues du fait que les bâtiments à terre relèvent maintenant de juridictions différentes ? M. Serge MARTIN : Pour les immeubles bâtis, la situation est relativement simple : soit la marine, soit la DCN fait appel à un expert en bâtiment, qui procède à un diagnostic amiante et les locaux sont désamiantés. Les choses sont plus compliquées pour les ateliers car la majorité d'entre eux ont été récupérés par la DCN. Dans quel état sont-ils ? La marine nationale est incapable de répondre à cette question. À Toulon, il reste quelques ateliers relevant de la marine, qui sont dans des locaux relativement récents, et pour lesquels les opérations de retrait des dalles de plafond et de déflocage sont achevées. Là aussi, il a été fait appel à des experts extérieurs. M. le Rapporteur : Pouvez-vous nous en dire plus sur leur contribution ? M. Jean-Luc ALBERT : Je souhaite d'abord compléter la réponse à votre question précédente. La marine a engagé depuis un certain nombre d'années le recensement de l'amiante dans ses immeubles bâtis. À ce jour, sur 6 040 bâtiments occupés, 1 840 contiennent de l'amiante, friable pour 420 d'entre eux. Dans ces bâtiments, des actions de contrôle et de surveillance ont naturellement été entreprises. Il est d'ailleurs apparu qu'il était plus simple de faire disparaître l'amiante friable que de le confiner. Sur ces 420 immeubles, 200 sont toujours soumis à contrôle périodique, 60 sont sous surveillance d'empoussièrement, et les travaux sont terminés dans 140 d'entre eux. Ces chiffres montrent l'ampleur des travaux qui restent à faire. Au moment du changement de statut de DCN, la marine a hérité d'environ 1 700 immeubles supplémentaires, qui n'ont pas fait l'objet d'expertises extérieures préalables et dans lesquels on est en train de vérifier si l'état des lieux est bien celui qui a été transmis par la DCN. C'est pour cela que les chiffres que je viens d'indiquer ne sont que provisoires. Mme Martine DAVID : Vous nous avez indiqué que la Marine menait des identifications et faisait procéder au désamiantage. Mais qui décide de ces chantiers ? Quel budget y est consacré chaque année ? Quel regard portez-vous sur les techniques employées et sur les entreprises ? Pouvez-vous aussi nous dire comment ces dernières sont choisies ? Ces questions sont importantes pour nous car nous avons le sentiment, après avoir auditionné un certain nombre de techniciens, que des incertitudes fortes demeurent sur un certain nombre d'entreprises qui procèdent à des chantiers de désamiantage. Si certaines le font avec toute les qualifications et les certifications nécessaires et appliquent la réglementation, il semble que d'autres ne font preuve ni des mêmes compétences ni de la même vigilance. C'est pourquoi j'aimerais savoir comment vous vous assurez que les chantiers sont bien menés. M. Jean-Luc ALBERT : Le service de la Marine qui est chargé de conduire ces opérations est la direction des travaux immobiliers maritimes. Une réorganisation du ministère va d'ailleurs conduire à rassembler l'ensemble des services d'infrastructures de la défense en une seule unité, sous l'autorité du secrétariat général de l'administration. Nous avons des spécialistes en infrastructures terrestres et d'immeubles et c'est à eux que le chef d'état-major de la Marine a confié le soin de passer les marchés et de mener les expertises. Je ne puis donc répondre immédiatement à votre question, que je transmettrai à ce service. Il ne m'est pas davantage possible de vous indiquer le coût annuel du désamiantage, faute de disposer ici des éléments nécessaires, mais cette réponse pourra être intégrée à celles que nous apporterons à votre questionnaire. Pour les bateaux, nous avons un processus analogue : la DCN, principal maître d'œuvre industriel, fait appel à une société de désamiantage et, quand un chantier de désamiantage est ouvert, le contrôle est assuré par le contrôle général des armées, qui joue ainsi le rôle d'inspection du travail au sein de la défense. M. le Rapporteur : Pour le désamiantage d'un navire, votre premier interlocuteur est donc la DCN. Vous ne passez pas directement de marché avec des entreprises de désamiantage ? M. Jean-Luc ALBERT : A ma connaissance, non. Le service de soutien de la flotte (SSF) est notre maître d'ouvrage pour les bateaux et c'est lui qui passe les contrats avec le maître d'œuvre principal qu'est la DCN. Par ailleurs, le SSF passe des contrats avec des organismes extérieurs autres que la DCN pour l'établissement des diagnostics amiante. M. Serge MARTIN : Il arrive quand même que le SSF passe des marchés directement avec une société de désamiantage, pour des bâtiments situés outre-mer et pour certains travaux spécifiques. Ce processus est sans doute appelé à se généraliser pour des travaux ponctuels. Mais dans la plupart des cas, la DCN intervient, puisque les chantiers de désamiantage sont menés à l'occasion de grosses immobilisations pour entretien majeur. M. le Président : On sait que l'amiante a été très utilisé dans les bateaux et que le système de recyclage de l'air a entraîné des contaminations importantes. C'est ce qui m'a été dit pour la marine marchande, y compris pour les bateaux de pêche. On peut comprendre que, comme vous l'avez dit, l'éradication ne soit pas facile, mais qu'en est-il exactement ? Le Clemenceau ne vaut pas vraiment exemple, puisqu'il ne sera plus utilisé à des fins militaires. Quelle est aujourd'hui votre analyse pour les bateaux qui sont encore en service actif ? Quid par ailleurs du traitement des déchets ? Même s'il faut longtemps pour que les conséquences de l'exposition à l'amiante apparaissent, avez-vous connaissance du nombre de symptômes observés sur les personnels embarqués ? J'observe enfin que vous avez parlé d'amiante friable, alors que la distinction entre amiante friable et non friable est de plus en plus contestée. M. Jean-Luc ALBERT : L'éradication n'est pas possible dans tous les recoins des bateaux. Il y a tout l'amiante friable des flocages, des calorifugeages et des faux plafonds, qu'il est plus facile d'enlever et de remplacer par des produits de substitution. Nous procédons à des diagnostics sur l'ensemble de la flotte et 680 bâtiments doivent aujourd'hui bénéficier d'un diagnostic amiante. À ce jour 25 % des unités ont été expertisées par des sociétés agréées. En fait, nous avons eu un peu de mal à définir le processus permettant d'identifier les endroits où l'amiante a été utilisé. Nous avions donc demandé à la DCN, en tant que concepteur et constructeur des bateaux, de nous fournir des indications permettant d'orienter ensuite les expertises extérieures. Ce travail a été assez décevant et on se rend compte qu'on connaît mal les endroits où on a pu mettre des matériaux amiantés. Après cette période de rodage, les choses ont avancé puisque 95 % des expertises ont eu lieu en 2004 et 2005. On devrait donc parvenir assez rapidement à un diagnostic de l'ensemble des bateaux. Bien évidemment, depuis la parution du décret amiante en 1996, on s'est efforcé de limiter l'utilisation d'amiante dans la construction. Ainsi, alors que le Clemenceau, construit dans les années 1960, comptait 220 tonnes d'amiante, on arrive depuis 2002 à des navires garantis sans amiante, tandis que les frégates La Fayette, dont la construction a commencé en 1996, n'en comportent pas plus de cinq kilos. Il y a une autre façon d'éradiquer l'amiante : quand on démonte régulièrement les appareils embarqués pour maintenance, on en profite pour remplacer systématiquement les joints amiantés par des produits de substitution. Le ministère a demandé de supprimer toutes les pièces amiantées à compter du 1er janvier 2004, sauf celles qui mettent en jeu la disponibilité des bateaux et pour lesquelles une dérogation est demandée au contrôle général des armées. Considérant que le processus adopté dans la Marine n'aboutirait pas assez vite, l'état-major de la Marine a ordonné en mars 2005 le retrait des pièces amiantées des stocks de rechanges et de toutes les installations. Ce dernier procède à un contrôle extrêmement strict pour obtenir les résultats les plus rapides possibles. En ce qui concerne le suivi du personnel et les symptômes, qui peuvent en effet apparaître très longtemps après l'exposition, le fait que la marine soit composée à la fois de militaires et de civils pose problème. La direction du personnel civil et militaire de la marine, qui dépend du secrétariat général de l'administration, a délégué au directeur du personnel militaire la gestion des militaires mais a conservé celle des personnels civils, à propos desquels j'éprouve des difficultés à me procurer des informations. S'agissant des marins militaires, nous avons, depuis 2001, institué une attestation d'exposition à l'amiante. À ce jour, 800 attestations ont été délivrées à ceux qui en ont fait la demande et qui ont subi une affection résultant de l'exposition, sous forme, par exemple, de plaques pleurales. À partir du 1er janvier 2005, comme tous les bateaux anciens contiennent de l'amiante, la marine nationale a décidé de fournir l'attestation à l'ensemble des marins qui quittent le service. On va ainsi perdre la relation entre l'embarquement et le nombre de ceux qui déclarent une maladie. M. le Président : Il est dommage de se priver ainsi d'un outil de suivi. M. Jean-Luc ALBERT : On retrouvera sans doute l'information par le biais des demandes d'indemnisation. Il paraît quand même normal que tout ceux qui ont été exposés reçoivent une attestation d'exposition... Nous savons par ailleurs que, depuis 1966, le service des pensions des armées a délivré 462 pensions pour des maladies liées à l'amiante ; 24 dossiers sont actuellement en cours. Ces chiffres sont à rapporter aux 800 attestations, tout en sachant que ces dernières n'existaient pas avant 2001. Mais on voit que le dispositif de recueil des informations est très partiel, et j'ai eu du mal à trouver des réponses satisfaisantes aux questions que vous m'aviez posées. M. le Président : Pouvez-vous nous rappelez les effectifs de la Marine ? M. Jean-Luc ALBERT : Ils se composent d'environ 10 000 civils et 45 000 militaires. On peut aussi obtenir des informations grâce au dispositif de cessation anticipée d'activité qui permet de suivre le nombre de personnes touchées, mais les marins n'y ont pas droit. En ce qui concerne le personnel civil, dont on me dit que 90 % sont des personnels DCN, il y aurait à ce jour un peu moins de 1 000 dossiers. M. le Rapporteur : Les personnels militaires n'ont donc droit ni à la cessation progressive d'activité ni au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) ? M. Jean-Luc ALBERT : Ils n'ont pas droit au FIVA parce qu'ils relèvent du code de pension des armées. D'après mes informations, des négociations sont engagées pour que le service des pensions rembourse au Fonds les sommes déjà versées à des pensionnés de la défense. Les dispositifs sont d'ailleurs comparables et certains dossiers ont été antérieurement traités par le FIVA, mais ce n'est aujourd'hui plus le cas. M. le Rapporteur : Le service des pensions attribue donc une pension calculée sur la base du taux d'invalidité, comme pour les blessés de Karachi, auxquels on a versé une pension calculée sur la base du taux d'invalidité divisé par deux, jusqu'à ce que l'employeur soit condamné pour faute inexcusable et que les blessés perçoivent l'intégralité de la pension. Rien n'est prévu, en revanche, pour remplacer la cessation progressive d'activité ? M. Jean-Luc ALBERT : Les personnels militaires n'ont pas accès à ce dispositif. M. le Président : À la différence du personnel civil de la DCN. M. Jean-Luc ALBERT : Il y a 10 000 civils dans la Marine, qui sont traités par le service de pension des armées, comme les civils de la DCN. Dès lors, les chiffres que j'ai pu obtenir concernent l'ensemble des civils : marine, DCN, armée de l'air, gendarmerie, armement, etc. Cela étant, il semble que les civils atteints se trouvent à 90 % parmi ceux qui ont travaillé à la DCN. Mais il conviendrait que vous vous adressiez à la direction des personnels civils et militaires de la défense pour obtenir des renseignements plus précis. Pour ma part, tout ce que je sais figure dans la fiche qui vous a été remise. M. le Rapporteur : Pour en revenir au LASEM, est-ce lui qui fait le diagnostic ? M. Serge MARTIN : Absolument pas, ou de façon involontaire, quand, à l'occasion de la pose d'une pompe sur un bateau, nous repérons une dalle suspecte. Mais notre accréditation COFRAC ne nous le permet pas. Notre tâche est de procéder à l'identification. C'est parce qu'un expert l'a recommandé ou au vu des plans d'un bâtiment que l'on nous adresse des prélèvements et que nous répondons sur l'absence ou la présence d'amiante, de tel ou tel type. Nous intervenons aussi pour la surveillance des populations, non pas pendant le chantier de désamiantage, mais pour la mesure de deuxième libération, c'est-à-dire quand les locaux sont rendus à leurs utilisateurs. Dans les procédures de désamiantage, c'est l'industriel qui est responsable du confinement, de la protection de ces travailleurs et de la protection du chantier vis-à-vis de l'extérieur. C'est donc lui qui va contrôler les fibres totales dont je parlais tout à l'heure, à l'aide de techniques rapides de microscopie optique. Une fois qu'il a fini, sont aussi à sa charge le nettoyage du chantier et l'évacuation des déchets, par une filière d'élimination des produits dangereux, donc vers une décharge ultime. Une fois que tout cela est terminé et que le local est rendu, le LASEM pose des pompes qui tournent pendant 36 heures et procède au comptage pour vérifier qu'on est bien en dessous de cinq fibres par litre et qu'on peut autoriser à nouveau l'accès des marins au local. Le rôle du LASEM est donc la protection du marin et l'aide au dossier technique amiante, ainsi que la préparation des marchés passés par le SSF ou la DCN. Nous sommes donc bien un service de santé, qui n'intervient pas pour la phase industrielle. M. le Rapporteur : Nous avons bien compris ce que vous faites en aval des opérations de désamiantage, mais procédez-vous aussi, en amont, à des analyses de l'air ? M. Serge MARTIN : C'est possible, dans le cadre de la surveillance des locaux. Une fois que l'expert a fait son diagnostic initial, on a des locaux en état 1, 2 ou 3, pour lesquels nous effectuons un suivi périodique annuel. Tant que l'état de vieillissement du local n'impose pas de retirer l'amiante fixé et que la numération reste inférieure à cinq fibres par litre, l'utilisation du local est autorisée non pas par le LASEM, mais par le commandant et par le propriétaire du bâtiment. S'agissant des 25 % de navires qui ont déjà été étudiés et qui correspondent à la grande majorité des gros bâtiments de la marine nationale, sur plus de 3 000 locaux visités, une cinquantaine posent un problème, mais qui reste minime, puisqu'on est en dessous d'une fibre par litre. M. le Président : A-t-on choisi de contrôler ces bateaux parce que ce sont les plus anciens ? M. Serge MARTIN : Le choix a surtout été fait de façon pragmatique, en fonction de leur présence au port base et des périodes de calme opérationnel. En effet, ces opérations prennent beaucoup de temps et il ne faut donc pas que le bâtiment soit susceptible d'appareiller rapidement. Par ailleurs, compte tenu de la taille du laboratoire, nous refusons de recevoir plus de 30 échantillons en même temps, alors que nous avons dû en traiter 800 pour une frégate comme le Duquesne. Dans ce cas, les analyses sont étalées tout au long d'une phase d'entretien majeur qui dure plusieurs mois. Sur ces bases, c'est l'autorité organique de commandement de la force d'action navale qui détermine quel bâtiment doit passer entre les mains des experts. Jusqu'ici nous n'avions fait que nous raccrocher à la demande, désormais il est possible de prévoir ce qui nous sera demandé au deuxième semestre de cette année. M. le Rapporteur : Intervenez-vous aussi sur les sous-marins nucléaires ? M. Jean-Luc ALBERT : Trois sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) ont été mesurés - pas le Vigilant, mais il est tout neuf. Je puis vous dire qu'il y a cinq joints amiantés sur ces SNLE type « Le Triomphant ». M. Serge MARTIN : Les sous-marins d'attaque (SNA) sont également surveillés régulièrement. Seuls quelques joints et une partie du système de purification d'oxygène contiennent de l'amiante. Il s'agit d'amiante fixé et il n'y a donc pas d'exposition s'il n'y a pas d'entretien. Ce n'est pas le LASEM qui effectue ces analyses, mais un laboratoire rattaché à la DGA, qui assure le contrôle de l'atmosphère des sous-marins : gaz, micro toxiques et amiante. Des pompes sont régulièrement embarquées sur les SNA. Exceptionnellement, le LASEM en prête une et c'est ainsi que je sais qu'on est en dessous d'une fibre par litre. M. le Président : Peut-on dire que le commandement est très sensibilisé aux problèmes de l'amiante et des personnels embarqués ? M. Serge MARTIN : Pour avoir eu à traiter depuis deux ans, selon les procédures COFRAC, les « réclamations clients » et, selon le code du travail, les « accidents amiante », je puis attester de la prise de conscience tant des commandants de navires que du commandement de la force d'action navale et du service de soutien de la flotte. Mais il est nécessaire d'expliquer régulièrement une réglementation complexe et, en particulier, de distinguer les phases industrielles et celles de vie à bord. Il y a une période délicate, quand des équipages restreints restent à bord pendant une période d'activité industrielle, avec par exemple la présence de fibres confinées, qui impose de ne pas arracher le colmatage. Nous intervenons alors, à la demande du commandant de bord, pour rassurer l'équipage et nous procédons pour cela à des mesures qui ne sont pas obligatoires. M. Jean-Luc ALBERT : Nous sommes parfois obligés de convaincre certaines personnes qu'elles jouent avec leur propre santé. L'organisation de la santé au travail dans la marine confie au chef d'établissement qui a, au plus près du lieu de travail, la responsabilité de mettre en œuvre la réglementation. En dépit de l'information et de la sensibilisation, certains marins sont surpris en train de travailler sur une pièce en amiante sans leur équipement de protection individuel. Faute de pouvoir être derrière chacun, il est difficile de développer la culture de la santé au travail. Nous essayons d'éliminer le plus possible de cas particuliers, mais le contrôle général des armées a encore récemment identifié, notamment dans les ateliers militaires de la flotte, de vieux marins qui refusent de changer leurs habitudes de travail. C'est pour cela que la seule véritable mesure de protection est l'éradication de l'ensemble des pièces amiantées. M. le Rapporteur : On a dit que les bateaux-portes étaient bourrés d'amiante. M. Jean-Luc ALBERT : En effet, ne serait-ce que parce que la peinture noire spéciale qui recouvre le fond des navires a longtemps contenu de l'amiante. Même si tel n'est plus le cas aujourd'hui, cela montre l'ampleur de la tâche à accomplir. Je précise que sur les 680 bateaux dont j'ai parlé tout à l'heure, un certain nombre sont des chalands sans équipage. M. le Président : La Royale fait-elle profiter la Marchande de son expérience ? M. Jean-Luc ALBERT : Je n'ai pas de réponse. Mais les bateaux de la marine marchande sont soumis à la réglementation, dont j'ai dit qu'elle ne s'imposait pas aux bateaux militaires. M. le Rapporteur : La question du Clemenceau est révélatrice de l'héritage que vous devez gérer. On peut, en particulier, se demander jusqu'où va le contrôle de la marine nationale, qui reste propriétaire de ses bateaux quand ils sont désarmés. M. Jean-Luc ALBERT : La situation juridique est extrêmement complexe. Le Clemenceau a été vendu aux domaines qui en sont désormais propriétaires. Il entre dans la catégorie des bateaux anciens, avec 220 tonnes d'amiante, qui ne flottent plus si on enlève tout l'amiante qui est à bord. J'ajoute qu'il n'existe aucun chantier capable de les accueillir en France et même en Europe. Aujourd'hui, le Clemenceau est toujours à quai. Nous avons utilisé la procédure qui vous a été décrite : après le diagnostic, une entreprise extérieure est intervenue pour le désamianter et il ne reste plus que quelque dizaines de kilos d'amiante à bord. Des experts sont venus effectuer un contrôle et ont conclu qu'il était encore possible d'en retirer un peu, ce qui est fait. Parallèlement, la Marine s'est assurée que le personnel du chantier indien qui a été sélectionné pour détruire la coque a reçu une formation. Des Indiens sont venus en France pour voir comment les chantiers de désamiantage travaillaient. Ils ont été formés aux techniques de désamiantage. Ce chantier a été choisi parce qu'il a une qualification particulière en termes de méthodes de travail. L'État a donc pris un ensemble d'assurances pour faire en sorte que ce bateau puisse être démoli quelque part dans le monde. Il n'est toujours pas parti parce qu'une action en justice a été engagée par des associations écologistes qui contestent l'exportation de la coque. Mais on entre là dans le débat sur la nature du navire de guerre en fin de vie : s'agit-il d'un navire de guerre, d'un navire ou de déchets ? Cette question a été soumise au service juridique du ministère de la défense et au ministère de l'écologie, qui ont conclu, de façon identique, à la possibilité d'exporter la coque. Néanmoins, le tribunal de grande instance de Paris doit d'abord se prononcer sur sa compétence, le 6 juillet, ce qui peut laisser espérer, s'il se déclare compétent, un jugement au fond début septembre.4 M. le Rapporteur : Si je comprends bien, l'amiante a été utilisé dans des compartiments qui permettent aux bateaux de flotter ? M. Jean-Luc ALBERT : Je dirais plus exactement que, pour accéder à l'amiante, il faudrait détruire des structures porteuses. M. le Rapporteur : On a un exemple de désamiantage avec le Redoutable, qui est maintenant un établissement ouvert au public à la Cité de la mer à Cherbourg, et j'ai bien vu que les opérations n'étaient pas faciles. M. le Président : Je vous remercie d'avoir participé à cette intéressante audition. Audition de M. Christian COCHET, de la division santé et bâtiments du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Après avoir entendu les administrations compétentes pour l'encadrement juridique de la gestion de l'amiante résiduel, la mission entend maintenant les acteurs du diagnostic et du désamiantage. Nous recevons donc, dans le cadre d'une série d'auditions sur le thème de la gestion de l'amiante résiduel, M. Christian Cochet, de la division Santé et Bâtiments du Centre scientifique et technique du bâtiment, établissement public à caractère industriel et commercial, auquel sa mission de recherche, de conseil, d'évaluation et d'information donne une approche globale des dossiers du bâtiment. M. Christian COCHET : Comme vous l'avez rappelé, le Centre scientifique et technique du bâtiment est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministère du logement par le biais de la Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (DGUHC). Il assiste les pouvoirs publics pour la réglementation technique et la qualité de la construction. Il a des missions de recherche, de conseil, d'évaluation, de certification et de diffusion du savoir. Il apporte également son concours aux industriels, entrepreneurs, bureaux d'étude, architectes et maîtres d'ouvrage. Le CSTB s'est impliqué dès 1995 dans la prévention des expositions à l'amiante en apportant son concours à son ministère de tutelle pour la définition des éléments techniques nécessaires à l'élaboration de la réglementation sur le repérage de l'amiante dans les bâtiments. Il s'est alors organisé autour d'un projet interne regroupant les services technologiques concernés, tels que le service « feu » et la division chargée des questions de santé. Outre sa contribution à la définition du contenu technique des textes réglementaires, le CSTB a mené depuis lors, seul ou en partenariat, plusieurs actions relatives à l'amiante dans le bâtiment. Il a ainsi organisé en 1995 une mission d'information en Belgique et en Allemagne pour son administration de tutelle, afin de cerner les dispositions sur l'amiante prises dans ces pays et, en 1996, un rendez-vous d'information sur le thème « Amiante : comment réaliser le bon diagnostic ? », destiné aux professionnels. La même année, un rapport sur la gestion des déchets d'amiante en Europe est paru dans les Cahiers du CSTB. En 1998, une liste de matériaux et produits de construction contenant de l'amiante a été établie sur la base des classements et archives disponibles au CSTB, et singulièrement des activités de notre service « réactions au feu ». La même année, un guide de repérage de produits dégradés contenant de l'amiante a été élaboré pour le compte de la DGUHC. Des guides et avis techniques sur les procédés d'encapsulage des flocages fibreux à base d'amiante ont été rédigés entre 1997 et 2003. En 1999, le CSTB a publié un rapport sur les quantités d'amiante dans les flocages et calorifugeages des bâtiments en France, fondé sur une étude de grande qualité réalisée par un groupement de contrôleurs techniques. En 2001, il a publié un guide de rénovation des sols recouverts de dalles et produits associés contenant de l'amiante, ainsi qu'un rapport conjoint avec l'Institut national de veille sanitaire (INVS) consacré aux « Trémolite et cancers respiratoires en Nouvelle-Calédonie ». Par ailleurs, le CSTB a contribué à l'expertise collective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) réalisée en 1996 sur les effets sur la santé des principaux types d'exposition à l'amiante. II participe, depuis l'an 2000, à la normalisation des méthodes de diagnostic de la présence d'amiante dans les bâtiments - je préside moi-même la commission « diagnostic amiante » de l'AFNOR. La norme « princeps » a été publiée en novembre 2002 et la norme « examen visuel » ce mois-ci. Une norme sur l'échantillonnage et une autre sur la cartographie sont en cours d'élaboration. Le CSTB réalise actuellement à la demande du ministère de la santé, qui la finance, et en coordination avec son ministère de tutelle, une évaluation de l'application de la règlementation relative à la protection de la population contre l'exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. L'étude est conduite principalement sur la base des données disponibles au sein de l'administration dans le cadre réglementaire. Les éléments pris en compte sont notamment les rapports annuels des opérateurs de repérage, les données du bilan réalisé sur les établissements sanitaires et sociaux et les données en cours de constitution sur les établissements scolaires. L'étude vise à donner des informations sur la proportion de bâtiments contenant de l'amiante, sur la proportion de dossiers technique amiante (DTA) réalisés pour chaque catégorie de bâtiments, sur les types de matériaux contenant de l'amiante existant dans les bâtiments, sur la proportion de travaux réalisés, sur la qualité des opérateurs de repérage et sur le comportement des acteurs du dispositif. Il est prévu que les conclusions de l'étude seront rendues fin 2005. Au-delà de la question de l'amiante, la santé environnementale est désormais au cœur des préoccupations du CSTB et spécifiquement prise en compte par le département du développement durable, qui regroupe les activités du centre relatives à l'environnement, l'énergie et la santé. Ainsi, de nombreuses études et recherches sont conduites, dans le cadre de partenariats nationaux et européens, sur les multiples interfaces entre les questions de santé et les environnements intérieurs : ventilation, climatisation, températures extrêmes, plomb dans l'habitat ancien, qualité de l'eau dans les réseaux intérieurs, composés organiques volatils, formaldéhyde, valeurs guides de l'air intérieur, fibres, légionelles, radon... En application de la loi portant création de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE), le CSTB est le partenaire de l'agence et contribue à ses travaux lorsque les saisines ont des implications pour le bâtiment. Le CSTB accompagne ainsi plusieurs actions prévues dans le cadre du plan national « santé environnement ». Il est, en particulier, l'opérateur de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur installé en 2001 pour dresser l'état des pollutions de l'air intérieur et formuler des recommandations après en avoir identifié les causes. Une campagne nationale est en cours dans les logements, dont les résultats seront connus en 2006. Les écoles et les bureaux feront l'objet des prochaines campagnes. Par ailleurs, le CSTB contribue aux travaux visant à promouvoir, par la création d'un étiquetage informatif, l'utilisation de produits et de matériaux ayant de faibles niveaux d'émissions de polluants, en visant, dans un premier temps, les composés organiques volatils et le formaldéhyde. Ces travaux sont étroitement liés à ceux de l'AFSSE. Enfin, le CSTB a créé en 2003 le Comité environnement santé de l'avis technique pour faciliter la prise en compte des préoccupations de santé et d'environnement dans l'évaluation des produits de construction innovants, et il participe activement à la normalisation dans ce domaine. M. le Président : Je vous remercie. Rapports, recherche, vulgarisation, conseil : le très large éventail de vos activités vous permet de porter un regard éclairé sur les professionnels du diagnostic de l'amiante. Quel est-il ? M. Christian COCHET : On entend dire que la qualité du diagnostic et celle des travaux ne sont peut-être pas à la hauteur de ce que prévoit la réglementation. La très importante étude en cours permettra, pour la première fois, d'analyser objectivement les données puisqu'elle est fondée sur la recension des rapports établis par les opérateurs de repérage transmis en 2003 à l'administration, conformément à la réglementation. Nous échantillonnerons ces rapports et tenterons d'extrapoler les indications qu'ils fournissent pour établir si la réglementation est respectée. Nous venons d'achever un travail équivalent à propos du repérage du plomb dans les habitations, qui montre un écart, parfois important, avec les exigences réglementaires. Nous verrons si ce que nous avons mis en évidence pour le repérage du plomb vaut pour le repérage de l'amiante. Nous nous sommes engagés à rendre nos conclusions à la fin de l'année et nous avons déjà collecté l'essentiel des données, que nous sommes en train de vérifier et d'analyser. M. le Président : Il va sans dire que nous vous prierons de revenir nous présenter cette étude, qui est d'une importance particulière pour nos travaux. Y a-t-il une nuance sémantique entre « repérage » et « diagnostic » ? M. Christian COCHET : Aucune. Le terme officiel est « repérage de l'amiante », mais « diagnostic » a le même sens. M. le Président : Quels sont les moyens du CSTB ? M. Christian COCHET : Établissement public industriel et commercial, le CSTB a des financements divers. Un quart de ses ressources lui vient du budget civil de la recherche pour mener à bien un programme pluriannuel. Le reste provient des contrats que nous passons soit avec notre ministère de tutelle pour des études ciblées, soit avec d'autres ministères, ou encore des prestations effectuées pour des industriels ou pour l'Union européenne. L'effectif du CSTB est d'un peu plus de 700 personnes. La division de la santé dont je suis responsable, elle-même intégrée à une unité de cent personnes, compte 25 employés. M. le Président : Considérez-vous vos moyens comme suffisants ? M. Christian COCHET : Un responsable d'unité ne vous répondra pas que ses moyens sont suffisants... Le fait est que le champ des questions dont nous traitons s'élargit sans cesse : amiante, plomb, maintenant radon... La question de la qualité de l'air intérieur prend une importance croissante, et nous sommes contraints de cibler les sujets sur lesquels nous nous investirons plus particulièrement. Notre activité de veille nous donne une capacité de réactivité pour l'ensemble du champ dont nous traitons, mais nous avons approfondi plus particulièrement la question des composés organiques volatils, qui sera l'un des grands dossiers du futur, et celle de la contamination par les légionelles. Donc, oui, il existe une marge d'augmentation de nos moyens et de nos personnels. La santé environnementale a beau disposer d'une dotation « recherche » plus élevée que la moyenne des unités du CSTB, puisqu'elle représente 40 % de ses ressources, cela ne nous dispense pas de trouver d'autres ressources ailleurs. M. le Président : Pourriez-vous préciser l'objet de l'étude en cours ? M. Christian COCHET : L'étude prévue pour s'achever fin 2005 tend à donner des informations globales sur la présence ou l'absence d'amiante par catégories de bâtiments, qu'il s'agisse de constructions privées ou de constructions publiques, de l'Etat ou des collectivités territoriales, à partir des données fournies réglementairement à l'administration par les opérateurs de repérage. M. le Président : C'est un champ d'investigation considérable. Ce sera donc la première analyse scientifique exhaustive permettant de définir l'ampleur du problème ? M. Christian COCHET : Oui. Il y a cependant un problème : nous traitons de données déjà agrégées car les rapports annuels sont globalisés. On y relève le nombre de bâtiments où l'on a trouvé de l'amiante et sous quelle forme et, dans ce nombre, celui de bâtiments de catégorie N1, N2 ou N3. On y indique aussi si l'amiante repéré était dégradé ou non dégradé. Pour les maisons individuelles, les rapports traduisent les données relevées lors des mutations. Mme Martine DAVID : Compte tenu des précisions que vous venez d'apporter, on ne peut pas considérer que l'étude sera exhaustive, mais elle aura le mérite d'offrir un panorama jusqu'à présent inexistant. Au nombre des indications collectées, trouvera-t-on le nombre de personnes exposées, soit qu'elles vivent dans des immeubles amiantés, soit qu'elles y travaillent ou y exercent une activité, ou bien ce recensement devra-t-il faire l'objet d'une autre enquête ? Il est bon de savoir à quoi s'en tenir à propos des immeubles, mais ce sont bien les individus qui sont au cœur de nos préoccupations. M. Christian COCHET : Les données disponibles ne nous permettront pas de mesurer directement l'exposition de la population. A titre d'exemple, si l'on étudie la catégorie des établissements sanitaires et sociaux, on ne saura pas si, dans tel bâtiment où la présence d'amiante a été repérée, il y a seulement quelques personnes ou quelques centaines de personnes. Pour l'habitat privatif collectif et les maisons individuelles, l'étude donnera quelques pistes pour une estimation grossière - mais même celle-là n'existe pas à ce jour -, mais pas d'idée sur l'exposition potentielle des travailleurs amenés à intervenir dans ces bâtiments. L'une des limites des données qui nous sont transmises est qu'elles ne disent pas la quantité d'amiante contenue dans les bâtiments où il en a été repéré. Dans le cadre d'une étude engagée par l'Éducation nationale pour reconstituer l'exposition à l'amiante de ses salariés, le ministère de la santé nous a confié un travail de ce type, que nous menons en collaboration avec le ministère de l'éducation nationale. Pour ce faire, nous mettons au point un dispositif électronique de collecte des informations par l'Internet, qui nous donnera des renseignements beaucoup plus précis sur les bâtiments concernés, les quantités et les formes d'amiante présentes dans les établissements. M. le Président : Qui, au ministère de l'éducation nationale, est votre correspondant ? M. Christian COCHET : L'Éducation nationale n'ayant plus la charge des bâtiments, nous sommes en relation avec la sous-direction chargée des personnels. M. le Rapporteur : Qui sont exactement les opérateurs de repérage ? Pouvez-vous être certains de leur fiabilité ? M. Christian COCHET : À votre seconde question, la réponse est non. Les opérateurs de repérage sont définis par les textes comme des contrôleurs techniques ou des techniciens de la construction titulaires d'une attestation de compétence qui leur est délivrée sur la base d'une formation. Mais je ne sais pas s'ils travaillent correctement. Mme Martine DAVID : Comment vont être exploitées les très nombreuses données que vous aurez ainsi collectées ? Qui va s'en saisir ? Vos conclusions seront-elles rendues publiques ? D'autres ministères en auront-ils connaissance ? M. Christian COCHET : Pour l'étude générale, notre client est le ministère de la santé, auquel nous remettrons le rapport. L'étude conjointe portant sur l'exposition à l'amiante de ses personnels sera bien entendu remise également au ministère de l'éducation nationale. Il reviendra ensuite aux ministères concernés de décider ce qu'ils comptent en faire. M. le Président : Notre mission sera donc la première informée... Mme Martine DAVID : On imagine que les ministères donneront suite à vos rapports pour ce qui les concerne, mais quelle suite sera donnée à la partie de l'analyse relative aux résidences privées et locatives ? M. Christian COCHET : Le ministère du logement, notre tutelle, sera également destinataire de l'étude, dont il est partie prenante. M. le Président : Le problème se posera aussi pour les collectivités territoriales, puisque l'Education nationale n'est plus propriétaire des établissements. M. Christian COCHET : C'est exact, mais les données à ce sujet ne sont pas encore rassemblées. Mme Martine DAVID : L'étude porte-t-elle aussi sur les écoles élémentaires et maternelles ? M. Christian COCHET : Les diagnostiqueurs ont réalisé des repérages dans tous les bâtiments, puisque tous sont visés par la réglementation, y compris les écoles et les crèches. Le repérage a commencé en 1996 pour le flocage, le calorifugeage et les faux plafonds. En 2001, avec la création du diagnostic technique amiante, d'autres produits ont été ajoutés à cette liste. M. le Président : Selon vous, quelle est la fiabilité du repérage ? M. Christian COCHET : Même si nous nous attachons à les affiner, les outils actuels permettent des repérages corrects. Cela dit, nul ne sait précisément comment les choses se passent sur le terrain, puisqu'il existe plusieurs milliers de diagnostiqueurs en France. M. le Président : En tout cas, l'étude de grande ampleur dans laquelle vous vous êtes engagés aura une validité statistique et scientifique raisonnable, étant donné le volume considérable des données analysées. M. Christian COCHET : Nous ferons au mieux avec les données qui nous sont fournies et qui portent sur les diagnostics établis en 2003. La collecte des données ultérieures continuera. M. le Rapporteur : Le rôle de conseil du CSTB le conduit-il à faire des préconisations de retrait ou de confinement ? M. Christian COCHET : Non. Au démarrage de la gestion de l'amiante, en 1996-1997, le CSTB avait créé des outils méthodologiques permettant d'évaluer l'encapsulage de l'amiante. Mais les obligations réglementaires de protection et de confinement du site étant pratiquement les mêmes que l'on retire ou que l'on encapsule, très peu d'encapsulages ont eu lieu. Le CSTB a délivré quatre avis techniques sur des encapsulages, dont trois n'ont jamais donné lieu à aucun chantier. Un seul industriel a dû réaliser quelques encapsulages. Ce fut notre seule intervention sur le volet « travaux » car très peu nombreux sont les propriétaires et les maîtres d'ouvrage qui choisissent de traiter ainsi l'amiante de flocage. Pour les interventions techniques sur les revêtements de sol, nous avons élaboré un guide général, en collaboration avec l'INRS et l'office de prévention du BTP, qui traite, entre autres matériaux, de l'amiante en dalles. Je pense qu'en ce domaine l'encapsulage existe, mais je ne dispose d'aucune statistique à ce sujet. M. le Rapporteur : Quelle est votre opinion personnelle sur les avantages comparés du confinement et du retrait ? M. Christian COCHET : Si vous m'aviez interrogé en 1996, je vous aurais répondu que, pour une question de coût et pour protéger plus vite la population, il fallait privilégier le confinement. Mais cette option a très vite été balayée par les maîtres d'ouvrage et les propriétaires qui, pour des coûts peu différents, ont préféré le retrait. M. le Rapporteur : Qu'en est-il du traitement des déchets ? M. Christian COCHET : Il n'y a pas eu d'autre étude que celle, de portée très générale, réalisée en 1996 sur la gestion des déchets de l'amiante en Europe. Je n'ai pas d'avis argumenté. M. le Président : Considérez-vous qu'il s'agit d'un problème d'importance croissante ? M. Christian COCHET : En tant que citoyen, je pense que pour les déchets d'amiante friable, tel celui qui est utilisé dans le flocage, il existe des filières technologiques adéquates. Je serai moins affirmatif pour les autres matériaux contenants de l'amiante, notamment l'amiante-ciment. M. le Rapporteur : S'agissant des fibres ou des autres techniques de substitution à l'amiante dans le cadre de la prévention incendie, apportez-vous une expertise ? Proposez-vous des solutions ? Exprimez-vous des mises en garde ? M. Christian COCHET : Le CSTB participe à l'élaboration de la codification technique de la protection incendie, et je n'ai pas le sentiment que l'interdiction de l'usage de l'amiante ait posé des problèmes insurmontables, car d'autres matériaux d'enrobage des structures étaient disponibles. Par ailleurs, les techniques du bâtiment ont évolué depuis que, dans les années 70, l'utilisation de structures métalliques portantes a entraîné le recours massif à l'amiante. Ou l'on prend d'autres dispositions en matière architecturale, ou l'on projette de la vermiculite, ou l'on utilise, comme à Jussieu, des peintures intumescentes. S'agissant des autres usages de l'amiante, pour ses propriétés de résistance mécanique par exemple, les industriels ont, ou avaient, déjà mis au point d'autres dispositifs performants. La question est souvent posée de la toxicité éventuelle des fibres minérales artificielles, telles que les laines de verre ou les laines de roche ; or, si elles sont abondamment utilisées en isolation thermique, elles ne le sont pas comme produits substitutifs de l'amiante. Restent les fibres céramiques réfractaires et certaines fibres de verre spéciales, dossier dont l'AFSSE est saisie et le CSTB participe aux études en cours. Il faudra traiter cette question avec un intérêt particulier s'il apparaît que ces matériaux sont utilisés de manière significative dans le bâtiment, mais il ressort des premières analyses que ce n'est pas le cas et que l'usage en est plutôt réservé aux fours industriels et à d'autres applications très particulières. M. le Rapporteur : Certaines des personnes que nous avons entendues ont pourtant évoqué la nocivité des laines de roche pour la santé de la population, les distinguant des laines de verre. M. Christian COCHET : Nous ne disposons pas d'informations dissociées sur les laines de verre et les laines de roche mais, je le répète, l'AFSSE est saisie de cette question. Une précédente étude conduite par l'INSERM ne montrait pas de différence fondamentale entre ces deux matériaux, ni d'évidence épidémiologique forte. M. le Président : Je vous remercie. Nous attendons, bien sûr, les réponses que vous voudrez bien faire au questionnaire que nous vous avons adressé et nous vous entendrons avec grand intérêt nous présenter votre étude dès qu'elle sera achevée. Audition de Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND, chef du Laboratoire d'étude des particules inhalées (LEPI) de la ville de Paris, accompagnée de M. Laurent MARTINON, son adjoint Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Nous recevons Mme Marie-Annick Billon-Galland, chef du Laboratoire d'étude des particules inhalées (LEPI) de la ville de Paris, et M. Laurent Martinon, son adjoint, qui nous expliqueront le rôle de ce laboratoire dans la gestion de l'amiante résiduel. Le LEPI est un laboratoire agréé par arrêté du ministre de la santé pour procéder à tous types de mesures de l'empoussièrement de l'air. Je rappelle que c'est en se fondant sur une étude sur la présence d'amiante dans l'air de Paris réalisée par le LEPI en 1974 que le seuil d'empoussièrement rendant obligatoire la réalisation de travaux a été fixé, en référence à la contamination de l'air extérieur, à 5 fibres par litre. Le rôle du laboratoire a donc été déterminant. Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : J'appartiens depuis 1974 au Laboratoire d'étude des particules inhalées, que je dirige à présent. Le laboratoire dépend de la Direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé de la mairie de Paris. Son budget est départemental. C'est un petit laboratoire dont l'effectif est de 20 personnes : trois médecins vacataires hospitalo-universitaires, dont deux professeurs de médecine du travail - un pneumologue et un toxicologue, qui sont responsables scientifiques - et une biologiste anatomo-pathologiste, ainsi que quatorze techniciens et trois secrétaires. Nous avons pour matériel d'analyse des outils d'analyses ponctuelles, des microscopes optiques et un microscope électronique. Le LEPI, créé en 1965, s'est immédiatement penché sur les pathologies professionnelles respiratoires - silicoses et asbestoses - et a mis au point des méthodes analytiques d'identification par microscopie optique de traceurs de l'exposition à l'amiante dans les tissus pulmonaires. C'est le seul laboratoire qui travaille sur les effets sur la santé de l'exposition professionnelle et environnementale à l'amiante. Il a réalisé une étude à ce sujet en 1970 - car on connaît, depuis 1935, le lien entre l'exposition à l'amiante et les cancers broncho-pulmonaires et, dans les années 60, on savait déjà que l'exposition pouvait provoquer mésothéliomes et plaques pleurales. En 1974/75, le LEPI, ayant fait l'acquisition d'un microscope électronique à transmission analytique, met au point des méthodes de prélèvements d'air et d'analyse des fibres d'amiante, méthodes que nous continuons d'utiliser pour les prélèvements réglementaires. Les mesures, qui se faisaient à l'époque en nanogrammes par mètre cube, sont à présent exprimées en fibres par litre. En 1974, sur commande du ministère de l'environnement, le LEPI a conduit une étude de la pollution générale par l'amiante de l'air de Paris qui a permis d'établir une valeur maximale de référence de 9 ng5/m3. En 1974 et 1978, le LEPI a réalisé des prélèvements d'air à Jussieu dans le cadre d'une étude portant sur les mécanismes d'établissement de la pollution à partir des matériaux contenant de l'amiante. Outre qu'elle a mis en évidence la mobilisation des fibres par l'activité dans un local donné, l'étude a révélé une pollution de 700 ng/m3, cent fois supérieure à la valeur de référence pour l'amiante chrysotile, qui s'établissait à l'époque à 7ng/m3 dans l'air extérieur. En 1979, le laboratoire a mis au point des méthodes d'analyse, par microscopie électronique à transmission analytique, des fibres d'amiante dans les échantillons biologiques pulmonaires. Ainsi peut-on mettre en évidence, plus de trente ans après l'exposition, les traceurs d'exposition à l'amiante que sont les corps asbestosiques, par microscopie optique et les fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission analytique. Ces analyses nous sont demandées dans les dossiers de demande de compensation de maladie professionnelle, particulièrement en cas de cancers broncho-pulmonaires, qui peuvent être dus à l'exposition à l'amiante ou à d'autres causes. Elles permettent de mettre en évidence les marqueurs de la rétention des particules d'amiante. Pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et pour les commissions régionales de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qui nous demandent de telles analyses lorsqu'ils ne parviennent pas à reconstituer l'histoire professionnelle d'un malade, un résultat positif est très significatif d'une exposition. M. le Rapporteur : Vous avez donc mis au point une méthode de traçage prouvant l'inhalation de fibres d'amiante. Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : À partir de prélèvements biologiques de trois sources - parenchyme pulmonaire, liquide de lavage broncho alvéolaire, expectorations - nous avons vérifié, au cours des années 80, la probabilité de la présence de ces traceurs dans la population générale. Il est apparu que dans 90 % des cas, la présence de corps asbestosiques est inférieur à 1 000 par gramme de tissu pulmonaire sec, une valeur supérieure signalant une rétention de fibres qui traduit une exposition professionnelle à l'amiante. Toutefois, l'amiante chrysotile, qui a été de très loin le plus utilisé en France, est moins biopersistant que l'amiante amphibole. En résumé, lorsque le résultat de la recherche est positif, le FIVA et les CRRMP s'en servent pour reconnaître l'exposition à l'amiante, mais un résultat négatif ne signifie pas qu'il n'y a pas eu exposition. Notre analyse est une aide au diagnostic. M. le Président : Outre le FIVA et les CRRMP, qui vous demande ces analyses ? Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : Tous les hôpitaux de France, à chaque fois que la médecine du travail procède à une étude ou qu'il faut monter un dossier, puisque notre laboratoire est le seul qui les pratique. Au début, nous ne les faisions pas payer, puis nous avons obtenu qu'elles soient codifiées à la nomenclature, si bien que nous pouvons désormais facturer les hôpitaux publics. Mais, parce que nous sommes un laboratoire départemental et non un laboratoire d'analyses médicales, nous ne pouvons pas facturer les analyses aux cliniques privées - pour lesquelles nous les réalisons malgré tout, car nous ne refusons jamais une analyse qui peut aider un patient. Mme Martine DAVID : Quel type de budget est le vôtre ? Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : Il a toujours été uniquement départemental. Des pourparlers ont bien eu lieu dans les années 80 avec le ministère de la santé pour que le LEPI lui soit transféré mais ils n'ont pas abouti, et nous sommes demeurés laboratoire de la ville de Paris. M. le Rapporteur : Le LEPI a donc le statut de laboratoire d'analyses départemental, laboratoire tel qu'il en existe dans d'autres départements. Celui de la Manche a réalisé des analyses relatives à l'ESB, gratuitement lui aussi, pour les raisons que vous avez dites. Mais il réalise également des analyses portant sur les radionucléides aux alentours de l'usine Cogema de La Hague, et son objectivité est parfois mise en cause au motif que son budget lui est alloué par le conseil général. Avez-vous fait l'objet de critiques similaires ? Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : Pour ce qui nous concerne, le demandeur n'est pas la ville : ce sont les hôpitaux de toute la France, pour lesquels nous jouons le rôle d'experts. S'agissant des écoles et des crèches de la ville de Paris, nous intervenons pour des expertises en amont ou en aval, en jouant un rôle de conseil qui va au-delà de la réglementation, assez succincte d'ailleurs. De plus, nous sommes un laboratoire accrédité - j'ai d'ailleurs participé à la préparation du programme du Comité français d'accréditation (COFRAC) - si bien que des audits réguliers sont faits par des personnes extérieures au LEPI pour s'assurer que nous sommes impartiaux et que nous ne subissons pas de pressions. Enfin, nos deux responsables scientifiques sont des médecins hospitalo-universitaires qui n'ont rien à voir avec la Ville et qui ont un droit de regard sur nos pratiques. Voilà comment notre indépendance est assurée, et je ne vois pas comment on pourrait faire mieux. M. le Président : Vous êtes donc les seuls à pratiquer des analyses de ce type ? Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : Pour la mise en évidence des traceurs biologiques, oui. M. le Président : Pourquoi les discussions engagées avec le ministère de la santé se sont-elles arrêtées ? Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : Parce qu'il n'y a pas eu de réaction du ministre à l'époque. M. le Rapporteur : Pensez-vous devoir conserver le statut de laboratoire départemental ? Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : Effectivement, nos activités relèveraient davantage du ministère que de la ville de Paris, mais laboratoire départemental nous sommes, et la ville ne nous a jamais empêchés de travailler, si bien que nous avons réalisé de nombreuses études qui fondent la réglementation relative à l'amiante. Cela dit, si la ville considère un jour que nous lui coûtons cher, je ne sais ce qui se passera. Pour l'instant, nous attendons une réponse à la demande que nous avons faite d'un budget spécifique, destiné à acheter un nouveau microscope électronique, d'un coût très élevé, pour remplacer le nôtre, qui date de 1991. M. Laurent MARTINON : J'ajoute que le LEPI est un outil technique et d'expertise très utile à la ville de Paris, dont le parc immobilier est très important. L'existence du laboratoire permet des prélèvements d'air à coût zéro, qui coûteraient très cher s'ils étaient commandés à d'autres. Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : J'en reviens à l'historique des travaux du LEPI. En 1980, nous avons procédé à la mesure de la pollution de l'air dans les bâtiments contenant des flocages en la comparant à un algorithme d'évaluation mis au point par l'Environmental Protection Agency6 (EPA) américaine. Les comparaisons auxquelles nous avons procédé nous ont permis d'établir l'absence de corrélation entre le taux de pollution et le pourcentage d'amiante dans les matériaux ; la pollution varie selon le type de matériau, sa friabilité et sa densité. L'algorithme d'évaluation de l'EPA est beaucoup plus complet que la grille d'évaluation actuellement utilisée en France, qui ne tient compte que de quatre critères. Je sais que M. Christian Cochet du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), que je viens de croiser, a travaillé à l'élaboration de cette grille, qui nous a toujours posé problème. Il arrive en effet que nous soyons appelés à porter une appréciation après qu'un diagnostic a été réalisé en fonction de cette grille, et il peut se trouver que notre appréciation ne soit pas du tout la même que celle du diagnostiqueur, et que là où il porte le score « 2 », nous aurions dit « 3 ». Les critères réglementaires sont trop limités. M. Laurent MARTINON : Voilà qui renvoie à l'une des préoccupations que vous exprimez dans le questionnaire que vous nous avez adressé : aujourd'hui, aucune comparaison n'est faite de l'évaluation de la dégradation des matériaux, sur un même site, par des opérateurs de repérage différents. Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : La manière de remplir la grille d'évaluation tient sur une demi page d'une circulaire ! En particulier, il n'y a ni critère d'activité, ni critère d'occupation du local. Il n'est pourtant pas indifférent de savoir si le local est vide, cas où la pollution par l'amiante importe moins que s'il s'agit d'une école ou d'une faculté ! Il n'y a pas davantage de critère de surface, et rien non plus sur les personnes qui occupent les locaux. Mais l'on sait que la liste des critères avait, à l'époque, été établie pour pallier les lacunes de la réglementation. M. le Président : Vous considérez donc que cette liste est à revoir ? Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : Oui. Elle devrait être explicitée et étendue à d'autres critères car elle n'est pas satisfaisante en l'état. Je rappelle qu'il ne s'agit pas de mesurer mais de retenir des critères visuels de l'état de dégradation, sans tenir compte, par exemple, de l'existence de chocs et de vibrations. M. Laurent MARTINON : La grille d'évaluation comporte, pour les quatre paramètres retenus, trois niveaux de cotation - faible, moyen, fort -, ce qui est assez rudimentaire. De plus, il entre dans cette appréciation une part de subjectivité manifeste. Or la décision est lourde de conséquences pour le propriétaire, puisque coter « 1 » signifie qu'il n'y a pas de problème et que l'on reviendra dans trois ans, coter « 2 » qu'il faut faire des prélèvements d'air mais que coter « 3 » emporte l'obligation de travaux importants dans les douze mois. La différence de coût selon la cotation retenue est telle que l'on peut se poser la question de l'autocensure que peut s'imposer le diagnostiqueur, même inconsciemment. Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : L'éventualité de l'autocensure ne mettant effectivement pas en cause la bonne foi, c'est le faible nombre de critères qui est en cause. M. le Rapporteur : Vos travaux sont-ils publiés ? Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : Une bonne partie l'a été depuis 1965, et peut être consultée. Vous aurez compris pourquoi nous n'avons jamais cessé d'utiliser l'algorithme de l'EPA pour suivre l'évolution de la dégradation : la grille française ne le permet pas. En 1982, on a constaté la prévalence élevée de plaques pleurales dans le Nord-est de la Corse, zone géologique amiantifère, au sein d'une population qui n'avait jamais été exposée professionnellement à l'amiante. Le LEPI a entrepris une étude de la pollution de l'air qui a démontré une forte exposition environnementale. Nous avons procédé à une autre étude aux abords de la mine de Canari, dont les déchets se déversaient sur la plage. Là encore, un taux élevé de pollution a été mis en évidence. Le lessivage qui a eu lieu depuis lors a réduit la pollution sur la plage, mais le site de la mine demeure à l'état de friche industrielle. M. le Rapporteur : D'autres pathologies ont-elles été signalées après la publication de vos études ? Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : La littérature fait également état de mésothéliomes. M. le Rapporteur : Quelle quantité de fibres par litre aviez-vous mesurée ? Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : De 15 à 20. Nous continuons de travailler en collaboration avec la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS) de Haute-Corse car, à chaque fois que l'on fait des travaux à Bastia, on libère des fibres. Et l'on continue de mettre en évidence un taux de 20 fibres par litre dans certaines zones, même en l'absence de travaux. M. Laurent MARTINON : Une nouvelle étude épidémiologique aurait été souhaitable en Corse mais elle n'a pu se faire. La DDASS de Haute-Corse a donc décidé une étude métrologique, que nous avons réalisée, mais les capteurs ne captent que quelques jours ou une semaine ; or, la concentration d'amiante est fluctuante, et le fait de ne rien capter cette semaine-là ne signifie pas l'absence d'amiante. Une étude épidémiologique aurait permis de remonter dans le temps. M. le Rapporteur : Êtes-vous en relation avec des laboratoires étrangers ? Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : Nous sommes en relation avec des laboratoires européens, particulièrement avec des équipes belges, anglaises, espagnoles et italiennes et finnoises, avec lesquelles nous comparons nos méthodes. M. le Président : Des réunions européennes ont-elles lieu ? Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : Non, mais dans le cadre de l'European Respiratory Society, un groupe de travail a établi des valeurs de référence pour les échantillons biologiques et nous avons procédé à de nombreux dosages. Une banque de données a été constituée, et les laboratoires qui le souhaitent peuvent acheter ces échantillons qui leur serviront à calibrer leurs analyses. Nous avons rédigé un guide de méthode où nous comparons les résultats obtenus selon les techniques utilisées. M. le Président : Arrive-t-il que le ministère de la santé s'intéresse à vos travaux ? Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : Cela arrive, mais depuis 1974, date à laquelle je suis entrée au LEPI, j'ai vu se succéder beaucoup de personnes au ministère de la santé... Le problème est que la personne chargée du dossier de l'amiante change tous les deux ou trois ans, si bien qu'il n'y a ni mémoire ni suivi des connaissances. M. Laurent MARTINON : On peut prolonger votre question en se demandant si le ministère de la santé s'intéresse au travail de la personne qui, en son sein, s'occupe de l'amiante... Pour en revenir à la pollution de l'air, la collaboration avec les laboratoires européens fait d'autant plus défaut qu'il n'y a harmonisation ni pour les techniques de relevé d'empoussièrement ni pour les seuils limite. Les méthodes sont très disparates : nous utilisons la microscopie électronique à transmission, alors que certains laboratoires utilisent la microscopie optique ou la microscopie électronique à balayage. Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : J'ai travaillé à la mise au point des méthodes de relevé par microscopie électronique à transmission et j'ai pu constater que, dès 1974, les Allemands voulaient continuer d'utiliser le microscope à balayage. Cela aurait été parfaitement injustifié ici, et nous nous sommes battus pour que notre méthode soit utilisée en France. En effet, la granulométrie de l'amiante chrysotile, celui qui a été utilisé dans 90 % des cas dans notre pays, étant très faible, on ne le repère pas si l'on utilise les autres méthodes. A quoi sert d'utiliser des techniques qui ne permettent pas de voir les fibres ? Le seuil limite est de cinq fibres par litre en France et d'une fibre en Allemagne ; fort bien, mais les Allemands ne voient pas les fibres d'amiante chrysotile... Mme Martine DAVID : Je constate, à la lecture du document que vous nous avez remis, que propriétaires privés et chefs d'entreprise peuvent demander au LEPI de procéder à des analyses. Comment connaissent-ils l'existence du laboratoire ? Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : Nous sommes connus dans la profession car nous sommes le laboratoire de référence et je fais partie de la commission AFNOR. Nous sommes d'ailleurs plus connus à l'extérieur qu'au sein de la ville de Paris ! Nous sommes un laboratoire agréé. Lorsqu'un particulier nous demande une analyse, nous lui faisons une offre de prix ; si elle est acceptée, le marché est conclu. Mme Martine DAVID : Quel est le coût de votre intervention ? Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : Nos tarifs sont assez élevés par rapport à ceux du secteur privé. Jusqu'en 1996, il y avait en France quatre laboratoires spécialisés dans le domaine de l'amiante dans l'environnement : le LEPI, le LHCF7, le BRGM8 et l'INERIS9. La réglementation ayant été modifiée cette année-là, une soixantaine d'organismes se sont lancés dans les prélèvements et trente laboratoires privés ont été agréés pour les analyses, ce qui a entraîné la chute des tarifs. Le BRGM et l'INERIS ont alors arrêté cette activité, jugée non rentable, et nous demeurons, avec le LASEM10 pour la marine nationale, les seuls laboratoires publics. Le cas du Laboratoire hygiène et contrôle de fibres est différent, car il est issu de l'industrie. Je n'ai pas voulu modifier nos tarifs, et nos prix restent calculés en fonction du coût de l'intervention, car je me refuse à proposer pour 15 euros une analyse de matériau qui nous en coûte 90. Nous ne sommes donc pas concurrentiels mais, notre équipe étant réduite et nos activités multiples, nous ne pourrions pas répondre à la demande si nous l'étions. Mme Martine DAVID : Ainsi, les propriétaires particuliers payent vos analyses, mais pas les cliniques privées ? Voilà qui est un peu surprenant. Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : C'est un fait... Mais nous assurons une fonction de conseil auprès des particuliers, par exemple en les incitant expressément à saisir la copropriété quand les analyses sont positives dans un local donné. M. le Président : Il serait très utile que vous acceptiez, si votre emploi du temps vous le permet, de participer à la table ronde que nous réunissons demain pour traiter de la certification et du contrôle des entreprises. Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : Je me libérerai. M. le Président : Je vous en remercie. Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : Pour en revenir à la chronologie des études et travaux du LEPI, nous avons établi en 1988 la corrélation entre concentration pondérale et concentration numérique. De ce fait, le seuil limite de 50 ng/m3 retenu à l'époque par le Conseil supérieur d'hygiène publique a dès lors été transcrit sous la forme « 25 fibres par litre ». Par la suite, ce seuil a été abaissé à 5 fibres par litre, valeur maximale de l'air extérieur à Paris. Mais une nouvelle étude conduite en 1994 a montré que cette valeur maximale était descendue à 0,5 fibre par litre. M. le Président : Il nous a été dit que la réduction constatée tiendrait à l'évolution technique des matériels de la RATP. Le pensez-vous ? Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : Non. Il y avait beaucoup d'amiante dans les bâtiments, et on a commencé à l'enlever. Le taux de 5 fibres par litre n'était, lui-même, pas très élevé ; la diminution constatée n'est donc pas significative et ne signale pas une réduction de la pollution. M. le Rapporteur : D'autant qu'une fourchette d'incertitude demeure. Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : Oui, et d'autant plus grande que les valeurs sont basses. Les nouvelles mesures avaient d'ailleurs été faites pour savoir si la pollution avait augmenté, et non si elle avait diminué. Les documents retraçant nos autres activités étant en votre possession, je me limiterai à vous indiquer que depuis 1991, nous participons, au sein de différentes commissions de l'AFNOR, à l'élaboration de normes, relatives, par exemple, à l'examen visuel et aux stratégies d'échantillonnage. Au nombre des problèmes en suspens, je citerai celui de la réalisation d'une étude pilote de l'exposition environnementale autour de deux anciens sites de fabrication d'amiante en déshérence, pour laquelle nous avons été sollicités par l'Institut national de veille sanitaire (INVS) : nous ne parvenons pas à obtenir les autorisations préfectorales d'accès. Par ailleurs, contrairement à ce qui était d'usage au début des travaux de désamiantage, le LEPI n'est plus associé aux chantiers dès qu'ils sont décidés. On nous presse désormais d'intervenir au plus vite une fois les travaux achevés, sans que nous ayons eu connaissance du contexte. Au lieu d'être partie prenante de la chaîne de désamiantage, nous en sommes donc devenus le dernier maillon. La main est prise par les entreprises de désamiantage et les maîtres d'œuvre et les chantiers sont calfeutrés. Pourtant, ce sont nos mesures et la valeur que nous donnerons qui permettront de « libérer » le chantier. Cette évolution est regrettable. M. le Rapporteur : Comme le LASEM, vous préconisez donc une intervention de votre laboratoire en amont et en aval du désamiantage ? Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : Oui. M. Laurent MARTINON : En 2002, nous avons fait une étude pour le ministère de la recherche et constaté sur deux chantiers de désamiantage un grand déficit de métrologie. À ce jour, les seuls contrôles obligatoires sont le contrôle libératoire de fin de chantier en microscopie électronique et, parfois, des mesures dans le sas où les ouvriers enlèvent leurs protections respiratoires, ici en microscopie optique. Mais ces derniers contrôles sont des mesures d'hygiène du travail qui peuvent être réalisées sans qu'il soit besoin d'agrément. Pendant deux ans, nous avons voulu multiplier les mesures avant, pendant et après le chantier - y compris après le contrôle obligatoire de restitution - et nous avons constaté que dans de nombreuses situations des salariés étaient exposés, alors qu'ils pensaient ne pas l'être. Nous avons aussi constaté de nombreuses contaminations environnementales à des endroits où l'on ne pose jamais de capteurs. Tout cela pose un réel problème. Par ailleurs, une étude de l'INRS a montré que la réglementation n'est pas respectée sur les trois quarts des chantiers de désamiantage. Le contrôle de ces chantiers doit être renforcé, notamment sur le plan métrologique. M. le Rapporteur : Le LEPI a-t-il eu à connaître de l'usine Ferodo de fabrication de freins à Condé-sur-Noireau ? Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : Oui. Des membres de l'équipe se sont rendus sur le site en 1967, quand se posait le problème des déchets rejetés à la rivière. Une étude a été publiée à ce sujet, mais le LEPI n'en était pas l'auteur. M. le Rapporteur : Comment avez-vous vécu les vingt années d'« usage contrôlé de l'amiante » ? Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : En 1974, nous avons été, par hasard, amenés à étudier la pollution de la faculté de Jussieu après que des personnes qui y travaillaient nous ont fait parvenir des échantillons de la poussière qu'ils trouvaient sur leur bureau. Après l'interdiction édictée par la France en 1997, le Canada a déclaré que l'amiante chrysotile est moins dangereux que l'amiante amphibole. Les expertises conduites par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ont montré que les deux catégories d'amiante sont cancérigènes, mais aussi que les sources d'amiante chrysotile sont parfois contaminées par la trémolite, une variété d'amiante amphibole. Les Canadiens ont alors expliqué que là était le danger, et il s'en est suivi la polémique que l'on sait. L'usage contrôlé n'est pas possible, puisque même une fois l'amiante interdit, les personnes ne sont pas protégées. Les ouvriers du secteur 3, celui du bâtiment, sont les plus exposés : plombiers et électriciens ne portent pas de masques, et là se trouvent les malades de demain. M. le Président : Et l'on trouve aussi de l'amiante résiduel dans certaines usines métallurgiques et chimiques. Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : C'est exact. Les grandes entreprises font attention mais, pour les petites, c'est autre chose, d'autant qu'il n'y a pas d'obligation de contrôle, et qu'en hygiène du travail il n'est pas besoin d'agrément pour réaliser ce contrôle dans le secteur 3, au contraire de ce qui vaut pour le secteur 1 -- qui n'existe pratiquement plus, puisque c'est le secteur de la fabrication ou du traitement des déchets. Et lorsqu'il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de contrôle. M. le Rapporteur : Quelle est votre position dans la polémique qui porte sur la distinction entre amiante friable et amiante non friable ? Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : D'évidence, certains amiantes dits non friables le deviennent quand on commence à les enlever. Cette distinction n'est donc pas très judicieuse. M. le Président : Cette remarque a été faite plusieurs fois devant nous. Elle montre que la distinction, artificielle, n'est pas tenable. M. Laurent MARTINON : Je tiens à souligner que le contrôle du seuil de 5f/L imposé par la réglementation après travaux d'enlèvement ne vaut que pour l'amiante dit friable, c'est-à-dire pour les flocages, calorifugeages et faux plafonds. Autrement dit, si l'on enlève des dalles amiantées, aucun contrôle obligatoire de la pollution résiduelle n'est prévu en fin de chantier, ce qui est très gênant quand on sait quel empoussièrement cela peut provoquer. M. le Rapporteur : Quelle est votre opinion sur les mérites comparés de l'inertage et de l'enfouissement ? Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : L'inertage est la meilleure solution mais il n'y a qu'une usine en France et le coût de l'opération est très élevé, si bien qu'une préférence générale est donnée à l'enfouissement. Mais si le coût est aussi élevé, c'est que tout y passe, y compris, par exemple, les radiateurs et les tables, ce que rien ne justifie. Un tri devrait être fait, car bien des objets considérés comme déchets amiantés ne le sont pas. L'avantage de l'inertage est aussi que ceux qui choisissent cette solution ne sont plus propriétaires de leurs déchets, contrairement à ce qui vaut en cas d'enfouissement. M. Laurent MARTINON : La société Inertam vitrifie les déchets amiantés par fusion plasma, à prix d'or. En 1997/98, des cimentiers avaient procédé à des expériences d'inertage concluantes dans leurs propres fours, mais ils en sont restés là car la forte demande apparue en 1997/98 est retombée. M. le Rapporteur : Existe-t-il d'autres techniques de neutralisation de l'amiante ? Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : Pas à ma connaissance. M. le Rapporteur : Que se passe-t-il quand l'amiante est en milieu liquide ? Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : Rien. En Corse, les déchets qui étaient sur la plage sont maintenant dans la mer où ils restent, car l'amiante est très résistant. C'est un matériau étrange, aux caractéristiques si particulières qu'on lui a trouvé trois mille usages. M. le Président : Ce qui laisse entendre des dommages prévisibles considérables ? Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : Oui, si l'on observe la courbe des pathologies et des implantations. M. Laurent MARTINON : Il faut rappeler que la France était l'un des plus grands producteurs d'amiante au monde. M. le Rapporteur : Est-ce la seule fibre minérale aussi particulière ? Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : On trouve, en Turquie, des gisements de zéolite, fibre utilisée pour fabriquer des torchis et dont on a constaté qu'elle provoque aussi des mésothéliomes. Mais son usage est très limité. Parmi les fibres naturelles, je ne connais pas d'autres exemples, mais des études portant sur les fibres synthétiques, particulièrement les fibres céramiques, sont en cours au ministère du travail. Elles montrent une incidence de leur utilisation sur l'apparition de plaques pleurales chez les personnes qui y sont exposées, et aussi l'apparition de tumeurs chez l'animal. M. le Président : Je vous remercie pour cet exposé très complet. Table ronde sur le thème « La certification et le contrôle des entreprises intervenant dans la gestion de l'amiante résiduel » · Qualibat représentée par M. André CHAPUIS · AFAQ-AFNOR Certification représentée par Mme Corinne DUCASTELLE de l'Apave Groupe · Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) représenté par M. Christian COCHET · École spéciale des travaux publics (ESTP) représentée par M. Roger PIOTTO · Laboratoire ADP, Orly sud représenté par M. Alain MILLOTTE · SOBATEN représentée par M. Guy JEAN, président · Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) représenté par M. Michel HÉRY · Comité français d'accréditation (COFRAC) représenté par Mme Nathalie SAVÉANT · Comité anti-amiante de Jussieu représenté par M. Michel PARIGOT, président · Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND, chef du laboratoire d'étude des particules inhalées (LEPI) de la ville de Paris, accompagnée de M. Laurent MARTINON Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Je vous remercie d'être présents à cette première table ronde qu'organise notre mission, sur le thème de la certification et du contrôle de la qualité des acteurs dans le domaine de la gestion de l'amiante résiduel. La gestion de l'amiante résiduel est en effet notre premier thème d'investigation. Nous avons déjà reçu des acteurs du repérage et du désamiantage, à l'occasion d'auditions simples, pour comprendre le fonctionnement de ce secteur. J'ajoute que le Rapporteur et moi-même, respectivement députés de Cherbourg et de Dunkerque, avons eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes qui ont terriblement souffert des conséquences de l'amiante. Après ce premier thème auquel seront encore consacrées plusieurs réunions, notamment pour étudier la question des déchets, la mission abordera d'autres aspects du dossier de l'amiante : les aspects scientifiques et médicaux, la prévention des risques et la prise en charge des victimes, les problèmes de responsabilité pénale et la gestion internationale du dossier. Cela nous conduira jusqu'à la fin de l'année et la mission devrait rendre ses conclusions début 2006. Nous avons ce matin de nombreux invités. Afin que chacun fasse connaissance, je laisse immédiatement la parole à chacun d'eux, pour une très courte présentation. Mme Corinne DUCASTELLE : Je représente l'AFAQ-AFNOR international, organisme de certification des entreprises de désamiantage et de formation des diagnostiqueurs, puisqu'une certification des formations a été instituée il y a deux ans. M. André CHAPUIS : Je représente pour ma part Qualibat. Nous sommes également un organisme de qualification et de certification des entreprises du bâtiment. Notre but et notre vocation sont d'indiquer aux maîtres d'œuvre et aux maîtres d'ouvrage que les entreprises ont bien engagé les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de tels ou tels travaux. M. Christian COCHET : Je travaille au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), qui est un établissement public de l'État sous tutelle du ministère du logement, auquel nous apportons notre appui, ainsi qu'aux autres ministères concernés. Nous conduisons des études et des recherches qui, depuis 1995, ont pris en compte la question de l'amiante et de son diagnostic. M. Roger PIOTTO : Je représente l'École Spéciale des Travaux Publics (ESTP), où je coordonne les enseignements d'une section d'ingénieurs, j'y suis également professeur notamment pour ce qui touche à l'expertise technique et à la gestion des risques liés à la santé dans le bâtiment. Par ailleurs, j'ai créé un organisme de formation : AEL Ingénierie, qui est notamment, certifié AFAQ-AFNOR pour les formations d'opérateurs et la délivrance des attestations réglementaires de compétence de repérage de l'amiante, et agréé par arrêté du Ministre du Travail pour l'habilitation des coordonnateurs de sécurité et de protection de la santé .Je suis également ingénieur expert près la Cour d'Appel de Versailles pour la coordination de sécurité, la protection de la santé, et les polluants du bâtiment. J'ai d'ailleurs sollicité l'inscription en 1997 de cette spécialité à cette Cour d'Appel. M. Guy JEAN : Je suis président directeur général de la société SOBATEN, société spécialisée dans le désamiantage. M. Alain MILLOTTE : Au sein d'Aéroports de Paris (ADP), je m'occupe, entre autres, de tous les problèmes d'amiante : repérage, constitution des documents techniques amiante (DTA), conseil pour les travaux de désamiantage, en particulier dans le choix des entreprises. Mme Nathalie SAVÉANT : Je travaille au COFRAC, Comité français d'accréditation. Cette association, loi 1901, est en charge de l'accréditation des trois grandes catégories d'organismes d'attestation de la conformité, parmi lesquels les certificateurs des organismes de désamiantage. M. Michel HÉRY : Je viens de la direction scientifique de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), qui est un organisme de la sécurité sociale intervenant dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Nous nous occupons de recherche, d'assistance, de formation et d'information auprès des partenaires sociaux et des pouvoirs publics. Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : Je dirige le Laboratoire d'études des particules inhalées (LEPI) de la ville de Paris, qui se situe sur le volet analyse. M. Michel PARIGOT : Je préside le comité anti-amiante de Jussieu et je vois donc les problèmes plutôt de l'autre côté. Je m'intéresse aux chantiers de désamiantage depuis 1994 et je puis dire que notre comité est saisi chaque semaine d'au moins deux problèmes relatifs à l'amiante en région parisienne. M. Laurent MARTINON : J'appartiens également au LEPI et j'accompagne Mme Billon-Galland. M. le Président : Nous ne disposons que de trois heures pour traiter un vaste sujet. Aussi, je vous propose d'adopter la méthode suivante : conformément à l'ordre du jour que vous avez reçu, nous allons aborder successivement trois thèmes auxquels nous tenterons d'accorder une importance égale : les exigences qui pèsent sur les diagnostiqueurs de l'amiante ; la qualification des acteurs du désamiantage ; le cas des entreprises qui interviennent sur de l'amiante à l'occasion de travaux de maintenance, ce que l'on appelle le « secteur 3 ». Pour chacun de ces thèmes, je donnerai d'abord la parole à ceux d'entre vous qui souhaiteront intervenir, avant que le rapporteur, les membres de la mission et moi-même ne vous posions des questions. Nous abordons maintenant le premier thème : les exigences pesant sur les diagnostiqueurs. Nous avons pu constater que la compétence de ces diagnostiqueurs résultait essentiellement de la formation agréée qu'ils ont obligatoirement suivie. Pourtant, à en croire les propos rapportés à la mission, cette formation ne dure apparemment qu'entre deux et quatre jours. Nous souhaitons donc tout d'abord savoir quelle est la qualité de la formation minimum des techniciens opérant le repérage. M. Alain MILLOTTE : J'ai vécu une période où il n'y avait pas de formation de diagnostiqueur. Après les premiers décrets, en 1996, n'importe qui ou presque pouvait s'installer comme tel, et nous avons bien sûr eu des gens de qualité très inégale. Maintenant, qu'il y a une formation, la situation est meilleure, mais Aéroports de Paris a éprouvé le besoin de demander que les diagnostiqueurs aient, en plus, soit une formation initiale, soit une expérience dans le bâtiment. Car l'amiante est tellement bien caché qu'il faut des spécialistes pour le repérer correctement et le qualifier immédiatement. À défaut, on risque de passer à côté de matériaux amiantés et de voir des entreprises - qui, elles, commencent à s'y connaître - s'apercevoir qu'il y a de l'amiante non diagnostiqué. Bien sûr, cela bloque les chantiers et ne va dans l'intérêt de personne. M. Roger PIOTTO : Il y a eu plusieurs étapes dans la formation. Au cours de la première, antérieure au 1er janvier 2003, le point de contrôle réglementaire était l'assurance, puisque la réglementation indiquait : « Contrôleur technique ou technicien de construction qualifié muni d'une assurance ». Ce sont donc les assureurs qui se sont les premiers interrogés sur la nécessité de vérifier la compétence des opérateurs de repérage, compte tenu de l'incidence sur leur responsabilité civile. A partir du 1er janvier 2003, on est passé à la formation certifiée obligatoire. Mais on peut regretter que les pré-requis demandés par les organismes certificateurs ne soient pas les mêmes, ce qui a pu entraîner des difficultés pour les organismes de formation. Bien évidemment, ce n'est pas en quatre jours qu'on forme un opérateur de repérage à tout ce qui concerne le bâtiment. Il faut donc que les intéressés soient déjà dans la partie ou préalablement formés, avant de recevoir une formation certifiée correspondant au programme réglementaire. On arrive maintenant à la troisième étape. Je fais partie des groupes de travail coordonnés par le ministère du logement, et auxquels participent les ministères du travail et de la santé, qui préparent, sur la base de l'ordonnance du 8 juin 2005, des projets de décret et d'arrêtés concernant les conditions et modalités d'application, en particulier concernant l'amiante. On se dirige vers une certification non plus des formations mais directement des opérateurs personnes physiques. M. le Président : Pouvez-vous nous en dire plus sur ce décret ? M. PIOTTO : Après y avoir été habilité par la loi de décembre 2004, le Gouvernement a pris, le 8 juin dernier, une ordonnance sur la protection des acquéreurs grâce aux diagnostics. Il prépare maintenant un décret qui portera, entre autres, sur la certification des diagnostiqueurs et qui sera complété par des arrêtés spécifiques pour chaque formation. M. le Président : Êtes-vous consultés ? M. Roger PIOTTO : Oui. Je suis aussi président délégué de la fédération des associations de coordonnateurs de sécurité et de protection de la santé (AFCO) qui réalisent également des diagnostics, et c'est à ce titre que j'ai été appelé par le ministère du logement. M. le Président : Quand le décret doit-il être publié ? M. Roger PIOTTO : L'objectif qui nous a été communiqué est le 4ème trimestre 2006, mais une réunion est organisée demain au ministère à la suite de laquelle nous disposerons d'éléments plus précis. Mme Corinne DUCASTELLE : Cette réunion portera en effet sur le projet de décret et sur la reconnaissance des diagnostiqueurs. Il est prévu qu'au lieu d'une attestation de compétence liée à la formation, ce sont désormais les personnes qui seront certifiées. Mais les pré-requis et les formations ne sont pas encore définis. Des groupes de travail seront créés demain pour les préciser. La formation certifiée sera complètement abandonnée et on suppose que le passage à la certification de la personne permettra de combler les lacunes actuelles de la formation. Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : Ceux qui disposent actuellement de la certification vont-ils la conserver, ou devront-ils repasser par le nouveau système ? Mme Corinne DUCASTELLE : A priori les choses vont changer puisqu'on va passer de l'attestation de compétence à la certification de personnes : les processus seront totalement différents. M. Roger PIOTTO : Des personnes qui exercent actuellement pourront, en effet, ne pas obtenir la nouvelle certification si elles ne remplissent pas les conditions, et elles cesseront alors d'exercer. Le Conseil général des ponts et chaussées a rendu un rapport qui propose des critères élevés de pré-requis et de niveau de formation, et la réflexion se poursuit sur ce point. Pour ma part, je trouve dommage qu'au motif qu'on a constaté des dérives, l'aspect formation soit passé sous silence dans le projet de décret et que l'on considère que la certification suffira pour attester la compétence. Les formations à la sécurité et à la protection de la santé se déroulent sur trois fois cinq jours avec, comme pré-requis, cinq ans d'expérience dans la conception et ou cinq ans d'expérience de contrôle de travaux. Il paraît difficile, quel que soit le niveau de la certification, de juger de la compétence d'une personne sans critères préalables réglementaires d'expérience et de formation spécifique. M. le Président : Nous voyons bien qu'il y a des problèmes en ce qui concerne les pré-requis et le niveau de formation, et nous regarderons tout cela de près. Mme Nathalie SAVÉANT : Nous discuterons de ces questions demain au ministère. À l'évidence, le système de certification, qui permettra d'évaluer les compétences d'une personne en bout de chaîne, devra être complété par des critères de certification : connaissances de base, expérience professionnelle mais aussi formation. Il est également prévu un projet de décret sur l'accréditation par le COFRAC des organismes opérant cette certification, dont l'intérêt sera que les compétences seront évaluées de la même manière par les organismes certificateurs, à partir d'un référentiel commun. M. Michel PARIGOT : La consultation des acteurs de terrain - et pas seulement des organismes certificateurs - paraît essentielle à la transparence et à la pertinence du processus. Par ailleurs, on voit bien que l'État n'a pas organisé d'évaluation de la réglementation. On ignore ainsi quelles mesures sont applicables et appliquées et on ne sait pas si elles répondent aux objectifs fixés. Il faudrait que les pouvoirs publics se donnent les moyens d'évaluer la réglementation autrement qu'en organisant de telles tables rondes. Pour l'instant, on a une vision partielle, mais aucune certitude statistique, alors qu'on en aurait pourtant bien besoin pour gérer le problème de l'amiante. Il faut donc se doter d'outils pour recueillir les informations et pour vérifier que la réglementation est adaptée. M. le Président : Vous admettrez que nous avons pris l'initiative de cette table ronde et qu'elle permet de poser un certain nombre de questions. Pour pouvoir intervenir ultérieurement, nous avons d'abord besoin d'être mieux informés. M. Michel PARIGOT : L'organisation de cette table ronde est une excellente initiative, mais je pense que les pouvoirs publics devraient systématiquement, dès qu'une réglementation est adoptée, prévoir les outils de son évaluation. M. Christian COCHET : Il faut disposer d'éléments objectifs sur la situation et sur les diagnostics sur le terrain. J'ai indiqué hier qu'un travail était en cours avec les ministères de la santé et du logement sur le traitement des informations qui remontent grâce aux obligations réglementaires, en particulier des déclarations annuelles des opérateurs de repérage. Nous allons nous fonder sur ces premières données et sur l'examen d'un certain nombre de dossiers pour aller vers un examen objectif et global de l'état des diagnostics, conformément au souhait de M. Parigot. Je plaide moi aussi pour que l'ensemble des dispositifs réglementaires prévoie cette remontée de l'information, ce qui ne paraît pas très compliqué et qui permettrait une évaluation technique de l'application de la réglementation. Dans le nouveau dispositif on aurait donc intérêt à prévoir le recueil, le traitement, l'exploitation et le partage des informations. Mme Nathalie SAVÉANT : Cela existe déjà dans le dispositif réglementaire actuel. Il est prévu que les organismes certificateurs délivrent un rapport annuel sur l'ensemble des certifications qu'ils ont octroyées ou retirées. L'exploitation de telles données est explicitement prévue par d'autres textes réglementaires, ce qui permet ensuite un traitement statistique. M. Guy JEAN : Nous sommes en bout de chaîne, et nous voyons tout ce qui résulte du diagnostic. Je puis donc exprimer un souhait, qui émane du terrain : évitons de multiplier les décrets car les propriétaires, qui ne sont pas des spécialistes de l'amiante, n'y comprennent plus rien. Comment peuvent-ils, par exemple, imaginer qu'un diagnostic effectué dans un certain cadre n'est plus valable dans un autre cadre ? Une simplification est nécessaire car l'amiante est l'affaire de la population et pas seulement des spécialistes. Dans la formation, il faudrait insister sur le rapport temps/coût. Alors qu'un bon diagnostic est nécessairement très long, des diagnostics sont aujourd'hui effectués trop rapidement, dans un souci d'économie. Quand on voit qu'on découvre de l'amiante partout, on peut comprendre qu'il est pratiquement impossible de réaliser un diagnostic exhaustif dans de telles conditions. Nous essayons néanmoins de faire au mieux, mais il faut disposer de personnes hautement spécialisées et faisant preuve d'une grande sensibilité, qui seule permet d'être efficace. Cela ne vaut d'ailleurs pas seulement pour le désamiantage où il y a des moyens et de la vigilance mais aussi pour l'ensemble des travaux de maintenance. M. Roger PIOTTO : S'agissant du coût, on peut faire le parallèle avec les coordonnateurs de sécurité et de protection de la santé, qui existent depuis dix ans. Dans la réglementation les concernant, il est indiqué que le donneur d'ordre - ici le maître d'ouvrage - doit leur donner les moyens nécessaires à leur mission. À défaut, il peut être condamné. Il est vrai qu'il est plus difficile de responsabiliser un propriétaire, qui n'est pas un professionnel, mais il faudrait réfléchir à la façon dont on pourrait s'inspirer de l'expérience de ces coordonnateurs. Par ailleurs, les organismes de certification et les organismes habilités à délivrer actuellement l'attestation de compétence doivent transmettre la liste des diagnostiqueurs formés au ministre de la construction, par l'intermédiaire des directeurs départementaux. Ne serait-il pas plus efficace de prévoir, comme pour les coordonnateurs de sécurité, une centralisation directe au ministère, afin de remédier au fait que les propriétaires ignorent le plus souvent à qui s'adresser. On m'a dit que ce problème serait réglé avec la certification de personnes, mais il ne serait quand même pas bien compliqué, à l'ère des communications électroniques, d'adresser un courriel à un chef de projet qui serait, au ministère, en liaison avec les Directions départementales de l'équipement (DDE). M. Michel PARIGOT : Je souscris aux propos de M. Jean sur le fait que le diagnostic est d'abord un problème de terrain. Les connaissances, y compris historiques, de la personne chargée du diagnostic sont extrêmement importantes et il est vrai qu'il y a un peu de flair dans le repérage de l'amiante. Mais il pourrait aussi y avoir, dans la formation, une partie consacrée à l'analyse de risques et à l'hygiène, qui permettrait de mieux comprendre les problèmes liés à la pollution par l'amiante et à sa propagation. Le fait que la réglementation soit complexe et qu'il y ait d'un côté un décret santé et de l'autre un décret travail pose aussi problème. En effet, le repérage de l'amiante est essentiel pour la protection des travailleurs, et il faudrait qu'il aille jusqu'à une certaine analyse des risques. Cela suppose une classification en fonction des interventions futures qui faciliterait le contrôle de l'inspection du travail. En effet, celle-ci n'est pas capable de tout contrôler, et il faudrait que les opérations soient signalées en amont, dans le dossier technique amiante, lequel indiquerait qu'en cas d'opérations, il faudrait tel ou tel niveau de sécurité. Cela ne peut, à l'évidence, être fait qu'au moment du repérage et du diagnostic, car on échappe ensuite à tout contrôle. Mme Nathalie SAVÉANT : Un des intérêts de la certification de la compétence de la personne, sous accréditation, est qu'on peut envisager de dresser une liste centralisée des personnes certifiées. Cela rendrait le système plus accessible. M. le Rapporteur : L'accréditation sera-t-elle désormais délivrée à une personne physique pour une période déterminée ? Un contrôle de la qualité des intervenants est-il prévu ? Je suis par ailleurs sensible à ce qu'a dit M. Jean, qui est à l'origine d'une des premières entreprises de désamiantage, sur la nécessité de partir de l'expérience de terrain. Mme Nathalie SAVÉANT : Je ne peux pas parler pour le ministère en charge de l'équipement, mais je crois savoir que des personnes de terrain participeront aux groupes de travail. La procédure de certification prévoira à la fois le référentiel de compétences M. le Président : Prendra-t-on en compte de ce qu'a dit M. Parigot à propos de la gestion des risques ? Mme Nathalie SAVÉANT : Tout reste à bâtir en ce qui concerne le référentiel de compétences de la personne. Il faudra en particulier déterminer si l'on y inclut une formation aux risques. Mais pour lier le contenu de la certification avec la prestation de la personne certifiée, il va bien falloir lier les compétences avec ce qu'on entend être inclus dans le diagnostic. Il me semble donc que l'important dans ce cas est une définition précise du contenu de la prestation, avant même d'établir un schéma de certification. M. Roger PIOTTO : Il est évident que lorsque une personne formée à l'analyse de risque fait un diagnostic, elle ne s'inscrit pas dans la même démarche qu'un expert immobilier... Pour ma part, bien que je n'y sois pas tenu, j'ai intégré ces aspects dans les formations que je dispense. Et je répète qu'il serait utile de s'inspirer des dix ans d'expérience des coordonnateurs de sécurité et de protection de la santé. M. Jean-Marie GEVEAUX : Ne pourrait-on pas prévoir différents niveaux de compétence, car les bâtiments dans lesquels on cherche à détecter l'amiante ne sont pas tous les mêmes : il est sans doute moins difficile de le rechercher dans un immeuble récent et de construction classique. Une telle évolution permettrait de régler en partie le problème du coût. M. Roger PIOTTO : Il existe, chez les coordonnateurs de sécurité et de protection de la santé, plusieurs niveaux de compétence en fonction des risques de l'opération. La situation concernant l'amiante varie selon qu'on a affaire à un donneur d'ordre maître d'ouvrage, avec des professionnels, ou à un donneur d'ordre propriétaire. Les arrêtés en cours pourraient prévoir 2 niveaux de compétence, avec le plus élevé pour les immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public et autres opérations complexes à définir. Mme Nathalie SAVÉANT : Nous n'en sommes qu'au début du travail sur le décret et nous n'avons pas encore abordé les arrêtés. Le décret concernera tous les diagnostics nécessaires à la cession d'un bien. Le souhait du ministère est que le propriétaire n'ait besoin ni de faire venir six diagnostiqueurs différents, ni, au sein du diagnostic amiante, de devoir choisir en fonction de son type d'habitation. L'objectif est qu'il y ait en face de lui un seul opérateur. M. Michel PARIGOT : Un des problèmes est la distinction entre repérage et diagnostic. La perspective de cession d'un bien est extrêmement particulière. Or on est en train d'organiser la profession autour de ce type d'opération, alors que le vrai problème tient aux risques encourus lors des interventions. D'ailleurs, le fait que le diagnostic ne concerne que les propriétaires et pas les locataires montre bien qu'on ne s'est pas placé dans une perspective d'analyse du risque. Le projet de décret s'inscrit donc dans la mauvaise voie. M. le Président : Vous constaterez que c'est bien la notion de risque qui sous-tend notre démarche. M. Laurent MARTINON : Après la mise en place d'un nouveau référentiel pour la formation des diagnostiqueurs, quelle sera la validité des diagnostics effectués à partir de l'ancien ? Faudra-t-il recommencer les diagnostics pour l'ensemble du parc ? M. le Président : Je crains que cette bonne question ne reste pour l'instant sans réponse, mais nous essaierons de la trouver. Pour terminer sur ce thème, peut-être est-il nécessaire d'apporter quelques précisions sur l'évaluation des travaux de diagnostics, notamment en ce qui concerne le contrôle de la réglementation. M. Roger PIOTTO : On peut distinguer le diagnostic pour vente du diagnostic pour travaux. Le code de la santé publique a d'ailleurs identifié un certain nombre de diagnostics, y compris pour démolition, mais pas le repérage avant travaux, qui est déclenché par la loi sur la coordination SPS, qui impose au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage d'éviter les risques. On rejoint donc ainsi la notion d'analyse de risque. Pour l'instant, le ministère du logement s'est concentré sur les ventes et il faudrait prévoir la même démarche pour les travaux, comme pour le plomb, pour lequel le futur constat de risque d'exposition vaudra à la fois pour les travaux et pour la vente. Il est vrai qu'on arrive aujourd'hui à de nombreux documents que nous-mêmes pouvons comprendre, mais dans lesquels des particuliers et même des professionnels moins avertis se perdent. M. Christian COCHET : Sur plusieurs centaines de milliers de diagnostics avant vente réalisés chaque année, une dizaine de milliers seulement portent sur des immeubles plus complexes. Il est important de connaître ces ordres de grandeur quand on réfléchit à la façon de structurer les diagnostics. M. Guy JEAN : On en revient toujours à la multiplicité des diagnostics, qui est catastrophique. Imaginons qu'un particulier achète un pavillon avec un diagnostic de détection de fibrociment. Il considère qu'il n'y a pas lieu de trop s'inquiéter mais s'il engage des travaux sans qu'il y ait eu un diagnostic exhaustif, dans trente ans tout le monde payera... C'est pour cela qu'il faut que les diagnostics soient réalisés par des personnes spécialisés, mais aussi douées de la sensibilité nécessaire à une véritable analyse des risques. Cela doit être écrit dans le diagnostic, en particulier pour que le locataire soit également averti. Mais cela a effectivement un coût. M. Michel PARIGOT : Pour contrôler, il faut d'abord connaître l'état d'application de la réglementation. Les pouvoirs publics devraient diligenter une étude pour vérifier dans quelques centaines d'immeubles si les DTA ont été faits - en général ce n'est pas le cas - et s'ils ont été bien faits. Le contrôle varie en fonction des situations. Si l'inspection du travail peut contrôler les chantiers, les moyens de l'administration ne lui permettent pas de contrôler tous les DTA. Il n'y aurait donc pas de meilleur contrôle que de les rendre totalement transparents, en faisant en sorte que chacun y ait accès, au moins pour ceux qui ne portent pas sur des maisons particulières. Il est par ailleurs anormal de mélanger termites et amiantes car il s'agit de deux problèmes très différents. Pour tout ce qui touche à la sécurité, le contrôle doit rester une prérogative des pouvoirs publics. M. Alain MILLOTTE : Il est vrai que pour les DTA, tout n'a pas encore été fait. Mais leur qualité dépend de la façon dont ils sont commandés. Pour bien commander, il faut être bien formé et la plupart des propriétaires ne le sont pas. C'est pourquoi les DTA sont effectués au moindre coût. Par ailleurs, je ne suis pas convaincu qu'il faille diffuser largement les conclusions des diagnostiqueurs car, si elles sont lues par des gens incompétents, on risque de déclencher une psychose. J'ai connu ce phénomène, j'en suis venu à bout grâce à un effort d'explication, mais il m'a fallu une demi-journée pour convaincre le CHSCT qui m'interrogeait... M. Laurent MARTINON : Je pense, au contraire, que c'est quand les décideurs et les gestionnaires tentent de retenir l'information, au motif que le grand public est incompétent, que les psychoses se développent. Le manque de transparence crée des difficultés, nous le voyons sur le terrain. Je rejoins donc Michel Parigot sur la nécessité d'une transparence des DTA. Mme Marie-Annick BILLON-GALLAND : J'ai participé au groupe AFNOR sur l'examen visuel et une norme est parue, qui explique comment on doit faire un repérage, que ce soit pour les DT, les DTA, avant travaux, avant vente. Mais cette norme n'est pas obligatoire : si elle doit être appliquée dans le cadre d'un appel d'offres dans le public, tel n'est pas le cas dans le privé. M. Roger PIOTTO : On parle beaucoup des DTA, mais c'est uniquement dans le repérage avant travaux que l'analyse de risques est prévue. M. le Rapporteur : Avant que nous en venions au désamiantage, j'aimerais que M. Jean nous dise s'il lui est arrivé de découvrir de l'amiante non repéré par un diagnostic préalable. M. Guy JEAN : Très souvent ! Mais cela peut se comprendre et ce n'est pas dramatique quand c'est une entreprise spécialisée qui s'en aperçoit. Les conséquences peuvent être beaucoup plus graves si cela se produit à l'occasion de travaux de maintenance. M. Laurent MARTINON : On a parlé du diagnostic uniquement en termes de repérage, mais pas des grilles d'évaluation des matériaux et de leur état de conservation. M. le Président : Je vous remercie pour toutes les informations que vous nous avez apportées au cours de la première partie de cette table ronde. Elles nous permettront de jouer notre rôle d'interpellation. Je propose d'aborder maintenant le deuxième thème de notre table ronde : la qualité des acteurs du désamiantage. Il nous a semblé, au Rapporteur et à moi-même, que le dispositif de certification réglementaire avait plutôt bien fonctionné ces dernières années, au point d'ailleurs que le nombre des entreprises certifiées avait diminué. Notre première question est donc presque une demande de confirmation : la certification des entreprises de désamiantage est-elle efficace ? Je vous indique immédiatement, car vos réponses se recouperont sans doute, que la deuxième question portera sur le fait de savoir si la transparence et l'indépendance des processus de certification et de retrait de la certification suffisent à garantir l'équité entre les entreprises qui souhaitent intervenir dans le domaine du désamiantage. Enfin, nous vous demanderons si la certification actuelle prend bien en compte tous les aspects de réglementation, notamment ceux qui s'appliquent à la gestion des déchets. M. Michel HÉRY : Il est bien difficile de répondre par oui ou par non à votre question sur l'efficacité de la certification, mais je vais essayer de dresser un tableau de la situation. Nous avons certainement la meilleure réglementation du monde et nos entreprises ont fait ces dix dernières années d'éminents progrès, y compris dans des domaines pour lesquels elles avaient signifié clairement que ce serait impossible. Cela montre bien que quand on est obligé de faire quelque chose, on y arrive... Je travaille avec un certain nombre d'organismes représentés autour de cette table, notamment le COFRAC, AFAQ-AFNOR, Qualibat. Ils font très bien leur travail et leurs référentiels sont de qualité. Mais rien n'est jamais tout blanc. Une réglementation, aussi bonne soit-elle, ne vaut que si elle est appliquée et elle ne l'est que si on en a les moyens. Or, l'année dernière, quand la Direction des relations du travail a diligenté une enquête à travers la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), les Caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), on est arrivé à la conclusion que les trois-quarts des 72 chantiers audités ne répondaient pas, au moins pour partie, aux exigences de la réglementation. Il y avait, dans un faible nombre de cas, des manquements graves, voire très graves, mais aussi, pour d'autres chantiers, des manquements qui, tout en pouvant paraître véniels, me semblaient les prémices de phénomènes plus graves, et devaient donc absolument être signalés. Une campagne identique est menée cette année, du 1er juin jusqu'à fin juillet, et j'ai quelque raison de penser qu'on arrivera à des résultats similaires. Si les entreprises se sont professionnalisées, si elles jouent parfaitement le jeu, elles le font dans un contexte de concurrence exacerbée qui les oblige à tirer les prix. J'ai eu, au Sénat, une discussion un peu vive sur ce thème, à propos des marchés publics : des entreprises sont retenues parce qu'elles sont les moins-disantes, alors qu'elles sont loin d'être les mieux-disantes. Le fait de recevoir un devis à 70 % de la moyenne des autres entreprises devrait faire prendre conscience au donneur d'ordre qu'on ne peut pas faire n'importe quoi à n'importe quel prix, ou plutôt qu'à n'importe quel prix on risque de faire n'importe quoi. Pour répondre à votre question, la certification est sûrement bien faite, de là à dire qu'elle est suffisamment efficace, il y a un pas. Mme Nathalie SAVÉANT : Le dispositif réglementaire a été récemment encore amélioré par un arrêté du 25 avril 2005, qui est l'aboutissement d'un long travail d'harmonisation à la fois des procédures de désamiantage et de la manière d'octroyer ou non la certification aux entreprises. Ce processus a abouti à deux normes, NFX 46-010 et NFX 46-011. On espère que le système sera ainsi plus efficace. Il est également prévu une procédure d'urgence dans laquelle l'organisme certificateur qui constate une situation de danger grave - que les nouvelles normes distinguent de la conformité - devra informer immédiatement les services de l'inspection du travail, qui pourront exercer leur pouvoir de police et de sanction. Il reste la question, qu'évoquait tout à l'heure M. Parigot, de la remontée des informations et de l'exploitation qui en est faite, en particulier par la DRT. C'est bien cette remontée qui peut garantir l'application de la réglementation en vigueur et son contrôle. À partir des échantillons prélevés lors des audits, les enquêteurs peuvent découvrir de graves manquements et alerter la DRT. M. Michel PARIGOT : Je souscris à ce qui a été dit : la réglementation est sans doute la meilleure du monde, le problème c'est le contrôle de son application. On voit bien la différence entre le contrôle, forcément lacunaire, effectué par les organismes qui qualifient, et celui de l'inspection du travail. Mais on sait aussi qu'il n'y a pas assez d'inspecteurs du travail, qu'ils ont autre chose à faire et, surtout, qu'ils ne sont pas spécialisés. Toutes les entreprises de désamiantage le savent : on peut aussi bien avoir un arrêt de chantier pour des choses qui ne le méritent pas qu'un chantier qui se poursuit en dépit de problèmes qui justifieraient son arrêt. Tout dépend de l'inspecteur du travail. On a par ailleurs beaucoup insisté sur les efforts des entreprises de désamiantage et il est vrai qu'elles ont fait des choses dont on pouvait penser qu'elles ne les feraient pas, comme l'usage de l'adduction d'air. Mais il reste au moins un problème : l'absence de contrôle de la maîtrise d'œuvre. Alors que l'entreprise qui mène le chantier a une obligation de compétence et de qualification, celui qui conçoit le chantier n'y est aucunement soumis. Dès lors, pour un certain nombre de chantiers complexes, les maîtres d'oeuvre mettent les entreprises en grande difficulté. Il faudrait imposer une qualification. M. Guy JEAN : Je croise MM. Héry et Parigot depuis de nombreuses années sur des sujets difficiles, notamment le sous-équipement, et j'adhère totalement à leurs remarques. Il peut toujours y avoir des petits problèmes de qualification, car il s'agit de gestion des hommes, mais telle qu'elle est, la réglementation me va tout à fait et je la juge excellente. C'est en revanche sa mise en œuvre qui pose problème : l'inspection du travail et les services de prévention des CRAM n'ont pas assez de moyens. La question de la formation est aussi très importante. On voit des inspecteurs du travail venir contrôler des chantiers de désamiantage sans avoir reçu de formation sur l'amiante. Ils se contentent d'utiliser les textes, alors que chaque chantier à sa particularité. Il faut donc vraiment réagir pour éviter des dérives qui inquiètent les inspecteurs eux-mêmes. M. Roger PIOTTO : Comme l'a dit Michel Parigot, le problème de la formation de la maîtrise d'œuvre est également essentiel. M. le Rapporteur : Dans le domaine de l'industrie nucléaire, l'Autorité de sûreté joue le rôle de gendarme. Ne pourrait-on suggérer de créer une autorité de sûreté de l'amiante et un corps spécifique ? M. Michel PARIGOT : Si un parallèle doit être fait, il me semble que ce serait plutôt avec l'organisation de la sécurité incendie. Mais un contrôle de ce type implique un vrai changement de conception. M. Michel HÉRY : Je ne souscris que pour partie à ce qu'ont dit Guy Jean et Michel Parigot sur la compétence des inspecteurs du travail : la réglementation est quand même techniquement très précise et un inspecteur, qui doit bien sûr recevoir un minimum de formation, n'a pas besoin d'être un spécialiste de l'amiante pour effectuer des contrôles qui tiennent la route. M. Roger PIOTTO : J'ajouterais que, sur un chantier, l'inspecteur, qui est le gardien du code du travail investi d'une mission de service public, est entouré des ingénieurs de la CRAM qui, eux, ont reçu une formation amiante. Cela compense un peu son manque de formation technique. M. Guy JEAN : J'insiste à nouveau sur l'importance de la sensibilité de la personne qui intervient. Les inspecteurs du travail, c'est tout à leur honneur, sont des gens très indépendants, mais je pense quand même qu'il faut améliorer leur formation. Sur le terrain, on voit bien la différence entre celui qui a compris de quoi il s'agit et celui qui vient avec sa bible... Il est vrai que la réglementation est très bien faite, mais l'analyse pêche quand même parfois beaucoup. S'agissant des maîtres d'œuvre, il est vrai qu'il y a un gros problème. Quelques-uns se sont investis et ont acquis cette sensibilité dont je parlais. D'autres vendent un « paquet » aux maîtres d'ouvrage en leur disant qu'ils s'occupent de tout, qu'ils choisissent les entreprises, qu'ils prennent toutes les responsabilités. Mais ces derniers auraient tort de croire qu'ils ne se retrouveront jamais devant le juge... M. le Président : Deux problèmes ont donc été posés : celui du niveau de formation et celui de la maîtrise d'œuvre. M. Guy JEAN : Ce sont effectivement des éléments clé. M. Jean-Marie GEVEAUX : Pour les collectivités comme pour les particuliers, il est compliqué de suivre de multiples entreprises, dans tous les corps de métiers. Ne serait-il pas utile que chaque chantier ait son référent amiante ? Sur de gros chantiers, il arrive bien parfois qu'un spécialiste de l'acoustique ou du béton soit responsable de la coordination dans son domaine de compétence. M. Roger PIOTTO : Je pense que dans la formation des maîtres d'œuvre, des ingénieurs ou des techniciens supérieurs, on pourrait imaginer que soit créée une option amiante. Aujourd'hui, lorsqu'un étudiant sort de l'école, tout juste connaît-il l'existence de l'amiante. Il est vrai qu'il n'est jamais facile de modifier les référentiels de formation car les cours sont déjà lourds et lorsqu'une matière est ajoutée, il faut en retirer une autre, mais il importe de poser le problème pour dépoussiérer les programmes. M. le Président : Cette idée me paraît intéressante ; elle pourra figurer parmi nos recommandations. M. Christian COCHET : Les maîtres d'œuvre ne sont pas toujours suffisamment qualifiés ; quant aux maîtres d'ouvrage, leurs pratiques ne sont pas non plus toujours idéales. Pour faire progresser le contrôle et le suivi, ne serait-il pas envisageable de s'orienter vers la certification des opérations de traitement et de retrait de l'amiante ? Cette démarche de plus en plus courante, qui prend en considération le cycle de vie, s'inscrit dans l'idée de haute qualité environnementale. M. Jean-Marie GEVEAUX : La haute qualité environnementale fait de gros progrès et il serait intéressant, pour l'amiante, de s'en inspirer. M. Michel PARIGOT : Pourtant, il ne faudrait pas lancer une grosse machinerie pour une multitude de chantiers de nature et de taille différentes. Je reviens sur ma remarque concernant l'inspection du travail. Une centaine d'entreprises seulement sont qualifiées pour retirer l'amiante, ce qui facilite les contrôles : si quelques inspecteurs du travail étaient spécialisés sur le sujet ou si quelques experts de l'amiante étaient chargés de les accompagner sur les chantiers, toutes les opérations pourraient être contrôlées. Pourquoi nous priverions-nous de ce dispositif d'exception, qui constituerait un dernier verrou ? Cette voie mérite en tout cas d'être explorée. M. Guy JEAN : Je précise que la centaine d'entreprises dont a parlé M. Parigot sont celles qui ont obtenu une qualification pour l'amiante friable. M. le Président : Nous avons déjà évoqué ce sujet et, rassurez-vous, nous y reviendrons. M. Guy JEAN : Les entreprises qualifiées ne couvrent que 20 à 30 % du marché, le reste n'étant pas sous contrôle. Pourtant, un matériau non friable est toujours mêlé à des matériaux friables et, une fois manipulé, il peut lui-même devenir ultra-friable. M. le Président : Si le nombre d'entreprises qualifiées est limité, il n'en demeure pas moins que le champ à couvrir est beaucoup plus large. M. Michel PARIGOT : Au total, 300 ou 400 entreprises sont concernées, pas davantage, ce qui est assez peu par rapport à l'ensemble des entreprises du BTP. Mme Nathalie SAVÉANT : Le système de certification des entreprises, extrêmement lourd et pointilleux, a été mis sur pied pour remplacer le contrôle systématique. À quoi servirait-il de les superposer, d'autant que, dans les deux cas, il faudrait procéder par échantillonnage ? Ne serait-il pas préférable de mieux utiliser les remontées d'informations et d'accroître la réactivité de l'inspection du travail, dès lors qu'elle est informée d'un danger ? Mme Corinne DUCASTELLE : Les contrôles ne sont pas similaires : celui des organismes de certification porte sur un chantier par an, tandis que l'inspection du travail, pour une même entreprise, peut en visiter plusieurs. Mme Nathalie SAVÉANT : À condition qu'elle en ait les moyens... Mme Corinne DUCASTELLE : Pour notre part, nous n'avons pas les moyens d'arrêter un chantier. Nous pouvons toutefois sanctionner les entreprises en leur retirant leur certificat, ce qui leur fermera l'accès au marché. Mais beaucoup d'entre elles se replient aussitôt sur l'amiante non friable, secteur dans lequel elles peuvent agir à leur guise. M. le Président : Je note donc qu'une fraction énorme du marché n'est pas prise en charge par les entreprises qualifiées. M. Michel PARIGOT : La DRT réfléchit au problème puisque le décret est en cours de modification pour intégrer la directive européenne. Est-il préférable d'élaborer une réglementation théoriquement parfaite mais qui ne sera pas appliquée, ou bien une réglementation moins parfaite mais applicable ? Certaines interventions sur les matériaux non friables doivent relever de la même réglementation que les opérations sur les friables mais il serait injustifié et inefficace d'imposer les mêmes exigences pour n'importe quel travail au contact de l'amiante. Les contrôles de qualification et ceux diligentés par l'inspection du travail ressortissent de deux registres très différents, autant en ce qui concerne les points examinés que la fréquence des visites et les types de sanctions. L'inspection du travail dispose de toute une graduation de sanctions permettant de placer l'entreprise sous pression. J'estime pour ma part que le chevauchement des deux contrôles ne pose pas de problème. M. le Président : Il faut trouver un juste milieu entre, d'un côté, une trop grande rigidité et, de l'autre, un système où toute une partie du marché échappe aux contrôles. Par ailleurs, il me semble que la sensibilisation des inspecteurs du travail et des ingénieurs n'est pas un objectif irréaliste. Les processus de qualification sont-ils suffisamment transparents et indépendants pour garantir l'équité entre les entreprises ? M. André CHAPUIS : Les commissions d'attribution sont composées d'un collège maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, d'un collège entreprises et d'un collège désigné par le ministère, constitué de représentants de la CNAM, de l'INRS et d'un médecin du travail. Les commissions de recours, elles-mêmes, suivent cette organisation en collèges. Ce dispositif offre une garantie d'indépendance et de transparence. Mme Nathalie SAVÉANT : La mission des organismes certificateurs est de procéder à des vérifications sur place, leur indépendance et leur compétence étant notamment garanties par les profils et la diversité de leurs experts, et reconnues par l'accréditation. M. Guy JEAN : Pour ce qui me concerne, je n'ai jamais été soumis à des pressions et je suis convaincu de l'intégrité des organismes de qualification, qui ont fait progresser la corporation. Mais ils n'agissent pas en policiers : ils contrôlent simplement les moyens matériels et humains de l'entreprise à l'instant « t ». Pour que nous continuions à progresser, le reste de la chaîne doit se perfectionner. Mais la délation est le drame de notre profession ; les gens feraient mieux de venir voir sur place ce qui s'y passe. M. le Président : Nous en venons au point suivant de notre table ronde : la certification prend-elle suffisamment en compte la gestion des déchets ? M. André CHAPUIS : Les deux organismes certificateurs vérifient que les entreprises connaissent la réglementation et la respectent, y compris pour ce qui est des procédures de transport et de suivi des déchets. Mais je parle des entreprises certifiées ; il n'en est certainement pas de même pour les autres. M. Guy JEAN : La réglementation sur les déchets est bien faite. J'émets simplement le souhait que leur traitement soit géré par l'entreprise spécialisée, mais que le coût de leur élimination soit pris en charge directement par le maître d'ouvrage. En effet, tous les déchets ne parviennent pas à destination et beaucoup d'appels d'offres s'en trouvent faussés. Résultat : toutes les décharges publiques de France sont chargées en fibres d'amiante et cela passe inaperçu. Il faut aussi savoir que toutes les entreprises de démolition transportent leurs déchets, alors que nombre d'entre elles ne disposent pas d'habilitation à cet effet : la réglementation est très claire mais force est de constater que la plupart des déchets sont transportés illégalement. M. le Président : Votre proposition a le mérite d'être claire et précise : le transport des déchets doit être assuré par l'entreprise de désamiantage mais payé par le maître d'ouvrage. M. Michel HÉRY : Nous sommes d'accord ! M. le Rapporteur : Arrive-t-il que l'inspection du travail contrôle la phase du transport et du déchargement ? M. Guy JEAN : Les inspecteurs du travail sont nos meilleurs défenseurs mais, pour bien faire, leur surveillance des chantiers devrait s'exercer vingt-quatre heures sur vingt-quatre : l'entreprise qui veut rentabiliser son contrat s'arrange pour évacuer les déchets en douce lorsqu'ils ne sont pas là. J'en reviens au problème du dossier d'appel d'offres : en fonction des surfaces et des volumes traités, il est possible d'évaluer à 5 % près le tonnage de déchets. Dès lors, quand 40 % de déchets manquent au dossier dès l'appel d'offres, il y a un problème. M. Roger PIOTTO : Certains maîtres d'œuvre ignorent des mesures comme l'examen visuel préalable à la réception de l'ouvrage. Cette prestation doit figurer dans le cahier des charges élaboré par le maître d'œuvre. Dans la réglementation, il est question du propriétaire et de l'entreprise mais jamais du maître d'œuvre d'amiante, alors que ce dernier est responsable de la conception et du contrôle des travaux, en association avec le maître d'ouvrage. C'est l'entreprise qualifiée qui va compenser. M. Jean-Marie GEVEAUX : Ces propos sont impressionnants. Ne conviendrait-il pas de renforcer la réglementation relative au cahier des charges ? De fait, les différences de prix dans les réponses à un même appel d'offres sont curieuses. M. le Président : Nous progressons encore un peu plus. M. Christian COCHET : Sur la question des déchets aussi, l'idée d'un regard global sur les opérations est justifiée, afin que le maître d'ouvrage soit certain que, d'un bout à l'autre de la chaîne, tous les opérateurs interviennent correctement. Compte tenu de la répartition actuelle des rôles, même les vérifications les plus simples ne sont pas assurées. M. Michel HÉRY : Je suis surpris que la problématique du respect de la concurrence ne soit évoquée qu'à propos des déchets. À tous les stades de la chaîne, y compris lors de la conception et de la réalisation des travaux, il est anormal que certaines entreprises soient 25 ou 30 % moins chères que les autres, car cela signifie forcément qu'elles rognent sur la sécurité des travailleurs. Il peut arriver qu'une entreprise ait un éclair de génie sur un chantier et le mène à bien de façon plus performante que ses homologues mais il est inadmissible que certains fonds de commerce se bâtissent sur des bas prix systématiques. M. le Président : La remarque que M. Geveaux a formulée à propos du cahier des charges apparaît donc extrêmement pertinente. M. Guy JEAN : Nous sommes entrés dans le vif du sujet dès la semaine dernière, lors de notre première audition. Je rappelle que 80 % du prix d'un chantier de désamiantage est consacré à la sécurité. Or la priorité va le plus souvent au moins-disant. M. Roger PIOTTO : Le premier rôle du maître d'œuvre est d'élaborer un cahier des charges. Quant au maître d'ouvrage, il lui appartient d'établir un règlement de consultation dans lequel figurent les critères de jugement des offres. Si ceux-ci n'y apparaissent pas, il est bien évident que la commission ne pourra pas les prendre en compte. Le rôle des maîtres d'œuvre est donc essentiel et c'est pourquoi il importerait de leur faire suivre une formation et de garantir leur indépendance. M. le Président : D'accord. Nous commençons à comprendre les lacunes de la filière. M. Michel PARIGOT : Garantir la qualification et la compétence des maîtres d'œuvre, mais aussi leur indépendance, permettrait également de lutter contre le phénomène inverse : celui des ententes. La profession est confinée - si j'ose dire -, avec une centaine d'entreprises, dont une demi-douzaine seulement est susceptible de prendre en charge de gros chantiers. Je propose qu'une étude soit réalisée sur une centaine de chantiers pour voir qui a soumissionné, qui a été sélectionné et à quel tarif ; nous y verrions plus clair et il serait possible de mettre un peu d'ordre dans la profession. M. Ghislain BRAY : La formation des ingénieurs est tout aussi primordiale. Faire établir un document en bonne et due forme est une chose, mais encore faut-il que les services des collectivités locales disposent d'agents qualifiés pour connaître les indicateurs sur la base desquels peut être jugée la qualité des offres. Mme Martine DAVID : Je reviens au problème du transport des déchets, lequel, si je comprends bien, doit aussi être traité dans le cahier des charges. Mais qui, pratiquement, est habilité, formé et en capacité de contrôler que les déchets sont transportés de façon conforme ? Si vous ne pouvez pas répondre à ma question, le problème est grave. M. Roger PIOTTO : Le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé est chargé, en application du code du travail, sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, de proposer des mesures en matière d'évacuation des déchets. Ces prescriptions doivent figurer dès le dossier de consultation afin d'être pris en compte par l'entreprise. Mme Martine DAVID : Je ne stigmatise personne, mais je recommande que les pouvoirs publics étudient la question pour se donner les moyens de contrôler véritablement le transport des déchets. M. Michel HÉRY : Ce sont les Directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) qui sont responsables de cet aspect. Mme Martine DAVID : Vous connaissez les moyens mis à leur disposition... M. Michel HÉRY : C'est un autre problème. Mme Martine DAVID : Pas du tout ! Nous pouvons émettre des propositions tendant à accroître les moyens de telle ou telle institution. M. le Président : Beaucoup de propositions intéressantes ont été formulées. Nous en venons maintenant au troisième thème de notre table ronde, consacré aux entreprises qui interviennent sur des produits amiantés non friables à l'occasion de travaux de maintenance. Il arrive que de tels produits, à la suite de manipulations, deviennent friables, ce qui soulève des problèmes redoutables. L'information et la formation sont-elles suffisantes ? Convient-il d'élargir le champ de qualification des entreprises ? Sur quel type de référentiel ? Le sujet est difficile mais il est de notre devoir de l'aborder. M. Michel PARIGOT : Il requiert aussi une bonne dose de pragmatisme. Je considère qu'il faut étendre la qualification pour une partie des matériaux non friables, assimilable aux matériaux friables. En revanche, à l'autre bout de la chaîne, il serait inutile et impossible d'imposer une certification pour chaque intervention au contact de l'amiante. D'une façon ou d'une autre, toute intervention sur de l'amiante nécessite une formation, mais une graduation des précautions à prendre s'impose selon le type d'intervention et la configuration de chaque bâtiment. Il conviendrait d'enrichir le dossier technique amiante sur ce point. Et le problème doit être traité par le biais du décret « travail » mais aussi du décret « santé », ainsi que par une articulation entre les deux. C'est la seule solution pour éviter que soient pris des risques inutiles. M. Michel HÉRY : Je souscris entièrement à ces propos. L'amiante non friable, dans 99 % des cas, ne pose aucun problème, mais il peut arriver qu'il fasse peser sur les travailleurs des risques comparables à ceux encourus avec l'amiante friable. Le dossier technique amiante doit de toute évidence être enrichi par des préconisations relatives aux éventuels travaux qui devront être réalisés. J'estime pour ma part que toutes les entreprises intervenant sur ces chantiers doivent détenir une certification, mais pas forcément la même que celle des entreprises travaillant sur les friables. C'est compliqué car des produits amiantés non friables peuvent être déconstruits très facilement tandis que, pour d'autres, il faut mettre en œuvre des moyens de protection de l'environnement et du personnel du même niveau que pour les matériaux friables. J'ai visité il y a peu un élevage de volailles construit presque entièrement en fibrociment ; il était dans un état déplorable. J'ai signalé à l'agriculteur qu'il serait confronté au problème de la déconstruction et que soixante ou cent vingt heures de travail seraient nécessaires, mais il m'a expliqué qu'il viendrait à bout de son bâtiment en six heures de bulldozer - je vous laisse imaginer ce qu'il compte faire des déchets. Je le comprends : où trouverait-il l'argent pour faire venir une entreprise spécialisée ? Tous les particuliers, voire les chefs de PME ou de TPE, sont confrontés à ce problème. M. le Président : Nous pourrions aussi nous interroger sur le problème de la chaîne alimentaire dans de tels locaux ! Se posent donc le problème du nombre d'entreprises concernées et celui du coût d'intervention. M. Guy JEAN : Nous en revenons toujours au même point. Le cas de ce propriétaire est très représentatif : lorsqu'il a acheté son exploitation, personne ne se préoccupait de l'amiante, d'autant que le fibrociment était employé dans toutes les régions de France, en particulier pour les bâtiments d'élevage. Aujourd'hui, on lui demande d'y faire passer son bénéfice de dix ans ! Il est donc coincé ! Si aucune aide ne lui est proposée, il est évident qu'il finira par recourir au bulldozer. Les travaux de maintenance du « secteur 3 » constituent un autre problème et j'en reviens à la qualité du diagnostic, car les opérateurs de corporations comme les plombiers, les chauffagistes ou les électriciens sont souvent confrontés à l'amiante et s'exposent à de graves maladies professionnelles. M. Roger PIOTTO : La seule procédure intégrant l'analyse de risque est le repérage avant travaux mais celui-ci n'apporte pas les préconisations que contient le DTA. Il faut par conséquent que tous les documents intègrent l'analyse de risques et les recommandations au propriétaire. Hormis sur les petits chantiers, entre l'entreprise de maintenance et le maître d'ouvrage, intervient toujours le même acteur qui conçoit les travaux et établit le cahier des charges : le maître d'œuvre. En cas de contestation judiciaire, sa responsabilité sera recherchée. M. le Président : Je vois deux problèmes. Premièrement, il faut rechercher une graduation, une souplesse. M. Roger PIOTTO : Absolument. M. le Président : Deuxièmement, personne ne sait combien d'entreprises sont concernées. M. Guy JEAN : Pour la maintenance, toutes les entreprises non qualifiées du bâtiment sont concernées. M. Michel PARIGOT : Le problème ne saurait être résolu par le seul biais de la maîtrise d'œuvre car il n'y a pas de maîtrise d'œuvre sur les petits chantiers. La solution passe surtout par la sensibilisation et la formation des ouvriers du bâtiment, de préférence à l'extérieur de leur entreprise. Le problème du coût se posait rarement pour l'amiante friable parce que les résidences des particuliers ne sont pas souvent pourvues de flocages et autres calorifugeages, si ce n'est dans de grands immeubles où tous les balcons étaient floqués pour des raisons d'isolation phonique. Il est alors très difficile d'appliquer la réglementation car les copropriétaires n'ont pas suffisamment d'argent, il faudrait vider les appartements et la conception technique des travaux se révèle extrêmement complexe. Des problèmes de ce type surgiront en très grand nombre, dès lors que nous passerons à l'amiante non friable car énormément de particuliers seront concernés. M. Christian COCHET : Je pense moi aussi qu'il faut renforcer la qualification pour l'amiante non friable. S'agissant des professionnels du bâtiment exposés à de l'amiante au cours de travaux fortuits, nous sommes face à un défi majeur, pour lequel il n'existe pas vraiment de solution pratique. Le même problème se pose, du reste, pour l'exposition au plomb, qui comporte des risques du même ordre. L'information et la formation constituent la base de la réponse, à condition que les programmes soient rigoureux et très volontaristes. Cela doit faire partie de l'apprentissage de la pratique professionnelle dispensée durant la formation initiale. Pour les opérateurs en activité, c'est plus difficile, d'autant que, contrairement aux sociétés agissant en atmosphère confinée, il s'agit le plus souvent d'entreprises unipersonnelles, d'artisans, qui échappent, pour partie, aux programmes de formation. Faire passer ces messages, créer des réflexes constitue un vrai enjeu. M. le Rapporteur : Ne conviendrait-il pas d'organiser une vraie campagne d'information à destination du public ? Toutes les exploitations agricoles et d'innombrables maisons de France sont pourvues de tôles ondulées en fibrociment. Les entreprises amenées à intervenir sur de l'amiante non friable, sans aller jusqu'à la combinaison de cosmonaute, ne devraient-elles pas faire porter un masque et des gants à leurs ouvriers ? Le Président et moi-même attendons vos propositions. M. Ghislain BRAY : Dans l'établissement d'enseignement technique où j'ai enseigné, tous les ateliers sont couverts en amiante-ciment - ce qui représente une surface totale de 15 000 à 20 000 mètres carrés - et des centaines d'élèves s'en sont donnés à cœur joie, au cours de leur formation, pour remplacer des tôles tombées. Des cas de cancer étant apparus dans l'établissement, je suis intervenu sur ce sujet. Dans les derniers référentiels de diplômes du secteur du bâtiment et des travaux publics, qui datent de 2000, aucune information ou formation concernant l'amiante n'est encore proposée. Et pourtant, ces jeunes sont envoyés dans les entreprises auxquelles il sera demandé d'intervenir sur l'amiante non-friable. Mme Catherine GÉNISSON : Quel message voulons-nous faire passer ? L'application du devoir de précaution et la volonté de désamianter ? Mais quelles conséquences une telle campagne d'infirmation pourrait-elle avoir sur les comportements individuels ? Soyons très vigilants : les conséquences risquent d'être pires que mieux. M. le Président : Je suis effectivement toujours très prudent lorsqu'il est question d'organiser une campagne d'information vers le grand public, les conséquences étant très difficiles à maîtriser. En ce qui concerne les référentiels de formation, MM. Bray et Cochet ont parfaitement raison. M. Michel HÉRY : Il est très difficile de former et d'informer les TPE et les artisans. L'INRS mène des actions préliminaires en procédant à des interviews pour essayer de déterminer les médias par lesquels l'information passerait le mieux et quelle doit être sa teneur. Lorsque nous reviendrons devant votre mission, en septembre ou octobre, j'espère que nous serons en mesure de vous présenter les résultats de ces actions. M. le Président : Nous avons en effet prévu d'organiser des auditions à ce propos. M. Laurent MARTINON : La solution au problème passe par la formation et par une amélioration des DTA. Cependant, ceux-ci n'inventorient absolument pas l'amiante contenu dans les parties privatives, pour une raison que j'ignore. Or énormément d'appartements HLM sont revêtus de dalles de sol amiantées, lesquelles ne peuvent être détectées à l'occasion d'une vente, puisque ces logements appartiennent au parc locatif. M. Michel PARIGOT : Lors de l'élaboration du décret de 2001, nous nous sommes mobilisés pour lever cet obstacle concernant les parties privatives du parc HLM, mais le ministère du logement a fait barrage. Le repérage de l'amiante ne doit pas être limité aux cessions immobilières mais généralisé, dans une optique de maîtrise du risque. Je n'hésite pas à me répéter. M. le Président : Il est dans votre tempérament d'insister sur les idées qui vous sont chères, mais croyez bien que, pour notre part, notre qualité d'écoute est optimale. M. Michel PARIGOT : Il est très positif que l'INRS conduise une étude sur la meilleure façon de faire passer le message. Je ne crois pas trop que l'information puisse être nuisible et susciter des mouvements de panique. Il s'agit simplement de sensibiliser les propriétaires et les intervenants, sachant que toute prise de précaution supplémentaire entraîne un coût. Par ailleurs, dans le bâtiment, il faut savoir que la prise de risque est valorisée et qu'il est par conséquent plus compliqué de faire passer des messages de prudence que dans d'autres secteurs. Porter un masque, au demeurant, est aussi une contrainte au quotidien. C'est pourquoi une formation efficace passe par des actions sur le terrain, plutôt que par la diffusion de guides. M. le Président : Cette table ronde a été extrêmement intéressante et je vous en remercie très chaleureusement. Nous avons fait le tour du problème et des pistes intéressantes ont été tracées. Nous mesurons bien l'ampleur du problème. Si nous avons oublié certains points, je vous demande de nous faire parvenir une note complémentaire. M. Roger PIOTTO : Je souhaite mentionner le problème de l'assurance. Aucun assureur français n'accepte plus de prendre en charge des personnels démarrant leur activité pourtant valablement formés. Nous sommes donc contraints de nous tourner vers des assureurs anglo-saxons. Dans ce désengagement, je vois une contradiction. M. le Président : Nous avions identifié le problème et il est prévu que nous le traitions au cours de nos travaux. M. Guy JEAN : Je soutiens totalement les propos de M. Piotto, la grande majorité des entreprises de désamiantage rencontrant d'énormes difficultés pour se faire assurer et n'ont d'autre solution que de se faire couvrir par des compagnies étrangères, ce que je réprouve. Les assureurs acceptent pourtant de couvrir des entreprises qui s'exposent davantage que les structures spécialisées. M. le Président : Le problème est maintenant identifié et nous engagerons une réflexion sur ce point. Je vous remercie encore pour vos contributions, qui nous permettront de progresser vers des propositions concrètes. Audition conjointe de M. Michel RICOCHON, chef de la mission d'animation des services déconcentrés de la Direction des relations du travail et de M. Jacques LE MARC, inspecteur du travail à Nantes Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Nous recevons aujourd'hui M. Michel Ricochon, chef de la mission d'animation des services déconcentrés de la Direction générale des relations du travail, et M. Jacques Le Marc, inspecteur du travail à Nantes. Ils vont nous parler du contrôle exercé par l'inspection du travail sur le respect de la réglementation relative aux chantiers. Vous intervenez dans le cadre d'une première série d'auditions consacrées à la gestion de l'amiante résiduel. Après avoir entendu les administrations compétentes ainsi que les différents acteurs du diagnostic et du désamiantage, nous nous intéressons maintenant au contrôle de la réglementation. M. Michel RICOCHON : Je suis affecté depuis un an à une mission transversale d'appui et d'animation de l'inspection du travail. Précédemment, j'ai été inspecteur du travail pendant une dizaine d'années, puis directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pendant une autre dizaine d'années. M. Jacques LE MARC : Inspecteur du travail depuis quatorze ans, j'appartiens au service depuis vingt-deux ans, puisque j'exerçais auparavant les fonctions de contrôleur du travail. M. Michel RICOCHON : Lorsque j'étais inspecteur du travail, dans les année 80, l'amiante était un risque chimique comme un autre et nous ne prenions pas de précautions spécifiques car nous ne disposions ni du recul ni de l'appréciation scientifique aujourd'hui disponibles. Maintenant l'inspection du travail a évidemment une autre approche : nous sommes passés de principes généraux de prévention à une réglementation draconienne tendant à interdire l'utilisation de l'amiante et à assurer le traitement de l'amiante résiduel. Les connaissances, la réglementation et l'approche ont petit à petit été approfondies. Ces éléments de contexte sont importants. Du reste, si la France a interdit la production et la mise sur le marché d'amiante en 1996, la législation européenne n'a été clarifiée que le 1er janvier 2005. Et, au niveau mondial, nous avons eu un très fort contentieux avec le Canada : la dangerosité particulière de l'amiante, qui paraît une évidence en France, n'est pas une réalité partout. Il a fallu démontrer à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en s'appuyant sur les travaux de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), que la France ne cherchait pas à créer une barrière économique à l'importation d'amiante produit aux Canada ou en Russie, mais que la santé des travailleurs était en cause. L'inspection du travail, dans sa mission de protection des travailleurs vis-à-vis de l'amiante, dispose d'une assise réglementaire. Les premiers éléments de réglementation datent de 1977 mais il y a un avant et un après 1996. Entre ces deux dates, les exigences ont été progressivement durcies, avec une décroissance de la valeur limite d'exposition. Au final, l'adoption de la directive de 2003, qui prévoit l'interdiction totale de l'amiante, dans toute l'Europe, à compter du 1er janvier 2005, est due à l'engagement de la France. M. Jacques LE MARC : J'ai surtout eu à faire appliquer les textes de 1996, qui contiennent des dispositions très exigeantes concernant l'amiante résiduel : normalement, toute activité de fabrication ou de transformation d'amiante est interdite depuis le 1er janvier 1997. Les problèmes qu'est amenée à traiter l'inspection du travail concernent donc l'amiante résiduel, c'est-à-dire des interventions sur des matériaux contenant de l'amiante, des opérations de retrait ou de confinement d'amiante, ou encore des travaux de maintenance au cours desquels des travailleurs, à un moment ou l'autre, sont en contact avec des matériaux amiantés. Notre principal moyen d'information est le plan de retrait ou de confinement Nous recevons bien des plans de retrait mais nous sommes persuadés que des chantiers restent inconnus de nos services. J'ai notamment le souvenir d'un chantier de retrait de plaques de fibrociment sans plan de retrait ni protection des ouvriers - j'avais d'ailleurs été informé par l'un d'eux. Il faut cependant distinguer entre deux types de retraits. Les chantiers portant sur de l'amiante friable, en particulier des calorifugeages ou des flocages, sont les plus dangereux pour les travailleurs car ce sont ces matériaux qui libéreront le plus de fibres dans l'atmosphère. L'entreprise doit alors être qualifiée : on peut espérer qu'elle soit sérieuse et dotée de personnel compétent, de fait, généralement, la réglementation est plutôt bien respectée. En revanche, pour les matériaux non friables contenant de l'amiante, notamment les toitures en fibrociment, les canalisations, les ardoises ou les dalles, toute entreprise de bâtiment ou de démolition peut intervenir. Le plan de retrait est obligatoire pour le retrait des matériaux friables comme non friables. Mais, si pour les matériaux friables la réglementation est globalement respectée, pour les non-friables, nous recevons des plans de retrait qui sont bien souvent formels et pas vraiment adaptés au chantier : le copier/coller a fonctionné, seules changent les références du chantier. En pratique, la procédure et les techniques à respecter seront ignorées. Toujours pour les matériaux non friables, nous demandons systématiquement que nous soient communiquées avec le plan de retrait les attestations de formation des salariés. Cette formation est moins exigeante que pour le friable mais n'est pas toujours assurée. Il est non seulement indispensable de connaître les risques liés à l'amiante mais aussi de savoir revêtir convenablement un équipement de protection individuelle, la protection individuelle étant obligatoire, dès lors qu'il est impossible de garantir la protection collective. Cet équipement se compose d'une combinaison étanche, de surbottes et d'une protection respiratoire, totale pour l'amiante friable, plus allégée pour l'amiante non friable. Est également requise une fiche d'aptitude médicale indiquant expressément l'absence de contre-indication au retrait d'amiante. Nous sommes déjà satisfaits lorsqu'un plan de retrait nous a été adressé car nous pouvons alors demander au chef d'entreprise de rectifier tel ou tel point - par exemple si nous constatons que des ouvriers retirent de l'amiante sans équipement de protection individuelle, sans formation ou sans aptitude médicale -, faute de quoi nous arrêterions les travaux. D'ailleurs, la notification de cette mesure est le plus souvent inutile car la menace suffit à faire réagir l'entrepreneur. En revanche, faute de plan de retrait, aucune observation ne peut être émise. Or, d'expérience, nous savons que des chantiers de retrait d'amiante non friable sont conduits sans plan de retrait ni respect des procédures, ce qui est de nature à éveiller quelque inquiétude quant à la protection des travailleurs. Nous disposons néanmoins d'autres sources d'information. Lorsque des voisins constatent que des plaques en fibrociment sont retirées ou que des sacs marqués du symbole « amiante » sont transportés, ils s'inquiètent et nous alertent. De même, le salarié qui craint pour sa santé car son employeur ne lui donne pas tous les moyens de se protéger peut être amené à nous contacter. Il n'en demeure pas moins que des chantiers échappent à toute information et à tout contrôle. M. le Rapporteur : Vous n'avez pas évoqué la politique d'usage contrôlé de l'amiante qui a été suivie pendant un temps. M. Michel RICOCHON : La dangerosité de l'amiante, dans un premier temps, était connue mais insuffisamment armée sur le plan scientifique. L'usage contrôlé de l'amiante a donc tout d'abord été la règle. Puis, à partir de la fin des années 1980, la connaissance scientifique a énormément évolué et des mesures radicales se sont imposées : les valeurs limites d'exposition sont passées de 2 fibres à 0,1 fibre par centimètre cube et l'amiante a été interdit. Ces mesures ont été prises à la suite d'un travail énorme de l'INSERM, qui a procédé à l'analyse de 1 200 études scientifiques. Mais je ne souhaite pas m'étendre davantage sur le passé. M. le Rapporteur : Nous n'avons effectivement pas souhaité nous lancer dans une monographie historique dans la mesure où nous sommes davantage préoccupés par le présent et l'avenir. Cela dit, dès lors que nous aborderons la dimension pénale du sujet, il sera difficile de faire abstraction du passé. J'ajoute que les syndicats ont participé à la politique d'usage contrôlé de l'amiante. M. Michel RICOCHON : Cette politique faisait l'objet, je crois, d'un relatif consensus national. M. le Président : L'amiante non-friable pouvant très vite devenir friable, cette distinction est-elle appropriée ? L'existence d'un plan de retrait vous apporte des moyens de contrôle mais il est clair que, dans bien des cas, aucun document de ce type n'existe, en particulier pour les travaux effectués par les petites entreprises des secteurs du bâtiment ou de l'entretien. Je pense notamment à la multitude de toitures en fibrociment, notamment en milieu rural. Lors de la table ronde de la semaine dernière, on nous a d'ailleurs raconté l'histoire d'un petit éleveur de poulets qui envisageait purement et simplement de raser au bulldozer un bâtiment en fibrociment fortement dégradé. M. Michel RICOCHON : Il arrive même que cet amiante-ciment soit récupéré pour combler les chemins... M. Jacques LE MARC : Notre direction départementale a demandé aux mairies de la Loire-Atlantique de bien vouloir l'informer des permis de démolir portant, selon toute vraisemblance, sur des toitures en fibrociment ou au autres matériaux contenant de l'amiante, afin que nous puissions adresser systématiquement au propriétaire un courrier lui rappelant ses obligations, en termes de repérage, de diagnostic et de remise de ces informations à l'entreprise intervenante. Par la suite, nous devrions logiquement recevoir les plans de retrait. Le problème est que nous constatons un écart énorme entre le nombre de permis de démolir et le nombre de plans de retrait. M. le Président : Cette piste concernant les permis de démolir est très intéressante - nous en entendons parler pour la première fois. Et que pensez-vous de l'amiante résiduel dans les processus de production ? M. Michel RICOCHON : Entendez-vous par là qu'il pourrait rester de l'amiante dans l'industrie, alors que cette matière n'est plus produite ni distribuée depuis 1977ou que les entreprises possèdent encore des stocks ? M. le Président : Oui, par exemple dans des fours ou des goulets de refroidissement. M. Jacques LE MARC : Nous avons parfois connaissance de plans de retrait dans l'industrie, mais rarement. M. le Président : Je connais par exemple une usine de 500 salariés où l'amiante est encore présent dans le processus de fabrication et où je ne suis pas sûr qu'il existe un plan de retrait. Dans de tels cas, l'inspection du travail reçoit-elle des informations ? M. Jacques LE MARC : Si l'amiante n'est pas détérioré, l'entreprise n'a pas obligation de le retirer et nous ne sommes donc pas tenus au courant. Nous ne sommes informés que si des fibres sont libérées dans l'atmosphère. M. le Président : Ne faut-il pas en conclure qu'il existe des zones grises ? M. Michel RICOCHON : C'est un point d'interrogation, en effet. M. le Président : Sur le sujet, les rapports avec les organisations syndicales ne sont pas commodes. M. Michel RICOCHON : Pour revenir à la distinction entre amiante friable et non friable, il convient de rappeler la réalité à laquelle nous avons été confrontés en 1996-1997, lorsque nous avons commencé à travailler sous le régime de la nouvelle réglementation. Premièrement, si la même exigence avait été posée pour l'amiante friable et non friable, il aurait été impossible de répondre à la demande, eu égard au faible nombre d'entreprises dotées de personnel qualifié. Face à un risque difficile à appréhender dans sa globalité, une montée en charge des entreprises qualifiées a été nécessaire. Deuxièmement, la mise en œuvre de tout l'arsenal de protection, très contraignante, génère des surcoûts importants. Dès lors, une question se pose : le risque peut-il être jugulé sans que tous ces moyens soient mobilisés ? Troisièmement - mais cet argument peut paraître spécieux -, si, en toutes circonstances, des contraintes individuelles trop lourdes sont imposées aux salariés au regard du risque qu'ils perçoivent, ils prendront eux-mêmes des libertés avec la sécurité et perdront leurs réflexes face au friable. M. le Président : C'est vrai ! M. Michel RICOCHON : Il n'en demeure pas moins que de l'amiante non friable peut devenir friable selon la façon dont il est agressé. Une colle de dalle vinyle, une fois poncée, devient, en effet, friable. Mme Martine DAVID : Vous nous avez dit que, « normalement, toute activité de fabrication ou de transformation d'amiante est interdite depuis le 1er janvier 1997 ». L'adverbe m'inquiète un peu ; une certitude serait préférable. Par ailleurs, quelle est la nature de la formation à laquelle les contrôleurs et les inspecteurs du travail sont astreints pour être capables d'intervenir sur les chantiers de désamiantage et de les contrôler efficacement, en dialoguant avec les chefs d'entreprise et en gagnant la confiance des salariés ? M. Jacques LE MARC : Ma remarque sur l'interdiction de l'amiante ne comportait aucun sous-entendu ; je n'ai jamais rencontré d'entreprise fabriquant ou transformant de l'amiante, et j'ai le sentiment que cela ne se fait plus. Nous recevons une formation continue tout au long de notre carrière. S'agissant de l'amiante, j'ai suivi un module de trois jours sur les textes réglementaires, les risques, les différents types de matériaux, la méthode pour contrôler les chantiers et surtout le port des équipements de protection individuelle (EPI). J'ai ainsi appris à m'équiper, ce qui m'a servi lorsque j'ai été amené à contrôler un très gros chantier, avec le passage dans plusieurs compartiments pour entrer en zone contaminée et surtout pour en sortir. L'équipement doit être parfaitement hermétique. Quant à la sortie, elle implique le passage par un tunnel à cinq sas : on aspire la poussière avec un appareil à filtre absolu ; on se douche avec tout l'équipement ; on ôte la combinaison et les chaussures ; on prend une douche corporelle avec le masque de protection respiratoire ; on pénètre dans le vestiaire. Pour certains collègues, ces obligations provoquent de l'appréhension. Mme Martine DAVID : Suivre un tel module est-il obligatoire ? M. Jacques LE MARC : Non, c'est un choix, mais fortement conseillé - selon moi, c'est même incontournable -, car nous sommes tous susceptibles de contrôler un jour un chantier de désamiantage. Mme Martine DAVID : J'imagine que cela renforce la crédibilité vis-à-vis du chef d'entreprise ? M. Jacques LE MARC : C'est certain. En revanche, je n'entrerai jamais en zone contaminée si je ne suis pas équipé correctement. M. Michel RICOCHON : L'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'INTEFP, s'est fortement mobilisé, en 1996-1997, pour mettre des formations sur pied. Puis l'accent a été mis sur d'autres sujets. Depuis deux ans, nous centrons de nouveau notre activité sur l'amiante et nous cherchons à moderniser notre offre de formation, ce qui nous a conduits à former de nouveaux formateurs. Cet effort doit être couplé aux campagnes. En 2004, plusieurs campagnes sur l'amiante ont constitué des moments de mobilisation intenses et ont agi comme autant de piqûres de rappel. Par ailleurs, une campagne européenne est programmée pour 2006. En outre, dans le cadre du « Plan santé au travail », le PST, qui court sur la période 2005-2009, nous avons renforcé les formations en santé et sécurité, notamment sur l'amiante. D'autre part, sur la période 2005-2007, l'inspection du travail met en place des cellules régionales pluridisciplinaires, pourvues d'ingénieurs de prévention et de médecins supplémentaires, afin de créer une force de frappe d'expertise technique. Sur un tel sujet, formation, appui et animation constituent un tout. M. le Rapporteur : Lorsque vous intervenez sur un chantier dépourvu de plan de retrait, que se passe-t-il ? M. Jacques LE MARC : Si cela arrivait, je notifierais immédiatement un arrêt des travaux, sans aucun état d'âme, car cela signifierait que les risques n'ont pas été évalués, c'est-à-dire qu'il a été impossible de déterminer le processus le plus adapté pour protéger les travailleurs : c'est la santé de travailleurs qui est en jeu. Je l'ai d'ailleurs déjà fait pour un chantier de toiture sur lequel les ouvriers n'étaient pas dotés d'équipements de protection individuelle. M. le Président : Possédez-vous des statistiques nationales sur les arrêts de travaux ? M. Michel RICOCHON : Les chiffres peuvent apparaître faibles : trente arrêts de chantier en 2000, vingt en 2001, trente en 2002, quinze en 2003. Il faut dire que l'arrêt de chantier se passe la plupart du temps de manière informelle : l'inspecteur du travail se contente de dire « stop » et l'entreprise obtempère, sans entrer dans une procédure, en s'arrangeant pour mettre en œuvre au plus vite les mesures adéquates. M. Jacques LE MARC : C'est la même problématique que pour le risque de chute de hauteur : je demande souvent aux ouvriers d'arrêter de travailler tant que leur échafaudage n'est pas conforme, sans pour autant notifier un arrêt de travaux sur l'imprimé officiel, ce qui alourdirait la procédure. C'est toujours efficace car cela entraîne un coût pour l'entreprise, et, si elle ne se plie pas à mes demandes, je dresse un procès-verbal. Pour l'amiante, c'est pareil : si je m'aperçois que le plan de retrait ne mentionne pas l'aptitude médicale des ouvriers, je demande à l'entreprise de m'apporter la preuve qu'ils ont passé les examens médicaux requis. Je peux formuler en amont des observations analogues concernant les équipements de protection individuelle. Si une entreprise commençait les travaux sans avoir tenu compte de mes remarques, j'en arriverais probablement au procès-verbal, considérant qu'elle aurait eu le temps de prendre les mesures nécessaires pour respecter la réglementation. Peu de collègues osent pénétrer en zone contaminée par de l'amiante friable, et, de fait, ce n'est pas indispensable. Cela m'est arrivé au tripode de Nantes, deuxième chantier de désamiantage de France, qui a duré dix-huit mois, et je n'ai pas identifié de gros problèmes. C'est en amont qu'il faut intervenir, en examinant le plan de retrait, en interrogeant le chef d'entreprise, en vérifiant les équipements de protection individuelle et la formation du personnel, voire en procédant à un test de fumée pour vérifier la qualité du confinement. Si tout cela est verrouillé, il ne me semble pas nécessaire d'aller en zone contaminée, à moins qu'un salarié ne nous alerte à propos d'un problème. M. Michel RICOCHON : En 1996, 47 chantiers ont été arrêtés, c'est-à-dire le même ordre de grandeur qu'aujourd'hui. Depuis 1997, les indications sont plus précises : en 1997, 950 chantiers visités, 1 400 observations et 120 arrêts de chantier ; en 1998, plus de 1 500 chantiers visités ; en 2000, 615 chantiers visités, 30 arrêts de chantier ; en 2001, 7 000 observations, 100 procès-verbaux, 20 arrêts de chantier ; en 2002, 6 600 observations, 70 procès-verbaux, 30 arrêts de chantier. Bref, l'activité est forte mais il est rare de devoir recourir à l'arme de l'arrêt de chantier. M. le Rapporteur : Ces arrêts de chantier concernent-ils de l'amiante friable ou non friable ? M. Michel RICOCHON : Ces années-là, il s'agissait, pour l'essentiel, d'amiante friable. M. le Président : Vous nous communiquerez bien évidemment ces chiffres. M. Michel RICOCHON : Bien entendu. M. le Président : Ces statistiques laissent entendre que des moyens importants sont mobilisés. Mais sont-ils à la hauteur de l'enjeu ? Les petits chantiers sont difficilement identifiables, ce qui implique un travail d'une autre nature, avec parfois l'utilisation d'informations indirectes. M. Jacques LE MARC : Non, nous ne disposons pas de moyens suffisants. Nous contrôlons également les produits CMR, c'est-à-dire cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, aussi dangereux que l'amiante, ainsi que le travail des jeunes sur les machines dangereuses ou les chantiers du bâtiment, sans compter nos fonctions administratives. L'amiante, activité à risque, n'est donc qu'une infime partie de notre travail. Nous aimerions nous en soucier plus souvent mais nous n'en avons pas les moyens. Lorsque nous menons une campagne, les entrepreneurs s'aperçoivent qu'il se passe quelque chose et sont sensibilisés au problème : il faudrait développer ces actions. De surcroît, tous les plans de retrait ne donnent pas lieu à un contrôle sur chantier. M. le Président : Votre réponse ne m'étonne pas. Mais la sensibilisation par les branches professionnelles ne constitue-t-elle pas une approche à creuser ? M. Michel RICOCHON : Il convient en effet de s'appuyer sur les branches professionnelles, en particulier celle du bâtiment. Soyez rassurés, nous travaillons aussi avec la caisse régionale d'assurance maladie ou l'OPPBTP, l'Office professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Mais la temporalité s'allonge et il n'est guère évident de maintenir la mobilisation de tous : l'essentiel est donc d'agir sur le terrain, quotidiennement, pour limiter l'exposition des salariés, d'autant que, depuis les études de l'INSERM publiées en 1996, il semble que des expositions faibles peuvent être dangereuses. Le cas de la tour Montparnasse a été monté en épingle par la presse, mais l'inspection du travail le connaissait bien et était régulièrement amenée à intervenir sur ce site. Il importe surtout de continuer à porter une attention constante à tous les travaux de maintenance car c'est à ce niveau que se posent les problèmes. À l'échelon européen, compte tenu du danger, certains pays ont d'abord recommandé de tout enlever. D'autres, dont la France et l'Allemagne, se sont opposés à cette solution radicale, non seulement pour un problème de coût mais surtout pour ne pas recréer des foyers de diffusion de l'amiante en suscitant l'ouverture de chantiers innombrables, sans disposer de la force de frappe suffisante en entreprises et en salariés qualifiés. Il a donc été choisi d'entrer dans un processus long d'enlèvement de l'amiante résiduel au fur et à mesure des travaux de maintenance et de réhabilitation. M. le Rapporteur : Lorsque l'intervention d'une entreprise de désamiantage certifiée n'est pas obligatoire, par exemple pour retirer du fibrociment ou des tôles ondulées, quel équipement de sécurité préconisez-vous ? Ne convient-il pas de rendre obligatoire un appareillage intermédiaire entre la combinaison de cosmonaute et rien du tout ? Lorsqu'une décision de retrait a été prise, quelles fibres de substitution recommandez-vous aux entreprises ? M. Jacques LE MARC : Il nous est donné de rencontrer des ouvriers qui nous objectent qu'ils ont travaillé pendant des années sans protection. Nous leur rétorquons que, pendant toutes ces années, ils ont peut-être inhalé de l'amiante sans le savoir et qu'ils doivent maintenant se protéger. Avec mes collègues, nous nous demandons s'il ne faudrait pas exiger que toutes les entreprises soient certifiées, qu'elles retirent de l'amiante friable ou non friable, car de l'amiante non friable peut devenir friable : quand une toiture est retirée, des plaques usées et dégradées tombent au sol et sont sciées. Le chef d'entreprise du bâtiment est-il en mesure, tout seul, d'évaluer convenablement les risques ? Je m'interroge. M. Michel RICOCHON : J'émettrai un avis un peu différent : si la barre est placée trop haut pour les maîtres d'ouvrage, le phénomène de sous-déclaration risque de se généraliser et le nombre de plans de retrait se ferait encore plus rare. S'agissant de nos effectifs, nos deux ministres de tutelle se sont exprimés il y a quelques mois. Nous avons 1 330 à 1 350 agents de contrôle alors que, pour le seul champ santé et sécurité du travail, il nous en faudrait 2 000 pour atteindre le même niveau que nos voisins européens. Et il faut savoir que, dans notre pays, les inspecteurs et contrôleurs sont des généralistes, compétents sur bien d'autres sujets. Les négociations budgétaires pour 2006 ne sont pas encore tout à fait terminées mais j'ai l'impression que nous ne ferons pas un pas significatif. M. Jacques LE MARC : Sur les fibres de substitution, je suis un peu démuni, d'autant que les fibres minérales artificielles, plus précisément les fibres céramiques réfractaires, sont également cancérogènes et par conséquent soumises au décret de février 2001 sur les produits CMR. M. le Président : Pour la diffusion de l'information, travaillez-vous de concert avec les organisations syndicales ? Celles-ci vous sollicitent-elles ? À votre connaissance, existe-t-il des études scientifiques et techniques analysant le degré de dangerosité des matériaux contenant de l'amiante non friable ? M. Michel RICOCHON : Je n'ai pas entendu parler d'études particulières sur ce sujet. Il est cependant certain que la distinction est contestable dans la mesure où, en fonction des conditions d'intervention, le matériau non friable peut devenir friable. Je n'ai jamais eu non plus connaissance de sollicitations insistantes des services déconcentrés de la part des organisations syndicales sur le sujet de l'amiante. Mais l'ensemble des partenaires sociaux y prête une grande attention dans le cadre du Conseil supérieur des risques professionnels. M. Jacques LE MARC : Pour ma part, il m'est simplement arrivé de recevoir des membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) s'inquiétant de savoir si leur patron avait fait réaliser un diagnostic amiante. Mme Martine DAVID : Je regrette que la mobilisation des organisations syndicales soit aussi limitée. M. le Rapporteur : Avez-vous déjà été sollicités par des travailleurs constituant leur dossier en vue de toucher l'ACAATA, l'allocation de cessation anticipée d'activité du travailleur de l'amiante ? Votre intervention a-t-elle alors des limites ou êtes-vous parfaitement libres d'établir des certificats établissant que la personne a travaillé dans une même entreprise ayant changé de dénomination ou dans plusieurs entreprises, où elle a été au contact de l'amiante ? M. Jacques LE MARC : N'ayant pas le souvenir d'avoir jamais été sollicité par une personne désireuse de constituer un dossier en vue d'une cessation anticipée d'activité, je suppose que les intéressés s'adressent à d'autres administrations. Le ministère nous a cependant interrogés pour fixer la liste des entreprises ayant utilisé de l'amiante. M. Michel RICOCHON : En ce qui me concerne, il m'est arrivé d'être saisi, mais je ne me souviens plus si j'étais alors inspecteur du travail ou directeur départemental. Le problème principal est celui de la disparition des entreprises, compte tenu des temps d'exposition extrêmement longs et, au contraire, de la durée de vie limitée des entreprises. Même si la mémoire de l'exposition est désormais gérée par le médecin inspecteur régional du travail, dès lors que bien des entreprises ont déposé leur bilan et ont été complètement liquidées, les attestations reposent sur des recoupements assez fragiles. M. Jacques LE MARC : En Loire-Atlantique, nous sommes pratiquement sûrs que l'amiante a été utilisé dans les entreprises de deux secteurs d'activité : la réparation navale et la construction navale. Après, tout dépend de l'âge des salariés et des périodes où ils y ont été employés. M. le Rapporteur : Je connais un inspecteur du travail qui a participé à la reconstitution de la mémoire d'une entreprise qui avait changé de dénomination. Par ailleurs, intervenez-vous dans le monde des ports et docks ? M. Jacques LE MARC : Non ; ils relèvent des affaires maritimes, hormis pour certaines professions. La construction navale, en revanche, ne nous échappe pas. M. Jean-Marie GEVEAUX : Les entreprises de désamiantage parviennent-elles facilement à recruter des personnels qualifiés ? M. Jacques LE MARC : Sur le gros chantier de désamiantage que j'ai suivi, quarante ouvriers travaillaient simultanément et le chef d'entreprise ne m'a pas fait part d'une quelconque difficulté à trouver du personnel qualifié. Et, pour les interventions sur de l'amiante non friable, aucune compétence particulière n'est requise. M. Michel RICOCHON : Dans la mesure où les entreprises sont certifiées et en nombre limité - il y en a environ 70 -, le marché est captif et les coûts sont moins pressurés qu'ailleurs : il est par conséquent possible de fidéliser les salariés grâce à un surcroît de rémunération. Celui-ci est au demeurant nécessaire pour motiver les travailleurs à intervenir en zone contaminée. M. le Président : On nous a dit qu'il existait une centaine d'entreprises de désamiantage. Avez-vous une idée du nombre de salariés qu'elles emploient ? M. Michel RICOCHON : Franchement, non. M. le Président : Pourriez-vous faire cette recherche ? Ce serait intéressant. M. Jacques LE MARC : Absolument. Je pense qu'une fois qu'une entreprise a recruté et formé un salarié, elle cherche à le fidéliser. En effet, un salarié formé entre dans la zone confinée et en ressort avec une aisance étonnante, qui incite l'entreprise à vouloir le conserver. M. Michel RICOCHON : On peut dire également que si dans les entreprises du bâtiment classiques, la pression sur les coûts rend les salaires extrêmement bas, pour les entreprises de désamiantage, la réalité est différente. M. le Rapporteur : Les entreprises ont-elles signé des conventions collectives ? Si oui, celles-ci prennent-elles en compte la pénibilité de la tâche ? M. Michel RICOCHON : Les entreprises n'ont pas signé de convention collective. Par contre, nous avons noté qu'elles se sont structurées dans une sorte de sous-branche professionnelle, autour d'un syndicat professionnel unique qui affiche une politique claire, notamment en matière de charte de qualité. M. le Président : C'est le Syndicat de retrait et de traitement de l'amiante et des autres polluants (SYRTA) que nous avons entendu. Pour la monographie des salariés, nous nous adresserons directement à eux. M. Michel RICOCHON : Je m'étonne que vous ne nous ayez pas questionnés sur l'obligation de repérage incombant aux propriétaires. Cette obligation, faute de moyens, étant peu ou pas contrôlée par les Directions départementales de l'action sanitaire et sociale (DDASS), il arrive que des travaux soient réalisés dans des bâtiments amiantés sans aucun suivi. Nous souhaitions appeler votre attention sur ce problème car la santé des travailleurs est là encore en danger. M. Ghislain BRAY : Lors de l'instruction des dossiers d'urbanisme par les collectivités territoriales, ne serait-il pas opportun que l'amiante fasse l'objet d'une obligation déclarative ? M. le Rapporteur : L'entreprise SOBATEN nous a dit que ses salariés ne travaillaient que deux heures et demie sous combinaison, avec deux ou trois interventions par jour en milieu hostile, entrecoupées par un arrêt obligatoire. Les conditions de travail sont-elles identiques partout ? Sont-elles parfois meilleures ou, au contraire, pires ? Par ailleurs, qu'avez-vous à nous dire sur l'exposition à l'amiante des salariés des entreprises transportant des déchets ? M. Jacques LE MARC : La durée de deux heures et demie, évoquée dans un arrêté du 13 décembre 1996 relatif à la surveillance médicale des travailleurs effectuant le retrait ou le confinement d'amiante, ne concerne pas le temps de travail mais le temps de port de l'équipement individuel, habillage et déshabillage inclus : il est indiqué que celui-ci « ne devrait pas excéder deux heures trente ». Ces travaux, particulièrement durs, entraînent une contrainte cardiaque importante et, pour peu qu'il fasse chaud, personne ne tient aussi longtemps : la durée de travail doit alors être restreinte. Sur le chantier dont j'ai déjà parlé, par souci de rentabilité, les ouvriers devaient accumuler trois postes de deux heures et demie. En accord avec mon collègue ingénieur prévention de la direction départementale, j'ai considéré que cela faisait beaucoup, mais le médecin du travail, après examen du plan de retrait, a estimé que c'était faisable. M. Michel RICOCHON : En 2004, sur plus de 40 % des soixante-dix chantiers contrôlés, la durée de travail quotidienne excédait six heures. Mais l'arrêté se contente d'une recommandation. M. Jacques LE MARC : Si je constatais que la durée de port de l'équipement de protection individuelle excède deux heures et demie, je m'y opposerais, mais la formulation de l'arrêté ne contraindrait pas nécessairement l'employeur à me suivre. Les patrons savent toutefois parfaitement que leurs ouvriers, au bout de deux heures et demi, sont fatigués et doivent s'arrêter. Sur les déchets, je possède peu d'informations. L'article 23 du décret 96-98 du 7 février 1996, autant que je me souvienne, n'impose pas que le plan de retrait apporte des précisions concernant les déchets. Nous nous y intéressons cependant et nous demandons que le plan de retrait indique dans quel type de décharge seront envoyés les déchets. Ceux-ci doivent évidemment être emballés dans du polyane, avec le symbole « A » pour amiante. Nous pouvons exiger un bon de suivi pour vérifier leur acheminement mais cela ne relève plus tout à fait de notre compétence. Je note que deux contrôleurs de Loire-Atlantique ont récemment trouvé du fibrociment abandonné dans une décharge sauvage, au bord de la route. M. Michel RICOCHON : Nous contrôlons le conditionnement des déchets, leur étiquetage et leur emballage - c'est-à-dire, d'une certaine manière, leur confinement. Ensuite, en vertu du décret de 1996, l'élimination ne relève plus de la protection des travailleurs mais de l'industrie et de l'écologie. M. Jacques LE MARC : Quand nous avons connaissance d'une atteinte à l'environnement, nous la signalons au procureur de la République, mais l'intervention incombe à d'autres services. M. le Président : Je vous remercie vivement pour ces apports extrêmement utiles à notre réflexion. Table ronde sur la gestion de l'amiante résiduel · inspection générale des Finances représentée par Mme Véronique HESPEL · Assistance publique - Hôpitaux de Paris représentée par Mme Rose-Marie VAN LERBERGHE, directrice générale et M. Dominique NOIRÉ, directeur du personnel et des relations sociales · Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur représenté par M. Jean-Marie SCHLÉRET, président et Mme Marie-Hélène BOURCHEIX, chargée de mission · Établissement public du Campus de Jussieu représenté par M. Michel ZULBERTY, directeur et Mme Aline PRIGENT, responsable de la cellule désamiantage du campus de Jussieu · Comité anti-amiante de Jussieu représenté par M. Michel PARIGOT, président · RATP représentée par M. Patrick LECOCQ, chef de projet Amiante /désamiantage et M. Luc ROUMAZEILLE, responsable du département Santé/Sécurité du travail · Ville de Paris représentée par M. Jean-François DANON, directeur du patrimoine et de l'architecture, Mme Véronique LE GALL, chef du service de l'innovation et des projets techniques et M. Yves COURTOIS, responsable du bureau de la prévention des risques professionnels à la direction des ressources humaines · Ministère de la fonction publique représenté par M. Jean-Pierre JOURDAIN, sous-directeur de la gestion des ressources humaines et Mme Bénédicte RENAUD, chargée de la coordination de l'enquête interministérielle sur l'amiante dans la fonction publique Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : La mission tient aujourd'hui sa deuxième table ronde, dont le thème est « la gestion de l'amiante résiduel dans le patrimoine public ». Elle intervient dans le cadre de notre premier thème d'investigation de la mission, c'est-à-dire la gestion de l'amiante résiduel, en particulier les opérations de diagnostic, les chantiers de désamiantage et les travaux de maintenance. La mission abordera ensuite les autres aspects du dossier de l'amiante : les aspects scientifiques et médicaux, la prévention des risques, la prise en charge des victimes, les problèmes de responsabilité pénale et la gestion internationale du dossier de l'amiante. Cela nous conduira jusqu'à la fin de l'année et la mission devrait rendre ses conclusions début 2006. Nous allons d'abord entendre les représentants d'Assistance publique -Hôpitaux de Paris (AP-HP), de la RATP, de la Ville de Paris et de l'établissement public du campus de Jussieu qui vont nous faire part de leurs expériences, avant que nous en débattions. Nous aborderons ensuite les trois thèmes prévus : le repérage et l'inventaire des sites amiantés, les marchés publics de désamiantage, les travaux de maintenance. Mais nous avons ce matin de nombreux invités. Afin que nous fassions connaissance, nous allons procéder à un rapide tour de table pour que chacun se présente brièvement. (Chacun des invités se présente) M. le Président : Nous commençons la série des interventions introductives par celle de l'AP-HP. Mme Rose-Marie VAN LERBERGHE : Au cours des années 80, des enquêtes ponctuelles ont été engagées pour repérer l'amiante dans nos locaux, mais elles n'étaient pas exhaustives et ne suivaient pas de méthode stricte. Les décrets de 1996 et 1997 ont prévu un diagnostic général de présence d'amiante friable, qui a été réalisé en 1997 et 1998 pour la totalité de nos sites. Il a fait apparaître environ 34 000 m2 de ce type d'amiante, soit environ 1 % de nos surfaces bâties. Des instructions ont alors été données par le siège aux établissements pour que ces matériaux soient retirés ou confinés. Sur ces 34 000 m2, en cinq ans, deux tiers de l'amiante ont été retirés et un tiers confiné. Le diagnostic a été réalisé par le biais d'un marché public centralisé à lot unique attribué à l'Apave. Dès cette époque, nous avons assuré la traçabilité de la filière déchets. Le décret du 13 septembre 2001 a étendu les recherches à l'amiante lié et imposé la constitution d'un dossier technique amiante ainsi que l'information des occupants et des travailleurs. Nous sommes une maison de 91 000 personnes, réparties entre 39 établissements. Soumis à un rythme bureaucratique, nous avons fait comme toute autre administration et donné des instructions aux hôpitaux. Mais cela n'a pas suffi, et le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'avril 2003 a travaillé à nouveau sur cette question. Nous avons adressé des instructions plus précises en juillet, avec un reporting à respecter, et les choses ont avancé. Nous avons néanmoins procédé à une relance en 2004. C'est à cette occasion, et parce que nous effectuions le travail demandé, qu'un problème est apparu à l'hôpital Saint-Louis, dont la presse s'est fait l'écho. Je rappelle à ce propos que, à l'AP-HP, ce sont uniquement les personnels techniques qui sont touchés et que l'amiante liée ne crée de risques ni pour les malades, ni pour les visiteurs, ni pour le personnel médical, mais uniquement quand on intervient dessus. A l'hôpital Saint-Louis, les radios des poumons ont été analysées, confirmées par scanner, et on a trouvé 19 cas de plaques pleurales. Cela a provoqué une émotion légitime, qui s'est traduite par un important travail avec le CHSCT. Au cours de plusieurs heures de séance, auxquelles participait M. Parigot, ainsi que des experts, nous avons élaboré, de février à juin 2005, un plan d'action précis, qui comportait des mesures permettant d'identifier le risque, d'informer, de protéger, de recenser les expositions antérieures, d'assurer le suivi médical, d'accompagner, de prendre en charge les personnes atteintes et de s'assurer que le plan était bien exécuté de manière déconcentrée. Après des propositions très constructives des organisations syndicales, le plan d'action a été adopté le 10 juin 2005 à l'unanimité, ce qui n'est guère fréquent dans notre maison... Nous le suivons personnellement avec Dominique Noiré, de même que le groupe de suivi qui associe représentants du personnel, services techniques, direction, médecine du travail et techniciens. Nous voulons nous appuyer sur la force que représente la connaissance médicale pour assurer ce suivi. Aujourd'hui, les personnes qui interviennent à l'AP-HP le font sans s'exposer à quelque risque que ce soit. Le repérage a permis de bien identifier les zones où il y a de l'amiante : dès qu'il y en a, et même s'il y a seulement doute, il y a protection. Nous essayons d'aller plus vite que le décret ne l'exige : dès que les contrôles montrent que l'amiante est dégradé et qu'il y a des risques, le retrait est immédiat, alors que la réglementation donne trois ans pour le faire. Pour les matériaux de niveau 2, quand il n'y a pas encore de danger évident mais suspicion et nécessité de contrôle, nous imposons aux établissements de suivre cela de façon très précise et de saisir toute occasion d'intervention pour retirer l'amiante. Je précise que nous n'avons pas l'intention de tout retirer, non pas parce que c'est onéreux, mais parce que cela crée aussi des risques. L'essentiel nous paraît donc le suivi, au siège comme sur le terrain, par exemple au moyen des fiches navette dont je vous remettrai un exemplaire. J'indique enfin que nous avons des difficultés à repérer le personnel qui a été autrefois exposé à l'amiante. M. Michel ZULBERTY : À l'origine des travaux, quand un diagnostic a été fait en 1995-1996 par un bureau d'études qui repérait l'amiante friable, le campus de Jussieu représentait environ 310 000 m2 de surface hors d'œuvre nette sur 13 hectares. Conçu à l'origine pour accueillir 25 000 personnes, il en abritait 45 000. Il était occupé par trois entités : Paris VI pour 65 %, Paris VII pour 33 %, l'Institut de physique du globe pour 2 %. Les deux tiers des surfaces étaient consacrés à la recherche, le reste à l'enseignement. Le campus est composé de deux groupes de bâtiments. D'une part, les barres de Cassan édifiées par l'architecte Urbain Cassan entre 1958 et 1961, qui bordent les côtés nord et est du campus, le long du quai Saint-Bernard et de la rue Cuvier. Ces bâtiments de huit niveaux sur transparence (ou pilotis) ne contiennent pas d'amiante. D'autre part, le « gril » d'Albert, construit entre 1964 et 1972 par l'architecte Edouard Albert. Archétype de l'urbanisme de dalle, il comporte un socle de deux niveaux surmontés de deux types de bâtiments-barres à ossature métallique de cinq niveaux sur transparence, organisés en un quadrillage comportant 24 rotondes accueillant les circulations verticales et 37,5 barres. On y trouve également ce symbole qu'est la tour centrale, à l'entrée du campus. L'amiante a été utilisé sous forme friable de flocages pour la protection contre le feu des structures métalliques intérieures du gril et de la tour centrale, ainsi que comme isolant thermique ou absorbant acoustique dans le socle. Mais on le trouve aussi abondamment sous forme captive dans les dalles vinyle/amiante sur les sols, dans la colle ayant servi à fixer ces dalles, et sous forme de plaques d'amiante-ciment. En 1995, après que le diagnostic portant sur les flocages a été réalisé, des mesures de protection d'urgence ont été prises par les universités, et un plan de retrait de ces flocages a été envisagé. Des bâtiments provisoires ont été hâtivement réalisés pour pouvoir reloger les services pendant les travaux de retraits. Lancée par les services du rectorat et les universités, l'opération s'est très vite révélée d'une ampleur telle qu'il fut jugé nécessaire d'y consacrer une structure ad hoc. En avril 1997, l'établissement public du campus de Jussieu a été créé avec pour mission essentielle de désamianter le campus. Très vite, cette mission a dû être étendue à la mise en sécurité dans le cadre d'une réflexion sur l'aménagement général du site. En effet, des bâtiments conçus dans les années 60 nécessitaient une vaste campagne de mise aux normes, notamment de sécurité, qui se heurtait à deux problèmes. D'une part, leur suroccupation et d'autre part les nouveaux besoins d'aménagement résultant de l'évolution des techniques et de la science, qui conditionnent le périmètre des différents laboratoires. Pour l'aménagement général du site, il fallait connaître le calendrier, ainsi que les besoins des entités susceptibles d'être relogées, et la nature des laboratoires susceptibles d'être externalisés. À l'époque, on a pris la décision d'externaliser Paris VII, à hauteur de 40 000 m² d'abord, puis de 100 000 m², avec pour objectif, à terme, une externalisation totale de l'université. Les choses sont devenues d'autant plus compliquées que l'établissement public n'avait pas la compétence sur les activités de Paris VII ni la maîtrise d'ouvrage des bâtiments sur la zone d'aménagement concerté (ZAC) Paris-Rive gauche, ce qui a induit, à l'évidence, des problèmes de cohérence dans la maîtrise globale de l'opération. Tout cela a été relevé dans différents rapports. On a aussi beaucoup écrit à ce propos, trop sans doute, car d'un point de vue technique l'opération est plutôt exemplaire. En 1998, une première barre a été libérée, sur laquelle ont été testées les procédures et techniques qui devaient être mises en œuvre. Cela fait l'objet d'un petit film que je vous remettrai. On a fait à cette occasion plusieurs constats. Premier constat : pour enlever l'amiante il faut tout démonter. En effet, puisqu'il est floqué sur les structures métalliques, il faut mettre ces structures à nu, donc déshabiller complètement le bâtiment. Cela signifie que le chantier de désamiantage sera nécessairement suivi d'un chantier de reconstruction, que nous avons appelé « rénovation ». Deuxième constat : il faut respecter plusieurs étapes. D'abord le curage, qui consiste à déposer tous les équipements qui ne sont pas contaminés - certains, pas toujours bien intentionnés, sont venus filmer ces opérations pour montrer que nous ne prenions pas de précautions, ce qui était bien évidemment faux. Puis le confinement des locaux, sous forme statique, avec la pose de films plastiques pour rendre étanche le local qu'on va traiter, ou dynamique, en mettant le local en dépression pour éviter la dispersion des fibres. Ensuite le démantèlement et la dépose de tous les matériaux contaminés - dalles de faux plafond, épingles de chauffage, etc. Enfin l'arrachage de l'amiante par la méthode d'enlèvement à l'humide pour éviter la dispersion des fibres, ce qui suppose le recueil et le traitement des eaux. La fin du désamiantage respecte une procédure stricte qui commence par une inspection visuelle et se poursuit, 48 heures après, par des mesures au microscope électronique à transmission analytique du nombre de fibres d'amiante dans l'air. Si les résultats sont corrects, c'est-à-dire si l'on observe moins de cinq fibres par litre d'air, nous déposons le confinement, avant de procéder à de nouvelles mesures au microscope électronique à transmission analytique (META). Troisième constat : l'équipement technique qui doit entourer ces chantiers est extrêmement lourd et nécessite une organisation appropriée. On a imaginé des tours techniques, qui permettent d'accéder aux différents niveaux sans passer par les bâtiments et qui accueillent tout l'environnement du chantier - compresseurs pour l'adduction d'air, filtres, pompes. Elles accueillent aussi tout ce qui est utile à l'accès au chantier et à la sortie : sas pour les personnels et pour les matériels, sous le contrôle permanent d'un « sasman », qui surveille notamment le temps de présence des ouvriers en zone. Les personnels sont équipés de combinaisons dont l'étanchéité est vérifiée avant l'entrée en zone. Les déchets amiantés sont directement collectés dans des sacs étanches, placés dans une deuxième enveloppe dans les sas « matériel » et mis dans des « big bags », de grands sacs, avant d'être pesés et de rejoindre des conteneurs en vue du traitement des déchets. Les déchets sont triés en 3 catégories qui font chacune l'objet d'un traitement spécifique : les déchets amiantés vont à l'inertage, les déchets non décontaminables sont mis en décharge de classe 1, les déchets lavables vont en décharge classique. Aujourd'hui, sur les 190 000 m2 amiantés, 118 000 ont été traités, soit 62 %. Le calendrier des travaux de retrait a été calé sur les dates imposées par le décret du 13 septembre 2001, qui en prévoyait la fin le 1er janvier 2005. Nous avons bénéficié le 1er juillet 2004, par arrêté du préfet, d'une prorogation jusqu'au 1er janvier 2008, une nouvelle prorogation pouvant intervenir dans le cas d'opérations particulièrement complexes. Tout dépendra des décisions qui seront prises dans les jours qui viennent quant à l'avenir du campus. M. Luc ROUMAZEILLE : Je ferai une brève présentation historique avant de laisser la parole à Patrick Lecocq, qui est responsable de la mission amiante. À la RATP, l'amiante a été utilisé depuis la fin des années 50 et surtout au cours des années 1960 et 1970, en raison de ses qualités anti-feu, de friction et de traction, aussi bien dans les bâtiments que dans les matériels roulants, bus, métro et RER. La question de l'amiante s'est posée à partir de 1974. A la suite de travaux qui en montraient la nocivité, la médecine du travail de la RATP a lancé une étude qui a duré deux ans et qui a abouti à un rapport comportant un certain nombre de préconisations, qui ont largement rejoint celles du décret de 1977. Elles visaient à la neutralisation de l'amiante, à la surveillance particulière des agents exposés à des concentrations supérieures à 0,5 gramme, à un travail d'information auprès du personnel. La neutralisation a été menée de façon importante jusqu'en 1994-1995, plus de 100 millions de francs y étant consacrés. À partir de 1995, on a cherché à mesurer ce qu'on avait fait et, surtout, à dresser un véritable état des lieux. Ce travail de fond se poursuit aujourd'hui et l'éradication a été assez bien réalisée. C'est aussi à ce moment, rejoignant cette fois le décret de 1996, qu'on a mis en place la mission amiante. J'ajoute simplement que nous sommes actuellement en phase de négociations avec le personnel en vue de parvenir à un protocole sur l'indemnisation. M. Patrick LECOCQ : Je suis arrivé en 2001 à la mission amiante, qui avait été créée dès octobre 1996, quelques mois après le décret, par une note de direction. Elle a pour tâches l'expertise, le conseil, la coordination, la sécurisation des chantiers, le recensement et l'éradication de l'amiante. Elle touche toutes les branches d'activité de la RATP : bus, métro, RER, ateliers techniques et électriques. Engagé en 1997, le recensement s'est poursuivi jusqu'en 1999, mais les outils de collation des données faisaient défaut, et c'est seulement en 2001 qu'a été constituée une base de données, avec une arborescence très lourde, qui répertorie l'amiante friable - flocage, calorifugeage et faux plafonds - et non friable présent dans toutes les zones, ainsi que les MCA Les premiers chantiers ont été lancés de 1999 à 2001 sur la ligne 13, où les flocages ont été enlevés. Depuis, nous travaillons surtout sur les bâtiments de type technique, électrique et les ateliers. Nous distinguons friable et non friable. Tous les travaux relatifs à l'amiante friable répondent à la législation. Pour retirer l'amiante, nous utilisons un marché « menus travaux », avec des entreprises qui changent tous les deux ou trois ans. Les grosses opérations font l'objet d'appels d'offres particuliers. L'autorité est exercée par la directrice du service gestion et innovation sociale, qui délègue sa responsabilité de maîtrise d'ouvrage au chef de projet que je suis. Les travaux sont effectués avec des maîtres d'œuvre particuliers, chargés, tous services confondus, de retirer l'amiante des locaux dont ils ont la responsabilité. Nous travaillons avec un laboratoire accrédité COFRAC11. La base amiante dont je vous parlais peut être utilisée en Intranet par tous les agents de la RATP : lorsqu'ils doivent intervenir sur un site, l'arborescence leur permet de savoir s'il y a de l'amiante à cet endroit. Dans des locaux électriques où il faudrait tout démonter, nous ne menons pas d'opérations spécifiques de désamiantage s'il y a pas de pollution, mais nous procédons aux mesures et demandons aux autres services s'ils sont capables de retirer leurs installations en posant des relais pour que le trafic ne soit pas interrompu. Nous privilégions donc le désamiantage à l'occasion de travaux de réhabilitation des installations électriques. Lorsque nous sommes gênés, nous procédons par chantier prototype, avec une analyse de risque avant et après, ce qui nous permet de savoir comment conduire l'appel d'offres. Nous considérons avoir éradiqué, en moins de dix ans, pratiquement 90 % de l'amiante friable de notre patrimoine. Les 10 % restants correspondent à la marge que nous nous donnons, car il n'est pas toujours facile de visiter tous les locaux et de pénétrer dans l'ensemble des gaines techniques. S'agissant de la gestion des déchets, nous avons assez peu recours à l'inertage, qui est très onéreux, et nous privilégions donc l'enfouissement. La RATP consacre environ 1,5 million d'euros par an à la gestion de l'amiante. Les problèmes que nous rencontrons tiennent essentiellement à la sensibilité, quelque peu exacerbée, des agents à ces sujets. Pour lever leurs craintes, ils ont absolument besoin du référent qu'est la mission amiante. L'Intranet leur est particulièrement utile pour savoir à quoi s'attendre quand ils vont travailler. M. Jean-François DANON : Pour la Ville de Paris, je distinguerai ce qui concerne les occupants de ce qui a trait à nos interventions pour travaux. Notre organisation est assez comparable à celle de l'Assistance publique, puisqu'elle est dictée par les mêmes textes. À la suite du décret de 1996, nous avons engagé la phase diagnostic pour tout ce qui était flocage, calorifugeage et, à partir de 1997, faux plafonds. À cet égard, la Ville a rempli ses obligations : nous avons fait procéder aux analyses de 2 752 bâtiments représentant 2,5 millions de mètres carrés et allant de l'Hôtel de ville aux crèches en passant par les écoles, c'est-à-dire tous les équipements offrant un service au public. L'organisation a été centralisée, la direction du patrimoine passant tous les marchés publics, avec l'appui des gestionnaires qui connaissaient les bâtiments. Les résultats des diagnostics ont été exploités pour classer les locaux en niveau I, II et III. Nous avons relevé 2 % de cas en niveau II et III, qui ont tous été traités par retrait des matériaux amiantés. Nous avons donc rempli l'ensemble de nos obligations réglementaires au titre des décrets de 1996 et 1997. Nous assurons désormais les contrôles prévus tous les trois ans pour les bâtiments classés en niveau I. Avec le décret de 2001, la deuxième phase a été le repérage de l'amiante non friable. Nous avons adopté la même stratégie de centralisation et de passation de marchés publics. Nous diagnostiquons à nouveau les 2 752 bâtiments pour les dossiers techniques amiante (DTA). Les marchés publics ont été passés et notifiés et nous aurons terminé les DTA à la fin 2006, le petit retard s'expliquant par la mise en œuvre des décrets de 2003 sur la certification des organismes. Pour la première partie, relative aux diagnostics faux plafonds, calorifugeage et flocage, liée aux décrets de 1996 et 1997, la dépense a été de 1,8 million d'euros. Pour la partie DTA, nous aurons engagé 2,8 millions d'euros d'ici la fin de 2006. J'en viens à la protection des travailleurs qui effectuent des travaux de maintenance et de restauration sur notre patrimoine. Nous travaillons beaucoup avec des entreprises extérieures. Quand elles interviennent, nous leur remettons le DTA. J'observe d'ailleurs qu'elles le demandent désormais systématiquement. Pour les démolitions, des diagnostics complets sont réalisés, grâce à des marchés à commande, avant le début des travaux. Depuis 1996, la ville a consacré en moyenne 180 000 euros par an à ces diagnostics avant travaux, les travaux d'enlèvement représentant un coût annuel de 600 000 euros. Au total, depuis cette date et jusqu'à fin 2006, la ville aura dépensé un peu plus de 9 millions d'euros. Le dispositif est assez complet : nous avons des marchés à commande pour tout ce qui est repérage, diagnostic et enlèvement. Par ailleurs, nous avons mené une action assez importante de formation du personnel, en particulier d'encadrement, lorsque nous intervenons non par le biais d'entreprises mais par nos équipes en régie. Elles connaissent la situation de chaque bâtiment au regard de l'amiante. Des cahiers techniques sont disponibles sur l'Intranet. M. le Rapporteur : Je souhaite aborder la question des marchés publics. Quand vous lancez des appels d'offres, quels critères utilisez-vous pour retenir certaines entreprises de désamiantage ? Avez-vous parfois du mal à trouver des professionnels capables de répondre à vos souhaits ? M. Michel ZULBERTY : Il est vrai qu'au vu de l'ampleur de nos travaux, assez peu d'entreprises sont capables de répondre. En lançant de nombreux appels d'offres en 2004 et 2005, nous avons ainsi eu l'impression de saturer le marché et de provoquer une flambée des prix. Les entreprises qui soumissionnent doivent bénéficier d'une qualification et disposer d'un personnel compétent et formé, ce qui suppose qu'elles ne l'ont pas trouvé le matin même dans une agence d'intérim... Trois ou quatre entreprises sont vraiment à même de répondre à nos appels d'offres. CMS, du groupe Vinci, est la plus grosse. Le groupe Bouygues essaie de revenir dans ce domaine, qu'il avait abandonné, par le biais de la société Brézillon. Il y a aussi Isotherma des chantiers de l'Atlantique, ainsi que des entreprises plus petites comme DBS, la SNADEC et Keiffer. Nous avons eu quelques difficultés avec l'une de ces petites sociétés. S'agissant des critères de choix, nous avons toujours privilégié le mémoire technique qui permet de voir, dans l'appel d'offres, si l'entreprise a l'habitude et l'expérience du traitement de ce type de problème. M. le Rapporteur : Si je comprends bien, pour vous le mieux-disant est plus important que le moins-disant ? M. Michel ZULBERTY : Tout à fait. M. Patrick LECOCQ : Nous faisons appel aux mêmes entreprises, qui se comptent sur les doigts d'une main, ainsi qu'à une société de droit anglais, Pectel, qui a une filiale en région parisienne. Il est vrai que nous constatons parfois qu'elles sont déjà occupées ailleurs. Parmi les critères de sélection, nous demandons une analyse de risque, car c'est bien de la protection de nos voyageurs et de nos personnels qu'il s'agit. Nous ne retenons que des entreprises présentes en région parisienne, car il est souvent nécessaire de procéder à une analyse META, le week-end, pour une remise en exploitation le lundi. Mme Rose-Marie VAN LERBERGHE : L'appel d'offres central permet des vérifications, mais il est certain qu'il y a peu d'opérateurs. Nous n'avons donc pas renouvelé ce que nous avions fait pour le diagnostic et les opérations sont maintenant plutôt déconcentrées. J'ai oublié de préciser dans mon propos liminaire que, de 1997 à 2003, 4,2 millions d'euros avaient été consacrés à ces opérations. S'agissant des critères, ce sont bien évidemment les aspects techniques de sécurité qui l'emportent, et non le coût, qui paraît tout à fait supportable, puisque nous avons décidé, dans notre plan stratégique, d'augmenter de 75 % nos crédits d'investissement, lesquels atteignent ainsi 1,5 milliard d'euros. Cela doit permettre aux hôpitaux de faire face à leurs obligations, d'autant que nous avons pris l'engagement que des dotations exceptionnelles permettraient de couvrir des opérations plus onéreuses. Je l'ai dit : ce qui serait coûteux, c'est de tout enlever, mais cela ne paraîtrait pas raisonnable. Enfin, il est vrai que la qualité et le nombre des opérateurs peuvent poser problème. M. Jean-François DANON : La Ville de Paris procède par appels d'offres européens et n'a pas de difficulté à trouver des entreprises pour le diagnostic et le repérage. Ainsi, nous venons d'avoir vingt-six candidats pour huit lots de repérage. S'agissant des travaux, les nôtres sont de peu d'importance et n'ont rien de comparable avec ceux de l'AP-HP ou de la RATP et nous n'avons pas non plus de difficulté. Nous privilégions les critères techniques. En fait, nous avons la même approche que la RATP à partir du mémoire technique et du plan de retrait. M. le Président : J'ai un peu le sentiment, M. Danon, que la Ville de Paris n'a pas vraiment de plan de désamiantage et qu'elle réalise surtout ses opérations à l'occasion de travaux. M. Jean-François DANON : S'agissant de l'amiante friable, tous les travaux nécessaires ont été accomplis à la suite des décrets de 1996 et de 1997. En revanche, c'est à l'occasion de travaux de restructuration qu'il peut arriver qu'on trouve de l'amiante non friable. Dans ce cas, un diagnostic complémentaire est effectué et les travaux nécessaires sont réalisés. M. le Président : Nos travaux nous montrent que la distinction entre amiante friable et non friable est moins évidente qu'on avait pu le penser, et qu'il suffit de percer une plaque à l'occasion de travaux d'entretien pour que l'amiante non friable change en quelque sorte de nature. Partagez-vous ce sentiment ? M. Jean-François DANON : Vis-à-vis des occupants, ce n'est pas du tout la même chose, et la distinction reste très importante. En matière de travaux, la frontière est effectivement moins nette. M. le Président : Mais peut-on distinguer facilement entre les habitants, les utilisateurs et les personnels qui travaillent dans ces bâtiments ? M. Michel PARIGOT : Je crois que la distinction reste pertinente et qu'il faut distinguer le repérage pour risque et les travaux, mais qu'elle n'est pas à prendre de façon absolue : ce qui est important, en particulier pour les travaux de maintenance, ce n'est pas le matériau, mais le couple matériau/activité. Il faut donc une analyse du risque lié à l'activité pour pouvoir adopter l'attitude appropriée. Mme Véronique HESPEL : Notre mission était censée se préoccuper uniquement de la rénovation de Jussieu, mais quand il a été question d'implanter Paris-III sur le site, j'ai été amenée à m'intéresser à Censier. J'ai rencontré M. Parigot, qui m'a dit qu'il n'y avait pas d'amiante friable et que les travaux avaient été faits. Mais j'habite ce quartier et j'ai reçu un grand nombre de tracts, d'origine inconnue et parfois douteuse, sur les risques de l'amiante. J'ai donc engagé le dialogue avec l'Université, et je me suis aperçue que, s'il n'y avait pas à proprement parler de risque lié à l'amiante, sa présence empêchait de réaliser des travaux élémentaires de maintenance, ce qui rendait de fait ce chantier prioritaire. Je rappelle que Censier a été construite à la même époque que le collège Pailleron, et que les technologies étaient voisines, même si l'on m'a interdit de le dire comme cela. Après l'incendie du collège Pailleron, on a donc décidé d'isoler avec de l'amiante, qu'il a fallu plâtrer quelques années plus tard. Tout cela intervient dans un contexte de suroccupation encore plus forte qu'à Jussieu. Aujourd'hui, il n'est, par exemple, plus possible, parce que le mécanisme les fait remonter dans un matériau amianté, de rénover les fenêtres, et elles tombent... La question du président est donc très pertinente. M. Michel PARIGOT : On voit là le danger qu'il y a à tenir des propos nuancés ... Il faut bien évidemment retirer l'amiante de Censier. Ce que j'ai voulu dire, c'est que la présence d'amiante ne doit pas être utilisée pour justifier des décisions politiques prises pour d'autres raisons. Pour avoir une gestion saine du problème de l'amiante, il est essentiel que les décisions politiques soient prises dans la transparence sur la base des données techniques et en respectant une hiérarchie claire des risques, les bâtiments les plus à risque devant être traités en priorité. Or la lettre du ministre donnant mission à Mme Hespel fixait un cadre décisionnel concernant Censier en le justifiant par des données fausses. J'ai donc essayé de donner une description plus conforme de la situation réelle. Au début des années 80, l'amiante de cette université a été confiné par recouvrement de plâtre et cela a été plutôt bien fait pour l'époque, quoique de manière incomplète. Ce type de solution pose, comme partout, le problème des travaux de maintenance et du suivi à long terme. Or les précautions qui s'imposaient du fait du maintien de l'amiante en place n'ont pas été prises et on a notamment percé dans les confinements, ce qui a engendré des pollutions. Il y a deux raisons principales à cela : la traditionnelle absence de prise en compte des questions de sécurité par les responsables universitaires et l'insuffisance notoire des budgets de maintenance des universités pour gérer ce type de situation. Ce que montre l'exemple de Censier est que le maintien de l'amiante en place n'est pas une solution viable sur le long terme. Mme Rose-Marie VAN LERBERGHE : La réglementation est claire, et prévoit des mesures appropriées et sérieuses. Il est en effet important de repérer tous les endroits où il y a de l'amiante, même lié, car toute intervention peut mettre en péril ceux qui l'effectuent. Il ne faut donc rien minimiser, mais je crois qu'il y a aussi un risque de dérive émotionnelle : des gens qui passent sous une dalle ont peur d'être contaminés par une maladie qu'ils assimilent au sida. Ce n'est pas bien. Mme Martine DAVID : Je souhaite revenir sur la participation des partenaires sociaux, non pas en interrogeant la représentante de l'AP-HP, car elle nous a déjà dit que cette participation avait été exemplaire dans le cadre de l'élaboration du plan d'action, mais en m'adressant aux représentants des autres institutions. Quel est l'état d'esprit des partenaires sociaux par rapport à ces dossiers techniques ? Quels sont leurs niveaux de préoccupation, d'information et d'alerte ? Nous avons eu le sentiment, au cours de nos travaux, qu'ils n'avaient pas toujours la connaissance suffisante pour être des partenaires efficaces et pour relayer l'information ? M. Luc ROUMAZEILLE : À la RATP, l'idée de faire participer les partenaires sociaux est extrêmement importante depuis les années 80, et nous avons encore des rencontres régulières. En 1994-1995, nous avons eu des discussions assez vives, mais les problèmes se sont nettement atténués depuis le lancement du plan et de la mission amiante, grâce à tout le travail de communication accompli qui permet notamment à chaque agent de consulter la base de données sur l'Intranet. Le plan amiante a fait également l'objet de rencontres régulières. Ce n'est qu'une fois les inquiétudes levées, que les partenaires sociaux peuvent devenir des relais de communication, mais je n'ai pas le sentiment que tel soit vraiment le cas à la RATP. Aujourd'hui, les représentants du personnel se préoccupent plus des questions d'indemnisation que du désamiantage. Il y a encore parfois des remous à l'occasion d'un chantier, mais ce phénomène n'a pas pris d'ampleur. M. Yves COURTOIS : C'est à partir de 1996-1997 que la Ville de Paris a informé ses personnels. Au fur et à mesure de l'avancement des diagnostics, un point a été fait régulièrement devant chacun des CHS, la Ville en comptant un pour chacune de ses vingt directions. Des questions ont été posées par les représentants du personnel, elles portaient sur le processus technique et surtout sur la reconnaissance de la maladie et la réparation. Le processus de reconnaissance de la maladie professionnelle a été expliqué car les agents ignoraient notamment qu'il leur appartenait de monter les dossiers. Une action a donc été engagée pour renforcer les contacts avec le service médical. M. Michel ZULBERTY : À Jussieu, les partenaires sociaux ont été particulièrement bien informés par le comité anti-amiante et je laisserai donc M. Parigot, qui voit les choses de l'autre côté, vous en parler. Pour notre part, nous avons mis en place des dispositifs d'information, notamment un bureau spécialisé. Toutes les analyses sont affichées sur notre site Internet. Un bureau de coordination entre les établissements a été créé. Nous informons régulièrement les CHSCT, auxquels nous assistons - je devais d'ailleurs participer ce matin à celui de Paris-VI. On peut donc considérer que l'information circule bien. Mme Martine DAVID : Ma question ne portait pas seulement sur le niveau d'information. M. Michel PARIGOT : Il y a des niveaux d'information très différents. La transparence, par exemple grâce aux bases de données, est la bonne méthode. Contrairement à ce qu'on croit parfois, elle permet bien mieux que le secret d'éviter l'effet de panique. Mais il est vrai que les partenaires sociaux ne sont pas assez impliqués et qu'on se contente le plus souvent d'une information après coup, dans les CHSCT. Il y a bien sûr le contre-exemple remarquable de l'AP-HP, où les organisations syndicales ont participé à un travail collectif d'élaboration du plan amiante. À Jussieu, un comité inter établissements amiante, auquel nous participions, a fonctionné pendant plusieurs années et permis de gérer le problème. Depuis que les présidents d'université ont décidé de ne plus le réunir, la situation s'est nettement dégradée, car il n'y a plus de véritable suivi de la situation. Quant à la structure consultative de l'établissement public, elle ne s'est jamais réunie et les partenaires n'ont pas pu être impliqués dans le processus et apporter leurs connaissances sur le sujet. Au sein de l'Éducation nationale, il existe un comité central d'hygiène et de sécurité, mais le plan d'action amiante y arrive déjà élaboré et ne peut pas être discuté. On joue aussi sur le fait qu'il y a plusieurs CHS qui doivent adopter le même plan, et les syndicats sont dessaisis de ces questions. Mme Véronique HESPEL : Alors que la mission interministérielle a rencontré tous ceux qui le lui ont demandé et qu'elle se préoccupait de voir comment accélérer les opérations de rénovation et respecter les délais imposés par les décrets, elle n'a été sollicitée par aucun syndicat d'étudiants ou de personnels. Elle a en revanche reçu un grand nombre de demandes émanant de scientifiques peu convaincus des risques réels d'une exposition à l'amiante. Les choses ont été pour nous assez difficiles, mais nous avons réussi à faire bouger les présidents d'université et à accélérer les choses, non sous la pression des syndicats, mais sous celle de la justice, puisque nous sommes intervenus au moment où les trois universités avaient été mises en examen. Mme Rose-Marie VAN LERBERGHE : Il est difficile à la fois de bien mesurer les risques et d'éviter la panique, et ce souci a été pleinement partagé par les syndicats. Au sein du CHSCT de l'AP-HP, ils ont demandé des informations très précises, y compris sur les conséquences médicales, et nous avons monté ensemble un diaporama qui a été adressé à chaque établissement. Des plaquettes ont également été envoyées aux agents avec les feuilles de paye. Cet effort d'information et son adaptation au public ont fait l'objet de discussions au sein du comité. M. le Président : C'est sans doute précisément parce que cet effort a été fait que l'effet anxiogène a été maîtrisé. M. Luc ROUMAZEILLE : J'ai dit que la base de données est très importante, en particulier pour rassurer, mais elle n'est pas suffisante. Ce qui joue surtout, c'est le fait que la mission amiante est devenue tout à fait fiable : dès qu'un problème se pose, elle intervient immédiatement, en toute transparence, et les services de la santé au travail sont présents. Le fait que la mission ait été reconnue au fil des ans nous a considérablement aidés. J'ajoute que la question de la reconnaissance de la maladie est aujourd'hui réglée et que nous sommes désormais davantage sur les questions d'indemnisation. M. le Président : L'excellente question de Mme David nous a permis de montrer combien la transparence est importante. Pour en venir au premier thème du débat, qui porte sur le repérage et l'inventaire des sites amiantés, je vais tous d'abord demander à M. Jourdain de nous parler de l'enquête interministérielle en cours au sein de la fonction publique. M. Jean-Pierre JOURDAIN : Je suis ici en tant que représentant de la Direction générale de la fonction publique, service du Premier ministre qui s'est saisi de la question de l'amiante à la fin de 2004. Nous sommes partis du constat qu'il appartenait à chaque ministère d'appliquer la réglementation. Néanmoins il est apparu indispensable d'avoir une vision interministérielle, panoramique, de cette application, afin que le Premier ministre connaisse les difficultés ponctuelles et puisse prendre les mesures correctives nécessaires. Pour cela, nous avons décidé de réaliser, dès le début de 2005, auprès de tous les ministères une enquête portant à la fois sur le bâtiment et sur le personnel. Pour les bâtiments, l'objectif était de recenser le parc immobilier concerné en distinguant les niveaux de risque établis par le décret et d'identifier les mesures de protection mises en œuvre. Pour le personnel, il s'agissait d'identifier les agents selon les risques d'exposition, active comme passive. Une évaluation grossière permettait de dire qu'entre 100 000 et 200 000 agents de la fonction publique d'État pouvaient être concernés. Les résultats de l'enquête nous permettront d'affiner ce chiffre. Nous souhaitions également que les ministères nous décrivent les procédures de suivi médical qu'ils ont mises en oeuvre, ainsi que les mesures de protection des personnels soumis à une exposition active. Nous voulions aussi, ce qui n'est pas facile, identifier les personnels en retraite et les procédures de suivi médical qui leur sont appliquées. Vous le voyez, il s'agit d'un travail extrêmement ambitieux, élaboré avec les directions de la santé et du travail. Pour le mener à bien, nous avons mis en place un réseau, avec un correspondant amiante dans chaque ministère. Nous nous sommes également appuyés sur un comité d'experts qui s'est réuni périodiquement pour guider la direction générale de la fonction publique sur le plan méthodologique. Nous comptons aussi beaucoup sur lui pour interpréter les résultats que nous obtiendrons. Nous avions fixé la date de réponse des ministères au 15 mars 2005 pour les bâtiments et au 16 mai 2005 pour les personnels. Nous les avons collectées, mais je ne suis pas en mesure de vous communiquer les résultats car le travail d'analyse et d'expertise est en cours. Notre objectif est de publier un rapport à la fin de l'année. Nous souhaitons prendre toutes les précautions méthodologiques et bien interpréter ce que disent les ministères, avant de livrer les résultats. S'agissant du dialogue social, nous avons informé les organisations syndicales du lancement de cette enquête le 15 décembre 2004, à la commission centrale d'hygiène et de sécurité, instance dépendant du Conseil supérieur de la fonction publique. Nous y avons à nouveau évoqué le sujet le 28 juin dernier, en communiquant le cadre de l'enquête. Il apparaît que les syndicats apprécient ce travail et en attendent les résultats. Le cabinet du Premier ministre a demandé que l'enquête soit étendue aux collectivités locales et à la fonction publique hospitalière. Pour les premières, un contact a été pris entre la Direction générale de la fonction publique et la Direction générale des collectivités locales, qui vient de lancer, par l'intermédiaire des préfets, une enquête identique auprès de toutes les collectivités locales. L'enquête n'est pas encore lancée, en revanche, dans la fonction publique hospitalière. Une concertation est en cours entre nos services pour bien en adapter le cadre à la spécificité de ce secteur. Nous espérons que la base que constituera cette enquête permettra de donner une impulsion interministérielle. M. le Rapporteur : En 1996, une commission interministérielle avait été créée. Pouvez-vous nous confirmer qu'elle ne s'est jamais réunie, et que vous commencez un travail qui aurait dû être amorcé il y a huit ans ? M. Jean-Pierre JOURDAIN : Je suis dans mes fonctions depuis deux ans, et n'ai jamais entendu parler de cette commission interministérielle. Mme Bénédicte RENAUD : Nous allons vérifier ce point. Cela dit, il faut préciser que la fonction publique établit annuellement un bilan d'application des règles de sécurité, et notamment de la réglementation amiante. Ce bilan n'est évidemment pas satisfaisant, mais cette question a toujours fait partie des préoccupations d'hygiène et de sécurité. M. le Président : Vous avez évoqué, M. Jourdain, l'établissement d'un inventaire concernant les collectivités territoriales. Quand a-t-il été lancé ? M. Jean-Pierre JOURDAIN : La circulaire adressée aux préfets date du 22 juin dernier. M. le Président : Nous sommes heureux de l'apprendre. Si nous en avions été informés plus tôt, cela n'aurait pas été plus mal. Confirmez-vous que vous disposerez, avant la fin de cette année, d'un premier recensement, tant s'agissant des surfaces que des personnels qui peuvent être concernés, de manière active ou passive ? M. Jean-Pierre JOURDAIN : Oui. Le calendrier a été fixé et il est impératif. Nous pressons les ministères. M. le Président : Nous retenons cette date et nous demanderons à avoir connaissance de ce rapport à la fin de cette année. La RATP a créé une base de données Intranet. Pour connaître assez bien l'administration, je sais que l'horizontalité n'est pas dans sa culture. Mais n'y aurait-il pas moyen de procéder à des échanges de données ? Cela permettrait d'éviter les redondances. Enfin, je constate que vous n'évoquez guère vos difficultés. M. Jean-Marie GEVEAUX : Je souligne que les collectivités territoriales n'ont pas attendu qu'une circulaire soit adressée aux préfets pour mener à bien le recensement des bâtiments qui peuvent être concernés par le problème. Si le ministère de la fonction publique veut disposer d'un inventaire, il me semble que la première chose à faire serait de s'adresser aux collectivités. M. le Président : Je précise toutefois que toutes les collectivités territoriales n'ont pas mené à bien ce travail. Mme Rose-Marie VAN LERBERGHE : J'aimerais évoquer nos difficultés, puisque M. le Président nous y invite. Dans une administration comme l'AP-HP, qui regroupe 38 établissements et 91 000 personnes, la grande difficulté est de faire partager les objectifs et de s'assurer que les plans d'action sont réalisés, ce qui n'est pas évident. En outre, lorsqu'une action est présentée comme prioritaire par le niveau central, les structures locales ont tendance à considérer qu'il lui appartient de prendre en charge les coûts correspondants. La question de la responsabilisation est donc capitale. Nous ne sommes plus dans un mode de travail prescrit. La deuxième difficulté est que nous devons continuer d'assurer nos missions de service public. Nous ne pouvons même pas compter sur les vacances pour réaliser les travaux. Les malades sont présents au mois d'août. De plus, certains services sont uniques. La question des rocades est extrêmement importante. M. le Président : Les rocades ? Mme Rose-Marie VAN LERBERGHE : Les rocades sont les opérations « tiroirs ». Il faut déménager un service pour pouvoir réaliser des travaux. C'est un problème majeur, sachant que tout cela se fait en site occupé. Les travaux occasionnent des nuisances pour les malades, pour les familles, pour le personnel. Nous avons une troisième difficulté avec les entreprises. Comme vous le savez, l'importance de la sous-traitance est une caractéristique traditionnelle du BTP. Nous sommes parfois obligés de redéfinir les objectifs techniques de travaux à réaliser. Mon angoisse est que cette cascade de sous-traitance occasionne des déperditions. C'est aussi un problème pour la sécurité des personnes qui interviennent. Je me permets d'indiquer trois autres difficultés qui sont d'un autre ordre. S'agissant de la reconnaissance des maladies professionnelles, nous avons voulu être très rigoureux et nous assurer que les radios étaient bien examinées, et même doublées par des scanners. Les médecins du travail ont considéré que c'était une atteinte absolument insupportable à leur autonomie. Deuxièmement, nous avons voulu rechercher des antécédents dans notre personnel comme dans les personnels qui sont passés par l'AP-HP. C'est une vraie difficulté. Enfin, je pense qu'on n'évitera pas que se pose une question d'ordre éthique. Quand on effectue des examens, on s'expose toujours à découvrir des pathologies autres que celles liées à l'amiante. Mme Véronique HESPEL : Je partage entièrement l'analyse de Mme Van Lerberghe sur les deux premiers sujets qu'elle a évoqués. Nous n'évoluons plus dans un système de travail prescrit, mais dans un système de décisions partagées. Dans le cas de Jussieu, cela est apparu de manière évidente. Une pléthore d'acteurs s'occupait du dossier, c'est-à-dire qu'aucun ne s'en occupait vraiment. Nous nous heurtons au principe d'autonomie, surtout quand celle-ci est interprétée comme une autonomie sans responsabilité. Quand on est directeur général de l'AP-HP, on peut encore demander des comptes rendus, mais quand on est directeur de l'enseignement supérieur, cela semble plus difficile. L'établissement public du campus de Jussieu, que dirige M. Zulberty, n'est pas véritablement maître d'ouvrage. Il n'a pas l'autorité qui lui permettrait de contester les décisions prises par son principal client, qui occupe 80 % du campus. Si celui-ci veut donner 2 000 mètres carrés de plus aux mathématiciens, tout est à refaire. Et c'est ainsi que les choses traînent en longueur. La raison majeure qui explique les dysfonctionnements du chantier de Jussieu est que nous ne sommes plus dans un monde où il n'y a qu'un responsable. Le dossier de Jussieu est partagé, en outre, avec la région Île-de-France et le département de Paris. Deuxièmement, comme l'a dit Mme Van Lerberghe, les services publics doivent continuer à fonctionner. Cela a été une de nos premières préoccupations : a-t-on pris soin, en définissant le calendrier des travaux, de mettre les étudiants à l'abri ? Nous avons constaté que cela n'a pas forcément été le cas. Il y aura encore en 2008 des étudiants qui pourraient être exposés à l'amiante, même s'ils ne courront pas vraiment de risques. J'ajoute que les préoccupations de santé publique ne pèsent pas très lourd par rapport aux préoccupations des chercheurs. Dans le dossier de rénovation de Jussieu, le problème de l'amiante a été utilisé pour faire avancer le projet de certains établissements scientifiques. En 1996, lorsque les travaux ont été lancés, un diagnostiqueur avait évalué leur coût à 136 millions d'euros et leur durée à 36 mois. Deux ans plus tard, l'établissement public a parlé d'environ 700 millions d'euros. Quatre ans plus tard, on s'est rendu compte que le coût serait plutôt de 900 millions d'euros. On en est aujourd'hui à une estimation de 1 300 millions d'euros. Je précise que le désamiantage proprement dit représente moins de 10 % de cette somme. Les grands postes de dépenses sont ailleurs. Il y a d'abord la rénovation, laquelle est plus coûteuse dans l'ancien que la construction de bâtiments neufs. Il y a ensuite les loyers tiroirs correspondant à ces fameuses opérations de rocade. Pendant la durée des travaux, on loue des locaux à des loyers exorbitants, car la puissance publique, confrontée à son obligation de protection, choisit très vite, dans l'urgence. Des occupations initialement prévues pour deux ans, finissent par durer cinq ans, six ans, sept ans, huit ans, en raison des disputes entre féodalités, en l'absence d'un véritable maître d'ouvrage. M. Michel ZULBERTY : Le processus de décision est effectivement d'une très grande complexité. Nous ne vivons plus dans une administration gérée en vertu d'un pouvoir de droit divin, mais dans un système de concertation. Cela correspond à l'évolution de la société. Le maître d'ouvrage doit pourtant faire la synthèse des différentes contraintes et prendre des décisions. Il ne peut le faire qu'à l'intérieur des compétences qu'il a reçues. Quand on ne maîtrise pas la moitié du champ d'action, il est difficile de faire des prévisions. Quand l'opération de Jussieu sera achevée, on s'apercevra sans doute que ce ne sont pas les travaux qui auront coûté le plus cher. M. Jean-Marie GEVEAUX : Les chiffres ont considérablement évolué. Pourquoi ? M. Michel ZULBERTY : Mme Hespel a donné l'essentiel des raisons de l'évolution des prix. Au départ, le problème essentiel semblait être celui du flocage. Il s'agissait de faire sortir d'une pièce ses occupants, d'enlever le flocage, et de faire revenir les occupants dans la pièce. On s'est aperçu que les choses n'étaient pas aussi simples. Il a fallu tenir compte de la suroccupation des locaux. De plus, une mise aux normes s'est avérée nécessaire, notamment en matière de sécurité. De plus, on s'est, par exemple, rendu compte que les poteaux extérieurs n'étaient pas stables au feu. Il a fallu également refaire l'électricité. M. le Président : Peut-on dire que, sur le plan technique, la rénovation revient presque à une reconstruction ? M. Michel ZULBERTY : Oui. Et cette reconstruction sera plus chère que si l'on était reparti de zéro, parce que cette reconstruction s'effectue dans un champ contraint. M. Luc ROUMAZEILLE : Je voudrais revenir à la notion de transversalité et de partage d'expérience. J'anime, dans le cadre de la santé/sécurité au travail de la RATP, deux réseaux. L'un regroupe de grandes entreprises, l'autre des entreprises de transport. Nous abordons de nombreux sujets, mais nous parlons très peu de l'amiante. Il me semble très important d'échanger nos expériences, de confronter nos difficultés, et de réfléchir aux améliorations possibles. Les problèmes que vous avez évoqués sont déjà anciens. Nos préoccupations actuelles concernent beaucoup plus l'indemnisation, ainsi que les fins de projet. J'ajoute que tous les agents de la RATP qui ont été exposés et qui ont plus de cinquante ans se sont vu ou se verront proposer de subir des examens tomodensitométriques thoraciques par scanner. Nous nous sommes rendu compte que le nombre de cas de maladies liées à l'amiante sera probablement assez faible. Par contre, nous avons découvert d'autres problèmes de santé, ce qui rejoint la remarque de Mme Van Lerberghe. M. Michel PARIGOT : Le travail que nous sommes en train de faire consiste à mettre tous les problèmes sur la table. C'est ce qu'il faudrait faire à Jussieu comme ailleurs. Le constat qui a été dressé est grave de tous les points de vue, y compris du point de vue financier. Le dossier de Jussieu a connu des dérives financières évidentes. Il faut se demander pourquoi il n'a pas été maîtrisé. Certains ont prononcé le mot de « concertation », en suggérant qu'elle constituerait le problème central. Le mot est bien mal choisi. Ce sont des lobbies qui agissent, et de manière souterraine. Le problème de l'amiante a été utilisé pour faire passer des projets coûteux qu'on aurait eu du mal à faire passer sur leur propre mérite. Au bout du compte, on aura à la fois pris des risques inutiles en retardant de plusieurs années le chantier et dépensé de manière injustifiée des sommes faramineuses. Parallèlement on aura imposé des restructurations et construit des bâtiments dans la précipitation en se dispensant de les justifier au plan de l'enseignement et de la recherche universitaire. Il n'y aura eu de transparence qu'en 1996, au moment de la mise en place de la mission Jussieu. Il serait nécessaire de créer une nouvelle mission Jussieu de telle sorte que tous les acteurs soient contraints de présenter leur position dans un cadre contradictoire et public et que les décisions soient prises sur la base d'une argumentation, elle-même publique. Car quand on dépense des sommes aussi importantes, les citoyens ont le droit de savoir pourquoi on dépense cet argent, comment on le dépense et à quoi exactement il va servir. Si la transparence avait été appliquée, on aurait réglé le problème plus vite et on aurait économisé beaucoup d'argent. Il n'est pas vrai qu'il était nécessaire de tout reconstruire. Même dans la construction elle-même, beaucoup de surcoûts n'étaient pas justifiés. Dans la fonction publique, on est en train de lancer des enquêtes sans concertation. Or la concertation préalable est un élément indispensable car ceux qui les lancent n'ont pas de connaissance de la réalité du terrain. Par exemple, le CHS de l'enseignement supérieur s'apprêtait à approuver un plan d'action utilisant un logiciel de recensement des bâtiments réalisé par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) : nous avons demandé à l'examiner et en une heure nous avons découvert pas mal de lacunes et proposé des améliorations de bon sens. La concertation est indispensable si l'on veut être efficace. Cela ne concerne pas seulement les associations et les syndicats. Les collectivités territoriales devraient elles aussi être associées à la définition de l'enquête qui les concerne. M. Jean-François DANON : Je voudrais souligner à mon tour que nous ne sommes plus dans une administration de prescription, mais dans un système de partage des décisions. La direction du patrimoine et de l'architecture de la Ville de Paris est le support technique d'opérations qui sont conduites par les directions gestionnaires, les responsables des crèches et des écoles. La dimension émotionnelle est aujourd'hui essentielle. Elle comporte un aspect positif, à savoir l'énorme sensibilité de tous les gestionnaires aux problèmes de santé et de sécurité. Mais d'un autre côté, cette dimension constitue aussi une difficulté majeure. Les moindres défauts lors de travaux de désamiantage peuvent susciter un réel affolement. M. Jean-Pierre JOURDAIN : J'ai indiqué tout à l'heure que nous avions présenté le cadre de notre enquête au sein de la commission centrale d'hygiène et de sécurité le 15 décembre dernier, pour recueillir l'avis des organisations syndicales. Nous n'avons nullement écarté les personnels de notre réflexion. Nous comptons bien poursuivre cette concertation jusqu'à la fin du processus. M. le Rapporteur : S'agissant des aspects financiers, il serait bon de se mettre d'accord sur les chiffres, notamment sur la répartition entre les différentes lignes budgétaires - diagnostic, repérage, désamiantage. Il faudrait également faire le point sur l'impact financier du problème de l'amiante non friable. Le deuxième aspect du problème sur lequel je souhaiterais revenir est sa dimension émotionnelle. Je suis président de la commission permanente de surveillance de l'usine COGEMA. Nous avons réussi à dédramatiser les choses en créant les commissions locales d'information, auxquelles participent tous les acteurs, y compris ceux qui sont le plus opposés au nucléaire. S'agissant de la gestion du futur, c'est avant qu'il faut se demander comment éviter qu'il y ait d'autres malades et d'autres morts. On sait que les personnes les plus exposées sont celles qui interviennent dans le cadre d'une opération de maintenance et qui entrent en contact avec un secteur confiné, oublié dans les repérages. Ce sont de futurs malades potentiels. Je souhaiterais que les uns et les autres fassent le point sur la mise en place des DTA. M. Michel ZULBERTY : En ce qui concerne les coûts, je vous ai transmis un document sur les données chiffrées relatives aux coûts de traitement et de désamiantage, ainsi qu'aux coûts des analyses. À Jussieu, l'inertage coûte en moyenne 1 070 euros la tonne, TTC. Ce chiffre correspond au traitement et n'inclut pas le transport. Par comparaison, l'enfouissement coûte 224 euros la tonne. Le rapport, comme vous le voyez, est de un à cinq. Il faut donc être assez sélectif quand on choisit d'inerter. Nous partons du principe que tous les matériaux friables et tout ce qui est particulièrement pollué doit être envoyé en inertage. Au contraire, nous envoyons à l'enfouissement les autres déchets comme les gravats. M. le Président : L'inertage est-il utilisé à la RATP ? M. Patrick LECOCQ : L'inertage concerne surtout ce qui relève du flocage. Le coût est au moins de 2 000 euros la tonne, en incluant le transport. Il est évident que la mise en décharge de classe 1 est moins chère (environ 1 000 euros la tonne), surtout quand, dans un chantier de démolition, certains déchets sont pollués. Dans une démolition générale sous confinement amiante, il est difficile de faire la différence entre le béton qui a été amianté et celui qui ne l'a pas été. Mme Aline PRIGENT : À Jussieu, on limite les démolitions. Ce qui est démoli et qui part en centre de traitement de classe 1, est ce qui est en contact direct avec les poutres amiantées. La démolition de cloisons est traitée comme une démolition classique. Mme Rose-Marie VAN LERBERGHE : L'AP-HP est dans une situation très différente de celle de Jussieu. Dans les hôpitaux tout neufs, il n'y a pas d'amiante. Quant aux DTA, ils sont pratiquement achevés pour les deux tiers des hôpitaux. A notre connaissance, il faut surveiller 33 000 mètres carrés sur 16 sites, sur un total de 3,5 millions de mètres carrés et de 50 sites, ce qui relativise les choses. Il est important de procéder au repérage exact des endroits où il y a des risques, d'organiser la surveillance, de donner ces indications à la maintenance. En cas de doute, nous prenons les précautions amiante. Les 4,3 millions d'euros dont je parlais tout à l'heure représentent les coûts directs. Cela dit, il y a des opérations qui ne sont pas de désamiantage, mais pour lesquelles des précautions amiante sont prises, ce qui occasionne un surcoût que j'évalue entre 4 et 5 %. M. Dominique NOIRÉ : A l'hôpital Beaujon - l'un des établissements les plus amiantés -, le surcoût que représente le désamiantage dans une opération de rénovation est de 5 %. M. Jean-François DANON : Pour nous, le coût de l'élimination en classe 1 est de 1,2 euro le kilo. Le coût de l'inertage est de 3,35 euros le kilo. M. Jean-Marie SCHLÉRET : En 1994, suite au projet de révision de la loi Falloux, les pouvoirs publics avaient décidé la création d'une commission d'évaluation de la sécurité des bâtiments scolaires. À l'issue des travaux de cette commission a été créé un Observatoire permanent, que j'ai l'honneur de présider depuis une dizaine d'années. Il regroupe l'ensemble des partenaires, au premier rang desquels les collectivités territoriales, mais aussi les représentants de l'enseignement privé, de l'enseignement public, de la conférence des présidents d'université, des organisations syndicales et de parents d'élèves, ainsi que d'un certain nombre de ministères. L'Éducation nationale n'est qu'une composante de cet observatoire, ce qui lui donne une relative indépendance dans sa mission, qui consiste à évaluer l'état des bâtiments, des équipements, ainsi que les risques majeurs. Dès la création de l'Observatoire, en 1995, nous avons été confrontés aux retombées de l'affaire du lycée professionnel de Gérardmer, dans les Vosges, où des enseignants ont été victimes de mésothéliome. Cela a été très douloureusement ressenti dans la communauté scolaire. Nos premières enquêtes ont porté sur les collèges et les lycées, en lien avec les collectivités. Elles ont fait apparaître que 5 % des collèges déclaraient avoir des surfaces amiantées. Mais seuls les flocages et les calorifugeages étaient concernés, en vertu des textes de février 1996. Pour ce qui est des lycées, 13 % des établissements déclaraient des surfaces amiantées. S'agissant des universités, mis à part Jussieu et Censier, les chiffres étaient d'un tout autre ordre. Sur environ 13 millions de mètres carrés, le flocage concernait 126 000 mètres carrés, et le calorifugeage 47 000 mètres carrés, soit un total inférieur aux surfaces floquées de Jussieu, alors estimées à 200 000 mètres carrés. Les collectivités se sont prêtées au jeu dans un premier temps. L'État leur a apporté son aide, puisqu'une partie du plan quinquennal de 1994 pour la mise en sécurité des écoles - 2,5 milliards de francs - a été détournée de sa destination pour financer les diagnostics des collèges et des lycées. Cela n'a pas été suffisant. Nous avons tenté de lancer une enquête systématique pour les écoles. Nous n'y sommes pas parvenus. Les collectivités ont déploré, à juste titre, que les règles du jeu changent. Elles se sont engagées dans un diagnostic des collèges et lycées. Un an après, la règle avait changé : il fallait contrôler les faux plafonds. C'est ce qu'elles ont fait. Puis, on leur a dit qu'il fallait vérifier les revêtements de sols. J'attends de voir comment elles vont réagir à l'enquête détaillée que préconise aujourd'hui le ministère de la fonction publique. Les différents ministères, en particulier celui de l'éducation nationale, se sont engagés dans le traitement du problème. L'Observatoire a donc achevé son rôle d'aiguillon. Nous laissons aux ministères le soin de faire ce qu'ils ont à faire. Par contre, nous continuons une enquête annuelle portant sur tous les établissements du second degré. Elle concerne tous les paramètres de la sécurité. Nous avons un questionnaire sur les diagnostics et les DTA. Il en ressort que 86 % des collèges et des lycées ont établi le diagnostic obligatoire. Parmi eux, 14,6 % des établissements disent avoir réalisé ou engagé des travaux. S'agissant des DTA, la législation impose, pour les quatre premières catégories, d'avoir été au rendez-vous en 2003. Beaucoup ne le sont pas. Pour la cinquième catégorie, seuls 44 % des établissements scolaires ont établi le dossier technique. Les collectivités ont pris ce problème à bras-le-corps. Nous sommes assurés de leur volonté de collaborer. M. le Rapporteur : Dans le cadre du transfert du patrimoine de l'État aux collectivités territoriales, le coût des contraintes liées à l'amiante a-t-il été pris en compte ? M. Jean-Marie SCHLÉRET : Le transfert a été accompagné d'audits et de diagnostics portant sur l'état du patrimoine. Mais l'amiante n'entrait pas en ligne de compte. Aujourd'hui, les collectivités territoriales héritent de ce problème supplémentaire. Il n'en reste pas moins que les collectivités territoriales ont déjà eu beaucoup de mal à faire face au coût de la seule sécurité incendie. On peut dire que 80 % du parc de 1 200 bâtiments comportant des structures métalliques a été, sinon reconstruit, du moins profondément réhabilité. M. Jean-Marie GEVEAUX : Je confirme tout ce qu'a dit M. Schléret. J'ajoute que si l'État est son propre assureur, ce n'est pas le cas des collectivités territoriales, qui doivent donc assumer les frais d'assurance. M. le Président : On sait que les machines-outils de l'enseignement technique et professionnel ne sont pas toujours du dernier cri. J'ai vu des machines-outils qu'aucun contremaître n'aurait acceptées dans une usine, pour des raisons de sécurité. M. Jean-Marie GEVEAUX : Je dois préciser que les normes que nous avons mises en place ont été parfois mal acceptées par les professeurs et les élèves. M. Jean-Marie SCHLÉRET : En juin 1996, nous étions à six mois de l'entrée en application de la directive européenne de mise aux normes de toutes les machines et machines-outils. Le parc scolaire français comptait environ 160 000 machines-outils. Nous avons diligenté une enquête, qui a fait apparaître que 40 % du parc était en conformité aux normes, et ce à six mois de l'entrée en vigueur d'une directive européenne, d'ailleurs renforcée par une loi du 13 mai 1996 relative aux responsabilités pénales. Les travaux nécessaires étaient évalués à 9,5 milliards de francs. À peine 500 millions avaient été engagés. La moitié des 60 % de machines-outils qui n'étaient pas aux normes ne valaient pas la peine d'être mises aux normes : elles étaient bonnes pour la réforme. Les collectivités se sont engagées dans un effort résolu. On peut dire aujourd'hui qu'entre 90 et 95 % des machines-outils ont été mises en conformité, grâce à l'effort des collectivités. M. Ghislain BRAY : Je confirme tout à fait ces propos. J'étais à l'époque enseignant dans un lycée technique. En trois ans, tout le parc de l'établissement a été renouvelé. M. Jean-Marie GEVEAUX : On a dit tout à l'heure, en ce qui concerne Jussieu, que la reconstruction aurait finalement coûté moins cher que la rénovation. Dans le cadre de mes fonctions de président de la commission éducation de mon conseil général, j'ai eu l'occasion d'intervenir sur le cas d'un collège dont les bâtiments contenaient de l'amiante. La restructuration lourde était estimée à 5 millions d'euros, la reconstruction à 12 millions d'euros. J'avais pris l'engagement, devant le conseil d'administration et les parents d'élèves, que si les cabinets spécialisés arrivaient à la conclusion que la restructuration lourde était impossible, le conseil général déciderait la reconstruction totale. Finalement, elle était possible, et les travaux ont commencé il y a trois mois. Quand on joue la carte de la transparence, sans être alarmiste, on arrive à faire progresser les choses. M. Michel PARIGOT : Il y a une différence très nette entre la gestion de ces problèmes par les collectivités territoriales et par l'État. Celles-là les gèrent beaucoup mieux que celui-ci, qui d'ailleurs ne gère absolument pas certains problèmes. Je voudrais revenir à l'inertage. En 1996, des projets autres que celui de la société INERTAM pouvaient être mis en oeuvre à un coût moindre. Mais à partir du moment où les décharges de classe 1 sont beaucoup moins chères que n'importe quel projet d'inertage, une obligation est nécessaire. S'agissant de la maintenance, il y a une grande différence entre le privé et le public. Dans le privé, l'application de la réglementation est peu contrôlée. Dans le public, il n'y a pas de contrôle. L'inspection du travail n'est pas compétente. Certaines administrations ont créé leurs propres inspections, mais celles-ci ne fonctionnent pas vraiment. J'ajoute que dans le public, en cas de situation défectueuse, vous ne pouvez pas la faire constater par huissier. La seule possibilité est de saisir un tribunal administratif, qui peut ordonner un constat d'urgence contradictoire, lequel sera fait un mois après, lorsque la situation aura cessé. L'État ne peut continuer à édicter des réglementations en s'exonérant de leur application. M. Ghislain BRAY : L'une des difficultés des enquêtes est de rechercher les personnes retraitées. Dans l'établissement où j'ai enseigné jusqu'en 2002, il a fallu attendre un cas de cancer avéré et trois cas suspects pour se lancer dans une étude. En aucun cas il n'a été question d'envoyer les retraités à l'hôpital intercommunal de Créteil, alors que cet établissement d'enseignement n'a qu'une trentaine d'années et que les personnels sont encore bien connus. Qui plus est, on a fermé certains ateliers. Un atelier a été complètement verrouillé pendant un mois. Or, pendant vingt-cinq ans, des sections de trente à quarante élèves ont travaillé dans ce bâtiment. En aucun cas on ne parle des élèves. L'établissement comportait une section de canalisateur d'hygiène publique et voies urbaines. Que faisait-on découper à longueur de journée à ces élèves ? De l'amiante-ciment ! M. Jean-Pierre JOURDAIN : Je laisserai à Mme Renaud le soin de répondre à la question de la non-application par l'État des règles qu'il édicte... Mme Bénédicte RENAUD : En matière d'hygiène et de sécurité, le décret qui s'applique à la fonction publique de l'État respecte les dispositions du Livre II, titre III du code du travail. Un certain nombre de dispositions dérogatoires ne permettent pas à l'inspection du travail d'être compétente en matière de vérification. En revanche, les inspecteurs en hygiène et sécurité, qui sont les équivalents des inspecteurs du travail pour la fonction publique de l'État, peuvent effectuer des contrôles - à cette différence près qu'ils n'ont pas de pouvoir de sanction. M. le Président : Ce qui n'est pas une mince différence ! Mme Bénédicte RENAUD : M. Parigot a indiqué que les agents du secteur public ne peuvent pas faire état des dangers qui peuvent être imminents pour leur santé. Or, le décret de 1982 prévoit la possibilité pour un agent de la fonction publique de l'État d'utiliser le droit de retrait. Il en avertit le chef de service, lequel a 24 heures pour prendre toutes les mesures d'urgence nécessaires pour rétablir la possibilité pour les agents d'exercer leurs missions. M. le Président : Peut-on revenir sur le cas des établissements scolaires du premier degré ? M. Jean-Marie SCHLÉRET : Dans le premier degré, 2 % des écoles, soit un millier, sont concernées à des degrés très divers. Il est nécessaire de procéder à une enquête plus précise. Je sais que la Direction générale des collectivités locales (DGCL) est en contact avec les collectivités, y compris avec l'Association des maires de France. Cela dit, les problèmes sont très différents. Dans les années 70, des salles avaient été équipées d'isolations thermiques. Récemment, des maires ont dû entreprendre des travaux de déflocage en raison de l'émoi des parents. M. Jean-Marie GEVEAUX : Beaucoup de classes en préfabriqué, censées être provisoires, ont été utilisées pour des activités artistiques. Ce sont souvent ces bâtiments qui posent le plus de problème. M. Jean-Marie SCHLÉRET : Les toitures de préau en fibrociment posent également problème dès que l'on commence à percer. M. le Rapporteur : Aux États-unis, je crois savoir qu'il existe une réglementation spécifique pour les établissements accueillant de jeunes enfants. C'est une piste de réflexion. S'agissant des agents de maintenance dans la fonction publique, il est important de mettre en place une information préalable. M. Jean-Marie GEVEAUX : L'une des pistes serait la mise en place d'une équipe mobile d'ouvriers professionnels, une EMOP, spécialisée dans les problèmes de maintenance liés à l'amiante. Mme Rose-Marie VAN LERBERGHE : Je reviens au problème de la non-application par l'État des obligations qu'il impose aux entreprises, pour préciser que dans la fonction publique hospitalière, l'inspecteur du travail est membre de droit du CHST, que les agents ont un droit de retrait, et que les organisations syndicales ont la possibilité de recourir à l'avis de danger grave et imminent. C'est d'ailleurs ce qui nous a conduits à nous mobiliser au mois de février 2005. M. le Président : Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre contribution aux travaux de notre mission d'information. Audition conjointe de M. Philippe BOURGES, ingénieur conseil à la direction des risques professionnels de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, et de M. Bruno BISSON, ingénieur conseil de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Mes chers collègues, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui M. Philippe Bourges, ingénieur conseil du bâtiment et des travaux publics (BTP) et spécialiste de l'amiante à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), et M. Bruno Bisson, de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF). Nous allons aborder la question du contrôle exercé par les caisses d'assurance maladie sur le respect de la réglementation amiante, dans les chantiers de désamiantage proprement dit, mais aussi dans les chantiers dits de secteur 3, ceux où sont effectués des travaux de maintenance. L'important est de savoir quel est le rôle précis dévolu aux caisses régionales en matière de contrôle, et, bien sûr, si elles disposent des moyens suffisants pour exercer leur activité. Notre mission a adopté à l'unanimité un programme de travail incluant en premier lieu l'ensemble des problèmes liés au traitement de l'amiante résiduel. Dans ce cadre, nous avons déjà entendu l'inspection du travail, qui a lancé une campagne sur ce sujet. Nous souhaitons en savoir plus sur l'articulation entre l'action de l'inspection du travail et celle de la CNAMTS. M. Philippe BOURGES : La direction des risques professionnels, la DRP, est hébergée au sein de la CNAM. Elle compte environ 60 personnes. Ses deux principaux départements sont celui de la prévention et celui de l'assurance, auxquels s'ajoute l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), qui remplit une mission très importante de recherche et d'information. Vingt services sont chargés de mettre en œuvre la politique de prévention sur le terrain : seize sont situés en France métropolitaine, au sein des CRAM, et quatre dans les départements d'outre-mer, qui sont regroupés au sein des caisses générales de sécurité sociale. Le dernier organisme de la branche « accidents du travail / maladies professionnelles » (AT-MP) est EUROGIP. Cet organisme de treize personnes s'efforce de promouvoir la politique de prévention des risques professionnels au niveau européen. Pour ma part, je suis notamment chargé de la prévention des risques liés à l'amiante, ainsi que du suivi du CACES, le certificat d'aptitude à conduire en sécurité. Il s'agit d'un dispositif national que nous avons mis en place avec les partenaires sociaux. M. le Président : Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce point ? M. Philippe BOURGES : Le CACES a pour but de répondre à l'obligation de formation des salariés sur les équipements de travail, en application du décret de 1998. Nous avons émis des recommandations relatives à la définition du CACES, en collaboration avec le COFRAC, le Comité français d'accréditation, qui délivre une certification aux organismes qui font passer les tests. L'intérêt du CACES est qu'il répond à la fois aux obligations réglementaires des entreprises et à nos obligations de prévention. Pour mémoire, plus d'un million de salariés ont subi ces tests en moins de trois ans. Pour revenir à l'amiante, nous pouvons intervenir, conformément au code de la sécurité sociale, dans tous les chantiers déclarés, puisque nous recevons les plans de retrait. Nous avons la faculté d'adresser aux entreprises des injonctions, sous peine de cotisations supplémentaires. Nous avons défini des recommandations sur certaines pratiques, par exemple le retrait de l'amiante-ciment et le sciage des canalisations en amiante-ciment, qui posait un problème particulier aux entreprises du BTP. M. le Président : S'agissant du retrait de l'amiante-ciment, pourriez-vous être plus explicite ? M. Philippe BOURGES : L'amiante-ciment emprisonne les fibres. Celles-ci sont donc a priori moins susceptibles d'être libérées dans l'atmosphère. Mais il arrive que les entreprises soient amenées à casser des toitures en amiante-ciment, et donc à libérer des fibres. Les canalisations en amiante-ciment sont le plus souvent enterrées. Lorsque les entreprises interviennent, elles peuvent également être amenées à casser. Il importe donc de prendre un certain nombre de précautions, qui ont fait l'objet d'une recommandation approuvée par les partenaires sociaux. M. le Président : Nous retrouvons une fois de plus la différence entre amiante friable et amiante non friable. M. Philippe BOURGES : C'est un vrai problème, en effet, aussi bien pour les techniciens que pour ceux chargés de faire respecter la loi ou les bonnes pratiques. M. le Rapporteur : Estimez-vous que la réglementation est suffisante ? Certains points devraient-ils précisés ? Quel est votre point de vue sur ce point, et notamment sur la différence de traitement entre l'amiante friable et l'amiante non friable ? M. Philippe BOURGES : La réglementation est déjà assez lourde. Elle est complexe, même pour des personnes qui connaissent bien le sujet. Je précise, par ailleurs, que nous avons une mission de prévention. Notre rôle n'est pas de faire respecter le code du travail, même si nous sommes consultés sur ce sujet. S'agissant du retrait de l'amiante en place, la réglementation est assez complète. Elle va très loin, en particulier, en ce qui concerne la formation des salariés et la qualification des entreprises. Je ne vois guère sur quel point elle pourrait être améliorée. Pour l'amiante non friable, les obligations ne sont pas les mêmes. Nous sommes régulièrement amenés à constater, sur les chantiers réputés d'amiante non friable, que les salariés travaillent dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes. Concernant l'environnement, qui est un sujet connexe à notre champ de compétences, nous ne sommes pas certains que les déchets soient traités conformément aux textes en vigueur. Pour être tout à fait franc, je dirai que nous ne sommes pas certains que le ministère de l'équipement partage les préoccupations de celui de l'environnement. M. Alain CLAEYS : Vous voulez parler de la traçabilité des déchets ? M. Philippe BOURGES : Sur ce point, les choses sont relativement claires. La question qui se pose toujours est de savoir quelle est la proportion de déchets pirates, qu'on ne voit pas dans les vraies décharges. Cette question fait l'objet de discussion au sein des comités de certification. Nous l'évoquons également avec les entreprises. Ces problèmes ont un impact sur l'organisation économique du secteur. Encore une fois, l'environnement ne fait pas partie de notre champ de compétences, mais nous en parlons constamment. M. le Président : Si vous en parlez constamment, c'est qu'un problème important se pose. M. Philippe BOURGES : Je pense plutôt que la question est évoquée en ce moment pour des raisons conjoncturelles, liées à la parution d'une circulaire très récente. M. le Président : Que dit-elle, cette circulaire ? M. Philippe BOURGES : Je ne l'ai pas lue dans le détail. Je la connais au travers de conservations que j'ai eues avec des personnes qui l'ont étudiée. Elle concerne la gestion des déchets en décharge. M. le Président : De quand date-t-elle ? M. Philippe BOURGES : J'en ai eu connaissance au début du mois de juin. Elle venait de paraître. M. le Rapporteur : Quelles sont vos recommandations en matière de traitement de l'amiante non friable ? M. Philippe BOURGES : Nous avons émis trois recommandations, qui concernent des points techniques très précis. Toutes nos recommandations concernant le BTP - il y en a 72 -définissent des règles de l'art en matière d'hygiène et de prévention et sont approuvées par les partenaires sociaux. Elles sont connues des entreprises. Certaines d'entre elles, commencent même à être connues des juges. Elles ont un effet positif sur les pratiques des entreprises. M. le Président : En quel sens dites-vous que certaines recommandations sont « même » connues des juges ? M. Philippe BOURGES : L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) avait publié un bref document visant à préciser la valeur juridique des recommandations. C'est une question que l'on nous pose régulièrement. Les recommandations étant approuvées par les partenaires sociaux, les entreprises de la branche concernée sont réputées les connaître et les appliquer, nos services de prévention peuvent adresser des injonctions aux entreprises qui ne les respectent pas et ces textes conventionnels peuvent, bien qu'ils ne soient pas législatifs, être utilisés par les juges. Il est arrivé, par exemple, qu'après un accident causé par un conducteur, l'employeur soit relaxé parce qu'il lui avait fait passer le CACES. Pour revenir à la question de M. le Rapporteur, je souhaite insister sur l'obligation de diagnostic, qui s'impose aux propriétaires d'immeubles. Cette disposition n'est pas toujours effective. Les propriétaires sont souvent déconnectés des travaux qu'ils font faire et les entreprises qui interviennent sur un immeuble ne sont pas toujours très vigilantes, ne serait-ce que parce qu'elles sont désireuses d'obtenir le contrat. M. le Rapporteur : Les dossiers techniques amiante (DTA) sont-ils entrés dans la pratique de manière effective ? M. Philippe BOURGES : Les DTA ne sont pas envoyés aux organismes de prévention. J'en entends parler parce que je siège au sein des deux comités de certification des entreprises de désamiantage. M. Bisson pourrait vous en parler davantage. Il semble que certains diagnostiqueurs aient des progrès à faire, et que les documents eux-mêmes ne soient pas toujours exploitables. M. Bruno BISSON : Les DTA font partie des éléments sur lesquels s'appuie l'évaluation des risques amiante. Lorsque nous avons connaissance de travaux effectués dans des bâtiments existants, nous vérifions si le bâtiment concerné est mentionné dans le DTA, que nous réclamons à la réception du plan de retrait. Les ingénieurs et contrôleurs de sécurité qui ont une bonne pratique des chantiers soulignent que les diagnostics sont parfois incomplets et que les termes employés sont parfois incompréhensibles. Il arrive aussi que le maître d'ouvrage, le propriétaire ou le locataire, ne transmette pas le dossier. Dans ce cas, l'entreprise ignore l'existence d'amiante dans le bâtiment. M. Philippe BOURGES : J'ajoute que les auteurs des DTA ont souvent paru restreindre le champ du diagnostic afin de limiter leurs responsabilités. Quand on leur demandait de vérifier les plafonds et les murs, ils n'examinaient pas les sols, ni les convecteurs électriques. Je parle volontairement au passé. M. Antoine CARRÉ : S'agissant de l'amiante non friable, vous avez évoqué des conditions de travail qui ne sont pas satisfaisantes. Pouvez-vous préciser votre pensée ? S'agit-il d'entreprises qui ne respectent pas la réglementation ou les recommandations ? Vous appuyez-vous sur des constats médicaux ? M. Philippe BOURGES : Non, je ne m'appuie pas sur des constats médicaux. Nous n'avons pas de retours, et de toute façon, la plupart des problèmes de santé liés à l'amiante se manifestent après une longue période. Nous constatons des manquements à des obligations de certification, qui sont souvent réglementaires et d'ordre technique. Par exemple, un groupe électrogène se trouve dans une zone confinée maintenue sous dépression : lorsque nous demandons que l'on fasse démarrer le groupe électrogène et qu'il ne démarre pas, il s'agit, du point de vue de la certification, d'un cas de non-conformité. Pour nous, c'est une situation qui présente un risque très important, parce qu'elle peut occasionner une pollution grave et poser des problèmes dans l'organisation du travail. De manière générale, plus que de graves carences, nous constatons un manque de rigueur. Une accumulation de négligences peut avoir pour effet que les salariés soient exposés. Mais nous ne pouvons pas dire que nous ayons constaté des effets sur la santé des salariés. C'est d'ailleurs pourquoi le chiffre, qui a été avancé lors de la campagne 2004, de 76 % d'entreprises ne respectant pas la réglementation est contestable, dans la mesure où il correspond à des problèmes très divers. Mais c'est un fait que le secteur du désamiantage ne travaille pas avec toute la rigueur souhaitable. M. le Président : Vous ne récusez pas ce chiffre de 76 % ? M. Philippe BOURGES : J'ai un peu l'impression qu'on a ajouté des choux et des carottes. On peut dire que 24 % des entreprises étaient blanches comme neige et que 76 % ne l'étaient pas. M. le Président : Vous n'avez pas les mêmes moyens de contrôle que l'inspection du travail, n'est-ce pas ? M. Philippe BOURGES : Les inspecteurs du travail sont des juristes qui ont souvent une vraie compétence technique, qu'ils acquièrent sur le terrain. De notre côté, les contrôleurs de sécurité et les ingénieurs conseil sont des techniciens, qui ont une formation comprise entre bac plus deux et bac plus cinq, avec au moins cinq ans d'expérience professionnelle. Ils sont en général affectés dans les secteurs dont ils sont issus. Ils connaissent donc le fonctionnement de l'entreprise, ainsi que ses rouages ; ils ont les réflexes de l'entreprise. Et sur le plan technique, ils se maintiennent au niveau de compétences nécessaire à leur crédibilité. En termes d'effectifs, l'inspection du travail représente environ 1 300 personnes présentes sur le terrain, qu'il s'agisse d'inspecteurs ou de contrôleurs, et une assez faible proportion d'entre eux s'occupe des problèmes liés à l'amiante Les services de la CNAM disposent, quant à eux, de 800 à 1 000 agents de terrain, dont un peu moins de 20 % suivent les entreprises du BTP. Environ 200 agents se rendent, régulièrement ou ponctuellement, sur des chantiers amiante. Au bout du compte, les moyens humains sont très voisins. Et dans un cas comme dans l'autre, ils sont très nettement insuffisants. M. le Président : Nous sommes tout à fait d'accord sur ce dernier point. Avez-vous avec l'inspection du travail des relations régulières ? Échangez-vous des informations ? Travaillez-vous en commun, en dehors des campagnes que vous menez conjointement ? M. Philippe BOURGES : Nous avons des relations formelles au niveau régional, où nous avons des obligations de coordination. Elles sont souvent déclinées au niveau des directions départementales. Mais elles dépendent aussi des hommes. Elles sont plus ou moins efficaces, et plus ou moins formelles. Sur le terrain, les inspecteurs et contrôleurs du travail, d'une part, et les ingénieurs conseil et contrôleurs de sécurité, d'autre part, travaillent parfois ensemble. Mais en général, nous préférons intervenir de façon indépendante, afin de ne pas brouiller les messages. Notre rôle est de faire de la prévention, afin d'éviter que les salariés soient victimes d'accidents ou de maladies professionnelles. Le rôle de l'inspection du travail est de vérifier que le code du travail est respecté. Les personnes recevant la visite de l'inspection du travail sont souvent un peu moins décontractées, et ne parlent pas forcément des mêmes sujets. S'agissant de l'amiante, la campagne a été suivie de façon nationale. M. le Président : Sur ce sujet, pensez-vous qu'il y a des améliorations à apporter ? M. Philippe BOURGES : Il y en a très certainement, mais nous considérons que nous avons des missions qui nous sont propres. On peut améliorer l'efficacité des contrôles en augmentant les moyens, quitte, pour cela, à redéfinir les champs de compétences. S'agissant de la coordination entre les services de prévention de la CNAM et l'inspection du travail, je ne vois pas quelles dispositions pourraient nous amener à travailler ensemble, lorsque nous ne le souhaitons pas, ou pour nous en empêcher lorsque nous le souhaitons. Si l'on devait absolument modifier les choses, on pourrait augmenter le niveau de coordination entre les directions des relations du travail et les directions régionales du travail. Nous perdrions vraisemblablement en autonomie. M. Alain CLAEYS : Vous gagneriez peut-être en efficacité. M. Philippe BOURGES : C'est possible, si les champs de compétences étaient redéfinis. M. le Rapporteur : S'agissant de la campagne de 2004 et du chiffre de 76 % d'entreprises ne respectant pas la réglementation, vous avez dit que l'on avait ajouté des choux et des carottes. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce point ? Par ailleurs, quand une entreprise, dans le cadre d'une opération de maintenance, découvre de l'amiante confiné ou dissimulé, les organismes de sécurité sociale ne reçoivent pas de plan de retrait. Comment envisagent-ils les problèmes qui se posent dans ce cas de figure ? Enfin, le médecin de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) que nous avons auditionné nous a dit que, dans le secteur du BTP, la part des maladies de l'amiante dans l'ensemble des maladies professionnelles était en augmentation. Confirmez-vous cette appréciation, en particulier en ce qui concerne les entreprises de maintenance ? M. Philippe BOURGES : La CNAMTS couvre 67 % de la population active12. J'aurais tendance à dire que la part des maladies de l'amiante dans l'ensemble des maladies professionnelles est stable, alors que nous assistons à une explosion des troubles musculo-squelettiques et des maladies dorsolombaires. Mais en valeur absolue, le nombre de maladies liées à l'amiante est probablement en augmentation. En ce qui concerne les entreprises du secteur 3, nous ne disposons pas d'éléments nous permettant d'identifier les chantiers. En revanche, nous tentons de les sensibiliser au risque amiante, en particulier pour leurs interventions régulières et de courte durée. C'est ainsi que nous avons mené l'action « Centre de ressources amiante », avec la direction des relations du travail, l'INRS, et des partenaires du BTP. Cela dit, nous ne parvenons que difficilement à toucher les entreprises du secteur 3. Elles ont l'obligation de s'informer du risque amiante, le propriétaire est censé leur fournir les informations nécessaires, mais les marchés qui sont passés le sont assez rapidement et ne laissent pas de traces. De sorte que ces entreprises travaillent souvent dans des conditions qui laissent présumer qu'un risque amiante peut se rencontrer régulièrement. Les organisations professionnelles jouent bien leur rôle de relais, mais au total, je ne suis pas sûr que les entreprises concernées soient suffisamment sensibilisées. M. le Président : Le BTP regroupe des grandes entreprises, mais aussi leurs entreprises sous-traitantes, ainsi que toute une myriade de petites entreprises et les entreprises du secteur 3. Il y a donc une zone grise très importante. M. Philippe BOURGES : Oui, je crois que 96 % des entreprises du bâtiment comptent moins de dix salariés. M. le Président : C'est cela. Au total, le jugement que vous portez sur le niveau d'information et les conditions de prévention est donc extrêmement sévère. M. Philippe BOURGES : Le problème est réel. J'ai du mal à trouver les solutions. Il faudrait renforcer le diagnostic, renforcer l'obligation du propriétaire en matière d'information. Mais ces pistes restent extrêmement ponctuelles. Nous nous heurtons à un vrai problème de communication. Pourtant, les entreprises ne sont pas de mauvaise foi. M. le Président : Je n'en doute pas. Il reste que, pour des raisons qui ne sont pas liées à la mauvaise volonté, les politiques de prévention sont faiblement suivies. C'est bien le constat que vous faites ? M. Philippe BOURGES : Oui. Le cœur du problème est une méconnaissance du risque, de la part des propriétaires comme des entreprises, en particulier de petite taille. Une entreprise de trois ou quatre salariés n'a même pas, bien souvent, les compétences nécessaires pour évaluer les risques. M. le Président : S'agissant des diagnostics, il me semble que vous avez également porté un jugement assez sévère. Pourriez-vous préciser votre pensée ? M. Philippe BOURGES : Les professionnels de l'amiante nous disent que tous les diagnostiqueurs ne sont pas d'un grand sérieux, et que les diagnostics ne sont pas faits de façon homogène. M. le Président : Le contrôle devrait donc être renforcé, ainsi que la formation des diagnostiqueurs ? M. Philippe BOURGES : Oui. Cela dit, le dispositif est relativement récent. Mais il me semble, en effet, qu'il faut que le ménage se fasse. M. le Président : Nous retenons donc cette expression : il faut faire le ménage. M. Philippe BOURGES : J'aurais mieux fait de dire qu'une décantation est nécessaire. M. le Président : Non, non. Nous retenons le mot qui vous est venu spontanément à la bouche. Vous dites que le CACES a contribué à améliorer la prévention pour les conducteurs d'agents. S'agissant de la maintenance amiante, pensez-vous qu'un dispositif analogue serait concevable ? Et serait-il utile ? M. Philippe BOURGES : Le CACES est un test visant à valider des compétences. Sa mise en place a été lourde, puisqu'elle a impliqué la définition d'une procédure d'accréditation et de certification, ainsi que la participation des partenaires sociaux. S'agissant de l'amiante, un dispositif analogue serait peut-être difficile à mettre en œuvre, mais ce n'est pas forcément une mauvaise idée. M. le Président : Combien de salariés ont-ils obtenu le CACES ? M. Philippe BOURGES : Au cours des années 2002, 2003 et 2004, 850 000 salariés ont obtenu le CACES. M. le Président : Si vous avez touché 850 000 salariés, ce qui n'est pas rien, dans le domaine de la conduite d'engins, il n'est pas impossible d'en faire autant concernant les précautions à prendre dans le secteur 3. M. Philippe BOURGES : Mais cela veut dire que l'on demanderait à des entreprises de plomberie ou d'électricité, qui ont des obligations de formation déjà assez lourdes, d'obtenir un certificat supplémentaire au motif qu'elles peuvent éventuellement avoir l'occasion d'intervenir un jour sur l'amiante. Cela suppose un grand travail de préparation psychologique. Cela dit, techniquement, c'est possible. M. Jean-Marie GEVEAUX : Nos auditions font ressortir deux problèmes. Le premier est celui de la qualité du diagnostic et du recensement des immeubles qui peuvent contenir de l'amiante, à des doses plus ou moins élevées et sous des formes diverses. Le second est celui de l'information et de la qualification des entreprises, en particulier les petites entreprises. S'agissant des bâtiments, les propriétaires ne sont pas toujours conscients que le diagnostic amiante est obligatoire. Que pensez-vous de l'idée d'apposer des affiches dans les halls d'immeubles afin d'attirer l'attention des entreprises sur les dangers potentiels de leurs interventions, ce qui pourrait les conduire à interpeller les propriétaires avant d'effectuer les travaux ? M. Philippe BOURGES : Il me semble que l'information devrait prendre d'autres formes. Lorsque des opérations de désamiantage ont eu lieu dans une gare parisienne, on a renoncé à un affichage qui aurait pu affoler la population. Une affiche dans un hall d'immeuble peut également poser des problèmes difficiles à maîtriser. En revanche, on peut envisager une obligation d'information sous une forme légère. M. le Président : Une information est-elle menée en direction des syndics ? D'une manière générale, les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage sont-ils sensibilisés aux exigences de sécurité et de diagnostic ? M. Philippe BOURGES : Le propriétaire se décharge très souvent sur le syndic quand il en a un. Les choses sont donc plus simples dans ce cas. Cela dit, le syndic n'est qu'un gestionnaire. M. le Président : Certes, mais il reste que les syndics peuvent être un canal de sensibilisation tout à fait utile, comme ils l'ont été en ce qui concerne la question des termites. Avez-vous fait un travail en direction des syndics ? M. Philippe BOURGES : Nous travaillons davantage avec les entreprises. Mais nous sommes prêts à prendre contact avec les organisations de syndics. Nous avons également travaillé avec l'Association des maires de France. Il existe plusieurs canaux. Le problème est qu'il est difficile d'agir en dehors d'un cadre réglementaire. Le CACES a été une réussite parce qu'il s'est appuyé sur un décret et des arrêtés. M. le Président : Avez-vous mené des actions en vue de sensibiliser les offices HLM ? M. Philippe BOURGES : Non. Nul n'étant censé ignorer la loi, nous n'avons, a priori, pas besoin de les sensibiliser. Mais ce serait sans doute une piste très intéressante pour les entreprises du secteur 3. M. Bruno BISSON : Une autre suggestion est la constitution d'une base de données. Quand une entreprise intervient dans un immeuble, elle hésite, pour des raisons commerciales, à demander au client si le bâtiment contient de l'amiante ou pas. Qui dit amiante dit précautions à prendre, et donc surcoûts. Si une base de données était alimentée par les propriétaires, les entreprises pourraient la consulter directement. Elle serait gérée par un organisme qui reste à définir. M. le Président : C'est une idée intéressante. Mais je vois mal comment une base de données pourrait être constituée si les personnes sont réticentes à faire des diagnostics. M. Bruno BISSON : Il faudrait une obligation d'informer cette base de données. M. Philippe BOURGES : Il serait bon que les informations soient succinctes. Actuellement, l'obligation d'un dossier technique ne donne guère de résultats parce que le DTA est souvent indigeste, et dépasse souvent les compétences des petites entreprises de plomberie ou d'électricité. L'instrument informatique pourrait être fort utile, même s'il impose quelques contraintes. M. le Président : Le secteur du BTP, cela a été dit, comporte beaucoup de petites entreprises. Les salariés, en particulier dans les entreprises qui n'appartiennent pas au secteur 3, n'ont pas nécessairement les compétences requises. M. Philippe BOURGES : La formation n'est pas obligatoire pour les entreprises de secteur 3. Il existe une obligation d'information en cas de présence d'amiante, et, pour ces entreprises, une obligation d'organiser les travaux en conséquence. Mais quand l'intervention ne porte pas sur l'amiante, il n'est pas nécessaire d'être formé au risque amiante. Les salariés doivent seulement savoir qu'il y en a. L'obligation d'une formation analogue au CACES est une piste à explorer. M. le Président : Il me semble que les problèmes liés à l'amiante non friable et ceux que pose la maintenance se recoupent partiellement. M. Philippe BOURGES : La prévention concernant l'amiante non friable porte sur les activités de retrait. S'agissant de la maintenance, nous intervenons pour des travaux qui n'ont rien à voir avec l'amiante mais au cours desquels il est possible d'en rencontrer. L'organisation de la prévention n'est pas la même. Dans le secteur 2, il s'agit de travailler sur de l'amiante, friable ou non friable. Dans le secteur 3, ce n'est pas le cas. M. le Président : Cela dit, un électricien peut fort bien être amené à travailler sur des couvertures contenant de l'amiante non friable, qui devient friable si des travaux de démolition sont effectués. Par ailleurs, de plus en plus d'entreprises du bâtiment ont recours à des salariés étrangers, pour lesquels les obligations de formation sont les mêmes que pour les salariés français. Sont-elles remplies ? M. Philippe BOURGES : C'est un problème qui n'est pas apparu lors de la dernière réunion des spécialistes BTP de toutes les caisses que j'ai organisée il y a trois semaines. Le problème que rencontrent les entreprises est celui de la concurrence étrangère. M. le Président : Cela ne veut pas dire que le problème n'existe pas. M. Philippe BOURGES : En effet. D'ailleurs, s'agissant du CACES, il est arrivé que des salariés étrangers ne puissent pas le passer parce qu'ils ne savaient ni lire ni écrire le français. M. le Président : Quel est votre degré d'information sur la dangerosité des matériaux dits de substitution à l'amiante ? M. Philippe BOURGES : Tout passe par l'INRS. Lorsque nous sommes interrogés sur les fibres céramiques, par exemple, nous nous appuyons sur les travaux de l'INRS. M. le Président : Êtes-vous régulièrement informés de ces travaux ? M. Philippe BOURGES : Oui. Nous finançons l'INRS à hauteur de 90 %. Même si l'Institut est autonome dans son fonctionnement, nous participons à son conseil d'administration comme à son conseil scientifique. L'INRS nous fait parvenir ses travaux, à nous comme aux CRAM. M. le Président : Sur les matériaux de substitution, en sommes-nous encore au stade des analyses ou y a-t-il des données définitivement acquises ? M. Philippe BOURGES : On sait que ces fibres présentent des risques. L'INRS est en train de les hiérarchiser. M. le Président : La mission aura l'occasion de revenir sur ce point. Pouvez-vous nous parler de l'activité d'EUROGIP ? M. Philippe BOURGES : EUROGIP est un groupement d'intérêt public créé en 1991, auquel participent l'INRS et la branche AT-MP de la CNAMTS. Son action est assimilable à un travail de lobbying visant à promouvoir la prévention auprès de nos partenaires européens. Il s'intéresse également aux normes européennes, puisque celles-ci structurent la prévention. Il est bon, par exemple, d'intégrer une prévention intrinsèque dans les normes de construction d'une machine. EUROGIP répond également à des appels d'offres de la Commission européenne pour aider les pays candidats ou pour procéder à des évaluations. M. le Président : EUROGIP travaille-t-il sur l'amiante ? M. Philippe BOURGES : Son champ est celui des maladies professionnelles de façon générale. Il a travaillé sur la comparaison des systèmes de prévention, ainsi que sur les taux de reconnaissance. En n'employant que treize personnes, EUROGIP effectue un travail qui nous est très utile. M. le Président : A-t-il publié des rapports récents ? M. Philippe BOURGES : Une lettre d'information régulière peut être téléchargée à partir du site www.eurogip.fr, sur lequel divers documents sont également présentés. M. le Président : Y a-t-il des points que nous n'avons pas abordés ou sur lesquels vous souhaiteriez apporter des précisions ? M. Philippe BOURGES : S'agissant de la distinction entre l'amiante friable et l'amiante non friable, la réglementation ne porte pas sur l'organisation des travaux. Une fois que le marché est passé entre le client et son entreprise, si l'on découvre que la technique mise en œuvre rend nécessaire une certification amiante friable, l'entreprise est normalement obligée d'arrêter le chantier et de le réorganiser. Les entreprises ne le font pas, pour des raisons économiques. Il me semble que la différence entre amiante friable et amiante non friable concerne avant tout la technique de retrait, et non le matériau lui-même. D'autre part, je voudrais souligner que nos contrôles ne se limitent pas aux deux campagnes qui ont été organisées à la demande du ministère du travail. Nos contrôleurs se rendent quotidiennement sur les chantiers amiante. M. le Président : Lorsque vous effectuez des contrôles, informez-vous l'inspection du travail, qui a des moyens de sanction que vous n'avez pas ? M. Philippe BOURGES : En général, quand nous découvrons de vrais problèmes sur les chantiers amiante, le chantier est arrêté et l'inspection du travail est prévenue. Cela passe par les bonnes relations que nos ingénieurs entretiennent avec les inspecteurs du travail. Cela dit, l'inspection du travail ne souhaite pas nécessairement que nous lui confiions tous les problèmes qui se posent. Il importe d'optimiser les moyens. Nous ne saisissons pas l'inspection du travail de façon systématique. Le plus souvent, en cas de problème, nous l'informons de manière informelle, et nous enjoignons l'entreprise d'arrêter le chantier. M. le Président : Votre réponse a le mérite de la clarté, même si je ne suis pas d'accord avec cette méthode. M. Philippe BOURGES : L'expérience a montré que saisir systématiquement l'inspection du travail n'est pas forcément le gage d'une plus grande efficacité. Mais par ailleurs, nous ne sommes pas derrière tous les contrôleurs de sécurité pour savoir ce qu'ils font réellement. M. le Président : Messieurs, nous vous remercions de votre contribution aux travaux de la mission. Audition de M. Hervé VANLAER, sous-directeur des produits et des déchets au ministère de l'écologie et du développement durable, accompagné de Mme Claudine BOURHIS et de Mme Pascale CLOCHARD Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Nous recevons aujourd'hui M. Hervé Vanlaer, ingénieur des Ponts et chaussées, sous-directeur des produits et des déchets au ministère de l'écologie, accompagné de Mme Claudine Bourhis, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État, chef du bureau de la planification et de la gestion des déchets à la direction de la prévention des pollutions et des risques, et de Mme Pascale Clochard, qui s'occupe de la convention de Bâle au sein de ce bureau. La mission d'information sur les risques et les conséquences de l'exposition à l'amiante a consacré ses premiers travaux à la gestion de l'amiante résiduel : conditions d'application de la réglementation en cours, diagnostic, retrait, etc. Nous nous intéressons plus particulièrement cette semaine à la gestion des déchets. M. Hervé VANLAER : Je rappellerai d'abord les grands traits de la réglementation relative aux déchets, particulièrement ceux qui contiennent de l'amiante. Les déchets amiantés font partie de ce que l'on appelle des déchets dangereux, tels que définis par le décret du 18 avril 2002. La notion de déchet dangereux impose de prendre des mesures particulières pour en assurer la traçabilité. Le producteur de ces déchets doit être en mesure de savoir à quel endroit ils ont été éliminés. Cela se traduit concrètement par l'émission d'un bordereau de suivi de déchets amiantés - BSDA - qui en indique très précisément la destination. On distingue traditionnellement deux grandes catégories de déchets amiantés : les déchets d'amiante dit libre et les déchets d'amiante dit lié. L'amiante libre, susceptible d'émettre des fibres, se retrouve dans tous les déchets de flocages enlevés dans le cadre d'un chantier de retrait, mais également dans le matériel et les vêtements des personnels. L'amiante lié correspond essentiellement à l'amiante-ciment où l'amiante est noyé dans un support et ses destinations possibles sont très différentes. Il est à noter que les déchets d'amiante lié n'ont été classés déchets dangereux qu'au cours de l'été 2001, à la suite d'une décision communautaire que d'ailleurs treize États membres sur quinze avaient jugé non justifiée ; mais la Commission a persisté dans sa démarche. Les déchets d'amiante libre peuvent être éliminés de différentes façons. La plus courante est l'admission en centres de stockage pour déchets dangereux. On compte quatorze sites en France dont douze acceptent les déchets d'amiante. Ceux-ci sont enfermés dans des big bags - des grands sacs - et entreposés dans des alvéoles spécifiques. Précisons qu'il s'agit de sites très bien suivis, dont l'exploitation est très différente de celle des décharges pour déchets ménagers. Une deuxième solution consiste à les vitrifier. Une seule installation en France est capable de réaliser ce traitement, située à Morcenx dans les Landes. L'opération consiste à porter les déchets à très haute température afin de produire un vitrifiat qui ne présente plus aucun risque d'émission de fibres d'amiante. Pour les déchets d'amiante lié, il existe pour l'heure essentiellement deux possibilités d'élimination. La première consiste à les stocker dans une alvéole spécifique dans les décharges pour déchets ménagers et assimilés, sachant que cette alvéole n'aura pas forcément de dispositif de recueil des eaux ni du biogaz dans la mesure où les déchets d'amiante lié ne polluent pas les eaux et ne sont pas fermentescibles. La deuxième solution consiste à les entreposer dans des décharges pour déchets inertes, toujours dans des alvéoles spécifiques. Dans la mesure où les matériaux n'ont pas perdu leur intégrité - il s'agit en général de plaques en amiante-ciment -, ils ne posent pas de problèmes particuliers : l'essentiel est de les recouvrir et de garder la mémoire du site pour éviter tout bouleversement ultérieur. Cette réglementation des déchets amiantés s'est concrètement mise en place dans les années 1996-1997, en même temps que tout le cadre réglementaire de l'amiante. Mais bon nombre de dispositions, jusqu'à une date récente, ont été prises seulement par circulaire : ainsi en a-t-il été pour le BSDA, puisqu'il a fallu attendre le 30 mai 2005 avant de voir un décret instaurer le bordereau de suivi pour tous les déchets dangereux, dont les déchets amiantés, et prévoir quelques sanctions pénales en cas de défaut de bordereau. Encore n'entrera-t-il en application que le 1er décembre 2005. Même si les retours montraient que le dispositif du BSDA fonctionnait assez bien jusqu'alors, il est bon qu'il puisse désormais s'appuyer sur une réelle base réglementaire. Notre action reste largement guidée par le rapport du professeur Got de 1998, qui traite de l'amiante, mais qui contient également une série de préconisations tout à fait pertinentes en matière de déchets et particulièrement sur tout ce qui concourt à améliorer leur taux de collecte. Si, pour l'amiante libre, les chantiers de désamiantage sont très bien suivis et si le devenir des déchets n'y pose, à notre connaissance, aucune difficulté particulière, il n'en est malheureusement pas de même pour l'amiante lié. On entend régulièrement les personnes concernées se plaindre de l'absence de solutions simples, sinon à des prix exorbitants. Aussi nous efforçons-nous d'encourager la mise en place de solutions de proximité tout à la fois sûres pour l'environnement et à un coût raisonnable. Se pose enfin le problème des mouvements transfrontaliers de déchets. Mme Claudine BOURHIS : Nous avons engagé une démarche visant à faciliter l'acceptation des déchets d'amiante lié dans les déchetteries comme dans les installations de stockage pour déchets inertes. Une circulaire a été rédigée à cet effet en concertation avec la Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (DGUHC), qui décrit les conditions dans lesquelles ce type de déchet peut être accepté. Nous lancerons avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) une action de communication pour faire connaître ces préconisations. L'objectif est de faire en sorte que de plus en plus de sites puissent accueillir ces déchets à un coût acceptable pour ceux qui veulent s'en débarrasser. Mme Pascale CLOCHARD : L'exportation des déchets est soumise à un règlement européen de 1993 qui définit les modalités de contrôle et de surveillance des échanges de déchets. Il instaure un principe d'autorisation des transferts ainsi qu'un principe d'interdiction d'envoi en dehors de l'Union européenne des déchets considérés comme dangereux. Ce texte reprend en fait une décision de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de 1992 sur les échanges de déchets en vue d'une valorisation, ainsi que la convention internationale de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. L'amiante, codifié RB 01, est présent dans l'annexe IV de la décision de l'OCDE, autrement dit dans la « liste rouge » des produits soumis à un contrôle particulier, mais également à l'annexe V qui reprend les listes de déchets de la convention de Bâle, laquelle mentionne, sous la codification A 2150, les déchets d'amiante, poussières et fibres. M. le Rapporteur : Vous avez tous trois retracé avec beaucoup de précision la réglementation applicable à l'amiante. Nous avons entendu les termes d'amiante libre et d'amiante lié, alors que la plupart de nos invités utilisent généralement ceux d'amiante friable ou non friable... Je suppose que c'est la même chose ? L'amiante libre correspond à ce que nous appelons l'amiante friable, c'est-à-dire les déchets issus du flocage ou du calorifugeage, et l'amiante lié à l'amiante non friable, autrement dit à l'amiante-ciment. M. Hervé VANLAER : Dans le monde des déchets, on dit « lié » ou « libre ». Très peu de textes parlent d'amiante friable. Je comprends évidemment l'expression, mais elle me paraît renvoyer plutôt au cadre de la réglementation du travail. M. le Rapporteur : La réglementation est-elle parfaitement respectée ? Avez-vous les moyens d'en contrôler l'application ? M. Hervé VANLAER : Nous n'avons pas de police spécifique pour les déchets. Dans les faits, c'est très souvent l'inspection des installations classées qui se charge de ce rôle, et prioritairement, pour ce qui est de l'aimante libre, dans les treize décharges pour déchets dangereux qui font l'objet d'au moins une visite par an. Nous n'avons pas eu connaissance de difficultés particulières pour ce qui touche à l'admission de déchets d'amiante. De même, dans certains sites - pas tous - d'origine industrielle, un expéditeur de déchets d'amiante sera contrôlé dans le cadre d'installations classées. En revanche, pour les chantiers plus classiques de déflocage, nous n'avons pas de police particulière. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais, en quatre ans, vu de plainte à propos d'amiante libre - par exemple un big bag rempli d'amiante libre sans responsable identifié. Jamais un tel cas n'a été signalé au ministère. M. le Rapporteur : Le problème se pose surtout pour l'amiante-ciment, autrement dit l'amiante lié ou non friable, mais qui devient friable sitôt qu'on le meule, qu'on le casse ou qu'on le transforme. Les recommandations en la matière sont-elles réellement appliquées sur le terrain et dans les déchetteries ? En milieu rural comme en milieu urbain, on trouve partout des plaques de fibrociment... M. Hervé VANLAER : C'est sans doute, effectivement, le point le plus difficile. Une circulaire de 1997 chiffrait à un niveau assez élevé les quantités d'amiante-ciment enlevées ; or le total des quantités effectivement admises dans les centres de stockage est bien loin du compte. Ou bien il y a du stockage domestique - nous-mêmes au ministère recevons des courriers de personnes qui nous disent avoir un bout de plaque ou de canalisation en amiante-ciment chez eux dont ils ne savent que faire -, ou bien il y a un risque réel d'élimination illicite. Notre souci est de bien rappeler les obligations de chacun et de fixer des règles simples et facilement applicables, afin de mieux capter ce flux de déchets par la mise en place d'exutoires de proximité. M. le Président : « Loin du compte », avez-vous dit. Pouvez-vous préciser ? M. Hervé VANLAER : La circulaire parlait d'un volume de 400 000 tonnes chaque année ; or nous serions plutôt autour de 100 000 à 150 000 tonnes admises en centres de stockage... M. le Président : Vous êtes effectivement très loin du compte ! M. Hervé VANLAER : Reste à savoir comment a été estimé ce chiffre de 400 000 tonnes. Je ne sais d'où il vient. M. le Rapporteur : Dans une décharge de déchets ménagers, il doit y avoir une alvéole à part pour l'amiante-ciment, dites-vous. M. Hervé VANLAER : C'est une possibilité, non une obligation. M. le Rapporteur : Effectivement, car j'en ai vainement cherché une dans la décharge que j'ai visitée la semaine dernière ! M. Hervé VANLAER : Nous avons effectué un recensement sur les 200 sites les plus significatifs - plus de 20 000 tonnes par an : trente-sept seulement acceptaient l'amiante-ciment. Autrement dit, le réseau est loin d'être complet. Force est de recourir aux installations de stockage pour déchets inertes. Mme Claudine BOURHIS : Dans certains départements, il n'existe aucun exutoire possible. Il se pose donc un réel problème de répartition des sites sur le terrain. M. le Président : Je retiens donc que sur 400 000 tonnes de déchets, seulement 150 000 collectées, et que sur 200 sites, seulement 37 acceptent les déchets d'amiante-ciment... Sous réserve de confirmation, évidemment. M. le Rapporteur : Si l'amiante lié est classé parmi les déchets dangereux, c'est bien qu'il présente une réelle dangerosité - ce dont nous sommes ici persuadés. Auquel cas toute décharge de déchets ménagers devrait disposer d'une alvéole spécifique à l'amiante liée... N'y a-t-il pas un décalage entre la classification comme produit dangereux et la banalisation de son traitement, dans un site où tout un chacun peut venir déposer des produits non considérés comme dangereux ? M. Hervé VANLAER : C'est toute l'ambiguïté de la notion de déchet dangereux. Classiquement, on distingue le danger, intrinsèque, et le risque, produit du danger et de l'exposition. Le classement de l'amiante-ciment parmi les déchets dangereux a fait l'objet de grandes discussions au niveau communautaire. Treize États membres y étaient opposés. Normalement, cette affaire aurait dû passer en conseil des ministres ; encore aurait-il fallu qu'il y eût un consensus. Mais la Commission a fait front et deux États membres ont appuyé sa position. Reste que la notion de déchet dangereux est importante pour ce qui touche à la traçabilité. De ce point de vue, le classement comme tel de l'amiante-ciment me semble intéressant : il s'agit de déchets dont on doit connaître le devenir. M. le Rapporteur : L'un des buts de notre mission d'information est d'examiner le problème au plan européen et international. À défaut de connaître la position du conseil des ministres de l'écologie, il serait intéressant de savoir comment les pays ont déterminé leur position. M. Hervé VANLAER : Avant même le conseil des ministres, on réunit des groupes de travail avec des experts nationaux. Je ne sais jusqu'où le dossier est allé, mais force a été de reconnaître, dès le départ, une absence de consensus. La présidence l'a peut-être constaté avant même que cette affaire ne vienne en Conseil des ministres. Il faut savoir que si aucune décision n'est prise dans les trois mois, la Commission peut faire ce qu'elle veut dans le cadre de la procédure dite de « comitologie13 » applicable à des décisions considérées comme non fondamentales. À propos de la réglementation communautaire applicable aux déchets d'amiante, une décision a été adoptée fin 2002 sur l'admission des déchets d'amiante lié en décharge pour déchets non dangereux, qui peut avoir un aspect trompeur : les déchets d'amiante lié en question englobent ceux dont nous parlons - amiante-ciment pour l'essentiel -, mais également les fibres d'amiante emballées dans du plastique, autrement dit pratiquement tous les déchets d'amiante libre ! La réglementation française est à cet égard beaucoup plus stricte que la réglementation communautaire pour ce qui touche aux déchets d'amiante libre. Mme Martine DAVID : À vous entendre, il y aurait sur le territoire français 200 sites qui pourraient recevoir des déchets d'amiante lié ? M. Hervé VANLAER : Ce chiffre correspond au nombre de décharges pour déchets ménagers et assimilés recevant plus de 20 000 tonnes par an. Mme Martine DAVID : Mme Bourhis a évoqué les campagnes informatives et pédagogiques engagées pour faire accepter les déchets d'amiante lié dans les déchetteries. Mais à qui est destinée cette information ? Aux préfectures, aux collectivités territoriales ? En tant que maire, je n'ai jamais vu passer un document de ce genre. Par ailleurs, le faible nombre des contrôles n'est-il pas de nature à rendre plus difficile encore l'acceptation de ces sites et donc la couverture de tout le territoire ? Avec un seul contrôle par an, on en conclura qu'il peut finalement s'y passer n'importe quoi... En tout cas, ce n'est pas rassurant et cela ne peut que contribuer à la méconnaissance de la destination de ces déchets. Ne faut-il pas augmenter les contrôles ? Du côté du grand public enfin, comment ces sites sont-ils acceptés par la population ? L'entreposage de ce type de déchets a-t-il à votre connaissance donné lieu à des oppositions, des manifestations diverses ? Ce genre d'opération est-il clairement répertorié et connu ? Il serait intéressant pour les élus locaux de savoir comment tout cela évoluera, sachant que les besoins sont appelés à croître. Comment s'y prendre pour le faire accepter ? Je n'ai pas l'impression que tout cela soit bien connu de ceux qui seront appelés à prendre des décisions, que ce soit dans le cadre des intercommunalités ou au niveau strictement communal. Mme Claudine BOURHIS : Nous n'avons pas encore communiqué en direction des élus, mais une action commune avec l'ADEME est prévue à l'adresse des élus, des gestionnaires, des décideurs concernés par le traitement. La circulaire que j'évoquais tout à l'heure est quant à elle destinée aux préfets. Le nombre de contrôles est fonction de la répartition des moyens entre les installations classées, autrement dit du nombre d'inspecteurs et du temps raisonnable qu'ils doivent consacrer à ce travail. Cela dit, la visite de contrôle d'une installation n'est pas le seul moyen de s'assurer de son bon fonctionnement : les arrêtés préfectoraux édictent toute une série de prescriptions et l'exploitant a lui-même ses propres responsabilités à assumer. Les éventuelles dérives entre deux contrôles sont le plus souvent repérées par l'administration. Reste que la question des moyens a déjà été évoquée. Il est d'ailleurs prévu de commencer à augmenter le nombre d'inspecteurs. Je n'ai jamais entendu parler de problèmes d'acceptation. En général, ces installations ne provoquent pas de nuisances, sur le plan de l'odeur notamment et des poussières, qui souvent conditionnent l'acceptation ou l'opposition des riverains. De surcroît, il s'agit de déchets emballés et recouverts. M. Jean-Marie GEVEAUX : L'importance des tonnages de déchets qui ne parviennent pas à destination soulève déjà une sérieuse interrogation. Mais vous avez aussi parlé des actions visant à accroître les tonnages apportés en déchetterie. Quel est l'objectif exact de cette démarche ? S'agit-il d'accroître l'offre en sites classés ou d'assouplir la réglementation pour faciliter les dépôts ? N'oublions pas non plus que, après quelques allers et retours, la compétence en question est redevenue départementale ; or on ne trouve pas forcément dans un département de centres d'enfouissements capables d'accueillir des déchets dits dangereux. Quand bien même les déchets amiantés ne provoquent pas autant de nuisances ou d'odeurs que les déchets ménagers, d'autres aspects doivent être pris en considération : le trafic des camions, les aménagements, etc., autant de conséquences qui ne sont pas forcément du goût de tout le monde. J'en sais quelque chose car dans ma circonscription, dont le sous-sol se prête assez bien à l'implantation d'un centre d'enfouissement, quatre projets - privés, comme par hasard - sont en concurrence. Faire comprendre et accepter la création d'un centre d'enfouissement n'est pas chose facile. S'agissant des déperditions de tonnages, avez-vous un droit de regard sur les entreprises chargées des transports des déchets, en particulier sur la manière dont elles s'y prennent ? Mme Claudine BOURHIS : Les déchetteries ne sont pas des installations de stockage, sinon à titre très temporaire, mais des endroits où les particuliers peuvent apporter des déchets qui sont ensuite emmenés vers les centres de stockage définitif. L'objectif reste la proximité : si vous refaites la toiture de votre cabanon et que vous souhaitez vous débarrasser de trois plaques de fibrociment, le mieux est de trouver une solution de proximité en faisant en sorte que les déchetteries puissent admettre ces déchets - pour de faibles quantités, s'entend -, ce qui évitera de les retrouver au fond du jardin. En concertation avec le ministère du travail, nous avons émis une série de préconisations simples sur les conditions de manipulation, d'emballage et d'admission, afin de protéger la santé tant des particuliers que des personnels des déchetteries. Quant aux centres de stockage des déchets ménagers, c'est un autre problème... M. Jean-Marie GEVEAUX : Un centre de stockage habilité à recevoir des déchets dangereux peut-il recevoir des déchets d'une autre catégorie, mais présentant d'autres inconvénients M. Hervé VANLAER : Classiquement, il existe trois familles de décharges : premièrement, les décharges pour déchets dangereux, essentiellement des résidus industriels chargés en métaux lourds et majoritairement inorganiques - les déchets dangereux à forte dominante organique sont le plus souvent incinérés, sauf traitement particulier ; deuxièmement, les décharges pour déchets ménagers, qui accueillent, à côté des ordures ménagères, des déchets industriels considérés comme non dangereux, parfois avec une teneur organique un peu plus faible ; troisièmement, les décharges de déchets inertes. Or le cas de l'amiante ne correspond pas exactement à cette classification. Aussi les déchets d'amiante libre vont-ils dans les décharges pour déchets dangereux, bien protégées - l'ouverture d'un big bag, entraînant immédiatement un fort risque d'émission. Pour l'amiante lié, en revanche, l'essentiel est d'emballer et de bien couvrir ces déchets, et surtout de garder la mémoire du site pour éviter d'y creuser par la suite. On peut donc les entreposer soit en décharge pour déchets non dangereux, soit en décharge pour déchets inertes, dans une alvéole spécifique, mais sans qu'il soit besoin d'un dispositif particulier de collecte des eaux ou des biogaz. M. Jean-Marie GEVEAUX : La collecte des déchets et la gestion des déchetteries sont de plus en plus l'affaire de sociétés privées. Or il est difficile de procéder à des contrôles inopinés car les autorités préfectorales, m'a-t-on dit, doivent systématiquement déposer une demande auprès de l'entreprise gérant la déchetterie. Dès lors, il est aisé pour le contrôlé d'éviter de se voir mis en difficulté en cas de problème particulier. Est-ce la vérité ? M. Hervé VANLAER : C'est un peu plus compliqué... Il est effectivement fréquent de prendre rendez-vous avec l'exploitant, ne serait-ce que pour s'assurer qu'il sera là. Cela dit, le but du contrôle n'est pas seulement de prendre en flagrant délit ; c'est également l'occasion de mettre les procédures à plat, de voir comment les choses se passent. Mais les contrôles inopinés sont parfaitement possibles et se pratiquent couramment, surtout lorsqu'une exploitation pose problème. Une déchetterie ne crée tout de même pas des nuisances du même type qu'un centre de stockage ou un incinérateur avec autorisation Seveso. Mme Claudine BOURHIS : Précisons également que les procédures de contrôle sont exactement les mêmes, que le gestionnaire soit privé ou public. Mme Martine DAVID : L'État, comme nous tous, porte une part de responsabilité. Tous ces tonnages qui disparaissent proviennent bien de chantiers répertoriés. Mais lorsque l'on y ajoute tout ce qui provient des particuliers qui, vous l'avez dit, remplacent deux ou trois plaques de fibrociment et cherchent à s'en débarrasser, on peut s'inquiéter des quantités que tout cela représente au total. Force est de constater qu'un gros retard a été pris dans notre pays au regard de l'exigence d'information, de transparence et de clarté vis-à-vis du grand public, entrepreneurs et particuliers. La réglementation s'applique également aux particuliers ; mais les informe-t-on des procédures, des dispositifs et des précautions applicables aux déchets amiantés ? Plus nous avançons dans nos auditions, plus cette question devient inquiétante. Je n'ai pas l'impression que les réponses de l'État soient à la hauteur de l'enjeu, qu'il s'agisse des grands chantiers publics, des entreprises ou des particuliers. Si les procédures d'information et de transparence vis-à-vis du grand public étaient accélérées, loin de paniquer les gens, on les responsabiliserait en leur expliquant la nature du danger et les précautions à prendre. Mais pour l'instant, je n'ai pas le sentiment que l'on ait pris cette affaire à bras-le-corps. M. Ghislain BRAY : Je rejoins les propos de Mme David. D'audition en audition, j'en viens à de moins en moins bien comprendre... Nous avons un réel problème d'information. Pour ma part, je n'avais jamais entendu parler de cette possibilité de déposer de l'amiante dans nos déchetteries classiques. Et à voir les écarts dans les tonnages et la déperdition, il y a de quoi s'inquiéter... Encore n'a-t-on effectivement pas pris en compte le cas du particulier bricoleur qui démonte un bout de bâtiment : une plaque ou deux auxquelles s'ajoutent une ou deux plaques supplémentaires, cela finit par faire beaucoup de déchets... Les gestionnaires des déchetteries privées ou intercommunales ont-ils reçu une information précise ? Une simple benne suffit-elle ? Si vous lancez quelques plaques dans une benne et qu'elles se cassent, l'amiante lié deviendra immédiatement friable... Mme Martine DAVID : C'est bien ce qui se passe... M. Ghislain BRAY : Certaines auditions m'avaient fait reprendre confiance dans le système : notre réglementation, nous a-t-on dit, est très stricte, on nous a expliqué tout le processus d'un chantier de désamiantage - organisation, tenues, aspiration, douches, etc. ; aujourd'hui, nous parlons de déchetteries totalement à l'air libre, où l'on peut faire ce qu'on veut ! Pire, sachant qu'il n'y a pas forcément eu d'information, on peut même trouver de l'amiante provenant de particuliers mélangé à d'autres gravats, provenant de bâtiments démolis sans les protections ni les précautions nécessaires. M. le Président : Toutes ces questions montrent l'étendue du problème. Pour commencer, la notion de déchet inerte, utilisée dans la circulaire de février 2005, suscite nombre d'interrogations. Si le qualificatif « inerte » peut se concevoir à l'origine du produit, il devient de moins en moins approprié au fur et à mesure que celui-ci vieillit. Ensuite, le problème tient finalement moins à la réglementation qu'au décalage entre les masses en jeu - énormes - et la capacité à les gérer, d'autant qu'elles échappent à tout mode de détection commode. On n'a pas encore évoqué le problème de l'inertage ; mais il n'existe qu'une seule entreprise, qui de surcroît connaîtrait, paraît-il, quelques difficultés économiques. Le coût de l'opération, très lourd, obère les estimations de travaux. A-t-on envisagé un moyen d'aider à la maîtrise de ces coûts ? Existe-t-il d'autres projets similaires ? M. Hervé VANLAER : Les estimations de tonnages avancées dans la circulaire de 1997 se fondaient, me semble-t-il, sur les quantités d'amiante-ciment auparavant mises sur le marché et sur la durée prévisible de ces produits. Elles devraient donc a priori couvrir tous les chantiers. Mais si les maîtres d'ouvrage des gros chantiers font les choses correctement, il en va tout autrement pour les petites quantités, d'autant que l'amiante-ciment est un déchet qui se prête facilement à une élimination illicite. L'esprit de la circulaire de février 2005 était de bien rappeler, à la suite du classement de l'amiante-ciment en déchet dangereux, l'existence de possibilités relativement simples d'élimination de ces déchets. Trop d'exigences, entraînant des coûts trop élevés, n'auraient fait qu'accentuer davantage encore le phénomène de pertes. Les dispositions préconisées en concertation avec les autres administrations nous ont paru suffisantes car un durcissement de la réglementation se serait traduit par une augmentation des quantités non contrôlables, sachant que l'amiante-ciment était un produit très largement diffusé. Un inventaire, déjà peu aisé pour l'amiante-flocage, deviendrait particulièrement complexe à réaliser dans le cas de l'amiante-ciment. Vous avez évoqué la question de l'inertage. D'après le rapport du professeur Got, le stockage en décharge pour déchets dangereux des déchets d'amiante libre semble présenter des garanties suffisantes : le professeur Got souligne notamment que le risque de l'amiante est exclusivement lié à l'envol. Il n'y a pas de risque de transfert par voie des eaux : ainsi, il existe en Amérique du Nord des nappes d'eau naturellement assez contaminées par des fibres d'amiante, et aucun cas de cancer documenté n'y a jamais été relevé. L'inertage a l'avantage de régler la question sur le long terme ; mais l'admission en décharge pour déchets dangereux est également une bonne formule car elle concerne un faible nombre de sites et de surcroît très bien suivis. Le risque pour le long terme est très modeste. Ajoutons que l'inertage consomme énormément plus d'énergie que le stockage ; le bilan écologie n'est donc pas aussi évident a priori. Aucun élément ne nous semble de nature à véritablement justifier le soutien de tel mode de traitement particulier. Certains maîtres d'ouvrage, pour des raisons qui leur sont propres, préfèrent que leurs déchets d'amiante libre soient inertés plutôt que stockés. Cela relève de leur libre choix, et aussi des lois du marché. Mme Claudine BOURHIS : Certaines déchetteries acceptent d'ores et déjà les déchets d'amiante-ciment. J'en connais au moins une vers Bordeaux et une autre du côté de Nancy, me semble-t-il. M. Ghislain BRAY : Le problème n'est pas tant celui du nombre que de la méthode utilisée et des règles de prévention. Je ne doute pas que les dispositifs mis en place dans les grands chantiers donnent satisfaction sur ce point mais je le sens moins bien pour une déchetterie, qu'elle soit privée ou intercommunale... Je n'ai pas le sentiment que l'information soit très développée. Je trouve donc que l'on prend beaucoup de risques à autoriser le dépôt d'amiante dans les déchetteries. M. Hervé VANLAER : Il y a un compromis à trouver. Faut-il interdire l'apport des déchets d'amiante en déchetterie au motif qu'il n'est pas suffisamment sécurisé ? Quelle solution proposer aux particuliers qui en détiennent ? Là est toute la difficulté... La direction du travail a été particulièrement attentive à la rédaction des dispositions concernant l'apport des déchets en déchetterie, identifié comme un point sensible du dispositif. Une série de précautions ont été prévues pour prévenir au maximum l'envol d'amiante - la benne doit notamment être bâchée - afin de préserver la santé des personnels de ces sites tout en offrant aux particuliers la possibilité de se défaire de ces déchets. M. le Rapporteur : Pouvez-vous nous répondre dès maintenant sur la récente décision du TGI de Paris, qui s'est déclaré incompétent dans l'affaire du Clemenceau ? M. Hervé VANLAER : Nous aimerions disposer d'un peu plus de temps... M. le Président : Vous répondrez dans le cadre du questionnaire. Nous avons, grâce à vous, eu confirmation de la complexité du problème entre principe de précaution et principe de réalité... M. Hervé VANLAER : Et le souci d'offrir un nombre suffisant de débouchés aux détenteurs de ces déchets. M. le Président : En effet. Mesdames, Monsieur, nous vous remercions. Audition de représentants de la Fédération française du bâtiment (FFB) : M. Dominique FLORIO, président du groupement national amiante, et M. Gérard du CHESNE, ingénieur à la direction des affaires techniques Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Nous recevons aujourd'hui M. Dominique Florio, chef d'entreprise et président du groupement national amiante, et M. Gérard du Chesne, ingénieur à la direction des affaires techniques représentant l'un et l'autre la Fédération française du bâtiment, la FFB. Nous avons choisi de traiter prioritairement de l'amiante résiduel, que l'on trouve partout, sous forme inerte ou non inerte - la distinction nous paraissant au demeurant fragile, voire discutable. Au cours de nos auditions, nous avons abordé les problèmes du diagnostic, du désamiantage et du traitement des déchets. Je vous informe que le Rapporteur a dû nous quitter pour se rendre au Sénat, afin de rencontrer le rapporteur de la mission amiante du Sénat. M. Dominique FLORIO : Mon entreprise est basée à Rennes et je précise que M. Gérard du Chesne, qui suit le dossier amiante depuis 1997, complétera mon intervention. La Fédération française du bâtiment a mis sur pied, en 1997, le groupement national amiante, qui réunit tous nos métiers, soit environ 56 000 entreprises dont quelque 40 000 artisans. Notre groupement réfléchit, analyse, propose et agit. Nous avons mené des opérations de sensibilisation auprès des entreprises mais aussi des étudiants et apprentis de la filière, notamment pour la gestion des déchets de chantier. Nous avons participé à la rédaction des fiches pratiques de l'OPPBTP, l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, et à celle des guides amiante de l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, en particulier le fameux guide ED 815, qui fait aujourd'hui référence. Les représentants du comité directeur de notre groupement participent régulièrement aux commissions de qualification professionnelle pour l'amiante friable ainsi qu'aux commissions de normalisation. Enfin, dans le cadre du projet de transposition de la directive européenne du 27 mars 2003, nous avons de nombreux échanges avec la direction du travail. J'interviens devant vous coiffé de deux casquettes : chef d'une entreprise de cloisons sèches, je suis susceptible de rencontrer de l'amiante et j'entre par conséquent dans le cadre de la section 3. Je dirige également une entreprise de désamiantage certifiée Qualibat 1513 - notre premier chantier, en 1997, était situé à Belle Île en Mer. Le problème de l'amiante appelle une réponse à géométrie variable : le préalable est toujours l'évaluation des risques, en section 2 comme en section 3. En effet, j'estime que les travaux de section 3 font aussi partie du désamiantage. M. le Président. La section 3, est-ce bien la maintenance ? M. Gérard du CHESNE : Ce sont les travaux au cours desquels une entreprise rencontre inopinément de l'amiante. M. Dominique FLORIO : Le désamiantage souffre d'un déficit d'image, l'environnement du marché - je ne parle pas des professionnels eux-mêmes - ayant tendance à minimiser le risque. Je ne prendrai qu'un exemple : sur le chantier de l'Écluserie, en centre ville de Rennes, les pouvoirs publics, au lieu de montrer l'exemple, ont décrédibilisé le métier de désamianteur et la réglementation. La préfecture a, en effet, expulsé des squatteurs pour démolir - et non pas déconstruire - un petit ensemble immobilier couvert en amiante-ciment sans prendre en considération le diagnostic amiante. Le site est resté en l'état pendant trois mois, constituant une véritable décharge à ciel ouvert avec des débris d'amiante-ciment mélangés à d'autres gravats, alors qu'ils auraient dû être dirigés en centre d'enfouissement technique de classe 1. Les riverains ont organisé une action symbolique : munis de masques et de gants, ils ont chargé des brouettes d'amiante-ciment et les ont vidées devant la préfecture et la mairie. Le lendemain, la préfecture, par l'intermédiaire de la Direction départementale de l'équipement (DDE), a procédé au nettoyage du site au tractopelle, sans précaution, et des déchets d'amiante ont seulement été recouverts par un remblai de trente centimètres. La préfecture, par voie de presse, a cependant fait savoir que le désamiantage avait été opéré dans les règles. L'association de riverains vient logiquement de porter plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Dans ces conditions, comment voulez-vous que les désamianteurs soient crédibles quand ils remettent un devis dans lequel ils vendent de la protection, ou quand ils s'efforcent de sensibiliser leurs collègues aux mesures nécessaires pour intervenir dans le cadre de la section 3 ? C'est un exemple parmi tant d'autres. Il arrive aussi qu'un promoteur privé achète une usine avec du calorifugeage, du flocage, et la fasse désamianter par des gens du voyage, en échange de la récupération, par ces derniers, de matériaux comme le laiton ou l'aluminium. M. le Président : Sans doute avez-vous des cas précis en tête ? M. Dominique FLORIO : C'est pratiquement au quotidien que la Fédération, par le canal de ses adhérents, a vent de tels cas. Nous commençons à bien maîtriser les risques ; nos personnels, dont la moyenne d'âge est de plus en plus basse, acquièrent même progressivement une culture du risque. Malheureusement, dans le cadre d'appels d'offres publics comme privés, les maîtres d'œuvre, pour gagner de l'argent, font tenir le lot de désamiantage sur deux feuilles et le noient dans d'autres lots. L'entreprise générale de construction prend alors un sous-traitant qui ne déposera pas de plan de retrait. Le diagnostic, qui ne regarde que le maître d'ouvrage, sera oublié : l'opération se fera le soir, tranquillement, à la bougie. Telle est l'ambiance actuelle sur le marché du désamiantage. Mme Martine DAVID : S'agit-il d'un problème de prix ? M. Gérard du CHESNE : Il s'agit d'un problème de délai et de prix. M. Dominique FLORIO : Les Français, aujourd'hui, ne sont pas prêts à payer pour de la protection individuelle et collective. M. Gérard du CHESNE : À la Fédération, je suis en contact quotidien avec des entrepreneurs ayant répondu à des appels d'offres et qui s'aperçoivent, sur le chantier, qu'il y a de l'amiante. Pour que le travail soit bien fait, ils sous-traitent alors à une entreprise qualifiée mais cette intervention n'avait pas été chiffrée. D'autres dérives sont aussi à déplorer. Récemment, alors qu'une succursale automobile avait élaboré un plan de retrait pour retirer de l'amiante-ciment à l'air libre, l'inspecteur du travail a finalement imposé le confinement. L'entreprise a honoré sa commande mais n'acceptera plus ce type de contrats car elle ne peut se permettre de risquer des arrêts de chantier. Il arrive donc que des contrôleurs exigent des procédures différentes de celles qui avaient été validées dans le plan de retrait. Résultat, lorsqu'un problème est constaté le vendredi, si l'on revient sur le chantier le lundi, l'amiante a disparu, par miracle. Notre fédération, je tiens à le dire, ne valide pas ces procédés mais demande que la législation soit lisible et raisonnable : le confinement est parfois nécessaire mais pas toujours, pour des questions de coûts et de délais. Nous n'en recommandons pas moins aux entreprises de continuer à établir des plans de retrait pour l'amiante non friable. M. Dominique FLORIO : Le Petit Larousse illustré définit ainsi le désamiantage : « Action de retirer un matériau ». De fait, la profession - ce n'est pas une activité mais un métier - manque de lisibilité. Parce qu'il veut produire de la valeur ajoutée, le premier démolisseur non qualifié venu inscrit « Désamiantage » sur sa camionnette. M. le Président : Je vous remercie pour ces propos décapants. Votre discours, extrêmement sévère, tranche avec celui que tenait le lobby des entreprises, il y a encore une dizaine d'années, afin d'empêcher une prise de conscience du risque et de bloquer la moindre décision. J'ai néanmoins cru comprendre que vous jugiez la réglementation trop complexe, tout en reprochant aux pouvoirs publics de ne pas l'appliquer. Ce problème d'application est-il lié à la complexité de la réglementation ou à la méconnaissance des problèmes ? Même si ses interventions peuvent de-ci de-là être gênantes, l'inspection du travail se borne généralement à vérifier l'application de la réglementation. Le désamiantage est un métier, c'est vrai, mais toute une zone noire subsiste à la marge, avec des tentatives de camouflage. Vous avez cité le chiffre de 40 000 artisans. Je crains que la formation et l'information dont ils bénéficient ne soit moins bonne que celle dispensée en direction des grandes structures - ne voyez pas dans cette remarque un quelconque jugement de valeur. Ne faites-vous pas entrer une partie des artisans dans la zone noire ? M. Dominique FLORIO : La réglementation en vigueur est trop complexe et difficilement applicable. Par exemple, en matière d'amiante friable comme non friable, nous avons l'obligation d'employer du personnel sous contrat à durée indéterminée, pour des motifs justifiés de traçabilité et de suivi médical. Mais une grosse partie du patrimoine à désamianter est constitué d'établissements scolaires et il faudrait que la centaine d'entreprises qualifiées interviennent partout en même temps, c'est-à-dire lors des vacances scolaires. Alors on s'aperçoit un lundi que tout l'amiante a disparu. Les professionnels du bâtiment, coincés entre les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les pilotes d'opération et les coordinateurs de sécurité, sont taillables et corvéables à merci. Celui qui fait la loi, aujourd'hui, c'est le pilote de l'opération, parce que le temps, c'est de l'argent. Je ne sais pas comment il serait possible d'introduire davantage de souplesse et de flexibilité pour abaisser les coûts, mais il importe en tout cas de ne pas imaginer de dispositif de certification supplémentaire. L'esprit de la réglementation en vigueur est bon mais n'alourdissons pas les contraintes. En matière de désamiantage, l'évaluation des risques prime. On ne peut demander à une entreprise de désamiantage d'appréhender le risque comme un petit carreleur qui doit retirer quatre mètres carrés de dalles thermoplastiques contenant de l'amiante : il serait irréaliste d'exiger un plan de retrait pour un matériau qui ne dégage pas spontanément des fibres d'amiante. Mais il est dangereux que certains cherchent à profiter de l'amiante pour faire de la valeur ajoutée : tout le monde, aujourd'hui, inscrit « Désamiantage » sur son véhicule et même un boucher ou un charcutier, si l'envie lui en prenait, pourrait en faire de même. Mme Martine DAVID : Voilà une information stupéfiante. M. le Président : Il existe tout de même des contrôles. M. Dominique FLORIO : Pour contrôler une entreprise, encore faut-il pousser sa porte. M. le Président : Et les organismes de qualification ? M. Dominique FLORIO : Ils ne sont compétents que pour l'amiante friable. Un maître d'ouvrage peu scrupuleux qui a 12 000 mètres carrés de couverture en fibrociment à retirer peut se laisser aller à faire enlever trois mètres linéaires de calorifugeage dans le même lot. M. le Président : Nous vous écoutons attentivement, vous parlez vrai, mais vos propos sont parfois contradictoires : vous dénoncez la complexité de la réglementation tout en semblant attendre qu'elle soit renforcée. M. Dominique FLORIO : Mais pas vis-à-vis des entreprises : la réglementation doit être renforcée pour améliorer la lisibilité du marché du désamiantage. Le professeur Got, par exemple, a préconisé la constitution d'une base de données sur l'amiante. M. le Président : Vous appelez donc de vos vœux le renforcement de la réglementation applicable aux maîtres d'ouvrage ? M. Dominique FLORIO : Et aux maîtres d'œuvre, qui ne sont absolument pas qualifiés. M. Gérard du CHESNE : Imaginez l'étonnement d'un entrepreneur confronté à un inspecteur du travail qui dit se moquer de la destination des déchets. Ne conviendrait-il pas d'améliorer la vue d'ensemble du marché du désamiantage ? M. le Président : Merci de nous faire parvenir les documents que votre fédération a élaborés à ce sujet. Mme Martine DAVID : Nombre d'établissements scolaires sont effectivement sujets à des obligations de désamiantage. Mais, en l'espèce, c'est surtout l'insuffisance du nombre d'entreprises certifiées que vous avez pointé du doigt, pas l'inadéquation de la réglementation. Le processus de certification serait-il trop complexe pour permettre à un nombre suffisant d'entreprises de répondre aux appels d'offres passés par les communes et les intercommunalités ? M. Dominique FLORIO : Vous avez entièrement raison, pour ce qui concerne l'amiante friable. Une centaine d'entreprises qualifiées, au regard du patrimoine immobilier amianté, c'est insuffisant. On en demande beaucoup trop aux entreprises : pour quatre employés productifs, un non productif travaille au bureau afin de gérer la traçabilité ainsi que la préparation et le suivi des chantiers. Le désamiantage est décidément un métier à part entière. Beaucoup d'entreprises aimeraient entrer sur le marché mais ne le peuvent pas car le référentiel est trop compliqué. M. le Président : Cela entre tout de même en ligne de compte dans les prix pratiqués par les entreprises. M. Dominique FLORIO : Tout à fait mais cela n'en vaut pas pour autant la peine. Mon carnet de commande a beau être fourni, les résultats de fin d'année ne compensent pas les soucis que je dois endurer et je vais peut-être tout arrêter. M. le Président : Ces entreprises marchent tout de même très bien ! M. Dominique FLORIO : Des entreprises de désamiantage déposent le bilan tous les ans : il fut un temps où nous étions 150 ou 160 et la tendance reste à la baisse, d'autant que nous ne parvenons plus à nous assurer pour la responsabilité civile amiante ! M. le Président : Cela pose effectivement un problème. Mme Martine DAVID : Mais cela ne serait-il pas plus vrai encore si nous abaissions le niveau de certification ? M. Dominique FLORIO : Vous avez malheureusement raison mais je ne détiens pas la solution. M. Gérard du CHESNE : Encore hier, la fédération a été contactée par une personne qui envisage de créer son entreprise et de demander sa qualification mais ne peut se lancer, faute de trouver un assureur qui accepterait de le couvrir. M. le Président : Peut-on affirmer que le ratio rentabilité/risque est trop faible ? M. Dominique FLORIO : De fait, les résultats ne sont pas à la hauteur des efforts déployés, dans un secteur qui se caractérise par une technicité supérieure. Pour se faire une idée, il suffit de confronter les bilans des entreprises de désamiantage à ceux des entreprises de génie climatique, par exemple. M. le Président : Combien de salariés votre entreprise de désamiantage compte-t-elle ? M. Dominique FLORIO : Dix, pour la quiétude de mon sommeil. M. Jean-Marie GEVEAUX : J'ai cru comprendre que les maîtres d'ouvrage ne souhaitaient pas assumer le problème de l'amiante. Les cahiers des charges ne sont-ils pas trop flous ? Pour ne pas passer à côté des problèmes, toute présence d'amiante diagnostiquée dans un immeuble ne devrait-elle pas être impérativement transcrite dans le cahier des charges ? Il s'agit aussi de jouer la sécurité pour les salariés des entreprises appelées à intervenir. M. Dominique FLORIO : Sur dix dossiers d'appel d'offres, un seul diagnostic est précis et complet mais les dossiers tendent néanmoins à s'améliorer. Quant aux diagnostiqueurs, ce ne sont bien souvent que des techniciens de la construction, qui n'ont reçu qu'une formation de deux jours, mais aucunement des professionnels. Faut-il établir un recensement et une cartographie nationale ? Pour le plomb, toutes les informations remontent à la préfecture, mais pas pour l'amiante. Mettons-nous à la place d'un locataire qui viendrait de faire l'acquisition de son appartement et apprendrait que, les parties communes étant floquées, le coût du mètre carré de son bien est divisé par quatre ? C'est la perspective de tels scandales, me semble-t-il, qui freine toute décision. M. le Président : Votre remarque sur la cartographie m'apparaît très juste mais je voudrais vous pousser dans vos retranchements. Je reste sur mon sentiment : vos propos sont un peu contradictoires. À quel point de vue jugez-vous la réglementation trop complexe ? Dans ce secteur d'activité qui relève d'une haute technicité, les problèmes sont-ils imputables aux maîtres d'œuvre ? M. Dominique FLORIO : Lorsqu'un économiste doit évaluer le coût de travaux de désamiantage, il nous appelle pour nous demander notre avis car il n'en a qu'une idée très vague. Pour le savoir précisément, il faudrait presque qu'il dispose d'un bureau d'étude imaginant un mode opératoire en amont. Convient-il d'utiliser une épingle à nourrice ou un bazooka ? Le coût ne sera pas le même et l'économiste est bien ennuyé ! S'agissant de la rigidité du carcan administratif, je pourrais vous parler du projet de transposition de la directive et du problème des mesures d'empoussièrement. S'il fallait qu'un laboratoire certifié par le COFRAC - le Comité français d'accréditation - accomplisse systématiquement des mesures, il devrait pratiquement être présent à demeure sur le chantier, et, croyez-moi, cela serait difficile à vendre. N'oublions pas qu'un lien de subordination existe entre l'entreprise de désamiantage et les laboratoires, du fait de leurs relations commerciales. J'ai été démarché par des laboratoires agréés COFRAC qui m'offraient des bouteilles de champagne à chaque mesure libératoire conforme. Ils recherchent le volume et ce n'est pas avec l'amiante non friable qu'ils pourraient y parvenir. M. le Président : L'insuffisance de la formation des diagnostiqueurs ne pèse-t-elle pas sur la capacité des entreprises de désamiantage à construire leurs projets ? M. Dominique FLORIO : Tout à fait, et je vais plus loin. J'approuve l'arrêté relatif à la formation du 25 mai 2005, applicable le 26 novembre, dont les modalités d'application ne sont pas encore bien définies mais qui augmentera incontestablement le contenu des modules. Il n'en demeure pas moins que je suis effrayé lorsque mon chef de chantier, au retour d'un stage de recyclage où je l'ai inscrit pour une piqûre de rappel, me rapporte que le responsable de la formation l'a remercié pour tout ce qu'il a appris, à son contact, sur le métier du désamiantage ! Mme Martine DAVID : Vous nous avez essentiellement parlé des grands chantiers et votre témoignage est déjà très inquiétant. Mais êtes-vous souvent appelés par des particuliers ? Quel est votre sentiment sur ce marché ? Fonctionne-t-il aussi mal, voire plus mal encore ? M. Dominique FLORIO : Nous intervenons sur des chantiers de tailles très différentes, du palais de Chaillot au pavillon, pour y enlever des dalles de sol thermoplastiques. Nous sommes sollicités toutes les semaines par des particuliers faisant état d'un problème d'amiante mais nos prix, sur ce marché, ne sont pas compétitifs. En effet, pour enlever trois mètres carrés de dalles thermoplastiques et de colle, avec un ouvrier, une heure de travail suffit. En revanche, en désamiantage, trois personnes au minimum sont nécessaires : un gardien de sas et deux personnes en zone. Nous n'avons d'autre choix que de répercuter le coût financier sur le particulier et ce n'est pas jouable : nous remettons des devis mais nous ne sommes jamais retenus. Soit le particulier opère tout seul en utilisant un masque, après quoi je récupère le sac de déchets et je le traite, soit je fais le travail moi-même. Quoi qu'il en soit, le risque, en pavillon, pour le particulier, est très faible, car il s'agit d'amiante non friable. M. le Président : Vous avez mis à jour des problèmes que nous avions déjà rencontrés mais dans un langage extrêmement franc et décapant. Vous avez notamment soulevé les difficultés relatives à l'équilibre financier des entreprises de désamiantage. M. Dominique FLORIO : Un autre souci est le manque de centres d'enfouissement technique en France. Dans certaines régions, nous souffrons vraiment : c'est le désert. M. le Président : Où donc ? M. Gérard du CHESNE : Principalement dans le Sud-Est. Les déchets de Nice doivent être acheminés dans le Languedoc-Roussillon. Dans toute la région Midi-Pyrénées, on ne dénombre que trois centres de classe 1 et je crois que ceux-ci n'acceptent même pas l'amiante. M. le Président : Sur ce sujet, avez-vous établi une cartographie ? M. Gérard du CHESNE : Le site Internet de la fédération aborde la question des déchets au sens large. J'ai par ailleurs questionné sur ce thème plusieurs de nos correspondants régionaux environnementaux. En Rhône-Alpes, il existe une offre de la part des grands du déchet mais à des coûts presque dissuasifs. Sur la Bretagne, je laisserai à M. Florio le soin de s'exprimer. En Midi-Pyrénées et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, cela ne se passe pas bien. M. le Président : Merci de nous fournir un document analytique, quitte à émettre des réserves si vous n'êtes pas sûrs à 100 % de vos informations. M. Gérard du CHESNE : Entendu. Il est souvent question du distinguo entre amiante friable et non friable mais le fond du problème concerne plutôt les petites quantités : comment les recenser et assurer leur transport en déchetterie à un coût raisonnable ? Par ailleurs, comment faire pour rendre la filière plus performante ? M. Dominique FLORIO : L'organisme INERTAM ne nous fait parvenir le certificat d'élimination que deux ans après l'arrivée des déchets en centre d'inertage. Or le maître d'ouvrage ne nous paie le solde du chantier que lorsqu'il reçoit ce certificat. Cela contribue à déséquilibrer nos résultats financiers. Mme Martine DAVID : Pourriez-vous nous donner des indications sur le niveau d'exigence souhaitable pour la certification ? Selon vous, le niveau actuel est trop contraignant, ce qui restreint le nombre d'entreprises. Mais en dessous de quelles normes ne faut-il absolument pas descendre, afin de garantir que les entreprises soient bien qualifiées ? Pourrez-vous nous donner votre avis à ce sujet ? M. Dominique FLORIO : Entendu. Mais, en tout cas, il faut bien continuer à distinguer amiante friable et non friable. Mme Martine DAVID : Je parlais évidemment du friable. M. le Président : Merci messieurs de vos informations. N'hésitez pas à nous faire parvenir des documents complémentaires, notamment sur les centres d'enfouissement. Audition conjointe de Mme Isabelle MARTIN, directrice de la prospective et de la veille réglementaire de la société SITA France Déchets, et de M. Christophe CAUCHI, chef de centre du site de classe 1 de Villeparisis Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Nous recevons aujourd'hui Mme Isabelle Martin, directrice prospective et veille réglementaire de la société SITA France Déchets, et de M. Christophe Cauchi, chef de centre du site de classe 1 de Villeparisis. Madame, Monsieur, nous sommes heureux de vous rencontrer. La mission d'information a adopté un programme de travail très précis et a commencé à aborder le problème de l'amiante résiduel : conditions d'application de la réglementation en cours, diagnostic, retrait, traitement des déchets. Vous entrez donc parfaitement dans le cadre de ce dernier volet. Mme Isabelle MARTIN : Filiale de SITA France, elle-même filiale du groupe Suez Environnement, SITA FD est une société spécialisée dans le stockage des déchets dits de classe 1 et des déchets municipaux. M. le Président : Qu'appelez-vous déchets municipaux ? Mme Isabelle MARTIN : Les déchets ménagers et les déchets industriels banals qui ne présentent aucun caractère dangereux. SITA est un opérateur bien implanté sur le territoire national, mais également en Europe, sur les différents métiers du traitement des déchets : le tri, le traitement biologique/compostage, l'incinération, les centres de stockage de déchets de classe 2 et de classe 1. Notre société SITA FD a plus de vingt-cinq ans d'existence et gère les sites de stockage de classe 1 répartis sur le territoire national. Elle a depuis bientôt dix ans développé une démarche d'assurance qualité : 97 % de notre activité est certifiée ISO 9001. Nous avons également développé des techniques de stabilisation/solidification des déchets - afin de répondre à l'obligation réglementaire, depuis 1995, de respecter certains seuils de présence de polluants métalliques et autres -, dans le cadre d'un groupement avec la société Solétanche Bachy dont les compétences sont reconnues dans les domaines du traitement et de la consolidation des sols. Nous traitons ainsi un certain nombre de déchets, dont les poussières d'incinération d'ordures ménagères ou de déchets industriels spéciaux. SITA FD compte environ 300 collaborateurs et son chiffre d'affaires s'est élevé à 150 millions d'euros en 2004. Le tonnage réceptionné représente 600 000 tonnes de déchets industriels spéciaux - ou dangereux, selon la terminologie européenne -, dont 24 000 tonnes de déchets amiantifères - 65 % d'amiante-ciment et 35 % de flocage. La réglementation applicable au stockage de l'amiante est très claire : une directive européenne a été adoptée en 1999, que le ministère de l'environnement a retranscrite en droit national à travers plusieurs textes, notamment l'arrêté ministériel du 30 décembre 2002, qui régit les centres de stockage de déchets dangereux. En attendant la retranscription, les centres de stockage de déchets non dangereux sont régis par l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997. Les déchets inertes, enfin, obéissent à deux régimes différents : un guide technique s'appuyant sur le code de l'urbanisme a été rédigé pour les déchets inertes provenant du bâtiment et des travaux publics (BTP), alors que les déchets inertes provenant de l'industrie sont régis par un arrêté ministériel de décembre 2004 et relèvent du code de l'environnement. Aux termes de la directive européenne, tous les déchets d'amiante, y compris l'amiante-ciment, sont classés déchets dangereux et orientés en centres de stockage pour déchets dangereux. Toutefois, les déchets dits « code jaune », ne contenant pas d'amiante libérable, sont aujourd'hui dirigés soit en décharges de classe 2 soit en décharges de classe 3, dans un casier dédié. La France a obtenu cette possibilité en expliquant que l'amiante lié ne présente pas spécialement de danger dans la mesure où il ne s'agit pas d'un polluant chimique, mais d'un polluant physique, et de surcroît enrobé dans une matrice cimentaire. L'orientation des déchets d'amiante non libérable en centre de classe 3 n'est pas spécialement partagée par notre société, d'autant que les décharges habilitées à recevoir des déchets inertes du BTP dépendent du code de l'urbanisme, ne font l'objet d'aucune enquête publique ni de contrôle d'entrée et n'ont quasiment pas de pont-bascule. Autrement dit, la traçabilité y est très faible, sinon inexistante, par rapport aux décharges qui relèvent du code de l'environnement, étroitement surveillées par les inspecteurs des installations classées. Il nous paraît donc, comme à tout citoyen sans doute, assez dangereux d'entreposer de tels déchets dans des installations ne dépendant que du code de l'urbanisme et dont personne ne sait comment elles seront surveillées ni même identifiées à l'avenir. 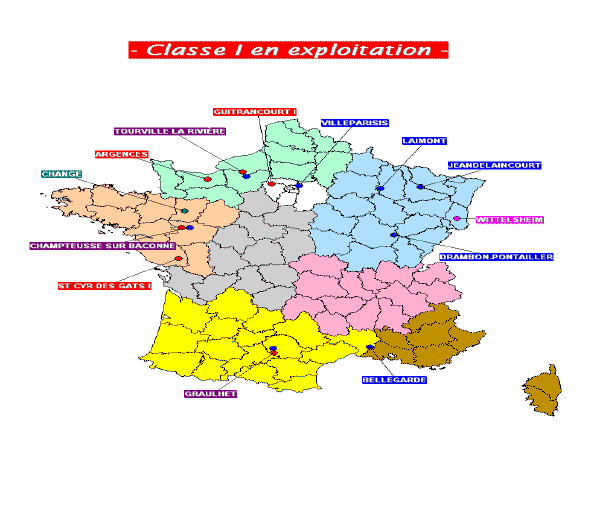 La carte ci-dessus vous présente la répartition des treize centres de stockage de déchets dangereux, dits de classe 1, sur l'ensemble du territoire. Leur nombre n'a guère augmenté depuis une douzaine d'années. Ces centres sont parfaitement habilités à recevoir des déchets d'amiante libre dans les conditions prévues aux articles 43, 44 et 45 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 2002 : ces déchets doivent être conditionnés en double sachet et enfermés dans des big bags, des grands sacs, doivent avoir obtenu un certificat d'acceptation préalable et faire l'objet d'un étiquetage particulier. Une procédure « amont » est prévue avant même l'arrivée des déchets sur le site, avec identification du producteur et certificat de non-mélange avec d'autres déchets dangereux. Le grand principe de cette filière est de ne pas réexposer ses travailleurs à l'amiante. Aussi n'ouvre-t-on jamais les big bags qui ont été conditionnés sur le chantier et identifiés comme tels. Après arrivée du camion sur le site, avec prise de rendez-vous, et contrôle des différents papiers, les déchets sont dirigés vers les alvéoles de stockage. Christophe Cauchi, responsable du site de Villeparisis, qui reçoit environ 250 000 tonnes de déchets dangereux par an, va vous en expliquer le fonctionnement. M. Christophe CAUCHI : Après avoir fourni tous les documents préalables à l'acceptation M. le Président : Ce tonnage est-il en progression ? M. Christophe CAUCHI : Non, mais il est constant alors que nous pensions qu'il diminuerait d'année en année. Entre la remise à niveau de certains locaux et les grosses opérations de restructuration du parc immobilier, les chantiers de désamiantage sont nombreux. M. le Président : Avez-vous essayé de faire une prospective à dix ans ? M. Christophe CAUCHI : Nous ne sommes pas allés aussi loin : les actionnaires ont tendance à raisonner à court terme ! Nous estimons que le niveau actuel se maintiendra au moins jusqu'en 2008. Mme Isabelle MARTIN : Alors que l'interdiction de l'amiante remonte à 1997, les tonnages restent pratiquement identiques d'une année sur l'autre. On s'attendait à une explosion du fait des nouveaux textes ; or le mouvement a plutôt tendance à se prolonger dans le temps. M. le Président : Je puis vous assurer qu'il se prolongera après 2008 ! M. Christophe CAUCHI : L'exploitation du centre de Villeparisis durera jusqu'en décembre 2020. Une fois le site fermé et réaménagé, nous devons un suivi post-exploitation d'un minimum de trente ans. Autrement dit, nous suivrons l'évolution du site et des déchets que nous y avons enfouis au moins jusqu'en 2050. Dès l'instant où nous réceptionnons un déchet, nous en assumons la pleine responsabilité. M. le Président : Voilà qui est clair et précis ! M. le Rapporteur : Votre position a le mérite d'être claire quant à la distinction entre amiante friable ou non friable, dite amiante lié ou amiante libre. Nous avons apprécié que vous considériez l'amiante-ciment comme un déchet dangereux, à traiter en tant que tel. Vous êtes une société privée, obligée d'équilibrer ses comptes et de réaliser des bénéfices. Comment faire des bénéfices dans un tel marché ? Quels sont les tarifs ? Avez-vous des concurrents ? Nous avons invité INERTAM, spécialisé dans l'inertage. Président de la commission de surveillance de l'usine COGEMA de La Hague, je connais bien le site de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Y a-t-il un plancher plastique à Villeparisis ? M. Christophe CAUCHI : Oui. M. le Rapporteur : Que mettez-vous dessus ? Vous avez évoqué le suivi sur trente ans. Sur une de vos photos montrant un site réaménagé, nous avons vu des arbres plantés. Pouvez-vous nous donner quelques précisions techniques ? Le pire - problèmes sismiques, etc. - a-t-il été prévu, à l'instar des contraintes applicables à la filière des déchets nucléaires ? Mme Isabelle MARTIN : Nos prix sont parfaitement affichables : le stockage des flocages d'amiante en site de classe 1 coûte 400 à 450 euros la tonne - nous travaillons toujours en tonnes et non en volume. Pour l'amiante-ciment, le prix est plus faible : 100 à 110 euros la tonne, taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) comprise. Du côté de nos concurrents, dans la filière vitrification, le prix est de l'ordre de 1100 à 1250 euros la tonne pour le flocage et environ 1 300 euros la tonne pour l'amiante-ciment. Vitrifier l'amiante est, tout le monde le reconnaît, une solution assez séduisante. Pourtant, alors qu'elle compte déjà dix ans d'existence, cette filière connaît toujours des problèmes d'élimination de ses stocks et ne fonctionne pas à pleine capacité. Aussi ne nous y sommes-nous jamais associés, jugeant cette technologie encore insuffisamment mature dans la mesure où elle pose encore des problèmes techniques et sanitaires : il faut trier au préalable l'amiante, donc rouvrir les big bags et réexposer les travailleurs au risque, ce que nous avons toujours refusé. C'est également pour cette raison que nous avons rejeté l'idée de stabiliser l'amiante flocage dans une matrice cimentaire. Cela reviendrait du reste à refabriquer de l'amiante-ciment, activité bannie du territoire français. M. le Président : Vous faites pourtant de l'inertage, mais pas pour l'amiante. Mme Isabelle MARTIN : Exactement. Nous pratiquons l'inertage afin de respecter certaines normes de présence de polluants chimiques. Or l'amiante ne présente aucun caractère de pollution chimique. Nous ne stabilisons dans une matrice cimentaire que les déchets susceptibles de relâcher des polluants chimiques dans l'eau, ce qui peut nous amener, par ailleurs, à introduire des additifs pour réduire ou, à l'inverse, oxyder certains métaux afin de les rendre insolubles. M. Christophe CAUCHI : Les centres de stockage de classes 1 et 2 sont des installations classées, donc soumises à étude préalable. Avant ouverture d'un site, un dossier de demande d'autorisation est établi, comportant une étude d'impact, une étude d'environnement et une étude de danger. Le risque sismique notamment est pris en compte : les sites de classe 1 en France sont situés sur des territoires géologiques ne présentant aucun risque de nature sismique. Ainsi le risque sismique n'existe pas à Villeparisis, non plus que le risque d'inondation. L'étude de danger n'a fait apparaître aucun aléa majeur de nature à remettre en cause la pérennité du stockage. Toutes ces études ont été menées préalablement à l'obtention de l'autorisation. Le site de Villeparisis est une ancienne carrière de gypse, matière première du plâtre. Soluble dans l'eau, le gypse ne peut exister à l'état naturel que s'il est enfermé entre deux couches imperméables d'argile. Le carrier de l'époque a enlevé la première couche d'argile, qu'il a remise dans le trou, sur la couche inférieure, une fois l'exploitation terminée. De ce fait, notre site a été aménagé sur deux couches d'argile superposées : entre 35 et 90 mètres d'épaisseur, alors que la réglementation impose cinq mètres ! Encore avons-nous étendu par-dessus des liners14 de polyéthylène parfaitement étanches, protégés par des géotextiles de protection pour éviter d'être abîmés lors de l'exploitation. Vient par-dessus tout un complexe de drainage et de collecte des eaux de percolation qui traverseront le massif de déchets. Ces eaux, polluées, doivent être retraitées. Nous avons alors commencé à exploiter notre site avec des déchets dangereux, mais non amiantés, pour atteindre une certaine épaisseur et nous avons coulé par-dessus un coulis d'inertage en béton qui forme le corps de notre alvéole « amiante », dans laquelle nous disposons les big bags de déchets amiantés. Une fois le sarcophage rempli, nous le recouvrons et nous poursuivons l'exploitation avec d'autres déchets. Autrement dit, l'alvéole d'amiante vient se superposer au milieu d'alvéoles de déchets, comme dans un millefeuille. Quand vient le moment de fermer le site, nous épandons de nouveau des matériaux argileux, puis un liner, puis un complexe de drainage pour les eaux de ruissellement, puis de la terre végétale. Les arbres que vous avez vus sur la photo sont situés sur la périphérie dans la mesure où il est impossible de planter des végétaux à racines pénétrantes sur une zone où sont entreposés des déchets : il s'agira essentiellement d'herbe et de quelques buissons. Ensuite, pendant trente ans, nous sommes tenus de suivre le site, conformément aux prescriptions de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) Île-de-France qui détaillent toutes les modalités de la surveillance à effectuer. Un mécanisme de garantie financière est également mis en place. M. le Président : Vos explications sont parfaitement claires et témoignent de l'application solide d'une réglementation très précise. En est-il de même sur les autres sites de classe 1 ? M. Christophe CAUCHI et Mme Isabelle MARTIN : Oui. M. le Président : Vous n'avez pas répondu à la question du rapporteur sur la concurrence. J'ai été frappé par la force de votre position sur la classe 3 et l'amiante lié. Je me garderai bien de vous soupçonner de chercher à capter un marché qui s'élargirait... Ce serait déplaisant. Reste que votre position était extrêmement claire. Pouvez-vous en dire davantage ? Mme Isabelle MARTIN : L'amiante lié est un déchet dangereux. Un déchet dangereux ne peut être stocké qu'en décharge de déchets dangereux, voire être déclassé d'un cran, c'est-à-dire être stocké dans une décharge de classe 2. Le mettre dans une décharge de classe 3, surtout si elle ne relève que du code de l'urbanisme, ne peut être considéré comme une solution durable. N'y voyez aucune considération de marché, mais simplement une réaction de citoyenne. M. le Président : D'où ma précaution oratoire : vous aviez déjà utilisé cette expression et nous l'avions bien noté. Sans doute avez-vous conscience que l'amiante lié peut non seulement n'être stocké qu'en classe 3, mais parfois ne pas être stocké du tout... Mme Isabelle MARTIN : Tout à fait. Notre société est adhérente du Syndicat du retrait et du traitement de l'amiante (SYRTA) avec lequel nous agissons en totale solidarité. Nous avons d'ailleurs travaillé pour le compte du ministère de l'environnement à l'élaboration d'un protocole de traçabilité des déchets d'amiante, mais qui n'a pas été repris à l'époque. Notre position sur la classe 3 a été très fortement rappelée au ministère de l'environnement par le biais de notre syndicat, la Fédération nationale des activités du déchet (FNAD). L'Union nationale des exploitants du déchet (UNED) s'est également exprimée contre ce double régime administratif de la classe 3, les installations de stockage des déchets du BTP relevant du code de l'urbanisme, tandis que les décharges pour déchets industriels inertes, dont l'impact environnemental est identique, sont des ICPE, c'est-à-dire des installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à enquête publique. Force est de constater qu'il y a bel et bien deux textes... M. le Président : Il serait intéressant que vous nous communiquiez les positions de ces diverses instances syndicales et patronales. Mme Isabelle MARTIN : Très volontiers. Ajoutons que les textes ont connu des modifications : ainsi le guide rédigé pour les sites de classe 3 relevant du code de l'urbanisme prévoyait il y a quatre ans des alvéoles spécifiques. Depuis, il est passé de quarante pages à vingt, ne prévoit plus rien en matière de couverture finale et autorise désormais les mélanges de déchets ! Pour moi, ce n'est pas de l'environnement. M. Ghislain BRAY : J'ai ainsi la réponse à la question que j'ai posée hier sur le dépôt de l'amiante-ciment en déchetterie... À en juger par les propos tenus hier, déposer l'amiante-ciment en déchetterie n'est pas si grave que si c'était pire ! Vos propos prouvent qu'il y a un réel problème. Mêler en déchetterie l'amiante et les matériaux inertes revient à rendre toute traçabilité impossible. Mme Isabelle MARTIN : Non. Une déchetterie est également une installation classée pour la protection de l'environnement, soumise au régime de déclaration, et de ce fait tenue de respecter la réglementation applicable à l'amiante, y compris pour ce qui touche à la traçabilité. La déchetterie ne fait que collecter des déchets d'amiante dont on ne sait trop que faire - une table à repasser, par exemple - et peut de ce fait répondre à un besoin. Rappelons que les déchets d'activités de soin, à risque infectieux, peuvent également être collectés par les déchetteries... M. Ghislain BRAY : Si le cas des entreprises doit pouvoir se gérer assez aisément, il en va tout autrement des particuliers et des petits bâtiments agricoles ou des constructions de type cabanon, pour lesquels il n'y a guère d'autre solution que d'apporter soi-même les matériaux à la déchetterie. Malheureusement, à la déchetterie qui se trouve à côté de chez moi, le contrôle sur l'amiante ne fait l'objet d'aucune information et je suis convaincu que, dans les douze déchetteries de mon syndicat, on peut tranquillement mettre un paquet de déchets d'amiante dans les déchets inertes ! De surcroît, un matériau non friable devient friable sitôt qu'il est déstructuré... Mme Isabelle MARTIN : Bien sûr. M. le Rapporteur : L'argument est souvent entendu : mieux vaut apporter son fibrociment dans une déchetterie que le jeter dans l'étang du coin ou le voir réutilisé par un copain ! Comment prendre en compte cet aspect et gérer au mieux le problème de l'amiante-ciment ? Nous pourrions également poser le problème de votre implantation en réseau sur l'ensemble du territoire : bon nombre de vos sites se concentrent dans la partie nord, alors que l'amiante-ciment s'est diffusé partout. M. Christophe CAUCHI : Un particulier qui se présente dans une déchetterie avec des déchets d'amiante - fibrociment ou amiante libre - trouvera différentes bennes à sa disposition. Sans se poser de questions, il mettra le fibrociment avec les matériaux inertes et son four comportant un joint amiantifère avec la ferraille... Du fait de ces mélanges, la traçabilité n'est évidemment pas assurée. En revanche, la déchetterie sait exactement où elle envoie ses bennes et tout cela sera notifié sur des bordereaux de suivi. Contrairement à une installation de stockage de classe 1 ou 2, une décharge de classe 3 n'a pas d'alvéoles spécifiques à l'amiante : un bulldozer vient et pousse tout dans la terre... M. Ghislain BRAY : Je parlais de la traçabilité non pas pour les bennes des déchetteries, mais précisément pour les produits d'amiante dans les différentes bennes. M. le Président : Et d'autres produits ! Mme Isabelle MARTIN : Tout cela ne devrait normalement pas se produire avec un responsable de déchetterie parfaitement formé et au fait de la réglementation. Mais on trouve beaucoup de dispositions sur l'amiante et elles ne sont pas toujours appliquées. M. Jean-Marie GEVEAUX : La plupart des responsables de déchetteries sont de braves gens, des contrats emploi solidarité (CES) ou des contrats emploi consolidés (CEC), que l'on a été bien heureux d'engager, alors qu'ils n'ont pas forcément la formation qui s'impose. Cela dit, il faut savoir faire la part des choses et reconnaître que, pour imparfaites qu'elles soient, ces structures ont un indéniable intérêt. Mieux vaut que les déchets soient entreposés là qu'abandonnés n'importe où... Et le prix d'un personnel qualifié n'est pas du tout du même ordre. Mme Isabelle MARTIN : Pour ce qui touche à la seule partie amiante, la SITA peut également proposer des services au titre de l'exploitation des déchetteries, avec des personnes qualifiées et au fait de la réglementation. Mais tout cela a effectivement un coût. M. le Rapporteur : Vous m'avez surtout répondu tout à l'heure sur la concurrence des systèmes - l'inertage par rapport à l'enfouissement. Pouvez-vous nous dresser un rapide panorama des entreprises qui, comme vous, travaillent dans ce domaine ? Mme Isabelle MARTIN : Dans la gestion des centres de classe 1, on trouve la SARP et l'EMTA, du groupe Onyx, ainsi que le groupe Séché qui possède un centre à Laval. Dans le domaine de la vitrification, il n'y a qu'INERTAM à Morcenx. Il n'y a pour l'instant pratiquement pas de marché d'amiante-ciment en classe 2 : l'amiante-ciment va soit en classe 1, soit en classe 3. La classe 2 n'est pas compétitive face à la classe 3. Tant que la classe 3 leur restera ouverte, les déchets amiantés iront forcément en classe 3. C'est ce qui nous a conduits à fermer nos classes 2 à l'amiante voilà trois ou quatre ans. M. le Président : C'est très important ! Vos alvéoles en classe 2 correspondaient-elles techniquement à peu près aux alvéoles des classes 1 ? M. Christophe CAUCHI : Disons qu'elles étaient conçues suivant le même principe du sarcophage. Il s'agissait d'alvéoles exclusivement dédiés à l'amiante et dotées de doubles étanchéités et de doubles couvertures. D'où un surcoût par rapport à une alvéole classique, qui justifiait un prix plus élevé pour l'amiante en classe 2. Apporter une tonne d'amiante en classe 3 peut revenir à 20 euros seulement, contre 100 à 120 euros en classe 2 et 100 à 150 euros pour du fibrociment en classe 1. M. le Président : Ce n'est pas rien... M. Christophe CAUCHI : Autre avantage de la classe 3 : vous n'êtes pas obligé de venir avec des camions ne contenant que de l'amiante, contrairement à ce qui est exigé en classe 1 ou 2. En classe 3, vous mélangez tout - terre, fibrociment, bois, etc. -, puisque tout va dans le même exutoire, sans autres précautions... M. le Rapporteur : Les sites de classe 1 sont surtout présents au nord de la Loire. La rareté des sites dans le Sud ne nuit-elle pas à la récupération des déchets d'amiante-flocage, sans même parler de l'amiante-ciment ? Sur le plan économique, pouvez-vous vous permettre de créer d'autres sites ? La création d'un site vous expose-t-elle à des réactions négatives de la part des populations ? Jugeriez-vous opportun de prévoir le sort des déchets dans les plans de retrait définis par le décret relatif à la protection des travailleurs ? Enfin, vous utilisez la technique de la vitrification, mais pas pour l'amiante... Mme Isabelle MARTIN : Nous menons actuellement une expérimentation visant à tester la vitrification des poussières d'incinération. M. le Rapporteur : Estimez-vous que les produits de vitrifications sont eux aussi dangereux ? M. Ghislain BRAY : Vous avez à juste titre insisté sur votre souci de ne pas réexposer le personnel aux dangers de l'amiante. Que préconiseriez-vous pour les décharges de classe 3 et les déchetteries sur le plan de la protection, actuellement inexistante ? Que faudrait-il améliorer en priorité pour protéger les personnels et les particuliers déposants ? M. Jean-Marie GEVEAUX : Je sais par expérience que le moindre projet d'usine ou de centre provoque immanquablement une levée de boucliers dans le secteur concerné... Le transport des déchets s'effectue essentiellement par la route. Peut-on imaginer une solution de transport ferroviaire ? Les conteneurs et les wagons nécessaires existent-ils ? Il y a dix ans, 70 % des ferrailles étaient transportées par fer et 30 % par la route. Aujourd'hui, la proportion s'est inversée, faute de conteneurs disponibles et de wagons en état... J'ai interrogé à plusieurs reprises les ministres successifs, sans jamais obtenir de réponse. Mme Isabelle MARTIN : Les sites de classe 1 sont surtout dédiés aux résidus de flocage : le marché étant national, la répartition de ces décharges ne semble pas poser problème, d'autant que le coût du transport n'a rien de prohibitif. Rappelons à ce propos que l'élimination des déchets ne représente généralement que 3 % d'un budget de désamiantage... M. le Président : Très intéressant ! Avez-vous des études précises là-dessus ? Mme Isabelle MARTIN : Tout au moins des ratios, que nous vous communiquerons dans le cadre du questionnaire. Le transport n'est vraisemblablement pas un problème. Quant aux décharges de classe 2, elles sont beaucoup plus nombreuses, de l'ordre de 100, voire de 200, relativement bien réparties et pratiquement inutilisées. Quant aux classes 3, on en compte une par commune... Le nombre des sites ne me paraît pas en soi poser de difficulté. L'introduction très en amont du plan de retrait et une identification approximative des déchets serait, à notre avis, une solution à recommander. C'est d'ailleurs ce que nous faisons au niveau du SYRTA. Le producteur de déchets est, en fait, le commanditaire des travaux de désamiantage, autrement dit le maître d'ouvrage ; il serait intéressant de le mettre au courant de la nature de ses déchets et des solutions possibles, qui ne relèvent pas de la responsabilité de l'entreprise maître d'œuvre. Jussieu en est la meilleure illustration : la problématique déchets y a fait l'objet d'un contrat séparé du contrat de travaux. Dans son bilan 2004, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) recommande l'identification d'un lot séparé pour les déchets du BTP ; malheureusement, cette recommandation est fort peu suivie. Peut-être faudrait-il en faire une exigence... Tout le monde s'accorde à dire que les vitrifiats ne présentent pas de caractère dangereux. Force pourtant est de constater que le ministère de l'environnement n'a pas autorisé leur valorisation en sous-couche routière, laquelle serait au demeurant peu appréciée parce que ces matériaux siliceux sont par nature très abrasifs. C'est une limite supplémentaire à la valorisation de ces produits qui à mes yeux restent des déchets. La déchetterie est un lieu de collecte et en aucune façon de stockage permanent. Sans doute appellent-elles des recommandations : le système de déclaration des déchets dangereux prévu par le ministère de l'environnement est-il suffisant, sachant qu'il n'y a pas de contrôles ? Ne conviendrait-il pas d'appeler davantage l'attention des maires sur une meilleure connaissance de la réglementation ? M. le Président : Avez-vous eu des contacts avec l'Association des maires de France ? Mme Isabelle MARTIN : Pas moi en particulier mais au niveau du groupe, certainement. M. Christophe CAUCHI : Certaines déchetteries ont mis en place des bennes spécifiques à l'amiante, vers lesquelles le gardien guide les déposants de fibrociment... M. le Président : Voilà qui est très bien ! M. Christophe CAUCHI : Ces bennes dédiées sont prééquipées d'un grand big bag identifié amiante, refermé par le collecteur qui le remmène sur le site de Villeparisis. Mais seulement deux déchetteries sur toutes celles que je connais ont adopté cette pratique... M. Ghislain BRAY : Donc deux sur 36 000... M. Christophe CAUCHI : Peut-être y en a-t-il plus de deux en Île-de-France... M. le Président : Donnez-nous l'adresse : il serait intéressant que l'un d'entre nous y fasse un saut. M. Ghislain BRAY : Bien sûr ! M. Christophe CAUCHI : Bon nombre de syndicats ont développé une action d'information auprès des particuliers, expliquant que le fibrociment est un matériau dangereux, à ne pas découper en petits morceaux au motif que c'est plus facile à transporter qu'une plaque de deux mètres cinquante... M. Ghislain BRAY : Bien souvent, ils ne la découpent pas, ils la hachent menu sur le sol... et après, on balaie ! M. Christophe CAUCHI : L'identification des sites de classe 1 dans le cadre des différents plans régionaux d'élimination des déchets dangereux - celui de l'Île-de-France est en cours de révision - a permis d'établir que le parc existant était suffisant au regard de la demande. Aucun nouveau projet n'existe à ma connaissance. Pour les classes 2, en revanche, nous sommes clairement en déficit, notamment en Île-de-France. Le nouveau plan régional d'élimination sera l'occasion d'identifier les secteurs nécessitant l'implantation d'un site de classe 2. De nouveaux projets devraient donc voir le jour. Reste que les décharges, c'est comme les prisons : on sait qu'il en faut, mais surtout pas dans sa commune ! M. le Président : On connaît bien le problème, effectivement. Madame, Monsieur, nous vous remercions de cet échange particulièrement intéressant. Nous vous demanderons d'accompagner M. Bray pour aller voir, en notre nom à tous, la déchetterie dont vous nous avez parlé. M. Christophe CAUCHI : Bien volontiers. Audition conjointe de M. Didier PINEAU, président-directeur général d'Europlasma, et de M. Patrice BLANCHOT, responsable du développement de la société INERTAM-COFAL Europlasma Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Nous sommes heureux d'accueillir ce matin M. Didier Pineau, président-directeur général d'Europlasma, et M. Patrice Blanchot, responsable du développement de la société INERTAM-COFAL Europlasma. Vous intervenez dans le cadre d'une série d'auditions consacrées à la gestion de l'amiante résiduel. Votre entreprise s'est spécialisée dans la vitrification, seule alternative réglementaire à l'enfouissement. Avant d'engager la discussion avec les questions du rapporteur et des membres de la mission, nous souhaiterions connaître les conditions dans lesquelles votre entreprise a été créée, ainsi que votre point de vue sur notre système de gestion des déchets d'amiante. M. Didier PINEAU : Monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, nous sommes très honorés que vous ayez souhaité nous entendre. C'est pour nous un grand jour. Cette audition est une reconnaissance de notre activité. Europlasma, la maison-mère dont INERTAM est la filiale à 100 %, a été fondée en 1992 par deux ingénieurs de l'Aérospatiale, dont moi-même. Initialement destinée à tester la résistance des matériaux des missiles dans leur entrée dans l'atmosphère, la torche à plasma est un outil industriel permettant de produire de très hautes températures, jusqu'à 4 000 degrés. Il s'agit d'une sorte de sèche-cheveux électrique dans lequel on aurait remplacé la résistance par un arc électrique. L'énergie est très concentrée et ne dégage pas de gaz fatal, du type gaz à effet de serre, CO2,... Une première unité de vitrification des cendres d'incinération a été installée dans la région de Bordeaux. Ces déchets sont très toxiques, puisqu'ils comportent de la dioxine, du furane, du chlorure et autres métaux lourds. S'agissant des déchets d'amiante, la vitrification est une alternative au stockage - temporaire pour l'instant mais la loi pourra évoluer sur ce point - et présente l'intérêt de revaloriser la matière. Le vitrifiat que nous obtenons après fusion, de l'amiante ou d'autres produits, peut être utilisé dans des opérations de travaux publics, et notamment routières. Europlasma est l'unique détenteur français de cette technologie française, qui s'exporte, puisque quatre installations, extrêmement importantes, existent au Japon, où nous avons vendu deux licences. Je voudrais insister sur trois mots clés : environnement, haute technologie, industrie. La torche à plasma présente un intérêt évident en termes d'environnement, qu'il s'agisse des résidus d'incinération ou des déchets amiantés. Sur le plan technologique, ce procédé, qui a nécessité beaucoup de recherches, est maintenant au point. Nous avons derrière nous 700 000 heures de fonctionnement. Il ne pose aucun problème, ce qui n'est pas forcément le cas du réfractaire, du traitement des fumées ou du convoyeur. La torche à plasma est une haute technologie, pour ainsi dire banalisée. Du point de vue de l'industrie, enfin, les cycles auxquels nous nous référons sont des cycles longs. Nous développons des procédés qui n'existent pas ailleurs. Nous sommes, aujourd'hui, la seule unité au monde de traitement d'amiante par vitrification. Les investissements nécessaires sont lourds. La dernière ligne d'Inertam coûte 12 millions d'euros. Elle est aujourd'hui opérationnelle, avec cependant entre un à deux ans de retard, ce qui s'est traduit dans nos comptes par une perte, pas une perte d'exploitation, mais ce qu'on pourrait appeler une « queue d'investissement » permettant de faire en sorte que le prix du produit vendu corresponde aux coûts de fonctionnement normaux de cette usine. Inertam a été initialement développé dans les Landes par EDF pour reconvertir sa mine de lignite, qui était exploitée depuis 1950. Outre cette mine, une station de conversion d'énergie était remplie d'amiante. En juillet 1992, EDF crée le GIE INERTAM, un groupement d'intérêt économique dédié à la mise au point d'un prototype industriel pour traiter l'amiante par vitrification, et pour lequel Europlasma était prestataire technologique. En 2000, lorsque Europlasma s'est inscrite sur le marché libre, nous avons racheté INERTAM, d'abord avec nos amis de Veolia Environnement, puis nous en sommes les seuls propriétaires depuis mars 2003. Nous sommes convaincus que cette technologie doit porter haut les couleurs françaises et qu'elle devra un jour ou l'autre tomber dans les mains de ceux qui savent exporter, comme la Lyonnaise des Eaux ou la Générale des Eaux. Notre installation, classée pour la protection de l'environnement, peut traiter jusqu'à 8 000 tonnes d'amiante par an, et 2 000 tonnes d'autres déchets. Nous recevons entre 4 000 et 5 000 tonnes de déchets par an, dont plus de 60 % d'amiante libre, le reste étant de l'amiante lié, ce qui n'est pas une très bonne chose pour nos fours. Nous avons plus de 600 clients, qui, dans un premier temps, étaient surtout des clients institutionnels, voire gouvernementaux. Ils sont maintenant, à plus de 80 %, des clients privés, parce qu'ils y trouvent leur intérêt. En effet, pour une entreprise, le traitement de ses déchets amiantés par inertage représente 3 % du coût total de ses travaux de désamiantage. En payant 3 % de plus, elle sera libérée totalement et définitivement, sans contestation possible, de sa responsabilité. Si, par contre, elle confie ses déchets d'amiante à une décharge, cela lui coûtera, certes, moins cher Nous pensons, pour notre part, que l'amiante friable, qui présente la plus grande dangerosité, doit être traité en priorité par vitrification, et que l'amiante non friable peut aller en décharge, puisqu'il est déjà lié par du ciment. Mais les grands groupes qui nous confient leurs déchets ne veulent pas s'embarrasser de ces distinctions, et nous confient tous leurs déchets amiantés, friables ou non. Par ailleurs, dans une décharge, les déchets d'amiante friable ont une densité comprise entre 0,1 et 0,2. On peut les comparer à des plumes d'oreiller : ils sont légers mais prennent énormément de place. De plus, on ne peut rien mettre au-dessus de ces déchets, puisqu'ils ne sont pas stabilisés. Les clients de la décharge paient au poids, mais le volume de ces déchets réduit considérablement la place disponible. Si les décharges appliquaient le prix réel, les clients ne paieraient pas 600 euros la tonne, mais peut-être trois fois plus. Tous les éléments plaident petit à petit en faveur de notre technologie. M. le Rapporteur : Pourquoi une chaleur aussi importante, 4 000 degrés, est-elle nécessaire pour vitrifier l'amiante ? Existe-t-il d'autres techniques susceptibles de remplacer la torche à plasma ? M. Didier PINEAU : Les divers types de fibre d'amiante fondent entre 1 380 et 1 760 degrés. Or, l'enceinte du four doit être à une température de 300 ou 400 degrés supérieure à celle du bain pour que la chaleur nécessaire soit atteinte. Les fours conventionnels sont capables de porter les matériaux à une température maximale de 1 300 degrés, la température de flamme étant au maximum de 1 600 degrés. Seule l'électricité, qu'il s'agisse de l'arc électrique ou de la torche à plasma, peut faire fondre de l'amiante-ciment à 1 700 degrés. EDF avait développé un prototype qui fonctionnait de manière discontinue. Les réfractaires tenaient quelques jours, au mieux quelques semaines. Le traitement d'une tonne nécessitait 4 mégawatheures. Le prix était donc d'environ 200 euros la tonne. Nous en sommes aujourd'hui à 1,1 ou 1,2 mégawatheure par tonne, ce qui est à peu près l'équivalent de ce qui est nécessaire pour traiter une tonne de verre. Y a-t-il des procédés concurrents ? Nous pensons que le nôtre a quelques années d'avance. Cela dit, nous souhaitons la concurrence. La vraie concurrence, ce serait d'avoir en face des sociétés indépendantes qui auraient investi, comme nous l'avons fait, pour prendre une part du marché de la vitrification. Pour l'instant, notre seule concurrence est celle des décharges. Par exemple, les marges nettes de SITA, entreprise majeure sur les décharges de classe 1, sont de l'ordre de 70 %. Dans ces conditions, il est difficile pour n'importe qui de faire émerger de nouveaux procédés, même si l'on peut penser qu'à terme il faudra y venir. M. le Président : Vous avez parlé des marges de SITA. De votre côté, j'ai entendu dire que vous connaissiez certaines difficultés économiques. Qu'en est-il ? Deuxièmement, un chiffre m'a beaucoup frappé : 40 % des déchets que vous traitez sont des déchets d'amiante lié. Comment cela s'explique-t-il ? Troisièmement, l'amiante libre arrive en sacs. Il faut le traiter, ce qui n'est pas très commode. Pourriez-vous nous en parler ? Quatrièmement, certains disent que l'utilisation des produits vitrifiés n'est pas si facile que cela, qu'ils peuvent être abrasifs. M. Didier PINEAU : Je précise tout d'abord que nous sommes cotés en bourse, que nous avons deux commissaires aux comptes et que nous sommes soumis au risque d'une injonction d'arrêt d'exploitation. Nous ne faisons donc pas n'importe quoi. Nous prenons d'énormes précautions pour respecter notre autorisation d'exploiter, qui, pour la première fois en France, comporte une caution d'un million d'euros, que nous avons nous-mêmes sollicitée. Nous avons donné cette somme à l'État pour reconditionner le site au cas où nous disparaîtrions. Notre chiffre d'affaires est fondé sur le traitement, et non sur les entrées. Cinq mille tonnes d'entrées à 1 200 euros la tonne, ce n'est que de la trésorerie. Le chiffre d'affaires, c'est ce que nous traitons. Les produits constatés d'avance sont libérés en chiffre d'affaires au fur et à mesure du traitement. Nous ne trompons personne. Notre traitement a subi une légère baisse l'année dernière. Cela ne signifie pas que l'entreprise est exsangue. Notre chiffre d'affaires est compris entre 8 et 9 millions d'euros. Sur les deux derniers exercices, nous avons subi un million d'euros de pertes. Il s'agit de pertes d'exploitation, mais elles s'analysent comme des compléments d'investissement, car c'est la mise au point de notre nouvel outil qui les a occasionnées. Nous sommes à la recherche de financements européens, sous forme d'une augmentation du capital d'Europlasma. Deux nouvelles lignes pourraient être installées, l'une au Royaume-Uni et l'autre aux Pays-Bas. M. le Président : Pourquoi pas en France ? M. Didier PINEAU : En France, nous pensons que le marché est saturé. Pour ce qui est de l'amiante friable, il ne l'est probablement pas, mais comme nous ne savons pas ce qui part en décharge, il nous est difficile de nous faire une idée précise du marché. Cela me permet, M. le Président, de répondre à votre question sur l'amiante lié. Oui, il représente 40 % des déchets que nous traitons. Une circulaire de Mme Lepage, qui date de 1996, recommande la vitrification pour l'amiante libre et la mise en décharge pour l'amiante lié. Si ces recommandations étaient suivies, cela irait tout à fait dans le sens de nos intérêts, puisque nous sommes le seul site de vitrification et que nos fours sont conçus pour cela. Mais nous comptons parmi nos clients de grandes entreprises, qui veulent que tous leurs déchets soient vitrifiés. Il ne nous est pas possible de dire au président d'Unibail que nous ne traiterons que ses déchets d'amiante friable. En application d'un décret inspiré par M. Vesseron, alors directeur de la Direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR), il est interdit d'ouvrir les sacs qui arrivent sur un site de stockage et d'enfouissement. Il est beaucoup plus facile, en effet, de déposer l'amiante tel quel dans un trou, d'autant qu'on n'y touche pas. Il en résulte que n'importe quoi peut être mis en décharge. Dans notre usine, il n'en va pas de même. Nous devons séparer l'amiante friable et l'amiante non friable, qui ne fondent pas à la même température. Au total, nous traitons quinze types d'amiante. C'est pourquoi nous ouvrons tous les sacs pour trier leur contenu. M. le Président : C'est une opération à risques. M. Didier PINEAU : Tout cela est contrôlé. Nous sous-traitons cette tâche à des désamianteurs professionnels, ce qui représente un investissement global de 3 à 4 millions d'euros. Dans une décharge, on n'ouvre pas les sacs, de sorte qu'on ne sait pas ce qu'ils contiennent. Voyez l'exemple de Stocamine, qui gère un stockage profond prévu pour recevoir 200 000 tonnes sans traitement. En septembre 2002, de l'amiante est entré, ainsi qu'un sac de cendres provenant d'un incinérateur : tout cela brûle encore ! Cela signifie que quand on n'ouvre pas les sacs, des réactions en chaîne peuvent intervenir. Et cela peut se produire tous les jours dans n'importe quelle décharge, y compris dans les décharges de classe 1. S'agissant du vitrifiat, je souligne que son comportement est très peu évolutif. Une eau que l'on met en contact avec du vitrifiat reste potable au bout de 250 000 ans. Des tests accélérés ont été faits avec le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), par comparaison avec le verre nucléaire. Le vitrifiat peut être employé pour des sous-couches de revêtements routiers. Il peut également être lié dans du ciment. La preuve est faite que la valorisation est possible. La difficulté est que nous avons très peu de vitrifiat. Les 20 000 tonnes que nous avons correspondent à 200 mètres de routes, autant dire presque rien. Les entreprises de travaux publics nous les achètent entre un et vingt euros la tonne, soit le prix du transport. Nous devons le vendre, parce que ce qui n'a pas de prix est un déchet - c'est la définition américaine -, mais il est clair que ce n'est pas le produit de ces ventes qui nous fait vivre. M. Patrice BLANCHOT : Je précise que nous avons labellisé le vitrifiat que nous produisons. Nous avons procédé à toutes les analyses nécessaires pour démontrer son innocuité : il a satisfait à toutes les exigences, que ce soit celles de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE), de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM), du ministère de l'environnement ou des utilisateurs potentiels. M. le Président : Les pouvoirs publics ont-ils porté un regard attentif à ce que vous faisiez ? M. Patrice BLANCHOT : Non. M. Didier PINEAU : Nous avons eu des subventions de la région Aquitaine. C'est la seule région européenne qui vitrifie ses déchets, qu'il s'agisse des cendres d'incinération ou de l'amiante. La DRIRE d'Aquitaine connaît très bien notre technologie. Mais à Paris, au ministère de l'environnement, nous sommes perçus comme des empêcheurs de mettre en décharge en rond. Un responsable du ministère est allé jusqu'à comparer le vitrifiat au sang contaminé ! Si l'on additionne les déchets d'incinération et les déchets amiantés traités en France par vitrification, on arrive à un total inférieur à 10 000 tonnes, à comparer au million de tonnes de déchets industriels. Le ministère explique qu'il est difficile de légiférer pour 10 000 tonnes. Mais tant qu'on ne légifère pas, le traitement par vitrification ne progresse guère. M. le Président : Les déchets hospitaliers pourraient-ils être traités par vitrification ? M. Didier PINEAU : Nous faisons plus que réfléchir aux déchets hospitaliers. Mais le prix des déchets traités - entre 300 et 500 euros la tonne - est tel qu'il ne faut pas utiliser la torche à plasma. Leur dangerosité n'est d'ailleurs pas la même. Une température de 450 degrés suffit pour tuer les virus les plus résistants. Par contre, après le traitement de déchets hospitaliers ou d'ordures ménagères, il reste un résidu ultime, qu'il est possible de vitrifier. M. le Rapporteur : Le vitrifiat pourrait-il être davantage valorisé ? M. Didier PINEAU : En termes d'images, cela ne fait pas de doute. En termes de prix, je n'en suis pas sûr. M. Patrice BLANCHOT : L'usage du vitrifiat pourrait être diversifié dans le secteur du BTP. M. Ghislain BRAY : On pourrait partir du principe que ce qui vient du bâtiment peut retourner au bâtiment. Les tonnages sont peut-être insuffisants pour les revêtements routiers, mais les besoins ne sont pas les mêmes pour le bâtiment. Le vitrifiat peut être utilisé pour la décoration architecturale, par exemple. M. Didier PINEAU : En effet. La Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) demande que les vitrifiats issus du traitement des déchets d'incinération soient utilisés dans les travaux de bâtiment et travaux publics (BTP) qu'elle finance. Mais la CUB peut le faire parce qu'elle sait d'où proviennent les déchets dont le traitement a abouti à la production du vitrifiat. M. le Président : Le ministère de l'environnement devrait être le plus chaud défenseur de votre technique ? M. Patrice BLANCHOT : Parmi nos clients, nous comptons nombre de ministères : la Culture, la Justice, l'Éducation nationale, la Défense, le Secrétariat général du Gouvernement. Le ministère de l'environnement, c'est une autre histoire ! M. Didier PINEAU : Je rappelle que la circulaire de Corinne Lepage, alors ministre de l'environnement, a clairement distingué l'amiante friable et l'amiante non friable, et recommandé la vitrification pour les déchets d'amiante friable. C'était en 1996. Près de dix ans après, on n'a guère progressé dans ce sens. Tant mieux pour nos amis enfouisseurs, mais il conviendrait tout de même de faire bouger les choses, d'autant que d'autres pays - Japon, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas - souhaiteraient avoir recours à la vitrification. Ils demandent quelles sont nos normes. Malheureusement, les textes officiels restent flous. Pour une fois que la France a une avance technologique, il serait bon d'en profiter ! Par exemple, la seule solution pour les Suisses, qui n'ont pas de décharges, est de vitrifier. M. le Président : Messieurs, je vous remercie pour votre contribution aux travaux de notre mission. Audition de représentants de la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) : M. Stéphane PENET, directeur adjoint de la direction des assurances de biens et des responsabilités, Mme Valérie DUPUY, responsable de la coordination juridique, et M. Jean-Paul LABORDE, conseiller parlementaire Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Mes chers collègues, nous sommes heureux d'accueillir ce matin M. Stéphane Penet, directeur adjoint de la direction des assurances de biens et des responsabilités de la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA), Mme Valérie Dupuy, responsable de la coordination juridique, et M. Jean-Paul Laborde, conseiller parlementaire. Nous vous entendons ce matin dans le cadre d'une série d'auditions consacrées à la gestion de l'amiante résiduel au cours desquelles il nous a été dit à plusieurs reprises que les assureurs seraient de plus en plus réticents à s'investir, de façon générale, dans le champ de l'amiante résiduel. Nous souhaiterions connaître votre point de vue sur ce point. M. Stéphane PENET : M. le Président, mesdames, messieurs les députés, la Fédération française des sociétés d'assurance considère qu'il n'y a pas de problème majeur d'offre d'assurance en ce qui concerne les professionnels du traitement de l'amiante résiduel. Nous ne connaissons pas une pénurie d'offre telle que celle que nous avons connue, au lendemain du 11 septembre 2001, pour la garantie attentats des entreprises, ou telle que celle que nous avons connue pour la responsabilité civile médicale après le vote de la loi Kouchner en 2002. Dans le premier cas, 40 % des entreprises risquaient de ne plus être assurées en 2002. Dans le second cas, ce sont entre 40 et 50 % des cliniques privées qui risquaient de ne pas être assurées. Tel n'est pas le cas pour les professionnels de l'amiante. Dans ce domaine, il n'y a pas de pénurie d'offre, mais le marché est tendu. Sur environ 150 entreprises qualifiées de désamiantage, nous avons été saisis d'un ou deux cas de difficulté d'assurance. Nous avons répertorié, sur le marché de l'amiante résiduel, cinq ou six acteurs d'assurance, dont deux acteurs majeurs. Des courtiers spécialisés placent les risques chez des acteurs français ou étrangers. À la fin de l'année 2004, nous avons été saisis par notre ministère de tutelle du cas d'une vingtaine de professionnels qui n'avaient pas d'assurance. Nous avons examiné à la loupe les cas qui nous étaient présentés. Il s'agissait, pour la plupart, d'entreprises qui venaient d'être créées et qui étaient visiblement incompétentes pour traiter les problèmes relatifs à l'amiante résiduel. Un certain nombre de professionnels se sont improvisés diagnostiqueurs ou désamianteurs sans en avoir les compétences ni les moyens. Pourquoi le marché de l'assurance compte-t-il peu d'acteurs pour la couverture amiante ? Parce qu'un certain nombre d'acteurs se sont retirés du marché de l'amiante. Soit ils ont purement et simplement interdit à leurs équipes de souscription ou à leurs équipes commerciales de souscrire un quelconque risque lié à l'amiante, soit ils ont exclu le risque amiante de leurs contrats, soit ils ont fixé des plafonds relativement bas, de façon à se protéger en termes d'engagement. S'ils ont fait ce choix, c'est essentiellement sur prescription de leurs réassureurs. Ceux-ci raisonnent à une échelle mondiale, ou au moins européenne. Or, les messages qu'ont reçus les réassureurs sur le problème de l'amiante en France ont été plutôt négatifs. Premièrement, les mesures prises par les pouvoirs publics ont été beaucoup plus tardives en France qu'ailleurs. La première législation relative à la protection contre l'amiante est apparue en France en 1977, alors qu'elle date de 1930 au Royaume-Uni et de 1946 aux États-unis. L'interdiction formelle et totale d'utilisation et de commercialisation de l'amiante sur le territoire français date de 1997, alors que cette mesure avait été prise en 1970 au Royaume-Uni et en 1976 aux États-unis. Si les mesures sont plus tardives, le risque potentiel est évidemment plus important. En second lieu, la Cour de cassation a étendu l'interprétation de la notion de faute inexcusable de l'employeur. Les réassureurs y ont vu un changement des règles du jeu, puisque tout d'un coup, les employeurs se trouvaient beaucoup plus vulnérables. M. le Président : Pourriez-vous préciser ce point ? Mme Valérie DUPUY : Depuis 1987, les assureurs délivraient des garanties « faute inexcusable ». Ces garanties étaient standard dans les contrats de responsabilité civile des employeurs, et n'étaient pas spécifiquement tarifées. Elles étaient délivrées presque gratuitement, dans la mesure où la législation sur les accidents du travail prévoyait une indemnisation par la sécurité sociale, et où la jurisprudence appréciait très strictement la faute inexcusable de l'employeur. À partir de 2002, l'environnement jurisprudentiel, avec un effet non seulement quasi législatif mais aussi rétroactif, a totalement changé. La Cour de cassation, dans ses arrêts d'assemblée plénière du 28 février 2002, a considéré que l'employeur était tenu à une véritable obligation de résultat du point de vue de la sécurité de ses salariés, et qu'il ne pouvait être exonéré de sa responsabilité que dans les cas d'absence de conscience du danger. M. Stéphane PENET : À partir de cette date, certains réassureurs ont demandé aux assureurs de ne pas couvrir les risques liés à l'amiante. Certains assureurs ont suivi cette recommandation. D'autres ont continué à couvrir ces risques, mais en le faisant sur leurs fonds propres, ce qui les a conduits à être extrêmement sélectifs ou à fixer des plafonds de garantie relativement bas. Voilà ce qui explique les difficultés ponctuelles du marché, lequel peut être qualifié de tendu. En ce qui concerne les perspectives du marché, il faut souligner que les assureurs, et donc, à terme, les réassureurs, voient d'un très bon œil l'évolution de la réglementation relative au désamiantage et au diagnostic. La récente ordonnance sur la profession de diagnostiqueur technique immobilier va dans le bon sens. Tout ce qui va dans le sens de la professionnalisation de ce secteur est positif. Cela dit, les relations entre assureurs et réassureurs sont régies par des traités annuels. C'est au 1er janvier de l'année que telle ou telle disposition peut être modifiée. C'est pourquoi il peut y avoir un décalage entre les évolutions positives et les réactions positives du marché. À cette réserve près, il nous semble que le marché devrait devenir plus fluide, ce qui devrait avoir pour effet de réduire les difficultés ponctuelles d'assurance qui ont été constatées ici ou là. M. le Rapporteur : Vous avez évoqué le cas d'une vingtaine d'entreprises qui n'avaient pas trouvé d'assureur, en soulignant leur manque de compétences. S'agit-il d'entreprises qui n'avaient pas obtenu de qualification ? Ou avaient-elles une qualification que les assureurs ont jugé insuffisante ? M. Stéphane PENET : La plupart n'avaient pas de qualification. M. le Rapporteur : Le paysage national tel que le perçoivent actuellement les réassureurs est dessiné par un ensemble de procès, notamment devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), qui ne concernent généralement pas des employés ayant travaillé dans des entreprises de désamiantage. Il s'agit d'affaires du passé concernant des personnes ayant été en contact avec l'amiante, alors qu'elles travaillaient dans des entreprises de construction navale ou des entreprises sous-traitantes, par exemple. Si elles déposent des recours devant les tribunaux, c'est parce qu'elles estiment que les indemnisations au titre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) sont insuffisantes. Pensez-vous qu'une meilleure indemnisation du FIVA entraînant une diminution du nombre de procès aurait un effet sur le climat général que vous avez décrit ? Mme Valérie DUPUY : Ce n'est pas certain. Il ne faut pas oublier que le FIVA est subrogé dans les droits du salarié. Rien ne peut l'empêcher de déposer un recours subrogatoire pour démontrer la faute inexcusable de l'employeur. Le contentieux ne sera pas supprimé, même si le FIVA offrait aux personnes concernées des indemnisations plus conformes à leurs attentes. Par ailleurs, s'agissant des salariés qui sont exposés au titre de l'amiante résiduel, les premières procédures apparaissent déjà. C'est, par exemple, le cas des employés de garage automobile qui ont été en contact avec des plaquettes de frein intégrant de l'amiante. M. le Président : J'admire les ressources sémantiques que nous offre la langue française. Certains parlent de pénurie d'offre. Vous parlez, quant à vous, de « marché tendu ». Qu'en termes élégants ces choses-là sont dites ! Cela dit, tournons-nous vers l'avenir. Vous vous efforcez de procéder à une analyse prospective des risques. Avez-vous fait cette analyse concernant l'amiante ? D'autre part, vous considérez que le marché devrait être moins tendu l'année prochaine en raison de l'évolution de la réglementation. Êtes-vous déjà entré dans une phase de négociation avec les réassureurs ? Enfin, je crois que l'action subrogatoire du FIVA existe essentiellement dans les textes, et que sa mise en œuvre réelle est extrêmement difficile. Mme Valérie DUPUY : Nous commençons à voir arriver les premiers recours subrogatoires du FIVA. Il y a toujours un décalage dans le temps. Le FIVA a mis un certain temps à fonctionner et à prendre en compte les dossiers qui lui ont été adressés. M. Stéphane PENET : Pour répondre à votre deuxième question, nous ne connaissons pas encore les engagements des réassureurs sur le risque amiante en France. En ce qui concerne le renouvellement des traités entre assureurs et réassureurs, la tradition veut que ceux-ci se réunissent en septembre à Monte-Carlo, ce qui marque le coup d'envoi des renégociations des traités. S'agissant de l'appréciation du risque, nous invitons nos adhérents à être attentifs aux évolutions positives de la réglementation. Nous souhaitons que le nombre d'acteurs s'accroisse, afin que l'offre soit suffisante. Un marché réduit à deux acteurs principaux et trois autres acteurs mineurs n'est pas satisfaisant. Cela dit, je ne peux que vous faire part d'une impression. Il me semble que les acteurs présents sur le marché, comme ceux qui s'en sont retirés, analysent très positivement les choses. Nous sommes donc, a priori, au creux de la vague. Pour répondre à votre première question, nous n'avons pas d'analyse prospective. Elle est plus qualitative que quantitative. Je peux vous dire que les prévisions chiffrées qui ont été faites dans d'autres pays, notamment aux États-unis et au Royaume-Uni, se sont toujours révélées soient complètement sous-estimées, soit complètement surestimées. Je n'ai jamais vu la définition de critères solides permettant d'extrapoler de manière scientifique l'évolution du risque dans les années à venir. Mme Valérie DUPUY : J'ajoute que la création d'un fonds d'indemnisation est envisagée aux États-unis. La France l'a fait en 2000, le FIVA étant réalimenté chaque année par des dotations votées par le Parlement. Cela démontre la difficulté de quantifier l'ampleur du sinistre de l'amiante. Le fonds est le mécanisme le plus flexible pour faire face aux demandes d'indemnisation. M. le Président : Quelle est l'importance du fonds dont la création est envisagée aux États-unis ? Mme Valérie DUPUY : La proposition de loi adoptée le 26 mai dernier par le Judiciary Committee du Sénat américain tend à l'instauration d'un fonds qui serait alimenté par les contributions des entreprises et des assureurs, et dont le montant s'élèverait, sur une durée de trente ans, à 140 milliards de dollars. J'ajoute qu'un certain nombre d'entreprises américaines n'ont pas la capacité de faire face aux demandes d'indemnisation et se sont placées sous la protection du Chapter XI, c'est-à-dire la « faillite virtuelle » qui permet aux société nord-américaines de ne pas être considérées comme responsables quand le risque qui devrait engager leur responsabilité n'était pas mesurable. M. le Président : Il est difficile, en effet, d'apprécier ce type de risque. Mme Valérie DUPUY : Il est aussi difficile de déterminer les pathologies qui vont survenir. Elles sont plus ou moins graves, et les montants d'indemnisation devraient énormément varier en fonction de leur gravité, ce qui n'est pas toujours le cas à l'heure actuelle. M. le Président : Avez-vous des remarques à formuler au sujet de la réglementation ? M. Stéphane PENET : Plus que la réglementation, ce sont les qualifications et les certifications de compétences que nous privilégions dans l'appréciation du risque. Qu'il s'agisse du désamiantage ou du diagnostic immobilier, nous avons constaté des progrès. Ce que nous voulons éviter avant tout, ce sont les entreprises qui, comme je le disais tout à l'heure, s'improvisent désamianteurs ou diagnostiqueurs sans que nous disposions de repères nous permettant d'évaluer leurs compétences réelles. J'insiste, encore une fois, sur le fait que ce problème est soulevé par les réassureurs. C'est là un point fondamental. Nos adhérents peuvent avoir une appréciation positive du risque mais s'abstiennent de le couvrir parce que leurs réassureurs le leur ont interdit. M. le Rapporteur : Pour quel type de risques assurez-vous les diagnostiqueurs ? En matière de certification, quels sont vos souhaits ? Par ailleurs, les entreprises de désamiantage sont généralement certifiées. Par contre, les entreprises qui travaillent dans le domaine du bâtiment et des travaux publics (BTP) n'ont pas forcément besoin de certification quand elles sont confrontées à des problèmes relatifs à l'amiante non friable. Quelle est votre position sur ce point ? Enfin, les personnels travaillant dans des entreprises de désamiantage souscrivent des assurances individuelles. Comment analysez-vous la situation de ce point de vue ? M. Stéphane PENET : Prenons l'exemple d'un diagnostiqueur qui intervient sur un chantier. Il remet un rapport selon lequel il n'y a pas d'amiante, mais au cours des travaux, on découvre qu'il y en a. Cela entraîne l'arrêt du chantier, ainsi que des surcoûts. Dans ce cas, la responsabilité civile du diagnostiqueur est en jeu. Son assurance peut couvrir les surcoûts. Voilà les risques que nous couvrons, liés à une erreur professionnelle du spécialiste. Le système de certification nous semble satisfaisant. Il nous paraissait inutile d'ajouter à la réglementation une assurance obligatoire. L'assurance obligatoire est normalement faite pour couvrir les particuliers qui peuvent oublier de s'assurer et mettre en danger la société. Des professionnels tels que les diagnostiqueurs ou les désamianteurs sont suffisamment responsables et avisés pour savoir qu'ils doivent s'assurer. En ce qui concerne les chantiers eux-mêmes, ce qu'on appelle la « rencontre inopinée d'amiante » n'est pas exclue des contrats de construction. Je parle bien de la rencontre inopinée d'amiante. Si, par la suite, un travail de désamiantage ou de diagnostic doit être effectué, il doit bien entendu l'être par des corps de métier spécialisés. Mme Valérie DUPUY : En ce qui concerne l'amiante non friable, il n'y a pas de sélection du risque en fonction du type d'amiante que les entreprises sont susceptibles de rencontrer. S'agissant des salariés qui travaillent dans des entreprises confrontées à l'amiante, nos collègues spécialisés dans les assurances de personnes nous ont dit qu'aucun contrat ne prévoit d'exclusion des pathologies liées à l'amiante. Au vu de ce que nous ont dit nos collègues, nous n'avons pas le sentiment qu'une sélection serait pratiquée en fonction de l'environnement professionnel des personnes. Pour les personnes qui présentent déjà une pathologie liée à une exposition à l'amiante, nous avons la même réponse que pour tous les risques aggravés, c'est-à-dire la possibilité de passer par la « convention Belorgey ». M. le Président : Je reviens un instant à la question posée par le Rapporteur au sujet des entreprises du BTP qui n'ont pas de certification. Il pensait aux entreprises du secteur 3, le secteur de la maintenance, dans lequel évoluent surtout des petites entreprises pour lesquelles le problème qui se pose est le plus souvent celui de l'amiante lié. Que se passe-t-il en termes d'assurance dans ce cas ? M. Stéphane PENET : Dans notre approche assurancielle, nous distinguons clairement deux catégories de professions : celles qui traitent de l'amiante, et celles qui risquent de rencontrer inopinément de l'amiante. Les rencontres inopinées d'amiante constituent des risques qui ne sont pas exclus des contrats. Il peut y avoir un problème de mise en jeu de la garantie si le salarié qui a inopinément rencontré de l'amiante, voulant résoudre le problème par lui-même, s'engage dans des travaux de traitement de l'amiante. Dans un tel cas, l'assureur peut mettre en avant le fait que le traitement de l'amiante ne faisait partie des activités déclarées. M. le Rapporteur : La prévention des risques fait partie de vos missions. Avez-vous une action spécifique en direction des risques liés à l'amiante ? M. Stéphane PENET : L'amiante a été étudié sous l'angle de la maladie professionnelle. Ce n'est pas du tout l'objet du Centre national de prévention et de protection (CNPP), organisme partenaire des assureurs pour la prévention. Les assureurs n'ont pas mené d'étude particulière sur ce sujet. Mme Valérie DUPUY : Il est possible que les assureurs très spécialisés dans les métiers du bâtiment conduisent des opérations en direction de leurs assurés. Je pense à un acteur important sur le marché. M. le Président : Quels sont les acteurs les plus spécialisés ? M. Stéphane PENET : Les principaux acteurs sont SMA-BTP, Axa et QBE. M. le Rapporteur : Les collectivités territoriales sont-elles assurées ? Elles sont responsables de parcs immobiliers importants, dans lesquels des problèmes peuvent se poser. D'autre part, l'on dit souvent que « l'État est son propre assureur ». Je serais curieux de savoir comment les assureurs réagissent à une telle affirmation. Mme Valérie DUPUY : Il y a un marché de l'assurance des collectivités locales et des collectivités territoriales et il est assez actif. Donc, si les universités sont la propriété des régions, celles-ci sont assurées. Si elles sont la propriété de l'État, celui-ci est effectivement son propre assureur. M. le Rapporteur : Ce qui veut dire ? Mme Valérie DUPUY : Cela veut dire que l'État indemnise. Il a d'ailleurs créé le FIVA. Il a donc la possibilité d'indemniser les étudiants ou les enseignants qui auraient été exposés à l'amiante. M. le Président : Madame, messieurs, nous vous remercions de votre contribution aux travaux de notre mission. Table ronde sur l'état des connaissances scientifiques sur les risques sanitaires liés à l'exposition à l'amiante · M. le professeur Claude GOT, président du Collège scientifique de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, auteur du rapport sur « La gestion du risque et des problèmes de santé publique posés par l'amiante en France », commandé par Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, et M. Bernard Kouchner, ministre de la santé · M. le professeur Marcel GOLDBERG, épidémiologiste, membre de l'Institut de veille sanitaire (IVS), chargé du programme national de surveillance du mésothélium (PNSM) et coordinateur du rapport de l'INSERM de 1996, Effets sur la santé des principaux types d'exposition à l'amiante · Docteur Ellen IMBERNON, épidémiologiste, responsable du département santé/travail à l'IVS · M. le professeur Jean-Claude PAIRON, responsable de l'Unité pathologie professionnelle de l'hôpital de Créteil, membre du PNSM et professeur de médecine du travail · M. le professeur Patrick BROCHARD, pneumologue, professeur de médecine du travail et responsable de l'unité de pathologie professionnelle du CHU de Bordeaux · M. le professeur Jacques AMEILLE, pneumologue, professeur de médecine du travail et responsable du département de pathologies professionnelles de l'hôpital Raymond Poincaré · M. le professeur Michel FOURNIER, pneumologue, responsable d'une unité de transplantations pulmonaires et président du jury de la conférence de consensus de janvier 1999 sur le suivi médical des personnes ayant été exposées à l'amiante, spécialiste de ce thème au sein de la Société de pneumologie de langue française · M. Jean-Pierre GRIGNET, chef du service de pneumologie de l'hôpital de Denain (Nord), expert auprès des caisses d'assurance maladie Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Mes chers collègues, je remercie nos invités de s'être rendus disponibles pour cette table ronde, la troisième que nous organisons. Je vous rappelle que notre mission d'information a été créée en avril dernier par une décision de la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale, sur proposition du président Debré. Son rapporteur est Jean Lemière, député de la 5e circonscription de la Manche, dont fait partie Cherbourg. Moi-même, son président, suis député de la 12e circonscription du Nord, qui comprend une partie de la ville de Dunkerque. C'est dire que nous sommes souvent confrontés au problème de l'amiante. Nous avons établi, à l'unanimité, notre programme de travail autour de six thèmes : la gestion de l'amiante dit « résiduel », thème sur lequel nous venons d'achever nos travaux ; la prévention des risques professionnels ; les aspects scientifiques et médicaux ; la prise en charge des malades, notamment le fonctionnement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et du dispositif de cessation anticipé d'activité ; la responsabilité juridique, et notamment le difficile problème de la responsabilité pénale ; les aspects internationaux. La mission prévoit d'adopter son rapport au début de l'année 2006, mais nous ne sommes tenus à aucun délai et nous poursuivrons nos travaux autant qu'il sera nécessaire. Nous avons choisi de commencer par le problème de l'amiante résiduel parce que la logique de notre démarche est moins tournée vers le passé que vers l'avenir. Il s'agissait d'évaluer le dispositif mis en place depuis 1996 car, si la dangerosité de l'amiante a conduit à l'interdiction de l'utilisation du produit à compter de 1997, le problème se pose maintenant de savoir si les quantités énormes d'amiante qui restent dans nos bâtiments sont bien gérées et s'il n'y a pas encore à craindre un grave problème de santé publique. Les dix-neuf réunions, dont deux tables rondes, que nous avons organisées sur cette question et les 55 personnes que nous avons reçues nous ont permis d'évaluer la réglementation en place sur le repérage et le traitement de l'amiante et de ses déchets. La mission se réunit d'ailleurs cet après-midi pour établir le bilan de cette première étape. La table ronde qui nous réunit ce matin a pour objet de faire le point sur les connaissances scientifiques relatives au risque d'exposition de l'amiante. Dans un premier temps, je souhaiterais que nous fassions un point scientifique sur l'état de la connaissance des maladies liées à l'exposition à l'amiante, de leurs causes et de leur gravité, ainsi que sur les données dont nous disposons pour l'évaluation du nombre de victimes, actuelles et futures. Dans un second temps, nous aborderons le thème de l'évolution de la connaissance des risques liés à l'amiante. Faut-il considérer que l'interdiction de l'amiante est intervenue trop tard, que peut-on dire des risques dits « environnementaux » et des risques liés à la maintenance ? M. Claude GOT : Je suis anatomo-pathologiste honoraire, professeur à l'université René Descartes. Je ne suis pas spécialiste de l'amiante, mais j'ai eu à répondre à une question qui m'avait été posée à la fin de 1997 - après l'interdiction de l'amiante - par Mme Aubry et M. Kouchner : que pouvons-nous faire pour améliorer la gestion du risque et l'indemnisation éventuelle des victimes ? Cette étude devait se dérouler sur trois mois. Je m'y suis consacré pendant dix-huit mois. Ce travail m'a conduit à me poser trois questions, que je me pose d'ailleurs toujours. Comment une somme d'erreurs a-t-elle pu perdurer aussi longtemps ? Pourquoi n'a-t-on pas recensé les bâtiments contenant de l'amiante ? Comment fonctionne le FIVA ? S'agissant des connaissances scientifiques, je pense que le compte rendu de 700 pages de la réunion de l'Académie des sciences de New York, rédigé il y a quarante ans, contenait toutes les connaissances nécessaires à la gestion du problème. Comme c'est souvent le cas en santé publique, nous ne sommes pas face à un problème de connaissances, mais à un problème de gestion des connaissances par les décideurs publics et privés. La question est la suivante : quels sont les arguments qui emportent les décisions ? M. Marcel GOLDBERG : Professeur à la faculté de médecine Paris - Île-de-France, j'ai longtemps dirigé à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) une unité de recherche en épidémiologie, orientée essentiellement vers les risques professionnels. C'est à ce titre que j'ai participé à l'étude collective de 1996 sur les effets de l'amiante et que je suis maintenant chargé du programme national de surveillance du mésothélium, au sein de l'Institut de veille sanitaire (IVS). Mme Ellen IMBERNON : Médecin épidémiologiste, je suis responsable du département santé/travail de l'IVS, chargé de quantifier l'impact de l'activité professionnelle sur la santé de la population française. Nous travaillons sur plusieurs programmes consacrés à l'amiante qui permettent notamment de confronter l'observation de la population aux modélisations mathématiques établies il y a quelques années. M. Jean-Claude PAIRON : Professeur de médecine du travail à Paris XII Créteil, je suis responsable de l'unité de pathologie professionnelle de l'hôpital de Créteil et je fais également partie du programme national de surveillance du mésothélium. M. Patrick BROCHARD : Pneumologue de formation et professeur de médecine du travail à Bordeaux, j'ai antérieurement travaillé à Créteil dans le service de pneumologie du professeur Bignon qui fut le premier à mettre sur la place publique le problème de l'amiante en 1973. À sa demande, et à celle de l'administration, j'ai participé au comité permanent de l'amiante (CPA) à l'époque où ses travaux ont conduit à l'interdiction de l'amiante. Récemment, j'ai animé la conférence de consensus sur la surveillance des personnes antérieurement exposées à l'amiante qui vient de remettre son rapport au ministère du travail sur l'expérimentation conduite dans quatre régions françaises (Aquitaine, Rhône-Alpes et les deux Normandie). M. Jacques AMEILLE : Pneumologue et professeur de médecine du travail à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines, je dirige une unité de pathologies professionnelles à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Dans le domaine de l'amiante, j'ai participé à plusieurs études et à l'organisation de la conférence de consensus de 1999 et je suis co-auteur avec Jean-Claude Pairon et Patrick Brochard d'une monographie sur l'amiante et les pathologies professionnelles. M. Michel FOURNIER : Professeur de pneumologie à l'hôpital Beaujon de Clichy et responsable de l'unité de transplantation pulmonaire, j'ai présidé la conférence de consensus de 1999 sur le suivi médical des personnes ayant été exposées à l'amiante et, depuis, je fais partie d'une commission d'évaluation au sein du FIVA. Mon centre d'intérêt porte sur les outils utilisés pour le diagnostic et la réparation des victimes de l'amiante. M. Jean-Pierre GRIGNET : Médecin pneumologue à l'hôpital de Denain, dans le Nord, je m'intéresse de façon accrue au problème de l'amiante depuis 1976, époque à laquelle on m'a fermé les portes de l'usine d'amiante-ciment située à 5 kilomètres de l'hôpital. Il y avait pourtant de sérieux problèmes jusqu'en 1985. 190 pathologies professionnelles y ont été brusquement déclarées cette année-là, alors qu'elles se limitaient à 10 l'année précédente, ce qui a coûté sa place au médecin du travail de l'époque. M. le Président : Nous allons maintenant examiner le premier point de notre ordre du jour consacré à l'état des connaissances concernant les risques liés à l'exposition à l'amiante. Quelles sont les avancées depuis 1996 ? M. Michel FOURNIER : J'essaierai de répondre à cette question pour ce qui concerne les mécanismes toxicologiques de l'amiante. La toxicologie s'étend sur deux grands domaines. Le premier concerne l'expérimentation animale, que je connais mal. Elle est utile, mais pose des problèmes d'extrapolation à l'homme, aussi bien en ce qui concerne la cancérogenèse que la biopersistance des fibres d'amiante. L'autre domaine est celui de l'espèce humaine et il y a eu effectivement des avancées tangibles depuis quelques années. Ces avancées concernent la cytogénétique et l'anatomo-pathologie. Un consensus s'est fait sur le diagnostic anatomopathologique du mésothéliome. Des erreurs de diagnostic ont été faites car c'est un problème difficile, mais des progrès ont été réalisés dans la précision des critères de diagnostic du mésothéliome. La connaissance des étapes du mésothéliome a également bien progressé. Le rôle, par exemple, des espèces réactives de l'oxygène a été beaucoup mieux précisé, ce qui a débouché non seulement sur des écrits scientifiques mais aussi sur de nouveaux moyens pour quantifier les anomalies et, surtout, pour orienter les recherches thérapeutiques. On connaît aussi beaucoup mieux à présent le profil cytogénétique tumoral du mésothéliome. Les cellules tumorales ont des caractéristiques cytogénétiques particulières, qui sont bien identifiées. On sait maintenant qu'il y a trois anomalies génétiques. Cela permet de repérer les profils génétiques particuliers et d'ouvrir la voie à des avancées thérapeutiques expérimentales. Enfin, les facteurs de croissance qui entretiennent la prolifération des cellules tumorales sont mieux connus qu'ils ne l'étaient par le passé. Ce que j'essaie d'expliquer c'est que les recherches en toxicologie permettent d'aboutir à des avancées thérapeutiques. Par exemple, on sait que la transformation des cellules mésothéliales aboutit à la libération dans l'organisme et dans le sang - d'où la possibilité de la doser - d'une protéine, la mésothéline. Cette protéine est plus élevée chez les sujets porteurs d'un mésothéliome que chez ceux qui ont été exposés à l'amiante mais ne sont pas porteurs, et plus encore que chez ceux qui n'ont pas du tout été exposés à l'amiante. La question qui se pose est de savoir si la mésothéline est un marqueur du mésothéliome. Peut-elle permettre de repérer l'apparition d'un mésothéliome en prévoyant un traitement ? C'est là un point de débat très important. M. Marcel GOLDBERG : Je voudrais rappeler que l'amiante ne provoque pas seulement des mésothéliomes, mais aussi d'autres types de tumeurs, qui affectent notamment le poumon. Le problème est que les cancers du poumon provoqués par l'amiante n'ont aucune caractéristique particulière permettant de les distinguer de ceux provoqués par d'autres causes. Concernant la plèvre, il semble établi que les types de tumeurs primitives qui ne sont pas considérées comme des mésothéliomes sont néanmoins très fortement associées à l'exposition à l'amiante. S'agissant de la biopersistance des fibres dans le tissu pulmonaire, on sait que les fibres amphiboles sont beaucoup plus persistantes que les fibres chrysotiles. Celles-ci disparaissent très vite. L'absence de chrysotile dans le tissu pulmonaire a été mis en avant par certains pour « innocenter » le chrysotile. En réalité, celui-ci est tout aussi cancérogène. Cela est tranché. M. Jean-Pierre GRIGNET : Je voudrais insister sur trois points. Premièrement, on ne peut plus voir dans l'acide hyaluronique un marqueur du mésothéliome. Deuxièmement, l'adénocarcinome pleural, une forme de cancer de la plèvre proche du mésothéliome, affecte des sujets qui ont été exposés à l'amiante. Le problème est qu'il existe aussi des adénocarcinomes secondaires d'un autre cancer qu'il faut éliminer, ce qui exige un bilan plus approfondi. Troisièmement, toutes les fibres ont un processus de cancérogenèse mais certaines fibres déclenchent un cancer au bout de quatre à cinq ans de plus que certaines autres. Les fibres sont d'autant plus toxiques qu'elles sont longues. Mais plus elles sont longues, moins elles pénètrent dans les alvéoles. Il y a donc un effet fibre qui est mécanique et non pas toxicologique. M. Jean-Claude PAIRON : S'agissant des marqueurs biologiques dont a parlé le professeur Fournier, je voudrais ajouter que les recherches sont toujours en cours pour mieux comprendre le mode spécifique d'action des fibres d'amiante, notamment en ce qui concerne l'induction des recombinaisons génétiques qui conduisent au développement des tumeurs. On ne sait donc pas encore tout sur le mode d'action des fibres d'amiante et ces recherches visent à caractériser les voies de signalisation grâce à des marqueurs biologiques témoignant d'un processus de cancérogenèse initié par les fibres d'amiante. M. Michel FOURNIER : On a pu avancer l'idée d'étendre à tout sujet exposé la mesure du taux de mésothéline car le dosage de la mésothéline est très simple. En fait, c'est un problème difficile et, avant de se lancer dans un dépistage systématique, il faut être prudent. La relation entre mésothéline et la présence de la maladie est loin d'être aussi simple que celle existant, par exemple, entre le taux de PSA15 et le cancer de la prostate. Il faut un peu de temps pour arriver à définir les limites de ce dosage et sa pertinence à l'égard du diagnostic de la maladie, du mésothéliome en particulier. M. Patrick BROCHARD : Les premières études expérimentales qui ont permis de montrer que toutes les variétés d'amiante étaient certainement cancérogènes chez l'animal datent de 1973. Le concept d'effet fibre a été introduit à la suite d'études réalisées par des chercheurs américains, en particulier l'équipe de Stanton, qui ont montré que quelle que soit la nature chimique de la fibre, sa structure physique pouvait entraîner les mêmes effets lorsqu'elle était déposée au niveau de la cible, à savoir la cellule pleurale. Ce concept « d'effet fibre » a donné lieu à d'autres études expérimentales, parallèlement au rôle toxique de l'amiante (fibrose ou cancer), qui ont mis en lumière dans les années 90 des effets pratiquement identiques à ceux d'autres matériaux fibreux, notamment les fibres céramiques dont on vérifie actuellement, de façon expérimentale, qu'elles ont des propriétés biologiques très voisines de celles de l'amiante. M. le Rapporteur : Cette question est importante. Certains avancent en effet, en France comme à l'étranger, que tel ou tel type d'amiante n'est pas dangereux et se fondent sur cette affirmation pour continuer à l'utiliser. Nous comptons bien d'ailleurs poser le problème international de l'extraction et de la commercialisation de l'amiante qui se poursuivent malgré ce que l'on sait des risques. La position du Canada est assez surprenante à cet égard. S'agissant de la santé publique, nous sommes tous confrontés aux questions que nous posent les familles. Y a-t-il un espoir ? Un dépistage précoce est-il possible ? Le pronostic peut-il être plus heureux que celui qui est souvent annoncé ? Par ailleurs, des chiffres ont été avancés, notamment celui de 100 000 morts à venir. Pouvez-vous les confirmer ou les infirmer ? Enfin, certains laboratoires prétendent que de nouveaux médicaments seraient en mesure de combattre le mésothéliome. Qu'en est-il ? M. Michel FOURNIER : S'agissant des avancées thérapeutiques, vous songez probablement, M. le Rapporteur, au Pemetrexed, molécule mise au point par le laboratoire Lilly. L'association de cette molécule à un sel de platine devient l'association de référence pour le traitement du mésothéliome en chimiothérapie. Cela dit, elle ne modifie que très faiblement l'espérance de vie du sujet. Par rapport à la médiane de survie, le gain est de l'ordre d'un mois. L'intérêt n'est donc pas d'ordre thérapeutique. Mais le fait que cette chimiothérapie devienne le traitement de référence aidera au regroupement des cas, ce qui pourra permettre de réunir les données et d'en tirer plus d'enseignements. M. Marcel GOLDBERG : S'agissant des chiffres de mortalité qui ont été avancés, ils sont assez fiables. Lorsqu'on étudie les effets cancérogènes de l'amiante, on se fonde sur le mésothéliome, car celui-ci est une pathologie presque exclusivement liée à l'amiante. Dans une population qui n'a pas été exposée à l'amiante, il y a moins d'un cas annuel par million d'habitants. L'une des particularités de ce cancer est que le temps de latence, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre le moment où un sujet est exposé à l'amiante et celui où le mésothéliome survient, est extrêmement long, entre trente et quarante ans en moyenne. Le chiffre de 50 000 à 100 000 - les médias ont bien sûr retenu le chiffre correspondant au haut de la fourchette - est le résultat d'une modélisation mathématique à partir des données concernant le mésothéliome dans les décennies passées. D'autres méthodes, s'appuyant sur les expositions à l'amiante dans la population, ont abouti à des chiffres voisins. Jusqu'en 2030, le risque est donc fixé : on sait qu'entre 30 000 et 40 000 mésothéliomes surviendront dans la population française. À ce chiffre, il faut ajouter le nombre de cancers du poumon provoqués par l'exposition à l'amiante, qui n'est pas connu avec précision, parce qu'ils sont plus difficiles à identifier, mais dont on sait qu'ils sont plus nombreux que les mésothéliomes. M. Jean-Marie GEVEAUX : Un dépistage plus précoce est-il possible, et pourrait-il permettre des traitements plus efficaces ? M. Daniel PAUL : Ma question est similaire : le temps de latence du mésothéliome est de trente ou quarante ans après le moment de l'exposition à l'amiante. Est-il possible de repérer précocement la présence de fibres, et peut-on alors éviter la survenue d'un mésothéliome ? Par ailleurs, s'agissant du cancer du poumon, peut-on espérer pouvoir déterminer son origine - tabac, amiante, ou autre ? On comprend aisément que cette question est importante du point de vue de l'indemnisation. M. Jean-Marie LE GUEN : On sait que les connaissances scientifiques ne se traduisent pas immédiatement et automatiquement en termes épidémiologiques, et encore moins en termes de décision politique. Cette distinction des plans est au cœur du problème de santé publique qui est le nôtre mais aussi au cœur d'autres problèmes de santé publique d'actualité. S'agissant du dépistage, vous avez exprimé des doutes quant à l'opportunité d'instaurer un dépistage systématique au moyen de la mésothéline. Vos scrupules sont-ils motivés par les raisons légitimes avancées par le Comité national consultatif d'éthique - il y a un risque à systématiser un dépistage quand aucun traitement n'est offert -, ou sont-ils liés à des raisons d'ordre technique ? Par ailleurs, étant donné que le mésothéliome signe a priori une exposition à l'amiante, ne pensez-vous pas qu'il serait opportun de décider politiquement - sinon scientifiquement - une automaticité de l'indemnisation, au lieu de faire courir les gens d'un diagnostic à l'autre ? Les diagnostics erronés de mésothéliome sont-ils assez nombreux pour remettre en cause une telle automaticité ? M. Patrick ROY : Mon collègue Daniel Paul a posé la question que je voulais poser. Ne peut-on pas agir pendant le temps de latence, très long, du mésothéliome pour mieux protéger les personnes ? Mme Martine DAVID : Les plaques pleurales sont à l'origine de grandes angoisses. Les personnes concernées n'ont pas les réponses aux questions qu'ils se posent. Il serait bon que l'information médicale soit plus nette, plus lisible et plus largement répandue sur les développements des plaques pleurales. M. Claude GOT : S'il n'y avait pas de doutes sur les connaissances scientifiques, cette table ronde n'aurait pas été organisée. Mais si les recherches en toxicologie ont un intérêt pour le progrès de la connaissance, elles n'ont pas d'incidence opérationnelle en termes de décisions politiques. Nous savons depuis longtemps qu'il n'y a pratiquement pas de mésothéliome sans amiante et donc que la quasi-totalité des tumeurs primitives de la plèvre doivent être imputées à l'amiante. Quand on diagnostique un cancer de la plèvre et qu'il n'y a pas d'autre tumeur ailleurs, il faut l'imputer à l'amiante et les risques d'erreur sont très faibles. Les conséquences en ont d'ailleurs été tirées au niveau législatif. Il faut donc cesser de se poser des questions sur la décision politique et sur la gestion des victimes, même si l'on peut légitimement continuer à s'en poser au niveau des connaissances scientifiques. Les choses sont beaucoup moins simples en ce qui concerne le cancer bronchique, où d'autres facteurs entrent en jeu, à commencer par le tabac. Il n'est donc pas possible d'instaurer une indemnisation systématique. Certains pays ont mis en œuvre une recherche systématique des fibres dans toutes les tumeurs primitives du poumon, et imputent le cancer bronchique à l'amiante à partir d'un certain seuil. On sait que cette disposition entraîne des injustices, puisque certaines fibres disparaissent plus vite que d'autres et ne peuvent pas être mises en évidence lorsque le cancer survient vingt ans après l'exposition du sujet. Mais c'est déjà un progrès en terme d'indemnisation. Le problème du diagnostic précoce et de la prévention est que l'on ne dispose pas d'une méthode qui permettrait d'empêcher la survenue d'un cancer après exposition, ni même d'améliorer le pronostic, contrairement à d'autres types de cancers ouverts aux thérapeutiques comme le cancer du col utérin, ou le cancer du sein. Or l'opportunité du dépistage est directement liée aux thérapeutiques disponibles en aval. En matière de plaques pleurales, le progrès des techniques d'imagerie médicale fait apparaître des petits épaississements pleuraux qu'on ne voyait pas auparavant. On fait naître ainsi des angoisses chez les sujets, alors qu'en fait, c'est l'exposition qui fait naître le risque. Quand des ouvriers ont travaillé dans la même usine et ont été exposés de la même façon à l'amiante, entre ceux qui ont des plaques pleurales et ceux qui n'en ont pas, le risque de voir survenir un cancer bronchique ou un mésothéliome n'est pas très différent. Le dépistage a donc des effets pervers en terme d'inquiétude. Les incertitudes sur le pronostic lié à un diagnostic précoce ou non sont encore trop grandes pour que la généralisation du dépistage soit considérée comme une mesure opportune. Beaucoup de travailleurs de l'amiante préfèrent d'ailleurs ne pas subir d'examen parce qu'ils ont compris qu'ayant été exposés à un risque majeur ils pourront développer un cancer pour lequel les résultats thérapeutiques sont mauvais. M. Jacques AMEILLE : Je souscris tout à fait aux propos de M. Got. Toutefois, je préciserai qu'en matière de dépistage et de pronostic, il est important de distinguer mésothéliome et cancer broncho-pulmonaire. S'agissant du mésothéliome, les progrès thérapeutiques existent mais ils sont faibles. Généraliser le dépistage n'apporterait donc pas à coup sûr un bénéfice pour les patients. S'agissant du cancer broncho-pulmonaire, il existe un traitement efficace ; c'est la chirurgie, à condition que la tumeur ait été identifiée suffisamment tôt. Cela étant, on n'a pas encore la preuve - ce n'est pour le moment qu'un espoir - qu'un dépistage systématique par scanner apportera un bénéfice en termes de survie. Beaucoup d'études sont conduites dans différents pays, dont la France, pour évaluer le bénéfice éventuel qui pourrait résulter de la pratique de scanners itératifs. Ces études visent essentiellement les fumeurs - il n'y a pas d'études spécifiques concernant les personnes exposées à l'amiante - mais si les résultats étaient concluants, ils pourraient être utilisés pour préconiser un dépistage plus systématique des pathologies tumorales chez les personnes exposées à l'amiante. Il faudra encore attendre plusieurs années pour obtenir des conclusions valables. Les plaques pleurales sont de très loin les pathologies les plus fréquemment observées chez les personnes exposées à l'amiante. C'est donc un problème important générant une angoisse majeure en raison d'idées fausses largement répandues. Une plaque pleurale est une sorte de tissu cicatriciel au niveau du collier externe de la plèvre, qui n'entraîne généralement aucun retentissement sur la fonction respiratoire. La question que se posent légitimement les personnes concernées est, d'une part, de savoir si ces plaques pleurales vont se transformer en cancer, et d'autre part, si le fait d'avoir des plaques pleurales augmente le risque d'un cancer du poumon ou de la plèvre. À la première question, on peut répondre non. On peut avoir une plaque pleurale et développer un cancer, mais ce sont deux maladies distinctes. Quant à l'augmentation du risque d'avoir un cancer de la plèvre ou du poumon, curieusement, la littérature scientifique comporte assez peu de données. Une étude conduite en Suède a été publiée en 1994. Sur une cohorte de 1 500 hommes ayant des plaques pleurales, il a été observé une augmentation du risque de cancer broncho-pulmonaire de 40 % par rapport à la population. On a observé, par ailleurs, neuf mésothéliomes. On peut donc considérer que la probabilité de développer un cancer du poumon ou un mésothéliome est accrue chez les personnes ayant des plaques pleurales. Le problème est qu'on n'a pas comparé une population ayant été exposée à l'amiante et ayant des plaques pleurales à une population ayant eu le même niveau d'exposition et n'ayant pas de plaques pleurales. Au stade actuel des connaissances, on n'a pas de raison de penser que, à exposition identique, le fait d'avoir des plaques pleurales augmente le risque de cancer. Mme Ellen IMBERNON : L'impact de l'exposition à l'amiante sur les cancers du poumon est quand même important. Certes, en l'état actuel des connaissances, on ne peut pas dire si un cancer du poumon est dû à l'exposition à l'amiante ou à une autre cause. Mais il est néanmoins possible, en connaissant la probabilité que le cancer du poumon soit associé à l'amiante, de calculer combien de cancers du poumon sont attendus dans la population française compte tenu des estimations relatives à l'exposition à l'amiante. Le nombre attendu de cancers du poumon associés à l'exposition à l'amiante est de 2 000 à 3 000 par an chez les hommes, sur un total de 25 000, soit environ 10 %. Pour l'exposition féminine, les estimations sont encore difficiles car on connaît très mal l'exposition à l'amiante des populations féminines. M. Jean-Marie LE GUEN : Statistiquement, peut-on dire que la présence de fibres signe la liaison entre l'exposition à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire, et si oui dans quelles proportions ? Mme Ellen IMBERNON : Je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question. M. Jean-Claude PAIRON : Il existe deux techniques de dosage permettant de quantifier les fibres présentes dans le poumon. L'une relève de la microscopie optique, et est assez facile à mettre en œuvre de manière routinière, grâce au marqueur dit « corps asbestosiques » qui permet de compter les fibres par gramme de poumon. L'autre consiste en un comptage, par microscopie électronique, de l'ensemble des fibres d'amiante présentes dans le poumon. Il y a des seuils témoignant d'un niveau de rétention anormal dans le poumon par rapport à la population générale. Ainsi, quand il y a plus de 1 000 corps asbestosiques par gramme de poumon, on peut dire qu'on fait partie des 5 % d'individus ayant un taux supérieur à celui de la population française. À l'échelon individuel, les données sont difficiles à interpréter car il y a des « faux négatifs ». Néanmoins, on dispose de séries, en France comme en Belgique, qui montrent qu'entre 10 et 15 % des cancers bronchiques ont un niveau de rétention anormalement élevé (supérieur à plus de 1 000 corps asbestosiques par gramme). En Belgique, le fait d'avoir plus de 5 000 corps asbestosiques par gramme est associé à une reconnaissance automatique du lien entre l'exposition à l'amiante et le cancer du poumon. Mme Ellen IMBERNON : Je voudrais ajouter que la probabilité d'avoir un cancer si l'on a été exposé à l'amiante est la même, que l'on soit fumeur ou non, même si la probabilité d'avoir un cancer du poumon est plus élevée si l'on est fumeur. Sur les 2 500 cancers du poumon dus à l'exposition à l'amiante, environ 450 faisaient l'objet d'une réparation au titre des maladies professionnelles en 1999. En 2004, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) annonçait environ 800 cancers du poumon ayant fait l'objet d'une réparation au titre des maladies professionnelles. Tous étaient liés à l'amiante car très peu de cancers du poumon sont reconnus comme étant en relation avec d'autres expositions professionnelles, alors qu'il existe bien d'autres cancérogènes professionnels avérés. Il y a donc une évolution des mentalités, même si l'écart reste important entre les cancers diagnostiqués et les cancers indemnisés. Cela est dû au fait que le système de réparation des maladies professionnelles est fondé sur la déclaration volontaire des victimes. On peut certes s'interroger sur le système de la déclaration volontaire, mais c'est une autre question. Les pouvoirs publics avaient mis en place, en 1995, un dispositif visant à suivre médicalement, après leur départ en retraite, les personnes qui ont été exposées à des nuisances cancérogènes potentielles, y compris l'amiante. Ce dispositif - le suivi médical post-professionnel - n'est quasiment pas appliqué. D'une part, il est trop peu connu. D'autre part, une grande proportion des travailleurs qui ont été exposés à l'amiante dans leur vie professionnelle l'ignorent. C'est pourquoi l'Institut de veille sanitaire a expérimenté, en 2001, une méthode visant à repérer les retraités qui ont probablement été exposés à l'amiante et à les en informer pour préserver leurs droits. Cette méthode va être appliquée en 2005-2006 par la Caisse d'assurance maladie des professions indépendantes (CANAM) et la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM). J'ajoute que beaucoup de personnes non salariées ont été exposées à l'amiante et ne bénéficient d'aucun suivi médical. Je pense en particulier aux artisans qui n'ont pas de médecine du travail et pour lesquels on essaie d'initialiser un suivi médical. M. Jean-Pierre GRIGNET : Un rapport de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) datant de décembre 1996 a montré que si le risque d'avoir un cancer bronchique est de 1 dans la population générale, il est de 11 si l'on fume, de 5,6 si l'on est exposé à l'amiante et qu'on ne fume pas, et de 56 si l'on est exposé à l'amiante et que l'on fume. Il y a donc un effet multiplicateur. S'agissant de la prévention, parmi les malades que j'ai eu à soigner atteints de mésothéliome pleural, seuls ont eu plus de cinq ans de survie ceux qui étaient jeunes et ont pu subir une pleuro-pneumonectomie, opération chirurgicale très lourde, qui n'est possible que dans un petit nombre de cas et qui suppose un diagnostic précoce. Toutefois, la cohorte n'était pas suffisamment importante pour en tirer des conclusions valables. En ce qui concerne le cancer bronchique, c'est pareil : seule la chirurgie rend possible la survie. Plus le dépistage est précoce, plus il est possible de proposer un traitement chirurgical, plus les chances de survie sont élevées. M. le Rapporteur : À partir de quelle durée et de quelle fréquence y a-t-il un risque ? Une seule exposition suffit-elle pour que le nombre de fibres inhalées ait des répercussions pathologiques. C'est ce qui risque de se produire avec l'amiante résiduel, celui qu'il faut traiter depuis l'interdiction du produit en 1997. On considère que 5 fibres par litre d'air est une dose inoffensive. À Paris, le Laboratoire d'étude des particules inhalées (LEPI) nous a confirmé que le taux actuel était de 0,5 fibre par litre d'air. Que pensez-vous de cet outil de mesure et quelles conséquences peut-on tirer de son utilisation ? Par ailleurs, nous n'avons pas encore parlé de l'asbestose. Est-ce une maladie spécifique de l'amiante ? Enfin, je souhaiterais que vous évoquiez le problème de la présence de fibres d'amiante dans un liquide, en particulier dans l'eau. Cela présente-t-il un danger et quels sont également les risques à long terme des sites ou l'on entrepose les « bigs bags » d'amiante ? M. Marcel GOLDBERG : S'agissant des seuils, le consensus scientifique est que le risque de développer un cancer du fait de l'exposition à l'amiante correspond à un « modèle linéaire sans seuil ». Cela signifie que le risque augmente de façon strictement proportionnelle à la dose totale d'amiante inhalé, sans qu'il soit possible de définir un seuil inférieur au-dessous duquel il n'y aurait aucun effet toxique. En théorie, l'inhalation d'une seule fibre d'amiante peut donc déclencher un cancer, de même qu'une seule bouffée de cigarette peut en déclencher un. Mais le risque est bien entendu proportionnel : l'augmentation du risque du fait d'avoir été exposé à de très faibles doses d'amiante est donc elle-même très faible et on ne pourra sans doute jamais l'observer par aucune méthode. Cela dit, comme l'indiquent les premiers résultats du PNSM, le plus grand nombre des mésothéliomes touchent des professions dans lesquelles l'exposition à l'amiante est intermittente, et sans doute beaucoup moins élevée que dans les chantiers navals, par exemple. Dans les chantiers navals, le risque est beaucoup plus élevé que dans le bâtiment, mais en valeur absolue, le nombre de personnes travaillant dans les chantiers navals est très inférieur au nombre de celles qui travaillent dans le bâtiment. Le risque individuel est donc plus faible dans le bâtiment parce que l'exposition est plus faible mais le risque collectif génère plus de cancers que dans les chantiers navals. M. le Président : Ce point est d'une extrême importance. Et c'est bien la raison pour laquelle nous avons commencé nos travaux par le problème de l'amiante dit « résiduel ». M. Marcel GOLDBERG : Un article qui va paraître prochainement dans une grande revue internationale montre qu'on observe encore, à plusieurs dizaines de kilomètres de sources industrielles d'amiante, une augmentation des risques de mésothéliomes. Donc, des doses faibles peuvent, au niveau collectif, générer un certain nombre de cas. S'agissant des expositions « environnementales », nous savons que le travail sur un matériau contenant de l'amiante ou le fait de se trouver à proximité augmente le risque. Le fait de résider - même assez loin - aux environs d'une source d'amiante industrielle - usine d'amiante textile ou d'amiante-ciment ou d'une mine - augmente également les risques. Il y a également des sources géologiques naturelles d'amiante. En France, des sites ont été identifiés en Corse et en Nouvelle-Calédonie où l'on observe des augmentations énormes de risques de développement du mésothéliome. Tout cela est très bien documenté mais il y a encore des incertitudes sur les risques encourus du fait de travailler dans un bâtiment qui a été floqué à l'amiante. C'est le cas des professeurs de Jussieu. Une étude est en cours sur ce point et il faut savoir que l'on peut, dans ce cas, être exposé à des doses beaucoup plus élevées qu'on ne l'imagine. M. Michel FOURNIER : L'asbestose est une fibrose du poumon que l'on voit apparaître chez des sujets qui ont été soumis à des expositions massives à l'amiante, notamment autour des chantiers navals. Le nombre de cas est relativement restreint et devrait décroître dans les années qui viennent. Dans un tiers des cas, cette maladie évolue vers une insuffisance respiratoire grave et une espérance de vie réduite. Dans deux tiers des cas, elle reste à peu près stable. J'ajoute que les problèmes d'exposition environnementale sont abordés sous un angle très pratique au sein de la commission d'évaluation du FIVA. Lorsqu'il s'agit d'étudier un dossier complexe, on utilise des cartes météo, des données de la Direction départementale de l'équipement (DDE) et diverses sources provenant d'organismes d'État pour essayer de savoir si l'on peut imputer la maladie à l'exposition à l'amiante. La grande difficulté est de qualifier l'importance de l'exposition et du « sur-risque ». M. Alain CLAEYS : Vous avez évoqué une étude en cours sur Jussieu, M. le professeur Goldberg. Quand sera-t-elle publiée ? M. Marcel GOLDBERG : Cette étude a pris beaucoup de retard, pour une raison simple : il n'existe pas de fichier du personnel à l'université de Jussieu ! On est donc obligé de rechercher les personnes susceptibles d'avoir été exposées. M. Patrick BROCHARD : En ce qui concerne la contamination des liquides, le débat n'a pas vraiment été renouvelé depuis la fin des années 80. Des études expérimentales ont été conduites, par gavage d'animaux de laboratoires, en particulier des rats. Les résultats d'études très médiocres ont été publiés, qui ne permettaient pas de conclure à un excès de risque clair. Par contre, beaucoup d'études portant sur d'autres données, indirectes, d'ordre épidémiologique, ont montré des risques d'augmentation des tumeurs du tube digestif. Ces constatations ne sont pas systématiques. D'une étude à l'autre, les résultats peuvent être contradictoires. On sait qu'une grande partie des fibres qui se déposent dans les alvéoles vont être dégluties dans le tube digestif. Par ailleurs, lorsque les personnes sont exposées à l'amiante, non seulement elles inhalent les particules, mais elles déglutissent des fibres mêmes si celles-ci ne vont pas dans les alvéoles. Au total, la réponse est beaucoup moins claire que s'agissant de l'inhalation. En ce qui concerne le risque lié aux décharges, il me semble que le risque le plus important est que ces décharges soient mal contrôlées et soient réutilisées à des fins de construction. Cela est déjà arrivé. On a ainsi remis en suspension dans l'air des quantités de fibres tout à fait significatives. Il s'agit alors d'un risque absolument certain, d'où l'importance du contrôle des décharges. L'inertage n'est pas non plus la panacée. Car si l'amiante est bien entièrement dénaturé par la chaleur, dans l'environnement des entreprises d'inertage, le stockage des matériaux contenant de l'amiante en quantité très importante peut donner lieu à des erreurs de manipulation conduisant à des expositions par inhalation. M. Claude GOT : Il y a une confusion fréquente, et importante, entre le risque lié aux faibles concentrations de fibres et le risque lié aux expositions intermittentes. Pour savoir si l'inhalation répétée d'un tout petit nombre de fibres peut provoquer des pathologies, il faudrait étudier des cohortes tellement importantes pendant tellement de temps qu'il n'est pas possible de conduire ces études. Voilà qui clôt le débat. De toute façon, l'usage de l'amiante est maintenant interdit. On ne respire plus de l'amiante dans Paris comme on en respirait il y a vingt ans. Autre chose est le problème de l'exposition intermittente d'un très grand nombre d'ouvriers du bâtiment. Les salariés exposés à l'amiante-ciment dans les entreprises manufacturant l'amiante représenteront sans doute beaucoup moins de mésothéliomes que les millions de personnes qui sont exposées à l'amiante dans leur activité professionnelle quotidienne dans le bâtiment. Cette exposition n'est pas une exposition à de faibles niveaux. Lorsqu'un ouvrier se trouve à 25 centimètres du plâtre chargé d'amiante qu'il est en train de percer, il n'est pas exposé à de faibles concentrations. Il peut même y avoir des pics considérables. C'est là un point qui a échappé à l'Académie de médecine dans son rapport de 1996, qui est centré sur les faibles concentrations et non sur les expositions intermittentes à des concentrations parfois très élevées, et qui est un des éléments de l'erreur commise sur l'amiante. Si l'épidémiologie du mésothéliome avait eu les moyens nécessaires - d'ailleurs exigés par les textes -, on aurait eu la réponse beaucoup plus tôt sur la question de l'exposition intermittente. Il aurait fallu disposer de registres des cancers avec des registres précis des métiers car le comptage des cancers sans lien avec les métiers ne donne pas au décideur les éléments dont il a besoin. Cette confusion est un élément majeur dans la genèse des erreurs de gestion concernant l'amiante. M. le Président : Nous allons maintenant aborder la seconde partie de notre table ronde. Je rappelle rapidement les points à aborder - dont certains ont déjà été évoqués - en quelques questions : Comment expliquer que l'interdiction de l'amiante ait été si tardive, alors que le danger avait été démontré depuis longtemps, parfois depuis le début du siècle, par les travaux d'éminents spécialistes ? Le problème de l'amiante « résiduel » a déjà été abordé en première partie. Peut-on considérer, comme nous commençons à le penser et comme vous avez commencé à nous le confirmer, que c'est désormais le facteur de risque le plus important ? Nos premiers travaux nous ont permis de mesurer l'ampleur de ce problème, sur lequel nous avons organisé deux tables rondes et auditionné environ cinquante-cinq personnes. Enfin, vous avez très précisément montré que nous disposions des moyens scientifiques nécessaires pour mieux appréhender les risques sanitaires liés à l'amiante. Quelles leçons peut-on en tirer pour la prévention d'autres risques ? Les moyens affectés à la recherche et notamment à l'épidémiologie sont-ils suffisants ? Permettront-ils d'éviter la répétition d'erreurs déjà commises ? M. Marcel GOLDBERG : Je ne suis absolument pas qualifié pour expliquer pourquoi la France s'est décidée assez tardivement à intervenir, alors que non seulement le problème était connu, mais que d'autres pays avaient depuis longtemps pris des mesures réglementaires : la première législation de protection des travailleurs exposés à l'amiante remonte à 1931 en Grande-Bretagne... En France, il a fallu attendre 1977 ! Et nous n'avons pas été, et de loin, les premiers à interdire l'amiante en 1997. Je ne saurais vous expliquer le pourquoi de ce retard mais je peux en revanche vous en détailler les conséquences actuelles. Aux États-Unis, pays dont on ne peut a priori penser que les employeurs ont une fibre particulièrement plus philanthropique que chez nous, on observe en 2005 une diminution des cas de mésothéliome par rapport à 2004 ; en France, nous sommes certains qu'ils continueront à augmenter pendant au moins vingt ou trente ans. Si l'on regarde les risques par génération, on constate que la génération la plus touchée aux États-Unis est celle qui est née dans les années 1920 ; chez nous, les risques continuent à augmenter pour les générations les plus récentes. Traduit en français ordinaire, cela signifie que nous avons au moins trente à quarante ans de retard en matière de protection des travailleurs vis-à-vis de l'amiante. Quelle qu'en soit la cause - employeurs, réglementation, etc. -, le résultat factuel est que le risque et le nombre de cas continueront d'augmenter en France, alors qu'ils baissent aux États-Unis. Ce sont là des données incontestables. Pour ce qui est de l'épidémiologie et de ses moyens, le docteur Imbernon pourra en parler mieux que moi. Pas mal de choses ont été lancées au sein de l'Institut de veille sanitaire, bien que les moyens restent certainement très insuffisants. M. le Président : Pouvez-vous précisez ? M. Marcel GOLDBERG : L'épidémiologie au sens large est encore, parmi toutes les sciences biomédicales, une discipline extrêmement marginale, et cela dépasse largement le cas de l'amiante ou des risques professionnels. L'Académie a commandé un rapport retraçant la place de l'épidémiologie dans notre pays ; le constat est accablant. Rapportée à la population, la production scientifique française dans le domaine de l'épidémiologie est quinze fois plus faible que celle des Pays-Bas... Autrement dit, les Hollandais publient quinze fois plus que les Français en épidémiologie dans les journaux internationaux. Nous sommes très en retard d'une façon générale ; et dans le domaine plus particulier de l'épidémiologie des risques professionnels, nous avons été très mauvais, en tout cas pendant très longtemps. Lorsque l'expertise collective concernant l'amiante a été réalisée par l'INSERM en 1996, nous avons relu l'ensemble de la littérature consacrée à l'épidémiologie ; sur les centaines d'études analysées, nous n'avons trouvé qu'une seule étude française publiée sur l'exposition aux risques professionnels... Depuis, beaucoup d'efforts ont été faits : la création du département « santé/travail » au sein de l'Institut de veille sanitaire a été un progrès considérable. Mais du côté de la recherche proprement dite, cela fait trois ans de suite que l'INSERM met au recrutement un seul poste de jeune chercheur par an dans le domaine de l'épidémiologie pour toutes les disciplines... Ce n'est pas cela qui améliorera beaucoup la situation. M. Claude GOT : Nous sommes tous d'accord sur ce fait : l'épidémiologie permet d'agir, même si l'on ne comprend pas les mécanismes. Dès lors que l'on a les preuves des relations entre les expositions, les doses, les effets, le fait que l'on ne comprenne pas le mécanisme est peut-être contrariant pour le scientifique qui aimerait savoir ce qui se passe au niveau de la cellule, mais cela n'empêche en rien de prendre une décision. L'épidémiologie est une technique qui permet d'obtenir des arguments et même des preuves, dans la mesure où l'on peut souvent aller jusqu'à une interprétation causale. C'est particulièrement important dans un pays qui n'a pas une culture de passage à l'acte de qualité. On aura beau avoir des connaissances, de bons textes, des règlements, tout cela ne servira à rien si, sur le terrain, on n'a pas une évaluation permanente de la qualité de ce que l'on fait. Nous avons en France un texte centenaire sur la protection des ouvriers vis-à-vis des poussières. Ce texte a été très discuté en Conseil d'État au moment où celui-ci a condamné l'État en appel, après un premier jugement du tribunal administratif de Marseille sur l'exposition à l'amiante. Cette inaptitude à vérifier dans les faits les conditions d'une réelle application des réglementations décidées par la représentation nationale, le Gouvernement et l'Administration, est à mes yeux le constat le plus important que l'on puisse tirer en termes de bilan de notre efficacité dans le domaine de la santé publique. Je le disais en riant, car il faut bien rire de ce qui devrait nous faire pleurer : va-t-on vous demander, quinze ans après, de revoter la loi Evin destinée à protéger les non-fumeurs au motif qu'elle n'est pas appliquée sur le terrain ? Pour ce qui est des poussières d'amiante, les ouvriers me racontaient que, à une époque encore récente, ils ouvraient les sacs d'amiante sans masque ni protection et les vidaient directement dans les mélangeurs pour fabriquer l'amiante-ciment. À l'usine Ferodo de Condé-sur-Noireau, on testait les qualités de l'amiante dans un atelier - où presque tout le monde est mort - en frottant les fibres sur des disques abrasifs avant de les utiliser dans les plaquettes de frein alors que, depuis des années, un texte prescrivait de protéger les ouvriers des poussières dans les ateliers ! C'est ce décalage entre réalité et fiction de la réglementation qui explique que des pays plus rationnels, en tout cas dans les faits, voient maintenant diminuer chez eux le nombre de cancers attribuables à l'amiante alors qu'ils vont croissant chez nous. Je peux donner des dizaines d'exemples de ce genre, qui renvoient au problème général de l'évaluation de la mise en œuvre des pratiques. On aurait pu en dire autant du sang contaminé : la circulaire du professeur Roux était de bonne qualité ; le tribunal correctionnel lui a simplement reproché le fait qu'elle n'était pas appliquée sur le terrain, ce à quoi il a répondu qu'il n'en avait pas les moyens. Même chose pour le risque routier : on parle du risque des 4X4, de ces gros véhicules inutilement rapides, puissants et pollueurs. Mais peut-on produire en France une statistique du risque routier lié aux 4X4 ? Non. Tout simplement parce que l'on est incapable d'identifier correctement les véhicules dans les accidents. Dans le bulletin d'analyse statistique, l'identifiant des véhicules est passé voilà dix ans de huit à douze caractères, mais on n'a pas augmenté le nombre de cases dans le formulaire ni modifié, au moment de l'informatisation, les programmes pour que les policiers puissent le saisir... Je l'ai dit devant six ministres au moment du lancement du programme de sécurité routière du gouvernement Raffarin : c'est comme si l'on assurait la traçabilité de la viande bovine en commençant par couper en deux l'étiquette jaune à l'oreille des vaches ! Deux ans et demi après, ce n'est toujours pas fait. Au bout de dix ans, on vient tout juste d'augmenter le nombre de cases pour saisir les douze caractères ! Notre pays, c'est un fait, n'a pas de culture du passage à l'acte et de l'évaluation. Et il ne m'a pas semblé que le Parlement se soit ému de la suppression du Conseil supérieur de l'évaluation, alors que cette structure, adossée au Commissariat au plan, commençait à peine à travailler, vingt ans après avoir été lancée par le rapport Viveret qu'avait commandé Michel Rocard. La commission Ternier avait recommandé l'automatisation du système de contrôle/sanction et la mise en place de radars automatiques. Le produit est arrivé juste au moment où le Gouvernement en avait besoin : il y a eu un passage à l'acte efficace. Mais cette commission a été la dernière à fonctionner dans le cadre du Conseil de l'évaluation... Comment le pays de Descartes peut-il avoir une gestion d'aussi mauvaise qualité ? Je le disais déjà il y a sept ans : pour l'amiante, nous avons un fichier informatisé du cadastre, un fichier des impôts locaux. Tous les propriétaires, tous les locaux bâtis sont identifiés. J'avais négocié avec les Finances et obtenu qu'ils transmettent leur fichier et en fassent le support de l'identification de l'amiante. Un diagnostic amiante positif pouvait ainsi être inscrit sur un fichier informatisé ; un chef d'entreprise pouvait, au moment de faire un devis, vérifier s'il y avait de l'amiante dans le bâtiment et accéder aux documents. Sept ans après, ce n'est toujours pas fait et on a vu ce qui s'est passé avec la tour Montparnasse... Cette absence de culture du passage à l'acte est le point le plus dangereux pour l'État, pour la collectivité. On est en train de tuer l'État si l'on n'est pas capable d'améliorer, sur le terrain, la qualité de son fonctionnement décisionnel. M. le Président : Je n'engagerai pas un débat sur le fonctionnement de l'État, même si le sujet m'intéresse beaucoup... Cela dit, vos remarques sont très justes : il y a encore quelques années, 80 % des manutentions d'amiante en sac de vrac étaient effectuées par les dockers de Dunkerque en ambiance confinée, c'est-à-dire en fond de cale ! M. Daniel PAUL : Qui respiraient les fibres d'amiante et les prenaient pour de la neige ! Mme Ellen IMBERNON : Le professeur Goldberg a insisté sur notre manque de moyens humains en épidémiologie et je ne peux qu'acquiescer. Reste que la création, en 1998, d'un département « santé/travail » au sein d'un organisme chargé de la santé publique tel que l'Institut de veille sanitaire a marqué l'amorce d'une évolution des esprits, en inscrivant pour la première fois les relations entre santé et travail dans les préoccupations relatives à la santé de la population française. Ce n'est certes qu'un début, un balbutiement ; nous partons de zéro et tout est à mettre en place. Mais cette démarche d'observation et de quantification répond à cette nécessité d'un suivi des mesures préventives et réglementaires régulièrement adoptées. Nous sommes actuellement une vingtaine de personnes au département « santé/travail » de l'Institut de veille sanitaire ; nous avions commencé à deux en 1998. Force est de reconnaître une montée en charge des effectifs, encore bien insuffisante eu égard à l'immensité de la tâche. Néanmoins, un programme de surveillance du mésothéliome fonctionne depuis maintenant six ans, qui associe un certain nombre de partenaires. Sans oublier d'autres programmes de surveillance des effets de l'amiante ou d'autres facteurs professionnels dans la population ou encore l'enquête sur les personnels de Jussieu qui, bien que très difficile à mener à terme, devrait apporter des éléments d'information très intéressants. Il faut poursuivre les efforts. M. le Rapporteur. Je m'interroge cependant sur le rôle, dans le passé, du comité permanent « amiante » (CPA) et des scientifiques qui y ont siégé, de même que sur certains propos : « À faible dose, la poussière d'amiante n'est sans doute pas plus dangereuse que la poussière de silice que l'on respire sur la plage... » Ce sont les propos de Claude Allègre, dans L'Express, le 11 avril 2005 ! M. Claude GOT : C'est le cas typique de l'erreur d'interprétation. Dans le débat sur les fibres de remplacement, le problème de la dimension de la particule est fondamental. Qu'elle soit fibrillaire ou polyédrique, si sa taille ne lui permet pas d'aller jusque dans l'alvéole du poumon, on peut laisser les enfants sur la plage... Le contresens de Claude Allègre était total. Il devait pourtant le savoir : je le lui avais dit dès le début de la mission amiante. Mais il avait cette idée en tête et a persisté à la défendre avec une totale mauvaise foi. On savait depuis toujours que certaines fibres de remplacement avaient une dimension qui garantissait la sécurité ; à l'inverse, celle de certains types de céramiques pouvait laisser craindre, et cela s'est confirmé, des effets similaires à ceux de l'amiante. L'histoire du comité permanent « amiante » renvoie à un problème organisationnel. Créé par des personnes de bonne volonté pour essayer de réunir des scientifiques, des syndicalistes, des administratifs, des industriels dans le but de gérer au mieux l'amiante, cet organisme s'est retrouvé à assumer en partie des rôles dévolus à l'État et aux administrations alors qu'il n'avait ni statut, ni président, ni budget. Le lieu de travail était un organisme de conseil dont les financements provenaient de l'industrie de l'amiante ! C'était déjà là un péché originel que l'on ne commettrait plus maintenant. Les scientifiques qui y ont siégé ont travaillé en toute bonne foi. J'ai fait scanner la totalité de ses comptes rendus, qui ont été mis en ligne sur le site Internet du ministère. Nous savons donc exactement ce qui s'y est dit pendant toute la durée de son fonctionnement. C'est pour moi une manipulation et une certaine forme de malfaisance qui ont permis une aussi longue discussion sur l'amélioration de la sécurité au travail et de la gestion de l'amiante, un peu dans la ligne de ce que les Québécois m'avaient dit lorsqu'ils nous poursuivaient devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) - et qu'ils continuent à soutenir. La France a certes réagi tardivement pour interdire l'amiante par rapport à certains pays européens, mais n'oublions pas qu'une majorité de pays dans le monde continue à l'utiliser... M. le Président : Tout à fait. M. Claude GOT : « On peut avoir un usage sécuritaire de l'amiante », disaient-ils. Effectivement, on peut... Mais lorsqu'on ne sait pas où il se trouve et que des ouvriers vont travailler dessus sans le savoir, l'usage sécuritaire de l'amiante n'est qu'une illusion ! Les Canadiens prétendaient que leur amiante était moins dangereux, mais ils achetaient sur le marché de l'amiante, à Chicago en particulier, des masses provenant aussi bien d'Afrique du Sud que du Brésil, tant et si bien qu'il y a paradoxalement autant d'amiante plus dangereux au Québec que dans les autres pays du monde. Le comité permanent amiante n'avait pas la capacité d'expertise pour poser la seule vraie question : peut-on se débarrasser de l'amiante dans telle ou telle activité ? Quels en seront le coût, les inconvénients, les avantages ? En relisant les comptes rendus de ses débats, on s'aperçoit que l'expertise industrielle n'y était pas. Les industriels de l'amiante ont donc une responsabilité majeure. Lorsqu'ils rachetaient l'entreprise des frères Blandin, qui savait faire des flocages avec des fibres non dangereuses, ils suivaient une logique de combat, de méthodes et de marchés, et non pas une logique de santé publique face à un produit reconnu cancérogène, dont on sait depuis quarante ans qu'il présente probablement le risque de cancer industriel le plus élevé au monde. « Les données accumulées indiquent que les cancers liés à l'exposition à l'amiante, spécialement du poumon, sont la cause la plus importante de cancers industriels à ce jour », écrivait un chercheur américain en décembre 1965 ! Le caractère cancérogène de l'amiante a commencé à être reconnu, après l'asbestose, dès la fin des années 30, le mésothéliome un peu plus tard. Mais nous étions dans des luttes de pouvoir avec des industriels qui avaient une technique et assuraient le fonctionnement de leurs usines, donc le versement de salaires, donc une activité économique, et qui refusaient toute idée de se débarrasser du produit à telle date ou pour telle application. Ce fut une erreur organisationnelle de laisser le comité permanent amiante prendre, en quelque sorte, le pouvoir et devenir aux yeux de tout le monde l'organisme gestionnaire de l'amiante, alors qu'il n'avait ni l'habilitation ni la volonté de mener la bonne expertise, autrement dit l'expertise industrielle. M. Patrick BROCHARD : J'ai déjà eu l'occasion d'apporter quelques réponses aux parlementaires puisque j'ai participé, voilà quelques années, à la rédaction d'un document produit par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, dans lequel cette situation avait été longuement analysée. Je me suis retrouvé à siéger dans ce comité que j'ai pris en marche, parce que l'on m'avait demandé d'y participer et que je n'avais en fait guère d'autre possibilité. Rappelons que le débat lancé par le professeur Bignon en 1973-1974 avait abouti à la législation de 1977 qui, replacée dans le contexte de l'époque, n'était pas si en retard par rapport aux autres pays. Le dogme alors posé par l'administration était le suivant : force était de continuer à utiliser l'amiante, à défaut de disposer de matériaux de substitution pour fabriquer des freins ou du fibrociment. Dès lors que ce dogme était établi, la question était de savoir comment faire pour limiter au maximum les expositions. Nous nous sommes ainsi retrouvés dans un groupe effectivement totalement informel - ce qui a posteriori semble hallucinant -, mais avec l'impression d'être dans une instance très officielle dans la mesure où tous les ministères étaient représentés, de même que les partenaires sociaux... M. le Président : Sauf un : Force ouvrière. M. Claude GOT : En effet. M. Patrick BROCHARD : ...et aux travaux desquels nous n'étions associés qu'à travers une série de questions techniques directement liées à nos domaines d'action propres : l'épidémiologie pour mon ami le professeur Valleron, la pneumologie, puis la médecine du travail pour ce qui me concernait. De surcroît, vous le savez, la position du médecin du travail est toujours très délicate dans la mesure où on lui demande de prendre en charge des entreprises et d'intervenir autant que faire se peut sur des techniques de prévention. Malheureusement, ce n'est pas le médecin du travail qui conçoit les systèmes de production, surtout lorsqu'ils sont défaillants... La question posée était d'accompagner l'utilisation de ces matériaux - dont on savait, depuis 1977 au moins, qu'ils étaient classés comme cancérogènes certains - dans une logique de développement de l'industrie au sens large, de la même façon que l'on continue aujourd'hui à utiliser du benzène ou des radiations ionisantes, eux aussi cancérogènes certains, la société ayant décidé qu'elle acceptait de les utiliser en s'entourant des précautions ad hoc. Ces précautions ont été traduites dans la série de textes réglementaires parus entre 1977 et 1996, au fil des aménagements qui se sont succédé durant cette période : ainsi les flocages ont été interdits dès 1977, mais les amphiboles un peu plus tard seulement. Des valeurs limites d'exposition avaient été fixées, comme dans la plupart des autres pays, y compris aux États-Unis qui continuent à utiliser l'amiante. Nous nous sommes donc retrouvés dans une situation extrêmement difficile, comme actuellement, au sein du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels, face d'un côté à l'administration et aux partenaires sociaux, de l'autre aux industriels, et tenus comme quantité très négligeable dans les débats, à une époque où l'Institut de veille sanitaire et les agences n'existaient pas : il n'y avait que cette structure informelle et, la suite l'a montré, totalement ingérable. Claude Got a, de ce point de vue, parfaitement résumé la situation. M. le Président : Les scientifiques se trouvaient effectivement en situation difficile. Mais de là à accepter le principe d'une utilisation contrôlée, eu égard à ce que vous saviez déjà, on peut avoir quelque difficulté à comprendre... M. Marcel GOLDBERG : Je ne reviendrai pas sur l'histoire du CPA, mais sur les leçons à en tirer. Historiquement, il y avait effectivement un vide, mais la situation n'a pas fondamentalement changé depuis : dans la pratique, le principe de la séparation entre l'évaluation et la gestion des risques ne s'applique toujours pas au domaine de la santé au travail. Les textes confient à l'employeur la responsabilité entière de la santé des travailleurs, et les moyens publics que l'on y consacre ne proviennent pas, ou en très faible partie, de l'État. La Direction des relations du travail possède un ou deux petits bureaux spécialisés dans ces questions. À la Direction générale de la santé, on ne compte qu'une seule personne chargée des problèmes de la santé au travail et de son impact sur l'état sanitaire de la population. La santé au travail est encore gérée de facto par les partenaires sociaux, et la commission « accidents du travail et maladies professionnelles » continue d'être présidée par un représentant des employeurs. Notons que lorsque ceux-ci ont quitté la CNAMTS, on a fait appel à un représentant des artisans ce qui est d'autant plus surprenant qu'il n'existe pas de risque professionnel reconnu dans le régime des artisans ! Ajoutons que l'expertise est prise en charge par les partenaires sociaux : autrement dit, ce sont les représentant des employeurs et des syndicats qui sont chargés de l'expertise scientifique... L'expert n'est souvent même pas auditionné ! Le scénario de l'amiante peut parfaitement se reproduire demain avec un autre produit. M. le Président : Je vous remercie de la franchise de vos propos. La santé au travail a déjà fait l'objet de nombreuses interpellations ; je suis personnellement intervenu plusieurs fois sur ce sujet. M. Jean-Marie LE GUEN : L'amiante aura vraisemblablement été la cause de la plus grave crise sanitaire qu'aura connu notre pays, que l'on raisonne en termes de santé au travail ou de santé en général, et en valeur absolue comme en valeur relative : les professeurs Got et Goldberg ont montré à quel point nous étions particulièrement touchés en comparaison d'autres pays - pays comparables s'entend : le risque mortel de l'amiante n'est pas perçu de la même façon dans un pays où l'espérance de vie dépasse soixante dix ans, alors que dans ceux où elle reste extrêmement faible, on a bien souvent l'occasion de mourir d'autre chose que d'une exposition à l'amiante... Face à une crise de santé majeure, je ne crois pas que, parmi les experts, Claude Allègre doive forcément être le premier à être cité... Au demeurant, nous n'avons pas à nous substituer à la justice, même si notre travail devrait servir à faciliter le sien, mais c'est un autre sujet... M. le Président : Que nous aborderons à un autre moment. M. Jean-Marie LE GUEN : Mais qui reste en débat. Je ne crois pas que notre séance de ce matin doive être consacrée à l'histoire du comité permanent amiante : si ce sujet mérite d'être traité par notre mission, comme je le crois, il devra l'être complètement et non au détour d'une question de personnes. Et il n'est pas du ressort des parlementaires de chercher des responsabilités ; c'est - éventuellement - l'affaire de la justice. La nôtre est de rechercher les fautes d'organisation et de savoir si les systèmes mis en place dans notre pays sont défaillants sur le plan de l'organisation. À cet égard, le retard de la France en matière d'épidémiologie - sur ce sujet comme sur d'autres - a été unanimement souligné. Rapporteur pour avis du budget de la sécurité sanitaire au nom de la commission des affaires sociales, je ne manquerai pas de parler de l'Institut de veille sanitaire en d'autres occasions, tant il est vrai que nous avons matière à réagir sur la veille sanitaire d'une façon générale et sur l'épidémiologie en particulier, au plan académique comme au plan opérationnel. Ce que vient de dire le professeur Goldberg à propos de l'organisation et de la problématique de l'évaluation et de la gestion des risques me paraît fondamental. Ces structures que l'on crée, ou que l'on laisse se créer, ne peuvent que dysfonctionner, car l'on essaie d'y arbitrer - plutôt dans l'opacité - entre des arguments de nature différente - ici des raisons économiques, là des principes de santé publique -, et entre des acteurs, eux-mêmes prisonniers de leur propre logique : si un industriel peut s'intéresser à la santé de ses salariés, sa préoccupation première reste naturellement de défendre son entreprise, cependant que le salarié se préoccupera évidemment d'abord de l'emploi. Sur cette question de l'amiante, comme sur d'autres sujets touchant à la santé au travail, qu'est-ce qui vous paraît dysfonctionner dans la façon dont on traite cette problématique d'évaluation et de gestion des risques ? Pour ma part, je suis persuadé que l'un des intérêts majeurs de notre mission sera de dégager une vision critique de notre système de protection de la santé au travail. Au-delà des mises en causes personnelles et même de la question de l'amiante, il faut enfin poser ce problème en tant qu'élément stratégique. C'est un aspect que nous avons trop longtemps négligé. Nous découvrons seulement aujourd'hui les dramatiques conséquences de l'amiante pour les finances publiques. Jamais elles n'avaient jusqu'à présent été prises en compte dans les décisions publiques. C'est pourquoi j'aimerais que vous reveniez sur ces problèmes d'organisation, d'évaluation et de gestion du risque. M. Patrick ROY : La France a interdit très tardivement l'amiante. Je pose à nouveau la question. Comment expliquez-vous ce retard ? Il y a forcément des raisons, et vous devez avoir un avis sur la question. M. Daniel PAUL : L'Institut de veille sanitaire (IVS) vient de rendre un rapport sur ces questions. Est-il exact qu'un cancer professionnel sur deux n'est pas pris en charge dans le cadre des maladies professionnelles - autrement dit, que la caisse AT-MP16 se débarrasse de cette question en la mettant sur le dos du régime général ? Et est-il exact, comme semblent l'indiquer les calculs de l'IVS, que cette insuffisance de prise en charge par la caisse AT-MP s'élève à environ 15 milliards d'euros, ce qui correspond au déficit annuel de la caisse du régime général ? Peut-on envisager, comme je l'ai demandé hier dans une question écrite au Premier ministre, que ce rapport, qui éclaire d'un jour un peu plus cru la situation réelle de la santé au travail et ses conséquences financières, soit mis sur la place publique ? M. Gérard BAPT : Un médecin du travail me confiait récemment qu'il était impossible à un centre régional anticancéreux de retracer, à des fins épidémiologiques, le parcours professionnel de bon nombre de patients. Confirmez-vous ces propos ? Croyez-vous, par ailleurs, que nous pourrions nous retrouver dans la même situation avec les éthers de glycol ? M. le Président : Je voudrais préciser que nos travaux reprennent - et ne doivent pas refaire - tout ce qui s'est fait jusque-là, y compris le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Nous ne partons pas de rien. Je remercie à ce propos le professeur Brochard de la justesse de ses explications, y compris sur l'extrême difficulté de la position des scientifiques siégeant au CPA, explications qui complétaient parfaitement l'analyse du professeur Got quant au caractère aberrant de cette structure. Force est de reconnaître que les contradictions ne manquent pas entre l'impératif de santé publique, l'intérêt économique et les préoccupations liées à l'emploi : la position des partenaires sociaux, et particulièrement des organisations syndicales, n'est pas toujours facile. Je retiens également vos remarques sur notre extraordinaire faiblesse dans le domaine de l'épidémiologie : la situation est encore plus grave que je ne le pensais. Mme Ellen IMBERNON : Vous devez faire allusion au rapport de la commission présidée par M. Noël Diricq, magistrat à la Cour des comptes, chargée de calculer tous les deux ou trois ans la part que la branche AT-MP du régime général de la sécurité sociale doit reverser à la branche maladie pour tenir compte du fait que bon nombre de pathologies d'origine professionnelle - qui devraient être prises en compte par la branche AT-MP, gérée et abondée par les employeurs -, sont prises en charge comme des maladies ordinaires par la branche maladie. En fait, la réalité est encore en deçà des chiffres que vous citez, dans la mesure où nous n'avons travaillé que sur les affections « réparables » (cancers, troubles musculo-squelettiques) et répertoriés comme tels dans les tableaux de maladies professionnelles. Le système français de réparation repose sur un ensemble de tableaux répertoriant des maladies et des expositions bien définies, assorti depuis quelques années d'un système complémentaire permettant, grâce à des commissions régionales, de réparer des pathologies jugées d'origine professionnelle par l'intéressé et son médecin, bien qu'elles ne soient pas répertoriées comme telles dans les tableaux. La commission Diricq s'est limitée à quantifier le manque à gagner pour la branche maladie dans le seul cadre des tableaux de maladies professionnelles, parmi lesquelles les cancers, mais également des maladies très invalidantes et très coûteuses. Il est à noter que nous ne disposons pas, en France, d'organismes capables de chiffrer exactement le coût du traitement d'un cancer du poumon. La direction des hôpitaux en est incapable, tout comme la CNAM. Force est de s'en remettre à des estimations de sources diverses. Une telle carence est assez surprenante. Ce rapport est remis au ministre, mais il est également destiné à alimenter le débat parlementaire. À moins que le ministre ne s'en serve pour élaborer ses propositions dans le cadre de la discussion du Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) ... M. Daniel PAUL : À ma connaissance, ce rapport a déjà été remis au ministre, mais il n'est pas rendu public. M. Jean-Marie LE GUEN : Il n'est pas inclus dans le rapport de la Cour des comptes sur la sécurité sociale. M. le Président : Nous vérifierons cela. Mme Ellen IMBERNON : Au demeurant, les éléments communiqués par l'Institut de veille sanitaire peuvent très bien faire l'objet d'une publication spécifique, comme cela a été fait en 2003. M. le Président : « La réalité est encore en deçà », avez-vous déclaré. Qu'est-ce à dire ? Mme Ellen IMBERNON : Que la sous-réparation dépasse largement la moitié des cas. M. le Président : C'est bien ce que j'avais compris... Mme Ellen IMBERNON : Mettre l'accent sur la dimension économique du problème est également un moyen de faire avancer la question. On savait depuis longtemps que l'amiante était un facteur de risque de cancer ; mais c'est seulement à partir du moment où l'on parvient à quantifier les cancers liés à l'amiante et leur coût que l'on met des mesures efficaces en place. Le système français de médecine du travail prête également à interrogations, notamment le fait que le médecin du travail est plus ou moins directement rémunéré par les employeurs, bien qu'il jouisse d'une indépendance statutaire dans la mesure où il ne peut être licencié qu'avec l'accord du comité d'entreprise. Le fait qu'il ne soit que conseiller de l'employeur et des salariés pose également question. L'idée avait été émise de mutualiser les cotisations des employeurs pour les redistribuer par le biais d'un organisme auquel le médecin serait moins directement lié. Cette proposition n'a pas encore été suivie d'effets, non plus que celle d'une organisation régionale, mais ces pistes sont à explorer si l'on veut améliorer le fonctionnement de la médecine du travail. Il faut également prendre conscience que les médecins du travail pourraient participer d'une façon plus effective à l'amélioration de la connaissance de la santé des populations au travail, en mettant en commun des informations qu'ils recueillent quotidiennement sur le terrain. Or ce n'est pas le cas aujourd'hui : un médecin du travail fait des études médicales, surveille l'entreprise, contrôle les postes de travail, mais rien ne sort de l'entreprise. Il n'existe aucune traçabilité des expositions auxquelles les salariés ont été soumis : la seule façon de reconstituer ces expositions reste de les interroger. L'idée d'un « carnet des expositions », conservé par le salarié, avait recueilli l'assentiment de certains syndicats ; mais d'autres s'y étaient opposés, craignant que cela ne vienne contrarier des possibilités d'emploi futur. Enfin, un professionnel de la santé publique doit, me semble-t-il, se placer du point de vue de la santé publique. L'intégration ultérieure de considérations liées à l'économie ou à l'emploi relève de choix sociaux qui ne sont pas de notre ressort. À cet égard, la question peut parfois se poser de sacrifier la santé, et c'est à l'issue du débat social que les choix doivent être faits. M. Patrick BROCHARD : Premièrement, la notion d'expertise scientifique fait effectivement partie des enseignements importants de ce dossier. Il est clair qu'il n'y a eu aucune expertise correcte avant 1996 dans le domaine de l'amiante. Il faut savoir gré à l'INSERM d'avoir su organiser les expertises collectives, qui ont permis une connaissance aussi détaillée que possible, et indépendante des partenaires ordinairement associés au champ santé/travail, autrement dit des pouvoirs publics, comme des partenaires sociaux. Un des dysfonctionnements que l'on peut analyser a posteriori tient justement à l'absence d'expertise collective jusqu'en 1996. Cela dit, si une démarche a été initiée, il est important de la poursuivre : ainsi en est-il du dossier des éthers de glycol cités tout à l'heure, et d'autres problèmes encore, qui touchent au champ santé/travail et ne sont pas encore résolus. Certaines fibres sont susceptibles d'entraîner les mêmes pathologies que l'amiante : une expertise collective a également été menée en 1998-1999 sur les fibres de substitution. Cette méthode est indispensable si l'on veut porter à la connaissance des pouvoirs publics les informations adéquates. À eux, ensuite, de prendre les décisions ad hoc. Deuxièmement, je veux appuyer les propos d'Ellen Imbernon. Nous sommes plusieurs ici à être professeurs de médecine du travail, et donc bien placés pour apprécier les efforts déployés par les médecins du travail sur le terrain. Mais si leurs efforts individuels sont depuis longtemps reconnus - encore qu'il y ait toujours des choses à améliorer -, je ne peux que reconnaître avec elle une carence de l'effort collectif, surtout en matière de collecte et de traitement de l'information collective. Pourquoi ce décalage des médecins du travail par rapport au problème de l'amiante ? Parce qu'il n'existait pas en France, en tout cas jusqu'à la mise en place du département santé/travail, de remontée systématique des informations du terrain. C'est là un deuxième enseignement très fort, et j'espère que vous saurez nous apporter votre appui sur ce point. M. le Président : C'était un de nos objectifs... M. Patrick BROCHARD : Troisième élément sur lequel je veux insister encore : il suffit de comparer les textes réglementaires adoptés en France avec ceux dont s'étaient dotés, à l'époque, les autres pays pour s'apercevoir que la réglementation de 1977 était très intéressante. Malheureusement, et il y a eu là une carence manifeste, ces textes n'ont pas été appliqués. La France ne compte pas suffisamment de personnels capables de mener les contrôles qui s'imposent. Les inspecteurs du travail notamment - il y a eu récemment des débats sur l'inspection du travail - ne sont pas en mesure de vérifier si les textes sont appliqués ou non. M. le Président : Assurément, nos précédentes auditions ont permis de le vérifier. M. Patrick BROCHARD : Cette fonction de contrôle est totalement défaillante. Et si les informations ne remontent pas au niveau des décideurs, je ne vois pas comment ils pourront s'apercevoir rapidement d'un dysfonctionnement. Cette situation n'est pas spécifique à l'amiante et vaut malheureusement pour nombre d'autres domaines ; si vos travaux permettaient de déboucher sur une solution, nous aurions fait un gros pas. M. le Président : Ils déboucheront, car nous avons déjà largement travaillé sur ce sujet dans la première partie de nos auditions. M. Michel FOURNIER : Il y a tout de même des choses qui ne vont pas si mal... M. le Président : Nous vous écoutons ! M. Michel FOURNIER : On pourrait croire que tout est en train de s'écrouler strate par strate... Heureusement non ! Plusieurs d'entre nous ont apporté leur aide à certains ministères qui se lancent dans le recensement du bâti amianté sous l'égide de la fonction publique. Une enquête transversale de grande envergure a été lancée par les pouvoirs publics, qui a mobilisé des moyens non négligeables. Les résultats devraient être disponibles à la fin de l'année. Plusieurs ministères avaient précédé le mouvement en visant deux objectifs qu'il fallait évidemment rapprocher : premièrement, le recensement quantitatif et qualitatif du bâti amianté Évidemment, personne ne s'attend à des résultats précis à la décimale près, qu'il s'agisse des bâtiments - surtout s'ils ont disparu - ou des trajectoires des personnels, d'autant que sont concernées la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale. Au moins cette opération aura-t-elle le mérite de révéler la dimension, l'ordre de grandeur des problèmes qui se posent. Pour approximative qu'elle soit, en espérant qu'elle le soit le moins possible, l'information recueillie n'en sera pas moins de valeur. Il faut donc saluer et soutenir ce genre d'initiatives. Le problème se pose également pour les médecins. Quelle connaissance ont-ils du risque amiante ? Vous-mêmes avez posé la question. Force est de reconnaître certains progrès tangibles : ainsi les généralistes, en particulier ceux qui ont commencé à travailler dans les dix dernières années, ont désormais une connaissance réelle des risques de l'amiante. Probablement seront-ils alertés par certaines lectures d'examens radiologiques ou par certaines maladies et auront-ils le réflexe de susciter une déclaration, par exemple. Sans aller jusqu'à demander un examen spécifique, ils seront déjà au moins un peu alertés. Malheureusement, la médecine générale n'a pas beaucoup avancé, me semble-t-il, dans la connaissance des postes de travail, des métiers et des emplois qui exposent au risque considéré. Autrement dit, en schématisant un peu : connaissance générale du risque et des maladies associées, oui ; connaissance des emplois qui y exposent, non. Cela rejoint un peu le problème de l'enseignement de santé au travail et de sa diffusion parmi les généralistes, qui peuvent être un relais. M. Marcel GOLDBERG : Tout ce qui vient d'être dit est parfaitement pertinent. Les moyens de concevoir un système de santé au travail plus performant - objectif clairement réaliste - sont divers et variés. Sans entrer dans le détail des pistes à explorer, quelques grands principes devraient être posés, à commencer par la séparation nette et formalisée de l'évaluation et de la gestion des risques. L'évaluation des risques doit impérativement être indépendante des acteurs concernés. Ainsi, les membres du comité scientifique européen chargé de faire les recommandations pour les valeurs limites d'exposition au niveau de l'Union européenne - le SCOEL17 - sont exclusivement des scientifiques. Il n'y a aucune interférence avec les industriels ni avec les États pendant le travail d'expertise. Une fois notre travail achevé, un comité tripartite se réunit qui, sur la base de notre expertise, prendra des décisions pour tenir compte des contraintes économiques, de la protection des travailleurs, des problèmes de réglementation, etc. Mais nous ne nous voyons jamais ; en six ans, je n'ai jamais rencontré ces personnes, je ne sais même pas où ils siègent. Nous sommes totalement indépendants. L'expertise scientifique n'est jamais remise en cause. Ce n'est absolument pas le cas en France, où les textes confient l'expertise scientifique à ceux qui sont les premiers concernés ! Autant avons-nous su tirer les conséquences, me semble-t-il, des grandes crises sanitaires dans le domaine des maladies infectieuses ou des médicaments en mettant en place des dispositifs qui respectent ce principe, autant s'est-on refusé à y toucher dans le domaine de la santé au travail. Et cela se vérifie aussi bien au niveau de l'expertise qu'à celui des financements, eux aussi gérés par les partenaires sociaux, ou du terrain, c'est-à-dire de la médecine du travail, dans la mesure où le médecin du travail - Ellen Imbernon l'a dit -, est l'employé direct ou indirect de l'employeur. Tout cela transparaît dans la faiblesse extrême des moyens que l'État consacre à ce secteur. Beaucoup d'argent va dans notre système de santé au travail ; mais la quasi-totalité de ces ressources est gérée par ceux-là mêmes qui sont concernés par le problème et qui, dès lors, ne peuvent avoir un jugement et une action indépendants des objectifs de leurs mandants. Un représentant syndical qui siège dans une instance paritaire vient avec un mandat, tout comme le représentant des employeurs, et c'est parfaitement normal. La plupart du temps, il sait ce qu'il va voter avant que le débat n'ait commencé, avant même que l'expert n'ait parlé. On peut envisager bien des solutions - mutualiser ou non, centre régional ou non, etc. -, mais s'agissant des grands principes, le premier d'entre eux devrait être de séparer évaluation et gestion et de donner une véritable indépendance à ceux qui ont à s'occuper de la santé. Un exemple intéressant pour terminer : le ministère du travail a souhaité que se développent des études épidémiologiques sur les fibres de substitution à l'amiante - si elles sont aussi dangereuses, ce n'est pas la peine de substituer... Un réel effort a été engagé dans cette direction depuis quelques années. L'INRS a été chargé de mettre en place une étude épidémiologique et de réaliser des explorations fonctionnelles respiratoires chez les travailleurs exposés aux fibres de substitution à l'amiante. Après un ou deux ans, vingt ou trente réunions et des milliers d'heures de travail, les épidémiologistes de l'INRS n'ont pas pu commencer leur étude, car la totalité des employeurs concernés ont refusé leur concours, bien que l'INRS puisse se prévaloir à leurs yeux d'une certaine légitimité ! Tout est donc stoppé. Le ministère du travail avait mis l'argent sur la table, et la compétence de l'équipe est incontestable. Malheureusement, on aura dépensé une somme d'énergie faramineuse pour rien, pas un employeur n'ayant accepté que l'étude épidémiologique se fasse chez lui. Or il n'y a aucun moyen de l'y obliger. M. le Président : J'ai presque envie de conclure sur cette intervention, parfaitement construite, claire, cohérente et déterminante pour la suite de nos travaux : ce constat doit nous servir de fil rouge pour les semaines à venir. M. Daniel PAUL : Je veux remarquer la très grande précision, mais également la retenue dont ont su faire preuve tant le professeur Goldberg que ses collègues. À travers ces questions difficiles de confusion et de choix, nous touchons au nœud du problème. Si nous ne réussissons pas à remplacer des produits dangereux et reconnus comme tels pour la santé des salariés par des substances à moindre risque, nous faillirons à l'évidence. Et je ne vois pas comment on pourrait imposer dans notre pays un no man's land, des lieux interdits à la réglementation, à la santé publique. Cela ne saurait s'arrêter en tout cas à la porte des entreprises - pas plus dans un sens que dans l'autre. M. le Président : Madame, messieurs, je vous remercie d'avoir répondu non seulement à nos questions, mais à nos attentes. Nous n'en serons que plus assurés dans notre démarche. Votre appel à la séparation entre l'évaluation et la gestion des risques notamment nous apparaît tout à fait déterminant. Audition de M. Claude GOT, président du collège scientifique de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), auteur du rapport de 1997 sur la gestion du risque et des problèmes de santé publique posés par l'amiante en France Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Mes chers collègues, nous recevons aujourd'hui le professeur Claude Got, qui vient devant notre mission pour la seconde fois, puisqu'il faisait partie, mercredi 14 septembre dernier, de la table ronde publique organisée sur les aspects scientifiques du problème de l'amiante. Monsieur le professeur, vous êtes l'auteur du rapport de 1997 sur « la gestion du risque et des problèmes de santé publique posés par l'amiante en France ». Ce rapport vous avait été commandé par Martine Aubry et Bernard Kouchner qui étaient respectivement, à l'époque, ministre de l'emploi et de la solidarité et ministre de la santé. Vous avez d'ailleurs souligné la semaine dernière que cette étude, qui devait initialement être conduite en trois mois, vous avait demandé dix-huit mois de travail. C'est dire la complexité du problème ! Si nous vous avons demandé de revenir devant nous - et je vous remercie de votre disponibilité -, c'est donc parce que vous connaissez très bien la problématique de l'amiante, tout particulièrement du point de vue qui nous intéresse maintenant : celui des mécanismes de la prévention des risques et des liens entre la connaissance des risques et la décision politique. Nous abordons en effet aujourd'hui le deuxième thème d'investigation de notre mission, après avoir traité la gestion de l'amiante dit « résiduel ». Il s'agit de comprendre pourquoi le drame de l'amiante n'a pas pu être évité et, au-delà de ce drame, d'étudier les mécanismes actuels de prévention afin de les améliorer. M. Claude GOT : M. le Président, mesdames, messieurs les députés, je souhaite, avant d'en venir au problème particulier de l'amiante, traiter de la question plus générale de la gestion du risque sanitaire par l'État. En 1970, un médecin de Renault a demandé au service d'anatomie pathologique que je dirigeais à Garches de l'aider à améliorer les ceintures de sécurité. Nous avons procédé à des études épidémiologiques. En tant que pathologiste, j'ai procédé à des autopsies d'accidentés de la route. Nous avons ainsi collaboré à toute une série de recherches biomécaniques qui nous ont permis d'établir, par exemple, que le port de la ceinture divisait par 2,4 la mortalité des occupants d'un véhicule. Les conclusions de cette étude ont coïncidé avec une période où le Gouvernement s'interrogeait sur les mesures à prendre en matière de sécurité routière. Le nombre de morts avait augmenté de manière inquiétante, passant en quelques années de 10 000 à 17 000. Un comité interministériel de la sécurité routière avait été créé, rattaché aux services du Premier ministre. Le délégué interministériel avait consulté notre service. Nous avions préconisé un certain nombre de mesures simples et efficaces, en particulier l'obligation du port de la ceinture et la limitation de la vitesse. Avec une rapidité incroyable, l'accord du Premier ministre d'alors, M. Pierre Messmer, a été obtenu et les textes réglementaires ont été publiés. Je précise que sur ce dossier un délégué interministériel placé auprès du Premier ministre avait été désigné pour coordonner l'action qui dépendait de plusieurs ministères. D'un mois sur l'autre, la courbe des morts a commencé à descendre. En six mois, il y a avait déjà 2 000 morts de moins, et 4 000 morts de moins l'année suivante. On avait ainsi la preuve que des mesures simples et peu coûteuses pouvaient être extrêmement efficaces. C'est depuis cette époque que je m'intéresse à la question du passage d'une connaissance scientifique à une décision politico-administrative dans le but d'éviter les morts prématurées. Dans ce domaine, où ce qui importe le plus n'est pas tant le nombre de morts que le nombre d'années de vie perdues, les trois problèmes essentiels sont les accidents de la route, l'alcool et le tabac. On en voit d'ailleurs poindre un quatrième, l'obésité qui va affecter l'espérance de vie de la population. Et je précise que l'objectif est non pas de lutter contre les « gros » ou les « alcooliques » mais de lutter contre l'obésité et l'alcoolisme. Dans tous ces dossiers, la responsabilité de l'État est de s'attaquer aux facteurs de risque, au lieu de renvoyer au libre déterminisme. Car si l'on poussait la logique du libre déterminisme jusqu'au bout, on ferait du darwinisme social et il faudrait mettre l'héroïne et le crack en vente libre. La difficulté majeure est donc, dans chaque cas, de trouver le juste compromis entre le respect de la liberté individuelle et les exigences de la solidarité, dont le sens ultime est la fraternité. L'expérience des trente dernières années a montré que les erreurs commises ne sont pas dues à des risques nouveaux, au sujet desquels les connaissances ne seraient pas disponibles. Les échecs peuvent être dus à une certaine timidité dans la confrontation avec des intérêts, confrontation qu'exigent le plus souvent les politiques de prévention. Ils peuvent aussi être la conséquence d'une application insuffisamment rigoureuse des mesures qui ont été décidées, comme en témoigne l'échec relatif de la loi Evin, du moins dans son volet « alcool » et son volet « protection des non-fumeurs ». La défaillance des dispositifs d'évaluation est également en cause. Les moyens affectés, notamment, aux études épidémiologiques sont notoirement insuffisants en France. Alors que c'est en France qu'ont été inventés les outils statistiques - c'est l'analyse de la surmortalité dans les quartiers de Paris qui a permis de mettre en place les premières classifications internationales des maladies -, la grande tradition clinique française a toujours marqué les plus vives réticences à l'utilisation de ces outils statistiques. L'un des derniers exemples qui en témoignent est la réaction de certains à « l'amendement Accoyer » proposant d'évaluer la pratique des psychologues et psychanalystes. De manière générale, notre pays éprouve les plus grandes difficultés à évaluer les politiques publiques. Et j'irai plus loin, il y a une différence entre évaluer et gérer, entre avoir des connaissances et avoir une capacité de gestion. Chaque tentative de progresser sur ce point s'est soldée par un échec et d'ailleurs, je le répète, on vient de supprimer le Conseil supérieur de l'évaluation. M. le Rapporteur : S'agissant de l'amiante, quels seraient vos conseils ? Les outils d'évaluation et de gestion du risque vous paraissent-ils suffisants ? M. Claude GOT : Mes recommandations sont celles que je faisais en 1998 et 1999. Ce qui n'a pas encore été fait à cette époque doit être fait. Je pense que le dépistage systématique n'a aucun intérêt, aucune efficacité, et même qu'il est pervers. Je le dis plus brutalement que lors de la table ronde du 14 septembre dernier. Les espoirs de guérison sont actuellement faibles. Ce n'est pas rendre service aux gens que de les exposer à l'anxiété du dépistage régulier. On compense les erreurs du passé en donnant l'impression qu'on s'intéresse aux victimes. La création du FIVA a été une bonne chose. Mais l'atmosphère qui règne au conseil d'administration est désagréable. Il y a d'un côté les payeurs - les représentants des entreprises et de la sécurité sociale - et de l'autre, les associations et les syndicats. Le directeur a quitté ses fonctions, peut-être par lassitude. J'ai moi-même failli refuser d'être reconduit comme membre du conseil d'administration en tant que personnalité qualifiée, parce qu'il est très pénible d'entendre des affirmations fausses. Les conflits de personnes et les agressions verbales ne sont pas de bonnes façons pour régler des problèmes difficiles. J'ajoute que j'avais préconisé la création d'un organisme unique dont la vocation aurait été, en général, de réparer les fautes commises par l'État. Créer, pour chaque problème, un fonds spécifique, avec des règles différentes, ne me paraissait pas une bonne solution. Je n'ai pas été suivi au motif que, s'agissant d'une responsabilité dans laquelle sont impliqués les employeurs, à côté de l'État, le financement équitable du fonds unique d'indemnisation poserait des problèmes. Il me semble, par ailleurs, que l'on n'a pas organisé correctement la surveillance du diagnostic amiante. L'évaluation du désamiantage a été mieux faite que celle du diagnostic, alors qu'une bonne évaluation des entreprises de diagnostic s'imposait tout autant, comme en témoigne le cas de la Tour Montparnasse où l'on a obtenu des résultats différents selon les entreprises. Il aurait fallu, par exemple, tirer au sort une liste d'immeubles diagnostiqués par une entreprise donnée, et contrôler la qualité de ses diagnostics. Enfin, mon grand regret est de ne pas avoir convaincu les décideurs administratifs et politiques de la nécessité de mettre les diagnostics à disposition de tous, des habitants comme des entreprises qui sont amenées à intervenir. Car quand un client demande un devis pour des travaux, il est difficile pour l'entreprise de demander le diagnostic amiante. Si elle est trop curieuse, elle n'aura pas le marché. Il faudrait donc qu'elle ait accès aux renseignements sans avoir besoin de les demander. Il eût été très simple d'utiliser l'outil informatique existant, celui qui est utilisé par l'administration fiscale pour la taxe foncière et la taxe d'habitation. Il suffisait d'intégrer aux fichiers les données relatives au diagnostic amiante. Cela ne s'est pas fait. Certains prétendent que la CNIL s'y serait opposée et il est vrai qu'elle n'aime pas que les fichiers soient affectés à d'autres usages que ceux pour lesquels ils ont été autorisés. Il me semble pourtant que l'argument est bien léger car la CNIL a été créée par le Parlement et il appartient à celui-ci d'apprécier ce qui relève de la sécurité sanitaire pour en tirer les conséquences sur l'extension de l'usage d'un fichier. M. Jean-Marie LE GUEN : Monsieur le professeur Got, votre engagement dans les problèmes de santé publique est connu de tous. Je voudrais vous poser une question très simple : qu'attendez-vous de notre mission d'information ? M. Claude GOT : J'attends qu'elle permette de tirer les enseignements des erreurs qui ont été faites. Les victimes ne veulent pas la vengeance mais la prévention. Pour que les choses ne se reproduisent pas, il serait bon, d'abord, de connaître dans le détail l'histoire de la gestion du dossier amiante par l'administration. Pour cela, il faudrait faire réémerger tous les textes produits par l'administration sur ce dossier. Le rapport rédigé par Mme Prada-Bordenave, Commissaire du Gouvernement, à l'occasion de l'examen par le Conseil d'État du recours contre la décision de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 octobre 2001 est très éclairant à cet égard. Il faut ensuite en tirer les conséquences et dire, par exemple, que les moyens consacrés à l'épidémiologie doivent être accrus et que le registre des cancers exhaustif et complet soit enfin établi. Il y a une directive européenne imposant un registre de mésothéliomes : il n'existait pas encore quand j'ai fait le rapport de 1998, avec les renseignements utiles, notamment les formes de l'exposition. M. le Président : Quels sont selon vous les enseignements du texte de Mme Prada-Bordenave dans l'affaire du Conseil d'État ? M. Claude GOT : Elle explique de manière lumineuse les responsabilités de l'État. Elle montre qu'il n'a pas cherché à faire le point sur les connaissances, ni à documenter l'application de sa réglementation en demandant des vérifications sur le terrain. Cela rejoint ce qui s'est passé dans l'affaire du sang contaminé. Le directeur général de la santé, le professeur Jacques Roux, avait été condamné pour ne s'être pas assuré de l'application de la réglementation qu'il avait édictée, notamment à l'occasion de la circulaire sur la sélection des donneurs de sang dans les centres de transfusion. Elle était parfaite mais il ne s'était pas donné les moyens d'évaluer son application sur le terrain. Dans le domaine de la sécurité routière, nous sommes confrontés au même problème. L'État ne cherche pas à savoir quels sont les risques différentiels selon la vitesse des véhicules. Il est inacceptable que, en France, pays civilisé, où l'on est capable de produire plus d'une centaine de pages sur la sécurité routière, il n'y ait pas une ligne sur cette question. M. Daniel PAUL : Vous avez dit que les victimes ne voulaient pas la vengeance mais la prévention. Je partage ce souci. L'effort de connaissance qui aurait dû être fait ne doit-il pas l'être au sujet d'autres produits, afin d'éviter de répéter les mêmes erreurs ? M. Claude GOT : Oui. C'est le principe de la pédagogie par l'erreur. La proposition d'interdire l'amiante est apparue très tardivement. Pendant très longtemps, on a cru à ce que les Québécois appellent « la gestion sécuritaire de l'amiante » parce que l'amiante était un produit très intéressant dont on ne voulait pas se passer. La remise en cause de l'amiante a été tardive parce que les risques étaient sous-évalués, ainsi que les solutions de remplacement. On a posé les mauvaises questions et aux mauvaises personnes. On a demandé au Comité permanent amiante (CPA) de gérer le dossier, mais on n'a pas procédé à suffisamment d'expertises industrielles pour savoir à quel moment il aurait été possible, par exemple, de fabriquer des plaquettes de frein sans amiante. L'un des grands enseignements du dossier amiante est qu'il faut développer les études de manière transversale. Ce n'est pas aux médecins spécialistes d'un sujet donné qu'il faut demander de s'occuper de tous les aspects de la prévention. En matière de sécurité routière, mes collègues qui soignent les accidentés n'ont aucune connaissance en accidentologie et disent n'importe quoi. Il faut donc croiser les expertises. M. le Président : Dans la sidérurgie, le grand risque a été pendant longtemps celui des brûlures. On a justifié l'usage d'un produit dangereux parce qu'on n'avait pas trouvé un produit de substitution. À cet égard, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots l'histoire des frères Blandin ? M. Claude GOT : Dans les années 70, les frères Blandin avaient mis au point un flocage inerte à base de « laine de laitier », après avoir pris conscience des dangers de l'amiante. Le point de fusion était proche de celui de l'amiante et les fibres, plus grosses que les fibres d'amiante, ne pouvaient pas pénétrer les poumons. On n'avait donc pas besoin pour ces fibres du recul épidémiologique sur les risques à long terme, comme pour les autres fibres de substitution. Il suffirait de se fonder sur les critères de dimension des fibres susceptibles de pénétrer les poumons. Mais leur procédé était plus coûteux que l'amiante du fait du choc pétrolier. Mis en concurrence, ils ont été finalement rachetés et ceux qui ont repris l'affaire n'ont pas continué cette production. La méthode la moins coûteuse a prévalu. M. le Rapporteur : Pensez-vous que les Québécois vont maintenir leur position actuelle sur l'usage de l'amiante ? M. Claude GOT : Oui. Au demeurant, beaucoup de pays n'ont toujours pas interdit l'amiante. Toute l'Amérique du Sud, tout le Sud-est asiatique, le Japon et même les États-unis. L'agence américaine de l'environnement a échoué dans sa tentative d'interdire l'amiante face au juge. Par contre, les États-unis ont interdit les usages les plus dangereux. L'industrie continue à fabriquer du fibrociment qui n'est pas dangereux tant qu'on ne le brise pas. La « gestion sécuritaire de l'amiante » en Amérique du Nord consiste aussi souvent à expédier de l'amiante pour qu'il soit manufacturé dans des pays où la sécurité au travail n'est pas aussi rigoureuse. M. le Président : Les préoccupations relatives à l'emploi ont été souvent invoquées, notamment au CPA. Elles font d'ailleurs partie du rapport bénéfices/risques dont vous avez parlé. M. Claude GOT : Elles l'ont été, en effet, y compris par des syndicalistes. Les dés ont été pipés. Je pense que l'industrie n'a pas été sincère sur la question des possibilités de mettre au point des produits de substitution. On peut se demander si les industriels ont défendu l'amiante par habitude et en raison des qualités du produit, ou s'ils ont consciemment décidé d'accepter les risques en considérant que le risque est inhérent à la vie industrielle. On peut d'autant plus se poser la question quand on sait que les réglementations de 1977 n'ont pas été appliquées, comme ont pu me l'indiquer les ouvriers de l'amiante de Condé-sur-Noireau. En tout état de cause, le problème n'était pas un défaut de connaissances. Quand on est habitué à un risque, on le considère consciemment ou inconsciemment comme acceptable, sans avoir la volonté de diffuser les connaissances qu'on a dans le but de faire en sorte qu'il devienne inacceptable. On constate le même phénomène en matière de sécurité routière puisqu'on n'arrive pas à obtenir la limitation de la vitesse à la construction malgré tout ce que l'on sait des risques liés à la vitesse. La France devrait avoir le courage d'agir unilatéralement dans ce domaine. On ne sait pas documenter le présent pour prévenir l'avenir. Il est vrai que l'accélération de la production de produits nouveaux dans tous les domaines met les experts en grande difficulté. M. Jean-Marie LE GUEN : À ce sujet, je voudrais insister sur le fait que l'épidémiologie n'est pas seulement utile pour la gestion du risque long. Elle l'est aussi pour le risque court. Si nous avions de très bons réseaux épidémiologiques, nous pourrions gérer les épidémies de grippe de manière beaucoup plus efficace. M. le Président : Monsieur le professeur Got, nous vous remercions de votre contribution aux travaux de notre mission d'information. Audition de M. Dominique MOYEN, ingénieur général du corps national des Mines, ancien directeur général de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), co-fondateur du Comité permanent amiante dans les années 80 Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Mes chers collègues, nous recevons aujourd'hui M. Dominique Moyen, qui est ingénieur des mines et qui a été longtemps le directeur général de l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité des accidents et maladies du travail, organisme dépendant de la CNAMTS, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Il fut aussi, en 1984, cofondateur du Comité permanent amiante (CPA), avec Marcel Valtat, aujourd'hui disparu. Je vous remercie de vous être rendu disponible pour cette audition dont l'objet, comme il vous a été indiqué, est d'éclairer la mission sur la gestion de l'amiante en France dans les années 80 et sur la prévention des risques professionnels en général. Je souhaite insister devant vous sur le fait que notre mission a une vision prospective du problème de l'amiante - et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons souhaité commencer nos travaux par l'examen de la gestion de l'amiante dit « résiduel ». Mais nous ne pouvions envisager d'étudier le problème de l'amélioration de la prévention des risques professionnels - qui est notre deuxième thème d'investigation - sans essayer de comprendre pourquoi le drame de l'amiante n'a pu être évité. Il s'agit en effet de tirer des leçons de ce drame pour évaluer les mécanismes actuels de prévention et voir comment les améliorer. Votre audition est donc au cœur du retour d'expérience qu'il nous faut exploiter pour réfléchir à l'amélioration de la gestion collective des risques, et notamment du lien entre l'évaluation des risques et la gestion du risque. M. Dominique MOYEN : M. le Président, mesdames, messieurs les députés, je suis entré à l'INRS en 1975, après avoir été conseiller technique auprès du ministre de l'environnement, puis directeur de la prévention des pollutions et des nuisances. L'INRS est une association régie par la loi de 1901, dont le conseil d'administration est composé paritairement de représentants des organisations syndicales et patronales. Il est financé par la CNAMTS. En matière de politique de prévention, deux « filières » fonctionnaient sans réelle coordination, d'un côté, la Direction des relations du travail (DRT), le Conseil supérieur des risques professionnels, les directions régionales, les entreprises et leurs médecins du travail, leur texte de référence étant le code du travail, assorti de sanctions pénales, et, de l'autre côté, la CNAMTS, les caisses régionales et leurs services de prévention, leur texte de référence étant le code de la sécurité sociale, assorti de sanctions financières. Je précise que l'autorité de tutelle de l'INRS est la CNAMTS. Je m'employais à établir des relations avec la DRT, ce qui n'était pas facile. La position de l'INRS était délicate et la dualité des deux filières de prévention sans interférences était catastrophique pour la prévention. Je m'efforçais d'être l'intermédiaire entre ces deux mondes qui s'ignoraient. À l'époque, l'INRS avait quatre missions : une mission d'étude et de recherche ; une mission d'assistance à tous ceux que la prévention intéressait ; une mission d'information directe et de publication ; une mission de formation. Nous avions une publication plus particulièrement destinée aux médecins du travail, éditée chaque mois. En 1975, la prévention des risques était essentiellement organisée autour de la recherche de solutions à des problèmes techniques, mécaniques et chimiques. J'ai tenté d'introduire la notion de « risque organisationnel », selon laquelle les risques ne sont pas seulement liés à la nature d'un produit ou d'une technique, mais aussi à la façon d'organiser le travail. Je rappelle que l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) venait à peine d'être créée. Du point de vue de la médecine, la notion phare était celle de valeur limite d'exposition (VLE). Ainsi, la prévention des maladies professionnelles en URSS était fondée sur une liste de quelque deux cents VLE. L'INRS procédait en particulier à des expériences sur des animaux pour contribuer à définir ces valeurs. Il était aussi chargé de définir les méthodes de mesures de ces valeurs. Il contribuait enfin à l'information sur ces données. L'INRS était aussi chargé d'émettre un avis sur l'application des directives européennes concernant le contrôle des machines dangereuses. Son avis était pris en compte par la DRT. Il était également chargé de procéder à des analyses toxicologiques des nouveaux produits mis sur le marché, pour le compte du ministère du travail. Au cours des années 80, le décor a sensiblement changé. La prévention a intégré la notion de risque organisationnel. Pour ce qui est des maladies professionnelles, nous avons tenté de compléter la formation et l'information des médecins du travail, ce qui a suscité l'étonnement de certaines personnes qui estimaient que ce n'était pas notre rôle. Notre travail, je le répète, était centré autour de la définition de valeurs limites d'exposition. Nous n'étions pas en mesure de procéder à des études épidémiologiques, ce qui d'ailleurs ne nous était pas demandé. Nous participions aussi aux réunions du Conseil supérieur des risques professionnels qui se réunissait deux fois par an. Dans ce contexte, les maladies professionnelles classiques étaient relativement bien cernées. Par contre, on a vu apparaître des maladies « à retard », qui se manifestent après la fin de la vie professionnelle d'une personne. Un exemple hélas bien connu est la silicose. On s'est également rendu compte que certaines maladies étaient en partie professionnelles et en partie domestiques. Sur ce point, la sécurité sociale ne s'est pas mobilisée pour mettre au point des moyens d'expertise nouveaux, du moins pas via l'INRS. S'agissant de l'amiante, le premier cas de maladie professionnelle liée à l'inhalation de l'amiante a été identifié en 1906. Par ailleurs, entre 150 et 200 publications de l'INRS sont consacrées à l'amiante. Je précise ce point parce qu'il m'est arrivé de lire ici ou là que l'INRS avait complètement ignoré ce sujet, ce qui est faux et calomnieux. En 1984 s'est tenu à Paris un congrès, que j'ai présidé, à la demande des représentants des organisations syndicales et patronales. J'ai conclu ce congrès en souhaitant que les réunions consacrées à l'amiante soient plus régulières parce que cette journée avait été très intéressante. M. Valtat m'a ensuite demandé si j'étais d'accord pour que l'INRS participe à la création d'un Comité permanent. J'ai bien sûr donné mon accord et désigné un représentant de l'INRS à ce groupe. La participation au Comité amiante ne faisait pas partie des fonctions de l'INRS, mais j'ai régulièrement rendu compte à son conseil d'administration des travaux du CPA. On a dit que j'étais « vendu, naïf, manipulé ».Ce n'est pas agréable à entendre mais cela n'appelle pas de commentaire de ma part. De même, le Comité amiante mérite-t-il les critiques qui lui sont adressées aujourd'hui ? Je ne pense pas qu'il ait été inutile. Le décret du 17 août 1977 avait fixé à deux fibres par millilitre d'air la valeur limite de la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée pendant sa journée de travail par un salarié effectuant des travaux susceptibles d'être à l'origine d'émissions de fibres d'amiante. Grâce au CPA, cette valeur limite est passée à une fibre par millilitre, puis à 0,5 fibre - on ne peut pas aller plus loin. Ensuite, le Comité s'est principalement consacré à la question du désamiantage et du déflocage. On peut dire que les publications comportaient des ambiguïtés, ce dont nous sommes tous coupables. Mais, en 1978, le flocage amianté a été interdit. En 1988, toutes les variétés de l'amiante ont été interdites, à l'exception du chrysotile, classé comme non dangereux par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). En 1997, la France a interdit l'amiante. Elle a été le septième pays de l'Union européenne à prononcer cette interdiction et beaucoup d'autres pays continuent à utiliser l'amiante. S'agissant des valeurs limites, on ne savait pas que les deux maladies liées à l'amiante, le mésothéliome et le cancer bronchique, étaient distinctes en ceci que l'une est une maladie à risque stochastique - elle peut être causée par une seule inhalation - alors que l'autre ne peut être provoquée qu'à partir de l'inhalation d'une certaine dose d'amiante. La référence à la notion de valeur limite n'était donc pas illogique à l'époque, même si elle s'est révélée fausse par la suite. Les médecins qui siégeaient au Conseil supérieur des maladies professionnelles appliquaient l'adage en vigueur pour les produits radioactifs : il faut descendre à des niveaux d'exposition aussi bas que possible. L'idée d'interdire l'amiante n'était proposée par personne. C'est une pratique qui était inconnue à l'époque. Je n'ai pas connaissance d'un produit qui ait été interdit sur les lieux de travail. Aurais-je pu faire progresser l'idée d'une interdiction ? C'est une question qui me hante aujourd'hui. Je pense que si j'avais proposé l'interdiction, je n'aurais probablement pas été suivi, car cette idée n'était pas dans l'air du temps. Par ailleurs, je n'avais pas la possibilité de prouver que cette mesure était nécessaire. Peut-être aurais-je dû suggérer, à la fin d'un congrès, qu'on pouvait se passer de l'amiante. Je ne l'ai pas fait. M. le Président : Avant de donner la parole à M. le Rapporteur, je tiens à souligner que j'apprécie la grande honnêteté dont vous avez fait preuve dans vos propos. M. le Rapporteur : J'ai moi aussi été sensible à l'éclairage que vous venez de nous apporter sur une époque qui est parfois présentée de manière assez partielle, à la lumière de ce que l'on sait aujourd'hui. L'auteur du livre Amiante : 100 000 morts à venir est particulièrement dur à l'égard de la personnalité de Marcel Valtat. Pourriez-vous nous en parler ? Pourriez-vous nous également compléter le panorama de cette époque ? M. Dominique MOYEN : Pour vous donner un exemple des ambiguïtés de l'INRS, mon prédécesseur et moi-même avions défini une méthode qui permettait de remonter la chaîne des causes des maladies liées à l'amiante. Le conseil d'administration nous a interdit de publier cette étude. Les syndicats avaient sans doute peur que soient mises au jour des responsabilités ouvrières. Les patrons avaient peur de voir l'INRS s'intéresser de trop près à l'organisation du travail. La leçon que j'en tire est que la cohabitation entre syndicats et patrons n'est pas forcément une bonne chose. Il est nécessaire qu'une autorité de service public puisse faire respecter son point de vue. Marcel Valtat était un bon communiquant. Je lui ai fait confiance au sujet de la charte du Comité permanent. Les délibérations des réunions, par exemple, ne débouchaient pas sur des décisions, lesquelles devaient être laissées au Conseil supérieur des maladies professionnelles et à la DRT. Cela dit, il est vrai que nous avons utilisés les services de la profession. Nos réunions avaient lieu dans une salle payée par elle. Nos publications étaient payées par elle. Mais doit-on refuser de participer à une réunion parce que la salle où elle a lieu est payée par celui qui est assis en face de vous ? Cela ne m'a jamais posé de problème. Certains ont parlé de « lit d'infamie ». M. le Président : Je crois que le mot n'est pas justifié. Mais tout cela présentait certainement des risques, sur lesquels vous avez vous-même insisté. M. Dominique MOYEN : Je suis hanté par l'idée que j'aurais pu faire plus. À l'époque, j'étais considéré sur le plan international comme une référence sur les questions de prévention. À mon avis, le contexte n'était pas favorable à une interdiction. D'autre part, la profession a certainement fait tout ce qu'il fallait pour que l'idée ne soit pas émise. Elle a aussi fait beaucoup d'efforts pour éviter la confrontation devant les juges. M. Daniel PAUL : La France a été en 1997 le septième pays de l'Union européenne, avez-vous dit, à interdire l'amiante. Les six pays qui l'ont précédé ont dû eux aussi subir les pressions des professionnels, et y ont résisté. Le CPA se réunissait chez les patrons, les comptes rendus de ses réunions étaient édités par eux, l'un de ses membres les plus « communicants », comme on dit aujourd'hui, était, semble-t-il, payé par les patrons. Mais ce n'est pas cela qui me choque le plus. Ce qui me frappe le plus est l'inertie des pouvoirs publics, qui devaient sans doute savoir que l'amiante avait été interdit dans d'autres pays et qui ont tardé à prendre la même décision. Il y a eu démission, j'ose le terme, de la puissance publique sur une question qui touche à la santé publique. Cela signifie que ceux qui parlent aujourd'hui de « faute intentionnelle » sont légitimés. Les pays proches du nôtre qui ont interdit l'amiante avant 1997 ne disposaient-ils pas d'éléments suffisamment probants pour amener la puissance publique à prendre une décision qu'elle a tardé à prendre ? M. le Président : Je souhaite compléter la question de M. Paul. Au sein du CPA, la dualité entre responsables syndicaux et responsables patronaux n'a pas non plus été heureuse, avez-vous dit. Avez-vous eu l'impression que le problème de l'emploi était une donnée qui revenait fréquemment ? M. Dominique MOYEN : Le problème de l'emploi était souvent évoqué dans les discussions informelles plus que lors des réunions. Les patrons insistaient sur le fait que l'abandon de l'amiante serait coûteux. Pour prendre un autre exemple, l'INRS avait inventé un marteau-piqueur qui faisait moins de bruit que les autres. Il a fallu cinq ans avant qu'un constructeur accepte de mettre cette machine sur son catalogue. Pourtant, son prix était d'environ 30 % supérieur, ce qui n'était pas de nature à bouleverser les prix de revient. S'agissant de l'amiante, il est certain que la question de l'emploi a pesé d'un certain poids. Les pays européens qui ont interdit l'amiante avant la France sont les suivants : le Danemark en 1980 ; la Suède en 1992, avec des dérogations ; l'Italie et les Pays-Bas en 1993 ; l'Autriche et la Finlande en 1994 ; l'Allemagne en 1994, avec des dérogations. La Commission européenne a publié en 1999 un texte recommandant l'interdiction avant 2005. Le Royaume-Uni a interdit l'amiante en 1999. Je dirais que l'interdiction de l'amiante n'a pas changé le passé. Ceux qui étaient condamnés sont morts. Au moment où les interdictions ont été édictées dans divers pays d'Europe, l'exposition à l'amiante était déjà très inférieure à ce qu'elle avait été par le passé. Oui, il est vrai que nous avons perdu cinq ans. Il eût été préférable de ne pas perdre cinq ans. Mais il reste que cela n'aurait pas changé l'ampleur du scandale. À mon sens, l'interdiction a été retardée par deux facteurs, outre le fait que cette idée, encore une fois, n'était pas dans l'air du temps. Il y a eu incontestablement une carence des pouvoirs publics. Il est inconcevable que le Conseil supérieur des maladies professionnelles ne se soit pas ému du problème avant 1990. D'autre part, il est inacceptable que la sécurité sociale, qui me donnait 500 millions par an pour faire fonctionner l'INRS, ne m'ait pas autorisé à dépenser plus sur les maladies professionnelles et la prévention. Nous aurions pu faire beaucoup de choses, mais les maladies professionnelles ne faisaient pas partie des préoccupations principales de la sécurité sociale. La coupure entre le monde des médecins du travail et celui de la sécurité sociale est catastrophique. Pour vous donner un exemple, j'avais voulu publier un dossier Santé et travail. J'ai entendu à cette occasion des choses extravagantes, par exemple que le lieu de travail était un lieu où l'on pouvait promouvoir la santé comme le font les entreprises japonaises en faisant faire des exercices aux ouvriers, ou encore que l'entreprise pouvait participer à la prévention de la carie dentaire en invitant les salariés à se brosser les dents. Tout cela est peut-être vrai, mais l'essentiel est ailleurs. Ma préoccupation était de promouvoir une politique de santé au travail. Or, je n'ai jamais pu intéresser le conseil d'administration et la direction de la sécurité sociale à cette approche. Un directeur de la prévention m'a dit un jour : « La prévention, c'est bien mais pour la CNAMTS, c'est l'INRS qui s'en occupe. »
M. le Président : Cette phrase est lourde de signification, en effet. Monsieur Moyen, nous vous remercions de votre contribution aux travaux de notre mission d'information. Audition de M. Jean-Luc PASQUIER, ancien responsable de la Direction des relations du travail (DRT), représentant la DRT au Comité permanent amiante et actuellement directeur délégué à la formation à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Mes chers collègues, nous recevons aujourd'hui M. Jean-Luc Pasquier, qui est actuellement directeur délégué pour la formation à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, et qui a une longue expérience de la gestion du dossier amiante. Il était important que nous vous entendions, monsieur Pasquier. En effet, vous êtes entré à la Direction des relations du travail (DRT) à la fin des années 70 comme ingénieur et vous y avez dirigé le bureau « santé au travail » dans les années 1980 et 1990. A ce titre, vous avez représenté la DRT au Comité permanent amiante pendant toute la durée de son fonctionnement. Votre audition est donc au cœur du retour d'expérience qu'il nous faut exploiter pour réfléchir à l'amélioration de la gestion collective des risques, à partir du cas de l'amiante, et notamment au lien entre l'évaluation des risques et la gestion du risque. Tel est, en effet, l'objectif du deuxième thème d'investigation de notre mission, que nous abordons aujourd'hui, après avoir étudié le problème de la gestion de l'amiante dit « résiduel ». Comme ce premier thème l'indique, notre démarche est davantage tournée vers l'avenir que vers le passé, mais nous ne pouvions envisager d'étudier le problème de l'amélioration de la prévention des risques professionnels sans essayer de comprendre pourquoi le drame de l'amiante n'a pu être évité. Il s'agit en effet de tirer les leçons de ce drame pour évaluer les mécanismes actuels de prévention des risques professionnels et voir comment les améliorer. M. Jean-Luc PASQUIER : M. le Président, mesdames, messieurs les députés, je souhaiterais d'abord vous dire que l'amiante, même si je n'ai plus à m'en occuper depuis dix ans, est un dossier qui m'est particulièrement douloureux et qui me taraude chaque jour, étant donné ce que l'on sait aujourd'hui. J'estime qu'il est de mon devoir de m'exprimer sur ce dossier, et je vous remercie de m'avoir invité à témoigner devant votre mission. Je suis entré à la Direction des relations du travail le 1er décembre 1977. Au sein de la délégation à la sécurité au travail, on m'a confié, entre autres dossiers, la mise en œuvre des mesures d'application prévues par le décret du 17 août 1977 relatif à l'amiante, et en particulier celles qui concernaient la métrologie. Je suis physicien de formation et spécialiste de la physique de l'atmosphère. En 1982, à la suite d'une réorganisation de la DRT, on m'a confié la direction d'un bureau qui venait d'être créé, le bureau 4, qui s'appelait « Hygiène en milieu de travail ». Il couvrait un spectre d'activités extrêmement important, comprenant l'ensemble des risques chimiques, physiques et biologiques, la préparation des tableaux de maladies professionnelles, ainsi que toutes les affaires contentieuses et administratives traditionnelles. Outre moi-même, ce bureau comprenait deux ingénieurs, un médecin, un attaché d'administration, une secrétaire administrative et une dactylo. Avant 1982, il existait une délégation à la sécurité, mise en place à la suite de la loi du 6 décembre 1976, relative à la prévention des accidents du travail, afin de prendre en charge les mesures d'application de cette loi, laquelle fut d'ailleurs la première loi à traiter de manière approfondie le problème des maladies professionnelles et des accidents du travail. Le bureau 4 a produit, entre 1982 et 1994, vingt-deux décrets en Conseil d'État dans le domaine des risques chimiques, dont quatorze concernaient le risque cancérogène chimique, 9 décrets en Conseil d'État concernant les risques physiques, en particulier celui portant sur les rayonnements ionisants, un décret sur les risques biologiques et treize décrets relatifs aux maladies professionnelles, qui ont permis de créer plus de trente tableaux de maladies professionnelles, ce qui avait fait dire à un syndicaliste représentant la CFDT au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels que nous avions produit et modifié plus de tableaux entre 1982 et 1994 qu'entre 1918 et 1980. Comme vous le voyez, l'amiante n'était pas distingué par rapport à d'autres cancérogènes chimiques. Je me souviens que l'un des premiers dossiers sur lesquels j'ai eu à travailler était celui du chlorure de vinyle monomère, qui présente à peu près les mêmes caractéristiques que l'amiante. Ce produit, qui sert de base aux PVC, provoque des cancers mortels. En ce qui concerne l'amiante, la première phase de mon travail a consisté à mettre en place des mesures d'application du décret de 1977, et à en vérifier l'application. Contrairement à ce qui a été dit et relayé par la presse, des enquêtes ont été effectuées par l'inspection du travail sur le niveau d'application du décret de 1977. Certaines de ces enquêtes ont d'ailleurs été publiées dans des revues, en particulier la Revue Échange travail en 1981, sous ma propre signature. Une deuxième enquête a été conduite au cours de l'année 1983. Tout montrait à l'époque que les valeurs limites d'exposition qui avaient été fixées étaient en voie d'être appliquées. Je rappelle que la valeur maximale fixée par le décret était de deux fibres par cm3, qu'elle a été ensuite fixée à une fibre puis à 0,5. Il faut savoir que, dans les années 70, les quelques estimations qui étaient à notre disposition montraient que les niveaux d'empoussièrement dans les ateliers et les usines étaient de l'ordre de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers de fibres par cm3. Après la publication du décret, on peut affirmer que, globalement, la valeur limite de deux fibres par cm3 était respectée. J'ai du mal à admettre que certains puissent prétendre qu'aucune vérification n'a été faite à cette époque et que la réglementation n'était pas appliquée. Je ne dis pas qu'elle était appliquée partout. Je dis que nous avons constaté un début d'application significatif, en tout cas chez les producteurs de produits à base d'amiante. Après le décret, la Commission européenne a publié deux directives. Je peux attester que la France ne s'est jamais opposée aux mesures qui étaient préconisées par Bruxelles. On nous a reproché de ne pas avoir transposé ces directives dans les délais. L'une a été transposée avec trois mois de retard, l'autre l'a été dans les délais. M. le Président : Pourquoi ces trois mois de retard ? M. Jean-Luc PASQUIER : S'agissant de la directive du 19 septembre 1983, qui ne soulevait aucune difficulté de transposition puisque l'économie générale du texte correspondait à celle du décret d'août 1977, la transposition fut transmise au cabinet du ministre en vue de sa signature le 29 janvier 1987 et fut finalement adoptée le 27 mars 1987. Entre-temps, la section sociale du Conseil d'État avait été saisie en décembre 1986 et a rendu son avis le 20 janvier 1987. Il a fallu également solliciter l'avis de la Commission permanente du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, qui avait été consultée le 20 novembre 1986. La Commission nationale d'hygiène et de sécurité en agriculture avait été consultée le 20 juin 1986. Enfin, la commission des risques chimiques du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels avait été consultée au cours du printemps 1986. La rédaction de l'avant-projet de décret par mon bureau avait été réalisée au cours de l'année 1985. M. le Président : Arrêtons-nous un instant sur ce point. Alors même que, comme vous nous l'avez dit, la transposition de la directive de 1983 ne posait pas de problème particulier puisque son économie générale correspondait au décret de 1977, il aura donc fallu quatre ans pour la transposer. Nous devons faire le constat de la terrible lourdeur du processus. M. Jean-Luc PASQUIER : Le processus de consultation est en effet extrêmement lourd. Pour certains autres textes, il est encore plus compliqué. Par exemple, pour les rayonnements ionisants, il a fallu consulter, en plus des instances que je viens de citer, la commission interministérielle des installations nucléaires de base, la commission interministérielle des radioéléments artificiels et le Conseil supérieur d'hygiène public de France, le tout selon un mode séquentiel. Il y a une question qui se pose, et que vous m'avez d'ailleurs posée implicitement dans le questionnaire que vous m'avez adressé : pourquoi n'ai-je jamais envisagé d'interdire l'amiante ? J'ai d'ailleurs été présenté, dans une note relative à mon audition, comme un défenseur de « l'usage contrôlé ». Je ne suis pas un défenseur de l'usage contrôlé, je constate les faits. Ou plus exactement, nous sommes tous, et vous êtes tous, mesdames, messieurs les députés, des défenseurs de l'usage contrôlé : vous tolérez que l'on continue d'utiliser le chlorure de vinyle monomère pour fabriquer vos bouteilles d'eau minérale ; vous tolérez que l'on mette du benzène dans l'essence, alors que ce produit est hautement cancérogène ; vous êtes pour l'usage contrôlé des hydrocarbures insaturés, qui constituent l'essentiel des produits chimiques que nous utilisons. De même, personne ne remet en cause l'utilisation du nucléaire pour produire de l'électricité. Certains s'y opposent certes, mais globalement, l'utilisation des rayonnements ionisants a l'assentiment de notre corps social. Nous sommes donc tous favorables à l'usage contrôlé d'un certain nombre de produits qui sont des cancérogènes avérés. Je vais me permettre, M. le Président, d'entrer un instant dans des considérations techniques. Nous étions conscients, bien sûr, du risque cancérogène. Lorsque Mme Martine Aubry est devenue ma patronne au ministère du travail, au début des années 1980, l'une de ses principales préoccupations était de définir une doctrine du ministère en matière de prévention du risque cancérogène. C'est elle qui nous a demandé, à l'époque, de créer sur ce thème un groupe de travail spécialisé, permanent. Cela nous a d'ailleurs conduits, en 1984, à rédiger une circulaire dont l'objet était d'attirer l'attention de l'inspection du travail sur le problème des risques cancérogènes. Dans cette circulaire, qui fut publiée au Journal officiel, nous disions très clairement que la définition de valeurs limites d'exposition n'était pas la panacée, que ces valeurs n'étaient que des indicateurs de prévention, et qu'en tout état de cause, il fallait s'efforcer de réduire les expositions au niveau le plus bas possible. Il est vrai que nous ne remettions pas en cause, à l'époque, l'utilisation de l'amiante. Celui-ci était cité à côté de toute une série d'autres produits. Et c'est là qu'il me faut entrer dans des considérations techniques. Quand on s'occupe de prévention en milieu de travail, on doit gérer le danger et le risque, qui correspondent à deux notions totalement différentes. Le danger est lié à la caractéristique intrinsèque du produit : un produit peut être cancérogène, ou toxique, ou mutagène, ou toxique pour la reproduction, etc. La notion de risque, elle, nous conduit à tenter de quantifier les effets qu'un produit est susceptible de produire sur les travailleurs qui y sont exposés, en mesurant le degré d'exposition des personnes. Par ailleurs, il faut faire une distinction entre le risque déterministe et le risque aléatoire. Prenons l'exemple de l'eau de Javel. Si vous buvez un litre d'eau de Javel, ce produit peut détruire votre œsophage. Si vous mettez une goutte d'eau de Javel dans une eau non potable, vous la rendrez potable. Entre une goutte et un litre, il existe une limite au-delà de laquelle un effet se produit et en deçà de laquelle il ne se produit rien. Évidemment, au-delà de la limite, plus la dose est importante, plus l'effet est important. La relation proportionnelle est une relation entre la dose et la gravité de l'effet. Pour le gestionnaire du risque, ce type de produit est, si j'ose dire, pain bénit. Car dans ce cas, il est possible de fixer des règles et mettre en place des moyens de protection qui permettent de garantir une sécurité absolue, dès lors qu'on est capable d'assurer que l'exposition reste en deçà d'une valeur limite. Mais il existe des produits qui ne répondent pas à ce schéma. Il s'agit des produits cancérogènes, des produits mutagènes, et des produits toxiques pour la reproduction. Pour ces produits, ce n'est pas le danger mais le risque qui croît en proportion de la dose. Il n'existe pas une relation proportionnelle entre la dose et la gravité de l'effet, mais entre la dose et la probabilité d'apparition de l'effet. Et il n'y a pas de seuil en deçà duquel la probabilité s'annule. C'est le cas des rayonnants ionisants, c'est aussi le cas de l'amiante. Autrement dit, on pourrait presque dire que si vous n'avez pas de chance, la première fibrille d'amiante que vous inhalez peut provoquer un cancer. Face à ces données, le gestionnaire du risque peut tout de même fixer des valeurs limites, même s'agissant de produits dont on sait qu'ils sont cancérogènes. C'est le cas des rayonnements ionisants. On sait que la valeur limite n'assure pas une garantie d'innocuité. Elle constitue un guide pour la prévention. Cela signifie que la valeur limite correspond à une probabilité qui est le seuil de l'inacceptable. Dans ma jeunesse, maintenant assez lointaine, on appelait cela le « seuil socialement acceptable ». Mais je ne reprends pas ce terme à mon compte, car il est totalement banni, comme le terme d'usage contrôlé. Il est évident que la définition d'une valeur limite au-delà de laquelle le risque est inacceptable doit être assortie d'une précaution. Car en tout état de cause, il faut faire en sorte de réduire les expositions au plus bas niveau possible, sans se contenter de rester en deçà de la valeur limite. À partir de là, vous pourriez me poser la question suivante : puisque vous ne pouvez pas définir une limite en deçà de laquelle il est impossible de garantir la sécurité absolue, pourquoi ne prononcez-vous pas une mesure d'interdiction ? J'ai déjà apporté une première réponse à cette question : si l'on entrait dans cette logique, on interdirait beaucoup de produits, et des plus courants, y compris certains produits qui se trouvent dans votre cuisine. Mais il y a d'autres raisons, des raisons spécifiques, qui expliquent qu'on n'ait pas interdit l'amiante. Tout d'abord, l'interdiction implique que l'on utilise, à un moment ou à un autre, des produits de remplacement. Or, un produit de remplacement aura des propriétés comparables - résistance à la chaleur, résistance aux acides, etc. Et ces propriétés comparables risqueront de produire des effets comparables. Toute l'histoire de la toxicologie démontre d'ailleurs que les produits de remplacement, sauf lorsqu'ils sont d'une nature complètement différente de celle du produit qu'ils remplacent - et c'est rarement le cas - présentent le plus souvent des propriétés toxiques équivalentes. La différence est que ces produits ne sont pas réglementés. Le raisonnement qui était fait à l'époque consistait à dire qu'il valait mieux, en la contrôlant et en réduisant les expositions au plus bas niveau possible, « s'accommoder » de l'utilisation d'un produit qu'on a assez bien circonscrit, plutôt que de permettre l'utilisation intempestive de produits à peu près comparables mais non réglementés et non expertisés. Ce fut une raison importante de la non-interdiction. Une deuxième raison importante était qu'il aurait fallu pouvoir s'assurer que l'interdiction serait effectivement respectée et aboutirait à une disparition de l'utilisation de l'amiante. S'agissant d'un produit aussi largement utilisé, l'interdiction ne pouvait être prononcée qu'à condition de se donner les moyens de désamianter de manière massive. À ma connaissance, on en est encore à rechercher les moyens de désamianter, et même d'identifier la présence d'amiante. La troisième raison est que l'interdiction désarmait le contrôle. Comment pouvait-on demander à des inspecteurs du travail de contrôler des produits qui n'étaient pas réglementés ? Enfin, il faut bien reconnaître que l'on avait tendance, dans les années 80, à exporter nos sources de pollution vers des pays du tiers-monde, quitte à importer des produits finis devenus inoffensifs ou considérés comme tels. L'interdiction accentue cette tendance. M. le Rapporteur : S'agissant des produits de remplacement, ne peut-on pas vous objecter que des fibres de dimension suffisamment importante constituaient une solution au problème ? M. Jean-Luc PASQUIER : Nous savions à l'époque que plus les fibres sont fines, mieux elles peuvent s'infiltrer dans l'arbre pulmonaire supérieur, le pharynx, puis dans les bronches, puis dans les bronchioles, et enfin dans les alvéoles pulmonaires. C'est tout à fait clair. Mais qu'est-ce qui nous garantit que des fibres de céramique ou de verre qui présenteraient les mêmes caractéristiques granulométriques n'auraient pas les mêmes effets ? Et qu'est-ce qui vous dit que l'on ne fabrique pas en ce moment des fibres minérales aujourd'hui connues des seuls spécialistes de l'industrie et qui ont les mêmes caractéristiques que l'amiante ? Je ne vois pas en quoi les techniques actuelles interdiraient de fabriquer des fibres de verre d'un diamètre inférieur à trois microns, puisque c'est à peu près la limite qui permet de descendre au niveau alvéolaire. M. le Président : Si nous poussions votre raisonnement à l'extrême, on aboutirait à la conclusion qu'il n'y avait pas de raison d'être favorable à l'interdiction de l'amiante. M. Jean-Luc PASQUIER : Je n'ai pas de réticence envers l'interdiction de l'amiante. Je dis simplement qu'il faut maintenant aller jusqu'au bout, c'est-à-dire faire que personne, dans un avenir plus ou moins lointain, ne soit exposé à l'amiante. Mais je n'ai pas d'objection à l'interdiction. J'ai d'ailleurs moi-même proposé, dans les années 80, l'interdiction d'un certain nombre de produits chimiques dont je pensais la gestion impossible. M. le Président : Vous n'êtes pas défavorable à l'interdiction de l'amiante, mais vous nous dites que les produits de remplacement peuvent produire des effets analogues à ceux que produit l'amiante ? M. Jean-Luc PASQUIER : Oui, il y a un risque que l'on découvre, trente ou quarante ans après, les dégâts causés par un produit de substitution. M. le Rapporteur : La laine de verre ou la laine de roche sont, d'après vous, des produits dangereux ? M. Jean-Luc PASQUIER : Je ne dis pas qu'ils sont dangereux. Je dis qu'ils n'ont pas été expertisés d'une manière approfondie. Imaginez que votre laine de roche contienne du quartz microscopique, produit dont on sait qu'il est silicogène, et peut-être cancérogène. M. Daniel PAUL : D'autre pays européens ont interdit l'amiante avant nous. Forts de cette expérience, ne serait-il pas nécessaire d'être beaucoup plus prudents encore vis-à-vis des produits de substitution ? Le drame de l'amiante ne doit-il pas nous conduire à réagir beaucoup plus vite et envisager plus tôt qu'on ne l'a fait dans le passé des mesures d'interdiction, en étant conscient que certains intérêts se font entendre, dont on a bien vu qu'ils ont retardé l'interdiction à laquelle on a abouti en 1997 ? M. Jean-Luc PASQUIER : Il y a plusieurs questions dans votre question. Faut-il faire mieux pour étudier les risques ? C'est évident. Les scientifiques sont-ils intervenus de manière vigoureuse pour alerter l'administration ? C'est moins évident. Même sans parler des scientifiques qui ne sont intervenus que récemment sur le sujet, les figures de proue du milieu scientifique spécialisé dans la connaissance de l'amiante - je pense par exemple à M. Goldberg, ou encore à M. Pézerat - ne nous ont pas alertés. Ils n'ont pas remis en cause l'usage qui était fait de l'amiante, assorti de valeurs limites. Dans un colloque qui s'est tenu en 1984, dont les actes ont été publiés à la Documentation française, et dont le thème était « Évaluation des risques et des actions de prévention en milieu professionnel », l'amiante a été évoqué parmi d'autres risques cancérogènes, y compris par les personnes que je viens de citer, sans qu'on en fasse un cas particulier. Dans la revue Santé et Travail, édité par la Mutualité française, et dont le rédacteur en chef est M. François Desriaux, le président de l'Association de défense des victimes de l'amiante, un article de 1992 signé par M. Pézerat déplorait qu'« en ce qui concerne les cancérogènes inorganiques, seul l'amiante bénéficie - je souligne ce terme - d'une valeur moyenne d'exposition impérative ». M. Pézerat déplorait donc qu'on n'applique pas à d'autres cancérogènes aussi dangereux le même régime que l'amiante. Il ne demandait pas l'interdiction de l'amiante. Lorsque j'ai pris connaissance, en novembre 1994, d'un article sur l'amiante signé d'un expert britannique, j'ai immédiatement demandé au directeur des relations du travail de réunir les meilleurs spécialistes. Nous les avons réunis le 20 décembre 1994. Participaient à cette réunion, outre moi-même, des membres de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), M.Pézerat, M. Ameille, M. Fournier, M. Goldberg. Les conclusions de cette réunion n'étaient pas la recommandation d'interdire l'amiante, mais celle de renforcer la réglementation et de demander à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) de procéder à une évaluation collective. En 1984, un article signé par des chercheurs de l'INSERM, publié dans la revue Épidémiologie et santé publique, et intitulé « Contribution méthodologique à des déterminations de valeurs limites d'exposition professionnelle à l'amiante », concluait, en substance, que la valeur limite en vigueur à l'époque pour l'amiante assurait la même protection que celle relative aux rayonnements ionisants. Autrement dit, c'est récrire l'histoire que d'affirmer que les scientifiques ont alerté les pouvoirs publics et demandé l'interdiction de l'amiante. M. le Président : En résumé, les moyens consacrés à l'évaluation sont insuffisants, et même quand l'évaluation est faite, c'est la capacité d'en gérer les conséquences qui est insuffisante ? M. Jean-Luc PASQUIER : Au début des années 80, l'accent était mis sur la négociation collective, sur les conditions de travail et sur la sécurité intégrée. La gestion du risque sur le terrain n'était pas la préoccupation principale des politiques. La perception générale des risques environnementaux n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. M. le Rapporteur : Il est frappant de constater que la sécurité de l'activité nucléaire a connu une progression régulière et que cela n'a pas été le cas pour l'amiante. Pour ce qui est des victimes, ce n'est que tardivement que les associations se sont mobilisées sur le thème de l'amiante, alors que la sûreté nucléaire a fait l'objet d'actions de la part de toute une série de groupes et de mouvements. Et en ce qui concerne le nombre de morts, il n'y a, d'ailleurs, aucune commune mesure entre l'amiante et le nucléaire. M. Jean-Luc PASQUIER : La vraie comparaison que l'on peut établir, est plutôt celle entre les rayonnements ionisants et l'amiante. La première constatation des effets néfastes des rayonnements ionisants date de 1901, quand Pierre Curie et Henri Becquerel observent les effets de brûlure des rayonnements d'une source radioactive et publient une note : «L'action physiologique des rayons du radium ». Dans les années 20, les médecins radiologues meurent en masse. La première réglementation concernant la radioprotection en milieu de travail date de décembre 1934 et est présentée comme provisoire. Elle est restée provisoire jusqu'en 1967. En 1980, une directive Euratom impose de modifier la réglementation française. La transposition a lieu deux ou trois années plus tard, et ne produit ses effets qu'en 1986, en raison de l'opposition de l'establishment nucléaire. J'ai la preuve qu'on a été jusqu'à demander ma tête au Président de la République, au simple motif que je m'occupais de la transposition, sur ordre de ma hiérarchie. La directive de 1996 devait être transposée en 2001, et a produit ses premiers effets en 2003. Du strict point de vue de la protection de la population, des travailleurs et des patients, les choses avancent à un rythme dont on ne peut pas dire qu'il soit rapide. Le zonage, par exemple, devrait être révisé conformément à la directive de 1996 : l'arrêté correspondant n'est toujours pas pris, et ce alors que la directive se fonde sur des principes scientifiques énoncés par la commission internationale de protection radiologique de 1990. Quant au nombre de morts, on nous dit qu'il n'y en a pas. Je veux bien le croire. Mais cela dépend du modèle mathématique sur lequel on se fonde. S'agissant de l'amiante, les projections prévoient que le nombre de morts devrait s'accroître. J'espère que les experts se trompent. Il y a d'ailleurs quelques indices qui nous permettent d'être moins pessimistes qu'eux. La politique de prévention qui a été mise en œuvre a peut-être, malgré tout, produit au moins quelques effets. Si l'on est passé de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de fibres par cm3, à deux fibres par cm3, cela devrait tout de même produire quelques effets. L'expertise collective de l'INSERM de 1987 concluait qu'on pouvait attendre 1 200 morts pour l'année 1996. Or, les chiffres de la CNAMTS indiquent 429 morts pour l'année 2003. Il serait malhonnête de ma part de tirer des conclusions de ces chiffres. Mais je m'interroge sur ce décalage. Vous m'avez demandé si le système d'évaluation qui a été récemment mis en place était plus performant. J'espère qu'il l'est, mais je n'en suis pas absolument certain. Mon sentiment est qu'il n'est pas possible, sur des sujets aussi sensibles, de procéder à une évaluation des risques complètement scientifique et objective avec nos experts français. Une bonne évaluation des risques implique une collaboration internationale. M. le Rapporteur : Je reviens un instant sur la comparaison entre l'amiante et les rayonnements ionisants. Je veux bien admettre que, s'agissant de ces derniers, l'application de certaines directives ait connu des retards. Mais du point de vue de la santé publique, il n'y a aucune commune mesure. M. Jean-Luc PASQUIER : Cela peut se discuter, M. le Rapporteur. Certains articles publiés dans des revues scientifiques affirment qu'il faut s'attendre à 5 000 morts par an dus au cancer du poumon en Bretagne. M. le Président : Ce débat illustre la difficulté et la complexité de l'évaluation. M. Jean-Luc PASQUIER : Je tiens à préciser qu'il va de soi que je n'ai jamais subi aucune pression de ma hiérarchie ou de mon ministre tendant à retarder des mesures de prévention. J'assume donc, moralement, et au-delà s'il le faut, la responsabilité des mesures qui ont été prises en la matière. M. le Président : Monsieur Pasquier, nous vous remercions de votre contribution aux travaux de notre mission d'information. Table ronde regroupant des partenaires sociaux sur les risques professionnels liés à l'amiante · MEDEF, représenté par M. Dominique De CALAN, délégué général adjoint de l'UIMM, M. Bernard CARON, directeur de la commission protection sociale du MEDEF, Docteur François PELLET, médecin-conseil du MEDEF et de l'UIMM, accompagnés de M. Guillaume RESSOT, chargé des relations avec le Parlement · CGPME, représentée par le Docteur Pierre THILLAUD, représentant de la CGPME au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et directeur de l'Association médicale interentreprises · UPA, représentée par M. Pierre BURBAN, secrétaire général, Mme Houria SANDAL, conseillère technique et M. Daniel BOGUET, membre, accompagnés de M. Guillaume TABOURDEAU · CGT, représentée par M. Serge DUFOUR, conseiller confédéral de l'activité santé au travail, Dr Gilles SEITZ, médecin du travail, M. Jean BELLIER, expert santé au travail · CFE-CGC, représentée par M. Bernard SALENGRO, délégué national au pôle protection sociale · CFDT, représentée par M. Dominique OLIVIER, secrétaire permanent, responsable des risques professionnels et de la santé au travail et Mme Laurence THÉRY, secrétaire confédérale chargée de la santé au travail · FO, représentée par M. Franck URBANIAK, assistant confédéral et M. Jean PAOLI, administrateur du FIVA Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je vous remercie de vous être rendus disponibles pour cette table ronde, la quatrième depuis le début de nos travaux qui ont commencé en juin dernier et ont déjà donné lieu à plus de vingt réunions. Le sujet dont nous allons traiter aujourd'hui est d'une extrême importance : au-delà du problème de l'amiante, il s'agit d'évaluer notre système de prévention des risques professionnels. Nous sommes nombreux, je m'en félicite, et nous allons faire en sorte que ce débat soit le plus interactif possible. Dans un premier temps, je vous propose de nous intéresser à l'attitude du monde du travail vis-à-vis du risque amiante jusqu'à l'interdiction du produit en 1997. Dans un second temps, je souhaiterais que nous nous interrogions sur la gestion des risques professionnels aujourd'hui. Le but est de nous appuyer sur le passé pour maîtriser le présent et, si possible, l'avenir. Je vous indique que la CFTC, empêchée, n'a pu participer à cette réunion. Mais elle nous a fait parvenir, en même temps que ses excuses, sa position et ses propositions. (Il est procédé à un tour de table de présentation.) M. le Président : Notre premier thème concerne donc l'attitude du monde du travail vis-à-vis du risque amiante jusqu'à l'interdiction du produit en 1997. Comment le risque « amiante » a-t-il été appréhendé par les partenaires sociaux ? À partir de 1977, la réglementation a imposé des valeurs maximales d'exposition à l'amiante au travail. Cette réglementation était-elle adaptée ? Et surtout, a-t-elle été correctement appliquée ? En 1997, l'amiante a été interdit. Toutefois, à partir de 1984, le Comité permanent de l'amiante (CPA) a servi d'enceinte officieuse mais active de gestion de l'amiante. Fallait-il interdire l'amiante plus tôt ? Le CPA, auquel tous les syndicats - sauf un, Force ouvrière - ont participé, n'aurait-il pas contribué à prolonger dangereusement l'exposition des travailleurs ? M. Dominique OLIVIER : M. le Président, je tiens au préalable à vous faire part de ma surprise quant aux modalités d'organisation de cette table ronde, à laquelle vous avez décidé d'inviter conjointement la partie patronale et la partie syndicale. Si bien des choses relèvent du dialogue social, on ne peut pas dire pour autant, s'agissant de l'amiante, que le dialogue social ait présidé à toutes les initiatives et prises de position. Ajoutons que nous n'avons pas été associés à vos autres tables rondes. J'ai été particulièrement étonné que l'on n'ait pas daigné écouter les représentants des travailleurs, pourtant les premiers exposés, sur la question de l'amiante en place. M. le Président : Tout mode d'organisation peut être critiqué. Nous avons souhaité un débat interactif ; c'est pourquoi nous avons invité en même temps les organisations syndicales et patronales. Je suis bien d'accord sur le fait que tout ne relève pas du dialogue social, encore que celui-ci ait joué en la matière un rôle indéniable. Nous entendons évidemment tous les acteurs. Si, dans la suite de nos travaux, vous souhaitez intervenir sur un sujet précis, faites-nous le savoir. Nous nous efforcerons de répondre à votre demande. M. Daniel BOGUET : L'entreprise artisanale a toujours utilisé l'amiante en toute bonne foi. De la même façon, le modeste élu municipal que je fus à une époque a permis l'utilisation de canalisations en amiante ou de toitures en Eternit dans des bâtiments communaux. C'était pour tous un matériau miracle, dont personne ne voyait les effets pervers. Premiers ouvriers de nos entreprises artisanales, nous étions les premiers exposés. Ajoutons que nous n'étions pas admis à siéger au CPA - c'est seulement en 1983 que le gouvernement Mauroy a reconnu la représentativité de l'Union Professionnelle Artisanale (UPA). Si nous avons pu être involontairement responsables, je considère que nous n'étions pas coupables. M. Bernard SALENGRO : Je vous remercie pour cette réunion. À la façon dont votre questionnaire est construit, on s'aperçoit que l'on dépasse largement le seul cadre de l'amiante pour aborder toute la problématique de la santé au travail, sujet de plus en plus prégnant et dont on commence seulement à mesurer les effets, sur le plan des souffrances endurées comme sur le plan épidémiologique, ainsi que les répercussions économiques sur les équilibres entre les branches accidents du travail et maladie. La Cour des comptes elle-même s'en est émue : si l'on prenait en compte le coût des pathologies professionnelles à sa réelle hauteur, les chiffres seraient, à l'évidence, considérablement bouleversés. L'histoire de l'amiante rejoint celle de la toxicologie en général. On sait depuis longtemps que l'amiante, la silice ou le plomb ne sont pas bons pour la santé : un de vos illustres prédécesseurs, médecin du travail avant de devenir homme politique, le docteur Clemenceau, n'avait-il pas écrit de beaux articles dans l'Aurore sur le plomb et la céruse ? Pourtant, c'est tout récemment que des mesures sérieuses ont été prises pour ces produits. Parallèlement à l'évolution, incontestable, des connaissances scientifiques sur l'amiante, il y a eu l'histoire : on a cru un moment à un possible « usage contrôlé » de l'amiante, on a longtemps ignoré que certaines pathologies n'étaient pas liées à un effet de seuil, sans oublier le rôle joué dans cette affaire par le comité permanent de l'amiante, instance de réflexion organisée par les industriels. La CGC n'est en rien gênée d'y avoir participé : nous sommes partisans du dialogue jusqu'au bout, estimant que, dès lors que l'on peut échanger, cela vaut la peine d'essayer, même si c'est difficile, voire dangereux. Il est logique et prévisible que les employeurs aient tenté de tirer la couverture à eux. Ce qui, en revanche, est décevant est que les responsables de l'État n'aient pas joué leur rôle, alors qu'ils représentaient la société civile, et disposaient de moyens que les partenaires sociaux n'avaient pas. Là est le problème de fond. Certains se demandent si les partenaires sociaux n'ont pas une certaine responsabilité dans la gestion de cette affaire. N'entend-on pas d'ailleurs, à propos du plan santé/travail, les services ministériels déclarer que les partenaires sociaux gèrent la médecine du travail ? Allez voir sur le terrain : les services ministériels prouvent leur totale incompétence en déclarant de telles choses ! On le leur a dit, mais en vain ! Que gèrent les partenaires sociaux en réalité ? La branche accidents du travail (AT), me dira-t-on. Mais la branche AT est dans la sécurité sociale et qui dirige la sécurité sociale - certes avec des mains gantées et à distance -, sinon l'État ? Les partenaires sociaux sont partie prenante dans la gestion de l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Mais regardez ses statuts : l'INRS est libre... Libre de faire ce qu'on lui dit de faire, autrement dit ce que lui dit de faire la branche AT, donc le Gouvernement ! La liberté des partenaires sociaux apparaît finalement assez faible : bien qu'ils aient le titre de partenaires, ils n'ont pas la capacité de provoquer un audit ou une enquête, contrairement à un administrateur de société civile. La gestion est tripartite et les finances, on le sait, contrôlées. Sans doute y a-t-il un problème. Mais voyez la façon dont l'État gère la santé, les médecins et les inspecteurs du travail. Voyez comment les médecins de main-d'œuvre et les médecins scolaires fonctionnent ! Quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console ! Il y a quelques mois à peine, les partenaires sociaux sont venus au Conseil supérieur des risques professionnels accompagnés d'experts pour dénoncer le formaldéhyde, reconnu cancérogène par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Nous avons dit au représentant du Gouvernement de faire attention à ne pas recommencer comme avec l'amiante. Cela n'a servi à rien. Depuis des années, nous interpellons l'État, en vain, sur la problématique du stress au travail, chiffres et études japonaises, espagnoles et autres à l'appui, confirmés par la fondation de Dublin. Et que dire de tous les chantiers de désamiantage en cours dont une récente étude de l'INRS montre que les trois quarts ne sont pas réglementaires ! Que font vos gendarmes du code du travail ? Les inspecteurs du travail ne sont pas assez nombreux et leurs constatations finissent en classement vertical chez le juge, quand ils ne se font pas tirer dessus ! Lorsqu'une telle chose arrive à un représentant de l'État, à un gendarme, aussitôt la télé et le ministre accourent. Là, il ne s'est rien passé. C'est symbolique ! Voilà le problème tel qu'il se pose dans son intégralité. M. le Président : Vous avez d'ores et déjà abordé le deuxième thème... Mais il n'est pas mauvais que l'interactivité prime sur la rationalité. M. Serge DUFOUR : Je partage les propos de mon collègue Salengro, à quelques nuances près. Si beaucoup de choses ont été dites et écrites sur cette affaire de l'amiante, nous n'avons pas pour autant fini d'en tirer les enseignements. Je mettrai, pour ma part, l'accent sur les différences de traitement entre partenaires sociaux. On parle de la faillite de l'INRS sur la question de l'amiante ; l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) elle-même a, dans un rapport, pointé le fait que, durant des années, on s'y est évertué à éviter de traiter les problèmes qui fâchent et à rechercher un consensus. Or la mise en présence des intérêts économiques, d'un côté, et des intérêts de santé, de l'autre, ne pouvaient qu'aboutir à un point de conflit énorme, auquel l'INRS ne s'est naturellement pas intéressé. Il faudrait également resituer le contexte de l'époque. Après les ordonnances de 1967, l'organisation même de la gestion de la sécurité sociale est devenue paritaire : le patronat, « offreur de risque », a pris la main sur une institution chargée de protéger la santé des populations... C'était là, de notre point de vue, une anomalie grave, la sécurité sociale faisant prévaloir la réparation sur la prévention, le but essentiel étant désormais de gérer les risques plutôt que de chercher à les éviter. La hiérarchie était totalement inverse dans les ordonnances de 1945, 1946 et 1947, où la priorité était donnée, premièrement, à la prévention, deuxièmement, au maintien dans l'emploi, troisièmement, à l'accompagnement social et, quatrièmement, à la réparation. On sait que pour Pierre Laroque la réparation était un échec de la prévention, à réintégrer en tant qu'un indicateur, afin de mieux activer la prévention. Examinons maintenant les moyens dont disposent les partenaires sociaux. Dans un véritable dialogue social, chacun doit être à égalité. Qu'en est-il du côté des salariés ? Depuis 1998, les témoignages ne manquent pas... J'ai en mémoire les assises de la santé lancées par M. Kouchner, alors ministre de la santé, dont le point 15 était précisément consacré à la santé au travail. Une trentaine d'anciens salariés d'Eternit, à Paray-le-Monial, y étaient venus raconter devant 500 personnes tout ce qu'ils avaient subi : dès 1977, leur employeur les avait réunis pour les prévenir que l'amiante était dangereux, en leur demandant de choisir entre la poursuite ou l'arrêt de la production, autrement dit la fermeture de la boîte... Et chacun à son niveau avait délibéré en se disant : « Après tout, l'amiante ne m'a pour l'instant pas rendu malade, on verra ce qu'on verra ; en attendant, j'ai du travail. » Peut-on parler d'égalité dans ces conditions, surtout lorsque, quelques semaines avant l'interdiction effective, l'Académie de médecine maintenait que l'amiante n'était finalement pas si dangereux ? Je partage l'avis de Bernard Salengro sur la carence de l'État - l'Angleterre et les États-Unis avaient interdit l'usage de l'amiante bien avant la France -, mais n'oublions pas qu'aucun statut ne protège nos administrateurs d'un licenciement, à moins qu'il ne soit permanent syndical ou retraité ! M. Daniel BOGUET : Nous avons été plusieurs à participer à un congrès mondial organisé à Orlando sur la santé et la sécurité au travail. Laissons de côté les objectifs de la Chine, dont la mise en œuvre ne commencera qu'en 2020 ! En revanche, même si je ne suis pas béat devant les États-Unis, leur idée d'une approche équilibrée pour accroître la sécurité au travail me parle... Dans l'intérêt de nos petites entreprises notamment, la chasse aux coupables doit cesser. Tout le monde a été exposé au risque amiante sans vraiment comprendre ce dont il était question, y compris moi-même, quand je découpais une plaque d'amiante pour l'installer entre ma cuisinière et mon réfrigérateur, ou lorsque je m'en servais pour griller le pain ! Nos chefs d'entreprises doivent pouvoir s'appuyer sur les examens des médecins du travail. Notre responsabilité est donc de commencer par organiser les services de médecine du travail pour qu'ils répondent aux besoins de toutes les entreprises, y compris des plus petites qui n'ont pas les mêmes moyens que les autres. Pour autant, nous n'exigeons pas de délégués de site : pour nous, la prévention est d'abord de la responsabilité du chef d'entreprise. À cet égard, le document unique permet de prendre conscience de la nécessité d'une réflexion collégiale dans la petite entreprise. C'est un outil de travail commun. Pourquoi n'essaierions-nous pas d'adopter une approche équilibrée ? M. le Président : Considérez-vous que les conditions d'établissement et de diffusion de ce document unique sont satisfaisantes ? M. Daniel BOGUET : Non seulement le document unique a le mérite d'exister, mais les organisations syndicales - parmi lesquelles je compte nos organisations professionnelles - se sont attachées, sur le terrain, à y sensibiliser les intéressés et, en premier, lieu à dissiper leurs craintes. Jadis, les artisans ne demandaient rien d'autre à Colbert que de les laisser travailler ; cette fois-ci encore, nos collègues redoutaient qu'une nouvelle charge pèse sur leurs épaules. Nous leur avons expliqué qu'il y allait de l'intérêt bien compris de tout le monde. Je crois sincèrement qu'il était bon de leur laisser un délai de réflexion. Ce document unique est une bonne chose, mais il faut aider le chef d'entreprise à comprendre qu'il peut participer à la qualité du dialogue social dans l'entreprise, même s'il n'a qu'un ou deux compagnons. M. Bernard CARON : Il est toujours un peu compliqué d'écrire et de réécrire l'histoire sur un sujet aussi complexe et tragique, dont j'ai moi-même suivi l'évolution depuis de nombreuses années. À l'évidence, ce sont les entreprises qui créent le risque, tout comme elles créent les richesses. Sans risque, il n'y a pas de création de richesses et sans richesses, on aura beau multiplier les incantations, on n'aura guère de moyens. C'est une situation que nous assumons parfaitement. Pour autant, je ne peux laisser dire que nous aurions totalement étouffé la prévention pour privilégier la réparation. C'est exactement l'inverse que nous faisons depuis 1945, depuis 1967 et encore dans les années récentes. Il suffit de se pencher sur les statistiques Cela dit, on peut commettre des erreurs et nous en avons commis de différentes sortes dans les années écoulées. Le dossier de l'amiante a été, à l'évidence, marqué par des erreurs d'appréciation collectives. Bien entendu, il y avait des intérêts économiques derrière toute cette affaire ; bien entendu, chacun défend ce qu'il peut. Mais il le fait dans un cadre législatif, et avec le souci de préserver les intérêts de chacun - y compris les impératifs de santé, pour nous toujours prioritaires. Une doctrine d'utilisation contrôlée de l'amiante avait été élaborée, comme il en existe pour d'autres produits, sur la base de laquelle nous avons imaginé des barrières dont il peut apparaître aujourd'hui qu'elles étaient insuffisantes. Au surplus, nous nous voyons confrontés à de nouvelles pathologies dites à « effets différés », effets que nous ne pouvions apprécier à une époque où l'espérance de vie était beaucoup plus courte. Parallèlement aux problèmes de toxicité, les technologies évoluent et donnent naissance à de plus en plus de nouveaux produits dont il n'est pas toujours facile de connaître toutes les incidences. La question se pose notamment pour les produits de substitution de l'amiante. N'oublions pas enfin que lorsque l'on s'est mis à utiliser l'amiante, ce n'était pas pour nuire, mais bien pour protéger : on n'a du reste jamais fait le bilan des aspects positifs de l'amiante. L'amiante était par essence une matière de protection. Que l'on en ait abusé et qu'on l'ait par trop éparpillé, c'est sans doute vrai ; nous sommes prêts à renforcer tous les dispositifs nécessaires pour éviter que ce genre d'erreur se reproduise, à défaut de pouvoir réécrire l'histoire. Mais nous avons également une préoccupation : permettre à l'activité de ce pays de se développer. La difficulté tient précisément à la gestion de cette compatibilité entre le développement de l'activité et le respect de règles strictes garantissant l'intégrité physique de ceux qui travaillent. Nous sommes donc tout à fait concernés par ce dossier et nous souhaitons que l'on puisse progresser dans la voie d'une large concertation, pour définir des règles claires qui permettront aux chefs d'entreprise de connaître les limites à l'intérieur desquelles ils peuvent évoluer, ce qui n'est pas toujours facile pour eux. Nous avons parfois de sérieux problèmes en interne entre fabricants et utilisateurs car la problématique ne se résume pas au produit lui-même mais dépend aussi des conditions d'utilisation. De gros progrès ont déjà été réalisés en matière de prévention grâce à l'action conjointe des employeurs et des salariés. Il reste des marges de progrès considérables et nous y travaillons en permanence. Mais les technologies évoluent et le niveau d'exigence ne cesse de s'élever. De nouvelles pathologies d'ordre multifactoriel apparaissent. Ce ne sont pas des sujets simples et nous ne prétendons pas détenir la vérité absolue. Nous voulons seulement pouvoir en discuter dans une relative sérénité. Il ne sert à rien de jeter des anathèmes ou des accusations. Nous souhaitons qu'il se dégage du rapport de votre mission des informations claires qui permettront d'avancer positivement, en faisant la part des intérêts économiques, des intérêts de l'emploi mais également, et surtout, de la nécessité d'éradiquer tout risque de nocivité des nouveaux produits de substitution. M. le Président : Comptez sur nous pour dégager de nos travaux des orientations précises et claires. M. Dominique OLIVIER : Au-delà des critiques que j'ai exprimées tout à l'heure, je me félicite de la constitution de cette mission d'information, même si l'on peut regretter qu'elle n'ait pas pris la forme d'une véritable commission d'enquête. M. le Président : Pour avoir participé à de nombreuses commissions d'enquête, je considère que cette mission a des pouvoirs suffisants pour aller jusqu'au bout de sa démarche. M. Dominique OLIVIER : Elle peut effectivement produire le même résultat. Comme l'a dit mon camarade de la CGT, les enseignements de la catastrophe sanitaire de l'amiante n'ont pas été tirés. Première remarque : à la fin des années 70, l'interdiction des flocages d'amiante a eu un premier effet massif, à la mesure de leur utilisation, qui s'est immédiatement répercuté dans la consommation et les tonnages importés. Mais, restaient les utilisations courantes de l'amiante qui étaient tellement nombreuses que la réglementation de l'époque en perdait toute efficacité. L'extrême banalisation du produit et le montant considérable des tonnages utilisés Deuxième remarque de fond : depuis seulement quelques années, les stratégies de prévention sont fondées sur une évaluation a priori des risques. C'est une totale nouveauté, imposée par les instances européennes le 31 décembre 1991 - encore a-t-il fallu attendre le décret du 5 novembre 2001 pour rendre effectif le fameux document unique. Autrement dit, contrairement à ce qui se disait, on ne faisait pas, jusqu'alors, de prévention, ou plus exactement - expression paradoxale et contradictoire - on faisait de la prévention a posteriori : après avoir constaté des dégâts, sous forme d'accidents ou de maladies professionnelles, on se posait la question de savoir ce qu'il faudrait faire pour éviter qu'ils se reproduisent ! C'est parfaitement légitime, mais cela n'a rien à voir avec la prévention. La vraie prévention, c'est l'analyse de l'activité, la recherche des dangers potentiels, puis la définition de stratégies de prévention, à laquelle est venue s'ajouter depuis peu la notion de précaution. Face à l'amiante, la réglementation n'était pas la bonne et les bonnes décisions n'ont pas été prises, parce que les stratégies étaient dépassées et défaillantes. Avec l'évaluation a priori des risques, nous pouvons désormais espérer que cette expérience ne se renouvellera pas. Reste que les enseignements ne sont pas tirés et que, du côté patronal, on entend toujours les mêmes raisonnements. Nous connaissons bien les contraintes économiques et les contraintes de coûts : nous-mêmes, en tant que salariés, en sommes victimes. Mais le difficile débat sur REACH18 - la future réglementation européenne sur les substances chimiques - est significatif : le patronat reprend les mêmes arguments que pour l'amiante. « Cela va coûter cher, cela va perturber l'activité économique, cela va faire perdre des emplois, vous allez vous retrouver au chômage, on ne peut pas envisager l'interdiction de produits, etc. » On retrouve les mêmes raisonnements, alors que l'enjeu de REACH est autrement plus important et massif : il s'agit de savoir ce que nous allons faire devant non plus un seul, mais des dizaines de milliers de produits potentiellement dangereux. Si, au niveau de la stratégie globale, REACH est déjà mal engagé, imaginez ce qu'il en sera produit par produit ! Mon collègue a cité le cas du formaldéhyde ; s'agissant des éthers de glycol, les décisions d'interdiction n'ont toujours pas été prises pour les molécules les plus toxiques. Autrement dit, la question des stratégies de prévention et de l'évaluation a priori des risques reste d'actualité et l'affaire n'est en rien gagnée. Un mot sur le Comité permanent amiante. La CFDT ne regrette pas non plus d'y avoir participé, au moins lors de sa phase de lancement, car il aura réellement permis de développer l'information, la sensibilisation, et de s'engager dans la voie de la prévention. Malheureusement, après cette première phase, il s'est produit un mouvement de perversion et la CFDT regrette d'avoir poursuivi sa participation, car le CPA est peu à peu devenu un véritable lobby du maintien de l'usage contrôlé de l'amiante, ce dont nous ne nous sommes pas aperçus. Cette deuxième phase s'est effectivement révélée négative en ce qu'elle a retardé l'interdiction qui est finalement apparue comme la seule solution valable. M. Pierre THILLAUD : Une remarque préalable : pour les PME, la prévention, c'est avant tout la médecine du travail. Or, j'ai lu récemment qu'on fait le procès de la médecine du travail. C'est prendre le problème à l'envers car la médecine du travail dépend de l'expertise. En fait, toute l'approche historique de l'amiante renvoie à la question de l'expertise. Juger l'histoire, c'est juger l'expertise. Or, en histoire, il convient de se méfier d'un risque mortel : l'anachronisme. Juger le passé à l'aune du présent et de ses connaissances ne peut conduire qu'à de graves erreurs de jugement. En 1977, le CIRC inscrit l'amiante en catégorie 1. Notons que sont également classés dans cette catégorie le benzène, toujours présent dans nos réservoirs d'essence, la pilule contraceptive et les médicaments spécifiques à la ménopause... Autrement dit, l'étiquette ne saurait justifier l'histoire ni le danger, ni à plus forte raison engager les responsabilités. Quelqu'un a remarqué que l'Académie de médecine, à la veille de l'interdiction de l'amiante, continuait à prôner l'usage contrôlé moyennant le respect de certaines conditions... Sans parler de la réglementation, adoptée pour sa plus grande part dans cette enceinte même, qui invitait les citoyens, comme les entreprises, à utiliser l'amiante : tout le monde a en mémoire la dramatique catastrophe du lycée Pailleron, à la suite de laquelle l'usage de l'amiante a été systématiquement promu. Si donc l'on pense que l'histoire doit permettre de distribuer les responsabilités, évitons l'anachronisme et reconnaissons que tout le monde a sa part dans cette affaire. Vous avez auditionné, il y a deux jours, plusieurs professeurs de médecine du travail. Je vous invite à vous reporter au procès-verbal de cette fameuse réunion de la commission « maladies professionnelles » du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels qui, en 1995 ou 1996, avait engagé le processus de l'interdiction de l'amiante. Une des personnes auditionnées y faisait l'apologie de l'usage contrôlé. Ce n'est qu'au bout de trois heures d'âpres discussions qu'elle a changé d'avis et s'est résolument engagée en faveur de l'interdiction... Vous voyez à quel point ce procès de l'expertise est redoutable. Les entreprises, et particulièrement les plus petites, dépendent de l'expertise car celle-ci alimente la médecine du travail, seul vecteur de la prévention dans les PME. Comment faire pour que celles-ci puissent appliquer une réelle prévention en prenant un peu de champ vis-à-vis du problème de l'amiante ? C'est extrêmement difficile. Administrateur de l'INRS depuis plus de vingt ans, j'emplis les procès-verbaux de cette institution d'une demande pressante d'action spécifique envers les PME. Certes, l'INRS a ses qualités et ses défauts, d'ailleurs relevés dans une enquête de l'IGAS à laquelle je souscris largement. Reste que le nombre de petites et moyennes entreprises est un frein à la prévention et que si celle-ci se fonde sur des expertises trop fluctuantes ou opportunistes, on aboutit à une totale cacophonie. On a beau jeu ensuite d'accuser les PME d'ignorance. Le problème ne se pose pas en termes de responsabilité, mais en termes de capacité à synthétiser des connaissances, à les transmettre et à les diffuser à un nombre considérable de petites et moyennes entreprises. Vous revenez sur la question du Comité permanent amiante. On comprend, pour peu que l'on se garde de tout anachronisme, à quel point, au vu des circonstances de l'époque, ce comité était parfaitement à sa place. Rappelons que l'usage contrôlé de l'amiante existe encore dans bon nombre de pays, ce qui montre bien que personne ne peut se prévaloir d'une connaissance exacte, précise et définitive en matière d'amiante, et que certaines circonstances - sociales, culturelles, économiques - contribuent incontestablement à valider tel ou tel aspect de la connaissance de ce produit, pourtant à l'évidence dangereux. M. Bernard SALENGRO : Pour la CFE-CGC, la médecine du travail est à l'évidence le meilleur outil de prévention, en termes tant d'approche que de relais d'information et d'indépendance. Peut-être est-ce pour cela que l'on cherche à la déstabiliser. On parle souvent du rôle des partenaires sociaux dans le fonctionnement de la santé au travail. Or, quand les textes sont sortis, en plein été, les représentants du ministère ont proclamé urbi et orbi qu'ils avaient reçu l'accord des partenaires sociaux, alors qu'en Conseil supérieur des risques professionnels, les cinq organisations syndicales avaient quitté la salle - cela ne s'était jamais vu - lors de la présentation des textes. Malgré cela, pas un iota n'en a été changé. Et l'on ose parler de concertation ! On a ainsi mis au point un système déstabilisateur qui, en multipliant les trous dans le navire, vise délibérément à l'effritement du système. N'ayant pas eu la chance, ou la malchance, de siéger au CPA, je me suis renseigné et un médecin du travail de Normandie m'a raconté l'histoire qui suit. En 1985, un garagiste assez important avait des problèmes d'amiante et est venu les lui signaler. Il a bénéficié d'une aide technique du CPA pour monter un système d'aspiration. Cela mérite d'être salué. Mais lorsqu'il s'est adressé à la préfecture pour savoir où jeter les résidus, il n'a trouvé que des incompétents. Personne ne savait lui répondre, et il a fallu bricoler une solution avec le département d'à côté. Bref, le problème n'est pas simple et il faut se méfier des jugements trop rapides. Pour la CGC, la présence des partenaires sociaux dans la santé au travail est incontournable. Mais pas comme à l'heure actuelle, où ils ne servent que de prête-noms. Ils veulent des moyens et des responsabilités. M. Serge DUFOUR : Ces questions très conflictuelles sont évidemment sources de désaccords qu'il faudrait dépasser. S'il faut effectivement en finir avec les allégations sans fondements, on ne peut pour autant soupçonner la Cour des comptes d'être trustée par la CGT... Or, dans son rapport sur la sécurité sociale, celle-ci relève que les transferts des dépenses - qui normalement devraient relever du régime « accidents du travail - maladies professionnelles » (AT-MP) - vers le régime maladie ne cessent d'augmenter. Nous avons estimé qu'ils étaient de l'ordre de 15 milliards d'euros et personne n'ose nous démontrer qu'il pourrait en être autrement. Bien au contraire, la Cour des comptes nous apprend que les 330 millions d'euros reversés chaque année, sur proposition du Gouvernement, de la branche AT-MP vers la branche « régime général » couvrent à peine les frais d'hospitalisation liés aux AT-MP supportés par les budgets des hôpitaux... J'ai ici un document du groupe Arkema, qui est un véritable mode d'emploi pour contourner la réglementation en transférant les coûts des maladies professionnelles vers les comptes mutualisés - supportés pour l'essentiel par les petites et moyennes entreprises. Un autre - du groupe Coved - est un formulaire de renonciation, par le salarié, aux arrêts de travail que le médecin pourrait prescrire en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ce qui permet à l'employeur de diminuer le taux de gravité de l'accident ou de la maladie ! Les employeurs ne se cachent même plus pour contourner l'esprit du texte voté par le législateur en jouant sur le « consentement éclairé » instauré par la loi Kouchner sur les droits du patient. Et si le salarié ne renonce pas, on imagine ce qui peut se passer dans un contexte de précarité de l'emploi... On nous affirme également, avec une certaine audace, qu'il faut compter cinquante ans avant de constater une diminution mesurable de la gravité des choses. Mais on se garde bien d'expliquer que le CIRC, par exemple, a identifié 46 nouveaux produits cancérogènes qui ne sont toujours pas mentionnés sur les tableaux de maladies professionnelles... L'Institut de veille sanitaire a pourtant alerté les pouvoirs publics et le Conseil supérieur, nous-mêmes réclamons au Conseil supérieur et au ministre de travailler sur cette question ; or le plan « santé au travail » n'y fait même pas allusion... On a évoqué le projet REACH. Mais en février 2005, Mme Alliot-Marie, afin de pouvoir vendre des terrains militaires, n'avait-elle pas proposé de diminuer les exigences réglementaires du code du travail, et notamment les seuils d'exposition et de pollution ? On pourrait également évoquer le cas de l'Auvergne où de nombreux terrains amiantés correspondant à d'anciennes usines ont été livrés aux collectivités territoriales, simplement recouverts de trois ou quatre mètres de terre, alors qu'ils seront peut-être urbanisés - ce qui pose le problème de la préservation de la mémoire. On a également évoqué les produits de substitution et les enjeux de la recherche. L'épidémiologie est devenue la discipline reine en matière de prévention dans le domaine de la santé au travail. Malheureusement, l'épidémiologie consiste finalement à dénombrer les victimes - ce qui n'a rien à voir avec de la prévention a priori - et la formation des toxicologues n'est absolument pas à la hauteur des enjeux. Par ailleurs, les journaux ont raconté comment MM. Chirac, Blair et Schröder, sous la pression des lobbies de la chimie européenne et française, avaient écrit à M. Romano Prodi pour lui demander de limiter les exigences de REACH au motif qu'il ne fallait pas encombrer nos entreprises avec de la « paperasserie » ! C'est ainsi que l'on parle de la santé des salariés... L'expérience de l'amiante a également remis en cause la notion d'effets de seuil, autrement dit la réversibilité. Rien ne démontre, en effet, que l'exposition à un produit cancérogène n'aurait pas de conséquences au-dessous d'un certain niveau : le cancérologue Dominique Belpomme n'a-t-il pas souligné que l'un des plus grands dangers liés à l'exposition aux produits cancérogènes tenait justement aux micro-expositions chroniques ? Or où peut-on mieux parler d'expositions chroniques que sur le lieu de travail ? Dans le cas des éthers de glycol, et particulièrement des types E, les dernières mesures réglementaires visent à interdire à la consommation les produits dont le taux de concentration est supérieur à 0,5 %. On sait pourtant les efforts qu'ont déployés les organisations syndicales pour faire baisser les tonnages utilisés de ces produits Mais dans le milieu du travail, aucune disposition n'est prise, au motif qu'on y est mieux protégé ! Comment expliquer une telle aberration ? Parallèlement à la toxicologie, une nouvelle discipline scientifique mériterait à nos yeux d'être développée : l'expologie, c'est-à-dire l'étude a priori des expositions, emplois et usages des produits. L'INRS nous a annoncé qu'il avait stoppé l'étude relative aux fibres céramiques réfractaires au motif que les Caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) - en principe indépendantes et récipiendaires des déclarations des employeurs - ne communiquent pas les noms des entreprises concernées... On a alors beau jeu de considérer que l'échantillonnage n'est pas suffisant pour mener une étude suffisamment sérieuse ! M. le Président : Nous en prenons note. M. Jean PAOLI : Commençons par le début, c'est-à-dire par l'amiante. Je suis un des rares ici à avoir travaillé dans une entreprise utilisant de l'amiante - Eternit - pendant trente-huit ans. J'ai commencé à quatorze ans et j'ai cessé mon activité à cinquante-deux ans, grâce au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mis en place par le gouvernement Jospin. Je suis heureux d'avoir pu, avec mes camarades, bénéficier de ce dispositif, très attendu à l'époque. Il est certes plus facile de parler aujourd'hui, lorsque certaines questions ont trouvé des réponses. Mais pratiquement tout avait déjà été dit en 1977 avec les premières analyses du CIRC. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dès cette date, nous avions demandé l'interdiction de l'amiante. Reste qu'il faut se replacer dans le contexte de l'époque : nous avons travaillé l'amiante durant soixante-dix ans sans réglementation spécifique, dans le cadre dit de la « poussière totale », qui n'a rien à voir avec l'amiante et les matières fibreuses. La poussière totale se dépose, alors que les poussières d'amiante restent éternellement en suspension. En 1977 apparaît la première réglementation prévoyant un taux maximum de deux fibres par centimètre cube, hélas ni adaptée, ni respectée. Les contrôles d'empoussièrement étaient-ils réalisés par un organisme indépendant ? Non : par l'entreprise elle-même et ses services de contrôle interne. On communiquait, quand on le voulait bien, les résultats intéressants... Ajoutons qu'il n'existait pas de Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à l'époque. Les lois Auroux ont apporté, de ce point de vue, un progrès extraordinaire dans la prévention, même si une immense majorité des salariés continuent à travailler sans CHSCT. On sait que, pendant les « Trente Glorieuses », on travaillait n'importe comment. Il était interdit de parler de santé au travail. On en voit les effets aujourd'hui... On a fait le procès de la médecine du travail. Je suis membre de la commission consultative du département de Saône-et-Loire : 55 médecins, 135 000 salariés. Je pourrais vous montrer les rapports des médecins du travail, rapporter leurs réflexions, témoigner de leur mal-être. Et je parle d'aujourd'hui, pas d'il y a trente ans, époque à laquelle les médecins du travail n'existaient pas : il n'y avait alors que des généralistes, dont certains étaient payés par l'employeur... Les médecins du travail sont totalement dépassés par les réglementations qui leur arrivent de toutes parts, alors qu'ils n'ont ni le temps ni les moyens d'aller voir ce qu'il en est réellement sur le terrain. Il leur est impossible de visiter les plus petites entreprises. Dès lors Nous avons aujourd'hui des fibres de substitution - on a parlé des fibres céramiques réfractaires. Nous avons été les premiers à demander, dès 1995, une expertise collective sur les produits de substitution. Quel a été le résultat de l'analyse réalisée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ? « Il se pourrait que... Nous ne savons pas, nous n'avons pas suffisamment de recul ». Il faut savoir que les fibres céramiques réfractaires développement des mésothéliomes de la même façon que l'amiante ! Qu'a-t-on fait depuis ? Rien. Avec l'amiante, il est évident que nous avons pris trente ans de retard et c'est la raison pour laquelle nous allons continuer de payer pendant encore vingt ans. Je préférerais siéger ailleurs, dans un organisme de prévention, plutôt qu'au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) ! M. Caron a rappelé quelle était la problématique de l'industrie, d'abord centrée, en quelque sorte, sur le profit. Certains peuvent soutenir que, pendant trente ans, on ne savait pas. Mais aujourd'hui, nous savons tout de l'amiante. Comment se fait-il, alors, que les grands groupes industriels, et notamment français, implantés à l'étranger et particulièrement dans les pays en voie de développement, continuent à y faire ce qu'ils ont fait chez nous pendant soixante-dix ans ? Pourtant les produits de substitution à l'amiante-ciment, par exemple, existent bel et bien. M. Bernard CARON : Nous nous retrouvons une fois de plus dans le traditionnel procès en sorcellerie : on prend des éléments à droite et à gauche, on les amalgame et on bâtit une belle théorie dont le seul objectif est de démontrer le caractère odieux des employeurs qui, implacablement, asservissent leurs salariés... J'en ai l'habitude, même si je m'en lasse un peu. Nous ne sommes pas responsables de tout ce qui se passe dans le monde. Nous aimerions certainement que l'on applique dans toutes les entreprises de la planète les mêmes règles d'hygiène, de sécurité et de santé de travail que celles qui existent en France ! Non seulement ce serait un grand progrès, mais cela améliorerait beaucoup les conditions de la concurrence dans le contexte de la mondialisation car nos chefs d'entreprise doivent produire et vendre avant de pouvoir distribuer ce qu'ils ont gagné ! Nous n'aurions pas facturé 15 milliards d'euros supplémentaires à la branche AT, a-t-on entendu. Pourquoi pas 20, pourquoi pas 30 ? Pourquoi maintenir la branche ? Il y a une réglementation, nous essayons de l'appliquer. Si elle n'est pas bonne, qu'on la change, mais que l'on cesse de vouloir augmenter notre facture au motif qu'on la juge mauvaise ! Toute cette logique nous échappe. Nous sommes prêts, je le confirme, à assumer nos responsabilités, mais nous refusons d'être les victimes expiatoires de je ne sais quel procès. Nous agissons dans un cadre déterminé, conformément à l'intérêt général. Nous essayons de développer l'activité en France, nous continuerons à rester vigilants, mais nous ne reconnaissons pas notre action et notre responsabilité dans tout ce qui vient d'être décrit, même si c'est une tragédie dont nous assumons notre part. Il faut cesser d'essayer de nous faire croire qu'il existerait un procédé capable d'éradiquer tout risque et de faire régner la santé sur le monde ! Le docteur Pellet pourra vous apporter des éléments d'appréciation scientifiques. M. François PELLET : J'hésitais à prendre la parole, compte tenu du tour très politique que prenaient les discours... Je n'ai pour ma part aucun état d'âme vis-à-vis de l'amiante. Ancien médecin du travail, je n'accuse jamais la médecine du travail. J'ai été formé en 1976 à Grenoble par des équipes qui nous ont parfaitement enseigné les dangers de l'amiante. Sitôt que j'ai commencé à travailler sur le terrain, en 1977, je me suis mis à lutter contre l'amiante. Dès 1978-1979, je me suis retrouvé secrétaire général de la société des médecins du travail de Dauphiné/Savoie - 230 médecins - et nos colloques trimestriels comportaient déjà nombre d'interventions sur l'amiante. Ne mettons donc pas tous les médecins du travail dans le même sac. Si certains n'ont pas agi assez vite, pour des tas de raisons dont nous pourrions parfaitement discuter, d'autres ont agi. À partir de 1990, je suis devenu médecin-conseil d'un grand groupe français présent dans 35 pays. J'y ai partout fait supprimer l'amiante dès 1993, et les neuf éthers de glycol dangereux en 1999. Sur les fibres céramiques, j'ai fait, dans ces mêmes années, mettre au point des conduites de prévention analogues à celles de l'amiante. Je n'ai donc aucun état d'âme. Face à un tel désastre - dont nous sommes tous responsables -, nous devons nous attacher à comprendre pourquoi il est arrivé, au lieu de nous lancer des anathèmes. M. Paoli est remonté à 1977 - à juste raison, car c'était un peu confus auparavant - en disant, à propos du taux de deux fibres par centimètre cube, qu'il n'était ni adapté ni respecté. C'est effectivement un exemple dont nous pourrions parler. Avant 1977, les choses n'étaient pas très claires. Si Irving Selikoff a, le premier, mis en évidence le mésothéliome en 1964, la chose n'a été confirmée en toxicologie animale qu'en 1974 et le CIRC a rendu ses conclusions en 1977. Autrement dit, on ne peut parler de délais proprement exagérés. Tout au plus aurait-on pu gagner trois ans. Au niveau du cancer broncho-pulmonaire, l'affaire a été beaucoup plus compliquée. Certes, les premières démonstrations de Doll remontent à 1955, mais les premières publications sur les relations entre doses et effets n'apparaissent qu'en 1967 avec Enterline. De nombreux problèmes se sont ensuite posés avec les faibles doses d'exposition, voire les effets du tabac : Selikoff lui-même pensait que seuls les fumeurs étaient atteints. Aujourd'hui encore, bien des questions restent encore en suspens. En 1977 a donc été défini le seuil de deux fibres par centimètre cube. La France était-elle réellement en retard ? Certes, l'Angleterre avait été la première à arrêter, dès 1931, des valeurs limites d'exposition : mais n'oublions pas qu'elles étaient très hautes et destinées à prévenir la fibrose. Regardons ce qu'ont fait les États-Unis et l'ACGIH19, toujours très en avance : leur limite était également de deux fibres par centimètre cube en 1973, quatre ans seulement avant nous. Il est d'ailleurs à noter que les plus grands experts médicaux ayant mis en évidence ces pathologies et ce désastre sont, pour la plupart, Américains. Or les États-Unis ont interdit l'amiante en 1973 pour revenir plus ou moins sur cette décision en 1989. Qu'en est-il aujourd'hui ? Ils sont encore producteurs - 6 000 tonnes, dans une seule mine - et en importent 15 000 tonnes, estimant que certaines applications nécessitent toujours une utilisation très contrôlée de l'amiante. Le Canada a toujours maintenu une utilisation contrôlée et le rapport canadien sur l'expertise de l'INSERM n'était pas aussi critique qu'on le dit. S'il l'était, c'était sur quelques points précis. Les Canadiens ont un panel de scientifiques extraordinaires ; sont-ils vraiment tous des incompétents ? Entendons-nous bien : on a eu raison d'interdire en 1996 l'amiante, et sous ses deux formes. Mais de là à dire qu'il n'y a plus de problème, ce n'est pas vrai. On sait que la chrysotile, ou serpentine, ou amiante blanc, est trois fois moins cancérogène que l'amiante bleu. On le répète constamment, et dans beaucoup de publications scientifiques. L'Europe va d'ailleurs reprendre cette idée dans la fiche en cours de rédaction sur les maladies professionnelles liées à l'amiante. On peut donc comprendre qu'en 1977, le législateur, l'administration, le patronat et les syndicats, considérant que, à la différence de l'Angleterre qui utilisait de l'amiante bleu, la France se servait surtout de l'amiante blanc, le danger n'était finalement pas si grand. On le sait aujourd'hui, il était énorme. Mais ce n'était pas aussi évident à l'époque. Il en va exactement de même pour le cancer du poumon. On est loin d'avoir tout résolu pour ce qui touche aux basses doses d'exposition et aux risques encourus par les travailleurs. Il est toujours facile, trente à quarante ans après, de dire : « Les gens devaient savoir ». Mais ceux qui nous ont précédés dans le domaine de la prévention des risques industriels - ingénieurs, administrateurs, politiques - n'étaient pas plus sots que nous. Personne ne peut soutenir que toutes ces personnes sont à mettre dans le même panier et se désintéressaient du problème. Non, ils ne savaient pas. Patrick Brochart a eu raison de dire qu'il a fallu cinquante ans pour que ce dossier soit précis au niveau scientifique. Espérons que cela ira plus vite pour les fibres céramiques : qu'en sait-on exactement aujourd'hui ? Si l'on trouve des mésothéliomes chez le rat, aucune étude épidémiologique ne montre de pathologie cancéreuse chez l'homme. Mais peut-être le danger existe-t-il. Je pense, en tant que conseiller du MEDEF, que le patronat français doit appliquer le principe de précaution, qui n'existait pas il y a quelques années. Reste que, au niveau scientifique, on n'en sait pas davantage. M. Daniel BOGUET : Il serait injuste de parler des CRAM pour seulement relever un loupé. Non seulement les seize CRAM forment notre réseau avec les quatre Caisses générales de sécurité sociale (CGSS), mais elles sont au service de toutes les entreprises. Je sais que certains autour de cette table pensent que le meilleur moyen de rendre un entrepreneur vertueux, c'est de lui imposer des cotisations et de le sermonner... Dans les CRAM, nous sommes plusieurs à penser que la prévention peut également être comprise par les employeurs et je peux témoigner que les petites entreprises savent consulter leur CRAM, et les « préventeurs » pour les aider à concevoir un nouvel atelier ou un nouveau plan de circulation. Je suis également surpris d'entendre certains se plaindre de transferts, bien que je regrette aussi ces transferts : il arrive effectivement que l'argent des entreprises soit pillé pour alimenter le tonneau des Danaïdes. Mais pourquoi ne reprendrait-on pas les 9 milliards donnés à la SNCF pour rééquilibrer son régime spécial ? L'intervention de M. Paoli montre bien que la voix des victimes n'est pas exclue des préoccupations des employeurs en matière de santé au travail et de dialogue social. Avant d'être malades, ces victimes étaient des salariés. C'est pourquoi nous sommes attachés au paritarisme intégral qu'un certain personnage, devenu depuis commissaire européen aux transports, avait souhaité remettre en cause pour des raisons qui lui sont propres. Je persiste à penser que le paritarisme intégral devra sans doute être réaffirmé, mais que, au-delà des commodités de circonstances, les organisations syndicales - salariés et patronat - sont les plus à même de nourrir la réflexion de cette honorable assemblée. M. le Président : Premièrement, il est parfaitement normal que ces tables rondes donnent lieu à des propos parfois relativement vifs. Cela ne pose aucun problème et M. Caron lui-même reconnaît en avoir l'habitude. Deuxièmement, le rôle de cette mission n'est pas d'arrêter une vision « politique » - le mot a été utilisé et il recouvre pour moi une signification très noble et importante -, mais d'explorer le passé afin de voir où nous en sommes à propos de l'amiante et aussi de réfléchir à l'amélioration des systèmes de prévention à propos d'autres produits. J'ajoute, monsieur Pellet, que personne n'a mis en cause la médecine du travail. Nous nous sommes simplement bornés à constater l'insuffisance des moyens et du rôle de la médecine du travail, constat sur lequel nous devrions pouvoir nous retrouver. M. Serge DUFOUR : La seule mise en cause portait sur ceux qui la gèrent ! M. le Président : Soit ! M. le Président : Les deux thèmes de notre table ronde ont été quelque peu mélangés - c'était à peu près inévitable et, allais-je dire, presque habituel. Durant la première partie, vous vous êtes exprimés avec la plus grande liberté en des termes parfois un peu durs : cela aussi fait partie du dialogue. Nous ne manquerons pas d'entendre d'autres structures qui jouent un rôle essentiel dans le domaine de la santé du travail : la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), la médecine du travail, l'INRS, l'Institut de veille sanitaire (IVS), la nouvelle Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET), ainsi, bien entendu, que l'administration compétente. La deuxième partie de cette table ronde sera donc l'occasion de déterminer la place que prennent les partenaires sociaux dans la gestion de la santé au travail. Vous l'avez déjà un peu évoquée, mais j'aimerais que nous allions un peu plus loin. M. le Rapporteur : La création, en 2003-2004, du groupe d'études parlementaire sur l'amiante, le premier jamais créé à l'Assemblée nationale, a eu pour conséquence la constitution d'une mission d'information au Sénat, puis ici même, ce qui nous donne aujourd'hui l'occasion de parler avec vous du passé et du présent, afin de préparer l'avenir. Certains d'entre vous ont participé au Comité permanent amiante. Nous avons compris, au fil des auditions, qu'il fallait nous méfier du manichéisme et de la simplification excessive. Vous avez, comme nous, lu des ouvrages « grand public » sur l'amiante. Il est facile de se faire beaucoup d'argent en écrivant des articles ou des livres sur le thème du « tous pourris » et en fustigeant ceux qui ont siégé au CPA. Vous avez clairement montré ce matin ce qu'étaient les conditions de travail de l'époque, les problèmes de l'emploi et la difficulté à prendre certains risques en compte. Il n'est pas question de minimiser les responsabilités, ni d'oublier le passé, encore moins de l'utiliser pour lancer je ne sais quelle chasse aux sorcières. Certes, les mesures ont été prises trop tardivement ; certes, les choses ont parfois traîné ; acceptons l'héritage et reconnaissons que, administration et élus, nous n'avons pas été bons dans cette affaire. Il faut maintenant en tirer les conséquences. M. Serge DUFOUR : Je vais satisfaire la demande du Rapporteur en évitant le manichéisme, mais force est de remarquer certains glissements sémantiques préoccupants. « La prévention est de la responsabilité de l'employeur », a dit M. Boguet. Non. La prévention est de la responsabilité de tous les acteurs. En revanche, la mise en œuvre des mesures de prévention est de la responsabilité exclusive de l'employeur. Pourquoi ce rappel ? Lors du congrès mondial de la santé et de la sécurité des travailleurs, je me souviens avoir vu un jeune étudiant paraguayen interpeller la tribune en ces termes : « Tout ce que vous interdisez dans les pays développés, c'est très bien, mais pourquoi vos groupes viennent-ils le faire chez nous ? » Et toutes les institutions internationales - OIT, BIT - et gouvernements présents de lui répondre que cela ne devait pas se produire... Telle est pourtant bien la réalité. Un des dangers de la globalisation et des délocalisations qui en découlent tient précisément à ce transfert des risques, alors même qu'ils ne sont pas encore entièrement supprimés sur nos propres territoires. On parle de « chasses aux sorcières » ; n'oublions pas que les victimes sont d'abord ceux qui ont été exposés à l'amiante et dont nous sommes les représentants légitimes ! C'est en leur nom, et seulement en leur nom, que nous nous exprimons ici, au nom de tous ces travailleurs exposés, de ceux qui ont été atteints dans leurs chairs, de ceux qui en sont morts, de leurs familles. Voilà notre légitimité et tout le sens de notre parole. Mais venons-en au présent et aux rapports sociaux. Que sont les rapports sociaux dans l'entreprise ? Le droit du travail donne à l'employeur l'exclusivité de l'organisation du travail et le droit disciplinaire, et au salarié l'obligation de s'y soumettre. Ce n'est pas le salarié qui offre le risque : on l'expose au risque. Or, du fait que le paritarisme leur reconnaît 50 % des places dans les institutions de prévention, les employeurs continuent, de fait, à exercer leur domination sur l'ensemble du réseau. C'est comme si l'on confiait tout à la fois la boîte d'allumettes et la lance d'incendie au pyromane ! Il faut inverser cette logique. La prévention suppose d'abord l'esprit critique, et c'est un des enseignements fondamentaux que l'on devrait tirer de cette affaire. Critiquer ne signifie pas détruire, mais analyser l'environnement c'est permettre aux représentants des salariés, victimes potentielles, d'occuper pleinement leur place. Vous avez évoqué à juste titre, M. le Président, la mise en opposition de l'emploi et de la santé. Les exemples ne manquent pas, et celui de Metaleurop est à cet égard tout à fait révélateur. La loi du 4 mai 2004 prévoit des dérogations, mais n'exclut pas les enjeux de santé au travail du champ des négociations dérogatoires. Et c'est ainsi que les salariés des abattoirs Doux, en Bretagne, ont accepté de travailler pendant 36 heures et de perdre des jours de congé dans une entreprise où les salariés tombent comme des mouches... Le choix est simple : accepter de travailler davantage, payé sur la base de trente-cinq heures, ou perdre son emploi ! Nous proposons que le domaine de la santé soit exclu du champ de la négociation dérogatoire instauré par la loi du 4 mai. Personne n'a effectivement critiqué les médecins du travail mais la question est de savoir dans quelles conditions ils exercent leur art : lors de la mise en place du plan « santé au travail », M. Douste-Blazy, ministre de la santé, alors que M. Larcher qui préside le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels se félicitait de l'action des médecins du travail, son collègue de la santé, trois jours auparavant, avait réduit de 76 à 10 le nombre de médecins devant sortir des formations ! Certes, le nombre est repassé depuis à 56, mais on sait pertinemment que 5 000 médecins du travail viendront, en raison du déficit démographique, à manquer d'ici peu : à raison de 56 par an, il faudra un siècle pour résorber le manque ! Il nous faut une véritable réforme de la médecine du travail. Des propositions ont été faites, concrètes et précises. Il faut avancer dans cette direction et donner les moyens nécessaires. Tout le monde répète que le médecin du travail est le pivot de la prévention. Pour notre part, même si nous ne partageons pas tout à fait cet avis, nous pensons qu'il en est un maillon essentiel. Or la mise en place de la pluridisciplinarité, loin de conduire à une véritable coopération, se traduit finalement par une mise en concurrence de plusieurs disciplines sur des périmètres mal définis... Le médecin du travail est le seul à être soumis, en plus du secret médical, à un code déontologique. Que demande-t-on aux nouveaux arrivants ? Une déclaration sur l'honneur attestant de leur indépendance ! Ce n'est même plus au patronat de garantir qu'il ne fera pas pression sur ce professionnel, mais au professionnel de garantir qu'il saura résister à cette pression ! Tout est organisé de façon à empêcher chaque partie prenante de jouer son rôle dans l'organisation de la prévention. Passons sur la constitution de ces groupements d'intérêt économique (GIE), en Franche-Comté ou en Bretagne, qui permettent aux entreprises de contourner la loi et de cotiser à la médecine du travail en fonction non plus de leurs effectifs, mais du nombre de visites médicales et de certificats d'aptitude ! De ce fait, les GIE échappent totalement au contrôle social, le seul qui permette de vérifier que les choses se déroulent correctement. Nous ne demandons pas d'exclure le patronat de la gestion des services de prévention - il doit aussi se rendre compte des dégâts qu'il provoque et prendre les mesures appropriées -, mais nous souhaitons rétablir, au profit des salariés, l'équilibre dans l'entreprise, où jusqu'à présent le patron décide de tout et détient le pouvoir disciplinaire. M. le Président : Nous attendons une analyse, la plus fine possible, du rôle des partenaires sociaux : essayez de présenter des propositions dont nous pourrions nous inspirer. M. Serge DUFOUR : Vous avez bien compris que je proposais de revenir à une répartition « deux tiers salariés / un tiers patrons », autrement dit aux ordonnances de 1947 ! M. Bernard SALENGRO : Je ne reviendrai pas sur les dysfonctionnements induits par les nouveaux textes, qu'il s'agisse des « Intervenants en prévention des risques professionnels » (IPRP) ou des GIE qui se créent à droite et à gauche pour contourner les règles et l'agrément des services déconcentrés de l'État. C'est ainsi qu'on s'est amusé, en Franche-Comté, à décompter à la minute la prestation du médecin de travail et à l'évaluer par rapport à la démarche de l'entreprise... L'effet comptable ainsi créé est un parfait antidote ! Que dire également du détournement de l'accès aux systèmes informatiques à Toulon ou à Pau ? L'affaire, actuellement entre les mains de la justice, avance avec une lenteur désespérante... Pour notre part, nous réclamons un système de médecine du travail où le contradictoire garantirait l'indispensable visibilité et la transparence. Le « contradictoire » est une notion de droit qui doit s'appliquer également au social : sans ce « contradictoire social » garantissant l'équilibre entre les employeurs et les salariés, les premiers apportant leur investissement, les seconds leur peau, aucun contrôle sérieux ne sera possible. La médecine du travail appelle une gestion non seulement paritaire, mais également coordonnée, et si possible nationale, afin de pouvoir développer des moyens, des associations de moyens, des spécialisations et des équipes pluridisciplinaires exemptes de ces méfiances, et a priori légitimes, que l'on retrouve avec les IPRP, construits de façon totalement perverse pour les opposer à la médecine du travail. Or, actuellement, si un médecin du travail s'occupe d'une entreprise de désamiantage située à Marseille, mais dont tous les chantiers sont à Paris, il n'aura ni l'autorisation ni les moyens de suivre les chantiers à Paris, alors même qu'il est responsable des plans de prévention et de leur suivi... Il se retrouvera fatalement en contradiction avec les obligations que lui assigne la loi. D'où la nécessité incontournable d'une structure nationale coordonnée et paritaire. Nous revenons d'un congrès sur la santé au travail. La plupart des institutions internationales évaluent l'impact des conditions de travail à 3 % au moins du Produit intérieur brut (PIB). Je me suis amusé à comparer les chiffres - PIB, branche AT, CNAM - pour l'année 2002. L'AT représente 8,5 milliards d'euros, la branche maladie 125 milliards d'euros, et 3 % d'un PIB de 1 520 milliards d'euros, 45 milliards d'euros... Cherchez l'erreur ! Cela rejoint une découverte que j'avais faite lorsque je siégeais aux instances nationales de la CGC, à l'occasion d'une circulaire élaborée par les voyageurs-représentants-placiers (VRP). Ceux-ci avaient calculé qu'ils perdaient énormément en déclarant un accident de la route comme accident du travail : une indemnisation d'accident avec tiers identifié est, en effet, beaucoup plus intéressante car le préjudice est évalué sur la base du salaire plein, sans être divisé par deux, sans révision au bout de deux ans et il intègre le préjudice esthétique, le praetium doloris, etc. La différence est considérable : de un à quatre. J'ai appelé les employeurs à renégocier au plus vite cette affaire, avant qu'elle ne tombe dans la main du juge car la réparation intégrale en droit civil coûte énormément, sans parler des avocats pour lesquels l'enjeu ne sera pas gagnant/gagnant ! Une négociation s'impose de toute urgence, à moins que le législateur ne s'en mêle. Mais une procédure gagnant/gagnant ne peut se concevoir que dans la mesure où nous en avons les moyens et seulement si nous avons la responsabilité du système. Si c'est pour faire le prête-nom, comme actuellement, c'est inutile. M. Pierre THILLAUD : M. le Président, vous avez très justement souligné en début de réunion qu'il fallait distinguer l'évaluation et la gestion des risques. Mais il convient de séparer tout aussi nettement la prévention de la réparation des risques professionnels. Cette association, tout à fait spécifique à la France, est certes un moyen de favoriser la réparation, mais elle est dommageable pour la prévention. Depuis vingt-cinq ans que je siège au Conseil supérieur, j'ai l'impression que la réparation est l'objectif principal - à preuve, la façon dont sont conçus les tableaux de maladies professionnelles. Remarquons au passage qu'à peine 10 % des tableaux représentent 90 % de la réparation : autrement doit, 90 % de tableaux n'existent qu'à titre botanique, historique ou scientifique ! Souvent, on établit un tableau, qui vise à la réparation, dans le seul but préventif de prévenir les assurés de la réparation... Cette déviation est typique de notre système de prévention français, axé d'abord sur la réparation. Au demeurant, toute la dialectique que nous venons d'entendre, ici même, au sujet de la prévention montre bien que l'on cherche à réparer avant de prévenir. Nous sommes les seuls en Europe à agir ainsi : les pays anglo-saxons et les autres pays européens font d'abord de la prévention et n'engagent qu'accessoirement, après constat d'échec, un processus de réparation le plus souvent fondé sur l'expertise individuelle. On parle souvent d'expertise indépendante. Ne nous leurrons pas : l'indépendance de l'expertise n'existe pas et le seul moyen d'y tendre est de faire en sorte qu'elle soit plurielle et contradictoire. Peut-on imaginer que l'indépendance soit acquise au motif qu'elle a été confiée à un institut public ? Le statut public garantit peut-être la sécurité de l'état et le bien-être de la personne, mais en aucun cas l'indépendance d'esprit ! Avant-hier encore, au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels, dans le cadre de l'application du « Plan santé au travail » 2005-2009, M. Combrexelle est venu nous présenter une expérimentation visant à garantir l'indépendance en sortant les partenaires sociaux de l'action d'expertise, confiée au seul IVS ! En France, ce qui est vertueux ne saurait être que public... Autrefois, on considérait que les choses publiques étaient celles qui manquaient le plus de vertu ! Les partenaires sociaux ont été unanimes à s'élever contre leur exclusion de l'expertise, fondement de l'analyse. N'oublions pas que la réparation est avant tout un compromis social, fondé sur une présomption d'origine, laquelle ne peut être issue que d'un consensus ou, à tout le moins, d'une discussion plurielle contradictoire. La pire des choses serait de s'en remettre à un organisme qui, au motif qu'il serait public et de ce fait présupposé indépendant, écarterait les partenaires sociaux de l'appréhension de la réparation. Il y a quelques mois, l'INSERM a produit une évaluation des traitements en psychothérapie : après intervention du lobby des psychanalystes, le ministre a fait expurger comme il se devait les conclusions parfaitement indépendantes de cet institut public ! Quant à la réforme de la médecine du travail, elle ne répond pas à une volonté politique, mais à une exigence démographique. Depuis 1984, nous n'avons plus assez de médecins du travail ; depuis 2000, nous savons que nous n'aurons plus jamais assez de spécialistes médicaux, quelle que soit la spécialité. Pour les PME, il est très satisfaisant de savoir qu'aux côtés des médecins du travail viennent s'associer des compétences techniques qui les aideront à appliquer des mesures de prévention. La réforme de la médecine du travail leur apporte à cet égard une réponse satisfaisante. M. Dominique de CALAN : Pour commencer, je n'ai pas la compétence de mes collègues représentants syndicaux ou patronaux, mais j'ai toutefois la responsabilité d'avoir été un des négociateurs du « Plan santé au travail »... Je peux donc répondre précisément à votre question sur le rôle des partenaires sociaux dans la prévention : au nom de l'ensemble des signataires de l'accord national sur la santé au travail, je puis vous dire notre conviction qu'il n'y aura pas de prévention sans négociation. Nous avons 2 600 pages de règlements mais la prévention dans l'entreprise, c'est au quotidien. Cet accord, qui a donné lieu à des mois de négociations, a déjà commencé à porter concrètement ses fruits au moment de la déclinaison des accords cadres dans les branches. Ainsi le bâtiment a, en matière de formation et de prévention, mis en place des qualifications professionnelles. La métallurgie vient de mettre en place, dans un cadre paritaire, un système permettant d'améliorer l'intervention des entreprises extérieures sur le site de leurs clients. Par ailleurs, la métallurgie vient de créer un certificat de qualification professionnelle dans le domaine de la sécurité et de l'environnement. La prévention repose d'abord sur la négociation, et la négociation, c'est d'abord les partenaires sociaux. Ce serait une erreur fondamentale de retourner à nos vieux démons. La réglementation - 2 600 pages - est le plus souvent inconnue de la quasi-totalité des chefs d'entreprises. Et dans les petites entreprises, ceux-ci sont tout aussi exposés que leurs salariés. Je ne connais pas de réparateur automobile qui ne soit pas avec ses compagnons ; il est d'ailleurs souvent compagnon lui-même. Non seulement les partenaires sociaux ont à jouer un rôle important dans la prévention, mais il faut encore le renforcer, notamment par des accords, quitte à les soumettre à un contrôle de légalité. Tout cela est en discussion. Deuxièmement, dans l'accord « santé au travail », nous avons appelé l'attention des partenaires sociaux sur cette évidence : ces problèmes deviennent tellement complexes qu'ils sont forcément pluridisciplinaires. Dès lors, on ne saurait les confier à une seule catégorie, médecins ou autres, aussi compétente soit-elle. Sans ingénieurs connaissant les machines, sans ergonomes, on ne peut faire de prévention. La formation est également partie prenante. Aussi avons-nous réclamé cette pluridisciplinarité dans l'accord sur la santé au travail. Troisièmement, lorsque la prévention n'est pas tout à fait opérationnelle, se pose le problème de la réparation. Nous allons entamer une négociation sur la question du choix entre réparation intégrale et réparation forfaitaire. Rappelons que, dans le cas d'une réparation forfaitaire automatique, l'éventuelle responsabilité ou coresponsabilité n'est pas recherchée, sauf faute inexcusable ou intentionnelle. Veut-on entrer dans un système où, contraint par les assureurs ou par la réglementation, la responsabilité civile des uns et des autres serait systématiquement recherchée devant les tribunaux ? On imagine les conséquences sur les délais d'indemnisation, le caractère juste ou injuste de la décision, selon que l'on aura ou non pris un bon avocat, et surtout sur le problème de la détermination de la coresponsabilité : il n'est qu'à lire certains rapports d'experts... Si nous ne nous entendons pas pour maintenir, en le clarifiant et en l'améliorant, l'actuel système de réparation, nous tomberons dans les travers d'un système judiciaire à l'anglo-saxonne que nous dénonçons par ailleurs. Autrement dit : premièrement, pas de prévention sans négociation et rôle renforcé des partenaires sociaux ; deuxièmement, nécessité d'une expertise indépendante, pluridisciplinaire et contradictoire ; troisièmement, choix entre la réparation intégrale et la réparation forfaitaire, cette dernière m'apparaissant plus juste, plus rationnelle et plus rapide, quitte à l'améliorer et à l'aménager au besoin. M. Daniel BOGUET : Le système de la caisse accidents du travail (CAT) n'est certes pas parfait. Mais la CAT a pris ses responsabilités dans l'affaire Metaleurop, comme elle les a prises dans les Chantiers de l'Atlantique. Sur les orientations à moyen terme et sur la convention d'objectif et de gestion, les partenaires sociaux ont tous pris leurs responsabilités. Par ailleurs, j'aimerais - je le dis le plus poliment possible - que la politique soit réservée aux élus et que les fonctionnaires dans les coulisses s'en tiennent à l'application, quelles que soient les alternances. Enfin, arrêtons de faire croire que la CAT serait sous les fourches caudines du patronat. Il nous arrive même quelquefois d'entendre parfaitement ce que nous disent nos camarades des organisations syndicales... Reste que l'UPA va là où on veut bien l'inviter - pas autant que nous le souhaiterions, mais ce serait encore pire avec le « un tiers/deux tiers » de M. Dufour ! Nous siégeons dans toutes les instances liées aux risques, à l'exception du conseil d'administration de l'INRS où nous siégeons sous un mandat MEDEF - mais il n'y a qu'une lame de couteau entre nous, en épaisseur s'entend... M. le Président : Je commençais à m'inquiéter ! M. Daniel BOGUET : On critique beaucoup l'INRS. Pourtant, cette institution, financée à 93 % par le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, fait un travail formidable. Je n'ai rien contre l'IVS, mais j'aurais aimé qu'il fasse son travail au moment de la canicule au lieu de chercher d'autres parts de marché... L'UPA tient à ce que l'hygiène et la sécurité au travail ne dépendent pas de la taille de l'entreprise. Nous ne sommes pas plus malins que d'autres et nous avons besoin d'être conseillés. Le dialogue dans les entreprises artisanales est quelque chose de très important, et même si nous respectons les permanents des organisations syndicales en trois ou cinq lettres, nous préférerions avoir affaire à des compagnons de chez nous, qui connaissent le métier, quelle que soit leur organisation syndicale. Nous n'avons pas été consultés sur le « Plan santé au travail » et nous l'avons regretté. M. Dufour a raison lorsqu'il dit que l'argent de la CAT ne doit pas aller ailleurs : il devrait être utilisé à la prévention. Je crois sincèrement à l'autonomie de la branche - je n'ai pas parlé d'indépendance - et je me doute bien que certains ici se méfient d'une autonomie. M. Franck URBANIAK : Certaines questions auraient mérité de figurer dans votre questionnaire, sur le rôle des partenaires sociaux dans la concertation avec les pouvoirs publics : si nous avons tous dévié ce matin vers les thèmes de la santé au travail et de la médecine du travail, c'est sans doute parce que nous ne sommes pas toujours écoutés lorsque nous en parlons dans d'autres instances... Depuis des années, nous sommes consultés sur des projets de réglementations, mais nos propositions ne sont jamais reprises. On a beau jeu, alors, de reprocher aux partenaires sociaux de ne rien faire : à quoi sert-il de multiplier les groupes ad hoc et les prétendues consultations des partenaires sociaux si leurs avis ne changent strictement rien ? La question de la place qu'on veut leur laisser dans ces instances mérite d'être posée. Ne vous étonnez pas, dès lors, que nous soyons particulièrement attachés aux institutions paritaires de la sécurité sociale : au moins, nous arrivons à y faire quelque chose... Les pouvoirs publics ont pris l'habitude de critiquer l'action de la branche AT-MP, mais qu'ont-ils fait de leur côté ? Les seules statistiques disponibles sont celles de l'AT-MP ! Les pouvoirs publics n'ont jamais produit que des enquêtes sur échantillons, autrement plus éloignées de la réalité. Existe-t-il un institut de recherche public spécifiquement dédié à la santé au travail ? Non. Pourtant, on aurait pu le créer depuis des années... Les partenaires sociaux ont avancé beaucoup plus vite dans le cadre du système paritaire que les pouvoirs publics. Nous sommes donc particulièrement attachés à la branche AT-MP et au fonctionnement de l'INRS. L'expertise publique a au moins un intérêt : celui de prouver que l'État s'intéresse déjà à la question. Mais à ne pas prendre en compte la demande sociale, on risque fort d'échouer sur le plan de la santé au travail. Les questions scientifiques doivent être débattues au regard des nécessités et des réalités de terrains. Or qui peut mieux les appréhender que les partenaires sociaux ? On en reste, sinon, à une recherche fondamentale sans grand intérêt dans le domaine qui nous préoccupe. Que pensons-nous des structures publiques de contrôle ou de recherche ? Pour ce qui est de l'inspection du travail, nous sommes très favorables au développement d'une réglementation qui puisse être mise en pratique. Or l'affaire de l'amiante est un bon exemple de réglementations jamais appliquées. Le Gouvernement nous a consultés à nouveau sur l'amiante en 2000, après s'être aperçu qu'il n'avait pris aucune mesure pour interdire l'amiante dans certaines pièces d'automobiles, trois ans après l'avoir officiellement interdit ! Produire une réglementation, c'est bien, en assurer le suivi, c'est mieux, mais en assurer l'application, c'est l'idéal... Un mot sur l'IVS. On oppose souvent les vertus de l'épidémiologie à la prévention classique que pratique l'INRS. Or le rôle de l'IVS se limite au décompte des victimes ce qui n'est pas la meilleure façon d'appréhender le risque professionnel. Construire le système français de prévention des risques professionnels autour de l'épidémiologie serait donc une erreur fondamentale. Ce serait abandonner toute idée de prévention des risques professionnels, alors que cela nous est présenté comme une solution miracle : il est effectivement beaucoup plus facile de tenir un décompte des victimes au niveau national que de faire de la véritable prévention d'entreprise. Mais cela suppose de consacrer, au niveau du terrain, les moyens nécessaires. M. Dominique OLIVIER : Quelle doit être la place des partenaires sociaux dans les actions préventives ? Nous devons réfléchir à une articulation complexe et la plus intelligente possible entre les initiatives issues du paritarisme, du dialogue social, et les prérogatives de l'autorité publique. Il nous paraît légitime que la puissance publique se dote d'un outil à même d'éclairer certaines problématiques, de produire des connaissances, de développer la recherche et d'aider à l'expertise, puisqu'il lui revient d'édicter les lois et les règlements garantissant la protection de la santé au travail et de la santé tout court. Mais cette connaissance des risques théoriques devant être confrontée aux réalités du terrain et du travail, le paritarisme doit jouer tout son rôle pour créer une dynamique sociale de prévention. Cela suppose que chacun, partie patronale et partie syndicale, motive ses troupes, afin que les acteurs de terrain - management, direction de l'entreprise et salariés - soient réellement impliqués dans l'action préventive, sans pour autant confondre les rôles ni oublier la responsabilité particulière de l'employeur. Voilà pourquoi nous tenons à préserver le paritarisme de la sécurité sociale et particulièrement de la branche AT-MP. Pour autant, le paritarisme ne doit pas conduire à l'inaction ou à un phénomène de neutralisation à 50/50 en cas de désaccord. Nous proposerons, lors de la négociation sur la gouvernance des AT-MP, qu'une possibilité d'arbitrage soit mise en place en cas de blocage, à l'exemple de ce qui se pratique avec l'échevinage chez les prud'hommes où, en cas de désaccord, on recourt à un juge professionnel pour trancher la question. Dans le cas des AT-MP, on pourrait faire appel à l'un des deux ministères de tutelle, Santé ou Travail, pour arbitrer entre les thèses en présence. Nous sommes également préoccupés par la complexité et la lourdeur de la réglementation. Les principes fondés sur la hiérarchie des principes de prévention, la mise en avant de l'évaluation a priori des risques et tout de qui en découle, comme le propose l'Europe, nous paraît de nature à faire face à toutes les situations. Les réglementions dont nous disposions jusqu'à présent ne sont que des réponses ponctuelles à des problèmes ponctuels qui pourraient tous entrer dans le cadre de ces grands principes, pour peu que tout le monde soit d'accord pour s'y conformer. Mais cela peut être lourd de conséquences : ainsi, faudra-t-il examiner l'éventuelle toxicité d'une gaine de ventilation, comme on me le demandait lors d'une récente émission de radio ? Sous-entendu, une réglementation l'impose-t-elle ? La question ne se pose pas. Si l'on soupçonne un risque d'intoxication, celui-ci doit immédiatement être évalué et les mesures de prévention prises. Or tout le monde reste sur les vieux schémas : tout problème exige une réglementation pour y répondre. Cette conception est totalement dépassée. Nous insistons surtout sur l'implication participative des salariés dans l'action préventive. Ainsi, les documents uniques d'évaluation des risques doivent être élaborés, conformément à l'excellente circulaire du 18 avril 2002 qui décrit sur vingt pages un dispositif participatif mettant à contribution les opérateurs eux-mêmes. Pour ce qui concerne les TPE-PME, nous appelons le législateur à répondre à la carence constatée en institutions représentatives : il n'existe pas de CHSCT dans les PME de moins de cinquante salariés, ni même de délégué du personnel. Autrement dit, la moitié des salariés n'ont pas d'institutions représentatives du personnel pour défendre leur santé au travail. Conscients que l'acharnement thérapeutique ne sert à rien et que jamais il ne pourra y avoir de CHSCT dans ces petites structures, nous demandons la mise en place de commissions paritaires sectorielles et territoriales de la santé au travail, organisées par profession et par unité géographique. Ce schéma n'est pas totalement utopique. Il existe déjà en France dans la production agricole. Sans même parler des pays nordiques, l'Italie et l'Espagne se sont engagées dans cette voie. Quelques mots sur la réparation intégrale. La CFDT a, quant à elle, fait le choix M. Dominique de CALAN : Je préfère la deuxième expression : elle est plus claire ! M. Dominique OLIVIER : Mais la première est plus ambitieuse ! C'est une question de réglage de curseur, dont nous sommes prêts à discuter. Mettons à l'écart la réparation « intégrale intégriste » : non seulement la sécurité sociale ne sait pas faire, mais le souci d'assurer une certaine rapidité au versement de la prestation à la victime pousse à privilégier des cotes mal taillées. Il devrait y avoir une base pour avancer ensemble sur cette question entre partenaires sociaux - avec sans doute un arbitrage des pouvoirs publics dans la mesure où le traitement équitable des victimes du travail est aussi un problème de société. Nous n'ignorons pas non plus que se pose le problème de la responsabilité du salarié. Nous souhaitons que la réparation intégrale sur la base de forfaits ne mette pas en cause la présomption d'imputabilité. Et nous sommes également conscients que se pose un problème pour la partie patronale du fait que l'application systématique de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la faute inexcusable risque de mettre à mal le principe de l'immunité civile de l'employeur. Le nouveau compromis à bâtir, qui succédera à celui de 1898, devra garantir l'équilibre entre quatre axes de tension : la présomption d'imputabilité, une réparation optimisée pour les victimes, une faute inexcusable redéfinie et la restauration de l'immunité civile de l'employeur, dans la mesure où il aura déjà payé tous les dégâts. S'agissant enfin de l'autonomie de la caisse AT-MP. Nous n'avons pas encore tout à fait arrêté nos choix. S'agira-t-il d'une caisse autonome avec un très fort lien conventionnel avec la caisse d'assurance maladie ou, toujours, d'une commission de l'assurance maladie, dotée d'une très forte autonomie ? Aux techniciens et aux juristes de mettre au point les meilleures garanties pour toutes les parties en cause. M. le Président : Vous êtes allé encore beaucoup plus loin que le sujet de notre table ronde, pourtant très vaste... Le mot d'évaluation contradictoire a été utilisé et M. Thillaud en a apporté une définition très précise. Suscite-t-elle des réactions ? M. Serge DUFOUR : Nous partageons évidemment toute la première partie des propos de M. Thillaud - le fait n'est pas banal ! M. le Président : Nous le notons ! M. Pierre THILLAUD : Mais cela devient de plus en plus fréquent ! M. Serge DUFOUR : Pour ce qui concerne la question de l'autonomie de la branche, je pourrais prendre plusieurs exemples, dont celui d'AZF : fondamentalement, la santé au travail est pour nous un élément structurant de la santé publique. Nous souscrivons à l'idée d'un lien étroit entre la branche AT-MP et la branche maladie. Davantage d'autonomie ? Dans tous les cas, les partenaires sociaux devront y être en mesure de mener leur barque. À ce propos, je tiens, alors que votre Assemblée sera bientôt saisie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, à appeler votre attention sur le fait que la branche AT-MP doit systématiquement être en équilibre, les recettes étant calculées sur les dépenses. Or, depuis quatre ans, le Gouvernement vous propose une mise en déficit artificielle et totalement scandaleuse. Cela m'amène à la question de l'articulation entre réparation et prévention. Et sur se point, je ne suis plus du tout d'accord avec M. Thillaud. Comment contraindre les entreprises à appliquer la prévention ? Peut-on parler de mauvaise volonté ? J'ai en tout cas ici une série de documents qui témoignent d'une volonté de contournement du côté patronal. Il y a deux moyens : appliquer des sanctions ou puiser dans la caisse. L'amiante est l'exemple typique - les scripts de conférences tenues en Angleterre ou lors de la mise en place du CPA le prouvent - de ces paris où l'on a calculé que la réparation coûterait moins cher que l'absence de fabrication, de production et de commercialisation. Face à de telles situations, il s'agit de rendre la réparation dissuasive, afin d'inciter l'employeur à mettre en œuvre la prévention. On sait que ce genre d'investissement est peu tentant pour l'employeur qui n'en voit pas le retour sur son compte d'exploitation. Mais nous, nous savons qu'il y va de notre santé... Voilà comment se présente l'articulation entre prévention et réparation. Je ne sais s'il faut parler de réparation intégrale ou « intégriste » ; toujours est-il que les salariés, en l'état actuel des choses, sont systématiquement floués par rapport à ce qu'ils endurent. La justice sociale exige tout à la fois une reconnaissance du droit à réparation individuelle de chaque victime exposée, et en même temps un versement au titre de la prévention collective, afin de financer les mesures propres à éviter que l'accident ne se reproduise. Or, si l'on n'atteint pas ce stade, c'est bien que l'on en reste à « l'expérimentation humaine » - c'est bien ainsi qu'il faut appeler la recherche épidémiologique, puisqu'on attend qu'il y ait des victimes. Les mesures REACH pourront-elles trouver leur pleine application ? Nous vous demandons de les affirmer à l'Assemblée nationale. Ensuite, chacun à sa place. Le Conseil d'État a très précisément défini le rôle de l'État. Je note d'ailleurs que nous avons laissé de côté la dimension État-employeur : les employeurs ne manquent jamais, non sans raison, d'inviter l'État à balayer devant sa porte ... Du côté des collectivités territoriales, la situation des fonctionnaires et des contractuels employés par l'État est proprement dramatique, d'autant que nous ne disposons d'aucune donnée agrégée : rappelons que la directive européenne de 1989 parle de « travailleurs », ce qui désigne tout aussi bien les salariés du privé que les agents de la fonction publique, et même les bénévoles. Le Conseil d'État, disais-je, a donné des indications claires sur le rôle de l'État. Celui-ci doit conduire les recherches - encore faut-il qu'il soit convaincu que la santé au travail est un bien public, richesse nationale et richesse sociale. Situation paradoxale : alors que la France est un des premiers pays à avoir ratifié la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) définissant la santé, je vous mets au défi de trouver au ministère de la santé un écrit reprenant cette définition ! Les services de l'État s'en tiennent à l'idée que la santé est l'absence de maladie, alors que la définition de l'OMS parle de la « construction du bien-être physique, mental et social ». Il y a là une difficulté fondamentale qu'il faudra bien lever un jour prochain. S'agissant de l'inspection du travail, à quoi conduit l'actuelle réforme de l'État ? La Loi organique relative aux lois de finances (LOLF) a posé le principe d'une orientation et d'une évaluation de l'argent public. De ce fait, nos organisations sont souvent convoquées par les préfets ou les directeurs régionaux du travail en ces termes : « Pour construire mon budget, il faut que j'oriente l'action de l'inspection du travail. Êtes-vous vous d'accord sur tel objectif ? » J'en prends un au hasard : en Seine-Maritime, nous avons la plate-forme chimique du Havre et celle de Rouen. On nous propose de concentrer les efforts sur la plate-forme de Rouen. Nous ne pouvons qu'être d'accord, mais cela signifie que rien ne sera fait pour le reste, alors que sa mission généraliste impose à l'inspection du travail d'intervenir et de faire appliquer la loi partout. Qui plus est, on lui crée des difficultés au moment d'appliquer les sanctions qui s'imposent, alors que la sanction participe également à la mise en œuvre de la prévention par les employeurs. Ceux qui ne font pas ce qu'il faut doivent être pénalisés. Or j'ai lu dans les écrits de certains services de l'inspection du travail qu'un agent qui sanctionne serait en échec : cela prouve qu'il est mauvais négociateur ou mauvais conseiller ! Autrement dit, on va jusqu'à culpabiliser l'inspecteur du travail lorsqu'il relève un délit ! Il est temps de remettre le train sur les rails et de faire en sorte que la loi soit appliquée. « Tolérance zéro », a dit un certain ministre de l'intérieur. Mais quand il s'agit de santé au travail et qu'il y a des morts dans les entreprises, on nous répond : « Dialogue social » ! En matière de santé, nous sommes pour la tolérance zéro. M. Daniel BOGUET : Dominique Olivier a soulevé le problème d'un blocage à 50/50. Mais lorsque nous avons collectivement mis au point le règlement intérieur de la CAT, nous avons considéré qu'en cas de vote à 50/50, la sagesse commandait de retravailler la question, estimant que notre cénacle ne pouvait pas être composé de 50 % de gens intelligents et de 50 % d'abrutis ! Un de nos honorables camarades a déploré l'absence de CHSCT dans les PME. Je lui rappelle que l'accord du 12 décembre 2001 n'est pas étendu. Or c'est une préoccupation forte des TPE : nous sommes pour un accord « 12 décembre 2001 ». M. Thillaud a déclaré que la réforme de la médecine du travail satisfaisait les petites entreprises : nous ne devons pas connaître les mêmes. L'UPA, en tout cas, n'est pas pleinement satisfaite de cette réforme. Nos services interentreprises fonctionnent tout à fait correctement et le fait a été unanimement confirmé par les syndicats. Je rappelle enfin que sur les 745,6 milliards d'euros de recettes versés par la sécurité sociale au fonds de cessation anticipée d'activité des victimes de l'amiante, 600 millions proviennent de la contribution des entreprises, 29 millions des droits sur les tabacs, 115,9 millions d'une nouvelle contribution sur les employeurs et zéro de l'État ! Sans commentaires... M. Bernard SALENGRO : Dominique Olivier a présenté quelques avancées sur la question de la réparation. Le système actuel, aux yeux de la CFE-CGC, n'est pas satisfaisant. Il faudra voir où placer les taquets ; cela dit, les bases du système ne nous choquent pas. En tout cas, la réparation n'a rien à voir avec la branche AT-MP. S'agissant de la question de l'autonomie, je partage totalement la formule de Serge Dufour : la santé au travail est un élément structurant de la santé publique. Cela se répercute sur la consanguinité des structures comme sur la répartition des coûts. L'autonomie ne peut donc se concevoir que dans l'enceinte de la sécurité sociale, dans des conditions à définir par les juristes. Vous nous avez demandé une réaction sur l'évaluation contradictoire. Pour moi, l'indépendance en tant que telle n'existe pas. C'est une notion purement virtuelle, une « parole verbale ». L'indépendance n'existe que dans l'équilibre des pressions. J'adhère donc pleinement au concept de l'évaluation contradictoire, malgré toutes les difficultés qu'il pose ; mais tout comme la démocratie, c'est le moins pire des systèmes. Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on parle des commissions paritaires de santé. On en avait même acté le principe dans un accord « santé au travail » en décembre 2000 - septembre pour d'autres... Nous n'avons pas besoin de l'État pour les mettre en place. Qu'attend-on ? Il en est de même pour la présence des représentants des salariés des services de la médecine du travail. Ce n'est qu'une décision à prendre. On ne peut pas signer quelque chose et ne prendre ensuite que ce qui nous intéresse. Certaines choses ne dépendent que de nous. Nous sommes partisans d'un fonctionnement au plus près du terrain ; encore faut-il jouer le jeu. Un mot sur la démographie médicale. Le malthusianisme ambiant qui sévit dans les cabinets ministériels - qu'ils soient de gauche ou de droite, d'ailleurs, on y relève une certaine consanguinité de pensée - a abouti à cette doctrine selon laquelle on diminuerait le coût de la santé en diminuant le nombre de médecins... Comme si les médecins produisaient la maladie ! Ils ont donc écrasé le numerus clausus. Malheureusement, le problème des médecins du travail n'est pas si simple. Pour commencer, seulement 40 % travaillent à temps plein. Si l'on développe l'attractivité de notre fonction - fonction, suivi, décisions - et de notre statut, on verra, comme l'herbe après la pluie, des temps partiels devenir des temps pleins, sans compter les confrères européens qui seront tentés de venir : le franco-français, c'est fini. Par ailleurs, je me souviens de réactions de cadres de magasins, et particulièrement d'une directrice, à laquelle j'expliquais ces problèmes démographiques. « Je travaille soixante heures par semaine », me disait-elle. « Il n'est pas question que, pour quelques personnes à temps partiel, on modifie un système qui nous protège ! » C'est à l'État de remplir la mission qu'il n'a pas assumée, faute de lui avoir consacré des moyens en rapport avec les règles qu'il avait lui-même créées et dont la société avait besoin. Mme Laurence THÉRY : La médecine du travail a connu une grande innovation : la pluridisciplinarité, qui devait changer la donne en passant d'une notion de quantité - le nombre de médecins du travail - à celle de la qualité du service rendu aux salariés. La CFDT a soutenu cette réforme, mais sa mise en œuvre n'est malheureusement pas à la hauteur des enjeux. Les GIE échappent effectivement au contrôle social ; le développement de la pluridisciplinarité reste très inégal. Les procédures d'agrément des services de santé au travail reposent encore trop sur des critères administratifs et non de qualité de service rendu, qu'il faudra mieux contrôler. Se pose également le problème du financement. Sous l'effet de la pluridisciplinarité et du changement de la périodicité des visites médicales, d'un à deux ans, les services se font de la concurrence, tandis que les entreprises décident unilatéralement de ne verser leurs cotisations qu'une année sur deux, considérant que la prestation de la médecine du travail se résume à l'examen médical. Le financement des services de santé au travail appelle la mise en place d'une cotisation harmonisée ainsi qu'une réflexion - évoquée par le « Plan santé au travail » - de son mode de collecte. Pour ce qui est de l'inspection du travail, nous ne pouvons qu'être d'accord avec la CGT : il n'existe aucun pilotage global de l'inspection du travail sur la santé au travail. Certes, des campagnes sur l'amiante ont été organisées, dont le seul résultat est de nous apprendre que la réglementation n'est pas respectée... Une opération menée en 2002 sur 72 chantiers a ainsi révélé que 76 % n'en respectaient pas les points essentiels ! On peut du reste s'étonner de la faiblesse de l'échantillon autant que du résultat, à tous égards édifiant. L'insuffisance des moyens de l'inspection du travail a été rappelée à de nombreuses reprises. Il manquerait 700 à 800 agents de contrôle de terrain. Pour toute réponse, trente créations de postes ont été décidées, mais pas sur le terrain ! Il faut enfin dénoncer le délitement de ce corps et l'absence de reconnaissance de son utilité sociale, en premier lieu par les pouvoirs publics. S'agissant des documents uniques, nous appelons à une évaluation de leur qualité. Pour l'heure, ces documents ne semblent pas élaborés en suivant une démarche participative, autrement dit en associant les salariés : ne sont-ils pas les meilleurs experts de leurs conditions de travail ? Ajoutons que l'évaluation des risques est très souvent menée sous l'angle technique et fort peu sous l'angle organisationnel. Or l'on sait que l'organisation du travail a un impact déterminant. Nous sommes tout à fait favorables à l'évaluation contradictoire pour peu, évidemment, que la puissance publique n'en soit pas absente. Enfin, les évolutions actuelles de l'organisation du travail se traduisent par des phénomènes d'intensification du travail au détriment des salariés, ce qui n'est pas sans incidences sur l'action syndicale au sein de l'entreprise. Cela devrait nous conduire à reposer la question de l'exercice du droit syndical dans l'entreprise. M. Dominique de CALAN : Je veux insister à nouveau sur le fait que la prévention est un état d'esprit et une formation. Les partenaires sociaux ont effectivement mis beaucoup de choses en place, tant au niveau territorial qu'au niveau des branches. Cela dit, nous aimerions que l'esprit de prévention fasse également partie de la formation initiale de nos concitoyens. Une réflexion collective sur la prévention serait très utile, non seulement pour les futurs cadres, mais également pour tous les citoyens. Nos conversations ont du reste montré que, en matière de formation à l'outil de prévention, nous étions plutôt les meilleurs - ce qui ne veut pas dire que nous ne pourrions pas faire mieux. Je remercie notre collègue de la CFDT d'avoir eu le courage, au-delà de l'aspect sémantique, de soutenir le principe d'une réparation forfaitaire aménagée ou améliorée. Il y a là matière à une concertation approfondie que nous devrions pouvoir ouvrir très rapidement, même s'il reste à déterminer où placer le taquet. Mais il a surtout eu le courage de rappeler le problème de la faute inexcusable et d'une pénalisation devenue parfois un peu excessive. Employeur, mais également élu régional et municipal et administrateur bénévole du secteur associatif, je puis témoigner sous cette triple casquette des difficultés que nous rencontrons, et appeler à examiner tranquillement, sereinement ce problème. Il ne s'agit pas d'excuser celui qui se serait rendu volontairement coupable de non-application de la réglementation, mais d'éviter des condamnations pénales systématiques qui décourageront toute action ou toute responsabilité collective. Bon nombre de nos salariés qui militent dans le secteur associatif se retrouvent ainsi confrontés, lorsque malheureusement survient un accident ou une maladie, aux mêmes difficultés que nous. Prenons également garde au risque de l'entreprise coupable, sur le plan de sa solvabilité. La mutualisation apparaît à cet égard comme un élément fondamental. À quoi sert une réparation si la PME-PMI est dans l'incapacité de payer ? L'application d'un principe « pollueur/payeur », a fortiori dans le cas d'une entreprise artisanale de deux salariés, est une absurdité contraire à l'intérêt même des victimes - encore faut-il le rappeler. La mutualisation assurantielle n'est qu'un palliatif : lorsqu'on est très gros, on s'assure un peu sur tout ; mais lorsqu'on est très petit, on retient un éventail de risques nettement moindre. La solvabilité d'un régime de réparation forfaitaire améliorée passe également par le maintien d'une mutualisation Nos trois organisations, MEDEF, CGPME et UPA, ont préparé une contribution écrite sur la réparation du drame de l'amiante, et notamment sur le moyen de mieux la cibler sur les personnes malades, sur la coresponsabilité - que nous assumons - entre le public et le privé, sur la simplification des mécanismes de répartition en matière de réparation, sur la définition des activités et du périmètre de la répartition, sur la réglementation enfin : une réglementation, c'est bien, encore faut-il qu'elle puisse fonctionner. Nous vous remettrons également un deuxième document reprenant des repères scientifiques à même de contribuer à l'éclaircissement du débat. M. Serge DUFOUR : M. de Calan parle d'ouvrir des discussions sur la question des réparations. Rappelons que le législateur, en votant la loi sur la retraite, a proposé aux partenaires sociaux d'ouvrir une négociation sur les départs anticipés liés à la pénibilité du travail, ce sur quoi le patronat a déjà répondu, par la voix de M. Gautier-Sauvagnac, qu'il n'était pas question de laisser partir à la retraite les gens abîmés par le travail ! Il y a là pour le moins une contradiction... Je partage le constat de Laurence Théry, tout en lui faisant remarquer que le problème posé est celui de l'égalité de traitement. Or à chaque fois que quelqu'un contourne la loi, on la réaménage et on donne une prime au tricheur. Pour éviter toute concurrence déloyale, puisque nous sommes dans un système libéral, le minimum serait de soutenir ceux qui respectent la réglementation et de sanctionner ceux qui ne l'appliquant pas. Ensuite, arrêtons de parler de solvabilité des entreprises ! Jusqu'à preuve du contraire, les cotisations des entreprises sont le résultat de la richesse créée par le travail. Mais peut-être pourrions-nous modifier fondamentalement la donne en taxant, comme nous le proposons, les actionnaires, autrement dit le capital... S'agissant enfin de la question du budget AT-MP dans lequel la réparation représente 80 % et la prévention seulement 1,8 %, nous proposons de porter la part de cette dernière à 10 %. M. le Président : Ce débat a donné lieu à des échanges parfois vifs, mais toujours intéressants, quoique un peu désordonnés. Mais sur un sujet aussi complexe, c'était probablement inévitable. J'ai bien noté que le problème de l'amiante, du fait de sa complexité et de la lourdeur de ses conséquences sociales et humaines, vous servait de point d'appui pour une réflexion sur l'ensemble des problèmes liés aux accidents du travail. Cela nourrira également notre réflexion. J'aimerais que vous repreniez notre questionnaire afin de le compléter par écrit sur les points qui n'auraient pas donné lieu à une réflexion suffisante. Le Rapporteur et la mission devront faire leur miel de toutes ces auditions, ce qui n'est pas chose aisée dans la mesure où l'on y sent plus de contradictions que de points d'accord... C'est toute la tâche, difficile mais passionnante, du législateur, car nous avons bien l'intention de faire des propositions fortes à l'adresse tant des gouvernements que des partenaires sociaux. Aidez-nous en complétant notre questionnaire sur les points qui vous semble appeler des précisions. Cela facilitera grandement le travail de notre Rapporteur et de nos collègues. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions pour cette matinée fort utile. Table ronde regroupant des représentants de collectivités territoriales sur la gestion des bâtiments amiantés · M. Patrice YUNG, membre du bureau de l'Assemblée des Communautés de France et vice-président de la Communauté de l'agglomération de Seine-Eure · M. Gilbert CONAN, maire d'Epouville (76) pour l'Association des maires de France (AMF) · MM. Franck FONTAINE, attaché territorial et Pascal FOUCHER, technicien supérieur, responsables de l'environnement pour la ville de Soisson, adhérente de la Fédération des maires des villes moyennes · Mme Lucie DESBONNETS, responsable de la sécurité des bâtiments et établissements recevant du public pour la ville de Nevers, adhérente de la Fédération des maires des villes moyennes · M. François MIERSMAN, conseiller municipal délégué pour la ville de Liévin, adhérente de la Fédération des maires des villes moyennes Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Notre mission d'information a établi un programme très précis, adopté à l'unanimité de ses membres. Le premier objectif est d'analyser la façon dont est traité l'amiante résiduel ; le problème est extrêmement préoccupant car la France, pendant des années, a équipé ses bâtiments, privés comme publics - y compris ceux des collectivités territoriales -, de millions de tonnes d'amiante. Après cette première étape, nous étudierons les questions relatives à l'indemnisation, les implications pénales et la gestion internationale du dossier. Le problème de l'amiante peut en illustrer d'autres, déjà survenus ou futurs. Dans le cadre de notre étude concernant l'amiante « résiduel », nous avons sollicité les associations représentant les différentes catégories de collectivités territoriales pour savoir comment celles-ci gèrent le problème. Je n'adresserai pas de reproches aux présents - et, au contraire, je les remercie de leur présence -, mais je signale que j'ai dû faire le gendarme et me « fendre » d'une lettre un peu sévère aux différentes associations concernées, afin qu'elles répondent au moins au questionnaire que nous leur avons envoyé. Compte tenu, en particulier, de la décentralisation, les collectivités sont responsables d'un nombre très important de bâtiments publics et vous connaissez parfaitement les problèmes que cela pose. Nous allons donc recueillir votre sentiment sur plusieurs points : le diagnostic auquel il vous est fait obligation de procéder avant la fin de cette année, le traitement de l'amiante diagnostiqué, les opérations de maintenance qui peuvent diffuser des fibres d'amiante et enfin la gestion des déchets, qui est compliquée surtout dans le cas des petites opérations courantes sur des matériaux contenant de l'amiante lié. Je suis satisfait que nous ayons pu tenir cette table ronde mais la mission ne s'arrêtera pas là. Il est de notre devoir d'examiner le plus précisément possible où en sont les collectivités territoriales. Nous n'ignorons pas les difficultés des élus locaux mais il s'agit aussi de les aider à identifier les problèmes et à rechercher des solutions. Si nous insistons autant, c'est que la pire des choses serait de se mettre la main devant les yeux et d'attendre que les problèmes surviennent. Nous sommes donc à votre écoute pour essayer de trouver des solutions. M. Gilbert CONAN : Je suis le maire d'Épouville, village de 3 000 habitants situé à une quinzaine de kilomètres du Havre. Notre commune ne contient pas de constructions amiantées pour la bonne raison qu'une usine d'amiante, Evers, y a été en activité de 1920 à 1996. Mon prédécesseur, pendant cinquante ans, était en même temps l'industriel et le maire, et a évité de construire quoi que ce soit en amiante. Chez nous, le diagnostic se passe très bien, grâce aux nombreux cabinets compétents, de même que le traitement ; tout est question de financements, mais nous parvenons toujours à dégager des moyens. En revanche, nous avons un problème de délai entre le diagnostic et le traitement : nous devons en effet attendre des mois, voire des années, avant que les services de l'État, Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) et préfet, nous donnent le feu vert pour commencer les traitements. C'est ainsi que le regroupement des professions médicales de mon village traîne depuis quatre ans. C'est désolant. M. le Président : Il n'y a donc pas d'amiante dans votre ville ? M. Gilbert CONAN : Il n'y a pas de bâtiments communaux en amiante, mais le problème concerne un terrain sur lequel était située une usine d'amiante et que la commune, ainsi que des sociétés civiles de commerçants, souhaiteraient acquérir. Des permis de construire sont déposés, ils sont acceptés, examinés par les services du préfet, mais lorsque les travaux doivent débuter, celui-ci nous oppose que le sol est pollué et nous en empêche. Légalement, il n'y aurait pas de passerelle entre l'attribution du permis de construire et l'application des règles concernant les sols pollués. Le responsable est pourtant une seule et même personne : le préfet. M. le Président : À votre connaissance, l'Association des maires de France (AMF), que vous représentez, a-t-elle engagé une action en direction de ses membres pour vérifier les conditions d'application du diagnostic ? M. Gilbert CONAN : Je l'ignore. M. le Président : Comprenez ma préoccupation. Votre expérience personnelle m'intéresse mais davantage encore la façon dont votre association gère la question. Vous n'en avez jamais parlé entre vous ? M. Gilbert CONAN : La commune de Condé-sur-Noireau, sur laquelle était également implantée une usine, rencontre les mêmes soucis que nous pour gérer sa friche. M. Daniel PAUL : Je soutiens une association qui pose quelques difficultés à Épouville, mais pour la bonne cause, puisqu'elle milite pour la dépollution du terrain. Le cas de Gaz de France pourrait faire jurisprudence : l'entreprise a dû dépolluer les terrains des anciennes usines à gaz qu'elle avait revendus ; c'est notamment le cas de celui où, dans les années 1980, ont été implantés les bâtiments de l'université du Havre. Mais je suppose que l'entreprise Evers n'existe plus. M. Gilbert CONAN : Elle a déposé son bilan en 1996, après l'adoption de la loi interdisant l'usage de l'amiante, et tout s'est arrêté là. L'administrateur liquidateur s'est même retourné vers l'État pour réclamer d'être liquidé à son tour. L'Association de défense des victimes de l'amiante demande que l'usine soit vendue et que le produit de la cession soit saisi. Je veux bien publier une annonce dans le journal mais je ne suis pas sûr qu'une usine d'amiante intéresse grand monde... Gaz de France a dépollué, parce qu'il lui a été demandé de le faire. Pour ma part, j'attends depuis des années que l'on me dise ce que je dois faire. M. Jean-Marie GEVEAUX : L'Association des maires de France s'est-elle posé la question de l'amiante ? A-t-elle ouvert un débat ? Comment les communes, de manière générale, procèdent-elles ? À quelles difficultés se trouvent-elles confrontées ? M. Gilbert CONAN : Une discussion a eu lieu avec notre président départemental, M. Denis Merville. À l'exception des quelques cas particuliers comme celui de ma ville, le diagnostic et le suivi de l'amiante ne posent pas de problème. M. Jean-Marie GEVEAUX : Les membres de votre association ne rencontrent donc pas de problème particulier concernant leurs bâtiments communaux ? M. Gilbert CONAN : Ceux-ci sont traités les uns après les autres, sans problème particulier. M. le Président : Nous ne voulons pas être trop insistants à votre égard mais nous nous devons de l'être car nous sommes inquiets. Quoique je ne mette pas en doute votre bonne foi, ce qui serait totalement injuste, je ne suis pas convaincu que le diagnostic ne pose pas de problème. L'Association des maires de France représente un nombre considérable de communes. Ne serait-il pas utile qu'elle envoie un questionnaire à ses adhérentes ? Il ne s'agit pas de tracasser les élus locaux - nombre d'entre nous le sont aussi - mais de répondre à une inquiétude : si un problème survient, des comptes vous seront demandés. Le diagnostic sera-t-il achevé avant la fin de l'année, comme la réglementation le prévoit ? Quelles sont les conséquences prévisibles du désamiantage, y compris en termes de coût ? Comment régler les cas particuliers comme celui des terrains amiantés, dont personne ne connaît l'impact sanitaire ? M. Gilbert CONAN : On a déjà pu mesurer les effets de l'amiante et ce n'est pas réjouissant. M. le Président : Les maires font leur maximum, je n'en doute pas un instant, mais ils n'obtiennent pas de réponse. M. Gilbert CONAN : Le ministère de l'intérieur nous a tout de même adressé, le 12 juillet 2005, un courrier à ce propos, nous enjoignant de répondre au service santé et solidarité de la préfecture avant le 15 octobre. M. Ghislain BRAY : Il me semble que l'Association des maires de France a aussi un rôle d'information vis-à-vis des élus. Je rappelle que je suis le député d'une circonscription très rurale. La note dont vient de parler M. Conan a une vocation de rappel et d'incitation. Mais le problème de l'amiante dépasse la question des bâtiments communaux ; il embrasse celle de l'instruction des permis de construire et de démolir. Des articles de presse indiquent qu'après l'orage ou la grêle, des tonnes de plaques d'amiante sont déposés par ignorance sur les chemins communaux ou en décharge sauvage. Les différentes associations de maires doivent s'emparer du problème, en débattre et informer toutes les communes, en particulier les plus petites, qui sont dépourvues de services techniques. Dans l'état actuel des choses, la gestion de l'amiante dépend de la manière dont le maire est imprégné du problème, de son degré de connaissance. M. Gilbert CONAN : En zone rurale, dans les communes de moins de 5 000 habitants, un permis de démolir n'est pas requis, hormis pour les bâtiments spéciaux, me semble-t-il. M. Ghislain BRAY : Le contrôle du droit d'urbanisme intervient tout de même avant toute démolition de bâtiment, et une autorisation est requise. Je suis responsable de l'urbanisme pour les vingt-sept communes de mon intercommunalité et je vous garantis que tout passe entre mes mains. Si les démolitions ne sont pas contrôlées, où va-t-on ? M. Jean-Marie GEVEAUX : Des bâtiments démolis peuvent être amiantés. Il est par conséquent crucial de respecter la législation en cours, concernant notamment le plan de retrait et les appels d'offre. Mais les communes sont confrontées à d'autres problèmes liés à l'amiante, en particulier celui des déchets amiantés, quand une déchetterie est installée dans leur secteur. M. le Président : Monsieur Conan, vous vous ferez l'interprète de notre insistance auprès de votre président ! M. Patrice YUNG : Je suis adjoint au maire de Louviers, responsable des services techniques, premier vice-président d'une agglomération de 60 000 habitants et membre du bureau de l'Association des communautés de France, l'ADCF. Les intercommunalités n'étant relativement fortes que depuis cinq ans, nous nous sommes surtout penchés, pour l'instant, sur des sujets comme la taxe professionnelle. Nous disposons néanmoins d'un site Internet sur lequel nous pourrions lancer une enquête, même si c'est un peu tardif dans la mesure où tout doit être terminé pour la fin de l'année. Notre communauté d'agglomération réunit vingt-neuf communes, en zone rurale, autour d'une ville centre de 20 000 habitants. À Louviers, le diagnostic sur les bâtiments a bien été réalisé avant 1999, mais les petites communes ne l'ont pas fait, pour de multiples raisons, à commencer par la peur des rumeurs et des campagnes de presse, même si le bureau d'étude conclut à l'absence d'amiante. C'est surtout la situation des écoles qui est délicate. Comment les parents réagiront et croiront-ils les résultats du diagnostic ? Le prélèvement d'échantillons ne favorise-t-il pas la dissémination de particules ? Quelles réparations s'avéreront nécessaires ? J'ai aussi entendu parler du cas d'une clinique où les infirmiers présentaient des troubles caractéristiques en dépit de l'absence d'amiante dans la salle d'opérations, tout simplement parce que la climatisation allait chercher l'air dans un grenier amianté. Bref, les communes qui en ont les moyens ont réalisé le diagnostic ; pas les autres. M. le Rapporteur : Quel tissu, quel réseau votre association représente-t-elle ? M. Patrice YUNG : Issue de l'Assemblée des districts et des communautés de France, l'ADCF, présidée par M. Marc Censi, rassemble plus des deux tiers des communautés d'agglomération, la moitié des communautés de communes et même certaines communautés urbaines. Mais ma commune, comme toutes les autres, adhère aussi à l'AMF. M. le Président : Vous avez donc le sentiment que le diagnostic est quelquefois trop rapide ou insuffisant ? M. Patrice YUNG : C'est ce que disent les bureaux d'études eux-mêmes : faire un diagnostic, c'est bien mais insuffisant ; si l'on veut aller plus loin, il convient de procéder à des analyses d'échantillons, etc. Mais peut-être poussent-elles à la consommation. Il est difficile de déterminer si un bâtiment est amianté et si c'est dangereux ou non. Et puis, mieux vaut repeindre un tuyau floqué que le changer et éparpiller l'amiante, d'autant qu'il y a le problème de la gestion des déchets. De même, mieux vaut laisser en place une dalle de dalami que la scier. M. le Président : Selon vous, les grandes villes ont donc fait leurs diagnostics ? M. Patrice YUNG : Le prix d'un diagnostic et même d'une étude supplémentaire n'est pas exorbitant. Mais, dans les petites communes, la moindre dépense pose problème. M. le Président : Le souci de ne pas affoler la population risque un jour ou l'autre d'avoir des conséquences redoutables. Si les élus sont laissés à leur sort, un problème surviendra un jour ou l'autre. Les citoyens sont très informés - quelquefois mal, avec une surestimation du risque - et, de fait, le risque existe. M. Patrice YUNG : Le problème de l'amiante a été rendu public par la presse et, à la campagne, on a entendu parler de l'amiante avant de savoir ce que c'était exactement - du reste, personne ne le sait encore vraiment. Quiconque avait le moindre flocage chez lui prenait peur. Je me mets donc à la place des maires qui ont pris garde de ne pas accentuer ce sentiment et ont préféré se taire. M. Ghislain BRAY : C'est un problème essentiel. Les maires ont peur non pas de l'amiante mais de ne pas être à même de répondre aux angoisses de la population, attisées par les articles de presse alarmistes. Les communautés de communes ont peut-être là un rôle à jouer car les maires des petites communes rurales isolées n'ont pas les moyens d'agir. M. Gilbert CONAN : Je rappelle que la compétence en matière de santé relève de l'État et non pas des communautés de communes ou d'agglomération. M. Ghislain BRAY : On peut toujours faire l'autruche, mais il n'en demeure pas moins que toutes les communes doivent procéder à une étude sur leurs bâtiments communaux avant la fin de l'année. L'État ne va pas se déplacer pour prendre la place du maire. Je ne me fais effectivement aucun souci pour les grandes communes. En revanche, les maires de communes rurales, avec la meilleure volonté du monde, ne peuvent ni ne savent gérer ce problème. C'est pourquoi je propose, comme piste, que les communautés de communes s'emparent de cette compétence. M. Gilbert CONAN : La communauté d'agglomération du Havre a essayé mais a essuyé un refus catégorique de la part de l'État. M. Jean-Yves COUSIN : La communauté de communes peut se doter de cette compétence par délibération ; celle-ci est ensuite acceptée par les services de l'État et le problème est résolu. Les compétences obligatoires des communautés de communes sont au nombre de trois, mais elles peuvent prendre des compétences facultatives. M. le Rapporteur : Il ne s'agit pas de se doter de la compétence santé, qui relève de l'État et des agences régionales d'hospitalisation, mais d'appliquer la loi concernant le repérage de l'amiante : les propriétaires d'immeubles publics ou privés doivent avoir établi un diagnostic avant fin 2005. M. le Président : Nul ne doute des conséquences de l'opération sur la santé. Le diagnostic n'est pas dénué de problèmes techniques et nous y travaillons. La maîtrise financière globale peut faire débat mais certainement pas la nature de la responsabilité du propriétaire. Alors, monsieur Conan, si beaucoup de maires éprouvent les mêmes doutes que vous, attention ! Si un problème survient un jour, ce que je ne souhaite pas, les responsables de la collectivité concernée auront de graves difficultés. C'est pourquoi nous insistons tant sur la nécessité d'appliquer les textes réglementaires. M. Patrice YUNG : Les communautés de communes et d'agglomération ont actuellement tendance à se faire transférer le maximum de compétences embêtantes, et celle-là s'ajoutera aux autres. Mais est-il possible qu'une compétence se résume pratiquement à un diagnostic ? Cela me semble difficile : une fois le doigt mis dans l'engrenage, où s'arrêter ? M. le Président : Au-delà du transfert de compétences, c'est aussi d'une aide technique et éventuellement financière qu'il est question. Vu la mobilisation de l'opinion publique sur ce sujet, nos électeurs se moqueront des compétences des uns et des autres et ne manqueront pas de nous interpeller en cas de problème. M. le Rapporteur : Vice-président du conseil général de la Manche, j'ai fait procéder au diagnostic sur les cinquante-six collèges publics dont j'ai la charge et, heureusement, nous n'avons pas trouvé d'amiante. Auparavant, directeur d'un institut universitaire, je n'avais pris aucun risque et j'avais mené la même opération, alors que la réglementation ne me l'imposait pas encore. Quoi qu'il en soit, pour ce qui concerne les collectivités territoriales, c'est une obligation. Le 1er janvier 2006, si un problème intervient et si quelqu'un se rend compte que le diagnostic n'a pas été effectué, les suites judiciaires ne sont pas exclues. Mais j'ai conscience que, pour une commune petite ou moyenne au budget restreint, cela représente une charge non négligeable. M. Jean-Marie GEVEAUX : Notre objectif n'est pas d'ennuyer les maires mais d'éviter des désagréments futurs plus grands. Les congrès des maires organisés dans chaque département après les grandes vacances seraient peut-être l'occasion de déterminer si l'ensemble d'entre eux ont pris la mesure de l'importance de ce qui est demandé. Par ailleurs, une communauté de communes peut apporter son soutien mais aussi, pourquoi pas, un département, s'il en fait le choix. M. Gilbert CONAN : Quand un administré de mon village enlève quatre mètres carrés de toiture en fibrociment et les emporte à la déchetterie de classe 3, je ne suis pas au courant. M. Ghislain BRAY : Le maire ne peut évidemment pas être dans chaque maison, mais il existe tout un ensemble de règles d'urbanisme et l'on ne démolit pas un bâtiment sans instruction. Cela dit, je sais que des milliers de mètres carrés d'amiante-ciment sont jetés au bord des chemins, les entreprises spécialisées ne collectant pas les démolitions des particuliers en l'absence de plan de retrait. De même, si vous mélangez l'amiante-ciment avec les autres matériaux inertes dans une même benne de déchetterie, le problème n'est absolument pas réglé. M. le Rapporteur : Qu'en pensent les autres associations représentées cet après-midi ? M. Franck FONTAINE : Pascal Foucher et moi représentons la ville de Soissons, collectivité de 30 000 habitants qui gère quelque 130 bâtiments communaux. Nous parlerons au nom de la ville de Soissons et non de la Fédération des maires des villes moyennes. Chez nous, un diagnostic a été effectué et il nous reste à réaliser un document général récapitulant les travaux à envisager et à financer sur plusieurs années. Le problème financier est important puisque nous avons consacré 50 000 euros en cinq ans aux seuls diagnostics, sans compter les coûts indirects en personnel. Les diagnostics et les dossiers techniques amiante sont consultables par le public à la direction des services techniques. Je note que les occupants des immeubles ou leurs représentants ont eu très peur, qu'ils ont demandé des explications et que nous n'avons pas été complètement en mesure de leur apporter les informations qu'ils attendaient : même si le document indiquait l'absence d'amiante, ils avaient une réaction d'incrédulité. Il faut dire que le sujet est tabou. Environ 80 % de nos bâtiments communaux contiennent de l'amiante, mais nous n'avons pas encore lancé les travaux et nous ne serons confrontés que l'année prochaine aux problèmes de traitement, de maintenance et de gestion des déchets. M. le Rapporteur : Vous avez donc parfaitement respecté les obligations imposées par la loi : le repérage de l'amiante a été effectué avant la fin de 2005. Il vous reste maintenant à fixer l'échelonnement des travaux, selon vos capacités budgétaires, et à opter entre retrait ou confinement. Bref, vous avez fait le maximum du minimum nécessaire. Il n'en reste pas moins que l'absence de beaucoup d'acteurs est significative et profondément regrettable. En qualité de vice-président du conseil général de la Manche, je juge particulièrement anormale l'absence de l'Assemblée des départements de France, dont les membres gèrent tout de même les collèges et les bâtiments sociaux - mais je sais que le département de la Manche a fait le travail. Pour éviter la peur panique de la population, la bonne démarche consiste à se confronter à elle. Si vous n'aviez rien fait, vous ne respecteriez pas les obligations découlant de la loi et vous risqueriez, d'ici un an ou deux, un scandale dans la presse avec de graves conséquences politiques et médiatiques. Même si c'est difficile, il faut avoir le courage d'affronter la réalité. Peut-être d'ailleurs ne sera-t-il pas indispensable de procéder au retrait ou au confinement ; tout dépend du taux de fibres enregistré dans l'air. M. le Président : Vos dossiers sont donc consultables par la population ; fort bien. Mais la campagne d'information menée par la commune de Soissons a-t-elle suscité des questions de la part des communes voisines, en particulier de celles appartenant à la même intercommunalité ? M. Franck FONTAINE : Les fonctionnaires territoriaux que nous sommes ne siègent pas à la communauté d'agglomération de Soissons, mais les autres communes, à ma connaissance, ne nous ont pas interrogés et ne se sont pas inscrites dans un travail prospectif. La ville pourrait jouer un rôle moteur. Nous ferons en sorte que le message passe au niveau de la communauté d'agglomération. M. le Président : Ce serait une bonne chose ! Avez-vous une idée, même vague, du coût du traitement ? M. Pascal FOUCHER : La présence d'amiante dans un bâtiment ne justifie pas automatiquement des travaux. Les matériaux non friables en bon état, ou dégradés localement, ne nécessitent qu'un contrôle visuel tous les trois ans par un agent des services techniques et non par un organisme agréé. Par contre, si l'état est mauvais, des travaux de retrait ou de confinement s'imposent. À Soissons, par exemple, des travaux de retrait ont été nécessaires pour modifier des salles de classe, ce qui a supposé l'établissement d'un plan de retrait par un organisme agréé et sa mise en œuvre par une entreprise agréée. Les décharges susceptibles d'accepter des matériaux amiantés sont classées en trois catégories et il n'en existe pas suffisamment. Pour Soissons, les quelques entreprises agréées sont obligées de se déplacer jusqu'à Amiens, Reims, Béthune, voire Villeparisis, le coût du transport s'ajoutant au coût du retrait. M. le Président : Pouvez-vous nous donner une estimation du coût de retrait pour une opération donnée ? M. Pascal FOUCHER : Le coût hors taxe à la tonne, sans le transport, atteint 120 euros pour les matériaux de classe 2 ou 3, c'est-à-dire non friables, et 160 à 180 euros pour les matériaux de classe 1, c'est-à-dire friables. M. Franck FONTAINE : Pour la démolition d'un préfabriqué dans une école, les services chargés des travaux m'ont indiqué que le montant total atteindrait 10 728 euros TTC. M. Jean-Marie GEVEAUX : La population ne croit pas forcément au résultat des diagnostics, mais il faut savoir que les sociétés qui les réalisent engagent leur responsabilité et n'ont par conséquent aucun intérêt à ne pas respecter le cahier des charges ni à cacher quoi que ce soit. Par ailleurs, le diagnostic permet non seulement de voir s'il y a de l'amiante, mais aussi de savoir si celui-ci est dangereux : s'il est piégé dans les sols ou les plafonds, il ne pose aucun souci, à moins que des travaux d'agrandissement ou de réaménagement ne soient engagés, auquel cas il convient de prendre des précautions. M. Pascal FOUCHER : Oui mais comment expliquer au public que de l'amiante est présent dans un établissement mais ne nécessite aucune intervention ? Ce n'est pas facile. M. Jean-Marie GEVEAUX : Je le dis sans ambages, dans mon département, nous avons joué la transparence et, une fois le diagnostic des établissements scolaires réalisé et présenté, aucune difficulté n'est apparue. Mme Lucie DESBONNETS : Je représente M. Didier Boulaud, sénateur et maire de Nevers, ville de 42 000 habitants. Nos 210 bâtiments sont désormais contrôlés et le bilan est le suivant : 34 % des sites contiennent de l'amiante lié et 3 % de l'amiante libre. À ce stade, nous ne pouvons estimer le coût de rénovation sachant que les bâtiments contenant de l'amiante lié doivent être vérifiés tous les trois ans, notamment au niveau des linos. Nous avons également des soucis avec une usine d'incinération désaffectée et un cinéma privé, en plein cœur de ville, que personne ne veut racheter, tant les travaux de rénovation à effectuer sont dissuasifs : ces deux sites sont donc abandonnés. M. le Président : Connaissez-vous le coût du diagnostic ? Mme Lucie DESBONNETS : Il atteint 37 000 euros pour 208 édifices. Et il faudra refaire un contrôle tous les trois ans - par du personnel extérieur car nous ne disposons pas de cette compétence en interne. M. le Président : Avec de l'amiante dans 37 % de bâtiments, vous n'êtes pas à l'abri de problèmes potentiels. Vous avez également parlé de bâtiments abandonnés. N'est-il pas envisageable que la mairie les préempte ? Mme Lucie DESBONNETS : Nous avons déjà nos propres sites à désamianter ! M. le Président : C'est sûr, mais un cinéma amianté en centre-ville ne pourra rester éternellement à l'abandon. Il ne faut pas laisser s'installer le sentiment de peur. Mme Lucie DESBONNETS : Les élus doivent également dresser des priorités entre l'aménagement des établissements recevant du public et celui des bâtiments historiques, dont certains sont dans un état de délabrement avancé. Il faut définir les urgences. M. le Rapporteur : Les expériences de terrain dont vous rendez compte sont très intéressantes. En janvier 2006, quand nous rédigerons notre rapport, il nous faudra trouver des solutions adaptées pour éviter le transport des déchets vers des sites trop éloignés. Je ne vois pas pourquoi un bac réservé à l'amiante-ciment ne serait pas disponible dans les déchetteries de classe 3, sous réserve de quelques précautions vis-à-vis du personnel. Ce serait toujours mieux que d'en retrouver abandonné sur les chemins. Se pose également le problème du coût de la dépollution des friches industrielles et de la destruction ou de la rénovation des bâtiments imposants en plein cœur de ville. Des analyses d'air ont-elles été effectuées dans ce cinéma ? Mme Lucie DESBONNETS : Bien sûr, et elles sont mauvaises. M. le Président : Et dans l'usine d'incinération ? Mme Lucie DESBONNETS : Même chose. Heureusement, celle-ci est isolée par rapport aux quartiers d'habitation. Elle date d'environ cinquante ans et est fermée depuis trois ans. L'amiante lié est stocké dans un hangar avant d'être acheminé vers l'unique déchetterie adaptée de la région Bourgogne, à Dijon. Nous manquons vraiment de structures. M. le Rapporteur : Il est rassurant que vous connaissiez correctement la réglementation. En dépit des absents, lorsque je rédigerai le rapport, je ne manquerai pas de dire que les mairies d'Épouville, de Nevers et de Soissons, ainsi que la communauté d'agglomération de Seine-Eure, ont relevé l'honneur des collectivités françaises ! M. le Président : J'imagine que la pollution causée par l'usine d'incinération doit être considérable. Mme Lucie DESBONNETS : Nous connaissons le coût de la dépollution, mais l'opération est repoussée d'année en année dans la mesure où l'usine n'est plus en service et où les habitants sont assez éloignés, hormis la caserne de pompiers. M. François MIERSMAN : Je représente M. Jean-Pierre Kucheida, membre de la Fédération des maires des villes moyennes, de l'Association des maires du Pas-de-Calais, de la Fédération départementale de l'énergie du Pas-de-Calais et de Villes et banlieues. Une approche intéressante est celle de l'énergie. À Liévin, nous avons demandé à une entreprise spécialisée d'établir un diagnostic sur notre consommation énergétique, ce qui présente l'intérêt non seulement de nous procurer un avis spécialisé, mais aussi d'être bien financé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. Le bilan énergie de chaque bâtiment de la ville nous amène fatalement à aborder la question de l'amiante. Le 1er juillet 2007, toutes les collectivités vont être confrontées au problème de la maîtrise des dépenses d'énergie car les tarifs augmenteront au bas mot de 30 %. Il faudra donc bien réfléchir à l'isolation de nos bâtiments. C'est une façon de positiver le problème de l'amiante, d'autant que les études sont en partie subventionnées. Les 840 maires du Pas-de-Calais, qui représentent 1,4 million d'habitants, ont tous adhéré à la Fédération départementale de l'énergie afin de constituer un groupement d'achat électrique et d'embaucher des techniciens chargés de conseiller les communes, petites et grandes, du département. M. le Président : Voilà une approche extrêmement intéressante et astucieuse, de nature à dissiper un peu le sentiment de peur. M. François MIERSMAN : Lorsque l'on applique la réglementation prévoyant dix-neuf degrés dans les classes, les parents trouvent qu'il fait froid. Dans notre communication, il faut donc aborder la question de l'isolation, qui mérite quelques précautions. Un degré de chauffage en moins représente 7 % d'économie sur la facture. M. le Rapporteur : Nous ajouterons Liévin sur la liste des villes honorables... M. le Président : Il arrive aux personnels communaux chargés de la maintenance des bâtiments de tomber sur de l'amiante, lié ou libre. Comment les informez-vous ? M. Pascal FOUCHER : Avant toute intervention, le gestionnaire du bâtiment a entre les mains la fiche récapitulative du DTA, le diagnostic technique amiante. En cas de présence d'amiante, il faut tout arrêter et mettre au point un plan de retrait. Le feuillet doit être communiqué avant un mois au gestionnaire de bâtiment. M. Franck FONTAINE : La question est de savoir dans quelles conditions interviennent les équipes de maintenance. Je ne suis pas certain qu'elles consultent les fiches techniques, ni qu'elles soient sensibilisées au danger que présente l'amiante. Nous allons d'ailleurs nous entretenir avec la personne chargée de l'hygiène et de la sécurité à la ville de Soissons à ce sujet. M. le Président : Faites-nous connaître les conclusions de cet entretien. M. François MIERSMAN : Je pourrai faire une note de synthèse. M. Patrice YUNG : Le problème qui se pose aux élus locaux est qu'on leur demande toujours davantage, qu'il s'agisse de construire des logements ou de réaliser des zones industrielles qui ne soient pas trop chères afin de favoriser l'emploi. Fort bien, mais cela signifie détruire des logements existants pour en construire d'autres, et les prix triplent, quadruplent, voire quintuplent ! Et il en va de même pour les zones industrielles ! Nous parlons aujourd'hui du diagnostic amiante ; ce n'est pas ce qu'il y a de plus cher, et nous pouvons y procéder. Mais se posera ensuite la question des fouilles archéologiques, sujet à propos duquel il serait également bon de réunir une mission ! Au train où vont les choses, il sera bientôt impossible aux communes et aux intercommunalités de faire quoi que ce soit ! Pour en revenir à l'amiante, c'est moins le coût du diagnostic lui-même qui fait peur que les suites qu'il faudra donner à ce diagnostic. Le fait est que l'Etat se tourne toujours davantage vers les collectivités, sans que les ressources suivent. M. le Président : Si nous avons tant insisté pour que vous nous donniez une estimation du coût du diagnostic amiante, c'est précisément parce que nous souhaitons appeler l'attention sur les problèmes que vous exposez. Il nous faut pour cela avoir une estimation des coûts que les collectivités doivent assumer, de manière à pouvoir ensuite procéder à des arbitrages. Voilà ce qui explique nos interrogations sur le coût du traitement de ces millions de tonnes d'amiante résiduel. M. Gilbert CONAN : Je partage l'opinion exprimée par mon collègue : aujourd'hui, priorité est donnée au diagnostic amiante, mais demain elle le sera au logement social, et après-demain à autre chose.... M. Pascal FOUCHER : Pour en revenir au coût du diagnostic, je dois ajouter que s'il s'agissait d'une première réglementation, ce ne serait rien. Seulement, une première réglementation à ce sujet est entrée en vigueur en 1996, et une autre, plus sévère, en 1999. Non seulement il a fallu recommencer ce qui avait déjà été fait, puisque le seuil initialement fixé à 25 fibres par litre a ensuite été fixé à 5 fibres par litre, mais si l'on envisage désormais de ramener ce seuil à deux fibres par litre, il faudra tout recommencer. Et les collectivités devront payer une nouvelle fois ! M. le Président : Vous avez raison de mettre l'accent sur ce point. M. Pascal FOUCHER : Il n'est pas contestable que les changements incessants de réglementation multiplient les coûts. M. Jean-Marie GEVEAUX : Il est vrai qu'en matière de sécurité, une importante évolution législative a eu lieu au cours des dernières années. M. le Rapporteur : L'ensemble des députés et le Gouvernement sont conscients qu'il faut essayer d'adopter la solution la moins chère, et c'est celle qui sera choisie si c'est possible. Mais l'on ne peut oublier que les futures victimes potentielles de l'amiante sont désormais les ouvriers communaux et les artisans qui devront intervenir en des lieux dont la contamination par l'amiante n'aura pas été repérée. Voilà pourquoi nous nous intéressons de près à la gestion de l'amiante résiduel : nous voulons éviter d'autres dizaines de milliers de morts au cours des décennies à venir. M. Pascal FOUCHER : Nul doute qu'après celui de l'amiante, le législateur soulèvera le problème du plomb et, une fois encore, le coût ne sera pas négligeable pour les collectivités. Quand l'obligation de détection du plomb entrera-t-elle en vigueur ? M. le Rapporteur : Nous ne pouvons vous répondre à ce jour. Toutefois, le problème sera plus facile à traiter que celui posé par l'amiante car, dans le cas du plomb, il n'est pas question de diffusion de particules dans l'air. Pour en finir avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui, nous souhaitons que vous nous teniez informés : tous vos documents et toutes vos synthèses nourriront notre réflexion et nous aideront à parvenir au meilleur compromis possible entre qualité, prix et prévention sanitaire. Vous avez eu raison de respecter la législation, car la pire des attitudes serait de prétendre ignorer les faits, avec toutes les conséquences inévitables qui s'ensuivraient. M. le Président : Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Cela a permis un tour de table intéressant, tant sur la nature des problèmes que sur les contraintes auxquelles les collectivités doivent faire face et sur les approches originales choisies pour maîtriser les coûts. Le principe de précaution prendra très certainement une importance croissante et les élus locaux seront les premiers concernés. Il appartient donc au législateur de légiférer avec prudence. Je vous demande de faire savoir aux collectivités que vous représentez qu'elles doivent répondre au questionnaire qui leur a été adressé, car le rapporteur et la mission ont besoin de leurs réponses. Audition conjointe de M. Gilles ÉVRARD, directeur des risques professionnels à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), et de M. Pascal JACQUETIN, directeur adjoint Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Mes chers collègues, nous recevons aujourd'hui, dans le cadre de nos auditions sur le thème de la prévention des risques professionnels, M. Gilles Evrard et M. Pascal Jacquetin, qui sont respectivement directeur et directeur adjoint de la direction des risques professionnels de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Je précise que cette direction est chargée d'appliquer les orientations de la sécurité sociale et de sa branche accidents du travail et maladies professionnelles, en matière de détection et de prévention des risques professionnels. Aux côtés de directions plus techniques Je vous remercie, messieurs, de vous être rendu disponibles pour cette audition dont l'objet, comme cela vous a été indiqué, est d'éclairer la mission sur l'organisation de la prévention des risques professionnels. La semaine dernière, nous avons réuni les partenaires sociaux autour d'une table ronde, et nous commençons aujourd'hui la série d'auditions qui nous permettra d'entendre tous les acteurs de la prévention. Il s'agit pour nous, à partir du drame de l'amiante, d'évaluer les mécanismes actuels de prévention et d'examiner les moyens de les améliorer. M. Gilles ÉVRARD : Je souhaiterais tout d'abord vous exposer la démarche qui est la nôtre en matière de prévention des risques professionnels en général. Depuis la création de la sécurité sociale, la prévention des risques professionnels est confiée à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, même si ceux-ci sont indemnisés respectivement depuis 1898 et 1911. Dans l'exposé des motifs de la loi qui a créé cette branche, la préoccupation relative à la prévention est clairement mise en évidence. Depuis soixante ans, la fréquence des accidents du travail donnant lieu à un arrêt de travail a été divisée par trois. Depuis vingt ans, celle des accidents du travail mortels a été divisée par deux. Les causes en sont multiples. La tertiarisation de l'économie a incontestablement joué un rôle, mais cette baisse sensible est également à mettre au compte de la diffusion de l'esprit de prévention. Au cours des dernières années, la courbe des maladies professionnelles indique au contraire une tendance à la hausse, ce qui est notamment dû à l'ouverture des tableaux de maladies professionnelles. Je voudrais insister sur une première dimension de la prévention, qui me semble trop souvent oubliée. Car la prévention, c'est d'abord celle qui s'applique au quotidien au bénéfice des quelque 18 millions de salariés relevant du régime général, dans le but d'éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles dus au travail ou à l'organisation du travail. C'est là l'essentiel de l'activité de terrain de la branche, ce qui est d'ailleurs à l'origine de l'obligation du document unique dans les entreprises. Il faut rappeler que près de 90 % des entreprises de notre pays comptent moins de dix salariés, et qu'elles emploient le quart du total des salariés. La fréquence des accidents du travail donnant lieu à un arrêt de travail est de l'ordre de 4 %. Concrètement, une entreprise de cinq salariés connaît un accident du travail avec arrêt de travail une fois tous les cinq ans. C'est dire que l'accident du travail est un événement rare dans les entreprises, ce qui n'est pas sans conséquence pour la prévention. Il est en effet difficile de convaincre les chefs d'entreprise de l'importance que revêtent des mesures visant à prévenir des accidents qui sont à leurs yeux une chose somme toute assez rare. La prévention de terrain qui s'exerce au quotidien n'est évidemment pas le seul volet de notre politique de prévention. Nous sommes également attachés à ce que nous appelons la prévention d'anticipation. La recherche doit répondre à la question de savoir quelle est la nocivité de tel produit ou de telle combinaison de produits, ou encore quels risques professionnels apparaîtront dans les années à venir. La CNAMTS ne procède pas elle-même à des activités de recherche. Elle confie le soin de mener les études de prévention à l'INRS, mais aussi, le cas échéant, à d'autres organismes publics, tels que l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ou l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS). Les programmes de recherche gagnent également à être partagés avec nos homologues étrangers. La mission essentielle de la Direction des risques professionnels (DRP) est de définir les politiques de prévention en liaison avec les partenaires sociaux. Une partie non négligeable de son travail est aussi de déterminer le montant des indemnisations et des cotisations. S'agissant de la prévention, nous travaillons avec la commission des accidents du travail, qui est notre instance délibérante, ainsi qu'avec les comités techniques nationaux, qui sont des organes paritaires. Cet ensemble concourt à définir des outils et des recommandations en termes de prévention. Mais je précise que nous sommes là au-delà, ou en deçà, du socle légal et réglementaire. Nous ne nous substituons pas à l'inspection du travail, laquelle peut exercer un pouvoir coercitif que nous n'avons pas. Nos ingénieurs n'établissent pas de procès-verbal. Leur rôle est de conseiller les entreprises. Ils peuvent, le cas échéant, leur signifier des injonctions lorsque le défaut de sécurité met en danger les salariés. L'ensemble de ces activités de prévention est encadré par des orientations pluriannuelles, la dernière en date ayant été définie par la convention d'objectifs et de gestion qui a été signée au début de cette année. Ces orientations déterminent la politique de prévention en l'organisant autour de chantiers nationaux, les « thèmes communs mobilisateurs ». Quatre thèmes ont été dégagés : les cancers professionnels ; les troubles musculo-squelettiques ; le risque routier ; la politique de formation délivrée à l'extérieur, en direction des entreprises. Ces orientations nationales étant fixées, une grande latitude est laissée aux caisses régionales, car la prévention doit s'exercer en fonction des particularités du tissu économique de chaque région. À quoi devrons-nous être attentifs dans l'avenir ? Nous devons, en premier lieu, avoir le souci de l'adaptation à l'évolution de l'économie, tant en termes d'organisation du travail que de produits utilisés. Cela peut être source de difficultés, car il faut que nos agents aient les qualifications adéquates. Notre deuxième grande préoccupation devra être, et est déjà, la recherche de partenariats et la démultiplication de nos actions. Car celles-ci, rappelons-le, sont menées en direction d'environ deux millions d'entreprises, celles dont les salariés relèvent du régime général. Il est donc essentiel de sélectionner les risques et de relayer les messages et les préconisations. C'est à cela que doit contribuer la formation. C'est également dans ce souci que nous avons noué des partenariats avec les branches professionnelles. Le secteur de la boulangerie, par exemple, connaît un problème spécifique, celui de l'asthme dû aux poussières de farine, ce qui justifie que nous menions avec les organisations professionnelles de cette branche des actions spécifiques. Nous travaillons également en amont de l'activité économique. C'est ainsi que nous avons signé il y a une quinzaine d'années un protocole d'accord avec l'Éducation nationale en vue d'intégrer dans les programmes de chacune des sections de l'enseignement professionnel une partie consacrée à la prévention des risques professionnels. Il est extrêmement important d'élargir ces partenariats si nous voulons surmonter l'une des principales difficultés auxquelles nous nous heurtons : la connaissance insuffisante par les entreprises des problèmes relatifs à la prévention. Pour conclure, je voudrais insister encore une fois sur la dimension quotidienne de la prévention. À la différence des autres branches, la prévention n'est pas une activité de production mais de main-d'œuvre, qui peut se comparer à une activité de consultant. Nos possibilités d'action sont directement fonction de la quantité et de la qualité de nos effectifs. M. le Président : Vous avez souligné l'augmentation du nombre de maladies professionnelles. Il me semble que cela est davantage dû à l'évolution du travail lui-même qu'à celle de l'économie. Qu'en pensez-vous ? Votre action repose sur des structures complexes. Comment gérez-vous cette complexité ? Pensez-vous, par ailleurs, disposer de moyens suffisants pour assurer une prévention efficace ? Les risques de l'amiante étaient connus, ce qui n'a pas empêché le drame que l'on sait. Quelles sont les leçons que vous en tirez en matière de prévention ? Quel regard portez-vous sur la réparation ? Vous paraît-elle être organisée selon des modalités adéquates ? Avez-vous un dialogue permanent avec les entreprises ? Vous avez souligné qu'une entreprise de cinq salariés connaissait en moyenne un accident du travail tous les cinq ans, mais la fréquence des maladies professionnelles est sans doute plus élevée. Et en ce qui concerne celles qui sont dues à l'amiante, cette fréquence est, à coup sûr, beaucoup plus élevée. L'ouvrage récent de Philippe Askenazy a mis en évidence l'évolution qui a conduit de l'accident du travail « classique » à une forme totalement différente de maladie professionnelle, en particulier les troubles musculo-squelettiques (TMS), mais aussi les troubles d'ordre psychologique. Cette évolution est-elle prise en compte dans vos activités de prévention ? M. Gilles ÉVRARD : S'agissant de l'évolution des maladies professionnelles, j'apporterai une nuance à votre constat. Différents facteurs expliquent que le nombre des maladies professionnelles reconnues ait quadruplé dans les cinq ou dix dernières années. Il est certain que des facteurs juridiques ont joué un rôle. Une étude, d'ailleurs disponible sur notre site Internet, a été conduite dans le but d'évaluer quel serait le nombre de maladies professionnelles réglées en 2003, à réglementation constante depuis 1991. Elle fait apparaître que le nombre de maladies réglées au titre des tableaux 30, 30 bis, 42, 57, 97 et 98 serait de 19 676 cas en 2003, au lieu de 32 003 cas constatés, soit une différence de près de 40 %. Je ne critique pas l'ouverture des tableaux. J'insiste simplement sur le fait que l'augmentation du nombre de cas de maladies professionnelles constatés ne me semble pas liée à une dégradation des conditions de travail. Un autre facteur de cette augmentation est qu'il existe aujourd'hui une plus grande sensibilité aux maladies professionnelles. Le phénomène de sous-déclaration s'est atténué depuis quelques années, même si les médecins n'ont pas assez souvent le réflexe de faire le lien entre les pathologies de leurs patients et leur passé professionnel. M. Pascal JACQUETIN : J'ajoute que des actions sont menées dans les régions pour sensibiliser à la déclaration. M. le Président : Cette sensibilisation est-elle intégrée dans la formation des médecins ? M. Gilles ÉVRARD : Ce thème fait l'objet d'une formation de quelques heures. Une petite place lui est également faite dans la formation continue. Mais il est vrai qu'il est difficile de sensibiliser les médecins. Il y a entre 40 000 et 50 000 maladies professionnelles par an : cela représente un cas tous les deux ans pour chaque médecin. M. le Président : Le sujet pourrait également être évoqué dans les écoles de formation des cadres. M. Gilles ÉVRARD : Dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs, nous avons des modules de formation, en partenariat avec l'Éducation nationale. Pour revenir un instant à la hausse du nombre de maladies professionnelles, elle est également due, comme vous l'avez dit, à des facteurs liés au travail lui-même, en particulier la multiplication des produits chimiques que l'on utilise. Les études sur leur nocivité éventuelle ne suivent pas le rythme de création des nouveaux produits. Un dernier facteur, qui vaut surtout pour les TMS, est que lorsqu'un salarié se voit reconnaître, dans une entreprise, une maladie professionnelle, cela conduit souvent d'autres salariés à engager les démarches en vue d'obtenir eux aussi cette reconnaissance. M. le Président : Dans la sous-traitance, n'y a-t-il pas un risque plus grand de camouflage des accidents du travail et des maladies professionnelles ? M. Gilles ÉVRARD : De manière générale, on peut dire que plus on a recours à l'intérim, plus il y a d'accidents du travail. Et il est certain que recourir à la sous-traitance peut être une façon d'externaliser les accidents du travail. Vous avez évoqué, M. le Président, la complexité des structures de la prévention. Elle est réelle, et tend à s'accroître. Beaucoup sont des structures de recherche. D'autres sont des structures tournées vers l'action de terrain. Dans ce domaine, il est nécessaire de respecter une certaine subsidiarité. Il ne faut pas multiplier les structures de terrain, mais plutôt démultiplier leurs actions pour améliorer la communication et l'information. Cela m'amène à la question des moyens, qui se pose de manière particulière dans le domaine de la prévention. Il ne serait pas inutile que l'effectif de nos contrôleurs de sécurité soit étoffé. Mais le problème est surtout de faire en sorte que leur qualification suivent l'évolution de l'économie. Et nous devons pouvoir compter sur des relais dans le tissu économique au niveau local. Car quels que soient nos moyens, nous ne pouvons intervenir partout. Dans la convention d'objectifs et de gestion, nous nous attachons à ne pas diminuer le nombre de techniciens et d'ingénieurs. M. le Président : Cela signifie-t-il qu'il existe des tentations de diminution des effectifs ? M. Gilles ÉVRARD : Oui, comme dans toutes les branches. M. Gérard BAPT : On insiste beaucoup en ce moment sur la nécessité d'augmenter la productivité de votre administration. Cette tendance touche-t-elle votre direction en particulier, ou la nature de votre activité vous permet-elle d'y échapper ? M. Gilles ÉVRARD : Il faut distinguer la prévention des autres secteurs - la réparation et la tarification - dans lesquels nos engagements de productivité correspondent à une tendance à la baisse des effectifs. S'agissant de la prévention, il n'y a pas de baisse. Le fonds de prévention des accidents du travail, pour la période 2004-2006, nous permet de maintenir les effectifs, voire de les augmenter. M. Pascal JACQUETIN : Il faut insister sur le fait que le métier des ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité a fortement évolué. Il y a vingt ans, leurs interventions étaient essentiellement techniques. Aujourd'hui, les problèmes se posent de manière beaucoup plus complexe. Et par ailleurs, nous travaillons beaucoup plus avec les organisations professionnelles. S'agissant de l'asthme, par exemple, une fédération de boulangers sera bien plus écoutée que les ingénieurs et contrôleurs, qui seraient de toute manière insuffisamment nombreux pour toucher l'ensemble des boulangers. Le métier d'ingénieur et de contrôleur consiste beaucoup plus que par le passé à discuter avec les branches en vue de bâtir des partenariats. M. Gilles ÉVRARD : En ce qui concerne l'amiante, je précise que je suis entré en fonctions peu après son interdiction. Mais le caractère nocif de l'amiante est connu depuis longtemps. Il fait l'objet d'un tableau de maladies professionnelles depuis la création de la branche. L'ensemble de la branche avait fourni des recommandations de prévention bien avant l'interdiction. Rétrospectivement, on peut dire que les actions ont été insuffisantes. Peut-être s'est-on trop attaché à éviter les conséquences de l'amiante au lieu de l'interdire purement et simplement. Aujourd'hui, le risque est loin d'avoir disparu car les mesures réglementaires ont entraîné des travaux de déflocage - dont certains étaient d'ailleurs inutiles - qui n'ont pas toujours été effectués avec toutes les précautions nécessaires. M. le Président : Vous songez à des cas précis ? M. Gilles ÉVRARD : On sait que des entreprises ont procédé à des déflocages sans avoir la qualification nécessaire et sans recourir aux méthodes préconisées par les experts. L'année dernière et cette année, nous avons mené une action conjointe avec le ministère du travail. L'observation conduite en 2004 a fait apparaître que 75 % des entreprises encouraient des reproches du point de vue du respect de la réglementation. C'est dire que le problème n'est pas forcément derrière nous. M. le Président : Nous le savons : l'amiante lié, en particulier, peut poser des problèmes très graves, notamment dans les petites entreprises. M. Gilles ÉVRARD : En effet. Et j'ajoute que le repérage est un problème essentiel. On ne dispose pas de la documentation nécessaire. Le premier risque est la rencontre inopinée d'amiante. M. le Président : Les produits de substitution ne peuvent-ils pas également poser des problèmes ? M. Gilles ÉVRARD : On n'en est encore qu'au stade des études. A priori, puisque ces produits ont des caractéristiques physico-chimiques assez proches de l'amiante, on est fondé à penser qu'ils peuvent présenter des risques. Mais les études épidémiologiques sont longues, de sorte que nous ne pouvons pas étayer ces soupçons sur des données scientifiques incontestables. Pour le moment, nous préconisons d'éviter l'usage de ces produits, tout en sachant que les produits dont on est sûr qu'ils sont inoffensifs sont également plus coûteux. L'une des leçons que nous tirons du drame de l'amiante est qu'il ne faut pas sous-estimer le potentiel nocif des produits utilisés dans l'industrie. Cela conduit l'INRS, comme d'autres organismes de recherche, à mener des programmes de recherche de nocivité, mais ceux-ci peuvent prendre un certain temps. M. Ghislain BRAY : Vous avez eu raison de rappeler le partenariat entre la CNAMTS et l'Education nationale, mais je souligne qu'il concerne les accidents du travail beaucoup plus que les maladies professionnelles. S'agissant de l'information relative à l'amiante, n'avez-vous pas le sentiment qu'il y a eu certaines défaillances ? Dans certains établissements, les élèves découpaient encore des tuyaux d'amiante en 1999, soit deux ans après l'interdiction. Visiblement, l'information n'a pas été diffusée comme elle aurait dû l'être dans les établissements scolaires. S'agissant enfin des produits de substitution, l'innocuité des laines de roche et des laines de verre est loin d'être établie. Doit-on attendre le résultat des études de nocivité pour prendre les précautions qui s'imposent ? M. Gilles ÉVRARD : Pour ce qui est de l'information, nous avons fait des recommandations. Il faut sans doute qu'elles soient mieux diffusées, et qu'elles le soient plus rapidement. J'indique au passage que les établissements de l'Éducation nationale ne relèvent pas du régime général. Quant à la nocivité des produits de substitution, on soupçonne notamment les fibres céramiques. Nous préconisons de limiter leur emploi. Sachant que les effets nocifs peuvent se révéler entre vingt et trente ans après l'exposition, la mise en évidence scientifique des effets nocifs ne peut pas se faire rapidement. Cela ne nous dispense pas, bien au contraire, de faire un effort important de sensibilisation. Certains fours nécessitent des chaleurs importantes, et il n'existe pas pour l'instant de produits de substitution pour les fibres céramiques. Nous faisons les recommandations maximales. J'ajoute que les produits chimiques totalement nouveaux sont une grande source d'inquiétude. M. Pascal JACQUETIN : En ce moment, nous menons des actions sur les nanotechnologies. Il est important que les travaux de normalisation intègrent les préoccupations de sécurité. Il faut faire fonctionner des groupes éthiques. M. le Président : Le principe de précaution n'implique-t-il pas une plus grande réactivité des structures de prévention ? J'ajoute que les syndicats s'interrogent même sur leur rôle dans la définition des risques. M. Gilles ÉVRARD : La définition des risques est d'une redoutable complexité. Il me semble qu'il appartient aux conseils scientifiques des différentes instances de se prononcer. Les partenaires sociaux n'ont pas eux-mêmes la compétence scientifique requise. Par ailleurs, s'agissant de la séparation évaluation / gestion des risques, on ne peut pas procéder à l'évaluation des risques s'il n'y a pas un minimum de gestion des risques. Pour ce qui est de la réparation, elle a été organisée de manière différente pour l'amiante. Le principal problème est celui du coût global de la réparation. Les réparations s'élèvent à 10 milliards d'euros, dont 7 milliards sous forme de prestations directement servies par la branche - rentes, indemnités journalières, remboursements de médicaments. Environ 1,5 milliard d'euros de réparation sont versés par des fonds spécifiques. Moins d'un milliard d'euros est consacré aux diverses actions de prévention et aux frais de gestion. J'ajoute qu'il est difficile d'évaluer combien coûtent, au total, les maladies professionnelles et les accidents du travail, dans la mesure où ils donnent lieu à des dépenses qui s'étalent sur une durée indéterminée. La difficulté est d'ailleurs la même quand il s'agit d'évaluer le coût d'une maladie non professionnelle. La particularité du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) est qu'il retient le principe d'une réparation intégrale des préjudices, alors que le principe général, depuis 1898, est la réparation forfaitaire. Il faut distinguer selon la gravité des maladies. Il ne me semble pas anormal, pour ma part, de considérer l'ensemble des préjudices. Par contre, il me semble important de souligner que si l'on choisit la réparation intégrale, il ne doit pas pouvoir être fait appel à la justice. C'est l'un ou l'autre. Il y a d'un côté la faute et la notion de faute inexcusable est pour le moment une notion exclusivement jurisprudentielle. De l'autre, la responsabilité et les mesures de réparation sont prononcées indépendamment de la notion de faute de l'entreprise. M. le Président : Vous pensez qu'il faudrait légiférer en la matière ? M. Gilles ÉVRARD : C'est une question que je me pose. L'intervention du législateur ne garantirait-elle pas une plus grande stabilité juridique ? Mme Martine DAVID : C'est un fait que la justice a précédé le législateur. Elle a dû prononcer des jugements en dehors d'un cadre législatif. Cela a fait naître un sentiment d'injustice chez les victimes, en raison des différences dans les décisions qu'ont prises les juridictions. M. le Président : C'est un point que nous allons explorer. Avez-vous constaté que l'inscription d'une maladie dans un tableau avait un impact sur la prévention ? M. Gilles ÉVRARD : Oui, même si la prévention peut s'intéresser à une maladie avant qu'elle ait été inscrite dans un tableau. M. le Président : Vous avez souligné la grande complexité de la prévention. Pensez-vous que la transformation de l'AFSSE en AFSSET contribuera à réduire cette complexité ? M. Gilles ÉVRARD : Il n'y aura certainement pas de réduction de la complexité. Cela dit, les décrets d'application de l'AFSSET ne sont pas encore parus. Il est difficile de se prononcer. Mais la complexité fait surtout sentir ses effets au niveau local, et notamment régional. Il faut éviter une surabondance d'organismes. Je crains une tendance allant dans ce sens avec le « Plan santé au travail », surtout s'il s'agit de structures d'interposition. M. Pascal JACQUETIN : Je souligne que la prévention appartient à plusieurs champs bien distincts : le champ administratif, le champ économique, le champ scientifique, le champ médical, le champ social. C'est une richesse, sous réserve que ces champs dialoguent entre eux. Si une structure nouvelle apparaît, la question est donc de savoir si elle contribue à enrichir ce dialogue ou, au contraire, à le perturber. M. le Président : La sécurité sociale en général est-elle consciente de cela ? M. Gilles ÉVRARD : La sécurité sociale s'adresse à un très grand nombre de situations. Les accidents du travail et maladies professionnelles constituent une petite part de cet ensemble. Il est sans doute nécessaire d'accentuer la spécificité du rôle de notre branche. M. le Président : Messieurs, nous vous remercions de votre contribution aux travaux de notre mission. Audition conjointe de Mme le Dr Monique LARCHE-MOCHEL, chef de service de l'inspection médicale du travail, de M. Marc BOISNEL, sous-directeur des conditions de travail, et de Mme Catherine TINDILLÈRE, chef du pôle médecine du travail à la Direction des relations du travail Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Mes chers collègues, nous recevons aujourd'hui Mme le docteur Monique Larche-Mochel, chef de service de l'inspection médicale du travail, ainsi que M. Marc Boisnel, sous-directeur des conditions de travail, accompagné de Mme Catherine Tindillère, chef du pôle médecine du travail à la Direction des relations du travail (DRT). L'inspection médicale du travail est l'administration centrale des médecins du travail. Sons rôle est essentiel dans la prévention des risques, puisque les médecins du travail sont sur le terrain. D'ailleurs, je crois savoir que le docteur Larche-Mochel a longtemps exercé sur le terrain avant de prendre la direction de l'inspection médicale du travail. Son expérience nous est donc précieuse. L'objectif de cette audition est donc d'apprécier l'efficacité de l'inspection médicale du travail dans sa mission de prise en compte les risques rencontrés par les travailleurs. M. Marc BOISNEL : L'organisation de la direction des conditions de travail est extrêmement simple. Elle s'appuie sur deux services : l'inspection médicale du travail et la sous-direction des conditions de travail, qui compte une soixantaine de personnes et est chargée de concevoir, d'animer, d'impulser la politique de santé et de sécurité au travail. Très schématiquement, l'inspection médicale du travail se charge de l'animation du réseau des médecins inspecteurs et, au deuxième degré, des médecins du travail. La sous-direction des conditions de travail, elle, a la responsabilité de fixer le cadre juridique dans lequel agit la médecine du travail et de mettre son action en synergie avec les stratégies de la politique de santé et de sécurité, et notamment le récent « Plan santé au travail » (PST). Ce cadre juridique se trouve aujourd'hui à un moment charnière, en raison de la volonté des pouvoirs publics, dans le droit fil de la loi de modernisation sociale de janvier 2002, ainsi que de l'accord interprofessionnel sur la santé au travail qui fait une très large place aux évolutions et à la modernisation de la médecine du travail. Nous avons ouvert trois chantiers. Le premier est celui de la ressource médicale. Vous savez en effet qu'un déficit chronique de médecins du travail a pendant très longtemps empêché que soit ouvert le fond du dossier. Le deuxième est l'approche pluridisciplinaire voulue par la loi de 2002. Il s'agit de proposer à chaque entreprise une offre de prévention qui soit diversifiée, à la fois médicale, technique et organisationnelle. Le troisième est la modification des missions, du fonctionnement et de l'organisation des services de santé au travail. La loi de 2002, comme vous le savez, a transformé les services médicaux du travail en services de santé au travail. L'ensemble de ces réformes nous a fait passer d'une logique institutionnelle à une logique de services vers trois types de destinataires : le salarié, l'entreprise - à travers les conseils en prévention - et la collectivité nationale dans une perspective de santé publique, notamment à travers la veille sanitaire. Il est difficile de mener à bien des réformes institutionnelles. C'est la raison pour laquelle nous avons plutôt cherché à mettre une nouvelle boîte à outils, la plus large possible, au service de la prévention en direction de l'entreprise. L'important est que tous les acteurs s'en saisissent. C'est le défi que nous avons à relever. Mme Monique LARCHE-MOCHEL : L'inspection médicale du travail a deux missions essentielles. La première est une action permanente en vue de la protection de la santé des salariés sur leur lieu de travail. La seconde est une mission de veille et d'alerte. La première mission, qui est extrêmement large, se concrétise de trois façons : le contrôle des services de santé au travail, le médecin inspecteur donnant un avis technique au directeur régional du travail sur l'agrément des services de santé au travail, lequel peut maintenant être renouvelé tous les ans ; l'animation du réseau des médecins du travail ; l'élaboration de politiques régionales de santé au travail. La mission de veille et d'alerte conduit les médecins inspecteurs à collaborer à un certain nombre d'enquêtes, notamment avec l'Institut de veille sanitaire (IVS), la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), les enseignants de médecine du travail. Pour vous donner un exemple, l'inspection médicale a participé, en collaboration avec la DARES, à l'enquête Sumer, réalisée en 2002 et 2003, sur les conditions de travail et les risques professionnels, et à laquelle ont participé 1 792 médecins du travail. Environ 50 000 salariés ont été interrogés. Cette enquête est actuellement en cours d'exploitation. Quatre synthèses ont déjà été publiées, sur l'exposition aux risques et la pénibilité du travail, sur le bruit au travail - qui a montré que trois salariés sur dix sont touchés -, sur l'exposition aux produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. On attend la publication d'une dizaine d'autres synthèses durant fin 2005 et l'année 2006. L'inspection médicale se compose de deux médecins inspecteurs au niveau de l'administration centrale et de 43 médecins inspecteurs dans les directions régionales du travail. Ces 45 médecins doivent animer un réseau de 7 000 médecins du travail. Ces derniers n'ont aucun lien hiérarchique avec les médecins inspecteurs. Ce sont des médecins du travail de secteur privé, qui « appartiennent » aux entreprises. Les médecins inspecteurs doivent les mobiliser par la conviction. Le seul contrôle est celui qui est exercé par le biais du contrôle des agréments. Mme Catherine TINDILLÈRE : Je suis responsable du pôle 2 du bureau CT1 à la sous-direction des relations du travail. Ce pôle est chargé de l'organisation de la prévention en entreprise. Nous participons à l'élaboration et à la mise en œuvre des textes réglementaires portant sur la santé au travail. M. le Président : Je suis frappé par l'extraordinaire complexité de nos structures de prévention. N'est-elle pas parfois dangereuse pour leur capacité de réactivité ? Les problèmes relatifs à la santé au travail connaissent une évolution très rapide, en raison des évolutions technologiques, de l'apparition de nouveaux produits, des formes mêmes d'organisation. Les cycles technologiques sont aujourd'hui de trois ans. C'est dire que la réactivité revêt une extrême importance. De ce point de vue, avez-vous tiré des enseignements du drame de l'amiante ? Les moyens mis à votre disposition sont-ils à la hauteur des problèmes qui se posent ? La situation particulière des médecins du travail rend les choses encore plus difficiles. Les enseignements de l'enquête Sumer seront-ils tirés quant à l'évolution du rôle de la médecine du travail ? Le principe de précaution est appelé à occuper une place de plus en plus importante dans notre société. Les éléments de veille et d'alerte sont-ils à la hauteur des objectifs que l'on se donne en prenant en compte le principe de précaution ? M. Marc BOISNEL : S'agissant de la complexité, il faut distinguer entre les structures propres à l'administration centrale et celles qui lui sont extérieures. Du point de vue interne au ministère, il n'y a pas de complexité. Notre organisation est extrêmement simple : un seul ministère, une seule direction, la Direction des relations du travail, au sein de laquelle deux services travaillent en interaction parfaite. Par contre, la complexité externe est effroyable quand on considère le système de l'assureur, la sécurité sociale et tous les organismes qui en dépendent, et le système propre de la médecine du travail. Oui, tout cela est très complexe, surtout en comparaison avec les autres pays de l'Union européenne. Alors que notre direction a la réputation de se consacrer essentiellement au droit, celui-ci n'occupe pas plus du quart de notre activité. Nous nous occupons essentiellement de veille, de coordination, d'impulsion. Les moyens sont-ils à la hauteur ? Dans le cadre du « Plan santé au travail », nous nous sommes donné des moyens importants pour le développement des connaissances car le déficit de connaissances est considérable. Pour prendre le seul exemple des substances chimiques : sur 100 000 substances, dont 30 000 d'usage courant, 5 000 ont été correctement évaluées depuis 1981. La politique de l'État au service de la recherche dispose ainsi d'un certain nombre d'outils, dont l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET). Le contrôle est un autre aspect du « Plan santé au travail ». Les moyens de contrôle ne sont pas au niveau des enjeux, et ils sont inférieurs à la moyenne européenne. Selon la moyenne dans l'Union européenne, nous devrions avoir 2 000 agents de contrôle. Nous en avons 1 350. Les moyens de l'administration centrale sont également insuffisants. Certes, notre petite taille est peut-être un avantage en ce qu'elle facilite la cohérence. Mais les missions de la sous-direction des conditions de travail sont assurées, dans d'autres pays, soit par une grande agence nationale, soit par une direction générale du ministère du travail. Sur le seul volet santé-travail, nous sommes une micro DGS20, avec l'équivalent d'un bureau et demi. Pour remplir toutes ses fonctions, la sous-direction compte 60 personnes. Les effectifs qui peuvent se consacrer à la santé au travail proprement dite correspondent à 20 personnes. Dans les autres pays, les situations sont diverses, pouvant aller d'une direction qui dépasse largement 100 personnes à une agence nationale comptant plusieurs centaines de personnes. M. le Président : Nous sommes donc un parfait exemple d'insuffisance de moyens ? M. Marc BOISNEL : Oui. M. le Président : Une insuffisance de moyens à laquelle s'ajoute une complexité croissante des problèmes de santé au travail. M. Marc BOISNEL : Tout à fait. S'agissant du principe de précaution, jusqu'à présent le ministère du travail n'avait pas de moyens propres d'évaluation des risques pour la santé humaine. Il devait s'en remettre, généralement par voie conventionnelle, à des organismes extérieurs. Ce système avait une double limite : d'une part, ces organismes ont une capacité d'expertise assez vite saturée ; d'autre part, ils ne sont absolument pas soumis à l'autorité du ministère, ils ont une gouvernance propre, par exemple celle des partenaires sociaux. Le très gros travail que nous menons en commun permet de faire converger nos priorités, mais ce n'est pas toujours le cas. Il est arrivé à plusieurs reprises que le ministère du travail, souhaitant mener une étude sur un domaine particulier, n'ait pas disposé des outils pour le faire. La création de l'AFSSET représente un énorme changement, qui permet au ministère d'enclencher ses priorités, tout en sachant que cette agence se heurtera aussi au problème du volume global de l'expertise disponible. M. le Président : Où en est la mise en place de l'AFSSET ? M. Marc BOISNEL : Le projet de décret d'application a été examiné hier en réunion interministérielle. Des réglages ont été demandés par le cabinet du Premier ministre. Les trois cabinets concernés, ceux des ministères du travail, de l'environnement et de la santé publique, étaient d'accord sur l'avant-projet de décret. M. le Président : C'est déjà un progrès considérable. M. Marc BOISNEL : Au cours des dernières années, le décloisonnement a beaucoup progressé. Cela dit, il y a globalement des ministères à vocation protectrice, alors que d'autres sont porteurs de la représentation et de la défense d'autres intérêts, notamment économiques. Mme Monique LARCHE-MOCHEL : En ce qui concerne la question de savoir si le drame de l'amiante a été une leçon pour les médecins du travail, je peux vous répondre en vous parlant de leur vécu et de ce que j'en perçois. Ce drame a mis en alerte leur responsabilité. On leur demande de traduire leur travail par un avis d'aptitude. Or, dire que quelqu'un est apte à être exposé à un risque pose aux médecins du travail un problème éthique fondamental. Lorsque les textes réglementaires concernant les produits cancérogènes sont sortis, ils ont réagi vivement. Il leur est difficile de déclarer qu'une personne est « apte à être exposée à des produits cancérogènes ». La décision d'aptitude qu'ils ont à formuler est pour eux la source d'une grande souffrance. Leur malaise est d'autant plus grand qu'il existe des risques que non seulement ils ne maîtrisent pas, mais même qu'ils ne connaissent pas. C'est le cas des produits qui peuvent produire des effets différés. Le drame de l'amiante reste dans les esprits. M. le Président : On peut même parler de traumatisme. Mme Monique LARCHE-MOCHEL : Oui. M. le Président : Dans la formation des médecins du travail, il me semble important d'insister non seulement sur la connaissance du risque, mais aussi sur la façon d'évaluer concrètement le risque dans l'entreprise. Mme Monique LARCHE-MOCHEL : Ils ont cette capacité. Ils ont tout de même fait quatre ans d'études spécialisées en médecine du travail. Cela dit, les médecins du travail donnent des conseils mais ces conseils peuvent être suivis ou pas. M. le Président : Vous font-ils part des problèmes qu'ils rencontrent à cet égard ? Mme Monique LARCHE-MOCHEL : Les médecins du travail sont en grande souffrance. Ils nous reprochent de ne pas entendre la souffrance qu'ils éprouvent par rapport à la décision d'aptitude. Ils ont l'impression qu'on les pousse à donner des avis d'aptitude ou d'inaptitude sans leur donner d'autres solutions. Quand ils donnent des avis d'aptitude avec réserve, les salariés ne vont pas être reclassés mais licenciés. L'avis médical aura donc une répercussion sur le contrat de travail lui-même. M. Marc BOISNEL : L'avis d'aptitude est l'un des chantiers ouverts par le « Plan santé au travail ». Nous allons, dans les prochaines semaines, constituer un groupe de travail chargé d'explorer les pistes d'une réforme possible. Nous avions tenté de prendre une initiative sur ce sujet il y a quelques années avec les partenaires sociaux, mais cette consultation s'est révélée un exercice assez vain. Les uns nous ont dit qu'il ne fallait surtout pas changer le système, d'autres qu'il fallait le supprimer complètement, certains qu'il fallait le modifier à la marge. Nous allons revenir à ce sujet pour poser l'ensemble des questions relatives à l'aptitude, sous l'angle juridique et sous l'angle social. M. le Rapporteur : Les médecins du travail sont en effet dans une situation délicate. S'ils déclarent l'inaptitude du salarié à effectuer telle tâche, cela peut se traduire par son licenciement ou par un déclassement par rapport à ses perspectives de carrière. À l'inverse, s'ils déclarent l'aptitude, ils peuvent évidemment éprouver un sentiment de culpabilité. Dans les négociations paritaires qui sont actuellement menées sur la prise en compte de la pénibilité du travail, le problème se pose également, notamment dans le secteur du désamiantage, ou encore dans les entreprises sous-traitantes du secteur nucléaire. Si l'on considère que le salarié court un danger, son avenir immédiat ne sera pas forcément le placement dans un poste confortable. Cela peut être le placement à l'ANPE. Mme Catherine TINDILLÈRE : Il me semble important de replacer cette réflexion sur l'aptitude dans le cadre de la réforme de la médecine du travail. La notion de santé au travail est une notion à vocation pluridisciplinaire. L'aspect médical n'est plus le seul à entrer en ligne de compte. C'est sous cet angle plus large qu'il faut envisager l'aptitude, qui doit être dissociée du contrat de travail. M. Marc BOISNEL : L'idée-force est de recentrer l'action du médecin du travail sur le milieu de travail. Il s'agit de développer l'action du médecin en l'orientant vers des propositions de correction du milieu de travail, à travers l'analyse des postes et des situations. C'est cela qui nous permettra de sortir de la mécanique infernale du système de l'aptitude. L'amélioration constante des conditions de travail doit, sinon empêcher, du moins retarder le plus possible les phénomènes d'usure prématurée ou de dégradation de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Plus on investit dans la correction du milieu de travail, plus on pourra diminuer cette tension qui pèse sur les médecins du travail et qui les conduit parfois à imaginer toutes sortes de solutions qui peuvent être bancales au regard du droit. On constate, à travers l'étude des recours contentieux ou hiérarchiques, que des avis d'aptitude sont parfois donnés avec des réserves telles que le salarié est dans l'impossibilité d'occuper le poste. Voilà qui nous fait sortir du droit comme de la logique. M. le Président : Quel est le statut du médecin du travail dans les autres pays ? M. Marc BOISNEL : Assez peu de pays ont des médecins du travail. D'une part, dans beaucoup de pays, il n'y a pas d'adéquation entre la surveillance de la santé et la surveillance médicale. La surveillance de la santé repose pour une grande part sur la mobilisation d'autres techniques, d'autres disciplines que la médecine. C'est notamment l'approche anglo-saxonne. D'autre part, lorsqu'un médecin intervient, ce n'est pas nécessairement un médecin spécialisé dans la connaissance du milieu et des pathologies professionnels. Dans beaucoup de pays, la surveillance médicale est déléguée à des médecins de ville ou à des systèmes de santé plus ou moins publics. La médecine du travail à la française est, institutionnellement, un système très isolé en Europe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Union européenne a définitivement abandonné toute idée d'harmoniser les pratiques en la matière. Cela dit, sous l'influence des très nombreuses directives européennes, qui prévoient toutes, risque par risque, des dispositions relatives à la protection des travailleurs exposés à ces risques, on assiste à un certain rapprochement. Les pays qui, auparavant, avaient une approche purement technicienne, se médicalisent peu à peu. La France, dans le même temps, s'ouvre aux approches non médicales, notamment organisationnelles. Les Vingt-cinq finiront peut-être par converger, non pas du point de vue institutionnel mais du point de vue des contenus. M. Gérard BAPT : Les produits chimiques font l'objet d'approches très diverses. Ne pensez-vous pas que les problèmes qui ont donné lieu à la constitution de notre mission d'information risquent de se reproduire ? M. Marc BOISNEL : C'est en effet l'un des problèmes les plus préoccupants. Il me semble qu'il faut l'envisager à l'échelon de l'Union européenne. Les interdictions pour le grand public sont la conséquence du classement de telle ou telle substance, au-delà d'un certain niveau de danger. Mais il n'y a pas plus de dix produits qui soient frappés par des interdictions générales, aussi bien pour le grand public que pour les professionnels. C'est qu'il est possible de protéger les personnes autrement, à travers diverses réglementations dont la clé de voûte est le principe de substitution. Il s'agit d'éviter d'utiliser des produits dangereux, ou, si cela n'est pas techniquement possible, d'utiliser ces produits de manière moins dangereuse. C'est une sorte d'interdiction déclinée au niveau de chaque processus. Ce système a une réelle efficacité, et pousse les industriels, soit à abandonner l'usage de certains produits, soit à les remplacer par des produits moins dangereux. Cela dit, la position du ministère a toujours été très claire : nous ne nous interdisons rien, et surtout pas l'interdiction. Les diverses saisines de l'AFSSE, et demain de l'AFSSET, sont bel et bien motivées par la possibilité de décider d'une mesure d'interdiction individuelle. Mais il faut savoir que l'interdiction, en France comme dans le reste du monde, restera exceptionnelle par rapport à la grande masse des utilisations. De plus, la question de l'interdiction intègre un si grand nombre de paramètres qu'elle ne doit pas être de la responsabilité des scientifiques, qui doivent fournir une expertise. Et elle pourrait faire l'objet d'un débat parlementaire. Par exemple, on sait depuis très longtemps que le plomb a des caractéristiques extrêmement nocives, reprotoxiques, neurotoxiques, cancérogènes. Cela lui vaut un classement en catégorie 1, qui déclenche l'interdiction au grand public. Va-t-on interdire le plomb en milieu professionnel ? L'une des conséquences d'une telle interdiction serait la disparition des voitures automobiles dans leur état actuel ! M. le Président : On voit bien que la prévention donne lieu à des arbitrages difficiles, qui sont d'ailleurs la cause des difficultés qu'ont rencontrées les organisations syndicales. Quelle différence y a-t-il entre le principe de substitution et l'usage contrôlé, qui a prévalu à un moment donné dans la gestion du risque amiante ? M. Marc BOISNEL : C'est très différent. L'usage contrôlé reposait sur le présupposé selon lequel, tout en connaissant les dangers de l'amiante, on pouvait soumettre son utilisation à des conditions suffisamment protectrices. Le principe de substitution correspond à tout autre chose. Vous êtes en présence de données avérées sur le danger d'une molécule. Vous devez la remplacer par une molécule moins dangereuse. Si c'est techniquement impossible, soit vous devez l'abandonner, soit vous devez l'utiliser dans le cadre d'un système clos, où personne n'est exposé. M. le Rapporteur : Par qui sont rémunérés les médecins du travail ? Mme Monique LARCHE-MOCHEL : Ils sont rémunérés par les employeurs, soit directement par les services autonomes, soit par l'intermédiaire d'un service interentreprises, qui est un regroupement d'employeurs. M. le Président : Est-il arrivé que cela pose des problèmes de conflits ? Mme Monique LARCHE-MOCHEL : Les problèmes se posent surtout dans les services interentreprises. Dans les services autonomes, un budget assez important est affecté au service de santé au travail. Le médecin n'aura pas de problème budgétaire, il pourra procéder aux examens complémentaires qu'il juge utiles. Mais il pourra faire l'objet de pressions autres que budgétaires, en ce qui concerne la gestion du reclassement ou la déclaration de maladie professionnelle. Dans les services interentreprises, la gestion est assurée par des directeurs qui sont souvent des gestionnaires financiers. Le médecin du travail pourra faire l'objet de pressions qui ne toucheront pas le contenu de sa mission mais, par exemple, la prescription d'examens complémentaires ou la gestion de son temps. M. le Président : Vous avez parlé de la souffrance des médecins du travail. La situation que vous venez de décrire contribue-t-elle à cette souffrance ? Mme Monique LARCHE-MOCHEL : En vérité, on n'a pas beaucoup analysé les causes de cette souffrance. On a constaté cette souffrance lorsque, dans le cadre de l'enquête Sumer, on a proposé aux médecins du travail de remplir un questionnaire sur le vécu psychologique. Les résultats n'inclinaient pas à l'optimisme. Les médecins du travail sont confrontés à la mise en place d'une réforme, ils vivent une démographie médicale délicate, ils se heurtent à un manque de moyens. Beaucoup de facteurs expliquent que la question du sens de leur métier les préoccupe. La question qui revient le plus souvent dans les discussions que nous avons avec eux est celle de la déclaration d'aptitude. Ils préféreraient avoir à se prononcer sur l'aptitude d'un poste de salarié à recevoir un salarié et non l'inverse. M. le Rapporteur : Ils souhaitent donc pouvoir se prononcer sur la dangerosité du poste de travail, voire proposer directement des modifications ? Mme Monique LARCHE-MOCHEL : À leurs yeux, dire que quelqu'un est apte ne protège pas sa santé. Dans l'état actuel des choses, seule l'inaptitude, c'est-à-dire l'exclusion du poste, protège sa santé. Or, le meilleur moyen de protéger sa santé est de déclarer qu'un poste est apte à recevoir un salarié, en indiquant les mesures qui sont nécessaires pour qu'il le devienne s'il ne l'est pas. C'est la solution qui est préconisée par beaucoup de médecins du travail. Mme Catherine TINDILLÈRE : La question de l'aptitude est une question juridique. Actuellement, le médecin du travail a, lorsqu'il reçoit un salarié en surveillance médicale individuelle, l'obligation d'émettre un avis d'aptitude de ce salarié au poste. C'est là une source de malaise, puisque cet avis peut avoir des conséquences, non seulement sur la santé au travail, mais aussi sur la relation contractuelle. S'agissant des modalités d'exercice des missions, il est vrai que des pressions peuvent être ponctuellement exercées dans tel ou tel service. Cela dit, la réglementation est assez protectrice et se veut respectueuse de l'indépendance des médecins du travail. Elle a été récemment renforcée, puisque pour modifier le secteur médical, il faut soit obtenir l'accord de la commission de contrôle, soit, à défaut de cet accord, une autorisation administrative. M. Marc BOISNEL : Le médecin du travail est un salarié protégé, et ce d'assez longue date. M. Gérard BAPT : Il m'est arrivé de répondre à des conseils du médecin du travail pour des employés municipaux, par exemple en modifiant des sièges pour qu'ils répondent à des exigences ergonomiques. Le médecin du travail a-t-il des pouvoirs de contrainte en la matière ? Je voudrais également vous faire part d'une expérience : j'ai été choqué par une déclaration d'inaptitude concernant un salarié que le médecin du travail estimait menacé de lombalgie. Je savais par ailleurs que ce salarié occupait chaque semaine le poste de talonneur dans l'équipe de rugby de la commune voisine. Le médecin m'a répondu qu'il n'avait pas à s'occuper de ce qu'il faisait en dehors de son travail. Mme Martine DAVID : Des exemples de ce genre sont assez fréquents. Mme Monique LARCHE-MOCHEL : Il est vrai que lorsqu'un médecin du travail propose un aménagement du poste, cela représente une dépense pour l'employeur. Mais en contrepartie, le salarié concerné sera moins souvent absent et il ne déclarera pas une maladie professionnelle. L'investissement de prévention est en réalité une source d'économies pour l'entreprise. M. Gérard BAPT : Ma question était plutôt d'ordre juridique. La proposition d'aménagement d'un poste de travail est-elle un simple conseil, ou est-elle une injonction que le médecin du travail adresse à l'employeur ? M. Marc BOISNEL : Les choses sont très claires : la proposition du médecin du travail est un conseil. Celui-ci est d'ailleurs en position d'équidistance par rapport au salarié et à l'employeur. Il est à la fois le conseiller du salarié et celui de l'employeur. J'ajoute que la réforme en cours invite les médecins du travail à développer cette fonction de conseil et à formuler des propositions d'aménagement de l'organisation du travail ou des postes de travail. C'est d'ailleurs ce qui explique peut-être, en partie, un certain malaise. Car le médecin du travail est invité à sortir du colloque singulier avec le salarié. Sa fonction n'est plus de donner un avis purement médical mais de faire des propositions qui peuvent être assez difficiles à mettre en œuvre, à expliquer ou à faire accepter par l'employeur. M. le Président : Environ deux millions d'entreprises relèvent du système général. Comment pouvez-vous toucher celles qui appartiennent à l'énorme réseau des petites et moyennes entreprises ? M. Marc BOISNEL : L'évolution vers une approche pluridisciplinaire est de nature à faciliter l'offre de prévention en direction des petites entreprises. Si nous voulons toucher les entreprises artisanales, par exemple, il est plus efficace de travailler avec les organisations professionnelles que d'aller pousser la porte de tous les salons de coiffure et de toutes les boulangeries. M. le Président : S'agissant de l'amiante lié, nous allons être confrontés à un grave problème de prévention, étant donné tous les risques qui vont apparaître avec les travaux de destruction, de maintenance et de réparation effectués par les entreprises de BTP. Mme Monique LARCHE-MOCHEL : Le problème du médecin du travail est souvent de savoir s'il est en droit de rendre publics les problèmes de santé qu'il aura soulevés auprès de l'employeur, lorsque celui-ci ne répond pas aux conseils qui lui sont donnés. La question a été posée, sur le plan déontologique et sur le plan éthique. L'Ordre des médecins insiste, pour sa part, sur l'obligation de confidentialité. Selon lui, la mission du médecin du travail est de réussir la prévention. Or, s'il dénonce à l'extérieur, par exemple, l'usage de l'amiante, il va certes provoquer une action de la part d'un organisme de contrôle, mais il va perdre la confiance que lui porte l'employeur, lequel ne lui dira pas forcément tout ce qu'il aura à lui dire. Ce problème fait l'objet d'une grande discussion. Il est difficile de définir la limite entre ce que les médecins doivent taire et ce qu'ils doivent dire. Mme Martine DAVID : Je comprends que cette question puisse se poser. Mais tout de même ! Si l'on s'en tient au seul drame de l'amiante, les enjeux de santé publique sont tels que j'ai du mal à accepter la position de l'Ordre des médecins. Le médecin doit certainement faire preuve de discernement dans ses interventions, qui doivent être encadrées, mais je ne pense pas que sa crédibilité serait entamée s'il dénonçait publiquement les négligences dont il aura pu être témoin. Bien au contraire, elle s'en trouverait renforcée. Mme Monique LARCHE-MOCHEL : Une partie des médecins du travail partage votre point de vue. D'autres pensent qu'il faut respecter la confidentialité. Soit dit en passant, un problème analogue se pose au médecin généraliste dont un patient est atteint du SIDA et qui ne peut pas le dire à son conjoint ou son compagnon, alors que celui-ci court un risque de contamination. S'agissant des médecins du travail, j'hésite toujours à leur donner un conseil dont la conséquence peut être une sanction ordinale par l'Ordre des médecins. M. le Président : Mesdames, monsieur, je vous remercie de votre contribution aux travaux de notre mission d'information. Audition conjointe de M. Michel RICOCHON, chef de la mission d'animation des services déconcentrés de l'inspection du travail, Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Rapporteur : Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue. M. Ricochon connaît déjà notre mission puisque nous l'avons entendu dans le cadre de nos auditions sur la gestion de l'amiante dit « résiduel ». Je rappelle que c'est un inspecteur du travail, Denis Auribault, qui, le premier en France, mit en lumière dès 1906 les risques liés à l'amiante dans une filature d'amiante de Condé-sur-Noireau, en Normandie. Son rapport, dans un style assez caractéristique de l'époque, relevait que ces ouvriers devaient certes boire beaucoup, mais de là à tomber comme des mouches... et proposait la mise en place d'un système de ventilation adapté. Mais l'espérance de vie d'un ouvrier de l'époque ne lui laissait pas le temps de développer un mésothéliome ! En tant que contrôleur de l'application de la réglementation du travail, l'inspection du travail a donc bien un rôle à jouer dans la protection de la santé des travailleurs et dans la prévention des risques professionnels. Nous connaissons les difficultés que vous rencontrez du fait du manque de moyens et des conditions délicates, souvent périlleuses, parfois même mortelles, dans lesquelles vous exercez quotidiennement votre mission. Reste que vous pouvez porter un regard efficace sur les difficultés d'application et de contrôle des réglementations. L'objet de cette audition est d'éclairer la mission sur l'organisation de la prévention des risques professionnels. Nous avons déjà entendu hier les responsables de la médecine du travail et de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Je vous propose de commencer par un exposé introductif, après quoi nous pourrons engager le débat. M. Michel RICOCHON : J'exerce mes fonctions à la Direction des relations du travail (DRT) et plus précisément à la MASD - mission d'animation des services déconcentrés - où je suis chargé d'appuyer l'inspection du travail. J'ai à mon actif dix ans d'inspection du travail, puis dix ans comme directeur départemental. M. Éric JANY : Inspecteur du travail dans les Hauts-de-Seine, je contrôle une partie du secteur de La Défense. Avec 22 sections, les Hauts-de-Seine sont le plus gros département de France, et les entreprises y appartiennent, pour l'essentiel, au secteur tertiaire et au secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP). On y compte très peu d'usines, et aucune dans mon secteur. M. Michel RICOCHON : En tant que représentant de la Direction des relations du travail, mon discours sera nécessairement plus institutionnel. Premièrement, l'inspection du travail en France est assurée par plusieurs corps de contrôle différents : l'inspection du travail dite du régime général, que nous représentons aujourd'hui, en charge des secteurs du bâtiment, du commerce, du tertiaire et de l'industrie ; l'inspection du travail des transports, compétente pour la majorité des activités du transport ; l'inspection du travail « agriculture » qui s'occupe de toute la partie agricole : agriculteurs, coopératives, etc. Le ministère de l'industrie a également certaines responsabilités à ce titre : ainsi, les mines et carrières ne relèvent pas de l'inspection du travail « généraliste », pas plus que la fonction publique qui a sa propre inspection, en cours de développement. Autrement dit, l'inspection du travail est, et restera sûrement demain, une entité assez multiforme. L'inspection du travail « généraliste » compte un peu plus de 1 350 agents de contrôle, inspecteurs et contrôleurs, dont 450 inspecteurs du travail, pour contrôler 1 500 000 entreprises privées, soit, en gros, 14,5 à 15 millions de salariés. Elle exerce sa mission dans un cadre territorial souvent infra-départemental appelé « section d'inspection ». Le nombre des sections dépend de l'importance de la population active salariée : si les Hauts-de-Seine en comptent 22, certains petits départements peuvent n'en avoir qu'une seule. La norme est d'un inspecteur du travail et deux contrôleurs pour 32 000 salariés. Deuxièmement, pour ce qui est des compétences, il existe deux « écoles » d'inspection du travail. Dans l'école « nordique », c'est-à-dire dans les pays du Nord et au Royaume-Uni, les inspections du travail sont essentiellement spécialisées en santé et sécurité du travail. Dans l'école « historique », portée par la France qui a créé l'inspection du travail, celle-ci est plutôt généraliste et assume des compétences qui dépassent largement le seul aspect santé et sécurité pour toucher aux relations individuelles du travail - CDD, intérim, etc. -, mais également aux relations collectives - accompagnement des syndicats, institutions représentatives du personnel, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) -, sans oublier la lutte contre le travail illégal, devenue une priorité, compte tenu des graves et multiples dégâts que celui-ci provoque. D'après les statistiques envoyées chaque année au Bureau international du travail (BIT), un inspecteur du travail consacre en moyenne entre 30 et 50 % de son activité, parfois plus, aux questions de santé et de sécurité. Cette activité historique est appelée à se maintenir, alors même que l'on aurait pu penser que ces sujets deviendraient moins prégnants du fait de la baisse des activités industrielles. En fait, il n'en est rien. Le développement du tertiaire et les nouvelles méthodes d'organisation du travail entraînent souvent une dégradation des conditions de travail et favorisent les phénomènes de stress. L'inspection du travail devra donc rester très présente, comme elle l'est aujourd'hui. Le « Plan santé au travail » mis en place en 2005 prévoit un volet important de renforcement de l'action de l'inspection du travail sur la santé et la sécurité, par la mise en place de nouvelles capacités d'expertise au niveau régional, sous la forme de cellules pluridisciplinaires composées de médecins et d'ingénieurs et chargées d'appuyer l'inspecteur du travail généraliste qui ne peut maîtriser toutes les données techniques. Autre innovation importante, la création de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET), sans oublier la mise en œuvre de moyens de recherche dans le domaine des risques professionnels liés aux produits chimiques. Un plan de formation, dit de « technicisation » de l'inspection du travail, a été mis en place : le but est de renforcer le bagage technique d'agents plutôt formés au droit et aux sciences humaines, afin de leur permettre de poser les bonnes questions lorsqu'ils évoluent dans l'environnement technique de l'entreprise. Troisièmement, les questions que vous nous avez posées nous font craindre une possible ambiguïté. Soyons clairs : la responsabilité du respect de la réglementation incombe au seul employeur. L'intervention de « préventeurs » - Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM), inspection du travail ou autres - ne saurait entraîner quelque transfert de responsabilité que ce soit. L'employeur est et reste responsable, quelles qu'aient été les modalités de l'inspection du travail, voire ses prescriptions. L'article L.230-2 du code du travail, tel qu'il découle de la loi du 31 décembre 1991 qui, elle-même, transpose une directive européenne de 1989, définit une série de principes d'actions en matière de prévention, parmi lesquels : éviter les risques, ce qui peut paraître évident mais n'est pas si simple ; évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; combattre les risques à la source ; adapter le travail à l'homme ; prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. Souvent, le premier réflexe de l'employeur est de faire mettre des protections individuelles, très contraignantes et pas toujours totalement efficaces. Or si l'on évite le risque à la source, ou si l'on met en place des mesures de protection collective, on n'a plus besoin de recourir aux protections individuelles. La diffusion de ces principes est un élément important dans la démarche de prévention et dans la responsabilisation et l'information de l'employeur. Une de vos questions portait sur le rôle de l'inspecteur du travail par rapport à la recherche. Lorsqu'il entre dans une entreprise pour la contrôler, un inspecteur n'est aucunement dans une démarche de recherche. Il agit dans un cadre juridique, celui de la réglementation du travail, elle-même s'appuyant sur l'état des connaissances scientifiques et techniques. Ce n'est ni un scientifique ni généralement un ingénieur. S'il tombe sur une question à laquelle la réglementation ne donne pas de réponse, il fera évidemment appel à un collègue de la CRAM, par exemple, ou même à un ingénieur. Il pourra éventuellement faire remonter ses observations qui donneront lieu, si besoin est, aux réflexions, études et recherches nécessaires. Mais, dans un premier temps, l'inspecteur agit dans un cadre juridique bien précis et non - ce qui ne peut que rassurer le citoyen employeur - en vertu d'un pouvoir régalien sans limites, comme on voudrait parfois le faire croire. M. Éric JANY : Nous intervenons effectivement dans un cadre réglementaire bien défini : l'article L. 611-1 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail est chargé de veiller à l'application de la réglementation codifiée, autrement dit, celle qui figure dans le code du travail, et de la réglementation non codifiée - cas du décret n° 96-98 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Dans mon secteur des Hauts-de-Seine, les risques auxquels je suis confronté se rencontrent essentiellement dans les secteurs liés au BTP, c'est-à-dire dans les opérations de démolition, de reconstruction et de réhabilitation d'immeubles - risques de chute ou encore d'inhalation de poussières d'amiante si l'immeuble contient des produits amiantés. Mais nous nous intéressons également aux risques liés à la gestion des immeubles, notamment dans les entreprises de maintenance : ainsi, un électricien qui perce un trou dans un matériau amianté est susceptible d'inhaler de l'amiante, mais également d'en faire respirer à toutes les personnes alentour. Sont également concernés les ascensoristes, les plombiers, les services de nettoyage, qui de surcroît utilisent des produits chimiques d'entretien, les entreprises de gardiennage, les chauffagistes, etc. Mes contrôles portent principalement sur ces deux grandes catégories. L'inspection du travail est donc chargée de faire appliquer la réglementation du travail. Cela se traduit d'abord par une activité de conseil : un employeur peut demander à l'inspecteur du travail un renseignement sur tel point particulier - par exemple, le champ d'application de la coordination sur les chantiers. Dans ce cas, l'inspecteur lui enverra les informations nécessaires. Le conseil peut également prendre la forme d'une lettre circulaire, à l'exemple de celle que j'ai envoyée aux principales entreprises de mon secteur Si l'inspecteur du travail constate une infraction très grave, susceptible de mettre en danger les salariés, ou si, malgré ses rappels, l'entreprise n'a pas modifié son attitude, il dressera un procès-verbal qui sera transmis au procureur de la République. À noter que les procès-verbaux ne sont pas l'outil principal de l'inspecteur du travail : seulement 2 % des infractions constatées font l'objet d'un procès-verbal. Un agent de contrôle ne diligente en moyenne annuelle pas plus de cinq à vingt procédures, pour les plus répressifs. M. le Rapporteur : Autrement dit, s'il constate qu'un chef d'entreprise n'a pas respecté la réglementation, il commencera par l'informer et le conseiller ; la méconnaissance de la loi ne génère pas une accumulation de procès-verbaux... M. Éric JANY : Tout à fait. Si vous faites travailler plusieurs salariés sur une toiture en terrasse sans garde-corps, l'infraction sera grave et entraînera procès-verbal. Si, en revanche, la terrasse a un garde-corps, avec seulement deux ou trois éléments manquants et que les risques de chute sont résiduels, nous n'enverrons qu'une lettre d'observations. Mais si le même phénomène se reproduit un mois plus tard dans la même entreprise - sur ce chantier ou ailleurs -, nous dresserons procès-verbal. Cela n'a évidemment rien de juridique : c'est une question d'appréciation de l'opportunité des poursuites. Le procès-verbal ne vaut pas obligation de faire. Tout au plus entraînera-t-il pour l'employeur une sanction, pour peu que le procureur veuille bien suivre et que le tribunal le condamne. Cela dit, les obligations de faire existent. Il s'agit, par exemple, des arrêts de travaux, ordonnés dans des cas très limités : l'exposition à des poussières d'amiante en fait partie. Un inspecteur arrivant sur un chantier de désamiantage où les polyanes de protections censés séparer la zone de travail de l'extérieur sont déchirés pourra prononcer un arrêt de travaux. Autre cas, le risque de chute mortelle : un inspecteur du travail voyant un travailleur en situation dangereuse au cinquième étage, par exemple, pourra ordonner au salarié de se retirer du chantier, et à l'employeur de mettre celui-ci en conformité. M. Michel RICOCHON : Et le chantier ne pourra reprendre que lorsque l'inspecteur du travail l'aura autorisé. M. Éric JANY : Troisième cas, le risque d'ensevelissement qui peut se produire, par exemple, lorsqu'un talus de sable ou de terre surplombe le chantier presque à la verticale. Estimant qu'il y a là un risque mortel, l'inspecteur est en droit d'ordonner au salarié de se retirer et à l'employeur de se conformer aux règles de protection. L'obligation de faire se retrouve également dans la mise en demeure de vérification. Ainsi, un inspecteur constatant qu'une machine n'est pas conforme à la réglementation, soit qu'elle ait provoqué un accident du travail, soit qu'elle ait été conçue sans les protections nécessaires, mettra l'employeur en demeure de vérification. Reste enfin, en cas de risque très important, la possibilité de saisir le tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour obtenir de faire cesser la situation de danger sous peine d'astreinte. Dans ce cas, l'obligation de faire n'est pas prononcée par l'inspection du travail mais, à sa demande, par le président du tribunal. M. le Rapporteur : Quotidiennement au contact avec les réalités du terrain, pensez-vous que les réglementations de protection des travailleurs vis-à-vis de l'amiante sont correctement appliquées ? Sont-elles suffisamment contrôlées ? Vous-même avez évoqué les chantiers de désamiantage et les risques de contact fortuit auxquels peuvent être exposés certains métiers. Votre activité de conseil est-elle également dirigée vers les petites entreprises, souvent sous-traitantes pour le compte de sociétés autrement plus importantes ? M. Éric JANY : La situation est assez contrastée. Pour ce qui est des activités de retrait d'amiante, les entreprises respectent globalement la réglementation. Ces chantiers font du reste l'objet de contrôles très réguliers, parfois même à la demande de notre ministère : une campagne a été ainsi décidée durant les mois de juin et juillet, qui s'est traduite dans les Hauts-de-Seine par des inspections sur 33 chantiers de désamiantage, qui ont donné lieu, au besoin, à des lettres d'observations, à des procès-verbaux et exceptionnellement à des arrêts de travaux, et ont fait l'objet d'une remontée d'informations au ministère. La même opération a été conduite dans tous les départements. La situation est, en revanche, moins maîtrisée pour ce que l'on appelle les « interventions sur les matériaux amiantés ». Nombre d'entreprises n'ont pas forcément conscience du risque d'inhalation d'amiante. Même si l'on en parle dans les journaux et si les gens sont réellement sensibilisés aux dangers liés à l'amiante, ils n'imaginent pas qu'il puisse y en avoir dans leur entreprise et qu'ils pourraient y être exposés. Il m'a été ainsi donné d'aller contrôler une grande entreprise sur un tout autre sujet. À la fin de ma visite, j'ai évoqué la question de l'amiante, mais surtout par acquit de conscience, car il s'agissait d'une entreprise informatique qui, a priori, ne fournissait que des prestations intellectuelles. La directrice des ressources humaines m'a alors demandé s'il leur fallait en faire autant lorsqu'ils intervenaient chez un client. En réalité, cette entreprise, occasionnellement, tirait des câbles dans des faux plafonds... En fait, les salariés étaient bel et bien exposés. Mon intervention était donc parfaitement justifiée et les responsables ont aussitôt engagé les démarches nécessaires Cela dit, le problème n'est pas simple. Si cette entreprise, ou un ascensoriste, par exemple, veut intervenir chez un client, elle est censée lui demander le diagnostic technique amiante (DTA). Mais les clients n'ont pas toujours envie de donner ce document, ou parfois ne l'ont pas fait... Donc, demander le DTA peut souvent conduire à perdre un marché. Quant aux petites entreprises, qui sont très nombreuses, elles n'ont souvent aucune conscience du danger. Il y a un réel déficit de formation et l'inspection du travail a le plus grand mal à les contacter. On peut évidemment leur envoyer une lettre, mais le mieux est de se déplacer pour leur expliquer le problème de vive voix. Elles aussi, du reste, sont soumises à la concurrence, de sorte que celles qui respectent la réglementation se trouvent finalement pénalisées. M. Michel RICOCHON : Je confirme que ces petites opérations de maintenance, qui n'ont rien à voir avec les grands chantiers, parfaitement délimités et contrôlés, nous causent un réel souci. Les remontées des opérations décidées ces derniers mois dans toute la France devraient nous donner, espérons-le, des informations sur la façon dont certains départements ont commencé à traiter le sujet. Contrairement aux précédentes, cette campagne portait sur l'amiante friable, mais également sur l'amiante non-friable. Ajoutons que nous manquons d'un état des lieux suffisamment contrôlé pour savoir si un bâtiment est amianté ou pas. Par ailleurs, l'inspection du travail ne peut pas vérifier si un propriétaire a fait les travaux nécessaires. Ce n'est pas sa mission. À propos de la question des moyens de l'inspection du travail, nous sommes actuellement engagés dans une réflexion nationale pour savoir s'il ne conviendrait pas de développer les sanctions administratives, plus souples et plus faciles d'utilisation que la voie pénale, qui nous pose problème depuis des années. Nombre d'inspecteurs y voient la solution, mais ce n'est pas si simple. Le Conseil constitutionnel, comme la Cour européenne des droits de l'homme, ont enserré les sanctions administratives dans une procédure analogue à celle qui prévaut pour les sanctions pénales : les exigences en matière de respect des droits de la défense sont pratiquement identiques, ce qui ne joue pas en faveur de la souplesse d'utilisation espérée. De surcroît, qui dit sanction administrative dit décision, et donc risque de contentieux administratifs qu'il faudra ensuite gérer... Autant de questions auxquelles nous réfléchissons au niveau national, avec précaution, car il n'existe pas de solution miracle. Reste que l'inspection du travail aimerait disposer de moyens plus efficaces, notamment pour les obligations de faire, afin d'être en mesure de faire cesser le plus rapidement possible une situation d'exposition. M. le Président : Ce n'est pas par hasard que nous avons commencé nos travaux avec l'amiante résiduel et la distinction - fragile - entre amiante lié et non lié qui concerne des dizaines de milliers d'entreprises. La réflexion engagée sur l'amiante est capitale car elle vaudra pour d'autres produits, notamment du fait de la transformation rapide du contenu du travail : les cycles ne sont plus que de deux ans et demi à trois ans... La médecine du travail et l'inspection du travail se retrouvent au centre de cette indispensable réflexion. Vous vous dites enserrés, ou près de l'être, dans des procédures se rapprochant des procédures pénales. Pouvez-vous nous apporter des précisions sur la réflexion en cours ? M. Michel RICOCHON : Cette réflexion ne se résume évidemment pas à la question de la sanction mais nous avons besoin d'un arsenal répressif adapté. Jusqu'ici, hormis dans les cas exceptionnels exposés par Éric Jany, on a privilégié la voie pénale avec une panoplie de contraventions et de délits pour les infractions les plus graves - qu'il s'agisse de santé et sécurité du travail ou des relations professionnelles. Lorsque l'agent de contrôle relève une infraction et, en raison de sa gravité, décide de transmettre le procès-verbal à la justice, intervient un premier filtre : le pouvoir d'appréciation de l'opportunité des poursuites, qui appartient au procureur de la République. Tout dépend ensuite des politiques pénales appliquées... Si l'on peut dire qu'il y a une politique pénale en France, celle-ci est réinterprétée par les parquets au niveau départemental, voire infra-départemental. Ainsi, la Seine-et-Marne, où j'ai exercé les fonctions de directeur, compte trois tribunaux de grande instance et les politiques pénales du travail n'étaient pas tout à fait les mêmes au nord et au sud du département. Par rapport aux constats d'infractions, la part du contentieux est faible, mais celui-ci s'inscrit dans un contexte de gestion globale des contentieux particulièrement lourde, où il devient d'autant moins visible. Face au flot continu des procédures, on en est réduit à faire des choix, recourir à des avertissements, à la médiation pénale, etc., ce qui est d'autant moins bien compris par les inspecteurs du travail qu'eux-mêmes pratiquent déjà une certaine forme d'opportunité des poursuites : la convention de l'Organisation internationale du travail (OIT) leur reconnaît, en effet, le droit de décider de la façon dont ils peuvent agir à l'encontre d'un employeur. Le passage par le procureur, puis en audience, se traduit donc par un taux de déperdition réellement significatif. Les agents de contrôle en viennent à se demander s'il faut continuer dans la voie pénale, peu productive et peu efficace. Mais, se pose alors la question du chois d'un autre moyen de coercition. Or il n'y en a pas, hormis dans quelques cas très particuliers. Cette situation n'est du reste pas nouvelle : il en est ainsi depuis vingt ans. L'idée est ainsi progressivement venue, tout en maintenant la voie pénale pour les infractions particulièrement graves - les atteintes à la personne, par exemple -, de suivre l'exemple de l'Angleterre ou de l'Allemagne en envisageant deux types de sanctions administratives : des sanctions financières qui viendraient en substitution des sanctions contraventionnelles, et des obligations de faire dans une série de cas : le bâtiment, mais également le risque chimique - il manque un décret - ou encore les machines - qu'un inspecteur du travail n'a pas pour l'heure le droit d'arrêter, même s'il constate une infraction grave - ou le risque électrique. C'est ce qu'a proposé Jean Bessières dans le cadre de sa mission sur le devenir de l'inspection du travail. Voilà ce qui est sur la table ; nous n'en sommes qu'au stade de la mise à plat. Mais la période est favorable : M. Larcher a annoncé en juillet dernier qu'il voulait engager un processus de réforme de l'inspection du travail. Qu'il s'agisse du risque chimique ou de toutes les obligations de faire, il est facile d'arrêter mais tout le problème est de reprendre... Lorsqu'une autorité régalienne, en la personne de l'inspecteur du travail, autorise la reprise, elle en porte toute la responsabilité. S'il s'agit d'un risque de chute dans le bâtiment, il suffit d'aller vérifier que les précautions nécessaires ont été mises en place. Mais s'il s'agit d'une entreprise chimique, ce n'est pas si simple. Cela exige une expertise forte. Comment accompagner l'inspecteur dans sa décision ? Sur un risque électrique, ce n'est pas non plus évident car le risque est caché. La décision administrative n'est donc pas la panacée. Ajoutons qu'un de nos juristes, après avoir très précisément examiné la question dans deux énormes ouvrages ainsi qu'un excellent article dans la revue Droit social, a prévenu que la sanction administrative ne sera pas plus « à la main » par le fait qu'elle est désormais assortie, et c'est heureux, d'une série de conditions précises, notamment en matière de droit de la défense. Autrement dit, le passage de la sanction pénale à la sanction administrative ne se traduira pas forcément par un gain en efficacité. Cela exige essais et expertise. M. le Président : Le sujet est d'une énorme importance et mérite à l'évidence d'être creusé. Les représentants de la médecine du travail nous ont indiqué, hier soir, qu'une réflexion était engagée sur le principe de la faute inexcusable. La dramatique expérience de l'amiante a montré combien il était nécessaire, des deux côtés, de répondre à ce problème qui se posera peut-être demain pour d'autres produits. M. Michel RICOCHON : C'est tout le problème du risque différé. M. le Président : Exactement. Nous sommes face à une réflexion de nature juridique extrêmement complexe, et je ne savais pas que l'inspection du travail y était elle-même engagée. M. le Rapporteur : Monsieur Jany, vous nous avez fait part de votre expérience dans le domaine des chantiers de désamiantage, mais également des entreprises de maintenance et autres. Vous avez également fait allusion aux chantiers de démolition. À quelles contraintes et procédures sont-ils astreints ? M. Éric JANY : Effectivement, ce sont des chantiers un peu risqués. On y retrouve le risque de chute de personnels, mais également de chute d'objets et d'exposition à des substances dangereuses, particulièrement le plomb et l'amiante. Avant toute démolition, le maître d'ouvrage doit établir un diagnostic de tous les matériaux présents dans le bâtiment. Et contrairement à un diagnostic amiante classique, qui se limite aux parties accessibles, ce diagnostic « destructif » doit être complété, sitôt que la démolition met à jour un élément contenant de l'amiante - une gaine floquée, par exemple. M. le Rapporteur : Quelles sont les mesures de protection prévues pour les travailleurs ? M. Éric JANY : Si la présence d'amiante est décelée, il doit être établi un plan de démolition, de retrait ou de traitement. Les travaux ne pourront démarrer qu'un mois après sa transmission à l'inspection du travail. Ce délai lui permet de s'assurer que les mesures de protection prévues sont adéquates et de formuler des observations si besoin est. M. le Président : On imagine que cette procédure, déjà complexe, est respectée dans les opérations importantes qui peuvent donner lieu à mobilisation. Mais il existe de multiples sortes de dossiers... M. Éric JANY : En effet, s'il s'agit d'un petit bâtiment dans une arrière-cour appartenant à un particulier, le risque ne sera peut-être pas maîtrisé. Et je ne vois pas ce qu'on peut faire : si un chantier est caché, il est caché... M. le Président : Vos contacts avec les organisations professionnelles sont-ils suffisamment développés pour attirer l'attention ? M. Éric JANY : Je n'ai pas connaissance de contacts au niveau départemental. Quant au niveau ministériel... Au demeurant, ils ne pourraient que se limiter à une simple information, ce qui n'empêcherait pas les entreprises de rester sensibles aux problèmes de concurrence et autres que j'évoquais tout à l'heure. On a parlé du diagnostic amiante ; encore faut-il qu'il soit fiable et contrôlé par la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS). S'il y est fait état de flocages en bon état, alors que vous trouvez des flocons d'amiante par terre, c'est que le diagnostic n'a pas été correctement effectué ! Or il n'est pas dans les attributions de l'inspection du travail de mettre en cause le diagnostic. Tout au plus pouvons-nous envoyer une lettre, mais en aucun cas engager une action contraignante. Les diagnostics sont le socle de notre intervention. S'ils sont mal faits, c'est une catastrophe. M. Frédéric REISS : Qui dit démolition dit permis de démolir : en général, c'est le maire qui l'a signé, avec au besoin l'avis de l'architecte des bâtiments de France... Si le diagnostic est mal fait, on est en droit de se poser des questions. M. Éric JANY : C'est vraiment un problème. Le premier chantier que j'ai contrôlé sur mon secteur était un plan de retrait d'amiante : il s'agissait de retirer des dalles en vinyle posées avec de la colle amiantée sur deux zones, la première de soixante mètres carrés, la deuxième de trente mètres carrés. En arrivant sur le chantier, j'ai trouvé deux niveaux de 400 mètres carrés chacun recouvert des mêmes dalles ! Les enjeux financiers n'étaient donc pas les mêmes. L'entreprise a été obligée de désamianter de manière correcte, mais que se serait-il passé si je ne m'étais pas rendu sur place ? M. le Président : Messieurs, vous avez soulevé des questions très lourdes et nous vous remercions de cette contribution à nos travaux. Audition conjointe de M. Marc BOISNEL, sous-directeur des conditions de travail à la Direction des relations du travail, de M. Patrick GUYOT, chef du bureau de protection de la santé en milieu de travail, et de Mme Isabelle PALUD-GOUESCLOU, chef du bureau de la politique de prévention des conditions du travail et de la médecine du travail Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Madame, Messieurs, nous vous remercions de vous être rendus à notre invitation. Le bureau de protection de la santé du travail, dirigé par M. Guyot, a en charge l'élaboration de la réglementation protectrice sanitaire des travailleurs. Celui de la politique de prévention des conditions de travail, dirigé par Mme Palud-Gouesclou, a supervisé la rédaction du « Plan santé au travail » (PST) ; il est aussi chargé de la concertation sociale et du suivi du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels. M. Guyot et Mme Palud-Gouesclou accompagnent M. Boisnel, déjà entendu hier par notre mission. L'audition d'aujourd'hui a pour objet de nous éclairer sur l'organisation de la prévention des risques professionnels. M. Patrick GUYOT : Mon bureau est chargé de l'ensemble des questions de prévention, auxquelles vient s'ajouter un volet réparation. Pour ce qui concerne la prévention, les risques visés sont de diverses natures : risques physiques, risques biologiques, exposition des travailleurs aux agents pathogènes, risques chimiques, dont le champ est particulièrement vaste. On recense, en effet, quelque 100 000 agents chimiques sur le marché, et si 5 000 substances dites nouvelles, mises sur le marché après 1981, ont été évaluées, nous ne disposons que pour une très faible part de données scientifiques. Sur ces substances évaluées, 251 sont classées au niveau européen comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction avérées, et donc interdites dans les produits destinés au public. Elles peuvent toutefois être utilisées dans des processus industriels, moyennant des conditions de contrôle strictes sous la responsabilité des employeurs. La réglementation repose sur un socle de directives européennes très générales visant à la protection des travailleurs exposés et fondées sur un principe essentiel dit « de substitution » : l'entreprise est tenue, lorsque c'est techniquement possible, de remplacer ces substances dangereuses par des substances non dangereuses ou moins dangereuses, afin de mettre progressivement un terme à leur utilisation. Comment progresse-t-on dans la connaissance des effets de ces substances et donc dans la prévention des risques et la protection des travailleurs ? Au niveau national, nous nous efforçons de mieux structurer l'expertise scientifique, et particulièrement l'expertise scientifique publique - c'est tout l'objet du « Plan santé au travail » et de la création de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET). Au niveau européen, nous suivons de très près l'élaboration du projet de règlement REACH dont nous attendons beaucoup. Le but est d'améliorer nos connaissances, mais également de chercher à éviter les risques dès le stade de la mise en marché par le jeu d'un mécanisme d'autorisation préalable applicable aux substances les plus préoccupantes pour l'environnement et la santé humaine. Cette démarche innovante ne va évidemment pas sans difficultés, compte tenu des divergences d'intérêts : les milieux industriels notamment considèrent ces contraintes comme excessives au regard des objectifs de compétitivité des entreprises européennes. M. Marc BOISNEL : La sous-direction des conditions de travail comptait antérieurement six bureaux avec une organisation verticale classique, par risque, conforme à une approche réglementaire. Nous sommes en train de la modifier profondément, afin de passer très prochainement à une approche transversale structurée autour de trois pôles : politique générale et stratégie - que vous présentera Mme Palud -, thématiques santé - que vient de présenter M. Guyot -, sécurité au travail, qu'il s'agisse des équipements comme des lieux. La sous-direction, qui rassemble soixante personnes, a quatre grandes caractéristiques communes à tous les bureaux : une très forte dimension interministérielle, avec la configuration classique « ministères protecteurs (travail, environnement, santé, ...) versus ministères défenseurs d'intérêts économiques » ; une énorme dimension européenne, les deux tiers de notre activité nationale découlant de ce qui se fait au niveau communautaire ; une concertation sociale traditionnellement permanente sous forme de contacts bilatéraux avec toutes les organisations professionnelles et syndicales, mais également de rencontres multilatérales beaucoup plus formalisées, dans le cadre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (CSPRP) notamment, réunissant partenaires sociaux, autres ministères et spécialistes en prévention ; une situation enfin « en prise directe » permanente avec l'inspection du travail, via, en particulier, des actions prioritaires. Le bureau dirigé par Mme Palud est issu, quant à lui, de la fusion de deux bureaux dont l'un était, jusqu'alors, spécifiquement dédié à la seule médecine du travail, dans le but, précisément, de passer à une approche transversale au niveau de l'entreprise mêlant la médecine du travail et les autres acteurs du terrain. D'où son organisation en un pôle « stratégie macro » et un pôle « entreprises ». Mme Isabelle PALUD-GOUESCLOU : Mon bureau assure effectivement tout à la fois le pilotage stratégique et l'animation et l'organisation de la politique de prévention des risques professionnels, ainsi que celles de plusieurs commissions du CSPRP. Il a donc un rôle de veille, d'impulsion, de mise en œuvre et de suivi de l'ensemble des plans d'action gouvernementaux. Le pôle n°1, « Politique générale de la prévention des risques professionnels », à vocation stratégique, est chargé de donner le tempo et de définir les grandes lignes de la politique du travail. Il a notamment une fonction de veille pour tout ce qui concerne le suivi des accidents du travail, mais également des études menées par la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques. Il a également une fonction de pilotage des plans d'action pluriannuels : le PST 2005-2009, mais également le Plan national santé environnement (PNSE), le premier à traiter de façon globale des dangers dans tous les milieux, environnemental, domestique et professionnel. Ce rôle de pilotage vaut également pour la conduite d'actions européennes et internationales - suivi de directives, travaux de l'Organisation internationale du travail (OIT). Ces actions sont menées dans tous les bureaux de la sous-direction, mais elles exigent une coordination sur la philosophie et les aspects transversaux. Autre fonction appelée à prendre de plus en plus d'importance : le pilotage et la tutelle des opérateurs de l'État. Depuis 1973, nous assurons la tutelle de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail - l'ANACT. Nous avons commencé à faire de même avec l'AFSSET créée par l'ordonnance du 1er septembre 2005. C'est pour nous un sujet hautement stratégique, compte tenu du besoin de développer les connaissances. Ce pôle est enfin chargé de la gestion des crédits de l'ensemble de la sous-direction - 27 millions d'euros - ainsi que des opérations d'information et de communication. Nous organisons ainsi tous les trois ou quatre ans une manifestation internationale - le Forum international travail - santé - réunissant environ 500 personnes pendant deux jours. Le pôle n°2, « Acteurs et organisation de la prévention en entreprise », a une vocation plus opérationnelle, l'application du droit dans l'entreprise, examinant dans sa globalité les relations avec l'ensemble des partenaires : les entreprises, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les salariés eux-mêmes. C'est lui qui suit plus particulièrement la réforme de la médecine du travail. Ce pôle a également une activité, non négligeable, de traitement des recours hiérarchiques et contentieux intéressant la médecine du travail ainsi que la représentation des CHSCT dans l'entreprise. Le pôle n°1 joue donc un rôle de pivot, au sein de la sous-direction, mais également vis-à-vis de ses partenaires extérieurs - partenaires sociaux, opérateurs de prévention, autres ministères. Nous travaillons à cette réorganisation depuis plusieurs années dans un souci constant de décloisonnement des politiques publiques. Ce mode d'action fonctionne de mieux en mieux - pour ce qui me concerne en tout cas. Si le Plan national santé/environnement (PNSE) comme le plan santé au travail (PST) ont pu s'élaborer dans ces conditions, c'est grâce à une très forte coopération interministérielle M. le Président : Je mesure les difficultés de l'exercice, pour l'avoir vécu durant plusieurs années ! M. le Rapporteur : On nous reprocherait de ne pas étendre notre réflexion sur l'amiante aux autres risques. Reste que l'amiante est le premier objet de notre mission. Quelle est votre appréciation sur la situation générale de la prévention des risques liés à l'amiante ? M. Patrick GUYOT : Nous sommes dans une configuration tout à fait particulière dans la mesure où l'amiante a été totalement interdit le 1er janvier 1997. Un décret de protection des travailleurs exposés du fait d'activités de désamiantage ou de maintenance existe depuis février 1996. Nous surveillons évidemment cette question de très près dans la mesure où cette affaire est loin d'être terminée. Une réflexion est en cours sur une réforme du décret de 1996 pour renforcer davantage encore ces règles de protection, en particulier dans le cas d'enlèvement d'amiante non friable, problème sur lequel nous avons été plusieurs fois alertés. Cette réflexion n'est du reste pas sans lien avec la transmission de la directive de 2003 dont certains éléments attendent d'être transposés. L'amiante pose essentiellement une problématique de contrôle. Pour ce qui nous concerne, nous avons mené depuis 2004 une série de campagnes ciblées (inspection du travail, INRS21, CNAMTS22), dont la dernière, en 2005, a été menée durant deux mois sur l'ensemble des chantiers et été étendue à l'amiante non friable. Nous essayons, par ce biais, de renforcer la surveillance des activités de traitement de l'amiante. Nous menons également une réflexion sur le système de certification des entreprises, qui jusqu'à présent ne prenait pas l'amiante non friable en compte. La nouvelle campagne 2006 sera liée à une campagne européenne de contrôle. M. le Rapporteur : Vous avez parlé de modifications au décret de 1996. Dans quelles directions travaillez-vous ? M. Patrick GUYOT : Nous venons tout juste d'engager une série de concertations. En gros, cela tourne autour du besoin de renforcer certaines règles de qualification des entreprises au regard, notamment, de l'amiante non friable, sans pour autant aller trop loin : compte tenu du très grand nombre de petites entreprises, il y a un équilibre à trouver. Un régime excessivement contraignant ne pourrait que favoriser les pratiques clandestines. Nous prévoyons également tout un volet visant à renforcer les règles de formation des travailleurs intervenant sur l'amiante. M. le Président : Ce n'est pas par hasard si nous avons commencé par réfléchir sur le problème de l'amiante résiduel. La distinction entre amiante friable et non friable résistera de moins en moins au temps... M. Patrick GUYOT : Tout à fait. M. le Président : L'extension de la qualification des entreprises à l'amiante non friable sera effectivement un problème lourd. Vous appelez à un équilibre, afin d'éviter les pratiques clandestines ; mais celles-ci existent déjà, comme nous avons pu le vérifier. Les artisans ne mesurent pratiquement pas le risque ; ceux qui en ont une petite idée mettent un masque en papier... La plupart ne mettent rien. Enfin, quelles relations entretenez-vous dans le cadre du projet REACH ? M. Patrick GUYOT : Tout l'enjeu porte sur le contrôle, le renforcement des règles et la sensibilisation des salariés. S'agissant des pratiques clandestines, certains éléments d'alerte ont pu survenir à l'occasion des campagnes ciblées dont j'ai parlé - tout au moins celle de 2004 : les résultats la campagne 2005, en cours d'analyse, seront connus début novembre. L'important est que l'inspection du travail se structure pour repérer également ces pratiques. Pour ce qui nous concerne, nous sommes dans une logique de protection, sans cesse renforcée, et de sensibilisation des entreprises, comme des travailleurs. M. Ghislain BRAY : Ces pratiques clandestines concernent essentiellement, j'imagine, l'amiante non friable ; pour l'amiante friable, les entreprises doivent désormais faire état de compétences et de qualifications reconnues, à quelques écarts près. Mon souci porte sur les entreprises qui, théoriquement, devraient avoir une qualification et qui sont sélectionnées pour opérer sur l'amiante non friable. Dans l'établissement où je travaillais, notre section « canalisation et hygiène publique », pendant des années, avait utilisé des tuyaux d'amiante-ciment. Une entreprise avait été choisie pour nous débarrasser de notre stock. Évidemment, les ouvriers portaient leur belle combinaison blanche, avec capuche et masque, et chargeaient les déchets dans de grands sacs placés dans les bennes... À ceci près que les tuyaux de quatre mètres entrant difficilement dans les sacs, ils les ont, à ma grande stupeur, hachés menu sur le gazon ! Là est le vrai problème. Je comprends que l'on veuille améliorer le décret de 1996 et s'intéresser à l'amiante non friable. Mais l'intervention d'entreprises, soi-disant reconnues et qualifiées, continue à donner lieu à des dérapages préoccupants. Comment réagir ? Quelle information faut-il faire passer ? Que peut-on, dès maintenant, exiger de ces entreprises, en attendant que le décret soit modifié ? M. Patrick GUYOT : Ces éléments mériteraient une analyse préalable... Le fait est que l'amiante non friable ne donne pas encore lieu à certification. C'est tout l'enjeu de la réforme engagée. Cela dit, si des entreprises sont en dehors des règles, il appartient à l'inspection du travail de jouer son rôle et de prendre les mesures qui s'imposent. On ne peut reprocher à l'administration centrale de ne pas avoir une connaissance précise de tout ce qui se passe sur le terrain. M. Marc BOISNEL : Au-delà de l'aspect réglementaire, nous devons collectivement contribuer à diffuser les bonnes pratiques professionnelles. Or ce n'est pas la vocation première du ministère, mais celle des organismes avec lesquels nous sommes régulièrement en contact. Ainsi, l'INRS a été créé pour apporter une assistance technique aux entreprises en diffusant, par divers supports, des conseils pratiques sur la prévention et les bons gestes professionnels. Il travaille en étroite relation avec les organisations professionnelles. Il nous appartient évidemment de le stimuler, à ceci près que nos seules armes sont la persuasion et la coordination informelle. La gouvernance de ces organismes, qui dépendent de la sécurité sociale, ne relève en aucun cas du ministère. M. le Rapporteur : Mes questions suivantes peuvent concerner l'amiante, mais également les produits chimiques, voire radioactifs. Que pensez-vous des réactions collectées sur le « Plan santé au travail » 2005-2009, du côté notamment des partenaires sociaux et des syndicats ? Quelle est la place des partenaires sociaux dans la prévention des risques professionnels ? Pensez-vous, enfin, que l'on peut faire un travail de recherche préventif sur le risque à partir des documents fournis par les entreprises ? M. Marc BOISNEL : Les réactions au PST se divisent en deux grands groupes. Du côté des autres ministères, partenaires décisifs, je confirme la volonté d'un décloisonnement et d'un véritable travail de coproduction entre les ministères protecteurs. Du côté des partenaires sociaux, les réactions ont beaucoup varié dans le temps. Très négatives au moment de la mise en chantier - et des deux côtés de la table -, elles ont tourné autour du thème de la nationalisation rampante de ce qui normalement revient aux partenaires sociaux à travers la gestion de la sécurité sociale. Le message était clair et net : « Nous avons nos organismes, nos outils, nous travaillons bien, nous n'avons pas besoin de l'État dans cette histoire ». À cette première phase assez virulente, durant laquelle nous avons persisté à défendre le plan, a succédé une phase plus contributive : la quasi-totalité des organisations professionnelles et syndicales nous ont remis des documents de travail en vue d'une éventuelle intégration. Toutes intéressantes, ces contributions n'étaient pas pour autant toujours opérationnelles. Non seulement elles étaient largement contradictoires, mais bon nombre ne cadraient pas avec le contexte politique actuel : développer les moyens des CHSCT mérite à l'évidence débat, mais il faut savoir faire preuve de réalisme... Enfin, dans une troisième phase, les partenaires sociaux - et ils l'ont réaffirmé publiquement tant à l'occasion de nos contacts bilatéraux qu'au moment du bouclage final du PST devant le Conseil supérieur - ont globalement finalement souscrit au plan - avec des nuances - en reconnaissant qu'il s'agissait d'un pas dans la bonne direction, mais en regrettant qu'il n'aille pas assez loin et que l'on ne soit pas sûr des moyens prévus par l'État. Mme Isabelle PALUD-GOUESCLOU : Je confirme cette évolution progressive de la position des partenaires sociaux, en ajoutant une petite note d'ambiance. Au début, nous avons souvent été confrontés à cette remarque de fond : « Que l'État fasse ce qu'il veut, mais pas avec nos sous, et surtout, qu'il n'empiète pas sur nos compétences ! » - le principe étant que l'État détient la responsabilité des politiques publiques et des mesures d'ordre sociales, les partenaires sociaux assurant la gestion du risque et sa réparation. Peu à peu, la situation a évolué à mesure que les partenaires sociaux, y compris les entreprises, s'apercevaient que plus personne ne pouvait passer à côté du sujet et comprenaient l'intérêt d'une coordination et d'une meilleure articulation. C'est particulièrement vrai pour les organismes de prévention. Nos liens se sont notamment resserrés avec la CNAMTS : nous avons depuis peu des programmes d'actions prioritaires communs. L'histoire pousse à des rapprochements tant des logiques que des actions. M. Patrick GUYOT : Je veux insister sur la question de la répartition des rôles en matière d'expertise, question qui ne se pose pas seulement pour le PST. Notre objectif est clair : nous tenons à bien séparer la phase d'expertise scientifique de la phase de concertation sociale - cela n'est pas sans susciter des réactions négatives des partenaires sociaux qui ont le sentiment d'être dépossédés de leur propre expertise. Pour l'État, la priorité est de pouvoir faire appel à une expertise indépendante et déconnectée de tout intérêt particulier. Pour ce faire, la phase d'expertise doit relever exclusivement des agences publiques de sécurité sanitaire et être clairement séparée de la phase de concertation sociale. C'est un point fondamental, mais assez difficile à faire passer... M. Marc BOISNEL : La mise en œuvre de ce principe de séparation entre l'évaluation scientifique du risque et sa gestion est un de nos combats de tous les jours. Pour nous, la gestion commence avec une phase de concertation sociale, prélude à la décision politique. Mais, alors même qu'il nous est désormais possible de produire, par divers canaux, des expertises plurielles et indépendantes, les partenaires sociaux, et des deux côtés de la table, persistent à penser qu'ils ont un rôle à jouer dans l'expertise première. Ainsi que nous nous évertuons à le leur expliquer, nous ne cherchons, à travers nos outils publics d'évaluation des risques ou de surveillance des populations, qu'à mettre sur la table un état des lieux scientifiques, afin d'amorcer le débat. Les partenaires sociaux maintiennent, contre l'avis du ministère, que ce sont eux qui devraient être à la source de l'expertise comme point de départ de la discussion et de la prise de décision. Le principe que nous défendons est fondamental et la France le fait de plus en plus partager dans les instances communautaires - travail extraordinairement complexe dans la mesure où il existe une foule de comités d'experts européens ouverts à tous les vents et tous les lobbies -, mais il se heurte à une vive résistance des partenaires sociaux. M. le Président : Ce problème est clairement apparu lors de notre table ronde avec les partenaires sociaux et l'affaire de l'amiante a mis en évidence son caractère central. J'ai toutefois le sentiment, encore diffus, que les positions peuvent évoluer et qu'elles s'apparentent davantage à une interrogation sur la position du curseur qu'à un rejet pur et simple. L'affaire n'est pas simple : la question de la responsabilité dans cette histoire oblige à la plus grande sagesse. M. Patrick GUYOT : Nous sommes quotidiennement confrontés au problème de la responsabilité de l'État. Mme Isabelle PALUD-GOUESCLOU : Vous avez posé la question de l'utilisation des documents fournis par l'entreprise à des fins de recherche sur la prévention. Rappelons que le document unique ne constitue pas une évaluation du risque au sens scientifique, mais une analyse du risque à partir de perceptions, de questions liées à l'organisation, aux techniques, aux facteurs humains. Élaboré sous la responsabilité du chef d'entreprise en relation avec le personnel, il n'est pas forcément exploitable : il n'existe pas de document unique type et il ne peut prétendre à déboucher sur des données objectives. Il est évidemment essentiel à la prévention dans l'entreprise, mais le but n'est pas tout à fait le même. D'autres éléments d'information permettraient d'améliorer la connaissance du risque : ainsi en est-il des informations qui pourraient remonter via la médecine du travail qui, avec la réforme, doit jouer un rôle clé dans la transmission de données épidémiologiques et autres. Cela vaut également pour celles que les entreprises devront fournir à l'Institut de veille sanitaire (IVS), en application de la loi relative à la santé publique. M. Marc BOISNEL : Nous-mêmes percevons cette heureuse maturation que vous sentez chez les partenaires sociaux. Ils n'en restent pas moins fortement attachés à leur idée de départ. J'en veux pour preuve les premières réactions enregistrées lors de la création de l'AFSSET : en dépit des indéniables points communs que l'on retrouve entre les approches professionnelle et environnementale - a fortiori lorsqu'il s'agit d'étudier les propriétés intrinsèques et les dangers d'une molécule -, les partenaires sociaux n'en continuent pas moins de réagir négativement à l'idée d'être fondus dans un ensemble plus vaste englobant environnement et travail, au risque de perdre les clés du système, dont ils s'estiment les légitimes détenteurs. « Nous avons réuni les compétences de l'INRS et désormais de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) pour les produits chimiques dans le Bureau d'études et de recherches sur les produits chimiques (BERPC) », nous disent-ils. « Pourquoi créer une agence publique sur ce sujet et nous fondre dans un ensemble où nous n'aurons plus voix prépondérante ? » Autant dire qu'il reste encore du chemin avant de les voir accepter cette idée... À côté des questions de responsabilités se posent également celles des sources d'expertise. Pratiquement chaque semaine voit une nouvelle molécule arriver sur le marché. Chaque jour voit se créer un nouveau processus industriel. C'est donc bien dans les entreprises que se trouve l'expertise à un moment donné, et il serait totalement irresponsable de s'en priver. Ce qu'il faut en revanche, par le jeu tout à la fois des organismes publics et de méthodes et procédures plurielles et contradictoires, c'est sortir de ce flou que l'on a connu avec l'amiante, où il était difficile de distinguer entre la réalité scientifique et l'expression d'un intérêt. La difficulté de la prise de décision dans l'incertitude scientifique est notre lot quotidien... Ce qui nous ramène à l'énorme problème de la connaissance, diagnostiqué tant par le PNSE que par le PST, et à l'impérieuse nécessité de développer la recherche sur ces sujets. Ni la France ni l'ensemble européen ne disposent pour l'heure des moyens d'expertise nécessaires pour savoir ce que nous devrions savoir. M. le Président : On pourrait discuter à l'infini de la signification du mot « expertise »... M. Marc BOISNEL : C'est vrai. M. le Président : Pour aller au plus simple, il y a d'une part la recherche fondamentale, de l'autre la recherche appliquée. Or le plus souvent, tout part de l'entreprise. Comment parvenir à un rapprochement ? Sera-ce le rôle de l'AFSSET ? Le problème de l'amiante est significatif : il y avait d'un côté une expertise, ou plutôt une connaissance scientifique, et de l'autre une application dans l'entreprise - on imagine le rôle qu'a pu jouer le comité permanent amiante. Je m'étonne parfois que les partenaires sociaux n'aient pas davantage conscience de cette problématique. Quel est votre sentiment sur cette différenciation entre la recherche fondamentale et ses applications ? M. Marc BOISNEL : Ce sont là des problèmes tout à la fois centraux et terriblement complexes du fait de l'extraordinaire diversité et de l'évolutivité des applications et processus industriels. Nous pourrions, certes, nous inspirer de la situation idéale - mais malheureusement impraticable, sitôt que l'on cherche à la transposer à l'échelle de toutes ces applications -, du principe dit de « justification » utilisé dans le cas de la protection contre les rayonnements ionisants. Le principe de justification consiste à dresser un bilan coût/avantages de l'utilisation des rayonnements ionisants, assorti d'un critère discriminant : le bénéfice sanitaire. Cela a conduit à interdire toute une série d'applications dans lesquelles l'inconvénient sanitaire apparaissait très supérieur au bénéfice social. Malheureusement, ce qui est possible avec un seul facteur - les rayonnements ionisants - et un nombre d'applications limité devient inimaginable, dans la pratique, sitôt que les facteurs se multiplient et donnent lieu à des dizaines de milliers d'applications industrielles. Force est de s'en remettre à la conscience collective qui, grâce aux progrès de la réglementation et des contrôles, permet de démanteler progressivement les facteurs de risque les plus dangereux par l'application du principe de substitution. Il est en tout cas difficile d'imaginer comment l'AFSSET - indépendamment de la question de ses moyens et du fait qu'elle ne soit que tête de réseau - pourrait avoir une vue d'ensemble d'une problématique aussi énorme, liée à la prolifération croissante des innovations industrielles. M. Patrick GUYOT : On estime que l'on met une nouvelle substance chimique par jour sur le marché... Nous avons déjà un gros problème d'évaluation de l'existant ; se pose au surplus toute la problématique de l'innovation technologique. Tout l'enjeu de REACH est de faire en sorte que les stratégies d'évitement de risques soient arrêtées le plus en amont possible, dès le stade de la mise sur le marché, sinon dans les stratégies de recherche elles-mêmes. M. le Président : Ce qui correspondrait à l'évaluation préalable à la mise sur le marché d'un médicament. Ce serait en tout cas une démarche de même nature. M. Patrick GUYOT : REACH prévoit un système d'autorisation pour les CMR23 de catégories 1 et 2, autrement dit les substances les plus dangereuses, utilisées dans les milieux professionnels. Les produits potentiellement dangereux sont classés en trois catégories, les catégories 1 et 2 correspondant à des dangers avérés, pour l'homme et pour l'animal. Se pose également la question de savoir comment vérifier l'effectivité de l'obligation de substitution dans l'entreprise - opération d'autant plus complexe qu'elle doit être déclinée usage par usage pour chaque substance. Le principe posé par le droit du travail oblige à substituer à un produit dangereux un produit non ou moins dangereux, dès lors que c'est techniquement possible. Mais comment vérifier dans les faits que l'impossibilité ne cache aucun sous-entendu ou arrière-pensée d'ordre économique ? Nous n'avons pas les moyens de savoir si, pour les dix usages de telle substance, il existe ou non des solutions de substitution. Sans attendre la création de l'AFSSET, le ministère du travail s'était, dès 2004, associé à des saisines de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE), à propos de certaines substances préoccupantes - les fibres minérales artificielles, les éthers de glycol, le formaldéhyde. Nous avons systématiquement demandé que cette agence s'emploie à développer des compétences propres à nous éclairer sur l'existence ou non de solutions de remplacement. Force est de reconnaître que cela ne sera pas simple : non seulement cela exige de développer une ingénierie spécifique, mais quelles informations les industriels accepteront-ils de communiquer sans soulever de problèmes de confidentialité ? M. le Rapporteur : De quelle façon est traitée la prévention des risques professionnels dans le domaine des rayonnements ionisants ou encore dans la filière nucléaire, qu'il s'agisse des centrales ou des unités de retraitement ? Pourrait-on s'inspirer d'un outil tel que l'autorité de sûreté nucléaire ? M. Patrick GUYOT : La radioprotection des travailleurs fait l'objet d'une réglementation spécifique issue du décret du 31 mars 2003, lui-même issu d'une directive européenne. En plus du principe de justification, déjà évoqué, il détaille toute une série de mesures de protection spécifiques à ce type d'exposition, avec notamment un système de valeur limite à l'exposition professionnelle, exprimée en millisieverts - mSv - par an, ainsi qu'un suivi dosimétrique de l'ensemble des travailleurs exposés, dont les données sont centralisées à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Un système de proratisation permet d'éviter tout dépassement de dose, y compris dans le cas de contrats à durée déterminée qui pourraient inciter à des phénomènes dits de gestion de l'emploi par la dose. Cette réglementation particulière n'est pas sans certains points communs avec celle qui s'applique aux substances chimiques et qui, elle aussi, fixe des valeurs limites d'exposition professionnelle, afin de limiter les concentrations dangereuses dans l'atmosphère de travail. M. Marc BOISNEL : Les réglementations protectrices sont généralement des réglementations génériques, par familles de risques, de type cancérogène ou reprotoxique, ou par « paquets » d'agents chimiques dangereux, certains faisant l'objet de textes spécifiques. Tous ces textes ont en commun les principes fondamentaux de prévention, classification, substitution, la mise en œuvre de solutions protectrices de type « système clos », la priorité donnée à la protection collective et, au besoin, la mise à disposition de protections individuelles. Autres points communs, les règles de suivi médical, d'information et de formation des travailleurs. Le tout forme un cadre horizontal et normé par l'Europe. Ce à quoi vient s'ajouter, dans le cas des rayonnements ionisants, un mécanisme d'origine législative destiné à interdire toute rotation de travailleurs sous contrat précaire qui, une fois la dose limite d'exposition atteinte, se retrouveraient sans emploi. Mais, au-delà de ces dispositions très spécifiques, on retrouve toujours un cadre commun à l'ensemble des règles de protection. M. le Président : Madame, Messieurs, nous vous remercions. Ce sujet est passionnant, mais nous en mesurons en même temps les terribles difficultés. Audition conjointe de M. Jean-Luc MARIÉ, directeur général de l'INRS, et de M. Jean-Claude ANDRÉ, directeur de la recherche scientifique Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Messieurs, nous sommes heureux de vous recevoir. Rappelons que l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) est une association, financée presque exclusivement par la sécurité sociale et dont le conseil d'administration est composé de façon paritaire par les partenaires sociaux. Le rôle de l'INRS est quadruple : recherche en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles, assistance aux politiques de prévention, publication d'informations et formation des acteurs de la prévention. M. Jean-Luc MARIÉ : Association loi de 1901, l'INRS a été créé en 1947, lors de la naissance de la sécurité sociale, sous le nom d'Institut national de sécurité (INS). Nous sommes devenus Institut national de recherche et de sécurité au moment des ordonnances de 1968, lorsque l'INS s'est adjoint le CERPAT, Centre d'études et de recherche pour la prévention des accidents du travail, mis en place par la Caisse nationale de sécurité sociale à Vandœuvre-lès-Nancy, avec des bâtiments très particuliers reproduisant les ambiances des usines de l'époque. Une partie études, recherche et recherche appliquée s'est ainsi mise en place à partir des années 70, avec le développement du centre de Lorraine. Créé sous l'égide de la CNAM, l'INRS fait clairement partie de la branche « accidents du travail - maladies professionnelles » (AT-MP) du régime général de la sécurité sociale - mais il nous arrive de travailler avec d'autres partenaires. Nous sommes donc l'expert, le conseil de l'assureur social public, en l'occurrence la branche AT-MP, financée à 97 ou 98 % par les cotisations des entreprises. M. le Président : D'où viennent les 3 % qui restent ? M. Jean-Luc MARIÉ : Des ventes de publications à d'autres régimes, éventuellement de travaux à façon et de contrats européens via notre agence de Bilbao24. Avec un budget de 75 ou 76 millions d'euros, l'INRS emploie quelque 670 personnes réparties sur deux centres - 460 à 470 en Lorraine, à Vandœuvre et Neuves-Maisons où nous avons un centre de formation, et 200 au siège social à Paris, dans le XIVe arrondissement. Dès lors que nous travaillons pour le régime général et les entreprises du régime général, tout ce que nous faisons est gratuit. À la différence de certains établissements publics, l'INRS n'a aucun contrat privé. Non seulement nos travaux sont gratuits, mais ils sont également publics et donc diffusés. Pour remplir ses missions telles que définies dans ses statuts, l'INRS a quatre modes d'action. En premier lieu, et depuis les années 70, l'institut conduit des études et recherches, pour la plupart tournées vers des applications concrètes, l'objectif étant de trouver des solutions de prévention applicables en entreprise. À cette fin, nous gérons des interfaces avec d'autres organismes de recherche et l'université pour transformer des savoirs fondamentaux en solutions de prévention. Pour autant, nous ne prétendons pas, faute de moyens, couvrir la totalité du champ. Ce volet représente un petit tiers de nos activités. Le plus gros des activités de l'INRS - 40 % - est constitué par l'assistance : assistance, en premier lieu, au réseau de la branche AT-MP, CNAM, caisses générales de sécurité sociale et caisses régionales d'assurance maladie. Nous répondons à leurs questions et nous menons, au besoin, des investigations plus poussées que ne peuvent le faire les services de prévention des caisses régionales. Il est à noter que ce sont eux qui sont au contact des entreprises et non l'INRS : autrement dit, nous n'intervenons dans les entreprises qu'à la demande de la caisse régionale. Nous allons dans les entreprises à la demande des caisses générales et souvent des caisses régionale d'assurance maladie (CRAM) dans le cadre d'études ou recherche, mais aussi dans le domaine de l'assistance : ainsi l'enquête épidémiologique que nous avons effectuée chez Usinor à Dunkerque pendant les cinq dernières années, en étroite liaison avec la CRAM Nord-Picardie. Mais les directions d'entreprise ou le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peuvent également nous saisir. Dans ce cas, nous renvoyons la demande à la CRAM qui se chargera de l'instruire en liaison avec la direction de l'entreprise et le CHSCT. L'assistance passe également par note site Internet, http://www.inrs.fr/, créé il y a un peu plus de cinq ans et qui enregistre environ 20 000 connexions par jour, dont 40 % hors France (Europe et Amérique du Nord). M. le Président : Sur quels sujets ? M. Jean-Luc MARIÉ : Tous les sujets. L'INRS ne sert parfois que de point de contact, mais nous réorientons systématiquement la demande. Pour ce qui concerne les rayonnements ionisants, par exemple, nous avons un accord-cadre permanent avec l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Un de nos spécialistes est chargé de répondre aux questions les plus simples, mais, sitôt qu'elles dépassent nos compétences, nous renvoyons la demande à des correspondants bien identifiés de l'IRSN. De même pour ce qui touche aux incendies et explosions : nous répondons tant que nous le pouvons, sinon nous renvoyons sur l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) qui dispose de spécialistes plus compétents que nous dans ce domaine. L'important dans ce rôle d'assistance et de conseil est de toujours bien réorienter le demandeur. Parallèlement, nous recevons quelque 40 000 demandes écrites par an, par lettre, télécopie ou courriel, provenant de tous les horizons : CRAM, médecine du travail, mais également, et de plus en plus, de particuliers. Ce n'est d'ailleurs pas sans poser problème. Ainsi cette mère de famille qui nous demandait, par courriel, s'il y avait des éthers de glycol dans le white-spirit que manipulait son fils assistant peintre. Nous lui avons répondu par la négative mais nous l'avons prévenue qu'il était beaucoup plus dangereux de se laver les mains au white-spirit à longueur de temps que de manipuler certains éthers de glycol... La « porosité médiatique » a parfois des effets pervers pour la compréhension des phénomènes par nos concitoyens ! Nous sommes également en réseau avec les centres anti-poisons, dans le cadre du contrôle des produits chimiques que l'INRS exerce depuis 1979 pour le compte de l'État et à la demande, notamment, de la Direction des relations du travail (DRT). Mais cela devrait bientôt changer avec le projet européen REACH. L'assistance représente donc une grosse part de notre activité qui mobilise, outre nos départements spécialisés, la totalité de nos départements scientifiques et techniques. Troisième mode d'action : la formation. L'INRS est le maître d'ouvrage délégué de la formation pour l'ensemble de la branche AT-MP. Notre département formation compte vingt-cinq à trente personnes. Nous formons soit directement, soit des formateurs (formations de formateurs) : formation interne pour les ingénieurs conseils, pour les contrôleurs de sécurité des CRAM, formation continue des médecins du travail, formation de moniteurs brevetés SST Par ailleurs, un accord fondamental a été signé en 1993 entre le ministère de l'éducation nationale et la branche AT-MP sur l'intégration de la prévention dans les référentiels et cursus de l'enseignement technique et professionnel. Sont ainsi concernés 200 000 étudiants par an. C'est à mes yeux une des meilleures choses que l'on ait faites dans la décennie 90. Quatrième mode d'action, la diffusion de l'information, à partir de notre site Internet, mais également par le biais de quelque 350 brochures spécialisées, régulièrement mises à jour et complétées par de nouvelles publications. Nous publions trois revues25. Travail et sécurité26 est un magazine mensuel qui s'adresse à tous les acteurs de la prévention : membres des CHSCT, médecins du travail, chefs d'entreprises, etc. Tiré à 80 000 exemplaires, il est diffusé à 60 000 exemplaires, plus 15 000 abonnés. Éditée chaque trimestre, la revue Documents pour le médecin du travail27, tirée à 8 000 exemplaires, apporte des informations techniques, médicales et juridiques aux médecins du travail et autres professionnels de santé. Enfin, Hygiène et sécurité du travail28 est la revue scientifique et technique de l'INRS. Éditée depuis cinquante ans - nous venons de fêter son deux centième numéro -, cette revue trimestrielle est beaucoup plus orientée vers les aspects techniques de la prévention. Par ailleurs, l'INRS est très connu depuis plus de cinquante ans par ses affiches, diffusées à raison d'un million par an. À côté de son travail pour le compte du régime général, l'INRS travaille également avec la puissance publique : en plus du contrôle des produits chimiques, déjà évoqué, qui prendra fin avec la mise en place du règlement REACH, nous sommes également agréés par la DRT pour l'inter-comparaison des laboratoires, autrement dit pour le suivi des laboratoires chargés de vérifier la présence de silice, de plomb, de mercure et de benzène. Nous avons également des conventions cadres, depuis longtemps avec la DRT, l'IRSN, et l'INERIS, depuis quatre ans avec l'institut de veille sanitaire, avec l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) depuis sa création et une en cours d'élaboration avec l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET). Dans le cadre de l'évaluation des dangers et des risques des produits chimiques, nous avons créé le 14 février dernier avec l'INERIS le Bureau d'évaluation des risques, des produits et agents chimiques, en cours de mise en place. Son effectif est composé à parts égales d'agents de l'INRS et de l'INERIS mis à disposition. Il est appelé à devenir un pôle de premier ordre d'évaluation des dangers, mais également des risques des agents chimiques, notamment dans le cadre de la mise en place de REACH. Le Bureau d'évaluation des risques des produits et agents chimiques (BERPC) sera évidemment à la disposition des pouvoirs publics et des demandeurs, mais également de la future agence des produits chimiques installée à Helsinki. D'ores et déjà, ce bureau travaille avec la Direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère de l'écologie et du développement durable sur l'évaluation des biocides, sous la coordination de l'ex-AFSSE (Agence française de sécurité sanitaire environnementale), devenue l'AFSSET. M. le Rapporteur : L'INRS est déjà une vénérable institution... Le cas des demandes d'informations particulières mis à part, qui vous demande de travailler sur le white-spirit ou les éthers de glycol, par exemple ? Qui organise vos programmes ? Compte tenu de votre ancienneté, quel rôle avez-vous joué - ou vous a-t-on fait jouer - dans l'affaire de l'amiante, avant 1977 et pendant la période 1977-1997 ? L'INRS a-t-il été chargé de missions particulières ? M. Jean-Claude ANDRÉ : L'organisation des programmes est une question assez délicate. Même si, dans sa catégorie, l'INRS est certainement l'un des plus gros instituts d'Europe, sinon du monde, il ne représente que quelques pour mille de la recherche française. Nous sommes donc obligés de faire des choix. Dans le cas de dangers connus, la mission de l'INRS est de trouver les moyens de protéger les salariés et donc de toucher à l'ingénierie : changer les procédés, trouver des systèmes de protection collectifs - contre le bruit, par exemple -, et, lorsqu'on ne peut pas faire autrement, mettre au point des équipements de protection individuels. Le rôle de certains de nos départements spécialisés dans les domaines d'ingénierie est ainsi de répondre à des enjeux bien connus, et si leur action ne conduit apparemment pas à des résultats immédiats, elle permet de mettre en place une normalisation et de changer la culture en la matière. Cette activité est quasiment programmée du fait que les dangers sont connus, sont causes d'accidents répertoriés au niveau national et international, ce qui nous amène à nous préoccuper d'aspects relativement faciles à identifier. Cela dit, nous nous retrouvons bien obligés au quotidien de gérer l'interface entre des risques connus et d'autres dont on ne sait encore s'ils posent réellement un problème ; or la question viendra rarement de l'entreprise. Nous sommes dans ce cas conduits à utiliser deux méthodes. La première consiste à développer des liens avec des partenaires occidentaux - nous avons un groupe mondial et un groupe européen - afin de savoir comment ils procèdent et quels moyens ils mettent en œuvre. Cela permet de gagner du temps et d'éviter les doublons. Deuxièmement, nous nous mettons en interaction avec nos collègues des services de prévention des CRAM afin de définir des objectifs raisonnables au regard de nos possibilités de recherche. Nos choix auront donc tendance à porter sur des substances très utilisées, que nous repérerons par les bilans de consommation de certains solvants, par exemple, ou encore en cherchant à anticiper par une étude de la bibliographie - le jeu n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Le troisième domaine est celui de la recherche du risque qui arrivera demain. Avec le charbon, qui remonte à quatre siècles, il suffisait d'attendre que les problèmes apparaissent, et on les éliminait au fur et à mesure. Aujourd'hui, dans des domaines tels que l'électronique, la capacité de mémoire double tous les dix-huit mois cependant que le prix se divise par deux. Pour la génétique, il faut compter deux ans, et deux à trois ans pour les nanotechnologies. Avec de tels systèmes en explosion totale, la question n'est plus de suivre ce qu'il se passe et d'attendre les problèmes, mais d'anticiper et de voir les problèmes qui n'existent pas encore mais qui pourraient émerger demain. Dès lors, notre rôle ne se borne plus à la définition du champ ; il nous appartient d'aller booster nos collègues qui travaillent dans l'innovation en les sensibilisant à la question du risque. Bref, il faut changer la culture de l'innovation pour qu'elle revienne dans le champ social. Parallèlement, dans la mesure où nous sommes obligés d'intensifier nos échanges avec l'extérieur, nous développons de plus en plus, en interne, des logiques de recherche sur l'analyse des dangers. Rappelons qu'un risque est un danger résultant d'une exposition. S'il n'y a pas de danger, l'exposition n'a aucune importance. Si, au contraire, il y a danger, il faut s'attacher à réduire l'exposition. L'essentiel de l'activité de l'INRS porte donc sur la réduction de l'exposition lorsque le danger est connu. Encore faut-il le connaître ; c'est pourquoi nous avons un département spécialisé dans les effets toxicologiques et un autre, capable d'utiliser les connaissances recueillies en interne ou à l'extérieur à des fins d'épidémiologie et de validation pour adapter la réglementation. Il ne nous appartient pas de modifier la réglementation mais nous apportons les éléments scientifiques crédibles pour le faire. M. le Rapporteur : Comment sont arrêtés vos programmes de recherche ? J'ai bien compris que vous étiez sollicités par des entreprises... M. Jean-Claude ANDRÉ : Par les secteurs professionnels. M. Jean-Luc MARIÉ : Nous nous inscrivons évidemment dans les orientations définies par la commission des AT-MP de la CNAM. De son côté, l'INRS définit depuis le début des années 1980 des plans à moyen terme, débattus et adoptés par le conseil d'administration, sur proposition de la direction générale et de la direction scientifique. Ces plans de cinq ans sont ensuite déclinés en programmes d'actions annuels, conformément aux quatre modes d'action exposés plus haut, en fonction de l'environnement extérieur et de l'analyse des remontées et, au-delà, de la perception de l'avenir. Tout le problème est de trouver l'équilibre entre les risques avérés permanents Tout cela se décide également dans le cadre de débats internes au sein de l'INRS, animés par la direction scientifique, mais avec la participation des CRAM, les médecins du travail et parfois les entreprises, au sein également de notre commission scientifique composée de vingt personnalités n'ayant aucun lien avec l'industrie - collègues étrangers, universitaires, instituts. À chaque département et à chaque projet est associé un groupe de suivi piloté par un ou deux membres de la commission scientifique, laquelle évalue le projet et vient rapporter devant la commission Études, recherches et assistance du conseil d'administration, qui lui-même n'a aucun pouvoir sur le résultat de l'étude scientifique. Autrement dit, si les partenaires sociaux, sur la base des éléments qu'on leur aura rapportés, décident des plans à moyen terme et des programmes d'action, ils n'interviennent en rien dans les études et ne font que prendre acte des résultats. Au demeurant, le fait que l'institut mène ses travaux gratuitement et rende systématiquement publics leurs résultats interdit toute possibilité d'ingérence extérieure. Au pire peut-on nous reprocher d'avoir mal travaillé. Votre deuxième question sur l'amiante est plus difficile. Je ne suis pas assez ancien à l'INRS pour y répondre. Sans doute avez-vous déjà interrogé mon prédécesseur. Pour ma part, je vois trois périodes. La première publication de l'INS sur l'amiante et l'asbestose date de 1954. Les plus gros travaux ont pu être menés lorsque l'INRS a pu développer des capacités d'étude et de recherche au début des années 70. Il a ainsi pu mettre au point toute une méthodologie de prélèvement et de mesure, indispensable en la matière. Un prédécesseurs de Jean-Claude André, qui avait participé à l'évaluation de l'amiante à Jussieu en 1976, avait alors préconisé de désamianter les bâtiments le plus vite possible. Le décret de 1977 sur le flocage a été un texte très important ; malheureusement, on n'en a pas tiré les conséquences. Les préoccupations de la décennie 1980 étaient toutes tournées vers l'emploi. L'INRS a fait du bon travail, mais nos concitoyens ne se souciaient guère, à l'époque, de sécurité et de conditions de travail. Il a fallu attendre le début des années 90, le procès du sang contaminé, puis l'article de Julian Petto en 1995 au Royaume-Uni, pour mesurer la réalité des conséquences de l'amiante sur la santé. Dans les années 80, le principe de l'usage maîtrisé tenait globalement lieu de doctrine pour tous les produits - et continue, sur encore bon nombre de produits, à gouverner la prévention en France. Peut-être me trompé-je ; il faudrait poser la question aux personnes directement intéressées, qu'il s'agisse des éthers de glycol potentiellement reprotoxiques ou des produits cancérogènes de niveau 1, à commencer par le benzène. Nous menons actuellement en liaison avec la DRT, dans le cadre du « Plan santé au travail » lancé par M. Larcher, une enquête sur 400 produits CMR29 non directement issus de l'industrie pétrolière, d'une ampleur comparable à celle que nous avons réalisée sur les solvants. Ses résultats devraient être disponibles en décembre ou janvier. L'INRS représentera l'État français dans une réunion en Italie pour le classement du formaldéhyde, que le ministère nous demande à juste titre, après nos évaluations et après classement du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), de faire classer en cancérogène de niveau 1, c'est-à-dire cancérogène avéré pour l'homme. Cela n'ira pas sans poser quelques problèmes dans la mesure où il y en a à peu près partout... Le choix entre principe de précaution et principe de prévention n'est pas toujours facile. M. le Président : Dans les années 80, l'idée de révolutionner les processus de travail était très faiblement répandue ; je l'ai moi-même remarqué. Cela explique beaucoup de choses. Le procès du sang contaminé, puis le scandale de l'amiante... M. Jean-Luc MARIÉ : Et la vache folle. M. le Président : ...et l'affaire de la vache folle ont incontestablement créé un choc. Les conséquences de cette sensibilisation sont très probablement appelées à persister, voire à s'aggraver et à multiplier les interrogations. D'où la difficulté grandissante pour des structures comme la vôtre à se poser en élément de réponse. Ajoutons à cela que les nouvelles techniques, dont le cycle devient de plus en plus affolant, ont souvent des effets retard dont l'apparition est quasi-mécanique. L'amiante en est une illustration évidente. Dès lors se pose le problème de la valeur de l'expertise scientifique, de son indépendance et de la gestion du risque. L'INRS se retrouve au centre du débat, ne serait-ce qu'en raison de sa nature et de son mode de financement. Or non seulement on sent bien qu'il ne peut y avoir d'expertise totalement indépendante, mais le risque, a fortiori s'il y a un effet retard, ne peut en être l'élément déclencheur. D'où la nécessité d'être presque en avance sur les mutations, ou à tout le moins de les suivre de très près. Autant d'éléments que l'amiante a révélés. M. Jean-Luc MARIÉ : Non seulement l'amiante a révélé tout cela, mais les leçons ont été entendues. Pour moi, le contrôle social n'a aucune influence sur la définition d'un risque professionnel. Le contraire serait impensable. On oppose souvent la gestion du risque à l'évaluation en laissant entendre que les partenaires sociaux ne seraient pas nécessairement les mieux placés pour l'évaluation. Or le partenariat social est tout de même la chose la plus efficace qui puisse exister en matière de prévention dans les entreprises. Il peut exister d'autres systèmes - il s'est tenu récemment un congrès mondial aux États-unis -, mais ils paraissent tellement éloignés de nos cultures d'Europe occidentale qu'on ne peut songer à les transposer. La prévention ne peut fonctionner sans un dialogue social dans l'entreprise. Elle ne peut se réduire à la seule application a minima des règles du code du travail. Le mode de gestion paritaire de l'INRS n'a jamais été, en tout cas depuis que je le dirige, un obstacle à la réflexion sur l'émergence des risques. Nous nous sommes penchés, non sans difficultés, sur des sujets parfois très sensibles - la susceptibilité individuelle au risque, les problèmes génétiques, etc. - qui ont donné lieu à d'extraordinaires débats au sein du conseil d'administration. Nous travaillons sur les substituts à l'amiante depuis vingt-cinq ans au prix d'énormes problèmes - Marcel Goldberg vous en a parlé. Nous menons avec lui des enquêtes épidémiologiques et lorsque nous renonçons à une enquête sur les fibres minérales artificielles, c'est parce que nous ne pouvons pas créer de cohorte. Nous avons déjà suffisamment à faire pour ne pas aller dans le mur en dépensant des moyens considérables. Rappelons à ce propos que l'INRS ayant été le seul à répondre à l'appel d'offres du ministère du travail, celui-ci voulait abandonner le projet. Nous avons décidé de continuer avec nos propres moyens. Mais au bout de quatre ans, après y avoir consacré de gros moyens tant techniques qu'humains - sans parler des complications juridiques -, nous nous sommes heurtés à une difficulté proprement insurmontable, de l'avis même de notre commission scientifique. Nous travaillons beaucoup sur les nanotechnologies depuis quatre ou cinq ans, parce que nous pensons effectivement que des risques peuvent apparaître de ce côté-là. Alors que nos moyens sont limités, l'émergence des risques nous impose d'être à même de répondre à tout instant ; nous avons donc tout intérêt à rester à l'écoute, afin de ne pas nous tromper. Le fait d'avoir désormais une prévention des risques professionnels plus ouverte - grâce à la création de notre agence de Bilbao, par exemple, ou par des liens permanents avec nos homologues européens - nous permet de travailler beaucoup plus sur les risques émergents. M. Jean-Claude ANDRÉ : Je suis un produit du Centre national de recherche scientifique (CNRS) détaché à l'INRS. Au CNRS, je vivais à 90 %, hors salaires, de financements industriels. À l'INRS, je ne suis pas amené à chercher de l'argent pour approfondir les études et rendre un avis convaincant. Au demeurant, une publication scientifique n'est pas tout ; il faut parvenir à créer une focalisation sur le sujet. Un financement permettant d'aller jusqu'au bout des études est à mes yeux un élément important. Autre élément important, l'indépendance. À l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail (IRSST), notre homologue canadien, la commission scientifique est composée pour un tiers de représentants de l'industrie, pour un tiers un tiers de représentants des syndicats et pour un tiers de scientifiques « ordinaires ». Même si un consensus est toujours souhaitable, on ne peut pas pour autant exclure la possibilité de certaines pressions. Cela dit, l'INRS est membre d'ECRIN30, une association chargée de rapprocher les points de vue entre scientifiques et entreprises, qui participe à un projet européen sur les nanotechnologies. Sachant que 50 % des financements proviennent de Bruxelles et 50 % des industriels concernés, j'ai imposé la mise en place d'un comité d'éthique. Notre mission de service public n'est pas garantie par la seule existence d'un financement public, national ou européen. Il faut donc être vigilant. Tant qu'il s'agit d'une expertise causale, avec une cause et un effet, l'exercice est facile et tout le monde peut le faire proprement. L'amiante est presque un système causal, quoique décalé dans le temps. Mais nous allons être de plus en plus amenés à donner des conseils sur un champ complexe ou en présence d'informations partielles - nous ne sommes plus très loin du principe de précaution. Que faire pour avancer en protégeant les salariés dans des conditions difficiles et avec une information scientifique modeste ? Là est la vraie question, qu'il ne faut surtout pas laisser brouiller par des pressions venant de tel ou tel partenaire. La séparation de l'acte scientifique du politique, quel qu'il soit, me paraît fondamentale. D'où la nécessité incontournable de pouvoir compter sur des financements qui la garantissent. M. le Président : Tout à fait. M. Jean-Claude ANDRÉ : C'est la politique que l'INRS mène depuis un certain temps : nos financements garantissant notre indépendance : une fois un projet engagé, plus personne n'intervient, hormis les scientifiques. Les résultats sont ce qu'ils sont, point. M. le Président : Reste que le principe que vous venez d'énoncer très clairement n'est pas aussi évident pour tout le monde. M. Jean-Claude ANDRÉ : Voyez ce qu'il en est de certains programmes gérés par l'Agence nationale de la recherche (ANR) : il y a incontestablement création d'une « intentionnalité » de la recherche en France. Qui définit le programme ? Sur quelles bases ? Quant au « Plan santé au travail », l'INRS n'a pas été associé, dans son volet recherche, à son élaboration, bien qu'il représente 60 % de ce qui se fait en la matière en France : le résultat est que bon nombre de contraintes imposées par ce programme ne sont pas socialement justifiées. Il n'existe pas de système où les chercheurs soient totalement indépendants, ne serait-ce que parce qu'ils ont un salaire. Au demeurant, la question de l'indépendance ne se pose pas seulement pour l'INRS, mais à l'occasion de tout choix. En tant que politiques, vous êtes de la même façon amenés à en faire. M. Jean-Luc MARIÉ : Quand bien même les processus n'ont connu que peu d'évolution, les années 80 n'en ont pas moins marqué, grâce notamment aux textes réglementaires de la fin des années 70, une prise en compte plus développée de la prévention. Les chiffres récents me rendent un peu moins pessimiste que Gilles Brücker de l'Institut de veille sanitaire (IVS) : les victimes actuelles de l'amiante ont, pour l'essentiel, été exposées à la fin des années 60 et au début des années 70. Ce qui n'empêche pas que le désamiantage pose un réel problème sur lequel nous travaillons énormément avec la DRT et la CNAM. J'espère que, dans dix ans, ce sera moins pire que ce que l'on craignait pour ceux qui ont travaillé au début des années 80. M. le Président : Quel doit être le rôle de la nouvelle AFSSET par rapport à l'INRS ? M. Jean-Luc MARIÉ : Je me souviens, pour avoir participé aux discussions, que le sénateur Huriet ne voulait pas d'une AFSSE du type de celle qui a été créée... Quoi qu'il en soit, l'AFSSE qu'a voulue le Parlement est une tête de réseau et il en sera de même avec l'AFSSET. L'INRS a toujours travaillé avec tout le monde, et particulièrement le ministère chargé du travail, et montré qu'il apportait une incontestable valeur ajoutée dans le domaine de la prévention des risques professionnels dans l'entreprise. Nous entendons bien continuer ainsi. L'AFSSET, du fait de sa nouvelle dimension, occupera probablement une partie de notre champ. Cela dit, elle s'intéressera d'abord aux risques liés à la chimie et à la toxicologie ; autant dire qu'il en reste 98 % ailleurs, sur lesquels nous continuerons à travailler directement avec la DRT et même le ministère de l'agriculture, pour ce qui touche, notamment, aux machines agricoles. Je n'ai donc aucun état d'âme pour travailler avec l'AFSSET, comme je n'en ai eu aucun à l'égard de l'IVS. Une convention cadre, à l'image de celles qui nous lient à d'autres organismes, est d'ailleurs en cours d'élaboration. Le seul sujet sur lequel j'ai quelques doutes - nous en avons débattu au sein de l'INRS et même avec les partenaires sociaux - tient au fait que la prévention du risque environnemental et la prévention des risques au poste de travail appellent une approche préventive différente. Bon nombre de nos interlocuteurs craignent qu'une prééminence soit donnée à la première, plus parlante, et qui s'appuierait de surcroît sur l'antériorité de l'AFSSE par rapport à l'AFSSET. J'ignore ce que sera le dimensionnement exact de l'AFSSET d'ici deux à trois ans. Je sais que dix experts de haut niveau dans les domaines de la chimie et de la toxicologie sont en cours de recrutement, ce qui me va très bien : nous allons pouvoir travailler ensemble - c'est dans cet esprit que nous avons créé le Bureau d'évaluation des risques des produits et agents chimiques (BERPC) - pour améliorer encore la connaissance et l'information et disposer d'une interface avec l'administration centrale. Je travaille déjà avec Michèle Froment-Védrine31 et ses troupes ; il n'y a aucune raison de penser que ce sera différent avec l'AFSSET. M. le Président : L'environnement est certes un véritable sujet de préoccupation qui est plus facile à illustrer : la photo d'une banquise en train de fondre - quitte à jouer sur les perspectives - éveille beaucoup plus spontanément l'attention... L'affaire est autrement plus complexe avec les risques liés au travail ! Nous organisons une table ronde le 19 octobre prochain, où l'INRS sera représentée aux côtés de l'AFSSET, de la DRT, de la DGS, de la médecine du travail, etc. Nous espérons y retrouver tous les acteurs, l'INRS compris, pour nous aider à formuler nos propositions le moment venu. Nous n'avons pas évoqué la question de vos moyens budgétaires... M. Jean-Luc MARIÉ : Nous n'avons pas trop d'inquiétudes à proprement parler. Même si la situation de la branche AT-MP, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA), etc., n'est plus celle de 1997-1998, nous devrions, à croire la commission des comptes, revenir à l'excédent vers 2008-2009. M. le Président : Je vous recommande la plus grande prudence ! M. Jean-Luc MARIÉ : Vous avez totalement raison. Contrairement à d'autres, je n'ai pas encore dû diminuer mes effectifs, alors que l'institut fédéral allemand correspondant est contraint de réduire les siens de 4 % par an pendant huit ans... Or la prévention, c'est « toujours plus ». Les partenaires sociaux, au niveau tant de mon conseil d'administration que de la commission des AT-MP, se sont toujours efforcés, tout en restant raisonnables, de donner à l'INRS les moyens de sa mission. Je n'ai pas à me battre quotidiennement, comme bon nombre de mes collègues directeurs d'établissements publics, pour chercher les financements nécessaires au bouclage de mes fins de mois. Au moins avons-nous les moyens d'aller au bout de nos travaux. M. le Président : Messieurs, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de cet échange très intéressant. Nous vous retrouverons donc lors de notre table ronde du 19 octobre prochain. Audition conjointe du Dr Renée POMARÈDE, responsable de la mission stratégie de l'Institut de veille sanitaire (IVS), et du Dr Ellen IMBERNON, responsable du département santé-travail de l'IVS Présidence de M. Jean-Marie GEVEAUX, Vice-président M. Jean-Marie GEVEAUX, Président : Mes chers collègues, nous recevons aujourd'hui Mme le docteur Ellen Imbernon, épidémiologiste et responsable du département santé-travail de l'Institut de veille sanitaire (IVS). Nous l'avions déjà entendue dans le cadre de notre table ronde scientifique du 14 septembre dernier. Elle est accompagnée aujourd'hui de Mme le docteur Renée Pomarède, responsable de la mission stratégie à l'IVS. Je vous remercie, mesdames, de vous être rendues disponibles pour cette audition dont l'objet est de nous informer sur les missions de l'IVS dans le cadre de la prévention des risques professionnels, qui constitue notre deuxième thème de travail après la gestion de l'amiante « résiduel ». Je rappelle que l'Institut de veille sanitaire est un établissement public sous tutelle du ministère de la santé. Créé en 1998, il est chargé de surveiller en permanence l'état de santé de la population et son évolution. Il fait désormais partie intégrante du pôle santé au travail, créé par le plan du même nom, avec l'AFSSET, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. Vous intervenez dans le cadre d'une série d'auditions qui nous permettra d'entendre tous les acteurs de la prévention. Nous avons déjà entendu les partenaires sociaux à l'occasion d'une table ronde, puis la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), la médecine du travail, l'inspection du travail, l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et l'administration, notamment, le bureau chargé de l'élaboration du plan « Santé au travail ». Il s'agit pour nous, à partir du drame de l'amiante, d'évaluer les mécanismes actuels de prévention. Cette question fera l'objet d'une table ronde, le 19 octobre prochain, à laquelle nous souhaitons inviter les principaux partenaires chargés de la mise en œuvre du plan santé au travail, dont, bien sûr, l'IVS. Mme Renée POMARÈDE : L'IVS, placé sous la tutelle du seul ministère de la santé, a été créé par la loi de 1998 et s'est réellement mis en place en mars 1999. Nos missions, effectivement, sont la surveillance et l'observation de la santé, la veille et vigilance sanitaire, l'alerte sanitaire, et, depuis la loi de 2004, une mission de contribution à la gestion des situations de crise sanitaire. L'IVS, comme vous le savez, a été créé sur la base du réseau national de santé publique, qui avait été créé en 1992. Les deux piliers de ce groupement d'intérêt public (GIP) étaient la surveillance des maladies infectieuses, et celle de la santé liée aux phénomènes environnementaux. À la suite de la loi de 1998, le champ des surveillances s'est considérablement élargi. C'est ainsi qu'a été constitué un embryon de département santé-travail, dont le volume et les actions se sont accrus depuis. Le budget de l'IVS est aujourd'hui de 49 millions d'euros, et comporte une dotation de l'État d'environ 40 millions d'euros. Il emploie, au niveau central et dans les cellules interrégionales d'épidémiologie, 397 équivalents temps plein (prévision 2006), dont un grand nombre de contrats à durée déterminée, ce qui pose quelques difficultés dans la mesure où les personnels concernés doivent réaliser des missions pérennes. S'agissant des productions de l'IVS, il est évident que les maladies infectieuses et les relations entre santé et environnement sont des champs dont l'antériorité est beaucoup plus grande que les autres, ce qui explique qu'ils aient été l'objet de travaux beaucoup plus nombreux, en particulier dans le cadre de l'alerte sanitaire. La santé au travail est l'objet d'une surveillance continue mais les alertes et les crises sont moins nombreuses. Sur ce sujet, qui était une nouveauté en France, nous avons souhaité, dans un premier temps, structurer l'activité en mettant en place des outils de surveillance pérenne de la santé des travailleurs. Parallèlement à ces outils de surveillance, et prenant en compte les grandes pathologies connues pour être liées à l'activité professionnelle, nous avons mis en place une surveillance épidémiologique des grandes pathologies : les cancers, dont le mésothéliome, mais aussi, plus récemment, les troubles musculo-squelettiques (TMS) et la santé mentale au travail. La part du budget de l'Institut consacrée au département santé-travail était de 5 % en 2003 - le budget total était alors de 30 millions d'euros - et de 6,2 % en 2004. Dans le budget prévisionnel 2005, cette part s'élève à 8,7 %. Nos demandes pour 2006 représentent 15 % du budget de l'Institut. Cette évolution est évidemment à rapprocher de la participation active que l'IVS doit avoir dans le « Plan santé au travail ». Mais il est à souligner que nous n'avons à ce jour aucun poste budgétaire dédié aux actions que nous aurons à mener dans le cadre de ce plan. Nous sommes donc dans l'incertitude. Dans la même période, la part du département santé-environnement, dont les missions se rapprochent de celles du département santé-travail, est passée de 10 à 15 %. S'agissant des personnels, le département santé-travail emploie 17 équivalents temps plein en CDI, et 11 en CDD. Pour 2006, dans le cadre du plan santé-travail, 15 postes supplémentaires sont demandés. Mme Ellen IMBERNON : Je souhaite revenir sur l'histoire et la création du département santé-travail. Dès 1998, la volonté du réseau national de santé publique a été d'intégrer la santé au travail dans son champ d'activité. C'était une première en France. Jamais aucun organisme de santé publique sous tutelle du ministère de la santé n'avait intégré dans son champ de compétences la santé des populations en relation avec l'activité professionnelle. Cette évolution était très positive, mais elle posait des difficultés institutionnelles qui ont expliqué en partie la lenteur de la mise en route de notre activité, bien que, dès 1998, nous ayons proposé un programme de travail qui avait reçu l'aval de l'ensemble de la communauté. J'ajoute que n'existait à l'époque aucune culture de santé publique appliquée à la santé des populations au travail. Tout le système était structuré autour d'une approche individuelle mettant l'accent sur la santé des individus au travail. Il a fallu démontrer que nous apportions une dimension importante au champ de la prévention individuelle, comme il a fallu montrer au milieu de la santé publique que la santé au travail faisait partie de la santé des populations. Nous avions des modèles étrangers, en particulier celui des Britanniques, qui sont très en avance, et ceux des pays scandinaves, mais il nous a fallu tout inventer. Il n'existait en France aucune systématisation de la surveillance au niveau de la collectivité de travail. À cet égard, on peut dire que si les publications du département des maladies infectieuses étaient plus nombreuses que les nôtres, cela était dû à l'antériorité de ce département mais aussi à la longue histoire de la surveillance des maladies infectieuses. Les déclarations obligatoires des maladies infectieuses existent depuis 1902. Il faut ajouter que les maladies que nous surveillons, mises à part deux ou trois, dont le mésothéliome, sont « banales » en ce sens que le fait qu'elles soient dues au travail n'apparaît pas immédiatement. La surveillance ne peut pas se limiter à surveiller des malades. Il faut mettre les pathologies en relation avec les conditions de travail et les expositions professionnelles. M. le Rapporteur : La séparation entre santé-travail et santé-environnement est-elle pertinente pour l'amiante ? D'autre part, pouvez-vous nous donner des chiffres précis sur les mésothéliomes et les cancers du poumon imputables à une exposition à l'amiante ? Mme Ellen IMBERNON : Les deux départements santé-travail et santé-environnement travaillent ensemble sur un certain nombre de sujets, et en particulier sur l'amiante. Le programme national de surveillance du mésothéliome (PNSM), créé dès 1998, a donné lieu à un recueil d'informations qui bénéficie à nos collègues du département santé et environnement, même si cette maladie est due à 90 % à une exposition professionnelle à l'amiante. Outre les raisons institutionnelles, la séparation entre les deux départements s'explique par les différences entre les méthodes utilisées. Ceux qui travaillent sur la santé en relation avec l'environnement s'appuient beaucoup sur des études épidémiologiques géographiques. L'étude de la santé au travail a recours à un suivi plus individuel. Pour ce qui est des chiffres, l'incidence des mésothéliomes a fortement augmenté ces vingt dernières années, comme l'avaient prévu les modèles mathématiques. Le chiffre d'environ 750 mésothéliomes annuels est fondé sur l'observation directe de la survenue de ces cancers. S'agissant du cancer du poumon, qui est plurifactoriel, nous avons recours à des observations indirectes qui nous permettent d'affirmer que chez les hommes, entre 10 et 15 % des cancers du poumon qui surviennent chaque année sont dus à l'exposition professionnelle à l'amiante, soit environ 2 200 cas annuels. Pour les femmes, il est plus difficile de procéder à des évaluations, car les données relatives à leur exposition professionnelle cumulée au cours de la vie entière sont plus difficilement accessibles. On observe cependant une augmentation assez rapide des mésothéliomes chez les femmes, la part due à l'exposition professionnelle étant moins grande que chez les hommes. Mais on n'est pas certain que cette moindre incidence des facteurs liés au travail ne soit pas due au fait que l'on mesure plus difficilement les expositions professionnelles des femmes. M. le Rapporteur : Constatez-vous une augmentation par rapport aux années précédentes ? Mme Ellen IMBERNON : L'incidence du cancer du poumon chez les hommes se stabilise. Il n'y a pas de grande variation sur les cinq dernières années. Cela dit, les projections mathématiques, en fonction de la date d'interdiction et des risques liés aux différents niveaux d'exposition à l'amiante, montrent qu'une augmentation est à prévoir jusque vers 2020 ou 2025. Après cette date, on ne sait pas si les chiffres se stabiliseront ou diminueront progressivement. (M. Jean LE GARREC remplace M. Jean-Marie GEVEAUX à la présidence) M. le Président : Une cartographie du mésothéliome a-t-elle été tentée ? Mme Ellen IMBERNON : Le PNSM surveille l'évolution de l'incidence nationale mais n'enregistre pas tous les cas qui surviennent sur le territoire français. Il enregistre les cas qui surviennent dans 21 départements, qui seront prochainement étendus à 24 départements. À partir de ces données, nous faisons une projection pour la France entière en comparant les nouveaux cas enregistrés avec la mortalité. Les cartographies de la mortalité par mésothéliome montrent une surmortalité dans le nord de la France et dans les régions industrielles et le PNSM nous permet d'affiner l'analyse en calculant les risques de survenue d'un mésothéliome par secteur d'activité ou par profession. M. Daniel PAUL : La question de M. le Président est importante. L'utilisation de l'amiante a été beaucoup plus importante dans certaines régions que dans d'autres et les sites industriels qui ont été pollués et ont contaminé des salariés risquent à présent de produire une deuxième phase d'effets. C'est pourquoi il est bon d'avoir un outil cartographique. Mme Ellen IMBERNON : Pour le moment, la politique n'est pas d'enregistrer de manière exhaustive tous les cas de mésothéliome survenant dans l'ensemble du territoire car cela demanderait des moyens énormes. En effet, pour recueillir un cas de mésothéliome, il ne suffit pas qu'un médecin nous signale qu'il a eu connaissance d'un mésothéliome. Il faut être certain du diagnostic. Même des anatomo-pathologistes peuvent commettre des erreurs de diagnostic. Cela dit, l'approche consistant à calculer les risques en fonction des métiers et des secteurs d'activité est applicable à l'ensemble des régions. M. le Rapporteur : L'asbestose a-t-elle disparu ? Mme Ellen IMBERNON : On peut dire que, pour l'essentiel, l'asbestose est derrière nous parce qu'elle est associée à des niveaux d'empoussièrement très importants. On a relevé, en 2000 ou 2001, environ 200 asbestoses. Il me semble donc que les risques d'asbestose sont aujourd'hui relativement limités. Cela dit, il faut être vigilants, notamment en ce qui concerne les personnes les plus exposées, c'est-à-dire celles qui procèdent au retrait ou au confinement de l'amiante. J'ajoute que toutes les personnes travaillant dans le bâtiment ou dans l'entretien des machines peuvent être exposées, bien qu'à des degrés moindres. M. le Rapporteur : Surveillez-vous d'autres manifestations pathologiques ? Mme Ellen IMBERNON : Il y a les plaques pleurales. Mais sont-elles pathologiques ? On peut avoir des plaques pleurales sans souffrir de troubles respiratoires. Rien ne montre que le fait d'avoir des plaques pleurales augmente le risque d'être affecté par telle ou telle maladie. Mais rien n'indique le contraire non plus. Cela étant, les plaques pleurales signent une exposition à l'amiante, et donc un risque d'être affecté. Par ailleurs, le lien entre l'exposition à l'amiante et la survenue d'un cancer du larynx a été très longtemps discuté par la communauté scientifique. On peut considérer que ce lien existe, le risque étant environ 1,2 fois plus élevé chez les personnes qui ont été exposées à l'amiante que chez celles qui ne l'ont pas été. D'ailleurs, les Allemands ont déjà inscrit le cancer du larynx dans la liste des maladies indemnisables, sous certaines réserves liées au niveau d'exposition. On s'interroge encore, au sein de la communauté scientifique, sur le cancer du côlon. M. le Rapporteur : Qu'est-ce qui explique le lien entre l'inhalation des fibres d'amiante et la survenue des cancers ? Mme Ellen IMBERNON : Les fibres pénètrent, selon leur taille, dans les bronches, les bronchioles, ou les alvéoles pulmonaires. Mais personne ne connaît le mécanisme exact qui produit l'apparition des cancers qu'elles provoquent. Seule l'observation épidémiologique a permis d'établir le lien entre la présence de fibres et la survenue d'un cancer. M. le Rapporteur : Vous procédez, à partir des données établies dans 24 départements, à des projections sur l'ensemble du territoire. Ces projections prennent-elles en compte les différences d'exposition aux sources industrielles de l'amiante ? Mme Ellen IMBERNON : Les départements dans lesquels sont enregistrées les données relatives aux mésothéliomes ont une diversité d'exposition comparable à celle qui existe sur l'ensemble du territoire. Peut-être pourrons-nous améliorer l'enregistrement des données au niveau national si les données du Programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) nous le permettent. Jusqu'à présent, le PMSI n'enregistrait, au niveau national, que des séjours hospitaliers et non pas des personnes. Il va bientôt être possible de chaîner les personnes et il sera peut-être possible, à terme, d'affiner nos données en les rapprochant de celles du PMSI. Mais ce sera long. Le mésothéliome est une tumeur tellement rare que si le pneumologue, ou même l'anatomo-pathologiste, n'a pas l'habitude d'en voir, il peut se tromper, par excès ou par défaut. M. le Rapporteur : Les registres que vous utilisez dans les départements sont-ils spécifiquement des registres de mésothéliome ? Mme Ellen IMBERNON : Oui. La moyenne de survie en cas de mésothéliome déclaré étant inférieure à douze mois, il est très important d'aller très vite, afin d'interroger les personnes. Les anatomo-pathologistes nous signalent toutes les suspicions de mésothéliomes qu'ils rencontrent et nous interrogeons les personnes avant même d'avoir confirmation du diagnostic. M. le Rapporteur : S'agissant du cancer du poumon, les chiffres que vous avez cités correspondent-ils bien aux cas nouveaux apparus durant l'année ? Mme Ellen IMBERNON : Oui. Il s'agit des cas que nous appelons « incidents ». M. le Rapporteur : L'interdiction du flocage a été décrétée en 1977. Elle a été suivie assez rapidement de l'interdiction des faux plafonds amiantés. Ces mesures visaient les niveaux d'exposition les plus forts. J'ai été surpris que vous citiez le chiffre de 200 asbestoses en 2001, quand on sait que l'asbestose implique des niveaux d'exposition énormes. Mme Ellen IMBERNON : Les statistiques de la réparation de maladies professionnelles ne constituent pas des diagnostics. Elles reposent sur une présomption d'imputabilité. Une fibrose pulmonaire chez une personne qui a été exposée à l'amiante sera indemnisée quelles que soient ses causes, dès lors qu'elle constitue une pathologie répertoriée dans les tableaux. M. le Président : Mesdames, je vous remercie de votre contribution aux travaux de notre mission. Audition conjointe du Dr Michèle FROMENT-VÉDRINE, directrice générale de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET), de M. Dominique GOMBERT, directeur du département 1 d'expertise, et de M. Antoine VILLA, toxicologue Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Mes chers collègues, nous recevons aujourd'hui aujourd'hui Mme le docteur Michèle Froment-Védrine, directrice générale de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET), M. Dominique Gombert, directeur du département d'expertise, et M. Antoine Villa, toxicologue. Je rappelle que l'AFSSET a remplacé l'AFSSE, Agence française de sécurité sanitaire environnementale, dans le cadre de la mise en œuvre du « Plan santé au travail » (PST). Elle est placée sous la tutelle des ministères du travail et de la santé et s'est vu charger d'importantes missions dans le cadre du PST aux côtés, notamment, de l'Institut de veille sanitaire que nous venons d'entendre. Je vous remercie, madame, messieurs, de vous être rendus disponibles pour cette audition dont l'objet est de nous informer sur les missions et les moyens de la nouvelle AFSSET. Vous intervenez dans le cadre d'une série d'auditions qui nous permettra d'entendre tous les acteurs de la prévention des risques professionnels, qui est notre deuxième thème de travail, après la gestion de l'amiante « résiduel ». Mme Michèle FROMENT-VÉDRINE : M. le Président, mesdames, messieurs les députés, l'AFSSE fait partie des agences sanitaires mises en place après l'affaire du sang contaminé. Sa particularité est de ne pas avoir été mise en place en 1999, mais après un long débat parlementaire qui a abouti à la création d'une agence d'objectifs et non d'une agence de moyens. Les autres agences sont des agences d'expertise, qui ont soit des moyens directs, soit des moyens rapportés. L'AFSSE, elle, est une agence de coordination. L'expertise est en effet éclatée, répartie entre diverses agences, sanitaires ou non, et toutes sortes de commissions et comités. Entre 50 et 100 commissions ou comités expertisent les produits chimiques, par exemple. Le décret de 2002 a prévu que quinze établissements apporteraient leur concours permanent au travail d'expertise des risques confié à l'AFSSE. Ce travail de coordination aurait dû s'accompagner d'un mouvement de l'ensemble des tutelles consistant à faire passer par un point d'entrée unique l'ensemble de l'évaluation. Nous n'en sommes pas là. Nous avons autour de nous des comités d'experts spécialisés et recevons l'appui des établissements les plus importants. Mais ceux-ci sont souvent saisis directement par les ministères. Pourquoi l'AFSSE devient-elle AFSSET ? La plupart des produits présents dans l'environnement dit « général », celui du consommateur, se retrouvent dans l'environnement de travail, à des doses différentes et avec des risques différents. L'AFSSE, créée en principe en 2002, ne comptait que huit personnes au mois de septembre 2003 et n'a pu recruter du personnel en nombre plus conséquent qu'à partir de la deuxième moitié de 2003. Depuis la fin de l'année 2004, il nous a été demandé d'étendre le champ de nos expertises au champ de la santé au travail. À chaque fois que nous sommes saisis d'une question, nous évaluons les risques dans l'environnement général et dans l'environnement de travail. La création de l'AFSSET nous donnera des moyens dédiés au travail, ce qui renforcera les capacités d'expertise qui sont déjà les nôtres. Nous avons d'autres missions, en particulier celle d'aider la recherche dans le domaine santé/environnement. Nous disposons d'un fonds de recherche qui nous permet de distribuer, après appel d'offres, 1,5 million d'euros chaque année. Nous avons également une mission d'information du public, à travers tous les outils qui nous semblent nécessaires. Le comité scientifique du « Plan santé et environnement » a dégagé deux orientations : le « Plan santé/environnement » en direction de la population générale, et le « Plan santé au travail ». Dans le cadre du « Plan santé/environnement », nous sommes chargés de la coordination scientifique et du suivi de 45 actions, ainsi que de la gestion de cinq actions propres, dont le portail santé/environnement. Dans le cadre du « Plan santé au travail », nos compétences sont les mêmes. Mais certaines missions pourraient être confiées à d'autres établissements, l'Institut de veille sanitaire (IVS), par exemple. Le décret d'application de l'ordonnance du 1er septembre n'est pas encore paru. Nous ne savons pas encore exactement les missions qui nous seront confiées dans le cadre du programme européen REACH32. D'après ce que j'ai compris, ces missions pourraient être relativement importantes. D'autres questions importantes seraient confiées à l'IVS, je pense en particulier aux troubles musculo-squelettiques (TMS) et au stress. Il semble que la mission qui nous serait confiée en premier lieu serait celle qui a fait l'objet d'une convention avec la Direction des relations du travail (DRT) en juillet 2005 et qui porte essentiellement sur les produits chimiques. Cette convention ajoute 1,7 million d'euros à notre budget 2005, ainsi que dix postes en santé/travail. À partir de l'année prochaine, notre budget devrait être augmenté de 73 %, et nous devrions recevoir dix autres postes. Ces vingt postes, au total, sont des postes de scientifiques de haut niveau, sans capacité d'encadrement supplémentaire. M. Jean-Marie GEVEAUX : Quel est votre budget actuel ? Quels sont vos effectifs ? Mme Michèle FROMENT-VÉDRINE : Le budget 2005, y compris les reports 2004, est de 15 millions d'euros. Nos effectifs actuels sont de 63, et passeront l'année prochaine à 84. Mme Martine DAVID : Quel est le profil des nouveaux personnels ? Mme Michèle FROMENT-VÉDRINE : Le « Plan santé au travail » a prévu dix scientifiques de haut niveau chaque année, sans aucun moyen nouveau d'encadrement et de gestion, j'insiste sur ce point. Ces scientifiques de haut niveau sont des ingénieurs chimistes, des médecins du travail, des toxicologues, titulaires d'un doctorat et ayant une expérience de dix ans. Mais ce type de profil ne se trouve pas facilement sur le marché français. Il ne reste plus guère qu'une quarantaine de toxicologues oeuvrant dans le domaine public en France, qui approchent l'âge de la retraite. Un rapport IVS-AFSSE datant de décembre 2004, qui a fait le point sur l'état de la toxicologie en France, fait apparaître une situation de paupérisation. Or, l'ensemble des missions que prévoit le « Plan santé au travail » porte, dans un premier temps, sur la toxicologie. Pour le moment, les toxicologues français travaillent surtout dans l'industrie privée, sur des produits spécifiques, et n'ont pas de connaissance en santé publique. Ceux qui ont des connaissances en santé publique travaillent essentiellement dans les centres antipoison. M. le Rapporteur : Votre agence est une agence de coordination. Comment cette coordination s'organise-t-elle concrètement ? M. Dominique GOMBERT : Le décret du 1er mars 2002 a dressé une liste de quinze établissements, sur lesquels nous pouvons nous appuyer en mode routinier, soit pour commander des expertises soit pour recevoir des données. Ce décret prévoit que le mode de fonctionnement de l'élaboration des expertises se fait dans un cadre collectif. Autrement dit, nous devons nous appuyer sur des comités d'experts spécialisés qui sont placés auprès de l'Agence. Quatre comités d'experts spécialisés ont été créés, qui travaillent sur les milieux atmosphériques, les substances chimiques, les substances biocides et les agents physiques. La liste des experts a été définie par arrêté ministériel. C'est sur eux que nous devons nous appuyer préférentiellement. Il se trouve que ces experts, dont le nombre est limité, ne sont pas forcément en mesure de répondre aux questions que nous pouvons être amenés à nous poser. Il faut savoir que nous souffrons d'un cruel manque d'experts. Pour une quinzaine de grosses saisines sur les substances chimiques, il nous est très difficile de mobiliser le nombre d'experts nécessaire pour avancer au rythme souhaitable. La rareté de l'expertise est un problème qui se pose avec acuité. Par ailleurs, un grand nombre d'experts sont de plus en plus réticents à s'engager sur des questions difficiles qui peuvent engager leur responsabilité, directement ou indirectement. Très récemment, nous avons été saisis d'un nouveau sujet sur les fibres courtes, d'une longueur inférieur à 5 microns. Nous avons beaucoup de difficulté à mobiliser les experts. Il en va de même sur les questions relatives aux fibres minérales artificielles, aux éthers de glycol, au téléphone mobile, ou à d'autres sujets encore. Une autre difficulté est liée à l'exigence d'indépendance des experts. On sait que des expertises sont souvent remises en cause au motif que les experts qui les ont délivrées ne seraient pas indépendants. Or, sur un sujet donné, les bons experts sont ceux qui, par la force des choses, ont été amenés à travailler avec des industriels, ou à exercer dans un laboratoire financé par des industriels, ou à siéger au conseil scientifique de telle ou telle société commercialisant tel ou tel matériau. Enfin, nous nous heurtons à des difficultés lorsque nous sommes amenés à mobiliser des organismes autres que ceux mentionnés dans le décret du 1er mars 2002. Lorsque nous leur demandons des mesures particulières ou des travaux scientifiques, les délais de mise en œuvre de l'expertise ne sont pas nécessairement compatibles avec les délais que les décideurs demandent de respecter. Il peut également arriver que des organismes nous considèrent comme des nouveaux venus, et ne comprennent pas bien ce que nous venons faire sur le terrain de l'expertise. Cela suppose de notre part un travail de conviction et de diplomatie. Mme Michèle FROMENT-VÉDRINE : J'ajoute que les meilleurs experts ont tendance à aller à Bruxelles, ou à travailler auprès de quelques établissements d'expertise de haut niveau, tel le centre international de recherche sur les cancers, voire aux États-Unis. Aux yeux de ces structures, la question de l'indépendance des experts, bien qu'elle se pose, n'est pas centrale au point de donner lieu à des remises en cause du genre de celles que l'on constate en France. Par ailleurs, les experts qui travaillent pour la Commission européenne sont bien payés et sont correctement indemnisés, aussi bien pour leur transport que pour leur séjour. Nous, nous leur donnons 37 euros ! Je vous souhaite bonne chance pour trouver à Paris un hôtel à 37 euros la nuit ! Je vous assure que c'est un vrai problème. N'oublions pas que ces experts sont des professeurs reconnus au niveau international. Enfin, nous les indemnisons à hauteur de 67 euros la vacation de quatre heures. S'ils travaillent pour la Commission européenne, ils touchent 300 euros net, non imposés. En outre, la superposition de la commande est un problème. Il peut arriver qu'un même sujet soit traité dans cinq établissements différents, parce que les commandes ne passent pas par un point d'entrée unique. Il arrive même qu'un sujet soit traité parallèlement par deux établissements sans que nous le sachions. M. le Président : Par exemple ? Mme Michèle FROMENT-VÉDRINE : Par exemple, les ultraviolets ont récemment fait l'objet d'une étude dans trois établissements, et par les mêmes experts. De même le formaldéhyde, ou encore les pesticides. Chaque ministère a un établissement relais auquel il a l'habitude de s'adresser, et qui a ses propres experts et ses propres publications, avec des enjeux de notoriété, et parfois financiers, extrêmement importants. Dans ces conditions, l'AFSSE, quand elle tente de remplir sa mission de coordination, dérange certaines habitudes. La situation s'est certes améliorée par rapport à 2002, mais si la commande est multiple, la dispersion ne facilite pas les choses. M. le Rapporteur : Pouvez-vous nous dire avec quelles structures vous travaillez, afin que nous mesurions mieux la complexité du réseau ? M. Jean-Marie GEVEAUX : Pour compléter cette question, il serait bon que vous nous disiez comment vous concevez l'organisation idéale. Mme Michèle FROMENT-VÉDRINE : Une mission d'investigation de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS), conduite dans le courant de l'année 2004, a conclu que l'AFSSE devait disparaître et fusionner avec l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ou avec l'IVS. La position du conseil scientifique de l'AFSSE est qu'il est nécessaire de désigner un point d'entrée unique, le coordinateur. Il faut ensuite lui donner les moyens de faire appel à la meilleure expertise et aux meilleurs experts. C'est ce à quoi nous nous efforçons. Mais les textes qui nous demandent de travailler avec d'autres établissements n'imposent pas à ces mêmes établissements de travailler avec nous, et il n'y a pas de point d'entrée unique. M. Dominique GOMBERT : La coordination dépend du type d'expertise dont nous sommes saisis. Une saisine complexe, par exemple, est celle qui porte sur le formaldéhyde, une substance cancérogène dont il est nécessaire d'identifier les usages, les expositions, les risques et les substitutions possible. Or on trouve du formaldéhyde partout. C'est dire que la question qui nous est posée est extrêmement large. Elle nous conduit à travailler avec une vingtaine d'organismes : les centres antipoison vont documenter les cas d'intoxication, l'Agence de l'environnement va coordonner les mesures de formaldéhyde à l'extérieur, le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) coordonnera les mesures à l'intérieur, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) va évaluer les risques, des organismes privés se chargeront de l'étude des substituts, l'IVS documentera des cas de cancers associés, l'INRS sera saisi pour étudier l'exposition professionnelle, etc. Notre travail consiste à répertorier l'ensemble des questions et des sous-questions, d'identifier l'interlocuteur français ou étranger le plus à même d'y répondre, et de rassembler les pièces du puzzle pour fournir le diagnostic final aux tutelles qui nous ont saisi de ce sujet. Sur d'autres saisines, nous ne travaillerons, par exemple, qu'avec l'INRS et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), et une ou deux universités, parce que les questions posées seront beaucoup plus restreintes. Mme Michèle FROMENT-VÉDRINE : Et il faut par ailleurs que les experts soient disponibles au moment où l'on a besoin. M. Dominique GOMBERT : Prenons l'exemple des fibres minérales artificielles, que l'on appelle produits de substitution à l'amiante, bien que le terme de « substitution » ne soit pas le mot propre. Il s'agit des fibres de céramique réfractaire, des fibres spéciales de verre, des laines minérales d'isolation. Nous sommes actuellement saisis d'une étude visant, non pas à évaluer les risques mais à recenser ces produits, leur utilisation et leur exposition. L'identification de l'exposition de la population générale et des travailleurs a fait l'objet de travaux distincts réalisés par un certain nombre d'organismes, l'INRS, l'IVS, l'INSERM, qui ont fixé leur propre calendrier de travail. M. le Président : Tout ce que vous nous dites est tellement important et, à certains égards, tellement énorme, que nous vous proposons de vous rencontrer sur place, en nous donnant le temps d'aller au fond des choses. Mme Michèle FROMENT-VÉDRINE : Avec plaisir. Nous pourrons vous exposer le travail que nous devons mener à bien dans le cadre de saisines ponctuelles, comme celui que nous sommes censés effectuer au quotidien. Les difficultés que nous rencontrons lorsque nous avons à répondre aux saisines ne nous permettent pas de nous consacrer à autre chose. Il est évident que si nous avions à travailler sur le dossier REACH des produits chimiques, il faudrait un consensus général sur la répartition des rôles dans ce dossier, ainsi que sur les moyens accordés aux uns et aux autres. M. le Rapporteur : Pouvez-vous nous en dire plus sur l'étude qui vous a été confiée sur les fibres courtes ? M. Dominique GOMBERT : Jusqu'ici, les travaux relatifs à l'amiante ont essentiellement porté sur les fibres d'une longueur supérieure à 5 microns, pour des raisons diverses, notamment celles qui sont liées à la facilité d'identification. Une revue scientifique américaine a publié récemment un article dressant le bilan des travaux portant sur les fibres d'une longueur inférieure à 5 microns. En février dernier, il nous a été demandé de réexaminer cette publication et de répondre à la question de savoir quels sont les risques associés à ces fibres courtes, et si on en trouve un grand nombre dans l'environnement. M. le Président : Que faut-il penser des fibres courtes en liaison avec l'amiante « résiduel » ? M. Dominique GOMBERT : Nous devrons examiner cette question plus avant. Mais il est certain que les diagnostics amiante qui ont été établis et qui ont conclu qu'une remise en état ne s'imposait pas ont pu concerner des bâtiments dont les matériaux ne libéraient pas des fibres longues mais libéraient des fibres courtes. En outre, plus les matériaux à base d'amiante vieillissent, plus ils libèrent des fibres courtes, en raison de l'usure. Mme Michèle FROMENT-VÉDRINE : Peut-être cet avis devrait-il être complété par celui d'un toxicologue. M. Antoine VILLA : Jusqu'à présent, on mesurait effectivement la présence de fibres d'amiante dont la longueur était supérieure à 5 microns. Actuellement, diverses méthodes permettent de mesurer les fibres dont la longueur est inférieure à 5 microns. Le microscope électronique permet de descendre jusqu'à 0,5 micron. Les fibres d'amiante se coupent horizontalement, à la différence des fibres minérales artificielles, qui se sectionnent transversalement. Des dalles vinyle amiante, par exemple, libéreront, sous l'effet de l'usure, des fibres courtes. Jusqu'à présent, on n'en tenait pas compte. La question qui nous est posée est de savoir s'il y a un intérêt à mesurer ces fibres courtes. M. le Président : À première vue, il n'y a pas de raison de supposer que ces fibres courtes ne puissent pas avoir les mêmes effets que les fibres plus longues ? M. Antoine VILLA : On connaît la toxicité des fibres longues. On connaît très mal, voire quasiment pas, celle des fibres courtes. Ce dont on est à peu près certain, c'est qu'elles sont moins toxiques que les fibres longues. Mais on ne peut rien dire de plus. Mme Michèle FROMENT-VÉDRINE : On sait maintenant qu'une durée d'exposition brève peut être toxique, soit parce qu'elle a été intense, soit parce qu'elle touche des sujets qui présentent une susceptibilité particulière. Les questions nouvelles qui se posent pourraient ouvrir de nombreux contentieux, par exemple en ce qui concerne des personnes qui ont été écartées de l'indemnisation parce qu'elles ne répondaient pas aux différents critères. Elles pourraient également avoir un impact sur l'évaluation de l'indemnisation à venir. M. le Rapporteur : Le problème de la rareté des experts et celui des réticences qu'ils peuvent manifester touchent-ils essentiellement la France ? La situation des autres pays européens est-elle plus favorable ? Par ailleurs, n'est-il pas possible de partager les réflexions au niveau européen ? Mme Michèle FROMENT-VÉDRINE : Un certain nombre d'actions sont menées par la Commission européenne pour harmoniser les données que l'on peut trouver dans les différents pays. Par exemple, nous participons à une action qui était initialement française, puisqu'elle était prévue dans le « Plan national santé/environnement », mais qui se retrouve au niveau européen : il s'agit de la mise en commun de bases de données. Nous y participons à la fois en France et au niveau européen. Nous essayons d'interconnecter ces bases de données, afin d'alimenter les travaux scientifiques ou les bases des directives européennes. Nous avons également lancé l'idée de la mise en commun de réseaux de chercheurs en santé/environnement. C'est un dossier que nous venons de déposer auprès de la Commission européenne, et qui réunit une dizaine d'acteurs dans les autres pays. Un réseau européen, ERANET33, existe d'ores et déjà, et dès que nous sommes saisis d'une question, l'une de nos premières réactions est d'interroger nos partenaires européens. Cette aide nous est précieuse, car il s'agit d'établissements très importants. Le RIVM néerlandais, le Rijksinstituut voor Volksgezondheit en Milieu, a une antériorité très importante, et emploie 1 500 personnes. Certains produits dangereux seront finalement moins dangereux dans certains pays en raison de l'information du public et de l'usage maîtrisé qu'on en fait. Il est donc nécessaire de mettre en commun la connaissance de ces substances, mais en veillant à ne pas perdre de vue les données et comportements proprement nationaux. Nous développons progressivement cet appel aux réseaux internationaux. Nous sommes toujours favorablement impressionnés par l'importance de l'expertise étrangère, et par la disponibilité que manifestent nos partenaires européens. M. Dominique GOMBERT : J'ajoute que le contexte européen a permis de partager entre les différents États membres un certain nombre de travaux dont ils ont la responsabilité. Je veux parler de la directive Biocides, qui impose de procéder à une évaluation des diverses substances biocides que nous utilisons. Cette année, la France doit évaluer huit substances. L'année prochaine, elle devra en évaluer vingt, puis quarante l'année suivante. Par la suite, ce sont les produits commerciaux qui devront être évalués. Le dispositif REACH s'inspirera de la même philosophie. M. le Président : Madame, messieurs, je vous remercie de votre contribution aux travaux de notre mission. Audition de M. Marcel GOLDBERG, professeur de santé publique à la faculté de médecine, épidémiologiste à l'INSERM, conseiller scientifique à l'Institut de veille sanitaire (IVS) Présidence de M. Jean LE GARREC, Président. M. le Président : Nous recevons à présent M. Marcel Goldberg - que la mission a déjà entendu lors de la table ronde consacrée, le 14 septembre dernier, aux aspects scientifiques - en sa qualité de membre de l'Institut de veille sanitaire (IVS) chargé du Programme national de surveillance des mésothéliomes (PNSM) et de coordinateur du rapport publié en 1996 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) sur les « Effets sur la santé des principaux types d'exposition à l'amiante ». Nous l'entendrons aujourd'hui au titre de ses activités à l'INSERM en matière de prévention des risques sanitaires en milieu professionnel. M. Marcel GOLDBERG : Comme je ne représente pas l'INSERM, je pense être invité au titre de mes activités de recherche dans le domaine de la santé au travail. Mais puisque vous m'avez interrogé, dans le questionnaire que vous m'avez adressé, sur les missions et les moyens de l'INSERM dans ce domaine, je rappellerai que l'INSERM a pour mission la recherche - et qui dit « recherche » dit « établissement de connaissances nouvelles ». S'agissant des risques professionnels, l'INSERM mène des recherches épidémiologiques qui tendent à identifier les risques nouveaux pour la santé au travail, à les étudier et à mesurer leur impact. L'Institut a d'autre part une mission d'expertise. C'est ainsi que j'ai participé, il y a dix ans, à un groupe d'expertise collective, réuni à la demande conjointe de la Direction générale de la santé (DGS) et de la Direction des relations du travail (DRT). Toutefois, l'expertise collective demeure marginale au regard de l'activité de recherche de l'INSERM. Si l'on en juge à l'aune habituelle, qui est celle du nombre de publications, la France n'est pas très prolifique dans le domaine de la recherche épidémiologique relative aux risques professionnels et, pour tout dire, elle n'est pas particulièrement performante. C'est que notre pays compte des épidémiologistes de très bonne qualité, mais qui sont très peu nombreux. Cette situation a aussi pour conséquence que la participation française aux études internationales ayant trait au risque professionnel est très faible, sinon inexistante dans certains domaines - mais c'est le cas pour l'ensemble des domaines de l'épidémiologie. Autrement dit, la France est sous-développée pour ce qui concerne la recherche épidémiologique, et la création de l'Institut de veille sanitaire n'a pas suffit à corriger cet état de fait. C'est à l'INSERM que la recherche épidémiologique est encore très majoritairement conduite, particulièrement pour ce qui est du risque professionnel. Dans ce domaine, l'IVS est son partenaire habituel, et de très nombreuses collaborations sont en cours. Que je sois moi-même conseiller scientifique à l'IVS illustre cette collaboration permanente. Avec d'autres organismes, la collaboration est bien moindre. Elle est ponctuelle avec l'INRS34, qui a très peu développé la recherche épidémiologique et qui ne compte qu'une douzaine d'épidémiologistes pour un effectif total compris dans une fourchette de 600 à 700 personnes. Enfin, il n'y a aucun épidémiologiste au Centre national de recherche scientifique (CNRS). Vous m'avez aussi interrogé sur les liens, dans ce domaine particulier, entre la recherche, les pouvoirs publics et la sécurité sociale. Ils sont très ténus, et irréguliers. La Direction des relations du travail fait parfois appel à des expertises, et des recherches sont alors engagées à la demande du ministère, mais cela ne se produit que de manière ponctuelle. Pendant de longues périodes il ne se passe rien et, en tout cas, il n'existe aucune politique de relations organisée entre le ministère et l'INSERM ou l'IVS. Pour ce qui est des relations de ces organismes avec la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), il n'existe de collaboration d'aucune sorte entre la branche « accidents du travail - maladies professionnelles » (AT-MP) et l'INSERM : ni financement de recherches, ni demandes d'expertise. De manière paradoxale, les relations sont plus fréquentes avec la branche maladie, car il nous arrive de mener des études avec des médecins-conseils. Quant au Conseil supérieur des risques professionnels, il ne suscite pas de travaux. Il a pu se produire qu'il fasse appel à des expertises individuelles, mais les exemples se comptent sur les doigts d'une main. M. le Président : Je vous remercie pour cet exposé, qui vous fait brosser un tableau inquiétant de la situation... M. Daniel PAUL : ... qui confirme ce que nous avons entendu précédemment. M. le Rapporteur : Notre mission souhaitant améliorer la prévention des risques professionnels, quels conseils pourriez-vous nous donner ? M. Marcel GOLDBERG : La prévention est chose compliquée, et suppose en premier lieu que l'on ait identifié les risques, puisque l'on ne peut, par définition, prévenir un risque que l'on ignore. Mon premier conseil serait donc de favoriser le développement de la recherche épidémiologique ! C'est l'épidémiologie qui a établi le lien entre tabac et cancer du poumon, c'est l'épidémiologie qui a mis en évidence le caractère pathogène de l'amiante, c'est l'épidémiologie encore qui a montré l'émergence d'une nouvelle maladie - le sida - dont les virologues ont identifié le virus deux à trois ans plus tard. Dans tous les cas, le point de départ a été la découverte d'une nouvelle pathologie par l'observation épidémiologique - et l'on pourrait multiplier les exemples. L'épidémiologie est donc indispensable pour caractériser les risques ; or, elle est bien trop faible en France. Il faut ensuite réglementer pour organiser la prévention. L'affaire de l'amiante a montré que des instruments juridiques existent mais qu'ils ne sont pas utilisés. Dois-je rappeler que la France a attendu 1977 pour se doter d'une réglementation visant à protéger les salariés exposés à l'amiante, alors que la Grande-Bretagne avait adopté ce dispositif dès 1931 ? En France, une première réglementation existait bien, mais elle visait à l'indemnisation et non à la prévention : en 1950 déjà, le tableau des maladies professionnelles reconnaissait l'asbestose au point de l'indemniser, mais on a attendu vingt-sept ans la première réglementation visant la prévention. Ainsi, une fois un facteur de risque identifié, il faut réglementer, puis s'assurer que la réglementation est appliquée... et l'on est assez loin du compte en France. On constate, en effet, qu'aux États-unis, pays dont les entreprises n'ont pas la réputation d'être particulièrement philanthropes, le nombre de mésothéliomes a commencé de baisser en 2005. Sachant le temps de latence, cela signifie que des mesures préventives y ont été prises il y a trente, voire quarante ans. Cela signifie également que notre effort de prévention accuse un retard d'égale durée, puisque l'on s'attend à ce que le nombre de maladies dues à l'amiante progresse, en France, jusqu'à 2020 au moins. Il est manifeste que, comme dans d'autres domaines, on a décidé, faute d'une culture de l'évaluation, une réglementation préventive sans instaurer de manière concomitante le dispositif qui aurait permis d'établir si cette réglementation fonctionne efficacement. M. le Rapporteur : Quelle est votre opinion sur la séparation entre évaluation et gestion du risque ? M. Marcel GOLDBERG : La séparation des deux fonctions est indispensable. L'évaluation du risque doit impérativement être faite par des gens « irresponsables », c'est-à-dire des scientifiques qui n'ont pas à s'interroger sur les conséquences de leur évaluation sur l'emploi ou sur l'économie, car ce n'est pas leur rôle. Je fais partie du Comité scientifique européen des valeurs limites d'exposition, et je puis vous assurer que nous sommes totalement indépendants. Nous exposons les risques associés à différents niveaux d'exposition à telle substance, nous disons l'incidence qu'aura l'augmentation de ce taux, et la décision de ce qui paraît tolérable est prise par d'autres. Elle peut, d'ailleurs, ne pas être celle que nous avons recommandée, car d'autres critères jouent que les seuls critères scientifiques, mais, dans tous les cas, évaluation et décision sont soigneusement séparées. En revanche, les décisions prises au sein de la commission des maladies professionnelles du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels sont d'un tout autre ordre. N'y siègent que des personnes sans compétences scientifiques, qui représentent des organisations d'employeurs et des organisations de salariés, et tous viennent avec un mandat leur enjoignant de voter une valeur pré-établie, sans avoir entendu l'avis de l'expert. M. le Rapporteur : Avons-nous entendu là votre opinion sur la participation des partenaires sociaux à l'évaluation du risque ? M. Marcel GOLDBERG : Mon opinion est qu'il faut absolument séparer évaluation et décision. L'expertise collective qui a conduit au rapport auquel il a été fait allusion précédemment a été menée, sous la tutelle de l'INSERM, par des scientifiques et par des scientifiques seulement. J'ajoute que nous avons été protégés : le nom des experts n'a pas été rendu public pendant la durée des travaux, et nous nous étions engagés à ne parler à aucun journaliste. L'étude a été menée dans une totale indépendance et je suis persuadé que si les choses avaient été organisées différemment, les conclusions du travail n'auraient pas été tout à fait les mêmes. De même, j'ai participé à une évaluation internationale de la cancérogénicité du formaldéhyde. Les vingt-six scientifiques réunis par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avaient été choisis sur la seule base de leurs publications, et tous, avant que l'étude ne commence, ont rempli un formulaire par lequel ils garantissaient l'absence de tout conflit d'intérêt potentiel. Dans tous les endroits raisonnables, les choses se passent ainsi...Mais force est de constater qu'en France, l'État est très peu, trop peu présent dans la fonction d'évaluation du risque. M. le Président : Vos propos sont d'une extrême importance pour la mission qui, par ce travail sur l'amiante, tient aussi à faire œuvre de mémoire sur une souffrance. Je retiens de ce que vous avez exposé qu'il convient de séparer l'évaluation de la gestion du risque proprement dite, et que nous avons accumulé un retard de trente années sur le plan épidémiologique, ce qui signifie que ce qui s'est produit pourrait se reproduire. M. Marcel GOLDBERG : Je me suis fait mal comprendre : certes, les études épidémiologiques françaises sont fort peu nombreuses, mais les connaissances scientifiques sont universelles et l'on savait de longue date la nocivité de l'exposition à l'amiante. Le retard auquel j'ai fait allusion est un retard dans l'application de la réglementation préventive. M. le Président : Je retiens aussi de vos propos la faible participation de la France à la recherche épidémiologique en général et dans ce domaine en particulier. M. Marcel GOLDBERG : Sachez que, chaque année, pour la France entière, l'INSERM ne met au concours qu'un seul poste de jeune chercheur pour l'ensemble des disciplines de la santé publique... M. le Président : J'ai aussi noté les lacunes de l'évaluation. Tels sont les problèmes majeurs que vous nous avez décrits. M. Daniel PAUL : Le tableau que vous dressez est tout aussi saisissant que celui qu'ont dressé les personnalités que nous avons entendues avant vous aujourd'hui. On pourrait dire, de manière lapidaire, que vous faites le procès de l'insuffisance de la médecine du travail et de sa relation étroite avec les employeurs. En parlant d'« insuffisance de la médecine du travail », je ne fais bien sûr pas allusion à une supposée incompétence des médecins du travail mais à leur insuffisance en nombre. J'observe également que la gestion du risque est, elle aussi, lacunaire, et ce fut une grande satisfaction pour moi de vous entendre rappeler que la nocivité de l'amiante était connue bien avant 1997. Expliquer aujourd'hui qu'« avant 1997, en France, on ne savait pas » et opposer cet argument aux salariés qui demandent réparation aujourd'hui, est osé ! Je vous remercie d'avoir rappelé les faits. M. Marcel GOLDBERG : Il est exact que la situation de la médecine du travail est paradoxale dans notre pays, car le médecin du travail est à la fois le conseil de l'employeur et celui du salarié, mais son contrat de travail est passé avec l'employeur uniquement. M. Daniel PAUL : Conformément au principe de séparation que vous avez évoqué, on peut estimer que si l'employeur doit la médecine du travail au salarié, le médecin du travail n'a pas à lui être rattaché. M. Marcel GOLDBERG : De fait, ce dispositif n'est pas satisfaisant, car le médecin du travail peut conseiller l'employeur si une situation donnée lui semble mauvaise, mais il ne peut intervenir directement, car il ne dispose d'aucune prérogative. Son seul moyen d'action est sa force de conviction. Diverses propositions de mutualisation ont été faites pour instituer une sorte de service public de la médecine du travail comme il en existe en Italie ou au Canada, mais elles n'ont jamais abouti, quelle que soit la couleur du gouvernement en place. En réalité, la chose n'a jamais été discutée sérieusement, alors que l'enjeu est considérable. La France dispose de 6 000 à 8 000 médecins du travail sur le terrain. Ce dispositif, probablement unique au monde, devrait être un rêve pour les épidémiologistes. Or, nous ne pouvons travailler avec les médecins du travail et, faute d'une mutualisation des moyens, la médecine du travail fournit très peu de données épidémiologiques. Pourtant, l'IVS a procédé à une expérience très intéressante dans la région Pays-de-la-Loire : pour la première fois, un réseau expérimental de 90 médecins du travail a été constitué, et a été chargé d'étudier la fréquence des troubles musculo-squelettiques par secteur d'activité. Le bilan de cette étude est d'un très grand intérêt, mais c'est l'IVS qui a dû l'organiser et la financer. On touche là du doigt l'un des défauts de notre système. Le coût de la médecine du travail n'est certainement pas négligeable, mais nul ne songe à consacrer ne serait-ce qu'un millième de ce budget à des études épidémiologiques. Il existe quelques petites exceptions dans de très grandes entreprises. Ainsi, EDF, pendant une certaine période, avait une équipe interne d'épidémiologistes qui travaillaient avec les médecins du travail, mais cela n'a pas duré très longtemps. Les médecins du travail ont une pratique solitaire, ils ne sont pas organisés, et il n'y a aucune mise en commun des moyens. Un pourcentage des cotisations des employeurs devrait être consacré à la réalisation d'études épidémiologiques. Que cela ne soit pas le cas constitue un véritable gâchis. M. le Président : L'expérience que vous avez citée montre que cela est possible. M. Marcel GOLDBERG : Bien sûr, et encore ne s'agissait-il que d'un réseau de quatre-vingt-dix médecins du travail. Le coût de l'enquête menée auprès des salariés n'a pas du excéder une petite centaine de milliers d'euros. M. le Rapporteur : Au cours de précédentes auditions, il a été fait référence à une étude consacrée aux « petites fibres » d'amiante. Quelle est votre opinion à ce sujet ? M. Marcel GOLDBERG : Les scientifiques cherchent à comprendre pourquoi l'amiante donne des cancers. Ils s'intéressent donc à la dimension des fibres, à leur diamètre, à leur biodégradabilité dans l'organisme et à leur composition chimique. S'agissant des fibres de petite taille, la controverse n'est pas tranchée mais cela ne change rien pour ce qui est de la prévention, car on inhale un mélange de fibres de toutes dimensions. Leur taille est donc sans conséquence particulière. M. le Président : Si ce n'est que les mesures sont faites en tenant compte de la taille des fibres ! M. Marcel GOLDBERG : Oui, mais les travailleurs sont exposés à des fibres de toutes tailles, celles qui se dégagent lorsque l'on perce ou que l'on vrille une paroi. L'étude des petites fibres a un intérêt scientifique : on considère que cela peut aider à la compréhension de la cancérogénicité. M. le Président : Monsieur le professeur, je vous remercie vivement. J'espère que vous accepterez de participer à la table ronde que nous organisons le 19 octobre sur ce thème. La clarté et la force de vos propos et votre langage direct et percutant, voire provocant, y feront merveille. M. Marcel GOLDBERG : Je ne cherche pas à provoquer, mais je considère que certaines choses doivent être dites. Table ronde sur la prévention des risques sanitaires · Direction des relations du travail (DRT) : M. Jean-Denis COMBREXELLE, directeur des relations du travail · Direction générale de la santé (DGS) : M. Yves COQUIN, chef du service « prévention programme de santé et gestion des risques » · Institut de veille sanitaire (IVS) : M. Gilles BRÜCKER, directeur général, professeur en Santé publique, accompagné du Dr Ellen IMBERNON, épidémiologiste, responsable du département santé · Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) : Mme le Dr Michèle FROMENT-VÉDRINE, directrice générale accompagnée de M. Henri POINSIGNON, directeur général adjoint · Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) : M. Jean-Luc MARIÉ, directeur général · M. le Professeur Marcel GOLDBERG, épidémiologiste, conseiller scientifique de l'IVS, chargé du Programme national de surveillance des mésothéliomes (PNSM) et coordonnateur du rapport de l'INSERM de 1996 « Effets sur la santé des principaux types d'exposition à l'amiante ». · Mme Françoise CONSO, professeur émérite des universités, membre du Collège national des hospitalo-universitaires de médecine du travail Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Mesdames, Messieurs, nous vous remercions d'être venus à cette table ronde qui sera probablement un des moments importants de notre mission en raison tant de votre qualité que de la nature des problèmes que nous allons aborder. L'accélération grandissante des avancées de la technologie et le raccourcissement incessant des cycles sont autant d'éléments nouveaux dans la genèse des risques professionnels. Par ailleurs, il y a la mobilisation légitime de l'opinion publique. À cet égard, l'affaire de l'amiante est autant un problème qu'un révélateur - il suffit de voir l'importance que la presse a légitimement accordée à la manifestation de dimanche dernier35 - qui s'est traduit par la condamnation de l'État devant le conseil d'État en 2004 pour n'avoir pas respecté ses obligations de recherche d'informations et de prévention, la multiplication des procédures pour faute inexcusable de l'employeur et l'implication grandissante des instances communautaires. Nous attachons d'autant plus d'importance à votre opinion que le récent « Plan santé au travail » appelle un regard très attentif. S'il est permis de considérer que tel ou tel point particulier est insuffisamment traité, il n'en reste pas moins que la mise en œuvre de quatre objectifs et vingt-trois programmes d'action représente un travail considérable. Votre concours nous sera des plus précieux pour apprécier la qualité de ce plan en réponse aux besoins. Relevons, entre autres exemples de difficultés, l'insuffisance des moyens pour passer de l'orientation à la concrétisation, l'incapacité de travailler en réseau, les moyens de recherche préventive sur les risques, l'utilisation plus efficace du réseau de veille et d'alerte sanitaire, le contrôle de la réglementation, particulièrement pour ce qui touche à l'amiante résiduel : nous avons essayé de décrire sous forme de tableau la façon dont les différentes structures compétentes agissent sur le terrain... Il ne faut pas moins de trois tableaux pour couvrir l'ensemble des réseaux ! Cela suffit à illustrer notre préoccupation. M. le directeur des relations du travail commencera par nous exposer le « Plan santé au travail », puis chacun de vous pourra s'exprimer en toute liberté pour répondre à la question suivante « à quelles conditions le " Plan santé au travail " est-il une bonne réponse au problème de la prévention des risques professionnels ? » Une question a été posée en séance publique cet après-midi sur l'amiante par notre collègue Daniel Paul et même si la réponse du ministre était ce qu'on pouvait en attendre,... M. Daniel PAUL : Il n'a rien annoncé que nous ne sachions déjà ! M. le Président : ...le président Debré a souligné l'ambition et l'importance des travaux que nous menons au sein de cette mission d'information. Le fait n'est pas courant. M. Jean-Denis COMBREXELLE: S'il traduit la priorité donnée par l'État à la santé au travail, le « Plan santé au travail » n'est pas une fin en soi. Le but n'est pas de produire un beau document d'une cinquantaine de pages ; nous ne réussirons le « Plan santé au travail » - le PST - que si nous parvenons à dynamiser non seulement l'ensemble des acteurs compétents, mais également les partenaires sociaux et les entreprises. La santé au travail doit être considérée comme une priorité, mais surtout comme un problème de santé publique : là est le fil rouge du PST. Si cette question ne se gère pas nécessairement comme d'autres problématiques de santé publique, elle n'en est pas moins un des éléments essentiels et doit être traitée comme telle. Le « Plan santé au travail » s'articule autour de quatre grands axes : la connaissance, le contrôle, le pilotage et l'implication des entreprises. Pour ce qui est de la connaissance, la situation était paradoxale : le ministre chargé du travail, et par le fait responsable de la santé au travail, ne disposait jusqu'à présent d'aucune instance scientifique capable d'assurer l'évaluation des risques ! Or c'est précisément cette instance qui a manqué pour l'amiante dans les années 70. La création de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) répond au souci d'éviter que le problème se reproduise avec les fibres céramiques, les éthers de glycol ou autres, en distinguant bien - même si ce n'est pas toujours aisé dans la pratique - ce qui relève de l'évaluation du risque et ce qui relève de sa gestion. Une fois que l'instance d'évaluation se sera prononcée sur un risque donné, il appartiendra à l'État, en concertation avec les partenaires sociaux et les autres acteurs, de définir les mesures de protection nécessaires. La création de l'AFSSET ne s'est pas faite sans hésitations ni arbitrages. Deux solutions s'opposaient : créer une grande agence compétente pour l'ensemble des questions d'évaluation ou, à l'inverse, une agence spécifiquement « santé/travail », comme le souhaitaient les partenaires sociaux, patronat et syndicats confondus. Compte tenu de la synergie qui existe désormais entre les questions touchant à l'environnement et au travail, le choix a été fait de refonder l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE) en lui donnant compétence dans les deux domaines - étant entendu que les questions d'environnement ne se gèrent pas exactement de la même façon que les questions de travail : on ne peut avancer dans le domaine de la santé au travail que si l'on y implique directement les partenaires sociaux et les entreprises. Ce qui ne veut pas dire pour autant que l'État ne se sente pas responsable. La recherche est également un enjeu extrêmement important, qui pose un problème de ressources, mais surtout un problème d'hommes : le milieu scientifique, pour des raisons qui, sans doute en partie, incombent à l'État, n'a pas suffisamment investi dans le champ « travail ». Deuxième axe, le contrôle ; est notamment visée l'inspection du travail. Disons les choses telles qu'elles sont : l'inspection du travail bénéficie d'une indépendance garantie par la convention de l'Organisation internationale du travail (OIT) de 1981 et en a une conception assez extensive... L'indépendance au sens où l'entend l'OIT couvre le traitement des dossiers particuliers : ainsi un directeur des relations du travail n'a pas le droit de demander à un inspecteur du travail d'annuler un procès-verbal qu'il estime infondé. En revanche, le ministre, politiquement responsable, est parfaitement en droit de fixer des priorités de contrôle à l'inspection du travail, et cela vaut tant pour les questions de santé au travail que pour toute autre question concernant les relations du travail. Autrement dit, nous devons veiller à ce que l'inspection du travail ait une efficacité collective à la hauteur de certaines priorités jugées nationales et mette en place les mécanismes d'évaluation nécessaires, afin d'être à même d'en tirer les conséquences, si besoin est. L'effectivité du contrôle renvoie directement aux réalités budgétaires. Les obligations de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) valent pour les relations du travail ; et même si celles-ci ne représentent que 0,6 % du budget du ministère, nous entendons bien utiliser la LOLF comme moyen de réforme de l'État et évaluer l'action de l'inspection du travail sur la base d'objectifs et d'indicateurs. La réforme de l'inspection du travail a été annoncée et engagée par M. Larcher ; les syndicats d'inspecteurs du travail lui opposent le principe de l'indépendance, pris dans son acception la plus large. Au demeurant, une amélioration de l'efficacité des contrôles va dans le sens de l'intérêt des syndicats et des salariés ; d'où un certain découplage entre les messages donnés par les syndicats des inspecteurs du travail et ceux des grandes centrales. Quoi qu'il en soit, l'importance de l'enjeu rend d'autant plus nécessaire la réforme de l'inspection du travail. On ne peut réclamer davantage de moyens sans avoir préalablement réussi à modifier sensiblement le mode de fonctionnement et améliorer l'efficacité collective de l'inspection du travail. Est également posée la question du caractère généraliste de l'inspection du travail. Les inspecteurs du travail doivent avoir une vision généraliste de l'entreprise : santé au travail et dialogue social vont de pair. Lorsqu'il y a des problèmes dans une entreprise, cela concerne tant le dialogue social que la santé au travail. Mais le maintien du caractère généraliste des inspecteurs du travail suppose qu'ils puissent faire appel à des ingénieurs ou des médecins, autrement dit bénéficier de moyens supplémentaires en termes d'appui méthodologique. Troisième axe : le pilotage au niveau national et régional. Au niveau national, il est arrivé que la question de la santé au travail soulève des difficultés entre la Direction générale de la santé (DGS) et la Direction des relations du travail (DRT). Aujourd'hui, les choses se passent bien ; les directeurs successifs ont fini par comprendre qu'il valait mieux réussir ensemble et qu'il n'était plus possible de jouer chacun de son côté. L'idée est d'engager une véritable discussion entre tous les acteurs concernés au sein notamment du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, en renforçant la légitimité de l'instance compétente en la matière. Au niveau régional, l'objectif est d'organiser l'articulation entre les plans régionaux de santé publique, tels que prévus par la loi et le domaine de la santé au travail, en intégrant dans chaque PRST36 une « brique » spécifique à la santé au travail, construite avec les partenaires sociaux et les entreprises. Le but est de déterminer, à partir des observations cliniques recueillies - un taux anomal de troubles musculo-squelettiques, par exemple, ou de telle maladie professionnelle -, les priorités et les moyens de lutte appropriés. Cela peut impliquer les Caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT), le réseau des Agences régionales pour l'amélioration des conditions de travail (ARACT), l'inspection du travail, etc., qui détermineront autour d'une table les priorités et les actions à engager. Quatrième axe, l'implication de l'entreprise dans le champ de la santé au travail. La réforme de la médecine du travail, d'ores et déjà engagée, est loin de recueillir le consensus, alors même que le contexte est difficile. Les médecins du travail seront de moins en moins nombreux : de 7 000 aujourd'hui, ils passeront rapidement à 3 000. Or ils doivent assurer trois missions : la visite individuelle du salarié, le « tiers-temps » passé dans l'entreprise où il contribue à la politique de prévention en jouant le rôle de conseil sur les procédés de fabrication ou sur l'organisation du travail - il y a là une difficulté de nature culturelle -, et enfin la participation à la veille sanitaire. Encore faut-il que les données ainsi collectées par le médecin du travail soient mieux exploitées dans le cadre de l'entreprise, comme au niveau national. La question se pose également de savoir dans quelle mesure on pourra utiliser les tarifs de la branche « accidents du travail - maladies professionnelles » (AT-MP) dans une logique un peu plus assurantielle, afin de développer une véritable incitation à la prévention dans l'entreprise : il est connu et admis que l'incitation financière peut devenir un vrai moteur pour faire progresser la prévention dans l'entreprise. Enfin, la notion d'aptitude est un sujet difficile ; un groupe de travail sera prochainement constitué pour dissiper toutes les ambiguïtés. Quant au document unique, il pose d'énormes difficultés : si les grandes entreprises ont compris qu'il ne se résume pas à une formalité administrative et qu'il peut les aider à progresser dans leur démarche de prévention, les moyennes entreprises ont tendance à se contenter de remplir un formulaire sans s'impliquer dans une démarche de prévention. Quant aux petites entreprises, une bonne part réclame la suppression pure et simple de cette obligation... Le ministère du travail estime quant à lui que l'importance du risque n'est pas proportionnelle à la taille de l'entreprise et que cette démarche de prévention s'impose à tous, ceci tout en prenant en compte les moyens des entreprises qui diffèrent en fonction de leur taille. La présentation du « Plan santé au travail » n'est à cet égard que le point de départ d'une démarche impliquant tous les acteurs, y compris les partenaires sociaux. M. le Président : Autrement dit, ce n'est pas parce que le document est rédigé que le problème est réglé. Bien au contraire, les choses ne font que commencer. Je demande à nos invités de réagir à cet exposé liminaire. M. Yves COQUIN : La Direction générale de la santé que je représente ici ne peut parler de ce sujet au même titre que la Direction des relations du travail. Les créateurs de la médecine du travail, il y a de cela presque soixante ans, en avaient confié l'organisation et la réglementation à l'administration chargée de faire évoluer les droits du travail. Cette démarche - alors parfaitement logique mais probablement beaucoup moins aujourd'hui - explique que nous ayons une perception des problèmes sanitaires liés aux expositions à des risques professionnels une fois seulement les dégâts commis, par le biais des divers systèmes de surveillance de morbidité mis en place en direction de la population, au sens général du terme. Il en résulte que nous ne pouvons percevoir les problèmes aussi rapidement que certains autres phénomènes qui, eux, font l'objet de dispositifs de surveillance spécifiques. Ainsi, lorsque je suis arrivé à la DGS en 1993, je savais que l'amiante était un produit cancérigène et j'en connaissais parfaitement la pathogénie. Il m'a toutefois fallu plusieurs années pour prendre la mesure de la problématique « exposition professionnelle » de l'amiante, des différentes situations d'exposition, des difficultés à maîtriser ces expositions et de l'ampleur de l'épidémie industrielle. Aussi, lorsque la DRT nous a demandé de participer à l'élaboration du « Plan santé au travail », nous nous sommes empressés d'acquiescer, considérant que le PST était un document tout à fait positif en ce qu'il affirmait la nécessité d'une expertise indépendante Il faut bien entendu « décloisonner » - le terme est à la mode et d'autant mieux venu que la santé au travail a toujours été entourée d'un mystère souvent bien différent des mystères de la santé... Heureusement, les relations entre la DGS et la DRT sont tout à fait excellentes, bâties depuis le décret de février 1996 dans la plus grande franchise et un souci commun de parvenir à un traitement utile pour nos concitoyens, qu'ils soient exposés de manière passive ou de manière active dans leur milieu professionnel. Cela dit, pour pérennes qu'elles soient, force est de constater que l'addition de tous les temps de travail consacrés, en relation avec la DRT, au traitement des questions concernant la médecine du travail atteint péniblement un équivalent temps plein... Nous ne pouvons que nous réjouir de la volonté affichée d'un renforcement Après avoir relu le rapport de l'inspection générale sur l'INRS, j'avoue ne pas comprendre pourquoi on a créé une AFSSE, puis une AFSSET. J'ai vécu la création de l'AFSSA, qui s'est opérée exactement dans les mêmes conditions, c'est-à-dire dans un contexte de crise - en l'occurrence, la crise provoquée par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) - et alors qu'il existait déjà un établissement public d'expertise auprès du ministère de l'agriculture, le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires (CNEVA). Or je suis convaincu que l'incontestable réussite de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) tient au fait qu'elle a été créée sur le socle du CNEVA, ce qui lui a permis de bénéficier immédiatement d'un fonds d'expertises considérable et notamment, dans le domaine de l'ESB, d'un laboratoire opérationnel. Dans le domaine de la sécurité en milieu du travail, les conditions étaient à peu près les mêmes avec l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) et l'INRS - même si je ne méconnais pas les difficultés liées au statut particulier du premier et encore plus particulier du second. Reste que les moyens donnés à l'AFSSET dans les années à venir, quels que soient les efforts déployés par le ministère du travail pour la doter en capacités d'expertise, la condamneront à vivre perpétuellement au crochet d'autres organismes. Cette perspective ruinera toujours sa capacité à faire de la prospective et par le fait à se saisir suffisamment en amont des problèmes. Mme Françoise CONSO : Il est effectivement très difficile pour des médecins d'avoir à traiter avec une tutelle « ministère du travail », plutôt que « ministère de la santé », et cela n'est pas sans répercussion sur notre dispositif de formation. La médecine du travail a bénéficié de la réforme de 1984 qui a inclus la spécialité dans l'internat. Cela a permis de disposer de médecins, certes peu nombreux, mais présents sur le terrain et surtout beaucoup plus impliqués dans l'évaluation des risques en milieu de travail que les praticiens formés jusqu'alors. Ce n'est pas rien, même s'il se pose des problèmes de démographie, auxquels vient s'ajouter un manque de lisibilité qui dissuade les jeunes médecins de s'engager dans cette discipline. Parallèlement, les effectifs de formateurs universitaires diminuent depuis cinq ans, du fait d'un problème de tutelle. Si le ministère du travail nous soutient totalement lorsqu'il s'agit de demander des postes, les suites données ont tendance à se perdre dans les arbitrages qui privilégient les disciplines cliniques au détriment de la médecine du travail. Sur les 32 professeurs de médecine du travail sur tout le territoire en 1998, nous ne sommes plus que 26 aujourd'hui. Pire, le nombre de postes de jeunes, autrement dit le vivier dans lequel se recrutent les futurs hospitalo-universitaires, est d'une pauvreté extrême : de 22 en 1998, ils ne sont plus que 17. M. le Président : Que pensez-vous de la vision du réseau développée par M. Combrexelle ? Mme Françoise CONSO : C'est une des forces, et l'honneur de la France, que d'avoir su mettre en place, au plus près du terrain, un réseau de médecins qui surveillent tous les salariés. Il doit être possible de renforcer leurs compétences par le biais de la formation continue, mais également leur indépendance. On aurait toutefois tort d'oublier, particulièrement dans le cas de l'amiante, le réseau des médecins libéraux : c'est vers eux que les patients se tournent en premier. Or je veux insister sur l'indigence de leur formation en santé du travail : dans le meilleur des cas, les étudiants de deuxième cycle n'ont droit qu'à huit ou dix heures d'enseignement en faculté. Et à vingt-six professeurs, il nous est impossible d'intervenir dans le troisième cycle... M. Gilles BRÜCKER : La santé au travail doit désormais s'inscrire de manière parfaitement visible dans le champ de la santé publique. La santé ne se morcelant pas, il nous appartient de prendre en compte l'immense dimension des facteurs de risques liés au travail dans une approche globale de la santé. Or tel n'est pas le cas. Du fait de son histoire, la médecine du travail a toujours été une filière à part et, quels qu'aient été les efforts de quelques pionniers comme Françoise Conso ou Marcel Goldberg, un peu en marge de la santé publique : la santé au travail reste l'affaire du médecin du travail et le médecin traitant ne s'en occupe pas. Cela pose un réel problème de fond. De ce fait, les progrès considérables observés en santé publique à partir des années 90 n'ont pas été équitablement répartis. Le nombre d'enseignants, rappelé par Françoise Conso, dans le domaine de la santé au travail est hautement préoccupant. À l'inverse, les effectifs de professeurs de santé publique sont au plus haut... La santé publique, que l'on a critiquée pendant des années, a pris aujourd'hui une incontestable dimension dans de nombreux secteurs, y compris dans les centres hospitaliers universitaires (CHU) et les universités, et cela se retrouve dans la formation. De ce fait, hormis quelques travaux réalisés par les unités de recherche qui s'étaient engagés sur le sujet, nous ne disposons pas des capacités d'expertise et de production de données dont nous avons véritablement besoin. Le premier rapport que le Haut Comité de santé publique a produit en 1994 ne compte en tout et pour tout qu'une page - sur plusieurs centaines - consacrée à la santé au travail, autrement dit rien ! Depuis, le tir a été partiellement rectifié. Dans cette perspective, l'Institut de veille sanitaire (IVS) s'est vu confier une mission totalement universelle : surveiller l'ensemble du champ de la santé sur l'ensemble des risques, détecter toutes les menaces et alerter les pouvoirs publics. Aussi s'est-il tout naturellement doté, dès 1998, d'un département santé/travail qui, sous l'impulsion de Marcel Goldberg puis d'Ellen Imbernon, a mis en place toute une série d'études visant à répondre à autant de lacunes et de besoins dans le champ de la connaissance, de la surveillance et de l'épidémiologie, afin de prendre véritablement la mesure du problème. Un ensemble d'outils Comment constituer des réseaux de surveillance à partir des médecins du travail ? Françoise Conso a raison de remarquer qu'ils existent déjà. Sont-ils pour autant capables de répondre à l'ensemble des besoins d'information, de fonctionnement, de surveillance ? À l'évidence non. La culture du signalement, l'organisation de la collecte des données et de leur transmission pose toute une série de problèmes non encore résolus. Le travail de surveillance épidémiologique des troubles musculo-squelettiques mis en place par Ellen Imbernon dans les Pays de la Loire37 grâce à un réseau de médecins du travail, est un exemple très intéressant que nous allons développer dans d'autres régions. Mais tout cela est loin d'être abouti. L'Institut de veille sanitaire n'a, rappelons-le, qu'une seule tutelle : le ministère de la santé. L'universalité du champ qui lui a été dévolu pose du reste la question de savoir s'il n'en aurait pas fallu plusieurs. Si les conditions remarquables dans lesquelles nous travaillons avec la DRT montrent qu'il n'est pas forcément nécessaire d'être sous la tutelle du ministère du travail pour développer de bonnes relations, il était évident que l'universalité de notre mission nous amenait à travailler avec d'autres ministères que celui de la santé, qu'il s'agisse du champ du travail, de celui de l'environnement ou encore d'autres questions de sécurité. Aussi avons-nous clairement affiché parmi les axes stratégiques de notre deuxième contrat d'objectifs et de moyens, opérationnel à compter de janvier 2006, le développement de la surveillance et des outils d'alerte et d'expertise dans le champ de la santé du travail. C'est un domaine à nos yeux prioritaire. Une convention a été signée, non seulement dans le cadre du « Plan santé environnement », mais également avec la DRT pour définir au sein du PST les éléments clés sur lesquels nous devions nous impliquer. L'institut de veille sanitaire est particulièrement concerné par le premier axe du PST : développer les connaissances sur les risques professionnels. Sur toute une série de points, nous avons défini avec la DRT des objectifs et un calendrier de travail. Mais si l'IVS a une mission universelle, il ne prétend pas pour autant être capable de tout faire. Il existe d'autres outils de recherche et d'autres structures d'expertise : l'INRS évidemment, l'AFSSET, avec lesquels nous devons chercher le moyen d'amplifier nos partenariats, afin de répondre à la question princeps que vous avez posée : quelles sont les conditions du succès du « Plan santé au travail » ? La définition du PST a été une excellente chose. Nous avions besoin de nous fixer des objectifs précis et de définir qui fait quoi. Dans ses grandes lignes, les choses sont assez claires. Quant aux conditions du succès, elles reposent d'abord sur la capacité de chacun à mener à bien les actions prévues. L'IVS, compte tenu de toutes les lignes du programme qu'il aura à développer, sera-t-il en mesure d'assurer le recrutement des experts nécessaires ? Il faut savoir que ce que vient de dire Françoise Conso à propos des professeurs de santé du travail vaut pour l'expertise « santé au travail » : non seulement il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont mieux payés ailleurs... M. Marcel GOLDBERG : Ce qui n'est pas très difficile ! M. Gilles BRÜCKER : Effectivement ! Qui plus est, du fait notamment des nouvelles modalités de la loi de finances, nous sommes enfermés dans une enveloppe d'équivalents temps plein. Si nous devons pouvoir nous en sortir en 2005-2006, on peut réellement s'interroger pour la suite. Une des clés du succès repose sur notre capacité à former les ressources humaines dont nous avons besoin et à leur offrir des statuts professionnels corrects. Mais si ceux-ci ne sont pas mauvais - la définition des statuts des agences nous a grandement aidés à clarifier la question -, encore faut-il qu'il y ait des postes et des CDI. Or 25 % des ressources humaines de l'IVS sont en CDD... Il nous faut ensuite conforter le positionnement d'une expertise scientifique indépendante. S'il faut maintenir la santé au travail en tant qu'élément du dialogue social, l'expertise sur les questions de santé au travail ne doit pas pour autant être prisonnière du dialogue social, ce qui suppose une expertise totalement indépendante d'autres enjeux, aussi respectables soient-ils. À voir les expériences pilotes qui pourraient être conduites par l'IVS, les premiers pas ne me paraissent pas d'une simplicité absolue... J'ai du reste été étonné de la rapidité avec laquelle des gens aux positionnements sociaux totalement différents pouvaient se mettre d'accord pour considérer que personne ne devait venir dans le champ de l'expertise ! Évidemment, la coordination de l'ensemble des instituts est indispensable. La pluralité, c'est très bien ; encore faut-il instaurer des règles du jeu. La loi du 9 août 2004 a confié à l'IVS une mission de centralisation des données sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les maladies présumées professionnelles. C'est une tâche fantastique, mais qui nous oblige à faire appel à de nombreux partenaires. Enfin, parallèlement à cette expertise qui pose autant d'interrogations que de certitudes, nous devons être capables de promouvoir véritablement de la recherche dans le domaine de la santé au travail, aussi bien sur les risques liés aux produits que sur l'organisation du travail ou la problématique sociale. Le problème de la santé au travail ne se limite pas à l'exposition à un produit : il touche à un environnement beaucoup plus large que nous devons également prendre en compte - et ce, dans une totale transparence des résultats, qui va de pair avec l'indépendance de l'expertise. Nous n'avons pas d'autre choix si nous voulons répondre à l'inquiétude croissante des citoyens. M. Marcel GOLDBERG : Il ne peut y avoir d'expertise réellement mobilisable sans recherche. Or pratiquement tous les indicateurs montrent une très grande faiblesse de notre recherche dans le domaine des risques professionnels : il n'est que de voir le nombre de publications d'équipes françaises dans les revues internationales ou encore les difficultés que nous rencontrons pour trouver des experts en la matière. Aussi concentrerai-je mon propos sur le problème spécifique de la recherche. Disons-le : nous sommes très faibles, nous avons fort peu d'équipes, en tout cas pour ce qui concerne le domaine que je connais un peu, l'épidémiologie, autrement dit une des disciplines en première ligne dans la nécessaire expertise. Françoise Conso a souligné le très faible nombre, en diminution qui plus est, des enseignants de santé au travail. Du côté des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), c'est encore pire. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) offre en tout et pour tout un poste de jeune chercheur par an pour l'ensemble des disciplines de la santé publique... Je ne parviens pas à me souvenir quand on y a recruté pour la dernière fois un chercheur travaillant dans les problématiques de risques professionnels ! Cela remonte à bien des années... Non seulement les équipes sont très rares et numériquement faibles, mais elles sont éclatées entre équipes d'EPST, très peu nombreuses, et équipes universitaires, pratiquement sans moyens. Nous nous retrouvons face à un paysage désolé, sans rapport avec les besoins d'expertise exprimés, à très juste titre, dans le « Plan santé au travail ». Mais comment trouverons-nous les experts compétents et en nombre suffisant pour répondre à toutes les sollicitations ? On a déjà évoqué la formation. On me permettra un regret un peu ponctuel : lors de la réforme de l'internat dans les années 80, la médecine du travail et la santé publique étaient ensemble. On les a très vite séparées et il y a tout lieu de le regretter. Mais on n'avait visiblement guère envie de faire entrer la santé au travail dans la santé publique, comme nous le souhaitons tous aujourd'hui. La recherche se construit sur le très long terme. On ne forme pas un chercheur en quelques semaines et une circulaire ministérielle, ou même des créations de postes, ne suffit pas. M. Marié et Mme Imbernon peuvent témoigner de l'extrême difficulté à recruter des spécialistes en épidémiologie des risques professionnels. Certains postes ouverts depuis longtemps n'ont toujours pas trouvé preneur. Pour former des chercheurs, il faut des financements, et pour que les gens viennent, il faut mettre de l'argent sur la table. De gros efforts sont faits à l'heure actuelle, mais force est de reconnaître que les politiques publiques ont été extrêmement erratiques en la matière, avec des appels d'offres qui disparaissent, puis reviennent pour disparaître à nouveau. La recherche a besoin de continuité et j'espère que le « Plan santé au travail » sera l'occasion de réaffirmer cette nécessité. Se pose également un problème qui nous est assez spécifique, par comparaison avec d'autres pays que je connais un peu : l'interface entre le monde académique et la recherche et les pouvoirs publics. Nous rencontrons parfois de sérieuses difficultés de dialogue entre les pouvoirs publics responsables de ces questions, dans leurs demandes, leurs conceptions, leurs souhaits, et le monde de la recherche. Force est d'admettre, sans vouloir vexer personne, que nous ne trouvons pas dans les directions d'interlocuteur ayant une compétence scientifique suffisante pour que nous puissions dialoguer efficacement et développer ensemble des demandes communes. Il nous est plusieurs fois arrivé de transmettre des résultats de recherche susceptibles à nos yeux d'attirer l'attention sans jamais en voir de retour. Inversement, nous sommes parfois saisis de demandes dont tout spécialiste scientifique conviendra qu'elles ne présentent pas le moindre intérêt. Il se pose donc globalement un véritable problème de ressources et de compétences humaines dans le domaine des disciplines scientifiques concernées, et ce à tous les niveaux. La formation des médecins généralistes et spécialistes est d'une totale indigence, le nombre de postes d'internes en santé publique en constante diminution. Mme Françoise CONSO : Et en médecine du travail... M. Marcel GOLDBERG : Vous avez raison. L'internat en santé publique est une des voies par lesquelles on forme de bons spécialistes en épidémiologie ; pratiquement à chaque alternance politique, on annonce sa prochaine suppression ou à tout le moins une réduction drastique - de 80 à 7 postes du jour au lendemain - du nombre de postes offerts. À chaque fois il nous faut remonter à l'assaut ; nous avons déjà connu pas moins de quatre tentatives... Il y a quelque chose de schizophrène entre, d'un côté, les grandes déclarations sur l'évaluation du risque, la nécessité d'une expertise forte, etc., et de l'autre la diminution constante du nombre de postes et des possibilités de formation. M. Jean-Luc MARIÉ : Responsable d'une humble association loi de 1901, je confirme les propos de Marcel Goldberg sur les difficultés à recruter des épidémiologistes : notre poste de chef du département « épidémiologie en entreprise » vient d'être pourvu, mais il était resté vacant pendant deux ans, et deux autres postes le sont toujours. Nous en avons parlé lors de notre réunion annuelle avec l'IVS : nous avons un réel problème de formation et le « Plan santé au travail » a le mérite de l'aborder. Malheureusement, comme l'a dit Marcel Goldberg, c'est dès aujourd'hui qu'il faut faire quelque chose si nous voulons disposer des compétences nécessaires dans les années qui viennent. En ce qui concerne la recherche, il y a des endroits où nous sommes pauvres et d'autres où nous le sommes moins. Ainsi en est-il du domaine de l'acoustique où la France n'est pas si mal lotie par rapport aux autres pays. L'INRS travaille comme leader d'un centre thématique pour l'agence européenne de recherche, de sécurité et de santé au travail de Bilbao : chez nos voisins européens aussi, la situation n'est guère reluisante - c'est bien la raison pour laquelle nous nous efforçons de développer les travaux en commun au niveau européen, afin de jouer sur les effets de masse. Il ne faut pas oublier que la dimension européenne peut aider dans l'approche de la santé au travail : même si l'on n'est pas très riche, on peut toujours apporter quelque chose. Je reviens sur les propos d'Yves Coquin à propos de la création de l'AFSSE puis de l'AFSSET. Regretter les décisions de la représentation nationale n'avance à rien ; l'AFSSET est une agence tête de réseau et, comme l'a dit Gilles Brücker, il faut vraiment que nous travaillions tous en réseau, c'est-à-dire que chaque organisme ou institut apporte à l'agence ses connaissances et ses expertises. Tout cela ne se fait pas en claquant des doigts ; les cultures sont différentes, il faut apprendre à travailler ensemble. Je me souviens que lorsque Mme Michèle Froment-Védrine a pris ses fonctions à l'AFSSE, les problèmes de construction de l'agence n'étaient pas simples, non plus que les délais financiers, de construction ou de recrutement... Il faut s'efforcer de faciliter la vie des gens, afin d'aller le plus vite possible vers le travail en réseau. L'INRS s'est d'ores et déjà engagé dans cette voie et la masse de travail que me demande Mme Michèle Froment-Védrine nous a conduits à préparer une convention cadre arrêtant les choix et les priorités communes. L'efficacité du PST dépendra de la définition claire des priorités, des hiérarchies et du travail de chacun. Ce sera un des gros chantiers du PST, probablement pas facile, mais il faudra le faire, et en commun. Mme Michèle FROMENT-VÉDRINE : Il y a trente ans, je suis entrée à la sécurité sociale ; la culture de la médecine du travail y était relativement forte. Des unités « médecine du travail » étudiaient les dossiers d'accidents du travail, alors extrêmement nombreux, ou de pathologies professionnelles. Il y avait là des gens d'une très grande compétence, auprès desquels j'ai beaucoup appris, et surtout que l'expertise n'était pas indépendante. Lorsqu'un dossier était déposé à propos de l'amiante, l'expertise commençait toujours par chercher une cause ailleurs, de sorte que l'affection ne soit pas reconnue... J'ai ainsi appris très tôt qu'il existait une multitude de moyens de parvenir à une expertise niant la reconnaissance du risque. Trente ans plus tard, les choses n'ont guère évolué. Nous restons d'abord dans une logique de soin, autrement dit de maladie déclarée ; nos connaissances de santé publique sont encore très récentes, malgré une loi adoptée en 1998. Pour y être vraiment, encore faudrait-il que l'ensemble des besoins de santé publique soit coordonné, ce qui n'est pas encore le cas, même si des instituts prestigieux et anciens étudient ces besoins. L'éclatement est proprement sidérant. La nécessité de coordonner était précisément une des raisons d'être de l'AFSSE. Or la coordination d'établissements de taille si différente est une gageure, à plus forte raison lorsque chacun a des missions différentes, mais dont certaines se superposent, et qu'on leur demande à tout moment des interventions urgentes. Les lois ne sont pas les mêmes, ni les tutelles, ni les priorités. Qu'appelle-t-on coordination dans une telle situation ? Par ailleurs, au fil du temps, des priorités se sont établies en santé publique. Il a fallu toute la puissance d'un Président de la République pour avoir un plan cancer. C'est devenu la préoccupation de toute la population - et pour cause, une personne sur quatre étant appelée à finir avec un cancer ou à en avoir un. Reste qu'il a fallu un plan cancer : on lui a donné 200 millions et 200 personnes. L'AFSSE n'a eu droit qu'à douze postes lorsqu'elle a été créée... Ce n'est pas tout à fait la même dimension. Je sais le mal que M. Combrexelle s'est donné pour obtenir les dix postes de 2005 et les dix postes de 2006. Encore ne s'agissait-il que de dix postes et non de deux cents ! Les choix de priorités de santé publique ne relèvent pas de M. Combrexelle, mais d'un niveau supérieur. Le travail est-il une priorité ? Assurément oui, puisqu'il y a un plan. Mais il y a également un « Plan national santé/environnement » (PNSE). On ne va pas étudier le formaldéhyde ou les nanomatériaux d'un côté dans l'environnement général et de l'autre dans le milieu de travail, avec à chaque fois des experts et des établissements différents ! Tout est devenu prioritaire en santé publique, tout le monde a peur de tout et le nombre de priorités est devenu sidérant : 45 actions dans le PNSE, 23 dans le PST, je ne sais combien dans le plan cancer, qui se recoupent ! Où sont les véritables priorités ? Qui les choisit ? On ne peut pas tout faire en même temps : on n'en a ni les moyens financiers, ni le réservoir technique. Je vous renvoie à ce qu'ont dit Mme Conso et M. Goldberg : avec Gilles Brücker et la DRT, nous avons remis en activité la recherche sur la santé au travail l'an dernier. Les équipes étaient faibles et peu nombreuses. Plus inquiétant encore, ce sont aussi des équipes étrangères qui répondent à nos appels d'offres européens. Une équipe belge et une équipe romande ont présenté de très bonnes réponses. Allons-nous donner nos crédits à des équipes étrangères, tout simplement parce qu'elles sont meilleures et leurs projets mieux présentés ? On ne trouve pas non plus de toxicologues, alors que la toxicologie a été pendant longtemps une spécialité plutôt industrielle. Un rapport IVS/AFSSE a été produit sur ce sujet en 2004, qui ne s'est pas traduit en pratique par un plan de formation. Or un diplôme de toxicologue n'est pas un BTS : c'est une formation très longue et très compliquée. Et comme ils ne sont pas nombreux, les toxicologues vont là où on les paie le mieux, c'est-à-dire dans l'industrie ou en médecine du travail - on est carrément 30 % au-dessous ! Moi, je ne sais pas faire + 30 %, surtout avec mon contrôleur financier qui m'enjoint de respecter la grille... Au mieux arriverais-je à trouver un toxicologue de vingt-six ans certainement remarquable, mais qui n'a jamais travaillé en dehors de ses études, alors que M. Combrexelle me demande très logiquement de recruter des seniors expérimentés ! Au surplus, à supposer que l'AFSSET puisse recruter en payant 30 % plus cher, les autres spécialistes qui travaillent sur le plan « santé/environnement » ne trouveraient pas cela normal. Nous manquons également, Mme Conso l'a bien dit, de professeurs de médecine du travail. Comme les toxicologues, beaucoup vont partir en retraite. Que ferons-nous alors ? Les chercher en Belgique, en Suisse, au Canada ? En tout cas pas en France... Et un professeur de médecine ne se forme pas en dix ans. C'est beaucoup plus long. D'ores et déjà, nous savons que nous n'en avons plus, comme nous n'avons plus d'accoucheurs et d'autres spécialités médicales oubliées. Il est également des éléments de base de l'évaluation du risque auxquels on ne pense pas. Il y a des laboratoires de métrologie agréés mais certains laboratoires méritent-ils vraiment un agrément ? Peut-être faudrait-il s'interroger sur la manière dont sont faites certaines mesures, et sur les laboratoires qui les supportent. Si l'IVS a 25 % de contrats à durée déterminée (CDD), l'AFSSET en compte 50 %. Que se passe-t-il lorsqu'un de nos salariés se voit proposer un CDD, même de 3 ans, et qu'il a envie de s'acheter un appartement ? Il quitte l'AFSSET pour aller n'importe où, dans une association, une mutuelle en CDI. Qu'il soit épidémiologiste ou toxicologue, même si son métier le passionne, il préférera avoir sa maison et son prêt bancaire et il partira. Il faut avoir en tête tous ces éléments qui seront une des raisons du succès ou, sinon, la cause de l'échec. Vient ensuite la question des classements. L'AFSSET est certes une agence dite de coordination, une « tête de réseau ». Pour commencer, je ne suis pas sûre que ce soit pour l'heure vraiment sa vocation, si je me réfère au projet de décret : il y est bien indiqué que l'AFSSET organise un réseau mais on n'y trouve aucune obligation faite aux divers établissements de lui apporter leurs concours et notamment un concours gratuit. Pour ce qui est du niveau régional et local, l'AFSSET n'ayant pas d'antennes locales, les « plans régionaux santé/environnement » ou les « plans régionaux santé au travail », je ne connais pas ! Les antennes sont essentiellement à l'IVS, avec lesquelles nous pouvons monter une formidable coordination ; reste que l'IVS a ses propres missions - dont certaines se superposent - et n'est pas le seul établissement concerné. Il faut également compter avec les positions des différentes tutelles. Si M. Combrexelle souhaite que l'AFSSET ait un rôle dans le projet communautaire REACH38, le ministère de l'environnement ne voulait pas en entendre parler. M. le Président : En vous entendant les uns après les autres, on n'a plus qu'une envie : se jeter à l'eau ! M. Ghislain BRAY : Plus on avance, plus on recule... Mme Michèle FROMENT-VÉDRINE : Tout le monde fait de la prévention. Les fiches de l'INRS sur les différents produits toxiques et sur divers procédés sont remarquables ; il suffit de les consulter sur internet, il n'y a pas besoin de les refaire. Et pourtant, certains recommencent, car il existe d'autres instances chargées de la prévention. Est-ce bien nécessaire ? Éclatement national, éclatement de la recherche, éclatement régional, éclatement également de l'inspection du travail... En gros, ne serions-nous pas dans une structure de soins palliatifs ? Je crois qu'il y a une immense ambition légitime et que la population en général est très angoissée de ce qui lui arrive : l'amiante n'est pas le seul risque grave qui nous attend en France, mais il est particulièrement représentatif de ces dangers que l'on aurait largement pu limiter - le « on » étant évidemment à prendre dans son sens le plus général. L'AFSSET est-elle une coquille vide, comme le laissait entendre M. Coquin ? M. Yves COQUIN : Je n'ai pas dit cela. Mme Michèle FROMENT-VÉDRINE : Après avoir entendu le président Paillotin il y a quelques jours, j'avoue commencer à douter, et les personnels avec moi, de la volonté d'existence de cette agence... Créer une tête de réseau suppose de lui donner des moyens juridiques et des moyens financiers. On ne peut se contenter de lui dire de passer des conventions avec les autres instituts, alors que ceux-ci ont chacun leurs missions... Ou bien l'AFSSET a des priorités, en nombre réduit, et l'on demande à tout le monde de travailler avec elle, ou bien elle a une mission plus générale de coordination, auquel cas cela est prévu dans les contrats d'objectifs et de moyens de chaque établissement et on donne à l'agence des moyens à redistribuer, y compris dans la recherche. Au contraire, on a créé une agence nationale de la recherche qui, elle aussi, a lancé son plan « santé au travail »... Combien y a-t-il de PST en tout ? Nous avons vraiment un problème de conception d'un réseau autour d'un enjeu prioritaire. Ne confondons pas non plus urgence et précipitation. Il y a évidemment urgence à organiser ce dossier santé au travail et à connaître l'état de santé de la population et notamment des travailleurs. Mais recevoir une lettre en septembre enjoignant d'avoir recruté dix spécialistes de haute volée dans le mois suivant relève de la précipitation - ou de l'affichage politique, ce que je comprends tout à fait. Reste que c'est méconnaître la façon dont les choses se passent dans la pratique, du vivier et de sa disponibilité. Permettez-moi quelques métaphores. Sans doute aimez-vous le millefeuille et probablement ne l'achetez-vous pas n'importe où, car il y en a qui collent au palais et d'autres qui sont merveilleux. Or, pour réussir la pâtisserie, il ne suffit pas d'avoir tous les ingrédients avec tous les dosages : encore faut-il savoir comment les mettre ensemble pour que le gâteau soit bon. On peut également penser à la diligence. Dans les westerns, on voit des diligences avec douze chevaux où le cocher tient douze rênes, six de chaque côté. Il est déjà difficile de diriger un cheval ; en conduire douze est encore plus compliqué. Mais sur les traîneaux comme sur les diligences, il y avait toujours un cheval de tête et toujours un conducteur. Je ne crois pas que l'on puisse faire face à toutes les priorités M. le Rapporteur : Rappelons que c'est à l'amiante que nous nous intéressons d'abord, même si nous voulons nous servir de cet exemple pour préparer l'avenir... Reste que vos déclarations nous interpellent vivement. Vous avez déjà anticipé nos questions, notamment sur les difficultés de l'AFSSET à mobiliser les capacités françaises et internationales d'expertise, ou encore celle de savoir si les moyens mis en œuvre pour améliorer la connaissance scientifique sont à la hauteur des enjeux - c'est bien le problème posé dans la première partie du « Plan santé au travail ». Nous ne sommes ni des spécialistes ni des médecins, mais seulement trente et un députés de toutes tendances et de toutes origines, qui veulent simplement que ce qui s'est passé entre 1970 et 1997 ne se reproduise pas. Représentants de la nation, nous représentons également ceux qui ont eu le moins d'informations, à l'opposé des messages très précis que vous venez de formuler. La pratique généralisée de « l'usage contrôlé » de substances dangereuses ne peut plus être la réponse préventive apportée classiquement à un risque professionnel lié à une exposition. Cela a été le cas dans le passé ; j'aimerais que cela ne le soit pas dans l'avenir. M. le Président : Je veux d'abord vous remercier de votre sincérité, quitte à faire apparaître des contradictions. C'est ce que nous souhaitions. Notre mission d'information est composée d'hommes et de femmes qui ont vécu et vivent encore sur le terrain les problèmes de l'amiante : c'est particulièrement le cas de Jean Lemière, député de Cherbourg, et de moi-même, député de Dunkerque. À nous deux, nous connaissons bien le problème de l'amiante... Le meilleur hommage que nous puissions rendre aux hommes et aux femmes qui ont connu ce drame est effectivement de faire tout ce que nous pouvons pour ne pas rester dans une logique de réparation mais, au contraire, de promouvoir une logique de prévention. Par ailleurs, M. Combrexelle peut en témoigner, je ne suis pas en reste dans le débat parlementaire. Mais il est un point sur lequel je suis entièrement d'accord avec M. Larcher : il a eu le courage de poser clairement le problème de la santé au travail. Nous avons du reste souvent les mêmes lectures... Donc, le « Plan santé au travail » est une bonne chose, mais s'il n'y a pas le début d'un commencement d'effectivité, ses effets assurément utiles ne se feront pas sentir avant vingt ans... Pour l'amiante, hélas ! il ne nous reste plus qu'à faire en sorte - et ce n'est pas une mince affaire - d'empêcher les risques liés à l'amiante résiduel d'apparaître ; mais pour ceux qui ont été exposés pendant des années, nous sommes impuissants, tout comme vous. Il y a donc urgence : sinon, la même catastrophe se répétera demain avec une autre substance et non seulement le monde politique, mais l'équilibre même d'une vision démocratique de la société en sera sévèrement bousculé. Vous-mêmes en avez conscience. J'entends bien ce que vous me dites : pas de réservoir, insuffisance de moyens, travail en réseau, conditions de définition des priorités... J'ai tout entendu et tout doit être soigneusement analysé. La seule chose que nous puissions faire, c'est poser le problème avec la plus grande énergie. Je connais les capacités de Jean Lemière en la matière ; quant à moi, M. Combrexelle peut témoigner qu'il faut un char pour m'arrêter... Nous le ferons ; encore faut-il que vous nous y aidiez, que nous arrêtions une méthodologie de recherche d'un maximum d'efficacité au vu des conditions que nous connaissons aujourd'hui. Vous-même avez parlé de votre incapacité à recruter. Comment rendre notre action plus efficace ? Une absence de moyens peut-elle être répartie ? Comment la coordonner ? Comment travailler davantage en interministériel ? Sortant du monde de l'entreprise, je sais à peu près ce que cela signifie et je l'ai pratiqué longtemps, y compris en tant que ministre. Vous êtes des acteurs clés. Nous poserons clairement les problèmes, faites-nous confiance. Encore faut-il que nous ayons une amorce de réponse, connaître la manière dont on peut gérer avec la plus grande efficacité possible la pauvreté ou l'insuffisance de moyens. Sinon, nous n'aurons pas fait notre travail et il y aura un autre problème demain. M. Gilles BRÜCKER : Reconnaissons que la progression des outils et des questions de santé publique depuis dix ans a été énorme. M. le Président : Nous sommes d'accord. M. Gilles BRÜCKER : Je ne le dis pas pour mettre du baume au cœur, mais pour l'avoir moi-même vécu. Lorsque je suis entré dans la santé publique, c'était quasiment le néant. Depuis les années quatre-vingt-dix, où se sont progressivement mis en place toute une série d'outils, d'instituts et de structures, les avancées ont été considérables. Nous savons désormais ce qu'il faut faire, quels outils il faut privilégier. Un réel savoir-faire s'est développé dans le domaine de la surveillance. Cela n'enlève évidemment rien aux problèmes effectifs ; reste que la mise en place de certains outils comme MATGENE - matrice générale emploi exposition - permettant de mesurer l'exposition des travailleurs et les risques encourus dans les filières, ou comme les cohortes de suivi des travailleurs pour mesurer la mortalité et la morbidité, montre que la définition des outils à promouvoir est pratiquement chose faite : nous disposons d'un formidable potentiel, prêt à être activé. Nous avons su mettre en place, dans toute une série de domaines, une panoplie d'outils de surveillance et d'alerte - on n'a pas beaucoup parlé de l'alerte, grâce à laquelle, sitôt qu'il se passe quelque chose quelque part, compte tenu de la sensibilisation que l'on peut désormais promouvoir parmi les médecins du travail, on intervient immédiatement. Le cas de l'usine Adisseo39 est assez exemplaire : un médecin du travail ayant été confronté à un nombre étonnamment élevé de cancers du rein, nous avons été alertés et une enquête a été immédiatement diligentée. Mais il faut comprendre que c'est un énorme travail. Plus on développera la culture du signalement... M. le Président : « Culture du signalement » : voilà un mot que je note... M. Gilles BRÜCKER : Il faut promouvoir la culture du signalement dans le cadre des réseaux de médecins du travail dont nous avons déjà parlé. Voilà deux wagons qui s'enclenchent bien l'un avec l'autre. Encore faut-il être en mesure d'intervenir et d'expertiser derrière. Heureusement que nous n'avons pas dix affaires Adisseo à régler : celle-ci a mobilisé des ressources humaines considérables. Mais en matière de veille sanitaire, de surveillance et d'alerte, nous disposons d'une série d'outils qui, s'ils ne sont peut-être pas totalement finalisés, peuvent d'ores et déjà être mis au service de la santé au travail. M. le Rapporteur : Le « Plan santé au travail » ne modifie pas la mission de la médecine du travail dans la mise en place une alerte, une sentinelle sanitaire. Pourquoi ? De même, pourquoi le PST ne prévoit-il pas d'exploitation du document unique ? M. Jean-Denis COMBREXELLE : Il faut effectivement que le médecin du travail soit en réseau - je suis sur ce point totalement d'accord avec Gilles Brücker. J'ai toujours été surpris par la capacité du système à créer de la complexité... La question est pourtant simple : il existe un certain nombre de produits susceptibles de créer des difficultés au sein des entreprises. D'où un problème de signalement - par les médecins du travail notamment -, puis un problème d'expertise par l'IVS ou l'AFSSET. Je ne crois pas qu'il faille ajouter aux priorités du « Plan santé au travail », qui se posent en termes d'organisation et de fonctionnement, celles du « Plan national santé environnement » qui ne sont pas du même ordre. Mes sujets de préoccupations, comme ceux du ministre, se limitent aux éthers de glycol, aux fibres céramiques, aux nanotechnologies, autrement dit à quatre ou cinq produits. Une fois le signalement et l'expertise faite, il appartient au ministre, au vu des conclusions de l'IVS ou de l'AFSSET, de prendre les décisions Le ministère du travail est énormément attaqué à propos du document unique. En termes de stratégie, je considère que celui-ci ne doit pas se limiter à une simple démarche de prévention au sein de l'entreprise : il faut pouvoir l'exploiter au niveau régional et au niveau national. Mais cela suppose, à terme, une certaine rationalisation et formalisation. M. le Président : Cela me paraît évident. M. Jean-Denis COMBREXELLE : Nous avons décidé, non sans hésitations, de ne pas mettre le document unique dans le « Plan santé au travail », estimant qu'il fallait commencer par le défendre et par convaincre les entreprises de s'engager dans cette démarche de prévention des risques professionnels, et que la rationalisation et l'exploitation viendraient dans un second temps. L'objectif est évident : le document unique doit être une démarche tout à la fois interne à l'entreprise et, à terme, exploitable au niveau national. Mais pour l'heure, de nombreux ministères réclament purement et simplement sa suppression... M. le Président : La bagarre doit être difficile ! M. Jean-Denis COMBREXELLE : Et elle le sera encore plus si nous annonçons que, loin de le supprimer, il va falloir le rationaliser, afin de mieux l'exploiter. M. Marcel GOLDBERG : Vous sembliez regretter tout à l'heure le catastrophisme de nos interventions ; mais la réalité est catastrophique. Nous savons d'ores et déjà que le nombre de cancers liés à l'amiante en France continuera à augmenter pendant au moins deux ou trois décennies, alors qu'il a déjà commencé à baisser dans nombre d'autres pays. Rappelons également que, de tous les pays d'Europe, c'est en France que la différence de mortalité entre travailleurs manuels et non manuels est la plus grande. Ce n'est donc pas nous qui sommes pessimistes ou fatigués, mais bien la réalité qui est mauvaise... Je suis d'accord pour donner au médecin du travail un rôle d'alerte et de sensibilisation. Mais on n'a pas suffisamment insisté, à mon sens, sur l'insuffisante structuration et la difficulté à mobiliser. Il n'y a pas à proprement parler d'organisation de la médecine du travail : chaque médecin du travail, dans son service interentreprises, mène sa politique de façon autonome. À cet égard, la mise en place, citée par Gilles Brücker, d'un réseau expérimental de surveillance épidémiologique des troubles musculo-squelettiques dans les Pays de la Loire a une valeur hautement exemplaire et nous place en pointe au niveau international : un organisme, l'IVS, a pu consacrer les moyens financiers, humains et méthodologiques nécessaires et les médecins du travail ont aussitôt répondu à son appel. Ils sont toujours disposés à participer. Encore faut-il que quelqu'un organise. Mme Françoise CONSO : Le réseau des médecins du travail existe d'ores et déjà, même s'il pourrait être plus efficace. Vers qui se tourne un médecin du travail lorsqu'il se sent un peu isolé ? Vers ses sources, c'est-à-dire ses professeurs universitaires auprès desquels il trouvera tout à la fois des références et des ressources hospitalières. On oublie qu'une trentaine de grands CHU abritent un réseau clinique de consultations de pathologies professionnelles qui - même si elles vivent petitement grâce à un financement du fonds AT-MP - ont une réelle capacité d'expertise sur les cas individuels soulevés par les médecins du travail. Même si, globalement, l'hôpital ne comprend pas très bien les problèmes des pathologies professionnelles, il existe bel et bien un réseau organisé au niveau des CHU, fondé sur la compétence des professeurs de médecine du travail, dont le travail intéresse l'IVS et qui peut servir de plate-forme intermédiaire de validation de faits cliniques tout à fait intéressante pour les épidémiologistes. Ce peut être une façon de solliciter le réseau des médecins du travail et de « mettre en forme » l'alerte telle qu'on la souhaite. M. le Président : Voilà un point très positif. Mme Françoise CONSO : Le deuxième point, tout aussi précis, est à prendre comme un regret. À côté du document unique, il y a le dossier « médecine du travail » et bientôt un dossier médical personnalisé pour chaque individu. On pourrait rêver et imaginer, grâce à toutes ces données, établir une traçabilité des expositions pour tout un chacun. On sait combien il est difficile de retracer un historique en la matière. Pourquoi ne pas construire l'avenir en mentionnant les expositions individuelles dans le dossier médical personnalisé ? Le problème est que le médecin du travail, à côté de son rôle de prévention, doit également se prononcer sur l'aptitude au travail du salarié et, à ce titre, n'aura pas accès au dossier médical personnalisé. Cela me paraît grave lorsque l'on parle de prévention des risques professionnels. L'intégration des données liées aux expositions rendrait un grand service à la surveillance épidémiologique. Ce serait possible, pour peu que l'on résolve le blocage dont je viens de parler. M. Gilles BRÜCKER : Il suffit de rapprocher la santé au travail et la santé publique. Mme Françoise CONSO : Ajoutons que cette disposition ne coûterait rien. M. le Rapporteur : De nombreux travailleurs du nucléaire arrivés à la retraite sont victimes de cette absence de communication entre leurs médecins traitants et la médecine du travail en milieu nucléaire, qui détient énormément d'informations. Le médecin de la COGEMA se plaignait devant moi de cette coupure stupide qui nous prive d'une fantastique somme de données. M. Jean-Luc MARIÉ : La mise en place du document unique a été un progrès fondamental, un véritable déclencheur dans nombre d'entreprises, y compris de très petites entreprises. Rappelons que le document unique n'est pas un plan de prévention, mais une évaluation des risques dans un établissement, qui oblige ensuite à mettre en place des correctifs nécessaires dans le cadre d'un plan de prévention. Le fait d'avoir laissé un délai d'un an aux entreprises pour le mettre en place et de ne pas avoir imposé un document structuré a été très bénéfique. L'INRS a reçu à peu près 5 000 demandes d'établissement de document unique envoyées par des cabinets d'avocats qui demandaient où il fallait mettre les croix... Ils recevaient, moyennant honoraires, les entreprises et leur donnaient une liste des risques - on peut en trouver partout - en leur expliquant qu'il suffisait de mettre des croix ! Si l'évaluation des risques se limite à ce type de documents, elle ne sert à rien. En revanche, amener un établissement à établir lui-même, au moins dans un premier temps, une véritable évaluation des risques à partir de sa propre réflexion, du regard qu'il porte lui-même sur ses postes de travail notamment, est fondamental. Il faut l'obliger à réfléchir. Le problème est que l'inspection du travail, les CRAM et même l'INRS ont reçu des montagnes de lettres demandant de l'aide. Au contraire, c'est l'employeur qui précisément doit fabriquer le document unique et prendre conscience des risques présents dans son établissement, particulièrement s'il s'agit d'une PME-TPE. Certes, l'enquête qui a été réalisée dans les Pays de la Loire par l'observatoire régional de la santé au travail montre qu'il y a encore des « trous » et des marges de progrès. Mais restons prudents quant à une normalisation et une possible concaténation des documents uniques dans une approche future : le document unique doit clairement rester dans l'entreprise, et doit évidemment être tenu à la disposition de l'inspection ou des CRAM lorsqu'elles y viennent. Une normalisation trop rapide nous ferait perdre tout le bénéfice pédagogique de l'opération, qui tient précisément à ce « faire faire » auquel nous voulons obliger l'entreprise. Mme Ellen IMBERNON : La mise en réseau des informations provenant de la médecine du travail est un chantier auquel nous nous sommes attelés depuis longtemps. Parallèlement aux consultations de pathologies professionnelles, dont a parlé le professeur Conso, il existe également un corps de médecins de l'État, les médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'œuvre, au nombre d'une cinquantaine, qui jusqu'à aujourd'hui étaient en contrat - en CDD - auprès des directions régionales du travail et de la formation professionnelle. Ils ne passent pas de concours. Leur statut est en cours d'évolution. Ils ont pour mission de coordonner l'activité de la médecine du travail et de mettre les informations en synergie. Cooptés, en fait, dans le milieu de la médecine du travail, sans véritable statut professionnel, mais investis de réels pouvoirs de contrôle des services de la médecine du travail, ces médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'œuvre sont pour nous des relais incontournables en régions. Depuis la création du département santé/travail à l'IVS en 1998, nous nous battons pour essayer d'avoir un médecin inspecteur du travail et de la main-d'œuvre détaché pour justement faciliter cette coordination. Malheureusement, cela n'est administrativement pas possible. M. le Président : Pourquoi ? M. Marcel GOLDBERG : Parce qu'un contractuel de l'État ne peut ni être détaché ni mis à disposition ! M. Jean-Denis COMBREXELLE : Directement placés auprès des directeurs régionaux du travail, dont ils se retrouvent ainsi les conseillers, ces quarante-cinq médecins/inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'œuvre (MIRTMO) - deux par région - ont une bonne vision de l'ensemble des services de la médecine du travail. Leur rôle, déjà essentiel, devrait à mon sens devenir encore plus important. Néanmoins, les MIRTMO posent un problème de statut. En accord avec leur syndicat, nous avons considéré que, plutôt que de créer un statut spécifique, la solution passait par l'amélioration de leur situation contractuelle. Se pose également un problème de formation. La plupart du temps, ces médecins inspecteurs sont d'anciens médecins du travail. Or un bon médecin du travail ne devient pas forcément un bon inspecteur, de surcroît numéro deux de la direction régionale pour les questions de santé au travail, agissant dans le cadre d'une logique de santé publique. Aussi tous les MIRTMO sont-ils dorénavant envoyés à l'école de la santé publique de Rennes, afin d'y recevoir une formation administrative et de santé publique. Les MIRTMO sont appelés à jouer un rôle très important dans le cadre de la mise en œuvre des plans régionaux de santé au travail et de la réforme de la médecine du travail puisque, outre le système de l'agrément, il est prévu d'instaurer une contractualisation avec les services de santé au travail qui devront s'engager sur des objectifs concrets. D'où la nécessité d'un effort tout particulier de formation des MIRTMO. Mme Michèle FROMENT-VÉDRINE : J'ai bien compris l'importance d'une vertu pédagogique du document unique. Néanmoins, tous les pays voisins ont organisé des bases de données. Nous devons pouvoir saisir au moins une partie des données collectées si nous voulons disposer de repères face à des risques nouveaux. Sinon, nous continuerons à travailler en chapelles avec quelques médecins du travail plus pointus que d'autres, quelques industriels plus motivés, de la façon la plus hétérogène qui soit. Je suis très dubitative en voyant comment le minuscule dossier de l'Observatoire national des résidus de pesticides, pourtant partie intégrante du plan national santé environnement, est tombé en deux ans quasiment en désuétude du fait de querelles de chapelles. Je remarque également que les fibres minérales artificielles ont donné lieu à deux saisines parallèles de deux établissements distincts. Enfin, alors que l'on me demande de valoriser les consultations dont parlait Mme Conso, un autre établissement me dit qu'il ne sert à rien de les subventionner... Même chose pour l'Observatoire national de l'asthme professionnel (ONAP), réseau volontaire composé de médecins du travail et de médecins de ville, sans grands moyens, dont on me dit qu'il ne vaut rien. Des bases de données, c'est toujours mieux que rien... Mme Ellen IMBERNON : Qui est ce « on » ? Mme Michèle FROMENT-VÉDRINE : C'est là où je suis allée chercher l'information. M. Marcel GOLDBERG : Trouvez-vous anormal que des personnes ayant une certaine expertise dans un domaine donnent un avis scientifique ? Mme Michèle FROMENT-VÉDRINE : Je trouve tout à fait normal qu'on donne un avis scientifique. Mais on me demande de valoriser un réseau de données, et on me dit après que ce réseau ne vaut rien ! Cela pose quand même quelques problèmes d'organisation... Ajoutons que le réseau des médecins du travail passera bientôt de 7 000 à 3 000 personnes. Je veux bien qu'il soit capable de faire beaucoup plus de choses, mais ce sera plus difficile en le divisant par deux... On pourrait former des médecins traitants et obtenir de certains d'entre eux une collaboration sur certaines pathologies et certains risques très précis. Sans bases de données, ou avec des bases de données dispersées et qui ne se parlent pas, en subventionnant les uns et pas les autres, nous ne parviendrons pas à monter un système qui fonctionne. Le problème n'est pas que le Réseau national de vigilance des pathologies professionnelles (RNVPP) soit chez l'un ou chez l'autre. Mais on ne peut pas dire d'un tel qu'il ne vaut rien et demander de le mettre en avant. J'ai besoin d'une coordination. M. le Président : Vous dites les médecins du travail passeront de 7 000 à 3 000. Pourquoi ? M. Jean-Denis COMBREXELLE : Du fait de l'évolution démographique. La moyenne d'âge des médecins du travail tourne autour de 50 ans. M. le Président : Autrement dit, des mesures d'urgence s'imposent. Où pourrions-nous trouver un réducteur de complexité, monsieur le directeur ? Mme Ellen IMBERNON : Je remercie M. Combrexelle d'avoir répondu à ma question sur l'inspection médicale du travail et de la main-d'œuvre qui doit effectivement être un pilier régional et un relais très important pour nous. Ces MIRTMO, dont la mission vient d'être affirmée, animent un réseau de médecins du travail. Mme Conso avait remarqué que les médecins du travail n'avaient pas accès au dossier médical personnel, gardé secret dans l'intérêt du patient. Le médecin du travail étant amené à se prononcer sur l'aptitude, la connaissance de certains éléments pourrait avoir des implications sur l'emploi du salarié. Pour l'heure, le médecin du travail décide en fonction de son propre jugement, de ses examens cliniques, éventuellement d'examens extérieurs complémentaires, pour peu que l'employeur soit d'accord pour les payer, et enfin de ce que voudra bien lui dire le patient. Cette suspicion serait à mon avis atténuée - et peut-être même levée - si l'on était allé jusqu'au bout de la réflexion, engagée lors de la préparation de la réforme de la médecine du travail, sur les modalités de rémunération des médecins du travail. Les premières ébauches du PST étaient allées relativement loin dans la suppression de la rémunération directement versée par l'entreprise en proposant un système de reversement. Cette piste ne doit pas être abandonnée. Mme Françoise CONSO : Le déficit en médecins du travail, annoncé depuis bon nombre d'années, a donné lieu à des mesures palliatives efficaces sous forme de formations parallèles qui ont permis de maintenir les effectifs. Malheureusement, ces formations ont eu un effet pervers par le fait qu'elles ont découragé les étudiants de choisir une spécialité qu'il pouvait être toujours possible de rejoindre par la suite en profitant de mesures de régularisation. Le réseau restant le point de départ de toute amélioration du dispositif, nous pourrions trouver une solution permettant de préserver la qualité des médecins du travail. À côté du concours classique de l'internat existe un concours dit européen de reconversion d'autres disciplines médicales vers la médecine du travail. Or ce concours a peu à peu cessé de fonctionner à cause, précisément, des mesures de régularisation. Aussi les enseignants de médecine du travail proposent-ils de redynamiser, en le régionalisant, le concours européen qui présente l'avantage de n'avoir qu'une formation de spécialistes. Peut-être sera-t-il nécessaire de chercher un financement complémentaire - qu'il pourrait être possible de trouver auprès du patronat, par exemple. M. Yves COQUIN : Le sujet du dossier médical personnel, assez complexe, exigerait que l'on examine soigneusement les arguments des uns et des autres. Et si j'insiste sur le mot « personnel » - sans doute est-ce lié à mon passé de clinicien -, c'est pour rappeler que ce dossier médical appartient d'abord au malade. Autrement dit, il doit pouvoir comporter des informations, mais le patient doit également pouvoir rester maître des gens qui le consultent. À cet égard, gardons-nous bien de confondre la réintégration d'une action des médecins de travail dans un cadre populationnel plus général - celui de la santé publique -, et la divulgation auprès d'un médecin du travail, caractérisé par une fonction et un lien de subordination vis-à-vis d'un employeur, de données auxquels le patient n'aurait pas voulu qu'il eût accès. C'est là un sujet particulièrement complexe. Un arbitrage a été rendu, non pour désavantager qui que ce soit, mais pour répondre à un objectif de santé publique et de protection des intérêts de l'individu. Prenons donc soin d'examiner les arguments de chacun avant de faire ressurgir ce débat. Plus généralement, je m'en voudrais - car ce serait une erreur - de vous avoir donné une impression pessimiste. M. le Président : Tant mieux ! M. Yves COQUIN : Comprenez que quelqu'un qui a vécu l'affaire du sang contaminé, l'affaire de l'hormone de croissance, l'affaire de la vache folle, les diverses affaires d'affections nosocomiales, l'affaire de l'amiante, en passant sur l'affaire de la canicule, doit avoir la devise de Guillaume d'Orange assez chevillée au corps ! C'est en tout cas ainsi que j'ai interprété les propos de M. Combrexelle et des autres intervenants. Dans ce domaine, il faut rester lucide... Vous aimeriez être sûrs que l'affaire de l'amiante ne puisse jamais se reproduire. Je suis bien placé pour dire, comme Gilles Brücker, que nous avons vécu depuis les années 90 de fantastiques progrès en termes d'organisation et de développement de la santé publique, de systèmes d'alerte et de systèmes d'expertise. On ne pourra effectivement pas revivre une affaire de l'amiante qui s'est caractérisée par un retard à l'allumage considérable. Nos systèmes d'alerte sont désormais affûtés de façon à nous prévenir beaucoup plus tôt de l'ampleur du phénomène, ce à quoi il faut ajouter le rôle des associations et la sensibilité de la société civile : non seulement les interpellations monteront beaucoup plus tôt, mais les administrations et les gouvernements réagiront beaucoup plus rapidement. Mais dans le même temps, je suis bien obligé de reconnaître que, pour éviter que l'effet de l'amiante ne se reproduise avec les fibres minérales artificielles qui ont a priori exactement les mêmes propriétés, la DRT et la DGS ont élaboré un « plan fibres ». C'est dans ce cadre que l'INRS et l'IVS ont été sollicités pour entreprendre des études épidémiologiques. Or l'un et l'autre ont été obligés de déclarer forfait, aucune entreprise n'acceptant de jouer le jeu... Autrement dit, si l'État et les structures ont considérablement évolué, des révolutions culturelles restent à faire au niveau de certaines catégories sociales. M. le Président : Je vous rejoins totalement sur ce dernier point. Ce sont là des batailles que je mène depuis longtemps, et qui restent à gagner. M. Henri POINSIGNON : Je m'appuierai sur ma petite expérience d'inspecteur du travail, puis de chargé de mission à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) et, enfin, de tout récent directeur général adjoint à l'AFSSET pour réagir sur quelques points. Document unique standardisé ou non ? Je suis totalement d'accord avec M. Marié sur le fait qu'il revient aux entreprises de fabriquer le document unique. Cela dit, je regrette pour ma part que la DRT n'ait pas eu les moyens de faire passer l'idée d'une standardisation, ne serait-ce que par le biais d'un résumé, des documents uniques. Elle seule permettrait d'avoir une analyse globale des risques professionnels, tels qu'ils sont perçus sur le terrain, et de « connaître le 100 % ». Les systèmes d'alerte et de veille sanitaire actuels - via les appareils de sécurité sociale où les médecins traitants sont en principe obligés de déclarer toutes les maladies à caractère professionnel qui ne sont pas dans les tableaux - en sont incapables et ne permettent pas de dire si le risque concerne 1 ou 10 % de la population et de savoir qui est exposé à quoi, hormis dans quelques circonstances, expositions et populations bien déterminées. Les arguments contre la standardisation du document unique sont les mêmes que ceux que l'on a entendus à propos du bilan social qui remonte à une loi de 1973 et un arrêté de 1977. Aujourd'hui, les bilans sociaux des entreprises de plus de 300 salariés ne sont toujours pas consolidés, le patronat s'y étant toujours opposés. Ils sont déposés à l'inspection du travail, mais celle-ci n'a même pas le droit de les consolider au niveau du département ! Sitôt que nous avons reçu notre premier micro-ordinateur dans les années 80, j'avais eu envie de mettre les renseignements des bilans sociaux - qui, eux, sont standardisés - dans une mini base de données, afin de nous en servir pour dégager des priorités d'action. Nous n'en avons toujours pas le droit... Si donc l'entreprise doit être le moteur de son évaluation des risques, nous devons pouvoir disposer de données standardisées sur la politique de prévention des entreprises, à l'exemple du résumé standardisé de sortie qui existe dans l'hôpital public. Sur les médecins du travail, vous nous avez appelés à faire des propositions, afin de répartir plus efficacement les moyens existants et de mieux travailler ensemble. Mme Conso a appelé l'attention sur le fait que les médecins du travail n'ont pas accès au dossier personnel et souffrent même d'une certaine méfiance de la part des salariés. Non seulement ils sont rémunérés par les employeurs, mais ils passent le plus clair de leur temps à faire des visites individuelles au détriment du tiers-temps passé, en principe, sur le terrain à faire de la prévention et qui inclut tout le travail de documentation, de formation, d'épidémiologie, autrement dit toutes les autres priorités ! Si nous leur retirions la fonction de déclaration d'aptitude, spécificité franco-française, alors que nos voisins l'ont organisée de manière bien plus souple et plus ponctuelle, le tiers-temps deviendrait deux tiers de temps et ils pourraient se consacrer à la prévention collective. Enfin, qu'est-ce qu'un réseau ? Ce n'est pas simplement avoir des références professionnelles, des conseillers, un appui technique et scientifique ou des échanges professionnels entre pairs : un réseau suppose une tête de réseau, c'est-à-dire un responsable, et des membres clairement définis, avec une organisation du travail dont la tête de réseau est l'arbitre, une gestion des flux d'information et un enfin budget. Tout cela se réglemente. On sait organiser des réseaux dans le domaine de la santé publique. Mais ce que l'on appelle le réseau des médecins inspecteurs du travail et des médecins du travail est très informel. Il a besoin d'une colonne vertébrale, et il en va de même pour les relations entre l'AFSSET et les autres établissements dont elle doit pouvoir obtenir le concours permanent. Il manque une définition de ce qu'est véritablement le travail en réseau, ainsi que l'appui juridique et budgétaire qui permet de le faire fonctionner. M. Marcel GOLDBERG : J'ai cru comprendre que notre discussion touchait à de grands principes, mais j'ai entendu deux ou trois points plus techniques qui méritent d'être soigneusement analysés avant d'être enregistrés. Je ne pense pas qu'une donnée, parce qu'elle est recueillie, soit par définition quelque chose d'utile. C'est plus compliqué que cela. Dans certaines situations, on peut être amené à considérer que telles données ne présentent aucun intérêt. Les rapports d'activité des médecins du travail sont depuis très longtemps formalisés et pourtant, je n'ai jamais vu rien d'utile en sortir en termes de connaissance de la santé des travailleurs... Croyez-vous qu'il nous soit possible, en deux ou trois heures de discussion, d'entrer dans le détail des aspects méthodologiques et techniques ? Faisons très attention. Ce n'est pas un hasard si ces 7 000 médecins - que j'ai moi aussi peine à considérer comme un réseau dans la mesure où il n'est pas organisé - que le monde entier nous envie, n'ont pas finalement sorti beaucoup de données. On pourrait nous croire les premiers du monde en termes de connaissance de l'état de santé des travailleurs et des expositions, puisque nous sommes les seuls à disposer de ce « réseau ». Or nous n'avons aucune donnée, beaucoup moins en tout cas que d'autres pays qui n'ont pas ce système. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas mis ce qu'il fallait derrière, la petite cerise en plus, l'équivalent du département santé/travail pour le réseau TMS où nous avons su modéliser, faire travailler ensemble le professeur de médecine du travail local, le MIRTMO et le réseau des médecins. En terme de coût, cela ne représente rien. Mais on ne l'avait jamais fait. Au-delà des « il n'y a qu'à », il faut un gros travail de réflexion. M. le Président : Ces propos sont à rapprocher de ce qu'ont dit M. Brücker et Mme Imbernon de l'expérience en Pays de la Loire. M. Gilles BRÜCKER : En effet, et cela conforte l'idée d'une approche régionalisée. La mesure de l'exposition des populations dans un cadre d'activités régional va de pair avec une logique de régionalisation de la santé publique et la mobilisation de corps professionnels régionaux, les fameux MIRTMO, en articulation avec le système de veille et de surveillance existant et qui se développe au niveau régional, notamment autour des cellules épidémiologiques régionales de l'IVS. L'enjeu régional pourrait répondre à toute une série d'objectifs opérationnels : ce n'est pas un hasard si nous avons lancé l'expérimentation TMS en Pays de la Loire, que nous allons essayer de décliner dans d'autres régions en mobilisant les MIRTMO. M. le Président : La question de l'indépendance des médecins du travail a été posée, en relation avec le délicat problème du dossier personnel. M. Jean-Denis COMBREXELLE : L'indépendance des médecins du travail a été renforcée avec le décret de juillet 2004 qui leur a donné le statut de salariés protégés. Concrètement, un éventuel licenciement est subordonné à une autorisation de l'administration. M. le Président : Cela ne me rassure pas totalement sur le rôle qu'il devrait pouvoir jouer ! M. Jean-Denis COMBREXELLE : Certes ! Mais toute une série de dispositions participe à la garantie de cette indépendance. Reste que l'indépendance dépend également de la personne elle-même. On aura beau publier tous les textes possibles, le métier de médecin du travail ne sera jamais facile. M. Marcel GOLDBERG : On ne peut nier l'existence d'une subordination contractuelle, et ce n'est pas uniquement un problème de personnes. Entre les textes qui protègent et la personnalité du médecin, il peut y avoir place pour organiser un système, ce qui n'a jamais été fait. M. Jean-Denis COMBREXELLE : Toute une série de dispositions ont été prises pour préserver l'indépendance des médecins du travail, mais il arrive un moment où c'est également affaire de responsabilité individuelle. C'est par ce mot que j'ai conclu ma présentation de la réforme au congrès de la médecine du travail à Bordeaux. Je savais très bien que je me ferais contester, mais il est un moment où il faut dire les choses clairement et reconnaître que l'indépendance du médecin du travail suppose une part de responsabilité individuelle, même s'il appartient au Gouvernement de tout mettre en œuvre pour la garantir. M. Yves COQUIN : Ne voyez surtout aucune polémique dans mes propos. Je suis employé de l'administration, je m'y sens parfaitement à l'aise en tant que médecin et, même si je me sens totalement dépendant du système, j'ai toujours joui d'une indépendance d'esprit et d'expression parfaite. Cela dit, je suis moins enthousiaste que la DRT sur certains aspects du décret de juillet 2004 et de la circulaire d'avril 2005. L'indépendance résulte de deux facteurs, dont le premier est l'éducation et en particulier la formation professionnelle. Or il y aurait beaucoup à dire sur la formation des médecins du travail que j'estime encore inadaptée à leur véritable fonction, au sens « santé publique » du terme. Mais l'indépendance résulte également de la situation et du lien de subordination avec ceux qui vous entourent. Le renforcement de certaines garanties de sécurité d'emploi reste à mes yeux un palliatif qui ne résout pas véritablement la question. Dans le régime agricole, les médecins du travail sont salariés d'une caisse et n'ont aucun lien de dépendance avec l'employeur. M. Marcel GOLDBERG : Très juste. M. Yves COQUIN : Cet exemple doit être médité. Si nous voulons que la médecine du travail puisse jouer le rôle qui est le sien, il faut, premièrement, former de véritables médecins du travail, deuxièmement, les dégager de tout lien de subordination avec l'employeur. Cela dit, je conçois que la tâche soit particulièrement difficile. M. Gilles BRÜCKER : Je rejoins les propos de Mme Imbernon et de M. Coquin sur la subordination. À noter, monsieur Combrexelle, que le problème de la protection du médecin et celui de la protection du salarié ne vont pas forcément ensemble. Poursuivant, pour ma part, une modeste activité clinique, je constate que l'accès du médecin du travail au dossier médical pose des questions extrêmement difficiles. Les porteurs du VIH, par exemple, n'ont pas envie que cette information soit communiquée au risque de circuler dans l'établissement. Gérer l'ensemble du dossier du salarié au regard de ses intérêts médicaux propres, mais également de ses intérêts liés à ses activités professionnelles, c'est poser une équation difficile à résoudre. Jusqu'à présent, le patient choisissait lui-même le médecin traitant auquel il confiait l'ensemble des informations, et le médecin du travail n'était pas celui avec lequel il voulait avoir cet échange. M. le Président : Et le problème de la « traçabilité » ? L'expérience de l'amiante a montré la difficulté à reconstituer les parcours professionnels. Mme Michèle FROMENT-VÉDRINE : C'est impossible. M. Jean-Luc MARIÉ : Le développement de la connaissance et de la prévention fait appel à de nombreux acteurs, et pas seulement les médecins. Si le réseau des médecins du travail, souvent les plus près des entreprises, fait un travail fondamental, il ne faudrait pas pour autant mésestimer celui des ingénieurs, des psychologues ou des techniciens qui effectuent les mesures sur les lieux de travail. C'est tout le problème de la pluridisciplinarité posé dans le « Plan santé au travail » ; il n'est pas facile de faire travailler tout le monde ensemble : ingénieur ou médecin, chacun veut être le chef. Se pose également le problème du décloisonnement entre les divers acteurs qui interviennent dans l'entreprise. Parfois l'entreprise elle-même ne comprend pas ce qui se passe avec tous ces intervenants : l'inspecteur du travail, le contrôleur de la CRAM, le médecin du travail, l'équipe pluridisciplinaire, la boîte privée venue l'aider à établir le document unique... Cela pose un problème d'information et d'affichage commun. Ce n'est pas le moindre mérite du « Plan santé au travail » que d'avoir fixé des objectifs communs à l'ensemble des intervenants. Encore faut-il communiquer dessus si nous voulons que cela serve aux entreprises et qu'elles comprennent ce que nous faisons. M. le Président : M. Coquin a relevé la persistance d'un problème culturel, et celui-ci doit être résolu du côté des partenaires sociaux - tous compris... M. Yves COQUIN : Tous compris, effectivement. M. le Président : ... entreprises et syndicats, à l'occasion de la négociation qui doit s'engager sur la santé au travail. Mais le problème existe aussi du côté des pouvoirs publics qui auront à jouer un rôle clé en la matière. Que prévoyez-vous dans le « Plan santé au travail » en direction des entreprises, d'une part, et des partenaires sociaux, d'autre part ? M. Jean-Denis COMBREXELLE : Tout au long de son élaboration, le « Plan santé au travail » a été plusieurs fois présenté en Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Comme il arrive souvent en France, tout le monde se tourne vers l'État, mais les difficultés commencent sitôt qu'il s'agit de répartir les rôles entre les partenaires sociaux et l'État. La position des partenaires sociaux est assez ambiguë : les organisations professionnelles, comme les organisations syndicales, considèrent que la santé au travail est leur affaire, que l'État n'est en quelque sorte que le notaire de l'accord qu'elles ont signé en décembre 2000 et qu'il doit se borner à le transposer dans la loi et les décrets. Ainsi, dans le cadre de l'établissement du tableau des maladies professionnelles, nous avions imaginé de confier la première phase de l'expertise à l'IVS ; Gilles Brücker et moi-même avons essuyé au Conseil supérieur un véritable tir croisé de la part des partenaires sociaux. L'articulation est d'autant moins évidente à trouver que, d'un côté, les partenaires sociaux considèrent que c'est eux, et que, de l'autre, l'État estime parfois qu'ils n'en font pas suffisamment... Au-delà de nos divergences, tout le monde ici s'accorde à reconnaître que la santé au travail, telle que nous l'avons connue a vécu et qu'il faut changer d'échelle. M. le Président : C'est clair. C'est l'aspect rassurant de cette réunion... M. Jean-Denis COMBREXELLE : Mais les partenaires sociaux ne semblent pas avoir pris conscience de cette nécessité de changer... M. Jean-Luc MARIÉ : De braquet. M. le Président : La multiplication des procédures en faute inexcusable devrait pourtant attirer leur attention ! M. Jean-Denis COMBREXELLE : On accuse souvent l'État de vouloir se servir du « Plan santé au travail » comme d'un moyen de repasser le « mistigri » à une instance indépendante. Ce à quoi nous répondons que c'est précisément parce que le politique a pris conscience des enjeux qu'il a besoin d'une meilleure évaluation. Mais les partenaires sociaux persistent à considérer que l'État est le responsable et qu'il a inventé le « Plan santé au travail » pour se décharger de ses responsabilités. Cela dit, si les partenaires sociaux n'ont pas encore compris la nécessité de changer de braquet, du côté des entreprises, une prise de conscience semble apparaître, par exemple au sein de l'UPA. M. le Président : À l'UPA, incontestablement. M. Jean-Denis COMBREXELLE : Cette évolution est particulièrement nette chez les entreprises qui travaillent à la fois sur notre sol et à l'étranger, lorsqu'elles voient notamment ce qui se passe aux États-Unis où les sociétés provisionnent des sommes de plus en plus considérables sur des questions de santé au travail. Le levier se trouve finalement peut-être plus du côté des entreprises que de celui des partenaires sociaux. M. le Président : Je sortirai de cette réunion avec une volonté plus optimiste... J'ai été très frappé par la profondeur de ces débats, dont, avec le rapporteur, je veux très sincèrement vous remercier. Nous mesurons l'extraordinaire complexité du problème et la difficulté à changer de braquet. Le réducteur de complexité n'est pas encore volonté, notamment lorsqu'il s'agit de travailler en réseau ou en interministériel, sans parler de la difficulté du rôle de l'État par rapport aux partenaires sociaux. Il me souvient des problèmes que j'ai moi-même rencontrés, lorsque je me suis mis en tête de rendre compatibles les fichiers de l'UNEDIC et de l'ANPE... M. Jean-Denis COMBREXELLE : Et ce n'est pas fini ! M. le Président : Cela remonte pourtant à des années ! Comme me l'a déclaré un syndicaliste de très haut rang : « Une fois de plus, l'État se mêle de ce qui ne le regarde pas ! » Vingt ans après, la complexité n'est donc toujours pas résolue... Nous sommes en tout cas déterminés à jouer notre rôle de parlementaires en présentant des propositions. Nous vous recontacterons au besoin. Pendant ces trois heures que vous avez bien voulu nous consacrer, d'un temps que nous savons précieux, nous avons fait un excellent travail. Soyez-en tous remerciés. Audition de M. Jean LEMIÈRE, président du groupe d'étude de l'Assemblée nationale sur l'amiante Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Mes chers collègues, notre mission aborde aujourd'hui la troisième partie du programme de travail qu'elle a adopté à l'unanimité. Il s'agit de l'examen de l'ensemble du dispositif de réparation en direction des victimes. Nous allons commencer par entendre notre collègue Jean Lemière, président du groupe d'étude de l'Assemblée nationale sur l'amiante, qui a particulièrement travaillé sur ce thème. M. Jean LEMIÈRE : Avant d'entamer cette nouvelle phase de nos travaux qui concerne plus particulièrement la prise en charge des victimes de l'amiante, il m'a semblé en effet utile de faire connaître à l'ensemble des membres de la mission le travail effectué par le groupe d'étude dont je suis le président et dont les premiers travaux ont, précisément, principalement concerné cet aspect du dossier. J'ai découvert le problème de l'amiante en 1971, à la fin de mes études, à l'occasion d'un conflit social. Les syndicats avaient mis en lumière les atteintes à la santé des travailleurs de l'usine Ferodo de Condé-sur-Noireau, et manifestaient pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Cela montre que la connaissance des effets nocifs de l'amiante ne date pas d'hier. Ma deuxième rencontre avec l'amiante date des contacts directs avec les associations de victimes de l'amiante. La création d'un groupe d'étude à l'Assemblée nationale sur l'amiante résulte d'une initiative que j'avais souhaité prendre, en 2003, avec notre collègue Jean-Yves Cousin pour répondre aux difficultés constatées dans nos circonscriptions respectives où nous sommes en relations suivies avec les associations locales de victimes. Tout particulièrement à Cherbourg, pour ma part, et à Condé-sur-Noireau pour ce qui concerne Jean-Yves Cousin. Le premier noyau dur de ce groupe était notamment constitué de Patricia Adam, Catherine Génisson, Jean-Yves Cousin, Jean-Pierre Decool, Michel Delebarre, Patrick Delnatte, Jean-Marc Nesme, Daniel Paul, Patrick Roy, Christophe Priou et moi-même. Presque une soixantaine de députés auraient voulu y participer mais n'ont pu se libérer le jour où le groupe fut créé. Les témoignages du terrain laissant apparaître que les dispositifs en place ne sont pas entièrement satisfaisants, il fallait en faire le bilan pour essayer de trouver des pistes d'améliorations. En proposant la création de ce groupe, notre objectif était ainsi d'informer la représentation nationale et de maintenir les pouvoirs publics en alerte sur une des plus grandes catastrophes sanitaires de notre pays. C'était aussi, bien sûr, d'en tirer toutes les conséquences pour éviter qu'une telle catastrophe se renouvelle. La première réunion du groupe s'est tenue le 25 juin 2003. A cette date, le groupe n'avait pas encore été formellement constitué mais dès le début, l'initiative a suscité un vif intérêt de sorte que nous avons pu tenir plusieurs réunions avant même que le groupe ne soit officiellement constitué. Il l'a été le 23 mars 2005, après avis favorable de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales et acceptation du Bureau de l'Assemblée. Le groupe comporte maintenant plus de 120 membres, et je suis heureux que ses premiers travaux aient contribué à la création de notre mission d'information où je retrouve, d'ailleurs bon nombre de mes collègues du groupe d'études. Les premières réunions informelles ont permis d'entendre l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante (ANDEVA). Puis, à l'occasion d'une demi-journée de travail, le 2 décembre 2004, un grand nombre de représentants d'associations nationale et locales de victimes. Ces premières réunions ont permis de recueillir des informations sur un certain nombre de problèmes touchant tout particulièrement à la prise en charge des victimes et que notre mission va pouvoir prendre en compte au cours des auditions que nous allons organiser sur ce thème à partir d'aujourd'hui et jusqu'aux alentours du 20 novembre. Ces problèmes peuvent se regrouper autour de deux grands axes : d'une part, les problèmes liés à l'identification et au suivi des victimes de l'amiante et, d'autre part, les problèmes liés au fonctionnement des systèmes de prise en charge, c'est-à-dire le FCAATA, le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, et le FIVA, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. S'agissant de l'identification des victimes de l'amiante et de leur suivi, les travaux du groupe de travail ont fait ressortir des difficultés sur un certain nombre de points que je vais rappeler maintenant : La procédure de classement des sites amiantés est, semble-t-il, trop longue et difficile, notamment pour les PME qui sont souvent des entreprises sous-traitantes. La question a également été abordée des établissements dans lesquels l'amiante était utilisé dans le processus de fabrication et qui ne sont pas inscrits, au motif que la réglementation se réfère à l'amiante présente dans les produits finis. Le problème du secteur automobile et du secteur ferroviaire a aussi été signalé : ces secteurs d'activité ne sont pas encore retenus dans la liste des activités à risque. J'ajoute que les entreprises de nettoyage ne sont pas non plus concernées, alors que leurs personnels ont pu avoir à faire le ménage dans des bureaux situés directement dans les ateliers de construction navale. La question de la liste des entreprises concernées par le dispositif FCAATA est donc un vrai problème. D'après les informations données par le ministre de la santé mercredi dernier, en réponse à une question de notre collègue Daniel Paul, ces entreprises seraient actuellement au nombre de 1 500 et une trentaine viendraient d'être ajoutées à la liste - il s'agit, pour l'essentiel, d'entreprises de construction navale. Autre problème : les victimes connaissent souvent des difficultés pour reconstituer leur dossier de carrière, surtout quand elles ont eu un parcours professionnel discontinu et que les entreprises où elles ont travaillé ont disparu. Les centres hospitaliers ne sont pas toujours suffisamment équipés pour faire face à la recrudescence des demandes d'admission ni pour assurer le suivi des travailleurs de l'amiante pour lequel, une surveillance médicale particulière est prévue. On sait pourtant que les examens périodiques peuvent permettre un dépistage qui favorisera les démarches d'accès aux mesures de réparation, d'où l'inquiétude des associations. S'agissant du suivi médical, les associations ont également exprimé le souhait devant le groupe de travail que la réglementation intègre les recommandations de la conférence de consensus de 1999, au cours de laquelle les experts ont préconisé la réalisation régulière de scanners pulmonaires - et non pas seulement de radios - pour obtenir des diagnostics plus précoces. Notre mission devra examiner cette question, mais notre réflexion sur ce point devra tenir compte de ce que nous ont dit certains professeurs sur les effets pervers de ces examens. Selon eux, les incertitudes thérapeutiques liées à un diagnostic précoce - ou non - sont en effet encore trop grandes pour que la généralisation du dépistage soit justifiée. Ils estiment que ces examens engendrent plus de stress que d'espoir, même s'ils ouvrent droit à une indemnisation, le cas échéant. Le suivi médical est encore plus problématique pour les retraités car, dans ce cas, il faut identifier les victimes potentielles, ce qui suppose souvent de difficiles recherches, d'autant que les intéressés ne sont pas nécessairement conscients d'avoir été exposés. Nous recevrons demain matin trois médecins qui viennent de participer à un programme pilote de suivi post-professionnel dans quatre régions, sous l'égide de l'Institut de veille sanitaire (IVS). Ils viendront nous présenter le bilan de leur mission, qui a été remis au Gouvernement la semaine dernière, et nous verrons si cette expérience mérite d'être étendue à l'ensemble du territoire, comme le souhaitent les associations. Les associations ont également souligné devant le groupe d'études le problème de l'identification des artisans retraités qui ont pu être en contact avec l'amiante et qu'il est extrêmement difficile d'identifier. Cette question rejoint le constat que notre mission a pu faire dans le cadre de notre premier thème d'investigation consacré à l'amiante « résiduel » : nous le savons, le secteur de la maintenance n'est pas épargné par le risque de contamination. C'était déjà vrai avant l'interdiction de l'amiante et c'est encore vrai à présent : la maintenance est même le secteur le plus touché et le plus à risque pour l'avenir, parce qu'il touche des activités qui ne sont pas bien encadrées. Un programme de surveillance vient cependant d'être mis en œuvre, toujours sous l'égide de l'IVS : le programme ESPRI - Épidémiologie et surveillance des professions indépendantes - dans trois régions, l'Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes. Les premiers résultats de cette étude sont attendus pour le printemps 2006. S'agissant maintenant du fonctionnement des systèmes de réparation, de nombreuses difficultés ont été mises en relief par le groupe d'études. On notera toutefois qu'une d'entre elles a déjà trouvé réponse : les associations souhaitaient que les indemnités perçues dans le cadre de la réparation des dommages liés à l'amiante soient exonérées d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les successions, comme c'est déjà le cas pour les indemnisations liées au SIDA ou à l'ESB. On sait que cette demande a été satisfaite dans le cadre de la loi de finances pour 2005. S'agissant du dispositif de cessation anticipée du travail, les travaux du groupe d'étude ont montré tout d'abord que l'accès au dispositif est très inégalitaire dans la mesure où le périmètre des bénéficiaires exclut de son champ la plupart des agents publics des trois fonctions publiques : d'État, territoriale et hospitalière Au contraire, les salariés des grandes entreprises y sont surreprésentés. Par ailleurs, le système semble très complexe. Il souffre, notamment d'un défaut d'organisation entre les différents dispositifs de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante et les autres dispositifs spécifiques de certains régimes spéciaux. Il nous faudra étudier ce problème que les contacts de la mission avec le Médiateur de la République ont d'ailleurs confirmé. Le montant de l'allocation amiante versée dans le cadre du FCAATA fait aussi problème : beaucoup d'allocataires seraient en dessous du seuil minimum de rémunération parce que l'allocation ne peut pas dépasser 85 % du salaire de référence et que beaucoup de victimes travaillaient dans des activités très mal rémunérées. S'agissant du fonctionnement du FCAATA, certaines voix se sont exprimées, devant le groupe d'études, comme devant notre mission, pour dire que le dispositif a pu être utilisé comme instrument de gestion de l'emploi, c'est-à-dire comme un mécanisme de préretraite accompagnant des restructurations économiques. A côté de cette dérive, le récent rapport de la Cour des comptes sur l'indemnisation des victimes de l'amiante a mis en relief le coût extrêmement élevé - et sans doute de plus en plus élevé - du mécanisme, alors qu'il concerne beaucoup de travailleurs qui, on peut l'espérer, ne développeront jamais de maladie liée à l'amiante. La Cour des comptes propose donc un recentrage des financements sur l'indemnisation des victimes avérées dans le cadre du FIVA et envisage une intégration de l'allocation de cessation anticipée dans les négociations sur la prise en compte de la pénibilité du travail dans les conditions de départ à la retraite. Il nous faudra voir cette question, notamment avec les gestionnaires du FCAATA que nous devons recevoir le 8 novembre prochain. Peut-être devrons-nous réfléchir à une procédure d'individualisation des cas, afin de permettre à des personnes exclues du dispositif d'en bénéficier. S'agissant du FIVA, les travaux du groupe d'étude ont mis en relief le manque de moyens du fonds, qui conduit à un engorgement important des procédures. Par exemple, l'an dernier, le FIVA n'avait qu'un agent comptable, son service juridique, ne comprenait que cinq personnes, qui devaient traiter 700 dossiers par mois - et ce sera sans doute beaucoup plus dans les années à venir. Ce service est censé, en même temps, exercer l'action subrogatoire. Les moyens auraient été récemment augmentés mais semblent être encore insuffisants : nous interrogerons les gestionnaires du FIVA sur ce point lorsque nous les entendrons le 8 novembre prochain. Ce manque de moyens explique certainement pour partie que le FIVA ait les plus grandes difficultés à exercer l'action récursoire auprès des entreprises responsables des dommages. Il s'agit pourtant d'une disposition légale à caractère obligatoire et financièrement indispensable, comme l'ont souligné les associations devant le groupe d'étude. Le niveau des indemnisations allouées dans le cadre du FIVA est également problématique dans la mesure où il est, dans certains cas, très inférieur à ce que les tribunaux accordent dans le cadre des recours exercés sur la base de la faute inexcusable de l'employeur. Alors que la création du FIVA devait tarir le recours aux tribunaux, puisque l'indemnisation devait couvrir l'intégralité des dommages, 14 % des victimes préfèrent encore suivre la voie contentieuse. M. Daniel PAUL : C'est ce que je conseille à celles que je rencontre. M. Jean LEMIÈRE : Enfin, les associations ont souligné que le mode de financement des mécanismes de prise en charge des victimes - État et assurance maladie - n'impliquait pas suffisamment les entreprises responsables et que, par une forme de déresponsabilisation, il ne les incitait pas à investir davantage dans la prévention. Sur ce point, on rappellera que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 a prévu une contribution de ces entreprises au financement du FCAATA. Mais les moyens seront-ils suffisants ? Tels sont les principaux problèmes mis en relief par le groupe d'études en matière de prise en charge des victimes. Les auditions que notre mission va tenir sur cet aspect du dossier devraient permettre d'approfondir ces constats. Outre les associations et les gestionnaires du FCAATA et du FIVA, nous avons en effet prévu de recevoir : la Cour des comptes sur son rapport concernant l'indemnisation des victimes de l'amiante ; la commission accidents du travail - maladies professionnelles (AT-MP) de la CNAMTS, chargée des orientations de la politique de prévention des risques professionnels ; le Conseil d'État sur son rapport consacré à la responsabilité et à la socialisation du risque ; les deux cabinets d'avocats qui se sont spécialisés dans la défense des victimes de l'amiante aux côtés des associations. Nous entendrons également l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS), qui a été chargée d'une étude sur l'avenir du FCAATA et dont le rapport a été annoncé par le ministre de la Santé pour la fin du mois de novembre. Nous essayerons aussi de rencontrer d'autres juristes pour examiner avec eux, au-delà du problème de l'amiante, la question de la jurisprudence relative à la faute inexcusable de l'employeur. Nous entendrons aussi M. Michel Laroque, inspecteur des affaires sociales, au sujet de son rapport de 2004 sur « la rénovation de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ». Enfin, nous ferons le tour des partenaires sociaux, que nous reverrons les uns après les autres à la fois sur la question de la prise en charge des malades et sur la prévention. Cette série d'auditions nous permettra de clore ce chapitre avec une nouvelle table ronde contradictoire comme nous l'avons fait pour les étapes précédentes. Le groupe d'études, comme je l'ai indiqué, s'est principalement penché, pour l'instant, sur les problèmes relatifs à la prise en charge des victimes à travers les mécanismes de réparation. Mais le problème de la responsabilité pénale a, bien entendu, également été évoqué, même si l'unanimité s'est faite pour refuser toute « chasse aux sorcières ». Les associations ont notamment souligné que si la Cour de Cassation a reconnu la faute inexcusable de l'employeur pour la réparation des dommages au plan civil - en décembre 2004, 209 procédures avaient abouti à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur - aucune responsabilité pénale n'avait encore pu être établie. On sait, à cet égard que la Cour de cassation a été saisie d'une décision de non-lieu de la cour d'appel de Douai dans une affaire concernant l'amiante et que sa décision, annoncée pour le 15 novembre, aura un impact important sur le traitement des affaires traitées par les pôles judiciaires de santé publique. La première audience s'est déroulée le 18 octobre dernier et on sait que l'avocat général a demandé la cassation de l'arrêt de la cour de Douai en raison des erreurs et des contradictions de sa motivation : la chambre d'instruction a en effet reconnu l'existence d'une faute éventuelle de l'employeur du fait de la connaissance du caractère nocif des poussières d'amiante. Mais, alors que ce constat aurait du conduire à la caractérisation de la faute, la chambre d'instruction conclut au non-lieu au motif que la prise de conscience généralisée de ce danger n'a été faite que tardivement. L'annonce de la demande de cassation de cette décision a évidemment été très favorablement accueillie par les associations et nous pourrons, tout à l'heure, les interroger sur ce point, sans attendre l'examen du volet pénal par notre mission qui doit intervenir un peu plus tard. Deux autres aspects ont également été évoqués par le groupe de travail : le problème de l'application de la réglementation sur les chantiers de désamiantage, ce que la mission a pu vérifier au cours de la première étape de ses travaux ; la question de l'attitude des entreprises françaises installées à l'étranger et qui ne respecteraient pas les normes de protection applicables en France. Nous examinerons cette question lorsque nous aborderons la gestion internationale du dossier de l'amiante. Avant de terminer cette présentation des travaux du groupe d'études, je voudrais rappeler que c'est grâce à son existence que les missions du Sénat et de l'Assemblée nationale ont été créées. Celle du Sénat est sur le point de remettre son rapport, comme l'a indiqué le ministre de la santé lors des questions au Gouvernement de mercredi dernier. Je sais qu'il a été adopté ce même mercredi et qu'il sera rendu public lors d'une conférence de presse demain 26 octobre. Lorsque notre mission aura achevé son propre travail, en février prochain, le groupe d'études - dont le travail s'inscrit dans la durée - disposera sans doute d'une somme d'informations très importante et de tout un ensemble de propositions dont il lui appartiendra de suivre l'application. En tant que président de ce groupe, croyez bien que je m'y attacherai. M. le Président : Les travaux du groupe d'étude nous seront très utiles. S'agissant de l'allocation de cessation anticipée, vous avez évoqué une possible individualisation. D'un autre côté, la Cour des comptes souligne le coût très important du dispositif. Plusieurs problèmes se posent. Le premier est que les maladies dues à l'exposition à l'amiante se manifestent avec retard. Personne ne peut savoir ce qui se passera dans dix ans ou vingt ans. Deuxièmement, l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, définit les conditions d'octroi de cette allocation de manière relativement large, mais qui peut être interprétée de façon restrictive. Troisièmement, on ne corrige pas une situation, on ne peut que permettre une halte dans une vie difficile. Quatrièmement, si l'on veut prendre en compte des cas individuels, on est bien obligé de concevoir le dispositif de manière très large, en intégrant non seulement les cas de personnes effectivement atteintes, mais aussi les cas où, seule, une probabilité existe. Mais d'après quels critères faut-il élargir le champ d'application de l'article 41 ? Le groupe d'étude a très bien posé ce problème. Élargir ce champ peut avoir pour effet d'appliquer le dispositif à des personnes qui ne seront pas affectées. M. Daniel PAUL : Le doute doit profiter à la victime éventuelle. M. le Président : C'est ce que j'appelle la probabilité significative de risque, qui ne peut être qu'une probabilité, s'agissant d'une maladie qui se manifeste avec retard. Cela dit, s'il se trouve que des personnes bénéficiaires ne seront finalement pas victimes d'asbestose ou de mésothéliome, tant mieux pour elles. M. Jean LEMIÈRE : Je souligne qu'il existe de nombreux cas où le dispositif de cessation anticipée d'activité a été utilisé pour diminuer les effectifs d'une entreprise. Mais, inversement, il y a des secteurs où les victimes ne sont pas prises en charge. Par exemple, je le répète, il serait bon que le FCAATA puisse être étendu aux entreprises d'entretien quand leurs personnels ont été exposés. Un autre problème est posé par la disposition de l'article 41 aux termes de laquelle peuvent bénéficier de l'allocation les ouvriers dockers professionnels et les personnels portuaires ayant travaillé « au cours d'une période déterminée, dans un port au cours d'une période pendant laquelle était manipulé de l'amiante ». Il peut ainsi arriver que des personnes soient considérées comme ayant été exposées à l'amiante jusqu'en 1975, puis pendant telles années, mais pas telles autres. Cela conduit à des aberrations. M. le Président : Cher collègue, nous vous remercions de l'éclairage que vous nous avez apporté. Audition de représentants de la FNATH, association des accidentés de la vie : MM. Marcel ROYEZ, secrétaire général de la FNATH, Philippe Karim FÉLISSI, administrateur du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) pour la FNATH, et Alain PRUNIER, secrétaire général du groupement de la FNATH pour la Sarthe Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Mes chers collègues, nous recevons aujourd'hui MM. Marcel Royez, secrétaire général de la FNATH, association des accidentés de la vie, Philippe Karim Félissi, administrateur du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante pour la FNATH, et Alain Prunier, secrétaire général du groupement de la FNATH pour la Sarthe. Je vous remercie, messieurs, de vous être rendus disponibles pour cette audition dont l'objet est de nous informer sur le rôle de la FNATH dans le dossier de l'amiante et sur la position de votre association concernant la prise en charge des victimes de l'amiante. Je rappelle que la FNATH est aujourd'hui la première association de personnes accidentées ou handicapées. Depuis 1921, elle défend les droits des accidentés de la vie et agit pour leur intégration sociale. Elle exerce maintenant ses activités à travers un réseau de 83 groupements départementaux, 1 500 sections locales et 20 000 bénévoles. Dans les années passées, l'action de la FNATH a permis d'alerter l'opinion sur les risques liés à l'amiante, ce qui a conduit les pouvoirs publics à prendre des mesures que l'on connaît. Elle a par ailleurs contribué à la création de l'ANDEVA, l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante, que nous allons d'ailleurs recevoir tout à l'heure. M. Marcel ROYEZ : M. le Président, mesdames, messieurs les députés, le sujet de l'amiante nous tient particulièrement à cœur, dans la mesure où il relève à la fois de la santé publique et de la santé au travail. Comme l'a rappelé M. le Président, la FNATH existe depuis 1921. C'est dire qu'elle a acquis une expérience et une expertise dans les domaines touchant à la prévention et à la réparation des risques professionnels. S'agissant de l'amiante, nous avons lancé une alerte en direction de l'opinion publique comme des pouvoirs publics en 1996. C'est à cette époque qu'ont été prises les dispositions que vous connaissez touchant la santé publique et la protection des citoyens et des travailleurs. Je crois pouvoir dire que l'interdiction de l'amiante qui a finalement été décidée est au moins en partie le fruit des démarches pressantes que nous avons engagées auprès des ministres de la santé et du travail de l'époque. Nous nous sommes beaucoup mobilisés pour attirer l'attention des ministres sur le problème de la prise en charge des victimes, ce qui a conduit à la création du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA), qui sont les deux piliers du dispositif de réparation. La FNATH n'était pas partisane d'un fonds d'indemnisation spécifique. Étant donné que la très grande majorité des victimes de l'amiante sont des victimes d'exposition professionnelles, il nous paraissait souhaitable de rester dans le cadre de la branche accidents du travail - maladies professionnelles (AT-MP), en veillant à ce qu'elle ait les moyens de mieux prendre en compte le cas des victimes de l'amiante, mais aussi des autres maladies professionnelles et accidents du travail. Nous déplorons une profonde inégalité dans le traitement des victimes, puisque les personnes atteintes d'accidents du travail ou d'autres maladies professionnelles que l'amiante ne sont toujours pas indemnisées sur le principe de la réparation intégrale. Si nous nous sommes beaucoup battus pour une réparation intégrale des dommages subis par les victimes de l'amiante, c'était dans la perspective de voir ce principe retenu pour toutes les victimes de maladies professionnelles et d'accidents du travail. L'indemnisation des victimes de l'amiante pèse très lourdement sur la branche AT-MP, ce qui obère ses perspectives d'évolution. Cette branche souffre d'une absence de réforme et d'une absence de financement. Le fait d'avoir renoncé pendant plusieurs années à augmenter les cotisations a abouti à une situation de déficit. On annonce près de 100 000 morts dues à l'amiante d'ici 2025. Nous sommes très inquiets quant aux conséquences humaines, sanitaires et économiques de cette catastrophe, dont les ressorts sont connus : la défaillance notre système de veille sanitaire et de notre système de prévention des risques professionnels. Celui-ci n'ayant pas été fondamentalement réformé, il est possible que nous ayons à faire face dans les années à venir à d'autres catastrophes de grande ampleur, faute de pouvoir disposer d'un système de prévention indépendant, notamment à l'égard des industriels. M. le Rapporteur : Pourriez-vous préciser les contours de la réforme de la branche AT-MP que vous avez appelée de vos vœux ? M. Marcel ROYEZ : En matière de risques professionnels, le système de veille sanitaire n'est pas suffisamment indépendant et efficace. Cela tient au fait que la santé au travail a été trop longtemps traitée à la marge de la santé publique, alors que les spécialistes de santé publique soulignent que le travail est l'un des déterminants essentiels de la santé publique, comme le confirme d'ailleurs les écarts d'espérance de vie selon l'appartenance socioprofessionnelle de nos concitoyens. Depuis l'origine, la santé au travail est laissée entre les mains des partenaires sociaux, représentants des employeurs et des salariés. J'ai coutume de dire que l'État s'est souvent comporté comme le notaire des accords, ou absence d'accord, entre partenaires sociaux. Si le compromis social a sa place dans les relations du travail, il n'a pas sa place dans le domaine de la santé au travail, qui met en jeu l'intégrité physique, voire la vie et la mort des personnes. On ne peut pas laisser les employeurs et les syndicats décider entre eux de ce qui est bon pour la santé de nos concitoyens. Comme le drame de l'amiante l'a d'ailleurs mis en lumière, les employeurs ont un intérêt à produire et les salariés ont un intérêt à continuer à travailler. S'agissant de l'amiante, on n'a pas vu parce qu'on n'a pas voulu voir, ce qui a été à l'origine d'un terrible drame. La responsabilité de l'État est d'avoir laissé faire et de ne pas être intervenu. Il nous faut donc aller vers une séparation très stricte entre, d'une part, l'évaluation des risques, qui doit être indépendante et scientifique, et ne souffrir l'intervention d'aucun lobby, et, d'autre part, la gestion des risques, qui, elle, peut être confiée en partie aux partenaires sociaux, dès lors que les règles ont été posées par le législateur et les pouvoirs publics. La branche AT-MP n'appréhende pas la totalité des risques, à tel point qu'un prélèvement annuel de la branche assurance maladie sur la branche AT-MP a été instauré pour compenser les charges indues supportées par l'assurance maladie au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui ne sont pas reconnus ou insuffisamment pris en charge. À notre demande, la loi relative à la santé publique a prévu la définition d'un indicateur de risques professionnels plus pertinent que les seules statistiques de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Celles-ci n'intègrent en effet que les maladies professionnelles déclarées et reconnues, alors qu'il faut appréhender la totalité des risques professionnels pour pouvoir en mesurer les conséquences sur le plan économique et les répercuter sur les cotisations versées par les entreprises. Le système de tarification doit être plus individualisé. Il mutualise beaucoup trop les risques entre les entreprises. Cela a été mis en lumière dans un rapport de l'IGAS, mais aussi dans l'excellent ouvrage d'un chercheur au Centre national de recherche scientifique (CNRS), Philippe Askenazy, Les désordres du travail, qui montre que le système français de tarification est beaucoup moins efficace que le système américain, lequel repose sur les compagnies d'assurance. Celles-ci ont le souci de tarifer leurs entreprises en fonction du risque réel. Le système est beaucoup plus pertinent en ceci qu'il impute à l'entreprise la réalité des coûts qu'elle représente pour la compagnie d'assurance. La branche AT-MP, elle, a recours a un « pot commun », une mutualisation qui a le double inconvénient de ne pas suffisamment pénaliser les entreprises qui négligent la prévention et de ne pas récompenser celles qui font des efforts en la matière. Enfin, depuis 1898, la réparation est forfaitaire, ce qui veut dire que nous faisons supporter par la victime une part de son préjudice. Si le principe de la réparation intégrale s'imposait, les entreprises seraient beaucoup plus fortement incitées à s'engager résolument dans la voie de la prévention. M. le Président : Vous avez dit que l'État s'est trop souvent comporté comme « le notaire des compromis sociaux ». Cette formule très forte correspond, me semble-t-il, à une réalité. J'imagine que vous avez dû la prononcer devant les partenaires sociaux. Comment ont-ils réagi ? Par ailleurs, faites-vous une différence entre les accidents du travail et les maladies professionnelles ? Troisièmement, quel jugement portez-vous sur le « Plan santé au travail » ? Certains s'inquiètent de l'insuffisance des moyens qui pourront être dégagés pour sa mise en œuvre. Enfin, vous avez ébauché une comparaison entre un système français socialisé et un système privatisé à travers les compagnies d'assurance, dans lequel la réalité des coûts pèse sur les entreprises. Cela signifie-t-il, en creux, que dans notre système les entreprises ne font pas suffisamment d'efforts pour assumer le financement des risques dont elles sont, volontairement ou non, la cause ? M. Daniel PAUL : Pour compléter la dernière question du Président, iriez-vous jusqu'à dire que dans le système de solidarité qui est le nôtre, nous devrions introduire une modulation de la péréquation de l'effort entre les entreprises, pour charger la barque de celles qui ne font pas l'effort de prévention nécessaire et favoriser celles qui le font ? M. Marcel ROYEZ : Pour répondre à votre dernière question, M. le Président, nous ne sommes pas partisans d'un système privatisé. Nous ne souhaitons pas revenir à la situation que nos aînés en connue dans l'entre-deux-guerres, sous l'égide des assurances privées. Les principes qui gouvernaient ce système étaient très différents, puisque les compagnies d'assurance n'étaient pas chargées de la prévention, alors que la sécurité sociale a eu l'immense mérite d'intégrer cette dimension. Elle a même considéré que prévention et réparation étaient les deux faces d'une même question. Nous ne remettons nullement en cause ce système. Nous constatons seulement qu'il ne fonctionne pas bien. Il ne faut pas le privatiser mais revenir aux fondamentaux pour que la tarification couvre la réalité des risques professionnels, afin d'inciter les entreprises à développer leurs actions de prévention. Je rappelle qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, les partenaires sociaux étaient invités, « dans un délai d'un an après la publication de la présente loi, à soumettre au Gouvernement et au Parlement des propositions de réforme de la gouvernance de la branche accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que, le cas échéant, d'évolution des conditions de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ». Alors que ce délai est aujourd'hui largement dépassé, ils n'ont toujours pas ouvert les négociations en vue de formuler ces propositions. C'est dire qu'ils ont du mal à appréhender ce sujet. Cela me conduit, M. le Président, à répondre à votre première question. Nos contacts avec les partenaires sociaux ont fait apparaître des différences, voire, quelquefois, des divergences fondamentales. Manifestement, les partenaires sociaux n'apprécient guère d'entendre que l'État s'est comporté comme le notaire de leurs accords ou de leurs désaccords. Cela les renvoie au comportement qui a été le leur pendant des décennies. L'emploi étant, comme il est naturel, la première préoccupation des organisations syndicales, elles ont eu tendance à oublier la dimension de la prévention et de la santé au travail. Je dois à la vérité de dire que les choses ont beaucoup changé depuis. La question de la santé au travail est désormais intégrée dans la réflexion des organisations syndicales, mais aussi dans celle des organisations patronales comme des pouvoirs publics. En témoignent, d'ailleurs, les dispositions que vous avez adoptées dans la loi relative à la politique de santé publique. C'est bien la première fois que l'on voit émerger dans un texte relatif à la santé publique des préoccupations relatives à la santé au travail. Cette évolution va dans le bon sens, et doit être poursuivie. Pour autant, je ne suis pas absolument convaincu que les partenaires sociaux soient prêts à accepter l'idée que l'État doit beaucoup plus intervenir dans ce domaine. Il me semble qu'ils continuent à considérer que ce dossier leur appartient, et que moins l'État s'en mêlera, mieux cela vaudra. Il y a là entre nous et eux une divergence de fond. Nous pensons que l'État a toute sa place dans la politique de prévention. C'est si vrai que tout le monde, à commencer par le Conseil d'État, a pointé du doigt la responsabilité de l'État dans le drame de l'amiante. On ne peut pas à la fois dire que l'État est responsable quand survient une crise majeure et ne pas lui reconnaître une responsabilité dans l'organisation et la gestion de la politique de prévention et de veille sanitaire. M. le Président : Il y a là, effectivement, un véritable conflit dans la façon de concevoir le rôle de l'État. M. Marcel ROYEZ : Au risque de paraître jacobins ou centralisateurs, nous prenons la responsabilité des positions qui sont les nôtres. Au demeurant, elles ne sont pas du tout antinomiques de la responsabilité des partenaires sociaux quand il s'agit de décliner, dans l'entreprise, les règles posées par l'État. Ils doivent pouvoir négocier sur les moyens à mettre en œuvre pour appliquer les règles de prévention définies par la puissance publique. Mais ils ne doivent pas avoir les mains libres pour définir eux-mêmes ces règles. S'agissant du « Plan santé au travail », je rappelle que nous avons été largement consultés par le ministère dans la période qui a précédé sa rédaction. Nous avons également salué les avancées qu'il comporte. Mais nous avons fait part de certaines craintes, dont il est malheureusement en train d'apparaître qu'elles étaient fondées. Comme pour tout projet ambitieux, la question des moyens se pose. La création d'une agence chargée de la santé au travail est en soi une bonne chose, et la FNATH l'a d'ailleurs longtemps appelée de ses vœux. Mais ce n'est pas avec les moyens prévus pour l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) qu'une expertise indépendante des risques professionnels pourra être menée. Par ailleurs, il n'était pas forcément très opportun de créer cette agence en s'appuyant sur l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE) existante, sur le fonctionnement de laquelle il est permis de nourrir quelques doutes. Mêler la question du travail à celle de l'environnement au sein d'un organisme dont on n'est pas sûr qu'il assume de manière satisfaisante les missions qui sont actuellement les siennes, ce n'est pas le meilleur moyen d'intégrer la santé au travail dans la politique de santé publique. M. le Président : On peut ajouter que cette agence aura trois ministres de tutelle. M. Marcel ROYEZ : Nous avons toujours dit que seul le ministre de santé devait être le patron de la veille sanitaire, qu'il s'agisse de la santé au travail ou des aspects environnementaux de la santé. Mais il y a plus grave. La composition du conseil d'administration de cette agence reprend celle du conseil d'administration actuel de l'AFSSE, en y ajoutant les partenaires sociaux et quelques personnalités qualifiées. Ainsi, on revient à la perversion que j'évoquais tout à l'heure, et qui consiste à laisser les partenaires sociaux intervenir dans un domaine dans lequel ils ne devraient pas intervenir. J'ajoute que les représentants de la FNATH ont quelque chance d'être désignés en tant que personnalités qualifiées. Or, nous estimons que nous n'avons pas non plus notre place dans cette agence. La concertation avec les partenaires sociaux et les différents acteurs du système, dont la FNATH fait partie, doit se faire au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. L'agence santé au travail devrait avant tout être une agence d'expertise scientifique au service des pouvoirs publics et à l'abri de toutes les pressions. Autre motif d'inquiétude : on va créer une nouvelle agence sans s'être posé la question de la cohérence globale de notre système. On ajoute ainsi à la confusion. Encore une fois, l'idée d'une agence consacrée à la santé au travail était bonne. Mais la façon dont elle est mise en place augure des résultats qui pourront être obtenus. J'ajoute qu'il n'y a pas non plus de remise en cause du statut de la médecine du travail, dont il nous semble qu'elle doit être au service de la santé au travail et non pas des entreprises, et qu'en voie de conséquence elle doit être indépendante de celle-ci. Pourquoi les médecins du travail n'ont-ils pas tiré plus tôt la sonnette d'alarme au sujet de l'amiante ? Tout simplement parce qu'ils dépendaient des entreprises, et qu'ils risquaient de perdre leur place. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Nous ne sommes pas certains que le « Plan santé au travail » réponde de manière adaptée à ce dysfonctionnement majeur de notre système. Je pourrais également parler des inspecteurs du travail, qui sont en nombre insuffisant, et qui ne sont pas suffisamment spécialisés. Il y a une grande différence entre vérifier que la réglementation sur l'amiante est bien respectée et contrôler que les dispositions relatives aux 35 heures le sont. Dans un certain nombre de cas, les inspecteurs du travail doivent, pour être efficaces, être quasiment des ingénieurs. Mme Martine DAVID : Vous avez surtout insisté sur ce que notre système de veille sanitaire ne devait pas être. Pourriez-vous décrire plus précisément ce qu'il devrait être, selon vous ? M. Marcel ROYEZ : Pour la FNATH, il importe, avant tout, de se prononcer sur les principes qui gouvernent un système. C'est ce que j'ai fait. À partir de là, comment ces principes peuvent-ils se décliner concrètement ? Si j'étais chargé d'organiser le système de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, je tenterais d'abord d'identifier les zones de chevauchement entre les nombreux organismes qui interviennent dans ce champ. Il s'agit de savoir qui, de la CNAMTS, de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT), de l'Institut de veille sanitaire (IVS), est le plus pertinent pour agir dans chacun des domaines. S'agissant de l'expertise et de l'alerte sanitaire, par exemple, il faut se poser la question de savoir si l'IVS, ou du moins son département « Santé au travail », et l'INRS assument comme il convient les missions qui leur sont confiées. Loin de moi l'idée de mettre en doute la compétence des chercheurs de l'INRS, mais il est de notoriété publique - un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) l'a d'ailleurs souligné - que l'INRS n'est pas un organisme indépendant. Il est géré paritairement, il a été présidé de manière assez constante par le patronat. On sait d'ailleurs que quelques chercheurs ayant manifesté quelques velléités de chercher là où il ne fallait pas ont été licenciés. Il est possible d'utiliser le potentiel de l'INRS dans un cadre différent, et selon des principes d'organisation différents. La création de l'AFSSET ne rendra pas le système plus cohérent. Elle risque même de le rendre plus compliqué dans la mesure où on n'a pas redéfini les missions et l'articulation des organismes préexistants. En ce qui concerne la tarification, elle est très complexe et ne constitue pas un véritable levier de la prévention. Il me semble que nous devons nous orienter vers un système de type assuranciel, avec bonus et malus. Philippe Askenasy développe cette question dans son ouvrage sur les désordres du travail. Pour ce qui est de la réparation, nous appelons de nos vœux l'instauration de la réparation intégrale au sein d'une branche AT-MP autonome et dotée d'un véritable organe de gouvernance où siègent les partenaires sociaux, mais aussi d'autres acteurs, dont la FNATH. Le système ne doit pas être géré dans une logique de strict paritarisme. C'est d'ailleurs l'objet de la négociation que les pouvoirs publics ont demandée aux partenaires sociaux d'ouvrir. Je connais déjà le résultat de cette négociation : syndicats et patronat s'entendront pour dire qu'il faut maintenir la gestion paritaire. Ce serait une erreur d'en rester là. On ne peut pas se priver de l'expertise et de l'expérience d'une partie de la société civile. M. Daniel PAUL : Vous avez souligné que la médecine du travail devait être au service de la santé au travail. Cela pose la question de savoir de qui elle dépend. Par ailleurs, lorsque nous avons entendu les représentants de l'inspection médicale du travail, plusieurs intervenants ont souligné que la médecine du travail devait être pluridisciplinaire et faire appel à plusieurs spécialités. Ils ont expliqué que les médecins du travail ne pourront jamais atteindre l'expertise nécessaire compte tenu de l'évolution technique et technologique à l'œuvre dans le monde du travail, d'autant plus que l'on n'est pas à l'abri de l'arrivée de substances chimiques extrêmement dangereuses sur lesquelles les inspecteurs n'ont pas l'expertise nécessaire. M. Marcel ROYEZ : S'agissant de la médecine du travail, il est possible de créer un service public de santé au travail, auquel les médecins du travail seraient rattachés. À tout le moins, il faut que les médecins cessent d'être subordonnés aux employeurs. Ceux-ci financent la médecine du travail et il n'y a aucune raison que cela change. Mais dans ce domaine, le principe « qui paie, commande » est un très mauvais principe. Car pour l'instant, les médecins, dans leur très grande majorité, sont essentiellement au service de l'employeur. J'ajoute que le tiers-temps que le médecin du travail doit passer au sein de l'entreprise est très peu utilisé. Certaines entreprises n'ont même jamais vu un médecin du travail. Les salariés se rendent à la visite annuelle, mais le médecin ne sait pas comment les choses se passent dans l'entreprise. En outre, l'ensemble des médecins du travail constitue un formidable réceptacle de données sur la santé au travail, qui est complètement inutilisé. Il est essentiel de connecter les médecins du travail à la veille sanitaire. Imaginez ce qui aurait pu se passer si des centaines de médecins du travail avaient pu alerter les autorités supérieures au sujet des pathologies qu'ils constataient chez les salariés exposés à l'amiante ! M. le Rapporteur : En ce qui concerne le FCAATA, certains préconisent sa suppression et le transfert vers le FIVA des quelque 700 millions d'euros qu'il gère. Or, on peut lire dans le rapport de la Cour des comptes la phrase suivante : « À l'exception notable de celle de la FNATH, aucune réponse ne traduit une défense vigoureuse du FCAATA. » Pourriez-vous préciser votre position ? M. Marcel ROYEZ : Pour ne rien vous cacher, j'ai un peu sursauté lorsque j'ai lu cette phrase. Le compte rendu de mon audition par la mission d'information du Sénat montre que j'ai exprimé une autre position. Le FCAATA est nécessaire pour que les personnes exposées à l'amiante obtiennent réparation, étant donné que leur espérance de vie est limitée. Cela dit, la façon dont le système a été conçu n'est pas satisfaisante et la façon dont il fonctionne ne l'est pas davantage. L'inscription des entreprises sur une liste est une procédure lourde, qui aboutit à ce que certains salariés qui ont travaillé dans des entreprises traitant de l'amiante mais qui n'ont pas eux-mêmes été exposés bénéficient de ce dispositif, alors que d'autres, qui ont travaillé dans des entreprises non inscrites sur la liste mais ont été exposés, n'en bénéficient pas. On sait aussi que le FCAATA a parfois été un outil de reconversion industrielle plus que de réparation. Il faut introduire davantage d'équité dans le système, de manière à prendre en charge toutes les personnes qui ont été exposées. Il est regrettable que les personnes concernées n'aient pas la possibilité de déposer la demande et de voir leur dossier traité à partir de leur situation individuelle. M. le Rapporteur : Que pensez-vous de la procédure suivie pour l'établissement de la liste des entreprises concernées ? M. Marcel ROYEZ : Je rappelle que des enquêtes sont d'abord réalisées par les directions régionales du travail. La liste des entreprises est ensuite transmise au ministère du travail. Les arrêtés d'inscription des entreprises sur la liste sont alors transmis, pour consultation, à la CATMP, la Commission accidents du travail et maladies professionnelles de la CNAMTS, dans laquelle siègent des représentants des partenaires sociaux. Leur avis n'est que consultatif. Mais encore une fois, il est regrettable que les personnes concernées n'aient pas la possibilité de déclencher eux-mêmes une procédure, sur une base individuelle. M. Daniel PAUL : Lorsqu'il était ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, j'avais eu l'occasion de rencontrer François Fillon au sujet d'une entreprise havraise qui avait été retirée de cette liste. En réponse à l'une de mes questions, il m'avait dit qu'il faisait davantage confiance au médecin, qui devait recevoir les malades et déterminer l'origine de leur affection. J'avais mis en doute une telle idée, compte tenu de la grande difficulté qu'il y a à déterminer l'origine précise d'un certain nombre de cancers pulmonaires. Si vous jugez nécessaire de changer le dispositif, pouvez-vous préciser quel autre système vous appelez de vos vœux ? Je vois bien tous les défauts de la procédure actuelle, mais changer complètement de procédure ne me paraît pas chose facile. M. Marcel ROYEZ : Je n'ai pas préconisé de changer de système. Il faut faire cohabiter le système actuel - en y introduisant davantage de souplesse pour l'instruction des dossiers et en mettant fin à un certain arbitraire - avec des instructions individuelles. J'ajoute qu'il y a une différence entre le cas des malades et celui des personnes qui ont été exposées à l'amiante, sans être actuellement atteintes d'une affection. Ces personnes doivent pouvoir déposer des demandes, et les exigences quant à l'administration de la preuve doivent être assouplies, notamment quand elles ont travaillé au sein d'entreprises qui ont disparu. Mme Martine DAVID : Il m'est arrivé de recevoir des personnes isolées, qui ont été exposées à l'amiante sans que cela soit reconnu. Elles manquent d'informations et sont un peu perdues. Des cas de ce genre sont-ils régulièrement portés à la connaissance de la FNATH ? M. Marcel ROYEZ : Nous sommes sensibles à ces cas, d'autant que nous ne nous considérons pas comme une association de victimes, mais comme une association d'acteurs sociaux. La question que vous posez met le doigt sur la grande inégalité qui existe entre les victimes individuelles, anonymes, que l'on ne connaît pas et que l'on n'informe pas, et les victimes collectives. Notre pays doit conduire une réflexion sur ce problème. Comment accompagner, informer et soutenir les victimes individuelles au même titre que les autres ? Ce problème se pose dans le cas de l'amiante. Quand il s'agit des grands bataillons de la construction navale, tout le monde a des repères bien précis. On sait que ces personnes ont été exposées, et l'on sait comment les indemniser. Pour les victimes isolées, ce n'est pas le cas. Les médias accentuent encore cette inégalité. J'en profite pour souligner que l'un des défauts du FCAATA est d'être limité aux entreprises qui ont traité ou manipulé de l'amiante et d'exclure toute une série de professions intermédiaires. Quantité d'électriciens ou de plombiers sont exposés à l'amiante, alors qu'ils ne sont pas censés l'être de par leur profession. M. Alain PRUNIER : La médiatisation s'est beaucoup faite à travers des procédures judiciaires engagées par des groupes de salariés contre les employeurs. Les victimes isolées dont vous parliez, madame la députée, ont souvent travaillé dans des petites structures, qui représentent pour elles quasiment une « famille ». Il est difficile d'engager une procédure contre une petite entreprise lorsque cela revient à attaquer sa propre « famille ». Lorsque nous parlons à ces salariés d'une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, ils entendent notre discours. Mais lorsque nous évoquons la possibilité d'engager une procédure en faute inexcusable contre l'employeur, nous sentons une forte réticence. M. Marcel ROYEZ : Avant que vous ne concluiez cette audition, monsieur le Président, je souhaiterais, très brièvement, formuler une observation concernant la politique pénale. Celle-ci ignore très largement les problèmes de la santé au travail. La plupart des procès-verbaux de l'inspection du travail sont classés sans suite. Intervenir dans les affaires touchant à la santé au travail n'est à l'évidence pas une priorité pour les parquets. Ceux-ci se mobilisent dans le domaine de la sécurité routière, et ils ont raison de le faire. Nous ne comprenons pas qu'ils ne mettent pas autant d'ardeur à intervenir lorsque la santé des travailleurs est en jeu. M. le Président : Messieurs, nous vous remercions de votre contribution aux travaux de notre mission. Étant donné la richesse et la précision de vos analyses, nous espérons votre participation à la prochaine table ronde que nous organiserons autour du thème de la réparation. Audition de représentants de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante (ANDEVA) : M. François DESRIAUX, président, MM. Michel PARIGOT, Alain BOBBIO et André LETOUZÉ Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Mes chers collègues, nous recevons aujourd'hui M. François Desriaux, président de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante, qui est accompagné de MM. Michel Parigot - que nous retrouvons pour la troisième fois -, Alain Bobbio et André Letouzé. Je vous remercie, messieurs, de vous être rendus disponibles pour cette audition dont l'objet est de nous informer sur le rôle de l'ANDEVA et, plus particulièrement sur la position de votre association concernant l'organisation de la prise en charge des victimes de l'amiante. Je rappelle que l'ANDEVA a été créée en 1996, à l'initiative de trois associations, l'ALERT, l'Association pour l'étude des risques au travail, la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), que nous venons d'entendre, et le Comité anti-amiante de Jussieu, que nous avons déjà entendu dans la première phase de nos travaux relatifs au traitement de l'amiante en place. Votre association compte environ 15 000 adhérents et exerce ses missions à travers un réseau constitué d'une trentaine d'associations locales. Elle travaille avec des conseillers techniques - médecins, chercheurs, spécialistes de la prévention - et aussi avec des juristes. M. François DESRIAUX : Toutes les leçons du drame de l'amiante n'ont pas été tirées. Le principe de la séparation entre l'évaluation des risques et la gestion des risques n'est pas respecté. Un récent rapport de la Cour des comptes dresse le même constat. Malgré le « Plan santé au travail » de février 2005, malgré la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'État et la sécurité sociale à la même date, malgré l'adoption par le Parlement de la loi relative à la politique de santé publique en juillet 2004, force est de constater qu'un certain nombre de choses n'ont guère évolué depuis trois ans. La Cour des comptes fait notamment observer que l'on n'a pas remis en cause le cloisonnement entre le ministère de la santé et celui chargé de la sécurité sociale. L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET), qui a reçu pour mission de mener une expertise indépendante, a très peu de moyens pour le faire. Ce ne sont pas les dix postes de scientifiques inscrits au budget qui lui permettront de remplir sa mission. L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), lui, a des moyens, dispose de beaucoup plus de chercheurs, mais on ne peut pas considérer qu'il mène une expertise indépendante. Lorsque, par exemple, l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE) actuelle passe un contrat avec l'INRS, les chercheurs interviennent sous le contrôle hiérarchique. Ils ne sont donc pas indépendants. Le Conseil supérieur des risques professionnels n'a toujours pas fait l'objet d'une réforme, alors que le rapport de la Cour des comptes de 2002 avait fait apparaître combien elle était nécessaire. De même, il n'y a toujours pas eu de réforme de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, afin de la rendre plus incitative. Nous attendons également une réforme de la médecine du travail du point de vue de son indépendance et de ses missions. Le contrôle de l'application de la réglementation en matière de risques professionnels continue de souffrir de carences importantes. Cela tient à l'insuffisance de moyens de l'inspection du travail, ainsi qu'à l'absence de réforme de celle-ci pour la rendre plus efficace et plus compétente sur un certain nombre de sujets, dont la prévention des risques professionnels. D'une manière générale, trois grandes questions doivent être posées. La première est celle des moyens. Il nous semble illusoire et dangereux de penser que la réforme de la médecine du travail peut se faire à coûts constants. Il est illusoire et dangereux de croire que l'AFSSET et l'Institut de veille sanitaire (IVS) vont pouvoir fonctionner efficacement avec les moyens budgétaires qui leur sont accordés. Il est illusoire et dangereux de penser que la création de trente postes d'inspecteurs du travail comblera le déficit actuel de l'inspection du travail : il nous manque 700 postes par rapport aux standards européens. La deuxième est celle du contrôle. C'est une tendance française que d'adopter des textes très précis en négligeant de veiller à leur application. C'est ce qui s'est produit dans le drame de l'amiante. Le décret de février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est un bon décret. Le seul problème est qu'il n'est pas appliqué, comme le montrent les résultats de l'enquête SUMER La troisième question est celle de la séparation entre l'évaluation des risques et la prévention des risques. Dans l'entreprise, elle n'est pas respectée, puisque l'employeur est, en vertu de la réglementation, responsable de l'évaluation des risques. Le décret paru en 2004 relatif aux risques chimiques en est un bon exemple : l'employeur évalue les risques, et choisit, en fonction de son évaluation, le niveau des contraintes qu'il va s'imposer en matière de prévention. M. Alain BOBBIO : S'agissant du suivi médical des personnes exposées à l'amiante, on peut dire que la situation n'est pas satisfaisante : pour le suivi post-professionnel des retraités exposés à l'amiante, seuls 1 700 examens ont été financés par le FNASS (le Fonds national d'action sanitaire et sociale) en 2002 pour l'ensemble du territoire national, ce qui représente une goutte d'eau par rapport à ce qu'il faudrait faire. Il est possible d'avancer, notamment en s'appuyant sur le bilan du suivi médical dans les quatre régions pilotes où le suivi par scanner a été expérimenté. La semaine dernière, le conseil scientifique de ce programme régional a présenté ses conclusions. La première d'entre elles est que le suivi médical est justifié pour des niveaux d'exposition qualifiés de « forts » ou d'« intermédiaires ». Il permet de repérer efficacement des fibroses dues à l'amiante. La deuxième est que les caisses primaires et les caisses régionales peuvent développer une politique active : lorsque l'on va au-devant des personnes concernées en les informant sur leurs droits, les réponses peuvent être nombreuses. La troisième est que le scanner doit être inclus dans le protocole de surveillance comme examen de référence, du fait de sensibilité, Là où le scanner permet de repérer cinq fibroses pleurales, la radiographie n'en repère qu'une seule. Le risque d'une irradiation excessive lors d'examens tomodensitométriques (examens TDM) est un réel problème. L'ANDEVA est opposée à la multiplication irresponsable de scanners trop rapprochés dans le temps et sans protocole. Mais avec une périodicité raisonnable, et un protocole strict, le scanner peut être utile, tout en évitant le risque d'une irradiation excessive. L'impact psychologique du suivi médical est un problème que nous ne nions pas, mais qui doit être traité, d'une part, par une information précoce et de qualité des personnes concernées et, d'autre part, par la mise à disposition d'un accompagnement psychologique en particulier lorsqu'une pathologie a été repérée. Le conseil scientifique de ce programme régional a également insisté sur la nécessité d'un continuum entre le suivi des actifs et celui des retraités. Un bilan complet des salariés exposés à des cancérogènes devrait être effectué à l'âge de 50 ans. C'est un âge clé, à la fois du point de vue de l'ouverture des droits et du point de vue médical. Les conclusions du conseil scientifique ont été développées en présence de représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), de la Direction des relations du travail (DRT), des partenaires sociaux et des associations. Elles ont semblé faire consensus. Maintenant, il s'agit de passer au stade de la décision politique et nous avons des propositions à faire. Il faut apporter plusieurs modifications à l'arrêté du 28 février 1995 (J.O n° 69 du 22 mars 1995 page 4474 relatif aux examens médicaux). La première est d'inclure le scanner dans le protocole de suivi amiante. La deuxième est d'ajouter les fibres céramiques à la liste des agents. La troisième concerne la délivrance des attestations d'exposition : il y a manifestement un blocage de la part des employeurs. Plusieurs solutions permettraient de le surmonter. La première serait de considérer que, s'agissant d'examens médicaux, l'avis du seul médecin du travail est suffisant. La deuxième serait de considérer que la délivrance d'une attestation d'exposition n'est qu'une voie d'accès au suivi médical parmi d'autres. Quel est le bénéfice du suivi médical ? La conférence de consensus de 1999 abordait cette question d'un double point de vue : bénéfice médical et bénéfice social. Le bénéfice social est absolument évident, en termes d'indemnisation comme de droit à la cessation anticipée d'activité. Le bénéfice médical, dans l'état actuel des connaissances médicales, se pose malheureusement davantage en termes de suivi et d'accompagnement qu'en termes de guérison. Pour ce qui est du suivi médical des actifs, il est important, compte tenu du temps de latence des maladies dues à l'amiante, qu'il intègre l'ensemble du parcours professionnel de la personne concernée, y compris lorsque, après avoir été exposée, elle travaille dans une entreprise où elle ne l'est plus. En outre, le bilan de référence à l'âge de cinquante ans devrait inclure un examen par scanner, des épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR) et un examen clinique. Par ailleurs, nous estimons que la mission du médecin du travail ne saurait en aucun cas se réduire à du dépistage et à une évaluation d'aptitude. Il y a une nécessaire imbrication entre le travail d'information, la prévention et le suivi médical. L'entretien avec le médecin du travail doit inclure l'information du salarié sur le risque et sur les moyens de protection. Il doit être présent sur le terrain. Le suivi médical n'est pas un acte ponctuel. Les personnes examinées doivent être périodiquement reconvoquées, ce qui n'est pas le cas actuellement, Lorsque certaines pathologies sont détectées, des plaques pleurales par exemple, le suivi médical doit continuer : les personnes ne doivent pas « sortir du circuit » comme c'est le cas aujourd'hui. M. le Président : Je vous remercie. Messieurs, étant donné que l'heure avance, et que de nombreux points n'ont pas encore été abordés, je vous proposerai de revenir le 2 novembre prochain. Je vous propose d'aborder la question de l'efficacité des mécanismes des fonds destinés aux victimes. M. André LETOUZÉ : Trois services sont concernés par l'allocation de cessation anticipée d'activité : la Direction des relations du travail, la Direction de la sécurité sociale et la CNAMTS. Les salariés déposent leur dossier à la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM), au sein de laquelle une cellule amiante gère le dossier. Lorsqu'un problème n'a pas été prévu, le dialogue entre les structures est difficile. Prenons l'exemple des personnes ayant travaillé dans des mines de fer, pour lesquelles existe un système de couverture sociale spécifique. Elles ont droit à l'allocation quand elles ont ensuite travaillé dans des établissements traitant de l'amiante, mais on n'est pas capable de calculer le montant du prélèvement des cotisations sociales. On applique donc un prélèvement autoritaire de 20 %, alors que le taux moyen est inférieur à 10 %. Nous estimons que toutes les personnes ayant été exposées à l'amiante devraient pouvoir bénéficier d'un dispositif leur permettant de cesser leur activité avant l'âge de la retraite, parce que leur espérance de vie est réduite. Il n'y a pas de raison que les agents des trois fonctions publiques n'en bénéficient pas. L'ANDEVA était associée, en 1999, à l'établissement de la liste des établissements dont les salariés peuvent bénéficier de l'Allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Depuis 2002, nous n'y sommes plus associés. Il est difficile de comprendre qu'une entreprise fabriquant des joints en amiante ne soit pas incluse dans la liste, au motif que son secteur d'activité, « fabrication de joints », n'a pas de lien avec la fabrication ou le traitement de l'amiante. On relève aussi certaines anomalies dans le dispositif, notamment en ce qui concerne le cumul des années de travail lorsqu'une personne a changé de régime. Elle aura droit à l'allocation si elle a d'abord travaillé dans un établissement relevant du régime général avant d'intégrer la fonction publique d'État, mais pas dans le cas inverse. De même, il y a des inégalités de traitement étonnantes entre deux salariés ayant travaillé au même poste de travail : celui qui appartient à l'établissement cité dans la liste peut avoir accès à l'allocation amiante, l'autre qui appartient à une entreprise sous-traitante n'a pas de droit et ne peut donc avoir accès à celle-ci. Une autre anomalie concerne le capital décès, qui n'est pas attribué dans tous les cas. Il faudrait également que soit précisé le statut de l'ACAATA : est-ce une retraite ou un salaire de remplacement ? M. Michel PARIGOT : Le dispositif du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) a été visiblement sous-dimensionné au départ, parce qu'on a d'abord pensé qu'il serait limité à l'industrie de l'amiante. À ce stade, il n'y aurait pas besoin de structure spécifique. Mais on s'aperçoit maintenant que le nombre et la diversité des bénéficiaires sont tels que l'on ne peut plus faire face à la complexité. Une structure devrait être mise en place, chargée de centraliser tous les problèmes et de leur apporter une solution. M. le Président : Pour les cas très complexes, votre interlocuteur est-il le ministère du travail ? M. André LETOUZÉ : Ce n'est pas si simple ! J'ai toute une liste de numéros de téléphone ! Il n'y a pas de guichet unique. M. Michel PARIGOT : Et même quand il y a un guichet unique, comme c'est le cas pour le FIVA, gérer les relations entre les différents régimes de sécurité sociale est d'une complexité extrême. Quant à la proposition de la Cour des comptes de recentrer le bénéfice du FCAATA sur les victimes de l'amiante de manière à dégager les financements nécessaires à une meilleure indemnisation par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), nous y sommes opposés. Le FIVA et le FCAATA répondent à deux objectifs nettement distincts. Le FIVA vise à indemniser les préjudices des victimes et de leurs familles, que les victimes soient malades ou qu'elles soient décédées. Le FCAATA vise à compenser une perte d'espérance de vie mesurable, en permettant aux personnes de cesser plus tôt leur activité pour qu'elles puissent jouir d'un véritable droit à la retraite. Réserver le bénéfice de la cessation anticipée d'activité aux seules personnes malades est, au mieux, dépourvu de sens. Les personnes atteintes de mésothéliome ont une espérance de vie qui ne dépasse pas dix-huit mois, et de toute manière, le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité est inférieur à leurs indemnisations journalières. De plus, la moyenne d'âge des victimes, au moment où elles déposent leur dossier au FIVA, est de soixante-quatre ans. Sachant que l'âge moyen de départ à la retraite est inférieur à soixante ans, l'essentiel des victimes ne bénéficieraient pas du FCAATA. S'agissant de la pénibilité du travail, il n'apparaît pas opportun d'intégrer le dispositif en vigueur pour les victimes de l'amiante dans les négociations entre les partenaires sociaux prévues par la loi du 21 août 2003. La cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante est relativement bien circonscrite dans la mesure où existe un critère bien défini, celui de la diminution de l'espérance de vie, qui est lui-même étroitement corrélé au niveau d'exposition à l'amiante. La pénibilité, elle, est une notion beaucoup plus large et complexe et il sera beaucoup plus difficile de mettre en place à ce niveau des solutions qui soient à la fois opérationnelles et équitables. Le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est autonome et doit le rester. Il s'agit plutôt de remédier aux dysfonctionnements qui l'affecte, de l'améliorer et de s'inspirer de cette expérience pour imaginer des solutions à la question générale de la pénibilité. En ce qui concerne le FIVA, la création d'un établissement public était à nos yeux une nécessité. On aurait pu imaginer l'utilisation du fonds de garantie automobile, ou plus exactement du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), puisque c'est sa nouvelle appellation. Il est déjà chargé de la gestion d'autres fonds d'indemnisation. Mais cette solution aurait eu un inconvénient majeur, lié au fait que le FGAO a une pratique d'assureur. Quand il traite un dossier, il examine la jurisprudence de la cour d'appel concernée et accorde une indemnisation inférieure : le critère est de diminuer le plus possible tout en limitant le nombre d'appel à un pourcentage fixé à l'avance. Cette pratique peut fonctionner dans la mesure où les victimes d'accidents de la route ne sont pas organisées et, de ce fait, n'en n'ont pas connaissance et n'ont pas les moyens de s'y opposer. Les victimes de l'amiante sont, elles, organisées et si leur indemnisation avait été confiée au FGAO, des conflits majeurs seraient survenus. L'autre possibilité aurait été de confier l'indemnisation des victimes aux caisses d'assurance sociale. Mais celles-ci n'ont aucune expérience, et même aucune compétence, dans le domaine de l'évaluation des préjudices. Un problème d'uniformisation des pratiques se serait très rapidement posé. Le bilan du FIVA comme établissement public est bon. Le coût de gestion des dossiers est très inférieur au coût de gestion par le FGAO, qui a géré les dossiers pendant un an. Le fait qu'une petite structure ait été créée a permis une meilleure réactivité, et une certaine synergie avec le conseil d'administration. La composition de ce dernier a fait l'objet de critiques. Il lui a notamment été reproché de rendre impossible une majorité automatique. Pour notre part, nous n'y voyons pas quelque chose de négatif. Il n'y a pas de majorité de gestion, ce qui veut dire que sur chaque question, un vrai débat s'instaure et qu'il est nécessaire de convaincre les personnalités qualifiées. Loin de moi l'idée de peindre un tableau idyllique du conseil d'administration du FIVA, mais il a au moins le mérite d'éviter les petits arrangements. L'absence d'un représentant du ministère de la justice est cependant à regretter. On sait que le conseil d'administration compte en son sein cinq représentants de l'État : le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; le directeur du budget ou son représentant ; le directeur du Trésor ou son représentant ; le directeur général de la santé ou son représentant ; le directeur des relations du travail ou son représentant. Que la direction du budget et celle du Trésor soient toutes deux représentées ne semble guère justifié. Il serait préférable de remplacer le représentant du Trésor par un représentant du ministère de la justice, compte tenu des missions du fonds. Vous nous avez posé une question que tout le monde se pose : pourquoi la création du FIVA n'a-t-elle pas tari le contentieux ? Non seulement elle ne l'a pas tari, mais les recours en faute inexcusable sont en augmentation constante depuis la création du FIVA. Il y a deux raisons essentielles à cela. La première est que le FIVA ne remplit pas l'une de ses missions les plus importantes, à savoir l'engagement des recours subrogatoires. Or, les victimes sont attachées, à juste titre, à faire condamner les responsables. Elles n'ont pas d'autre choix, actuellement, que de le faire elles-mêmes. La seconde est que les niveaux d'indemnisation offerts par le FIVA sont très inférieurs à ceux décidés par les tribunaux en cas de faute inexcusable de l'employeur. Selon le FIVA lui-même, les tribunaux offrent en moyenne, pour les plaques pleurales, et s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, 28 400 euros. Le FIVA offre en moyenne 15 900 euros. Nous proposons que le FIVA indemnise au moins à hauteur de la moyenne des tribunaux. M. le Président : Il faut tout de même préciser que la durée du traitement des dossiers est de six mois pour le FIVA et de deux ans et demi pour les tribunaux. M. Michel PARIGOT : C'est vrai, mais cette différence n'est pas déterminante pour les plaques pleurales. Pour les personnes atteintes de cancer, le FIVA a fait des efforts pour traiter les dossiers en moins de trois mois. Cela constitue un avantage réel par rapport à la voie contentieuse. Il faut savoir néanmoins qu'un certain nombre de tribunaux accepte désormais, en cas de cancers, et lorsque la faute inexcusable de l'entreprise concernée est déjà acquise, de verser en référé une provision égale au montant de l'indemnisation finale. M. le Rapporteur : Nous rencontrons dans nos circonscriptions des personnes dont l'activité professionnelle passée n'est absolument pas répertoriée parmi celles qui sont susceptibles de les exposer à l'amiante, et qui n'y en ont pas moins été exposées. Je pense en particulier à des femmes de ménage qui travaillaient dans les bureaux de la Direction des chantiers navals (DCN). Or ces bureaux étaient situés dans les ateliers eux-mêmes. Il est donc nécessaire d'ouvrir le champ des bénéficiaires du FCAATA. Un autre problème est celui des travailleurs des ports et docks à qui l'on reconnaît des années d'exposition, mais pour lesquels on considère qu'ils ont été exposés en 1970 mais pas en 1971, en 1972 mais pas en 1973, etc. La conséquence est que la date de leur départ en préretraite s'en trouve retardée. Il nous faut mettre en place une procédure permettant de traiter des cas individuels, qui n'entrent pas dans le cadre fixé par la législation et la réglementation actuelles. M. François DESRIAUX : Il est nécessaire de compléter la liste, qui n'intègre pas certains secteurs où de nombreuses personnes ont pourtant été exposées, je pense en particulier aux fonderies. Il faut aussi introduire de la souplesse dans la procédure aboutissant à inscrire une entreprise dans la liste. Le troisième problème est de permettre à des individus de faire valoir le fait qu'ils ont été exposés, même s'ils n'ont pas travaillé dans un secteur où les salariés ont été très nombreux à l'être. La mise en place d'un tel système n'est pas simple, et pose d'autres questions : qu'est-ce qu'une exposition forte, comment l'apprécie-t-on ? De plus, la médecine du travail n'ayant pas toujours rempli son rôle, les dossiers ne sont pas complets. Je voudrais également souligner que certains salariés peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité mais qu'ils y renoncent, en raison de son trop faible montant. M. Daniel PAUL : Tout le monde s'accorde sur le fait que la liste est insuffisante. Ne serait-il pas opportun que des instances décisionnelles puissent compléter le dispositif au niveau local, afin de gagner du temps ? M. André LETOUZÉ : En effet. Le port de Brest, par exemple, n'est pas inscrit dans la liste. Pourquoi ? Parce qu'il ne déchargeait pas d'amiante. Mais, le port de Brest est l'un des premiers ports touchés par des navires pour réparer ou remettre en ordre les cargaisons désarrimées et il reste que les dockers déchargeaient et rechargeaient des bateaux dont les cargaisons contenaient de l'amiante en sac. M. le Président : C'est vrai aussi pour le port de Boulogne. La situation est extrêmement complexe, et je ne vois pas comment une structure centrale peut réduire cette complexité. M. Michel PARIGOT : Il faut distinguer la gestion administrative et l'instruction d'un dossier qui vise à établir l'exposition à l'amiante. On peut imaginer qu'une structure centralisée prenne en charge les aspects de la gestion administrative qui peuvent être centralisés, et que l'instruction des dossiers soit réalisée au niveau local. M. François DESRIAUX : Nous avions proposé que les CRAM prennent en charge l'instruction des dossiers. Elles connaissent le tissu local et sont près du terrain. M. le Président : Il faut donc distinguer ce qui relève des relations d'administration à administration et ce qui relève du suivi des dossiers. M. Patrick ROY : S'agissant de l'ACAATA, d'une part, le niveau de l'allocation est souvent très faible. Quelles sont, d'après vous, les réformes qui permettraient de faire en sorte qu'elle atteigne un niveau acceptable ? D'autre part, la question de la nature de cette allocation a été posée. Est-ce une retraite ou un salaire ? Quelle est la position de l'ANDEVA sur ce point ? M. André LETOUZÉ : Il faudrait que l'allocation permette de vivre décemment et atteigne au moins le SMIC. Actuellement, l'allocation ne doit pas dépasser 85 % de la dernière rémunération. C'est un verrou qu'il faut faire sauter. Il n'existe plus pour les retraites. Pourquoi existe-t-il encore pour l'allocation ? S'agissant de la nature de l'allocation, il me semble qu'elle devrait être un salaire de remplacement. Actuellement, les bénéficiaires ne reçoivent pas une fiche mensuelle indiquant le montant de l'allocation. Cela pose problème pour ceux qui demandent un crédit, par exemple. M. le Président : M. Parigot a souligné que le FCAATA visait à accorder un droit à la retraite à des personnes dont l'espérance de vie a été réduite. Cela semble contradictoire avec le fait de donner à l'allocation le statut d'un salaire de remplacement. M. André LETOUZÉ : Quand on demande le bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL), le dossier n'est pas du tout traité de la même façon selon que l'on est en activité ou en retraite. M. le Président : Je n'en disconviens pas. Cela n'empêche pas qu'il y a une contradiction. M. François DESRIAUX : La remarque de M. Parigot visait à répondre à la proposition de la Cour des comptes de limiter le bénéfice du FCAATA aux seules personnes malades. M. le Président : Je reviens un instant au problème des recours subrogatoires. S'ils ne se font pas systématiquement, il faut peut-être souligner que ce n'est pas le fait d'une volonté délibérée du FIVA, mais d'une insuffisance de moyens ? M. Michel PARIGOT : C'est tout à fait clair. Le FIVA n'a pas actuellement les moyens humains de mener ces recours. Alors qu'il reçoit 8 000 dossiers par an, il ne dispose que de cinq personnes pour traiter à la fois le contentieux subrogatoire et le contentieux d'appel. Les recours subrogatoires ne concernent que 2 % des dossiers. Il faudrait au moins aller jusqu'à 30 %. Cela dit, l'absence de moyens est le fait d'une volonté politique. C'est l'État qui n'a pas voulu que l'on recrute des juristes. C'était un choix de la Direction de la sécurité sociale, qui a expliqué que ce n'était pas une priorité. C'est une erreur d'un point de vue financier. Car deux actions subrogatoires gagnées permettraient le versement d'une somme correspondant au salaire annuel d'un juriste. Un premier obstacle était qu'au départ, pour l'essentiel des dossiers, l'action subrogatoire n'était pas possible en raison de la prescription. Ce n'est plus le cas des dossiers qui sont déposés actuellement. Un deuxième obstacle était que la faute inexcusable n'était pas opposable à l'employeur, parce que les caisses n'avaient pas respecté le caractère contradictoire de l'enquête. Elles ont, depuis, rectifié le tir. M. Daniel PAUL : Le FIVA ne peut-il pas avoir, comme d'autres établissements publics, des postes gagés sur les recettes ? Cela se fait dans l'enseignement supérieur. M. le Président : Ce serait gênant du point de vue éthique. M. François DESRIAUX : Je précise que le FIVA n'a pas le choix de mener ou de ne pas mener une action subrogatoire. C'est pour lui une obligation légale. Il doit donc se donner les moyens de la mener. M. Michel PARIGOT : Nous sommes, en outre, dans cette situation rare où le fait de se donner les moyens de mener une action ne coûte pas d'argent mais en rapporte ! Par ailleurs, l'aléa judiciaire n'existe guère s'agissant de dossiers où les choses sont très claires. M. Alain BOBBIO : Avant que vous ne concluiez cette audition, M. le Président, je voudrais vous faire part d'un cas d'inégalité dont j'ai eu connaissance hier soir. Pour les premiers dossiers déposés au FIVA en Nouvelle-Calédonie, les demandes de dossier adressées à la CAFAT (la Caisse de Protection sociale) ont reçu la réponse suivante: « Je vous indique que, compte tenu du principe de spécialité législative consacré par la loi organique du 19 mars 1999, la législation métropolitaine, et notamment les textes de la sécurité sociale, ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, sauf mention expresse d'applicabilité. Aucune mention ne figurant dans la loi du 23 décembre 2000 relative au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, nous ne pouvons donner suite à votre demande. » Je précise que la contamination en Nouvelle-Calédonie a été massive. M. le Président : Nous allons examiner le problème. Messieurs, je vous remercie pour votre contribution aux travaux de notre mission, et je vous donne rendez-vous pour la deuxième audition dont nous sommes convenus. Audition conjointe des professeurs Marc LETOURNEUX et Christophe PARIS et de Mme Évelyne SCHORLÉ sur le suivi post-professionnel des salariés de l'amiante Présidence de M. Jean-Marie GEVEAUX, Vice-président, M. Jean-Marie GEVEAUX, Président : Je vous prie d'excuser l'absence temporaire de M. Jean Le Garrec, Président de notre mission, retenu par d'autres travaux et que je suppléerai jusqu'à son arrivée. Nous recevons aujourd'hui les professeurs Marc Letourneux et Christophe Paris ainsi que le docteur Évelyne Schorlé. Tous trois ont participé au dispositif expérimental de suivi post-professionnel (SPP) des salariés de l'amiante mis en œuvre en Aquitaine, en Normandie et en Rhône-Alpes. M. Marc Letourneux et M. Christophe Paris ont piloté le programme en Basse-Normandie et en Haute-Normandie respectivement, et Mme Évelyne Schorlé, médecin conseil coordonnateur régional de la Sécurité sociale, en Rhône-Alpes. Je vous remercie, Madame, Messieurs, de vous être rendus disponibles pour cette audition dont l'objet est de nous informer sur ce programme pilote dont le bilan médical préliminaire vient d'être présenté au Gouvernement. Vous avez reçu un questionnaire indicatif des questions que nous souhaitons voir abordées aujourd'hui. Si certains points du questionnaire ne sont pas traités, nous aimerions que vous y répondiez par écrit. M. Marc LETOURNEUX : À la demande conjointe de la Direction des relations du travail du ministère de l'emploi d'une part, de la direction des risques professionnels de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CMAMTS) d'autre part, nous avons conduit une étude expérimentale sur le suivi des personnes retraitées ou inactives ayant été exposées à l'amiante. Cette étude a été jugée nécessaire en raison de la sous-utilisation criante du dispositif existant. La législation est ancienne, puisque les textes datent de 1958 et 1988, et c'est un décret de 1993 qui organise le suivi post-professionnel des personnes ayant été exposées à des agents cancérogènes. L'exposition à l'amiante partageant, avec beaucoup d'autres risques professionnels, la particularité d'induire une pathologie survenant très tardivement du fait d'une très longue période de latence, la médecine du travail se trouve le plus souvent hors circuit lorsque la pathologie intervient, c'est-à-dire après le départ à la retraite. Le programme pilote visait en premier lieu à faire savoir aux personnes ayant été exposées qu'elles peuvent bénéficier d'un suivi médical spécifique gratuit. Comme je l'ai dit, ce droit est prévu par les textes, mais il en est très peu utilisé en raison de la complexité apparente des démarches à accomplir - apparente seulement, car il suffit, en réalité, de s'adresser à sa caisse d'assurance maladie. Il nous a été demandé de faciliter encore l'accès au dispositif. Je ne suis pas certain que nos propositions simplifieront beaucoup les choses pour les administrations, mais nous espérons qu'elles le feront pour les personnes concernées. On avait, par ailleurs, constaté que l'information sur ce bilan médical gratuit est dispersée et mal contrôlée. Il en résulte que les médecins consultés ne sont pas toujours bien préparés à répondre à cette demande et que les consultations se déroulent dans des conditions que l'on ne peut qualifier d'optimales et qui, en tout cas, ne sont pas celles qu'a souhaitées la conférence de consensus du 15 janvier 1999. La réglementation prévoit, en effet, un examen « radiologique » du thorax - ce qui est généralement entendu comme une simple radiographie - et des explorations fonctionnelles respiratoires, tous les deux ans. La conférence de consensus, estimant que ce protocole n'était plus parfaitement adapté à son objet, a recommandé la standardisation des bilans par le recours systématique au scanner thoracique, technique diagnostique de meilleure qualité scientifique que la radiographie pulmonaire simple. Il nous a donc été demandé de proposer une méthodologie répondant mieux à ces recommandations, tout en faisant preuve de vigilance quant aux conséquences sanitaires éventuelles de l'irradiation, plus forte en cas d'examen tomodensitométrique que lorsque l'on pratique une radiographie. Il nous a enfin été demandé d'évaluer l'étude elle-même, ce que nous avons commencé de faire en remettant, le 7 septembre dernier, un rapport sur le dispositif expérimental proposé et sur les résultats médicaux préliminaires constatés. Le bilan médical complet de l'expérimentation sera achevé en juin 2006. Mme Évelyne SCHORLÉ : Les régions choisies pour l'expérimentation l'ont été parce que les bassins d'emploi ne sont pas les mêmes et que l'exposition des populations à l'amiante a également varié. Il était prévu pour chaque région une méthode de sollicitation différente. En Aquitaine, les expérimentateurs ont choisi, dans un premier temps, de s'appuyer sur les médecins libéraux, en passant par le canal de leur union régionale, qui les a informés, afin qu'ils informent ensuite eux-mêmes leurs patients. L'idée était bonne, mais il est parfois difficile de faire passer un tel message au cours d'une consultation demandée pour un tout autre sujet, et la mobilisation a été faible. Aussi a-t-il été décidé dans un deuxième temps de s'appuyer sur les registres des Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), lesquelles ont sollicité les assurés sur simple critère d'âge. En Normandie, région très concernée par l'exposition à l'amiante et dont la population a un niveau d'information sur ces questions plus élevé qu'ailleurs, les médias locaux ont été largement sollicités. On s'est rendu compte que cette méthode donnait des résultats importants mais éphémères et qu'il convenait de réitérer le message. En Rhône-Alpes, on a choisi d'utiliser le fichier des retraités de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) et d'adresser des courriers à des personnes ciblées en fonction des établissements où ils avaient pu être exposés à l'amiante au cours de leur carrière professionnelle. Trente-cinq mille lettres ont ainsi été envoyées sur critères d'âge et d'activités passées. Le taux de réponse a été de 25 % sans relance, ce qui est un taux de retour très important. C'est ainsi que l'organisation de l'information s'est faite. S'agissant du bilan proprement dit, des questionnaires ont été distribués qui permettaient aux personnes interrogées de confirmer l'estimation de leur taux d'exposition ou de donner les éléments propres à une évaluation rétrospective. Cette évaluation étant faite, on a proposé aux personnes qui entraient dans le dispositif un kit d'examens à réaliser, assorti de documents destinés au suivi des résultats dans le temps. On a alors constaté que les modalités habituelles de facturation du suivi post-professionnel sont relativement lourdes pour les médecins car elles les obligent à tenir une comptabilité séparée et diffèrent le paiement. Il y a de ce fait « échappement » d'une partie de la prise en charge du suivi post-professionnel vers l'assurance maladie. Si l'on veut mesurer exactement le recours au dispositif de suivi pour mieux connaître le risque et, d'autre part, imputer aux bons comptes les bonnes dépenses, il faut revoir ces modalités, tant pour le suivi post-professionnel de l'exposition à l'amiante que pour l'exposition à tous les cancérogènes. L'évaluation des expositions a été faite par des hygiénistes en Aquitaine et en Normandie. En Rhône-Alpes, elle a été confiée aux agents spécialisés des caisses primaires, qui ont reçu une formation spécifique et qui ont été munis d'un guide d'aide à la cotation. Elle a ensuite été validée par l'ingénieur de prévention de la CRAM. On a, par ailleurs, demandé aux radiologues de respecter le protocole défini par la conférence de consensus pour éviter que les personnes se prêtant à ce bilan ne soient trop irradiées lors de l'examen tomodensitométrique. Les radiologues participant au dispositif expérimental ont signé une convention dans laquelle ils indiquaient respecter le protocole défini par la conférence de consensus, s'engageaient à informer les patients et acceptaient de nous transmettre un CD contenant les images des scanners thoraciques réalisés, en vue d'analyses globales et de relecture. M. Christophe PARIS : Je m'attacherai à résumer le bilan de l'expérimentation. Notre premier objectif était de tester les différents canaux d'information par lesquels les populations susceptibles d'entrer dans le dispositif pouvaient être amenées à le faire. Comme l'a indiqué Mme Schorlé, deux méthodes ont été choisies : l'envoi d'un courrier individuel d'une part, l'information par la télévision et presse locales d'autre part. Il est apparu que la meilleure méthode est le courrier individualisé, en particulier lorsqu'il est adressé à des retraités présélectionnés en fonction d'une exposition estimée a priori, selon leur carrière professionnelle, après qu'un repérage a été fait par les CRAM. C'est l'enseignement principal de l'étude. Le taux de réponse a, en effet, varié de 20 % à 40 % dans les régions où l'on a procédé ainsi, ce qui est un taux extrêmement élevé. Il est particulièrement remarquable en Rhône-Alpes, où l'exposition à l'amiante n'avait pas fait l'objet d'un battage médiatique préalable. En Normandie, la médiatisation a conduit 6 000 sujets à se déclarer intéressés par le dispositif mais, au regard de la population touchée, le taux de réponse est moindre. Notre première recommandation est donc l'envoi d'un courrier à une population retraitée ciblée, l'informant sur le dispositif de suivi post professionnel spécifique et l'invitant à y participer. Le deuxième enseignement de l'expérimentation porte sur l'évaluation des expositions professionnelles. Il a été prévu en 1993 de subordonner l'entrée dans le dispositif de suivi post-professionnel à la fourniture d'une attestation d'exposition à l'amiante cosignée par l'employeur et par le médecin du travail. Le faible nombre de bilans réalisés depuis lors montre que ce système ne fonctionne pas - c'est d'ailleurs ce qui a motivé l'expérimentation. Aussi, au lieu de prévoir que la possibilité d'un suivi soit subordonnée à une enquête des services sociaux des CPAM, notamment lorsque les entreprises dans lesquelles avaient travaillé les personnes concernées avaient disparu - enquêtes qui, faute de moyens, n'étaient pas toujours réalisées -, nous avons d'emblée choisi un processus d'« entrée libre », indépendante de toute attestation d'exposition. Le questionnaire simplifié reprend la carrière professionnelle et contient quelques questions clé sur l'exposition à l'amiante. La classification des sujets éligibles au SPP a ensuite été faite par des cellules d'hygiène industrielle spécialement constituées, les évaluations étant individualisées. J'insiste sur ce point : l'analyse d'un cursus professionnel se fait sur le contenu d'un métier et non sur le seul intitulé d'une activité. Pour expliciter mon propos, je citerai le cas de cette secrétaire du service comptable d'un chantier naval, à première vue non concernée mais qui a cependant développé une pathologie liée à l'amiante, parce qu'elle allait chaque semaine distribuer les feuilles de paye dans les ateliers. L'évaluation de l'exposition ne se résume pas à une classification par métier a priori et il faut rassembler un minimum de renseignements individuels sur chaque carrière. L'expérimentation a montré que les évaluations sont ensuite réalisables en s'appuyant sur les enquêteurs des CPAM et sur le personnel de la prévention des risques professionnels au sein des CRAM. Il existe donc déjà une structure opérationnelle permettant d'évaluer l'exposition passée, clef d'entrée dans le dispositif pour des retraités dont il faut retracer la carrière sur vingt, trente, voire quarante ans, et pour lesquels on ne dispose d'aucune preuve administrative et d'aucun élément tangible. La seule difficulté persistante est la hiérarchisation des niveaux d'exposition au sens des recommandations de la conférence de consensus, mais c'est là un aspect technique subsidiaire. Le troisième résultat de l'expérimentation a trait à l'évaluation dosimétrique des protocoles de tomodensitométrie thoracique, réalisée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Les caractéristiques des appareils utilisés par les radiologues participant à l'expérimentation, recensées par l'IRSN, sont apparues conformes à celles du parc national. Pour vérifier la conformité des protocoles suivis avec la recommandation des sociétés savantes, l'IRSN a, par ailleurs, procédé à des sondages aléatoires dont il est résulté que l'irradiation globale induite par la réalisation d'un scanner thoracique était de 4 millisieverts. L'IRSN a jugé tout à fait acceptable ce niveau qui est de deux fois inférieur à la norme habituelle pour l'imagerie thoracique et équivalent à 1,6 fois l'irradiation annuelle. Il est cependant apparu qu'en dépit des engagements souscrits par les radiologues ayant signé la convention d'expérimentation, 20 % des examens n'étaient pas réalisés dans le respect du protocole prévu. Aussi recommandons-nous que l'optimisation des doses fasse l'objet d'une recommandation technique spécifique et que la réalisation de ces examens continue d'être encadrée. Le quatrième enseignement de l'expérimentation est l'intérêt incontestable du scanner thoracique dans le dépistage des pathologies liées à l'exposition à l'amiante. Cet outil va bien au-delà de la radiographie pulmonaire, qu'il s'agisse de diagnostiquer la présence de plaques pleurales ou une asbestose. S'agissant des résultats médicaux, le bilan préliminaire que nous avons transmis le 7 septembre dernier au ministère du travail porte sur 80 % des données, dont l'enregistrement complet sera achevé en juin 2006. Il montre l'existence de populations clairement identifiées, pour lesquelles la prévalence de plaques pleurales est significativement élevée. Dans les régions où a eu lieu l'expérimentation, 20 000 demandes de suivi post-professionnel ont été faites ; 16 000 personnes ont renvoyé le questionnaire d'exposition. Les cellules d'hygiène industrielle ont attesté l'exposition professionnelle de 14 000 d'entre elles, qui sont entrées dans le dispositif. Parmi elles, quelque 6 600 sujets, à ce jour, ont fait un bilan médical comportant un scanner thoracique, et ils seront 8 000 à la fin du protocole en décembre 2005. Dans cette population de 6 600 individus, on a constaté 10 % de maladies professionnelles possibles, dont 90 % de plaques pleurales, des asbestoses, quelques cancers bronchiques et deux ou trois mésothéliomes. En dépit de ces résultats encourageants, nous avons formulé plusieurs recommandations. La première porte sur la nécessité absolue de respecter le protocole technique de réalisation des scanners thoraciques pour éviter toute irradiation excessive. Ensuite se pose un problème d'interprétation des images radiologiques en raison d'une absence de consensus parmi les sociétés savantes, qui ne s'accordent pas sur la définition des anomalies de quelques millimètres. Il leur revient de trancher et de caractériser les images en définissant ce qui est une plaque pleurale et ce qui signale une simple séquelle traumatique. Mais il se pose aussi un problème d'interprétation des images, si bien que nous recommandons, comme pour les mammographies, une double lecture. Sur un autre plan, nous recommandons de combler le hiatus important qui existe entre la surveillance de l'exposition au travail et la surveillance post-professionnelle. De fait, les sujets en activité ne sont pas ou peu surveillés mais, dès lors qu'ils sont retraités, ils se voient proposer un suivi complet. Ce dispositif discrédite la médecine du travail et le suivi lui-même. Nous recommandons donc que l'évaluation rétrospective de l'exposition se fasse dès l'âge de cinquante ans. Nous recommandons aussi une « cotation traçante » des actes médicaux réalisés dans le cadre du SPP, permettant d'utiliser la carte Vitale, ce qui n'est pas le cas actuellement. Les dépenses seraient ainsi automatiquement imputées à la branche accidents du travail - maladies professionnelles (AT-MP) et non plus, comme souvent, par commodité, à la branche maladie. On y gagnerait sensiblement en lisibilité et donc en connaissance du risque. Je ne conclurai pas sans souligner que se pose la question générale de la surveillance de l'exposition des salariés, actifs et retraités, aux substances cancérogènes, car l'amiante n'est malheureusement pas le seul agent cancérogène répertorié. M. le Rapporteur : Je vous remercie pour cet exposé très complet. Comment explique-t-on l'action cancérogène des fibres d'amiante sur les tissus pulmonaires et la plèvre ? Mme Évelyne SCHORLÉ : Tout cancer est la somme de plusieurs facteurs. L'amiante n'est donc pas à lui seul responsable d'un cancer mais le tabagisme, les habitudes de vie, le comportement, le reste de l'environnement, la génétique sont autant de co-facteurs qui, dans le cas des cancers pulmonaires, se potentialisent. M. Marc LETOURNEUX : Certains arguments expérimentaux donnent à penser que l'amiante est probablement, parmi les cancérogènes professionnels, l'un des plus complet et des plus importants, à la fois comme initiateur et comme promoteur. Toutefois, l'apparition d'un cancer broncho-pulmonaire suppose une possible fragilité constitutionnelle personnelle dans les défenses contre les agressions cellulaires, à laquelle s'ajoutent les co-facteurs évoqués par Mme Schorlé. Si l'on ne comprend pas encore tout de la cancérogenèse, il semble, même si cela est encore discuté, que la biopersistance de l'amiante soit l'élément clé de sa nocivité, la difficulté de l'organisme à se débarrasser des fibres inhalées et l'interaction biologique persistante qui s'ensuit avec les cellules des tissus pulmonaires expliquant probablement l'amorce, puis le développement du cancer. La chimie de la particule et son aspect géométrique sont également en cause. L'appréhension de ces mécanismes nous conduit à recommander la même vigilance que pour l'amiante dans l'utilisation des fibres céramiques ou vitreuses, à propos desquelles certains arguments expérimentaux sont rassurants, mais qui ont la même bio persistance. M. le Rapporteur : Précisément, la question des matériaux de substitution est de celles qui nous préoccupent. Pour ce qui est du traitement, la recherche progresse-t-elle ou faut-il malheureusement considérer, comme le pensent de nombreuses familles, que la mort de toute personne atteinte de cancer bronchique induit par l'amiante, ou de mésothéliome, est inéluctable et que l'on peut tout au plus retarder l'échéance d'un ou deux mois ? M. Jean-Marie GEVEAUX, Président : Au delà, ne peut-on s'interroger sur l'intérêt d'un dépistage systématique, s'il n'y a pas de cure possible ? Et que penser de l'effet psychologique du dépistage dans un tel contexte ? (M. Jean LE GARREC remplace M. Jean-Marie GEVEAUX à la présidence) M. Christophe PARIS : La toxicité des fibres d'amiante et le risque de cancérisation ne sont pas les mêmes pour le tissu pulmonaire et pour la plèvre, et les niveaux d'exposition susceptibles d'induire un cancer bronchique et un mésothéliome diffèrent. La recherche sur les cancers bronchiques - foisonnante - a entraîné des progrès marquants dans la compréhension des mécanismes de la cancérogenèse bronchique liés au tabagisme mais assez peu pour ce qui concerne celle liée à l'exposition à l'amiante ou à l'exposition conjointe. Par ailleurs, la partie « facteur de risque professionnel » est assez peu étudiée, si bien qu'il est difficile de caractériser les populations risquant de développer des cancers bronchiques. Cela dit, des thérapeutiques ciblées ont été mises au point qui tentent de tenir compte des mécanismes de cancérogenèse spécifiques, et l'on peut espérer que l'efficacité du traitement du cancer bronchique sera renforcée. Je serai beaucoup moins optimiste en ce qui concerne les marges de progrès du traitement du mésothéliome. Les mécanismes de cancérisation mis en évidence sont liés à la dimension, à la réactivité de surface et la biopersistance des fibres, sans que l'on sache lequel des composants du cocktail de facteurs de risque liés à l'amiante est prépondérant. Et comme il existe plusieurs facteurs de cancérisation, le phénomène n'est pas transposable à d'autres fibres sur la base d'un seul critère - la biopersistance par exemple. On a beaucoup moins avancé dans le dépistage et le traitement du mésothéliome, si bien que la médiane de survie reste globalement inchangée. On peut gagner un, deux ou six mois mais, globalement, il n'y a pas de progrès thérapeutique réel. Mais il faut, je le répète, distinguer les cancers broncho-pulmonaires du mésothéliome, fort heureusement beaucoup plus rare. Mme Évelyne SCHORLÉ : Le cancer est une maladie chronique, et gagner deux mois, de mois en mois, ce n'est déjà pas si mal car on peut espérer, à terme, restaurer une durée de vie acceptable. Mais votre question portait aussi sur l'opportunité de dépister une maladie que l'on ne guérit pas. Il est clair que tout l'intérêt de ce dépistage est d'ordre médico-social : c'est l'indemnisation. M. Marc LETOURNEUX : L'objectif du SPP mené dans les conditions que nous recommandons est effectivement d'ordre médico-social, et la performance de nos examens n'est réelle que pour le dépistage des maladies bénignes, puisque nous ne disposons d'aucun outil efficace de dépistage du mésothéliome. Pour ce qui est du cancer pulmonaire, la question qu'il faut se poser est la suivante : une collectivité de personnes exposée à l'amiante, et de surcroît fumeuse, ne sera-t-elle pas, demain, une bonne cible pour un dépistage par scanner thoracique annuel faiblement irradiant ? La systématisation de cet examen constituerait-elle un progrès en termes de santé publique s'agissant de la mortalité spécifique par cancer du poumon ? En résumé, le SPP de l'amiante a une bonne efficacité pour les pathologies bénignes mais son objectif est d'ordre médico-social. Dans le même temps, on sait que le dépistage, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, est inopérant pour les cancers pulmonaires. On sait aussi que, même si l'on s'orientait vers un dépistage réalisé par le biais d'un scanner thoracique annuel pour la population la plus exposée et à risque majeur de cancer pulmonaire, la démarche ne serait pas validée scientifiquement, car les expérimentations faites à ce sujet il y a trente ans n'ont pas été probantes. Leur relecture montre, toutefois, un biais méthodologique qui conduit à se demander si de simples radiographies pulmonaires réalisées tous les quatre ou six mois et standardisées, comme on sait le faire maintenant, ne suffiraient pas.40 M. Christophe PARIS : Des essais randomisés sur le dépistage du cancer bronchique par scanner thoracique faiblement irradiant sont conduits aux États-unis, dont les conclusions définitives seront publiées en 2009 ou 2010. Mais, déjà, l'observation de plusieurs cohortes montre qu'en cette matière les performances du scanner thoracique sont incomparablement meilleures que celles de la radiographie pulmonaire. Les arguments s'accumulant pour donner à penser que l'examen tensodensitométrique thoracique est le bon examen de dépistage dans ce cas, nous devons être prêts à agir lorsque cette efficacité aura été définitivement démontrée. Je tiens qu'il faut donc, dès à présent, définir quelles sont les populations à risque sur le plan professionnel susceptibles de bénéficier d'un dépistage du cancer bronchique, sans attendre 2009, sans quoi on aura encore perdu cinq ans. Mme Évelyne SCHORLÉ : On peut toutefois s'interroger : le dépistage lui-même est-il d'une innocuité totale ? Quel est son impact sur des personnes qui pouvaient ignorer avoir été exposées ? N'y a-t-il pas un risque à les confronter à ce qu'elles ont dénié ou méconnu et de voir alors leurs défenses s'effondrer ? Par ailleurs, le fait de découvrir des plaques pleurales - ce qui est le cas pour 90 % des bilans positifs réalisés - déclenche une indemnisation. Ne convient-il pas de s'interroger à la fois sur le montant de l'indemnisation et sur le déséquilibre induit à l'égard des individus atteints de cancer d'origine professionnelle mais qui ne bénéficient pas, eux, d'un dispositif équivalent au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) ? M. Jean-Marie GEVEAUX : Avant d'être informées par vos soins à la suite de la mise en œuvre du protocole de dépistage, les personnes considérées ignoraient-elles le risque qu'elles courraient ? Mme Évelyne SCHORLÉ : En Rhône-Alpes, la population est moins au courant du risque qu'elle ne l'est en Normandie. Le « couloir de la chimie » excepté, les personnes concernées sont, pour la plupart, celles qui ont travaillé dans de petits garages. M. Jean-Marie GEVEAUX : Une méthode de repérage des retraités potentiellement atteints vous a-t-elle semblé substantiellement meilleure que les autres ? M. Christophe PARIS : C'est sans conteste l'envoi d'un courrier individualisé à des retraités présélectionnés par les CPAM. Ce mode d'information a suscité un taux de réponse de 38 % en Rhône-Alpes. M. Jean-Marie GEVEAUX : Vous avez parlé tout à l'heure de « résultats encourageants ». Que faut-il entendre par là ? M. Christophe PARIS : J'évoquais les résultats que nous avons obtenus en matière de sensibilisation de la population. Le dispositif expérimental a montré que l'information des retraités présélectionnés grâce au fichier de la CRAM est un système qui fonctionne bien, comme a bien fonctionné le système d'évaluation de l'exposition professionnelle par les cellules d'hygiène industrielle. M. Marc LETOURNEUX : Il va sans dire que ce qui fonctionnera le mieux, ce sera d'assurer la continuité entre la période de travail et la retraite. Actuellement, nous devons gérer une situation particulière : l'absence d'information suffisante d'une population qui a été exposée autrefois à un risque professionnel. On peut espérer que cette gestion tardive n'aura plus lieu d'être. Voilà pourquoi l'une de nos recommandations principales est de suggérer que la médecine du travail prenne le temps, lorsque les gens ont cinquante ans, de récapituler leurs activités professionnelles passées et, bien sûr, de documenter leurs activités en cours, afin de leur garantir le bénéfice du SPP. Ainsi satisferait-on le besoin légitime des populations qui ont été exposées autrefois à un suivi médical proportionné au risque encouru. M. Christophe PARIS : Le rapport montre que depuis la création du dispositif expérimental, le nombre de bilans effectués a été multiplié par 20, voire 22 par rapport à 2002, l'année de référence. L'efficacité du dispositif est donc démontrée, et c'est pourquoi j'ai parlé de résultats encourageants. Mais il est vrai que l'on dépiste des plaques pleurales en grand nombre, ainsi que quelques asbestoses, vestiges malheureux d'expositions historiques. Comme l'a souligné Mme Schorlé, cela pose la question du volume d'indemnisation par le FIVA. M. Jean-Marie GEVEAUX : Comment qualifieriez-vous le rôle joué par la médecine du travail à ce sujet ? Insuffisant ? Inapproprié ? M. Marc LETOURNEUX : La médecine du travail a évolué, et l'évaluation des risques professionnels fait maintenant partie de ses priorités, ce qui était beaucoup moins certain il y a quelques décennies, mais la nécessité de cette évaluation n'est pas encore toujours intégrée dans les activités multiples des services de santé au travail. Ils doivent pourtant prendre le temps de récapituler les expositions anciennes en vue d'une transmission aux médecins chargés du suivi post-professionnel - qui s'engage au moment où, étant donnée la durée de latence, les pathologies sont susceptibles d'être dépistées ou d'apparaître. M. le Président : Je vous ai entendue parler d'« effondrement des défenses ». Pourriez-vous préciser votre propos ? Mme Évelyne SCHORLÉ : Les individus sont habituellement confrontés à des traumatismes, et se construisent des défenses pour y résister. C'est ce qu'on appelle « l'effet iatrogène de la parole ». Mais ces défenses peuvent s'effondrer lorsqu'on apprend que l'on est confronté à un risque méconnu et l'on court, alors, le risque de développer certaines maladies. M. le Président : Vous avez aussi évoqué la nécessité d'une récapitulation des carrières ; mais l'on sait la difficulté que cela présente. M. Marc LETOURNEUX : Les médecins du travail sont les moins mal placés pour le faire. M. le Président : J'entends bien. Toutefois, ce qui se conçoit pour les grandes entreprises, voire pour les entreprises moyennes, s'envisage beaucoup plus mal quand les activités professionnelles se sont déroulées dans de petites, ou très petites, entreprises, et plus difficilement encore lorsqu'elles ont eu lieu dans le cadre de la sous-traitance. Dans ce cas, la capacité de récapitulation devient très faible. M. Marc LETOURNEUX : Et cela demande du temps, d'où l'importance de repérer dès aujourd'hui les populations à risque pour pouvoir les prendre en charge demain. M. le Président : J'approuve le principe, mais sa mise en œuvre me préoccupe. Mme Évelyne SCHORLÉ : De plus, le risque fluctue dans le temps, ce qui suppose de regrouper les données. La récapitulation des carrières par les CRAM y contribue grandement. C'est dire l'importance du rôle des ingénieurs de prévention, qui pourront, dans chaque région, préciser les expositions à l'attention du médecin traitant. M. Marc LETOURNEUX : Les compétences locales et régionales doivent être rassemblées. Je le répète, on ne peut se contenter d'une évaluation nationale. La tentation est grande d'utiliser les matrices emploi/exposition, c'est-à-dire d'attacher un niveau d'exposition à un poste de travail. C'est un très bon outil épidémiologique, mais cela ne suffit pas ; on ne peut faire l'économie du recueil des informations individuelles. M. Christophe PARIS : Il faut aussi distinguer l'exposition passée de la situation actuelle et colliger les risques quotidiens ; c'est d'ailleurs une aberration de ne pas avoir prévu le partage des informations sur les risques professionnels dans le dossier médical partagé. Une partie de notre travail, dans les centres de consultation de pathologie professionnelle des CHU, est aussi d'interroger les malades pour tenter de reconstituer les expositions et de faire le lien avec les pathologies déclarées. Si tout n'est pas encore réglé, l'évaluation rétrospective est maintenant en place, dans un protocole qui, en associant les ingénieurs de prévention des CRAM, les médecins du travail et les centres de consultations de pathologie professionnelle des CHU, permet de raisonner au cas par cas. Pour l'instant, il existe assez peu d'autres moyens de traiter le problème. M. Jean-Yves COUSIN : Vous conduisez un très important travail dans un champ expérimental très vaste. Les données collectées vous permettent-elles d'extrapoler le nombre de personnes ayant des plaques pleurales, celui des mésothéliomes et celui des individus qui ne sont pas malades bien qu'ayant été exposés ? M. Christophe PARIS : Les conclusions de l'expérimentation nous permettent de donner la prévalence des plaques pleurales - la pathologie la plus fréquente - par groupes professionnels ou par métiers : elle s'étage de 10 % à 35 % dans les métiers « classiques » de l'exposition. C'est l'un des intérêts épidémiologiques de la cohorte des 6 614 personnes qui ont fait le bilan auquel nous les invitions, et c'est pourquoi nous souhaitons continuer de la suivre. M. Marc LETOURNEUX : J'en viens aux problèmes de diagnostic. Quand on s'intéresse à des collectivités faiblement exposées, on est amené à s'intéresser aux images de petites anomalies très discrètes et, faute de groupes témoins, une relecture des scanners thoraciques est nécessaire, que nous avons, d'ailleurs, prévue dans le protocole. Car, d'une manière générale, quand on parle de fréquence et de prévalence, il faut aussi penser à l'outil utilisé, et savoir que la fiabilité de l'information collectée est bien meilleure avec des protocoles standardisés. M. le Rapporteur : Existe-t-il des moyens de détecter la présence de fibres d'amiante avant que des plaques pleurales ne se créent ? L'éventualité de prélèvements sanguins à cette fin a été évoquée devant nous ; qu'en pensez-vous ? La présence de plaques pleurales peut-elle avoir d'autres causes que l'exposition à l'amiante ? Est-il exact qu'une plaque pleurale ne dégénère pas forcément en tumeur maligne ? L'asbestose est-elle bien en voie de disparition en France ? Certaines projections mathématiques annoncent une mortalité considérable liée à l'exposition à l'amiante ; quelle est votre opinion à ce sujet ? M. Christophe PARIS : Nous ne disposons pas, à ce jour, d'outils validés permettant de détecter la population susceptible de développer une pathologie liée à l'exposition à l'amiante. On peut, certes, détecter des corps asbestosiques dans les expectorations, et cela même trente ou quarante ans après l'exposition, mais ce n'est là qu'un marqueur d'exposition et aucun moyen ne permet de dire qui, parmi ceux qui ont été exposés, développera une pathologie. Une littérature scientifique australienne et nord-américaine assez récente fait état d'un dosage de protéines qui seraient liées à l'apparition de mésothéliomes, mais il semble ne s'agir, là encore, pour l'instant, que d'un marqueur. De plus, les séries étudiées sont très petites et les résultats annoncés très préliminaires. Je ne crois donc pas à la découverte, à court terme, de marqueurs qui pourraient susciter l'espoir. Actuellement, le meilleur marqueur d'évaluation du risque est l'évaluation individualisée de l'exposition professionnelle et, pour l'asbestose, le niveau d'exposition. M. Marc LETOURNEUX : Les plaques pleurales ne dégénèrent pas et, selon quelques études, il ne semble pas qu'à exposition égale une personne porteuse de plaques pleurales présente plus de risque de développer un cancer pulmonaire qu'une personne qui n'en a pas. Quant à l'asbestose, c'est une maladie « à seuil », directement liée à une forte exposition à l'amiante. Dans l'expérimentation que nous avons conduite, les anomalies du poumon de ce type étaient soient inexistantes soient très discrètes et très peu nombreuses car les mesures de prévention ont déjà donné des résultats. Cette pathologie est devenue très rare. M. Christophe PARIS : Et cela, en dépit des progrès techniques considérables du dépistage. De par les mesures de prévention de l'exposition prises dans les années 70, l'asbestose est en voie de disparition en France, et les rares cas détectés au scanner sont d'une gravité bien moindre qu'il y a vingt ans. S'agissant des plaques pleurales, celles qui étaient liées à la tuberculose ayant très largement disparu, l'étiologie principale est maintenant l'amiante mais d'autres causes existent. Lorsque leur présence est unilatérale, le diagnostic, assez facile, est celui d'une séquelle de traumatisme ou de pleurésie. Lorsque les plaques sont bilatérales et dispersées, l'étiologie est celle de l'amiante. M. Marc LETOURNEUX : Il n'y a pas de diagnostic différentiel dans ce cas typique, et une telle anomalie évoque très significativement une exposition à l'amiante. Dans certaines régions du globe, on le sait, la population générale est porteuse de plaques pleurales, sans avoir été exposée à l'amiante - en Finlande par exemple, ou en Corse là où une serpentine affleure -, mais en Normandie les plaques pleurales bilatérales évoquent immanquablement l'exposition à l'amiante. Et, dans cette région, on aura tendance à imputer aussi à l'amiante un épaississement unilatéral, bien moins spécifique. M. Christophe PARIS : Pour ce qui est des projections, les modèles internationaux, qui reflètent l'interrogatoire systématique des patients atteints de cancers bronchiques, sont assez concordants et la fréquence de l'exposition professionnelle significative à l'amiante est compatible avec l'extrapolation du nombre de décès annoncés en France. En Haute-Normandie, la fréquence de l'exposition à l'amiante chez les patients atteints de cancer bronchique est de 30 % ; elle est de 20 % en Basse-Normandie, de 20 % à Grenoble, de 25 % en Lorraine et de 28 % à Créteil. A chaque fois que l'on recherche une exposition professionnelle chez ces sujets, on observe une prévalence d'exposition non négligeable. M. Jean-Marie GEVEAUX : L'expérimentation a-t-elle eu lieu en liaison avec l'Institut de veille sanitaire (IVS) ? M. Christophe PARIS : Non. Elle répond à une demande conjointe de la Direction des relations du travail du ministère de l'emploi et de la Direction des risques professionnels de la CNAMTS, et elle a été conduite sous la responsabilité scientifique de Mme Françoise Conso. M. Jean-Marie GEVEAUX : Conviendrait-il d'étendre l'étude à l'ensemble du territoire ? Mme Évelyne SCHORLÉ : Il conviendrait, certes, d'étendre la pratique du dépistage par scanner thoracique, en prenant toutes les précautions nécessaires tant pour ce qui est du niveau d'irradiation que pour la lecture des résultats. Mais cela impose d'adresser un nombre considérable de courriers proposant de se prêter au bilan. Pourra-t-on le faire ? M. Marc LETOURNEUX : Il faut insister sur le risque de pathologie différée et faire que tous ceux qui veulent un bilan médical puissent l'avoir. Cela suppose une information plus musclée des médecins du travail. Toutefois, aller ainsi chercher les personnes par la main jusqu'à un âge très avancé peut poser des problèmes éthiques. M. le Rapporteur : On sait que des employés ont été exposés à l'amiante, mais que l'entreprise dans laquelle ils travaillaient n'entre pas dans la nomenclature retenue. Parlons, aussi, de ces femmes de ménage qui nettoyaient les bureaux de l'établissement de la Direction des chantiers navals (DCN) de Cherbourg, bureaux situés dans les ateliers...Toutes ces personnes éprouvent des difficultés extrêmes à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité, alors qu'elle ont été exposées. Nous essayons de les aider mais, bien souvent, les activités professionnelles au cours desquelles elles ont été exposées ont eu lieu par le biais de la sous-traitance, ou il s'agit, comme on le voit, d'activités qui ne sont pas directement liées à la production ou à la transformation de l'amiante et, dans ces deux cas, les problèmes sont considérables. M. Marc LETOURNEUX : Le fléchage sur des listes officielles d'entreprises exposantes est, en effet, particulièrement insatisfaisant. Il a pour conséquence que tout le personnel de ces entreprises bénéficiera de l'allocation de cessation anticipée d'activité, alors même que certains salariés n'ont pas été exposés, cependant que des personnes intervenues sur des sites notoirement exposants mais dans le cadre de la sous-traitance ne pourront bénéficier du dispositif s'ils n'ont pas de pathologie liée à l'amiante. Il y a là une distorsion flagrante du traitement social. M. Christophe PARIS : La différence est patente. Ainsi, tel mécanicien exposé toute sa vie à un niveau non négligeable d'amiante, parce qu'il a travaillé trente ans dans un garage à garnir les freins des poids lourds, et pour lequel le scanner n'aura pas décelé de plaques pleurales, sera exclu du dispositif. Au contraire, d'autres sujets, moins exposés, en bénéficieront, alors que 80 % d'entre eux n'auront pas de pathologie liée à l'exposition. La distorsion du traitement social est manifeste. M. le Président : La réponse sociale a été ciblée sur de entreprises précises. La tentation de l'élargir existe, mais la maîtrise du champ d'intervention devient alors extrêmement aléatoire. Ce serait probablement plus juste, mais si l'on en vient à raisonner uniquement par métiers et non plus par entreprises, le dispositif va devenir redoutablement complexe et la charge extraordinairement lourde. M. Marc LETOURNEUX : Il serait légitime d'indemniser l'exposition, puisque le fait d'être porteur de plaques pleurales ne signifie pas un risque à long terme. Le mécanisme actuel crée une iniquité majeure. Si l'on disposait d'une cellule efficace d'authentification des niveaux d'exposition, on pourrait indemniser l'exposition comme on indemnise l'usure professionnelle. S'en tenir, comme c'est le cas actuellement, à une liste d'entreprises est un compromis qui n'est pas satisfaisant. M. le Président : L'idée d'indemniser l'exposition est pertinente, mais les outils manquent. Mme Évelyne SCHORLÉ : Encore faut-il, en plus, avoir la maîtrise des outils éventuellement mis au point. M. le Président : Madame, Messieurs, je vous remercie. Audition de M. François MARTIN, président de l'Association de défense des victimes de l'amiante de Condé-sur-Noireau (ALDEVA) Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Nous accueillons M. François Martin, président de l'Association de défense des victimes de l'amiante de Condé-sur-Noireau (ALDEVA), que nous avons souhaité entendre car cette commune est au cœur du drame de l'amiante. C'est en effet dans le voisinage de Condé-sur-Noireau qu'a été établi, en 1906, le premier rapport de l'inspection du travail sur les dangers de l'amiante. Il portait sur une usine textile où les ouvriers manipulaient l'amiante pour fabriquer des joints ou des cordelettes. Un mémorial vient, d'ailleurs, d'être inauguré en souvenir des nombreux habitants de la vallée de la Vère qui n'ont pas survécu à la contamination par le produit qu'ils respiraient chaque jour dans ces ateliers textiles ou, plus tard, dans l'usine d'équipement automobile Ferodo. Notre collègue Jean-Yves Cousin et notre Rapporteur, Jean Lemière, connaissent très bien ces faits. En adoptant, à l'unanimité, son programme de travail, la mission d'information a souhaité en premier lieu rappeler cette histoire terrible qui est au premier chef la vôtre, hélas, et rappeler aussi le retard pris dans bien des décisions. Le rapport que vient de publier le Sénat va d'ailleurs en ce sens. Mais, au-delà de l'histoire, il faut définir les moyens d'action. Dans cette optique, notre mission s'est longuement penchée sur le traitement de l'amiante résiduel. Elle a ensuite axé sa réflexion sur la prévention des risques professionnels, qu'il s'agisse de l'amiante ou d'autres substances. Nous en venons à un autre volet de nos travaux, consacré à l'indemnisation des victimes et aux départs anticipés à la retraite. On ne corrigera certes pas les conséquences de l'exposition à l'amiante, mais il faut essayer de définir l'accompagnement social le plus juste possible. Nous poursuivrons ensuite notre tâche en nous penchant sur la question de la responsabilité et donc sur l'aspect pénal du dossier. À cet égard, nous attendons avec beaucoup d'intérêt l'arrêt que doit rendre la Cour de cassation. Nous aborderons pour finir la dimension internationale du problème. Nous pensons ainsi tirer tous les enseignements nécessaires d'une histoire dramatique et contribuer à en corriger les effets. M. François MARTIN : La question de l'amiante se pose de manière emblématique à Condé-sur-Noireau, et nous sommes, malheureusement, presque certains qu'il en sera ainsi pendant des décennies encore. Les pathologies induites par l'exposition à l'amiante ayant la gravité que l'on sait, les victimes ont droit à l'indemnisation de leur préjudice. Mais, au-delà de la réparation, le problème est que l'on n'entend parler ni de recherche, ni de thérapeutique : nous ne savons pas ce qui se fait, ni même si quelque chose se fait. Dans ces conditions, on peut s'interroger sur l'utilité d'un suivi médical spécifique. Il ne suffit pas d'indemniser et, sans recherche, on risque de devoir indemniser pendant des années. S'il est acquis que les malades ne pourront être guéris, qu'on le dise carrément. Mais, si c'est le cas, la responsabilité des entreprises, et celle de l'État par ricochet, paraît encore plus importante qu'elle ne l'est actuellement. De plus, l'exposition à l'amiante est une chose mais bien d'autres personnes sont exposées à des substances cancérigènes au cours de leur carrière professionnelle. L'Institut de veille sanitaire (IVS) a indiqué que de telles substances sont utilisées en très grande quantité dans l'industrie, sans que les employeurs prennent des mesures de précaution particulières, alors même que les salariés qui les manipulent sont mis en danger. Le suivi doit être fait dès l'amont. D'ailleurs, un rapport préliminaire décrivant un programme expérimental de suivi post-professionnel des salariés exposés à l'amiante vient d'être remis au ministre du travail, dont les auteurs préconisent, notamment, que le suivi médical ait lieu dès l'âge de cinquante ans, quand les salariés sont encore au contact de l'amiante. Ils recommandent également la réalisation de scanners thoraciques. Et pour cause : les radiographies pulmonaires n'ont aucun effet en matière de dépistage, et lorsqu'elles montrent quelque chose, c'est que le malade est déjà dans un état catastrophique. Les spécialistes précisent que les scanners réalisés avec les nouveaux appareils ne présentent pas plus de risques d'irradiation qu'une promenade dans la Bretagne granitique et qu'il sont très utiles pour l'indemnisation des victimes. Après que le rapport aura été complété, en juin 2006, les autorités devraient être amenées à prendre des décisions constructives s'agissant du suivi des personnes touchées. Pour ce qui est de la réparation proprement dite, on pourrait nous reprocher de ne nous intéresser qu'aux victimes de l'amiante, alors que d'autres personnes meurent, elles aussi victimes de produits cancérigènes utilisés dans leur exercice professionnel. C'est pourquoi nous considérons que les autres victimes de maladies professionnelles graves méritent d'être indemnisées dans les mêmes proportions que les victimes de l'exposition à l'amiante. Prenons l'exemple d'un chantier naval où ont travaillé, côte à côte, un charpentier métallique et un charpentier bois. Si le premier meurt victime de l'amiante, il sera indemnisé au travers d'un dispositif spécifique, cependant que son collègue, atteint d'un cancer induit par l'inhalation de poussière de bois, n'obtiendra pas réparation. Ce n'est ni juste ni logique. Le scandale de l'amiante, en montrant l'inadaptation des dispositifs de réparation des maladies professionnelles, a permis de faire avancer les choses en matière de réparation et de mieux indemniser les victimes. On est toutefois loin de l'indemnisation totale à laquelle elles peuvent prétendre car, lorsque le principe de l'indemnisation a été décidé, son montant a été défini en tenant compte de l'espérance de vie des personnes qui avaient été exposées à l'amiante, laquelle est inférieure de dix ans à celle des personnes qui n'y ont pas été exposées. La Cour des comptes a remis ce mode de calcul en cause et incité à une indemnisation fondée sur d'autres critères. Il est vrai que la situation actuelle est contestable à bien des égards, puisque certains malades ne peuvent bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité au motif que l'entreprise pour laquelle ils travaillaient ne figure pas dans la liste fixée par décret. Non seulement cette liste est bien trop restrictive, mais un grand nombre de personnes qui n'ont jamais travaillé dans une des entreprises considérées sont pourtant atteints. Et ces victimes « environnementales », bien que frappées comme leurs proches le sont, ne peuvent faire valoir leurs droits. De plus, ni les membres des professions libérales ni les fonctionnaires ne peuvent prétendre à cette allocation. Cette situation est parfaitement anormale. Il est exact que tous les salariés n'ont pas été pareillement au contact de l'amiante et que les maladies dont ils souffrent ne sont pas les mêmes. Mais l'on oublie de prendre en compte un facteur de risque qui concerne des personnes apparemment indemnes aujourd'hui : la poussière d'amiante est volatile, si bien que commencent à se déclarer - à Condé-sur-Noireau en tout cas - des pathologies qui frappent des secrétaires et des cadres, qui meurent, eux aussi, bien qu'ils n'aient pas été directement exposés. Il faut savoir aussi ce qui s'est passé dans la sidérurgie : les entreprises ont massivement utilisé l'amiante produit à Condé-sur-Noireau, et nombreux sont maintenant leurs anciens salariés à être empoisonnés eux aussi. Pourtant, ils ne peuvent prétendre à indemnisation, alors que dans la même région, une autre entreprise dans laquelle on manipulait le produit fini a, elle, été portée sur la liste fixée par décret... Peut-être entendait-on régler ainsi un certain problème social, mais peut-on parler d'égalité entre les citoyens dans ces conditions ? Cela dit, puisque j'entends évoquer sotto voce le nom de Moulinex, je tiens à souligner que, contrairement à ce que l'on a pu dire, certains salariés ont été rendus malades par leur exposition à l'amiante dans cette entreprise. Pour mettre un terme à cette inéquité, peut-être faudrait-il raisonner par métiers plus que par entreprises. Pensez à tous ces garagistes qui ont inhalé de l'amiante pendant des décennies ! Je suis persuadé qu'aujourd'hui encore certains véhicules contiennent des produits amiantés. Les mécaniciens continuent de les démonter et de les poncer, ce qui constitue un risque majeur pour leur santé, et nombreux sont touchés. Quant à ceux qui ont manipulé le produit fini, pour l'aléser par exemple, ils ont produit une poussière encore plus fine que celle qu'inhalaient les salariés de la fabrication ; ceux-là sont victimes de mésothéliome et non « seulement » de plaques pleurales. Les dossiers dont j'ai à connaître depuis deux ou trois ans le démontrent. La même chose vaut dans le monde agricole car, dans notre beau pays, il y a de l'amiante partout. Ainsi, tous les bâtiments agricoles sont recouverts de plaques de fibrociment, et les agriculteurs les installent sans prendre de précautions particulières. Ils prennent ainsi des risques considérables, mais ils l'ignorent. Dans le secteur de la mécanique agricole il y a aussi bien des salariés atteints. Le temps de latence étant celui que l'on connaît, tout cela fait froid dans le dos. Le préjudice moral est considérable. A Condé-sur-Noireau seulement, 80 % des foyers comptent un malade au moins, et parfois des familles entières sont atteintes. Les scientifiques ont beau affirmer qu'il n'y a pas de relation entre la présence de plaques pleurales et la survenue d'un mésothéliome, on sait que tous ceux qui meurent des suites d'un mésothéliome, ou d'un cancer broncho-pulmonaire qui trouve son origine dans l'exposition à l'amiante, ont eu des plaques pleurales. Il faut se mettre à la place de ces personnes et comprendre qu'elles méritent une importante réparation. A ce sujet, vous savez sans doute que l'ALDEVA a engagé des procédures contre des entreprises dans le cadre de la faute inexcusable de l'employeur. Si nous avons décidé d'agir ainsi, c'est que l'indemnisation proposée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) n'est pas ce qu'elle devrait être. Certes, nous n'obtiendrons pas du FIVA ce que certains tribunaux ont accordé, mais si l'indemnisation consentie par le fonds était meilleure, nous encombrerions certainement moins les prétoires. Encore faudrait-il aussi que la question de la responsabilité pénale ne soit pas éludée. Les victimes attendent une issue pénale en mémoire de leurs proches. Ils veulent entendre expliquer comment on en est arrivé au scandale qu'est cet empoisonnement massif, et que soient définis les moyens permettant d'éviter qu'une telle tragédie se reproduise. Les poursuites pénales auraient un aspect pédagogique, considération qui a aussi sous-tendu l'édification du mémorial inauguré le 1er octobre dernier à Condé-sur-Noireau. Il ne s'agit pas tant que des gens aillent en prison que de dire pourquoi cette catastrophe a eu lieu, pourquoi rien n'a été fait, et de garantir que cela ne recommencera pas. Or, les entreprises qui ne fabriquent plus d'amiante fabriquent désormais des produits à base de fibres céramique et de fibres de verre, dont on sait qu'ils sont également cancérigènes. Pourtant, elles n'ont en rien amélioré la sécurité de leurs employés, qui manipulent ces produits comme ils manipulaient autrefois l'amiante. M. le Président : Je vous remercie. Vous avez posé le problème dans toutes ses dimensions, et votre intervention rejoint la logique de nos travaux. L'objectif de notre mission est bien qu'une leçon soit tirée du drame de l'amiante, afin qu'il ne se reproduise pas lors de la manipulation d'autres produits cancérigènes comme il en est inventé tous les jours. Voilà pourquoi nous avons souhaité entendre les représentants de toutes les structures qui ont un rôle dans la prévention, en organisant une table ronde à cette fin. Cela nous a conduits à nous interroger sur les relations qu'elles entretiennent entre elles, sur l'absence criante de moyens et sur la manière de renforcer leur efficacité. Comme vous le constatez, nos préoccupations rejoignent les vôtres. S'agissant du suivi post-professionnel des salariés de l'amiante, nous avons entendu ce matin même les professeurs Letourneux et Paris, ainsi que Mme Schorlé. Ils nous ont donné une idée précise de l'étude expérimentale entreprise, des conclusions auxquelles ils ont abouti et de la nécessité d'étendre le processus de suivi. Là encore, nos préoccupations sont communes. Pour ce qui est de la prévention, nous suivons de très près le « Plan santé au travail » mis en place, à juste titre, par le Gouvernement. Nos interrogations ne portent, d'ailleurs, pas tant sur le plan lui-même, qui constitue un progrès indéniable, que sur les moyens dont on dispose pour l'appliquer, qu'il s'agisse de l'inspection du travail, de la médecine du travail, de la coordination des structures ou du renouvellement des générations de scientifiques qui partent à la retraite. S'agissant de la cessation d'anticipée d'activité, j'ai suivi ce dossier avec attention lorsque j'étais président de la commission des affaires sociales. Je vous rappelle qu'il s'agissait d'un dispositif nouveau. Nous sommes partis des plus grandes entreprises, celles qui utilisaient l'amiante dans de grandes proportions. Nous avons parfaitement conscience que, même si cette étape a été importante, elle est relativement inégalitaire, parce que l'on a davantage tenu compte des plus grandes entreprises, parce que la sous-traitance n'est pas traitée, tout comme les salariés des PME, et parce que certains métiers, et notamment ceux du bâtiment, sont pratiquement ignorés. Il est donc exact que d'importants problèmes demeurent, qu'il n'est pas très commode de traiter. Peut-on réellement envisager un suivi personnalisé de chaque carrière et de chaque métier ? M. François MARTIN : Il est certain que si la réparation était estimée par métiers, le dispositif serait plus juste ; mais il est vrai que cela entraînerait des coûts importants. M. le Président : Il faut aussi mesurer l'extraordinaire difficulté qu'il y aurait à reconstituer des carrières de plus en plus discontinues. En bref, nous sommes conscients du problème, nous avons abordé toutes ces questions au cours de nos travaux, et vos préoccupations, dans ce domaine aussi, rejoignent les nôtres. Mais le problème est complexe et il faut être prudent. Je ne m'appesantirai pas sur les quelques cas où l'allocation de cessation anticipée d'activité a été utilisée pour résoudre, comme vous l'avez dit, des problèmes sociaux, car s'ils existent, ces cas restent marginaux. Pour ce qui est du traitement de l'amiante résiduel, notamment dans le monde rural, notre préoccupation est tout aussi réelle, mais aucune réponse n'est véritablement satisfaisante. Je suis donc très content de savoir que la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) a décidé la réalisation d'un audit. Il y a également la question du traitement des déchets et je note aussi que les artisans ont tendance à éluder le problème, faute de savoir comment le traiter. S'agissant de l'indemnisation, je connais la revendication de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante (ANDEVA) relative au barème du FIVA. Vous imaginez bien qu'à titre personnel je serais favorable à une révision, mais il se trouve que la question a été tranchée par le conseil d'administration du fonds, au terme d'arbitrages difficiles. J'observe que les procédures conduites par le FIVA ont notablement progressé : le coût de traitement d'un dossier est très raisonnable et, après une phase de démarrage, les délais de traitement sont devenus relativement courts. M. François MARTIN : En ma qualité de représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) au sein du conseil d'administration du FIVA, je ne vous démentirai pas sur ce point. M. le Président : Les progrès accomplis sont donc incontestables. Quant à savoir si le barème doit être revu, la question peut se poser. Mais, puisque vous avez évoqué des actions en justice fondées sur la faute inexcusable de l'employeur, j'aimerais savoir s'il est exact que les honoraires des avocats s'élèvent, dans ce cas, à 10 % en moyenne des sommes allouées. M. François MARTIN : Il n'y a pas de moyenne mais un seuil : les honoraires des avocats ne peuvent dépasser 10 %. Et même en ce cas, la réparation obtenue du tribunal, déduction faite de ces honoraires, demeure supérieure à l'indemnisation accordée par le FIVA. Je souhaite par ailleurs rappeler que, dès l'origine, nous avons voté contre un barème que nous estimions insuffisant. A l'époque, il nous a été dit que si ce barème, adopté par la majorité du conseil d'administration, devait être revu, il le serait en fonction des décisions prises par les tribunaux. Le même processus a valu pour le sang contaminé : le barème fixé a été contesté, des actions en justice ont eu lieu, le barème a été revu et il n'y a désormais plus de procédures. M. le Président : La question pénale est également au cœur de nos préoccupations. Nous étudierons attentivement l'analyse du Sénat et nous entendrons le sénateur Pierre Fauchon. Nous attendons aussi avec un grand intérêt, je vous l'ai dit, le prochain arrêt de la Cour de cassation, dont on peut espérer qu'il créera une jurisprudence. M. François MARTIN : Nous attendons tous avec un grand intérêt l'arrêt de la Cour de cassation, car, s'il ne résout pas tout, il améliorera bien des choses. En effet, la loi Fauchon est invoquée à tort et à travers : il y a quelque temps, l'avocat d'un employeur a même cru bon de le faire à propos d'un accident mortel du travail ! M. le Président : Le sénateur Pierre Fauchon a dit lui-même qu'il existait des utilisations abusives de la loi dont il a été l'inspirateur. Peut-être la Cour de cassation confirmera-t-elle cette thèse. A titre personnel, je considère que la jurisprudence est parfois la voie la meilleure pour tenir compte des évolutions et que, dans certains cas, mieux vaut s'en tenir à la jurisprudence que de légiférer. Je le pensais, avec Claude Evin, pour ce qui était de l'arrêt Perruche, et la Cour européenne de justice nous a donné raison après coup. M. Jean-Yves COUSIN : Je vous remercie de votre présence, et je ne doutais pas que vous exposeriez l'ensemble des aspects du dossier. Vous nous avez rappelé que vous siégiez au conseil d'administration du FIVA comme représentant de la FNATH et vous avez rappelé que le barème du FIVA ne vous satisfait pas. Avez-vous envisagé de l'attaquer devant le tribunal compétent ? Vous avez, par ailleurs, évoqué nombre des questions qui nous préoccupent au sujet de la cessation d'activité anticipée. Avez-vous quelques idées de pistes à explorer qui permettraient plus d'équité ? Vous avez aussi parlé du suivi post-professionnel et, singulièrement, de l'étude expérimentale qui vient de se dérouler dans quatre régions, dont la Normandie. Avez-vous été associés aux travaux du groupe de travail, très rigoureux, animé par le professeur Letourneux ? Celui-ci a appelé notre attention sur la solution de continuité du suivi médical entre le moment où les salariés sont en activité et celui où ils sont pensionnés. Qu'en pensez-vous ? M. Francis VERCAMER : J'ai particulièrement apprécié votre intervention relative aux victimes de substances autres que l'amiante. Mes questions porteront sur les victimes potentielles de l'amiante résiduel dans l'agriculture et dans les autres secteurs. Pouvez-vous recommander une méthode d'information ? Actuellement, on assiste à une sorte de mouvement de panique qui créé l'engorgement des hôpitaux et qui fait que l'on a du mal à cerner quels sont les gens vraiment malades. Dans un tel contexte, ne pensez-vous pas que le fait de médiatiser des rapports tels que celui du Sénat va à l'encontre de l'intérêt des victimes véritables ? La question peut d'autant plus se poser que vous avez évoqué la peur du diagnostic, si l'on ne peut offrir de thérapeutique efficace aux victimes potentielles. M. François MARTIN : Lorsque le barème du FIVA a été fixé, nous aurions, certes, pu le contester devant le Conseil d'Etat, mais il nous a semblé plus juste de faire établir son insuffisance par la jurisprudence. S'agissant de l'indemnisation des victimes, je rappelle que le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) et le FIVA sont alimentés à près de 90 % par les cotisations des employeurs, et pour le reste par l'Etat - lorsqu'il n'oublie pas de le faire, comme ce fut le cas l'an dernier.... Si l'on tient à ce qu'une prévention efficace s'instaure, il faut imposer une véritable réparation. Ainsi seulement contraindra-t-on les employeurs à une prévention réelle. Actuellement, la quasi mutualisation du risque a un effet pervers, qui ne se manifeste pas lorsque nous attaquons pour faute inexcusable de l'employeur : dans ce cas, c'est bien l'employeur fautif qui est condamné à payer, et lui seul. Lorsque le risque est mutualisé, la sanction ne leur coûte rien. On entend les entreprises se plaindre de manière récurrente de ce que les cotisations sont élevées. Le fait est que les employeurs qui n'ont jamais exposé leurs salariés à l'amiante sont pénalisés, puisqu'ils paient pour les grosses entreprises qui, elles, ont exposé leurs salariés à cette substance - et cela n'est jamais dit ! Pourquoi les entreprises mettraient-elles en place des actions de prévention, puisqu'elles ne sont pas sanctionnées si elles ne le font pas ? Il faut que le principe « empoisonneur/payeur » entre dans les faits. On peut faire un parallèle avec la diminution du nombre de morts sur les routes : M. de Robien a expliqué que les sanctions avaient conduit à une prise de conscience. Si le même principe était appliqué aux entreprises, je suis persuadé que la prévention s'améliorerait. Encore faudrait-il que la prévention soit faite autrement qu'elle n'est faite aujourd'hui. Pour être vraiment efficace, la médecine du travail devrait être vraiment indépendante et les CRAM devraient pouvoir intervenir quand un problème est détecté. Je me dois d'ajouter que si la médecine du travail avait mis le holà à temps, on n'en serait pas là. Quand on affirme faire de la prévention, on ne met pas son mouchoir sur ce que l'on sait ! Les salariés en activité sont examinés par la médecine du travail traditionnelle. Le médecin du travail sait quels salariés ont été exposés à l'amiante ; c'est donc à lui de recommander les examens nécessaires au diagnostic éventuel de plaques pleurales. Mais, s'il s'agit de passer des scanners, encore faut-il que l'employeur les paie. Pour ce qui est de l'étude expérimentale, nous avons eu plusieurs réunions avec les professeurs Letourneux et Paris, et nous avons contribué, tout comme les caisses de sécurité sociale, à diffuser l'information sur la possibilité du suivi post-professionnel. Cependant, pour qu'un tel suivi soit pris en charge dans le cadre de la branche accidents du travail - maladies professionnelles (AT-MP), il faut apporter la preuve de l'exposition à l'amiante. Il existe bien un certificat d'exposition, mais les salariés concernés éprouvent souvent les plus grandes difficultés à obtenir ce précieux document. Je me félicite d'avoir entendu un représentant patronal affirmer que la loi doit être appliquée et que ceux qui ne l'appliquent pas doivent être poursuivis, mais il n'empêche, bien des difficultés persistent. Pour ce qui est des victimes potentielles, elles sont nombreuses, puisque l'on estime à 37 % la proportion des retraités de France qui ignorent avoir travaillé au contact de l'amiante. Les Caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) s'attachent à diffuser l'information sur le suivi médical spécifique, et nous les relayons. Si panique il y a, elle ne tient pas tant aux conséquences de l'exposition à l'amiante qu'à la crainte de ce que le scanner pourrait faire découvrir : voilà ce dont les gens ont peur. Pour ma part, je ne pense pas que la médiatisation pourrait provoquer une panique. En revanche, j'estime que si l'on a connaissance d'un problème, il faut le prévenir. Enfin, pourquoi devrait-on s'abstenir de tout tapage sur les conséquences de l'exposition à l'amiante, alors que l'on n'entend parler que de grippe aviaire ? M. le Président : Ne nous faites pas dire ce que nous ne pensons pas ! M. François MARTIN : Je ne mets pas en cause votre mission, qui permet que nous nous exprimions. M. le Président : C'est pourquoi nous avons souhaité vous recevoir, et notre collègue Jean-Yves Cousin tout particulièrement. Nous comprenons tous que la situation de la commune doit être terrible. M. François MARTIN : Elle l'est. L'entreprise considérée a employé plus de 2 500 salariés jusqu'à la fin de l'année 1975, sans compter les intérimaires. Les gens y travaillaient volontiers, car c'était elle qui offrait les meilleures rémunérations dans la région. Je précise d'ailleurs qu'il s'agissait, à l'origine, d'une société anglaise, qui cherchait à s'implanter en France dans une région tranquille où les populations n'étaient pas révoltées. Il est certain que le risque de manifestations était moindre à Condé-sur-Noireau qu'à Dunkerque, par exemple. De fait, pour beaucoup d'habitants, l'entreprise était leur gagne-pain et beaucoup rechignent encore à revendiquer. M. Jean-Yves COUSIN : J'ai, moi-même, eu l'occasion de constater la grande dignité des victimes et de leurs familles. M. le Président : On n'imagine que trop bien le sentiment d'oppression qui doit toucher les 80 % de foyers concernés. Vous avez pris l'exemple du dispositif très sévère de contrôle de la vitesse des voitures et des résultats positifs enregistrés, faisant un parallèle implicite entre la question de l'exposition à l'amiante et le système assurantiel de « bonus/malus » qu'il vous semblerait utile d'instaurer pour convaincre les entreprises d'agir en faveur d'une prévention plus efficace. Nous savons, d'ailleurs, que dans d'autres pays le système mis au point penche davantage que le nôtre vers l'assurance. Cependant, chacun le sait, le temps de latence est très long ; dans ces conditions, doit-on raisonner en fonction de la durée de vie d'une entreprise, alors que les entreprises vivent et meurent ? Pour que les salariés puissent bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité, il fallait, à l'origine, effectuer un véritable parcours du combattant pour reconstituer les carrières individuelles. Dans ce contexte, la mutualisation est aussi une garantie. De plus, il est exact qu'à ce jour les entreprises concernées sont de grandes entreprises, mais l'on sait que demain seront concernées des PME et des entreprises artisanales. La mutualisation permet donc l'alimentation d'un fonds garanti par les cotisations et donc un certain niveau de réparation, même si vous pouvez le juger insuffisant. M. François MARTIN : Vous avez certainement raison sur le fond, mais je rappelle que la branche AT-MP est, elle-même, fondée sur un régime assurantiel. Que la mutualisation soit une garantie, j'en suis d'accord, mais je maintiens qu'il est anormal que les entreprises où l'on compte un nombre important de victimes d'exposition à l'amiante ne s'en trouvent pas plus mal que les autres. M. le Président : Mais demeurez-vous favorable, ou non, à la mutualisation du risque ? M. François MARTIN : Je suis favorable à la mutualisation du risque global. Mais, une fois encore, si le scandale de l'amiante a permis que les victimes de l'exposition à ce matériau soient indemnisées, ce n'est pas le cas pour les victimes d'autres maladies professionnelles graves. Cette disparité de traitement est injuste et, si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue par le tribunal, l'employeur doit payer pour cette faute. Jusqu'à la fin 2003, la branche AT-MP était excédentaire. Depuis, elle est déficitaire et l'on a expliqué ce déficit par l'indemnisation des victimes de l'amiante qui représente, c'est vrai, un coût très important, même si les sommes versées sont encore insuffisantes. Mais dois-je rappeler quelle est la règle du financement de la branche AT-MP ? S'il y a un excédent, les cotisations baissent ; lorsqu'on constate un déficit, les cotisations augmentent. Ce système doit être appliqué ! Aujourd'hui il ne l'est pas, si bien que le bistrotier du coin de la rue doit payer une cotisation AT-MP qui représente dix fois le risque auquel il expose ses salariés. Ce dispositif est anormal. Pour autant, il ne convient pas de s'écarter du système en vigueur. Des outils existent, qui ont fait la preuve de leur efficacité, autant s'en servir en surveillant la manière dont ils sont utilisés, sans en créer de nouveaux. J'observe enfin que si ces outils relevaient du régime de la sécurité sociale, il n'y aurait aucun problème de barème d'ordre médical. Seul demeurerait celui de l'indemnisation. M. le Président : Je vous remercie pour cette très intéressante contribution à notre débat, qui se poursuivra avec les représentants de l'ANDEVA. Audition de M. François DESRIAUX, président de l'Association nationale des victimes de l'amiante (ANDEVA), accompagné de MM. Michel PARIGOT, Alain BOBBIO et André LETOUZÉ Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Avant que nous ne reprenions le dialogue que nous avons commencé la semaine dernière sur le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), je voudrais vous signaler que nous sommes de plus en plus souvent sollicités par certaines personnes, qui n'ont pas eu de carrière continue dans l'administration territoriale ou qui, appartenant à l'administration territoriale, ont travaillé dans des établissements amiantés. Elles revendiquent le bénéfice du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA). Sauf lorsqu'il y a eu constat de maladie, il est difficile de leur répondre, dans la mesure où l'accès au FCAATA est fonction de listes globales. C'est tout le débat entre une éventuelle individualisation de l'approche et le ciblage sur un métier ou une entreprise donnée. J'aimerais que vous me fassiez part de votre réaction en la matière. M. André LETOUZÉ : Le problème concerne toutes les administrations, dont certains salariés ont pu être fortement exposés à l'amiante. Il faudrait étendre le système existant à d'autres secteurs d'activités et mieux cibler les personnes qui ont été exposées, même si ce n'est pas facile. Dans un garage, par exemple, peuvent être concernés ceux qui travaillaient dans l'atelier, mais aussi dans le bureau attenant ou dans le magasin. Nous avons eu l'occasion d'en discuter au ministère. Dans les fonderies ou dans les verreries, des personnes ont été exposées, d'autres ne l'ont pas été, simplement parce que le processus de fabrication n'était pas le même. Voilà pourquoi il faudrait pouvoir aller au plus près du travail effectif. M. François DESRIAUX : Cette question a fait débat au sein de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante (ANDEVA). Jusqu'à présent, les pouvoirs publics ont fait entrer dans le dispositif des secteurs où l'ensemble des salariés avait été massivement exposé. Mais il y a des secteurs où seule une partie d'entre eux l'a été. Et d'autres encore où ce sont seulement des individus, non identifiables sur le seul critère de leur métier, qui ont été exposés. Quel système mettre en place ? Cela suppose de repérer les expositions et de fixer des critères pour déterminer ce que signifie avoir été « massivement exposé » ou « fortement exposé ». Ce n'est pas simple, mais c'est indispensable, car on ne saurait se satisfaire du système actuel. M. le Président : Il n'existe pas de réponse toute faite à ce problème. Il faut être, par ailleurs, conscient que si l'on fait glisser le système vers l'individualisation, on risque de se heurter, en raison du temps de latence, à des difficultés impossibles à maîtriser. M. Michel PARIGOT : Des pistes existent néanmoins. Le FIVA, en cas de cancers broncho-pulmonaires et plus généralement de cancers multifactoriels, s'adresse à une commission d'évaluation des expositions qui intervient au niveau individuel. S'agissant du FCAATA, il ne faudrait pas que la démarche soit purement individuelle, car il est quand même possible de cerner des catégories. Nous disposons déjà de données sur les expositions. Mais il faudrait mettre en place une véritable structure, dédiée au problème, et pas seulement un fonctionnaire. M. Alain BOBBIO : Je voudrais évoquer l'expérience de suivi médical post-professionnel menée dans quatre régions pilotes. Dans le Rhône, par exemple, la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a choisi, sur la base de données concrètes, d'inclure la chimie lourde dans ce suivi médical. Je souhaiterais, par ailleurs, qu'on n'oublie pas d'aborder le problème de l'amélioration du système d'indemnisation de la sécurité sociale, qui pose des problèmes distincts de ceux du FIVA, ni le problème de l'amiante en Nouvelle-Calédonie. M. le Président : Je vous propose de nous faire parvenir des contributions sur ces points, si cela est nécessaire. M. Michel PARIGOT : Dans votre questionnaire, vous avez évoqué la divergence d'indemnisation existant entre le fonds d'indemnisation et les tribunaux, et le manque d'homogénéité des indemnisations entre les tribunaux eux-mêmes. Ce manque d'homogénéité n'est pas spécifique aux victimes de l'amiante. Il s'inscrit dans le problème plus global de l'indemnisation du dommage corporel par la voie judiciaire : les niveaux d'indemnisation ne sont pas publiés ; seuls les assureurs disposent des données en dommage corporel, celles figurant sur le minitel étant très partielles. Par ailleurs, les tribunaux ne motivent pas leurs jugements, ce qui conduit certaines cours d'appel à appliquer, implicitement, des principes différents. Une réflexion générale est en cours, au niveau du ministère de la justice et de la Cour de cassation, au moins sur le premier point, c'est-à-dire la publicité des niveaux d'indemnisation, qui permettrait d'aboutir à leur uniformisation. On pourrait l'étendre au domaine de l'amiante. M. le Président : C'est ce qui ressort de vos rencontres avec le ministère de la justice ? M. Michel PARIGOT : Pas vraiment. Ces réflexions sont en cours, au Conseil national de l'aide aux victimes (CNAV) ou à la Cour de cassation, laquelle est en train d'établir un rapport sur ce sujet. Mais les réflexions sont parcellaires et se font dans le secret, alors que l'indemnisation des victimes est un problème de société qui mériterait un large débat. Dans le cas de l'indemnisation des victimes de l'amiante, le FIVA aurait pu être un facteur d'uniformisation. Mais il aurait fallu pour cela qu'il accepte de prendre, comme niveau d'indemnisation, le niveau moyen des tribunaux. On aurait pu, alors, espérer que, par la suite, les tribunaux s'alignent sur lui. Il ne l'a pas accepté et cela lui a fait perdre sa légitimité auprès des tribunaux. Il apparaît maintenant comme une sorte de tribunal particulier qui contribue à l'hétérogénéité de l'ensemble. On pourrait envisager de confier le contentieux d'appel des offres d'indemnisation à une cour d'appel unique, et nous n'y sommes pas défavorables. Reste qu'une telle solution, qui aurait été facile à mettre en œuvre à l'origine, poserait maintenant des problèmes délicats. Si l'on décidait de le faire, il faudrait en tout cas s'appuyer sur des critères objectifs : la compétence et la spécialisation. La première chambre de la cour d'appel de Paris, spécialisée dans les questions de santé, et qui s'occupe déjà du contentieux du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH), nous semble être le seul choix raisonnable ; le niveau d'indemnisation qu'elle accorde n'est d'ailleurs pas très loin de la moyenne des tribunaux. Sur le plan des principes, l'architecture générale du système nous semble satisfaisante : celui-ci est destiné à indemniser rapidement les victimes, il offre une réparation intégrale de droit commun sous contrôle des tribunaux, il doit engager les actions subrogatoires pour mettre l'indemnisation à la charge du responsable et enfin, il laisse le choix aux victimes entre la voie judiciaire et la voie du fonds d'indemnisation. Malheureusement, en pratique, la réparation intégrale n'est pas véritablement appliquée. L'architecture de départ du barème d'indemnisation, à l'élaboration duquel nous avons contribué, était bonne. Mais, pour des raisons financières, un arbitrage inadéquat a eu lieu y compris sur des principes d'indemnisation qui sont donc aujourd'hui contestés devant les cours d'appel. Nous allons sans doute gagner, mais cela risque de prendre des années. Nous souhaiterions donc que ces problèmes soient résolus sans qu'on ait à passer devant les cours d'appel, du moins quand les plus importantes d'entre elles, dont celle de Paris, auront tranché. Il n'est ni dans l'intérêt du fonds d'indemnisation ni dans celui des victimes que de tels contentieux traînent en longueur. Si, en principe, les victimes ont le choix entre l'indemnisation par le FIVA et la faute inexcusable de l'employeur, la pratique est très différente. La faute inexcusable de l'employeur ne permettant pas de réparation intégrale, la victime qui s'engage dans cette voie devrait pouvoir obtenir un complément d'indemnisation par le fonds d'indemnisation, sur les postes de préjudice qui ne sont pas prévus par la législation de la sécurité sociale ou sur les postes de préjudice, comme l'incapacité, qui ne sont indemnisés que forfaitairement. À l'origine, le FIVA acceptait d'indemniser ces deux postes de préjudice, mais il ne le fait plus, sans pour autant qu'aucune décision n'ait été prise à ce sujet. Le résultat est qu'il y a probablement plusieurs centaines de dossiers en instance au FIVA. Au bout de six mois, l'absence de réponse vaut refus, et il serait logique de contester, mais nous avons accepté de ne pas faire appel, pour ne pas engager des contentieux massifs. Il faut savoir que le FIVA n'engage pas les actions subrogatoires qu'il devrait engager. Les victimes, là encore, n'ont donc pas le choix : celles qui souhaitent que leur employeur soit condamné et que ce soit lui qui supporte la charge de l'indemnisation, et non la collectivité, doivent engager elles-mêmes une procédure pour faute inexcusable. Le FIVA refusant par ailleurs qu'une personne qu'il a déjà indemnisée entame une action sur le fondement de la faute inexcusable, la victime doit commencer d'emblée par la faute inexcusable. Mais, de ce fait, elle n'obtient pas de réparation intégrale qui est pourtant prévue par la loi. Le sujet est donc complexe. Le texte de loi dispose seulement qu'on ne peut pas faire indemniser d'un côté un poste de préjudice, ayant déjà été indemnisé intégralement de l'autre. Il faudrait donc que le FIVA complète l'indemnisation poste de préjudice par poste de préjudice, pour les postes non indemnisés ou indemnisés forfaitairement, sans qu'il soit évidemment question d'avoir une double indemnisation. M. le Président : Il serait utile que vous nous adresseriez une note précise sur cet aspect du problème. M. Michel PARIGOT : Nous pouvons, effectivement, vous faire des propositions concrètes par écrit car le problème nous semble relativement facile à résoudre. S'agissant de la répartition des coûts, nous sommes favorables au principe selon lequel l'indemnisation doit être mise à la charge des responsables, au prorata de leurs responsabilités. Dans l'affaire de l'amiante, les responsables sont nombreux : l'État, qui n'a pas rempli sa mission de prévention, les industriels de l'amiante, qui se sont organisés pour continuer à commercialiser un matériau qu'ils savaient cancérogène et les employeurs, qui n'ont pas respecté la réglementation. Nous sommes favorables à ce que l'État, chargé de la politique de prévention sanitaire, supporte une part de l'indemnisation, 25 % nous paraissant raisonnable. Mais il ne faudrait pas oublier les industriels de l'amiante. A l'heure actuelle, seuls sont mis à contribution la branche accidents du travail - maladies professionnelles (AT-MP) et certains employeurs. Mais ceux qui ont commercialisé le matériau, pas plus que leurs assureurs ne sont inquiétés, alors qu'il ne serait pas anormal qu'ils participent au fonds d'indemnisation car leur responsabilité civile et celle de leur compagnie d'assurance sont engagées. M. Alain BOBBIO : Malgré des améliorations importantes, le traitement des dossiers par la sécurité sociale n'est pas exempt de critiques. Entre la déclaration et la notification de décision, le délai légal de traitement est fixé à trois mois (éventuellement reconductibles trois mois). En revanche, entre d'une part la notification de décision - ou la consolidation - et, d'autre part, la notification du taux d'incapacité partielle permanente (IPP) et du taux de rente, le délai n'est pas encadré. Il faudrait qu'il le soit. Le délai de notification de décision, en cas d'aggravation devrait l'être également. La Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) est plutôt favorable. Par ailleurs, le point de départ pour le versement des prestations devrait être la date d'apparition de la maladie, comme c'était le cas auparavant et non la date du Certificat médical initial (le CMI) comme aujourd'hui. Ce changement a été introduit à la suite d'une confusion entre la notion de « délai de prescription » et celle de « délai de prise en charge ». Cette anomalie a des conséquences financières au plan individuel, mais également au plan collectif. En effet, des examens financièrement très lourds peuvent être imputés à la branche maladie, alors qu'il s'agit, et personne ne le nie, d'une maladie professionnelle. La situation du conjoint survivant est également problématique. Le taux de rente du conjoint survivant était de 30 % jusqu'à 55 ans, puis de 50 % à partir de 55 ans. Il a été majoré : il est maintenant de 40 % jusqu'à 55 ans et 60 % ensuite. Dans le même temps, pour tenir compte de l'évolution des mœurs, les droits du conjoint survivant ont été élargis aux concubins et aux « pacsés ». Malheureusement, cet élargissement est incomplet : aujourd'hui, les concubins et les « pacsés » ne bénéficient pas, à 55 ans, du taux de 60 %. Chacun convient qu'il y a discrimination, mais celle-ci perdure. Autre problème concernant la rente de conjoint survivant : lorsque le décès est antérieur au 1er septembre 2001, le conjoint ne peut pas bénéficier des nouveaux taux (de 40 et 60 %). L'argument est qu'il ne s'agit pas d'une revalorisation du montant de la rente de conjoint survivant applicable à tous, mais d'une revalorisation du taux applicable à partir de la date d'effet. Cette inégalité est très mal ressentie. Il y a également un problème concernant les personnes qui sont parties en préretraite progressive (PRP) : elles touchent un revenu égal à 80 % de leur salaire (50 % versés par l'employeur, et 30 % par les Assedic). Or les calculs d'indemnité de la sécurité sociale se font sur la base de 50 % du salaire de référence, ce qui ne correspond pas à leur revenu réel. Cette situation est très préjudiciable. C'est le salaire plein antérieur qui devrait être la référence. Je voudrais maintenant aborder le sujet important de la Nouvelle-Calédonie. On trouve, sur 40 % du territoire de la Nouvelle-Calédonie, des roches amiantifères à l'état naturel. Selon une enquête réalisée par l'Institut de veille sanitaire (IVS) en 1994, le taux de mésothéliomes y est dix fois supérieur à celui mesuré dans des pays comparables ! Et ce chiffre est sans doute sous-estimé car les causes de décès et les maladies ne sont pas correctement enregistrées, particulièrement en dehors de Nouméa. Autre particularité : le nombre de personnes touchées est le même chez les hommes et chez les femmes, alors que la proportion est très différente en cas d'expositions professionnelles. On se heurte au lobby des industriels du nickel qui bloquent toute avancée. L'origine de ces contaminations est généralement attribuée au « Pö », un enduit utilisé pour le parement des cases d'habitation : cet enduit, qui remplace le lait de chaux, contient de l'amiante. Ce n'est pas faux, mais l'essentiel de la pollution vient de l'industrie du nickel elle-même, qui laboure des sols amiantifères en profondeur. Or il s'agit-là d'un sujet tabou. Je vous communiquerai des documents. Nous avons une association de l'Andeva sur place et nous vous proposons d'organiser une audition, le cas échéant par audioconférence. J'ajoute que des compétitions automobiles sont organisées en Nouvelle Calédonie sur des routes non bitumées, chargées de poussière d'amiante. Selon certains relevés, on dépasserait les 1 000 fibres par litre ! Un journal qui l'a signalé a vu sa parution suspendue... M. François DESRIAUX : Je reviens sur la question de la réparation intégrale. La création du fonds d'indemnisation était une porte ouverte vers la réparation intégrale pour l'ensemble des risques professionnels et vers la modification de la loi de 1898 établissant le principe de la réparation forfaitaire des accidents du travail et maladies professionnelles. Au regard de l'évolution de l'indemnisation du dommage corporel en France, la réparation forfaitaire est complètement dépassée. D'autant qu'aujourd'hui, la nouvelle définition de la faute inexcusable donnée par la Cour de cassation aboutit pratiquement à une réparation intégrale de droit, dès lors que les victimes engagent des procédures devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale. La mission d'information du Sénat a écarté le passage à la réparation intégrale au nom de la baisse des charges et de la politique de l'emploi. Cela signifie que les victimes seront incitées à multiplier les procédures en faute inexcusable. Je ne sais pas si les organisations syndicales, la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) et les associations de victimes, autres que celles de l'amiante, s'engageront dans cette voie mais, à la suite des rapports publiés par la Cour des comptes, notamment en 2005, il nous semblerait aberrant qu'on n'évolue pas, en France, vers la réparation intégrale de droit commun pour les accidents du travail et des maladies professionnelles. Je voudrais revenir sur la question du suivi médical. Pour des actifs exposés, soit à l'amiante, soit à d'autres produits cancérogènes, il faut effectivement un suivi médical particulier et renforcé par rapport aux autres salariés. Mais, à part les cas où il existe des marqueurs biologiques de l'exposition, l'important n'est pas tant l'examen médical proprement dit que l'action préventive de terrain. Pour le dire autrement, une radio des poumons n'apporte rien du point de vue de la prévention ; la seule perspective de cet examen est de retirer le salarié de l'exposition quand la radio commence à montrer une image positive, c'est-à-dire quand il est déjà trop tard ! Cet exemple caricatural illustre cependant l'ambiguïté du rôle de la médecine du travail, qui est à la fois de préserver la santé des salariés mais aussi de déterminer leur aptitude au poste de travail. Cette ambiguïté peut conduire à des aberrations en matière de cancers professionnels. Ainsi, dans le décret dit CMR (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques), on demande aux médecins du travail de délivrer une attestation de non contre-indication à l'exposition à ces produits. Sur le plan scientifique, c'est un non-sens ; sur le plan éthique, c'est plus que discutable. Imagine-t-on, qu'un médecin généraliste puisse dire à son patient qu'il est « apte » à fumer ou qu'il peut être exposé à la cigarette sans risque pour sa santé ? La détermination de l'aptitude en médecine du travail - à ne pas confondre avec le fait pour le médecin de délivrer un certificat d'inaptitude ou de restriction d'aptitude, dans l'intérêt exclusif de protection de la santé du salarié - est un héritage d'une conception eugéniste de la médecine du travail (à l'époque où elle devait jouer un rôle dans la sélection et l'orientation de la main-d'œuvre), qui perdure aujourd'hui et qui nuit gravement à la mission de prévention de la médecine du travail. La visite médicale du travail, vécue négativement par une majorité des salariés à cause de son caractère routinier et souvent sans véritable lien avec le travail et les conditions dans lesquelles il est exécuté, est largement conditionnée par la détermination de l'aptitude. Une réforme de la médecine du travail digne de ce nom passe obligatoirement par la suppression de la détermination de l'aptitude du salarié au poste de travail. M. le Président : C'est un point sur lequel nous travaillons. Nous avons eu le souci de dialoguer avec vous, mais j'aimerais aussi que vous nous fassiez parvenir par écrit vos remarques qui ont porté sur des points très importants. Pouvez-vous nous dire maintenant ce qui ressort de l'échange que vous avez eu avec les représentants du cabinet du garde des sceaux à la suite de votre manifestation ? M. François DESRIAUX : Nous allons organiser des réunions de travail avec le cabinet et la direction des affaires criminelles et des grâces pour mettre en place un suivi, dossier par dossier. Après quelques réunions, nous verrons ce qu'il en sera. Mais il ne faut pas se cacher que la position de la Cour de cassation sera déterminante. Pour notre part, nous espérons que, le 15 novembre, le non-lieu de la Cour d'appel de Douai sera cassé. Nous pensons également que les pôles de santé publique chargés d'instruire l'affaire de l'amiante ne pourront pas le faire dans un délai raisonnable avec les moyens dont ils disposent, comme les magistrats l'ont clairement dit à la mission d'information du Sénat. Par ailleurs, la loi Fauchon complique l'instruction et exige un travail minutieux. De fait, nous constatons, depuis dix ans que les premières plaintes ont été déposées, qu'aucun procès pénal de l'amiante n'a pu avoir lieu. M. le Président : Le pôle de Marseille a-t-il été mis en place ? M. Michel PARIGOT : Il est embryonnaire. De toutes façons, il n'a pas été saisi à ce jour du dossier de l'amiante. Il semble - et ce serait raisonnable -, que l'ensemble du contentieux amiante reviendra au pôle de santé publique de Paris. M. Jean-Marie LE GUEN : Combien ce pôle compte-t-il de magistrats ? M. Michel PARIGOT : Quatre. M. Jean-Marie LE GUEN. Prévoit-on, à l'intérieur du pôle, que les magistrats soient spécialisés ? M. Michel PARIGOT : Pour le moment, rien n'est vraiment organisé. Ce qui manque le plus, ce sont des officiers de police judiciaire spécialisés. L'instruction est ainsi rendue délicate. Pour instruire une affaire comme celle de l'amiante, il faudrait une saisine globale, dossier par dossier, pour l'ensemble des victimes concernées, et pas seulement pour celles qui ont déposé plainte. Et cette saisine globale ne peut intervenir qu'à l'initiative du Parquet. En effet, on ne peut pas apprécier les responsabilités à partir d'un cas particulier. Dans le cas de l'amiante, comment établir un lien certain entre le dommage et le responsable, quand il y a pu avoir des décennies d'exposition, des expositions multiples, et une succession de responsables ? La recherche des responsabilités dans l'affaire de l'amiante est rendue plus difficile du fait de la loi Fauchon. Nous en avons demandé, non l'abrogation, mais la révision, laquelle passe par une réflexion générale sur les responsabilités et sur la gestion des risques dans la société. La question majeure est : quels sont les outils juridiques dont la société a besoin pour gérer les risques ? Dans notre pays, le pénal joue un rôle important dans ce domaine car il n'y a pas, en France, de commissions d'enquête à l'instar de celles qui existent dans d'autres pays. Le pénal ne se contente donc pas de punir les coupables, il est aussi, en pratique, le seul outil d'analyse des responsabilités. Il faudrait donc éviter de rendre plus difficile l'analyse des responsabilités indirectes parce que, dans les catastrophes sanitaires, les responsabilités sont surtout indirectes. M. Jean-Marie LE GUEN : On m'a soumis le cas d'une personne à qui on avait proposé un projet de retraite dans le cadre du FCAATA, qui avait donc démissionné de son travail, et dont on voudrait maintenant recalculer les droits sur d'autres bases. Avez-vous entendu parler de tels cas ? M. André LETOUZÉ : Le calcul se fait sur les douze derniers mois de salaire de la période travaillée. Quelqu'un qui aurait quitté son entreprise pour en intégrer une autre, avec un salaire nettement moindre, verrait ses droits calculés à partir du salaire de ce dernier emploi. M. Jean-Marie LE GUEN : Et s'il était en maladie ? M. André LETOUZÉ : Dans le dispositif actuel, certaines périodes à salaire moindre M. Jean-Marie LE GUEN : Les erreurs de calcul sont-elles exceptionnelles ? M. André LETOUZÉ : Quand les intéressés demandent qu'on recalcule leur salaire de référence, cela leur est souvent favorable. Quand ils ont un doute, nous les incitons à faire une telle demande. Mais ils ne connaîtront leur salaire de référence que le jour où ils démissionneront de l'entreprise. On ne peut donc pas leur garantir, avant ce jour, le montant de leur allocation. M. Jean-Marie LE GUEN : Mais dans le cas que je vous ai soumis, c'est au bout de deux mois qu'on a recalculé les droits du salarié, pour lui annoncer qu'il allait toucher moins. M. André LETOUZÉ : Il est arrivé qu'on s'aperçoive, après qu'une personne a démissionné, qu'elle n'avait même pas de droits. Par ailleurs, dans certaines CRAM, il faut jusqu'à cinq mois pour communiquer le salaire de référence, alors que ce devrait être fait dans les deux mois. M. Patrick ROY : Je voudrais vous remercier pour la clarté de vos propos, et revenir assez brièvement sur un sujet majeur : la disparité entre l'indemnité donnée par le FIVA et celle accordée par les tribunaux, ainsi que celle existant entre les tribunaux eux-mêmes. J'ai cru comprendre que la création du FIVA avait eu, notamment, pour but de soulager les victimes et les familles en les dispensant de passer devant un tribunal. Mais pour cela, encore faut-il que le FIVA leur assure une juste indemnité. M. Michel PARIGOT : La voie judiciaire est longue et difficile. Toutes les victimes ne souhaitent pas y recourir, d'ailleurs. Les personnes atteintes d'un cancer ont peu de chance d'être indemnisées de leur vivant par la voie judiciaire, même si des progrès ont été faits et qu'il est parfois possible d'obtenir assez rapidement des provisions. L'un des avantages décisifs du FIVA était la rapidité et la simplicité de l'indemnisation. Encore faut-il, effectivement, que celle-ci ne soit pas nettement inférieure à celle qu'on pourrait obtenir par ailleurs. Il faut donc que le FIVA joue son rôle. Notre proposition consistant à adopter, comme niveau d'indemnisation, la moyenne des indemnisations judiciaires en faute inexcusable de l'employeur était raisonnable. Elle aurait permis une certaine uniformisation et évité aux personnes qui ne le souhaitent pas de s'engager dans la voie judiciaire. M. François DESRIAUX : Le jour où le FIVA indemnisera correctement les victimes et où on aura avancé sur le procès pénal, il y aura beaucoup moins de fautes inexcusables. M. Jean-Marie LE GUEN : Quel jugement portez-vous sur le fonctionnement institutionnel du FIVA et sur la composition de son conseil d'administration ? M. Michel PARIGOT : Il arrive qu'on reproche au conseil d'administration de ne pas avoir de majorité de gestion. Nous considérons que ce n'est pas un handicap, car cela permet que toutes les questions soient effectivement débattues, chacun des acteurs essayant de convaincre les personnes qualifiées. Le problème est plutôt que, lorsque le conseil d'administration décide de quelque chose, l'État fait systématiquement jouer son droit d'opposition, et ce au-delà du raisonnable. Pour nous, c'est une cause de dysfonctionnement. Le conseil d'administration devrait avoir les moyens d'exercer son pouvoir, au moins dans une certaine limite. M. le Président : C'était bien l'esprit de la création du FIVA. M. le Rapporteur : Sur le plan pénal, les victimes peuvent individuellement mettre en cause le chef d'entreprise ou le responsable de l'institution dans laquelle elles ont été exposées à l'amiante. Le chef d'entreprise peut arguer du fait qu'à l'époque où se sont produits les faits, on acceptait l'« usage contrôlé » de l'amiante et que tous ceux qui ont participé au Comité permanent amiante (CPA) étaient également responsables, voire coupables. De la même manière, les responsables de l'État ou des différents ministères, les responsables des relations du travail et de la santé au travail, peuvent être amenés à comparaître. Je ne souhaite pas trancher, mais je m'interroge sur l'étendue de la judiciarisation du dossier. M. François DESRIAUX : Il faudrait déjà que l'initiative des poursuites revienne au Parquet. Jusqu'à présent, il n'y a eu que des initiatives individuelles de victimes soutenues par leurs associations. Il ne s'agit d'ailleurs pas de citations directes, mais de plaintes contre X. Mais dans le domaine de la justice pénale, c'est le parquet qui, au nom de la société et de l'intérêt général, garde l'initiative. Or, dans l'affaire de l'amiante, le parquet a été, au mieux inexistant, quand il n'a pas été contre les victimes, en requérant, comme à Dunkerque, le non lieu. Normalement, le juge d'instruction devrait instruire la totalité de l'affaire et remonter jusqu'aux responsabilités des industriels, des pouvoirs publics et des structures qui ont été mises en place, comme le CPA. À Dunkerque, par exemple, l'instruction s'est contentée d'examiner la responsabilité des entreprises dans lesquelles les victimes avaient travaillé. La responsabilité des industriels ou de l'État a échappé à l'instruction. Nous avons bien conscience que cette affaire est extrêmement complexe, qu'il y a des responsabilités croisées entre les industriels, les pouvoirs publics et les employeurs et que tout ceci s'étale sur plusieurs dizaines d'années. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas chercher à déterminer les responsabilités. M. le Président : Ce n'est, certes, pas facile. Mais est-ce possible ? M. François DESRIAUX : Oui. M. Michel PARIGOT : C'est possible, effectivement. Reste que l'affaire de l'amiante constitue un défi pour la justice, qui n'a jamais été confrontée à un problème de cette ampleur et de cette complexité. Nous sommes persuadés que la justice pénale sortira transformée d'un procès de l'amiante. Le code pénal n'a pas été conçu pour traiter ce type d'affaires ; il l'a été pour des affaires où le lien de causalité était certain et direct. Voilà pourquoi il faudrait engager une réflexion sur les outils juridiques dont nous avons besoin pour analyser les catastrophes de santé publique. M. Jean-Marie LE GUEN : Devant ce drame majeur, vous réagissez de façon très responsable. La balle est dans le camp de la justice et du pouvoir politique, notamment du Parlement. A nous de dire ce que nous estimons relever de la responsabilité collective et de la responsabilité individuelle. Il faudra que nous ayons le courage de poser les questions dans leur crudité et d'éviter les échappatoires. M. François DESRIAUX : C'est en effet un vrai problème politique. Il apparaît aujourd'hui que, dans l'affaire de l'amiante, les responsabilités sont essentiellement indirectes, et ce n'est pas la loi Fauchon qui permettra d'y répondre. M. le Président : Comme vous avez pu le remarquer, nous avons eu le souci d'aller avec vous jusqu'au bout des questions. Je vous remercie. Audition conjointe de M. Raymond CLAVIER et de Mme Andrée AMAT pour l'Association de défense des fonctionnaires territoriaux du Languedoc-Roussillon victimes de l'amiante (ADFTLRVA) Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Madame, monsieur vous êtes tous les deux fonctionnaires territoriaux de la mairie de Montpellier, à la retraite depuis un an s'agissant de Mme Amat, et encore en activité pour ce qui est de M. Clavier. Vous êtes venus évoquer le problème de l'application du dispositif de cessation anticipée d'activité aux fonctionnaires. La question a été abordée lors de l'examen du projet de financement de la sécurité sociale. Le ministre délégué à la sécurité sociale, M. Philippe Bas, a reconnu l'existence d'une inégalité et s'est officiellement engagé à l'examiner, notamment au vu des conclusions du rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS), attendu pour la fin du mois de novembre. J'aimerais d'ailleurs savoir si vous avez été consultés dans le cadre de cette enquête. M. Raymond CLAVIER : Je suis fonctionnaire territorial en activité, électricien reconnu en maladie professionnelle pour plaques pleurales calcifiées depuis 2003, et président de l'Association de défense des fonctionnaires territoriaux du Languedoc-Roussillon victimes de l'amiante (ADFTLRVA). Notre association, membre de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante (ANDEVA), s'occupe des dossiers soit directement, soit via d'autres associations de l'ANDEVA. Elle est intervenue auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier et participe au collectif amiante du service maritime de navigation du Languedoc-Roussillon. Hors Languedoc-Roussillon, nous travaillons en contact étroit avec l'Association départementale des victimes de l'amiante (ADEVA) et le Comité « amiante prévenir et réparer » (CAPER) Auvergne. Ma collègue Andrée Amat, fonctionnaire territoriale à la retraite, ingénieur en chef au service des études informatiques, a été exposée à l'amiante de mars 1971 à juillet 1997. Elle présente un déficit obstructif des petites bronches devant faire l'objet d'une surveillance. Elle est membre du bureau de notre association. Nous souhaitons attirer votre attention sur la situation inique dans laquelle se trouvent les fonctionnaires face à la catastrophe de l'amiante. Mme Andrée AMAT. Au début des années 70, de nombreux bâtiments administratifs ont été construits en utilisant de l'amiante. A la mairie de Montpellier, un flocage généralisé recouvrait l'ensemble des plafonds. Les plafonds, câbles, gaines et fils électriques étaient recouverts d'un flocage d'amiante ; les cloisons démontables étaient en amiante-ciment, le système de climatisation recyclait un air chargé de fibres d'amiante. En outre, l'usinage, le tronçonnage des plaques amiante-ciment s'effectuait à quelques mètres de la bouche générale d'aspiration d'air neuf. Le personnel de maintenance et d'entretien effectuait tous les travaux de maintenance, de réaménagement, de création de bureaux et de nettoiement sans aucune protection et en présence du personnel administratif, dont les bureaux étaient recouverts d'une poussière blanche d'amiante. Ainsi, le personnel de maintenance et d'entretien a été soumis à une exposition certaine et le personnel administratif à une exposition passive mais réelle. En mars 1971, les premiers services ont été installés en mairie. En 1975, le problème de la nature du flocage a été soulevé par notre syndicat et nié, dans un premier temps, par nos élus. Nous avons fait faire nous-même des analyses : c'était bien de l'amiante. Depuis cette date, tous les trois ou quatre ans, des analyses d'air ambiant ont été effectuées. Les résultats ont montré, à certains étages, des taux de fibres d'amiante quarante fois supérieurs à la norme en vigueur ! Le troisième étage a été désamianté en 1982-1983, les sept autres en 1996 et 1997. Aujourd'hui, il n'y a plus d'amiante, si ce n'est dans des faux plafonds, des cloisons ou des gaines techniques. Le personnel a donc été exposé pendant vingt-six ans à l'amiante. Nos employeurs connaissaient les dangers de l'amiante, mais ils les ont systématiquement minimisés. Parfois même, en toute connaissance de cause, ils n'ont pas assumé leur obligation de préserver la santé et l'intégrité physique de leur personnel : pas de suivi médical prenant en compte le problème de l'amiante, pas d'étude épidémiologique. Aujourd'hui, on est incapable de savoir qui a déclenché un cancer. Nous avons mené une enquête sur le personnel de service qui travaillait dans les étages de la mairie de Montpellier et nous avons appris que sur sept personnes, quatre étaient mortes d'un cancer et que la cinquième était en phase terminale. Comme elles étaient parties à la retraite, il était difficile de se renseigner. Il faut savoir, par ailleurs, qu'il est difficile de faire parler l'entourage. M. Raymond CLAVIER : J'ajoute que beaucoup de personnes, y compris parmi les élus, ne veulent pas savoir s'ils sont malades. Il semblerait pourtant que deux élus aient pu être décédés de l'amiante. Mme Andrée AMAT : Un des élus a téléphoné peu de temps avant son décès pour annoncer qu'il allait en mourir. Mais tout cela est mis sous l'éteignoir. Actuellement, trois maladies professionnelles seulement ont été reconnues. C'est sans doute bien loin de la réalité. Nous rencontrons de grosses difficultés avec l'administration, bien qu'on commence à pouvoir discuter avec elle et avec les élus. Mais nous n'arrivons pas à obtenir des attestations d'exposition valables. Nous n'arrivons pas non plus à obtenir du corps médical de Montpellier des certificats. Moi-même, j'ai passé un scanner prouvant que j'avais des problèmes de bronches. L'année suivante, le pneumologue qui examine tous les personnels de la mairie a prétendu que j'avais de l'asthme, puis de l'allergie ! Devant un tel blocus, j'ai décidé maintenant d'aller consulter à Marseille, chez un professeur qui est le médecin référent de l'association. M. le Président : Comment expliquez-vous ce blocus médical ? M. Raymond CLAVIER : Notre employeur est président du conseil d'administration du CHU. Plus généralement, nos élus pensent au sang contaminé, ils ont très peur de l'amiante. Le sujet est tabou, c'est l'omerta. Mme Andrée AMAT : Nous rencontrons des difficultés pour que les maladies soient reconnues en maladie professionnelle. Ainsi, certaines personnes sont incitées à déclarer une maladie professionnelle due à l'amiante, par rapport à une période d'activité dans le privé. On leur indique qu'il leur sera plus facile ainsi d'obtenir l'Allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) et on les encourage à « oublier » l'administration. Nous sommes en contact avec de nombreux CHU et de nombreuses mairies qui rencontrent les mêmes problèmes que nous. Les fonctionnaires ont la possibilité de saisir le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) pour être indemnisés de tous les préjudices. Mais ils ne peuvent accéder à l'ACAATA, parce que leurs employeurs ne cotisent pas au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA). Dans certains régimes spéciaux comme la SNCF, la RATP, EDF-GDF ou le ministère de la défense pour les ouvriers d'État, les syndicats ont pourtant signé une convention avec les employeurs, qui ouvre droit à l'ACAATA. Sur un total de 26 185 victimes reconnues en maladie professionnelle due à l'amiante, 93,35 % ont droit à l'ACAATA et 6,65 % n'y ont pas droit. Celles qui n'y ont pas droit sont essentiellement des fonctionnaires, toutes fonctions publiques confondues. Les fonctionnaires territoriaux, quant à eux, ne représentent que 0,099 %. Nous voulons l'égalité des droits entre le privé et le public. Nous souhaitons qu'on ne sépare pas les fonctionnaires victimes de l'amiante de l'ensemble des travailleurs de ce pays. C'est une question de respect de l'égalité de chaque citoyen face à la Constitution. Le gouvernement Chirac/Raffarin, en réformant les retraites, a mis en avant la parité des droits entre le public et le privé. Nous demandons qu'il en soit ainsi pour la reconnaissance des victimes de l'amiante. Ceux qui votent les lois sont en général élus à la tête des services de l'État, des CHU ou des collectivités territoriales. Ils sont nos employeurs. Les groupes politiques qui revendiquent le droit de défendre les citoyens doivent assumer leurs responsabilités. Soyez à nos côtés dans notre combat pour que soit reconnu notre droit à la cessation anticipée d'activité. Mesdames et messieurs les députés, que vous soyez ou non nos employeurs, vous qui vous réclamez du progrès social et de la justice sociale, œuvrez à réparer cette injustice ! Nous avons contacté tous les députés de la région, toutes tendances confondues. Nous avons rencontré le député Jeanjean, qui nous a dit qu'il serait bon de proposer une loi. Le député Domergue, qui est le rapporteur du projet de financement de la sécurité sociale, nous soutient. Le député Liberti, avec le groupe des députés communistes et républicains, a déposé en juillet 2005 une proposition de loi - évoquée dans le dernier rapport d'information du Sénat - tendant à ouvrir les droits de la cessation anticipée d'activité aux fonctionnaires territoriaux victimes de l'amiante dans l'exercice de leurs fonctions. Comment y parvenir ? Soit nos employeurs cotisent au FCAATA, soit ils cotisent à une caisse qui leur est propre et qui couvre actuellement les accidents du travail et les maladies professionnelles, soit ils couvrent eux-mêmes les accidents du travail et les maladies professionnelles. M. Raymond CLAVIER : Je précise que la mairie de Montpellier est prête à signer un protocole d'accord qui nous permettrait d'obtenir un congé de cessation d'activité et dont elle supporterait le coût. Il y a donc, tout de même, de la part de nos élus, une certaine écoute. Mme Andrée AMAT : Nous demandons à l'ensemble des parlementaires ici présents d'œuvrer pour que soit reconnu notre droit à la cessation anticipée d'activité. Il ne peut pas y avoir en France de citoyens de deuxième classe qui seraient, dans les faits, victimes de ségrégation. L'ordonnance du 17 mai 1945 a créé la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et l'ordonnance de juin 1945 a instauré les différents régimes de sécurité sociale, sous la condition que les régimes particuliers territoriaux et hospitaliers offrent des prestations au moins équivalentes à celles fournies par le régime général. En 2005, on ne peut pas faire moins pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qu'en 1945 ! Les fonctionnaires doivent bénéficier des mêmes droits que les travailleurs du secteur privé. Il est temps de mettre fin à cette situation inique, afin que l'égalité des citoyens devant la loi devienne une réalité. M. le Président : Je vous remercie de vos propos très précis. Vous avez souligné une évolution dans les comportements, ce qui était très intéressant. Venons-en aux questions. M. le Rapporteur. L'objectif d'égalité de traitement entre les fonctionnaires et les autres catégories de salariés est tout à fait légitime. Jacques Domergue, lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, avait déposé un amendement en ce sens. Je tiens à préciser que s'il a été mis de côté, c'est parce que l'on attend les rapports des trois missions, de l'Assemblée, du Sénat et de l'IGAS, pour proposer certaines mesures. En tout cas, l'échange que nous avons avec vous nous permettra de les préciser. Madame Amat, vous avez été exposée à l'amiante pendant vingt-six ans. De quelle période à quelle période ? Mme Andrée AMAT : De mars 1971 à décembre 1997. M. le Rapporteur. Le bâtiment avait été construit en 1971 ? Mme Andrée AMAT : Oui. Les premiers services sont entrés en 1971 dans des bâtiments neufs. M. le Rapporteur. Donc, avant l'interdiction du calorifugeage et du stockage qui date de 1977 et avant l'interdiction des faux plafonds, qui a suivi. Vous avez cité des taux de déplacement de fibres d'amiante par litre d'air. Quand ont-ils été révélés ? M. Raymond CLAVIER : Voilà comment cela se présentait : un bureau, avec un plafond en nid d'abeille, et au-dessus un plancher en béton floqué à l'amiante. L'air était pris dans la pièce, passait dans ce flocage et y était renvoyé. L'air neuf partait du rez-de-chaussée de la mairie et passait dans une colonne montante qui arrivait au centre du bâtiment. Mais lorsque le travail de découpage de l'amiante a été fait, les femmes de ménage jetaient l'amiante juste à côté des bouches d'aspiration. Si les appareils de mesure indiquaient quarante fois plus d'amiante que ce qui était autorisé, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas aller au-delà. Ce qu'ont pu respirer nos collègues de l'administration représente un maximum pour une vie de travail. Mme Andrée AMAT : Tous les travaux étaient faits pendant que le personnel administratif travaillait. L'amiante allait sur les bureaux et sur les documents. Les femmes de service nettoyaient avec des chiffons, mettaient l'amiante dans des corbeilles et allaient la jeter à la main dans des conteneurs. Il n'y avait aucune protection pour personne. M. le Rapporteur. Dans quelles conditions se sont déroulés les chantiers de désamiantage ? M. Raymond CLAVIER : Avant les élections de 1977, le maire avait déjà mis en place un suivi médical. Celui qui allait être élu s'est engagé à faire des travaux de désamiantage. Dans cette nouvelle municipalité, un médecin s'est battu pour préserver la santé du personnel et est parvenu à faire désamianter un étage qui était très pollué. Il était prévu d'en désamianter un par an, c'était d'ailleurs budgétisé. Or, un jour, le maire de Montpellier a déclaré publiquement qu'il ne paierait pas les pots cassés de la droite et que c'était l'État qui devait assurer le financement de ces travaux. Tout a été arrêté. Les travaux ont commencé après que la loi de 1996 ait été promulguée. M. le Rapporteur : Comment se présentait le chantier de désamiantage ? M. Raymond CLAVIER : Les personnels travaillaient bien en combinaison, mais les femmes de ménage travaillaient au milieu du chantier, sans aucune protection. M. le Président : Et personne ne disait rien ? Mme Andrée AMAT : Mais si, on s'époumonait ! M. Raymond CLAVIER : Le maire, alors en fonction, avait beaucoup de charisme. Il était très difficile de s'y opposer. Mme Andrée AMAT : Il faut bien reconnaître qu'il a géré une situation qu'il n'avait pas engendrée. En 1977, aussi bien les syndicats que les élus estimaient que c'était à l'État de désamianter. En 1981, nous avons rencontré le ministre Ralite à Montpellier. Je suis moi-même intervenue auprès de lui pour que ce problème soit pris en charge par l'État. Il faut reconnaître aujourd'hui que c'est le contribuable qui a payé. M. Raymond CLAVIER : Et ce sont les employés qui sont malades. M. le Président : Ce que vous racontez est effrayant. Mais la mairie possède d'autres bâtiments à Montpellier. Sont-ils concernés de la même manière ? M. Raymond CLAVIER : Dans les autres bâtiments de la mairie, il y avait beaucoup moins d'amiante. Il y en avait également au CHU et à la CPAM. Cet amiante a été enlevé, mais on en trouve encore régulièrement. M. le Président : Quelle est la position des organisations syndicales ? Mme Andrée AMAT : Pendant longtemps, le problème a été porté essentiellement par les syndicats, surtout la CGT. Une fois le désamiantage du premier étage effectué, on a pensé que les autres étages allaient suivre. Les syndicats, comme le personnel, se sont un peu endormis. Ceux qui se préoccupaient de ce problème sont partis à la retraite et ceux qui leur ont succédé n'ont pas jugé qu'il était crucial. M. Raymond CLAVIER : Actuellement, au plan syndical, nous travaillons au niveau national, d'ailleurs souvent en opposition avec les syndicats locaux. M. le Président : Y a-t-il, entre les syndicats, des divergences d'approche de ces problèmes ? Mme Andrée AMAT : Non. Si le problème a resurgi, c'est parce que des cas de maladie professionnelle sont apparus depuis trois ans. On ne peut pas dire que le comité d'hygiène et de sécurité en ait fait une priorité. Les déflocages avaient été effectués en 1996 et 1997 et tout le monde était content. Mais maintenant, le problème nous rattrape : déclarations de maladies, cancers, plaques pleurales, etc. Ensuite, quand on est malade, on ne s'en rend pas compte. Et même lorsqu'on l'est, on ne veut pas savoir, parce que cela fait peur. M. le Président : Comment parvenir à identifier les victimes pour l'accès à la cessation anticipée d'activité ? Le temps de latence de la maladie est relativement long. Faudra-t-il raisonner par métier, par établissement ? Un raisonnement d'ensemble est très difficile. Mme Andrée AMAT : Par métier, non, car certains ont touché l'amiante, mais pas tous. Au contraire d'autres, sans le toucher, l'ont respiré toute la journée et ont ainsi été tout aussi massivement contaminés. M. Raymond CLAVIER : Je m'exprime aussi au nom des hospitaliers. J'ai été en contact avec le responsable de l'ANDEVA du CHU de Brest. Les salariés n'ont pas été les seuls à être touchés, puisqu'un professeur a déclaré un mésothéliome. Mais comment déclarer la maladie professionnelle ? De la même façon, comment faire lorsque nos élus sont malades ? Je pense qu'il faut procéder à un classement, bâtiment par bâtiment, pièce par pièce. M. le Président : Votre approche est donc fondée sur la localisation. M. Patrick ROY : Je suis interloqué par les propos tenus sur le chantier de désamiantage. Si j'ai bien compris, les personnels qui y procédaient avaient toutes les protections nécessaires, alors que d'autres personnels passaient dans les locaux concernés sans aucune protection ? M. Raymond CLAVIER : Nous nous sommes mal compris. Le chantier de désamiantage était fermé hermétiquement, avec des écrans plastiques. Mais il était dans la mairie même. À un mètre du chantier, au bout d'un couloir, tout le monde travaillait. Quand les salariés du chantier sortaient, ils croisaient les autres salariés qui étaient donc en contact avec eux. Ils n'avaient même pas enlevé leur combinaison. M. Gérard BAPT : C'est stupéfiant ! Mme Andrée AMAT : D'après ce que je sais, en 1996-1997, le chantier a été conduit dans les normes. Un étage était complètement isolé, il y avait de la ventilation. Les salariés de l'entreprise spécialisée travaillaient avec des masques et des combinaisons. Ils avaient une sortie spéciale. M. Raymond CLAVIER : Mais les règles n'étaient pas très rigides. Mme Andrée AMAT : Certes, mais on ne pouvait vider sept étages de la mairie. Quand on désamiantait un étage, le personnel travaillait en dessous et au dessus. M. Patrick ROY : Vous nous avez indiqué qu'un premier étage avait été désamianté et que, pour diverses raisons, les travaux n'avaient pas suivi dans les autres étages. Comment le personnel de la mairie a-t-il réagi ? S'est-il bien rendu compte des dangers ? M. Raymond CLAVIER : Non. Mme Andrée AMAT : Le personnel pensait qu'on allait désamianter un étage par an. Mais le temps de latence de la maladie a fait qu'on a vite oublié. Lorsque j'ai su que des collègues étaient malades, je l'ai moi-même mal vécu et j'ai attendu un an ou deux pour faire des tests. M. Raymond CLAVIER : Lorsqu'on m'a dit que j'étais atteint, on m'a précisé que je n'avais aucune maladie déclarée. Ce sont des collègues qui m'ont poussé à faire des tests. Sinon, je considérais que je n'étais pas malade. Il faut dire qu'au travail, personne ne me voit malade, même s'il m'arrive d'être fatigué et de devoir m'allonger. Reste que je suis obligé d'aller travailler, ce qui n'est pas normal. M. Gérard BAPT : On comprend bien le déni de la part des malades. Mais on comprend moins le déni médical. Vous avez dit que vous aviez consulté un spécialiste au CHU, mais que vous alliez désormais consulter à Marseille. Or, je suppose qu'à Montpellier, il existe d'autres pneumologues, des cliniques privées ou des médecins du travail dont vous auriez pu obtenir des certificats. M. Raymond CLAVIER : En effet. M. Gérard BAPT : Depuis que ces phénomènes sont connus, a-t-on fait une enquête épidémiologique auprès du personnel municipal, actif ou retraité ? Mme Andrée AMAT : On l'a demandé. M. Gérard BAPT : En tant que médecin, je vois mal comment un directeur général de CHU, un président du conseil d'administration ou un président de commission médicale d'établissement peut ainsi faire peser une chape de plomb sur un service universitaire. M. Raymond CLAVIER : Je ne sais pas. Un collègue s'est vu refuser un scanner au CHU, alors qu'il possède une expertise indiquant qu'il est amianté. En discutant avec un professeur cancérologue, nous avons parlé du manque de transparence, qui est dû à des peurs irrationnelles. Maintenant, lorsqu'un collègue veut savoir s'il est malade ou pas, nous organisons des covoiturages vers Marseille pour consulter un expert agréé auprès de la sécurité sociale, lequel est devenu notre référent. M. Frédéric REISS : Vous nous avez dit que vous aviez des contacts. S'agit-il d'autres associations comme la vôtre dans d'autres mairies ? Avez-vous l'intention de vous fédérer ? Vous avez précisé que, syndicalement, vous préfériez agir au niveau national. Avez-vous des contacts avec des personnels fédérés, comme vous, au sein d'une association de fonctionnaires territoriaux ? M. Raymond CLAVIER : L'ANDEVA comprend des associations regroupant des salariés de toutes origines, mais elle s'intéresse surtout aux victimes du privé. Les autres, comme les militaires que je reçois régulièrement, ou les salariés de la Monnaie à Pessac, par exemple, ne savent pas comment faire. À l'origine, nous nous occupions uniquement du Languedoc-Roussillon. Maintenant, toutes les semaines, je suis en contact avec Brest ou ailleurs. Mais physiquement, nous manquons de forces. Mme Andrée AMAT : Notre association a été créée pour les fonctionnaires territoriaux. Mais, au fur et à mesure, nous avons été contactés par les CHU, la fonction publique hospitalière, etc. Certains de ceux qui nous contactent sont à l'ANDEVA, mais les problèmes auxquels ils sont confrontés étant différents, de fait, ils sont plus proches de nous. M. Frédéric REISS : Avez-vous l'impression que, sur le plan national, il y ait vraiment un manque ? Mme Andrée AMAT : Tout à fait. M. le Président : Depuis quand existez-vous ? M. Raymond CLAVIER : Nous avons existé en collectif pendant deux ans, et nous existons sous la forme associative depuis le 24 avril 2003 - avec un e-mail. M. Frédéric REISS : Êtes-vous les seuls à être constitués en association ? Mme Andrée AMAT : Oui. M. le Président : C'est pour cela que j'ai posé une question sur les organisations syndicales. J'ai rencontré des fonctionnaires territoriaux la semaine dernière. Je les interrogés sur leur approche du problème, et lorsque je leur ai parlé des organisations syndicales, cela ne s'est pas très bien passé. M. Raymond CLAVIER : Je voudrais souligner les problèmes que nous rencontrons en matière d'expertise. Certains experts peuvent reconnaître que telle maladie est indiscutablement liée à l'amiante - tableau 30. C'est sans doute valable dans le privé, mais pas chez nous. À partir du moment où la maladie n'a pas été constatée par la médecine du travail, nous n'avons aucune pièce administrative à produire, si bien que notre dossier est bloqué. Du fait de cette absence de communication entre le secteur privé et le secteur administratif, nous nous retrouvons une seconde fois victimes. M. le Président : J'ai eu l'occasion de parler de ces problèmes cette semaine, et j'ai pu en mesurer les difficultés. On ne peut que déplorer qu'ils ne soient pas pris en compte au niveau national, par l'ANDEVA ou par les organisations syndicales. Je vous remercie donc, car vous avez été très précis dans votre analyse. Vous avez même évoqué une ou deux situations assez terrifiantes. M. Raymond CLAVIER : Je vais vous donner un exemple des problèmes que nous rencontrons avec l'administration : aujourd'hui, pour me rendre à cette audition officielle, j'ai demandé un congé exceptionnel. Comme il m'a été refusé, j'ai pris sur mes congés annuels. Voilà la vie quotidienne d'un amianté au travail ! M. le Président : Je vais écrire à votre responsable hiérarchique, ne serait-ce que pour le principe. Mme Andrée AMAT : Nous allons vous remettre le projet de protocole d'accord. Merci de nous avoir reçus. M. le Président : Madame, Monsieur, je vous remercie. Audition conjointe de M. Alain BOURDELAT, directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages (FGAO), et de M. Loïc BOUCHET, directeur adjoint Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Nous recevons aujourd'hui M. Alain Bourdelat, directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), et M. Loïc Bouchet, directeur adjoint. Le FGAO a été chargé pendant un an d'instruire les dossiers d'indemnisation des victimes de l'amiante, jusqu'à ce que la gestion complète du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) soit confiée à un établissement public spécifique. Nous souhaitons vous entendre expliquer quel dispositif vous aviez mis en place et pourquoi le FGAO n'a pas continué de gérer le FIVA, alors qu'il gère d'autres fonds du même type, qu'il s'agisse du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) ou du Fonds d'indemnisation pour les transfusés et hémophiles (FITH) contaminés par le virus du sida. Les personnes que nous avons entendues ce matin nous ont dit, après d'autres, que les moyens du FIVA sont insuffisants non seulement pour gérer les dossiers mais aussi pour exercer les actions récursoires. Fallait-il, selon vous, créer une structure nouvelle alors que l'on aurait pu utiliser vos moyens et votre pratique ? M. Alain BOURDELAT : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est la nouvelle dénomination donnée par la loi du 1er août 2003 à l'ancien Fonds de garantie automobile, dit aussi Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse. Cet organisme de droit privé, doté d'une personnalité morale, indemnise les victimes au titre de la solidarité nationale quand aucune assurance ne peut intervenir, puis exerce des recours contre les responsables de dommages pour obtenir le remboursement des sommes engagées. Le FGAO est une structure de gestion qui compte 220 collaborateurs aguerris. L'organisme est apprécié pour sa réactivité, son expérience, son savoir-faire et sa capacité d'écoute des victimes. Il intervient dans des situations complexes et graves, et le législateur n'a cessé d'étendre son champ de compétences. Nous avons ouvert 45 000 dossiers en 2004, et 465 000 dossiers au cours de la dernière décennie, dont 300 000 au titre de la circulation et 165 000 relatifs à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. Le FGAO intervient soit parce que l'auteur d'un dommage n'est pas assuré, soit parce qu'il n'est pas identifié, soit, encore, parce qu'il est assuré auprès d'un assureur en faillite - et l'on compte une faillite tous les dix-huit mois dans ce secteur. C'est ainsi qu'une seule liquidation a conduit à l'ouverture de 5 000 dossiers par le FGAO en février 2003. Ce qui était encore le FGA à l'époque a servi de modèle à d'autres fonds, en premier lieu au Fonds d'indemnisation spécifique pour les victimes d'actes de terrorisme. La loi créant ce fonds a été publiée le 9 septembre 1986 et, dès le 30 septembre 1986, les premières provisions étaient versées. Ce fonds, devenu en 1990 le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, est un organisme sui generis qui contracte avec le FGAO pour que celui-ci gère ses différentes missions : indemnisation, recours, comptabilité et trésorerie. En janvier 1992 était publiée la loi portant création du Fonds d'indemnisation pour les transfusés et hémophiles contaminés par le sida ; en mars, la structure était opérationnelle et, en avril, le FGA, là encore prestataire de services, versait les premières provisions. Le 1er août 2003, les missions du FGA, devenu le FGAO, étaient étendues par le législateur à la couverture du risque minier. Elles ont à nouveau été élargies, début 2004, par la loi « Perben 2 », dont le décret d'application est paru le 28 mai 2005. L'indemnisation est donc notre métier et notre raison d'être, et nous sommes l'interlocuteur naturel des victimes et des administrations. C'est aussi la profession de notre personnel, composé de très compétents spécialistes, de formation supérieure. La vocation du Fonds est de rendre le meilleur service aux victimes par une écoute attentive et par l'information qu'on leur donne. Nous procédons d'ailleurs à des enquêtes de satisfaction auprès d'elles. Nos moyens informatiques, très puissants, exigent des investissements très coûteux, qu'il s'agisse des matériels ou des logiciels spécifiques nécessaires aux règlements, aux recours ou à l'établissement de statistiques. Nous avons pour objectifs constants l'amélioration du service et de la productivité et l'adaptation permanente de l'outil de travail. Les objectifs annuels fixés au personnel portent sur la maîtrise des frais généraux et l'amélioration des délais de gestion. Notre recherche continue d'amélioration de la qualité nous a conduits à engager, il y a un an, une démarche visant à obtenir la certification de management délivrée par un organisme indépendant. M. le Président : Je vous remercie de cet exposé, mais j'observe que vous ne nous avez rien dit de la période pendant laquelle vous avez géré l'indemnisation de l'exposition à l'amiante. M. le Rapporteur : Mes questions vont dans le même sens : pourquoi avez-vous été chargés de cette mission ? Comment l'avez-vous menée ? Pourquoi en avez-vous été dessaisis ? M. Alain BOURDELAT : Pendant un an, nous sommes intervenus en qualité de prestataires de services pour le FIVA, mais personne ne nous a dit : « Nous vous confions la mission pour un an, puis vous nous rendrez compte ». Dès l'origine, les décisions ont été prises par le FIVA, avec lequel nous avons signé une convention de gestion qui répartissait les rôles. Le FGAO, créé par le législateur, n'a pas de vocation commerciale. Il est indépendant, et sa mission est d'assurer la réparation intégrale ou l'indemnisation selon le droit commun ; le FIVA a été créé sur ce modèle, très souple. Le FGAO avait déjà eu à connaître de dossiers d'amiante dans le cadre du FGTI. En effet, avant la création du FIVA, les victimes de l'exposition à l'amiante avaient plusieurs possibilités d'indemnisation : elles pouvaient voir leurs maladies professionnelles reconnues ; elles pouvaient aussi, depuis que l'Etat en avait décidé ainsi, fin 1990, se voir allouer une indemnité complémentaire ; demeurait enfin la possibilité d'engager une action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour faute inexcusable de l'employeur. Mais, étant donné le nombre croissant des victimes et les lenteurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), certains avocats ont eu l'idée d'utiliser le régime des infractions pour faire obtenir une indemnisation à leurs clients victimes de l'exposition à l'amiante. Ainsi sollicité, le FGTI s'est demandé si, en rédigeant la loi de janvier 1990, le législateur ne pensait pas à l'indemnisation des vieilles dames agressées pendant qu'elles retirent de l'argent à un distributeur automatique de billets plutôt qu'à l'indemnisation des maladies professionnelles. Le FGTI a donc souhaité connaître l'interprétation de la Cour de cassation, et après que celle-ci se fut prononcée, le FGTI a réglé les dossiers qui lui étaient présentés. C'est à cette époque que le FGA, en sa qualité de prestataire de services pour le FGTI, a eu à connaître de dossiers des victimes de l'amiante. Je rappelle que le FIVA a été créé ex nihilo, dans une grande incertitude, car personne ne savait combien de dossiers lui seraient présentés la première année, les évaluations variant de 2 000 à 10 000. Aussi, il est apparu que la meilleure formule consisterait à confier au FGA la sous-traitance de la gestion de ces dossiers. Nous avons alors fait suivre à soixante de nos rédacteurs une formation spécifique, apporté une aide juridique à la rédaction des formulaires nécessaires et aussi mandaté des pneumologues et d'autres spécialistes. Le fait que le FIVA ait le statut d'établissement public administratif pouvait créer des difficultés, les comptables publics étant parfois réticents à l'idée de déléguer certaines décisions. Une collaboration d'un an a été décidée, durée apparue comme étant la plus acceptable pour nos partenaires, mais il n'a jamais été dit explicitement que cette première année ne serait pas suivie d'une autre, et les interprétations à ce sujet sont diverses. Le discours de Mme Elisabeth Guigou lors de l'installation du FIVA mentionnait que l'on se reverrait dans un an pour dresser un bilan. Le décret prévoyait que le FIVA pourrait conclure une convention de gestion à titre transitoire avec le FGA, lui confiant l'instruction des dossiers la première année. C'est ce qui a été fait. Le président du conseil d'administration du FIVA nous a ensuite fait savoir que la collaboration cesserait et que nous ne devions plus ouvrir des dossiers à partir du 1er juin 2003, mais continuer de suivre les dossiers ouverts jusqu'à leur règlement définitif, ce que nous avons fait jusqu'au 31 décembre 2004. M. le Président : Si je comprends bien, il y a eu une hésitation sur l'interprétation de la durée de la mission qui vous était confiée ? M. Alain BOURDELAT : Oui. M. le Président : Pensez-vous que ce qui a été fait pour d'autres fonds aurait dû être fait pour l'amiante ? M. Alain BOURDELAT : Les missions que nous remplissions pour le FIVA constituaient pour nous une grosse opération, puisque quinze personnes, soit 16,5 % de notre effectif de rédacteurs, se consacraient aux dossiers des victimes de l'amiante, ce qui n'est pas neutre. Je considère, en effet, que l'on aurait pu fonctionner différemment, comme pour les autres fonds. Mais il aurait fallu pour cela qu'une volonté politique se manifeste, car le FIVA étant un établissement public, la gestion déléguée est plus compliquée, comme je l'ai dit, que lorsque le FGAO agit en tant que prestataire de services pour des organismes tels que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles. M. le Président : Le problème actuel est celui des recours subrogatoires, que vous aviez pourtant toute compétence pour traiter, me semble-t-il. M. Alain BOURDELAT : C'est exact, puisque nous traitons 70 000 dossiers de ce type, tous fonds confondus. Cela suppose une informatique très performante et beaucoup de savoir-faire. Les recours, s'agissant du FIVA, sont surtout de nature juridique. Il existe aussi des recours pour faute inexcusable, mais ils visent parfois des administrations ou des entreprises avec lesquelles il serait possible de passer des accords. Nous n'éprouverions aucune difficulté particulière à traiter ces dossiers. M. le Rapporteur : Pourriez-vous nous donner quelques indications sur le volume annuel d'indemnisation que vous réalisez ? M. Alain BOURDELAT : Pour l'indemnisation des accidents de la circulation, nous traitons 25 000 dossiers par an, et 17 000 dossiers liés à des infractions. En outre, comme je vous l'ai dit, les liquidations judiciaires de compagnies d'assurance peuvent nous conduire à devoir ouvrir jusqu'à 5 000 dossiers en même temps. Pour ce qui est du risque minier, nous avons ouvert 2 000 dossiers en 2004, première année de fonctionnement du nouveau fonds. M. le Rapporteur : De quel ordre sont les sommes en jeu ? M. Alain BOURDELAT : L'ensemble des indemnisations versées en 2004 s'est élevé à 310 millions d'euros. M. le Rapporteur : Dans quelle proportion ces sommes vous seront-elles remboursées après recours ? M. Alain BOURDELAT : Pour les indemnisations après accidents de la circulation et infractions, nous parvenons, en nous donnant beaucoup de mal, à obtenir le remboursement de 16 à 17 % des sommes versées. M. le Président : Vous avez évoqué la spécificité des logiciels que vous utilisez. Quelle est-elle ? Quel est le coût, pour le FGAO, de la gestion d'un dossier ? M. Alain BOURDELAT : Le logiciel que nous utilisons a différentes applications : la prise en compte des données personnelles des victimes, la récapitulation des tâches qui doivent être effectuées quotidiennement par nos collaborateurs, la gestion des relances, les encaissements, les vérifications et le conventionnement avec les agents comptables des centres pénitentiaires car dix mille auteurs d'infractions que nous indemnisons sont dans les prisons françaises. Nous estimons à quelque 400 euros le coût d'un dossier pour le FGAO, ce coût étant établi en divisant nos frais de fonctionnement par le nombre des dossiers traités. Ce montant comprend une prestation complète, c'est-à-dire l'indemnisation, le recours, la comptabilité et la gestion de la trésorerie du fonds pour lequel nous intervenons. La convention de gestion que nous avions signée avec le FIVA en 2002 tenait compte du temps passé par nos collaborateurs à gérer les dossiers d'indemnisation des victimes de l'exposition à l'amiante au regard de l'ensemble de notre masse salariale. C'était ce sur quoi nous étions tombés d'accord, mais nous nous sommes rendu compte progressivement que notre prestation était vouée à s'affiner, et il est vraisemblable que si celle-ci avait duré plus longtemps, les prix auraient été renégociés. M. le Rapporteur : En résumé, le FGAO et le FIVA ont collaboré de 2002 à 2004 mais la convention n'a pas été renouvelée et, depuis lors, le FIVA gère lui-même les procédures d'indemnisation. Est-ce bien cela ? M. Alain BOURDELAT : Oui. Notre seule intervention actuelle consiste en la mise à disposition du FIVA d'un de nos collaborateurs de haut niveau : le responsable qui gérait l'ensemble du pôle « indemnisation des victimes de l'amiante » chez nous. M. le Rapporteur : J'aimerais que vous nous disiez ce qui, selon vous, explique la fin de votre collaboration avec le FIVA. Est-ce la pression des associations de victimes de l'amiante, qui souhaitaient la création d'un outil spécifique ? S'agit-il d'une volonté gouvernementale ? Comment s'explique ce changement d'organisation, puisque le FGAO respectait le cahier des charges du FIVA ? M. Alain BOURDELAT : Je vous répondrai de manière directe. Il y a eu, dès le départ, un malentendu fondamental avec les associations. Comme je vous l'ai dit, le FGTI avait eu à connaître des dossiers d'indemnisation de l'amiante dans un autre cadre. Mais, contrairement au FGAO, le FGTI est décisionnaire, et il a estimé qu'étant donné les multiples possibilités d'indemnisation dont jouissaient les victimes de l'exposition à l'amiante, le fait de lui demander d'intervenir dans ce champ n'allait pas de soi. Il a donc cherché à connaître la position de la Cour de cassation à ce sujet et, une fois que celle-ci s'est prononcée, le FGTI a indemnisé les victimes de maladies professionnelles, comme il savait désormais devoir le faire. Par ailleurs, en 1999, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Cherbourg s'était montrée particulièrement bienveillante dans ses évaluations. La Cour d'appel de Caen les a revues à la baisse, mais les décisions de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) étant exécutoires, il a fallu récupérer l'argent auprès des victimes, ce qui est une situation terrifiante pour elles et désastreuse pour l'image du FGTI. L'incompréhension a été telle qu'en juin 2000, notre siège de Vincennes a été envahi par quelques centaines de manifestants, qui ont d'ailleurs compris que nous exercions notre métier en toute objectivité. Je pense que cette manifestation a fait s'interroger sur l'organisation de l'indemnisation, et que les pouvoirs publics se sont alors demandé s'il convenait de maintenir le dispositif en vigueur ou s'il était préférable de créer un fonds spécifique qui pourraient gérer en transaction, ce qui donne une meilleure maîtrise de l'ensemble. De fait, lorsque l'on propose une indemnisation personnelle, on peut discuter les offres en fonction des arguments avancés et, éventuellement, les réajuster. De là est venue l'idée de créer un fonds à personnalité propre chargé d'indemniser les victimes d'exposition à l'amiante, dont les représentants siègeraient au comité consultatif, comme cela a été fait pour le FITH. C'est ainsi que le FIVA a été créé. Il est possible que les ministères concernés auraient souhaité garder le FGAO comme prestataire de services. Mais, étant donné l'origine de ses fonds, le FIVA a été doté du statut d'établissement public, ce qui complique la gestion conjointe, je l'ai dit. D'autre part, la pression des associations s'est exercée tout au long de l'élaboration du décret, et il semble bien que la durée d'un an fixée à notre mission ait été décidée en contrepartie d'un subtil équilibre au sein du conseil d'administration du FIVA. Le conseil d'administration du FGAO a proposé à l'État des solutions innovantes, telle que la création d'un GIE ou la constitution d'une association de moyens entre le FIVA et le FGAO, mais ces idées n'ont pas été retenues. M. le Rapporteur : Quel est le budget annuel du FGAO ? M. Alain BOURDELAT : À la charge d'indemnisation s'ajoutent les provisions, qui sont fluctuantes, car en matière de dommages corporels l'évaluation est faite dès l'ouverture du dossier. La situation évoluant, l'estimation s'affine par la suite. Quant aux recettes, elles sont issues des contributions des assurés. M. le Rapporteur : Ce qui signifie que chaque assuré contribue au financement du FGAO et du FGTI lorsqu'il règle ses primes ? M. Alain BOURDELAT : Oui. M. le Président : En revanche, ce sont la sécurité sociale et l'Etat qui indemnisent la contamination par le virus du sida. M. Alain BOURDELAT : Le financement du FITH a été fait par un don initial de 1,2 milliard de francs, fait par les assureurs l'année de sa création, l'abondement ayant lieu ensuite par dotations budgétaires. Les indemnisations du sida ont été considérables, véritablement hors norme. C'est le tarif des mésothéliomes et des cancers broncho-pulmonaires. M. le Président : Un très important effort de prévention a été fait, s'agissant de l'amiante, mais il faut tirer tous les enseignements nécessaires de l'exposition à ce matériau au moment où les innovations technologiques se multiplient, qui peuvent induire des risques connus et inconnus. Dans ces conditions, n'aurait-on pas intérêt à créer des fonds dédiés, mais dont la gestion serait commune ? Une telle organisation permettrait des financements différents selon les fonds, sans éparpiller les moyens. M. Alain BOURDELAT : Je partage sans réserve ce point de vue : plus on associe les moyens, mieux c'est. L'indemnisation recouvre une grande variété de situations et traiter ces cas divers améliore le savoir-faire et la prise en compte de la dimension humaine des dossiers. Ainsi, nos collaborateurs qui ont eu en ligne les malades atteints du sida ont appris à prêter une oreille attentive à leur détresse et parfois à leur fureur. De plus, les situations juridiques sont à chaque fois différentes, et ces expériences nouvelles se fertilisent. Il est d'ailleurs certain que si le FGAO était à nouveau amené à traiter de l'indemnisation des victimes de l'amiante ou d'un problème similaire, nous nous y prendrions d'une autre manière pour adapter notre offre aux demandes des différents ministères. M. le Rapporteur : Si la puissance publique l'avait voulu, votre prestation aurait-elle pu perdurer ? M. Alain BOURDELAT : Il faut certes savoir s'adapter, mais il n'en reste pas moins que certains modes de fonctionnement sont plus efficaces que d'autres. Or, le partage des compétences entre le FGAO pour l'instruction et le FIVA pour la décision n'a pas été des plus commodes, le FIVA exigeant qu'une fois le dossier instruit, toute décision soit prise par son directeur et son agent comptable, qui se rendaient à notre siège, à Vincennes, pour étudier les dossiers sur papier. C'est une procédure extrêmement lourde, si lourde qu'à la fin décembre 2003 nous avons recensé 1 000 dossiers en attente. De même, alors que nos logiciels permettaient de respecter strictement l'obligation de distinguer ordonnancement et règlement par l'emploi de verrous informatiques à tous les stades de la procédure, le FIVA a souhaité que l'ordonnateur et le payeur soient des personnes physiques distinctes. Cela nous a contraints à rompre les séquences de traitement informatique. Cette régression a eu pour conséquence qu'il a fallu de deux mois et demi à trois mois à l'agent comptable du FIVA pour régler des dossiers que le traitement informatique aurait permis de régler en deux à trois jours. Nous avons eu le sentiment d'une grande désorganisation, et je suis certain que l'on peut trouver le moyen d'une plus grande efficacité. M. le Président : Vous venez d'en faire une démonstration redoutable ! Je vous remercie. Audition conjointe de M. Roger BEAUVOIS, président du conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), et de M. François ROMANEIX, ancien directeur du FIVA Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Nous recevons MM. Roger Beauvois, président du conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), et François Romaneix, qui en fut le directeur depuis sa création jusqu'en septembre dernier. Je rappelle que le FIVA fut fondé fin 2000 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, afin de procéder à la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes de l'amiante. Comment le FIVA fonctionne-t-il ? Comment envisagez-vous son évolution ? Que pensez-vous du récent rapport de la Cour des comptes ? Telles sont les questions que nous souhaitons aborder avec vous, comme l'indique d'ailleurs le questionnaire qui vous a été adressé, et pour lesquelles nous aimerions avoir une réponse écrite. M. Roger BEAUVOIS : Nos réponses au questionnaire vous seront effectivement transmises dès que nous les aurons finalisées. Le conseil d'administration du FIVA ne ressemble ni à celui de la plupart des autres établissements publics nationaux, ni à celui des caisses de sécurité sociale, par sa composition comme par ses prérogatives. C'est une sorte de « mini-parlement », en raison de ses effectifs - vingt-deux membres - et de l'absence de majorité de gestion, l'État y détenant moins de la moitié des sièges. Il est présidé par un magistrat de la Cour de cassation, qui joue un rôle d'arbitre, de facilitateur, chargé de tenter la conciliation d'intérêts opposés. L'autre caractéristique du conseil d'administration tient à l'importance de ses pouvoirs : il fixe la politique d'indemnisation du Fonds, qui recouvre les principes généraux, les procédures et le montant des indemnités accordées. Chacune des décisions mettant en jeu des intérêts contraires, il n'est pas facile de trouver un équilibre et nous nous sommes trouvés au bord du blocage à plusieurs reprises. Malgré tout, le FIVA fonctionne et répond depuis trois ans à sa mission d'indemnisation des victimes. La solution adoptée par les pouvoirs publics était sans doute la bonne : la confrontation des financeurs et des représentants des victimes aide à tendre vers un résultat acceptable par le plus grand nombre au regard de la sensibilité particulière du dossier. J'émettrai quelques réflexions sur la place du Fonds en tant qu'institution, après quoi je reviendrai sur les questions du barème, du niveau d'indemnisation et de l'articulation avec les juridictions. Dans leurs rapports, la Cour des comptes et la mission d'information du Sénat ont regretté les délais de mise en place du dispositif. La publication des mesures réglementaires nécessaires au fonctionnement du Fonds a en effet pris du retard : le décret n'a été publié qu'en octobre 2001 et le conseil d'administration n'a pu se réunir qu'une fois ses membres nommés, en avril 2002. Ensuite, le FIVA s'est mis en marche très rapidement, grâce à l'appui du Fonds de garantie automobile puis de manière autonome. L'importance du dossier, tant humainement que financièrement - le nombre de victimes devrait encore augmenter pendant une vingtaine d'années -, plaidait pour la création d'un établissement public administratif, animé par un esprit de réparation intégrale d'un préjudice particulier mais d'envergure nationale. Et j'ai la faiblesse de considérer que la formule de l'autonomie s'est révélée plus efficace et plus efficiente qu'une gestion en régie par le Fonds de garantie automobile. L'existence du FIVA, à mon sens, ne constitue pas un obstacle à une éventuelle réforme du régime d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, bien au contraire. Si une telle réforme devait voir le jour, le maintien du FIVA devrait certes être examiné, mais il n'était pas possible d'attendre qu'elle soit mise en œuvre car cela n'aurait pas permis de procéder rapidement à l'indemnisation des victimes de l'amiante. À tout le moins, l'expérience du FIVA pourra être utile. L'indemnisation du FIVA est-elle juste ? Les victimes de l'amiante sont-elles suffisamment indemnisées ? D'un autre côté, le dispositif ne coûte-t-il pas trop cher ? Certains parlent d'« indemnisation au rabais » quand d'autres estiment au contraire que le FIVA va trop loin par rapport à l'indemnisation de droit commun ou à celle d'autres maladies professionnelles, s'agissant surtout des affections bénignes. Être critiqué par les uns et les autres ne signifie nullement que la solution trouvée est la bonne, mais pas non plus qu'elle est la plus mauvaise. La juste indemnisation n'est pas celle qui satisfait les souhaits des victimes mais plutôt celle qui assure un traitement équitable de chacune d'entre elles, sans condition de lieu de résidence, de circonstances ou de type d'exposition. Le caractère relatif de la jurisprudence a déjà été exposé dans notre rapport d'activité. La Cour de cassation refuse de contrôler le montant des indemnités, estimant que c'est une question de fait et non de droit, ce qui a conduit à des divergences surprenantes entre les décisions rendues par les différentes juridictions. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, par exemple, pour des dommages similaires, a accordé des indemnités de 3 500 à 7 000 euros puis, quatre jours plus tard, de 30 000 à 45 000 euros, ce qui est évidemment incompréhensible. Il est vrai que ni les tribunaux des affaires de sécurité sociale ni les chambres sociales des cours d'appel ne sont des juridictions spécialisées dans la réparation intégrale des préjudices. Si la jurisprudence constitue un élément central pour définir la juste indemnisation, il convient d'intégrer la faible signification des moyennes et de relativiser l'exercice de comparaison, d'autant que l'adoption du barème du FIVA a pu modifier l'appréciation de certaines juridictions et surtout l'attitude des demandeurs. Les sommes accordées par les tribunaux jusqu'à la création du FIVA étaient légèrement supérieurs au montant du nouveau barème pour les maladies bénignes mais conformes à celui-ci pour les maladies malignes. La prise en compte objective de la diversité des pathologies liées à l'amiante est cruciale, les maladies allant des plaques pleurales jusqu'au mésothéliome, cancer à l'issue fatale. Lors de la fixation du barème, la hiérarchisation des indemnisations en fonction de la réalité des maladies a été l'un des points les plus âprement discutés, certaines d'entre elles ne se traduisant pas par des conséquences fonctionnelles graves et n'étant pas vouées à dégénérer en cancer. Je précise que 80 % des victimes déposant un dossier devant le FIVA souffrent uniquement d'affections bénignes. En janvier 2003, après avoir constaté l'impossibilité de rapprocher les positions de l'État et des associations de victimes, j'ai cru devoir proposer un barème pour sortir de l'impasse dans laquelle le FIVA risquait de s'enfermer. Ce barème a fait l'objet d'une campagne hostile, principalement de la part d'une association de victimes, mais je constate que 95 % de nos offres d'indemnisation sont acceptées. Les décisions des cours d'appel concernant les 5 % de recours reflètent la diversité d'une jurisprudence, au surplus toujours en construction. La mission d'information du Sénat recommande de « mieux informer les tribunaux sur le barème d'indemnisation du FIVA afin d'harmoniser les indemnisations accordées par la justice ». Cette information n'a certes pas été assurée par la chancellerie mais le FIVA s'en est chargé en diffusant son premier rapport d'activité dans toutes les juridictions. Mais en fait, certains magistrats refusent de valider cette référence. Des ajustements du barème sont sans doute nécessaires, mais je ne pense pas qu'il faille pour autant modifier son équilibre. Doit-on en conclure qu'une cour d'appel unique devrait statuer sur les contestations des offres du FIVA, comme le suggère la Cour des comptes ? Cette option aurait le mérite d'unifier la jurisprudence, mais la juridiction ainsi créée deviendrait une sorte d'ordonnateur de dépense publique, à moins que les critères d'évaluation soient encadrés par un texte normatif. Somme toute, je partage la circonspection manifestée par la mission d'information du Sénat. La meilleure voie pour garantir l'homogénéisation des indemnisations semble être celle du législateur et du pouvoir réglementaire, mais les associations de victimes - sans parler des magistrats - y seraient très hostiles. Quelles sont les insuffisances du dispositif actuel ? L'ambition initiale du législateur était de limiter les procédures contentieuses. Cette volonté a été contrariée une première fois par la jurisprudence de la Cour de cassation de février 2002 en vertu de laquelle les victimes peuvent obtenir plus facilement la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La reconnaissance de la responsabilité de l'État par le Conseil d'État, en mars 2004, offre également une nouvelle voie contentieuse. Dès lors, les victimes d'expositions professionnelles dépendant de la sécurité sociale - c'est-à-dire un peu plus de 90 % des demandeurs - ont le choix entre l'indemnisation par le FIVA ou la procédure contentieuse en reconnaissance de la faute inexcusable. Quoique le taux d'indemnisation par le FIVA soit passé de 84 à 87 % entre 2003 et 2004, le nombre de contentieux a bondi de 300 en 2002 à près de 1 300 en 2004, et seules quelques juridictions se sont alignées sur le barème du FIVA. En moyenne, les indemnisations offertes par les tribunaux sont maintenant supérieures à celles du FIVA, y compris pour les pathologies malignes. La croissance du contentieux à deux sources : pour les plaques pleurales, la générosité de certaines juridictions ; pour les autres maladies, la majoration de la rente, compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable, qui en fait une sorte de « réparation super intégrale ». Le FIVA peut accorder ce complément d'indemnisation lorsque la faute inexcusable est reconnue à l'issue d'un contentieux subrogatoire. Le nombre de ces procédures a considérablement augmenté ces derniers mois : entre mai et fin octobre 2005, 262 recours ont été engagés, dont 207 actions judiciaires et 55 demandes de remboursement à titre amiable par le service contentieux. Le FIVA, depuis sa création, a donné la priorité à l'indemnisation, mais les victimes et leurs familles sont très attachées à la mise en cause des responsables et l'intention du législateur était manifestement de faire reposer le plus possible la charge de l'indemnisation sur ces derniers. Le recours subrogatoire est toutefois marqué par une double ambiguïté : du fait de la puissance des mécanismes de mutualisation dans le système d'assurance des maladies professionnelles et des accidents du travail, la plupart des recours ne peuvent se conclure que par une condamnation morale, sans aucune conséquence financière pour le responsable. Le recours subrogatoire ne peut donc avoir comme enjeu que l'attribution d'un complément d'indemnisation. La conjonction de ces deux éléments a quatre conséquences négatives : le FIVA est contraint d'engager des recours sans autre issue possible que le versement d'un complément d'indemnisation ; des frais de procédures pèsent sur le Fonds ainsi que sur les caisses de sécurité sociale, et les juridictions sont inutilement mobilisées ; les employeurs ou leurs assureurs n'ont aucun intérêt à rechercher un accord amiable avec nous ; enfin, nous n'avons pas les moyens de mener à bien l'ensemble des recours nécessaires, le nombre de dossiers avoisinant les 2 500 par an. Le maintien du système actuel réserverait donc à un nombre limité de victimes le bénéfice d'un complément d'indemnisation au titre de la faute inexcusable. En outre, le recours subrogatoire est marqué par une sorte de concurrence entre le FIVA et les tribunaux de sécurité sociale, alors qu'il devrait être le moyen d'acclimater le barème du Fonds et de valoriser son rôle d'aide aux victimes. Les propositions de la mission d'information du Sénat constituent tout de même l'une des réponses possibles à ces enjeux. M. le Rapporteur : Merci pour cette présentation très complète des problématiques de la juste indemnisation et de la difficulté à mener des actions récursoires contre les responsables des sites amiantés qui ont exposé leur personnel. Quelles sont les pistes d'amélioration ? Je ne pense pas qu'il soit possible d'attribuer à nouveau cette mission au Fonds de garantie automobile, car cela provoquerait une incompréhension sociale, d'autant que le bilan de votre activité est très positif. Reste cette dérive judiciaire qui rend les indemnisations injustes quand elles ne sont pas directement du ressort de votre établissement. Comment parvenir à une relative égalité des indemnisations ? Peut-on éteindre la pratique du recours systématique au tribunal des affaires de sécurité sociale, qui crée un climat malsain ? Ne convient-il pas d'augmenter le montant des indemnisations versées par le FIVA ? Celui-ci ne manque-t-il pas de moyens pour assumer l'exercice des recours subrogatoires ? M. Roger BEAUVOIS : Le FIVA manque effectivement de moyens mais le problème est aussi de nature juridique : dans l'action subrogatoire, il est uniquement investi des droits de la victime, s'agissant notamment des délais de prescription. Dans 70 % des cas - les maladies bénignes -, la victime n'a rien à attendre d'une action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, puisque la rente servie, même majorée, serait de toute façon inférieure à l'indemnité accordée par le FIVA. Compte tenu de la mutualisation opérée par la branche AT-MP - accidents du travail - maladies professionnelles, l'employeur n'étant généralement pas tenu de réparer, il n'y a vraiment pas d'intérêt à agir. Pourtant, le recours subrogatoire devrait être exercé plus souvent, notamment à titre conservatoire, en prévision d'une aggravation des affections, mais le manque de moyens a pour conséquence une inégalité dans le traitement des victimes : pour certaines d'entre elles, nous n'engageons rien alors qu'elles auraient pu en bénéficier un jour, au-delà du délai de prescription. M. François ROMANEIX : Il convient de distinguer entre deux catégories de dossiers. Les personnes présentant un taux d'incapacité de 5 % - c'est-à-dire la grande majorité de cas - perçoivent de la part de la sécurité sociale une indemnité en capital de l'ordre de 1 600 euros, qui peut être doublée. L'indemnité servie par le FIVA au titre de l'incapacité est alors largement supérieure, que la faute inexcusable soit reconnue ou non. M. le Président : Pour les maladies dites « bénignes », le recours subrogatoire est donc sans effet sur le montant de l'indemnité. Mais pour les maladies malignes ? M. François ROMANEIX : La reconnaissance de la cause inexcusable peut avoir un impact sur la rente de la victime, mais surtout pour le conjoint survivant : la faute inexcusable fait passer le taux de la rente à 100 % du salaire de la victime décédée, alors qu'il est, sinon, de 40 % pour les conjoints survivants de moins de cinquante-cinq ans et de 60 % au-delà de cet âge. M. le Président : Cela signifie que le recours subrogatoire devrait être pratiquement systématique dans les cas de maladies malignes, sans quoi l'égalité de traitement ne serait pas garantie. Le problème est grave ! Comment faire ? M. Roger BEAUVOIS : La solution la plus directe serait de confier au FIVA les moyens matériels lui permettant d'exercer le recours subrogatoire dans tous les cas. La mission d'information du Sénat préconise, pour sa part, de créer une présomption de faute inexcusable et d'ajuster les indemnisations en conséquence. M. le Président : Donner des moyens, soit, mais encore faudrait-il déterminer leur montant et les modalités de leur mise en œuvre. Quant à la présomption de faute inexcusable, elle présente au moins l'intérêt d'être une mesure très claire. M. Roger BEAUVOIS : Le surcoût est estimé à 50 millions d'euros pour 2006 et atteindrait quelque 250 millions d'euros en 2035 ou 2040. M. François ROMANEIX : L'effet de montée en charge est lié au délai de perception des rentes. M. le Président : Le travail accompli par le FIVA est en tous points remarquable, mais il est de création récente et le problème est d'une grande complexité. Il est par conséquent normal que des difficultés surgissent - le législateur, du reste, ne les avait pas anticipées. M. François ROMANEIX : Il ne le pouvait pas car elles résultent de la jurisprudence de la Cour de cassation du 28 février 2002. La jurisprudence de 2004 fait, quant à elle, apparaître un très faible taux de rejet des contentieux, de l'ordre de 2 %. Il faut dire que les victimes et leurs avocats privilégient le passage devant le tribunal pour les dossiers les plus faciles, c'est-à-dire pour les grosses entreprises. Une reconnaissance systématique de la faute inexcusable ouvrirait des perspectives pour les salariés des petites entreprises. M. le Président : La recommandation de la Haute Assemblée me paraît très judicieuse. L'absence de moyens serait donc un faux-semblant ? M. François ROMANEIX : Le nombre de dossiers sur lequel un contentieux subrogatoire est possible risque d'augmenter. En effet, pour certaines catégories d'employeurs, la mutualisation est liée à des dispositions législatives dont les effets sont susceptibles de s'atténuer. Mais cela ne remet aucunement le raisonnement en cause. M. le Président : Notre mission ayant une vision prospective, elle s'est beaucoup intéressée au traitement de l'amiante résiduel et à la prévention des risques professionnels à l'avenir. Ce qui est arrivé avec l'amiante ne risque-t-il pas de se reproduire avec d'autres matériaux ? Pensez-vous que l'expérience du FIVA, établissement autonome, porte en soi les germes d'organismes similaires pour d'autres produits ou d'une structure unique intégrée à la branche AT-MP ? M. Roger BEAUVOIS : Cela relève d'un choix politique. Il est certain qu'une réforme du système d'indemnisation des AT-MP dans le sens de la réparation intégrale ferait perdre leur raison d'être aux fonds d'indemnisation autonomes. En revanche, lorsqu'un phénomène est aussi important et généralisé que celui des victimes de l'amiante, je persiste à penser que l'existence d'un établissement public autonome chargé de l'indemnisation est justifiée. M. le Président : Vous n'êtes donc pas favorable à la fusion du FIVA dans une structure globale dépendant de la branche AT-MP ? M. Roger BEAUVOIS : Non. La sécurité sociale sait indemniser les maladies professionnelles, et les caisses éprouveraient des difficultés majeures à abandonner le système forfaitaire actuel pour passer à la réparation intégrale. Mais le FIVA a acquis une certaine expérience, dont il serait possible de s'inspirer s'il s'avérait nécessaire de réparer les dommages subis par les victimes d'autres produits cancérigènes. M. le Président : Avez-vous été consultés sur le « Plan santé au travail » du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ? M. Roger BEAUVOIS : Non M. François ROMANEIX : Il ne comportait d'ailleurs pas de volet indemnisation. M. le Président : Certes, mais je suppose que le FIVA ne se contente pas d'indemniser. Avec des responsables de votre qualité, il doit avoir un regard sur le problème dans son ensemble. M. François ROMANEIX : Deux thèmes de réflexion sont actuellement en débat : celui de la tarification, sur lequel a travaillé une mission de l'inspection générale des affaires sociales ; celui de l'évolution de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui a donné lieu à plusieurs rapports et à propos duquel le projet de loi de financement de la sécurité sociale fait obligation aux partenaires sociaux d'engager une discussion. Le FIVA peut constituer une sorte de laboratoire de la réparation intégrale, même si l'angle d'indemnisation qu'il a choisi est très spécifique aux maladies professionnelles et ne saurait être appliqué, tel quel, aux accidents du travail du bâtiment, par exemple. M. le Président : Il convient en effet de distinguer accidents du travail et maladies professionnelles. Les accidents du travail sont de mieux en mieux maîtrisés, contrairement aux maladies d'aujourd'hui et de demain. Mais le FIVA ne peut jouer un vrai rôle de laboratoire en matière de réparation s'il ne s'interroge pas sur les risques d'émergence de nouvelles crises, quand bien même cela ne relève pas de sa responsabilité directe. Revenons à votre difficulté à trouver un équilibre, eu égard à l'absence de majorité de gestion au sein du conseil d'administration du FIVA. Pouvez-vous nous rappeler quelle est sa composition ? M. Roger BEAUVOIS : Il est constitué de cinq représentants de l'État, de huit représentants des partenaires sociaux, de quatre représentants des associations nationales d'aide aux victimes de l'amiante - deux de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), et deux de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante (ANDEVA) - ainsi que de quatre personnalités qualifiées, dont le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et un inspecteur général des affaires sociales, plus le président, magistrat de la Cour de cassation. M. le Président : Ce fonctionnement assurément délicat peut-il faire émerger des pistes pour l'avenir ? M. Roger BEAUVOIS : Il a le mérite de mettre en présence les financeurs et les représentants des victimes en vue de délibérations communes, mais il nous arrive d'approcher du blocage : la situation est alors arbitrée par les personnalités qualifiées ou le président, qui doit parfois faire usage de sa voix prépondérante pour faire pencher la balance. M. le Président : Voilà qui change du paritarisme classique ; il n'est pas exclu que cela constitue une piste intéressante pour l'avenir. M. Roger BEAUVOIS : Je n'ai pas de recette en tête, mais il est clair que nous aurions besoin de mécanismes pour faciliter la prise de décision. M. le Président : La solution est pourtant sans doute à rechercher au sein de la structure elle-même, car une intervention extérieure ne contribuerait sans doute qu'à renforcer les blocages. M. Roger BEAUVOIS : Je suis très prudent car lorsque me vient une idée, j'en perçois immédiatement non seulement les avantages mais aussi les inconvénients ! C'est sans doute une déformation professionnelle... M. le Président : Un conseil : ne faites jamais de politique ! M. Roger BEAUVOIS : On pourrait envisager d'accroître la représentation de l'État ou celle des personnalités qualifiées, afin d'éviter une lutte entre deux blocs d'importance égale. M. le Président : Le bloc de l'État et celui des organisations syndicales ? M. Roger BEAUVOIS : Les organisations syndicales plus les associations de victimes, les deux adoptant généralement des positions identiques. M. le Président : D'où l'idée d'un corps intermédiaire des personnalités qualifiées. M. Roger BEAUVOIS : C'est une piste. M. François ROMANEIX : En dépit du fonctionnement délicat de son conseil d'administration, le FIVA est quand même parvenu à trouver des équilibres, sous le contrôle des tutelles, qui peuvent toujours rejeter une décision si elles la jugent illégale ou porteuse de risques financiers. M. le Président : Vous avez dit que vous êtes entrés dans une phase ascendante du volume d'indemnisation, du fait de la progression sensible des maladies bénignes. Que pouvez-vous ajouter sur ce point ? M. Roger BEAUVOIS : Le pourcentage des maladies bénignes augmente en effet, tandis que le nombre total de dossiers ne cesse lui non plus de croître : en 2005, plus de 700 dossiers auront été ouverts chaque mois, soit une progression de 6 % par rapport à 2004. M. François ROMANEIX : Près de 26 000 demandes ont été enregistrées depuis la création du FIVA. M. le Président : Il semblerait que le coût de traitement par dossier est d'un très bon niveau. Est-ce exact ? M. Roger BEAUVOIS : Les frais de gestion ne représentent, en effet, que 1 %. M. le Président : Par rapport à d'autres structures, c'est remarquable. Il n'en reste pas moins que le financement du dispositif, pour les prochaines décennies, est inquiétant. M. Roger BEAUVOIS : Le financement vient pour 90 % de la branche AT-MP. M. le Rapporteur : Et les 10 % restants ? S'agit-il d'une participation de l'État ? D'un prélèvement sur la taxe sur le tabac ? M. Roger BEAUVOIS : D'une subvention de l'État. M. le Rapporteur : Achevez-vous l'exercice 2005 avec une réserve ? Quelles sont vos perspectives financières ? M. Roger BEAUVOIS : Nous allons achever l'année 2005 sans avoir épuisé nos réserves. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit une subvention de 315 millions d'euros de la branche AT-MP, à laquelle l'État ajoutera 50 millions, soit 365 millions, plus notre réserve. Nous prévoyons donc de boucler notre budget de 517 millions. Toutefois, fin 2006, la réserve sera pratiquement épuisée : elle ne couvrira plus qu'un mois d'activité. M. François ROMANEIX : Cette réserve résulte du retard pris par les textes réglementaires, puis par les délais nécessaires à l'adoption du barème. Le FIVA, à ce jour, a proposé plus de 20 000 indemnisations, pour un total excédant un milliard d'euros. En vertu de l'article 53 de le loi de 2000, le budget du FIVA est alimenté chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances, à due concurrence de ses besoins. M. le Rapporteur : Je voudrais vous poser plusieurs questions. L'action subrogatoire ne pourrait-elle pas être maintenue uniquement dans les cas où les victimes y gagneraient ? Par ailleurs, la présence au conseil d'administration des associations de défense des victimes est-elle positive ou d'un intérêt contrasté ? Enfon, quel regard portez-vous sur le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) ? Des échanges d'expérience avec le FIVA, voire un rapprochement des deux structures, ne sont-ils pas envisageables ? Le Sénat a d'ailleurs cru déceler un chevauchement de compétences. M. François ROMANEIX : Il existe deux portes d'entrée dans le FCAATA : le fait d'avoir travaillé dans une entreprise figurant sur les listes de manufactures d'amiante et le fait d'être atteint d'une maladie reconnue comme imputable à l'amiante, c'est-à-dire, depuis 2001, toutes les maladies, plaques pleurales incluses. M. le Rapporteur : Les allocataires du FCAATA peuvent-ils également prétendre à une indemnisation du FIVA ? M. François ROMANEIX : Le FCAATA est une sorte de dispositif de préretraite, qui accorde au travailleur 65 % de son salaire brut, sans indemniser le préjudice subi. M. Roger BEAUVOIS : S'agissant du recours subrogatoire, nous nous efforçons de l'actionner dans tous les cas où cela présente un intérêt pour la victime, mais celui-ci n'est pas toujours perceptible immédiatement : une aggravation des symptômes peut survenir à tout moment. Quant à la présence des associations de victimes au sein du conseil d'administration, elle est positive à bien des points de vue, notamment parce que celles-ci enrichissent notre réflexion en nous apportant beaucoup d'informations. M. le Rapporteur : La Cour des comptes considère que le FCAATA dépense beaucoup d'argent, qu'il est en réalité employé pour accompagner la restructuration de branches industrielles et qu'il serait préférable de reverser ses moyens au FIVA. Qu'en pensez-vous ? M. Roger BEAUVOIS : La conclusion - nous donner plus d'argent - me séduit forcément, mais je ne m'engagerai pas plus avant dans le débat ! La Cour des comptes a préconisé pour sa part que les demandes soient examinées non plus en fonction de l'entreprise incriminée mais au cas par cas, ce qui est le pain quotidien du FIVA. M. le Président : J'ignore ce que décidera la Cour de cassation à propos de la décision de la cour d'appel de Douai. En tout cas, le fait que la faute inexcusable tende à devenir la norme constitue, certes, une garantie pour les victimes, mais pose le problème de la recherche en responsabilité. Comment concilier ces deux approches ? M. Roger BEAUVOIS : La recherche de la faute inexcusable est animée par des motifs non seulement financiers mais aussi psychologiques, les victimes désirant voir désigner et condamner ceux qu'elles considèrent comme les coupables, ce que je comprends parfaitement. Mais, en matière pénale, il faut encore établir l'existence de l'infraction, en l'occurrence la négligence. M. le Président : Ce qui implique une enquête du Parquet. M. Roger BEAUVOIS : Le parquet, en cette matière, n'a jamais pris l'initiative des poursuites. Toutes les affaires sont ouvertes à la suite d'une constitution de partie civile. Dans ces conditions, c'est au juge d'instruction qu'il appartient de faire procéder à toutes les investigations nécessaires, à charge et à décharge. Certains juges d'instruction ont fait procéder à des investigations, mais cela s'est terminé par des non-lieux, notamment à la cour d'appel de Douai, la faute n'ayant pas été établie. Les affaires sont difficiles et les investigations sont forcément longues car elles requièrent des expertises scientifiques. M. le Président : Je vous remercie pour cette discussion extrêmement ouverte et intéressante. Audition de Mme Marianne LÉVY-ROSENWALD, présidente du conseil de surveillance du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Nous recevons maintenant Mme Marianne Lévy-Rosenwald, présidente du conseil d'administration du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA). Je précise que nos travaux ont vocation à prolonger et à compléter ceux du Sénat et que nous avons choisi de porter notre regard davantage sur l'avenir que sur le passé. C'est pourquoi nous insistons sur le traitement de l'amiante résiduel, sur la prévention et sur la prise en charge des victimes. Je rappelle que le FCAATA a été fondé fin 1998 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 - je présidais à l'époque la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale -, pour financer un mécanisme dérogatoire de préretraite destiné aux travailleurs de l'amiante âgés de plus de 50 ans. Le FCAATA a été la première réponse institutionnelle au drame de l'amiante, avant la création du FIVA, deux ans plus tard. Le récent rapport de la Cour des comptes a noté que ce Fonds avait pu être utilisé comme un mécanisme d'accompagnement de restructurations économiques et s'est interrogé sur le bien-fondé de son extension - désirée par certains intervenants sociaux, par exemple pour la fonction publique territoriale -, considérant que 10 % seulement des bénéficiaires sont atteints d'une pathologie professionnelle liée à l'amiante. Cet outil a donc dépassé la volonté initiale du législateur et se trouve devant une double problématique de coût et de pérennisation, voire d'élargissement. Quelles solutions proposez-vous ? Mme Marianne LÉVY-ROSENWALD : Permettez-moi d'abord de préciser que le FCAATA n'ayant pas, contrairement au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), la personnalité morale, il n'est pas doté d'un conseil d'administration mais d'un conseil de surveillance, qui détient beaucoup moins de pouvoirs : l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est définie de manière très précise par la loi et le conseil de surveillance a simplement pour mission de suivre les activités du Fonds, son bon fonctionnement et d'établir un rapport annuel sur les comptes. Le conseil de surveillance du FCAATA n'a donc aucun pouvoir de décision, ce qui en fait une instance beaucoup plus consensuelle que le conseil d'administration du FIVA. M. le Président : Pardonnez-moi pour cette erreur. Mais cela ne retire rien à l'intérêt de votre témoignage personnel. Mme Marianne LÉVY-ROSENWALD : Initialement, seuls pouvaient prétendre à l'allocation les salariés ou anciens salariés des établissements fabriquant de l'amiante et les salariés ou anciens salariés atteints des pathologies les plus graves liées à l'amiante. L'extension du FCAATA à des populations de plus en plus importantes est imputable au législateur. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a ouvert des droits au bénéfice des salariés ou anciens salariés des établissements de flocage et calorifugeage à l'amiante, aux salariés ou anciens salariés des établissements de construction et de réparation navale, ainsi qu'aux ouvriers dockers professionnels. S'en sont suivies des ouvertures, en 2002, pour le personnel portuaire assurant la manutention et, en 2003, pour les salariés agricoles. En outre, un arrêté de 2001 étend le droit à l'allocation à l'ensemble des maladies professionnelles, plaques pleurales incluses. Compte tenu de la montée en charge du système, le nombre de personnes indemnisées est passé de 3 800 à 27 500 entre 1999 et fin 2004, mais les modalités de l'allocation n'ont jamais été modifiées. M. le Président : Avez-vous une idée du nombre de personnes indemnisées en 2005 ? Mme Marianne LÉVY-ROSENWALD : Je serai en mesure de communiquer ces informations à votre mission courant décembre, après la prochaine réunion du conseil de surveillance. Ce qui est certain, c'est que les premières sorties du système ne compensent pas encore les entrées. L'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, l'ACAATA, est gérée par les caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), qui examinent les demandes et versent les allocations, ainsi que par la Caisse des dépôts, qui joue un rôle de back-office et établit les comptes annuels au vu des éléments transmis par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Les ressources du Fonds résultent d'un apport de la branche accidents du travail - maladies professionnelles (AT-MP), de droits sur les tabacs ainsi que de la nouvelle contribution votée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, qui, fin 2005, ne se matérialisait pas encore par le moindre transfert financier - la circulaire de la CNAMTS expliquant aux CRAM la marche à suivre pour repérer les entreprises éventuellement redevables n'ayant été publiée qu'au printemps 2005. Le conseil de surveillance, chargé du bon fonctionnement du système, est composé des représentants des organisations syndicales et patronales, des représentants d'administrations de l'État et de personnalités qualifiées (deux principales associations de victimes - la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), et l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante (ANDEVA) -, plus la présidente). Assistent également aux réunions la CNAMTS et la Caisse des dépôts. Les CRAM et la Caisse des dépôts reçoivent des moyens de fonctionnement. Ceux des CRAM ont été fixés par convention à 2 % des allocations versées mais la convention d'objectifs et de gestion passée entre l'État et la CNAMTS tend à réduire ce taux. La Caisse des dépôts est pour sa part refinancée aux frais réels. Le conseil de surveillance est une structure d'échanges qui examine les problèmes concrets rencontrés par les personnes demandant à bénéficier de l'allocation, étudie les données statistiques, débat du financement de l'ACAATA et propose des ajustements. M. le Rapporteur : Quel est l'âge moyen des bénéficiaires de l'ACAATA ? Mme Marianne LÉVY-ROSENWALD : L'âge minimum est de cinquante ans, l'âge moyen de cinquante-quatre ans et huit mois, l'âge de sortie de cinquante-neuf ans et sept mois : les personnes restent environ cinq ans dans le dispositif. M. le Rapporteur : L'intermédiation de la Caisse des dépôts est-elle vraiment utile ? Mme Marianne LÉVY-ROSENWALD : Je la trouve parfaitement inutile. Au départ, les droits sur les tabacs couvraient les cotisations versées au titre des retraites volontaires et complémentaires, mais ils sont maintenant insuffisants, ce qui rend nécessaires des mouvements financiers complémentaires entre la CNAMTS et la Caisse des dépôts. Le service rendu par la Caisse des dépôts n'est pas en cause, mais n'apporte pas de réelle valeur ajoutée. Le législateur l'avait introduite dans le circuit pour que cette allocation ne soit pas confondue avec une prestation sociale, mais les régimes versent déjà des allocations qui ne sont pas des prestations sociales. M. le Président : Présidez-vous le conseil de surveillance depuis la création du Fonds ? Mme Marianne LÉVY-ROSENWALD : Depuis 2000, j'ai succédé à un collègue après son décès. M. le Rapporteur : Puis-je avoir l'indiscrétion de vous demander quelle est votre activité principale ? Mme Marianne LÉVY-ROSENWALD : Je suis conseiller maître à la sixième chambre de la Cour des comptes, ce qui m'occupe à plein temps, l'activité de présidente du conseil de surveillance étant peu prenante : elle se résume à préparer et tenir deux réunions par an, à vérifier les comptes rendus et à élaborer le rapport annuel. M. le Rapporteur : Dans quelle situation se trouve le FCAATA ? Comment réagissez-vous à l'affirmation selon laquelle il s'agirait d'un outil de restructuration industrielle de certains bassins d'emploi ? Mme Marianne LÉVY-ROSENWALD : Dans le cadre de mes fonctions, je n'en ai pas directement connaissance. Cet outil de restructuration fonctionne grâce à l'extension des listes d'établissements dont les salariés et anciens salariés sont admis au bénéfice de l'allocation. D'une part, ces listes peuvent être complétées et, d'autre part, les dates d'activité ouvrant droit à l'allocation peuvent être élargies. Le système est dans la main du ministre du travail. Par exemple, quand on veut étendre les droits des salariés des Chantiers de l'Atlantique, on étend les dates à des périodes plus larges. Pour Moulinex, il suffit de considérer que les câbles amiantés des fers à repasser sont des éléments de calorifugeage. M. le Rapporteur : La commission de la branche AT-MP donne un avis et le ministre tranche ? Mme Marianne LÉVY-ROSENWALD : Absolument, par arrêté ministériel. J'ajoute que, selon la CNAM, des entreprises ont pu augmenter le salaire de référence des bénéficiaires pendant leurs dernières années d'activité, afin de réduire la perte de revenu supportée par ces derniers une fois qu'ils toucheront la préretraite amiante. C'est donc une forme d'invitation à demander le bénéfice de l'ACAATA. M. le Rapporteur : Quelles sont les revendications des associations de victimes de l'amiante au sein du conseil de surveillance ? Mme Marianne LÉVY-ROSENWALD : Elles ont pour objectif de défendre les droits des victimes. M. le Président : Je comprends que vous n'avez pas de rôle décisionnaire mais le conseil de surveillance est un lieu où l'on parle et, étant conseiller maître à la sixième chambre, qui couvre notamment les problèmes de santé et de financement de la sécurité sociale, vous connaissez parfaitement ces questions. Mme Marianne LÉVY-ROSENWALD : Je m'efforce de faire convenablement mon travail. M. le Président : Je vais donc me permettre de pousser les feux. L'objectif, au départ, est d'essayer de répondre au risque de perte de vie, qui, pour les maladies les plus graves, tel le mésothéliome ou les cancers du poumon, atteint en moyenne dix ans. À cet effet, il faut fixer un critère d'activité ou de catégories d'entreprise mais certains salariés seulement seront atteints, sans qu'il soit possible de savoir à l'avance lesquels : l'approche n'est donc pas scientifique. Par ailleurs, la tentation existe d'élargir le principe d'indemnisation à d'autres fins sociales, ce qui conduit le ministère du travail à jouer sur les dates d'éligibilité des entreprises ou la composition des listes. Enfin, apparaissent de plus en plus de demandes concernant de nouvelles activités, émanant par exemple d'agents des collectivités territoriales, vraiment touchés, sans qu'il soit possible de les faire entrer dans le système, puisqu'il est limité au secteur privé. Comment la présidente du conseil de surveillance réagit-elle à ces différents problèmes ? Mme Marianne LÉVY-ROSENWALD : Si le système n'est ouvert qu'aux salariés du secteur privé, c'est parce qu'il est financé par le régime général. Pour résoudre le problème, il suffirait de trouver des financements spécifiques, comme cela a été fait dans le cadre des régimes spéciaux d'EDF, de la SNCF ou de la marine marchande. Le seul souci, compte tenu de la demande permanente des représentants du patronat de faire jouer la solidarité nationale, c'est que la modification de la loi contraindrait à revoir l'ensemble du financement de l'allocation. La présentation du rapport de la Cour des comptes a suscité un petit débat au sein du conseil de surveillance. Les représentants des salariés reconnaissent que, lorsqu'une entreprise figure sur une liste, les salariés de ses ateliers, qui ont effectivement pu être au contact de l'amiante, sont aussi bien concernés que ceux des bureaux, qui n'ont pas nécessairement encouru le risque de respirer des fibres du produit. Il y a donc un avantage qui est d'ouvrir un droit à une population et un inconvénient qui est de faire naître une anxiété inutile, comme toutes les politiques de prévention, à mon sens. Le cas des intérimaires constitue une autre source d'inégalité sur laquelle la CNAMTS a essayé de travailler. Un salarié stable d'une entreprise pourra assez facilement prouver qu'il travaillait dans un établissement aux dates prévues par les textes mais la situation est autrement plus difficile pour un intérimaire, par exemple une femme de ménage. Le conseil de surveillance réfléchit aux moyens de faire admettre ces salariés aux mêmes droits que les titulaires d'un contrat à durée indéterminée. M. le Rapporteur : Certaines personnes bénéficient effectivement de la classification de leur établissement sans avoir jamais été en contact avec l'amiante. En revanche, les ouvrières d'entretien intérimaires employées par les sociétés sous-traitantes qui faisaient le ménage dans les bureaux d'ateliers n'entrent pas dans la classification, alors qu'elles ont été en contact avec l'amiante - certaines d'entre elles souffrent malheureusement déjà de plaques pleurales. Mme Marianne LÉVY-ROSENWALD : Elles entrent dans la classification si elles parviennent à prouver qu'elles ont travaillé sur le site le temps nécessaire pour bénéficier de l'allocation, mais elles ont plus de difficulté à le prouver qu'un salarié sous contrat à durée indéterminé. Les organisations syndicales et les associations de victimes ont appelé à plusieurs reprises l'attention de la CNAM sur ce problème ; j'ai le sentiment que la situation, à cet égard, s'est améliorée car, depuis quelque temps, j'en entends moins parler. M. le Rapporteur : Quel est le pouvoir concret du conseil de surveillance ? Peut-il émettre des recommandations ? Interpeller les ministres concernés ? Mme Marianne LÉVY-ROSENWALD : Les administrations compétentes entendent les messages en direct, puisqu'elles siègent au conseil de surveillance et, quand elles sont interpellées, je veille à ce qu'elles donnent une réponse au plus tard lors de la séance suivante. Par exemple, le conseil de surveillance a progressivement reconnu que le caractère exclusif de l'ACAATA était injuste : il est désormais autorisé de la cumuler avec une pension de réversion ou d'invalidité, le montant total étant déterminé par un calcul différentiel. M. le Président : Ces évolutions figurent-elles dans vos rapports annuels ? Mme Marianne LÉVY-ROSENWALD : Peut-être pas dans les rapports, mais dans les dossiers préparatoires aux réunions. M. le Président : Je récapitule. Votre position extérieure d'écoute est bien utile. Pour ouvrir des droits nouveaux, au bénéfice, par exemple, des agents de la fonction publique territoriale, il suffirait de trouver un mécanisme financier équilibrant le dispositif. L'opinion publique est de plus en plus mobilisée sur le problème, d'autant que les conditions dans lesquelles les victimes décèdent sont souvent épouvantables. Les organisations de défense des victimes jouent un rôle social utile. Mais comment expliquez-vous qu'il soit de plus en plus difficile de faire reconnaître que les employés d'une entreprise ont été exposés à l'amiante ? Par la peur de l'extension du dispositif ? Mme Marianne LÉVY-ROSENWALD : C'est évident. Il faut dire que le dispositif coûte 100 millions d'euros supplémentaires chaque année. Les pouvoirs publics cherchent par conséquent à limiter les nouvelles inscriptions d'établissements. M. le Président : Cela ne peut pas tenir car le nombre de décès, lui, sera de plus en plus élevé. Mme Marianne LÉVY-ROSENWALD : Pour le moment, les statistiques de sortie du dispositif par décès ne sont pas anormalement élevées ; elles ne témoignent fort heureusement pas d'une hécatombe. On peut donc penser que les victimes de l'amiante ne décèdent pas de manière anticipée. Mais la prudence est de mise car il est possible que les personnes très gravement atteintes ne demandent même pas l'allocation, parce que ce n'est pas la peine. M. le Président : J'imagine que le conseil de surveillance se penche sur le sujet ? Mme Marianne LÉVY-ROSENWALD : Les statistiques de sortie du système sont regardées de près, effectivement, les uns espérant que le système se stabilise enfin, les autres étant attentifs à la courbe des décès. M. le Rapporteur : Le souci de limiter l'extension du dispositif est compréhensible. La vraie injustice, me semble-t-il, est que des personnes bénéficient du dispositif, alors qu'elles ne le devraient pas, tandis que d'autres rencontrent toutes les peines du monde pour faire valoir leurs droits. Mme Marianne LÉVY-ROSENWALD : L'instruction des dossiers individuels par les CRAM me semble tout de même désormais très équitable ; les associations et les organisations syndicales reconnaissent d'ailleurs que le système fonctionne bien. L'inégalité réside davantage dans la typologie des métiers et des entreprises que dans l'examen des situations individuelles. La vraie injustice consiste à traiter différemment les différentes catégories de travailleurs ; pour les dockers, par exemple, la prise en compte de la dimension restructuration économique a joué. Par contre, lorsqu'un salarié entre dans une catégorie reconnue, il n'aura aucune difficulté à faire valoir ses droits. Que ce salarié soit intérimaire ou non, il obtiendra donc gain de cause, mais à condition que l'établissement où il a travaillé figure sur une liste. M. le Président : La Cour des comptes préconise l'intégration de la problématique de l'amiante dans celle de la prise en compte de la pénibilité pour la détermination des conditions de départ à la retraite. Qu'en pensez-vous ? Mme Marianne LÉVY-ROSENWALD : Je pense que cet amalgame tendrait à nier le caractère exceptionnel de l'amiante. M. le Président : Cela ne conduit-il pas à différencier ce qui relève, d'une part, de la dureté physique de certains travaux et, d'autre part, des risques encourus lorsque l'on manipule certains produits, de plus en plus variés et en invention permanente. Mme Marianne LÉVY-ROSENWALD : C'est une différenciation qui a un sens, effectivement : le risque de l'amiante aurait pu être évité, alors que certains métiers sont pénibles par nature. Le mélange des genres pourrait conduire à banaliser les maladies professionnelles : au lieu de prémunir les salariés contre ce risque, on le compenserait a posteriori par une indemnisation, sous forme de prestations de retraite plus avantageuses. Il faut au contraire éviter que ce risque n'apparaisse. C'est différent de la dureté physique qui est plus un fait qu'un risque à éviter. M. le Rapporteur : Les quelque 20 000 salariés des entreprises sous-traitantes intervenant à la périphérie des sites nucléaires, au-delà du risque d'irradiation, effectuent des travaux physiquement pénibles en milieu hostile et sont donc sujets à une fatigue cardiaque prématurée. Cela n'a pas de lien avec le risque d'irradiation. J'adhère donc à cette distinction. M. le Président : Je le répète, notre souci est moins de refaire l'histoire que d'explorer les problèmes nés de l'amiante pour se projeter vers l'avenir. M. le Rapporteur : Quel est l'organisme chargé de percevoir la participation des entreprises, qui s'élève à environ 115 millions d'euros ? Mme Marianne LÉVY-ROSENWALD : Je ne sais pas encore si les fonds transiteront par la CNAMTS ou par la Caisse des dépôts. En tout cas, le recouvrement auprès des entreprises appelées à cotiser sera centralisé par l'URSSAF de Nantes. M. le Rapporteur. Comment voyez-vous l'avenir du financement du FCAATA ? Mme Marianne LÉVY-ROSENWALD. Des pressions très fortes sont exercées sur l'État pour qu'il augmente sa contribution. L'ACAATA est mutualisée entre toutes les entreprises alors que, selon les règles de la branche AT-MP, seules devraient cotiser celles dont les salariés ont été victimes de l'amiante. Cela ne pourra pas continuer indéfiniment ; les entreprises finiront par faire entendre leur demande de rééquilibrage du système, à moins que sa montée en puissance reste modérée. C'est un élément à prendre en compte lorsque l'on réfléchit à l'extension du dispositif à de nouvelles catégories de salariés. M. le Rapporteur : Au fur et à mesure que l'année 1997 s'éloigne, le nombre de personnes qui ont été exposées à l'amiante devrait être de mieux en mieux cerné. Des travaux prospectifs ont-ils été menés à ce propos ? Mme Marianne LÉVY-ROSENWALD : À la demande du Parlement, des travaux prospectifs ont été menés par le FIVA et le ministère sur le nombre de victimes à l'échéance de vingt ans. Je vous signale toutefois, à titre anecdotique, le cas surprenant d'une personne née dans les années 60 qui souffre d'un cancer lié à l'amiante ; eu égard à son âge, elle n'a pas pu être contaminée sur son lieu de travail. M. le Rapporteur : Cela nous renvoie au problème de l'amiante résiduel ; il faut être prudent. M. le Président : Madame, je vous remercie sincèrement pour cet échange extrêmement utile. Audition de représentants de la Cour des comptes : Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Nous sommes heureux d'entendre aujourd'hui M. Michel Cretin, président de la sixième chambre de la Cour des comptes, ainsi que Mme Rolande Ruellan et M. Frédéric Salas, respectivement contre-rapporteure et rapporteur du rapport de mars 2005 sur l'indemnisation des conséquences de l'utilisation de l'amiante, réalisé par la Cour à la demande de la commission des affaires sociales du Sénat. Je précise à nos invités qu'après avoir commencé par le problème de l'amiante dit « résiduel », nous avons abordé la question de la prévention avant d'en venir aux dispositifs d'indemnisation, cessation anticipée d'activité et autres. Viendront ensuite l'approche juridique et particulièrement pénale, puis l'approche européenne et internationale. Nous connaissons votre rapport et ses conclusions, très critiques. Aussi commencerons-nous par entendre vos remarques avant d'engager le débat. M. Michel CRETIN : Le Premier Président de la Cour des comptes, empêché, m'a demandé de le suppléer - ce que je fais volontiers, bien que mon installation à la présidence de la sixième chambre, chargée de la sécurité sociale et de la santé, remonte seulement à une quinzaine de jours... Je vais donc vous faire part des résultats des travaux réalisés par la Cour, à la demande de la commission des affaires sociales du Sénat, sur l'indemnisation des conséquences de l'utilisation de l'amiante, et plus particulièrement sur les deux fonds créés à cet effet, et sur les dépenses de la branche « accidents du travail - maladies professionnelles » (AT-MP) du régime général. S'ils ne couvrent qu'une partie du champ d'investigation de votre mission d'information, nous n'en sommes pas moins en mesure de vous apporter des éléments originaux. Ces travaux ont donné lieu à une communication, reprise dans un premier rapport du Sénat publié en avril 2005 et, depuis, largement exploité dans la deuxième partie d'un second rapport, sorti tout récemment. L'amiante est à l'évidence un grand problème de santé publique. On estime que 2 500 décès professionnels par an sont associés à l'amiante, et ce chiffre est susceptible d'évoluer. C'est également une grande question politique qui touche au fonctionnement de nos institutions, dans la mesure où son traitement illustre le poids des groupes de pressions dans la décision politique et les dommages qui peuvent en résulter. C'est aussi un problème juridique dans la mesure où se posent toutes les questions liées au principe de l'indemnisation des victimes, d'autant que des arrêts récents ont encore fait évoluer la situation. C'est enfin une question économique qui se pose en termes de coûts et surtout de modalités de leur prise en charge - et c'est naturellement sur ce dernier aspect que j'insisterai. Il est à noter que le « coût de l'amiante » ne se limite pas à celui de la seule indemnisation des victimes : il conviendrait d'y ajouter, entre autres, toutes les dépenses liées au désamiantage : la Cour les avait estimées, pour la seule université de Jussieu, à quelque 800 millions d'euros dans son rapport de février 2005... L'indemnisation des conséquences de l'utilisation de l'amiante représente en charges annuelles environ 10 % des dépenses totales liées aux accidents du travail et maladies professionnelles. Les dépenses cumulées du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) auront été de l'ordre de 1,1 milliard d'euros en 2004 et atteindront 1,2 milliard d'euros en 2005. Le FCAATA devrait dépenser en indemnisations environ 788 millions d'euros en 2005, soit 20 % de plus qu'en 2004. C'est ce que l'on appelle, en termes technocratiques, une dépense dynamique... M. le Président : C'est le moins que l'on puisse dire ! M. Michel CRETIN : Celles du FIVA, en revanche, semblent se stabiliser : après une période de rattrapage de la période ancienne, il semble avoir adopté un régime de croisière avec des dépenses de l'ordre de 400 millions d'euros. Ces charges sont couvertes - de manière du reste très inégale - par le régime général des AT-MP à hauteur de 600 millions d'euros, par l'État à hauteur de 29 millions d'euros par le biais d'une partie de la fiscalité sur le tabac, et par une contribution spécifique des employeurs plafonnée à 40 millions d'euros. Soit un total de 669 millions d'euros pour 2005. Il est difficile de comparer les dépenses et les ressources sur l'année par le fait que nous sommes dans une période de montée en charge. Entre 1999, année de création du FCAATA, et 2004, dernière année complète connue, le financement des deux fonds aura été assuré à hauteur de 2,6 milliards d'euros par la branche « accidents du travail » et à hauteur de 294 millions d'euros par l'État. Autrement dit, la branche AT-MP aura supporté environ 90 % du financement et l'État les 10 % restants. Cette répartition n'est pas le résultat d'une décision explicite signifiée à l'avance ; on peut observer que ces 10 % correspondent à peu près à ce qui pourrait être considéré comme la part imputable à l'État-employeur - à distinguer de l'État-puissance publique - compte tenu de la proportion de salariés indemnisés après avoir occupé un emploi dans le secteur public pris au sens large. Bien évidemment, la part de responsabilité qui pourrait être imputée à l'État-puissance publique n'entre pas dans ce calcul... Ce sujet est du reste en train d'évoluer depuis que le Conseil d'État, dans quatre décisions prises en 2004, a validé le raisonnement des juges du fond, lesquels avaient estimé que l'État avait failli à sa mission de prévention des risques professionnels et donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour carence fautive. Aussi, compte tenu de ce nouvel élément et de l'absence, jusqu'alors, d'une clé de répartition explicite, la question de la répartition des charges entre la branche AT-MP et l'État est-elle devenue un véritable sujet de réflexion. Parmi les quatorze pistes de travail que la Cour avait tracées en conclusion de sa communication remise au Sénat, figurait en deuxième position la définition d'une clé de répartition entre l'État et la branche AT-MP pour le financement des deux fonds. C'est dire l'intérêt qu'attachait la Cour à un mécanisme de répartition stable dans le temps, quand bien même sa définition proprement dite ne relevait évidemment pas de ses compétences. La Cour avait également posé la question de l'intégration de l'indemnisation des victimes de l'amiante dans le cadre plus général de l'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles. La question de la réforme des modalités de l'indemnisation n'est pas nouvelle : la Cour elle-même l'avait posée dans le rapport qu'elle avait consacré en février 2002 à la gestion du risque « accidents du travail - maladies professionnelles », étayé, du reste, par plusieurs constats relatifs aux modalités appliquées aux victimes de l'amiante. Autrement dit, le problème commençait déjà à se poser. Mais, faute de l'avoir résolu, on risque d'assister à une multiplication de dispositifs particuliers qui nuisent à la cohérence d'ensemble du système de réparation et de prévention des risques professionnels. J'ai bien conscience que la position prise par la Cour diffère de celle des associations de victimes de l'amiante, qui persistent à défendre un dispositif particulier. Cette position peut évidemment se comprendre en l'état actuel de la législation ; reste que l'actuel cloisonnement des systèmes de réparation nous paraît peu propice à une action d'ensemble contre les risques professionnels. Aussi sommes-nous partisans d'une rénovation générale du dispositif d'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles, plutôt qu'à une prolifération de dispositifs particuliers. Autre constat de la Cour, la sédimentation des dispositifs - qui s'est traduite par la création de deux fonds - a abouti à consacrer à l'indemnisation de personnes qui, bien qu'ayant pu être exposées au risque, n'en sont pour l'heure que des victimes potentielles, des financements plus importants qu'aux victimes effectives : 800 millions d'euros pour le FCAATA contre 400 pour le FIVA. La création du FIVA par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2002 n'a pas été mise à profit pour repenser l'indemnisation dans son ensemble. Premier fonds d'indemnisation, le FCAATA a été créé par la LFSS 1999. Il s'agit, en fait, d'une forme particulière d'indemnisation dans la mesure où le dispositif est assimilable à celui d'une préretraite : l'objet du FCAATA est de permettre aux salariés ayant travaillé dans les industries de l'amiante de prendre une retraite anticipée au motif que leur espérance de vie aurait été réduite du fait de leurs conditions d'emploi durant leur vie professionnelle. Ce dispositif s'applique donc tout aussi bien à des salariés qui pourraient développer ultérieurement une pathologie liée à l'amiante, à des salariés qui, bien qu'ayant été exposés au risque, ne présentent aucun symptôme et enfin à des salariés employés par des établissements ayant utilisé de l'amiante, sans pour autant avoir été exposés directement au risque... La liste des établissements en question étant fixée par arrêté, on a progressivement, par la voie réglementaire, étendu la possibilité de bénéficier d'une allocation de cessation anticipée d'activité - et le fait que le FCAATA soit un des derniers dispositifs de préretraite existants a, nous semble-t-il, joué un certain rôle. Le dispositif initial, tel que créé par la LFSS de 1999, concernait les personnes de plus de cinquante ans reconnues porteuses d'une maladie professionnelles causée par l'amiante La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a élargi le champ des bénéficiaires aux salariés des établissements de flocage et de calorifugeage, eux aussi listés dans un arrêté, aux travailleurs ayant exercé certains métiers de la réparation et de la construction navales et aux dockers de plusieurs ports. La LFSS pour 2002 a ensuite étendu le bénéfice de l'allocation aux personnels de manutention dans les ports et modifié les règles de non-cumul et d'accès en autorisant un cumul partiel de la prestation avec une pension de réversion, un avantage d'invalidité ou un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial sous forme de versement d'une indemnité différentielle. La LFSS pour 2003 a enfin élargi le champ d'application de l'allocation aux salariés agricoles. Par ailleurs, l'arrêté du 3 décembre 2001 en a ouvert le bénéfice aux malades souffrant de plaques pleurales, originellement exclus du dispositif. Dans le même temps, la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation s'est régulièrement accrue et les périodes d'activité prises en compte ont été progressivement étendues, sans qu'il soit toujours possible de distinguer les motifs ayant conduit à retenir telle période plutôt que telle autre. Ainsi, les Chantiers de l'Atlantique ont fait l'objet de deux arrêtés, celui du 7 juillet 2000 couvrant la période de 1945 à 1975 et celui du 11 décembre 2001 reportant la limite de ladite période de 1975 à 1982. À la suite de ces élargissements successifs, le nombre des bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante, qui était de moins de 4 000 en 2000, a atteint environ 27 000 en 2005 et les charges ont connu un accroissement rapide, passant de 54 millions d'euros en 2000 à 650 millions d'euros en 2004 pour s'établir, en gros, à 788 millions d'euros en 2005. Or 10 % seulement des bénéficiaires de l'Allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) sont effectivement atteints d'une pathologie associée à l'amiante, plaques pleurales incluses... Le recensement des abus les plus manifestes, et même de certains détournements, a pu cacher l'essentiel : le dispositif financé par la branche AT-MP bénéficie à des salariés dont la majorité ne développera jamais de pathologie liée à l'amiante ! Or les fonds que la branche dépense pour ces dispositifs de préretraites sont près de deux fois supérieurs à ceux qu'elle consacre à l'indemnisation des victimes. Le PLFSS pour 2006 illustre bien ce que l'on peut être tenté de qualifier de « paradoxe », puisqu'il prévoit une dotation de 700 millions d'euros au profit du FCAATA et seulement 315 millions d'euros pour le FIVA. Il se pose donc, aux yeux de la Cour, un problème d'allocation des ressources. Dans le prolongement de la communication remise au Sénat, le rapport annuel de la Cour sur la sécurité sociale publié en septembre 2005 indique que le financement du FCAATA « apparaît à bien des égards une charge indûment supportée par la branche AT-MP et contribuant pour une part importante de son déficit. Les financements que la branche AT-MP a consacrés au FCAATA sont depuis 2002, année d'apparition du déficit, supérieurs en cumulé au déficit de la branche. Un recentrage des financements accidents du travail et maladies professionnelles sur les préretraites servies par le FCAATA aux seules victimes ayant développé une maladie s'impose41. » C'est pourquoi la Cour propose que la situation des personnes ayant été exposées à l'amiante dans leur travail, mais n'ayant pas développé de pathologies soit examinée, par exemple, dans le cadre des travaux de mise en œuvre de l'article 12 de la loi portant réforme des retraites sur la prise en compte de la pénibilité dans les conditions de départ à la retraite. Venons-en au FIVA. Un des motifs essentiels de sa création était d'assurer aux victimes une indemnisation rapide et totale de leur préjudice et de ne pas ajouter à leurs souffrances le fardeau des recours juridictionnels. Cet objectif n'a pas été totalement atteint, à en juger par les différences qui subsistent entre, d'une part, l'indemnisation « intégrale » accordée par le FIVA et, d'autre part, la réparation sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur que seul le juge peut consentir. Un amendement parlementaire avait déjà tenté de lever cette difficulté en proposant une procédure fondée sur le principe de l'action subrogatoire, à charge pour le FIVA de l'enclencher et de se voir subrogé dans les droits de la victime pour aller devant le juge faire reconnaître la faute inexcusable. Malgré cela, de nombreuses victimes continuent à saisir elles-mêmes la justice. Le FIVA pourrait de lui-même, dans un souci d'équité et dans l'intérêt des victimes, décider de faire bénéficier celles qui pourraient prétendre à indemnisation sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur, d'une revalorisation correspondant à la réparation qu'elles auraient obtenue devant un tribunal - autrement dit, admettre la notion de faute inexcusable et revaloriser ses barèmes en conséquence, afin que la victime n'ait plus à aller en justice. Le financement de cette mesure pourrait être assuré par le recentrage du FCAATA sur les seules victimes aux pathologies déclarées, recentrage d'autant plus souhaitable que les dépenses afférentes à l'indemnisation des conséquences de l'amiante pourraient continuer à croître très rapidement dans les prochaines années. M. le Rapporteur : L'instruction des dossiers d'indemnisation avait initialement été confiée au fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages, dont le FIVA s'est servi dans un premier temps comme prestataire de services, avant de voler de ses propres ailes. Était-il à votre avis utile de créer un établissement spécifique ? Par ailleurs, la Cour des comptes jette un regard très critique sur le fonctionnement des deux fonds. N'y a-t-il pas lieu de réfléchir sur l'avenir du FIVA en tant qu'établissement spécifique ? M. Michel CRETIN : Les relations entre le fonds général d'indemnisation et les associations des victimes de l'amiante n'étaient pas très bonnes. Ils s'étaient souvent opposés lors des contentieux développés devant les commissions d'indemnisation des victimes. Les associations étaient très hostiles à l'idée que l'indemnisation des conséquences de l'amiante soit prise en charge par un organisme auquel elles s'étaient heurtées à l'occasion de maintes procédures. C'est la principale raison qui a conduit à la création d'un fonds spécial. Mme Rolande RUELLAN : La Cour conçoit très volontiers que les associations, compte tenu de l'émotion que suscitait ce dossier, aient tenu à avoir « leur » établissement, dans lequel elles sont, du reste, bien mieux représentées qu'elles ne l'auraient été dans un fonds chargé de gérer la totalité des indemnisations de toutes sortes de victimes. Peut-être aurait-on pu faire autrement ; quoi qu'il en soit, le FIVA a été créé et la Cour en a pris acte. Se pose ensuite la question de ses conditions de fonctionnement. Le fait que le FIVA ait mutualisé une partie de ses tâches avec l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) procède déjà d'un louable souci d'économie de moyens. Mais on pourrait aller un peu plus loin en imaginant que le FIVA se contente d'instruire les dossiers et fasse payer les prestations par le réseau de la sécurité sociale, d'autant que son indemnisation est déjà versée aux victimes en complément de la prestation versée par la branche AT-MP. Autrement dit, les victimes reçoivent deux chèques, ou tout au moins ont deux payeurs. On pourrait envisager qu'ils n'en aient plus qu'un, le FIVA continuant d'instruire les dossiers selon ses propres règles - on sait que l'appréciation des préjudices dans la branche AT-MP n'est pas la même que celle du FIVA qui suit une logique de réparation intégrale. Si donc il est encore un peu tôt pour songer à une fusion complète, au moins le paiement pourrait-il être unifié, afin de simplifier les procédures de contrôle et d'éliminer certains frais de gestion. Mais, cette démarche de rationalisation mise à part, je ne crois pas que l'on reviendra sur le principe d'un fonds spécifique dans l'immédiat. M. le Président : Assurément ! M. le Rapporteur : Dans l'immédiat, certainement pas : nous sommes toujours sous le coup de l'émotion, et toucher à un système qui reçoit l'assentiment global des associations de victimes serait particulièrement maladroit. Reste que les maladies liées à l'amiante se caractérisent par un temps de latence très élevé et que le problème de l'indemnisation se posera encore dans vingt ans. L'émotion s'apaisant, il pourrait être possible de nous engager dans le processus de rationalisation suggéré par la Cour. Le FCAATA a essuyé la plus grosse part de vos critiques. On peut relever une double injustice : d'un côté, des personnes ont bénéficié d'une cessation d'activité utilisée à des fins de restructuration industrielle ; de l'autre, certaines personnes réellement exposées, mais dans des métiers ou des entreprises non listés dans l'inventaire, sont exclues du dispositif ou à tout le moins contraintes à un véritable chemin de croix pour faire valoir leurs droits... Par exemple, certains agents d'entretien travaillant dans des établissements de construction navale ont été écartés au motif qu'ils étaient salariés d'une entreprise sous-traitante ou affectés à un emploi non classé « amianté ». Mais qui connaît les chantiers navals sait que les bureaux des chefs d'équipe sont situés dans les ateliers, et amiantés tout autant ! Il s'agissait souvent de femmes, qui d'ailleurs commencent, elles aussi, à présenter des plaques pleurales. En attendant que leur sort soit pris en compte, elles en sont réduites à recueillir des témoignages, des attestations, etc., bref, à vivre un véritable calvaire pour se voir reconnaître leurs droits. Cela dit, le FCAATA a précisément le mérite de faire prendre en compte le temps de latence des maladies liées à l'amiante : si seulement 10 % des bénéficiaires ont pour l'heure développé une pathologie, rien ne dit que les autres n'en développeront pas une dans les années à venir. Un mésothéliome peut demander 25 à 30 ans pour apparaître. M. Michel CRETIN : Le seul critère objectif dont nous disposons pour recentrer le FCAATA sur les véritables victimes est l'apparition de la maladie. Aussi la Cour propose-t-elle que le bénéfice du FCAATA soit réservé aux seules personnes ayant développé une pathologie avérée. M. Frédéric SALAS : Il s'agit d'un point difficile du dossier... M. le Président : Assurément ! M. Frédéric SALAS : Les parlementaires avaient à l'origine fortement limité le champ du FCAATA aux seuls malades, d'une part, et aux producteurs d'amiante, d'autre part. C'est seulement par la suite qu'il a été étendu jusqu'à arriver chez Moulinex. M. le Président : L'extension à Moulinex n'était pas du fait du législateur. M. Frédéric SALAS : Mais on en est bien arrivé jusque-là... En sens inverse, j'ai découvert que, dans les fonderies de Fumel, par exemple, les salariés ayant développé une silicose ou une sidérose sont plus nombreux que ceux victimes d'affections de l'amiante, mais c'est au titre de celle-ci qu'ont été effectués les départs en préretraite FCAATA. La silicose, affection particulièrement grave, ne donne, en effet, droit à aucun traitement particulier. Comment expliquer cette différence de traitement ? Pourquoi l'amiante et pas la silicose ? Par ailleurs, nous vivons dans un système budgétaire contraint. Comment expliquer que l'on dépense deux fois plus pour indemniser des personnes dont la maladie n'est pour l'heure - heureusement - que potentielle que pour indemniser des malades reconnus ? Aussi proposons-nous de recentrer les financements sur ceux qui ont réellement développé une pathologie. On ne peut que s'inquiéter en voyant le FCAATA augmenter cette année de 20 %, alors même qu'aucun changement de nature réglementaire n'est venu influer sur ses effectifs. Le risque est grand de voir cette évolution des dépenses se poursuivre. Comment les financera-t-on ? Recentrons l'effort financier sur l'indemnisation des victimes, faisons le maximum pour que les malades atteints de mésothéliome ou d'asbestose soient indemnisés dans les meilleures conditions, mais limitons le FCAATA aux seules personnes réellement touchées par une maladie liée à l'amiante - sachant qu'un patient présentant une plaque pleurale ne développera pas forcément pour autant un mésothéliome. M. le Président : En tant que président de la commission des affaires sociales, j'ai activement contribué à faire évoluer la législation, pour ce qui concerne les dockers notamment. Mais nous avons le plus grand respect pour la Cour des comptes et ses rapports... Pour commencer, comment êtes-vous arrivés à ce chiffre de 10 % de bénéficiaires réellement atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante ? M. Frédéric SALAS : J'ai repris les statistiques d'entrées dans le dispositif du FCAATA : 10 % y sont entrés au titre d'une maladie liée à l'amiante, 90 % pour avoir travaillé dans une entreprise listée. M. le Président : Mais vous ne savez pas combien, parmi ces 90 %, ont développé une pathologie. Mme Rolande RUELLAN : Nous n'avons jamais dit autre chose. M. Frédéric SALAS : C'était simplement une photo à l'instant « t ». M. le Président : Encore faut-il savoir l'interpréter. C'est donc chose faite. Sur les contraintes financières, vous avez parfaitement raison. Ce n'est pas un problème que l'on évacue du dos de la main. Reste que l'amiante provoque des maladies dont le temps de latence est très long, et dont aucun dispositif scientifique ne permet de déceler les symptômes à l'avance. C'est là une des plus grandes difficultés de ce dossier et le rapporteur a parlé, avec raison, de double injustice. C'est tout à fait sciemment que nous avons pris le risque de faire bénéficier du FCAATA les dockers de Dunkerque, qui transportaient 80 % de l'amiante dans des sacs de jute, en univers confiné, dans des conditions dont vous n'avez pas idée. Certains tombent malades - il en meurt tous les mois - et d'autres pas ; mais c'était en somme une assurance tous risques, puisque rien ne nous permettait de faire la distinction entre ceux qui seraient atteints et ceux qui ne le seraient pas. Et l'on pourrait aller encore plus loin : tombent également malades les femmes de dockers, qui battaient les bleus de travail... Deuxième injustice, liée au fait que les listes ont été établies par arrêté, non sans difficulté - parfois même pour résoudre des problèmes d'emploi ou des problèmes sociaux, à Moulinex par exemple. Certaines entreprises n'y figurent pas, alors qu'elles pourraient y être. J'en connais plusieurs, où l'amiante vole encore dans l'air... Troisièmement, nous verrons de plus en plus, à cause de l'amiante résiduel, de salariés demander à bénéficier d'un dispositif dont ils sont encore exclus, par exemple dans la fonction publique territoriale : je connais une ville où les conditions de désamiantage n'ont pas été totalement respectées, c'est le moins que l'on puisse dire ! On en imagine les conséquences. Nous avons bien une réglementation ; encore faut-il savoir comment elle est appliquée. Et sur ce point, nous avons tout lieu de nous interroger... J'ajoute que la distinction entre accidents du travail et maladies professionnelles me paraît de plus en plus grande ; l'affaire de l'amiante la met, d'ailleurs, encore plus en évidence. Un accident du travail, on sait ce que c'est ; une maladie professionnelle, cela devient de plus en plus complexe, compte tenu de la prolifération des techniques, des produits et des mesures de prévention qu'ils appellent. Une évolution se dessine donc, qui n'était pas inscrite dans les faits voilà vingt ou trente ans et que personne même ne concevait. Notre débat fait ainsi émerger des problèmes jusqu'alors insuffisamment pris en compte, parfois même totalement nouveaux, et l'amiante a de ce point de vue servi de révélateur. Toute la difficulté des négociations actuellement en cours tient précisément à la nouveauté de concepts que les partenaires sociaux n'avaient guère l'habitude de manier. L'intensité, les accidents physiques et l'environnement du travail n'ont plus rien à voir avec la vision que l'on en avait voilà vingt ou a fortiori cinquante ans. M. le Rapporteur : Faire bénéficier quelqu'un qui ne présente ni plaque pleurale ni aucun symptôme d'affections autrement plus graves - pour certaines irrémédiables - est en quelque sorte une façon de lui donner un peu plus de temps hors travail pour le cas où il serait atteint d'une maladie après quelques années de retraite. Autrement dit, une façon d'accorder une sorte d'indemnisation sur la durée de vie... C'est en tout cas ainsi que le dispositif est fortement ressenti. Mme Rolande RUELLAN : Mais pourquoi réserver ce dispositif aux seuls malades de l'amiante ? On connaît nombre de maladies professionnelles, de cancers liés aux produits que l'on respire et, pourtant, on ne va pas mettre les personnes en préretraite à cinquante ans au motif que, à un moment de leur vie, ils ont été en contact avec tel produit... Cela ferait sauter la banque à coup sûr et c'est précisément cela qui nous préoccupe. M. Jean-Marie GEVEAUX : Je connais le cas d'une entreprise du Mans, qui travaillait à la fabrication et à la réparation de wagons pour la SNCF, et qui n'a jamais figuré sur la liste, alors qu'un site dans l'Eure, qui faisait exactement la même chose, avait été mentionné dans l'arrêté, tout comme son siège social à Paris... Un des ouvriers de cette entreprise m'a confié que ses deux compagnons étaient déjà morts et que, de son poste de travail, il était le seul à avoir survécu - pour l'instant. Vous avez parlé d'une possible utilisation de l'article 12 de la loi Fillon, qui permet de prendre en compte la pénibilité du travail. Pour l'heure, les discussions avec les syndicats sont dans l'impasse. Mais cela ne revient-il pas à déplacer le problème du financement ? En avez-vous discuté avec eux ? Est-ce plus ou moins intéressant sur le plan financier ou s'agit-il seulement pour vous d'alléger la charge de la branche AT-MP ? Mme Rolande RUELLAN : Nous avons effectivement émis cette idée dans le rapport, alors que la négociation n'avait pas encore commencé. C'était une possibilité, mais également une façon pour la Cour de rappeler la responsabilité des partenaires sociaux dans cette affaire. L'État culpabilise, et à juste titre, sur l'amiante et tout le dispositif qu'il a mis en place est une réponse à cette culpabilisation ; mais les partenaires sociaux n'en sont pas pour autant exempts de toute responsabilité. M. le Président et M. le Rapporteur : Nous sommes bien d'accord. Mme Rolande RUELLAN : Or l'extrême mutualisation qui préside au financement du système aboutit à une totale dilution de cette responsabilité. Si certaines entreprises ont disparu, que l'on ne peut donc plus poursuivre en responsabilité, d'autres existent toujours et devraient se préoccuper de la situation de leurs salariés autrefois au contact avec de l'amiante au lieu de tout renvoyer sur un mode de financement collectif alimenté par l'ensemble des entreprises, dont bon nombre ne sont pour rien dans cette affaire. Ce n'est là qu'une réponse partielle : il n'est évidemment pas question qu'elles se substituent totalement au FCAATA. Quant aux plaques pleurales, force est de reconnaître qu'elles représentent 93 % des affections, alors qu'elles ne créent aucun handicap. À l'origine exclues du champ du FCAATA, elles ont été introduites par la suite. Or la plus grande part des bénéficiaires ne présentent, et c'est heureux, que des plaques pleurales. M. Michel CRETIN : Vous avez à juste titre relevé le « dynamisme » et le potentiel de développement de la notion de maladie professionnelle, qui inclut désormais jusqu'à des aspects psychologiques, autrefois non pris en compte. Vous reconnaissez tout autant l'existence d'une contrainte de financement. Reste à trouver un critère aussi objectif et équitable que possible pour indemniser les gens réellement victimes de l'exposition à l'amiante. Or la liste dont nous nous servons à ce jour, nonobstant les injustices auxquelles donne lieu son établissement, reste à l'évidence un critère plutôt large, qui se traduit par une population d'allocataires potentiels très étendue. D'où notre suggestion de recentrer le dispositif en faisant appel à un critère objectif, simple et le moins contestable possible : la déclaration d'une pathologie. Peut-être existe-t-il d'autres pistes ; celle-là en tout cas nous semblait de nature à permettre un équilibre entre deux contraintes difficilement conciliables. M. Jean-Marie GEVEAUX : Pourra-t-on faire marche arrière ? M. le Président : Le problème est trop difficile pour se poser en termes de marche arrière ou pas. Le président de la sixième chambre connaît aussi bien que nous l'extraordinaire mobilisation que suscite cette affaire dans l'opinion publique. Je comprends parfaitement votre souci de maîtriser un processus dont le coût est considérable ; reste qu'en s'appuyant sur l'existence d'une pathologie maligne - je ne parle pas des plaques pleurales, affection bénigne -, on ne répondra pas à la préoccupation, dans la mesure où lorsque la maladie se déclarera, il sera le plus souvent trop tard... L'apparition d'un mésothéliome, cancer typiquement lié à l'amiante, ne laisse guère qu'une espérance de vie de six à dix-huit mois, et dans des conditions épouvantables. On ne saurait donc limiter le bénéfice de ce « rachat » de quelques années de tranquillité à l'apparition d'une maladie fatale à très court terme. Par ailleurs, et cela montre tout à la fois la difficulté du débat, le caractère méritoire et respectable du travail de la Cour et la complexité énorme du sujet, le traitement de la question des accidents du travail par les partenaires sociaux depuis plusieurs dizaines d'années, à coup de compromis et de négociations, peut-il s'appliquer à la nouvelle vision, qui apparaît progressivement, de la nature même du travail ? Nous savons tous très bien ce qu'il en a le plus souvent été pour l'amiante : entre le risque et l'emploi, un compromis a été vite trouvé. Mme Rolande RUELLAN : Un chantage... M. le Président : Je ne veux même pas employer ce mot ; mais dans certains cas, c'était bien de cela qu'il s'agissait. Depuis, les procédés de travail ont considérablement changé. Si la problématique des accidents du travail reste classique, connue, maîtrisée, celle des maladies professionnelles a considérablement évolué. Pourra-t-elle toujours être abordée par le biais de la négociation partenariale ? Mme Rolande RUELLAN : La négociation partenariale reste incontournable. La branche AT-MP est précisément celle que les partenaires sociaux s'estiment le plus légitimement en droit de contrôler et de piloter. Ce qui ne signifie pas pour autant que l'État abdique de ses responsabilités. L'amiante servira probablement de leçon pour les partenaires sociaux et particulièrement les syndicats, jusqu'alors totalement inexistants dans la commission « accidents du travail » de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), pilotée par le MEDEF. On y sentait une sorte de complicité dans la non-défense des intérêts des salariés. Sans chercher à se substituer totalement aux partenaires sociaux, l'État devra se montrer plus vigilant qu'il ne l'a été dans la défense des intérêts de la santé au travail. Un plan a été élaboré... M. le Président : Tout à fait, et il faut saluer cette approche. Mme Rolande RUELLAN : La commission des maladies professionnelles au ministère du travail met des années, du fait de l'obstruction du MEDEF, à reconnaître une évolution et à accepter la modification d'un tableau et l'inscription d'une nouvelle maladie ou d'une nouvelle condition. L'État est trop faible... M. le Président : Tout cela n'est-il pas dépassé au regard de la rapidité des mutations liées aux nouvelles technologies, dont les cycles ne sont désormais plus que de trois ans ? Mme Rolande RUELLAN : Cela appelle sans doute d'autre d'autres façons de travailler, et plus de sens de la responsabilité du côté de l'État. M. Michel CRETIN : Ouvrir un dispositif très large pour l'amiante conduira tôt ou tard à ouvrir d'autres dispositifs tout aussi larges pour nombre de situations susceptibles d'entraîner des pathologies. Toute la question est de savoir où est le point d'équilibre, et ce n'est pas à la Cour de le définir. Un arbitrage s'impose. Notre critère vaut ce qu'il vaut ; il avait en tout cas le mérite de l'objectivité. M. le Président : Vous avez ouvert une porte que nous ne pouvons plus refermer. Je partage totalement l'avis de Mme Ruellan : pour moi, le terme « partenaires sociaux » signifie patronat et syndicats. Ce n'est pas moi qui appellerai à une remise en cause du partenariat... Et pourtant ! Mme Rolande RUELLAN : Ils ont failli. M. le Président : Ce n'en était pas loin. Ce jeu de pressions et de terrain n'a tenu qu'à un doigt, et reste très fragile. N'aurait-il pas mieux valu une approche plus scientifique, point de départ d'une analyse plus prospective, comme y appelait le professeur Got ? La prévention exige de prendre le plus de recul possible. En admettant, comme je le souhaite, que l'État se décide à reprendre davantage la main, encore faut-il qu'il s'en donne les moyens. Le tableau des structures de prévention et d'articulation que nous nous sommes amusés à dresser est particulièrement éclairant : insuffisance de moyens et éclatement total ! Voilà un beau sujet pour la Cour des comptes... Mme Rolande RUELLAN : On ira voir... M. le Président : On crée l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET), structure nouvelle, à partir de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE) qui avait déjà eu bien du mal à démarrer... Non seulement le démarrage est chaotique, mais voilà qu'on en rajoute sans donner les moyens de faire face à des problèmes énormes ! C'est vous qui avez ouvert la porte et vous aurez beau pousser du pied, jamais vous ne la refermerez. Vous êtes condamnés à aller jusqu'au bout... M. le Rapporteur : Je veux saluer votre courage, madame la contre-rapporteure : à l'évidence, vous dites des choses qui dérangent, alors même que les temps pousseraient plutôt à se dire que moins on travaille, mieux c'est ! J'y vois aussi une réaction face à l'application excessive du principe de précaution. Enfin, vous nous mettez sous les yeux une réalité financière : le poids que l'ensemble de la nation aura à supporter durant des années si l'évolution des chiffres se confirme. Reste qu'il sera très difficile d'expliquer tout cela et de prendre certaines décisions : il faudra bien s'y résoudre un jour ou l'autre, mais je ne me sens pas encore le courage d'annoncer de but en blanc la remise en cause du FCAATA, désormais réservé aux seules pathologies déclarées... En revanche, il nous faut rapidement intégrer toutes vos recommandations : la dérive de l'extension peut être sans limites et nous ferons immanquablement sauter la banque, l'État et la nation à poursuivre dans ce sens. Cela dit, je veux bien que travailler, cela fasse mal, et que se lever le matin, cela stresse. Mais doit-on vraiment tout prendre en compte, y compris le petit mal de dos, le stress, la difficulté du transport, la durée du travail ? À lire certaines conclusions sur la prise en compte de fatigues physiques au travail, on en vient à se demander s'ils ne se sont pas fait mal pendant le week-end à faire du sport ! M. le Président : Cela arrive... M. le Rapporteur : Souvent ! Je tenais en tout cas à vous remercier de votre contribution, écrite et orale. Vous avez mis le doigt sur la plaie ; il nous faudra tenir compte de la réalité, mais également gérer un climat devenu proprement fantasmatique, où l'irrationnel tient une grande place sur le terrain. Sans doute faudra-t-il des années pour que la raison l'emporte. M. Jean-Marie GEVEAUX : Il faudra effectivement beaucoup de courage aux uns et aux autres pour remettre tout cela en ordre. M. le Président : On découvre seulement en France qu'il serait tout de même très important, pour des raisons économiques, mais également sociales, de travailler au-delà de cinquante-cinq ans... Mme Rolande RUELLAN : Et même de soixante... M. le Président : ...et même au-delà de soixante. Or cette découverte est toute récente. On s'aperçoit soudain qu'il se pose un problème des seniors, confirmant ce que plusieurs d'entre nous disions déjà depuis longtemps, quelles qu'aient été les alternances gouvernementales. M. Michel CRETIN : Bien des problèmes - il n'est que de voir l'exemple de la métallurgie - ont été réglés par les préretraites ; celui-là est le dernier dispositif du genre. M. le Président : Et de surcroît chargé d'une connotation symbolique découlant d'une réalité terrible. M. le Rapporteur : Comprenez bien le sens de ma précédente intervention : en ce moment même, dans les entreprises sous-traitantes du milieu nucléaire, des personnes travaillent dans des conditions épouvantables qui se traduisent sur le plan de la santé par des manifestations très précises. Astreints à un travail très physique - démanteler des sites nucléaires au marteau-piqueur enfermés dans une combinaison de vinyle -, ils sont fréquemment victimes de maladies cardiaques et mériteraient vraiment de partir en cessation anticipée d'activité, car tout porte à croire que leur retraite sera bien moins longue que celle de nombre de bénéficiaires du FCAATA et autres. « Nous, on trinque tous les jours », me disent-ils. « Et pour nous, rien ! » Et pour cause : ils ne sont pas en contact avec un produit dangereux ; les questions de contamination et d'irradiation nucléaires sont relativement bien contrôlées. C'est tout simplement leur activité physique qui est véritablement pénalisante. Mme Rolande RUELLAN : Le problème est bien celui de la pénibilité du travail et sa solution ne réside pas forcément dans la préretraite : il suffit de faire en sorte que des salariés ne passent pas toute leur vie sur des postes épuisants et de mettre en place une véritable gestion des carrières. M. le Rapporteur : Tout à fait. M. le Président : Je suis bien d'accord. Mme Rolande RUELLAN : Il ne faut pas qu'on en reste à l'idée que la préretraite est la solution à tout. C'est même assez effrayant. Ainsi que vous le dites, nous avons du chemin à parcourir dans l'autre sens. M. Michel CRETIN : L'intervention du Rapporteur montre qu'il se pose un problème de justice ; or on ne répond pas forcément à un problème de justice par une réaction émotionnelle, fût-elle institutionnalisée et entretenue par diverses associations. Si on le replace sur un plan général, on se retrouve face à une dynamique financière qui apparaît immédiatement insupportable ; force est de trouver au plus vite un critère. Quel est le plus juste, celui qui permettra d'indemniser les conséquences de l'exposition non seulement à l'amiante, mais également à toute une série de situations susceptibles d'entraîner des pathologies, et ce d'autant plus que la notion elle-même de pathologie s'élargit notablement ? Face à cette dynamique, les conditions jusqu'alors retenues, sous la pression d'une certaine émotion, ont abouti à une réponse non seulement partielle, mais également injuste. Comment maintenant trouver un critère tout à la fois juste, objectif, défendable et applicable à toutes les situations ? Voilà le problème de fond qui nous est posé. M. le Président : Nous le percevons bien. Malheureusement, rien n'est plus difficile que d'aller à contre-courant d'une réaction émotionnelle : le seul fait de refuser de participer à une manifestation réclamant la réécriture de la loi Fauchon vous fait montrer du doigt... Nous sommes plusieurs dans ce cas - pas tous, d'ailleurs ! Nos courages sont souvent à géométrie variable... Quel critère ? Si je comprends la logique de celui que vous proposez, je vois difficilement comment le mettre en œuvre. Je partage votre préoccupation, mais nous n'avons pas encore la réponse. M. Frédéric SALAS : Nous avons bien conscience du problème, et c'est la raison pour laquelle notre proposition d'un recentrage du FCAATA sur les victimes avérées va de pair avec l'application de la présomption de faute inexcusable dans les indemnisations du FIVA. M. le Président : Sur le FIVA, nous comprenons parfaitement votre raisonnement, d'autant que la présomption de faute inexcusable est quasiment devenue la norme - ce qui, au passage, compliquera le raisonnement sur le plan pénal ; mais c'est là un tout autre débat, qui ne regarde plus la Cour des comptes, mais la Cour de cassation. Sur le FCAATA en revanche... M. Frédéric SALAS : Loin de moi l'idée de rompre le secret de l'instruction, mais le FCAATA ne m'est pas apparu, et j'en ai été surpris, comme un point véritablement majeur dans les réponses de l'ANDEVA et de la FNATH. Cette dernière, devant le Sénat, a même été jusqu'à se montrer relativement ouverte à l'idée d'un recentrage des financements. M. le Président : En effet. Votre remarque est très juste. M. Frédéric SALAS : Il faut avoir cela en mémoire. Je précise enfin que, pour avoir été marin et bien connaître la Direction des chantiers navals (DCN) de Cherbourg, j'ai pu, connaissant le dossier de l'intérieur, dépasser certaines inhibitions avant de rédiger mon rapport. M. le Président : Madame, Messieurs, vous nous avez grandement aidés à progresser dans notre réflexion en répondant à un interrogatoire tout à la fois critique et approfondi. Soyez en tous les trois remerciés. Audition de Maître Michel LEDOUX, avocat Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Nous vous remercions, maître, d'avoir accepté notre invitation. Votre cabinet, spécialisé dans la défense des victimes de l'amiante, engage régulièrement des actions judiciaires en dommage et intérêt sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur, mais également des actions au pénal visant à la condamnation des responsables. Nous avons délibérément mis l'accent sur le présent et l'avenir, la question de l'histoire de l'amiante étant déjà bien connue et, du reste, fort bien rappelée dans le récent rapport du Sénat. C'est pourquoi, à partir de cette malheureuse expérience, notre réflexion se concentre sur plusieurs sujets bien précis : la gestion de l'amiante résiduel, la prévention, l'indemnisation des victimes, l'aspect pénal et enfin la dimension européenne et internationale. Compte tenu du peu de temps dont nous disposons ce matin, nous ne traiterons que de l'aspect civil de votre activité. Nous vous demanderons de revenir lorsque nous aborderons le volet pénal de notre investigation, fin novembre. M. Michel LEDOUX : Je « m'occupe » de l'amiante depuis longtemps, puisque dès 1995, nous avons été deux cabinets - le mien et celui de mon confrère Jean-Paul Teissonnière - à prendre en charge la dimension juridique et judiciaire de cette affaire, lorsque nous avons eu connaissance, grâce à M. Goldberg, des premières constatations de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Nous nous sommes aussitôt mis à rechercher ce qu'il était possible de faire, sur le plan judiciaire, pour obtenir une indemnisation. Mais parallèlement, puisque nous vivons dans un pays où seul compte le pénal, nous avons essayé d'appeler l'attention des médias sur le sort des victimes de l'amiante en déposant plainte et en saisissant le juge d'instruction. Autrement dit, nous avons d'entrée de jeu décidé d'engager des procédures civiles et des procédures pénales. Les premières victimes de l'amiante étaient considérées comme des victimes du travail et indemnisées dans le cadre des maladies professionnelles. Dans ce dispositif, l'employeur bénéficie d'une immunité légale : moyennant paiement de ses cotisations à l'URSSAF, calculées par les caisses régionales d'assurance maladie, il est quitte de toute indemnisation. Si un accident ou une maladie survient, c'est la caisse primaire d'assurance maladie qui prend en charge la victime, de façon forfaitaire. On lui rembourse ses frais médicaux, une indemnité journalière en cas d'arrêt de travail, et enfin une rente, c'est tout. Ce système d'indemnisation forfaitaire, qui remonte à 1898, ne souffre qu'une exception : la faute inexcusable, la victime considérant, dans cette hypothèse, que l'origine de son accident ou de sa maladie est due à une infraction de son employeur aux règles d'hygiène et de sécurité. Tenter de faire établir la faute inexcusable de l'employeur était donc le seul moyen d'obtenir une indemnisation un peu moins misérable que ce que l'on offrait à l'époque : une incapacité permanente partielle de 5 % - cas d'environ 60 % des victimes - donnait droit, pour solde de tout compte, à seulement 9 501 francs, les rentes inférieures à 10 % étant capitalisées ! Le problème était qu'à l'époque, on n'avait quasiment jamais vu de faute inexcusable assise sur des maladies professionnelles. Nous avons lancé des procédures, que nous avons assez rapidement gagnées, grâce à la mobilisation, mais également à la compréhension des tribunaux. Sans doute avez-vous entendu les gestionnaires du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) trouver - s'ils ne le disent pas, ils le pensent - que certains tribunaux vont un peu trop loin dans l'indemnisation des victimes. C'est tout simplement que nous avons rendu visible ce qui ne l'était pas jusqu'alors. On voyait bien de temps en temps quelques victimes en fauteuil roulant, quelques veuves en noir et des orphelins, mais jamais les réelles conséquences du milieu de travail. Avec l'amiante, alors même que, paradoxalement, les pathologies qui en résultent ne sont pas véritablement visibles, on a amené sous le nez des magistrats des personnes atteintes de mésothéliomes, avec leur bouteille d'oxygène à la main et des tuyaux directement reliés aux poumons, bref, la réalité des souffrances de ces victimes. Cela explique que nous ayons pu gagner en dépit des difficultés juridiques, et même conceptuelles, que pose la notion de faute inexcusable avec la question, fondamentale, de la conscience du danger : connaissait-on tous les dangers de l'amiante dans les années 60 ? L'argumentation était du reste souvent reprise par les employeurs : ils nous disaient « on ne peut pas juger des faits d'hier en se basant sur les connaissances d'aujourd'hui et en oubliant le contexte d'une époque où très peu de maladies étaient visibles, où l'amiante était en vente libre et utilisé par tout le monde », etc. Nous avons rapidement gagné en première instance et les cours d'appel ont fini par confirmer la faute inexcusable des principales entreprises auxquelles nous nous étions attaquées. Toutes ces procédures ont abouti aux arrêts du 28 février 2002 dans lesquels la Cour de cassation, en rejetant les pourvois, a bouleversé les obligations des employeurs, bien au-delà de l'amiante, en créant une obligation de résultat en matière de sécurité au travail. Dès lors, les procédures pour faute inexcusable dans le domaine de l'amiante sont devenues plus faciles. Maintenant, nous gagnons la plupart des affaires, mais pas encore systématiquement : hier encore, le tribunal de Pau, statuant sur le cas d'une veuve dont le mari, salarié à EDF, est mort d'un mésothéliome, a encore rejeté la faute inexcusable d'EDF. Mais nous gagnerons en appel, dans la mesure où nous avons déjà gagné sur plusieurs dossiers concernant le même site. Au final, nous gagnons en appel, voire en cassation, dans pratiquement 95 à 100 % des cas, mais la bataille est encore rude : certains employeurs se débattent vigoureusement et certains tribunaux persistent à considérer que l'on ne pouvait pas véritablement percevoir les dangers de l'amiante avant les années 80 et que, par conséquent, l'employeur n'a pas commis de faute suffisamment lourde pour être reconnue inexcusable. Toujours est-il que la « bataille de la faute inexcusable » s'est terminée dans un sens relativement favorable pour nous. Dans le même temps, l'indemnisation est globalement arrivée à un bon, sinon un très bon, niveau. Elle n'est pas tombée du ciel : on n'a pas cherché à se déculpabiliser en accordant à cette catégorie de victimes davantage de dommages et intérêts qu'à d'autres. C'est tout simplement, là encore, parce que nous avons rendu visible la réalité d'un drame. Avant que ne débute l'affaire de l'amiante, personne ne savait ce qu'était le tribunal des affaires de sécurité sociale. C'était une instance improbable où intervenaient quelques avocats - rarissimes car la plupart du temps, les victimes se présentaient seules -, un tribunal « familial » que la plupart de mes confrères ignoraient totalement. Il a fallu l'affaire de l'amiante, des victimes en masse dans les tribunaux, la vision de leurs souffrances, pour que non seulement on reconnaisse la faute inexcusable, mais également que l'on indemnise convenablement les victimes. À partir de 1999, nous avons été confrontés à une première difficulté : toutes les victimes de l'amiante ne pouvaient pas agir en faute inexcusable. Ainsi en est-il des travailleurs de la fonction publique, dont le statut ne le leur permet pas, des artisans, non indemnisés sur le risque « accidents du travail », des victimes « environnementales » ou « domestiques » - les épouses de victimes de l'amiante -, sans oublier les cas de prescription. Au final, la majorité des victimes se retrouvaient dans ce cas. D'où notre idée, vers 1999, de saisir les fameuses CIVI, les Commissions d'indemnisation des victimes d'infractions. Une CIVI est un tribunal, présidé par un magistrat professionnel, chargé d'indemniser les victimes d'infraction lorsque l'auteur est inconnu ou insolvable. Il faut aussi que la blessure ou la lésion soit provoquée par des faits présentant les éléments matériels d'une infraction pénale. Partant du principe que l'affaire de l'amiante avait pour origine une imprudence colossale au moins de certains employeurs, des industriels et probablement d'une partie du système de veille sanitaire, nous nous sommes employés, avec toute l'inconscience de la jeunesse, à démontrer devant les CIVI que cette affaire présentait les éléments constitutifs de blessures ou d'homicide involontaires. Au bout de deux ans, nous avons fini par gagner - la première fois dans l'affaire Drouet42 -, les cours d'appel ont suivi et l'apothéose est arrivée fin 2001, lorsque la chambre civile de la cour d'appel de Paris a reconnu que la contamination des agents de Jussieu résultait de faits présentant le caractère matériel d'une infraction pénale et a indemnisé les victimes en conséquence43. Le problème est que chaque fois que la CIVI indemnise une victime, c'est le fonds de garantie qui paie, autrement dit chacun de nous, puisque le financement du fonds provient d'un prélèvement sur les contrats d'assurance. Nous avions bien prévu que la situation deviendrait rapidement intenable pour les pouvoirs publics : non seulement les CIVI et le fonds de garantie ne sont pas faits pour cela, mais le fait que, d'une certaine façon, les victimes de l'amiante cotisent elles-mêmes pour financer leurs propres dommages et intérêts posait à l'évidence un problème d'équité. Le fonds de garantie allait à coup sûr exploser et la création d'un fonds d'indemnisation spécifique apparaissait inévitable, tout au moins pour les victimes qui ne pouvaient invoquer la faute inexcusable. C'est dans ce contexte qu'a été créé le FIVA. Le principe du FIVA, que nous avons réclamé et obtenu, est formidable ; malheureusement, il pose une difficulté fondamentale du fait qu'il est arrivé bien tard. Il n'a commencé à fonctionner qu'en 2002, alors que les TASS avaient déjà accumulé sept à huit ans de jurisprudence en matière d'indemnisation. D'un côté, les victimes, l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante (ANDEVA) en tête, comptaient bien que le barème d'indemnisation du FIVA soit calé sur cette jurisprudence déjà fixée, sur la base d'une sorte de moyenne des montants accordés jusque-là par les tribunaux ; de l'autre, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), pressentant que le principe de la réparation intégrale pourrait se généraliser, entendait maintenir ledit barème au niveau le plus raisonnable possible, de crainte qu'il ne vienne un jour à s'appliquer non plus aux seuls malades de l'amiante, mais à toutes les victimes du travail, et qu'il n'aboutisse à une explosion du système et à une hausse faramineuse des cotisations payées par les employeurs. De fait, devenus otages de la réparation intégrale, nous-mêmes avons compris qu'il fallait maîtriser les dépenses, afin de ne pas mettre en péril ce formidable laboratoire de la réparation intégrale en donnant trop d'argent aux victimes. Finalement, nous sommes arrivés à un barème qui, sans être catastrophique, est objectivement en dessous, et parfois très largement, de ce que les victimes pourraient obtenir devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) au titre de la faute inexcusable. C'est pourquoi la création du FIVA qui répondait à un objectif louable : supprimer, sinon réduire le contentieux, n'a pas pu atteindre son but. Il y a dix ans, ou même il y a cinq ans, lorsque la jurisprudence n'était pas véritablement fixée, l'ANDEVA, moi-même, tout le monde aurait signé des deux mains si l'on nous avait accordé le barème du FIVA. Mais aujourd'hui, comment expliquer à des victimes qu'en saisissant le FIVA, elles toucheront 20 à 40 % de moins que ce qu'elles obtiendront en poursuivant l'employeur pour faute inexcusable ? Jamais elles ne comprendront que l'on ne choisisse pas la deuxième solution, quitte à patienter un an de plus. Le barème du FIVA est donc insuffisant. Pourquoi 14 % des victimes préfèrent-elles encore la voie contentieuse plutôt que le FIVA ? Je vois deux raisons à cela. Pour commencer, beaucoup de victimes tiennent absolument à faire reconnaître la responsabilité de leur employeur. Or la faute inexcusable présente cette caractéristique d'être à la fois une procédure civile d'indemnisation et une sanction : avant 1976, les entreprises ne pouvaient pas s'assurer contre les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur. Elles devaient payer les dommages et intérêts sur leur trésorerie propre. Autrement dit, la faute inexcusable ne se résume pas à une banale procédure d'indemnisation ; aux yeux de nombre d'employeurs, c'est même un gros mot. Et pour bien des salariés, c'est un moyen d'individualiser, de montrer du doigt l'entreprise fautive, condamnée à indemniser celui qu'elle a rendu malade. Bon nombre de victimes y tiennent absolument, quitte à perdre du temps. Certains syndicalistes, qui ont tiré la sonnette d'alarme depuis des années, n'entendent pas lâcher aujourd'hui. La deuxième raison tient à la nature de la réparation. Dès lors que la faute inexcusable est reconnue, la réparation est double : non seulement la rente servie par la caisse primaire est majorée, parfois doublée et même davantage, mais viennent s'y ajouter les dommages et intérêts réparant le préjudice personnel ; or ceux-ci sont beaucoup plus importants que ceux que l'on obtient par le FIVA. Ajoutons que la rente est versée trimestriellement, revalorisée deux fois par an, cumulable avec la retraite, non imposable... Et depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2004 ( ?), la majoration obtenue devant le tribunal continuera d'évoluer en fonction de l'aggravation de l'état de la victime. Indiscutablement, les modalités de l'indemnisation obtenue pour faute inexcusable sont plus intéressantes pour les victimes. Inversement, comment expliquer que 86 % des victimes aient été indemnisées en 2004 par le FIVA ? Les raisons sont multiples. Cela tient tout d'abord à un effet de déstockage : des milliers de victimes attendaient derrière la porte, qui ne pouvaient être indemnisées par personne. Ensuite, bon nombre d'entreprises - les plus malines - se sont dépêchées, dès que le FIVA a été créé, d'inciter leurs salariés à le saisir. EDF, par exemple, sitôt qu'un de ses salariés est reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'amiante, lui envoie systématiquement les formulaires du FIVA et lui propose même de l'aide pour les remplir, et ce d'autant plus volontiers qu'il n'y a pas à craindre d'actions récursoires. On trouve également certaines petites associations qui, sans connaître grand-chose au sujet, peuvent bomber le torse en se contentant d'envoyer au FIVA les imprimés préalablement remplis par leurs adhérents ; six mois plus tard, la victime est toute heureuse de recevoir 10 000 euros sans jamais avoir été informée qu'elle aurait pu obtenir dix fois plus... Lorsque je suis arrivé avec l'ANDEVA à Canari, en Corse, où la mine d'amiante a été fermée en 1965, les victimes n'étaient indemnisées par personne et le représentant de l'association locale ne savait même pas ce qu'était la faute inexcusable. Il faisait simplement remplir par ses adhérents des imprimés pour le FIVA. Nous avons « fait » quelques fautes inexcusables et obtenu dix fois le barème du FIVA ! Les personnes très âgées ont également intérêt à passer par le FIVA. Lorsque j'ai une victime de quatre-vingts ans, je ne vais pas lui proposer d'aller en faute inexcusable au risque d'y passer cinq ans... Il faut savoir que les victimes de l'amiante et leurs avocats en ont assez des tribunaux ! M. le Président : Que voulez-vous dire ? M. Michel LEDOUX : Nous sommes quinze au cabinet, et depuis dix ans, chaque jour, nous usons nos robes sur les bancs de tous les tribunaux de France et de Navarre : les civils, les TASS, les cours d'appel, les tribunaux administratifs, la Cour de cassation... On en a assez des procédures ! Il se dit que les deux avocats « historiques » de l'affaire de l'amiante auraient bâti leur fonds de commerce là-dessus... M. le Président : Cela se dit, en effet... M. Michel LEDOUX : Je n'aime pas ce genre de propos, et pour deux raisons. Premièrement, Jean-Paul Teissonnière, comme moi-même, avons passé six ans à travailler sans toucher un centime. Lorsque les arrêts du 28 février ont été rendus, j'étais à 2 millions d'euros de découvert à la banque ! En cas d'échec en cassation, je songeais à entrer dans la magistrature. Avec ma secrétaire et mes deux collaborateurs, nous courions à travers la France entière sans toucher un centime d'honoraires. Certes, cela a changé durant les trois ou quatre années qui ont suivi, mais il faut voir le travail que nous avons fourni... Aujourd'hui, nous avons mis en place des sortes de conventions d'honoraires au temps passé, modulées en fonction de la difficulté des affaires : lorsque je vais plaider à Bordeaux contre Everit, où je gagne à chaque fois, je me contente d'honoraires très modestes. Il en va autrement lorsque je plaide contre EDF, ou certains employeurs, avec lesquels nous ne faisons que commencer - certaines entreprises n'ont pas eu droit aux charmes de la faute inexcusable et ont encore des avocats combatifs... Il n'y a plus qu'un tribunal que nous aimerions expérimenter : le tribunal correctionnel - nous en reparlerons dans quelques jours. La Cour des comptes propose que le FIVA accorde le « supplément faute inexcusable ». C'est facile à dire, mais extrêmement compliqué à mettre en oeuvre. La faute inexcusable, permet, en fait, une majoration de la rente. Comment voulez-vous que le FIVA majore une rente qui correspond déjà à une réparation intégrale ? La faute inexcusable est liée au système mis en place en 1898 qui partait du principe selon lequel l'accident était de la faute de l'employeur, comme du salarié. Sur cette base, schématiquement, on divisait la rente en deux et celle-ci n'était versée en totalité qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur. Puisque dans une logique de réparation intégrale, la rente servie par le FIVA est déjà complète, comment peut-on donner plus que la réparation intégrale ? Le « supplément faute inexcusable » de la Cour des comptes n'est donc qu'un mot qui, sur le plan conceptuel, n'a guère de sens. Au demeurant, on ne pourra pas accorder le « supplément faute inexcusable » à une victime environnementale, puisque la majoration de la rente résultant de la faute inexcusable est versée par la caisse primaire d'assurance maladie et normalement payée par l'employeur. Je comprends l'idée d'indemniser totalement toutes les victimes et dans les mêmes conditions que la faute inexcusable mais cela exigerait une réforme beaucoup plus vaste. M. le Rapporteur : Ayant eu l'occasion de m'intéresser au sort des blessés de l'attentat de Karachi, j'ai compris que le salarié ne peut effectivement obtenir une rente complète que pour autant que soit établie la faute inexcusable de la Direction des chantiers navals (DCN). Si tel n'est pas le cas, la rente est systématiquement divisée par deux, comme vous l'avez expliqué. Mais puisqu'il faut désengorger les TASS en améliorant l'indemnisation versée par le FIVA, selon quelles modalités faut-il le faire ? M. Michel LEDOUX : Par exemple, une veuve dont le mari décède dans un accident du travail touche aujourd'hui 40 % du salaire de son mari si celui-ci n'a pas cinquante-cinq ans. Pourquoi ? Parce que la réparation est incomplète et forfaitaire. Mais si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, elle touchera 100 %. C'est ce qui s'est passé lors de l'affaire de Karachi, où les rentes des conjoints survivants ont été fixées au maximum, c'est-à-dire à 100 %, par le TASS. Le FIVA raisonne quant à lui en réparation intégrale. Pour déterminer le montant de la rente due à une victime non professionnelle - pour une victime professionnelle, il intervient en complément de la rente versée par la sécurité sociale -, il calcule le préjudice économique subi par la victime sous la forme d'un capital qu'il transforme ensuite en une rente annuelle. De ce fait, les rentes servies par le FIVA ne peuvent pas être majorées, puisqu'elles correspondent déjà à la totalité de la réparation du préjudice. Plaquer la majoration pour faute inexcusable sur les rentes versées par le FIVA n'est conceptuellement pas possible. Cela ne pourrait fonctionner que pour les victimes professionnelles qui, déjà indemnisées par la sécurité sociale, saisissent ensuite le FIVA. Dans le cas, par exemple, d'une victime ayant 10 % d'incapacité partielle permanente (IPP), qui n'est pas allée en faute inexcusable et qui saisit le FIVA, on pourrait imaginer que celui-ci lui verse automatiquement la majoration pour faute inexcusable. Mais encore faudrait-il que le fonds exerce son action récursoire contre l'employeur coupable de faute inexcusable... Ce n'est pas si simple. Autrement dit, la majoration pour faute inexcusable n'est qu'un mot : il signifie que l'on voudrait que les victimes relevant du FIVA soient indemnisées comme elles l'auraient été en faute inexcusable. Mais on ne peut pas plaquer la majoration de rente pour faute inexcusable sur le système FIVA : c'est la carpe et le lapin... D'un côté, on a une réparation forfaitaire complétée par la faute inexcusable, de l'autre une, une réparation intégrale qui, par principe, ne peut être complétée par quoi que ce soit. La préconisation de la Cour des comptes est par trop superficielle. La vraie solution serait de prévoir une réparation intégrale pour toutes les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Quand vous êtes victime d'un accident de la circulation, vous êtes intégralement indemnisé, alors que quand vous êtes victime d'un accident du travail, vous êtes indemnisé forfaitairement, sauf en cas de faute inexcusable... C'est insensé. Ce qui était une bonne solution il y a cent ans est désormais en total décalage avec la réalité. M. le Président : Le fait que la faute inexcusable devienne désormais la norme est quand même une évolution considérable. M. Michel LEDOUX : C'est exact : la réparation offerte par la reconnaissance de la faute inexcusable est effectivement bien meilleure que la réparation de masse servie par la sécurité sociale. M. le Président : La généralisation de la présomption de faute inexcusable, telle que la propose la Cour des comptes, n'appelle-t-elle pas moins une majoration du barème qu'une révision ? M. Michel LEDOUX : Il faut les deux. La réparation d'un préjudice, quel qu'il soit, se subdivise traditionnellement en deux grandes parties : la réparation des préjudices extrapatrimoniaux et celle des préjudices patrimoniaux. Les premiers sont ce qu'on appelle des préjudices personnels : la souffrance physique, le préjudice esthétique, les préjudices d'agrément, etc., autrement dit des préjudices subjectifs. Ceux-là sont indemnisés que ce soit sur le fondement de la faute inexcusable ou par le biais du FIVA. Même si les « tarifs » ne sont pas les mêmes, les choses sont relativement simples du fait que les préjudices extrapatrimoniaux ouvrent droit à réparation dans un cas comme dans l'autre : il suffirait donc de réévaluer le barème FIVA pour arriver à une situation acceptable. Le préjudice patrimonial correspond aux pertes de revenu engendrées par l'accident ou la maladie. Du côté de la sécurité sociale, depuis la loi du 9 avril 1898, le préjudice patrimonial est réparé de façon forfaitaire par l'allocation d'une rente calculée sur la base du salaire de la victime et d'un taux d'incapacité déterminé par le médecin-conseil de la caisse. La rente ne répare pas la totalité du préjudice : c'est un forfait versé tous les trimestres par la caisse jusqu'à la fin de la vie de la victime, et qui peut être majoré en cas de faute inexcusable de l'employeur. Le système est financé par les entreprises. Dans le système FIVA, en revanche, celui-ci est censé réparer l'intégralité du préjudice économique de la victime. Mais avec l'amiante, celui-ci est assez rarement indemnisé car les victimes sont souvent des retraités qui n'ont pas de perte de « salaire ». Parfois cependant, la disparition du mari crée pour la veuve un préjudice économique du fait de la chute concomitante de ses revenus. Dans tous les cas, le FIVA calcule le préjudice réellement subi. Ces deux systèmes, on le voit, obéissent à des philosophies radicalement différentes : d'un côté, une réparation forfaitaire majorée en cas de faute inexcusable, de l'autre une réparation intégrale. L'idée d'appliquer la majoration du premier à la réparation intégrale du second, avancée par la Cour des comptes, n'est pas possible. Ce sont deux planètes différentes. Je le répète, on ne pourrait le faire que dans un seul cas : lorsque la victime qui saisit le FIVA est déjà indemnisée en maladie professionnelle par une rente forfaitaire, le FIVA pourrait alors systématiquement verser la majoration - à condition d'engager lui-même une action récursoire en faute inexcusable. M. le Président : Prenons le schéma de la géométrie de Lobatchevski, où les parallèles se rejoignent à l'infini... La Cour des comptes connaît-elle votre raisonnement ? M. Michel LEDOUX : Oui. M. le Président : C'est donc qu'elle cherche autre chose. Que cherche-t-elle ? M. Michel LEDOUX : Ce que nous cherchons tous : éviter que les victimes ne continuent à encombrer les TASS, en s'efforçant de rendre la saisine d'un tribunal économiquement inutile. M. le Président : Par une révision du barème du FIVA. M. Michel LEDOUX : Absolument. Il faut effectivement revoir les modalités de réparation des préjudices économiques par le FIVA, et surtout lui permettre de mener des actions récursoires. Or, une fois qu'il a indemnisé les victimes, le FIVA n'a pas les moyens de se retourner contre l'entreprise fautive comme le prévoit la loi : il n'a que trois personnes ... M. Jean-Marie GEVEAUX : Les modalités d'indemnisation sont-elles les mêmes sur l'ensemble du territoire ou varient-elles, comme c'est souvent le cas dans le droit commun ? M. Michel LEDOUX : Les offres du FIVA peuvent être contestées devant la cour d'appel du ressort où habite la victime, et la jurisprudence varie en fonction de la cour d'appel, parfois du simple au triple... M. Jean-Marie GEVEAUX : Assureur de profession, je connais cela... M. Michel LEDOUX : On avait vanté le caractère rationnel et réfléchi de ce fameux barème du FIVA mais au moins dix cours d'appel - dont celles de Paris et de Versailles - ont déjà considéré que c'était n'importe quoi et multiplié par deux ou trois le montant des indemnisations... C'est dire à quel point le FIVA, excellente idée au demeurant, doit absolument être revu, remis à plat, renégocié à la lumière de l'expérience et en toute sérénité. Cela paraît une évidence. M. le Rapporteur : Vous considériez tout à l'heure que les indemnisations décidées par les tribunaux étaient bonnes ou à tout le moins correctes. Sur quels montants devrait-on se baser pour réévaluer le barème du FIVA ? M. Michel LEDOUX : Vous posez là un problème qui perturbe nombre de juristes : chaque juridiction en France a de tout temps eu son tarif propre. Selon que votre accident se sera produit à Mont-de-Marsan, à Dunkerque ou ailleurs, votre indemnisation variera du simple au triple. Paris a toujours bien mieux indemnisé que Perpignan... Un rapport, commandé par le précédent ministre de la justice à Mme Lambert-Faivre44, préconise non pas un barème, mais un référentiel revu chaque année et communiqué à tous les tribunaux de France afin d'essayer d'uniformiser l'indemnisation sur tout le territoire. L'amiante a du reste révélé de façon éclatante les disparités auxquelles donnaient lieu les indemnisations : avec seulement quatre maladies, parfaitement connues, des victimes pratiquement toutes du même âge et présentant le même profil socioprofessionnel, le même mode de vie, obtiennent des indemnisations différentes. Par exemple, les indemnisations pour des plaques pleurales vont de 3 000 à 4 000 euros à Rennes à 70 000 euros devant le TASS de Lille, pour des victimes qui ont connu exactement les mêmes conditions de travail et parfois même travaillé côte à côte dans le même établissement ! Tout simplement parce que l'une aura eue la malchance de choisir de passer sa retraite à Rennes et l'autre la chance de s'installer à Lille... Ce problème dépasse largement le seul cadre de l'amiante. La Cour de cassation ne s'est jamais occupée du calcul des indemnisations, estimant que cette question relève de l'appréciation souveraine du juge du fond. Elle n'a sur ce point jamais joué son rôle d'unificateur de la jurisprudence. Peut-être devrait-elle le faire, à moins que ce ne soit le législateur, en donnant au juge un référentiel, quitte à ce que celui-ci s'en écarte au vu de cas particuliers, l'indemnisation restant toujours intuitu personae. Le rapport Lambert-Faivre contient à cet égard nombre de propositions très intéressantes. L'affaire de l'amiante aura eu le mérite de mettre cette question en évidence en révélant des situations parfaitement baroques. M. le Président : Il me semble, par ailleurs, que la reconnaissance systématique de la faute inexcusable ouvre un champ totalement nouveau, qui ira au-delà du seul problème de l'amiante... M. Michel LEDOUX : On ouvre là un chantier dangereux. Je ne suis pas de ceux qui prétendent que tous les employeurs commettent des « fautes inexcusables ». Le terme a quand même a une signification précise : il désigne l'hypothèse dans laquelle l'accident ou la maladie a été provoqué par une négligence de l'employeur, une imprudence relativement lourde. Le principe de l'obligation de résultat en matière de sécurité, posé par la Cour de cassation n'a jamais signifié, par exemple, que chaque accident du travail est nécessairement lié à une faute inexcusable de l'employeur. Deux ou trois ans après les arrêts en question, beaucoup de plaignants se voient encore déboutés : pour qu'il y ait faute inexcusable, il faut que l'employeur ait conscience du danger et que la victime prouve qu'il n'a pas pris les mesures destinées à préserver l'opérateur. Mais il n'en est pas de même avec les maladies professionnelles : contrairement à l'accident du travail, la maladie étant le plus souvent inscrite dans un tableau, l'employeur peut difficilement soutenir qu'il n'avait pas conscience du danger. Reste que la faute inexcusable n'est pas mécanique et qu'appliquer cette notion à tout le monde serait un non-sens juridique. Il faudrait inventer un autre mot et un autre concept. M. Jean-Marie GEVEAUX : La reconnaissance de la faute inexcusable par un tribunal est-elle une décision exceptionnelle ? M. Michel LEDOUX : A priori, oui. Il ne peut pas y avoir de distribution gratuite de fautes inexcusables... Ou alors les mots n'ont aucun sens. M. le Président : C'est pourtant bien cette direction que préconise le rapport de la Cour des comptes. M. Michel LEDOUX : En effet. M. le Président : Mais vous avez bien distingué le cas des accidents du travail de celui des maladies professionnelles, pour lesquelles il existe un tableau ? M. Michel LEDOUX : Souvent, en effet, mais pas toujours. M. le Président : N'y a-t-il pas là une nouveauté qui pourrait conduire à distinguer entre ce qui relève des accidents du travail, lesquels procèdent d'une vision assez traditionnelle et bien établie, et ce qui relève des maladies professionnelles, c'est-à-dire d'un concept appelé, du fait de l'affaire de l'amiante, mais également de l'apparition de produits et procédés nouveaux, à prendre de plus en plus d'ampleur ? M. Michel LEDOUX : Je suis d'autant plus d'accord que je pense, tout comme vous, que l'avenir des accidents du travail, ce sont malheureusement les maladies professionnelles... Mais comment expliquer une telle discrimination dans l'indemnisation entre accidents du travail et maladies professionnelles ? La faute inexcusable est effectivement, en principe, quelque chose d'exceptionnel : elle désigne un cas où l'employeur n'a pas fait son travail d'employeur. Or bon nombre d'accidents du travail ne sont pas provoqués par un mauvais employeur, mais par une méconnaissance de certains risques, par des « angles morts » dans la réglementation ou la prévention, et même parfois par des événements totalement imprévisibles. Ce n'est pas si simple que cela. Appliquer la notion de faute inexcusable au FIVA est une mauvaise idée juridiquement et même idéologiquement. Il faut effectivement rediscuter les modalités d'indemnisation, indemniser totalement mais pas ainsi. On ne peut pas prétendre que tous les employeurs ont commis des fautes inexcusables, fût-ce au motif que leur salarié a contracté une maladie liée à l'aimante. Les employeurs ne l'accepteront jamais. Je ne suis pas leur avocat, bien au contraire, mais je les comprendrais parfaitement. M. le Président : Nous allons nous retrouver dans le débat ouvert par la proposition n° 7 du rapport du Sénat45. M. Jean-Marie GEVEAUX : Intellectuellement, c'est tout à fait compréhensible : on ne peut systématiquement invoquer la faute inexcusable, y compris pour l'amiante. Ce serait du reste ouvrir une boîte de Pandore, l'extension aux autres maladies pourrait suivre très vite. M. le Président : C'est évident ! Ou alors, on construit une nouvelle approche de ce problème extrêmement complexe, en termes notamment de prévention, en distinguant l'accident du travail - concept historiquement établi - et les maladies professionnelles - notion très évolutive. M. Michel LEDOUX : Tout le problème vient de ce que l'on bricole sur un système en ruine. Le mécanisme de réparation des AT-MP date de 1898 ! M. le Président : On bricole sur un système en ruine avec des concepts nouveaux nés de situations nouvelles. M. Michel LEDOUX : Parfaitement. On ne fera jamais du bon travail sur ce qui était encore, il y a sept ans, un magnifique monument historique, et qui n'est plus aujourd'hui qu'un édifice en ruine, totalement décalé. La solution passe par la réparation intégrale qu'il faut discuter avec les partenaires sociaux. Le FIVA, conçu dans l'urgence, a été mal réfléchi : son fameux supplément pour faute inexcusable a été rajouté dans la loi, alors que rien n'y obligeait. C'est cela qui a créé la confusion. M. le Président : Mais cette disposition a-t-elle un effet aujourd'hui ? M. Michel LEDOUX : Non, aucun. Au niveau de l'ANDEVA et de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), les choses sont simples : une équipe arrive, j'examine le dossier et nous choisissons ensemble d'aller en faute inexcusable ou au FIVA. C'est soit l'un, soit l'autre. Nous ne mélangeons pas les genres. Mais comme la loi prévoit que le FIVA peut demander le supplément faute inexcusable, celle des victimes qui agissent seules et qui en ont vaguement entendu parlé le demandent immédiatement. Or, la Cour de cassation, elle-même, n'a toujours pas statué clairement sur la nature de ce « supplément faute inexcusable » ! C'est ainsi que deux univers se télescopent, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. La seule solution rationnelle est donc de discuter le plus rapidement possible de la réparation intégrale. On réglera ainsi le cas de tous les accidents du travail, de toutes les maladies professionnelles, sur des bases rationnelles et modernes. Pour autant, je ne prétends pas que ce soit facile. C'est même extrêmement délicat. M. Jean-Marie GEVEAUX : Mais c'est sûrement la solution. M. le Rapporteur : En dehors du FIVA, n'avez-vous jamais été contacté par une victime qui n'aurait pas pu bénéficier de l'Allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ? M. Michel LEDOUX : Si. Beaucoup de bénéficiaires de l'ACAATA, du fait qu'ils touchent un salaire réduit en attendant d'avoir l'âge de la retraite, s'estiment victimes d'un préjudice économique et me demandent de réclamer une indemnisation au FIVA... Or celui-ci considère, en toute logique, qu'un bénéficiaire de l'ACAATA l'a par définition demandée et qu'on ne peut pas s'imposer un préjudice à soi-même... Toutefois, après négociation, le FIVA a admis qu'un malade gravement atteint ayant été contraint, en raison de son état, de solliciter le bénéfice de l'ACAATA était en droit d'obtenir une compensation de salaire. M. le Président : Il serait intéressant que vous nous rapportiez des cas précis. Me Michel Ledoux : M. Romaneix ou M. Beauvois pourront vous le confirmer. C'était une décision prise en conseil d'administration du FIVA. Quant à l'ACAATA, elle ne peut qu'être source de contentieux : les fameuses listes établies, dans l'urgence, par le ministère du travail posent d'énormes problèmes et fourmillent d'incohérences. Il suffit que le nom de l'entreprise ne soit pas le bon, qu'il s'agisse de la société Untel et non de l'établissement Untel, ou que l'on ait travaillé dans le cadre de la sous-traitance - phénomène endémique dans la construction navale - pour n'avoir aucun droit à l'ACAATA. C'est difficile à admettre et à expliquer... Nous avons connu des cas particulièrement accablants. Je vous ferai parvenir le texte d'un mémoire particulièrement illustratif. Nous avons là un nouveau contentieux très mal vécu par les personnes qui ont été exposées. M. le Président : D'autant qu'il y a une volonté de resserrer le dispositif, comme le recommande la Cour des comptes. M. Michel LEDOUX : Évidemment... En même temps, tout le monde sait que les entreprises utilisent le FCAATA pour boucler leurs plans sociaux. M. le Président : Avec la bénédiction de l'État... M. Michel LEDOUX : En effet. Mais on a les deux modèles : certaines entreprises, à l'inverse, ne veulent pas laisser partir leurs salariés. M. le Président : Vous nous avez aidés à avancer dans une perception tout à fait nouvelle du problème. Nous aurons à revenir sur le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA). Essayez de nous préparer une note sur cette question. M. Michel LEDOUX : Je vais le faire. M. le Président : Il nous faudra également aborder le problème pénal... M. Michel LEDOUX : Je ne suis pas sûr que l'on ait beaucoup avancé sur ce point d'ici au 15 novembre. M. le Président : Je le crains également. M. Michel LEDOUX : Il y a un gros risque que le pourvoi soit déclaré irrecevable. M. le Président : Pour des raisons de procédure, semblerait-il. M. Michel LEDOUX : En effet. Je suis pratiquement sûr que la Cour bottera en touche en déclarant le pourvoi irrecevable. L'avocat général a pourtant demandé la cassation... M. le Président : S'il demande la cassation, c'est qu'il a une argumentation. Il est probable que la Cour ne le suivra pas mais son argumentaire a-t-il une valeur, ne serait-ce qu'indicative ? M. Michel LEDOUX : Une valeur indicative, incontestablement. C'est de la doctrine, un point de vue qui montre - enfin ! - que les plus hautes autorités de l'État, au niveau du parquet, commencent à se rendre compte que l'amiante pose un petit problème pénal... Le malheur veut que le procureur de Douai ne se soit pas pourvu en cassation contre l'arrêt confirmant le non-lieu rendu à Dunkerque. Et personne ne peut l'y obliger. M. le Président : On s'aperçoit de plus en plus que, derrière ce problème du pénal, se pose le problème des parquets. M. Michel LEDOUX : C'est le problème fondamental. M. le Président : Maître, je vous remercie. Nous nous reverrons sur ce point. Audition de Maître Michel Jean-Paul TEISSONNIÈRE, avocat Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Nous vous remercions, Maître, d'avoir accepté notre invitation. Votre cabinet s'est spécialisé dans la défense des victimes de l'amiante et engage régulièrement des actions judiciaires en dommage et intérêt sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur, ainsi que des actions au pénal visant à la condamnation des responsables. Comme je le précise souvent à nos invités, la mission a orienté ses travaux moins sur la question de l'histoire de l'amiante, déjà bien connue et traitée dans de multiples rapports Je rappelle que notre mission d'information a été créée à l'initiative du président de l'Assemblée nationale et par une de ses commissions, ce qui lui donne une signification symboliquement très forte. Notre Rapporteur, M. Lemière, député de Cherbourg, et moi-même, député de Dunkerque, avons souvent eu à connaître des problèmes de l'amiante. Nous souhaiterions, maître, que vous nous fassiez part de votre analyse de la situation actuelle ? Les échanges que nous venons d'avoir avec votre confrère Maître Ledoux nous ont laissé à penser que certains concepts, sur le plan juridique comme sur le plan économique, pouvaient être extrêmement évolutifs. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : J'ai cru comprendre que la question posée aujourd'hui touchait essentiellement à la réparation et à l'indemnisation. M. le Président : Tout à fait. Nous aborderons le volet pénal à l'occasion d'autres réunions. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : L'affaire de l'amiante a débuté en 1995, date à laquelle, l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante (ANDEVA) s'étant constituée, les premiers procès ont eu lieu. Tout en travaillant sur quelques plaintes - pour Jussieu et Eternit-Valenciennes notamment -, Michel Ledoux et moi-même avions alors décidé de privilégier la question de l'indemnisation des victimes. Dix ans plus tard, le bilan me paraît positif. L'arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2002 n'a fait que couronner une évolution jurisprudentielle déjà très largement engagée au niveau des Tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) et des cours d'appel. La novation des arrêts du 28 février, qu'Arnaud Lyon-Caen appelait « une révolution dans le droit social » tient finalement moins à la faute inexcusable en elle-même qu'à la nouvelle définition donnée à l'obligation de sécurité qui pèse sur le chef d'entreprise, désormais conçue comme une obligation de résultat et dont le manquement entraîne, sous réserve de quelques conditions, la reconnaissance d'une faute inexcusable. Cette avancée jurisprudentielle, qui ne concerne pas que les victimes de l'amiante, marque un renversement de la situation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la faute inexcusable, jusqu'alors exception rarissime, devenant désormais - j'exagère un peu - pratiquement la règle. Si l'indemnisation sur le fondement de la faute inexcusable n'est pas devenue la quasi-règle, c'est simplement parce que toutes les victimes n'engagent pas de procédure en faute inexcusable. Mais le bilan des procédures engagées sous cette forme montre un résultat positif dans 98 % des cas. À la suite des arrêts du 28 février 2002 de la Cour de cassation, je m'attendais à une refonte du droit de l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Car le système est devenu totalement incohérent : selon que votre cancer sera dû à l'inhalation de benzène ou de poussière d'amiante, votre indemnisation variera du simple au double, voire au quadruple... L'injustice ou tout au moins l'inégalité est patente. Les arrêts de la chambre sociale ne contenaient pas moins qu'un appel, en filigrane, à revoir un mécanisme remontant à la loi sur les accidents du travail du 9 avril 1898, étendue aux maladies professionnelles en 1919. J'ai eu l'occasion de me reporter aux débats parlementaires de cette époque. Ce que Jean-Jacques Dupeyroux a appelé le deal de 189846 peut se résumer ainsi : la réparation systématique des accidents du travail en échange d'une réparation à demi-tarif fondée sur le principe d'un partage des responsabilités. Ce principe, posé par la loi de 1898, et légèrement revu en 1945 lors des ordonnances sur la sécurité sociale, apparaît choquant non seulement en droit social, mais encore plus si l'on compare le traitement des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles à celui des accidents de la circulation, de l'aléa thérapeutique et autres dommages : désormais, l'indemnisation n'est quasiment plus jamais subordonnée à la preuve d'une faute, et encore moins d'une faute inexcusable. Les seules victimes à ne pas encore bénéficier d'une réparation intégrale aujourd'hui sont les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles... J'insiste sur ce point car votre questionnaire fait référence à l'hypothèse d'une exportation de la faute inexcusable dans le système FIVA - le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Pourquoi pas ? Mais c'est tout de même, pour un juriste, une idée bien étrange... M. le Président : Le questionnaire ne faisait que reprendre une suggestion de la Cour des comptes, précisément parce qu'elle prête à interrogation. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Je sais qu'une légère correction a été apportée en 1945 pour les taux d'incapacité supérieurs à 50 %. Reste qu'il est parfaitement anormal qu'une victime qui se voit reconnaître un taux d'incapacité de 20 % perçoive une rente de 10 %, en application d'une théorie assez obsolète du partage des responsabilités en matière d'accidents du travail ! La création du FIVA, le 23 décembre 2000, a utilement complété le dispositif en permettant d'indemniser plusieurs catégories de victimes qui ne pouvaient engager une procédure en faute inexcusable, en particulier les victimes environnementales pour lesquelles le lien de causalité était difficile à prouver, ou encore les fonctionnaires et les militaires auxquels le principe du forfait de pension interdisait à l'époque - la situation a depuis un peu changé - tout autre forme d'indemnisation. C'est la raison pour laquelle nous avions, à Cherbourg, saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour un mécanicien travaillant dans les sous-marins et atteint d'un cancer de la plèvre en réclamant symboliquement une indemnisation très exactement à hauteur de celle octroyée aux victimes du sang contaminé ayant le même âge... La commission nous avait accordé cette indemnisation, confirmée au centime près par la cour d'appel de Cherbourg : ce parallèle implicite pouvait être interprété comme un signe donné par les magistrats, d'autant que la Cour de cassation a ultérieurement validé la démarche. Par la suite, le FIVA ayant été créé, la loi a interdit aux victimes de l'amiante l'accès aux CIVI dans la mesure où elles bénéficiaient désormais d'un système d'indemnisation autonome, y compris pour celles qui ne relevaient pas du régime de la faute inexcusable. M. le Président : Si je comprends bien vos propos, le renversement de l'approche posé par les arrêts de la Cour de cassation, et plus précisément ce que l'on pourrait peut-être appeler la « généralisation » de la notion de faute inexcusable, rend totalement obsolète l'antique législation régissant les accidents du travail et les maladies professionnelles... M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Tout à fait. M. le Rapporteur : Peut-on envisager de diminuer le nombre de contentieux devant les TASS en modifiant le barème du FIVA ? Par ailleurs, votre confrère Me Ledoux nous a dit qu'il en avait assez d'aller plaider dans tous les TASS de France et de Navarre, l'important, pour lui, étant de réformer radicalement la prise en compte des maladies professionnelles. Quel est votre sentiment ? M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Il faut effectivement supprimer cette exception archaïque qui fait que les salariés du régime général sont désormais les seuls à être exclus du système de réparation intégrale s'ils n'ont pas démontré la faute du responsable. Dans le cas des accidents de la circulation, par exemple, les magistrats ont su, depuis longtemps, se servir de l'article 1384 du code civil, qui n'avait pourtant pas du tout été prévu pour cela en 1802, et construire une théorie de la responsabilité du fait des choses pour poser le principe d'une l'indemnisation des victimes sans qu'il soit besoin de démontrer la faute de quiconque. Ce mécanisme de responsabilité objective, de responsabilité sans faute a, depuis, été progressivement étendu, jusqu'aux accidents médicaux, aux aléas thérapeutiques, etc., pour la période la plus récente, tant et si bien que plus personne n'exige désormais d'une victime qu'elle démontre la faute du responsable pour être intégralement indemnisée : seules les victimes d'accident du travail sont dans cette situation, de même, jusqu'à une date très récente, que les fonctionnaires et les militaires, indemnisés par une pension censée, en théorie, réparer intégralement tous les chefs de préjudice. Aucune indemnisation complémentaire ne pouvait donc être réclamée devant les tribunaux administratifs - d'où la saisine des CIVI. Cette théorie du forfait de pension a été abandonnée par le Conseil d'État en 2003 pour les fonctionnaires et tout récemment, en juillet 2005, pour les militaires. Ne restent plus maintenant que les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles à ne percevoir qu'une demie pension, sans autre forme de réparation de leur préjudice pour souffrances physiques, morales, etc. Le fossé est donc en train de s'agrandir entre les salariés de droit privé et les autres catégories de victimes. Il y a véritablement là, me semble-t-il, une urgence sociale. M. le Président : Et si l'on recourt à l'élargissement du principe de la faute inexcusable ? M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Je crois plutôt qu'il faut supprimer ce principe. Le dispositif retenu en 1898 consistait, en gros, à indemniser tout le monde à demi-tarif, sauf en cas de faute inexcusable où la victime était intégralement indemnisée ; mais seules pouvaient l'être celles qui parvenaient à en faire la démonstration. Il suffit de prévoir que chaque victime d'accident du travail a droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices pour que le recours à la faute inexcusable devienne inutile. Le concept de la faute inexcusable est totalement archaïque. Il était destiné à limiter les cas de réparation intégrale d'une catégorie de victimes tout à fait particulières : les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Supprimons-le et prévoyons que celui qui a 20 % d'incapacité percevra une pension de 20 % et non plus de 10 %. M. le Président : Il y a deux solutions : soit supprimer la faute inexcusable, soit considérer d'office qu'on est en situation de faute inexcusable dans tous les cas... M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Mais dans le second cas, on exporte un archaïsme pour le généraliser... La Cour de cassation a finalement banalisé la faute inexcusable, afin de rendre la réparation automatique mais en se servant des outils qui sont les siens. Le Parlement en a d'autres, qui permettraient de mieux résoudre le problème. Cela dit, la généralisation de la faute inexcusable, ou son utilisation sous une autre forme, peut évidemment servir de dispositif d'attente. M. le Président : Autrement dit, la Cour de cassation, à défaut d'autres moyens, généralise un archaïsme qu'il serait de votre avis beaucoup plus judicieux de supprimer. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Sous réserve, évidemment, que l'on fasse bénéficier toutes les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles de la réparation intégrale. M. le Président : Bien entendu. M. le Rapporteur : J'observe toutefois que Me Ledoux et d'autres personnes auditionnées ont relevé que la faute inexcusable recouvrait, aux yeux de nombreuses victimes, une dimension de sanction personnelle et morale à l'encontre de celui qui était à l'origine de leur maladie. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : C'est tout à fait exact. Cette dimension symbolique a d'ailleurs eu son utilité dans l'affaire de l'amiante. La stigmatisation de la responsabilité de l'employeur, dans plusieurs cas d'abus tout à fait criants, a, dans une certaine mesure, satisfait une demande de réparation morale des victimes. Mais le dispositif a ses revers. Le système de 1898 avait sa cohérence, renforcée au moment de la création de la sécurité sociale, qui tenait à la volonté, particulièrement en 1945, de faire en sorte que le système d'indemnisation soit en même temps un système de prévention, par le biais d'une pénalisation financière dissuasive ou tout au moins de nature à fortement inciter les employeurs à mettre en place les dispositifs de sécurité leur permettant d'échapper à la surcotisation en cas de faute inexcusable. Le problème est que si la Cour de cassation a largement ouvert les portes de l'indemnisation des victimes grâce à la faute inexcusable, elle a, dans le même temps, durci les conditions d'opposabilité de la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles aux entreprises : assez curieusement, la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, mais la maladie professionnelle n'est pas opposable à l'employeur, pour peu que la caisse ait oublié de lui notifier un certificat médical et que la procédure de reconnaissance n'ait pas été totalement contradictoire... D'où une situation paradoxale dans laquelle le tribunal condamne une entreprise pour faute inexcusable, mais déclare ladite faute inexcusable non opposable à l'entreprise ! De ce fait, la généralisation de la faute inexcusable n'est pas supportée financièrement par les employeurs responsables, mais par la branche « accidents du travail - maladies professionnelles » (AT-MP). Paradoxalement, les victimes de l'amiante en France, tous systèmes d'indemnisation confondus, sont probablement celles qui, dans le monde, bénéficient des meilleurs conditions d'indemnisation, alors même que nous sommes le pays dans lequel la catastrophe de l'amiante a coûté le moins cher à ses responsables, la sécurité sociale ayant finalement servi d'amortisseur. Le souci de prévention des pères fondateurs de la sécurité sociale a disparu, et c'est précisément ce déséquilibre qui explique la montée en puissance de la demande de sanction pénale : la faute inexcusable n'entraîne finalement aucune sanction économique, mais seulement une sanction symbolique. M. le Président : Tout à fait. Alors même que le terme même de « faute inexcusable » a une signification très forte pour les victimes, il ne se traduit pas dans la réalité des faits. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Le cas d'Eternit est à cet égard particulièrement choquant. On recensait à l'époque au moins 500 maladies professionnelles pour le seul site de Valenciennes ; le total en France devait avoisiner les mille victimes, alors même que les effectifs d'Eternit n'ont rien à voir avec ceux de la DCN. Les maladies professionnelles en question étant reconnues depuis longtemps, l'entreprise payait des surcotisations assez élevées. Arrivent les procès en faute inexcusable ; Eternit est condamnée, mais en même temps, son avocat, Me Philippe Plichon, va très astucieusement démontrer, dossier après dossier, que la caisse a oublié, à un moment donné, de notifier à l'employeur qu'elle allait, par exemple, prendre sa décision dans les trois jours afin qu'il lui transmette au plus vite ses éventuelles observations... Même si, dans la plupart des cas, il s'agissait de mésothéliomes, d'asbestoses caractérisées ou de plaques pleurales qui n'appelaient rigoureusement aucune observation, la sécurité sociale avait manqué à une obligation formelle. De ce fait, les tribunaux, tout en reconnaissant la faute inexcusable d'Eternit, ont déclaré le jugement non opposable dans la mesure où le processus de reconnaissance de la maladie professionnelle avait été vicié. Au final, après plusieurs centaines de procès en faute inexcusable, Eternit a eu beau jeu, sur cette base, de faire remarquer à la sécurité sociale qu'on l'avait tarifée depuis des années sur des centaines de maladies professionnelles déclarées non opposables, autrement dit qu'on l'avait surtarifée à tort ! Tant et si bien que, l'année dernière ou il y a deux ans, Eternit a reçu de la sécurité sociale un chèque fantastique en remboursement de surcotisations indues... M. le Président : Pourrez-vous nous communiquer des éléments précis sur ce point ? M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : J'ai eu entre les mains une copie de la lettre de la caisse accompagnant le remboursement... M. le Président : Pouvez-vous la retrouver ? M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Je peux essayer. La caisse de Valenciennes vous le confirmera assez facilement. Cela remonte à 2004, peut-être 2003. M. le Président : Je comprends mieux votre position tendant à supprimer cet archaïsme plutôt que d'en renforcer la portée... M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Cela me paraît relever plutôt du rafistolage, d'autant que l'on retrouvera d'autres incohérences ailleurs. Mieux vaut, certes, rafistoler que ne rien faire, mais la décision de la chambre sociale doit être comprise comme un appel à revoir le système dans sa totalité. M. Jean-Marie GEVEAUX : Ce sera un travail considérable... M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Évidemment. M. le Président : Notre objectif est d'ouvrir des chantiers, non de les conduire nous-mêmes... À votre avis, la décision de la chambre sociale était donc une manière assez habile d'ouvrir une porte ? M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Je me demande s'il n'était pas écrit noir sur blanc dans le rapport 2002 de la Cour de cassation que cette nouvelle jurisprudence devait inciter le législateur à revoir la question. M. le Président : Nous le relirons attentivement. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Le système de tarification en raison du nombre de reconnaissances de maladies professionnelles est certainement bon. Mais si les accidents du travail marquent, à ma connaissance, une stagnation, sinon une légère décroissance, les maladies professionnelles sont en augmentation considérable. M. le Président : Nous avons effectivement ce débat depuis quelque temps. Si les accidents du travail relèvent d'une approche ancienne, historique et bien fixée, la notion de maladie professionnelle évolue sans cesse au gré des mutations du rapport au travail, de l'apparition de nouvelles technologies ou de nouveaux produits dont le cycle de rotation, de plus en plus rapide, complique l'approche préventive. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Ce à quoi vient s'ajouter un problème de visibilité : ce qui est extraordinaire, mais significatif, est que la catastrophe de l'amiante soit restée invisible pendant des décennies, alors qu'elle était présente depuis bien longtemps. Compte tenu du délai de latence - vingt à trente ans - des maladies qui y sont liées, la sécurité sociale passe son temps à surtarifer des entreprises qui ont disparu depuis dix ans... À Marseille, par exemple, il n'y a plus de réparation navale ; ainsi, alors qu'il reste des centaines ou des milliers de victimes de l'amiante, il n'y a plus de sanction financière possible, parallèlement à l'indemnisation. La question des cancers professionnels, qui sont la forme moderne des maladies professionnelles, est appelée à devenir de plus en plus problématique dans les années à venir. Ces pathologies se déclarent dix, vingt, quarante ans après l'exposition au risque - voire à la génération suivante : je pense aux éthers de glycol et à leurs effets tératogènes. Comment retrouver ce rapport entre l'indemnisation et la sanction financière lorsque l'entreprise responsable a disparu au moment où la maladie se déclenche ? Parmi les pistes envisageables, il y a la possibilité de relier les questions de tarification non pas à la survenue de la maladie professionnelle quand l'entreprise ne peut plus exister, mais aux situations de mise en danger ou aux dysfonctionnements constatés par la caisse régionale d'assurance maladie, sans attendre l'apparition des conséquences ou la catastrophe avérée. Mais je suis en train d'ouvrir un autre débat... M. le Président : Pas du tout : vous êtes au coeur des réflexions que nous sommes en train de mener sur la prévention et la prise en charge des maladies professionnelles. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Cela montre à quel point le chantier est considérable. Sans doute faudra-t-il revoir des pans entiers du code de la sécurité sociale. M. le Président : On retrouve cette approche à travers le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) dont la Cour des comptes a dénoncé le caractère inégalitaire, certains salariés bénéficiant de l'ACAATA, alors qu'ils ne seront probablement jamais malades, tandis que d'autres, malades avérés, en sont exclus, avant d'émettre l'idée de n'en faire bénéficier que les salariés atteints de pathologies déclarées. Le problème... M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : C'est qu'il est souvent trop tard ! M. le Président : Exactement ! M. le Rapporteur : Il faut savoir que le coût de la réparation intégrale de tous les AT-MP en 2004 représenterait 3 milliards d'euros... Par ailleurs, votre cabinet a-t-il été amené à agir dans le cas de contentieux impliquant le FCAATA ? M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Bien sûr, le plus souvent liés au fait que nombre d'établissements, quoique connaissant de très nombreuses maladies professionnelles, n'ont pas été inscrits sur la liste figurant à l'annexe II du décret. La question se pose de façon récurrente dans le secteur de la sidérurgie... M. le Président : Tout à fait. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Je pense en particulier au cas des aciéries Aubert et Duval aux Ancizes, dont les fours, qui contiennent évidemment des matériaux amiantés, exigent en permanence des opérations de réparations, voire de démolition/reconstruction, qui ont provoqué la mise en suspension de quantité de poussières considérables. Or ces entreprises ne sont pas reconnues comme ouvrant droit, par nature, à l'Allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), alors que le nombre de maladies y est considérable et la revendication des syndicats très forte. M. le Rapporteur : Quelle est dans ce cas la juridiction compétente ? M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Tout le monde pensait que c'était le Conseil d'État ; mais celui-ci, dans un arrêt tout récent, a déclaré que la décision revenait au tribunal administratif local. Tant et si bien que tous les contentieux sont en cours de rapatriement dans les tribunaux administratifs. À Forgeval, société sidérurgique située à Valenciennes, tous les salariés bénéficient de l'ACAATA. Mais pour d'autres salariés travaillant à peu près dans les mêmes conditions dans d'autres entreprises du secteur, la réponse a été négative... On a le sentiment d'une certaine incertitude des critères. M. le Président : J'ai la même analyse. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Le problème se pose particulièrement pour le calorifugeage. Cette activité est incessante dans ces grands halls sidérurgiques où l'on voit en permanence des fours en construction ou en démolition, d'où un empoussièrement de décalorifugeage permanent. M. le Président : J'ai moi-même réalisé des dossiers très complets à propos d'affaires mettant en jeu des procédés de calorifugeage ou, à l'inverse, de refroidissement faisant appel à l'amiante - sans parler des plaquettes de freins... La situation est inégalitaire, et dans les deux sens. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : J'avoue être plus sensible à l'inégalité découlant d'une non-inscription dans l'annexe II... La Cour des comptes cite, à l'inverse, des exemples aberrants d'entreprises ne connaissant pratiquement pas de maladies professionnelles, mais où tout le monde a droit à l'ACAATA ! On peut trouver deux raisons à cela : ou bien les maladies existent bel et bien, mais n'ont pas été reconnues, ou bien il y a une erreur quelque part... Mais je suis plus préoccupé par le premier aspect que par celui-là. M. le Président : La Cour des comptes insiste beaucoup sur cet aspect. M. le Rapporteur : La notion de faute inexcusable de l'employeur existe-t-elle ailleurs que dans le domaine des accidents du travail ? En imaginant que la notion de faute inexcusable disparaisse, ne sera-t-on pas alors tenté d'accuser sur le fondement de l'homicide volontaire ou involontaire, ou encore de l'empoisonnement ? En effet, certaines victimes tiennent à saisir le TASS moins pour être indemnisées que pour stigmatiser un employeur, à leurs yeux coupable. Il serait peut-être intéressant de trouver un système de remplacement - ce peut être la procédure pénale. Par ailleurs, dans l'affaire de Karachi, il a fallu attendre que la Direction des chantiers navals (DCN) soit reconnue coupable de faute inexcusable pour que les blessés ou les proches des salariés décédés perçoivent la totalité de la rente. C'était possible parce que les salariés étaient en déplacement et que l'attentat entrait dans le cadre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Si la faute inexcusable disparaissait, il faudrait faire en sorte que l'indemnisation soit bien totale et que la victime puisse porter plainte et faire sanctionner celui qu'elle estime responsable de sa situation. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : La notion de faute inexcusable n'existe que dans ce domaine précis. C'est la raison pour laquelle, intellectuellement, elle ne se justifie plus. Mais elle a incontestablement, à un moment donné, joué un rôle positif dans l'affaire de l'amiante en apportant aux victimes une satisfaction morale, du fait de sa connotation stigmatisante. La réparation intégrale rendant inutile la faute inexcusable, comment, effectivement, retrouver cette compensation morale, mais également une cohérence dans le lien entre prévention et indemnisation ? Toute la problématique est là. Au Parlement belge, une proposition de loi avait été déposée par les députés, qui visait à inscrire la faute inexcusable dans la loi, afin que les victimes de l'amiante en Belgique soient indemnisées - elles ont le plus grand mal à faire valoir leurs droits, les procès n'avancent pas, etc. Il nous a été très difficile de leur expliquer que c'était totalement incohérent : la législation belge, adoptée quelques années après la nôtre, s'est inspirée de notre loi de 1898, à ceci près qu'elle n'a pas retenu le principe de partage des responsabilités : une victime belge d'accident du travail ayant 20 % d'incapacité perçoit une pension de 20 % et non de 10 %. La faute inexcusable en France était destinée à permettre d'aligner le taux de pension sur celui de l'IPP. En Belgique, la faute inexcusable ne se justifiait pas puisque le taux de pension suit déjà celui de l'IPP. La notion de faute inexcusable est totalement liée au principe du partage de la responsabilité, dont il nous faut désormais sortir. Tout le problème sera, effectivement, ensuite de « rattraper les bons côtés » de la faute inexcusable... M. le Président : Grâce à vous, Maître, et à toutes les autres personnalités auditionnées, nous ne cessons d'ouvrir des chantiers - je doute que nous soyons capables de les fermer. Nous organisons le 23 novembre prochain une table ronde sur la prise en charge des victimes de l'amiante. Accepteriez-vous d'y participer ? Je précise qu'elle ne sera pas publique afin de garantir la plus grande liberté de ton. L'ANDEVA et la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), de même que la Cour des comptes seront également présentes. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Je déplacerai mes rendez-vous pour y participer. M. le Président : Je vous en remercie. Audition de représentants du Conseil d'État sur le rapport annuel relatif à la responsabilité et à la socialisation du risque : M. Jean-Michel BELORGEY, président de la section du rapport et des études, et M. Bernard PIGNEROL, maître des requêtes Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui M. Jean-Michel Belorgey, président de la section du rapport et des études du Conseil d'État - qui connaît bien notre Assemblée - et M. Bernard Pignerol, maître des requêtes et rapporteur général adjoint du rapport annuel du Conseil d'État pour 2005, consacré, cette année, à la responsabilité et à la socialisation du risque. Nous avions également sollicité Mme Edwige Belliard, rapporteure générale de ce rapport. Mais elle n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, en raison d'une audience de la Cour européenne des droits de l'homme sur une affaire pour laquelle elle représente le Gouvernement français, au titre de ses fonctions actuelles de directrice des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères. Je vous remercie, messieurs, de vous être rendus disponibles pour cette réunion qui intervient dans le cadre d'une série d'auditions relatives à la prise en charge des victimes de l'amiante et, plus généralement, à la prise en charge de l'ensemble des victimes de dommages liés au travail. Nous avons souhaité vous rencontrer parce que le sujet qui a retenu l'attention du Conseil d'État cette année rejoint, à de nombreux égards, les interrogations de notre mission sur la façon de traiter les risques professionnels. Notre interrogation touche non seulement l'avenir de la réparation des risques liés au travail, mais aussi la question de la prévention. Cette audition, un peu générale, est au cœur de notre démarche, qui consiste à tirer les leçons de l'affaire de l'amiante pour l'avenir. L'affaire de l'amiante a remis en cause le compromis social de 1898 sur lequel repose le dispositif de réparation des dommages liés au travail. D'abord, en créant des fonds d'indemnisation spécifiques pour sortir du principe de la réparation forfaitaire et améliorer la prise en charge des victimes d'un drame considéré comme national. Le Conseil d'État a d'ailleurs reconnu la responsabilité de l'État dans cette affaire. Ensuite, en remettant en cause le principe de l'immunité civile des employeurs par l'élargissement considérable du champ de la « faute inexcusable » de l'employeur qui découle de l'arrêt de la Cour de cassation de 2002. Désormais, l'indemnisation forfaitaire de la branche « accidents du travail - maladies professionnelles » (AT-MP) se révèle moins intéressante que les indemnisations susceptibles d'être obtenues par la voie judiciaire sur le fondement de la faute inexcusable. Elle paraît également injuste par rapport au mode d'indemnisation de tous les autres dommages. D'où le risque d'une multiplication des recours judiciaires et l'idée qu'il faudrait peut-être réviser le mode d'indemnisation des maladies professionnelles. En même temps, une généralisation de la réparation intégrale des risques professionnels aurait un coût considérable et pourrait déresponsabiliser à outrance les employeurs. Beaucoup de questions sont donc posées. Quel avenir pour la branche AT-MP, compte tenu des risques élevés de maladies professionnelles liées notamment aux produits innovants ? Faut-il revenir sur le compromis de 1898 ? Quelle prévention faut-il promouvoir ? Comment appliquer le principe de précaution sans pénaliser l'innovation et l'activité économique ? Jusqu'où faut-il accepter de mutualiser les responsabilités dans le domaine de la santé au travail ? Nous allons donc vous écouter pendant une dizaine de minutes sur le rapport que vous avez rédigé, puis nous engagerons le débat avec les membres de la mission. M. Jean-Michel BELORGEY : Il est dommage que Mme Edwige Belliard n'ait pu se rendre disponible pour cette audition. Elle a porté avec beaucoup de conviction et de talent l'exercice qui a conduit au rapport public du Conseil d'État relatif à la responsabilité et à la socialisation du risque. Cela dit, nous avons travaillé ensemble, et je crois pouvoir retracer fidèlement ce que le rapporteur général et le Conseil d'État avaient en tête en rédigeant ce rapport. Vous nous avez interrogés sur le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Je rappellerai tout d'abord les raisons qui ont conduit à la création de ce fonds. Les autorités publiques, avant même que des actions soient conduites par différentes victimes et associations de victimes, ont pris conscience qu'il était extraordinairement compliqué pour les victimes d'obtenir une indemnisation dans des conditions satisfaisantes. Elles ont donc décidé de résoudre la question de l'indemnisation des victimes en déconnectant le problème de la responsabilité de celui de la réparation. Il a été ainsi prévu qu'il n'y aurait pas d'indemnisation sous condition de mise en cause de la faute inexcusable de l'employeur, comme c'est le cas pour certains accidents du travail. Pourquoi une telle générosité ? Parce que les maladies dues à l'amiante ont des caractéristiques très singulières. Il est difficile de savoir au bout de combien de temps l'exposition aux poussières produit ses effets, et il est donc difficile, quand une personne a travaillé successivement dans plusieurs entreprises, de savoir dans laquelle elle a subi les atteintes les plus graves. Mais il y a une autre raison : avant même la décision du Conseil d'État, on a pris conscience, dans les milieux gouvernementaux, que l'État n'avait pas fait face à l'obligation qui est la sienne de réguler et d'encadrer les disciplines que doivent observer les entreprises face à des risques comme celui résultant de l'exposition à l'amiante. Lorsque le Conseil d'État a eu à se prononcer, il n'y avait pas l'ombre d'un doute sur les atermoiements des pouvoirs publics. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont pris les premières mesures, respectivement, dans les années 30 et dans les années 40, alors que la France a pris des initiatives dispersées et imparfaites. Le comité qui a été créé en 1982 regroupait des industriels de l'amiante, des syndicats représentatifs des personnels, des médecins, des chercheurs et des représentants de l'administration. Pendant des années, il a marqué le pas, ne rendant pas de conclusions, ou rendant des conclusions extrêmement timides. Les entreprises voulaient continuer à fabriquer leurs produits, les personnels voulaient protéger l'emploi, les chercheurs étaient un peu isolés. Les quelques cris d'alerte qui ont été lancés n'ont pas intéressé les pouvoirs publics. L'inspection du travail n'a pas fait d'enquête pendant trente ans. À partir de là, il importait de permettre aux victimes d'être indemnisées sans ménager les efforts de l'État. C'était une question de paix sociale, peut-être. C'était aussi une question d'égalité devant les charges publiques. C'était, enfin, une question de dignité. François Ewald nous dit, en substance, que la création du FIVA correspond à la fin du régime de sécurité sociale des accidents du travail. Pourquoi ? Parce qu'il indemnise mieux. Par ailleurs, ce système serait choquant parce qu'il fait porter le poids de l'indemnisation des dommages, non pas sur d'éventuels responsables mais sur l'ensemble des entreprises, et même sur tous les citoyens. Certes, mais à partir du moment où les études n'ont pas été conduites de façon suffisamment précise, à partir du moment où les itinéraires professionnels sont mal connus, à qui peut-on imputer les responsabilités ? Inévitablement, la difficulté se reproduit quand il s'agit d'engager les actions subrogatoires. Séparer la question de la réparation de celle de la responsabilité ne signifie, certes pas, de renoncer à engager la responsabilité. Mais comment engager des actions quand les itinéraires professionnels ont été discontinus et quand on ne sait pas quelles doses ont été inhalées et dans quelle entreprise ? Contrairement à ce que pense François Ewald, on ne peut pas dire que c'en est fini du régime de sécurité sociale des accidents du travail et maladies professionnelles, même si ce régime est loin d'être parfait. En particulier, il est, à première vue, moins avantageux que ne peuvent l'être les procédures engagées au titre de l'article 1384 du code civil. Il est également moins favorable que le régime de la loi du 6 juillet 1990 relative aux victimes d'infractions, modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances. Il est moins favorable que le régime applicable aux collaborateurs occasionnels du service public. Cela étant, la Cour de cassation donne depuis une dizaine d'années une interprétation de plus en plus ouverte de la notion de faute inexcusable. En 2002, elle a d'ailleurs avancé l'idée qu'une faute inexcusable pouvait être liée au manquement à l'obligation de sécurité de résultat. Le juge administratif, traditionnellement avare dans sa manière d'indemniser les accidents du travail dans la fonction publique, s'est éloigné de cette tradition. Dans l'arrêt Moya-Caville du 4 juillet 2003, le Conseil d'État a crevé l'abcès en considérant que le forfait de pension n'indemnisait qu'une fraction des préjudices liés à un accident du travail et que la victime pouvait rechercher des compléments d'indemnisation, soit en invoquant des troubles de toute nature dans les conditions d'existence, soit en engageant des actions en responsabilité reposant sur d'autres fondements que la perte de ressources liée à la survenue d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. S'il est vrai que le compromis de 1998 est dépassé, les juges ont donc trouvé des solutions qui ne sont pas désordonnées. Dans le domaine de l'indemnisation des accidents du travail des agents publics, les choses ont également progressé. Vous nous avez demandé si la législation actuelle en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles a déjà été contestée sur le fondement de son incompatibilité avec la Convention européenne des droits de l'homme. Autant la Charte sociale du Conseil de l'Europe traite des questions de fond - l'hygiène et la sécurité au travail, le risque « accidents du travail » au sein de la sécurité sociale -, autant la Convention européenne des droits de l'homme ne concerne que les procédures. À cet égard, la France a été condamnée dans une décision de 1995, parce que le Gouvernement français et les juridictions françaises avaient tenu que la loi excluait la possibilité d'une action parallèle, une fois acceptées les propositions d'un fonds d'indemnisation. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que la garantie procédurale résultant de la Convention oblige à admettre qu'une action parallèle puisse être intentée, même après acceptation des propositions du fonds. Dans ses conclusions sur l'affaire Moya-Caville, Didier Chauvaux s'est penché sur la question de savoir si le forfait de pension pouvait être regardé comme contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Il a conclu par la négative, car la Convention de Strasbourg est essentiellement la gardienne de dispositions procédurales, et la France admet d'autres voies d'action en complément du forfait de pension. S'agissant de la répartition des coûts entre l'État et l'assurance maladie, je ne crois pas que la question de la répartition des financements dépende de critères objectifs. Elle dépend essentiellement de choix politiques et d'opportunités d'affichage. Je rappelle que le FIVA a été créé non pour dédommager les victimes des insuffisances de l'État mais pour mettre en œuvre la solidarité nationale. Cela étant, on sait que la branche AT-MP rembourse chaque année à l'assurance maladie une certaine somme correspondant à ce qui aurait dû être pris en compte par le régime des accidents du travail et qui l'a été par l'assurance maladie. Cette somme est déterminée en fonction de critères assez largement arbitraires. En ce qui concerne la prévention, le Conseil d'État n'a pas de position singulière. Il pense qu'il est de la responsabilité de l'État d'organiser des structures de prévention, de guider les entreprises dans l'exercice des disciplines dont elles sont comptables. L'État doit organiser la connaissance par le biais d'une expertise indépendante, l'information, et guider les entreprises réticentes à prendre les mesures nécessaires. Une société de précaution peut devenir une société de totale paralysie. Mais, inversement, une société qui ne prend pas un certain nombre de précautions va à sa perte. Il faut donc une prévention accrue, mais non stérilisante. Bien sûr, il n'est pas acceptable que la collectivité prenne généralement en charge des dépenses résultant de l'exposition à des risques professionnels. Mais cela est acceptable dans le cas de l'amiante, parce que l'État a trop tardé à prendre les mesures nécessaires. M. le Rapporteur : Vous avez évoqué les difficultés auxquelles se heurte le FIVA lorsqu'il s'agit de mener des actions subrogatoires. Ne croyez-vous pas que les mêmes difficultés risquent de se poser dans des poursuites pénales ? M. Jean-Michel BELORGEY : Il me semble que la difficulté essentielle tient au temps de latence très long des maladies dues à l'amiante, et donc au fait qu'il faut, dans un certain nombre de dossiers, procéder à des investigations trop approfondies. Il serait intéressant de demander aux gestionnaires du fonds s'ils ont cherché à savoir si les chances de réussites des actions subrogatoires variaient selon les types de dossiers - cas où l'intéressé a eu une carrière hachée, cas où sa carrière a été continue, etc. M. le Président : Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il faut accroître la prévention, et procéder à des analyses indépendantes préalables. Mais ne pensez-vous pas qu'il existe un risque de transfert presque total de la responsabilité sur l'État ? D'autant que la multiplication des produits utilisés dans l'industrie rend de plus en plus difficile la maîtrise des effets de ces produits. M. Jean-Michel BELORGEY : Ma pensée se distingue aussi bien de celle des écologistes crispés que de celle des aventuriers de l'entreprise. Si nous souhaitons une société d'initiative, où l'entreprise ne soit pas subordonnée à des autorisations d'engager certains types de production, il faut bien que l'État s'attelle aux tâches qui correspondent à ses missions fondamentales de sécurité. Il doit, pour cela, développer une expertise indépendante, définir les précautions à prendre, et inciter les entreprises à les respecter, quitte à ce que celles-ci souscrivent des assurances sur le marché privé. C'est ce qu'il n'a pas fait dans le cas de l'amiante. M. le Président : À la différence des accidents du travail, qui sont clairement identifiables, les maladies professionnelles sont en constante évolution. Est-on capable d'ajuster les tableaux de maladies professionnelles à un rythme suffisant pour qu'ils soient adaptés à ces mutations ? M. Jean-Michel BELORGEY : Nous n'avons pas le choix. Nous devons en être capables. M. le Président : Cela implique que l'État se dote de moyens qu'il n'a pas encore aujourd'hui. M. Daniel PAUL : La presse fait état, depuis quelques semaines, d'entreprises où l'on utilise toujours de l'amiante, huit ans après son interdiction. On évoque notamment le cas d'Alstom et de la SNCF. Cela ne justifie-t-il pas une autre approche que celle que vous décrivez ? Par ailleurs, le programme REACH47 porte sur une grande quantité de produits extrêmement dangereux. On ne peut les traiter selon les mêmes modalités que l'amiante, dont l'interdiction est d'ailleurs remise en cause par le Portugal. Enfin, la médecine du travail et l'inspection du travail sont inféodées aux entreprises, alors que les dispositifs de veille et de contrôle devraient être totalement indépendant du pouvoir économique et s'imposer à lui, sous peine d'entrer dans une logique extrêmement dangereuse. Qu'en pensez-vous ? M. Bernard PIGNEROL : À un moment donné, la responsabilité des pouvoirs publics est d'utiliser les instruments juridiques dont ils disposent. Si l'amiante est interdit et que des entreprises l'utilisent, il existe des incriminations pénales. Le dispositif juridique existe, sans qu'il soit nécessaire de le renforcer. Il y a de plus en plus de produits dangereux, c'est évident. Mais il me semble qu'une extension absolue du principe de précaution pourrait avoir d'assez fortes conséquences en termes de progrès technique et d'utilisation de ce progrès. Il faut donc veiller à un certain équilibre. S'agissant de la médecine du travail, je ne suis pas sûr que les autorités indépendantes qui ont été créées garantissent mieux le respect de la prévention. Je pense par exemple au secteur de la téléphonie, où l'on sait qu'un certain nombre de risques existent pour les usagers. M. Jean-Michel BELORGEY : La démarche du Portugal illustre un phénomène que je voudrais souligner. La lutte des pays défavorisés est fondée sur des calculs délicats. Il s'agit de savoir ce que certaines exigences amènent à sacrifier, et aux dépens de quel avenir. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue, dans le cadre des Nations unies, avec des Pakistanais qui étaient exaspérés par les décisions prises par certains pays en ce qui concerne le travail des enfants. Il est normal, me disaient-ils, que l'on interdise certaines formes monstrueuses d'exploitation des enfants. Mais ce n'est pas protéger nos enfants que d'énoncer des règles qui nous imposent de les traiter comme vous traitez les vôtres. En d'autres termes, il y a une alchimie de ce qu'il faut payer aujourd'hui pour que l'avenir des générations suivantes soit meilleur. Elle ne doit pas être ignorée. Sinon, nous aurons les mains pures mais nous n'aurons pas de mains. Le débat sur l'amiante est compliqué du fait qu'il y a des espèces d'amiante plus ou moins dangereuses. En outre, certains produits permettraient de rendre l'amiante moins dangereux. Mais la question doit être posée aux experts. M. le Rapporteur : Au sein du Comité permanent amiante (CPA), on a pu constater un certain laisser-aller. Mais n'est-on pas tombé dans l'excès inverse, conduisant à des mises en cause systématiques ? On voit apparaître des positions fermées, sclérosées, qui ont pour effet qu'on n'ose plus rien entreprendre. Les produits que le programme REACH se donne pour objectif d'expertiser ne sont pas tous forcément dangereux. Le FIVA et le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) sont des outils d'exception, sur lesquels il me semble difficile de fonder la gestion des maladies professionnelles à venir. M. Jean-Michel BELORGEY : Le principe de précaution doit être appliqué en amont. Il s'agit de border les difficultés perceptibles, d'organiser l'accès à la reconnaissance des maladies professionnelles individuelles. Cela étant, il convient de procéder à des études de coût, afin de vérifier si la prise en charge des risques peut être assurée dans le cadre des budgets actuels, ou si, le cas échéant, il faut faire appel à d'autres ressources, éventuellement celles de l'assurance. Mais tout ce travail doit être effectué en amont. Ne pas le faire ne serait pas conforme à l'idée d'égalité devant les charges publiques. Et chaque fois que ce travail de prévention n'aura pas été fait, l'État sera obligé de créer un fonds, tardivement, et après bien des souffrances humaines. M. le Président : Hier, dans l'hémicycle, à l'occasion de l'examen des crédits du travail et de l'emploi, M. Gérard Larcher soulignait qu'on ne pouvait « se satisfaire de connaître 3 000 produits toxiques sur les 100 000 répertoriés » et qu' « il faudrait en connaître 30 000 ». Cela signifie que notre système de prévention pose des problèmes d'une acuité nouvelle à la puissance publique, et pour le traitement desquels elle ne dispose pas des outils et des moyens nécessaires. M. Jean-Michel BELORGEY : C'est pourtant l'une des missions qu'elle ne peut pas refuser d'exercer, au même titre que la défense nationale. M. Bernard PIGNEROL : Le Rapporteur a raison de souligner que les fonds doivent rester l'exception. Il ne faut pas arguer de l'existence de ces fonds pour dire que tout le système antérieur doit être balayé. Il fonctionne au quotidien, et je ne vois pas par quoi nous le remplacerions. Mais pour que les fonds restent une exception, il est clair que le travail de prévention doit être mené en amont. M. le Président : Messieurs, je vous remercie de votre contribution aux travaux de notre mission. Audition de M. Michel LAROQUE, inspecteur de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS), auteur en 2004 d'un rapport sur « la rénovation de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles » Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui M. Michel Laroque, inspecteur général des affaires sociales, auteur en 2004 d'un rapport consacré à « la rénovation de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ». Nous avons souhaité vous rencontrer parce que le sujet de votre rapport rejoint à de nombreux égards les interrogations de notre mission sur l'avenir de la réparation des victimes de risques liés au travail. Le drame de l'amiante a abouti à une remise en cause du compromis social de 1898 sur lequel repose le dispositif de réparation des dommages liés au travail, avec d'une part la création d'un fonds d'indemnisation spécifique et, d'autre part, l'élargissement considérable du champ de la « faute inexcusable » de l'employeur qui résulte de l'arrêt de la Cour de cassation de 2002. La question qui se pose est donc l'évolution de la branche « accidents du travail et maladies professionnelles » (AT-MP) dans un contexte d'augmentation des maladies professionnelles. C'est pourquoi votre rapport se situe au centre de notre démarche qui consiste à tirer les conséquences de l'affaire de l'amiante. Nous allons donc vous écouter nous parler de votre rapport, pendant une dizaine de minutes, puis nous engagerons le débat avec les membres de la mission. M. Michel LAROQUE : L'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles est effectivement actuellement en porte-à-faux. Jusqu'à il y a quelques années, la réparation des accidents du travail était considérée comme un exemple. Aujourd'hui, elle apparaît insuffisante comparée à la réparation de droit commun, à laquelle elle est souvent inférieure. Cette évolution reflète une évolution générale de notre société, du point de vue du niveau de protection assuré comme de celui de la notion de responsabilité. On peut se demander, à voir l'attitude des juges et du législateur, si l'on n'est pas en train de passer d'un monde de risques et d'aléas à une société du « tout assurance ». Cela peut constituer un progrès social, mais aussi un facteur de sclérose et de paralysie si l'on généralise le principe de précaution et si l'on écrase la société sous les charges assurancielles, qu'elles soient publiques ou privées. Je ne suis d'ailleurs pas certain que l'on cerne correctement le coût de l'ensemble du système assuranciel, qui intègre non seulement les prélèvements obligatoires, mais aussi toutes les contributions privées : assurance automobile, assurance multirisque habitation, assurance des professions médicales et des établissements hospitaliers, assurance des entreprises... Tout cela représente des prélèvements très importants et peut-être faudra-t-il se demander s'ils ne sont pas excessifs. Je rappellerai d'abord brièvement le compromis social de 1898, avant de dégager les facteurs de déstabilisation de l'équilibre atteint. J'examinerai enfin les nouveaux équilibres susceptibles d'être envisagés. Le compromis historique originel repose sur trois piliers : la présomption d'imputabilité, la réparation forfaitaire, et l'immunité civile de l'employeur, sauf faute intentionnelle ou inexcusable. Je précise d'emblée que la notion de réparation forfaitaire ne signifie pas, en elle-même, une réparation globalement inférieure à la réparation intégrale, contrairement à l'acception commune. Elle signifie un système d'évaluation par avance, assurant une égalité entre les victimes. C'est un élément important qu'il n'est pas inutile de rappeler. Le système actuel de réparation se situe dans la ligne de ce compromis de 1898. Il est relativement généreux, si on le compare, par exemple, à l'assurance invalidité. Mais on notera au passage que si une réparation a été faite dans le cadre des risques professionnels, on n'a plus droit à l'assurance invalidité, alors que celle-ci peut parfois être plus généreuse. Il y a là un problème de cohérence du système, qui n'existe pas en Allemagne, où pension d'invalidité et réparation intégrale peuvent se combiner. Notre système, malgré sa générosité, présente aussi des insuffisances. Le barème accidents du travail est supérieur au barème physiologique de droit commun - dit « barème du concours médical » -, mais il constitue un barème global où l'on ne distingue pas le préjudice physiologique et le préjudice professionnel. Ce barème est cependant indicatif, puisqu'il peut être corrigé par des coefficients professionnels, comme la jurisprudence de la Cour de cassation l'a reconnu. De même, on peut relever des insuffisances en ce qui concerne les prestations en nature remboursées - puisqu'elles sont inférieures aux prestations que l'on a ouvertes aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire - et en ce qui concerne aussi les conditions de la majoration pour tierce personne qui ont été assouplies ces dernières années mais qui restent cependant relativement rigides. Enfin, les efforts de réinsertion professionnelle ne sont pas suffisamment précoces, à la différence du système allemand, où, dès l'hospitalisation d'une victime, un agent de la caisse examine les possibilités de réinsertion. S'agissant de l'évolution du système actuel de prise en charge des AT-MP, les facteurs de déstabilisation du compromis de 1898 résultent de certaines dispositions législatives, de l'évolution jurisprudentielle et de plusieurs rapports officiels. La grande rupture législative résulte de la loi dite « Badinter », du 5 juillet 1985 qui a développé un système de présomption, tout en maintenant, à la différence de la loi de 1898, les principes de réparation de droit commun qui permettent une réparation intégrale. À cette loi Badinter s'est ajoutée une série de lois visant des situations plus spécifiques : les victimes d'infractions, les victimes de transfusions sanguines, les victimes de l'amiante... Ces divers textes combinent, donc, la présomption et la réparation de droit commun, parfois en utilisant même la notion de « réparation intégrale », dont je ne comprends pas tout à fait ce qu'elle signifie. On a donc un système dans lequel les dispositions de l'assurance AT-MP et les dispositions du droit commun peuvent se combiner. Ce qui est le cas pour la réparation des victimes de l'amiante. Ces législations sont perçues comme assurant un niveau d'indemnisation supérieur à l'assurance AT-MP, ce qui pose désormais la question du niveau de réparation assurée par celle-ci et des principes qui doivent la fonder. À ces législations s'ajoutent des évolutions jurisprudentielles. J'en évoquerai trois principales. La première est l'élargissement progressif du principe de présomption. Le deuxième est la redéfinition de la notion de faute inexcusable. Je souligne à cet égard la distinction faite par la Cour de cassation entre la faute inexcusable de l'employeur et celle du salarié, pour lesquelles les définitions sont presque contradictoires. La troisième évolution est l'extension de l'indemnisation dans la fonction publique depuis l'arrêt Moya-Caville. Aux dispositions législatives et aux évolutions jurisprudentielles se sont ajoutés des rapports administratifs successifs. Le rapport Dorion de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS), en 1991, a conduit à la possibilité de reconnaître les maladies professionnelles, même en l'absence d'inscription sur un tableau. Il préconisait également de séparer la réparation du préjudice physiologique et celle du préjudice professionnel, ce qui n'a pas été fait. En 2001, le rapport du professeur Masse s'est prononcé en faveur d'une réparation intégrale des accidents du travail et maladies professionnelles. Puis, le rapport de Michel Yahiel et le rapport du comité technique de pilotage de la réparation des accidents du travail, que je présidais, ont été plus nuancés. Ce dernier rapport a notamment souligné certaines des limites de la réparation intégrale et il lui est apparu que la priorité devait être donnée à la prévention et à la réinsertion par rapport à la réparation financière. Il faut, en effet, éviter qu'une réparation financière trop généreuse ou trop rapide s'effectue au détriment de l'objectif de réinsertion professionnelle des intéressés, qui est tout de même le principe essentiel de la réparation. J'en viens maintenant aux nouveaux équilibres susceptibles d'être envisagés, compte tenu de ces évolutions et des exemples étrangers. En matière d'accidents du travail, les pays européens peuvent être regroupés en trois familles. Les pays anglo-saxons offrent des indemnités forfaitaires d'un niveau très faible, et proposent le recours contre l'employeur pour obtenir davantage car il n'y a pas d'immunité civile au Royaume-Uni ou en Irlande. La seconde catégorie de pays - la plupart des pays continentaux - indemnise un préjudice unique - l'incapacité permanente -, sans distinguer entre préjudice physiologique et préjudice professionnel, et sur la base d'un barème médical. C'est le cas de la France, de l'Allemagne, de l'Autriche. Dans ces pays, l'employeur bénéficie de l'immunité civile, sauf en cas de faute grave ou intentionnelle. La troisième catégorie de pays indemnise séparément la perte de capacité de gains et le préjudice physiologique. C'est notamment le cas des pays scandinaves et de la Suisse. Ces pays exigent un taux minimum de perte de capacité de gains ou de capacité physiologique - mais cela est également vrai pour d'autres pays - et le recours contre l'employeur est possible. Par rapport à ces systèmes, la France se caractérise par un système d'indemnisation comparable à la majorité de ceux des pays d'Europe continentale, appuyé sur la réparation forfaitaire des pertes de capacités de gains sur la base d'un barème unique d'invalidité, par la possibilité d'indemniser des petits taux - situation qu'elle ne partage qu'avec la Belgique, le Luxembourg et le Portugal. Aucun des pays examinés n'assure, au niveau du régime de base de l'assurance accidents du travail, une réparation intégrale des préjudices extrapatrimoniaux. J'envisagerai quatre scénarios envisageables pour l'avenir. Le premier est le maintien du système actuel. C'est la solution de facilité, mais ce n'est probablement pas la meilleure. D'abord, parce qu'elle risque d'être coûteuse, car à l'assurance accidents du travail va s'ajouter, sauf revirement de la jurisprudence, une extension progressive de la faute inexcusable. Ensuite, parce que cette évolution ne corrigera pas les défauts du système. Il me semble donc préférable d'envisager une réforme, notamment pour caler la notion de faute inexcusable à un niveau intermédiaire entre le niveau où elle se situait antérieurement et celui où elle se situe désormais. Le deuxième scénario est le scénario n° 1 du comité que j'ai présidé, qui propose, sans réforme substantielle, un certain nombre de modernisations du système actuel. Le préjudice professionnel, sans être distingué du préjudice physiologique, pourrait être un peu mieux pris en compte par le biais d'un coefficient professionnel plus adapté, avec des prestations en nature en faveur de l'insertion professionnelle, notamment. Le troisième scénario - le numéro 2 du comité - est l'institution de la réparation intégrale de droit commun. Elle présenterait des avantages importants dont le coût a été estimé à plus de 3 milliards d'euros, par rapport à une dépense qui est déjà de 8 milliards d'euros dans la branche au moment de cette estimation. Mais cette mesure aurait des inconvénients. Privilégiant l'indemnisation, la réparation de droit commun prend insuffisamment en compte la réinsertion professionnelle et sociale. Par ailleurs, le système de droit commun est, par nature, très individualisé. Si l'on transposait, telles quelles, les pratiques du système assuranciel privé et les pratiques judiciaires faisant appel aux avocats et aux juges, on aboutirait à des appréciations au cas par cas, dépendant des éléments qu'apportent les parties, de la qualité des avocats et de l'appréciation des juges. Or, vous n'ignorez pas l'extrême variété des appréciations des cours d'appel. Ce système présente donc des risques financiers difficilement acceptables par un système d'assurance social, parce qu'on ne sait pas jusqu'où il peut aller. L'établissement de nomenclatures des préjudices indemnisables et de barèmes légaux pourrait limiter ces risques, mais alors on pourrait s'éloigner du droit de commun et de l'objectif de réparation intégrale, sauf à ce que le législateur envisage des barèmes indicatifs s'appliquant à l'ensemble de la réparation des dommages corporels, aussi bien pour les victimes de risques professionnels que pour les victimes d'autres accidents, comme cela existe dans d'autres pays. Par ailleurs, le système de droit commun ne correspond qu'imparfaitement à la logique de solidarité, de règles objectives avec une marge d'appréciation réduite, et de gestion de masse de la sécurité sociale. Il serait lourd en gestion pour les caisses et il nécessiterait des appréciations au cas par cas par un personnel qu'il faudrait former, si du moins c'était aux caisses que l'on demandait de gérer un tel système. Surtout, ce recours au système de droit commun risque de remettre en cause le compromis de 1898, et de conduire à une appréciation au cas par cas de l'imputabilité et des facteurs de causalité, tant pour la reconnaissance que pour le niveau de réparation. Ce scénario comporte donc des choix délicats pour les partenaires sociaux. Le dernier scénario serait une « réparation intégrale d'assurance sociale ». Cette formule intermédiaire vise à compenser des préjudices de caractère objectif et matériel, en considérant que l'assurance sociale n'a pas, elle-même, à indemniser les préjudices extrapatrimoniaux, mais qu'elle doit bien indemniser le préjudice fonctionnel et le préjudice professionnel. La notion de maladie multifactorielle serait clarifiée, le modèle suisse pouvant être une source d'inspiration à cet égard. La prise en compte de la faute inexcusable et de la faute intentionnelle pourrait s'inscrire dans deux systèmes différents. Soit elles seraient réservées au droit privé, sans aucune intervention des caisses, ce qui présenterait l'avantage de clarifier parfaitement les concepts mais compliquerait la vie des victimes. Soit on maintiendrait une alternative permettant à la victime d'obtenir une réparation complémentaire attribuée par la caisse, avec suppression, dans ce cas, de la possibilité d'un recours contre l'employeur. En revanche, la possibilité du recours de droit commun serait maintenue si la caisse refusait le versement de cette réparation complémentaire. Telles sont les options étudiées qui doivent s'inscrire dans une nécessaire réflexion sur la réparation du préjudice corporel visant à assurer une plus grande égalité entre victimes, ainsi qu'une articulation adaptée entre assurance sociale, fonds d'indemnisation et assurance privée, compte tenu du coût global des prélèvements assuranciels. M. le Rapporteur : Certaines personnes que nous avons auditionnées ont affirmé que la victime d'un accident de la route bénéficiait d'une meilleure réparation que la victime d'un accident du travail. Qu'en pensez-vous ? M. Michel LAROQUE : Si l'accident de la route d'un salarié est un accident de trajet ou de mission, la victime bénéficie de la loi Badinter, en combinaison avec la réparation de l'assurance et elle sera donc très correctement indemnisée. Celui qui a un accident au sein même de l'entreprise n'a pas, en effet, la possibilité de se retourner contre un tiers et n'aura que la réparation de l'assurance, sans complément. M. le Rapporteur : Vous avez souligné que la réparation forfaitaire n'était pas forcément inférieure à la réparation intégrale. Vous vous êtes également déclaré sceptique quant à la notion même de réparation intégrale. Pourriez-vous nous en dire plus ? M. Michel LAROQUE : Je ne sais pas ce qu'est une réparation « intégrale ». Dans le cadre du droit commun, on s'adresse à des organismes d'assurance ou, si l'on n'en est pas satisfait, à un juge, et la réparation est en quelque sorte négociée. Tout dépend de la qualité des avocats et de l'appréciation des juges. Les aléas sont importants et je ne sais donc pas, au bout du compte, ce qui permet de dire que la réparation finalement obtenue est « intégrale ». Je crains aussi que les victimes d'accidents du travail, qui ne font pas toujours partie des milieux les plus favorisés, aient des difficultés à obtenir les meilleurs avocats et à bien monter leur dossier. Le système de droit commun est donc assez inégalitaire. M. le Rapporteur : La situation en ce qui concerne les maladies professionnelles est extrêmement diverse. Les salariés victimes d'autres maladies que celles dues à l'amiante se plaignent de ce que les victimes de l'amiante sont mieux indemnisées qu'eux. Parmi les victimes de l'amiante, certains acceptent l'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), tandis que d'autres suivent la voie contentieuse. Dans ce dernier cas, les décisions des tribunaux sont diverses. On ne peut donc pas réfléchir à l'évolution équitable de l'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles à partir du système mis en place pour l'amiante, qui a donné lieu à la création d'outils d'exception. Qu'en pensez-vous ? M. Michel LAROQUE : Je pense que le système actuel est un peu bancal. Il me semble qu'il faudrait encadrer de façon générale le dommage corporel et sa réparation par un barème indicatif, qui devrait s'appliquer à l'ensemble du dommage corporel, avec éventuellement certaines différences, dès lors qu'un système de présomption serait introduit car il faut alors une compensation, sauf en cas de responsabilité avérée. Le cas de l'amiante est singulier en ceci que la responsabilité de l'État a été reconnue par le Conseil d'État. Cela crée une différence juridique, qui peut légitimer une différence de traitement. M. le Président : D'une part, vous avez évoqué un risque de sclérose dans l'hypothèse où le principe de précaution gouvernerait totalement la logique d'ensemble de ce système. D'autre part, s'agissant de la faute inexcusable, vous avez souligné que cette notion différait selon qu'elle s'appliquait aux salariés ou aux employeurs. Pourriez-vous préciser votre point de vue ? M. Michel LAROQUE : Dans la jurisprudence de la Cour de cassation, la notion de gravité de la faute a pratiquement disparu pour l'employeur, alors que pour le salarié, la Cour de cassation a défini la faute inexcusable comme une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité. Il y a donc deux définitions de la faute inexcusable. M. le Président : On constate clairement, me semble-t-il, que les accidents du travail et les maladies professionnelles connaissent des évolutions très différentes. Or, on continue à raisonner comme s'il était possible de les traiter de la même manière. Qu'en pensez-vous ? Par ailleurs, quel rôle les partenaires sociaux peuvent-ils jouer pour aménager le système et peut-on maintenir le compromis de 1898 ? M. Michel LAROQUE : Il y a, en effet, une évolution différente à laquelle s'ajoute, pour les maladies professionnelles, le décalage temporel entre l'exposition au risque et la manifestation de la maladie, qui pose le problème de l'efficacité d'un système de prévention lié à l'assurance. Du point de vue de la prévention et de la tarification, on ne peut pas traiter de la même manière les maladies professionnelles et les accidents du travail. Dans le cas de certaines maladies, comme celles qui résultent d'une exposition à l'amiante et qui peuvent se manifester trente ans après l'inhalation des poussières, l'entreprise responsable a souvent disparu et, si elle a survécu, elle ne sera reconnue comme responsable que si le salarié n'est pas passé par plusieurs entreprises. Il ne faudrait pas que celle qui a été la plus constante se trouve pénalisée par rapport à d'autres, le cas échéant, aussi impliquées qu'elle. S'agissant des partenaires sociaux, je pense qu'ils devraient jouer un rôle majeur. Si le système de prise en charge n'est plus adapté, c'est toute la vie sociale de l'entreprise qui peut être compromise. Si l'on multiplie les accidents judiciaires de droit commun, on ne voit pas comment les relations entre l'employeur et ses salariés pourraient être décontractées. M. le Président : En ce qui concerne les maladies professionnelles, pensez-vous qu'il appartienne aux partenaires sociaux de passer un compromis social ? M. Michel LAROQUE : La politique de santé appartient d'abord à l'État et non aux partenaires sociaux. En outre, les employeurs comme les salariés n'ont pas forcément les connaissances nécessaires. Les pouvoirs publics ont donc un rôle essentiel à jouer, ce qui n'exclut pas que les partenaires sociaux jouent le leur dans la mise en œuvre des modalités concrètes des principes. M. le Rapporteur : Le caractère professionnel d'une maladie n'est pas toujours évident. Autant certaines sont très clairement et incontestablement dues à l'activité professionnelle, autant d'autres ont un statut ambigu. Par exemple, s'agissant de l'amiante, on peut attribuer à l'amiante un cancer du poumon et considérer qu'il s'agit d'une maladie professionnelle - ce que je ne critique pas - alors même que le tabac aura pu être le principal responsable de son déclenchement ou un facteur aggravant. Qu'en pensez-vous ? M. Michel LAROQUE : Certains pays, comme le Danemark, excluent, à partir d'un certain niveau de consommation de tabac, la reconnaissance de la maladie professionnelle. M. le Rapporteur : De la même façon, les troubles musculo-squelettiques peuvent être dus à la répétition de gestes professionnels - comme dans le cas que je connais bien du démantèlement de sites nucléaires où l'on manie le marteau-piqueur -, mais leur caractère professionnel n'est pas toujours absolument certain. L'origine professionnelle du stress n'est pas non plus évidente. Au bout du compte, ne risque-t-on pas d'assister à une extension indéfinie de la notion de maladie professionnelle ? M. Michel LAROQUE : C'est un vrai problème. S'agissant des maladies multifactorielles, je pense qu'il faut tenter de clarifier les choses et d'apprécier la part professionnelle et la part extérieure au travail. Si une maladie est inscrite dans les tableaux, on peut considérer que l'affection est professionnelle quand elle correspond aux caractéristiques du tableau. Si l'on est dans un autre cadre que celui des tableaux, il faudrait exiger que le caractère professionnel soit nettement prépondérant. En Suisse, il est exigé que la maladie soit d'origine professionnelle à au moins 75 %. Peut-être pourrait-on définir une catégorie intermédiaire si l'affection est inscrite dans un tableau mais que toutes les caractéristiques ne sont pas remplies. Tout cela est délicat à apprécier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il serait peut-être opportun de confier l'appréciation de l'invalidité à des équipes pluridisciplinaires, et non à un seul médecin-conseil, comme c'est le cas actuellement dans la branche AT-MP. M. le Président : Quoi qu'il en soit, le système doit évoluer, ce qui peut conduire à bousculer les partenaires sociaux. M. Michel LAROQUE : Les partenaires sociaux sont très mal à l'aise sur ces sujets. M. le Président : Monsieur l'inspecteur général, nous vous remercions de votre contribution aux travaux de notre mission. Audition conjointe de MM. Franck GAMBELLI, président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), Pascal JACQUETIN, directeur adjoint à la direction des risques professionnels, et Raphaël HAEFLINGER, responsable du département « assurance des risques professionnels » Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui M. Franck Gambelli, président de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, M. Pascal Jacquetin, directeur adjoint à la Direction des risques professionnels - que nous avons déjà reçu dans le cadre de nos travaux sur la prévention - et M. Raphaël Haeflinger, responsable du département « assurance des risques professionnels ». Nous avons souhaité vous rencontrer parce que l'une des interrogations de notre mission, à la lumière du drame de l'amiante, concerne l'avenir de la réparation des victimes de risques liés au travail. On sait que le dispositif d'indemnisation des victimes de l'amiante compromet l'équilibre de la branche « accidents du travail - maladies professionnelles » (AT-MP), ce qui est déjà un grave problème. Mais, plus fondamentalement, le drame de l'amiante semble avoir abouti à une remise en cause du compromis social de 1898. D'abord, par la création de fonds d'indemnisation spécifiques visant à sortir du principe de la réparation forfaitaire, ensuite par l'élargissement considérable du champ de la « faute inexcusable » de l'employeur depuis l'arrêt de la Cour de cassation de 2002. Désormais, l'indemnisation forfaitaire de la branche AT-MP paraît injuste par rapport au mode d'indemnisation de tous les autres dommages, d'où l'idée qu'il faudrait peut-être réviser le mode d'indemnisation des maladies professionnelles, mais avec le risque d'un accroissement considérable du coût de la réparation. La question qui se pose est donc de savoir comment va évoluer la branche AT-MP dans un contexte d'augmentation du nombre des maladies professionnelles et s'il faut revenir sur le compromis de 1898 ? M. Franck GAMBELLI : Je suis président de la branche AT-MP depuis un an. J'ai commencé à travailler en 1983 à la Fédération des industries mécaniques pour m'occuper de sécurité du travail et d'affaires juridiques. Je m'occupe également de sécurité du travail et d'environnement à l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM). Je souhaiterais préciser que ce que je vais vous dire n'engage que moi en tant que président de la branche. Des négociations sont en cours sur la pénibilité du travail et des consultations vont commencer sur la branche AT-MP, mais je n'engage évidemment pas les organisations professionnelles membres de la Commission des accidents du travail. Le constat d'une évolution du risque des accidents du travail vers les maladies professionnelles est incontestable. Cette évolution est liée, à mon sens, à la fois à la perception du risque et à des développements technologiques. Il me semble que dans l'après-guerre, nous avons continué à organiser la prévention du risque telle qu'elle ressortait de l'économie industrielle de la fin du XIXe siècle. Nous nous sommes polarisés sur le risque dur, qui était une réalité forte à l'époque et un énorme travail a été accompli sur ce plan. Mais le risque diffus passait au second plan ; le drame de l'amiante l'a mis au premier plan, et en a fait, aujourd'hui, une priorité de la branche AT-MP. D'autres réalités influent sur cette évolution, comme la socialisation croissante du risque, ainsi que l'a montré un récent rapport du Conseil d'État. Il s'agit d'une tendance lourde qui s'est manifestée dans le cadre de la prise en charge des maladies professionnelles avec le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA). La loi de 1898 peut-elle nous permettre de faire face à cette évolution ? Un compromis doit être trouvé entre les partenaires sociaux. Il m'est difficile de dire sur quoi porteront les concessions réciproques, mais il me semble certain que le régime d'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles nécessite une évolution et que cette question sera au centre des négociations. Les enjeux sont financiers, humains, et il faudra aussi réfléchir à un système incitatif pour la prévention. M. le Président : Nous allons maintenant essayer de balayer l'ensemble des questions qui vous ont été adressées, étant précisé que nous allons nous concentrer sur l'essentiel ; vos réponses écrites complèteront cette audition. M. Franck GAMBELLI : La première question que vous nous avez posée concerne la réparation. La branche AT-MP est un assureur particulier, qui n'a aucun pouvoir sur la dépense - celle-ci est fixée par le ministère des affaires sociales et le ministère du travail - et assez peu de pouvoir sur les recettes, puisqu'il n'émet qu'un avis sur les arrêtés de tarification de l'État. La branche a donc essentiellement une fonction de gestionnaire, en disposant d'assez peu de marges d'ajustement, moins que l'assurance maladie n'en a sur la gestion de son propre risque. Notre branche a trois grandes activités : la réparation, la prévention, et la gestion d'un système de préretraite. M. Raphaël HAEFLINGER : J'insiste sur le fait que la gestion dont la branche AT-MP est chargée est très encadrée. La nomenclature des maladies définit les critères d'entrée dans le dispositif. Les dépenses de soins sont faibles, puisqu'elles représentent moins de 10 % des dépenses et l'essentiel des dépenses est représenté par les indemnités journalières et les rentes en capital, calculées de manière très mécanique par rapport au salaire de référence. Les leviers de gestion du risque sont donc faibles. La branche ne peut pas jouer, par exemple, sur les offres de soins. Le risque est déterminé en amont et à partir du moment où on est dans ce risque, la réparation est automatique. Cela dit, le régime AT-MP a pour particularité de gérer à la fois une réparation forfaitaire, une réparation intégrale et une préretraite. M. Franck GAMBELLI : S'agissant du financement de la réparation des dommages subis par les victimes de l'amiante, il y a plusieurs pistes. La première est le resserrement du FCAATA. C'est l'objet du rapport de la Cour des comptes. À l'origine, ce fonds était lié à l'activité principale de l'entreprise et les producteurs d'amiante en étaient les principaux bénéficiaires. De fil en aiguille, la liste s'est élargie à des entreprises où l'amiante n'était pas le cœur du métier et le système a connu un certain nombre de dérives. Le resserrement proposé est destiné à faire en sorte que le fonds ne bénéficie qu'à ceux qui en ont vraiment besoin : les personnes qui ont été exposées à l'amiante, les malades, les personnes présentant des plaques pleurales. Il s'agit donc de le rendre plus équitable. En effet, le système, tel qu'il fonctionne actuellement couvre l'ensemble des établissements des entreprises inscrites sur la liste, que les personnes aient été exposées à l'amiante ou pas. Les pouvoirs publics, quand ils ont adapté le système à leurs propres établissements, l'ont resserré, par un décret du 21 décembre 2001 précisant, d'une part, que l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité serait versée aux seuls ouvriers et, d'autre part, que la mesure concernait des parties d'établissement. Je crois savoir que la SNCF et la RATP ont, elles aussi, prévu un système resserré. Un resserrement est donc nécessaire pour le FCAATA pour respecter l'objectif initial qui était de compenser le préjudice dû à la réduction de l'espérance de vie liée à l'exposition à l'amiante. La deuxième piste est l'augmentation de la participation de l'État, à laquelle nous sommes favorables. L'État employeur contribue, nous dit la Cour des comptes, à la hauteur de ses responsabilités d'employeur. En réalité, l'État est également responsable, du fait de son abstention, dans le retard pris par la réglementation, et il l'est en tant que prescripteur, puisqu'il a cautionné et validé, en 1959, l'utilisation de l'amiante dans les dispositifs de protection contre l'incendie. Le Sénat a proposé de doubler la participation de l'État. Il appartient à l'État de proposer un montant. C'est un acte politique. La troisième piste est l'augmentation des cotisations. Quoi qu'il en soit, pour répondre à l'une des questions que vous nous avez posées, je ne pense pas qu'il y ait de risque que les victimes de l'amiante ne soient plus indemnisées par la branche AT-MP. S'agissant de l'inégalité de traitement, il est certain que les victimes de l'amiante bénéficient d'un traitement privilégié par rapport au droit commun des accidents du travail. Quand on y réfléchit bien, c'est le cas pour toutes les victimes qui relèvent d'un fonds. L'existence même d'un fonds est en soi discriminatoire, puisque, ciblé sur un risque précis, il privilégie l'accès de certaines victimes à une réparation. Pour avoir une idée précise de l'inégalité de traitement, il faudrait pouvoir comparer le fonctionnement de la branche AT-MP et des fonds dédiés aux victimes de l'amiante par rapport au fonctionnement des autres fonds - et il y en a une dizaine. L'inégalité peut naître, par exemple, de différences dans le droit de la preuve et dans les quantum de l'indemnisation. Une comparaison européenne serait également opportune et une étude d'Eurogip a, d'ailleurs, récemment été menée sur ce sujet, que nous vous ferons parvenir. S'agissant de la prévention, vous estimez que certains employeurs ne semblent pas contribuer financièrement à la hauteur de leur implication réelle. Sur ce point, je laisse de côté la fraude, qui donne lieu à des sanctions assez lourdes : non seulement des sanctions pénales, mais aussi le double remboursement de l'accident du travail en cas de non-déclaration. M. Raphaël HAEFLINGER : Au demeurant, la fraude reste marginale en matière d'accidents du travail. Elle suppose une connivence entre un employeur et un salarié, qui est peu probable, étant donné leurs intérêts divergents. M. Franck GAMBELLI : Je pense que l'objet de votre question portait plus probablement sur la non-imputation des maladies au compte employeur du fait de vices de procédures et d'exceptions d'inopposabilité. La réponse tient à la discipline de traitement des dossiers des Caisses régionales d'assurance maladie (CRAM). Cette discipline fait partie des objectifs que nous leur avons fixés dans notre convention d'objectifs et de gestion qui arrive à échéance dans un an. Il importe de « blinder » et de sécuriser les procédures en matière de maladies professionnelles. Des instructions ont été données pour que les caisses ne soient plus prises en défaut sur ce point ; des formations sont dispensées dans ce but. Par ailleurs, la jurisprudence est très tatillonne sur le respect des procédures. M. Raphaël HAEFLINGER : Peut-être conviendrait-il de distinguer entre deux aspects. Parmi les dépenses imputées au compte spécial, c'est-à-dire celles qui, en terme d'assurance, sont entièrement mutualisées sur la collectivité des entreprises, il y a des dépenses de la branche AT-MP qui ne peuvent pas être individualisées par nature. Il s'agit, par exemple, des dépenses afférentes à des maladies professionnelles reconnues mais dont l'exposition au risque de cette maladie est antérieure à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, et à des maladies contractées dans une entreprise disparue, ou susceptible d'avoir été contractée dans plusieurs entreprises, sans qu'il puisse être déterminé dans laquelle. Autre chose est la question de la sécurisation juridique des décisions. La gestion d'un dossier AT-MP va de l'instruction jusqu'à la tarification des entreprises, laquelle est liée aux accidents et aux maladies qui y sont réellement intervenues. La jurisprudence nous impose un certain nombre d'obligations d'information au cours de l'instruction d'un dossier d'AT-MP, qui peuvent conduire, en cas d'omission d'une des nombreuses formalités d'information liées au principe du contradictoire, à des contestations ultérieures d'imputation des dépenses au moment de la tarification des entreprises. Dans ce dernier cas, comme pour le compte spécial, la victime reste indemnisée par la branche AT-MP, mais les dépenses qui pourraient être en tout ou partie imputées à l'entreprise au moment de sa tarification sont mutualisées sur la collectivité des entreprises. M. le Président : Vous parlez de l'incitation à mener une politique de prévention ? M. Raphaël HAEFLINGER : Je ne suis pas certain que la vocation première du système de tarification soit actuellement la prévention. Mais la question est, effectivement, de savoir quelles missions l'on assigne à une tarification. La prévention doit-elle être intégrée à la tarification ? Je ne me prononce pas sur cette question. Il reste que la tarification, pour les entreprises de plus de 200 salariés, est actuellement calculée en fonction de la valeur du risque, c'est-à-dire à partir des dépenses engagées par la branche AT-MP pour les salariés de ces entreprises. Pour les entreprises situées entre 10 et 199 salariés, la tarification est mixte. Il s'agit d'une tarification à la fois collective (taux de la branche) et individuelle, selon le risque propre de l'entreprise. La partie individuelle augmente selon l'effectif, pour aboutir à une tarification totalement individuelle à partir de 200 salariés. Pour les entreprises de moins de 10 salariés, l'individualisation de la tarification aurait de telles conséquences qu'on applique un taux collectif. M. le Président : Il est bien certain que le compromis social doit évoluer étant donné la complexité croissante des maladies professionnelles. Mais nous souhaiterions savoir comment il peut évoluer et quel rôle la puissance publique doit jouer. Comment jouer sur le financement, étant entendu que, comme vous l'avez dit, la création de tout fonds est, dans une certaine mesure, discriminatoire ? M. Franck GAMBELLI : Mon sentiment, en tant que président de la branche AT-MP, est que les débats qui vont avoir lieu sur l'avenir de la branche vont devoir inclure : le champ de la réparation ; la nature des risques ; la nature des préjudices ; la réparation intégrale ou forfaitaire ; le quantum de la réparation et le mode d'administration de la preuve. Sur ce dernier point, la question est de savoir si l'on en reste au compromis de 1898 ou si l'on retient le droit commun de la preuve, si tant est que l'on soit capable de le définir. Car qu'est-ce que le droit commun ? L'article 1382 du code civil ? L'article 1384 ? Les régimes spéciaux ? Les juristes seraient bien en mal de définir avec précision ce qu'est l'indemnisation du préjudice corporel en droit commun. Les partenaires sociaux auront cette discussion, mais il serait bon de la replacer dans le contexte plus général de l'évolution du droit de la réparation. D'une part, cela nous éviterait de refaire cet exercice dans quelques années. D'autre part, cela nous permettrait de mettre en perspective les avantages et les inconvénients des textes actuels. Car la loi de 1898 n'a peut-être pas que des inconvénients. La facilité d'accès à la réparation, l'absence de contentieux, l'automaticité, ce n'est tout de même pas rien. Je ne suis pas absolument certain que les autres régimes spéciaux de responsabilité offre des avantages comparables. M. le Président : L'évolution des maladies professionnelles fait que la nature du risque n'est pas toujours immédiatement perceptible. Dans les contacts que vous avez avec vos partenaires, percevez-vous une interrogation sur l'évolution du risque ? M. Franck GAMBELLI : Tout à fait. Elle est au centre de leurs préoccupations. La négociation autour de la branche AT-MP porte sur trois volets : la gouvernance, la réparation et la tarification. La réparation relève d'un compromis dont je souhaite qu'il soit en cohérence avec les autres évolutions du droit de la responsabilité civile et de l'indemnisation du préjudice corporel. En France, un accident n'est pas du tout réparé de la même manière selon qu'on est militaire, instituteur, travailleur du secteur privé, contractuel de l'État. Cette disparité est peut-être encore plus accusée pour les maladies professionnelles. Il faut la réduire au sein de la branche AT-MP, mais encore faudrait-il que l'évolution soit en cohérence avec les autres régimes indemnitaires. S'agissant de la tarification - et, en particulier, de son caractère incitatif -, on pourrait presque dire qu'elle relève moins de la négociation que de calculs informatiques. Certains préconisent le bonus/malus, en citant en exemple le système américain, qui serait très performant en matière de prévention des risques professionnels. Je rappelle qu'il existe actuellement un système de bonus/malus au sein de la branche AT-MP qui semble totalement méconnu. Et, au passage, je rappelle qu'il existait autrefois un système de ristourne sur cotisation accidents du travail, qui a totalement disparu. Enfin, il existe un régime de cotisations supplémentaires, qui, lui, fonctionne encore mais, à mon avis, il ne change rien. La pénalisation financière de l'entreprise n'incite pas réellement à faire des efforts en matière de prévention. Au final, je ne suis pas sûr que l'instauration d'un système généralisé de bonus/malus soit vraiment un levier efficace. La cotisation AT-MP est, en effet, perçue, dans les entreprises, comme une cotisation sociale et, la plupart du temps, elle est traitée par les services comptables. L'autre système de bonus/malus utilisé est celui de la tarification qui s'applique aux entreprises de plus de 200 salariés et qui est calculée selon le taux réel de risque. Dans ce cas, l'effet dynamisant de la tarification peut jouer. Mais, entre 10 et 199 salariés, l'effet incitatif est inversement proportionnel au nombre de salariés et il disparaît totalement pour les entreprises de moins de dix salariés. Enfin, il existe un système de bonus pour les accidents du trajet, mais il concerne principalement les grands groupes. Mon sentiment est qu'une incitation ou une pénalisation financière ne peut être performante que si elle est portée par la branche, par un acte précis de la CRAM en direction de l'entreprise, par exemple un acte répressif. Mais un système automatique de type assuranciel ne me semble pas de nature à être incitatif. Il est plus souhaitable de multiplier les contacts positifs entre la CRAM et les entreprises, quitte à les accompagner d'un système d'incitation ou de répression, que de miser sur un système de tarification automatique dont il est vain d'espérer qu'il influe significativement sur les efforts de prévention des entreprises. Reste qu'un certain nombre d'études sont actuellement conduites sur ce point par l'IGAS et la branche AT-MP. M. le Rapporteur : Le Président a souligné à juste titre que la prévention doit maintenant porter sur un risque beaucoup plus diffus qu'auparavant. J'ajouterai que ce risque est aussi plus incertain car le caractère professionnel d'une maladie n'est pas toujours évident. Autant certaines maladies sont incontestablement dues à l'activité professionnelle, autant d'autres ont une origine ambiguë. On peut penser au cancer du poumon dû à l'amiante, qui a été considéré comme une maladie professionnelle - ce que je ne critique pas - alors même que le tabac a pu être le principal responsable de son déclenchement. De même, les troubles musculo-squelettiques (TMS) peuvent être dus à la répétition de gestes professionnels, mais leur caractère professionnel n'est pas toujours certain. L'origine professionnelle du stress, enfin, n'est pas évidente. D'où le risque d'une extension indéfinie de la notion de maladie professionnelle ? Quel est votre sentiment sur ce point ? M. Franck GAMBELLI : Il est clair que l'explosion des tableaux va conduire à une évolution telle que la branche AT-MP ne pourra rester ce qu'elle est aujourd'hui. Actuellement, la branche finance à 100 % la prise en charge des maladies multifactorielles. Demain, ce ne sera plus possible. L'évolution des tableaux dépend de tant de variables - politiques, médiatiques, scientifiques - que nous n'avons aucune visibilité à moyen terme. Quelle est la solution ? Socialiser encore plus le risque ? Découpler les accidents du travail des maladies professionnelles, comme l'a fait la Belgique ? Si l'on mutualise plus, comment va-t-on pouvoir inciter les entreprises à la prévention des maladies professionnelles ? M. le Président : À quel rythme les tableaux évolueront-ils ? M. Franck GAMBELLI : Les partenaires sociaux n'ont pas la maîtrise des tableaux de maladies professionnelles. La branche AT-MP n'a pas son mot à dire. C'est à la commission des maladies professionnelles du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnelles qu'il appartient de se prononcer. Le Conseil supérieur vient, d'ailleurs, de confier à l'Institut de veille sanitaire (IVS) la conception des tableaux. L'expertise sera scientifique et la décision d'opportunité sera politique. On peut dire que c'était déjà le cas auparavant, mais les choses sont maintenant plus claires. Les partenaires sociaux n'auront plus leur mot à dire sur les tableaux des maladies professionnelles. M. Raphaël HAEFLINGER : Il y a 98 tableaux de maladies professionnelles et je précise que les évolutions successives du tableau 57 portant sur la prise en charge des TMS sont à l'origine de 50 % de l'évolution récente de nos reconnaissances en matière de maladies professionnelles. M. le Président : On voit donc bien qu'on ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion approfondie sur l'évolution de la branche AT-MP. J'ai bien compris que la tarification, même si elle peut avoir des effets positifs, ne suffira pas à répondre à la complexité du système. Faut-il, alors, découpler accidents du travail et maladies professionnelles ? M. Franck GAMBELLI : Si c'était le cas, il faudrait avoir une forte action en matière de prévention. Certains États ont opéré un découplage, mais j'ignore comment ils gèrent la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Quant aux Américains, ils ont tout privatisé et certains estiment que ce modèle est très performant. Je pense qu'il serait intéressant de pouvoir disposer d'études portant sur la sous-déclaration des maladies professionnelles aux États-Unis. M. Pascal JACQUETIN : S'il y avait découplage, il ne faudrait pas perdre le lien entre la prévention et l'entreprise car la prévention correspond dans chaque entreprise à une démarche spécifique, mais globale, qui inclut, et doit inclure, les deux natures de risque (AT et MP). Quant au mode d'accès à la réparation et à l'indemnisation des préjudices, il faut qu'il soit organisé de manière plus cohérente. Je n'imagine pas qu'on laisse durablement s'installer un système à trois ou quatre vitesses. M. le Président : En amont se pose donc le problème de la responsabilité de l'État en matière de prévention, ainsi que celui de l'indépendance de l'analyse. Que pensez-vous des nanotechnologies ? M. Franck GAMBELLI : Il est clair que les nanomatériaux, qui sont une chance extraordinaire pour notre industrie, posent un problème majeur. Par ailleurs, les décisions d'interdiction des substances, notamment les Composés organiques volatiles (COV), ont conduit certaines entreprises recourir à des procédés de substitution dangereux. J'attire votre attention sur le fait que cette politique de prohibition environnementale ne mesure pas nécessairement le transfert de risque qu'elle engendre. Par exemple, on se dirige vers l'interdiction du chrome hexavalent, un produit très toxique. Mais faut-il le remplacer par un procédé de traitement aux nanomatériaux ? Pour la branche AT-MP, c'est une préoccupation réelle que de voir se développer la réflexion sur l'impact environnemental des produits qu'on souhaite interdire, sans que se développe une réflexion parallèle sur les produits de substitution. M. le Président : Messieurs, je vous remercie de votre contribution aux travaux de notre mission. Table ronde sur le thème : « Après l'amiante, quel avenir pour la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ? » · M. Pierre SARGOS, président de la Chambre sociale de la Cour de cassation · M. François DESRIAUX, président de l'ANDEVA · M. Michel PARIGOT, vice-président de l'ANDEVA, président du Comité anti-amiante Jussieu · M. Marcel ROYEZ, secrétaire général de la FNATH · M. Franck GAMBELLI, président de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) · M. André HOGUET, vice-président de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) · M. Gilles ÉVRARD, directeur des risques professionnels à la branche AT-MP · Mme Pascale ROMENTEAU, sous-directrice de l'accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail à la Direction de la sécurité sociale · M. Michel LAROQUE, inspecteur de l'IGAS, auteur du rapport intitulé « La rénovation de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles (2004) · Maître Jean-Paul TEISSONIÈRE, avocat spécialisé dans la défense des victimes de l'amiante. Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : La table ronde qui nous réunit aujourd'hui intervient à l'issue d'une série d'auditions consacrées à la prise en charge des victimes de l'amiante et, plus largement, au dispositif de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Comme l'indique le courrier qui a été adressé à nos invités, l'objectif de cette table ronde est d'apprécier les conséquences du système légal et jurisprudentiel de traitement des victimes de l'amiante - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA), faute inexcusable de l'employeur - sur l'avenir de la branche accidents du travail - maladies professionnelles (AT-MP) et sur l'évolution du compromis social de 1898. Je vous remercie tous de vous être rendus disponibles pour cette table ronde. L'affaire de l'amiante a remis en cause le compromis social de 1898 sur lequel repose le dispositif de réparation des dommages liés au travail. D'abord par la création de fonds d'indemnisation spécifiques visant à sortir du principe de la réparation forfaitaire et à améliorer la prise en charge des victimes d'un drame considéré comme national. Ensuite par la remise en cause du principe de l'immunité civile des employeurs, du fait de l'élargissement considérable du champ de la « faute inexcusable » de l'employeur qui résulte de l'arrêt de la Cour de cassation de 2002. Désormais, l'indemnisation forfaitaire de la branche AT-MP se révèle beaucoup moins intéressante que les indemnisations susceptibles d'être obtenues par la voie judiciaire. Elle peut paraître également injuste par rapport au mode d'indemnisation de tous les autres dommages. D'où le risque d'une multiplication des recours judiciaires et l'idée qu'il faudrait peut-être réviser le mode d'indemnisation des maladies professionnelles. En même temps, une généralisation de la réparation intégrale des risques professionnels dans un cadre mutualisé aurait un coût considérable et pourrait déresponsabiliser à outrance les employeurs. Il faut aussi tenir compte du contexte qui est marqué par le développement des maladies professionnelles : il existe 30 000 produits dangereux, et de nouveaux produits apparaissent tous les jours... La double question qui se pose est donc de savoir, d'une part, comment va évoluer la branche AT-MP, et d'autre part, quel doit être le régime de responsabilité des employeurs. C'est autour des ces deux questions que je vous propose d'articuler notre table ronde. Il est vrai qu'elles se recoupent mais disons que la première a une coloration plus économique et que la seconde a un caractère plus juridique. Cette deuxième partie sera d'ailleurs introduite, et je l'en remercie, par M. Pierre Sargos qui, en sa qualité de président de la Chambre sociale de la Cour de cassation nous commentera les arrêts du 28 février 2002. Mais auparavant, je souhaiterais que nous entamions ce débat par un tour de table, afin que chacun de vous se prononce sur le dispositif d'indemnisation spécifique mis en place pour l'amiante. Peut-on dire que les outils d'indemnisation des victimes de l'amiante sont des dispositifs dérogatoires et exceptionnels qui soulèvent des inégalités de traitement avec les victimes des autres maladies professionnelles ? La question est simple et directe mais je sais que la réponse est complexe ! M. Michel PARIGOT : Le dispositif d'indemnisation des victimes de l'amiante est un système dérogatoire par rapport au système d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Certains, effectivement, le décrivent parfois comme créant une injustice. Je pense que c'est exactement le contraire. L'injustice réside dans le fait que les accidents du travail et les maladies professionnelles sont indemnisés dans le cadre d'un régime dérogatoire, dont l'effet est l'absence de réparation intégrale. La création du FIVA a permis de corriger cette injustice fondamentale, mais pour les seules victimes de l'amiante. Il s'agit donc maintenant d'étendre la correction de cette injustice à l'ensemble des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La réparation intégrale est un droit, qui ne devrait pas souffrir d'exception, et qui est d'ailleurs mentionné dans la résolution 75-7 du 14 mars 1975 du Conseil de l'Europe. Je suis frappé par le fait que l'on chipote sur la réparation du dommage corporel, alors qu'on ne chipote pas sur la réparation du dommage matériel. Dans le cas des accidents de la route, les dommages matériels sont pourtant cinq fois supérieurs aux dommages corporels. Nous souhaitons donc que la branche AT-MP ne soit plus une exception et indemnise sur le mode de la réparation intégrale, comme pour les autres dommages corporels. Cette réparation intégrale implique, bien sûr, le contrôle des tribunaux civils. M. Franck GAMBELLI : Je pense, moi aussi, que l'indemnisation des victimes de l'amiante obéit à un régime dérogatoire par rapport au fonctionnement ordinaire de la branche AT-MP. Elle l'est beaucoup moins par rapport au droit commun, tel qu'il a évolué depuis vingt ou trente ans. Le FIVA s'inscrit donc dans la tendance lourde de l'évolution de la réparation du dommage corporel. M. Pierre SARGOS : Le problème de l'égalité de traitement se pose à situation égale. Or, le drame de l'amiante, que j'ai qualifié de « crime sociétal », introduit dans le système de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles un effet de masse extraordinaire, sur le plan quantitatif comme sur le plan qualitatif. Le système issu de la loi de 1898, de la création de la sécurité sociale et des réformes successives de celle-ci ne permettait guère de gérer les conséquences de ce drame. Un mécanisme particulier s'imposait donc, et il me paraît corriger une inégalité. Dénoncer une injustice en mettant en avant le fait que les victimes de l'amiante bénéficient d'une indemnisation dont ne bénéficient pas les victimes d'autres maladies professionnelles me paraît relever d'une approche quelque peu simpliste. Le système d'indemnisation des victimes de l'amiante est dérogatoire, mais cette dérogation était nécessaire. M. Marcel ROYEZ : Le système d'indemnisation des victimes de l'amiante est dérogatoire et il est inégalitaire. La FNATH n'a pas attendu le drame de l'amiante pour considérer que le principe de réparation forfaitaire pour les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles était dépassé et que la réparation intégrale devait être le principe de base pour l'ensemble des victimes. Lorsque la question de l'indemnisation des victimes de l'amiante s'est posée, nous avons évidemment défendu ce principe. Nous avons compris que, pour des raisons circonstancielles, politiques et économiques, le Gouvernement veuille répondre vite aux attentes des victimes. Ce que nous ne comprendrions pas, c'est qu'on en reste là, et que ce principe de réparation intégrale, qui vaut pour les victimes de l'amiante, ne vaille pas pour les autres victimes. Dans un pays qui porte haut les valeurs d'égalité et de fraternité, on ne voit pas comment il serait possible de justifier que la veuve et les orphelins d'un travailleur décédé d'un cancer dû à l'inhalation de poussières de bois, par exemple, soient moins bien indemnisés que la veuve et les orphelins d'un travailleur décédé d'un cancer dû à l'exposition à l'amiante. L'inégalité ne réside donc pas dans le fait que l'on indemnise les seules victimes de l'amiante selon le principe de la réparation intégrale. Elle réside dans le fait que l'on n'indemnise pas les autres victimes sur la base de ce principe. M. Jean-Paul TEISSONIÈRE : Je suis d'accord avec ce qui a été dit. J'aurais tendance, comme Michel Parigot, à renverser la question et à considérer que les victimes de l'amiante sont traitées à égalité avec les autres victimes de dommages corporels, à l'exception des accidents du travail et des maladies professionnelles. C'est en ce sens que l'inégalité de traitement est choquante. Mais, dans ce domaine, nous sommes dans un océan d'inégalité. Songeons à la catastrophe d'AZF, dont les victimes salariées ont été indemnisées au quart de ce que percevaient les riverains. Il a fallu recourir à une sorte d'astuce, avec l'aval de la caisse primaire d'assurance maladie, pour parvenir à indemniser les victimes de l'accident du travail à égalité avec les autres victimes. L'inégalité dans la réparation est due fondamentalement à une incohérence d'ensemble, qu'il me semble important de dépasser. M. Michel LAROQUE : Oui, le système d'indemnisation des victimes de l'amiante est dérogatoire ; oui, il est inégalitaire. Mais peut-être ce dernier terme mérite-t-il plus de réflexion et de prudence. Tout est infiniment inégalitaire, mais dans quel sens ? Il est certain qu'il existe des différences de traitement très importantes, mais elles ne touchent pas seulement les catégories que nous avons évoquées. Des personnes malades ou invalides de droit commun qui ne peuvent faire jouer aucune assurance ont un niveau de réparation bien inférieur à ce dont bénéficient les victimes dont nous parlons ici. Nous avons affaire à une gradation entre modes de traitement. Faut-il uniformiser ces modes de traitement, ou faut-il au contraire maintenir des différences qui correspondent à des situations différentes ? Les choses ne sont pas si simples. Mme Pascale ROMENTEAU : On ne peut nier le caractère dérogatoire du dispositif d'indemnisation des victimes de l'amiante, qui a été conçu en attendant que l'on puisse faire mieux pour les victimes d'autres maladies professionnelles. Cela étant, si ce dispositif était exceptionnel à l'époque de sa création, il n'avait pas vocation à le rester durablement. Je ne souhaite et ne pense pas qu'il soit créateur d'une rupture d'égalité et, sur ce point, je préfère m'en remettre aux juges. M. André HOGUET : Lorsque la loi créant le FIVA a été discutée, le sentiment général était que cette loi était et devait être dérogatoire. Il fallait répondre à l'exigence de convergence avec la directive européenne. Par ailleurs, il fallait permettre une réparation beaucoup plus large que celle que permettait le système existant. En application de l'article 54 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, les partenaires sociaux vont être amenés, dans les jours à venir, à réfléchir ensemble sur la gouvernance de la branche AT-MP, ainsi que sur l'évolution de la réparation et de la tarification. S'agissant de la réparation, le rapport de M. Laroque nous a éclairés sur un ensemble de choix possibles. Le sens de notre démarche est bien de viser à une protection intégrale de l'homme au travail. M. Gilles ÉVRARD : Le dispositif d'indemnisation des victimes de l'amiante est dérogatoire, c'est vrai. Mais est-il inégalitaire ? Est-il inéquitable ? Est-il injuste ? Ce sont là trois questions différentes. Pour m'en tenir à la question que vous avez posée, monsieur le président, je dirai que ce dispositif est inégalitaire, si l'on considère que l'inégalité renvoie à la mesure, et que les victimes de maladies médicalement aussi graves ne peuvent pas prétendre aux mêmes indemnisations que les autres. On est donc dans une situation spécifique. M. le Président : Le drame de l'amiante a donc été, pour reprendre l'expression du président Sargos, un « crime sociétal » justifiant la mise en place d'un système dérogatoire. Or, celle-ci a des conséquences évidentes sur l'évolution de la branche AT-MP. C'est de ce sujet que je vous invite maintenant à débattre. Le système peut-il être maintenu en l'état en étant amélioré ? La réparation peut-elle être intégrale et individualisée ? Comment évaluer le coût de cette nouvelle réparation ? J'ajoute que ces questions doivent être envisagées dans un contexte marqué par la grande vitesse des évolutions qui touchent le contenu du travail, les cycles technologiques, et bien sûr les maladies professionnelles elles-mêmes. M. André HOGUET : Nous avons un devoir envers les personnes qui ont manipulé de l'amiante, qu'elles soient encore en activité ou non. Le premier devoir de la nation est de protéger la personne au travail et de prévenir les risques. Nous sommes donc très attachés à ce que l'on appelle le « suivi professionnel ». La question du financement, si elle doit être posée, ne doit l'être qu'en second lieu. Par ailleurs, l'amélioration du suivi professionnel et post-professionnel de santé sont essentiels dans la vie du travailleur. Troisièmement, nous souhaitons vivement un renforcement de la recherche sur les maladies professionnelles. Nous ne serions pas opposés à ce que des études soient menées, afin de mesurer l'état de santé des personnes qui, arrivées à un certain âge, auront côtoyé un certain nombre de produits dangereux. L'établissement d'un bilan est important. Cela aurait, certes, un coût important, mais la nation a un devoir envers tous ceux qui ont été touchés. M. Marcel ROYEZ : À ce stade de la discussion, je me contenterai d'exposer les principes sur lesquels nous pensons qu'il est possible d'asseoir une évolution du système de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Nous estimons d'abord que la réparation doit demeurer fondée sur la responsabilité sans faute de l'entreprise. Deuxièmement, le système doit rester intégré à la sécurité sociale. On n'imagine pas qu'il soit complètement transféré au droit commun, ou au champ de l'assurance privée. Cela nous ramènerait à la situation d'avant 1947, ce qu'il convient d'éviter, ne serait-ce que parce que l'un des avantages essentiels d'une gestion intégrée à la sécurité sociale est d'articuler prévention et réparation. Des progrès peuvent, d'ailleurs, être faits en la matière, notamment en ce qui concerne la tarification. Celle-ci doit reconnaître beaucoup plus qu'elle ne le fait actuellement les efforts réalisés par certaines entreprises, et pénaliser celles qui ne prennent pas les précautions nécessaires. Notre attachement à ce que le système de réparation demeure au sein de la sécurité sociale est l'une des raisons pour lesquelles nous avions porté un jugement critique sur la création du FIVA. Le troisième principe auquel nous sommes attachés est l'articulation dont je parlais entre prévention et réparation, au moyen d'une tarification réformée. M. le Président : La tarification réformée, est-ce un système de bonus et malus ? M. Marcel ROYEZ : On peut présenter les choses ainsi pour faire court. L'essentiel est que des outils modernisés permettent d'appréhender la réalité des coûts. On sait bien, par exemple, ce qu'il faut penser du prélèvement annuel de la branche maladie sur la branche AT-MP, en vue de compenser une partie des coûts supportés par la première au titre de ce qui devrait normalement être pris en charge par la seconde48. Tous les rapporteurs ont souligné qu'il était insuffisant, faute d'un instrument de mesure suffisamment précis. De même, on est dans l'ordre de l'approximation en ce qui concerne la tarification des entreprises. Le système est trop mutualisé. Il faut s'orienter vers une tarification beaucoup plus précise et beaucoup plus individualisée, qui constitue un véritable levier au service de la prévention. Le quatrième principe est celui de la réparation intégrale de tous les préjudices subis par les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Cette réparation intégrale est tout à fait compatible avec la présomption d'imputabilité. Prétendre le contraire est une ineptie et une contrevérité. Beaucoup de systèmes de réparation sans faute associent à la réparation intégrale une responsabilité sans recherche de faute. Je rappelle, au demeurant, que la présomption d'imputabilité n'est pas irréfragable, puisque l'employeur a toujours la possibilité de démontrer que la cause de l'accident ou de la maladie est étrangère au travail. M. Michel PARIGOT : Il me semble que la réflexion doit faire la distinction entre différents niveaux. Il y a un premier niveau qui est celui de l'indemnisation. Le second est celui de la charge de l'indemnisation. Le troisième est celui de la gestion du système. Dès que l'on confond ces trois niveaux, on n'arrive pas à poser les vrais problèmes. S'agissant du premier niveau, il me semble que l'indemnisation ne doit dépendre que de l'existence d'un préjudice, et non de la situation juridique du responsable, ou supposé responsable. La responsabilité peut être contractuelle, avec faute ou sans faute. Cela ne doit pas impliquer que l'on indemnise certains préjudices et pas d'autres. Tous doivent être indemnisés selon un même principe, celui de la réparation intégrale. En outre, la réparation intégrale doit être sous le contrôle des tribunaux. Cela n'est pas incompatible avec la présomption d'imputabilité. Cela n'a pas non plus de rapport avec la question de la mutualisation, plus ou moins grande, de la charge de l'indemnisation. La gestion du système est une question entièrement distincte. La réparation intégrale est compatible avec de nombreux modes de gestion. Le système peut être géré par la sécurité sociale. Il peut l'être par d'autres fonds. Les assureurs peuvent aussi intervenir mais seulement en deuxième ligne : l'employeur aurait la charge de l'indemnisation mais pourrait prévoir, dans certaines circonstances, un système d'assurance. Quel que soit le type de gestion, le grand principe est celui de la réparation intégrale. M. le Président : Qu'entendez-vous par « contrôle des tribunaux » ? M. Michel PARIGOT : Il doit y avoir un contrôle des tribunaux sur le point de savoir quels sont les préjudices de l'individu et à quelle hauteur ils doivent être indemnisés. Ce système s'oppose à un système de nature réglementaire, où l'on aurait fixé à l'avance les préjudices indemnisés et le montant des indemnisations. M. le Président : Cela s'oppose donc à l'idée d'un barème ? M. Michel PARIGOT : Non. Il peut y avoir des barèmes indicatifs, sous le contrôle des tribunaux. M. le Président : L'indemnisation serait donc individualisée ? M. Michel PARIGOT : Oui, la réparation intégrale est nécessairement individualisée. Les préjudices des uns ne sont pas les préjudices des autres. Une réflexion est en cours, qui viserait à une uniformisation : les décisions de justice seraient publiques, on pourrait prendre connaissance des indemnisations moyennes accordées par les tribunaux, les préjudices feraient l'objet d'une nomenclature. Toutes ces idées permettraient d'aboutir à un système qui fonctionne. Car je ne pense pas que l'indemnisation actuelle par la voie judiciaire soit parfaite. M. Jean-Paul TEISSONIÈRE : Je suis moi aussi attaché à la question des principes, qui a été évoquée à plusieurs reprises. Si nous raisonnons dans le cadre de la sécurité sociale, ce serait l'occasion de revenir aux principes qui ont présidé à sa mise en place en 1945 et je n'inclus pas dans ces principes le compromis de 1898. Celui-ci a été importé dans le système de sécurité sociale de 1945, mais il obéissait à d'autres contraintes et répondait à d'autres questions. Quel était, finalement, l'intérêt de ce compromis en 1898 ? Les arrêts des cours d'appel donnaient déjà régulièrement satisfaction aux victimes d'accidents du travail en instaurant une sorte de présomption de responsabilité de l'employeur - les théories de responsabilité objective commençaient à être prises en compte. Dans une certaine mesure, le compromis de 1898 a, d'ailleurs, constitué une régression par rapport à la jurisprudence. Cela étant, il a sans doute été une étape nécessaire et a constitué un progrès général dans les mécanismes de réparation des victimes, même si ce progrès doit être relativisé et paraît aujourd'hui dépassé. Car enfin, qu'a-t-on en contrepartie de la réparation incomplète des accidents du travail et des maladies professionnelles ? Une présomption de responsabilité qui serait de toute façon obtenue dans le cadre du droit commun. L'intérêt de ce compromis a disparu pour les victimes, et il faut situer ailleurs un autre compromis, qui permette aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles d'être indemnisés à la même hauteur que les autres. Dans son rapport, M. Masse interprétait la décision du Conseil constitutionnel validant la loi portant création du FIVA de la manière suivante. Le Conseil, selon lui, a validé cette loi, parce que celle-ci répondait à deux conditions : le respect de la réparation intégrale, sans laquelle la loi n'aurait pas été constitutionnelle ; un recours effectif devant les tribunaux en cas de non prise en compte des paramètres particuliers de la victime. À vrai dire, je ne suis pas sûr que la décision du Conseil constitutionnel puisse être interprétée ainsi, mais ces deux conditions me conviennent. En d'autres termes, je vois mal comment on pourrait éviter, en cas de réforme du système, le passage à un système de réparation intégrale. Le fonctionnement du FIVA est un exemple qui montre qu'en nous orientant dans cette voie, nous ne nous avancerions pas sur un terrain complètement inconnu. M. Franck GAMBELLI : Je veux souligner que le compromis de 1898 a tout de même le mérite, entre autres, d'introduire l'automaticité de la réparation, l'absence de contentieux, et l'absence de prise en compte de la pluralité des causes, ce qui n'est pas négligeable. Il serait également utile de se poser la question de savoir ce qu'est le droit commun. Est-ce le droit commun pratiqué par les différents fonds ? Est-ce le droit commun des régimes spéciaux ? Y a-t-il une et une seule définition de la réparation intégrale ? De fait, il n'est aucunement nécessaire de sortir de la sécurité sociale. Néanmoins, il y a une économie de la réparation intégrale qui, en renvoyant au droit commun, tend à faire sortir la branche de la sécurité sociale. Je n'y suis guère favorable. On nous a opposé à maintes reprises le caractère extraordinaire de la réparation américaine, ainsi que la performance des assureurs privés américains, en confondant allègrement tarification et réparation. La réparation intégrale ne rend pas nécessaire la sortie du système de la sécurité sociale, mais qu'est-elle au juste ? N'a-t-elle pas un impact sur le régime de la preuve ? Ne soulève-t-elle pas la question de la multifactorialité, avec toutes les atténuations que pourrait présenter l'employeur à sa décharge ? Ou bien doit-on concevoir un régime de réparation intégrale ne prenant pas en compte la multifactorialité ? Bref, il est nécessaire de préciser cette notion de « réparation intégrale ». Je doute même qu'en droit commun, le contenu des chefs de préjudice soit défini avec une très grande clarté dans la jurisprudence. L'idée d'un barème évoquée par M. Parigot est un peu antinomique avec le concept de réparation intégrale. Quant à la tarification, je voudrais exprimer ici un avis qui est purement personnel et qui n'engage que moi. En premier lieu, il faut bien distinguer le problème de la tarification de celui de la mutualisation. La mutualisation est absolument indispensable : parce que des entreprises ont disparu ; parce qu'il faut organiser la solidarité avec les anciens régimes déficitaires. Aujourd'hui, les accidents du trajet sont totalement mutualisés, de même que les charges générales de la sécurité sociale et les frais de réadaptation professionnelle. Tout cela ne peut pas être démutualisé. En outre, il ne me paraît pas acceptable de faire peser sur les seules branches qui travaillent la matière l'ensemble du risque économique généré par le cycle de production des biens et services. Pour ma part, il n'en est pas question. La métallurgie, le bâtiment, la production de la matière sont des activités beaucoup plus risquées que l'assurance ou la promotion immobilière. Et pourtant, tout le monde habite dans des immeubles, tout le monde utilise des véhicules. Je plaide donc pour une solidarité interprofessionnelle, car d'une certaine façon, tout le monde bénéficie de la sinistralité des secteurs à risques. Il faut absolument conserver la mutualisation. C'est une question de solidarité nationale et de solidarité économique. En deuxième lieu, il ne faut pas se faire trop d'illusions sur ce que peut apporter la tarification. C'est une question technique, sur laquelle on peut faire des progrès et plusieurs pistes peuvent être explorées. L'IGAS travaille en ce moment sur la définition d'un coefficient de sinistralité. On peut simplifier la tarification en utilisant les coûts moyens comme on faisait autrefois, et comme on le fait toujours dans le bâtiment. On peut réactiver le système de ristournes qui a totalement disparu depuis vingt ans sauf pour les chantiers de bâtiments. Le système de cotisations supplémentaires est peu appliqué. On peut également multiplier les actes positifs, incitatifs. Cela dit, il est illusoire de faire reposer une politique de prévention exclusivement sur un signal prix. La tarification n'est pas l'essentiel. Il nous faut, en fait, revaloriser nos travaux techniques. Dans les communautés de travail que constituent les branches, il nous faut tenter de recréer des politiques d'incitation à la prévention. Le mot de « recommandation » n'est plus prononcé. C'est à croire qu'il n'intéresse pas les théoriciens de la prévention. Il serait souhaitable de mener à bien une redynamisation des instances techniques de la sécurité sociale (CTN, CTR) en vue de transférer, dans les règles de l'art des communautés de métiers, les recommandations de prévention élaborées paritairement. Ce travail est long, mais peut être décisif. Les succès existent, même si je reconnais qu'ils concernent plutôt les accidents du travail, c'est-à-dire le risque dur. Mais sur le risque chimique, ce travail peut être effectué. De plus, il nous faut définir un rôle nouveau pour la médecine du travail. Le médecin est indispensable pour évaluer l'impact sur la santé des produits chimiques, et surtout pour aider à mettre en place une gestion de la production des produits dans l'entreprise. Il est également très important de ne pas laisser s'introduire dans les entreprises des produits de substitution qui peuvent paraître anodins mais qui peuvent être dangereux. À cet égard, le programme REACH49 peut nous aider à mener cette politique, en combinant les autorisations de mise sur le marché aux pratiques d'usage contrôlé. M. le Président : Je partage largement les remarques faites par M. Gambelli sur la mutualisation, d'autant que le rôle des petites entreprises est de plus en plus important. En outre, le problème de la latence ne doit pas être perdu de vue : les effets des produits chimiques ne sont pas mesurables immédiatement. Enfin, devant l'ampleur des problèmes, un partage des compétences entre les États européens sera probablement indispensable. M. André HOGUET : Si, demain, l'approche de la réforme de la branche AT-MP se plaçait sous le signe d'une sortie de cette branche de la sécurité sociale, il n'y aurait aucune organisation syndicale autour de la table ! S'agissant de la tarification et de la prévention, je rejoins les propos de M. Royez. La mutualisation est nécessaire, ne serait-ce que pour organiser la continuité du fonctionnement de la branche. Nous sommes donc attachés au barème. Par contre, il nous semble bon que les tribunaux interviennent dans la mesure où le travailleur considère que les barèmes n'apportent pas la réparation attendue. Les réponses des tribunaux peuvent aussi être une référence pour améliorer les barèmes, comme nous souhaiterions que les barèmes du FIVA soient révisés à la lumière des décisions de justice. Cela dit, la prévention ne peut être entièrement liée à la tarification. Car le risque serait que les entreprises qui ont une forte croissance de production avec peu de salariés préféreraient payer plutôt que d'engager une politique de prévention. Il faudra aller plus loin dans l'implication de tous les acteurs, non seulement les médecins du travail, mais aussi les Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), et tous ceux dont la loi ou la réglementation prévoit qu'ils ont un rôle à jouer en matière de prévention. M. Pierre SARGOS : Les travaux préparatoires de la loi du 9 avril 1898 sont particulièrement intéressants. Ils dégagent trois grands principes, dont le premier est l'institution du risque professionnel : la responsabilité du chef d'industrie est engagée de plein droit, dès qu'un accident quelconque se produit. Il s'agit là d'une innovation dont il faut souligner le caractère extraordinaire. Le deuxième grand principe était la fixation d'une indemnité forfaitaire englobant tous les accidents. Le troisième grand principe était la certitude donnée à l'ouvrier qu'il obtiendrait le paiement de son indemnité. Ce principe de certitude a trouvé son achèvement avec l'intervention de la sécurité sociale, qui est également compétente, et c'est fort heureux, pour le paiement des chefs de réparation, lorsqu'il y a faute inexcusable. Le problème de cette législation est que l'indemnité forfaitaire est beaucoup trop faible. La réparation de plein droit est satisfaisante pour les frais médicaux ou les frais de réadaptation. Mais elle est manifestement insuffisante au regard de tous les autres préjudices que peut causer un accident du travail ou une maladie professionnelle. Il est notamment regrettable qu'il faille passer par le système particulier de la faute inexcusable pour obtenir les réparations de préjudices liés à cette faute. Cela étant, faut-il poser en axiome absolu que toute réforme doit passer par la réparation intégrale ? Certes, il n'y a pas d'antinomie entre une responsabilité de plein droit et la réparation intégrale. Mais la notion de mutualisation est très importante. La loi Badinter peut être efficace, parce que le système repose sur une trentaine de millions de contrats d'assurance, qui permettent une collecte de fonds nécessaires pour assurer la réparation. En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la situation n'est malheureusement pas tout à fait semblable. De plus, il est délicat d'exiger la réparation intégrale en évoquant le recours aux tribunaux. Ceux-ci sont déjà victimes de l'effet de masse. Pour répondre à des situations qui aboutissent à des dizaines ou des centaines de milliers de sinistres chaque année, il faut nécessairement un système très simple, qui repose sur la responsabilité de plein droit, sur des barèmes et sur une forfaitisation qui soient dans les limites raisonnables. Cela n'exclut pas le recours aux tribunaux, mais dans des cas particuliers. J'ajoute, même si ce sujet peut paraître éloigné de celui qui nous occupe, que la crise de la couverture assurantielle de la responsabilité médicale est fondamentalement due à l'absence de mutualisation. Les grandes compagnies d'assurance acceptent d'assurer les risques faibles, par exemple ceux des généralistes. Par contre, un gynécologue-obstétricien aura à payer une prime extrêmement élevée. Je rejoins M. Gambelli pour dire qu'une mutualisation entre les différentes branches professionnelles est nécessaire. Les risques varient d'un secteur à l'autre. On ne pourra aboutir à une mutualisation satisfaisante qu'en acceptant l'idée que la réparation intégrale est peut-être un miroir aux alouettes. M. Gilles ÉVRARD : S'agissant de l'indemnisation, le fait de partir de l'amiante pour évoquer, ensuite, l'ensemble des accidents du travail et des maladies professionnelles introduit peut-être une sorte de biais. Les accidents du travail et maladies professionnelles sont d'une extraordinaire diversité. Les outils d'indemnisation peuvent être, eux-mêmes, divers. Il n'est pas nécessaire d'appliquer à toutes les situations un principe unique, qu'il s'agisse de la réparation forfaitaire ou de la réparation intégrale. S'agissant de la tarification, qui est devenue très complexe au fil des années, la mutualisation est souhaitable. Mais, la tarification ne peut pas être le seul outil de prévention. D'une part, l'existence d'un « effet prix » suppose que l'entreprise soit réactive, et donc qu'elle sache quoi faire en réaction à une forte tarification. Or, ce n'est pas toujours le cas, notamment lorsqu'il s'agit d'intervenir très en amont d'une activité professionnelle, par exemple lorsque l'on construit une usine ou un atelier. D'autre part, les accidents du travail sont un phénomène finalement assez rare. Pour une entreprise donnée, il y a en moyenne moins d'un accident du travail par an. L'effet d'une tarification annuelle sur quelque chose qui se produit très rarement n'est pas perceptible. M. Michel PARIGOT : Je pense n'avoir pas été suffisamment clair en ce qui concerne le rôle des tribunaux. Il faut nettement distinguer l'indemnisation « par » les tribunaux de l'indemnisation « sous » le contrôle des tribunaux. Je plaide pour celle-ci : il doit être possible de faire appel d'une décision d'indemnisation par l'organisme qui en est chargé. C'est ce qui se passe dans le cadre des fonds existants. La très grande majorité des personnes indemnisées par le fonds de garantie automobile ne passent pas par les tribunaux, mais elles ont le droit de s'adresser à eux, ce qui change complètement les choses dans la mesure où il y a un contrôle du montant de l'indemnisation. Par ailleurs, je ne parle que de l'évaluation des préjudices, et non pas des questions relatives à la responsabilité. M. François DESRIAUX : Dans la période qui a précédé l'examen de la loi portant création du FIVA, la première demande de l'ANDEVA n'était pas la création d'un fonds. Notre position était que les problèmes rencontrés dans l'indemnisation des victimes de l'amiante ne faisaient que révéler les insuffisances du système de réparation des maladies professionnelles. Nous voulions une réforme de ce système, tout en sachant que cela n'empêcherait sans doute pas la création d'un fonds spécifique, parce que toutes les victimes de l'amiante ne relevaient pas du système d'indemnisation des risques professionnels - c'est notamment le cas des victimes environnementales, ou encore de celles de Jussieu. À l'époque, le ministère avait pris l'engagement de lancer une réflexion dont le but était de déboucher sur une réforme. C'est ainsi que Mme Aubry a confié un rapport à M. Roland Masse. Un autre rapport a été rédigé par M. Michel Yahiel. Mais, alors que M. Michel Laroque a rendu un troisième rapport, on n'a toujours pas avancé d'un pouce. J'ajoute qu'aucun des scénarios proposés dans le rapport de M. Laroque n'évoque la réparation intégrale. Chose curieuse, la seule réparation intégrale que l'on connaisse, celle des maladies professionnelles dues à l'amiante, n'est absolument pas prise en compte dans ce document. Un énorme travail a pourtant été fait par les commissions du conseil d'administration du FIVA, auquel M. Parigot a largement participé. Ce travail n'a absolument pas servi pour l'établissement de l'un ou l'autre des scénarios envisagés par M. Laroque. Le système né du compromis de 1898 est complètement obsolète, et il est inéquitable, d'autant que les victimes de maladies professionnelles, autres que celles dues à l'amiante, ne bénéficient pas du système mis en place dans le cadre de la création du FIVA. Il ne faudrait pas mesurer l'indemnisation de l'ensemble des accidents du travail et des maladies professionnelles à l'aune de l'indemnisation des victimes de l'amiante. Pour les faibles taux d'IPP50 - je pense en particulier aux plaques pleurales donnant lieu à un taux d'IPP de 5 % -, on voit apparaître des indemnisations liées au préjudice moral. Mais une personne victime d'un trouble musculo-squelettique (TMS) donnant lieu à un taux d'IPP de 5 % ne se verra pas reconnaître un préjudice moral comparable à celui qu'on reconnaît en cas de plaque pleurale. Je voudrais insister, enfin, sur le problème du maintien dans l'emploi. Une personne ayant un taux d'IPP de 5 % en raison d'un TMS a toutes les chances de perdre son travail et de ne pas pouvoir en retrouver un. Cela constitue un préjudice, qu'il faut prendre en compte et indemniser. Les déclarations d'inaptitude ont été multipliées par trois au cours des cinq dernières années. Les personnes concernées vont donc perdre leur emploi et très peu seront reclassées dans une nouvelle activité. Le livre de Philippe Askenazy montre clairement que, au-delà même de la question de la tarification, l'absence de prise en compte de l'ensemble des préjudices n'est pas une incitation à la prévention. La réparation intégrale ne doit donc pas être envisagée uniquement sous l'angle de la justice sociale, mais aussi sous celui de l'incitation des entreprises à la prévention. M. Marcel ROYEZ : Ma première intervention portait sur les principes d'une réforme du système. Je voudrais apporter quelques précisions sur la question de la tarification et de la mutualisation. Loin de moi l'idée d'abandonner toute mutualisation. Mais entre mutualisation et individualisation, il faut savoir où l'on met le curseur. Or, toutes les analyses convergent pour montrer que le système est trop mutualisé. S'agissant du rôle respectif de la sécurité sociale et des tribunaux, je rappelle que la FNATH est très attachée à une gestion du système par la sécurité sociale, pas seulement parce que ce système a constitué un progrès considérable au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, mais aussi parce que le système de réparation touche aux relations sociales. On n'imagine pas un système dans lequel tous les salariés qui subiraient un accident du travail ou une maladie professionnelle devraient le régler devant les tribunaux. Du point de vue des relations sociales, cela n'est pas concevable. En revanche, nous considérons que la garantie du droit au recours aux tribunaux existant dans le système actuel doit demeurer. J'observe que, si l'on voit se multiplier les procédures en faute inexcusable, cela est dû non seulement à la jurisprudence de la Cour de cassation, mais aussi au fait que la réparation forfaitaire est très insuffisante. Pour obtenir une réparation qui s'approche de la réparation intégrale, beaucoup de salariés sont tentés de faire valoir la faute inexcusable pour, par exemple, être indemnisés de leurs préjudices personnels. Nous sommes favorables à une réparation intégrale mais pas « intégriste ». Il ne s'agit pas d'une réparation intégrale appréciée au millimètre par les tribunaux sur chaque préjudice. Il faudra un système barémisé. C'est la raison pour laquelle il est dommage que le rapport de M. Laroque n'ait pas montré que le FIVA peut constituer l'ébauche de ce que pourrait être un système de réparation intégrale socialisé. M. Michel LAROQUE : Je rappelle que la réparation est un élément d'un ensemble qui inclut également la prévention et la réinsertion, dont nous n'avons pas beaucoup parlé. Il existe aujourd'hui un vrai problème de réinsertion des accidentés du travail et des personnes atteintes de maladies professionnelles. La sécurité sociale ne s'occupe plus suffisamment de cet aspect des choses. S'agissant de la réparation, je souligne que la notion de réparation intégrale n'est pas claire. La réparation intégrale, est-ce que cela existe ? Et si oui, à quelles conditions ? Ce qui existe, c'est une réparation de droit commun, au terme d'une procédure au cours de laquelle sont intervenus des assurances, des avocats et des tribunaux. Or, le résultat n'est pas le même, on le sait, selon la compagnie d'assurance qui aura traité du dossier, selon l'avocat qui aura défendu les intérêts de la personne concernée et selon la juridiction qui aura tranché. Le système est inégalitaire et aléatoire. C'est pourquoi, à moins que l'on parvienne à faire en sorte que les tribunaux appliquent, pour l'ensemble des dommages corporels, un système de barèmes et d'évaluations - ce qui se fait dans d'autres pays -, il me semble préférable de maintenir un système d'évaluation barémisé. Au demeurant, la réparation forfaitaire n'a jamais signifié que l'on écartait l'idée d'une réparation intégrale. Il s'agissait d'obtenir, grâce à un système d'évaluation par avance, une réparation égalitaire entre les victimes, sur la base d'un barème. Mais il faut s'assurer que ce système permet aussi une réparation juste, ce qui n'est pas le cas actuellement. S'agissant de mon rapport, je rappelle qu'il n'a pas tranché entre les scénarios qu'il a présentés. Il a tenté de dégager les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux. Une variante du scénario de réparation intégrale de droit commun comprend l'exemple du FIVA. En outre, je ne dis pas que ce rapport est complet. Il existe des variantes entre les différents scénarii envisagés. Mme Pascale ROMENTEAU : Je confirme que, lors de la mise en place du FIVA, ce système de réparation a été conçu comme un système exceptionnel. Mais c'est au cours de la même conférence de presse que furent annoncés la création du fonds et le lancement de la mission Masse. L'idée du ministère, à tout le moins du cabinet du ministre, était que l'idéal était une réparation intégrale pour l'ensemble des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Cela n'a pas pu se faire, pour différentes raisons. Cela étant, l'exemple FIVA a montré que l'existence d'un barème n'était nullement incompatible avec un contrôle du juge. Par ailleurs, il n'a jamais été envisagé par le ministère que la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles sorte du cadre de la sécurité sociale. Aujourd'hui, la branche AT-MP étant déficitaire, il est clair qu'à financement constant, il n'est pas possible de généraliser la réparation intégrale dans le cadre de la sécurité sociale. M. le Président : Je confirme qu'au moment de la création du FIVA, l'idée était bien d'aller au-delà. En élargissant notre réflexion à l'ensemble de la réparation, notre mission d'information, consacrée à l'amiante, est donc dans le prolongement des préoccupations qui prévalaient à l'époque. M. le Rapporteur : Nous avons principalement parlé du FIVA. Il serait bon que nos invités nous fassent également part de leur avis sur le FCAATA. Par ailleurs, il faudrait s'interroger sur la notion même de préjudice. On sait que différents préjudices sont pris en compte, selon qu'il s'agit du FIVA, du régime général de la branche AT-MP, ou des décisions rendues par les tribunaux. M. le Président : Nous allons faire une pause, puis nos invités répondront à ces questions après l'exposé de M. Sargos sur la faute inexcusable. (pause) M. le Président : Je vous propose à présent d'aborder le deuxième thème de cette table ronde : quelles conséquences tirer des arrêts de la Cour de cassation sur le régime de responsabilité des employeurs ? M. le président Sargos va introduire le débat par un commentaire de ces arrêts, après quoi nous nous demanderons s'il convient de revoir le cadre légal du régime de la responsabilité civile des employeurs et si oui, comment ? Nous répondrons aux questions du Rapporteur. M. Pierre SARGOS : J'ai pris mes fonctions de président de la chambre sociale de la Cour de cassation en septembre 2001. À cette date, il y avait en stock 14 500 dossiers. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, j'indique que la moyenne du stock, pour l'ensemble des cinq chambres civiles, est de l'ordre de 2 000 dossiers. Parmi ces 14 500 dossiers, un peu plus de 300 concernaient le seul contentieux de l'amiante, ce qui est considérable. Nous avons décidé d'extraire de ce stock une trentaine d'affaires qui permettraient de tenter de résoudre les principaux problèmes, dont la définition même de la faute inexcusable, puisque nous pressentions qu'il faudrait peut-être en arriver là. Il est rapidement apparu que nous étions face à une situation très différente du contentieux classique des accidents du travail et maladies professionnelles, de par la masse d'affaires, de par l'effet retard dans l'apparition des maladies, et aussi de par le fait que l'ensemble des acteurs du monde du travail - avec une plus grande responsabilité du côté des employeurs - avaient manifestement occulté un risque qui était connu depuis très longtemps. C'est ce dernier point qui me paraît justifier que l'on parle de « crime sociétal ». Par ailleurs, nous avons tenu compte de la directive du 12 juin 1989, qui représente une évolution majeure dans le droit de la protection des salariés, qui est d'abord un droit de la santé. Cette directive a été transposée en droit français par une loi de 1990. Face à ces dossiers, pouvions-nous continuer à appliquer la définition de la faute inexcusable énoncée par l'arrêt des chambres réunies du 15 juillet 1941, dit arrêt Dame Veuve Villa ? Selon cette définition, la faute inexcusable est « une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d'un élément intentionnel ». Cette définition était extrêmement restrictive, ce qui explique d'ailleurs que très peu de décisions judiciaires ont retenu la faute inexcusable. Les juges se sont rendus compte que cette définition était de moins en moins raisonnable au regard de l'insuffisance de la réparation, mais aussi au regard de l'évolution du droit de la responsabilité contractuelle. Celui-ci a vu se dégager, à partir de l'arrêt Compagnie générale transatlantique du 21 novembre 1911, le concept d'obligation de sécurité de résultat, qui a abouti à une responsabilité de plein droit en cas d'atteinte à la sécurité, dont il n'est possible de s'exonérer que par la preuve de la force majeure. Le droit commun de la responsabilité contractuelle était donc devenu infiniment plus protecteur que le mécanisme de réparation, également contractuel, de la faute inexcusable en droit des accidents du travail. Un autre constat devait être fait : pour la Cour des comptes, comme pour les tribunaux, il est très difficile de traiter cas par cas chacune de ces affaires en examinant si les conditions retenues dans telle ou telle situation relèvent d'« une faute d'une exceptionnelle gravité dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d'un élément intentionnel ». Cet examen au cas par cas aurait été générateur de retards considérables, qui n'étaient humainement pas acceptables. Par ailleurs, nous avons été éclairés par le rapport de la Cour des comptes, dont nous avions connaissance de la teneur, par celui du professeur Masse, par un rapport de l'Académie de médecine d'avril 1996, et par diverses analyses qui ont pu être faites aux États-Unis et au Canada. Nous avons décidé de mettre un terme à la jurisprudence Dame Veuve Villa et de raisonner sur le concept de responsabilité contractuelle en imposant à l'employeur une obligation de sécurité de résultat. Celle-ci ne résulte pas d'une invention de notre part. La directive européenne pose des exigences en matière de prévention qui aboutissent à une véritable obligation de sécurité de résultat, dont il n'est possible de s'exonérer que par la preuve de la force majeure. Une partie de la doctrine allait également dans ce sens. Le professeur Jean-Emmanuel Ray, dans son ouvrage Droit du travail, droit vivant, concluait que l'exigence de sécurité au travail est une obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur. Le précis Droit du travail de Jean Pélissier, Alain Supiot et Antoine Jeammaud allait dans le même sens. Nous avons donc finalement franchi le pas. Nous aurions pu nous arrêter là. Cela aboutissait au schéma de la responsabilité contractuelle classique, c'est-à-dire à une situation où la seule exonération de l'obligation de sécurité de résultat est la preuve de la force majeure. Mais la loi de 1898, qui était destinée à éviter au salarié d'avoir à se lancer dans les affres de la preuve d'une faute de l'employeur, continuait à exister. Or, la Cour de cassation, bien qu'il lui en soit parfois fait reproche, hésite tout de même beaucoup à statuer contra legem. Nous étions donc obligés d'intégrer dans cette reconnaissance de l'obligation de sécurité de résultat la législation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles. Pour schématiser, il y a désormais faute inexcusable, dès lors qu'il est établi que l'employeur avait conscience du danger - cette conscience étant appréciée de façon objective par rapport à un employeur normalement diligent - et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité du salarié. Mais le paradoxe est que la faute inexcusable permet d'attribuer aux victimes, ou à leurs ayants droit, la réparation de préjudices qui n'entrent pas dans le champ de la réparation forfaitaire. La réparation intégrale, qui est très bien définie dans l'ouvrage de Mme Yvonne Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel, consiste à réparer tout le dommage, rien que le dommage et le dommage réel. Des arrêts de la deuxième chambre de la Cour de cassation ont défini la réparation comme « le fait de rétablir la victime dans l'état où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu », ce qui signifie que l'on doit normalement réparer toutes les conséquences dommageables. Nous étions obligés de maintenir le système légal qui existe en matière de réparation des accidents du travail et maladies professionnelles, en conservant notamment l'intervention de la caisse de sécurité sociale, qui est le tiers payeur indispensable. De fait, avant 1946, certaines victimes d'accidents du travail n'obtenaient rien, tout simplement parce que leur employeur n'était pas solvable. Le paradoxe est que le système aboutit à l'inverse de ce qui avait été prévu à l'origine comme un mécanisme réducteur de responsabilité. Ce mécanisme est cependant maintenu. L'apport essentiel de ce revirement jurisprudentiel est de faciliter la démonstration de la faute inexcusable, mais sur un substrat de responsabilité de plein droit, issu de la reconnaissance de l'obligation de sécurité de résultat, qui est en droit assez artificielle. Cette construction a été acceptée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 24 juin 2005, qui a statué exactement dans les mêmes termes. Mais, sans trahir ce qui a été dit en délibéré, nous avons parfaitement conscience qu'il y a là un certain artifice juridique, qui était nécessaire pour résoudre ce drame épouvantable. Je crois que c'est l'office du juge que d'adapter, avec les armes relativement souples qu'il a à sa disposition, ses interprétations jurisprudentielles au regard de situations dramatiques, telles que celles qui sont issues de l'affaire de l'amiante. Par ailleurs, nous avions aussi en vue l'éradication de certaines restrictions au droit de réparation des victimes issues de jurisprudences très contestables. Par exemple, une jurisprudence exigeait, pour que la réparation du salarié dépasse la réparation forfaitaire, non seulement qu'il y ait faute inexcusable, au sens de l'arrêt Dame Veuve Villa, mais aussi que cette faute inexcusable soit la cause déterminante de l'accident. Cela nous est apparu extravagant. Nous avons donc jugé qu'il suffisait que la faute inexcusable soit une cause nécessaire. Une autre jurisprudence pour le moins singulière aboutissait au fait que, dans les situations où la faute inexcusable était retenue, avec toute la rigueur qu'elle avait selon l'arrêt Dame Veuve Villa, une simple imprudence malheureuse du salarié victime pouvait aboutir à réduire fortement sa réparation. Nous avons décidé que seule une faute inexcusable du salarié, définie de manière un peu différente, peut permettre de réduire sa réparation. Cela étant, la nouvelle jurisprudence a permis de résoudre dans l'urgence les problèmes nés du drame de l'amiante, et a répondu à la nécessité d'assurer une meilleure réparation. Mais il y a une part d'empirisme dans cette construction juridique. Il n'est pas tout à fait normal que pour arriver à une réparation aussi élémentaire que celle des troubles dans les conditions d'existence, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique dans certains cas, du préjudice moral entendu d'une façon large, il faille passer par la démonstration de la faute inexcusable de l'employeur. On peut donc se demander si une intervention du législateur n'est pas nécessaire. J'entends bien qu'il y a aussi des problèmes de coûts. Je voudrais appeler votre attention sur les risques de cette jurisprudence pour certains types d'employeurs. Les emplois d'aides à la personne se développent beaucoup en ce moment. Imaginez que, demain, quelqu'un se blesse chez la personne de faibles revenus qui l'emploie, parce que cette personne aura mis à sa disposition un instrument défectueux. S'il engage un procès sur la base de la faute inexcusable, il aura de fortes chances de le gagner. Et les employeurs en question ne sont pas assurés. Cela peut aboutir à des situations humainement et socialement dramatiques pour des employeurs dont la surface financière ne permettra pas de faire face. Jusqu'ici, quelques affaires ont été jugées, et les tribunaux ont été très prudents. Mais le jour où un dommage énorme se produira, le risque est réel que des décisions soulèvent un problème majeur. M. le Président : La réparation intégrale est-elle compatible avec l'idée de barème ? Qui peut dire si tel barème correspond à une réparation intégrale ? C'est une vraie question. Par ailleurs, il y aura toujours des recours devant les tribunaux parce qu'on n'obtiendra jamais une véritable indemnisation intégrale dans le cadre du système public qui sera « barémisé ». Quel type de responsabilité faut-il alors retenir pour l'employeur ? M. Pierre SARGOS : Il existe une définition abstraite de la réparation intégrale. En réalité, la grande distinction est celle qui existe entre les préjudices économiques - c'est-à-dire les pertes de revenus, les dépenses supplémentaires et les pertes futures prévisibles de gains ou de perspectives de carrière -, et tous les préjudices personnels : préjudice moral, pretium doloris, préjudices esthétiques, etc., c'est-à-dire tous les troubles que va entraîner le dommage corporel dans les conditions d'existence. M. François DESRIAUX : Comme vous vous en doutez, l'ANDEVA s'est félicitée de la nouvelle définition de la faute inexcusable. D'ailleurs, faut-il continuer de l'appeler « faute inexcusable » ? À partir du moment où il ne s'agit plus d'une faute « d'une exceptionnelle gravité » qui ouvre droit à une indemnisation complémentaire, mais d'un manquement à une obligation de sécurité de résultat qui incombe à l'employeur du fait du contrat de travail, que reste-t-il de l'ancienne jurisprudence ? Le président Sargos a, certes, souligné que la Cour de cassation a dû procéder à une légère contorsion pour reprendre à la définition de l'arrêt Dame Veuve Villa le critère de la conscience du danger. Mais l'évolution de la notion est telle qu'il vaudrait peut-être mieux renoncer au terme de « faute inexcusable ». M. le Président : Mais encore ? M. François DESRIAUX : Les dernières remarques du président Sargos font bien apparaître que la balle est maintenant dans le camp du législateur. De la jurisprudence issue des arrêts de février 2002, il ressort que l'on ne sanctionne pas une faute, mais que l'on indemnise une personne qui a subi un dommage. Ce n'est pas la même chose. Pour répondre à la question de M. le Rapporteur, je souligne que le FCAATA se distingue du FIVA en ce sens qu'il compense un préjudice qui n'est pas encore réalisé, un préjudice statistique, à savoir la diminution de l'espérance de vie. Le dispositif actuel intègre l'ensemble des salariés appartenant aux secteurs les plus évidemment concernés. Mais il y a d'autres salariés qui ont été exposés à l'amiante, et qui n'appartiennent pas à des secteurs reconnus, je pense en particulier au bâtiment. Il faut corriger cette lacune. Par ailleurs, comme pour le FIVA, le FCAATA a créé une inégalité par rapport aux salariés d'autres professions, qui sont exposés à d'autres produits ou à d'autres conditions de travail, qui subiront aussi une diminution de l'espérance de vie, et pour lesquels rien n'a été prévu. Nous nourrissons beaucoup d'espoirs dans la négociation sur la pénibilité, bien que celle-ci ait pris beaucoup de retard. Je reviens aux salariés du bâtiment. Ils ont été exposés, comme l'a montré l'enquête SUMER, à toute une série de produits dangereux pour leur santé et pour leur espérance de vie. La France est l'un des pays industriels où la mortalité prématurée est la plus élevée. Il importe de mettre en place un dispositif assurant l'équité, du point de vue du bénéfice de la retraite, entre les différentes catégories professionnelles. Pour les ouvriers du bâtiment, un autre problème se pose. Passé cinquante ans, il est impossible d'exercer dans le gros œuvre. Les conditions de travail qui ont contribué à diminuer leur espérance de vie diminuent aussi leur capacité à continuer de travailler dans des conditions de plus en plus lourdes et intenses. Le risque est que de plus en plus de salariés soient inaptes au travail, et se retrouvent donc soit au chômage soit en invalidité. Les invalidités augmentent vertigineusement. M. Jean-Paul TEISSONIÈRE : La réparation intégrale semble effrayer l'assemblée. On la présente comme quelque chose de très incertain, de balbutiant, d'incohérent. Sans doute certains éléments de critique ne sont-ils pas complètement infondés. Mais le droit de la réparation du dommage corporel a fait, au cours des dix ou vingt dernières années, des progrès tout à fait substantiels. Il y a vingt ans prévalait une incohérence et une approximation qui pouvaient nourrir des craintes. On a évoqué les travaux de Mme Lambert-Faivre. On pourrait citer le rapport que M. Dintilhac a récemment remis à M. le garde des sceaux et qui établit une nomenclature des chefs de préjudice corporel. C'est une pierre de plus sur le chemin d'un progrès substantiel dans l'appréciation de la réalité des préjudices. La réparation intégrale n'appartient donc plus à un domaine marqué par l'incertitude. Par ailleurs, s'agissant de la responsabilité civile des employeurs, je crois que, dans le compromis de 1898, on a échangé la présomption de l'imputabilité de l'employeur contre son immunité. Cela nous renvoie à la question de la tarification. Quant on compare la manière dont a été géré le drame de l'amiante dans différents pays, on constate que la sécurité sociale a constitué une garantie remarquable pour les travailleurs français. Dans les autres pays, les assureurs exigeaient que l'on fasse la preuve que la victime avait bien été contaminée durant la période couverte par le contrat d'assurance. La garantie apportée par la mutualisation est donc tout à fait essentielle. Mais si l'on en reste à la mutualisation, on risque d'aboutir à la déresponsabilisation des acteurs. C'est une dérive qui me paraît inquiétante. Je souligne que les arrêts de février 2002 ont été des arrêts de rejet de pourvoi, ce qui signifie que les cours d'appel avaient anticipé le revirement de jurisprudence qu'elle a consacré. La chambre sociale, qui a été audacieuse, n'était pas pour autant isolée. Sur quelle base peut-on tarifer quand on sait que le temps de latence des maladies dues à l'amiante peut être de trente ans. À Marseille, des milliers de personnes qui travaillaient dans la réparation navale ont été victimes de l'amiante. Toutes les entreprises concernées ont disparu. Le système de sécurité sociale garantit l'indemnisation et c'est tout à fait remarquable. Mais il reste que nous sommes face à un véritable risque de déresponsabilisation. À l'époque du compromis de 1898, on mourait de maladies aiguës et d'accidents. Aujourd'hui, on ne meurt plus de maladies aiguës, on meurt très peu d'accidents mais on meurt de maladies chroniques. Celles-ci sont souvent des maladies imputables à l'activité professionnelle, et les questions de responsabilité se posent beaucoup plus qu'à la fin du XIXe siècle. De plus, elles apparaissent très tard après l'exposition au risque, ce qui pose de redoutables problèmes, en particulier en ce qui concerne la tarification. M. Marcel ROYEZ : Je suis un peu agacé que l'on se pose la question de la définition de la réparation intégrale quand il s'agit de l'appliquer aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, alors que ce concept est couramment admis dans le champ de la réparation. Le président Sargos a d'ailleurs défini la réparation intégrale. Autre chose est le fait de s'interroger sur le niveau de la réparation intégrale. Il y a plusieurs références en matière de réparation intégrale, comme d'ailleurs en matière de réparation forfaitaire. L'une des références qui peut être utilisée pour faire progresser le système d'indemnisation est indiscutablement le système d'indemnisation mis en place à l'occasion de la création du FIVA, même s'il n'est pas possible de le transposer purement et simplement à l'ensemble des systèmes d'indemnisation. Cela dit, certains problèmes se posent davantage pour certaines victimes que pour d'autres. Je pense notamment au préjudice professionnel qui pose d'autres questions que l'indemnisation : le reclassement, le maintien dans l'emploi sont ainsi d'autres éléments qu'il importe d'intégrer dans un système de réparation. En fait, la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation a abouti à une certaine forme de banalisation de la faute inexcusable. Il faut accepter l'idée qu'il conviendrait de requalifier cette notion, pour redonner à la faute inexcusable son caractère exceptionnel, tout en conservant les mérites de cette jurisprudence. Les arrêts de 2002 sont une invitation pressante à légiférer en la matière. S'agissant du FCAATA, je souligne qu'il a un double objectif : il est un élément de réparation, et il est aussi, d'une certaine façon, un instrument de reconversion industrielle et une contrepartie de la pénibilité. Les deux aspects doivent être nettement distingués. L'aspect de réparation concerne avant tout les malades. Mais les travailleurs exposés relèvent d'une problématique générale, qui ne concerne pas uniquement les salariés de l'amiante, et qui doit être resituée dans un autre cadre que celui de la branche AT-MP. N'oublions pas, en effet, que le FIVA et le FCAATA ont lourdement « plombé », si vous me permettez cette expression, la branche AT-MP, au point que l'on n'a maintenant aucune marge de manœuvre. Il convient de calibrer la réparation en évitant de tout mélanger. S'il faut imputer à la branche AT-MP l'ensemble des conséquences de la pénibilité du travail, il faudra trouver un calibrage qui ne sera pas le calibrage financier actuel. M. Franck GAMBELLI : Je pense moi aussi que l'évolution de la jurisprudence a conduit à une banalisation de la faute inexcusable. Le terme même de « faute inexcusable » revêt un fort caractère afflictif et moral. Le fait de le banaliser me semble grave. Dans certains cas, il y a coïncidence entre le caractère afflictif de la notion et la réalité des faits. Il arrive que des employeurs commettent une vraie faute inexcusable. Mais dans d'autres entreprises, l'automaticité de la faute inexcusable conduit les employeurs à ne plus comprendre l'intérêt de mettre en œuvre des politiques de prévention. Car, quel que soit leur niveau d'engagement dans la prévention, la faute inexcusable est systématiquement au bout de chemin. Il faudra donc bien, un jour, redéfinir cette notion de faute inexcusable, de façon que soient sanctionnés ceux-là seuls qui en ont vraiment commis une. Il importe également de la distinguer de la sanction pénale, car la faute inexcusable est actuellement plus afflictive que la sanction pénale, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes. Comme l'a rappelé maître Teissonière, la chancellerie travaille à une réflexion sur les formes que pourrait revêtir un effort d'homogénéisation de l'indemnisation du préjudice corporel. Je souhaite que l'évolution de la branche ne soit pas complètement déconnectée de cette réflexion. Il me semble également important que des efforts d'homogénéisation soient faits au plan communautaire. Si la jurisprudence de 2002 est bien fondée sur la directive de 1989, il serait logique qu'un texte communautaire analogue fixe les principes en matière de réparation. Actuellement, le paysage communautaire de la réparation est extrêmement éclaté. M. André HOGUET : L'extension de la notion de faute inexcusable ne doit pas être un moyen de se donner bonne conscience. Le recours à cette notion doit être une arme contre les employeurs dont les pratiques vis-à-vis des salariés seraient abusives. Par ailleurs, j'insiste sur le fait que le travailleur doit être accompagné tout au long de sa vie professionnelle, et dans les divers aspects de celle-ci. La réforme de la branche AT-MP doit aboutir à une rénovation de notre système pour le mettre à la disposition de l'ensemble des salariés. Cela dit, les employeurs, s'ils veulent éviter que les cotisations augmentent trop, doivent faire en sorte que le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles diminue très significativement. Seul un effort de prévention associant tous les acteurs pourra permettre d'atteindre cet objectif. M. Michel PARIGOT : Je voudrais répondre à M. Gambelli. S'il était décidé de passer à la réparation intégrale, les problèmes qu'il a soulevés disparaîtraient. Le décalage entre la force du terme même de « faute inexcusable » et la réalité indemnitaire qu'il recouvre disparaîtrait automatiquement. Comme je le disais au début de cette table ronde, il est assez singulier que l'on chipote sur la réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles, alors que l'on ne chipote pas en dehors du système AT-MP, et encore moins pour l'indemnisation du dommage matériel que pour celle du dommage corporel. Il y a là quelque chose de choquant. Sur le plan des principes, la réparation intégrale est bien définie. Le président Sargos l'a définie tout à l'heure, et cette définition apparaît dans la résolution 75-7 du Conseil de l'Europe. Cette notion est également définie en pratique, dans les différents systèmes juridiques européens, qui reprennent grosso modo les mêmes chefs de préjudice, même s'ils sont définis de manière variable. La définition du préjudice d'agrément peut être restrictive ou extensive. L'incapacité est également définie de diverses façons selon les pays. Le poids des dommages corporels causés par les accidents du travail et maladies professionnelles est équivalent à celui des dommages corporels résultant d'accidents de la route. Si un organisme assurait la réparation intégrale, il aurait une très grande influence sur l'indemnisation du dommage corporel. Des réflexions sont en cours. On a évoqué le groupe de travail dirigé par M. Dintilhac, ainsi que les travaux de Mme Lambert-Faivre. Le problème est que ces réflexions sont menées dans un cercle étroit. Il faudrait qu'elles soient publiques, et que tout le monde puisse y participer. J'ajoute que l'ANDEVA est favorable au maintien de l'indemnisation dans le cadre de la sécurité sociale. Le système de l'assurance privée a pour principal inconvénient le fait que celui qui indemnise est celui qui paie. C'est un problème réel. Nous sommes favorables à une certaine forme de mutualisation, mais qui ne doit pas exclure la responsabilité individuelle en cas de faute caractérisée. M. Pierre SARGOS : Il est vrai que la faute inexcusable est banalisée du fait de sa nouvelle définition, dont la finalité était de permettre aux victimes d'accéder aux réparations ouvertes par la faute inexcusable. Il y a donc maintenant une distorsion, qui n'est effectivement pas très heureuse, entre la force du terme « faute inexcusable » et la réalité qu'elle désigne. Si une réforme devait être conduite, le législateur devrait peut-être définir lui-même cette notion. Je voudrais revenir un instant à la réparation intégrale. Je ne perçois pas très bien la possibilité d'un mécanisme pur de réparation intégrale en matière d'accidents du travail. J'ajoute une autre objection : si l'on veut maintenir une pression sur l'employeur au moyen de la notion de faute inexcusable, il faut bien que cette faute inexcusable, nouvellement définie, permette d'aboutir à un complément de réparation. Si la réparation est déjà intégrale, on ne peut pas ajouter une réparation supplémentaire, à moins d'avoir recours aux dommages punitifs, ce qui n'est pas dans la tradition du droit français. Le débat est un peu analogue à celui qui porte sur le principe de précaution. Les mesures à prendre doivent avoir un coût économiquement acceptable. Je doute de la possibilité pour la collectivité nationale de faire exploser le coût de la réparation. Par ailleurs, il faut garder à l'esprit le fait qu'il existe d'autres types de réparation. J'ai eu l'occasion d'appliquer une loi remarquable à laquelle M. Evin a attaché son nom, la loi du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. La prévoyance collective permet de réparer des situations d'invalidité, et concerne des millions de salariés. Il faut en tenir compte quand on fait la balance de ce que reçoivent ou ne reçoivent pas les victimes d'accidents du travail. M. Marcel ROYEZ : On peut fort bien imaginer que la faute inexcusable ne donne pas lieu à un complément d'indemnisation mais à une sanction financière de l'entreprise, sanction qui pourrait alimenter le système. Par ailleurs, M. Laroque a souligné que, s'il y a inégalité entre les victimes de l'amiante et les autres victimes, il y a également une inégalité par rapport aux personnes qui sont en longue maladie ou en invalidité. Je pense qu'il faut se garder de tout mélanger. Ou alors, il faut instaurer un risque unique. En maladie et en invalidité, on est dans le cadre de l'assurance sociale d'un risque social ; en AT-MP, on est en réparation d'un risque professionnel ; cela justifie que les principes ne soient pas les mêmes. Pour l'heure, des principes juridiques et économiques différents gouvernent des systèmes de droit à réparation différents. Des risques de nature différente justifient qu'on ne les gère pas avec les mêmes outils. Je me permets de rappeler que beaucoup de nos concitoyens ne bénéficient pas des régimes de prévoyance, qui n'ont pas un caractère général. Et même pour ceux qui en bénéficient, il faudrait poser le problème de l'inégalité considérable entre ces régimes, selon les entreprises et les professions. On ne peut pas imaginer que ces services servent de complément à l'insuffisance de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Conceptuellement, c'est choquant. Mécaniquement, c'est inopérant. M. Franck GAMBELLI : Je souhaiterais évoquer brièvement trois points. En premier lieu, il n'existe au sein de l'Union européenne aucun pays ayant un système légal de type AT-MP qui prévoie la réparation intégrale. En revanche, on peut, dans certains pays européens, obtenir une réparation intégrale par le biais du contentieux. En deuxième lieu, en ce qui concerne la prévention des accidents du travail et la réparation dans le secteur public, le Conseil d'État a sans doute fait évoluer la jurisprudence dans la lignée de la Cour de cassation. Mais si nous réformons la branche AT-MP, il faudrait peut-être qu'une réflexion s'engage pour envisager aussi quelques changements dans un système qui concerne les quelque cinq millions de salariés de la fonction publique. En troisième lieu, il y a sans doute une réflexion à mener sur les accidents du trajet. Je me suis toujours interrogé sur la superposition et l'articulation des assurances automobiles : celle payée éventuellement par le salarié au titre de sa police personnelle, celle de l'entreprise quand elle a une police de groupe, celle versée au titre de la cotisation forfaitaire trajet de la branche AT-MP. En pratique, dans la vie de l'entreprise, cela pose des difficultés très importantes. M. le Président : Madame, messieurs, cette table ronde a été passionnante. Elle a fait clairement apparaître les points d'accord et les points d'interrogation, qui sont peut-être plus nombreux que les désaccords. Beaucoup de problèmes juridiques sont ouverts. Notre volonté était d'ouvrir notre démarche à d'autres champs que l'amiante. Si nous parvenons à dégager des pistes de réflexion, ce ne sera pas un mince résultat. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de votre contribution aux travaux de notre mission. Audition de M. Pierre FAUCHON, sénateur Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Monsieur le sénateur, cher collègue, notre mission a choisi d'orienter ses travaux dans quatre directions principales : la gestion de l'amiante résiduel, les aspects scientifiques, la prévention des risques et la prise en charge des victimes, mais aussi l'aspect pénal, pour lequel la mission a souhaité vous entendre, puisque vous êtes l'initiateur de la loi de juillet 2000 qui porte votre nom. Notre mission traitera, bien sûr du passé, puisque l'objet de notre investigation est de tirer les leçons de l'affaire de l'amiante. Mais nous le ferons en raccourci, grâce au travail effectué, notamment par le Sénat. Au-delà de l'amiante, le thème de la prévention nous a amenés à engager une réflexion prospective extrêmement difficile sur la prise en charge des risques professionnels et sur la réparation des maladies professionnelles. Au sein de la branche AT-MP - accidents du travail et maladies professionnelles -, il nous est apparu que si les accidents du travail sont très bien maîtrisés, le champ des risques liés aux maladies professionnelles s'étend, avec l'innovation permanente et la multiplication des produits. En abordant cette question, on s'éloigne du sujet mais tout en y revenant, car l'amiante est un révélateur. Le débat autour de la responsabilité pénale est également engagé. Dans l'affaire qui avait été jugée par le tribunal de Dunkerque, puis par la cour d'appel de Douai, la Cour de cassation, en assemblée plénière, vient de statuer en employant un argument de procédure À cette occasion, le problème de l'application de la loi du 10 juillet 2000, dite « loi Fauchon », a été posé. Vous estimez que la rédaction de ce texte n'empêche pas son application à l'amiante au-delà du seul cas des élus mais vous êtes ouvert à sa révision, si celle-ci s'avère nécessaire. Nous sommes donc très intéressés par ce que vous allez nous dire sur ce point. M. Pierre FAUCHON : C'est un plaisir d'établir une relation de coopération sur ce sujet avec les députés. La loi que vous évoquiez, dans laquelle j'ai, en effet, fortement trempé, a été votée à la quasi-unanimité de nos deux assemblées, à l'issue d'un très bon travail mené de concert avec le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. René Dosière, sans oublier le rôle d'arbitrage qu'exerça Mme Élisabeth Guigou au titre du Gouvernement. J'ai la faiblesse de croire que le résultat n'est pas si mauvais mais je suis prêt à rouvrir la réflexion et je vous indique dès à présent que le Sénat organise, le 1er mars prochain, un colloque de bilan et de prospective avec la Cour de cassation, auquel j'inviterai naturellement Mme Guigou et M. Dosière. Plutôt que de revenir sur l'historique de l'amiante, déjà fort bien tracé dans le rapport du Sénat, je tâcherai de répondre point par point au questionnaire très intéressant qui m'a été adressé. J'avais prévu que l'examen par la Cour de cassation se traduirait par un échec, mais pas pour le motif qui a été retenu. Dans le droit des pays civilisés, pour qu'un délit soit constitué - c'est-à-dire un acte répréhensible, au sens moral du terme, différent de la faute civile qui peut concerner tout le monde -, l'intention de le commettre doit être caractérisée. Il faut certes prévoir l'existence de délits non intentionnels pour inciter à la prudence, mais ils doivent relever de l'exception. C'est ce qui a conduit à la formulation suivante qui fait appel au bon sens : le délit non intentionnel suppose « une faute caractérisée et qui expose à un danger qu'on ne peut ignorer ». La Cour de cassation examinant le droit et non les faits, je m'attendais à ce qu'elle bute sur cet obstacle. Mais l'argument de procédure, de toute façon, était imparable : l'article 575 du code de procédure pénale prévoit que la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction qu'en cas de pourvoi du ministère public, hormis sept exceptions, dans le cadre desquels le cas d'espèce n'entrait pas ; or le ministère public ne s'était pas pourvu. La Cour de cassation n'avait donc d'autre choix que de constater le vice de procédure et l'impossibilité de statuer. Le plus surprenant est que le commissaire du Gouvernement, qui fait partie du ministère public, ait fait, en quelque sorte, bon marché de cette difficulté ; les justiciables sont tout de même en droit d'attendre une certaine cohérence de la part du parquet. Au-delà de cet élément de procédure, quel est l'obstacle au procès de l'amiante ? L'instruction, à cet égard, est éclairante. Je vois d'abord une difficulté technique de date, sur laquelle Mme Martine Aubry a attiré l'attention du Sénat. Il se passe vingt-cinq ou trente ans entre le moment de la contamination et celui où la maladie se révèle, sans le moindre signe précurseur, de sorte qu'il se peut que la plupart des victimes concernées par ces procès aient été atteintes à une époque où la dangerosité de l'amiante était inconnue, c'est-à-dire jusqu'aux années 65/70, du moins en France. J'ai moi-même dénoncé l'amiante en 1981, en qualité de directeur de l'Institut national de la consommation : au vu des expertises que je leur avais présentées, j'avais convaincu des viticulteurs alsaciens de ne plus utiliser de filtres en amiante. En second lieu, les pouvoirs publics, notamment les services de l'inspection du travail, ont mis beaucoup de temps à prendre conscience de la dangerosité de l'amiante, contrairement à ceux de pays comme la Grande-Bretagne. Les juges d'instruction, puis la chambre de l'instruction, ont sans doute estimé qu'un chef d'entreprise ne pouvait deviner le danger ni prendre des mesures efficaces, dès lors que les services chargés de la santé publique n'avaient pas tiré la sonnette d'alarme ni procédé à des interdictions. Dans un tel climat d'incertitude, ils ont sans doute préféré ne pas instruire, plutôt que d'avoir à étendre les inculpations à beaucoup de responsables. Le climat local - celui du Nord - a peut-être aussi joué un rôle. Je désapprouve la décision de la Cour d'appel de Douai, pour deux raisons. D'abord parce que, dans notre droit de la responsabilité, un chef d'entreprise doit assumer ses actes et s'informer pour prendre des dispositions de sécurité, sans attendre les instructions de l'inspection du travail ou d'une autre structure : l'absence de consignes ne l'exonère pas de ses responsabilités d'autant, qu'à l'époque, il y avait déjà tout une littérature professionnelle et scientifique sur les dangers de l'amiante. Les responsabilités doivent donc être examinées. Ensuite, je considère qu'il n'appartient pas à un juge d'instruction ni à une chambre d'instruction, dès lors qu'il y a des éléments qui paraissent sérieux - et c'était le cas - de conclure que les conditions du délit ne sont pas réunies et de confisquer ainsi les prérogatives du juge du fond ; c'est en effet au juge du fond d'examiner les faits et de décider de condamner ou de relaxer ; la transmission d'un dossier du juge d'instruction au juge du fond signifie, non pas qu'il y a certitude et condamnation, mais qu'il y a de fortes présomptions qu'il appartient au juge du fond d'examiner. Ce qui s'est passé n'est donc pas correct du point de vue du fonctionnement de notre système judiciaire et du rôle de l'instruction par rapport au juge du fond. Je comprends donc l'exaspération et la douleur des victimes de l'amiante, qui attendent une audience publique sur ce drame, en présence de la presse : cette affaire, peut-être une des plus terribles que notre génération ait connue, doit aller devant une juridiction du fond. Si les parquets se montrent aussi peu zélés pour instruire les dossiers liés à l'amiante, c'est qu'ils sont épouvantés par l'ampleur de la catastrophe, dans le Nord comme à Cherbourg ou à Condé-sur-Noireau. Pour ne pas rester prisonnier des cultures locales, le système pénal tend de plus en plus à regrouper les poursuites ressortissant au même domaine sur des pôles spécialisés, à l'instar de la cellule antiterroriste, qui instruit tout le contentieux terroriste national de façon remarquable. C'est sans doute la bonne solution pour l'amiante. Pourquoi le ministère public ne s'est-il pas lui-même pourvu en cassation, permettant ainsi un examen au fond de l'affaire par la Cour de cassation ? Je l'ignore ! Il faut le demander directement au ministère public ! En tout cas, c'est surprenant ; il n'est pas satisfaisant que le ministère public n'appuie pas le pourvoi en cassation, alors que l'avocat général préconisait les poursuites dans ses conclusions générales. Comment le législateur de l'époque entendait-il la notion de « faute caractérisée » de l'article 121-3 du code pénal, que les juges ont apparemment du mal à cerner ? Nous avons recherché une formule de français courant plutôt qu'une définition savante. Il arrive un moment où il revient au juge d'apprécier, et il convient simplement de lui fournir un critère, sans entrer dans le détail, d'autant que deux affaires pénales ne sont jamais identiques et qu'il est donc impossible de prévoir tous les cas de figure. M. Lionel Jospin avait, du reste, accepté que nous légiférions sur la délinquance involontaire, mais à condition que le texte fût de portée générale ; c'était la seule position tenable politiquement même si, juridiquement, elle pouvait se discuter. Ce texte devait, en effet, concerner tout le monde et pas seulement les élus locaux. L'idée de « faute caractérisée et qui expose à un danger que l'on ne peut ignorer » fait appel au bon sens : elle désigne un niveau de faute particulier - qui n'est pas la faute simple - ayant provoqué directement un dommage qui pouvait être prévu. C'est important car il peut y avoir des enchaînements de causalité qui empêchent de prévoir le dommage final, même si, dans ce cas, il peut y avoir une faute, au sens civil du terme, et donc une indemnisation. La deuxième partie de l'expression, essentielle, a été négociée avec Mme Guigou au dernier moment. Voir sa responsabilité civile mise en cause est moins grave que se retrouver sur les bancs de la justice correctionnelle. D'ailleurs, les condamnations civiles sont couvertes par l'assurance, c'est-à-dire mutualisées, contrairement aux sanctions pénales. La notion de « faute caractérisée » me semble donc compréhensible. D'ailleurs, elle n'est pas contestée, y compris par l'avocat des victimes de l'amiante. Il faut comprendre la loi telle qu'elle est rédigée, et j'ai tendance à penser que les lois compréhensibles sont les meilleures ! Certains voudraient réviser la loi sur la question de la relation indirecte entre l'imprudence et le dommage, en suppriment la distinction entre cause indirecte et cause directe : il me semble que c'est une fausse piste. Leur raisonnement est le suivant : la loi ne s'appliquant que si la causalité entre l'imprudence et le dommage est indirecte, elle rend - et c'est incontestable - plus difficile la condamnation pénale. Ils en concluent que les tribunaux retiendront plus facilement les cas de délinquance lorsque la causalité sera directe, c'est-à-dire quand elle mettra en cause l'auteur immédiat de l'imprudence, donc le plus souvent non pas le responsable lointain mais un exécutant. La loi risquerait donc de protéger les dirigeants, et il eut mieux valu, selon eux, ne pas distinguer entre causalité directe et indirecte, dans les cas de délits non intentionnels. À l'époque, la raison de cette distinction s'imposait parce qu'il s'agissait, en réalité, d'exclure les accidents de la circulation du régime de la faute caractérisée. Nous avions envisagé de les exclure explicitement du champ d'application de la loi - et pour les accidents du travail, on s'était également posé la question -, mais il aurait été délicat d'envisager que la loi pénale ne soit pas la même pour tous. Il fallait donc trouver autre chose. Or dans la jurisprudence de la Cour de cassation, les accidents de la circulation relèvent toujours de la causalité directe. Le fait de limiter la portée de la loi aux seules causes indirectes du dommage nous permettait donc d'atteindre notre objectif de ne pas toucher au régime des accidents de la circulation. Telle a été la motivation de la distinction, et ni votre rapporteur, M. Dosière, ni votre assemblée n'a fait de difficulté pour l'adopter. Tous les magistrats chevronnés de la Cour de cassation m'ont encouragé à suivre la piste de la distinction entre causalité directe et indirecte, sur laquelle ils m'ont affirmé être habitués à trancher. Un certain M. Guillaume Perrault s'est permis de consacrer un ouvrage entier à expliquer que cette loi avait été conçue pour protéger les dirigeants et faire payer les lampistes, ce qui est parfaitement faux. Mais l'affaire du Tunnel du Mont Blanc a clos la polémique en trouvant les responsabilités là où elles se trouvaient, y compris auprès des responsables plus éloignés du drame que le constructeur du camion. Les juges peuvent interpréter la loi comme ils le souhaitent en fonction des faits. La notion d'« obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » résulte-t-elle, comme l'a affirmé l'avocat général près la Cour de cassation, de la législation de 1906 sur l'empoussièrement et de la réglementation de 1977 sur les valeurs d'exposition ? Je n'ai pas d'avis sur la question car je ne suis pas un expert technique de l'amiante. Quel est mon sentiment quant à l'issue d'un futur procès au fond de l'amiante ? M. Pierre Pluta, président de l'ARDEVA - l'Association régionale des victimes de l'amiante - du Nord-Pas-de-Calais, a un ennemi : la loi Fauchon. Je ne cesse de lui répéter qu'il perd son temps, qu'il est sur une fausse piste. Les protestations médiatiques sont utiles mais ne remplaceront jamais les citations directes - procédure très spécifique à notre droit, l'action publique à l'étranger ne pouvant généralement être mise en œuvre que par des fonctionnaires du parquet ou de la police, à l'exclusion des particuliers. Les victimes ont un peu tendance à confondre réparation civile et la condamnation pénale. Les médias aidant, elles cherchent souvent à ce que les responsables soient marqués au fer rouge, pour l'effet d'exemplarité - de ce point de vue, elles n'ont pas tout à fait tort. De toute façon, notre droit pénal a pour spécificité d'autoriser une partie civile à saisir directement la juridiction pénale, quel que soit l'avis du parquet. Un avocat m'a dit que c'est un peu « casse-cou » et il est vrai que les juges du fond n'aiment pas être directement saisis par les particuliers. C'est vrai pour les affaires banales, mais celle de l'amiante n'en est pas une ! Si un procès public de l'amiante était organisé, dans une salle d'audience, les victimes pourraient citer cinquante témoins et vingt experts en vue de les faire défiler devant le juge du fond ! Le juge serait bien obligé de les entendre. Connaissant l'état d'esprit des magistrats, je suis convaincu que certains d'entre eux seraient ravis d'être saisis et de faire leur métier, d'assumer leurs responsabilités. Et, à partir de la décision rendue, il serait encore possible d'aller en appel et en cassation. Pourquoi attendre ? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les responsables de l'ANDEVA - l'Association nationale de victimes de l'amiante - tergiversent ; ils semblent avoir peur. Si je plaidais encore, je leur proposerais mes services gratuitement : ce serait la plus belle affaire de ma carrière ! Tous les juristes vous confirmeront que la citation directe est possible ; elle ne l'est plus pour les personnes nommément désignées dans des procédures qui ont abouti à un non-lieu mais elle le reste pour les victimes nouvelles, qui n'apparaissaient pas dans l'instruction et qui se font connaître. Il faut que le procès public ait lieu. Je n'ai pas à donner mon avis sur le fond mais je suppose que vous l'avez deviné... Faut-il réviser la loi Fauchon ? Je ne m'entête pas sur le texte du 10 juillet 2000 car je sais que tout est perfectible et que nous sommes habitués à ravauder la législation pour l'améliorer. Toutefois, hormis la ligne d'attaque sur la distinction entre causalité directe et indirecte, qui ne tient pas, je ne vois pas bien quelles seraient les modifications envisageables ; le colloque du 1er mars, au cours duquel les différentes catégories concernées - élus et victimes - s'exprimeront, nous éclairera peut-être. En tout état de cause, une révision du dispositif pénal ne serait pas rétroactive et ne pourrait, hélas, concerner les affaires liées à l'amiante. Comme le texte de 2000 adoucissait un peu la réglementation, il s'est appliqué immédiatement et a produit une jurisprudence complète, du haut en bas de l'échelle. En revanche, une nouvelle loi, plus sévère, ne pourrait rétroagir, si ce n'est pour des cas nouveaux, or l'amiante n'est plus utilisé dans l'industrie, du moins je l'espère. Vous demandez également si la loi du 10 juillet 2000 était adaptée aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Selon moi, elle poursuivait des objectifs d'équité d'application générale. Une loi pénale ne peut être destinée à un type particulier d'accidents, surtout lorsqu'il s'agit de délinquance involontaire. On ne pouvait pas faire une loi spécifique pour les accidents de la route ou les accidents du travail ; la position de M. Jospin était donc raisonnable. Faut-il protéger de manière identique, d'un côté, les élus ou les fonctionnaires, en charge d'une fonction ou d'une mission d'intérêt général et, de l'autre, les employeurs ? D'abord, le terme « protection » me semble exagéré. Il arrive que des gens très simples soient bombardés maires ou conseillers généraux du jour au lendemain - c'est le jeu de la démocratie -, et ils ne peuvent pas résoudre immédiatement tous les problèmes de leur collectivité, d'autant qu'ils peuvent hériter de situations dans lesquelles ils n'ont pas trempé. Au contraire, un préfet ou un chef d'entreprise a décidé d'exercer son métier après avoir bénéficié d'une formation, tandis qu'un maire est obligé d'exercer sa fonction. La Cour de cassation dispose que la loi pénale est identique, mais pour tous ceux qui occupent des situations identiques. Or, pour moi, l'élu n'est pas dans une situation identique. L'Association des maires de France désirait que les maires ne puissent être mis en cause qu'en cas de faute lourde ; c'était politiquement impossible, quoique pas nécessairement injuste. Il fallait un texte général. De même, afin de garder l'unité du droit pénal, je ne crois pas qu'il soit pertinent d'envisager une loi spéciale pour les risques professionnels. Il n'en reste pas moins que la législation sur les accidents du travail pose problème. Elle a constitué un grand progrès social à la fin du XIXe siècle mais ne l'est plus. Les indemnités sont plafonnées et il faut se voir reconnaître plus de 50 % d'incapacité pour doubler l'indemnité, d'où de terribles querelles d'experts autour des 50 %. D'une manière générale, de nos jours, les accidentés du travail sont moins bien indemnisés que les victimes de droit commun, comme les accidentés de la route. En outre, pour échapper au plafonnement, il faut prouver que le chef d'entreprise a commis une faute inexcusable. Certains tribunaux prononcent donc la faute inexcusable pour régler un cas humain en accordant une grosse indemnité, de sorte que l'on peut être blanchi de toute faute caractérisée par la juridiction correctionnelle tout en étant reconnu responsable d'une faute inexcusable par la juridiction de sécurité sociale ! Quelle cohérence intellectuelle ! La législation sur les accidents du travail est devenue obsolète et, selon moi, le droit commun serait plus protecteur. Mais cela supprimerait de nombreuses juridictions sans doute ravies d'exister ! Une réflexion devrait être engagée sur ce point et une commission d'enquête parlementaire pourrait peut-être même se saisir de cette question. À la question que vous me posez sur les principes à retenir pour modifier la responsabilité pénale des employeurs, je préconise tout simplement que le législateur retienne de « bons » principes ! Pourquoi avons-nous souhaité cette loi de 2000 ? Parce que dans une société civilisée, s'il n'y pas de faute pénale sans volonté de la commettre, il convient quand même de créer des exceptions pour nous contraindre tous à la prudence. La menace d'une amende non couverte par l'assurance, voire la menace de la prison, est une nécessité. Mais cette règle ne doit pas jouer sans condition. Un maire, au moins, dont la responsabilité pénale avait été mise en cause a été poussé au suicide ; et je ne parle pas des enseignants, en particulier de ceux condamnés en première instance dans l'affaire du Drac, qui ont heureusement été absous par la cour d'appel de Lyon, qui n'a pas relevé en l'espèce la « faute caractérisée ». Je crois donc que nous avons fait du bon travail avec cette loi du 10 juillet 2000 mais je suis ouvert à toute proposition de modification. M. le Président : J'ajoute que la jurisprudence est déjà importante. M. Pierre FAUCHON : Elle est considérable. M. le Président : Je vous remercie pour votre précision et votre rigueur. M. le Rapporteur : Vous avez évoqué la possibilité d'un vrai procès pénal de l'amiante. M. Pierre FAUCHON : Ce procès est nécessaire, je le répète. M. le Rapporteur : Ne craigniez vous pas que nous entrions dans une série décennale de procès ? M. Pierre FAUCHON : C'est sans doute ce qui a jusqu'à présent bloqué les juges d'instruction, car il est vrai que c'est effrayant. M. le Rapporteur : Dans les cas où l'interdiction de l'amiante a été enfreinte après 1997, la responsabilité pénale est évidemment incontestable. De même, la responsabilité de ceux qui ont enfreint les réglementations de 1977, peut être engagée. En revanche, je serais gêné que soient incriminées des personnes qui, entre 1977 et 1997, ont été pris par la vague de la politique officieuse d'usage contrôlé de l'amiante, même si cette politique fut une erreur. Qu'en pensez-vous ? M. Pierre FAUCHON : Ayant peu participé aux réunions de la mission d'information du Sénat, hormis sur ses aspects juridiques, je ne me risquerai pas à émettre un avis à ce propos. Jouer les justiciers après coup serait, peut-être, trop facile mais il n'empêche qu'une affaire de cette nature, dans un État de droit comme la France, doit venir devant un juge du fond. M. Daniel PAUL : Des milliers de personnes sont mortes ou vont mourir, leurs familles les accompagnent et souffrent, mais l'indemnisation au civil est insuffisante - je ne parle même pas des sommes accordées par le FIVA, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Dans ces conditions, l'absence de procès pénal est intolérable. Les institutions de la République doivent affirmer haut et fort qu'il faut sortir de cette situation. Il faudra le dire. M. le Président : C'est ce que fait la mission, mon cher collègue. M. Daniel PAUL : Mais il faut aller jusqu'au bout, M. le Président, sous peine de désespérer le peuple. M. le Président : Même s'il risque de se trouver devant des situations extrêmement complexes, l'intervention du juge du fond me paraît indispensable. M. Pierre FAUCHON : Il y a suffisamment d'éléments pour que le juge du fond soit saisi. M. Daniel PAUL : Mais la citation directe serait-elle suffisante ? M. Pierre FAUCHON : Je ne connais pas de président de tribunal qui saboterait une telle audience. Les témoins et les experts s'exprimeront en présence du public et de la presse, qui rendra compte du procès avec compte-rendu. Je ne comprends pas pourquoi les avocats ne recourent pas à cette procédure. M. Jean-Marie GEVEAUX : La citation directe est sans doute la piste à suivre, mais le président du tribunal ne sera pas obligé de rendre sa décision le jour de l'audience et sera en mesure de diligenter une enquête supplémentaire. M. Pierre FAUCHON : Bien entendu. Le tribunal, composé de trois juges, mettra en délibéré. Il rendra peut-être un premier jugement qui désignera plusieurs experts pour éclaircir les zones d'ombre. M. le Président : Et la disposition de procédure pénale invoquée par la Cour de cassation ne jouera plus. M. Pierre FAUCHON : Absolument. Même si le parquet se lève pour dire que le délit n'est pas constitué, le juge du fond est totalement autonome ; il statue en son âme et conscience. M. Patrick ROY : Je salue à mon tour la qualité de l'analyse de notre collègue Fauchon. Je dois cependant dire que les victimes font de la révision de la loi du 10 juillet 2000 une revendication emblématique. J'ai d'ailleurs signé la pétition, contrairement à d'autres, les raisons de fond de chacun étant parfaitement honorables. Je suis conscient toutefois qu'une révision ne servirait pas à grand-chose... M. Pierre FAUCHON : Non, car elle ne pourrait rétroagir. M. Patrick ROY : ...mais elle est nécessaire pour ne pas donner l'impression aux victimes qu'elles ne sont pas écoutées. M. le Rapporteur : Il n'est pas envisagé de réviser la loi. Nous nous orientons plutôt vers la préconisation d'un jugement pénal sur le fond. M. le Président : Pas de faux débats entre nous ! M. Patrick ROY : Les explications de M. Fauchon, que je découvre aujourd'hui, me paraissent limpides. Alors pourquoi l'ANDEVA ne se rallie-t-elle pas à ces arguments judicieux ? Par ailleurs, s'il devait y avoir un procès au pénal, je serais, pour ma part, favorable à un grand procès unique plutôt qu'à un éparpillement des procédures. M. Jean-Yves COUSIN : La décision au fond et au pénal est indispensable pour que la justice passe, tout simplement. Pourquoi les avocats n'emploient-ils pas la procédure de la citation directe ? La réponse est sûrement simple mais elle m'échappe. M. Daniel PAUL : Je suis également signataire de la pétition dont a parlé M. Roy et, dans les conclusions que je formulerai au nom de mon groupe, je proposerai à la mission de demander la révision de la loi de 2000. Même si le nouveau texte doit être dépourvu d'effet rétroactif, il est impossible de laisser ce mouvement sans réponse. Par ailleurs, je pense qu'il n'appartient pas à notre mission de se prononcer en faveur d'un procès global ou d'actions éclatées ; cela ne relève pas de notre pouvoir. Mme Martine DAVID : L'idée d'un procès unique est bonne mais, de toutes façons, nous n'aurions, bien entendu, pas le pouvoir d'empêcher d'autres procédures. M. le Président : Le Rapporteur n'a fait qu'exprimer une inquiétude. Le premier procès au fond produira l'effet de catharsis que tout le monde attend, mais une multitude d'affaires se succéderont aussi probablement. M. Pierre FAUCHON : Autant une association peut se contenter d'exiger une révision de la loi, autant une mission d'information, si elle choisit cette option, se doit de déterminer les directions dans lesquelles il convient de légiférer. Je comprends parfaitement que certains élus aient signé la pétition mais je vous demande d'aller jusqu'au bout de la réflexion, faute de quoi le crédit de votre Assemblée serait compromis. Je me permets de vous le dire, et je vous lirai avec le plus grand intérêt ! Je vous rappelle au passage que la rédaction votée par l'Assemblée nationale était beaucoup plus protectrice encore : pour que les juges ne puissent plus condamner à tours de bras, vous aviez d'abord retenu la notion de « faute d'une exceptionnelle gravité » et non celle de « faute caractérisée ». Le Sénat s'apprêtait à voter conforme mais les associations de victimes se sont manifestées et le gouvernement de M. Jospin a finalement proposé la formule « faute caractérisée ». Un seul procès serait idéal, mais c'est sans doute impossible. En tout cas, pour regrouper les affaires sans enfreindre les règles de la compétence territoriale, une loi serait peut-être nécessaire, comme en matière de terrorisme ou de délinquance financière. Pourquoi ne pas y réfléchir ou au moins l'évoquer dans votre rapport ? Si personne n'a encore recouru à la citation directe, c'est sans doute par prudence. Sauf preuve du contraire, aucun motif juridique ne s'y oppose. M. Jean-Marie GEVEAUX : Si les victimes prennent un avocat, c'est pour obtenir une indemnisation rapidement. Or une citation directe aboutirait à un jugement sur le fond, sans indemnisation immédiate. M. le Président : Le civil et le pénal sont désormais dissociés. M. Pierre FAUCHON : L'indemnisation repose en effet sur une base juridique distincte. Et une citation directe va beaucoup plus vite qu'une instruction : l'affaire peut arriver en jugement dans trois semaines et avoir un effet foudroyant. Cette solution fait peur, mais l'affaire n'est pas banale et les avocats sont faits pour cela ! M. Patrick ROY : Comment les victimes peuvent-elles avoir peur d'une telle procédure ? M. Pierre FAUCHON : Parce qu'elles sont entre les mains des associations et ne saisissent pas toutes les dimensions du problème. M. le Président : Ce ne sont pas les victimes qui ont peur ! Il faut être bien naïf pour ne pas comprendre que le jeu des associations, voire des avocats, n'est pas totalement neutre ! M. Pierre FAUCHON : Dès notre première rencontre, j'ai expliqué à l'avocat de l'ANDEVA l'intérêt que représenterait une citation directe mais celui-ci m'a affirmé que ce serait « casse-cou ». M. Jean-Marie GEVEAUX : Encore faut-il que le magistrat soit solide. M. Pierre FAUCHON : Le juge n'est pas seul. Il siégera en formation collégiale et la cour d'appel sera peut-être amenée à se prononcer en deuxième instance. M. le Président : Mon cher collègue, je vous remercie. Il nous est toujours agréable de coopérer avec le Sénat. Audition de Mme Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY, coordinatrice du pôle santé publique du tribunal de grande instance de Paris Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : La mission souhaite vous entendre pour avoir des informations précises sur le rôle, le fonctionnement et les moyens du pôle de santé publique du tribunal de grande instance de Paris, ainsi que sur la façon dont se déroulent les actions pénales diligentées dans l'affaire de l'amiante. Vous avez d'ailleurs reçu un questionnaire qui pourra servir de trame à cette audition. Nous constatons un mouvement tendant à la révision de la loi Fauchon mais nous savons que les éventuelles nouvelles mesures ne seraient, en tout état de cause, pas rétroactives et ne répondraient donc pas au problème des anciennes victimes de l'amiante. M. Pierre Fauchon, que nous venons d'entendre, est partisan d'un procès pénal au fond et d'une action par citation directe, et nous savons que la Cour de cassation, pour sa part, vient de rejeter le pourvoi de victimes en s'appuyant sur un article du code de procédure pénale. Mme Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY : Vous m'avez demandé quels sont les obstacles au procès de l'amiante attendu par les victimes, au-delà de la raison de procédure invoquée devant la Cour de cassation. La première réponse est d'ordre juridique : le droit pénal se trouve le plus souvent inadapté aux affaires de santé publique. Les infractions pouvant être retenues - car ce sont celles qui ne sont pas prescrites - sont principalement des homicides et blessures involontaires, pour lesquels il faut constater une faute d'imprudence ou de négligence, un dommage, et déterminer un lien de causalité certain entre les deux : or ce lien certain qui s'assoit parfois sur des constatations scientifiques, elles-mêmes parfois incertaines, est une difficulté majeure dans ces dossiers (syndrome de la guerre du golfe, effets secondaires du vaccin anti-hépatite B, conséquences sanitaires du nuage de Tchernobyl). Une autre difficulté se trouve dans le fait que les fautes à rechercher sont intervenues vingt ou trente ans auparavant. Ces affaires présentent également la particularité d'être ouvertes sur constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal du lieu de l'infraction ou du domicile de la personne soupçonnée. Le juge d'instruction entame donc son dossier à partir du dommage d'une ou plusieurs victimes, c'est-à-dire, en matière d'amiante, par exemple à partir de plaques pleurales ou d'un mésothéliome d'un ou plusieurs ouvriers, et non de toutes les pathologies liées à l'amiante des ouvriers de telle usine : je réponds ainsi à la deuxième interrogation de votre questionnaire concernant des reproches faits au parquet par les victimes de si peu instruire les dossiers liés à l'amiante. En effet, le fait que le parquet n'ouvre jamais d'information lui-même crée également une difficulté : ce n'est pas le dossier de la catastrophe sanitaire elle-même ou des personnes touchées dans telle entreprise, mais celui d'une seule victime, ou plusieurs victimes comme dans le dossier du sang contaminé. Il en est ainsi pour l'ouverture des dossiers de l'amiante, par exemple pour le dossier de Jussieu pour Paris. Il en est également de même pour tous les dossiers d'amiante arrivant des cabinets d'instruction de province pour être centralisés au pole santé de Paris : ils ont tous été ouverts sur constitution de partie civile d'une ou plusieurs victimes devant le doyen des juges d'instruction du tribunal compétent. Il faut préciser qu'aucun des dossiers de santé publique que j'ai traités ou que je traite actuellement n'a été ouvert sur initiative du Parquet. Ces ouvertures d'informations avec nomination d'un juge d'instruction ont toujours été effectuées sur initiative des victimes elles-mêmes par le moyen de cette constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction. M. le Président : Comment expliquez-vous cette attitude ? Mme Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY : J'aimerais en connaître les véritables raisons mais c'est le parquet lui-même qui doit répondre à cette question. La création du pôle spécialisé de santé publique de Paris en septembre2003 constitue tout de même une réponse à l'émergence de ces affaires de santé publique. Depuis la mise en place de ce pôle, le parquet s'intéresse davantage à ces procédures puisqu'il a été également créé un pôle santé parquetier. Il y a lieu d'indiquer que son action a été positive dans le dossier de l'hormone de croissance dont l'instruction touchait à sa fin. Quant aux dossiers d'amiante du pôle santé, les substituts attachés à ce pôle du parquet s'organisent pour pouvoir suivre l'évolution de ceux-ci avec les juges d'instruction. Précisons qu'une grande partie des dossiers arrivés à Paris sans ouverture d'information par les parquets de province sont actuellement en enquête préliminaire, le parquet de Paris appliquant ainsi sa politique actuelle d'utilisation préférentielle de ces enquêtes avant toute ouverture d'information nécessitant la nomination d'un juge d'instruction. Il faut ajouter que les avocats des victimes avaient souvent obtenu par le passé, sur d'autres affaires, la centralisation de fait des dossiers au tribunal de Paris, dans la mesure où ils visaient, dans leur plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Paris, comme personnes soupçonnées, les directeurs d'administration centrale ou les conseillers des ministres, donc des personnes domiciliées à Paris (hormone de croissance, contaminations humaines liées à la « vache folle » et en fait tous les autres également). Par ailleurs, les juges d'instruction de province, lorsqu'ils avaient ainsi connaissance de l'existence de l'ouverture, à Paris, d'un dossier de santé publique, s'interrogeaient sur l'opportunité de continuer parallèlement leurs procédures concernant des victimes de leur ressort se rattachant à ce dossier et demandaient si le juge d'instruction de Paris voulait bien se saisir de leur procédure. Ainsi, le dossier de l'hormone de croissance implique une soixantaine de parties civiles, dont une dizaine viennent de province par dessaisissements demandés par les juges locaux. Le dossier de l'amiante à Jussieu relève de Paris, de par sa compétence territoriale, mais toutes les autres affaires d'amiante ont eu lieu en province, à Dunkerque, au Havre, etc. Elles sont donc disséminées sur tout le territoire sans demande de dessaisissement des juges de province sur Paris - du moins à ma connaissance puisque je ne suis saisie de ce dossier que depuis 2 ans. C'est grâce à une directive du ministère de la justice du 12 mai 2005 que les dossiers sont actuellement centralisés à Paris. C'est une bonne chose mais une centralisation plus précoce aurait été bien plus bénéfique même si, au départ, les investigations locales peuvent en toute logique être menées par le juge de province. Je constate que, sur chaque dossier - le pôle est saisi actuellement de six dossiers sur l'amiante -, trois juges d'instruction se sont succédé en moyenne au fil des ans, à cause des mutations, le turn-over des magistrats de base étant très fort. En tout état de cause, j'estime que cette cohérence de traitement des différentes plaintes disséminées sur plusieurs tribunaux concernant une même origine - c'est-à-dire en l'espèce les conséquences de l'exposition à l'amiante - est une bonne chose et confirme la raison d'être de ce pôle santé. Si le pôle de santé publique est une bonne solution, nos moyens matériels demeurent encore trop faibles. Il s'agit là du deuxième obstacle au procès de l'amiante. Nous sommes quatre juges d'instruction. Quant au parquet, il compte sept magistrats, mais leur compétence s'étend au-delà des questions de santé publique (contrefaçons, droit de la concurrence, droit de la construction). Le manque de moyens se fait surtout sentir au niveau des enquêteurs, c'est-à-dire les officiers de police judiciaire (OPJ) : ainsi j'ai appris ce matin qu'une perquisition prévue en décembre dans un dossier de santé publique ne pourra être effectuée, faute d'OPJ en nombre suffisant, et devra être reportée en janvier. C'était l'OCLAESP, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique - organisme national de création récente dirigé par les gendarmes - qui devait effectuer avec moi cette perquisition. Il faut dire que cet office ne dispose que de quatre OPJ, alors qu'il est chargé non seulement de nombreuses commissions rogatoires concernant des affaires de santé ouvertes à l'instruction, mais également de beaucoup d'enquêtes préliminaires du parquet. En effet, les dossiers en enquête du parquet sont régulièrement confiés à l'OCLAESP ou à la BRDP - la brigade de répression de la délinquance contre la personne -, police spécialisée en matière de responsabilité médicale et de santé publique et compétente uniquement en région parisienne. Mais la BRDP souffre également d'un problème de moyens et de l'effet des mutations : en effet un OPJ partant à la retraite, ou muté sur sa demande, est maintenant systématiquement remplacé - depuis une réforme récente de la police - par un gardien de la paix, qui ne devient à son tour OPJ qu'après avoir suivi les stages nécessaires, donc deux ans plus tard. En attendant, il n'est pas habilité à travailler sur les commissions rogatoires délivrées par les juges d'instruction. La situation du pôle de santé publique est donc dramatique et je ne cesse de demander des moyens. En ce qui concerne l'amiante, j'ai été désignée comme juge d'instruction en co-saisine avec un autre juge dans un certain nombre de dossiers arrivant de province, alors que j'instruisais depuis deux ans - étant nommée après 3 juges d'instruction successifs du pôle financier, alors compétent en accidents du travail avant la création du pole santé - le dossier des victimes de l'amiante à Jussieu, dans lequel des mises en examen et placement sous témoins assistés de personnes morales ont été effectués. Il est certain que dans tous ces dossiers d'amiante, la responsabilité de l'État, c'est-à-dire des décideurs publics personnes physiques - puisque l'État n'est pas une personne morale sur le plan juridique - et parfois celle des inspecteurs du travail ou des médecins du travail ou des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) ou des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT), est mise en avant par les parties civiles et par certains mis en examen. Je reviens aux difficultés juridiques rencontrées dans les dossiers de l'amiante. Il est incontestable que l'on peut faire un lien certain entre les maladies qui sont en quelque sorte « signées » amiante, comme par exemple le mésothéliome, et leur exposition à l'amiante, contrairement à d'autres pathologies dans d'autres affaires de santé publique (par exemple, les scléroses en plaques pour la vaccination anti-hépatite B, les cancers de la thyroïde qui pourraient être liés au passage du nuage de Tchernobyl en France). Mais il reste une difficulté qui est celle de déterminer le lien de causalité certain entre telle pathologie liée à l'amiante et les fautes qui pourraient être retenues contre les personnes physiques ou les personnes morales. En effet, il n'est pas si simple d'établir le lien de causalité car il faut prouver que les fautes ont été commises lorsque la personne physique mise en examen dirigeait l'usine. Mais lorsqu'une partie civile a travaillé successivement dans trois usines, comment savoir celle dans laquelle elle a été contaminée ? Lorsqu'un ouvrier a connu six directeurs différents dans une même usine, comment savoir lequel est responsable, même si tous ont commis des fautes d'imprudence ou de négligence ? Car il est difficile de déterminer la période de contamination si celle-ci n'est pas continue, les scientifiques distinguant sur ce point les différentes pathologies liées à l'amiante. Il y aura alors peut-être controverse scientifique sur ce point. Faire peser la responsabilité sur la personne morale - qui peut être mise en examen, en lieu et place de la personne physique ou en plus de celle-ci, depuis le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau code pénal qui a introduit l'imputabilité d'un homicide involontaire à une personne morale - n'est pas simple non plus. En effet, une difficulté toute récente vient de se produire en ce qui concerne les personnes morales. Un arrêt récent du 14 octobre 2005 de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, sur requête en annulation formulée par le parquet de Paris concernant la mise en examen par un juge du pôle santé d'une personne morale dans un dossier d'amiante, a annulé cette mise en examen au motif que les fautes pouvant être retenues étaient antérieures à la date de création de la responsabilité pénale de la personne morale. Pourtant, en l'espèce, les victimes étaient, compte tenu du long délai d'incubation, décédées postérieurement au 1er mars 1994. Cela signifie que la personne morale ne pourrait pas être mise en examen dans les dossiers d'amiante. Il faudrait donc demander l'annulation des mises en examen déjà effectuées dans les dossiers qui viennent d'être transmis au pôle santé par les tribunaux de province. En ce qui me concerne, je ne partage pas cet avis juridique. En effet, l'infraction d'homicide involontaire est constatée lorsque tous les éléments de l'infraction sont réunis, soit au jour du décès, lesquels, dans la plupart des cas, sont intervenus après le 1er mars 1994. Or, cet arrêt de la chambre d'instruction n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation du parquet général puisque celui-ci présentait lui-même cette requête en annulation et a obtenu gain de cause. Les conséquences de cette décision sur les nombreuses instructions en cours au pôle santé publique du tribunal de grande instance de Paris relatives aux risques liés à l'exposition à l'amiante peuvent être importantes. Il m'apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que cette question - qui peut aboutir dans certains cas à l'absence de toute responsabilité pénale et constituer une non-réponse judiciaire -, soit tranchée par la chambre criminelle de la Cour de cassation. La solution serait de recourir au pourvoi dans l'intérêt de la loi qui, selon le code de procédure pénale peut être demandé par le ministre de la justice. M. le Président : C'est la première fois que cette notion de « pourvoi dans l'intérêt de la loi » est évoquée dans nos travaux. Pouvez-vous expliquer la procédure ? Mme Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY : Le ministre donne au procureur général de la Cour de cassation l'ordre d'effectuer un pourvoi dans l'intérêt de la loi pour que la Cour de cassation règle un problème juridique, alors que les délais sont forclos ; cette procédure est prévue dans le code de procédure pénale. M. le Président : A-t-elle déjà été utilisée ? Mme Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY : Bien sûr, mais j'ignore si le ministère voudra y recourir dans ce cas d'espèce. Pour répondre à une autre de vos questions relative à la saisine de la Cour de cassation dans l'affaire d'amiante de Dunkerque, si le parquet général a demandé la confirmation de l'arrêt de la chambre de l'instruction, il est logique qu'il ne se soit pas pourvu en cassation, puisque la Cour d'appel lui a donné raison. En revanche, s'il avait émis des réquisitions contraires, il aurait logiquement dû se pourvoir. Mais chaque procureur général peut avoir sa propre politique d'opportunité des pourvois. Le dossier de l'amiante est décidément un condensé de problèmes juridiques. Une saisine globale - qui ne peut être donnée que par le parquet - dans le dossier de l'amiante pourrait être envisagée car, en matière de santé publique, quel que soit le dossier, lorsque le juge d'instruction n'est saisi que des dossiers de certaines parties civiles, il ne peut instruire qu'à partir des éléments de ces dossiers, ce qui ne facilite pas son travail. M. Jacques Toubon, lorsqu'il était ministre de la justice, avait donné l'ordre au parquet, après une émission de télévision qui avait donné la parole aux victimes de l'hormone de croissance, de m'accorder la saisine globale sur cette affaire. C'est le seul dossier sur lequel j'ai pu travailler à partir de l'ensemble des victimes et mener ainsi des investigations générales sur toutes les victimes. M. le Président : Que pensez-vous, d'une part, de la révision de la loi du 10 juillet 2000, dite « loi Fauchon », et, d'autre part, de l'action pénale des victimes ? Mme Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY : Je dis toujours que la loi Fauchon constitue un obstacle supplémentaire en cas de lien indirect, dans la mesure où la faute simple était beaucoup plus facile à déterminer que la faute caractérisée avec la connaissance du risque. Cela dit, c'est une question de qualité d'investigations de l'instruction. Il faut préciser qu'avant son entrée en vigueur, on ne mettait pas en examen pour une « poussière » de faute ou une faute simple, parce que dans les délits non intentionnels, il faut toujours que la mise en examen repose sur des charges importantes, car toute la chaîne judiciaire doit confirmer la décision du juge de base. Or les obstacles sont nombreux : le juge d'instruction met en examen mais la chambre de l'instruction peut suivre la requête du parquet ou du mis en examen en annulation de cette mise en examen ; si le juge d'instruction renvoie devant le tribunal correctionnel, alors que le parquet a effectué des réquisitions de non-lieu - ou même si les réquisitions du parquet demandent le renvoi devant le tribunal -, la relaxe peut être prononcée par le tribunal correctionnel. La cour d'appel peut ensuite infirmer la condamnation prononcée par un tribunal correctionnel et, enfin, la Cour de cassation peut également casser une décision de condamnation de cour d'appel. Il faut donc que, lorsqu'elles existent, les fautes soient solidement établies sur le plan juridique au niveau de l'instruction Dans mes dossiers de responsabilité médicale, lorsque est mis en cause un chef de service d'hôpital, ou bien dans mes dossiers de santé publique, dans lesquels il y a nécessairement application - de cette loi - puisque le lien de causalité entre les fautes d'un décideur et le dommage est indirect, il est toujours moins difficile d'appliquer la 2ème partie du paragraphe de cette loi, c'est-à-dire « la faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité et qu'elle ne pouvait ignorer ». Cela d'autant plus que la chambre criminelle de la Cour de cassation n'a pas donné de définition de cette notion et s'en remet à l'appréciation retenue par la chambre de la cour d'appel ou de la chambre de l'instruction. Par contre, il est extrêmement difficile de caractériser la violation « manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » prévue dans la première partie de cette loi. À cet égard, une révision de cette loi réclamée par les associations me semble justifiée. M. le Président : Si je comprends bien, vos hésitations portent surtout sur la notion de violation « manifestement délibérée » ? Mme Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY : Oui, car il faut que la personne ait violé délibérément la loi, ce qui peut nécessiter des témoignages d'alerte sur sa violation et qui équivaut, alors, à presque transformer l'infraction non intentionnelle qu'est l'homicide involontaire - soit une négligence ou une imprudence grave - en infraction intentionnelle. Le deuxième paragraphe de l'article 121-3 du code pénal issu de la loi Fauchon, celui consacré à la faute caractérisée avec connaissance du risque, est effectivement moins difficile à appliquer. Je rappelle d'ailleurs qu'il procède d'un amendement et que si la loi Fauchon avait été votée sans cet amendement, elle aurait vraiment été inapplicable à toutes les affaires de santé. La première partie est selon moi très difficilement applicable à ces dossiers, ce qui peut être moins souvent le cas pour les accidents de la circulation ou les accidents du travail, car il y a de nombreuses réglementations spécifiques. L'application de cette loi est donc possible, à condition de disposer des moyens d'investigation nécessaires. Mais, si dans un dossier se trouvent à la fois des personnes ayant un lien direct et d'autres ayant un lien indirect, il est difficilement compréhensible qu'une personne physique, qui souvent constitue le dernier maillon de la chaîne - comme un chirurgien dans un dossier de responsabilité médicale -, soit mise en examen pour une faute simple, alors que le chef de service, qui a généralement un lien indirect avec le dommage, ne va pas être inquiété s'il a commis également une faute simple : c'est une inégalité difficile à admettre. M. le Président : Vous considérez donc que la loi Fauchon fonctionne mais appelle une amélioration ? Mme Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY : Il est vrai qu'il est plus facile, pour le juge d'instruction chargé d'une affaire de santé publique complexe, de conclure, en cas de lien indirect, à l'absence de faute caractérisée, que ce soit pour la responsabilité des décideurs publics ou pour celle d'un chef d'entreprise lorsqu'il a tout de même pris des mesures de protection de ses salariés : il peut alors prononcer le non-lieu sans aller plus loin dans ses investigations plutôt que le renvoi. C'est ce que je vois dans certains des dossiers récemment centralisés au pôle santé de Paris - sans parler précisément des dossiers d'amiante - et c'est pourquoi je souhaitais, depuis longtemps, la création de ce pôle santé pour une formation des juges d'instruction ainsi que des experts et des enquêteurs aux questions de santé publique ; nous en sommes encore bien loin. M. le Président : Que pensez-vous de l'action pénale des victimes et de la décision du Conseil constitutionnel à propos de l'indemnisation de victimes et de l'application de l'article 575 du code de procédure pénale par la Cour de cassation ? Mme Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY : Sur ce dernier point, la Cour de cassation n'a fait qu'appliquer la loi en se référant à l'article 575 du code de procédure pénale, qui établit une inégalité d'accès à la Cour de Cassation entre les parties civiles et les mis en examen. En réponse à la question de l'action pénale des victimes, je dirai que dans le domaine de la responsabilité médicale individuelle comme dans celui de la santé publique, les victimes qui attaquent au pénal sont motivées par la recherche de la vérité grâce aux pouvoirs d'investigations de la procédure pénale (perquisitions, saisies, commissions rogatoires). Ces dossiers sont complexes, mais voici les questions auxquelles les familles des victimes attendent une réponse : qui est responsable de la mort de mon mari ou de mon fils et pourquoi celle-ci n'a-t-elle pas été évitée ? Quels dysfonctionnements, à tous les niveaux, ont abouti au décès ? Au cours de l'instruction, nous menons un travail d'archiviste afin de rechercher tous les documents probants, en s'efforçant de suivre le cheminement de l'information du décideur pour découvrir le stade où a eu lieu le dysfonctionnement, ou la faute de non transmission, ou le retard de transmission des informations d'alertes sur le danger. Ce travail, qui nécessite parfois des perquisitions pour la recherche de ces documents et leur analyse méthodique, est très long et fastidieux. C'est identique pour tous les dossiers de santé publique. Il est d'ailleurs intéressant de noter que, dans cette affaire de l'amiante, la police et la gendarmerie travaillent ensemble, ce qui n'était pas évident à mettre en place. En réalité, l'indemnisation ne peut tenir lieu de justice Lorsque la perte est irréparable, comme le décès d'un proche, la justice, après les fonds d'indemnisation, a donc une place certaine, grâce à l'instruction qui peut faire la transparence sur la chaîne des causes ayant abouti aux dommages, même si aucun procès ne s'en suit, comme ce fut le cas pour le volet non ministériel du sang contaminé En effet, tout le travail que j'ai accompli sur le dossier du sang contaminé n'a finalement pas abouti à un procès, alors que la Cour de justice de la République, elle, a été saisie sur la base des documents saisis lors de mon instruction suivant le cheminement de l'information qui arrive ou non jusqu'au décideur. Il faut dire que la chaîne judiciaire, dans ce cas, a fonctionné de manière totalement inhabituelle. La chambre de l'instruction, saisie à la fin de l'instruction de l'affaire, a procédé à une première annulation. La Cour de cassation a cassé cette annulation et le non-lieu de la deuxième chambre de l'instruction, saisie après cette cassation, a ensuite été confirmé par la Cour de Cassation après ces quatre années de procédure. Mais tout ce travail a permis d'analyser les dysfonctionnements à la source des décès des hémophiles et transfusés. Or, au-delà de la vérité, les familles des victimes agissent également pour que le drame ne recommence pas. Cela peut s'appeler le « retour d'expérience ». Celui-ci s'est traduit, à la suite de toutes les affaires des années 80, par la création des agences de sécurité sanitaire, qui ont une vraie fonction de contrôle et de prévention. C'est la raison d'être du pénal dans ces constitutions de partie civile, car le civil a uniquement pour effet l'attribution d'une indemnisation. Le juge civil, contrairement au juge d'instruction, ne possède aucun pouvoir d'investigation. Il ne fait que recevoir les documents des avocats des deux parties. Lorsqu'il y a procès en cas de fautes pénales involontaires, celui-ci est une vraie réponse qui est donnée non seulement aux victimes elles-mêmes, mais aussi, de par la publicité des débats, à la société. La justice est souvent distributive de peines ou de dommages et intérêts, mais elle peut également avoir un rôle important de prévention pour éviter dans le futur que se reproduisent de tels drames, et un rôle de reconstruction pour les victimes. M. le Président : D'où la nécessité d'un procès au fond. Mme Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY : Absolument. Si les charges sont suffisantes et reçoivent une qualification juridique, le procès public permet que les choses y soient dites, avec la distance nécessaire et les débats contradictoires qui s'imposent. Et parfois, ils permettent le deuil. M. le Président : Les moyens de la justice, sur ce dossier, sont effectivement dérisoires, quel que soit le gouvernement. C'est d'autant plus grave que les problèmes de maladies professionnelles vont s'alourdir et deviendront de plus en plus difficiles à cerner. Par ailleurs, pour remonter aux sources, il faut bénéficier d'une certaine traçabilité des carrières ; or celles-ci sont fractionnées entre plusieurs sociétés et les entreprises elles-mêmes sont assurément plus évolutives qu'il y a dix ou vingt ans. Mme Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY : Au civil, une pondération pourrait être possible en fonction du temps passé par le salarié dans les différentes entreprises où il a travaillé - cela s'applique aux États-unis dans les affaires civiles - mais, au pénal, c'est beaucoup plus difficile car il faut établir un lien certain avec le dommage. Les victimes, lorsque leurs espoirs s'envolent, sont encore plus amères. Je voudrais ajouter à ce propos que le rapport de la mission d'information du Sénat, qui est très sévère à l'égard des décideurs publics concernant ce drame sanitaire, a été très médiatisé et tout le monde pense maintenant qu'il y a une responsabilité et une culpabilité des décideurs sanitaires, y compris à travers des personnes physiques. Mais c'est maintenant à la justice pénale d'en tirer les conséquences et la tâche me semble très difficile pour le pôle de santé publique. M. le Président : Je n'avais pas idée qu'un rapport parlementaire pouvait produire cet effet. Mme Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY : Quand le vôtre sera rendu public, ce sera la même chose. M. le Président : Le nôtre aura un poids encore plus lourd ! Mme Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY : Certainement ! Il est vrai que le rapport du Sénat a bien posé les problèmes, mais le public attend maintenant un procès pénal de l'amiante, qui lui parait inéluctable. Tout le poids de cette conviction et de cette attente du public repose sur l'instruction pénale. Je viens de vous exposer toutes les difficultés juridiques et matérielles de ce dossier. Et, selon moi, il serait bon que le public les connaisse également, grâce à votre propre rapport M. le Rapporteur : Vos propos sur les objectifs de la justice et sur la nécessité d'un fonctionnement serein de la justice, en dehors des pressions médiatiques ou associatives m'ont beaucoup intéressé. Le public est-il constitué par les victimes ou par les associations ? Nous recherchons la vérité sur l'amiante et sur le climat dans lequel, à une époque ancienne, des responsables ont œuvré, de bonne ou de mauvaise foi. Je dois dire que, sur plusieurs points, j'ai été amené à changer d'avis depuis le début de cette mission. Ce qui pouvait nous paraître évident, simple, voire simpliste, dans une vision un peu trop manichéenne, se trouve être en réalité bien plus complexe. J'attends, en particulier, avec intérêt l'analyse des procès-verbaux d'audition du Comité permanent amiante. Il serait un peu facile de traîner devant les tribunaux des agents de maîtrise ou des responsables d'entreprise de quatre-vingt-quatre ou quatre-vingt-cinq ans qui ont travaillé à une époque particulière ou l'État brillait par son absence. Mme Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY : Et qui sont parfois contaminés eux-mêmes. M. le Rapporteur : D'ailleurs, quand les victimes ou leurs familles, qui réclamaient le passage devant le pénal, ont réalisé qu'il s'agissait de mettre en cause des personnes avec qui ils avaient travaillé il y a trente ans, les choses se sont compliquées. La mission doit aider les médias à tendre à l'objectivité et à expliquer que le problème n'est pas simple. Cela contribuera peut-être à plus de sérénité. Mme Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY : Je dois dire que, depuis la demande du ministère de centraliser les affaires au pôle santé de Paris, certains dossiers y sont arrivés alors qu'ils étaient considérés comme terminés par les juges d'instruction, qui s'orientaient vers un non-lieu. Les parquets - ou la Cour de Cassation en cas de refus de se dessaisir du juge d'instruction - ont cependant décidé de les envoyer au pôle santé. On peut en déduire qu'il y a une volonté de traitement unique de ces procédures pouvant aboutir à la possibilité d'englober dans un procès unique - s'il est possible de les établir et si les personnes ne sont pas décédées - les responsabilités locales des directeurs d'usine, voire des personnes morales, et les responsabilités en matière d'absence ou de retard de réglementation. M. le Président : Nous en revenons à la nécessité de l'instruction au fond. Ensuite, il sera temps de prendre les bonnes décisions. Mme Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY : Il convient, en effet, de faire toute la transparence possible sur les circonstances dans lesquelles les décisions nécessaires de protection des personnes n'auraient pas été prises suffisamment tôt. M. Jean-Yves COUSIN : Certaines victimes recherchent effectivement la vérité. Même si cela doit se conclure par un non-lieu, elles désirent ce passage. Il n'en demeure pas moins qu'il est extrêmement difficile d'apporter la bonne réponse. Mme Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY : C'est une réponse qui leur ait donné en fonction de nos moyens, de la qualité de nos investigations et de l'application possible des qualifications pénales. Cette réponse est liée également à la qualité des expertises dans ce type de dossier. Nous disposons d'une liste d'experts judiciaires auprès de la cour d'appel ou de la Cour de cassation. Toutefois, dans des domaines spécifiques comme celui de la biochimie ou des nanotechnologies, nous n'en trouvons pas, alors que ce serait essentiel, par exemple, pour le syndrome de la guerre du Golfe. Une formation est nécessaire pour les juges et pour les magistrats du parquet, mais aussi pour les experts judiciaires médecins. Ces derniers savent parfaitement évaluer un préjudice et fixer une incapacité permanente ou temporaire de travail, mais sont moins à l'aise en matière de responsabilité médicale pour établir le lien entre la faute et le dommage. Pour les expertises du dossier de l'amiante, trois pneumologues seulement figurent sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, et dans la mesure où ils sont en activité, on ne peut pas leur imposer des délais trop courts. Si l'Assemblée nationale et le Sénat pouvaient contribuer à réduire les difficultés juridiques auxquelles se heurtent les dossiers de ce type au pénal lorsque c'est le choix des victimes, ce serait une grande avancée ! En effet, les délits non intentionnels de blessures involontaires ou homicides involontaires par imprudence ou négligence ne sont pas adaptés en l'état à la santé publique. Par ailleurs, il faut dire, même si en ce qui me concerne cela m'indiffère, qu'il est extrêmement mal perçu de mettre en examen un directeur de cabinet ou un directeur d'administration centrale, comme cela a été fait dans le dossier du sang contaminé : cela provoque un tollé général. Tout un chacun est pourtant responsable lorsqu'il apparaît dans une procédure qu'il a pu commettre des imprudences ou négligences ayant une conséquence, même non voulue, sur la vie d'autrui. Je me souviens, dans un tout autre domaine, celui des accidents de la route, du responsable d'un accident mortel qui s'étonnait sincèrement auprès de moi au moment de sa mise en examen d'être présenté à un juge d'instruction, sous prétexte qu'il était assuré et que son assurance réglerait les dommages aux orphelins. En résumé, ces délits non intentionnels ont été créés dans le code pénal pour s'appliquer à tout le monde car chacun est responsable de la vie des autres. M. le Rapporteur : Votre témoignage était particulièrement important car vous nous avez fait mesurer les difficultés de votre tâche. Cela devrait nous aider dans la rédaction de notre rapport. Mme Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY : Les parties civiles ne doivent évidemment pas diriger l'instruction, mais il convient au moins de leur ouvrir certaines portes restées jusqu'à présent fermées. Le travail du juge d'instruction est toujours très critiqué, mais peut-être le sera-t-il moins dans le cas de l'amiante car l'opinion publique comprend déjà que l'affaire peut relever du pénal. M. le Président : Je vous remercie pour ce témoignage tout à fait passionnant. Audition de Mme Emmanuelle PRADA-BORDENAVE, Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Je vous remercie de vous être rendue disponible pour cette réunion qui intervient dans le cadre d'une série d'auditions consacrées au volet juridique de l'affaire de l'amiante et, au-delà, au problème des responsabilités dans le domaine des risques sanitaires au travail. Vous avez été commissaire du Gouvernement dans l'affaire qui a conduit le Conseil d'État à retenir la responsabilité de l'État pour « carence fautive dans la prévention des risques liés à l'exposition aux poussières d'amiante » dans son arrêt du 3 mars 2004. Nous souhaiterions que vous nous commentiez cette décision et que vous nous aidiez à en tirer les conséquences. Quelle responsabilité pour l'État ? Quelle responsabilité pour les employeurs ? La Cour de cassation a, vous le savez, également reconnu la responsabilité des employeurs sur la base de la faute inexcusable et les victimes cherchent, par ailleurs, à obtenir une décision sur le plan pénal. La Cour vient de rejeter le pourvoi des victimes pour un problème de procédure pénale. Vous avez reçu une liste des questions que nous souhaitions voir aborder aujourd'hui, mais celle-ci n'a évidemment qu'une valeur indicative. Mme Emmanuelle PRADA-BORDENAVE : Je n'ai malheureusement pas eu le temps de répondre à votre questionnaire par écrit. Les deux premières questions ont trait à des informations statistiques qu'il suffit de demander au service de greffe ; je vous les communiquerai. Du reste, le Conseil d'État statue en cassation : depuis la condamnation de l'État en 2004, il est vraisemblable que les tribunaux administratifs ont été saisis d'autres actions en réparation, mais elles ne sont pas encore arrivées au stade de la cassation. Le Conseil d'État avait été saisi par les familles de quatre travailleurs décédés dont les deux premiers avaient été employés dans des usines de fabrication de produits à base d'amiante et les deux autres dans des secteurs non producteurs d'amiante, la chimie et l'industrie lourde, mais où ils étaient amenés à circuler et à travailler dans des locaux amiantés et à respirer des poussières issues de perçages ou de la dégradation de vieux flocages. Ces deux cas de figure ont amené le Conseil d'État à produire deux réponses différentes, selon qu'il s'agissait de MM. Thomas et Bourguignon, qui avaient travaillé dans la société Eternit, ou de MM. Botella et Xuereff, employés de Sollac et d'Atochem, qui sont tombés malades non parce qu'ils manipulaient de l'amiante, mais à cause de leur cadre de travail. Rappelons que le Conseil d'État est intervenu comme juge de cassation dans cette affaire, autrement dit sans remettre en question les appréciations de faits des juges du fond - en l'espèce, de la cour administrative d'appel de Marseille. C'est ce qui explique que les aspects de fait, longuement développés dans mes conclusions, apparaissent quelque peu en retrait dans la décision du Conseil d'État, lequel, en sa qualité de juge de cassation, s'est borné à donner quitus à la cour administrative, après avoir vérifié que celle-ci n'avait pas dénaturé les faits, sans entrer dans le détail des dossiers. De surcroît, le fait que le Conseil d'État ne soit pas juge du litige, mais de l'arrêt de la Cour aboutit à une rédaction un peu longue et embrouillée, sa décision portant sur des moyens de cassation qui n'intéressent personne - exception faite de la juridiction administrative. Pourquoi le Conseil d'État a-t-il finalement décidé de retenir la responsabilité de l'État ? Sur le fond, il a d'abord, me semble-t-il, été influencé par trois éléments de contexte propres à l'amiante. Le premier est le fait que l'amiante n'est pas un produit nouveau, mais un minerai naturel connu depuis la plus haute Antiquité, dont les exceptionnelles qualités de résistance au feu et à la traction ont été établies au moins dès le XIXème siècle et les dangers reconnus d'une façon assez certaine dès le début du XXème siècle. Cet élément spécifique à l'amiante a beaucoup influencé le Conseil d'État et répond par avance à la question d'un possible dérapage, par effet de capillarité, vers d'autres produits : l'amiante ne résulte pas d'une découverte de la science, d'une innovation de la chimie fine ou d'un processus nouveau ; c'est un produit naturel dont les caractéristiques et les dangers étaient connus de longue date. Le deuxième élément de contexte tient au fait que les maladies provoquées par l'amiante sont particulièrement graves. L'asbestose, si elle n'est pas mortelle, est une affection particulièrement invalidante ; le cancer et le mésothéliome sont, quant à eux, mortels. Autrement dit, ces pathologies ne se limitent pas à des irritations cutanées, des pertes de cheveux ou des problèmes ophtalmologiques comme peuvent en provoquer certaines substances chimiques : elles touchent réellement à la vie des travailleurs. Ces maladies graves sont également bien connues. Leur lien avec l'amiante n'a pas été découvert récemment : il est établi depuis longtemps. Dès 1906 avait été publié dans le bulletin de l'inspection du travail - autrement dit une revue officielle, diffusée à tous les services compétents - un article du docteur Auribault qui donnait une description très exacte du développement de la maladie, de ses effets et de la façon dont on la contracte, très révélatrice du contexte médical de l'époque, puisque l'auteur précisait qu'elle provoque « une phtisie spéciale ». En ces débuts du XXe siècle, la tuberculose sévissait partout, la silicose faisait rage dans les mines et les préoccupations de santé publique portaient essentiellement sur les maladies pulmonaires qui faisaient énormément de morts. Et le docteur Auribault de conclure cette étude très précise, effectuée à la suite d'une inspection dans une usine du Calvados, en soulignant que les effets de la fibre sont bien connus des hygiénistes des environs. Autrement dit, dès 1906, l'administration française savait de manière certaine qu'il existait une maladie très grave, comment on l'attrapait et comment elle développait ses effets, ce que plusieurs études ont confirmé par la suite : en 1930, une étude statistique à Lyon, elle aussi réalisée par les services administratifs, plusieurs travaux réalisés à l'étranger, au Royaume-Uni en 1950, en Afrique du Sud en 1960 et aux États-Unis en 1961. Le fait que le ministère du travail ait été prévenu depuis 1906 a constitué aux yeux du Conseil d'État un élément supplémentaire à prendre en compte. Qui plus est, ces affections ne se sont pas traduites par des cas isolés, mais bien par de véritables épidémies autour des usines concernées, où le nombre de décès de personnes encore jeunes s'est soudainement mis à augmenter. Dans les années 50, le mésothéliome ne représentait qu'un cas de décès sur un million ; peu à peu, on est arrivé à détecter presque un millier de mésothéliomes par an. Le troisième élément de contexte qui a influencé le Conseil d'État tient aux employeurs eux-mêmes et plus particulièrement au faible nombre des sites de production de produits amiantés. Imaginons, par exemple, que l'on découvre un problème dans les boulangeries ; ce pourrait être un casse-tête épouvantable dans la mesure où il en existe des milliers sur tout le territoire. Dans le cas de l'amiante, au contraire, les usines étaient certes assez disséminées, mais peu nombreuses. Une intervention des services du travail posait nettement moins de difficulté que s'il avait fallu visiter des centaines de petits ateliers disparates et dispersés. Quant au fondement juridique de la décision du Conseil d'État, il n'a rien d'innovant. La mise en cause de la responsabilité de l'État, est habituelle et ne posait aucune difficulté juridique sur le plan conceptuel. Le Conseil d'État considère depuis très longtemps que la responsabilité de l'État est engagée pour carence lorsque, en application d'une loi, il aurait dû prendre une réglementation et qu'il ne l'a pas fait. Une série de décisions plus ponctuelles, et moins solennelles, jalonne la construction de cette appréciation : ainsi, une décision de 1974 a retenu la carence d'un préfet qui ne réglemente pas l'activité d'un établissement industriel portant atteinte à l'environnement. Au moment de l'adoption des textes relatifs aux établissements dangereux, incommodes et insalubres, il avait été prévu que l'État devrait les surveiller et encadrer leur activité en prenant, si nécessaire, des décisions ponctuelles déterminant les conditions dans lesquelles l'industriel devrait fonctionner. Une décision de 1965 assimilait déjà l'inaction d'un préfet dans ce domaine à une faute engageant la responsabilité de l'État. Autrement dit, l'outil juridique utilisé par le Conseil d'État dans les affaires Botella et Xuereff n'a rien d'une innovation jurisprudentielle ; il est manié de façon très habituelle par les formations de jugement de la juridiction administrative. L'État a une obligation de réglementer, de même qu'il a une obligation de police. Dans le cas de l'amiante, on trouve un peu les deux : la réglementation du travail, mais également la police de prévention des risques sanitaires. Or, en droit français, la police est depuis très longtemps une activité obligatoire pour les pouvoirs publics, dont ils ne peuvent s'exonérer. L'État commet une faute qui engage sa responsabilité lorsqu'il tolère un comportement illégal et, a fortiori, lorsqu'il le connaît et l'autorise de manière implicite par ses carences. Le Conseil d'État ne s'est donc pas aventuré sur un terrain nouveau, contrairement à la Cour de cassation qui, elle, a opéré un véritable retournement de jurisprudence en redéfinissant, en 2002, la faute inexcusable dans le domaine des risques au travail. Loin de se lancer dans une avancée jurisprudentielle, le Conseil d'État s'est borné à utiliser des outils auxquels il recourt dans des affaires très ordinaires, à l'exemple de ce panier de basket qu'un maire avait installé dans sa commune sans penser à réglementer les horaires d'usage ; le voisinage s'étant plaint, et le maire n'ayant rien fait, la juridiction avait condamné celui-ci pour s'être exonéré d'une mission de police obligatoire. Les pouvoirs publics ne peuvent pas s'abstenir de prendre une décision de police lorsqu'elle apparaît nécessaire, qu'il s'agisse de préservation de la tranquillité publique ou de protection sanitaire. On relèvera également que, depuis la loi du 12 juin 1893 sur l'empoussièrement, le législateur a confié à l'État une mission de réglementation du travail pour prévenir les risques auxquels pouvaient être exposés les ouvriers. Les débats parlementaires de l'époque sont révélateurs d'une conviction : conscient du vide laissé par la disparition des corporations, mais également de la priorité limitée que les industriels, du fait de son coût, accorderaient à cette affaire, le législateur de 1893 a explicitement confié à l'État la mission d'imposer des mesures simples et de bon sens pour préserver la santé des travailleurs exposés à des risques nouveaux Ainsi ont été posés deux éléments fondateurs, qui resteront très longtemps intouchés dans notre législation jusqu'à très récemment : non seulement l'État a une obligation de réglementation des conditions de travail, mais il est également tenu de vérifier l'application de sa réglementation. Cette deuxième obligation avait déjà été explicitée par la loi de 1874 qui a créé un corps d'inspecteurs du travail, bras armé doté par les textes de pouvoirs considérables Cet élément d'ancienneté a beaucoup pesé dans le raisonnement du Conseil d'État. Il ne s'agissait pas d'un produit nouveau ni d'une découverte de la technologie ; il ne s'agissait pas d'une maladie nouvelle, qui, à l'instar du sida, aurait surgi dans une société totalement démunie ; il ne s'agissait pas d'une réglementation nouvelle tombée de Bruxelles et dont on se demandait comment l'appliquer, mais de textes très anciens exprimant une volonté très déterminée du législateur, et de surcroît accompagné de tous les instruments d'application nécessaires : l'inspection du travail, mais également tous les outils d'hygiène industrielle mis en place par le constituant, puis par le législateur après 1945. Ce « grand élan » de 1945, où a été réaffirmé le droit à la protection des travailleurs, s'est aussi traduit par la création des diverses instances de sécurité sociale censées les surveiller et faire remonter l'information pour mieux les protéger, et par la mise en place d'instituts de recherche et de surveillance de la santé publique, dont l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) découle directement. Face à ces obligations clairement définies par le législateur, le Conseil d'État a relevé deux carences, qui correspondent à deux populations de travailleurs, à deux périodes et donc à deux fautes relativement différentes. La faute commise à l'époque d'Eternit, c'est-à-dire durant la première période, ressort de la carence : l'État n'a pris aucune réglementation des usines d'amiante, alors même Or l'amiante n'a jamais, durant tout ce temps, fait l'objet d'une réglementation. Pourquoi ? On ne sait pas. Et pourtant, on savait depuis 1906 que l'amiante était dangereux et que l'on attrapait des maladies mortelles dans les usines. C'est ce « trou » étrange, cette absence de réglementation, alors même que le code du travail l'impose, que le Conseil d'État a considéré comme une faute. Durant la deuxième période, dite de l'usage contrôlé - à partir de 1977 -, l'amiante était soumis à réglementation. La France, comme d'autres pays d'Europe, a alors instauré une politique d'usage contrôlé de l'amiante qui imposait la mise en œuvre de technologies assez fines dans la mesure où la pureté de l'air dans les ateliers devait être surveillée par un système de microscopie à balayage. Huit heures par jour, un outil de mesure très fin vérifiait la teneur de l'air en fibres. Ce n'est évidemment pas cette réglementation que le Conseil d'État a jugée répréhensible, mais le fait qu'elle n'était applicable et appliquée que dans des ateliers manipulant de l'amiante, où le danger était donc connu. Eternit et Saint-Gobain ont mis en place ces dispositifs de mesure. Or, à côté des unités de fabrication, on voyait se développer un risque lié à l'amiante dans nombre d'autres endroits, jusque dans ce lycée de Gérardmer dont les professeurs ont été contaminés en respirant des fibres d'amiante tombées de vieux flocages. C'était précisément le cas de MM. Xuereff et Botella, qui avaient travaillé chez Sollac et Atochem. Jamais ces sociétés n'avaient songé à installer dans leurs couloirs des microscopes à balayage électronique pour surveiller la teneur en amiante de l'air respiré : cela ne leur était même jamais venu à l'esprit... La faute de l'État est donc de n'avoir pas vérifié que sa réglementation était appliquée là où elle aurait dû l'être et surtout si elle était adaptée à la réalité des risques : installer un microscope à balayage au beau milieu d'un pôle chimique traversé de tuyaux et de courants d'air dans tous les sens ne sert rigoureusement à rien, et pas davantage dans un garage où les ouvriers travaillent sur des plaquettes de frein : on sait désormais que le mésothéliome se contracte par une inhalation brutale de poussière d'amiante - en travaillant sur un matériau amianté, en perçant une cloison amiantée ou en évoluant sous un flocage dégradé, par exemple. Or l'État n'a jamais utilisé les moyens dont il disposait pour vérifier que la réglementation qu'il avait prise garantissait une protection suffisante des travailleurs. Il pouvait, pourtant, s'informer auprès des inspecteurs du travail et des Caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), chargées de centraliser les informations sur les accidents du travail et des maladies professionnelles et de les faire remonter à la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), afin que celle-ci diffuse les recommandations adéquates. Les maladies liées à l'amiante ont été inscrites au tableau des maladies professionnelles dès 1945, en 1950 pour l'asbestose, et le comité international du cancer a déclaré l'amiante matériau cancérigène en 1977. Autrement dit, lorsque les statistiques des maladies, systématiquement relevées par les CRAM, ont fait état de l'apparition, dans des endroits bizarres, de pathologies de type mésothéliome, on aurait logiquement dû s'interroger. Que des mésothéliomes surviennent autour des sites Eternit, on pouvait le comprendre ; mais que des cancers commencent à s'y développer dans des proportions importantes en prenant, qui plus est, des formes propres à l'amiante, voilà qui aurait logiquement dû alerter les autorités sanitaires sur la réalité des risques. Or cela n'a provoqué aucune réaction. Pourtant, les chiffres ont été relevés, les déclarations faites à la médecine du travail étant systématiquement reprises par les caisses et centralisées, via les caisses régionales, à la caisse nationale. L'outil d'information n'a pas fonctionné. Ce à quoi est venu s'ajouter le problème de la veille scientifique et du rôle du Comité permanent amiante (CPA) qui, en associant des savants de renom, a en quelque sorte déchargé nos instances scientifiques publiques de leur rôle de veille. Il s'en est suivi un curieux phénomène d'anesthésie, les chercheurs en laboratoire renonçant à travailler sur l'amiante au motif que M. Tartempion, illustre professeur de pneumologie et membre du CPA, s'en chargeait... Or le CPA a été délibérément endormi par les professionnels, tant et si bien que plus personne n'était au courant, au moment même où se développait en France une épidémie que tous les clignotants des caisses d'assurance maladie auraient dû mettre en évidence ! Le plus surprenant était que ces personnes étaient le plus souvent d'une totale bonne foi. Il y a bien eu, au début, des personnes de mauvaise foi qui ont sciemment manipulé le Comité permanent amiante ; mais au début des années 80, les gens de la rue n'avaient aucunement conscience des risques liés à l'amiante. Ils ne savaient pas, parce que la veille scientifique n'existait plus. Comment peut-on éviter que pareille catastrophe se reproduise ? Tout d'abord en mettant en place un dispositif de veille efficace. « Les statistiques, c'est assommant », me confiaient des inspecteurs du travail lors d'un colloque à Lyon ; sans doute, mais c'est à partir de la statistique que l'on met en évidence un problème de santé publique, que l'on peut s'interroger en repérant des évolutions étranges dans les causes de morbidité. La veille statistique médicale menée par les caisses d'assurance maladie doit faire l'objet d'une réelle attention des pouvoirs publics. Certes, il n'est peut-être pas très valorisant pour un chercheur, à l'époque de la biologie moléculaire, de s'échiner dans un laboratoire de l'INSERM à faire des cohortes sur les causes de morbidité en France. Sur ce point, notre pays est coupable de n'avoir pas suffisamment honoré les personnes qui s'occupaient de santé publique, pourtant considérée comme un problème majeur pendant toute la première moitié du XXème siècle - du temps où sévissait la tuberculose. Mais petit à petit, et jusqu'à l'épidémie de sida, les chercheurs en santé publique ont fait l'objet d'un relatif mépris. Si la veille permet de collecter l'information, il reste à la transformer et les structures de l'État ont à cet égard un rôle essentiel. À chaque fois que l'inspection du travail détecte dans une usine un dysfonctionnement au regard de la réglementation du travail, elle doit faire remonter l'information et le ministre doit, si besoin est, transformer cette information en réglementation. Ensuite, l'État ne peut pas édicter une réglementation, puis s'en désintéresser. Il est tenu d'en surveiller l'application et, si elle apparaît mauvaise ou inadéquate, la changer. Enfin, l'État a une responsabilité au niveau de l'information des travailleurs. Les textes prévoient explicitement que la réglementation sur l'hygiène au travail doit être affichée dans les locaux. Or les Français font preuve d'une certaine désinvolture dans ce domaine : pourquoi afficher la réglementation dans une cuisine, cela n'intéresse personne, etc. C'est une faute de laisser les travailleurs dans l'ignorance des risques, fût-ce contre leur gré. On doit les informer lors de l'embauche, sur les lieux de travail et lors des visites médicales. Tels sont les trois axes sur lesquels le Conseil d'État a jugé nécessaire d'appeler l'attention ; ils ne paraissent pas inaccessibles, ni très compliqués à mettre en œuvre. M. le Président : Votre démonstration est décidément d'une rigueur impressionnante... Elle n'en pose pas moins des problèmes difficiles dans la mesure où, au-delà de l'amiante, notre mission s'efforce de porter son regard sur l'évolution des accidents du travail, pour lesquels la relation de causalité est assez aisée à établir, et surtout sur le développement des maladies professionnelles pour lesquelles le lien de causalité est moins évident. Le principe de la responsabilité de l'État, que vous venez de traiter avec une grande clarté, implique que celui-ci se donne les moyens d'assumer ses obligations, ce qui n'est assurément pas le cas dans le domaine de la veille sanitaire. Si plusieurs décisions récentes vont dans le bon sens, comme le « Plan santé au travail », nous sommes encore loin du compte. Mais on ne saurait pour autant écarter la responsabilité des employeurs. Vous aviez, d'ailleurs, vous-même déclaré au Conseil d'État que la question des responsabilités respectives des employeurs et de l'État restait à venir et qu'elle serait probablement l'une des plus difficiles. Nous y sommes... Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Se pose également le problème de la prévention des risques liés aux produits nouveaux, en constante multiplication et qui, à la différence de l'amiante, ne sont pas toujours bien connus... Ce qui n'en facilite évidemment pas la prise en compte. Mme Emmanuelle PRADA-BORDENAVE : Certains ont parfois soutenu qu'il n'était finalement pas très bon que le Conseil d'État retienne la responsabilité de l'État, car cela risque de déresponsabiliser les employeurs qui ne manqueront pas de rejeter la faute sur l'État. Mais c'est inhérent au rôle de police et de régulation que celui-ci est tenu d'endosser dans notre pays. Prenons l'exemple du transport d'un détenu de la prison à l'hôpital. Supposons que, du fait d'un cafouillage à l'hôpital, celui-ci parvienne à prendre la poudre d'escampette et tue quelqu'un. Il y a dans cette affaire deux responsabilités : celle de l'État, coupable d'une négligence qui aura permis le meurtre ; mais également celle de l'évadé meurtrier, que le défaut de surveillance ne saurait atténuer de quelque façon. Personne n'aurait l'idée de l'exonérer de son crime au motif qu'il n'a pas été empêché de le commettre ! Ce raisonnement peut être tenu dans le cas de malades mentaux, dont la responsabilité est très atténuée, mais en aucun cas lorsque l'auteur d'une faute pénale ou civile est en pleine possession de ses moyens. Une entreprise comme Eternit connaissait parfaitement le matériau qu'elle employait et - les saisies et plusieurs procès aux États-Unis notamment l'ont prouvé - les risques auxquels elle exposait ses travailleurs. L'État n'a pas rempli son rôle à l'égard de ces entreprises : il y a eu peu de missions de l'inspection du travail, des rapports font état d'une médecine du travail particulièrement laxiste et nombre de documents photographiques montrent que ces usines étaient fort mal tenues, pour ne pas dire carrément immondes : l'amiante volait dans tous les locaux... Ces personnes étaient donc des délinquants et de surcroît n'appliquaient pas les dispositions générales du code du travail, lesquelles disposent que les ateliers doivent être maintenus en parfait état de propreté, avec ventilation et aspiration : le simple fait d'installer une hotte aurait considérablement amélioré les conditions de travail. Il faut, à ce propos, relever cette obsession de la poussière qui inspire le code du travail au tournant du siècle, directement liée à la silicose que l'on contractait dans les mines. On avait déjà parfaitement compris qu'il était malsain de respirer un air saturé de substances solides qui, par un processus encore mal connu, déclenchaient, à coup sûr, des maladies graves. Autrement dit, les dirigeants de ces usines dans lesquelles on fabriquait ou on manipulait un produit toxique - en l'espèce, l'amiante - et qui n'ont rien fait ne sauraient mettre en avant le défaut de surveillance de l'État pour minimiser leur responsabilité. Le Conseil d'État, en tout cas, ne le considère pas ainsi : car si l'on s'engageait dans cette voie, on hésiterait à punir les autorités publiques lorsque, par manque de courage, elles renoncent à user ou font mauvais usage des pouvoirs de police qu'elles sont tenues de mettre en œuvre pour préserver les citoyens. Le cas d'Atochem est différent. Lorsqu'on leur oppose la faute inexcusable de l'employeur devant les juridictions judiciaires, ces entreprises ont beau jeu de répondre qu'il leur était difficile d'être au courant, alors que l'État lui-même n'était pas capable de réglementer... La responsabilité de l'« employeur tiers » par rapport au produit peut effectivement être atténuée par le fait que l'État a failli à sa mission en n'appelant pas son attention sur ce point précis. Peut-être existe-t-il, dans ce cas, une possibilité, dans le cadre d'actions mutuelles, d'une répartition in fine de la charge de l'indemnisation de la victime. M. le Président : D'où la nécessité d'un procès au pénal, qui permettra de saisir les documents, de suivre l'enquête... Mme Emmanuelle PRADA-BORDENAVE : Je ne m'avancerai pas sur le terrain pénal. Je veux simplement insister sur le fait qu'à chaque fois que la puissance publique faillit à son obligation de prévenir un comportement délinquant ou dangereux, elle commet une faute. Mais cette faute de la puissance publique n'exonère pas, éventuellement devant d'autres juridictions, de l'appréciation fine de la responsabilité du tiers auteur. Il existe à ce propos un précédent jurisprudentiel assez parlant, même s'il fait sourire : l'affaire « Établissements Bichebois », du nom de l'exploitant d'un cinéma dont on venait de refaire la moquette. Or, dans le même temps, la commune venait de refaire le trottoir... Arrivent les spectateurs qui passent sur le goudron frais et entrent dans le cinéma : la moquette est fichue. Évidemment, ils auraient pu s'essuyer les pieds... Pour autant, le fait qu'ils aient été, par inattention, les vecteurs du dommage n'exonère en rien la responsabilité de la commune qui aurait dû prendre les précautions nécessaires. Cet exemple bénin montre qu'il peut y avoir une coexistence des responsabilités dont chacune doit être appréciée séparément, quitte à voir ensuite ce que l'on peut faire pour ce qui est des indemnités, de la charge ; mais il peut y avoir de la responsabilité à 200 %. M. le Rapporteur : Tout comme notre Président, je trouve votre exposé parfaitement clair : les mesures normales de lutte contre l'empoussièrement auraient normalement dû être prises, comme le préconisait l'inspecteur du travail Auribault dès 1906, après avoir établi la relation entre l'amiante et ce qu'il appelait une phtisie. Ces aspects de chronologie, d'antériorité des réglementations non respectées auront un rôle de premier plan dans la détermination de la responsabilité pénale. On a souvent insisté sur le fait que, durant toute la « première période », qui concerne les entreprises de fabrication ou de transformation de l'amiante, il n'existait aucune réglementation sur l'amiante. C'est oublier que l'on a interdit en 1965 de faire travailler les moins de dix-huit ans dans l'amiante... Mme Emmanuelle PRADA-BORDENAVE : Sans oublier la mise en place du registre spécial des mésothéliomes en 1968 : c'était bien prendre acte du développement de cette maladie, pratiquement inconnue en 1950. Or ce registre s'alimente des déclarations qui remontent des caisses, et peut-être plus d'une caisse que d'une autre. Les variations d'un endroit à un autre auraient dû amener à s'interroger. Or on ne l'a pas fait. On s'est borné à mettre en place un registre, sans se demander comment il était alimenté et sans en tirer les conséquences. M. le Président : Avez-vous en tête les chiffres de 1968 ? Mme Emmanuelle PRADA-BORDENAVE : Ils sont cités dans le rapport de l'INSERM. M. le Rapporteur : Vous avez dit, à propos de la période de l'usage contrôlé, qu'il y avait des gens de bonne foi et des gens de mauvaise foi. D'où vous vient cette impression ? Mme Emmanuelle PRADA-BORDENAVE : Il n'y a pas à faire preuve d'irénisme dans cette affaire : on ne peut nier le fait qu'il y ait eu une pression industrielle forte pour anesthésier tout le monde. Encore récemment, la France a été poursuivie devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour entrave à la liberté du commerce par le Canada, pour lequel l'interdiction de l'amiante n'était qu'une ruse grossière et n'avait d'autre objet que de l'empêcher de vendre ses produits. Autrement dit, les industriels continuent à faire pression dans certains pays pour continuer à fabriquer des produits amiantés. Il est à noter que les Canadiens avaient repris mot pour mot le raisonnement que tient la France lorsque les États-Unis veulent interdire les fromages non pasteurisés, et ont multiplié les articles virulents dans la presse pour défendre, comme la France son camembert, l'utilisation de l'amiante, décrit comme un matériau anodin nécessitant seulement quelques précautions. Et ils ont même failli gagner... Lorsque, dans les années 70, l'usage contrôlé de l'amiante a été mis en place en France, les personnes dont ce minerai était à la base de l'activité n'ont pas poussé, c'est le moins que l'on puisse dire, à des vérifications plus approfondies. Ils estimaient avoir fait un gros effort et il fallait surtout en rester là. M. le Président : Vous avez insisté sur le fait qu'Eternit avait une parfaite connaissance des risques... Mme Emmanuelle PRADA-BORDENAVE : En effet. La France a mis en place la politique de l'usage contrôlé à la fin des années 70. Mais aux États-Unis, le début des années 80 a été la période des grands procès de l'amiante : la presse en était remplie. Évidemment, Mme Tartempion ne lit pas la presse américaine mais d'autres ne s'en privent pas. Dans les universités américaines, les étudiants en droit travaillaient sur les décisions rendues par les juridictions : le cas des chaudronniers, notamment, était au cœur des procès. Il faut dire que les Américains se sont énormément servis de l'amiante, et plus tôt que nous. Logiquement, les procès sont arrivés plus tôt. L'amiante a été particulièrement utilisé durant la seconde guerre mondiale dans les véhicules, les chars, les navires... Tous les ouvriers ayant travaillé à la fabrication de matériels de guerre protégés par de l'amiante ont été concernés. D'où des procès énormes, que des industriels en France ne pouvaient pas ignorer. M. Frédéric REISS : Vous avez utilisé le mot « faute » un nombre impressionnant de fois, à propos de l'État, des entreprises, de l'inspection, du contrôle, etc. Que recouvre-t-il à votre sens ? Pour moi, il est lourd de conséquences. Cette faute est-elle réparable ? Mme Emmanuelle PRADA-BORDENAVE : La conséquence est que l'on va indemniser les familles des victimes ! La juridiction administrative a très tôt mis en place un système de responsabilité sans faute qui repose sur le principe de l'égalité de tous devant les charges publiques, alors même que la puissance publique est parfois amenée à faire des choses présentant davantage d'inconvénients pour certains que pour d'autres. On refait une rue, ce qui met en péril un commerce : personne n'a fait de faute, mais on l'indemnise. Mais prenant acte du caractère inégalitaire des rapports entre la puissance publique et les individus, et de la nécessité de faire prévaloir l'intérêt général sur les intérêts particuliers, le juge administratif reconnaît un droit à indemnisation au titre de ce que l'on appelle la responsabilité pour risques, pour cause de rupture d'égalité devant les charges publiques. Ce cadre juridique pourrait s'appliquer, par exemple, à un hôpital psychiatrique testant une méthode thérapeutique nouvelle qui laisserait davantage de liberté à un malade. Supposons qu'au cours d'une de ces sorties d'essai, le malade tue quelqu'un ou commette un acte grave. Les victimes seront évidemment indemnisées, non parce que l'hôpital aura mal fait, mais parce qu'il ne serait pas juste de ne pas indemniser les effets collatéraux d'une nouvelle thérapie. C'est une responsabilité sans faute : l'hôpital n'est pas fautif d'avoir laissé le malade sortir. Il essayait une thérapie nouvelle et il faut l'y encourager. Reste que cette thérapie a fait une victime, qu'il convient d'indemniser. Si l'on cherchait partout la faute pour indemniser les victimes, on briderait le service public et celui-ci n'avancerait plus. Or l'intérêt général exige que le service public avance, quitte à indemniser les éventuelles victimes de ces avancées. Dans le dossier de l'amiante, le Conseil d'État, et avant lui la cour administrative d'appel de Marseille et le tribunal, a voulu mettre l'accent sur le fait que l'on n'était précisément pas dans ce cadre juridique là. L'État français, d'ordinaire très interventionniste, s'était chargé de longue date d'une mission de réglementation et de surveillance de son application, d'autant que le préambule de la Constitution de 1946 proclame que la nation doit aux travailleurs la protection. Personne ne l'avait obligé à le dire ! Ce n'est du reste pas le cas dans tous les pays. Au cours d'un colloque à la Cour de cassation, nous avions rencontré un grand professeur de droit anglais, et un membre du Conseil d'État lui avait demandé s'il arrivait que la responsabilité de la Couronne fût recherchée. Il a mis beaucoup de temps à comprendre notre question avant de nous répondre que cela n'arrivait pas au Royaume-Uni. La Couronne ne pouvait être reconnue fautive qu'en tant qu'employeur ; pour le reste, elle n'était tenue à aucun rôle particulier en la matière. L'État français, tout au contraire, est par nature très interventionniste. La lecture des travaux préparatoire de la loi de 1893 est à cet égard parfaitement explicite : les travailleurs sont par essence démunis et l'État se doit de les protéger. Or on ne peut pas dire aux gens qu'on les protège et ne rien faire ; car les gens se croient protégés. Là est la faute. Non pas la faute de Mme Tartempion, mais la faute de l'État qui, par un choix politique délibéré, a décidé d'assumer une responsabilité particulière de réglementation et de surveillance de son application, mais n'a rien fait. Lorsque vous achetez un moulin à légumes, il est inscrit dessus « breveté SGDG », sans garantie du Gouvernement. Là, c'est l'inverse : il y a une garantie du Gouvernement. Et dès lors que celui-ci s'est engagé, ne rien faire est une faute. Les récents événements dans les banlieues sont là pour nous rappeler ce principe : quand l'État est chargé d'une mission de police, il est obligé de la remplir, il a une obligation de résultat. L'État doit au citoyen lambda la tranquillité, la sécurité, la salubrité. La puissance publique, parce que le Parlement en a décidé ainsi, doit apporter sa protection au travailleur. Si elle ne le fait pas, elle est en faute. Mme Catherine GÉNISSON : L'inscription en 2003 du principe de précaution dans la Constitution, sans autre déclinaison législative, n'est-elle pas de nature à remettre en cause le principe de la responsabilité sans faute ? Mme Emmanuelle PRADA-BORDENAVE : Nous nous sommes nous-mêmes posé la question. Il faut noter que le principe de précaution a déjà été inscrit en droit positif, dans le code de l'environnement. L'État doit l'avoir présent à l'esprit à chaque fois qu'il prend une décision en matière d'environnement ou d'installation classée. Cela dit, tout est affaire de curseur : ce serait également une faute de ne pas agir en arguant systématiquement du principe de précaution. Autrement dit, si, par peur qu'il puisse se produire quelque chose, l'État se ratatinait totalement, n'agissait plus, ne faisait plus avancer sa recherche, ce serait également une faute. M. le Président : Votre exemple de l'hôpital psychiatrique était particulièrement éclairant. On ne peut empêcher l'action publique de progresser. Mme Emmanuelle PRADA-BORDENAVE : C'est un souci très fort de la juridiction administrative. M. le Rapporteur : Vous avez fait remarquer que, durant la première période, le défaut d'inspection était d'autant plus coupable que, contrairement aux boulangeries, les sites de production ou de transformation d'amiante n'étaient pas très nombreux. L'inspection du travail peut difficilement se retrancher derrière le manque de moyens : c'était bel et bien un problème de priorités. Les entreprises à contrôler devaient se compter sur les doigts des deux mains... Mme Emmanuelle PRADA-BORDENAVE : La convention de l'Organisation internationale du travail (OIT) pose, certes, le principe de l'indépendance des inspecteurs du travail, mais insiste sur le fait qu'ils doivent être rattachés directement au ministre et que celui-ci doit pouvoir leur donner des orientations fortes de contrôle. Afin que l'action des inspecteurs sur le terrain ne soit par trop systématique et aveugle, il revient au Gouvernement d'orienter leur action sur un secteur donné, dès lors qu'il pressent un risque précis. M. le Rapporteur : Croyez bien qu'il va nous falloir rappeler ce principe. On présente souvent les inspecteurs du travail comme totalement autonomes ; en fait, la loi prévoit bien que le Gouvernement doit fixer des priorités, des axes, des cadrages et des urgences. Mme Emmanuelle PRADA-BORDENAVE : C'est effectivement prévu par la loi française, mais également par la convention internationale, et l'OIT y insiste beaucoup. Cela ne peut que renforcer la légitimité de l'inspecteur du travail, surtout lorsqu'il se fait accueillir à coups de fusil... M. Gérard BAPT : C'est finalement depuis le sida que les premiers réseaux de surveillance ont été mis en place, et depuis la canicule que l'Institut de veille sanitaire (IVS) et les Centres internationaux de recherche (CIR) ont été activés, que l'on tente de raccourcir le délai de traitement des certificats de décès, que les services d'urgences de certains hôpitaux notent systématiquement les motifs d'entrée... Mme Emmanuelle PRADA-BORDENAVE : On savait déjà que ce n'était pas bien de ne pas le faire... Je me souviens en tout cas qu'à l'INSERM, on prenait peu à peu conscience de l'utilité de ces procédures. M. le Président : Il ne nous reste plus qu'à vous remercier, Madame, de cet échange et de votre remarquable exposé. Audition conjointe de Maîtres Michel LEDOUX Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Maître Ledoux, nous vous remercions de vous être rendu à notre invitation, en dépit de ce retard sans doute lié à un défaut de communication. Aussi allons-nous grouper votre audition avec celle de Me Teissonnière, lorsqu'il arrivera. Après vous avoir entendu le 9 novembre dernier sur l'aspect civil de la prise en charge des victimes de l'amiante, nous abordons le volet pénal de ce dossier. Nous avons déjà entendu le sénateur Fauchon hier et, ce matin même, Mme Prada-Bordenave dont vous connaissez sans doute l'excellent mémoire devant le Conseil d'État. M. Michel LEDOUX : C'est le meilleur travail jamais réalisé sur la question. M. le Président : Nous avons évoqué hier l'éventualité d'une révision de la loi Fauchon. À supposer qu'elle soit possible et nécessaire, elle ne serait, de toutes façons, pas rétroactive. Quel est votre sentiment sur l'issue d'un procès pénal sur l'amiante ? La Cour de cassation a rendu sa décision... M. Michel LEDOUX : Prévisible, et regrettable car elle n'a pas pu se prononcer sur le fond. M. le Président : Elle-même semble, d'ailleurs, regretter sa décision qui s'est fondée, on le sait, sur des éléments de procédure. Mais la nécessité d'un procès au pénal n'en est que plus évidente. M. Michel LEDOUX : Le plus choquant à mes yeux n'est pas tant l'absence de procès que l'absence d'instruction. M. le Président : Je suis parfaitement d'accord. Mais qui dit procès dit instruction. M. Michel LEDOUX : En effet. Il ne nous appartient pas, ni à vous, de dire si quelqu'un mérite une condamnation. En revanche, compte tenu de ce que nous en savons depuis maintenant une dizaine d'années, il y a tout lieu de s'étonner que personne n'ait rien fait, du côté des parquets et des procureurs de la République, pour que cette affaire fasse l'objet d'une enquête et d'une instruction approfondies. La loi Fauchon ne constitue pas à mon avis un obstacle infranchissable dans l'affaire de l'amiante, même si elle nous complique quand même un peu la tâche parce qu'elle exige une enquête encore plus approfondie qu'auparavant pour établir la « faute caractérisée ». Or, dans une affaire de santé publique, les auteurs, tout au moins les plus intéressants, ne peuvent être qu'indirects et la multiplicité des responsables potentiels impose une enquête phénoménale, ce qui suppose tout à la fois des moyens en proportion et, de la part des parquets et des procureurs, une réelle volonté d'agir, ce qui n'est pas le cas. L'irrecevabilité du pourvoi en cassation reflète, du reste, parfaitement l'état d'esprit des procureurs de la République, au moins jusqu'en juin 2004, puisque celui de Douai n'a pas jugé utile de former un recours en cassation, ce qui a conduit à l'arrêt du 15 novembre dernier. Me Teissonnière pourra témoigner qu'à Valenciennes, le procureur lui-même avait entrepris, à l'audience, de nous expliquer pendant une heure qu'Eternit n'avait pas commis de faute inexcusable de l'employeur... Et dans une autre affaire à Douai, dans laquelle une entreprise était poursuivie pour mise en danger de la vie d'autrui, le procureur expliquait, en audience publique, que l'amiante n'avait qu'un effet modeste sur la santé, mais surtout un effet médiatique très fort... Et de requérir la relaxe pour l'employeur, lequel était reparti sous les acclamations du tribunal ! Tout cela ne remonte guère qu'à trois ou quatre ans... Pour résumer : la loi Fauchon, si elle ne pose pas de problèmes du point de vue théorique, pose donc des difficultés supplémentaires car elle impose des investigations poussées, ce qui suppose une volonté politique claire du côté du ministère de la justice. Celui-ci doit donner aux procureurs des instructions fermes leur enjoignant de s'intéresser à l'affaire de l'amiante, et aux nouveaux pôles de santé publique les moyens matériels appropriés. M. le Président : Une volonté claire et des instructions aux parquets... Pouvez-vous préciser ? M. Michel LEDOUX : De la même façon que l'on poursuit le moindre étudiant qui télécharge dans des conditions irrégulières sur Internet, les procureurs de la République doivent être appelés à ouvrir des informations judiciaires sur toute affaire ayant trait à l'amiante, y compris, et surtout, les affaires d'actualité : on sait que 67 % des chantiers de désamiantage - 76 % l'an passé - sont conduits sans respecter les règles de sécurité... Si l'on est capable de produire des chiffres, c'est bien qu'on les a repérées ! Ne pas respecter les règles de sécurité en matière de désamiantage revient à faire courir aux salariés des risques évidents pour les vingt ou trente ans qui viennent. Qui poursuit les employeurs qui font désamianter des locaux dans les conditions de rusticité dignes des plages indiennes ? Personne ! Par « volonté claire » du ministère de la justice, j'entends des instructions précises et un suivi attentif des affaires d'actualité liées à l'amiante, dont les procureurs se désintéressaient totalement jusqu'à ces dernières semaines : nous verrons si les choses ont évolué à l'occasion du prochain procès d'Alstom à Lille, pour mise en danger de la vie d'autrui. Reste que depuis dix ans, je vois toujours les procureurs de la République nous regarder avec un petit sourire en coin : « L'affaire de l'amiante, c'est bien gentil, à la rigueur c'est de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, mais ne venez pas me parler de droit pénal ! » Voilà ce qu'était la situation, et probablement encore aujourd'hui. Avec des moyens et une volonté politique, nous aurons une instruction, des enquêtes. Pour ce qui est du procès, nous y reviendrons car il y a des difficultés juridiques. La loi Fauchon exige que l'on démontre l'existence d'une faute caractérisée. Il est normal, et même juste, que le législateur l'ait prévu car cela impose que l'enquête soit sérieuse, l'instruction précise et la faute précisément établie. Mais on devrait l'exiger pour les auteurs indirects comme pour les auteurs directs : le pénal est une affaire grave et prouver la faute caractérisée de celui que l'on veut faire condamner pour un délit non intentionnel me paraît un minimum. Le problème est que la loi Fauchon établit une distinction entre les auteurs directs et indirects, ce qui est un contresens total. Notre code pénal, en particulier pour ce qui touche aux délits non intentionnels, a été conçu pour les accidents de diligence ou de voiture, alors que les catastrophes sanitaires résultent le plus souvent de fautes collectives où entrent en jeu tant les mauvaises décisions que l'absence de décision ou les conditions économiques ou organisationnelles créées par certains. En matière de santé publique, notamment mais pas seulement, les auteurs indirects sont ceux qui peuvent faire le plus de bien comme le plus de mal. On l'a vu dans le domaine du risque routier lorsqu'on a décidé de sanctionner davantage les automobilistes en excès de vitesse : les accidents de la circulation ont considérablement baissé, tout simplement parce que les auteurs indirects ont fait leur travail. Le contre-exemple parfait est l'affaire de l'amiante, parce qu'ils n'ont rien fait. Ce sont ceux qui peuvent faire le plus de mal, qui se retrouvent paradoxalement protégés par la loi Fauchon. Dans le monde complexe qui est le nôtre, il faudrait donc cesser de distinguer entre auteurs directs et auteurs indirects. Tous les auteurs d'une infraction - et surtout, en matière de santé publique, les auteurs indirects - devraient être en mesure de répondre, de s'expliquer et, le cas échéant, d'être condamnés. M. le Président : Mais si le lien de causalité, en matière d'accidents du travail, est indiscutable, il n'en est pas de même dans le cas de maladies professionnelles. M. Michel LEDOUX : La difficulté, avec l'amiante, sera effectivement de faire le lien entre telle maladie de telle personne et telle faute de telle autre. Même s'il n'est pas insurmontable, c'est un vrai problème, ne serait-ce qu'en raison du décalage entre l'exposition au risque et l'apparition de la maladie : l'exposition à l'amiante aura pu durer quinze ans, dix chefs d'établissement auront pu se succéder, la technostructure politique et administrative de l'entreprise aura évolué et il ne sera pas facile de dire qui est à l'origine du mésothéliome de M. Dupond - à moins que la Cour de cassation ne rende ce lien moins exigeant. Mais si l'on persiste à distinguer la causalité directe et la causalité indirecte, on ne fera qu'inciter les tribunaux à condamner les lampistes. Le sénateur Fauchon soutient que sa loi n'a rien changé à la répression pénale. C'est faux, comme en témoignent les chiffres du ministère du travail : le nombre de condamnations de responsables d'entreprises - personnes physiques - pour délits non intentionnels est passé de 732 en 1997 à 472 en 2003... Autrement dit, la loi Fauchon, en termes de répression des manquements en matière d'hygiène et de sécurité au travail, a fait baisser de moitié le nombre de condamnations. Je ne suis pas un fanatique des condamnations en matière pénale, mais force est d'admettre que ces chiffres ont un sens ! Alors que le nombre de condamnations a largement augmenté dans le domaine du risque routier, il est pratiquement divisé par deux dans celui de l'hygiène et de la sécurité. Cela signifie que la répression pénale ne joue pas son rôle. En pratique, ce sont les personnes morales qui sont condamnées. En effet, elles ne sont pas soumises à la loi du 10 juillet 2000 et, comme la moindre petite faute engage leur responsabilité, ce sont elles qui sont sanctionnées et non plus les personnes physiques. Mais la condamnation d'une entreprise à 15 000 euros d'amende n'a rien à voir avec la sanction d'une personne physique. Au sein de l'entreprise, tout le monde est content, parce que les cadres ne sont pas envoyés devant le tribunal correctionnel et parce que l'amende, en passant dans les charges, ne sera payée par personne ... Mais, tout l'effet d'exemplarité et de prévention des risques sera réduit à néant. (M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE est introduit.) M. le Président : Maître Teissonnière, vous êtes à l'heure, alors que votre confrère Ledoux était en retard, mais la faute n'était pas intentionnelle... Cette circonstance imprévue rendra d'ailleurs cette audition encore plus intéressante. Nous nous posions à l'instant la question de l'opportunité d'une révision de la loi Fauchon après être convenus de la nécessité d'une procédure pénale qui permette enfin une enquête et une instruction sérieuses, alors que le parquet n'a jamais, à ce jour, diligenté la moindre action. Nous abordions la distinction entre causalité directe et indirecte. M. Michel LEDOUX : Pour résumer, j'expliquais que le problème posé par la loi Fauchon tenait moins à la reconnaissance de la faute caractérisée qu'à la distinction, peu judicieuse, entre les responsabilités directes et indirectes. À entendre le sénateur Fauchon, le procès du tunnel du Mont-Blanc montrerait que sa loi n'empêchait aucunement les poursuites pénales. En réalité, outre le fait que cette affaire a bénéficié de moyens considérables - le juge d'instruction de Bonneville a été détaché sur ce seul dossier pendant pratiquement deux ans - et du total soutien du parquet, on a trouvé des fautes caractérisées absolument partout, que le tribunal a classées en fonction de la chronologie : fautes indirectes avant l'incendie, fautes directes à partir de l'incendie. Ce n'est pas le même type d'affaire que celle de l'amiante. Le problème de la loi Fauchon vient de cette distinction entre auteurs directs et auteurs indirects. En santé publique, c'est chez les auteurs indirects que les responsabilités sont les plus nombreuses et les plus engagées. Or, en France, plus on est nombreux à s'être trompés, plus la faute a tendance à disparaître... Lorsqu'on est tout seul à se tromper, on est mort. Lorsqu'on est à cinquante, c'est déjà mieux ; à mille, on peut être tranquille, tout se dilue dans la masse ! C'est d'ailleurs le seul risque de la faute caractérisée : si les auteurs sont trop nombreux, chacun aura beau jeu de dire que ce n'est pas lui, mais l'autre. Il n'y a plus de faute lourde et caractérisée, seulement des erreurs d'appréciation... C'est du reste ce que Me Plichon n'a pas manqué de plaider au moment où nous avons attaqué les employeurs en faute inexcusable. Mais la distinction entre causalités directe et indirecte va, je le répète, à contresens de l'évolution de notre société. De nos jours, comme je l'ai déjà dit, ce sont les auteurs directs qui peuvent faire le plus de bien comme le plus de mal. Prenons un exemple banal dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité. Un donneur d'ouvrage demande à une entreprise de construire un immeuble. Et comme font tous les donneurs d'ouvrage - surtout s'ils sont publics -, il choisira l'entreprise la moins disante et le responsable des achats négociera pour tirer encore sur les prix. Une entreprise prendra le marché, mais sous-traitera, comme tout le monde fait aujourd'hui ; et tout au bas de l'échelle, on trouvera un petit artisan et son ouvrier. Cet artisan, qui aura tiré ses prix au maximum, devra gratter pour tirer un centime de bénéfice et, comme d'habitude, il le fera sur la sécurité. Arrive l'accident, l'ouvrier tombe et se tue. Avec la loi Fauchon, l'auteur direct est indiscutablement le petit artisan qui sera condamné sans l'ombre d'une hésitation. L'auteur indirect, ce pourra être le gros promoteur qui aura voulu dépenser le moins d'argent possible. Mais qui est véritablement à l'origine de la mort de l'ouvrier ? Le petit artisan noyé dans les soucis ou bien celui qui a créé les conditions économiques de l'accident ? Je suis désolé pour le sénateur Fauchon, mais l'artisan sera condamné et le promoteur relaxé - il ne sera même pas poursuivi. C'est cela qui devient de plus en plus intolérable en 2005 et c'est en cela que la loi Fauchon va à contresens de ce qu'il faudrait faire. C'est une loi du XIXe siècle. L'affaire de l'amiante illustre, à l'évidence, les problèmes que posera la loi Fauchon. Certes, des personnes morales sont mises en examen et condamnées mais une personne morale, c'est... personne ! D'ailleurs, au début, nombre de parquetiers refusaient pour cette raison de les poursuivre : ce n'est pas l'entreprise qui prend la décision, mais bien le chef d'entreprise. La loi du 10 juillet 2000 pose un réel problème du point de vue de l'exemplarité de la peine. On poursuit de plus en plus souvent les automobilistes, mais de moins en moins souvent les chefs d'entreprises. C'est bien la preuve qu'il y a deux poids deux mesures, et que l'hygiène et la sécurité au travail n'intéressent guère. M. le Président : Et le lien de causalité sera d'autant plus complexe à établir que le problème, à côté des accidents du travail, sera de plus en plus celui des maladies professionnelles. M. Michel LEDOUX : Encore plus, par le fait que la maladie n'a pas de date certaine. M. le Président : Il faudra compter avec la nature des produits, le parcours professionnel du salarié,... M. Michel LEDOUX : Et surtout l'impossibilité de déterminer la date précise de contamination. Dès lors, toute la difficulté sera d'établir, au terme d'une enquête suffisamment précise, le lien de causalité entre la contamination et l'existence d'une faute caractérisée suffisamment précise. Peut-être conviendra-t-il de trouver une solution sur le terrain législatif, car il sera pratiquement impossible de poursuivre les infractions en matière de contamination, professionnelle ou pas. M. le Président : Les débats autour du programme européen REACH illustrent parfaitement cette problématique. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Je partage l'appréciation de mon confrère. J'ai pour ma part été particulièrement choqué par l'attitude des parquets : ainsi, à Mâcon, en plein débat sur la faute inexcusable, le parquet est intervenu contre tous les usages pour nous dire que nous nous trompions de procès, le procureur de la République allant jusqu'à prendre la défense d'Éternit ! Ces interventions actives dans un premier temps, puis l'inertie qui a suivi, alors que des fautes d'une extrême gravité étaient de plus en plus souvent caractérisées devant les juridictions civiles, ont scandalisé les victimes et leurs défenseurs. Le débat suscité par la loi Fauchon m'a paru légitime. Un colloque était organisé la semaine dernière à la Cour de cassation sur les incertitudes de la causalité, qui affectent tant notre droit civil que notre droit pénal. La Cour n'a, du reste, jamais tranché entre les deux grandes écoles : la théorie de la causalité adéquate, où l'on fait le tri entre les causalités pour trouver celle dont la mise en évidence apparaît la plus utile et la plus pertinente, et la théorie de l'équivalence des conditions, où toutes les causes nécessaires à l'apparition du dommage sont retenues comme d'égale valeur. Bien que l'on ait du mal à retrouver dans la jurisprudence de la Cour de cassation une référence à l'une de ces deux théories, les juristes s'accordent à admettre que le droit français est plus proche de la théorie de l'équivalence des conditions. Celle-ci n'est pas sans avantages, sur le plan civil en particulier, dans la mesure où elle permet de rattacher beaucoup plus facilement un dommage à un responsable et donc d'indemniser les victimes. Je suis donc un partisan, sans nuance, de l'équivalence des conditions en matière de responsabilité civile. Dans le domaine de la responsabilité pénale, en revanche, la possibilité de rattacher un dommage à une multitude de causalités et donc de responsabilités peut aboutir, par un effet pervers, à une dilution, et parfois à la disparition de la responsabilité - d'où le discours tenu par les employeurs auquel faisait allusion Michel Ledoux, d'autant que l'État figure parmi les responsables. Si, sur le plan pénal, le débat me paraissait donc légitime, la solution me semble mauvaise. Dans l'affaire du tunnel du Mont Blanc, les juges ont d'ailleurs tenté d'échafauder une théorie permettant de différencier la responsabilité directe et la responsabilité indirecte en recourant à la proximité temporelle... Ceux qui ont pris des décisions ou sont intervenus à partir du moment où le premier camion a pris feu sont des auteurs directs et ceux qui sont intervenus avant des auteurs indirects. Pourquoi pas ? Peut-être était-ce, dans le cas d'espèce, la meilleure façon de traiter le problème. Mais dans les affaires qui nous préoccupent - contaminations, irradiations, intoxications - et dont les effets se déclarent dix, vingt ou trente ans après l'exposition au risque, la loi pose d'énormes difficultés. Je serais, pour ma part, tenté de distinguer les auteurs des infractions entre auteurs intellectuels et matériels ; et dans le domaine des risques au travail, les premiers, c'est-à-dire ceux qui prennent les décisions, sont les principaux responsables. À l'inverse, la distinction entre auteurs directs et indirects risque d'aboutir à ne condamner que les lampistes et en aucune manière le principal responsable. Prenez le cas de cet accident survenu à Toul où une grue s'était effondrée sur une école, tuant plusieurs jeunes filles dans la cour. Le vent soufflait très fort, mais, pour des raisons économiques, il n'était pas question d'interrompre le chantier. Le grutier refuse de monter dans sa grue à cause du vent. On l'y oblige, sous peine de le renvoyer ; il monte, la grue tombe, il échappe par miracle à la mort, et se retrouve condamné comme auteur direct au même titre que celui qui l'a contraint à monter ! La loi Fauchon, précisons-le, n'était pas encore adoptée, mais on s'était fondé sur les mêmes critères, et l'on voit bien qu'ils ne sont pas pertinents au regard de telles situations. M. Michel LEDOUX : Ajoutons que les critères de la loi Fauchon ont été conçus pour les décideurs publics, les maires des communes. C'est à eux que vous avez pensé en la votant, et c'était parfaitement légitime. À ceci près que la loi Fauchon s'applique à tout le monde - on imagine le tollé que provoquerait une loi qui traiterait différemment les décideurs publics et les décideurs privés. Dans l'accident de Toul, le grutier - intérimaire -, a été mis sur le même pied que le chef de chantier qui l'a menacé de le licencier s'il ne montait pas. Or le responsable dans cette affaire est bien celui que Jean-Paul Teissonnière appelle l'auteur intellectuel, ou économique. M. le Président : Pour vous, le problème posé par la loi Fauchon est donc d'abord celui du lien de causalité indirecte et non celui de la faute caractérisée ? M. Michel LEDOUX : En effet. Et la faute caractérisée devrait être exigée pour tout le monde M. le Président : Il s'ensuit une dilution entre un très grand nombre d'auteurs plus ou moins concernés, au point que, tout le monde étant coupable, plus personne ne l'est. M. Michel LEDOUX : Et c'est d'autant plus irrationnel que le juge pénal ne doit pas trier par rapport aux causalités, mais par rapport à la gravité de la faute et à son importance dans le processus accidentel. Le petit grutier qui a peur de perdre son emploi et qui a deux enfants à nourrir ne commet pas la même faute que le patron qui forcera son service achats à négocier au plus juste les rémunérations de ses sous-traitants. On ne peut plus considérer en 2005 que ces deux fautes sont de la même gravité. La faute lourde, grave, a toujours gouverné le droit pénal. C'est cela qui devrait gouverner la détermination de la responsabilité, et non le caractère direct ou indirect. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Sans doute conviendrait-il également de resituer la responsabilité des chefs d'entreprise dans un cadre qui n'est pas neutre, celui de relations hiérarchiques profondément inégales entre employeurs et salariés : la situation n'est pas exactement celle des décideurs publics par rapport aux usagers de services publics au regard des mesures de sécurité. En matière d'hygiène et de sécurité, la principale institution de santé au travail, aux termes du code du travail, reste l'employeur. C'est à lui qu'il appartient d'évaluer les risques et de prendre les mesures adéquates. Un des acteurs se retrouve investi d'un pouvoir qui doit avoir sa contrepartie en termes de responsabilité. Votre questionnaire est à cet égard des plus pertinents... M. le Président : Nous allons donc nous y référer. M. Michel LEDOUX : Pourquoi les parquets instruisent-ils si peu ou si mal les dossiers liés à l'amiante ? Nous en avons déjà parlé... Il faudrait le leur demander ! M. le Président : Nous le ferons. M. Michel LEDOUX : Nous pensons pour notre part que le problème de la santé au travail de la France « d'en bas », celle des usines, n'intéresse personne. Ce n'est pas spectaculaire. Le sort de ces braves gens, qui restent discrets, qui ne détournent pas des ferries pour aller en Corse, n'intéresse personne et sûrement pas les procureurs. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de dégâts pour que la santé au travail suscite un début d'intérêt. M. le Président : Le regroupement des dossiers de l'amiante auprès du pôle de santé publique de Paris pourrait-il améliorer leur instruction ? M. Michel LEDOUX : A priori oui, s'il y a les moyens. M. le Président : Je souligne le « a priori », et même trois fois. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : J'avais noté en marge du questionnaire : « oui, hélas ! » en pensant, entre autres, aux victimes d'Amisol dont le dossier est toujours traité à Clermont-Ferrand. En fait, un procès pénal prend son véritable sens lorsqu'il n'est pas délocalisé. Je suis par principe attaché à ce que les dossiers soient jugés là où les faits se sont produits. Mais indiscutablement, la lourdeur et la complexité des dossiers de l'amiante rendaient nécessaire un regroupement auprès du pôle de santé publique. M. le Président : À condition que celui-ci ait les moyens de son action, ce qui n'est assurément pas le cas. M. Michel LEDOUX : C'est objectivement une réalité ! M. le Rapporteur : Les moyens et l'esprit... M. Michel LEDOUX : Y compris l'esprit d'équipe ! M. le Rapporteur : Si le pôle de santé publique reste dans cette capacité/incapacité de fonctionner, on court au massacre du procès de l'amiante. M. le Président : La volonté est très forte, mais cela ne suffit pas ! Pourquoi le ministère public ne s'est pas lui-même pourvu en cassation ? M. Michel LEDOUX : Comme cela a été dit, le parquet de Douai avait demandé la confirmation du non-lieu devant la cour d'appel. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Le ministère public était cohérent, à l'époque, avec la position que nous dénoncions tout à l'heure ; c'est tout récemment qu'il a changé de position. M. Michel LEDOUX : À l'été 2004 encore, tous les procureurs de France considéraient que l'affaire de l'amiante n'était pas une affaire pénale. La sixième question évoque l'autre alternative offerte par la loi du 10 juillet 2000, très peu utilisée dans les faits : la violation « de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité ». Cela vise le cas où un comportement révèle non plus une simple indifférence à la norme sociale, mais une franche hostilité à une règle connue. Les condamnations prononcées au titre de cette « première branche » ont été relativement rares, par exemple, à l'encontre de skieurs qui persistaient à faire du ski hors pistes en amont des pistes ouvertes, alors même qu'un arrêté du maire l'interdisait expressément et qu'ils mettaient en danger la vie d'autrui. Un employeur qui connaît la règle et qui met sciemment en danger la vie de ses salariés, ce n'est tout de même pas le cas général. Il s'agit plus souvent d'une délinquance de l'indifférence que d'une délinquance de l'intention, infiniment plus rare. La « première branche » est très peu utilisée, parce qu'en pratique très peu utilisable. M. le Président : Mais que pensez-vous des conclusions de l'avocat général près la Cour de cassation concernant l'inapplication des règles de sécurité existant à l'époque des faits ? M. Michel LEDOUX : La question s'est effectivement posée de savoir s'il existait ou non une réglementation particulière avant 1977, date à laquelle sont apparues les premières références explicites à l'amiante dans le code du travail. Jusqu'alors, les textes ne portaient que sur les poussières, et on a longtemps soutenu que les employeurs n'avaient pas fait le rapport entre les poussières légères et les poussières d'amiante. Autrement dit, personne n'aurait commis de faute inexcusable avant 1977 - cela ne pouvait se discuter qu'après. Ce à quoi nous avons fait remarquer que, depuis 1945, le risque « amiante » figurait expressément dans le tableau des maladies professionnelles. On a aussi eu débat, que nous retrouverons au pénal, sur la question de savoir si les textes du code du travail antérieurs à 1977, qui datent du début du siècle, sont des textes particuliers applicables et entraînant obligation pour l'employeur. M. le Président : C'est pour cette raison qu'il faut une instruction. M. Michel LEDOUX : Oui, entre autres raisons. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : L'expression « manifestement délibérée » rend ces textes très difficilement utilisables. Pour commencer, il faut se mettre dans la tête du responsable pour apprécier la réalité de ce « manifestement », ce qui explique que la Cour de cassation ait toujours préféré contourner la question en se rabattant sur la deuxième branche de l'article. Je suis, en ce qui me concerne, partisan d'une révision radicale de la loi Fauchon ; mais s'il devait y avoir seulement quelques retouches, la question du « manifestement délibérée » se pose. Se pose également celle de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité. Pour moi, la loi de 1893 et le décret de 1894 repris le 10 juillet 1913 sont des textes particuliers de sécurité concernant les poussières. L'obligation générale de sécurité est celle qui pèse sur l'employeur concernant la sécurité des salariés en général. Les données métrologiques de l'époque ne permettant pas de distinguer entre les poussières d'amiante, les poussières de fer, de plomb, etc., on a pris une réglementation générale sur les poussières. Mais cela n'en reste pas moins un texte particulier sur un secteur particulier de l'hygiène et de la sécurité, de la même façon que la réglementation sur les presses et machines dangereuses est un texte particulier sur un autre secteur de la sécurité. Si l'on acceptait l'idée que la réglementation sur les poussières est un texte général au motif qu'elle ne distingue pas les poussières d'amiante et le reste, on aurait beau jeu de faire remarquer que la réglementation sur l'amiante est tout aussi générale au motif qu'elle ne distingue pas la chrysotile et la crocidolite ! Il faudrait trouver une autre formulation qui coupe court à ce type d'objection. Mme Catherine GÉNISSON : D'autres pathologies, et non des moindres - la silicose, l'anthracose - sont dues aux poussières. Quelle a été l'interprétation des textes lors des éventuels procès ? M. Michel LEDOUX : Il n'y a pas eu de procès. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : L'amiante serait le premier procès pénal sur ces questions. M. Michel LEDOUX : Même au civil, la silicose a rarement donné lieu à procès. Mme Catherine GÉNISSON : Et pourtant, les ouvriers touchés sont tous morts avant soixante ans... M. le Président : D'où l'importance d'un procès pénal, pour les victimes de l'amiante, mais également pour tout ce qui en découlera pour l'ensemble des maladies professionnelles. C'est bien pour cette raison que nous avons également débattu de l'évolution de la branche maladies professionnelles. M. Michel LEDOUX : Effectivement. Tout est lié, responsabilité civile et responsabilité pénale. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est probablement parce que les questions de responsabilité civile n'ont pas été traitées en temps et heure. Si l'on avait pris le taureau par les cornes, dès 1995, en respectant les victimes et en les indemnisant correctement, nous ne serions pas sur le terrain pénal aujourd'hui. M. le Président : La septième question qui vous demande votre sentiment quant à l'issue d'un futur procès au fond de l'amiante, est un peu une provocante... M. Michel LEDOUX : En toute franchise, je ne suis pas absolument certain que l'on pourra obtenir des condamnations, compte tenu de toutes les difficultés que nous venons de décrire. Peut-être la Cour de cassation montrera-t-elle la voie au législateur par une interprétation plus souple et une lecture plus intelligente du lien de causalité, qui permettra d'organiser un procès « pédagogique » et de débattre sur la place publique des vraies raisons d'un drame aussi épouvantable. C'est notre seul espoir. M. le Président : En tout état de cause, la nécessité de ce procès, quelle qu'en soit l'issue, est évidente. M. Michel LEDOUX : Tout à fait. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Je ne sais si l'on pourra parler du « procès de l'amiante » comme on parle du « procès du sang contaminé », dans la mesure où sont actuellement conduites des procédures très différentes, à des stades très différents : Amisol à Clermont-Ferrand, Éternit à Valenciennes, Dunkerque, etc. Verra-t-on un regroupement de certaines de ces procédures, qui pourrait donner lieu au procès le plus important - en quantité au moins - de notre histoire judiciaire ? Y aura-t-il, à l'inverse, plusieurs procès dont certains seront plus symboliques que d'autres ? Je crois pour ma part qu'il y aura un procès au fond et que le résultat pourra en être positif car je suis d'un naturel optimiste... M. le Président : Nous avons déjà largement discuté de la deuxième partie du questionnaire concernant l'éventuelle révision de la loi du 10 juillet 2000 ? Avez-vous quelque chose à ajouter ? M. Michel LEDOUX : La question pourrait se poser de créer un délit spécifique aux affaires de santé publique, mais j'ai tendance à penser qu'il y a souvent trop de pénal : plutôt que de multiplier les textes, commençons par réviser et appliquer ceux qui existent. Le code pénal, tel qu'il existait auparavant, appliqué par des juges rationnels et intelligents, moyennant quelques coups de bistouri pour le remettre au goût du jour, suffirait probablement à réprimer la délinquance - n'oublions pas qu'il est fait pour cela. Je suis donc pour une remise à plat de la loi Fauchon, en ayant à l'esprit non pas le cas des seuls décideurs publics, mais la situation d'ensemble en matière d'hygiène et de sécurité en France, à la lumière des cinq ou six années d'expérience, mais pas pour construire une usine à gaz et rajouter du pénal sur du pénal. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Je m'interroge, au contraire, sur la création d'un délit spécifique concernant les délits non intentionnels des employeurs. Nous sommes dans un contexte très particulier, où le chef d'entreprise est investi de pouvoirs considérables et généralement incontestés. Cela doit avoir une contrepartie en termes de responsabilité, y compris en termes de responsabilité pénale. La loi Fauchon essayait de régler par un même texte des situations radicalement différentes : là est peut-être la cause de toutes nos difficultés. Je n'ai pas encore d'avis définitif, mais la question mériterait d'être posée. Nous parlons beaucoup de la loi Fauchon mais il ne faut pas oublier que nous avons créé un texte nouveau - très utile - en instituant le délit de mise en danger et qui sera utilisé, pour l'amiante, à l'occasion de l'affaire Alstom à Lille, dont le procès se tiendra le 16 décembre. Les dirigeants de l'entreprise, qui n'ont pas respecté les obligations qui résultaient des décrets de 1996 en matière de désamiantage, comparaîtront devant la huitième chambre du tribunal de Lille pour mise en danger du personnel de la société. C'est une affaire de l'amiante, et non la moindre, dans la mesure où il s'agit d'une situation très récente, avec des dirigeants toujours en activité dans le groupe Alstom : autrement dit, il n'est pas toujours nécessaire d'attendre vingt ans et de compter les morts pour demander à certains de rendre des comptes. Le délit de mise en danger permet d'intervenir sur le plan répressif dans un délai relativement restreint, sans attendre l'apparition des possibles dégâts. M. Michel LEDOUX : Le délit de mise en danger a été introduit dans le nouveau code pénal en 1993 et est applicable depuis le 1er mars 1994. Il vise le fait d'exposer autrui à un risque immédiat pour sa santé par la violation d'un texte particulier. Il ne s'applique pas qu'au désamiantage, mais également à tous les risques chimiques. C'est un texte effectivement important parce qu'il permet de punir en temps réel les expositions à des risques qui pourront ne déclencher d'éventuelles pathologies que des années plus tard. C'est dans le même texte qu'a été introduite la responsabilité pénale des personnes morales. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Sur le plan de la prévention, c'est un progrès considérable. Voilà un texte de droit pénal, moderne et efficace, qui permet une réelle prévention et non une punition symbolique trente ans après, lorsqu'on ne peut plus rien changer. M. le Président : C'est effectivement un texte clé ! M. Michel LEDOUX : Pourtant, c'est un texte qui n'était pas encore bien utilisé, il y a encore quatre ans : lorsque nous avons poursuivi devant le tribunal de Douai un employeur du bâtiment et des travaux publics, très connu, pour mise en danger d'autrui, le procureur avait déclaré qu'il n'aimait pas ce texte et qu'il n'y croyait pas. Cela montre à quel point la motivation du parquet est un élément fondamental. M. Daniel PAUL : Mais pourquoi ce texte n'est-il jamais appliqué ? M. Michel LEDOUX : Il faut poser la question aux parquets ! M. Daniel PAUL : Et, par ailleurs, faut-il comprendre que les multiples mesures de clémence, la loi Fauchon, ne font que participer à la chaîne de déresponsabilisation des donneurs d'ordre que vous décriviez tout à l'heure, jusqu'au lampiste ? M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Il y a d'abord un problème de prescription. La mise en danger d'autrui est un délit instantané, prescrit trois ans à partir des faits. Pour une plainte déposée aujourd'hui, on ne peut donc remonter qu'à 2002. Pour le délit d'homicide involontaire et d'atteinte à l'intégrité physique, la prescription court à partir du moment du décès ou de l'apparition de la maladie : autrement dit, cela permet de remonter à des faits datant de trente ans, cas exceptionnel en droit pénal. Voilà pourquoi, dans le procès de l'amiante, on recourt essentiellement aux délits non intentionnels. À l'inverse, le délit de mise en danger n'est pas systématiquement utilisé parce qu'il ne permet pas de remonter très loin - or l'essentiel du scandale de l'amiante s'est produit voilà plus de trois ans. Il n'en reste pas moins que c'est l'instrument moderne, qui permet de faire une réelle prévention. M. Michel LEDOUX : Je précise quand même que, dans l'affaire de Jussieu, les personnes morales ont été mises en examen sur la base de ce texte. Mais la loi pénale n'étant pas rétroactive, ne pouvaient être visées que les négligences commises après le 1er mars 1994. Ajoutons que c'est un texte pénal et que l'on voit rarement des gendarmes se promener dans une travée d'usine... Il faut vraiment que les représentants du personnel signalent au procureur de la République une machine dangereuse pour que celui-ci envoie les gendarmes ou les services de la police judiciaire dans l'entreprise. Les inspecteurs du travail revendiquent la possibilité de relever eux-mêmes ce type de délit mais, pour le moment, ils ne peuvent pas, puisque ce texte figure non pas dans le code du travail, mais dans le code pénal. Si on entend peu parler de ce texte, c'est donc pour des raisons pratico-pratiques, juridico-organisationnelles. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Il y a également des raisons culturelles. Dans les années soixante-dix, les viols étaient correctionnalisés et personne ne bougeait. Il a fallu un mouvement de la société pour que ce qui était un crime soit véritablement reconnu et poursuivi comme tel. Encore a-t-il fallu vaincre la passivité de la société, laquelle se reflétait dans la magistrature. Plus près de nous, la délinquance routière a fait l'objet d'une prise de conscience relativement récente : pendant très longtemps, ces risques étaient sous-estimés. Nous sommes encore dans cette situation pour ce qui est des questions d'hygiène et de sécurité au travail : la prise de conscience est seulement en train d'émerger, grâce à des affaires comme celle de l'amiante. Les magistrats ont longtemps persisté à sanctionner les délits de mise en danger de 10 000 ou 20 000 francs d'amende, souvent avec sursis au motif qu'« il n'y a pas de morts ni de blessés, ce n'est pas bien grave, ne recommencez plus »... Le procès de Lille, en janvier prochain, sera l'occasion de faire émerger ces questions en invoquant le comportement de la direction d'Alstom entre 1997 et 2001, sur le terrain de la mise en danger d'autrui. M. Daniel PAUL : La SNCF et le constructeur Alstom sont actuellement mis en cause parce que le revêtement des locomotives contiendrait de l'amiante. Cela ne remonte ni à dix ans ni à trois ans, mais à quelques semaines. Le délit de mise en danger d'autrui peut-il être invoqué dans ce cas ? M. Michel LEDOUX : Il a vocation à s'appliquer. J'ai déjà fait condamner, voilà trois ou quatre ans, la RATP par le tribunal correctionnel d'Évry, pour mise en danger d'autrui à l'occasion d'une exposition au risque amiante. Mais depuis onze ans que le texte est applicable, on doit compter trois ou quatre décisions. Non seulement il est peu connu, mais les poursuites sont rendues très délicates par le fait que les inspecteurs du travail n'ont pas compétence pour relever ce délit. M. le Président : Je reviens au problème de la loi Fauchon : pensez-vous que la meilleure solution serait de la réviser - ce qui paraît très complexe - ou bien de proposer un cadre juridique nouveau, spécifique aux risques professionnels ? M. Michel LEDOUX : C'est ce que se demandait Jean-Paul Teissonnière tout à l'heure. Contrairement à un chef d'entreprise, un maire ne peut pas licencier ses concitoyens... On est donc dans une situation très différente. Par ailleurs, l'introduction du délit de mise en danger d'autrui dans le code du travail rendrait la veille pénale beaucoup plus pertinente. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Dans tous les cas, il faut revoir la loi Fauchon, et peut-être envisager un texte spécifique sur la question de la responsabilité dans le domaine de la sécurité au travail. M. le Président : Me Ledoux a évoqué tout à l'heure le recours systématique au moins-disant dans les marchés publics et la pression qui en découlait sur la sous-traitance, d'un bout à l'autre de la chaîne. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce point ? M. Michel LEDOUX : J'avais préparé lors de la discussion du projet de loi une note à l'attention de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH) qui décrivait bien ce risque de provoquer un « accident théorique » avec dilution des responsabilités en cascade. Mme Élisabeth Guigou, ministre de la justice, avait répondu que l'on pouvait compter sur les juges pour éviter un tel scénario catastrophe. Pourtant, c'est exactement ce qui se passe : les condamnations de chefs d'entreprise pour délit non intentionnel ont pratiquement chuté de moitié en dix ans. M. le Président : D'autant que la sous-traitance se pratique non seulement en cascade, mais parfois dans le cadre de l'entreprise elle-même avec l'externalisation qui est fréquemment utilisée, par exemple, dans la sidérurgie. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : AZF avait externalisé la gestion des nitrates déclassés, perdant, de ce fait, la mémoire et les informations en matière de sécurité du stockage des ammonitrates. Le donneur d'ordre s'est débarrassé de toute une série de fonctions sur ses sous-traitants, à charge pour ceux-ci de réinventer les normes de sécurité. C'est un vrai problème. M. Michel LEDOUX : Depuis l'accident d'AZF, dans les établissements classés « Seveso haut », l'entreprise d'accueil est tenue de veiller directement à la sécurité des entreprises intervenantes. Mais dans la pratique, tout le travail ingrat est fait par des sous-traitants, qui eux-mêmes le confient à des intérimaires. Or ceux-ci représentent 7 % des Français qui travaillent, mais 20 % des accidents ! Ce sont des chiffres officiels. Le moment est d'autant mieux venu de rediscuter de toutes ces questions que nous disposons d'un retour d'expérience parfaitement clair - les chiffres du ministère du travail crèvent les yeux - sur ce qui n'était peut-être pas visible il y a dix ans. M. le Président : Et qui le deviendra de plus en plus. M. Daniel PAUL : Une solution ne consisterait-elle pas d'abord à limiter, autant que possible, la longueur de la chaîne et ensuite à rendre, quelle que soit cette longueur, le donneur d'ordre systématiquement responsable. M. Michel LEDOUX : On l'a déjà fait pour les entreprises dites « Seveso haut ». M. Daniel PAUL : Je parle également pour les autres cas, bâtiment compris. Aux chantiers navals de Saint-Nazaire, lorsque le sous-traitant polonais n'a pas payé ses ouvriers, ce sont les chantiers qui ont payé. Ce faisant, ils ont assumé une forme de responsabilité - de nature différente certes, mais également prioritaire. M. Michel LEDOUX : C'est, à l'évidence, le sens de l'histoire et toute une série de textes le permettent d'ores et déjà en moralisant plus ou moins le droit : ainsi, un décret de 1992, au demeurant fort peu appliqué, met à la charge de l'entreprise d'accueil l'établissement du plan de prévention applicable aux entreprises extérieures. Malheureusement, comme toujours, on fait du rapiéçage ; aucun texte général ne vient englober la situation de travail dans son ensemble en rendant l'entreprise dominante responsable de la santé de tous ceux dont, au-delà de la fiche de paie, elle utilise la force de travail. Mme Catherine GÉNISSON : Est-ce facile à définir ? M. Michel LEDOUX : Oui. Les notions de donneur d'ordre et de maître d'ouvrage sont bien connues. M. le Président : Nous ne sommes pas en train de bâtir un texte, mais seulement de dégager quelques principes. Parlons maintenant de l'action pénale des victimes, et notamment du problème du recours en cassation qui a été au cœur de la décision du 15 novembre dernier. M. Michel LEDOUX : Le droit pénal est quelque chose de compliqué. La principale victime d'une infraction pénale est par principe la société, représentée par le parquet. Celui-ci doit faire son travail, y compris dans l'intérêt des victimes - ce qu'il n'a pas fait dans l'affaire de Dunkerque. Faut-il revoir l'article 575 du code de procédure pénale ? Peut-être conviendrait-il d'ouvrir quelque peu les possibilités de pourvoi. Mais le vrai problème est ailleurs. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Les dernières réformes ont sans cesse tenté d'aligner les droits des parties civiles sur les droits des parquets en matière de recours. Non seulement on n'est pas parvenu à l'égalité, mais surtout l'article 575 reste une mosaïque de bouts raccrochés les uns aux autres, sans grande cohérence. Pourquoi ne pas ouvrir carrément le droit de recours, à charge pour la Cour de cassation de faire le tri ? Accorder aux parties civiles des droits équivalents à ceux des parquets dans ce domaine ne devrait pas créer d'inflation exagérée du contentieux. M. le Président : Et que pensez-vous du recours à la citation directe, défendue par certains ? M. Michel LEDOUX : Soyons sérieux ! Cette procédure est faite pour les bagarres entre voisins, pas pour l'amiante ! M. le Président : Le sénateur Fauchon ne voit pas les choses ainsi... M. Michel LEDOUX : En dix ans, les juges d'instruction ne sont pas parvenus à commencer à instruire ; or, en citation directe, l'instruction se fait à l'audience ! Sur quelques petites histoires locales, passe encore ; mais nous voyez-vous citer trois mille personnes devant le tribunal correctionnel de Paris ? M. le Président : Cela ferait son effet ! M. Michel LEDOUX : Nous y avons pensé... Mais, en cas de relaxe, l'autorité de la chose jugée empêcherait toute autre action. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Pour ma part, je ne cesse d'y penser ! Mais si nous engagions une telle procédure, ce ne serait pas dans les meilleures conditions : faute de disposer des moyens d'investigation appropriés, nous serions obligés de bricoler des dossiers, les textes, etc., et l'affaire de l'amiante consacrerait la faillite du parquet et dans une certaine mesure de l'institution judiciaire. Nous n'avons pas choisi la voie de la provocation. M. le Président : La provocation ne sera-t-elle pas nécessaire ? M. Michel LEDOUX et M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : S'il le faut, on en fera. M. le Président : Quand je vois la manière dont le pôle de santé publique fonctionne, quand je vois les désastres de l'affaire d'Outreau, quand je vois l'inertie des parquets, j'en viens à me demander si la provocation ne serait pas utile... M. le Rapporteur : Certains de nos collègues vont d'ailleurs commencer à réfléchir à une modification du fonctionnement de l'instruction... Que se passerait-il si la citation directe ne permettait pas, en première instance, d'obtenir un procès dans de bonnes conditions, et même dans l'hypothèse où la décision du tribunal ne vous donnerait pas satisfaction ? Que se passerait-il devant la cour d'appel ? M. Michel LEDOUX : La même chose : il nous appartiendrait de démontrer - a priori sans le soutien du parquet - la réalité des fautes décrites. Mais en cas de relaxe, il ne serait plus possible de revenir sur la chose jugée. Le jeu est dangereux, et c'est bien ce qui nous retient. M. le Président : Croyez-vous vraiment à l'hypothèse d'une relaxe ? Une telle décision aurait un effet énorme dans l'opinion publique... M. Michel LEDOUX : Effectivement. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Ce qui nous retient est plutôt le fait qu'en usant de la citation directe, nous avons le « bras court », pour reprendre l'image de Hans Jonas : faute de pouvoir pousser nos investigations dans les locaux de certains ministères, nous ne comprendrons pas la totalité de ce qui s'est passé. Dans les affaires civiles, avec les arrêts du 28 avril 2002 et la redéfinition de la faute inexcusable, nous sommes plutôt sortis par le haut : l'affaire de l'amiante n'aura pas été inutile sur ce plan. Nous souhaiterions qu'il en soit de même dans le domaine pénal et que l'on puisse en tirer les leçons. M. le Président : Je ne peux préjuger des conclusions de notre mission, mais tout m'incite à croire qu'elle aura une position très nette sur la nécessité d'un procès au pénal. Je crois même, pour en avoir discuté avec notre rapporteur, qu'elle y insistera particulièrement. M. Patrick ROY : Nous avons compris hier, en entendant le sénateur Fauchon, qu'une révision de sa loi n'aurait pas d'incidences directes sur l'affaire qui nous occupe. Ce dont ne s'est pas ému le sénateur qui nous a vanté les mérites de la citation directe, laquelle, à vous entendre, ne pourrait se concevoir que pour des points mineurs, et surtout risquerait de clore définitivement le dossier en cas de relaxe. Le procès au pénal que la mission pourrait appeler de ses vœux reste donc avec un point d'interrogation. Cela dit, de l'avis de Me Teissonnière, une procédure de citation directe n'est pas pour autant à exclure si ce procès n'a pas lieu. Dans combien de temps en viendrez-vous à penser qu'il ne reste plus que cette solution ? M. Michel LEDOUX : Depuis juillet dernier, les dossiers de l'amiante passent au pôle de santé publique. Nous sommes donc en situation de stand by et nous attendons de voir comment celui-ci va les traiter... Et comme nous sommes optimistes, nous espérons que l'on y mettra peut-être un peu d'ordre et de cohérence, que les personnes parviendront à s'entendre et à travailler ensemble. Si, d'ici à quelques mois, rien ne se passe, nous reviendrons à ce que Jean-Paul Teissonnière envisage assez régulièrement : donner un coup de pied dans la fourmilière en jouant du « bras court », c'est-à-dire en recourant à la procédure de citation directe, au risque de ne pas aller très loin avec nos petits moyens... Mais pour l'instant, il faut espérer que le pôle de santé publique pourra mettre un coup de booster à des procédures qui s'enlisent depuis près de dix ans. M. Jean-Paul TEISSONNIÈRE : Je le répète, la citation directe serait le constat de faillite de l'institution judiciaire et nous n'en sommes pas encore à cet état de désespoir. M. Michel LEDOUX : Si vous présentez un rapport dur, après les sénateurs, le Conseil d'État, la Cour de cassation, l'Office des choix technologiques, c'est la France entière qui aura montré du doigt l'existence d'un problème de délinquance derrière l'affaire de l'amiante. S'il ne se passe rien, ce sera le désespoir total : ne restera plus que la citation directe. M. le Président : Nous tâcherons de faire en sorte d'éviter le désespoir... Je vous remercie, votre prestation commune a été particulièrement intéressante. Audition de M. Robert FILNIEZ, Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Nous recevons aujourd'hui M. Robert FINIELZ, qui est avocat général près la Cour de cassation et qui a rédigé les conclusions dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 15 novembre dernier sur l'amiante. On sait que, pour des raisons de procédure, la Cour de cassation n'a pu se prononcer sur le recours exercé par les parties civiles contre la décision de non lieu de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Douai du 15 juin 2004, laquelle confirmait la décision du tribunal de Dunkerque. En tant que député du Dunkerquois, j'attache beaucoup d'importance à ces décisions, qui ont choqué les associations de victimes. M. Jean Lemière, notre Rapporteur, est, quant à lui, député de Cherbourg et, à ce titre, également très sensibilisé au problème de l'amiante. Monsieur Filniez, nous avons lu vos conclusions avec beaucoup d'intérêt. L'ampleur du problème et la forte mobilisation de l'opinion publique prouvent encore une fois la nécessité d'une action au pénal, quelle que soit, d'ailleurs, l'issue d'une telle action. Nous sommes donc très intéressés par ce que vous allez nous dire après l'arrêt de la Cour de cassation qui s'est fondé sur un article du code de procédure pénale pour rejeter le recours des parties civiles. M. Robert FILNIEZ : J'ai connu ce dossier uniquement par le biais du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Douai, et dans le cadre d'un examen de recevabilité. Dans mes conclusions, je n'évoque pas ce qu'aurait dû être la décision de renvoi. Je me contente d'indiquer que l'arrêt critiqué justifiait une cassation et qu'il convenait de procéder à un nouvel examen. En tant que parquetier, j'ai été surpris par l'absence du parquet, s'agissant du problème de l'amiante. Il en est d'ailleurs de même tous les problèmes de santé publique. Dans ces domaines particuliers, l'action publique n'est pas menée par le parquet, comme elle le pourrait, mais par des associations. Il en fut exactement de même sur le dossier de l'hormone de croissance. Pourquoi le parquet ne suit-il pas de tels dossiers ? J'ai été procureur de la République, et je dois vous faire l'aveu que si le dossier de l'amiante était parvenu dans mon parquet, je l'aurais peut-être vu d'un mauvais œil, parce que les procureurs de la République ont toujours à faire face à l'urgence et au traitement des flux : dans cette logique là, ce dossier renvoie à des faits anciens, demande des investigations très longues et très approfondies et ne s'intègre pas aux priorités immédiates de l'action publique d'aujourd'hui. Par ailleurs, le parquet - c'est sa faiblesse - est une structure à court rayon d'action. C'est un centre de triage qui n'est pas armé pour suivre les procédures de bout en bout, même si cela lui arrive quand la politique pénale est très forte dans un domaine particulier - affaires de stupéfiants, de travail clandestin ou en matière économique et financière. Voilà pourquoi, dans ce type de dossiers, il est presque naturel que la partie civile se substitue à lui. Un tel constat a amené la création de juridictions d'instruction spécialisées, qui procèdent d'une autre logique. Compte tenu de l'importance du dossier, on affecte à ces juridictions des magistrats du parquet, des juges d'instruction et des juges qui pourront travailler différemment en s'investissant dans le temps. Ces juridictions spécialisées permettent de corriger cette « incapacité » des parquets à s'investir dans de tels dossiers. Le reproche qui est fait aux parquets est donc fondé mais il paraît difficile de faire autrement. La nature des choses fait que les parquets ne s'investissent pas énormément - c'est le cas dans l'affaire de l'amiante - mais ce n'est pas toujours ainsi. Cela m'amène directement à une autre question, celle du regroupement des procédures au sein des pôles spécialisés dans le domaine de la santé publique. A plusieurs reprises, la Cour de cassation a confirmé le dessaisissement du juge d'instruction et s'est prononcée en faveur de la saisine du pôle de santé publique de Paris, notamment pour des affaires liées à l'amiante. Dans de telles affaires, le premier niveau « territorial » est celui de l'entreprise. On y mène une enquête approfondie, portant sur la taille de l'entreprise et ses responsables ; sur l'époque d'exposition à l'amiante et son caractère habituel ou non ; sur la façon dont l'entreprise a appliqué les dispositions réglementaires ; sur la réalité des examens médicaux obligatoires ; sur l'information des salariés ; sur les mesures d'empoussièrement après le texte de 1977 et sur le dispositif de protection. Le deuxième niveau est celui de l'environnement de l'entreprise qui concerne les autorités publiques : quelles sont les informations dont disposait la caisse régionale ? Quelle était la politique de la direction départementale du travail en la matière ? Quel rôle la médecine du travail a-t-elle joué ? Le troisième niveau est beaucoup plus général. Il concerne la connaissance du risque, les études menées et l'évolution de la législation. Le regroupement est donc intéressant. Il permet d'avoir un magistrat spécialisé, une méthodologie d'enquête uniforme et une bien meilleure appréhension de la problématique de l'amiante. Sans compter une économie de moyens, un meilleur suivi des dossiers et donc plus de cohérence dans les décisions rendues. Dans l'affaire que vous avez évoquée, la Cour de cassation a observé dans son communiqué que d'autres décisions pourraient intervenir, qui donneraient raison aux parties civiles. Il pourrait donc y avoir, d'un côté, des personnes auxquelles on n'aura pas donné raison, parce que l'article 575 rend leur pourvoi irrecevable malgré une instruction critiquable, et de l'autre côté des personnes qui pourront obtenir satisfaction. Je suis gêné par cette éventuelle incohérence de la réponse judiciaire. Si j'ai censuré l'arrêt, c'est pour des considérations d' « opportunité ». J'aurais préféré qu'intervienne une décision de fond, permettant la cohérence des décisions rendues en matière d'amiante. Si l'on était passé par le pôle de santé publique, on aurait eu affaire à des magistrats du parquet qui se seraient davantage investis, ce qui aurait peut-être débouché sur un pourvoi du parquet général. En l'occurrence, ce dernier s'est contenté de suivre la position du parquet « de base », qui avait confirmé l'ordonnance de non-lieu. Sans doute n'a-t-il pas exercé sur ce dossier l'esprit critique qu'il aurait dû exercer, se contentant de suivre, par une sorte d'habitude. Il faut dire que les dossiers de partie civile sont considérés comme étrangers à notre véritable mission. Ils concernent une justice que les parties civiles mettent en œuvre, parce qu'elles ont le droit d'agir et il appartient au juge du fond, au juge d'instruction de prendre les décisions. La plupart du temps, le parquet « colle » à la position prise par le juge. Nous n'avons pas, par nature, l'obligation de nous associer pleinement aux actions de la partie civile. Le moteur de l'action publique étant la partie civile, c'est à celle-ci d'agir - et le code lui donne les moyens d'action. Dans ce cas particulier, la partie civile n'a pas utilisé ces moyens d'action et l'on peut lui en faire le reproche. Mais on peut aussi faire une autre analyse : l'association des victimes ayant été déclarée irrecevable à agir en application de l'article 2 du code de procédure pénale51, le juge d'instruction n'a trouvé face à lui, procéduralement parlant, que les quatre victimes de l'amiante. Or les personnes privées n'ont pas la capacité d'agir et de corriger la pesanteur de l'instruction. Dans le raisonnement du parquet, un troisième élément a pu également jouer : le dossier de l'amiante est un dossier ancien, compliqué, sur lequel l'instruction sera longue. Sans doute, y a-t-il aussi, sous-jacente, l'idée que de tels dossiers n'ont pas à être examinés par le juge. Il faut reconnaître, d'ailleurs, que ce n'est pas le parquet qui agit, mais que c'est la victime qui se substitue au parquet. D'autres exemples existent : dans le cadre de la lutte contre les propos racistes, il n'y a pas de victimes directes. Auparavant, c'était au parquet d'agir. Comme il ne le faisait pas souvent, la loi de 1972 a accordé le droit d'agir à des associations constituées. On peut ainsi répondre aux faits de racisme par le biais des associations. On peut prolonger cette réflexion et s'interroger sur les droits procéduraux de ces associations. Mais dans notre cas d'espèce, les associations n'avaient aucun droit à agir. M. le Président : Je vous remercie de la très grande honnêteté de votre réponse. Il est vrai que le dossier de l'amiante est complexe, parce que le temps de latence entre le contact avec l'amiante et la maladie est très long. Mais on sait, par ailleurs, que le problème des maladies professionnelles va devenir de plus en plus préoccupant et que le dossier de l'amiante est un révélateur des modifications intervenues dans le domaine des risques au travail, comme en témoignent les débats sur le programme européen REACH. Le poids du dossier de l'amiante dans l'opinion publique, les chiffres qui circulent sont tels qu'après l'instruction, l'action pénale au fond aurait un effet de catharsis. D'ailleurs, la Cour de cassation, qui a fondé sur un article du code de procédure pénale sa décision de rejeter le pourvoi des victimes, a semblé exprimer un regret, comme vous l'avez vous-même signalé. Vous constatez - en l'expliquant - l'absence du parquet sur toutes les affaires de santé publique et vous estimez que la seule solution consiste à se tourner vers un pôle de juridiction spécialisée. Or nous avons dû constater que les moyens du pôle spécialisé dans les affaires de santé publique sont plus que dérisoires. Cela nous paraît d'une désinvolture d'autant plus grande que l'État a été condamné dans l'affaire de l'amiante et que des remarques sont formulées en ce moment sur le fonctionnement de la justice. M. Robert FINIELZ : J'admets que les affaires de santé publique vont se multiplier et que le contexte est tendu. Mais l'affirmation, au plan juridique, du principe de précaution, va sans doute changer la façon d'aborder la problématique spécifique des risques sanitaires, dès lors qu'on ne pourra plus prétendre ignorer des risques liés à des techniques dont on aura dû tester au préalable les conséquences. À propos du pôle de santé publique, on a, effectivement, un peu le sentiment que les affaires qui lui sont confiées tombent dans les oubliettes pour n'en ressortir qu'après plusieurs années. Cela dit, de telles affaires devraient naturellement être traitées par le pôle de santé publique. La lourdeur des problèmes techniques qu'elles soulèvent exige, en effet, des personnes compétentes, et le juge de proximité n'est pas armé pour cela. M. le Président : Je comprends tout à fait votre argumentation, s'agissant des problèmes du terrorisme. Mais, s'agissant de l'amiante, les situations sont très différentes les unes des autres et l'on peut se demander comment le pôle pourra s'en sortir, étant donné les moyens scandaleusement dérisoires dont il est doté. Les parquets ont-ils les moyens de faire quelque chose ? M. Robert FINIELZ : Je vous ai fait un bref résumé de la méthodologie de l'enquête. Le problème ne tient pas tant au manque de temps qu'au manque de volonté. Les parquets préfèrent les affaires simples, qui se traitent rapidement. Le dossier de l'amiante est resté à l'instruction pendant quatre ou cinq ans. Une commission rogatoire a permis d'entendre les salariés et quelques médecins, et de travailler du côté de la CRAM. Nous avons alors appris que les archives disparaissaient au bout de dix ans... Pourtant, dans l'arrêt de la chambre de l'instruction, on peut lire cette phrase extraordinaire : « l'instruction a été menée de manière très complète ». Ce n'est pas le cas. Depuis le début, l'instruction a été menée comme si l'on s'attendait à ce qu'elle aboutisse à un non-lieu. Aucune volonté de la part de la hiérarchie judiciaire, pas même de la direction des affaires criminelles et des grâces ! J'y vois un échec de notre fonctionnement. M. le Président : Votre franchise est impressionnante. Elle croise ce que nous pensons du fonctionnement de la justice dans cette affaire. M. Robert FINIELZ : Ce n'est la faute de personne. C'est plutôt la faute d'un système d'organisation. Reste que pour moi, ministère public à la Cour de cassation, ce dossier me laisse un goût amer. M. le Rapporteur : Sur ce type d'affaires, vous distinguez trois niveaux : l'entreprise, son environnement et la connaissance du risque au moment où les évènements se sont produits. Vous vous intéressez à l'entreprise - sa taille, ses dirigeants, sa hiérarchie, l'hygiène et les conditions de travail - et à l'environnement de l'entreprise. Et, précisément, de Condé-sur-Noireau à Dunkerque et de Cherbourg à Brest en allant jusqu'à Montpellier et Toulon, les entreprises peuvent être assez différentes. Les tribunaux locaux ne seraient-ils pas les plus à même de reconstituer les différentes situations ? M. Robert FINIELZ. Il est exact que les dossiers d'amiante nécessitent un examen correct. Il n'y a pas deux entreprises semblables. Ces dossiers doivent être autonomes et individualisés. Pour autant, en termes de moyens, le coût de la centralisation des dossiers dans un pôle de santé publique est peut-être moindre que si ces dossiers sont éparpillés. M. le Rapporteur : J'ai une autre inquiétude. Dans les grandes entreprises, les directions changent à peu près tous les trois ans. Les ingénieurs et les autres responsables sont davantage intégrés au tissu local et risquent d'être amenés à rendre compte. Je crains donc que ce soient les lampistes qui paient. Comment établir le degré de responsabilité des uns et des autres ? M. Robert FILNIEZ : Vous avez tout à fait raison. Dans le dossier de Dunkerque, on a mis en examen un ingénieur, et je ne vois pas comment celui-ci pourra répondre des faits qui lui sont reprochés. Un tel dossier est révélateur du problème que pose le choix des personnes à poursuivre ou à mettre en examen. Les questions de sécurité liées à l'amiante doivent être examinées à un haut niveau de responsabilité. Le regroupement dans un pôle de santé publique permet justement de mener une réflexion cohérente s'agissant, précisément, des personnes à poursuivre. À Dunkerque, la manière dont on a déterminé les responsabilités était critiquable. Si j'avais eu à traiter ce problème de renvoi, j'aurais posé des questions sur l'inculpation de certaines personnes. M. le Président : De toutes les actions menées, n'y a-t-il pas une vision qui se dégage ? M. Robert FILNIEZ : Il faudrait qu'il y en ait une. Dans un pôle de juridiction spécialisée, il y a un parquet spécialisé qui peut avoir une vision d'ensemble. Avec une multiplicité de parquets et de substituts, les compétences sont dispersées, ce qui risque d'aboutir à une certaine incohérence. Or les victimes sont les mêmes, elles ont simplement été exposées dans des conditions différentes. Certes, il est normal que les décisions diffèrent et la chambre sociale de la Cour de cassation, par exemple, n'indemnise pas automatiquement. L'analyse peut varier. Mais il faut que la décision du juge soit déterminée par des éléments objectifs et clairs. M. le Président : Votre raisonnement se tient. À une condition cependant : qu'on accorde les moyens nécessaires à cette structure spécialisée. M. Robert FILNIEZ : La justice ne peut pas fonctionner de la même manière pour toutes les affaires. Face à une criminalité particulière, il faut qu'elle s'adapte. Face à des problèmes très techniques, il faut qu'elle accepte de se spécialiser. Reste qu'elle a, bien entendu, besoin de moyens pour fonctionner. Ce qui n'empêche pas de se demander, lorsqu'on instruit un dossier, à quel moment s'arrêter. En l'occurrence, ces dossiers sont énormes et il faut conserver un souci d'efficacité. En conclusion, il faut avoir des moyens et une vraie politique. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, la justice fonctionne mal. M. le Président : Ce qui est le cas aujourd'hui. M. Robert FILNIEZ : Peut-être... M. le Président : C'est patent. Nul ne peut penser qu'on s'est donné les moyens de cette spécialisation. M. Robert FILNIEZ : Pour la justice, c'est une nouvelle manière d'aborder les problèmes. Il lui faut donc peut-être un peu de temps. Mais pas trop... M. le Président : Nous vous avons fait parvenir un questionnaire, et il serait bon que vous nous fassiez connaître vos réponses assez rapidement. Certaines questions sont de nature très juridique, comme celles qui tournent autour de l'application de l'article 121-3 du code pénal ou du débat sur la loi Fauchon, lequel a été abondamment utilisé par le tribunal de Dunkerque. D'un côté, on utilise un texte qui n'a pas été fabriqué pour ce type de problème, de l'autre on s'appuie sur une disposition du code de procédure pénale pour rejeter un pourvoi. Et, enfin, on constitue un pôle de compétence spécialisé dont l'absence de moyens est dramatique. Reconnaissez que le phénomène est inquiétant pour les parlementaires que nous sommes, qui pourraient être tentés de suivre les mouvements de protestation. Au-delà du manque de volonté, nous avons l'impression qu'on essaie de tout faire passer à la trappe. Rajoutez à cela la pression externe due aux maladies professionnelles, au programme européen REACH, au principe de précaution, etc. Imaginez un peu notre sentiment ! M. le Rapporteur : Nous avons auditionné le sénateur Fauchon et nous avons entendu ceux qui souhaitent que la loi Fauchon soit modifiée et adaptée. Qu'en pensez-vous en tant que juriste ? M. Robert FILNIEZ : Je ne suis pas spécialiste de cette matière. Mais le peu que j'en connais m'amène à penser que la loi Fauchon ne pose pas de problème. La faute d'imprudence et de négligence, de par son amplitude et de par le caractère indirect du préjudice, aboutissait à mettre dans le sac de la justice pénale beaucoup trop de personnes. On a donc voulu, par cette loi, restreindre le domaine pénal, en distinguant le préjudice direct et le préjudice indirect et en retenant pour le préjudice indirect, deux niveaux de faute : la violation manifestement délibérée - qui est une faute lourde - et la violation des dispositions réglementaires. Cette distinction peut, il est vrai, poser des difficultés d'interprétation. L'amiante est un préjudice indirect. Cela dit, on peut se demander si un chef d'entreprise qui ne respecterait aucune des obligations de sécurité relatives à l'amiante ne causerait pas un préjudice direct. On pourrait aborder le cas par le biais d'une faute délibérée. Tout texte dans ce domaine posera des problèmes d'interprétation. Je rappelle qu'avant la loi Fauchon, il y avait corrélation entre la faute civile et la faute pénale : si le juge pénal ne retenait pas la faute pénale, il ne pouvait pas y avoir indemnisation, d'où le réflexe du juge, attentif aux droits des victimes, d'élargir la faute pour assurer une indemnisation la plus large possible. Ce n'est plus cas maintenant, puisque la loi Fauchon a supprimé le couplage de la faute pénale et de la faute civile. L'acquittement ou la relaxe sur le plan pénal ne signifie donc pas qu'il n'y aura pas de condamnation sur le plan civil. Mais, inversement, ce n'est pas parce qu'il y a condamnation et indemnisation sur le plan civil qu'il y aura relaxe sur le plan pénal. Par ailleurs, l'application de la loi Fauchon par la Cour de cassation me paraît assez cohérente. Personnellement, la jurisprudence, relative à la loi Fauchon, ne me pose pas de problème métaphysique. M. le Rapporteur : Il s'agit donc bien d'un problème de volonté. M. Robert FINIELZ : En fait, on a raisonné à contre sens dans l'affaire de l'amiante. On a parlé d'abord de la loi Fauchon, pour démontrer qu'il n'y avait pas de faute, alors qu'il aurait fallu, d'abord, parler de la faute. M. le Président : Dommage que le tribunal de Dunkerque ne se soit pas exprimé aussi clairement que vous ! M. Robert FINIELZ : Il est vrai que les décisions de relaxe du tribunal de Dunkerque et de la chambre de l'instruction sont critiquables. M le Président : En effet. Il fallait d'abord parler de la faute, puis analyser les conditions dans lesquelles elle avait été commise. Nous sommes nombreux à penser qu'il faudra une instruction et une information sérieuses au pénal, mais sans préjuger pour autant du résultat de ces procédures. Il faut au moins qu'on essaie d'y voir clair dans les responsabilités, l'État lui-même ayant déjà été condamné. M. Robert FINIELZ : Dans mes réquisitions, je ne cherche pas de coupable. Il faut qu'un processus judiciaire aboutisse à un procès, à l'issue duquel un jugement sera rendu et une décision sera prise. Les personnes seront ou ne seront pas contentes, mais la justice aura fait son travail. On ne peut pas lui demander plus. Mais encore faut-il qu'elle fasse ce travail. Je crois qu'une confusion a été faite. De manière inconsciente, on a pu être amené à se dire que, puisque les victimes allaient être indemnisées ou étaient susceptibles de l'être, elles n'avaient plus rien à faire dans un procès pénal. C'est ne pas tenir compte du découplement de la faute pénale et de la faute civile et c'est grave de conséquences. Pourrait-on dire à une personne dont l'enfant a été tué dans un accident de la circulation, que dans la mesure où la compagnie d'assurances a pris en charge le préjudice, elle n'a pas à porter plainte ? Je regrette la rédaction du communiqué, qui n'apprend pas grand-chose sur ce qu'a dit le ministère public et qui fait allusion au fait que les victimes pourraient demander une indemnisation sur le plan civil. Cela me paraît grave du point de vue de la politique pénale. L'action publique doit avoir un objectif qui dépasse le sort des victimes. Si, parce que les victimes sont indemnisées, on considère que leur prise en charge par la société, ou que la socialisation du risque, constitue un motif de ne pas poursuivre, où va-t-on ? Au contraire, plus on fait prendre en compte, au plan civil, les conséquences du risque par des personnes qui ne sont pas à l'origine de ce risque, plus il faut rechercher, sur le plan pénal, s'il y a eu faute. Sinon chacun pourra tout faire, sans avoir à répondre de ses actes. Je ne suis pas du tout d'accord ! Voilà pourquoi, dans mes réquisitions orales, j'ai défendu une politique pénale visant à rechercher la faute. C'est en recherchant la faute, qu'in fine, on maîtrisera le risque. Au-delà de la sanction, la responsabilité pénale est une manière, pour la société, de maîtriser des comportements générateurs de risques et fautifs. Le risque pénal doit exister. M. le Président : Ce que vous dites est extrêmement important. Nous sommes amenés à nous appuyer sur le travail que nous faisons sur l'amiante pour le dépasser et en tirer des conséquences. À cet égard, nous avons, notamment, la conscience aiguë que la question des maladies professionnelles pèsera très lourd sur nos sociétés dans les années à venir. Par ailleurs, les victimes et leurs proches vivent des moments terribles. Le mésothéliome est une maladie épouvantable et les veuves de Dunkerque expriment une véritable douleur. Si nous n'avons pas la volonté de rechercher la faute et d'en maîtriser les conséquences, où allons-nous en effet ? M. Robert FINIELZ : Dans ce dossier, j'ai été étonné par la retenue des victimes. Elles veulent savoir pourquoi c'est arrivé et s'il y a des fautes, et elles veulent aussi que cela fasse l'objet d'un débat public. De telles demandes ne sont pas scandaleuses. Dans ces affaires, les poursuites pénales constituent un enjeu important dans lequel la justice a un rôle à jouer en termes de politique. Il ne faut pas croire que poursuivre, c'est perdre son temps. C'est, au contraire, affirmer certaines choses qui sont fondamentales pour notre société. M. le Président : Notre huitième question concernait l'article 575 du code de procédure pénale. Par ailleurs, la révision de la loi du 10 juillet 2000 est réclamée fermement par les associations des victimes de l'amiante. Confirmez-vous qu'une révision du dispositif pénal, dans le sens de la sévérité demandée par les victimes, ne serait pas rétroactive et qu'elle ne concernerait donc, en aucun cas, les affaires liées à l'amiante ? M. Robert FINIELZ : L'article 575 a été un peu le nœud du débat devant la Cour de cassation. Cet article pose en premier lieu la prohibition du pourvoi de la partie civile contre l'arrêt de non lieu et prévoit sept exceptions à ce principe. La sixième exception me paraît importante. Elle joue « lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale », c'est-à-dire quand le vice de forme est grave : arrêt rendu par deux juges ou rendu alors que le ministère public était absent... Cette exception a été étendue par la jurisprudence à l'article 593 du code de procédure pénale relatif, notamment, aux arrêts de la chambre de l'instruction. Elle joue aussi en cas de « vices de motivation », c'est-à-dire lorsqu'il y a absence de motivation ou contradiction dans la motivation. Ainsi, « les arrêts de chambre d'instruction doivent être motivés de manière à permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de s'assurer de la légalité de la décision rendue ». Le respect de cette règle est fondamental car il s'agit du respect du droit des parties. L'alinéa 6 de l'article 575 constitue donc une sorte de soupape de sécurité qui permet de corriger les fautes graves qui s'appliquent à des hypothèses extrêmes, où la justice n'a pas rempli sa mission. Il s'agit de maintenir une certaine exigence de qualité de la justice, qui doit se retrouver à travers sa motivation. C'est pourquoi, dans ce dossier, j'ai pris une position d'ouverture de l'article 575. Je ne connais pas très bien la jurisprudence en la matière, mais je sais qu'à une certaine période, l'interprétation était très stricte et qu'ensuite, elle l'a été un peu moins. Le 8 novembre 2005, une semaine avant l'arrêt rendu dans l'affaire de l'amiante, un autre arrêt avait été rendu dans des circonstances semblables. A la suite du décès d'un pilote d'avion, une faute avait été soulevée et une décision de non-lieu avait été rendue. La Cour de cassation a rendu une décision contraire à celle de l'amiante : « Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter des motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties et que l'insuffisance et la contradiction des motifs équivaut à leur absence... » La décision de la Cour de cassation a ainsi censuré celle de la chambre de l'instruction. Ce qui ne fut pas le cas dans l'affaire de l'amiante. C'est sans doute beaucoup trop subtil pour moi... M. le Président : Et encore plus pour nous ! Si ce n'est qu'il y a une absence de volonté. M. Robert FINIELZ : Dans l'affaire de l'amiante, je mettais pourtant en avant une contradiction de motifs et je ne vois pas pourquoi on n'a pas suivi mes réquisitions. En conclusion, il y a une réticence à ouvrir la porte du pourvoi en cassation aux parties civiles. Il est vrai que nous sommes dans un système juridique où l'action de la partie civile est considérée de manière négative par le juge. Certes, la partie civile peut poursuivre des objectifs privés, proches de l'abus de droit. Mais il n'empêche que ce texte débouche sur un certain arbitraire. Pourquoi ce qui est possible dans un cas ne le serait pas dans l'autre ? Tous les ans, on observe deux ou trois arrêts qui « ouvrent » le texte, puis d'autres qui le « ferment ». On pouvait concevoir cette restriction du droit d'action des parties civiles à une époque où elles agissaient uniquement pour elles-mêmes. Mais aujourd'hui, les parties civiles se substituent au parquet à l'occasion de problématiques très compliquées et remplissent la fonction du ministère public. Je ne vois pas pourquoi on interdirait à ces associations de se pourvoir en cassation. L'exemple de la lutte contre le racisme est intéressant. On s'est aperçu qu'en cas d'injures raciales, les parquets exerçaient mal l'action publique. Et comme ces injures étaient générales, il n'y avait pas de partie privée. On a donc donné un droit d'action aux associations. C'est ainsi que la plupart des procédures pénales pour injures raciales sont initiées par des associations qui se substituent au parquet. Supposez qu'il y ait une instruction, que le parquet ne fasse pas appel et qu'il y ait un arrêt de non-lieu pour des motifs extravagants. L'association serait irrecevable dans son pourvoi, ce qui n'est pas normal. Je ne supporte pas cet arbitraire et j'appelle à une modification de l'article 575. Celle-ci pourrait se faire de deux manières. Soit on ouvre complètement le droit d'appel aux parties civiles en supprimant l'article 575. Cette solution comporte un petit risque, car il peut y avoir des abus de constitution de partie civile qu'il ne faut pas encourager en leur permettant d'aller jusqu'au terme de la procédure, c'est-à-dire jusqu'au pourvoi en cassation. Par ailleurs, la suppression de l'article aurait sans doute un effet sur l'activité de la Cour de cassation qui aurait peut-être besoin de moyens nouveaux. Soit on donne à certaines associations un droit d'action équivalent à celui du parquet sur l'appel et les ordonnances de non-lieu. Cela reviendrait à faire une exception à l'article 575 en faveur de certaines associations auxquelles on reconnaîtrait un droit d'action. Mais, dans le dossier de l'amiante, l'association des victimes de l'amiante n'a pas d'existence juridique ni procédurale, parce qu'on considère que son préjudice est indirect. Elle a donc été irrecevable. C'est un vrai problème. Sans le support procédural de l'association, les victimes sont évidemment plus faibles. Il y a donc peut-être quelque chose à faire sur ce point. M. le Président : Concernant la suppression ou plutôt la modification de l'article 575, vous venez d'ouvrir quelques pistes très importantes. M. Robert FINIELZ : Il faut savoir que le juge de la Cour de cassation est parfois confronté à des décisions qu'il considère comme particulièrement injustes. Dans le dossier dont je vous ai parlé concernant le pilote d'avion, le juge n'a pas accepté cette décision. Il a forcé la porte de l'article 575 pour qu'elle soit remise en question. M. le Président : Dans le fond, il nous a peut-être envoyé un signal ? M. Robert FINIELZ : Ce que j'ai dit de l'article 575 correspond au sentiment de mes collègues. Nous avons l'impression qu'il est appliqué de manière beaucoup trop restrictive. M. le Président : Merci beaucoup. Non seulement vous avez fait une analyse très fine, mais vous vous êtes exprimé avec une netteté que la mission a beaucoup appréciée. Audition de M. Alain SAFFAR, sous-directeur de la justice pénale spécialisée à la Direction des affaires criminelles et des grâces Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Monsieur le directeur, comme l'a indiqué le questionnaire qui vous a été adressé, nous réfléchissons, à ce stade de notre mission, au traitement pénal du dossier de l'amiante. Nous souhaitons, d'ailleurs, que vous répondiez à ce questionnaire, au-delà de ce qui pourra être dit au cours de cette audition. Je suis député de Dunkerque, dont le tribunal de grande instance a eu à connaître du problème de l'amiante en première instance, avant que la cour d'appel de Douai soit amenée à statuer en appel par une décision assez médiatisée. Cette région a été très touchée et les décès y sont nombreux. Le rapporteur, Jean Lemière, est quant à lui député de Cherbourg. Nous sommes donc tous les deux très sensibilisés à la question de l'amiante. Vous savez ce qu'il en est de la procédure pénale qui a récemment fait l'objet de la décision de la Cour de cassation du 15 novembre dernier : ordonnance de non lieu à Dunkerque ; confirmation par la Cour d'appel de Douai ; rejet des pourvois des victimes contre cet arrêt par la Cour de cassation, malgré les réquisitions de l'avocat général qui préconisaient une utilisation plus souple de l'article 575 du code de procédure pénale. L'opinion publique s'est fortement mobilisée autour de ce problème de santé extrêmement lourd qui va causer, pendant une quinzaine d'années : 50 000 ou 100 000 morts. À partir de nos travaux sur l'amiante, nous essayons de tirer quelques leçons pour l'avenir, notamment en ce qui concerne le problème grandissant des maladies professionnelles. Si le lien de causalité entre la cause et le dommage est très clair dans le cas des accidents du travail, il en va différemment avec les maladies professionnelles. D'où l'importance de la prévention et des modalités de prise en charge des victimes. Dans l'affaire de l'amiante, l'État a été condamné par le Conseil d'État et maintenant se pose la problème du procès pénal Nous avons eu un débat au fond sur ce point avec l'avocat général près la Cour de cassation, qui a insisté sur le fait que la création du pôle de santé publique à Paris permettrait peut-être de mieux maîtriser ces affaires complexes. Encore faut-il que ce pôle de santé publique ait les moyens de son action. Or, le moins qu'on puisse dire, est que ses moyens sont dérisoires par rapport à la difficulté du dossier de l'amiante ! À tel point qu'on peut s'interroger sur l'existence d'une véritable motivation dans la recherche des causes et des responsabilités, quels que soient les résultats de cette recherche. Voilà pourquoi votre audition nous a paru importante. M. Alain SAFFAR : La question de l'amiante est difficile et les chiffres font effectivement frémir. On parle de 3 000 décès par an et de 50 000 décès dans les vingt-cinq ans à venir, dans l'hypothèse la plus basse. Cela équivaut presque au nombre de décès par accidents de la circulation, lesquels sont d'ailleurs plutôt en baisse. La question de l'amiante se pose en termes généraux du point de vue de la responsabilité pénale car il n'y a pas de régime spécial en ce qui concerne le droit applicable au fond. En revanche, il existe un régime procédural particulier à travers ces pôles santé. Sur le droit applicable au fond, des condamnations pénales - une petite dizaine - ont bien été prononcées en matière d'amiante. Mais elles sont intervenues dans des affaires où il n'était pas question de blessures ou d'homicides involontaires dus à des expositions longues à l'amiante. Il s'agissait d'infractions plus ponctuelles de non respect de la réglementation amiante, notamment dans le domaine professionnel, par exemple sur des chantiers. Mais ce n'est pas le cœur de notre sujet. Le problème concerne les victimes d'une exposition longue à l'amiante, qui doivent inscrire leur action dans le cadre de la procédure très générale de la responsabilité pénale en matière d'infractions non intentionnelles. Et, dans ce domaine, la loi Fauchon, votée le 10 juillet 2000, rend la recherche de la preuve plus précise pour obtenir condamnation. Mais il ne faudrait pas que la loi Fauchon soit l'arbre qui cache la forêt. Toute une série d'instructions pénales ont été menées, qui se sont conclues par des non-lieux non fondés sur la loi Fauchon. D'autres éléments juridiques sont intervenus : la prescription de l'action publique si, dans le délai de trois ans après le décès ou la consolidation de la maladie, l'action n'a pas été engagée ; l'extinction de l'action publique par le décès des personnes possiblement mises en cause ; l'impossibilité de poursuivre des personnes morales pour des fautes commises avant l'entrée en vigueur de la loi créant la responsabilité pénale des personnes morales, c'est-à-dire avant le 1er mars 1994. Une autre difficulté est également apparue au niveau de la recherche probatoire liée à l'absence de démonstration d'un lien de causalité certain entre la faute et le dommage, ce qui nous rapproche de la loi Fauchon. La loi Fauchon a une vocation générale, même si elle a été envisagée, à l'origine, pour régler principalement les problèmes de responsabilité pénale indirecte des élus. Il s'agissait de responsabiliser ceux-ci, sans avoir à dévider à l'infini l'enchaînement des causes pour essayer de trouver une responsabilité. Cette loi s'applique donc à tous car il ne peut y avoir de régime spécial de responsabilité pour les fonctionnaires, les élus ou les chefs d'entreprise, etc. En matière de responsabilité pénale pour homicide ou blessures involontaires, une simple négligence, imprudence, inobservation des règlements suffit normalement si un lien de causalité certain est établi avec le dommage. C'est relativement simple à appréhender lorsqu'on a affaire à l'auteur direct du dommage, l'exemple le plus simple étant celui de l'automobiliste qui renverse un piéton. Mais c'est plus difficile lorsque l'on a affaire avec un auteur indirect, auquel on reproche de ne pas avoir pris les mesures qui auraient permis d'éviter le dommage, ou qui se trouve bien plus haut dans la chaîne des responsabilités que le simple auteur direct. Prenons le cas de l'automobiliste qui heurte un piéton et le blesse très légèrement. Le piéton est conduit à l'hôpital pour y subir une intervention chirurgicale sous anesthésie générale. Cette intervention se passe mal, et il décède. Aux termes de la jurisprudence, la responsabilité de l'anesthésiste était retenue, ainsi que celle de l'automobiliste, qui se trouvait pourtant assez loin dans l'enchaînement des causalités. Depuis la loi Fauchon, l'auteur indirect S'agissant de la récente affaire concernant l'amiante, on avait l'occasion que la Cour de cassation se prononce sur l'applicabilité ou non de la loi Fauchon à l'affaire de l'amiante. Le juge d'instruction, en première instance, avait estimé, en rendant une ordonnance de non-lieu, que la loi Fauchon interdisait de mettre en œuvre la responsabilité pénale des employeurs et, en appel, la chambre de l'instruction avait confirmé cette décision. Mais la Cour de cassation n'a rien pu dire à ce sujet car elle ne s'est pas prononcée sur le fond. Elle a simplement dit que les pourvois des parties civiles étaient irrecevables. Pourquoi, dans cette affaire, le Parquet général ne s'était-il pas pourvu en cassation ? Tout simplement parce que, devant la chambre d'instruction, il avait conclu au non-lieu. La chambre d'instruction lui ayant donné raison, il aurait manqué de cohérence s'il avait demandé à la Cour de cassation de casser un arrêt qu'il avait, lui-même, appelé de ses vœux. Mme Martine DAVID : On peut toujours s'apercevoir qu'on a eu tort. M. Alain SAFFAR : J'adhère complètement à votre propos, d'autant que l'on vit actuellement une période turbulente... Mais le délai de pourvoi en cassation n'est, malgré tout, que de cinq jours et, pendant cette période, je doute que des changements tels que ceux auxquels vous pensez soient intervenus. Dans votre questionnaire, vous demandiez s'il ne serait pas nécessaire de modifier l'article 575 du code de procédure pénale, qui pose le principe selon lequel la partie civile, sauf exception, ne peut se pourvoir seule en cassation. Je remarque d'abord que sept cas d'exceptions sont prévus, ce qui n'est pas rien. Par ailleurs, il faut modifier avec prudence ce genre de dispositions. En effet, la Cour de cassation est un organe régulateur du droit. Elle dit le droit, unifie la jurisprudence à l'échelle nationale, mais ne constitue pas un troisième degré de juridiction. L'ouverture aux parties civiles du droit de saisir la Cour de cassation, à côté du ministère public, augmenterait le risque qu'on utilise la Cour de cassation pour juger une troisième fois l'affaire. Ce n'est pas dans notre tradition juridique et c'est pourquoi il n'est pas d'actualité d'augmenter le nombre de cas où la Cour de cassation peut être saisie directement par les parties civiles. Sur le plan procédural, on l'a vu, l'amiante fait l'objet de particularités, puisque les pôles de santé publique, qui sont en concurrence avec les juridictions de droit commun, ont la possibilité de juger ces affaires. Les pôles de santé publique existent depuis la loi Kouchner de 2003, mais à l'origine, leur saisine n'était pas possible pour des produits pouvant attenter à la santé de l'homme. Elle ne l'était que pour les produits alimentaires et pour les produits dits « de santé », ce qui n'est pas le cas de l'amiante. Le regroupement des procédures concernant des produits tels que l'amiante devant les pôles de santé publique ne date que de la loi du 9 mars 2004 et la dépêche circulaire qui a préconisé ce regroupement pour l'amiante date du 12 mai 2005. S'agissant de dossiers lourds, complexes, avec de nombreuses victimes et où les responsabilités peuvent être multiples, la réponse judiciaire n'en sera que meilleure, puisqu'on aura affaire à des magistrats spécialisés. Les associations de victimes étaient, d'ailleurs, particulièrement satisfaites que ce regroupement ait été ordonné. Avant mai 2005, on comptait sept procédures au pôle santé de Paris. Depuis cette date, il y en a une vingtaine de plus. Actuellement, la direction des affaires criminelles et des grâces suit 33 enquêtes - dont 21 informations judiciaires - parmi lesquelles 28 sont au pôle de santé publique de Paris et une au pôle de Marseille. Au moment de la mise en place du pôle santé de Paris, il y avait trois juges d'instruction. Depuis 2005, ils sont quatre. Et il y a six magistrats du parquet. Les demandes de moyens supplémentaires dont nous avons connaissance proviennent des magistrats du Parquet qui ont été transmises à la direction des services judiciaires. On nous a également demandé d'augmenter le nombre d'enquêteurs. M. le Président : Apparemment, la partie « siège » du pôle manque également d'enquêteurs. M. Alain JAFFAR : Il y a tout de même 4 OPJ à la section des recherches, auxquels s'ajoute un groupe de travail de quinze personnes qui traite de la pollution au travail au sein de la Brigade de répression de la délinquance à la personne, la BRDP, qui est rattachée à la préfecture de Paris, plus les douze enquêteurs de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, l'OCLAESP. Cette dernière structure se partage entre police et gendarmerie mais elle est commandée par un colonel de gendarmerie et ne comprend, pour le moment, que des gendarmes. J'ajoute que l'ANDEVA, qui s'était manifestée auprès de nos services et de notre cabinet, a pu obtenir, par notre entremise, d'être reçue par le cabinet du ministre de l'intérieur pour parler de ces problèmes d'effectifs d'enquêteurs. M. le Président : Quand même, comprenez notre interrogation : nous sommes dans un cas où il n'y a pas prescription de l'action publique, où il y a bien dommage et où le lien de causalité est certain, du moins dans de nombreux dossiers, entre la cause et le dommage. Prenons le cas des dockers : 80 % du trafic d'amiante, en fibres, à Dunkerque, s'est fait en sacs de jute et en univers confiné et il y a déjà eu plusieurs décès par mésothéliome, cancer qui est indiscutablement lié à l'amiante. Les faits sont prouvés, les rôles d'embarquement, les bateaux, les tonnages sont connus et les témoignages multiples. Comment expliquer que dans une telle situation, où des fautes ont pu être relevées, puisqu'il existait déjà des réglementations susceptibles d'être appliquées, même si elle sont intervenues tardivement - l'État a d'ailleurs été condamné - les procédures aient abouti à des non-lieux et, en dernier ressort, à un arrêt de la Cour de cassation qui se limite - d'ailleurs à regret, semble-t-il - à rejeter le pourvoi des victimes ? Résultat : faute d'une instruction correcte, tout s'arrête, ce qui est terrible pour ceux qui ont intenté l'action. En fin de compte, on ne peut que s'interroger sur l'existence d'une véritable motivation de la part du Parquet, de même que sur la pertinence des textes M. Alain SAFFAR : Dans l'affaire de l'amiante, des juges d'instruction ont été nommés, et il y a eu des informations judiciaires, pour l'essentiel à l'initiative des parties civiles. Les victimes avaient d'ailleurs pris le parti, dans un premier temps, de saisir la justice en se constituant partie civile, pour mettre en mouvement l'action publique, comme elles en ont tout à fait le droit. L'arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre fait suite à une instruction, effectuée par un juge d'instruction, qui a estimé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la juridiction de jugement, d'où la décision de non-lieu de la chambre de l'instruction. Par ailleurs, on observe qu'aujourd'hui les parquets sont saisis de plaintes simples qui transitent obligatoirement par le Parquet, lequel ne dispose, dans un premier temps, que de documents succincts qui nécessitent toujours d'être étayés avant qu'un juge d'instruction ne soit saisi. En effet, lorsque le Parquet reçoit une plainte simple, aucun procès verbal de gendarmerie n'est encore établi. Sa première réaction est donc de déclencher une enquête préliminaire, dont est saisi le plus souvent l'OCLAESP, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mme Martine DAVID : Quelle est sa hiérarchie ? M. Alain SAFFAR : L'OCLAESP est saisi par les magistrats du parquet du pôle de santé publique et il dépend du ministère de l'intérieur pour l'aspect organique et le ministère de la défense pour l'aspect gendarmerie. Les associations de victimes que nous avons reçues avaient le sentiment que l'enquête préliminaire était inutile et qu'il fallait immédiatement enchaîner sur l'instruction. C'est leur opinion, mais le déclenchement d'une enquête préliminaire à la suite d'une plainte simple n'a rien d'exceptionnel et ce n'est pas un « non acte juridique » que de déclencher une procédure qui permet, quand même, de préciser qui est la victime, les périodes où elle a travaillé, les certificats médicaux dont elle peut disposer, etc. C'est au retour de cette enquête préliminaire que le Parquet juge de l'intérêt d'ouvrir une information. Mme Martine DAVID : Cela peut vous paraître logique et juste. Mais quand un mésothéliome est avéré, la victime peut considérer qu'il est injuste de faire encore une enquête préliminaire. Il faut comprendre l'impatience des victimes ou de leur famille. M. Alain SAFFAR : Les enquêtes préliminaires permettent souvent de bien cadrer les contours de la saisine du juge d'instruction. N'oublions pas qu'il faut gérer des moyens qui sont contingentés. Grâce à de telles enquêtes, on peut débroussailler le terrain avant de le saisir. Cela dit, je comprends l'impatience des victimes et je pense qu'on finira logiquement par aboutir à l'ouverture d'informations. Un problème se posera toutefois lorsqu'on aura des victimes différentes dans des affaires qui impliquent des responsabilités pénales ayant déjà été examinées dans le cadre de l'instruction d'autres dossiers : des victimes ont pu se constituer parties civiles devant un juge d'instruction qui a ouvert une information, sur laquelle un juge s'est déjà positionné ; par ailleurs, d'autres victimes ont pu déposer une plainte simple qui a abouti à une enquête préliminaire. Dans un tels cas, on aura deux enquêtes parallèles et il faudra organiser le rapprochement de l'instruction effectuée à l'initiative des parties civiles, de l'enquête préliminaire suivie par le Parquet. Il est logique que ces affaires soient jointes et c'est d'ailleurs l'intérêt du regroupement. M. le Rapporteur : Nous avons conçu quelque inquiétude devant le manque de personnel du pôle de santé publique. Est-ce un problème de moyens ? Est-ce un problème d'organisation ? Si je comprends bien, ce pôle de santé publique, qui fonctionne comme une juridiction, avec un parquet et un siège, intervient sur d'autres domaines que celui de l'amiante ? M. Alain SAFFAR : Il intervient sur toutes les grandes questions de santé publique. M. le Rapporteur : Son fonctionnement est-il satisfaisant dans ces autres domaines ? M. Alain SAFFAR : À ma connaissance, oui. Je n'ai entendu parler de difficultés qu'à propos de l'amiante - le dossier avancerait trop lentement. Pour le moment, il n'y a que quatre juges d'instruction. Je précise que si d'aventure, à l'issue de son instruction, un juge d'instruction estimait qu'il y a des charges suffisantes, il renverrait les personnes concernées devant le tribunal correctionnel de Paris pour un jugement de fond car, au niveau du siège, c'est-à-dire au niveau des juges de fond, il n'y a pas de chambre spécialisée. Autrement dit, il n'y a pas de pôle santé publique pour les juges qui jugent. Il y a un pôle santé pour le Parquet et pour l'instruction seulement. C'est exactement ce qui se passe en matière de terrorisme, par exemple. M. le Président : Comme vous le savez, un débat a eu lieu sur la loi Fauchon. J'aurais bien aimé avoir votre sentiment sur la portée de cette loi. M. Alain SAFFAR : Vous me demandez si la réglementation de la fin du XIXe siècle pourrait être considérée comme une « obligation particulière » justifiant que soit retenue la responsabilité pénale des personnes mises en cause au sens de la loi Fauchon. Ce n'est pas à la Direction des affaires criminelles et des grâces de le dire. C'est aux tribunaux qu'il appartiendra de se prononcer et de dire si la loi de 1893, qui parle « d'empoussièrement » et non pas « d'amiante », peut correspondre à la notion « d'obligation particulière prévue par la loi ou le règlement », ou s'il s'agit d'une loi d'obligations « générales ». M. le Président : On vous demandait également si l'interprétation judiciaire de la loi vous paraît acceptable ? M. Alain SAFFAR : Le Garde des Sceaux ne peut pas commenter une décision de justice et la Direction des affaires criminelles et des grâces non plus. Dans l'affaire de Dunkerque, le juge a estimé que la loi Fauchon s'appliquait. Mais il ne faut pas en tirer une conclusion définitive pour les autres dossiers à venir. Mme Martine DAVID : Reste que c'est décourageant pour les victimes ! M. Alain SAFFAR : Certes. Mais ce n'est pas parce que cette décision judiciaire est intervenue que toutes les suivantes iront nécessairement dans le même sens. J'ai souvent entendu : « nous voulons un procès pénal "de l'amiante" ». Mais les juges ne jugent pas « l'amiante ». Ils jugent le dommage causé à M. Untel, précisément identifié, qui a travaillé dans telle entreprise, de telle date à telle date. Qui était le responsable pénal de cette entreprise à ce moment-là ? Quelle était la réglementation applicable à ce moment-là ? Ils ne sauraient appréhender, dans sa globalité, le phénomène de santé publique qu'est l'amiante. M. le Président : Nous vous comprenons très bien et nous avons eu ce débat avec l'avocat général près la Cour de cassation qui nous faisait remarquer qu'un pôle centralisé traitant les problèmes de santé pouvait avoir une plus grande efficacité, ce à quoi nous répondions, comme vous, qu'aucune affaire ne ressemble à une autre : le problème des dockers de Dunkerque peut valoir pour les dockers de Cherbourg mais, en effet, il concerne une autre entreprise. Toutefois, quand on sait, par ailleurs, que ce pôle d'instruction - dont on attend beaucoup - a des moyens insuffisants, on a l'impression qu'on tourne en rond. Finalement, y a-t-il une véritable motivation pour qu'un jour, une instruction sérieuse soit menée sur une affaire, quelle que soit la décision finale ? Mais peut-être estimez-vous que c'est un raisonnement plus politique que juridique. M. Alain SAFFAR : J'observe que la décision à laquelle la Cour de cassation avait répondu, avait été prise par la chambre de l'instruction de Douai. Ce n'était pas une décision de la chambre de l'instruction de Paris. Dans le pôle de santé publique, interviendront d'autres magistrats que ceux qui se seront déjà positionnés en faveur de l'application de la loi Fauchon. Pourquoi craindre un positionnement de principe ? M. le Président : J'ai tout lieu de le craindre, en effet. M. Alain SAFFAR : Non, car chaque cas est un cas d'espèce. Par ailleurs, ceux qui devront désormais se prononcer sur les cas qui nous intéressent seront les magistrats, non plus de Dunkerque et de Douai, mais du pôle de santé de Paris, c'est-à-dire des personnes différentes. Mme Martine DAVID : J'ai tout de même le sentiment que vous avez botté en touche s'agissant de la nécessité, ou non, de réviser la loi Fauchon. Certes, le garde des Sceaux ne commente pas les décisions de justice. Mais il exerce une responsabilité gouvernementale qui peut l'amener, lui-même et ses collaborateurs, à proposer ou non la révision de cette loi. C'est sur ce point que nous souhaitons connaître votre opinion. D'après vous, il ne faut pas que nous déduisions des premières décisions que toutes les décisions iront dans le même sens en utilisant la loi Fauchon. Mais rien ne nous en donne la certitude aujourd'hui. Depuis des décennies, on savait que l'amiante aurait des conséquences lourdes en matière de santé publique sur un grand nombre d'individus et l'on craint encore des dizaines de milliers de morts dus à l'amiante. Comprenez que notre préoccupation soit réelle. Voilà pourquoi il vaudra peut-être mieux aller vers une révision de la loi Fauchon, même s'il y a le risque d'ouvrir une boîte de Pandore. M. Alain SAFFAR : Je ne peux pas vous dire que certaines juridictions écarteront l'application de la loi Fauchon. Je constate, simplement, comme vous, qu'elle a déjà trouvé application dans le dossier de l'amiante ; je ne peux pas non plus vous affirmer que demain il y aura des condamnations ; et je ne peux pas vous dire le contraire. Je pense simplement que le regroupement des magistrats au sein des pôles de santé publique permettra de mieux appréhender la question et d'y répondre dans de meilleures conditions. M. le Président : Est-ce que le Parquet peut se saisir lui-même au niveau de ces pôles ? M. Alain SAFFAR : Le Parquet a la possibilité de saisir les juges d'instruction. Jusqu'à présent, il n'a pas reçu de plainte simple directement de la part des parties civiles, mais des plaintes simples qui avaient été adressées à des juridictions extérieures à Paris et que celles-ci lui ont envoyées. Ensuite, il y a eu déclenchement des enquêtes préliminaires auprès de l'OCLAESP. Quand ces enquêtes reviendront - et nous allons vérifier où elles en sont -, le procureur de la République de Paris décidera ou non d'ouvrir des instructions. Cela dépendra de ce qu'il y aura dans les dossiers. M. le Président : Mais si les enquêtes préliminaires ne sont pas faites, on aura l'impression de tourner en rond. M. Alain SAFFAR : Elles sont faites mais le problème est de savoir si elles seront rapidement terminées. Les premières saisines de l'OCLAESP datent d'un peu après mai 2005 et je ne connais pas le plan de charge de cet office central. M. le Président : Comprenez notre préoccupation : c'est un dossier très lourd, complexe, où la recherche de responsabilités ne sera pas facile. L'opinion publique et les acteurs sont très mobilisés. Le nombre des décès augmente et il y a un souci très fort qu'une action pénale soit engagée sur un dossier significatif, emblématique - par exemple celui de Condé-sur-Noireau, où l'on vient d'inaugurer un monument dédié aux victimes de l'amiante, mais il y en a d'autres. Les victimes et les ayants droit veulent une réponse à cette question : est-ce qu'on aurait pu éviter une telle catastrophe ? La pression est très forte et ira en grandissant. Le pays est inquiet, il s'interroge sur lui-même et sur son avenir. Les maladies professionnelles se multiplient. Le rapport même à la justice a déjà été très malmené après l'affaire d'Outreau. Il faut qu'un mouvement s'engage sur une affaire significative, car la situation est terriblement inquiétante pour la justice et pour les parlementaires que nous sommes. Il y a quelque part un doute. Nous traitons d'autres sujets dans ce rapport - l'amiante résiduel, par exemple, mais le volet pénal est important. Vous avez répondu à nos questions en juriste, en haut fonctionnaire, mais j'ai voulu vous faire sentir quelles étaient les préoccupations de l'ensemble de la mission. Vous avez des contacts dans votre ministère. Mme Martine DAVID : Je tiens à conforter les propos du Président. À l'évidence, pendant des dizaines d'années en France, certains lobbies ont permis le silence sur l'amiante et sur ses conséquences. Aujourd'hui, des familles, des victimes ont, à l'égard du monde économique, plus que des doutes. Il ne faudrait que s'y ajoute un autre doute en matière de justice. Ne passons pas à côté de tout ce que les victimes ou leurs ayants droit peuvent attendre de nous, de vous, de tous ceux qui, à des niveaux différents de responsabilité, peuvent tenter de faire quelque chose pour leur répondre un tant soit peu. M. Alain SAFFAR : Pensez bien que nous sommes conscients de l'importance du sujet. Le fait que le directeur du cabinet du garde des Sceaux, son conseiller et nous-même ayons reçu des associations de victimes le prouve. Je ne pense pas qu'on puisse nous taxer de désintérêt. M. le Président : Au poste que vous occupez, ce serait irresponsable. Nous qui sommes sur le terrain, nous prenons la précaution de ne pas nous engager dans toutes ces manifestations, ce qui n'est pas toujours commode et pas toujours compris. Nous le faisons cependant, jusqu'au moment où il n'y aura plus de compréhension du tout. Il ne serait pas inutile que vous passiez le message à votre hiérarchie. Et, en tout état de cause, nous le ferons passer directement au ministre quand nous l'entendrons. Monsieur, nous vous remercions. Audition de représentants de la direction santé et sécurité d'Arcelor : M. Jean-Claude MULLER, directeur, et le docteur Michel DISS Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Rapporteur : Mes chers collègues, nous recevons aujourd'hui M. Jean-Claude Muller, directeur de la direction santé et sécurité d'Arcelor, accompagné du docteur Michel Diss qui travaille également au sein de cette direction. Cette audition fait suite au dossier que vous m'avez adressé sur votre position concernant le dispositif de prise en charge des victimes de l'amiante en France, ainsi que sur la politique d'Arcelor en matière de santé au travail et, plus généralement, sur la position du groupe concernant la prise en charge des maladies professionnelles. Pour résumer de façon peut-être un peu lapidaire votre dossier, vous estimez : que le traitement de l'amiante en France est unique en Europe et qu'il manque de rigueur médico-légale ; que la jurisprudence de la « faute inexcusable » de l'employeur qui s'est développée à l'occasion de l'amiante conduit à des dérives dont les entreprises ne seront pas les seules à faire les frais sur le long terme ; et que la prise en charge des plaques pleurales dans le cadre du dispositif propre à l'amiante ne correspond ni à la réalité des expositions professionnelles à l'amiante ni à un véritable trouble au plan médical. Ces positions s'appuient sur un certain nombre d'études médico-légales et débouchent sur des propositions concernant la réglementation de la réparation des accidents et des maladies professionnelles. Vous indiquez par ailleurs qu'Arcelor a mis en place une « politique proactive » fondée sur la notion de « bien-être au travail ». Tous ces points qui concernent à la fois la gestion du problème de l'amiante mais aussi les leçons qu'il faut en tirer du point de vue de la prévention et de la prise en charge des risques professionnels sont tout à fait au cœur du travail de notre mission. C'est pourquoi nous avons souhaité vous entendre. Après avoir reçu à peu près tous les acteurs institutionnels de ce dossier, il était intéressant d'avoir le point de vue d'une entreprise, et qui plus est, d'une entreprise multinationale, Arcelor étant une référence mondiale pour les aciers. Avant de vous donner la parole pour une dizaine de minutes, je vous demande d'excuser notre Président qui a été empêché de présider le début de cette réunion et qui m'a demandé de le remplacer. Il nous rejoindra tout à l'heure. Après votre propos liminaire, nous engagerons le débat avec les membres de la mission. M. Jean-Claude MULLER : J'ai effectué l'essentiel de ma carrière à Usinor, jusqu'en 2002, date de la création d'Arcelor. À partir de 1969, j'ai occupé pendant dix ans divers postes de responsabilité à l'aciérie de Sérémange. Puis, j'ai travaillé durant cinq ans aux hauts-fourneaux, comme directeur de l'usine à fonte de Hayange. Je présidais le comité d'établissement et le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). J'ai ensuite été muté dans le sud de la France, où j'ai été directeur général de l'usine de Sollac de Fos-sur-Mer, en exerçant, là aussi, la présidence du comité d'établissement et du CHSCT. Depuis 1995, j'exerce mes fonctions au siège d'Usinor, puis d'Arcelor. Du Luxembourg, on regarde la France sidérurgique, et on se demande d'où vient ce problème français, alors que toute la sidérurgie européenne a fait face au même problème, avec les mêmes moyens : se procurer des produits dans le commerce de façon à protéger efficacement contre le feu ou le métal liquide le personnel et les équipements ? J'ai passé beaucoup de temps dans des stages à l'étranger : à Brême en 1971, au Royaume-Uni en 1972, au Luxembourg en 1974. Les préoccupations et les réponses étaient voisines d'un pays à l'autre. Nous échangions avec nos collègues étrangers au sujet de problèmes techniques, y compris concernant les moyens de protection. Pourquoi dénaturer ainsi les relations de travail qui ont prévalu pendant des décennies et poursuivre en justice des personnes à la retraite. Deux personnes, âgées respectivement de 77 et 81 ans, ont été, sur simple dénonciation, l'objet de poursuites qui, après neuf ans de procédure, viennent de s'achever par un arrêt de la Cour de cassation qui les absout définitivement, du moins nous l'espérons. Pourquoi transférer sur les salariés d'aujourd'hui des charges du passé ? La mine d'amiante de Canari, en Corse, est fermée depuis 1965. On a estimé qu'il appartenait aux travailleurs d'aujourd'hui et de demain d'indemniser, par leurs cotisations AT-MP (accidents du travail - maladies professionnelles), les ayant droits de victimes de l'amiante. Pourquoi décourager tout entrepreneur de s'installer en France en maintenant une incertitude maximale sur l'ampleur des charges sociales passées qui devront être payées dans l'avenir ? Je rappelle que les assureurs ont retiré le risque amiante de leur couverture. Tout cela se passe dans un contexte réglementaire. Personne ne conteste aujourd'hui que les entreprises ont respecté la loi française. Aujourd'hui, il est facile de dire que nous étions, ou aurions dû être, conscients du danger. J'ai participé à la mise à jour d'un recueil de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans l'industrie du fer et de l'acier, sous l'égide du Bureau international du travail (BIT). Au 9 février 2005, aucune mention de l'interdiction de l'amiante n'était faite dans ce document mais en juillet 2005 - donc tout récemment - le BIT a recommandé de bannir l'amiante. Au Japon, qui est aux yeux de beaucoup de sidérurgistes européens une référence en matière de sécurité au travail, l'amiante vient d'être interdit à compter du 1er janvier 2006. La catastrophe sanitaire annoncée - 100 000 morts dans les 30 ans à venir - n'alarme pas les pays limitrophes. Elle n'est pas une préoccupation au Luxembourg, en Allemagne et en Espagne. Il est vrai que ce chiffre représente moins de 0,7 % des 15 millions de morts attendus dans les trente ans qui viennent, puisque l'on dénombre 550 000 décès par an en France. Toute entreprise se doit de tenir compte des contraintes qui lui sont imposées dans les décisions concernant son futur. Je constate que le dossier de l'amiante, tel qu'il est traité en France, est source d'injustices, tant pour les personnes indemnisées ou indemnisables que pour celles qui auront la charge de payer. M. Michel DISS : Je suis médecin du travail et membre de la direction santé et sécurité du groupe Arcelor. J'ai été médecin généraliste dans un village près de Thionville de 1972 à 1983, puis médecin du travail au sein du groupe Usinor de 1983 à 2002, où j'ai eu en charge des hauts-fourneaux en 1983 et 1984 et l'aciérie de Sollac Sérémange de 1985 à 2002, où j'ai été chef du service médical de 1987 à 2002, et médecin coordinateur du groupe Usinor de 1997 à 2002. Depuis cette date, j'ai en charge, au sein de la direction santé et sécurité du groupe Arcelor, le département « sécurité produits ». J'ai travaillé avec le CHSCT de l'aciérie sur l'amélioration des conditions de travail et d'hygiène de 1987 à 2002. Lorsque, jeune médecin du travail, en 1983, je suis arrivé dans les installations produisant de la fonte et de l'acier, j'ai cherché à savoir comment était appliqué le décret de 1977 concernant l'exposition des salariés à l'amiante. Mon constat a été le suivant : dans un contexte d'empoussièrement important dû aux oxydes de fer, les maçons fumistes étaient plus particulièrement exposés à la silice et à l'amiante, mais l'utilisation de l'amiante était occasionnelle pour les autres métiers. Le choix qui avait été fait à l'époque était, d'une part, le port de protections individuelles pour les salariés exposés à la silice et à l'amiante, et d'autre part, de remplacer, déjà à l'époque, des équipements de protection contenant de l'amiante par d'autres. Quand je suis arrivé, les fondeurs, à l'aciérie ou aux hauts-fourneaux, étaient équipés de manteaux en amiante aluminisés. Ils ont commencé à être remplacés, après 1985, par des manteaux en Kevlar, donc bien avant l'interdiction de l'amiante en France. En tant que médecin coordinateur du groupe Usinor, j'ai participé au comité de suivi de l'étude épidémiologique réalisée, à la demande d'Usinor, par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) de 1997 à 2003 dans l'usine de Dunkerque. Il s'agit de l'étude de mortalité la plus importante qui ait jamais été réalisée en sidérurgie. Au début des années 2000, en collaboration avec les médecins du travail et les experts du groupe Usinor, après le décret de 2001 sur les substances chimiques dangereuses, j'ai réalisé le référentiel d'évaluation et de surveillance médicale des risques professionnels en sidérurgie, mis à la disposition des médecins d'Arcelor en 2002. Parmi les quelque trente-cinq ou quarante fiches de risques de maladies professionnelles ainsi réalisées, figure encore une fiche sur l'amiante. En effet, tout l'amiante n'a pas pu être retiré de sites aussi importants que les usines sidérurgiques, tout comme il n'a pas pu l'être encore dans les bâtiments d'habitation. Dans mes fonctions actuelles, et au contact de mes collègues médecins du travail étrangers au sein d'Arcelor, j'ai constaté, au niveau des maladies professionnelles attribuables à l'amiante en France, un manque de rigueur scientifique dans leur définition et dans la recherche de leur étiologie diverse, ainsi que dans le traitement administratif de ces affections dans le cadre des tableaux de maladies professionnelles. M. le Rapporteur : Je précise que la Cour de cassation, si c'est bien à l'arrêt du 15 novembre dernier que vous faisiez allusion, n'a pas « absous » les personnes contre lesquelles une plainte avait été déposée. À la suite d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Dunkerque, le 16 décembre 2003 et confirmée le 15 juin 2004 par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, elle a simplement rejeté le pourvoi formé par différentes parties civiles pour des raisons de procédure, en application de l'article 575 du code de procédure pénale. M. Jean-Claude MULLER : En tout état de cause, je suis heureux qu'il ait été mis un terme à cette procédure qui aura duré neuf années pendant lesquelles ces braves gens, mis hors de cause en correctionnelle et en appel, ont eu à subir des auditions au tribunal, alors qu'ils sont à la retraite depuis quinze ans. M. le Rapporteur : Vous avez évoqué l'importance de l'étude menée dans le milieu sidérurgique. Il serait intéressant que vous développiez ce point. Je souhaiterais également que vous évoquiez la question des plaques pleurales, du mésothéliome et du cancer broncho-pulmonaire. M. Michel DISS : Le groupe Usinor a réalisé, en collaboration étroite avec le département « épidémiologie du travail » de l'INRS, six études épidémiologiques dans ses différentes usines. Il s'agissait de six études de mortalité, depuis le début des années 80. Nous avons d'abord cherché, dans cinq usines où l'on fabriquait de l'inox, des relations avec le chrome, le nickel et d'autres cancérogènes pulmonaires. Ces études, qui sont de niveau international, ont été publiées dans les meilleures revues épidémiologiques. Je vous remettrai la liste de ces études ainsi que leurs résumés. Pour l'étude de Dunkerque, je vous remettrai une synthèse un peu plus longue. Je vous remettrai également un document qui retrace la mortalité, par cause, de toute la cohorte de l'étude, de 1959 à 1998 effectuée à Dunkerque. Pourquoi le site de Dunkerque a-t-il été choisi ? Parce que l'on recherchait une relation entre le cancer broncho-pulmonaire et les oxydes de fer, l'amiante, la silice, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les brouillards d'huile et le tabac. L'usine de Dunkerque ayant la particularité de n'être qu'une usine à chaud, c'était l'usine qui produisait le plus d'oxydes de fer, et où le personnel, du fait de la cokerie et du métal chaud, aurait dû subir l'exposition maximale à ces différents cancérogènes. Toutes causes confondues, la mortalité par cancer des membres de la cohorte - c'est-à-dire des salariés embauchés entre 1959 et 1998 - est inférieure à celle de l'ensemble de la population du Nord. Je précise que cette étude a été réalisée entre 1997 et 2000 par Jean-Jacques Moulin et Denis Hémon, de l'INSERM. M. Jean-Claude MULLER : La cohorte comportait environ 30 000 salariés, dont 3 000 étaient décédés au moment de l'étude. On a recherché leurs cursus et les causes de leur décès. M. Michel DISS : Dans la cohorte définitive, ont été retenus 2 338 décès. Le total des cancers était de 843, dont 233 décès dus au cancer broncho-pulmonaire, pour 261 attendus étant donné la mortalité par cancer du poumon dans la population générale du Nord. Le SMR - Standardized Mortality Ratio, ou ratio standardisé de mortalité - est donc de 0,89. S'agissant des cancers de la plèvre, 7 ont été relevés pour 8,77 attendus, le SMR étant de 0,81. L'INRS a comparé les populations exposées dans l'usine aux différents cancérogènes pulmonaires avec les populations non exposées. Il a étudié les décès par cancer broncho-pulmonaire des salariés exposés aux oxydes de fer, à l'amiante, aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, aux brouillards d'huile et au tabac, facteur extraprofessionnel. Concernant l'amiante, les experts de l'INRS et de l'INSERM concluent à un risque relatif supérieur à l'unité, de 1,22, mais statistiquement non significatif, dans l'intervalle de confiance de 95 %. Aucune relation entre dose et effet n'a été constatée. Le risque relatif de 1,22 n'augmente pas avec la durée de l'exposition, sa densité ou sa fréquence. Cela résulte du fait que les niveaux d'exposition observés en sidérurgie sont relativement bas par rapport à ceux d'industries où l'amiante constitue une matière première essentielle. S'agissant du tabac, qui concernait 77 % de la cohorte, il est apparu que le risque relatif d'un cancer broncho-pulmonaire est de 26,22 pour les fumeurs et de 6,82 pour les anciens fumeurs. Sur plusieurs milliers de salariés d'Usinor, 36 % étaient fumeurs, contre 26 % dans la population générale. Nous avons donc entrepris des actions visant à diminuer ce nombre. Usinor, comme les autres entreprises sidérurgiques en Europe et dans le monde, a utilisé des articles en amiante. Malgré cela, on recense dans le groupe Usinor France 2 215 dossiers de maladies professionnelles liées à l'exposition à l'amiante, dont plus de la moitié concernent des salariés à la retraite. Parmi ceux-ci, 440 actions en faute inexcusable sont intentées, dont 70 % pour des plaques pleurales, 63 dossiers concernant des cancers broncho-pulmonaires, dont le plus âgé à 97 ans ; 20 dossiers concernent des mésothéliomes. Je précise que, dans les dossiers de maladies professionnelles concernant la sidérurgie française, il n'y a pas d'asbestose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surcharge pulmonaire liée, comme pour la silicose, à un empoussièrement massif par l'amiante. Pour le cancer broncho-pulmonaire primitif, toutes les publications actuelles disent que le risque relatif dû aux expositions massives à l'amiante est de 5. Or, les expositions n'ont pas été massives à Usinor, comme en témoigne l'absence d'asbestose, ainsi que l'absence de cancers broncho-pulmonaires liés au tableau 30, qui sont des conséquences de maladies antérieures liés à l'amiante. Parmi 280 000 nouveaux cas de cancers, sont recensés entre 727 et 820 mésothéliomes par an, ce qui représente 0,3 % des cas de cancers en France. Par ailleurs, une première publication de l'INRS concerne les relations dose/effet entre faibles niveaux d'exposition à l'amiante et mésothéliome pleural dans la population générale. Un réseau d'anatomo-pathologistes, le réseau Mésopath, a été créé. Plusieurs centaines de cancers de la plèvre - 950 - ont été identifiés par les anatomo-pathologistes non spécialistes du mésothéliome. Le réseau Mésopath a rendu la conclusion suivante : le diagnostic de mésothéliome a été confirmé par le collège français des anatomo-pathologistes du mésothéliome. Ce collège a exclu 46 sujets, soit 10 % de ceux recrutés initialement. Chez 125 sujets, soit 31 % des 405 cas restants, le collège n'a pas pu conclure, parce que le matériel histologique prélevé était insuffisant ou parce que les lames ne lui avaient pas été envoyées. Le diagnostic probable a, alors, été établi après lecture des données publiques. Une deuxième étude a été produite lors du symposium « Amiante et risques professionnels : études épidémiologiques récentes ». Parmi ses conclusions, on peut lire ceci : « Au cours du PNSM52 1998-2003, le groupe Mésopath a enregistré 980 signalements. Le diagnostic fait par le pathologiste initial a été confirmé pour la période 1998-2001 dans 68,5 % des cas, rejeté dans 14 % des cas. Pour 17,5 %, il a été impossible d'affirmer ou d'exclure définitivement le diagnostic de mésothéliome en raison d'un matériel jugé non significatif ou parce que la tumeur est restée inclassée. » M. le Rapporteur : Quelle leçon pouvez-vous dégager de ces chiffres ? M. Michel DISS : Notre souci est la rigueur médicale. Le mésothéliome est le cancer lié à l'amiante, cela n'est pas contestable. Pour un certain nombre d'autres cancers, on a institué la double ou la triple lecture, afin que les diagnostics soient parfaitement faits et que les causes soient bien déterminées. Dans le cas du mésothéliome, et cela m'a été confirmé par un pneumologue de Thionville qui est également expert auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), la lecture des lames histologiques est très difficile. Ce collègue a très clairement dit que les lames n'étaient pas lues deux fois, et que la majorité des diagnostics n'avaient pas été portés dans le cadre du réseau Mésopath, mais par des laboratoires d'anatomopathologie de la région concernée. Il y a donc bien un manque de rigueur scientifique. M. Jean-Claude MULLER : J'ajoute que nous sommes dans un système où, à partir du moment où une maladie a été reconnue comme maladie professionnelle, on s'interdit de poursuivre plus avant l'examen des données médicales. Nous avons deux dossiers en cours. Dans l'un d'eux, la victime a fait rechercher la présence d'amiante. Elle n'en a pas trouvé. Mais cela ne gêne pas son avocat : la maladie est reconnue, et cela seul suffit. Une maladie liée à l'amiante n'a pas besoin d'amiante. Voilà un exemple de manque de rigueur. M. Gérard BAPT : S'agissait-il d'un mésothéliome, en l'occurrence ? M. Jean-Claude MULLER : Non, il s'agissait de plaques pleurales. L'autre cas concerne une personne qui fumait quarante cigarettes par jour. Son cancer broncho-pulmonaire a été considéré comme n'étant pas lié à son comportement tabagique. Pour revenir au mésothéliome, qui est particulièrement dramatique, nous souhaitons que l'on développe la recherche afin de savoir ce qui s'est réellement passé. M. Michel DISS : Notre propos n'est pas de contester en quoi que ce soit la relation entre l'exposition à l'amiante et le mésothéliome. Il s'agit de faire preuve de plus de rigueur médicale et scientifique dans le diagnostic. M. le Rapporteur : Pourriez-vous développer votre analyse en ce qui concerne les plaques pleurales ? M. Michel DISS : Les lésions pleurales bénignes sont reconnues dans le tableau 30 des maladies professionnelles. Ces plaques pleurales représentent, je l'ai dit, 70 % des actions intentées contre Arcelor pour faute inexcusable. Elles représentent également 70 % des maladies professionnelles relatives à l'exposition professionnelle à l'amiante réparées par le FIVA. Elles sont reconnues sans critère radiologique ni conséquences directes. Il n'y a pas de définition spécifique identifiant telle image de plaques pleurales comme étant celle de plaques liées à l'exposition à l'amiante. Un excellent document du professeur Choudat montre que ces plaques pleurales, qui sont majoritairement sans conséquences, c'est-à-dire qui ne s'expriment ni par des troubles respiratoires, ni par des douleurs, ni par des maladies, sont simplement des images radiologiques que l'on indemnise actuellement dans le cadre du tableau 30. Dans la majorité des cas, ce sont des épaississements pleuraux, qui sont dépistés dans le cadre de la surveillance post-exposition à l'amiante. Quand les personnes concernées ont travaillé dans une usine où elles ont pu être en contact avec de l'amiante, en particulier une usine à chaud, elles sont très majoritairement indemnisées par le FIVA, entre 15 000 et 35 000 euros. Elles peuvent également avoir bénéficié de la préretraite dite « amiante à cinquante ans ». Par ailleurs, les études menées à partir d'autopsies systématiquement pratiquées sur plus de 7 000 personnes ont fait apparaître des plaques pleurales dans 12,2 % des cas. On peut donc estimer qu'entre 10 et 12 % de la population a des plaques pleurales. Étant donné que les indemnisations du FIVA peuvent être versées dans le cas d'expositions non professionnelles, on peut estimer qu'entre 10 et 12 % de la population est potentiellement bénéficiaire des indemnisations du FIVA. Mais ce n'est pas là mon propos. La situation de la France est unique. En Allemagne, les plaques pleurales, dès lors qu'elles sont bien définies radiologiquement, peuvent être reconnues, mais elles ne sont pas indemnisées lorsqu'elles ne s'expriment pas par une maladie. M. Jean-Claude MULLER : J'ajoute que les règles du jeu ont changé par rapport à il y a dix ou quinze ans. La France a modifié les tableaux de sorte que tous les épaississements pleuraux sont automatiquement reconnus. M. Michel DISS : Je peux citer le tableau 30 B. Il intègre les « lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires », de même que les « plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ». Auparavant, les plaques pleurales devaient être bilatérales pour figurer au tableau. Le tableau intègre également « l'épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. » Dans sa version initiale, il précisait que « ces anomalies constatées en l'absence d'antécédents de pleurésie de topographie concordante de cause non asbestosique devront être confirmées par un examen tomodensitométrique. » Mais le Conseil d'État a annulé cette disposition. On s'interdit donc tout diagnostic différentiel. Pourtant, ce type d'anomalie peut fort bien correspondre aux séquelles d'une pneumonie. Là aussi, nous estimons que plus de rigueur médicale et des critères définis par la faculté permettraient, comme dans les autres pays européens, un diagnostic mieux étayé et moins de dérives en ce qui concerne le nombre de cas attribués à l'exposition à l'amiante. Par ailleurs, le cancer broncho-pulmonaire primitif, qui, on le sait, dans la majorité des cas, entraîne la mort après une durée comprise entre cinq et dix ans, fait l'objet du tableau 30 bis. Or, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) peut reconnaître comme maladie professionnelle toute maladie entraînant une Incapacité partielle permanente (IPP) de plus de 25 %, dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la profession exercée et la maladie. L'expérience montre qu'il suffit pratiquement que le salarié atteint d'un tel cancer ait travaillé dans la sidérurgie pour que le CRRMP le reconnaisse comme maladie professionnelle. Je précise qu'un cancer broncho-pulmonaire est dit « primitif » quand il n'y a pas d'autre lésion associée. Nous estimons que la totalité des cancers broncho-pulmonaires survenant chez des personnes ayant été exposées à l'amiante ou à d'autres cancérogènes broncho-pulmonaires dans le milieu professionnel sont reconnus d'origine professionnelle, avec les conséquences judiciaires que l'on connaît, alors que 90 % d'entre eux sont également imputables au tabac. Le collège des pneumologues des hôpitaux généraux français a mené une étude sur les cancers broncho-pulmonaires, responsables de 25 000 morts par an en France. Cette étude fait ressortir que l'âge moyen des malades est de 64,3 ans. Parmi eux, 7,2 % n'ont jamais consommé de tabac, 40,3 % sont des anciens fumeurs et 52,5 % étaient toujours des fumeurs au moment de la découverte de la lésion cancéreuse. Autrement dit, d'après cette étude, 92 % des personnes atteintes d'un cancer broncho-pulmonaire ont fumé ou fument encore. Je rappelle que, d'après l'étude menée à Dunkerque, le risque relatif de survenue d'un cancer broncho-pulmonaire est de 6,82 pour les anciens fumeurs, de 26,22 pour les fumeurs, et de 1,22 pour les personnes anciennement exposées à l'amiante dans la sidérurgie. M. Gérard BAPT : Je suppose que ce risque de 1,22 concerne les personnes exposées et qui n'ont jamais fumé ? Si elles avaient fumé, le risque relatif serait beaucoup plus élevé. M. Michel DISS : Les docteurs Moulin et Hémon vous expliqueraient sans doute beaucoup mieux que moi comment ils sont arrivés à ces conclusions. Mais l'étude a tenu compte du comportement tabagique des personnes concernées. M. Jean-Claude MULLER : De manière générale, si vous n'avez pas été exposé à l'amiante et que vous ne fumez pas, votre risque relatif est de 1. Si vous êtes exposé à l'amiante, votre risque relatif est de 5. Si vous fumez, votre risque relatif est de 10. Si vous êtes exposé à l'amiante et que vous fumez, votre risque est de 50. M. le Président : Il est clair que le risque que présente l'exposition à l'amiante est aggravé par le tabac, comme l'ont montré les épidémiologistes de haut niveau que nous avons auditionnés lors de notre table ronde du 14 septembre dernier. Cela dit, il est très difficile de séparer les différentes causes possibles d'un cancer. Et faire varier un système d'indemnisation en fonction des différentes causes est un problème d'une rare complexité. Par ailleurs, le lien direct entre l'exposition à l'amiante et le mésothéliome n'est contesté par personne. M. Michel DISS : Je ne le conteste nullement. J'ai simplement cité un rapport de l'Institut de veille sanitaire (IVS) mettant en évidence que le diagnostic du mésothéliome peut être incertain, et qu'il est nécessaire d'introduire une plus grande rigueur scientifique. Concernant la sidérurgie, six études ont été menées, la dernière, conduite à Dunkerque, étant sans doute la plus puissante qui ait été menée dans le monde du travail. Elle sera publiée, comme les cinq autres, dans les meilleures revues internationales d'épidémiologie. M. Jean-Claude MULLER : Que le mésothéliome soit un traceur de l'amiante, cela n'est pas contestable, dans la mesure où il s'agit vraiment d'un mésothéliome. Par contre, l'essentiel des cancers broncho-pulmonaires qui nous sont imputés n'ont pas été causés exclusivement par l'exposition à l'amiante. Je regrette qu'on ne laisse pas les veuves de Dunkerque faire leur deuil. M. le Président : Elles doivent faire leur deuil, en effet. Et c'est un sacré deuil ! Car la mort par mésothéliome est l'une des choses les plus atroces que je connaisse. Je voudrais revenir à l'affaire de Dunkerque et à la décision de la Cour de cassation. Premièrement, vous avez regretté la longueur de la procédure. Je la regrette aussi. Les victimes avaient déposé plainte en février 1997. C'est trop long. Mais qu'y pouvons-nous si ce n'est déplorer le manque de moyens dont dispose la justice ? Deuxièmement, la Cour de cassation, qui n'a d'ailleurs pas suivi l'avocat général, n'a pas porté de jugement au fond. Elle a rejeté le pourvoi formé par différentes parties civiles en justifiant ce rejet au moyen d'un article du code de procédure pénale. Troisièmement, je ne pense pas que le problème soit de savoir quel serait le résultat final d'une procédure qui irait jusqu'à son terme. Nous sommes dans une situation où les conséquences de l'amiante sont très lourdes, même si elles sont aggravées par d'autres facteurs, ce que je veux bien admettre. Les procès, s'ils ont lieu, peuvent avoir un effet de catharsis. Il ne s'agit pas de désigner des responsables. Nous avons bien conscience que remonter dans le temps, étant donné les délais de latence très longs, sera extrêmement difficile, si ce n'est impossible. Il reste que l'État a été condamné et qu'il assume cette condamnation. Il faudra bien que, un jour ou l'autre, un regard soit porté sur ce qu'a été l'attitude des entreprises, non pas aujourd'hui, mais il y a vingt ou trente ans. Cela se traduira-t-il par des sanctions ? C'est une autre question. Je n'ai pas d'opinion sur ce point et je n'ai pas à en avoir. Je sais simplement qu'à Dunkerque, les dockers ont, pendant plusieurs années, transporté de l'amiante en sacs de jute, en univers confiné. M. Jean-Claude MULLER : Est-ce vrai de tous les dockers de France et de Navarre ? M. le Président : Je parle des dockers de Dunkerque, parce que c'est un cas que je connais bien. Pour le reste, vous avez parfaitement le droit de juger que les dispositions qu'a prises l'État sont critiquables, mais il les a prises. Il a assumé ses responsabilités. M. Jean-Claude MULLER : Sur le dossier de Dunkerque, je ne conteste pas ce que vous avez dit de l'arrêt de la Cour de cassation. Il reste qu'avant cet arrêt, le juge d'instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai. Dans ces deux cas, l'affaire a été jugée au fond. M. le Président : Non, et c'est bien là qu'est le problème. L'ordonnance de non-lieu n'était pas un jugement au fond. M. Jean-Claude MULLER : Il faudrait peut-être un jugement au fond. Cela étant, nous faisons tout notre possible pour défendre les intérêts de nos salariés, y compris quand ils sont en retraite. M. le Président : Je vous en félicite. M. Jean-Claude MULLER : En l'occurrence, deux d'entre eux ont été victimes de dénonciations rapides et ont ensuite été traînés devant la justice pendant près de dix ans. L'un accepte qu'on l'aide. L'autre est tellement écœuré qu'il a refusé toute aide de l'entreprise en décidant de se défendre tout seul. Les victimes, sont aussi les personnes qui sont traînées en justice sur de faux principes. On est en train d'ouvrir la boîte de Pandore en accusant un grand nombre de personnes d'avoir volontairement contaminé leurs collaborateurs. Les membres de l'Association régionale de défense des victimes de l'amiante (ARDEVA) ont été un peu trop loin, en maintenant la pression pour que des plaignants déposent plainte. Aujourd'hui, comme au Far West, il faut trouver quelques personnes à pendre. M. le Président : Ne mélangez pas tout, monsieur ! Je respecte votre personne, vos responsabilités et votre entreprise, que, soit dit en passant, je connais très bien, mais il ne faut pas tout mélanger. L'ARDEVA a pris une position qui lui est propre, et sur des thèmes que beaucoup d'entre nous ne partagent pas. Vous n'avez pas vu nos noms associés à des manifestations de l'ARDEVA. C'est une association qui mène une action. C'est la vie démocratique. En l'occurrence, elle demande la révision de la loi Fauchon, et ce n'est pas nécessairement notre position. Personne ici ne souhaite montrer du doigt tel ou tel. Mais il faudra bien, un jour, que soient analysées les responsabilités ou les non-responsabilités. Cette position est d'ailleurs aussi celle de l'avocat général près la Cour de cassation, que nous avons auditionné. On peut dire, effectivement, que l'opinion publique s'est emparée de ce dossier. Dans un tel cas, l'intérêt de tout le monde est de faire le maximum de clarté, ce que nous nous efforçons de faire, avec beaucoup de rigueur et sans parti pris. M. Michel DISS : Je suis venu ici pour témoigner parce que, d'une part, j'ai été médecin du travail dans une aciérie de 1984 à 2002, et que, d'autre part, nous avons mené, dans la sidérurgie française, six études épidémiologiques de mortalité, dont la dernière fait référence dans le monde entier. M. le Président : Fort bien ! Les informations de ce rapport figureront à côté de toutes les autres informations scientifiques sur lesquelles la mission pourra s'appuyer. M. Michel DISS : Nous avons toujours tenté de savoir, afin d'orienter nos actions de prévention, à quoi avaient été exposés nos salariés et de quoi étaient décédés nos anciens salariés. Il est tout à fait clair que les salariés ont été exposés à l'amiante dans la sidérurgie, en particulier dans les usines à chaud, où l'on a utilisé, pour les salariés et pour les installations, des protections à base d'amiante. Ces protections ont été remplacées, dès avant 1980, par des manteaux en amiante stabilisé aluminé, conseillé par les Caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) après le décret de 1977, puis par des manteaux en Kevlar. Le désamiantage a commencé dès le début des années 90. Les niveaux d'exposition du personnel exposé à l'amiante ont été faibles, comme s'accordent à le dire les experts de l'INRS et de l'INSERM. Concernant le cancer broncho-pulmonaire, il est certain que l'exposition à l'amiante n'est pas la cause unique de la majorité des cancers qui sont reconnus. Certains pays savent faire la différence entre les cancers directement liés à l'exposition à l'amiante et les autres, liés en majorité au tabac. Il suffit de se donner les moyens nécessaires pour faire des diagnostics exacts de mésothéliome. La rigueur est d'autant plus indispensable que les reconnaissances de maladies professionnelles, si l'on reconnaît une cause unique, peuvent être suivies de plaintes au pénal. Il serait souhaitable pour tout le monde, pour les victimes et leurs ayant droits, pour les entreprises, pour nos caisses de sécurité sociale, pour nos enfants et petits-enfants, que les diagnostics des affections soient étayés scientifiquement, à partir de critères reconnus internationalement, et que, par ailleurs, l'on sache faire la part du feu : les cancers broncho-pulmonaires primitifs, même quand ils sont reconnus comme étant dus à l'amiante, ne sont pas dus exclusivement à l'amiante. Nous constatons actuellement trop de dérives en ce qui concerne les plaques pleurales, les cancers broncho-pulmonaires primitifs, et les mésothéliomes, dont je ne conteste nullement qu'ils ont leur origine dans l'inhalation de fibres d'amiante, mais qui doivent être diagnostiqués de manière précise. M. le Rapporteur : Nous avons eu avant cette audition un premier échange, dont j'ai retenu que vous teniez sur un certain nombre de sujets un discours différent de celui que l'on a l'habitude d'entendre. Tout l'intérêt de cette mission est de nous amener à envisager autrement des problèmes sur lesquels il est utile de confronter différentes analyses. Au fur et à mesure des auditions, nous avons pris la mesure de la complexité médicale du sujet. J'ignorais, par exemple, que les plaques pleurales ne sont pas nécessairement liées à l'amiante. Pour poursuivre notre débat, je voudrais maintenant aborder la question de la présomption d'origine des maladies professionnelles et celle de la judiciarisation de la réparation complémentaire. M. Gérard BAPT : S'agissant des plaques pleurales, je suppose que des études médico-légales ont dû être faites, en particulier pour déterminer si des plaques pleurales sont liées ou non à l'exposition à l'amiante. Par ailleurs, j'ai appris récemment que l'ostéopontine serait un biomarqueur du mésothéliome. Cela permettrait de lever cette hypothèque des diagnostics contestables ou contestés de ce cancer. M. Michel DISS : En ce qui concerne les plaques pleurales, je peux simplement parler de mon expérience. Avant 1990, lorsque nous découvrions des plaques pleurales bilatérales et calcifiées, le pneumologue envoyait la personne chez un chirurgien thoracique en vue d'une thoracotomie bilatérale, afin de prélever un morceau de plèvre, l'analyser et rechercher des corps asbestosiques. Cette pratique, heureusement, a été supprimée. Les personnes concernées étaient déjà inquiètes quand on découvrait des plaques pleurales bilatérales, dont on sait maintenant qu'elles ne se cancérisent pas. Actuellement, le diagnostic ne se fait en France que sur la base d'images d'épaississements pleuraux, la plupart du temps par scanner. Or la série d'autopsies de routine publiée par Schwartz a montré que 12 % des personnes autopsiées étaient porteuses de plaques pleurales. M. Gérard BAPT : Il eût été intéressant de savoir s'il y avait de l'amiante dans ces plaques. M. Michel DISS : À ma connaissance, cela n'a pas été recherché. M. Gérard BAPT : C'est bien dommage. M. Michel DISS : Pour répondre à votre question relative au marqueur biologique, j'en ai entendu parler. Je ne peux guère en dire plus. J'insiste sur le fait qu'en France, on se fonde sur les travaux du réseau Mésopath. Or, étant donné le nombre de cas incertains publiés par Mésopath et par l'IVS, il serait bon de garantir un peu plus la qualité scientifique du diagnostic. M. Jean-Claude MULLER : Je voudrais revenir au problème de la présomption d'imputabilité. Celle-ci remonte, comme vous le savez, à la loi de 1898, date à laquelle le compromis social concernait surtout les accidents du travail. Il s'agissait d'éviter les discussions inutiles pour savoir si l'accident était lié ou non au travail. Mais il existe une grande différence entre un accident du travail et une maladie professionnelle. L'accident est clairement défini et daté. S'agissant de la maladie professionnelle, il est beaucoup plus difficile d'établir une relation de causalité. M. le Président : Nous sommes bien d'accord sur ce point. Le lien de causalité entre le travail et l'accident du travail est relativement facile à déterminer. Les choses sont autrement plus complexes en ce qui concerne les maladies professionnelles et c'est en cela aussi que le problème de l'amiante est intéressant. Cela ne change rien au fait que la tenue de plusieurs procès au fond - un seul procès n'aurait guère de sens - aurait l'intérêt de révéler les difficultés. M. le Rapporteur : Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le problème du diagnostic du mésothéliome ? M. Michel DISS : Je pensais, comme tout le monde, que le mésothéliome était nécessairement lié à une exposition à l'amiante, mais les deux études du réseau Mésopath que j'ai citées ont clairement établi que, dans l'une, pour environ 14 à 15 % des cas diagnostiqués il ne s'agissait pas de mésothéliome et, dans l'autre, il pouvait y avoir des doutes pour 30 % des diagnostics, ce qui représente entre 30 et 40 % des cas de mésothéliomes déclarés en 2000. Dans un contexte marqué par la judiciarisation, cela risque de conduire à une extension des procès à d'autres maladies professionnelles. Il faut donc que le diagnostic anatomopathologique soit rigoureux. M. Jean-Claude MULLER : J'appelle votre attention sur le fait que les maladies sont reconnues ou non selon que l'on respecte les critères administratifs définis dans les tableaux. Or, nous sommes en train de traiter le dossier d'une personne qui est affectée d'une maladie professionnelle mais qui n'a jamais occupé l'un des postes précisés dans le tableau correspondant. De bonne foi, tout le monde en tire la conclusion qu'elle ne peut pas être reconnue comme maladie professionnelle. Mais pour revenir à la présomption d'imputabilité, 90 % des cancers broncho-pulmonaires sont probablement dus au tabac, alors qu'on a tendance à nous en imputer 100 % qui seraient exclusivement dus à l'amiante. M. le Président : Mais personne ne vous impute rien ! M. Jean-Claude MULLER : Ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui paieront. M. le Président : Vous n'allez pas reprocher à la société d'indemniser un certain nombre de maladies! Quant à savoir qui paie, je pourrais vous tenir un long discours sur la nature de la fiscalité en France... M. le Rapporteur : On connaît les usages de l'amiante dans la construction navale et dans le bâtiment. Dans la sidérurgie, il a été utilisé, avez-vous dit, pour les vêtements de protection. Quels étaient ses autres usages ? M. Michel DISS : Je précise d'abord que tous les articles, et pas seulement les vêtements de protection, ont été achetés sur catalogue. Nous avons énormément travaillé pour remplacer l'amiante quasiment partout, sauf dans quelques coffrets électriques inaccessibles où il était identifié par un pictogramme, en application du décret de mars 1996. Pour l'essentiel, l'amiante a été éradiqué dès les années 90. Il reste encore des endroits où l'amiante est présent. Pour ceux-là, nous appliquons le décret de 1996 relatif aux mesures de protection. Je précise également que nous n'utilisons pas de fibres réfractaires céramiques à l'aciérie et aux hauts-fourneaux de Sollac Serémange, dont on sait qu'elles ont été classées cancérogènes 2 en 2002. On utilise des fibres naturelles de roche ou des carborouilles. M. le Président : Je suis bien persuadé qu'Arcelor a fait le maximum pour éliminer les risques. Personne n'a de doute à ce sujet. M. Michel DISS : Je vais parler en tant que citoyen. Je suis tout de même étonné que tout le monde reconnaisse que nous avons travaillé très en amont de l'interdiction de l'amiante, que nous étions conscients des problèmes, et que malgré cela je risque, comme mes deux collègues à la retraite, d'être poursuivi parce que j'ai signé, en tant que médecin, des avis d'aptitude. C'est un risque que je cours, M. le Président, puisque vous dites que des procès permettraient d'y voir plus clair. Même avec des expositions minimes, comme l'ont confirmé des études nombreuses, des salariés ou des anciens salariés d'Arcelor sont ou seront atteints de cancer broncho-pulmonaire et de mésothéliome. J'ai donc des raisons d'être inquiet. M. le Président : Votre inquiétude va bien au-delà de la réalité. Je connais bien le monde de l'entreprise, où j'ai fait toute ma carrière professionnelle. Je connais assez bien la sidérurgie française, que j'ai contribué à sauver de la faillite. Je préfère que l'expression « tous coupables » soit évacuée des esprits, plutôt que de laisser se développer des campagnes qui jettent la suspicion sur les entreprises. M. Michel DISS : On entend tout de même dire, dans différents rapports, que les médecins du travail ont été complices, comme les employeurs. M. le Président : Où avez-vous lu cela ? M. Michel DISS : Je ne peux pas citer de mémoire, mais je pense que les médecins du travail ont été mis en cause dans un certain nombre de rapports. M. le Président : Il faut être précis quand on dit de telles choses, aussi précis que vous l'êtes en matière scientifique. Je connais le rapport du Sénat. Je connais celui de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui est un rapport remarquable. Je connais aussi les rapports de la Cour des comptes, les textes du Conseil d'État. Jamais je n'ai vu dans ces rapports le souci de montrer du doigt qui que ce soit. C'est au contraire si l'on continue de laisser les choses dans l'ombre que, inévitablement, diverses personnes tenteront d'exploiter ces zones d'ombre. C'est pourquoi nous nous efforçons de faire toute la clarté. Jamais nous ne dirons « tous coupables ». Messieurs, je vous remercie de votre contribution à notre travail. Audition de Mme Annie THÉBAUD-MONY, directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), coordinatrice du Réseau international Ban Asbestos et membre de Ban Asbestos France Présidence de M. Jean LE GARREC, Président, M. le Président : Madame, nous sommes heureux de vous recevoir. J'ai à mes côtés notre Rapporteur, Jean Lemière, député de Cherbourg, et je suis moi-même député de Dunkerque. Notre mission d'information, dont les travaux en sont presque à leur terme, a été créée par le président Debré il y a six mois. Vous êtes la coordonnatrice du réseau international Ban Asbestos et vous êtes directrice de recherches à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Vous avez écrit plusieurs articles, en particulier sur la « stratégie criminelle des industriels de l'amiante ». Vous êtes donc très engagée dans le combat contre les risques liés à l'amiante. C'est au titre de votre action au niveau international que nous avons souhaité vous entendre, car notre investigation porte également sur cet aspect. Il y a dix jours, nous avons d'ailleurs rencontré à Bruxelles un sénateur belge, M. Alain Desthexe, ainsi qu'une députée belge, Mme Muriel Gerkens et les différentes directions de la Commission européenne. Mme Annie THÉBAUD-MONY : Après vous avoir présenté le réseau international Ban Asbestos et l'action qu'il mène, je souhaiterais également vous parler du Clemenceau. En effet, cette affaire me semble résumer la problématique de l'amiante dans laquelle nous sommes engagés de façon planétaire et, au-delà, celle de la gestion des risques industriels. Le réseau international Ban Asbestos est un réseau d'associations, d'organisations syndicales et d'individus qui ont décidé d'échanger des informations et de mener certaines actions communes, sans se constituer pour autant en ONG internationale. Il est parti de deux réunions, l'une à Milan en 1993, l'autre à São Paulo en 1994. Participait à cette dernière la responsable de l'inspection du travail de São Paulo, Fernanda Giannasi, qui a été à l'origine du mouvement contre l'amiante au Brésil et qui a organisé en 1994 un séminaire international sur l'amiante. Nous avions mené auparavant, avec elle et des universitaires brésiliens, un travail sur la question de l'amiante. Il faut savoir que nos deux pays sont liés par une multinationale française, Saint-Gobain, et par une multinationale européenne, Eternit. Nous souhaitions mettre en commun notre expérience et poser l'alternative suivante : « usage contrôlé ou bannissement ? » ; nous voulions aussi évoquer les conditions de travail des travailleurs de l'amiante et les effets sanitaires de celui-ci, car si, en France, on commençait à s'inquiéter, au Brésil c'était l'invisibilité quasi totale. Je précise qu'il y a entre la France et le Brésil trente ans de décalage en termes de production, d'utilisation et de commercialisation de l'amiante. En France, on a utilisé l'amiante à partir de 1945 jusqu'aux années 80-90. Au Brésil, on ne s'y est mis qu'à la fin des années 60, dans une mine qui était exploitée par Saint-Gobain et Eternit. Les premiers cas de mésothéliome se sont déclarés au Brésil à la fin des années 90, au bout des trente ans de latence. Ce séminaire international réunissait, outre les Français et les Brésiliens, des chercheurs et militants européens, nord-américains et sud-américains. L'appel de São Paulo visait à la constitution d'un réseau international qui, dans un premier temps, était centré sur l'information. Il répondait à la nécessité d'articuler les mouvements sociaux, au niveau syndical et associatif, et le travail des scientifiques dans la discussion sur les effets sanitaires de l'amiante. Notre action s'est organisée autour d'échanges d'informations par tous les moyens. Internet a permis à ce réseau de soutenir des actions en temps réel dans un pays ou dans un autre. Nous avons organisé deux réunions mondiales, l'une au Brésil en 2000, l'autre au Japon en 2004 - je peux vous laisser le CDRom. Nous avons coordonné la publication de deux numéros de l'International Journal of occupational and environmental Health sur la question de l'amiante, en rassemblant les contributions de l'ensemble du réseau. Depuis peu, le réseau s'exprime en solidarité avec d'autres mouvements sur des questions comme le démantèlement des navires. L'amiante est une bombe à retardement, pour deux raisons. D'abord, en raison de ses effets sanitaires. On prévoit 100 000 morts en France, et bien plus dans les pays où l'amiante a été travaillé sans aucune protection. Ensuite, parce qu'il faut maintenant gérer l'amiante en place. On compte, par exemple, 80 kilogrammes d'amiante par habitant en France. On a pu constater que les chantiers de désamiantage ne sont pas une mince affaire. S'agissant des navires en fin de vie, qui sont très contaminés, on a choisi de transférer le risque vers des pays qui n'ont ni les mêmes réglementations ni les mêmes systèmes de protection sociale que la France. Une telle stratégie n'est, d'ailleurs, pas propre à la France. Un grand nombre de navires sont envoyés sur des chantiers situés en Inde, au Bangladesh, en Chine, au Pakistan ou en Turquie. Il faut savoir que l'Inde et le Bangladesh sont les premiers destinataires de ce marché du démantèlement des navires. L'association Ban Asbestos France, qui a pour objectif de relayer cette action internationale au niveau français, s'est très vite inquiétée de ce qui allait se passer avec le Clemenceau. Je vous laisserai le document que j'ai présenté à la réunion de Bruxelles que nous avons organisée au mois de septembre. Dans un premier temps, fin 2004, nous avons écrit au ministère de la défense pour savoir quelle était la situation du Clemenceau. Le directeur de cabinet du ministre nous a répondu qu'il ne restait que 22 tonnes d'amiante dans le navire, qui allait partir en mer. Nous avions à Toulon des contacts avec une association locale et avec le syndicat local CGT des chantiers, et nous nous interrogions. Mais nous avons été alertés par l'association indienne et par le syndicat indien qui nous ont demandé d'intervenir pour tenter d'empêcher que le Clemenceau ne parte vers la baie d'Alang. En effet, contrairement à ce qui avait été écrit dans la lettre du ministère de la défense, la situation du chantier d'Alang est tout à fait déplorable. Un rapport, publié hier par la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) et l'association Greenpeace, montre qu'en 2005 il y a eu, au minimum, un mort par bateau, et que des milliers de travailleurs sont exposés à un ensemble de produits toxiques, à toutes les fumées et à des conditions de travail qui semblent proches de celles de l'esclavage. Ce sont des paysans pauvres qui vont sur les plages désosser les navires, avec des méthodes primitives. Il n'est donc pas possible de dire que le chantier du Clemenceau sera un chantier modèle. Nous avons donc saisi la justice par le biais d'un référé, en nous appuyant sur plusieurs textes : le décret 90-267 du 23 mars 1990, relatif à l'exportation, à l'importation et au transit de déchets générateurs de nuisances, qui prévoit dans son article 18 que l'exportation des déchets, parmi lesquels figure l'amiante, est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministère de l'environnement au vu de l'accord préalable de l'État de destination ; l'article L.541-40 du code de l'environnement, qui prévoit que l'exportation de déchets est interdite lorsque le destinataire ne possède pas la capacité et les compétences pour assurer l'élimination de ces déchets. La Cour suprême de l'Union indienne, s'appuyant sur la convention de Bâle, veut vérifier que tout navire importé en Inde est débarrassé de l'ensemble de ses déchets - et il n'y a pas que des déchets d'amiante. Le règlement du Conseil de l'Union européenne du 1er février 1993 prévoit dans son article 14 que sont interdites toutes les exportations de déchets destinés à être éliminés. À partir du moment où un bateau est envoyé pour être démantelé, il passe dans la catégorie des déchets. Enfin, la convention de Bâle, qui s'applique également au matériel de guerre, renforce l'ensemble de cet arsenal. Le juge des référés s'est déclaré incompétent. La cour d'appel a considéré que le Tribunal de grande instance (TGI) était compétent, mais le TGI s'est déclaré incompétent. Enfin la cour d'appel a considéré que les cours civiles n'étaient pas compétentes et qu'une telle affaire devait être plaidée devant le tribunal administratif. C'est ainsi qu'il a été impossible de plaider sur le fond. On ne sait donc toujours pas comment l'État français se prononce par rapport à l'application de textes qu'il a ratifiés au niveau international et européen. L'association Greenpeace a participé à une manifestation à Toulon au cours de laquelle certains sont même montés sur le Clemenceau. Aucune télévision nationale n'a relayé cette information, alors qu'il y avait un mouvement en Inde, un mouvement au Bangladesh, une réunion très importante à Genève réunissant notamment l'Organisation maritime internationale et l'Organisation internationale du travail (OIT) sur cette question. Il y a bien eu des articles de presse dans Libération et dans Le Monde ces deux derniers jours, mais Ban Asbestos, la FIDH et Greenpeace ont tenu une conférence de presse qui n'a eu d'écho ni à la radio, ni à la télévision. Un tel silence m'interpelle. Il vient confirmer le silence de l'État qui ne s'est pas exprimé. L'avocat général, dans sa plaidoirie du 5 septembre, n'est pas du tout intervenu sur le fond et s'est contenté d'aborder les questions de compétence. M. le Président : Vous avez parlé de 80 kilos d'amiante par habitant. D'où provient ce chiffre énorme ? C'est la première fois que nous l'entendons. Mme Annie THÉBAUD-MONY : Ce sont les importations divisées par le nombre d'habitants. Lorsque l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante (ANDEVA) a été créée, on a calculé le poids d'amiante en France à partir des importations. M. le Président : Les chiffres des importations sont-ils sûrs ? Mme Annie THÉBAUD-MONY : Ce sont ceux du ministère de l'économie. Ils portent sur l'ensemble de la période où l'on a importé de l'amiante. Le problème est que l'amiante est indestructible. M. le Président : Vous avez parlé également d'un « grand nombre » de navires en Inde et au Bangladesh. Pouvez-vous être plus précise ? Mme Annie THÉBAUD-MONY : Les chiffres sont dans le document que je vais vous laisser. Mais je peux d'ores et déjà préciser qu'entre mai 2001 et mai 2002, 264 bâtiments ont été vendus aux ferrailleurs indiens. On sait qu'il y a actuellement 300 ferries scandinaves qui attendent de partir vers les chantiers de désamiantage asiatiques. Il y a 44 bâtiments en Angleterre, qui est sur le point d'adopter une autre politique. Enfin, la plage d'Alang est divisée en 184 parcelles d'à peu près 30 mètres de large et il y a entre 25 000 et 40 000 travailleurs. M. le Président : Il était intéressant que vous puissiez nous préciser ces chiffres. M. le Rapporteur : Vous êtes directrice de recherches à l'INSERM, qui est célèbre pour une étude publiée sur l'amiante. Avez-vous personnellement travaillé dans ce domaine ? À quel moment vous êtes-vous personnellement mobilisée et avez-vous été convaincue des dangers de l'amiante ? Mme Annie THÉBAUD-MONY : J'ai commencé à travailler sur l'amiante dès les années 1986-1990, dans le cadre d'une recherche que j'ai faite à la demande du ministère du travail sur le système de reconnaissance des maladies professionnelles. Il s'agissait d'une des premières études de cas sur la non-visibilité des maladies professionnelles liées à l'amiante, en particulier les mésothéliomes et les cancers broncho-pulmonaires. Au début des années 90, mon rapport a été publié à la Documentation française sous l'égide de la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES). À cette époque, il y avait une controverse sur le nombre de mésothéliomes : l'INSERM tablait déjà sur 500 à 600 mésothéliomes annuels, alors que le Comité permanent amiante (CPA) en donnait 200. J'ai commencé à travailler à partir de situations concrètes. Il s'agissait de comprendre pourquoi certains cas n'avaient pas été déclarés et comment cela s'était passé pour ceux qui avaient été déclarés et reconnus. Il s'agissait aussi d'étudier le fonctionnement et les dysfonctionnements du système de réparation. C'est par ce biais-là que j'ai abordé le dossier de l'amiante. Dès la fin des années 80, j'étais convaincue qu'il fallait que des scientifiques s'engagent. Qu'est-ce qui permettait au CPA de dire qu'il n'y aurait que 200 cas de mésothéliomes annuels en France, alors que les statistiques officielles de l'INSERM, établies par le service qui gère les causes de mortalité en France, en donnaient au moins le double ? M. le Rapporteur : Le mésothéliome peut être considéré comme indice marqueur des effets de l'amiante. Pouvez-vous en dire autant du cancer bronchique ? Mme Annie THÉBAUD-MONY : Nous travaillons depuis cinq ans à un programme sur les cancers d'origine professionnelle en Seine-Saint-Denis. S'agissant du mésothéliome, la situation est très exceptionnelle et ne se retrouve que dans le cancer de l'ethmoïde, chez les personnes qui ont été exposées aux poussières de bois : sa cause est unique, ce qui est rare pour les cancers. Reste que, comme pour les autres cancers, c'est le résultat de tout un processus, de toute une histoire marquée par divers événements. En revanche, s'agissant du cancer broncho-pulmonaire, nous n'avons aucun moyen, dans l'état actuel de la science, de dire que c'est tel ou tel facteur qui a joué. Ils ont joué ensemble mais nous sommes certains que l'amiante intervient de façon très importante dans l'incidence des cancers du poumon, avec un ensemble d'autres polluants. M. le Président : Je crois que personne ne peut récuser le qualificatif de marqueur, s'agissant du mésothéliome. Mais certains spécialistes s'interrogent sur la façon de le détecter. Pour eux, cette détection ne serait pas scientifiquement sûre et serait mal faite. Ainsi, dans le nombre de mésothéliomes déclarés, certains ne seraient pas des mésothéliomes. Ce que vous faites en Seine-Saint-Denis depuis cinq ans est très intéressant. Est-ce que les résultats sont connus ? Mme Annie THÉBAUD-MONY : Je peux vous les envoyer. M. le Rapporteur : Pourriez-vous également nous communiquer les références de l'étude qui a suscité une controverse avec le CPA sur le nombre de mésothéliomes en France ? M. le Président : Le cancer du poumon a des causes multiples et le fait qu'un travailleur de l'amiante fume deux paquets de cigarettes par jour n'est pas sans incidence. Personne ne le nie. Mais vous avez évoqué le rôle « spécifique » de l'amiante. Pourriez-vous nous donner des précisions ? Mme Annie THÉBAUD-MONY : Il faut être conscient qu'aucune des techniques de diagnostic dont nous disposons n'est une science exacte : pas plus l'anatomopathologie que les tests et marqueurs des cancers dont nous disposons, et qui reposent tous sur des bases probabilistes. L'anatomopathologie est une pratique, dont les résultats dépendent de tout un ensemble d'éléments méthodologiques : le prélèvement et les conditions dans lesquels il est fait et l'analyse de la tumeur. Si vous faites lire une lame par plusieurs anapathologistes, vous risquez d'avoir des réponses différentes. Par ailleurs, le diagnostic de mésothéliome repose, du point de vue clinique, sur un ensemble d'indices. Le professeur Jean-Luc Breau, chef du service de cancérologie de l'hôpital Avicenne, à propos d'un diagnostic qui avait été remis en cause par le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), a fait remarquer que c'étaient les cliniciens qui étaient le mieux à même de faire un diagnostic. D'abord, l'anapathologiste dit s'il s'agit ou non d'un cancer. Ensuite il faut aussi prendre en compte les caractéristiques cliniques de la maladie, notamment la manière dont elle démarre. Le mésothéliome a des caractéristiques tout à fait particulières : il débute souvent par une pleurésie, il est très brutal et son évolution est très rapide. Le professeur Breau ajoutait que, lorsqu'il soignait un mésothéliome, il cherchait d'autres localisations. Mais lorsqu'au bout d'un an, malgré le scanner et l'IRM, on n'a trouvé aucune autre localisation, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un autre cancer, même si l'anapathologiste s'interroge, surtout lorsque l'on sait que le mésothéliome est un cancer rare, fruit d'une pénétration de fibres dans la plèvre. En revanche, sur la seule base d'une lecture de lames, sans rien savoir de l'aspect clinique et de tout cet ensemble d'éléments, un diagnostic ne peut être qu'approximatif. M. le Président : Est-ce que vous préconisez un double examen, c'est-à-dire une double lecture de lames ? Mme Annie THÉBAUD-MONY : Le docteur Jacques Brugères, qui a été l'un des principaux cliniciens de Curie pendant des années, considérait que l'anapathologiste n'était qu'un des piliers du diagnostic et qu'un bon diagnostic supposait l'articulation entre plusieurs disciplines. L'anapathologiste ne fait que contribuer à un diagnostic fait par un médecin qui rassemble toute une série d'éléments. M. Gérard BAPT : Je remarque que les contestations des diagnostics de mésothéliomes dont parlait le Président étaient fondées sur la mauvaise qualité des lectures d'anatomopathologistes. Par ailleurs, on nous a expliqué hier que le risque de cancer bronchique était beaucoup plus élevé en cas d'intoxication tabagique que d'exposition à l'amiante. Il passait d'un rapport de 1 à 5. Pouvez-vous nous préciser si, lorsque le Comité permanent amiante réfutait un certain nombre de diagnostics de mésothéliomes, il le faisait sur une base anatomopathologique ou à partir d'autres éléments ? Mme Annie THÉBAUD-MONY : Il n'existe aucun moyen scientifique, mathématique ou autre de déterminer la part attribuable à tel ou tel polluant. Un cancer broncho-pulmonaire n'a pas des caractéristiques différentes s'il est lié à l'amiante ou s'il est lié au tabac ou aux hydrocarbures polycycliques aromatiques (HPA). Je voudrais maintenant revenir sur les résultats de notre enquête de 1993. Depuis cinq ans, nous faisons, avec les services volontaires de trois hôpitaux, l'hôpital Avicenne, celui de Montfermeil et celui d'Aulnay-sous-Bois, un suivi des nouveaux patients atteints de cancer. Nous avons maintenant 500 dossiers environ. Nous en avons analysé 250, sur les deux premières années. Les médecins nous communiquent le signalement des patients, après les avoir informés de notre travail sur les cancers d'origine professionnelle et après avoir obtenu leur consentement. Nous reconstituons de façon très détaillée le parcours professionnel des patients, poste de travail par poste de travail. On a remarqué, en effet, que les patients ne connaissaient pas les polluants auxquels ils avaient été exposés. M. Gérard BAPT : Cela ne doit pas être facile. Mme Annie THÉBAUD-MONY : Cela ne pose pas de problème. Lorsque vous êtes atteint d'un cancer et qu'un médecin vous explique qu'un travail est mené pour essayer de déterminer si votre cancer est en rapport avec votre activité professionnelle, vous acceptez volontiers de revenir sur une vie de travail que vous avez le plus souvent appréciée et dans laquelle vous vous êtes investi. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'un questionnaire, mais d'un entretien qualitatif. Ensuite, nous faisons lire ces parcours par des spécialistes des conditions de travail et des expositions aux produits toxiques : tout un panel d'experts, un représentant de l'INRS, des ingénieurs CRAM (Caisse régionale d'assurance maladie), des retraités, des actifs, des toxicologues, des médecins du travail. Ce collège d'experts statue sur la qualification des expositions. En effet, nous n'avons aucune trace, aucune mesure, aucune attestation de ces expositions. Le seul moyen est de croiser l'expérience des travailleurs et celle de ces personnes qui ont une compétence par rapport aux milieux de travail. Ces experts se prononcent alors sur la possibilité, ou non, pour ces personnes, d'avoir contracté une maladie professionnelle, et nous renvoyons les informations au médecin pour qu'il fasse le certificat médical de maladie professionnelle. Sur le plan des expositions, nous avons été frappés - et cela se confirme au fil des années -, par le fait qu'on est majoritairement face à des ouvriers - plus de 60 % dans la population masculine et 40 % dans la population féminine - et face à de très lourdes polyexpositions : à l'amiante, à la silice, aux hydrocarbures polycycliques aromatiques, au benzène, aux fumées de diesel et d'essence, aux poussières métalliques. Tous ces polluants sont classés en catégorie 1 par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Cela pose un problème quant à la reconnaissance et la visibilité de ces cancers. J'ai parlé précédemment du rôle spécifique de l'amiante. En l'occurrence, environ 60 à 80 % des patients concernés y ont été exposés. L'amiante joue donc certainement un rôle important, mais ce rôle n'est pas spécifique au sens où on pourrait lui attribuer un rôle spécifique dans la maladie. On ne peut pas faire la distinction entre tel ou tel polluant en disant que c'est davantage les HPA ou le benzène, ou l'amiante, ou la silice. On est face à une polyexposition qui a joué en synergie. On a d'ailleurs peu de données internationales sur les effets de synergie ; la seule qu'on ait concerne la synergie amiante/tabac. On sait maintenant que plus l'attaque est diverse et forte, et plus les risques que la personne fasse un cancer sont élevés. M. Gérard BAPT : S'agit-il de fumeurs ? Mme Annie THÉBAUD-MONY : Une partie d'entre eux fume, mais la proportion est la même que dans l'ensemble de la population ouvrière. « S'ils ont fumé, ce ne peut être que le tabac ! » : voilà malheureusement la réponse qui est faite par les commissions régionales de reconnaissance des maladies professionnelles ! Or, certains patients ont été exposés à des polluants qui ne sont pas encore dans les tableaux : aux fumées de diesel essence, qui sont des cancérogènes de catégorie 1, aux poussières métalliques, etc. Des déclarations ont été faites pour eux sur la base d'une polyexposition lourde. Mais à partir du moment où il y a consommation de tabac, même si la personne a été exposée pendant trente ans à un cumul de cancérogènes professionnels, la demande est automatiquement rejetée. Il faudrait réfléchir à ce qu'on entend par preuve de la relation directe et essentielle entre travail et cancer. En effet, le cancer n'est pas une maladie où l'on peut apporter la preuve de la causalité. On est toujours dans des raisonnements probabilistes. Des juristes réfléchissent, d'ailleurs, au niveau international sur la différence entre preuve médicale, preuve scientifique et preuve juridique. Il faudrait aussi reprendre la réflexion sur le rôle du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, afin de mieux faire émerger le rôle du travail, qui ne doit pas être considéré comme un cofacteur qu'on écarte dès que le tabac est en jeu. Il faut étudier dans quelle mesure le travail a pu jouer un rôle dans la survenue du cancer de la personne. Cela pourrait faire évoluer la réglementation. M. Gérard BAPT : J'aimerais savoir quels types de cancers avaient été sélectionnés pour cette étude. Mme Annie THÉBAUD-MONY : Nous avions choisi des cancers sur lesquels nous disposions déjà d'éléments scientifiques et réglementaires pour étayer leur éventuelle origine professionnelle : cancers du poumon, mésothéliomes, leucémies, cancers de la vessie, du rein, du larynx. En revanche, nous avons écarté, pour l'instant, les myélomes et les lymphomes qui sont en très forte augmentation. Nous ne sommes pas épidémiologistes et nous ne disposons pas des outils nécessaires. Mais on y viendra peut-être. Bien entendu, je mettrai cette étude à votre disposition. Un article a été publié dans une revue internationale. Nous avons rendu un rapport à la Direction des relations du travail (DRT) dont un résumé figure dans le « Bilan, conditions de travail » de la DRT. Je le mettrai aussi à votre disposition. M. Daniel PAUL : Le sens commun conduit à dire que, lorsqu'il y a plusieurs expositions, il est impossible de déterminer les causalités. Lorsqu'une personne qui a fumé et bu est atteinte d'un cancer, on a tendance à attribuer au tabac et à l'alcool la cause de ce cancer, même s'il a été exposé à l'amiante. A-t-on fait des progrès, et existe-t-il aujourd'hui des outils permettant de mieux préciser les choses ? C'est, en effet, un problème qui revient en permanence au cours des réunions des associations de victimes de l'amiante. Les médecins qui viennent à ces réunions y sont également confrontés. Mme Annie THÉBAUD-MORY : Nous sommes face à une épidémie de cancers, dont on a effectivement du mal à analyser les causes. Il faut dire qu'en France, nous ne nous sommes pas donné les outils de santé publique qui auraient pu nous aider, ne serait-ce qu'en nous fournissant des informations sur les expositions professionnelles ou comportementales. En Australie, par exemple, il existe depuis 1984 un registre national des mésothéliomes, qui permet de connaître les personnes atteintes et les conditions d'exposition à l'amiante. En France, il existe bien des registres des cancers, mais on n'y trouve rien sur la profession du patient. On n'a pas d'outil de santé publique pour documenter les expositions professionnelles versus les expositions comportementales. Par ailleurs, le milieu de travail bouge, et pas dans le bon sens. Dans l'enquête permanente que nous menons depuis cinq ans, nous sommes frappés par la jeunesse de certains patients : la moitié d'entre eux ont moins de soixante-cinq ans. On se trouve donc dans la catégorie des cancers dits évitables, les cancers dits du vieillissement survenant après soixante-cinq ans. Des jeunes font des cancers broncho pulmonaires entre trente-cinq et quarante-cinq ans. Leur parcours professionnel est emblématique de la précarisation : travail d'intérimaires, jusqu'à 65 postes différents ! Un tel parcours concentre les expositions aux cancérogènes. J'ai fait une étude sur la sous-traitance de la fonction de maintenance dans l'industrie nucléaire, dont il résulte que 80 % de la dose collective de rayonnements ionisants est supportée par les travailleurs extérieurs. C'est dans cette population que se concentrent cette exposition et toutes les autres expositions, à l'amiante notamment. Un calorifugeur travaille dans une centrale nucléaire pour enlever le calorifuge autour des tuyaux dans les centrales les plus anciennes, où l'on est sûr qu'il y a de l'amiante. Il reçoit donc une double exposition : aux rayons ionisants et à l'amiante. S'agissant du calcul de la part attribuable, on est encore plus loin du but que lorsqu'on a fait les premières enquêtes sur le cancer du poumon. Les grandes enquêtes menées dans le secteur de l'isolation aux États-Unis concernaient des travailleurs qui passaient toute leur carrière dans ce secteur. Aujourd'hui, l'ensemble des patients que nous recevons a occupé une moyenne de six à dix emplois. D'où un cumul d'expositions à cause duquel il sera extrêmement difficile de départager les causes pour dire que le cancer est plutôt dû à ceci qu'à cela. La Cour de cassation, dans un arrêt de 2003, a d'ailleurs reconnu le bien-fondé d'une reconnaissance du cancer comme maladie professionnelle, à partir du moment où le travail a pu jouer un rôle et où l'employeur ne peut pas prouver que le cancer est lié exclusivement à une autre cause que le travail. Il y a donc inversion de la charge de la preuve. M. le Rapporteur : Nous n'attendions pas moins d'un directeur de l'INSERM, de sa rigueur scientifique et de sa pondération sur de telles questions. Vous comptiez davantage nous entretenir de l'aspect international du sujet. Mais quand nous entendons un scientifique à propos de l'amiante, nous en profitons. Nous ne sommes pas tous des scientifiques et nous essayons de travailler avec une certaine rigueur. Asbestos signifie amiante en grec. L'asbestose est différente du mésothéliome et du cancer bronchique. Est-ce un marqueur significatif, au même titre que le mésothéliome ? Est-ce une maladie en régression ? Dans les premiers temps, le Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) n'avait pas considéré que la présence de plaques pleurales permettait d'offrir une indemnisation aux victimes de l'amiante. Ensuite, on a changé d'avis. Reste que se pose la question de la non dégénérescence des plaques pleurales en cancer, et donc de leur aspect « inoffensif ». Que pouvez-vous nous dire sur ce point ? Mme Annie THÉBAUD-MONY : Il y a deux types de maladies liées à l'amiante, et qui n'ont rien à voir entre elles. L'asbestose et les plaques pleurales sont des fibroses. La fibrose est une réaction de la membrane, du poumon ou de la plèvre face à un corps étranger. Il peut en résulter une production de collagène qui, en séchant, se rigidifie. Il imprègne les alvéoles, la membrane du poumon perd de son élasticité, d'où des problèmes d'insuffisance respiratoire. Il peut en résulter une calcification, les fibres s'agglomérant à la base de la plèvre. Les cancers, quant à eux, répondent à un mécanisme totalement différent et indépendant. On peut d'ailleurs avoir des plaques pleurales ou une asbestose sans jamais avoir de cancer. Nous nous sommes aperçus - ce que nous avons pu confirmer en confrontant nos expériences au niveau international - que le mésothéliome peut se déclarer après de très faibles expositions. Un malade est décédé à quarante-neuf ans, deux ans après qu'un mésothéliome s'est déclaré. Il avait été exposé, alors qu'il travaillait dans l'école maternelle qui jouxtait l'usine du Comptoir des minéraux et matières premières, installée dans le centre d'Aulnay-sous-Bois. Autre cas : une secrétaire, qui avait travaillé pendant six mois ou un an dans un bureau situé en mezzanine au-dessus d'un atelier, a été atteinte de mésothéliome. C'était sa seule exposition connue à l'amiante. Autre cas encore : un ingénieur chimiste du ministère du travail, chargé des produits chimiques, a été contaminé en travaillant à la paillasse du laboratoire avec quelques matériels contenant de l'amiante. Ce sont des expositions environnementales. Ces maladies sont indépendantes, comme peuvent l'être une appendicite et une maladie rénale. C'est pourquoi la rubrique « dégénérescence cancéreuse d'une asbestose ou d'une atteinte pleurale », qui se trouve dans le tableau 30, n'est pas correcte du point de vue scientifique. Ces maladies peuvent se succéder. Mais on n'a pas besoin de passer par une asbestose ou par des plaques pleurales, qui sont des marqueurs d'exposition à l'amiante, pour développer un cancer broncho-pulmonaire ou un mésothéliome. Peut-on dire que l'asbestose diminue ? En France, sans doute, mais dans des proportions à apprécier, dans la mesure où nous n'avons pas de données sur les expositions. L'asbestose est plutôt liée à des expositions relativement importantes ou à des pics d'exposition relativement importants. On dispose de si peu d'informations qu'il nous faut considérer avec beaucoup de prudence le postulat selon lequel l'asbestose serait en diminution radicale. Le problème du diagnostic se pose également. Car si l'anatomopathologie n'est pas une science exacte, la radiologie l'est encore moins : c'est une interprétation d'images radiologiques. Il existe plusieurs maladies proches de l'asbestose, comme la silicose ou les broncho-pneumopathies chroniques obstructives (BPCO) - avec l'emphysème. Et pour avoir travaillé sur les fibroses des mineurs de charbon, je peux vous dire qu'à partir des mêmes clichés, des désaccords sont possibles - en l'occurrence, il s'agissait de deux collèges de trois médecins, de Lille et de Marseille. Au niveau mondial, il est certain que les conditions dans lesquelles s'opèrent, par exemple, les démantèlements des navires en Inde, au Bangladesh ou au Pakistan, sont sources d'asbestose et d'autres maladies : les travailleurs se trouvent dans des espaces confinés, ils transportent l'amiante sans aucune précaution et à main nue, pendant des heures... Mais ils n'ont pas accès au diagnostic... S'agissant des plaques pleurales, nous rencontrons divers problèmes. Il y a de grandes différences d'un patient à l'autre, notamment au niveau de la douleur. Et celui qui se sait atteint de plaques pleurales sent planer au-dessus de sa tête la menace du mésothéliome. Le préjudice clinique n'est pas présent dans tous les cas - sauf en cas d'épaississement pleural, qui se localise entre la plèvre et la membrane du poumon. En revanche, le préjudice moral est toujours très important. Sans compter le préjudice économique : les patients atteints de plaques pleurales ont très souvent de la difficulté à trouver du travail, en raison de la réticence des entreprises à embaucher quelqu'un qui connaît un problème lié à l'amiante. M. le Rapporteur : Est-ce qu'on peut avoir des plaques pleurales sans avoir jamais été exposé à l'amiante ? (M. Jean-Marie GEVEAUX remplace M. Jean LE GARREC à la présidence) Mme Annie THÉBAUD-MONY : Pas à ma connaissance. M. Gérard BAPT : Hier, on nous a pourtant affirmé précisément le contraire, en citant des études. J'ai alors demandé si l'on disposait de preuves médico-légales permettant de savoir si, dans le cadre d'une autopsie, on pouvait retrouver de l'amiante dans des plaques pleurales. On nous a affirmé que la majorité des plaques pleurales ne serait pas liée à l'amiante. Est-il possible d'en savoir davantage sur la causalité des plaques pleurales ? Mme Annie THÉBAUD-MONY : Je ne connais pas d'études sur d'autres causes que l'amiante. Il faut savoir qu'on ne retrouve pas systématiquement des fibres d'amiante dans les pièces histologiques. J'espère qu'on ne fait plus de biopsies sur des plaques pleurales. En tout cas, on a abandonné la pratique barbare du lavage broncho-alvéolaire. De toutes façons, l'amiante finit par être détruit par le milieu biologique, en raison d'un phénomène d'oxydation. Au tout début, après une forte exposition, il est possible de trouver des fibres en suspension dans le poumon. Mais ce n'est pas parce qu'on n'en trouve pas que les plaques pleurales ou le cancer ne sont pas liées à l'amiante. Le travail du réseau international Ban Asbestos est très important, dans la mesure où il a permis à des scientifiques de contrôler leurs données, d'où qu'elles viennent : d'Angleterre, des États-Unis, du Canada, du Brésil, ou encore d'Afrique du Sud - qui a été à l'origine de la découverte des mésothéliomes des mineurs avec les études de Wagner -, de France, de Suède ou d'Italie. Il existe dans ces pays des études tout à fait documentées, et un consensus s'agissant des deux éléments dont je viens de vous parler. Vous m'avez demandé sur quelles bases le CPA affirmait qu'il y avait 200 mésothéliomes, et que le diagnostic n'était pas bien fait. Nous n'avons pas trouvé d'études allant dans ce sens. Il s'agissait simplement d'affirmations qui ont été reprises par la suite. Par exemple, j'ai entendu le professeur Bignon et le professeur Brochard réfuter ce que nous avancions, c'est-à-dire que le nombre de mésothéliomes était beaucoup plus important, et affirmer : mais non, le Comité permanente amiante dit que... M. Gérard BAPT : S'agissant des plaques pleurales, on nous a parlé d'une étude systématique portant sur une population d'un certain âge. On aurait trouvé une proportion de 10 à 12 % de plaques pleurales dans la population générale, proportion qui ne saurait être attribuée à l'amiante, car il ne s'agit pas de populations ayant été exposées à l'amiante. Cette étude a été faite chez Arcelor à Dunkerque. M. Annie THÉBAUD-MONY : Personnellement, je ne connais pas d'études ni n'ai pas participé à des réunions scientifiques dans lesquelles on aurait émis un doute sur le fait consensuel que les plaques pleurales sont liées à l'amiante. S'agissant des plaques pleurales dans la population générale, je vais prendre l'exemple d'Aulnay-sous-Bois, que je connais bien. En 1936, des ouvriers ont commencé à essayer d'y trouver des lopins de terre pour prendre l'air. L'usine du Comptoir des minéraux et des matières premières s'est installée cette même année en plein centre d'Aulnay avec, autour d'elle, une zone pavillonnaire. Cette usine a broyé de l'amiante au moins jusqu'au début des années 80, et elle n'a fermé qu'en 1996 ou 1997. Le site est encore debout, sans avoir été décontaminé. D'où l'action d'un collectif d'associations, dont une association de parents d'élèves, car l'usine jouxte une école maternelle. Un toit en fibrociment menace même de tomber dans la cour de l'école. Lorsque Pierre Léonard, la première victime de mésothéliome d'Aulnay, est décédé, sa famille a décidé de comprendre. Ils ont fini par trouver des documents sur des plaintes de riverains et sur un rapport de l'inspection du travail montrant qu'il y avait eu une très forte exposition à l'amiante à l'extérieur comme à l'intérieur de l'usine. La famille, dans les années 1997-2000, a organisé une réunion publique à laquelle se sont rendues cent personnes ! C'est ainsi que les habitants ont pu apprendre qu'un voisin, un parent était mort de mésothéliome et que des familles, dont celle du gardien, avaient été décimées. Le collectif s'est mobilisé pour aider les victimes à obtenir la reconnaissance de leur maladie comme maladie professionnelle ou à s'adresser au FIVA. Aujourd'hui, par le biais des associations, ont été déposés plus de 60 dossiers, avec 27 décès et 14 mésothéliomes. Si les associations n'avaient pas fait ce travail, on ne saurait rien ! On a pu obtenir une information sur un excès de mésothéliomes à Aulnay-sous-Bois par rapport au reste de l'Île-de-France. Parmi les patients, il est clair que certains ont des plaques pleurales. Si, à partir de 1997, moment où la situation a été connue, les autorités sanitaires avaient signalé systématiquement tous les cas et permis à ceux qui le souhaitaient de passer un examen, on aurait recensé un nombre important de cas de plaques pleurales au sein de cette population. À une époque, on n'avait aucune information sur l'amiante et certains lavaient leur salade, blanche de poussière d'amiante, avant de la consommer, et les gamins écrivaient leur nom sur les tombes du cimetière, recouvertes elles aussi de poussière d'amiante... Une telle situation me paraît riche d'enseignements. On a forcément une élévation du taux de plaques pleurales dans la population générale en raison de la fréquence de l'exposition environnementale à l'amiante. M. Gérard BAPT : On pourrait encore faire un examen systématique. Mme Annie THÉBAUD-MONY : C'est ce que les associations demandent depuis six ans. Mais ce n'est toujours pas fait. M. Patrick ROY : Je voudrais vous remercier pour la qualité, la précision et la franchise de vos propos. Vous avez dit qu'en France, on ne s'était pas donné tous les outils qui auraient pu nous servir en matière de santé publique. Quelle reforme faudrait-il engager en matière de santé publique ? Mme Annie THÉBAUD-MONY : Je la vois à deux niveaux. D'abord, au niveau de l'application du code du travail et du code de la sécurité sociale, en améliorant la traçabilité des expositions professionnelles et des risques de maladies professionnelles, notamment à effet différé. Premier outil à utiliser : l'article L. 461-4 du code de la sécurité sociale, qui dispose que toute entreprise qui expose ses salariés à un produit ou procédé pouvant entraîner une maladie professionnelle doit déclarer ce produit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Autre outil très important : l'attestation individuelle d'exposition, qui figure déjà depuis une vingtaine d'années dans notre réglementation s'agissant du risque chimique, et qui est dans le prolongement de ce qui est mis en place pour transposer la directive européenne. Elle permettrait de documenter les expositions des personnes ayant été exposées à des cancérogènes. Dans la période d'emploi actuelle, il est encore plus urgent d'appliquer cet article du code du travail, qu'on soit en présence d'amiante ou de tout autre cancérogène. La deuxième réforme concerne les institutions de santé publique. Il faudrait donner à l'Institut de veille sanitaire des moyens beaucoup plus importants pour ouvrir certains registres. Il y a des maladies à déclaration obligatoire comme, par exemple, la tuberculose. Mais on ne s'est jamais donné les moyens de faire ce travail pour le cancer, alors que nous subissons à l'heure actuelle une grave épidémie sur laquelle nous manquons cruellement de données. Ces registres devraient plutôt être départementaux. C'est un peu le parti qu'on a pris en Seine-saint-Denis avec le dispositif « Scop53 93 ». Il conviendrait de mettre en place un signalement plus aigu de façon à toucher les médecins. Une articulation est possible entre les médecins des services de l'État, des services du conseil général, des services de la santé au travail. Cela ne demande pas des actions spectaculaires, mais un travail quotidien de recensement systématique qui nous fournirait les données dont on a besoin pour savoir comment, et où, faire de la prévention. M. le Rapporteur : Votre exposé sur les différentes pathologies liées à l'amiante était d'une parfaite clarté. Permettez-moi de recentrer le débat sur le volet international de la gestion de l'amiante, en vous demandant quelles sont les principales entreprises européennes qui utilisent encore de l'amiante en dehors de l'Union européenne et quels arguments elles avancent pour ne pas en abandonner la production. Mme Annie THÉBAUD-MONY : Il s'agit principalement d'Eternit Belgique et d'Eternit Suisse, deux entités distinctes du groupe Etex qui continuent d'exploiter l'amiante dans différents pays, en Amérique latine par exemple, et en particulier au Pérou. Dans ce pays, les autorités, qui commencent à envisager l'interdiction, se heurtent à une campagne très offensive du groupe. Etex poursuit aussi ses activités en Inde par le biais de filialisation, de restructuration ou de sous-traitance. Au Brésil, l'interdiction a été décidée dans certains Etats, mais des mines sont encore exploitées par les successeurs de Saint-Gobain et d'Eternit, et les liens sont, pour le moins, flous entre Brasilit, filiale d'Eternit au Brésil, et ses parrains, les deux sociétés susnommées. Il semble en effet qu'Eternit - ouvertement - mais aussi Saint-Gobain participent, au travers de Brasilit, à la production d'amiante. Dans tous les cas, le groupe Etex continue de produire du fibrociment en Inde et dans le Sud-est asiatique. Le Japon a tout récemment interdit l'amiante mais, cette année encore, des accords avaient été passés entre des sociétés japonaises et Eternit Belgique. Quant à Eternit Suisse, elle opère au Nicaragua et elle opérait au Brésil. Il existe une étanchéité parfaite entre Eternit Belgique et Eternit Suisse, mais l'hypothèse est forte qu'Eternit Suisse continue des activités d'extractions et de commercialisation d'amiante au travers de sociétés écran. Hors d'Europe, certains pays ont interdit l'amiante. C'est le cas, en Amérique latine, du Chili et de l'Argentine et le Pérou s'interroge. Au Brésil, l'interdiction n'est pas complète sur tout le territoire. Elle ne l'est pas non plus en Amérique centrale, et il n'y a pas d'interdiction en Amérique du Nord. Comme chacun le sait, le Canada exporte au moins 97 % de sa production. Les États-unis ont édicté des normes strictes mais n'ont pas interdit l'amiante, non qu'ils utilisent de l'amiante de manière courante mais parce qu'ils en ont besoin pour les navettes spatiales. Nous avons très peu d'information sur la production en Afrique, si ce n'est que l'Afrique du Sud l'a interdit. M. le Rapporteur : Vous avez évoqué le fibrociment. Est-ce l'industrie principale ? Les industriels qui en produisent encore ont-ils tiré partie des expériences européenne et américaine ? Mme Annie THÉBAUD-MONY : Il y a dans le fibrociment une présence massive d'amiante. Pourtant, il reste d'une utilisation extensive dans le monde et des usines existent sur tous les continents, là où il n'y a pas de réglementation et, malheureusement, même là où il en existe une. Ainsi, lors du Forum social mondial de Porto Alegre, une manifestation a eu lieu aux portes de deux usines d'amiante-ciment, dont l'une appartient au groupe Eternit. J'ai participé à cette manifestation pour témoigner de la solidarité de Ban Asbestos France et je puis décrire ce que j'ai vu : nous sommes arrivés à la porte de cette usine par une route blanche d'amiante et nous avons vu sortir de l'usine des camions tout aussi blancs d'amiante, chargés de plaques ondulées non bâchées, qui soulevaient des nuages de poussière. Quant aux conditions de travail dans les usines, ce sont celles que la France connaissaient dans les années 60, et le Brésil n'est pas le pays le plus mal loti. En résumé, le fibrociment continue d'être très largement utilisé et il est produit dans des conditions dénoncées en Europe. M. le Rapporteur : Nous savons que l'on peut fabriquer du ciment avec d'autres fibres que les fibres d'amiante. Que pouvez-vous nous dire de cette industrie de remplacement ? Mme Annie THÉBAUD-MONY : Dès la fin des années 80, Eternit Suisse, tout en extrayant de l'amiante des mines brésiliennes, procédait à des essais, au Costa Rica par exemple, en utilisant, à la place d'amiante, des fibres de sisal, de coco et de chanvre pour la fabrication de fibrociment. Les essais ont été parfaitement concluants, mais l'amiante est une si grande source de gains que les deux productions ont continué d'être menées en parallèle. Au Brésil, Saint-Gobain a choisi d'arrêter complètement la production de fibrociment contenant de l'amiante, lui préférant l'utilisation d'autres fibres, et les chaînes de production ont été modifiées en conséquence. M. le Rapporteur : Nous voulions comprendre pourquoi les autorités canadiennes continuent d'accepter la production d'amiante mais leurs représentants n'ont pas souhaité répondre à nos invitations répétées. À défaut, nous entendrons avec intérêt votre point de vue. Mme Annie THÉBAUD-MONY : Nous avons organisé un séminaire à Ottawa en septembre 2003. Pendant qu'il se tenait, une manifestation de mineurs a eu lieu devant le Parlement ; ils étaient venus dénoncer la bande d'activistes que nous étions... Pourquoi le Canada continue-t-il d'extraire et de commercialiser l'amiante ? C'est difficile à dire, mais il faut envisager la situation internationale dans son ensemble. Comme vous le savez, le Canada exporte 97 % de sa production. Une des mines d'amiante, au moins, reçoit des subventions, car si elle n'en recevait pas, elle devrait fermer boutique. Le lobby de l'amiante est extrêmement puissant au Canada, parce qu'il est subventionné à la fois par le gouvernement du Québec et par le gouvernement fédéral qui en fait une question stratégique. Le jour où la production d'amiante s'arrêtera au Canada, l'Institut de l'amiante ne pourra plus se livrer à sa propagande actuelle. Nous sommes là dans une situation de tricherie scientifique pure et simple. Tout a été dit sur les effets sanitaires de ce matériau, mais l'Institut canadien de l'amiante continue, malgré tout, à faire la promotion de l'amiante. Pour commencer, l'Institut a été rebaptisé « Institut du chrysotile », le chrysotile étant une variété d'amiante, dangereuse certes, mais moins que les autres variétés. Il a tout fait pour obtenir des rapports favorables à l'usage du chrysotile de la part de différents organismes, dont l'OMS. Il a aussi tenté d'engager une campagne sur le thème : « Le chrysotile crée de l'emploi au Brésil », mais le mouvement social brésilien est parvenu à la bloquer en faisant reconnaître la publicité mensongère. Seulement, l'Institut procède de la même manière en Inde, en Thaïlande, en Malaisie et ailleurs, sans être contré. Autant dire qu'il est devenu un institut de propagande dont la mission est de soutenir les exportations canadiennes d'amiante. Toutefois, il se heurte à des difficultés nouvelles, car les compagnies maritimes japonaises et danoises refusent désormais de transporter le chrysotile. Par ailleurs, l'industrie s'est efforcée de diversifier ses ventes en incluant de l'amiante dans le revêtement des routes canadiennes mais, pour la première fois, l'Institut de santé publique du Québec a publié les conclusions d'une étude selon laquelle le taux de mésothéliome est extraordinairement élevé dans les villes de Thetford Mine et d'Asbestos ; pour les femmes, ce taux est même le plus haut du monde. Il n'y a là rien d'étonnant : le documentaire de Sylvie Deleule, La Mort lente de l'amiante, montre que les déchets extraits des mines forment des terrils juste derrière les maisons... M. Daniel PAUL : Les pathologies liées à l'amiante sont-elles plus élevées sur l'ensemble du territoire canadien qu'ailleurs ? On peut comprendre que des pressions économiques et sociales s'exercent, telles que la production d'amiante se poursuive, mais il serait difficile de comprendre que l'on continue d'autoriser l'extraction et la commercialisation si la situation sanitaire au Canada était plus grave qu'ailleurs. Mme Annie THÉBAUD-MONY : La situation sanitaire au Canada n'est pas plus grave qu'ailleurs, pour la raison que l'amiante est exportée à 97 %. Je me rappelle avoir présenté le résultat de mes recherches sur les conséquences de l'exposition à l'amiante à des collègues canadiens dans les années 90. Ils se sont dits inquiets, mais ont observé qu'il ne se passerait rien chez eux en raison de ces exportations massives. En effet, après les très importants procès qui ont eu lieu aux États-unis dans les années 60, l'extraction et la commercialisation de l'amiante ont été arrêtées dans ce pays, et l'usage de l'amiante a très vite chuté au Canada, alors que les exportations flambaient. C'est un exemple d'hypocrisie parfait : on exporte ce que l'on ne veut pas utiliser. M. le Rapporteur : Qu'en est-il de la Russie ? Mme Annie THÉBAUD-MONY : La Russie est le deuxième producteur mondial d'amiante, ou peut-être le troisième désormais, car la Chine la rattrape à très vive allure. La Russie exporte et utilise l'amiante-ciment, après l'avoir produit dans des conditions équivalentes à celles qui prévalaient en France. Elle a adopté la même position que le Canada, et l'on a très peu d'informations réelles sur ce qui se passe. Mais un travail mené avec nos collègues polonais dessine pour la Pologne, où l'interdiction a été décidée en 1997, le même type de situation que celle qui prévaut en Europe du Sud, avec l'apparition de nombreuses maladies professionnelles. On est fondé à considérer que la situation est analogue en Russie, à la différence qu'il n'y a pas eu d'interdiction, si bien que la production continue et qu'il n'y a pas de veille sanitaire. M. le Rapporteur : Que savez-vous de la situation en Chine ? Mme Annie THÉBAUD-MONY : Un collègue professeur à Philadelphie qui travaille avec une équipe de Pékin indique que la situation est catastrophique, notamment dans l'industrie des matériaux de friction et dans l'industrie textile. Cette dernière continue d'utiliser des matériaux incluant de l'amiante pour fabriquer des équipements de sécurité. En Europe, on utilise pour cela des fibres synthétiques, plus chères, mais ce n'est pas le cas dans d'autres pays, en Inde par exemple. M. Gérard BAPT : J'aimerais revenir sur l'absence de réponse à la demande d'enquête épidémiologique autour de l'usine d'Aulnay ; selon vous, s'explique-t-elle par le manque de moyens ou par l'inertie administrative ? Mme Annie THÉBAUD-MONY : Quand des cas de légionellose se déclarent, on se donne les moyens d'en connaître l'origine. À Aulnay, il y a un hôpital dans la ville même et un autre à Montfermeil, à proximité. Il y a aussi des médecins libéraux et des cliniques. Demander un signalement systématique, ce n'est pas difficile ! Selon moi, il s'agit d'inertie administrative plus que d'autre chose. Or, les victimes potentielles ont le droit de savoir à quoi s'attendre et, de plus, la question du site lui-même est loin d'être réglée. En effet, un diagnostic approfondi a été fait après que l'usine a été vendue à un promoteur, celui-ci ayant découvert après coup que le site était amianté, ce que le préfet n'avait pas fait connaître. Le nouveau propriétaire a fait procéder à une expertise complète avant d'engager la démolition et, en décembre 2000, il a alerté par lettre recommandée sur le péril imminent, soulignant la nécessité de mesures immédiates de confinement du site et de consolidation de la toiture pour éviter qu'en s'effondrant elle ne disperse des poussières toxiques. Mais un recours administratif a été engagé par l'ancien propriétaire, qui ne veut pas payer le coût de la décontamination. L'inertie est totale, alors que la gravité de la situation est connue depuis huit ans. J'ajoute, pour faire bonne mesure, qu'au moment d'acheter le promoteur s'est vu remettre un document sur lequel, au minimum, il n'est pas fait mention de la présence d'amiante, au pire il est indiqué qu'il n'y en a pas. M. Jean-Marie GEVEAUX, Président : On peut donc s'attendre à une belle bataille juridique. Madame, je vous remercie pour cette très intéressante contribution à nos travaux. Audition de Mme Martine AUBRY, Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Je voudrais tout d'abord, Madame, vous remercier. Sachant que vous aviez déjà été très longuement auditionnée par la mission du Sénat, nous nous étions résolus à ne pas vous imposer le même exercice mais vous avez vous-même demandé à être entendue par notre mission et nous y sommes très sensibles. Une audition est toujours un exercice difficile et vous connaissez, comme nous-mêmes, la complexité et la gravité du sujet, puisque vous avez eu à vous en occuper en tant que haut fonctionnaire entre 1984 et 1987, puis en tant que ministre de l'emploi et de la solidarité entre 1997 et 2000. Vous avez, du reste, pris une série de décisions importantes - je le sais d'autant mieux que, en tant que président de la commission des affaires sociales, j'ai souvent eu à travailler avec vous, notamment sur le FIVA et la cessation anticipée d'activité. Bien évidemment, notre rapport rappellera succinctement l'histoire de l'amiante durant les cinquante dernières années, mais notre mission, à l'unanimité, a considéré que ce travail avait été déjà fait par le Sénat et bien d'autres travaux, à commencer par celui du Conseil d'État. Aussi avons-nous considéré que l'objet essentiel de cette mission était de faire des propositions précises sur le désamiantage, la prévention des risques professionnels, leur réparation - et notamment la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles - et d'étudier les aspects juridiques de la question. C'est à nos yeux la meilleure réponse à apporter à ceux qui souffrent encore de cette affaire, et à la mémoire de ceux qui en sont morts. M. le Rapporteur : Madame la ministre, nous sommes touchés par votre souhait de nous rencontrer et heureux de cet échange avec vous. Notre objectif est davantage de gérer le présent et de préparer l'avenir, mais vous pouvez également nous faire partager l'expérience que vous avez acquise dans le domaine de l'emploi et de la solidarité en y occupant des postes de direction importants avant d'en devenir ministre. À ce propos, une question me vient tout de suite à l'esprit. J'ai passé quelques jours à relire les comptes rendus du Comité permanent amiante (CPA). On y sent un climat particulier. Comment expliquez-vous les retards constatés dans le traitement de l'amiante en France ? Peut-on affirmer que l'interdiction aurait pu intervenir plus tôt ? Mme Martine AUBRY : Je veux d'abord vous remercier de m'avoir reçue. Je suis persuadée que votre mission, après celle du Sénat, a un rôle majeur pour l'avenir, évidemment, mais doit également être l'occasion de nous pencher sur le passé : nous le devons bien à toutes celles et ceux qui souffrent de l'amiante ou qui en sont déjà morts. Nous avons, vis-à-vis des victimes et de leurs familles, le devoir d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et surtout de réfléchir afin que cela ne se reproduise pas. Le rapport du Sénat apparaît à cet égard utile, même s'il me semble parfois trop insister sur des éléments à mes yeux moins importants comme le CPA. Peut-être devrait-on avancer des propositions plus ambitieuses pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Cela m'amène à répondre à la question de M. le Rapporteur, sachant que j'ai eu à traiter de cette question à plusieurs reprises. Lorsque je suis entrée au ministère du travail en 1975, l'amiante n'entrait pas dans mes fonctions, mais quand le directeur des relations du travail, M. Cabannes, a sorti le décret de 1977, nous en étions très fiers à la DRT. Je me souviens que, lors d'une session sur l'amélioration des conditions de travail à Genève, tout le monde nous félicitait. Les Anglais étaient certes déjà intervenus, mais nous avions alors réellement l'impression d'être très en avance - sans évidemment nous imaginer ce qui se produirait plus tard. Rien ne serait pire que d'analyser ce qui s'est passé à cette époque à l'aune de nos connaissances d'aujourd'hui. Nous devons à tout moment nous resituer dans le contexte de l'époque et nous demander si, en fonction des connaissances d'alors, nous avons fait tout ce que nous devions faire. Mon impression est que la France n'a été ni en avance ni en retard par rapport aux autres pays. J'ai longuement réfléchi et travaillé sur cette question, et encore à présent car ma région compte malheureusement beaucoup de salariés qui souffrent de l'amiante. La France aurait-elle pu à un moment donné prendre une décision qui n'a pas été prise ? Rappelons qu'aucun pays industrialisé n'a été capable d'éviter ce drame et la Grande-Bretagne pas plus que d'autres : c'est l'amélioration progressive des connaissances sur l'amiante qui a permis une évolution de la réglementation. Pendant longtemps, on a cru que les risques liés à l'amiante se limitaient à une fibrose pulmonaire, une asbestose, autrement dit une insuffisance respiratoire : c'est du reste la raison pour laquelle la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante a été inscrite dès 1945 au tableau des maladies professionnelles. Mais c'est seulement à partir des années 50-60 que l'on a commencé à établir un lien entre l'amiante et le cancer, notamment en Grande-Bretagne où une série d'études a fait état de cancers des poumons et de la plèvre - les mésothéliomes. Ces études ont été réalisées sur des hommes qui avaient intensivement produit ou utilisé de l'amiante vingt ans auparavant en s'exposant à des quantités sans commune mesure avec ce que l'on tolérait en France dans les années 70 : de 10 fibres à 100 fibres par millilitre dans les mines ou usines d'amiante et jusqu'à 1 000 fibres par millilitre pour les travaux d'isolation comme le flocage. On voyait même flotter dans les usines des années 30-40 de véritables nuages, comparables à celui qu'a dégagé le World Trade Center en s'écroulant : ce sont ces quantités énormes qui ont provoqué chez les salariés des cancers vingt à quarante ans plus tard, et c'est sur ces salariés qu'ont été effectuées les premières études en Grande-Bretagne. Ajoutons que la diffusion de ces travaux ne s'est faite que très progressivement : c'est seulement à la fin des années 70 qu'ils ont été considérés suffisamment convaincants pour que l'effet cancérigène de l'amiante sur l'homme soit reconnu - en 1976 par la France avec inscription au tableau des maladies professionnelles et en 1977 seulement par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Pourquoi n'a-t-on pas alors interdit immédiatement le produit ? Il faut, là encore, comprendre ce qu'est la protection des risques professionnels ; il faut distinguer entre le danger intrinsèque pour l'homme d'un produit et le risque lié à son utilisation et aux conditions de son utilisation. De là découle toute la réglementation applicable à la protection des travailleurs et même des consommateurs car il y a des produits cancérigènes dans toutes les cuisines et dans toutes les entreprises françaises. Le problème est donc, pour le ministère du travail, le ministère de la santé, le ministère de l'économie et les autres, de savoir à tout moment si les conditions d'utilisation sont en place pour éviter qu'elles n'entraînent un cancer chez l'homme. C'est pourquoi les différents produits sont étiquetés et classés, par le ministère de l'industrie - comme substances inflammables, nocives, toxiques, très toxiques, etc. -, afin d'appeler l'attention de tous ceux qui les manipulent. On peut aussi retirer des produits du marché, par décision du ministre de l'économie et des finances, avec une signature connexe du ministre du travail. Reste que la plupart des produits cancérigènes employés aujourd'hui dans l'industrie ne sont pas interdits, parce que nous sommes convaincus qu'ils sont utilisés de telle sorte qu'ils ne provoquent pas de cancer. L'enquête SUMER de 199454 est intéressante à cet égard : elle a établi que le nombre de salariés potentiellement exposés aux risques biologiques était de 1,2 million, aux risques chimiques de 4 millions et aux produits reconnus cancérigènes - hors amiante, désormais interdit - de 1 million. La vraie question est donc celle des consignes de sécurité et des restrictions à l'usage des produits concernés. C'est un peu comme la voiture : elle peut tuer, tout dépend de la façon dont on l'utilise, d'où les réglementations successives sur la vitesse, la ceinture, etc. La réglementation du travail s'inscrit dans la même logique et c'est le choix qui a été fait pour l'amiante : le danger potentiel de l'amiante - c'est en tout cas ce que l'on croyait à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui - étant lié à l'inhalation de poussière, on a pensé, à tort, pouvoir l'écarter en réduisant les quantités de poussières dans l'air, en définissant des conditions strictes de manipulation et d'utilisation du produit et en abaissant le seuil d'exposition des salariés. La plupart des pays industrialisés ont du reste réagi de la même manière et à peu près en même temps. Les valeurs limites d'exposition (VLE) ont été mises en place dans les années 70 et progressivement resserrées dans les années 80, jusqu'à l'interdiction totale de l'amiante dans les années 90. La France a été l'un des premiers pays à se doter, en 1977, d'une législation spécifique à l'amiante ; les États-Unis l'avaient fait un peu avant en fixant une VLE à cinq fibres par millilitre, puis deux, tout comme nous, bien loin des expositions des années 50 et 60 en Angleterre. La Direction des relations du travail (DRT) croyait réellement être en avance et éprouvait une véritable fierté à avoir sorti un texte qui réduisait aussi fortement le taux de fibres dans l'air. Pour prendre un parallèle, c'est un peu comme si, découvrant les risques pour la santé de fumer plus d'un paquet par jour, on avait interdit de fumer plus de deux cigarettes par jour. Les dernières études en la matière (publiées il y a quelques semaines) montrent d'ailleurs qu'il y aurait encore un risque à ce niveau de consommation ! On nous fait valoir que le Royaume-Uni était alors en avance puisqu'il avait, dès 1931, adopté une législation visant à réduire le risque d'asbestose. C'est oublier que la France disposait depuis le début du XXème siècle - contrairement aux autres pays - d'une protection générale contre les poussières. La fibrose pulmonaire a été reconnue comme maladie professionnelle dès 1945 ; cela est d'autant plus important que l'inscription au tableau induit non seulement le droit à indemnisation, mais également une obligation pour l'entreprise de protection de ses salariés contre ce risque. Il est enfin paradoxal de vanter l'avance du Royaume-Uni, alors que l'on sait aujourd'hui que c'est le pays où les maladies déclarées sont les plus nombreuses du fait que l'amiante y a été utilisé beaucoup plus tôt et en fortes quantités ; c'est malheureusement parce que les maladies se sont déclarées en nombre, plus tôt que chez nous, ce qui explique d'ailleurs que les Anglais, comme les Américains, aient réagi avant nous pour les premières réglementations spécifiques amiante. Remarquons enfin que dès la fin des années 60, de nombreux pays, dont la France, les États-Unis, la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas, ont interdit le flocage, une des utilisations les plus dangereuses de l'amiante, alors que le Royaume-Uni ne l'a fait qu'en 1985... Nous n'avons pas davantage été en retard ni en avance par rapport à la première directive européenne, applicable à compter du 1er janvier 1987. L'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, la Belgique et le Danemark l'ont transposée quelques mois avant nous (avec application au 01/01/87). Notre texte est sorti en mars 1987 du fait d'un retard au niveau du Conseil d'État : nous le lui avions transmis dès septembre 1986. Tous les autres pays européens l'ont fait après, parfois plusieurs années. Au demeurant, cette directive qui réduisait encore le taux de fibres n'a eu finalement que peu d'influence en France où la plupart de ses dispositions étaient déjà mises en œuvre : pour 98 % des salariés l'exposition se situait déjà en dessous des taux limites. Seule la Suède avait une avance sur les autres pays. Pour ce qui est de l'interdiction générale, nous avons été dans les premiers à l'imposer : le Danemark est le seul à l'avoir réellement fait avant nous, en 1993-1994. Plusieurs raisons expliquent pourquoi nous ne l'avons pas fait avant : nous étions toujours dans une logique de réduction de l'exposition des travailleurs - plus de vingt-cinq textes ont ainsi été publiés alors que j'étais DRT, depuis l'interdiction d'exposer les travailleurs temporaires jusqu'aux obligations concernant les douches - et convaincus que la faiblesse des taux de fibres écartait tout danger. Encore fallait-il que la réglementation fût appliquée ; nous y reviendrons. Deux éléments ont conduit la France à décider l'interdiction par un décret du 24 décembre 1996 modifiant le code de la consommation et le code du travail. Premièrement, l'étude de Julian Peto, en 1994, a mis en évidence des cas de cancer chez dans des catégories de salariés - ouvriers du bâtiment, garagistes, plombiers - soumis à des pics d'exposition mais que nous croyions à l'abri en raison des faibles quantités de fibres d'exposition. La question s'est alors posée de l'amiante dans les logements, où, contrairement aux entreprises, il n'est pas possible de contrôler la teneur de l'air en fibres. Nous n'étions pas encore sûrs de devoir absolument interdire l'amiante, mais comme c'était le seul moyen de nous assurer qu'il n'y en aurait plus dans les logements, nous l'avons interdit. Deuxièmement, l'expertise collective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) de 1996 a montré, à partir d'hypothèses alors non démontrées mais scientifiquement crédibles, qu'un risque de cancer significatif pouvait subsister, même à de très faibles doses d'exposition. Il ne s'agissait que d'une présomption et non d'une certitude absolue mais cette présomption nous imposait d'agir, ce qui nous a valu d'être attaqués par le Canada, premier producteur d'amiante. En fait, la différence entre les pays tient à leur appréciation du principe de précaution dans une situation où le risque était possible, mais non encore prouvé. À cet égard, je ne peux que vous citer une phrase du professeur Got auquel j'avais confié une mission d'étude en 1997 : « Contrairement à ce qui a parfois été dit, il n'y a pas d'ambiguïté à éclaircir dans les positions exprimées par les scientifiques français et celle des Canadiens. Il y a une différence d'appréciation sur la nécessité de prendre en compte les risques des faibles doses, mais nous sommes d'accord pour reconnaître qu'ils ne sont pas actuellement prouvés55. » Cette phrase a été écrite en 1998 par le spécialiste de l'amiante, deux ans après l'interdiction, et il la maintient aujourd'hui encore. Autrement dit, contrairement à ce que l'on lit dans la presse, il ne suffit pas de montrer du doigt untel ou untel pour comprendre : il faut admettre, et encore aujourd'hui, qu'il n'y a pas de certitudes, seulement des questions fortes qui se posent. Les études de Julian Peto et de l'INSERM avaient montré qu'il existait un risque vital hypothétique mais crédible ; il fallait donc intervenir. Ce n'est pas la certitude à 100 %, mais le risque hypothétique qui a conduit à décider l'interdiction. Le doute subsistait, mais les présomptions étaient suffisamment importantes. Dans ce cas, pourquoi encore n'avoir pas agi plus tôt ? D'abord pour une raison simple - j'ai du reste été étonnée que le Sénat ne s'en soit pas aperçu alors que j'étais pratiquement la dernière personne auditionnée - : le mésothéliome se déclare en moyenne trente-huit ans après le début de l'exposition, sans aucun signe précurseur... Autrement dit, il se passe pratiquement deux générations entre l'exposition et la déclaration de la maladie. Les cas observés au début des années 80 correspondaient donc à des expositions intervenues dans les années 40 ! Et l'effet des mesures dont nous étions si fiers en 1977 ne sera pas perceptible avant 2015... C'est là un point majeur qui commande d'exclure toute analyse simpliste en la matière. Nous ne sommes pas dans le cas de figure d'un accident ou d'une maladie courante. Le sénateur Fauchon lui-même a reconnu qu'il n'avait pas pris conscience de ce décalage. La deuxième raison tient au caractère extrêmement rare - à l'époque, s'entend, du fait même de ce décalage - de cette maladie dans les années 70-80. C'est seulement aujourd'hui que nous voyons les cas se multiplier. À cette époque, les agents de prévention des Caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), les premiers à tirer la sonnette d'alarme, en matière de maladies professionnelles, voyaient - et encore - un cas tous les trois ans de cancer du poumon chez un salarié travaillant sur l'amiante. Les analyses n'étaient pas claires et personne ne pouvait dire à l'époque si ces cancers n'étaient pas dus à la cigarette et aggravés par l'exposition à l'amiante. Personne n'imaginait que l'amiante puisse en être la cause première, d'autant que l'on fumait beaucoup dans les entreprises et que l'on manquait cruellement d'études dans ce domaine. On sait d'ailleurs que le tabac multiplie le risque par dix et l'amiante par cinq, soit un facteur cinquante pour un salarié fumeur travaillant dans l'amiante. En 1987, lorsque j'étais directeur des relations du travail, j'ai inscrit le cancer du poumon au tableau des maladies professionnelles alors que les employeurs s'y opposaient depuis dix ans en soutenant que la cancer était dû à la cigarette et non à des situations de travail. Mais nous commencions à cerner plusieurs causes, dont l'amiante et nous l'avons inscrit - l'inscription déterminant, je le répète, le droit à indemnisation financière, mais également des mesures de prévention. Dernier point - personne n'en parle, mais nous avions commencé à y réfléchir dès les années 90 - : l'incertitude sur les fibres de substitution. Interdire, c'est bien, mais pour mettre quoi à la place ? Au fond, ces nouvelles fibres ont les mêmes caractéristiques mécaniques, et s'il faut attendre trente ans pour s'apercevoir de leurs effets et devoir réglementer, mieux faut ne pas tenir de raisonnements trop rapides ! Au total, c'est bien notre système de prévention, pris globalement, qui n'était pas adapté, et qui ne l'est toujours pas. Il y a une multitude de responsabilités du fait que la question de la santé au travail n'a pas été traitée dans notre pays aussi sérieusement que la santé publique ou même la sécurité routière. Les CRAM sont les premières à disposer de données permettant de donner l'alerte au niveau du ministère de la santé. C'est d'abord par ce canal que l'on peut commencer à avoir des doutes sur tel produit toxique ou tel mode d'organisation. Ensuite, les services centraux reçoivent l'alerte et doivent réfléchir à l'évolution de la réglementation et les organismes de recherche peuvent conduire les études nécessaires. Or nous avions d'un côté la sécurité sociale - gérée par les partenaires sociaux -, de l'autre, des instituts de recherche Je dois avouer que je n'ai découvert le CPA qu'au moment où j'ai demandé à Claude Got de faire son rapport en 1997. J'étais au ministère du travail depuis 1975, j'ai été directeur des relations du travail entre 1984 et 1987 et je crois connaître assez bien la DRT : nous n'avons jamais considéré l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) comme une référence. Il était géré par le patronat et les syndicats et nous avions avec lui des débats très houleux : moi-même, en tant que directeur, j'ai pendant deux ans refusé de participer à son conseil d'administration, considérant qu'il ne travaillait pas sur les causes, mais seulement sur les effets, sans chercher à intégrer la sécurité dans les concepts, les machines, les équipements, les procédures. Par exemple, l'INRS préférait travailler sur des systèmes de protection contre le bruit, alors qu'ils auraient été inutiles si on avait cherché à réduire le bruit au moment de la conception des machines. Il y avait, à cette époque, des centaines de groupes de travail au sein de l'INRS, auxquels assistaient naturellement les fonctionnaires du ministère du travail. Il en était de même au CPA où siégeaient le professeur Bignon ou le professeur Brochard, spécialistes reconnus de l'amiante, que je connais très bien et que je ne peux imaginer un instant sensibles à je ne sais quelle pression : il faut rappeler que le professeur Bignon avait écrit à Raymond Barre pour lui demander de mettre en place un groupe de travail sur l'amiante. J'ai été très choquée par certains propos tenus sur les fonctionnaires du ministère du travail. C'est un ministère dans lequel on entre avec un réel engagement - non pas un engagement politique, mais un engagement pour améliorer les conditions de vie des salariés. Lorsque j'y suis arrivée en 1975, mon chef de service a tenu à me faire savoir qu'il n'avait jamais reçu un patron... Cela aurait été, à ses yeux, proprement ignominieux ! Nous avons évolué par la suite et c'est heureux. Mais supposer que ces personnes aient pu être influencées, via l'INRS, par le monde patronal est tout simplement aberrant pour qui connaît le ministère du travail. Jean-Louis Pasquier, que vous avez auditionné, est l'exemple type de ces fonctionnaires qui sont d'une rigueur absolue. Au demeurant, jamais je n'ai vu les entreprises chercher à faire pression sur eux ; elles ont toujours préféré, lorsqu'elles s'y sont essayées, passer par ceux qui sont susceptibles de les écouter plus facilement, au ministère de l'industrie, voire au cabinet des Premiers ministres successifs. Mais cela n'a jamais été le cas pour l'amiante. Je n'ai jamais, de près ni de loin, senti une pression des entreprises en la matière et ce qui pouvait se dire au CPA n'avait aucun effet sur nos décisions. Le CPA n'était qu'une commission d'experts, parmi une centaine d'autres. Imaginer qu'en le supprimant on aurait supprimé le problème montre que l'on n'a rien compris. Il faut chercher ailleurs d'éventuelles responsabilités. M. le Rapporteur : Nous sommes très sensibles à la manière dont vous essayez de rendre compte, avec honnêteté et courage, d'une période qui n'a pas dû être facile. Et la publication récente de certains livres à sensation montre qu'il est aisé de noircir le tableau... À ce propos, la lecture des comptes rendus du CPA montre que ces ouvrages contiennent des affirmations totalement fausses : ainsi, Force ouvrière a participé au CPA, alors qu'on entend - ou on lit - le contraire. Mme Martine AUBRY : Bien sûr, comme tous les syndicats. M. le Rapporteur : La logique d'interdiction totale et internationale défendue aujourd'hui au niveau européen et ailleurs n'a rien à voir avec celle qui prévalait à l'époque où l'on préconisait un usage contrôlé le plus respectueux possible de la santé, et vous l'avez expliqué avec beaucoup de courage. M. le Président : Vous avez chiffré à trente-huit ans le temps de latence d'un mésothéliome. Nous savions que le temps de latence pouvait être très long, mais c'est la première fois que nous entendons parler de trente-huit ans. J'avais dans la tête un délai de vingt à trente ans... Mme Martine AUBRY : Vingt ans, c'est pour l'asbestose et les plaques pleurales. Trente-huit ans est considéré comme la durée moyenne entre la première exposition et l'apparition d'un mésothéliome, c'est-à-dire du cancer de la plèvre. C'est indiqué dans le rapport de l'INSERM56. M. le Président : C'est plus long que ce que nous pensions, et cela explique beaucoup de choses. Vous nous avez expliqué comment vous avez vécu - et souvent directement - cette affaire et vous avez remis certaines vérités à l'endroit. Mais revenons à plusieurs questions qui sont au centre de nos travaux. Premièrement, la prévention. Nous avons acquis la conviction qu'il fallait impérativement dissocier ce qui relève de l'analyse scientifique et ce qui relève de l'élaboration et de la mise en œuvre du programme d'actions. Les deux sont bien souvent mélangés. Qu'en pensez-vous ? Deuxièmement, nous sommes face à une multitude d'organismes : l'IVS, l'INSERM, etc., le plus récent étant l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE) devenue l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET). À votre avis, faut-il mettre en place un organisme indépendant, financé par l'État et ayant autorité sur l'ensemble des organismes existants, sachant que cette position n'est pas commode à défendre auprès des partenaires sociaux, patronats et syndicats, très jaloux de leurs prérogatives ? Nous avons acquis le sentiment que c'était indispensable, sous peine d'avoir à affronter demain des risques du même type que ceux de l'amiante à propos d'un autre produit. Troisièmement, et le programme REACH57 est à cet égard particulièrement révélateur, si le compromis de 1898 sur les accidents du travail était incontestablement une avancée, le véritable problème est de plus en plus celui des maladies professionnelles où le lien de cause à effet est beaucoup plus difficile à établir et à maîtriser. Cela pose le problème de la réparation et de l'évolution de la branche « accidents du travail - maladies professionnelles » (AT-MP). Comment l'imaginez-vous ? Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) constitue une avancée, mais c'est aussi, aux yeux de certains, une manière inégalitaire de traiter le problème. On pressent un tournant dans l'évolution de cette branche, même si tout le monde s'accorde généralement à reconnaître qu'elle doit demeurer au sein de la sécurité sociale. Mme Martine AUBRY : Certains chiffres sont particulièrement intéressants, notamment le nombre de salariés encore exposés aux fibres durant les années où nous avons pris ces réglementations. Avant 1973, les niveaux d'exposition dépassaient fréquemment 10 fibres par millilitre. Or la proportion de salariés exposés à moins de 0,5 fibre par millilitre est passée de 66 % en 1980 à 90 % en 1987 et à 99 % en 1993. On voit comment une réglementation qui limitait l'exposition à deux fibres par millilitre a, en fait, obligé les entreprises à un changement complet puisque, au moment où nous avons appliqué la première directive de 1987(1f/ml), 99 % des salariés étaient déjà en dessous du taux prescrit. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils ne seront pas malades dans la mesure où ils ont pu être soumis à des expositions plus fortes dans les années qui ont précédé. La prévention est donc une dimension majeure du problème. J'ai été très attentive à la réflexion engagée par M. Larcher sur la santé au travail. Je ne mets nullement en cause ni sa volonté ni les principes posés dans le « Plan santé au travail » (PST) : introduire la santé au travail dans le dispositif de sécurité sanitaire, structurer et développer la recherche publique en santé et sécurité au travail, organiser l'accès à la connaissance, on ne peut qu'être d'accord. Le problème reste celui des moyens que l'on entend donner à cette politique si l'on veut vraiment changer les choses. Or, sur l'agence de santé au travail, devenue l'AFSSET, et l'IVS, que nous avions mis en place avec Bernard Kouchner, on propose de mettre dix personnes en 2005, cinquante en 2009... Ce n'est pas à la hauteur du sujet. Pour ce qui est des moyens de la recherche, 500 000 euros de crédits à la DRT. Rien pour l'inspection du travail. Je ne voudrais pas tout ramener à ce que j'ai fait, mais lorsque j'étais en fonction, j'ai multiplié les promotions d'élèves inspecteurs par cinq. De vingt, nous sommes passés à cent ; depuis, le nombre est redescendu. Pour assurer l'application de la réglementation, j'ai demandé, en 1985, aux inspecteurs du travail de renforcer les contrôles sur les cancers professionnels en leur indiquant que notre objectif n'était pas de rester en dessous des normes, mais d'empêcher qu'elles soient atteintes en faisant comme si l'interdiction existait déjà, par une exposition la plus basse possible. Déjà à l'époque, alors même que, dans notre esprit, le risque n'existait pas au point de justifier une interdiction, nous demandions aux inspecteurs d'effectuer des contrôles pour éviter l'utilisation de certains produits, dont l'amiante. Les inspecteurs du travail jouent donc un rôle majeur ; malheureusement, ils sont trop peu nombreux. Le rapport avec l'Allemagne est de un à sept... La prévention passe d'abord par l'application des textes. Ensuite, se pose le problème de la réforme de la tarification et du système global de prévention des risques professionnels. Même si les organisations syndicales et patronales ne sont pas prêtes à l'accepter, je persiste à penser que les recherches dans le domaine de la santé au travail devraient être indépendantes. Le paritarisme a du bon dans bien des domaines, mais la recherche suppose de conduire de pair la recherche fondamentale et de la recherche appliquée et de financer les deux, en partie par l'État et peut-être en partie par les entreprises, mais de la manière la plus indépendante possible. Certains nous reprochent d'avoir mis en place, avec le FIVA, un mécanisme d'indemnisation qui n'existe pas pour les autres maladies professionnelles, ce qui est vrai. Mais lorsque je me suis rendue compte de la réalité du drame de l'amiante en 1997, au moment où les cas commençaient à se multiplier alors que l'interdiction était déjà entrée dans les faits, j'ai compris que ces hommes et ces femmes n'avaient pas le temps d'attendre. Lorsque nous accueillions les représentants de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante (ANDEVA) - nous l'avons aidée à se structurer -, nous recevions des personnes qui ne pouvaient plus respirer, qui étaient condamnées à court terme, et d'autres, qui présentaient déjà des plaques pleurales dépassées et qui savaient quel serait leur chemin. Ma conviction était que nous ne pouvions pas attendre la mise en place de la réforme que nous avons engagée, mais qui nécessitait un énorme travail de réflexion, sur la réparation intégrale des accidents du travail. D'où la mise en place du FIVA, spécifique à l'amiante, dont je reconnais qu'elle peut paraître incohérente dans un schéma administratif classique où tout le monde devrait être traité de la même manière, mais qui répondait à une urgence et à un drame que, collectivement, nous n'avons pas su éviter. Il est vrai qu'en France les accidents du travail ont longtemps été considérés comme une sorte de fatalité qui ne pouvait pas donner lieu à la même réparation que les autres Dans ces domaines très difficiles, gardons-nous de montrer une seule catégorie du doigt. Certes, il s'est trouvé des chefs d'entreprise qui n'ont pas respecté la réglementation, y compris sur l'amiante. Je le vis tous les jours dans ma région : des salariés morts de l'amiante n'ont jamais figuré dans la liste des victimes car l'entreprise a refusé de les déclarer au moment où la liste a été ouverte. Leurs ayants droit ne peuvent donc plus faire reconnaître leur droit à indemnisation. Il faut, dans ces cas, aller jusqu'au bout des responsabilités pénales et c'est là que la loi Fauchon pose problème à cause de l'application qu'en a fait la cour d'appel de Douai en étendant le principe de non-responsabilité des élus - dès lors que la faute n'était pas intentionnelle - à tous les domaines, chefs d'entreprise compris. Cela revient à dire que, dès lors que vous n'avez pas appliqué la réglementation du droit du travail non intentionnellement, vous n'êtes pas coupable ! Pourtant, nul n'est censé ignorer la loi, à plus forte raison le dirigeant d'une entreprise travaillant avec des produits dangereux... Et puisque la Cour de cassation n'a pas pu trancher sur le fond, il faut avoir le courage de revenir sur la loi Fauchon. On ne peut continuer à laisser appliquer ce principe d'irresponsabilité aux chefs d'entreprise. Enfin il faut, chaque fois que possible, établir un lien entre le financement et la responsabilité. On a récemment prévu une intervention financière des entreprises en la matière, ce qui est une bonne chose ; mais il faut aller plus loin. La mise en place du système de cotisations sociales « accidents du travail » en 1976 avait constitué un énorme progrès en instituant des taux individuels - pour les grandes entreprises, pour lesquelles il est relativement facile de connaître le taux moyen d'accidents dans un secteur déterminé -, et des taux collectifs pour les petites entreprises. Les moyens dont nous disposons désormais en termes de connaissances, de statistique et de suivi devraient nous permettre d'instituer un système de cotisation beaucoup plus incitatif - pour ceux qui font d'énormes efforts sans en être récompensés - et réellement pénalisant pour ceux qui n'appliquent pas la réglementation. M. le Rapporteur : Le compromis de 1898 ne peut à l'évidence plus tenir tel quel et nous réfléchissons tous ici aux dispositions qui pourraient le faire évoluer. Pour l'instant, qu'il s'agisse de maladie professionnelle, d'accident du travail ou même d'une situation du type de l'attentat de Karachi, les salariés se voient obligés d'attaquer leur entreprise en justice pour faute inexcusable s'ils veulent bénéficier de la totalité de la pension et non des 50 % forfaitaires... Pourriez-vous nous conseiller sur les directions à suivre ? J'aimerais également que vous nous retraciez l'historique de la création du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA). Il y a de nombreux commentaires à ce sujet, dont celui de la Cour des comptes. Quelle est votre appréciation personnelle ? Mme Martine AUBRY : Ce que j'ai dit pour le FIVA vaut pour le FCAATA : lorsque, après le rapport de l'INSERM et l'interdiction de l'amiante, nous avons vu le nombre de victimes se multiplier, nous nous sommes dit que la nation avait un devoir de solidarité envers elles. Elle devait les indemniser mais également autoriser un certain nombre d'entre elles à partir en retraite anticipée. Jusqu'à l'instauration du FIVA, le salarié devait suivre un véritable parcours du combattant, qui souvent allait au-delà de ses forces et se terminait avec son décès. La mise en place du fonds d'indemnisation était à l'évidence une nécessité. Le FCAATA a été critiqué par la Cour des comptes sur deux terrains. La Cour a d'abord remarqué que certaines entreprises ont utilisé le FCAATA pour régler des problèmes économiques. J'ai été très surprise de l'apprendre : il appartient au ministre de vérifier ce genre de choses... Les modalités de ces préretraites sont connues, elles sont soumises à signature : si l'on ne veut pas les accorder, elles ne sont pas accordées. Ou alors, les services ne fonctionnent plus comme à mon époque... La Cour des comptes estime également que des salariés partent en préretraite alors qu'ils ne développeront jamais la maladie en question. C'est peut-être vrai ; mais tous ont été victimes d'une réelle perte de chances, et vivront désormais avec, en permanence, la peur de mourir d'un mésothéliome. Nous avions à l'origine réservé le bénéfice du FCAATA aux salariés des entreprises ayant produit de l'amiante. Les premiers décès survenant les uns après les autres, nous avons repris nos listes en y ajoutant d'autres catégories, y compris - non sans mal - les dockers des ports qui transportaient les sacs d'amiante. Nous nous sommes même rendu compte - alertés par le Président Le Garrec -, que des femmes de dockers de Dunkerque mouraient de l'amiante qu'elles avaient inhalé en lavant les bleus de travail de leurs maris ! Aussi avons-nous publié une circulaire prévoyant que la femme d'un ouvrier décédé de l'amiante pouvait, elle aussi, bénéficier d'une indemnisation - ou d'une cessation anticipée d'activité mais, généralement, elle ne travaillait pas. Compte tenu de l'importance du risque, je ne crois pas qu'il faille regretter d'avoir pris cette décision générale. Il n'est qu'à voir le cas de l'entreprise « SI Énergie », dans la métropole lilloise, dont Alstom s'est débarrassée, alors qu'elle posait un problème d'amiante, qu'elle ne pouvait ignorer. Deux retraités sont décédés quelques mois plus tard et l'entreprise qui avait repris le site a été obligée de fermer pour désamiantage. Les salariés ont fait des tests ; en l'espace de cinq ans, les deux tiers ont déclaré la maladie et les autres vivent avec cette menace au-dessus de la tête. Cela leur porte même préjudice lorsqu'ils recherchent un travail ! Certains en viennent à se suicider. Il en est de même chez ceux de « Fives-Cail-Babcock ». « On a comme une étoile jaune lorsqu'on cherche du travail », disent-ils. Et que dire de ceux qui ayant déclaré la maladie sont promis à une fin de vie épouvantable ! Il faut les avoir rencontrés pour s'en rendre compte. Même si quelques uns ont pu profiter de la cessation anticipée d'activité et ne déclencheront pas la maladie, ils n'en ont pas moins été victimes d'une perte d'espérance de vie. Par rapport à tous ceux qui sont partis en préretraite pour des raisons économiques, nous leur devions bien cela. M. le Président : Je suis très sensible à cette argumentation : quand bien même il ne déclarera peut-être pas la maladie, le salarié amianté vivra pendant des années avec cette hypothèque. L'argument est très fort. Vous êtes clairement en faveur de la réparation intégrale ; mais le coût en sera lourd. Comment mobiliser les entreprises sur une politique plus efficace de prévention ? Nous y avons réfléchi avec des responsables économiques et sociaux et la solution n'est pas si facile à trouver. L'idée d'une autorité indépendante, capable de mener des études, de poser un diagnostic, etc., recueille un certain consensus au sein de la mission. Vous avez parlé de l'inspection du travail, mais ne vous paraît-il pas indispensable de faire également évoluer la médecine du travail, qu'il s'agisse de son statut, de son indépendance, de son financement, sachant que, de plus en plus, le problème sera d'abord celui des maladies professionnelles, avec des liens de causalité beaucoup plus difficiles à établir ? Mme Martine AUBRY : Je raisonne sur les accidents du travail et les maladies professionnelles comme sur les licenciements économiques mais tout le monde n'est pas de cet avis, y compris chez mes amis. Si je n'ai jamais été favorable à l'interdiction du licenciement économique, je crois beaucoup au fait de faire payer les entreprises qui en ont les moyens. Si un groupe qui fait des résultats veut faire de la productivité en fermant un site, il devra payer. Et payer, ce n'est pas seulement donner de l'argent : c'est financer la réindustrialisation, trouver les emplois, assumer une responsabilité sociale. Ainsi, l'on réfléchira à deux fois avant de prendre une décision coûteuse pour faire plaisir à des actionnaires. Il en est de même pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il n'y a malheureusement pour moi que deux moyens de les éviter : faire payer les entreprises et les contrôler. Le contrôle est l'affaire de l'inspection du travail - avec des moyens renforcés - et du médecin du travail. Or, je n'ai jamais réussi à faire évoluer le statut de la médecine du travail et je le ressens comme un échec personnel. Tant que les médecins du travail ne seront pas indépendants du chef d'entreprise, tant que leur rémunération - et parfois leurs choix - dépendront de l'employeur, jamais on ne pourra exiger d'eux qu'ils prennent des décisions en totale liberté, à moins de les mettre dans des situations vraiment inhumaines. Nous avons besoin de médecins du travail mieux formés, dans des organisations extérieures à l'entreprise, au besoin paritaires. L'employeur ne doit pas choisir les médecins du travail et ceux-ci doivent exercer leur activité en toute indépendance, sans que leur rémunération ou leur avenir dépende du chef d'entreprise. Il faut contrôler, mais il faut également faire payer ceux qui ne font pas d'effort de prévention. Or il y a la réglementation, mais également ce qu'il y a autour. Lorsqu'on sait qu'un produit est dangereux, on peut faire respecter strictement la prévention, mais on peut faire beaucoup plus. La loi de 1976 sur les accidents du travail incitait à agir à la source, à carrosser les machines, à intégrer dans les équipements les produits dangereux. Mais cela coûte plus cher et les entreprises qui le font devraient payer moins de cotisations. Je crois beaucoup à une réforme - certes complexe - du système de cotisations accidents du travail qui créerait un lien entre la politique de prévention et son taux de cotisation, plutôt que de faire payer pour les autres les entreprises qui font de réels efforts en la matière. Cela dit, je me réjouis que les entreprises contribuent dorénavant au financement du FCAATA ; elles devraient même payer un peu plus. Beaucoup trouvent que le FCAATA coûte cher. Je crois pour ma part qu'il était nécessaire, pour les raisons déjà exposées. Mais il serait également souhaitable que le FIVA exerce plus souvent l'action subrogatoire contre les entreprises. Il le fait insuffisamment et depuis le vote de la Loi Fauchon, on a l'impression que les employeurs ne sont jamais poursuivis. M. le Président : Revenons sur la loi dite « Fauchon » - le sénateur insiste d'ailleurs sur le fait que ce n'est pas « sa » loi et que c'est un travail collectif. Mme Martine AUBRY : Personne ne lui prête de mauvaises intentions ! M. Gérard BAPT : Il souhaite pourtant que l'on n'y touche pas ! M. le Président : Je n'en suis pas si sûr ! Reste que cette loi existe et l'on sait dans quel esprit elle a été adoptée. Elle n'avait rien à voir avec l'amiante mais elle a été utilisée par le tribunal de grande instance de Dunkerque, puis par la cour d'appel de Douai, de sorte que le dossier n'a pas été traité au fond, et la Cour de cassation a été empêchée de se prononcer pour de raisons de procédure. Son avocat général considère, quant à lui, qu'un procès au fond est indispensable et nous partageons son sentiment. Deux « pôles de santé publique » ont été créés, l'un à Paris, l'autre à Marseille et des instructions ont été engagées par le pôle de Paris. Faut-il ou non corriger la loi Fauchon pour éviter que ce texte ne soit utilisé pour des problèmes de responsabilité en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ? La question est difficile... Mme Martine AUBRY : Loi Fauchon ou pas, n'oublions pas que la recherche des responsabilités impose de remonter vingt, trente, voire quarante ans en arrière, ce qui suppose que les données relatives aux produits utilisés aient été conservées. Et si l'entreprise n'existe plus, ce n'est pas possible. Ajoutons à cela que les juges ne sont ni des ingénieurs, ni des techniciens ; ils auraient besoin d'une expertise. Ainsi, la Cour d'appel de Douai a refusé de reconnaître la responsabilité pénale d'un chef d'entreprise au motif qu'il n'y avait pas de réglementation avant 1977, ce qui est totalement faux : il existait déjà une réglementation sur les poussières et une maladie professionnelle avait été reconnue au tableau des maladies professionnelles, ce qui prouve bien que l'on savait qu'il fallait faire attention en utilisant ce produit. Ce sont des sujets complexes et il n'existe pas de banques de données relatives aux produits utilisés par chaque entreprise. Le sénateur Fauchon n'avait évidemment pas souhaité cette utilisation contestable de la loi qui porte son nom - et que tout le monde avait d'ailleurs votée -, selon laquelle un chef d'entreprise, dès lors qu'il n'a pas eu la volonté délibérée de violer une obligation, n'est pas considéré coupable. Mais peut-être est-ce préférable : les juges n'ont-ils pas voulu, au fond, nous dire qu'il ne fallait pas faire de réglementation d'exception ? Nous n'avons pas besoin de la loi Fauchon. Il n'est pas bon de faire croire que les élus ne sont pas soumis aux mêmes règles que les autres. Si les juges considèrent qu'il faut mettre le maire en prison sitôt que quelqu'un tombe lorsqu'un pavé est descellé, il faut une instruction générale du ministère de la justice, mais pas une loi... La manie actuelle veut qu'à chaque fois qu'il se pose un problème, on fabrique une loi. Mais comme on ne peut pas l'appliquer, on décrédibilise la loi et la démocratie. Une démocratie doit fonctionner avec des registres propres et chaque fois que nous essayons collectivement de nous protéger, nous créons des effets pervers. Si j'avais été députée au moment où elle a été examinée, je n'aurais pas voté la loi Fauchon, même si j'en comprends très bien les motivations. Il vaudrait mieux faire en sorte que les juges se posent la vraie question : chacun a-t-il bien fait ce qu'il avait à faire dans le cadre de ses responsabilités ? On verrait, alors, que le maire n'est pour rien dans la chute du panneau de basket - sauf évidemment s'il y a eu des plaintes ou des écrits dont il n'a tenu aucun compte. Je préfère les mécanismes généraux aux mécanismes particuliers. M. le Président : Vous êtes encore plus radicale que moi... J'avais voté cette loi, peut-être à tort. M. le Rapporteur : Mais que fait-on de la loi Fauchon ? Mme Martine AUBRY : Comment modifier la loi Fauchon ? Nous avons travaillé sur le sujet avec l'ANDEVA en nous entourant des conseils de deux grands spécialistes : c'est très difficile dans la mesure où le droit pénal s'applique à tous. On ne voit pas pourquoi on ouvrirait le champ d'une volonté non délibérée au bénéfice de certains et non de tous. Nous n'avons toujours pas trouvé de porte de sortie. Si une loi en vient à entraîner une « mini responsabilité » pour toute une catégorie, alors même que le juge est là pour vérifier si chacun a fait ce qu'il devait faire dans le cadre de ses responsabilités, on devra se demander s'il ne faut pas revenir en arrière. M. le Président : Voilà qui ne nous aide guère dans notre réflexion... Ainsi que nous l'a dit le sénateur Fauchon, dont on connaît la vivacité d'esprit : « Modifier la loi, pourquoi pas, mais sur quoi ? » Mme Martine AUBRY : C'est très difficile. Mme Catherine GÉNISSON : Il faut l'abroger. M. Jean-Marie GEVEAUX : L'abroger ou en changer. Mme Catherine GÉNISSON : Votre argumentation est très séduisante. À votre avis, la cour d'appel de Douai manquait probablement de connaissances techniques sur le sujet. Plusieurs personnes auditionnées ont défendu l'idée de juridictions spécialisées pour traiter de ces dossiers. Quelle est votre opinion ? Mme Martine AUBRY : Je n'ai pas suffisamment réfléchi à cette question pour y répondre. Une chose est sûre : il faut une expertise que le juge pénal n'a pas obligatoirement et l'on ne peut le lui reprocher. Faut-il une expertise auprès du juge ou dans le cadre d'un tribunal particulier ? Je me méfie des juridictions particulières. La notion de risque, comme de faute, évolue sans cesse et il n'y a pas de raison qu'un domaine soit traité différemment des autres. Je plaiderais plutôt pour que la justice dispose des moyens nécessaires pour faire appel à des experts compétents, au besoin permanents. M. Daniel PAUL : Un maire ne doit pas être condamné pour un panneau de basket tombé, avez-vous dit, à moins qu'il n'ait été alerté et n'en ait tenu aucun compte. Je ne peux pas manquer de faire le rapprochement avec un superbe rapport de la Cour des comptes d'il y a déjà quelques années, sur le fonctionnement des centrales nucléaires, et qui fait état d'une évolution préoccupante en matière de respect des normes de sécurité : tout porte à craindre, avec l'ouverture du capital d'EDF, que l'on n'atteigne un jour les limites à ne pas dépasser. Il y a d'un côté la réglementation et de l'autre son application et son contrôle. Peut-être est-ce par ce biais que nous pourrions retoucher la loi Fauchon. Quand bien même il n'a pas appliqué la réglementation, un maire ou un chef d'entreprise n'a pas pour autant voulu la mort d'un enfant ou d'un salarié. Mais dès lors qu'il ne l'a pas appliquée strictement - et dans le cas de l'amiante, c'est à la fibre près -, il est coupable et, dans la mesure où il y a mort d'homme, on est en droit de le lui reprocher. J'avais indiqué, lorsque nous avons auditionné le sénateur Fauchon, que je proposerais au nom de mon groupe plusieurs adaptations à sa loi. « Modifier quoi et comment », a-t-il demandé. C'est donc qu'il faut la modifier, ou bien l'abroger, comme vous semblez le proposer. Il faudrait à tout le moins la compléter par cette référence à l'application stricte des réglementations. Ainsi, nous avons découvert que deux entreprises de désamiantage sur trois n'étaient pas aux normes. Que fait-on lorsqu'une de ces entreprises déclare un bâtiment exempt d'amiante, et que l'on s'aperçoit ensuite qu'il ne l'est pas ? L'entreprise n'a pas voulu tromper les gens, à ceci près qu'elle n'était pas compétente. Auquel cas elle est coupable, puisqu'elle a voulu exercer une activité sans avoir les moyens de le faire. De même ceux qui l'ont laissée s'installer et faire ce métier. Si l'on suit cette logique, il faut aller jusqu'au bout. Ajoutons à cela qu'une éventuelle modification de la loi Fauchon n'aurait aucun effet rétroactif : nous travaillons pour les cas qui se poseront à l'avenir - avec toujours trente ou quarante ans de décalage. Mes amis ont voté en faveur du programme REACH en disant que c'était un progrès par rapport à ce qui existait auparavant. Certes, mais on en a dit autant à propos de l'amiante tout au long du XXème siècle... Et si l'on aperçoit demain que, parmi les dizaines de produits concernés, l'un deux est encore pire que l'amiante, que fera-t-on ? Nous travaillons donc pour l'avenir et non pour analyser le passé - vous-même avez dit que les réglementations ont évolué en fonction des connaissances. C'est vrai, même si l'on peut s'interroger sur le CPA et sur la façon dont les uns et les autres ont agi au sein des diverses instances, ou - pire encore - sur les effets du chômage qui sévit depuis trente ans. Mais nous devons modifier la loi Fauchon dans la mesure où nous pouvons, dans les années qui viennent, nous retrouver face à des produits peut-être plus dangereux encore. Si nous ne le faisons pas, compte tenu de tous les arguments entendus à propos de REACH - « on va tuer l'industrie européenne, l'industrie chimique, notre compétitivité dans un contexte de mondialisation, etc. » -, nous irons vers des difficultés encore plus importantes. Ce hiatus entre la réglementation et la réalité de son application se retrouve également au niveau de la médecine du travail. Vous avez évoqué le statut des médecins du travail et insisté sur le fait que la santé au travail doit être partie intégrante de la santé publique : or les conséquences du non-respect des normes de santé au travail, c'est après qu'on les paie, à l'extérieur de l'entreprise. Notre inspection du travail, elle non plus, n'est pas aux normes : il faudrait au moins deux fois plus d'inspecteurs. Au total, je partage une grande part de ce que vous avez dit. Mais comment faire pour tirer les leçons du passé et éviter qu'il ne se répète ? Nous ne les tirerons pas, me semble-t-il, en laissant la loi Fauchon en l'état. Mme Catherine GÉNISSON : Vous avez bien mis en évidence la distorsion entre la réglementation et son application, et surtout appelé à faire preuve de modestie et d'intelligence en appréciant les sujets à la lumière des circonstances et des connaissances de l'époque. La meilleure solution serait sans doute d'abroger la loi Fauchon : nous devrions tous réagir en fonction du risque identifié et, dès lors qu'il l'est, de la norme prescrite. Toute la difficulté est précisément de l'identifier, à plus forte raison s'il est à venir. Vous avez à juste titre rappelé qu'il fallait compter en moyenne trente-huit ans entre l'exposition aux fibres d'amiante, à des doses parfois infime, et l'apparition d'un mésothéliome dont le patient meurt en quelques semaines. Sans doute est-ce là pour nous le sujet le plus difficile. M. Gérard BAPT : J'ai été très frappé de vous entendre dire que les administrations ignoraient tout des agissements du CPA, que l'on nous avait jusqu'à présent décrit comme un organisme particulièrement influent, pratiquement le porteur du péché originel... Certains chercheurs nous ont du reste expliqué que la mise en place du CPA pouvait expliquer le faible nombre d'enquêtes scientifiques et épidémiologiques sur l'amiante. Il serait intéressant de recouper vos propos... Nous avons beaucoup parlé du programme REACH lorsque nous nous sommes rendus à Bruxelles. J'ai également été frappé par l'audition d'une chercheuse de l'INSERM, effarée par ce qu'elle appelle une épidémie de cancers liés, semble-t-il, à la chimie et à ses effets sur le milieu de travail comme sur l'environnement. Daniel Paul aurait pu citer le cas des éthers de glycols, interdits à l'usage domestique et toujours autorisés à l'usage industriel... On sait ce que valent les recommandations et les précautions d'usage lorsqu'on entend des responsables syndicaux expliquer que, dans telle mairie, l'entreprise de désamiantage était correctement équipée, mais que les femmes de ménage passaient la serpillière derrière sans même porter un masque ! Le problème de la substitution, dans le cas particulier des éthers de glycol, ne doit pas être plus difficile à résoudre que dans celui de l'amiante, encore indispensable dans certains pays, nous a-t-on dit, pour fabriquer certains filtres très spécifiques dans l'industrie nucléaire. Si nous ne voulons pas que ce drame se reproduise, n'est-il pas de la responsabilité de notre mission de poser le problème, peut-être caricatural, de ces solvants si souvent utilisés dans nombre de produits et de peintures ? M. Patrick ROY : Je veux d'abord remercier Mme la ministre pour la qualité de cette audition qui nous a apporté un éclairage nouveau sur nombre de points, tout en montrant la difficulté et la complexité du sujet. Je me garderai bien de polémiquer sur l'histoire de l'amiante, sur le moment où l'on a su, où l'on a compris la gravité, etc. En janvier 2006 en tout cas, les risques d'une exposition sont parfaitement connus et les maladies bien identifiées, certaines handicapantes, d'autres carrément mortelles. Or des industriels français, parfaitement au fait des dangers de l'amiante, ne l'utilisent ou ne l'exploitent plus en France, mais n'hésitent pas à le faire ailleurs, dans des pays moins vigilants. Autrement dit, ils exportent la mort en toute connaissance de cause. Pouvez-vous le confirmer ? Si tel est le cas, que nous suggérez-vous pour y mettre un terme ? La vie d'un citoyen du monde, quel qu'il soit, est tout aussi importante que la vie d'un Français. Mme Martine AUBRY : Rappelons que la directive européenne interdisant l'amiante ne date que de 1999 et n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2005... On ne peut pas parler d'un abîme entre l'Europe et le reste du monde. Encore n'est-elle même pas appliquée partout en Europe, compte tenu de la difficulté à trouver des entreprises capables de désamianter sans risque pour les autres salariés. Croire que le CPA était le lieu de toutes les entourloupes serait une erreur profonde - je le dis d'autant plus librement que, si tel avait été le cas, il nous serait facile de nous dégager collectivement de toute responsabilité dans cette affaire et de ne rien changer au système. Comme je l'ai déjà dit, j'ai travaillé à la direction des relations du travail de 1975 à 1987, j'ai moi-même été DRT entre 1984 et 1987 et je n'ai jamais entendu parler du CPA. Tous les fonctionnaires du ministère participent à de nombreux groupes organisés qui par tel syndicat, qui par telle fédération, etc. : à aucun moment on n'a fait référence au CPA à propos de l'amiante. Il est facile de parler de complot, comme le font certains journalistes mais cela supposerait que des fonctionnaires comme M. Pasquier en aient été complices, alors que - je peux en témoigner pour l'avoir vécu - il est la rigueur personnifiée ! Tout ce groupe d'ingénieurs n'avait qu'un objectif : améliorer les conditions de travail. Imaginer qu'ils aient pu un seul instant se faire « acheter » intellectuellement par des employeurs, c'est vraiment chercher le scandale pour le scandale. J'aurais, du reste, beau jeu, si tel était le cas, de me défausser en tant que directeur en disant que je n'avais rien vu parce que des fonctionnaires m'avaient tout caché. Cela n'a rigoureusement aucun sens. J'entends aujourd'hui des chercheurs taper sur ces pauvres Bignon et Brochard que je connais très bien : ils n'étaient pas beaucoup à travailler sur l'amiante à l'époque ! Les autres préféraient travailler sur des sujets à la mode... Il leur est facile aujourd'hui, quand on sait ce que l'on sait, de dire que leurs collègues se sont fait abuser ! Le malheureux professeur Brochard en vient à se poser toutes sortes de questions. Le professeur Bignon avait eu le courage d'écrire à Raymond Barre pour lui demander d'agir. Je trouve honteux d'accuser des gens qui ont consacré leur vie à un sujet qui n'était pas d'actualité de s'être fait manipuler par les entreprises. Qui, parmi ceux que l'on entend parler si haut maintenant, travaillait sur ces questions si difficiles à l'époque ? Assez de cette médiatisation ! Ce qui est malheureusement beaucoup plus grave, c'est que l'on a toujours considéré que la santé au travail n'était pas aussi importante que la santé publique, qu'il y avait une sorte de fatalité à tomber malade ou à subir un accident au travail. Non, il n'y a pas de fatalité ! Il faut y mettre en place les mêmes moyens qu'ailleurs, et une organisation publique capable, sitôt que l'on soupçonne un risque, de faire remonter l'information et de commander des études. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Nous ne savions pas, au ministère du travail, ce qui remontait du côté de la santé, si ce n'est très tardivement. Lorsque j'étais ministre, en 1997, j'ai lu un article anglais sur les éthers de glycol. J'en ai aussitôt parlé à Bernard Kouchner et organisé une réunion de consensus avec des spécialistes. Ils m'ont assuré que, mis à part sur le fœtus et les femmes enceintes, les éthers de glycol, tels qu'ils étaient utilisés, ne présentaient aucun risque. Un ministre ou un DRT ne connaît rien aux éthers de glycol ; il doit seulement se tenir informé et, en cas de doute, poser des questions à ceux qui savent. Et quand ceux qui savent - les vrais, s'entend, pas le journaliste qui a en aura parlé avec quelqu'un dans la rue ! - vous assurent qu'il n'y a pas de risque avec ces produits et que tout ce qui pourrait les remplacer serait pire, vous dites : « très bien... » La seule question que je me suis toujours posée est de savoir si nous savions réellement tout, si nous disposons de toutes les études et les recherches. Lorsqu'on est au ministère du travail, on n'en sait rien et le seul moyen de le savoir est de disposer d'un vrai système de prévention des risques professionnels, un lieu où toutes les informations remontent à chaque fois que survient un accident ou une maladie reconnue. Sitôt que quelques cas sont repérés, on commande une étude en toute indépendance... M. le Président : Un lieu d'autorité. Mme Martine AUBRY : Un lieu d'autorité et de rassemblement des connaissances. Pour l'heure, tout est éclaté. Il ne faudrait pas que l'autorisation de mise sur le marché - ou l'interdiction - soit donnée par le seul ministère de l'économie et des finances. M. le Président : Nous n'en avions pas encore parlé... Mme Martine AUBRY : Cela doit-il être le Premier ministre, le ministre de la santé, le ministre du travail ? Je n'en sais rien. Je ne veux pas dire que le ministre de l'économie soit sous influence ; je dis simplement qu'il n'est pas dans le sujet en permanence. Il est regrettable que des ministres chargés de la santé et du travail n'aient pas la responsabilité de donner les autorisations de mise sur le marché. Nous l'avons désormais décidé au niveau européen pour les médicaments ; il faudrait faire de même pour le reste. En arrivant du ministère du travail, j'ai travaillé sur la loi de 1976 relative à la responsabilité du chef d'entreprise. Nous ne trouvions pas normal qu'un salarié victime d'un accident du travail ne soit pas indemnisé de la même façon qu'un salarié victime d'un accident de la route en se rendant au travail. De la même façon, si vous abîmez l'œil de votre voisin en lui donnant un coup de poing dans l'escalier, vous pouvez être poursuivi au pénal. Si le même accident survient dans l'entreprise, alors qu'il y a eu faute, c'est impossible ! La loi de 1976 a introduit de ce point de vue une avancée considérable. Elle impose très clairement d'indiquer qui est responsable et le chef d'entreprise est tenu de le désigner - à un niveau suffisant : ce doit être un cadre. On sait alors qui l'on peut poursuivre. Mais dans l'administration ou dans les collectivités locales, les fonctionnaires n'existent pas sur le plan pénal. Si bien que dès qu'il y a un problème, le responsable est le maire. D'où la loi Fauchon. Il peut y avoir deux types d'accidents : l'accident lié à un concours de circonstances - sans faute particulière -, qui n'en nécessite pas moins réparation, et l'accident découlant d'une faute - où quelqu'un n'a pas fait son travail - ce qui nous ramène à la question : chacun, à la place qu'il occupe, a-t-il rempli le rôle qui était le sien ? Cette déclinaison n'existant pas, hormis dans le cas d'une faute individuelle et volontaire, tout remonte au maire. J'ai connu dans ma ville l'exemple d'un enfant qui s'était cassé la jambe en tombant d'un talus planté de buissons et d'arbres : personne n'avait à monter là-haut. Nous nous sommes toutefois demandé s'il ne fallait pas songer à installer des grilles, même s'il n'y a pas d'obligation. Mais pouvons-nous être responsables ? Oui, répondra probablement le juge. Je ne trouve pas anormal d'indemniser cet enfant, mais comment pourrions-nous être poursuivis pénalement ? La loi Fauchon n'a pas vraiment changé l'attitude des juges vis-à-vis des politiques. Il vaudrait mieux donner des directives générales aux juges : rechercher le responsable, se demander si l'on a fait tout ce qu'il fallait faire. C'est ce que je dis en permanence à mes agents : « je ne vous demande pas de faire plus, mais de faire bien votre travail, dans l'esprit et dans la lettre, de poser les bonnes questions en allant au-delà de ce qui est dans la loi et les règlements ». Sinon, on tombe dans le juridisme : on est meilleur lorsqu'on applique la loi, mais aussi lorsqu'on réfléchit sur sa mission. Si l'on dit à chaque fois aux gens qu'ils sont responsables, ils se retrancheront derrière le droit en disant : « voilà ce qu'il faut que je fasse, et rien d'autre. » M. le Président : Madame la ministre, vous nous avez apporté des explications très précises et des analyses très intéressantes sur des points que nous n'avions pas eu l'occasion d'aborder sous cet angle. Nous vous remercions pour cette audition, que vous aviez vous-même souhaitée. Audition de M. Pascal CLÉMENT, Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui M. le Garde des Sceaux dans cette salle de la commission des lois qui est un peu la sienne et où souffle l'esprit des lois... Nous achevons donc les travaux de cette mission par l'audition des ministres concernés. Nous avons adopté à l'unanimité un programme de travail qui nous a amenés à mettre en avant un certain nombre de problèmes clés relatifs en particulier au traitement de l'amiante en place, à la prévention des risques professionnels et aux questions juridiques, notamment pénales, liées aux responsabilités dans le domaine de l'amiante et, plus globalement, de la santé au travail. Le lien contentieux entre le responsable présumé du dommage et les victimes est, en effet, un sujet qui suscite une émotion forte, des demandes d'indemnités, des actions au pénal et dont je dirai qu'il relève presque de la catharsis. Dans ma circonscription, proche de Dunkerque, j'ai rencontré des veuves et je sais que vous-même avez reçu à plusieurs reprises des délégations, notamment pour évoquer les moyens de procédure qui ont empêché de traiter les problèmes au fond. Comme nous l'a dit l'avocat général de la Cour de cassation, on fait une confusion au sujet de l'arrêt du 15 novembre de la chambre criminelle. Je cite ses propos : « De manière inconsciente, on a pu être amené à se dire que, puisque les victimes allaient être indemnisées ou étaient susceptibles de l'être, elles n'avaient plus rien à faire dans un procès pénal. C'est ne pas tenir compte du découplement de la faute pénale et de la faute civile. Et puis, est-ce qu'on peut dire à une personne dont l'enfant a été tué dans un accident de la circulation, que dans la mesure où la compagnie d'assurances a pris en charge le préjudice, elle n'a pas à porter plainte ? » Nous souhaitons aussi vous interroger sur la loi Fauchon, ainsi que sur le rôle des parquets et sur les pôles de santé publique qui ont été créées à Paris et à Marseille. Tous les dossiers sont-ils en train d'y être centralisés ? Disposeront-ils des moyens nécessaires face à l'ampleur de la tâche et à la complexité de dossiers dans lesquels une maladie rapidement fatale intervient parfois plus de trente ans après l'exposition qui l'a provoquée ? Mais je vous propose d'entrer sans plus tarder dans le vif du sujet car je sais que vous n'aimez pas tourner en rond comme le Clemenceau à Port-Saïd... M. Pascal CLÉMENT : Vous comprendrez que je tienne à adresser mes premiers mots aux victimes, que j'assure de toute la solidarité du Gouvernement et de sa détermination à tout mettre en œuvre au plan humain, économique et social afin de répondre efficacement à ce grave problème de santé publique. Toute notre action aura pour objectif de soulager la douleur des victimes de la contamination à l'amiante et de leurs familles. Mon cabinet et les services de la Chancellerie on reçu à plusieurs reprises les associations des victimes de l'amiante en 2005 et la direction des affaires criminelles organisera d'autres réunions de travail avec elles en 2006 afin de prendre en compte leurs attentes dans le traitement général de ces dossiers. Je connais aussi l'attachement que le Parlement porte à ces questions. J'ai eu l'occasion de m'exprimer fin juin 2005 devant la commission du Sénat et je suis heureux de me trouver aujourd'hui devant la vôtre. Je résumerai de la façon suivante la problématique judiciaire essentielle de l'amiante : les pouvoirs publics ont créé un système d'indemnisation qui repose à la fois sur la création d'un fonds d'indemnisation et sur la reconnaissance d'une responsabilité civile, administrative et pénale. Ce dispositif est certes respectueux de notre tradition juridique mais il est complexe et il peut nuire à l'objectif recherché de mieux indemniser les victimes. C'est pourquoi, il convient de présenter les améliorations qui peuvent être apportées à l'indemnisation civile sans négliger la spécificité de la responsabilité pénale. En matière civile, je sais que les victimes de l'amiante sont en attente de réponses immédiates. Je veux en premier lieu revenir sur la question des écarts qui peuvent intervenir entre les indemnisations allouées par les juridictions. Ce faisant, j'exclus volontairement les différences d'appréciation entre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et les juridictions. En effet, le fonds est un établissement public, qui peut à ce titre définir un barème, ce qui n'est pas envisageable pour les juridictions. Le principe même de la réparation intégrale s'oppose à ce que le juge puisse se trouver dans l'obligation de limiter son indemnisation en fonction d'un barème. En revanche, je suis très attaché à ce que les magistrats bénéficient d'une aide à la décision par la diffusion d'un référentiel des indemnisations versées par l'ensemble des tribunaux, à situation égale. En clair, il ne s'agit pas d'un barème, mais d'un tableau de ce qu'allouent les juridictions dans des cas d'espèce comparables. La Chancellerie finalise un tel projet, qui devrait par lui-même conduire à une harmonisation des décisions rendues. Cette harmonisation sera d'autant plus aboutie que les magistrats et les assureurs emploieront un vocabulaire commun : qu'entend-on par préjudice d'agrément ou par préjudice d'établissement ? Il conviendrait que les définitions soient identiques. Les magistrats, mais pas seulement eux, gagneront à avoir une liste indicative des chefs de préjudice, une grille de lecture commune leur permettant de fonder leur raisonnement sans entraver leur liberté d'appréciation. Jean-Pierre Dintilhac, président de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, m'a remis au mois d'octobre dernier un rapport à cette fin. Il contient une nomenclature des chefs de préjudice à la fois plus claire et plus complète que celle qui est utilisée actuellement. Elle est désormais en ligne sur le site du ministère de la justice. Elle appelle au préalable une réforme législative pour mieux définir la nature des préjudices pour lesquels les caisses de sécurité sociale peuvent demander le remboursement des frais qu'elles ont avancés à la victime. Je m'emploie à faire examiner cette réforme dans des délais que je souhaite brefs. Sur la question de la centralisation dans une cour d'appel unique des recours introduits à l'encontre des décisions du FIVA, les positions ne sont pas tranchées. C'est ce que suggère la Cour des comptes, mais après mûre réflexion, il ne me semble pas que cette piste puisse être retenue. Elle va en effet à l'encontre de l'objectif de proximité des juridictions, objectif qui mérite d'être maintenu, les victimes pouvant être confrontées à des difficultés de déplacement. Certains souhaitent financer une partie des indemnisations du FIVA par des recours subrogatoires contre les employeurs. Je crains que le développement des actions récursoires n'aboutisse en définitive qu'à un jeu d'écritures complexe. D'abord parce que la philosophie de notre système de sécurité sociale, vous le savez mieux que quiconque, M. le Président, est la mutualisation du risque d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Ensuite parce que les entreprises fautives ont souvent disparu au moment de l'indemnisation des victimes. Je veux aussi souligner l'apport des hautes juridictions judiciaires et administratives dans ce dossier et rappeler l'avancée majeure qui a résulté des arrêts du 28 février 2002, qui ont consacré l'obligation de sécurité de résultat pesant sur les employeurs. Pour leur part, les arrêts du 3 mars 2004 du Conseil d'État ont reconnu la responsabilité de l'État du fait de sa carence fautive à prendre les mesures de prévention adéquates. Ces deux jurisprudences nous rappellent les responsabilités de chacun à l'égard du risque inhérent au monde du travail et au développement des technologies et des savoirs qui s'y rapportent. Au-delà de la question de l'indemnisation civile, se pose bien sûr la question des enquêtes pénales en cours et, sur ce point, il faut rappeler en premier lieu qu'il appartient évidemment aux juridictions saisies de se prononcer souverainement en fonction des cas d'espèce. Les plaintes déposées devant les juridictions pénales sont toutes examinées par les parquets, même s'il est exact que peu de procédures pénales du fait de l'exposition durable à l'amiante ont abouti à des condamnations. La durée des informations judiciaires et l'absence de condamnations s'expliquent en partie par les difficultés propres aux dossiers liés à l'amiante qui tiennent à plusieurs éléments : l'ancienneté des faits, l'ampleur des investigations policières La justice n'est cependant pas inactive sur ce dossier. Actuellement, 47 procédures, dont 25 informations judiciaires, sont en cours et portent principalement sur des expositions longues à l'amiante dans le cadre du travail. En décembre 2005, trois citations directes ont été délivrées par le procureur de Paris sur des faits de violation de la réglementation en matière de désamiantage. Les juridictions de jugement ont quant à elles prononcé sept condamnations définitives relatives à des poursuites des chefs de mise en danger de la vie d'autrui et de violation des règles de désamiantage. Le problème principal concerne évidement les procédures portant sur l'exposition longue à l'amiante. Les actions doivent alors être menées dans le cadre général de la responsabilité pénale non intentionnelle. La loi Fauchon du 10 juillet 2000 est exigeante en matière de preuve mais n'exclut évidemment pas l'engagement de la responsabilité. Je rappelle qu'elle a été adoptée à l'unanimité par le Parlement. Elle a modifié l'article 121-3 du code pénal afin de limiter la pénalisation excessive des faits causant un préjudice à autrui dans le cadre des infractions non intentionnelles. Le texte actuel est équilibré. Il réprime les infractions d'imprudence, ce qui est indispensable pour responsabiliser les acteurs sociaux, tout en évitant les condamnations excessives et inéquitables. Il exige ainsi une faute plus grave qu'une simple faute civile d'imprudence lorsque le comportement non intentionnel d'une personne a entraîné indirectement une contamination à l'amiante. La distinction entre causalité indirecte et directe constitue l'essence même de la réforme. La décision rendue par le tribunal correctionnel de Bonneville le 27 juillet 2005 dans l'affaire du tunnel du Mont Blanc est à cet égard exemplaire. Elle a conduit à la condamnation de dix personnes physiques, dont deux étaient des responsables directs et huit des responsables indirects de ce drame. La loi permet donc de sanctionner des décideurs et pas seulement des collaborateurs d'exécution. J'ai moi-même interrogé le président du tribunal de Bonneville à propos de la loi Fauchon, qui est beaucoup plus compliquée qu'elle n'en a l'air, et je lui ai demandé comment il avait fait condamner le maire de Chamonix car je ne voyais pas où était sa responsabilité. Il m'a expliqué qu'en fait Michel Charvet avait, au sein de son conseil municipal, un conseiller d'État qui, mû sans doute par un réflexe pédagogique, lui avait demandé de saisir le préfet pour s'assurer que tous les critères de sécurité étaient bien réunis. Le maire l'avait écouté courtoisement, mais il n'avait rien fait. Or cela figurait dans les procès-verbaux du conseil municipal, et c'est sur cette base qu'il a été condamné car il avait été prévenu qu'il devait avertir l'autorité compétente. C'est cela la loi Fauchon. Vous le savez, l'article 121-3 prévoit deux cas d'engagement de la responsabilité pénale si la négligence n'est pas directement à l'origine du dommage : la « violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité » et la « faute caractérisée qui expose aussi à un risque grave qu'on ne peut ignorer ». Certains d'entre vous s'interrogent sur les risques de confusion entre ces deux notions. Je reconnais qu'elles sont complexes, mais il est nécessaire de conserver ces deux cas d'ouverture de la responsabilité pénale. Si le droit ne prévoit pas d'obligation particulière de sécurité, il faut pouvoir condamner celui qui savait qu'il exposait des individus au risque de l'amiante. Inversement, si la personne négligente n'était pas consciente du risque, il faut une obligation particulière de sécurité pour engager sa responsabilité. Les deux dispositifs sont donc complémentaires et c'est leur articulation qui permet de prévoir toutes les possibilités permettant de protéger les victimes. Simplement la mise en œuvre de ces dispositions dépend toujours des circonstances de l'espèce. L'arrêt rendu le 15 novembre 2005 par la Cour de cassation, était très attendu par le monde judiciaire et par les victimes. Les associations de victimes ont évidemment fortement décrié cette décision dans un communiqué de presse, mais quelles en sont les conséquences réelles ? Tout d'abord, ce n'est pas une décision de principe sur la responsabilité pénale des chefs d'entreprise ou des décideurs publics en cas de causalité indirecte entre la faute et le dommage. Les procédures judiciaires en cours ne s'en trouveront donc pas fragilisées et la recherche de responsabilités pénales éventuelles reste bien évidemment pertinente. Dans cette affaire, la chambre criminelle a déclaré irrecevable le pourvoi au motif que les demandeurs ne justifient d'aucun des griefs mentionnés à l'article 575 du code de procédure pénale. On sait que l'article 575 limite la possibilité de pourvoi d'une partie civile contre une décision de la chambre de l'instruction. C'est un point important car les victimes souhaitent que le Gouvernement accepte de modifier l'article 575. Ma réponse est donc oui, le ministère de la justice en examine la possibilité. Mais il s'agit d'une question délicate, car il faut éviter les pourvois abusifs ou totalement injustifiés. N'oublions pas que la plupart des non-lieux sont justifiés par des éléments de fait sur lesquels la Cour de cassation, qui n'est pas une deuxième cour d'appel, ne peut ni ne doit exercer son contrôle. Cela risquerait, en effet, à la fois de paralyser le fonctionnement de la cour et de donner de faux espoirs aux victimes. En tout état de cause, un durcissement éventuel de l'article 121-3 ne pourrait pas s'appliquer rétroactivement aux procédures relatives à l'amiante antérieures à l'entrée en vigueur du nouveau texte. Pour l'ensemble de ces raisons, je n'envisage pas pour le moment de modifier la loi Fauchon. Je crois que ceux qui demandent une réforme n'ont pas vu toutes les conséquences d'une loi dont l'application est très compliquée, mais que les tribunaux appliquent, je crois, fort bien. Soyez assurés que je m'engage à ce que toutes ces procédures puissent être menées à leur terme dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne les délais. Afin de parvenir à un traitement plus rapide et plus efficace, il a été décidé en 2005 de procéder au regroupement des procédures au sein des pôles santé créés dans les TGI de Paris et de Marseille. Cette mesure me paraît contribuer à la rapidité des procédures, tout en permettant un traitement efficace par des magistrats spécialisés. La souplesse est ici l'élément le plus important. À titre d'illustration, je vous indique que j'ai souhaité l'ouverture de trois nouvelles informations judiciaires, le 12 décembre dernier, par le procureur de la République de Paris, dans des affaires très importantes d'exposition à l'amiante dans la région de Dunkerque. Celui-ci a décidé de tenir une réunion trimestrielle avec les associations des victimes de l'amiante pour suivre régulièrement l'évolution de ces dossiers. Les besoins matériels et humains nécessaires à la mise en place des deux pôles ont été évalués dès 2003. Des postes ont été créés et pourvus. Actuellement le pôle de Paris dispose de quatre magistrats instructeurs, de six magistrats du parquet, et de quatre assistants. Je viens d'être saisi par le parquet de Paris d'une demande de renfort, que j'ai demandé à mes services d'étudier avec une particulière attention. Toutefois, en raison du regroupement des dossiers résultant de la circulaire précitée, les magistrats du pôle de santé publique de Paris connaissent un accroissement important de leur charge de travail puisqu'ils suivent 41 dossiers à ce jour, au lieu de 7 jusqu'en juin 2005. Les victimes ont rappelé la faiblesse des effectifs d'enquêteurs dédiés aux dossiers d'amiante, en particulier des services d'enquêtes et le cabinet du ministre d'État, de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a été sensibilisé à cette question, qui relève de lui. Je suis évidemment favorable au renforcement du nombre d'enquêteurs supplémentaires et à la création d'une cellule d'enquête dédiée spécifiquement aux procédures liées à l'amiante. Comme vous le voyez, la question de la réparation pénale et de l'indemnisation des victimes de l'amiante est complexe. Elle fait l'objet d'un traitement spécifique par l'autorité judiciaire. J'attache un grand intérêt à ce que ce traitement ne souffre aucun retard. Telles sont les observations générales que je tenais à formuler devant vous. M. le Président : Je vous remercie pour cette intervention d'une grande précision, qui a répondu à l'essentiel des questions que notre mission se posait. Je ne reviens pas sur l'augmentation des moyens des pôles de santé publique, vous vous êtes engagé. Par ailleurs, prévoir un contact régulier avec les associations de victimes est également une bonne initiative. Vous avez dit également que vous réfléchissiez à une éventuelle modification de l'article 575. Nous aussi et nous aurons donc des propositions à vous faire. Sans entrer dans une réflexion en cours, il ne paraîtrait pas inutile que vous nous donniez dès aujourd'hui une idée de ce vers quoi vous vous orientez. M. Pascal CLÉMENT : Actuellement, pour que le pourvoi d'une partie civile soit recevable, il faut que le parquet s'y joigne. Tel n'a pas été le cas, en l'espèce, et c'est pourquoi la Cour de cassation a déclaré l'irrecevabilité. Il paraît donc nécessaire de disjoindre le pourvoi du parquet de celui de la partie civile. L'idée serait d'ouvrir un huitième cas à l'article 575 du code de procédure pénale, où la partie civile, hors tout pourvoi du ministère public, serait autorisée à saisir la Cour de cassation. Mais le Premier Président et le procureur général de la Cour de cassation m'ont fait observer que le formalisme devant la Cour était bien plus fort qu'ailleurs et qu'il ne paraissait pas souhaitable, tout simplement parce qu'il serait presque systématiquement rejeté, qu'un recours soit formé devant la juridiction sans le secours d'un avocat. Il me semble donc que nous devrions nous orienter vers un recours de la partie civile avec l'intervention d'un avocat, certes onéreuse mais susceptible d'être prise en charge par l'aide juridictionnelle. Je dois aussi veiller à ne pas encombrer la Cour de Cassation par une nouvelle réforme législative qui serait propice à des pourvois abusifs. M. le Président : D'après mes informations, une seule affaire est traitée à Marseille et toutes les autres à Paris. Pourquoi avoir créé deux pôles ? M. Pascal CLÉMENT : Je les ai trouvés en arrivant. Sont doute n'a-t-on pas voulu tout regrouper à Paris, mais cette décentralisation ne fonctionne pas. M. Jean-Marie GEVEAUX : Puisque le nombre de dossiers est appelé à croître, envisagez-vous de créer d'autres pôles de santé publique dans les régions les plus touchées ? M. Pascal CLÉMENT : Comme je viens de le dire, tout est traité à Paris. Si même à Marseille, deuxième ville de France, il n'y a pas de dossier, je ne vois pas pourquoi nous créerions d'autres pôles. Je me demande même s'il faut garder celui de Marseille, qui coûte cher. M. Daniel PAUL : Tout le monde s'accorde à dire que, dans les années qui viennent, des dizaines de milliers de personnes seront concernées. On sait, en outre - c'est toute la question du programme REACH -, qu'on va découvrir bon nombre de projets qui ont été mis sur le marché sans aucun contrôle, et qu'il va y avoir non pas une crise de l'amiante, mais des crises successives. Sur la base du comptage fait dans d'autres pays, on peut miser sur 100 000 dossiers de produits nouveaux. Dans ces conditions, je comprendrais mal qu'on se contente d'un seul pôle à Paris, alors qu'il conviendrait d'engager les moyens nécessaires pour que les plaignants aient accès à une justice de proximité. M. Pascal CLÉMENT : Mon prédécesseur avait tenu un raisonnement décentralisateur, et je n'y puis rien si tout se passe à Paris. Mais il est évident que si les affaires devaient se multiplier, ce ne sont pas quelques pôles mais un grand nombre qu'il faudrait créer. Nous allons suivre ce dossier, mais il va de soi que la justice disposera des moyens dont elle aura besoin. M. le Rapporteur : Je vous remercie pour votre exposé exhaustif et d'une grande clarté. S'agissant de la loi Fauchon, qui a fait l'objet d'un vrai débat au sein de cette mission et dont on a dit qu'elle faisait obstacle à la poursuite de l'instruction consécutive aux plaintes des victimes de l'amiante, vous avez répondu que tel n'était pas le cas. Par ailleurs, le code de procédure pénale prévoit que, dans certains cas, la partie civile peut être représentée par une association habilitée. Envisagez-vous d'ouvrir cette possibilité aux associations qui représentent des victimes de l'amiante, voire d'autres maladies professionnelles ? M. Pascal CLÉMENT : Oui, avec constitution d'avocat, comme l'a conseillé le Premier Président de la Cour de cassation, car la méthode d'analyse de la cour ne correspond en rien aux pratiques des autres juridictions, à tel point qu'un magistrat chevronné se trouve, au moment de sa nomination à la Cour de cassation, dans la situation d'un simple auditeur de justice qui a tout à apprendre. Par ailleurs, je le répète, l'ouverture des conditions du pourvoi ne doit pas conduire à inonder la cour et il faut donc trouver un verrou, dans un contexte général d'explosion du nombre de dossiers. M. le Président : Sur la loi Fauchon, vous avez été très précis. La notion de manifestation délibérée pose le problème du lien de causalité qui est difficile à établir. L'exemple du procès du tunnel du Mont Blanc est très intéressant, mais la situation de l'amiante et des maladies professionnelles est particulière car il est très difficile d'établir ce lien de causalité, notamment lorsque la période de latence entre la cause et l'apparition de la maladie est très longue. M. Pascal CLÉMENT : L'article 121-3 prévoit deux cas d'engagement de la responsabilité pénale si la négligence n'est pas directement à l'origine du dommage : la violation délibérée d'une obligation de sécurité et la faute caractérisée. Si le droit ne prévoit pas d'obligation particulière de sécurité, il faut pouvoir condamner celui qui savait qu'il exposait des individus au risque de l'amiante. On rejoint là l'affaire du sang contaminé. Inversement, dans le cas où la personne négligente n'était pas consciente des risques, il faut une obligation particulière de sécurité pour engager sa responsabilité. Ces deux dispositifs sont donc complémentaires et c'est leur articulation qui permet de prévoir toutes les possibilités pour protéger les victimes. Mais leur mise en œuvre dépend toujours des circonstances de l'espèce et on ne peut donc pas poser de règle générale, on le voit bien avec l'exemple que j'ai cité. M. le Président : Pour autant, la réflexion doit se poursuivre et les analyses sont diverses, en particulier au sein de notre mission et nous nous interrogeons notamment sur la pertinence des termes « manifestement délibérée » quand il y a eu violation d'un texte imposant une obligation de sécurité. Le référentiel que vous préparez est une initiative très intéressante, car on a constaté des écarts très importants dans l'indemnisation, en particulier pour les plaques pleurales. Pensez-vous que le référentiel permettra de rapprocher les jurisprudences ? M. Pascal CLÉMENT : C'est évident et l'on doit cette initiative à la chambre civile de la Cour de cassation. Si les magistrats ne souhaitent pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent dire, ils sont intéressés de savoir ce qui s'est dit ailleurs, et ce référentiel leur permettra de disposer des fourchettes des décisions prises dans des cas analogues. Ils auront ainsi un ordre de grandeur qu'ils pourront adapter à chaque espèce M. le Président : Je vous remercie une nouvelle fois de la précision de vos réponses, qui nous a permis d'aller vite. Audition conjointe de M. Xavier BERTRAND, ministre de la santé et des solidarités, et de M. Gérard LARCHER, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Messieurs les ministres, nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous représentez deux ministères très importants au regard du sujet qui nous occupe et vos remarques nous seront particulièrement utiles alors que nous nous acheminons vers la fin de nos travaux. Notre mission, à l'unanimité, a considéré que, l'histoire de ce drame ayant été longuement traitée dans nombre de rapports - dont celui du Sénat, le dernier en date -, nous devions, certes, nous attacher à traiter des problèmes de l'amiante, mais également élargir le sujet à des préoccupations beaucoup plus générales. Nous nous sommes penchés en premier lieu sur le dossier de l'amiante résiduel et constaté qu'il posait un problème très lourd - ce qui se passe en ce moment même autour du Clemenceau n'en est du reste pas un bon signe. Nous nous sommes très rapidement rendu compte que la question des maladies professionnelles et de leur indemnisation était au centre des préoccupations - non pas que nous sous-estimions celle des accidents du travail, mais le lien de causalité est nettement plus difficile à établir dans le cas des maladies professionnelles. Ce qui nous a naturellement amenés à nous pencher sur le problème, fondamental, de la prévention des risques professionnels et à nous interroger sur les incidences du changement de la nature du travail, de l'indépendance de l'expertise et de notre capacité à conduire des programmes d'actions. De ce point de vue, le « Plan santé au travail » mis en place par M. Larcher nous semble à la hauteur des enjeux, tout au moins dans ses objectifs. Encore faut-il que l'autorité indépendante - l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) en l'occurrence - soit à même de coordonner les recherches en la matière. Sans oublier la dimension européenne, qui se concrétisera avec le programme REACH58 : le nombre de produits visés - on parle de 30 000 - pourrait amener à envisager une spécialisation par pays. Reste évidemment le problème de l'indemnisation, qui pose celui de l'évolution de la branche « accidents du travail - maladies professionnelles » (AT-MP). Des rapports existent, des travaux ont déjà été menés, mais il faut aller plus loin : la réparation intégrale, la responsabilisation des entreprises, la coordination de tout cela, autant de questions qui sont dès à présent au centre des préoccupations des organisations syndicales et professionnelles, et sur lesquelles travaillent plusieurs commissions. Enfin, nous nous sommes intéressés à bien d'autres sujets, moins directement liés à vos domaines de compétence : le problème de la responsabilité civile et pénale de l'employeur, sur lequel nous avons entendu le Garde des Sceaux. Mais vos éventuelles remarques n'en seront pas moins les bienvenues pour éclairer notre propre réflexion. M. Xavier BERTRAND : On ne peut parler de l'amiante sans rappeler l'ampleur du drame humain qui en est résulté : on estime que 35 000 personnes sont décédées en France de pathologies liées à l'amiante entre 1965 et 1995, et entre 60 000 et 100 000 décès seraient probablement à déplorer au cours des prochaines années. Face à ce drame, le Gouvernement a entendu apporter une triple réponse, qui passe par la réparation, par la prévention de nouveaux cas et surtout par l'information des victimes potentielles. Notre premier devoir est d'assurer un système de réparation juste et équitable. La France se distingue des autres pays européens par la mise en place de trois dispositifs cumulés d'indemnisation : un mécanisme de rentes allouées au titre des maladies professionnelles, un dispositif de cessation anticipée d'activité, le FCAATA59, et la mise en place d'un fonds d'indemnisation des victimes, le FIVA60. En 1999 a été créé le FCAATA au profit des victimes de maladies professionnelles occasionnées par l'amiante, mais également au profit des salariés et anciens salariés d'usines de fabrication de matériaux contenant de l'amiante. La liste des secteurs bénéficiaires a été progressivement élargie aux établissements de flocage et de calorifugeage, de construction et de réparation navales ainsi qu'aux ports. Au 30 novembre 2005, le fonds avait accueilli près de 40 000 allocataires, dont 31 211 en bénéficient aujourd'hui. Le FIVA a quant à lui été constitué afin d'assurer la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices subis par toutes les personnes atteintes d'une affection liée à l'amiante, et dans des délais très courts, évitant aux victimes de devoir s'engager dans une procédure judiciaire longue et à l'issue parfois inégale. Fin 2005, le FIVA a présenté plus de 20 000 offres, acceptées dans 95 % des cas, et versé 925 millions d'euros d'indemnisations. Les principales interrogations concernent les règles d'accès au dispositif du FCAATA. Doit-il bénéficier aux seules victimes avérées ou à toute personne ayant été exposée ? C'est à ce titre que 80 % des allocataires y accèdent actuellement. Procédure d'accès individuel ou d'accès collectif ? Auquel cas, pour quels secteurs économiques et selon quels critères d'exposition ? Le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) propose des pistes de réflexion et de réforme, que nous sommes en train d'examiner très attentivement. Ma conviction est que le système de réparation des victimes de l'amiante doit reposer sur trois principes : non-discrimination dans l'accès, égalité dans les modalités d'indemnisation avec une réflexion plus globale sur l'indemnisation des maladies professionnelles, primauté aux victimes dans l'indemnisation dont l'efficacité doit être renforcée : pour l'heure, les deux tiers des moyens consacrés à la réparation de ce drame financent la préretraite. La prévention de ce risque est une priorité de santé publique. Le dispositif réglementaire applicable aux immeubles bâtis s'est progressivement mis en place à partir de 1996 ; courant 2005, plusieurs affaires ont rappelé la nécessité d'une extrême vigilance de la part des propriétaires, mais également de l'État qui doit s'assurer de son application effective. L'Inspection générale de l'administration, le conseil général des Ponts et Chaussées et l'IGAS ont été mandatés le 9 décembre 2005 par l'organisme de tutelle pour réaliser un bilan de l'application de la réglementation amiante à l'approche de ses dix ans et réévaluer le dispositif de contrôle au plan de l'outil juridique, de la méthodologie et des moyens. Sans préjudice des conclusions de cette mission, attendues pour avril prochain, le Gouvernement a décidé de mobiliser l'ensemble des services déconcentrés pour mener des actions ciblées de contrôle, afin de s'assurer que les propriétaires ont respecté leurs obligations Par ailleurs, plusieurs enquêtes exhaustives ont été lancées l'an dernier auprès de propriétaires de bâtiments. Le ministère de la fonction publique s'est ainsi intéressé aux bâtiments relevant de la fonction publique de l'État, le ministère de l'intérieur a sollicité les collectivités territoriales par le biais des préfets. Le ministère de la santé a quant à lui interrogé les 18 000 établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ; les résultats intermédiaires font apparaître une réelle mobilisation des directeurs d'établissement, mais notre enquête n'est qu'une première étape dans la mise en place de véritables tableaux de bord régionaux de suivi de la réglementation amiante. Nous devons aussi renforcer les campagnes de sensibilisation afin de rendre les propriétaires plus vigilants et les inciter non seulement à évaluer, mais à réévaluer les risques d'exposition en leur rappelant notamment l'étendue de leurs responsabilités. Aussi mon ministère rééditera-t-il en 2006, en liaison avec le ministère du logement, une plaquette reprenant les obligations réglementaires des propriétaires, dont nous assurerons une large diffusion. La dernière opération de ce genre remonte à 2002. Nous voulons également qu'un suivi post-professionnel soit offert à toutes les personnes qui s'interrogent sur les conséquences de leur exposition professionnelle passée. Le Sénat a adopté un amendement dans le cadre du PLFSS61 obligeant les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) à informer les personnes anciennement exposées de leur droit à un suivi médical. Nous travaillons à la rédaction du décret d'application. Chaque personne ayant côtoyé l'amiante dans sa vie et qui s'en inquiéterait pour sa santé doit pouvoir consulter gratuitement un médecin pour s'informer et éventuellement procéder à des examens ; toutefois, le contrôle médical lourd, avec scanner et radios, ne saurait être obligatoire pour des raisons éthiques - le but n'est pas de créer des angoisses inutiles chez des personnes âgées, par exemple, dont l'état de santé serait par ailleurs satisfaisant. Le rapport de synthèse de l'expérimentation conduite dans quatre régions pilotes, attendu pour juin 2006, permettra de définir la conduite de ce suivi post-professionnel. D'ores et déjà, nous proposons avec Gérard Larcher de constituer dès 2006 un socle complet d'information sur les maladies de l'amiante à destination des médecins généralistes. Sur ces trois fronts, réparation, information et prévention, il nous est demandé une action claire et lisible, dans le respect des besoins de chacun ; face à ce drame humain, nous avons toutes et tous à cœur d'agir dans l'intérêt de nos concitoyens. M. Gérard LARCHER : C'est un peu un symbole que nous soyons auditionnés ensemble : l'amiante, et plus généralement la santé au travail, sont des sujets de santé publique de premier plan qui me mobilisent tout particulièrement. J'en fais un des thèmes prépondérants de la politique du travail : avec le « Plan santé au travail », que j'ai lancé en février 2005, mon objectif est d'éviter de reproduire, avec d'autres substances chimiques, un drame comparable à celui de l'amiante. L'amiante, c'est de la souffrance et de l'inquiétude pour des dizaines ou centaines de milliers de travailleurs - je peux en témoigner dans ma région natale de Basse-Normandie. C'est enfin un sentiment d'incompréhension et d'injustice par rapport à un système qui ne les a pas protégés et par rapport à la collectivité qui aujourd'hui ne les aiderait pas suffisamment. Cette douleur, cette révolte compréhensible - et respectable - s'exprime lors de manifestations, mais parfois plus silencieusement dans le vécu de certaines régions industrielles. Cette catastrophe sanitaire a conduit à mettre en place un dispositif public de réparation, de prévention vis-à-vis de l'amiante résiduel et de précaution vis-à-vis de toute nouvelle entrée d'amiante dans notre pays. Quarante pays ont d'ores et déjà interdit son utilisation et la France a proposé son interdiction générale à l'occasion de l'assemblée générale de l'Organisation internationale du travail (OIT). Mais le triple dispositif public français est unique en Europe, globalement performant mais coûteux, à la hauteur des conséquences sanitaires de l'amiante. Je reviendrai, si vous le voulez bien, lors du débat qui va suivre sur ses lacunes et voies d'améliorations possibles, mais je veux d'ores et déjà insister sur les leçons que je tire de ce drame et l'élargir à l'ensemble du champ de la santé au travail. Les arrêts « amiante » du Conseil d'État de mars 2004, qui reconnaissent la responsabilité de l'État, ont remis en cause la philosophie d'un système de prévention de la santé au travail conçu au lendemain de la guerre, laquelle plaçait le chef d'entreprise comme responsable de la santé de ses employés, les partenaires sociaux comme responsables de l'édiction des règles opérationnelles au niveau des CHSCT62 ou de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), et l'État comme concepteur du socle commun de règles d'hygiène et de sécurité, applicable à toutes les entreprises. Ce que réfute le Conseil d'État : pour lui, l'État aurait dû avant 1977 se doter de moyens d'expertise pour évaluer le risque amiante et après 1977 de moyens de contrôle pour s'assurer de la bonne mise en œuvre de la réglementation qu'il édictait. Or en mars 2004, l'État ne disposait d'aucune agence publique d'expertise et de seulement quelques centaines d'agents en équivalent temps plein pour contrôler la santé au travail dans les deux millions d'entreprises françaises. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé dès mon arrivée la préparation d'un plan d'actions sur cinq ans, adopté en conseil des ministres. Première leçon à tirer du drame de l'amiante : l'État doit disposer d'une expertise publique forte et indépendante pour évaluer scientifiquement et rigoureusement les risques et organiser la veille scientifique. Deux principes fondamentaux ont été mis en lumière : la nécessité de l'indépendance de l'expertise et la séparation des phases d'évaluation scientifique, de concertation sociale et de décision. Sur la base de ces principes, le « Plan santé au travail » propose de créer une agence publique de sécurité sanitaire dans le champ de l'expertise et de l'évaluation des risques professionnels, la gestion de ces risques demeurant de la compétence des ministres, et de repositionner le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels sur le champ de la concertation sociale. L'AFSSET, créée par ordonnance le 1er septembre dernier, fournira à l'État les études et expertises qui lui permettront d'asseoir scientifiquement la gestion des risques dont il a la responsabilité. Elle aura mission d'organiser un réseau d'évaluation des risques sanitaires en milieu professionnel avec les établissements publics et organismes privés intervenant dans ce domaine. L'AFSSET se penchera prioritairement sur les produits les plus potentiellement nocifs - et notamment les produits cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction - pour évaluer leurs risques, proposer des valeurs limites, rechercher des solutions de substitution. Avant même que la nouvelle agence ne soit créée, j'ai d'ailleurs passé des conventions, dès l'été 2005, avec l'AFSSE63, l'Institut de veille sanitaire (IVS) et l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) pour conduire des expertises sur les éthers de glycol, les fibres céramiques réfractaires, le formaldéhyde, la substitution des produits cancérogènes ou encore sur les nanomatériaux Je compte aussi sur l'AFSSET pour préparer la mise en œuvre du programme européen REACH. Pour ce faire, dans le réseau qu'elle coordonnera, l'Agence pourra s'appuyer notamment sur les compétences du Bureau d'évaluation des risques chimiques, qui vient d'être formé par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) et l'INRS. Nous devons également faire progresser la recherche. Aussi avons-nous, avec les ministres de la recherche successifs, mobilisé la communauté scientifique sur la santé au travail avec un programme de recherche et un appel à projets spécifiques. Nous prévoyons par ailleurs de structurer la recherche avec des pôles scientifiques pluridisciplinaires. Deuxième leçon à tirer du drame de l'amiante : l'État doit se montrer beaucoup plus interventionniste dès lors que les experts ont tiré la sonnette d'alarme, faire évoluer la réglementation en fonction des connaissances et mener des campagnes de contrôle pour s'assurer de son respect dans les entreprises. Ainsi, le lendemain du classement du formaldéhyde en cancérogène avéré par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en juin 2004, les ministères du travail et de la santé ont constitué les dossiers nécessaires au classement de cette substance au niveau européen. Des expertises ont été demandées à l'AFSSET et à l'IVS, une concertation interministérielle et avec les professionnels a été conduite. En ce qui concerne les fibres céramiques réfractaires, qui ont été utilisées en substitution à l'amiante et ont été classées cancérogènes probables au niveau européen, un décret est en préparation qui devrait instituer une valeur limite contraignante. Édicter de nouvelles réglementations, c'est bien, parfois difficile, compte tenu des enjeux économiques et de l'état souvent lacunaire des connaissances disponibles, mais ce n'est pas suffisant. Il est absolument nécessaire, pour la crédibilité du dispositif, que la réglementation existante soit respectée. Or sur ce point, on ne peut pas dire que nous ayons éprouvé une totale satisfaction... Deux tiers des chantiers de désamiantage contrôlés sont en infraction. Certains présentent des manquements graves à l'obligation de sécurité de l'employeur envers ses salariés. Je l'ai dit publiquement le 16 novembre dernier : face à un risque connu, identifié, quantifié comme l'amiante résiduel, ne pas respecter les règles et procédés qui permettent de protéger les travailleurs est totalement irresponsable, voire criminel. J'en ai donc appelé à la responsabilité des entreprises concernées pour qu'elles respectent la réglementation sur le désamiantage et la protection des travailleurs exposés dans le cadre de ces travaux. Un nouveau décret sur la protection des travailleurs exposés à l'amiante est en préparation. Il renforcera les obligations des maîtres d'ouvrage, les obligations des entreprises en matière de formation des travailleurs, les règles relatives à la qualification des entreprises de désamiantage. Enfin, les contrôles seront renforcés : 74 avaient été effectués en 2004, 780 en 2005 et nous ferons encore mieux cette année. J'ai inscrit dans les actions prioritaires nationales de la politique du travail l'organisation de campagnes de contrôle des chantiers de désamiantage et des instructions très fermes ont été données aux préfets et aux services d'inspection. D'autres campagnes de ce type seront organisées, notamment sur les substances chimiques les plus préoccupantes. L'inspection du travail s'investit déjà beaucoup sur le champ de la santé au travail. Mais une présence accrue est à mes yeux une des conditions nécessaires à l'amélioration des conditions de travail et à la réduction des risques professionnels. C'est dans cet esprit que j'ai souhaité réaffirmer le caractère généraliste de notre inspection, mais aussi renforcer les compétences des agents de terrain dans leurs missions par un appui scientifique et technique. Aujourd'hui, quatorze régions sont dotées d'une cellule d'appui scientifique et technique. Mon objectif est de couvrir toutes les régions l'année prochaine. Mais malgré les efforts budgétaires importants obtenus pour 2006 - 230 postes ouverts au concours à l'Institut national du travail et de la formation professionnelle -, les moyens de notre inspection demeurent au-dessous de la moyenne européenne et restent insuffisants au regard de l'ampleur de ses missions. Il faut redonner toute sa place au contrôle sur le terrain, cœur du métier de l'inspection du travail et du socle de l'ordre public social, et donc accroître les effectifs de contrôle. Leur augmentation est programmée jusqu'à la fin de l'année 2009, l'objectif étant de rejoindre le niveau européen en 2010. Troisième leçon à tirer du drame de l'amiante : malgré l'investissement plus fort de l'État dans le champ de la santé au travail, le chef d'entreprise reste aujourd'hui plus qu'hier responsable de la santé de ses employés. Au-delà du strict respect de la réglementation, les entreprises doivent prendre conscience des enjeux de la santé au travail et agir en conséquence. Il y va même de leur intérêt. La bonne santé des travailleurs est en effet un facteur de performance pour l'entreprise. Plusieurs études récentes l'ont confirmé : l'investissement dans la prévention permet d'éviter des coûts directs, indirects et stratégiques, dont le total est bien supérieur à la dépense de prévention, le rapport étant estimé de 1 à 5 au minimum. Le corollaire, c'est l'accompagnement des entreprises. De manière complémentaire aux contrôles, les services de l'État devront s'attacher à développer l'action de conseil sur le terrain pour répandre la logique de prévention, sensibiliser les employeurs, les aider à réaliser leur document unique d'évaluation des risques, particulièrement dans les petites et moyennes entreprises. C'est un investissement nécessaire, tout à la fois au jour le jour et dans la durée. Les employeurs demeurent trop souvent mal informés ou, lorsqu'ils le sont, insuffisamment conscients du risque. La plupart, même dans les grands groupes, n'ont pas de vision claire ni de vision d'ensemble de ce qu'est la santé au travail dans leur établissement. Souvent, ils ne connaissent même pas les chiffres des maladies professionnelles qui surviennent dans leur entreprise. Ils ont pourtant tout intérêt à exploiter les données recueillies par le médecin du travail et, en fonction de ces résultats, à s'engager dans une démarche de prévention. C'est pourquoi j'ai demandé à mes services de renforcer leurs actions de conseil sur le terrain, en liaison avec les « préventeurs », l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT), l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) et l'INRS. Quatrième et dernière leçon de l'amiante : la santé ne s'appréhende pas par compartiments. La santé au travail fait partie de la santé publique. C'est le message que nous avons voulu faire passer avec Xavier Bertrand, en étant auditionnés ensemble. J'ai demandé aux directeurs régionaux de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle de commencer dès le début de l'année à décliner le « Plan santé au travail » au niveau régional, sans attendre la formalisation des comités régionaux. Il me paraît essentiel de veiller dès à présent à la bonne articulation entre les plans régionaux de la santé au travail et les plans régionaux de santé publique. La santé au travail a vocation à être une brique supplémentaire de la santé publique et j'ai demandé à mes services de travailler dans ce sens avec les directions départementales (DDASS) et régionales (DRASS) de l'action sanitaire et sociale. Une autre dimension ressort du drame de l'amiante, et de façon plus large de l'ensemble des sujets de santé au travail : la nécessité d'un décloisonnement et d'une coordination plus étroite entre administrations. Dans cet objectif, le « Plan santé au travail » a proposé la création d'une commission interministérielle de prévention des risques professionnels placée sous la présidence du Premier ministre. Elle devrait être installée au printemps prochain. Cette coordination, ou meilleure intégration des politiques publiques, s'impose aussi au niveau européen afin de mieux protéger les travailleurs, et de manière concertée, dans un contexte de marché concurrentiel. La majeure partie de la réglementation française sur la santé et la sécurité au travail découle de directives et de règlements communautaires. La France doit être aujourd'hui plus qu'hier force de proposition dans les processus d'élaboration de ces normes. Nos campagnes de contrôle sur les chantiers de désamiantage ont d'ailleurs inspiré la campagne de contrôle européenne qui se tiendra au second semestre. Mais il faut intensifier nos travaux en commun, en particulier pour ce qui touche à l'évaluation des effets des substances chimiques sur la santé, dès le stade de leur mise sur le marché. J'attends à cet égard beaucoup du règlement REACH sur lequel nous sommes parvenus en décembre à un premier accord politique et qui intègre une bonne part des positions défendues par la France. Enfin, je ne peux pas ne pas être préoccupé par l'avenir de la médecine du travail et particulièrement par le maintien de son enseignement à l'université où elle est trop souvent considérée comme une discipline accessoire et secondaire. Si nous n'y prenons garde, nous n'aurons plus suffisamment de médecins de travail par défaut de transmission du savoir. Il m'apparaît également essentiel que la médecine du travail soit incluse dans les programmes de recherche. Vous me pardonnerez d'avoir été un peu long, mais il me semblait important de bien camper devant vous le travail mené en commun par nos deux ministères et qui nécessite, à l'évidence, d'en mobiliser d'autres, du fait notamment de l'étendue du champ et des enjeux qu'il porte. M. le Président : C'est à nous de vous remercier pour vos exposés très complets. Compte tenu de la multiplicité des problèmes, que nous ne saurions tous épuiser aujourd'hui, nous vous avons fait parvenir un questionnaire très précis que vos services auront à cœur de nous retourner le plus rapidement possible. M. le Rapporteur : La présence conjointe du ministre de la santé et des solidarités et du ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes est symbolique et le fait qu'ils répondent ensemble un bon signe, tant la nécessité d'une coordination interministérielle est évidente. Bien d'autres ministères, jusqu'à celui de la fonction publique, sont concernés par ce lourd héritage. Certes, depuis quelques années, la sensibilisation autour de l'amiante a amené les représentants de la nation à créer d'abord un groupe d'étude, puis des missions parlementaires, et parallèlement l'IGAS à présenter un rapport ; autrement dit, elle a déclenché une véritable mobilisation. Mais si l'amiante a tué nombre de personnes, il continuera sans doute à tuer encore plus de monde et pendant longtemps. Nous sommes donc conduits à nous inscrire dans la durée - 2012, voire 2025 -, compte tenu du danger potentiel d'un matériau que l'on retrouve partout dans nos habitations, nos administrations, nos collectivités. L'information, la prévention, la vigilance doivent rester de mise au-delà des changements de gouvernements et de ministres. Les hommes restant des hommes, j'ai parfois des craintes à cet égard. D'où l'importance que nous attachons à la coordination, par le biais de l'AFSSET, et à l'action interministérielle et européenne. Aujourd'hui, les scientifiques, les politiques, les associations sont mobilisés ; mais qu'en sera-t-il dans dix, quinze ou vingt ans ? Sans compter d'autres dangers latents, prêts à survenir : éthers de glycol, formaldéhyde, fibres céramiques réfractaires, et bien d'autres produits encore parmi tous ceux qui circulent au niveau mondial. Toute la difficulté sera de maintenir notre vigilance face à ce lourd héritage, mais également face à d'autres produits qui pourraient eux aussi faire des ravages. M. le Président : Vous avez évoqué le FCAATA. J'insiste pour que nous ayons communication du rapport de l'IGAS. J'ai moi-même participé à la mise en place de ce fonds. On en voit aujourd'hui les limites, d'autant que certains en bénéficient sans être malades alors que, à l'inverse, certains malades s'en voient exclus ; le sujet est complexe. Par ailleurs, une dimension n'est pas toujours suffisamment prise en compte : dès lors qu'une entreprise entre dans ce champ, ses salariés, sans nécessairement être malades, n'en vivent pas moins avec une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête, d'autant que l'apparition d'un éventuel mésothéliome est tout à la fois brutale et rapidement fatale. S'agissant de la prévention, M. Bertrand a rappelé, à raison, les efforts menés tant sur le plan du diagnostic que sur celui de la sensibilisation des propriétaires privés. Nous avons toutefois quelques inquiétudes à propos du traitement de l'amiante résiduel dans les collectivités territoriales, particulièrement pour ce qui concerne les petites communes et la prise en charge des déchets. S'agissant du suivi post-professionnel, vous nous dites qu'un décret est en cours. Pourriez-vous nous en dire plus sur son contenu ? M. Larcher a, de son côté, posé à juste titre le problème des médecins généralistes. Nous partageons cette préoccupation, relevée lors de plusieurs auditions. Au-delà de leur formation, qui pose effectivement problème, et de leur nombre, la place même des médecins généralistes au regard des maladies professionnelles - et par le fait leur rémunération - appelle une réflexion. M. Larcher a souligné la nécessité d'une expertise publique forte et indépendante : cette position est totalement partagée par notre mission d'information. Mais l'AFSSET, de création certes récente, a-t-elle les moyens de cette ambition ? Le décret organisant les missions de l'agence n'est pas, à ma connaissance, encore publié. Mais n'est-il pas indispensable pour asseoir l'autorité de l'AFSSET face à d'autres structures déjà existantes, qui pourraient n'être pas forcément disposées à la reconnaître ? S'agissant de la réglementation, il apparaît à l'évidence indispensable d'améliorer les conditions de contrôle et d'évaluation. Le renforcement de l'inspection du travail paraît à cet égard une exigence fondamentale. S'agissant enfin du traitement de l'amiante résiduel, nombre de situations posent un problème juridique de détermination des responsabilités très complexe. Il n'est qu'à citer le cas de cette usine désaffectée d'Aulnay-sous-Bois, située - cela ne s'invente pas - entre un cimetière et une école maternelle, qui broyait de l'amiante, il y a soixante ans, de cela. La recherche des responsabilités est particulièrement difficile. Ne serait-il pas possible, dans des cas aussi précis et prioritaires, de permettre à l'autorité administrative, en l'occurrence le préfet, de prendre les décisions qui s'imposent, comme on le fait déjà pour les logements abandonnés, au lieu d'attendre l'épuisement de procédures judiciaires interminables ? M. Xavier BERTRAND : Nous vous transmettrons le rapport de l'IGAS dans les prochains jours, de même qu'aux partenaires sociaux, compte tenu de ses incidences dans le cadre de la négociation sur la branche AT-MP. Je considère pour ma part qu'un rapport, dès lors qu'il a été lu par une personne, a un caractère public : autant le publier le plus rapidement possible, ne serait-ce que pour éviter des efforts d'imagination superflus... M. le Président : Je vous rejoins. On peut parfois le regretter, mais c'est comme cela. M. Xavier BERTRAND : La mission de l'IGAS sur le fonctionnement du FCAATA recoupe le bilan assez négatif établi par l'ensemble des parties concernées ainsi que par la Cour des comptes au printemps 2005. Sont notamment pointés l'injustice du dispositif qui, en raison tout à la fois de son aspect collectif et de l'étroitesse de son champ d'application, fait bénéficier de préretraites des personnes non exposées tout en en excluant d'autres, pourtant lourdement exposées - le cas du BTP a été plusieurs fois cité - mais également son coût, deux fois plus élevé que celui du FIVA. Il est également relevé qu'aucun autre pays en Europe ne propose un triple dispositif des personnes exposées ou malades de l'amiante ; est également évoquée la faible proportion de personnes reconnues malades parmi les bénéficiaires de la cessation d'activité. Au-delà du FCAATA, c'est plus largement l'inégalité de traitement entre les personnes victimes de l'amiante, selon leur régime de protection sociale et d'affiliation, qui est dénoncée. Cela dit, je tiens à préciser un point de sémantique ou de méthodologie, qui vaut pour ce sujet comme pour d'autres, également d'actualité : un rapport de l'IGAS n'est ni plus ni moins qu'un rapport de l'IGAS et ne lie en aucune manière son destinataire, fût-ce le Gouvernement ou les partenaires sociaux. C'est seulement un élément à apporter à la réflexion, sans préjuger de quoi que ce soit. M. Jean-Marie LE GUEN : Raison de plus pour le communiquer. M. Xavier BERTRAND : C'est ce que j'ai dit : sitôt qu'une personne l'a lu, il est à mes yeux public... La mission suggère plusieurs pistes d'évolution du FCAATA, pour ce qui touche tant aux règles d'accès qu'aux modalités de financement, tout en en examinant les avantages et les inconvénients : soit réserver le dispositif aux seules victimes, soit poursuivre et élargir la voie d'accès collective pour les personnes exposées, soit basculer sur une voie d'accès totalement individuelle, soit encore adopter un dispositif mixte sur la base d'un pré-tri par métier et d'un examen individuel. L'inspection a notamment étudié la faisabilité technique des différentes pistes, l'impact en termes de gestion et la méthodologie des divers scénarios possibles ; il revient maintenant aux différents ministères concernés d'examiner ces travaux particulièrement denses et vous-mêmes aurez à cœur d'apporter votre contribution. Nous attendions cette audition pour vous communiquer ce rapport ; il sera également mis en ligne et transmis aux partenaires sociaux. S'agissant du suivi médical post-professionnel, nous avons déterminé quatre régions pilotes : Aquitaine, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Rhône-Alpes. Cette première phase a déjà donné lieu à un pré-rapport en automne 2005, le rapport final devant être rendu milieu 2006. L'expérimentation consiste surtout en une information systématique des personnes de leur droit à un suivi et à un examen médical, ce qui, dans les régions en question, leur a permis de faire reconnaître une maladie et de prétendre à une indemnisation. Ce qui peut être terrible dans cette affaire, c'est de ne pas savoir précisément à quoi on a droit en termes de suivi médical. L'amendement adopté dans le cadre du PLFSS nous permettra cette information systématique, mais nous devrons nous en inspirer davantage. L'objectif était également d'évaluer les meilleures méthodes d'information des retraités, l'apport du scanner thoracique dans le dépistage des lésions liées à l'amiante, ainsi que les risques sanitaires en fonction des doses délivrées. Les experts préconisent d'étendre cette expérimentation à l'ensemble du territoire national, tout en soulignant une question de fond, d'ordre éthique : du fait de la sensibilité du scanner, on risque d'angoisser certaines personnes alors que l'utilité thérapeutique de cette démarche est jugée faible par certains. M. Jean-Marie LE GUEN : Absolument. M. Xavier BERTRAND : Ce à quoi on peut répondre que les scanners ont évolué. Les tout derniers matériels ne provoquent plus de sensation d'enfermement. Nous serions plutôt partisans tout à la fois d'une systématisation de l'information et d'une démarche volontaire des personnes concernées, mais nous entendons consulter le conseil national d'éthique pour approfondir cette question, saisir la haute autorité de santé pour bien valider le protocole médical, et donner à la CNAM les crédits nécessaires - 5 à 6 millions d'euros - afin d'améliorer la standardisation des comptes rendus, la formation et l'agrément des radiologues, et l'information des généralistes et du grand public sur l'existence et les modalités du suivi post-professionnel. S'agissant des collectivités territoriales, une étude conjointe a été réalisée avec le ministère de l'intérieur, dont nous attendons de connaître les résultats. Je comprends évidemment votre inquiétude à propos des petites collectivités locales qui n'ont ni les moyens d'expertise ni la capacité de mener à bien de tels travaux. M. le Président : Y compris sur le plan financier. M. Xavier BERTRAND : Bien sûr. M. le Président : L'organisation de l'acheminement des déchets d'amiante lié pose un véritable problème, particulièrement dans les petites collectivités. Si les grandes n'ont aucune difficulté à les transporter dans des centres de classe 1, nous nous sommes souvent inquiétés de savoir comment ces produits pouvaient être acheminés à partir de déchetteries de proximité dans des conditions de sécurité suffisantes. M. Xavier BERTRAND : Un travail devra être mené avec les préfets en direction des communes de taille modeste qui, tout en étant disposées à le faire, peuvent ne pas savoir comment ni si elles en ont les moyens. M. le Président : La mobilisation des sous-préfets en particulier, proches du terrain, serait probablement des plus utiles pour répondre à cette préoccupation. M. Gérard LARCHER : Le rapporteur s'est inquiété de la pérennité, à terme, de la prise en charge des victimes de l'amiante, ce qui pose le problème du suivi des dossiers médicaux des salariés exposés. La réglementation prévoit une conservation des dossiers médicaux par le médecin du travail, puis par l'inspection régionale de la médecine du travail. Les dossiers sont conservés par les services de santé au travail jusqu'au départ à la retraite du salarié ou jusqu'à la fermeture de l'entreprise. Ils sont alors reversés à l'inspection régionale qui doit les garder quarante ans après la cessation de l'exposition, afin de garantir une traçabilité suffisante en cas de pathologie à effet différé. M. le Président : À quel moment a été défini ce principe ? M. Xavier BERTRAND : Au milieu des années 90. Dans la pratique, cet archivage continue de se heurter à certaines difficultés : les directions régionales du travail et de l'emploi n'ont pas toujours les moyens d'en assurer le suivi. L'objectif pour 2006 est de parvenir à une certitude en matière de traçabilité tout au long des quarante années suivant la cessation de l'exposition. Pour ce qui est de la médecine du travail, son avenir sera déterminé par l'évolution des effectifs de ses enseignants. Avec seulement 29 professeurs des universités/praticiens hospitaliers (PUPH) et 23 maîtres de conférence, c'est la discipline qui possède le moins d'enseignants pour le maximum de formation assurée. Depuis 1998, 12 PUPH sont partis à la retraite, neuf postes ont été supprimés, trois maintenus ou récupérés ultérieurement. Le vieillissement des enseignants s'accélère et devient un facteur limitant pour la formation et le renouvellement des praticiens. Il va falloir récupérer des postes par les autres disciplines et nous avons demandé de flécher les postes dès 2004. La pérennité de la discipline est en jeu. Il faut d'abord compenser les départs à la retraite des PUPH - aucun remplacement n'est possible à Cochin, par exemple -, obtenir les postes dont la discipline a besoin là où il y a des candidats, à Paris, Grenoble, Lille, Angers, Clermont-Ferrand, Montpellier, flécher à partir de 2006 des postes dédiés à la médecine du travail avec un quota minimum d'un professeur et d'un maître de conférence par région, sensibiliser enfin les hôpitaux aux spécificités de la médecine du travail : cinquante-six postes d'interne seulement - sur soixante-dix - ont été ouverts sur l'année 2005. Il faut stopper durablement cette évolution dès la prochaine année universitaire et mettre sur pied un programme pluriannuel. Pour ce qui est des généralistes, leur formation en santé au travail se limite à trois heures en tout et pour tout dans le cursus. La médecine du travail a trop longtemps été considérée, disons-le clairement, comme une discipline secondaire. Pour ce qui est de l'AFSSET, le décret est au Conseil d'État. Mais cela ne l'empêche pas de se pencher d'ores et déjà sur la santé au travail. M. le Président : Naturellement non. Mais quand devrait-il sortir ? Cela fait déjà un moment... M. Gérard BAPT : Qu'y a-t-il dedans ? M. Gérard LARCHER : Nous venons d'adresser une supplique au Conseil d'État, que le directeur de la DRT connaît bien... M. le Président : Nous la soutenons totalement. Depuis le temps... M. Gérard LARCHER : Le ministère du travail, après l'avoir dotée de dix agents et 5 millions d'euros l'année passée, lui apportera 8,6 millions d'euros en 2006, l'objectif pour 2009 étant de parvenir à cinquante agents dédiés à la fonction « travail ». Plusieurs autres études ont par ailleurs été commandées en dehors de l'AFSSET. Face à la multiplication des crises de santé publique, le ministère de la justice a mis en place à Paris et Marseille deux pôles constitués de juges d'instruction et d'enquêteurs, auxquels sont désormais envoyées toutes les plaintes. Tout comme le ministère du travail, les juges sont confrontés à la complexité du dossier - longueur des délais entre l'exposition et l'éventuel décès, disparition des entreprises, traçabilité des expositions inexistante, difficulté de la détermination de la responsabilité des employeurs, multiplicité des acteurs, autant de difficultés que nous connaissons bien dans l'instruction des dossiers de cessation anticipée d'activité. M. Jean-Marie LE GUEN : Comment pouvez-vous connaître des dossiers en cours d'instruction ? M. Gérard LARCHER : Je parlais des dossiers à l'instruction dans le cadre des fonds, non de ceux dont la justice a été saisie. Nous n'avons évidemment pas accès aux dossiers du pôle de Paris ni de celui de Marseille. Pour ce qui est enfin du dossier d'Aulnay-sous-Bois... M. le Président : Ce n'était qu'un exemple parmi tant d'autres. M. Gérard LARCHER : Mais révélateur du problème de l'amiante résiduel. La solution peut être trouvée en faisant appel à la notion de site pollué : il s'agit bien d'une installation arrêtée en 1990 et qui a pollué son environnement. Malheureusement, l'arrêté préfectoral obligeant l'ancien exploitant à dépolluer a été annulé par le tribunal. La procédure d'appel est en cours et nous amène également à réfléchir aux modalités d'application de la loi Barnier et à la détermination des responsabilités à l'occasion de dommages environnementaux. M. le Président : Vous êtes donc bien d'accord sur le fait que, lorsqu'il n'est plus possible de savoir qui a fait quoi, il faut trouver une réponse adaptée. Le site d'Aulnay n'est qu'un exemple. M. Daniel PAUL : Le fait de reconnaître les difficultés n'absout pas pour autant des conséquences... Plus vite nous aurons connaissance du rapport de l'IGAS, plus vite nous pourrons y puiser des enseignements utiles. S'agissant du suivi des dossiers, tout dépend de la date à laquelle l'entreprise a cessé son activité. Certaines l'ont poursuivie jusqu'à l'interdiction de l'amiante en 1997, autrement dit il y a moins de dix ans. Mais des pathologies qui n'apparaissent qu'aujourd'hui sont liées à des expositions remontant aux années 65-70. Dès lors, va-t-on, comme je le souhaite, continuer à prendre en compte tous les salariés ayant, à un certain moment, travaillé dans une entreprise concernée par l'amiante ou va-t-on demander à chaque salarié de faire valoir lui-même son propre dossier devant un généraliste n'ayant suivi que trois heures de formation ? Signalons que cette approche d'un « portage individuel » était mise en avant par un de vos prédécesseurs, le présumé malade devant apporter la preuve qu'il avait attrapé cette maladie dans l'entreprise, alors même que c'est la présence dans l'entreprise qui explique la maladie. Les deux tiers des chantiers de désamiantage ne sont pas aux normes, avez-vous dit. Or des centaines, voire des milliers d'immeubles dans les quartiers dits en difficultés ont été démolis, dont bon nombre ont été construits à une époque où l'on ne se préoccupait guère de l'amiante. Lorsque l'on découvre que l'entreprise ne répond pas aux normes, que fait-on ? Arrête-t-elle immédiatement ? Avec quelles conséquences ? De trois entreprises, on tombe à une... Je veux également insister sur la misère de l'inspection du travail et de la médecine du travail. Vous avez insisté à juste titre sur la nécessité d'assurer la suite des formateurs à tous les niveaux de l'enseignement. Mais qu'il s'agisse de la médecine ou de l'inspection, ne pensez-vous pas que la séparation s'impose ? Le médecin du travail ne doit plus avoir aucun rapport avec le chef d'entreprise. Que celui-ci paie, c'est normal, mais le maintien de quelque rapport de subordination que ce soit entre l'un et l'autre me semble aller à l'encontre de tout ce que l'on dit depuis plusieurs années à propos de la santé au travail - et que la mission ne manquera pas de redire dans les formes appropriées. Je suis élu d'une des quatre régions pilotes retenues pour le suivi post-professionnel. Dans quels délais connaîtrons-nous les résultats de cette expérimentation et quels moyens mettrez-vous en œuvre pour la généraliser le plus rapidement possible, et plus particulièrement dans les régions directement concernées par l'amiante ? M. Patrick ROY : Une question me tient particulièrement à cœur. Si tout un chacun a son opinion sur les responsables de ce drame, plus personne en France n'ignore en 2006 le caractère mortel de l'amiante. Or des entreprises françaises, qui n'exploitent évidemment plus l'amiante sur le territoire national, continuent à le faire dans des pays à la législation nettement plus souple. Quelles actions l'État peut-il envisager à l'encontre de ces industriels qui, osons le dire, exportent en toute connaissance de cause la mort chez des travailleurs étrangers ? Cela m'amène à revenir aux péripéties, que l'on pourrait trouver tragi-comiques, du Clemenceau, naguère fleuron de la marine française et destiné à être désamianté dans des chantiers indiens où, d'après tous les témoignages, les mesures de sécurité ne sont guère comparables à celles que nous connaîtrions en France... Je suis surpris et choqué que le Gouvernement français, qui connaît fort bien les dangers de l'amiante, ait lui aussi choisi d'exporter la mort chez les travailleurs indiens. Quelle est votre opinion ? M. Larcher a parlé des entreprises de désamiantage. Si certaines réalisent parfaitement ces opérations dans des conditions de sécurité impressionnantes, ce n'est effectivement pas le cas partout. Que fait l'État à l'encontre de ces patrons voyous qui n'hésitent pas à exposer leurs salariés en pleine connaissance de cause ? Je suis assailli de nombreuses demandes à propos du FCAATA. Le niveau de l'allocation est très faible, à tel point que de nombreux salariés modestes, qui pourraient bénéficier de ce dispositif, y renoncent après avoir calculé que leurs revenus en seraient encore réduits. Si le FCAATA a un coût pour la nation, encore faut-il mettre en balance « l'économie » budgétaire liée à la réduction de l'espérance de vie des salariés concernés, qui se répercute par la force des choses sur le montant des retraites versées. Cela justifierait à tout le moins une revalorisation de l'indemnité versée par le FCAATA. Enfin, comme Daniel Paul, j'estime qu'il ne faut plus aucun lien entre la médecine du travail et l'entreprise. Nous avons entendu de multiples témoignages de victimes qui, pendant des années, se sont entendues dire à chaque contrôle qu'elles ne présentaient aucune pathologie jusqu'à ce que des examens pratiqués ailleurs montrent des résultats tout à fait contraires... M. Jean-Marie LE GUEN : Le drame de l'amiante est, à tous égards, exceptionnel par son ampleur et l'immensité des dégâts humains et financiers qui en résultent. Faut-il pour autant le considérer comme un phénomène isolé, et ne pas y voir le symptôme d'un dysfonctionnement général de notre système de santé au travail ? Nous aurons vraisemblablement à traiter d'autres dossiers de santé publique certes moins dramatiques, mais qui eux aussi montreront que nous n'avons pas collectivement su réagir. S'il ne s'agit pas pour nous de rechercher les responsabilités - il revient à la justice de s'en charger au besoin -, nous ne saurions nous borner à tirer de cette situation des conclusions concrètes et compassionnelles. Notre rôle de politiques nous commande de voir ce qui n'a pas marché : peut-être les hommes, ici ou là, mais fondamentalement le système. Si tel est également votre avis, quelles conclusions en tirez-vous au niveau des principes ? Cela pose évidemment le problème de la médecine du travail et de son indépendance, celui de l'expertise, de ses moyens et de son aura, celui de la volonté politique qui est derrière. L'expérience administrative dont bon nombre d'entre nous peuvent se prévaloir nous a appris que la coordination des services est souvent utile, mais que ce n'est pas un bon mode de pilotage. N'est-il pas temps de franchir le Rubicon en affirmant que la santé au travail, c'est d'abord la santé publique, autrement dit qu'elle doit relever désormais de la responsabilité du ministre de la santé, donc de l'État ? Ce disant, j'ai conscience de bousculer un certain nombre d'habitudes, de comportements, de traditions. Mais n'est-ce pas de notre responsabilité, au regard de ce drame et de ceux qui pourraient survenir demain ? Nous pouvons être exposés dans le cadre de notre travail à des pathologies qui, sans être aussi visuellement dramatiques que les cancers liés à l'amiante, se traduiront peut-être demain non seulement par une importante souffrance sociale, mais également par des freins considérables au fonctionnement économiques de nos sociétés. Sans parler du coût : celui de l'amiante n'a pas, à ma connaissance, été comptabilisé par la commission Pébereau. C'est là une erreur technique dommageable, mais également un oubli supplémentaire révélateur. Allons-nous, au-delà du traitement de ses conséquences humaines du drame de l'amiante, nous servir de toute l'énergie qui s'en est dégagée pour véritablement faire face aux enjeux de demain ? Les réparations individuelles sont évidemment légitimes, mais nous devons avant tout tirer de ce drame des leçons sérieuses, à la hauteur des enjeux. M. Gérard BAPT : Les décrets relatifs à l'AFSSET sont au Conseil d'État, avez-vous dit. Mais celle-ci aura-t-elle vraiment un rôle de pilote, de conduite d'ensemble ? Ayant assisté récemment à un colloque autour du thème « santé et environnement », j'ai été frappé par la multiplicité des acteurs et des études : l'AFSSET n'était même pas au courant de certaines d'entre elles, menées dans le secteur agricole... Ses moyens ne peuvent se comparer à ceux de l'IVS, lequel dispose d'études épidémiologiques, de remontées d'information des CRAM et de bien d'autres données qu'il se doit de mettre à disposition de l'Agence, ce qui n'est visiblement pas toujours le cas. J'ai déjà eu l'occasion d'interroger le ministre de la santé sur l'insuffisance des moyens de la Direction générale de la santé (DGS) qui, elle aussi, devrait jouer un rôle pilote dans la gestion du risque ou encore lorsque l'intervention du ministre de la santé est requise lors du vote de certaines dispositions, par voie d'amendement, à l'occasion de texte n'ayant a priori rien à voir avec la santé publique - nous en avons eu deux exemples tout récemment. Là encore, c'est une question de cohérence dans la gestion du risque comme dans le lancement des études d'évaluation qui ont fait cruellement défaut - au niveau tant français qu'international, ai-je cru comprendre. M. le Président : Où en est la réflexion sur l'évolution de la branche AT-MP - réparation intégrale, compromis de 1898, etc. ? Je remercie enfin M. Le Guen qui, avec sa précision habituelle, a parfaitement résumé en quelques phrases ce qui a constitué l'essentiel des travaux de cette mission : souffrance sociale, évolution du rapport au travail dont la nature même se transforme, poids grandissant des risques sur le plan des maladies professionnelles, inadéquation du système de prévention qui doit être remis à plat, autant de sujets qui ont mobilisé l'essentiel de notre réflexion et de nos énergies. M. Xavier BERTRAND : La négociation entre les partenaires sociaux sur l'avenir de l'AT-MP doit enfin s'ouvrir, avec un an de retard... Le principe posé par le compromis de 1898 de la présomption de la responsabilité de l'employeur ouvrant droit à une réparation forfaitaire a déjà été mis en cause à maintes reprises : la loi Badinter, par exemple, a étendu les conditions d'indemnisation des victimes d'accidents de la route aux accidents de trajet et accidents de mission. Le FIVA assume la réparation intégrale des préjudices occasionnés par l'amiante et, depuis 1947, la faute inexcusable de l'employeur - qui depuis 2002 résulte du simple manquement à une obligation de sécurité et de résultat - ouvre à la victime la possibilité de réclamer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par elle-même ou ses ayants droit. La réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles, que préfigure le FIVA, est depuis longtemps une demande des syndicats à laquelle les employeurs semblent également sensibles. Mais cela relève d'abord de la négociation entre partenaires sociaux ; s'ils ne se mettaient pas d'accord, nous prendrions nos responsabilités. En tout cas, rien ne peut justifier un traitement différent des malades selon que leur cancer est lié à l'amiante ou à un autre facteur d'origine professionnelle. D'un autre côté, le déficit de la branche AT-MP est obéré notamment par le financement du dispositif de cessation anticipée d'activité dont la progression - 100 millions d'euros par an - posera de réelles difficultés que les partenaires sociaux ne pourront ignorer dans leurs discussions. Cette dynamique devra être prise en compte, à moins que les travaux de la mission d'information donnent droit à une des pistes envisagées dans le rapport de l'IGAS. Quoi qu'il en soit, ce problème devra trouver une solution, même si la branche AT-MP sera elle aussi amenée à prendre ses responsabilités. M. Bapt a rappelé le rôle de la DGS, mais on ne saurait pour autant oublier celui des agences et notamment de l'IVS. La prise en compte de ses données épidémiologiques nous permet une approche beaucoup plus fine de ces sujets. Nous tenons également à une bonne coordination entre agences, en précisant bien les missions de chacune dans les contrats d'objectif et de moyens. Ce serait la pire des choses que d'avoir mis en place des agences et, par manque de coordination, de passer à travers les problèmes sans les avoir résolus. M. Le Guen a, de l'avis de votre Président, résumé les travaux menés par votre mission... M. le Président : Ce en quoi je lui rendais hommage. M. Xavier BERTRAND : C'est bien ainsi que je l'avais compris. M. Jean-Marie LE GUEN : Faites comme si je n'étais pas là ! M. Xavier BERTRAND : Force de reconnaître que l'amiante nous a fait faire, en particulier durant ces dix dernières années, d'importantes avancées en matière de santé publique - ce qui tend à prouver que la situation antérieure n'était pas satisfaisante. Ce à quoi sont venus s'ajouter d'autres facteurs, dont la montée en puissance du principe de précaution, sans même parler de sa consécration juridique, mais surtout la mise en place d'une expertise scientifique indépendante, de qualité et bien dotée en moyens. Des efforts considérables ont également été réalisés dans le domaine de l'épidémiologie : la veille et l'alerte ont fait ainsi leur entrée dans le dispositif de sécurité sanitaire. Je crois enfin pouvoir noter, face à l'éventualité d'un phénomène similaire, une évolution des mentalités et des comportements, une plus grande sensibilité à ces questions en raison précisément du drame de l'amiante. L'identification des causes tout comme la réaction des pouvoirs publics en seraient à l'évidence notablement accélérées. Précisons toutefois que tout cela ne concerne pas seulement l'État : même s'il n'est pas question de méconnaître la responsabilité des pouvoirs publics, on ne saurait laisser de côté celle des industriels, des syndicats, des experts. Il n'est qu'à voir l'opposition que l'INRS et l'IVS ont dû affronter sur le terrain industriel pour effectuer des études épidémiologiques commandées par l'État sur le devenir des employés ayant manipulé des fibres minérales artificielles, dont certaines pourraient avoir sur la santé des effets à certains égards similaires à ceux de l'amiante. Des enseignements ont-ils été tirés de ce drame ? Oui, mais les choses ne sont pas terminées. Ces réticences prouvent à quel point nous devons continuer à faire évoluer les mentalités, les comportements et les consciences. Au-delà de la compétence « santé au travail » de l'AFSSET, nous devons mener une réflexion en profondeur sur les moyens de contrôle que l'État peut engager pour s'assurer du respect des règles de sécurité dans les entreprises. Le rapport définitif sur le suivi post-professionnel à la lumière des expérimentations conduites dans quatre régions, dont celle de M. Daniel Paul, nous sera remis à la mi-2006, et à la fin 2006 sortira le décret d'application visant à mettre l'information en place dans toute la France, ce qui nous donnera le temps de débloquer les financements nécessaires. D'ores et déjà, la généralisation à toute la France, à moins que vous ne contestiez cette voie, est à nos yeux un principe acquis. M. Daniel PAUL : Ce qui suppose de prévoir des moyens dès 2007. M. Xavier BERTRAND : À moins que l'on sache aller plus vite : 5 à 6 millions d'euros mis en place par l'assurance maladie, ce ne devrait pas être un obstacle. Si nous pouvions gagner du temps dans la concertation préalable à la parution du décret, je n'y verrais que des avantages. Le caractère volontaire de la démarche est également à nos yeux un principe acquis, après évidemment information systématique sur les droits de chacun, en application de la loi de financement de la sécurité sociale, et saisine de la Haute Autorité de santé et du comité d'éthique. S'agissant du Clemenceau, les ouvriers indiens qui auront à le démanteler devront également bénéficier des éléments de protection essentiels. Non seulement la France est le premier pays à avoir réalisé un désamiantage préalable, mais le contrat prévoit des mesures de protection des travailleurs en conformité avec la réglementation européenne, notoirement plus exigeante que beaucoup d'autres. Le chantier d'accueil est certifié ISO 9 001 et ISO 14 000 pour ce qui est de l'environnement, et le démantèlement se fera sous le contrôle d'ingénieurs indiens à qui a été proposée une formation à Mulhouse, et d'ingénieurs français dépêchés sur place par la société qui a procédé au désamiantage. M. Daniel PAUL : Accepteriez-vous qu'un comité médical indépendant assure le suivi du chantier ? M. Xavier BERTRAND : Je ne peux que rester dans le cadre de ma compétence santé, mais je le répète : ce n'est pas parce que ces travaux se déroulent loin de chez nous que nos principes ne doivent pas s'y appliquer. M. Daniel PAUL : J'interrogerai M. le ministre de l'industrie la semaine prochaine sur la mise en place d'une filière de désamiantage des navires. Le port de Cherbourg pourrait parfaitement la recevoir, tout comme Toulon ou Brest. Savez-vous qu'une filière expérimentale de ce genre va bientôt se mettre en place à Caen pour les bateaux de plaisance - 1 500 par an ? Il doit être possible d'en faire autant pour tous ces déchets flottants. Incapable de naviguer de façon autonome, le Clemenceau n'est à mes yeux qu'un déchet, soumis par le fait aux dispositions de la convention de Bâle. Je vois de surcroît une certaine indignité pour la France à laisser partir dans de telles conditions un navire vers un pays en voie de développement, dans un chantier - à supposer qu'il y arrive - où les normes dont vous parlez ne sont à l'évidence pas respectées : Internet a au moins le mérite de permettre de visualiser ce qui se passe loin de chez nous, et j'ai visité voilà trois ans un chantier en tout point similaire à celui-ci... Les conditions y sont proprement abominables. Le pire est que le navire en question a, contrairement au France, devenu Norway, battu jusqu'à la fin pavillon national. Nous nous serons débarrassés du Clemenceau de la pire manière qui soit. M. le Président : Monsieur le ministre, nous n'avions pas l'intention de vous interroger sur le Clemenceau, même si le problème est à nos yeux important - la preuve en est que nous avons écrit au Premier ministre qui vient juste de nous répondre. Cela dit, outre le fait que le désamiantage n'a été que partiel, les évaluations font état de quantités d'amiante lié beaucoup plus importantes que ce que l'on a affirmé jusqu'à présent - probablement de l'ordre de 500 à 1 000 tonnes. Enfin, l'entreprise initialement chargée de former le personnel sur place et d'assurer l'accompagnement nécessaire vient de dénoncer son contrat, faute d'avoir pu recevoir aucun des techniciens indiens pour les mettre au courant et organiser les opérations. J'ai donc toutes les raisons d'être très inquiet. Sans moteur, sans organes de transmission, sans hélice, le safran soudé, le Clemenceau est devenu ce que l'on appelle dans le langage maritime une épave et entre, par conséquent, dans le cadre de la convention de Bâle. Vous avez répondu avec les informations dont vous disposiez et je ne saurais vous le reprocher. Mais je peux vous faire état des miennes, totalement différentes. M. Patrick ROY : Celles dont je dispose montrent que les chantiers indiens ne répondent en aucune façon aux normes requises. On m'a fait valoir que le Clemenceau n'entrait pas dans le cadre de la convention de Bâle parce que c'était un navire militaire. Heureusement que nous ne sommes pas en guerre : il ne serait probablement pas le plus performant... Aussi ai-je téléphoné au ministère pour avoir la liste de nos navires de guerre. Je suis tombé sur une secrétaire qui, après me l'avoir promise, m'a renvoyé quelques heures plus tard à un capitaine qui, de la même façon, m'a renvoyé au général qui finalement m'a annoncé que la décision devait attendre la signature sur le bureau du ministre... En clair, quand le navire sera arrivé ! M. le Rapporteur : Je vais vous donner la liste, que j'ai obtenue sans problème en tant que membre de la commission de la défense nationale et des forces armées. Tous les navires et leurs caractéristiques y sont recensés de manière précise et exhaustive. Mme Martine DAVID et M. Daniel PAUL : Y trouve-t-on le Clemenceau ? M. le Rapporteur : Le problème de la gestion de l'amiante résiduel reste posé, tant pour le Clemenceau que pour les collectivités locales. Je crains qu'en appliquant des normes drastiques pour le traitement de l'amiante-ciment ou en plaques, nous n'allions à l'encontre du but recherché : face aux coûts fantastiques qui en découleront, particuliers, petites collectivités et artisans n'auront qu'une hâte : aller balancer tout cela dans la nature... Dans le cas particulier du Clemenceau, prenons garde à bien distinguer amiante friable et amiante lié. Le problème est complexe et parmi les organisations impliquées dans cette affaire, il en est que je respecte et d'autre avec lesquelles je prends quelque distance : pour avoir eu à gérer le problème de l'industrie nucléaire sur le Cotentin, j'ai découvert qu'elles n'hésitaient pas à brandir des informations parfaitement inexactes : ainsi les préconisations du professeur Viel reprises par Greenpeace se sont révélées totalement erronées. Si nous avions le temps, nous devrions aller à la baie d'Alang voir ce qui s'y passe. M. Gérard LARCHER : Permettez-moi de revenir à des choses plus immédiates et nationales. Sur 750 chantiers de désamiantage contrôlés, 21 % enlevaient de l'amiante friable, qu'il faut distinguer de l'amiante lié, encore que certaines conditions de conservation et de démolition exigent dans les deux cas une haute technicité. Sur deux tiers des chantiers, des infractions ont été relevées, les unes graves, les autres moins : repérage non transmis aux entreprises de démolition, absence de signalétique, accès non interdit au public, absence ou insuffisance de travail en milieu humide, etc. A ce stade, 84 chantiers ont été arrêtés, 41 procès-verbaux ont été dressés, auxquels se sont ajoutés six injonctions de changement immédiat et 390 courriers d'observation. Autrement dit, nous n'avons pas fait que passer sur ces 750 chantiers... Précisons que la sanction en cas de non-transmission du plan de retrait, par exemple, est l'arrêt immédiat de tout chantier, comme je l'ai rappelé aux préfets par une circulaire du 18 novembre 2005, entre autres instructions - pression sur les chantiers de désamiantage, mobilisation sur l'identification des chantiers non déclarés, contrôle aléatoires, sensibilisation des entreprises aux obligations réglementaires. J'ai du reste réuni dans le même temps, en novembre 2005, l'ensemble des acteurs de la branche professionnelle pour les mettre devant leurs responsabilités. Pour ce qui est de la médecine du travail, le premier combat reste celui de la qualité et de la quantité. La réforme progressivement mise en œuvre vise également à préserver l'indépendance du médecin salarié, protégé par une autorisation administrative préalable à tout licenciement. Nous avons également modifié des règles de fonctionnement de certains services interentreprises afin d'y conforter la place du médecin du travail. Tout cela me paraît de nature à répondre à une partie des préoccupations exprimées. Pour répondre à M. Roy, c'est sur proposition du représentant de la France, à l'époque M. Philippe Séguin, que l'interdiction totale de l'amiante a été demandée, par ma voix, à l'OIT. Cette position officielle n'est naturellement pas sans conséquences pour nos entreprises. Je dois précisément en discuter cet après-midi avec un de nos représentants au titre des organisations syndicales : cela fait partie des sujets que nous remettrons sur la table dès la prochaine assemblée générale. Notre position est claire, publique et unanimement soutenue tant par les représentants des entreprises que par ceux des salariés - la représentation à l'OIT est tripartite : États, entreprises et salariés. Sur l'AFSSET, évoquée par M. Bapt et M. Le Guen, Xavier Bertrand a dit l'essentiel : rôle de veille scientifique et de pilotage, évaluation des risques pour l'homme, expertises nécessaires, cependant que l'IVS mettra en place la surveillance de l'état de santé des populations. À noter que cette agence indépendante comprendra dans son collège d'administration un collège des partenaires sociaux, car il manquerait une véritable dimension à la santé au travail dans cette agence s'il n'y avait pas une représentation des partenaires du monde du travail dans ce conseil. Quant aux études que nous avons commandées sur les éthers de glycol, le formaldéhyde, les fibres céramiques et les nanomatériaux, elles montrent précisément que nous entendons dépasser le principe du constat en fixant, dès à présent, des valeurs d'expositions clairement définies, voire en décidant le retrait de certaines substances : j'attends justement une étude qui pourrait m'amener à faire des propositions dans ce sens. S'agissant de REACH enfin, la question essentielle est celle du principe de substitution, sur lequel la France a joué un rôle majeur alors que nos partenaires ne souhaitaient pas l'affirmer. Nous ne devons donc avoir aucun complexe dans le domaine de la santé au travail, mais bien au contraire rester volontaristes. Le drame que nous avons connu nous impose d'en tirer toutes les leçons, bien au-delà de la seule problématique amiante, et d'en faire un sujet à porter au plan européen comme au plan mondial. Je vois une évolution significative dans le fait que l'OIT ne se préoccupe plus simplement de normes minimales du travail, mais désormais de normes de santé au travail ; et si je souhaite qu'elle se saisisse du sujet de l'amiante, c'est pour qu'elle s'empare demain des autres substances. Mon ambition est que REACH ne soit pas seulement un programme européen que l'Union s'imposerait seulement à elle-même, mais que nous devenions « contagieux » dans le cadre de l'OIT où la France doit continuer à jouer un rôle de premier plan. Face à la mondialisation, la réponse de l'Organisation internationale du travail doit, conformément aux valeurs qu'elle défend, conduire à l'application de normes, en Inde comme dans tous les pays du monde où persistent des formes de dumping social. M. Roy représente un département où l'on a longtemps arbitré entre la production et la santé ; c'est là un sujet auquel je sais le Président Le Garrec tout aussi sensible que moi. Il n'est plus possible d'enfermer les gens dans ces situations d'arbitrage passif entre santé et production. Il y va de notre rôle, de la responsabilité de l'État et c'est tout le sens du travail que Xavier Bertrand et moi-même conduisons, avec le sentiment qu'il reste encore beaucoup à faire. J'ai, je vous l'avoue, le sentiment d'être parfois injuste en prenant certaines décisions, lorsque je refuse par exemple l'accès au FCAATA au motif que l'entreprise ne figure pas sur la liste arrêtée par le Parlement, mais également lorsque je me vois l'accorder à des gens qui n'ont jamais été exposés. Car la justice vaut dans les deux sens : il faut avoir le courage de dire la vérité. Accès collectif ou décision individuelle ? Cela aussi fait partie des éléments sur lesquels nous devons réfléchir. Le pire serait de générer un sentiment d'injustice en plus du sentiment de colère et d'inquiétude que peuvent ressentir ces hommes et ces femmes. Raison de plus nous pencher sur ces sujets avec humilité et souci de vérité. M. le Président : Messieurs les ministres, nous vous remercions. Je suis très satisfait de la manière dont nous avons pu dialoguer, en allant jusqu'au bout de nos raisonnements. Audition de M. François LOOS, ministre délégué à l'industrie, accompagné de M. Jean-Jacques DUMONT, directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle (DARQSI) Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Monsieur le ministre, nous vous remercions de votre présence. Nous avons transmis un questionnaire à votre cabinet en souhaitant que les réponses nous reviennent rapidement car nous arrivons presque au bout de nos travaux. Plutôt que de revenir en détail sur l'histoire de l'amiante - amplement traitée dans maints rapports, dont celui du Sénat -, notre mission s'est plutôt interrogée sur l'avenir, les conséquences directes du drame de l'amiante évidemment, mais également au-delà, car ce drame a mis en lumière l'importance des mécanismes de prévention, notamment en amont des process. Le rôle de l'industrie est devenu majeur dans un contexte marqué par la multiplication des produits nouveaux, à travers des cycles industriels de plus en plus rapides. Le programme REACH64 s'inscrit dans cette logique. Que pensez-vous précisément des conséquences de cette accélération des cycles technologiques sur l'émergence des risques professionnels nouveaux ? Au sein de la branche « accidents du travail - maladies professionnelles » (AT-MP), les accidents du travail diminuent et c'est heureux, mais en contrepartie de l'apparition d'un nombre grandissant de maladies pour lesquelles le lien de causalité avec l'activité professionnelle n'est pas toujours facile à prouver, d'autant que le temps de latence peut être très long - il peut dépasser une trentaine d'années dans le cas de l'amiante. S'y ajoute le problème des déchets amiantés, conséquence inévitable de la nouvelle réglementation, qui se pose en termes particulièrement aigus dans les zones rurales. Compte tenu des énormes quantités d'amiante utilisées dans les années cinquante et soixante, on peut compter une trentaine de kilos par habitant, disséminés un peu partout. Votre ministère est chargé de la négociation communautaire sur le projet de règlement REACH. Pourquoi un tel dossier relève-t-il de la compétence exclusive du Conseil « compétitivité » alors qu'il concerne également la santé publique et la santé au travail ? Tous ces domaines ne sont-ils pas de plus en plus étroitement liés ? M. François LOOS : À ce stade de vos auditions, je n'aurai plus grand-chose à vous apprendre sur ce dossier ; c'est plutôt votre expérience qui m'intéresse... Qu'il s'agisse des déchets ou des produits toxiques, on part désormais du principe qu'il faut avoir d'emblée une bonne information sur tout ce que l'on utilise, autrement dit une information normalisée, vérifiée, à travers des procédures précises organisées en fonction du danger et auxquelles les industriels sont devenus très attentifs. Celui à qui il est arrivé de « pécher » sait combien la punition est lourde : indépendamment des effets sur le travailleur et sur l'environnement, la sanction sociale est très forte. Aucun chef d'entreprise ne peut désormais maltraiter ces questions de sécurité liées aux produits sans courir le risque, indépendamment des conséquences humaines et environnementales, de voir son activité s'arrêter purement et simplement. Face à ce risque énorme, bon nombre de secteurs industriels se sont fixé comme objectif un taux zéro en matière d'accidents du travail. Dans le secteur chimique en particulier, DuPont de Nemours a été le premier à l'imposer dans toutes ses usines dans le monde entier, et même à lutter contre les accidents sur le trajet domicile/travail et jusque dans le domicile. La préoccupation éthique est aujourd'hui très présente dans les entreprises. Il n'est plus questions de biaiser face à ce genre de considérations et l'industrie française en est bien consciente - au demeurant, tous nos systèmes de contrôle sont là pour le rappeler. Au-delà des variations de perception selon les domaines et les risques, c'est une tendance générale marquée depuis trente ans. Le drame de l'amiante est à certains égards révélateur d'une époque où l'on pensait pouvoir trouver des compromis entre l'utilisation de produits dangereux et la poursuite d'une certaine façon de travailler. On a compris depuis qu'il fallait savoir changer de façon de travailler et analyser le danger dans sa totalité. M. le Rapporteur : L'usage contrôlé de l'amiante correspondait effectivement à une certaine forme de culture industrielle à laquelle adhéraient globalement les syndicats et les représentants du personnel. Au souci de préserver l'emploi s'ajoutait l'impossibilité de trouver rapidement un substitut : n'oublions pas que l'usage contrôlé de l'amiante a fait suite à l'incendie du lycée Pailleron... Comment imaginer se passer d'un produit aussi essentiel à la sécurité et qui présentait tant d'avantages ? Cela explique, au bout du compte, quinze ou vingt ans de comité permanent amiante. Il ne faut pas y voir l'effet d'un lobby industriel, mais bien, d'une certaine manière, la conséquence d'une phase industrielle où partenaires sociaux, scientifiques et industriels se sont accordés, après les premières limitations de 1977, sur l'idée de continuer à utiliser l'amiante jusqu'en 1997, date de son interdiction définitive. Au total, le prix à payer est énorme ; remarquons toutefois, à leur décharge, que les quelque 3 000 victimes annuellement recensées - 700 mésothéliomes, 200 asbestoses et le reste en cancers bronchiques - correspondent sans doute à des expositions antérieures aux limitations de 1977. Le problème est que les effets se produisent souvent très tard, jusqu'à trente ans après l'exposition. M. le Président : Monsieur le ministre, je suis d'accord sur le fait que les entreprises ont fait un énorme effort. L'évolution de la courbe des accidents du travail le montre clairement. Cela dit, il faut également regarder, pour avoir une vision complète, du côté de la sous-traitance. Dans la sidérurgie, j'ai vu le taux zéro atteint dans bon nombre d'entreprises, mais les résultats n'étaient pas de même nature chez les sous-traitants, y compris lorsque ceux-ci travaillaient dans les locaux mêmes de l'entreprise ! Et les organisations syndicales dans les Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ne se sentaient pas forcément mobilisées sur les conditions de travail de leurs collègues issus de la sous-traitance... Il reste donc des efforts à faire de ce côté, mais il y a incontestablement eu une prise de conscience. Plus préoccupante est cette accélération du cycle des innovations. Le programme REACH ne vise pas moins de 30 000 produits. Une évolution aussi rapide n'est pas de nature à faciliter l'établissement d'un lien de causalité entre une maladie et une activité, à plus forte raison lorsque les conséquences n'apparaissent qu'après un temps de latence très long, qui incitera d'autant moins les principaux concernés à se mobiliser. C'est du reste ce qui s'est produit avec l'amiante où le temps de latence dépasse souvent trente ans. Le niveau actuel des décès par mésothéliome correspond à la phase d'utilisation massive de l'amiante, durant les années cinquante à soixante-dix ; nous ne savons pas encore ce qu'a donné l'application de l'usage dit contrôlé dans la période qui a suivi. M. Larcher est très mobilisé sur les problèmes de la santé au travail et particulièrement sur cette question. Votre ministère travaille-t-il en liaison avec lui sur cette approche ? M. François LOOS : La mécanique REACH vise précisément à éviter qu'un drame de ce genre ne se produise à l'avenir. Chaque produit devra subir des contrôles et, s'il s'avère dangereux, il devra être remplacé par une autre substance. Les produits dangereux ou toxiques ne pourront être utilisés que sous réserve d'autorisations détaillant précisément les utilisations et les conditions d'emploi. L'avantage du système REACH - s'il est bien appliqué - sera que toutes les entreprises européennes seront traitées à l'identique. M. le Président : Sans distorsions de concurrence. M. François LOOS : Une fois qu'il aura atteint sa vitesse de croisière, le programme REACH deviendra la norme pour toutes les entreprises concernées. Dès lors que tous les produits seront dès le départ analysés, et particulièrement les plus toxiques, nous ne devrions plus connaître de problèmes tels que ceux de l'amiante. En France, ce qui relève des « relations du travail » est d'ordinaire géré par le ministère du travail. Toutefois, le ministère de l'industrie participe à certaines instances dont la tutelle relève du travail ou de la santé, où il apporte sa connaissance industrielle. L'engagement de Gérard Larcher s'inscrit totalement dans son domaine de compétence. J'approuve totalement son plan santé au travail : il ne contient rien que je n'aurais voulu y voir en tant que ministre de l'industrie. Mais sa mise en œuvre relève clairement de la responsabilité du ministère du travail. Au niveau européen, le programme REACH a effectivement été traité dans le cadre du Conseil « compétitivité », mais les autres ministères ont tous été associés aux positions prises par la France - et il en a été de même dans les autres pays. Je m'y suis toujours exprimé dans le cadre d'un mandat interministériel - ce qui ne m'a du reste jamais posé aucun problème. Il n'y a aucun conflit sur ces questions entre les ministères du travail, de la santé et de l'industrie. Nous pouvons avoir des nuances d'appréciation sur l'efficacité ou la méthode, mais en aucun cas sur le principe d'examen préalable des produits et sur le principe de substitution des produits toxiques. Cette logique interministérielle est également de mise chez nos partenaires : ainsi, sous le gouvernement allemand précédent, c'était le ministre de l'environnement qui venait au Conseil « compétitivité ». Celui-ci n'était en rien une pure émanation des seuls ministères de l'industrie - en tout cas pas du côté franco-français où l'interministériel a toujours été la règle. Au demeurant, les conseils « environnement » entendaient également les débats sur REACH. En terme de procédure, le texte adopté à la mi-décembre par le Conseil n'est pas exactement le même que celui que le Parlement européen a voté en novembre. La Commission travaille actuellement à une nouvelle version qui lui sera soumise, une sorte de « deuxième lecture ». En fait, il n'y a pas de sujets de désaccord majeur : c'est surtout une question de procédure parlementaire européenne. On peut penser que l'exercice se conclura bientôt par l'adoption d'un compromis qui devrait permettre au règlement REACH d'être définitivement adopté dès 2007. Nous étions très attachés au principe de la création d'une agence européenne, ne serait-ce que pour garantir le principe d'une égalité de traitement entre des pays dont les niveaux d'industrialisation et, par conséquent, les préoccupations en matière de contrôle, sont très différents. La mise en place d'une agence européenne chargée d'organiser le suivi systématique des produits REACH était à nos yeux un point essentiel. Nous avons finalement été suivis, mais lorsque je l'avais défendu il y a six mois, plusieurs pays tenaient à ce que leur système de contrôle national ait seul la compétence pour évaluer les produits. Nous avons fait valoir que l'agence serait à la fois source d'économie, en évitant de devoir analyser chaque produit dans vingt-cinq États différents - sans compter que les résultats pourraient n'être pas partout les mêmes -, mais également garantie de professionnalisme. Cette solution s'est au bout du compte imposée, mais ce n'était pas gagné d'avance... Ce principe étant posé, nous avons proposé que tous les producteurs d'un même produit s'associent dans un consortium qui supporterait les frais d'évaluation et d'enregistrement ; le but était de rendre le fonctionnement de l'agence plus opérationnel. Dans certains cas toutefois, nous avons souhaité que les entreprises puissent échapper au consortium afin de protéger leurs droits de propriété industrielle et leurs secrets de fabrication. Certaines entreprises utilisent, en effet, des produits tout en tenant à ce que cela ne se sache pas. Elles ne sont pas opposées au système REACH, mais elles ne voudraient pas que, par le biais du consortium, leurs concurrents aient accès à tous les détails de leurs procédés de fabrication. En revanche, nous avons demandé que l'on ne puisse pas échapper au consortium lorsque les produits nécessitent des tests sur animaux, afin de limiter le plus possible la quantité d'animaux à utiliser. A également été posé le principe de substitution des produits dangereux : l'amiante étant un produit reconnu cancérigène, il ne saurait être autorisé par derrière. L'entreprise doit indiquer le produit de substitution qu'elle envisage pour le cas où l'utilisation d'un produit dangereux sera interdite. Ce principe a été admis et voté par le Parlement européen. Certains pays auraient souhaité qu'il ne fût pas adopté par le Conseil ; la France a pris la tête dans la défense du principe de substitution et j'ai eu l'occasion, à plusieurs reprises, de défendre cette position face à des groupes d'industriels ou des associations de défense de l'environnement. Les secondes ont fini par admettre que cela correspondait à ce qu'elles demandaient, les premiers qu'il était difficile de reconnaître la dangerosité d'un produit tout en refusant de le remplacer... M. le Président : On aurait pu utiliser un mot un peu plus large que celui de « compétitivité »... M. François LOOS : C'est comme cela... M. le Président : N'allons pas en faire un problème. L'organisation interministérielle est l'affaire de chaque pays et chacun agit comme il l'entend, mais je vous remercie de nous avoir confirmé que vous avez agi en concertation avec le ministère de la santé et celui du travail. Une agence européenne était effectivement indispensable. Cela dit, compte tenu de l'ampleur du programme REACH et de la rapidité des cycles, le seul niveau européen n'y suffira pas ; il faudra bien envisager une spécialisation par pays. Cela implique également que la France se dote de moyens d'analyse à la hauteur des enjeux. Même si elle est une tête de réseau indispensable, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) est encore loin d'avoir les moyens d'y répondre. Par ailleurs, l'idée d'une autorisation de mise sur le marché, comparable au dispositif utilisé pour les médicaments, a-t-elle été évoquée lors de vos débats ? Enfin, nous avons bien compris que les producteurs des produits de base ne voulaient pas être les seuls à supporter le poids de toutes ces nouvelles contraintes - ce qui peut se comprendre. M. François LOOS : La procédure d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament a également pour objet la fixation d'un prix ; il ne peut y avoir d'équivalent pour un produit ordinaire. M. le Président : C'est vrai. M. François LOOS : Par ailleurs, un médicament est une substance toxique ; s'il devait passer par le programme REACH, il faudrait le remplacer, et s'il n'avait pas d'effet, ce ne serait pas un médicament... L'agence recevra toutes les demandes d'enregistrement. Nous avons demandé, pour ce qui concerne les entreprises françaises, qu'elles soient toutes déposées dans les dix-huit mois. Le dépôt d'une demande est obligatoire : seront soumis à REACH tous les produits consommés à raison de plus d'une tonne par an - d'où ces 30 000 produits. M. le Président : Nous n'avions pas cette information. M. François LOOS : De même, une installation classée est déterminée en France par la possession d'une quantité donnée d'un produit figurant dans une liste. Si vous détenez plus d'un kilo de dynamite, par exemple, ou du pétrole au-dessus de telle quantité, votre installation est classée. Dans le système REACH, il n'y a pas de liste ; tous les produits sont concernés. De l'avis des experts, 1 000 ou 2 000 sur les 30 000 produits sont plus toxiques - mutagènes, cancérigènes, etc. - que d'autres et nécessiteront d'être prioritairement évalués. Les substances les plus préoccupantes nécessiteront une autorisation et appelleront une analyse plus fouillée. Ou bien ils seront purement et simplement interdits, ou bien l'entreprise pourra s'en servir, sous certaines conditions, que l'agence étudiera et proposera au cas par cas à la Commission. La mécanique n'est pas exactement la même que celle de l'AMM, puisque l'on traite de tous les produits, et de surcroît sans qu'il soit question de fixer un prix. Les fabricants de matières premières ne seront pas les seuls concernés. Les importateurs seront également soumis à l'obligation de déclaration. Le but est de protéger les consommateurs comme l'environnement, que le produit soit fabriqué sur place ou en Chine. M. le Rapporteur : Ce peut être un moyen de contrôler la circulation de produits dangereux sur le plan international... On sait que l'amiante continue à être produit au Canada et l'on peut craindre que des produits prohibés ou à utilisation très restreinte dans l'Union européenne ne soient commercialisés ailleurs. Le problème de l'amiante n'est pas résolu au niveau international et notre mission sera vraisemblablement amenée à préconiser son interdiction totale. Or des producteurs puissants - Canada, Russie, Brésil, Zimbabwe - continuent à le commercialiser et l'on peut craindre que d'autres produits interdits dans l'Union circulent également. Que proposeriez-vous face à une telle situation ? M. François LOOS : Dès lors que l'Europe interdit une substance - qu'il s'agisse du veau aux hormones ou des OGM -, elle s'expose à des attaques devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) de la part des pays qui, ne la considérant pas dangereuse, y voient une manœuvre visant à les empêcher de nous en vendre. D'où des procès dans lesquels l'attaquant fait valoir son préjudice et demande réparation : c'est ce qu'a fait le Canada pour l'amiante et il a perdu, l'OMC ayant appliqué l'accord dit OTC - obstacle technique au commerce - après que l'Europe eut mis en avant la proportionnalité des risques : on a le droit de prendre des mesures contre un produit en proportion du risque qu'il génère. S'il est important, on peut aller jusqu'à l'interdire ; s'il est scientifiquement prouvé qu'il ne l'est pas, on n'a pas le droit d'en gêner l'importation. L'OMC a, en application de ce principe, reconnu à l'Europe le droit d'interdire l'importation d'amiante et a débouté le Canada. Sur le plan international, le programme REACH a provoqué bien des préoccupations. Les entreprises européennes se disaient « disqualifiées » par une contrainte qui ne s'imposait pas à leurs concurrents américains ou japonais. Aujourd'hui, ce sont les Américains et les Japonais qui s'élèvent contre ce qu'ils jugent être un obstacle à l'importation de leurs produits. Mais le système REACH ne fait qu'anticiper sur une démarche appelée progressivement à se généraliser dans les autres pays, États-Unis et Japon compris. Durant les périodes intermédiaires, ce qui est autorisé chez les uns et interdit chez les autres fait l'objet d'obstacles aux échanges, et celui qui gagne le procès finit par imposer son point de vue aux autres. Le processus est long, mais il fonctionne... M. le Président : C'est effectivement un débat clé et qui s'imposera de plus en plus à l'avenir. On nous a laissé entendre que votre ministère serait plutôt favorable à la suppression du document unique prévu par le décret du 5 novembre 2001, alors qu'il participe à la prévention du risque professionnel. Nous aimerions également connaître votre point de vue sur la relation entre les entreprises et les médecins du travail, appelés à s'exprimer de plus en plus souvent au nom d'une collectivité sur ces questions de santé, parfois même à participer à des études, ce qui pose de plus en plus la question de l'évolution du lien contractuel entre l'entreprise et la médecine du travail. M. François LOOS : Nous n'avons trouvé aucune trace d'une demande du ministère de l'industrie tendant à supprimer le document unique. Peut-être certaines entreprises l'ont-elles cru ; je ne sais d'où vous tenez cela... M. le Président : Voilà qui est clair. M. François LOOS : Chaque fois qu'une exigence est justifiée et comprise, elle est utile. Sans doute des entreprises l'ont-elles jugée exagérée et n'y ont vu qu'une paperasserie supplémentaire, mais cela ne saurait constituer un argument. Lorsqu'il y a danger, ce n'est pas parce qu'il peut paraître pénible d'avoir à se protéger qu'il ne faut pas le faire. On ne peut faire l'impasse sur ce genre de choses. M. le Président : D'autant que le problème se complique du fait du temps de latence et de l'évolution des parcours professionnels, qui ne sont plus aussi linéaires qu'il y a vingt ou quarante ans. Quoiqu'il en soit, votre réponse est claire. M. François LOOS : S'agissant de la médecine du travail, je n'ai ni la compétence ni les lumières nécessaires pour vous répondre. J'ai conscience que le médecin du travail est dans une situation complexe, en même temps salarié, donc financièrement dépendant, et indépendant par le fait que ses responsabilités sont fixées par le code du travail et non par le chef d'entreprise. Cela ne me dérange pas pour autant et je ne pense pas que les entreprises se sentent troublées par cette situation tout à la fois dedans et dehors. D'autres professions sont confrontées à la même problématique : être rémunéré par l'entreprise mais avoir une obligation d'indépendance. Il en est ainsi pour les commissaires aux comptes, par exemple. Concernant le médecin du travail, il peut très bien servir de conseil auprès du chef d'entreprise et aider le CHSCT, le comité d'entreprise ou les syndicats dans leurs missions. Bien que n'ayant aucune compétence en la matière, je ne suis pas choqué par cette situation et je ne crois pas que les entreprises aient lieu de l'être. M. le Président : Sachez simplement que la question est posée et une réflexion engagée. M. François LOOS : Je crois connaître la position de Gérard Larcher : son indépendance est garantie par le code du travail et le lien avec l'entreprise est utile. M. Daniel PAUL : Entrera dans le cadre du programme REACH tout produit consommé raison de plus d'une tonne par an, avez-vous dit. Mais par rapport à quoi ? Où ? Dans le monde, en France, sur un site ? Certes, la médecine du travail est régie par le code du travail, mais on peut imaginer que se constituent, à défaut de dépendances, des relations entre le médecin du travail et les entreprises - certaines grosses entreprises ayant leur médecin - dont on peut imaginer les conséquences ; nous en avons tous des exemples. La question est pour le moins posée si nous voulons prendre en compte les nécessaires évolutions. Si l'entrepreneur a évidemment toujours son mot à dire, reconnaissons que c'est la santé des salariés qui prime avant tout et que ce principe peut parfois se heurter à des pratiques internes à l'entreprise. Enfin, croyez-vous que notre pays ait pu vendre à l'Iran de vieilles rames SNCF - des RTG Turbotrain, à croire ce courrier - au mépris des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, lequel interdit l'exportation, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de tout produit contenant de l'amiante65 ? Vous parliez de contrôle des importations ; la même logique vaut pour les exportations. La tentation peut être grande pour un pays comme le nôtre de vendre, céder, donner des matériels contenant de l'amiante à des pays à la législation moins stricte. Je ne doute pas que l'expérience que vous avez accumulée dans une vie antérieure vous permettra de répondre à cette question... M. François LOOS : Pour ce qui est des critères applicables aux produits soumis au système REACH, je vous renvoie à l'article 5 du projet de règlement REACH : « Sauf disposition contraire du présent règlement, tout fabriquant d'une substance en quantité de une tonne ou plus par an soumet à un enregistrement à l'agence. » Suit plus bas la même rédaction, applicable aux importateurs. Ce qui devrait concerner, pense-t-on, 30 000 produits. M. Daniel PAUL : C'est donc, en fait, le mode de calcul qui fait arriver à 30 000. M. François LOOS : Exactement, sur les quelque 100 000 produits que l'on soupçonne d'exister... On ne connaîtra le chiffre exact qu'au moment du démarrage. Sur la médecine du travail, je n'ai aucune compétence et je ne suis saisi d'aucune demande. L'important à mes yeux, pour une entreprise, reste d'être informée en temps utile et, dès que possible, des dangers que peuvent présenter un produit ou un procédé. C'est précisément le but du médecin du travail et de tous les contrats qui peuvent exister dans ce domaine, afin que les bonnes décisions soient prises en toute connaissance de cause. Pour la solidité de l'industrie française, je souhaite des industriels informés le plus tôt possibles et conscients des risques et de leurs responsabilités. Le médecin du travail joue un rôle clé dans cette affaire, mais il n'est pas le seul. Le chef d'entreprise lui-même, avant de mettre un œuvre un nouveau procédé, avant même le médecin, doit en connaître les risques et les dangers. La force de l'industrie dépend de l'état de ses connaissances et de sa capacité d'anticipation. De leur côté, l'État et singulièrement le ministère de l'industrie se doivent de donner de la visibilité à nos opérateurs afin qu'ils sachent que les textes existent, qu'ils s'appliquent et qu'ils seront appliqués. Pour le reste, je n'ai pas de demande spécifique concernant les médecins du travail. S'agissant de ces trains vendus à l'Iran, je n'ai aucune information. La France en a vendu l'année dernière pour un total de 350 milliards, et probablement 330 milliards en 2003. J'ai beau avoir été ministre du commerce extérieur à cette époque, je n'en ai jamais entendu parler. Est-ce possible ? Sûrement. Je ne sais pas. M. Daniel PAUL : J'ai reçu ce courrier hier. J'interrogerai le président de la SNCF et je vous ferai part de sa réponse. M. François LOOS : Ce serait la SNCF qui les aurait vendus ? M. Daniel PAUL : Probablement. Mais ce que je voudrais savoir, c'est s'il est possible à notre pays, compte tenu de sa législation, de vendre à un pays moins regardant du matériel dont il est avéré qu'il contient de l'amiante, alors même qu'un décret interdit l'exportation, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de tout produit en contenant - etje ne parle pas du Clemenceau... M. le Président : Je m'interroge sur la certification des formations dans le domaine de la sécurité au travail. Que pensez-vous de la qualité des systèmes d'accréditation des organismes formateurs en matière de sécurité et des normes ISO qui en forment le socle ? Plusieurs personnes travaillant sur les matières de substitution des fibres céramiques se sont esbaudies quand nous leur en avons parlé, n'y voyant qu'une tracasserie administrative totalement inutile. Avez-vous une petite idée là-dessus ? M. François LOOS : Un arrêté du 25 avril 2005 du ministère du travail rend obligatoire l'obtention d'un certificat pour toutes les entreprises participant aux opérations de désamiantage, ce qui conduit à vérifier la compétence des employés. Des normes professionnelles régissent la façon de faire ; le ministère de l'industrie n'intervient pas dans leur élaboration, mais dans la vérification de leur bonne application. Sitôt qu'une norme est délivrée par un organisme certifié - l'Association française de normalisation (AFNOR), par exemple -, celui-ci sera aussitôt contrôlé par le COFRAC66 qui vérifiera que l'AFNOR s'assure régulièrement de son respect et des procédures. Sur le plan tant français qu'européen et mondial, les normes fonctionnent selon des systèmes en cascade où chaque niveau supérieur vérifie la qualité du contrôle opéré par le niveau inférieur. Le COFRAC dépend du ministère de l'industrie ; son rôle n'est pas de fixer ni même de juger les normes, mais seulement de vérifier leur respect. Libre à une entreprise de considérer qu'elles sont inutiles, mais il ne m'appartient pas de me prononcer là-dessus. L'important est que les normes en question soient fixées et contrôlées par un organisme lui-même vérifié par le COFRAC qui est lui-même sous la tutelle de la Direction de la qualité et de la sécurité industrielle, dont le directeur est ici présent. M. le Président : Ce décret très récent ne concerne que les entreprises de désamiantage. M. François LOOS : Mais cette procédure vaut pour toutes les normes. M. Jean-Jacques DUMONT : Ce système d'accréditation a pour objet d'attester du sérieux des organismes chargés de certifier la conformité d'entreprises ou d'autres organismes à des normes données. La réglementation impose souvent aux organismes certificateurs agréés d'être accrédités par le COFRAC dans des domaines très variés, y compris celui des entreprises spécialisées dans le confinement et le désamiantage. M. le Président : Le fait est que les opérations de désamiantage sont soumises à des normes très sévères. Or celles-ci sont relativement récentes. Existe-t-il des dispositions équivalentes au plan international ? M. Jean-Jacques DUMONT : Cela dépend de quelles normes on parle... M. le Président : Je parle des normes spécifiques au désamiantage. M. François LOOS : Il y a une norme de formation et une norme d'exploitation ; ce n'est pas la même chose. M. Jean-Jacques DUMONT : Il s'agit de la norme NF X 46-010, autrement dit une norme française. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, par un abus de langage, une norme n'est généralement pas une prescription réglementaire, mais fondamentalement un système de communication commun à un certain nombre de parties prenantes, en général les entreprises et les utilisateurs à quelque titre que ce soit d'un produit ou d'une prestation donnée, qui disposent ainsi d'un référentiel commun. Il arrive que ce référentiel soit transformé en une obligation par le pouvoir réglementaire qui pourra exiger la conformité à telle norme. Mais la normalisation reste avant tout l'affaire des acteurs économiques qui élaborent des normes par consensus dans des comités de normalisation, sous l'égide de l'AFNOR en France, du CEN en Europe et de l'ISO au plan mondial, organismes certificateurs chargés d'une mission de service publique. M. le Président : C'est un problème important. Ce référentiel, établi par les entreprises elles-mêmes sous le contrôle de l'AFNOR, peut-il être complété par des obligations arrêtées par le pouvoir réglementaire ? M. Jean-Jacques DUMONT : Une norme a défini une série de bonnes pratiques en matière de désamiantage, sur lesquelles les parties prenantes se sont mises d'accord. Ensuite, le pouvoir réglementaire, en l'occurrence le ministre du travail, a obligé les prestataires de service de désamiantage à s'y conformer, ladite conformité devant faire l'objet d'une certification délivrée par un organisme accrédité COFRAC. M. le Président : Mais cette démarche nationale n'a pas eu d'équivalent au plan européen ni, a fortiori, au-delà. M. Jean-Jacques DUMONT : À ceci près que le COFRAC, en tant qu'organisme d'accréditation, agit en conformité avec une norme européenne qui définit la manière d'accréditer - mais cela n'est pas spécifique à l'amiante. M. François LOOS : Existe-t-il une DIN amiante à l'exemple de la NF X 46-010 ? M. Jean-Jacques DUMONT : Je vous ferai parvenir la réponse. M. Jean-Marie GEVEAUX : Ces normes régissent-elles la qualification des personnels des entreprises en question, au-delà de la méthodologie et des procédés techniques, qu'il s'agisse des salariés ou des employeurs ? M. Daniel PAUL : Les normes applicables aux entreprises de désamiantage valent-elles également pour les bureaux spécialisés dans la réalisation des diagnostics amiante ? M. le Président : Non. M. Daniel PAUL : Ce ne sont donc pas eux qui se chargeront du désamiantage. On nous a remis hier, dans mon conseil municipal, le diagnostic amiante de quelque 700 bâtiments municipaux, réalisé par deux entreprises de diagnostic dont j'ignorais jusqu'à l'existence. M. le Président : Elles n'ont pas de normes, à ma connaissance. M. Jean-Jacques DUMONT : Pas celles-là en tout cas. Je n'ai pas connaissance d'une norme applicable à cette catégorie. M. François LOOS : Si des normes peuvent être transformées en textes réglementaires, il arrive aussi que des obligations réglementaires deviennent des « normes » sans avoir fait l'objet d'un consensus entre industriels - à ceci près que cela s'appelle non pas une norme, mais un arrêté. C'est ce qui s'est produit pour l'amiante. En sens inverse, certaines obligations réglementaires peuvent tomber après concertation. Mais rien de tout cela ne relève du ministère de l'industrie qui se borne à vérifier que les normes mises en application par une entreprise sont bien contrôlées par l'organisme certificateur dont le sérieux est lui-même vérifié. Autrement dit, nous sommes la « grand-mère », deux niveaux au-dessus : le contenu même de la norme n'est pas édicté par nos services. M. Jean-Jacques DUMONT : Je précise que la norme applicable aux entreprises de désamiantage comprend bien un volet sur la qualification des personnels. Le contraire eût été inquiétant... M. François LOOS : Il serait bon de savoir s'il existe un équivalent dans les autres pays. Nous essaierons de vous procurer ces éléments, bien que cela ne relève pas de notre domaine. M. le Président : Nous vous en remercions. Cela nous ramène au programme REACH, d'une certaine manière. Si nous pouvions savoir ce qu'il en est au moins dans les pays limitrophes... N'avez-vous jamais eu vent de soucis ou de réflexions sur l'existence de normes européennes, monsieur le directeur ? M. Jean-Jacques DUMONT : Je n'ai pas eu connaissance de soucis à cet égard, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en existe pas, qui fonctionneraient sans pour autant créer de soucis... M. le Président : La réponse est habile... M. Jean-Jacques DUMONT : Je m'engage à vous faire parvenir une fiche répondant précisément à vos questions sur l'environnement international en matière de normalisation applicable à l'amiante. M. François LOOS : N'oublions pas que nous avons interdit l'amiante en France avant qu'il ne soit interdit en Europe. M. le Président : Le but est seulement de savoir si la question se pose dans d'autres pays. M. le Rapporteur : Nous nous préoccupons davantage aujourd'hui de produits issus de nouvelles technologies et de leur utilisation dans la vie quotidienne comme dans l'industrie. L'amiante est un produit naturel, à tel point qu'il affleure en certains endroits, comme un Nouvelle-Calédonie où des populations en ont été victimes. Existe-t-il d'autres produits naturels qui aient fait l'objet d'investigations ? M. Daniel PAUL : Le radium, l'uranium... M. François LOOS : Jusqu'aux champignons... On trouve bon nombre de produits toxiques dans la nature. M. Daniel PAUL : Et l'homme est le premier d'entre eux ! M. le Rapporteur : L'amiante a cette particularité d'avoir été utilisé massivement. Nous nous sommes surtout focalisés sur les produits issus des technologies chimiques, pétrolières et autres, mais il y a les produits nocifs naturels. M. François LOOS : L'idée qu'un produit naturel soit totalement sûr est effectivement parfaitement fausse. Nous vivons souvent dans un rousseauisme parfaitement obsolète et source de tous les malentendus. La philosophie du système REACH s'appliquera à bon nombre de substances naturelles, par exemple celles que l'on utilise dans la fabrication des parfums : qu'on le veuille ou non, ce sont aussi des produits chimiques, et le « vrai » produit chimique a souvent l'avantage d'être plus pur que son équivalent naturel composite ! L'opium est un produit parfaitement naturel, tout comme le cyanure... Même le sucre et le sel peuvent poser des problèmes si l'on en mange trop. M. le Président : Il ne nous reste plus qu'à remercier M. le ministre de cet échange très libre et très intéressant, et par avance M. le directeur des informations qu'il nous a promises. Audition de l'amiral Alain OUDOT DE DAINVILLE, Présidence de M. Jean LE GARREC, Président M. le Président : Nous accueillons aujourd'hui l'amiral Alain Oudot de Dainville, chef d'état-major de la marine, accompagné du capitaine de frégate Guy Dabas et du commandant Wilfried Troiville, afin de parler du désamiantage du Clemenceau. Le Rapporteur et moi-même avions écrit au Premier ministre le 17 janvier dernier pour obtenir des explications sur cette opération ; celui-ci nous a répondu par courrier le 23 janvier que le dossier avait été confié au ministère de la défense. Cette affaire nous préoccupe grandement, et à divers titres. C'est d'abord un problème international, qui a déjà donné lieu à des réactions du Parlement égyptien, du commissaire européen à l'environnement, d'organisations syndicales indiennes, sans préjuger de la décision finale de la Cour suprême de l'Inde. Il pèse en tout cas sur la qualité de l'image de la France ; à preuve, la quantité de pages que la presse lui consacre. Elle touche également à l'une des préoccupations essentielles de notre mission d'information : la gestion de l'amiante résiduel, l'état de la réglementation en la matière, le niveau de formation des entreprises spécialisées, etc. En se basant sur les tonnages d'amiante importé, on estime qu'il reste en France à peu près 80 kilos d'amiante par habitant ! Autant dire que l'attitude de l'État face à ce problème est très importante. Enfin, on ne saurait oublier que le Clemenceau n'est que l'arbre qui cache la forêt : des centaines de bateaux mais également des armements très divers - les chars notamment - attendent eux aussi d'être traités : l'amiante a été, on le sait, abondamment utilisé dans les matériels de défense. Amiral Alain OUDOT de DAINVILLE : Je commencerai par vous imposer un exposé assez long, mais le dossier est complexe et suffisamment important pour que l'on y consacre un peu de temps. Avant d'entrer dans le vif du sujet et d'aborder le cas précis de l'ex-Clemenceau, je voudrais évoquer la problématique générale de la déconstruction des bâtiments en fin de vie, ainsi que la façon dont la marine nationale traite le problème de l'amiante. La marine nationale sera confrontée, dans les prochaines années, au problème de la gestion des navires de guerre en fin de vie, construits avant 1995. Chaque année, plus de sept cents navires de commerce sont détruits dans le monde, en Asie pour la majorité d'entre eux. Ce chiffre devrait doubler d'ici à 2008 sous l'effet de l'interdiction des pétroliers à simple coque. Or aucun chantier en Europe ni a fortiori en France n'a actuellement la capacité de démanteler de grands bateaux de commerce ou de croisière ainsi que des bâtiments de guerre du tonnage de l'ex-Clemenceau. Actuellement, des milliers de bateaux rouillent dans les ports, dans des cimetières marins ou sont coulés dans les grands fonds marins. Des discussions internationales sont en cours pour définir un cadre juridique international adapté à la situation des navires en fin de vie, civils ou militaires, sous l'égide de l'Organisation maritime internationale (OMI), de l'Organisation internationale du travail (OIT) et de la Convention de Bâle. L'amiante a été largement utilisé dans la construction navale jusque dans les années quatre-vingt en raison de ses qualités d'isolant, de sa résistance au feu et de son incomparable polyvalence. En revanche, les bâtiments construits depuis 1996 - vedettes de gendarmerie, SNLE67 le Vigilant - ne contiennent plus que de l'amiante piégé, auquel le personnel n'est pas exposé directement, et dans des volumes de plus en plus faibles. Par la suite, l'amiante a été peu à peu remplacé par des produits de substitution. Ainsi, les frégates de la classe « La Fayette », les dernières admises au service actif, ne contiennent quasiment plus d'amiante (moins de 5 kg), et le bâtiment hydrographique Beautemps Beaupré, par garantie du constructeur, n'en contient pas. Aucun bâtiment en construction n'en contient désormais. La présence historique de l'amiante dans la construction navale ne permet pas de l'éradiquer totalement aujourd'hui sans éliminer la quasi-totalité de la flotte. Mais la marine est très sensibilisée au problème de l'amiante et soucieuse de la protection de son personnel et des ouvriers des industries de la réparation navale. Pour garantir la sécurité de ses équipages et des ouvriers qui interviennent à bord de ses bâtiments, la marine applique sans restriction la réglementation de droit commun qui découle des décrets et arrêtés de 1996, 1998 et 2000, déclinés et synthétisés dans un document de référence à l'usage de nos marins : l'instruction n° 102 DEF/EMM/HSCT du 25 janvier 2001. Consciente de cet enjeu, la marine nationale dispose d'un laboratoire de mesures unique au sein du ministère de la défense, qu'elle a fait agréer par le ministère de la santé, pour le comptage des poussières d'amiante. La marine nationale applique l'ensemble des mesures prévues par la réglementation générale qui traite à la fois de la protection de la population, c'est-à-dire des équipages, et de la protection des personnels appelés à intervenir sur des installations contenant de l'amiante. Après ces considérations générales sur la déconstruction et sur le problème de l'amiante dans la marine, j'en viens au cas particulier du dossier dit Q 790, autrement dit du porte-avions Clemenceau. La construction du Clemenceau a commencé en 1954. Admis au service actif en 1961, il a parcouru cinquante fois le tour du monde ; on estime que vingt mille marins ont servi à son bord. Retiré du service en 1997, il a été aussitôt placé en réserve spéciale. Sa « condamnation » ayant été prononcée par le ministre de la défense le 16 décembre 2002, le Clemenceau a, comme le veut la tradition, été débaptisé et la coque Q 790 a été remise à la Direction nationale des interventions domaniales (DNID) afin d'être vendue par voie d'appel d'offres, pour être démantelée. La DNID lance un appel d'offre européen en avril 2003 et retient à l'issue l'offre la mieux disante, présentée par la société espagnole Gijonesa de Desguaces, qui prévoit un désamiantage et une démolition en Espagne. Mais, en violation du contrat, la coque Q 790 se dirige vers la Turquie. À la demande de la DNID, nous l'avons interceptée et, après discussions, ramenée à Toulon le 6 décembre 2003. Le 23 juin 2004, la DNID passe un nouveau contrat avec le consortium Ship Decomissioning Industries Corporation (SDI) administré par Eckhart Marine GmbH, à l'époque filiale du groupe Thyssen. Le dossier de démantèlement du Q 790, ex-Clemenceau constitue sans conteste une avancée concrète dans le traitement des navires en fin de vie qui est un problème mondial. Ce projet est un véritable dossier pilote fondé sur une démarche innovante et exemplaire, soucieuse de la maîtrise des processus industriels et respectueuse de la protection des travailleurs et de l'environnement. En effet, par le contrat signé par la DNID avec la consortium SDI, l'État a exigé que : - la France reste propriétaire de la coque jusqu'à son démantèlement ; - tout le désamiantage techniquement réalisable en France y soit effectué ; - le chantier choisi en Inde pour le démantèlement ait des certifications internationales en matière de protection des travailleurs et de l'environnement ; - un transfert de compétences soit assuré vers le chantier en Inde ; - l'encadrement du chantier de désamiantage résiduel et de démantèlement en Inde soit assuré par des ingénieurs français ; - le contrôle du chantier soit garanti par un expert indépendant qui certifiera le retrait des pièces amiantées dans le respect de la réglementation européenne. Jamais aucun navire, tant de commerce que de guerre, n'avait jusqu'à aujourd'hui été partiellement désamianté pour en retirer l'amiante friable, le plus dangereux, directement accessible avant son démantèlement. Les navires de commerce sont généralement vendus à des chantiers de démantèlement sans qu'aucune disposition ne soit prise vis-à-vis de l'amiante. La démarche entreprise pour le dossier Q 790 apparaît d'autant plus novatrice que le tonnage (environ 25 000 tonnes) n'a d'égale que la complexité de la tâche. Pour pallier l'absence de chantiers adaptés en Europe, tout en restant le plus « vertueux » possible, le projet a prévu un désamiantage en deux phases. La première, réalisable en France, a été effectuée par des sociétés spécialisées à Toulon et a permis de retirer l'amiante friable directement accessible. Elle a été limitée dans son ampleur par le fait que la structure du navire devait rester suffisamment intègre pour autoriser un remorquage de longue durée - sans couler - et le franchissement du Canal de Suez. La totalité de l'amiante friable directement visible et accessible a été enlevée. Les déchets amiantés ont été traités conformément à la circulaire du ministère de l'écologie et du développement durable du 19 juillet 1996 qui précise, en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996, les filières d'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de l'amiante dans les bâtiments, et transférés au site d'enfouissement technique de Bellegarde (Gard). La surveillance des travaux a été exercée conjointement par la Caisse régionale d'assurance maladie de la région PACA et par le contrôle général des armées, en charge de l'inspection du travail dans les établissements militaires. Ces organismes, compétents pour vérifier l'application de la réglementation hygiène sécurité et conditions du travail, pouvaient intervenir dans 1'enceinte militaire à tout moment et sans aucun préavis. Le bon accomplissement de cette phase a été vérifié par des expertises réalisées par des organismes indépendants : ITGA (Institut technique des gaz et de l'air), IS Services (Institut de soudure) et ISODIAG, une société d'expertise enregistrée au Havre. On peut noter à cette occasion que, commencé par la société Technopure, le désamiantage a été achevé en septembre 2005 par une autre société, Prestocid, qui a en outre procédé à l'encapsulage - mise sous plastique - de certaines parties aimantées difficilement accessibles. En effet, le contrat passé par l'État prévoyait que l'achèvement du chantier toulonnais serait contrôlé par un expert indépendant ; ce dernier ayant constaté que Technopure, premier sous-traitant de SDI, n'avait pas terminé correctement le chantier, SDI l'a confié à une deuxième entreprise, Prestocid. Celle-ci a terminé les travaux début septembre 2005 et l'expert indépendant a reconnu la conformité aux exigences du contrat. La deuxième phase du désamiantage sera réalisée en Inde par le chantier Luthra Group, durant l'opération de démantèlement. Un deuxième cocontractant indien de SDI, l'entreprise Shree Ram Vessels, est chargé du démantèlement proprement dit. Ces deux entreprises ont toutes les qualifications requises ; j'y reviendrai plus loin. Pour la phase de désamiantage, le chantier fournira la main-d'œuvre pendant que les SDI et Prestocid assureront l'encadrement et le contrôle qualité. Ainsi, Prestocid enverra en Inde son ingénieur qualité. Tout le matériel de protection individuelle des ouvriers indiens sera fourni par SDI et Prestocid. Le système de ventilation sera apporté de France. SDI fera appliquer les règles françaises du droit de travail sur l'amiante. Ces conditions sont précisées dans l'arrangement technique entre les partenaires. De plus, pour s'assurer plus rigoureusement de la conformité de l'action en Inde, l'État français reste propriétaire de la coque tant que le désamiantage et la démolition - on désigne sous ce terme l'ensemble des opérations visant à rendre la coque inutilisable - ne sont pas achevés. Ce qui me permet d'affirmer devant vous que l'opération de désamiantage et de démantèlement de l'ex-Clemenceau, telle qu'elle a été élaborée à l'occasion de ce contrat, est une première. Pourtant, les détracteurs du projet ne manquent pas et déploient une énergie notable pour le faire échouer en se fondant sur des éléments juridiques et techniques. Entre autres arguments juridiques, les opposants au projet font valoir l'applicabilité de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, d'une part, et l'existence d'une infraction à cette Convention, d'autre part. La Convention de Bâle n'est pas applicable, en l'occurrence, dans la mesure où ses stipulations écartent de son champ d'application les matières relevant de la souveraineté nationale et confirment notamment les immunités souveraines reconnues par le droit international aux navires de guerre ou aux navires d'État. Le droit international applicable au démantèlement des navires reste en grande partie à écrire. Si un groupe de travail au sein des instances de la Convention de Bâle est parvenu en octobre 2003, à la conclusion « qu'un navire peut devenir un déchet, conformément à l'article 2 de la Convention de Bâle, tout en restant un navire en vertu d'autres règlements internationaux », c'est pour constater les contradictions et les impasses auxquelles menaient ces réflexions. C'est la raison pour laquelle la Convention de Bâle, l'Organisation internationale du travail et l'Organisation maritime internationale ont approuvé la constitution et le mandat d'un groupe de travail sur le recyclage des navires. Réuni pour la deuxième fois le 15 décembre dernier, ce groupe de travail conjoint a conclu à la nécessité de rédiger un nouvel instrument juridique contraignant. Greenpeace International a d'ailleurs admis la nécessité « de remédier aux lacunes et aux décalages identifiés dans la Convention de Bâle ». Un projet de traité devrait être présenté d'ici à 2009. Dans ce cadre, une proposition a été préparée par la Norvège, sous le titre de « Convention internationale relative à la sécurité et à la bonne gestion environnementale du recyclage des navires ». L'article 3 de ce projet précise que la Convention en question ne s'appliquera pas aux « navires appartenant aux États ou exploités par eux, et utilisés exclusivement pour un service non commercial, notamment les navires de guerre. » En attendant un instrument juridique contraignant applicable aux navires, la conférence des parties à la Convention de Bâle, l'Organisation maritime internationale et l'Organisation internationale du travail ont chacune publié des recommandations pour le démantèlement des navires. Les opérations de désamiantage et de démantèlement du Clemenceau, telles qu'elles ont été réalisées à Toulon tout comme celles qui seront conduites en Inde, sont conformes à ces recommandations. On remarquera d'ailleurs que l'Inde, partie à la Convention de Bâle, considère qu'un navire à démanteler n'est pas un déchet dangereux, comme l'a indiqué le ministre de l'environnement indien qui, interrogé par le gouvernement danois en 2005, a autorisé l'importation d'un navire amianté en vue de son démantèlement - en l'occurrence le ferry Kong Frederik IX, rebaptisé « Riky » pour l'occasion, propriété d'une société danoise de droit privé. L'Inde a fait valoir sa capacité à s'assurer que le recyclage des éléments du navire s'effectue dans les conditions environnementales les plus appropriées, conformément au droit international et à son droit interne. Il convient, par ailleurs, de rappeler que la Convention de Bâle n'a pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne des États parties. Elle ne crée que des obligations entre les États parties à la Convention. C'est donc à ces États de mettre en œuvre, dans leur droit interne, les obligations issues de la Convention. Le juge français l'a rappelé récemment à l'occasion de l'affaire du navire marchand Sea Beirut (Tribunal administratif de Lille, 10 février 2005). Aux termes du droit français, le Clemenceau reste un matériel de guerre. En effet, en application de l'article L. 2331-1 du Code de la Défense et de son décret d'application du 6 mai 1995, « les navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs d'aéronefs » appartiennent à la deuxième catégorie des matériels de guerre : matériels destinés à porter ou utiliser au combat les armes à feu. Du reste, l'utilisation de ce bâtiment en tant que matériel de guerre est toujours possible. L'ex-Clemenceau conserve ses caractéristiques techniques lui permettant d'être utilisé à des fins militaires. Il peut être remorqué et son pont d'envol au blindage renforcé lui permet d'accueillir des aéronefs de toute nature et des hélicoptères militaires. À tel point que, il y a dix ans, l'état-major de la marine avait été interrogé sur la possible vente du Clemenceau à une grande puissance asiatique qui comptait le désosser pour le copier et accéder à la technologie des porte-avions... C'est donc fort logiquement que l'arrêté du 20 novembre 1991 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'autorisation d'exportation s'applique en particulier aux catapultes, dispositifs d'arrêt et dispositifs de manutention d'aéronefs embarqués, toujours à bord du Clemenceau. C'est bien parce qu'il est matériel de guerre que le Clemenceau a été soumis à un régime particulier d'exportation. Il a fait l'objet d'un examen préalable par la commission interministérielle d'étude d'exportation des matériels de guerre et c'est le ministère chargé des douanes qui a délivré l'autorisation d'exportation. Qui plus est, ce matériel de guerre n'entre pas dans le champ d'application de la Convention de Bâle qui ne couvre que les déchets dangereux destinés à être éliminés. La convention définit le terme déchet comme étant « des substances ou objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit national ». Or la nature particulière du Clemenceau, considéré comme un matériel de guerre au sens de la législation du pays d'exportation, la France, fait que l'État français n'a pas l'intention de l'éliminer puisqu'il deviendra, après désamiantage et démantèlement, de l'acier, lequel sera ensuite cédé à l'issue d'un processus de valorisation et non d'élimination. Il ne constitue pas, au sens de la Convention, un déchet dans la mesure où l'on peut considérer qu'il ne sera à aucun moment éliminé, mais bel et bien transformé. Au vu de ces éléments, le Tribunal administratif de Paris, saisi en référé d'une demande en suspension de la décision autorisant le départ de l'ex-Clemenceau, a considéré qu'il n'y avait pas de doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Examinons maintenant la question de la qualité du chantier indien : je vous ai apporté une série de photos que je vous invite à examiner. Dans le contrat de désamiantage et de démolition de la coque Q 790 signé avec le consortium SDI, la DNID a retenu le chantier indien de déconstruction de navires Shree Ram Vessels et Luthra Group, société indienne de dépollution, spécialisée dans le traitement de déchets dangereux incluant l'amiante. Le projet Q 790 s'attache au strict respect des règles en matière d'environnement, d'hygiène et de sécurité du travail sur le chantier indien comme cela a été le cas sur le chantier toulonnais. Le chantier naval Shree Ram Vessels et la société Luthra Group sont certifiés ISO 9001/2000, ISO 14001 et OHSAS 18001. La certification ISO 9001/2000 est une certification qualité des travaux effectués ; elle signifie que la société a mis en place un système permettant d'identifier les dysfonctionnements et garantit à ses clients que le travail est exécuté de manière contrôlée. La certification ISO 14001 est, quant à elle, liée au système de « management environnemental » (SME), lequel fournit à une entreprise un processus structuré (procédures, consignes, etc.) en vue d'obtenir une amélioration continue de sa performance environnementale. Enfin, la certification OHSAS 18001 est une norme anglaise relative à la sécurité et à la santé des travailleurs, attestant que des processus de contrôle et d'amélioration dans ces domaines sont mis en place. Dans l'esprit de ces certifications, le chantier indien de déconstruction nous a déjà fait parvenir un plan de management industriel spécifique à l'opération « ex-Clemenceau » qui montre le sérieux de sa méthodologie. Par ailleurs, les opérations de désamiantage en Inde seront suivies par plusieurs experts français. Des ingénieurs des sociétés SDI et Prestocid assureront le contrôle effectif des opérations de désamiantage durant toute la durée des travaux. Un expert européen habilité choisi par l'État français, sur proposition de la société SDI, sera mandaté. Il aura pour mission de faire rapport périodique à l'État propriétaire et de certifier le désamiantage dans le respect de la réglementation européenne en vigueur. Dans le processus retenu par l'État français, il importe aussi de souligner le transfert de technologie qui accompagne le projet, dont un volet est consacré à la formation, l'autre constitué de l'envoi de matériels, aux normes françaises, qui permettront aux ouvriers indiens d'œuvrer dans le respect des normes techniques françaises. C'est ainsi qu'en février 2005, cinq cadres indiens des groupes Shree Ram et Luthra Group qui seront les responsables techniques des chantiers indiens sont venus à Mulhouse passer des examens de qualification identiques à ceux des intervenants français. À l'issue de ce contrôle de compétences, opéré par la société JMA Environnement, des attestations de capacité en qualité de responsable technique de chantier d'amiante friable leur ont été délivrées. Ils ont poursuivi leur formation à Toulon sur l'ex-Clemenceau en août 2005 afin de se familiariser avec les technologies et équipement utilisés sur place. Ces cinq ingénieurs, en collaboration avec les personnels de SDI et Prestocid, assureront la conduite des opérations et l'encadrement du chantier en Inde qui devrait mobiliser environ soixante ouvriers. Parmi les équipements individuels et collectifs qui seront expédiés depuis la France vers Alang avant l'arrivée de la coque Q 790, citons : - des unités déprimogènes multi-vitesse à démarrage automatique sur chute de dépression avec leurs matériels consommables, - des clapets d'entrées d'air additionnelles, - des unités de chauffe et de filtration avec leurs matériels consommables, - des générateurs de fumées pour tester l'étanchéité, - des masques à adduction d'air avec tuyaux et bloc de raccordement en zone, - des masques à ventilation assistée, - des sas « personnel » et « déchets », - des équipements de protection individuelle, comme les tenues et les masques nécessaires à la protection des équipes d'ouvriers. Il s'agit d'un véritable transfert de technologie et de savoir-faire qui garantira que les conditions de sécurité des personnels répondent aux critères du droit français en vigueur. Les chantiers retenus par SDI, et pour lequel l'État français a donné son accord, présentent donc les garanties nécessaires et le processus de déconstruction sera réalisé sous contrôle. Le chantier de déconstruction a été visité à deux reprises par des officiels français. Ces visites ont confirmé qu'il est conforme à ce que l'on est en droit d'attendre d'une société affichant de telles qualifications. L'attention des visiteurs a été particulièrement marquée par l'ampleur des investissements dédiés à l'instruction et à la protection des travailleurs. Enfin, en réponse au récent rapport publié par Greenpeace et la Fédération internationale des droits de l'homme, qui décrit les conditions déplorables des chantiers de la baie d'Alang, rappelons qu'il existe dans la baie d'Alang plus de cent cinquante chantiers différents qui s'étendent sur plus de dix kilomètres de côtes. Les niveaux techniques, de protection des travailleurs, d'hygiène et de sécurité des uns et des autres y sont extrêmement variables. Très rares sont les entreprises capables de présenter autant de garanties que les cocontractants de SDI. Venons-en maintenant à l'état de la coque Q 790 à son départ de Toulon. L'objectif fixé était de retirer un maximum de produits toxiques ou dangereux avant son démantèlement, sans casser la structure. Ces opérations ont été conduites à Toulon par des sociétés spécialisées, contrôlées par des organismes d'experts indépendants. Pour ce qui concerne les matières et sources ionisantes, on comptait à bord 1 161 plaquettes électroluminescentes de signalisation renfermant du tritium, seule matière de ce type subsistant à bord. Elles ont toutes été enlevées et remises le 7 février 2005 au service de surveillance radiologique. Pour ce qui concerne la présence éventuelle de polychlorobiphényle, ce matériau (PCB/pyralène) n'entre pas dans la composition des transformateurs électriques présents à bord qui, comme tous ceux de la marine nationale, sont de type « sec ». De même, les peintures et les joints ne contiennent pas de PCB. Ce produit n'apparaît pas non plus dans les spécifications des câbles utilisés à la construction du bâtiment. La totalité des soutes ayant contenu des hydrocarbures avaient été lessivées et dégazées entre octobre 1997 et janvier 1998. À l'issue, toutes ces soutes ont été remplies d'eau douce. Pour ce qui concerne l'amiante, à partir de l'étude conduite sur plans en 2003, et compte tenu de la difficulté du processus il a été retenu une valeur initiale de 220 tonnes de matières amiantées de laquelle a été soustraite par la suite, lors d'une expertise complémentaire, la masse d'isolants de la cheminée, constituée en quasi-totalité non pas d'amiante, mais de 60 tonnes de laine de verre. Ce qui laisse une masse estimée résiduelle de 160 tonnes de produits amiantés. Le désamiantage majeur, qui a représenté plus de 50 000 heures de travail sur le chantier et deux années d'ingénierie, avait pour but de retirer tous les produits amiantés friables et directement accessibles sans travaux de découpe ou de déconstruction portant atteinte à l'intégrité du navire. Les produits friables non accessibles ont été encapsulés à l'issue du chantier. Le désamiantage a été conduit en dix tranches et certifié par deux instituts indépendants (ISODIAG et Institut de Soudure). Deux zones, incomplètement traitées par la société Technopure ont été refusées et ont fait l'objet de travaux complémentaires de la société Prestocid. La quantité de déchets amiantés retirés a été évaluée, au vu des « bordereaux départ » du bâtiment signés par la société Technopure, à 115 tonnes. La teneur de ces matériaux d'isolation en amiante pur est très variable, de plus de 80 % pour certains, proches des chaudières, à moins de 1 % pour d'autres. Ces produits sont présents dans l'isolation sous forme de flocage et d'amiante-ciment projeté sur des cloisons, et de fine toile amiantée recouvrant des matelas de fibre de verre. Les locaux attenants aux conduits de fumée sont ainsi protégés par moins de 1,2 tonne de toile amiantée. Des produits de même nature - films et ciment amiantés pour un poids évalué à environ 25 tonnes - sont également présents dans les vases clos des chaudières de production de vapeur, qu'il faut déconstruire pour en assurer la récupération. Certains câbles électriques sont partiellement recouverts d'une fine pellicule amiantée dans les zones soumises à de fortes températures. Le poids total de cette isolation spécifique est estimé à 1,5 tonne. Les revêtements de sol d'origine ont été remplacés par des matériaux qui, à partir de 1982, ne comportaient plus d'amiante incorporé. Les contrôles effectués en 2004 sur les dalles de sol ont confirmé l'absence d'amiante dans ces matériaux. Enfin, les peintures amiantées n'ont pas été utilisées à bord du bâtiment ; la peinture des fonds est à base d'aluminium. Le recueil exhaustif des procès-verbaux du désamiantage réalisé à Toulon et validé par les deux sociétés de certification indépendantes est détaillé local par local, photos à l'appui. Il sera remis au chantier indien de déconstruction ainsi que les plans d'origine du bâtiment qui précisent la localisation et la nature des isolations. Cet ensemble de documents constitue une cartographie détaillée des produits amiantés qui permettra aux industriels indiens de mettre en place une ingénierie adaptée. Pour être le plus complet possible, il faut noter que si les bordereaux retour du centre d'enfouissement sont en cohérence avec les estimations « départ de chantier » de la société Prestocid, il n'en est pas de même pour les mouvements organisés par la société Technopure. Une enquête est en cours pour expliquer les différences constatées. Enfin, les produits contenant de l'amiante sont parfaitement localisés dans le navire et les plans précis permettent un désamiantage comme un démantèlement rigoureux. Un plan de localisation de l'amiante à bord de la coque Q 790 a été remis aux autorités indiennes. La situation à bord de la coque Q 790 est donc loin de ressembler à l'apocalypse décrite par certaines associations écologistes. Je ne conteste pas leur bonne foi, mais je leur reproche de se fonder sur les seuls éléments apportés par la société Technopure, évincée par SDI après des contrôles qualité insuffisants. Elle-même précisait dans un mémoire du mois de mars 2005 : « Il est impossible de déterminer les quantités exactes d'amiante présentes à bord ». Appréciation, réitérée par M. Giannino, PDG de Technopure, devant le TGI de Versailles en janvier 2006 (ordonnance de référé du 11 janvier 2006). Et le même Giannino déclarait dans une interview au quotidien Le Parisien, en date du 22 janvier dernier, vouloir créer sa propre filière de déconstruction au Bangladesh ! Mesdames et messieurs les députés, vous vous interrogez naturellement sur les alternatives, envisageables et réalistes, au choix fait par l'État français pour la déconstruction de la coque de l'ex-Clemenceau. Deux familles de possibilités peuvent être envisagées : l'utilisation de la coque comme cible dans le respect des normes environnementales ou la déconstruction dans un autre chantier. L'utilisation de coques comme cibles est permise à titre d'exception par les diverses conventions internationales relatives aux immersions dans la mesure où il ne s'agit pas d'immersion mais d'« un dépôt sur le fond à des fins autres que la simple élimination » et dans la mesure où l'opération n'est pas incompatible avec lesdites conventions. Nous n'avons pas retenu cette solution. Le droit nous aurait permis de le faire, mais nous avons estimé que cela ne serait pas convenable. M. le Président : Très bien ! Acte vous en soit donné. Amiral Alain OUDOT de DAINVILLE : Cette solution n'a pas été retenue initialement dans le cas de l'ex-Clemenceau pour des raisons techniques liées à la spécificité de sa coque qui comporte un pont et des compartiments machines blindés qui n'auraient pas pu permettre de garantir qu'elle coule dans des conditions satisfaisantes de sécurité, sauf à déployer des moyens techniques considérables. Certaines associations avaient, à une période, évoqué l'utilisation de la coque en tant que récif artificiel, arguant du fait que cela permettait de conserver un exemple significatif de l'architecture navale militaire à la disposition d'un public de plongeurs, par nature restreint. Cette solution qui implique une immersion par faible profondeur est susceptible d'engager une responsabilité permanente de l'État en cas d'accident de plongée. En tout état de cause, elle nécessiterait une étude d'impact approfondie et vraisemblablement une surveillance écologique de la zone ; elle a donc été écartée. En outre, il ressort de la récente modification du code de l'environnement que si le représentant de l'État en mer peut encore autoriser l'immersion de navires dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur, au titre de l'article L. 218-44, cette possibilité ne vise plus que l'immersion de navires impliqués dans des activités illicites saisis par l'État dans les zones non couvertes par la Convention OSPAR et la Convention de Barcelone - autrement dit, pour nous, outre-mer. Il ne restait donc plus que la solution de la déconstruction de la coque dans un autre chantier. Le marché de la démolition des navires est actuellement concentré à 90 % dans le Sud asiatique, et plus précisément en Inde, au Pakistan, au Bangladesh ainsi qu'en Chine. Le Japon, la Corée du sud et Taiwan se sont retirés du marché de la démolition depuis plusieurs années. Des organisations non gouvernementales s'inquiètent des conditions d'hygiène et de sécurité du travail sur les chantiers de déconstruction, mais sans faire de distinction entre les chantiers ; et les images diffusées par les médias ne reflètent pas toujours la réalité du moment. Ainsi, les images d'archives de Thalassa diffusées sur les écrans de télévision ces dernières semaines datent, à ma connaissance, de 1992 et n'ont plus rien à voir avec le chantier avec lequel SDI a contracté. Il n'existe pas actuellement d'alternative crédible en Europe ni aux États-Unis pour des navires de cette taille. La Maritime Administration (MARAD) américaine, chargée de vendre les navires appartenant à l'État, estime qu'il ne reste que quatre entreprises capables de démolir des navires aux États-Unis dans des conditions satisfaisantes. Elle a été contrainte par l'ampleur de la tâche à rechercher d'autres entreprises à l'étranger. Quatre navires de l'US Navy ont ainsi été envoyés au Royaume-Uni en novembre 2003 pour démolition au chantier Able UK à Hartlepool. Les travaux sont stoppés depuis 2003 du fait d'actions judiciaires d'associations écologistes contestant la qualification du chantier pour cette activité. L'agence de l'environnement britannique, qui avait initialement autorisé le chantier à démanteler les bâtiments, a reconsidéré sa position. Celui-ci n'a pas réussi à obtenir les certifications nécessaires des autorités britanniques et les quatre navires sont toujours bloqués à Hartlepool. Une frégate de la Royal Navy a été immergée au large de la Cornouaille en tant que récif artificiel en mars 2004. Sur trente-neuf sociétés consultées en 2004 pour la déconstruction d'un bâtiment amphibie, le HMS Intrepid, neuf offres seulement ont été présentées, dont six de sociétés basées au Royaume-Uni. Aucune n'a été jugée satisfaisante au regard des critères de protection de l'environnement. Le navire attend toujours à Portsmouth que l'on statue sur son sort. Le gouvernement des Pays-Bas qui avait confié la démolition du navire-citerne Sandrien battant pavillon bolivien à un chantier d'Amsterdam, n'a pu à ce jour mener à bien cette opération, le chantier choisi ayant fait faillite en mai 2005 après n'avoir pu démolir que la moitié du navire. Le ministère de l'environnement néerlandais recherche toujours une entreprise capable d'achever l'opération... En France, malgré quelques offres informelles, au sérieux contestable, aucun chantier n'a aujourd'hui l'expérience de la démolition navale pour un navire d'une telle taille. Et quoi qu'il en soit, cela supposerait une infrastructure importante, l'acceptation locale d'une telle activité et enfin des coûts très conséquents. Au-delà de la difficulté à identifier un autre chantier potentiellement capable de déconstruire une coque de cette taille dans de bonnes conditions ailleurs qu'en Asie, il est essentiel de noter que cette solution se heurterait à l'absence d'une filière d'écoulement des produits issus de la démolition des navires en Europe ou aux États-Unis. Les prix des métaux de récupération dans ces pays sont en effet de l'ordre du tiers de ceux pratiqués couramment sur les marchés asiatiques où la demande est forte. En résumé, si la solution de démantèlement à l'étranger devait être remise en cause, seule une déconstruction dans une filière française ou européenne, aujourd'hui inexistante et donc à créer ab initio, serait susceptible de répondre au besoin. Le coût d'une telle déconstruction avait été évalué, il y a trois ans, à un minimum de 45 millions d'euros. Cette évaluation semble aujourd'hui largement sous-estimée. L'exemple britannique témoigne d'ailleurs que l'acceptabilité de ce genre d'activité par l'opinion est limitée. La situation actuelle montre bien que, abstraction faite de la solution retenue par la France, qui est certes une première mais qui est susceptible de s'étendre et de déboucher sur un partenariat équilibré et respectueux, aucune alternative ne semble à la portée d'un seul pays. Or cette problématique vaut non seulement pour les bâtiments militaires, mais aussi pour tous les navires civils de tous les pays disposant d'une activité maritime, soit environ 700 navires par an à recycler actuellement, et peut-être le double dans un proche avenir, du fait de l'élimination des pétroliers à simple coque. L'ampleur des moyens techniques et financiers à mettre en place, mais également des filières économiques à concevoir et à mettre en œuvre, milite pour que l'Union européenne se saisisse de ce dossier. C'est uniquement à son échelle, et grâce aux moyens communautaires que l'Union pourrait décider d'y consacrer, que l'on peut imaginer voir un jour une industrie de déconstruction occidentale se mettre en place. Mesdames et messieurs les députés, je voudrais en conclusion souligner à nouveau le caractère vertueux de la démarche initiée en France par le processus de démantèlement imaginé pour la coque de l'ex- Clemenceau, malgré les difficultés et les critiques. Du reste, certains observateurs éclairés de l'environnement et du monde maritime ne s'y sont pas trompés et soutiennent cette démarche. L'association Robin des Bois, qui d'ordinaire nous met plutôt en difficulté, a écrit dans un communiqué paru mi-janvier : « Les groupes écologistes et la presse se ruent sur le Clemenceau et y prospèrent, sans prendre en compte la valeur positive et exceptionnelle de son désamiantage volontaire et de l'ensemble des dispositions prises en Inde par les industriels soucieux d'améliorer la filière de démantèlement des navires et du recyclage des métaux ». L'association prône même de mettre en avant la procédure suivie pour la coque de l'ex- Clemenceau afin d'obliger tous les armateurs européens à en faire autant et d'éviter le spectre de l'abandon de navires hors d'usage et bruts de pollution. De même, dans son édition du 3 février l'hebdomadaire Le Marin, référence du monde maritime français, cite les propos des responsables de la société GMS, un des principaux acteurs du marché de la démolition de navires outre-Atlantique : « le travail qui a été réalisé pour nettoyer le navire avant son arrivée, la programmation d'autres travaux sur le site de démolition, sont l'exemple de ce qui devrait toujours être fait. Mais les critiques ont pris ce bateau pour cible, alors qu'il est l'exemple de ce qu'il faut faire ». M. le Président : Amiral, vous avez parlé de vertu : croyez bien que les parlementaires ne sont jamais juges de la vertu... Vous pouvez être rassuré sur ce point. En revanche, ils se doivent d'avoir l'esprit critique et, en tant que militaire, vous ne m'en voudrez pas d'employer un langage un peu rude. Ma première remarque sera un regret. Votre exposé était précis et intéressant. Je sais que l'armée est « la Grande Muette », mais si vous aviez mieux communiqué au bon moment, peut-être aurions-nous avancé un peu plus vite ! Nous avons eu en permanence l'impression, sinon la certitude, sur un problème d'une ampleur considérable qui appellera effectivement demain une réponse européenne, de vous arracher les réponses une à une - tel jour sur la formation des ingénieurs, dont on a bien voulu me donner des certificats, tel autre jour sur le rapatriement des déchets, tel autre jour sur autre chose ! Cette image désastreuse, c'est vous qui l'avez créée et c'est cela que je vous reproche. On sait combien il est difficile de corriger une image par la suite. Quant aux réponses du Premier ministre comme du ministère de la défense, elles tombaient en général toujours à côté de nos questions. Cela n'arrange pas les choses. J'ai lu attentivement la réponse qu'a faite votre ministre hier à une sénatrice : « Dans cette affaire où l'intérêt personnel guide nombre d'interventions... » Si elle m'avait dit cela, je puis vous assurer que cela ne se serait pas très bien passé ! Aucun d'entre nous n'a d'intérêt personnel dans cette affaire, si ce n'est le respect que nous y apportons et la gravité que nous y attachons. Sans oublier les conséquences sur l'image de notre pays et de notre marine... Lorsqu'un problème est difficile, il faut le poser dans toute sa difficulté et voir comment trouver des solutions, y compris à l'échelle européenne. Deuxième remarque : nous n'avons jamais pu savoir ce qu'il y avait dans ce bateau. Quarante-cinq tonnes d'amiante friable, admettons. Mais il y a l'amiante lié - « piégé », comme vous dites. Le mot est assez juste... Vous-même avez dit que l'amiante friable qui ne pouvait être atteint a été confiné ! Reste qu'à la première découpe au chalumeau - opération la plus dangereuse qui soit -, il se dégagera inévitablement des poussières. Votre amiante piégé ou confiné ne le restera pas... S'il y avait eu au départ, comme c'est obligatoire, une expertise par des entreprises dûment formées sur la situation de l'amiante - sans même parler de la présence ou non de PCB -, nous ne serions pas restés en permanence dans ce flou. Vous avez traité l'amiante friable, et certainement dans de bonnes conditions. Reste l'amiante non friable que vous avez confiné, et qui sera déconfiné. Ce serait un miracle qu'il n'y ait pas de l'amiante « piégé » un peu partout, à voir ce que l'on retrouve dans les constructions. Le mot est du reste tout à fait approprié : il s'agit bel et bien d'un « piège », où les fibres n'attendent que d'être expulsées avec les poussières. On nous dit qu'un suivi médical des opérateurs indiens sera mis en place, avec un examen au début du chantier, un autre à la fin, puis un autre un an après. Parfait ! Je suis tout à fait pour le suivi médical et la santé des salariés à ceci près qu'en matière d'amiante, ce qui a été prévu ne sert à rien. Le délai entre l'exposition à l'amiante et l'apparition des premiers symptômes de la maladie est extraordinairement long et vous le savez parfaitement. On n'a pas le droit de nous dire que c'est une réponse au problème de l'amiante, ou alors on se moque de nous et ce n'est pas acceptable. Pardonnez-moi, mais dans la marine, on ne tourne pas autour du cap. On dit les choses carrément... C'est tellement vrai que plus de 50 % des Français sont contre l'opération. Cela prouve bien que quelque chose n'a pas fonctionné quelque part ! Je ne m'engagerai pas dans une discussion juridique sur la question de savoir si le Clemenceau est encore ou non un navire de guerre. Mais le dossier m'intéresserait si j'étais avocat spécialisé en droit maritime... Pour moi, passionné de la marine du XVIIIème siècle, le Clemenceau est une épave. Oser me soutenir qu'il pourrait redevenir un navire de guerre... In abstracto, passe encore, mais dans la réalité, bigre ! Il n'a plus de moteurs, ni même toutes ses hélices, puisqu'une s'est retrouvée sur le Charles de Gaulle,... Amiral Alain OUDOT de DAINVILLE : On peut lui en remettre une... M. le Président : ...ni de transmission et le safran est soudé ! Au demeurant, s'il n'était pas une épave, on ne le traînerait pas au bout d'un filin... Tout cela crée un formidable sentiment de confusion. Je reconnais volontiers que votre texte est précis et intéressant et que vous nous révélez enfin des choses que l'on aurait dû nous apprendre depuis longtemps au lieu de nous traiter avec dérision ou à tout le moins une certaine désinvolture. Or c'est précisément ce qu'un parlementaire aime le moins, et qu'un président de mission d'information ne saurait accepter. Nous ne sommes pas tout à fait des imbéciles. S'il y avait eu un travail d'explication clair, nous aurions pu discuter : sur le fait que les cent chantiers concentrés sur les dix kilomètres de côte de la baie d'Alang ne soient pas tous comparables et que certaines images diffusées renvoient à une période ancienne et à d'autres chantiers, je suis prêt à vous croire. M. Daniel PAUL : De la même manière que les photos distribuées par l'amiral peuvent avoir été prises dans un endroit très particulier du chantier, non significatif de l'ensemble... M. le Président : Tout à fait. La réalité est certainement beaucoup plus complexe. La découpe d'une coque de 23 000 tonnes est l'opération la plus dangereuse qui soit sur le plan de la contamination et vous le savez comme moi. On connaît les entreprises de désamiantage et toutes les normes ISO n'y changeront rien. Deux heures de travail, deux heures en sas de décontamination, destruction des vêtements, etc. : la procédure est d'une incroyable rigueur, elle nous a été présentée. Je ne doute pas un instant de votre bonne foi, mais j'hésite quelque peu à croire que votre opération de désamiantage en Inde se fera dans le respect de normes aussi contraignantes que celles que l'on a pu voir à la tour Montparnasse et ailleurs. Voilà, amiral, avec la plus grande franchise, ce que je souhaitais vous dire. Votre texte est utile, mais certaines questions demeurent. Nous aurions bien été aidés si elles avaient été traitées avant et d'une manière plus précise. M. le Rapporteur : L'intervention de l'amiral Alain Oudot de Dainville était indispensable. Nous n'avions entendu sur ce sujet que l'argumentation de Ban Asbestos ; il était pour le moins nécessaire d'entendre toutes les parties. Nous avions cru un moment que Mme Alliot-Marie viendrait devant nous... Amiral, vous avez le courage d'être ici et de nous présenter tout le travail réalisé avec vos collaborateurs sur l'ensemble de l'opération. Votre exposé extrêmement riche va jusqu'à évoquer tous les aspects juridiques de cette aventure depuis ses tout débuts, de même que les autres possibilités alternatives envisagées qui, peu à peu, se sont fermées et ont conduit à prendre cette décision - décision des domaines, en l'occurrence, de vendre un bâtiment de l'État. Ce texte, qui contient toutes les références juridiques et réglementaires, sera intégré dans la deuxième partie de notre rapport, qui rassemble en plusieurs centaines de pages le compte rendu de nos travaux. Votre lecture de la convention de Bâle, si elle n'est pas forcément partagée par tout le monde, n'en est pas moins intéressante et votre prestation a également le mérite de poser le problème de l'avenir, c'est-à-dire des sept cents navires qui attendent d'être démolis, en invitant les vingt-cinq pays de l'Union à réfléchir à la gestion de ce dossier énorme. Je signale, en tant que député de Cherbourg, que la marine - et c'est tout à son honneur - a choisi de traiter totalement à part le cas des sous-marins nucléaires et d'en gérer le sort pour des années - et même des décennies pour ce qui concerne les réacteurs. Dans cette affaire où l'on va sans cesse de Bercy à l'Hôtel de Brienne en passant par la rue Royale, il n'est pas inintéressant de voir comment les uns et les autres assument le problème difficile de la déconstruction des navires : la marine en tout cas a pris ses responsabilités pour ce qui est de ses SNA68 et SNLE dont elle s'occupera jusqu'au bout, y compris lorsqu'ils seront coupés en rondelles, sachant que cet acier ne pourra être ni immergé, pour des raisons environnementales, ni cédé en raison de son caractère stratégique. Le Clemenceau était un bâtiment de surface non nucléaire ; le problème est qu'il contient de l'amiante à son bord comme tous les navires de sa génération. La contribution de l'amiral Alain Oudot de Dainville enrichit en tout cas notre rapport... M. le Président : Incontestablement. M. le Rapporteur : ...du fait de sa très grande précision sur le plan tant juridique que financier. M. Bonnemains lui-même, président de Robin des Bois, association écologiste et antinucléaire des plus virulentes, reconnaît les efforts que les services de la marine ont déployés pour gérer au mieux une situation où les possibilités d'alternatives étaient des plus réduites, en tenant compte d'un encadrement juridique et de contraintes que Bercy ne manque jamais de rappeler. Vous avez, amiral, très justement posé le problème : la France et l'Europe seront très rapidement confrontées au délicat problème d'un accroissement des navires à démanteler, compte tenu de la suppression des pétroliers et chimiquiers à simple coque. De surcroît, le changement culturel vis-à-vis de l'environnement est tel que la solution consistant à les couler purement et simplement apparaît d'une autre époque et totalement impossible. Dès lors, force est de gérer au mieux cette situation, dans le respect des prescriptions environnementales adoptées par les parlementaires nationaux et européens, et de trouver une solution. Reconnaissons - mais la responsabilité de la marine n'est plus en cause - qu'il eût été souhaitable de réfléchir au plus haut niveau sur les conséquences politiques et médiatiques de cette affaire, sachant à quel point le climat était tendu à propos de l'amiante depuis deux ans. D'un autre côté, en tant que président de la commission de surveillance d'un grand site nucléaire, j'ai quelques doutes quant à l'objectivité de certaines associations. M. le Président : Une fois de plus, nous sommes d'accord... J'ai seulement, en toute franchise, regretté que l'amiral ne soit pas venu plus tôt et que la communication n'ait pas, jusqu'à présent, été aussi claire. Nous n'aurions pas été forcément d'accord, mais au moins aurions-nous su de quoi l'on parlait. C'est d'autant plus dommage qu'il ne sera pas aisé de redresser la barre. Quant à l'idée de créer une filière de déconstruction technologiquement pointue à l'échelle européenne, j'en suis à 100 % d'accord. M. Jean-Marie GEVEAUX : On ne peut qu'être d'accord. M. le Président : Totalement. Et, au-delà des bateaux, tous les matériels de guerre sont concernés. L'amiral voudra bien excuser la vivacité de mes propos,... Amiral Alain OUDOT de DAINVILLE : Au moins, on se comprend ! La marine est certes mouillée dans cette affaire, mais elle n'est pas la seule. Certains aspects dépassent largement le cadre du seul ministère de la défense. Le ministère des finances est concerné au premier chef, via les domaines et les douanes, de même que le ministère des affaires étrangères - nos ambassadeurs sont très actifs sur ce dossier, sans oublier celui de l'écologie et du développement durable. Vous avez critiqué l'absence d'un bilan amiante, mais il est très difficile de se faire une vision exhaustive. Nous avons fait venir nombre d'experts à bord, mais on ne peut travailler utilement que sur papier. Il existe beaucoup d'endroits où l'on ne peut aller. On ne peut estimer les quantités qu'en allant chercher les plans qui, du reste, sont restés chez le constructeur après le changement de statut de DCN. Nous avons une estimation relativement précise des masses initiales d'amiante : on sait, par exemple, qu'il y en a cinquante tonnes sur les calorifugeages des collecteurs de vapeur - l'amiante avait été principalement utilisé pour se protéger de la chaleur -, quarante tonnes sur les collecteurs incendie, vingt-cinq tonnes sur les vases clos, quinze tonnes pour le calorifugeage des structures des chaudières, dix tonnes sur les isolants de structure, une tonne sur les joints, six tonnes sur le matelas des fosses catapultes, qui dégageaient beaucoup de chaleur, dix tonnes sur les protections des gaines de ventilation diverses dans les endroits chauds, une tonne et demie sur les films amiantés qui protégeaient les câbles électriques passant dans les chaudières et les machines, une tonne de toile amiantée à proximité de la cheminée et une demie tonne sur le sol amianté d'usines particulières d'oxygène et d'azote situées à l'arrière du bateau. Autant d'éléments que nous connaissons précisément, avec un plan où toutes les zones amiantées sont répertoriées. S'agissant des conditions d'exécution de l'opération, notre objectif, vérifié par un expert européen et sous contrôle d'ingénieurs français, est de conduire ce chantier de désamiantage de l'amiante résiduel en Inde, mais conformément aux normes et modes d'action français. Nous envoyons tout le matériel qui permettra de confiner les hommes et d'empêcher que l'amiante ne file à l'extérieur au moment du découpage. Tous les équipements seront sur place, et en quantité suffisante afin de pouvoir en changer fréquemment. Des sas « personnel » et « déchets » seront mis en place. Le but est de respecter les normes françaises. Enfin, sans revenir sur la convention de Bâle, signalons que l'Inde a racheté à la Russie le porte-avions Admiral Gorchkov qui avait brûlé69 et qu'elle est en train de le remettre en état pour l'utiliser ! Je ne vous donne qu'un exemple. M. le Rapporteur : Vous évoquez dans le détail le déroulement prévu du chantier et l'ensemble des normes garantissant un désamiantage correct - tenues, masques, etc. Connaissez-vous - à moins que ce ne soit Bercy - le prix que coûtera le chantier en Inde ? M. le Président : Nous pouvons vous aider, pour ce qui est de Bercy... Nous savons approximativement le prix de vente de la coque. Nous commençons à connaître le prix de passage de l'Égypte... M. Daniel Paul : Autrement dit, les différents frais... M. le Président : L'Inde aurait, semble-t-il, exigé une caution très importante. Amiral Alain OUDOT de DAINVILLE : C'est ce que dit Libération. M. le Président : C'est pourquoi je reste prudent. Amiral Alain OUDOT de DAINVILLE : Il est fait allusion à la délibération d'un sous-comité alors que l'avis devrait être rendu par une commission de la Cour suprême indienne. J'ai essayé d'avoir confirmation de cette information de Libération, mais rien ne permet pour l'instant de la confirmer ni de l'infirmer. Deux contrats ont été passés. Dans le premier, la coque avait été vendue au prix de 272 223 euros. La caution qu'avait versée la Gijonesa de Desguaces a permis de payer les frais de remorquage lorsque nous avons rompu le contrat - autrement dit, la première opération a été blanche. La deuxième fois, la coque a été vendue 100 000 euros à la société SDI. L'objectif est que SDI supporte tous les autres frais et se paie avec la vente de l'acier. C'est elle qui a réglé le prix du passage du canal de Suez - au tarif normal, 1,3 million de dollars, majoré de 200 000 dollars -, de même que celui des équipements dont je vous ai donné la liste. Le prix de vente des 25 000 tonnes d'acier du Clemenceau, au cours actuel, est estimé à 8 millions d'euros (300 dollars la tonne). M. le Président : Et vous ne l'avez vendu que 100 000 euros ? Amiral Alain OUDOT de DAINVILLE : Pas moi, la DNID... À la SDI de se débrouiller pour tirer le meilleur profit de la vente de l'acier, mais après avoir payé les quelques millions de désamiantage à Technopure et Prestocid, le passage du canal et les frais de remorquage. M. le Président : Et supporté le coût d'un désamiantage aux normes françaises stricto sensu. Amiral Alain OUDOT de DAINVILLE : Comme prévu dans le contrat, ainsi que de tout le matériel que je vous ai cité. M. Patrick ROY : Je partage le jugement du président sur la mauvaise communication dont a fait l'objet ce dossier, dont j'ai moi-même fait l'expérience. Désireux de savoir si le Clemenceau entrait ou non dans le cadre de la convention de Bâle, j'ai téléphoné le 17 janvier dernier au ministère pour avoir la liste de nos navires de guerre. Je suis tombé sur une charmante secrétaire qui, après m'avoir promis de me la faxer, m'a renvoyé quelques heures plus tard à un capitaine qui, de la même façon, m'a renvoyé au major général qui finalement me l'a promise, mais en me prévenant que la décision devait attendre la signature du ministre ! Nous sommes aujourd'hui le 8 février et j'attends toujours... Amiral Alain OUDOT de DAINVILLE : La voilà... M. le Président : Bien joué, amiral ! M. Patrick ROY : Je vous remercie. Je ne sais ce que j'y trouverai, mais je devine ce qui s'est passé : un député demande la liste, on se renseigne, on voit qu'il est membre de la mission amiante... Je ne suis pas naïf ! Reste que le procédé laisse planer un doute. Cela dit, même si je ne suis pas militaire, j'ai une vague idée de ce que doit être un navire de guerre. Et s'il devait y avoir un conflit demain, j'espère que ce n'est pas le Clemenceau que l'on mettra en première ligne ! Je suis assez d'accord avec vous sur la fiabilité de certains documents de presse ou télévisuels. La presse en France est libre et c'est fort heureux, mais on a toujours intérêt à aller vérifier que les photos correspondent à la réalité... Je suis prêt à croire que celles que l'on nous a montrées ne retracent pas l'exacte réalité d'aujourd'hui. Reste qu'en France même, si certains chantiers de désamiantage - ainsi celui d'Europe 1 par SOBATEN, que nous avons visité - sont à tous égards exemplaires, de nombreux témoignages prouvent que ce n'est pas toujours le cas. Qu'en sera-t-il sur votre chantier indien ? Vous dites avoir pris toutes les assurances et je ne demande qu'à vous croire. Mais si nous avons déjà du mal à faire respecter les textes français en France, je suppose que, plus loin, ce pourrait être encore plus difficile... Sur un sujet aussi délicat et hautement symbolique, nous aurions eu besoin de parfaitement communiquer. M. Daniel PAUL : Je rejoins l'appréciation du Président : l'expérience de La Hague et de la COGEMA montre que l'on a toujours intérêt sur ces questions de précéder la demande plutôt que de s'enfermer dans le silence. J'ai eu l'occasion de le rappeler au président de la COGEMA en des termes aussi vifs que ceux de Jean Le Garrec à l'instant. Dommage de venir si tard... Je suis également d'accord avec lui sur le suivi médical prévu par le contrat ; un an après, c'est une plaisanterie... Mieux vaudrait que Mme la ministre ou toute autorité française évite d'utiliser pareil argument : n'importe quelle victime de l'amiante lui répondra qu'elle a été contaminée voilà trente ans, et que sa maladie apparaît seulement aujourd'hui. C'est dans vingt ou trente ans qu'il faudrait juger des conséquences de ce qui pourra se passer dans ce chantier ! Ensuite, qu'est-ce qu'un déchet ? À vous entendre, il n'y a plus de déchets... J'ai reçu voilà quelques jours d'une entreprise une écharpe bien chaude, accompagnée d'une carte expliquant qu'elle avait été fabriquée avec cinq bouteilles de plastique. C'est très bien ; or, jusqu'à preuve du contraire, une bouteille en plastique, c'est un déchet, et tous les déchets sont désormais destinés à être récupérés d'une manière ou d'une autre. Ne resteront que les déchets dits « ultimes ». On envisage même d'utiliser l'amiante vitrifié dans les fondations des ouvrages de travaux publics. Se pose encore le cas des déchets nucléaires appelés, dans l'attente d'une décision définitive, à être enfouis sous terre ou ailleurs, une fois la décision prise par le législateur. Votre acception du terme « déchet » me semble bizarrement restrictive. Pour moi, ainsi que je l'ai écrit au Premier ministre, l'ex-Clemenceau, devenu Q 790, n'est plus une épave, mais bien un déchet. Quant à l'idée qu'il puisse être réarmé ou à tout le moins réutilisé pour servir à la défense nationale lors d'un conflit, elle témoigne cette fois d'une extension surprenante de la signification du mot - au demeurant, plus personne n'y croit. L'objectif était d'échapper à la convention de Bâle ; et je suppose que si celle-ci a prévu cette éventualité, c'est bien que tous les pays signataires se retrouvaient confrontés à la même difficulté ! Lorsque la France a vendu une première fois le Clemenceau à une société espagnole, celle-ci avait-elle l'intention de le déconstruire en Espagne ? Amiral Alain OUDOT de DAINVILLE : Oui. M. Daniel PAUL : C'est donc qu'il y existe des chantiers de déconstruction, et des entreprises capables de le faire aux normes espagnoles, qui doivent être conformes aux normes européennes. Autrement dit, il existerait d'ores et déjà une filière en Europe, dans un pays voisin et de surcroît maritime - je sais bien qu'un pavillon luxembourgeois flotte désormais sur les mers, ainsi qu'un pavillon suisse, et pas seulement sur le lac Léman, mais je ne suis pas sûr que la République tchèque ou la Slovaquie aient une flotte... Contentons-nous des pays ayant une côte ! De même en Grande-Bretagne, à Hartlepool notamment, on trouve des possibilités de déconstruction, qu'il serait intéressant de développer. Et si les Anglais semblent se heurter à des difficultés d'ordre environnemental - nous en avons aussi dans le Cotentin -, ce ne semble pas être le cas en Espagne, puisqu'il était prévu d'y envoyer le Clemenceau. Même si je ne doute pas de la qualité des contrôles et des ingénieurs que nous enverrons en Inde, je reste moi aussi très sceptique. On sait déjà que, dans un pays comme la France, pays développé, en pointe dans cette affaire, un des trente-sept signataires de l'interdiction totale de l'amiante, deux entreprises de désamiantage sur trois ne sont pas en règle. Qu'en sera-t-il en Inde ? J'y suis allé il y a trois ans, non pas à Alang, mais dans un autre endroit où l'on déconstruit des pétroliers. C'est proprement infâme, et parfaitement conforme aux images de Thalassa - et les miennes ne datent pas de 1992, mais bien de 2002 ! Je ne sais si le chantier dont vous avez parlé ressemble à vos photos ou à l'émission de Thalassa ; toujours est-il que j'ai plus que des doutes, ne serait-ce qu'à voir ce qui se passe en France dans les entreprises de diagnostic et de désamiantage. La société chargée du désamiantage sera fatalement obligée de « rabioter » sur quelque chose, d'autant qu'à vous entendre détailler le coût de toutes les opérations, je ne suis pas sûr qu'il lui en restera suffisamment pour rentrer dans ses frais. Ainsi que l'a rappelé le rapporteur, notre pays s'est montré exemplaire en montant à Cherbourg, et pour ses sous-marins nucléaires, une filière de production, de maintenance, de sécurité tout au long de la vie des bâtiments, et finalement de stockage de ces engins non seulement en raison du caractère stratégique de leur acier, mais surtout parce qu'on ne peut se permettre de les envoyer n'importe où. De la même façon, à quelques kilomètres de là, au cap de La Hague, on a su, à propos de matériaux encore plus dangereux que l'amiante, mettre en place une filière de formation, de maintien de l'excellence des personnels et de traitement des déchets nucléaires qui fait de la France le pays le plus avancé du monde dans ce domaine. Vous nous avez parlé de 700 navires à déconstruire par an, et probablement encore plus dans les années qui viennent. Sans doute y trouvera-t-on progressivement moins d'amiante ; reste qu'il y a là un marché, et qui deviendra obligatoire compte tenu des normes environnementales. Voilà pourquoi je suis partisan de la mise en place d'une filière de déconstruction en France, voire en Europe s'il n'était pas possible de faire autrement. M. Jean-Marie GEVEAUX : Sur le fond, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit : cette dramatique affaire du Clemenceau n'a pas été très bonne pour l'image de la France. Il ne pouvait s'agir d'un déchet, avez-vous dit, dans la mesure où il ne devait pas être détruit, mais transformé... La formule mérite explication. De même sur le fait que l'amiante serait en voie de disparition sur nos navires depuis 1996 : ou bien il est purement et simplement interdit depuis 1997, comme je le croyais, ou bien il a été maintenu, fût-ce sous sa forme « piégée », sans pour autant être dangereux, il faut en tout cas l'espérer, pour ceux qui servaient à bord de ces navires. Enfin, je rejoins mes collègues sur le fait qu'un suivi médical un an ou deux ans plus tard n'a guère de sens. Mais le Clemenceau a été construit en 1954 et mis en service en 1961 ; 20 000 marins ont navigué à son bord. A-t-on décelé chez eux des cas de maladies liées à l'amiante ? Eux aussi ont besoin d'un suivi médical... M. le Président : Très bonne question ! M. Gérard BAPT : La même question pourrait se poser pour les sous-marins. Je remarque que la société espagnole qui avait acheté l'ex-Clemenceau devait le déconstruire en Espagne, mais l'a dirigé vers la Turquie. Quel est l'état des éventuels sites de déconstruction en Espagne ? Notre mission n'aurait-elle pas intérêt à s'y rendre, de même qu'en Inde, pour répondre à toutes ces interrogations mieux qu'à partir de photos ou de reportages télévisés ? Ma seconde remarque a trait à la transparence. À croire l'article de Libération paru ce matin, un arrêté de la Cour suprême indienne imposerait à tout propriétaire de navire de fournir un inventaire des produits toxiques à bord, un document que la France n'a jamais fourni ni à la justice française ni à la Cour suprême. Et l'article de conclure : « Il serait plus simple de mettre fin à cette imprécision en fournissant l'inventaire des produits toxiques de la vieille coque ». Considérez-vous que la liste que vous nous avez lue tout à l'heure dans votre exposé correspond à cet inventaire ? M. le Président : Notre mission est soumise à des contraintes d'organisation qui ne permettront pas de faire le déplacement que vous souhaitez. Mais il existe un groupe d'étude, présidé par Jean Lemière, qui pourrait se charger de ce travail. Ce serait effectivement utile, cela concerne de nombreux bateaux et nous aurions ainsi l'occasion de vous revoir. M. Paul a posé, à très juste titre, la question de l'équilibre financier de l'opération. Après avoir fait le calcul de tous les frais, remorquage, découpe, etc., j'ai quelque doute sur le solde qui restera à la société si elle garantit effectivement un désamiantage dans des conditions techniques optimums. Il serait souhaitable, amiral, que vous examiniez ce solde. Au fur et à mesure que je vous entendais égrener les chiffres, je me demandais ce qui allait rester au bout du compte, sachant que cette affaire n'a pas été montée par simple philanthropie, mais pour gagner de l'argent. Amiral Alain OUDOT de DAINVILLE : Commençons par la notion de déchet. L'argument de la transformation n'est somme toute qu'accessoire. L'argument principal reste celui du matériel de guerre. Le code de la défense prévoit que certains matériels ne peuvent pas être exportés sans autorisation ; et chaque fois que nous avons fait valoir le statut du matériel de guerre devant le juge administratif, nous avons eu gain de cause. Mais c'est là un débat d'experts juridiques dans lequel je ne veux pas entrer. En passant le premier contrat, la DNID avait estimé que l'Espagne était une solution viable. Mais le navire n'est jamais allé en Espagne et nous considérons que ce pays n'a pas les capacités pour désamianter et démanteler un tel bâtiment. C'est donc un « tuyau crevé », pour parler trivialement. M. Gérard BAPT : Et la Turquie ? Amiral Alain OUDOT de DAINVILLE : La Turquie a refusé de prendre en charge l'ex-Clemenceau, et dans la foulée, la Grèce a fait de même. M. Daniel PAUL : Autrement dit, les domaines ont vendu le navire sans vérifier que l'Espagne n'était pas un tuyau crevé, pour reprendre votre expression ? Amiral Alain OUDOT de DAINVILLE : C'est ainsi que je l'interprète... mais je ne peux pas répondre à la place des domaines. N'oublions pas que nous étions en 2003 : la pression de l'actualité et l'état de nos connaissances n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. En Grande-Bretagne, la filière s'est également arrêtée en 2003. En France, à ma connaissance, la dernière société de déconstruction travaillait en Normandie, jusque dans les années 1994. Elle avait fait le principal de son chiffre d'affaire en démantelant du matériel du débarquement, à une époque où la législation sur l'amiante était très différente. Nous estimons toujours qu'il n'y a pas de solution européenne crédible en l'état actuel des choses ; d'où ma suggestion de saisir la Commission. Quant aux difficultés de faire appliquer les règles sur l'amiante, elles sont vraies partout. Le chantier conduit à Toulon par Prestocid a été conforme aux normes et vérifié par des experts indépendants. Le principe de toute l'architecture du contrat que nous avons passé est de transférer cette technologie à l'Inde. Nous essayons de prendre toutes les garanties possibles avec des experts indépendants pour surveiller, contrôler, conseiller. Nous avons formé des ingénieurs. Rappelons enfin que ce chantier ne concerne qu'une soixantaine d'ouvriers et non mille personnes comme le dit parfois la presse. Réussirons-nous ce transfert de technologie ? On peut évidemment en douter. Cela nécessitera, à l'évidence, un contrôle. Il n'est pas question de rester ici en se bouchant les yeux - je partage à cet égard votre point de vue. L'équilibre financier de l'opération me paraît effectivement précaire - n'y voyez qu'une estimation personnelle. Je crois toutefois que la société cherche à créer une filière pour ensuite la rentabiliser. M. le Président : Amiral, je veux vous remercier. Entre la défense, les domaines et le budget, votre tâche n'est pas facile. Votre exposé figurera naturellement au compte rendu de nos travaux. Il montrera que l'on commence à y voir plus clair ; c'est le souci de la mission, mais également le vôtre. Cela dit, des questions demeurent ouvertes, et vous les avez très clairement posées, sur la faisabilité d'une chaîne technologique en France ou en Europe, sur l'équilibre financier de l'opération et sur son contrôle permanent. La mission formulera, sans doute à cet égard, une recommandation, que le groupe d'étude présidé par Jean Lemière aura à cœur de suivre, et qui viendra en soutien de la démarche que nous venons d'effectuer ensemble. Je regrette seulement que celle-ci ait été si tardive. M. le Rapporteur : Mon collègue Geveaux avait posé la question du suivi médical des marins du Clemenceau... Amiral Alain OUDOT de DAINVILLE : Je pensais que l'amiral Albert, qui est déjà venu devant votre mission, vous avait répondu sur ce point. Nous sommes en tout cas très sensibilisés à la question du suivi médical du personnel de la marine - au sens large, ouvriers de DCN inclus. La majorité des cas de maladies liées à l'amiante se retrouve dans cette population : huit cents cas ont été recensés au total. Nous sommes très attentifs à cette affaire. N'importe qui peut venir consulter et, au moindre doute, nous ouvrons un dossier de maladie « amiante ». M. le Président : L'amiral Albert ne nous avait pas parlé du cas du Clemenceau. Amiral Alain OUDOT de DAINVILLE : Nous ne distinguons pas entre bateaux. M. le Rapporteur : Nous arrivons aux derniers mètres de notre mission : la conférence de presse aura lieu le 23 février, le vote sur le rapport le 22. Les trente et un députés membres de la mission consulteront le rapport à partir du 15. Le compte rendu de notre échange vous sera très rapidement soumis afin que vous nous fassiez part au plus vite de vos éventuelles observations. Amiral Alain OUDOT de DAINVILLE : Je comprends votre préoccupation. Vous les aurez en temps utile. M. le Président : Amiral, nous vous remercions. Auditions du Président et du Rapporteur (par ordre chronologique) - Audition de représentants de la CGPME : M. Jean-François VEYSSET, vice-président chargé des affaires sociales, M. Georges TISSIÉ, directeur des affaires sociales et M. Pierre THILLAUD, directeur de l'Association médicale interentreprises (16 novembre 2005) - Audition de représentants de la confédération CFDT : M. Dominique OLIVIER, responsable risques professionnels de la santé au travail et Mme Laurence THERY, secrétaire confédérale, chargée de la santé au travail (16 novembre 2005) - Audition de représentants de la confédération CGT : M. Serge DUFOUR, conseiller confédéral de l'activité santé au travail, M. Gilles SEITZ, médecin du travail, et M. Jean BELLIER, expert santé au travail (16 novembre 2005) - Audition de représentants du MEDEF : M. Jean-René BUISSON, président de la commission de la protection sociale et Mme Véronique CAZALS, directrice de la protection sociale (16 novembre 2005) - Audition de M. Bernard SALENGRO, délégué national au pôle protection sociale de la CFE-CGC (22 novembre 2005) - Audition de M. Marcel SUSZWALAK, président de l'APDA (Association portuaire de défense des victimes de l'amiante)- CGT (23 novembre 2005) - Audition de M. André HOGUET, représentant de la CFTC (23 novembre 2005) - Audition de représentants de l'Association européenne représentant l'Industrie des laines d'isolation haute température (ECFIA) : M. Philippe CLASS, directeur santé, sécurité et environnement de Thermal Ceramics et M. André COUYRAS, Unifrax (25 janvier 2006) - Audition de représentantes du CAPER (Comité amiante prévenir et réparer) du Puy-de-Dôme : Mmes Josette ROUDAIRE, Marie-Jeanne OUTURQUIN et Brigitte PECHAR Programme du déplacement à Bruxelles - Jeudi 1er décembre 2005 A 10 h00 : Représentants de la Commission européenne : M. Stéphane Brion, administrateur à la Direction général Entreprises et Industrie M. Stephen Pickering, administrateur à la Direction général Entreprises et Industrie A 11 h 15 : Représentants de la Commission européenne : M. Philippe Brunet, directeur-adjoint du cabinet de M. Markos Kyprianou, Commissaire européen à la santé et la protection des consommateurs Mme Gigliola Fontanesi, administratrice à la Direction générale Santé et protection des consommateurs A 13 h 00 : Déjeuner de travail avec M. Charles-Henri Levaillant, conseiller en charge de l'industrie et Mme Nathalie Nikitenko, conseillère adjointe en charge de la protection sociale, de l'exclusion, de la santé et de la sécurité au travail à la Représentation permanente de la France auprès de l'Union . A 15 h 00 : Représentants de la Commission européenne : Mme Odile Quintin, directrice générale de l'emploi et des affaires sociales M. Bernhard Jansen, directeur de l'adaptabilité, du dialogue social et des droits sociaux à la Direction générale de l'emploi et des affaires sociales M. Francisco Jesús Alvarez, administrateur à la Direction générale de l'emploi et des affaires sociales A 16 h 30 : Représentants de la Commission européenne : M. Alexandre Paquot, administrateur à la Direction générale de l'environnement Mme Anna Karamat, administratrice à la Direction générale de l'environnement - Vendredi 2 décembre 2005 A 10 h 30 : M. Alain Destexhe, sénateur fédéral de Belgique A 11 h 45 : Mme Muriel Gerkens, députée fédérale de Belgique Mme Marie-Christine Lahaye, membre du cabinet de Mme Evelyne Huytebroeck, ministre de l'environnement de la Région bruxelloise Marie-Anne Mengeot, journaliste retraitée à la télévision RTBF, représentante de l'ABEVA Mme Vandenbroucke, représentante de l'ABEVA A 15 h 00 : M. Laurent Vogel, responsable de l'Observatoire syndical de l'application des directives européennes au sein du département santé-sécurité de l'Institut syndical européen pour la recherche, la formation et la santé-sécurité ACAATA Allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ADEME Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ADEVA Association départementale des victimes de l'amiante AFNOR Association française de normalisation AFSSA Agence française de sécurité sanitaire des aliments AFSSE Agence française de sécurité sanitaire environnementale AFSSET Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ALERT Association pour l'étude des risques au travail ANACT Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ANDEVA Association nationale de défense des victimes de l'amiante ANDRA Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ANR Agence nationale de la recherche ANRU Agence nationale de la rénovation urbaine AP-HP Assistance publique - Hôpitaux de Paris APL Aide personnalisée au logement ARACT Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail ARDEVA Association régionale de défense des victimes de l'amiante AT-MP Accidents du travail - maladies professionnelles AVAQ Association des victimes de l'amiante du Québec BERPC Bureau d'évaluation des risques des produits et agents chimiques BIT Bureau international du travail BPCO Broncho-pneumopathie chronique obstructive BRDP Brigade de répression de la délinquance contre la personne BRGM Bureau de recherche géologique et minière BSDA Bordereau de suivi de déchets amiantés BTP Bâtiment et travaux publics CACES Certificat d'aptitude à conduire en sécurité CANAM Caisse d'assurance maladie des professions indépendantes CAPEB Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment CAPER Comité amiante prévenir et réparer CATMP Commission accidents du travail et maladies professionnelles CCMSA Caisses centrales de la mutualité sociale agricole CEA Commissariat à l'énergie atomique CEC Contrat emploi consolidé CERPAT Centre d'études et de recherche pour la prévention des accidents du travail CES Confédération européenne des syndicats CGPC Conseil général des ponts et chaussées CGSS Caisses générales de sécurité sociale CHSCT Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail CHU Centre hospitalier universitaire CIRC Centre international de recherche sur le cancer CIVI Commission d'indemnisation des victimes d'infractions CJCE Cour de justice des communautés européennes CMI Certificat médical initial CMR Cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction CMU Couverture maladie universelle CNAMTS Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés CNAV Caisse nationale d'assurance vieillesse CNEVA Centre national d'études vétérinaires et alimentaires CNPP Centre national de prévention et de protection CNRS Centre national de recherche scientifique COFRAC Comité français d'accréditation COG Convention d'objectif et de gestion COV Composés organiques volatiles CPA Comité permanent amiante CPAM Caisse primaire d'assurance maladie CRAM Caisse régionale d'assurance maladie CRAMIF Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France CRRMP Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles CSHPF Conseil supérieur d'hygiène publique de France CSPRP Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels CSTB Centre scientifique et technique du bâtiment CU Communauté urbaine DADS Déclaration annuelle des données sociales DARES Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement DCN Direction des chantiers navals DDASS Direction départementale de l'action sanitaire et sociale DDE Direction départementale de l'équipement DGCCRF Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes DGS Direction générale de la santé DGUHC Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction DNID Direction nationale des interventions domaniales DPPR Direction de la prévention des pollutions et des risques DRASS Direction régionale de l'action sanitaire et sociale DRIRE Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement DRP Direction des risques professionnels DRT Direction des relations du travail DTA Dossier technique amiante EFR Épreuves fonctionnelles respiratoires EPI Équipement de protection individuelle EPST Établissement public à caractère scientifique et technologique ESB Encéphalopathie spongiforme bovine ESPRI Épidémiologie et surveillance des professions indépendantes ESTP École spéciale des travaux publics FCAATA Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante FFSA Fédération française des sociétés d'assurance FGA Fonds de garantie automobile FGAO Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages FGTI Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions FIDH Fédération internationale des droits de l'homme FITH Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles FIVA Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante FNASS Fonds national d'action sanitaire et sociale FNATH Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés FNSEA Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles GIE Groupement d'intérêt économique GIP Groupement d'intérêt public HPA Hydrocarbures polycycliques aromatiques IGAS Inspection générale des affaires sociales IGF Inspection générale des finances IGH Immeubles de grande hauteur INERIS Institut national de l'environnement industriel et des risques INRS Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles INS Institut national de sécurité INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale INTEFP Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle IPP Incapacité partielle permanente IRD Institut de recherche pour le développement IRSN Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire IRSST Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail ITGA Institut technique des gaz et de l'air IVS Institut de veille sanitaire LASEM Laboratoire d'analyse et de surveillance des particules inhalées de la marine LEPI Laboratoire d'étude des particules inhalées, de la ville de Paris LFSS Loi de financement de la sécurité sociale LOLF Loi organique relative aux lois de finances MASD Mission d'animation des services déconcentrés MIRTMO Médecins/inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'œuvre OCDE Organisation de coopération et de développement économiques OCLAESP Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique OFDT Observatoire français des drogues et des toxicomanies OIT Organisation internationale du travail OMC Organisation mondiale du commerce OMI Organisation maritime internationale OMS Organisation mondiale de la santé ONAPT Observatoire national de l'asthme professionnel ONIAM Office national d'indemnisation des accidents médicaux OPECST Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques OPPBTP Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics PLFSS Projet de loi de financement de la sécurité sociale PMSI Programme de médicalisation des systèmes d'information PNSE Plan national santé environnement PNSM Programme national de surveillance des mésothéliomes PRAPE Prévention des risques liés à l'activité physique et ergonomie PRP Préretraite progressive PRST Plan régional de santé au travail PST Plan santé au travail PUPH Professeurs des universités/praticiens hospitaliers REACH « Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals » RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheit en Milieu RNVPP Réseau national de vigilance des pathologies professionnelles SCOP Surveiller les cancers d'origine professionnelle SGDG Sans garantie du Gouvernement SME Système de management environnemental SNA Société nationale de l'amiante SNA Sous-marins nucléaires d'attaque SNLE Sous-marins nucléaires lanceurs d'engins SPIRALE Suivi post-professionnel individuel des travailleurs exposés SSF Service de soutien de la flotte SST Santé et sécurité au travail SYRTA Syndicat de retrait et de traitement de l'amiante et des autres polluants TASS Tribunal des affaires de sécurité sociale TDM Tomodensitométriques TGAP Taxe générale sur les activités polluantes TGI Tribunal de grande instance TMS Troubles musculo-squelettiques UIMM Union des industries et métiers de la métallurgie VLE Valeur limite d'exposition ZAC Zone d'aménagement concerté ------------ N° 2884 - Tome II - auditions - Rapport fait au nom de la mission d'information sur les risques et les conséquences de l'exposition à l'amiante (M. Jean Lemière) 1 REACH : « Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals » : Autorisation, évaluation et enregistrement des produits chimiques 2 COFRAC : Comité français d'accréditation 3 KFOR : Force internationale de paix au Kosovo 4 Pour information, le 6 juillet 2005, le tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur le cas du Clemenceau. 5 ng : nanogramme, milliardième partie du gramme (10-9g) 6 Environmental Protection Agency : Agence de protection de l'environnement. 7 LHCF : Laboratoire hygiène et contrôle de fibres 8 BRGM : Bureau de recherche géologique et minière 9 INERIS : Institut national de l'environnement industriel et des risques 10 LASEM : Laboratoire d'analyse et de surveillance des particules inhalées de la marine 11 COFRAC : Comité français d'accréditation 12 Population au sens du BIT : 26 759 501 personnes en 2003 (source INSEE) 13 La "comitologie" peut être définie comme étant le processus d'adoption de mesures d'exécution des actes législatifs, prévoyant que ces mesures sont adoptées par la Commission assistée par un Comité d'experts des États membres. 14 Liners : Géomembrane en polyéthylène haute densité (matériau étanche) 15 PSA : Prostatic Specific Antigen (antigène spécifique de la prostate en français 16 AT-MP : accidents du travail - maladies professionnelles 17 Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle). 18 Le 29 octobre 2003, la Commission a présenté ses propositions pour une révision radicale de la politique communautaire sur les substances chimiques. La proposition de réforme met en place un système global d'enregistrement, d'évaluation, d'autorisation et de restriction des produits chimiques (REACH : Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Celle-ci doit encore être approuvée par le Conseil et le Parlement. 19 ACGIH : "American Conference of Governmental Industrial Hygienists". 20 DGS : Direction générale de la santé 21 INRS : Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 22 CNAMTS : Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés 23 Cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction. 24 L'agence européenne pour la sécurité et la santé au travail de Bilbao a été créée en 1996 et a pour mission de rendre les lieux de travail en Europe plus sûrs, plus sains et plus productifs et, notamment, d'encourager une culture de la prévention plus efficace sur le lieu de travail. 25 NDCR : quatre revues en comptant Réalité prévention, qui traite de la prévention des risques professionnels en la resituant dans le champ des enjeux de société en matière de travail, de santé, d'environnement, de maîtrise des risques. Quatre numéros par an. 26 http://www.travail-et-securite.fr/ 27 http://www.dmt-prevention.fr/ 29 Cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques 30 ECRIN : Échange - Coordination - recherche - industrie. Écrin rapproche les entreprises des laboratoires de recherche pour optimiser le transfert de technologies et développer l'innovation transversale. 31 Directrice générale de l'AFSSE. 32 REACH : « Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals » 33 ERANET : « European Research area - net » (work) : Outil de structuration de l'espace européen de la recherché inséré dans le 6ème programme cadre européen. 34 INRS : Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 35 Manifestation du 15 octobre 2005 des victimes de l'amiante à Paris 36 PRST : Plan régional de santé au travail 37 Yves Roquelaure, Catherine Ha, Marine Sauteron : Réseau expérimental de surveillance épidémiologique des troubles musculo-squelettiques dans les Pays de la Loire - Surveillance en entreprises en 2002, mai 2005. 38 REACH : « Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals » 39 Dix cas de cancers du rein ont été recensés depuis 1994 chez les ouvriers de l'usine Adisseo de Commentry (03). L'origine professionnelle de ces cancers est suspectée : ils pourraient être liés à un intermédiaire de synthèse : le chloracétal C5. L'INRS met ses moyens et connaissances à disposition pour tenter de déterminer l'origine de ces affections. 40 Après relecture du compte-rendu, M. Letourneux a estimé nécessaire de réviser ses propos comme suit : « Concernant le cancer broncho-pulmonaire, en revanche, il y a des raisons de penser que l'objectif d'un dépistage par le scanner thoracique faiblement irradiant pourrait être également médical : réalisé annuellement dans des groupes à haut risque de cancer broncho-pulmonaire (exposition à l'amiante associée à un tabagisme important), il pourrait transformer le mauvais pronostic de cette affection, en permettant un traitement à un stade beaucoup plus précoce que celui du diagnostic habituel. Cependant, ceci demande encore à être validé scientifiquement, tout comme, d'ailleurs, l'apport possible d'une simple surveillance radiographique rapprochée : l'absence de bénéfice, en termes de mortalité spécifique, des dépistages radiographiques réalisés dans les années 70 était liée en réalité à une impossibilité de conclure, compte tenu d'importants biais méthodologiques. » 41 Rapport 2005 de la Cour des comptes sur la sécurité sociale, page 76. http://www.ccomptes.fr/Cour-des-comptes/publications/rapports/secu2005/integral-secu.pdf 42 TGI Cherbourg (Commission d'indemnisation des victimes), 25 mars 1999, "Drouet contre Fonds de garantie". Ce jugement, qui accordait à M. Drouet, mécanicien de la Marine nationale, atteint de mésothéliome, une indemnisation de 980 000 francs, fut confirmé par la cour d'appel de Caen, puis par la Cour de cassation le 1er décembre 2000. La victime était décédée entre-temps. 43 http://www.juritel.com/Ldj_html-394.html 44 http://www.justice.gouv.fr/publicat/rapport-dommage-corporel.pdf 45 « 7) permettre au FIVA d'accorder aux victimes le bénéfice qui s'attache à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, afin que ces dernières ne soient plus incitées à emprunter la voie judiciaire ». 46 JJ Dupeyroux, un Deal en Béton. Droit social, juillet/août 1998. 47 REACH : « Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals » 48 Le montant du versement est évalué tous les 3 ans par une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et voté chaque année dans le cadre du projet de loi de financements de la sécurité sociale. 49 REACH : « Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals » 50 IPP : Incapacité permanente partielle 51 Article 2, alinéa premier du code de procédure pénale : « L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ». Il peut néanmoins être dérogé à cette règle par disposition légale. 52 PNSM : Programme national de surveillance des mésothéliomes 53 Scop : Surveiller les cancers d'origine professionnelle 54 http://www.travail.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques/statistiques/sante-au-travail/les-resultats-sumer-1994/fiches-par-nuisance-2018.html 55 Claude Got - Rapport sur la gestion politique et administrative du problème de santé publique posé par l'amiante en France, 29 juillet 1998. http://www.sante-publique.org/amiante/rapportgot1998/gotrapport.htm 56 Effets sur la santé des principaux types d'exposition à l'amiante - Expertise collective, 1997.http://www.inserm.fr/fr/questionsdesante/mediatheque/ouvrages/expertisecollectiveamianteexpo.html 57 REACH : « Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals » 58 REACH: « Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals » 59 FCAATA : Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante 60 FIVA : Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante 61 PLFSS : Projet de loi de financement de la sécurité sociale 62 CHSCT : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 63 AFSSE : Agence française de sécurité sanitaire environnementale, nouvellement nommée AFSSET 64 REACH « Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals » 65 Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du Code du travail et du Code de la consommation (JO du 26 décembre 1996) - http://aida.ineris.fr/textes/decrets/text0461.htm 66 Comité français d'accréditation - http://www.cofrac.fr/fr/cofrac/norme.htm 67 SNLE : sous-marins nucléaires lanceurs d'engins 68 SNA : sous-marins nucléaires d'attaque 69 http://kombrig20.homestead.com/Gorshkov.html |