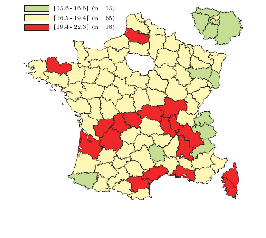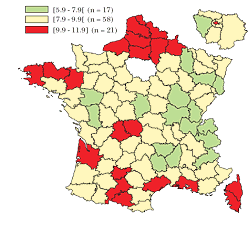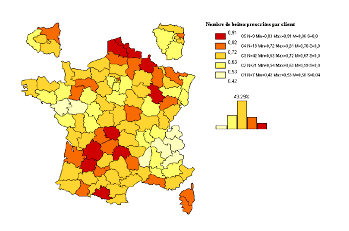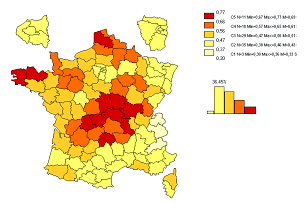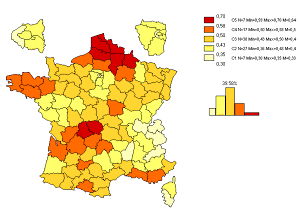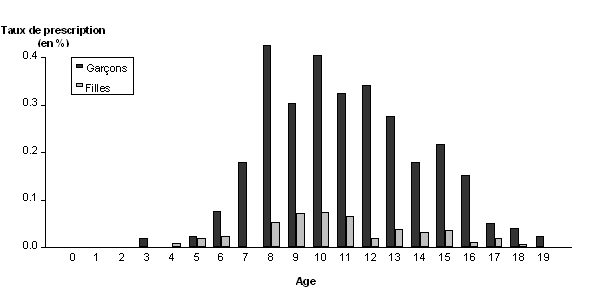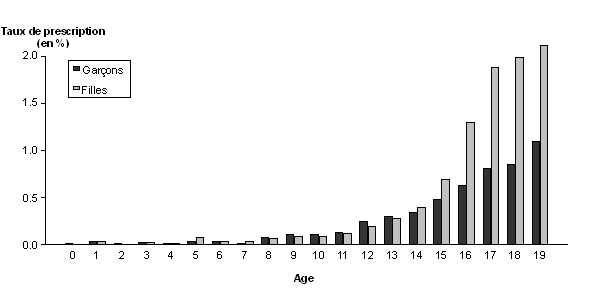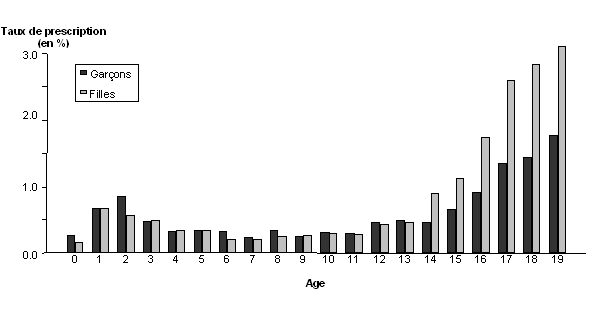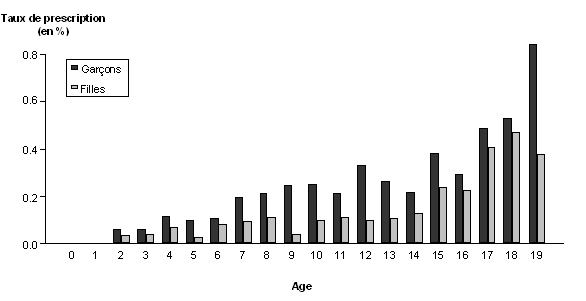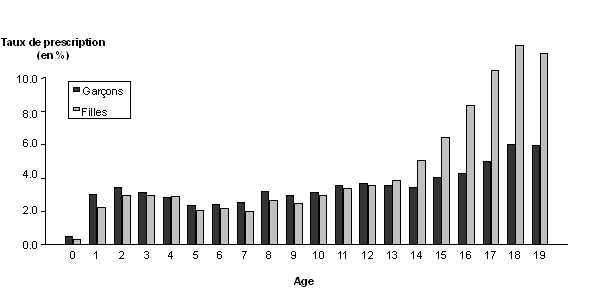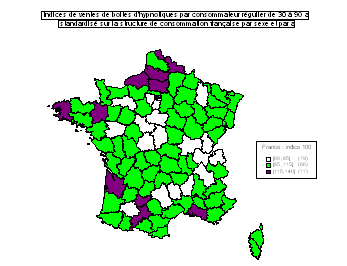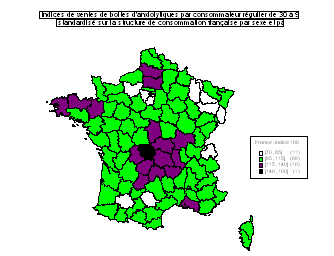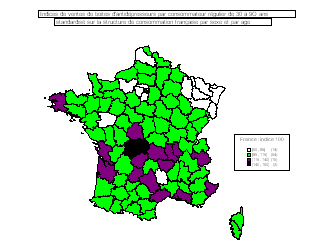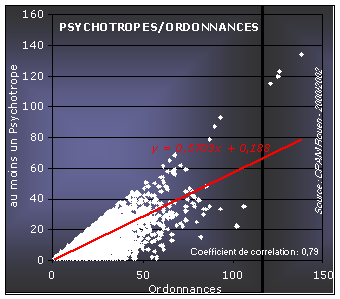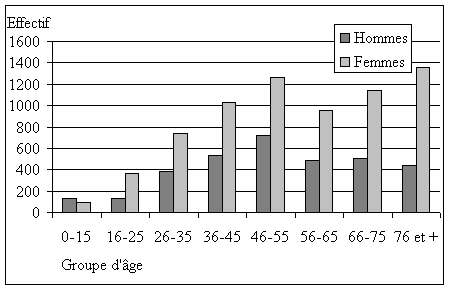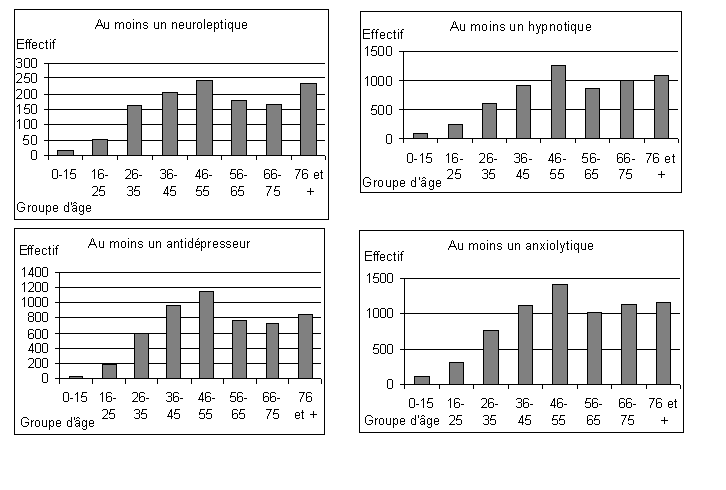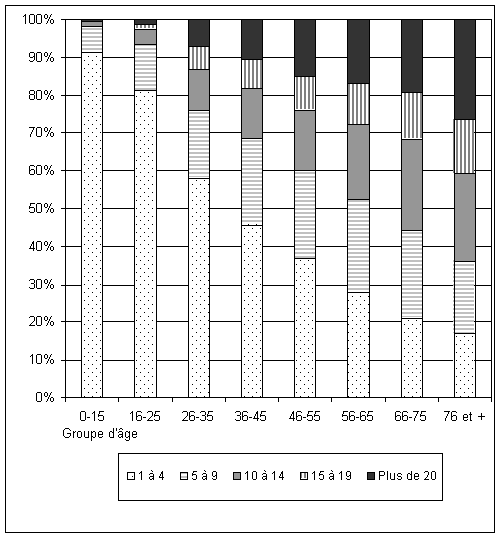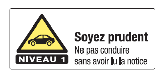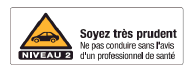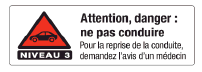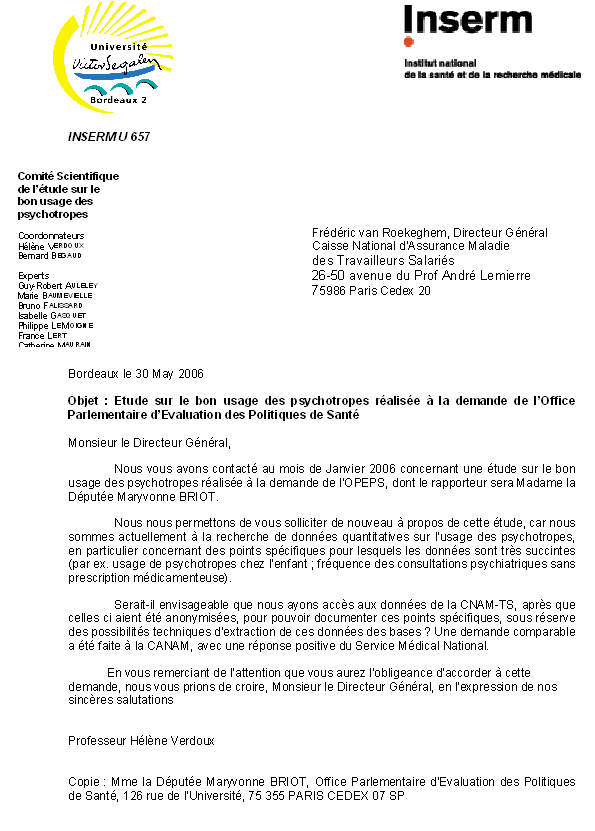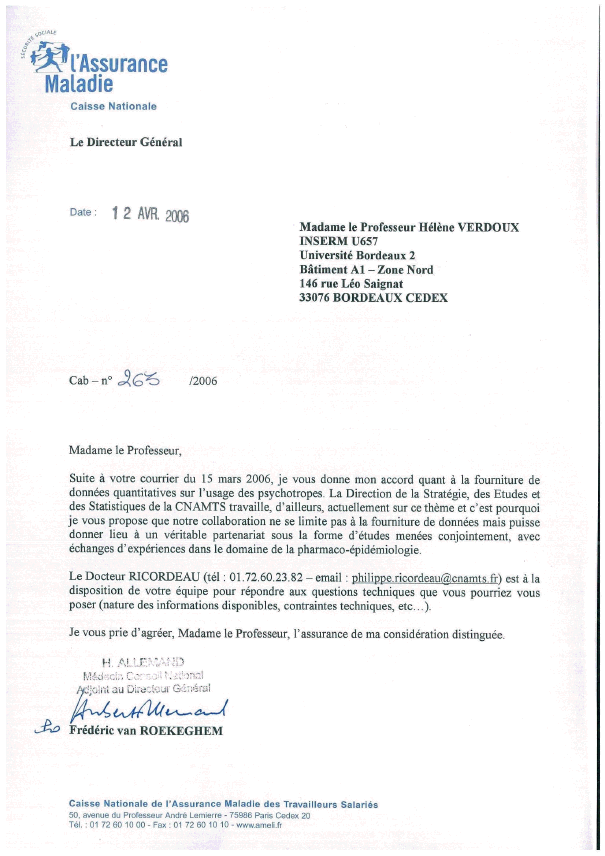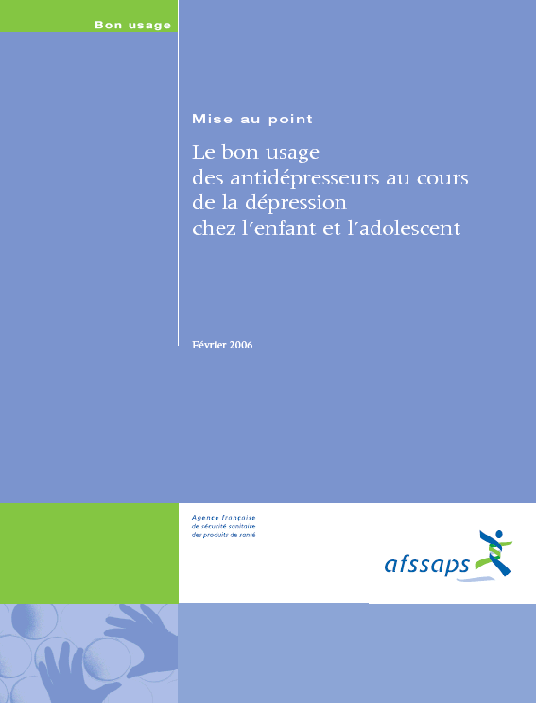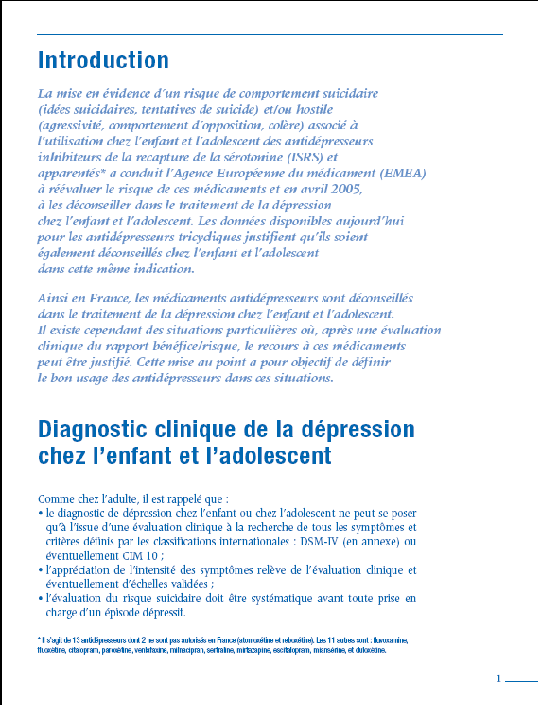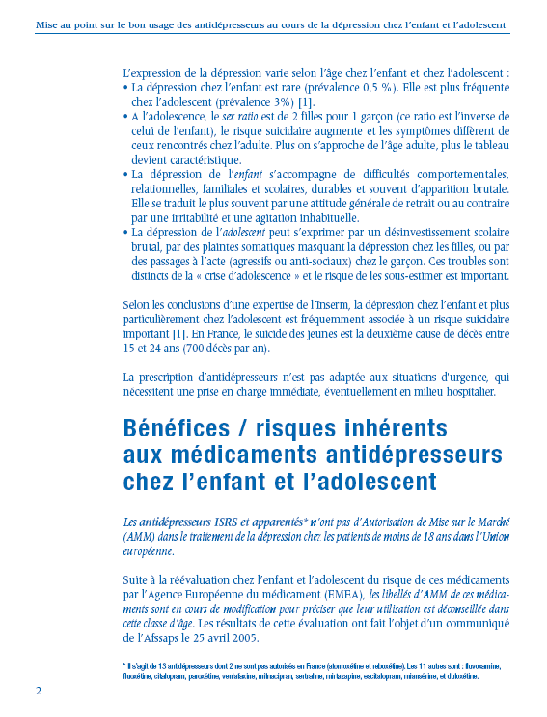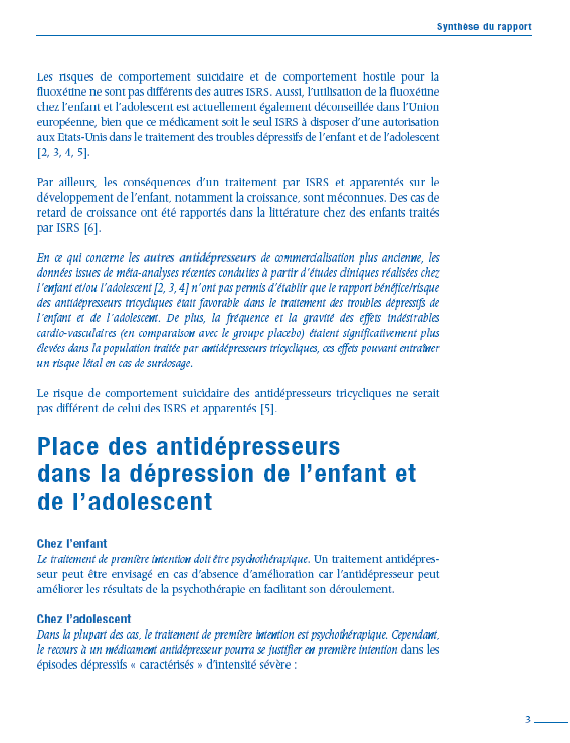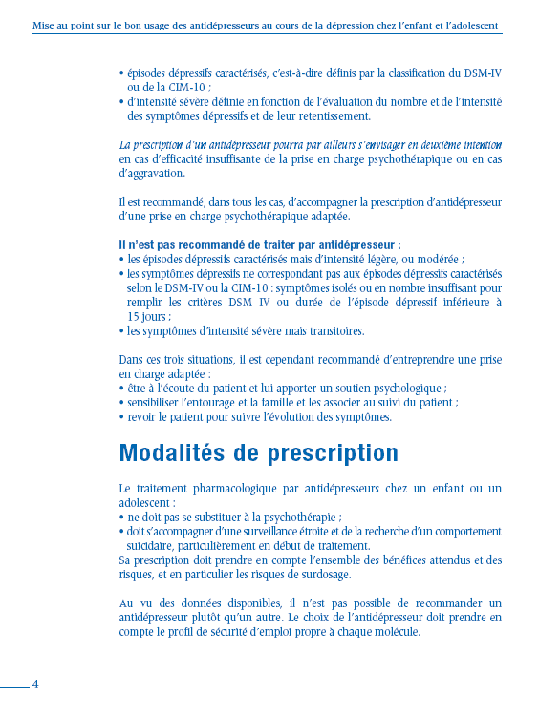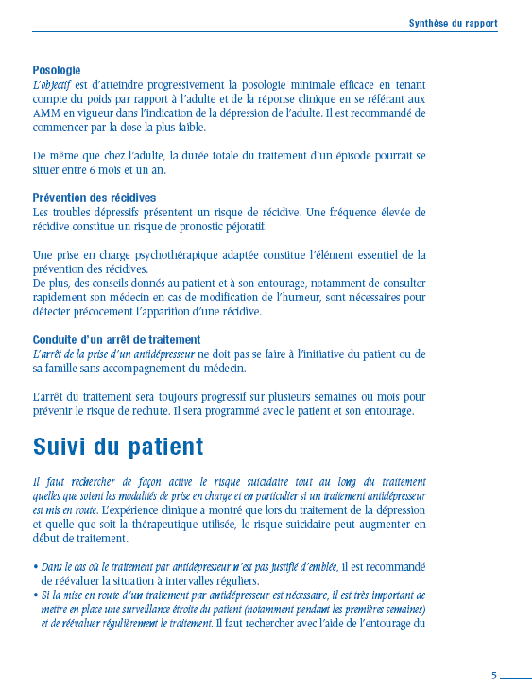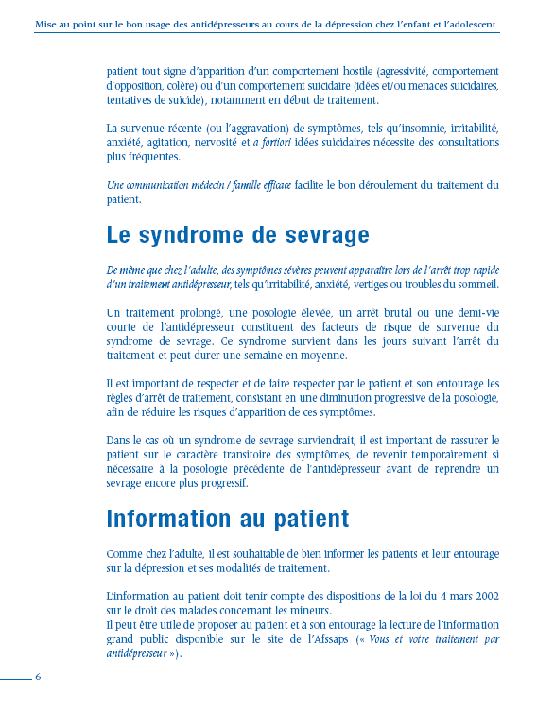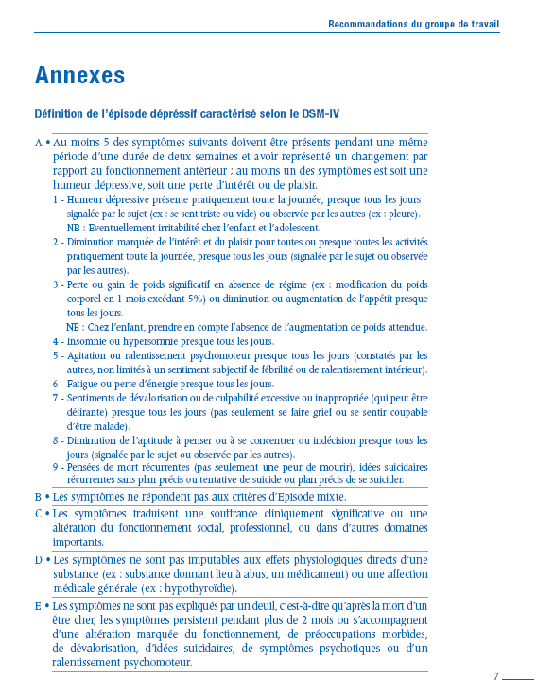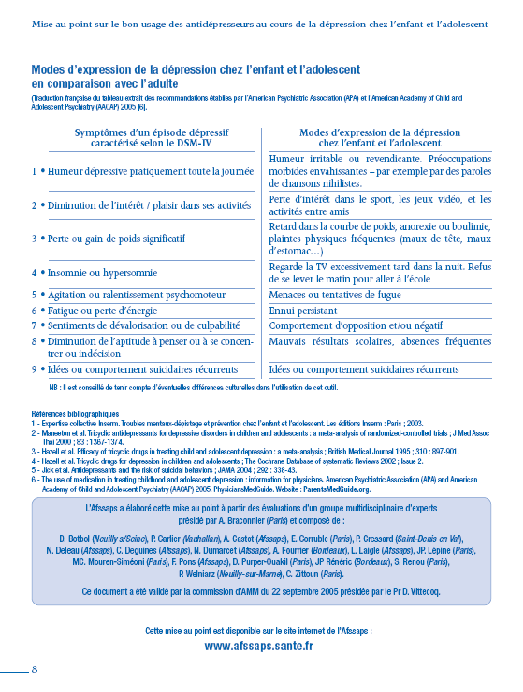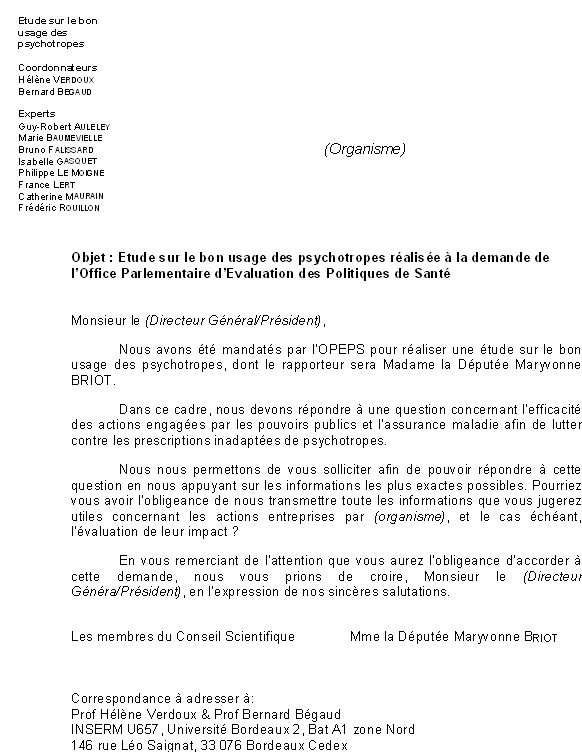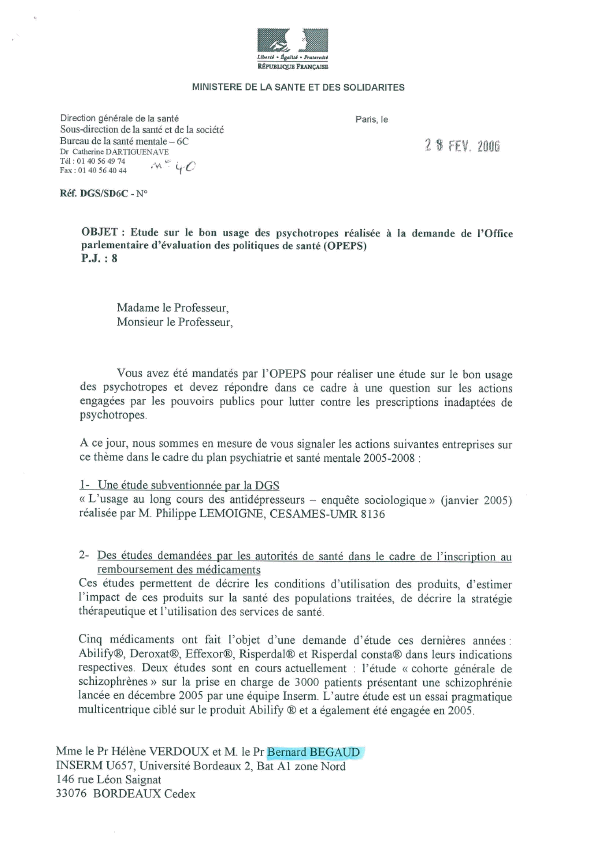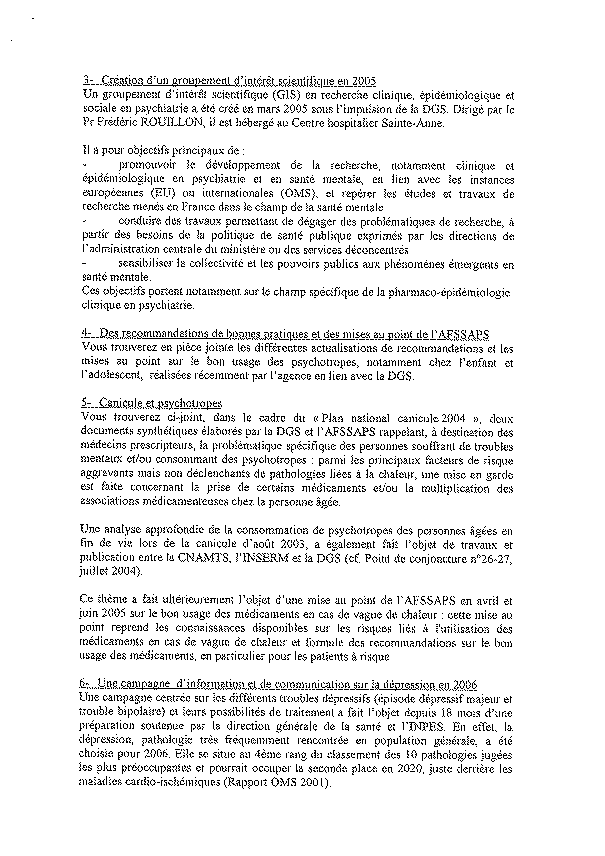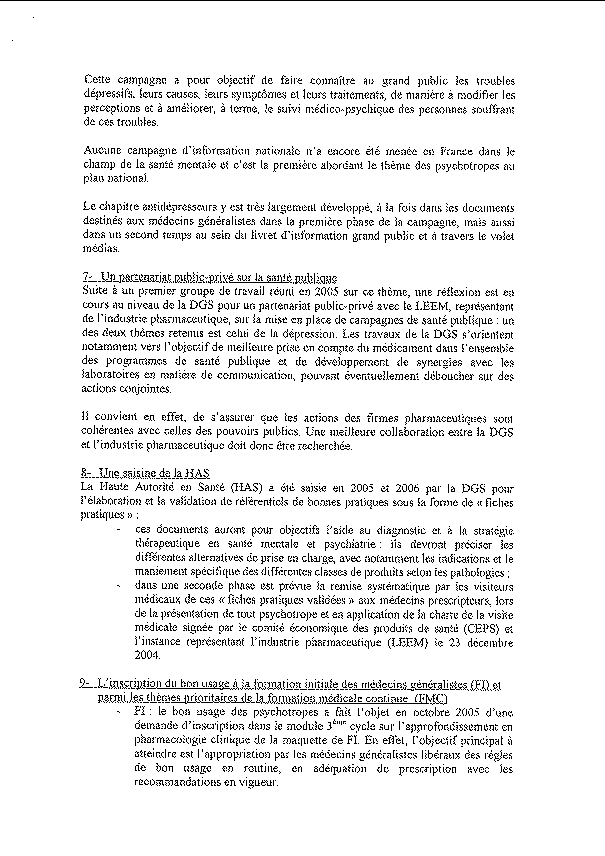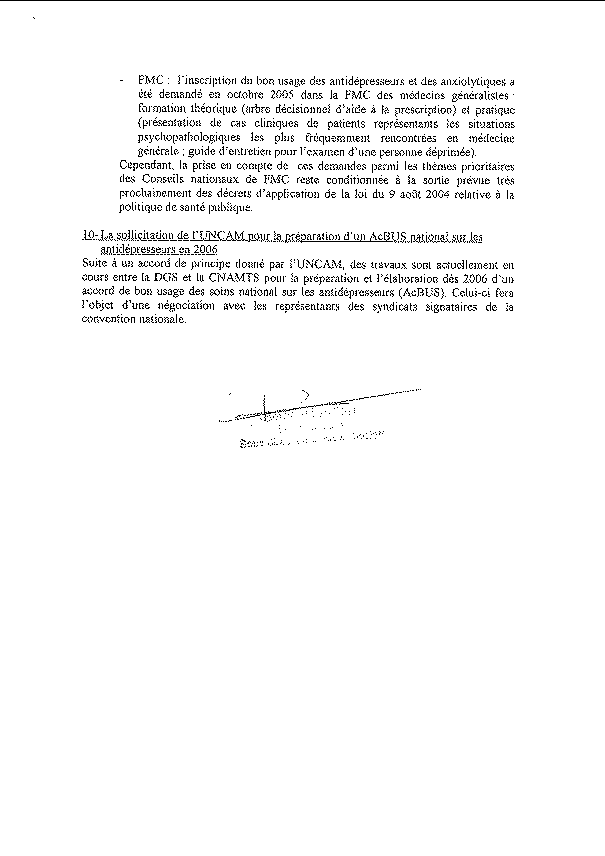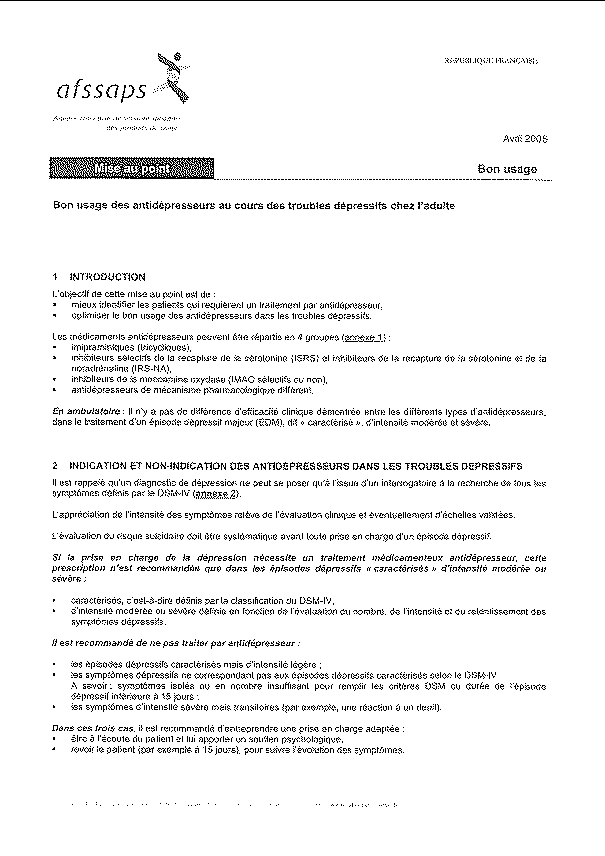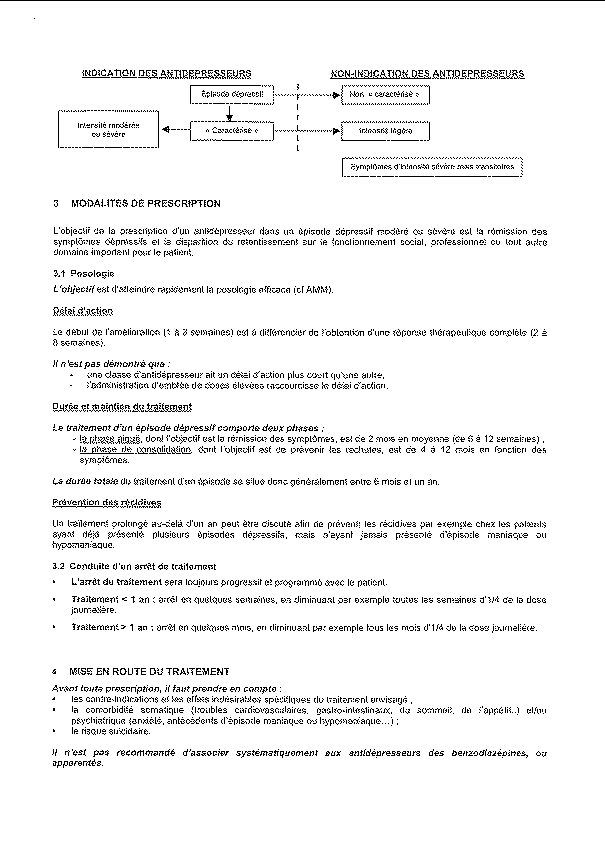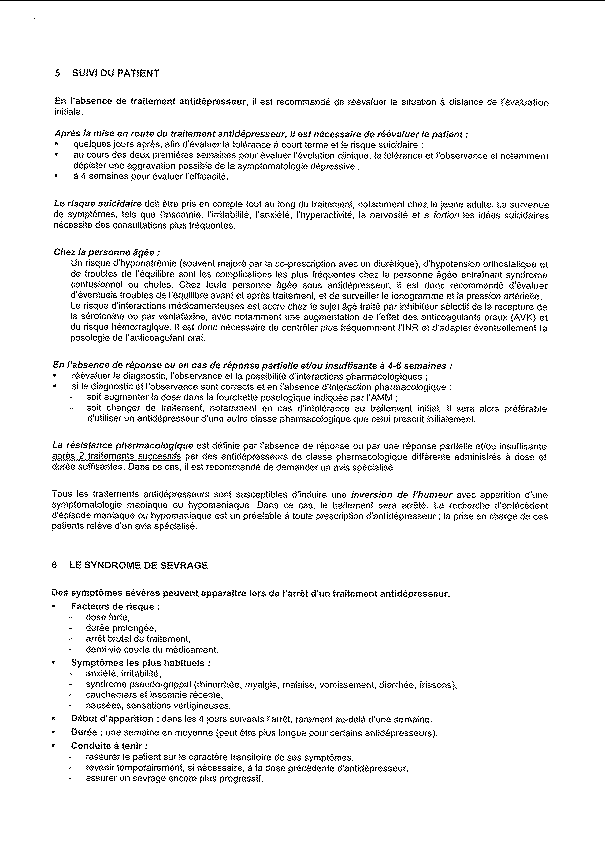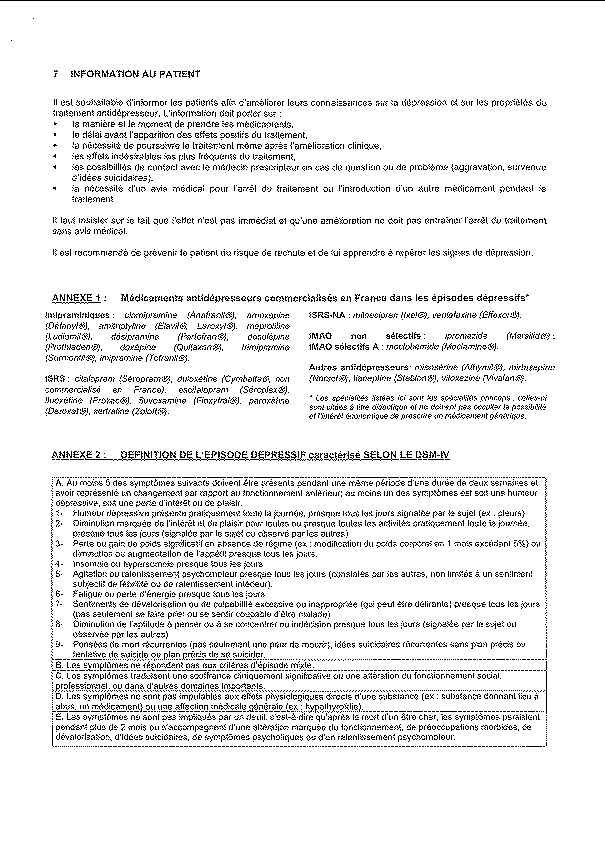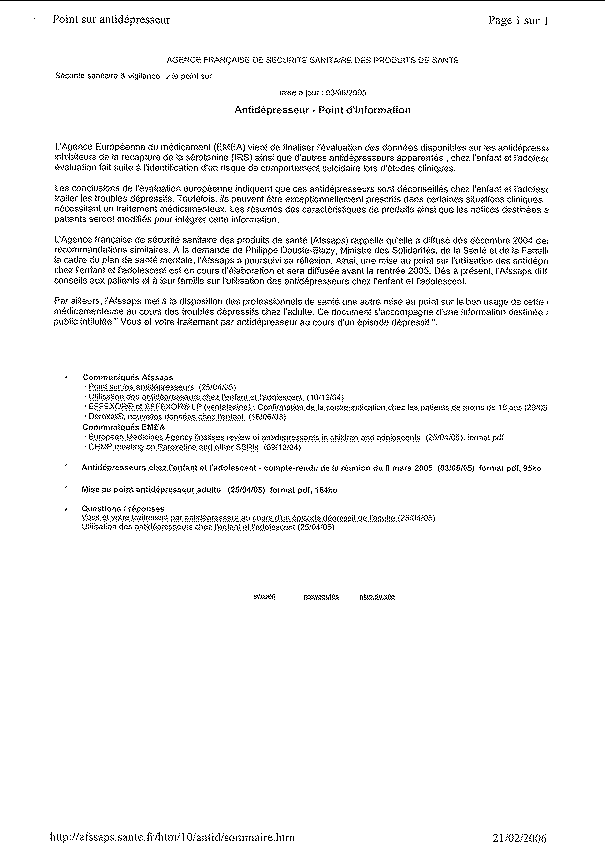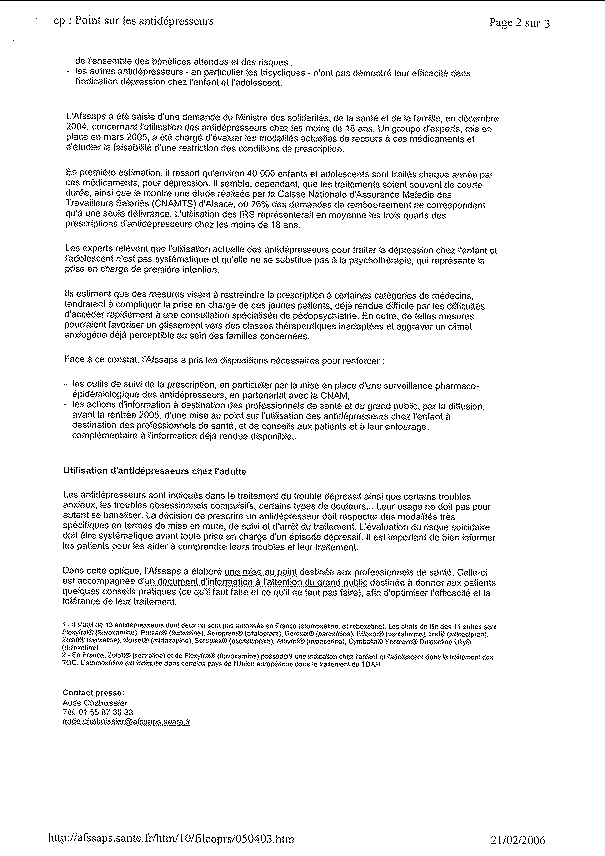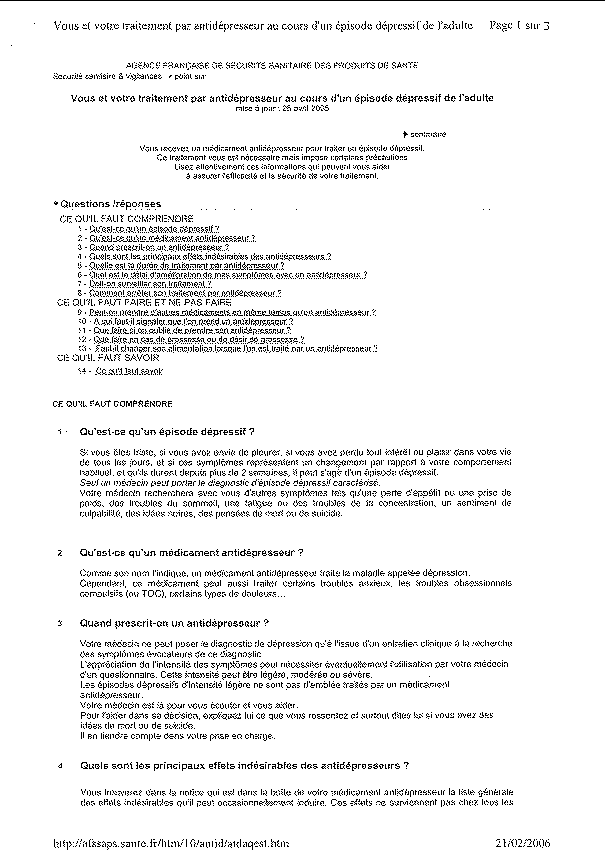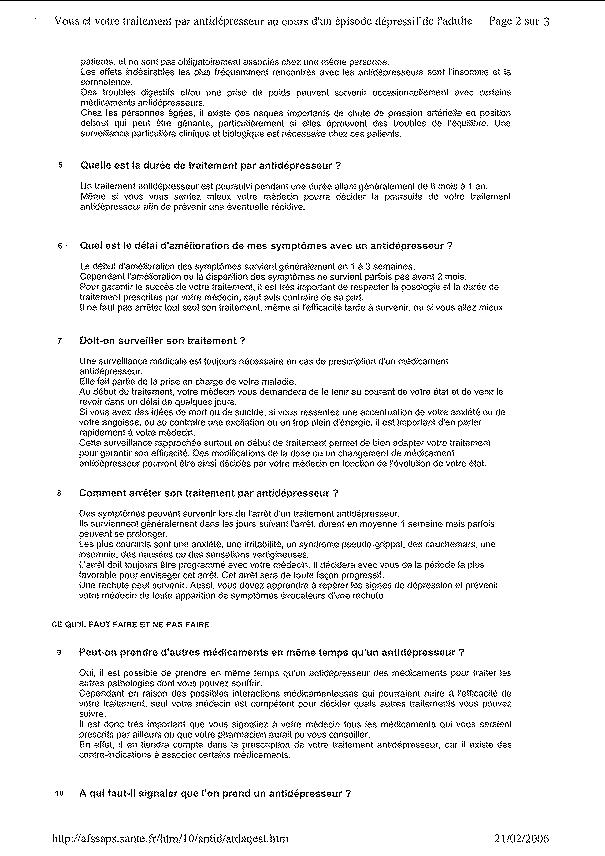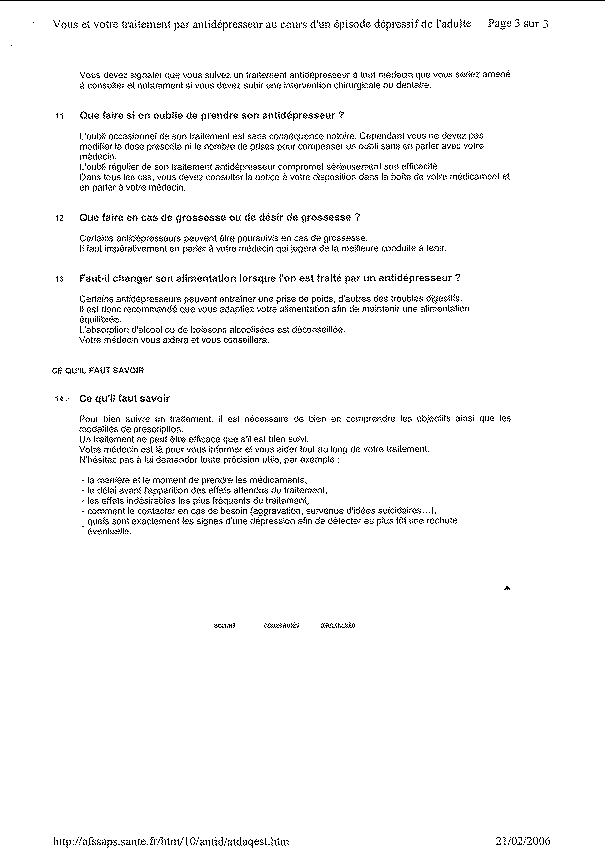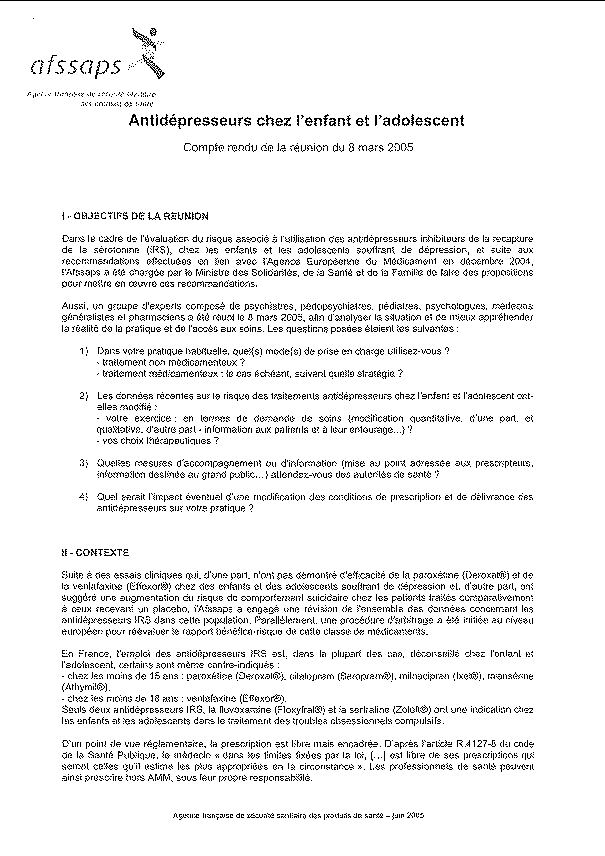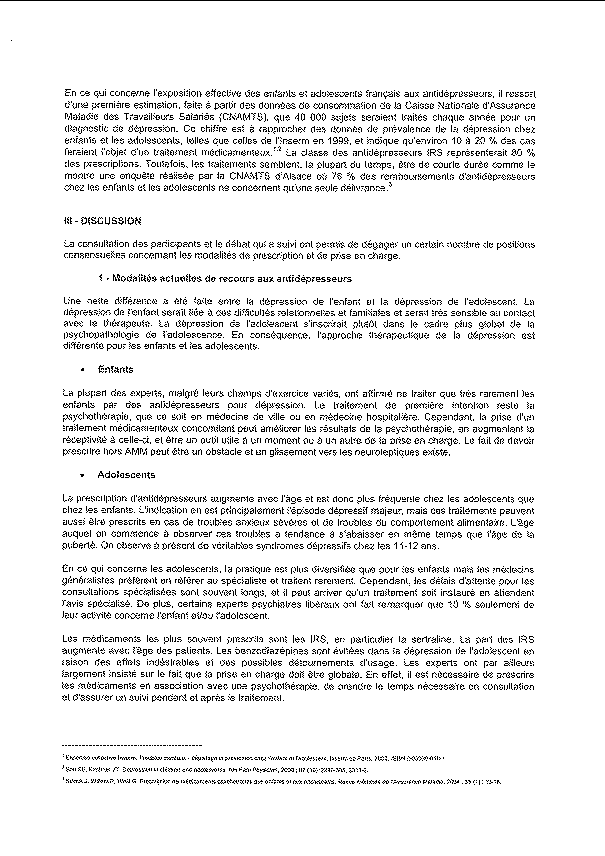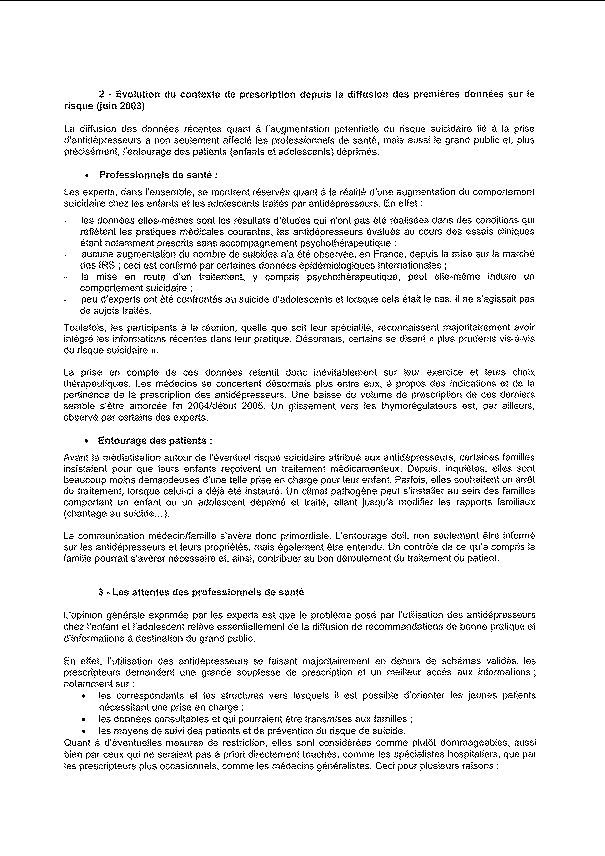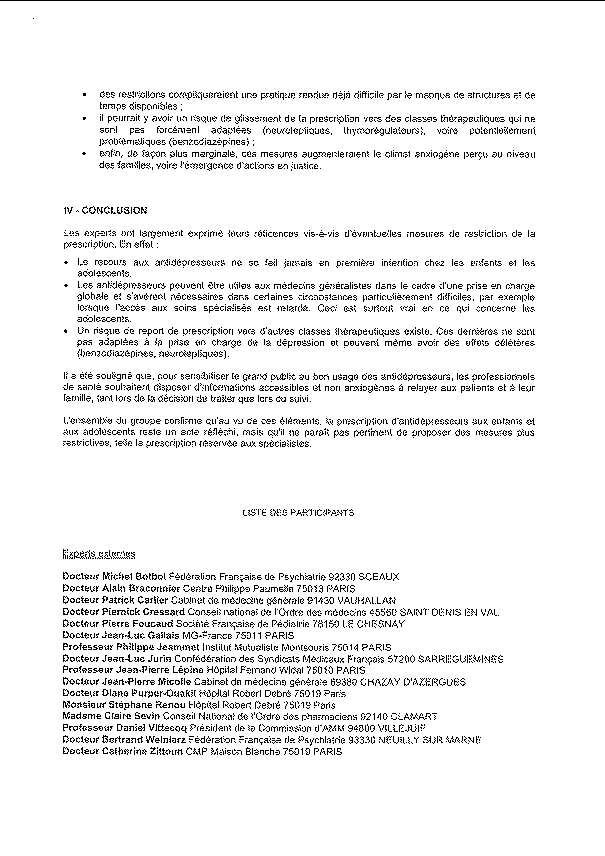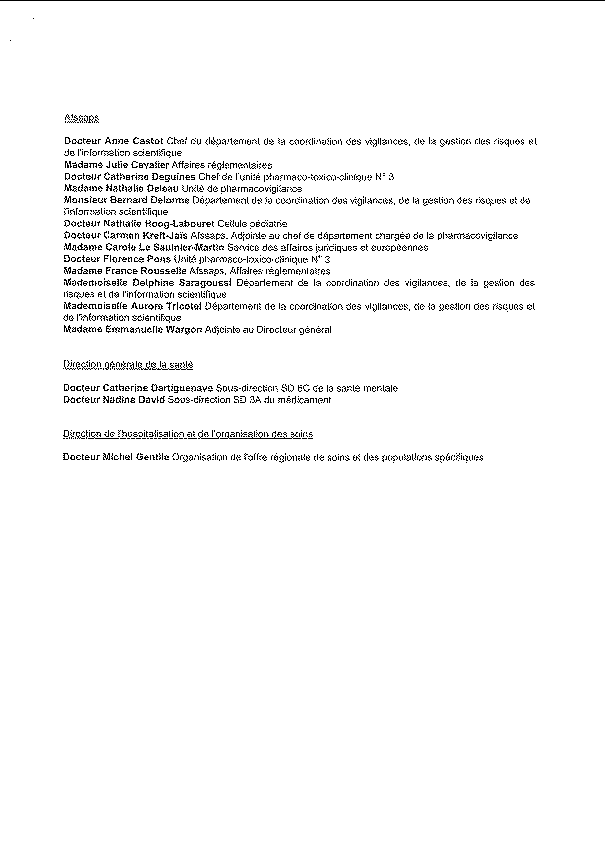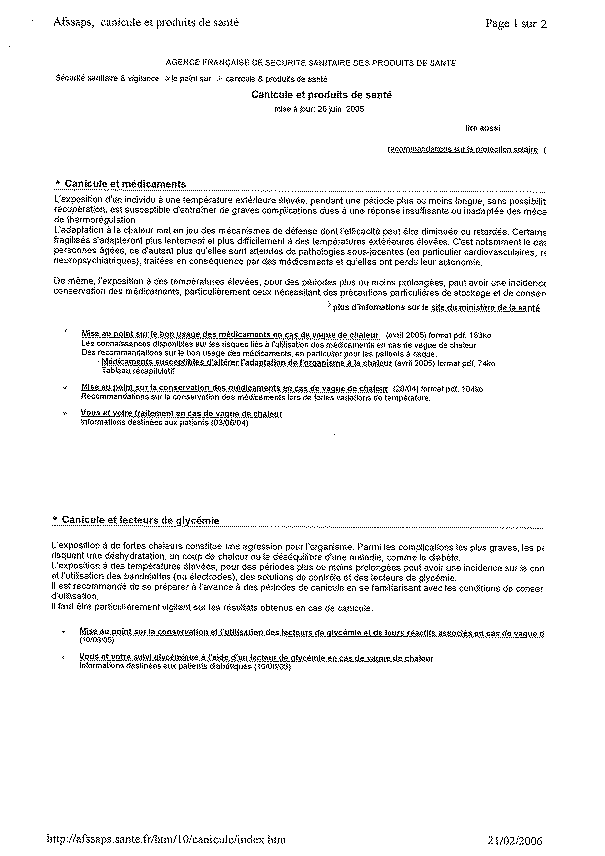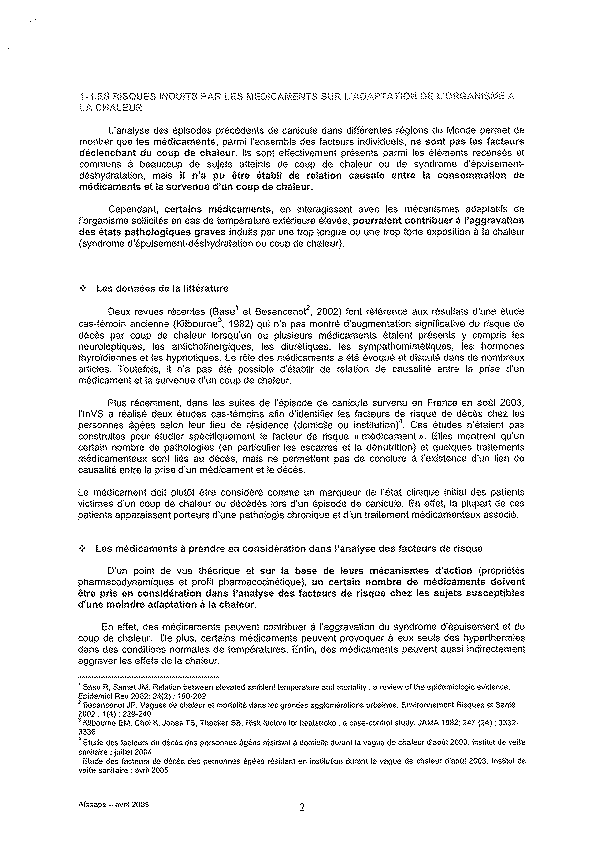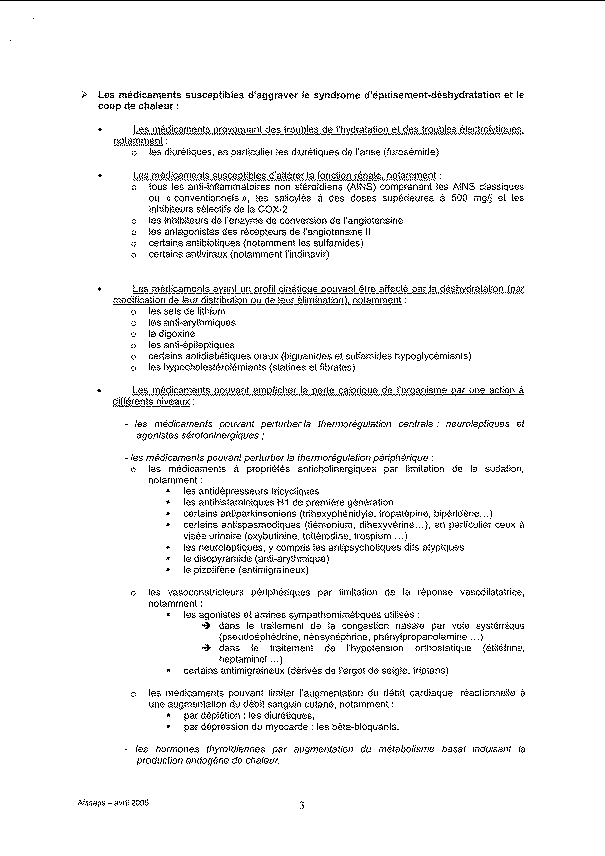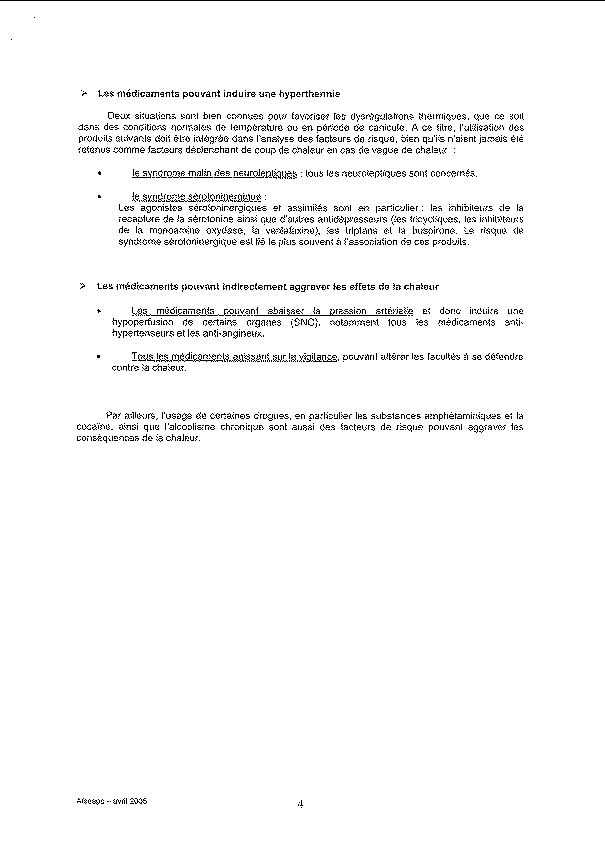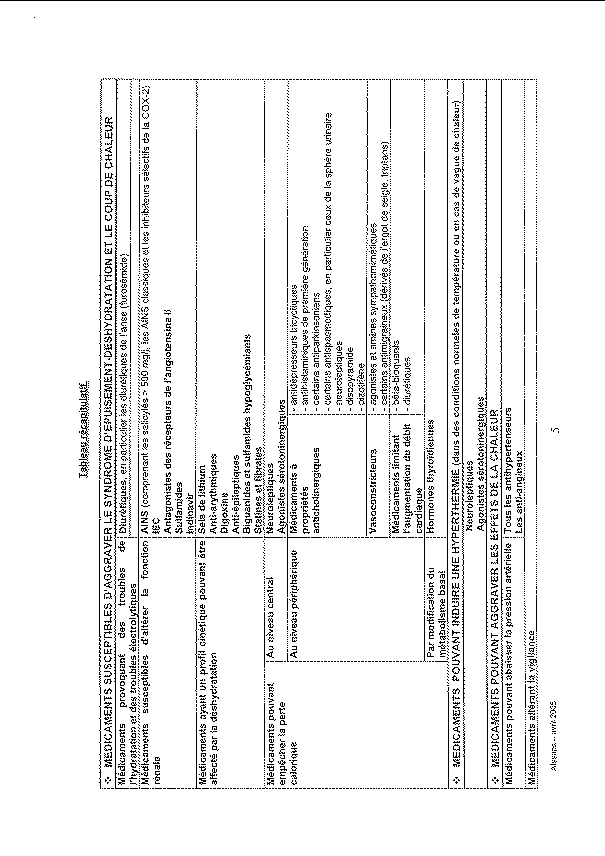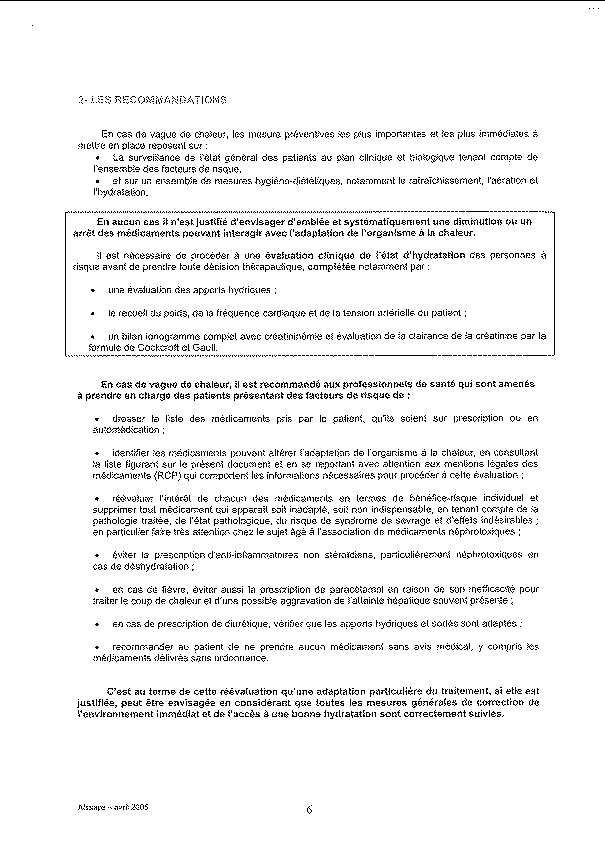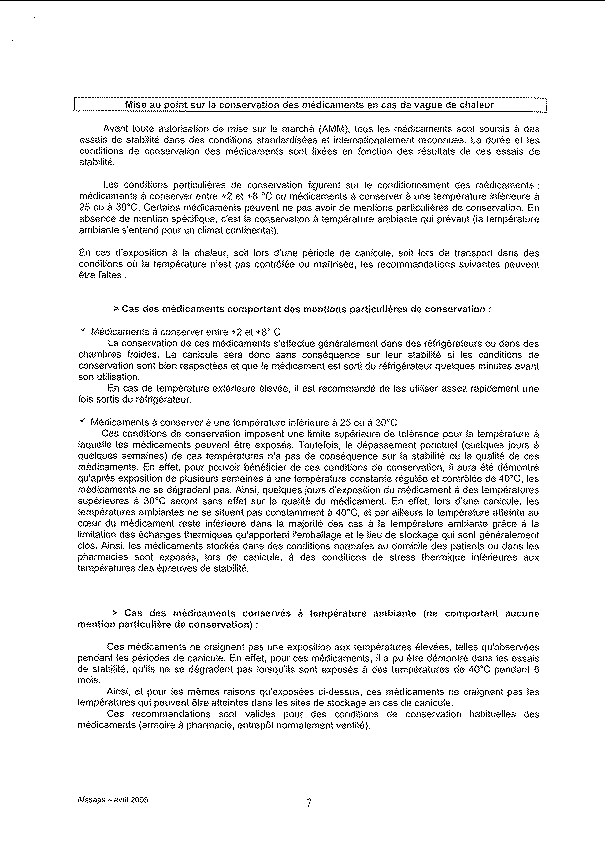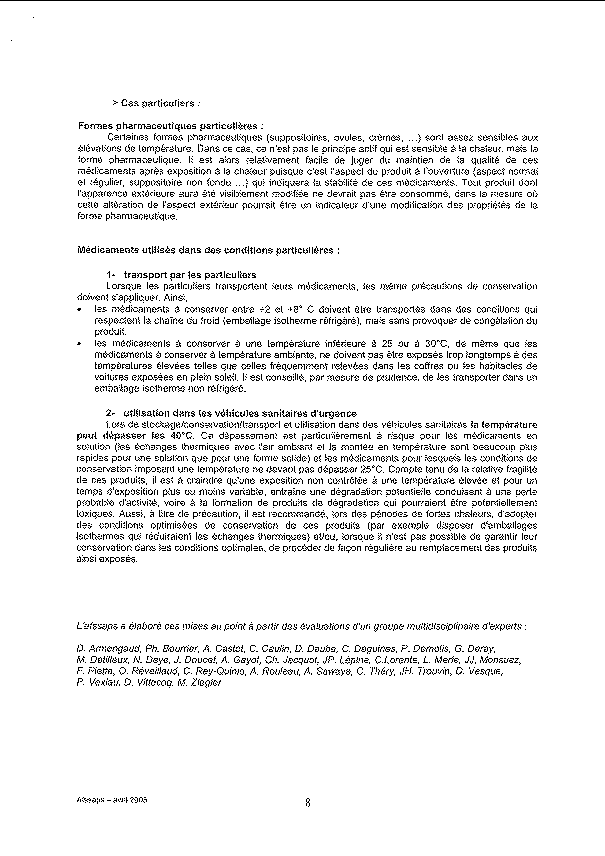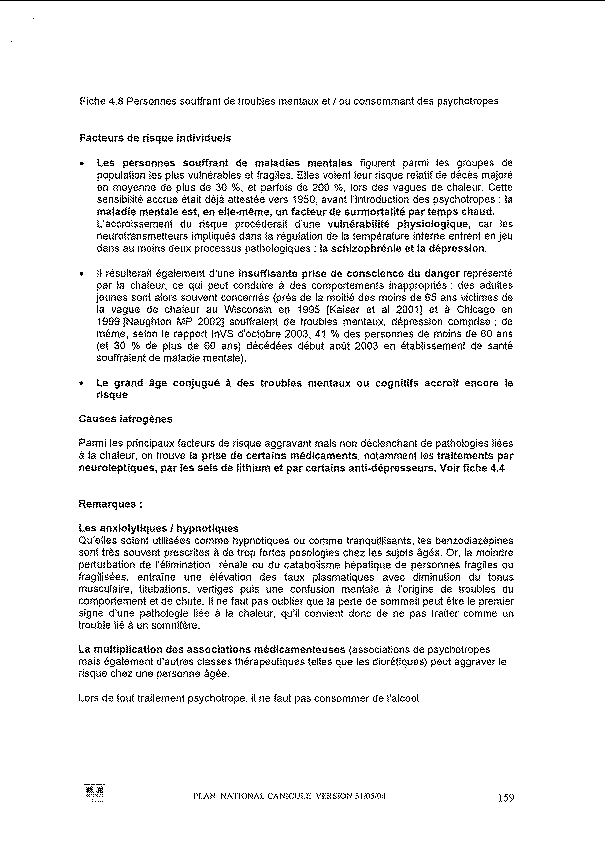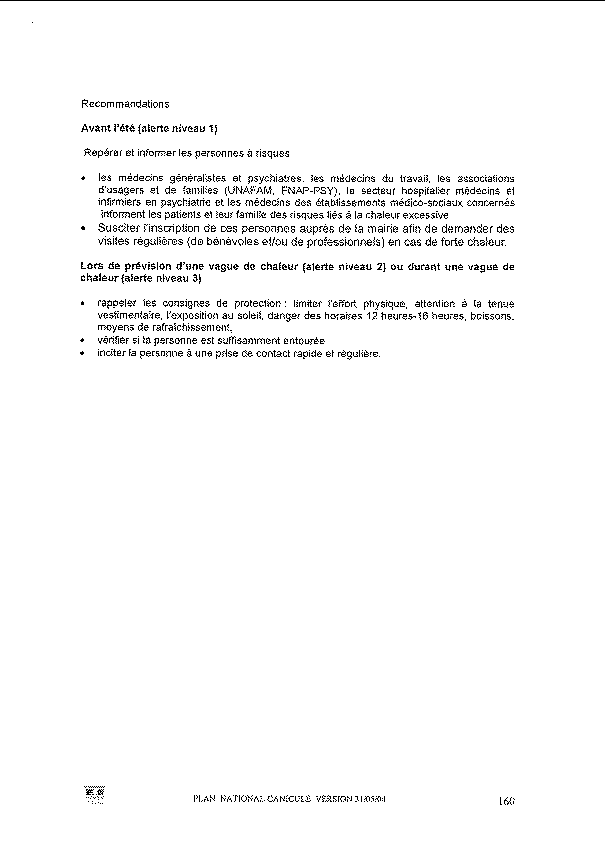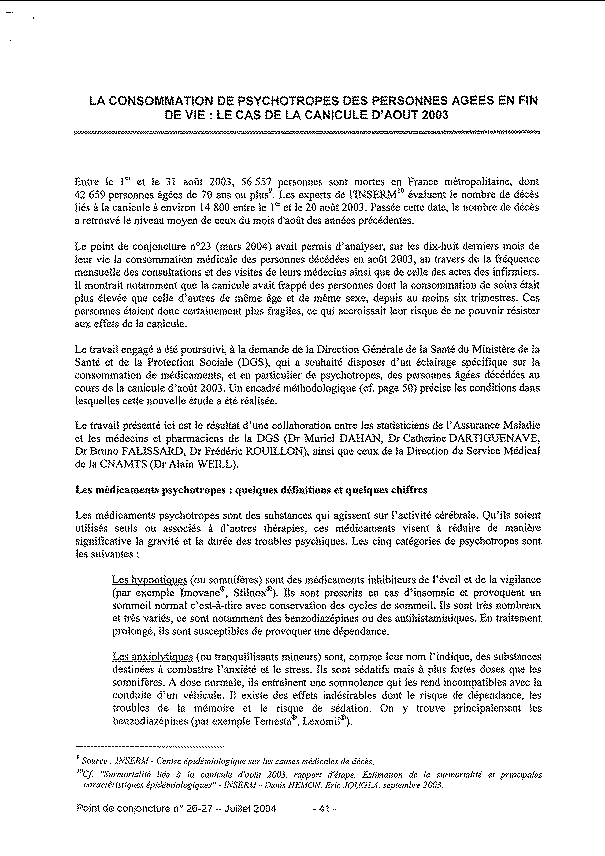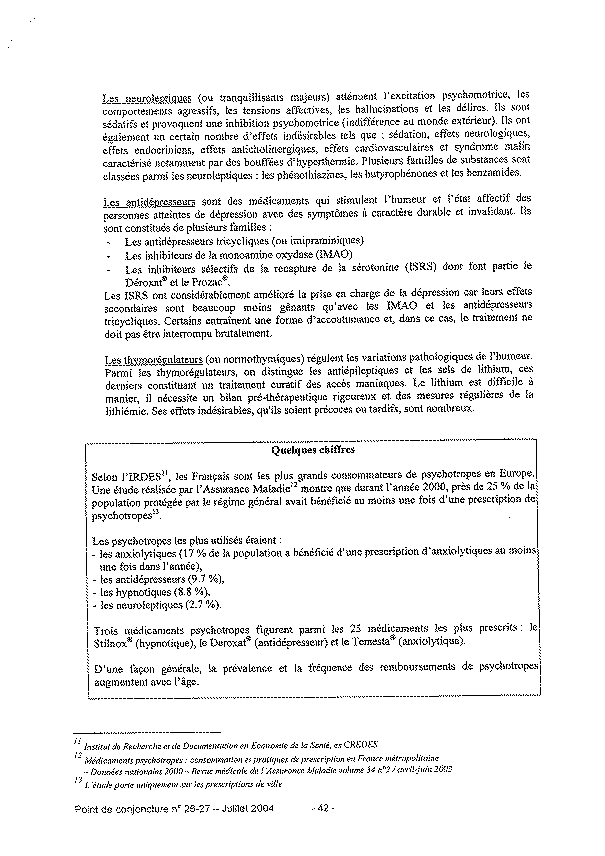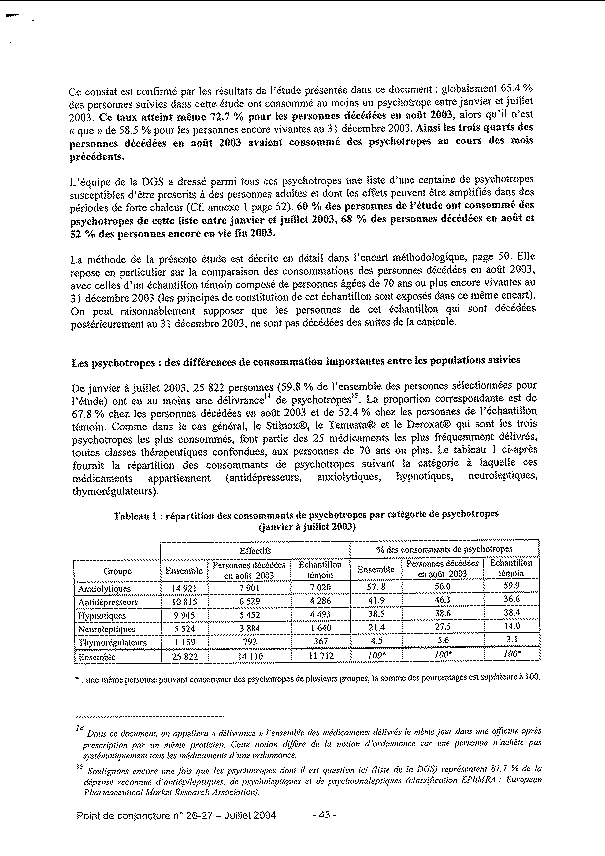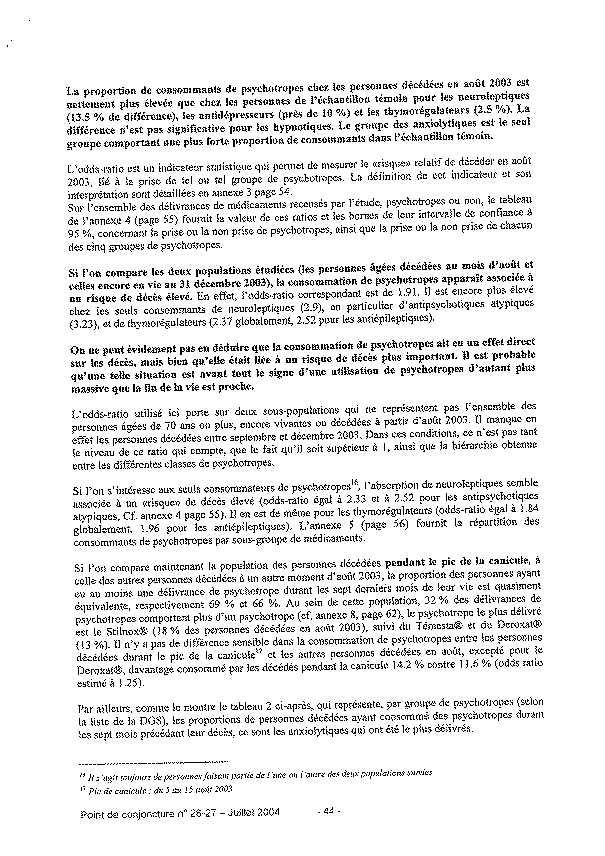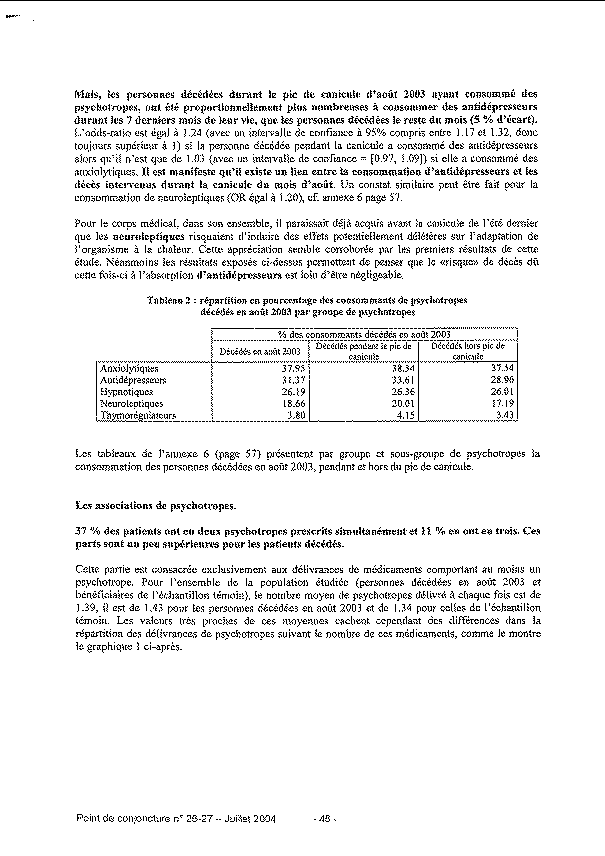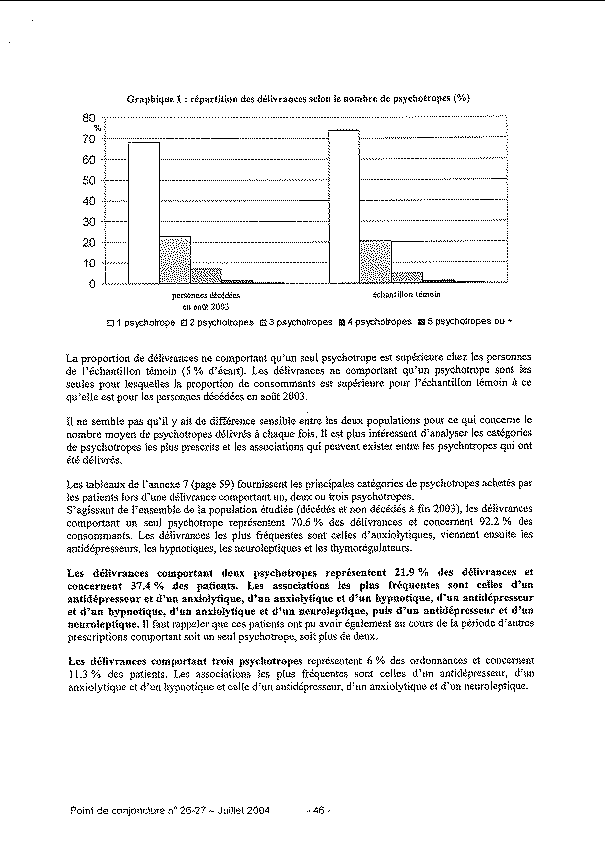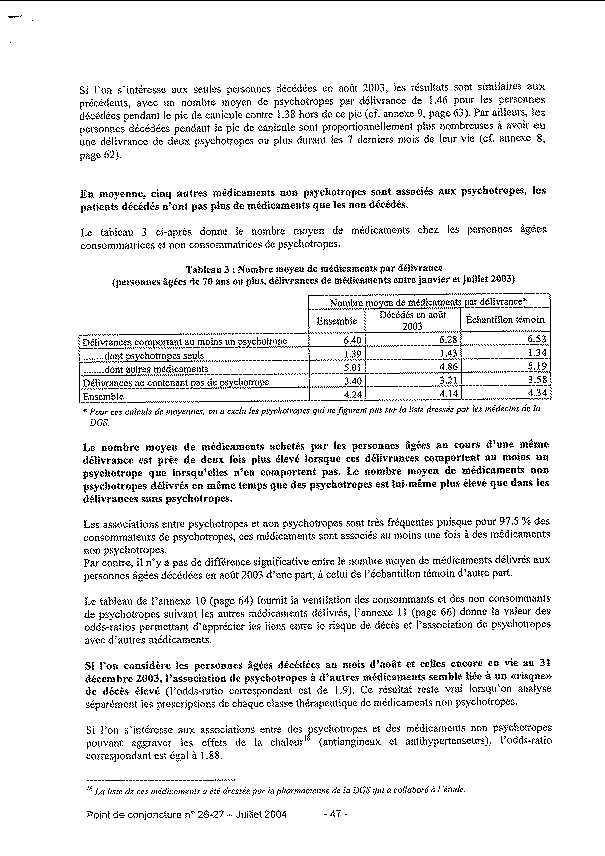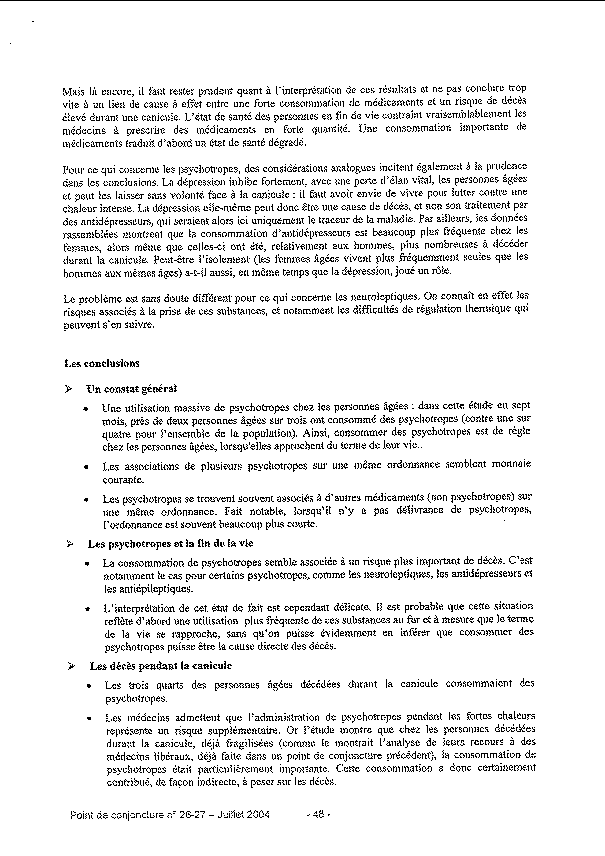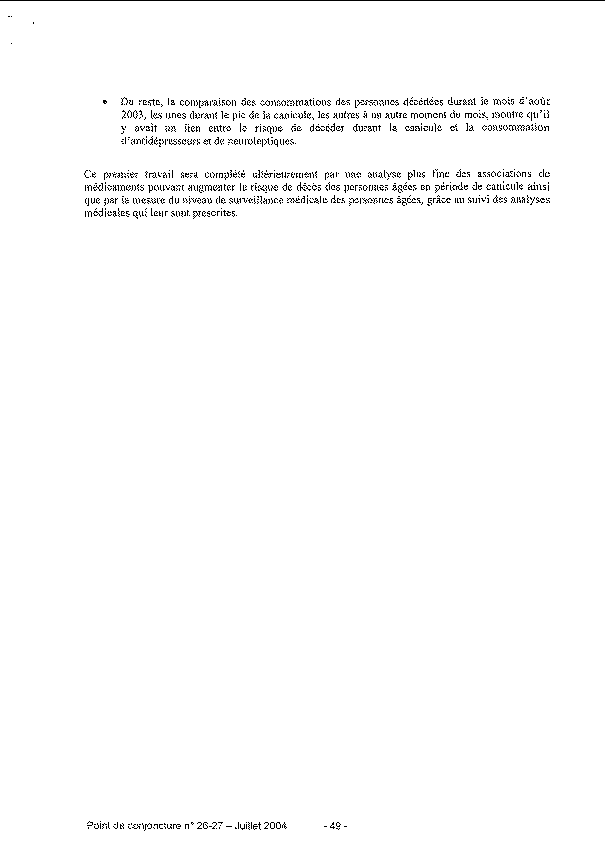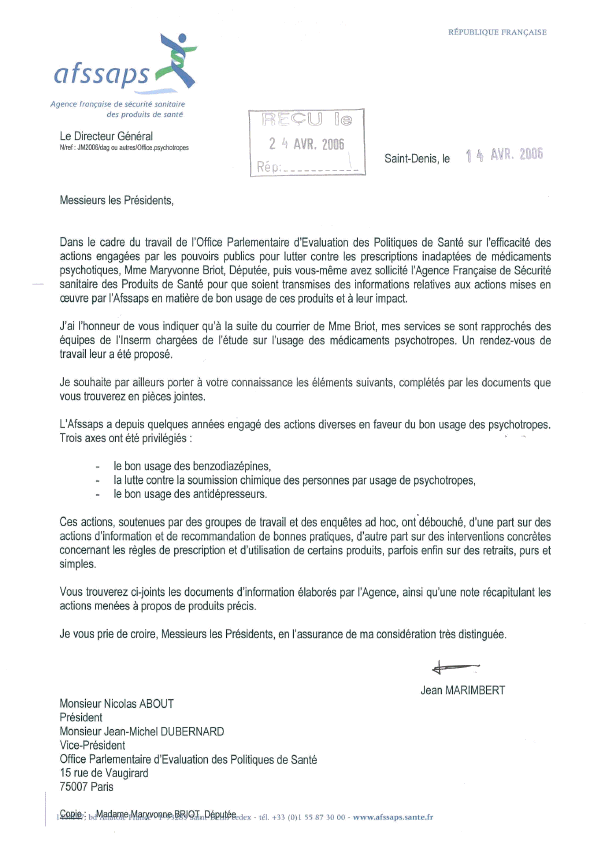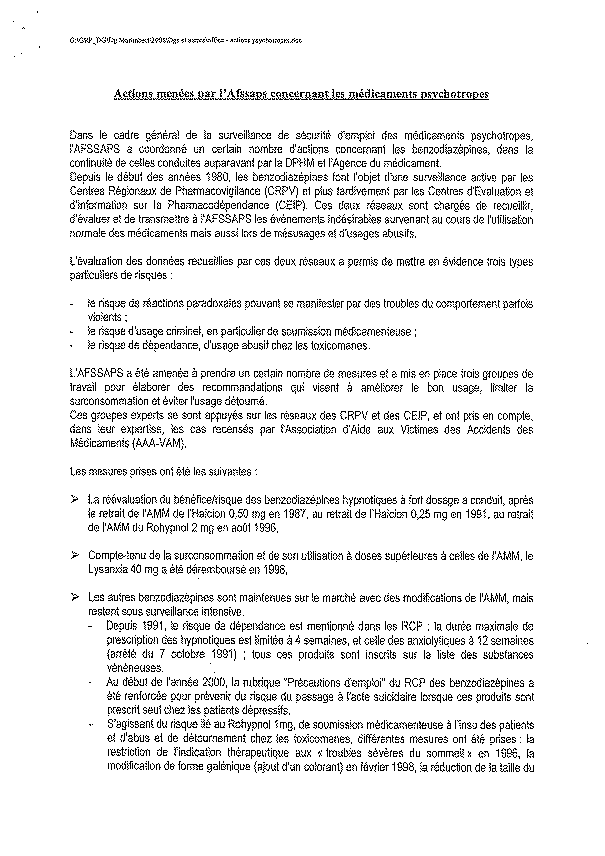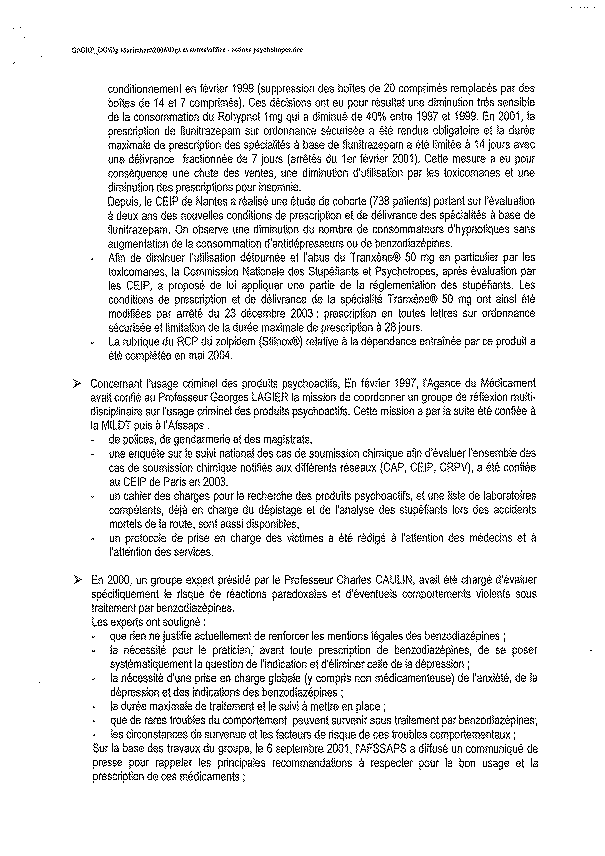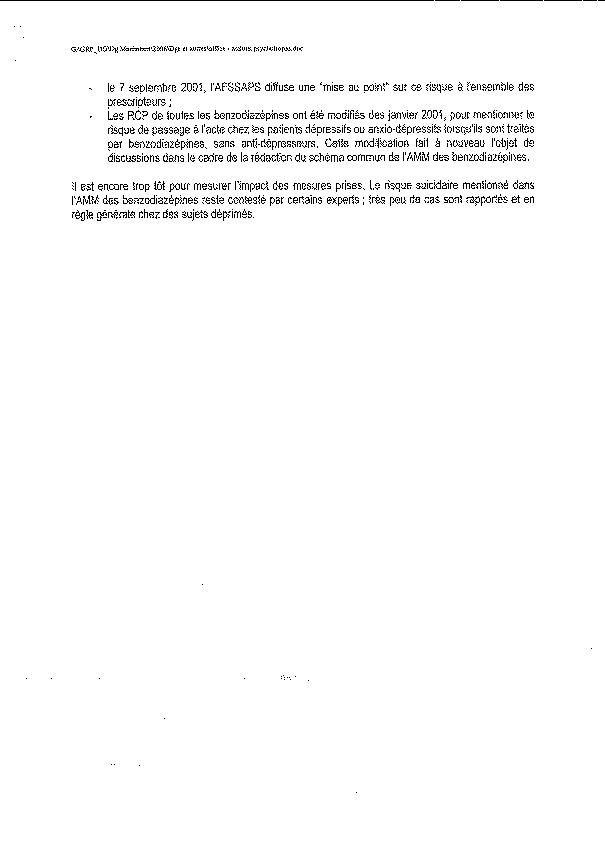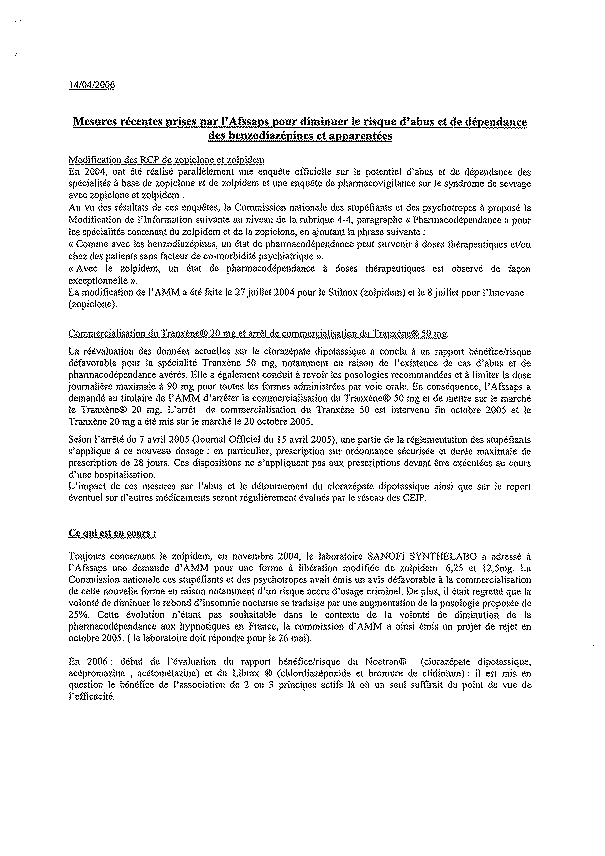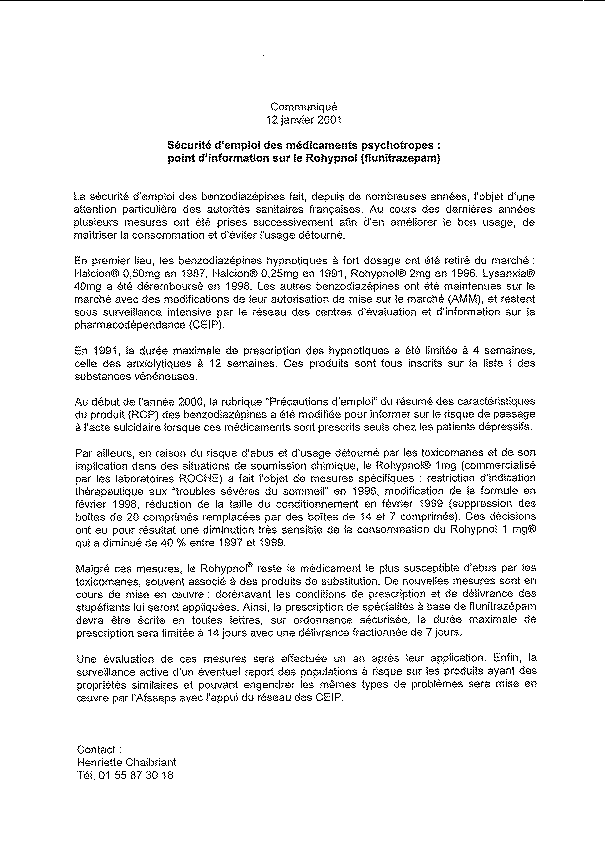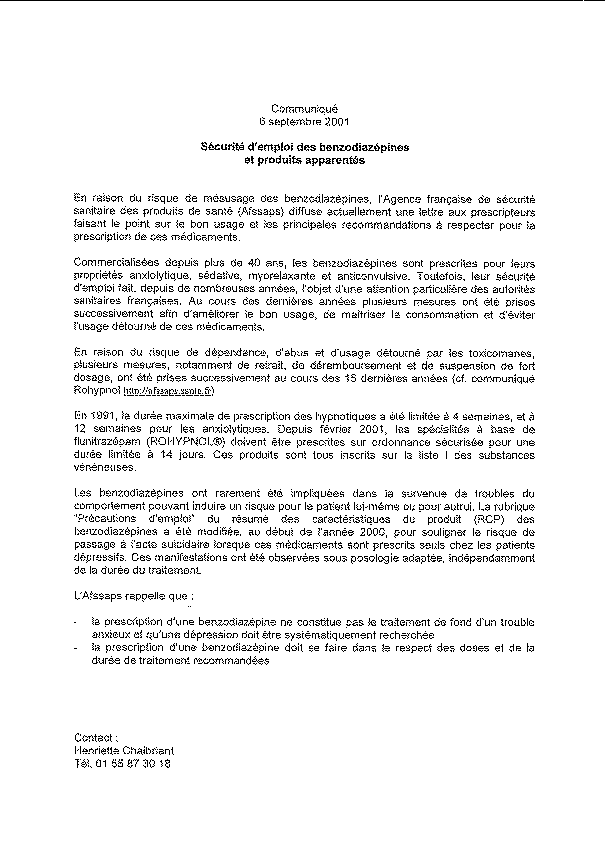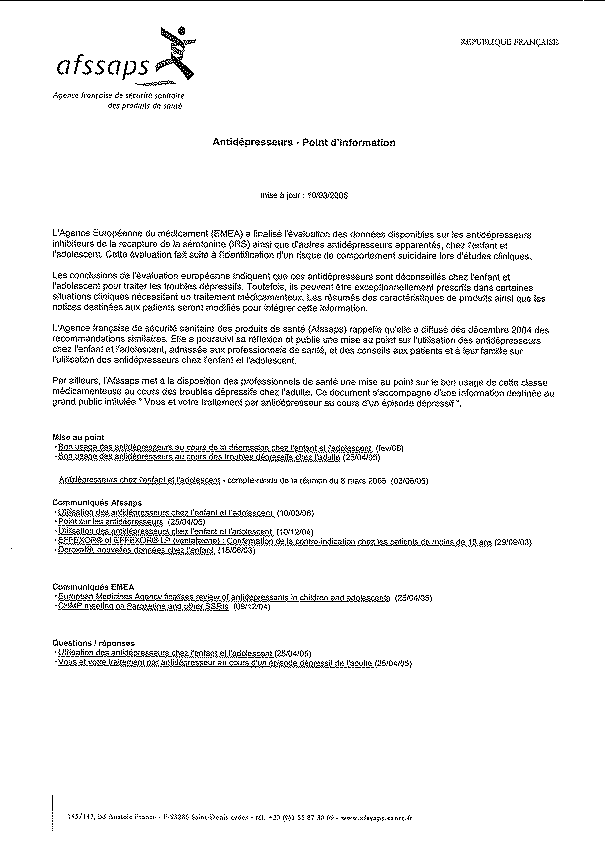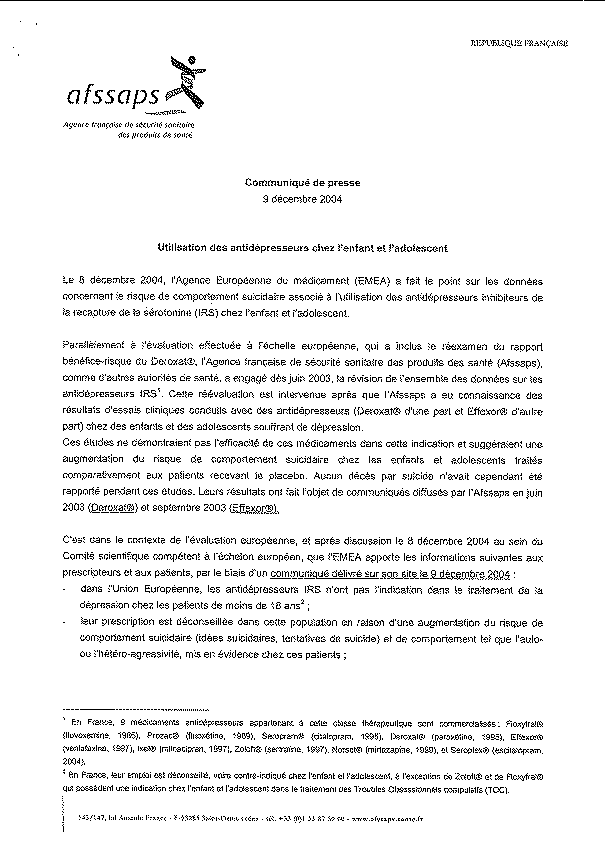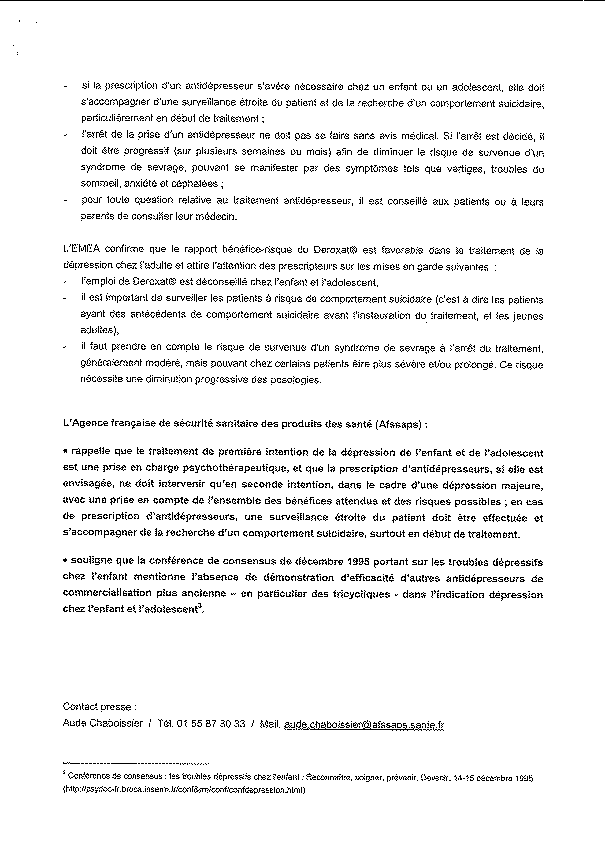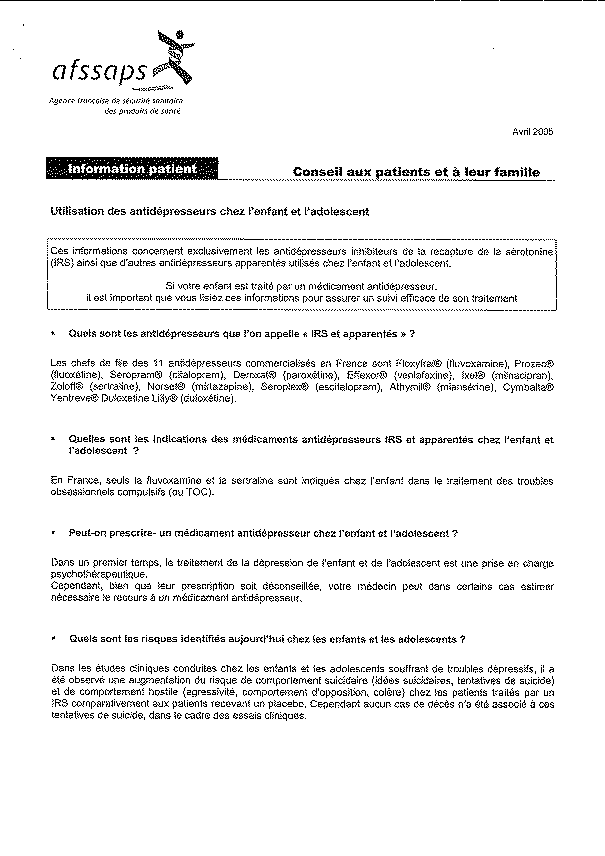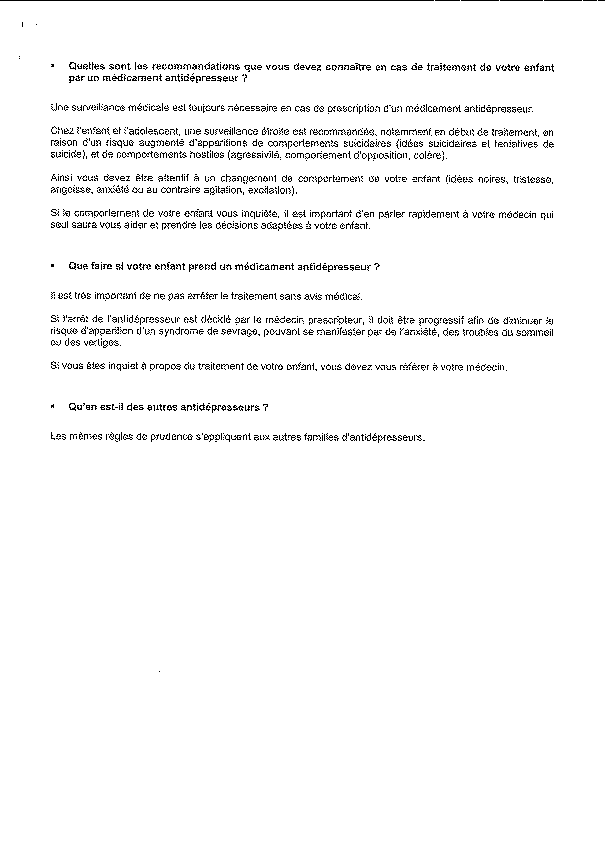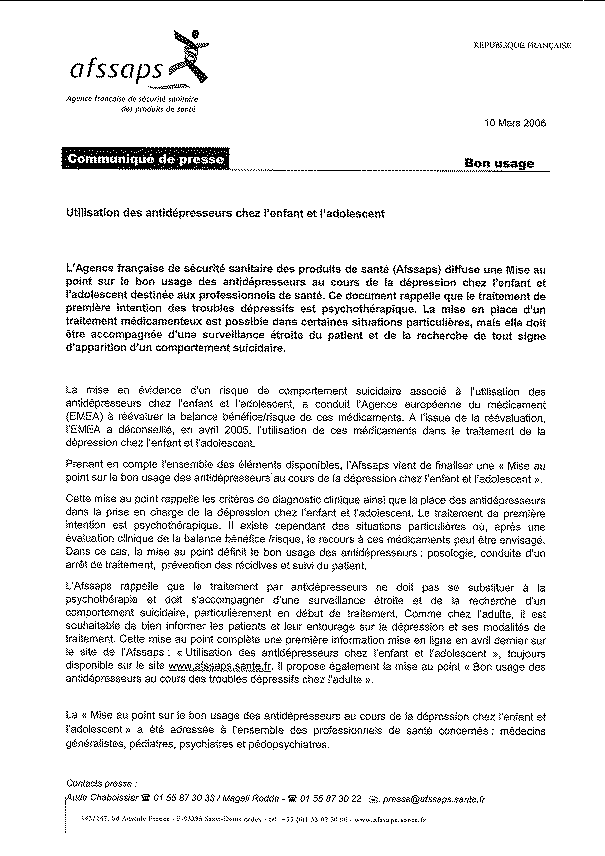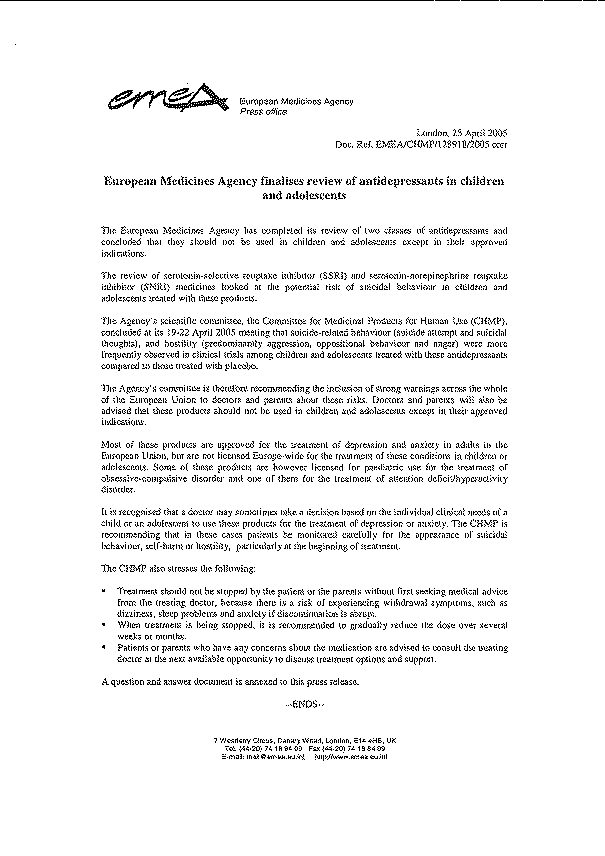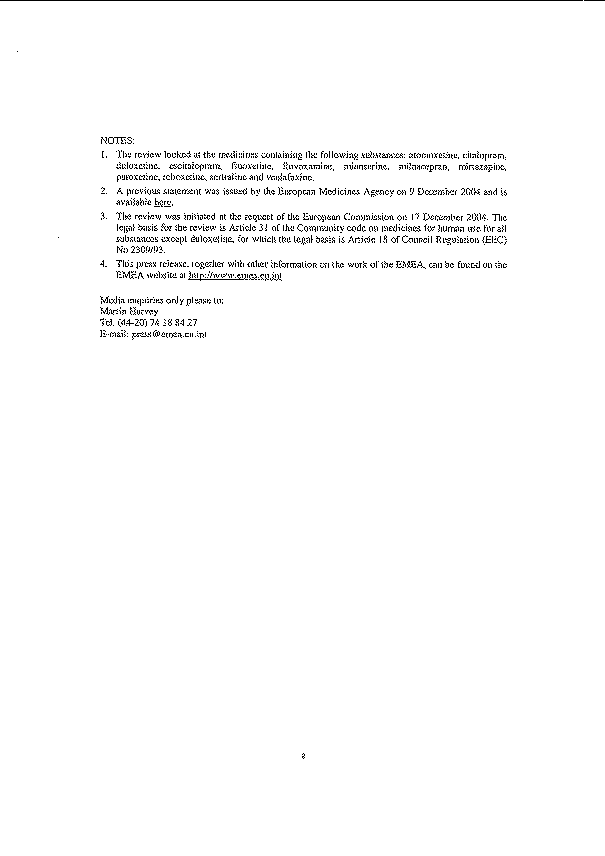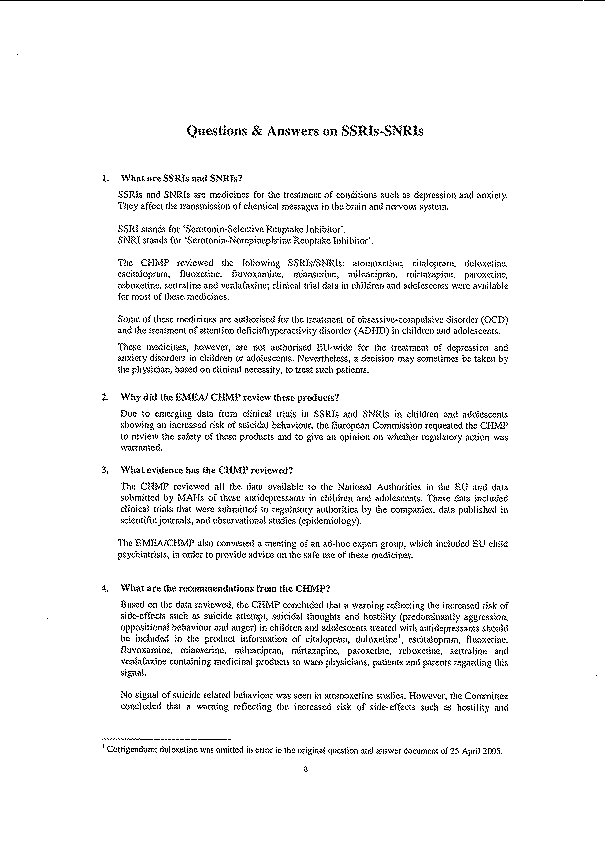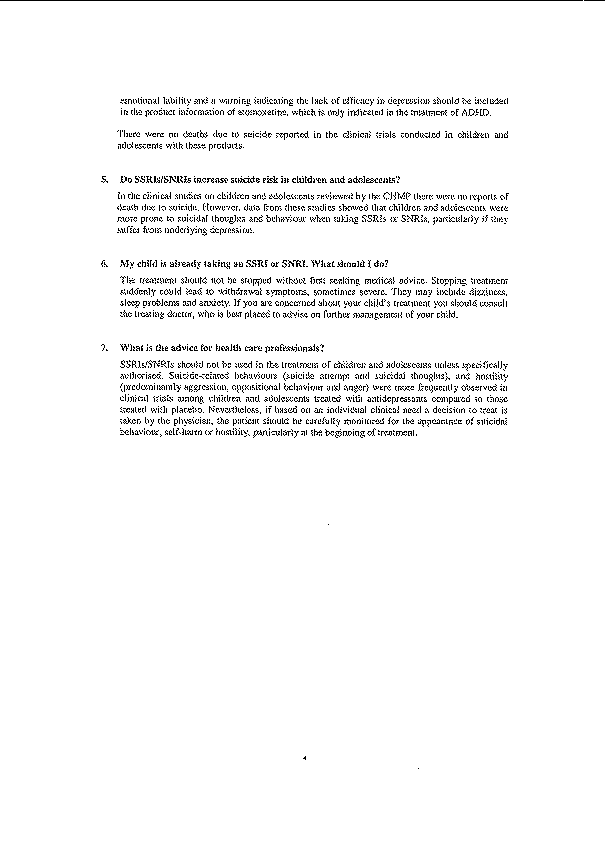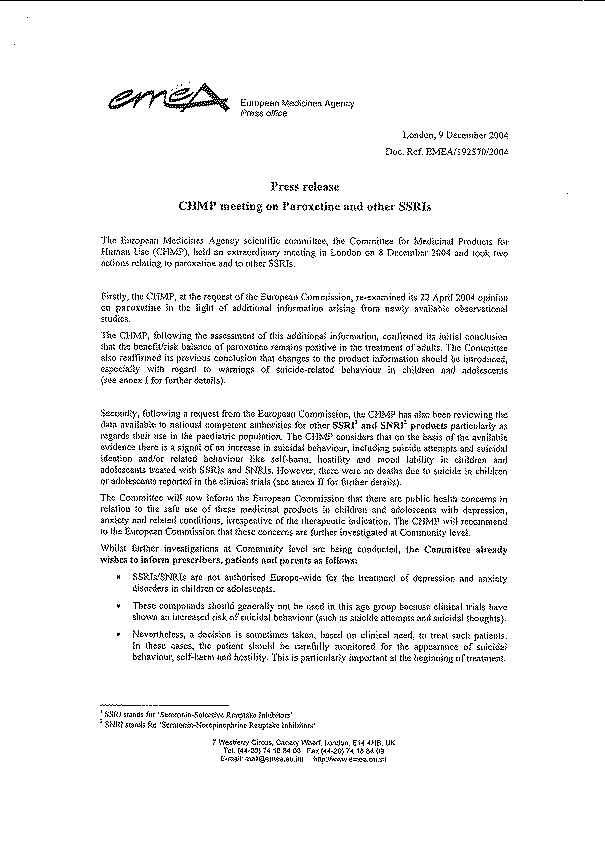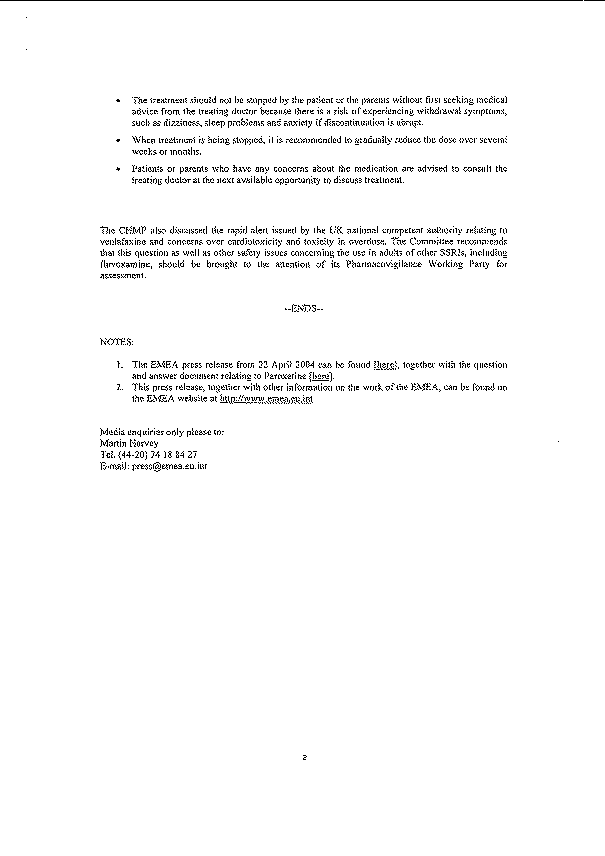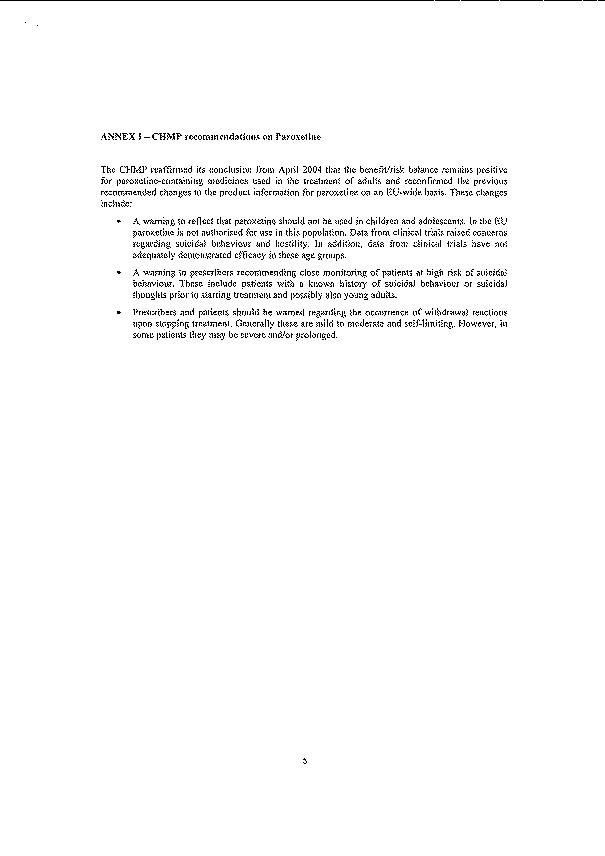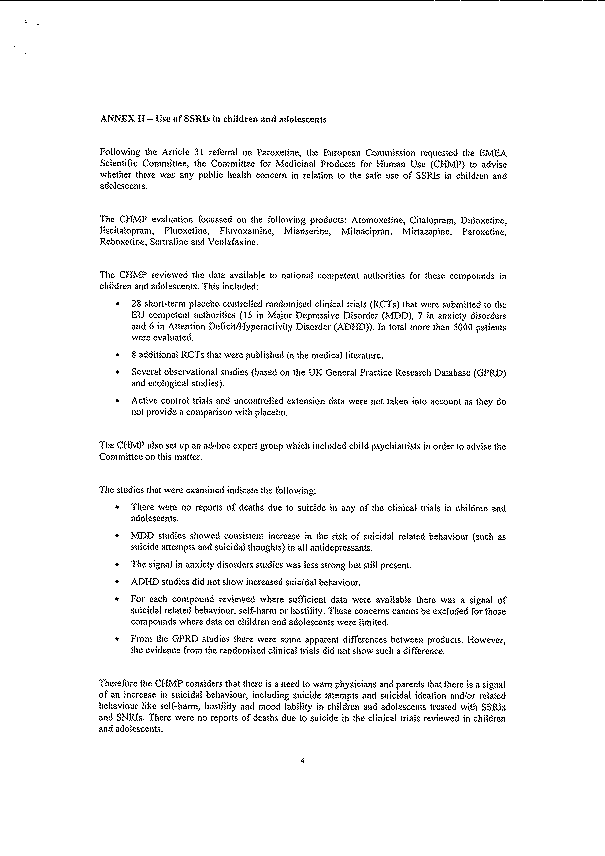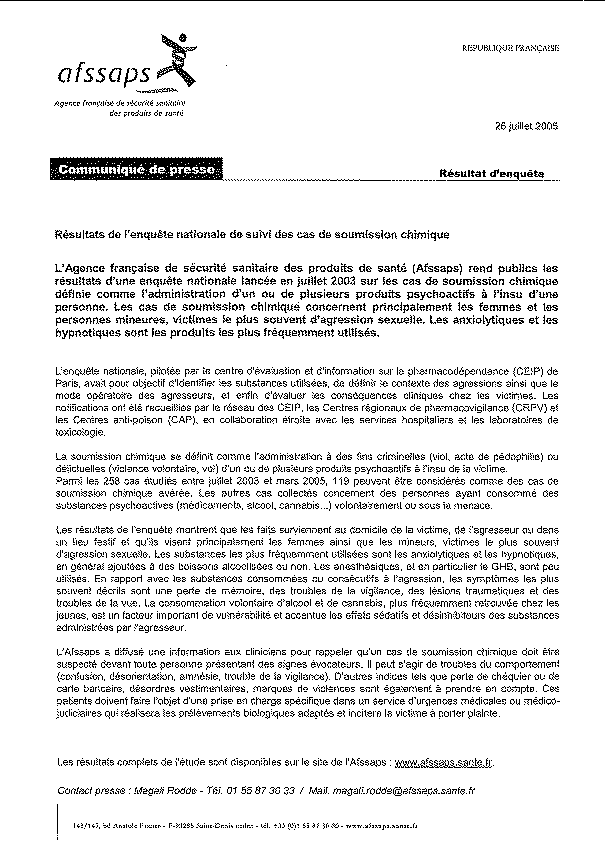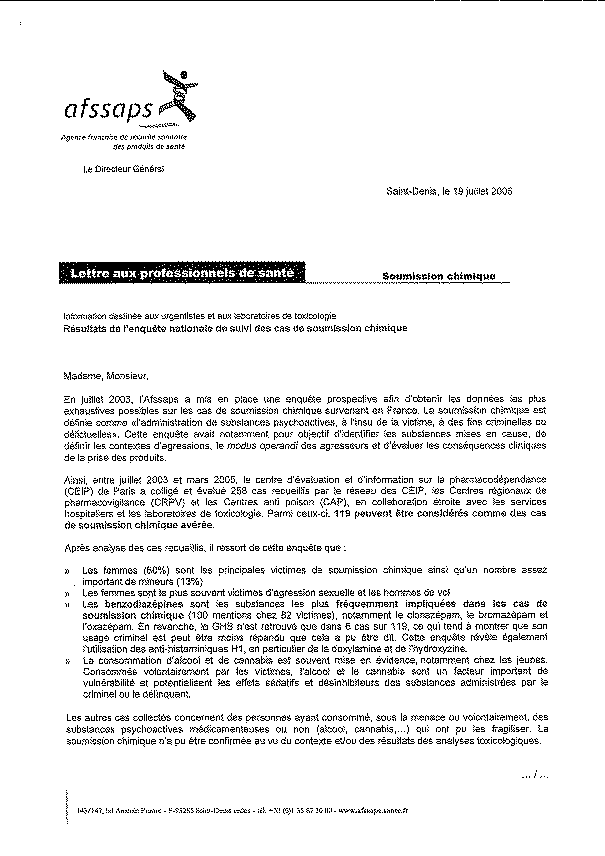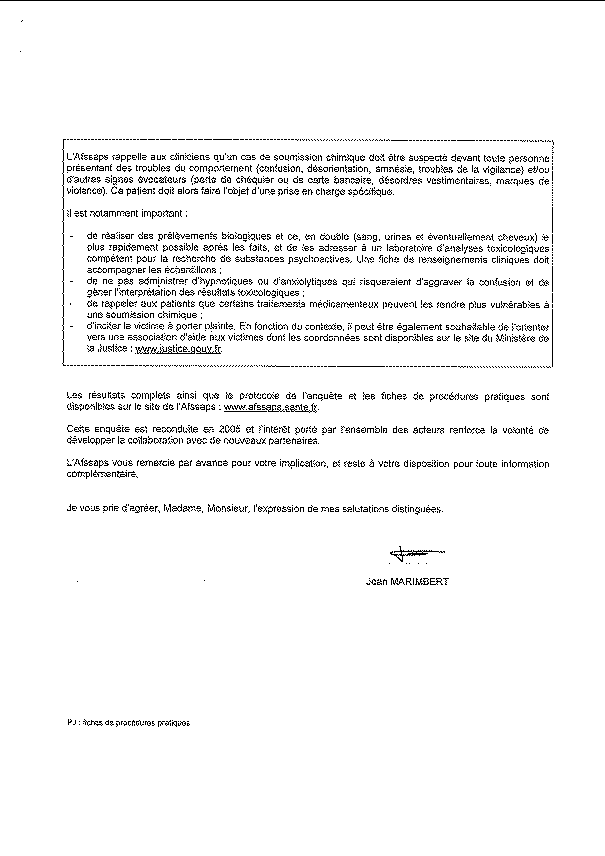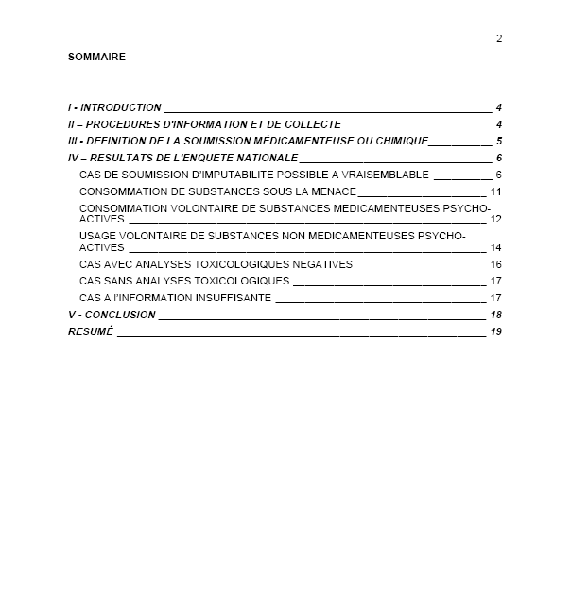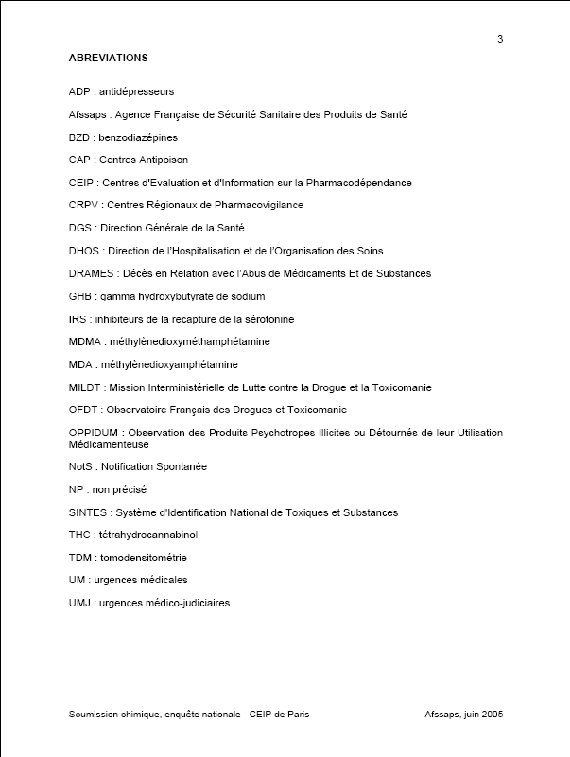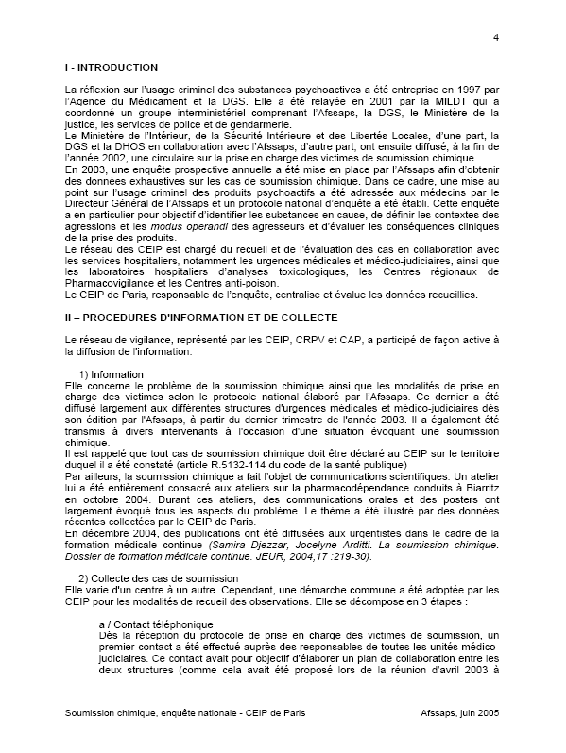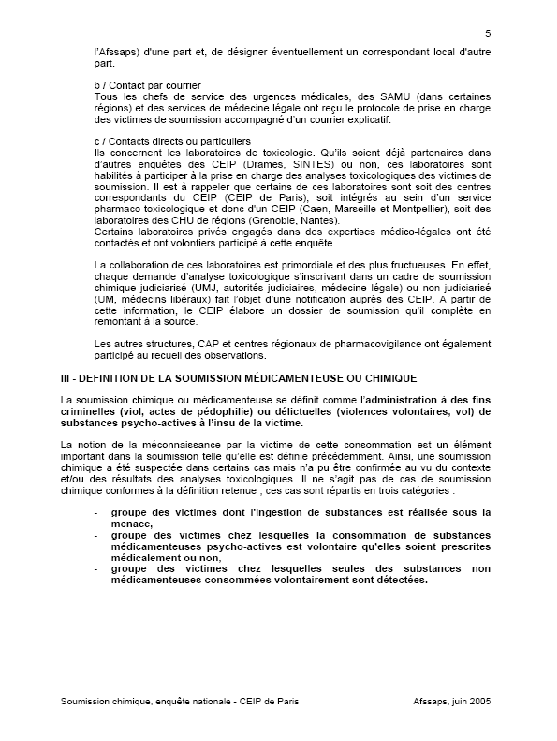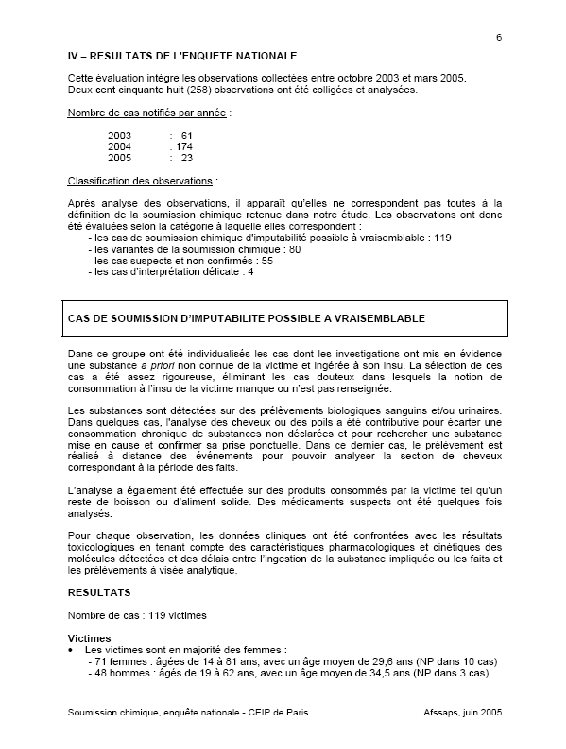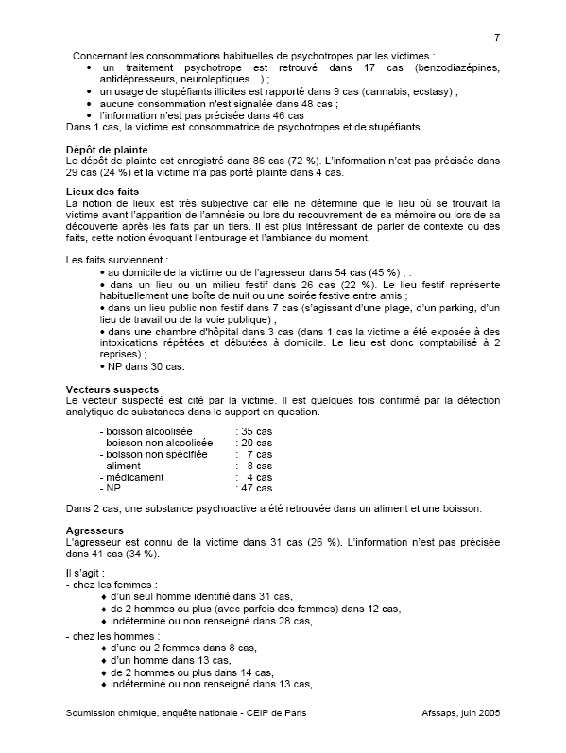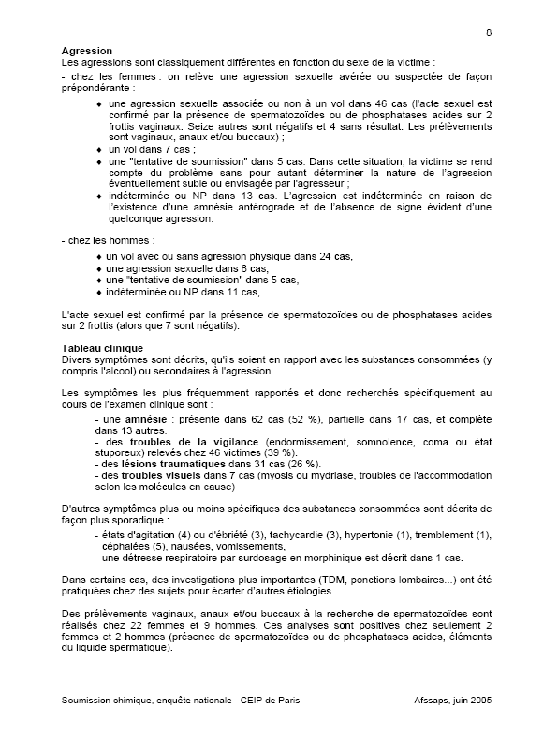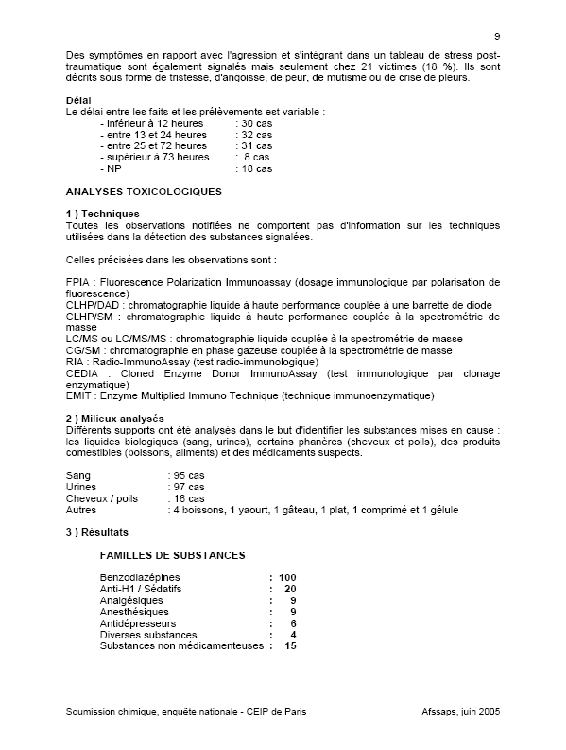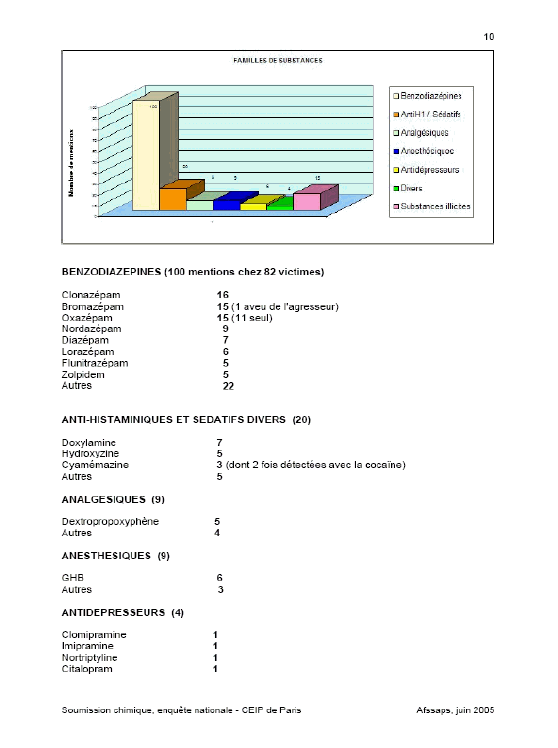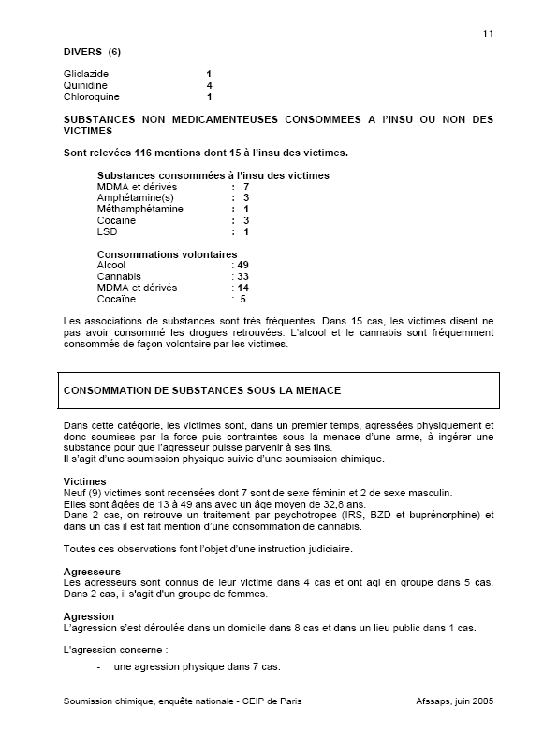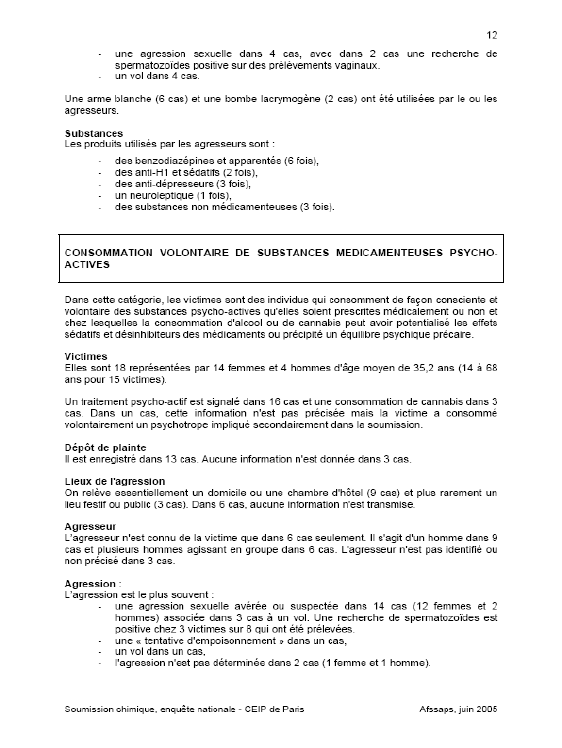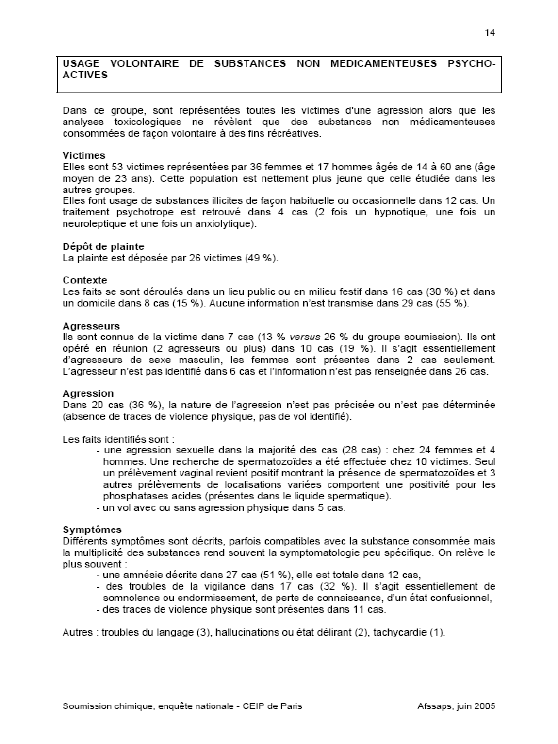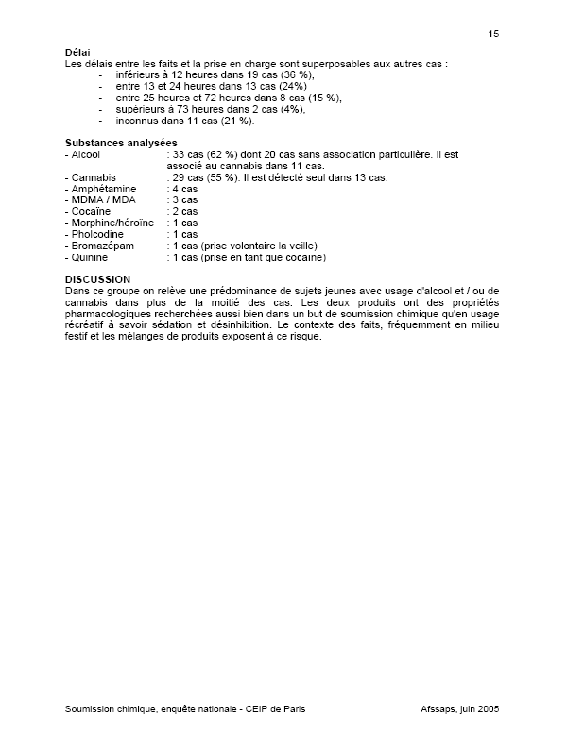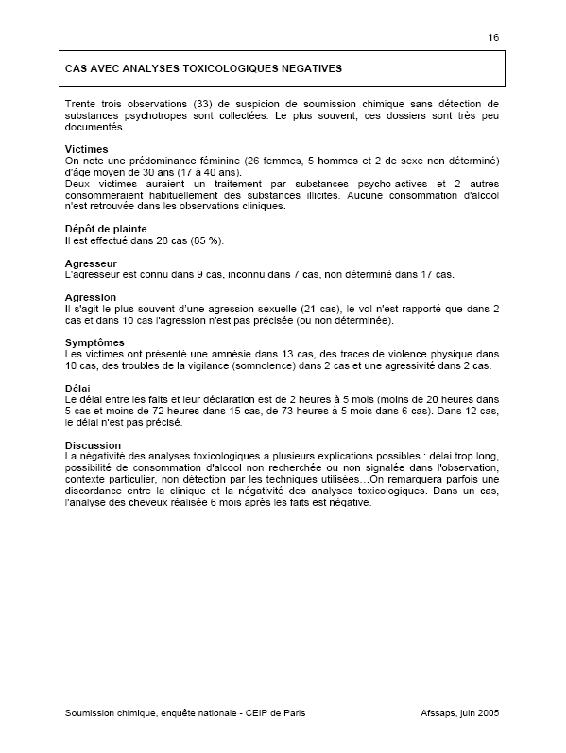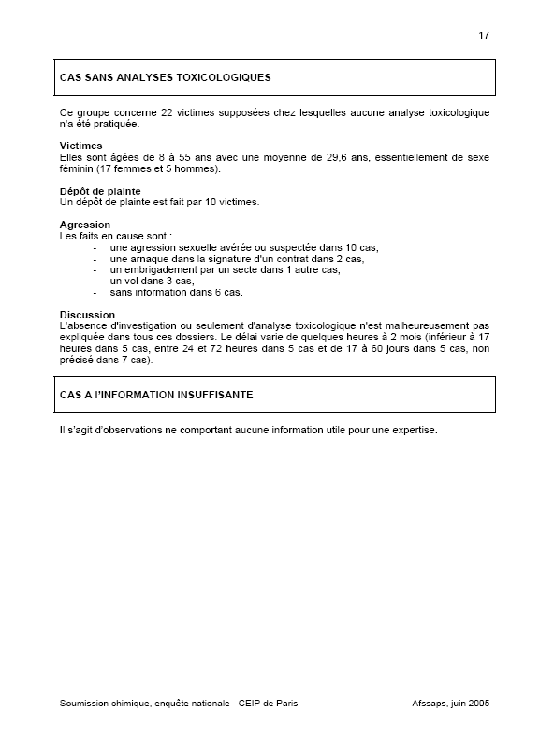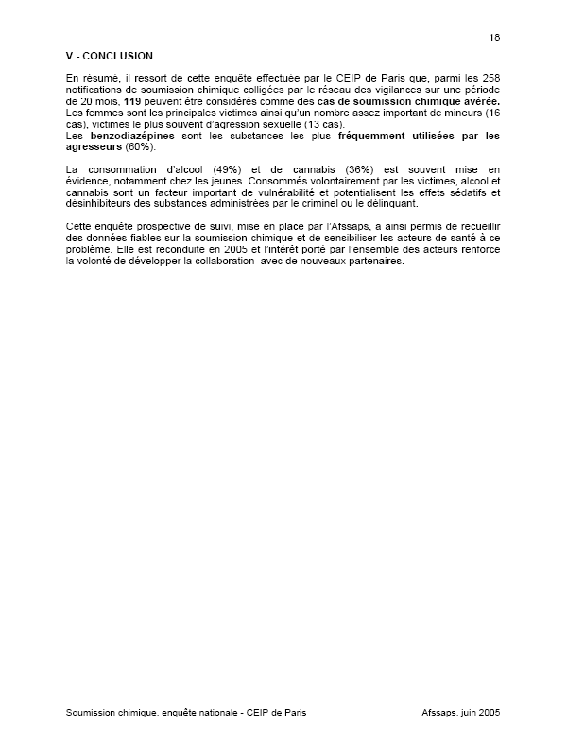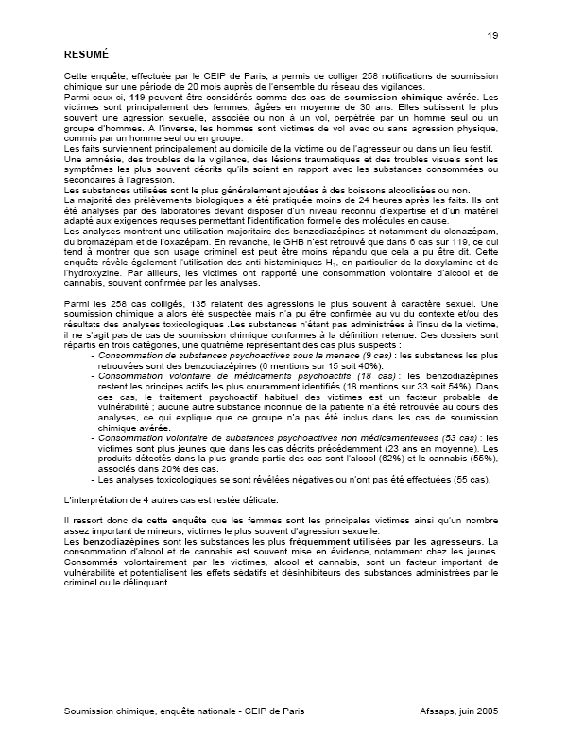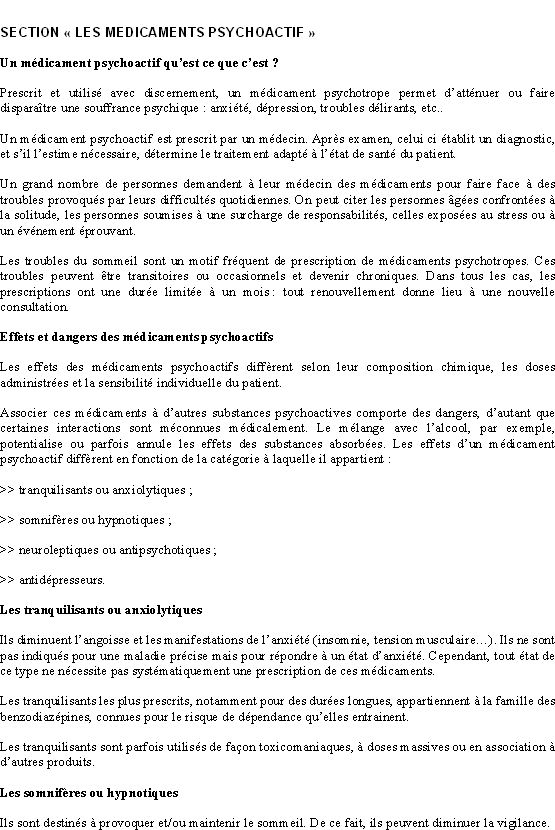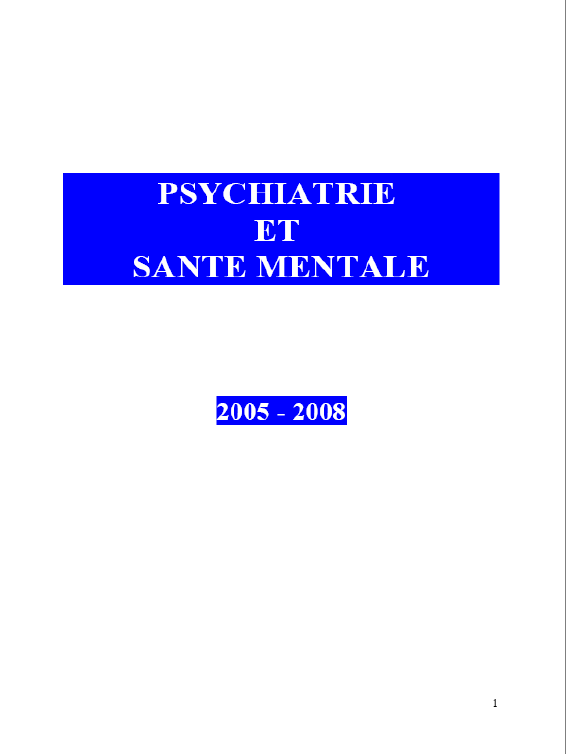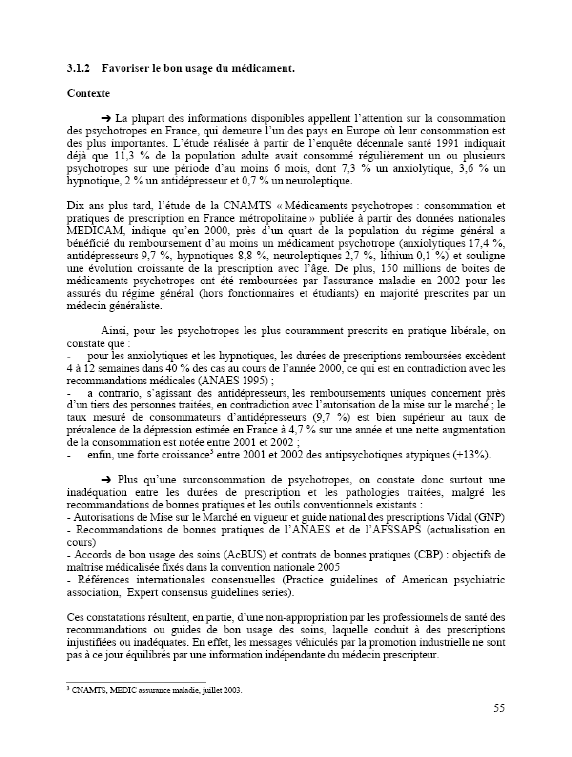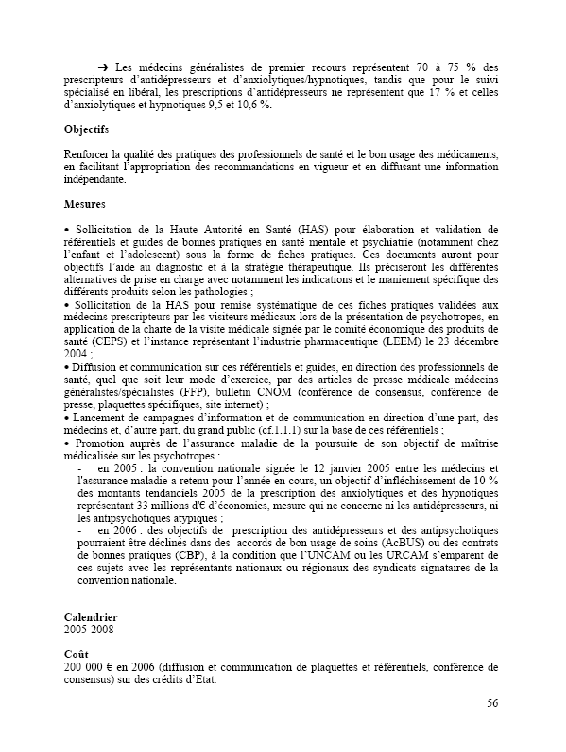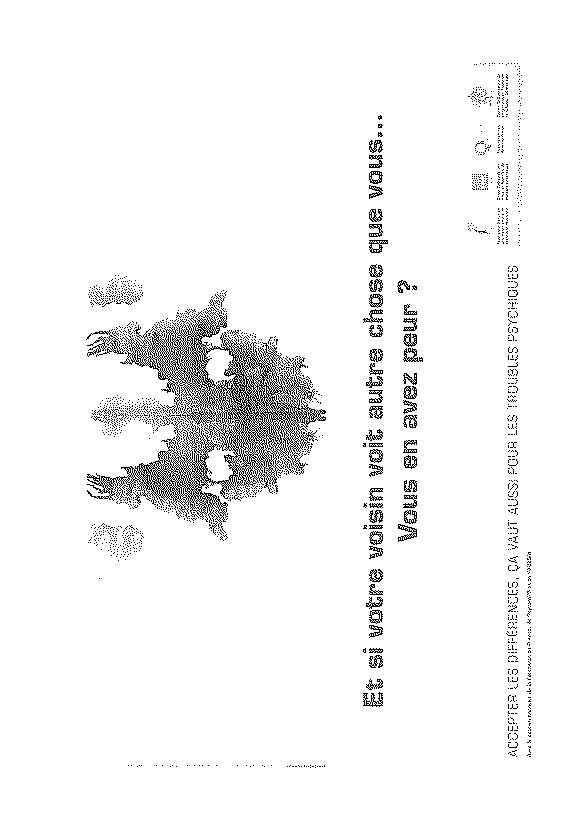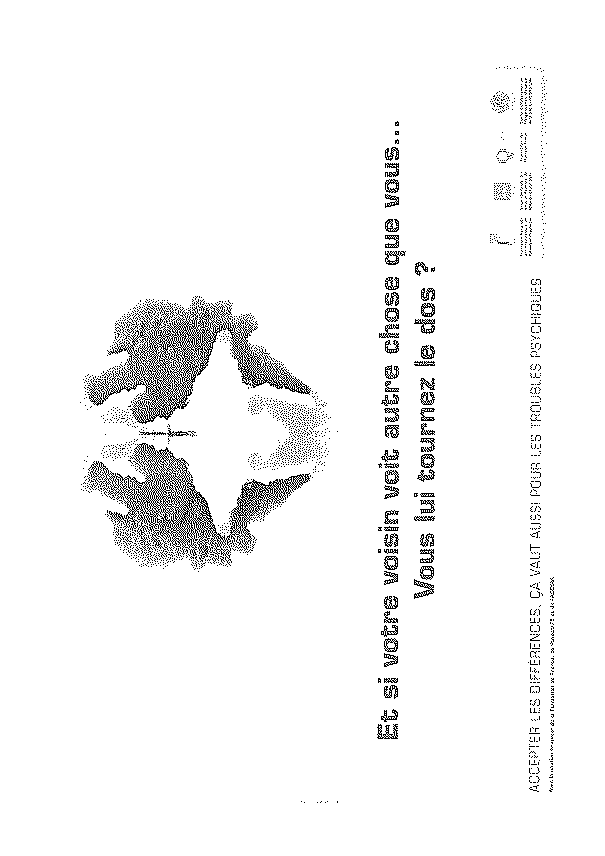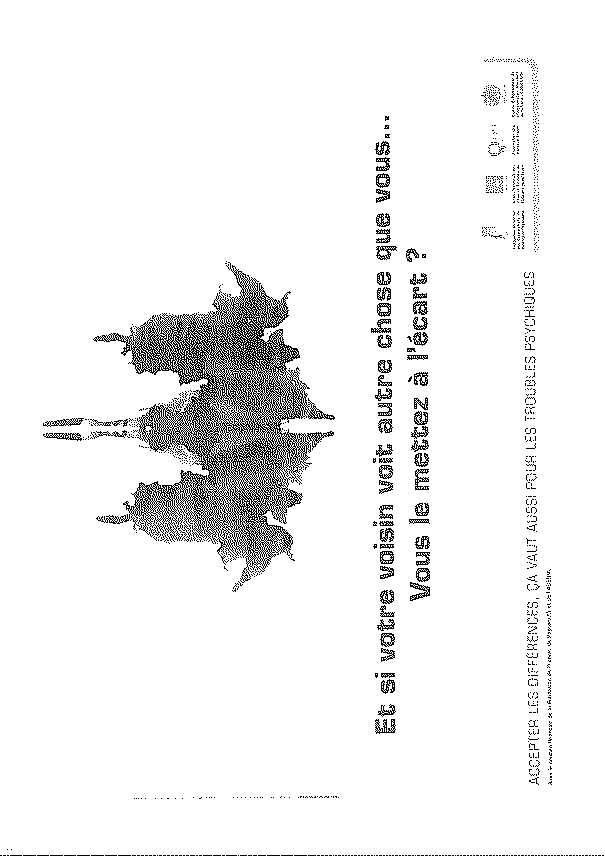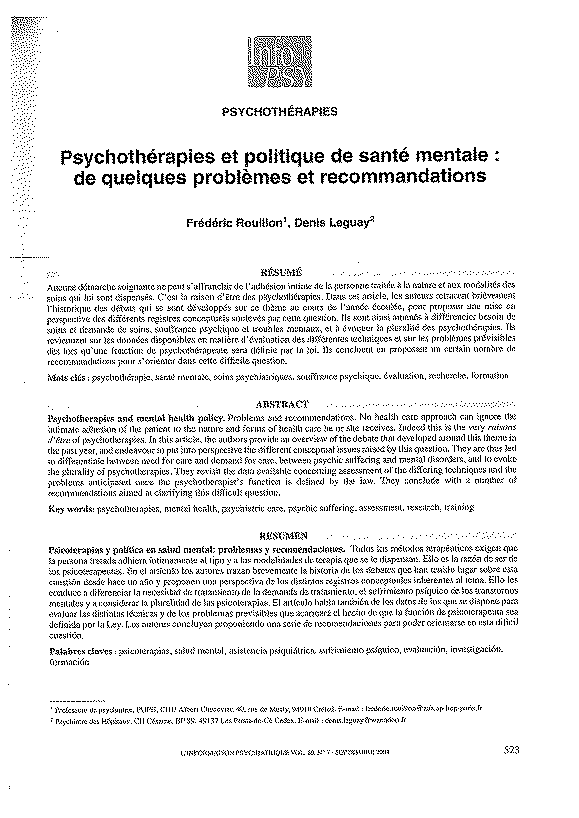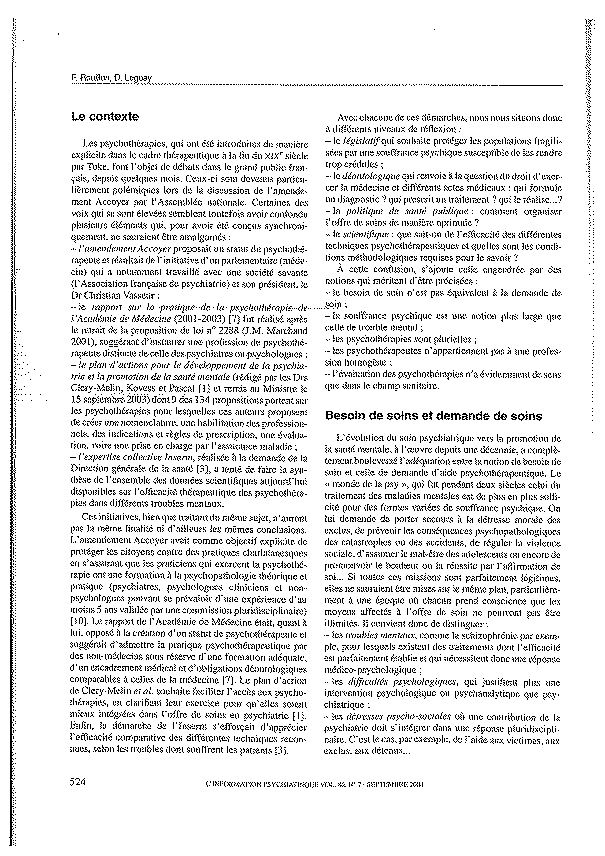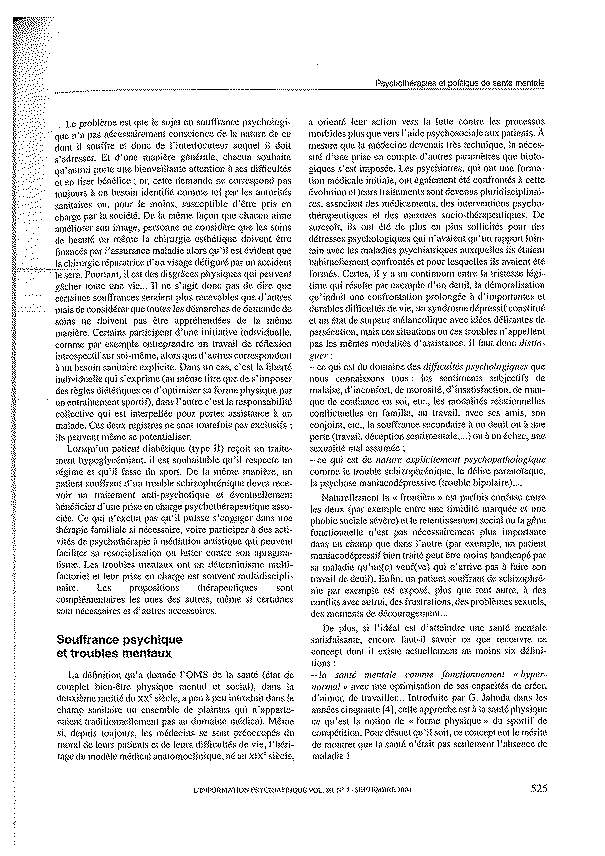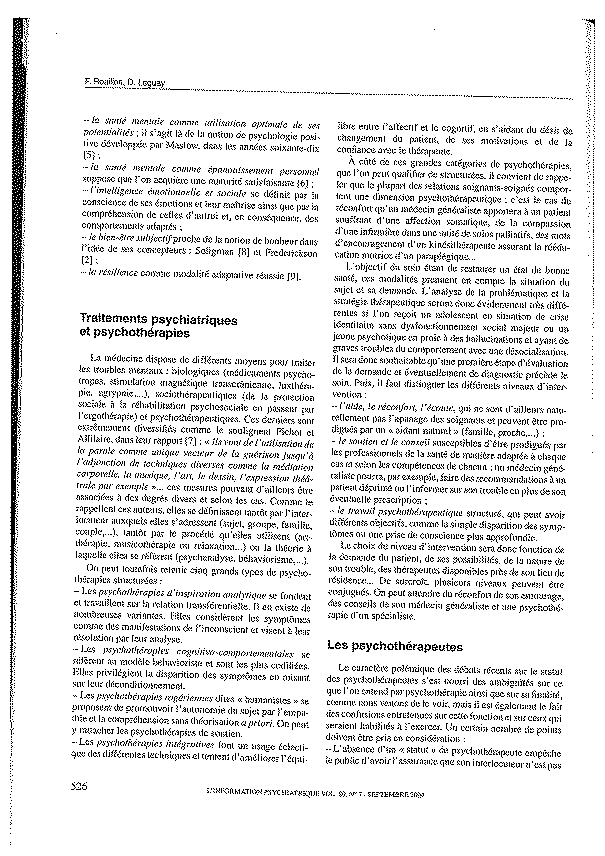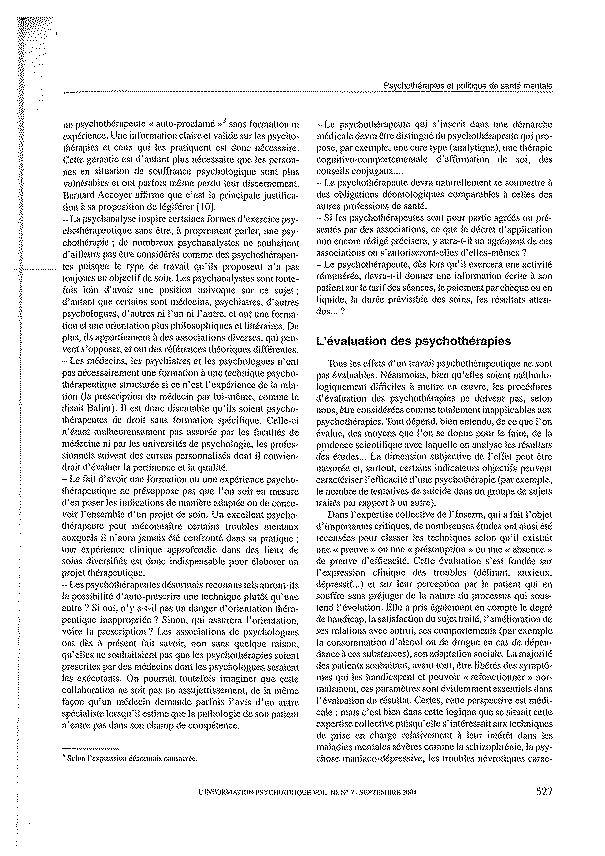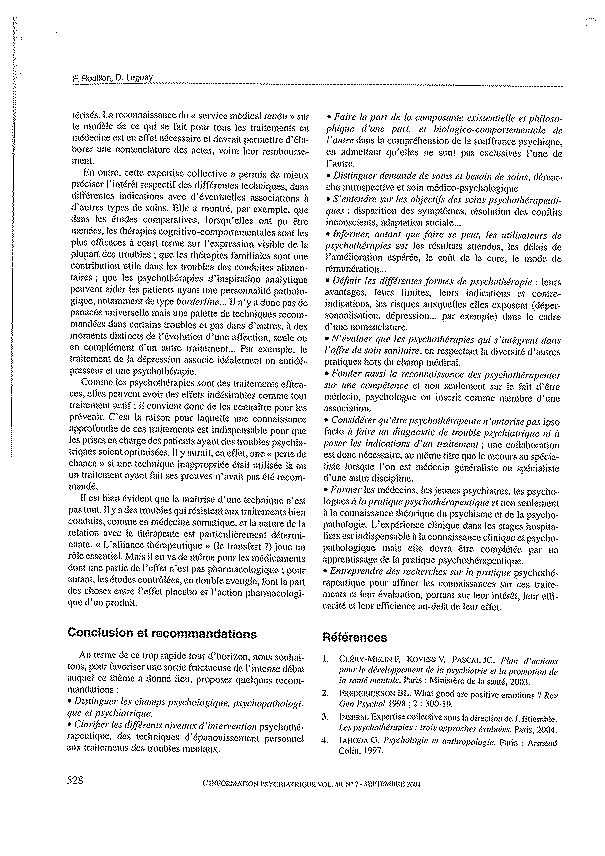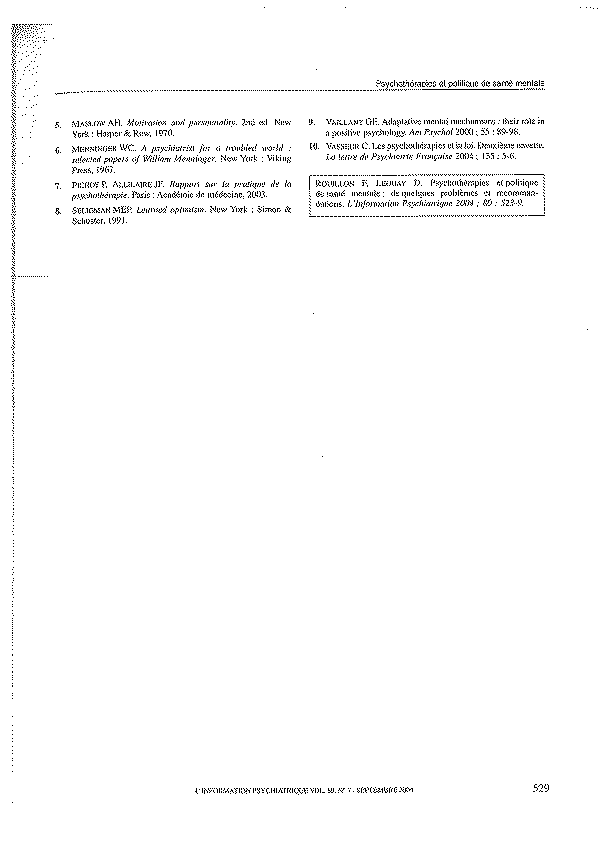__________ OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES POLITIQUES DE SANTÉ __________ RAPPORT sur le bon usage des médicaments psychotropes, par Mme Maryvonne BRIOT, Députée
Cet Office est composé de : MM. Jean-Michel Dubernard, premier vice-président, Mme Jacqueline Fraysse, M. Jean-Marie Le Guen, Jean Bardet, Gérard Bapt, Marc Bernier, Mme Maryvonne Briot, MM. Paul-Henri Cugnenc, Claude Evin, Mme Cécile Gallez, M. Jean-Luc Préel, Jean-Marie Rolland, députés MM. Nicolas About, président, Gilbert Barbier, Jean-François Picheral, Jean-Pierre Godefroy, Alain Vasselle, Paul Blanc, Bernard Cazeau, Gérard Dériot, Jean-Claude Etienne, Guy Fischer, Dominique Leclerc, Alain Milon, sénateurs. INTRODUCTION 15 I.- LE NIVEAU ÉLEVÉ DE LA CONSOMMATION FRANÇAISE DES PSYCHOTROPES EST UN SUJET D'INQUIÉTUDE. 17 A. LE RECOURS AUX MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES S'EST BANALISÉ 17 1. La population française recourt plus facilement aux psychotropes que celles des autres pays européens, et la consommation croît avec l'âge 17 2. L'analyse des ventes de médicaments montre une évolution de la consommation dans le temps, liée à l'apparition de nouvelles molécules 18 3. L'incidence de la demande sociale de traitement psychiatrique explique également l'augmentation de la consommation de psychotropes. 19 B. L'ANALYSE DES PRESCRIPTIONS MONTRE QU'IL N'EST ACTUELLEMENT PAS FAIT UN BON USAGE DES MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES EN FRANCE 20 1. Les prescriptions témoignent du rôle majeur de la médecine générale dans la prise en charge des troubles psychiques. 21 2. Les phénomènes de surconsommation sont largement liés à la chronicité du recours à ces médicaments 22 3. Les risques liés au sevrage ne doivent pas être confondus avec les risques liés à la dépendance 23 4. L'absence de traitement en cas de troubles psychiatriques avérés témoigne tout autant d'un mauvais usage des médicaments psychotropes 24 II.- LES CONSÉQUENCES DE LA CONSOMMATION MASSIVE DE PSYCHOTROPES SONT ENCORE INSUFFISAMMENT ÉVALUÉES 27 A. DES RISQUES ENCORE INSUFFISAMMENT DOCUMENTÉS 27 1. Les effets secondaires des psychotropes à base de benzodiazépines. 27 2. Le risque de suicide chez les personnes traitées avec des antidépresseurs, notamment chez les jeunes. 27 3. Les effets secondaires indirects de l'emploi de psychotropes 28 B. UNE APPRÉCIATION INSUFFISANTE DU RAPPORT BÉNÉFICES / RISQUES DANS LA PRESCRIPTION DES PSYCHOTROPES 28 C. UN MANQUE MANIFESTE DE DONNÉES PHARMACO-ÉPIDÉMIOLOGIQUES 29 III.- AMÉLIORER L'USAGE DES MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES 31 A. FAVORISER UN MEILLEUR USAGE DES MÉDICAMENTS 31 1. Promouvoir le respect des recommandations de bonnes pratiques concernant la prescription des médicaments 31 a) Améliorer la formation initiale et continue des médecins généralistes en matière de prescription 31 b) Améliorer la diffusion des recommandations de bonnes pratiques 32 2. Améliorer la régulation du médicament 32 a) Généraliser les études d'évaluation bénéfices/risques 32 b) Préciser les compétences des autorités sanitaires et des agences existantes en matière d'évaluation après autorisation de mise sur le marché 33 c) Evaluer systématiquement l'impact des mesures de maîtrise médicamenteuse 34 B. AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES SOINS EN SANTÉ MENTALE 35 1. Améliorer la formation des médecins généralistes pour un diagnostic plus fiable 35 2. Décloisonner la prise en charge des troubles psychiatriques 35 C. LES MESURES SPÉCIFIQUES AUX MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES 36 1. Se donner les moyens de mettre en place un système de suivi pharmaco-épidémiologique régulier 36 2. Mieux associer la délivrance de psychotropes et la prise en charge psychologique 37 3. Informer les prescripteurs sur les syndromes de sevrage et les former aux protocoles existants. 38 4. Assurer l'éducation du public sur les règles d'emploi des médicaments psychotropes 38 a) Promouvoir les règles d'hygiène de vie 38 b) Ne pas stigmatiser les consommateurs de médicaments psychotropes 39 RECOMMANDATIONS DE L'OPEPS 41 TRAVAUX DE L'OFFICE 43 ÉTUDE 45 I.- OBJECTIF DE L'ÉTUDE 49 II.- QUESTION 1 : « QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES ET LES SPÉCIFICITÉS AU NIVEAU EUROPÉEN DE LA CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES EN FRANCE ? » 51 A. MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES : DÉFINITION ET DIFFÉRENTES CLASSES 51 a) Classification 52 b) Anxiolytiques 52 c) Hypnotiques 53 d) Neuroleptiques/antipsychotiques 53 e) Normothymiques/thymorégulateurs/régulateurs de l'humeur 54 f) Antidépresseurs 54 g) Psychostimulants 55 B. DONNÉES SUR L'USAGE DES PSYCHOTROPES ISSUES D'ÉTUDES PHARMACO-ÉPIDÉMIOLOGIQUES PUBLIÉES DANS DES REVUES SCIENTIFIQUES 55 1. Critères de sélection des études 55 2. Étude ESEMeD (European Study of the Epidemiology of Mental disorders) 56 a) Présentation de la méthode de l'étude 56 b) Principaux résultats concernant l'usage des psychotropes 57 c) Commentaires 59 3. Étude comparative de l'usage des médicaments psychotropes dans 4 pays européens. 60 a) Présentation de la méthode de l'étude 60 b) Principaux résultats concernant l'usage des psychotropes 60 c) Commentaires 62 4. Enquête « santé mentale en population générale : images et réalité » 62 a) Présentation de la méthode de l'étude 62 b) Principaux résultats concernant l'usage des psychotropes 63 c) Commentaires 64 5. Études portant sur l'utilisation d'une classe de psychotropes 66 a) Antidépresseurs 66 b) Anxiolytiques et hypnotiques 67 c) Neuroleptiques/antipsychotiques 68 6. Études portant sur des populations spécifiques 70 b) Enfants et adolescents 74 c) Médecins 80 C. DONNÉES FOURNIES PAR LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE 81 1. CNAM-TS (Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) 81 a) Enquête nationale sur le comportement des médecins et des pharmaciens face à la limitation réglementaire de la durée de prescription des anxiolytiques et des hypnotiques 81 b) Étude sur la consommation et les pratiques de prescription en France métropolitaine 82 c) Disparités géographiques dans les prescriptions médicamenteuses d'antibiotiques, de psychotropes et de statines 86 d) Étude de la consommation des antidépresseurs dans la région Midi-Pyrénées 86 e) Étude sur la prescription de psychotropes chez les enfants et adolescents 88 2. CANAM (Caisse Nationale d'Assurance Maladie des professions indépendantes) 89 a) Enquête nationale sur la prescription de psychotropes 90 b) Consommation de psychotropes chez l'enfant et l'adolescent âgé de 0 à 19 ans 94 D. AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTÉ (AFSSAPS) 99 E. AUTRES SOURCES DE DONNÉES ISSUES DES ORGANISMES PUBLICS 100 1. IRDES (Institut de Recherche et Documentation en Économie de la Santé) 100 2. OFDT (Observatoire Français des Drogues et Toxicomanie) 101 a) Rapports 101 b) Usage de médicaments psychotropes chez les adolescents : enquêtes ESPAD et ESCAPAD 101 3. INPES (Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé) 105 F. DONNÉES DE VENTE ET COÛT DES MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES 108 1. Comparaison des systèmes de soins européens 108 a) Organisation des soins et dépenses pharmaceutiques 108 b) Mode de régulation et médicaments pris en charge en France, Allemagne et Royaume-Uni 112 2. Données issues de Rapports 114 a) « Mission générale concernant la prescription et l'utilisation des médicaments psychotropes en France » (Zarifian, 1996) 114 b) Rapport européen : the State of Mental Health in the European Union 116 3. Caisses d'assurance maladie 118 a) CNAM-TS (Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) 118 b) CANAM (Caisse Nationale d'Assurance Maladie des professions indépendantes) 123 4. Afssaps (Agence française de sécurite sanitaire des produits de sante) 123 a) Analyse des ventes de médicaments aux officines et aux hôpitaux en France, 1988-1999 123 b) Analyse des ventes de médicaments aux officines et aux hôpitaux en France, 1993-2003 124 c) Étude de la prescription et de la consommation des psychotropes en ambulatoire 127 5. DREES (Direction de la recherche, des études de l'évaluation et des Statistiques, ministère de la santé et des solidarités) 129 a) Les dépenses de médicaments remboursables 129 b) Les ventes d'antidépresseurs 130 c) Des comptes de la santé par pathologie 132 6. IRDES (Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé) 134 7. Sociétés d'information médicale 134 8. Industrie pharmaceutique 137 III.- QUESTION 2 « QUELS SONT LES PRINCIPAUX FACTEURS EXPLICATIFS DE CETTE ÉVOLUTION ? » 147 A. LE REGARD DES SCIENCES SOCIALES 147 a) Un indicateur de la prescription pharmaceutique 150 b) Les populations prescrites : distinguer la diffusion de la consommation de sa durée 153 3. De la norme thérapeutique à la pratique médicale 158 a) L'adéquation clinique de la prescription 158 b) La rationalité thérapeutique des généralistes : la convergence des pratiques 160 c) L'isolement du médecin généraliste 163 4. Du côté des patients : les logiques de l'usage 164 a) La consommation, des discours aux pratiques 164 b) Consommation et durée de recours 169 B. ACTIONS DE PROMOTION DE LA PRESCRIPTION DE PSYCHOTROPES PAR L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 173 1. Les actions qui précèdent l'AMM 174 a) La participation des « leaders d'opinion » aux essais cliniques de phase III 174 b) La sensibilisation des prescripteurs et du public à la pathologie cible du nouveau médicament 174 c) Le rôle de l'industrie pharmaceutique dans l'élaboration des catégories diagnostiques 175 d) Élargissement des indications d'un médicament déjà commercialisé 175 e) Introduction d'une nouvelle forme galénique d'un médicament déjà commercialisé 175 f) Autorisation Temporaire d'Utilisation 175 2. Les actions mises en œuvre après l'AMM 176 a) La visite médicale 176 b) Les médecins régionaux 177 c) Les congrès 177 d) Les leaders d'opinion 177 e) La presse 178 f) Les usagers et les usagers potentiels 178 C. APPROCHE JURIDIQUE : LE CORPUS NORMATIF 179 1. Le médicament psychotrope : une appellation au carrefour de l'approche médicale et juridique du médicament 179 a) Dualité de l'appellation « médicament psychotrope » 179 b) Contribution de la liste des substances psychotropes à la qualification d'un médicament en tant que psychotrope 180 2. Cadre juridique de la prescription et de la dispensation des médicaments psychotropes 181 a) Dispositions générales 181 b) Dispositions spécifiques susceptibles d'être appliquées aux psychotropes 186 c) La prescription et la dispensation restreintes 188 3. Adaptation du cadre juridique à l'évolution de l'état des connaissances concernant un médicament (à droit constant) 189 a) Le circuit décisionnel 189 b) L'articulation avec l'évaluation des médicaments en conditions réelles d'utilisation 191 c) Portée des processus d'évaluation 193 4. Encadrement de l'activité promotionnelle des laboratoires pharmaceutiques 195 a) État du marché : demande croissante, offre mondialisée 195 b) Le dispositif d'encadrement des activités promotionnelles 197 c) La taxation des budgets promotionnels 203 D. SYNTHÈSE 205 1. Le regard des sciences sociales 205 2. Actions de promotion de la prescription de psychotropes par l'industrie pharmaceutique 206 3. Approche juridique : le corpus normatif 207 E. BIBLIOGRAPHIE 209 IV.- QUESTION 3 : « DE QUELLE FAÇON CES MÉDICAMENTS SONT-ILS UTILISÉS AU REGARD DES RECOMMANDATIONS DE BONNE PRATIQUE ? » 213 A. DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUE SUR LA PRÉVALENCE DES TROUBLES PSYCHIATRIQUES 213 1. Critères de sélection des études 213 2. Etude ESEMeD (European study of the Epidemiology of Mental disorders) 214 3. Enquête santé mentale en population générale 216 4. Étude de prévalence des troubles psychiatriques dans une population de personnes âgées 217 5. Données épidémiologique sur la prévalence des troubles psychiatriques chez l'enfant 218 6. Commentaires 219 B. ADÉQUATION ENTRE USAGE DE PSYCHOTROPES ET DIAGNOSTIC PSYCHIATRIQUE 220 1. Définitions et critères de sélection des études 220 2. Etude ESEMeD (European study of the Epidemiology of Mental disorders) 220 3. Enquête santé mentale en population générale 222 4. Enquête santé et protection sociale du Centre de Recherche, d'Etude et de Documentation en Economie de la Santé 230 5. Adéquation entre usage de benzodiazépines et diagnostic 231 6. Troubles du sommeil et usage des psychotropes chez les sujets âgés 232 7. Adéquation à l'autorisation de mise sur le marché des instaurations de traitement par des inhibiteurs spécifiques du recaptage de sérotonine 232 C. IMPACT POPULATIONNEL DE L'UTILISATION INAPPROPRIÉE DE PSYCHOTROPES (ÉVALUATION DU RAPPORT RISQUE/BÉNÉFICE) 234 1. Antidépresseurs et risque suicidaire 235 a) Antidépresseurs et conduites suicidaires dans la population adulte 235 b) Antidépresseurs et conduites suicidaires chez l'enfant et l'adolescent 241 c) Hypothèses concernant le lien entre antidépresseurs et conduites suicidaires 244 d) Commentaires sur les données de la littérature 245 e) Estimation par analyse de décision du nombre de suicides évités/induites par les traitements antidépresseurs dans la population française 246 2. Médicaments psychotropes et accidents de la voie publique 253 a) Données expérimentales et épidémiologiques 253 b) Aspects réglementaires 257 3. Benzodiazépines et risque de chutes chez la personne âgée 260 4. Benzodiazépines et risque de déclin cognitif ou de démence 264 D. RECOMMANDATIONS DE BONNE PRATIQUE 269 E. SYNTHÈSE 272 1. Epidémiologie des troubles psychiatriques et adéquation diagnostic-traitement 272 2. Impact populationnel de l'utilisation inappropriée de psychotropes (Evaluation du rapport bénéfice / risque) 276 3. Recommandations de bonne pratique 278 F. BIBLIOGRAPHIE 280 V.- QUESTION 4 : « QUELLE EST L'EFFICACITÉ DES ACTIONS ENGAGÉES PAR LES POUVOIRS PUBLICS ET L'ASSURANCE MALADIE AFIN DE LUTTER CONTRE LES PRESCRIPTIONS INADAPTÉES » ? 289 A. RECENSEMENT DE L'ENSEMBLE DES ACTIONS ENTREPRISES EN MATIÈRE DE MAÎTRISE MÉDICALISÉE DE LA CONSOMMATION DE PSYCHOTROPES 289 1. Caisses d'assurance maladie 290 a) RMO (Références Médicales Opposables) 290 b) Rapport de la Cour des Comptes « La Sécurité Sociale 2005 » 290 c) Convention médicale 2005 291 d) Moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés et évaluation de l'impact des actions 291 2. Direction générale de la santé 293 3. Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 294 4. Haute Autorité de santé 296 5. Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie 297 6. Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé 298 7. Unions Régionales de Médecins Libéraux 298 8. Formation médicale continue 299 B. « PLAN POUR LA PSYCHIATRIE ET LA SANTÉ MENTALE » 2005-2008 299 C. SYNTHÈSE 300 D. BIBLIOGRAPHIE 303 VI.- QUESTION 5 : « QUELLES SONT LES ALTERNATIVES THÉRAPEUTIQUES » ? 305 A. ALTERNATIVES THÉRAPEUTIQUES 305 1. Traitements biologiques non médicamenteux 305 a) Electroconvulsivothérapie 305 b) Stimulation magnétique transcrânienne 306 c) Photothérapie 307 2. Méthodes thérapeutiques non allopathiques 308 a) Homéopathie 308 b) Autres méthodes 310 3. Psychothérapies 311 a) Estimation du nombre de psychothérapeutes en France 311 b) Estimation du nombre de sujets ayant une prise en charge psychothérapique en France 312 c) Les différentes approches et leur efficacité 314 4. Mesures hygiéno-diététiques 320 B. MESURES DE PRÉVENTION PRIMAIRE ET SECONDAIRE 321 1. Prévention des troubles psychiatriques 321 2. Prévention de l'usage inapproprié de médicaments psychotropes 323 VII.- QUESTION 6 : « COMMENT SORTIR DE LA DÉPENDANCE ? » 329 A. DÉFINITIONS 329 1. Dépendance à une substance psychoactive 329 2. Syndrome de sevrage 330 3. Implications concernant les psychotropes 331 B. SEVRAGE AUX ANXIOLYTIQUES ET HYPNOTIQUES 332 1. Caractéristiques du syndrome de sevrage 332 2. Recommandations pour l'interruption du traitement 333 a) Durée d'action de la molécule 333 b) Diminution progressive des doses 333 c) Autres stratégies pharmacologiques et non-pharmacologiques 334 d) Synthèse des recommandations 335 C. SEVRAGE AUX ANTIDÉPRESSEURS 335 D. DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES CONCERNANT LA DÉPENDANCE ET L'USAGE DÉTOURNÉ DE MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES 337 1. Rapports d'activité des centres spécialisés de soins aux toxicomanes 337 2. Enquête OPPIDUM (Observation des Produits Psychotropes Illicites ou Détournés de leur Utilisation Médicamenteuse) 339 a) Présentation de la méthode de l'étude 339 b) Principaux résultats 340 c) Commentaires 345 3. Enquête tendances récentes et nouvelles drogues (Trend) 346 a) Présentation de la méthode de l'étude 346 b) Principaux résultats 346 4. Enquête OSIAP (Ordonnances Suspectes Indicateurs d'Abus et de Pharmacodépendance) 347 a) Présentation de la méthode de l'étude 347 b) Principaux résultats 348 c) Commentaires 350 5. Usage de médicaments psychoactifs chez l'enfant et l'adolescent (CEIP de Marseille) 351 VIII.- QUESTION 7. SYNTHÈSE ET PROPOSITIONS DE RECOMMANDATIONS POUR L'ACTION PUBLIQUE 357 ANNEXES 367 ANNEXE 1 : PRINCIPAUX ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS UTILISÉS DANS CE RAPPORT 369 ANNEXE 2. LISTE DES TABLEAUX 375 ANNEXE 3. LISTE DES FIGURES 383 ANNEXE 4 : COURRIER AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CNAM-TS ET RÉPONSE CONCERNANT LA RÉALISATION D'ÉTUDES SUR L'USAGE ET L'IMPACT DES PSYCHOTROPES 385 ANNEXE 5 : ANAES. PRISE EN CHARGE D'UN ÉPISODE DÉPRESSIF DE L'ADULTE EN AMBULATOIRE (EXTRAITS) 387 ANNEXE 6 : AFSSAPS. MISE AU POINT. LE BON USAGE DES ANTIDÉPRESSEURS AU COURS DE LA DÉPRESSION CHEZ L'ENFANT ET L'ADOLESCENT 389 ANNEXE 7 : COURRIER ADRESSÉ AUX DIRECTEURS DE LA CNAM-TS ET DES INSTITUTIONS PUBLIQUES (AFSSAPS, HAS, DGS, MILDT, INPES). 399 ANNEXE 8 : RÉPONSE DE LA DGS 401 ANNEXE 9 : RÉPONSE DE L'AFSSAPS 441 ANNEXE 10 : LES PRINCIPALES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES, ÉDITION MILDT-DGS-INPES, À PARAÎTRE. 485 ANNEXE 11 : PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE 2005-2008 SECTION « FAVORISER LE BON USAGE DES MÉDICAMENTS » 487 ANNEXE 12 : CAMPAGNE NATIONALE EN FAVEUR DE LA SANTÉ MENTALE : « ACCEPTER LES DIFFÉRENCES, ÇA VAUT AUSSI POUR LES TROUBLES PSYCHIQUES » 491 ANNEXE 13 : PSYCHOTHÉRAPIES ET POLITIQUE DE SANTÉ MENTALE : DE QUELQUES PROBLÈMES ET RECOMMANDATIONS, ROUILLON ET LEGUAY. 495 La dépense pharmaceutique des Français - plus de 30 milliards d'euros en 2004 - place la France au deuxième rang, après les Etats-Unis, parmi les pays de l'Organisation de coopération et développement économique (OCDE). S'agissant plus particulièrement des médicaments psychotropes, la consommation française est la plus importante de celles des autres pays de l'Union européenne. Les médicaments psychotropes, qui regroupent un ensemble hétérogène de molécules, ont comme point commun d'être des substances psychoactives d'action exclusivement symptomatique, c'est-à-dire qu'ils n'agissent pas sur la cause des troubles. Ils font partie de la prise en charge thérapeutique psychiatrique sans pour autant la résumer. S'interrogeant sur les raisons du niveau élevé de la consommation française et sur ses conséquences en matière de santé publique, les membres de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé (OPEPS) ont souhaité disposer d'un état des lieux de la situation en France, afin de déboucher sur des recommandations argumentées. Le cahier des charges de l'étude a été structuré autour de six questions portant sur : - les caractéristiques et les spécificités de la consommation de médicaments psychotropes en France par comparaison avec les autres pays européens ; - les principaux facteurs explicatifs de l'évolution de la consommation dans notre pays ; - l'utilisation des médicaments psychotropes au regard des bonnes pratiques ; - l'efficacité des actions engagées par les pouvoirs publics et l'assurance maladie afin de lutter contre les prescriptions inadaptées ; - les alternatives thérapeutiques ; - la dépendance aux psychotropes. La réalisation de cette étude a été confiée après appel d'offres à l'unité INSERM 657 et IFR99 de l'Université Victor Segalen de Bordeaux 2, sous la responsabilité des professeurs Hélène Verdoux, médecin psychiatre, docteur en épidémiologie, et Bernard Bégaud, médecin pharmacologue, docteur en biologie humaine, professeur des universités-praticien hospitalier, directeur de l'unité INSERM U 657 et président de l'Université Bordeaux 2. Elle a permis de réunir des contributions scientifiques de premier ordre et rassemble des éléments importants sur un sujet qui n'a pas fait l'objet de synthèse récente. Les Professeurs Verdoux et Bégaud ont animé une équipe pluridisciplinaire de scientifiques (dix experts), qui a effectué un important travail de synthèse, prenant en compte de manière approfondie un grand nombre de travaux scientifiques et intégrant les contributions directes de plus de vingt personnes associées à l'équipe proprement dite. Par leur intermédiaire, des organismes très divers ont été associés à la réalisation de l'étude, parmi lesquels plusieurs unités de recherche de l'INSERM et services de Centres hospitaliers universitaires (CHU), la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes (CANAM), l'Agence française de sécurité sanitaire (Afssaps), l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), ainsi que la direction générale de la santé (DGS). Cette étude a donné lieu à un rapport scientifique, annexé au présent rapport, sur lequel s'appuient l'analyse de l'Office et ses recommandations. 1. La population française recourt plus facilement aux psychotropes que celles des autres pays européens, et la consommation croît avec l'âge La synthèse des résultats des enquêtes épidémiologiques sur la consommation de médicaments psychotropes fait apparaître qu'un français sur quatre a consommé au moins un médicament psychotrope au cours des douze derniers mois et qu'un Français sur trois en a déjà consommé au cours de sa vie. Le premier constat tiré des études pharmaco-épidémiologiques relatives aux psychotropes est donc celui d'une banalisation du recours à ces médicaments au sein de la population française. Les comparaisons européennes permettent de mieux saisir les particularités de la consommation française et montrent que la part de la population ayant pris un psychotrope au cours des douze derniers mois est deux fois supérieure à la moyenne des pays européens limitrophes à la France. Toutefois, si l'on associe fréquence (régularité) de consommation et durée de prise, le constat est plus nuancé et fait apparaître une durée moyenne de consommation plus réduite en France que dans ces autres pays. Le recours aux médicaments psychotropes se traduit de manière différenciée au sein de la population. Les études épidémiologiques font apparaître de façon assez constante un rapport entre les hommes et les femmes, de un à deux, que l'on observe à tous les âges de la vie, dès l'adolescence. On note également un recours massif aux médicaments psychotropes parmi les tranches d'âge les plus élevées. Après 60 ans, la moitié des femmes et un tiers des hommes ont pris au moins un psychotrope dans l'année. Enfin, encore plus inquiétant est le phénomène, certes marginal et pour le moment assez mal caractérisé, que l'étude d'une caisse régionale d'assurance maladie a relevé, de l'administration de ces médicaments aux âges les plus précoces de la vie, parfois même dès la première année. 2. L'analyse des ventes de médicaments montre une évolution de la consommation dans le temps, liée à l'apparition de nouvelles molécules Les comptes de santé par pathologie indiquent que les « troubles mentaux » représentent en France le quatrième poste de dépenses liées aux médicaments (5,5 % du total) et que les médicaments psychotropes se situent au deuxième rang derrière les antalgiques pour le nombre d'unités prescrites. Sur la période 1990-2005, on constate une croissance soutenue des ventes de médicaments psychotropes. Le montant des remboursements assurés par la sécurité sociale en 2003 et 2004 pour les médicaments psychotropes est estimé à un milliard d'euros, alors qu'en 1980, ce montant équivalait à 317 millions d'euros. Cette croissance est spectaculaire en valeur, en raison de l'augmentation du coût unitaire des médicaments qui se sont imposés sur le marché, mais elle est aussi observée en volume. L'analyse par catégories de psychotropes montre que la croissance globale est surtout liée à la montée en puissance de la catégorie des antidépresseurs, liée à l'apparition sur le marché de nouvelles spécialités pharmacologiques. Il faut rappeler à cet égard que la consommation pharmacologique, du point de vue statistique, s'appuie sur un classement des substances psychotropes en quatre catégories principales, selon leurs propriétés thérapeutiques :
L'essentiel de la croissance du marché de l'ensemble des psychotropes s'explique donc par la montée en puissance, à partir de 1990, de la catégorie des antidépresseurs de nouvelles générations. Alors que le marché global des psychotropes a cru de 700 millions d'euros entre 1980 et 2001, le seul segment des antidépresseurs est passé de 84 millions d'euros à 543 millions d'euros sur la même période. Cette progression est confirmée par une enquête - réalisée dans des conditions identiques en 1994, 1996 et 2003 - montrant que le nombre de sujets traités par antidépresseurs, est passé de 2,8 % de l'échantillon en 1994, à 3,5 % en 1996 et à 5 % en 2003. Elle correspond à l'arrivée sur le marché des ISRS (inhibiteurs sélectifs du recapturage de la sérotonine), dont l'atout par rapport aux antidépresseurs tricycliques plus anciens réside dans la réduction des effets secondaires, ce qui a facilité leur utilisation en médecine générale et l'élargissement de la gamme d'indications thérapeutiques associées, avec un effet probable de substitution aux anxiolytiques et hypnotiques. Parallèlement, les données disponibles suggèrent que la consommation d'anxiolytiques-hypnotiques, qui avait déjà atteint un niveau élevé au début des années 1990, est restée stable, ou a faiblement progressé. Ainsi, les antidépresseurs représentent aujourd'hui plus de 50 % des ventes de psychotropes, alors qu'ils en représentaient 25 % et les anxiolytiques et les hypnotiques 60 % en 1980. Ceci n'a pas été sans incidence sur les comptes sociaux, compte tenu du coût unitaire élevé des nouveaux médicaments mis sur le marché 3. L'incidence de la demande sociale de traitement psychiatrique explique également l'augmentation de la consommation de psychotropes. Les études sociologiques montrent que depuis l'apparition des médicaments psychotropes, dans les années 1960, le champ de la santé mentale a largement débordé de son domaine primitif - celui de la maladie mentale, objet thérapeutique de la psychiatrie - et que la vulgarisation des données de la psychologie moderne a modifié la perception des souffrances psychiques et les représentations associées à leurs manifestations. Ainsi la demande psychiatrique, telle qu'elle s'exprime aujourd'hui dans les réponses aux enquêtes sanitaires, indique clairement que les frontières entre les souffrances psychiques et les psychopathologies sont confuses pour nombre de nos concitoyens. De même, les enquêtes épidémiologiques citées dans le rapport d'étude montrent qu'une large proportion de la population française - plus d'une personne résidant en France sur trois - déclare avoir été affectée par des symptômes psychiques répondant aux critères diagnostiques d'un trouble psychiatrique. Les études conduites sur les populations de personnes âgées mettent en relief une fréquence de troubles psychiques encore plus élevée dans cette tranche de la population. L'existence de ces troubles psychiques ne suffit probablement pas à caractériser la morbidité psychiatrique au sein de la population française, mais elle a une incidence directe sur le niveau de consommation en médicaments psychotropes. Le champ d'intervention des médicaments psychotropes recouvre en effet le champ de la santé mentale et a connu le même élargissement. Leur diffusion en médecine générale a, en outre, été facilitée par leur action exclusivement symptomatique, qui ne nécessite pas de diagnostic spécialisé. L'indication de ces traitements s'étend d'ailleurs aujourd'hui aux manifestations de troubles épisodiques ou attachés à un événement de la vie. Certains dénoncent ce qu'ils perçoivent comme une médicalisation de confort de la vie psychique, voire un traitement pharmaceutique de problèmes sociaux, mais les résultats de l'étude ont totalement infirmé l'idée que le recours aux psychotropes pourrait correspondre en partie à une médicalisation de la crise sociale. Certains sociologues soutiennent également que les troubles psychiques ont eux-mêmes évolué, indépendamment de leurs représentations sociales. Les phénomènes d'hystérie sévère, plus fréquents dans les sociétés où les interdits sont forts, céderaient la place aux cas de dépression, affectant des individus de plus en plus isolés, « écrasés par les exigences de l'idéal d'autonomie contemporain. » La prescription de psychotropes représente aussi pour l'usager une marque de reconnaissance de sa souffrance vis-à-vis d'un entourage familial ou professionnel éventuellement dubitatif. La propension de la consommation en produits psychotropes à augmenter régulièrement depuis 1990 s'explique donc autant par l'évolution des besoins que par celle de l'offre pharmaceutique. Reste que la problématique majeure, du point de vue médical, est devenue celle de la qualité de la prise en charge de la souffrance psychique des individus, les médicaments psychotropes n'ayant pas d'autre action thérapeutique dans ce domaine que la réduction momentanée des manifestations symptomatiques. B. L'ANALYSE DES PRESCRIPTIONS MONTRE QU'IL N'EST ACTUELLEMENT PAS FAIT UN BON USAGE DES MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES EN FRANCE Les médicaments psychotropes ne peuvent être obtenus que sur prescription médicale et le rapport d'étude ne fait d'ailleurs pas apparaître de phénomènes d'automédication spécifique à cette catégorie de médicaments. L'analyse des comportements d'usage des médicaments psychotropes s'inscrit donc clairement dans un cadre médical, où la prescription occupe un rôle central. Le rapport scientifique rappelle sur ce point que l'analyse de la consommation en psychotropes ne peut pas être dissociée du contexte de forte consommation médicamenteuse en France. 1. Les prescriptions témoignent du rôle majeur de la médecine générale dans la prise en charge des troubles psychiques. Une des données importantes mises en évidence par le rapport scientifique est la prépondérance de la médecine générale dans la prescription de médicaments psychotropes : plus de 80 % des prescriptions sont le fait de médecins généralistes. Ce chiffre prouve l'importance de la participation de la médecine générale à la prise en charge de la morbidité psychiatrique. En effet, hors usages spécifiques (telle que l'utilisation d'antidépresseurs dans certains traitements contre la douleur), les psychotropes ont pour seule indication le traitement symptomatique des troubles mentaux. Les enquêtes relatives aux pratiques de prescriptions montrent par ailleurs que les médecins généralistes sont amenés à établir cette prise en charge dans le cadre du traitement de maladies organiques : dans 80 % des ordonnances, la prescription de psychotropes est en effet associée à la prescription de médicaments appartenant à d'autres spécialités médicales relevant souvent du traitement de maladies chroniques. Cette situation témoigne d'une ouverture manifeste des médecins généralistes aux questions de santé mentale, mais comporte un certain nombre de risques : - risques liés au défaut de diagnostic spécialisé, face à des pathologies dont l'identification est parfois difficile à faire. Pour les sujets répondant aux critères de troubles dépressifs, seul un quart a bénéficié du traitement de référence (antidépresseur) ; - risques liés aux modalités d'emploi de médicaments. Le rapport d'étude souligne que l'initiation d'un traitement antipsychotique paraît s'être banalisé en médecine générale, alors que les conditions d'utilisation définies par les autorisations de mise sur marché sont relativement restreintes. Par ailleurs, 43 % des assurés sociaux ayant bénéficié d'un remboursement pour un médicament psychotrope en 2000, ont reçu une ordonnance prescrivant plusieurs types de psychotropes. Cette proportion est manifestement trop élevée au regard des recommandations actuelles qui visent à éviter la superposition des effets de différentes molécules ; - risques d'installation d'un traitement chronique, faute de pouvoir traiter les causes des troubles. Les médicaments psychotropes n'ont en effet pas de pouvoir curatif spécifique : ils ne font que réduire l'importance des symptômes pendant la durée du traitement, sans action sur les causes des troubles psychiques. On peut donc craindre que la chronicité de certains traitements ne résulte en fait d'une inadéquation de la prescription à l'état de santé mentale réel des personnes, tel que l'apprécierait un spécialiste. Dans la pratique, les critiques portent surtout sur le non-respect par les médecins des indications thérapeutiques présentes dans les autorisations de mise sur le marché (AMM) ou des recommandations professionnelles : inadéquation du traitement aux troubles psychiques constatés, mais surtout dépassement fréquent des limites de durée de traitement préconisées, par le jeu du renouvellement des prescriptions. 2. Les phénomènes de surconsommation sont largement liés à la chronicité du recours à ces médicaments Selon la durée de consommation (3 mois, 6 mois, 1 an et plus consécutifs) et la régularité de prise considérée (consommations journalière, hebdomadaire), 10 à 20 % des usagers de psychotropes font un usage régulier de ces médicaments. Du point de vue statistique, les consommateurs réguliers de psychotropes bénéficiant d'au moins quatre remboursements sur une année pour une même classe thérapeutique représentent 11,2 % des ayants droits du régime général de sécurité sociale. Le rapport scientifique mentionne les résultats d'une enquête indiquant que 30 % des consommateurs de psychotropes sont engagés dans une consommation d'au moins deux ans, que 30 à 40 % auront un usage prolongé mais inférieur à deux ans, tandis que la même proportion de patients arrêtera sa consommation dans l'année. Mais on constate également que la durée de consommation croît de manière linéaire avec l'âge des consommateurs, ce qui tend à montrer que plus le consommateur est âgé, plus la probabilité qu'il consomme des produits de façon durable est élevée. L'analyse plus approfondie du profil des consommateurs a fait l'objet d'un certain nombre d'études que le rapport scientifique passe en revue. Certaines se sont efforcées d'établir le lien entre l'usage de psychotropes et la morbidité psychiatrique des consommateurs, d'autres ont exploré les dimensions sociales du recours aux psychotropes, ce qui laisse supposer que la logique de consommation ne répond pas toujours aux besoins sanitaires. Leurs résultats peuvent être consultés directement dans le corps de l'étude scientifique annexée au présent rapport. 3. Les risques liés au sevrage ne doivent pas être confondus avec les risques liés à la dépendance Les usages abusifs, addictifs, détournés ou toxicomaniaques, qui font l'objet d'un suivi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) et par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), sont abordés du point de vue médical en termes de dépendance. Celle-ci, au sens strict du terme, est définie comme un mésusage des médicaments caractérisé par une perte de contrôle de la consommation, malgré des conséquences sur l'état de santé ou le comportement social. Elle doit être distinguée du syndrome de sevrage. Un syndrome de sevrage est un ensemble de symptômes apparaissant lors de l'interruption brutale de la prise d'une substance consommée de manière régulière et prolongée. En termes de santé publique, le problème majeur généré par l'usage de médicaments psychotropes n'est pas celui de la dépendance, laquelle ne concerne qu'une très faible minorité d'usagers, mais celui de la prévention et du traitement du syndrome de sevrage. Le risque concerne essentiellement les anxiolytiques et hypnotiques de la famille des benzodiazépines. La fréquence d'apparition d'un syndrome de sevrage chez les consommateurs chroniques de benzodiazépines se situe entre 15 et 26 %, mais les fréquences augmentent avec l'ancienneté du traitement (autour de 80 % pour des traitements supérieurs à 3 ans). Si les causes ayant motivé l'instauration du traitement n'ont pas significativement régressé et qu'une stratégie de sevrage n'a pas été mise en place, les tentatives de sevrage ont alors toutes les chances d'être compromises. La survenue de symptômes souvent très éprouvants lors de l'arrêt d'un traitement explique en grande partie la réticence des usagers et des prescripteurs à interrompre ce traitement. Face à de tels symptômes, parmi lesquels il est difficile de distinguer résurgence des troubles psychiques et manifestation d'un syndrome de sevrage, le manque global d'information d'une partie des médecins non spécialistes risque de conduire à l'installation de traitements chroniques. Par ailleurs, la dépendance qui en résulte sera d'autant plus admise et tolérée, au nom du principe de réalisme thérapeutique, que les effets secondaires d'une prise au long cours sont généralement sous-estimés. 4. L'absence de traitement en cas de troubles psychiatriques avérés témoigne tout autant d'un mauvais usage des médicaments psychotropes Le rapport scientifique relève que la moitié des sujets français présentant un trouble psychiatrique n'a reçu aucun traitement psychotrope au cours de l'année écoulée. Ce phénomène n'est pas propre à la France. Il a également été observé dans d'autres pays européens et l'on peut penser qu'il est lié à la nature de certaines pathologies psychiatriques où le désir de soins est absent et la capacité d'auto-diagnostic faible. Même si les résultats des études citées ne convergent pas, elles permettent de penser que le défaut de prise en charge pourrait être massif pour certaines populations : une très grande proportion des dépressifs majeurs ne ferait l'objet d'aucune prise en charge dans la tranche des 15-34 ans ; parmi les 15-54 ans, les désordres de l'humeur ne susciteraient une consultation que dans 50 % des cas et ne donneraient lieu qu'une fois sur deux à un traitement. Par ailleurs, quand une prescription a été faite, il arrive fréquemment qu'elle ne soit pas respectée. Les études citées dans le rapport scientifique font ainsi apparaître qu'un taux important de sujets interrompt précocement le traitement antidépresseur, de leur propre initiative. Conscients des effets secondaires et craignant une forme de dépendance, les usagers privilégient les traitements à court terme, interrompant la prise dès la survenue d'une amélioration, au risque de devoir les reprendre ultérieurement. * Pour résumer, il apparaît que beaucoup de patients en France consomment des anxiolytiques sur de longues durées, alors que les durées de traitement recommandées sont courtes, tandis que d'autres consomment peu de temps des antidépresseurs, alors que ce traitement doit être poursuivi au moins six mois après la rémission de l'épisode dépressif. Les indications des traitements sont également peu respectées : la moitié des personnes consommant des antidépresseurs et plus des deux tiers de celles consommant des anxiolytiques et hypnotiques ne présentent pas de trouble psychiatrique relevant d'une indication reconnue. Inversement, moins d'une personne sur trois souffrant de dépression en France bénéficie d'un traitement approprié. Le niveau élevé de la consommation française n'implique donc pas une meilleure couverture des besoins sanitaires, et s'accompagne dans les faits d'un mauvais usage des médicaments. II.- LES CONSÉQUENCES DE LA CONSOMMATION MASSIVE DE PSYCHOTROPES SONT ENCORE INSUFFISAMMENT ÉVALUÉES L'utilisation massive des psychotropes n'est pas sans risque pour la santé publique. La fréquence des effets secondaires n'est pas nécessairement importante mais cela ne préjuge pas de leur impact sur la santé publique, qui peut être considérable si une proportion importante de la population est exposée au médicament en question, comme c'est le cas pour les psychotropes. En tout état de cause, leur prévalence ne peut être mise en évidence que sur des échantillons de grande taille, à l'échelle d'une population. Or, comme le souligne le rapport scientifique, on ne dispose pas actuellement de données sur l'impact des psychotropes pour l'ensemble de la population française. Le rapport scientifique a sélectionné trois types de risques, en se fondant sur leur impact en termes de santé publique et de population exposée. D'autres risques associés à certains psychotropes exposant à des complications aussi sévères auraient pu être analysés, mais étaient moins représentatifs. 1. Les effets secondaires des psychotropes à base de benzodiazépines. L'impact délétère des benzodiazépines sur les performances cognitives, et en particulier sur la mémoire à court terme, a été mis en évidence par plusieurs études, même s'il n'est actuellement pas possible de conclure à l'existence d'un lien causal entre exposition aux benzodiazépines et détérioration cognitive. Les résultats de ces études conduites en population générale peuvent en tout cas être considérés comme un signal épidémiologique indiquant que des études complémentaires sont nécessaires. Du fait de la proportion importante de sujets exposés à ces médicaments, une augmentation, même minime, du risque de détérioration cognitive pourrait générer un nombre significatif de cas de démence, avec de larges répercussions sur la santé des populations âgées. 2. Le risque de suicide chez les personnes traitées avec des antidépresseurs, notamment chez les jeunes. Les données issues de quelques essais thérapeutiques ont suggéré que ces médicaments pourraient augmenter la fréquence des idées suicidaires (mais pas des décès effectifs par suicide), en particulier chez les enfants et adolescents. À partir des éléments documentaires disponibles, le rapport scientifique a estimé que les synthèses des essais thérapeutiques sont difficilement généralisables à l'ensemble des personnes traitées par antidépresseurs. Par ailleurs, l'équipe scientifique a entrepris une analyse de sensibilité au travers de la littérature scientifique, qui a montré que le rapport bénéfices/risques reste très favorable au traitement par antidépresseurs, même en se plaçant dans les hypothèses les plus défavorables sur l'effet de ces produits. Les antidépresseurs ont en effet pour propriété intrinsèque de désinhiber les sujets, y compris dans leurs tendances éventuellement suicidaires, mais comme ils soignent les dépressions qui sont un facteur bien plus important de suicide, il convient de traiter dans tous les cas. 3. Les effets secondaires indirects de l'emploi de psychotropes Les études épidémiologiques évaluant la responsabilité des médicaments psychotropes dans les accidents de la voie publique fournissent des résultats difficiles à interpréter. Elles indiquent que l'usage de psychotropes augmente le risque d'accident, mais aucune donnée n'est disponible sur le nombre de décès attribuables en France aux médicaments psychotropes. Il en est de même pour la question du risque de chute chez les personnes âgées. Différentes études ont montré un lien entre la prise de psychotropes et une augmentation du risque de chute - notamment dans les 15 premiers jours qui suivent le début de la prise -, mais les mécanismes n'ont pas pu en être précisés. En tout état de cause, le rapport scientifique recommande qu'une évaluation du rapport bénéfices/risques soit faite au cas par cas, lorsqu'une prescription de psychotropes est envisagée, compte tenu des conséquences parfois dramatiques des chutes pour les personnes âgées. B. UNE APPRÉCIATION INSUFFISANTE DU RAPPORT BÉNÉFICES / RISQUES DANS LA PRESCRIPTION DES PSYCHOTROPES L'efficacité des médicaments psychotropes, et leur apport thérapeutique dans la prise en charge médicale des troubles psychiatriques sévères, tels que la schizophrénie, les troubles bipolaires ou la dépression sévère, sont incontestés. Les bénéfices des traitements psychotropes excèdent en effet le plus souvent, dans ces cas sévères, les risques liés à un traitement, même prolongé. La nécessité d'une évaluation du rapport bénéfices/risques concerne essentiellement les troubles légers. Dans ce cas, il faut aussi considérer les risques d'incidence faible, non documentés par les études traditionnelles. Du fait du vieillissement de la population, les personnes âgées concentrent aujourd'hui une grande partie des risques, puisque sur une population de 10 millions de personnes âgées, 20 % consomment des anxiolytiques de façon chronique. On observe également une prescription fréquente de médicaments à visée hypnotique, excédant largement la prévalence des troubles pour lesquels ils sont indiqués. Le rapport scientifique considère que le bénéfice thérapeutique de telles consommations est minime par rapport aux risques. Le niveau de consommation est également considéré comme « préoccupant » par l'assurance-maladie, notamment à cause des effets secondaires potentiels de ces produits : risque accru de chute, troubles confusionnels ou délirants et troubles du rythme cardiaque. En matière sanitaire, il convient de distinguer la détection des risques - objet de la pharmacovigilance - de l'évaluation de la prévalence de ces risques, qui est du ressort de la pharmaco-épidémiologie. La pharmaco-épidémiologie est l'application des méthodes épidémiologiques à l'étude des médicaments et de leurs effets au sein d'une large population d'individus. Le dispositif français de pharmacovigilance est organisé autour de l'Afssaps, qui centralise les informations recueillies par 31 centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) repartis sur le territoire français, afin de pouvoir détecter des cas isolés au sein de la population. Depuis 1999, l'Agence a mis en place un comité de l'iatrogènie médicamenteuse consacré à l'évaluation des risques médicamenteux. Les termes d' « effets iatrogènes » sont employés pour désigner les effets indésirables des produits ou des pratiques médicales. Le rapport scientifique estime que le manque de données pharmaco-épidémiologiques constitue aujourd'hui un obstacle à la mise en place d'une veille efficace pour certaines populations particulièrement exposées (les personnes âgées) ou à protéger (les enfants et les adolescents). Il est en effet regrettable que l'évaluation du rapport bénéfices/risques liés à l'usage des psychotropes au niveau de la population française repose essentiellement, à l'heure actuelle, sur les données issues d'études pharmaco-épidémiologiques conduites dans d'autres pays où l'exposition aux psychotropes est plus faible. L'extrapolation de ces résultats à la population française n'est pas fiable. Par ailleurs, pour la mesure des risques de faible incidence, les résultats des enquêtes sur échantillons apportent des éléments de moins bonne qualité que l'exploitation statistique des données de remboursement des frais médicaux. Ces données statistiques permettent en effet de définir des profils de consommation et de cerner des populations cibles, afin de mieux orienter les investigations. Or les auteurs du rapport scientifique ont rappelé, lors de la présentation de leur travail devant l'OPEPS, le 15 juin 2006, que 83 % des remboursements étaient pour le moment inaccessibles aux investigations statistiques. À l'exception des données gérées par de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs indépendants, il n'est actuellement pas possible pour les chercheurs de disposer de statistiques de remboursement concernant chaque spécialité pharmaceutique, à l'inverse de ce qui se pratique dans les autres pays développés. Le rapport scientifique souligne ainsi que la partie de l'étude portant sur l'adéquation entre les traitements médicamenteux et l'état psychique des patients n'a pu être réalisée que de façon globale, faute de données disponibles sur les prescriptions. Les conclusions ont été présentées à partir des résultats d'enquêtes de population dans lesquelles les informations relatives aux diagnostics et aux traitements médicamenteux étaient fournies par les personnes elles-mêmes. Il est regrettable de ne pas disposer des instruments adéquats pour évaluer avec précision les pratiques de prescription, ou la fréquence des prescriptions inappropriées, ou leur coût. Sans doute ces obstacles méthodologiques ne sont-ils pas non plus étrangers au fait que les mesures prises par les pouvoirs publics pour maîtriser la consommation médicamenteuse n'ont jamais été évaluées après leur mise en place, comme le regrette également le rapport scientifique. L'importance des enjeux sanitaires, économiques et sociaux justifierait pourtant que les pouvoirs publics accordent une attention prioritaire à ces questions. L'objectif essentiel des recommandations du présent rapport est de promouvoir un meilleur usage des médicaments psychotropes. Elles peuvent être classées en trois catégories : - les mesures de maîtrise, susceptibles de concerner l'ensemble des médicaments, toutes spécialités confondues ; - les mesures concernant la prise en charge psychiatrique ; - les mesures spécifiques aux médicaments psychotropes. 1. Promouvoir le respect des recommandations de bonnes pratiques concernant la prescription des médicaments L'étude a montré combien les indications attachées aux autorisations de mise sur le marché des produits pharmaceutiques et les recommandations de bonne pratique sont insuffisamment respectées en France par les prescripteurs, notamment pour les durées de traitement. Cette situation s'explique en partie par l'insuffisance de la formation initiale et continue des professions de santé en matière de prescription. Il est donc nécessaire d'améliorer la formation des médecins, en particulier celle des médecins généralistes qui formulent 80 % des prescriptions de psychotropes. a) Améliorer la formation initiale et continue des médecins généralistes en matière de prescription Comme l'a indiqué le professeur Bégaud lors de la présentation du rapport scientifique devant l'OPEPS, plusieurs rapports européens ont établi que le nombre d'heures de formation initiale consacrées à la prescription de médicaments en France est cinq à six fois inférieur à ce qu'il est dans les pays de l'Europe du Nord. A propos de la formation médicale continue, le rapport scientifique rappelle à juste titre les critiques exprimées par la Cour des comptes, dans son rapport de 2005 sur les comptes de la Sécurité sociale. Bien que la formation médicale continue soit obligatoire depuis la loi du 4 mars 2002, elle ne concerne que 9 % des professionnels libéraux et reste massivement financée par l'industrie pharmaceutique. La connaissance des praticiens sur les conditions d'emploi des produits pharmaceutiques est encore beaucoup trop influencée par les informations fournies par les laboratoires pharmaceutiques, lesquels n'ont évidemment pas pour objectif prioritaire de réduire les prescriptions de psychotropes. Il faut donc insister encore une fois sur l'importance de la formation continue des médecins et sur son indépendance. Dans cet esprit, votre rapporteure approuve la proposition de l'étude scientifique de confier la coordination et la validation de cet enseignement à un organisme public dont la compétence scientifique est reconnue, telle l'Université. b) Améliorer la diffusion des recommandations de bonnes pratiques Différentes sources de normes de bonnes pratiques ont été identifiées. La Haute autorité de santé (HAS), mise en place en 2005, en est la plus importante. Il s'agit d'ailleurs d'une de ses principales missions, pour laquelle elle a succédé à l'Agence nationale pour l'accréditation et l'évaluation en santé (ANAES), mais d'autres sources de référence existent, parmi lesquelles figurent l'Afssaps et les conférences de consensus organisées par les associations professionnelles. On peut regretter que la multiplicité des sources de référence affaiblisse la crédibilité des recommandations d'origine publique, face aux informations diffusées par les laboratoires. La Cour des comptes, dans son rapport 2005 sur la sécurité sociale, a également estimé que la diffusion des recommandations de bonnes pratiques n'adopte pas les méthodes les plus efficaces, notamment pour les supports informatiques. Un effort doit donc être fait pour améliorer l'accessibilité des recommandations de bonnes pratiques aux prescripteurs à qui elles sont destinées. C'est pourquoi, comme le rapport scientifique le suggère, votre rapporteure recommande qu'elles soient placées sous la responsabilité d'un organisme unique, qui pourrait être la Haute autorité de santé (HAS). 2. Améliorer la régulation du médicament a) Généraliser les études d'évaluation bénéfices/risques Un rapport d'information sénatorial (1) très récent sur la politique du médicament en France considère le développement d'études « post-AMM » comme un des aspects les plus innovants de la surveillance des médicaments. Les études post-AMM sont des études pharmaco-épidémiologiques menées une fois l'autorisation de la commercialisation d'un médicament délivrée, en vue de mettre à jour, en situation réelle, les effets secondaires non détectés lors des essais cliniques. Le rapport relève que « le recours à de telles études se justifie par le fait que la décision de mise en marché ne porte en aucun cas sur l'impact du médicament sur la santé publique mais uniquement sur la qualité du produit ». En d'autres termes, l'analyse bénéfices/risques, réalisée au niveau de la décision de remboursement, doit être actualisée en tenant compte des effets secondaires découverts en situation réelle, ainsi que des pratiques de prescription. Les résultats de ces études peuvent alors conduire à l'édiction de recommandations complémentaires de bonnes pratiques, par exemple. Les études post-AMM cherchent également à évaluer l'efficacité des médicaments en conditions réelles, ce qui peut amener à réévaluer l'analyse du service médical rendu (ASMR) des produits commercialisés, sur laquelle s'est fondée la décision de remboursement ainsi que la détermination du prix de commercialisation. Pour les médicaments psychotropes, cette démarche présente un intérêt renforcé, en raison des risques liés à l'élargissement des indications. Il semble en effet que sur ce segment du marché pharmaceutique, les laboratoires soient plus tentés qu'ailleurs, d'initier des demandes d'extension d'AMM pour leurs produits déjà commercialisés et d'obtenir la reconnaissance de nouvelles indications, pour un service médical rendu en réalité assez faible. Ainsi les problèmes de timidité paraissent depuis quelque temps attirer davantage l'attention des laboratoires pharmaceutiques et un médicament a reçu l'année passée une autorisation de mise sur le marché en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis pour l'indication d'« anxiété sociale ». Votre rapporteure considère que l'évaluation précise du rapport bénéfices/risques représente un enjeu important pour une utilisation rationnelle de la consommation des produits psychotropes et recommande d'y recourir systématiquement. b) Préciser les compétences des autorités sanitaires et des agences existantes en matière d'évaluation après autorisation de mise sur le marché Un récent rapport commandé par la Direction générale de la santé et l'Afssaps dénonce la fragmentation des responsabilités entre les différents organismes intervenant dans l'évaluation des médicaments en situation réelle. L'ensemble des organismes qui interviennent dans le processus d'autorisation de commercialisation d'un médicament - l'Afssaps, la Commission de la transparence rattachée à la Haute autorité de santé, le Comité économique des produits de santé (CEPS), l'assurance maladie et la direction générale de la santé du ministère de la santé - sont susceptibles d'engager des études post-AMM. Pour les médicaments psychotropes, il faut, en outre, tenir compte de l'action de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT), dont le champ de compétence recouvre les usages non thérapeutiques de ces médicaments. La compétence de tous ces organismes pour la conduite d'actions d'évaluation favorise la dispersion des actions et la faible concentration des moyens consacrés. Deux structures de coordination ont ainsi été créées : un groupement d'intérêt scientifique (GIS) « évaluation épidémiologique des produits de santé » et un comité de liaison informel regroupant la DGS, l'Afssaps, la HAS et le CEPS. Votre rapporteure estime toutefois que ces actions de coordination ne suffisent pas à renforcer la cohérence du système lorsqu'il s'agit d'évaluer un risque d'effets secondaires susceptibles d'avoir un impact sur la santé publique, comme c'est le cas pour les médicaments psychotropes. Aussi recommande-t-elle que la compétence et la responsabilité de l'Afssaps pour la réalisation des études post-AMM, portant sur la prévalence d'effets secondaires et l'évaluation du rapport bénéfices /risques pour certaines parties de la population, soit clairement précisée. c) Evaluer systématiquement l'impact des mesures de maîtrise médicamenteuse Le rapport scientifique regrette à juste titre l'absence d'études d'évaluation de l'impact des dernières mesures destinées à maîtriser la consommation de médicaments psychotropes : mesures de déremboursement de médicaments à base de plantes, restrictions à la prescription des benzodiazépines et hypnotiques dans une convention signée en 2005 entre l'assurance maladie et les partenaires médicaux. Ces évaluations sont d'autant plus importantes qu'elles sont nécessaires pour vérifier si les objectifs poursuivis ont été atteints, mais aussi pour évaluer les effets de report sur d'autres médicaments. L'optimisation des soins en santé mentale passe par l'application effective du « Plan pour la psychiatrie et la santé mentale 2005-2008 », établi par le ministre des solidarités, de la santé et de la famille. Certaines des mesures préconisées dans le cadre de ce plan sont en effet susceptibles de contribuer à un meilleur usage des médicaments psychotropes. Un premier bilan de la mise en œuvre des mesures inscrites dans le plan est en cours de préparation par le ministère de la santé et devrait être prochainement présenté. On rappellera les mesures présentant le plus d'intérêt au regard de l'objet du présent rapport. 1. Améliorer la formation des médecins généralistes pour un diagnostic plus fiable Huit prescriptions sur dix de médicaments psychotropes émanent de médecins généralistes. Il est donc essentiel qu'ils soient davantage formés à la prise en charge des troubles psychiatriques, afin de mieux discerner parmi les troubles dont font état leurs patients, ce qui constitue l'expression de pathologies avérées et ce qui relève de souffrances psychiques sans troubles caractérisés. Ceci est d'autant plus nécessaire que l'installation d'un traitement chronique traduit souvent l'inadéquation des prescriptions. Il convient de réfléchir aux moyens de familiariser, pendant leur cursus, l'ensemble des étudiants en médecine avec la réalité de la psychiatrie, même s'il paraît actuellement difficile de rendre obligatoire un stage en psychiatrie, pour des raisons pratiques liées au nombre de places disponibles. D'après les informations obtenues par votre rapporteure auprès du ministère de la santé, le nombre de postes proposés en service de psychiatrie dans le cadre des stages optionnels du cursus médical a été relevé et fait désormais l'objet d'un suivi par les services ministériels. Pour la formation médicale continue, le plan gouvernemental sur la santé mentale avait proposé aux conseils nationaux et notamment au conseil national de formation continue des médecins hospitaliers, d'inscrire la formation en psychiatrie parmi les orientations nationales. L'inscription du bon usage des antidépresseurs dans la formation continue des médecins généralistes a également été demandée en octobre 2005. 2. Décloisonner la prise en charge des troubles psychiatriques Le plan gouvernemental soulignait que les médecins généralistes français adressent moins fréquemment que dans les autres pays leurs patients aux psychiatres et aux psychologues, quelle que soit la pathologie. De fait, les passerelles entre la médecine générale et les médecins psychiatres fonctionnent mal. Dans un chapitre « Rompre l'isolement des médecins généralistes », le plan gouvernemental envisageait un certain nombre de mesures propres à développer la coordination et les partenariats avec les professionnels spécialisés, ainsi que l'insertion dans les réseaux de prise en charge en santé mentale. Sur ce point, il semble que peu de progrès aient, jusqu'à présent, été enregistrés sur le terrain, En tout état de cause, il est indispensable que les autorités sanitaires gardent à l'esprit ces priorités. 1. Se donner les moyens de mettre en place un système de suivi pharmaco-épidémiologique régulier Bien que les besoins en épidémiologie pour la psychiatrie et la santé mentale aient été soulignés et énumérés par le plan gouvernemental, les mesures envisagées pour y répondre et qui visent à mieux mobiliser les moyens existants (notamment par la création d'un groupe d'intérêt scientifique) ne semblent pas à même de répondre aux lacunes constatées. Afin de mieux comprendre l'évolution de la consommation et les effets secondaires des médicaments, le rapport scientifique insiste sur la nécessité de constituer des études de cohortes fondées sur un suivi de plusieurs années de personnes représentatives de la population. Pour être pérennes, de telles études doivent bénéficier de financements spécifiques récurrents intégrés dans des programmes de recherche médicale, tels que le programme hospitalier de recherche clinique et le programme de l'Agence nationale pour la recherche. Les axes d'études à développer sont les suivants : - l'analyse des pratiques de prescription et de l'impact des mesures prises pour maîtriser la consommation médicamenteuse ; - la surveillance de la consommation des populations particulièrement exposées (personnes âgées) ou à protéger (enfants et adolescents). - la connaissance des effets secondaires d'une consommation chronique, notamment chez les personnes âgées. Une attention spécifique doit également être portée au problème particulier de la situation des personnes âgées dans les établissements médico-sociaux. Sur ce point, il convient d'évaluer les pratiques de prescription en vigueur dans ces établissements, compte tenu de l'état de santé évolutif des personnes âgées. Le rapport présenté l'année dernière par Mme Cécile Gallez devant l'OPEPS, sur la maladie d'Alzheimer, rappelle à cet égard l'importante prévalence de cette maladie et l'intérêt thérapeutique d'un diagnostic précoce. La consommation en psychotropes des personnes âgées doit donc être systématiquement surveillée, y compris dans les institutions médico-sociales, afin de ne pas masquer la manifestation des premiers symptômes de la maladie. 2. Mieux associer la délivrance de psychotropes et la prise en charge psychologique La consommation de médicaments psychotropes peut être considérée comme un indicateur de souffrance psychique, même quand elle est inappropriée au regard des recommandations de bonnes pratiques. Des alternatives thérapeutiques sont disponibles pour réduire cette souffrance, mais elles ne sont pas suffisamment utilisées. Ainsi, le recours à une psychothérapie permettrait à certains patients d'éviter la prescription d'antidépresseurs. C'est pourquoi, certains experts préconisent que les psychothérapies puissent être prescrites par les médecins généralistes, car ils en connaissent les indications et les limites. Votre rapporteure estime que, lors du renouvellement d'une prescription de psychotropes, la question devrait être systématiquement posée de la pertinence d'une consultation concomitante chez un psychothérapeute, afin d'éviter le risque d'installer un traitement chronique. Toutefois, les psychiatres étant les spécialistes de la santé mentale et ceux qui pratiquent les psychothérapies dans les meilleures conditions de remboursement, on ne peut recommander une extension des prises en charge par psychothérapie sans aborder la question des moyens, et notamment celle de l'offre psychothérapeutique, étant donné la saturation du réseau des psychiatres en France. 3. Informer les prescripteurs sur les syndromes de sevrage et les former aux protocoles existants. Comme on l'a vu, en termes de santé publique, les besoins de la population concernent essentiellement la prévention et la prise en charge des syndromes de sevrage, en particulier pour les benzodiazépines. Il est donc essentiel que les prescripteurs et les usagers soient mieux informés de l'existence des phénomènes liés à l'arrêt d'un traitement, afin d'éviter des erreurs de diagnostic et la prolongation injustifiée des prescriptions. Dans les situations où l'usage est prolongé, l'arrêt du traitement doit absolument faire l'objet d'un accompagnement médical, à la nécessité duquel les prescripteurs doivent être sensibilisés. 4. Assurer l'éducation du public sur les règles d'emploi des médicaments psychotropes L'usage rationnel des médicaments psychotropes en France impose également que le public soit informé de manière appropriée sur les traitements ainsi que sur les règles d'hygiène de vie qui permettraient d'éviter la consommation de psychotropes. a) Promouvoir les règles d'hygiène de vie Il est souhaitable que les campagnes d'information rappellent des règles d'hygiène de vie qui ne sont plus assez connues parmi le grand public. Par exemple, certaines personnes en viennent à prendre des psychotropes pour trouver le sommeil sans avoir pensé à abandonner leur habitude de boire du café après dix-sept heures, alors que le métabolisme de la caféine varie avec l'âge. Aucune campagne d'information nationale n'avait été menée jusqu'à présent sur le thème de la santé mentale ou celui des psychotropes. L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) et la Direction générale de la santé (DGS) préparent, dans le cadre du plan santé mentale, une campagne centrée sur les différents troubles dépressifs (épisode dépressif majeur et trouble bipolaire) et leurs possibilités de traitement. Ce choix paraît particulièrement judicieux au regard des résultats de l'étude faisant apparaître le défaut de traitement chez un grand nombre de personnes souffrant de dépression. Votre rapporteure ne peut que se féliciter de cette initiative et recommande que cet effort d'information sur la santé mentale soit poursuivi. b) Ne pas stigmatiser les consommateurs de médicaments psychotropes Les pouvoirs publics doivent favoriser une information nuancée sur les psychotropes pour éviter que les personnes dont l'état psychiatrique le justifie décident de ne pas faire appel à un traitement. En effet, la confusion entre les usages thérapeutiques et toxicomaniaques des médicaments psychotropes subsiste toujours parmi le grand public, sous la forme d'une crainte de la dépendance, qui conduit les consommateurs d'antidépresseurs à interrompre trop tôt leur traitement. Votre rapporteure souligne que l'information sur les médicaments psychotropes doit donc toujours veiller à éviter l'écueil de la stigmatisation des consommateurs qu'entraîne souvent la confusion entre les deux types d'usages des psychotropes. - FAVORISER LE BON USAGE DES MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES 1. Adapter le contenu de la formation initiale et continue des médecins afin d'assurer un meilleur respect des recommandations de bonnes pratiques en matière de prescription des médicaments ; 2. Confier la coordination et la validation des enseignements de formation médicale continue à un organisme public dont la compétence scientifique est reconnue ; 3. Améliorer la diffusion des recommandations de bonnes pratiques, en la plaçant sous la responsabilité de la Haute autorité de santé (HAS) ; 4. Affirmer la compétence et la responsabilité de l'Afssaps pour les études à finalité sanitaire réalisées après autorisation de mise sur le marché, en complément des études à finalité économique entreprises par les autres autorités sanitaires ; 5. Evaluer systématiquement l'impact des mesures destinées à maîtriser la consommation de médicaments psychotropes ; - AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES SOINS EN SANTÉ MENTALE 6. Publier un bilan de la mise en œuvre du Plan gouvernemental pour la psychiatrie et la santé mentale 2005-2008 ; 7. Développer les connaissances en psychiatrie des étudiants en médecine et des autres professions de santé ; 8. Favoriser la coordination des médecins généralistes et des médecins psychiatres dans la prise en charge des troubles psychiatriques ; - MESURES SPÉCIFIQUES AUX MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES 9. Développer un suivi pharmaco-épidémiologique des populations les plus exposées aux risques, ainsi qu'une meilleure analyse des pratiques de prescription. Le champ de surveillance doit inclure notamment les personnes âgées, avec un suivi différencié des personnes âgées en institutions, les jeunes enfants et les adolescents ; 10. Systématiser les études d'évaluation bénéfices/risques en situation réelle pour les médicaments psychotropes, afin d'établir des recommandations pour des prescriptions plus adaptées ; 11. Mieux associer la délivrance de psychotropes et la prise en charge psychologique des patients souffrant de troubles psychiques ; 12. Informer les prescripteurs sur les syndromes de sevrage et les former aux protocoles existants ; 13. Mettre en œuvre des campagnes d'information sur le bon usage des médicaments psychotropes, rappelant en particulier la distinction entre les usages thérapeutiques - dont il faut éviter la stigmatisation - et les usages toxicomaniaques de ces médicaments ; 14. Mettre en œuvre des campagnes de promotion des règles d'hygiène de vie, en particulier en ce qui concerne la qualité du sommeil. L'office s'est réuni, le mercredi 21 juin 2006, au Sénat, sous la présidence de M. Nicolas About, sénateur, président, pour examiner le rapport de Mme Maryvonne Briot, députée, sur le bon usage des médicaments psychotropes. Un débat a suivi l'exposé de Mme Maryvonne Briot, rapporteure. M. Nicolas About, sénateur, président, a remercié la rapporteure et regretté que les prescriptions ne respectent pas davantage les recommandations de bonnes pratiques, en particulier sur les durées de traitement. Mme Maryvonne Briot, députée, rapporteure, ayant indiqué que, selon l'étude scientifique, le nombre de prescriptions effectuées par les médecins généralistes augmente à mesure qu'ils avancent en âge, M. Nicolas About, sénateur, président, a estimé que ce phénomène est peut-être lié à la croissance de la clientèle qui réduit leur disponibilité et leur temps d'écoute. M. Jean-Michel Dubernard, député, premier vice-président, a félicité Mme Maryvonne Briot, députée, rapporteure, pour son rapport, qui souligne bien les enjeux de santé publique attachés au bon usage des médicaments psychotropes. Il a indiqué qu'il fallait vérifier si l'Université n'avait pas déjà un rôle dans la validation des enseignements de formation médicale continue et a confirmé que le besoin d'approfondir les connaissances en psychiatrie au stade de la formation initiale ne se limite pas aux étudiants en médecine et concerne d'autres professions de santé, telles que les infirmières et les sages-femmes. M. Jean-François Picheral, sénateur, a demandé si les pratiques de prescription des médecins psychiatres sont différentes de celles des médecins généralistes pour ce qui est des durées de traitement. Mme Maryvonne Briot, députée, rapporteure, a indiqué que pour les psychiatres, la conduite de psychothérapies impliquant de nombreuses séances sur une longue période, elle permet de se constituer une clientèle régulière et qu'en ce qui concerne les prescriptions, on peut penser que la meilleure capacité diagnostique des médecins psychiatres favorise un traitement approprié. M. Jean-François Picheral, sénateur, a relevé que les médecins généralistes se heurtent souvent à la réticence des patients à qui ils ont conseillé de consulter un médecin psychiatre, ceux-ci préférant se voir prescrire des médicaments psychotropes par leur médecin généraliste, plutôt que de laisser croire qu'ils sont atteints par une maladie mentale en allant consulter un psychiatre. Mme Maryvonne Briot, députée, rapporteure, a souligné combien la peur d'une stigmatisation est un obstacle à la poursuite de traitements adaptés. M. Nicolas About, sénateur, président, a estimé qu'il faut renforcer le rôle d'expertise des médecins psychiatres, auxquels les médecins généralistes peuvent adresser leurs patients pour un bilan. Mme Cécile Gallez, députée, a remarqué que la durée de la consultation chez un médecin généraliste ne donne pas toujours à ce dernier le temps nécessaire à une écoute approfondie de son patient. * A l'unanimité, l'office a autorisé le dépôt du rapport d'information en vue de sa publication. ÉTUDE Cette étude a été réalisée dans le cadre de l'unité INSERM U 657 « Pharmaco-épidemiologie et évaluation de l'impact des produits de santé sur les populations », Institut Fédératif de Recherche (IFR) en Santé Publique 99, Université Victor Segalen Bordeaux 2 Coordonnateurs - Hélène Verdoux, médecin psychiatre, docteur en épidémiologie, professeur des universités-praticien hospitalier, INSERM U 657, Université Victor Segalen Bordeaux 2 - Bernard Bégaud, médecin pharmacologue, docteur en biologie humaine, professeur des universités-praticien hospitalier, directeur de l'unité INSERM U 657, Président de l'Université Victor Segalen Bordeaux 2 Membres du Comité Scientifique - Guy-Robert Auleley, médecin rhumatologue, docteur en épidémiologie, Service Médical National de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des professions indépendantes (CANAM) - Marie Baumevieille, docteur en pharmacie, docteur es sciences pharmaceutiques, maître de conférence en droit et économie de la santé, INSERM U 657, Université Victor Segalen Bordeaux 2 - Bruno Falissard, médecin psychiatre, docteur en statistique et santé, professeur des universités-praticien hospitalier, directeur de l'unité INSERM U 669 « Santé mentale de l'adolescent », Université Paris 11 - Isabelle Gasquet, médecin psychiatre Assistance Publique Hôpitaux de Paris , docteur en épidémiologie, INSERM U 669, Université Paris 11 - Philippe Le Moigne, chercheur sociologue, chargé de recherche, directeur de l'équipe "Pathologies, Pratiques et Système de Prise en Charge" du Centre de Recherche Psychotropes, Santé Mentale, Société (CESAMES), CNRS UMR 8136/ INSERM U 611, Université Paris 5 - France Lert, chercheur en santé publique, directeur de recherche, INSERM U687-IFR69, Université Paris 11-UVSQ - Catherine Maurain, docteur ès sciences pharmaceutiques, maîtrise de droit public, professeur de droit et économie de la santé INSERM U 657, Université Victor Segalen Bordeaux 2 - Frédéric Rouillon, médecin psychiatre, professeur des universités-praticien hospitalier, INSERM U669, Université Paris 5 Ont contribué à la réalisation et à la rédaction de l'étude - Adeline Grolleau, master de neuropsychopharmacologie et addictologie, INSERM U 657, Université Victor Segalen Bordeaux 2 - Livia Velpry, docteur en sociologie, CESAMES, CNRS UMR 8136/ INSERM U 611, Université Paris 5 - Marie Tournier, médecin psychiatre, docteur en épidémiologie, INSERM U 657, Université Victor Segalen Bordeaux 2 - Audrey Cougnard, docteur en épidémiologie, INSERM U 657, Université Victor Segalen Bordeaux 2 - Quitterie Thompson, interne DES de psychiatrie, service des Professeurs JD Guelfi et F. Rouillon, Clinique des Maladies Mentales et de l'Encéphale, Hôpital Sainte Anne, Paris Sont remerciés pour leur contribution à la réalisation de l'étude - Lucien Abenhaim, professeur de santé publique, INSERM U 657 et Université Paris 11, ancien Directeur Général de la Santé - Marc Auriacombe, professeur de psychiatrie, université Victor Segalen Bordeaux 2, chef du département d'addictologie, CH Charles Perrens, Bordeaux - Bernard Basset, Directeur 6eme Sous Direction Santé et Société, Direction Générale de la Santé - Agnès Cadet-Tairou, responsable de l'unité Tendances Récentes et Nouvelles drogues (TREND), Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies - François Caroli, médecin psychiatre, chef de service, président de la Commission Médicale d'Etablissement, Hôpital Sainte Anne, Paris - Anne Castot, médecin, chef du département CORGRIS (comité de coordination des vigilances des produits de santé), Afssaps - William Dab, médecin épidémiologiste, professeur de la chaire hygiène-sécurité du Conservatoire National des Arts et Métiers, ancien Directeur Général de la Santé - Jean Deligne, Médecin Conseil Régional, Caisse Maladie Régionale du Nord, CANAM - Mélina Fatséas, chef de clinique assistante, Université Victor Segalen Bordeaux 2, département d'addictologie, CH Charles Perrens, Bordeaux - Julien-Daniel Guelfi, médecin psychiatre, chef de service, Clinique des Maladies Mentales et de l'Encéphale, Hôpital Sainte Anne, Paris - Françoise Haramburu, praticien hospitalier, CHU Bordeaux, INSERM U 657, responsable des centres de pharmacovigilance (CRPV) et d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance (CEIP) de Bordeaux - Viviane Kovess-Masfety, médecin psychiatre, professeur Université Paris 5, directrice de la Fondation pour la Santé Publique de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale - Joelle Micallef Roll, maître de conférence-praticien hospitalier, responsable du CEIP centre associé de Marseille, Fédération de Pharmacologie et Toxicologie, CHU Timone, Institut des Neurosciences Cognitives de la Méditerranée, Faculté de Médecine, UMR 6193 Université de la Méditerranée-CNRS, ainsi que ses collaboratrices Elisabeth Frauger et Delphine Laurenceau - Maryse Lapeyre-Mestre, Maitre de Conférence-Praticien Hospitalier, Université Toulouse et CHU Purpan, directrice du centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance (CEIP) de Midi-Pyrénées et Limousin - Nadine Richard, Chef de Bureau Santé Mentale, 6eme Sous Direction Santé et Société, Direction Générale de la Santé - Hélène Sainte-Marie, Directrice 3eme Sous Direction Politique des Produits de Santé, Direction Générale de la Santé L'objectif de l'étude est de répondre aux sept questions suivantes, spécifiées dans l'appel d'offre de l'Office Parlementaire d'Evaluation des Politiques de Santé sur « Le bon usage des médicaments psychotropes » : - Question 1 : « Quelles sont les caractéristiques et les spécificités au niveau européen de la consommation de médicaments psychotropes en France ? » - Question 2 : « Quels sont les principaux facteurs explicatifs de cette évolution ? » - Question 3 : « De quelle façon ces médicaments sont-ils utilisés au regard des recommandations de bonne pratique ? » - Question 4 : « Quelle est l'efficacité des actions engagées par les pouvoirs publics et l'assurance maladie afin de lutter contre les prescriptions inadaptée ? » - Question 5 : « Quelles sont les alternatives thérapeutiques ? » - Question 6: « Comment sortir de la dépendance ? » - Question 7 : « Synthèse et propositions de recommandations pour l'action publique» La méthode utilisée pour répondre aux questions a reposé sur les étapes suivantes : - Premièrement, la mise en place d'un comité scientifique pluridisciplinaire regroupant un panel d'experts français, chargé de valider les choix méthodologiques, de prioriser les thèmes d'enquêtes, de faire une lecture critique de l'étude et le cas échéant, de rédiger les sections de l'étude correspondant à leur champs de compétence, et de participer à l'élaboration des recommandations. - Deuxièmement, réaliser un état des lieux aussi exhaustif que possible sur l'usage des psychotropes en France, en identifiant les données existantes, à partir des bases de données bibliographiques scientifiques et biomédicales, des rapports précédents, des informations accessibles sur les sites des organismes publics, et de toute autre source d'information disponible. Une analyse critique des données identifiées a ensuite été réalisée, afin de déterminer leur pertinence et leur validité vis à vis des questions posées. Pour chaque source, nous avons choisi de présenter toutes les informations identifiées, afin que les données sur lesquelles reposent les recommandations soient directement accessibles au lecteur de ce rapport. Ce choix implique que le volume d'information présenté soit parfois considérable, notamment concernant les données portant sur la consommation de psychotropes (question 1). Plusieurs niveaux de lecture sont donc proposés : · les informations détaillées sur la méthode et les résultats de chaque étude ont pour objectif de fournir à la communauté scientifique les critères de jugement permettant d'évaluer le bien-fondé de nos analyses; · une section "commentaires" permet de connaître les principaux apports et limites de chaque étude; · à la fin de chaque question, une section "synthèse" résume les principales informations détaillées dans la réponse à la question ; · la synthèse générale reprend les points essentiels des réponses à chaque question. Cette présentation a l'avantage de rassembler deux types de rapports en un seul volume : un rapport exhaustif pour une lecture détaillée et un rapport condensé constitué de synthèses des questions 1 à 6, de la synthèse générale et des recommandations. - Troisièmement, des enquêtes circonscrites réalisables dans le cadre du délai imparti pour mener à bien l'étude, avec pour objectif de fournir des réponses aux questions pour lesquelles aucune donnée exploitable n'était disponible. - Quatrièmement, une synthèse des données analysées et l'élaboration de recommandations. II.- QUESTION 1 : « QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES ET LES SPÉCIFICITÉS AU NIVEAU EUROPÉEN DE LA CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES EN FRANCE ? » Après une brève introduction consacrée à la définition de la catégorie des médicaments psychotropes et la distinction entre les différentes classes thérapeutiques (anxiolytiques, antidépresseurs, hypnotiques, neuroleptiques), faire le point sur le niveau et l'évolution de la consommation des médicaments psychotropes en France. Cette analyse devra notamment comporter : - une analyse globale du nombre et de la proportion de consommateurs de psychotropes depuis 1990 ainsi qu'une description du profil des gros consommateurs ou de longue durée, s'agissant notamment de leurs caractéristiques socioprofessionnelles (âge, sexe, état de santé, revenu moyen des ménages, profession, niveau d'éducation, etc.) ; - une description des variations spatiales de la consommation de psychotropes en France, selon les classes thérapeutiques, en présentant les éventuels facteurs explicatifs ; - une analyse comparée de la consommation des psychotropes dans les principaux pays européens, s'agissant notamment des antidépresseurs et des anxiolytiques. Donner également une évaluation du montant total annuel et par individu de ces dépenses de médicaments, en précisant sa répartition entre l'assurance maladie et l'assuré. Selon la définition proposée par Jean Delay en 1957, un psychotrope est « une substance chimique d'origine naturelle ou artificielle, qui a un tropisme psychologique, c'est-à-dire qui est susceptible de modifier l'activité mentale, sans préjuger du type de cette modification ». Le terme psychotrope est officiellement utilisé par l'ONU (Organisation des Nations Unies) pour désigner les substances classées aux tableaux I, II, III ou IV de la convention sur les substances psychotropes ratifiée le 21 février 1971 à Vienne, dont l'objectif, en établissant une liste de ces substances, était de limiter la production et le commerce de substances psychotropes synthétiques. 2. Différentes classes de psychotropes Selon la classification ATC (Anatomical Therapeutical Chemical), qui s'inspire de la classification proposée par Jean Delay et adoptée par le 3ème congrès mondial de psychiatrie en 1961, on différencie: 1. les psycholeptiques : anxiolytiques, hypnotiques et sédatifs, antipsychotiques. Les termes tranquillisants et anxiolytiques sont équivalents en français, mais l'usage du terme anxiolytique doit être préféré pour éviter toute ambiguïté, notamment pour la traduction de « tranquilizer » qui, en anglais, recouvre les neuroleptiques (major tranquilizers) et les anxiolytiques (minor tranquilizers). · les psychoanaleptiques : antidépresseurs et psychostimulants. · Les psychodysleptiques : substances hallucinogènes qui n'ont pas d'indication thérapeutique. · Le lithium, inclus dans la catégorie ATC des antipsychotiques, sera considéré dans la suite du texte dans la catégorie des régulateurs de l'humeur (ou thymorégulateurs ou normothymiques). Les autres régulateurs de l'humeur sont inclus dans la catégorie ATC des antiépileptiques. Nous décrirons brièvement ces différentes classes, afin d'en préciser les indications thérapeutiques et les principaux produits disponibles sur le marché en France. Ces produits seront désignés par leur dénomination commerciale, qui reste en France la plus utilisée, même si plusieurs d'entre eux existent sous forme de génériques. La cible thérapeutique de ces substances est la réduction des états anxieux par l'induction d'une sédation. Les indications thérapeutiques sont symptomatiques et non nosographiques, c'est à dire qu'elles visent à réduire la présence de symptômes indépendamment du trouble (diagnostic) sous-jacent. Cet effet thérapeutique est obtenu rapidement après l'administration du traitement, et ne persiste pas après l'élimination de la molécule et de ses éventuels métabolites actifs par l'organisme. Cette classe est essentiellement représentée par les benzodiazépines, avec une quinzaine de molécules commercialisées en France, parmi lesquelles on peut citer le Témesta®, Séresta®, Lexomil®, Xanax®, Tranxène®, etc.. Les anxiolytiques n'appartenant pas à la famille des benzodiazépines sont en nombre restreint, et issus de familles chimiques différentes : anti-histaminiques sédatifs (Atarax®), carbamates (Equanil®), autres (Buspar®, Stresam®). Les hypnotiques ont pour cible thérapeutique l'induction et/ou le maintien du sommeil. Les indications thérapeutiques sont là aussi symptomatiques et non nosographiques, visant à réduire un problème concernant le sommeil indépendamment du trouble (diagnostic) sous-jacent. Cette classe est représentée essentiellement par les benzodiazépines (Noctran®, Havlane®, Noctamide®...) et apparentés (Stilnox®, Imovane®). Les quelques autres hypnotiques actuellement commercialisés sont des antihistaminiques seuls (par ex. Noctran®) ou en association (par ex. Mépronizine®). d) Neuroleptiques/antipsychotiques Les neuroleptiques ont pour cible thérapeutique la réduction des symptômes psychotiques, avec comme indication principale la schizophrénie et les autres troubles psychotiques aigus ou chroniques. Le terme antipsychotique est de plus en plus utilisé comme synonyme de neuroleptique. Des produits neuroleptiques ayant un effet essentiellement sédatif ont également une AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) dans des traitements de courte durée pour traiter les symptômes anxieux associés à des troubles non psychotiques, tels que les états dépressifs sévères. De manière récente, certains neuroleptiques ont également obtenu une AMM pour le traitement des états maniaques et/ou la prévention des récidives dans le trouble bipolaire. Des demandes d'AMM dans d'autres indications devraient être déposées à court terme. Les neuroleptiques appartiennent à différentes familles chimiques. La sous-classification actuellement la plus utilisée en clinique est celle différenciant : · les neuroleptiques conventionnels (ou antipsychotique de 1ère génération), découverts dans les années cinquante, représentés par des produits tels que Largactil®, Haldol®, Piportil®, Fluanxol®, etc. · les neuroleptiques atypiques (ou antipsychotiques de 2ème génération), de commercialisation plus récente, qui ont schématiquement pour caractéristiques un profil d'effets secondaires différent (moins d'effets secondaires neurologiques mais plus d'effets secondaires métaboliques) pour une efficacité comparable à celle des produits plus anciens. Les produits actuellement commercialisés en France sont le Solian®, le Risperdal®, le Zyprexa®, l'Abilify®, ainsi que le Leponex® avec pour ce dernier produit des indications restrictives (schizophrénie résistante) du fait de sa toxicité hématologique. e) Normothymiques/thymorégulateurs/régulateurs de l'humeur Les thymorégulateurs ont pour cible thérapeutique le traitement curatif des épisodes maniaques et la prévention des épisodes maniaques et dépressifs dans le trouble bipolaire (maladie maniaco-dépressive). Le chef de file de cette classe est le lithium (Téralithe®). Des molécules antiépileptiques ont également l'AMM dans ces indications (Dépamide®, Dépakote®, Tégretol®) ainsi que, comme mentionné précédemment, des antipsychotiques de 2ème génération (Zyprexa® et Risperdal®). D'autres antiépileptiques sont également utilisés dans ces indications sur la base d'études ayant montré leur efficacité clinique, mais sans avoir obtenu à ce jour d'AMM en France (Lamictal® et Trileptal®, en particulier). La cible thérapeutique initiale des antidépresseurs est le traitement des épisodes dépressifs. Actuellement, le terme antidépresseur n'est plus en adéquation avec les indications cliniques, qui dépassent largement ce cadre nosographique. Un grand nombre de molécules récentes appartenant à cette classe ont ainsi obtenu des AMM pour le traitement des troubles anxieux et des troubles des conduites alimentaires (Tableau 1). Tableau 1. AMM des principaux antidépresseurs commercialisés
1. Trouble anxiété généralisée ; 2. Trouble obsessionnel compulsif ; 3. Etat de stress post-traumatique Les antidépresseurs sont subdivisés en plusieurs sous-classes : a. Antidépresseurs imipraminiques ou tricycliques, découverts dans les années cinquante, représentés par des produits tels que l'Anafranil®, le Tofranil® et le Laroxyl®. b. ISRS (Inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine), commercialisés en France depuis la fin des années quatre-vingt, ayant un profil d'efficacité comparable à celui des produits les plus anciens, et un profil de tolérance caractérisé par la moindre survenue d'effets secondaires. Les produits actuellement commercialisés sont le Floxyfral®, Prozac®, Deroxat®, Zoloft®, Seropram® et Seroplex®. c. ISRSNA (Inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline), avec un nombre plus restreint de produits : Ixel® et Effexor®. d. IMAO (Inhibiteurs de la Mono-Amine Oxydase), famille actuellement restreinte à deux produits : Humoryl® et Moclamine®. e. Autres antidépresseurs : Norset®, Athymil®, Vivalan®, Stablon®. La seule indication psychiatrique de cette classe pharmacologique est le traitement des troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité de l'enfant de plus de 6 ans. Seuls deux produits ont actuellement obtenu l'AMM en France dans cette indication, la Ritaline® et le Concerta® LP. Ces deux produits sont classés comme stupéfiants (prescription limitée à 28 jours sur ordonnance sécurisée). B. DONNÉES SUR L'USAGE DES PSYCHOTROPES ISSUES D'ÉTUDES PHARMACO-ÉPIDÉMIOLOGIQUES PUBLIÉES DANS DES REVUES SCIENTIFIQUES 1. Critères de sélection des études La pharmaco-épidémiologie a pour objectif d'étudier l'usage (prescription, délivrance, consommation) et les effets (impact thérapeutique, effets indésirables) des médicaments commercialisés1 2. Nous analyserons ici les études ayant évalué l'usage des psychotropes en France et/ou dans les autres pays européens, et ayant fait l'objet de publications dans des revues scientifiques. En effet, la publication dans une revue scientifique avec comité de lecture offre la garantie que l'article a été évalué avant publication par des experts (reviewers) qui ont estimé la méthode de l'étude suffisamment rigoureuse pour que les résultats soient considérés comme valides. Cette garantie est bien sûr à pondérer en fonction du niveau de notoriété de la revue (impact factor), en l'absence de conflit d'intérêt au niveau éditorial, le niveau d'exigence méthodologique est en règle générale d'autant plus élevé que la notoriété est importante. Les bases de données bibliographiques scientifiques et biomédicales (type Medline) ont été consultées pour identifier les études pharmaco-épidémiologiques d'utilisation des psychotropes dans la population française. Afin de permettre une recherche large, les mots-clés suivants ont été utilisés : [psychotropic /antidepressant /anxiolytic /benzodiazepine /tranquilizer /antipsychotic /neuroleptic /mood stabiliser /psychostimulant] AND [France /French]. Les abstracts identifiés ont été lus et sélectionnés en fonction de leur pertinence par rapport au sujet étudié, les articles identifiés ont été collectés. Les références, citées dans les articles sélectionnés en relation avec le thème d'étude et non identifiés dans les bases de données, ont été recherchées. Les études pharmaco-épidémiologiques ont été sélectionnées sur les critères suivants : (i) étude conduite entre 1990 et 2005; (ii) méthode d'échantillonnage permettant, a priori, de sélectionner une population représentative de la population générale française. Ce critère exclut les études conduites sur des populations sélectionnées sur un critère d'accès aux soins : sujets recrutés dans des services hospitaliers psychiatriques ou autres, ou en consultation de médecine générale ou de psychiatrie. Les rares exceptions à cette règle seront explicitées; (iii) incluant ou non une comparaison avec d'autres pays européens. 2. Étude ESEMeD (European Study of the Epidemiology of Mental disorders) a) Présentation de la méthode de l'étude L'étude ESEMeD (European Study of the Epidemiology of Mental disorders) est une étude épidémiologique européenne3 4 qui s'intègre dans une étude mondiale sur la santé mentale (World Mental Health Surveys) conduite dans 14 pays sous l'égide de l'OMS5. Il s'agit d'une étude transversale conduite entre 2001-2003 en population générale, chez 21 425 sujets de 18 ans et plus, non institutionnalisés, et ayant un domicile fixe. Six pays européens ont participé à cette enquête : Allemagne (n = 3 555 sujets inclus), Belgique (n = 2 419), Espagne (n = 5 473), France métropolitaine (n = 2 894), Pays-Bas (n = 2 372) et Italie (n= 4 712). Un échantillon représentatif de la population de chaque pays a été sélectionné par tirage au sort en utilisant la base de sondage disponible la plus représentative pour chaque pays (liste électorale en Italie, registre postal aux Pays-Bas, registres municipaux en Allemagne, Belgique et Espagne). En France, les sujets ont été sélectionnés à partir d'une liste de numéros de téléphones générés aléatoirement6. A l'aide d'un annuaire inverse, les numéros correspondant à des personnes recensées dans l'annuaire France Télécom ont été identifiés. Celles ci ont été contactées par téléphone, afin de sélectionner un membre du foyer et d'obtenir son consentement pour participer à l'enquête. Les taux de participation (d'acceptation) a été en moyenne de 61,2 % dans les 6 pays participants, avec les plus forts taux en Espagne (78,6 %) et Italie (71,2 %) et les plus faibles en Belgique (50,6 %), en France (45,9 %) qui est, comparativement à sa population, le pays le plus sous-représenté. On ne dispose pas d'information sur les caractéristiques des sujets ayant refusé de participer. Dans l'ensemble des pays européens, les sujets inclus étaient dans 48,0 % des cas des hommes, en moyenne âgés de 47 ans, la tranche d'âge entre 35 et 49 ans étant la plus représentée (28,2 %). Plus d'un tiers (38,9 %) vivaient en milieu urbain de taille moyenne, et plus de la moitié (54,1 %) avaient un emploi rémunéré. L'échantillon français était comparable à celui des 6 pays ESEMeD, avec des caractéristiques socio-démographiques proches de la population nationale décrite dans le dernier recensement de l'INSEE. Les données ont été recueillies lors d'un entretien au domicile des sujets en utilisant une technique d'interview assisté par ordinateur. En France, les sujets ont été évalués par des enquêteurs professionnels de l'institut IPSOS. Les informations recueillies concernaient : (i) Les diagnostics de troubles psychiatriques selon les critères du DSM-IV (Manuel Diagnostique et Statistique des troubles mentaux, quatrième édition7), posés à partir de l'entretien diagnostique structuré WMH-CIDI (World Mental Health Composite International Diagnostic Interview), une version révisée du CIDI spécifiquement élaborée pour cette enquête8 9. (ii) Les données sur la consommation de psychotropes au cours des 12 derniers mois4 6 . Pour faciliter la remémoration et l'identification des médicaments, un livret de photos en couleurs a été utilisé, présentant les boîtes, les blisters et les produits pour les spécialités les plus utilisées dans chaque pays. Les enquêteurs posaient les questions suivantes : « Avez-vous pris un médicament présenté sur ces images à un moment donné dans ces 12 derniers mois ? Citez les médicaments même si vous ne les avez pris qu'une fois », complétées par trois questions explorant la prise d'autres médicaments non identifiés sur les photos, pris au moins une fois au cours des 12 derniers mois, et destinés à «être en forme psychiquement », « aider à se détendre ou à garder son calme à un moment donné », ou « aider à se concentrer ou pour donner de l'énergie ». Les psychotropes identifiés ont ensuite été regroupés en 5 classes pharmacologiques à partir de la classification ATC (antidépresseurs, anxiolytiques/hypnotiques, antipsychotiques, thymorégulateurs). b) Principaux résultats concernant l'usage des psychotropes Seuls sont rapportés dans ce chapitre les résultats concernant les fréquences d'usage des psychotropes, les données concernant la prévalence des troubles psychiatriques et l'adéquation diagnostic-traitement seront présentées dans la question 3. Le Tableau 2 indiquant le pourcentage de sujets par pays ayant fait usage d'au moins un médicament psychotrope dans l'année montre que la France arrive en tête des 6 pays, avec plus d'un sujet résidant en France sur 5 rapportant avoir consommé ces médicaments. L'Espagne, l'Italie et la Belgique ont des niveaux de consommation inférieurs mais restant dans des fourchettes supérieures à 10 %, tandis que les Pays-Bas et surtout l'Allemagne se démarquent par des niveaux de consommation nettement plus bas. Tableau 2. Prévalence annuelle d'usage des médicaments psychotropes1 dans 6 pays européens (étude ESEMeD 2001-2003).
1. Antidépresseurs, anxiolytiques (catégorie incluant également les hypnotiques benzodiazépiniques ou apparentés), antipsychotiques et stabilisateurs de l'humeur. 2. Odds Ratio ajusté sur le sexe, évaluant la probabilité relative d'usage de psychotrope par rapport au pays de référence, qui est ici les Pays-Bas. La fréquence d'utilisation des psychotropes dans les 12 derniers mois est, quelle que soit la classe, quasiment deux fois supérieure en France par rapport à la moyenne des 6 pays européens (Tableau 3). Les psychotropes les plus utilisés sont les anxiolytiques et les hypnotiques, la quasi-totalité des usagers de psychotropes (87 %) déclarent avoir pris l'un de ces médicaments au moins une fois dans l'année. Dans l'ensemble des pays européens, l'association de psychotropes la plus fréquente (bien que non nécessairement simultanée) est celle associant anxiolytiques et antidépresseurs. Les durées de traitement sont en moyenne plus courtes en France que dans les autres pays pour toutes les classes, sauf pour les antipsychotiques. En particulier, 20,8 % des antidépresseurs sont prescrits moins de 15 jours en France vs. 16 % pour les 6 pays. La différence est moindre pour les anxiolytiques-hypnotiques. Tableau 3. Prévalence de la consommation de psychotropes en France et dans l'ensemble des six pays participant à ESEMeD4 6.
1. Pondéré pour prendre en compte l'écart entre les caractéristiques socio-démographiques de l'échantillon national et de la population nationale. Les caractéristiques associées à l'usage de psychotrope sont similaires pour les 6 pays considérés globalement et la France. Dans l'échantillon français, la probabilité d'utilisation de psychotrope au cours des 12 derniers mois est 2 fois plus élevée pour les femmes que pour les hommes [OR (Odds Ratio) = 2,1, IC 95 % (Intervalle de Confiance à 95 %) : 1,9-2,4]. Cette fréquence plus élevée chez les femmes est mise en évidence pour les antidépresseurs et des anxiolytiques-hypnotiques, mais pas pour les antipsychotiques et thymorégulateurs. L'usage de psychotropes augmente également avec l'âge, la probabilité d'utilisation de psychotrope au cours des 12 derniers mois est 2 fois plus élevée dans la tranche d'âge 50-64 ans que dans la tranche 18-24 ans (OR = 2,0, IC 95 % : 1,4-2,8). Après prise en compte de l'effet de l'âge et du sexe dans les analyses, l'usage de psychotropes est plus fréquent chez les personnes vivant seules, chez celles ayant une durée d'études supérieure à 12 ans, chez les personnes en activité professionnelle. La consommation augmente de manière linéaire avec la taille de l'agglomération de résidence. Les résultats de l'étude ESEMeD doivent être interprétés en prenant en compte ses limites méthodologiques6. La limite la plus importante est liée au taux de participation relativement bas dans l'échantillon français. Ce taux reste néanmoins très honorable si on considère le thème de l'enquête et la lourdeur de la procédure d'évaluation pour les sujets participants, même si l'on ne peut pas exclure que les sujets ayant accepté de participer diffèrent de manière systématique des non-participants, en particulier concernant la fréquence des troubles psychiatriques et la fréquence d'usage des psychotropes. Les données de la littérature montrent que cette fréquence est plus élevée chez les sujets refusant de participer à des enquêtes sur la santé mentale. Si un tel biais de sélection a existé dans l'étude, il a donc plus probablement entraîné une sous-évaluation plutôt qu'une sur-évaluation de la fréquence d'usage des psychotropes. Ce type d'enquête se heurte également aux biais de mémorisation quand une personne doit se remémorer tous les traitements pris au cours de la dernière année, mais ce biais est ici minimisé par la rigueur et la standardisation du recueil des données. Malgré ces limites inhérentes à toute étude épidémiologique de cette envergure, les qualités méthodologiques de cette étude en font l'une des plus informatives sur l'usage actuel des psychotropes dans la population française. Les résultats obtenus peuvent donc être considérés comme particulièrement informatifs. Les données sur les fréquences d'usage montrent que les Français consomment plus fréquemment des psychotropes, mais sur des durées plus brèves, que les sujets des autres pays européens. Cet usage plus important n'est pas associé à un profil particulier des usagers français, puisque les caractéristiques associées à l'usage sont les mêmes en France et dans les autres pays européens. La fréquence plus élevée est donc probablement liée à une augmentation globale des prescriptions en France, quelles que soient les caractéristiques de l'usager. 3. Étude comparative de l'usage des médicaments psychotropes dans 4 pays européens. a) Présentation de la méthode de l'étude Cette étude transversale conduite par Ohayon et collaborateurs10 a été réalisée auprès de 18 679 sujets représentant la population générale des sujets non-institutionnalisés âgés de plus de 15 ans dans 4 pays : France (5 622 sujets interviewés en 1993) ; Royaume Uni (4 972 sujets interviewés en 1994) ; Allemagne (4 115 sujets interviewés en 1996) ; Italie (3 970 sujets interviewés en 1997). Dans chaque pays, un échantillon « représentatif » a été sélectionné en 2 étapes, tout d'abord, en prenant en compte la répartition géographique donnée par le dernier recensement national disponible de chaque pays, puis au sein de chaque foyer identifié, en sélectionnant de manière aléatoire un membre de la famille afin d'obtenir un échantillon représentatif en terme d'âge et de sexe. Les critères d'exclusion étaient l'impossibilité de mener à bien un entretien du fait de problèmes de langue, d'audition, d'élocution, ou de santé. Le taux global de participation sur les 4 pays était de 78,8 % (France : 80,8 % ; Royaume Uni : 79,6 % ; Allemagne : 68,1 % ; Italie : 89,4 %). L'enquête était réalisée par un entretien téléphonique structuré reposant sur un questionnaire informatisé (« Sleep-Eval Expert System »). Les données recueillies concernaient : (i) les diagnostics actuels psychiatriques selon le DSM-IV ; (ii) les traitements psychotropes actuels (noms, durées, dosage, prescripteur), les sujets étant en particulier interrogés sur la prise de médicaments « pour les aider à dormir », « pour réduire l'anxiété », ou « pour réduire les pensées dépressives », ou sur le fait qu'ils consultent un médecin qui leur prescrit un traitement pour des problèmes de santé mentale. L'usage actuel de médicaments était défini comme la prise d'un médicament au moment de l'entretien quelle que soit la fréquence de prise. Les psychotropes identifiés ont ensuite été regroupés en 5 classes pharmacologiques à partir de la classification « National Compendium of Pharmaceutical Spécialities » : hypnotiques, anxiolytiques, antidépresseurs, neuroleptiques, et autres psychotropes. b) Principaux résultats concernant l'usage des psychotropes Seules les données concernant la fréquence d'usage des différentes classes pharmacologiques sont fournies par pays, confirmant que la France occupe la première position pour l'usage des hypnotiques et anxiolytiques, avec un écart particulièrement marqué avec l'Allemagne et le Royaume-Uni (Tableau 4). Tableau 4. Prévalence d'usage des hypnotiques, anxiolytiques, antidépresseurs, et neuroleptiques dans quatre pays européens entre 1993 et 1997
Les autres résultats sont rapportés globalement pour les 4 pays étudiés. Les prescriptions sont essentiellement le fait de généralistes (82 % pour les hypnotiques, 79 % pour les anxiolytiques, 56 % pour les antidépresseurs, mais seulement 32 % pour les neuroleptiques). Les fréquences d'usage de chaque type de molécule (Tableau 5) concernent les molécules disponibles au moment de l'enquête dans chaque pays. Tableau 5. Psychotropes utilisés dans les quatre pays européens entre 1993 et 1997
1. non commercialisé au Royaume-Uni; 2. non commercialisé aux Etats-Unis; 3. non commercialisé en Italie ; 4. commercialisé seulement en France ; 5 commercialisé seulement en Allemagne ; 6. non commercialisé en Allemagne. Les durées d'utilisation (Tableau 6) montrent que la plupart des usagers sont des utilisateurs chroniques, avec une durée d'usage supérieure à 5 ans dans plus d'un tiers de cas pour les anxiolytiques et hypnotiques. Même si on ne dispose que des données calculées sur l'ensemble des 4 pays, il est peu vraisemblable que ce phénomène soit lié à un seul pays ; il est donc probable qu'il s'agit d'un phénomène plus général. Tableau 6. Durée d'utilisation des hypnotiques, anxiolytiques et antidépresseurs, dans quatre pays européens entre 1993 et 1997
Cette étude confirme la prévalence élevée d'usage des anxiolytiques et hypnotiques en France par rapport aux autres pays européens, sans apporter d'informations supplémentaires, car la plupart des résultats sont présentés de manière globale pour les 4 pays. De plus, cette étude souffre de limites méthodologiques notables ; en particulier aucune information n'est fournie sur les bases de sondage à partir desquelles les individus ont été identifiés dans chaque pays, la représentativité alléguée est donc difficile à vérifier ; la méthode de recueil d'informations par téléphone, sans contrôle sur des ordonnances ou dans les armoires à pharmacie, limite la validité des informations recueillies ; enfin, seul l'usage au moment de l'entretien téléphonique a été relevé, ce qui limite la comparabilité avec les études évaluant l'utilisation sur des durées plus longues. 4. Enquête « santé mentale en population générale : images et réalité » a) Présentation de la méthode de l'étude Cette enquête multicentrique a été réalisée sous l'égide de l'OMS par le Centre Collaborateur de OMS pour la recherche et la formation en santé mentale (Lille-Hellemmes, France) et la DREES (Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques)11. Elle avait pour objectifs principaux d'évaluer la prévalence des troubles psychiatriques et les représentations liées à ces troubles. L'enquête a porté sur 39 617 personnes de 18 ans et plus en France métropolitaine (37 063 individus) et dans les DOM (2554 individus), recrutés dans 47 sites entre 1999 et 2003. Pour chaque site, la méthode des quotas a été utilisée pour sélectionner un échantillon représentatif de la population générale du site pour l'âge, le sexe, la catégorie socioprofessionnelle, selon les données issues du recensement 1999 de la population. Les données ont été recueillies lors d'entretiens d'une quarantaine de minutes par 1700 étudiants infirmiers formés à la méthode de recueil. Les participants ont été recrutés dans les lieux publics. Environ 900 participants ont été recrutés par site. Du fait de la méthode utilisée (en cas de refus d'une personne sollicitée, sélection de la personne suivante remplissant les critères d'inclusion selon les quotas), on ne dispose pas d'information exploitable sur les personnes ayant refusé de participer. Le questionnaire incluait: (i) des questions sur les caractéristiques socio-démographiques ; (ii) des questions sur les représentations de la « folie », la « maladie mentale », la « dépression » ; (iii) des questions sur les modes d'aides et de soins, incluant en particulier la question « Avez-vous déjà pris des médicaments pour les nerfs, pour la tête ? » ; (iv) un entretien diagnostique structuré avec le MINI (Mini International Neuropsychiatric Interview) pour estimer la prévalence des troubles psychiatriques, catégorisés selon les critères de la Classification Internationale des Maladies de l'OMS, dixième version (CIM-10)12 ; (v) pour les sujets ayant un trouble identifié, des informations complémentaires sur le recours aux soins et le retentissement du trouble. Un fichier national a été constitué par agrégation de toutes les personnes ayant été interrogées, quels que soient le site et la date. Les données de ce fichier ont été redressées (pondérées) afin que l'échantillon soit représentatif de la population générale française (données issues du recensement de la population réalisé par l'INSEE en 1999) selon les variables : sexe, âge, niveau de formation, catégorie socioprofessionnelle, et statut professionnel. b) Principaux résultats concernant l'usage des psychotropes Les données concernant l'usage de psychotropes ont pu être analysées dans le cadre de l'Unité INSERM U657 grâce à la mise à disposition du fichier national. Ces résultats n'ont pas encore fait l'objet d'une publication scientifique, mais du fait de leur intérêt, ils sont présentés ici de manière préliminaire avec l'autorisation du Comité de Coordination de l'enquête SMPG. Les données concernant la prévalence des troubles psychiatriques et l'adéquation diagnostic-traitement sont présentées dans la question 3. Parmi les 39 260 personnes (dont 36 785 personnes en France métropolitaine) participant à l'enquête avec une réponse documentée à la question « Avez-vous déjà pris des médicaments pour les nerfs, pour la tête ? », plus d'un tiers rapportaient avoir déjà fait usage au cours de leur vie d'un tel traitement, quelle que soit sa durée (Tableau 7). Les anxiolytiques, hypnotiques et antidépresseurs sont les plus fréquemment cités. Ces résultats montrent de plus que le recours à des traitements traditionnels ou à l'homéopathie concernent un nombre très restreint de sujets. Quand plusieurs psychotropes sont rapportés (Tableau 8), les résultats concernant l'usage au cours de la vie entière, il n'est donc pas possible de déterminer si l'usage est concomitant ou séquentiel. Les anxiolytiques sont les médicaments les plus souvent cités chez les sujets mentionnant un autre traitement, ils sont mentionnés par la moitié des sujets ayant pris un antidépresseur, neuroleptique et normothymique, mais aussi par près d'un quart des sujets ayant pris un traitement homéopathique « pour les nerfs, pour la tête ». Tableau 7. Traitements psychotropes consommés au cours de la vie rapportés par les sujets inclus dans l'enquête SMPG
Contrairement aux études précédentes qui documentent l'usage de psychotropes actuel ou au cours de l'année écoulée, cette étude explore cet usage sur la vie entière, expliquant que la prévalence d'usage d'au moins un psychotrope soit plus élevée. Les tendances restent toutefois comparables, avec les anxiolytiques arrivant en premier rang, y compris chez les sujets ayant fait usage d'un autre traitement. L'intérêt de cette étude est d'explorer les traitements autres qu'allopathiques, montrant que ceux ci sont largement minoritaires face aux médicaments psychotropes. Ce point sera repris dans la question 5. La principale limite méthodologique de cette étude est liée au fait que ni le moment ni la durée de la prise ne sont documentés, et que les biais de mémorisation sont nettement plus importants lorsque l'on explore l'usage au cours de la vie que l'usage récent. Le caractère relativement vague et ambigu de la question posée pour explorer la prise de psychotropes peut avoir entraîné une mauvaise compréhension de la part de certains participants. Enfin, même si l'échantillon est représentatif de la population française en termes de caractéristiques socio-démographiques, le taux de participation et les caractéristiques des sujets exclus ne sont pas documentés. Du fait du mode de recrutement (dans les lieux publics), il est probable que l'éventuel biais de sélection a contribué à exclure les sujets présentant des troubles psychiatriques sévères, et donc à minorer plutôt qu'à majorer les fréquences d'usage. Tableau 8. Fréquence d'association de plusieurs psychotropes rapportés par les sujets inclus dans l'enquête SMPG
5. Études portant sur l'utilisation d'une classe de psychotropes Deux études portant sur l'usage des antidépresseurs ont été réalisées en 1994-199513 14 et 199615 sur un échantillon constitué à partir du panel SOFRES qui inclut 20 000 foyers français, représentatifs de la population française pour 5 variables socio-démographiques ou quotas (âge, catégorie socio-professionnelle de la personne de référence du foyer, région, taille de l'agglomération, et nombre de personnes présentes au foyer). La première étude, financée par les laboratoires Lilly13 14, a été réalisée par questionnaire postal, avec un taux de participation de 79 % des foyers. Comparativement aux non-répondeurs, les répondeurs étaient en moyenne plus âgés, plus fréquemment « inactifs », avec un plus faible nombre de personnes par foyer. Les sujets ont été interrogés sur la consommation des huit antidépresseurs qui représentaient à l'époque 90 % des ventes en France. Parmi les sujets (n= 896) qui déclaraient prendre un traitement antidépresseur, 754 personnes ont été sélectionnées par tirage au sort, en privilégiant les consommateurs d'antidépresseurs depuis moins d'un an pour limiter les biais de mémorisation, dont 500 ont pu participer à un entretien téléphonique réalisé par un psychiatre. La prévalence d'usage ponctuel (au moment de l'enquête) des antidépresseurs était de 2,75 %. Les usagers d'antidépresseurs étaient plus souvent des femmes, des sujets âgés de plus de 35 ans, vivant dans le Sud plutôt que dans le Nord ou l'Est de la France. Les tricycliques étaient les produits les plus prescrits (36,7 %), suivis de près (31,9 %) par le seul ISRS investigué dans l'étude, qui était le Prozac® commercialisé par les Laboratoires Lilly (l'autre ISRS alors commercialisé -Floxyfral®- étant classifié dans la catégorie « autres »). Pour deux tiers des sujets (65 %) les antidépresseurs étaient co-prescrits avec un autre psychotrope, le plus souvent (57 %) un anxiolytique ou un hypnotique, et exceptionnellement (5 %) un second antidépresseur. Le prescripteur était le plus souvent (60 %) un médecin généraliste, dans 30 % des cas un psychiatre, et dans 10 % des cas un spécialiste d'une autre discipline. La durée d'utilisation était supérieure à un an pour plus de moitié (54 %) des sujets, plus longue si l'antidépresseur était un tricyclique (reflétant probablement le fait que ceux ci étaient plus anciennement commercialisés), et si le prescripteur est un psychiatre (74 % supérieure à un an contre 44 % pour les généralistes). La méthode de la deuxième étude réalisée en 199615 est globalement comparable concernant le recrutement des sujets, avec un taux de participation également très élevé (82 %). La principale différence est qu'il ne s'agit plus d'une étude transversale, mais prospective, avec suivi des sujets usagers d'antidépresseurs sur 8 mois. La prévalence ponctuelle d'usage des antidépresseurs était de 3,5 %. Les ISRS (45 %) passaient en tête devant les antidépresseurs tricycliques (39 %). Les caractéristiques associées (usagers et prescripteurs) étaient similaires à celles mises en évidence dans la première étude. Au cours du suivi, 25 % des usagers d'antidépresseurs avaient arrêté ce traitement un mois après la première interview. Dans deux tiers des cas l'arrêt survenait après une prise de traitement de moins de 8 mois. Les arrêts ont été décidés dans 45 % des cas par le médecin et dans 45 % par le consommateur, le motif invoqué étant dans la moitié des cas une amélioration de l'état ayant motivé la prescription. Pendant cette période, des interruptions transitoires de traitement avec reprise ultérieure du même antidépresseur ont concerné un quart des sujets. Parmi les sujets (2,6 %) ayant débuté un traitement antidépresseur au cours du suivi de 8 mois (soit par changement de molécule, soit par reprise après arrêt), 61 % l'ont interrompu avant 4 mois, 91 % avant 8 mois, et seuls 5 % l'ont suivi plus de 8 mois. Ces études sont relativement anciennes, les données concernant les types d'antidépresseurs prescrits ne reflètent pas les pratiques actuelles du fait de la mise sur le marché de plusieurs spécialités au cours de la dernière décennie. Elles ont pour intérêt de documenter la prévalence d'usage dans les années suivant l'introduction des premiers ISRS, et avant la généralisation de l'usage des nouveaux antidépresseurs ayant un meilleur profil de tolérance que les antidépresseurs tricycliques. Si l'on se réfère aux résultats de l'étude ESEMeD, qui trouve en 2001-2003 une prévalence d'usage des antidépresseurs de 5 % sur 12 mois, les prévalences ponctuelles trouvées en 1994 (2,8 %) et 1996 (3,5 %), on peut suggérer que la fréquence d'usage n'a pas augmenté de manière spectaculaire au cours de cette période. Un intérêt de l'étude prospective réalisée par Olié et collaborateurs, est de mettre en exergue le taux important de sujets interrompant précocement le traitement antidépresseur de leur propre initiative. b) Anxiolytiques et hypnotiques Une étude financée par les laboratoires Merck a exploré en 2001 l'usage des benzodiazépines dans un échantillon de sujets âgés de plus de 18 ans représentatif de la population française16. Les participants ont été sélectionnés par l'institut IPSOS par tirage au sort de numéros de téléphone stratifiés par zone géographique et par taille de ville, avec application dans chaque strate d'une procédure de sélection par quota, pour que l'échantillon soit représentatif en termes d'âge et de sexe de la population française du recensement INSEE de 1999. Sur les 7 973 personnes contactées et éligibles pour l'étude, 50,3 % ont accepté de participer. Les caractéristiques des non-participants ne sont pas connues. Les données étaient recueillies par téléphone. L'usage d'anxiolytiques et hypnotiques était exploré par la question « prenez-vous actuellement des médicaments pour vous aider à dormir ou pour réduire l'anxiété ? ». En cas de réponse positive, des questions étaient posées sur le nom du médicament utilisé, son dosage, la durée de prise, et le prescripteur. L'existence de troubles psychiatriques était évaluée par un entretien diagnostic structuré (MINI). Les 4007 sujets interviewés étaient âgés en moyenne de 45 ans, et incluaient 52 % de femmes. La moitié des sujets (49,3 %) déclaraient prendre actuellement au moins un médicament, 11,5 % étaient des usagers actuels de médicaments « contre l'anxiété, le stress, pour dormir ou se relaxer », et 7,5 % étaient des usagers actuels de benzodiazépines. La plupart des utilisateurs (86,4 %) prenaient une seule benzodiazépine, 12,9 % en prenaient 2, et 0,7 % 3 simultanément. La durée d'utilisation des benzodiazépines était de plus de 6 mois pour 76,5 % des usagers, de 3 à 6 mois pour 6,9 % , d'une semaine à 3 mois pour 9,6 %, et de moins d'une semaine pour 2,6 %. Dans la plupart des cas (88,7 %), les benzodiazépines utilisées étaient à demi-vie courte (donc a priori avec une durée d'action brève), pour lesquelles le risque de survenue d'un syndrome de sevrage est le plus élevé (cf. question 6). Les limites de l'étude sont liées à la méthode de recueil des informations par téléphone, et au fait qu'aucune information n'est disponible sur les caractéristiques des non-participants. Son intérêt est de montrer que la co-prescription de benzodiazépines n'est pas exceptionnelle (près de 15 % des usagers), et que plus des trois quarts des usagers prennent ces produits depuis plus de 6 mois. c) Neuroleptiques/antipsychotiques La quasi-totalité des études sur l'usage des neuroleptiques et antipsychotiques ont été conduites sur des populations de sujets sélectionnés sur la base d'une consultation ou d'une hospitalisation psychiatrique17-22. Ces études montrent que les neuroleptiques atypiques (ou antipsychotiques de 2ème génération) sont actuellement plus prescrits que les neuroleptiques conventionnels, et ce dès le premier épisode psychotique. À notre connaissance, une seule étude publiée évaluant l'usage des antipsychotiques a été conduite sur un échantillon représentatif de la population générale23. Un échantillon de 500 ordonnances incluant la rispéridone, consécutivement remboursées à partir du 1er janvier 2001, a été sélectionné à partir de la base de données de la CNAM-TS (Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) en Aquitaine. Il s'agissait d'une étude transversale, sans recueil de données sur le début de la prescription de rispéridone, donc l'échantillon inclut à la fois les prescriptions prévalentes (renouvellement) et incidentes (initiation de traitement). Les données enregistrées par l'assurance maladie ne permettent pas de connaître la posologie (qui peut uniquement être approximée par le nombre de boites délivrées par unité de temps) et le diagnostic. Cette étude montre que l'antipsychotique est très souvent prescrit en association avec un antidépresseur (42,8 %), en particulier de type ISRS, alors qu'aucune étude n'a évalué l'intérêt ou les risques de ce type d'association. La co-prescription avec un médicament anticholinergique visant à réduire les effets secondaires neurologiques (extra-pyramidaux) est également fréquente (22 %), y compris chez des patients traités avec des doses faibles ou modérées, alors qu'un des arguments pour justifier la prescription de ces nouvelles molécules est la rareté des effets secondaires extra-pyramidaux. Le résultat le plus notable de cette étude est de montrer que la majorité des prescriptions (64 %) sont faites par les généralistes, alors que les indications principales de ce traitement sont les troubles psychotiques, qui sont peu pris en charge en médecine générale24. Les généralistes prescrivent des doses de rispéridone plus élevées en moyenne que les psychiatres (généraliste : 142,3 mg par ordonnance contre 135,4 mg pour les psychiatres, correspondant à des doses moyennes journalières de 4,6 vs. 4,4 mg). On peut citer dans ce cadre l'enquête postale conduite auprès de l'ensemble des médecins généralistes d'Aquitaine25. Près d'un quart des 3829 médecins contactés (23 %) ont renvoyé un questionnaire complété, documentant, entre autre, les pratiques de prescription de médicaments antipsychotiques commercialisés au moment de l'enquête (amisulpride, risperidone, olanzapine). Les résultats montrent que les médecins généralistes prescrivent fréquemment ce type de produit, puisqu'au cours du dernier mois, 82 % ont renouvelé un tel traitement, quel que soit le motif de prescription. Un médecin généraliste sur trois (33 %) a initié un traitement antipsychotique au cours de cette période. Ce résultat suggère donc que l'initiation d'un traitement antipsychotique est relativement banalisée en médecine générale. Si l'on rappelle que les AMM de ces médicaments sont relativement restreintes, car actuellement limitées aux pathologies psychotiques et aux accès maniaques de l'adulte, il est donc très probable que bon nombre des nouvelles prescriptions d'antipsychotiques sont faites hors AMM, et correspondent à des extensions d'indication. En l'absence d'études antérieures comparables, il n'est toutefois pas possible d'établir si les pratiques de prescription des neuroleptiques/antipsychotiques par les médecins généralistes ont été modifiées par l'introduction de ces nouvelles molécules, dont un argument promotionnel central est qu'ils sont mieux tolérés que les neuroleptiques classiques. Des études évaluant l'évolution des prescriptions des antipsychotiques en médecine générale conduites au Royaume-Uni suggèrent toutefois l'existence d'une telle tendance. Une première étude26 a porté sur les prescriptions des antipsychotiques de 2ème génération en médecine générale dans 13 « Health Authorities » de la région des West Midlands sur la période 1996-2001. Cette étude montre que les prescriptions (évaluées par la dose quotidienne standardisée ou Defined Daily Dose) ont augmenté de 500 % pendant cette période, alors que celle des neuroleptiques conventionnels diminuait de 24 %. Cette étude ne permet toutefois pas d'évaluer la proportion de sujets exposés à ces produits. Une autre étude plus détaillée a été conduite au Royaume-Uni, à partir des données collectées dans la General Practice Research Database, portant sur les prescriptions de 270 cabinets médicaux de médecine générale27. Tous les patients âgés de 10 à 99 ans avec au moins une prescription de neuroleptiques/antipsychotiques pendant la période 1991-2000 ont été identifiés. La proportion annuelle de sujets usagers de neuroleptique/antipsychotique a augmenté de 10,5 à 12,2 pour mille au cours de cette période (soit 16 % d'augmentation), essentiellement du fait de l'augmentation de la durée de prescription, le nombre de nouveaux usagers restant relativement stable. Les prescriptions d'olanzapine et de rispéridone, les deux antipsychotiques de 2ème génération alors commercialisés, ont augmenté de manière continue au cours de la période. De manière notable, moins de 10 % des sujets chez qui un traitement neuroleptique/antipsychotique était initié souffraient de troubles psychotiques, les indications les plus fréquentes (50 %) étant les troubles dépressifs et anxieux, suivis des démences. 6. Études portant sur des populations spécifiques Etude EVA (Etude sur le Vieillissement Arteriel / Epidemiology of Vascular Aging) L'étude EVA est une étude prospective dont l'objectif principal était d'étudier les conséquences cognitives et vasculaires du vieillissement et leurs facteurs de risque28. Cette étude a été financée dans le cadre d'une convention INSERM/Merck Sharp et Dhome-Chibret, ainsi que par le laboratoire ESAI. Elle a été réalisée à partir de 1991 chez 1 389 sujets non-institutionalisés, âgés entre 60 et 70 ans, tirés au sort à partir des listes électorales de la ville de Nantes. On ne dispose pas d'information sur le taux de participation parmi les sujets sollicités, ni sur les caractéristiques des sujets ayant refusé de participer à l'étude. Les caractéristiques socio-démographiques des sujets inclus suggèrent toutefois l'existence d'un biais de sélection favorisant les sujets ayant un plus haut niveau d'études et de revenus que l'ensemble de la population de Nantes âgée de 60 à 70 ans. Les sujets participants étaient évalués dans un centre d'examen mis en place pour les besoins de l'étude dans les locaux de la mairie de Nantes. Les données recueillies lors de l'évaluation initiale incluaient des informations sur l'histoire médicale et l'état somatique actuel, plus particulièrement sur les pathologies vasculaires et leurs facteurs de risque. L'intensité des symptômes dépressifs et anxieux était évaluée par autoquestionnaires (Center for Epidemiologic Studies-Depression scale et Spielberger Inventory Trait, respectivement). Les données concernant les médicaments utilisés étaient recueillies en demandant aux sujets d'apporter lors de la visite d'évaluation les ordonnances et les boîtes correspondant aux médicaments consommés au cours du mois précédent. Les psychotropes ont été catégorisés à partir du Guide National des Prescriptions de 1991 (VIDAL®) en hypnotiques, sédatifs, neuroleptiques, anxiolytiques, antidépresseurs et normothymiques. Les données ont été analysées séparément chez les femmes (n=815) et les hommes (n=574). La plupart des sujets avaient consommé régulièrement au moins un médicament au cours du dernier mois (81 % des femmes et 71 % des hommes). Parmi ces sujets, un tiers des femmes (33,2 %) et près d'un homme sur cinq (19,2 %) avaient pris régulièrement au moins un psychotrope au cours du mois précédent. Il s'agissait le plus souvent d'hypnotiques et anxiolytiques, les antidépresseurs représentaient 5,6 % des psychotropes consommés et les neuroleptiques moins de 2 %. Seuls 23 sujets (1,7 %) consommaient uniquement des psychotropes. Les caractéristiques associées à l'usage de psychotropes au cours du dernier mois différaient en partie chez les hommes et les femmes. Les psychotropes étaient plus fréquemment utilisés par des hommes vivant seuls, ayant des revenus mensuels inférieurs à 10 000 francs, souffrant d'une maladie chronique, et par les sujets non-buveurs ou buveurs excessifs (plus de 40ml/j d'alcool par jour) par rapport aux buveurs modérés. Chez les femmes, on retrouvait l'association avec un bas niveau de revenus et la non consommation d'alcool, ainsi qu'avec l'âge (plus élevé chez les consommatrices) et un bas niveau d'éducation. Dans les deux sexes, l'intensité des symptômes anxieux et dépressifs était associée à l'usage de psychotrope. Les analyses évaluant l'impact indépendant de chacune de ces caractéristiques montrent que l'intensité des symptômes anxieux est le seul facteur qui reste associé à l'usage de psychotropes. En d'autres termes, les associations mises en évidence avec les autres caractéristiques sont en partie liées au fait que le niveau d'anxiété est plus élevé chez les sujets présentant ces caractéristiques (par exemple le fait de vivre seul, d'être dans une situation sociale défavorisée, etc..). Cette étude réalisée à partir des données collectées à l'inclusion a pour intérêt principal de souligner que les sujets âgés recrutés en population générale, et particulièrement les femmes, sont très fortement exposés aux psychotropes. La fréquence d'usage est même ici probablement sous-estimée du fait du biais de sélection favorisant l'inclusion de sujets moins susceptibles de prendre ces traitements (niveau d'études et de revenus élevés). On ne dispose toutefois dans cette étude d'aucune information concernant l'ancienneté de la prescription, ni d'information très détaillée sur les types de psychotropes utilisés. Même si une association est mise en évidence entre usage de psychotrope et présence de symptômes anxieux et dépressifs, les données sur l'état psychiatrique des sujets sont succinctes, et se limitent à des scores obtenus par des échelles d'auto-évaluation de symptômes, qui ne permettent pas de déterminer si les sujets présentaient des troubles psychiatriques avérés. Une étude réalisée à partir des données collectées lors du suivi permet de compléter et préciser ces résultats29. Les sujets inclus en 1991 ont été revus pour une deuxième évaluation à deux ans (1993). Sur 1389 participants, 117 n'ont pu été revus dont 7 pour causes de décès. Les sujets non revus avaient un niveau d'études plus bas que les sujets revus, et étaient comparables aux autres sujets pour les autres caractéristiques socio-démographiques et les antécédents médicaux. Un auto-questionnaire à renvoyer par la poste concernant l'utilisation de médicaments psychotropes a été remis au 1272 sujets revus à deux ans, et rempli de manière exploitable par 1265 d'entre eux. Dans cet autoquestionnaire, les sujets devaient préciser s'ils consommaient ou avaient consommé au cours des 6 mois précédents des médicaments « pour se détendre, pour se calmer ou pour dormir (tranquillisants, somnifères, antidépresseurs ou autres )». Si la réponse était positive, étaient alors recueillis les motifs d'utilisation, le nom de la spécialité, la posologie quotidienne, la fréquence des prises, l'ancienneté de consommation, l'origine des prescriptions et l'observance des recommandations de la prescription pour chaque médicament déclaré. Un tiers des sujets (33 %) déclaraient consommer ou avoir consommé au cours des 6 derniers mois au moins un psychotrope, la plupart (29 %) faisant toujours usage de ce produit au moment de l'évaluation. Les types de psychotropes utilisés sont décrits dans le Tableau 9. On retrouvait là encore une surprésentation féminine (71,3 % des consommateurs actuels et 77,8 % des consommateurs passés). Le motif d'usage le plus souvent mentionné était l'aide à l'endormissement pour 64,7 % des consommateurs actuels et 50 % des consommateurs passés. Tableau 9. Psychotropes consommés au cours des 6 derniers mois dans la cohorte EVA
1. Inhibiteurs Sélectifs de la Recaptage de la Sérotonine 2. Inhibiteurs de la MonoAmine Oxydase Des analyses plus détaillées ont été effectuées concernant les modalités d'usage des benzodiazépines, qui étaient les produits les plus consommés dans cette population. Dans la quasi-totalité des cas (99 % chez les femmes et 95 % chez les hommes), ces médicaments ont fait l'objet d'une prescription médicale, le plus souvent par un généraliste (86,8 % des femmes et 80,9 % des hommes). Les posologies étaient modérées, par exemple plus de 70 % de femmes et d'hommes prenaient du Lexomil® à une posologie inférieure ou égale à celle recommandée chez le sujet âgé (3 mg/j). Plus des deux tiers des femmes et trois quarts des hommes consommaient quotidiennement ces produits, le plus souvent depuis au moins deux ans (80,4 % des femmes et 67,5 % des hommes). La plupart des sujets déclaraient avoir respecté la prescription médicale (66,5 % des femmes et 69,6 % des hommes), et si ce n'était pas le cas, le non-respect allait essentiellement dans le sens d'une diminution des doses et de la durée du traitement, et exceptionnellement (moins de 5 % des cas de non-respect) dans l'autre direction. Cette deuxième étude réalisée à partir des données de la cohorte EVA permet de préciser deux points importants : le fait que les sujets âgés usagers d'anxiolytiques ont un usage chronique de ces produits, mais surtout que cet usage régulier ne s'associe que très exceptionnellement à une surconsommation par rapport au traitement prescrit par le médecin. Cette étude illustre donc une notion importante, qui sera reprise dans la question 6 concernant la dépendance, à savoir que la quasi-totalité des usagers chroniques d'anxiolytiques respectent les prescriptions médicales et ne développent pas de conduites addictives vis à vis de ces substances. Etude PAQUID (Personnes Agées QUID ?) Une étude sur l'usage des psychotropes a été réalisée à partir des données collectées dans la cohorte PAQUID30. Cette cohorte a été mise en place en 1988-1989 avec pour objectif principal d'étudier le vieillissement fonctionnel et cérébral. Les sujets âgés de 65 ans et plus résidant dans 75 districts de Gironde et Dordogne, non-institutionalisés, ont été tirés au sort sur les listes électorales après stratification par âge et par sexe en fonction des caractéristiques de la population du district de résidence. Sur les 4 050 sujets contactés, 2 792 (68,9 %) ont accepté de participer à cette étude de cohorte. Les sujets non-participants et participants ne différaient pas pour l'âge, le sexe et le niveau d'éducation. Les données ont été recueillies à l'inclusion (1998-1989), à un an (1989-1990), à 3 ans (1991-1992) et à 5 ans (1993-1994) au moyen d'un entretien d'une heure au domicile des sujets par des psychologues entraînés. Le questionnaire incluait entre autres des questions sur l'état de santé actuel et passé, et sur la prise de traitements dans les 2 semaines précédant l'entretien. Les médicaments investigués incluaient ceux prescrits et ceux pris sans ordonnance. Les noms des médicaments étaient notés et confirmés par une inspection des boîtes contenues dans la pharmacie de la maison. Aucune information n'était recueillie sur la durée de traitement et la posologie. La classification des médicaments en fonction de leur indication était celle du dictionnaire VIDAL®. Plus d'un tiers (37,6 %) des sujets interrogés à l'inclusion rapportaient l'usage d'au moins un psychotrope au cours des deux dernières semaines, qui était dans la majorité des cas (31 % des sujets) une benzodiazépine. La fréquence d'usage des autres psychotropes n'excédait pas 10 %. La plupart des sujets (86 %) avait fait usage d'une seule benzodiazépine, les autres en consommait deux (13 %) voire trois (1 %). L'usage concomitant d'antidépresseurs était retrouvé chez 10,5 % des usagers de benzodiazépine, et celui de neuroleptiques chez 6,1 % d'entre eux. Au cours du suivi, parmi les usagers de benzodiazépine à l'inclusion, plus de la moitié des sujets (55,9 %) rapportaient faire toujours usage de ces médicaments pendant au moins 2 visites consécutives. Plusieurs caractéristiques étaient associées à l'usage de benzodiazépine à l'inclusion. Celui ci était plus fréquent chez les femmes, les sujets ayant un bas niveau d'éducation, les veufs, les sujets ayant des antécédents psychiatriques. Une association était également mise en évidence avec l'existence de pathologies chroniques, 57,6 % des usagers rapportaient plus de 3 maladies chroniques (vs. 37,8 % des non-usagers), et en corollaire, 60 % d'entre eux (vs. 38 % des non-usagers) consommaient plus de 3 médicaments non-psychotropes. Les usagers rapportaient une moindre consommation journalière de vin, moins d'activités extérieures et à domicile. Ils étaient moins satisfaits de leur vie et considéraient plus souvent leur statut de santé comme mauvais. Les analyses évaluant l'impact de chacune de ces caractéristiques montrent que présenter plusieurs maladies chroniques ou avoir une mauvaise perception de son état de santé sont associés à la prise de benzodiazépines, indépendamment du sexe et des antécédents psychiatriques. Parmi les non-usagers de benzodiazépines à l'inclusion, 5 % des sujets débutaient l'usage de ces médicaments par année de suivi. Les caractéristiques à l'inclusion significativement associées à l'usage ultérieur de benzodiazépines étaient là encore les antécédents psychiatriques, une mauvaise perception de sa vie, et la présence d'au moins 3 maladies chroniques. Les consommateurs modérés de vin étaient en revanche moins susceptibles de débuter un tel traitement. La principale limite de cette étude est liée au fait que les informations sur l'usage des psychotropes concernent exclusivement la période précédant chaque évaluation, et que l'on ne dispose pas de données sur l'exposition antérieure et l'usage entre ces évaluations. La sélection des sujets à partir des listes électorales peut aussi entraîner une sous-représentation des sujets les plus désinsérés socialement, ou sous mesure de protection des biens. Cette étude confirme la fréquence élevée d'exposition des personnes âgées aux psychotropes en général, et aux benzodiazépines en particulier. L'association d'au moins deux benzodiazépines est trouvée chez plus d'un usage sur deux, et l'usage de ces produits est le plus souvent prolongé. Son apport principal est de montrer que cet usage est plus fréquent chez les sujets qui présentent un état somatique précaire avec plusieurs pathologies chroniques, et une mauvaise perception de leur qualité de vie. Etudes françaises À notre connaissance, seules deux études françaises sur l'usage des psychotropes conduites sur un échantillon représentatif de la population générale ont fait l'objet d'une publication dans une revue scientifique. La première est une étude prospective conduite auprès des enfants âgés de 6 ans pendant l'année scolaire 1989-1990, dans les 609 établissements scolaires du Bas-Rhin répartis dans 440 communes31. Le choix de l'âge de 6 ans a été motivé par le fait qu'une consultation en médecine scolaire est obligatoire à l'entrée en cours préparatoire, en présence des parents. Le recueil des données a été effectué par les médecins scolaires pendant cette consultation auprès de 11 274 enfants, sur un total de 11 595 enfants éligibles pour l'étude (les motifs de non participation étaient l'absence des parents lors de la visite pour 340 enfants, le fait que les parents ne comprenaient pas les questions pour 80 enfants, et 1 refus). La moitié des enfants résidaient dans une agglomération de plus de 5 000 habitants. Un médicament psychotrope était défini comme un médicament agissant sur le système nerveux central, et un consommateur comme un enfant prenant un médicament de ce type, prescrit ou non, sans considérer de périodicité. Plus d'un enfant sur 10 (12,1 %) était consommateur de psychotropes largement définis. Les médicaments consommés sont présentés dans le Tableau 10. Tableau 10. Consommation de médicaments psychotropes chez les enfants de six ans du Bas-Rhin, 1990
À noter que la définition large de psychotropes incluait les antalgiques et antipyrétiques, de ce fait le contexte de consommation le plus fréquent (45 %) est l'épisode fébrile. La prise quotidienne de médicaments concerne 14,8 % des enfants consommateurs (soit 2 % de la population étudiée). Indépendamment de la fréquence de prise, plus de la moitié des enfants consommateurs utilisaient un médicament psychotrope depuis plus d'un an. Environ 35 % des enfants avaient débuté leur prise à l'âge d'un an. Cette prise médicamenteuse est souvent interrompue pour reprendre à une autre période de l'enfance. Dans 95 % des cas, le médicament était obtenu par une prescription médicale, les autres situations étant sur conseil du pharmacien (1,4 %), sur l'initiative des parents (2,4 %), du fait d'une publicité (0,1 %) ou par des relations (1,3 %). Le statut professionnel de la mère est associé à l'usage de psychotropes, avec une discrète augmentation du nombre d'enfants consommateurs (13,2 %) chez les enfants de mères qui travaillent par rapport aux enfants de mères au foyer (8,4 %). Les limites de cette étude sont liées à la méthode de recueil des informations sur l'usage de psychotropes, faisant exclusivement appel à la mémoire des parents, le caractère rétrospectif et l'absence de validation par une autre source pouvant exposer à des biais de mémorisation. Bien qu'elle soit relativement ancienne, cette étude a pour intérêt de mettre en exergue la fréquence non négligeable d'exposition aux psychotropes chez les enfants très jeunes, et de montrer que cette exposition débute très précocement. Une étude récente a été conduite sur l'usage de psychotropes chez les enfants à partir des données de la CNAM-TS d'Aquitaine32. Tous les enfants âgés de 0 à 5 ans ayant eu au moins un remboursement de psychotropes pendant l'année 2002 ont été identifiés. Une enquête postale, avec envoi d'un questionnaire postal aux parents et aux prescripteurs, a été réalisée sur un échantillon aléatoire de 1000 enfants usagers âgés de 2 à 5 ans, et sur un nombre égal de sujets témoins (sans remboursement de psychotropes en 2002) de même âge que les non-usagers. La prévalence d'usage des psychotropes chez les enfants de 0 à 5 ans était de 3,2 %, plus élevée chez les garçons (3,5 %) que chez les filles (2,7 %). Cette prévalence varie avec l'âge (2,3 % chez les enfants âgés d'un an ou moins ; 4,6 % chez les enfants de 2 ans : 4,0 % chez les enfants de 3 ans ; 3,6 % chez les enfants de 4 ans ; 1,2 % chez les enfants de 5 ans). Les psychotropes les plus souvent délivrés sont l'Atarax® (1,5 %), le Valium® (0,8 %) et le Nopron® (0,7 %). Si ces 3 psychotropes sont exclus, la prévalence d'usage diminue de 3,2 % à 0,5 %. Pour 75 % des usagers, une seule délivrance a été identifiée dans la base de données en 2002. Les psychotropes étaient prescrits dans trois quarts des cas par des généralistes (76,7 %), par des pédiatres dans 20 % des cas, moins de 1 % des prescriptions étant faites par des psychiatres, les neurologues ou les neuropsychiatres. Les enfants usagers de psychotropes avaient plus de consultations médicales, et plus de remboursements de médicaments non-psychotropes que les non-usagers. Les indications rapportées par les prescripteurs (taux de participation : 41,2 %) sont indiquées dans le Tableau 11 ; les troubles du sommeil représentaient l'indication la plus fréquente, dans 84,8 % des cas aucun diagnostic psychiatrique spécifique n'était rapporté. Les prescriptions correspondaient à une décision du médecin dans 63,7 % des cas et à une demande insistante des parents dans 35,3 % des cas. Les principales informations fournies par les parents (taux de participation 21,8 %) sont que 91,1 % d'entre eux rapportent l'utilisation depuis la naissance d'au moins un médicament pour calmer ou aider à dormir l'enfant, et que 60 % des enfants usagers utilisent l'homéopathie quotidiennement pour les aider à dormir. Tableau 11. Indications des prescriptions de psychotropes à partir des questionnaires envoyés aux médecins prescripteurs d'après Levy et al32
1. Plusieurs motivations pouvaient être indiquées Nous rapportons les résultats d'une étude qui ne répond pas strictement aux critères d'inclusion que nous avons précédemment définis, car elle porte sur des enfants et des adolescents hospitalisés ou consultants dans un service de pédopsychiatrie d'un hôpital pédiatrique général33. Même si ces enfants et adolescents ne sont absolument pas représentatifs de la population générale du fait de ce mode de recrutement, cette étude a pour intérêt d'explorer la relation entre consommation de psychotropes chez l'enfant et chez les parents. Les enfants âgés de 6 à 16 ans ont été évalués si au moins un des parents acceptait de répondre à un questionnaire sur la consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs par l'enfant et les parents. Une liste complète des médicaments disponibles en France a été montrée à chaque sujet pendant l'interview. Les enfants de plus de 13 ans ont été interrogés en l'absence de leurs parents au moyen du même questionnaire. Aucune information n'est fournie sur le taux de participation à l'enquête. Les 221 jeunes patients (158 garçons et 63 filles) étaient âgés de 10 ans en moyenne. Leur consommation sur la vie entière d'anxiolytiques et d'antidépresseurs était de 21,7 %, sans différence significative entre garçons (22,2 %) et filles (20,6 %). La consommation vie entière d'anxiolytiques et d'antidépresseurs par les parents étaient de 36,2 % avec 91 mères (45,1 %) et 35 pères (23,6 %) rapportant avoir fait usage au moins une fois d'un de ces psychotropes. La consommation vie entière d'anxiolytiques et d'antidépresseurs était 5 fois plus fréquente chez les enfants dont au moins un des parents était usager de psychotropes. Les analyses évaluant l'effet indépendant de plusieurs caractéristiques associées à l'usage de psychotropes montrent que seule la consommation de psychotropes par les mères reste significativement associée à la consommation des enfants, celle des pères, le sexe et l'âge des enfants n'étant pas des variables explicatives de cette consommation. Les résultats de cette étude doivent être interprétés avec beaucoup de prudence car ils portent sur une population d'enfants et d'adolescents présentant des symptômes psychiatriques suffisamment sévères pour justifier le recours à un service hospitalier de pédo-psychiatrie. Ce biais de sélection implique aussi que les parents ne sont pas représentatifs de la population générale, du fait de l'agrégation familiale des troubles psychiatriques, l'association entre consommation par les parents et les enfants pouvant être le reflet de l'existence de troubles psychiatriques avérés dans les deux générations. Même si ces résultats ne sont pas extrapolables à la population générale, ils attirent l'attention sur le possible impact des comportements de consommation de psychotropes par les parents sur la consommation par les enfants, et justifient que des études soient conduites sur des échantillons plus représentatifs. Etudes Européennes Une étude a été conduite de 1995 à 1999 chez tous les enfants âgés de 0 à 19 ans du nord des Pays-Bas à partir des données d'utilisation des médicaments fournies par les registres des pharmacies34. Aux Pays-Bas, les médicaments ne sont délivrables que par la pharmacie à laquelle la personne est affiliée. L'histoire complète des traitements est ainsi enregistrée dans une base de données (InterAction) gérée dans le cadre d'une collaboration entre les pharmaciens du nord des Pays-Bas et l'université de Groningen. La base de données InterAction comprend toutes les prescriptions à partir de 1994 pour environ 120 000 personnes, sa représentativité de la population générale est excellente puisque les personnes sont enregistrées dans cette base indépendamment du fait qu'ils aient ou non une assurance de santé. Par définition, les médicaments utilisés pendant le séjour à l'hôpital et les médicaments sans ordonnance ne sont pas inclus dans cette base. La base de données incluait en 1995 31 140 prescriptions pour des enfants, et 37 670 en 1999. Les psychotropes étaient définis selon la classification ATC, et excluaient les anticonvulsivants, ainsi que les formes intraveineuses ou rectales des benzodiazépines. Les usagers incidents étaient définis comme n'ayant pas eu de prescription du psychotrope en question depuis au moins un an. Les résultats sont présentés dans le Tableau 12. La donnée la plus spectaculaire concerne l'augmentation de la prévalence et de l'incidence d'usage des psychostimulants pendant cette période. Une discrète augmentation du taux de prévalence des antipsychotiques et des anxiolytiques/hypnotiques est également notée. Dans la majorité des cas, les traitements sont donnés en monothérapie (89,6 % des stimulants, 93,4 % des hypnotiques/anxiolytiques). Tableau 12. Usage de psychotropes par les enfants de 0 à 19 ans du nord des Pays-Bas d'après Schirm et al34
1. Taux de prévalence et d'incidence exprimés en nombre d'enfants pour 1000 enfants de la population 2. Augmentation significative au cours du temps Une analyse plus détaillée, conduite sur les prescriptions de psychostimulants, montre que la plus forte prévalence est trouvée pour le groupe des 5-9 ans, avec plus d'un enfant sur 100 en 1999 (Tableau 13). Sur la totalité de la période d'étude, plus de garçons que de filles ont reçu des psychostimulants mais cette différence diminue au fil du temps : en 1995, le sex ratio (M / F) pour les 0-19 ans recevant un psychostimulant était de 8,4 /1 et en 1999 de 5,5 /1. Tableau 13. Usage de stimulants par groupe d'âge et de sexe, nord des Pays-Bas, 1995-1999 d'après Schirm et al34.
1. Taux de prévalence exprimé en nombre d'enfants avec une prescription de stimulants pour 1000 enfants de la population Cette étude illustre le fait que la fréquence d'utilisation des psychotropes est importante chez les enfants aux Pays-Bas, avec 7 enfants sur 1 000 âgés de 0 à 19 ans usagers de psychostimulants ou d'anxiolytiques/hypnotiques. L'augmentation de l'usage de psychostimulants est notable, ainsi que la précocité de ces traitements, avec une proportion non négligeable d'enfants traités dès la tranche d'âge de 0-4 ans. Une étude plus récente confirme cette croissance importante des prescriptions de psychostimulants chez les enfants des Pays-Bas35. Des études conduites au Royaume-Uni en 199936, et en Allemagne en 200037, trouvent des fréquences d'usage comparables, avec respectivement 0,5 % des enfants de 5 à 14 ans et 0,6 % des enfants de 5 à 15 ans traités par ce médicament. Peu d'informations sont disponibles sur le nombre d'enfants traités par méthylphénidate en France, où la prescription de ces produits n'est autorisée qu'à partir de l6 ans. Trenque et collaborateurs38 estiment que le nombre d'usagers de ce produit était d'environ 4 500 en 2001 (1800 en 1997), et qu'approximativement 0,047 % des enfants de 6 à 18 ans étaient traités par ce médicament (0,019 % en 1997). La fréquence d'usage serait donc nettement moindre qu'aux Pays-Bas. A titre comparatif, Trenque et collaborateurs rapportent qu'aux USA, 2,8 % des enfants âgés de 5 à 18 ans étaient traités pour hyperactivité par ce médicament en 1995, et que cette fréquence d'usage va croissant, particulièrement chez les enfants d'âge pré-scolaire. Une étude conduite en Irlande entre janvier 2001 et août 2004 a plus spécifiquement exploré l'usage des antidépresseurs chez les enfants de moins de 15 ans39. Les données sont issues des bases des General Medical Services qui offrent des soins gratuits à environ 30 % de la population irlandaise, dont 28 % des enfants. La population explorée dans cette étude est donc caractérisée par une surprésentation des personnes en situation sociale précaire. Les prescriptions étaient codées selon la classification ATC. En 2003, les antidépresseurs ont été prescrits à 1 079 enfants soit 0,43 % de la population éligible (par rapport à 16,9 % dans la population adulte, dont 9 % dans la tranche d'âge 16-24). Les filles ont été traitées 1,6 fois plus souvent par antidépresseurs que les garçons. Les types d'antidépresseurs prescrits étaient similaires chez les enfants et les adultes, les ISRS étant le groupe le plus prescrit. Plus de la moitié (58 %) des enfants avaient une seule prescription d'antidépresseur, et seuls 19,4 % d'entre eux avaient des prescriptions de 3 mois ou plus (comparativement, 23,5 % des adultes avaient une seule prescription et 66,5 % avaient des prescriptions de 3 mois ou plus). L'évolution globale des prescriptions au cours du temps montre une baisse significative entre janvier 2001 et août 2004, qui n'est toutefois mise en évidence que pour les antidépresseurs tricycliques, et non pour les ISRS (pendant la même période, la fréquence d'usage augmente chez les adultes). La prévalence d'usage des antidépresseurs chez les enfants dans cette étude (1 sur 2000) est comparable à celle de l'étude conduite aux Pays-Bas. Dans les autres pays européens, la fréquence d'usage des antidépresseurs est estimée à 0,6 % au Royaume-Uni en 2004 chez les moins de 18 ans40 et 0,4 % en Allemagne en 2003 chez les moins de 20 ans41. Là encore, on ne dispose pas d'études similaires en France. Quel que soit le pays, il est vraisemblable que ces estimations doivent être actuellement revues à la baisse suite aux restrictions d'usage des antidépresseurs dans ces tranches d'âge (cf. question 3). Nous rapportons pour mémoire une étude conduite sur un échantillon très spécifique constitué de médecins généralistes libéraux42. Une enquête transversale téléphonique a été réalisée en mars 2002 auprès d'un panel de généralistes exerçant dans la région PACA (Provence Alpes Côte d'Azur). Ce panel excluait les médecins avec une pratique exclusive de l'homéopathie ou de l'acupuncture, et était constitué par la méthode des quotas après stratification de l'échantillon par sexe, âge et taille de leur zone de pratique. Parmi les médecins éligibles, 600 (55,8 %) ont accepté de participer. Le questionnaire explorant les pratiques incluait une question sur l'usage de psychotropes par le médecin (« pendant les 12 derniers mois, avez-vous consommé un hypnotique ou un anxiolytique ? »), ainsi que sur le nombre de prescriptions d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs faites au cours des quatre dernières semaines. Les prévalences d'usage ont été comparées à celle de la population générale de PACA, à partir de données collectées sur un échantillon de 8 609 personnes d'âge similaire (30-68 ans). Près d'un généraliste sur 4 (23 %) a rapporté avoir fait usage au moins une fois d'hypnotiques ou d'anxiolytiques dans l'année précédente, les femmes étant plus nombreuses (28,5 %) que les hommes (21 %) à rapporter un tel usage. Cette prévalence d'usage est plus élevée que dans l'échantillon de sujets de la population générale (17,5 %). Plus d'un médecin sur 10 (12 %) rapportait un usage régulier (plus d'une fois par mois). Les caractéristiques professionnelles associées de manière indépendante à l'usage de ces psychotropes étaient le fait d'avoir une insatisfaction par rapport à la pratique, une clientèle comportant beaucoup de pathologies lourdes, le fait d'exercer en secteur 1, d'avoir un nombre élevé d'heures de travail hebdomadaires (55h). L'usage d'hypnotiques ou d'anxiolytiques par le médecin était associé avec un plus grand nombre de prescriptions d'anxiolytiques, mais pas d'antidépresseurs. En analyse stratifiée sur l'âge, ces associations ne sont identifiées que chez les médecins les plus âgés (plus de 48 ans). Du fait de la méthode de recueil, une sous-déclaration de l'usage des psychotropes par les médecins généralistes ne peut pas être exclue, cette étude pourrait donc sous-estimer plutôt que surestimer cette consommation. Le résultat le plus intéressant est celui montrant que l'usage personnel de ces psychotropes par les médecins influe sur leurs pratiques de prescription, au moins chez les généralistes les plus âgés. 1. CNAM-TS (Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) Le Directeur Général de la CNAM-TS a été sollicité par courrier concernant la réalisation d'études sur l'usage et l'impact des psychotropes qui pourraient être réalisées, dans le cadre du présent rapport, à partir des bases de données de la CNAM-TS. Une réponse positive a été faite à cette demande (Annexe 4). Du fait des délais impartis pour la remise du présent rapport, il n'a pas été possible d'élaborer en collaboration avec la Direction de la Stratégie, des Etudes et des Statistiques de la CNAM-TS une étude dont les résultats seraient disponibles à la date de remise du rapport. Cette réponse positive ouvre des perspectives très intéressantes pour améliorer le niveau de connaissance sur l'usage et l'impact des psychotropes en France, du fait du potentiel d'informations pouvant être issues des bases de données de la CNAM-TS, qui représentent quantitativement l'une des plus grosses sources de données au Monde sur l'utilisation du médicament2. a) Enquête nationale sur le comportement des médecins et des pharmaciens face à la limitation réglementaire de la durée de prescription des anxiolytiques et des hypnotiques Nous citons pour mémoire cette étude ancienne déjà rapportée dans le rapport Zarifian43, qui a porté sur toutes les demandes de remboursement de médicaments présentées dans toutes les CPAM métropolitaines au cours d'une semaine de prescription en mai 1993. Près de 15 % des ordonnances analysées comportaient au moins la prescription d'un anxiolytique ou hypnotique. Les associations de plus de 2 anxiolytiques et/ou hypnotiques représentaient au moins 3,5 % des ordonnances (6,4 % d'association de 2 anxiolytiques et 0,62 % d'association de 2 hypnotiques). Plus d'une ordonnance sur 5 (21,5 %) ne respectait pas les durées de prescription fixées par l'arrêté du 7 octobre 1991 à 12 semaines pour les anxiolytiques et à 4 semaines pour les hypnotiques. b) Étude sur la consommation et les pratiques de prescription en France métropolitaine Cette étude transversale a été conduite en 2000 sur la population des 41,5 millions de bénéficiaires du régime général d'assurance maladie à partir des bases de données de remboursement de l'assurance maladie issues des 128 CPAM (Caisses Primaires d'Assurance Maladie) de France métropolitaine44. Les assurés et bénéficiaires du régime général des travailleurs salariés stricto-sensu auxquels a été remboursé au cours de l'année 2000 au moins un médicament psychotrope ont été identifiés. Comme le codage des médicaments n'était pas exhaustif (86 %) en 2000, avec des écarts entre CPAM, un coefficient de redressement a été appliqué. Un échantillon de sujets a été tiré au sort (fraction de sondage à 9,3 %) au sein de l'ensemble des sujets avec remboursement de psychotropes, ceci en utilisant les 2 derniers chiffres du numéro de sécurité sociale (qui sont attribués de façon aléatoire). La population prise en compte pour le calcul des taux était celle des bénéficiaires du régime général au 31 décembre 1999. Six classes de psychotropes ont été prises en compte selon la classification EphMRA (European Pharmaceutical Marketing Research Association). Au cours de l'année 2000, près d'un assuré sur quatre a eu au moins un remboursement de médicament psychotrope. La fréquence de remboursement en fonction de la classe thérapeutique est donnée dans le Tableau 14. L'analyse des prescriptions répétées (au moins 4 remboursements) montre que celles ci concernent la moitié des sujets. L'étude ne fournit des indications que sur les remboursements, et non sur la durée du traitement. Si l'on considère que les prescriptions sont généralement faites pour un mois, ce pourcentage de renouvellement est trop élevé au regard des durées recommandées pour les hypnotiques (un mois) et les anxiolytiques (trois mois), et trop bas au regard des recommandations concernant les antidépresseurs (6 à 8 mois de traitement après la rémission des symptômes). Tableau 14. Fréquence annuelle de remboursement des psychotropes en 2000, étude CNAM-TS
L'étude des remboursements uniques (un seul remboursement en 12 mois) fournit des indicateurs allant dans la même direction (Tableau 15). Pour près d'un tiers des assurés ayant une prescription d'antidépresseur, celle ci est unique. Toujours selon l'hypothèse que le traitement a été prescrit pour un mois, le traitement est probablement interrompu avant même que l'effet thérapeutique ait pu apparaître, ou dès son apparition, puisque la latence d'action de ces médicaments est d'environ 3 semaines, quelle que soit la classe pharmacologique. Tableau 15. Nombre de remboursements par assuré de médicaments psychotropes en 2000, étude CNAM-TS
1. Médicaments utilisés dans le sevrage alcoolique L'étude des prescriptions en fonction de l'âge et du sexe montre que les femmes ont plus souvent bénéficié d'un remboursement que les hommes, et que le pourcentage d'utilisateurs augmente avec l'âge (Tableau 16). Une femme sur deux dans les classes d'âge 50-79 a eu au moins un remboursement de psychotrope au cours de l'année 2000. Le pourcentage d'enfants ayant eu des prescriptions de psychotropes est bas, sans être négligeable, en particulier pour les prescriptions d'anxiolytiques. Tableau 16. Taux annuel de consommateurs de psychotropes selon la classe thérapeutique, l'âge et le sexe en 2000, étude CNAM-TS
1. Médicaments utilisés dans le sevrage alcoolique ; 2. H : hommes, F : femmes Dans 90 % des cas les prescriptions étaient faites par un médecin généraliste. La fréquence des prescriptions faites par un psychiatre variait selon la classe thérapeutique (de 9,5 % pour les anxiolytiques à 48,7 % pour les sels de lithium). L'analyse des disparités régionales a été faite après une standardisation sur les critères âge et sexe avec comme population de référence le recensement INSEE de 199945. Pour l'ensemble des psychotropes les taux régionaux varient de 22,6 % (Alsace) à 28,2 % (Limousin). Les départements les plus consommateurs d'anxiolytiques sont situés sur un axe transversal passant par le centre de la France (Figure 1). Le Nord de la France regroupe 7 des 21 départements les plus consommateurs d'hypnotiques (Figure 2). Le profil régional des prescriptions d'antidépresseurs apparaît proche de celui des anxiolytiques (Figure 3). Les disparités régionales restent toutefois relativement modérées, le profil global restant identique d'une région à l'autre. Les limites de cette étude sont inhérentes au fait que l'existence d'un remboursement ne préjuge pas d'une consommation effective, et que comme cela a déjà été souligné, la durée du traitement prescrit n'est pas connue, ne permettant que des approximations par rapport aux durées de traitement. Hormis les résultats confirmant ceux d'études précédentes (prévalence élevée de l'usage des psychotropes, en particulier anxiolytiques/hypnotiques chez les sujets âgés), son intérêt principal est de mettre en évidence une inadéquation marquée des prescriptions d'antidépresseurs, avec un nombre très élevé de prescriptions ponctuelles. Figure 1. Taux standardisés de consommation d'anxiolytiques par département en 2000, étude CNAM-TS
Figure 2. Taux standardisés de consommation d'hypnotiques par département en 2000, étude CNAM-TS
Figure 3. Taux standardisés de consommation d'antidépresseurs par département en 2000, étude CNAM-TS 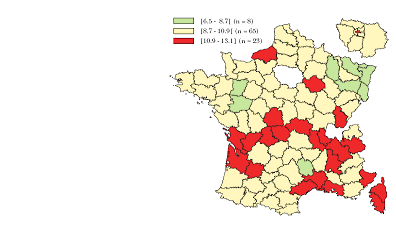 c) Disparités géographiques dans les prescriptions médicamenteuses d'antibiotiques, de psychotropes et de statines Cette étude explore les disparités régionales de prescriptions pour trois classes médicamenteuses, antibiotiques, hypnotiques/anxiolytiques et statines46. Les prescriptions étudiées sont celles des médecins généralistes libéraux conventionnés et exerçant en France métropolitaine en 2004, pour lesquels ont été recueillis, à partir des données de la base nationale CNAM-TS, le nombre de conditionnements prescrits ainsi que le nombre de consultations et visites effectuées. Cette étude montre que les disparités régionales existent pour d'autres classes que les psychotropes (Figures 4, 5 et 6). Sans être totalement superposables pour les trois classes, ces disparités permettent néanmoins d'identifier des régions où les prescriptions sont plus importantes quel que soit le médicament considéré (Nord et Centre en particulier). d) Étude de la consommation des antidépresseurs dans la région Midi-Pyrénées Cette étude a été réalisée sur une population constituée des affiliés du régime général d'assurance maladie de la région Midi-Pyrénées (hors section mutualiste) soit une population de 1 560 000 assurés (62,4 % de la population de la région Midi-Pyrénées), parmi lesquels ont été identifiés les assurés ayant eu une prescription d'antidépresseur par un médecin libéral de janvier 2002 à décembre 200347. En décembre 2003, la prévalence ponctuelle de traitement par antidépresseurs imipraminiques, ISRS ou ISRSNA était de 4,8 %. La distribution des produits les plus prescrits apparaît dans le Tableau 17. L'évolution sur deux ans montre une croissance de 17 % pour les ISRS, de 26 % pour les ISRSNA, et une diminution de 10 % pour les imipraminiques. Tableau 17. Proportions de patients traités au mois de décembre 2003 par les cinq antidépresseurs les plus prescrits en Midi-Pyrénées
Parmi ces principes actifs seule la fluoxétine a été concurrencée par l'arrivée des spécialités génériques (1ère AMM pour un générique en 2001). À noter que 1,8 % de la population traitée par ISRS est âgée de moins de 20 ans, et que sur la période de 2 ans étudiée, 68 prescriptions d'antidépresseurs pour des enfants âgés de moins de 6 ans ont été relevées. Figure 4. Nombre moyen de boites d'antibiotiques prescrites par patient par les généralistes entre janvier et août 2004, étude CNAM-TS
Figure 5. Nombre moyen de boites d'anxiolytiques prescrites par patient par les généralistes entre janvier et août 2004, étude CNAM-TS
Figure 6. Nombre moyen de boites de statines prescrites par patient par les généralistes entre janvier et août 2004, étude CNAM-TS
e) Étude sur la prescription de psychotropes chez les enfants et adolescents L'objectif de cette étude réalisée par les cinq CPAM d'Alsace était d'explorer à partir des médicaments remboursés par l'assurance maladie, l'usage des psychotropes chez les enfants (< 15 ans) et les adolescents (15-19 ans)48. Les sujets âgés de moins de 20 ans bénéficiaires du régime général et auxquels a été remboursé au moins un médicament psychotrope, ont été identifiés. Deux périodes ont été prises en compte : juin 2002, pour déterminer la répartition des différentes classes de psychotropes et celle de la discipline des prescripteurs ; entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002, pour déterminer le nombre de patients et la durée des traitements. Les médicaments psychotropes ont été catégorisés en utilisant les classes thérapeutiques EphMRA. La durée de traitement a été estimée à partir du nombre de délivrances remboursées à chaque patient sur un an. En juin 2002, en Alsace, le régime général d'assurance maladie a remboursé 779 prescriptions de psychotropes destinées à des enfants et 863 prescriptions de psychotropes destinées à des adolescents, le détail des médicaments est donné dans le Tableau 18. On ne dispose pas des pourcentages d'enfants et d'adolescents utilisant des psychotropes dans chaque tranche d'âge, car les effectifs ne sont pas rapportés à un dénominateur (nombre de sujets bénéficiaires dans chaque classe d'âge). Il est donc impossible de comparer les fréquences de prescription en fonction de l'âge. Tableau 18. Psychotropes prescrits selon l'âge des patients (Alsace, régime général d'assurance maladie, juin 2002)
1. Moins de 15 ans ; 2. 15-19 ans ; 3. Inclut les thymorégulateurs Sur une année, le régime général d'assurance maladie a remboursé en Alsace des traitements psychotropes à 2,0 % des enfants et 4,0 % des adolescents. A noter que 30 % des prescriptions destinées aux enfants concernaient des produits pouvant être prescrits dans d'autres situations que des affections psychiatriques (diazépam, hydroxyzine) ; en excluant ces médicaments, le taux de consommateurs est de 1,4 % pour les enfants. Plus d'une prescription sur 10 (12,6 %) chez les enfants correspondait à des médicaments sans indication reconnue par l'AMM pour une utilisation avant l'âge de 15 ans, avec un pourcentage variable selon la classe thérapeutique : 29,0 % pour les antidépresseurs, 27,7 % pour les antipsychotiques, 19,4 % pour les hypnotiques et 3,0 % pour les tranquillisants. Concernant la durée des traitements, sur l'année, une seule délivrance de psychotropes est identifiée pour les trois-quarts (76 %) des enfants et 61 % des adolescents ; seuls 5 % des enfants et 10 % des adolescents ont en plus de 5 délivrances. Les prescripteurs sont le plus souvent des médecins généralistes et des médecins hospitaliers ; pour ces derniers la spécialité n'est pas identifiée, il n'est donc pas possible de déterminer le taux de psychiatres et pédiatres (Tableau 19). Tableau 19. Discipline d'exercice des médecins prescripteurs de psychotropes selon l'âge des patients (Alsace, régime général d'assurance maladie, juin 2002)
1. Moins de 15 ans ; 2. 15-19 ans ; 3. Consultations externes Cette étude présente les limites inhérentes aux bases de données de l'assurance maladie : motifs de prescription non connus, prescriptions hospitalières non prises en compte. On peut rappeler que l'une des rares études françaises sur l'usage des psychotropes chez les enfants a également été conduite en Alsace (Cf. chapitre B de cette même question, section « Etudes portant sur des populations spécifiques »)31, alors que paradoxalement cette région se caractérise par le plus faible taux d'usage de psychotropes chez les adolescents et jeunes adultes (Cf. chapitre E de cette même question section « INPES »). Même si ces prescriptions ne concernent qu'un pourcentage très réduit d'enfants, un élément notable est là encore que la prescription d'hypnotiques et de tranquillisants débute très précocement, avant l'âge d'un an ; les antidépresseurs (incluant les thymorégulateurs) et psychostimulants étant prescrits à partir de 5 ans, et les antipsychotiques à partir de l'adolescence. 2. CANAM (Caisse Nationale d'Assurance Maladie des professions indépendantes) La CANAM est la caisse nationale qui gère le régime obligatoire d'assurance maladie maternité des artisans, commerçants, industriels et professions libérales, en activité ou retraités. Cette caisse compte 3 millions de bénéficiaires dont 1,3 millions d'actifs et près de 600 000 retraités. C'est le 3ème régime français d'assurance maladie. a) Enquête nationale sur la prescription de psychotropes Les données présentées ici sont issues d'une enquête de grande envergure réalisée en 1996 sur la prescription de psychotropes par la CANAM49-51. Les rapports présentant les résultats de cette étude nous ont été communiqués par G.R. Auleley du Service Médical National de la CANAM. Première phase : étude des prescriptions de psychotropes un jour donné Dans une première phase, les praticiens conseils ont analysé 25 378 prescriptions pharmaceutiques liquidées au cours d'une journée choisie au hasard (8 février 1996) dans 6 régions (Ile de France, Midi-Pyrénées, Centre, Poitou-Charentes, Lorraine, Pas de Calais) représentant une population de 838 695 bénéficiaires de ce système. L'ensemble des prescriptions (n=2 952) comportant un ou plusieurs psychotropes ont été retenues. Les 101 psychotropes explorés incluaient les principales classes pharmacologiques, à l'exception des "sédatifs divers", à base de plantes ou d'oligoéléments. Ces prescriptions représentaient 11,6 % de l'ensemble des prescriptions avec des extrêmes allant de 9,8 % dans la région Centre à 14,7 % dans la région Midi-Pyrénées. Plus de la moitié (50,5 %) des prescriptions de psychotropes concernaient des personnes de plus de 70 ans, et 82 % des sujets plus de 50 ans. Les femmes étaient surprésentées parmi les usagers de psychotropes (62 % pour 48 % des bénéficiaires du régime d'assurance maladie des professions indépendantes). Plus d'un tiers (38,2 %) des ordonnances de psychotropes étaient faites à des bénéficiaires d'une ETM (exonération du ticket modérateur), alors que ce pourcentage était de 11,6 % dans la population d'étude ; le motif de l'ETM était majoritairement une affection cardiovasculaire (23,2 % des prescriptions), l'ETM pour affection psychiatrique (incluant les démences séniles ou préséniles) ne représentant que 6,3 % des prescriptions. Ce résultat étant probablement lié au fait que ce motif d'ETM est plus fréquent dans la classe d'âge où les psychotropes sont les plus prescrits, et ne préjuge pas d'un lien entre maladie cardiovasculaire et prescription de psychotropes. Le prescripteur était majoritairement un médecin généraliste (89,8 %), les psychiatres (4,0 %) et autres spécialistes (6,1 %) n'assurant qu'un pourcentage très faible des prescriptions, avec toutefois des variations régionales (psychiatres 6,1 % en Ile de France et 0 % dans le Pas de Calais par exemple, ce résultat étant très probablement explicable par la forte pénurie de psychiatres dans cette région). Les types de psychotropes prescrits sont présentés dans le Tableau 20, les plus utilisés sont les benzodiazépines anxiolytiques, présentes dans 54,2 % des prescriptions de psychotropes, seules ou en association, suivis par les hypnotiques (34,4 %) et les antidépresseurs (29 %). Le Temesta® et le Lexomil® représentent à eux deux 60 % des anxiolytiques benzodiazépiniques, le Stilnox® et l'Imovane®63 % des hypnotiques et le Prozac® 33 % des antidépresseurs. Tableau 20. Classes thérapeutiques utilisées dans l'enquête CANAM 1996
Le Tableau 21 indiquant la répartition des prescriptions en fonction des classes d'âge montre que, quel que soit le psychotrope, celles ci concernent surtout les personnes de plus de 50 ans, et sont très rares avant 20 ans. La tranche d'âge 21-50 ans est relativement plus représentée pour les prescriptions d'antidépresseurs que pour les autres classes thérapeutiques. Tableau 21. Répartition des prescriptions de chaque classe thérapeutique par classe d'âge dans l'enquête CANAM 1996
1. Anxiolytique benzodiazépinique ; 2. Hypnotique benzodiazépinique L'analyse des co-prescriptions (Tableau 22) montre que la monothérapie représente le cas de figure le plus fréquent, sauf chez les sujets ayant une ALD (Affection Longue Durée) pour motif psychiatrique, pour lesquels les associations de 3 médicaments et plus représentent plus d'un tiers des prescriptions. La monothérapie est d'autant moins fréquente que le sujet est jeune (21-50 ans 61,6 % ; 51-70 ans : 69,3 % ; plus de 70 ans : 73,1 %). Les prescriptions des généralistes sont dans 71,4 % des cas des monothérapies, alors que ce n'est le cas que pour 24,4 % de celles issues de psychiatres. Même s'il n'a pas été procédé à une analyse des caractéristiques associées à la polythérapie, on peut néanmoins supposer qu'elles reflètent les différences de gravité entre les pathologies suivies en médecine générale et en psychiatrie, et le fait que les pathologies psychiatriques les plus sévères débutent le plus souvent avant 30 à 40 ans. Tableau 22. Nombre de médicaments prescrits dans l'enquête CANAM 1996
1. Affection Longue Durée Les durées moyennes de prescription (Tableau 23) les plus longues sont retrouvées pour les anxiolytiques benzodiazépiniques (45 jours) et pour les antidépresseurs (42 jours) en prescriptions isolées. A noter que la durée n'est pas indiquée dans 35 % des cas. Sur les cas renseignés, les généralistes prescrivent sur une durée significativement plus longue que les psychiatres (39,4 j vs. 32,8 j) mais plus courte que les "autres spécialistes" (56,4 j). Tableau 23. Durée de prescription dans l'enquête CANAM 1996
Une étude subsidiaire a été conduite sur les prescriptions comportant un antidépresseur (28,8 % des prescriptions). Les résultats principaux montrent que ces prescriptions sont plus fréquentes chez les sujets les plus jeunes : 4 prescriptions sur 10 concernent un patient de moins de 50 ans contenant un antidépresseur. Même si dans 83,7 % des cas ces prescriptions sont faites par les généralistes, le recours au psychiatre est plus important en cas de prescription d'un antidépresseur (9,5 % des ordonnances avec antidépresseurs vs. 1,8 % des ordonnances sans). Les ordonnances avec antidépresseurs incluent plus souvent plusieurs psychotropes que celles sans (64 % vs. 16 %). En 1996, 4 spécialités représentaient 66,5 % des prescriptions d'antidépresseurs (Prozac® : 33 % ; Athymil® : 12,9 % ; Anafranil® : 11,5% ; Deroxat® : 9,0 %) et les ISRS représentaient 46 % du marché des antidépresseurs. Seconde phase : contexte clinique à l'origine des prescriptions Cette phase de l'enquête CANAM a porté sur le contexte clinique à l'origine de la prescription à partir d'un échantillon de prescripteurs, sélectionnés par tri aléatoire, correspondant à 738 prescriptions. Un questionnaire leur a été adressé. Le taux de réponse était de 61 %. Les répondeurs différaient des non-répondeurs par une clientèle plus âgée, avec plus de patients ayant une affection de longue durée psychiatrique, et une durée plus longue de prescription des psychotropes. En d'autres termes, il existait un biais de réponse favorisant la participation de prescripteurs avec une sur-représentation d'usagers (au long cours) de psychotropes dans leur clientèle. Seuls seront détaillées ici les résultats apportant des informations complémentaires par rapport à ceux de la phase 1. Dans plus de la moitié des cas (52,5 %), la prescription correspondait à un renouvellement (avec une posologie non modifiée pour 80 % des prescriptions) et dans 24,2 % des cas, à une première prescription ; dans 23,3 % des cas, cette information était non renseignée. Lorsqu'il s'agissait d'un renouvellement, les traitements psychotropes étaient prescrits depuis « plusieurs années » dans 47 % des cas pour l'ensemble des classes thérapeutiques, pour 52 % des prescriptions d'anxiolytiques, pour 59 % des prescriptions d'hypnotiques et pour 26 % des prescriptions d'antidépresseurs. Si le premier prescripteur était documenté, il s'agissait d'un médecin généraliste dans 61 % des cas, d'un psychiatre dans 26,5 % des cas, et d'un autre spécialiste pour les cas restants. Ces proportions varient en fonction de la classe thérapeutique, les traitements neuroleptiques étant par exemple le plus souvent initiés par des psychiatres. Le prescripteur prévoyait un arrêt de la prescription des psychotropes uniquement dans un tiers de cas, l'arrêt n'était pas prévu pour 45 % des prescriptions d'antidépresseurs, 52 % des prescriptions d'anxiolytiques, 57 % des prescriptions d'hypnotiques, et 64% des prescriptions de neuroleptiques. Cet arrêt était envisagé pour plus de la moitié des patients de moins de 51 ans, 39 % des patients âgés de 51 à 70 ans, et seulement 23 % des personnes âgées de plus de 70 ans. Le motif de poursuite du traitement psychotrope lorsque l'arrêt n'était pas envisagé était l'état clinique actuel du patient dans 79 % des cas, et un échec d'une tentative de sevrage dans 16 % des cas (motif invoqué dans 32 % des cas pour la poursuite des hypnotiques). La principale limite de cette enquête est d'être basée sur les prescriptions un jour donné et non sur les patients. Elle ne permet donc pas d'évaluer de manière exhaustive la consommation réelle des bénéficiaires, puisque ceux ci peuvent avoir d'autres psychotropes n'ayant pas fait l'objet d'un renouvellement ce jour là. Cette enquête a néanmoins plusieurs intérêts. Elle montre qu'un jour donné, plus d'une prescription sur 10 aux adhérents du régime d'assurance maladie des professions indépendantes incluait un psychotrope. Un résultat intéressant est le fait que même si les prescriptions de psychotropes sont d'autant plus fréquentes que le bénéficiaire est âgé, la polythérapie est plus fréquente chez les sujets jeunes. L'enquête postale auprès des prescripteurs met en exergue le fait qu'il s'agit le plus souvent de prescriptions de longue durée que le prescripteur envisage rarement d'interrompre, d'autant plus que le patient est âgé. L'échec d'une tentative de sevrage n'explique qu'un nombre restreint des poursuites de prescription (sauf pour les hypnotiques). L'imprécision du motif « état clinique actuel du patient » inclut probablement nombre de situations disparates, telles que la persistance effective des troubles ayant motivé la prescription, mais aussi des prescriptions routinières pour lesquelles toute tentative de modification serait estimée par le médecin comme trop coûteuse en temps, ou considérée a priori comme vouée à l'échec, ou refusée par le patient. b) Consommation de psychotropes chez l'enfant et l'adolescent âgé de 0 à 19 ans Cette étude a été réalisée pour le présent rapport grâce à une collaboration entre le service médical de la CANAM (GR Auleley et J Deligne) et l'unité INSERM U 669 (B. Falissard, I. Gasquet, E Acquaviva). Elle repose sur l'analyse des données dont dispose la CANAM sur la consommation de psychotropes chez l'enfant et l'adolescent. Pour l'année 2004, ont été recueillies l'ensemble des ordonnances des enfants d'assurés âgés de 0 à 19 ans comportant la prescription d'au moins un médicament psychotrope. Le terme psychotrope est ici défini par le code ATC N05 (psycholeptiques) ou N06 (psychoanaleptiques). Il correspond aussi aux prescriptions de phytothérapie (Antinerveux Lesourd®, Cardiocalm®, Cimipax®, Euphytose®, Passiflorine®, Spasmine®, Spasmosédine®, Sympaneurol®, Sympathyl®, Sympavagol®, Vagostabyl®). Sont rapportés ici les pourcentages de sujets ayant bénéficié au moins une fois dans l'année d'une prescription de ces produits, calculés par rapport à l'ensemble des enfants assurés à la CANAM et âgés de 0 à 19 ans (n = 536 606, 265 548 filles et 271 058 garçons). Figure 7. Prescriptions de méthylphénidate en 2004
La prescription de méthylphénidate (Figure 7), dont l'indication est l'hyperactivité de l'enfant et de l'adolescent, est nettement plus importante chez les garçons que chez les filles, en accord avec le sex ratio de ce trouble. Un maximum est atteint vers l'âge de 8-12 ans (0,4 % de prescription chez les garçons). Figure 8. Prescriptions d'antidépresseurs (ISRS) en 2004
La consommation des antidépresseurs augmente avec l'âge (Figure 8), avec une accélération observée à l'adolescence, plus précoce et plus marquée chez les filles que chez les garçons. À 18 ans, 2 % des filles ont eu une ordonnance d'antidépresseur dans l'année 2004. Figure 9. Prescriptions de benzodiazépines en 2004
La consommation des benzodiazépines est bimodale (Figure 9). Le pic observé aux bas âges correspond vraisemblablement à des prescriptions pour convulsions. Le pic observé à l'adolescence, là encore plus marqué chez les filles, est à rapprocher de celui observé avec les antidépresseurs. À 18 ans, 3 % des filles ont eu une prescription de benzodiazépines durant l'année 2004. Figure 10. Prescriptions d'antipsychotiques en 2004
Les prescriptions de neuroleptiques sont plus fréquentes chez les garçons que chez les filles quel que soit l'âge (Figure 10), le pourcentage augmentant progressivement avec l'âge. Ces prescriptions sont vraisemblablement en rapport avec des troubles des conduites ou des pathologies psychotiques (troubles envahissants du développement, schizophrénie). Figure 11. Prescriptions d'Euphytose®, Spasmine®, etc. en 2004
Le profil de consommation de phytothérapie est superposable au profil de consommation d'antidépresseurs ou de benzodiazépines (Figure 11). À 18 ans, 6 % des filles ont eu une ordonnance d'un de ces produits en 2004. Figure 12. Prescriptions d'au moins un psychotrope en 2004
Au total, à 18 ans, environ 5 % des garçons et 10 % des filles ont eu une prescription d'au moins un médicament psychotrope en 2004 (Figure 12). Cette étude confirme que l'usage de médicaments psychotropes débute précocement, même si cette prescription reste exceptionnelle chez l'enfant. Le taux de prescription reste relativement stable jusqu'à l'âge de 13 ans (autour de 4 %) pour augmenter par la suite et atteindre un maximum autour de l'âge de 18 ans. Le profil de consommation des adolescents est superposable à celui des adultes en termes de sex ratio, avec une sur-représentation féminine, particulièrement marquée pour les antidépresseurs, benzodiazépines et produits phytothérapiques. Comparativement aux autres pays européens, l'écart est surtout marqué concernant les prescriptions de méthylphénidate. En France, comme dans les autres pays étudiés, la grande majorité des prescriptions de ce médicament concerne les enfants âgés de 5 à 15 ans, et essentiellement les garçons. Le pourcentage de prescriptions est inférieur en France par rapport au Royaume-Uni, à l'Allemagne et aux Pays-Bas : il se situe dans ces pays entre 0,5 et 1 % entre l'âge de 5 ans et la fin de l'adolescence, alors que chez les enfants d'adhérents de la CANAM, le pourcentage maximum de prescriptions, atteint chez les garçons entre 8 et 10 ans, est voisin de 0,4 %. 3. MGEN (Mutuelle générale de l'éducation nationale) Les données concernant la consommation et les pratiques de prescription issues des premières analyses sur les données de la banque de liquidation 2004 de la MGEN nous ont été communiquées par V. Kovess, Fondation MGEN pour la santé Publique, Université Paris 5. Deux échantillons ont été tirés au sort parmi les assurés : le premier (n = 20 099) incluait les personnes âgées de 18 ans et plus, le second (n = 7550) celles des 17 ans et moins. L'étude a porté sur les remboursements de la MGEN pour les adultes et les enfants du 1/1/2004 au 31/12/2004. Les médicaments du système nerveux (code ATC « N », incluant les psychotropes et les traitements neurologiques) se situent au 2ème rang des dépenses MGEN en 2004 (3ème en 2001) et représentent 17,5 % de la dépense pharmaceutique totale. Plus d'un assuré sur 4 (26,4 % ; 17,1 % des hommes et 32,8 % des femmes) ont eu au moins une prescription de psychotrope en 2004, avec en tête les anxiolytiques (15,4 %), les hypnotiques (13,9 %) et les antidépresseurs (10,7 %). Les co-prescriptions les plus fréquentes concernent l'association anxiolytique-hypnotique (43,5 % des usagers d'hypnotiques ont également une prescription d'anxiolytique, et 39,2 % des usagers d'anxiolytiques ont une prescription d'hypnotique) et anxiolytiques-antidépresseurs (41,6 % des usagers d'anxiolytiques ont une prescription d'antidépresseur, et 60,1 % des usagers d'antidépresseurs ont une prescription d'anxiolytique). Les données d'usage par âge (Tableau 24) montrent une croissance de la consommation des psychotropes avec l'âge avec plus de la moitié (57,0 %) des sujets âgés de plus de 80 ans ayant au moins une prescription de psychotropes en 2004. Tableau 24. Taux annuel (%) de consommateurs de psychotropes selon la classe thérapeutique et l'âge en 2004, enquête MGEN
4. Mutualité Sociale Agricole (MSA) Des données succinctes sur l'usage des psychotropes chez les assurés de la MSA sont fournies par une analyse des données recueillies lors de 35 000 examens de santé pratiqués en 200052. Ici encore, on retrouve une forte prévalence d'usage de médicaments psychotropes, avec 43,9 % des assurés âgés de 38 à 65 ans déclarant consommer des médicaments « contre l'anxiété, la dépression ou les troubles du sommeil ». On dispose toutefois de peu d'informations sur la méthode utilisée, et les sujets acceptant un examen de santé ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble des assurés de la MSA. Un rapport sur l'étude de la prescription et de la consommation des antidépresseurs en ambulatoire a été publié en 1998 par l'Observatoire National des Prescriptions et Consommations des Médicaments, sous l'égide de l'Afssaps53. Ce rapport synthétise les études passées en revue dans ce chapitre et présente les résultats d'une étude comparative du traitement de la dépression en médecine générale en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. Cette étude a été réalisée entre 1995 et 1997 par la Direction des Etudes et de l'Information Pharmaco-Economiques de l'Afssaps à partir des données commandées à la société IMS. Cette société réalise des études, généralement pour l'industrie pharmaceutique, à partir de panels de médecins sélectionnés sur la base du volontariat. La taille des panels était variable selon les pays (400, 500 et 900 médecins généralistes par trimestre respectivement pour la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne). Le panel était permanent au Royaume-Uni, et tournant ou partiellement tournant en Allemagne et en France (fréquence de renouvellement non précisée). Les diagnostics psychiatriques étaient choisis sur une liste pré-établie au Royaume-Uni, alors qu'en France et en Allemagne le médecin inscrivait le diagnostic selon sa propre terminologie. Les diagnostics de dépression ont été recodés selon la classification internationale CIM-9 par la société IMS. La classe des antidépresseurs retenue par IMS comporte des molécules qui ne bénéficiaient pas de l'indication « dépression» en France (lithium, Dépamide® par exemple). Inversement, le Dogmatil® considéré comme antidépresseur uniquement en Allemagne n'est pas inclus dans cette classe. Les résultats concernent l'ensemble des panels (tous âges confondus). En 1997, le nombre de consultations pour dépression ayant donné lieu à un traitement était plus élevé en France (163/1 000 habitants) qu'au Royaume-Uni (155/1 000) et qu'en Allemagne (68/1 000). L'augmentation du nombre de consultations entre 1995 et 1997 était plus importante au Royaume-Uni qu'en France (33,6 % vs 18,4 %), et était stable en Allemagne. Un patient pouvant consulter plusieurs fois par an, ce nombre ne permet donc pas d'estimer la prévalence de la maladie. Le nombre de prescriptions d'antidépresseurs pour cent diagnostics de dépression concernait, en 1997 en France, la quasi-totalité des sujets pour lesquels ce diagnostic était posé par un généraliste (93,7 % des cas), discrètement plus élevé qu'au Royaume-Uni (86,3 % des cas) et surtout qu'en Allemagne (62,1 %). Tableau 25. Nombre de prescriptions d'antidépresseurs dans la dépression et part relative des principales classes d'antidépresseurs en 1997.
La part relative des dix premiers antidépresseurs était plus faible en Allemagne qu'en France et au Royaume-Uni. Les médecins généralistes allemands se distinguaient des médecins des deux autres pays par la prescription de phytothérapie (incluant le millepertuis) et par l'absence de prescription d'ISRS. L'interprétation de ces résultats doit prendre en compte plusieurs limites, les plus importantes étant liées à l'absence de représentativité des médecins participants aux panels de la société IMS, et au fait que les diagnostics de dépression étaient, dans deux des pays, ceux posés par les médecins et ne reposaient pas sur des critères diagnostiques standardisés. Seule la prescription d'antidépresseurs dans l'indication dépression a été étudiée, cette étude ne permet donc de connaître l'utilisation des antidépresseurs en dehors de cette pathologie. L'écart entre la France et le Royaume-Uni est ainsi relativement modéré, avec un profil de prescription globalement similaire pour tous les paramètres étudiés, qui diffère nettement de celui de l'Allemagne. 1. IRDES (Institut de Recherche et Documentation en Économie de la Santé) Une enquête, maintenant assez ancienne, a été réalisée en 1991 par le CREDES (Centre de Recherche, d'Etude et de Documentation en Economie de la Santé) devenu IRDES (Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé), en collaboration avec l'INSEE54. Sur les 21 600 personnes de 20 ans et plus participant à l'enquête, 11,3 % consommaient des psychotropes au moins une fois par semaine depuis au moins 6 mois, cette fréquence étant de 7,3 % pour les anxiolytiques, 3,6 % pour les hypnotiques, 2,0 % pour les antidépresseurs, 0,7 % pour les neuroleptiques et 0,2 % pour les psychostimulants. Plus de la moitié (57 %) des consommateurs réguliers prenaient leur traitement depuis au moins 5 ans (soit 6,4 % de l'échantillon), et un tiers depuis 10 ans. La part des psychotropes dans l'ensemble de la consommation pharmaceutique représentait 7,6 % des acquisitions de produits pharmaceutiques des adultes. 2. OFDT (Observatoire Français des Drogues et Toxicomanie) L'OFDT publie régulièrement des rapports proposant un état des lieux sur les drogues et dépendances55 56. Les données utilisées sont issues d'enquêtes en population générales, de données de vente, de registres (statistiques nationales issues de déclaration obligatoire tels que registre de décès...), de statistiques administratives, d'études qualitatives et de la surveillance des phénomènes émergents (dispositif TREND (Tendances Récentes et Nouvelles Drogues) mise en place par l'OFDT depuis 1999, cf. Question 6). Les médicaments psychotropes y sont considérés comme des « drogues » (ou «produits psychoactifs ») au même titre que les substances illicites, l'alcool et le tabac, ce qui est un choix très contestable, car aucune différenciation n'est faite entre usage de médicaments psychotropes à visée thérapeutique, sur prescription médicale, et consommation de médicaments détournés de leur usage ou consommation abusive (cf. Question 6). Un rapport sur l'épidémiologie de la consommation des psychotropes réalisé par un groupe d'étude coordonné par le Dr Cadet-Taïrou sous l'égide de l'OFDT va être prochainement publié. Ce rapport nous a été communiqué par la coordonnatrice du groupe d'étude, et les informations issues de ce rapport ont été utilisées dans plusieurs sections de la présente étude, en citant à chaque fois la source57. b) Usage de médicaments psychotropes chez les adolescents : enquêtes ESPAD et ESCAPAD Les données des rapports et études de l'OFDT concernant les adolescents sont issues des enquêtes ESCAPAD (Enquête Santé et Consommation au cours de l'Appel de Préparation à la Défense) et ESPAD (European School Survey on Alcohol and Other Drugs). L'usage de médicaments psychotropes est dénommé « expérimentation » dans le rapport de l'OFDT55, mais nous éviterons ici l'emploi de ce terme qui porte à confusion en assimilant la consommation de psychotropes à un usage toxicomaniaque, alors que les informations disponibles dans le rapport ne permettent pas, le plus souvent, de différencier les médicaments utilisés à visée thérapeutique de ceux détournés de leur usage ou consommés de manière abusive. Le critère médicament, prescrit ou non prescrit, n'est pas suffisant pour distinguer ces situations, car des médicaments issus de la pharmacie familiale peuvent être utilisés de manière non abusive chez les adolescents. ESCAPAD est une enquête transversale interrogeant tous les adolescents passant leur journée d'appel de préparation à la défense (JAPD) le mercredi et le samedi d'une semaine donnée et permettant de donner des résultats précis sur une tranche d'âge restreinte située à la fin de l'adolescence et d'en suivre les évolutions. Le recueil des informations est fait par auto-questionnaire totalement anonyme portant sur les consommations de produits psychoactifs. Les médicaments psychotropes sont explorés par des questions sur les « médicaments pour les nerfs, pour dormir ». La 1ere enquête ESPAD a été menée en 2000 sur 14 553 adolescents métropolitains, les enquêtes suivantes ont porté sur des effectifs comparables (2001 n= 15 582 adolescents ; 2002, n= 16 552 ; 2003, n=15 664)58-62. À 17 ans, l'usage au cours de la vie de médicaments « pour les nerfs, pour dormir » est près de trois fois plus important chez les filles que chez les garçons (Tableau 26). La première prise de psychotropes se situe en moyenne à 15 ans pour les filles et à 14,6 ans pour les garçons. La proportion de consommateurs de médicaments psychotropes augmente avec l'âge chez les filles, entre 14 et 18 ans alors qu'elle est stable chez les garçons. Parmi les jeunes ayant consommé ces produits au cours de l'année, 40 % déclarent 1 ou 2 prises et 30 % plus de 10 prises. Si l'âge, le sexe et l'existence d'un redoublement sont pris en compte dans les analyses, le fait de ne plus être scolarisé n'a pas d'influence sur la consommation de médicaments, ni au cours de la vie, ni au cours de l'année. Tableau 26. Fréquence de l'expérimentation et de l'usage récent de médicaments psychotropes chez les jeunes à la fin de l'adolescence (Source : ESCAPAD 2000)
L'enquête ESCAPAD 2003 confirme ces tendances (Tableau 27), et montre une progression de la fréquence d'usage chez les adolescents de 17 ans (19,8 % en 2000 vs. 24,7 % en 2003). Cette enquête apporte des précisions sur la prise régulière de psychotropes : une consommation depuis au moins six mois de médicaments « pour un problème de santé psychologique » est rapportée par 3,2 % des adolescents (5,3 % des filles et 1,3 % des garçons). Le type de médicament est rarement précisé ; ceux cités incluent de plus des spécialités phytothérapiques (exemple, Euphytose®) ou des anticonvulsivants (exemple, Dépakine®). Les motifs les plus fréquemment cités sont le stress, les difficultés d'endormissement et la volonté de se soigner. Un médecin est à l'origine de la dernière prise de ces psychotropes dans 49,7 % des cas, un parent dans 28,4 %, le médicament étant pris en autoprescription dans 17,5 % des cas. Tableau 27. Usage de médicaments psychotropes au cours de la vie, des 12 derniers mois et des 30 derniers jours à 17-18 ans (% en ligne) (Source : ESCAPAD 2003)
Les données régionales de l'enquête ESCAPAD 2000 montrent que l'usage des psychotropes à 17 ans est uniforme sur tout le territoire pour les filles. La seule différence significative est mise en évidence pour les garçons, avec une plus faible consommation dans la région Nord-Est (7,1 % vs. 10,0 % dans l'ensemble des autres régions). A noter que cette région est également celle où la consommation est la plus faible pour les filles (25,2 % vs. 28,1 % dans l'ensemble des régions, non significatif). Les régions de forte consommation sont le Centre-Est avec 12,3 % chez les garçons et 33,0 % chez les filles et la région parisienne (uniquement pour les garçons). Les enquêtes ESCAPAD 2002-2003 comparant les adolescents de la région Ile de France à ceux des autres régions montrent que les niveaux d'usage de psychotropes en Ile de France sont proches de ceux du reste de la France, même si le taux d'usage, au moins une fois dans la vie, est légèrement plus élevé pour les garçons en Ile de France par rapport au reste du pays (Tableau 28). Tableau 28. Usages de médicaments psychotropes et âge moyen d'expérimentation, à 17 ans en Ile de France et dans les autres régions françaises (ESCAPAD 2002-2003)
1. Test du chi2, différences significatives entre l'Ile de France et les autres régions au seuil de 0,05 2. Test du chi2, différences significatives entre l'Ile de France et les autres régions au seuil de 0,01 3. Test du chi2, différences significatives entre l'Ile de France et les autres régions au seuil de 0,001 4. Au moins 10 usages au cours des 30 derniers jours 5. Au moins 30 usages ou usage quotidien au cours des 30 derniers jours L'enquête ESPAD réalisée en France depuis 1999, documente la consommation de substances psychoactives chez les collégiens et lycéens de 12 à 18 ans55 63. La tendance à la hausse des déclarations de consommation de psychotropes est confirmée par l'enquête ESPAD. Depuis le début des années 1990, on observe une hausse des déclarations, chez les garçons qu'il y ait ou non prescription et chez les filles pour les usages hors prescription (enquête santé des adolescents 1993 de l'INSERM et ESPAD 1999) (Tableau 29) ; cette augmentation est à relativiser car la question posée en 1993 portait sur les 12 derniers mois, et celle posée en 1999 sur la vie entière. Tableau 29. Fréquence de l'usage de médicaments psychotropes chez les jeunes scolarisés en 1993 et 1999 (ESPAD 1999)
Ces chiffres concernent l'ensemble des lycéens quel que soit leur âge. Les totaux ne correspondent pas à la somme des 2 pratiques, celles-ci pouvant être le fait des mêmes individus Les comparaisons avec les trente autres pays interrogés dans l'enquête ESPAD 2001 montrent que l'usage, au cours de la vie, de tranquillisants ou de somnifères des élèves français de 16 ans, place la France parmi les pays de tête, qu'il y ait prescription ou non, pour les garçons comme pour les filles. La moyenne des pays de l'Union Européenne se situe autour de 10 % pour les consommations avec prescription, la France (18 %) est en deuxième position derrière la République Tchèque (26 %) et au même niveau que la Croatie. Pour les consommations hors prescription, la France, avec 12 %, est en troisième position derrière la République tchèque et la Pologne (18 %), au même niveau que la Lituanie. Les données de l'étude ESPAD 200363 sur l'usage des médicaments psychotropes au moins une fois au cours de la vie sont indiquées dans le Tableau 30. En 2003, plus d'une fille sur 4 et près d'un garçon sur 5 a fait usage de médicaments psychotropes avant l'âge de 18 ans. L'usage sans ordonnance augmente avec l'âge. En 10 ans (1993-2003), la fréquence d'usage a augmenté chez les garçons, et est restée relativement stable chez les filles. Tableau 30. Usage de tranquillisants ou de somnifères (ESPAD 2003)
Le total n'est pas l'addition des deux car certains élèves ont pu répondre positivement aux deux questions 3. INPES (Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé) L'enquête Baromètre Santé réalisée par l'INPES est une enquête quantitative nationale dont l'objectif est de décrire les comportements, attitudes, opinions et connaissances des Français en matière de santé64-66. Sa répétition dans le temps permet de suivre des évolutions de ces déterminants de santé et de mieux définir les objectifs des programmes nationaux de prévention, d'orienter des études spécifiques et de mieux cibler les actions de prévention et d'éducation pour la santé sur des types de population ou dans certaines régions. Les enquêtes régionales ont pour objectif de fournir une photographie de l'état de santé des jeunes de 12 à 25 ans, de leurs habitudes de vie et de leur insertion dans leur environnement proche. L'enquête nationale Baromètre Santé 2000 qui a été menée en 1999 portait sur 13 685 personnes âgées de 12 à 75 ans, et était associée à une étude régionale (Alsace, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie) portant sur 2 765 jeunes âgés de 12-25 ans. Les personnes étaient sélectionnées par sondage en deux étapes, avec tout d'abord tirage au sort des ménages à partir de numéros de téléphones générés aléatoirement, suivi d'une identification des personnes à partir de la liste des abonnés de France Télécom. Les ménages étaient ensuite sélectionnés s'ils comportaient au moins une personne âgée de 12 à 75 ans, parlant le français et ayant son domicile principal au numéro composé. Dans un deuxième temps, la personne éligible à l'intérieur du ménage était sélectionnée par la méthode « anniversaire » (individu dont l'anniversaire était le prochain à venir). Pour les 12-14 ans, avant de procéder au questionnement, l'enquêteur validait l'accord de participation du jeune sélectionné auprès d'au moins un des parents. L'enquête téléphonique a été réalisée par l'institut BVA entre octobre et décembre 1999 (en excluant la période du 24 décembre au 15 janvier), avec une durée moyenne d'interview de 34 mn (25 mn pour les études régionales). Le taux de refus par ménage était de 25,1 %, les refus individuels de 6,7 %, et le taux d'abandon après acceptation initiale 2 %. Le refus était plus élevé chez les femmes que chez les hommes, ainsi que chez les personnes sur liste rouge. Les taux de refus des échantillons régionaux variait de 18,3 % en Alsace à 32,7 % en Poitou-Charentes. Les résultats obtenus ont été pondérés par le nombre de personnes éligibles par ménage et après redressement sur la base des données du recensement de la population 1999. Parmi les 300 questions du questionnaire, la section « douleurs, consommation de soins et de médicaments » incluait les questions suivantes : « Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous consulté pour vous-même un psychiatre, un psychanalyste ou un psychologue ? » ; « Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris des antidépresseurs ? » ; « Au cours des 12 derniers mois avez-vous pris des tranquillisants ou des somnifères ? » ; « Au cours des 30 derniers jours combien de fois avez-vous pris des tranquillisants ou des somnifères ? » ; « La dernière fois où vous avez pris des tranquillisants ou des somnifères, où vous les êtes vous procurés ? ». Parmi les 18-75 ans, 4,6 % des personnes interrogées ont déclaré avoir consulté un psychiatre/psychanalyste/psychologue au cours des 12 derniers mois, cette proportion étant plus élevée chez les chômeurs (7,7 % vs. 4,4 %), et chez les personnes ayant vécu une rupture (divorce, veuvage...) que chez les personnes vivant en couple (7,1 % vs. 4,1 %). Près d'une personne sur 5 de 18-75 ans (16,1 %) déclarait avoir fait usage de tranquillisants/somnifères au cours des 12 derniers mois, et 9,3 % déclaraient avoir fait usage d'antidépresseurs. L'usage récent (au moins une fois au cours de la semaine passée) est rapporté par 11,7 % des hommes et 20,3 % des femmes pour les tranquillisants/somnifères, et par 6 % des hommes et 12,4 % des femmes pour les antidépresseurs. L'usage des médicaments dans le but déclaré de « se droguer » ne concerne que 0,7 % des adultes au cours de leur vie. Les prévalences d'usage de psychotropes par classes d'âge sont données dans le Tableau 31, celles par sexe et par période d'évaluation dans le Tableau 32. Tableau 31. Fréquence déclarée de l'usage de tranquillisants/somnifères et d'antidépresseurs par classes d'âge (Baromètre Santé 2000)
Tableau 32. Fréquence de l'usage déclaré de médicaments psychotropes parmi les 18-75 ans en 2000, par sexe et par âge (Source : Baromètre santé 2000, exploitation OFDT 58)
Des analyses complémentaires ont été réalisées pour le rapport OFDT sur les psychotropes57, afin d'identifier les variables socio-démographiques associées de manière indépendante à l'usage de psychotropes. La consommation de tranquillisants/somnifères est plus élevée chez les 35-75 ans (particulièrement dans la tranche 60-75 ans) que chez les 15-34 ans. La consommation des antidépresseurs est plus élevée entre 50 et 60 ans, puis stagne ou diminue légèrement pour les classes d'âge supérieures. Les 35-75 ans ont une prévalence de consommation dans l'année (ajustée sur les autres facteurs) supérieure de 50 % à celle des 15-34 ans. La consommation de tranquillisants/somnifères est deux fois plus fréquente en cas de maladie chronique ou de handicap physique que si l'on en est exempt (après prise en compte des autres facteurs, surconsommation de 60 % pour les maladies chroniques et de 40 % pour un handicap physique). Concernant les antidépresseurs, l'influence des maladies chroniques est plus importante avec une surconsommation de 90 % (20 % pour le handicap physique). Le chômage accroît également la fréquence de consommation des antidépresseurs, mais pas des tranquillisants/somnifères. L'influence du revenu n'est pas univoque : les personnes ayant les plus bas revenus consomment plus d'antidépresseurs, celles ayant les plus haut revenus plus de tranquillisants/somnifères. Les études régionales portent sur les comportements des 12-25 ans des régions Alsace, Pas-de-Calais, Pays de la Loire et Picardie. La région avec la plus forte fréquence de consultations de professionnels de santé mentale est la Picardie, cette fréquence est pratiquement 2 fois (1,7) plus élevée qu'en Alsace, où est la plus faible. Les fréquences d'usage des psychotropes par région sont données dans le Tableau 33. L'Alsace se distingue également par une consommation significativement inférieure par rapport au niveau national, aussi bien pour les filles que pour les garçons ; la Picardie a le plus haut niveau de consommation. Tableau 33. Pourcentages de sujets âgés de 12-25 ans1 ayant pris des antidépresseurs au cours des douze derniers mois
1. Standardisé sur l'âge et le sexe (population de référence : France métropolitaine, deux sexes, INSEE RP 99) Les données disponibles sur les psychotropes issues des précédentes enquêtes Baromètre Santé sont plus succintes67. Le Baromètre Santé 1995 a porté sur 1 993 sujets âgés de 18 à 75 ans, interviewés du 20 novembre au 22 décembre 1995. Le taux de refus total était comparable à celui de l'enquête précédente (24,5 %). La consommation de sédatifs/tranquillisants pendant les 7 derniers jours était rapportée par 9,2 % des sujets, dont 67,6 % avec un usage quotidien. Les associations avec les caractéristiques socio-démographiques et médicales sont comparables à celles mises en évidence dans l'enquête 2000. Le Baromètre Santé Jeune 199/1998 a porté sur 4 115 adolescents âgés de 12 à 19 ans, interviewés du 6 novembre au 23 décembre 1997 (taux de refus total 21,6 %), parmi lesquels 3,5 % déclarent avoir pris un médicament pour les aider à dormir au cours du dernier mois. Les 2 autres enquêtes (Baromètre Santé nutrition de 2002 et Baromètre Santé généralistes 1998/99) n'incluaient pas de questions sur les psychotropes. Les résultats du Baromètre Santé 2005 ne sont pas encore disponibles. L'intérêt de ces enquêtes, particulièrement la plus récente, est de porter sur un très large échantillon représentatif de la population générale, avec un recueil portant sur de nombreuses caractéristiques. La contrepartie du caractère généraliste de l'enquête est que les données concernant l'usage des psychotropes sont peu précises, et doivent être considérées plus comme des tendances que comme des estimations précises ; celles-ci sont, de plus, difficilement comparables d'une enquête à l'autre, les périodes investiguées n'étant pas superposables. 1. Comparaison des systèmes de soins européens a) Organisation des soins et dépenses pharmaceutiques Nous évoquerons brièvement les grandes lignes des systèmes de soins des pays européens pour lesquels on dispose de données comparatives avec la France concernant la consommation de psychotropes ; ceci pour prendre en compte les éventuelles différences d'organisation dans l'interprétation des données de vente et de prescription. Les informations sont essentiellement issues d'un rapport de la commission européenne sur les statistiques de santé publié en 2002, c'est à dire avant l'élargissement de l'Union Européenne à 25 membres68, ainsi que d'études réalisées par la DREES69 70. L'organisation des soins dans les pays de l'UE pour lesquels on dispose des données comparatives concernant la consommation de psychotropes est présentée dans le Tableau 34. Dans tous les pays, la majeure partie des coûts générés par les dépenses de santé est assurée par des institutions publiques. L'Espagne, l'Irlande, l'Italie, et le Royaume-Uni couvrent la totalité de leur population grâce à un service national de santé ; les soins de santé sont essentiellement financés par l'impôt sauf en Espagne et Italie, où le financement est mixte basé sur l'impôt et sur les cotisations d'assurance maladie. Dans les autres États membres (Belgique, Allemagne, France, Pays-Bas), la couverture médicale est assurée par l'assurance sociale. Tableau 34. Organisations des systèmes de santé dans les pays de l'Union Européenne68
1. Y compris les employeurs 2. Sécurité sociale assortie de la liberté de choix des caisses 3. Pour accéder à un spécialiste, il faut normalement passer par un généraliste 4. Il existe également des composantes de salaire, de rémunération à l'acte et de primes accordées pour la réalisation de certains objectifs préventifs. Source: Beratungsgesellchaft für angewandte Systemforschung (BASYS), Augsburg, 2002. Les données concernant le nombre de médecins et la densité médicale sont reprises dans le Tableau 35. La densité de médecins généralistes apparaît relativement faible en France, alors que celle des psychiatres est la plus élevée d'Europe71. Tableau 35. Nombre de médecins généralistes et psychiatres, année disponible la plus récente68
Pour Irlande et Angleterre : données disponibles exclusivement pour les employés du service national de santé Source : Eurostat, base de données New Cronos Les données les plus récentes de OCDE (Organisation pour la Coopération et le Développement Economique) concernant la part des dépenses nationales de santé dans le PIB (Produit Intérieur Brut) dans les pays européens explorés dans la présente étude sont indiquées dans le Tableau 36. Ces pourcentages sont relativement proches pour la France, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Tableau 36. Part de la dépense nationale de santé dans le PIB dans les pays européens de l'OCDE en % (Source : OCDE, Eco-santé 2005)
1. France métropolitaine + DOM ; e : estimation Si l'on tient compte des différences de structure d'âge de la population, la France est devenue en 1996 le deuxième pays européen en termes de dépenses globales de santé par habitant, derrière l'Allemagne et devant les Pays-Bas70. L'évolution des dépenses de santé concernant les produits pharmaceutiques (préparations médicales, médicaments de marque et génériques, médicaments brevetés, sérums et vaccins, vitamines et minéraux, et contraceptifs) entre 1990 et 2000 est indiquée dans le Tableau 37. Ces dépenses représentent environ 15 % des dépenses totales de santé dans les pays de l'OCDE. Les dépenses pharmaceutiques par habitant sont les plus élevées en France, en Italie et en Allemagne, et les plus faibles en Espagne. Tableau 37. Dépenses totales en produits pharmaceutiques délivrés à des patients en consultation externe (source Eco-santé OCDE 2002)
L'analyse des dépenses par classe montre des différences nationales importantes69. Quel que soit le pays, arrivent en tête les médicaments cardio-vasculaires, du système nerveux central, et les anti-inflammatoires. Ces trois classes sont suivies pour la France et l'Allemagne, par les anti-infectieux et les médicaments du système digestif, classés en avant-dernière position en Italie et au Royaume-Uni. La France est caractérisée par une consommation importante d'anti-hypertenseurs, de vasodilatateurs, d'antibiotiques, de psycholeptiques et psychoanaleptiques. En Allemagne, les consommations sont les plus faibles pour tous ces produits, sauf pour les anti-hypertenseurs où ce pays se situe devant l'Italie et le Royaume-Uni. L'Italie se différencie par des consommations élevées d'anti-inflammatoires, le Royaume-Uni par des consommations élevées d'anti-inflammatoires et de psycholeptiques. Le rapport réalisé par le Pr E. Zarifian en 199643 rapportait les résultats d'une étude réalisée par le CREDES, indiquant les variations de la consommation de grandes classes médicamenteuses dans les différents pays européens. Quelle que soit la classe de médicaments considérée, la consommation française est globalement plus importante que celle des autres pays, à l'exception des anti-inflammatoires, où le niveau est comparable à celui du Royaume-Uni et de l'Italie. Tableau 38. Consommation de médicaments en DDD1/1000 habitants/jour, données CREDES43
1. Defined Daily Dose (dose quotidienne recommandée) 2. La comparaison entre pays a été réalisée en attribuant la valeur 100 à la consommation française. Au total, la France se situe en tête des pays européens concernant les dépenses de santé en général, et les dépenses en produits pharmaceutiques en particulier. Ceci doit être gardé à l'esprit pour interpréter les données concernant les volumes de ventes des médicaments psychotropes, les comportements de prescription et d'usage des médicaments psychotropes s'intégrant dans des phénomènes plus généraux concernant la prescription et le recours au médicament. b) Mode de régulation et médicaments pris en charge en France, Allemagne et Royaume-Uni Une étude comparative a été réalisée par l'IRDES concernant les modes de régulation et le contenu du panier de médicaments pris en charge en France, Allemagne et au Royaume-Uni (RU) à partir de différentes classes de médicaments, dont les benzodiazépines72. La comparaison repose, pour la France, sur la liste des spécialités remboursables par l'Assurance Maladie (liste positive) et sur des listes de médicaments non pris en charge par la collectivité (listes négatives) pour l'Allemagne et le RU. Ici, encore la France avec 18,4 %, occupe le premier rang pour la part des dépenses pharmaceutiques dans les dépenses publiques de santé, contre 13,9 % pour l'Allemagne et 12,3 % pour le RU. Le coût des dépenses publiques pour les médicaments en $ PPA par habitant (Parités de Pouvoir d'Achat, permettant de convertir les prix dans une monnaie commune en éliminant des différences de pouvoir d'achat entre monnaies) est également le plus élevé en France (326 $ PPA vs. 238 en Allemagne et 208 au RU). La même tendance est mise en évidence pour les dépenses médicamenteuse prises en charge par l'usager : 198 $ PPA en France vs. 110 en Allemagne et 50 au RU. Pour mémoire, en France après l'obtention d'une AMM délivrée par l'Afssaps, un médicament, pour être remboursable, doit être inscrit sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (liste positive). Le co-paiement (ticket modérateur) est à la charge des assurés, et est assuré par une couverture complémentaire pour plus de 90 % de la population. Le prix des médicaments remboursables est directement contrôlé et fait l'objet d'une négociation entre le laboratoire producteur et le CEPS (Comité Economique des Produits de Santé). Il intègre, en principe, l'Amélioration du Service Médical Rendu (ASMR) qu'apporte le médicament, du prix des produits comparables inscrits sur la liste et des volumes de ventes prévus. Le prix des médicaments a été pendant longtemps moins élevé en France que sur les autres grands marchés européens, en particulier allemand et britannique ; le prix des nouveaux produits tend cependant actuellement à se rapprocher de la moyenne européenne. En Allemagne, l'AMM, valable 5 ans renouvelable, précise les conditions de délivrance (prescription obligatoire ou non) et les lieux de délivrance (pharmacie ou non). Le prix est librement fixé par le laboratoire producteur, les consommateurs devant payer la différence entre le prix fixé par l'industriel et le prix de référence, avec un plafond de prise en charge pour les groupes de médicaments comparables. Tout produit pharmaceutique admis sur le marché est pris en charge par l'assurance maladie, en sachant que de nombreux médicaments sont exclus de ces listes depuis la réforme de 2004 (liste négative). Un co-paiement est entièrement à la charge du patient (10 % du prix de vente, avec un minimum de 5 € et un maximum de 10 €), mais de nombreux dispositifs d'exemption existent (en 2001, près de la moitié des prescriptions en étaient exemptées). Pour les médicaments soumis à prix de référence, l'écart entre le prix de vente et le prix de référence s'ajoute au co-paiement. Au Royaume-Uni, la mise sur le marché d'un médicament est soumise à une autorisation de la Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency (MHRA). Les médicaments sont classés comme accessibles seulement avec une prescription (Prescription only Medicine), disponibles uniquement en pharmacie (Pharmacy only) ou disponibles dans le circuit ordinaire de distribution (General Sale List). Le prix des médicaments est libre mais les profits réalisés par les laboratoires sont encadrés par le Pharmaceutical Pricing Regulation Scheme fixant un seuil de gains (21 % actuellement) qui, en cas de dépassement, donne lieu à un retour de l'excédent dans les caisses du NHS (National Health Service) ou à des baisses de prix pour l'année suivante. Deux listes sont établies : une liste négative (liste noire) recensant les médicaments que les médecins n'ont pas le droit de prescrire dans le cadre du NHS (National Health Service) ; une liste restrictive (liste grise) recensant les molécules dont la prescription est prise en charge pour des indications et des catégories d'individus précises. Parmi les produits exclus, certains le sont pour des motifs économiques, seuls les médicaments les moins chers de la classe sont alors remboursés, comme c'est le cas pour les benzodiazépines. Un copaiement forfaitaire par médicament prescrit est à la charge des patients (environ 10 € en 2004), 85 % des prescriptions passant par le NHS étant exemptées de ce co-paiement. Concernant les benzodiazépines, 20 molécules sont remboursées en France, 18 en Allemagne, et 10 au RU. Le panier allemand est presque identique à celui de la France, et la quasi-totalité des produits est soumis à prix de référence. Les dépenses pour 1 000 habitants étaient en 2002 de 2 615 € en France, 1 185 € en Allemagne, et 1 108 € au RU. Avec un panier comparable, la France dépense donc 2,2 fois plus que l'Allemagne pour les benzodiazépines. A noter que l'écart entre la France et l'Allemagne était comparable pour les benzodiazépines et les vasodilateurs (qui étaient alors remboursés en France) avec 3 829 €/1 000 habitants en France, 1 440 en Allemagne, et seulement 181 (21 fois moins) au RU. Inversement, seul le RU prend en charge les médicaments contre l'obésité et pour le sevrage tabagique, illustrant le fait que le remboursement des médicaments est, dans ce pays, dépendant des priorités de santé publique définies. a) « Mission générale concernant la prescription et l'utilisation des médicaments psychotropes en France » (Zarifian, 1996) Nous reprenons ici les informations issues du rapport réalisé par le Pr E. Zarifian en 199643 concernant la période 1990-1994, car elles permettent de disposer d'une référence pour l'évolution des prescriptions pendant la période 1990-2005 considérée dans le présent rapport. Ces données ont essentiellement pour source des panels utilisés par l'industrie pharmaceutique à vocation internationale comme IMS (Informations Médicales Statistiques). Au cours de la période 1990-1994, on note une stabilité des consommations d'hypnotique, une discrète baisse des consommations d'anxiolytique, et une augmentation des consommations d'antidépresseurs. Les données de vente, en nombre de boites, sont indiquées dans le Tableau 39. Tableau 39. Evolution des ventes de psychotropes de 1990 à 1994, en milliers de boites vendues (source IMS)43
N5B1 : non barbituriques seuls (benzodiazépine essentiellement) ; N5B2 : non barbituriques en association N5B3 : hypnotiques barbituriques seuls ; N5B4 : hypnotiques barbituriques en association En chiffres d'affaires (Tableau 40), les profils sont comparables, avec une augmentation marquée (près de 10 %) des ventes d'antidépresseurs, qui correspond à l'arrivée sur le marché des ISRS (seul le Floxyfral® et le Prozac® étaient alors commercialisés). En 1994, les marché des antidépresseurs représentait 2,8 % du marché général remboursable. Le coût des hypnotiques augmente malgré la stabilité des ventes, probablement du fait du lancement de nouvelles molécules apparentées aux benzodiazépines. Tableau 40. Evolution des ventes de psychotropes de 1990 à 1994 converties en euros (source LMP :IMS)43
N5B1 : non barbituriques seuls (benzodiazépine essentiellement) ; N5B2 : non barbituriques en association N5B3 : hypnotiques barbituriques seuls ; N5B4 : hypnotiques barbituriques en association En comparaison avec les autres pays européens, les ventes d'anxiolytiques, au cours de la période considérée, apparaissent très élevées en France. Le Royaume-Uni en consomme 8 fois moins que la France, avec une baisse régulière depuis 1990 (Tableau 41). Tableau 41. Ventes d'anxiolytiques en unités fractionnées1 par habitant de plus de 15 ans entre 1990 et 199443
1. Unités fractionnées ou unités de prise = unité galénique (comprimé, gélule) La France arrive également en tête pour les ventes d'hypnotiques. La comparaison entre pays est difficile car tous les produits ne sont pas remboursés de la même manière, par exemple les plantes sont davantage remboursées en Allemagne qu'en France. Concernant les antidépresseurs, la France arrive également en tête (Tableau 42). Tableau 42. Ventes d'antidépresseurs en unités fractionnées1 par habitant de plus de 15 ans entre 1990 et 199443
1. Unités fractionnées ou unités de prise = unité galénique (comprimé, gélule) La part des ISRS sur le marché des antidépresseurs en 1994 montre des différences notables entre les pays, les ISRS étaient très peu prescrits en Allemagne, et déjà très bien implantés en Espagne et en Belgique, et même en Italie (où ils ne sont pourtant pas remboursés) (Tableau 43). La part des ISRS, en nombre de prescriptions, est passée de 13 % à 29 % pendant la période 1990-1994 en France. Tableau 43. Poids des différentes classes d'antidépresseurs en 1994 (en prescriptions)43
b) Rapport européen : the State of Mental Health in the European Union Ce rapport réalisé par Kovess, Brugha, Carta et Lehtinen73 a pour objectif de décrire et comparer l'état de santé mentale et ses déterminants dans l'Union Européenne et la Norvège. Les données sont issues de statistiques nationales portant sur différents indicateurs de santé mentale, de résultats d'enquêtes et études en population générale (dont l'étude ESEMeD), et de données issues d'Eurobaromètre (enquête financée par la commission européenne sur la population âgée de 15 ans et plus et portant sur des thèmes variés dont la santé mentale). Les données sur la consommation de médicaments psychotropes ont été fournies essentiellement par la société IMS. La comparaison des prescriptions et ventes d'antidépresseurs et d'anxiolytiques a été faite selon trois critères : 1) la somme annuelle (€) dépensée par habitant ; 2) le nombre annuel de prescriptions par habitant ; 3) la DDD (Defined Daily Dose) pour 100 000 habitants, correspondant à la posologie quotidienne nécessaire pour traiter un adulte de 75 kg. Les pays où les dépenses en antidépresseurs sont les plus élevées sont la Suède, la Belgique, et Royaume-Uni, les plus faibles sont l'Allemagne, l'Italie, et les Pays-Bas (Tableau 44). En nombre d'unités consommées (DDD/1000 habitants), la France est le pays le plus consommateur, alors qu'elle est dans une position intermédiaire pour les autres indicateurs. La consommation d'antidépresseurs augmente dans tous les pays entre 2000 et 2002. Tableau 44. Consommation d'antidépresseurs dans 14 pays européens en 2002
Sources : 1. Finland Data Bank, 2. IMS Health ; 3. DDD : defined daily dose. ( ) : classement des pays Concernant les anxiolytiques/hypnotiques (Tableau 45), les pays où les dépenses sont les plus élevées sont l'Italie, le Portugal, et ceux où elles sont moins élevées : le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas. Là encore, la France se situe en premier rang pour l'indicateur DDD. La consommation diminue ou reste stable dans presque tous les pays, à l'exception de la France et, dans un moindre degré, du Royaume-Uni et du Portugal, où elle augmente. Tableau 45. Consommation d'anxiolytiques et d'hypnotiques dans 14 pays européens
Sources : 1. Finland Data Bank, 2. IMS Health ; 3. DDD : defined daily dose (voir texte). ( ) : classement des pays. Ces données doivent être considérées comme des tendances générales, du fait des différences importantes entre pays dans l'organisation du système de soins, incluant en particulier la fixation des prix et le remboursement des médicaments. Les limites de la principale source d'information ont déjà été signalées, concernant en particulier la représentativité des médecins et pharmaciens fournissant les données sur lesquelles sont basées ces estimations. Surtout, l'expression en DDD/1000 habitants équivaut à une prévalence d'usage à un instant donné mais ne renseigne nullement sur les durées de traitement, ce qui ne permet pas de juger de leur adéquation aux recommandations en vigueur. Le premier rang de la France selon l'indicateur DDD est de ce fait d'interprétation difficile, car il peut correspondre à un niveau plus élevé d'usage, mais aussi à des différences dans les conditionnements de médicaments vendus (vente par boite quel que soit le nombre d'unités de prise effectivement prescrites et consommées en France). 3. Caisses d'assurance maladie a) CNAM-TS (Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) Depuis septembre 2000, la CNAM-TS publie les résultats de l'exploitation nationale des données issues du codage des médicaments. Les établissements hospitaliers ne codant pas encore les médicaments qu'ils délivrent, les analyses sont menées sur les médicaments délivrés en officine de ville, qui représentent environ 95 % des médicaments remboursés par l'Assurance Maladie. Les données sont redressées afin de tenir compte du fait que certains médicaments délivrés en ville restent encore non codés. Les données étudiées dans ce document sont celles du régime général, à l'exclusion des sections locales mutualistes, et correspondent pour les périodes étudiées à environ 70 % des remboursements de médicaments de l'ensemble des régimes d'assurance maladie obligatoire. L'étude concernant les années 2001 et 200274 présente des informations sur les montants présentés au remboursement (nombre d'unités prescrites multiplié par le prix public unitaire en vigueur au moment de la délivrance du médicament), les remboursements en montant (valeur) et en unités (volume), sur les taux moyens de remboursement, sur la part des prises en charge à 100 %, ainsi que sur la spécialité du prescripteur. Concernant les psychotropes, deux antidépresseurs figuraient en 2002 parmi les 20 premiers produits présentés au remboursement en valeur. Le premier était le Deroxat® au 7ème rang des montants présentés au remboursement, et au 8ème rang des montants remboursés (103,1 millions €). Le second était le Prozac® au 14ème rang des montants présentés au remboursement et au 13ème rang des montants remboursés (79,4 millions €). A noter que le Prozac® était classé respectivement 6 et 7ème en 2001, soit une diminution de 19,4 % des montants remboursés entre 2002 et 2001 (liée à l'introduction de génériques). Concernant le nombre d'unités prescrites, les psychotropes arrivaient au 2ème rang après les antalgiques. En 2002, trois produits psychotropes (contre six en 2001) figuraient parmi les 25 médicaments les plus prescrits. Le premier était un hypnotique -Stilnox®- (rang 5 vs. 6 en 2001), le second un antidépresseur -Deroxat®- (rang 11 vs. 16 en 2001) et le dernier un anxiolytique -Témesta®- (rang 25 vs. 36 en 2001). Pour ces 3 spécialités les prescriptions en unités ont augmenté de 2001 à 2002 de +6,8 % pour le Stilnox® (14 millions de boîtes), de +11,3 % pour le Deroxat® (11 millions), et de + 10,2 % pour le Temesta® (8 millions de boîtes). Le recul du Prozac® (rang 19 en 2001 vs. 42 en 2002), de l'Imovane® (20 vs. 30), du Lexomil® (24 vs. 28), et du Xanax® (25 vs. 31) s'explique essentiellement par l'apparition de leurs génériques, la prescription de ces molécules n'étant toutefois pas en régression (Tableau 46). Tableau 46. Evolution 2001-2002 des produits référents et de leur principe actif (Source CNAM-TS).
Concernant le coût, cinq classes thérapeutiques concentraient plus de 75 % des dépenses, la première étant celle du système cardio-vasculaire (25 % des montants remboursés de médicaments par le régime général en 2002, classe en progression de +4,1 % de 2001 à 2002). Les médicaments du système nerveux représentaient 18,1 % des remboursements de médicaments, avec une progression de +7,5 % de 2002 à 2001. Sur les 486 produits remboursables de cette classe, les 5 premiers (Deroxat®, Prozac®, Doliprane®, Efferalgan®, Subutex®) contribuaient à 19,7 % des dépenses engendrées par la classe (405 M€ sur 2 059M€). Le premier poste des médicaments du système nerveux central était le groupe des analgésiques (35,8 % de la classe). Les antidépresseurs arrivaient en seconde position avec un peu plus de 24 % des dépenses et une progression de + 6,1 % en montants remboursés. Le sous groupe des antipsychotiques atypiques (Risperdal®, Solian®, Zyprexa® et Leponex®) se caractérisait en 2002 par une forte croissance (+13 %), celle de la classe des antipsychotiques étant imputable à ces seuls produits. Les données concernant les médicaments remboursés en 2003 et 2004 par le régime général d'Assurance Maladie (hors sections locales mutualistes, France métropolitaine) ont pu être analysées dans le cadre de ce rapport grâce au fichier en ligne sur le site de la CNAM-TS75. Ce fichier présente pour chaque code CIP les montants présentés au remboursement en 2003 et en 2004, les montants remboursés en 2003 et en 2004, les bases de remboursement concernant les prescripteurs de ville et le nombre d'unités remboursées en 2003 et 2004. Les données analysées correspondent pour les périodes étudiées à environ 72 % des remboursements de médicaments de l'ensemble des régimes d'assurance maladie obligatoire. Le Tableau 47 présente les données concernant les grandes classes thérapeutiques de psychotropes définies à partir de la classification ATC (et pas l'ensemble des médicaments du système nerveux central comme pour la période précédente). Entre 2003 et 2004, la part du montant des psychotropes présentés au remboursement a progressé de 2,7 % (2,8 % en considérant la phytothérapie et les « autres » produits), celle des montants remboursés de 3,1 % et celle des quantités prescrites de 2,5 % (2,7 % avec « autres »). Plus de 80 % des médicaments présentés au remboursement ont été prescrits par des médecins de ville. En valeur, les psychostimulants ont enregistré une progression de plus de 150 % en montants présentés au remboursement et remboursés ; cette évolution est également constatée en terme de quantités prescrites (+21,3 %). Les neuroleptiques enregistrent une augmentation de 12,3 % des montants remboursés due comme en 2001/2002 aux antipsychotiques atypiques (+20,1 %). Les thymorégulateurs et anti-épileptiques enregistrent une progression de 11,0 et 10,0 %, respectivement. La progression des antidépresseurs n'est plus que de 1,6 % alors qu'elle était de 6,1 % entre 2001 et 2002. Néanmoins, cette dernière classe se situe en deuxième position en terme de quantités prescrites avec une évolution de +5,4 % entre 2003 et 2004. Les anxiolytiques et les hypnotiques sont quant à eux en régression en terme de montants remboursés (-6,8 % et -4,1 % respectivement) alors que les quantités prescrites sont relativement stables. Tableau 47 . Médicaments psychotropes remboursés par le régime général au cours des années 2003 et 2004 (Métropole)
Tableau 47 (suite) . Médicaments psychotropes remboursés par le régime général au cours des années 2003 et 2004 (Métropole) 1. Part des montants prescrits par un praticien libéral au cours de l'année (calcul réalisé à partir des montants présentés au remboursement). 2. Neuroleptiques atypiques : Leponex®, Risperdal®, Solian®, Zyprexa®, et génériques 3. Neuroleptiques conventionnels : Clopixo®l, Dipiperon®, Dogmatil®, Droleptan®, Fluanxol®, Haldol®, Largactil®, Loxapac®, Majeptil®, Melleril®, Modecate®, Moditen®, Neuleptil®, Nozinan®, Orap®, Piportil®, Semap®, Synedil®, Tercian®, Théralene®, Tiaprida®l, et génériques 4. Thymorégulateurs à base de lithium : Neurolithium® et Téralithe® 5. Autres thymorégulateurs : Dépakote® et Dépamide® 6. Anti-épileptiques : Lamictal®, Tégrétol® et Trileptal® 7. Antidépresseurs ISRS : Deroxat®, Floxyfral®, Prozac®, Seropram®, Zolof®t et génériques 8. Antidépresseurs tricycliques : Anafranil®, Defanyl®, Laroxyl®, Prothiaden®, Surmontil®, Survector®, Trofanil® et génériques 9. Autres antidépresseurs : Athymil®, Effexor®, Ixel®, Moclamine®, Norset®, Stablon®, Vivalan® et génériques 10. Anxiolytiques benzodiazépines et dérivés : Lexomil®, Lysanxia®, Nordaz®, Rivotril®, Seresta®, Temesta®, Tranxene®, Urbanyl®, Valium®, Veratran®, Victan®, Xanax® et génériques 11. Autres anxiolytiques : Atarax®, Buspar®, Equanil®, Stresam® et génériques 12. Hypnotiques benzodiazépines et dérivés : Halcion®, Havlane®, Imovane®, Ivadal®, Mogadon®, Noctamide®, Normison®, Rohypnol®, Stilnox®et génériques 13. Autres hypnotiques : Mepronizine®, Noctran®, Natisedine®, Spasmidenal® 14. Antiparkinsoniens anticholinergiques : Artane®, Lepticur® et Parkinane® 15. Psychostimulants : Concerta® et Ritaline® 16. Médicaments de la dépendance alcoolique : Aotal®, Esperal®, Nalorex®, Revia®, TTD B3 B4® b) CANAM (Caisse Nationale d'Assurance Maladie des professions indépendantes) L'enquête, décrite précédemment, réalisée par la CANAM en 1996 (cf. chapitre C de cette même question)49-51 montre que sur 2913 cas renseignés, le montant total d'une ordonnance est en moyenne de 59,0 € (min-max=1,43 - 486,4 €). Le coût moyen des psychotropes par prescription est de 12,2 € (min-max= 0,85-146,9 €), soit 20,6 % du montant total. Il n'existe pas d'association entre le montant des psychotropes et la présence ou non d'une exonération du ticket modérateur, le nombre d'affections exonérantes, et le sexe du patient. En cas d'existence d'une pathologie psychiatrique exonérante, le coût des psychotropes passe à 23,6 € vs. 11,4 €. Le montant moyen des psychotropes est plus élevé pour les psychiatres (27,4 €) que pour les généralistes (11,7 €). Là encore, ces résultats sont probablement le reflet de la gravité des pathologies. Le coût moyen des psychotropes est plus que triplé en cas de prescription d'antidépresseur (25,1 €) par rapport à une prescription sans antidépresseur (6,9 €), cette différence s'expliquant par le coût des ISRS et la polythérapie psychotrope dans les prescriptions incluant un antidépresseur. En cas de prescription d'antidépresseur, la part des psychotropes représente une moyenne de 38,5 % du coût total de l'ordonnance alors qu'elle n'est que de 12 % pour les prescriptions sans antidépresseur. Par exemple, la part des psychotropes dans le montant total de l'ordonnance est respectivement de 45,9 % en cas de prescription de Prozac® et 49,8 % en cas de prescription de Deroxat®. 4. Afssaps (Agence française de sécurite sanitaire des produits de sante) a) Analyse des ventes de médicaments aux officines et aux hôpitaux en France, 1988-1999 Les données Afssaps concernant les ventes de médicaments sont issues de la déclaration annuelle obligatoire des laboratoires pharmaceutiques. Les ventes des industriels vers les grossistes de métropole sont exprimées en unités de ventes (ou nombre de boites vendues) et en chiffres d'affaires. Seules les données AFSSPaS renseignent sur les chiffres de vente en milieu hospitalier, contrairement aux données type IMS qui ne portent que sur les officines. En 1999, le chiffre d'affaire des 4 principales classes de psychotropes (hypnotiques, anxiolytiques, antidépresseurs, neuroleptiques) atteignait plus de 6 milliards de francs pour les ventes effectuées en ville et près de 500 millions de francs pour celles réalisées en hôpital. Les antidépresseurs généraient le chiffre d'affaire le plus important (plus de 3 milliards de francs en 1999), près de 3 fois supérieur à celui des neuroleptiques ou des anxiolytiques (Tableau 48). Tableau 48. Ventes de médicaments psychotropes en 1999 (Source : Afssaps)
En raison des différences dans les tailles de conditionnement, il n'est pas pertinent d'additionner les unités vendues en ville à celles vendues en hôpital Le Prozac® était classé parmi les 5 premiers produits présentés au remboursement dès 1993. Parmi les 10 produits les plus fréquemment cités en 1999 apparaissent deux antidépresseurs, le Prozac® et le Deroxat® (au même niveau que le Vastarel®, le Tahor® ou le Di-Antalvic®). L'évolution des ventes depuis 1990 montre qu'en 10 ans, la plus forte progression du volume des ventes concerne les antidépresseurs (+ 67 %). En 1990 les ISRS représentaient 15 % en unités de ventes d'antidépresseurs et 30 % en chiffres d'affaires. En 1999, ces pourcentages étaient de 57 % et 69 %. Pour les neuroleptiques et les hypnotiques, après une légère hausse au cours de la première moitié de la décennie, les ventes sont en baisse et rejoignent quasiment en 1999 le niveau de 1990. Les ventes d'anxiolytiques diminuent jusqu'en 1998, puis augmentent d'environ 3 % en 1999, tout en restant en deçà du niveau de 1990. L'interprétation de ces données doit prendre en compte le fait que de nombreux facteurs peuvent influencer le volume de vente, tels que des modifications de conditionnements, des changements de prix, la mise sur le marché de nouvelles molécules, le retrait d'un produit, etc. Ainsi, la hausse des ventes des hypnotiques au début des années 90 est liée au moins en partie à la mise sur le marché de nouveaux conditionnements comprenant moins de comprimés (boîte de sept au lieu de vingt). L'augmentation du montant de remboursement des antidépresseurs est liée à la mise sur le marché des ISRS, plus chers que les antidépresseurs tricycliques. De même, la revalorisation des prix des neuroleptiques et l'arrivée de nouvelles spécialités ont favorisé la croissance des coûts de cette classe. b) Analyse des ventes de médicaments aux officines et aux hôpitaux en France, 1993-2003 Les données76 concernent, comme précédemment, les ventes de médicaments issues de la déclaration annuelle obligatoire des laboratoires pharmaceutiques. Contrairement aux options retenues pour les éditions précédentes, lorsque la substance active n'était pas recensée dans la classification établie par l'OMS, aucun code ATC n'était attribué. Les spécialités de phytothérapie initialement classées en fonction de leur usage traditionnel (par exemple, troubles mineurs du sommeil), ont été réaffectées à la classe qui regroupe, par défaut, les médicaments n'ayant pas fait l'objet d'une classification spécifique (V03AX). Les chiffres d'affaire sont exprimés en « prix fabricant hors taxes », et non en prix public, et tiennent compte des remises éventuellement consenties. Pour le marché hospitalier, les chiffres d'affaires sont calculés sur la base des prix de cession effectifs et intègrent également les ventes aux diverses collectivités (cliniques privées, dispensaires, centres de vaccination, etc.). Les parts de marché en valeur (chiffres d'affaires) et en quantités (unités ou nombre de boites vendues) ont été calculées par rapport au montant total des ventes de spécialités pharmaceutiques (hors spécialités homéopathiques à nom commun). Le taux de variation calculé pour chaque classe correspond au taux de croissance moyen annuel au cours de la période 1993-2003. En 2003, la classe ATC la plus vendue en valeur en officine (médicaments remboursables et non remboursables) était celle des médicaments appartenant au système cardio-vasculaire (23,4 % de part du marché officinal en 2003 vs. 27,0 % en 1993) suivie par la classe des médicaments appartenant au système nerveux (16,3 % en 2003 vs. 12,6 % en 1993) (Tableau 49). Cette dernière était la classe la plus vendue en quantité (25,4 % en 2003 vs 19,9 % en 1993) (Tableau 50). Parmi les médicaments du système nerveux, la classe ATC N05 des psycholeptiques (à savoir antipsychotiques, anxiolytiques, hypnotiques et sédatifs) représentait en valeur 3,1 % du marché officinal en 2003 (10ème rang) vs 3,3 % en 1993 (9ème rang). En quantité, la classe N05 représentait 4,9 % du marché officinal en 2003 vs 5,4 % en 1993 (2ème rang pour les deux dates). Les ventes des psycholeptiques ont donc augmenté modérément en valeur (4,6 %) et sont restées stables en quantités (- 0,2 %). Concernant la classe ATC N06 des psychoanaleptiques (antidépresseurs, psychostimulants et nootropiques, psycholeptiques et psychoanaleptiques en association et médicaments contre la démence), leur part du marché officinal en 2003 était de 4,9 % en valeur et 2,6 % en quantité, soit une augmentation par rapport à 1993 de 8,2 % en chiffre d'affaire et de 1,0 % en unités vendues. Plus spécifiquement les ventes en valeur concernant les antidépresseurs ont progressé en moyenne de 9,0 % entre 1993 et 2003. Cependant, l'augmentation des ventes de psychoanaleptiques est principalement due à celles des médicaments de la maladie d'Alzheimer qui, avec une progression de 25 % des ventes en 2003, représentaient 18 % des ventes de psychoanaleptiques. Tableau 49. Chiffre d'affaires de ventes aux officines (en millions d'euros)
1. Taux de croissance annuel moyen Tableau 50. Unités vendues aux officines (en millions )
1. Taux de croissance annuel moyen Concernant les médicaments psychotropes vendus en officine, seul le Deroxat® était classé parmi les 50 produits les plus vendus en 2003 à la fois en termes de valeur et de quantités vendues (Tableau 51). Le classement des produits les plus vendus aux établissements hospitaliers en valeur ne montrait qu'un seul produit en commun avec celui du marché officinal, le Zyprexa®, seul psychotrope classé parmi les 50 premiers médicaments vendus en secteur hospitalier (41ème position en 2003). Concernant le marché des génériques, la fluoxétine-Prozac®- (spécialité de référence et génériques) se situait en huitième position parmi les 30 produits pharmaceutiques ayant les chiffres d'affaire les plus importants avec 27,9 millions d'€ en 2003. La zopiclone-Imovane®- se plaçait au 25ème rang de ce classement (11,3 millions d'€) et le bromazépam-Lexomil®- au 29ème rang (9,9 millions d'€). Les différences entre ventes en valeur et en quantités s'expliquent par les écarts de prix entre les spécialités vendues dans les officines. Les médicaments les plus couramment achetés (sur prescription ou non) restent les antalgiques dont les prix sont généralement faibles, tandis que les médicaments qui représentent les chiffres d'affaires les plus importants appartiennent à des classes dont les prix sont, en règle générale, beaucoup plus élevés (anti-ulcéreux, hypolipidémiants, antidépresseurs). Tableau 51. Psychotropes parmi les 50 produits les plus vendus en officine en 2003
À l'hôpital, les antinéoplasiques et les immunomodulateurs représentaient le poste de dépenses le plus important (25,7 %), les médicaments du système nerveux représentant 7,5 % du marché hospitalier en 2003 (10,9 % en 1993). Plus particulièrement, les psycholeptiques représentaient en valeur 2,0 % du marché hospitalier en 2003 (13ème rang) et 2,9 % en 1993 (12ème rang). Cette classe occupait la deuxième place en valeur devant les analgésiques, ce résultat devant prendre en compte le fait que les analgésiques bénéficient souvent de remises très importantes pour les marchés hospitaliers, aussi l'évolution du chiffre d'affaire ne permet pas d'estimer l'évolution des quantités vendues. La classe des psychoanaleptiques ne figurait pas parmi les 20 classes les plus vendues en secteur hospitalier. L'interprétation de ces données doit prendre en compte certaines limites méthodologiques. Tout d'abord, le régime de remboursement ne constitue pas une donnée stable car un médicament peut être radié de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux et être ensuite commercialisé en non remboursable. La deuxième limite est que tout changement dans la classification ATC se répercute immédiatement sur les montants des ventes des classes concernées, comme cela a été le cas, en 2000, avec le changement de classification des médicaments de la maladie d'Alzheimer. c) Étude de la prescription et de la consommation des psychotropes en ambulatoire La méthodologie de cette étude a été décrite précédemment (Cf. chapitre D de cette même question, section « Afssaps »)53. Les données de ventes sont également issues de la déclaration relative aux ventes de spécialités pharmaceutiques adressée à l'Agence du Médicament par les laboratoires pharmaceutiques. En 1997, les psychotropes représentaient 6 % du marché total des médicaments (remboursables ou non) en ville contre 2,6 % du marché des médicaments en secteur hospitalier. Les anxiolytiques étaient les psychotropes les plus vendus en quantité (68,9 millions d'unités vendues) devant les hypnotiques et sédatifs (63,5 millions), les antidépresseurs (47,6 millions) et les neuroleptiques (20,9 millions). Néanmoins, le nombre d'unités vendues d'anxiolytiques a chuté de près de 10 % entre 1991 et 1997 (Tableau 52). La progression des neuroleptiques est due à une revalorisation du prix des anciennes spécialités et à la mise sur le marché de nouvelles spécialités de prix élevé. Celle des hypnotiques s'explique en essentiellement par la mise sur le marché de petits conditionnements (boîtes de 7 au lieu de 20) des «benzodiazépines et apparentés » afin de favoriser le bon usage, mesure encouragée financièrement par une hausse relative du prix de ces spécialités (Tableau 53). Tableau 52. Evolution des unités vendues des quatre principales classes de psychotropes entre 1991 et 1997
Tableau 53. Evolution du chiffre d'affaire des quatre principales classes de psychotropes entre 1991 et 1997 (converti en euros)
En terme de chiffre d'affaire, les antidépresseurs ont représenté la classe la plus importante avec 369,7 millions d'€ et une croissance très nette depuis 1991 (+97,1 %) ; ils représentaient 50,6 % du chiffre d'affaire total réalisé par les psychotropes en 1997 (vs. 39,2 % en 1991). Comme cela a déjà été souligné, cette augmentation est liée à la part de marché acquise par les nouveaux antidépresseurs plus chers que les autres antidépresseurs (effet de structure). En effet, les ventes d'ISRS ont augmenté de 50,9 % entre 1991 et 1997, au détriment des autres classes d'antidépresseurs moins chers (Tableau 54). La même progression est observée concernant le chiffre d'affaires avec 248 millions d'€ pour les ISRS en 1997 (Tableau 55). Si l'on exclut les antidépresseurs, le taux de croissance des ventes des autres psychotropes (neuroleptiques, hypnotiques, sédatifs et anxiolytiques) est négatif en terme de quantités vendues (-0,6 %), et le taux de croissance du chiffre d'affaire n'est plus que de 24,3 %. Tableau 54. Répartition des ventes en quantités des antidépresseurs
Tableau 55. Répartition des ventes en valeurs des antidépresseurs
5. DREES (Direction de la recherche, des études de l'évaluation et des Statistiques, ministère de la santé et des solidarités) a) Les dépenses de médicaments remboursables La DREES publie régulièrement des analyses concernant les dépenses de médicaments remboursables issues de la base de données du GERS (Groupement pour l'Élaboration et la Réalisation de Statistiques ). Cette base, largement utilisée par l'industrie pharmaceutique, recense les volumes des ventes des laboratoires aux pharmaciens et les chiffres bruts hors taxe de chaque présentation. La principale mesure utilisée est la contribution à la croissance définie comme le produit du taux de croissance et de la part de marché. Pour la période d'août 1999 à juillet 2000, le chiffre d'affaires du médicament remboursable s'élevait à 19 milliards d'€77. Pendant cette période, les neuf premières classes contribuant le plus à la croissance ont expliqué près de 4 points de croissance du chiffre d'affaires annuel. Ces classes correspondaient aux pathologies suivantes : prévention et traitement des maladies cardio-vasculaires, traitement des ulcères, traitement des troubles mentaux et lutte contre la douleur. Concernant les psychotropes (Tableau 56), la contribution des antidépresseurs à la croissance était de 0,39 point ; il s'agissait de la quatrième classe sur le marché pharmaceutique français, représentant à elle seule environ 3,5 % du chiffre d'affaire et faisant ainsi partie des quatre classes ayant le poids le plus fort dans le total des ventes de médicaments. La contribution à la croissance des antipsychotiques atypiques était également de 0,39 point, mais cette classe représentait une part de marché limitée (0,25 %) cette forte contribution est liée à la mise sur le marché des nouveaux produits à cette période. Tableau 56. Contribution à la croissance de certains médicaments psychotropes (Source : base GERS juillet 2000, traitement DREES)
En 2001, le chiffre d'affaire en prix producteur hors taxes des médicaments remboursables s'élevait à 14,3 milliards d'€, soit un taux de croissance de 7,1 % par rapport à l'année précédente78. Les antidépresseurs occupaient toujours la quatrième place avec une part de marché en constante augmentation (3,8 % vs. 3,6 % en 2000 et 3,5 % en 1999). De plus, la croissance des ventes s'accélérait, passant de 8,9 % en 1999 à 12,2 % en 2001 avec pour conséquence une contribution à la croissance atteignant 0,44 point. Les antipsychotiques atypiques avaient un poids plus modeste dans la dépense globale (moins de 1 %) avec un ralentissement de la croissance de leurs ventes (26 % en 2001 vs. 40 % en 2000). Entre 2001 et 2002, le taux de croissance du chiffre d'affaire était de 4,6 %79. La diminution de la contribution à la croissance des antidépresseurs (0,18 point en 2002) est expliquée par l'apparition de génériques dans cette classe. Le poids des antipsychotiques atypiques dans le chiffre d'affaires total restait modeste (0,87 %) même si le taux de croissance des ventes était toujours élevé (21 %). L'étude la plus récente portant sur l'année 2003 indiquait un taux de croissance de 6 % par rapport à l'année précédente80. Contrairement aux autres années, les antidépresseurs ne figuraient plus parmi les médicaments contribuant le plus à la croissance, du fait de la part croissante des génériques, mais cette classe demeurait néanmoins la cinquième en terme de part de marché global. b) Les ventes d'antidépresseurs Cette étude réalisée par la DREES caractérise l'évolution des ventes d'antidépresseurs entre 1980 et 2001, en distinguant l'évolution des prix et celle des volumes81. Les données présentées ici sont essentiellement issues de la base de données du GERS (voir chapitre précédent). Le chiffre d'affaire correspondant aux ventes d'antidépresseurs a augmenté entre 1980 et 2001 de 84 millions d'€ à 543 millions d'€ (en euros constants 2001) soit un facteur multiplicatif de 6,7, alors que pendant la même période les ventes globales de médicaments ont été multipliées par 2,7. Cette croissance explique en partie la croissance du marché de l'ensemble des psychotropes, de 317 millions d'€ en 1980 à plus d'un milliard d'€ en 2001 (euros constants 2001). En effet, en 1980, les anxiolytiques et les hypnotiques représentaient près de 60 % du chiffre d'affaire hors taxe des psychotropes contre 25 % pour les antidépresseurs. En 2001 la situation s'est inversée puisque 50 % des ventes de psychotropes sont représentées par les antidépresseurs. En 1980, le marché des antidépresseurs était dominé par les imipraminiques (60 % des ventes), en 1992, ce pourcentage tombait à 21 %, les ISRS représentant 44 % du marché des antidépresseurs. Les ISRSNA (Ixel® et Effexor®), apparus en 1997, atteignaient presque 10 % des ventes d'antidépresseurs dès 2001, date à laquelle, les ISRS et ISRSNA représentaient 76 % du marché alors que les imipraminiques n'étaient plus qu'à 7 %. Entre 1980 et 2001, le prix moyen d'une journée de traitement par psychotrope a augmenté d'environ 50 % passant de 0,43 € en 1980 à 0,60 € en 2001. Des écarts de prix importants existent entre les différents traitements, en lien avec leur ancienneté : en 2001, une journée de traitement par ISRS (0,64 €) coûte deux fois plus cher que par imipraminique (0,32 €) (Tableau 57). Le prix moyen est sensible à la fois aux évolutions des prix et à celles de la structure de la consommation : il augmente lorsque la consommation se déplace vers des médicaments plus chers, par exemple vers les ISRS à partir de la fin des années 80, même si les prix unitaires sont stables. Tableau 57. Prix moyen par présentation en 2001, pondéré par le chiffre d'affaires (Source : GERS, traitement DREES)
c) Des comptes de la santé par pathologie Nous citons pour mémoire les données de l'étude de la DREES réalisée avec le concours du CREDES sur les dépenses de santé par grandes catégories diagnostiques. Cette étude porte sur les dépenses relatives à la CBSM (Consommation de Soins et Biens Médicaux), qui sont donc nettement plus larges que les dépenses liées au seul médicament. Elle a néanmoins l'intérêt de situer le coût des troubles psychiatriques par rapport aux autres pathologies. Pour le secteur hospitalier, le PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information) a été principalement utilisé, diverses sources ayant été croisées pour le secteur ambulatoire. La catégorie diagnostique la plus importante en termes de dépenses de santé était celle des maladies de l'appareil circulatoire avec 11,83 milliards d'€ soit 10,7 % de la CSBM de l'année 1998. Elle est suivie de la catégorie « troubles mentaux » avec 9,4 % de la CSBM, représentant la première catégorie pour le secteur hospitalier avec, en 1998, une part de la dépense hospitalière de 15,5 %. En ambulatoire, les dépenses de soins sont largement dominées par les affections de la bouche (22,3 %), les troubles mentaux arrivant loin derrière (3,3 %). Concernant les dépenses de médicaments, les maladies de l'appareil circulatoire (17,8 % des dépenses de médicament de l'année 1998) et les maladies de l'appareil respiratoire (11,3 %) pèsent le plus lourd, les troubles mentaux représentant 5,5 % des dépenses (Tableau 58). Tableau 58. Dépenses par grande catégorie diagnostique (en %) (Source : CREDES)
6. IRDES (Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé) Une étude de l'IRDES a testé différents modes de fixation des tarifs de responsabilité pour les antidépresseurs en s'inspirant des expériences étrangères de remboursement forfaitaires par classe thérapeutique (Pays-Bas et Allemagne)82. Le tarif de responsabilité correspond au tarif sur lequel se base la prise en charge de l'Assurance Maladie (par exemple, 65 % pour le Régime général). La première hypothèse testée postule que les assurances complémentaires ne rembourseraient pas au delà du tarif de responsabilité fixé par l'Assurance Maladie. Ceci inciterait alors les industriels à baisser les prix des médicaments au niveau de ce tarif afin d'éviter un report de prescription vers des produits moins chers. Ce scénario a été mis en place dans différents pays (Allemagne, Pays-Bas...). Si le tarif est fixé au niveau du prix le moins élevé de la classe thérapeutique, la diminution du coût de la prescription serait de 39 % pour les antidépresseurs, soit de l'ordre de 152 millions d'euros. Les économies réalisées se reporteraient sur l'ensemble des financeurs (Assurance Maladie, assurances complémentaires et patients). Le coût à la charge de la Sécurité Sociale passerait alors de 1,4 millards à 884 millions d'euros, le coût à charge des patients de 49 à 31 millions d'euros. Dans cette hypothèse, les économies réalisées par les différents financeurs seraient entièrement supportées par l'industrie pharmaceutique. La deuxième hypothèse testée considère que les assurances complémentaires décident de prendre en charge l'intégralité du différentiel entre prix et tarif de responsabilité. Les industriels ne sont alors pas incités à diminuer les prix. En conséquence, le coût global de la prescription ne diminue pas et seule l'Assurance Maladie réalise des économies, pour un montant identique à celui obtenu dans le scénario précédent, au détriment des assurances complémentaires et des patients. Si le tarif le plus bas est appliqué, la prise en charge des antidépresseurs par l'Assurance Maladie passerait de 71 % à 43 %. L'économie réalisée par l'Assurance maladie varierait de 6 % à 39 % selon la méthode choisie. En revanche, la prise en charge de ces médicaments par les assurances complémentaires passerait de 26 % à 50 % (de 518 à 945 millions d'€), et le montant à la charge des patients serait de 2 % à 6 % (de 49 à 128 millions d'€). Pour les patients, bénéficiant d'une couverture complémentaire, la participation serait nulle (en ne considérant pas le coût d'adhésion à ces assurances complémentaires). À l'opposé, la contribution financière des personnes sans assurance complémentaire (hors bénéficiaires de la CMU) serait d'environ 14 € par prescription d'antidépresseur. 7. Sociétés d'information médicale Les données de la société IMS-Health sur les disparités régionales d'usage des psychotropes ont été analysées dans le cadre d'une étude réalisée par l'OFDT, qui nous a été communiquée par A. Cadet. Cette étude repose sur l'évaluation du nombre de boites vendues en officine par département pour l'année 2001. Les pharmacies participant au recueil des données sont recrutées sur la base du volontariat (c'est à dire non tirées au sort), avec, en moyenne, 4 pharmacies retenues par zone géographique de 10 pharmacies. Les données sont ensuite extrapolées au niveau départemental en tenant compte du nombre de pharmacies du département et du nombre de pharmacies du département participantes. Des indices de vente par département par rapport à l'ensemble de la France sont ensuite calculés en prenant en compte la structure d'âge et sexe de la population de chaque département, ce qui permet ensuite d'estimer le nombre de consommateurs réguliers (au moins 1 fois par semaine depuis 6 mois) de 30 à 90 ans attendus par département. Un indice supérieur à 100 indique des ventes supérieures à la moyenne nationale, et inversement si l'indice est inférieur à 100. Concernant les hypnotiques (Figure 13), les départements enregistrant un nombre de boites vendues supérieur à la moyenne de la France sont les Bouches du Rhône (indice 135), la Somme et le Nord (129 et 125). Pour les anxiolytiques (Figure 14), trois zones de forte consommation sont identifiées : la région du Limousin avec la Creuse (160) et la Haute Vienne (135), une zone bretonne comprenant essentiellement le Finistère (133) et les Côtes du Nord (131) et, de manière un peu moins marquée, les Bouches du Rhône (122), l'Oise et la Somme (119 et 121). Les ventes d'antidépresseurs (Figure 15) sont plus élevées dans le centre de la France (Creuse et Haute Vienne, 155), à Paris (131), en Savoie (129), et en Charente Maritime (127). Ces données qui sont globalement superposables à celles fournies par l'étude de la CNAM-TS (cf. chapitre F de cette même question, section « caisses d'assurance maladie ») doivent néanmoins être considérées en prenant en compte les nombreuses limites méthodologiques, inhérentes au mode de calcul des estimations, qui reposent sur une série d'approximations et d'hypothèses. De plus, la représentativité de la source initiale de données (pharmacie) est incertaine, du fait d'une sélection sur la base du volontariat. Les indices par département doivent donc être considérés comme des tendances, et le classement qui en découle comme indicatif. Figure 13. Indices de vente de boites d'hypnotiques par consommateur régulier de 30 à 90 ans, standardisés sur la structure de la consommation française par sexe et par âge
Sources : Données IMS Health et INSEE, traitement OFDT Figure 14. Indices de ventes de boites d'anxiolytiques par consommateur régulier de 30 à 90 ans, standardisés sur la structure de consommation française par sexe et par âge
Sources : Données IMS Health et INSEE, traitement OFDT Figure 15. Indices de ventes de boites d'antidépresseurs par consommateur régulier de 30 à 90 ans, standardisés sur la structure de consommation française par sexe et par âge
Sources : Données IMS Health et INSEE, traitement OFDT Un courrier a été adressé aux directeurs médicaux des principaux laboratoires pharmaceutiques commercialisant des psychotropes en France avec copie au LEEM (Les entreprises du médicament), afin de leur demander si des études pharmaco-épidémiologiques d'utilisation des psychotropes avaient été réalisées à leur initiative, et le cas échéant, s'ils acceptaient d'en transmettre les résultats pour les intégrer dans le présent rapport. A la date de remise du rapport, cinq laboratoires pharmaceutiques nous ont adressé une réponse. Deux laboratoires (Novartis et Organon) nous ont informé qu'il ne disposait pas d'études de ce type. Les trois autres laboratoires (Sanofi-Aventis, Janssen-Cilag, Pfizer) nous ont transmis des informations sur des études d'utilisation des antipsychotiques et des antidépresseurs). Aucune de ces études ne répondait aux critères d'inclusion retenus pour le présent rapport, car elles avaient toutes été menées en population clinique, essentiellement sur des populations de patients suivis par des psychiatres libéraux ou hospitaliers. De ce fait, leurs résultats ne seront pas présentés ici. Des résultats relativement convergents sont obtenus sur l'usage des médicaments psychotropes en France, quelle que soit la source de données. A partir des données disponibles, on peut ainsi estimer qu'une personne sur 4 résidant en France fait usage au moins une fois par an des médicaments psychotropes, qu'environ une personne sur 10 en a un usage régulier (> 3 mois), et que plus d'une personne sur 3 fait usage de médicaments psychotropes au moins une fois au cours de sa vie. Une étude réalisée par la CANAM montre qu'un jour donné, plus d'une prescription sur 10 aux adhérents du régime d'assurance maladie des professions indépendantes inclut un psychotrope. Les anxiolytiques et hypnotiques sont parmi les médicaments les plus consommés en France, avec environ 15 % à 20 % de ses habitants ayant un usage au moins ponctuel de ces traitements, et 10 % un usage régulier. Les antidépresseurs arrivent en seconde position des psychotropes, environ une personne sur 10 en faisant usage par an, et 5 % en ayant un usage régulier. Les co-prescriptions sont fréquentes, notamment celles associant anxiolytiques-hypnotiques et anxiolytiques-antidépresseurs. L'usage d'antipsychotiques concerne actuellement un pourcentage nettement plus réduit de personnes (autour de 1 %) mais cette fréquence d'usage doit être surveillée avec attention du fait de la tendance actuelle à l'élargissement, voire au dérapage, des indications de ces molécules. Les durées de prescription indiquent qu'en France celles ci sont souvent prolongées pour les anxiolytiques-hypnotiques, la durée d'usage pouvant être estimée à plus de 6 mois pour les trois quarts des usagers de benzodiazépines, soit très au-delà des recommandations actuelles. En revanche, un nombre important de sujets utilisent les antidépresseurs sur des courtes périodes, inférieures à celles recommandées pour obtenir et maintenir un effet thérapeutique. Selon la synthèse réalisée par l'OFDT57, l'usage pendant au moins un an concernerait 2,7 % de la population tous âges confondus pour les anxiolytiques, 1,5 % de la population pour les hypnotiques, et 3 % de la population pour les antidépresseurs. En simplifiant, on peut conclure que les prescriptions d'anxiolytiques, hypnotiques et antidépresseurs sont particulièrement nombreuses dans notre pays mais peu conformes aux recommandations, au moins en ce qui concerne la durée : ce qui devrait être court (anxiolytiques/hypnotiques) est long et ce qui devrait être long (antidépresseurs) est court. Une donnée importante de l'étude EVA conduite chez les personnes âgées est de montrer que les usagers respectent le plus souvent la prescription d'anxiolytiques-hypnotiques faite par le médecin, et s'ils ne le font pas, la modification est quasi-systématiquement dans le sens d'une diminution, des doses et de la durée du traitement. Les données des études sur les antidépresseurs vont dans la même direction, à savoir que l'arrêt prématuré des traitements à l'initiative de l'usager est fréquent. L'évaluation de l'impact des durées inadaptées de traitement doit donc prendre en compte la prolongation excessive des prescriptions, mais aussi les problèmes d'observance et d'arrêt prématuré des traitements. Les profils des usagers sont globalement similaires d'une étude à l'autre. Notamment pour les anxiolytiques-hypnotiques et les antidépresseurs, l'usage est plus fréquent chez les femmes, les personnes âgées, les personnes vivant seules et celles présentant une ou plusieurs pathologies somatiques chroniques. Les données concernant l'effet du niveau d'éducation, des revenus et du statut professionnel sont moins univoques : un mauvais contexte socio-économique favorise l'usage des antidépresseurs et des anxiolytiques, mais ces derniers sont également plus consommés par les sujets les plus favorisés socialement. A noter que très peu d'études ont évalué l'effet indépendant de chacune de ces caractéristiques socio-démographiques, qui sont très fortement associées l'une avec l'autre. L'existence d'une pathologie psychiatrique, dont la fréquence diffère largement en fonction de ces caractéristiques socio-démographiques, a rarement été prise en compte de manière indépendante. L'âge est le facteur socio-démographique qui paraît le plus fortement associé à l'usage anxiolytiques-hypnotiques, et à l'usage prolongé en particulier : plus d'une personne sur trois de plus de 60 ans fait usage de ces médicaments, voire une personne sur deux pour les tranches d'âge plus élevées. Les données disponibles ne permettent pas de répondre à la question posée concernant les caractéristiques des « gros consommateurs ». Il serait nécessaire de disposer d'informations quantitatives détaillées sur les doses et co-prescriptions dans un échantillon de consommateurs, pour réaliser des analyses visant à identifier de tels sous-groupes de sujets, et de déterminer leurs caractéristiques. Les rares études ayant évalué l'usage chez les enfants montrent que le pourcentage d'enfants de moins de 10 ans traités par psychotropes peut être estimé à moins de 5 %, et que l'usage de ces médicaments est le plus souvent ponctuel dans ces tranches d'âge. Toutefois, les prescriptions peuvent débuter très précocement, avant l'âge de un an, le plus fréquemment pour des troubles du sommeil. Les études réalisées chez les adolescents montrent que plus d'une fille sur 4 et près d'un garçon sur 5 a fait usage de médicaments psychotropes avant l'âge de 18 ans, et que cette fréquence tend à augmenter au cours des dernières années dans ces classes d'âge. Des variations régionales peuvent être mises en évidence, avec des régions où la fréquence d'usage des médicaments psychotropes paraît plus élevée (Centre et Nord), ou inversement plus faible (Alsace pour les adolescents et jeunes adultes). Toutefois, ces variations restent relativement modérées, et ne paraissent pas être spécifiques de cette classe de médicaments, puisque des variations existent pour d'autres classes telles que les antibiotiques ou les statines. Les facteurs explicatifs de ces variations ne sont pas connus, et seules des hypothèses (demandant à être vérifiées) peuvent être émises concernant l'impact de l'offre de soins régionale (densité de généralistes et de spécialistes), des caractéristiques socio-démographiques de la population (par exemple nombre de personnes vivant seules, taux de chômage), et des différences régionales de morbidité psychiatrique. Au cours de la période 1990-2005, l'évolution des consommations a été caractérisée par une progression de la consommation des antidépresseurs. Cette progression, déjà soulignée dans le rapport Zarifian43, est essentiellement liée à l'arrivée sur le marché des ISRS, qui du fait d'un profil d'effets secondaires plus favorable que celui des antidépresseurs tricycliques, a favorisé leur utilisation en médecine générale. Depuis le milieu des années 90, le nombre de sujets traités par antidépresseur à un moment donné paraît relativement stable (près de 4 % de la population dans des enquêtes réalisées entre 1994 et 1996, et 5 % dans l'étude ESEMeD réalisé en 2002). La modification la plus notable est que la part de marché des ISRS et autres nouvelles molécules a continué à augmenter au cours de cette période au détriment des antidépresseurs tricycliques. Les données disponibles suggèrent que la consommation d'anxiolytiques-hypnotiques, qui était déjà à un niveau élevé au début des années 9043, est restée stable, voire a discrètement progressé. L'arrivée des nouveaux antidépresseurs peut avoir favorisé l'usage d'anxiolytiques-hypnotiques chez des personnes qui n'étaient pas jusqu'alors consommatrices. Ceci contraste avec la tendance observée dans plusieurs pays européens allant plutôt vers la baisse des consommations d'anxiolytiques-hypnotiques au cours de cette période, avec une probable substitution anxiolytique-antidépresseur. Cette substitution a pu être favorisée par les campagnes d'éducation sur le traitement adéquat de la dépression tel que le programme « Defeat Depression » mis en place au Royaume-Uni dans les années 9083, mais aussi par le fait que plusieurs antidépresseurs ont obtenu une AMM pour le traitement des troubles anxieux. En France, les modifications induites par l'arrivée des ISRS pourraient avoir pris la forme d'une addition (antidépresseur + anxiolytiques-hypnotiques) plus que d'une substitution. Les comptes de santé par pathologie indiquent que les « troubles mentaux » représentent en France le 2ème poste de dépense avec 9,4 % des « consommations de soins et bien médicaux » (en particulier du fait du poids de l'hospitalisation), et le 4ème poste pour les dépenses liées aux médicaments (5,5 %). Les médicaments psychotropes se situent au 2eme rang derrière les antalgiques concernant le nombre d'unités prescrites. Le montant remboursé par la sécurité sociale en 2003 et 2004 pour les médicaments psychotropes peut être estimé à un milliard d'euros (en 1980, ce montant équivalait à 317 millions d'euros). En 1980, les anxiolytiques et les hypnotiques représentaient près de 60 % du chiffre d'affaire des psychotropes, contre 25 % pour les antidépresseurs. En 2001, la situation s'est inversée puisque 50 % des ventes enregistrées de psychotropes sont représentées par les antidépresseurs. Cette augmentation a porté sur les volumes, mais surtout sur les coûts. Les ventes en valeur concernant les antidépresseurs ont progressé annuellement de 9 % en moyenne entre 1993 et 2003. Les antidépresseurs représentaient en 2000 la quatrième classe sur le marché pharmaceutique français, avec 3,5 % du chiffre d'affaire, faisant ainsi partie des quatre classes ayant le plus fort poids dans les ventes de médicaments. Un quart des dépenses des médicaments du système nerveux central était imputable aux antidépresseurs en 2002, deux antidépresseurs ISRS faisant partie des 20 premiers produits présentés au remboursement. Une enquête de la CANAM montre que la présence d'un médicament de la classe des antidépresseurs multiplie par trois le coût d'une ordonnance. On observe néanmoins depuis 2001 un ralentissement de la croissance des montants remboursés des antidépresseurs, lié à l'introduction des génériques. Les dépenses concernant les autres classes de psychotropes, en particulier des anxiolytiques et hypnotiques, sont restées relativement stables au cours de la période. Concernant les antipsychotiques, l'évolution a été marquée par une augmentation des coûts liés à l'introduction de nouvelles molécules plus onéreuses. Comparativement aux autres pays européens, la consommation de psychotropes est plus élevée en France. Toutefois, les études basées sur la même méthode de recueil de données pour tous les pays, qui seules autoriseraient une comparaison directe, sont très rares. Les écarts sont variables selon le pays considéré, le niveau d'usage en France est proche de celui de la Belgique et de l'Espagne, et nettement plus élevé que celui de l'Allemagne. L'écart entre la France et les autres pays est surtout marqué pour les anxiolytiques-hypnotiques, et moindre pour les antidépresseurs. La comparaison avec les autres pays européens doit prendre en compte le fait que la France se situe en tête des pays européens pour les dépenses concernant les produits pharmaceutiques en général. La France est en particulier caractérisée par une consommation importante d'anti-hypertenseurs, de vasodilatateurs, d'antibiotiques, de psycholeptiques et psychoanaleptiques. Les comportements de prescription et d'usage des médicaments psychotropes s'intègrent, en partie, dans des phénomènes plus généraux concernant la prescription et le recours au médicament. Ces écarts ne peuvent pas être expliqués par des modes différents de régulation (AMM, fixation des prix, montant du remboursement) : ainsi, la France dépense deux fois plus que l'Allemagne pour les benzodiazépines alors que le panier de produits disponibles et remboursés est similaire dans les deux pays. Même si les données disponibles fournissent des estimations et permettent de dégager des tendances, les limites des études dont elles sont issues doivent être prises en compte. Tout d'abord, les études épidémiologiques en population générale, dont sont extraites ces données, n'ont, à de rares exceptions près, pas été mises en place pour explorer de manière spécifique l'usage des médicaments psychotropes. Les questions relatives à ces médicaments sont le plus souvent inclues dans un questionnaire recueillant des informations sur des domaines très nombreux, ne permettant donc pas d'explorer de manière détaillée les caractéristiques de consommation. Les indicateurs recueillis sont ainsi le plus souvent sommaires, avec de plus des critères définissant l'usage variable d'une étude à l'autre (notamment la durée de la période explorée), et des méthodes de recueil (téléphone) pouvant limiter la validité des informations recueillies (pas de contrôle possible via les ordonnances ou la pharmacie familiale). Les populations explorées sont approximativement représentatives de la population française pour les principaux critères socio-démographiques, mais les informations sur les caractéristiques des non-participants sont rarement documentées. Comme nous l'avons déjà souligné, ce biais de sélection favorise toutefois l'inclusion de personnes moins susceptibles de faire usage de psychotropes, et sous-estimerait plutôt la fréquence d'usage. Les données issues des caisses d'assurance maladie ont les limites inhérentes au fait que ces bases de données n'ont pas pour vocation première d'être exploitées à des fins de recherche, et que l'information sur l'usage est issue de données sur le remboursement de prescriptions. L'évolution des usages de médicaments psychotropes au cours du temps ne peut actuellement être estimée qu'en comparant les données d'études transversales reposant sur des méthodes différentes. On ne dispose pas à ce jour de données issues d'une étude pharmaco-épidémiologique dont l'objectif principal serait d'évaluer de manière détaillée l'usage de psychotropes dans la population française et les caractéristiques des consommateurs. L'absence d'une telle étude de cohorte portant sur un échantillon représentatif avec un suivi prospectif de plusieurs années est particulièrement regrettable, car seul ce type d'étude permettrait d'évaluer, pour un coût relativement modeste, l'évolution des consommations, et donc éventuellement l'impact de mesures visant à modifier l'usage des psychotropes en France. 1. Begaud B. Dictionary of Pharmacoepidemiology. Chichester: John Wiley & Sons, 2000. 2. Begaud B, Costagliola D. La pharmaco-épidémiologie en France. Evaluation des médicaments après leur mise sur le marché. Etat des lieux et propositions. Rapport réalisé à la demande de la DGS et de l'Afssaps, 2006. 3. Alonso J, Angermeyer MC, Bernert S, Bruffaerts R, Brugha TS, Bryson H, et al. Sampling and methods of the European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) project. Acta Psychiatr Scand Suppl 2004:8-20. 4. Alonso J, Angermeyer MC, Bernert S, Bruffaerts R, Brugha TS, Bryson H, et al. Psychotropic drug utilization in Europe: results from the European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) project. Acta Psychiatr Scand Suppl 2004:55-64. 5. Demyttenaere K, Bruffaerts R, Posada-Villa J, Gasquet I, Kovess V, Lepine JP, et al. Prevalence, severity, and unmet need for treatment of mental disorders in the World Health Organization World Mental Health Surveys. JAMA 2004;291:2581-90. 6. Gasquet I, Negre-Pages L, Fourrier A, Nachbaur G, El-Hasnaoui A, Kovess V, et al. [Psychotropic drug use and mental psychiatric disorders in France; results of the general population ESEMeD/MHEDEA 2000 epidemiological study]. Encephale 2005;31:195-206. 7. American Psychiatric Association. DSM-IV. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th Edition. Washington, DC., 1994. 8. Lepine JP, Gasquet I, Kovess V, Arbabzadeh-Bouchez S, Negre-Pages L, Nachbaur G, et al. [Prevalence and comorbidity of psychiatric disorders in the French general population]. Encephale 2005;31:182-94. 9. Alonso J, Angermeyer MC, Bernert S, Bruffaerts R, Brugha TS, Bryson H, et al. Prevalence of mental disorders in Europe: results from the European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) project. Acta Psychiatr Scand Suppl 2004:21-7. 10. Ohayon MM, Lader MH. Use of psychotropic medication in the general population of France, Germany, Italy, and the United Kingdom. J Clin Psychiatry 2002;63:817-25. 11. Bellamy V, Roelandt J, Caria A. Troubles mentaux et représentations de la santé mentale: premiers résultats de l'enquête Santé Mentale en Population Générale. Etudes et Résultats, DREES 2004;n°347:1-12. 12. Organisation Mondiale de la Santé. Classification Internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement (CIM-10/ICD-10). Critères diagnostiques pour la recherche. Traduction coordonnée par CB Pull. Paris, 1994. 13. Rouillon F, Blachier C, Dreyfus JP, Bouhassira M, Allicar MP. [Pharmaco-epidemiologic study of the use of antidepressant drugs in the general population]. Encephale 1996;22 Spec No 1:39-48. 14. Bouhassira M, Allicar MP, Blachier C, Nouveau A, Rouillon F. Which patients receive antidepressants? A 'real world' telephone study. J Affect Disord 1998;49:19-26. 15. Olie JP, Elomari F, Spadone C, Lepine JP. [Antidepressants consumption in the global population in France]. Encephale 2002;28:411-7. 16. Lagnaoui R, Depont F, Fourrier A, Abouelfath A, Begaud B, Verdoux H, et al. Patterns and correlates of benzodiazepine use in the French general population. Eur J Clin Pharmacol 2004;60:523-9. 17. Fourrier A, Gasquet I, Allicar MP, Bouhassira M, Lepine JP, Begaud B. Patterns of neuroleptic drug prescription: a national cross-sectional survey of a random sample of French psychiatrists. Br J Clin Pharmacol 2000;49:80-86. 18. Brunot A, Lachaux B, Sontag H, Casadebaig F, Philippe A, Rouillon F, et al. [Pharmaco-epidemiological study on antipsychotic drug prescription in French Psychiatry: Patient characteristics, antipsychotic treatment, and care management for schizophrenia]. Encephale 2002;28:129-38. 19. Lachaux B, Casadebaig F, Philippe A, Ardiet G. [Pharmaco-epidemiology of antipsychotic prescription practices for schizophrenic patients (1995 and 1998 cross sectional surveys)]. Encephale 2004;30:46-51. 20. Gasquet I, Gury C, Tcherny-Lessenot S, Quesnot A, Gaudebout P. Patterns of prescription of four major antipsychotics: a retrospective study based on medical records of psychiatric inpatients. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2005;14:805-11. 21. Blin P, Olie JP, Sechter D, Petitjean F, Cialdella P, Gerard A, et al. [Neuroleptic drug utilization among schizophrenic outpatients]. Rev Epidemiol Sante Publique 2005;53:601-13. 22. Grolleau A, Cougnard A, Parrot M, Kalmi E, Desage A, Misdrahi D, et al. Pratiques de prescription des traitements antipsychotiques dans les premieres hospitalisations pour épisode psychotique : étude sur une cohorte de patients hospitalisés dans deux hôpitaux girondins. Encephale 2006;sous presse. 23. Martin K, Begaud B, Verdoux H, Lechevallier N, Latry P, Moore N. Patterns of risperidone prescription: a utilization study in south-west France. Acta Psychiatr Scand 2004;109:202-6. 24. Verdoux H, Cougnard A, Grolleau S, Besson R, Delcroix F. How do general practitioners manage subjects with early schizophrenia and collaborate with mental health professionals? A postal survey in South-Western France. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2005;40:892-8. 25. Verdoux H, Cougnard A, Grolleau S, Begaud B. Impact of visits from pharmaceutical company representatives on antipsychotic prescription in primary care. Schizophr Res 2005;77:107-9. 26. Ashcroft DM, Frischer M, Lockett J, Chapman SR. Variations in prescribing atypical antipsychotic drugs in primary care: cross-sectional study. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2002;11:285-9. 27. Kaye JA, Bradbury BD, Jick H. Changes in antipsychotic drug prescribing by general practitioners in the United Kingdom from 1991 to 2000: a population-based observational study. Br J Clin Pharmacol 2003;56:569-75. 28. Paterniti S, Bisserbe JC, Alperovitch A. [Psychotropic drugs, anxiety and depression in the elderly population. The EVA study]. Rev Epidemiol Sante Publique 1998;46:253-62. 29. Lechevallier-Michel N, Gautier-Bertrand M, Alperovitch A, Berr C, Belmin J, Legrain S, et al. Frequency and risk factors of potentially inappropriate medication use in a community-dwelling elderly population: results from the 3C Study. Eur J Clin Pharmacol 2005;60:813-9. 30. Fourrier A, Letenneur L, Dartigues JF, Moore N, Begaud B. Benzodiazepine use in an elderly community-dwelling population. Characteristics of users and factors associated with subsequent use. Eur J Clin Pharmacol 2001;57:419-25. 31. Kopferschmitt J, Meyer P, Jaeger A, Mantz JM, Roos M. [Sleep disorders and use of psychotropic drugs in 6-year-old children]. Rev Epidemiol Sante Publique 1992;40:467-71. 32. Levy L, Martin-Guehl C, Lechevallier-Michel N, Noize P, Moore N, Latry P, et al. Use of psychotropic drugs in 0 to 5 years old children in Aquitaine (France): prevalence and associated factors. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2006. 33. Pelissolo A, Notides C, Lepine JP, Bisserbe JC. Anxiolytic and hypnotic use by general hospital inpatients. The impact of psychopathology and general medical conditions. Gen Hosp Psychiatry 1999;21:79-86. 34. Schirm E, Tobi H, Zito JM, de Jong-van den Berg LT. Psychotropic medication in children: a study from the Netherlands. Pediatrics 2001;108:E25. 35. Hugtenburg JG, Heerdink ER, Egberts AC. Increased psychotropic drug consumption by children in the Netherlands during 1995-2001 is caused by increased use of methylphenidate by boys. Eur J Clin Pharmacol 2004;60:377-9. 36. Jick H, Kaye JA, Black C. Incidence and prevalence of drug-treated attention deficit disorder among boys in the UK. Br J Gen Pract 2004;54:345-7. 37. Schmidt-Troschke SO, Ostermann T, Melcher D, Schuster R, Erben CM, Matthiessen PF. [The use of methylphenidate in children: analysis of prescription usage based in routine data of the statutory health insurance bodies concerning drug prescriptions]. Gesundheitswesen 2004;66:387-92. 38. Frances C, Hoizey G, Millart H, Trenque T. Paediatric methylphenidate (Ritalin) restrictive conditions of prescription in France. Br J Clin Pharmacol 2004;57:115-6. 39. Bennett K, Teeling M, Feely J. Overprescribing antidepressants to children: pharmacoepidemiological study in primary care. BMJ 2005;331:1451-2. 40. Murray ML, de Vries CS, Wong IC. A drug utilisation study of antidepressants in children and adolescents using the General Practice Research Database. Arch Dis Child 2004;89:1098-102. 41. Fegert JM, Kolch M, Zito JM, Glaeske G, Janhsen K. Antidepressant use in children and adolescents in Germany. J Child Adolesc Psychopharmacol 2006;16:197-206. 42. Verger P, Aulagnier M, Protopopescu C, Villani P, Gourrheux JC, Bouvenot G, et al. Hypnotic and tranquillizer use among general practitioners in south-eastern France and its relation to occupational characteristics and prescribing habits. Fundam Clin Pharmacol 2004;18:379-85. 43. Zarifian E. Mission générale concernant la prescription et l'utilisation des médicaments psychotropes en France. Paris: Odile Jacob, 1996. 44. Lecadet J, Vidal P, Baris B, Vallier N, Fender P, Allemand H, et al. Médicaments psychotropes : consommation et pratiques de prescription en France métropolitaine. I. Données nationales, 2000. Revue Médicale de l'Assurance Maladie 2003;34:75-84. 45. Lecadet J, Vidal P, Baris B, Vallier N, Fender P, Allemand H, et al. Médicaments psychotropes : consommation et pratiques de prescription en France métropolitaine. II. Données régionales, 2000. Revue Médicale de l'Assurance Maladie 2003;34:233-48. 46. Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAM-TS) Direction des Etudes et des Statistiques. Prescriptions médicales et disparités géographiques. Point de conjoncture n°31-32. CNAM-TS, 2004:50. 47. Médistat'. Evolution récente de la consommation des antidépresseurs. Les analyses statistiques du service médical de la région Midi-Pyrénées,CNAM-TS 2004;11:1-8. 48. Schick J, Willem P, Weill G. Prescriptions de médicaments psychotropes aux enfants et aux adolescents. Revue Médicale de l'Assurance Maladie 2004;35:13-18. 49. Caisse Nationale d'Assurance Maladie des professions indépendantes (CANAM). Etude sur la prescription des psychotropes dans le régime des professsions indépendantes. Etude de phase I. CANAM, 1997:62. 50. Caisse Nationale d'Assurance Maladie des professions indépendantes (CANAM). La prescription de psychotropes en ambulatoire. Etude réalisée par six services médicaux régionaux du régime d'assurance maladie des professsions indépendantes en 1996. CANAM, 1997:7. 51. Caisse Nationale d'Assurance Maladie des professions indépendantes (CANAM). Etude sur la prescription des psychotropes dans le régime des professsions indépendantes. Etude de phase II. CANAM, 1999:43. 52. Mutuelle Sociale Agricole (MSA). Examens de santé de la MSA :des données d'informations précieuses. 2004:1-5. 53. Agence du médicament. Observatoire National des Prescriptions et Consommations des Médicaments. Etude de la prescription et de la consommation des antidépresseurs en ambulatoire. Direction des Etudes et de l'Information Pharmaco-Economiques, 1998:29. 54. Guignon N, Mormiche P, Sermet C. La consommation régulière de psychotropes. Insee Première 1994;310. 55. Rapport de l'Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies. Drogues et dépendances - Indicateurs et tendances 2002. Drogues et Dépendances. OFDT, 2002. 56. Rapport de l'Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies. Drogues et dépendances, données essentielles - Synthèse. Drogues et Dépendances. OFDT, 2005. 57. Cadet-Taïrou A, Canarelli T. Consommation des médicaments psychotropes, état des lieux. OFDT, A paraître (2006). 58. Beck F, Legleye S. Les adultes et les drogues en France: niveaux d'usage et évolutions récentes. Tendances, OFDT 2003;n°30:1-6. 59. Beck F, Legleye S, Spilka S. Drogues à l'adolescence : Niveaux et contextes d'usage de cannabis, alcool, tabac et autres drogues à 17-18 ans en France -ESCAPAD 2003. Rapport d'études. OFDT, 2004:251. 60. Beck F, Legleye S, Spilka S. Cannabis, alcool, tabac et autres drogues à la fin de l'adolescence : usages et évolutions récentes ESCAPAD 2003. Tendances, OFDT 2004;n°39:1-4. 61. Beck F, Legleye S, Spilka S. Consommations de produits psychoactifs des jeunes Français : une approche régionale - Exploitation de l'enquête ESCAPAD 2002/2003 en métropole et outre-mer. Tendances, OFDT 2005;n°43:1-4. 62. Beck F, Legleye S, Spilka S. Atlas régional des consommations de produits psychoactifs des jeunes français : Exploitation régionale de l'enquête ESCAPAD 2002/2003. Rapport d'études. OFDT, 2005:224. 63. Choquet M, Beck F, Hassler C, Spilka S, Morin D, Legleye S. Les substances psychoactives chez les collégiens et lycéens : consommations en 2003 et évolutions depuis dix ans. Tendances, OFDT 2004;n°35:1-6. 64. Guilbert P, Baudier F, Gautier A, Goubert AC, Arwidson P, Janvrin MP. Baromètre santé 2000: Méthodes. INPES, 2001:144. 65. Guilbert P, Bautier F, Gautier A, (sous la direction). Baromètre santé 2000: Résultats. INPES, 2001:480. 66. Guilbert P, Gautier A, Baudier F, Trugeon A, (sous la direction). Baromètre santé 2000: Les comportements des 12-25 ans: Synthèse des résultats nationaux et régionaux. INPES, 2004:216. 67. Baudier F, Arenes J, Guilbert P, Janvrin MP, Le Bihan G, Michaud C, et al. Health Barometers in France 1995/1999. Key Findings. Barometres. CFES, 2001:76. 68. Commission-Européenne. Statistiques de la santé. Chiffres clés sur la santé 2002. Données 1970-2001. Panorama de l'Union européenne. Commission-Européenne, 2002:472. 69. Chambaretaud S. La consommation de médicaments dans les principaux pays industrialisés. Etudes et Résultats, DREES 2000;n°47:1-8. 70. Bac C, Cornilleau G. Comparaison internationale des dépenses de santé : une analyse des évolutions dans sept pays depuis 1970. Etudes et Résultats, DREES 2002;n°175:1-12. 71. Verdoux H, Tignol J. Focus on psychiatry in France. Br J Psychiatry 2003;183:466-71. 72. Nguyen-Kim L, Or Z, Paris V, Sermet C. Les politiques de prise en charge des médicaments en Allemagne, Angleterre et France. Questions d'économie de la santé, IRDES 2005;n°99:1-6. 73. Kovess V, Brugha T, Carta MG, Lehtinen V. The state of mental health in the European Union. European Community, 2004:79. 74. Médic'Assurance Maladie. Les médicaments remboursés par le régime général d'Assurance Maladie au cours des années 2001 et 2002. CNAM-TS, 2003. 75. Médic'Assurance Maladie. Les médicaments remboursés en 2003 et 2004 par le régime général d'Assurance Maladie. http://www.ameli.fr/244/DOC/2333/article.html, 2005. 76. Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFFSaPS). Analyse des ventes de médicaments aux officines et aux hôpitaux en France 1993-2003 5ème édition. AFFSaPS, 2005:116. 77. Balsan D, Chambaretaud S. La croissance des dépenses de médicaments remboursables d'août 1998 à juillet 2000. Etudes et Résultats, DREES 2001;n°102:1-8. 78. Balsan D, Chambaretaud S. Les dépenses de médicaments remboursables entre 1998 et 2001. Version corrigée. Etudes et Résultats,DREES 2002;n°166:1-8. 79. Amar E. Les dépenses de médicaments remboursables en 2002. Etudes et Résultats, DREES 2003;n°240:1-8. 80. Amar E. Les dépenses de médicaments remboursables en 2003 : une contribution renforcée des produits nouveaux. Etudes et Résultats, DREES 2004;n°324:1-8. 81. Amar E, Balsan D. Les ventes d'antidépresseurs entre 1980 et 2001 - Document de travail. Série Etudes, DREES 2003;n°36:1-55. 82. Le Pape A, Paris V, Sermet C. Impact d'une politique de forfaits de remboursement en France. L'exemple des antidépresseurs et des antihypertenseurs. Questions d'économie de la santé, CREDES 2000;n°29:1-4. 83. Paykel ES, Priest RG. Recognition and management of depression in general practice: consensus statement. BMJ 1992;305:1198-202. III.- QUESTION 2 « QUELS SONT LES PRINCIPAUX FACTEURS EXPLICATIFS DE CETTE ÉVOLUTION ? » Présenter les principales raisons du niveau élevé de la consommation de médicaments psychotropes en France. Analyser notamment : - les comportements de prescription (médicaux, relationnels et financiers) des médecins, en précisant notamment le taux de médicaments prescrits par les médecins généralistes ainsi que la proportion d'entre eux qui s'adressent pour avis à un spécialiste, en évaluant la qualité de leur formation, initiale et continue, et en présentant les conditions d'évaluation de leurs pratiques professionnelles ; - les perceptions des assurés quant à leur attitude de consommation, et, au niveau national, les éléments d'ordre socioculturel contribuant à expliquer ce niveau de consommation élevé en France ; - les actions mises en oeuvre par les industries pharmaceutiques afin d'encourager la consommation de ces médicaments. Intégrer à la réponse des éléments de comparaison européenne. Pour répondre à cette question, nous avons eu recours à une approche pluridisciplinaire faisant appel à l'expertise de sociologues et de spécialistes du droit de la santé. Des entretiens ont également été conduits auprès de responsables des organismes sanitaires, de personnes travaillant dans l'industrie pharmaceutique et dans des revues médicales. Les réponses concernant la formation des médecins et l'évaluation des pratiques professionnelles seront traitées dans les réponses aux Questions 4 et 5. Ce chapitre a été rédigé par Livia Velpry et Philippe Le Moigne, Centre de Recherche Psychotropes, Santé Mentale, Société (CESAMES), CNRS UMR 8136/ INSERM U 611, Université Paris V. Le regard des sciences sociales sur la consommation des médicaments psychotropes apporte une contribution spécifique. Il se distingue du regard clinique ou épidémiologique en ce qu'il ne s'appuie pas sur une définition préalable de la santé : il cherche plutôt à comprendre comment les états, physiques ou psychiques, placés sous ce registre par l'ensemble des acteurs du soin affectent le contenu et la dynamique de dernier. Il devient ainsi possible de comprendre pourquoi la distribution des consommateurs, comme l'usage des médicaments psychotropes lui-même, ne recouvre pas, loin s'en faut, les normes administratives et cliniques de leurs indications. Au-delà des explications biochimiques et psychopathologiques, le regard des sciences sociales consiste à rendre compte de la distribution des prescriptions à partir des logiques sociales, à savoir, essentiellement, à partir des caractéristiques de la pratique de travail de la médecine générale, d'une part, du profil et des attentes de ses publics, d'autre part. La consommation des médicaments psychotropes est parfois associée à une pratique des classes supérieures, auquel cas, elle est assimilée à « une pharmacologie cosmétique », c'est-à-dire non pas à une logique de soin, mais plutôt à une « élévation » chimique des capacités personnelles, ou à une gestion optimisée de la vie quotidienne. A l'inverse, cette consommation a pu être également associée à une médication des plus pauvres, et saisie sous ce thème comme un nouvel « assommoir moderne », suscitant l'intoxication des plus démunis ou une gestion pharmaceutique des problèmes sociaux, à l'égard en particulier de « la jeunesse en difficulté ». Hors des populations traitées, les missions associées aux médicaments psychotropes ont fait l'objet de perceptions tout aussi tranchées. Elles sont assimilées à une prescription de la « folie » et continuent à ce titre d'éveiller la crainte et parfois la stigmatisation des patients traités par ce moyen. Ou bien, le médicament psychotrope est censé induire des formes de dépendance et nuire au libre arbitre des consommateurs, et incarne un dévoiement des politiques de santé publique. A l'inverse, les psychotropes ont pu être considérés comme des médicaments de confort dont l'utilité est discutée, sinon niée, au motif qu'il comblerait d'abord un défaut de la volonté1. La poussée récente des antidépresseurs est souvent interprétée dans ces derniers termes, leur diffusion semblant confirmer en outre l'opinion selon laquelle les médecins prescrivent trop facilement, et le plus souvent, à mauvais escient. Au regard des données disponibles, la plupart de ces opinions doivent être considérées comme autant d'idées reçues. La littérature inviterait plutôt à mettre l'accent sur deux éléments cardinaux. D'une part, la consommation des médicaments psychotropes est loin d'être monolithique ; elle est traversée par des tendances multiples et contrastées. D'autre part, il y a loin entre cette prescription et une pure médecine du psychisme : l'usage des médicaments psychotropes cristallise dans les faits une multitude d'indications qui vont de la gestion de la douleur à la prise en charge de la souffrance devant les accidents de l'existence. Pour donner à voir cette diversité et cette complexité, nous proposons ici une démarche en trois temps : 1) Nous aborderons en premier lieu la question du degré « élevé » de la consommation à partir du niveau de prescription de chacune des classes de psychotropes et de leur association avec les autres prescriptions pharmaceutiques. L'étude de l'ensemble des médicaments prescrits à un patient permettra d'observer que ce type de prescription est d'abord le signe d'une ordonnance fournie en produits pharmaceutiques en général. Cette prescription est, en ce sens, à l'image de l'engouement que le médicament connaît en France. 2) Sont ensuite abordées les caractéristiques démographiques des personnes traitées, afin de montrer que l'âge et le genre sont des facteurs discriminants. Pour comprendre la distribution de la consommation, il faut absolument distinguer la prévalence de l'usage dans la population de la durée des prescriptions. Cette distinction étant établie, la consommation paraît se diffracter en deux groupes : une majorité de consommateurs pour laquelle l'usage est ponctuel ; une minorité pour lesquels la chronicité du recours est indiscutable. En ce sens, la question de la durée est capitale : elle permet de dégager des profils de patients et des motifs de soin extrêmement différenciés. 3) La distribution générale de la consommation étant décrite, seront discutés les facteurs sociaux susceptibles de l'expliquer. A ce titre, sont d'abord analysées les logiques de prescription des médecins généralistes, de loin les principaux prescripteurs. On comprendra à cette occasion pourquoi et comment les médecins généralistes sont appelés à prescrire « en dehors des recommandations thérapeutiques », et on montrera l'utilité de considérer les modes de prescription dans un cadre de réflexion intégrant d'autres normes d'indication. On se penchera ensuite sur les ressorts de la consommation, tels qu'ils peuvent être identifiés auprès des usagers eux-mêmes, en vue de dégager, notamment, les différents facteurs intervenant dans l'arrêt ou la continuation de la prise de médicaments psychotropes. D'un point de vue méthodologique, nous nous appuyons sur une synthèse de résultats des travaux disponibles avec, comme difficulté, l'absence de comparabilité des données : comme cela a déjà été souligné dans la réponse à la Question 1, les études disponibles s'appliquent rarement aux mêmes échantillons de populations et ne s'appuient pas sur les mêmes critères de définition de l'usage ou de la chronicité. Toutefois, on doit souligner l'étonnante convergence des résultats de ces études, qu'elles soient françaises ou non. Ce constat oblige à considérer que des facteurs et rationalités homogènes entourent la consommation des médicaments psychotropes dans les pays occidentaux. Il invite à relativiser l'idée d'une « spécificité française » dans ce domaine. Pour illustrer notre propos, nous aurons recours à de nombreuses reprises à l'étude réalisée par Le Moigne et collaborateurs2 à partir des données de la CPAM de Rouen. Cette enquête est l'une des seules en France à avoir tenté d'inspecter l'ensemble des variables d'intérêt (données pharmaceutiques, démographiques, profil socio-économique des publics consommateurs, incidence de l'activité médicale, etc.), et à avoir doublé cette analyse d'une campagne d'interviews auprès de prescripteurs et d'usagers des produits. Les conclusions de cette enquête permettront d'affiner la compréhension des constantes mises au jour par la recherche, tant nationale qu'internationale. 2. La prescription : une distribution contrastée a) Un indicateur de la prescription pharmaceutique À quelle hauteur les différentes classes de psychotropes sont-elles prescrites et quelle évolution dénote-t-on dans ce domaine depuis ces dix dernières années ? Jusqu'au début des années 1990, les anxiolytiques et les hypnotiques représentaient l'essentiel des prescriptions de psychotropes, soit 80 % des ordonnances, même si les antidépresseurs renforçaient leur position dès cette Des médicaments associés à une médication somatique Comme cela a déjà été souligné dans la réponse à la Question 1, la prescription des psychotropes s'inscrit dans celle, plus large, des prescriptions de produits pharmaceutiques en général9. Comprendre ce phénomène impose de considérer en détail les co-prescriptions. Les études montrent que la prescription de psychotropes est souvent associée à celle de médicaments relevant d'autres spécialités : 80 % des ordonnances contenant des psychotropes comportent d'autres gammes de produits2 (Tableau 59). Les trois principales classes concernées sont les thérapeutiques cardio-vasculaires (49 % des ordonnances incluant un médicament psychotrope), des voies digestives et du métabolisme (41 %) et du système nerveux central, psychotropes exceptés (40 %). La prescription des médicaments psychotropes s'intègre donc pour une large part à une polythérapie pharmaceutique, pouvant expliquer, la chronicité de certains traitements. En effet, on observe dans la durée une corrélation entre le nombre de psychotropes prescrits et le nombre total d'ordonnances délivrées en pharmacie aux patients2 (Figure 16). Ceci suggère que la prescription de psychotropes accompagne la morbidité organique, en particulier la prévention du risque cardio-vasculaire, les problèmes digestifs, et à un degré moindre, les douleurs rhumatismales. Dans la mesure où ces pathologies présentent elles-mêmes un caractère de chronicité, les prescriptions de médicaments psychotropes tendent elles-mêmes à devenir chroniques. Tableau 59. Association des médicaments psychotropes aux autres spécialités pharmaceutiques (unité : ordonnance)2
Ces données s'appliquent à l'ensemble des prescriptions d'un échantillon aléatoire de 10 295 patients de la CPAM de Rouen ayant adressé au moins une demande de remboursement à la Caisse pour des médicaments psychotropes entre 2000 et 2002. Figure 16. Prescriptions de médicaments psychotropes et nombre d'ordonnances reçues en pharmacie (Unité : patient)2
Ces données de co-prescription ne permettent toutefois pas d'évaluer la part des troubles psychiques somatoformes (dont l'expression est organique) ou « psychosomatiques », dans ces co-prescriptions. Une certitude néanmoins : l'organisation des ordonnances permet d'observer combien la délivrance des médicaments psychotropes par les généralistes, principaux prescripteurs des produits, demeure associée à une médecine sinon à une « clause » organique. Par contraste, seules 18 % des ordonnances comprenant des médicaments n'incluent que ce type de produit. En ce sens, la consultation de médecine générale ne se solde que de manière exceptionnelle par une prescription où seule la question psychique serait traitée, à l'instar des traitements ordonnés dans le cadre des consultations psychiatriques. La co-prescription des médicaments psychotropes : une clinique du psychisme ? La prescription des médicaments psychotropes s'associe à une prescription élevée de produits pharmaceutiques. En revanche, les ordonnances traduisent rarement une « surcharge » de prescriptions en psychotropes. De façon générale, ces médicaments sont rarement prescrits en association. Ainsi, lorsque l'ordonnance comprend des médicaments psychotropes, dans plus de 60 % des cas, un seul produit de la classe est prescrit2 (Tableau 60). Ceci est particulièrement vrai pour les hypnotiques. Les neuroleptiques constituent une exception dans la mesure où ils sont plus souvent prescrits avec un autre psychotrope (75 % des cas), ils ne représentent cependant qu'une part marginale des prescriptions. Dans les cas d'une association entre plusieurs molécules, ce sont les antidépresseurs qui sont les plus souvent présents. A cet égard, l'association d'un antidépresseur et d'un anxiolytique dépasse, et a remplacé, celle plus classique des benzodiazépines entre elles, qu'il s'agisse d'anxiolytiques ou d'hypnotiques. L'apparition des ISRS a ainsi pour partie modifié les modes de prescription en créant un phénomène de « polythérapie interpsychotropes », contribuant ainsi à la croissance d'ensemble de la prescription. Tableau 60. La co-prescription des médicaments psychotropes (unité : ordonnance)2
Conclusion En médecine générale, l'usage des médicaments psychotropes est toujours à resituer dans le cadre d'une prise en charge globale du patient. Cette particularité permet de comprendre pourquoi ces produits sont prescrits avec d'autres classes de médicaments, et pourquoi le traitement de la plainte psychique s'entremêle à une plainte ou une morbidité somatique. Face à la progression des prescriptions d'ISRS à un rythme plus rapide que celle de la prescription générale de psychotropes, la question qui se pose est de savoir si l'augmentation des prescriptions d'antidépresseurs s'est faite en remplacement de celle des benzodiazépines (hypothèse d'une pure substitution) ou par surcroît (hypothèse d'une extension des troubles traités). L'hypothèse de la substitution laisserait à penser que le produit délivré change alors que les problèmes traités demeurent. De fait, il est probable que les médecins généralistes ont partiellement substitué les benzodiazépines par des antidépresseurs, notamment pour le traitement de l'insomnie. Pour autant, la large diffusion des antidépresseurs semble également indiquer une prise en charge plus spécifique de nouveaux troubles psychiques en médecine générale2. On a donc probablement affaire à la conjugaison d'un phénomène de substitution et d'extension. Ainsi, si la pratique des médecins généralistes demeure bien ancrée dans le cadre d'une médecine somatique, elle témoigne aujourd'hui d'une ouverture plus manifeste aux questions de santé mentale. Cette ouverture ne signifie pas que le médecin généraliste prend en charge davantage de troubles psychiques qualifiés : comme on va le voir, il y serait plutôt question de traiter du mal-être ou de la souffrance psychique, indépendamment des questions relatives à la douleur ou aux conséquences mentales d'un problème organique. Pour mieux comprendre cette évolution, son étendue et sa complexité, l'étude des populations auxquelles ces médicaments sont prescrits s'impose. b) Les populations prescrites : distinguer la diffusion de la consommation de sa durée La plupart des études dessinent le portrait d'un « consommateur moyen » d'antidépresseurs qui ressemble au consommateur d'anxiolytiques et d'hypnotiques du passé : comme évoqué dans la réponse à la Question 1, il s'agit d'une femme d'environ 50 ans, ayant reçu une éducation primaire ; elle est inactive ou au chômage, et possède des revenus moyens, voire faibles. Ce portrait s'associe à une série de traits permettant de mieux typer le contexte social de la prescription : morbidité organique importante, milieu social intermédiaire, isolement social important et cumul des événements de vie9 ; globalement, le genre et les définitions sociales des rôles sexuels sur l'accès au soin ; l'âge ; un niveau d'éducation et un statut socioprofessionnel de rang moyen ; la précarité de la vie professionnelle et les difficultés économiques, constituent les variables les plus souvent retrouvées dans la littérature5 9. Ainsi, en plus du fait d'être dominée par les femmes et les personnes âgées, la population consommatrice serait issue dans sa grande majorité des milieux populaires (ouvriers, employés) et des classes moyennes (les professions intermédiaires) ; les classes supérieures (cadres en particulier) et les plus pauvres seraient moins concernées par l'usage. Avant d'aborder la question du milieu social, on privilégiera l'étude des facteurs démographiques de la consommation, de loin, les plus discriminants. En effet, l'âge et le genre offrent une lecture immédiate de la prévalence et de la durée des consommations dans la population. Ils permettent de distinguer des publics davantage prescrits mais de manière conjoncturelle, de groupes de consommateurs, plus minoritaires, mais dont le recours est chronique. La prévalence de la prescription : la surreprésentation des femmes et des personnes âgées La surreprésentation des femmes est un phénomène constant et très bien documenté5, qui se vérifie à tous les âges, sauf pour les moins de 15 ans (Figure 17). Soulignons que cette surreprésentation féminine n'est pas spécifique aux psychotropes, et concerne les médicaments dans leur ensemble. Parmi les explications données, il est souvent fait mention d'une plus grande proximité à l'égard de l'appareil de soin, et d'une définition du mal-être plus souvent exprimé sous la forme d'une plainte psychique. Cette formulation serait d'ailleurs largement anticipée sinon proposée par les prescripteurs eux-mêmes2 10-12. Autrement dit, la consommation féminine n'est pas nécessairement à imputer à une plus grande vulnérabilité, mais à un effet de recrutement : l'accès au soin des hommes, jeunes en particulier, demeure en effet sans commune mesure avec celui des femmes. En outre, la communication de son mal-être auprès du médecin semble plus accessible aux femmes, de la même manière qu'elle semble davantage attendue par les médecins10. Figure 17. Distribution par âge et par sexe des assurés prescrits en médicaments psychotropes (CPAM Rouen 2000-2002)2
Le taux fort de prescription de psychotropes chez les personnes âgées a déjà été évoqué dans la Question 1. Depuis 2000, la part de personnes âgées, notamment des plus de 75 ans, a encore augmenté. Cette croissance peut être expliquée par le vieillissement général de la population, c'est-à-dire par l'augmentation de l'espérance de vie. Cette augmentation, passé 75 ans, s'applique en majorité aux femmes ; ce vieillissement est porteur de morbidités spécifiques que la prescription des médicaments psychotropes traite en propre, d'où notamment la poussée des prescriptions de neuroleptiques à l'intérieur de ces groupes d'âges (Figures 18, 19, 20, 21). Quels sont les facteurs qui permettent d'expliquer la plus grande représentation des personnes âgées ? Mishara13 a tenté de dresser la liste des éléments explicatifs de la relation observée entre âge et consommation de psychotropes. Cette liste est longue. Ainsi, la pratique de prescription des médecins, le rôle des institutions de soin ; les croyances des personnes âgées à l'égard de la santé et des médicaments psychotropes en particulier ; l'influence du genre, du déclin des relations sociales, de la multiplication des événements de vie ; l'incidence des épisodes d'hospitalisation, de l'état de santé physique, ou bien encore de l'altération de la santé mentale, offrent au regard de la littérature mobilisée par l'auteur autant de pistes plausibles d'interprétation. Peut-on néanmoins mettre au jour des facteurs prépondérants pour expliquer le rôle exercé par l'âge sur la consommation de médicaments psychotropes ? La surreprésentation des personnes âgées a fait l'objet d'hypothèses multiples, souvent étudiées séparément5, de sorte qu'il est rarement possible de proposer un modèle explicatif qui permettrait de pondérer le poids des différents facteurs. Parmi les hypothèses les plus plausibles, on doit considérer le niveau et le nombre de morbidités déclarées par cette population. A cet égard, la prescription de psychotropes peut être comparée ici à une médication de confort ou à une forme de soins palliatifs. Le second facteur le plus souvent évoqué a trait à l'isolement social de cette population : le départ des enfants, l'accès à la retraite ou l'apparition d'une maladie invalidante ayant pour effet de rompre les liens d'attaches des personnes avec leurs proches ou leurs amis2 4 7 13 14. En somme, c'est à l'ensemble des conséquences, tant physiques que sociales, induites par le vieillissement que la prescription des médicaments psychotropes semble s'adresser. Le maintien de la surreprésentation des personnes âgées avec l'arrivée des antidépresseurs tend de son côté à accréditer l'hypothèse de la substitution, c'est-à-dire du remplacement progressif des benzodiazépines par les ISRS. Toutefois, l'évolution de la répartition par âge des prescriptions depuis 10 ans nuance cette conclusion : la diffusion des antidépresseurs va de pair avec l'élargissement des groupes d'âges concernés. Elle s'ouvre vers des publics plus jeunes mais également à des personnes de plus en plus âgées, c'est-à-dire à des populations dont la souffrance psychique ou les troubles mentaux (liés notamment à la sénilité) sont de plus en plus traités pour eux-mêmes. Figures 18, 19, 20, 21. Prescription des classes de médicaments psychotropes selon l'âge (unité : patient - CPAM de Rouen)2
La chronicité de l'usage : une affaire d'âge Pour caractériser les modes de consommation, il faut impérativement intégrer la question de la durée du recours. D'après une étude de Baumann et collaborateurs 9 auprès de consommateurs de psychotropes âgés de 45 à 60 ans, 30 % s'engageront dans une consommation d'au moins deux ans, 30 à 40 % auront un usage prolongé mais inférieur à deux ans, tandis que la même proportion de patients arrêtera sa consommation dans l'année. A noter que cette étude porte sur des personnes volontaires participant à un essai contrôlé de supplémentation en sels minéraux et vitamines, la part des consommateurs de psychotropes dans la cohorte étant plus faible que celle décrite pour la population française. La durée des usages croît de manière linéaire avec l'âge, indépendamment du sexe. Autrement dit, plus le consommateur est âgé, plus sa probabilité de consommer les produits de manière durable est élevée, qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme (Figure 22). Figure 22. Nombre moyen de prescriptions en médicaments psychotropes par classe d'âges (CPAM Rouen, 2000-2002)2
Autrement dit, la population âgée est prescrite de façon particulièrement répétée : entre 2000 et 2002, 20 à 25% des sujets de plus de 65 ans ont été ordonnés plus de 20 fois2. Une part croissante des personnes âgées de plus de 75 ans tend donc aujourd'hui à recevoir des prescriptions de médicaments psychotropes, lesquelles sont sans conteste les plus durables. La part croissante des antidépresseurs dans les prescriptions n'a pas modifié cette structure de consommation, mais en a peut-être infléchi la tendance, en permettant l'allongement des durées de prescription aux âges élevés et un renforcement de la prescription des quinquagénaires. On pourrait penser qu'il y a là un effet de génération. En réalité, il est plutôt question d'un effet du cycle de vie, celui des changements occasionnés par le passage d'un cycle de vie à un autre (entrée dans la vie professionnelle, départ des enfants, rupture conjugale, retraite, apparition d'une maladie invalidante, etc.). 3. De la norme thérapeutique à la pratique médicale Les médecins généralistes sont, comme on l'a dit, prescripteurs de plus de 80% des ordonnances15. Dans le débat public, les médecins généralistes se voient souvent imputer un mode de prescription qui ne respecte pas les AMM, qui déborde du cadre diagnostique, et qui est généralement de trop longue durée. Qu'en sait-on exactement et comment peut-on expliquer les caractéristiques de leur prescription ? Cette question a fait l'objet de nombreuses études internationales qui ont abordé deux problèmes en particulier : l'adéquation de la prescription au diagnostic, d'une part, et plus marginalement, le rôle de la médecine générale dans la division du travail thérapeutique en santé mentale, d'autre part. On verra que pour comprendre les pratiques de prescription, on ne peut s'arrêter au seul critère des indications cliniques ; il faut tenir compte du fait que toute pratique médicale est une pratique sociale. a) L'adéquation clinique de la prescription La question de l'adéquation entre diagnostic et traitement sera développée dans la réponse à la Question 3, où seront présentés les résultats des études pharmaco-épidémiologiques documentant ce point. Les données présentées ici concernent plus spécifiquement la compréhension des logiques de prescription des médecins, et complète ainsi l'approche développée dans le chapitre suivant. L'écart à l'égard des recommandations Les pratiques de prescription des médecins généralistes s'écartent souvent des recommandations thérapeutiques en ce sens qu'elle est marquée par le sous-dosage des produits et une indication de traitement souvent trop courte16. La littérature indique également que les médecins généralistes consacrent en moyenne moins de temps que les psychiatres à leurs patients17, mais c'est comparer deux pratiques qui ne sont pas du tout concernées par le même type de contraintes. Le manque de formation des médecins généralistes a pu être également avancé en vue d'expliquer « l'approximation » de leur prescription18. En réalité, parler d'approximation revient à défendre une norme d'indication, héritée des études cliniques. Une telle perspective ne prête aucun égard aux conditions de l'exercice médical, pas plus qu'elle ne rend justice aux définitions concurrentes du mal-être et de la santé mentale qui traversent le corps social. Or, c'est bien également avec ces définitions que le médecin généraliste doit composer. En outre, la critique d'approximation de la pratique généraliste ne rend pas compte de l'évolution du mode de prescription de la médecine généraliste. Au cours des années 1990, le remplacement de la prescription d'antidépresseurs tricycliques par celle des ISRS semble avoir comblé une partie des différences des pratiques qu'on pouvait observer jusque-là entre psychiatres et généralistes. La tendance vaut pour la France comme pour les Etats-Unis ou l'Angleterre19 20. Le défaut de cible : prescrire hors diagnostic La plupart des études consacrées au diagnostic des populations prescrites en antidépresseurs rapportent un tableau dépressif incomplet. Des constats plus radicaux évoquent un décalage total entre l'indication de la thérapeutique et le profil pathologique des patients traités. Ainsi, pour la population âgée, les antidépresseurs seraient d'abord prescrits en vue d'accompagner, comme les benzodiazépines avant eux, les maladies somatiques chroniques21. En médecine générale, la prescription encadrerait surtout des personnes présentant des signes d'anxiété22 23 ou d'insomnie24. En outre, l'ordonnance incluant des antidépresseurs comprend davantage de médicaments que la moyenne des ordonnances, qu'il s'agisse de médicaments psychotropes ou non. Cette co-prescription est d'autant plus forte et durable (5 ans et plus) lorsque l'antidépresseur a été le premier médicament prescrit25 26. Autrement dit, on retrouverait ici les traits caractéristiques de la carrière thérapeutique des usagers réguliers de benzodiazépines : a) initiation du traitement pour « déprime », « nervosité » ou insomnie ; b) renforcement et chronicité de la thérapeutique sous l'effet des difficultés quotidiennes et de l'apparition d'une maladie organique invalidante2. Le défaut de prise en charge : la sous-prescription des personnes souffrant de dépression Si la prescription hors diagnostic paraît s'appliquer d'abord aux personnes âgées, ou croître avec l'âge du patient, en revanche, le défaut de prise en charge des personnes pour lesquelles un trouble dépressif peut être diagnostiqué concerne d'abord les publics les plus jeunes, à savoir les moins de 30 ans. L'une des raisons susceptibles d'expliquer ce phénomène a trait à l'inégalité de l'accès aux soins. Le recours au système sanitaire est en effet moins important chez les jeunes, en particulier chez les hommes jeunes, d'où la difficulté à mener une politique de prévention et de prise en charge à l'attention de cette population. Les pratiques de prescription des médecins généralistes s'écartent souvent des recommandations thérapeutiques. Cet écart ne doit pas être considéré de façon monolithique car il recouvre des réalités fort diverses : un défaut de cible, un défaut de prescription. L'affirmation selon laquelle les médecins généralistes prescrivent avec excès doit donc être complétée par le fait qu'ils sous-prescrivent également. Parallèlement, il semble en effet que la prescription des ISRS se soit étendue à un public plus large. Ce dernier point amène à considérer l'éventuelle ouverture de la pratique des médecins généralistes aux questions de santé mentale ; question qui n'a pas encore fait en France l'objet d'études approfondies. b) La rationalité thérapeutique des généralistes : la convergence des pratiques Quels sont les facteurs qui organisent la pratique de prescription des médecins généralistes ? Peut-on parler ici d'une hétérogénéité de pratiques ou bien faut-il considérer que les médecins généralistes partagent une même rationalité thérapeutique ? On peut montrer dans ce domaine que, sous l'apparente hétérogénéité des taux de prescription par médecin, la pratique de médecine de ville peut être ramenée à deux facteurs qui transcendent la diversité des modes d'exercice : 1) des normes de prescription partagées par la majorité du corps médical ; 2) le poids exercé par la gestion des clientèles qui n'est pas sans accroître la propension à prescrire des omnipraticiens. Structure de clientèle et pratique de médication Tamblyn et son équipe ont étudié au Québec les prescriptions de plus de Si la prescription des médecins est pour partie indépendante des caractéristiques des publics qu'ils reçoivent, alors il faut imaginer que certains profils professionnels appuient en particulier la médication psychotrope. Tamblyn et son équipe ont mis au jour trois éléments en particulier : l'âge du praticien, sa spécialité et son affiliation universitaire, le sexe du médecin n'intervenant qu'à la marge selon les auteurs. La fréquence de la prescription est d'abord sensible à l'âge du praticien, et connaît un pic chez les médecins de plus de 60 ans. Enfin, les praticiens font part d'habitudes de prescription selon l'université qui les a diplômés. Hormis l'effet de l'âge, on observe que l'attitude de prescription est elle-même marquée par l'apprentissage des indications, de la panoplie pharmaceutique et des normes de prescription, que chaque faculté enseigne28 29. Toutefois, les attitudes professionnelles ne peuvent être qu'en partie dissociées des caractéristiques de la clientèle. Ainsi, deux traits généraux fédèrent la prescription, quel que soit le profil des médecins : les patientes sont toujours davantage prescrites ; le nombre d'ordonnances fléchit chez les patients déjà hospitalisés à plusieurs reprises. Ceci est à mettre au compte d'une sorte de consensus professionnel qui, d'un côté, établit un lien entre vulnérabilité féminine et médication psychotrope, et de l'autre, vise à prévenir l'effet iatrogène chez les patients dont la morbidité est décuplée12. La gestion de la clientèle : le produit et le temps L'augmentation significative du recours à la médication chez les praticiens de plus de 60 ans pourrait suggérer, derrière l'effet âge, un effet de l'ancienneté professionnelle, la pratique professionnelle des "anciens" étant sous l'influence d'apprentissages différents et d'une adhésion plus marquée à la chimiothérapie. On a effectivement pu observer que la prescription pharmaceutique, toutes substances confondues, tend à croître chez les médecins après 10 ans d'exercice30, y compris pour les médicaments psychotropes, de sorte que Hadsall et son équipe ont pu considérer que la propension générale à prescrire constituait le facteur principal d'explication de la prescription des médicaments psychotropes par les médecins31. Dans le même ordre d'idées, il paraît possible d'établir un lien direct entre la durée d'exercice, la prescription de services médicaux (examens biologiques, radiographies, indication à un spécialiste), et la multiplication des actes ou des visites32. Autrement dit, la prescription, qu'elle qu'en soit la nature, croît logiquement à mesure que croît la clientèle du médecin. Ce phénomène requiert une antériorité professionnelle minimale, le temps que la clientèle se constitue ; c'est pourquoi les médecins âgés prescrivent plus souvent. Dans la mesure où l'augmentation de la prescription inclut logiquement les médicaments psychotropes, il devient possible d'établir un lien entre cette médication et l'ancienneté professionnelle. Ainsi, il s'agit moins d'une particularité d'exercice que d'une accélération de la prescription, consécutive à la croissance de la clientèle27 30. Tableau 61. Activité des généralistes selon l'âge : valeurs brutes (Données annuelles 2001)2
Tableau 62. Activité des généralistes selon l'âge : valeurs pondérées en fonction du nombre de patients (Données annuelles 2001)2
Les Tableaux 61 et 62 permettent d'illustrer la relation établie entre l'ancienneté professionnelle et la propension à prescrire. Le premier tableau décrit en valeur brute l'activité de l'ensemble des omnipraticiens du Grand Rouen pour l'année 2001 (N = 406). On observe que le volume de clientèle, le nombre d'actes médicaux, d'indemnités journalières (arrêts de travail) et d'ordonnances pharmaceutiques délivrées, ainsi que le nombre de patients prescrits en médicaments psychotropes augmentent avec l'âge du praticien. Autrement dit, l'activité croît avec l'ancienneté professionnelle, si bien que le volume brut de prescription croît lui-même. Lorsque l'on cherche à évaluer le nombre de prescriptions délivrées à chaque patient, la relation demeure constante (Tableau 62). Autrement dit, avec l'ancienneté, les praticiens tendent à prescrire plus fréquemment : ils délivrent davantage d'actes médicaux et d'ordonnances pharmaceutiques. De la même manière, la part de la clientèle prescrite en médicaments psychotropes croît dans des proportions qui sont sans commune mesure avec l'augmentation de la fréquentation. Ainsi, les grands prescripteurs de médicaments psychotropes, c'est-à-dire les médecins généralistes les plus âgés, sont d'abord de forts prescripteurs en général, qu'il s'agisse d'arrêts de travail ou d'ordonnances pharmaceutiques. Pour autant, la prescription des médicaments psychotropes décrit bien un trait spécifique de l'exercice professionnel. Cormack et Howells ont fait remarquer, à la suite d'une enquête menée par entretiens auprès de 25 médecins, que les grands prescripteurs de benzodiazépines établissent souvent une relation directe entre cette médication et leur charge de travail en considérant que ce type de prescription leur fait gagner du temps de consultation ; en un mot, ils estiment plus profitable de donner un second rendez-vous, après avoir ordonné un médicament psychotrope, plutôt que de prolonger le premier33. Les avantages de ces médicaments seraient ainsi de deux ordres : l'amélioration de la productivité quantitative de l'exercice et la fidélisation de la clientèle. Ce type d'ordonnance offrirait un gain de temps dans la mesure où il permettrait au praticien d'afficher une position dite objective, ou scientifique, qui le dédouanerait d'avoir à s'ouvrir à la situation vécue par le patient. Quant à la fidélisation, l'ordonnance permet de temporiser et de reporter à plus tard, lors d'une seconde entrevue, l'identification du problème. De ce point de vue, la prescription de médicaments psychotropes décrit bel et bien une particularité de l'exercice médical : elle n'accompagne pas seulement la croissance de l'activité professionnelle, elle contribue à la produire. Conclusion : les normes de l'exercice médical En résumé, trois facteurs paraissent aiguiller l'orientation de la pratique de prescription des médecins : - une médecine somatique : comme on l'a vu plus haut, la corrélation entre la prescription de psychotropes et le taux d'ordonnances pharmaceutiques est nette. Une part importante de cette prescription semble ainsi destinée à l'accompagnement de plaintes somatiques, notamment dans le cas des anxiolytiques et des hypnotiques2. En effet, l'une des caractéristiques de la pratique en médecine générale est de mêler indistinctement le traitement des plaintes somatiques et psychiques. C'est pourquoi le traitement des troubles psychiques reste encore largement suspendu ici à une « clause » somatique. Comme le soulignent Baumann et collaborateurs9, « cette liaison peut être due soit à une prescription globale de la part du médecin qui, en plus d'un traitement habituel pour telle ou telle pathologie, prescrit un sédatif sur la demande du patient, soit à une relation directe avec la pathologie traitée (par exemple, un sédatif prescrit dans le cadre d'une pathologie douloureuse) ». - des publics cibles : les médecins généralistes prescrivent également, et heureusement, en vertu du profil du patient. Ici, la prescription intègre la référence à des normes d'identité2. Autrement dit, le choix de prescrire se fonde non seulement sur des critères diagnostiques ou pronostiques (rapport bénéfice/risque de la médication) mais, également, sur les caractéristiques sociodémographiques du patient (âge, statut matrimonial, niveau d'étude, statut d'emploi, etc.)34 35. Cette équation permet d'expliquer la surreprésentation des femmes parmi les publics prescrits9 ou, à l'inverse, la prévention des omnipraticiens contre certaines formes de prescription : on pense en particulier à la réticence longtemps exprimée par le corps médical devant la perspective d'une médication des problèmes sociaux, du chômage notamment1. - une gestion de l'exercice : l'âge du médecin accroît sa propension à prescrire, y compris des antidépresseurs36 37 ; de même, le taux de prescription augmente avec le volume de la clientèle38. Plus les médecins reçoivent de patients quotidiennement, plus ils prescrivent de médicaments en général et de psychotropes en particulier2. Des études comparant le taux de prescription des médecins, à structure de clientèle comparable (sur le plan sociodémographique), ont montré que l'effet de l'âge demeurait constant30. Ceci permet d'apercevoir combien la prescription est liée à la gestion de la clientèle, dans un contexte d'exercice dominé en France par le paiement à l'acte. Ici, la délivrance du médicament représente un moyen de faire face à la cadence des visites, et de gagner du temps de consultation. Autrement dit, prescrire des médicaments, et des médicaments psychotropes en particulier, exprime une manière de composer avec les contraintes, mais également avec les atouts, de l'exercice. c) L'isolement du médecin généraliste Des filières de soin segmentées La prescription des médecins généralistes apparaît liée au cadre de la médecine de ville, mais elle ne se comprend tout à fait que si l'on situe cette médecine dans le cadre plus large de l'organisation des soins en France. Quelle est la place des médecins généralistes dans la division du travail en santé mentale ? Cette question est double : elle porte sur les spécificités psychopathologiques de leur clientèle, d'une part, et sur le chaînage de leur action avec l'ensemble des dispositifs de prise en charge (hospitaliers, libéraux, associatifs, etc.), d'autre part. On considère généralement que la morbidité psychique présentée par la clientèle des médecins généralistes est moins sévère que celle observée par les psychiatres. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'un patient qui présente un trouble psychiatrique caractérisé est systématiquement traité ou renvoyé au spécialiste par le médecin généraliste. Les circuits de prise en charge demeurent mal connus en France. Le constat d'un découplage massif entre la pratique généraliste et les filières de prise en charge des troubles psychiatriques est souvent évoqué, mais mériterait d'être confirmé par des études plus systématiques. Néanmoins, ce découplage est patent dans le domaine de la prévention et du dépistage des pathologies sévères. Ainsi, il n'est pas rare que des personnes souffrant de pathologies mentales soient traitées de façon ponctuelle par les généralistes ; il faut souvent attendre une aggravation manifeste des symptômes pour qu'une orientation vers l'hôpital psychiatrique soit décidée. Un tel constat permet d'entrevoir les limites d'une action thérapeutique fondée sur la prescription pharmaceutique. En l'absence d'une formation sur les troubles psychiatriques et de la mise en place d'une filière de soin, la prescription de médicaments psychotropes ne peut offrir d'appui à une véritable politique de prévention et de dépistage des pathologies psychiatriques les plus sévères. La formation professionnelle, l'évaluation des pratiques : une carence manifeste L'analyse des modes de prescription des médecins généralistes souligne l'importance de la formation, initiale et continue. Dans ce domaine, l'initiation à la psychopathologie, la connaissance des dispositifs de soin psychiatrique paraissent constituer un préalable évident. Or, comme cela sera souligné dans la réponse à la Question 4, la part de la formation médicale initiale dévolue à cet enseignement est notoirement faible39 40. De la même manière, l'évaluation des pratiques professionnelles des médecins généralistes est, pour ainsi dire, restée au point mort en France. Or, il s'agit là d'un levier indispensable, tant à la compréhension qu'à la maîtrise des logiques de prescription du corps médical. 4. Du côté des patients : les logiques de l'usage a) La consommation, des discours aux pratiques Compte tenu de la diffusion du recours aux médicaments psychotropes dans la population, on ne peut parler d'une attitude de consommation unique. Il faut plutôt considérer la diversité des modes de consommation comme un fait. En ce sens, il n'existe pas ici une population cible mais une série de publics dont les caractéristiques doivent être étudiées. L'analyse de la consommation de médicaments psychotropes requiert d'abandonner l'idée : 1) que les propriétés des produits expliquent cette consommation et les caractéristiques de la population traitée, 2) que leur usage correspond à des normes d'indication et de comportement stabilisées. En clair, il n'existe pas d'adéquation entre trouble, prescription et usage médicamenteux, les logiques d'usage et les logiques sanitaires ne se recouvrant qu'imparfaitement. Comprendre ce phénomène exige de décrire les facteurs qui, au-delà de l'argument pharmacologique, organisent dans les faits la profusion et la diversité d'usage des produits. Ces facteurs sont de nature sanitaire (morbidité, normes de prescription), mais dépassent de loin le cadre étroit des codifications médicales. Le propre de l'analyse sociologique est de tenter de comprendre comment, au-delà des catégories de la biologie, de la chimie et de la médecine, patients et médecins ont fini par imposer au recours leurs propres logiques d'action5. Les représentations du médicament : un facteur peu explicatif En dehors des caractéristiques socio-démographiques, les facteurs socio-culturels ont souvent été invoqués pour expliquer les différences de prévalence de consommation entre pays occidentaux et, à l'intérieur de ceux-ci, entre différents milieux. Les représentations sociales des médicaments, de leurs effets secondaires, le spectre de la dépendance ou de la maladie mentale ont constitué les principaux facteurs étudiés 9. L'étude des perceptions et des opinions de la population française sur les drogues et les toxicomanies étudiées à partir d'une enquête téléphonique en population générale montre que les personnes ont plutôt une perception favorable des médicaments psychotropes au regard de l'ensemble des produits psychoactifs. Lorsqu'il est demandé aux 15-75 ans de hiérarchiser selon leur dangerosité sept produits, une forte majorité place au premier plan l'héroïne (41 %), devant la cocaïne (20 %) et l'ecstasy (17 %), puis l'alcool (6 %), le cannabis (3 %), le tabac et les médicaments (2 %). Si la consommation de médicaments psychotropes suscite la crainte chez 55 % des personnes interrogées, elles sont 80 % à exprimer le même sentiment pour les opiacés, 68 % pour le cannabis, et 33 % pour le tabac et alcool 41. En revanche, si l'on interroge les personnes sur leur perception des médicaments psychotropes, sans faire référence à d'autres produits, leur représentation est plus négative9. Une telle prévention est parfois évoquée comme un facteur explicatif. Elle nuirait à l'observance, en suscitant l'arrêt prématuré du traitement. A l'inverse, cet a priori négatif, notamment la peur de la dépendance, permettrait de limiter la prévalence des recours chroniques. Toutefois, le rôle prêté aux représentations est loin d'être discriminant. En outre, la prévention contre les effets secondaires ou iatrogènes des produits ne suffit pas à dissuader les personnes de recourir aux produits. De fait, la peur de la dépendance, en particulier, revient comme un leitmotiv chez la plupart des consommateurs, y compris lorsque leur usage est chronique42. Les représentations jouent néanmoins un rôle : elles contribuent, en France, à doter les médicaments d'un crédit sans doute plus immédiat qu'ailleurs. Pour autant, ce crédit ne suffit pas à expliquer l'usage qui peut être fait des produits. Les effets secondaires, ressentis au cours du traitement, semblent jouer un rôle plus déterminant dans la poursuite et l'observance de la consommation9. Plus largement, les facteurs qui décident de la probabilité de consommer, a fortiori durablement, doivent plutôt être recherchés dans deux domaines en particulier : les conditions sociales de l'accès au soin (qui décident de la sélection des candidats à la prescription dans la population), d'une part, le degré de sévérité symptomatologique, notamment, en matière de morbidité organique, d'autre part. Consommation et pauvreté : un lien faible Les antidépresseurs ISRS ont été délivrés à des populations « nouvelles », dont la symptomatologie serait proche d'un tableau dépressif constitué. Aux Etats-Unis, certains auteurs estiment ainsi que la prescription des ISRS a, à la fois, remplacé la prescription de antidépresseurs tricycliques, accru la prise en charge de la dépression, et attiré vers la médecine générale des publics jusque-là exclus de l'accès au soin (en particulier, les minorités ethniques et les personnes à faibles revenus)43-46. En France, le phénomène semble plus atténué au regard des données existantes, dont il faut cependant souligner le caractère souvent incomplet. Les dimensions sociales du recours aux médicaments psychotropes décrivent des particularités qui s'opposent, du moins à première vue, aux caractéristiques ordinaires de la consommation pharmaceutique. En effet, généralement, le recours médicinal croît avec le niveau des diplômes, le revenu et la position occupée dans la hiérarchie sociale. Comme cela a déjà été évoqué dans la réponse à la Question 1, pour les médicaments psychotropes, chacune de ces relations est inversée, en France comme à l'étranger : l'absence de diplôme implique une consommation de 10 points plus élevée que la moyenne ; la probabilité d'usage des employés et des ouvriers est de 7 à 13 % supérieure à celle des autres actifs ; les bas revenus concentrent également les plus forts indices de recours4 7 8 47 48. Ces particularités paraissent plus appuyées encore lorsqu'on considère la précarité d'emploi. Alors que le chômage entraîne généralement une baisse de la fréquentation médicale, il induit, chez les hommes en particulier, une probabilité de consommation de 57 % supérieure à celle observée chez les actifs employés4 8. Ces résultats paraissent aller dans le sens d'une médicalisation de la précarité, d'une part, des inégalités sociales, d'autre part49. Quelle valeur accorder à cette interprétation? Weyerer et Dilling, étudiant l'usage des médicaments psychotropes au sein d'un échantillon de la population bavaroise, n'ont observé aucune relation entre le revenu et le taux de recours50. La méthodologie utilisée pourrait, en partie, expliquer cette divergence. Dans une autre enquête, Johnson et Vollmer, comparant la qualité des sources employées, ont fait remarquer que l'utilisation des bases de données du système de soins américain conduit à sous-estimer certaines populations de consommateurs. En effet, ces données prennent en compte les prescriptions ordonnées dans la population sur une période de 90 jours, ce qui contribue à sous-évaluer les traitements chroniques51, cette durée s'avérant trop courte pour étudier les profils des usagers chroniques et les facteurs explicatifs éventuellement associés. A l'inverse, les recherches pointant une forte relation entre précarité d'emploi, revenu et taux de recours, sont également dépendantes de durées de référence souvent trop courtes puisqu'elles s'appliquent à des périodes de 12 semaines ou de 6 mois de traitement4 7 8. C'est pourquoi le portrait de la consommation et des usagers, s'applique surtout aux recours ponctuels. Si on étend la durée de référence à 6 ans au moins d'usage continu, on obtient une image assez différente de la consommation. Les femmes au foyer et les inactifs retraités, les anciens ouvriers en particulier, se dégagent alors très nettement52. On retrouve ici le poids prédominant de l'isolement social, consécutif à la cessation d'activité, d'une part, de l'invalidité et du risque vital, d'autre part. En revanche, aucun lien tangible ne permet d'associer les consommations chroniques à la précarité d'emploi ou à la pauvreté. Le chômage et la rupture conjugale déterminent des recours moins durables. Par ailleurs, la fréquence des consommations épisodiques croît avec la position occupée dans la hiérarchie sociale. Autrement dit, du moins en France, les difficultés liées aux séparations ou à la perte de l'emploi paraissent motiver des usages plus ponctuels, le plus souvent le fait des membres de la classe moyenne. Si des nuances d'ordre social existent selon les pays, la consommation chronique n'est en revanche jamais associée à l'extrême pauvreté53-55. Il y a à cela une raison simple : le recours médicinal implique une insertion dans l'appareil de soins, laquelle tend à décroître lorsque les personnes sont privées de ressources56. La consommation de médicaments psychotropes, rapportée aux caractéristiques générales de la consommation pharmaceutique, n'est donc qu'en partie atypique57. En fait, dans sa partie chronique, elle se rapproche des médications utilisées dans le traitement d'autres pathologies chroniques. Cette prescription s'inscrit dans une convergence thérapeutique : les personnes prescrites sont celles déjà ordonnées pour d'autres pathologies. Seul le statut matrimonial semble constituer une exception. En effet, la séparation et le divorce, surtout dans la population féminine, occasionnent des prescriptions plus spécifiques, le médicament psychotrope constituant souvent dans ce cas l'essentiel de l'ordonnance30. A l'image des médications chroniques, les recours les plus durables aux médicaments psychotropes sont déterminés par la vulnérabilité des groupes sociaux face à la maladie, moins par la perte de l'emploi ou la pénurie de ressources. Les conditions de travail, l'abstention médicale et l'usage de substances psychoactives (tabac, alcool) conditionnent au premier chef les écarts de morbidité entre catégories sociales. Si l'inégalité face à la pathologie se développe au cours de la période d'activité, elle n'apparaît réellement qu'au moment du passage à la retraite. Ceci explique la sur-représentation des anciens ouvriers, donc des personnes dotées de revenus modestes et dépourvues de diplômes. Pour autant, elles ne permettent pas de conclure à la médicalisation de la pauvreté ou à un effet de la crise de l'emploi. On peut faire, à ce sujet, mention d'une des seules études françaises ayant tenté de cerner ce phénomène à partir des prescriptions des bénéficiaires de la CMU2. Comme l'indique le Tableau 63, les chiffres ne mettent pas en évidence des taux de prescription différenciés entre les assurés les plus pauvres et la population du régime général. Tableau 63. Distribution des patients selon le psychotrope prescrit et le type de couverture maladie
Toutefois, ces assurés représentent une part essentielle du public prescrit âgé de moins de 35 ans. Ils incarnent, pour ces tranches d'âge, les prescriptions les plus durables et les plus spécifiques. Ceci est particulièrement marqué pour les hypnotiques, anxiolytiques et, plus marginalement, pour les neuroleptiques, l'augmentation des prescriptions d'antidépresseurs restant, sinon marginale, proche de la moyenne2. Conclusion : la différenciation sociale des recours La relation entre volume de l'ordonnance et médication psychotrope peut expliquer, à l'inverse, la sous-prescription des classes supérieures : l'état de santé des personnes, la précocité de leur suivi médical, leur niveau d'intégration sociale, rendent moins nécessaire l'intervention médicale, en particulier pharmaceutique. Après avoir largement initié l'usage du fait d'une plus grande proximité aux soins58, la consommation des cadres paraît ne plus constituer qu'une part résiduelle du phénomène, hormis pour les motifs de recours liés à la décomposition familiale ou à la rupture conjugale : les membres de la classe moyenne en particulier contribuent en effet à construire une part essentielle des consommations liées à la séparation et au divorce59. Le recours tend dans ce contexte à demeurer épisodique, même s'il peut être appelé à se renouveler assez fréquemment. L'incidence de la morbidité, de l'isolement et de la division des rôles sexuels conduit plutôt à voir les usages réguliers, voire chroniques, comme une caractéristique de consommation des milieux populaires. Même lorsque des recours durables peuvent être imputés aux difficultés de la relation de travail, ils concernent surtout les fractions les plus modestes des classes moyennes, les employées en particulier60 ; les chefs d'entreprise, professeurs et cadres supérieurs n'apparaissant qu'à la marge. En résumé, les consommations sont plus répandues dans les classes moyennes, mais selon des durées généralement plus courtes (inférieures à 6 mois)6 61. Les consommations chroniques, étalées sur plusieurs années, sont davantage présentes chez les employés et les ouvriers inactifs (retraités ou femmes au foyer)2 5 54 55. Ces données sociales permettent d'observer le poids que les conditions de l'accès aux soins, hors des inégalités face à la maladie organique, exercent sur le recours aux médicaments psychotropes. Au cours de ces dernières années néanmoins, on a pu observer une différenciation accrue de la consommation sanitaire, laissant deviner trois formes cardinales d'accès aux soins : - le recours aux urgences : le cadre hospitalier a été témoin d'une croissance sans égale de la fréquentation. Ce type d'accès aux soins est de loin privilégié par les populations les plus démunies. En effet, certaines études tendent à montrer que la consommation médicale de ces populations n'est pas négligeable, surtout, qu'elle est orientée d'abord vers le recours aux urgences, bien avant la médecine générale62. Or, on a peu d'éléments sur la prescription hospitalière, et encore moins les thérapeutiques délivrées dans le cadre des services d'urgence. Si des études relatives à l'urgence psychiatrique, à ses modes de prises en charge et à ses liens avec les filières sanitaires ont été entamées63, les investigations produites dans ce domaine demeurent encore trop rares. - les psychothérapies : notre méconnaissance de la clientèle des psychothérapeutes (qu'ils soient psychiatres, psychologues ou psychanalystes) est à peu près égale à celle du recours aux urgences, même si quelques recherches visent à combler cette carence64. Pendant longtemps, ce recours a été l'apanage des classes supérieures. Cette tendance semble se démentir aujourd'hui ce qui mériterait d'être confirmé par des données fiables. Ce point sera repris dans la réponse à la Question 5. - la médecine générale : compte tenu de ce qui vient d'être dit, il ressort que le traitement des plaintes psychiques par la médecine générale tend à s'adresser d'abord aux milieux populaires et aux classes moyennes. Il reste que l'on sait peu de choses des liens que cette médecine de ville entretient avec les autres dispositifs de soins dans le traitement des troubles mentaux. Ces remarques soulignent toute la difficulté à promouvoir une politique unitaire de soin dans un contexte où la diversification et la segmentation de l'offre sanitaire semblent croissantes. Elles invitent à promouvoir un véritable programme d'évaluation afin que la décision publique s'appuie sur une meilleure connaissance des acteurs du soin, de leurs publics, des modes de prise en charge et des connexions instaurées entre les différents dispositifs ou qui mériteraient de l'être. b) Consommation et durée de recours Les motifs de consommation : entre maladie et mal-être Pour comprendre la consommation de médicaments psychotropes, indépendamment de la probabilité d'accès aux soins, une première approche peut consister à se pencher sur les raisons, selon les personnes, de cette consommation, et le cas échéant, à sa chronicité. Néanmoins, cette perspective demeure insuffisante tant que l'usage n'est pas rapporté à une étude détaillée des itinéraires de vie et de la carrière sanitaire des personnes. En effet, les recherches, centrées sur les motifs à l'origine de la prescription, font apparaître une difficulté de taille : avec le temps, les motifs initiaux de consommation perdent en précision. En outre, le statut du mal et la nature de l'indication revêtent souvent un caractère incertain et polymorphe chez les consommateurs. Pour Baumann et son équipe, la consommation s'apparente à « une carrière d'usage » dont on peut décrire la trajectoire comme suit: « on prend d'abord des psychotropes pour une étiopathologie avancée par le médecin, puis c'est l'individu qui fournit au médecin des raisons potentiellement acceptables pour que celui-ci légitime la poursuite de la prescription »9. Pour comprendre la consommation, il faut donc intégrer une rationalité sanitaire qui n'est pas celle de l'indication et qui, par ailleurs, est appelée à varier selon le profil des consommateurs et la durée des recours. Ces définitions alternatives de la santé puisent pêle-mêle leur légitimité dans la nécessité du maintien de l'autonomie face à la maladie ou la douleur, de la préservation de l'intégration sociale devant les conflits du travail, le chômage ou la rupture familiale. Il y est donc plutôt question d'une gestion du mal-être et de la souffrance psychique que d'une psychopathologie déclarée. En somme, le maintien d'un bien-être minimal est placé ici au centre des préoccupations, ou paraît à tout le moins doter d'une légitimité égale à celle attribuée à la visée réparatrice du geste médical. Celle-ci appelle une définition de la santé conçue en termes d'absence de maladie, ou d'une correction d'un dysfonctionnement et demeure, de ce point de vue, minimaliste au regard des exigences défendues par la population traitée en médecine générale. La distribution des motifs de recours aux médicaments psychotropes, la durée des consommations, donnent à voir comment l'équation entre ces différentes exigences de santé est résolue dans le cadre du colloque médical. L'entretien direct des généralistes et des consommateurs s'avère ici riche d'enseignements. Mais, avant d'aborder cette question plus en détail, précisons que si les exigences de santé des patients peuvent les conduire à des usages chroniques, voire extrêmement problématiques, on ne saurait comparer leur consommation avec une pratique toxicomaniaque, dominée par l'abus ou le détournement d'usage des produits. La très grande majorité des usagers de ces produits font preuve d'une grande maîtrise dans leur gestion des médicaments : en aucune façon, ils ne sont « débordés » ou « pris » par les substances, comme en témoigne leur respect scrupuleux des posologies 55 65 66. Une raison simple à cela : la plupart des motifs du recours sont guidés par le maintien de soi, la préservation d'une intégration minimale et, en aucune façon, par une logique de performance (de type dopage) ou de rupture (de type toxicomaniaque). Ce point, déjà évoqué dans la réponse à la Question 1, sera abordé de manière plus détaillée dans la réponse à la Question 6. Les usages ponctuels : le fait des circonstances L'essor des antidépresseurs a renforcé la prescription des populations âgées de 35 à 55 ans. Pour ces patients, la co-prescription de la thérapeutique antidépressive avec un anxiolytique est très fréquente, et la durée du recours paraît assez conforme aux normes sanitaires. Les prescriptions répondent ici à des crises passagères dues à des événements de vie ou des accidents biographiques (divorce, séparation, conflit au travail, tensions familiales ou conjugales, chômage, etc.). Ces motifs de recours, très diffus aujourd'hui parmi les quadragénaires, de la classe moyenne en particulier, pourraient être versés, au regard de la classification psychiatrique, au compte des traitements des troubles de l'adaptation avec humeur dépressive. Il s'agit de troubles caractérisés par la survenue transitoire de symptômes dépressifs en réaction à un événement de vie, pour lesquels les recommandations actuelles ne préconisent pas la mise en place d'un traitement antidépresseur. Ces recours « circonstanciels » sont épisodiques, mais peuvent devenir chroniques lorsque la situation qui motive la souffrance du patient tend elle-même à s'installer dans le temps. Dans la mesure où la médecine n'a pas prise sur ces circonstances, et où celles-ci peuvent être structurelles, la durée de la consommation s'élève souvent à plusieurs années. Mais, dans la mesure où le traitement peut être rapporté à un facteur pour tout ou partie extérieur au patient, le recours bénéficie d'une certaine légitimité tant auprès du consommateur que du prescripteur. Cela est d'autant plus vrai que l'amélioration des conditions de vie de l'usager semble probable à terme. Les usages chroniques : l'invalidité, l'insomnie, l'isolement Les usages tendent à devenir plus réguliers lorsqu'ils accompagnent le traitement d'affections organiques invalidantes, comme l'insomnie et le vieillissement. Cette relation permet d'expliquer pourquoi la part des ordonnances de benzodiazépines reste prépondérante, en particulier chez les personnes âgées des milieux populaires. On a affaire ici, comme par le passé, aux recours les plus chroniques. Dans la mesure où les praticiens ont tendu à substituer ou à associer au cours de ces dernières années les antidépresseurs aux benzodiazépines, il n'est pas rare que les ISRS intègrent ces usages au long cours. Ce phénomène est d'autant plus marqué que la population prescrite a également vieillie, avec une augmentation du nombre de patients de plus de 75 ans. La chronicité, qui peut impliquer plus de vingt ans d'usage, est admise et tolérée, y compris par les prescripteurs, dans la mesure où aucune perspective d'amélioration ne peut être escomptée. Le cas échéant, la chronicité a pu démarrer avant la survenue de la maladie organique ou de la perte du conjoint. C'est particulièrement vrai du traitement de l'insomnie chronique. Ici, la légitimité du recours est souvent bâtie sur deux arguments : la nécessité impérieuse de dormir, et la « nature » du patient. A cet égard, les discours des usagers et des prescripteurs rejoignent, par certains aspects, les modèles psychiatriques de traits de personnalité. Ces usagers au long cours se disent en effet porteurs d'une disposition personnelle à l'insomnie, le cas échéant, anxieuse. Dans la mesure où ce trait est dit structurel, la prescription s'engage à devenir chronique. Ce débouché est d'autant plus probable que la gestion des produits ajoute au mal-être de ces personnes. En particulier, l'oubli du produit ou les tentatives d'abstinence les empêchent de dormir, et la perspective que cette expérience se renouvelle les rend anxieux. En un mot, la thérapeutique devient d'autant plus nécessaire qu'elle conforte aussi bien le symptôme dont les usagers se plaignent que les explications qu'ils cherchent à lui donner. Néanmoins, si la proximité aux produits est grande, et l'attachement aux comprimés prescrits indéfectible, on ne peut évoquer l'idée d'un surinvestissement thérapeutique, dans la mesure où, le plus souvent, l'usager n'espère pas que le médicament va améliorer sa disposition à l'insomnie. La gestion du sevrage des hypnotiques de type benzodiazépiniques sera abordé plus précisément dans la réponse à la Question 6. Le paradoxe du déprimé : les chronicités problématiques La prescription des médecins généralistes est, en proportion, peu fondée sur les diagnostics d'anxiété généralisée et d'épisode dépressif majeur, sur lesquels se fondent les essais cliniques et la démonstration d'efficacité des médicaments les plus prescrits par eux. Mais, c'est ici sans doute que l'on peut observer les usages chroniques les plus problématiques, même si leur chiffrage demeure difficile. Ces patients sont généralement plus jeunes, âgés de 40 à 50 ans en moyenne. Ils se recrutent généralement parmi les classes moyennes, à savoir les enseignants et les travailleurs sociaux en particulier. La prescription est organisée par les antidépresseurs, parfois prescrits seuls, mais plus généralement associés à des anxiolytiques et des hypnotiques. Le symptôme est défini dans les termes de la dépression, ou de la dépressivité. Pour autant, l'origine du trouble, voire sa qualification en tant que pathologie, ne se laissent pas aisément deviner, c'est du moins ce que les usagers comme les prescripteurs tendent à rapporter. La légitimité du mal-être ne peut se prévaloir d'une cause événementielle ou organique. Elle laisse les patients penser qu'elle se situe à l'intérieur d'eux-mêmes, « en profondeur ». La thérapeutique paraît maintenir ici les usagers hors d'un retour massif à l'épisode initial de détresse, mais ne produit pas de rémission franche. C'est pourquoi, après quelques mois de traitement, certains prescripteurs finissent par douter de la réalité de la plainte et par l'attribuer à l'insuffisance du patient 67. Celui-ci est « pris » dans un jeu assez complexe : il ne sait pas si la stabilisation de son état est due aux produits, ou bien si c'est lui qui va mieux. Cette incertitude se double d'un rapport ambivalent à l'égard de la thérapeutique : le patient se dit soulagé par elle, mais reconnaît en même temps que la solution à son problème dépend d'abord de lui. Les usagers de ce type font part d'un rapport à soi dominé par l'attente d'autonomie mais également par le principe de la responsabilité personnelle. Leur vision de l'individu est dynamique et, plus qu'ailleurs, autocentrée. En écho à cette représentation, leur symptôme s'exprime d'abord dans les termes d'une dévalorisation de soi ou d'une incapacité personnelle. La trajectoire de consommation de ces usagers ajoute de fait à ce sentiment. L'attitude du médecin généraliste n'est pas en effet sans comporter une part de dépréciation : l'absence de rémission, la faible lisibilité du trouble, finissent tôt ou tard par mettre en cause le patient. En outre, l'usage n'acquiert jamais tout à fait ici la valeur d'une nécessité thérapeutique : le recours à la chimie apporte un effet stabilisateur, mais c'est l'abandon de toute thérapeutique qui incarne l'idéal de ces usagers68. La chronicité, qui se mesure souvent à plus de 10 ans d'usage, résonne donc pour eux comme un désaveu personnel. Face à l'absence de rémission, ces patients ont tendance à mettre en cause le produit : ils s'informent, essaient de nouvelles molécules, et connaissent éventuellement une période de rémission plus ou moins durable. Les signes de rechute, voire de récidive, sont néanmoins fréquents. De la même manière, l'adoption d'un nouveau médicament ou d'une nouvelle combinaison de produits n'est pas toujours à la hauteur des espoirs que l'usager peut placer en elle. Là encore, ce constat tend à renvoyer le patient à lui-même : ces consommateurs considèrent en effet que l'efficacité de la thérapeutique est variable, et que cette variabilité dépend d'abord d'un facteur personnel. C'est pourquoi l'investissement dans le produit atteint chez ces patients un point culminant, proche d'une dépendance : ils sont à l'affût de toute nouveauté thérapeutique, et vont parfois jusqu'à construire des schémas d'usage complexes où les variations des dosages, les circonstances de la prise sont pensées dans leurs moindres détails, donnant lieu à des expérimentations et des ajustements incessants. La relation aux produits est rarement plus marquée qu'ici. Le recours paraît à la fois « stabiliser » ces patients et induire un nouveau mal-être, relation que nous avons désignée sous le terme de « maintien paradoxal » 2. Et c'est bien d'un paradoxe dont il s'agit puisque ces patients, par leur caractère au moins pour partie dépressif, incarnent au plus près la cible visée par la thérapeutique. Ces trajectoires de prise en charge sont rares. Pour autant, elles méritent une considération particulière : elles montrent toute la difficulté que rencontrent les médecins généralistes lorsqu'il est question pour eux de traiter le trouble psychique pour lui-même. Le médecin généraliste paraît ici confronté aux limites de sa compétence : d'où l'évidente nécessité d'une collaboration plus étroite entre la médecine générale et la psychiatrie. Ce chapitre a été rédigé à partir d'une enquête réalisée par Quitterie Thompson et Frédéric Rouillon, Clinique des Maladies Mentales et de l'Encéphale, Hôpital Sainte Anne, Paris. Cette enquête a reposé sur des entretiens semi-directifs auprès de trois personnes travaillant dans l'industrie pharmaceutique, de deux personnes travaillant dans une revue médicale, et de plusieurs personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions de responsabilité au sein des autorités sanitaires (DGS, AFFSaPS). La plupart des personnes interrogées ont demandé à rester anonymes, en particulier celles travaillant dans l'industrie pharmaceutique, les autres sont mentionnées dans la section remerciements. L'industrie pharmaceutique est soumise aux principes généraux de l'économie de marché qui régissent le monde industriel, et doit à ce titre prendre en compte les contraintes de la concurrence. La spécificité du marché du médicament tient à son caractère très réglementé, et au fait que le prescripteur n'est pas le consommateur, et que l'acheteur n'est pas le payeur (ou ne l'est que partiellement). Les actions de promotion pour les médicaments psychotropes n'ont pas de spécificité par rapport à celles des autres classes de médicaments. On peut distinguer les actions qui précèdent l'AMM et celles qui suivent la commercialisation du produit. 1. Les actions qui précèdent l'AMM Ces actions ont pour objectif de « préparer le terrain » avant la mise sur le marché du médicament. Elles concernent avant tout les prescripteurs, mais ciblent également le public. a) La participation des « leaders d'opinion » aux essais cliniques de phase III La participation des experts ou « leaders d'opinion » aux essais cliniques de phase III (mise en évidence de l'efficacité du produit) est primordiale, afin de préparer la promotion du produit, et d'optimiser les chances d'obtenir un avis favorable de la commission d'AMM, puis de la Commission de Transparence. Le médecin régional du laboratoire concerné a pour mission de chercher le(s) leader(s) d'opinion qui aura(ont) d'une part le meilleur type de recrutement pour ces études de phase III, et qui pourra(ont) d'autre part intervenir dans le processus de décision des autorités sanitaires pour la mise sur le marché du produit. b) La sensibilisation des prescripteurs et du public à la pathologie cible du nouveau médicament Les leaders d'opinion qui participent aux essais cliniques jouent un rôle majeur pour la sensibilisation du milieu professionnel à la pathologie cible du nouveau médicament mis sur le marché. La communication sur cette pathologie, présentée comme des actions de formation des prescripteurs, permet une promotion indirecte efficace du produit qui sera ultérieurement commercialisé. Cette sensibilisation se fait par l'intermédiaire d'articles dans la presse médicale, de symposia satellites au cours de congrès, ou de présentations dans les services hospitaliers. Toutes ces actions se font théoriquement sans jamais nommer le produit en question, cela étant interdit avant l'obtention de l'AMM. La sensibilisation au nouveau produit via l'information sur la pathologie cible concerne également le public. La majorité des émissions de télévision consacrées à des questions de santé sont conçues par l'industrie pharmaceutique via des agences de communication. La communication sur le Prozac® auréolée de sa réputation de « pilule du bonheur » avait ainsi commencé bien avant l'obtention de son AMM. c) Le rôle de l'industrie pharmaceutique dans l'élaboration des catégories diagnostiques Quelle est l'influence de l'industrie pharmaceutique concernant l'identification (la création ?) de nouvelles maladies ? On a ainsi accusé le système de classification diagnostique DSM de l'American Psychiatric Association dont les éditions successives listent un nombre toujours croissant de troubles psychiatriques, d'avoir été créé pour doper les prescriptions de médicaments. Selon une chercheuse américaine, la moitié des experts psychiatres qui ont participé à la rédaction du DSM IV ont reçu des financements de l'industrie pharmaceutique, à titre personnel ou pour leur activité de recherche. Un des exemples le plus manifeste est le concept « d'attaque de panique » : les travaux du psychiatre américain qui a inventé ce concept ont été largement subventionnés par le laboratoire Upjohn, au moment de l'introduction du Xanax® qui était supposé avoir une action spécifique sur le trouble panique par rapport aux autres benzodiazépines. Nous reviendrons sur la question de la création ou de l'extension des troubles nécessitant un traitement dans la synthèse de la Question 3. d) Élargissement des indications d'un médicament déjà commercialisé Les exemples sont nombreux en psychiatrie : les antidépresseurs, indiqués initialement dans la dépression, ont vu leur indications s'étendre à la plupart des troubles anxieux ; les antipsychotiques, indiqués initialement dans le traitement de la schizophrénie, ont vu, pour certains d'entre eux, leur indication s'étendre à l'accès maniaque, puis à la prévention des récidives du trouble bipolaire, et sont dans l'attente d'autres indications faisant actuellement l'objet d'études pré-AMM. e) Introduction d'une nouvelle forme galénique d'un médicament déjà commercialisé La demande d'AMM pour une nouvelle forme galénique d'un produit déjà commercialisé correspond parfois à une innovation répondant à un réel besoin (par exemple, une forme injectable ou à action prolongée). Concernant les médicaments psychotropes, ces demandes sont le plus souvent faites en prévision de la sortie du générique de ce même médicament. En effet, cette nouvelle forme galénique venant d'obtenir l'AMM ne peut être copiée sous forme d'un générique pendant plusieurs années ; l'industriel s'emploie alors à convaincre les prescripteurs que cette nouvelle présentation représente un apport thérapeutique majeur pour le patient. C'est le cas, par exemple, du Prozac® dispersible ou de l'énanthiomère du citalopram (escitalopram, Seroplex®) commercialisés au moment où des génériques du Prozac® et le Séropram® pouvaient être mis sur le marché. f) Autorisation Temporaire d'Utilisation L'ATU (Autorisation Temporaire d'Utilisation) est un autre moyen de faire connaître un médicament avant qu'il n'obtienne l'AMM. Il s'agit d'une originalité française, théoriquement réservée aux produits pour lesquels on ne dispose pas d'alternatives thérapeutiques mais parfois détournée de son principe initial. Elle a, par exemple, été obtenue pour un antipsychotique (Abilify®) avant sa mise sur le marché. 2. Les actions mises en œuvre après l'AMM La visite médicale, dont l'objectif est d'informer les prescripteurs sur les produits commercialisés par le laboratoire, représente la part la plus importante du budget promotionnel d'un médicament. Elle est assurée par des délégués médicaux, sous la supervision de directeurs de région. Le cadre juridique de la visite médicale sera abordé dans le chapitre suivant. Les VM (visiteurs médicaux) reçoivent après leur embauche une formation médicale et marketing assurée par des organismes extérieurs au laboratoire pharmaceutique, puis une formation interne basée sur environ deux séminaires annuels. Cette formation porte sur les produits de leur laboratoire et ceux de la concurrence. Les séminaires consistent en cours théoriques et en « jeux de rôle » avec, éventuellement, un représentant du service réglementaire chargé de surveiller la concordance entre les informations écrites et celles données verbalement. Une carte professionnelle obligatoire, et devant être validée tous les ans, est délivrée après 3 mois de travail lors d'une première embauche. Les délégués médicaux perçoivent un salaire, des frais de déplacement et reçoivent des primes sur les chiffres de vente du secteur où ils exercent, qui est le principal critère d'évaluation de leur activité. Ces chiffres de ventes sont connus grâce à des bases de données portant sur les officines et les pharmacies des hôpitaux. Sur le terrain, l'évaluation des VM est également faite lors de tournées « en double » avec un directeur de région, et à partir des appels (relativement fréquents) des médecins visités signalant les « dysfonctionnements » de tel ou tel délégué médical. Le cadre juridique visant les documents promotionnels remis aux prescripteurs lors de la visite médicale sera détaillé dans le chapitre suivant. Le détournement le plus fréquent de la législation consiste à présenter des documents non officiels, comportant par exemple des résultats d'études ne figurant pas dans l'AMM. Le plus souvent, il s'agit de photocopies d'articles avec quelques éléments surlignés. La loi DMOS (Diverses Mesures d'Ordre Social) de 1993, révisée en 2002, dite « loi anti-cadeaux », a limité l'usage des présents remis aux médecins visités, avec des sanctions prévues pour les médecins qui acceptent certains avantages et les entreprises qui les proposent. Les « cadeaux » se limitent désormais (en théorie) à des objets de faible valeur (post-it, agendas, stylos, documents scientifiques ou monographies médicales...) et des participations à des réunions scientifiques, de destinations parfois lointaines et de valeur inégale. Beaucoup moins nombreux que les visiteurs médicaux (environ 4 % de l'effectif total), ils ont des rapports privilégiés avec les « leaders d'opinion ». Ils ont la possibilité de coordonner des études conduites par les prescripteurs, ce qui n'est plus autorisé aux visiteurs médicaux depuis la rédaction de la charte de la visite médicale. Parmi elles, les enquêtes « épidémiologiques » explorent une pathologie ou une prise en charge thérapeutique, et ne portent pas sur l'évaluation d'un médicament ; elles permettent de nombreuses visites du VM (par exemple, pour un « monitorage ») et donc une personnalisation de la relation avec le médecin investigateur. Les enquêtes de phase IV sur le médicament à promouvoir après sa mise sur le marché permettent de le faire connaître au médecin, qui pourra ainsi parler du produit expérimenté à ses confrères s'il en est satisfait. Ces études sont de moins en moins fréquentes, car du fait des exigences méthodologiques plus strictes, elles nécessitent le plus souvent l'intervention d'attachés de recherche clinique, leur coût s'en trouvant accru. La quasi-totalité des réunions médicales (congrès, symposia, enseignements post-universitaires...) sont réalisées avec le soutien financier des entreprises pharmaceutiques. La prise en charge des frais de participation à un congrès est soumise à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des médecins. En théorie, on peut distinguer, concernant les activités promotionnelles, les symposia ou réunions organisées directement par l'industrie pharmaceutique et les congrès parrainés par des associations scientifiques ; toutefois, cette démarcation est de moins en moins nette, notamment pour les congrès portant sur les thèmes neurobiologiques ou pharmacologiques, largement subventionnés par l'industrie, qui contrôle directement ou indirectement la majorité des communications scientifiques. Ce terme désigne des personnes (qui seraient plusieurs milliers en psychiatrie en France) ayant diverses caractéristiques : « gros » prescripteurs, ayant une influence régionale, nationale ou internationale. Il peut aussi s'agir d'experts dans le domaine de la psycho-phamacologie. Ces leaders peuvent faire partie de la commission d'AMM ou d'autres commissions (Transparence, CEPS, ...), et sont dans ce cas tenus de signaler tous leurs liens d'intérêts (financiers ou intellectuels) avec les industries pharmaceutiques. Ce point fait l'objet de critiques récurrentes. Bien qu'il soit cohérent que les mêmes personnes, reconnues pour leurs compétences, soient sollicitées aussi bien par l'industrie pharmaceutique que par les autorités sanitaires, la question de leur indépendance et de leur objectivité reste posée et mal résolue. La presse médicale est, en moyenne, financée aux deux tiers par les entreprises pharmaceutiques, la part restante étant générée par les abonnements et les petites annonces. Si ces proportions sont similaires dans la presse non médicale, la différence réside dans le caractère mono-sectoriel des annonceurs dans la presse médicale. Certaines revues éditées par des associations scientifiques sont largement financées par l'industrie pharmaceutique. Enfin, les entreprises pharmaceutiques éditent elles mêmes des revues « maisons » avec un total contrôle éditorial. L'industrie pharmaceutique peut faire de la publicité dans la presse par les annonces publicitaires, les numéraux spéciaux consacrés à un produit à promouvoir, ou par les « publi-rédactionnels » consacrés à la pathologie traitée par leur produit. Le recours aux publi-rédactionnels est de plus en plus limité par l'obligation de ne fournir que des informations validées par l'AMM ou provenant de revues à comités de lecture. La question de la dépendance de la presse vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique est régulièrement posée. Certaines des personnes interrogées affirment que les entreprises pharmaceutiques peuvent solliciter un article scientifique, d'autre le nient formellement (note des coordonnateurs du présent rapport : alors que d'innombrables exemples démontrant l'inverse peuvent être fournis ), en précisant que, tout au plus, l'industrie pharmaceutique peut inviter des journalistes d'une revue à un symposium et demander à ce qu'un article en rende compte. Néanmoins, si un produit commercialisé par l'annonceur est décrié dans un article de la revue ou que l'avantage est donné à un concurrent, l'industriel peut décider de suspendre ses annonces publicitaires dans la revue en cause. Les mises en cause itératives de l'industrie pharmaceutique à propos de son emprise sur la presse ont abouti à une diminution relative de son investissement publicitaire au cours de ces dernières années. f) Les usagers et les usagers potentiels L'industrie pharmaceutique peut financer une association d'usagers en tant qu'œuvre sociale, ce financement s'inscrivant le plus souvent dans le cadre d'un partenariat. Elle peut également financer des programmes psycho-éducatifs destinés aux usagers, visant notamment à améliorer l'observance thérapeutique, avec comme retombée une augmentation des ventes du médicament. Une autre retombée des financements accordés aux associations d'usagers est l'accélération de la mise sur le marché et l'obtention d'un meilleur taux de remboursement grâce à l'influence des associations auprès des autorités sanitaires. Selon la loi, les associations doivent bénéficier d'au moins une source de financement autre que celle provenant de l'industrie pharmaceutique. Cette loi peut être détournée, quand l'autre source est financée, indirectement, par une entreprise pharmaceutique. Les programmes d'aide à l'observance ou de psycho-éducation ("disease management") ne peuvent être distribués aux médecins qu'après autorisation de l'AFFSaPS, sous peine de sanctions. Citons, à titre d'exemple : le programme d'amélioration de l'observance dans la dépression (Pfizer) ou le programme Bipolact (Sanofi Aventis) pour les patients bipolaires. Les médecins généralistes sont la principale cible de ces programmes. On peut légitimement se demander si c'est à l'industrie pharmaceutique de réaliser ces programmes (quel que soit leur intérêt, souvent réel) et si elle peut le faire sans orienter les prescriptions vers le produit qu'elle commercialise. Enfin, le grand public peut être sensibilisé à une pathologie par les médias en général (presse, télévision, radio, internet) au travers d'émissions promues par l'industrie pharmaceutique. Ce chapitre a été rédigé par Catherine Maurain et Marie Baumevieille, INSERM U657, Université Victor Segalen Bordeaux2 1. Le médicament psychotrope : une appellation au carrefour de l'approche médicale et juridique du médicament a) Dualité de l'appellation « médicament psychotrope » Elle est traditionnellement utilisée pour désigner les indications thérapeutiques des médicaments agissant en tant qu'anxiolytiques, hypnotiques, antidépresseurs, thymorégulateurs, etc. ; le médicament ayant démontré, outre sa qualité pharmaceutique, un rapport bénéfice/risque favorable dans cette indication à l'issue du processus de développement clinique validé par l'autorisation de mise sur le marché sans laquelle aucun médicament ne peut être commercialisé (art. L. 5121-8 CSP). Cependant, le qualificatif psychotrope est aussi doté d'une portée juridique spécifique puisqu'il désigne l'une des catégories de substances vénéneuses prévues à l'article L. 5132-1 CSP (Chapitre II « substances et préparations vénéneuses », Titre III « autres produits et substances pharmaceutiques réglementés », du livre 1er « Produits pharmaceutiques » de la cinquième partie du Code de la Santé Publique relative aux « produits de santé »). En effet, « sont comprises comme substances vénéneuses : - les substances dangereuses classées selon les catégories définies à l'article L. 5132-2 ; - les substances stupéfiantes ; - les substances psychotropes ; - les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article L. 5132-6. On entend par « substances » les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché. On entend par « préparations » les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus ». En revanche, les textes définissant les listes sur lesquelles les médicaments peuvent être inscrits ne prévoient pas de liste des médicaments psychotropes (Cf. chapitre de cette même section « Cadre juridique de la prescription et de la dispensation des médicaments psychotropes »). b) Contribution de la liste des substances psychotropes à la qualification d'un médicament en tant que psychotrope Conformément à l'article L. 5132-7 du Code de la Santé Publique qui pose le principe d'un classement des plantes, substances ou préparations sur les listes des psychotropes, des stupéfiants, les listes I et II par arrêté ministériel, une substance est qualifiée de psychotrope dès lors qu'elle est inscrite sur la liste du même nom. La liste de ces substances dite « liste des psychotropes » (Tableau 64) est définie par l'arrêté du 22 février 1990 (JO n° 130 du 7 juin 1990), lequel a fait l'objet de modifications par arrêtés successifs : arrêté du 21 août 1991 (JO du 12 septembre 1991), arrêté du 11 octobre 1995 (JO du 28 octobre 1995), arrêté du 25 février 1999 (JO du 3 mars 1999), arrêté du 22 janvier 2001 (JO du 26 janvier 2001), arrêté du 15 juillet 2002 (JO du 23 juillet 2002). Cette liste, qui comporte des substances très diverses, présente des limites : - elle n'englobe pas toutes les substances ou préparations psycho-actives : certaines sont, en effet, librement commercialisées (alcool éthylique, tabac, caféine), d'autres sont classées dans la liste des stupéfiants dont l'usage est interdit (héroïne, LSD, etc.) ou autorisé dans le domaine médical (morphine, zipéprol, méthylphénidade etc.) ; - elle n'est pas non plus strictement superposable au champ des médicaments qualifiés de psychotropes qui est plus large. Tableau 64. Liste des psychotropes (arrêté du 22 février 1990 modifié)
La dissociation précitée entre l'appellation thérapeutique d'un médicament en tant que psychotrope et le fait qu'il ne contienne pas de substances classées comme psychotropes, au sens juridique du terme, est illustrée par de nombreux exemples. La zopiclone et le zolpidem, principes actifs de médicaments autorisés en France en tant qu'hypnotiques en 1984 et 1987, n'ont été inscrits dans la troisième partie de la liste des psychotropes qu'en 1991. L'arrêté du 15 juillet 2002 (JO du 23 juillet 2003) déplaçant le zolpidem vers le tableau IV de la première partie de cette liste atteste de son classement international. De même, alors que figurent sur la liste des psychotropes la plupart des benzodiazépines indiquées en tant qu'anxiolytiques et/ou hypnotiques, nombre d'autres principes actifs inclus dans le champ de ce rapport n'y sont pas intégrés (antidépresseurs, thymorégulateurs, neuroleptiques). 2. Cadre juridique de la prescription et de la dispensation des médicaments psychotropes Le droit communautaire La fabrication, l'importation l'exportation et, plus généralement, le commerce de substances ou médicaments psychotropes sont particulièrement encadrés au sein de l'Union Européenne dans le but d'empêcher leur détournement à des fins illicites (Règlement (CEE) n°3677/90 du 13 décembre 1990 modifié : JOCE L. 357 du 30 décembre 1990 ; Règlement (CEE) n°3769/92 du 21 décembre 1992 modifié : JOCE L. 383 du 29 décembre 1992 ; Règlement (CEE) n°302/93 du 8 février 1993 portant création d'un observatoire européen des drogues et des toxicomanies : JOCE L. 36 du 12 février 1993). Ces textes communautaires s'imposent aux états membres par une applicabilité intégrale et immédiate. En revanche, en matière de prescription et de dispensation, l'Union Européenne applique le principe de subsidiarité en définissant les principes d'une classification des médicaments, laissant aux états membres la compétence d'en déterminer les modalités d'application. Ainsi, bien que le 29ème considérant de l'introduction du Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (CCMH) précise qu'il « importe d'harmoniser les conditions de délivrance au public », force est de constater qu'il n'existe pas encore de liste positive commune des substances et médicaments soumis à prescription au sein de l'espace communautaire. Les autorités sanitaires de chaque état membre établissent la liste des médicaments dont la délivrance est soumise sur leur territoire à l'obligation de prescription médicale, l'actualisent et, le cas échéant, la modifient annuellement et la communiquent à la Commission et aux autres états membres (art. 73 à 75 CCMH). Aux termes de l'article 70 du code précité, la typologie communautaire est la suivante : - médicaments non soumis à prescription, - médicaments soumis à prescription médicale eux-mêmes subdivisés, si l'état membre le juge opportun, en : · médicaments sur prescription médicale à délivrance renouvelable ou non renouvelable, · médicaments soumis à prescription médicale spéciale, · médicaments sur prescription médicale dite « restreinte » réservés à certains milieux spécialisés. La formulation des motifs fondant la classification d'un médicament dans l'une de ces catégories est de nature différenciée. Ainsi, selon l'article 71-1 du CCMH, sont soumis à prescription médicale les médicaments : - susceptibles de présenter un danger, directement ou indirectement, même dans des conditions normales d'emploi, s'ils sont utilisés sans surveillance médicale, ou - utilisés, dans une très large mesure, dans des conditions anormales d'emploi avec le risque de mettre en danger, directement ou indirectement, la santé, ou - contenant des substances ou des préparations à base de ces substances, dont il est indispensable de mieux évaluer l'activité et/ou les effets indésirables, ou - sauf exception, prescrits par un médecin pour être administrés par voie parentérale. Elle est, en revanche, laissée à l'appréciation des états membres pour l'inclusion dans l'une des sous-catégories de prescription vues supra (art 71-2 et 71-3 CCMH). Ainsi, pour soumettre un médicament à prescription médicale spéciale, les États membres tiennent compte du fait que le médicament : - contient, à une dose non exonérée, une substance classée comme stupéfiant ou psychotrope au sens des conventions internationales des Nations Unies de 1961 et 1971, ou - est susceptible, en cas d'usage anormal, de faire l'objet de risques importants d'abus médicamenteux, d'entraîner une pharmacodépendance ou d'être détourné de son usage à des fins illégales, ou - contient une substance qui, du fait de sa nouveauté ou de ses propriétés, pourrait, par mesure de précaution, être considérée comme appartenant au groupe précédent. De même, pour la classification dans la sous-catégorie « prescription restreinte », les états membres tiennent compte des éléments suivants : - le médicament, du fait de ses caractéristiques pharmacologiques ou de sa nouveauté, ou pour des raisons de santé publique, est réservé à des traitements qui ne peuvent être suivis qu'en milieu hospitalier, ou - le médicament est utilisé dans le traitement de maladies qui doivent être diagnostiquées en milieu hospitalier ou dans des établissements disposant de moyens de diagnostic adéquats, l'administration et le suivi pouvant se faire hors de l'hôpital, ou - le médicament est destiné à des patients ambulatoires, mais son emploi peut être à l'origine d'effets indésirables graves, ce qui peut justifier une prescription par un spécialiste et une surveillance particulière pendant le traitement. La souveraineté des états membres est également préservée par la possibilité de déroger aux principes énoncés ci-dessus (art. 71-4) ou de ne pas créer les sous-catégories de prescription. Toutefois, ils doivent tenir compte des critères de classement dans ces sous-catégories pour déterminer si un médicament doit être soumis à prescription (art. 71-5). L'application de ces principes généraux implique que les états membres de l'Union Européenne soumettent a minima les médicaments psychotropes à une obligation de prescription, éventuellement assortie d'une obligation de « prescription spéciale ». Il n'y a donc pas de possibilité de variation notable du cadre normatif de nature à expliquer juridiquement les disparités de consommation constatées au sein de l'espace communautaire. Le droit interne En France, le dispositif encadrant la prescription et la dispensation des médicaments psychotropes ne fait pas l'objet d'un corpus normatif spécifique. Il s'inscrit dans le cadre plus large des médicaments contenant des substances vénéneuses, dont la rigueur modulable permet d'appliquer, le cas échéant, un régime juridique plus strict. La typologie de ces médicaments découle logiquement de la classification communautaire (art. L. 5132-1 et L. 5132-6 du Code de la Santé Publique, CSP) : - les médicaments sur prescription médicale à délivrance renouvelable ou non renouvelable, inscrits sur les listes I ou II, susceptibles de présenter, directement ou indirectement, un danger pour la santé et/ou contenant des substances dont l'activité ou les effets indésirables nécessitent une surveillance médicale. La liste I comprend les substances ou préparations et les médicaments ou produits présentant les risques les plus élevés pour la santé ; - les médicaments soumis à prescription médicale spéciale, inscrits sur la liste des stupéfiants, contenant des substances susceptibles de provoquer pharmacodépendance, accoutumance et toxicomanie. Les médicaments psychotropes sont actuellement soumis au régime général de la liste I (anxiolytiques, hypnotiques, neuroleptiques, antidépresseurs, thymorégulateurs, ). Les psychostimulants (Ritaline® et Concerta®) sont toutefois classés comme stupéfiants. On notera qu'un médicament : - peut faire l'objet d'un classement autre que celui de la (ou des) substance(s) ou préparation(s) qu'il comporte (art. R. 5132-1 CSP) ; - s'il contient plusieurs substances ou préparations relevant d'un classement différent, est soumis au régime le plus strict, soit, dans l'ordre décroissant : stupéfiant, liste I, liste II (art. R. 5132-1 CSP) ; - peut être exonéré des dispositions restrictives inhérentes à ces listes s'il renferme des substances classées à des doses ou concentrations très faibles ou sont utilisées pendant une durée de traitement très brève. Une liste précise les conditions de cette exonération (art. R .5132-2 CSP). S'il est inscrit sur l'une de ces listes, le médicament ne peut être obtenu que sur prescription d'un praticien habilité, en l'occurrence un médecin, les autres professionnels de santé habilités à prescrire en France ne l'étant pas pour les psychotropes objets de ce rapport. L'ordonnance, rédigée après examen du malade, doit indiquer lisiblement les informations indiquées dans le Tableau 65 (art. R. 5132-3 CSP) : Tableau 65. Mentions obligatoires devant figurer sur l'ordonnance
La dispensation doit respecter le délai de validité de l'ordonnance : - première délivrance de médicaments inscrits sur les listes I et II : ordonnance datant de moins de trois mois (art. R. 5132-21 CSP) ; - première délivrance de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants : ordonnance datant de moins de 24 heures (art. R. 5132-33 CSP). Présentée au-delà de ce délai, elle ne peut être exécutée que pour la durée de prescription restant à courir, le pharmacien étant autorisé à déconditionner la spécialité pour dispenser les quantités nécessaires. Par ailleurs, les durées maximales de prescription, les quantités délivrées et les conditions de renouvellement de la dispensation sans recours à une nouvelle ordonnance figurent dans le Tableau 66. Tableau 66. Modalités de prescription et de dispensation
1. Certains médicaments, pour des traitements chroniques, sont présentés en conditionnement de 3 mois. Cette mesure ne concerne évidemment pas les psychotropes (art. R. 5132-12 CSP). Un dispositif de traçabilité des médicaments contenant des substances vénéneuses et, notamment, des stupéfiants, est mis en œuvre par les laboratoires pharmaceutiques et les pharmacies d'officine : registres et archivage des commandes et prescriptions. b) Dispositions spécifiques susceptibles d'être appliquées aux psychotropes Les textes confèrent aux autorités sanitaires le pouvoir de modifier les conditions de prescription et de dispensation dans un sens plus restrictif. Réduction de la durée de prescription Pour des motifs de santé publique, pour certains médicaments, substances psychotropes ou susceptibles d'être utilisés pour leur effet psychoactif, la durée de prescription peut être réduite (art. R. 5132-21 CSP). Cette mesure est actuellement appliquée aux hypnotiques et aux anxiolytiques (Tableau 67). Lorsqu'un médicament contient un ou plusieurs hypnotiques et anxiolytiques et qu'il comporte l'indication « insomnie » validée par l'AMM, il est soumis à la réglementation la plus stricte. La réduction de la durée de prescription n'implique pas automatiquement une limitation de la durée de traitement, aucun texte n'interdisant au prescripteur de renouveler la prescription. Tableau 67. Limitation de la durée de prescription des hypnotiques et des anxiolytiques
1. Dénominations communes correspondant à des spécialités commercialisées en France Source : Ordre national des pharmaciens : http://www.meddispar.fr Extension de la réglementation des stupéfiants Les conditions de prescription et de dispensation des médicaments relevant des listes I et II peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumises en totalité ou en partie au régime des stupéfiants (art. R. 5132-23 CSP). Les autorités sanitaires ont appliqué cette mesure notamment à deux spécialités psychotropes inscrites en liste I : le Rohypnol® (flunitrazépam 1mg) et le Tranxène® (clorazépate dipotassique 20mg) pour lesquels les durées maximales de prescription sont, respectivement, de 14 et 28 jours. Dispensation fractionnée Les médicaments stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants peuvent faire l'objet d'une mesure de délivrance fractionnée par le pharmacien, par arrêté mentionnant la durée de traitement correspondant à chaque fraction. Toutefois, le prescripteur peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement par une mention expresse sur l'ordonnance (art. R. 5132-30 CSP). Parmi les psychotropes entrant dans le cadre de ce rapport, seul le Rohypnol® est susceptible de faire l'objet d'une délivrance fractionnée par périodes de 7 jours. c) La prescription et la dispensation restreintes Dans l'intérêt de la santé publique, les autorités sanitaires ont compétence pour restreindre le champ de prescription et de dispensation de certains médicaments dans le cadre de l'AMM ou de l'ATU (autorisation temporaire d'utilisation) (art. L. 5121-20, 10 CSP). Conformément aux principes communautaires, cinq catégories de médicaments sont ainsi définies : 1. Médicaments réservés à l'usage hospitalier (RH), 2. Médicaments à prescription hospitalière (PH), 3. Médicaments à prescription initiale hospitalière (PIH), 4. Médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes (RS), 5. Médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement qui peuvent également être classés cumulativement dans l'une des catégories précédentes (SP). Les modalités restrictives de prescription et de dispensation sont indiquées dans le Tableau 68. Tableau 68. Prescription et dispensation restreinte
Hormis les médicaments réservés à l'hôpital, certains psychotropes sont soumis à ces régimes : - Prescription initiale hospitalière (PIH) et par un spécialiste (RS) : Concerta®, Ritaline®, Leponex® ; - Surveillance particulière au cours du traitement (SP) : Leponex®. 3. Adaptation du cadre juridique à l'évolution de l'état des connaissances concernant un médicament (à droit constant) Toutes les décisions d'application de la réglementation des substances vénéneuses (classement des substances, des médicaments, détermination de doses d'exonération, application de régimes de prescription ou de délivrance particuliers, excepté le régime de prescription restreinte) sont du ressort du pouvoir ministériel, via des arrêtés du ministre chargé de la santé. La participation de l'Afssaps à ce processus décisionnel est importante puisque les arrêtés de classement sur les listes I, II, ou sur celle des stupéfiants sont pris sur proposition de son directeur général (art L. 5132-7 et R. 5132-1 CSP). Les textes font également intervenir expressément la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes : - sa consultation est obligatoire préalablement à tout arrêté ministériel d'exonération (art. R. 5132-2, R. 5132-21 et 22) ; - elle a aussi pour mission de donner au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Afssaps des avis sur les mesures à prendre pour préserver la santé publique dans le domaine de la lutte contre la pharmacodépendance ou l'abus, ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre ou le directeur général concernant l'application des dispositions prévues par la réglementation des substances vénéneuses (art R. 5132-103 CSP). La pharmacodépendance et l'abus ont été définis de la manière suivante (art. R. 5132-98 CSP) : - l'abus est « une utilisation excessive et volontaire, permanente ou intermittente, d'une ou plusieurs substances psychoactives, ayant des conséquences préjudiciables à la santé physique ou psychique » ; - la pharmacodépendance est « un ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques d'intensité variable, dans lesquels l'utilisation d'une ou plusieurs substances psychoactives devient hautement prioritaire, et dont les caractéristiques essentielles sont le désir obsessionnel de se procurer et de prendre la ou les substances en cause et leur recherche permanente ; l'état de dépendance peut aboutir à l'auto-administration de ces substances à des doses produisant des modifications physiques ou comportementales qui constituent des problèmes de santé publique ». La diversité des membres de droit de cette commission est cohérente avec la portée des décisions vis-à-vis desquelles elle exerce son pouvoir consultatif. Elle comporte (art R. 5132-104 CSP) : 1° Quinze membres de droit : - le DGS (directeur général de la santé) ou son représentant ; - le DHOS (directeur de l'hospitalisation ou de l'organisation des soins) ou son représentant ; - le directeur général de l'action sociale ou son représentant ; - le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ; - le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ; - le directeur des sports ou son représentant ; - le directeur général de l'Afssaps ou son représentant ; - le chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou son représentant ; - le président de la MILDT (mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie) ou son représentant ; - le directeur de l'OFDT (Observatoire français des drogues et toxicomanies) ou son représentant ; - le directeur général de l'AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments), ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ; - le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ; - le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ; - le président de la Commission nationale de pharmacovigilance ou le vice-président ; - le président de la Commission nationale de toxicovigilance ou son représentant. 2° Dix-huit membres nommés par le ministre chargé de la santé : - un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ; - un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ; - un représentant des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques ; - quinze personnalités choisies en raison de leur compétence. Dix-huit suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. 3° Deux membres à titre consultatif nommés par le ministre chargé de la santé et choisis parmi les producteurs de matières premières stupéfiantes ou psychotropes. b) L'articulation avec l'évaluation des médicaments en conditions réelles d'utilisation La force de proposition de l'Afssaps et la fonction consultative de la Commission précitée articulent le pouvoir décisionnel du ministre chargé de la santé à l'évolution des connaissances relatives au risque de pharmacodépendance, d'abus et d'effets indésirables des médicaments. Une articulation prévue dans les missions de l'Afssaps Au titre de ces missions (art. L. 5311-2 CSP), l'Afssaps : - recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle est destinataire des rapports de contrôle et de réflexion et des expertises réalisés dans son domaine de compétence par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés ; - recueille et évalue les informations sur les effets inattendus, indésirables ou néfastes des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 CSP, ainsi que sur l'abus et sur la pharmacodépendance susceptibles d'être entraînés par des substances psychoactives, et prend, en la matière, dans son champ de compétence, toute mesure utile pour préserver la santé publique ; - fournit au ministre chargé de la santé l'expertise qui lui est nécessaire en ce qui concerne les produits susvisés, notamment pour en permettre le bon usage ; - participe à la préparation des textes législatifs et réglementaires ; - propose aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale toute mesure de leur compétence. Pour exécuter cette mission d'évaluation, l'Afssaps bénéficie de deux réseaux dont elle assure la mise en œuvre, l'animation et la coordination : - le système national de pharmacovigilance (art. R. 5121-150 et suivants CSP) - le système national d'évaluation de la pharmacodépendance (art. R. 5132-97 et suivants CSP) Le second comporte la commission nationale des stupéfiants et des psychotropes. Sa structure et son fonctionnement sont directement inspirés du premier. En revanche, son champ d'activité est distinct. Il ne porte pas sur les effets indésirables, réactions nocives du médicament se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'homme (art R. 5121-153 CSP), mais sur l'abus et la pharmacodépendance mettant en cause des substances, plantes ou médicaments ayant un effet psycho-actif à l'exception de l'alcool éthylique et du tabac (art R. 5132-98 CSP). Il présente avec celui de la pharmacovigilance le point commun d'identifier la gravité de la pharmacodépendance ou de l'abus. Cette gravité est fondée sur un caractère « létal ou susceptible de mettre la vie en danger, ou d'entraîner une invalidité ou une incapacité, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation » (art. R. 5132-97 et art R. 5121-153 CSP). La participation de la Commission des stupéfiants et des psychotropes à l'évaluation Outre sa fonction consultative dans le circuit décisionnel précité, cette commission dont le secrétariat est assuré par l'Afssaps participe au système d'évaluation de la pharmacodépendance. Elle est ainsi chargée : - d'évaluer le risque de pharmacodépendance et d'abus des substances, plantes, médicaments ou autres produits en contenant et leurs conséquences pour la santé publique, - de proposer au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Afssaps les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'accomplissement de ses missions. Elle s'appuie sur un comité technique chargé de préparer, sauf urgence, ses travaux, coordonner la collecte des informations relatives à la pharmacodépendance et aux abus des substances, plantes, médicaments et autres produits précités, évaluer les informations collectées par CEIP (centres d'évaluation des informations sur la pharmacodépendance), coordonner et évaluer les enquêtes et travaux demandés à ces centres. Les CEIPs sont situés au sein d'établissements publics de santé, dans un service de pharmacologie, ou de toxicologie, un centre anti-poison avec lequel une convention de fonctionnement a été signée (Bordeaux, Caen, Grenoble, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Toulouse et Paris avec des centres collaborateurs à Paris, Nancy et Marseille). Leurs missions de recherche et d'évaluation sont : - le recueil et l'évaluation de données cliniques concernant des cas de pharmacodépendance et d'abus ; - le recueil des éléments nécessaires à l'évaluation du risque de pharmacodépendance auprès des professionnels de santé et tout autre professionnel concerné, des centres spécialisés de soins aux toxicomanes et des établissements de santé, notamment auprès des CRPV (centres antipoison, des centres régionaux de pharmacovigilance) et des services d'urgence; - la conduite des travaux et enquêtes demandés par le directeur général de l'Afssaps ; - la recherche sur le risque de pharmacodépendance et d'abus. Au niveau décentralisé, d'autres acteurs sont associés au système par le biais d'une obligation de déclaration des cas graves d'abus ou de pharmacodépendance qu'ils auraient observés ou dont ils auraient eu connaissance. Il s'agit, d'une part, des entreprises ou organismes exploitant des médicaments et, d'autre part, des médecins, chirurgiens dentistes, sages-femmes et pharmaciens. Les autres professionnels de santé et associés au système sont également invités à déclarer. c) Portée des processus d'évaluation Intérêt des définitions de la pharmacodépendance et de l'abus La définition de l'abus privilégie son identification selon des critères quantitatifs mettant en évidence le caractère excessif de la consommation par rapport au résumé des caractéristiques du produit validé lors de l'AMM qui constitue la norme de référence en termes de posologie à ne pas dépasser. Par la suite, ce point peut s'avérer d'une appréciation complexe dans le cas de pathologies chroniques (douleur, anxiété, insomnie), dans lesquelles il peut devenir difficile de différencier ce qui relève de la dépendance au produit par rapport à la persistance des symptômes d'une pathologie non guérie. En revanche, en raison de son caractère volontaire, l'abus exclut de sa définition l'utilisation criminelle ou la soumission thérapeutique. La définition française de la pharmacodépendance s'inscrit dans le prolongement de la définition de l'OMS en s'attachant à un comportement. Mais, contrairement à cette dernière, elle fait abstraction de l'existence ou non d'une tolérance, pour insister sur la répercussion de la pharmacodépendance sur le comportement puisqu'elle met l'individu dans une situation de quête obsessionnelle du produit. Elle met en exergue la capacité du pharmacodépendant à s'affranchir de la réglementation qui contrôle l'accès à ces produits (falsifications d'ordonnances, vols). Il est question d'auto-administration, qui peut s'entendre comme un détournement des conditions appliquées à la délivrance des médicaments, non seulement du fait de la réglementation des substances vénéneuses, mais aussi par l'autorisation de mise sur le marché qui détermine la forme galénique et la voie d'administration (injection de comprimés, inhalations). Une autre spécificité du champ de l'évaluation de la pharmacodépendance et de l'abus est son autonomie vis-à-vis du statut juridique des produits concernés (art. R. 5132-98 CSP). Ainsi, tous les médicaments sont concernés, qu'ils soient classés ou non, connus comme psycho-actifs ou non ; les consommations concomitantes pouvant, le cas échéant, être prises en compte. Une expertise interfacée dans le domaine des médicaments L'expertise en matière de risque de pharmacodépendance, d'abus ou d'effet indésirable concernant les médicaments psychotropes bénéficie des interfaces organisées entre les systèmes de pharmacovigilance et d'évaluation de la pharmacodépendance. Dès leur origine, les CEIPs bénéficiant souvent d'une communauté d'implantation avec les Centres Régionaux de Pharmacovigilance (CRPVs) dans les établissements publics de santé ont eu pour mission de recueillir les cas de pharmacodépendance ou d'abus susceptibles d'avoir été déclarés aux CRPVs. Deux mesures prises par un décret transposant en droit interne la modification des textes communautaires (décret du 29 janvier 2004 - JO 31 janvier 2004) ont renforcé cette interface : - l'exercice de la pharmacovigilance tient compte de toute information disponible sur les cas d'abus de médicaments ou produits pouvant avoir une incidence sur l'évaluation de leurs risques et bénéfices, sans préjudice des compétences du système national d'évaluation de la pharmacodépendance. Jusqu'alors l'abus était la seule forme de mésusage (utilisation non conforme au résumé des caractéristiques du produit) à ne pas être pris en compte par le système (art. R 5121-151 CSP) ; - le président de Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes participe à la commission nationale de pharmacovigilance (art. R5121-160 CSP). Dans un contexte où la rationalisation de l'usage des médicaments psychotropes ne passe pas seulement par la mise en œuvre de restrictions à la prescription et à la dispensation, mais repose aussi sur l'information les concernant, notamment contenue dans le résumé des caractéristiques du produit associé à l'autorisation de mise sur le marché, il est important de souligner la représentation des commissions nationales précitées à la commission d'autorisation de mise sur le marché (art R. 5121-54 CSP). De plus, les deux systèmes participent au niveau décentralisé à l'information des professionnels de santé en termes d'effets indésirables, de pharmacodépendance ou d'abus. Cette information encourage les professionnels de santé à la déclaration des cas. 4. Encadrement de l'activité promotionnelle des laboratoires pharmaceutiques a) État du marché : demande croissante, offre mondialisée En 2004, les parts de marché France des différentes classes thérapeutiques sont restées stables. En termes de quantités vendues, les antalgiques (315 millions de boîtes) et les psycholeptiques (hypnotiques, anxiolytiques et antipsychotiques globalisant plus de 122 millions de boîtes) demeurent les deux classes leaders, avant les antibiotiques avec 87 millions d'unités. En revanche, en termes de coûts, les hypocholestérolémiants, les médicaments à visée cardiovasculaire, les antiulcéreux et les antalgiques devancent largement les psychotropes. Nous avons déjà rapporté dans la réponse à la question 1 les données concernant les montants remboursés par le régime général de l'assurance maladie en 2003-200469. Pour mémoire, le premier psychotrope (Zyprexa®) est classé 11ème avec un montant proche de 90 millions d'euros. Suivent Deroxat® (77 millions d'euros, 18ème) et Risperdal® (73 millions d'euros, 20ème). En volume, Stilnox®, premier psychotrope classé, est à la 10ème place avec 11 315 000 unités prescrites. Cette spécialité subit un recul de - 23,7 % par rapport à 2003, en raison de la concurrence de ses génériques, mais la substance zolpidem enregistre, dans son ensemble, une hausse de 3,1 %. Témesta® suit en 19ème position (- 2,6 %) et Deroxat® en 24ème (- 31,8 %) alors que la substance paroxétine progresse globalement de 6,75 %. Ces données quantitatives témoignent de l'efficacité des incitations à la pénétration du marché par les génériques mais aussi d'une croissance constante de la consommation de molécules psychotropes Une enquête conduite auprès de 4 000 patients et 1 000 médecins dans quatre pays (Allemagne, Espagne, Pays-Bas, France) montre que l'équation « consultation = ordonnance = médicaments » est l'une des caractéristiques du rapport au système de soins des français, la prescription de médicaments intervenant 9 fois sur 10 contre un peu plus d'une fois sur deux aux Pays-Bas. L'observation des comportements « non consommant» est également significative : les populations n'ayant jamais consulté au cours de l'année s'échelonnent de 10 % en France, à 12 % en Allemagne, 18 % en Espagne et 23 % aux Pays-Bas. Et si 38 % des français n'ont pris aucun médicament au cours de la semaine précédant l'enquête, la proportion s'élève à 42 % en Allemagne, 45 % en Espagne pour atteindre 52 % aux Pays-Bas70. Outre les variables explicatives de cette propension à consommer des soins, et notamment des médicaments, analysées supra, il convient de s'interroger sur l'impact de l'offre des laboratoires pharmaceutiques. Sur 10 000 molécules criblées, 10 font l'objet d'un brevet et une seule atteindra le stade de la commercialisation. Ce processus est long (10 à 12 ans en moyenne) et implique des investissements en Recherche & Développement considérables (800 millions d'euros pour une molécule réellement originale). Le modèle économique de l'innovation pharmaceutique repose donc de facto sur un impératif de retour sur investissements qui ne peut être réalisé qu'à l'échelle mondiale. Outre la concentration des firmes, l'espace concurrentiel des laboratoires pharmaceutiques s'est profondément élargi à l'échelle transcontinentale, voire globale. Or, sur huit médicaments commercialisés à cette échelle, un seul pourra être considéré comme un « block-buster » générant un réel retour sur investissements. L'impact des systèmes de santé n'est pas sans incidence sur les stratégies de commercialisation. La disparité de l'accessibilité aux médicaments à l'échelle planétaire est flagrante : du « non droit à la santé » des pays en développement aux systèmes de financement très protecteurs mais déficitaires de l'Europe de l'Ouest et aux dispositifs « assurantiels » nord-américains, les marchés se différencient, tant par la capacité de financement des dépenses de soins, que par les règles plus ou moins libérales qui les régissent. Ainsi, au sein même d'un marché qui pourrait sembler homogène, l'Union Européenne, l'harmonisation est très avancée sur les procédures d'évaluation et de suivi des médicaments, mais la cohérence des systèmes de soins est encore une vue de l'esprit, des spécificités politiques et culturelles freinant le processus. Le prix d'un médicament, libre sur certains marchés et administré sur d'autres, présente ainsi une grande variabilité dans l'espace. En France, depuis les années 60, l'État et les organismes de protection sociale disposent d'un pouvoir « d'acheteur public » et déterminent les niveaux de prix et de prise en charge des médicaments remboursables. Ainsi, un rapport de 1 à 2,5 existait pour un même « panier » de médicaments entre les pays de l'Europe du Sud (Espagne, Portugal, France) et les Pays-Bas et l'Allemagne dans les années 90. Ce différentiel est en cours de lissage en raison de la commercialisation de médicaments innovants à des prix homogènes dans l'espace européen, non par harmonisation communautaire mais par la pression conjointe des laboratoires pharmaceutiques et du corps social pesant sur les pouvoirs publics en vue de rendre accessible l'innovation thérapeutique, quel qu'en soit le coût pour la collectivité. Dans ce contexte, les laboratoires pharmaceutiques ont pu sembler compenser la faiblesse des prix unitaires sur le marché français par des pratiques promotionnelles tendant à générer des volumes de ventes plus importants, dans un contexte concurrentiel très âpre, notamment au sein de certaines classes thérapeutiques (cardio-vasculaire, gastro-entérologie, asthme etc.). Mais il serait inexact de lier le différentiel de consommation français à la seule efficacité d'une pression promotionnelle induite par la recherche d'un « effet volume » : les stratégies marketing des laboratoires pharmaceutiques sont mondiales et sont peu segmentées en fonction du prix des produits. Parallèlement, les législateurs communautaire et français et les administrations de tutelle construisaient un dispositif juridique tendant à encadrer ces pratiques, tant pour des motifs sanitaires (« bon usage du médicament ») qu'économiques (régulation de l'offre). b) Le dispositif d'encadrement des activités promotionnelles L'Union Européenne a défini, dès 1992, la publicité en faveur des médicaments comme « toute forme de démarchage d'information, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de médicaments » (directive 92/28/CEE). Ce texte a été intégré dans le Code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, aux articles 86 à 100. Il prévoit un régime de contrôle (art. 97 et 99) mais laisse aux états membres une large autonomie dans le choix des moyens à mettre en œuvre, dès lors qu'ils sont « adéquats et efficaces pour contrôler la publicité ». Il faut souligner le rôle essentiel du responsable de la mise sur le marché dans l'application des dispositions en vigueur au sein de l'entreprise pharmaceutique, ainsi qu'en tant qu'interlocuteur des autorités de contrôle (art. 98). Les états membres de l'Union ont, avec quelques spécificités nationales, transposé ces principes dans leur droit interne. La France a ainsi actualisé un dispositif déjà contraignant en 1994 et 1996 et qui fait l'objet d'adaptations périodiques aux pratiques du marketing des firmes pharmaceutiques. Il est fondé sur une distinction entre la publicité « grand public » et la publicité destinée aux professionnels de santé pour tenir compte de l'asymétrie d'information existant entre ces deux types de cibles. Ne sera analysé ici que le cadre juridique de la promotion des médicaments ciblée sur les prescripteurs. Contrôle a posteriori des messages promotionnels Modalités : Le principe d'un contrôle a posteriori de la publicité destinée aux professionnels de santé est en vigueur depuis 1987. L'article L. 5122-9 CSP confère un fondement législatif à cette procédure en affirmant l'obligation d'un dépôt de tout message publicitaire, dans les huit jours qui suivent sa diffusion, auprès de l'Afssaps. Alors qu'était parfois discutée la portée de cette obligation pour certains types de messages, notamment ceux présentés aux professionnels de santé sans leur être remis (supports de visite médicale dits « aides de visite » ou ADV), l'article R. 5122-12 CSP la généralise à toute forme d'information communiquée aux professionnels de santé. Des situations spécifiques de communication sont, notamment, énumérées : - la présentation du médicament à ces professionnels par les délégués médicaux ; - les études ou enquêtes auprès de ces professionnels ; - les réunions ou congrès scientifiques auxquels assistent ces professionnels, en particulier lorsque ces réunions ou congrès font l'objet d'un parrainage (note : constitue un parrainage toute contribution au financement desdits réunions ou congrès) ; - les émissions de télévision destinées à ces professionnels, en particulier lorsque ces émissions font l'objet d'un parrainage dans les conditions et limites fixées par la réglementation relative à la communication audiovisuelle. Le dépôt s'impose donc pour tous les messages diffusés, quel qu'en soit le support : aide de visite médicale (ADV), annonce presse, tiré à part d'article scientifique et porte tiré à part, numéro spécial de périodique, brochure, revue maison (house organ), élément léger d'information médicale (ELIM), fiche signalétique si elle comporte des éléments hors RCP, diaporama, support audiovisuel (cassette, CD Rom, DVD, clé USB), sites Internet, écran de veille, poster, agenda, bloc d'ordonnances, cahier ou fiche d'observation, carte T mentionnant le nom d'une spécialité pour demande de documentation, message téléphonique enregistré accessible par numéro vert, etc. Également soumis au dépôt, les supports « objets » ne sont tolérés qu'à la condition qu'ils soient de valeur négligeable et aient trait à l'exercice de la médecine ou de la pharmacie (art. R. 5124-65 CSP). Des rapporteurs spécialisés par classe thérapeutique, appartenant à l'Unité « Contrôle de la publicité professionnelle » ou extérieurs à l'Agence et nommés par son Directeur Général, examinent les messages et relèvent les infractions éventuelles au corpus normatif. Ils sont alors transmis à la Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments qui formule un avis. Sanctions administratives et pénales : Le contrôle a posteriori des messages peut donner lieu au prononcé de sanctions administratives. L'article L. 5122-9 CSP donne pouvoir à l'Agence de sanctionner la méconnaissance des dispositions des articles L. 5122-2 et 3 CSP par décision motivée. Les motifs sur lesquels peut se fonder la décision sont expressément définis par ces textes : - publicité trompeuse ou portant atteinte à la santé publique ; - présentation non objective du médicament ou du produit ; - présentation non favorable à son bon usage ; - non-conformité aux dispositions de l'AMM ; - publicité pour des médicaments non enregistrés. Depuis 1999, dans l'intérêt de la santé publique, le champ des sanctions prévues à l'encontre des messages publicitaires destinés aux professionnels a été étendu aux cas de mésusage, de pharmacodépendance ou d'abus (art. R. 5122-16 CSP). Àl'issue du processus de contrôle a posteriori, le Directeur Général de l'Afssaps dispose d'un pouvoir coercitif gradué, aux termes des articles R. 5122-13 à R. 5122-15 CSP : - il peut mettre en demeure l'entreprise exploitant le médicament de modifier le contenu de la publicité dans un délai déterminé. En cas de non respect de la mise en demeure, et après avis de la commission de contrôle de la publicité, il peut interdire la poursuite et la diffusion ultérieure de cette publicité ; - après avis de la commission de contrôle, et présentation des observations de l'intéressé entendu par ladite commission s'il le désire, il peut interdire la publicité ou la poursuite de la campagne publicitaire, et, éventuellement, exiger la diffusion d'un rectificatif, approuvé par la commission, par les mêmes moyens ou l'envoi de lettres rectificatives, et ce, au frais de l'entreprise. Les décisions d'interdiction sont publiées au JO ; - en cas d'urgence, le directeur de l'Agence peut suspendre la diffusion d'une publicité manifestement contraire aux dispositions applicables pour une durée maximale de trois mois, à l'issue de laquelle la saisine de la commission est requise. Le dispositif de contrôle a posteriori n'exclut nullement la mise en œuvre de poursuites pénales et/ou disciplinaires à l'encontre des pharmaciens responsables des laboratoires annonceurs et/ou des agents de diffusion des messages. Pénalités financières : Le nombre d'interdictions publiées au JO est minime en regard du nombre de messages promotionnels déposés chaque année à l'Afssaps : 0,5 % en moyenne sur la période 1995-2005 (Base de données des décisions d'interdiction publiées au JORF depuis 1990 : Laboratoire de droit et économie de la santé, Université Victor Segalen Bordeaux 2). Cependant, l'Administration a estimé que le dispositif de sanction était insuffisamment dissuasif compte tenu des pratiques marketing des laboratoires pharmaceutiques. Ceux-ci planifient, en effet, des campagnes promotionnelles qui se renouvellent trois à quatre fois par an ; la durée de vie du matériel publicitaire est donc de l'ordre de trois à quatre mois. Quel que soit le délai de réaction des instances de contrôle, la procédure consultative préalable allonge la période décisionnelle et les interdictions s'appliquent assez fréquemment à des messages déjà largement diffusés et/ou en fin de cycle. Les sanctions administratives ont donc été lourdement renforcées par leur intégration dans le dispositif conventionnel de détermination du prix des spécialités pharmaceutiques en 1999 (art. L. 162-17-4 du code de la Sécurité Sociale). En cas d'interdiction de message publicitaire, c'est le Comité Economique des Produits de Santé qui prononce la pénalité financière à l'encontre de l'entreprise fautive, qui est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction. Ladite pénalité peut atteindre 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre de la spécialité pharmaceutique ayant bénéficié d'une publicité interdite durant les six mois précédant et les six mois suivant la date d'interdiction. Les critères d'évaluation de son montant sont également définis par l'article L. 162-17-4 CSS : - gravité de l'infraction sanctionnée par la mesure d'interdiction ; - évolution des ventes de la spécialité concernée durant la période définie précédemment. L'évaluation de la gravité de l'infraction ayant motivé l'interdiction confère implicitement à Afssaps un rôle consultatif. Visite médicale Conditions d'exercice : Depuis 1994, les connaissances scientifiques des délégués médicaux doivent être attestées par un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, en l'occurrence, l'arrêté du 17 septembre 1997 modifié (JO 25 sept. 1997). Leurs employeurs , quels qu'ils soient (laboratoires pharmaceutiques ou prestataires de services), doivent en outre veiller à l'actualisation de leurs connaissances. L'article R. 5122-11 CSP réserve aux délégués médicaux, attestant de la formation requise, toute présentation verbale d'un médicament. Obligations réglementaires : Les délégués médicaux sont expressément investis d'une mission de pharmacovigilance, puisqu'ils sont tenus de rapporter à l'entreprise toutes les informations relatives à l'utilisation des médicaments dont ils assurent la promotion, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables portés à leur connaissance par les professionnels de santé visités. La réglementation implique une information exacte et complète des professionnels de santé, notamment en matière de coût et d'apport thérapeutique du produit. Aux termes de l'article R. 5122-11 précité, un ensemble de documents, parfaitement lisibles et comportant la date de leur établissement ou de leur révision, doit être remis en mains propres au professionnel de santé par le délégué médical au cours de cette présentation (Résumé des caractéristiques du produit ou RCP complété par diverses informations socio-économiques, et avis le plus récent de la commission de la transparence). La finalité de cette obligation est de permettre aux prescripteurs de confronter les informations diffusées par le délégué médical, promotionnelles par nature, à des documents objectifs validés par l'administration (RCP) ou élaborés par elle (avis de transparence). Charte de la visite médicale : La charte de la visite médicale a été signée par le Comité économique des produits de santé (CEPS) et Les Entreprises du Médicament (LEEM) le 22 décembre 2004 et modifiée par un avenant n°1 du 21 juillet 2005. Ce document a pour finalité de mieux encadrer les pratiques commerciales et promotionnelles qui pourraient nuire à la qualité des soins. Elle a valeur contraignante, notamment pour les entreprises qui concluent des conventions avec le Comité économique des produits de santé. Ainsi, aux termes de l'article L.162-17-4 du Code de la Sécurité Sociale, les entreprises signataires de ces conventions doivent s'engager à respecter la charte et, selon une procédure établie par la Haute Autorité de Santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à ladite charte de la visite médicale qu'elles organisent ou qu'elles commanditent. Parmi les mesures novatrices on doit souligner : - l'interdiction faite aux délégués médicaux de remettre des échantillons ; - l'exclusion de ces mêmes délégués de « la mise en place (recrutement et relations financières avec les médecins) d'analyses pharmaco-économiques ainsi que d'études cliniques, y compris de phase IV, et d'études observationnelles ». Le délégué médical ne peut qu'en assurer le suivi ; En outre, un dispositif « expérimental » de limitation du nombre des visites est mis en œuvre. Ainsi, le CEPS arrête chaque année la liste des classes pharmaco-thérapeutiques pour lesquelles il estime qu'une réduction de la visite médicale est nécessaire. Cette décision intervient après consultation de la HAS (Haute autorité de santé), de l'UNCAM (Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie), des représentants des médecins dans le cadre du groupe de suivi de la charte, qui font valoir à cette occasion leurs besoins d'information sur ces médicaments, et du LEEM. Ces classes sont désignées au vu de critères rendus publics intégrant le contenu de ces consultations, notamment au regard du bon usage du médicament et des objectifs de santé publique ou de dépenses de l'assurance maladie. Les pouvoirs conférés au CEPS dans l'application de ces mesures sont larges : - en cas de non respect pour une classe du taux fixé : baisse temporaire ou définitive du prix des spécialités y figurant, dont l'importance est fonction notamment de l'écart entre l'évolution constatée et la décroissance prévue ; - modulation de ces baisses en fonction de la situation concurrentielle des produits, notamment pour des produits en lancement, et du comportement individuel des entreprises ; - transformation temporaire de la baisse de prix en ristourne en faveur des médicaments innovants, pédiatriques ou orphelins ; - prise en compte conventionnellement des efforts spécifiques d'une entreprise en matière de présentation des médicaments. Échantillons gratuits de médicaments Aux termes de l'article L. 5122-10 du code de la santé publique, est interdite la remise d'échantillons de médicaments contenant des substances classées comme psychotropes ou stupéfiants, ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie. Ainsi, rien ne s'oppose à la distribution d'échantillons de médicaments dont les principes actifs, médicalement considérés comme psychotropes, ne sont toutefois pas classés en tant que tels. Par ailleurs, tous les autres médicaments sont soumis à une limitation du nombre d'échantillons remis aux médecins : au maximum 10 par an et par spécialité pharmaceutique pour chaque prescripteur. Dons destinés à encourager la recherche ou la formation des professionnels de santé Ces dons, exclusivement réservés aux personnes morales, sont autorisés par l'article R. 5124-66 sous réserve de leur déclaration préalable au préfet du département où est situé le siège de l'organisme bénéficiaire à condition qu'ils n'aient pas pour objet réel de procurer un avantage individuel à un ou des membres des professions médicales. Avantages en nature ou en espèces L'article L. 4113-6 CSP énonce une interdiction générale de recevoir des avantages en nature ou en espèces des entreprises produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sous peine de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende, aggravés, en cas de condamnation, d'une éventuelle interdiction temporaire d'exercer la profession pour une période de dix ans prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale (art. L. 4163-2 CSP). Des sanctions sont également prévues à l'encontre des entreprises qui proposent de tels avantages. Toutefois des dérogations sont prévues : - les avantages prévus par conventions passées entre des professionnels de santé et des entreprises, dès lors qu'elles ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d'évaluation scientifique et qu'elles satisfont à deux conditions : la soumission des conventions au conseil de l'ordre compétent pour avis avec notification au responsable de l'établissement de santé si les recherches et évaluations y sont effectuées même partiellement, et la non-proportionnalité des rémunérations au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés ; - l'hospitalité offerte de manière directe ou indirecte lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique, sous réserve qu'elle soit prévue par convention passée entre le professionnel de santé et l'entreprise, soumise pour avis au conseil de l'ordre compétent avant sa mise en application, et qu'elle soit de niveau raisonnable, reste accessoire par rapport à l'objectif principal de la réunion et ne soit pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés. c) La taxation des budgets promotionnels C'est la Loi n°83-25 du 19 janvier 1983 qui a institué, au profit de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, une contribution des entreprises de préparation des médicaments donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie. Le champ d'application de ce texte, devenu l'article L. 245-1 du Code de la Sécurité Sociale, a été étendu par la Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 aux spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. L'assiette de cette taxe intègre les charges suivantes dès lors qu'elles sont afférentes à la promotion en France (y compris les DOM) des spécialités pharmaceutiques remboursables ou agréées à l'usage des collectivités : - les frais de visite médicale auprès des professions médicales (médecins, chirurgiens dentistes sages-femmes) et des établissements de santé, que les professionnels qui l'assurent soient on non salariés de l'entreprise (entreprises prestataires de service). Ils incluent les rémunérations de toutes natures y compris l'épargne salariale, les charges sociales et fiscales afférentes, les remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, les frais de repas et d'hébergement ; - les frais de publication et les achats d'espace publicitaire, sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément défini par voie réglementaire. Le taux de taxation varie en fonction du ratio R = assiette (charges de prospection et d'information après déduction des abattements) / chiffre d'affaires HT. Le barème de taxation, périodiquement alourdi, comporte actuellement quatre tranches (Tableau 69). Tableau 69 - Barème de taxation des frais promotionnels
1. Le regard des sciences sociales Depuis 1990, la diffusion massive des antidépresseurs et la stabilisation relative des anxiolytiques et hypnotiques n'a pas transformé sur le fond la structure démographique de la population consommatrice : dans 2 cas sur 3, l'usager est une femme et est âgé(e) de plus de 50 ans. Cette dynamique peut être mise sur le compte du vieillissement général de la population française. Les consommations sont d'autant plus durables que l'usager est âgé. En ce sens, la chronicité du recours est étroitement liée à la prise en charge du vieillissement, c'est-à-dire à la prévention et à l'accompagnement des maladies organiques et de l'invalidité, d'une part, de l'isolement, d'autre part. La prescription s'apparente ici à une gestion de la douleur, le cas échéant, à un soin palliatif. C'est la raison pour laquelle, dans 80 % des cas, l'ordonnance des médicaments psychotropes est associée à un médicament d'une autre classe pharmaceutique, cardio-vasculaire en particulier. La consommation des personnes quinquagénaires est caractérisée par des recours généralement ponctuels (inférieurs à l'année) et répondant à des événements de vie, souvent eux-mêmes conjoncturels (rupture conjugale, période chômée, etc.). Le public prescrit appartient en grande majorité aux milieux populaires (ouvriers, employés) et aux classes moyennes (professions intermédiaires), les classes supérieures étant peu représentées. En ce sens, la prescription ne s'adresse pas spécifiquement aux populations les plus démunies : la thèse d'une « intoxication des plus pauvres » ou d'une gestion médicinale de la crise de l'emploi ou de la pauvreté, n'a pas lieu d'être. La croissance des prescriptions d'antidépresseurs n'a pas non plus modifié sur le fond l'indication des médicaments psychotropes, ces médicaments s'étant, en partie, substitués aux benzodiazépines. S'ils ont contribué à ouvrir la médecine générale à la prise en charge des troubles psychiques, les traitements consacrés uniquement aux problèmes psychiques y demeurent marginaux, et s'appliquent essentiellement à la classe d'âge des 45-55 ans. De plus, l'essentiel des prescriptions concernent des formes atténuées de troubles psychiatriques ou ce qu'il est convenu d'appeler « la souffrance psychique » (mal-être, douleur, déprime, nervosité, etc.). Si l'usage de médicaments psychotropes est particulièrement répandu en France, l'ordonnance et la consommation de ces produits sont à l'image de l'engouement suscité dans notre pays par le médicament en général. Cette légitimité médicinale est telle qu'elle parvient à l'emporter sur les représentations souvent négatives qui entourent l'usage des médicaments psychotropes (dépendance, folie, etc.) : ces stéréotypes ne freinent pas la consommation, pas plus qu'ils ne dissuadent les consommateurs dont l'usage est chronique. Dans la mesure où le remboursement des médicaments continue d'être élevé en France, cette tendance est logiquement maintenue. L'organisation de l'offre de soin, en particulier de l'exercice en médecine de ville, ajoute à la diffusion des médicaments psychotropes. On observe en effet que la prescription des médecins généralistes, à clientèle égale, croît avec l'âge. Autrement dit, la propension à prescrire est pour bonne partie liée à l'ancienneté professionnelle, c'est-à-dire à la croissance d'activité des cabinets médicaux après 10 ans d'exercice. Les médicaments psychotropes, comme l'ordonnance en pharmacie de manière plus générale, sont dans ce cadre d'autant plus facilement délivrés et renouvelés qu'ils permettent aux praticiens de bénéficier d'un gain de temps, c'est-à-dire de faire face à la cadence des visites. La particularité française du paiement à l'acte n'est pas sans renforcer cette tendance. Deux visions de la santé cohabitent concernant les problèmes traités par les généralistes au moyen des médicaments psychotropes. L'une correspond à l'absence de maladie et s'emploie, sur ce motif, à corriger les dysfonctionnements physiques ou mentaux à l'origine de la pathologie. Les attentes des patients partagent cette visée, mais relèvent également d'une vision de la santé plus positive ou extensive : il y est question d'un maintien du bien-être, de la poursuite de l'intégration sociale face aux événements, de la conjuration du mal-être occasionné par la relation professionnelle ou conjugale, bref, d'une volonté d'échapper à la souffrance et au mal-être. Ce type d'attente a sa légitimité, et les prescriptions qui cherchent à répondre à cette demande ne doivent pas être considérées comme un dévoiement de l'intervention médicale et de la thérapeutique. La question porte plutôt sur l'accompagnement de la prescription, autrement dit, sur les moyens permettant de rompre l'isolement du médecin généraliste. Pour les traitements liés à la prise en charge des événements de vie, à la précarité (et aux conflits) professionnelle et familiale, et à certaines formes d'insomnie chronique, la prescription gagnerait à être prolongée, sinon substituée dans le temps, par une mesure d'action sociale et de soutien psychologique. De la même manière, le traitement des troubles psychiatriques, de la dépression en particulier, mériterait d'être entouré plus systématiquement d'une évaluation par un spécialiste, afin d'éviter l'installation de la pathologie, et par suite, une consommation de médicaments souvent chronique. Cette perspective implique de réunir autour du médecin généraliste des compétences idoines, tant dans le domaine du soin psychiatrique, psychothérapeutique, gériatrique que du travail social. 2. Actions de promotion de la prescription de psychotropes par l'industrie pharmaceutique Même si les actions de promotion des médicaments peuvent avoir pour objectif louable de former les médecins à leur utilisation optimale ou à mieux connaître la pathologie cible, elles ont incontestablement une finalité commerciale, directe ou indirecte. Lorsque la marge bénéficiaire d'un médicament devient faible, par exemple lors de l'arrivée d'un générique, l'investissement promotionnel dont il faisait l'objet est considérablement réduit. La promotion des médicaments psychotropes n'a guère de spécificité, et est fondée sur les stratégies marketing commune à tous les produits pharmaceutiques. Ces stratégies ont largement fait la preuve de leur capacité à augmenter le nombre de prescriptions, qui est in fine le seul indicateur intéressant les laboratoires pharmaceutiques et leurs actionnaires. On peut citer à titre d'illustration le résultat d'une étude réalisée en 2004 par enquête postale auprès de l'ensemble des médecins généralistes d'Aquitaine71. Dans le cadre de cette enquête explorant la prise en charge des schizophrénies débutantes, une question portait sur la visite médicale présentant l'un des antipsychotiques alors commercialisés (Risperdal®, Solian®, Zyprexa®). Les médecins ayant reçu une telle visite au cours du mois précédant (40 % des participants à l'enquête) avaient 3 fois plus de chances d'avoir initié un traitement antipsychotique au cours de cette période, indépendamment de toutes les autres caractéristiques (âge, sexe, lieu d'exercice, participation récente à une formation médicale continue sur la schizophrénie, stage en psychiatrie). Ce résultat démontre, s'il en était besoin, l'influence des visites médicales sur les pratiques de prescription72 73. Le fait que les médecins généralistes soient actuellement les cibles de stratégies promotionnelles concernant les antipsychotiques est étonnant puisque la population cible de ces médicaments est a priori restreinte, et le plus souvent prise en charge par des spécialistes. Ce point illustre le fait que les médicaments psychotropes sont devenu un créneau pour les industriels, qui mettent en œuvre des moyens marketing importants, y compris pour des produits dont les indications sont, encore, restreintes. Ce phénomène est relativement récent, les antidépresseurs ISRS ayant été les premiers médicaments psychotropes à atteindre le statut de blockbusters avec de campagnes promotionnelles mettant en œuvre des moyens considérables. Toutefois, la publicité pour les produits n'est pas seule à expliquer leur succès. Ainsi, les benzodiazépines, qui n'ont jamais fait l'objet de telles débauches de moyens marketing et ne sont plus promues depuis de nombreuses années, restent largement prescrites en France. 3. Approche juridique : le corpus normatif Même si les états membres de l'Union Européenne ne sont pas encore parvenus à élaborer une liste commune des substances et médicaments soumis à prescription, les textes impliquent que les psychotropes le soient, et, si nécessaire, avec un dispositif plus contraignant de « prescription spéciale ». La variable juridique n'est donc pas explicative des disparités de consommation au sein de l'Union . Au regard du droit communautaire, les autorités sanitaires françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation des critères de classement des médicaments psychotropes et du régime juridique qui en découle. Ce cadre évolutif autorise une adaptation constante des normes de prescription et de dispensation à l'évolution de l'état des connaissances relatives à ces produits. Les différents dispositifs juridiques applicables à la prescription et à la dispensation des psychotropes en France permettent, actuellement et à droit constant, d'étendre les mesures restrictives de manière graduée : limitation de la durée de prescription, extension de la réglementation des stupéfiants, dispensation fractionnée, prescription restreinte. Toutefois, ils ont pour limite l'étendue du champ de la liberté de prescription qui s'exerce, notamment, sur l'opportunité et la durée de traitement. Sans une pédagogie des bonnes pratiques de prescription des psychotropes, la portée coercitive de la norme peut s'avérer partiellement inopérante. Concernant la prise en compte de la pharmacodépendance ou de l'abus indépendamment du statut du produit consommé, ou de toute infraction à la réglementation des substances vénéneuses, la rationalisation du processus décisionnel s'appuie sur des systèmes de vigilance éprouvés. La mise en œuvre du principe de précaution est confrontée aux enjeux du marché des médicaments psychotropes, ainsi qu'à la place que la société souhaite accorder à un moment donné à des substances dont il incombe au ministre d'aménager les conditions d'accessibilité. Toutefois, ce pouvoir ne résout pas la question fondamentale de l'actualisation de la formation et de l'information des médecins et des pharmaciens dans le contexte évolutif du marché des médicaments psychotropes. Concernant l'encadrement de l'activité promotionnelle des laboratoires pharmaceutiques, il serait erroné de lier le différentiel de consommation français à la seule efficacité d'une pression promotionnelle induite par la recherche d'un « effet volume » : les stratégies marketing des laboratoires pharmaceutiques sont mondiales et sont peu segmentées en fonction du prix des produits. L'encadrement des activités promotionnelles des laboratoires peut être considéré comme comparable au sein des états membres l'Union Européenne ; la variable juridique n'est donc pas explicative des différentiels de consommation observés. Au regard du droit communautaire, les autorités sanitaires françaises disposent d'un large pouvoir de modulation de cet encadrement. Ce cadre évolutif autorise une adaptation constante aux pratiques marketing des laboratoires pharmaceutiques. Le dispositif français de contrôle a connu une évolution notable tendant à articuler les infractions commises par les laboratoires pharmaceutiques en matière de promotion avec le dispositif conventionnel placé sous le contrôle du CEPS. Les pratiques marketing conduisant à des interdictions de publicité et le non-respect de la « charte de la visite médicale » peuvent donner lieu à des pénalités financières et à des avenants aux conventions (baisses de prix). En outre, les laboratoires ainsi sanctionnés n'abordent pas les négociations tarifaires ultérieures avec le CEPS dans les meilleures conditions. Les psychotropes et les stupéfiants font l'objet de deux mesures spécifiques : l'intégration du mésusage, de la pharmacodépendance ou de l'abus du médicament faisant l'objet de la publicité dans les motifs d'interdiction des messages publicitaires ce qui permet de sanctionner le discours promotionnel au-delà de la conformité à l'AMM stricto sensu ; l'interdiction de distribution d'échantillons de ces produits. La visite médicale peut constituer, en raison du colloque singulier prescripteur/visiteur médical, un lieu de « dérapage promotionnel » éventuel. Toutefois, le dispositif mis en œuvre par la charte de la visite médicale et, notamment, l'affirmation de la pleine responsabilité du pharmacien responsable sur le « contenu des messages délivrés par le délégué médical » revêt une portée coercitive pouvant être appliquée, si nécessaire, avec plus de rigueur en matière de psychotropes. 1. Le Moigne P. Anxiolytiques, hypnotiques. Les données sociales du recours. Schweiz Z Soziol 2000;26:71-109. 2. Le Moigne P, Fernandez I, De Biasio V, Legrand E, Toppani A, Toussain J-M. La dépendance aux médicaments psychotropes. Enquête auprès des usagers et des prescripteurs. MILDT, 2004. 3. Ehrenberg A. Drogues et médicaments psychotropes. Le trouble des frontières. Paris: Esprit, 1998. 4. Guignon N, Mormiche P, Sermet C. La consommation régulière de psychotropes. INSEE-Première 1994;310. 5. Le Moigne P. Anxiolytique, hypnotiques : les facteurs sociaux de la consommation. Documents de Synthèse du Groupement de Recherche Psychotropes, Politiques et Société, CNRS 1999;1:1-41. 6. Mormiche P. Deux décennies d'évolution des consommations médicales. Enquête décennale (1991-1992). CREDES, 1994. 7. Rösch D, Hauesler L, Facy F. La consommation de produits psychotropes dans la population française : alcool, tabac, café, thé, médicaments psychotropes. CREDOC, 1989. 8. Sermet C. Les spécificités de la consommation d'anxiolytiques et d'hypnotiques. Enquêtes sur la santé et les soins médicaux (1991-1992). Paris: CREDES, 1995. 9. Baumann M, Alla F, Empereur F. Psychotropes et dépendances. Profils des consommateurs et trajectoires de leurs comportements. OFDT, 2001. 10. Ashton H. Psychotropic drug prescribing for women. Br J Psychiatry 1991;158:30-35. 11. Baumann M, Pommier J, Deschamps J-P. Prescription médicale et consommation de psychotropes : quelques interrogations sur les différences entre hommes et femmes. Cah Sociol Demogr Med 1996;36:63-78. 12. Tamblyn RM, Laprise R, Schnarch B, Monette J, Mc Leod PJ. Caractéristiques des médecins prescrivant des psychotropes davantage aux femmes qu'aux hommes. In: Cohen D, Pérodeau G. Drogues et médicaments mis en contexte: Santé Mentale au Québec, 1996:239-62. 13. Mishara BL. L'écologie familiale et la consommation de médicaments chez les personnes âgées : commentaires sur un facteur important ignoré dans les recherches et les projets de prévention. In: Cohen D, Pérodeau G. Drogues et médicaments mis en contexte: Santé mentale au Québec, 1996:200-15 14. Dupré-Lévêque D. Les "effets tertiaires" du médicament psychotrope. Bilan d'une recherche anthropologique menée dans le Sud-Ouest de la France auprès de consommateurs âgés. In: Cohen D, Pérodeau G. Drogues et médicaments mis en contexte: Santé Mentale au Québec, 1996:183-99. 15. Legrain M, Lecomte T. La consommation de psychotropes en France et dans quelques pays européens. Ann Pharm Fr 1998;56:67-75. 16. Katon W, von Koerff M, Lin E, Bish T, Ormel J. Adequacy and duration of antidepressant treatment in primary care. Med Care 1992;30:67-76. 17. Olfson M, Klerman GL. The treatment of depression : prescribing practices of primary care physicians and psychiatrists. J Fam Pract 1992;35:627-35. 18. Zarifian E. Le prix du bien-être. Psychotropes et société. Paris: Odile Jacob, 1996. 19. Fairman K, Drevets WC, Kreisman JJ, Teitelbaum F. Course of antidepressant treatment, drug type, and prescriber's specialty. Psychiatr Serv 1998;49:1180. 20. Lawrenson RA, Tyrer F, Newson RB, Farmer RDT. The treatment of depression in UK general practice: selective serotonin reuptake inhibitors and tricyclic antidepressants compared. J Affect Disord 2000;59:149-57. 21. Newman SC, Hassan AI. Antidepressant use in the elderly population in Canada : results from a national survey. J Gerontol 1999;54:527-30. 22. Lecrubier Y, Hergueta T. Differences between prescription and consumption of antidepressants and anxiolytics. Int Clin Psychopharmacol 1998;13:7-11. 23. Ohayon MM, Caulet M, Priest RC, Guilleminault C. Psychotropic medication consumption patterns in the UK general population. J Clin Epidemiol 1998;51:273-83. 24. Ohayon MM, Caulet M, P. L. Sujets âgés, habitudes de sommeil et consommation de psychotropes dans la population française. Encephale 1996;22:337-50. 25. Bebbington PE, Brugha TS, Meltzer H, Jenkins R, Ceresa C, Farell M, et al. Neurotic disorders and the receipt of psychiatric treatment. Psychol Med 2000;30:1369-76. 26. Bingefors K, Isaacson D. Continued use of antidepressants among patients in ambulatory care. Nord J Psychiatry 1996;50:217-23. 27. Tamblyn RM, Mc Leod PJ, Abrahamowicz M, Laprise R. Do too many cooks spoil the broth ? Multiple physician involvement in medical management of elderly patients and potentially inappropriate drug combinations. Can Med Assoc J 1996;154:1177-84. 28. Colvez A, Michel E, Quemada N. Les maladies mentales et psychosociales dans la pratique libérale. Approche épidémiologique. Psychiatrie Française 1979;10:35-42. 29. Tatossian A. Les pratiques de la dépression : étude critique. Revue Française de Psychiatrie 1985. 30. Le Moigne P, Colin I. Lieux et milieux de désarroi. Observation territorialisée des prescripteurs et consommateurs de médicaments psychotropes. LERS-INSERM-CNAMTS, 1997. 31. Hadsall RS, Freeman RA, Norwood GJ. Factors related to the prescribing of selected psychotropic drugs by primary care physicians. Soc Sci Med 1982;16:1747-56. 32. Davidson W, Molloy W, Somers G, Bédard M. Relation between physician characteristics and prescribing of elderly people in New Brunswick. Can Med Assoc J 1994;150:917-21. 33. Cormack MA, Howells E. Factors linked to the prescribing of benzodiazepines by general practice principals and trainees. Fam Pract 1992;9:466-71. 34. Kisely S, Linden M, Bellantuono C, Simon G, Jones J. Why are patients prescribed psychotropic drugs by general practitioners ? Results of an international study. Psychol Med 2000;30:1217-25 35. Lecrubier Y. Is depression under-recognised and undertreated ? Int Clin Psychopharmacol 1998;13:3-6. 36. Butler R, Collins E, Katona C, Orell M. How do general practionners select antidepressant for depressed elderly people ? Int J Geriatr Psychiatry 2000;15:610-13. 37. Kosky NM, Rasmussen JGC. Use and misuse : antidepressants in general practice. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 1999;3:121-28 38. Oxman TE, Korsen N, Hartley D, Sengupta A, Bartels S, Forester B. Improving the precision of primary care physician self-report of antidepressant prescribing. Med Care 2000;38:771-76. 39. Demailly L, Bresson M. Les modes de coordination entre professionnels dans le champ de la prise en charge des troubles psychiques: rapport final. Ifresi-Mire, 2005:246. 40. Haxaire C, Locquet C, Richard E, Bodénez P. "Enfin bon, elle va bien, mais elle prend son petit Imovane le soir" : Appréhension et gestion des dépendances médicamenteuses par les généralistes (Bretagne Occidentale). In: Egrot M, Desclaux A. Anthropologie du médicament: AMADES/Khartala, 2004. 41. Rapport de l'Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies. Drogues et dépendances - Indicateurs et tendances 2002. Drogues et Dépendances. OFDT, 2002. 42. Haxaire C. "Calmer les nerfs" : automédication et observance et dépendance à l'égard des médicaments psychotropes. Sci Soc Sante 2002;20:63-88. 43. Harman JS, Mulsant BH, Kelleher KJ, Schulberg HC, Kupfer DJ, Reynolds CF. Narrowing the gap in treatment of depression Int J Psychiatry Med 2001;31:239-53. 44. Mamdani MG, Parikh SV, Austin PC, Upshur REG. Use of antidepressants among elderly subjects : trends and contributions factors. Am J Psychiatry 2000;157:360-67. 45. Olfson M, Klerman GL. Trends in the prescription of antidepressants by office-based psychiatrists. Am J Psychiatry 1993;150:571-77. 46. Olfson M, Marcus SC, Pincus HA, Zito JM, Thompson JW, Zarin DA. Antidepressant prescribing practices of outpatient psychiatrists. Arch Gen Psychiatry 1998;55:310-16. 47. Eve SB, Friedsam HJ. Use of tranquilizers and sleeping pills among older texans. J Psychoactive Drugs 1981;13:165-73. 48. Gabe J, Lipshitz-Philipps S. Tranquilizers as social control? Sociol Rev 1984;36:320-52. 49. Koumjian K. The use of Valium as a form of social control. Soc Sci Med 1981;15:245-49. 50. Weyerer S, Dilling H. Psychiatric and physical illness, sociodemographic caracteristics and the use of psychotropic drugs in community : results from the upper Bavarian field study. J Clin Epidemiol 1991;44:303-11. 51. Johnson RE, Vollmer WM. Comparing sources of drug data about the elderly. J Am Geriatr Soc 1991;39:1079-84. 52. Le Moigne P. La faute au faubourg? La consommation de médicaments psychotropes en milieu urbain. Annales de la Recherche Urbaine 1996;73:74-82. 53. Cooperstock R, Lennard H. Some social meanings of tranquilizer use. Sociol Health Illn 1979;1:331-47. 54. Gabe J, Bury M. Tranquilizers and health care in crisis. Soc Sci Med 1991;32:449-54. 55. Gabe J, Thorogood M. Prescribed drug use and the management of everyday life: the experiences of black and white working class women. Sociol Rev 1986;34:737-72. 56. Mormiche P. Les disparités de recours aux soins en 1991. Econ Stat 1993;265:45-52. 57. Le Pen C. Une politique pour les tranquillisants ? In: Ehrenberg A. Individus sous influence Drogues, alcools, médicaments psychotropes. Paris: Esprit, 1991:271-80. 58. Chenu A. Sexe et mortalité en France - 1906-1980. Rev Fr Sociol 1988;29:293-324. 59. Le Moigne P. Territoires en déclin et consommation des médicaments psychotropes : une gestion ouvrière du désarroi urbain ? In: PIR-Villes. LERS, 1996. 60. Piotet F, Lattès C. Travail et relations de travail dans l'enquête sur la santé et les soins médicaux, 1991-1992. Laboratoire Georges Friedmann/MIRE, 1998. 61. Mant A, Duncan-Jones P, Saltamn D, Briges-Webb C, Kehoe L, Lansbury G. Development of long term use of psychotropic drugs by general practice patients Br Med J 1998;296:251-54. 62. Peneff. Les malades des urgences. Une forme de consommation médicale. Paris: Métailié, 2000. 63. Joubert M, Cocault G, Giraux-Arcella P, Maillard I, C. M. Urgences "psys". Arcanes et supports de l'accès aux aides et aux soins en santé mentale. Mire, 2005:270. 64. Champion F. Les psychothérapeutes en recherche de reconnaissance professionnelle. La difficile construction d'une légitimité. Mire, 2005:103. 65. Haafkens J. Rituals of silence. Long term tranquilizer use by women in the Netherlands. Amsterdam: Het Spinhuis, 1997. 66. Helman CG. "Tonic", "fuel" and "food" : social and symbolic aspects of long-term use of psychotropic drugs. Soc Sci Med 1981;158:521-33. 67. Haxaire C, Richard E, Dumitro-Lahaye C, Genest P, Bodénez P, Bail P. Représentations de la santé mentale et de la souffrance psychique par les médecins généralistes (de Bretagne Occidentale). Mire, 2005:315. 68. North D, Davis P, Powell A. Patients responses to benzodiazepines medication: a typology of adaptive repertoires developed by long-term users. Sociol Health Illn 1995;17:632-50. 69. Médic'Assurance Maladie. Les médicaments remboursés en 2003 et 2004 par le régime général d'Assurance Maladie. http://www.ameli.fr/244/DOC/2333/article.html, 2005. 70. IPSOS Santé pour la Caisse Nationale d'Assurance Maldie des Travailleurs Salariés (CNAM-TS). Les européens, le médicament, et le rapport à l'ordonnance. CNAM-TS, 2005. 71. Verdoux H, Cougnard A, Grolleau S, Begaud B. Impact of visits from pharmaceutical company representatives on antipsychotic prescription in primary care. Schizophr Res 2005;77:107-9. 72. McCormick BB, Tomlinson G, Brill-Edwards P, Detsky AS. Effect of restricting contact between pharmaceutical company representatives and internal medicine residents on posttraining attitudes and behavior. JAMA 2001;286:1994-9. 73. Wazana A. Physicians and the pharmaceutical industry: is a gift ever just a gift? JAMA 2000;283:373-80. IV.- QUESTION 3 : « DE QUELLE FAÇON CES MÉDICAMENTS SONT-ILS UTILISÉS AU REGARD DES RECOMMANDATIONS DE BONNE PRATIQUE ? » Fournir des données épidémiologiques concernant la prévalence des troubles psychiatriques, en particulier les troubles anxieux et dépressifs, en les comparant à la consommation des médicaments psychoactifs destinés à traiter ces troubles. Evaluer la proportion de personnes souffrant de troubles psychiatriques mais non diagnostiquées ou non traitées par voie médicamenteuse. Présenter le ratio bénéfice-risque de la consommation de médicaments psychotropes, s'agissant notamment des effets secondaires, des contre-indications et de l'iatrogénie, en évaluant également la prise en compte de ces risques lors de la prescription ainsi que le niveau d'information des patients sur leur existence. Rappeler les recommandations de bonne pratique pour les principaux médicaments psychotropes. Evaluer leur diffusion ainsi que leur application par les professionnels de santé (respect des durées de prescription, des indications, des posologies). Estimer le nombre et le montant total par an des prescriptions inappropriées de psychotropes. Intégrer à la réponse des éléments de comparaison européenne. 1. Critères de sélection des études Les études épidémiologiques ayant évalué la prévalence des troubles psychiatrique dans la population française ont été sélectionnées sur les critères suivants : (i) étude conduite entre 1990 et 2005 ; (ii) méthode d'échantillonnage permettant de sélectionner une population représentative de la population générale française (excluant donc les études menées sur des populations sélectionnées par le biais d'une consultation, y compris en médecine générale, telles que par exemple l'International Study of Psychological Problems in General Health Care) ; (iii) évaluation des troubles par une méthode standardisée de type entretien diagnostique structuré, permettant de poser les diagnostics selon les critères des classifications internationales de type CIM-10 ou DSM-IV. Un critère commun aux troubles identifiés dans ces classifications est que les manifestations symptomatiques génèrent soit une souffrance subjective, soit un retentissement sur le fonctionnement socio-professionnel ; (iv) évaluation diagnostique concomitante de plusieurs troubles (excluant donc les études ciblées sur un seul type de trouble tel que la dépression). 2. Etude ESEMeD (European study of the Epidemiology of Mental disorders) La méthode générale de l'étude ESEMeD, menée entre 2001 et 2003 dans 6 pays européens, a été présentée dans la question 11. Pour mémoire, les sujets ont été sélectionnés dans l'étude française à partir d'une base de sondage constituée de numéros de téléphones générés aléatoirement, avec stratification en fonction de la région et de la taille de la ville d'habitation. Les diagnostics de troubles psychiatriques ont été posés selon les critères du DSM-IV à partir de l'entretien diagnostique structuré WMH-CIDI (World Mental Health Composite International Diagnostic Interview), une version révisée du CIDI spécifiquement élaborée pour cette enquête2 3. Les résultats de cette étude sont synthétisés dans le Tableau 70. Les prévalences sur 12 mois ou sur la vie entière sont supérieures en France à celles mises en évidence dans les autres pays européens considérés conjointement, en particulier pour les troubles dépressifs et anxieux. Plus d'un français sur trois (38 %, dont 31 % des hommes et 45 % des femmes) ont présenté au cours de leur vie un trouble psychiatrique répondant aux critères diagnostiques DSM-IV. Il faut toutefois prendre en compte le fait que ces fréquences incluent les phobies spécifiques (animaux, événements naturels, etc..), qui ont une très forte prévalence, et pour lesquelles l'appréciation du retentissement (qui permet de les catégoriser en troubles) est difficile dans ce contexte d'évaluation, et a peut-être été surévaluée. Tableau 70. Prévalence des troubles psychiatriques selon les critères DSM-IV dans les 6 pays européens de l'étude ESEMeD et en France d'après Lepine et al, Alonso et al 2 3
1. 7,6 % en excluant la France 2. 19,8 % en excluant la France La comparaison des prévalences des troubles psychiatriques entre les pays est donnée dans le Tableau 714. Par rapport à l'Italie (pays de référence pour le calcul), la probabilité de présenter un trouble quel qu'il soit au cours des douze derniers mois est deux fois plus élevée en France, après prise en compte des différences de structure socio-démographique (sexe, âge, zone d'habitation rural/urbain et statut résidentiel). La probabilité est également deux fois plus élevée pour les troubles de l'humeur et les troubles anxieux. Les prévalences sont également élevée aux Pays-Bas et en Belgique par rapport à l'Italie, l'écart est moindre avec l'Allemagne et l'Espagne. Tableau 71. Troubles mentaux dans les 12 derniers mois dans six pays européens, étude ESEMeD.
Les limites de l'étude ESEMeD ont déjà été soulignées dans la question 1 (enquêteurs non professionnels, taux de réponse inférieur à 50 % dans l'échantillon français). Ces limites ne permettent toutefois pas d'expliquer la prévalence plus élevée des troubles dépressifs et anxieux dans la population française que dans les autres pays. En effet, la méthode d'enquête et de recueil de données sont comparables dans les différents pays et, comme cela a déjà été souligné, un faible taux de participation favorise la sous-représentation, et non la sur-représentation, des sujets les plus à risque de présenter un trouble psychiatrique. L'étude ESEMeD s'intègre dans une étude internationale dénommée World Mental Health Surveys, conduite sous l'égide de l'OMS dans 14 pays avec une méthode similaire5. Les résultats synthétiques de cette étude avec des données comparatives sur 7 pays européens, incluant les 6 pays de l'étude ESEMeD plus l'Ukraine, sont présentés dans le Tableau 72. Les données concernant les USA, qui est le seul autre pays développé inclut dans l'étude, sont également présentées ici à titre documentaire. Les troubles inclus diffèrent en partie de ceux présentés dans le Tableau 71 précédent, expliquant les différences de prévalence. L'inclusion d'autre pays que ceux de l'étude ESEMeD permet de relativiser la prévalence élevée des troubles psychiatriques dans la population française, si on considère celle mise en évidence aux USA. Cette étude permet de plus de préciser la fréquence des troubles "sévères", définis par la présence d'au moins un des critères suivants : trouble bipolaire type I ; dépendance aux substances avec un syndrome de dépendance physiologique; tentative de suicide; retentissement sévère sur le fonctionnement psychosocial. La méthode de recueil des information sur le retentissement a été moins exhaustive dans les pays inclus dans l'étude ESEMeD, et les données sur l'abus de substances psychoactives n'étaient pas recueillies dans cette étude, ce qui ne permet pas une comparaison avec les autres pays tels que les USA. En revanche, la comparaison entre les 6 pays ESEMeD reste pertinente, et montre que si le degré de sévérité est pris en compte, l'écart entre la France et les autres pays européens est moins marqué. Tableau 72. Prévalence sur 12 mois (%) des troubles psychiatriques selon l'étude World Mental Health Surveys5
1. Agoraphobie, anxiété généralisée, trouble obsessionnel-compulsif, trouble panique, état de stress post-traumatique, phobie sociale, phobie spécifique. 2. Trouble bipolaire, dysthymie, dépression majeure. 3. Boulimie (non exploré en Ukraine), trouble explosif intermittent (exploré uniquement aux USA et en Ukraine), troubles de l'enfance et de l'adolescence persistants à l'âge adulte (trouble hyperactivité déficit attention (non exploré en Ukraine), trouble des conduites, trouble oppositionnel). 4. Abus ou dépendance alcool ou substances psychoactives (exploré uniquement aux USA). 3. Enquête santé mentale en population générale La méthode de cette enquête conduite exclusivement en France entre 1999 et 2003 par le Centre Collaborateur de l'OMS et la DREES a été présentée dans la question 16. Les différences méthodologiques majeures avec l'étude ESEMeD précédemment décrite sont : (i) La méthode d'échantillonnage, basée ici sur une agrégation de données collectées dans 47 sites français, avec sélection des sujets par la méthode des quotas dans chaque centre. Le taux de participation n'a pas été documenté dans cette étude, notamment la proportion et les caractéristiques des personnes ayant refusé de participer. (ii) L'utilisation pour l'entretien diagnostique structuré du MINI pour lequel les critères de durée pour l'évaluation varient d'un trouble à l'autre, contrairement au WMH-CIDI. Les prévalences ne peuvent donc être directement comparées entre les deux études, puisque la période d'évaluation est différente. (iii) Les diagnostics générés par le MINI selon les critères CIM-10, peuvent être plus inclusifs que ceux posés selon les critères DSM-IV, en particulier pour le diagnostic d'épisode dépressif majeur. Tableau 73. Prévalence des troubles psychiatriques selon la CIM-10 dans la population française selon l'enquête Santé Mentale en population générale6
Ici encore, cette étude montre la prévalence élevée des troubles psychiatriques établis selon les critériologies internationales. Ainsi, plus d'une personne sur 10 présente au moment de l'enquête un syndrome dépressif d'intensité suffisamment importante pour répondre aux critères d'épisode dépressif majeur. 4. Étude de prévalence des troubles psychiatriques dans une population de personnes âgées Les résultats de cette étude conduite sur un échantillon sélectionné, non pas à l'échelon national, mais dans une ville française (Montpellier)7 sont rapportés ici car ils concernent une tranche d'âge où l'usage de psychotropes est particulièrement élevé en France. Les 1863 sujets inclus dans l'étude ont été tirés au sort parmi les personnes de plus de 65 ans inscrites sur les listes électorales de Montpellier, et ne vivant pas en institution. Le taux de non-participation a été faible (27,3 %), et ce bien que les conditions d'évaluation demandaient une implication active du sujet (une demi-journée d'examen dans un hôpital neurologique). L'évaluation des troubles psychiatriques a été conduite avec le MINI par des enquêteurs (infirmiers ou psychologues) formés, ce qui permettait de poser des diagnostics selon les critères DSM-IV. Les patients présentant un syndrome démentiel modéré à sévère ont été exclus de l'étude. L'âge moyen des sujets évalués était de 73 ans, et l'échantillon incluait 58,5 % de femmes. Les prévalences des troubles psychiatriques sont présentées dans le Tableau 74. Cette étude montre que la prévalence cumulée des troubles psychiatriques est très élevée dans une population de personnes âgées, avec près d'une personne sur deux répondant sur la vie entière aux critères diagnostiques DSM-IV d'un trouble psychiatrique. La fréquence élevée des troubles psychotiques est vraisemblablement liée aux limites du MINI qui évalue la présence de symptômes psychotiques, mais ni leur fréquence ni leur retentissement. Les prévalences instantanées des troubles anxieux et dépressifs sont globalement comparables à celles mises en évidence dans l'étude ESEMeD. Cette étude permet ainsi de confirmer qu'une proportion élevée de personnes âgées souffre de troubles dépressifs, et surtout de souligner que la fréquence des troubles anxieux reste très élevée dans cette tranche d'âge, ce qui est une donnée moins classique. Tableau 74. Prévalence des troubles psychiatriques DSM-IV dans une population de personnes âgées d'après Ritchie et al7
L'extrapolation de données locales au niveau national doit être faite avec prudence, car comme le soulignent les auteurs, plus d'un quart des sujets évalués ont été exposés à la guerre d'Algérie, ce qui peut avoir constitué un facteur de risque pour la survenue de troubles anxieux ou dépressifs. Les autres limites de cette étude sont liées au fait l'échantillon sélectionné n'est pas représentatif de la tranche d'âge évaluée, du fait de l'exclusion de personnes vivant en institution, et de la sélection de sujets inscrits sur les listes électorales. Toutefois, ces biais auraient entraîné une sous-estimation plutôt qu'une surestimation de la fréquence des troubles psychiatriques. 5. Données épidémiologique sur la prévalence des troubles psychiatriques chez l'enfant Les études conduites avec une méthode rigoureuse sur des populations d'enfants représentatives de la population française sont relativement rares. Une synthèse des données issues d'études françaises et internationales a été réalisée dans le cadre de l'expertise collective INSERM « Troubles mentaux : dépistage et prévention chez l'enfant »8. Cette synthèse a permis d'estimer le nombre d'enfants et adolescents de 0 à 19 ans souffrant d'un trouble psychiatrique (Tableau 75). Ces estimations suggèrent que la prévalence des troubles psychiatriques est relativement importante chez les sujets de moins de 20 ans, en particulier à l'adolescence, avec plus d'un sujet sur 10 âgé de 15 à 19 ans souffrant d'un trouble psychiatrique, dont 5 % d'un trouble anxieux et 3 % d'un trouble dépressif. Cependant, la rareté des études épidémiologiques françaises, et l'absence d'études internationales comparatives incluant la France, ne permettent pas d'estimer si ces prévalences diffèrent de celles des autres pays. Tableau 75. Estimation du nombre d'enfants et d'adolescents souffrant d'un trouble psychiatrique en France 8
1. Trouble envahissant développement ; 2. Troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité ; 3. Trouble obsessionnel compulsif Les études épidémiologiques conduites sur des échantillons représentatifs de la population française montrent qu'une large proportion de sujets présentent ou ont présenté à un moment de leur vie des symptômes psychiatriques dont le nombre, l'intensité et/ou la durée permettent de poser un diagnostic de trouble psychiatrique selon les critères internationaux. Une étude conduite dans une population de personnes âgées met en exergue la fréquence très élevée de troubles dans cette population. La prévalence des troubles psychiatriques apparaît plus élevée en France que dans les autres pays européens, tout en étant bien moindre que celle identifiée aux USA par exemple. Les instruments d'évaluation diagnostiques utilisés étant supposés contrôler les variations culturelles de réponse à des questions explorant les symptômes psychiatriques, il n'est donc pas possible d'invoquer ce mécanisme comme seule explication de ces différences de prévalence. A noter cependant que les estimations fournies par les études comparatives entre pays ne prennent pas en compte des facteurs explicatifs potentiels tels que des facteurs socio-économiques comme le taux de chômage. Quels que soient les mécanismes impliqués, la fréquence plus élevée de troubles psychiatriques en France par rapport aux autres pays européens devrait être prise en compte dans l'interprétation des études montrant une « surconsommation » de psychotropes en France par rapport à ces autres pays. Les données de l'étude ESEMeD montrent toutefois que ce critère est loin de suffire pour expliquer le niveau de consommation. Ainsi, la prévalence des troubles psychiatriques aux Pays-Bas est très proche de celle de la France, alors que sa consommation de psychotropes est une des plus faibles d'Europe. 1. Définitions et critères de sélection des études Il n'existe pas de définition univoque d'une prescription adéquate ou inadéquate de psychotropes. La définition légale repose sur le critère « pas d'AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) dans cette indication ». Cette définition est très restrictive. Des molécules commercialisées depuis plusieurs années, voire décennies, peuvent ne pas avoir d'AMM dans une indication car cette demande ne présente aucun intérêt commercial pour le laboratoire, alors qu'elles ont les mêmes propriétés que des molécules de la même classe possédant une AMM. Pour des médicaments plus récents, des prescriptions hors AMM peuvent être justifiées sur un plan médical, en particulier si elles sont étayées par les données d'études rigoureuses montrant l'intérêt de ce traitement dans cette indication. Ainsi, l'échelle dite « de la juste prescription hospitalière » décrit 4 niveaux d'adéquation 1 : prescription dans le cadre de l'AMM, 2 : prescriptions hors AMM correspondant aux données publiées, 3 : prescription discutable, 4 : erreur médicale. De plus, les données disponibles dans les études analysées dans ce chapitre portant exclusivement sur les classes de psychotropes, et non sur les molécules, l'application du critère AMM, par définition lié à une molécule, était impossible. Le critère d'adéquation utilisé pour les psychotropes a donc été l'existence d'une AMM pour un trouble donné pour la majorité des molécules de la classe considérée. Un trouble psychiatrique « avéré » a été défini comme remplissant les critères diagnostiques des classifications internationales. Nous reviendrons dans la synthèse sur les limites de ce critère. Les études ayant évalué l'adéquation entre traitement psychotrope et trouble psychiatrique ont été sélectionnées sur les critères suivants : (i) étude conduite entre 1990 et 2005 ; (ii) méthode d'échantillonnage permettant de sélectionner une population représentative de la population générale française ; (iii) évaluation des diagnostics psychiatriques répondant aux critères internationaux par une méthode standardisée de type entretien diagnostique structuré. 2. Etude ESEMeD (European study of the Epidemiology of Mental disorders) Le Tableau 76 montre les proportions de sujets présentant différents diagnostics de troubles psychiatriques au cours de l'année écoulée ayant pris au moins une fois durant cette période un psychotrope quelle que soit sa classe thérapeutique. La moitié des sujets français présentant un trouble psychiatrique n'ont pris aucun traitement psychotrope au cours de l'année écoulée, et cette proportion est encore plus importante dans l'ensemble des 6 pays ESEMeD. Si l'on considère les sujets répondant aux critères de troubles dépressifs, seul un quart des sujets ont été traités par le traitement de référence (antidépresseur) en France ou dans les 6 pays. En France, près de la moitié de ces sujets ont été traités par anxiolytiques, qui n'ont pas d'efficacité thérapeutique sur ces troubles s'ils ne sont pas associés à un antidépresseur. En revanche près d'une personne sur 5 (16,7 %) ne présentant aucun trouble psychiatrique a fait usage de psychotropes en France (essentiellement des anxiolytiques). Cette proportion est inférieure (10,1 %) dans les 6 pays considérés globalement et deux fois plus faible (7,8 %) si l'on considère la moyenne hors France. Tableau 76. Prévalence d'usage de psychotropes dans les 12 derniers mois en fonction des diagnostics psychiatriques DSM, étude ESEMeD9
1. Anxiolytique, hypnotique, antidépresseur, antipsychotique ou thymorégulateur. 2. Episode dépressif majeur ou dysthymie. 3. Agoraphobie, trouble anxieux généralisé, trouble panique, état de stress post-traumatique, phobie sociale ou phobie spécifique. 4. Trouble de l'humeur, anxieux ou abus/dépendance à l'alcool. Cellules grisées : données non disponibles pour la France. La concordance entre prescription de psychotrope et diagnostic psychiatrique a été évaluée sur l'échantillon français en estimant la proportion de personnes souffrant ou non d'un trouble psychiatrique chez les usagers de psychotropes10 (Tableau 77). Ces estimations montrent que plus des deux tiers des sujets usagers d'anxiolytiques/hypnotiques au cours des 12 derniers mois ne présentaient pendant cette période aucun trouble psychiatrique identifiable par la procédure d'évaluation utilisée. Cette proportion était de plus de la moitié chez les usagers d'antidépresseurs. Les proportions sont globalement comparables pour les diagnostics vie entière. Tableau 77. Prévalence des troubles psychiatriques chez les usagers d'anxiolytiques/ hypnotiques et d'antidépresseurs au cours des 12 derniers mois dans l'échantillon français ESEMeD10
1. Episode dépressif majeur ou dysthymie 2. Agoraphobie, trouble anxieux généralisé, trouble panique, état de stress post-traumatique, phobie sociale ou phobie spécifique 3. Trouble de l'humeur, anxieux ou abus/dépendance à l'alcool Les résultats de cette étude doivent être interprétés en prenant en compte de ses limites méthodologiques. Les durées de traitement ne sont pas précisées, la prise d'un seul comprimé d'hypnotique sur 12 mois (par exemple pour un voyage avec décalage horaire, ou tout autre événement ponctuel) peut donc faire passer une personne dans la catégorie « usage de psychotrope en l'absence de trouble identifié ». Inversement, la prise d'un antidépresseur pendant une semaine (alors que la durée recommandée est de plusieurs mois) peut faire passer une personne souffrant de trouble dépressif dans la catégorie « traitement psychotrope adéquat ». Les données concernent l'usage, et non la prescription, ainsi que les facteurs explicatifs ne peuvent être déterminés. En effet, le non usage d'un psychotrope en présence d'un trouble avéré peut être lié à plusieurs processus (absence de demande de soins, refus d'un traitement médicamenteux par le patient, prise en charge non médicamenteuse, non identification du trouble par le médecin, etc..). De même, l'usage en l'absence de trouble avéré peut être lié à plusieurs processus (automédication à partir de la pharmacie familiale, prescription indépendante du cadre nosographique, etc.). 3. Enquête santé mentale en population générale La méthode de cette étude a été présentée dans la question 1. Les résultats rapportés ici sont issus d'analyses effectuées au sein de l'Unité INSERM U657 grâce à la mise à disposition du fichier national, qui n'ont pas encore fait l'objet de publications scientifiques. Les données collectées dans le cadre de cette enquête permettent de mettre en relation les diagnostics de troubles psychiatriques évalués par le MINI et l'usage de psychotrope au cours de la vie entière, sans toutefois permettre d'établir si l'usage est ou non concomitant à la période de survenue du trouble. Les résultats concernant les traitements psychotropes rapportés chez les sujets présentant un diagnostic MINI sont résumés dans le Tableau 78. Près de la moitié des sujets avec un diagnostic MINI, quel qu'il soit, déclarent n'avoir jamais pris de traitement psychotrope au cours de leur vie. Ce pourcentage est plus réduit chez les sujets présentant un trouble de l'humeur, puisque les deux tiers ont fait usage de traitement à visée psychotrope; cependant, seuls 31 % d'entre eux ont fait usage d'antidépresseurs. De même, les sujets présentant un trouble anxieux rapportent plus fréquemment avoir fait usage d'anxiolytiques que d'antidépresseurs, alors que les antidépresseurs représentent actuellement le traitement de référence dans ces troubles. De manière cohérente, la fréquence d'usage des neuroleptiques est la plus élevée chez les sujets présentant un syndrome psychotique, tout en demeurant relativement faible. Ce dernier résultat est lié aux limites précédemment soulignées du diagnostic MINI de syndrome psychotique, qui est très surinclusif par rapport à un diagnostic clinique de trouble psychotique nécessitant des soins. Tableau 78. Usage de traitements à visée psychotrope sur la vie entière en fonction du diagnostic MINI chez les sujets participant à l'enquête SMPG
Les résultats concernant les diagnostics MINI identifiés chez les sujets rapportant l'usage d'un traitement à visée psychotrope sont présentés dans le Tableau 79. Pour interpréter les données présentées dans ce tableau, il faut tenir compte du fait que les co-morbidités ne sont pas prises en compte, c'est à dire que les fréquences d'usage des différents psychotropes sont rapportées par trouble, quels que soient les troubles associés. Ceci explique que les diagnostics de trouble anxieux soient les plus fréquemment identifiés chez les usagers quelle que soit la classe de psychotropes, du fait de la très fréquente co-morbidité anxieuse avec d'autres troubles. La proportion de sujets présentant au moins un trouble est la plus élevée chez les sujets usagers de neuroleptiques et de thymorégulateurs; il est toutefois notable que, même pour ces classes thérapeutiques dont les indications sont restrictives, une proportion non négligeable de sujets (un tiers pour les thymorégulateurs ; un quart pour les neuroleptiques) ne présentent aucun trouble identifié au MINI. Ceci n'est pas explicable par le fait que le MINI évalue essentiellement les troubles actuels (et que donc le trouble ayant motivé la prescription pourrait être en rémission), puisqu'en l'occurrence le syndrome psychotique (indication principale des neuroleptiques) et la survenue d'un épisode maniaque ou hypomaniaque (indication principale des thymorégulateurs) sont explorés sur la vie entière. Concernant les autres classes, un peu moins de la moitié des sujets usagers d'antidépresseurs n'ont aucun trouble identifié au MINI, et cette proportion est encore plus faible chez les usagers d'anxiolytiques et d'hypnotiques. Un résultat intéressant est que le profil de troubles présentés par les usagers d'anxiolytiques est globalement comparable à celui des usagers de traitements homéopathiques à visée psychotrope. Ces résultats vont dans la même direction que ceux de l'étude ESEMeD, à savoir que l'inadéquation entre diagnostic psychiatrique et traitement psychotrope existe aussi bien dans le sens « absence d'usage en présence d'un trouble avéré » que dans celui « usage en l'absence de trouble avéré ». Tableau 79. Diagnostics psychiatriques identifiés par le MINI chez les participants à l'enquête SMPG ayant fait usage au cours de leur vie d'un traitement à visée psychotrope
Des analyses complémentaires prenant en compte les co-prescriptions ont été effectuées pour évaluer l'adéquation diagnostic-traitement sur le sous-groupe de sujets présentant un trouble de l'humeur. Trois catégories de traitement et une catégorie « absence de traitement » ont été définies, ces catégories étant exclusives l'une de l'autre (impossibilité d'être dans plusieurs catégories à la fois) (Tableau 80). La catégorie « autre traitement » regroupe tous les traitements à visée psychotrope autres que les antidépresseurs, anxiolytiques et hypnotiques. Tableau 80. Usage de psychotropes chez les sujets participants à l'enquête SMPG présentant un trouble de l'humeur
La catégorie « traitement adéquat » a été ici définie comme incluant au moins un antidépresseur ou un thymorégulateur. Moins d'un tiers des sujets bénéficient ou ont bénéficié d'un tel traitement. Les autres catégories ont été définies, par défaut, comme « traitement non adéquat ». Nous avons exploré quelles étaient les caractéristiques associées à l'usage d'un « traitement inadéquat » chez les sujets ayant un diagnostic MINI d'épisode dépressif actuel et de trouble dépressif récurrent. La probabilité de recevoir un traitement inadéquat en fonction de telle ou telle caractéristique a été exprimée sous forme d'odds ratio (rapport de cotes). Un rapport supérieur à 1 signifie qu'un traitement inadéquat est plus fréquemment retrouvé chez les sujets présentant la caractéristique considérée. Un rapport inférieur à 1 signifie, au contraire, que les sujets présentant cette caractéristique sont moins fréquemment traités de manière inadéquate. Les résultats statistiques, relativement complexes, présentés dans les Tableaux 81 et 82 peuvent se résumer ainsi : (i) Les hommes présentant un épisode dépressif majeur sont plus fréquemment traités de manière « inadéquate » que les femmes : ils sont ainsi traités 1,6 fois plus souvent que les femmes par anxiolytiques ou hypnotiques que par antidépresseur ou thymorégulateurs; 1,7 fois plus souvent par un traitement "autre" que par antidépresseur ou thymorégulateur; et sont 2,2 fois plus susceptibles de ne recevoir aucun traitement. (ii) La probabilité de ne recevoir aucun traitement, ou un traitement « autre », par rapport à un traitement « adéquat », diminue de manière linéaire avec l'âge. Toutefois, la probabilité d'être traité par anxiolytique/hypnotique plutôt que par antidépresseur /thymorégulateur ne diffère pas en fonction de l'âge. Les sujets âgés sont donc globalement plus fréquemment traités de manière adéquate. L'âge n'influe cependant pas sur la probabilité de recevoir un traitement anxiolytique/hypnotique sans traitement antidépresseur/thymorégulateur associé. (iii) Le statut marital n'influe pas sur le type de traitement. (iv) Plus le niveau d'étude est élevé, moins les sujets sont susceptibles de recevoir un traitement « adéquat ». (v) Plus le niveau de revenu est élevé, moins les sujets sont susceptibles de recevoir un traitement « adéquat ». Comme certaines de ces caractéristiques peuvent être très fortement associées, des analyses complémentaires (non détaillées ici) ont été effectuées pour explorer quelles caractéristiques étaient indépendamment associées à l'inadéquation du traitement. Toutes les associations restent globalement inchangées, hormis la relation avec le niveau d'étude qui disparaît quand les autres caractéristiques sont prises en compte. Ceci s'explique par le fait que niveau d'étude et niveau de revenu sont très corrélés, et que l'effet du niveau de revenu sur l'inadéquation est plus fort que celui du niveau d'étude. Les résultats sont globalement similaires quand les analyses sont restreintes aux sujets présentant un trouble dépressif récurrent, en d'autres termes, la répétition des épisodes n'entraîne pas une meilleure adéquation du traitement chez les sujets présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus. Ces résultats doivent être interprétés avec prudence du fait des limites méthodologiques précédemment soulignées. La définition de traitement "adéquat" repose sur la notion de prise, au cours de la vie entière, d'un traitement antidépresseur ou thymorégulateur, sans que l'on connaisse la durée de celui-ci, les doses, et surtout la concomitance par rapport à la survenue du ou des épisodes dépressifs, informations qui, seules, permettent d'évaluer réellement l'adéquation. Il n'est pas possible de déterminer si l'absence de prise de traitement est liée aux caractéristiques des sujets (par exemple, les hommes souffrant de dépression ont un recours aux soins de moins bonne qualité que les femmes; les sujets ayant de plus haut revenus sont plus réticents à faire usage de psychotropes ou ont plus souvent recours à des traitements non médicamenteux), à celles du prescripteur (comportement de prescription différent en fonction des caractéristiques du sujet) ou aux deux associées. Malgré ces limites, ces résultats ont pour intérêt de montrer que le fait de ne pas bénéficier d'un traitement adéquat pour un épisode dépressif est étroitement lié aux caractéristiques socio-démographiques du sujet. Tableau 81. Facteurs associés au type de traitement psychotrope chez les sujets présentant un épisode dépressif majeur isolé ou récurrent chez les sujets participant à l'enquête SMPG
OR (IC 95%) = Odds Ratio (intervalle de confiance à 95%) Tableau 82. Facteurs associés au type de traitement psychotrope chez les sujets présentant un trouble dépressif récurrent, chez les sujets participant à l'enquête SMPG
4. Enquête santé et protection sociale du Centre de Recherche, d'Etude et de Documentation en Economie de la Santé Nous avons déjà rapporté dans la question 1 les résultats d'une enquête sur l'usage des psychotropes réalisée par le CREDES en 1991 (Centre de Recherche, d'Etude et de Documentation en Economie de la Santé ; devenu IRDES, Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé). Une autre étude réalisée par cet institut en 1996 et 1997 a porté sur la prévalence et la prise en charge de la dépression11. Les données sont issues de l'enquête Santé et Protection Sociale menée chaque année par le CREDES en France auprès d'environ 10 000 personnes, représentatives d'environ 95 % des ménages « ordinaires ». Les personnes souffrant de dépression au moment de l'enquête ont été identifiées d'une part à partir de la déclaration spontanée par l'enquêté à partir d'une liste de maladies, et d'autre part à partir d'une liste de question issues du MINI. La prévalence ponctuelle de la dépression varie pratiquement du simple au double selon la méthode utilisée : 7 % en déclaration spontanée (9 % de femmes et 3,5 % d'hommes) et 12 % avec le MINI (16 % de femmes et 7 % d'hommes). Le MINI identifie une dépression non déclarée chez 8 % des enquêtés, quand 3,8 % déclarent une dépression repérée par le MINI, et 2,8 % déclarent une dépression non repérée par le MINI. La dépression repérée par le MINI et non déclarée est plus fréquente chez les jeunes et les femmes. La consommation de médicaments et le recours aux soins des personnes souffrant de dépression sont indiquées dans le Tableau 83. Tableau 83. Prise en charge médicale des personnes souffrant de dépression de 16 ans et plus, enquête CREDES 1996-1997
Les personnes dont la dépression est identifiée exclusivement par le MINI ont un recours aux soins nettement inférieur à celui des personnes déclarant souffrir de dépression. La moitié des personnes avec dépression déclarée ont consommé un psychotrope la veille de l'enquête, contre un peu plus d'une personne sur dix dont la dépression est identifiée par le MINI. A noter que la proportion de dépression déclarée ou identifiée par le MINI et traitée par antidépresseur est encore plus faible. Ces proportions sont également plus faibles si on considère les traitements pris au cours du dernier mois. Un nombre très faible de sujets (0,5 %) consomment des antidépresseurs sans se déclarer dépressifs ou être repérés comme tels par le MINI. L'intérêt de cette étude est de montrer que l'appréciation de l'adéquation diagnostic-traitement est très dépendante de la méthode d'évaluation de la dépression. La proportion de sujets avec une dépression identifiée par le MINI et non traitée est nettement plus élevée que dans les autres études en population générale. Inversement, le pourcentage de sujets traités par antidépresseur et ne présentant ni dépression déclarée ni dépression identifiée par le MINI est très faible. Ces estimations doivent être considérées avec précaution, la méthode de passation du MINI (ou la sélection de questions ?) ayant peut être conduit à une inflation de diagnostics de dépression, les prévalences ponctuelles de dépression étant nettement supérieures à celles habituellement identifiées en population générale par les techniques d'entretien diagnostique structuré. 5. Adéquation entre usage de benzodiazépines et diagnostic La méthode de cette étude conduite sur un échantillon de 4000 sujets représentatifs de la population française sélectionnés par l'Institut IPSOS et interviewés par téléphone a déjà été présentée (Question 1)12. La fréquence des troubles anxieux et de troubles de l'humeur évalués par le MINI dans l'échantillon total et chez les usagers actuels de benzodiazépine est indiquée dans le Tableau 84. Seuls 5 % des utilisateurs de benzodiazépines ne présentent aucun de ces troubles, contre plus de 80 % des sujets de l'échantillon total. Indépendamment de l'âge et du sexe, la présence d'un trouble anxieux isolé (sans trouble de l'humeur) double le taux d'usage des benzodiazépines, celui d'un trouble de l'humeur isolé le multiplie par 4, et le fait de présenter ces deux types de troubles associés le multiplie par 8. L'usage de benzodiazépines est particulièrement élevé chez les sujets présentant une phobie sociale (28 %), un trouble panique (26,8 %) ou un épisode dépressif majeur actuel (25,8 %). Tableau 84. Usage actuel de benzodiazépines (BZD) selon la présence de troubles de l'humeur ou de troubles anxieux12
La limite de cette étude ciblée sur l'usage des benzodiazépines est que l'on ne dispose pas de données sur les traitements psychotropes associés. La proportion de sujets usagers de benzodiazépines qui ne présentent aucun trouble psychiatrique est plus faible que dans les études précédentes, ce qui pourrait suggérer que l'inadéquation, au sens large du terme, (traitement psychotrope en l'absence de trouble) concerne un nombre relativement limité de sujets. Toutefois, l'inadéquation est caractérisée quand on examine les prescriptions trouble par trouble. En particulier, l'usage de benzodiazépines n'est pas recommandé dans la phobie sociale ou le trouble panique, même en association avec les antidépresseurs, car ces traitements peuvent entraîner une pérennisation des symptômes, le risque de survenue d'une dépendance étant particulièrement élevé dans ces troubles. 6. Troubles du sommeil et usage des psychotropes chez les sujets âgés La méthode de cette étude conduite dans 4 pays européens par Ohayon et collaborateurs13 a déjà été présentée (Question 1). Les données recueillies dans l'échantillon français ont été utilisées pour explorer les relations entre habitudes de sommeil et usage de psychotropes chez les personnes âgées14. Les sujets âgés inclus dans cette étude n'étaient pas institutionnalisés, et étaient aptes à participer à un entretien téléphonique. Les plaintes concernant la qualité du sommeil augmentent avec l'âge, avec un temps de sommeil plus court, un délai d'endormissement plus long, et plus d'éveils nocturnes, avec toutefois également une augmentation du temps passé au lit ou la pratique de la sieste. Inversement, parmi les sujets se plaignant de leur sommeil, la fréquence des diagnostics d'insomnie primaire ou de troubles du sommeil liés à un trouble psychiatrique (critères DSM IV) décroît avec l'âge (30,6 % des sujets entre 45 et 64 ans ; 23,3 % entre 65 et 74 ans ; 14 % à 75 ans et plus). En d'autres termes, les personnes âgées ont une plainte par rapport à la qualité de leur sommeil, mais celle ci ne s'intègre le plus souvent pas dans le cadre d'un diagnostic de trouble. Un quart (22 %) des sujets âgés de 65 à 74 ans, et un tiers (32 %) de ceux âgés de 75 ans et plus, répondaient positivement à la question « prenez vous actuellement un médicament pour vous aider à dormir ? ». L'usage de ce traitement en l'absence de plaintes concernant le sommeil augmente avec l'âge (9,2 % des sujets entre 45 et 64 ans ; 19,5 % entre 65 et 74 ans ; 25,6% à 75 ans et plus). Les limites de cette étude ont déjà été évoquées, notamment pour la question explorée ici, la méthode de recueil d'informations par téléphone sur l'usage de psychotropes, avec absence de possibilité de contrôle sur des ordonnances ou dans les armoires à pharmacie. Son intérêt est de montrer la fréquente absence de concordance chez les personnes âgées entre plainte liée au sommeil et diagnostic de troubles du sommeil d'une part, et entre traitement hypnotique et diagnostic de trouble du sommeil de l'autre. 7. Adéquation à l'autorisation de mise sur le marché des instaurations de traitement par des inhibiteurs spécifiques du recaptage de sérotonine Cette étude réalisée en Basse-Normandie avait pour objectif d'évaluer l'adéquation des instaurations de traitement ambulatoire par ISRS aux indications de l'AMM15. La population source correspondait aux bénéficiaires du régime général de l'assurance maladie de Basse Normandie, âgés de 18 à 70 ans, pour lesquels un ISRS (fluoxétine, paroxétine, citalopram, sertraline, fluvoxamine) avait été remboursé sur la période du 1er décembre 2003 au 31 mars 2004 et sans antécédent de traitement antidépresseur, toutes classes confondues, dans les deux ans précédents. L'échantillon a été sélectionné par tirage au sort sur les dix derniers jours de chaque mois. Dans un délai de quatre à six semaines après la délivrance initiale d'ISRS, les patients ont été convoqués au service médical pour permettre le recueil d'information par un médecin-conseil, incluant la passation MINI pour établir les diagnostics. L'adéquation à l'AMM a examinée en fonction du diagnostic retenu par le médecin enquêteur étaient la dépression caractérisée (tous les ISRS), les troubles obsessionnels compulsifs (fluoxétine, paroxétine, fluvoxamine et sertraline), l'anxiété généralisée (paroxétine), les troubles pnaiques avec ou sans agoraphobie (paroxétine, citalopram), les phobies sociales (paroxétine) et le traitement d'appoint de la boulimie (fluoxétine). Au total, 292 patients ont été inclus dont 25 non répondants (comparables aux répondants pour le sexe, l'âge, et la répartition moyenne des molécules d'ISRS). Parmi les 267 répondants, 170 étaient des femmes (sexe ratio = 0,57) et la moyenne d'âge était de 43,3 ans. Le prescripteur était un médecin généraliste dans 88,8 % des cas, un psychiatre dans 6,4 % des cas et un praticien hospitalier de spécialité indéterminée dans 4,9 % des cas. La paroxétine était prescrite dans 36,3 % des cas, le citalopram dans 22,5 %, la fluoxétine dans 21 %, la sertraline dans 19,5 % et la fluvoxamine dans 0,7 %. Dans 62,5 % des cas, la prescription incluait un ou plusieurs autres psychotropes. Un tiers des patients (32 %, 83 sur 259 renseignés) avaient interrompu leur traitement au moment de l'examen par le médecin enquêteur. Le diagnostic le plus fréquemment retenu par le médecin-conseil était celui de dépression caractérisée, identifié dans plus de la moitié des cas (Tableau 85). Dans 22,1 % des cas, aucune pathologie psychiatrique n'était mise en évidence par le MINI ; ces patients ayant consulté pour une contrariété, une tristesse aiguë passagère, un deuil, un surmenage ou état de stress aigu. Selon les indications de l'AMM citées ci-dessus, le pourcentage des prescriptions hors AMM était de 33,7 % (n=90). L'adéquation à l'AMM était significativement associée à un suivi psychothérapeutique spécialisé quel que soit le prescripteur initial (OR = 6,1, IC 95 % : 2,1-17,6). De même, il existait une association significative entre inadéquation à l'AMM et arrêt prématuré du traitement (OR = 3,55, IC 95 % : 2-6,4). Tableau 85. Diagnostic MINI1 pour les bénéficiaires de 18 à 70 ans du régime général de l'assurance maladie de Basse-Normandie traités par un ISRS2
1. Mini International Neuropsychiatric Interview 2. Inhibiteurs Spécifiques du Recaptage de Sérotonine 3. Intervalle de Confiance à 95 % Cette étude confirme que les antidépresseurs ISRS sont fréquemment prescrits hors AMM, et que les extensions d'indication concerne essentiellement une réponse médicamenteuse à la survenue d'événements de vie aigus. Les symptômes motivant ces prescriptions correspondent probablement à des troubles de l'adaptation selon les classifications internationales, pour lesquels la prescription d'un antidépresseur n'est pas requise selon les recommandations. Une information intéressante est le fait que les traitements de durée inadéquate sont plus fréquents chez ces sujets, ce qui relativise l'impact délétère des interruptions prématurés de traitement puisque la prescription de départ était inadéquate (tout au ne respectait pas les recommandations). C. IMPACT POPULATIONNEL DE L'UTILISATION INAPPROPRIÉE DE PSYCHOTROPES (ÉVALUATION DU RAPPORT RISQUE/BÉNÉFICE) L'efficacité des médicaments psychotropes, et leur apport inestimable dans la prise en charge médicale des troubles psychiatriques sévères (par exemple, schizophrénie, trouble bipolaire, dépression sévère), sont incontestables. Dans ce cas, les bénéfices des traitements psychotropes excèdent le plus souvent, et de façon nette, dans ces cas les risques liés à la prise d'un traitement, même prolongé. L'évaluation du rapport bénéfice/risque se pose essentiellement dans les autres conditions, en sachant que, comme nous venons de le voir, les frontières entre les troubles psychiatriques sévères ou non, voire entre présence et absence de troubles psychiatriques, reposent, sur des critères relativement arbitraires. Il serait ici hors de propos de passer en revue tous les effets secondaires et complications liés à l'usage de psychotropes. Les risques détaillés ici ont été sélectionnés à titre illustratif, sur des critères d'impact en santé publique, à savoir l'existence d'un risque vital et/ou de handicap, et une proportion importante de sujets exposés dans la population générale. D'autres complications des psychotropes exposant à des complications avec un niveau de sévérité comparable ne seront pas détaillés ici (par exemple, syndrome malin des neuroleptiques, diabète induit par certains antipsychotiques atypiques), car la population exposée est (à ce jour) nettement plus restreinte. Le problème du rapport bénéfice/risque se poserait cependant si la population traitée s'élargissait notablement du fait d'une extension (exemple, des neuroleptiques atypiques) ou d'un non respect des indications. 1. Antidépresseurs et risque suicidaire a) Antidépresseurs et conduites suicidaires dans la population adulte Historique des décisions réglementaires des agences de régulation et de contrôle La première alerte concernant un rôle des antidépresseurs dans le risque suicidaire date du début des années 1990 avec la publication de quelques rapports de cas16 17. Une première méta-analyse des données issues d'essais cliniques ne montrait pas d'augmentation de risque suicidaire associé à l'usage d'antidépresseurs18. Ce n'est qu'à compter de 2003 que l'attention des agences de régulation sanitaire a été attirée par des données sur les conduites suicidaires issues d'essais cliniques. En juin 2003, le Committee on Safety of Medicines du Royaume-Uni met en garde contre l'usage de la paroxétine (Deroxat®) chez les moins de 18 ans et l'Afssaps contre-indique son usage chez les moins de 15 ans (âge définissant arbitrairement l'enfant), dans l'attente de résultats complémentaires. En septembre 2003, l'Afssaps interdit la prescription de venlafaxine (Effexor®) chez les moins de 18 ans. En octobre 2003 aux Etats-Unis, un communiqué de la Food and Drug Administration (FDA) alerte sur une augmentation possible de la prévalence des idées et des tentatives de suicide chez les enfants, traités par antidépresseurs, ceci à partir de données préliminaires tirées d'une revue de 20 essais cliniques comparant antidépresseurs et placebo. En décembre 2003, le Committee on Safety of Medicines interdit la prescription de tous les ISRS chez les moins de 18 ans, à l'exception de la fluoxétine (Prozac®) dont le rapport bénéfice/risque est jugé favorable. Début 2004, l'American College of Neuropsychopharmacology affirme que seule la fluoxétine a montré son efficacité chez les enfants et les adolescents19, mais que les données sur antidépresseurs et suicide sont insuffisamment étayées pour justifier que ces produits ne soient pas utilisés chez les jeunes, le suicide paraissant davantage imputable à la dépression. En mars 2004, la FDA alerte sur la nécessité d'une surveillance lors de l'usage d'antidépresseurs aussi bien chez les adultes que chez les enfants, par rapport au risque d'aggravation de la dépression ou d'émergence d'une « suicidalité », quelle qu'en soit la cause. En septembre 2004, la FDA insère dans les conditionnements de tous les antidépresseurs un avertissement (« warning box ») concernant un risque d'idées ou de tentative de suicide susceptibles de survenir chez 4 % des enfants/adolescents traités (contre 2 % sous placebo). En décembre 2004, l'Agence Européenne du Médicament (EMEA) déconseille la prescription d'ISRS chez les moins de 18 ans en raison d'un risque accru d'idéations suicidaires et de tentatives de suicide ; de son côté, l'Afssaps rappelle que leur emploi est contre-indiqué chez l'enfant et l'adolescent sauf en ce qui concerne la sertraline (Zoloft®) et la fluvoxamine (Floxyfral®) dans le trouble obsessionnel compulsif. En février 2005, la FDA édite un guide de traitement qui doit être remis par les pharmaciens à tous les patients ayant une délivrance d'antidépresseurs aux Etats-Unis, ainsi qu'un guide de bonne pratique recommandant une surveillance rapprochée dans les premières semaines de traitement20. La FDA recommande une surveillance régulière chez les adultes mais diffère ses conclusions quant à une éventuelle association entre antidépresseurs et « suicidalité » chez les adultes. Essais thérapeutiques Les conduites suicidaires sont un phénomène rare, aussi les essais thérapeutiques portant sur un nombre relativement limité de sujets pourraient manquer de puissance pour évaluer la fréquence de survenue de cet événement. Pour pallier cette limite, plusieurs méta-analyses regroupant les données de plusieurs essais thérapeutiques randomisés et contrôlés ont été conduites, avec des résultats contradictoires. Plusieurs de ces méta-analyses n'ont pas mis en évidence de différence significative entre antidépresseurs et placebo en ce qui concerne le risque de conduites suicidaires. L'une s'intéressait à la survenue de suicide et de tentatives de suicide à partir des données de 45 essais cliniques rassemblant 20 000 sujets déprimés adultes21. Une autre concernant les tentatives de suicide rassemblait les essais soumis entre 1983 et 1997 au Medicines Evaluation Board des Pays-Bas, ainsi que des essais publiés à l'époque (77 études à court terme avec 12 246 sujets et 15 études à long terme avec 1949 sujets)22. La plus récente, a été menée par la FDA à partir de 234 essais cliniques étudiant 20 antidépresseurs différents dans le traitement de la dépression, ne montrait aucune augmentation du suicide associée au placebo, ni à aucun antidépresseur23 24. Une méta-analyse montre même une diminution significative des idées suicidaires sous fluoxétine par rapport au placebo, à partir de 25 essais thérapeutiques rassemblant 4 016 cas de dépression25. Une autre méta-analyse a étudié, à partir de 17 essais cliniques, l'impact de la fluoxétine, utilisée dans le traitement de la dépression majeure (n= 1 765), par comparaison aux antidépresseurs tricycliques (n=731) et à un placebo (n=569)18. Cette étude ne retrouve pas d'augmentation significative de l'incidence des actes suicidaires sous antidépresseurs (prévalence de 0,2 % sous placebo, 0,3 % sous fluoxétine et 0,4 % sous tricyclique). L'incidence des idéations suicidaires est significativement plus basse sous fluoxétine (1,2 %) que sous placebo (2 %) ou tricycliques (3,6 %) ; l'amélioration d'idées suicidaires préexistantes est supérieure avec les antidépresseurs que sous placebo. Enfin, selon une autre méta-analyse d'essais publiés, le risque de suicide et de tentative de suicide est similaire pour les ISRS et les tricycliques mais il est supérieur sous placebo par rapport à ces deux classes d'antidépresseurs26. L'analyse secondaire d'essais thérapeutiques menés chez des sujets âgés retrouve également une diminution des idées suicidaires sous antidépresseurs27. Le groupe classé comme à haut risque suicidaire (tentative de suicide récente ou idées suicidaires actuelles) nécessitait une durée plus longue de traitement pour montrer une amélioration significative par rapport aux sujets considérés comme à risque modéré (idées de mort récurrente) ou faible. D'autres méta-analyses suggèrent néanmoins que l'usage d'antidépresseurs soit associé à un risque accru de conduites suicidaires. Ainsi, une méta-analyse basée sur neuf études rapportées par la FDA si elle ne montre pas de différence entre les ISRS, les autres antidépresseurs et le placebo en termes d'incidence du suicide par année d'exposition, retrouve une augmentation des idéations, impulsions et tentatives de suicide sous antidépresseurs28. Selon une autre méta-analyse comparant ISRS et placebo à partir de 477 études et plus de 40 000 sujets [données soumises à la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)], les ISRS élèvent le risque d'actes autoagressifs (OR de 1,6 ; IC95 % 1-2,6), mais pas de suicide (OR de 0,9 ; IC95 % 0,2-3,4), ni d'idéations suicidaires (OR de 0,8 ; IC95 % 0,4-1,6)29. Même si les méta-analyses permettent en synthétisant les données d'essais thérapeutiques d'atteindre une puissance statistique suffisante pour mettre en évidence des événements de survenue rare, leurs résultats sont difficilement généralisables à l'ensemble des sujets traités par antidépresseurs. En effet, ces méta-analyses portent exclusivement sur les sujets inclus dans des essais thérapeutiques, qui se déroulent sur une courte durée (4 à 12 semaines), chez des patients souffrant d'épisodes dépressifs d'intensité légère à modérée, et excluent le plus souvent les patients ayant des idées suicidaires ou une comorbidité (par exemple conduites addictives). Ainsi, les échantillons de patients évalués dans les essais thérapeutiques diffèrent considérablement de la population exposée aux antidépresseurs en conditions réelles de prescription30 31. De plus, la courte durée d'évaluation ne permet pas de mettre en évidence une réduction des conduites suicidaires à moyen ou long termes, qui pourrait contrebalancer un éventuel accroissement en début de traitement32. Enfin, selon différents auteurs, les données issues des essais cliniques ne permettraient pas de conclure sur l'existence d'un lien entre antidépresseurs et conduites suicidaires en raison de l'hétérogénéité de la définition des conduites suicidaires33. Donald Klein critique ainsi les décisions de la FDA, rappelant qu'aucun suicide n'est survenu au cours des études, et qu'il est difficile d'inférer un risque de suicide (sous-entendu par le terme « suicidalité ») à partir de données portant sur des idées suicidaires. Il souligne l'absence de définition précise et valide du terme « suicidalité » utilisé dans ces études et par la FDA, ainsi que le caractère rétrospectif des analyses de données, qui ont été collectées dans un autre objectif34. Etudes sur des populations cliniques Les études menées dans des conditions naturelles de prescription en population clinique souffrent de limites d'extrapolation moins importantes que les essais thérapeutiques, même si les sujets inclus dans les études analysées ici sont recrutés à partir d'un service de santé (hospitalisation ou consultation), et ne sont donc pas totalement représentatifs de la population générale. La NIMH Collaborative Depression Study a suivi 643 sujets, pendant plus de quatre ans, souffrant de dépression, traités ou non par antidépresseur35. L'usage d'antidépresseur est associé à une diminution non significative des conduites suicidaires, celles-ci étant liées à la sévérité de la psychopathologie et aux antécédents de tentatives de suicide. Une étude rétrospective de 521 patients traités par un même psychiatre pour dépression entre 1978 et 2000 a comparé les taux des conduites suicidaires pendant et après l'arrêt des traitements antidépresseurs36. Elle montre que ce risque est multiplié par un facteur cinq après l'arrêt des antidépresseurs, qu'il s'agisse d'une rechute, d'un effet rebond, d'un sevrage, ou d'une inefficacité du traitement à l'origine de l'arrêt. Il n'existait pas, sur ce plan, de différence significative entre ISRS et tricycliques. Trois études ont utilisé les données de la General Practice Research Database au Royaume-Uni, qui collige les informations collectées par plusieurs centaines de médecins généralistes37-39. La première s'est intéressée aux sujets ayant eu une première prescription d'antidépresseur entre 1993 et 199937. Elle montre une augmentation du risque de tentative de suicide dans le premier mois de traitement et, particulièrement dans les neuf premiers jours, avec un risque multiplié par quatre par rapport aux sujets traités depuis au moins 90 jours ; le risque n'étant pas augmenté à l'arrêt du traitement. Une étude cas-témoin intra-cohorte a comparé la survenue d'actes autoagressifs et de suicide chez 145 095 sujets souffrant de dépression ayant eu une première prescription d'antidépresseurs (ISRS et tricycliques) entre 1995 et 200138. Par comparaison aux tricycliques, les ISRS sont associés à un risque accru d'actes auto-agressifs chez les sujets de moins de 18 ans (OR de 1,6 ; IC95 % 1-2,5), mais pas dans l'échantillon total (OR de 0,99 ; IC95 % : 0,9-1,1). Le risque de suicide est moindre sous ISRS que sous tricycliques dans l'ensemble de l'échantillon (OR de 0,6 ; IC95 % 0,3-1,3). La dernière étude avait pour objectif d'évaluer si le choix de l'antidépresseur était influencé par un profil de risque suicidaire, en comparant les facteurs de risque suicidaires chez des sujets recevant de l'Effexor® (n=27 096), du Prozac® (n=134 996) et du Seropram® (n=52 035)39. Les patients traités par Effexor® avaient davantage d'antécédents de tentatives de suicide et d'hospitalisations en psychiatrie pour dépression que ceux traités par les autres produits. Ainsi, au Royaume Uni, l'Effexor® semble préférentiellement prescrit par les médecins généralistes à des patients à haut risque suicidaire. En Nouvelle-Zélande, 57 361 patients traités par antidépresseurs ont été identifiés dans la base de données du College of General Practitioners Research Unit et suivis pendant 120 jours40. Les sujets ayant des conduites suicidaires étaient comparés à ceux n'en ayant pas. Après la prise en compte dans les analyses statistiques de l'âge, du sexe, du diagnostic de dépression et des idéations suicidaires, l'association qui existait antérieurement entre ISRS et conduites suicidaires disparaissait. Les auteurs attribuent donc l'association entre ISRS et conduites suicidaires au biais de confusion par indication, c'est à dire que l'indication de la prescription d'antidépresseur est elle-même associée à un risque accru de conduites suicidaires. Une étude a rassemblé des données de remboursement de soins (HMO) concernant 65 103 patients âgés de 5 à 105 ans totalisant 82 285 épisodes de traitement antidépresseur entre 1992 et 2003 aux Etats-Unis41. Les patients étaient évalués durant les six mois suivant l'introduction du traitement. L'incidence du suicide était de 40 pour 100 000 épisodes de traitement (47,6 pour 100 000 patients) et celle des tentatives de suicide graves (nécessitant une hospitalisation) de 93 pour 100 000 épisodes de traitement (78 chez les sujets d'au moins 18 ans, IC95 % : 58-98). Le risque de tentative de suicide grave était maximal dans le mois qui précédait l'initiation du traitement puis déclinait progressivement. Le risque de suicide était stable sur la durée du traitement ; en particulier, il n'était pas significativement augmenté au cours du premier mois. Les auteurs ont comparé les nouveaux antidépresseurs figurant dans l'avertissement de la FDA en mars 2004 (bupropion, citalopram, fluoxétine, fluvoxamine, mirtazapine, néfazodone, paroxétine, sertraline, escitalopram, venlafaxine) avec les autres (essentiellement tricycliques et trazodone). Ils retrouvent une diminution de risque non significative avec les premiers (34/100 000 contre 51/100 000 pour le suicide et 76/100 000 contre 129/100 000 pour les tentatives de suicide). Avec les anciens produits, le risque de conduite suicidaire est significativement augmenté au cours du premier mois de traitement par rapport aux mois suivants. Les deux dernières études se sont intéressées aux conduites suicidaires chez les sujets âgés. La première a évalué les antécédents de tentative de suicide de 101 personnes âgées dans le mois précédant leur hospitalisation pour épisode dépressif majeur42. Les patients n'ayant pas fait de tentative de suicide étaient plus fréquemment traités par antidépresseurs avant leur admission (OR 1,9 ; IC95 % : 1,1-3,4). Les auteurs concluent à un rôle protecteur des antidépresseurs dans cette classe d'âge. La seconde étude a croisé les données de l'assurance maladie et le registre de décès de la province de l'Ontario43. Elle a retrouvé 1138 cas de suicide survenus entre 1992 et 2000 chez les sujets âgés de plus de 65 ans. Deux tiers des victimes de suicide (68 %) avaient été traités par antidépresseur au cours des six mois précédant leur décès. En ce qui concerne le premier mois de traitement, les ISRS étaient associés à un risque de suicide cinq fois plus élevé que les autres antidépresseurs (OR 4,8 ; IC95 % : 1,9-12,2). Pour les mois suivants, le risque était similaire pour tous les antidépresseurs. Le risque de suicide violent était plus élevé pour les ISRS que pour les autres antidépresseurs. Cependant, les auteurs soulignent que le risque de suicide demeure dans l'absolu faible au cours du premier mois de traitement par ISRS (2,98/10 000 patients contre 0,62/10 000 pour les autres antidépresseurs), ce qui pourrait suggérer un effet spécifique des ISRS chez des sujets vulnérables. Les auteurs considèrent par ailleurs que, si les ISRS diminuaient le risque suicidaire de 2 % chez les sujets souffrant de dépression majeure, le nombre de suicides évités surpasserait le nombre de suicides attribuables aux ISRS. Autopsies psychologiques Les autopsies psychologiques reposent l'évaluation rétrospective de la symptomatologie psychiatrique et du traitement chez les sujets suicidés, à partir du témoignage de proches et de professionnels de santé. Elles retrouvent jusqu'à 95 % de troubles de l'humeur chez les victimes de suicide, mais seulement 8 à 20 % d'entre elles étaient traitées par antidépresseur au moment de leur suicide44-50. Dans le cadre d'une étude menée en Suède entre 1992 et 2000, les auteurs ont recherché par prélèvement sanguin la présence d'antidépresseurs chez près de 15 000 victimes de suicide et plus de 26 000 témoins morts de cause accidentelle ou naturelle50. Les dosages étaient positifs chez 3 411 cas et 1 538 témoins, soit un rapport de pratiquement 4. Chez les adultes, les adolescents et les enfants, les ISRS étaient moins souvent associés au suicide que les autres antidépresseurs. Le risque suicidaire était même diminué chez les sujets déprimés traités par antidépresseur à dose efficace et « observants », par rapport aux sujets non traités ou traités avec une posologie insuffisante51 52. De plus, une étude toxicologique s'étant intéressée aux morts intentionnelles ou accidentelles directement imputables à l'effet toxique des antidépresseurs a montré que 93 % des sujets sous ISRS utilisaient également d'autres substances telles que les tricycliques (25 %), l'alcool (26 %) ou les opiacés (28 %)53. Etudes épidémiologiques Ces études reposent sur des corrélations écologiques, c'est à dire que des événements sont évalués à l'échelle globale d'une population (par exemple ici, évolution du taux de suicide en fonction du taux de consommation d'antidépresseurs), sans que ces événements soient documentés à l'échelon individuel (par exemple ici, on ignore si les sujets suicidés étaient ou non traités par antidépresseurs). Des études de ce type menées en Suède45, en Australie54, en Hongrie55, en Finlande56, en Irlande49 et aux Etats-Unis57 58, ont montré que l'augmentation de la consommation d'antidépresseurs, concomitante de l'introduction des ISRS dans les années 1990, s'est accompagnée d'une diminution des taux de suicide, particulièrement chez les sujets de plus de 30 ans. Ces études naturalistes comportent de nombreuses limites méthodologiques, liées à l'absence d'information à l'échelon individuel. Elles suggèrent néanmoins que la forte augmentation de la consommation d'antidépresseurs des années 1990 n'a pas été suivie d'une élévation des taux d'incidence du suicide. Toutefois, une éventuelle augmentation du risque de suicide pourrait difficilement être mise en évidence si elle est minime ou n'existe que dans une petite fraction vulnérable de la population ou encore si cet excès de risque est masqué par un bénéfice plus important. b) Antidépresseurs et conduites suicidaires chez l'enfant et l'adolescent Ce chapitre a été rédigé par Marie Tournier, INSERM U657, Université Bordeaux 2 Chez les enfants et les adolescents, le débat sur l'impact des antidépresseurs sur les conduites suicidaires se complique d'un débat concernant leur efficacité dans cette population59-62 et l'importante prévalence des idées suicidaires (27 %) dans cette tranche d'âge63. Cependant, des augmentations d'incidence d'idéations suicidaires ont été rapportées dès les années 199064 et le nombre croissant d'essais thérapeutiques ciblant cette population a généré des questions concernant l'innocuité des antidépresseurs, en particulier des ISRS et des IRSNA65. Essais thérapeutiques Selon la FDA, les enfants et les adolescents sous ISRS présenteraient un risque de conduites suicidaires accru par rapport à ceux qui n'en prenaient pas32 66. Une méta-analyse récente a rassemblé les données de 24 essais cliniques randomisés et contrôlés, publiés ou non, conduits chez des patients de moins de 18 ans (n=4582) sur une durée de 4 à 16 semaines et impliquant des ISRS et des IRSNA24. Seize de ces études concernaient la dépression. Les bases de données des études ont été fournies par l'industrie pharmaceutique à la FDA qui a conduit des analyses complémentaires sur les conduites suicidaires. Aucun suicide n'a été observé au cours de ces essais. Un seul d'entre-eux, une étude multicentrique évaluant la fluoxétine, montrait une augmentation significative des conduites suicidaires avec cet antidépresseur par rapport au placebo (OR 4,62 ; IC95 % : 1,02-20,9). La méta-analyse retrouvait une augmentation du risque d'idéations et de tentative de suicide chez les sujets souffrant de dépression traités par antidépresseurs par rapport à ceux qui recevaient du placebo (OR 1,66 ; IC95 %: 1,02-1,68). Sur 87 cas, 54 (62 %) impliquaient des idéations suicidaires et 33 (38 %) une tentative de suicide. Le risque de tentative de suicide était multiplié par 1,9 sous antidépresseurs (IC95 % : 1-3,63). Les auteurs de cette méta-analyse soulignent d'importantes variations entre les différentes études analysées et les difficultés d'interprétation liées au caractère rétrospectif de l'analyse, à la brève durée des essais, à la taille limitée des échantillons et à l'impossibilité de comparer les produits entre eux. De plus, de nombreuses informations étaient indisponibles dans la majorité des essais, comme les antécédents d'hospitalisation en psychiatrie, la durée du trouble, les conduites addictives et les comportements agressifs. Une méta-analyse récente a rassemblé huit essais publiés et neuf non publiés chez des sujets de moins de 19 ans67. A l'exception de la venlafaxine, les antidépresseurs n'étaient pas associés à une augmentation de la survenue de conduites suicidaires par rapport au placebo. L'accroissement du risque lié à la venlafaxine s'expliquait principalement par la survenue plus fréquente d'idéations et non d'actes suicidaires. A noter que dans les essais, l'enregistrement des effets indésirables reposait le plus souvent sur la déclaration spontanée des patients ou de leurs familles et les conduites suicidaires n'étaient parfois pas enregistrées comme effets secondaires. Les auteurs soulignent que l'utilisation des données d'essais thérapeutiques chez l'enfant reste difficile en raison de l'hétérogénéité des méthodologies et des variations importantes des taux de réponse aux traitements actifs et au placebo dans les différentes études. Deux études ont évalué des traitements psychothérapiques. La première est intéressante parce qu'elle retrouvait, chez 88 adolescents ne prenant aucun traitement médicamenteux, un taux d'incidence de conduites suicidaires proche de ceux rapportés dans les essais des médicaments antidépresseurs (12,5 %)68. Ces sujets ne rapportaient aucun projet suicidaire ni antécédent de tentative de suicide à l'inclusion. La seconde a comparé quatre groupes d'adolescents traités pour dépression par fluoxétine, thérapie cognitive et comportementale (TCC), les deux ou un placebo61. Les idéations suicidaires étaient améliorées de manière similaire dans les groupes recevant un traitement actif. Cependant, les sujets des deux groupes recevant de la fluoxétine (avec ou sans TCC) rapportaient plus fréquemment des automutilations ou des pensées concernant des actes d'automutilation (OR 2,19 ; IC95 % 1,03-4,62). Etudes en population clinique Une étude récente a été menée dans la population danoise âgée de 10 à 17 ans ayant reçu des antidépresseurs entre 1995 et 1999 (n=2 569) et une population témoin (n=50 000), à partir de quatre registres : le registre civil, le registre des médicaments, le registre des décès et le registre hospitalier (comprenant également les soins ambulatoires dispensés par les services hospitaliers)69. La première partie de cette étude est constituée d'une analyse écologique qui montre une incidence de suicide stable malgré un accroissement important des traitements antidépresseurs sur la durée de l'étude dans cette tranche d'âge. La deuxième partie s'est intéressée aux caractéristiques des suicides observés : aucun des enfants morts par suicide n'utilisait d'antidépresseur dans les deux semaines précédant leur décès (deux prenaient des antidépresseurs au moment de leur suicide mais, du fait de la durée du suivi, ces sujets avaient alors plus de 18 ans). Parmi les 19 suicides, 14 étaient des garçons, aucun n'avait reçu de soin psychiatrique. Les cinq filles avaient pris des antidépresseurs sur la durée de l'étude, quatre avaient été longuement hospitalisées en psychiatrie et aucune n'avait comme diagnostic, principal ou secondaire, la dépression (deux « troubles psychotiques », un « trouble des conduites alimentaires » et un « trouble grave de la personnalité »). La dernière partie de l'étude évaluait le risque de suicide lié aux antidépresseurs après prise en compte statistique des antécédents d'hospitalisation en psychiatrie, afin de réduire le biais de confusion par indication, une augmentation assez marquée du risque de suicide mais non significative (du fait de la faible puissance statistique) était mise en évidence (OR 4,47 ; IC95 % : 0,95-20,96). Au cours des études cas-témoins utilisant la base de données de la GPRD décrites précédemment ciblant les nouveaux utilisateurs d'antidépresseurs, aucun suicide n'est mentionné chez les sujets âgés de 10 à 19 ans. Dans la population de la GPRD, 15 suicides sont survenus dans cette tranche d'âge entre 1993 et 1999 ; aucun d'entre eux n'avait reçu d'antidépresseurs38. Une étude déjà évoquée, conduite aux Etats-Unis à partir des données de remboursement de soins 41 a inclus 5 107 épisodes de traitement antidépresseur de sujets de moins de 18 ans entre 1992 et 2003. Dans les six mois de suivi, on dénombre 3 suicides et 17 tentatives de suicide graves (314 pour 100 000 épisodes de traitement, IC95 % : 160-468). Le risque de survenue des tentatives de suicide suit, dans le temps, une courbe similaire à celle des adultes, avec un risque supérieur dans le mois précédant le traitement, une réduction brutale de ce risque dans le premier mois de traitement puis un déclin progressif. Une autre étude rétrospective menée, également aux USA à partir des données de remboursement de soins (Medicaid et Health Medical Organization), chez 24 119 sujets âgés de 12 à 18 ans avec un diagnostic de dépression majeure entre 1997 et 200370 montrait aucune augmentation du risque de tentative de suicide sous antidépresseurs. Les traitements d'une durée d'au moins 180 jours réduisaient, au contraire, le risque de tentative de suicide de manière significative par rapport aux traitements courts (moins de 55 jours). Autopsies psychologiques Dans une autopsie psychologique menée aux USA, 12 de 49 adolescents morts par suicide (24 %) avaient reçu une prescription d'antidépresseurs, mais les analyses toxicologiques se sont révélées négatives pour les antidépresseurs chez l'ensemble d'entre eux65. Une seconde étude américaine a étudié les 58 décès par suicide ou accident survenus entre 1993 et 1998 dans la ville de New York chez des sujets de moins de 18 ans71. Des antidépresseurs ont été détectés par analyse toxicologique chez quatre d'entre eux (6,9 %) ; deux analyses étaient positives pour l'imipramine et deux pour la fluoxetine. Une étude suédoise a comparé 14 857 suicides et 22 422 morts d'une autre cause entre 1992 et 200050. Chez les 52 sujets de moins de 15 ans morts par suicide, sept (13,5 %) avaient une toxicologie positive pour des antidépresseurs, dont aucun ISRS. Chez les 326 sujets âgés de 15 à 19 ans victimes de suicide, 13 (4 %) avaient une toxicologie positive pour des antidépresseurs, le risque associé aux ISRS étant inférieur à celui des autres antidépresseurs. Etudes épidémiologiques La Task Force of the American College of Neuropsychopharmacology a utilisé des données épidémiologiques rassemblées par l'OMS qui suggéraient une diminution moyenne d'environ un tiers des taux de suicide chez les sujets âgés de 15 à 24 ans dans 15 pays au cours des 14 dernières années72. Ce déclin coïncide avec l'élargissement de la prescription des antidépresseurs, principalement des ISRS. Les taux de suicide diminuent chez les adolescents aux Etats-Unis depuis le début des années 1990, date d'introduction des ISRS73 74. Chez les sujets âgés de 10 à 19 ans, il existe une relation négative significative entre les variations régionales de prescription d'antidépresseurs et les variations régionales du taux de suicide, une croissance de 1 % de la prescription d'antidépresseurs étant associée à une diminution de l'incidence du suicide de 0,23 /100 000 / an73. En Grande Bretagne, les taux de suicide et tentative de suicide n'ont pas augmenté chez les adolescents depuis le début des années 199075 76. De même, en Australie, le taux de suicide est resté stable entre 1991 et 2000 chez les adolescents de plus de 14 ans, malgré l'augmentation de la prescription des antidépresseurs54. Les groupes de sujets chez lesquels on notait la plus forte augmentation d'antidépresseurs bénéficieraient d'une diminution du risque de suicide. c) Hypothèses concernant le lien entre antidépresseurs et conduites suicidaires Plusieurs mécanismes sous-jacents à une éventuelle augmentation des conduites suicidaires par les médicaments antidépresseurs ont été évoqués. Depuis la découverte des premiers antidépresseurs, les premiers jours de traitement sont considérés à haut risque suicidaire en raison de la « levée d'inhibition »24 33. Au cours de cette phase, les pensées pessimistes et les émotions négatives restent inchangées, tandis que le ralentissement psychomoteur s'améliore. Ainsi, le patient récupèrerait suffisamment d'énergie pour « passer à l'acte » et éventuellement se suicider. Une étude observationnelle a effectivement retrouvé un risque accru de suicide dans le mois qui suit l'introduction du traitement antidépresseur, et plus particulièrement dans les premiers jours37. Les auteurs relient cependant ce résultat à l'absence d'amélioration de l'état dépressif du fait du délai d'action de ces médicaments et non à une levée d'inhibition ; autrement dit, le risque existant avant l'introduction du traitement persiste mais n'est pas accru par celui ci. Cette hypothèse est corroborée par les résultats d'une autre étude observationnelle qui montre un risque accru de tentative de suicide dans le mois qui précède l'introduction du traitement suivi d'une diminution progressive de ce risque au cours du traitement, ainsi qu'un risque de suicide non majoré au cours du premier mois de traitement par comparaison aux mois ultérieurs41. Une hypothèse alternative pourrait être l'augmentation du risque suicidaire du fait de la survenue d'effets indésirables des antidépresseurs, tels que l'insomnie, l'agitation, l'irritabilité et l'anxiété, ou l'induction de virages de l'humeur maniaques ou mixtes, chez des patients présentant un trouble bipolaire de l'humeur non encore identifié77-79. En effet, les états mixtes (association de symptômes dépressifs et maniaques) comportent un risque accru de suicide, en particulier lorsqu'ils associent idées et humeur négatives avec une agitation psychomotrice. De plus, les troubles bipolaires débutant sont très rarement identifiés chez les enfants et les adolescents80 81. Les conduites suicidaires pourraient également être liées à des symptômes de sevrage induits par une mauvaise observance des traitements antidépresseurs78. Bien que les guides de bonne pratique recommandent une durée minimale de six mois pour les traitements antidépresseurs dans le but d'éviter rechutes et récidives, les traitements de courte durée sont très fréquents82-85. Ces mécanismes ne sont pas spécifiques aux enfants ou aux adolescents. S'il s'avère que le risque de conduites suicidaires sous traitement antidépresseur est propre à ces classes d'âge, elles pourraient être liées à une modulation pharmacologique différente de réseaux neurochimiques en voie de maturation ou à une différence développementale de la nature de la maladie dépressive entre les enfants et les adultes86. d) Commentaires sur les données de la littérature Une des difficultés majeures pour l'interprétation de ces études est liée au biais de confusion par indication : l'indication de la prescription d'antidépresseur étant elle-même associée à un risque accru de conduites suicidaires. Idéations suicidaires et tentative de suicide sont en effet des symptômes de la dépression selon les critères diagnostiques internationaux utilisés dans les études87. Or, ce biais a été rarement pris en compte dans les analyses. La comparaison du risque associé aux différents produits est également d'interprétation difficile. En effet, certains antidépresseurs pour lesquels un excès de conduites suicidaires a été mis en évidence, pourraient, en raison d'une mise sur le marché récente ou d'un mécanisme d'action particulier, être utilisés de manière préférentielle dans des troubles sévères ou résistants, tandis que des antidépresseurs plus anciens seraient prescrits à des sujets les ayant bien tolérés antérieurement (effet de déplétion des sujets à risque)39 88. L'existence d'un risque accru de conduites suicidaires chez les sujets traités par antidépresseurs a été mise en évidence quasi-exclusivement sur des populations de sujets inclus dans des essais thérapeutiques, dont la faible représentativité vis à vis de la réalité du terrain a déjà été soulignée. Même dans ce cadre, la plupart des méta-analyses ne mettent pas en évidence d'augmentation de risque de conduites suicidaire. Il faut souligner qu'aucune méta-analyse portant sur ces essais thérapeutiques ne montre un risque accru de suicide chez les sujets traités par antidépresseur, les effets adverses portant exclusivement sur l'augmentation des idéations suicidaires ou des gestes auto-agressifs. Les études observationnelles portant sur des populations cliniques ou les études épidémiologiques ne montrent pas non plus d'augmentation de risque, que ce soit chez l'adulte, l'enfant ou l'adolescent. Il faut également rappeler qu'un des bénéfices de l'extension de l'usage des ISRS est le remplacement des traitements tricycliques, plus toxiques en cas d'intoxication volontaire. Comme 20 % des suicides médicamenteux impliquent des antidépresseurs, 300 à 450 morts seraient évitées en Angleterre chaque année du fait de l'introduction de molécules très faiblement toxiques en cas de surdosage32. Ainsi, de nombreux auteurs continuent à recommander l'usage des antidépresseurs en première ligne thérapeutique dans la dépression89 90. A noter qu'aucune étude évaluant les relations entre antidépresseurs et risque suicidaire n'a été à notre connaissance menée sur la population française, probablement du fait de l'absence de base de données permettant de documenter de manière concomitante ces deux types d'événements. e) Estimation par analyse de décision du nombre de suicides évités/induites par les traitements antidépresseurs dans la population française L'étude suivante a été réalisée pour le présent rapport par Audrey Cougnard, Adeline Grolleau, Marie Tournier et Hélène Verdoux, INSERM U657, Université Bordeaux 2 Du fait de l'absence de données sur le sujet, nous avons réalisé, une modélisation dont l'objectif était d'estimer le nombre de suicides évités/induits par les traitements antidépresseurs chez les sujets présentant une dépression caractérisée, en conditions réelles de prescription. La modélisation est une approche méthodologique particulièrement utile dans les situations où les données disponibles sont insuffisantes pour répondre à une question, et/ou des études de terrain ne sont pas réalisables du fait de contraintes méthodologiques, de temps ou de moyens. Partant de données déjà collectées (résultats d'études cliniques et épidémiologiques; données françaises de mortalité, d'incidence, d'utilisation de médicaments, etc.) et prenant en compte l'épidémiologie de la maladie en France et les caractéristiques de l'exposition au médicament, la modélisation permet de produire une estimation du nombre de cas évités ou induits d'un événement donné. La modélisation basée sur une analyse de décision permet de comparer différentes stratégies thérapeutiques afin d'identifier celle qui offrira le bénéfice attendu le plus élevé. Ces méthodes ont été largement utilisées par les décideurs de santé publique dans des analyses bénéfices/risques pour évaluer l'apport de stratégies de dépistage (cancer de la prostate par exemple) ou des programmes de vaccination (hépatite B par exemple). La réalisation d'une analyse de décision nécessite une simplification des stratégies thérapeutiques explorées, en particulier concernant le nombre de caractéristiques individuelles pouvant influer sur la réponse au traitement, et le nombre d'événements pouvant survenir lors de la prise d'un traitement en conditions réelles de prescription. Présentation de la méthode L'impact des antidépresseurs sur le risque suicidaire a été exploré sur une population théorique incluant exclusivement des sujets souffrant d'une dépression diagnostiquée, pour lesquels se pose, en conditions réelles de prescription, le choix de traiter ou ne pas traiter par antidépresseur. Une dépression a été définie comme un épisode dépressif majeur (épisode isolé ou récurrent) selon les critères diagnostiques internationaux. Deux stratégies d'intervention ont été comparées : 1) « traitement antidépresseur », défini comme la prescription d'un antidépresseur à posologie efficace, quelle que soit la classe pharmacologique, et quel(s) que soi(en)t le(s) traitement(s) associé(s) (psychothérapiques ou médicamenteux), le prescripteur, et le contexte de prescription (ambulatoire ou hospitalisation) ; 2) « pas de traitement antidépresseur », quel(s) que soi(en)t le(s) traitement(s) associé(s) (psychothérapiques ou médicamenteux). Une durée inadéquate de prise du traitement antidépresseur a été définie comme une prise de traitement d'une durée inférieure ou égale à un mois (c'est à dire inférieure ou égale au délai d'action des antidépresseurs, et très inférieure à la durée minimale recommandée de traitement de 6 à 8 mois après la rémission des symptômes). La fréquence de survenue des décès par suicide a été estimée sur une période de un an, correspondant approximativement à la durée de l'épisode dépressif et d'un traitement adapté. L'impact du choix de la stratégie thérapeutique sur le suicide a été étudié dans trois tranches d'âge: chez les adolescents et les adultes jeunes (10-19 ans), chez les adultes (20-64 ans) et chez les personnes âgées (65 ans et plus). Un arbre de décision a été élaboré pour chaque tranche d'âge à l'aide du logiciel Tree-Age91. Pour illustration, l'arbre des « 65 ans et plus » est représenté sur la Figure 23. La lecture de l'arbre se fait de gauche à droite, les événements se succédant dans cet ordre. Par exemple, la branche supérieure « traitement antidépresseur », représente les sujets âgés de 65 ans et plus, issus de la population générale, souffrant d'un épisode dépressif majeur diagnostiqué, traités par antidépresseur, sur une durée adéquate, ayant effectué une (ou des) tentative(s) de suicide et décédés par suicide. Figure 23 : Arbre de décision pour les sujets âgés de 65 ans et plus souffrant de dépression caractérisée 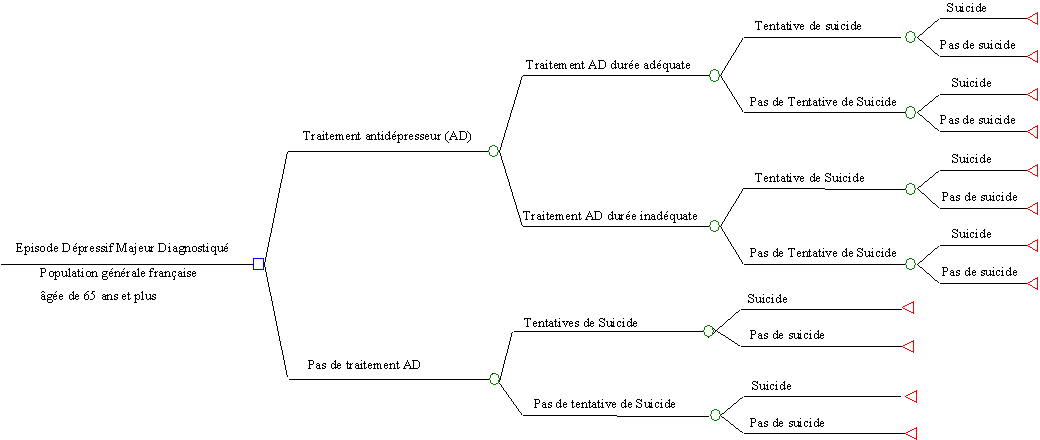 Chaque fois que des estimations issues d'études françaises étaient disponibles (par exemple, incidence du suicide), ces données quantitatives ont été utilisées pour l'analyse de décision (Tableaux 86, 87, 88). Concernant les paramètres nécessaires à la réalisation de l'arbre pour lesquels aucune donnée quantitative n'était disponible, les hypothèses suivantes ont été faites : (i) Le fait que l'épisode dépressif majeur soit diagnostiqué diminue le risque de suicide, quelle que soit la prise en charge proposée: sur la base de l'estimation que le risque de suicide est multiplié par 40 chez les sujets souffrant de dépression diagnostiquée ou non par rapport aux sujets de la population générale92, nous avons considéré que le risque de suicide était multiplié par 20 fois lorsque la dépression était diagnostiquée, tous types de prise en charge confondus. (ii) L'absence de traitement antidépresseur chez les sujets présentant une dépression diagnostiquée augmente le risque de suicide, conduisant à un risque de suicide 30 fois plus élevé chez ces sujets par rapport à la population générale. (iii) Un traitement antidépresseur de durée adéquate diminue par six le risque de suicide chez les sujets diagnostiqués par rapport à l'absence de traitement. Nous faisons donc ici l'hypothèse, plutôt pessimiste, que même en cas de traitement adéquat par antidépresseur, le risque de suicide ne revient pas au niveau de base de la population générale, et est cinq fois plus élevé. (iv) La prise de traitement antidépresseur sur une durée inadéquate augmente de 50 % le risque de suicide par rapport à l'absence de traitement antidépresseur. Les sujets ayant arrêté le traitement avant le délai d'action de ce dernier n'ont, en effet, pas bénéficié des effets bénéfiques du traitement (donc présentent au moins la même probabilité que les sujets ne recevant pas de traitement antidépresseur) tout en subissant les effets indésirables pouvant survenir lors de l'instauration du traitement (insomnie, tension interne) qui peuvent favoriser un passage à l'acte. Nous faisons donc l'hypothèse, là encore plutôt pessimiste, qu'un traitement de durée inadéquate augmente considérablement le risque de suicide, qui devient 45 fois plus élevé que celui de la population générale. (v) Des tentatives de suicide effectuées après le diagnostic d'épisode dépressif majeur multiplie par 5 le risque de suicide, par rapport aux sujets sans antécédent de tentative de suicide. La probabilité de survenue d'une tentative de suicide a été estimée à partir du rapport entre le nombre de tentatives de suicide et le nombre de suicides : 22 tentatives pour 1 suicide chez les adolescents ; 14 tentatives pour 1 suicide chez les 18-64 ans et plus 3 tentatives pour 1 suicide chez les 65 ans et plus93 94. Tableau 86. Probabilités appliquées dans l'analyse de décision portant sur les sujets âgés de 10 à 19 ans souffrant de dépression dans la population française
Tableau 87. Probabilités appliquées dans l'analyse de décision portant sur les sujets âgés de 20 à 64 ans souffrant de dépression dans la population française
Tableau 88. Probabilités appliquées dans l'analyse de décision portant sur les sujets âgés de 65 ans et plus souffrant de dépression dans la population française
Comme de nombreux paramètres nécessaires à la réalisation de l'analyse de décision reposent sur des hypothèses, il est donc nécessaire de s'assurer que les résultats obtenus restent stables si les probabilités changent. Pour les deux stratégies d'intervention, « traitement antidépresseur » et « pas de traitement antidépresseur », des analyses dites « de sensibilité » ont été réalisées afin d'évaluer si les résultats sont sensiblement modifiés lorsque l'on fait varier les différentes probabilités. Par exemple, pour le risque de suicide initialement fixé à 20 chez les sujets âgés de 65 ans et plus, nous avons exploré des variations du risque allant de 10 à 50 (Tableau 88). L'analyse de décision permet de calculer le nombre de suicide pour les deux stratégies d'intervention « traitement antidépresseur » et « pas de traitement antidépresseur ». La différence entre les deux nombres donne celui des suicides « évités » pour la population concernée, si la stratégie « traitement antidépresseur » diminue le risque de suicide par rapport à la stratégie « pas de traitement antidépresseur », ou le nombre de suicide « induits », si cette stratégie augmente le risque de suicide. Ces estimations permettent de calculer le nombre de sujets qu'il convient de traiter (Number Needed to Treat, NNT) pour éviter un suicide. Résultats Pour les trois tranches d'âge considérées, la stratégie « traitement antidépresseur » permet d'éviter plus de 50 % des suicides par rapport à la stratégie « pas de traitement antidépresseur ». Chez les sujets âgés de 10 à 19 ans, le nombre de suicides serait de 45 par an pour la stratégie «pas d'antidépresseur » (Tableau 89), la stratégie « traitement par antidépresseur » permettant d'éviter 19 suicides par an. Pour prévenir un suicide par an, le nombre de sujets à traiter serait de 8 584. Chez les sujets âgés de 20 à 64 ans, le nombre de suicides serait de 5 363 par an pour la stratégie «pas d'antidépresseur » (Tableau 89), la stratégie « traitement par antidépresseur » permettant d'éviter 2 198 suicides par an. Le nombre de sujets à traiter pour prévenir un suicide par an serait de 782. Chez les sujets âgés de 65 ans et plus, le nombre de suicides serait de 1 111 par an pour la stratégie «pas d'antidépresseur » (Tableau 89), la stratégie « traitement par antidépresseur » permettant d'éviter 461 suicides par an. Le nombre de sujets à traiter pour prévenir un décès par suicide par an serait de 656. Tableau 89. Nombre de suicides induits par les stratégies « traitement antidépresseur » et « pas de traitement antidépresseur » chez les sujets souffrant de dépression diagnostiquée
Pour toutes les tranches d'âge, les analyses de sensibilité (Tableau 90) montrent que l'efficacité de la stratégie « traitement par antidépresseur » dépend de la fréquence de traitement antidépresseur avec une durée de prise adéquate. Par exemple, pour les 10-19 ans, la valeur seuil de cette fréquence doit être au minimum de 42 % pour conclure que la stratégie « traitement par antidépresseur » induit moins de suicides que la stratégie « pas d'antidépresseur ». Pour les trois tranches d'âge, les résultats ne sont pas sensibles aux variations des autres probabilités. Tableau 90. Analyses de sensibilité
1. Nombre de sujets nécessaires à traiter pour l'hypothèse minimale des intervalles 2. Nombre de sujets nécessaires à traiter pour l'hypothèse maximale des intervalles 3. Seuils à partir duquel le nombre de suicides induits par la stratégie « traitement antidépresseur » est supérieur au nombre de suicides induit par la stratégie « pas de traitement antidépresseur ». 4. Non applicable. Variable pour laquelle la stratégie « pas de traitement antidépresseur » est plus efficace que la stratégie « traitement antidépresseur » Commentaires Ces résultats doivent être interprétés en tenant compte de plusieurs limites inhérentes à cette approche méthodologique. Tout d'abord, du fait de l'absence de données issues d'études françaises, nombre d'hypothèses ont été faites pour les probabilités ; pour pallier cette limite des analyses de sensibilité ont été réalisées, montrant que les résultats sont comparables même lorsque l'on fait varier ces valeurs dans une fourchette assez large. Nous n'avons pas différencié dans la stratégie «pas de traitement antidépresseur » les sujets n'ayant aucun traitement, de ceux ayant un traitement médicamenteux autre qu'un antidépresseur (par exemple, anxiolytique, phytothérapie) ou un traitement psychothérapique ; nous avons fait l'hypothèse que la proportion de sujets bénéficiant de ces autres traitements était identique dans les deux stratégies, ce qui n'est pas établi. Enfin, nous n'avons considéré que l'effet de deux événements survenant après le diagnostic sur le risque de suicide : la durée adéquate de prise de traitement antidépresseur et les tentatives de suicide effectuées après le diagnostic ; nous n'avons donc pas pris en compte d'autres événements (par exemple, survenue d'un effet indésirable, dosage adéquat ou non) ou caractéristiques individuelles (par exemple, trouble lié à l'usage d'alcool ou de substances psychoactives) qui peuvent modifier le risque suicidaire. Cette étude montre cependant que l'instauration d'un traitement antidépresseur permet d'éviter un nombre important de suicides dans toutes les tranches d'âge considérées, à condition que près de la moitié des sujets traités prennent ce traitement pendant une durée adéquate. Il convient de plus de souligner que ces résultats ont été obtenus avec des hypothèses peu favorables aux traitements antidépresseurs : persistance d'un risque important de suicide même en cas de traitement de durée adéquate ; augmentation majeure du risque en cas de traitement de durée inadéquate, supérieur à celui existant en l'absence de traitement. Ces résultats sont importants à prendre en considération dans le débat sur l'impact des antidépresseurs sur le risque suicidaire, car des campagnes médiatiques disqualifiant ces médicaments, ou des mesures visant à restreindre leur usage dans les dépressions caractérisées pourraient contribuer à augmenter la mortalité par suicide en France. 2. Médicaments psychotropes et accidents de la voie publique Une revue exhaustive de cette question ayant été faite dans le rapport d'A. Cadet pour l'OFDT (Cf. question 1), nous reprendrons ici les données issues de ce rapport concernant les psychotropes et les accidents98. a) Données expérimentales et épidémiologiques Dans ce rapport, sont tout d'abord présentées des données expérimentales issues de tests de laboratoire explorant le maintien ou l'altération des fonctions de base nécessaires à la conduite d'un véhicule parmi d'autres véhicules en circulation, en cas de prise ponctuelle ou chronique de médicaments. Ces études, effectuées sur simulateurs de conduite ou en conduite réelle, ont notamment contribué à l'établissement d'un classement par des experts belges et néerlandais des différents psychotropes en fonction de leur dangerosité probable99. Ce classement est échelonné de la classe I, concernant les médicaments pour lesquels les études scientifiques n'ont pas démontré d'effet négatif sur la conduite, à la classe III concernant les médicaments ayant des effets marqués sur la conduite automobile (Tableau 91). Les médicaments considérés comme les plus dangereux pour la conduite, qui incluent principalement des benzodiazépines, sont listés dans le Tableau 92. Les molécules considérées commme à très faible risque par cette classification (Classe II.1) sont le clobazam (Urbanyl®) et la buspirone (Buspar®) pour les anxiolytiques, le témazépam (Normison®) pour les hypnotiques, et enfin les ISRS (Prozac®, Deroxat®, Floxifral®, Zoloft®) pour les antidépresseurs. Les limites de cette classification sont liées au fait que les données obtenues dans ces conditions expérimentales pourraient ne pas être valides dans des situations de conduite réelle mettant en jeu des fonctions plus complexes100. De plus, les tests de laboratoire sont en général réalisés sur des sujets sains et jeunes, alors que les consommateurs de psychotropes sont en moyenne plus âgés et porteurs de pathologies sous-jacentes. Tableau 91. Classement des psychotropes selon leur dangerosité pour la conduite
Tableau 92. Médicaments psychotropes considérés comme les plus dangereux pour la conduite automobile (classe III)98
BZD : benzodiazépine ; anxio : anxiolytique ; ATD : antidépresseur La demi-vie d'élimination indiquée ne tient pas compte de celle d'éventuels métabolites actifs. Les études épidémiologiques évaluant la responsabilité des médicaments psychotropes dans les accidents de la voie publique fournissent des résultats contradictoires. Certaines ne mettent pas en évidence d'excès de risque lié à l'usage de benzodiazépines. L'étude de Merlin et collaborateurs101, réalisée en 1988 au CHU d'Angers auprès de 363 accidentés de la route (piétons inclus), a identifié des benzodiazépines et des barbituriques dans le sang de 7,7 % et 2,4 % des accidentés, respectivement. Les conducteurs ayant absorbé des psychotropes, à savoir benzodiazépines et barbituriques, étaient significativement plus responsables d'accident que ceux n'en ayant pas consommé (avec ou sans consommation d'alcool associée). Cet excès était toutefois significatif exclusivement pour la présence de barbituriques, aucune association avec la responsabilité d'un accident n'était mise en évidence pour les benzodiazépines. Une étude française réalisée sur 3 147 conducteurs accidentés responsables ou non de l'accident a également montré que la prévalence des benzodiazépines chez les responsables d'accidents ne différait pas de celle trouvée chez les non responsables, alors que cette même étude confirmait que l'alcool multipliait par deux le risque d'accident pour 0,2 et 0,8g/l d'alcool, et par 6 au-delà de 0,8g/l102. Une autre étude française103 réalisée sur 168 prélèvements sanguins de conducteurs accidentés a mis en évidence un surcroît de risque lié à la présence de benzodiazépines dans le sang, 20,8 % des conducteurs présumés responsables avaient des benzodiazépines dans le sang contre 9,1 % des non-responsables (RR = 2). D'autres études suggèrent que l'usage de benzodiazépines augmente le risque d'accident. Une étude anglaise104 a mis en évidence un risque d'accidents de la route multiplié par 2 chez les consommateurs de benzodiazépines et apparentés consommées dans la journée, surtout marqué pour les hypnotiques a demi-vie courte et les anxiolytiques à demi-vie longue. Une étude multicentrique française (Grenoble, le Havre, Limoges, Lyon, Poitiers et Strasbourg) a comparé la prévalence des dosages sanguins positifs pour toutes les substances psychoactives licites et illicites dans un groupe de conducteurs accidentés et un groupe témoin de sexe et d'âge comparables105. Les échantillons de sang ont été collectés de juin 2000 à septembre 2001 chez 900 conducteurs de voiture impliqués dans des accidents de la route non mortels et admis aux urgences. Le groupe témoin était constitué par 900 patients ayant leur permis de conduire, admis dans les mêmes services d'urgence que les cas pour un motif autre que traumatique. Les cas et les témoins ayant reçu de la morphine, des benzodiazépines ou des barbituriques pendant le transport aux urgences ont été exclus. Les médicaments psychotropes isolés (sans dosage positif pour les autres psychotropes) ont été identifiés plus fréquemment dans le sang des conducteurs (15,8 %) que dans celui des témoins (11,9 %). La prévalence augmentait avec l'âge. Les médicaments psychotropes les plus fréquemment identifiés dans les deux groupes (cas et témoins) étaient les benzodiazépines (14,0 % des conducteurs vs. 12,6 % des témoins) (Tableau 93). Ce n'est que pour les benzodiazépines que les dosages sanguins étaient plus fréquemment positifs chez les conducteurs (9,4 %) que chez les témoins (5,8 %). Les différences de prévalence entre cas et témoins concernant chaque molécule sont minimes : le nordiazépam est le plus fréquemment identifié (4,6 % des conducteurs et 4,0 % des témoins) suivi par le bromazépam (3,0 et 2,6 %). Tableau 93. Prévalence des médicaments psychoactifs (seuls ou associés) dans le sang des conducteurs accidentés et des contrôles105
1. Hypnotiques benzodiazépines exclues 2. Benzodiazépines exclues Bien que la prévalence de benzodiazépines soit plus élevée chez les accidentés que chez les témoins, ces résultats ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre la consommation de psychotrope et accidents98. En effet, la pathologie ayant motivé la prescription médicamenteuse n'est pas prise en compte, alors qu'elle peut favoriser la survenue d'un accident (par exemple, troubles attentionnels liés à un état dépressif) ; les capacités de l'usager à conduire en l'absence de son traitement ne sont donc pas évaluées. De plus, ces études prennent rarement en compte les facteurs de susceptibilité individuelle à l'effet de médicaments, l'accoutumance de l'usager à son traitement et la présence de traitements associés. Au total, certaines études suggèrent que la prise de benzodiazépines est associée à un surcroît de risque d'accidents de la circulation, mais que ce risque demeure cependant très inférieur à celui lié à l'usage d'alcool. Des recommandations en termes de prescription, de délivrance et d'information à dispenser par le médecin et le pharmacien, ont été publiées par l'ICADTS (International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety)106. Selon ces recommandations, les patients doivent être informés que l'usage des médicaments psychoactifs est associé à un risque accru d'accidents corporels, et conseillés sur la manière dont ils peuvent minimiser ce risque (par exemple, éviter l'alcool pendant la période de traitement, savoir reconnaître les signes d'une diminution de la capacité à conduire, telle que vision brouillée, difficultés de concentration ou difficulté à rester éveillé). Il est également recommandé de débuter le traitement avec la plus faible dose possible, d'éviter de multiplier les prises au cours de la journée, d'éviter d'associer différents médicaments psychotropes, et ne pas s'en remettre aux notices des laboratoires pour informer les patients sur les effets du médicament sur la conduite. Des recommandations ont ainsi été publiées par le Conseil de la Communauté Européenne concernant le renouvellement du permis de conduire, qui ne doit être ni délivré, ni renouvelé à un candidat en état de dépendance vis à vis de substances à action psychotrope ou qui, sans être dépendant, en abuse régulièrement100. En France, la consommation de psychotropes chez les conducteurs n'est pas illégale, et seule existe l'interdiction de « conduire un véhicule sous l'influence d'une substance ou d'une pathologie susceptible de diminuer les performances et de constituer ainsi un danger pour les autres »99. Certaines mesures préventives ont été cependant préconisées à savoir l'information des prescripteurs et des consommateurs par des avertissements mentionnés dans les caractéristiques des produits, dans les notices d'utilisation ou par un pictogramme sur la boîte elle-même (Décret n°99 338 du 3 mai 1999). En effet depuis 1999, un pictogramme rouge dans lequel se trouve une voiture noire doit être présent sur le conditionnement des médicaments susceptibles d'altérer les capacités à conduire (Figure 24)107. Cependant, ce pictogramme était insatisfaisant car il ne rendait pas compte du niveau de risque potentiel des médicaments ni n'indiquait une attitude pratique à adopter. Etant présent sur le conditionnement d'un médicament sur trois, soit plus de 4 000 spécialités, cette mise en garde devenait de fait banalisée ; une enquête réalisée dans une centaine de pharmacies en 2004 a confirmé que ce pictogramme actuel était informatif. L'Afssaps a donc décidé de décliner le pictogramme en fonction de trois niveaux de risque pour la conduite automobile. Le niveau 1 correspond à un risque faible dépendant largement de la susceptibilité individuelle et ne remet généralement pas en cause la conduite de véhicules ; les patients doivent néanmoins en être informés avant de prendre le volant. Les médicaments classés dans le niveau 2 présentent des effets délétères pour la conduite automobile quelle que soit la susceptibilité individuelle. La plupart du temps, le médicament n'est disponible que sur ordonnance, le prescripteur devra donc apprécier l'état du patient et sa réponse au traitement. La prise du médicament peut, dans certains cas, remettre en cause l'aptitude à la conduite de véhicules et nécessiter l'avis d'un professionnel de santé (médecin, pharmacien). Enfin, l'utilisation des médicaments regroupés dans le niveau 3 est formellement déconseillée en raison de leurs effets rendant la conduite automobile dangereuse. L'incapacité est généralement temporaire, mais elle est absolue pendant la durée d'action du médicament. Compte tenu d'un éventuel effet résiduel (par exemple, après une période de sommeil induite par un hypnotique), il est conseillé au patient de se faire aider du médecin prescripteur pour savoir quand il peut à nouveau conduire, après une prise de médicament. Ce classement a induit une déclinaison du premier pictogramme en trois nouveaux permettant d'apporter des informations complémentaires par la couleur (jaune, orange et rouge), l'indication en toutes lettres du niveau de risque qui lui est attribué (1,2,3), et une mise en garde écrite suivie d'un message informatif sur la conduite à tenir lors de l'utilisation du médicament de la classe concernée (Figure 25). Afin de procéder à cette nouvelle classification, les effets pharmacodynamiques susceptibles d'altérer les capacités de conduite ont été identifiés à partir des données du dossier d'AMM et de la littérature pour chaque principe actif ou association de principes actifs (selon la classification ATC). Ces effets ont été catégorisés en 1) troubles de la vigilance et de l'attention ; 2) troubles de la vision ; 3) troubles du comportement ; 4) autres troubles (perturbations de l'équilibre, du système cardio-vasculaire...). D'autre part, les centres régionaux de pharmacovigilance ont analysé les données issues de la base nationale de pharmacovigilance recensant les effets indésirables des médicaments. Une étude des données d'accidentologie de la littérature internationale a également été réalisée. Dans un délai d'un an à compter du 2 août 2005, les nouveaux pictogrammes devront apparaître sur les médicaments (Arrêté du 18 juillet 2005 pris pour l'application de l'article R.5121-139 du Code de la santé publique et relatif à l'apposition d'un pictogramme sur le conditionnement extérieur de certains médicaments). Figure 24. Pictogramme présent sur les boîtes de médicaments potentiellement dangereux pour la conduite depuis 1999
Figure 25. Nouveaux pictogrammes représentant les trois niveaux de risque des médicaments pour la conduite.
Actuellement, 60 % des médicaments comportant le pictogramme unique précédemment utilisé ont été classés selon cette nouvelle gradation, avec 15 % des médicaments classés en niveau 3. Concernant les psychotropes, 21 neuroleptiques ont été classés en niveau 2 (formes orales) et 10 en niveau 3 (formes injectables). Il est souligné que les effets secondaires des neuroleptiques (sédation, troubles de la vision, du comportement...), mais aussi les effets liés à l'arrêt ou la réduction des doses, peuvent entraîner une altération des performances. Les effets des anxiolytiques sur la conduite (diminution des capacités à répondre à des situations d'urgence, augmentation des temps de réaction aux stimuli visuels et auditifs, une altération de la coordination et du contrôle des mouvements, ou une réduction de la capacité à suivre une cible mobile) ont conduit au classement de la plupart de ces anxiolytiques en niveau 2 (n=13), trois étant classés en niveau 1 et six autres en niveau 3 (Tableau 94). Il est souligné que les benzodiazépines pouvant induire des comportements à risque en raison de la survenue d'effets paradoxaux tels que la désinhibition, et que l'utilisation des formes injectables ou de doses élevées est incompatible avec la conduite. Concernant les hypnotiques, la conduite de véhicule est formellement déconseillée après la prise, ces molécules ont donc été essentiellement regroupées dans le niveau 3 (n=17) à l'exception de deux molécules dans le niveau 1 et d'une dans le niveau 2. Tous les antidépresseurs ont été placés dans le niveau 2 (n=25) en raison de la somnolence, des troubles visuels, et troubles du comportement (anxiété, agitation, hallucinations, confusion, accès maniaques, risque suicidaire) qu'ils peuvent provoquer surtout en début de traitement. Enfin, les antiépileptiques sont classés en niveau 2 (sauf le clonazépam en forme injectable) en raison de la sédation, des sensations ébrieuses et des vertiges qu'ils peuvent induire. Ces recommandations s'appliquent à la conduite au sens large (de la voiture aux rollers) ainsi qu'aux activités nécessitant de l'attention et de la précision. De plus, il est recommandé aux médecins de noter que le patient a été informé des risques (Loi du 4 mars 2002 précisant l'obligation d'informer sur les traitements et leurs risques)108. Cette information est également disponible grâce à la mise à disposition d'un dépliant dans les pharmacies. Tableau 94. Liste des spécialités psychotropes présentant un niveau de risque plus faible ou plus élevé que la majorité des spécialités de leur classe respective1
1. Information fournie par F. Haramburu, directrice du CEIP de Bordeaux 3. Benzodiazépines et risque de chutes chez la personne âgée Les études concernant l'association entre la prescription de benzodiazépines et le risque de chutes présentent, elles aussi, des résultats contradictoires. Une étude française réalisée par Pierfitte et collaborateurs a cherché à déterminer l'existence d'une association entre la prise de benzodiazépines et le risque de fracture de la hanche chez les personnes âgées109. Pour cela, ont été incluses dans cette étude toutes les personnes âgées de 65 ans et plus (n=245), admises aux services d'urgence des hôpitaux universitaires de Bordeaux de janvier 1996 à juillet 1997, présentant une fracture aiguë de la hanche résultant d'une chute et non associée à un cancer, un accident de la circulation, ou à une agression. Les sujets témoins étaient des personnes âgées de plus de 65 ans admises dans les mêmes hôpitaux pour une pathologie somatique aiguë, appariés aux cas pour l'âge, le sexe et la semaine d'admission. L'exposition des sujets aux benzodiazépines était déterminée à l'aide d'un questionnaire structuré mentionnant les noms usuels de toutes les benzodiazépines vendues en France, en consultant les dossiers médicaux, et par dosage des échantillons sanguins recueillis à l'admission. L'exposition aux benzodiazépines a été définie dans cette étude comme un usage de benzodiazépines au moment de la fracture de la hanche ou à l'admission à l'hôpital ou par la présence de benzodiazépines dans le sang à l'admission. L'usage des autres médicaments était déterminé par questionnaire et dossiers médicaux uniquement. Les benzodiazépines étaient utilisées par 34 % des cas et 36 % des témoins selon le questionnaire, mentionnées dans 33 % des dossiers des cas et 29 % de ceux des témoins, et enfin retrouvées dans les échantillons sanguins de 36 % des cas et 32 % des témoins. Leur usage n'était pas associé à une augmentation du risque de fracture, quel que soit le mode de détermination de cet usage. De même, la durée de la demi-vie des benzodiazépines n'était pas associée à une augmentation du risque de fracture de la hanche. L'usage de deux benzodiazépines ou plus était plus fréquent chez les cas que chez les témoins (7,4 % vs 3,7 % déterminés à partir des questionnaires, 7,4 % vs 4,3 % déterminés à partir des dosages). L'usage d'antidépresseurs tricycliques était associé à un risque accru (OR = 2,07, IC 95 % : 1,12-3,82) et l'usage d'anti-acides (OR = 2,24, IC 95 % : 1,16-4,33). L'usage de diurétiques était associé à un plus faible risque de fracture (OR = 0,71, IC 95 % : 0,52-0,96) et aucune association n'était retrouvée pour les ISRS. Une autre étude française a évalué le risque de chute associé aux médicaments psychotropes en analysant, selon la méthode dite du cas-non cas, les données de la base de française de Pharmacovigilance110. Tous les dossiers comportant un code indiquant une chute chez les personnes âgées de 18 ans et plus, soit 328 rapports sur les 77 125 inclus dans la base entre 1995 et 1999, ont été comparés à des non-cas (ensemble des notifications concernant d'autres types d'évènements). Pour ces cas, 70 % des patients étaient des femmes, la moyenne d'âge était de 76 ans, et 77 % des effets indésirables étaient considérés comme sérieux (principalement à cause d'une hospitalisation ou d'une prolongation d'hospitalisation). Près de la moitié des cas (43,6 %) étaient traités par anxiolytiques ou par hypnotiques et près d'un tiers (30,2 %) par antidépresseurs. Après ajustement sur l'âge et le sexe, l'exposition aux benzodiazépines et aux antidépresseurs (imipraminiques ou ISRS) était associée à la survenue d'une chute. Concernant les benzodiazépines, le risque était plus élevé pour les molécules à demi-vie courte ; il était plus élevé pour les patients de moins de 65 ans [OR=6,6, IC 95 % : 3,1-14,0] que pour les patients âgés de 65 à 80 ans [OR=4,4, IC 95 % : 2,2-8,6] ou que ceux de plus de 80 ans [OR=2,4, IC 95 % : 1,3-4,3]. Cette analyse souffre des limites inhérentes à toute étude réalisée à partir de bases de données de pharmacovigilance, à savoir, de plus, que seuls les cas déclarés sont pris en compte, le taux de notification pouvant dépendre du type d'événement ou de médicament considéré ce qui peut induire des biais importants. Leipzig et collaborateurs ont réalisé une méta-analyse (synthèse des données quantitatives issues de plusieurs études) afin d'explorer l'association entre usage de psychotropes et chute111. Les études ont été sélectionnées si elles évaluaient l'association entre usage de sédatifs/hypnotiques, d'antidépresseurs, de neuroleptiques et les chutes chez les personnes âgées de plus de 60 ans. Au total, sur les 1 043 articles sélectionnés, 40 études remplissaient les critères d'inclusion. Dans 70 % des études, la définition de chute était conforme à la définition de Kellogg à savoir des événements non liés à une syncope, non attribuable à un coup violent, à une perte de conscience, à une attaque cérébrale ou à une crise d'épilepsie. Cette méta-analyse met en évidence un risque accru de chute lié à l'usage des psychotropes en général : neuroleptiques, sédatifs/hypnotiques, et antidépresseurs (Tableau 95). L'usage de benzodiazépines augmente le risque de chute de 1,5 fois. Ce risque est mis en évidence aussi bien pour les benzodiazépines à demi-vie courte (OR =1,44, IC 95 % : 1,09-1,90) qu'à demi-vie longue (OR =1,32, IC 95 % : 0,98-1,77). Ces résultats ne sont pas modifiés si on prend en compte le lieu de résidence, la fréquence des sujets faisant des chutes dans la population étudiée, la moyenne d'âge des sujets, ou le type d'étude, exceptés pour les neuroleptiques pour lesquels il existe un effet protecteur chez les patients hospitalisés en psychiatrie (Tableau 95). Tableau 95. Méta-analyse explorant les associations entre usage de psychotropes et chute (extrait du tableau réalisé par Leipzig et al)
1. Hétérogénéité statistiquement significative des odds ratio Une analyse de la littérature a été réalisée par Blain et al112 à partir d'études épidémiologiques portant sur le risque de chute lié à la consommation de médicaments. Les études portant sur les psychotropes chez des sujets autonomes à domicile sont présentées dans le Tableau 96. Les études portant sur les benzodiazépines montrent que celles-ci majorent le risque de chute avec fracture113. Certaines études ont montré un risque accru de chute ou de fracture plus marqué pour les benzodiazépines à demi-vie longue mais ces résultats ne sont pas confirmés par d'autres études114-118. Ces résultats discordants pourraient être liés aux différences interindividuelles du métabolisme des benzodiazépines, aux différences de posologies117 119 et à l'ancienneté du traitement (le risque de chute concerne surtout les 15 premiers jours)120. Les interactions avec d'autres médicaments ou toxiques (alcool par exemple), prises en compte par aucune de ces études, pourraient jouer un rôle plus important dans le risque de chute que le type de molécule utilisée121. Tableau 96. Risque de chute1 et usage de psychotropes dans les études épidémiologiques chez des sujets non institutionnalisés
1. Le critère de définition des chuteurs a comporté 1 voire 2 chutes ou plus. 2. n=nombre de sujets 3. p<0,05 par rapport aux non consommateurs du médicament ou de la classe médicamenteuse Au total, les données de la littérature suggèrent que l'usage de psychotropes soit associé à un risque accru de chute, particulièrement chez les personnes âgées, et ce quelle que soit la classe pharmacologique (à l'exception peut être des ISRS). L'augmentation du risque de chute lié peut être liée aux troubles de la vigilance, de l'équilibre ou à une hypotension orthostatique induits par ces médicaments. Evans141 souligne toutefois que les chutes peuvent être liées à la pathologie pour laquelle le médicament est prescrit plutôt qu'au traitement lui-même ; par exemple, une démence, motif fréquent de prescription de psychotropes chez les personnes âgées, est, en elle-même, un facteur de risque de chutes. Indépendamment des mécanismes impliqués, ces résultats indiquent que ce risque de chute doit être pris en compte dans l'évaluation, avant prescription, du rapport bénéfice/risque d'un traitement psychotrope chez les personnes âgées. En effet, une chute à cet âge peut avoir des conséquences dramatiques même si les lésions entraînées par la chute sont peu sévères, une hospitalisation même de courte durée pouvant entraîner une perte définitive d'autonomie et des complications iatrogènes. Du fait de la fréquence particulièrement élevée d'exposition aux psychotropes chez les personnes âgées en France, une évaluation médico-économique du coût lié aux chutes induites par les psychotropes en France paraît indispensable. 4. Benzodiazépines et risque de déclin cognitif ou de démence L'impact délétère des benzodiazépines sur les performances cognitives, et en particulier sur la mémoire à court terme, a été mis en évidence par de nombreuses études142. Les perturbations mnésiques induites par les benzodiazépines peuvent avoir un retentissement psycho-social important, particulièrement chez les personnes âgées. Sur un plan médico-légal, l'utilisation criminelle de ces substances pour induire une soumission chimique repose principalement sur cet effet perturbateur de la mémoire à court terme. Toutefois, les études ont essentiellement documenté les effets mnésiques contemporains de la prise de ces médicaments, et très peu ont exploré l'impact à long terme des benzodiazépines sur les fonctions cognitives. D'un point de vue de santé publique, il est essentiel de déterminer si les troubles cognitifs persistent ou non après le sevrage, du fait de la prévalence très élevée d'exposition à ces médicaments chez les personnes âgées. Cette question a été explorée récemment par une méta-analyse143 de 9 études publiées entre 1980 et 2000, menées sur des sujets ayant au moins un an d'exposition aux benzodiazépines (durée moyenne égale à 9 ans). Toutes ces études ont été conduites sur des populations "cliniques", c'est à dire chez des sujets recrutés en milieu hospitalier, dans le cadre de consultations spécialisées dans le sevrage aux benzodiazépines ou dans l'évaluation des troubles liés à l'usage de substances psychoactives. Une évaluation des performances cognitives a été réalisée à l'inclusion dans l'étude (avant le sevrage) et répétée après un délai médian de trois mois après le sevrage. En comparaison avec des témoins n'ayant jamais fait usage de benzodiazépines, les anciens usagers avaient des performances cognitives inférieures dans quasiment tous les domaines explorés, les déficits les plus importants concernant la mémoire verbale. Une étude plus récente144, non inclue dans cette méta-analyse, a comparé les performances cognitives de 20 usagers chroniques de benzodiazépines (durée moyenne d'exposition 108 mois), et ayant réussi à se sevrer de ces médicaments depuis plus de 6 mois (moyenne 42 mois), à celles de sujets témoins souffrant ou non de troubles anxieux, et n'ayant jamais fait usage de benzodiazépines. Les anciens usagers sevrés avaient des performances inférieures à celles des témoins aux tests explorant la mémoire verbale et non-verbale, et le contrôle de la motricité. En revanche, les performances visuo-spatiales et attentionnelles ne différaient pas entre les deux groupes. Ces résultats sont toutefois difficiles à interpréter, car les sujets consultant dans des centres spécialisés pour un trouble liés à l'usage de benzodiazépines ne sont vraisemblablement pas représentatifs des utilisateurs de benzodiazépines : - d'une part parce qu'ils sont susceptibles d'être exposés à des doses supérieures ou de prendre le traitement depuis plus longtemps que des usagers non sélectionnés, - d'autre part parce que seules les personnes ayant réussi à se sevrer sont prises en considération. De plus, ces études ne donnent pas d'information sur la chronologie d'apparition des déficits cognitifs par rapport à l'exposition aux benzodiazépines (déficit préexistant ou apparu au cours du traitement par benzodiazépines ?). Seules des études pharmaco-épidémiologiques prospectives basées sur des échantillons représentatifs de la population générale sont à même de déterminer si l'exposition aux benzodiazépines est susceptible d'induire un déficit cognitif qui n'existait pas, même a minima, avant le traitement (déficits « incidents »). Une telle étude a été conduite à partir de la cohorte de personnes âgées PAQUID déjà décrite (Cf. question 1), incluant des sujets âgés de plus de 65 ans non institutionnalisés, identifiés à partir des listes électorales82. Ces sujets ont été évalués à l'inclusion, puis 4 fois au cours d'un suivi de 8 ans, avec documentation de la consommation de benzodiazépines à chaque évaluation. Une étude cas-témoins intra-cohorte a été menée, les cas (n=150) étant définis comme les sujets pour lesquels un diagnostic de démence incidente selon les critères DSM-III-R a été posé par un neurologue, et les témoins (n=3 159) comme les sujets ne présentant pas de démence au moment où le diagnostic était posé chez le cas. Une consommation de benzodiazépines dans le passé était deux fois plus fréquente chez les sujets présentant une démence incidente, alors que les cas ne différaient pas des témoins en ce qui concerne la consommation actuelle. Cette étude suggère donc que l'exposition aux benzodiazépines pourrait augmenter le risque de démence. Une recherche bibliographique nous a permis d'identifier 5 autres études conduites en population générale, ayant exploré de manière prospective l'association entre exposition aux benzodiazépines et détérioration des performances cognitives145. Leurs méthodes et principaux résultats sont présentés dans le Tableau 97. Il est notable que 3 des 6 études sur ce sujet ont été conduites en France. Les résultats de ces études sont relativement contradictoires, deux d'entre elles ne mettant pas en évidence d'association entre usage de benzodiazépines et déficit cognitif incident146 147, une étude mettant en évidence un effet "protecteur" des benzodiazépines148, et les deux autres montrant que les nouveaux usagers149 ou les usagers chroniques150 présentaient plus de déficits cognitifs incidents. Ces discordances peuvent être liées aux limites méthodologiques des études, qui diffèrent notablement en particulier quant à la définition de l'exposition aux benzodiazépines. Par exemple, l'étude mettant en évidence un effet protecteur des benzodiazépines ne différencie pas les sujets exposés uniquement à l'inclusion de ceux exposés lors de deux évaluations consécutives. Cet effet "protecteur" est donc probablement lié au fait que le traitement par benzodiazépines a été interrompu chez les sujets débutant une démence, seuls les sujets indemnes ayant poursuivi ce traitement au cours du suivi82. Ces résultats relativement divergents peuvent aussi être expliqués par des différences méthodologiques telles que la durée du suivi, la mesure et la définition du déclin cognitif (démence répondant aux critères DSM, ou différences dans les performances à des tests neuropsychologiques entre l'évaluation au début et au cours ou à la fin du suivi). Toutes les études n'ont pas pris en compte l'impact de l'usage d'alcool, d'autres médicaments psychotropes, ou l'existence d'un trouble psychiatrique. Des informations essentielles manquent dans la plupart des études, notamment concernant l'observance, l'influence de la durée d'exposition cumulée et de la dose, la chronologie exacte entre l'exposition aux benzodiazépines et l'apparition des déficits cognitifs, et les symptômes motivant la prescription. De ce fait, il n'est pas actuellement possible de conclure à l'existence d'un lien, a fortiori, causal entre exposition aux benzodiazépines et détérioration cognitive. Néanmoins, les résultats de ces études conduites en population générale, avec trois d'entre elles montrant une augmentation du risque de déficit cognitif chez les usagers, peuvent être considérés comme un signal épidémiologique indiquant que des études complémentaires et indépendantes sont indispensables. Du fait de la proportion importante de sujets exposés à ces médicaments, une augmentation, même minime, du risque de détérioration cognitive pourrait générer, par an, un nombre important (plusieurs milliers) de cas de démence, et donc avoir de larges répercussions sur la santé des populations. Comme l'exposition aux benzodiazépines est un facteur de risque modifiable, les enjeux sont d'autant plus importants en termes de santé publique et de responsabilité politique. Tableau 97. Etudes de cohortes prospectives explorant l'association entre usage de benzodiazepines et déclin cognitif d'après Verdoux et al145
Tableau 97 (suite). Etudes de cohortes prospectives explorant l'association entre usage de benzodiazepines et déclin cognitif d'après Verdoux et al 145
Seules seront ici citées les recommandations issues de rapports, conférences de consensus ou mises au point, réalisées par des organismes ou des associations françaises, en sachant que celles ci reposent systématiquement sur l'analyse de recommandations internationales. 1. Anxiolytiques et hypnotiques Selon les fiches de transparence de l'ASSaPS (1999) concernant les indications des anxiolytiques «les symptômes psychiques, physiques et comportementaux de l'anxiété deviennent pathologiques lorsqu'ils atteignent un caractère invalidant qu'il appartient au médecin de reconnaître. Ils justifient alors un traitement spécifique ». Il est précisé que les anxiolytiques ne doivent pas être utilisés en monothérapie dans le traitement de la dépression, car ils peuvent masquer les signes sans prévenir les risques évolutifs. Les indications des hypnotiques doivent prendre en compte la différence entre insomnie transitoire et insomnie chronique (> 3 semaines). En cas d'insomnie chronique, une pathologie (psychiatrique ou somatique) qui pourrait en être à l'origine doit être recherchée et traitée. Si l'insomnie est idiopathique ou persiste, il faut évaluer le retentissement sur le fonctionnement diurne : s'il est moyen à modéré un « traitement comportemental » est préconisé, s'il est sévère, un traitement comportemental peut être associé à un traitement hypnotique (quelques jours à quelques semaines). Les recommandations de l'ANAES (Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé)151 précisent qu'en cas d'insomnie chronique (> 3 semaines), il est recommandé de prescrire des cures courtes plutôt qu'un traitement continu si la poursuite du traitement médicamenteux s'avère justifié. Pour mémoire, la RMO (Référence Médicale Opposable) dont la première version date de 1994 concernant les anxiolytiques et hypnotiques est citée dans le Tableau 98. Tableau 98. RMO « Prescription des anxiolytiques et hypnotiques »
Toutes les études présentées dans la question 1 montrent que ces recommandations sont peu appliquées. Notamment, la limitation de la durée des prescriptions dans le temps qui excède, pour plus de la moitié des usagers, celle recommandée. Les associations d'anxiolytiques sont également fréquentes, plus d'un sujet sur 10 prenant de manière concomitante deux benzodiazépines et plus. Cette situation illustre à nouveau le paradoxe français, qui consiste à édicter des règles et recommandations quand les précédentes sont, faute de volonté politique, discréditées par la réalité du terrain. L'ANAES (Agence Nationale d'Evaluation et d'Accréditation en Santé) a publié plusieurs rapports concernant les recommandations de prescription des antidépresseurs, le premier, général, en 1996152, le deuxième en 2002 concernant le traitement ambulatoire d'un épisode dépressif153 (Annexe 5), suivi en 2004 par la publication de référentiels pour les patients suivis en médecine générale154 et en psychiatrie155. Les grandes lignes des recommandations les plus récentes153 stipulent que dans le traitement ambulatoire de la dépression, un traitement psychothérapique doit être proposé en première intention dans les dépressions d'intensité légère à modérée, que les antidépresseurs les mieux tolérés (ISRS, ISRSNA, et autres antidépresseurs non imipraminiques non IMAO) doivent être prescrits en première intention si un traitement est indiqué, et que le traitement antidépresseur doit être poursuivi 6 mois à 1 an après obtention de la rémission clinique. L'Afssaps a récemment publié une mise au point sur le bon usage des antidépresseurs au cours de la dépression chez l'enfant et l'adolescent156 (Annexe 6). Schématiquement, les recommandations sont que le traitement de première intention chez l'enfant doit être psychothérapique, que le traitement antidépresseur peut être envisagé en l'absence d'amélioration. Chez l'adolescent, le traitement de première intention est psychothérapique dans la plupart des cas. La prescription doit s'associer dans tous les cas à une surveillance du risque suicidaire. Le traitement doit être poursuivi 6 mois à un an. Pour mémoire, la RMO concernant les antidépresseurs est citée dans le Tableau 99. Les études présentées dans la question 1 montrent là encore que ces recommandations sont peu appliquées. Notamment, la durée de prescription des antidépresseurs est inférieure à celle recommandée pour une proportion très importante de patients. La co-prescription antidépresseur-anxiolytique reste très largement répandue. On ne dispose pas de données permettant d'évaluer la recommandation préconisant l'instauration d'une psychothérapie en première intention chez l'adulte présentant une dépression modérée, ou chez l'enfant. En revanche, les recommandations concernant la non-association de plusieurs antidépresseurs, ou la prescription en première intention des molécules les plus récentes, sont globalement respectées. Tableau 99. RMO « Prescription des antidépresseurs »
Deux conférences de consensus ont porté sur le traitement des schizophrénies (indication principale de ces traitements, tout au moins jusqu'à l'élargissement récent des AMM et l'extension des indications à d'autres troubles dont les troubles bipolaires). La première, réalisée en 1994 par l'ANAES sous l'égide de la FFP (Fédération Française de Psychiatrie) et l'Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux (UNAFAM), a concerné les stratégies thérapeutiques à long terme dans les psychoses schizophréniques. Brièvement, les principales recommandations étaient que le traitement neuroleptique devait être le plus précoce possible, continu et maintenu au long cours sans interruption (au moins deux ans pour un premier épisode, au moins cinq ans après une phase de stabilisation), que les associations de neuroleptiques devaient être évitées, ainsi que la co-prescription systématique de correcteurs anticholinergiques. L'évaluation de l'impact de cette conférence de consensus sur les pratiques de prescription157 158 a mis en évidence une discrète augmentation de la prescription de neuroleptiques en monothérapie, passant de 51,1 % des traitements avant la conférence (1993) à 56,4 % trois ans après celle-ci (1996). En revanche, contrairement à la recommandation émise, la co-prescription des correcteurs anticholinergiques a augmenté, passant de 48,2 % des prescriptions en 1993 à 54,3 % en 1996. La deuxième conférence de consensus, également réalisée sous l'égide de la FFP, a porté sur les schizophrénies débutantes159. Les recommandations concernant les traitements pharmacologiques sont là encore la précocité du traitement, le choix en première intention d'antipsychotiques de seconde génération, recherche de la dose minimale efficace, si possible en monothérapie et par voie orale. L'utilisation de thymorégulateurs comme appoint ou alternative doit être envisagée « en présence d'un épisode psychotique aigu à tonalité thymique ». Dans une étude réalisée sur une cohorte bordelaise de sujets hospitalisés pour la première fois pour un épisode psychotique, nous avons montré que si la recommandation préconisant l'usage en première intention des nouvelles molécules antipsychotiques était globalement respectée, les co-prescriptions de neuroleptiques et d'anticholinergiques restaient fréquentes160. Pour mémoire, la RMO concernant les neuroleptiques est citée dans le Tableau 100. Tableau 100. RMO « Prescription des neuroleptiques »
1. Epidémiologie des troubles psychiatriques et adéquation diagnostic-traitement En accord avec les données de toutes les études internationales évaluant la prévalence des troubles psychiatriques en population générale, les études épidémiologiques conduites en France montrent que cette prévalence est très élevée : plus d'une personne résidant en France sur 3 répond aux critères diagnostiques d'un trouble psychiatrique avéré au cours de sa vie. Les troubles les plus fréquents sont les troubles de l'humeur et les troubles anxieux, avec 5 à 10 % de la population présentant un trouble de l'humeur au cours d'une année, et plus d'une personne sur 10 présentant un trouble anxieux au cours de la même période. Les données d'une étude internationale suggèrent que cette prévalence soit plus élevée en France que dans les autres pays européens, tout en étant inférieure à celle mise en évidence aux USA. Une étude conduite sur une population de personnes âgées montre que la prévalence des troubles est particulièrement élevée dans cette population, avec près d'une personne sur 5 présentant un trouble anxieux et/ou dépressif au moment de l'évaluation. Chez les enfants et adolescents, la prévalence des troubles psychiatriques est estimée à 7 % (soit, pour la France, un million d'enfants de 0 à 19 ans présenteraient au moins un trouble). Les données de l'étude ESEMeD montrent toutefois que la fréquence des troubles psychiatriques dans la population est un critère peu pertinent pour expliquer le niveau de consommation de psychotropes. Ainsi, la prévalence des troubles psychiatriques aux Pays-Bas est proche de celle de la France, alors que la consommation de psychotropes dans ce pays est l'une des plus faibles d'Europe. Les études ayant évalué l'adéquation entre diagnostic psychiatrique et traitement psychotrope suggèrent que l'inadéquation existe aussi bien dans le sens « absence d'usage en présence d'un trouble avéré » que dans celui « usage en l'absence de trouble avéré ». L'inadéquation dans le sens « absence d'usage en présence d'un trouble avéré » est particulièrement marquée pour les traitements antidépresseurs, avec une influence des caractéristiques socio-démographiques sur la probabilité de recevoir un traitement « adéquat ». Le résultat selon lequel les hommes sont, à niveau de pathologie égale, moins susceptibles de bénéficier d'un traitement « adéquat », est concordant avec les données sur le moindre recours aux soins et le moindre usage de psychotropes chez les hommes. La relation entre niveau socio-professionnel élevé et absence de traitement « adéquat » de la dépression est plus paradoxale, car l'accès aux soins est généralement de meilleure qualité chez les sujets les plus favorisés socialement. Une hypothèse est que ces personnes ont plus fréquemment recours à des alternatives thérapeutiques non médicamenteuses (psychothérapie en particulier) quand elles présentent un trouble dépressif. Cette hypothèse ne peut être étayée par les données disponibles, et devrait donc être explorée par des études complémentaires. L'inadéquation entre usage de benzodiazépines et diagnostic psychiatrique paraît plus marquée dans la direction « usage en l'absence de trouble avéré » que dans celui « absence d'usage en présence d'un trouble avéré », avec les réserves précédemment faites inhérentes aux limites méthodologiques des études (par ex. usage ponctuel d'hypnotique pour un événement particulier qui fait basculer le sujet dans la catégorie « usage en l'absence de trouble »). Cette inadéquation concerne surtout la catégorie des personnes âgées. Même si les études épidémiologiques montrent que la prévalence des troubles psychiatriques avérés est importante dans cette population, la fréquence des prescriptions de médicaments à visée hypnotique excède largement celle des troubles relevant d'une telle prescription. Une méta-analyse récente de 24 études évaluant l'efficacité des prescriptions d'hypnotiques chez les sujets âgés de 60 ans et plus et présentant une insomnie isolée (en l'absence d'autres troubles psychiatriques) a montré que le bénéfice thérapeutique d'une telle prescription était minime par rapport aux risques associés à l'usage d'hypnotiques chez les personnes âgées161. Ces données sur l'inadéquation diagnostic-traitement psychotrope doivent être interprétées avec la plus grande prudence. Comme nous l'avons déjà souligné dans le chapitre précédent, les données disponibles à ce jour sur ce sujet sont issues d'études épidémiologiques dont l'objectif principal n'était pas d'explorer cette question. Les informations recueillies sont donc le plus souvent trop succinctes pour permettre d'évaluer avec précision la fréquence des prescriptions « inadéquates ». Il convient également d'être vigilant par rapport à des interprétations exclusivement basées sur des estimations numériques. Le nombre de sujets recevant un traitement psychotrope en l'absence de trouble avéré est en valeur absolue supérieur à celui des sujets présentant un trouble relevant a priori d'un traitement médicamenteux et ne recevant pas le traitement adéquat. Cette supériorité numérique ne permet toutefois pas de préjuger des conséquences individuelles et sociétales respectives de ces deux cas de figure. La prescription d'un anxiolytique, voire d'un antidépresseur, en dehors de tout cadre nosographique, même si elle est fréquente, peut en effet avoir moins de répercussions délétères à l'échelon individuel et collectif que l'absence de prescription chez des sujets souffrant de troubles psychiatriques avérés (rupture du cursus scolaire, perte d'emploi, altération du réseau familial et social, développement d'une comorbidité addictive, suicide...). Un autre point à prendre en compte est que le critère principal qui a été utilisé ici pour évaluer l'inadéquation est l'existence ou non d'un trouble psychiatrique avéré selon les critères diagnostiques internationaux. L'élaboration de critères diagnostiques tels que ceux définis dans les classifications internationales des troubles psychiatriques comme le DSM-IV ou la CIM-10 a notablement contribué à homogénéiser les pratiques diagnostiques en psychiatrie. Si cette standardisation est nécessaire pour la réalisation d'études épidémiologiques, elle a des limites à l'échelon individuel, où la prescription d'un psychotrope peut être médicalement justifiée (ou injustifiée) sur des critères autres que le strict cadre nosographique. Une autre limite, trop souvent négligée, est que la validité des catégories diagnostiques ainsi définies reste incertaine, puisque ces regroupements syndromiques ont été établis exclusivement à partir du niveau d'observation clinique. Contrairement à d'autres pathologies, l'étiologie et la physiopathologie des troubles psychiatriques restent inconnues, on ne dispose donc pas d'examens complémentaires permettant de confirmer les diagnostics établis cliniquement à partir de l'identification des symptômes présentés par la personne. De plus, la spécificité des symptômes sur lesquels reposent les regroupements syndromiques est faible, les mêmes symptômes pouvant être présents dans plusieurs troubles. Du fait de ces incertitudes, les frontières entre les différentes catégories diagnostiques, ou entre normal et pathologique, reposent sur des critères relativement arbitraires et sont donc susceptibles d'être modifiées en fonction des décisions de consensus d'experts ; l'élargissement des critères diagnostiques d'une catégorie entraînant le fait que le diagnostic sera posé chez un nombre plus important de personnes. Comme dans la plupart des spécialités médicales, les diagnostics catégoriels ont pour utilité principale de permettre la prise de décision, notamment au niveau de la conduite à tenir thérapeutique ; toute modification des frontières diagnostiques entraîne donc une modification du nombre de sujets requérant tel ou tel traitement. Pour les raisons explicitées plus haut, la psychiatrie est une des spécialités médicales où le risque d'extension des indications est particulièrement élevé, et où l'influence d'experts, dont les liens avec l'industrie pharmaceutique ne sont pas toujours limpides, sur l'élaboration ou la modification des critères diagnostiques est régulièrement mise en cause162-165. Il est en effet relativement aisé dans ce champ de la médecine où les frontières diagnostiques sont incertaines de définir que telle ou telle condition correspond à un état pathologique requérant un traitement, favorisant ainsi la création de nouvelles entités diagnostiques, ou la médicalisation de comportements considérés comme socialement déviants. Les exemples pourraient être multipliés pour les traitements psychotropes prescrits aussi bien aux enfants qu'aux adultes. L'extension du cadre diagnostique de la phobie sociale au cours de la dernière décennie, entraînant une augmentation spectaculaire de la prévalence des ces troubles, et donc du nombre de sujets requérant un traitement (par antidépresseurs de type ISRS) est un des exemples régulièrement cités les plus caricaturaux162 164. Des interrogations récurrentes concernent également les extensions d'indications des psychostimulants chez l'enfant164 166. Un autre exemple concerne la tendance actuelle à l'extension des indications des traitements antipsychotiques chez les sujets présentant des troubles psychotiques "prodromiques", ce qui revient en fait à définir une nouvelle catégorie diagnostique "d'états mentaux à risque" ou "prépsychotiques" nécessitant un traitement. Les critères diagnostiques de cette catégorie, élaborés a priori, ont comme limite majeure leur faible spécificité et donc de générer un nombre important de sujets identifiés à tort comme à risque de transition vers un trouble psychotique, et, à ce titre, susceptibles d'être traités de manière injustifiée167. L'extension des indications concerne également d'autres troubles pour lesquels ces molécules n'avaient pas jusqu'alors d'AMM, tels que les troubles bipolaires. Il est notable que l'extension des indications des antipsychotiques ait coïncidé avec l'introduction des nouvelles molécules antipsychotiques entraînant moins d'effets secondaires neurologiques à court terme (mais exposant les sujets à la survenue d'autres complications tel qu'un diabète). En d'autres termes, il serait simplificateur dans le champ des troubles psychiatriques de considérer que l'application de critères diagnostiques permet de garantir le caractère approprié d'une prescription. Ces critères permettent uniquement une approximation de ce paramètre. A l'échelon individuel, une prescription d'antidépresseur chez un sujet présentant des symptômes dépressifs ne répondant pas aux critères diagnostiques DSM-IV ou CIM-10 d'épisode dépressif majeur ou de dysthymie peut être moins inappropriée que la prescription d'un antipsychotique au long cours chez un patient souffrant d'un trouble bipolaire qui pourrait être stabilisé par thymorégulateurs. Les études sur l'usage des psychotropes dans la population française ne permettent pas d'estimer avec précision la fréquence des prescriptions inappropriées. Cette fréquence ne peut être évaluée que par des études ayant pour objectif principal la mesure de ce paramètre, basées sur des critères stricts définis a priori, et sur les instruments d'évaluation adéquats. On ne peut donc actuellement pas connaître avec une précision suffisante le coût des prescriptions inappropriées dans la population française, et seules des estimations sont possibles. Le montant remboursé par la CNAM-TS pour les médicaments psychotropes est d'environ un milliard d'euros par an, dont 470 millions d'euros pour les antidépresseurs et 220 millions d'euros pour les anxiolytiques et hypnotiques, pour lesquels l'inadéquation diagnostique-traitement est la mieux documentée. Si l'on se base sur l'estimation selon laquelle la moitié des personnes consommant des antidépresseurs et plus des deux tiers des personnes consommant des anxiolytiques et hypnotiques ne présentent pas de trouble psychiatrique identifiable, une estimation maximale serait que la moitié des prescriptions d'antidépresseurs et les deux tiers des prescriptions d'anxiolytiques et hypnotiques correspondent à des prescriptions inappropriées, ce qui correspond à un montant remboursé annuel de 380 millions d'euros. Cette estimation plafond n'est pas basée sur le nombre de sujets traités, et ne tient par exemple pas compte du fait que les prescriptions courtes d'antidépresseurs sont plus fréquentes chez les sujets n'ayant pas de diagnostic identifiable. Une estimation plus vraisemblable pour ces deux classes est qu'une prescription sur 3 d'antidépresseurs et une prescription sur 2 d'anxiolytiques et hypnotiques ne respectent pas les recommandations de bonne pratique, ce qui amène à un montant remboursé annuel de 250 millions d'euros. Il s'agit d'une estimation minimale, car ne prenant pas en compte les prescriptions inappropriées d'antipsychotiques. En d'autres termes, le montant des prescriptions inappropriées peut être estimé comme compris dans une fourchette allant d'un quart à un tiers du montant remboursé par l'assurance maladie pour les médicaments psychotropes. Il faut souligner que cette estimation, purement comptable, ne prend pas en compte l'absence inappropriée de prescription de médicaments psychotropes en présence d'un trouble avéré, dont nous avons déjà souligné la fréquence élevée, et dont les coûts directs et indirects peuvent être considérables. 2. Impact populationnel de l'utilisation inappropriée de psychotropes (Evaluation du rapport bénéfice / risque) La question « les médicaments psychotropes sont-ils utilisés de manière inappropriée en France? » est indissociable de la question « quelles sont les conséquences de cette utilisation inappropriée sur la santé de la population française ? ». Ainsi, faire le constat qu'une large proportion de personnes résidant en France consomment régulièrement et sur des durées prolongées des anxiolytiques ou hypnotiques ne suffit pas pour établir que cet usage est problématique, et que des moyens doivent être mis en œuvre pour le réduire. Les benzodiazépines sont des médicaments rapidement efficaces sur leur cible symptomatique, globalement bien tolérés à court terme, et la stratégie consistant à poursuivre la prescription est effectivement le moyen le plus efficace d'éviter les complications liées au sevrage. Sur le seul argument que l'arrêt de leur consommation peut poser problème, faut-il diaboliser ces médicaments, et stigmatiser leurs usagers, si ceux-ci ont une meilleure qualité de vie grâce à ces molécules ? Prétendre limiter l'accès à des substances sous le seul prétexte qu'elles modifient le fonctionnement psychique relève d'une prise de position morale, voire moralisatrice, qui condamne l'accès au bien être, ou tout au moins à un mieux être, via des molécules chimiques non secrétées par l'organisme. Il est ici essentiel de différencier ce qui relève d'opinions et des fantasmes sur les psychotropes (et leurs usagers), de ce qui relève d'un point de vue de santé publique. Celui ci doit exclusivement se fonder sur l'évaluation de l'impact populationnel des psychotropes, c'est à dire de leur rapport bénéfice/risque à l'échelon de la population. En effet, des risques dont la fréquence de survenue est faible ne peuvent être documentés correctement qu'à l'échelon populationnel ou, du moins, sur des échantillons de grande taille. Ceci ne préjuge pas de leur impact en santé publique, qui peut être considérable, même pour un effet rare, si une proportion importante de la population est exposée au médicament en question. Or, comme le souligne le rapport du GTNDO (Groupe Technique National de Définition des Objectifs de santé publique)168, on ne dispose pas actuellement de données sur l'impact populationnel des psychotropes en France. Ainsi, des alertes peuvent être lancées, largement relayées par les médias, et des décisions réglementaires peuvent être prises, alors qu'on ne dispose pas de données pharmaco-épidémiologiques d'impact étayant leur bien fondé. Le meilleur exemple est probablement celui de la restriction d'usage des antidépresseurs visant à limiter le nombre de cas de suicide. A ce jour, aucune étude clinique ou pharmaco-épidémiologique n'a mis en évidence d'excès de suicide imputable à la prise d'antidépresseurs, même si les données issues de quelques essais thérapeutiques suggèrent que ces médicaments pourraient augmenter la fréquence des conduites suicidaires (mais pas des décès par suicide), en particulier chez les enfants et adolescents. En revanche, le risque suicidaire lié à une dépression non traitée est très bien documenté par des études épidémiologiques. Une modélisation de l'impact des antidépresseurs sur le risque de suicide dans la population française montre que l'instauration d'un traitement antidépresseur permet de réduire de moitié le nombre de suicide dans toutes les tranches d'âge considérées si les sujets prennent ce traitement pendant une durée adéquate, et ce même si on se base sur des hypothèses peu favorables aux traitements antidépresseurs. Ces résultats sont importants à prendre en considération dans le débat sur l'impact des antidépresseurs sur le risque suicidaire, car des campagnes médiatiques disqualifiant ces médicaments, ou des mesures visant à restreindre leur usage dans les dépressions caractérisées pourraient contribuer à augmenter la mortalité par suicide en France. Même si des études suggèrent que l'usage de psychotropes augmente le risque d'accident, aucune donnée n'est disponible sur le nombre de décès attribuables en France aux médicaments psychotropes, tels que ceux liés aux accidents de la circulation ou aux chutes, en particulier chez la personne âgée. On dispose également de peu de données sur la morbidité attribuable aux médicaments psychotropes (par exemple, accidents de la circulation et chutes non mortels, survenue de troubles cognitifs de type démentiel induits par les benzodiazépines). D'autres risques potentiels doivent également faire l'objet d'une surveillance, tel que le risque de survenue de troubles métaboliques (diabète, dyslipidémie) liés à l'extension croissante des indications des antipsychotiques atypiques. Ce dernier exemple illustre parfaitement le fait que l'évaluation du rapport bénéfice/risque d'un médicament psychotrope est largement dépendant de la condition clinique pour laquelle il est prescrit. Chez une personne souffrant de schizophrénie, le seul traitement disponible à ce jour repose sur les antipsychotiques, le choix thérapeutique se résume donc à prescrire une molécule ancienne, efficace, peu coûteuse, mais induisant des effets secondaires altérant la motricité et le fonctionnement cognitif ; ou une molécule plus récente, plus coûteuse, altérant peu la qualité de vie, mais exposant à des risques d'obésité et de diabète. Si la personne souffre d'un trouble bipolaire (maladie maniaco-dépressive), l'évaluation du bénéfice/risque lié à la prescription de ce même antipsychotique atypique va être différente, puisqu'on dispose ici d'une alternative thérapeutique représentée par les sels de lithium, traitement très peu coûteux, avec une efficacité largement démontrée, exposant à peu de risque à condition de respecter les règles de surveillance, et dont la prescription en première intention est recommandée par tous les experts et consensus internationaux. L'évaluation du rapport bénéfice/risque lié à l'usage des psychotropes au niveau de la population française repose essentiellement à l'heure actuelle sur des données issues d'études pharmaco-épidémiologiques conduites dans d'autres pays. L'extrapolation de ces résultats à la population française pose problème, car le niveau d'exposition et les modalités de consommation des psychotropes diffèrent d'un pays à l'autre, la plupart des études pharmaco-épidémiologiques européennes de qualité étant conduites dans les pays anglo-saxons et scandinaves, où le niveau d'exposition aux psychotropes est faible. L'incidence et la prévalence des pathologies (en l'absence d'exposition aux psychotropes) diffèrent également d'un pays à l'autre du fait de facteurs génétiques et/ou environnementaux ; il en va de même en ce qui concerne le risque de base des complications potentielles de ces traitements comme le suicide, ou le diabète. L'évaluation du rapport bénéfice/risque ne pourra donc être faite de manière rigoureuse que par des études pharmaco-épidémiologiques d'impact conduites dans la population française, ou par des modélisations basées sur des estimations obtenues dans cette population. A ce titre, aborder le problème des prescriptions inappropriées, par excès et par défaut, d'un seul point de vue économique est extrêmement réducteur. Que le traitement de personnes qui ne devraient pas l'être pèse directement 250 ou 380 millions d'euros sur les dépenses de l'assurance maladie ne doit pas faire oublier non plus le coût social, probablement considérable, des effets indésirables injustement induits. Le problème des chutes et des syndromes démentiels potentiellement associés à l'usage des benzodiazépines chez les sujets âgés ne peut qu'interpeller les responsables sanitaires quand elle concerne plus de 2 millions de personnes. La mise en place d'une étude d'envergure, centrée sur ce problème, nous paraît prioritaire. 3. Recommandations de bonne pratique Au cours de la période considérée dans ce rapport, des recommandations de bonne pratique concernant la prescription des médicaments psychotropes ont été élaborées par l'Afssaps, l'ANAES (actuellement HAS) et des conférences de consensus organisées par des associations professionnelles. Ces recommandations sont en adéquation avec celles diffusées à l'échelon international, et sont généralement claires et aisément applicables dans la pratique clinique. Elles permettraient, si elles étaient appliquées, d'optimiser les prescriptions de psychotropes, en réduisant le nombre de prescriptions inappropriées, en particulier au niveau des durées de traitement. Le problème majeur réside en effet dans le fait que ces recommandations sont insuffisamment respectées par les prescripteurs. Tout au moins, ce constat est suggéré par les résultats de l'ensemble des études pharmaco-épidémiologiques conduites en France, puisque comme nous le reverrons dans la réponse à la question 4, on ne dispose pas, à de rares exceptions près, d'études ayant évalué l'impact de ces recommandations sur les pratiques. 1. Alonso J, Angermeyer MC, Bernert S, Bruffaerts R, Brugha TS, Bryson H, et al. Sampling and methods of the European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) project. Acta Psychiatr Scand Suppl 2004:8-20. 2. Lepine JP, Gasquet I, Kovess V, Arbabzadeh-Bouchez S, Negre-Pages L, Nachbaur G, et al. [Prevalence and comorbidity of psychiatric disorders in the French general population]. Encephale 2005;31:182-94. 3. Alonso J, Angermeyer MC, Bernert S, Bruffaerts R, Brugha TS, Bryson H, et al. Prevalence of mental disorders in Europe: results from the European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) project. Acta Psychiatr Scand Suppl 2004:21-7. 4. Kovess V, Brugha T, Carta MG, Lehtinen V. The state of mental health in the European Union. European Community, 2004:79. 5. Demyttenaere K, Bruffaerts R, Posada-Villa J, Gasquet I, Kovess V, Lepine JP, et al. Prevalence, severity, and unmet need for treatment of mental disorders in the World Health Organization World Mental Health Surveys. JAMA 2004;291:2581-90. 6. Bellamy V, Roelandt J, Caria A. Troubles mentaux et représentations de la santé mentale: premiers résultats de l'enquête Santé Mentale en Population Générale. Etudes et Résultats, DREES 2004;n°347:1-12. 7. Ritchie K, Artero S, Beluche I, Ancelin ML, Mann A, Dupuy AM, et al. Prevalence of DSM-IV psychiatric disorder in the French elderly population. Br J Psychiatry 2004;184:147-52. 8. Expertise Collective INSERM. Données épidémiologiques. Troubles mentaux : dépistage et prévention chez l'enfant. In: INSERM, 2002. 9. Alonso J, Angermeyer MC, Bernert S, Bruffaerts R, Brugha TS, Bryson H, et al. Psychotropic drug utilization in Europe: results from the European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) project. Acta Psychiatr Scand Suppl 2004:55-64. 10. Gasquet I, Negre-Pages L, Fourrier A, Nachbaur G, El-Hasnaoui A, Kovess V, et al. [Psychotropic drug use and mental psychiatric disorders in France; results of the general population ESEMeD/MHEDEA 2000 epidemiological study]. Encephale 2005;31:195-206. 11. Le Pape A, Lecomte T. Prévalence et prise en charge médicale de la dépression en 1996-1997. Questions d'économie de la santé, CREDES 1999;n°21:1-6. 12. Lagnaoui R, Depont F, Fourrier A, Abouelfath A, Begaud B, Verdoux H, et al. Patterns and correlates of benzodiazepine use in the French general population. Eur J Clin Pharmacol 2004;60:523-9. 13. Ohayon MM, Lader MH. Use of psychotropic medication in the general population of France, Germany, Italy, and the United Kingdom. J Clin Psychiatry 2002;63:817-25. 14. Ohayon M, Caulet M, Lemoine P. [The elderly, sleep habits and use of psychotropic drugs by the French population]. Encephale 1996;22:337-50. 15. Kuhn F, Pedailles S, Pull MT, Guyon FX, Thielly P. Adéquation à l'autorisation de mise sur le marché des instaurations de traitement par inhibiteurs spécifiques de la recapture de sérotonine. Revue Médicale de l'Assurance Maladie 2006;37:1-7. 16. Healy D, Langmaak C, Savage M. Suicide in the course of the treatment of depression. J Psychopharmacol 1999;13:94-9. 17. Teicher MH, Glod C, Cole JO. Emergence of intense suicidal preoccupation during fluoxetine treatment. Am J Psychiatry 1990;147:207-10. 18. Beasley CM, Jr., Dornseif BE, Bosomworth JC, Sayler ME, Rampey AH, Jr., Heiligenstein JH, et al. Fluoxetine and suicide: a meta-analysis of controlled trials of treatment for depression. BMJ 1991;303:685-92. 19. The American College of Neuropsychopharmacology. Preliminary report of the task force on SSRIs and suicidal behavior in youth, 2004. 20. Food and Drug Administration. Antidepressant use in children, adolescents, and adults. http://www.fda.gov/cder/drug/antidepressants/default.htm ed.: FDA Website. 21. Khan A, Warner HA, Brown WA. Symptom reduction and suicide risk in patients treated with placebo in antidepressant clinical trials: an analysis of the Food and Drug Administration database. Arch Gen Psychiatry 2000;57:311-7. 22. Storosum JG, van Zwieten BJ, van den Brink W, Gersons BP, Broekmans AW. Suicide risk in placebo-controlled studies of major depression. Am J Psychiatry 2001;158:1271-5. 23. Hammad TA, Mosholder A, Boehm G, Racoosin JA, Laughren T. Incidence of suicide in randomized controlled trials of patients with major depressive disorder. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2003;12:S156. 24. Hammad TA, Laughren T, Racoosin J. Suicidality in pediatric patients treated with antidepressant drugs. Arch Gen Psychiatry 2006;63:332-39. 25. Wernicke JF, Sayler ME, Koke SC, Pearson DK, Tollefson GD. Fluoxetine and concomitant centrally acting medication use during clinical trials of depression: the absence of an effect related to agitation and suicidal behavior. Depress Anxiety 1997;6:31-9. 26. Fergusson D, Doucette S, Glass K. Association between suicide attempts and selective serotonin reuptake inhibitors: systematic review of randomized controlled trials. BMJ 2005;330. 27. Szanto K, Mulsant BH, Houck P, Dew MA, Reynolds CF, 3rd. Occurrence and course of suicidality during short-term treatment of late-life depression. Arch Gen Psychiatry 2003;60:610-7. 28. Khan A, Khan S, Kolts R, Brown WA. Suicide rates in clinical trials of SSRIs, other antidepressants, and placebo: analysis of FDA reports. Am J Psychiatry 2003;160:790-2. 29. Gunnell D, Saperia J, Ashby D. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and suicide in adults: meta-analysis of drug company data from placebo controlled, randomised controlled trials submitted to the MHRA's safety review. BMJ 2005;330:385. 30. Zimmerman M, Mattia JI, Posternak MA. Are subjects in pharmacological treatment trials of depression representative of patients in routine clinical practice? Am J Psychiatry 2002;159:469-73. 31. Zimmerman M, Chelminski I, Posternak MA. Generalizability of antidepressant efficacy trials: differences between depressed psychiatric outpatients who would or would not qualify for an efficacy trial. Am J Psychiatry 2005;162:1370-72. 32. Gunnell D, Ashby D. Antidepressants and suicide: what is the balance of benefit and harm. BMJ 2004;329:34-38. 33. Wong ICK, Besag FMS, Santosh PF, et al. Use of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors in Children and Adolescents. Drug Saf 2004;27:991-1000. 34. Klein DF. The flawed basis for FDA post-marketing safety decisions: the example of anti-depressants and children. Neuropsychopharmacology 2006;31:689-99. 35. Leon AC, Keller MB, Warshaw MG, Mueller TI, Solomon DA, Coryell W, et al. Prospective study of fluoxetine treatment and suicidal behavior in affectively ill subjects. Am J Psychiatry 1999;156:195-201. 36. Yerevanian BI, Koek RJ, Feusner JD, Hwang S, Mintz J. Antidepressants and suicidal behaviour in unipolar depression. Acta Psychiatr Scand 2004;110:452-8. 37. Jick H, Kaye JA, Jick SS. Antidepressants and the risk of suicidal behaviors. JAMA 2004;292:338-43. 38. Martinez C, Rietbrock S, Wise L, Ashby D, Chick J, Moseley J, et al. Antidepressant treatment and the risk of fatal and non-fatal self harm in first episode depression: nested case-control study. BMJ 2005;330:389. 39. Mines D, Hill D, Yu H, Novelli L. Prevalence of risk factors for suicide in patients prescribed venlafaxine, fluoxetine, and citalopram. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2005;14:367-72. 40. Didham RC, McConnell DW, Blair HJ, Reith DM. Suicide and self-harm following prescription of SSRIs and other antidepressants: confounding by indication. Br J Clin Pharmacol 2005;60:519-25. 41. Simon GE, Savarino J, Operskalski B, Wang PS. Suicide risk during antidepressant treatment. Am J Psychiatry 2006;163:41-47. 42. Barak Y, Olmer A, Aizenberg D. Antidepressants reduce the risk of suicide among elderly depressed patients. Neuropsychopharmacology 2006;31:178-81. 43. Juurlink DN, Muhammad MM, Kopp A, Redelmeier DA. The risk of suicide with selective serotonin reuptake inhibitors in the elderly. Am J Psychiatry 2006;163:813-21. 44. Isacsson G, Holmgren P, Wasserman D, Bergman U. Use of antidepressants among people committing suicide in Sweden. BMJ 1994;308:506-9. 45. Isacsson G, Holmgren P, Druid H, Bergman U. The utilization of antidepressants--a key issue in the prevention of suicide: an analysis of 5281 suicides in Sweden during the period 1992-1994. Acta Psychiatr Scand 1997;96:94-100. 46. Andersen UA, Andersen M, Rosholm JU, Gram LF. Psychopharmacological treatment and psychiatric morbidity in 390 cases of suicide with special focus on affective disorders. Acta Psychiatr Scand 2001;104:458-65. 47. Henriksson S, Boethius G, Isacsson G. Suicides are seldom prescribed antidepressants: findings from a prospective prescription database in Jamtland county, Sweden, 1985-95. Acta Psychiatr Scand 2001;103:301-6. 48. Marzuk PM, Nock MK, Leon AC, Portera L, Tardiff K. Suicide among New York City police officers, 1977-1996. Am J Psychiatry 2002;159:2069-71. 49. Kelly CB, Ansari T, Rafferty T, Stevenson M. Antidepressant prescribing and suicide rate in Northern Ireland. Eur Psychiatry 2003;18:325-8. 50. Isacsson G, Holmgren P, Ahlner J. Selective serotonin reuptake inhibitor antidepressants and the risk of suicide: a controlled forensic database study of 14,857 suicides. Acta Psychiatr Scand 2005;111:286-90. 51. Isacsson G, Bergman U, Rich CL. Epidemiological data suggest antidepressants reduce suicide risk among depressives. J Affect Disord 1996;41:1-8. 52. Hampton T. Suicide caution stamped on antidepressants. JAMA 2004;291:2060-1. 53. Cheeta S, Schifano F, Oyefeso A, Webb L, Ghodse AH. Antidepressant-related deaths and antidepressant prescriptions in England and Wales, 1998-2000. Br J Psychiatry 2004;184:41-7. 54. Hall WD, Mant A, Mitchell PB, Rendle VA, Hickie IB, McManus P. Association between antidepressant prescribing and suicide in Australia, 1991-2000: trend analysis. BMJ 2003;326:1008. 55. Rihmer Z, Belso N, Kalmar S. Antidepressants and suicide prevention in Hungary. Acta Psychiatr Scand 2001;103:238-9. 56. Ohberg A, Vuori E, Klaukka T, Lonnqvist J. Antidepressants and suicide mortality. J Affect Disord 1998;50:225-33. 57. Grunebaum MF, Ellis SP, Li S, Oquendo MA, Mann JJ. Antidepressants and suicide risk in the United States, 1985-1999. J Clin Psychiatry 2004;65:1456-62. 58. Gibbons RD, Hur K, Bhaumik DK, Mann JJ. The relationship between antidepressant medication use and rate of suicide. Arch Gen Psychiatry 2005;62:165-72. 59. Couzin J. Volatile chemistry: children and antidepressants. Science 2004;305:468-70. 60. Jureidini JN, Doecke CJ, Mansfield PR, Haby MM, Menkes DB, Tonkin AL. Efficacy and safety of antidepressants for children and adolescents. BMJ 2004;328:879-83. 61. March J, Silva S, Petrycki S, Curry J, Wells K, Fairbank J, et al. Fluoxetine, cognitive-behavioral therapy, and their combination for adolescents with depression: Treatment for Adolescents With Depression Study (TADS) randomized controlled trial. JAMA 2004;292:807-20. 62. Vitiello B, Swedo S. Antidepressant medications in children. N Engl J Med 2004;350:1489-91. 63. Zametkin AJ, Alter MR, Yemini T. Suicide in teenagers: assessment, management, and prevention. JAMA 2001;286:3120-5. 64. King RA. Emergence of self-destructive phenomena in children and adolescents during fluoxetine treatment. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1991;30:179-86. 65. Cheung AH, Emslie GJ, Mayes TL. The use of antidepressants to treat depression in children and adolescents. CMAJ 2006;174:193-200. 66. Check E. Analysis highlights suicide risk of antidepressants. Nature 2004;430:954. 67. Cheung AH, Emslie GJ, Mayes TL. Review of the efficacy and safety of antidepressants in youth depression. J Child Psychol Psychiatry 2005;46:735-54. 68. Bridge JA, Barbe RP, Birmaher B, Kolko DJ, Brent DA. Emergent suicidality in a clinical psychotherapy trial for adolescent depression. Am J Psychiatry 2005;162:2173-5. 69. Sondergard L, Kvist K, Andersen PK, Kessing LV. Do antidepressants precipitate youth suicide ? A nationwide pharmacoepidemiological study. Eur Child Adolesc Psychiatry 2006. 70. Valuck RJ. Antidepressant treatment and risk of suicide attempt by adolescents with major depressive disorder: A propensity-adjusted retrospective cohort study. CNS Drugs 2004;18. 71. Leon AC, Marzuk PM, Tardiff K. Paroxetine, other antidepressants, and youth suicide in New York City: 1993 through 1998. J Clin Psychiatry 2004;65:915-18. 72. American College of Neuropsychopharmacology. Preliminary report of the ask faorce on SSRIs and suicidal behavior in youth, 2004. 73. Olfson M, Shaffer D, Marcus SC, Greenberg T. Relationship between antidepressant medication treatment and suicide in adolescents. Arch Gen Psychiatry 2003;60:978-82. 74. Brent DA. Antidepressants and pediatric depression--the risk of doing nothing. N Engl J Med 2004;351:1598-601. 75. McClure GM. Suicide in children and adolescents in England and Wales 1970-1998. Br J Psychiatry 2001;178:469-74. 76. Hawton K, Rodham K, Evans E, Weatherall R. Deliberate self harm in adolescents: self report survey in schools in England. BMJ 2002;325:1207-11. 77. Berk M, Dodd S. Are treatment emergent suicidality and decreased response to antidepressants in younger patients due to bipolar disorder being misdiagnosed as unipolar depression ? Med Hypotheses 2005;65:39-43. 78. Rey JM, Dudley MJ. Depressed youth, suicidality and antidepressants. MJA 2005;182:378-79. 79. Baldessarini RJ, Pompili M, Tondo L. Suicidal risk in antidepressant drug trials. Arch Gen Psychiatry 2006;63:246-48. 80. Faedda GL, Baldessarini RJ, Glovinsky IP, Austin NB. Treatment-emergent mania in pediatric bipolar disorder: a retrospective case review. J Affect Disord 2004;82:149-58. 81. Akiskal HS, Benazzi F, Perugi G, Rihmer Z. Agitated "unipolar" depression re-conceptualized as a depressive mixed state: implications for the antidepressant-suicide controversy. J Affect Disord 2005;85:245-58. 82. Lagnaoui R, Begaud B, Moore N, Chaslerie A, Fourrier A, Letenneur L, et al. Benzodiazepine use and risk of dementia: a nested case-control study. J Clin Epidemiol 2002;55:314-8. 83. Oquendo MA, Kamali M, Ellis SP, Grunebaum MF, Malone KM, Brodsky BS, et al. Adequacy of antidepressant treatment after discharge and the occurrence of suicidal acts in major depression: a prospective study. Am J Psychiatry 2002;159:1746-51. 84. Kairuz T, Truter I, Hugo J, C. F. Prescribing patterns of tricyclic and selective serotonin reuptake inhibitor antidepressants among a sample of adolescents and young adults. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2003;12:379-82. 85. Pomerantz J, Finkelstein SN, Berndt ER. Prescriber intent, off-label usage, and early discontinuation of antidepressants: a retrospective physician survey and data analysis. J Clin Psychiatry 2004;65:395-404. 86. Leeder JS. Translating pharmacogenetics and pharmacogenomics into drug development for clinical pediatrics and beyond. Drug Discov Today 2004;9:567-73. 87. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders (DSM IV). Fourth edition. ed. Washington, DC . 1994. 88. Moride Y, Abenhaim L. The depletion of susceptibles effect in non-experimental pharmaco-epidemiologic research. J Clin Epidemiol 1994;47:731-37. 89. Bostic JQ, Rubin DH, Prince J, Schlozman S. Treatment of depression in children and adolescents. J Psychiatr Pract 2005;11:141-54. 90. Ebmeier KP, Donaghey C, Steele JD. Recent developments and current controversies in depression. Lancet 2006;367:153-67. 91. TreeAgePro by Tree Age software, inc.: Release 1.0 [program], 2005. 92. Cheng ATA, Chen THH, Chen C-C, Jenkins R. Psychosocial and psychiatric risk factors for suicide. Br J Psychiatry 2000;177:360-65. 93. La prévention du suicide des jeunes. Conférence européenne. Cité des Congrès de Nantes - 19 et 20 septembre 2000. . www.sante.gouv.fr/presidence/ fr/actu/septembre/suicide.pdf 2000. 94. Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La violence dirigée contre soi-même. www.who.int/violence_injury_prevention/ violence/world_report/en/chap7fr.pdf, 2002. 95. Institut National de la Santé et des Etudes Economiques (INSEE). La France en faits et chiffres. Recensement 1999 de la population française.: http://www.insee.fr, 1999. 96. SC8 INSERM. Service d'information sur les causes médicales de décès. sc8.vesinet.inserm.fr:1080/interrogation_fr.html, 1999. 97. Lecadet J, Vidal P, Baris B, Vallier N, Fender P, Allemand H, et al. Médicaments psychotropes : consommation et pratiques de prescription en France métropolitaine. I. Données nationales, 2000. Revue Médicale de l'Assurance Maladie 2003;34:75-84. 98. Cadet-Taïrou A, Canarelli T. Consommation des médicaments psychotropes, état des lieux. OFDT, A paraître (2006). 99. Dieleman R, Grenez O, Cornely H, Mercier-Guyon C, Charlier C, Verstraete A, et al. Médicaments et sécurité routière. Actes de la journée d'étude Service Promotion Santé de l'Union Nationale des Mutalités Socialistes et de l'association sans but lucratif Drive Mut en collaboration avec l'institut Belge pour la Sécurité Routière, 1999. 100. Marquet P, Gaulier JM, Merle L. Les médicaments anxiolytiques, hypnotiques et antidépresseurs. In: Elsevier. Alcool, médicaments, stupéfiants et conduite automobile. Paris: Elsevier, 1999:21-58. 101. Merlin G, Lepoittevin L, Turcant A, Mylonas J, Cavellat JF. [Responsibility of psychotropic drugs in road accidents]. Presse Med 1991;20:409-12. 102. Benzodiazepines/Driving Collaborative Group. Are benzodiazepines a risk factor for road accidents? 'Benzodiazepine/Driving' Collaborative Group. Drug Alcohol Depend 1993;33:19-22. 103. Arditti J, Bourdon JH, David JM, Lanze L, Thirion X, Jouglard J. [Benzodiazepine levels in drivers involved in traffic accidents]. Presse Med 1993;22:765-66. 104. Barbone F, McMahon AD, Davey PG, Morris AD, Reid IC, McDevitt DG, et al. Association of road-traffic accidents with benzodiazepine use. Lancet 1998;352:1331-36. 105. Mura P, Kintz P, Ludes B, Gaulier JM, Marquet P, Martin-Dupont S, et al. Comparison of the prevalence of alcohol, cannabis and other drugs between 900 injured drivers and 900 control subjects: results of a French collaborative study. Forensic Sci Int 2003;133:79-85. 106. International Council on Alcohol Drugs and Traffic Safety. Prescribing and dispensing guidelines for medicinal drugs affecting driving performance. ICADTS 2001:32. 107. Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps). Mise au point. Médicaments et conduite automobile. Afssaps, 2005:22. 108. Département de Pharmacologie du CHU de Bordeaux. Médicaments et conduite automobile. Bulletin d'information du Département de Pharmacologie du CHU de Bordeaux 2005;81. 109. Pierfitte C, Macouillard G, Thicoipe M, Chaslerie A, Pehourcq F, Aissou M, et al. Benzodiazepines and hip fractures in elderly people: case-control study. BMJ 2001;322:704-8. 110. Souchet E, Lapeyre-Mestre M, Montastruc JL. Drug related falls: a study in the French Pharmacovigilance database. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2005;14:11-6. 111. Leipzig RM, Cumming RG, Tinetti ME. Drugs and falls in older people: a systematic review and meta-analysis: I. Psychotropic drugs. J Am Geriatr Soc 1999;47:30-9. 112. Blain H, Blain A, Trechot P, Jeandel C. [The role of drugs in falls in the elderly. Epidemiologic aspects]. Presse Med 2000;29:673-80. 113. Wysowski DK, Baum C, Ferguson WJ, Lundin F, Ng MJ, Hammerstrom T. Sedative-hypnotic drugs and the risk of hip fracture. J Clin Epidemiol 1996;49:111-3. 114. Luukinen H, Koski K, Laippala P, Kivela SL. Predictors for recurrent falls among the home-dwelling elderly. Scand J Prim Health Care 1995;13:294-9. 115. Luukinen H, Koski K, Laippala P, Kivela SL. Risk factors for recurrent falls in the elderly in long-term institutional care. Public Health 1995;109:57-65. 116. Yip YB, Cumming RG. The association between medications and falls in Australian nursing-home residents. Med J Aust 1994;160:14-8. 117. Gales BJ, Menard SM. Relationship between the administration of selected medications and falls in hospitalized elderly patients. Ann Pharmacother 1995;29:354-8. 118. Cumming RG, Klineberg RJ. Psychotropics, thiazide diuretics and hip fractures in the elderly. Med J Aust 1993;158:414-7. 119. Herings RM, Stricker BH, de Boer A, Bakker A, Sturmans F. Benzodiazepines and the risk of falling leading to femur fractures. Dosage more important than elimination half-life. Arch Intern Med 1995;155:1801-7. 120. Neutel CI, Hirdes JP, Maxwell CJ, Patten SB. New evidence on benzodiazepine use and falls: the time factor. Age Ageing 1996;25:273-8. 121. Sheahan SL, Coons SJ, Robbins CA, Martin SS, Hendricks J, Latimer M. Psychoactive medication, alcohol use, and falls among older adults. J Behav Med 1995;18:127-40. 122. Prudham D, Evans JG. Factors associated with falls in the elderly: a community study. Age Ageing 1981;10:141-6. 123. Blake AJ, Morgan K, Bendall MJ, Dallosso H, Ebrahim SB, Arie TH, et al. Falls by elderly people at home: prevalence and associated factors. Age Ageing 1988;17:365-72. 124. Svensson ML, Rundgren A, Landahl S. Falls in 84- to 85-year-old people living at home. Accid Anal Prev 1992;24:527-37. 125. Lord SR, Sambrook PN, Gilbert C, Kelly PJ, Nguyen T, Webster IW, et al. Postural stability, falls and fractures in the elderly: results from the Dubbo Osteoporosis Epidemiology Study. Med J Aust 1994;160:684-5, 88-91. 126. Cumming RG, Miller JP, Kelsey JL, Davis P, Arfken CL, Birge SJ, et al. Medications and multiple falls in elderly people: the St Louis OASIS study. Age Ageing 1991;20:455-61. 127. Wickham C, Cooper C, Margetts BM, Barker DJ. Muscle strength, activity, housing and the risk of falls in elderly people. Age Ageing 1989;18:47-51. 128. Maki BE, Holliday PJ, Topper AK. A prospective study of postural balance and risk of falling in an ambulatory and independent elderly population. J Gerontol 1994;49:M72-84. 129. Tinetti ME, Speechley M, Ginter SF. Risk factors for falls among elderly persons living in the community. N Engl J Med 1988;319:1701-7. 130. Nevitt MC, Cummings SR, Kidd S, Black D. Risk factors for recurrent nonsyncopal falls. A prospective study. JAMA 1989;261:2663-8. 131. Campbell AJ, Borrie MJ, Spears GF. Risk factors for falls in a community-based prospective study of people 70 years and older. J Gerontol 1989;44:M112-7. 132. O'Loughlin JL, Robitaille Y, Boivin JF, Suissa S. Incidence of and risk factors for falls and injurious falls among the community-dwelling elderly. Am J Epidemiol 1993;137:342-54. 133. Weiner DK, Hanlon JT, Studenski SA. Effects of central nervous system polypharmacy on falls liability in community-dwelling elderly. Gerontology 1998;44:217-21. 134. Mustard CA, Mayer T. Case-control study of exposure to medication and the risk of injurious falls requiring hospitalization among nursing home residents. Am J Epidemiol 1997;145:738-45. 135. Shorr RI, Griffin MR, Daugherty JR, Ray WA. Opioid analgesics and the risk of hip fracture in the elderly: codeine and propoxyphene. J Gerontol 1992;47:M111-5. 136. Perry BC. Falls among the elderly living in high-rise apartments. J Fam Pract 1982;14:1069-73. 137. Hale WA, Delaney MJ, McGaghie WC. Characteristics and predictors of falls in elderly patients. J Fam Pract 1992;34:577-81. 138. Studenski S, Duncan PW, Chandler J, Samsa G, Prescott B, Hogue C, et al. Predicting falls: the role of mobility and nonphysical factors. J Am Geriatr Soc 1994;42:297-302. 139. Maxwell CJ, Neutel CI, Hirdes JP. A prospective study of falls after benzodiazepine use: a comparison of new and repeat use. Pharmacoepidemiol Drug Saf 1997;6:27-35. 140. Koski K, Luukinen H, Laippala P, Kivela SL. Risk factors for major injurious falls among the home-dwelling elderly by functional abilities. A prospective population-based study. Gerontology 1998;44:232-8. 141. Evans JG. Drugs and falls in later life. Lancet 2003;361:448. 142. Curran HV. Benzodiazepines, memory and mood: a review. Psychopharmacology (Berl) 1991;105:1-8. 143. Barker MJ, Greenwood KM, Jackson M, Crowe SF. Cognitive effects of long-term benzodiazepine use: a meta-analysis. CNS Drugs 2004;18:37-48. 144. Barker MJ, Greenwood KM, Jackson M, Crowe SF. An evaluation of persisting cognitive effects after withdrawal from long-term benzodiazepine use. J Int Neuropsychol Soc 2005;11:281-9. 145. Verdoux H, Lagnaoui R, Begaud B. Is benzodiazepine use a risk factor for cognitive decline and dementia? A literature review of epidemiological studies. Psychol Med 2005;35:307-15. 146. Allard J, Artero S, Ritchie K. Consumption of psychotropic medication in the elderly: a re-evaluation of its effect on cognitive performance. Int J Geriatr Psychiatry 2003;18:874-8. 147. Hanlon JT, Horner RD, Schmader KE, Fillenbaum GG, Lewis IK, Wall WE, Jr., et al. Benzodiazepine use and cognitive function among community-dwelling elderly. Clin Pharmacol Ther 1998;64:684-92. 148. Fastbom J, Forsell Y, Winblad B. Benzodiazepines may have protective effects against Alzheimer disease. Alzheimer Dis Assoc Disord 1998;12:14-7. 149. Dealberto MJ, McAvay GJ, Seeman T, Berkman L. Psychotropic drug use and cognitive decline among older men and women. Int J Geriatr Psychiatry 1997;12:567-74. 150. Paterniti S, Dufouil C, Alperovitch A. Long-term benzodiazepine use and cognitive decline in the elderly: the Epidemiology of Vascular Aging Study. J Clin Psychopharmacol 2002;22:285-93. 151. Agence Nationale Accréditation et Evaluation en Santé (ANAES). Prescription des hypnotiques et anxiolytiques. Recommandations et Références Médicales, 1995. 152. Agence Nationale Accréditation et Evaluation en Santé (ANAES). Recommandations et références médicales. Médicaments antidépresseurs. Concours Medical 1996. 153. Agence Nationale Accréditation et Evaluation en Santé (ANAES). Prise en charge d'un épisode dépressif isolé de l'adulte en ambulatoire. Service des recommandations et références professionnelles, 2002. 154. Agence Nationale Accréditation et Evaluation en Santé (ANAES). Prise en charge par le médecin généraliste en ambulatoire d'un épisode dépressif isolé de l'adulte. Rapport d'élaboration de référentiel d'évaluation des pratiques professionnelles, 2004. 155. Agence Nationale Accréditation et Evaluation en Santé (ANAES). Prise en charge par le psychiatre d'un épisode dépressif isolé de l'adulte en ambulatoire. Rapport d'élaboration de référentiel d'évaluation des pratiques professionnelles, 2004. 156. Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps). Mise au point. Le bon usage des antidépresseurs au cours de la dépression chez l'enfant et l'adolescent.: Afssaps, 2006:10. 157. Glikman J, Pazart L, Casadebaig F, Philippe A, Lachaux B, Kovess V, et al. Assessing the impact of a consensus conference on long-term therapy for schizophrenia. Int J Technol Assess Health Care 2000;16:251-9. 158. Lachaux B, Casadebaig F, Philippe A, Ardiet G. [Pharmaco-epidemiology of antipsychotic prescription practices for schizophrenic patients (1995 and 1998 cross sectional surveys)]. Encephale 2004;30:46-51. 159. Schizophrénies débutantes. Diagnostic et Modalités Thérapeutiques. Conférence de consensus. Montrouge: John Libbey Eurotext, 2003. 160. Grolleau A, Cougnard A, Parrot M, Kalmi E, Desage A, Misdrahi D, et al. Pratiques de prescription des traitements antipsychotiques dans les premieres hospitalisations pour épisode psychotique : étude sur une cohorte de patients hospitalisés dans deux hôpitaux girondins. Encephale 2006;sous presse. 161. Glass J, Lanctot KL, Herrmann N, Sproule BA, Busto UE. Sedative hypnotics in older people with insomnia: meta-analysis of risks and benefits. BMJ 2005;331:1169. 162. Moynihan R, Heath I, Henry D, Gøtzsche P. Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mongering. BMJ 2002;324:886-91. 163. Medawar C, Hardon A. Medicines out of control ? Antidepressants and the conspiracy of Goodwill: Aksant Academic Publisher, 2004. 164. Blech J. Les inventeurs de maladie. Manoeuvres et manipulations de l'industrie pharmaceutique. Arles: Actes Sud, 2005. 165. Shorter E, Tyrer P. Separation of anxiety and depressive disorders: blind alley in psychopharmacology and classification of disease. BMJ 2003;327:158-60. 166. Rey JM, Sawyer MG. Are psychostimulant drugs being used appropriately to treat child and adolescent disorders? Br J Psychiatry 2003;182:284-6. 167. Verdoux H, Cougnard A. The early detection and treatment controversy in schizophrenia research. Curr Opin Psychiatry 2003;16:175-79. 168. Groupe Technique National de Définition des Objectifs de santé publique. Analyse des connaissances disponibles sur des problèmes de santé sélectionnés, leurs déterminants, et les stratégies de santé publique. Définition d'objectifs.: Direction Générale de la Santé en collaboration avec l'INSERM, 2003. V.- QUESTION 4 : « QUELLE EST L'EFFICACITÉ DES ACTIONS ENGAGÉES PAR LES POUVOIRS PUBLICS ET L'ASSURANCE MALADIE AFIN DE LUTTER CONTRE LES PRESCRIPTIONS INADAPTÉES » ? Analyser la répartition des responsabilités entre les caisses nationales et locales d'assurance maladie, le ministère de la santé, la Haute autorité de santé (HAS), les unions régionales de médecins exerçant à titre libéral (URML), la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies (MILDT), etc. Evaluer l'efficacité des actions entreprises au cours de ces dernières années en matière de maîtrise médicalisée de la consommation de médicaments psychotropes, et en particulier l'impact de la réforme de l'assurance maladie par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, des dispositions prévues par la convention médicale signée le 12 janvier 2005 et des moyens mis en oeuvre par l'assurance maladie afin d'atteindre les objectifs fixés par la convention en matière de réduction des prescriptions d'anxiolytiques et d'hypnotiques en 2005. Evaluer également l'action de la HAS en matière d'élaboration et de diffusion des recommandations de bonne pratique. Présenter et évaluer les principales mesures du « plan pour la psychiatrie et la santé mentale 2005-2008 », annoncé par le ministre des solidarités, de la santé et de la famille en février 2005, et dresser un premier bilan de sa mise en oeuvre, s'agissant notamment de ses modalités de financement. Intégrer des propositions d'amélioration ainsi que des éléments de comparaison européenne. A. RECENSEMENT DE L'ENSEMBLE DES ACTIONS ENTREPRISES EN MATIÈRE DE MAÎTRISE MÉDICALISÉE DE LA CONSOMMATION DE PSYCHOTROPES Un courrier sur papier à en-tête de l'Assemblée Nationale et co-signé par Madame la Députée Maryvonne Briot a été adressé en janvier 2006 aux directeurs de la CNAM-TS et des institutions publiques (Afssaps, HAS, DGS, MILDT, INPES), afin de leur demander de fournir aux membres du comité scientifique des informations sur les actions entreprises, et sur l'évaluation de l'impact de ces actions (Annexe 7). Une demande similaire a été faite à la CANAM par l'intermédiaire de GR Auleley. A la date de remise du rapport, la DGS, l'Afssaps et la CANAM ont répondu à cette demande. Nous avons déjà mentionné la réponse de la CNAM-TS (Annexe 4), qui portait sur l'accès aux données sur l'usage des psychotropes, mais ne répondait pas à la question posée dans le courrier adressé en janvier sur les actions entreprises et leur évaluation. 1. Caisses d'assurance maladie a) RMO (Références Médicales Opposables) Les RMO sont apparues dans la convention nationale des médecins de 1993, et sont entrées en vigueur à partir de mars 2004. Celles portant sur les psychotropes ont été détaillées dans la question 3. Pour mémoire, les dispositifs de sanction des RMO contenus dans la convention des médecins généralistes de 1998 ont été annulés en 1999 par décision du Conseil d'Etat. Avant même cette annulation, il s'était avéré que le contrôle du respect des RMO « s'est heurté à de nombreux obstacles » (Rapport annuel au parlement sur la sécurité sociale, septembre 1997). Toutes RMO confondues, la proportion des médecins examinés ayant fait l'objet de sanctions financières sans sursis s'est avérée très faible (0,59 % d'octobre 1994 à décembre 1996). Une étude réalisée par le CREDES a évalué, à partir des données de vente collectées par la société IMS, l'impact de dix RMO, dont deux portant sur les psychotropes (anxiolytiques et hypnotiques; neuroleptiques)1. L'introduction des RMO a entraîné dans l'année qui a suivi une baisse de l'ordre de 264 à 311 millions de francs, en grande majorité due à l'application de la RMO sur les antibiotiques (232 millions de francs). La référence sur la double prescription des benzodiazépines a été peu appliquée (baisse de 13 % des double prescriptions), avec une économie de 19 millions de francs. Les auteurs de cette étude citent la mauvaise application de cette RMO en exemple de « comportements difficiles à modifier ». b) Rapport de la Cour des Comptes « La Sécurité Sociale 2005 » Le rapport de la Cour des comptes2 ne concerne pas spécifiquement les médicaments psychotropes, mais répond plus généralement à la question posée concernant l'évaluation de l'impact des actions entreprises par la CNAM-TS pour permettre une maîtrise médicalisée des prescriptions. Ce rapport souligne le fait que "la connaissance des comportements est insuffisante", que si les disparités régionales (entre autre en matière de prescription des psychotropes) sont bien décrites, "leurs explications sont moins satisfaisantes en raison notamment des limites méthodologiques qui affectent les études disponibles. En effet, les disparités de densité géographique médicale ou les différences de densité et de structures hospitalières qui peuvent expliquer certaines différences de comportement ne sont pas prises en compte. Il en est de même pour la durée de travail des médecins. Des investigations complémentaires sont donc indispensables". Ces conclusions sur l'insuffisance de données pharmaco-épidémiologiques issues d'études reposant sur une méthodologie rigoureuse rejoignent ainsi ce que nous avions mentionné en synthèse de la réponse à la question 1. Concernant le contrôle des professionnels de santé, la Cour des Comptes souligne que "la mise en oeuvre des sanctions reste velléitaire", incluant celles destinées à lutter contre les prescriptions d'un médicament ne respectant pas les référentiels de bonne pratique. La Cour des Comptes souligne également l'intérêt de développer l'éducation thérapeutique concernant les maladies chroniques (en citant l'exemple des campagnes nationales mises en place par les caisses d'assurance maladie concernant le diabète et l'hypertension artérielle) et les campagnes grand public (telle que celle "Les antibiotiques, c'est pas automatique"). Aucune campagne de ce type n'a été menée par les caisses d'assurance maladie sur les pathologies psychiatriques ou les médicaments psychotropes. Une convention médicale a été signée le 12 janvier 2005 entre, d'une part, l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie (UNCAM) et, d'autre part, le syndicat des médecins libéraux, la confédération des syndicats médicaux français et l'alliance intersyndicale des médecins indépendants de France3. Cette convention prévoit le développement d'une maîtrise médicalisée de l'évolution des dépenses avec les objectifs suivants : « Etendre le champ des recommandations de bonne pratique à l'ensemble des soins faisant l'objet d'une prise en charge collective. A cet effet, les parties conviennent d'établir chaque année une liste d'activités médicales à soumettre à la Haute Autorité de Santé en vue de l'établissement de références médicales opérationnelles. Développer l'information des praticiens et des patients sur les règles de prise en charge collective, dès lors qu'elles touchent au taux de remboursement de certaines prestations ou à la fréquence de réalisation de certains actes. Parvenir à une inflexion significative des dépenses de remboursement de certains produits de santé dès lors que, en comparaison avec des pays comparables au plan sanitaire, les évolutions constatées apparaissent manifestement sans rapport avec des besoins de santé ». Pour l'année 2005, un des 5 thèmes retenus sous forme d'engagements de maîtrise médicalisée est « un infléchissement de 10 % des montants tendanciels 2005 de la prescription des anxiolytiques et des hypnotiques (33 millions d'euros d'économies) ». Pour mémoire les autres thèmes sont : un infléchissement de 10 % des montants tendanciels 2005 de la prescription des antibiotiques (91 millions d'euros d'économies); une baisse de 1,6 % des montants tendanciels 2005 de la prescription d'arrêts de travail (150 millions d'euros d'économies); un infléchissement de 12,5 % des montants tendanciels 2005 des remboursements (prise en charge collective) de statines (161 millions d'euros d'économies); un meilleur respect de la réglementation de l'ordonnancier bi-zone et des feuilles de soins permettant une juste attribution des dépenses sans rapport avec une affection de longue durée à hauteur de 5 points (455 millions d'euros d'économies). d) Moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés et évaluation de l'impact des actions La CANAM nous a transmis une réponse détaillée à notre demande d'informations concernant les actions entreprises afin de lutter contre les prescriptions inappropriées et l'évaluation de ces actions. Cette réponse communiquée par GR Auleley le 17 mai 2006 par messagerie électronique est intégrée ici in extenso, même si elle inclut quelques informations redondantes par rapport à celles mentionnées dans les chapitres précédents. "L'UNCAM (Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie), crée par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 pour représenter les caisses d'assurance maladie dans les instances conventionnelles a, à ce titre, signé, pour l'ensemble des régimes d'assurance maladie, une convention nationale avec les médecins généralistes et les médecins spécialistes le 12 janvier 2005. Cette convention prévoit entre autres mesures la maîtrise médicalisée de l'évolution des dépenses de soins avec un engagement sur des objectifs quantifiés et régionalisés. Pour l'année 2005 et, à la suite de la signature d'un avenant le 23 mars 2006, pour les années 2006 et 2007, ces engagements concernent la prescription de prestations et de classes de médicaments, dont les anxiolytiques et les hypnotiques. Pour 2005, le but à atteindre pour la prescription des anxiolytiques et des hypnotiques était un infléchissement de 10 % des montants tendanciels, soit 33 millions d'euros d'économies. Pour 2006 et 2007, le but à atteindre est une diminution de 5 % des montants de prescription des anxiolytiques et des hypnotiques. Pour atteindre ces objectifs, les moyens prévus par la convention sont la mise en place de commissions paritaires conventionnelles, organisées en sections de représentants des syndicaux médicaux signataires de la convention d'une part et de représentants des trois principaux régimes d'assurance maladie, aux niveaux national, régional et local. Concernant la maîtrise médicalisée, ces commissions paritaires ont en particulier pour mission le pilotage et le suivi des réalisations au niveau des régions et des départements (Commission Paritaire Nationale), la coordination de la politique conventionnelle au niveau des régions (Commission Paritaire Régionale), la mise en œuvre et la mise en place opérationnelle de la maîtrise médicalisée au niveau départemental et la définition du contrat local d'objectifs (Commission Paritaire Locale). Ainsi, la Commission Paritaire Locale décide de la communication collective envers les praticiens et les assurés, analyse régulièrement des tableaux de bord de suivi des engagements et décide de toute mesure permettant d'atteindre les objectifs fixés au département, s'appuie sur la formation « médecins » pour toute mesure de caractère médical, décide des modalités d'information des médecins libéraux pour lesquels des écarts sont constatés par rapport aux engagements collectifs. La CANAM (Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes du Régime Social des Indépendants), comme les caisses nationales des deux autres principaux régimes d'assurance maladie suit l'évolution mensuelle globale des prescriptions d'anxiolytiques et d'hypnotiques à travers sa base de données. Elle transmet ces données à l'UNCAM. Concernant les performances individuelles de prescription, l'assurance maladie propose un outil personnalisé permettant à chaque prescripteur de situer son activité et son niveau de prescription par rapport à ses confrères du département sur les principaux thèmes de la convention collective, notamment les prescriptions d'anxiolytiques et d'hypnotiques (« audit feedback »). L'analyse des données de prescriptions de chaque prescripteur ne pouvant être réalisée à partir des seules bases de données du Régime Sociale des Indépendants en raison de la faible représentativité de chaque prescripteur dans cette base de données (les bénéficiaires du Régime Sociale des Indépendants représentent une faible proportion des patients de chaque prescripteur), celle-ci est réalisée à partir des bases de données de la CNAM-TS. Enfin, la convention nationale prévoit la possibilité de procédures contentieuses conduites par le service du contrôle médical de l'assurance maladie pour les médecins dont les pratiques ne respectent pas les dispositions de la convention. Les résultats des actions réalisées dans le cadre de cette convention et mesurant son effet sur les prescriptions des anxiolytiques et des hypnotiques sont rapportés par l'UNCAM. C'est donc l'ensemble des données de remboursement des trois principaux régimes d'assurance maladie, consolidées par l'UNCAM ou, au minimum, les données de remboursement des bénéficiaires de la CNAM-TS (environ 85 % des bénéficiaires de l'assurance maladie en France), qui permettent d'évaluer véritablement l'effet des moyens mis en œuvre par l'assurance maladie dans le cadre de la convention sur l'évolution des pratiques professionnelles individuelles et collectives concernant les prescriptions de psychotropes." 2. Direction générale de la santé Une réponse détaillée nous a été adressée par la DGS (Direction Générale de la Santé), sous-direction de la Santé et de la Société, Bureau de la Santé Mentale, au courrier sollicitant des informations concernant les actions entreprises afin de lutter contre les prescriptions inappropriées (Annexe 8). Les dix actions listées dans le cadre du plan Santé Mentale 2005-2008 sont les suivantes : - Etude subventionnée par la DGS sur l'usage au long cours des antidépresseurs, réalisée par P. Le Moigne (CESAMES-UMR 8136) (Cf. question 2). - Etudes demandées par les autorités de santé dans le cadre de l'inscription au remboursement des médicaments, avec évaluation de l'impact des produits sur les populations traitées pour trois antipsychotiques (Abilify®, Risperdal®, Risperdal Consta®) et deux antidépresseurs (Deroxat® et Effexor®). - Création d'un Groupement d'Intérêt Scientifique (GIS) en recherche clinique, épidémiologique et sociale, dirigé par le Prof F. Rouillon. - Recommandations de bonnes pratiques et mises au point sur le bon usage des psychotropes, réalisé par l'Afssaps en lien avec la DGS (Bon usage des antidépresseurs au cours des troubles dépressifs chez l'adulte ; Point sur les antidépresseurs ; Vous et votre traitement antidépresseur au cours d'un épisode dépressif de l'adulte ; Antidépresseurs chez l'enfant et l'adolescent). - Dans le cadre du plan national canicule 2004, élaboration de documents à l'usage des prescripteurs concernant les prescriptions de psychotropes en période de canicule, réalisation d'une étude en lien avec la CNAM-TS et l'INSERM sur la consommation de psychotropes chez les personnes en fin de vie lors de la canicule 2003, et mise au point de l'Afssaps sur le bon usage des médicaments en cas de vague de chaleur. - Campagne d'information et de communication sur la dépression en 2006 (Cf. question 5). - Mise en place d'un partenariat public-privé avec le LEEM (Les Entreprises du Médicament) sur la mise en place de campagne de santé publique, un des deux thèmes retenus étant la dépression. - Une saisine de la HAS en 2005 et 2006 pour l'élaboration et la validation de référentiels de bonnes pratiques sous la forme de « fiches pratiques ». - L'inscription du bon usage des psychotropes à la formation initiale des médecins généralistes et parmi les thèmes prioritaires de la formation médicale continue (cette dernière inscription dépendant de la sortie des décrets d'application de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique). - La sollicitation de l'UNCAM (Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie) pour la préparation d'un AcBUS (Accord de Bon Usage des Soins) national sur les antidépresseurs. 3. Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé Une réponse du Directeur Général de l'AFFSaPS au courrier sollicitant des informations concernant les actions entreprises afin de lutter contre les prescriptions inappropriées a été adressée à Mrs les Président et Vice-Président de l'OPEPS (Annexe 9). Cette réponse documentée spécifie que trois axes ont été privilégiés par l'AFFSaPs : 1) le bon usage des benzodiazépines ; 2) la lutte contre la soumission chimique des personnes par usage de psychotropes ; 3) le bon usage des antidépresseurs. Parmi les documents transmis, certains ont déjà été mentionnés dans le chapitre précédent (question 3) et dans la section de ce chapitre sur les actions entreprises par la DGS : fiches de transparence, élaboration des recommandations de bonne pratiques et mises au point sur le bon usage des psychotropes, notamment des antidépresseurs. Seuls sont inclus en annexe 9 les documents non redondants. L'action de l'AFFSaPS concernant le bon usage des benzodiazépines nous paraît pouvoir être citée en exemple d'une action efficace. La prise en compte des informations sur les mésusages recueillies via les CRP (Centres Régionaux de Pharmacovigilance) et les CEIP (Centres d'Evaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance) a été suivie de décisions telles des retraits, des modifications et des retraits d'AMM pour les médicaments les plus à risque, et de modifications des RCP (Résumé des Caractéristiques du Produit) pour l'ensemble de la classe. On dispose d'indicateurs permettant d'évaluer l'efficacité de cette action, notamment concernant la diminution de la consommation thérapeutique et addictive de Rohypnol®. Nous renvoyons au texte très détaillé « Actions menées par l'AFSSaPs concernant les médicaments psychotropes » (Annexe 9) pour plus de précisions sur cette action portant sur les benzodiazépines. L'impact de ces mesures sera aussi évoqué dans la réponse à la question 6 concernant la dépendance ; tout en confirmant l'intérêt de l'action de l'AFFSaPs, les données décrites dans cette section en montrent aussi les limites, inhérentes à la dynamique des comportements addictifs, à savoir que l'instauration de restrictions d'accès pour une molécule entraîne un report de consommation sur une autre molécule plus accessible. Il faut également souligner l'intérêt des actions menées concernant la soumission chimique, c'est à dire « l'administration de substances psychoactives, à l'insu de la victime, à des fins criminelles ou délictuelles ». Ce détournement d'usage, fort heureusement peu fréquent (bien que cette fréquence soit probablement sous-estimée), a néanmoins des conséquences potentiellement dramatiques pour la personne qui en est la victime, et toute action visant à améliorer l'information des prescripteurs et des usagers ne peut qu'être encouragée. On peut également noter qu'au cours de la période étudiée dans le présent rapport, l'Afssaps a assuré sa mission de vigilance, avec des réponses rapides lors d'alertes (par exemple concernant le risque suicidaire lié aux antidépresseurs), et des financements d'études portant sur des signaux épidémiologiques (par exemple concernant la relation entre exposition in utero aux oestrogènes de synthèse et troubles psychiatriques à l'adolescence et l'âge adulte). Nous avons déjà souligné (question 3) la tendance actuelle au niveau international à l'élargissement de la population cible des psychotropes par l'élargissement des indications, et le fait que celui ci ne repose pas toujours sur des arguments scientifiques solides. En contrôlant l'octroi des AMM, l'Afssaps peut potentiellement jouer un rôle majeur dans la limitation des extensions des indications des psychotropes. Les décisions conservatoires ne devraient donc pas se limiter aux molécules anciennes pouvant entraîner des usages abusifs et détournés mais se fonder également sur des considérations de santé publique. Les missions de la HAS (Haute Autorité de Santé) telles que définies sur le site de cet organisme « d'expertise scientifique, consultatif, public et indépendant » (www.has-sante.fr) sont « d'évaluer l'utilité médicale de l'ensemble des actes, prestations et produits de santé pris en charge par l'assurance maladie; de mettre en œuvre la certification des établissements de santé; de promouvoir les bonnes pratiques et le bon usage des soins auprès des professionnels de santé et du grand public. La HAS formule des recommandations et rend des avis indépendants, impartiaux et faisant autorité. Ils permettent d'éclairer les pouvoirs publics quant aux décisions de remboursement des produits et services médicaux et de contribuer à améliorer la qualité des pratiques professionnelles et des soins prodigués au patient. » La Commission de la Transparence est sous la tutelle de la HAS. Telle que définie sur le site de la HAS "cette commission est une instance scientifique composée de médecins, pharmaciens, spécialistes en méthodologie et épidémiologie. Elle évalue les médicaments ayant obtenu leur AMM, lorsque le laboratoire qui les commercialise souhaite obtenir leur inscription sur la liste des médicaments remboursables. Elle a notamment pour mission : - de donner un avis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur la prise en charge des médicaments (par la sécurité sociale et /ou pour leur utilisation à l'hôpital), notamment au vu de leur SMR (service médical rendu) qui prend en compte la gravité de la pathologie, l'efficacité et les effets indésirables du médicament, et sa place dans la stratégie thérapeutique, ainsi que de l'ASMR (amélioration du service médical rendu) qu'ils sont susceptibles d'apporter par rapport aux traitements déjà disponibles. - de contribuer au bon usage du médicament en publiant une information scientifique pertinente et indépendante sur les médicaments. Le groupe Intérêt de Santé Publique du Médicament issu de la Commission de Transparence est également sous la tutelle de l'HAS. Plusieurs rapports, dont certains issus de conférences de consensus, ont été publiés par la HAS (ou avant sa création, par l'ANAES, elle-même ex-ANDEM) sur des thèmes portant directement ou indirectement sur les modalités de prescription des psychotropes. Ces rapports ont été cités dans le chapitre précédent sur les recommandations de bonne pratique. Des programmes et outils participant aux actions d'EPP (Evaluation des Pratiques Professionnelles) sont élaborés par la HAS. Parmi les référentiels d'évaluation élaborés à ce jour, hormis ceux déjà cités dans le chapitre précédent (Prise en charge par le médecin généraliste en ambulatoire d'un épisode dépressif isolé de l'adulte; Prise en charge par le psychiatre d'un épisode dépressif isolé de l'adulte en ambulatoire), on peut citer celui portant sur la « Sécurité de la prescription médicamenteuse chez la personne âgée de plus de 70 ans ». Le rapport de la Cour des Comptes « La sécurité sociale 2005 »2 souligne que les méthodes de diffusion des recommandations de bonne pratique établies par la HAS « ne reposent pas sur les méthodes les plus efficaces telles que des rappels informatiques sur les pathologies les plus courantes intégrées aux logiciels utilisés par les professionnels de santé ». Concernant l'impact des recommandations, à notre connaissance, la seule évaluation standardisée dans le domaine des psychotropes a concerné l'impact de la conférence de consensus de 1994 sur les stratégies thérapeutiques à long terme dans les psychoses schizophréniques4 5. Nous avons déjà mentionné l'impact modeste des recommandations issues de cette conférence sur les pratiques de prescription (question 3). 5. Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie Les missions de la MILDT (Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie) concernant l'usage des psychotropes sont précisées dans le Plan gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l'alcool, 2004-2008 : « Les politiques en matière de mise sur le marché, de prescription, d'indications et d'évaluation des médicaments psychotropes relèvent du champ de la DGS et de l'Afssaps. Le recours croissant à ces médicaments psychoactifs est concomitant avec une insuffisance de traitement de certains troubles mentaux avérés. Cette situation relève de l'analyse épidémiologique et de l'évaluation des pratiques médicales compte tenu des recommandations thérapeutiques pour les troubles psychologiques. L'assimilation indistincte de ces médicaments à des drogues risquerait en effet de dévaloriser une ressource thérapeutique précieuse et efficace. En revanche, l'observation, la prévention et la prise en charge des consommations de médicaments hors d'un usage thérapeutique relèvent du champ de la MILDT en lien avec les administrations concernées, dans le champ sanitaire et répressif notamment, pour ce qui a trait à la circulation illégale de ces médicaments sur les marchés de rue. Les risques des usagers abusifs de ces médicaments sont d'ailleurs pris en compte lors de décisions d'autorisation de mise sur le marché, lorsqu'il existe un potentiel d'abus ou de dépendance connu du principe actif ou que la surveillance après commercialisation par les CEIP identifie des mésusages. La commission des stupéfiants et psychotropes de l'Afssaps peut alors être saisie en vue de mesures à prendre pour préserver la santé publique. Ces consommations entrent également dans le champ d'observation du phénomène de consommation dans les enquêtes en population. Seules ces consommations associées doivent donc être prises en compte dans les dimensions de la prévention et du soin développées dans ce plan. » Ce plan différencie donc très clairement consommation de médicaments psychotropes à visée thérapeutique et usage abusif de ces médicaments, distinction fondamentale sur laquelle nous reviendrons dans la question 6. Une information sur les médicaments psychotropes est inclue dans le livret sur les substances psychoactives destiné au grand public (à paraître aux Editions MILDT-DGS-INPES, annexe 10). On peut regretter que dans ces informations, la distinction entre dépendance physique et psychique soit toujours utilisée, et qu'inversement, les concepts de dépendance et de sevrage ne soient pas clairement différenciés. Comme nous le verrons dans la question 6, l'utilisation de ces terminologies et la non-distinction entre dépendance et sevrage contribue à entretenir la confusion entre usage thérapeutique et usage abusif de psychotropes, et est donc en opposition avec l'objectif affiché dans le plan gouvernemental de la MILDT. A noter qu'en accord avec la position de la MILDT sur les médicaments psychotropes, aucun des objectifs quantifiés et indicateurs permettant d'évaluer l'action gouvernementale ne porte spécifiquement sur l'usage (abusif) de médicaments psychotropes dans le plan 2004-2008. Un tel objectif n'était pas non plus spécifié dans le plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances 1999-2000-2001. L'évaluation de l'action de la MILDT dans ce domaine n'apparaît donc pas pertinente. 6. Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé L'INPES est en charge de programmes d'information et d'éducation à la santé. Les actions communes avec la MILDT concernant l'information sur les psychotropes ont déjà été mentionnées, ainsi que la campagne d'information et de communication sur la dépression actuellement en cours d'élaboration par la DGS et l'INPES (détaillée dans la question 5). 7. Unions Régionales de Médecins Libéraux Les Unions Régionales de Médecins Libéraux ont bénéficié de subventions très importantes via les Fonds d'Amélioration de la Qualité des Soins (FAQS) visant à optimiser la qualité et la coordination des soins dispensés en ville (55 millions d'euros engagés en 2003, dont 45 millions pour les projets régionaux2). Il n'existe pas à notre connaissance de données centralisées au niveau national concernant les actions des URML. A moins d'interroger chaque URML, ce qui n'était pas réalisable dans les délais impartis pour la présente étude, il est impossible de déterminer si des actions ont été entreprises dans des régions pour optimiser les prescriptions de psychotropes, de connaître les budgets qui y ont été consacrés, et d'évaluer leur impact. Cette absence de centralisation et de disponibilité de l'information pose problème pour un réseau qui dispose (année 2003) d'un budget équivalent à 63 % de celui de l'Afssaps (55 et 87,26 millions d'euros, respectivement). 8. Formation médicale continue On peut ici encore citer le rapport de la Cour des Comptes "Sécurité sociale 2005"2, qui rappelle que la FMC (Formation Médicale Continue) ne concerne que 9 % des professionnels libéraux bien qu'elle soit légalement obligatoire depuis la loi du 4 mars 2002, "et reste massivement financée par l'industrie pharmaceutique". La FMC portant sur le bon usage des psychotropes n'échappe pas à ce constat. Même s'il n'existe aucune donnée sur la proportion de formations sur les psychotropes indépendantes de l'industrie pharmaceutique, celles-ci sont très probablement largement minoritaires. Il est sans doute inutile de préciser que les "formations" financées par l'industrie n'ont pas pour objectif premier de réduire les prescriptions de psychotropes, hormis celles des laboratoires concurrents. Plusieurs objectifs du « Plan pour la psychiatrie et la santé mentale » 2005-20086 font référence à la nécessité d'optimiser le bon usage des médicaments psychotropes. Un des points de l'Axe 3 « Développer la qualité et la recherche » porte sur le thème « Favoriser le bon usage des médicaments » (Annexe 11), en sollicitant l'élaboration, la validation et la diffusion de référentiels et guides de bonnes pratiques, sous l'égide de la HAS, auprès des professionnels et du grand public. Ce plan préconise que les objectifs de maîtrise médicalisée des prescriptions de psychotropes mis en place par l'assurance maladie soient élargis aux antidépresseurs et antipsychotiques. Le budget prévisionnel (sur crédit d'état) pour mettre en place ces actions est de 200 000 € en 2006. L'amélioration du bon usage du médicament est également mentionnée dans l'objectif « Rompre l'isolement des généralistes », le plan rappelant que « Les médecins généralistes sont, en général, isolés par rapport aux professionnels spécialisés alors qu'ils sont des acteurs de premier recours et qu'ils prescrivent 85 % des psychotropes consommés en France. (...) Dans le cadre des conventions avec les médecins libéraux, il est prévu d'améliorer l'accès et la coordination des soins en s'appuyant sur le médecin généraliste. Ce protocole d'accord prévoit aussi, d'une part, une formation professionnelle conventionnelle (FPC) qui s'intègre dans l'obligation de formation médicale continue (FMC) et d'évaluation individuelle des pratiques professionnelles (EPP) et d'autre part, des outils conventionnels et notamment des accords de bon usage des soins (AcBUS) concernant les psychotropes pour l'année 2005 ». Un autre objectif est d'impliquer les associations d'usagers en santé mentale concernant l'information sur les psychotropes par le développement une action d'information, alternative à celle diffusée par les laboratoires pharmaceutiques, sur les médicaments pour les usagers et leurs proches. Les informations concernant le bilan de la mise en œuvre du Plan pour la Psychiatrie et la Santé Mentale 2005-2008 ont été sollicitées par le Pr F. Rouillon auprès du Dr Alain Lopez, Président du Comité de Suivi du Plan, et auprès de Madame Nadine Richard, Chef du Bureau Santé Mentale, 6eme Sous Direction Santé et Société de la DGS. Les réponses transmises les 15 et 16 mai 2006 indiquent que deux actions sont actuellement menées dans ce cadre. La première concerne un accord de bon usage du médicament dans le traitement de la dépression, accepté par la CNAM-TS début 2006. La deuxième action est relative à la création d'une fiche d'information à destination des usagers sur le bon usage des psychotropes, en collaboration avec une association d'usagers (Fédération Nationale des Associations d'(ex) Patients en Psychiatrie, FNAP-PSY). La complexité des structures et les responsabilités souvent mal coordonnées qui caractérisent le système de régulation du médicament en France ont été soulignées dans le récent rapport réalisé à la demande de la DGS et de l'Afssaps sur "La pharmaco-épidémiologie en France. Evaluation des médicaments après leur mise sur le marché"7 : "En simplifiant quelque peu, on pourrait dire que l'Agence octroie les AMM et assure la fonction de vigilance, la Commission de la Transparence (aujourd'hui incluse dans la Haute Autorité de Santé) juge de l'intérêt, le CEPS fixe le remboursement, l'ANAES (elle aussi rapprochée de la Haute Autorité) édicte des recommandations, l'Assurance Maladie rembourse et contrôle, éventuellement, le respect de ces recommandations mais, au final, personne n'étudie, à partir de la réalité du terrain, l'impact global de l'utilisation des médicaments sur la santé des populations et la réalité du bénéfice et des risques en conditions réelles." La régulation des prescriptions des médicaments psychotropes ne fait pas exception à ce constat général. L'optimisation des prescriptions se heurte là aussi à la complexité des systèmes de régulation et à la fragmentation des responsabilités entre de nombreuses institutions. Un point positif est que l'on peut identifier, à l'échelon de chaque institution, des mesures attestant de la prise en considération du fait que l'usage des psychotropes pose un problème de santé publique. Cependant, ces mesures n'apparaissent pas s'inscrire dans un plan national d'ensemble visant à optimiser l'usage et les prescriptions des médicaments psychotropes en France. Cette absence (ou cette faible) coordination ne peut que favoriser un gaspillage de ressources tant financières qu'humaines (par exemple, multiplication des groupes d'experts et des rapports), et ne permet pas de prioriser les actions et programmes. Quelle que soit l'institution, la carence la plus flagrante concerne la quasi-absence d'évaluation de l'impact des mesures et recommandations, c'est à dire la concordance entre les objectifs fixés et ceux réellement atteints. A l'exception des actions de l'Afssaps concernant le bon usage des benzodiazépines, nous n'avons pas identifié de mesures pour lesquelles on dispose d'indicateurs fiables sur l'évaluation de l'impact. Cette carence est particulièrement spectaculaire concernant les RMO, qui avant d'être annulées en 1999, ont été largement diffusées et ont fait l'objet de multiples réunions professionnelles. A notre connaissance, une seule étude réalisée par le CREDES a évalué l'impact de deux des RMO portant sur les médicaments psychotropes. Dans le cadre de la convention médicale 2005, un des thèmes de maîtrise médicalisée est « un infléchissement de 10 % des montants tendanciels 2005 de la prescription des anxiolytiques et des hypnotiques (33 millions d'euros d'économies) ». De manière prévisible du fait des délais, nous ne disposons pas à l'heure de la rédaction de ce rapport de données concernant l'impact de cette mesure. On ne peut donc que s'interroger sur les critères et justifications qui ont étayé l'élaboration de cette recommandation. Pourquoi les anxiolytiques et hypnotiques ont-ils été choisis pour cible prioritaire parmi toutes les classes de psychotropes, alors que les données d'usage suggèrent que leur consommation est stable, tandis que celle des antidépresseurs et antipsychotiques (plus coûteux) continue de croître ? Pourquoi durant le même temps dérembourser des spécialités phytothérapiques (Euphytose®) pouvant représenter une alternative a priori sans danger à ces prescriptions (voir question 5)? Cette mesure a-t-elle été assortie d'information sur la gestion des sevrages à ces molécules (voir question 6) ? Le risque de substitution par d'autres molécules plus coûteuses (puisque l'objectif est comptable) tels que les antidépresseurs a-t-il été réellement pris en compte, et sera-t-il quantifié ? L'absence d'évaluation pose problème par rapport à l'utilisation des financements publics. Par exemple, nous n'avons pas réussi à obtenir d'information sur les actions financées par les 55 millions d'euros engagés en 2003 les Fonds d'Amélioration de la Qualité des Soins (FAQS) visant à optimiser la qualité et la coordination des soins dispensés en ville (combien d'entre elles ont concerné les psychotropes ?), ni sur une quelconque évaluation de leur impact. Le fait que la FMC soit, à de rares exceptions près, assurée par l'industrie pharmaceutique, et l'absence d'applications des mesures permettant de limiter ce phénomène, a été régulièrement dénoncé sans volonté politique apparente de modifier cette carence. Nous ne pouvons que nous associer à ce constat. L'absence de coordination entre institutions entraîne aussi des discordances et incohérences dans l'information diffusée aux professionnels, voire au grand public. On peut ainsi regretter la confusion entretenue par la MILDT entre usage thérapeutique et usage abusif de médicaments psychotropes, et entre syndrome de sevrage et dépendance. Il est indispensable que les institutions publiques aient des discours cohérents et non stigmatisants vis à vis des usagers de ces médicaments, et que l'information diffusée repose sur des données scientifiques actualisées. Le bilan du Plan Psychiatrie et Santé Mentale 2005-2008 concernant les médicaments psychotropes se résume, à la date de remise de cette étude, à l'acceptation par la CNAM-TS début 2006 d'un accord de bon usage du médicament dans le traitement de la dépression, et à la réalisation en cours d'une fiche d'information à destination des usagers sur le bon usage des psychotropes. Nous ne disposons pas d'information sur l'utilisation du budget prévisionnel de 200 000 € alloué en 2006 pour mettre en place des actions sur les psychotropes. Parmi les rares points positifs, la création d'un Groupement d'Intérêt Scientifique (GIS) en recherche clinique, épidémiologique et sociale dans le champ de la psychiatrie, pourrait favoriser la mise en place d'études permettant l'évaluation et le suivi des actions visant à optimiser la prescription de psychotropes. 1. Le Pape A, Sermet C. Les références médicales opposables sur le médicament : bilan de trois années d'application. Questions d'économie de la santé, CREDES 1998;n°14:1-6. 2. Cour des Comptes. La Sécurité Sociale 2005. 3. Ministère des Solidarités de la Santé de la Famille. Convention médicale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie. Journal Officiel 3 février 2005. 4. Glikman J, Pazart L, Casadebaig F, Philippe A, Lachaux B, Kovess V, et al. Assessing the impact of a consensus conference on long-term therapy for schizophrenia. Int J Technol Assess Health Care 2000;16:251-9. 5. Lachaux B, Casadebaig F, Philippe A, Ardiet G. [Pharmaco-epidemiology of antipsychotic prescription practices for schizophrenic patients (1995 and 1998 cross sectional surveys)]. Encephale 2004;30:46-51. 6. Plan Psychiatrie et Santé Mentale 2005-2008. Ministère de la Santé et des Solidarités, 2005. 7. Begaud B, Costagliola D. La pharmaco-épidémiologie en France. Evaluation des médicaments après leur mise sur le marché. Etat des lieux et propositions. Rapport réalisé à la demande de la DGS et de l'Afssaps, 2006. VI.- QUESTION 5 : « QUELLES SONT LES ALTERNATIVES THÉRAPEUTIQUES » ? Exposer les stratégies non pharmacologiques de prise en charge thérapeutique des affections psychiatriques, en indiquant le nombre et la proportion de patients traités ainsi que leur mode de traitement, s'agissant notamment des psychothérapies. Présenter et évaluer l'efficacité des mesures de prévention primaire et secondaire de ces troubles. Intégrer à la réponse des éléments de comparaison européenne ainsi que des propositions d'amélioration. Les alternatives thérapeutiques aux médicaments psychotropes sont représentées par : (i) les autres techniques biologiques non médicamenteuses (électroconvulsivothérapie, stimulation magnétique transcrânienne, luxthérapie ou photothérapie), qui concernent une faible proportion d'usagers, et seront passées brièvement en revue ; (ii) les méthodes thérapeutiques non allopathiques (phytothérapie, homéopathie, oligothérapie, acupuncture), qui sont utilisées par une proportion plus importante de la population, mais pour lesquelles on dispose d'un nombre extrêmement limité d'études scientifiques valides évaluant leur efficacité ; (iii) les méthodes psychothérapiques, dont les différents types, indications, et évaluation de l'efficacité seront passés en revue ; (iv) les règles hygiéno-diététiques. 1. Traitements biologiques non médicamenteux Cette catégorie inclut toutes les thérapeutiques reposant sur une méthode physique visant à induire des modifications du fonctionnement cérébral. La sismothérapie ou ECT (électroconvulsivothérapie) consiste à provoquer une crise d'épilepsie généralisée au moyen d'un courant électrique administré par des électrodes placées sur le cuir chevelu. Ces séances se déroulent actuellement sous anesthésie générale, avec une curarisation qui permet d'éviter les contractions musculaires, l'objectif étant que la crise d'épilepsie soit exclusivement cérébrale1. L'effet thérapeutique peut être obtenu très rapidement, parfois dès la première séance. Les séances doivent être répétées à raison de deux à trois par semaine. Le nombre total de séances est le plus souvent compris entre 8 et 10, mais varie selon les indications. Dans certains cas, le traitement doit être maintenu plusieurs mois voire plusieurs années, avec un espacement de plusieurs semaines entre chaque séance (ECT d'entretien). Les principales indications psychiatriques de l'ECT sont les troubles de l'humeur sévères et/ou résistants aux traitements pharmacologiques, aussi bien pour les épisodes dépressifs que maniaques. L'ECT peut être indiqué en première intention dans des épisodes dépressifs mettant en jeu le pronostic vital (risque suicidaire majeur, déshydratation/dénutrition) ou dans les cas où ce traitement expose à moins de risques qu'un traitement pharmacologique (personne âgée avec état somatique précaire, femme enceinte). Les autres indications psychiatriques sont essentiellement les troubles psychotiques (schizophrénie et troubles schizoaffectifs), avec les mêmes critères que pour les troubles de l'humeur (sévérité de l'épisode et/ou résistance aux traitements pharmacologiques). Les modalités actuelles d'application d'un traitement par ECT doivent respecter un protocole très strict visant à garantir la sécurité des personnes traitées1. Les incidents et complications sont rares, et sont essentiellement liés aux complications de l'anesthésie générale. Les estimations du taux de mortalité varient entre 0,2 et 1 pour 10 000 patients traités, le taux de morbidité (survenue d'un accident ou d'une complication non létale) est estimé à environ 7,5 pour 10 000 traitements. L'effet secondaire le plus fréquent est la survenue de troubles mnésiques, le plus souvent transitoires (pendant la phase de traitement), mais pouvant persister quelques mois après l'arrêt du traitement. L'ECT représente ainsi une alternative thérapeutique aux traitements pharmacologiques pour un nombre très limité de sujets. A l'exception des rares cas où le traitement curatif et préventif du trouble psychiatrique repose exclusivement sur des ECT d'entretien, il s'agit dans la majorité des cas d'une alternative temporaire, le temps de la cure d'ECT. En effet, du fait de la gravité des troubles pour lesquels ce traitement est indiqué, le relais par des traitements psychotropes est le plus souvent indispensable au décours de la cure. Malgré la consultation de plusieurs spécialistes, aucune information quantitative n'est disponible sur le nombre d'ECT pratiqués en France, ni sur le nombre de patients bénéficiant de cet traitement. En effet, cet acte n'ayant pas de nomenclature spécifique, les seuls actes faisant l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie étant l'anesthésie et la surveillance post-anesthésique. b) Stimulation magnétique transcrânienne La stimulation magnétique transcrânienne répétée (repetitive Transcranial Magnetic Stimulation ou rTMS en anglais) repose sur l'application d'une impulsion électromagnétique brève produite par une bobine placée sur le cuir chevelu. L'objectif est d'obtenir une activation neuronale localisée à certaines zones cérébrales (alors que l'ECT entraîne une activation générale). Dans la plupart des protocoles, les séances sont répétées quotidiennement 5 jours par semaine, pendant plusieurs semaines. Contrairement à l'ECT, le traitement par rTMS ne nécessite pas d'anesthésie, n'entraîne a priori pas de troubles cognitifs, et les complications sont très rares (exceptionnellement, des crises d'épilepsie). La plupart des études ayant exploré l'intérêt thérapeutique de la rTMS dans les troubles psychiatriques ont porté sur la dépression. Même si certaines études mettent en évidence un effet thérapeutique, celui ci est le plus souvent modeste, et la synthèse des résultats de ces études ne permet pas à ce jour de conclure de manière formelle que cette technique présente un réel intérêt thérapeutique2-4. En dehors de la dépression, les essais thérapeutiques ont surtout porté sur la schizophrénie, en particulier sur le traitement des hallucinations auditives résistantes aux traitements psychotropes. D'autres indications ont été proposées, comme les troubles obsessionnels compulsifs, mais les données sont actuellement très succinctes. La rTMS doit donc être actuellement considérée comme une alternative thérapeutique potentielle, dont l'efficacité et les indications doivent être précisées par des études complémentaires. A l'heure actuelle, ce traitement est essentiellement utilisé en France dans le cadre d'essais thérapeutiques conduits par des équipes spécialisées. La photothérapie ou luxthérapie repose sur l'exposition quotidienne à une lumière blanche de forte intensité (2500 LUX et plus). L'effet du traitement passant par une stimulation directe de la rétine, la source lumineuse doit être fixée par le sujet, en moyenne deux heures par jour, pendant plusieurs semaines. Ce traitement a été initialement développé dans le traitement des troubles de l'humeur saisonnier, et en particulier de la dépression hivernale. Le caractère saisonnier est défini selon les critères DSM-IV (ce sous-type n'existe pas dans la classification CIM-10) sur « l'existence d'une relation temporelle régulière entre la survenue d'un épisode de trouble de l'humeur et une période particulière de l'année », avec survenue d'au moins deux épisodes pendant cette période au cours des deux dernières années. La dépression hivernale est caractérisée par la survenue à l'automne d'une symptomatologie dépressive dite « atypique », avec ralentissement psychomoteur, hypersomnie, hyperphagie avec prise de poids. Dans cette indication, la photothérapie a une efficacité comparable à celle des antidépresseurs (70 à 80 % d'amélioration), avec un délai d'action souvent plus rapide. Il s'agit dans ce cas d'une réelle alternative au traitement psychotrope, puisque l'association d'un antidépresseur n'est pas requise pour obtenir un effet thérapeutique5-7. La photothérapie a été proposée dans d'autres indications que les troubles de l'humeur saisonniers et pourrait avoir un intérêt comme traitement adjuvant (et non comme alternative au sens strict du terme) dans les dépressions non saisonnières. L'effet recherché est une action potentialisatrice des traitements psychotropes, en particulier dans les premiers jours de traitement, du fait de sa rapidité d'action supérieure à celle des antidépresseurs5 8. Ce traitement a également été proposé pour les troubles du sommeil chez les personnes âgées, en alternative aux traitements hypnotiques, mais les données sont actuellement insuffisantes pour étayer l'intérêt de cette stratégie9 10. Les complications et effets secondaires somatiques sont rares (céphalées, nausées, fatigue oculaire). Il existe comme pour tout traitement antidépresseur un risque de virage hypomaniaque ou maniaque. Il n'existe pas de données sur le nombre de patients bénéficiant de ce traitement en France. L'estimation serait très complexe, car l'achat ou la location d'un appareil à photothérapie par un particulier ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie, l'achat pouvant de plus se faire dans les grands magasins d'électroménager ou via internet. 2. Méthodes thérapeutiques non allopathiques On peut rappeler les chiffres déjà cités dans les sections précédentes (Questions 1 et 3), concernant la fréquence de recours à l'homéopathie pour des troubles ou symptômes psychiques. Dans l'étude Santé Mentale en Population Générale, 1,3 % des personnes interrogées rapportent avoir fait usage au cours de leur vie de médicaments homéopathiques « pour les nerfs, pour la tête ». Ces mêmes personnes ont fréquemment utilisé des médicaments allopathiques (antidépresseurs : 7 %; anxiolytiques : 21,9 % ; hypnotiques : 6,8 %), suggérant que le recours à des traitements homéopathiques n'est pas exclusif mais plutôt complémentaire de l'usage des médicaments psychotropes. Le profil des troubles psychiatriques présentés par les usagers de traitements homéopathiques à visée psychotrope est globalement comparable à celui des usagers d'anxiolytiques. Chez les enfants, l'enquête conduite par Levy et collaborateurs11 montre également que la co-prescription de médicaments allopathiques et homéopathiques est fréquente, 60 % des enfants usagers de psychotropes allopathiques utilisant quotidiennement des médicaments homéopathiques pour des troubles du sommeil. Les données de vente des médicaments homéopathiques utilisés dans le traitement de symptômes psychiques nous ont été communiquées par les laboratoires Boiron (Tableau 101). Plus de 22 millions d'unités de produits remboursables, et 2 millions d'unités de produits non remboursables, ont ainsi été vendues en France en 2005. Il n'existe pas, à notre connaissance, d'étude validant l'efficacité de l'homéopathie dans des symptômes psychiques encore moins la comparant à des traitements psychotropes classiques. Une étude dans les troubles anxieux et du sommeil, financée par les Laboratoires Boiron, devrait cependant être menée au cours de la période 2006-2008. Tableau 101. Médicaments homéopathiques vendus en France en 2005
On ne dispose à notre connaissance d'aucune donnée sur la fréquence d'usage en France des autres méthodes (acupuncture, phytothérapie, etc.), et les données sur l'efficacité de ces méthodes sont là encore très succinctes. La phytothérapie regroupe un grand nombre de plantes et substances le plus souvent connues depuis l'antiquité, et d'accès variés : cultures domestiques (tisanes), commerces de médecine naturelle, pharmacies d'officine. Indépendamment des antiasthéniques (ginseng, gingembre, kola, etc.) hors sujet ici, elles sont essentiellement positionnées dans les formes légères d'anxiété et de troubles du sommeil (passiflore, aubépine, valériane, etc.). Ces alternatives constituent indiscutablement dans ces indications une première intention de choix pouvant éviter le recours à des médicaments aux risques plus affirmés (ex. : benzodiazépines). Il est de ce point de vue regrettable que plusieurs médicaments positionnés dans ce créneau (ex. : Euphytose®) aient récemment fait l'objet d'une mesure de déremboursement. Cette spécialité a fait l'objet d'études cliniques présentées dans l'avis rendu le 13 avril 2005 par la Commission de la Transparence, qui en a réexaminé le service médical rendu à la demande du Ministère de la Santé (site http://www.has-sante.fr/has/transparence/htm/avis/html/act000_e.htm, consulté le 25 mai 2006). Les indications remboursables de Euphytose® étaient alors « le traitement symptomatique des états neurotoniques de l'adulte et de l'enfant, notamment en cas de troubles mineurs du sommeil ». Une seule étude montre que l'Euphytose® entraîne une réduction des scores d'anxiété plus importante que celle observée sous placebo. Comme cela est indiqué dans le rapport, les études portent le plus souvent sur de faibles effectifs et manquent donc de puissance pour mettre en évidence un effet de taille modeste. A noter, cependant, que deux études portant sur des effectifs relativement importants (une centaine de patients dans chaque bras) ne mettent pas en évidence de différence d'efficacité entre l'Euphytose® et le Témesta® ou le Séresta®, respectivement sur la symptomatologie anxieuse et la qualité du sommeil. Des enquêtes auprès de médecins généralistes, fournies dans le cadre de l'évaluation de l'Euphytose® par la Commission de la Transparence, indiquent qu'en cas de déremboursement des spécialités phytothérapiques, le report de prescription sur des psychotropes remboursés pourrait concerner 20 à 50 % des prescriptions. Le rapport de la Commission de la Transparence concluant que le service médical rendu par l'Euphytose® était insuffisant, était assorti des commentaires suivants concernant les conséquences d'un déremboursement : « Malgré la faiblesse méthodologique de ces études de report de prescriptions, la Commission ne peut exclure que les spécialités de phytothérapie à visée sédative qui permettent de limiter le recours aux psychotropes tels que les benzodiazépines et les hypnotiques dans les formes mineures des troubles concernés. Cependant, ce risque de report et la capacité de ces spécialités à le limiter sont difficiles à quantifier ». Une exception notable vis à vis des études d'efficacité concerne le millepertuis (St John's Wort), très prescrit en Allemagne dans les syndromes dépressifs, qui a fait l'objet de nombreux essais thérapeutiques, avec des résultats divergents12. Une autre alternative en plein essor est représentée par les compléments alimentaires (acides gras, acides aminés, magnésium, etc.), dont l'exemple le plus récent et le plus médiatisé concerne les acides gras poly-insaturés de type omega 3. Une récente revue de 6 articles leur accorde une efficacité potentielle dans les syndromes dépressifs mais il est difficile d'en situer le niveau et de le comparer à celui de traitements plus classiques et mieux évalués. a) Estimation du nombre de psychothérapeutes en France Selon la Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse (http://www.ff2p.fr/), on dénombrerait entre 8 000 et 12 000 psychothérapeutes en France. D'autres estimations donnent des chiffres plus élevés, avec 59 000 professionnels pratiquant les psychothérapies, incluant 40 000 psychologues (dont 70 % de psychologues cliniciens), 8000 psychiatres, 6000 psychanalystes, et 5000 professionnels non médecins et non psychologues de formations diverses. Ces estimations sont à considérer avec prudence, même si on se limite aux psychologues et psychiatres. En effet, si les études universitaires de psychologie ou de psychiatrie comportent généralement une formation théorique aux méthodes psychothérapiques, elles n'incluent pas le plus souvent de formation pratique, celle-ci devant donc être réalisée sur la base du volontariat en parallèle à la formation proposée à l'université. Ainsi, doit-on considérer comme psychothérapeutes les 13 000 psychiatres français ou, uniquement, ceux majoritaires en pratique libérale13, qui ont une pratique essentiellement psychothérapique ? La même question peut être posée concernant les psychologues. Même si depuis 2002, chaque psychologue est tenu de faire enregistrer ses diplômes auprès de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), il n'existe pas à notre connaissance de données nationales sur le nombre de psychologues ayant une activité psychothérapique en secteur libéral ou salarié, et il est très probable que le chiffre de 40 000 psychologues surestime fortement ce nombre. Les données concernant les autres professionnels sont encore plus imprécises. Cette imprécision est liée au fait que la plupart des professionnels pratiquant la psychothérapie ne sont pas affiliés à des structures syndicales ou fédérales, et que le statut de psychothérapeute n'a pas encore d'existence légale récente en France, tout au moins tant que les décrets d'application de la loi 2004-806 du 9 août 2004 sur la réglementation du titre de psychothérapeute ne sont pas parus. Brièvement, cette loi prévoit que l'usage du titre de psychothérapeute est réservé à des personnes inscrites dans un registre national, cette inscription étant de droit pour les médecins, psychologues cliniciens, et psychanalystes enregistrés dans les annuaires de leur association. Les autres professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute devront avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique. A ce jour, seules les psychothérapies pratiquées par des médecins peuvent faire l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. b) Estimation du nombre de sujets ayant une prise en charge psychothérapique en France Les données permettant d'estimer le nombre de personnes bénéficiaires d'une prise en charge psychothérapique en France sont très succinctes. Une enquête nationale a été réalisée en 2001 par l'institut BVA pour Psychologies Magazine et la Fédération Française de Psychothérapie, à l'occasion des Etats Généraux de la Psychothérapie (http://www.bva.fr/new/archives.asp; mot clé psychothérapie). Cette enquête a été menée par téléphone sur un échantillon de 8 061 personnes âgées d'au moins 15 ans, représentatives de la population française, et sélectionnées par la méthode des quotas (sur les critères sexe, âge, profession du chef de famille, région et catégorie d'agglomération). Le principal résultat est de montrer que 5 % des personnes déclarent avoir suivi une psychothérapie au cours de leur vie, dont moins de la moitié (1,7 %) en suivent toujours une. L'approche la plus fréquemment citée est la psychanalyse (30 %), suivie par l'approche TCC (Thérapie Cognitivo-Comportementale) (20 %) et la thérapie familiale (10 %), les autres méthodes représentant moins de 5 % des réponses. La moitié des suivis psychothérapiques durent moins d'un an, et un sur 5 (20 %) dure plus de 3 ans. Le psychothérapeute est un psychiatre dans près de la moitié des cas (47 %), les autres professionnels rapportés étant les psychologues (21 %), les psychanalystes (8 %) et « autres » psychothérapeutes (14 %). Une question de l'enquête investiguait la consommation de psychotropes avant, pendant et après la psychothérapie « de manière générale, sans parler du détail de votre traitement, avez-vous pris des psychotropes (antidépresseurs, anxiolytiques) ? » La fréquence d'usage augmente de 38 % à 49 % pendant la psychothérapie, pour diminuer à 27 % après la psychothérapie. Les résultats de cette enquête doivent être considérés avec prudence, car les questions étaient relativement vagues, et la définition de psychothérapie peut donc avoir été très variable d'une personne à l'autre. Aucune interprétation ne peut être faite concernant les résultats sur l'usage des psychotropes, la diminution de fréquence d'usage après la psychothérapie pouvant aussi bien refléter l'impact de celle-ci que celui des psychotropes eux-mêmes, qui peuvent être interrompus du fait de la rémission symptomatique (par ex, arrêt d'un antidépresseur après résolution de l'épisode dépressif). Une autre étude a été réalisée à partir l'enquête santé conduite en 1999-2000 auprès des adhérents de la MGEN (Mutuelle Générale de l'Education Nationale)14. Un questionnaire postal a été adressé à 10 000 sujets âgés de 20 à 60 ans tirés au sort, avec taux de réponse global de 66,5 %. En accord avec les caractéristiques de la population de départ, ces personnes sont plus souvent de sexe féminin, mariées, et avec un niveau d'éducation plus élevé que celui de la population générale française. La question explorant le traitement psychothérapique proposait 6 types de réponses, avec plusieurs réponses possibles : psychothérapie individuelle, psychothérapie de soutien, psychanalyse ; psychothérapie de groupe ; psychothérapie de couple ou familiale ; autre prise en charge individuelle (psychothérapie comportementale, nutritionniste...) ; prise en charge de groupe (anciens buveurs, Weight Watchers ...) ; autre traitement. Plus d'un mutualiste sur 10 (11,5 %, dont 14,4 % des femmes et 7,4 %, des hommes) déclaraient avoir suivi une psychothérapie au cours de leur vie. Plus de la moitié des psychothérapies (54,4 %) durent plus d'un an, 14,8 % de 6 mois à un an, et 29,3 % moins de 6 mois. Les psychothérapies catégorisées comme « intenses », c'est à dire durant au moins 6 mois à une fréquence minimale de 2 à 3 fois par mois, représentent la moitié des cas (51,4 %). Dans plus de 80% des cas, la psychothérapie a été réalisée dans le secteur privé. Les personnes ayant suivi une psychothérapie ont dans la plupart des cas (71 %) fait usage de psychotropes au cours de leur vie (somnifères, anxiolytiques, sédatifs : 62,1 % ; antidépresseurs : 52,3 %), la formulation des questions ne permettant toutefois pas de préciser la concomitance ou non de l'usage de psychotropes et d'une prise en charge psychothérapique. La fréquence plus élevée de personnes ayant suivi une psychothérapie dans l'enquête MGEN par rapport à l'enquête BVA pourrait être liée à la surprésentation de sujets ayant un haut niveau d'étude à la MGEN, ainsi qu'au fait que la tranche d'âge investiguée est plus réduite que dans l'enquête BVA. Toutefois, dans le cadre de l'enquête Santé Mentale en Population Générale, dont la méthode a été déjà présentée (Questions 1 et 3), portant sur un échantillon représentatif de la population française, le taux de réponse positive à la question « Avez vous déjà suivi une psychothérapie ? » (10,3 %) est proche de celui de l'échantillon MGEN. La proportion de sujets rapportant avoir suivi une psychothérapie est plus élevée chez les sujets présentant un trouble psychiatrique identifié au MINI : 31 % des sujets ayant un diagnostic de syndrome psychotique, 25 % des sujets ayant un diagnostic de trouble de l'humeur, et 20 % des sujets ayant un diagnostic de trouble anxieux. Parmi les personnes qui ont suivi une psychothérapie, les trois-quarts rapportent également avoir déjà pris un traitement psychotrope. La méthode de recueil de données ne permet pas d'avoir plus de précisions sur le type de psychothérapie suivie, et la concomitance ou non de traitements psychothérapiques et psychotropes. c) Les différentes approches et leur efficacité Les principales approches psychothérapiques utilisées dans la prise en charge des troubles psychiatriques ont récemment fait l'objet d'une évaluation dans le cadre d'une expertise collective INSERM15. Ce travail d'expertise a porté sur une analyse exhaustive de la littérature scientifique, basée sur des critères de sélection des études comparables à ceux appliqués aux études épidémiologiques et pharmaco-épidémiologiques analysées dans le présent rapport. Nous reprendrons donc ici pour mémoire les présentations des méthodes psychothérapiques (Tableau 102) et les principales conclusions (Tableau 103) issues de la synthèse de cette expertise. Cette expertise collective montre que, quelle que soit la technique, l'approche psychothérapique est une méthode thérapeutique dont l'efficacité peut être démontrée par des études conduites selon des règles méthodologiques strictes. Dans le détail, le niveau de preuve d'efficacité est particulièrement élevé pour les TCC, dont l'efficacité a été mise en évidence dans le plus grand nombre de troubles. Ce résultat à fait l'objet de suffisamment de débats passionnés pour que nous nous abstenions ici de tout commentaire supplémentaire. Par rapport à la question posée dans le présent rapport, l'intérêt des conclusions de cette expertise est de montrer que l'approche psychothérapique peut être une véritable alternative aux traitements psychotropes dans certains troubles psychiatriques avérés (c'est à dire répondant aux critères diagnostiques des classifications internationales), et notamment dans les troubles anxieux et les troubles de la personnalité. Pour la plupart des autres troubles, ces approches ont un intérêt en association avec un traitement psychotrope. D'autres méthodes psychothérapiques existent en dehors des trois approches évaluées dans le cadre de l'expertise collective INSERM. On recense ainsi sur le site de la Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse (http://www.ff2p.fr/) 38 techniques différentes, que nous citons pour mémoire, car à de rares exceptions près (hypnose par ex.), l'efficacité thérapeutique de ces autres approches n'a pas fait l'objet d'évaluation standardisée: 1 Analyse bio-énergétique ; 2 Analyse des rêves ; 3 Analyse psycho-organique ; 4 Analyse transactionnelle ; 5 Art-thérapie ; 6 Danse-thérapie ; 7 Intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires (EMDR) ; 8 Gestalt-thérapie ; 9 Haptonomie ; 10 Hypnose classique ; 11 Hypnose éricksonienne ; 12 Intégration posturale thérapeutique ; 13 Massage psychothérapeutique ; 14 Musicothérapie ; 15 Programmation Neuro-Linguistique thérapeutique ; 16 Psychodrame ; 17 Psychogénéalogie ; 18 Psychologie de la motivation ; 19 Psychosomatanalyse ; 20 Psychosomatothérapie ; 21 Psychosynthèse ; 22 Psychothérapie analytique ; 23 Psychothérapie brève ; 24 Psychothérapie centrée sur la personne ; 25 Psychothérapie intégrative ; 26 Psychothérapie transpersonnelle ; 27 Psychothérapie psychocorporelle ; 28 Relaxation ; 29 Rêve éveillé ; 30 Sexothérapie ; 31 Sophia-analyse ; 32 Sophrothérapie ; 33 Technique de respiration ; 34 Thérapie cognitivocomportementale ; 35 Thérapie familiale analytique ; 36 Thérapie familiale et systémique ; 37 Thérapie primale ; 38 Végétothérapie. Tableau 102. Différentes techniques psychothérapiques d'après l'expertise collective INSERM15
Tableau 102 (suite). Différentes techniques psychothérapiques d'après l'expertise collective INSERM 15
Tableau 103. Effets des psychothérapies15
TPB : thérapie psychodynamique brève; TI : thérapie interpersonnelle; TS : tentative de suicide Tableau 103 (suite). Effets des psychothérapies15
Tableau 103 (suite). Effets des psychothérapies15
4. Mesures hygiéno-diététiques Des conseils prodigués par des professionnels de santé concernant des règles élémentaires d'hygiène de vie peuvent être considérés comme de véritables alternatives thérapeutiques à la prescription de psychotropes. Le meilleur exemple est probablement dans le champ des plaintes concernant le sommeil, en l'absence de trouble psychiatrique avéré. Un interrogatoire sur le mode de vie, et des conseils sur des règles d'hygiène simple (réduction de la consommation d'excitants et d'alcool ; régularité des rythmes veille-sommeil ; etc.), sont des alternatives qui devraient être systématiquement considérées avant de prescrire un hypnotique, chez l'adulte aussi bien que chez l'enfant. On pourrait faire le parallèle entre cette situation et la prescription d'un hypocholestérolémiant qui ne serait pas associée à une enquête et des conseils sur le mode de vie et les habitudes hygiéno-diététiques. Dans cette perspective, une information du grand public sur ces règles élémentaires d'hygiène de vie pourrait avoir un intérêt, sur le modèle, par exemple, du Programme National Nutrition Santé pour l'alimentation. Des programmes structurés d'éducation, voire de rééducation du sommeil, sont développés dans des centres spécialisés tels que les cliniques du sommeil qui existent dans la plupart des grandes agglomérations. On peut également citer l'existence de « stages de sommeil », tels que ceux proposés par le centre régional de prévention santé de Lyon (http://sommeil.univ-lyon1.fr/articles/cfes/sante/stages.html). Brièvement, ces stages permettent aux participants de s'informer sur la physiologie du sommeil et, grâce à la tenue d'un agenda du sommeil sur plusieurs semaines, d'objectiver la qualité de leur sommeil et de leur éveil, et de développer des stratégies permettant d'obtenir un sommeil de meilleure qualité. 1. Prévention des troubles psychiatriques Il serait hors de propos de passer ici en revue les mesures de prévention primaire et secondaire, de l'ensemble des troubles psychiatriques. Brièvement, la prévention primaire vise à réduire l'incidence (nombre de nouveaux cas) d'un problème de santé en agissant sur les facteurs étiologiques à l'origine de sa survenue. Elle reste actuellement du domaine de la recherche dans le champ des troubles psychiatriques, car aucun facteur étiologique modifiable (c'est à dire pour lequel une intervention préventive serait possible) n'a été identifié à ce jour de manière formelle. La prévention secondaire a pour objectif de dépister et traiter le plus précocement possible un problème de santé afin de réduire sa prévalence (nombre de cas existants). Des programmes sont actuellement développés dans plusieurs pays, ciblés sur une tranche d'âge ou une population à risque (enfants, prisonniers) ou sur une pathologie donnée (suicide, dépression, troubles psychotiques). Un des programmes pionniers dans ce domaine est celui réalisé en Suède sur l'île de Gotland en 1938-198416-18. Une formation de tous les généralistes de l'île sur les symptômes, l'étiologie, le diagnostic et le traitement de la dépression a permis de réduire les hospitalisations et arrêts de maladie pour dépression, ainsi que le taux de suicide. Les prescriptions d'antidépresseurs ont augmenté alors que celles des anxiolytiques, hypnotiques et neuroleptiques diminuaient. L'évolution de ces indicateurs montre toutefois que l'impact est limité dans le temps, avec retour au niveau pré-programme dans les 3 ans suivant son arrêt, suggérant à ses promoteurs que ce type de campagne doit être répété très régulièrement pour avoir un impact à long terme. Le plan Psychiatrie et Santé Mentale 2005-200819 préconise la mise en place de tels programmes en France, notamment chez les enfants, ainsi que de campagnes d'information du grand public. Dans ce cadre, la DGS et l'INPES élaborent actuellement une campagne d'information et de communication sur la dépression. Les informations qui nous ont transmises par la DGS (sous direction de la santé et de la société, bureau de la santé mentale) à ce sujet (Annexe 8) apportent les précisions suivantes : « Une campagne centrée sur les différents troubles dépressifs (épisode dépressif majeur et trouble bipolaire) et leurs possibilités de traitement a fait l'objet depuis 18 mois d'une préparation soutenue par la DGS et l'INPES. En effet, la dépression, pathologie très fréquemment rencontrée en population générale, a été choisie pour 2006. Elle se situe au 4° rang du classement des pathologies jugées les plus préoccupantes et pourrait occuper la seconde place en 2020, juste derrière les maladies cardio-vasculaires (Rapport OMS 2001). Cette campagne a pour objectif de faire connaître au grand public les troubles dépressifs, leurs causes, leurs symptômes et leurs traitements, de manière à modifier les perceptions et à améliorer, à terme, le suivi médico-psychique des personnes souffrant de ces troubles. Aucune campagne d'information nationale n'a encore été menée en France dans le champ de la santé mentale et c'est la première abordant le thème des psychotropes au niveau national. Le chapitre antidépresseur y est très largement développé, à la fois dans les documents destinés aux médecins généralistes dans la première phase de la campagne, mais aussi dans un second temps au sein du livret d'information grand public et à travers le volet médias. ». Les informations transmises le 18 mai au Pr F. Rouillon par le bureau de la santé mentale indiquent que deux actions ont été engagées : l'une concerne la rédaction du livret d'information grand public sur la dépression, qui accompagnera la campagne médiatique prévue au printemps 2007 ; l'autre vise à créer une mallette d'outils à destination des médecins généralistes afin qu'ils repèrent au mieux la dépression des personnes âgées, qui devrait être disponible à la fin de l'année 2006. Notons, qu'en marge des programmes de prévention portant sur des troubles spécifiques, une campagne nationale en faveur de la santé mentale a été réalisée en 2005 par le Centre collaborateur de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la formation en santé mentale (CCOMS, Lille France) sous l'égide de la FNAP-Psy (Fédération Nationale des Associations de (ex) Patients en psychiatrie, de l'UNAFAM (Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques), et de l'Association des Maires de France (AMF) sur le thème «Accepter les différences, ça vaut aussi pour les troubles psychiques» (Annexe 12). Les objectifs étaient de « sensibiliser l'opinion publique à la question de la discrimination dont sont victimes les personnes souffrant de troubles psychiques et leurs proches ; souligner les exigences d'une alliance de tous les acteurs de la santé mentale : patients, familles, professionnels de santé et élus locaux ; appeler au développement d'un partenariat innovant, pour favoriser l'accompagnement et l'insertion des personnes ayant de troubles psychiques, et lutter contre l'exclusion, la discrimination et la stigmatisation. » 2. Prévention de l'usage inapproprié de médicaments psychotropes Concernant les mesures pouvant avoir un impact sur l'usage de médicaments psychotropes, la prévention primaire aurait pour objectif de limiter le nombre de sujets débutant un usage de psychotrope (cas incidents), la prévention secondaire de réduire la durée d'exposition aux psychotropes chez les sujets déjà usagers (cas prévalents). Deux cas de figure doivent être distingués. Dans le premier cas, correspondant aux situations où les psychotropes sont utilisés pour traiter un trouble psychiatrique avéré, les mesures générales précédemment évoquées de prévention des troubles psychiatriques s'appliquent. Il faut néanmoins souligner que l'objectif de réduire la prévalence des troubles psychiatriques et celui de réduire la prévalence d'exposition aux psychotropes peuvent être antagonistes. Le meilleur exemple est celui de la prévention des récidives du trouble bipolaire : la réduction de la durée des phases symptomatiques est obtenue grâce à un traitement préventif par un régulateur de l'humeur sur une durée forcément prolongée. Dans un domaine qui reste encore celui de la recherche, des études suggèrent que la mise en place « préventive » d'un traitement antipsychotique chez des adolescents et adultes jeunes présentant des symptômes psychotiques atténués ou transitoires pourrait permettre d'empêcher l'apparition d'un trouble psychotique tels qu'une schizophrénie (prévention primaire) ou tout au moins de différer son début (prévention secondaire)20. Si l'intérêt de cette stratégie était confirmé, ce qui n'est pas actuellement le cas, la réduction du nombre de cas de troubles psychotiques ou de la durée des phases symptomatiques passerait par une augmentation du nombre de sujets exposés à des antipsychotiques. Dans le deuxième cas, correspondant aux situations où les psychotropes sont utilisés en dehors d'un cadre nosographique strict, la prévention primaire passe par le développement d'alternatives thérapeutiques autres que la prescription de psychotropes chez les sujets présentant une souffrance psychique ou une détresse psycho-sociale (psychothérapie notamment). La réduction de la durée d'exposition aux psychotropes peut également être obtenue par le développement de ces alternatives thérapeutiques et par une meilleure diffusion des méthodes de sevrage (Cf. question 6). À notre connaissance, et si l'on excepte les mesures réglementaires limitant les durées de prescription de telle ou telle classe de psychotrope, aucun programme de prévention primaire ou secondaire visant à réduire l'exposition ou la durée d'exposition aux médicaments psychotropes n'a été développé, que ce soit en France, dans un pays européen, ou dans un autre pays. Les alternatives thérapeutiques aux médicaments psychotropes se résument essentiellement aux psychothérapies, et à la promotion des mesures hygiéno-diététiques. Les autres techniques thérapeutiques biologiques (ECT, photothérapie, stimulation magnétique transcrânienne) ne concernent qu'une fraction très restreinte de la population. A notre connaissance, aucun essai thérapeutique n'a à ce jour permis d'évaluer l'efficacité des traitements homéopathiques sur les symptômes et troubles psychiatriques. Indépendamment du critère pharmacologique d'efficacité, il faut néanmoins souligner qu'en conditions réelles de prescription, ces traitements homéopathiques représentent une réelle alternative thérapeutique à la prescription de médicaments psychotropes « allopathiques » chez des usagers attendant une réponse médicamenteuse à des plaintes dans la sphère psychique et comportementale, plaintes qui en l'absence de trouble psychiatrique avéré, ne relèvent pas d'un traitement psychotrope. Il n'est actuellement pas possible d'estimer le nombre de sujets « évitant » le recours aux médicaments psychotropes par la prescription de médicaments homéopathiques. Cette information serait fort utile pour évaluer l'impact de mesures éventuelles de déremboursement de ces spécialités, qui risqueraient d'entraîner les usagers et les prescripteurs à se tourner vers la prescription de médicaments psychotropes remboursés. Le même raisonnement peut être appliqué pour les autres méthodes thérapeutiques non allopathiques, telles que la phytothérapie. On peut ainsi se demander si l'impact du déremboursement récent de spécialités telles que l'Euphytose®, dont le coût était modéré, a été réellement évalué, aussi bien en termes économiques, qu'au niveau du risque de substitution de cette prescription par celles de médicaments hypnotiques et anxiolytiques. Il faut rappeler que l'Allemagne, qui est le pays européen avec le plus faible niveau d'usage de psychotropes, est aussi celui où la phytothérapie est la mieux remboursée. Il y a de ce point de vue une incohérence politique à prétendre vouloir diminuer l'exposition aux anxiolytiques et hypnotiques en France quand, dans le même temps, on prend la décision de dérembourser des alternatives acceptables dans certaines de leurs indications. Les enquêtes sur le recours aux psychothérapies indiquent que 5 à 10 % des personnes résidant en France ont suivi au cours de leur vie une psychothérapie. Ces estimations reposent exclusivement sur du déclaratif et ne permettent pas d'explorer avec précision l'approche effectivement utilisée. L'enquête BVA montre que dans la moitié des cas, le psychothérapeute est un psychiatre, mais sans fournir de précisions sur le remboursement ou non des actes de psychothérapie, ni sur le fait qu'il s'agit ou non d'une prise en charge psychothérapique exclusive (sans prescription conjointe de médicaments). L'enquête MGEN permet de préciser que les psychothérapies répondant à des critères minima de durée et de fréquence représentent la moitié des situations (le critère de durée minimum de 6 mois peut toutefois être discuté, dans certaines situations, la durée de prise en charge par une approche TCC pouvant être plus brève). Malgré leur imprécision, ces estimations suggèrent que le nombre de personnes ayant effectivement recours à ces approches thérapeutiques soit nettement inférieur à celui des personnes susceptibles d'en bénéficier, ne serait ce qu'en considérant les prévalences des troubles psychiatriques avérés pour lesquels les bénéfices d'un traitement psychothérapique structuré sont clairement documentés. Favoriser l'accès à ces approches thérapeutiques paraît donc légitime. Or, de même que le strict cadre nosographique ne permet pas d'appréhender les modalités d'usage et de prescription des médicaments psychotropes, la présence d'un diagnostic psychiatrique n'est pas un critère suffisant pour estimer qu'une personne peut bénéficier d'une approche psychothérapique. Le champ potentiel d'application des psychothérapies déborde en effet largement ce cadre, avec pour conséquence que les risques de confusion entre les différents indications et niveaux d'intervention sont particulièrement importants concernant ces approches thérapeutiques. Rouillon et Leguay21 (Annexe 13) rappellent qu'il convient de distinguer d'une part ce qui relève du traitement des troubles psychiatriques (nécessitant une réponse médico-psychologique), des difficultés psychologiques (justifiant une approche psychologique ou psychanalytique plus que psychiatrique) et des détresses psycho-sociales (nécessitant une réponse multidisciplinaire). D'autre part, les niveaux d'intervention devraient différencier (i) l'aide et l'écoute pouvant être prodiguées par des aidants qui ne sont pas soignants, (ii) le soutien et le conseil prodigués par des professionnels de santé, et (iii) le travail psychothérapique structuré. Le développement des approches psychothérapiques en tant qu'alternative à un traitement psychotrope peut donc potentiellement relever de ces différents niveaux : traiter un trouble anxieux tel qu'un trouble panique par une psychothérapie structurée type TCC plutôt que par antidépresseur ; privilégier la prise en charge de difficultés psychologiques ou psychosociales par du soutien ou une psychothérapie structurée, plutôt que par une prescription d'anxiolytique ou d'hypnotique. Le développement des prises en charge psychothérapiques nécessite de mieux connaître l'offre de soin actuelle, et les perspectives de développement de cette offre. Il faut de nouveau souligner l'absence d'indicateurs précis sur le nombre de professionnels qualifiés. Les questions relatives à la formation, à la reconnaissance, et à l'évaluation des psychothérapies dépassent le cadre de cette étude, et nous renvoyons à l'article de Rouillon et Leguay (Annexe 13) concernant ces points. Un élément en prendre en considération est toutefois celui de la démographie psychiatrique, avec une réduction de 40 % du nombre de psychiatres en exercice dans les prochaines années, avec des estimations indiquant que ce nombre passera de 13 000 au début des années 2000 à 8000 en 2020. L'augmentation récente du numerus clausus avec ouverture du nombre de postes dans la filière psychiatrique ne permettra pas de compenser cette diminution. Cela revient à dire que l'offre de soins concernant les psychothérapies structurées prises en charge par les caisses d'assurance maladie va être drastiquement réduite dans les années qui viennent. La promotion des approches psychothérapeutiques comme alternative aux médicaments psychotropes exige donc qu'une réflexion s'engage rapidement sur les missions des différents professionnels de santé, et sur les moyens à mettre en oeuvre pour favoriser leur développement. La meilleure application de règles élémentaires d'hygiène de vie devrait être considérée comme une véritable alternative thérapeutique à la prescription de psychotropes, notamment pour les plaintes concernant le sommeil en l'absence de troubles psychiatrique avéré. Dans cette perspective, une information structurée du grand public sur la physiologie du sommeil et sur ces règles d'hygiène de vie sur le modèle, par exemple, du Programme National Nutrition Santé pour l'alimentation, nous semble prioritaire. A ce jour, aucun programme de prévention ni aucune campagne d'information abordant le thème des psychotropes n'a été menée en France au niveau national. Une telle campagne devrait prochainement être lancée sur le thème de la dépression. L'information du grand public joue un rôle important vis à vis de l'adéquation des traitements prescrits, mais il ne faut pas négliger le rôle majeur de la formation initiale des prescripteurs. Actuellement, le nombre d'heures consacrées à la prescription des psychotropes est plus que restreint au cours des études de médecine. L'enseignement théorique portant sur les pathologies psychiatriques et leurs traitements se résume à une trentaine d'heures dans le cursus médical, ce qui revient à dire que dans le meilleur des cas, moins d'une dizaine d'heures sont consacrées au règles de prescription des psychotropes. Il faut également rappeler qu'un stage en psychiatrie n'est pas obligatoire au cours du cursus médical, et que les futurs généralistes peuvent donc valider leur cursus sans avoir jamais eu de formation pratique en psychiatrie, alors qu'un tiers de leur clientèle présentera des symptômes et plaintes dans le champ psychique et comportemental. Même si des mesures favorisant la formation théorique et pratique initiale en psychiatrie et psychopharmacologie des futurs médecins ne peuvent que favoriser l'optimisation des prescriptions de psychotropes, il faut souligner qu'un facteur limitant actuel en termes de formation est liée aux effectifs restreints des hospitalo-universitaires en psychiatrie (moins de 100 professeurs de psychiatrie adulte et enfant pour 13 000 psychiatres, à titre comparatif le nombre de professeurs de neurologie est similaire pour un peu moins de 2000 neurologues). 1. Agence Nationale Accréditation et Evaluation en Santé (ANAES). Indications et modalités de l'électroconvulsivothérapie. Recommandations professionnelles, 1997. 2. Galinowski A, Paillère-Martinot M. La stimulation magnétique transcrânienne répétée : vers un nouvel outil thérapeutique en psychiatrie. L' Evolution psychiatrique 2002;67:155-69. 3. Simons W, Dierick M. Transcranial magnetic stimulation as a therapeutic tool in psychiatry. World J Biol Psychiatry 2005;6:6-25. 4. Martin JL, Barbanoj MJ, Schlaepfer TE, Thompson E, Perez V, Kulisevsky J. Repetitive transcranial magnetic stimulation for the treatment of depression. Systematic review and meta-analysis. Br J Psychiatry 2003;182:480-91. 5. Terman M, Terman JS. Light therapy for seasonal and nonseasonal depression: efficacy, protocol, safety, and side effects. CNS Spectrums 2005;10:647-63; quiz 72. 6. Wirz-Justice A, Benedetti F, Berger M, Lam RW, Martiny K, Terman M, et al. Chronotherapeutics (light and wake therapy) in affective disorders. Psychol Med 2005;35:939-44. 7. Golden RN, Gaynes BN, Ekstrom RD, Hamer RM, Jacobsen FM, Suppes T, et al. The efficacy of light therapy in the treatment of mood disorders: a review and meta-analysis of the evidence. Am J Psychiatry 2005;162:656-62. 8. Tuunainen A, Kripke DF, Endo T. Light therapy for non-seasonal depression. Cochrane Database Syst Rev 2004:CD004050. 9. Forbes D, Morgan DG, Bangma J, Peacock S, Pelletier N, Adamson J. Light therapy for managing sleep, behaviour, and mood disturbances in dementia. Cochrane Database Syst Rev 2004:CD003946. 10. Lemoine P, Nicolas A, Faivre T. [Sleep and aging]. Presse Med 2001;30:417-24. 11. Levy L, Martin-Guehl C, Lechevallier-Michel N, Noize P, Moore N, Latry P, et al. Use of psychotropic drugs in 0 to 5 years old children in Aquitaine (France): prevalence and associated factors. Pharmacoepid Drug Saf 2006. 12. Linde K, Mulrow C, Berner M, Egger M. St John's wort for depression. Cochrane Database Syst Rev 2005;18:CD000448. 13. Lafitte C, Martin C, Grabot D, Tignol J. A survey of private practice psychiatrist's training and activity in activity in Aquitaine, France, in 1993. Encephale 1996;22:417-21. 14. Kovess V, Sapinho D, Briffault X, Villamaux M. L'usage des psychothérapies en France : résultats d'une enquête auprès des mutualistes de la MGEN. Encephale 2006;sous presse. 15. Expertise-Collective-INSERM. Psychothérapie. Trois approches évaluées. In: Les éditions INSERM, 2004. 16. Rutz W, Walinder J, Eberhard G, Holmberg G, von Knorring AL, von Knorring L, et al. An educational program on depressive disorders for general practitioners on Gotland: background and evaluation. Acta Psychiatr Scand 1989;79:19-26. 17. Rutz W, von Knorring L, Walinder J. Frequency of suicide on Gotland after systematic postgraduate education of general practitioners. Acta Psychiatr Scand 1989;80:151-4. 18. Rutz W, von Knorring L, Walinder J. Long-term effects of an educational program for general practitioners given by the Swedish Committee for the Prevention and Treatment of Depression. Acta Psychiatr Scand 1992;85:83-8. 19. Plan Psychiatrie et Santé Mentale 2005-2008. Ministère de la Santé et des Solidarités, 2005. 20. Verdoux H, Cougnard A. The early detection and treatment controversy in schizophrenia research. Curr Opin Psychiatry 2003;16:175-79. 21. Rouillon F, Leguay D. Psychothérapies et politique de santé mentale : de quelques problèmes et recommandations. L'Information Psychiatrique 2004;80:523-29. Présenter les différentes formes et les symptômes de dépendance aux médicaments psychotropes, en dressant le profil des personnes à risque. Indiquer s'il existe des recommandations de bonne pratique pour la conduite des sevrages. Préciser la nature des critères déterminants pour leur mise en oeuvre ainsi que l'ensemble des conditions nécessaires à leur succès. Ce point intègre l'évaluation du dispositif actuel, des éléments de comparaison européenne et des propositions d'amélioration. 1. Dépendance à une substance psychoactive Les critères diagnostiques du syndrome de dépendance à une substance psychoactive selon la CIM-101 sont listés dans le Tableau 104. Ces critères permettent de diagnostiquer un trouble dont une caractéristique essentielle est la perte de contrôle par rapport à l'usage de la substance, et ce malgré les conséquences délétères sur un plan somatique, psychologique ou social liées à cet usage. Le diagnostic de syndrome de dépendance est ainsi actuellement utilisé dans la terminologie médicale à la place de termes tels qu'addiction ou toxicomanie. La distinction entre dépendance physique et dépendance psychique n'est plus prise en compte dans ces critères, cette dichotomisation étant actuellement considérée comme peu pertinente. Très schématiquement, la survenue d'un syndrome de dépendance est de déterminisme multifactoriel, lié aux propriétés pharmacologiques de la substance (capacité à induire des modifications agréables), en interaction avec une vulnérabilité individuelle et des facteurs d'environnement. Un point essentiel est que l'existence d'un syndrome de sevrage, tout en étant un des critères permettant de poser un diagnostic de syndrome de dépendance, n'est ni nécessaire ni suffisante pour poser ce diagnostic. Tableau 104. Critères diagnostiques du syndrome de dépendance à une substance psychoactive selon la CIM-10.
Un syndrome de sevrage est un ensemble de symptômes apparaissant lors de l'interruption brutale de la prise d'une substance consommée de manière régulière et prolongée (Tableau 105). Ces phénomènes traduisent l'adaptation de l'organisme à cet usage répété, qui entraîne l'apparition d'un nouvel état d'équilibre. L'absence de la substance induit une rupture de cet état d'équilibre, et l'apparition de symptômes spécifiques à chaque substance, qui sont généralement opposés à ceux induits par la substance (par exemple, contractures musculaires lors de l'arrêt d'une benzodiazépine dont une des propriétés est l'effet myorelaxant). Le syndrome de sevrage est à distinguer de l'« effet rebond » qui est la réapparition ou l'aggravation des symptômes qui sont la cible thérapeutique initiale de la substance (par exemple, poussée hypertensive lors de l'arrêt brutal d'un anti-hypertenseur de type béta-bloquant). Lors d'un syndrome de sevrage peuvent aussi apparaître des symptômes qui n'existaient pas antérieurement (par ex. sensations vertigineuses lors de l'arrêt d'un antidépresseur ISRS, Cf. infra). La survenue d'un syndrome de sevrage est exclusivement liée aux propriétés pharmacologiques d'une substance, l'arrêt brutal induisant l'apparition de ce syndrome aussi bien chez les animaux que chez les sujets humains ayant un usage prolongé du produit, indépendamment des caractéristiques psychologiques ou d'environnement. Un point essentiel que nous soulignons encore une fois est que l'existence d'un syndrome de sevrage n'implique pas que le sujet présente un état de dépendance. Tableau 105. Critères diagnostiques du syndrome de sevrage à une substance psychoactive selon la CIM-10
3. Implications concernant les psychotropes La distinction entre syndrome de dépendance et syndrome de sevrage est essentielle concernant les psychotropes. La survenue d'un état de dépendance peut être considérée comme une complication, concernant une minorité de sujets exposés à ces substances, et qui va demander une prise en charge spécifique similaire à celle mise en œuvre pour tout sujet développant des conduites addictives vis à vis d'une substance psychoactive. Le risque de survenue d'une dépendance concerne essentiellement les anxiolytiques et hypnotiques de la famille des benzodiazépines2. Cependant, peu de sujets utilisant des benzodiazépines dans un but thérapeutique de manière prolongée répondent aux critères de dépendance ; ils doivent, en revanche, affronter la possibilité d'un syndrome de sevrage en cas d'interruption brutale du traitement, sevrage qui peut les amener à poursuivre l'usage pour éviter la survenue de ces symptômes. En termes de santé publique, les besoins de soins de la population concernent donc essentiellement la prévention et la prise en charge des syndromes de sevrage. L'utilisation prolongée à dose thérapeutique des médicaments psychotropes des autres classes, en particulier les antidépresseurs ou les thymorégulateurs antiépileptiques, expose également au risque d'un syndrome de sevrage en cas d'arrêt brutal. Toutefois, ces autres médicaments ne génèrent pas de dépendance au sens strict du terme, définie comme un mésusage avec perte de contrôle de la consommation, avec des conséquences délétères sur l'état de santé et/ou le fonctionnement psychosocial. Font exceptions parmi les molécules de la classe des antidépresseurs le Survector®, retiré du marché du fait de son potentiel addictogène, et le Stablon® (Cf. infra). Les psychostimulants commercialisés pour le traitement de l'hyperactivité (Ritaline® et le Concerta® LP) peuvent également entraîner la survenue d'une dépendance. 1. Caractéristiques du syndrome de sevrage Un syndrome de sevrage peut être observé après l'arrêt brutal d'un traitement par benzodiazépines à visée anxiolytique ou hypnotique administré à doses thérapeutiques, particulièrement si ce traitement est pris sans interruption pendant plusieurs semaines ou mois. Les critères permettant de poser ce diagnostic selon la CIM-101 sont listés dans le Tableau 106. Tableau 106. Syndrome de sevrage aux sédatifs et aux hypnotiques
Les symptômes les plus fréquemment observés sont l'apparition ou la recrudescence de troubles du sommeil (insomnie) ou de symptômes anxieux, y compris chez les sujets ne présentant pas de tels symptômes avant la mise en place du traitement. Des symptômes neurovégétatifs avec tension musculaire, myoclonies (secousses musculaires), céphalées, peuvent également être observés. Des complications plus sévères peuvent survenir, en particulier des épisodes confusionnels, des symptômes hallucinatoires, des crises comitiales, voire un état de mal épileptique. La fréquence d'apparition d'un syndrome de sevrage chez les consommateurs chroniques de benzodiazépines se situe entre 15 et 26 % mais augmente avec l'ancienneté du traitement (autour de 80 % pour des traitements supérieurs à 3 ans)3. Même si ces symptômes rétrocèdent spontanément en quelques jours, le degré d'inconfort est souvent tel que le sujet peut avoir recours à la reprise du traitement pour les faire disparaître. Cette stratégie est efficace, puisqu'elle permet d'obtenir très rapidement la rémission des manifestations de sevrage. Cette séquence arrêt du traitement - survenue de symptômes de sevrage - reprise du traitement pour faire disparaître les symptômes de sevrage, permet de mieux comprendre pourquoi le sevrage aux benzodiazépines doit faire l'objet d'un accompagnement médical, afin de limiter les risques d'échec. 2. Recommandations pour l'interruption du traitement Ce chapitre s'inspire largement de la synthèse de la littérature réalisée par l'équipe du Professeur Marc Auriacombe et, en particulier, par le Dr Mélina Fatseas (Université Victor Segalen Bordeaux 2 et département d'addictologie du Centre Hospitalier Charles Perrens, Bordeaux) que nous remercions de nous avoir communiqué ces documents4. Les recommandations évoquées ici concernent exclusivement les sujets utilisant des benzodiazépines de manière isolée. a) Durée d'action de la molécule En cas d'arrêt brutal, les symptômes de sevrage sont plus intenses si la benzodiazépine à une durée d'action courte. On évalue cette durée d'action par la demi-vie d'élimination, c'est à dire le nombre d'heures au bout duquel la concentration sanguine du produit a diminué de moitié. Une étude a été menée chez des sujets usagers de benzodiazépines pendant au moins un an à dose thérapeutique, qui ont été traités après tirage au sort pendant plusieurs semaines, soit par une benzodiazépine à demi-vie longue (Valium®, Tranxène®), soit par une benzodiazépine à demi-vie courte (Lexomil®, Xanax®)5. Le traitement a ensuite été arrêté brutalement. Les symptômes de sevrage étaient plus intenses dans le groupe ayant reçu une benzodiazépine à demi-vie courte. Le taux d'échec du sevrage était en corollaire plus important chez ces sujets. Une semaine après l'arrêt, 43 % des sujets du groupe benzodiazépine à demi-vie courte étaient sevrés contre 73 % dans le groupe demi-vie longue. A cinq semaines, ces pourcentages étaient de 38 % et 46 % dans les deux groupes. Cette étude montre qu'en cas d'arrêt brutal, le sevrage est plus efficace chez les sujets traités par benzodiazépine à demi-vie longue, mais illustre néanmoins que le maintien du sevrage à moyen terme est problématique même dans ce groupe (moins de 50 % de succès après un mois). Ainsi, une recommandation pour favoriser le succès du sevrage chez les sujets traités par benzodiazépine à demi-vie courte est de substituer ce produit par une molécule à demi-vie longue. Le Valium® est la benzodiazépine la plus utilisée dans les protocoles de sevrage. b) Diminution progressive des doses La réduction progressive des doses permet d'atténuer la sévérité des symptômes de sevrage, quelles que soient la posologie quotidienne et la demi-vie de la molécule6, mais est d'autant plus efficace qu'il s'agit d'une benzodiazépine puissante et à demi-vie courte7. La première phase du sevrage, avec une diminution de 50 % de la dose du traitement, peut s'effectuer relativement rapidement, en deux à quatre semaines. La poursuite de la diminution doit parfois être plus progressive, car les symptômes de sevrage peuvent alors devenir plus sévères. Certains patients doivent ainsi être maintenus à 50 % de la posologie initiale pendant plusieurs mois avant de pouvoir poursuivre la diminution du traitement2 7. A ce jour, une substitution d'une molécule à demi-vie courte par du Valium®, suivie d'une diminution progressive par pallier de 25 %, est la seule modalité de sevrage de benzodiazépines ayant démontré une efficacité dans le cadre d'études contrôlées. c) Autres stratégies pharmacologiques et non-pharmacologiques Plusieurs autres stratégies pharmacologiques ont été proposées pour traiter le sevrage aux benzodiazépines, telles que la substitution par des molécules anticonvulsivantes (Tégrétol®, Dépakote®), des béta-bloquants (Avlocardyl®), des anxiolytiques d'une autre classe (Buspar®) ou des antidépresseurs. L'efficacité de ces stratégies n'a pas été démontrée de manière formelle à ce jour, soit parce que les études conduites selon un protocole rigoureux n'ont pas confirmé l'efficacité de la stratégie, soit du fait des limites métholodologiques des études4. Lemoine et al ont montré l'intérêt d'un traitement adjuvant par Atarax® dans une étude randomisée en double-insu conduite en médecine générale8. Les patients (n=139) devaient être traités depuis au moins trois mois (64 mois en moyenne) par du Lexomil® avec une posologie quotidienne d'au moins 2 mg, et pouvaient répondre aux critères diagnostiques de trouble anxieux généralisé, à l'exclusion de tout autre diagnostic psychiatrique. Ils étaient répartis en 6 groupes : 1) sevrage brutal de la benzodiazépine et traitement par Atarax® 25mg ; 2) sevrage brutal et traitement par Atarax® 50 mg ; 3) sevrage brutal et traitement par placebo ; 4) sevrage progressif et traitement par Atarax® 25mg ; 5) sevrage progressif et traitement par Atarax® 50 mg ; 6) sevrage progressif et traitement par placebo. Le traitement par Atarax® ou placebo était maintenu un mois, et les patients suivis 60 jours après l'arrêt du traitement. L'intérêt de cette étude est de montrer que quelle que soit la stratégie adoptée, le sevrage peut être mené à bien pour la majorité des patients, avec 75 % de patients sevrés deux mois après l'inclusion dans l'étude. A noter toutefois que deux mois après le sevrage, plus de la moitié des patients (54 %) déclaraient avoir envie de reprendre un anxiolytique. Même si le taux de succès est meilleur en cas de sevrage progressif, les différences entre les groupes sont minimes, mettant en exergue le rôle probablement important d'un effet « pris en charge », favorisé par le fait que les patients inclus dans le protocole avaient des consultations et évaluations régulières. L'Atarax® rend le sevrage plus facile, avec réduction du nombre de signes de sevrage et du niveau d'anxiété chez les sujets présentant des symptômes anxieux importants, y compris en cas d'arrêt progressif de la benzodiazépine, pour la posologie la plus forte (50 mg). Chez les sujets présentant un trouble anxieux avéré ou un trouble dépressif traité exclusivement par benzodiazépines, les symptômes ayant motivé l'instauration d'un traitement ont une très grande probabilité de persister après l'arrêt des benzodiazépines, et donc de compromettre les tentatives de sevrage. L'instauration d'un traitement antidépresseur, par son action spécifique sur les symptômes du trouble, est dans ce cas souvent le pré-requis à toute tentative de sevrage en benzodiazépines. La stratégie peut aussi reposer sur des approches psychothérapiques structurées (Cf. question 5), qui par leur action sur les symptômes motivant la prise de benzodiazépines, vont faciliter l'initiation d'un sevrage. Les autres stratégies adjuvantes parfois proposées aux sujets présentant un usage au long cours de benzodiazépines (homéopathie, acupuncture, phytothérapie, etc.) n'ont pas fait à notre connaissance l'objet d'études évaluant leur efficacité. d) Synthèse des recommandations Nous reprendrons ici les recommandations élaborées par Rickels9 qui permettent d'optimiser la réussite d'un sevrage aux benzodiazépines : (i) établir une relation thérapeutique stable avec le patient ; (ii) traiter tout d'abord, par des méthodes pharmacologiques ou autres, les patients présentant des symptômes anxieux et dépressifs persistants sous benzodiazépine à posologie usuelle ; (iii) débuter la diminution progressive du traitement quand les symptômes ont été améliorés, après avoir mis en place un traitement par Valium® (à la dose initiale de 10mg par jour) ou équivalent ; (iv) maintenir une dose réduite pendant plusieurs mois avant d'initier la dernière phase du sevrage. Il est important de préciser que ces recommandations s'appliquent à des sujets pour lesquels le bénéfice à interrompre le traitement par benzodiazépines est supérieur au risque lié à l'arrêt. Dans certaines conditions, en particulier chez les sujets présentant des troubles psychiatriques sévères (telle que par exemple une schizophrénie avec une symptomatologie anxieuse importante), le maintien du traitement anxiolytique par benzodiazépine présente un intérêt thérapeutique certain, car il permet d'éviter le recours à d'autres thérapeutiques, dont les associations de neuroleptiques. 1. Caractéristiques du syndrome de sevrage Le diagnostic « syndrome de sevrage aux antidépresseur » n'apparaît pas dans les classifications internationales, car ce syndrome est d'identification relativement récente, ou tout au moins, la fréquence et l'importance clinique de ce syndrome ont été largement sous-estimées jusqu'à une date récente. Seul sera ici évoqué le syndrome de sevrage aux antidépresseurs non tricycliques (ISRS et autres) (discontinuation syndrome dans la littérature anglo-saxonne)10-13. Les symptômes du sevrage aux antidépresseurs sont listés dans le Tableau 107. La prédominance de symptômes neuro-sensoriels et végétatifs permet (en théorie) de différencier assez aisément un syndrome de sevrage de la réapparition de symptômes dépressifs ou anxieux à l'arrêt du traitement. Tableau 107. Symptômes les plus fréquents dans le syndrome de sevrage aux antidépresseurs ISRS d'après P.M. Haddad 13
Ces symptômes apparaissent généralement dans les jours suivant l'arrêt (ou la diminution des doses) de l'antidépresseur, en moins d'une semaine dans la quasi-totalité des cas. En l'absence d'intervention, ils persistent le plus souvent moins de 3 semaines, bien que des cas avec des durées nettement plus prolongées aient été rapportés. L'intensité des symptômes peut être très invalidante, les sensations vertigineuses et l'instabilité pouvant contraindre la personne à interrompre toute activité. Comme pour les benzodiazépines, la reprise du traitement ou l'augmentation des doses entraîne la résolution rapide des symptômes. La survenue d'un syndrome de sevrage est rare si le traitement est pris depuis moins d'un mois. Dans les autres situations correspondant aux recommandations thérapeutiques (traitement de 6 mois ou plus), les estimations indiquent que ce syndrome survient chez 20 à 30 % des usagers en cas d'interruption brutale. Ces estimations varient en fonction du type d'antidépresseur, ceux ayant une demi-vie longue exposant, là encore, à moins de syndromes de sevrage que ceux ayant une demi-vie courte. Comme cela a été précédemment souligné, l'existence d'un syndrome de sevrage aux antidépresseurs doit être différenciée d'un syndrome de dépendance à ces substances. Il n'existe actuellement aucun argument clinique ou épidémiologique permettant d'affirmer qu'un syndrome de dépendance pourra être induit par les antidépresseurs, tout au moins tel que défini par les critères diagnostiques précédemment mentionnés (Tableau 104). A noter toutefois que ce point fait l'objet d'une controverse : il a été suggéré que la modification des critères de dépendance entre le DSM-III-R et le DSM-IV, selon laquelle l'existence d'un syndrome de sevrage ne suffit pas à poser le diagnostic de dépendance, ait pu être introduite pour ne pas pénaliser les antidépresseurs de type ISRS : les symptômes survenant à l'arrêt du traitement définissant ainsi un syndrome de sevrage et non une pharmacodépendance14. 2. Recommandations pour la conduite des sevrages La stratégie actuellement préconisée pour éviter la survenue d'un syndrome de sevrage aux antidépresseurs est la diminution très progressive des doses, par exemple en réduisant la posologie d'un quart toutes les 4 à 6 semaines, voire encore plus lentement en cas de survenue de symptômes, particulièrement dans les dernières phases de diminution. Il est essentiel que les prescripteurs et les usagers soient mieux informés concernant l'existence de ce syndrome, et de sa fréquence élevée de survenue. En effet, l'existence d'un syndrome de sevrage aux antidépresseurs et de sa prévention restent encore méconnues de certains prescripteurs, pouvant entraîner des erreurs diagnostiques, et la prolongation injustifiée de prescriptions. D. DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES CONCERNANT LA DÉPENDANCE ET L'USAGE DÉTOURNÉ DE MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES 1. Rapports d'activité des centres spécialisés de soins aux toxicomanes Des rapports d'activité sont régulièrement réalisés sur les personnes prises en charge par les CSST (Centres Spécialisés de Soins aux Toxicomanes), structures qui ont pour mission d'assurer la prise en charge médico-psychologique et socio-éducative des usagers de drogues mais aussi l'accueil, l'orientation, l'information de ces patients, et le soutien à l'environnement familial15-17. L'OFDT est en charge de la saisie et de l'exploitation des données issues des rapports d'activité transmis par ces structures à la DGS. Le mésusage de médicaments psychotropes (opiacés exclus) est à l'origine d'un nombre très réduit (4 % à 5 %) des prises en charge liées à l'usage de drogues en produits « primaires » (c'est à dire cité en 1er pour la demande de prise en charge). Le pourcentage est également réduit (7,5 % en 1999) pour les produits cités en second. Les produits en cause sont essentiellement les benzodiazépines (70 à 80 % des recours, plus souvent citées en produits secondaires que primaires). En 1999, les usagers pris en charge pour usage de médicaments en produit primaire dans les institutions étaient en moyenne plus âgés que les autres, avec une plus forte proportion de femmes (près de 40 %) (Tableau 108). Pour ces usagers, les produits secondaires les plus fréquemment cités étaient : alcool (25 %), autres médicaments (13,5 %), opiacés (13 %) et cannabis (10 %). Tableau 108. Profil des prises en charge liées aux médicaments psychotropes et aux opiacés (en produit primaire), en 199916
En 2002, les rapports d'activité ambulatoire de 169 CSST (soit plus de Tableau 109. Pourcentages de patients pris en charge en ambulatoire dans les CSST pour usage problématique de médicaments psychotropes 1998-2002 (OFDT/DGS)
Ces données portent sur une population très sélectionnée, celles des personnes s'adressant à des structures spécialisées dans la prise en charge des toxicomanies pour un problème d'usage problématique de substances psychoactives. Elles ne permettent pas d'estimer la prévalence du mésusage des psychotropes en population générale, car on ne dispose d'aucune information sur le pourcentage des sujets présentant ce type de problème et s'adressant à ces structures. Au vu de la fréquence très élevée d'exposition aux médicaments psychotropes dans la population générale, ces estimations suggèrent toutefois qu'un nombre très restreint des usagers de ces médicaments (et de leur entourage, incluant les médecins prescripteurs) considère que l'usage de ces médicaments relève d'une « toxicomanie » et s'adresse aux structures prenant en charge ces problèmes. 2. Enquête OPPIDUM (Observation des Produits Psychotropes Illicites ou Détournés de leur Utilisation Médicamenteuse) a) Présentation de la méthode de l'étude L'Observation des Produits Psychotropes Illicites ou Détournés de leur Utilisation Médicamenteuse (OPPIDUM) est une enquête nationale d'observation et de surveillance multicentrique réalisée par les Centres d'Evaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance (CEIPs) en relation avec l'unité des stupéfiants et psychotropes de l'Afssaps. Ce programme, inspiré des systèmes de surveillance d'autres pays (SAWS -Substance Abuse Warning System en Allemagne et DAWN-Drug Abuse Warning Network aux Etats-Unis), a été mis en place dès 1990 par le CEIP de Marseille et a été adopté en 1995 par le comité technique des CEIPs pour constituer un outil de travail commun des centres. Il s'agit d'une enquête transversale réalisée de façon annuelle pendant le mois d'octobre auprès de sujets recrutés dans des structures de soins pour personnes souffrant de troubles liés à l'usage de substances. L'objectif de l'enquête est de surveiller l'évolution de la consommation des substances psychoactives par les sujets présentant une dépendance ou un abus à ces substances, et d'évaluer le potentiel d'abus et de dépendance des médicaments. Les CEIPs sont chargés de sélectionner les centres d'enquête dans leur région, de diffuser les consignes d'enquête et de regrouper les fiches à la fin des 4 semaines d'enquête. Les centres d'enquête doivent inclure tout patient présentant un trouble lié à l'usage de substances psychoactives ou sous traitement de substitution se présentant dans leur structure durant le mois étudié. Sont exclus les sujets non coopérants, incapables de répondre au questionnaire de recueil d'informations ou consommateurs exclusifs d'alcool ou de tabac. La base OPPIDUM regroupe des données sur des substances psychoactives licites ou illicites. Parmi les substances psychoactives licites, sont inclus les médicaments du système nerveux (classe ATC « N ») dont les anesthésiques (N01), les analgésiques (N02), les antiépileptiques (N03), les antiparkinsoniens (N04), les psycholeptiques (N05), les psychoanaleptiques (N06), les autres médicaments du système nerveux (N07). Sont également inclus d'autres médicaments pouvant avoir des propriétés psychoactives ou susceptibles d'être détournés (myorelaxants, antihistaminiques...). Pour chaque sujet inclus, tous les produits et médicaments consommés dans la semaine précédente sont étudiés. Chaque enquêteur recueille, lors d'un entretien avec le sujet, les données concernant tout d'abord le patient à savoir des informations socio-démographiques, des informations sur les conduites addictives (premier produit consommé, tabac, alcool) et des renseignements sur sa participation éventuelle à un programme de substitution. A chaque fiche patient, sont ensuite associées autant de fiches produits que de produits consommés. Elles renseignent sur le nom et la présentation du produit, la voie d'administration, la fréquence des prises, la quantité moyenne consommée par prise, la notion d'augmentation récente de la dose et de souffrance à l'arrêt, l'ancienneté de la consommation, le caractère solitaire ou non de la consommation, l'effet recherché, le mode d'obtention et la suspicion ou la certitude de pharmacodépendance. Les traitements médicamenteux prescrits à ces sujets sont analysés par les CEIPs, qui décident en fonction des informations indiquées dans les fiches de l'inclusion ou non des traitements dans la base OPPIDUM. En cas de doute, le produit entre dans la base, ce qui signifie qu'un médicament signalé dans OPPIDUM n'indique pas obligatoirement que ce produit fait l'objet d'un détournement d'usage. Les données, recueillies de manière totalement anonyme, sont adressées au CEIP de Marseille à la fin de l'enquête où elles font l'objet de vérification et de pré-codifications avant de faire partie de la base OPPIDUM. L'étude réalisée par San Marco et collaborateurs18 présente les résultats des six enquêtes menées à Marseille entre 1990 et 1995. Les centres ayant participé à ces enquêtes ont été l'Antenne Toxicomanies de la prison des Baumettes (recueil d'informations sur la période précédant l'incarcération), l'Association Méditéranéenne de Prévention de la Toxicomanie (AMPT), le Centre Antipoison (CAP), et l'Intersecteur de Toxicomanie (IST). Les six enquêtes ont recueilli des informations sur 1283 patients (214 sujets par enquête en moyenne) et enregistré 2241 produits. Les opiacés (héroïne, codéine, buprénorphine, méthadone et autres) ont été les plus consommés avec 53 % de consommateurs sur les six enquêtes. Les benzodiazépines arrivaient en deuxième position (21 %), les autres tranquillisants étant cités 23 fois soit 1,2 %. En considérant seulement les médicaments, le Flunitrazépam (Rohypnol®) arrivait en tête des médicaments les plus consommés, suivi par le clorazépate (Tranxène®, Noctran®), le bromazépam (Lexomil®) et le lorazépam (Témesta®) (Tableau 110). Il est à noter que 47 benzodiazépines ont été citées sans plus de précision. Un usage quotidien des produits a été rapporté par Tableau 110. Médicaments les plus consommés pendant l'étude OPPIDUM à Marseille entre 1990 et 1995
1. Néocodion® : camphosulfonate de codéine 2. Nétux® : codéine et phényltoloxamine 3. Binoctal® : Sécobarbital, Amobarbital 4. Dinacode® : Codéine, Belladone, Datura, Benzoate de sodium Tableau 111. Mode de consommation des différents produits pendant la totalité de l'étude OPPIDUM à Marseille entre 1990 et 1995
1. Données recueillies depuis la 4ème enquête 2. Données recueillies depuis la 6ème enquête Les 471 consommateurs de benzodiazépines représentaient 36 % des sujets avec 80 % d'hommes et un âge moyen de 27 ans (caractéristiques identiques à celui retrouvé pour l'ensemble des sujets inclus dans l'étude). Ils utilisaient principalement (98 %) la voie orale comme mode d'administration. Il s'agissait d'une consommation ancienne dans 74 % des cas avec une augmentation récente de la dose (depuis six mois) pour 40 % des sujets et des signes de souffrance à l'arrêt pour 63 %. Les consommateurs ont obtenu les benzodiazépines par prescription médicale dans 47 % des cas et par « deal » dans 39 %. Thirion et collaborateurs ont réalisé le même type d'étude à partir des données nationales de la neuvième enquête OPPIDUM de 199719 pour laquelle 38 centres d'enquête ont participé dont 24 CSST (Centres Spécialisés de Soins aux Toxicomanes), 2 unités de psychiatrie, 3 unités d'hospitalisation pour toxicomanes, 6 ECIMUD (Equipes de Coordinations et d'Intervention auprès des Malades Usagers de Drogues) parisiennes, 1 centre anti-poisons, 1 centre de pharmacologie clinique et 1 service d'accueil des urgences. Au total 1176 fiches ont été recueillies et 1066 ont été retenues après vérification. Sur ces fiches, 2052 produits ont été signalés soit un peu moins de 2 produits par observation en moyenne. Ils se répartissaient en 627 médicaments (31 %), 682 produits illicites (33 %), 741 produits de substitution (36 %) et 2 solvants. Les benzodiazépines, avec 323 observations était la classe la plus représentée puisqu'elle totalisait 53 % des médicaments relevés au cours de cette enquête. Parmi les benzodiazépines, cinq recouvraient à elles seules 83 % des observations (Tableau 112). Les consommateurs de benzodiazépines étaient pour 23 % également consommateurs d'héroïne et pour 11 % consommateurs de cocaïne, 34 % d'entre eux étaient sous Subutex® et 25 % sous Méthadone. Tableau 112. Répartition des principales benzodiazépines selon leur potentiel de dépendance, enquête OPPIDUM 1997
Les autres tranquillisants (60 observations) regroupaient l'Imovane® (n=21), le Stilnox® (n=19), la Mépronizine® (n=7), et l'Equanil® (n=6). Ces produits étaient suspectés d'être utilisés dans le cadre d'une pharmacodépendance dans 25 % des cas (vs 62 % pour les benzodiazépines) et étaient obtenus très rarement par « deal » ou fausse ordonnance. Les antidépresseurs (46 observations) les plus souvents cités étaient le Prozac® (n=9), le Survector® (n=7), l'Athymil® (n=6), le Deroxat® (n=6), et le Séropram® (n=5). Seul le Survector® montrait un potentiel de dépendance marqué avec une augmentation des doses et une pharmacodépendance pour plus de la moitié des observations, et une souffrance à l'arrêt 3 fois sur 4. Pour les neuroleptiques (38 observations), le Tercian® était le plus cité (n=11) mais aucun cas de pharmacodépendance n'a été signalé avec ces produits. Les benzodiazépines étaient donc les psychotropes les plus consommés, avec le Rohypnol® demeurant la molécule la plus prisée par les toxicomanes et pour laquelle le « décrochage » semble le plus difficile. Bernard et collaborateurs ont évalué le mésusage (défini ici comme une utilisation non conforme aux recommandations du résumé des caractéristiques du produit) des médicaments psychotropes utilisés seuls ou en association avec des produits illicites au niveau du CEIP de Lyon et ont comparé ces résultats aux données nationales20. Au niveau national et local, les benzodiazépines sont le produits les plus cités (Tableau 113), et 64 % des fiches produits concernant une benzodiazépine mentionnaient une suspicion ou une certitude de pharmacodépendance. Les doses utilisées étaient pour les deux niveaux supérieures à l'AMM dans 27 % des cas. Le mode d'obtention principal était autre qu'une prescription (fausse ordonnance, deal, donné, volé) dans 17 % des cas pour le CEIP de Lyon et dans 21 % des cas au niveau national, le mode d'obtention secondaire étant le deal (11 % et 9 % respectivement). Les quatre benzodiazépines les plus consommées étaient les mêmes au niveau national et local et représentaient 48 % des benzodiazépines consommées pour Lyon contre 38 % au niveau national. Le bromazépam était le plus consommé à Lyon représentant 17 % de cette famille tandis que le flunitrazépam restait le premier au niveau national (Tableau 114). Tableau 113. Répartition de consommation des médicaments psychoactifs au niveau national et local, étude OPPIDUM 1999 (CEIP de Lyon )
Tableau 114. Distribution des benzodiazépines les plus citées au niveau national et local, étude OPPIDUM 1999 (CEIP de Lyon )
Nous avons, de plus, obtenu par l'intermédiaire du Dr F. Haramburu, directrice du CEIP de Bordeaux, un rapport sur les psychotropes réalisé par Les antipsychotiques étaient, quant à eux, consommés par 8 % des sujets en 2004 (7 % en 2003). Trois quarts des signalements concernaient quatre molécules : la cyamémazine Tercian®, l'olanzapine Zyprexa®, l'amisulpride Solian® et la risperidone Risperdal®. Cette classe était cependant l'objet de peu de signalements d'abus ou de dépendance. Pour les antidépresseurs, le taux des signalements était de 9 % en 2003 et 2004 concernaient dans trois quarts des cas cinq molécules : la paroxétine Deroxat®, le citalopram Seropram®, la fluoxétine Prozac®, la venlafaxine Effexor® et la miansérine Athymil®. Cette classe faisait rarement l'objet de détournements, à l'exception de la fluoxétine (n=100), de la venlafaxine (n=73) et de la tianeptine Stablon® (n=13), cette dernière étant utilisée dans 56 % des cas à une dose supérieure à celle de l'AMM, avec 31 % de souffrance à l'arrêt. Tableau 115. Récapitulatif des données socio-demographiques et des conduites associées selon le profil de consommateurs
Tableau 116. Récapitulatif des caractéristiques de consommation selon les familles de produits
L'intérêt de cette enquête est, du fait de la spécificité de la population investiguée, d'obtenir un « effet loupe » sur les médicaments psychotropes pouvant donner lieu à détournement, abus ou dépendance. La famille des benzodiazépines représente la majorité des signalements dans les enquêtes OPPIDUM, le flunitrazépam étant la molécule qui présente les pourcentages les plus élevés selon les différents indicateurs de détournement et d'abus. De plus, l'enquête confirme les signaux retrouvés par d'autres outils des CEIPs sur le détournement du clonazépam (cf. chapitre suivant) en mettant en évidence une augmentation progressive des signalements et des données de son détournement (qui se rapprochent du clorazépate dipotassique). Après la famille des benzodiazépines, les apparentées (zopiclone et zolpidem) et le méprobamate présentent quelques signalements de détournement et d'abus. Enfin, les indicateurs montrent la rareté des détournements d'antidépresseurs ou d'antipsychotiques, à l'exception du Stablon®. La première limite de cette étude est qu'elle porte sur la population très spécifique des sujets présentant un trouble lié à l'usage de substances et suivis dans des structures spécialisées ; les résultats ne sont donc nullement généralisables à la population générale, ni même à celle de la population des sujets présentant un trouble de ce type19. De plus, l'item « suspicion ou certitude de pharmacodépendance » suppose une réponse subjective de l'enquêteur bien que celle si soit en générale bien corrélée avec les autres signes de détournement d'usage des médicaments19. Enfin, le recueil des données se faisant sur fiches totalement anonymes, certains patients peuvent être enregistrés plusieurs fois, même si cette éventualité doit être rare18. 3. Enquête Tendances récentes et nouvelles drogues (Trend) a) Présentation de la méthode de l'étude L'objectif du dispositif TREND (Tendances Récentes Et Nouvelles Drogues) mis en place en 1999 par l'OFDT, est de fournir aux décideurs, professionnels et personnes, des éléments de connaissance sur les usages et les usagers de drogues illicites ainsi que sur les phénomènes émergents qui leurs sont liés. Le dispositif TREND s'appuie sur le réseau de onze sites collectant des observations sur les personnes fréquentant les espaces urbains et festifs, espaces sociaux considérés comme innovateurs en termes de nouveaux produits et de modalités d'usage des produits. Les médicaments renseignés parmi les substances investiguées sont essentiellement les opiacés et les benzodiazépines. Un rapport réalisé par Bello et collaborateurs présente les résultats du sixième exercice annuel du dispositif TREND (réalisé en 200421). Concernant les médicaments psychotropes non opiacés, les sites ont fait état d'une consommation de Rohypnol® avec un profil type des usagers identique aux années précédentes, à savoir un sujet masculin en grande difficulté sociale, plutôt marginal, ayant un logement précaire et évoluant plutôt dans l'espace urbain que festif. En plus de ses effets « défonce », le Rohypnol® pouvait être consommé pour la désinhibition de type amnésique, qu'il provoque à haute dose, facilitant le passage à l'acte lors de vols avec prise de risques par exemple. Il était principalement consommé par voie orale ou sublinguale avec un très faible pourcentage de recours aux voies nasale et intraveineuse. Même si le Rohypnol® restait disponible sur certains sites (Paris, Marseille), le constat général du réseau des sites TREND confirmait, pour la troisième année consécutive, la diminution de sa disponibilité liée à la baisse marquée de la prescription médicale en ville depuis 2001. Ceci s'est traduit par une augmentation du prix de vente à l'unité sur le marché parallèle et par une désaffection des usagers, lui préférant d'autres produits tels que le Rivotril® plus facile d'accès et moins stigmatisant pour les consommateurs, la nouvelle forme galénique du Rohypnol® contenant en effet un colorant bleu très visible sur la langue des consommateurs. L'usage du Rivotril® ne cessait de s'accroître, probablement en lien avec le déclin du Rohypnol® , comme le suggèrent les sites de Toulouse et Paris. Pour les 2 sites, le Rivotril® se substituait au Rohypnol® à la fois dans les prescriptions de médecine de ville et comme produit de «défonce» chez les usagers de drogues. Les caractéristiques des consommateurs de Rohypnol® et de Rivotril® paraissaient cependant différentes, le site de Marseille soulignant la proportion élevée de femmes parmi les usagers du Rivotril® alors que ceux du Rohypnol® restaient en majorité des hommes. Le site de Paris indiquait que le Rivotril® intéressait des couches sociales beaucoup plus larges que le Rohypnol®. De nombreux sites signalaient en 2004 un usage détourné plus important du Valium® hors cadre médical mais sans trafic visible. Cet usage toucherait une population en grande difficulté sociale le consommant dans un but de « défonce ». Le Valium® pourrait également être utilisé de manière détournée afin de gérer la « descente » de stimulants en atténuant les effets de manque, pour produire des effets « défonce like » similaires à ceux engendrés par les opiacés, ou rechercher un effet stimulant à forte dose. Le réseau faisait état de la consommation détournée de nombreux autres médicaments, appartenant surtout à la famille des benzodiazépines dont le Lexomil®, l'Imovane®, le Xanax®, le Témesta®, le Tranxène®, le Tercian® et le Stilnox®, fréquemment utilisé en injection intraveineuse dans le but d'obtenir des effets stimulants (usage par des cocaïnomanes en rupture de cocaïne). 4. Enquête OSIAP (Ordonnances Suspectes Indicateurs d'Abus et de Pharmacodépendance) a) Présentation de la méthode de l'étude Dans le cadre de la lutte internationale contre la toxicomanie, la France a instauré un système national d'évaluation du potentiel de dépendance des substances psychoactives. L'étude des Ordonnances Suspectes Indicateurs d'Abus et de Pharmacodépendance (OSIAP) est basée sur le recueil des ordonnances falsifiées pour mettre en évidence un indicateur de potentiel de dépendance des médicaments commercialisés à partir du taux de détournement par produit. L'ensemble des CEIPs français ont participé à la constitution d'un réseau national de pharmaciens d'officine chargés de recueillir pendant deux périodes d'enquête de 4 semaines chacune (mai et novembre) toutes les ordonnances concernées. Le CEIP de Toulouse coordonne l'enquête. Les ordonnances falsifiées incluent (i) les fausses ordonnances rédigées à partir d'un ordonnancier volé ou lui-même falsifié, (ii) les ordonnances falsifiées proprement dites à savoir celles rédigées sur une ordonnance valide secondairement modifiée (par adjonction d'un médicament ne figurant pas initialement ou modification de la durée ou de la posologie du traitement), et (iii) les prescriptions manifestement anormales, ne rentrant pas dans les deux catégories précédentes (telles que les prescriptions de complaisance). Le recueil des données préserve l'anonymat du demandeur. La liste des critères de suspicion porte tout d'abord sur l'ordonnance dans son ensemble à savoir le vol, la photocopie, la surcharge, l'attitude du demandeur, le rajout de la mention « à renouveler », la rédaction non conforme à la législation, l'acte gratuit et la calligraphie suspecte. Les critères de suspicion portent également sur le médicament à savoir rajout de médicament, faute d'orthographe, surcharge sur le nom du médicament, posologie anormale ou surchargée, nombre de boites surchargé, incohérence de l'ordonnance, et ordonnance de complaisance. Le taux de détournement est défini pour un médicament comme le rapport du nombre d'ordonnances falsifiées sur les données de ventes, pondérées par le taux de sondage (nombre de pharmaciens sollicités sur le nombre de pharmacien de la région) et de participation (nombre de pharmacies ayant participé sur le nombre de pharmacies sollicitées). Une première étude pilote de faisabilité a été réalisée de septembre 1991 à juin 1993 par le CEIP de Toulouse22. L'étude a concerné entre 48 et 85 pharmacies sur les 1253 pharmacies de Midi-Pyrénées. Au total, 165 ordonnances falsifiées ont été recueillies concernant 305 spécialités différentes. Les analgésiques opiacés (38 % des prescriptions), les anxiolytiques (21 %), les hypnotiques (18 %) et les antiépileptiques (12 %) étaient les plus fréquemment impliqués. Les deux premiers médicaments étaient la buprénorphine (62 citations, 37,6 % des ordonnances) et le flunitrazépam (28 citations, 17,0 %). Le chlorazépate arrivait en quatrième position avec 17 citations (10,3 %) et le bromazépam en sixième position avec 7 citations (4,2 %). Nous avons obtenu par l'intermédiaire du Dr F. Haramburu, directrice du CEIP de Bordeaux, le rapport OSIAP 2004 réalisé par M. Lapeyre-Mestre (CEIP de Toulouse). En 2004, 1617 pharmacies ont été contactées en mai (7,9 % du nombre total des pharmacies répertoriées en France) et 1667 en novembre (8,2 %). Au total, 836 pharmacies ont répondu en mai et 791 en novembre soit respectivement un taux de réponse de 51,7 % et 47,4 %. Cette étude a recueilli un total de 517 ordonnances falsifiées. La classe la plus représentée était celle des médicaments du système nerveux central , représentant la moitié des ordonnances falsifiées, devant les médicaments du système cardio-vasculaire et des voies digestives (Tableau 117). Concernant les psychotropes, les hypnotiques et sédatifs étaient les plus cités (23,6 % des ordonnances en 2004), le pourcentage de citation des médicaments de substitution, des antidépresseurs et des antipsychotiques diminuant par rapport aux années précédentes (Tableau 118). Le médicament le plus cité était le zolpidem (Stilnox® et génériques) avec 10,4 % des ordonnances falsifiées suivi par le bromazépam (Lexomil®), la buprénorphine (Subutex®), le flunitrazépam (Rohypnol®), la zopiclone (Imovane®), une association paracétamol-codéine, le clorazépate (Tranxène®), l'alaprazolam (Xanax®) et une association paracétamol et dextropropoxyphène. Le clonazépam (Rivotril ®) arrivait en dixième position (2,1 %) et la tianeptine (Stablon®) en quinzième position. Tableau 117. Répartition des médicaments cités par classe ATC (en pourcentage du total des médicaments cités)
Tableau 118. Répartition des médicaments cités dans la classe « Système Nerveux Central » (en pourcentage d'ordonnances concernées)
L'âge moyen des sujets était de 50 ans, l'âge ne différant pas significativement entre hommes et femmes, légèrement plus nombreuses. A noter que 28,5 % des ordonnances identifiées comme suspectes étaient sécurisées. Les modifications de posologie ou de durée de prescription, écritures différentes et rajouts de médicaments restaient les motifs de suspicion les plus fréquents (Tableau 119). Une diminution de la proportion des ordonnances volées a été constatée par rapport aux années précédentes, les principaux médicaments cités sur ces ordonnances étant le Subutex®, le Rohypnol® et le Skénan® (Tableau 120). Concernant les ordonnances falsifiées, les médicaments les plus impliqués étaient les benzodiazépines avec le Stilnox® et le Rohypnol® (Tableau 121). Tableau 119. Répartition des ordonnances suspectes en fonction des critères de suspicion
Tableau 120. Spécialités citées sur les ordonnances identifiées comme volées
Tableau 121. Spécialités citées sur les ordonnances identifiées comme falsifiées
Le taux de détournement a été calculé à partir des données de remboursement de l'Assurance Maladie de la région Midi-Pyrénées. Pour le Rohypnol®, ce taux était en nette diminution en 2004, les plus élevés concernant le Skénan®, le Dicodin® et le Rivotril®. Malgré l'encadrement de l'usage de méthylphénidate, le nombre d'ordonnances dans le recueil OSIAP reste constant depuis 2002. Même si le nombre d'ordonnances suspectes notifiées dans OSIAP est réduit, l'intérêt de ce système de surveillance est de fournir des indications sur les médicaments susceptibles d'être l'objet de détournement d'usage. Les benzodiazépines sont avec les opiacés les médicaments les plus souvent identifiés, confirmant le potentiel de mésusage de ces produits. OSIAP fournit également des alertes concernant des médicaments pour lesquels les détournements d'usage augmentent, tels que le Rivotril®. Dans la moitié des cas, le médicament a été suspecté à partir d'une ordonnance sécurisée, ce qui souligne l'intérêt de ce type d'ordonnance pour repérer les falsifications. 5. Usage de médicaments psychoactifs chez l'enfant et l'adolescent (CEIP de Marseille) Une étude réalisée par Arditti et collaborateurs s'est intéressée à l'usage de produits psychoactifs licites ou illicites chez l'enfant et l'adolescent dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur23. Les observations notifiées de façon spontanée au CEIP de Marseille de 1992 à 2002 ont été colligées. Une analyse rétrospective a été effectuée sur 191 observations concernant tout enfant de moins de 12 ans et tout adolescent âgé de 12 à 15 ans utilisant des produits psychoactifs licites ou illicites, à l'exclusion des intoxications accidentelles ou des surdosages volontaires dans une conduite suicidaire. Les observations concernaient des sujets de sexe masculin dans 70 % des cas, des adolescents dans 87 % des cas et des enfants dans 13 %. Les garçons consommaient plus de solvants (86 %) que de médicaments (51 %) tandis que les produits illicites étaient consommés de façon équivalente par les deux sexes. Les médicaments étaient utilisés seuls dans la moitié des cas ou associés au cannabis ou à des boissons alcoolisées. Les benzodiazépines étaient les médicaments les plus consommés (51,6 %) avec par ordre de fréquence le Lexomil®, le Stilnox® et le Rohypnol®. La distinction entre syndrome de sevrage et syndrome de dépendance est essentielle dans la communication et l'information sur les risques liés à l'usage prolongé de médicaments psychotropes. Un syndrome de sevrage correspond aux symptômes générés par l'interruption brutale de la prise d'une substance consommée de manière régulière et prolongée, et est exclusivement liée aux propriétés pharmacologiques de la substance, indépendamment des caractéristiques psychologiques et d'environnement de l'usager. Un syndrome de dépendance traduit l'existence d'une perte de contrôle par rapport à l'usage de la substance, et ce malgré les conséquences délétères sur un plan somatique, psychologique ou social liées à l'usage de cette substance. La non distinction entre ces deux problèmes entraîne une confusion tout à fait dommageable entre les usagers au long cours de psychotropes à visée thérapeutique, pour lesquels l'arrêt du médicament peut entraîner l'apparition de symptômes indésirables, et les personnes ayant un usage toxicomaniaque de ces substances. Cette confusion entre usage de médicaments à visée thérapeutique (quelle que soit son adéquation) et usage abusif et/ou détourné est source de stigmatisation et de culpabilisation, et d'autre part, ne permet pas de différencier deux situations relevant de prises en charge différentes. À l'échelon de la population, le problème majeur généré par l'usage de médicaments psychotropes n'est pas celui de la dépendance, qui ne concerne qu'une très faible minorité d'usagers, mais celui de la prévention et du traitement d'un syndrome de sevrage chez les personnes ayant un usage prolongé de médicaments psychotropes. Autrement dit, ce problème important de santé publique pour la France trouverait en bonne part sa solution dans le respect des recommandations et des textes concernant la durée de prescription des anxiolytiques et des hypnotiques. En effet, la survenue de symptômes souvent très éprouvants lors de l'arrêt du traitement est l'un des principaux facteurs explicatifs à la réticence qu'ont les usagers (et les prescripteurs) à interrompre ce traitement. En termes de santé publique, la question prioritaire à poser est donc « comment prévenir et traiter les syndromes de sevrage ? » plutôt que « comment sortir de la dépendance ? » La meilleure mesure de prévention du syndrome de sevrage aux benzodiazépines, médicaments concernés en premier lieu, est de limiter la durée de prescription chaque fois que la situation médicale le permet. Dans les situations où l'usage est prolongé, que cette durée d'exposition soit ou non justifiée par l'état de santé de la personne, l'arrêt du traitement doit faire l'objet d'un accompagnement médical. Des stratégies permettant de prévenir ou de réduire l'intensité du syndrome de sevrage ont fait la preuve de leur efficacité. Ces stratégies reposent, si nécessaire, sur la substitution d'une molécule à demi-vie courte par une molécule à demi-vie longue (type Valium®), suivie d'une diminution très progressive des posologies quotidiennes, pouvant s'étaler sur plusieurs mois. La prévention du sevrage aux antidépresseurs repose sur les mêmes principes, en particulier la diminution très progressive des posologies. Il est donc indispensable que les prescripteurs, notamment les médecins généralistes, soient mieux informés sur l'existence de ces syndromes de sevrage (notamment aux antidépresseurs) et mieux formés à ces protocoles de sevrage. Il faut également rappeler que l'usage prolongé des psychotropes tels que les benzodiazépines peut être médicalement justifié chez patients présentant des pathologies psychiatriques sévères. Toute communication sur les risques liés à la prise au long cours des médicaments, notamment au niveau du grand public, devrait prendre en compte ces situations particulières, afin de ne pas inciter les patients à arrêter un traitement nécessaire par des messages trop généraux. Les études portant sur les populations très spécifiques des personnes prises en charge par les structures spécialisées dans les troubles liés à l'usage de substance (rapport d'activité des CSST, enquête OPPIDUM, enquête TREND), ainsi que le système de surveillance des ordonnances suspectes, fournissent des indications et des alertes sur les médicaments susceptibles de générer des usages abusifs ou détournés. Les médicaments psychotropes arrivent en tête des produits notifiés, et sont quasi-exclusivement représentés par les benzodiazépines et apparentées. Parmi les benzodiazépines, l'impact des mesures de contrôle des prescriptions influent sur les produits identifiés (par exemple, diminution de l'usage du Rohypnol®), avec toutefois un phénomène probable de substitution des produits moins accessibles par d'autres (par exemple, augmentation des usages abusifs ou détournés du Rivotril®). Les autres classes de médicaments psychotropes sont peu représentées dans les enquêtes sur les produits générant des usages abusifs ou détournés, à l'exception d'un antidépresseur, le Stablon® (pour mémoire, cette molécule est apparentée à un autre produit, le Survector®, qui a été retiré du marché, entre autres, du fait de son potentiel addictogène). A noter toutefois que l'abus ou la dépendance aux médicaments psychotropes s'inscrit quasiment toujours dans des conduites polytoxicomaniaques chez les personnes prises en charge par les structures spécialisées dans les troubles liés à l'abus de substance, et ne constitue qu'exceptionnellement un motif principal de prise en charge. Ces études sur les conduites d'abus ou de détournement d'usage des médicaments psychotropes confirment ainsi que le potentiel addictogène de ces médicaments existe essentiellement pour la classe des benzodiazépines et apparentées. Ce risque identifié chez les sujets les plus vulnérables doit être considéré comme potentiel chez toute personne faisant usage de ces substances. Même si l'on ne dispose pas d'estimation précise du pourcentage d'usagers de médicaments psychotropes, et de benzodiazépines en particulier, qui développent un usage abusif ou détourné, ces complications sont probablement rares dans le cadre d'une prescription pour des symptômes tels que des troubles du sommeil ou des manifestations anxieuses. Ce risque doit néanmoins être gardé en mémoire par les prescripteurs, et la survenue de cette complication évaluée systématiquement, afin de prendre en charge le plus rapidement possible un tel comportement addictif. Une fois encore, ce type de prise en charge ne concerne qu'une minorité d'usagers, et doit être clairement différencié de la gestion d'un sevrage aux benzodiazépines chez une personne ne présentant pas de syndrome de dépendance. 1. Organisation Mondiale de la Santé. Classification Internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement (CIM-10/ICD-10). Critères diagnostiques pour la recherche. Traduction coordonnée par CB Pull. Paris, 1994. 2. Schweizer E, Rickels K, DeMartinis N, Case G, Garcia-Espana F. The effect of personality on withdrawal severity and taper outcome in benzodiazepine patients. Psychol Med 1998;28:713-20. 3. Cadet-Taïrou A, Canarelli T. Consommation des médicaments psychotropes, état des lieux. OFDT, à paraître (2006). 4. Fatséas M, Lavie E, Denis C, Franques-Rénéric P, Tignol J, Auriacombe M. Comment sevrer de benzodiazépines des sujets dépendants des opiacés en traitement de substitution ? Analyse des données de la littérature. Presse Med 2006;35:599-606. 5. Rickels K, Schweizer E, Case G. Long-term therapeutic use of benzodiazepines : I. Effects of Abrupt Discontinuation. Arch Gen Psychiatry 1990;47:899-907. 6. Schweizer E, Rickels K, Case G. Long-term therapeutic use of benzodiazepines : II. Effects of Gradual Taper. Arch Gen Psychiatry 1990;47:908-15. 7. American Psychiatric Association. Benzodiazepine dependence, toxicity, and abuse : a task force report of the American Psychiatric Association. Washington: APA Press, 1990. 8. Lemoine P, Touchon J, Billardon M. [Comparison of 6 different methods for lorazepam withdrawal. A controlled study, hydroxyzine versus placebo]. Encephale 1997;23:290-9. 9. Rickels K, DeMartinis N, Rynn M. Pharmacologic strategies for discontinuing benzodiazepine treatment. J Clin Psychopharmacol 1999;19 suppl 2:12-16. 10. Haddad P, Lejoyeux M, Young A. Antidepressant discontinuation reactions. BMJ 1998;316:1105-6. 11. Lejoyeux M, Ades J. Antidepressant discontinuation: a review of the literature. J Clin Psychiatry 1997;58 Suppl 7:11-5; discussion 16. 12. Schatzberg AF, Haddad P, Kaplan EM, Lejoyeux M, Rosenbaum JF, Young AH, et al. Serotonin reuptake inhibitor discontinuation syndrome: a hypothetical definition. Discontinuation Consensus Panel. J Clin Psychiatry 1997;58 Suppl 7:5-10. 13. Haddad PM. Antidepressant discontinuation syndromes. Drug Saf 2001;24:183-97. 14. Medawar C, Hardon A. Medicines out of control ? Antidepressants and the conspiracy of Goodwill: Aksant Academic Publisher, 2004. 15. Palle C, Tellier S. Les usagers de drogues illicites pris en charge par le système de soins en novembre 1997. Etudes et Résultats, DREES 2000;n°59:1-8. 16. Tellier S. La prise en charge des toxicomanes dans les structures sanitaires et sociales - novembre 1999. Série Statistiques, DREES 2001;n°19. 17. Palle C, Bernard C. CSST en ambulatoire - Tableaux statistiques 1998 - 2002. Rapport d'études. OFDT, 2004. 18. San Marco JL, Jouglard J, Thirion X, Albertini F, Arditi J, Coulouvrat H, et al. [Observation of illicit or misused psychotropic drugs (OPPIDUM): five years of surveillance of products consumed by drug addicts at Marseille]. Thérapie 1996;51:586-98. 19. Thirion X, Micallef J, Guet F, Delaroziere JC, Arditti J, Huntsman A, et al. [Dependence on psychotropic drugs and substitution treatment: recent trends. The OPPIDUM study of the Centers for Evaluation and Information on Drug Dependence (CEIP), October 1997]. Thérapie 1999;54:243-9. 20. Bernard N, Bellemin B, Thirion X, Chuniaud-Louche C, Descotes J. [OPPIDUM, a tool for assessing the local misuse of psychotropic drugs?]. Thérapie 2002;57:198-201. 21. Bello PY, Toufik A, Gandilhon M, Evrard I. Phénomènes émergents liés aux drogues en 2004 - Sixième rapport national du dispositif TREND. Rapport d'Etude. OFDT, 2005:176. 22. Lapeyre-Mestre M, Damase-Michel C, Adams P, Michaud P, Montastruc JL. Falsified or forged medical prescriptions as an indicator of pharmacodependence: a pilot study. Community pharmacists of the Midi-Pyrenees. Eur J Clin Pharmacol 1997;52:37-9. 23. Arditti J, Spadari M, Camprasse MA, Dalecky C, Bourdon JH. [Abuse of licit and illicit psychoactive substances in children and teenagers in the PACA Region (Southeastern France)]. Thérapie 2004;59:595-97. VIII.- QUESTION 7. SYNTHÈSE ET PROPOSITIONS DE RECOMMANDATIONS POUR L'ACTION PUBLIQUE Reprendre et synthétiser les principales conclusions et propositions formulées dans les précédents points, de manière claire et exploitable. Fournir in fine une liste de propositions concrètes avec, pour chaque proposition, les moyens à engager (financiers, dispositions légales ou réglementaires) ainsi que les résultats attendus. Question 1 : « Quelles sont les caractéristiques et les spécificités au niveau européen de la consommation de médicaments psychotropes en France ? » La découverte des médicaments psychotropes dans la deuxième moitié du XXème siècle a révolutionné la prise en charge des troubles psychiatriques, permettant de réduire considérablement les conséquences psycho-sociales qui leur sont associées. Initialement limitées au traitement hospitalier des manifestations les plus sévères, les indications de ces médicaments ont rapidement été élargies à des troubles de moindre gravité ; leur usage s'est donc peu à peu banalisé. Comme cela a déjà été souligné dans les rapports de M. Legrain en 19901 et E. Zarifian en 19962, cette banalisation est particulièrement marquée en France, où une personne adulte sur 4 fait usage de médicaments psychotropes au moins une fois par an. La consommation de ces médicaments, notamment celle des anxiolytiques et hypnotiques, est en moyenne deux fois plus élevée en France que dans les autres pays européens, l'écart étant particulièrement flagrant avec l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Les personnes âgées sont particulièrement exposées, avec un usage le plus souvent chronique. La consommation de médicaments psychotropes concerne moins de 5 % des enfants jusqu'à l'adolescence, et augmente nettement ensuite, avec plus d'une fille sur 4 et près d'un garçon sur 5 ayant consommé des médicaments psychotropes avant l'âge de 18 ans. Au cours de la période 1990-2005, l'évolution des consommations a été caractérisée par une progression des antidépresseurs, liée à l'arrivée sur le marché de nouvelles molécules mieux tolérées et plus coûteuses, avec des indications de plus en plus larges. Les mêmes tendances sont observées pour les antipsychotiques, avec toutefois une population cible encore restreinte. La consommation des anxiolytiques et hypnotiques est restée globalement stable. Le montant remboursé par l'assurance maladie pour les médicaments psychotropes, d'environ un milliard d'euros en 2004, équivalait en 1980 à 300 millions d'euros. Bien qu'un nombre relativement important d'études et enquêtes portent sur l'usage des psychotropes en France, très peu remplissent les critères méthodologiques permettant de garantir la validité des résultats obtenus. De plus, on ne dispose pas de données fiables permettant de documenter l'évolution des consommations dans la population française. Il est donc essentiel de promouvoir la réalisation d'études pharmaco-épidémiologiques évaluant l'usage des psychotropes chez des sujets représentatifs de la population française, et son évolution dans le temps. L'accès aux données des caisses d'assurance maladie pour la réalisation de telles études pharmaco-épidémiologiques contribuerait notablement à améliorer le niveau de connaissance sur l'usage des psychotropes en France. Ces informations sont indispensables pour évaluer l'impact de mesures visant à modifier l'usage des psychotropes en France. Question 2 : « Quels sont les principaux facteurs explicatifs de cette évolution ?» Avant les facteurs explicatifs, difficiles à mettre en évidence, il convient de mentionner les facteurs n'expliquant pas le niveau de prescription des médicaments psychotropes particulièrement élevé en France par rapport aux autres pays européens. La variable juridique ne saurait expliquer les disparités de consommation au sein des états membres de l'Union Européenne : le cadre réglementaire de prescription des psychotropes est identique dans l'ensemble de ces pays et l'encadrement des activités promotionnelles des laboratoires peut y être considéré comme comparable. L'écart avec les autres pays européens ne peut pas, non plus, être expliqué par des modes différents de remboursement : ainsi, la France dépense deux fois plus que l'Allemagne pour les benzodiazépines alors que le panier de produits disponibles et remboursés est similaire dans les deux pays. De même, il serait inexact de lier le différentiel de consommation français à la seule efficacité d'une pression promotionnelle induite par la recherche d'un « effet volume » : les stratégies marketing des laboratoires pharmaceutiques sont mondiales et sont peu segmentées en fonction du prix des produits. Même si la fréquence des troubles psychiatriques apparaît être plus élevée en France que dans la plupart des autres pays européens, cette caractéristique est également un critère peu pertinent pour expliquer le niveau français de consommation de psychotropes : ainsi, la fréquence des troubles psychiatriques aux Pays-Bas est proche de celle de la France, alors que la consommation de psychotropes dans ce pays est une des plus faibles d'Europe. Enfin, la prescription ne s'adressant pas spécifiquement aux populations les plus démunies, le niveau élevé de prescription n'est pas explicable par une gestion médicale de la crise de l'emploi ou de la précarité. Les pratiques de prescription des psychotropes en médecine générale, où sont prescrits 80 % de ces médicaments, jouent un rôle probable sur leur niveau d'utilisation. Les médecins généralistes assurent la prise en charge de troubles psychiatriques avérés, mais une part importante de leurs prescriptions visent également à réduire, hors d'un cadre diagnostique précis, « la souffrance psychique » liée à des événements de vie, ou aux difficultés et conflits professionnels et familiaux. A clientèle égale, la prescription des médecins généralistes croît avec l'ancienneté professionnelle ; la prescription et le renouvellement de médicaments psychotropes permettant probablement aux praticiens de bénéficier d'un gain de temps par rapport à une approche basée sur le conseil ou la psychothérapie de soutien, ou à la gestion d'un sevrage. Les facteurs explicatifs du niveau de consommation des médicaments psychotropes en France paraissent relever de la conjonction de multiples facteurs qui, considérés isolément, ont probablement une contribution modeste, mais dont la sommation, dans le contexte de régulation trop passive qui caractérise notre pays, peut générer l'excès observé : consommation de médicaments globalement élevée ; paiement à l'acte favorisant la prescription de médicaments, plus économe en temps qu'une autre approche, pour des symptômes psychiatriques atténués ou des difficultés existentielles ; formations médicale initiale et continue notoirement insuffisantes ou essentiellement assurée par l'industrie pharmaceutique ; diffusion et évaluation de l'application des recommandations de bonnes pratiques également insuffisantes. Question 3 : « De quelle façon ces médicaments sont-ils utilisés au regard des recommandations de bonne pratique ? » La consommation élevée des médicaments psychotropes en France n'est pas non plus explicable par une prise en charge plus adéquate des troubles psychiatriques dans notre pays par rapport à celle observée dans les autres pays européens. Ainsi, les recommandations de bonnes pratiques concernant les durées de prescription sont peu respectées : ces durées sont longues quand elles devraient être courtes, supérieures à 6 mois pour plus de trois quarts des usagers d'anxiolytiques, alors que la durée recommandée maximale est de 3 mois; et courtes quand elles devraient être longues, inférieures à un mois pour au moins une personne sur 4 traitée par antidépresseur, alors que ce traitement doit être poursuivi au moins 6 mois après la rémission de l'épisode dépressif. Les indications des traitements sont également peu respectées : la moitié des personnes consommant des antidépresseurs et plus des deux tiers de celles consommant des anxiolytiques et hypnotiques ne présentent pas de trouble psychiatrique relevant d'une indication reconnue ; inversement, moins d'une personne sur 3 souffrant de dépression en France bénéficie d'un traitement approprié. Les deux situations posent problème : - la prescription en l'absence de trouble, hormis son coût (supérieur à 250 millions d'euros par an), expose de manière injustifiée le patient aux risques liés à l'usage de ces produits ; - l'absence de prescription en présence d'un trouble psychiatrique avéré a des répercussions délétères à l'échelon individuel et collectif (rupture du cursus scolaire, perte d'emploi, altération du réseau familial et social, développement de conduites addictives, suicide...), à l'origine de coûts sociaux et financiers importants, quoique difficilement chiffrables. S'il est important de connaître l'impact en termes de bénéfice et de risque de tout médicament mis sur le marché, ceci est particulièrement crucial pour les médicaments psychotropes du fait que leur cible thérapeutique porte sur les fonctions les plus spécifiquement humaines, de par leur capacité à modifier les émotions, les activités intellectuelles et relationnelles des sujets qui en font usage. Il est, de plus, indispensable d'évaluer l'impact des psychotropes en conditions réelles d'utilisation à l'échelon de la population traitée, car du fait de l'importance de la population exposée à ces médicaments (plus du quart de la population française de plus de 65 ans, par exemple), l'impact en santé publique d'un effet adverse, même rare ou de poids modeste, peut être considérable. Or, on ne dispose actuellement en France que très peu de données de ce type. Par exemple, on ne connaît pas à l'échelon de la population française le nombre de cas d'accidents de la voie publique, de chutes ou d'altération des fonctions intellectuelles chez la personne âgée, de diabètes ou de suicides induits par ces médicaments, et donc potentiellement évitables par une utilisation plus rationnelle. Les informations sur le rapport bénéfice/risque sont essentiellement issues d'études pharmaco-épidémiologiques conduites dans des pays où les bases de données de remboursement des médicaments sont plus aisément accessibles qu'en France ; leurs résultats ne sont pas toujours extrapolables à la population française, où les modalités d'usage des médicaments psychotropes sont différentes. Il est donc indispensable de promouvoir la réalisation d'études pharmaco-épidémiologiques évaluant le rapport bénéfice/risque des médicaments psychotropes dans la population française. Si les recommandations de bonnes pratiques existantes étaient respectées par les prescripteurs, le nombre de prescriptions inappropriées de médicaments psychotropes serait notablement réduit. Il est donc essentiel d'optimiser la diffusion de ces recommandations auprès des prescripteurs et de renforcer les formations initiale et continue : le nombre d'heures consacrées à la prescription des psychotropes dans le cursus des études médicales est particulièrement restreint en France ; les futurs généralistes peuvent, de plus, valider ce cursus sans avoir jamais fait de stage en psychiatrie, alors qu'un tiers de leur clientèle présente des symptômes et plaintes psychiques. La Formation Médicale Continue reste, à de rares exceptions près, essentiellement assurée par l'industrie pharmaceutique. Un facteur limitant pour ces actions de formation est incontestablement le faible nombre d'hospitalo-universitaires en psychiatrie, pharmacologie et santé publique. Question 4. « Quelle est l'efficacité des actions engagées par les pouvoirs publics et l'assurance maladie afin de lutter contre les prescriptions inadaptées ? » L'optimisation des prescriptions de médicaments psychotropes se heurte, en France, à la complexité des systèmes de régulation et à la fragmentation des responsabilités entre de nombreuses institutions publiques. Si l'on peut identifier, à l'échelon de chaque structure, des mesures attestant de la prise en considération du fait que l'usage des psychotropes pose, dans notre pays, un problème de santé publique, ces mesures ne paraissent pas s'inscrire dans un plan d'ensemble visant à optimiser l'usage et la prescription des médicaments psychotropes en France. Cette absence de (ou cette faible) coordination ne peut que favoriser un gaspillage de ressources, tant financières qu'humaines (par exemple, multiplication de groupes d'experts et de rapports), et ne permet pas de prioriser les actions et programmes. La carence la plus flagrante concerne la quasi-absence d'évaluation de l'impact des mesures et recommandations, ou de l'utilisation des financements publics (tels que ceux accordés dans le cadre des Fonds d'Amélioration de la Qualité des Soins). L'application du « Plan pour la psychiatrie et la santé mentale 2005-2008 » pourrait également permettre d'optimiser les prescriptions or, seules quelques actions ponctuelles concernant les médicaments psychotropes sont actuellement mises en place dans ce cadre. On peut conclure qu'à ce jour, l'efficacité des quelques actions ponctuelles des pouvoirs publics et de l'assurance maladie visant à lutter contre les prescriptions inadaptées de psychotropes n'a pas été encore mesurée. Question 5 : « Quelles sont les alternatives thérapeutiques ? » Les enquêtes sur les psychothérapies dans la population française suggèrent que le nombre de recours à ces approches thérapeutiques est nettement inférieur à celui des personnes susceptibles d'en bénéficier. Or, l'offre de soins concernant les psychothérapies structurées prises en charge par les caisses d'assurance maladie va être drastiquement réduite dans les prochaines années du fait de la réduction du nombre de psychiatres en exercice. Les polémiques autour de la réglementation de la profession de psychothérapeute n'ont pas permis de dégager les conditions garantissant l'accessibilité géographique et financière à des psychothérapies réalisées par des professionnels qualifiés à hauteur des besoins, sur l'ensemble du territoire, aussi bien dans le secteur public que dans l'offre libérale. La promotion des approches psychothérapeutiques comme alternative aux médicaments psychotropes exige donc qu'une réflexion s'engage rapidement sur les moyens à mettre en œuvre pour favoriser leur développement, et sur les missions des différents professionnels de santé. Hormis le cas d'une inefficacité démontrée ou d'un risque avéré, les traitements homéopathiques et phytothérapiques représentent indiscutablement, en pratique quotidienne, une alternative thérapeutique à la prescription de médicaments psychotropes « allopathiques » chez des usagers attendant une réponse médicamenteuse à des plaintes dans la sphère psychique et comportementale. Il n'est actuellement pas possible d'estimer le nombre de sujets « évitant » le recours aux médicaments psychotropes grâce à ces alternatives. Cette information serait cependant fort utile pour évaluer l'impact d'éventuelles mesures de déremboursement de ces spécialités, avec un risque évident de report vers des médicaments psychotropes remboursés et parfois mal tolérés. Il faut souligner que l'Allemagne, qui est le pays européen avec le plus faible niveau d'usage de psychotropes, est aussi celui où la phytothérapie est la plus utilisée. Une meilleure application des règles élémentaires d'hygiène de vie doit être considérée comme une véritable alternative thérapeutique à la prescription de psychotropes, notamment pour les plaintes concernant le sommeil en l'absence de trouble psychiatrique avéré. Dans cette perspective, il convient de promouvoir une information structurée du public sur la physiologie du sommeil et sur ces règles d'hygiène de vie. Question 6 : « Comment sortir de la dépendance ? » A l'échelon de la population, le problème majeur généré par l'usage de médicaments psychotropes n'est pas celui de la dépendance, ne concernant qu'une très faible minorité d'usagers ayant un usage abusif et/ou détourné de ces substances, mais celui de la prévention et du traitement d'un syndrome de sevrage chez les personnes ayant un usage prolongé de médicaments psychotropes. L'interruption brutale du traitement chez ces sujets peut en effet entraîner l'apparition de symptômes indésirables. Confondre l'usage de médicaments psychotropes dans un cadre thérapeutique (quelle que soit son adéquation) avec un usage toxicomaniaque est source de stigmatisation et de culpabilisation, et ne permet pas de différencier deux situations relevant de prises en charge différentes. La meilleure mesure de prévention du syndrome de sevrage aux benzodiazépines est d'en limiter l'usage et la durée de prescription, chaque fois que la situation clinique le permet. Dans les situations où l'usage est prolongé, l'arrêt du traitement doit faire l'objet d'un accompagnement médical. Des stratégies permettant de prévenir ou de réduire l'intensité du syndrome de sevrage, basées en particulier sur une diminution très progressive des posologies quotidiennes, ont fait la preuve de leur efficacité. La prévention du sevrage aux antidépresseurs repose sur également sur une diminution très progressive des posologies. Il est indispensable que les prescripteurs soient mieux informés sur l'existence de ces syndromes de sevrage et mieux formés à leur prévention et leur gestion. Recommandation n° 1. Promouvoir des études sur l'épidémiologie des troubles psychiatriques et sur les médicaments psychotropes, notamment par un accès plus aisé aux bases de données de l'assurance maladie et un soutien aux chercheurs. Afin de quantifier l'impact de mesures visant à modifier l'usage des médicaments psychotropes dans la population française, des études pharmaco-épidémiologiques reposant sur une méthode rigoureuse doivent impérativement être conduites, notamment des études de cohorte basées sur un suivi de plusieurs années de personnes représentatives de la population française, visant à évaluer l'évolution des consommations. Des études pharmaco-épidémiologiques et cliniques sont également indispensables pour mieux préciser le rapport bénéfice/risque de ces médicaments dans la population française, car les résultats d'études conduites dans d'autres pays ne sont pas forcément extrapolables à cette population. Ces études doivent porter sur toutes les tranches d'âge, y compris l'enfant et l'adolescent, ainsi que sur l'ensemble des produits alléguant une action psychique, incluant les produits phytothérapiques et homéopathiques et les compléments alimentaires commercialisés dans des indications telles que troubles du sommeil, nervosité, stress. Ces études seront réalisables si les conditions suivantes sont remplies : (i) Les conditions d'accès aux bases de données de l'assurance maladie doivent impérativement être définies, afin que les informations contenues dans ces bases soient rendues rapidement accessibles à la communauté scientifique. Ainsi, la création d'une base portant sur 5 à 10 millions de sujets avec un suivi de 10 ans permettrait de documenter de manière fiable l'évolution des consommations des médicaments psychotropes dans la population française. (ii) Des financements spécifiques et récurrents doivent être disponibles, notamment dès 2007, par un appel à projet de l'Agence Nationale de la Recherche, portant exclusivement sur le thème de la santé mentale, incluant comme axes prioritaires la recherche sur l'épidémiologie des troubles psychiatriques et sur les médicaments psychotropes en conditions réelles d'utilisation. Des financements spécifiques de bourses doctorales et post-doctorales sur ce même thème doivent également être mis en place; ces appels d'offre pourraient être gérés par le Groupement d'Intérêt Scientifique en recherche clinique, épidémiologique et sociale dans le champ de la psychiatrie, qui doit donc bénéficier de financements plus conséquents. Un thème Santé Mentale doit également figurer dans le 7eme PCRD (Programme-Cadre Européen de Recherche, de Développement Technologique et de Démonstration). Recommandation n° 2. Réduire la fréquence des prescriptions inappropriées en faisant respecter les recommandations de bonnes pratiques existantes, et en luttant contre les élargissements d'indication. Les mesures visant à réduire la fréquence des prescriptions inappropriées (par excès ou par défaut) de médicaments psychotropes ne doivent pas se résumer à des réductions autoritaires et parfois arbitraires basées exclusivement sur une maîtrise comptable. Ces mesures doivent s'appuyer sur une politique d'optimisation de la qualité des soins en santé mentale, fondée notamment sur une meilleure application des recommandations de bonnes pratiques existantes. Il est tout d'abord nécessaire d'améliorer la formation des prescripteurs, notamment des médecins généralistes, par les mesures suivantes : (i) Augmenter le nombre d'heures consacrées à la prescription, notamment des psychotropes, dans la formation initiale, et rendre obligatoire un stage en psychiatrie dans le cursus médical. Cette mesure nécessite le fléchage de créations de postes hospitalo-universitaires dans les filières concernées (psychiatrie et pharmacologie). (ii) Promouvoir une Formation Médicale Continue indépendante et de qualité, en confiant aux universités la coordination et la validation de cet enseignement. (iii) Améliorer la diffusion des recommandations de bonne pratique, qui doit être placée sous la responsabilité de la Haute Autorité de Santé (HAS), avec création d'un site unique permettant d'accéder facilement à ces recommandations. La limitation des prescriptions hors indication des psychotropes suppose également la mise en place des mesures suivantes : (i) Les dispositions encadrant la promotion des laboratoires pharmaceutiques doivent être appliquées avec rigueur, notamment celles dont la transgression fait l'objet de sanctions par le Comité Economique des Produits de Santé (CEPS). (ii) Les études de suivi permettant d'évaluer le respect des indications pour les nouvelles molécules mises sur le marché, doivent être généralisées. (iii) L'impact des restrictions imposées par l'assurance maladie à la prescription des benzodiazépines et hypnotiques doit être évalué, notamment concernant la substitution de ces médicaments par les antidépresseurs ou les antipsychotiques. Recommandation n° 3. Améliorer la coordination des autorités sanitaires et des agences existantes. La France est déjà bien (trop ?) dotée en structures et de recommandations touchant au médicament. En matière de lutte contre les prescriptions inappropriées de médicaments psychotropes, se pose avant tout un problème de volonté et de coordination politiques. En clair, il n'est pas souhaitable de créer une nouvelle structure (en particulier pas de comité de coordination), mais de mieux délimiter les champs propres de chacune des administrations et agences sanitaires, dans un programme cohérent visant à l'optimisation de la régulation des médicaments psychotropes, de leur prescription et de leur utilisation, notamment quand il y a chevauchement des compétences : par exemple, optimiser la coordination des structures de pharmacovigilance et de pharmacodépendance; assurer la diffusion des recommandations de bonne pratique via un organisme unique (HAS) comme mentionné dans la Recommandation n°2 ; harmoniser la communication institutionnelle, notamment sur la distinction entre usage thérapeutique et usage abusif/détourné de médicaments psychotropes. Les politiques publiques et les moyens mis en oeuvre par les organismes sanitaires et les agences pour réguler et rationaliser l'usage des médicaments psychotropes doivent d'abord être évalués avant que de nouvelles mesures et initiatives ne soient prises. Une priorité est donc de développer et d'organiser le suivi et l'évaluation de l'impact des mesures actuelles, notamment par des études pharmaco-épidémiologiques et des enquêtes auprès des prescripteurs et des usagers. Le cadre réglementaire actuel ne nécessite pas d'être modifié, car il permet déjà d'adapter les normes de prescription et de dispensation à l'évolution des connaissances relatives aux psychotropes (mesures restrictives graduées : limitation de la durée de prescription, extension de la réglementation des stupéfiants, dispensation fractionnée, prescription restreinte). L'optimisation de l'organisation des soins en santé mentale, notamment concernant l'accès aux soins et la coordination entre professionnels de santé, passe par l'application effective du "Plan pour la psychiatrie et la santé mentale 2005-2008 », annoncé par le Ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille en février 2005. Recommandation n° 4. Favoriser l'accès aux alternatives thérapeutiques. La consommation de médicaments psychotropes doit être considérée comme un indicateur de souffrance psychique, même quand elle est inappropriée au regard des recommandations de bonnes pratiques. La réduction de la fréquence de recours à ces médicaments nécessite donc que des alternatives thérapeutiques soient disponibles pour réduire cette souffrance. Ceci implique que : (i) L'accès aux traitements psychothérapiques soit facilité, notamment par la prise en charge par l'assurance maladie des psychothérapies assurées par des psychothérapeutes autres que médecins; ceci nécessite l'élaboration de critères de conventionnement des psychothérapeutes et une nomenclature des actes de psychothérapie validée par les autorités sanitaires. L'ouverture de postes de psychologues dans le service public pourrait également permettre l'accès aux traitements psychothérapiques assurés par des professionnels autres que des médecins. Il est essentiel que le mode de rémunération des psychothérapies assurées par des médecins ou d'autres professionnels garantisse une accessibilité égale à tous les assurés, y compris aux bénéficiaires de la CMU. (ii) L'impact des baisses du taux de remboursements ou des déremboursements des spécialités pharmaceutiques allopathiques et homéopathiques soit systématiquement évalué, du fait du risque de report de prescription vers des médicaments psychotropes remboursés et parfois plus mal tolérés. Recommandation n° 5. Donner aux prescripteurs les outils pour interrompre les traitements chroniques injustifiés. Il est indispensable de développer la formation et l'information des prescripteurs (en particulier les médecins généralistes), des pharmaciens et des usagers sur les méthodes de sevrage et les aides à l'arrêt des traitements psychotropes, notamment des hypnotiques et anxiolytiques en : (i) Promouvant des mesures d'accompagnement, avec dès la prescription initiale, une information et des conseils délivrés par le prescripteur au patient sur la durée recommandée du traitement, et une réévaluation de celui-ci lors de chaque renouvellement. La mise à disposition des prescripteurs de plaquettes d'information, élaborées par une autorité sanitaire et destinées aux patients, ne pourraient que faciliter cet accompagnement. (ii) Améliorant la formation initiale et continue des prescripteurs et des pharmaciens aux protocoles de sevrage, grâce aux moyens mis en œuvre ici dans le cadre de la Recommandation n°2. (iii) Associant toute communication institutionnelle ou médiatique sur les risques liés à l'usage chronique d'un traitement psychotrope d'une information sur la nécessité de consulter un médecin avant d'interrompre le traitement. Recommandation n° 6. Appliquer les programmes de promotion de la santé mentale et informer le public sur les médicaments psychotropes et les règles d'hygiène de vie. Une évolution de la situation française vers un usage plus rationnel des médicaments psychotropes et la mise en œuvre des mesures de régulation appropriées des médicaments psychotropes ne peuvent se concevoir que dans le cadre d'une politique de santé mentale qui fait actuellement défaut, malgré les annonces et engagements des pouvoirs publics restés à ce jour lettre morte. Cette optimisation de l'usage des médicaments psychotropes en France nécessite également que le public soit mieux informé en ce qui concerne ces traitements et les règles d'hygiène de vie. Il est pour cela nécessaire de : (i) Lutter contre la communication institutionnelle et médiatique assimilant usage thérapeutique de médicaments psychotropes et conduites toxicomaniaques. (ii) Promouvoir des campagnes de prévention et d'information sur la santé mentale, notamment en appliquant le Plan Dépression préparé par la DGS et l'INPES, et en l'intégrant dans le plan européen European Alliance Against Depression. (iii) Mettre en place, des campagnes de promotion des règles d'hygiène de vie pour améliorer le sommeil (du type "les hypnotiques, c'est pas automatique"). 1. Legrain M. Rapport du groupe de réflexion sur l'utilisation des hypnotiques et tranquillisants en France. Paris: SNIP, 1990. 2. Zarifian E. Mission générale concernant la prescription et l'utilisation des médicaments psychotropes en France. Paris: Odile Jacob, 1996. Annexe 1 : Principaux acronymes et abréviations utilisés dans ce rapport Annexe 2 : Liste des Tableaux Annexe 3 : Liste des Figures Annexe 4 : Courrier au Directeur Général de la CNAM-TS et réponse concernant la réalisation d'études sur l'usage et l'impact des psychotropes Annexe 5 : ANAES. Prise en charge d'un épisode dépressif de l'adulte en ambulatoire (extraits) Annexe 6 : Afssaps. Mise au point. Le bon usage des antidépresseurs au cours de la dépression chez l'enfant et l'adolescent. Annexe 7 : Courrier adressé aux directeurs de la CNAM-TS et des institutions publiques (Afssaps, HAS, DGS, MILDT, INPES) concernant l'efficacité des actions engagées par les pouvoirs publics et l'assurance maladie afin de lutter contre les prescriptions inappropriées de psychotropes. Annexe 8 : Réponse de la DGS Annexe 9 : Réponse de l'Afssaps Annexe 10 : Les principales substances psychoactives, Edition MILDT-DGS-INPES, à paraître. Annexe 11 : Psychiatrie et santé mentale 2005-2008 section « Favoriser le bon usage des médicaments » Annexe 12 : Campagne nationale en faveur de la santé mentale : « Accepter les différences, ça vaut aussi pour les troubles psychiques » Annexe 13 : Psychothérapies et politique de santé mentale : de quelques problèmes et recommandations, Rouillon et Leguay AcBUS : Accord de Bon Usage des Soins Afssaps : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé ALD : Affection de Longue Durée AMF : Association des Maires de France ANAES : Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé AMM : Autorisation de Mise sur le Marché AMPT : Association Méditéranéenne de Prévention de la Toxicomanie ASMR : Amélioration du Service Médical Rendu (par un médicament par rapport aux alternatives thérapeutiques déjà existantes). ATC : Anatomical Therapeutical Chemical ATU : Autorisation Temporaire d'Utilisation BVA : institut de sondage Brulé Ville et Associé CANAM : Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes CAP : Centre Antipoison CCMH : Code Communautaire relatif aux Médicaments à usage Humain CCOMS : Centre collaborateur de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la formation en santé mentale CEIP : Centres d'Evaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance CEPS : Comité Economique des Produits de Santé CESAMES : Centre de Recherche Psychotropes, Santé Mentale, Société CIM : Classification Internationale des Maladies CMU : Couverture Médicale Universelle CNAM-TS : Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique CPAM : Caisse Primaire d'Assurance Maladie CREDES : Centre de Recherche, d'Etude et de Documentation en Economie de la Santé CRPV : Centres Régionaux de Pharmacovigilance CSBM : Consommation de Soins et Biens Médicaux CSP : Code de Santé Publique CSST : Centres Spécialisés de Soins aux Toxicomanes DDD : Defined Daily Dose DGS : Direction Générale de la Santé DAWN : Drug Abuse Warning Network DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales DMOS : loi sur les Diverses Mesures d'Ordre Social DREES : Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Stastistiques DSM : Manuel Diagnostique et Statistique des troubles mentaux / Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ECIMUD : Equipes de Coordinations et d'Intervention auprès des Malades Usagers de Drogues ECT : Electroconvulsivothérapie EMDR : Eye Movement Desensitization and Reprocessing EMEA : European Medicines Evaluation Agency EphMRA : European Pharmaceutical Marketing Research Association EPP : Evaluation des Pratiques Professionnelles EPPM : Etude Permanente de la Prescription Médicale ESCAPAD : Enquête Santé et Consommation au cours de l'Appel de Préparation à la Défense ESEMeD : European Study of the Epidemiology of Mental disorders ESPT : Etat de stress post-traumatique ESPAD : European School Survey on Alcohol and Other Drugs EVA : Etude sur le Vieillissement Arteriel / Epidemiology of Vascular Aging FAQS : Fonds d'Amélioration de la Qualité des Soins FDA : Food and Drug Administration FFP : Fédération Française de Psychiatrie FMC : Formation Médicale Continue FPC : Formation Professionnelle Conventionnelle FNAP-PSY : Fédération Nationale des Associations d'(ex) Patients en Psychiatrie GERS : Groupement pour l'Elaboration et la Réalisation de Statistiques GTNDO :Groupe Technique National de Définition des Objectifs de santé publique GPRD : General Practice Research Database HAS : Haute Autorité de Santé IC : Intervalle de Confiance ICADTS : International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety ICD : International Classification of Diseases (id CIM) IMAO : Inhibiteurs de la Mono-Amine Oxydase IMS : Informations Médicales Statistiques INPES : Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale IRDES : Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé ISRS : Inhibiteurs Sélectifs du Recaptage de la Sérotonine ISRSNA : Inhibiteurs Sélectifs du Recaptage de la Sérotonine et de la Noradrénaline IST : Intersecteur de Toxicomanie JAPD : Journée d'Appel de la Préparation à la Défense LEEM : Les Entreprises du Médicament LP : Libération Prolongée MILDT : Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Toxicomanies MINI :Mini International Neuropsychiatric Interview MGEN : Mutuelle Générale de l'Education Nationale MHRA : Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency MSA : Mutualité Sociale Agricole NHS : National Health System NIMH : National Institute of Mental Health OCDE : Organisation pour la Coopération et le Développement Economique OFDT : Observatoire Français des Drogues et Toxicomanie OMS : Organisation Mondiale de la Santé ONU : Organisation des Nations Unies OPPIDUM : Observation des Produits Psychotropes Illicites ou Détournés de leur Utilisation Médicamenteuse OR : Odds Ratio OSIAP : étude des Ordonnances Suspectes Indicateurs d'Abus et de Pharmacodépendance PAQUID : étude Personnes Agées QUID ? PCRD : Programme-Cadre Européen de Recherche, de Développement Technologique et de Démonstration PH : Médicaments à prescription hospitalière PIB : Produit Intérieur Brut PIH : Médicaments à prescription initiale hospitalière RCP : Résumé des Caractéristiques du Produit RH : Médicaments réservés à l'usage hospitalier RS : Médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes RMI : Revenu Minimal d'Insertion RMO : Référence Médicale Opposable rTMS : stimulation magnétique transcrânienne répétée/ repetitive Transcranial Magnetic Stimulation RU : Royaume-Uni SAWS : Substance Abuse Warning System SMPG : enquête Santé Mentale en Population Générale SMR : Service Médical Rendu (par un médicament) SOFRES : Société Française d'Etudes par Sondage SP : Médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement TAG : Trouble de l'Anxiété Généralisée TPB : Thérapie Psychodynamique Brève TCC : Thérapie Cognitive et Comportementale TDHA : Troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité TED : Trouble envahissant du développement TI : Thérapie Interpersonnelle TOC : Trouble obsessionnel compulsif TS : Tentative de Suicide TREND : Tendances Récentes et Nouvelles Drogues UNAFAM : Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux UNCAM : Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie URML : Unions Régionales de Médecins exerçant à titre Libéral VM : Visiteur Médical WMH-CIDI: World Mental Health Composite International Diagnostic Interview Tableau 1. AMM des principaux antidépresseurs commercialisés Tableau 2. Prévalence annuelle d'usage des médicaments psychotropes dans 6 pays européens (étude ESEMeD 2001-2003) Tableau 3. Prévalence de la consommation de psychotropes en France et dans l'ensemble des six pays participant à ESEMeD Tableau 4. Prévalence d'usage des hypnotiques, anxiolytiques, antidépresseurs, et neuroleptiques dans quatre pays européens entre 1993 et 1997 Tableau 5. Psychotropes utilisés dans les quatre pays européens entre 1993 et 1997 Tableau 6. Durée d'utilisation des hypnotiques, anxiolytiques et antidépresseurs, dans quatre pays européens entre 1993 et 1997 Tableau 7. Traitements psychotropes consommés au cours de la vie rapportés par les sujets inclus dans l'enquête SMPG Tableau 8. Fréquence d'association de plusieurs psychotropes rapportés par les sujets inclus dans l'enquête SMPG Tableau 9. Psychotropes consommés au cours des 6 derniers mois dans la cohorte EVA Tableau 10. Consommation de médicaments psychotropes chez les enfants de six ans du Bas-Rhin, 1990 Tableau 11. Indications des prescriptions de psychotropes à partir des questionnaires envoyés aux médecins prescripteurs d'après Levy et al Tableau 12. Usage de psychotropes par les enfants de 0 à 19 ans du nord des Pays-Bas d'après Schirm et al Tableau 13. Usage de stimulants par groupe d'âge et de sexe, nord des Pays-Bas, 1995-1999 d'après Schirm et al Tableau 14. Fréquence annuelle de remboursement des psychotropes en 2000, étude CNAM-TS Tableau 15. Nombre de remboursements par assuré de médicaments psychotropes en 2000, étude CNAM-TS Tableau 16. Taux annuel de consommateurs de psychotropes selon la classe thérapeutique, l'âge et le sexe en 2000, étude CNAM-TS Tableau 17. Proportions de patients traités au mois de décembre 2003 par les cinq antidépresseurs les plus prescrits en Midi-Pyrénées Tableau 18. Psychotropes prescrits selon l'âge des patients (Alsace, régime général d'assurance maladie, juin 2002) Tableau 19. Discipline d'exercice des médecins prescripteurs de psychotropes selon l'âge des patients (Alsace, régime général d'assurance maladie, juin 2002) Tableau 20. Classes thérapeutiques utilisées dans l'enquête CANAM 1996 Tableau 21. Répartition des prescriptions de chaque classe thérapeutique par classe d'âge dans l'enquête CANAM 1996 Tableau 22. Nombre de médicaments prescrits dans l'enquête CANAM 1996 Tableau 23. Durée de prescription dans l'enquête CANAM 1996 Tableau 24. Taux annuel (%) de consommateurs de psychotropes selon la classe thérapeutique et l'âge en 2004, enquête MGEN Tableau 25. Nombre de prescriptions d'antidépresseurs dans la dépression et part relative des principales classes d'antidépresseurs en 1997 Tableau 26. Fréquence de l'expérimentation et de l'usage récent de médicaments psychotropes chez les jeunes à la fin de l'adolescence (Source : ESCAPAD 2000) Tableau 27. Usage de médicaments psychotropes au cours de la vie, des 12 derniers mois et des 30 derniers jours à 17-18 ans (% en ligne) (Source : ESCAPAD 2003) Tableau 28. Usages de médicaments psychotropes et âge moyen d'expérimentation, à 17 ans en Ile de France et dans les autres régions françaises (ESCAPAD 2002-2003) Tableau 29. Fréquence de l'usage de médicaments psychotropes chez les jeunes scolarisés en 1993 et 1999 (ESPAD 1999) Tableau 30. Usage de tranquillisants ou somnifères (ESPAD 2003) Tableau 31. Fréquence déclarée de l'usage de tranquillisants/somnifères et d'antidépresseurs par classes d'âge (Baromètre Santé 2000) Tableau 32. Fréquence de l'usage déclaré de médicaments psychotropes parmi les 18-75 ans en 2000, par sexe et par âge (Source : Baromètre santé 2000, exploitation OFDT) Tableau 33. Pourcentages de sujets âgés de 12-25 ans ayant pris des antidépresseurs au cours des douze derniers mois Tableau 34. Organisations des systèmes de santé dans les pays de l'Union Européenne Tableau 35. Nombre de médecins généralistes et psychiatres, année disponible la plus récente Tableau 36. Part de la dépense nationale de santé dans le PIB dans les pays européens de l'OCDE en % (Source : OCDE, Eco-santé 2005) Tableau 37. Dépenses totales en produits pharmaceutiques délivrés à des patients en consultation externe (source Eco-santé OCDE 2002) Tableau 38. Consommation de médicaments en DDD/1000 habitants/jour, données CREDES Tableau 39. Evolution des ventes de psychotropes de 1990 à 1994, en milliers de boites vendues (source IMS) Tableau 40. Evolution des ventes de psychotropes de 1990 à 1994 converties en euros (source LMP :IMS) Tableau 41. Ventes d'anxiolytiques en unité fractionnée par habitant de plus de 15 ans entre 1990 et 1994 Tableau 42. Ventes d'antidépresseurs en unité fractionnée par habitant de plus de 15 ans entre 1990 et 1994 Tableau 43. Poids des différentes classes d'antidépresseurs en 1994 (en prescriptions) Tableau 44. Consommation d'antidépresseurs dans 14 pays européens en 2002 Tableau 45. Consommation d'anxiolytiques et d'hypnotiques dans 14 pays européens Tableau 46. Evolution 2001-2002 des produits référents et de leur principe actif (Source CNAM-TS) Tableau 47 . Médicaments psychotropes remboursés par le régime général au cours des années 2003 et 2004 (Métropole) Tableau 48. Ventes de médicaments psychotropes en 1999 (Source : AFSSAPS) Tableau 49. Chiffre d'affaires de ventes aux officines (en millions d'euros) Tableau 50. Unités vendues aux officines (en millions ) Tableau 51. Psychotropes parmi les 50 produits les plus vendus en officine en 2003 Tableau 52. Evolution des unités vendues des quatre principales classes de psychotropes Tableau 53. Evolution du chiffre d'affaires des quatre principales classes de psychotropes entre 1991 et 1997 (converti en euros) Tableau 54. Répartition des ventes en quantités des antidépresseurs Tableau 55. Répartition des ventes en valeurs des antidépresseurs Tableau 56. Contribution à la croissance de certains médicaments psychotropes (Source : base GERS juillet 2000, traitement DREES) Tableau 57. Prix moyen par présentation en 2001, pondéré par le chiffre d'affaires (Source : GERS, traitement DREES) Tableau 58. Dépenses par grande catégorie diagnostique (en %) (Source : CREDES) Tableau 59. Association des médicaments psychotropes aux autres spécialités pharmaceutiques (unité : ordonnance) Tableau 60. La co-prescription des médicaments psychotropes (unité : ordonnance) Tableau 61. L'activité des généralistes selon l'âge : valeurs brutes (Données annuelles 2001) Tableau 62. L'activité des généralistes selon l'âge : valeurs pondérées en fonction du nombre de clients (Données annuelles 2001) Tableau 63. Distribution des patients selon le psychotrope prescrit et le type de couverture maladie Tableau 64. Liste des psychotropes (arrêté du 22 février 1990 modifié) Tableau 65. Mentions obligatoires devant figurer sur l'ordonnance Tableau 66. Modalités de prescription et de dispensation Tableau 67. Limitation de la durée de prescription des hypnotiques et des anxiolytiques Tableau 68. Prescription et dispensation restreinte Tableau 69. Barème de taxation des frais promotionnels Tableau 70. Prévalence des troubles psychiatriques selon les critères DSM-IV dans les 6 pays européens de l'étude ESEMeD et en France d'après Lepine et al, Alonso et al Tableau 71. Troubles mentaux dans les 12 derniers mois dans six pays européens, étude ESEMeD. Tableau 72. Prévalence sur 12 mois (%) des troubles psychiatriques selon l'étude World Mental Health Surveys Tableau 73. Prévalence des troubles psychiatriques selon la CIM-10 dans la population française selon l'enquête Santé Mentale en population générale Tableau 74. Prévalence des troubles psychiatriques DSM-IV dans une population de personnes âgée d'après Ritchie et al Tableau 75. Estimation du nombre d'enfants et d'adolescents souffrant d'un trouble psychiatrique en France Tableau 76. Prévalence d'usage de psychotropes dans les 12 derniers mois en fonction des diagnostics psychiatriques DSM, étude ESEMeD Tableau 77. Prévalence des troubles psychiatriques chez les usagers d'anxiolytiques/ hypnotiques et d'antidépresseurs au cours des 12 derniers mois dans l'échantillon français ESEMeD Tableau 78. Usage de traitement à visée psychotrope sur la vie entière en fonction du diagnostic MINI chez les sujets participants à l'enquête SMPG. Tableau 79. Diagnostics psychiatriques identifiés par le MINI chez les participants à l'enquête SMPG ayant fait usage au cours de leur vie d'un traitement à visée psychotrope Tableau 80. Usage de psychotropes chez les sujets participants à l'enquête SMPG présentant un trouble de l'humeur Tableau 81. Facteurs associés au type de traitement psychotrope chez les sujets présentant un épisode dépressif majeur isolé ou récurrent chez les sujets participants à l'enquête SMPG Tableau 82. Facteurs associés au type de traitement psychotrope chez les sujets présentant un trouble dépressif récurrent, chez les sujets participants à l'enquête SMPG Tableau 83. Prise en charge médicale des personnes souffrant de dépression de 16 ans et plus, enquête CREDES 1996-1997 Tableau 84. Usage actuel de benzodiazépines (BZD) selon la présence de troubles de l'humeur ou de troubles anxieux Tableau 85. Diagnostic MINI pour les bénéficiaires de 18 à 70 ans du régime général de l'assurance maladie de Basse-Normandie traités par un ISRS Tableau 86. Probabilités appliquées dans l'analyse de décision portant sur les sujets âgés de 10 à 19 ans souffrant de dépression dans la population française Tableau 87. Probabilités appliquées dans l'analyse de décision portant sur les sujets âgés de 20 à 64 ans souffrant de dépression dans la population française Tableau 88. Probabilités appliquées dans l'analyse de décision portant sur les sujets âgés de 65 ans et plus souffrant de dépression dans la population française Tableau 89. Nombre de suicides induits par les stratégies « traitement antidépresseur » et « pas de traitement antidépresseur » chez les sujets souffrant de dépression diagnostiquée Tableau 90. Analyses de sensibilité Tableau 91. Classement des psychotropes selon leur dangerosité pour la conduite Tableau 92. Médicaments psychotropes considérés comme les plus dangereux pour la conduite automobile (classe III) Tableau 93. Prévalence des médicaments psychoactifs (seuls ou associés) dans le sang des conducteurs accidentés et des contrôles Tableau 94. Liste des spécialités psychotropes présentant un niveau de risque plus faible ou plus élevé que la majorité des spécialités de leur classe respective Tableau 95. Méta-analyse explorant les associations entre usage de psychotropes et chute (extrait du tableau réalisé par Leipzig et al) Tableau 96. Risque de chute et usage de psychotropes dans les études épidémiologiques chez des sujets non institutionnalisés. Tableau 97. Etudes de cohortes prospectives explorant l'association entre usage de benzodiazepines and déclin cognitif d'après Verdoux et al Tableau 98. RMO « Prescription des anxiolytiques et hypnotiques » Tableau 99. RMO « Prescription des antidépresseurs » Tableau 100. RMO « Prescription des neuroleptiques » Tableau 101. Médicaments homéopathiques vendus en France en 2005 Tableau 102. Différentes techniques psychothérapiques d'après l'expertise collective INSERM Tableau 103. Effets des psychothérapies Tableau 104. Critères diagnostiques du syndrome de dépendance à une substance psychoactive selon la CIM-10. Tableau 105. Critères diagnostiques du syndrome de sevrage à une substance psychoactive selon la CIM-10 Tableau 106. Syndrome de sevrage aux sédatifs et aux hypnotiques Tableau 107. Symptômes les plus fréquents dans le syndrome de sevrage aux antidépresseurs ISRS d'après P.M. Haddad Tableau 108. Profil des prises en charge liées aux médicaments psychotropes et aux opiacés (en produit primaire), en 1999 Tableau 109. Pourcentages de patients pris en charge en ambulatoire dans les CSST pour usage problématique de médicaments psychotropes 1998-2002 (OFDT/DGS) Tableau 110. Médicaments les plus consommés pendant l'étude OPPIDUM à Marseille entre 1990 et 1995 Tableau 111. Mode de consommation des différents produits pendant la totalité de l'étude OPPIDUM à Marseille entre 1990 et 1995 Tableau 112. Répartition des principales benzodiazépines selon leur potentiel de dépendance, enquête OPPIDUM 1997 Tableau 113. Répartition de consommation des médicaments psychoactifs au niveau national et local, étude OPPIDUM 1999 (CEIP de Lyon ) Tableau 114. Distribution des benzodiazépines les plus citées au niveau national et local, étude OPPIDUM 1999 (CEIP de Lyon ) Tableau 115. Récapitulatif des données sociodémographiques et des conduites associées selon le profil de consommateurs Tableau 116. Récapitulatif des caractéristiques de consommation selon les familles de produits Tableau 117. Répartition des médicaments cités par classe ATC (en pourcentage du total des médicaments cités) Tableau 118. Répartition des médicaments cités dans la classe « Système Nerveux Central » (en pourcentage d'ordonnances concernées) Tableau 119. Répartition des ordonnances suspectes en fonction des critères de suspicion Tableau 120. Spécialités citées sur les ordonnances identifiées comme volées Tableau 121. Spécialités citées sur les ordonnances identifiées comme falsifiées Figure 1. Taux standardisés de consommation d'anxiolytiques par département en 2000, étude CNAM-TS Figure 2. Taux standardisés de consommation d'hypnotiques par département en 2000, étude CNAM-TS Figure 3. Taux standardisés de consommation d'antidépresseurs par département en 2000, étude CNAM-TS Figure 4. Nombre moyen de boites d'antibiotiques prescrites par patient par les généralistes entre janvier et août 2004, étude CNAM-TS Figure 5. Nombre moyen de boites d'anxiolytiques prescrites par patient par les généralistes entre janvier et août 2004, étude CNAM-TS Figure 6. Nombre moyen de boites de statines prescrites par patient par les généralistes entre janvier et août 2004, étude CNAM-TS Figure 7. Prescriptions de méthylphénidate en 2004 Figure 8. Prescriptions d'antidépresseurs (ISRS) en 2004 Figure 9. Prescriptions de benzodiazépines en 2004 Figure 10. Prescriptions d'antipsychotiques en 2004 Figure 11. Prescriptions d'Euphytose®, Spasmine®, etc. en 2004 Figure 12. Prescriptions d'au moins un psychotrope en 2004 Figure 13. Indices de vente de boites d'hypnotiques par consommateur régulier de 30 à 90 ans, standardisés sur la structure de la consommation française par sexe et par age. Figure 14. Indices de ventes de boites d'anxiolytiques par consommateur régulier de 30 à 90 ans, standardisés sur la structure de consommation française par sexe et par age Figure 15. Indices de ventes de boites d'antidépresseurs par consommateur régulier de 30 à 90 ans, standardisés sur la structure de consommation française par sexe et par age Figure 16. Prescriptions de médicaments psychotropes et nombre d'ordonnances reçues en pharmacie (Unité : patient) Figure 17. Distribution par âge et par sexe des assurés prescrits en médicaments psychotropes (CPAM Rouen 2000-2002) Figures 18, 19, 20, 21. La prescription des classes de médicaments psychotropes selon l'âge (unité : patient - CPAM de Rouen) Figure 22. Nombre moyen de prescriptions en médicaments psychotropes par classe d'âges (CPAM Rouen, 2000-2002) Figure 23. Arbre de décision pour les sujets âgés de 65 ans et plus souffrant de dépression caractérisée Figure 24. Pictogramme présent sur les boîtes de médicaments potentiellement dangereux pour la conduite depuis 1999 Figure 25. Nouveaux pictogrammes représentant les trois niveaux de risque des médicaments pour la conduite. ANNEXE 4 : COURRIER AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CNAM-TS ET RÉPONSE CONCERNANT LA RÉALISATION D'ÉTUDES SUR L'USAGE ET L'IMPACT DES PSYCHOTROPES
ANNEXE 5 : ANAES. PRISE EN CHARGE D'UN ÉPISODE DÉPRESSIF DE L'ADULTE EN AMBULATOIRE (EXTRAITS) III.2.1. Les antidépresseurs Toutes les classes thérapeutiques ont montré leur efficacité dans l'épisode dépressif. Il n'a pas été démontré de différence d'activité statistiquement significative entre les imipraminiques et les ISRS et ISRSNA chez les patients traités en ambulatoire. Le risque d'abandon de traitement toutes causes confondues ou à cause d'un effet indésirable est plus faible sous ISRS et ISRSNA que sous imipraminiques, de manière statistiquement significative (la réduction du taux d'abandons sous ISRS et ISRSNA est d'environ 4 %). Les ISRS et ISRSNA sont donc considérés comme mieux tolérés, notamment à long terme. Le choix d'un antidépresseur repose préférentiellement sur quelques critères spécifiques : - l'utilisation thérapeutique d'effets latéraux (par exemple, recherche de sédation, d'anxiolyse, ou de stimulation) (grade C) ; - l'indication préférentielle d'une classe thérapeutique dans certaines comorbidités psychiatriques, par exemple les ISRS pour les troubles obsessionnels (grade C) ; - le respect des contre-indications (comorbidités organiques) et des risques d'interactions médicamenteuses selon les résumés des caractéristiques des produits inscrits dans le Vidal. En l'absence d'indications particulières, il est recommandé de choisir l'antidépresseur le mieux toléré, le moins dangereux en cas d'absorption massive, et le plus simple à prescrire à dose efficace (grade C). Les ISRS, ISRSNA, et autres antidépresseurs non imipraminiques non IMAO obéissent le mieux à ces exigences. (...) III.3. Stratégies thérapeutiques en ambulatoire III. 3.1. En première intention Dans l'épisode dépressif léger à modéré, les antidépresseurs et les psychothérapies sont efficaces (grade A pour les antidépresseurs, grade B pour les psychothérapies cognitivo-comportementales, grade C pour les autres psychothérapies, accord professionnel pour la psychanalyse). L'association antidépresseurs-psychothérapie n'a pas fait la preuve d'une plus grande efficacité que la psychothérapie seule dans ces formes légères à modérées (grade C). - En cas d'épisode dépressif léger, une psychothérapie est proposée en première intention, en fonction de l'accessibilité de ce type de traitement et des préférences du patient (accord professionnel) ; sinon, les antidépresseurs peuvent être proposés. - En cas d'épisode dépressif modéré, les antidépresseurs sont proposés en première intention (accord professionnel) ; l'association antidépresseurs-psychothérapie peut être proposée en cas de difficultés psycho-sociales ayant un retentissement marqué sur la vie du patient (accord professionnel). Dans l'épisode dépressif sévère, les antidépresseurs sont indispensables (grade A). L'association antidépresseurs-psychothérapie peut être proposée (grade C). Les antidépresseurs peuvent être associés aux neuroleptiques dans les formes psychotiques (accord professionnel). Les différents antidépresseurs couramment utilisés en médecine générale doivent être utilisés aux doses efficaces spécifiées pour chaque molécule. La relation entre efficacité clinique et concentration plasmatique est probable pour les imipraminiques et la venlafaxine, les données les plus solides concernant l'imipramine. Ce n'est pas démontré pour les ISRS, bien que certaines études aient montré l'intérêt d'augmenter les doses chez des patients qui présentent un épisode dépressif sévère. (...) III. 3.3. Arrêt du traitement médicamenteux L'arrêt du traitement médicamenteux d'un épisode dépressif isolé peut être discuté 6 mois à 1 an après obtention de la rémission clinique (grade A). La réduction de posologie doit se faire très progressivement, sur plusieurs mois. Toute réapparition des symptômes nécessite une reprise du traitement à pleine dose, selon les schémas indiqués précédemment. Le risque maximum de rechute se situant dans les 6 à 8 mois qui suivent l'arrêt du traitement, le patient doit être revu régulièrement durant cette période (accord professionnel). ANNEXE 6 : AFSSAPS. MISE AU POINT. LE BON USAGE DES ANTIDÉPRESSEURS AU COURS DE LA DÉPRESSION CHEZ L'ENFANT ET L'ADOLESCENT
ANNEXE 7 : COURRIER ADRESSÉ AUX DIRECTEURS DE LA CNAM-TS ET DES INSTITUTIONS PUBLIQUES (AFSSAPS, HAS, DGS, MILDT, INPES).
ANNEXE 9 : RÉPONSE DE L'AFSSAPS
ANNEXE 11 : PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE 2005-2008 SECTION « FAVORISER LE BON USAGE DES MÉDICAMENTS »
ANNEXE 12 : CAMPAGNE NATIONALE EN FAVEUR DE LA SANTÉ MENTALE : « ACCEPTER LES DIFFÉRENCES, ÇA VAUT AUSSI POUR LES TROUBLES PSYCHIQUES »
ANNEXE 13 : PSYCHOTHÉRAPIES ET POLITIQUE DE SANTÉ MENTALE : DE QUELQUES PROBLÈMES ET RECOMMANDATIONS, ROUILLON ET LEGUAY.
1 () Rapport d'information (n° 382/2005-2006) fait au nom de la Commission des affaires sociales du Sénat, sur les conditions de mise sur le marché et de suivi des médicaments, par Mmes Marie-Thérèse HERMANGE et Anne-Marie PAYET, sénatrices, annexé au procès de la séance du 8 juin 2006. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||