


| Accueil > Travaux en commission > Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire > Les comptes rendus |
M. le président Didier Migaud. Avant d’aborder l’objet essentiel de notre réunion, je veux accueillir un nouveau collègue au sein de notre commission, M. Marc Francina.
M. le président Didier Migaud. Nous accueillons maintenant les dirigeants des six grandes banques françaises : M. Georges Pauget, directeur général du Crédit agricole SA, M. Bernard Comolet, président du directoire de la Caisse nationale des Caisses d'épargne, M. Philippe Dupont, président-directeur général de la Banque fédérale des banques populaires, M. Étienne Pflimlin, président du Crédit mutuel et président du conseil de surveillance du CIC, M. Frédéric Oudéa, directeur général de la Société générale et M. Baudouin Prot, directeur général de BNP Paribas.
Messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation dans un délai très bref. La raison de cette invitation est simple : depuis le mois d’octobre, le législateur a autorisé le Gouvernement à mettre en place plusieurs dispositifs de soutien au secteur bancaire afin d'assurer le financement de l'économie française. Le Parlement doit suivre et contrôler la mise en œuvre de ces dispositifs.
À la demande des parlementaires, Mme la ministre de l'Économie a installé mardi un comité de suivi auquel le rapporteur général et moi-même siégeons, avec nos homologues du Sénat. Le gouverneur de la Banque de France, le directeur général du Trésor et le directeur du Budget nous tiennent au courant du déroulement des opérations.
Il nous a semblé qu'au moment où les médias relaient chaque jour les questions que se pose l'opinion publique sur l'état du secteur financier, sur la responsabilité des banques dans la crise financière et économique actuelle, sur la légitimité des efforts consentis en leur faveur et sur leurs contreparties, il convenait qu'un débat public ait lieu entre la représentation nationale et les responsables du secteur bancaire sans qu'aucune question soit laissée de côté.
Vos établissements de crédit ont tous bénéficié du plan de renforcement des fonds propres de la Société de prises de participation de l'État, entièrement détenue par l'État, qui a souscrit des titres de dette émis par les banques – des titres super-subordonnés, autrement dit, des quasi-fonds propres. Pour l'heure, les souscriptions totalisent 10,5 milliards d'euros, mais une deuxième tranche du même montant est ouverte jusqu'à l'été. La SPPE, elle-même financée par l'emprunt, a donc une créance sur les banques pour laquelle elle est rémunérée à hauteur d'environ 8 %.
Parallèlement, vos établissements ont pu, comme sept autres banques, se procurer de nouvelles ressources financières en dehors des marchés, grâce aux prêts consentis par la Société de financement de l'économie française, détenue pour un tiers par l'État et pour deux tiers par les banques. La SFEF se finance par l'emprunt avec la garantie de l'État et prête aux banques à environ 4 %. Ce sont 23 milliards d'euros qui ont déjà été prêtés par ce biais.
Ces sommes s'inscrivent dans une enveloppe de 360 milliards d'euros : ces montants considérables, l'existence d'un risque d'appel en garantie pour l'Etat, la charge que les emprunts de la SPPE font peser sur la dette publique sont les premières raisons pour lesquelles nous avons souhaité vous entendre aujourd'hui.
Au-delà de ces considérations « budgétaires », qui sont essentielles, je crois nécessaire d'insister sur les interrogations, voire l'incompréhension que ce plan suscite chez beaucoup de nos concitoyens. Particuliers et entreprises n'en perçoivent pas toujours les effets sur les conditions de crédit. Chacun ici, quelle que soit sa sensibilité politique, a pu le constater dans sa circonscription.
L'impression peut dominer que l'on récompense indûment la gestion désastreuse de certains groupes bancaires, en particulier les errements des activités de financement et d'investissement adossées à vos groupes. Sans être à l'origine de la crise, les banques françaises ont participé, dans leur activité d'investissement, à la recherche d'un profit très élevé à court terme ; pour cela, elles ont cautionné un système et un volume de rémunération en faveur des traders qui laisse sans voix le commun des mortels. Sans bien en comprendre le risque, elles ont investi dans des produits qui se sont révélés toxiques. Pour nos concitoyens, elles ont donc bien une part de responsabilité.
Enfin, ce plan interroge car il semble accorder un soutien sans conditions, ou à des conditions jugées insuffisantes, qu'il s'agisse de la production de crédit, de la rémunération des dirigeants, de la distribution de dividendes. Je rappelle que, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, l'État n'entre pas au capital des banques aidées. Et cela, vous le savez, ne fait pas l'unanimité au sein de la représentation nationale.
En résumé, nous sommes face à quelques paradoxes : les banques françaises sont saines, mais il faut renforcer leurs fonds propres. Elles ont besoin de fonds propres, mais elles distribuent des dividendes. Elles sont solides, mais elles se méfient les unes des autres au point de paralyser le crédit interbancaire. L'État s'endette pour leur venir en aide, mais il y gagne. Les encours de crédits augmentent, mais il faut un médiateur pour les entreprises.
J'aimerais que vous puissiez répondre à ces paradoxes et à deux questions précises : proposerez-vous une distribution de dividendes ou des rachats d'actions au titre de l'exercice 2008 et, si oui, dans quelles proportions ? Le Gouvernement vous a-t-il fixé, parmi les contreparties à l'aide de l'État, des conditions particulières concernant vos activités dans les paradis fiscaux ?
M. Georges Pauget, directeur général du Crédit agricole SA. Le Crédit agricole a bénéficié en décembre d’un concours sous forme de titres super-subordonnés à hauteur de 3 milliards d’euros, la rémunération versée à l’État étant légèrement supérieure à 8 %. Nous n’envisageons pas de bénéficier de la deuxième tranche.
S’agissant des refinancements en trésorerie réalisés par la SFEF, ils s’élèvent à 6 milliards d’euros. Il convient de rapporter ce chiffre aux 455 milliards d’encours de crédits financés par le Crédit agricole. Si cette intervention a permis un déblocage des marchés financiers et constitué un appui, en aucun cas elle n’a été une source déterminante de financement pour les établissements bancaires, qui doivent, pour assurer leurs liquidités, continuer de rechercher des dépôts auprès de leur clientèle et trouver des financements sur le marché. Le Crédit agricole s’y est employé et ne devrait rencontrer aucun problème de liquidités à plus ou moins long terme.
La croissance de 7 % des crédits à l’économie recouvre des réalités différentes, selon qu’il s’agit de réseaux urbains ou ruraux, de crédits à la consommation, à l’habitat ou aux entreprises. L’impact d’une moindre demande des crédits immobiliers n’est pas encore sensible sur les encours ; cependant, les demandes nouvelles sont en baisse de 50 % par rapport à l’an dernier.
M. Étienne Pflimlin, président du Crédit mutuel et président du conseil de surveillance du CIC. Monsieur le président, je vous remercie de nous donner l’occasion de nous exprimer.
Vous avez parlé de « légitimité ». C’est à ce titre que nous refusons de nous placer dans une situation d’opposition à la société, dont vous êtes les représentants. Nous n’avons d’autre souci que de faciliter la sortie de cette crise profonde. À cet égard, nous considérons que les initiatives publiques que vous venez d’évoquer ne sont qu’une partie des éléments qui peuvent nous y aider.
Le Crédit mutuel est une banque coopérative qui, par nature, n’est pas confrontée à des problèmes de paradis fiscaux ou de dividendes. Nous comptons 15 millions de clients, dont 850 000 entreprises, et 24 000 administrateurs. L’encours de crédit a augmenté de 8,8 %
– 9,4 % pour l’habitat, 4,5 % pour la consommation, 6,1 % pour les crédits d’équipement. Cette augmentation est remarquable si on la rapporte au taux de croissance, mais elle coïncide avec une chute de la production de l’ordre de 16 %, la baisse de 25 % de la demande de crédits immobiliers étant due au fait que les acheteurs, pour le moment, réservent leur décision.
Si le dispositif de l’État a permis de débloquer la situation en réalimentant la liquidité, les sommes restent marginales par rapport aux financements auxquels nous recourons : les fonds mis à disposition du Crédit mutuel par la SFEF représentent entre deux et trois jours de ce que nous recherchons quotidiennement sur les marchés.
Le renforcement des fonds propres ne correspondait pas à une situation de fragilité comme ce fut le cas en Angleterre, en Espagne ou en Allemagne. Il nous a permis de gagner un demi-point de ratio afin de nous aligner sur le standard, qui est d’environ 8 %. Le ratio
tier one – fonds propres de base – du groupe Crédit mutuel CIC est situé bien au-dessus, à 9,43 %. Nous n’avons pas bénéficié de conditions de faveur, puisque ces fonds propres ont été acquis à un taux oscillant entre 8,49 % et 9,66 %.
Les banques françaises n’ont pas commis les mêmes erreurs que leurs homologues étrangères, mais elles ont à subir les conséquences de la crise des subprimes, de la faillite de Lehman Brothers ou de l’affaire Madoff. Faire des banques des boucs émissaires en propageant l’idée qu’elles auraient reçu des cadeaux de l’État sans contreparties a un effet désastreux sur nos réseaux et sur nos 450 000 salariés, en contact quotidien avec nos clients. En outre, cela ne correspond pas à la réalité du terrain : les affaires dont le médiateur a été saisi représentent 0,5 ‰ des crédits que nous accordons aux entreprises, la moitié seulement méritant une intervention.
Il n’y a pas de credit crunch, mais on observe un ralentissement économique que la crise financière a incontestablement contribué à aggraver. Les difficultés sont devant nous ; nous sommes déterminés, au Crédit mutuel, à les combattre.
M. le président Didier Migaud. Envisagez-vous, comme M. Pauget, de ne pas recourir à la deuxième tranche ?
M. Étienne Pflimlin. Nos réflexions sont proches des siennes, même si nous n’avons pas pris une décision définitive.
M. Bernard Comolet, président du directoire de la Caisse nationale des Caisses d'épargne. Quelques chiffres d’abord : notre banque coopérative compte 17 caisses régionales, 26 millions de clients, 5 millions de sociétaires répartis dans 450 sociétés d’économie locale. Ses fonds propres s’élèvent à 20 milliards d’euros.
Nous avons reçu à la fin de 2008 des concours en liquidités de la SFEF à hauteur de 1,9 milliard d’euros. Il convient de rapporter ce chiffre aux 7 milliards de crédits à l’économie que nous avons dispensés en novembre et en décembre et qui se décomposent ainsi : 2,9 milliards à l’immobilier, 1,8 milliard aux collectivités locales, 1 milliard à la consommation, 800 millions aux PME, 400 millions aux professionnels et 100 millions à l’économie sociale.
Les financements en fonds propres ont permis d’augmenter le ratio tier one du groupe d’un demi-point, le portant à presque 8,5 %. Nous avons reçu une première tranche de 1,1 milliard d’euros de titres super-subordonnés et souhaitons bénéficier d’une deuxième tranche du même montant, en titres super-subordonnés ou en actions de préférence, afin de conforter nos ratios.
L’année 2008 a été l’année de la crise financière ; la crise de l’économie réelle éclatera en 2009. Par un double effet d’abaissement des notations des contreparties et d’augmentation des défaillances, il y a fort à parier que les banques auront besoin de renforcer leurs fonds propres durs dans les prochains mois.
Nous n’avons pas de clients, mais des sociétaires à qui nous versons un intérêt. Le tiers du résultat du groupe y est consacré, tandis que la moitié du résultat permet de conforter les fonds propres.
S’agissant des bonus, les deux dirigeants du groupe ont indiqué qu’ils y renonçaient au titre de l’année 2008.
M. Philippe Dupont, président-directeur général de la Banque fédérale des banques populaires. Le groupe Banque populaire a bénéficié en 2008 d’une enveloppe de 950 millions d’euros sous forme de titres super-subordonnés, ce qui lui permet d’afficher un ratio de fonds propres supérieur à 9 % au 1er janvier 2009.
Par ailleurs, les 2,1 milliards d’euros provenant de la SFEF ont contribué au développement de l’encours des crédits. Il faut toutefois rapporter ce montant aux 145 milliards que nous consacrons au financement de l’économie, répartis en 50 % de crédits aux entreprises, artisans et commerçants – soit 1,1 million de clients –, et en 50 % de crédits à l’habitat et à la consommation pour nos 6,5 millions de clients particuliers.
À travers les dix-huit banques populaires régionales, l’encours de crédit aura progressé, au 31 décembre 2008, de plus de 10 % – de 12 % pour les entreprises et de 10 % pour les particuliers –, ce qui démontre la pleine mobilisation du groupe, notamment dans son activité de proximité. Comme c’est le cas au Crédit mutuel, nos conseils d’administration ont la particularité d’être essentiellement composés de chefs d’entreprise, d’artisans, de commerçants, de personnalités représentant les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers, les unions professionnelles artisanales. Tous ces administrateurs sont naturellement très mobilisés pour que la banque régionale accompagne, avec les outils dont elle dispose – y compris des outils historiques, puisque notre création est contemporaine de celle des sociétés de protection mutuelle –, les acteurs de l’économie de proximité dans la période difficile que nous traversons.
Le groupe comprend également deux banques à caractère national, le Crédit coopératif, qui intervient dans le domaine de l’économie sociale et dont l’encours de crédit continue de progresser de façon significative, et la CASDEN Banque populaire, qui est organisée autour d’une clientèle particulière, celle des personnels de l’éducation, de la recherche et de la culture, et qui continue elle aussi d’accompagner ses sociétaires dans le financement de leurs besoins.
Comme toujours dans un tel contexte, la politique de dividendes du groupe vise à renforcer ses fonds propres. Ceux-ci s’élèvent aujourd'hui à 19 milliards d’euros, dont 15 milliards de tier one. Nous poursuivrons dans cette voie : l’essentiel de nos résultats est réinvesti. Étant un groupe coopératif, nous avons également 3,3 millions de sociétaires qui perçoivent un intérêt statutaire annuel fixé par l’assemblée générale et représentant environ 15 % des résultats.
Le groupe Banque populaire est la première banque en matière de création d’entreprises. Avec OSEO, il accorde 25 % des prêts dans ce domaine. En 2008, nous avons ainsi accompagné entre 70 000 et 80 000 créateurs d’entreprise.
Pour ce qui est de la médiation du crédit, hormis deux dossiers dont nous avons été saisis au niveau national, toutes les questions ont été traitées en proximité. L’accompagnement de nos clients s’en trouve à l’évidence facilité.
M. le président Didier Migaud. Qu’en est-il de l’ouverture de la deuxième tranche de titres super-subordonnés ?
M. Philippe Dupont. Nous avons prévu de prendre des titres super-subordonnés à durée indéterminée de manière à augmenter de 0,5 point notre ratio tier one.
M. Frédéric Oudéa, directeur général de la Société générale. Pour tenter de lever certains des paradoxes que vous avez mis en exergue, monsieur le président, je commencerai par quelques commentaires généraux.
La faillite de Lehman Brothers marque une nouvelle étape dans la crise qui a débuté durant l’été 2007 car elle soumet le système bancaire mondial à un problème de liquidité. Or c’est en général à cause de problèmes de liquidité, et non de problèmes de solvabilité, que les banques font faillite. Il faut reconnaître que, de ce point de vue, la série de mesures que les États et les banques centrales ont prises a bien amélioré les choses par rapport à octobre, même si tout n’est pas réglé.
Nous entrons dans un monde nouveau où non seulement le capital est rare et cher, mais aussi la liquidité, et ce pour un certain temps. Toute banque a besoin de liquidité pour continuer à prêter. En outre, la liquidité doit être proportionnée à la durée des prêts consentis, faute de quoi la banque s’expose au risque qui a provoqué la faillite de Northern Rock en Grande-Bretagne : le financement de crédits à quinze ans avec des crédits de court terme.
Sous cet aspect, les mesures prises par les banques centrales, les gouvernements et le gouvernement français en particulier nous ont donné du confort pour continuer à prêter à un certain rythme. Il était en effet important que nous puissions évaluer dans notre programmation financière pour 2009 les exigences de liquidité et de capital. Bien entendu, ces dispositions ne correspondent pas à 100 % de nos besoins, loin de là, mais elles constituent un complément qui nous permet de nous engager sur un taux de 4 %.
De plus, par comparaison avec d’autres économies où le marché bancaire est beaucoup plus fragilisé, le marché bancaire français fonctionne. Les ménages français sont moins endettés. Les prix de l’immobilier vont probablement baisser, mais cela n’aura pas le même impact que dans d’autres pays. Par ailleurs, le régulateur français s’est montré plus exigeant que d’autres, les banques françaises ont été plus raisonnables pour ce qui est du développement de certains types de crédit et ont adopté des modèles équilibrés.
J’en viens à la situation de la Société générale. Selon l’estimation que nous avons communiquée, nos résultats pour 2008 s’élèvent à environ 2 milliards d’euros, ce qui nous conduirait à un ratio tier one d’environ 8,5 %. Nous avons bénéficié de la première tranche de titres super-subordonnés à hauteur de 1,7 milliard d’euros, soit l’équivalent, comme pour nos concurrents, de 0,5 % du ratio de solvabilité. Il nous en coûtera 8,2 % par an. Il est vraisemblable que nous souscrirons à la deuxième tranche, mais nous ne nous sommes pas encore prononcés sur la nature de l’instrument : le choix d’actions de préférence supposerait un changement de statut assez compliqué.
Par ailleurs, la SFEF se révèle être un instrument efficace. Elle nous apporte un complément de liquidité correspondant à 25 à 30 % du besoin estimé pour 2009. Cela aussi, nous le payons : nous apportons en garantie des actifs de bonne qualité et nous acquittons l’équivalent de 50 points de base.
Le montant du dividende est voté par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition du conseil d’administration. Celui-ci établira sa proposition le 17 février, lorsqu’il arrêtera les résultats. Selon toute vraisemblance, la part principale du résultat viendra renforcer nos fonds propres. Je rappelle toutefois que les investisseurs institutionnels et les 330 000 actionnaires individuels que nous comptons en France ont eu à souffrir de la baisse des cours. Aussi nous paraît-il raisonnable de leur offrir potentiellement un dividende, même si nous donnons la priorité au renforcement des fonds propres.
M. Baudouin Prot, directeur général de BNP Paribas. Le bien-fondé du plan de soutien français ne peut se comprendre que si l’on prend la mesure de la gravité des événements qui ont affecté le secteur bancaire. La crise est fondamentalement d’origine américaine. Après la faillite de Lehman Brothers – qui résulte d’une décision américaine –, la dislocation des marchés s’est considérablement accentuée, entraînant une raréfaction de la liquidité et une augmentation très forte de son coût.
Comparé aux autres plans, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne par exemple, le plan de soutien français se distingue par son caractère mesuré pour ce qui est des montants et par le fait qu’il s’applique à des établissements qui sont restés solides dans la crise. Sa rémunération, qui correspond à des prix de marché, me semble tout à fait justifiée, qu’il s’agisse de la dette levée par la SFEF ou de la première tranche de titres super-subordonnés souscrits par la SPPE. Il a permis des résultats importants alors même qu’il intervient de façon marginale sur les fonds propres : 10,5 milliards d’euros pour l’ensemble du système bancaire français, alors que beaucoup d’établissements européens ont reçu individuellement le même montant. Avec les 18 milliards levés par la SFEF, l’effet de levier s’est révélé très efficace.
Pour ce qui est de la distribution du crédit, le contraste entre la France et les autres pays européens ou les États-Unis est frappant. À la fin du mois de novembre, les encours de crédit à l’économie française dans nos six réseaux étaient en augmentation de 9,3 %, contre 7,1 dans l’ensemble de la zone euro, 5,6 en Allemagne et 4,9 en Italie. Pour les seuls crédits aux particuliers, nous en étions à 6,6 % contre – 0,5 en l’Allemagne et 0 en l’Italie. En outre, selon un article récent du Wall Street Journal, il est clairement établi que les crédits accordés au système économique des États-Unis par les treize principales banques de ce pays sont en baisse de 1,4 % en novembre, alors que ces établissements ont reçu 125 milliards de dollars d’actions de préférence et qu’ils bénéficient d’appuis en liquidité considérables de la part de la Réserve fédérale.
L’efficacité du dispositif français, attestée par tous ces chiffres, s’explique par deux caractéristiques de notre système bancaire.
Premièrement, tout au long de ces dernières années, les banques françaises ont distribué le crédit en France de façon responsable. Cela tient à la réglementation du crédit, à l’action des régulateurs, mais aussi au professionnalisme des établissements : aucun d’entre eux n’a pratiqué les formes de crédit qui dont provoqué une crise sans précédent aux États-Unis, en Grande-Bretagne et, d’une certaine manière, en Espagne.
Deuxièmement, les banques françaises n’ont jamais recouru de façon importante à la titrisation pour revendre leurs crédits à d’autres. Les marchés de la titrisation sont définitivement fermés depuis dix-huit mois : nous ne connaissons donc pas les problèmes rencontrés ailleurs. Le financement de l’économie américaine reposant sur la titrisation à 60 %, celui de l’économie britannique à 50 %, on s’emploie dans ces pays à réintermédier via les banques – ce qui est impossible avec leurs niveaux actuels de fonds propres et de liquidité – le financement des ménages et des entreprises.
Ce sont ces traits particuliers à notre système qui expliquent la continuité de la distribution du crédit en France. En outre, notre pays n’a que six réseaux bancaires, ce qui contraste avec la fragmentation du système allemand et la dislocation du système américain. Il dispose ainsi d’établissements responsables dont le fonctionnement ne s’est pas interrompu.
Il n’est nullement question d’affirmer que tout va pour le mieux, mais je voulais rappeler ces éléments structurels.
En ce qui concerne BNP Paribas, le groupe a eu recours à la première tranche de titres super-subordonnés pour un montant de 2,55 milliards d’euros. Il souhaite bénéficier de la seconde tranche sous forme d’actions de préférence et échanger les titres de la première contre des actions de préférence, ce qui suppose l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires. La rémunération de ces actions est sensiblement supérieure à celle des titres super-subordonnés dans la mesure où le dividende n’est pas fiscalement déductible. Il s’agit pour nous d’un choix de marché : les actions de préférence renforcent le core tier one, mais elles coûtent plus cher. Le fait que la deuxième tranche permette ce choix me paraît être une bonne chose.
Les fonds propres de BNP Paribas s’élèvent aujourd'hui à 41,7 milliards d’euros. Après la deuxième tranche, le tier one dépassera les 8 %.
Je voudrais aussi évoquer l’environnement financier pour 2009. Il y a deux ans, nos six réseaux pouvaient lever de l’argent à moyen terme pour un coût de 10 ou 20 points de base. Aujourd'hui, alors que nos notations nous placent parmi les meilleures banques, nous venons de lever un emprunt sur cinq ans à 160 points de base qui a été salué comme une grande réussite ! On peut estimer à 130 ou 140 points de base le coût des 30 à 35 milliards d’euros qu’il nous faudra lever en 2009. La SFEF nous apportera un montant évalué entre 8 et 9 milliards, soit un quart de nos besoins. C’est une proportion significative, mais il faudra aller chercher les trois autres quarts dans un contexte de forte concurrence sur les marchés de la dette : compte tenu de la dette des États et de la dette garantie des banques et des entreprises, la liquidité restera une ressource coûteuse. C’est pourquoi il faut distribuer le crédit de façon responsable, en répercutant – ni plus ni moins – cette hausse de la « matière première » que constitue pour nous l’argent à moyen terme.
Pour ce qui est des chiffres de BNP Paribas, l’augmentation des crédits distribués était de 6,3 % à la fin de décembre. Elle atteignait 9 % pour les entreprises et 7,4 % – soit une stabilisation par rapport à septembre – pour les entrepreneurs individuels.
La distribution du crédit dépend de l’existence d’une demande. Au travers de son réseau et de Cetelem, BNP Paribas a une importante activité de crédit à la consommation. Nous constatons que la demande de prêts personnels décroît, de même que la demande de crédits immobiliers. Nos agences sont sur le pied de guerre pour accorder des prêts à leurs clients ou à de futurs clients mais, pour des raisons qui tiennent à l’environnement général, les ménages sont moins allants quand il s’agit d’acheter un logement ou un bien durable. C’est un élément qui pèsera sur la distribution du crédit dans les mois qui viennent.
M. le président Didier Migaud. Il peut sembler contradictoire que le volume du crédit augmente alors que la demande ralentit. Peut-être y a-t-il là un problème de fiabilité des indicateurs.
M. Gilles Carrez, rapporteur général. À partir du mois d’octobre dernier, l’État a mis en place des dispositifs de garantie par le biais de la Société de prises de participation de l’État et de la Société de financement de l’économie française. Les 10,5 milliards d’euros apportés sous forme de titres super-subordonnés ont permis aux banques d’augmenter de 0,5 % leur ratio de fonds propres. Je retiens l’appréciation positive que les intervenants ont formulée au sujet de ce dispositif. Pourtant, c’est avec une certaine surprise que nous avons appris, début janvier, que le Gouvernement mettrait sur la table une deuxième tranche de 10,5 milliards. Si MM. Oudéa et Prot ont clairement exprimé leurs intentions quant à l’utilisation de cette nouvelle possibilité, leurs confrères m’ont semblé montrer moins d’entrain. N’est-il pas malgré tout nécessaire d’augmenter encore les ratios de fonds propres, en raison de ce qui arrive aux banques étrangères, mais aussi de la dégradation probable des comptes d’entreprise ?
Quant à l’apport de la SFEF, les premiers intervenants le jugent assez marginal alors que MM. Oudéa et Prot l’estiment à un quart du besoin de liquidité de leurs établissements, ce qui n’est pas négligeable.
Si l’État perçoit une rémunération de l’ordre de 20 points de base sur ces apports – soit une recette de plus de 300 millions d’euros pour la seule année 2008, et peut-être 800 millions dans l’hypothèse où la deuxième tranche serait intégralement levée –, il ne faut pas en conclure qu’il s’enrichit en accordant sa garantie ! Son intervention doit se faire au plus près des conditions de marché et s’inscrire dans une sorte de parenthèse, d’où la question du maintien d’une politique de dividende pour ne pas décourager les actionnaires actuels et les éventuels investisseurs.
La SFEF, qui a déjà mis en place 23 milliards d’euros, doit-elle continuer à accompagner les banques à proportion de 25 ou 30 % de leurs besoins ? Ne faut-il pas s’attendre, au vu des difficultés qui se dessinent, à une amplification du recours à ces financements ?
Cela dit, le dispositif mis en place en octobre fonctionne. Il a été bien calibré et répond aux caractéristiques du système bancaire national. Il serait excessif de parler d’intervention à la marge, mais il ne s’agit pas non plus de la substitution d’un mécanisme d’État aux mécanismes habituels des banques : c’est un soutien apporté dans un moment difficile. Voilà pourquoi notre appréciation est plutôt positive.
S’agissant des contreparties demandées par l’État, la difficulté est de trouver les bons indicateurs. L’évolution des encours n’est pas satisfaisante, car leur augmentation contraste avec le fléchissement que connaissent les productions nouvelles. En outre, même si la médiation fonctionne assez bien, les entrepreneurs que nous rencontrons dans nos circonscriptions nous font part de difficultés pour obtenir des crédits.
À quels types d’indicateurs pourrions-nous avoir recours ? Serait-il possible de mettre l’accent sur les flux, en différenciant, si cela est possible, les types de crédits selon qu’il s’agit d’immobilier, de crédits aux petites entreprises, aux moyennes entreprises ou aux collectivités territoriales ?
En ce qui concerne les entreprises, est-ce que vous notez une évolution du taux de défaut des remboursements ? Aujourd’hui, les grilles d’analyse des emprunts sont élaborées en référence aux résultats de 2007. Ne faudrait-il pas les faire évoluer pour tenir compte de la dégradation prévisible de la situation des entreprises et maintenir les flux de crédit ?
Des problèmes nous ont été signalés concernant les assurances liées aux crédits, notamment pour les prêts relais. Pouvez-vous nous en dire un mot ?
Enfin, j’aimerais aborder la question des contreparties « éthiques ». Envisagez-vous de modifier votre politique de rémunération des opérateurs de marchés et, si oui, dans quel sens ? Qu’en est-il de la distribution de dividendes ? Je sais que celle-ci relève des conseils d’administration, mais j’aimerais savoir quelles seront vos orientations en ce domaine, ainsi que pour ce qui concerne la distribution d’actions gratuites, l’attribution de stock options et la part variable de la rémunération des dirigeants ?
M. Jérôme Cahuzac. Mes propos concerneront également les contreparties économiques, voire morales, de l’intervention de l’État.
En 2007, l’épargne réglementée a été décentralisée. En contrepartie, 70 % des fonds collectés devaient être mobilisés en faveur du crédit aux entreprises. Or un rapport de l’Inspection générale des finances a montré que cette part n’était que de 50 %. Depuis lors, on vous a demandé de porter cet effort à 80 %. Quelle part de l’encours du livret de développement durable et du livret d’épargne populaire est aujourd’hui consacrée à ce pour quoi ils étaient prévus, c’est-à-dire, pour l’essentiel, au financement des entreprises et du logement social ?
En ce qui concerne les prêts, on pourrait croire, à vous entendre, que le médiateur national ne sert à rien : en effet, tous vos réseaux enregistrent une augmentation significative des encours. Pourtant, tous les dirigeants d’entreprise que nous rencontrons dans nos circonscriptions nous font part des difficultés considérables qu’ils éprouvent pour obtenir des concours bancaires dont ils auraient bénéficié sans problème en temps normal. J’ai en tête un exemple précis : dans ma circonscription, deux réseaux, celui de la Société générale et celui du Crédit agricole, ont dû être fortement stimulés par le médiateur national, dont le premier objectif a été d’obtenir que les négociateurs venus de Paris fassent preuve de moins d’arrogance. Je vous pose donc la question : le médiateur national est-il vraiment nécessaire ?
Notre pays autorise depuis quelques années le recours à l’hypothèque rechargeable. Cette possibilité est-elle offerte dans vos différents réseaux et, si oui, dans quelles proportions ? Dans le cas contraire, ne pensez-vous pas qu’il serait préférable de supprimer ce dispositif ?
Selon un représentant de la Fédération bancaire française, les marges concernant les prêts aux entreprises ont été multipliées par quatre ou cinq, et par deux s’agissant des prêts aux particuliers. Confirmez-vous ces chiffres ? Comment les justifiez-vous ?
Je crains d’être en désaccord avec M. Oudéa, qui juge nécessaire de distribuer des dividendes aux actionnaires au motif que ces derniers auraient souffert. Mais soit ils ont vendu leurs actions, et la question des dividendes ne se pose plus pour eux, soit ils ne les ont pas vendues, auquel cas leurs pertes sont encore latentes : ils craignent peut-être de souffrir, mais ne souffrent pas encore. La baisse du cours ne me semble donc pas un argument suffisant pour justifier le versement de dividendes de la part d’entreprises qui bénéficient de l’argent public. Par ailleurs, je ne vois rien d’original dans la pratique consistant à affecter aux fonds propres au moins la moitié du résultat. Même en dehors des périodes de crise, le taux de distribution des dividendes est en général de l’ordre de 40 à 45 % – le cas particulier des sociétaires constituant une exception.
J’en viens aux taux super-subordonnés. Répercutez-vous sur vos clients ce loyer de 8 % réclamé par l’État et, dans l’affirmative, le faites-vous intégralement ou partiellement, de façon immédiate ou différée ? Si vous le répercutez, cela signifie que vous n’assumez pas vous-mêmes le coût de cette transition.
Je constate qu’aucun d’entre vous n’a répondu à la question du président de la Commission sur les paradis fiscaux. Je la reprends donc à mon compte : quelles sont les actions menées dans ce domaine par vos différents établissements ?
Ma dernière question sera inspirée par de récents propos de Jacques Attali, selon lequel les choses commenceraient à aller mieux quand le métier de banquier redeviendrait ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être : terne et ennuyeux. Estimez-vous que vous devez désormais effectuer un métier terne et ennuyeux ?
M. Michel Bouvard. S’agissant des ressources dont vous disposez, nous avons évoqué la question des encours de prêts et celle de l’évolution des flux. Dans ce domaine, le deuxième trimestre est sans doute le plus significatif. Mais comment ont évolué les dépôts, notamment au cours des six derniers mois ? Lorsqu’ils craignent pour l’avenir, nos concitoyens ont en effet souvent le réflexe d’épargner. Par ailleurs, on sait que la baisse des prêts interbancaires a eu un effet important sur l’aggravation de la crise. Observez-vous une reprise des mouvements en ce domaine, qui serait le signe d’un retour progressif à la normale ?
L’État a mis certaines ressources à disposition des réseaux bancaires français, non seulement au travers de la SFEF et de la SPPE, mais aussi avec le redéploiement, à hauteur de 17 milliards d’euros, d’une partie des disponibilités du livret de développement durable et du livret d’épargne populaire. Comment ces sommes ont-elles été utilisées ? Ont-elles été distribuées sous forme de prêts ?
L’État a également sollicité les réseaux bancaires pour soutenir l’économie française. Deux adjudications ont ainsi été lancées, dont l’une destinée à faciliter la mise en œuvre de prêts pour financer le rachat de logements en VEFA – vente en l’état de futur achèvement –, afin de stimuler le marché de l’immobilier et le secteur du bâtiment. Or le réseau bancaire a répondu faiblement à cette adjudication. Pour quelle raison ? Les conditions n’étaient-elles pas intéressantes ? Il convient d’avoir un discours transparent sur les mécanismes mis en œuvre dans la crise financière et sur le rôle que peut jouer le réseau bancaire national, à sa mesure, pour en amortir les effets.
De même, tous les réseaux bancaires n’ont pas souscrit à la deuxième adjudication, par laquelle une partie des ressources du livret A, à hauteur de 2,5 milliards d’euros, devait être mobilisée pour favoriser l’octroi de prêts aux collectivités territoriales. Plus significatif encore, les prêts ont été faiblement consommés. A-t-on surestimé le problème du financement des collectivités, ou considérez-vous que ce problème concerne plutôt les réseaux spécialisés – à l’exception des Caisses d’épargnes, plutôt actives dans ce secteur ?
Je m’interroge également sur deux sujets qui sont à la limite des sollicitations de l’État et d’un problème structurel de financement de l’économie.
Le premier concerne le financement des exportations. De grands chefs d’entreprise – je pense notamment à Louis Gallois, président d’EADS et d’Airbus – ont en effet fait part des difficultés éprouvées par leurs clients pour trouver la ressource financière nécessaire à l’acquisition de certaines productions. Le problème se pose même pour les prêts bénéficiant d’une garantie de la COFACE. Ainsi, alors que la situation s’améliore pour ce qui concerne les prêts aux PME, les problèmes demeurent pour les grandes entreprises, ce qui paraît curieux.
Le deuxième dossier est celui du financement du consortium des électro-intensifs. On s’interroge lorsque l’on voit que les plus grands industriels du pays peinent à lever 3,2 milliards d’euros pour financer leur apport dans un projet électronucléaire. C’est pourtant à cette condition qu’ils pourront, dans les années à venir, bénéficier d’un approvisionnement énergétique à un prix raisonnable. S’agit-il d’un problème de liquidité causé par l’ampleur de la demande ? Nous attendons des éclaircissements sur ce point.
Enfin, on observe un mouvement de reflux s’agissant de l’ouverture de lignes de trésorerie au bénéfice des PME. Quelle est l’attitude de vos différents réseaux sur ce sujet – ne serait-ce que sur la reconduction de ces lignes ?
M. Jean-Pierre Brard. Tout ce que nous avons entendu est fort intéressant, mais je constate que M. Pflimlin est le seul à avoir évoqué la perception du métier de banquier par l’opinion publique. Or, en ce domaine, la défiance est totale. Vous avez tenu des propos rassurants, que je pourrais résumer ainsi : non seulement les choses ne vont pas si mal, mais à la limite, vous n’aviez pas besoin des aides de l’État puisque, comparées aux fonds dont vous disposiez, celles-ci représentent une part « marginale ». Je ne sais pas encore quoi penser de ces affirmations, mais je sais que nos concitoyens, à tort ou à raison, ne les jugeront pas crédibles. Si c’est à tort, c’est que vous n’avez pas été convaincants ; si c’est à raison, un problème se pose.
D’après les courriers que nous recevons de la part d’organisations professionnelles, si certaines facilités sont accordées en matière de découvert, il n’en est pas de même pour les crédits de trésorerie. Cela signifie que les ressources les plus chères sont aussi les plus disponibles, et inversement. Autrement dit, les banques continueraient d’agir pour elles-mêmes plutôt que pour faire fonctionner l’économie nationale. Cette conception du rôle des banques n’est-elle pas celle dont la crise a révélé la faillite ? Comme l’exprime une de ces organisations professionnelles, les banques demeurent des entreprises classiques dont la mission première est de générer de la rentabilité. Mais la fonction d’une banque n’est-elle pas également de contribuer à la solidité de l’économie nationale – à condition de ne pas perdre de l’argent, bien entendu ? J’aimerais connaître votre avis sur ce point.
L’État vous prête de l’argent, que ce soit pour la recapitalisation ou pour le financement de l’économie. Or je suis de ceux – cela vous semblera peut-être bizarre – qui jugent usuraire, anti-économique, le taux qu’il pratique à cette occasion. Cela prouve que le Gouvernement, pas plus qu’une partie des banquiers, n’a compris grand-chose à la crise. Nous devons sortir de la sphère strictement financière et réfléchir à partir de critères renvoyant aux idées fondamentales de l’économie politique.
Comme mes collègues, j’aimerais revenir sur la question des paradis fiscaux. Cette audition est ouverte à la presse, et nous sommes donc observés. C’est pourquoi il faut des réponses claires, dénuées de langue de bois, sous peine d’aggraver encore plus le climat de défiance qui règne actuellement. Le Président de la République a d’ailleurs eu, sur ce sujet, des propos très forts – même s’ils ne m’ont guère convaincu. Allez-vous mettre un terme à l’activité de vos filiales situées dans des paradis fiscaux, lorsque celles-ci existent ? Demanderez-vous aux établissements dont vous avez la responsabilité de coopérer sans réserve avec les services fiscaux des pays démocratiques ? Par ailleurs, êtes-vous favorables à l’idée de plafonner, par voie législative, les salaires et avantages annexes dont bénéficient les dirigeants de banques faisant appel aux subsides de l’État ? Ne pensez-vous pas, comme les Allemands, que ces établissements devraient renoncer à la distribution de dividendes pendant la période où ils bénéficient d’un soutien ? Plusieurs d’entre vous ont assuré qu’ils seraient plus modérés que d’habitude mais, faute d’une plus grande précision, je ne suis guère rassuré.
Vous êtes presque tous membres du MEDEF. Je souhaiterais donc savoir quelle efficacité vous attribuez aux règles de déontologie édictées par Mme Parisot à l’usage des grandes sociétés.
Certains d’entre vous ont été les victimes collatérales de l’organisation Madoff. Par simple curiosité, j’aimerais savoir comment des banquiers aussi expérimentés et compétents ont pu être séduits par des promesses de rentabilité aussi éloignées des réalités économiques.
Dernière question : en raison de la chute de la valeur des actions qu’ils subissent, certains de vos réseaux ne sont-ils pas devenus « opéables » ?
M. Nicolas Perruchot. En écoutant notre collègue Jean-Pierre Brard, j’avais presque l’impression de me trouver dans le cadre d’une commission d’enquête parlementaire plutôt que d’assister à la simple audition des présidents des six grandes banques ayant bénéficié des subsides de l’État. Peut-être que l’heure viendra où une telle commission d’enquête sera réunie, mais il ne serait pas souhaitable que l’on en arrive là.
Dans nos permanences, nous sommes de plus en plus souvent sollicités pour la préparation de dossiers destinés aux médiateurs locaux. Le dispositif de médiation est intéressant parce qu’il permet de résoudre en partie les difficultés en matière d’accès aux prêts. Mais ces difficultés sont souvent liées aux comportements particuliers adoptés dans certaines agences bancaires. À ce sujet, j’aimerais savoir comment l’information relative aux règles de gouvernance est transmise à destination de celles et ceux qui, in fine, assument la décision à l’égard du client.
Parmi les secteurs qui font l’objet d’inquiétudes, le commerce de détail, l’agriculture et l’intérim semblent particulièrement touchés. Mais les indicateurs dont nous disposons en ce domaine ne sont guère fiables. Ces difficultés sectorielles sont-elles observées dans vos établissements ? Si c’est le cas, avez-vous mis en place des dispositions correctrices ?
Autre source d’inquiétudes : les collectivités locales. Non seulement de nombreux élus ne parviennent pas à financer leurs projets, mais ils sont confrontés à un durcissement des conditions de prêt : soit la durée du crédit est allongée, soit le taux est augmenté. Alors que les collectivités locales représentent les trois quarts de l’investissement public, et qu’elles constituent un partenaire important du plan de relance, y a-t-il de votre part une volonté de restreindre leur accès au crédit ?
Au moment précis où l’État apportait son soutien pour aider les banques à traverser la crise boursière, vos réseaux ont lancé d’importantes campagnes de publicité, notamment à la télévision. Dans les cafés du commerce, on a vite fait le lien entre les deux phénomènes. Il convient de rassurer la population. Ces campagnes ont-elles porté leurs fruits ? Prévoyez-vous d’en lancer de nouvelles ? Pensez-vous qu’il soit nécessaire de communiquer autrement dans les mois à venir ?
Des questions se posent sur l’avenir des montages dits « LBO » – leverage buy out –, dont vous êtes parfois les financeurs ou les partenaires. Ces opérations ont pourtant permis à certaines PME, parfois très innovantes, de bénéficier d’un important effet de levier. Allez-vous continuer à les soutenir ? Est-ce la fin des LBO ?
J’en viens aux contreparties dont l’aide de l’État était assortie. D’après les informations dont vous disposez, pensez-vous que l’objectif d’augmenter de 3,5 % en moyenne les crédits à l’économie sera atteint ? De même, l’engagement de consacrer 7 milliards d’euros aux crédits à l’exportation sera-t-il tenu ?
Les membres de la Commission sont partagés sur l’idée qu’en pleine période de crise, des entreprises ayant bénéficié de l’aide de l’État puissent s’apprêter à distribuer des dividendes. Pouvez-vous nous expliquer clairement, à nous qui ne sommes pas des spécialistes, en quoi le versement de ces dividendes pourrait se révéler utile dans le contexte actuel ?
M. Baudoin Prot. Faut-il ou non continuer à augmenter nos ratios de fonds propres ? Cette question, monsieur Carrez, est fondamentale. Je suis pour ma part parfaitement d’accord avec Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale européenne, qui, au sommet de Davos, a estimé qu’il fallait mettre un terme à la surenchère. De grâce, que le marché cesse d’exiger des banques qu’elles augmentent sans cesse leur ratio de fonds propres ! Cela risque de provoquer un credit crunch et de déboucher sur une très grave crise. On ne peut demander aux banques à la fois d’accorder davantage de crédits et d’augmenter leur ratio de fonds propres !
Cela est d’autant plus important que, depuis un an, a été mis en place un nouveau dispositif de réglementation du système financier international, appelé Bâle II, dont la grande caractéristique est de provoquer mécaniquement, chaque fois que la santé d’une entreprise se détériore – et dans une crise comme celle que nous traversons, tout le tissu économique va se détériorer –, l’augmentation des fonds propres de l’établissement bancaire créditeur. C’est un cercle sans fin : pour distribuer le même montant de crédits à un tissu économique qui va souffrir, il faudra toujours davantage de fonds propres ! Si le régulateur et le marché s’engagent dans une surenchère en matière de fonds propres, la distribution de crédits va devenir problématique. Je pense pour ma part qu’il serait bon de suspendre quelque temps les éléments les plus procycliques de Bâle II – ou, tout au moins, de ne pas en rajouter.
S’agissant des prêts-relais, la Fédération bancaire française a pris le 21 octobre dernier l’engagement qu’ils seraient tous revus au cas par cas. Pour BNP Paribas, leur nombre s’élève à 9 000, ce qui n’est pas considérable : il est possible de les traiter au cas par cas, à l’échelle humaine.
Monsieur Cahuzac, permettez-moi de vous dire que votre démonstration sur le médiateur relève du sophisme. Ramenons les choses à leur juste proportion : le médiateur est saisi de 350 dossiers par semaine – sachant que nous comptons plusieurs millions de clients. Nous ne prétendons pas n’avoir aucun défaut ! À travers les banques, c’est en réalité un programme de soutien à l’économie qui a été déployé. Pour le mettre en œuvre, une sorte de partenariat entre la Fédération bancaire française et les pouvoirs publics a été établi. Dans cette période difficile, le médiateur instaure pour certains dossiers une sorte de droit d’appel, qui est le bienvenu puisque, une fois sur deux environ, la décision est corrigée. La proportion est raisonnable : si la décision n’était jamais révisée, on dirait que le médiateur ne sert à rien ; si elle l’était toujours, on en conclurait que les banques font très mal leur travail. C’est donc l’indice que la procédure est efficace.
Quel autre pays peut se targuer de posséder un système de médiation qui, deux mois après sa mise en place, fonctionne parfaitement, avec quelque 2 000 dossiers traités et des centaines qui ont trouvé une solution ? C’est bien que le médiateur a trouvé dans les réseaux bancaires des partenaires efficaces.
Monsieur Cahuzac, vous avez cité les propos d’un membre de la Fédération bancaire française, selon lesquels les marges des prêts aux entreprises auraient été multipliées par quatre ou cinq et celles des prêts aux particuliers par deux. Bien évidemment, ce n’est pas le cas. En revanche, nous avons changé de monde : autrefois, BNP Paribas empruntait à cinq ans à 20 points de base ; désormais, le taux est de 160 points de base, soit huit fois plus ! Il faut bien répercuter le coût de la matière première bancaire – même si, suivant l’établissement, nous le faisons différemment.
D’ailleurs, nos profits ont sensiblement diminué. Pour BNP Paribas, ils s’élèvent à 3 milliards d’euros pour 2008, ce qui représente une baisse de 60 % par rapport à l’année précédente. Si nous avions augmenté les marges, cela se verrait ! Pour nous aussi, la conjoncture est difficile et, en 2009, le coût du risque sera important. De même, cela fait plusieurs années que les tarifs des services bancaires évoluent très sagement.
Nos banques sont-elles « opéables » ? Pour l’éviter, monsieur Brard, il faut que leur rentabilité ne soit pas plus faible que dans d’autres pays. Si l’on veut des banques françaises solides, et qui restent françaises, il faut accepter qu’elles soient rentables – ce qui, de surcroît, n’est pas un désagrément.
Par ailleurs, le taux de distribution des dividendes est de la responsabilité des conseils d’administration. Je ne doute pas que, pour le fixer, ceux-ci tiendront compte des caractéristiques de l’époque et de l’existence du plan de soutien. Toutefois, il faut continuer à distribuer des dividendes, même mesurés, car il est essentiel que les banques françaises continuent à bénéficier de la confiance de leurs actionnaires privés et, en cas de nécessité, qu’elles puissent leur faire appel pour une augmentation de leurs fonds propres. Cela est indispensable si l’on veut que le système mis en place reste transitoire.
À vous en croire, monsieur Cahuzac, tant qu’une action n’est pas vendue, il n’y a pas de perte. Facile à dire ! Lorsque nos actionnaires, en consultant le relevé de leur portefeuille, découvrent que les cours des actions bancaires ont chuté de 50 à 60 %, soit la plus forte baisse sur un an depuis 1931, c’est tout de même marquant ! Parmi eux, on compte des centaines de milliers d’actionnaires individuels, notamment via les SICAV et les OPCVM. Si, de surcroît, nous ne versions aucun dividende, ce serait le signal que nous n’avons plus aucune confiance dans la capacité bénéficiaire de nos entreprises. Je précise qu’en ce qui concerne BNP Paribas, 92 % de nos salariés sont actionnaires de l’entreprise et qu’une grande partie de leur patrimoine dépend du cours de l’action. Eux aussi souffrent de la conjoncture : le dividende leur est aussi destiné.
M. le président Didier Migaud. S’agissant des paradis fiscaux, voulez-vous dire quelque chose ?
M. Baudoin Prot. Tout d’abord, cette question n’a jamais été abordée par les pouvoirs publics dans le cadre des contreparties exigées, que ce soit pour le renforcement des fonds propres ou le financement par l’État.
Ensuite, en ce qui concerne BNP Paribas, les choses sont parfaitement claires : nous n’avons aucune activité dans les pays inscrits sur la liste noire du GAFI et, dans ceux où nous sommes présents, nous appliquons les règles éthiques françaises. Il n’y a donc aucune incompatibilité entre les activités que nous y menons et notre soutien, que nous réitérons, à l’économie française.
M. Georges Pauget. Monsieur Carrez, le projet présenté par le Gouvernement français à la Commission européenne portait bien sur un plan d’un montant total de 21 milliards, réalisable en deux tranches. La deuxième tranche, dont la date n’était pas précisée, est intervenue au début de l’année. Le dispositif n’a donc pas changé. La seule novation, qui a été approuvée par Bruxelles, réside dans la possibilité de choisir des actions en lieu et place des titres super-subordonnés.
M. le président Didier Migaud. Cela pourrait-il entraîner la présence de l’État au sein des conseils d’administration ?
M. Georges Pauget. Non, car les actions de préférence ne donnent pas le droit de vote mais bénéficient d’une rémunération privilégiée par rapport au capital.
M. le président Didier Migaud. En quoi la présence de l’État serait une gêne pour vous, dès lors qu’il contribue à vos fonds propres ?
M. Georges Pauget. Je ne peux pas répondre pour tous les établissements, mais le Crédit agricole est un groupe contrôlé par une union de banques coopératives qui entend conserver la maîtrise de sa stratégie.
S’agissant de la rémunération des opérateurs de marché, dans le cadre des travaux du Haut comité de Place, j’ai présidé un groupe de travail chargé de définir les principes devant la régir. Ce groupe rassemblait non seulement les banques, mais aussi les compagnies d’assurance et tous les acteurs de marché, ainsi que la direction générale du Trésor et de la politique économique, l’Autorité des marchés financiers et la Commission bancaire. En trois semaines, nous sommes parvenus à un texte commun, qui sera présenté à Mme la ministre de l’économie afin d’être soumis au Haut comité de place. La France sera ainsi l’un des premiers pays à avoir défini des principes applicables à l’ensemble des opérateurs de marché nationaux – la Fédération bancaire française ayant approuvé le texte. Ce document fera l’objet d’une publication par le ministère de l’Économie, mais nous pouvons déjà vous en donner les principales caractéristiques. C’est un point acquis.
S’agissant du médiateur, cette question a déjà été évoquée le 20 janvier devant votre Commission des affaires économiques. Le médiateur, ainsi que le MEDEF, l’UPA et tous les organes représentatifs des entreprises participaient à cette réunion ; tous ont fait valoir que le dispositif fonctionnait.
Personne ne prétend que le système soit parfait. Observons toutefois que, sur les centaines de milliers de prêts qui sont accordés tous les ans, 900 litiges étaient en cours d’examen le 20 janvier – avec le taux de résolution cité. Le dispositif peut encore être amélioré. Le problème de la transmission des informations a été évoqué : non seulement nous y veillons, mais nous travaillons conjointement avec le médiateur pour que, en cas de difficulté, on puisse trouver des solutions acceptables par tous. S’agissant du risque de soutien abusif, nous avons défini ensemble à quelles conditions cet argument peut être légitimement avancé. Il ne s’agit donc pas d’un dispositif figé.
Les paradis fiscaux font l’objet d’une définition internationale, à travers la liste du GAFI. C’est aux pouvoirs publics qu’il revient de l’étendre ! La responsabilité des banques se limite à appliquer rigoureusement la réglementation internationale, en conformité avec les lois françaises et avec l’éthique qui guide l’exercice de notre métier.
M. Jean-Pierre Brard. On peut être moral sans attendre que les autres le soient !
M. Georges Pauget. C’est précisément le cas.
S’agissant des indicateurs d’activité, je suis en mesure de vous communiquer deux séries de chiffres sur l’exercice 2008.
Concernant tout d’abord l’agriculture, les encours de crédits ont progressé de 3,3 %, et les nouveaux concours de 12,7 % – ce qui signifie que l’agriculture française a bénéficié, par notre intermédiaire, d’un financement assez soutenu.
Quant aux collectivités locales, la croissance des encours est de 7,6 % et celle des réalisations sur l’année de 6 %. Le Crédit agricole a d’ailleurs participé à l’adjudication de novembre dernier et mis en œuvre les dispositifs de refinancement prévus. Vous vous inquiétiez des besoins de crédits sur la fin de l’année : ils ont été normalement satisfaits. Toutefois, le coût de la liquidité ayant augmenté, les conditions de crédits faites aux collectivités locales sont moins favorables qu’il y a un an.
S’agissant des LBO, ceux financés jusqu’à présent bénéficiaient en général d’un effet de levier significatif. Ils étaient calculés sur la base de cash-flows qui ne se réaliseront peut-être pas, compte tenu de la détérioration des conditions économiques. Pour nombre d’entre eux, les financements étaient calibrés sur des durées courtes ou moyennes ; par conséquent, dans la mesure où les données fondamentales de l’entreprise ne sont pas modifiées, il est toujours possible d’en allonger la durée.
Quant à ceux à venir, compte tenu de la dégradation de la situation économique, le poids des fonds propres à porter sera plus important que par le passé et, par conséquent, l’effet de levier sera réduit.
L’objectif d’une croissance de 3,5 % des crédits à l’économie est-il accessible ? Oui, sous réserve que la crise ne prenne pas une ampleur inattendue, la demande de crédits étant directement fonction des conditions économiques. Ainsi, le tiers des crédits à la consommation est consacré à l’achat d’un véhicule neuf ; sachant que les constructeurs automobiles déplorent une baisse de leurs commandes de 30 à 40 %, on peut prévoir une diminution équivalente des crédits à la consommation. Je précise en outre que la demande de crédits à la consommation et, en partie, celle des crédits immobiliers sont assez directement liées aux anticipations des ménages en matière d’évolution du chômage.
Quant aux entreprises, pour ce qui concerne le Crédit agricole, leur financement a progressé de 12,5 % au titre de l’année 2008. Toutefois, la demande d’investissement va se ralentir, les perspectives d’activité étant moins favorables ; on estime qu’elle sera en diminution de 30 % par rapport à l’an dernier.
M. Philippe Dupont. Je voudrais revenir sur le financement des entreprises.
En ce qui concerne les grandes entreprises, une opération spécifique, garantie par la COFACE, à hauteur de 7 milliards d’euros, va permettre le financement d’un certain nombre d’entre elles, dont EADS. Dans ce domaine, la situation a totalement changé par rapport à l’époque où la liquidité était abondante et la concurrence très ouverte. En particulier, les banques étrangères, qui alimentaient abondamment le marché à des coûts de liquidité très bas, dont les grandes entreprises profitaient pour se développer et financer leurs besoins, ont totalement disparu.
Autre limite, le principe de la division des risques amène le régulateur à vérifier que la concentration des risques sur telle ou telle entreprise ne serait pas anormale par rapport à l’ensemble de nos concours.
En ce qui concerne les PME, les TPE et les entrepreneurs individuels, nous avons noté, dans nos banques populaires, un net ralentissement de la demande de crédits au deuxième semestre 2008, et surtout depuis le 15 septembre. Si certains paramètres, comme l’évolution du chômage, ont provoqué un effondrement de la demande de crédits immobiliers en novembre et décembre, dans des proportions jamais connues – de l’ordre de 30-40 % –, un phénomène similaire se produit chez un certain nombre d’acteurs économiques, y compris les entrepreneurs individuels. Les incertitudes sur leurs carnets de commande les amènent à différer leurs investissements, notamment en ce qui concerne le renouvellement des équipements, ce qui va provoquer une forte baisse des crédits dans les mois à venir, en particulier par rapport aux années 2006 et 2007 où les niveaux atteints avaient été particulièrement élevés. Ainsi, notre groupe Banque Populaire enregistrait fin 2008 une augmentation de 13,8 %, ce qui signifie qu’il y a encore des entreprises qui investissent ; bien évidemment, nous serons là pour les accompagner. Les véritables difficultés proviendront de la chute des carnets de commandes, notamment dans des secteurs comme la sous-traitance automobile ou électronique, ce qui amènera un certain nombre d’entreprises à réduire leur demande de trésorerie ou d’investissement.
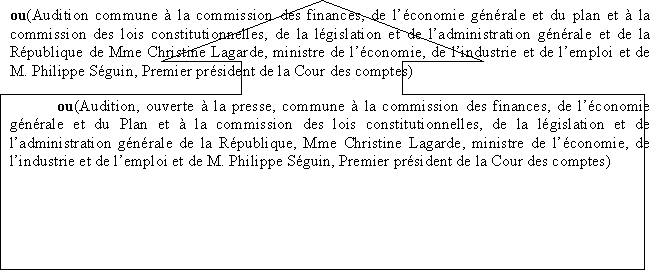
Vous nous avez interrogés sur l’évolution du taux de défaillance des entreprises. Le réseau des banques populaires n’a pas constaté d’augmentation significative fin 2008, mais tous les indicateurs font pressentir qu’il en ira autrement au cours des mois qui viennent.
L’évolution des dépôts reste positive, et l’épargne de précaution est patente. La situation est différente s’agissant de la demande de crédit émanant des entreprises ; elle était déjà en baisse en novembre et en décembre, et les premiers chiffres connus pour janvier ne sont pas rassurants.
M. Bernard Comolet. Mes confrères l’ont dit, les choses vont changer : les banques ne pourront plus refinancer tous les prêts à leurs clients par les dépôts de leurs clients. Le marché interbancaire fonctionne ; le problème tient à ce que nous ne pouvons prêter plus de liquidités que nous n’en avons. De plus, leur coût a augmenté et cette hausse n’a pas été intégrée dans les prix. Cela est particulièrement vrai pour les collectivités locales, confrontées à la raréfaction de l’offre. Les banques étrangères qui s’étaient spécialisées dans l’offre de produits « exotiques » aux collectivités ayant déserté ce marché, les six banques « domestiques » doivent y revenir. Dexia ne pourra faire face à elle seule à cette demande particulière, qui impose une réflexion spécifique. En effet, même les communes qui avaient défrayé la chronique ont fini par payer ce qu’elles devaient. Le risque est donc très faible et l’on pourrait imaginer mettre au point un mécanisme de refinancement spécifique aux collectivités locales à des conditions préférentielles, telles qu’en consent la SFEF.
Je ne considère pas, monsieur Brard, les apports de la SFEF et de la SPPE comme marginaux. Les fonds débloqués ont été déterminants : permettre un refinancement de 1,9 milliard sur 7 milliards de crédits à l’économie n’est pas négligeable, et si les pouvoirs publics ne nous avaient pas fourni ces concours, nous aurions eu un mal fou à trouver l’équivalent de cette somme. En termes prudentiels, 0,5 % peut paraître marginal rapporté à 8 % de fonds propres, mais ce demi-point nous manquait pour accompagner les entreprises. L’État et le système financier français ont répondu plutôt moins mal que d’autres à la crise, ce qui permet à nos six banques nationales de faire face aux demandes cumulées de notre économie, et je remercie les pouvoirs publics de nous avoir aidés.
M. le président Didier Migaud. J’observe qu’aucun de vous n’a répondu à la question de M. Jérôme Cahuzac relative à l’usage de l’épargne réglementée.
M. Frédéric Oudéa. Certaines banques étaient au bord du gouffre ; il a fallu l’engagement massif de l’État pour les sauver. Mais le terreau était plus sain qu’ailleurs, ce qui a permis de mettre au point un dispositif « gagnant gagnant », avec des contreparties pour le financement de l’économie française. Si ce dispositif n’avait pas été appliqué, nous aurions eu une politique de crédit plus restrictive. La SFEF est un mécanisme flexible, qui fonctionne bien. Il serait prématuré de réduire le rythme de ses interventions car nous ne sommes pas à l’abri de mauvaises nouvelles au cours du semestre à venir. Il faut attendre le retour de la stabilité et une visibilité plus grande de l’évolution de l’économie mondiale.
J’en viens à la gouvernance. La Société générale est une entreprise cotée en bourse. Il me paraît normal de respecter le modèle de gouvernance du groupe, qui a su traverser l’année 2008 sans faire appel à une aide massive des pouvoirs publics. La banque a reçu de l’État une aide transitoire, sous la forme d’un prêt qui sera remboursé. Il faut donc préserver le rôle de son conseil d’administration et de ses actionnaires, qui doivent continuer de définir et le montant des dividendes et la rémunération des dirigeants. Le conseil d’administration examinera, le 17 février, la question des dividendes ; vous en dire plus que je vous en ai dit à ce sujet m’exposerait à la prison. Les dirigeants du groupe ont renoncé, vous le savez, à la part variable de leur rémunération ; c’est le conseil d’administration qui en a délibéré, comme il se doit. L’État, qui a apporté des fonds à la banque par le biais d’actions particulières, n’en acquiert pas, de facto, un droit de vote ou de représentation au conseil d’administration.
Le médiateur du crédit a été cité. Permettez-moi de souligner qu’un tiers de nos agents sont âgés de moins de trente ans. Le secteur bancaire est en effet l’un de ceux qui ont le plus recruté – et qui continuera de le faire, car nous assistons à un mouvement massif de départs en retraite. Nous avons une intense activité de formation, mais nous ne sommes pas infaillibles et, comme l’a indiqué M. René Ricol, les responsabilités sont parfois partagées, j’en conviens. Nos jeunes agents sont, pour la première fois, confrontés à une grande crise, et il se peut que certains dispositifs ne fonctionnent pas du premier coup. Mais, rapporté à nos 2,1 millions d’entreprises clientes, la proportion d’imperfections me paraît très raisonnable. J’ajoute que critiquer « les banques » à répétition finit par faire souffrir nos agents ; or il faut préserver nos réseaux car personne n’a intérêt à ce qu’ils ne fonctionnent pas.
M. Étienne Pflimlin. Je tiens à lever deux malentendus. S’agissant du livret de développement durable, le respect des engagements pris par les établissements bancaires semble être envisagé avec circonspection. Pourtant, s’il est un domaine où la confiance est essentielle, c’est bien la banque, et si nous prenons des engagements, c’est avec l’intention de les tenir. Le malentendu relatif au livret de développement durable découle de ce que la partie de la collecte dont les entreprises pouvaient bénéficier n’a pas été clairement définie. Après que le taux a été précisé, l’utilisation des fonds a été multipliée par six et, s’agissant des livrets d’épargne populaire, la ressource disponible a été consommée en un mois. L’épargne comptable disponible correspond à un tiers des prêts supplémentaires que nous faisons. Je regrette que, contrairement à ce que le président de la République avait annoncé, lorsque le livret A a été « banalisé », la partie de la collecte qui n’était pas destinée au logement social n’ait pas été consacrée au financement de l’économie.
Je le redis, nous respectons les engagements que nous souscrivons. Toutefois, si l’existence des banques est une condition nécessaire au développement de l’économie, ce n’est pas une condition suffisante ; là est l’autre malentendu. Si les banques n’ont pas de consommateurs face à elles, le système ne peut fonctionner. Notre offre, qui est moderne, compétitive et proposée à un taux inférieur à la moyenne européenne, doit rencontrer une demande. Or, la crise financière se transforme en crise économique. Une récente enquête des chambres de commerce et d’industrie établit que la situation n’est pas encore très mauvaise. Nous avons souscrit des engagements et nous comptons les tenir, mais il va sans dire que si l’économie s’effondre nous aurons beaucoup de mal à y parvenir. Banques mutualistes et non mutualistes, nous devons unir nos forces par un travail de terrain.
M. le président Didier Migaud. Plusieurs députés ont encore des questions à poser.
M. Dominique Baert. On comprend, monsieur Pflimlin, que vous cherchiez à rassurer, mais si vous êtes dans cette enceinte, c’est que nous ressentons un malaise. On nous a demandé de donner, dans l’urgence, beaucoup d’argent, certainement pour couvrir des pertes, et parce que la stabilité de notre système bancaire était ébranlée. Or, que voit-on ? Que les grandes banques françaises présentent un solde net bénéficiaire et que dans le même temps elles ont une politique plutôt restrictive à l’égard des petits commerçants et des artisans. Voilà qui nous conduit à nous interroger. Avez-vous vraiment besoin de ces concours ? Si oui, sait-on véritablement tout de la situation de vos établissements et du système bancaire français ?
Monsieur Comolet et monsieur Dupont, qu’en est-il des épousailles de vos établissements ? Vous n’avez, ni l’un ni l’autre, dit mot de Natixis, qui est pourtant la question clef pour votre avenir !
Monsieur Comolet, vous présidez un établissement dont le dirigeant historique a été limogé en un week-end, après que la banque eut connu des pertes somme toute relativement contenues. Mais de nouvelles pertes se profilent. Où va la Caisse d’épargne ? Serait-elle un colosse aux pieds d’argile ?
Monsieur Prot, la BNP a été citée dans l’affaire Madoff. A-t-on touché le fond ?
Monsieur Pauget, le Crédit agricole en a-t-il fini avec ses déboires aux États-Unis ?
Monsieur Oudéa, la Société générale compte-elle conserver la participation dans Dexia qu’elle détient par le biais du Crédit du Nord ? Des rumeurs font état d’une recomposition du capital de Dexia ; l’accompagnerez-vous dans cette restructuration ?
Sur un plan général, la commission des Finances a confié à M. Gaël Yanno et à moi-même une mission d'information sur les nouvelles normes comptables, et nous analysons dans quelle mesure elles ont joué un rôle d’accélérateur dans la crise. Au delà, pensez-vous que les règles prudentielles dites Bâle II auxquelles les banques sont astreintes sont adaptées à la situation ?
M. Marc Francina. Quelles sont vos expositions aux risques et quelles provisions avez-vous passées ? Par ailleurs, vos subalternes ne saisiraient-ils pas le prétexte de la crise du crédit pour « faire le ménage » dans les agences, en éloignant les clients les moins désirables ? Enfin, comment évolue le crédit-bail ? Pose-t-il problème, ou le refinancement se fait-il par le biais du leasing ?
M. Jean-Michel Fourgous. Mon collègue Louis Giscard d’Estaing, qui a dû partir, m’a prié de vous demander pourquoi la France a moins titrisé que d’autres pays et pourquoi, alors qu’il en est ainsi, on ne parvient pas à mieux cantonner les produits bancaires toxiques.
S’agissant du livret A, avez-vous constaté des changements depuis le 1er janvier 2009 ?
Quel est votre sentiment sur les fonds souverains et sur le rôle qu’ils pourraient jouer en 2009 et en 2010 ?
Y a-t-il eu perte ou « dépréciation » ? Référence a été faite à l’année 1931, mais à quel indice pensiez-vous ? Faites-vous vôtre l’estimation des capitaux dans le monde comme étant comprise entre 150 000 et 200 000 milliards de dollars ?
Le pic de la crise n’est pas encore atteint. Quels conseils pourriez-vous donner au législateur sur le plan fiscal ? Faut-il revoir le dispositif Madelin, relever le plafond de déduction de l’ISF pour les investissements dans les PME, afin de leur permettre de renforcer leurs fonds propres ?
Enfin, quels sont selon vous les secteurs stratégiques ? Transport, énergie, défense, éthique, santé ? Vers quoi orienter les moyens ?
M. Alain Rodet. Monsieur Comolet, vous avez évoqué le financement des collectivités locales, des collectivités auxquelles le plan de relance fait largement appel. Or, les taux de marge des banques ont fortement augmenté, et même les collectivités qui ont une bonne signature se voient appliquer des conditions beaucoup plus dures qu’il y a peu. Non seulement on risque ainsi de plomber le plan de relance mais cela a pour effet pervers que le contribuable local paiera une partie de l’intérêt que les banques doivent verser à l’État. La concurrence des banques étrangères s’étant tarie, vous l’avez signalé, et Dexia défaillant, il faut que le Crédit agricole, les Caisses d’épargne et le Crédit mutuel pincent leurs marges, sinon les collectivités locales se refuseront à investir.
D’autre part, monsieur Dupont et monsieur Comolet, nous sommes sans cesse interpellés dans nos circonscriptions par des gens qui, ayant converti leur plan d’épargne en actions Natixis, se trouvent maintenant dans une situation très pénible.
M. Jérôme Cahuzac. Je remercie M. Pflimlin de sa courtoisie, mais j’aimerais des réponses, éventuellement écrites, de chacun d’entre vous à ma question sur l’utilisation de l’épargne réglementée. Vous avez parlé de « confiance », monsieur Pflimlin, mais il se trouve que tous les membres de la commission des Finances, toutes tendances politiques confondues, craignent que l’épargne réglementée ne soit pas utilisée à ce pour quoi elle a été prévue. Savoir quelle est son utilisation exacte restaurerait la confiance.
Monsieur Prot, il n’y a aucun sophisme à constater que personne n’a cité la qualité du travail du médiateur du crédit !
S’agissant des dividendes, si le taux de distribution était, en 2008, le même que celui que vous avez appliqué en 2007, ils s’élèveraient à 1,2 milliard, soit la moitié du montant de l’aide publique qui vous a été consentie. Si vous décidez de verser des dividendes, auriez-vous pu le faire sans avoir reçu l’aide publique ?
M. Philippe Dupont. Les groupes Banque Populaire et Caisse d’Épargne ont certes confirmé leur souhait de constituer un grand groupe, tant pour la collecte d’épargne que pour le financement de l’économie mais, compte tenu des incertitudes et des risques liés au contexte inédit que nous connaissons, nous nous devons aujourd’hui de redéfinir précisément ce projet.
Nous ne pouvons par ailleurs que déplorer le parcours boursier de Natixis, dû en particulier à son implantation aux Etats-Unis. À ce propos, j’entends bien les légitimes récriminations des actionnaires mais ce n’est qu’à travers ce regroupement que nous pourrons apporter des solutions durables en faveur d’une société qui, je le rappelle, comporte aussi dans son périmètre des fleurons comme la COFACE dont les positions sont éminentes dans la gestion d’actifs. Nos 20 000 collaborateurs n’ont pas démérité.
M. Bernard Comolet. Le 19 octobre, Alain Lemaire et moi-même avons pris les rênes du Groupe Caisse d’épargne qui, depuis 1818, date de sa création, a traversé et surmonté bien des épreuves.
Victime de la crise, certes, mais également d’un trader qui a causé une perte de 750 millions, l’organe central de gestion a dû constituer une provision de 500 millions sur les différents portefeuilles. Si la situation de Natixis nous affecte bien entendu considérablement, les caisses régionales, en revanche, se portent bien, de même que d’autres filiales, tel par exemple le Crédit foncier. La solidité du groupe n’est donc pas remise en cause, comme le prouvent tous les jours nos 26 millions de clients de même que le recentrage sur nos activités de détail. Quoi qu’il en soit, cette année, nous ne nous enorgueillirons pas de nos comptes.
S’agissant des collectivités territoriales, une société du Crédit foncier dédiée aux missions d’obligations foncières a réalisé des émissions à 1,10 % - ce qui constitue l’une des meilleures performances du marché aujourd’hui - mais il est impossible de refinancer ces dernières avec un taux dont les marges seraient de 0,10 % à 0,20 % : outre que tous les acteurs économiques devront bientôt intégrer des taux de marché, un mixte de ressources propres et d’emprunts ne permettra pas d’abaisser sensiblement le coût de cette ressource. Nous devons donc trouver ensemble un système permettant d’améliorer cette situation, grâce notamment à un meilleur traitement des crédits dans le cadre de Bâle II ou des mécanismes de titrisation.
Enfin, la clôture quotidienne de 1 000 Livrets A, en raison de la banalisation de ce dernier, fait évidemment souffrir le Groupe Caisse d’épargne.
M. Frédéric Oudéa. En guise de préambule, je tiens à préciser que c’est Dexia qui participe, à hauteur de 20 %, au capital du Crédit du Nord et pas l’inverse.
Par ailleurs, même s’il est difficile de donner un chiffre précis, les provisions pour risques ne pourront qu’augmenter.
Nous essayons, en outre, de traiter le mieux possible les petits dossiers sur le plan local, lesquels résultent sans doute plus d’une relation médiocre entre le banquier et le client que d’un problème de fond.
S’agissant des crédits-bails, ce sont surtout les valeurs résiduelles sur certains biens d’équipement ou les véhicules qui pèsent sur nos comptes.
En ce qui concerne le Livret de développement durable, je vous transmettrai dès que possible les réponses que vous souhaitez obtenir.
Cette crise ayant par ailleurs démontré combien les normes IFRS ont un caractère procyclique, sans doute conviendrait-il de s’interroger sur leur pertinence. J’ajoute que nous ne comptabilisons pas aujourd’hui de véritables pertes mais que nous les anticipons tout en incluant dans nos prévisions un coût de liquidité. Enfin, les banques françaises ont été très rigoureuses en ce qui concerne les actifs « toxiques » puisque nous en avons publié la liste dès juin 2008.
Le bilan des banques américaines est égal au PIB des États-Unis, celui des banques anglaises quatre fois supérieur au PIB britannique, et celui des banques françaises représente 2,8 fois notre PIB. Le résultat américain s’explique en particulier par le recours massif à la titrisation et l’augmentation du leverage ratio qui, à lui seul, ne constitue pas un critère efficace de régulation. Cette dernière doit plutôt reposer, comme c’est le cas en France, sur un dialogue étroit entre le régulateur et chaque établissement. Enfin, il ne faut pas diaboliser la titrisation – même si son extrême complexité a entraîné les difficultés que l’on sait – car elle finance l’économie réelle.
Les fonds souverains ont quant à eux perdu de l’argent.
M. Jean-Michel Fourgous. Combien ?
M. Frédéric Oudéa. Je l’ignore mais il me semble certain, en revanche, qu’ils feront preuve de beaucoup plus de prudence dans les investissements à venir.
Le Président Didier Migaud. Quelle est la part de l’actionnariat étranger dans votre groupe ?
M. Frédéric Oudéa. Il s’élève à 50 % mais nous ne dénombrons, par exemple, aucun fonds souverain du Moyen-Orient.
En ce qui concerne les secteurs stratégiques, il importe de veiller avant tout à accroître la compétitivité de notre pays, ce qui passe, selon moi, par l’éducation.
M. Baudouin Prot. BNP Paribas a quant à elle prêté la quasi-intégralité de l’aide reçue aux PME.
Si certains de nos prêts à des gestionnaires d’actifs étaient par ailleurs garantis par des fonds « Madoff », nous n’avons en revanche jamais recommandé directement des produits « Madoff » à nos clients.
La titrisation est très utile, en effet, mais son absence en France s’explique par la faiblesse des marges sur les crédits.
M. le Président Didier Migaud. Mais vous acheté ce type de produits ?
M. Baudouin Prot. Pratiquement pas.
Par ailleurs, je me fonde sur les différents indices boursiers – dont le Dow Jones – pour évaluer la crise actuelle et il ne fait aucun doute que 2008 aura été très difficile sur ce plan-là.
Enfin, je suis d’accord avec M. Oudéa : s’il ne me semble pas opportun de prendre des initiatives fiscales, la France a besoin avant tout de faire des efforts dans les domaines de la formation et de la création d’entreprises afin d’accroître sa compétitivité.
M. Philippe Dupont. Avec le médiateur, nous devons mobiliser l’ensemble des réseaux existants – dont les fonds d’investissement de proximité ou les associations qui proposent des micro-crédits – afin d’aider les entreprises. Nous vous rendrons compte, ensuite, de notre action afin que vous puissiez l’évaluer.
M. Jérôme Cahuzac. Je réitère ma question, monsieur Prot. Si en 2008, le taux de distribution des dividendes est identique à celui de 2007, envisagerez-vous de distribuer 1,2 milliard, soit, la moitié de l’apport financier de l’État ? En l’absence de ce dernier, auriez-vous pu distribuer cette somme ?
M. Baudouin Prot. Oui, mais elle représente le tiers de ce qui a été distribué l’an dernier, ce qui implique, après une baisse de 60 % des actions, un effort déjà très sensible de la part des actionnaires.
M. le Président Didier Migaud. Sans doute sera-t-il utile de réaliser une autre audition de ce type dans le courant de l’année.
Je vous remercie.
*
* *
Information relative à la Commission
La Commission a nommé Mme Arlette Grosskost pour siéger à la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.