


No 562
_______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIEME LEGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 janvier 2008
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
PAR LA DÉLÉGATION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
POUR L’UNION EUROPÉENNE (1),
sur le traité de Lisbonne,
ET PRÉSENTÉ
par M. Pierre LEQUILLER,
Député.
Tome 1
________________________________________________________________
(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.
La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Thierry Mariani, Pierre Moscovici, vice-présidents ; MM. Jacques Desallangre, Jean Dionis du Séjour, secrétaires ; MM. Alfred Almont, Jérôme Bignon, Emile Blessig, Mme Chantal Brunel, MM. Christophe Caresche, Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Daniel Fasquelle, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Jean-Claude Fruteau, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Mmes Annick Girardin, Elisabeth Guigou, MM. Régis Juanico, Mme Marietta Karamanli, MM. Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Robert Lecou, Céleste Lett, Noël Mamère, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, Mme Odile Saugues, MM. André Schneider, Philippe Tourtelier, Gérard Voisin.
SOMMAIRE
_____
Pages
Un « traité simplifié », pas un impossible « traité simple » 13
Répondre aux attentes de ceux qui ont dit non à la Constitution européenne 15
A. L’abandon de l’ambition constitutionnelle et des prémisses d’un Etat à vocation fédérale 17
1) Un traité « classique » 18
a) Des amendements aux traités fondateurs cependant profondément réorganisés 18
b) La Charte des droits fondamentaux non intégrée aux traités mais dotée d’une valeur juridique contraignante 20
2) La renonciation aux prémisses d’un Etat fédéral 21
3) Une protection renforcée des compétences des Etats membres 22
a) Une répartition claire et d’interprétation stricte des compétences de l’Union 22
b) Un « durcissement » de la procédure de contrôle de subsidiarité confiée aux parlements nationaux 25
B. Des réponses au déficit social de l’Europe 26
1) La reprise des acquis du traité constitutionnel 26
a) Une économie sociale de marché tendant au plein emploi et au progrès social 26
b) Le dialogue social européen 27
c) Vers un règlement général sur les services publics 27
d) Quelques autres progrès épars 28
2) Des nouvelles avancées prometteuses 29
a) La concurrence, moyen et non plus fin en soi de l’action de l’Europe 29
b) Le rôle reconnu de l’Europe dans la protection de ses citoyens 30
c) La reconnaissance de services publics nationaux de qualité élevée 31
C. Des concessions importantes aux Etats les moins enthousiastes dans la marche vers l’Europe unie 31
1) Dix ans de plus pour le traité de Nice ? Les retards dans l’application de la double majorité 32
a) La double majorité attendra 2017 32
b) Un droit de veto temporaire reconnu aux Etats membres en minorité : le mécanisme de Ioannina 33
2) Une Europe à la carte ? Les « opt-outs » britanniques 36
II. UNE EUROPE EN ÉTAT DE MARCHE : UN TRAITÉ « RÉFORMATEUR » 41
A. La clarification de l’architecture institutionnelle européenne : une Europe incarnée et mieux capable de décider 44
1) Le Parlement européen, colégislateur de l’Union, source de la politisation de l’Europe ? 45
a) Le Parlement européen sur un pied d’égalité avec le Conseil 45
(1) Un régime bicaméral égalitaire dans la procédure législative ordinaire et dans la procédure budgétaire 45
(2) Un pouvoir d’approbation et d’influence 46
(3) Un régime parlementaire ? 48
b) L’élection du président de la Commission : l’émergence d’une politisation de l’Europe ? 49
c) Le Parlement, représentant des citoyens européens ? La difficile question de sa composition 50
2) Le président du Conseil européen, le haut représentant, le président de la Commission : l’Europe incarnée 53
a) L’Europe aux vingt-sept visages : les limites des présidences tournantes 53
b) Le rôle délibérément imprécis du président du Conseil européen 54
c) Les risques de concurrence des pouvoirs 56
3) Un Conseil apte à décider 59
a) Une règle légitime et pérenne pour débloquer les décisions : la double majorité. 59
b) Un rôle d’appel reconnu au Conseil européen 62
4) Une Commission plus efficace 63
B. Les moyens des nouvelles politiques 65
1) L’extension du champ de la majorité qualifiée : l’Europe dotée des moyens d’agir 65
a) Un nouvel élan vers un espace européen de liberté, de sécurité et de justice 66
(1) L’entrée de la justice et des affaires intérieures dans la « méthode communautaire » 66
(2) Des moyens pour avancer : l’extension des compétences de l’Union et de la majorité qualifiée 67
(a) Vers une politique commune d’immigration 67
(b) Peu de progrès dans la coopération judiciaire civile, fortement encadrée mais déjà communautarisée 68
(c) Une impulsion décisive à la coopération judiciaire en matière pénale 69
(d) La coopération policière peu modifiée, sous le respect de la souveraineté des Etats membres 71
b) La capacité de répondre aux défis de notre temps 72
(1) De nouvelles missions pour l’Europe : la création de nouvelles bases légales 72
(a) L’Europe de demain : la sécurité et l’efficacité énergétique, la politique spatiale et la recherche 72
(b) L’Europe au plus près de ses citoyens : sport, tourisme, protection civile 73
(2) L’extension de la majorité qualifiée à une cinquantaine de domaines clefs 74
2) Des progrès mesurés dans la politique étrangère et de défense commune 75
a) Une politique incarnée : l’Europe, un seul numéro de téléphone ? 75
b) La politique étrangère commune, la stratégie des petits pas 76
c) Les premiers jalons d’une politique de défense commune 77
(1) L’objectif affirmé mais incertain d’une défense commune 77
(2) Un progrès opérationnel décisif : la coopération structurée permanente 78
3) L’encouragement aux coopérations renforcées : permettre à l’Europe des pionniers d’avancer sans être bloquée par les plus réticents 79
4) Des procédures de révision simplifiées pour faire vivre les traités 81
C. Des réponses innovantes au déficit démocratique de l’Europe 83
1) Des citoyens européens dotés d’un droit d’initiative novateur 83
2) Les parlements nationaux intégrés dans le processus décisionnel de l’Union 84
a) Un droit à l’information reconnu et étendu 85
b) La consécration de la coopération interparlementaire dans le corps des traités 85
c) Un droit de veto sur les révisions simplifiées, extension du pouvoir souverain de ratification des traités 86
d) Un contrôle original sur la construction de l’espace de liberté, de sécurité et de justice 86
e) Les parlements nationaux, acteurs institutionnels de l’Union grâce à la mission de contrôle de la subsidiarité 87
III. UNE FRANCE EXEMPLAIRE POUR DÉBLOQUER L’EUROPE : UN TRAITÉ « URGENT » 91
A. La France doit montrer l’exemple en étant l’un des premiers pays à ratifier le traité de Lisbonne 94
1) Le choix approuvé par les Français d’une ratification exemplaire parce que rapide passant par la voie parlementaire 94
2) Des délais serrés pour réviser la Constitution et ratifier le traité avant la mi-février 95
a) Une révision nécessaire de la Constitution 96
(a) Les droits de veto sur les révisions simplifiées et sur l’intervention de l’Union dans le droit de la famille 99
(b) Le recours auprès de la Cour de justice 100
(c) Le contrôle de subsidiarité 100
b) Un projet de loi constitutionnelle limité aux dispositions indispensables pour pouvoir ratifier le traité 101
B. Saisir l’opportunité de mieux impliquer le Parlement français dans la construction de l’Europe 105
1) Une implication moins dépendante des procédures que des pratiques 106
a) Les deux modèles par mandat et par résolution 106
b) Une distinction moins opérante qu’il n’y paraît 107
2) Les voies de progrès du contrôle parlementaire de l’Union 108
a) L’appropriation de l’Europe par les parlementaires 108
b) Peser au quotidien sur l’Europe et réagir mieux en amont des décisions 110
(1) Se saisir des enjeux européens dès le stade de leur préparation 110
(2) Les opportunités du traité de Lisbonne 110
TRAVAUX DE LA DELEGATION 113
Mesdames, Messieurs,
La construction européenne n’emprunte décidément pas des chemins de traverse. Mais elle avance. Et la célèbre expression de Robert Schuman dans sa déclaration du 9 mai 1950, « l’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes, créant d’abord une solidarité de fait », reste la vraie devise de notre Union.
La Constitution européenne était un grand « coup », une belle « construction d’ensemble ». Elle marquait une étape symbolique décisive, car, après tout, les Constitutions n’existent dans notre monde que pour les Etats.
Mais voilà, deux peuples lui ont dit non, et pas par la plus petite des majorités. Et d’autres s’apprêtaient peut-être à le faire, si l’occasion leur en était donnée.
Or, sans la légitimité de l’acquiescement des citoyens, rien n’est possible. C’est l’une des vertus de l’expérience constitutionnelle que d’avoir permis à chacun, à Bruxelles, dans nos capitales, de mesurer ce devoir d’exigence qui fait de la démocratie le meilleur des systèmes politiques.
Mais il faut entendre toute la phrase de Schuman. L’Europe a d’ores et déjà créé, par ses réalisations concrètes, une « solidarité de fait » qui rend impossible sa disparition et même interdit que sa construction ne s’interrompe, sous la lassitude d’architectes décidément déçus par tant de difficultés.
Dans ce sens, le nouveau traité est indispensable et inéluctable.
Il est indispensable, parce que l’Europe ne peut fonctionner, ne peut avancer sans lui. Le traité de Nice, la seule alternative au traité de Lisbonne, ne donne pas à l’Union les moyens de faire face aux défis qui l’attendent et la capacité de décider à vingt-sept. Tous les Etats membres le savent bien. Il est de notre devoir d’en convaincre chaque citoyen.
Il est inéluctable parce que l’envie d’Europe n’est pas morte. Et, surtout, le besoin d’Europe est plus fort que jamais, dans tous les domaines, qu’il s’agisse du changement climatique, de l’énergie, de l’immigration concertée, de la compétitivité, de la protection des citoyens ou de l’affirmation d’une puissance diplomatique voire militaire dans un monde qui, lui aussi, a besoin d’une Europe forte, cohérente et unie.
Cela ne diminue en rien les mérites de ceux, au premier rang desquels le Président de la République Nicolas Sarkozy et la Chancelière allemande Angela Merkel, ont sorti l’Europe de l’ornière et permis de réaliser cet exploit : rédiger au terme de la Conférence intergouvernementale la plus brève de l’Histoire un traité pleinement satisfaisant, intégrant toutes les dispositions aptes à remettre l’Europe sur les rails de l’efficacité sans rouvrir la boîte de Pandore institutionnelle et insulter nos dix-huit partenaires qui avaient ratifié la Constitution.
Les avancées sont en effet considérables, et un peu inespérées pour ceux qui, comme le rapporteur, avaient assisté avec tristesse aux doutes européens qu’avaient provoqués les référendums de 2005.
Grâce au traité de Lisbonne, le Conseil de l’Union, doté d’une règle de majorité claire et pérenne, sera en mesure de décider à vingt-sept, et d’avancer, au rythme des groupes pionniers fortement encouragés, sans être freiné par les plus réticents. Le Parlement européen sera désormais sur un vrai pied d’égalité avec le Conseil dans l’adoption de la législation européenne, et élira directement le Président de la Commission. Une Commission aux effectifs resserrés mieux adaptés à une action cohérente sera en mesure de défendre avec vigueur l’intérêt général de l’Union. Et l’Europe sera, enfin, incarnée, grâce à son futur président du Conseil européen et, pour la politique étrangère, par un haut représentant rassemblant toutes les prérogatives extérieures de la Commission.
Mais n’oublions pas pour autant le prix qu’il a fallu payer pour relancer l’Europe.
Sur le fond, l’abandon de l’ambition constitutionnelle peut être regretté, mais, après tout, la République ne s’est-elle pas imposée en France sans le secours d’une Constitution formelle et charpentée et, au moins jusqu’en 1875, dans une réelle ambiguïté institutionnelle ? Dans le même esprit, les symboles de l’Union, tellement importants pour renforcer l’appropriation par les citoyens de leur maison commune, n’apparaîtront pas dans les traités. Cependant, là encore, les trois couleurs ont-elles eu besoin d’une loi pour s’installer dans le cœur des français et dans l’âme de la nation ?
C’est dans le détail des procédures que se sont logées les concessions les plus dangereuses. L’application de la règle de double majorité au Conseil prend presque dix ans de retard. Dix ans, deux législatures européennes, c’est long pour ceux qui connaissent les limites du traité de Nice. Le risque d’une Europe à la carte est accru, avec le précédent que constituent les dérogations (« opt-outs ») britanniques sur l’ensemble de l’espace de liberté, de sécurité et de justice et sur la Charte des droits fondamentaux. Qu’un citoyen français puisse invoquer ses droits européens auprès de ses juges lorsqu’un citoyen britannique ne le pourra pas, voilà une profonde entorse à l’idéal d’un destin partagé.
Il faut mesurer ce prix en comprenant bien qu’il serait plus élevé encore si d’aventure nous échouions à ratifier le traité de Lisbonne.
Il n’y a pas en effet de plan B mais une seule alternative claire : plus ou moins d’Europe. Pas le plus possible, car chaque Etat membre n’y est pas prêt et nous devons avancer au même pas. Mais bien le moins possible si l’on laisse l’Europe s’enferrer dans des querelles institutionnelles ou, pire, dans un cadre institutionnel imparfait et impropre à l’action, qui écarte d’elle ses citoyens impatients de la voir enfin répondre à leurs aspirations concrètes et quotidiennes. Les formules de l’« Europe par la preuve » pour les uns, de l’« Europe par les résultats » pour les autres, résument bien ce qui nous attend.
Mais pour administrer cette preuve, il nous faut donner à l’Europe les moyens d’avancer. Le traité de Lisbonne, en dépit de toutes ses imperfections, y parvient. C’est pourquoi il est une chance qu’il nous faut saisir, avec lucidité, conviction et enthousiasme.
Un « traité simplifié », pas un impossible « traité simple »
Qualifier de « simplifié » un traité de 152 pages, plus 112 pages de protocoles et déclarations peu accessibles aux praticiens sans parler des citoyens appelle quelques mises au point.
Si le traité de Lisbonne est « simplifié », cela ne veut pas dire qu’il soit « simple ».
Il n’est pas simple parce que la réalité qu’il décrit ne l’est pas, et qu’elle ne peut pas l’être. Le fonctionnement institutionnel de l’Union, comme celui de tous les systèmes institutionnels étatiques, a fortiori lorsqu’ils comportent des éléments de fédéralisme, est impossible à appréhender de manière simple.
Ce n’est d’ailleurs pas le moindre des mérites du traité que de clarifier des éléments décisifs du fonctionnement de l’Europe, grâce à son incarnation par un Président du Conseil européen, grâce à la clarification des procédures législatives alignées, sauf exception, sur la codécision Parlement et Conseil, et surtout grâce à la définition d’une règle de majorité au Conseil claire et légitime, proportionnée à la population des Etats, qui permettra de s’épargner à l’avenir des négociations algébriques pour déterminer le poids de chaque membre.
Mais le traité de Lisbonne est incontestablement « simplifié », à la fois dans ses ambitions, dans sa démarche et, à de nombreux égards, dans son contenu.
■ Le traité est simplifié dans ses ambitions, en ce qu’il ne cherche pas à définir un nouvel objectif de fond pour l’Union.
L’Acte unique de 1986 avait posé le principe et fourni les moyens de l’achèvement du marché commun. Le Traité de Maastricht de 1992 était allé plus loin encore, en créant une monnaie unique, en jetant les bases d’une politique étrangère commune et en intégrant la justice et les affaires intérieures dans la construction européenne.
Rien de tel dans le traité de Lisbonne, dont l’essentiel des innovations demeure de nature institutionnelle.
Un pas de géant est fait pour faciliter les prises de décision. Mais aucune nouvelle direction n’est donnée à la marche de l’Europe.
En cela, le traité de Lisbonne est dans la droite ligne des traités d’Amsterdam et de Nice.
A l’inverse, la nature même de la Constitution européenne, l’intégration de la Charte des droits fondamentaux dans le corps du texte, la consécration constitutionnelle des politiques européennes dans sa fameuse troisième partie représentaient des ruptures importantes.
■ En renonçant ainsi à l’ambition constitutionnelle, le traité est simplifié dans sa démarche. Il revient, après la tentative constitutionnelle de rassembler en un texte unique toutes les institutions, procédures et politiques de l’Union, à une forme plus traditionnelle d’adaptation des institutions et de modification des traités, sans en changer l’organisation générale.
■ Le traité de Lisbonne est enfin simplifié dans son contenu. D’une part, il s’efforce de « nettoyer » dans les traités fondateurs les références périmées (« Ecu » remplacé par « Euro », « marché commun » par « marché unique ») et les procédures disparates (est clairement exposée la procédure législative de droit commun). D’autre part, il modifie profondément le déroulé des traités en allant dans le sens d’une plus grande logique de lecture (au traité sur l'Union européenne les dispositions fondamentales et intergouvernementales, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne les moyens et les procédures des politiques internes réorganisées par « blocs » cohérents). Le traité de Lisbonne lui-même, appelé à disparaître en se fondant dans les traités, ne comporte pas la lourde troisième partie de la Constitution. Il se concentre sur les modifications apportées par la Conférence intergouvernementale et ne reproduit pas le contenu de la Charte des droits fondamentaux, solennellement proclamée et publiée au Journal officiel de la Communauté. Au total, le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne modifiés par le traité de Lisbonne seront beaucoup plus lisibles que le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne dans leur version actuelle.
Répondre aux attentes de ceux qui ont dit non à la Constitution européenne
Mais la question décisive est ailleurs. Le traité constitutionnel a failli à recueillir l’adhésion d’au moins deux peuples dont l’attachement à la construction européenne ne peut être mis en doute. En quoi le nouveau traité répond-il aux insatisfactions, aux déceptions et aux angoisses exprimées par tous ces citoyens européens qui ont choisi de tourner le dos à la Constitution ?
■ Répondre impose de poser un diagnostic, forcément sommaire et réducteur, sur les motifs de rejet de la Constitution européenne.
– Le premier motif, traditionnel, est l’angoisse de la perte d’identité nationale. Il ne faut pas négliger ce besoin d’appartenance à une communauté forgée au plus près de l’histoire dont la force est visible partout à l’échelle du continent.
– Un second, particulièrement efficace en France, est la crainte de la mondialisation que la libéralisation du marché intérieur européen exacerbe plus qu’elle ne la régule, les espoirs se reportant soit sur l’Etat national, dernier rempart contre les forces du marché, soit sur l’idéal d’une Europe sociale s’engageant dans la promotion de son modèle de société régulée.
– Un troisième, plus diffus mais prégnant, est l’inquiétude provoquée par la vitesse et l’ampleur des élargissements des années 2000, avec ses corollaires fantasmés de vague migratoire et de dumping social et fiscal.
– Une dernière, récurrente, est l’exaspération devant le déficit démocratique européen, le sentiment que les décisions, trop complexes pour être comprises, mal politisées et donc peu identifiables, s’imposent d’en haut, d’un Bruxelles omnipotent mais obscur dont la mécanique institutionnelle échappe à l’entendement commun.
■ Répondre à ces attentes, dans le peu de temps que laisse l’urgence de réformer le traité de Nice dont les imperfections sont désormais bien admises par tous, relevait de la gageure. Néanmoins, les Gouvernements des Etats membres s’y sont attelés dès qu’ils ont été remis du choc des référendums, la présidence allemande du Conseil jouant un rôle déterminant dans le dégagement des pistes de compromis. Et l’élection du Président de la République française a tout changé, en débloquant la situation grâce à sa proposition de traité simplifié.
Les innovations introduites par la conférence intergouvernementale (CIG) de 2007, très clairement balisées par le mandat précis, détaillé et limitatif adopté par le Conseil européen de Bruxelles des 21, 22 et 23 juin 2007, se sont concentrées sur les réponses à apporter aux préoccupations des citoyens.
– Ainsi, pour atténuer les craintes exprimées sur l’émergence d’un « super-Etat » européen se substituant progressivement aux Etats nationaux, le traité abandonne tout ce qui pouvait s’interpréter comme les prémisses d’un fédéralisme européen, même tempéré. Il accroît parallèlement les moyens de contrôle des Etats, en particulier de leurs parlements nationaux, pour veiller à la juste répartition des compétences.
– Pour apaiser l’inquiétude récurrente sur le déficit social d’une Europe trop exclusivement concentrée sur le démantèlement des barrières économiques à la mondialisation, le traité renforce les moyens et les objectifs de l’Europe sociale, grâce notamment à la reconnaissance du rôle de l’Union dans la « protection » de ses citoyens, au ravalement de la concurrence à son statut nécessaire de « moyen » et non de « fin » en soi de l’action politique et à l’affirmation de la nécessité de préserver des services publics de qualité élevée et d’inspiration nationale.
– Pour mieux contenir les craintes induites par l’accélération du rythme de l’élargissement, le traité, tout en reprenant les garanties prévues par la Constitution européenne, avec en particulier une information préalable de chaque parlement, dispose dans le nouvel article 34 du TUE que les « critères d’éligibilité approuvés par le Conseil européen » doivent expressément être pris en compte.
Or, ces critères, dit de Copenhague, incluent des principes démocratiques et d’Etat de droit, la capacité administrative et économique de l’Etat candidat à absorber l’acquis communautaire et à s’intégrer au marché unique mais aussi « la capacité de l’Union à assimiler de nouveaux membres tout en maintenant l’élan de l’intégration européenne ».
– S’agissant de l’exigence démocratique, relevons que beaucoup avait été fait avec le traité constitutionnel, et qu’il n’était guère possible d’aller plus loin sans risquer de remettre en cause toutes les avancées obtenues en 2004. Remarquons aussi le paradoxe que le seul traité négocié selon une procédure résolument démocratique, avec la Convention de 2002, sera le seul traité à ne jamais voir le jour, et qu’il aura fallu recourir au dispositif le plus intergouvernemental et le moins transparent qui soit, une conférence intergouvernementale à laquelle n’était invité aucun parlementaire national, pour sortir de l’impasse. Citons enfin cette phrase de Jacques Delors, qui dit l’essentiel : « Il est erroné scientifiquement de faire peser sur l’Europe le désenchantement démocratique et la crise du politique. Ce sont des facteurs qui travaillent dans nos nations même et on ne peut pas demander à l’Europe de tirer le remède miracle ».
Les « non » français et néerlandais ont scellé le sort de la démarche constitutionnelle européenne.
Cette démarche reposait précisément – et principalement, puisqu’elle prenait concrètement la forme juridique d’un traité international – sur la force symbolique de la proclamation d’une Constitution, élaborée par une Convention dont la composition reflétait fidèlement les différents niveaux de représentation démocratique des peuples et non plus exclusivement dans le cénacle des négociations intergouvernementales.
Dès lors, son rejet par des citoyens européens, en la privant de la légitimité d’un consentement populaire, a fermé la porte constituante.
La négociation d’une nouvelle Constitution, qui aurait impliqué un long travail impliquant la réunion d’une autre Convention, contrevenait à la nécessité urgente d’adapter les institutions à l’Union à vingt-sept. En tout état de cause, les Etats membres ne souhaitaient manifestement pas remettre sur le métier un tel ouvrage. Il aurait été possible de limiter la Constitution aux seules dispositions institutionnelles (la première partie) et de conserver les dispositions matérielles (la troisième partie) dans les traités actuels. Mais cette solution s’est heurtée à l’hostilité de certains Etats membres (en particulier le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la République tchèque) désireux de renoncer à toute analogie constitutionnelle.
Dès lors, un consensus s’est rapidement dessiné pour abandonner le qualificatif de Constitution et la fusion en un seul texte des traités antérieurs et pour renoncer à toutes les dispositions pouvant s’interpréter comme des « prémisses » d’un Etat fédéral.
a) Des amendements aux traités fondateurs cependant profondément réorganisés
Le traité de Lisbonne ne se substitue donc pas aux traités fondateurs qu’il se borne à amender et à profondément réorganiser.
En cela, il est un traité de « facture traditionnelle », identique dans sa forme juridique à l’Acte unique européen, au traité d’Amsterdam ou au traité de Nice. Son article 1er comprend ainsi les modifications apportées au Traité sur l’Union européenne (TUE), son article 2 celles apportées au Traité instituant les Communautés européennes (TCE), son article 4 celles relatives aux protocoles annexés aux traités, tandis que les articles 3, 5, 6 et 7 reprennent les traditionnelles dispositions finales (durée illimitée, entrée en vigueur au 1er janvier 2009 sous réserve de la ratification par tous les Etats membres, dépôt des instruments).
Le traité de Maastricht, garde son nom de « Traité sur l’Union européenne », tandis que le traité de Rome est renommé « Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » (TFUE).
Afin de respecter l’exigence de lisibilité qui avait inspiré les conventionnels de 2002, le Traité sur l’Union européenne, de format plus ramassé (55 articles), regroupe les dispositions de portée générale qui s’approchent le plus de la matière habituellement traitée par les constitutions (pour l’essentiel la première partie du Traité constitutionnel), comme la définition des valeurs, des objectifs et des compétences de l’Union, la présentation de ses institutions et la définition des modalités d’adhésion, de retrait et de participation des Etats membres à l’Union. L’essentiel serait ainsi plus aisément consultable par les citoyens européens.
Le TUE traite aussi des questions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune en raison de son statut particulier à dominante intergouvernementale.
Le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour sa part reprend les dispositions du Traité instituant la Communauté européenne en présentant dans le détail les politiques de l’Union (la troisième partie du traité constitutionnel) et les modalités des prises de décision.
La structure en piliers de l’Union est ainsi abandonnée, l’ensemble des politiques européennes – à l’exception de la politique étrangère – relevant désormais d’une seule et unique méthode, la méthode jusqu’ici appelée communautaire. En conséquence, la « Communauté européenne » est remplacée par l’« Union », dotée de la personnalité juridique. Il n’y a plus qu’une seule et même Europe.
b) La Charte des droits fondamentaux non intégrée aux traités mais dotée d’une valeur juridique contraignante
■ L’intégration au corps même de la Constitution européenne de la Charte des droits fondamentaux, signée et solennellement proclamée par le Conseil, le Parlement européen et la Commission lors du Conseil européen de Nice des 7 et 8 décembre 2000, conférait indéniablement un contenu de nature constitutionnelle au traité. Logiquement, en abandonnant la démarche constitutionnelle, les chefs d’Etat et de gouvernement ont jugé inutile d’inscrire son détail dans le texte des traités modifiés.
Pour autant, l’article 6 du TUE dans sa rédaction proposée par le traité de Lisbonne lui donne valeur juridique contraignante en précisant que « l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux […] laquelle a même valeur juridique que les traités », tout en précisant que ces droits doivent être interprétés conformément aux explications de la CIG de 2004, marginalement complétées par la CIG de 2007, visées dans la Charte. En outre, un second alinéa, nouveau, précise que « les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies par les traités » ce qui renforce la portée de l’article 51 de la Charte qui précisait déjà que leur respect s’impose aux institutions, organes et agences de l’Union et aux Etats membres « uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ».
Cependant, comme il sera vu infra, le protocole no 7 dispense le Royaume-Uni et la Pologne d’une application contraignante de la Charte en précisant que cette dernière « n’étend pas la faculté de la Cour de justice de l’Union européenne, ou de toute juridiction du Royaume-Uni ou de la Pologne, d’estimer que les lois, règlements ou dispositions, pratiques ou actions administratives du Royaume-Uni ou de la Pologne sont incompatibles avec les droits, les libertés et les principes fondamentaux qu’elle réaffirme ».
A la demande des représentants du Parlement européen à la CIG de 2007, le Conseil européen des 18 et 19 octobre a décidé que la Charte soit solennellement proclamée le 12 décembre 2007 par le président du Conseil, le président du Parlement européen et le président de la Commission et publiée dans la partie législative du journal officiel de la Communauté. Cette proclamation a effectivement eu lieu à Strasbourg le 12 décembre dernier.
■ Toujours dans le souci de garantir aux Etats membres la maîtrise des droits que l’Union garantit à ses citoyens, si l’article 6 dans sa nouvelle rédaction du TUE reprend l’adhésion de l’Union à la Convention européenne des droits de l’homme prévue dans la Constitution européenne, elle demeure subordonnée à une décision du Conseil statuant à l’unanimité, approuvée par le Parlement européen et ratifiée par chaque Etat membre.
2) La renonciation aux prémisses d’un Etat fédéral
Dans le même esprit, la Conférence intergouvernementale (CIG) de 2007 a écarté toutes les dispositions et les notions qui, parce qu’elles se rapprochaient du corpus étatique traditionnel, pouvaient s’interpréter comme les fondations de la construction d’un super-Etat fédéral européen.
■ Disparaissent ainsi les termes de « Constitution », de « ministre des affaires étrangères » qui devient le « haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ». De même, les « règlements » et les « directives » ne deviendront pas des « lois » et « lois cadres » européennes.
■ De manière plus cruelle pour les plus fervents partisans de l’intégration européenne, les symboles de l’Union (le drapeau, l’hymne, la devise (« l’Union dans la diversité ») la monnaie et la journée de l’Europe du 9 mai), définis à l’article I-8 de la Constitution, ne sont pas repris. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils disparaissent. Tous, à l’exception de la devise forgée pour la circonstance, ont déjà été reconnus pas les institutions européennes : le drapeau, l’hymne et la journée ont été adoptés par le Conseil européen de Milan en juin 1985 et l’euro est consacré dans les traités.
Le rapporteur regrette l’abandon d’une des rares dispositions des textes aptes à renforcer la proximité affective des citoyens avec l’Union, reprise cependant dans une déclaration signée par seize Etats membres, sur la base d’une initiative allemande. Mais, comme l’écrivait Stefan Zweig en 1932, « une vraie conviction n’a pas besoin d’être confirmée par la réalité pour se savoir juste et vraie. Il ne peut être défendu à personne de rédiger lui-même dès aujourd’hui sa carte d’identité d’Européen, de se dire citoyen d’Europe et, malgré les frontières, de considérer fraternellement comme unité notre monde multiple ».
■ Enfin, si le traité reprend, comme il sera vu infra, la définition et la répartition des compétences arrêtées par la CIG de 2004, il renonce à clarifier la nature de l’Union en écartant le principe novateur de double légitimité (Etat et citoyens) de l’Union posé par l’article I-1 du traité constitutionnel selon lequel l’Union est « inspirée par la volonté des citoyens et des Etats d’Europe de bâtir leur avenir commun ». De même, la primauté du droit européen sur le droit national ne figure plus dans le corps du traité, mais simplement dans une déclaration, sans valeur juridique contraignante, rappelant la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, renommée Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Seule subsiste du préambule de la Constitution l’évocation des « héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe » qui avait fait couler tant d’encre.
3) Une protection renforcée des compétences des Etats membres
a) Une répartition claire et d’interprétation stricte des compétences de l’Union
Le traité de Lisbonne « durcit » fortement la répartition des compétences posées par la Constitution européenne en circonvenant clairement le champ d’action de l’Union.
De manière générale, l’article 5 du TUE dans sa nouvelle rédaction reprend à la forme négative, plus restrictive, la formulation du traité constitutionnel en disposant que « l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les Etats membres lui ont attribués dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux Etats membres ». Pour fixer encore plus rigoureusement les choses, une déclaration no 28 – sans valeur juridique cependant – à l’initiative de la République tchèque précise que « toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux Etats membres », ce qui relève de l’évidence.
Sous cette réserve de la compétence d’attribution qui réserve la « compétence de la compétence » aux Etats nationaux, les articles 2 à 6 TFUE dans leur nouvelle rédaction décrivent, à l’image du traité constitutionnel, les trois catégories de compétences de l’Union.
■ Les compétences exclusives sont celles dans lesquelles l’Union est seule compétente pour légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, sauf actes d’exécution et habilitations spécifiques. Ces compétences exclusives sont :
– l’union douanière ;
– l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ;
– la politique monétaire pour les Etats membres dont la monnaie est l’euro ;
– la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
– la politique commerciale commune.
■ Les compétences partagées sont celles pour lesquelles les Etats membres demeurent compétents dans la mesure où l’Union n’a pas décidé d’intervenir. La CIG de 2007, à la demande en particulier de la République tchèque, s’est attachée à encadrer avec vigueur la répartition de ces compétences partagées :
– en excluant tout droit de préemption d’un domaine par les initiatives communautaires intervenant en son sein, grâce à l’adoption d’un protocole no 8 sur l’exercice des compétences partagées qui précise que « lorsque l’Union mène une action dans un certain domaine, le champ d’application de cet exercice de compétence ne couvre que les éléments régis par l’acte de l’Union en question et ne couvre donc pas tout le domaine » ;
– en posant explicitement le principe de la réversibilité des compétences. Si l’article 2 précité du TFUE reprend la formulation du traité constitutionnel qui prévoyait que « les Etats membres exercent leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne [ou] dans la mesure où l’Union a décidé de cesser d’exercer la sienne », la déclaration no 28 précitée précise que ce dernier cas de figure « peut se produire lorsque les institutions compétentes de l’Union décident d’abroger un acte législatif, en particulier en vue de mieux garantir le respect constant des principes de subsidiarité et de proportionnalité ». Si la CIG de 2007 n’est pas allée aussi loin que le réclamait la République tchèque, qui souhaitait que le Conseil puisse contraindre la Commission à lui soumettre un projet d’abrogation d’acte législatif, au mépris de son monopole d’initiative, elle a cependant prévu, dans la déclaration précitée qui ne dispose pas, il faut le rappeler, d’une valeur juridique contraignante, que « la Commission déclare qu’elle accordera une attention particulière à ce type de demande » formulée par le Conseil.
Les compétences partagées sont ensuite décrites à l’article 4 du TFUE modifié, s’appliquant aux domaines suivants :
– le marché intérieur ;
– la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité ;
– la cohésion économique, sociale et territoriale ;
– l’agriculture et la pêche, à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer ;
– l’environnement ;
– la protection des consommateurs ;
– les transports ;
– les réseaux transeuropéens ;
– l’énergie ;
– l’espace de liberté, de sécurité et de justice ;
– les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le traité.
■ Le traité de Lisbonne reprend ensuite à l’identique la liste des compétences d’appui pour lesquelles l’Union ne peut mener des actions que pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des Etats membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne :
– la protection et l’amélioration de la santé humaine ;
– l’industrie ;
– la culture ;
– le tourisme ;
– l’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport ;
– la protection civile ;
– la coopération administrative.
b) Un « durcissement » de la procédure de contrôle de subsidiarité confiée aux parlements nationaux
Afin de protéger les compétences des Etats membres, le traité de Lisbonne accroît sensiblement l’efficacité du dispositif de contrôle de la subsidiarité, dit d’alerte précoce, inventé par la CIG de 2004. Rappelons qu’en vertu du principe de subsidiarité, qui serait défini à l’article 5 du TUE modifié en reprenant les dispositions de l’actuel article 5 du TCE, « l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etats membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union ».
Les parlements nationaux disposeront de huit semaines (et non plus six) pour adresser des avis à la Commission sur les projets d’actes législatifs européens qu’elle devra obligatoirement leur soumettre dès leur publication. La brièveté du premier délai, qui s’accommodait mal de l’encombrement des ordres du jour des assemblées et des divergences entre calendriers nationaux et européens, affaiblissait la procédure en réduisant la faculté des parlementaires à se saisir des textes intervenant dans les périodes d’intense activité politique.
L’essentiel est cependant que la portée des avis des parlements nationaux est très significativement accrue. Le « carton jaune » prévu par le protocole sur la subsidiarité annexé au traité constitutionnel est maintenu : si un tiers (ou un quart pour les actes intervenant dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice) des parlements nationaux conteste la conformité d’un projet d’acte législatif européen à la subsidiarité, la Commission devra revoir son projet et motiver son maintien éventuel. Mais s’y ajoute un « carton orange », selon lequel le Conseil et le Parlement européen, en première lecture, devront se prononcer sur la conformité à la subsidiarité d’un projet d’acte contesté par la moitié des parlements nationaux. Ils pourront le rejeter à la majorité de 55 % des membres du Conseil ou de la majorité des voix exprimées au Parlement européen.
Le traité de Lisbonne accorde une place particulière à l’Europe sociale et comporte des avancées importantes par rapport au traité constitutionnel.
1) La reprise des acquis du traité constitutionnel
En premier lieu, il reprend l’ensemble des progrès sociaux incorporés dans la Constitution européenne, dont il ne faut pas méconnaître la portée.
a) Une économie sociale de marché tendant au plein emploi et au progrès social
S’agissant de l’orientation générale de l’action européenne, l’article 3 du TUE modifié qui définit les objectifs de l’Union reprend la formulation constitutionnelle de la recherche d’une « économie sociale de marché hautement compétitive qui tend au plein emploi et au progrès social », de la lutte contre « l’exclusion sociale et les discriminations » et de la promotion de « la justice et la protection sociale, l’égalité entre les femmes et les hommes [et] la solidarité entre les générations ».
Surtout, l’article 9 du TFUE modifié retranscrit la « clause sociale horizontale » proposée par la CIG de 2004 qui prévoit que « dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine ».
b) Le dialogue social européen
Le traité reconnaît par ailleurs l’importance du dialogue social au niveau européen en consacrant dans l’article 152 du TFUE modifié le « rôle des partenaires sociaux » et en mentionnant pour la première fois dans les traités le « sommet social tripartite pour la croissance et pour l’emploi » qui se tient traditionnellement au printemps. Dans le même esprit, le 3 de l’article 153 élargit la faculté accordée aux Etats membres de confier aux partenaires sociaux la mise en œuvre des directives et des dispositions issues d’un accord collectif à l’échelle européenne. Le Parlement européen sera désormais informé des accords conclus entre partenaires sociaux ainsi que des mesures prises par la Commission pour encourager la coopération entre les Etats membres (échanges de bonnes pratiques, évaluations…).
c) Vers un règlement général sur les services publics
Le traité de Lisbonne crée, à l’article 14 du TFUE modifié, une base juridique spécifique pour les services d’intérêt économique général (SIEG) autorisant l’Union, lorsque ses législateurs le jugeront opportuns, à adopter un règlement transversal établissant les principes et fixant les conditions, « notamment économiques et financières » permettant à ces services « d’accomplir leurs missions », sans préjudice de la compétence exclusive des Etats membres de les fournir, les faire exécuter et les financer.
L’Union a jusqu’ici privilégié une approche sectorielle des services d’intérêt général, abordés sous l’angle de l’unification du marché commun et de la libéralisation de secteurs d’activité particuliers (télécommunications, postes, énergie). Ainsi, si la Commission et la Cour de justice ont progressivement dessiné le cadre applicable aux services publics, autorisant les compensations financières ou règlementaires permettant de couvrir le coût des obligations de service public (qu’elles prennent la forme d’une compensation entre activités rentables et non rentables assurées par le fournisseur du service ou celle d’une subvention ou d’une sur-tarification), les solutions empruntées n’ont pas obéi à un cadre général préalable décliné selon les secteurs, mais à une approche empirique, au coup par coup. Il sera désormais possible de faire autrement. S’il est vrai que la Commission actuelle s’est montrée peu désireuse de mettre en chantier cette législation transversale, il est néanmoins décisif que le traité prévoit et autorise cette possibilité, qui pourrait constituer, à terme, l’un des plus puissants encouragements au développement d’une Europe des services publics de qualité.
d) Quelques autres progrès épars
Si, au-delà de ces articles d’application générale, les avancées concrètes de l’Europe sociale se heurtent à l’absence d’une volonté commune des Etats membres, il est utile de relever :
– l’extension du vote à la majorité qualifiée aux mesures relatives aux prestations sociales des travailleurs migrants ;
– le recours possible, et désormais facilité comme il sera vu infra, aux coopérations renforcées dans tous les autres domaines de la politique sociale afin de surmonter les blocages inhérents à l’unanimité qui gouverne le secteur ;
– les droits sociaux garantis par le titre IV de la Charte des droits fondamentaux, qui seront juridiquement contraignants, qu’il s’agisse du droit à l’information et à la consultation des travailleurs dans l’entreprise, du droit de négociation et d’action collective, de la protection en cas de licenciement injustifié, des conditions de travail justes et équitables, de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, de la sécurité sociale et de l’aide sociale ou de l’accès aux services d’intérêt économique général. Les citoyens pourront désormais demander l’annulation des actes européens mettant en cause ces droits sociaux.
2) Des nouvelles avancées prometteuses
Le traité de Lisbonne va plus loin encore en posant des principes clairs et novateurs, dont l’efficacité juridique peut aujourd’hui être débattue mais qui seront autant de bases à partir de laquelle pourra se déployer, lorsqu’une volonté politique commune y pourvoira, une politique sociale européenne ambitieuse.
a) La concurrence, moyen et non plus fin en soi de l’action de l’Europe
A la demande de la France, la CIG de 2007 a retiré des objectifs que l’article 3 du TUE modifié assigne à l’Union la « concurrence libre et non faussée » ravalée ainsi au rang plus modeste des moyens de l’Union pour établir un marché commun.
Il est vrai que l’article 119 du TFUE modifié, reprenant l’article 4 du TCE dans sa rédaction actuelle, qui dispose que « l’action des Etats membres et de l’Union » demeure « conduite conformément au respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre » et un nouveau protocole no 6 qui rappelle que le marché intérieur « comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée », garantiront la pérennité des pouvoirs de l’Union, en particulier ceux de la Commission, pour promouvoir une concurrence aussi libre que possible.
Cependant, en devenant non plus une fin en soi mais un moyen, parmi d’autres et susceptible désormais d’être confronté à d’autres l’aiguillon de la concurrence pourrait être atténué par la recherche d’un équilibre avec d’autres moyens aptes à satisfaire les autres objectifs de l’Union.
Bien sûr, la portée réelle de cette modification dépendra de son interprétation par les deux institutions au cœur des politiques européennes de la concurrence, la Commission et la Cour de justice. Il n’en reste pas moins possible, sinon probable, que la nouvelle intention clairement exprimée par le législateur suprême qu’est le rédacteur des traités devrait freiner une application brutale d’une concurrence irrespectueuse des équilibres sociaux de l’Union.
b) Le rôle reconnu de l’Europe dans la protection de ses citoyens
Une démarche comparable, impulsée par la France, a conduit la CIG a intégrer pour la première fois au sein des objectifs de l’Union dans ses relations avec le reste du monde la « protection de ses citoyens ». Là encore, la portée de cet amendement est politique, donnant une direction claire à l’Union sans préjuger des moyens qui seront employés, lorsque les institutions européennes en décideront et selon des modalités qu’elles détermineront, pour satisfaire à cet objectif.
Le progrès n’en demeure pas moins important puisqu’il met au cœur de l’Europe la nécessité de protéger les européens contre une mondialisation débridée ou déloyale au profit d’Etats bénéficiant d’avantages compétitifs disproportionnés induits par leurs carences sociales ou environnementales
Nombreux seront ceux à objecter que tant que les Etats membres ne trouveront pas d’accord sur les instruments concrets aptes à protéger leurs citoyens, l’objectif nouveau demeurera une déclaration d’intention sans réelle portée. Ce serait cependant méconnaître le sens de l’Histoire et la dynamique propre de la construction européenne : l’Union a toujours tendu dans le passé à épuiser le champ de ses compétences. En témoigne l’expérience de la construction du marché unique affirmée dans le traité fondateur et poursuivie sans relâche durant les cinquante dernières années. Qu’un consensus puisse se faire aujourd’hui pour reconnaître la nécessité de protéger ses citoyens est déjà un grand pas, et le voilà gravé dans le marbre des traités.
c) La reconnaissance de services publics nationaux de qualité élevée
Dans l’attente de l’édification d’une Europe sociale ambitieuse, les Etats membres ont veillé à plus clairement protéger leur compétence pour mettre en œuvre des services publics d’une qualité aussi élevée et conforme aux exigences de leurs citoyens que possible.
A cette fin, lorsque la Constitution se contentait de créer une nouvelle base juridique permettant l’adoption d’un instrument transversal fixant les principes communs applicables aux services économiques d’intérêt général (SIEG), le traité de Lisbonne introduit un protocole no 9, de même valeur juridique que les traités, reconnaissant le rôle essentiel et la grande marge de manœuvre des autorités nationales dans la mise en place des services d’intérêt général, la légitime disparité des besoins des populations et la nécessité de promouvoir un niveau élevé de qualité, de sécurité et d’accessibilité, l’égalité de traitement, l’accès universel et les droits des utilisateurs.
L’innovation principale du protocole est de dresser une barrière plus étanche contre les initiatives communautaires qui pourraient, notamment lorsqu’elles visent à renforcer la concurrence dans un secteur d’activité déterminé, mettre en péril la capacité des Etats membres à fournir à leurs citoyens des services publics d’une qualité qu’il leur appartient de définir, selon cependant des critères objectifs (accessibilité, moindre coût, égalité de traitement, etc.) qui garantissent qu’ils ne servent pas de prétexte à une rupture déguisée de la concurrence loyale.
L’équilibre entre concurrence et service public pourrait en être substantiellement modifié. Surtout, le traité de Lisbonne marque l’attachement profond des Etats membres à persévérer dans le maintien ou la mise en place de services publics ambitieux.
Pour parvenir à un accord unanime, les plus enthousiastes dans la marche vers l’intégration ont dû faire de réelles concessions aux plus eurosceptiques, qui induisent autant de risques pour la construction européenne.
1) Dix ans de plus pour le traité de Nice ? Les retards dans l’application de la double majorité
a) La double majorité attendra 2017
La concession la plus significative est le report à 2017 de l’entrée en vigueur effective de la règle de la majorité qualifiée au sein du Conseil.
S’il ne fallait retenir qu’une mesure qui justifie, à elle seule, l’approbation du traité de Lisbonne, ce serait la définition d’une règle légitime et pérenne de majorité au sein du Conseil. La règle de double majorité, selon laquelle les actes de l’Union sont adoptés lorsqu’ils recueillent l’adhésion de 55 % des Etats membres représentant au moins 65 % de la population de l’Union (contre 74 % des voix attribués aux Etats membres dans le traité de Nice) simplifie considérablement la prise de décision. Elle est plus légitime car directement lié au critère objectif de la population. Elle est plus durable en permettant de s’épargner à l’avenir de négociations laborieuses pour (re)définir le poids de chaque Etat. Et remarquons aussi qu’elle est plus favorable pour les « grands » pays, dont la France.
Or, l’accord de Bruxelles du 22 juin 2007 s’est principalement fait, face à l’hostilité de la Pologne à la double majorité, sur l’aménagement d’un délai transitoire repoussant de 2006, prévue dans la Constitution européenne, à 2014 voire 2017 l’application effective de la nouvelle règle.
Le traité de Lisbonne prévoit ainsi une mise en œuvre progressive en trois phases :
– la pondération du traité de Nice sera maintenue jusqu’au 31 octobre 2014 ;
– entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017 la double majorité régira les décisions du Conseil sauf si un Etat membre demande l’application de la pondération du traité de Nice ;
– la double majorité deviendra la seule règle à partir du 1er avril 2017.
Dans la pratique, le recours au vote, conçu plutôt comme une « arme de dissuasion », est très rare au sein du Conseil.
Les négociations dépendent plutôt de la perception que chaque Etat membre se fait de son aptitude réelle à parvenir à bloquer une décision. Dans cet esprit, les avancées sont possibles lorsque les Etats réticents, conscients de ne pouvoir rassembler une minorité suffisante pour empêcher une décision, renoncent à s’enfermer dans une posture inutile d’hostilité sans concession et préfèrent s’attacher à rapprocher la décision finale de leurs vues.
Ce mode de fonctionnement rend probable que les membres du Conseil continueront jusqu’en 2017 de raisonner selon le système de pondération du traité de Nice, qui définira dans les faits la vraie minorité de blocage permettant d’obérer les décisions.
L’adoption des actes les plus débattus demeurera ainsi ralentie par la nécessité de rallier une très large majorité des Etats.
En outre, il faudra procéder à une nouvelle pondération des voix des Etats membres susceptibles d’adhérer à l’Union avant 2017, ce qui ne manquera pas d’induire des négociations difficiles que la nouvelle règle avait pour objet de prévenir.
b) Un droit de veto temporaire reconnu aux Etats membres en minorité : le mécanisme de Ioannina
Toujours à l’initiative principale de la Pologne et afin d’atténuer l’effet couperet de la double majorité la CIG de 2007 a défini une procédure de veto temporaire pour les Etats mis en minorité au Conseil en réactivant et précisant le mécanisme dit de Ioannina, héritier du compromis de Luxembourg de 1966, adopté en 1994 à la demande de l’Espagne lors du passage de l’Union européenne de 12 à 15 membres.
Ce compromis permet à la Présidence du Conseil de procéder à une nouvelle délibération, au terme d’un délai « raisonnable » (mais non précisément défini), d’un texte soumis à un vote à la majorité qualifiée lorsque des Etats membres approchant de la minorité de blocage sans l’atteindre le demandent.
En raison du maintien à titre subsidiaire des règles du traité de Nice, les seuils d’invocation sont fixés à un niveau élevé jusqu’en 2017. Les Etats requérants devront représenter au moins 75 % de la population ou 75 % du nombre d’Etats membres nécessaires à la constitution d’une minorité de blocage
Ces seuils seront cependant très significativement abaissés par la suite. Les pourcentages passeront en effet à au moins 55 % de la population ou au moins 55 % du nombre d’Etats par rapport aux 35 % ou aux 45 % constituant la minorité de blocage.
Il faut rappeler que le traité constitutionnel recourait à ce mécanisme mais, d’une part, avec des seuils plus exigeants (75 %) et, d’autre part, de manière transitoire, le Conseil devant réfléchir aux moyens d’y mettre fin à partir de 2014.
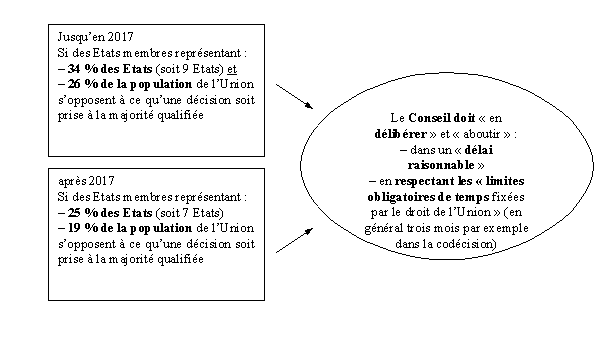
■ Le mécanisme de Ioannina n’est en aucun cas un droit de veto absolu qui aboutirait à faire passer, à partir de 2017, les seuils effectifs de majorité qualifiée de 55 % à 75 % des Etats et de 65 % à 81 % de la population (voir le graphique ci-dessus). En effet, le projet de décision du Conseil prévu à la déclaration no 4 du traité de Lisbonne rappelle que la constitution des « super-minorités » de blocage au sens de Ioannina interrompt la prise de décision au Conseil pour « un délai raisonnable ». Surtout, face aux divergences importantes entre les Etats membres sur l’interprétation du caractère raisonnable du délai, la Pologne avançant la durée inacceptable de deux ans et demi, la CIG a ajouté qu’il ne saurait « porter préjudice aux limites obligatoires de temps fixées par le droit de l’Union ». Cette précision est décisive. Le délai d’examen du Conseil est en effet généralement expressément limité par les traités. C’est en particulier le cas de la codécision qui oblige le Conseil à se prononcer dans les trois mois qui suivent le dépôt de la proposition.
■ Une deuxième difficulté s’est élevée s’agissant du statut juridique de ce compromis. Comme il a été vu, les déclarations annexées au traité n’ont pas de valeur juridique, à la différence des protocoles qui disposent du même statut que les traités eux-mêmes.
Dès lors, le mécanisme de Ioannina revêt la forme d’une simple décision du Conseil applicable à compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne qui peut être modifiée à la majorité qualifiée.
Afin de faire droit à l’exigence polonaise de garantir la pérennité du dispositif sans pour autant l’inscrire dans le marbre des traités et des protocoles la CIG a adopté un protocole n° 11 bis précisant que la décision de modifier le mécanisme devra être précédée d’un débat au Conseil européen qui statue par consensus. Ainsi protégé par son statut de droit primaire, le protocole garantit que le mécanisme ne pourra être modifié face à l’hostilité d’un seul Etat membre.
■ Il est dès lors raisonnable de penser que le compromis de Ioannina sera désormais un élément permanent tempérant la règle de la double majorité. Il est vrai qu’il n’en contrarie pas les effets, puisque le blocage ne peut être que temporaire. Mais il constitue un élément de ralentissement potentiel des travaux du Conseil qui va manifestement à l’encontre de l’objectif d’une prise de décision diligente et efficace.
2) Une Europe à la carte ? Les « opt-outs » britanniques
■ Les protocoles accompagnant le traité de Lisbonne accordent au Royaume-Uni et à l’Irlande, laquelle avait dans un premier temps réservé sa position, le droit de ne pas participer (« opting-out ») à l’ensemble de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Ils jouissent de cette faculté pour toutes les mesures de la justice et des affaires intérieures déjà communautarisées, c’est-à-dire intégrées dans les procédures de droit commun. Elle est donc ainsi étendue à la coopération judiciaire en matière pénale et à la coopération policière qui relevait jusqu’alors du troisième pilier de l’Union, intergouvernemental et donc soumis à l’unanimité, que le traité de Lisbonne communautarise.
En la matière, comme pour l’espace sans frontière de Schengen, le principe fixé par le protocole no 4 annexé au TFUE est que les deux Etats ne participent pas à l’adoption des mesures proposées dans le chapitre IV sauf s’ils notifient au président du Conseil, dans les trois mois qui suivent la présentation à l’institution du projet, leur souhait d’intégrer l’action envisagée. Ainsi, la dérogation est permanente et par principe, avec libre droit de participation (« opt-in ») à la carte.
Ce mécanisme de présomption de dérogation et de libre inclusion pour toutes les mesures relevant de la justice et des affaires intérieures peut être étendu, à sa demande, au Danemark, qui relève en attendant d’une dérogation permanente et globale, selon laquelle il ne participe à aucune mesure dans ce domaine sauf s’il renonce au bénéfice de son protocole et, dans ce cas, doit participer à toutes les avancées dans les mêmes conditions que ses partenaires.
Ce régime du « rien ou tout » est d’ailleurs celui qui s’applique aux Etats qui n’ont pas adopté l’euro et au Danemark pour toutes les mesures relevant de la citoyenneté, l’Union économique et monétaire (UEM) et la politique de défense.
Il est important de bien saisir la différence entre les deux modalités de dérogation.
Le « tout ou rien », aménagé dans le cas du Danemark pour répondre aux préoccupations de ses citoyens qui avaient rejeté en 1992 le traité de Maastricht, crée certes une Europe à géométrie variable, mais il n’affecte pas l’action des autres Etats membres qui participent au domaine faisant l’objet de la dérogation. En revanche, les participations « à la carte » permettent à l’Etat membre qui en bénéficie de pouvoir peser sur les décisions adoptées puisqu’il conserve le droit d’y participer lorsqu’il le souhaite. Le risque d’une Europe à plusieurs vitesses est dans ce dernier cas aggravé par le risque d’une Europe fragmentée, dont l’action perd en lisibilité voire en cohérence et dont l’efficacité peut être obérée par le comportement d’un seul Etat.
■ Pour faire face à cette difficulté, l’essentiel des débats de la CIG de 2007 a porté sur les modalités concrètes d’exercice des droits à participation (« opt-ins ») du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark aux mesures prises dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
L’enjeu était de parvenir à maintenir la cohérence et l’efficacité opérationnelle des mesures entreprises dans ces deux cadres dans les cas où le Royaume-Uni, l’Irlande ou le Danemark auraient accepté de participer à une mesure initiale mais refuseraient de participer à une mesure de développement de la première mesure. Par exemple, le Conseil s’est entendu en juin 2007 pour mettre en œuvre au niveau européen les principaux éléments de l’accord de Prüm de 2005, en prévoyant notamment que les services de police des Etats membres devront relier leurs bases de données ADN. Si, à l’avenir, la majorité décidait de créer une base de données centralisée sans que le Royaume-Uni accepte d’y participer, comment maintenir à la fois un système décentralisé pour un pays et un système centralisé pour tous les autres ? De même, dans l’espace de Schengen, comment serait-il possible de gérer la participation d’un Etat au système informatisé de gestion des frontières et son refus de participer à une mise à niveau ou une amélioration du système ?
Une solution radicale aurait pu être de réintroduire des éléments de « tout ou rien ». Dans cette logique, les autorités britanniques ont accepté en 2000 de participer de manière irrévocable à l’acquis de l’espace sans frontière de Schengen et à l’ensemble de ses développements.
Une approche plus nuancée a été retenue par la CIG. Les Etats membres participant à des mesures de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ou à l’espace de Schengen pourront décider d’exclure le Royaume-Uni ou l’Irlande des mesures initiales auxquelles ces derniers ont participé lorsqu’ils refusent de participer aux mesures de développement.
Cette décision relèvera du Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, avec une clause d’appel au Conseil européen. Il lui appartiendra cependant de tenir compte de la nécessité de la « participation maximale » du Royaume-Uni à l’acquis communautaire.
■ Dans le même esprit, le Conseil européen a agréé l’aménagement par les experts juridiques de dispositions transitoires s’agissant de la compétence de la Cour de justice et de la Commission à l’égard des mesures anciennement adoptées au titre du troisième pilier (coopération judiciaire et policière en matière pénale).
Celles-ci et les mesures de mise en œuvre dans les Etats membres sont actuellement exclues des procédures d’infraction pour manquement des articles 226 et suivants du TCE. Un protocole fixe une période transitoire de cinq ans avant que les compétences des institutions soient élargies, le Royaume-uni se voyant reconnaître là encore un opt-out de ce contrôle entraînant cependant l’annulation de sa participation aux mesures adoptées.
■ De toute évidence, ces dérogations complexes affaiblissent la cohérence de l’Union. Elles étaient cependant inéluctables car elles conditionnaient l’adhésion de leurs bénéficiaires à l’ensemble du traité. Le risque n’en est pas moins élevé que le fossé se creuse entre les nombreux Etats membres partisans de l’intégration pour faire face aux nouveaux défis et les plus réticents qui rejettent la poursuite de l’intégration communautaire pour traiter ces questions tout en se conservant prudemment la possibilité de changer d’avis « à la carte ».
Il est aussi possible d’être plus optimiste en observant que, le temps faisant, les plus réticents semblent évoluer dans leur position et que les « opt-ins » sont dans les faits plus contagieux que les « opt-outs », ce qui préjuge plutôt favorablement de l’attractivité de l’intégration.
En témoigne la déclaration unilatérale de l’Irlande accompagnant le traité de Lisbonne dans laquelle elle fait part :
– de « sa ferme intention d’exercer le droit qui lui est conféré […] de prendre part, autant que possible, à l’adoption de mesures relevant [l’espace de liberté, de sécurité et de justice en particulier] dans le domaine de la coopération policière » ;
– de son « intention de revoir le fonctionnement [des dispositions du protocole à son égard] dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du traité ».
En témoigne aussi la volonté exprimée par le Gouvernement danois de remettre en cause, le cas échéant par référendum, ses dérogations permanentes.
Le traité de Lisbonne est fruit de la nécessité, à la rencontre de deux exigences : résoudre une fois pour toute la crise institutionnelle qui obsède l’Europe depuis une dizaine d’années sans remettre en cause l’équilibre politique très délicat auquel étaient parvenus les Etats membres lors de la Convention de 2002 puis la Conférence intergouvernementale de 2004.
Sortir de l’impasse du traité de Nice
Le rapporteur a remarqué en introduction que le traité est « indispensable ». Cette remarque forte doit être étayée. L’essentiel tient à ce que le traité de Nice qui gouverne depuis 2004 le fonctionnement de l’Union a montré de fortes limites susceptibles de freiner durablement la construction européenne. A vrai dire, la « règle fondamentale » de l’Union est insatisfaisante depuis une dizaine d’années. En témoigne la rapidité avec laquelle nos institutions sont régulièrement réformées : le traité de Nice, négocié en 2000, n’avait suivi que de trois années le traité d’Amsterdam. Et moins d’un an plus tard, le Conseil européen de Laeken relançait des discussions institutionnelles à peine closes pour adapter l’Union à ses nouvelles dimensions et au siècle naissant.
Il serait excessif de dire que l’Europe est aujourd’hui bloquée et incapable d’agir. La Commission présidée par M. José Manuel Barroso continue à promouvoir un agenda législatif dynamique et ambitieux. Le Conseil fonctionne, prend des décisions et trouve des compromis. La qualité de la contribution du Parlement européen aux textes communautaires est sans cesse croissante.
L’Europe avance. Mais le traité de Nice l’enferme dans une impasse.
C’est qu’en effet nous approchons de très près des limites de ce que le système institutionnel du traité de Nice nous permet d’accomplir. Cela tient à ses profondes carences aujourd’hui évidentes.
■ La première est l’excessive rigidité du système de décision, en particulier au Conseil. A contre-courant de la marche européenne, le traité de Nice et les traités d’adhésion ont relevé le seuil de majorité au Conseil à 74 % des voix attribuées aux Etats membres. C’est beaucoup, sans doute trop. Cette majorité élevée ne pose pas de difficultés dans les domaines où les Etats membres souhaitent avancer au même pas. En cela, l’Europe continue à progresser, que ce soit dans l’unification du marché commun (directive postale par exemple) ou dans la pose des premiers jalons de l’espace judiciaire commun (reconnaissance mutuelle des peines, mandat d’arrêt, application commune des sanctions). Mais l’exigence d’un très haut degré de consensus freine indéniablement l’Union et affadit ses actions au moment même où le besoin d’Europe devient criant et appelle des choix ambitieux et efficaces. Il n’est ainsi pas possible aujourd’hui d’avancer substantiellement vers une gestion commune de l’immigration dans un système qui fait tant de place à l’obstruction des moins volontaires. De même, la modestie et la lenteur des décisions en matière de justice et d’affaires intérieures sont manifestement disproportionnées face aux enjeux d’une lutte efficace contre les crimes graves.
En dernière analyse, ce problème, que l’on découvre aussi dans le fonctionnement de la Commission dont l’inflation des membres peut parfois obscurcir la cohérence d’ensemble du programme législatif, est un problème de « taille ». Les institutions actuelles, conçues pour fonctionner à douze Etats, sont inadaptées à une Europe à vingt-sept dans laquelle les intérêts et les objectifs des Etats membres peuvent être considérablement divergents.
■ D’ailleurs, et c’est son deuxième grand défaut, le traité de Nice fait une part trop belle au carcan de l’unanimité qui étouffe les initiatives en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, d’intégration et de gestion des migrations avec les pays d’origine, de lutte contre le changement climatique… La politique étrangère peut parfois atteindre le paroxysme de l’impuissance liée à l’hégémonie du veto reconnu à chaque Etat membre.
■ De même, l’extrême complexité des procédures juridiques entrave l’action de l’Union dans ses relations avec le reste du monde. Par exemple, il est aujourd’hui nécessaire d’adopter trois actes successifs pour conclure un accord avec un pays tiers qui aborde les questions de délivrance des visas, de lutte contre la criminalité et de coopération dans les enceintes internationales. Dans le même ordre d’esprit, le fait qu’aucune coopération renforcée n’ait vu le jour dans le cadre prévu par les traités montre clairement qu’il y a, ici aussi, des progrès à faire.
■ Enfin, les référendums de 2005 ont montré sans appel que l’Europe ne parvient pas à résoudre son déficit démocratique dans sa forme actuelle. L’enchevêtrement des procédures, aggravé par l’existence de « piliers » aux modes de fonctionnement contraires, le rôle ambigu des institutions selon les domaines traités, la part trop faible voire inexistante laissée aux initiatives citoyennes et aux parlements nationaux, la concentration de l’efficacité institutionnelle vers les tâches les moins urgentes aux yeux des populations (concurrence, marché intérieur…) et la multiplication des obstacles procéduraux dans les plus décisives (terrorisme, immigration, innovation…), tout cela contribue à creuser le fossé entre l’Europe et ses peuples.
Ne pas rouvrir la boîte de Pandore institutionnelle
Ces carences sont graves, et elles compromettent l’avenir de la construction européenne. La Constitution apportait des remèdes efficaces et ambitieux. Son rejet impliquait-il d’en chercher de nouveaux ? Le rapporteur estime que non, pour au moins deux raisons.
■ La première découle d’une interprétation du verdict des peuples français et néerlandais. Il serait audacieux de sonder les cœurs, mais il semble au rapporteur que les débats, et les motifs de refus n’ont pas porté sur les institutions à proprement parler. Les Français n’ont manifestement pas rejeté la création d’un président pour l’Europe. Ils ne semblent pas avoir contesté la légitimité de la nouvelle règle de décision au Conseil. Que le Parlement européen devienne pleinement co-législateur n’a guère fait couler d’encre. Au fond, l’architecture institutionnelle est, avec la Charte des droits fondamentaux, la partie de la Constitution qui a le moins fait l’objet de critiques et, par conséquent, de rejet.
■ La deuxième raison qui justifie que l’on ait sagement choisi de ne pas rouvrir la boîte de Pandore institutionnelle est liée, comme tout ce qui touche à l’Europe, à l’extrême fragilité de l’équilibre atteint en 2004. Chaque Etat membre a alors dû faire d’importantes concessions. La force de la dynamique insufflée par la Convention, qui échappait à une logique intergouvernementale souvent restrictive et excessivement prudente, a permis d’aller très loin dans cette voie comme dans celle de la cohérence. La nouvelle architecture institutionnelle, à la différence des compromis atteints par les traités d’Amsterdam et de Nice, a ainsi pu apparaître ambitieuse et durable.
A l’inverse, les intérêts étatiques se sont vite engouffrés dans la brèche ouverte par la renégociation d’un traité en juin dernier, revenant sur des concessions pourtant agréées trois ans plus tôt. Qu’en aurait-il été si tout avait à nouveau été sur la table ?
En outre, dix-huit Etats ont ratifié la Constitution européenne. Etait-il possible de n’accorder aucun poids à leur engagement, parfois difficile ?
C’est pourquoi le traité de Lisbonne reprend l’essentiel des innovations institutionnelles proposées dans la Constitution européenne. Et leur exposé montre sans appel que c’est la meilleure des solutions envisageables.
A. La clarification de l’architecture institutionnelle européenne : une Europe incarnée et mieux capable de décider
Le traité de Lisbonne clarifie les institutions européennes. Les articles 13 à 19 du Traité sur l’Union européenne (TUE) modifié expose à cette fin la nature et les compétences des institutions dont l’article 13 dispose qu’elles visent à « promouvoir ses valeurs, poursuivre ses objectifs, servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des Etats membres, ainsi qu’à assurer la cohérence, l’efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions ».
1) Le Parlement européen, colégislateur de l’Union, source de la politisation de l’Europe ?
Le président de la Convention de 2002 avait qualifié le Parlement européen de « grand gagnant de la Constitution ». Promu en co-législateur de droit commun, y compris dans la procédure budgétaire, consulté dans la plupart des domaines dont il est exclu dans les traités actuels, « électeur » désormais consacré du président de la Commission, le Parlement est la première institution citée dans le TUE modifié.
a) Le Parlement européen sur un pied d’égalité avec le Conseil
(1) Un régime bicaméral égalitaire dans la procédure législative ordinaire et dans la procédure budgétaire
■ Le traité de Lisbonne étend la codécision, grâce à laquelle le Parlement et le Conseil sont traités sur un pied d’égalité dans l’adoption des actes législatifs, à presque tous les domaines dans lesquels s’appliquent la règle de la majorité qualifiée au Conseil. Une quarantaine de nouveaux sujets sont ainsi soumis à ce que l’article 294 du TFUE modifié nomme désormais la « procédure législative ordinaire » de l’Union : contrôles aux frontières, asile, immigration, coopération judiciaire en matière criminelle, harmonisation des peines minimales dans les domaines de criminalité grave revêtant une dimension transfrontalière, prévention du crime, Eurojust, Europol, protection civile, certains aspects de la politique agricole commune et du commerce extérieur, etc.
■ Dans le même esprit, en abandonnant la distinction entre les dépenses obligatoires (en particulier les crédits de la politique agricole commune), sur lesquelles le Conseil dispose du droit de dernier mot et les dépenses non obligatoires (fonds structurels et politiques internes notamment) décidées en dernier ressort par le Parlement, l’article 314 du TFUE modifié par le traité de Lisbonne met les deux institutions sur un pied d’égalité dans l’élaboration du budget avec cependant deux correctifs importants :
– afin d’accélérer la procédure, une seule lecture est prévue dans chaque institution et le calendrier d’examen est strictement encadré ;
– afin de trancher les éventuels conflits, le dernier mot est accordé au Parlement, mais avec cependant des contraintes de seuils l’obligeant à une forte cohésion : il ne pourra rejeter le projet de budget proposé par le comité de conciliation du Conseil et du Parlement qu’à la majorité de ses membres ; de même, il pourra adopter un budget rejeté par le Conseil, mais aux trois cinquièmes des suffrages exprimés représentant au moins la moitié de ses membres.
(2) Un pouvoir d’approbation et d’influence
Dans les autres domaines, le Parlement européen se voit reconnaître un droit d’intervention renforcée.
■ Un pouvoir d’approbation lui est reconnu dans des domaines où il n’était jusqu’alors que consulté.
C’est le cas notamment de la clause de flexibilité de l’ancien article 308 du TCE (désormais article 352 du TFUE) qui permet au Conseil statuant à l’unanimité d’ajuster les compétences de l’Union pour atteindre l’un des objectifs des traités.
C’est aussi le cas pour l’adoption du cadre financier pluriannuel, aujourd’hui négocié par le seul Conseil européen.
Dans le même esprit, devront désormais être approuvés par le Parlement européen la suspension de certains droits des Etats membres en cas de violation grave des valeurs de l’Union, l’extension par le Conseil du champ des domaines de criminalité pouvant donner lieu à une harmonisation et presque tous les accords internationaux.
Deux nouvelles procédures d’approbation pourraient enfin constituer une arme institutionnelle redoutable aux mains du Parlement européen.
L’article 329 du TFUE modifié dispose ainsi que l’autorisation de procéder à une coopération renforcée en dehors de la politique étrangère et de sécurité commune est accordée par le Conseil après approbation du Parlement européen. Il importe à cet égard de remarquer que l’article 20 du TFUE modifié précise que ces coopérations ont recours aux institutions de l’Union et exercent leurs compétences en « appliquant les dispositions appropriées des traités », ce qui signifie que le Parlement européen, dans sa plénitude (et quelle que soit la nationalité de ses membres, fussent-ils ressortissants d’un Etat ne participant pas à la coopération renforcée), intervient dans des conditions de droit commun dans l’élaboration des normes du groupe pionnier. Ainsi, le Parlement devient l’arbitre des coopérations renforcées, et il ne devrait pas manquer d’en profiter pour s’assurer que leur vocation soit de s’étendre, à terme, à tous les Etats membres. Dans ce contexte, il n’est pas exclu que l’implication parlementaire conduise les Etats membres à choisir d’autres voies que la procédure du traité pour avancer ensemble, à l’image de la coopération qui a mené au traité de Prüm.
L’approbation obligatoire par le Parlement du choix du Conseil européen de procéder à une révision des traités sans convocation préalable d’une Convention – laquelle devient le mode de révision de droit commun –, « lorsque l’ampleur des modifications ne le justifie pas », posée à l’article 48 du TUE modifié pourrait aussi se révéler un puissant facteur d’influence. Les chefs d’Etat et de gouvernement, dont il est probable qu’ils garderont une nette préférence pour la révision par conférence intergouvernementale qu’ils maîtrisent pleinement et exclusivement, devront ainsi « monnayer » le consentement du Parlement européen qui devrait en profiter pour s’arroger un rôle important dans la révision projetée.
■ Enfin, le Parlement européen sera désormais consulté dans des domaines qui échappent jusqu’alors à son regard, qu’il s’agisse des mesures concernant la protection diplomatique et consulaire des citoyens de l’Union, de celles relatives au régime linguistique des titres de propriété intellectuelle comme le brevet européen, des dispositions concernant les passeports, cartes d’identité, titres de séjour et assimilés, etc.
Désormais seules échappent au champ d’intervention du Parlement les mesures soumises à l’unanimité.
Au total, le Parlement européen est clairement promu dans le champ des compétences communautaires en chambre d’un bicamérisme quasi égalitaire. Cette évolution est d’autant plus décisive qu’elle intervient dans des domaines touchant au cœur de la souveraineté, en particulier l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Cet accroissement spectaculaire de compétences ne manquera d’ailleurs pas d’induire de lourdes tensions matérielles (nombre de commissions, organisation des sessions, etc.) qu’il lui appartiendra de résoudre dans des délais très brefs.
Qualifier l’Union de régime « parlementaire » serait cependant prématuré.
La première raison est de nature procédurale, mais d’importance : le Parlement européen ne dispose pas, au contraire des parlements nationaux, d’un droit d’initiative propre dans le domaine législatif, monopole que conserve la Commission sauf s’agissant de la coopération judiciaire et pénale où elle le partage avec les Etats membres. Ainsi, le Parlement européen ne maîtrise pas son agenda politique.
Ici réside une seconde limite plus « existentielle ». Le traité de Lisbonne ne tranche pas le débat sur le principe fondamental guidant le fonctionnement du Parlement européen, entre les légitimités proprement politique (existence d’une majorité et d’une opposition constituée selon des critères politiques, comme dans les démocraties), fonctionnelle (« pros » et « antis » intégration), institutionnelle (un Parlement « uni » pour asseoir son poids politique propre face au Conseil et à la Commission), voire nationale (députés européens « défenseurs » de leurs intérêts nationaux). En reprenant le fil de sa légitimité qui le relie aux « citoyens européens » mais en la tempérant par une représentation dégressive par Etats membres, en disposant surtout clairement que le président de la Commission est élu par le Parlement, tout en affirmant la vocation neutre de poursuite de l’intérêt général qui est assignée à cette institution, le traité apporte quelques réponses sans réduire une ambiguïté qui est celle de l’Europe.
b) L’élection du président de la Commission : l’émergence d’une politisation de l’Europe ?
■ L’article 9 du TUE modifié dispose que le Parlement « élit le président de la Commission », lorsque l’article 214 du TCE actuel se borne à indiquer que « cette désignation [par le Conseil européen] est approuvée par le Parlement ». Il est vrai que la nuance est d’autant plus sémantique que l’article 17 du TUE modifié conserve au Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, le rôle décisif de faiseur de roi. C’est lui qui sélectionne le candidat soumis à l’investiture du Parlement. Cependant, le traité indique clairement que ce choix doit se faire « en tenant compte des élections au Parlement européen ».
A toutes fins utiles, la déclaration no 6 annexée au traité de Lisbonne précise que « le Parlement européen et le Conseil européen ont une responsabilité commune dans le bon déroulement du processus conduisant à l’élection du président de la Commission européenne. En conséquence, des représentants du Parlement européen et du Conseil européen procéderont, préalablement à la décision du Conseil européen, aux consultations nécessaires dans le cadre jugé le plus approprié. Ces consultations porteront sur le profil des candidats aux fonctions de président de la Commission en tenant compte des élections au Parlement européen ».
En dernière analyse, l’application pratique de cette « responsabilité commune » dépendra des progrès accomplis dans la voie de la politisation de l’Europe. Si le Parlement s’organise clairement selon des lignes de fractures essentiellement politiques en encourageant, par exemple, les partis politiques européens à désigner lors des élections de 2009 leurs candidats pour la fonction de président de la Commission, le rôle du Conseil européen pourrait se limiter à celui exercé par la reine d’Angleterre ou le Président de la République italien, qui choisissent le principal dirigeant du ou des partis vainqueurs des élections sans réelle marge de manœuvre. Le rôle du PPE dans la désignation de M. José Manuel Barroso en 2004 à la place du candidat pressenti par les principaux Etats membres au sein du Conseil européen peut d’ailleurs s’interpréter comme les prémisses de cette évolution. Le risque est alors que la Commission elle-même se politise, entretenant la méfiance du camp vaincu aux élections à l’égard de ses projets et provoquant des tensions lorsque la majorité du Conseil européen est d’une couleur politique opposée à celle du Parlement. Mais ce risque est inhérent à la politisation de l’Europe.
■ Le même article 17 du TUE modifié reprend le principe de responsabilité collégiale de la Commission devant le Parlement européen qui peut adopter aux deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié de ses membres une motion de censure dont la Commission présidée par M. Jacques Santer a appris à ses dépens en démissionnant collectivement le 15 mars 1999 qu’elle n’est pas une vaine menace.
Comme il sera vu infra, les difficultés d’application pourraient naître de la responsabilité clairement posée du haut représentant en tant que membre du collège, alors même qu’il joue un rôle autonome au sein du Conseil. Cette responsabilité est une arme puissante à l’usage du Parlement, qui pourrait peser dans l’orientation que prendra le titulaire de cette fonction.
c) Le Parlement, représentant des citoyens européens ? La difficile question de sa composition
Comme la Constitution européenne, le traité de Lisbonne prévoit que les effectifs du Parlement sont rationalisés par l’introduction d’un plafond de 750 membres permettant de mettre fin à l’inflation du nombre de députés européens induite par les élargissements successifs de 2004 et 2007.
L’article 9 du TUE modifié, reprenant les dispositions agréées en 2004, ne précise plus la répartition des membres par Etats membres, renvoyant à une décision du Conseil européen prise à l’unanimité sur initiative et avec l’approbation du Parlement. Il se contente d’indiquer qu’elle doit respecter le principe « proportionnalité dégressive » qui induit que plus un Etat membre est peuplé, plus ses députés européens représentent un nombre élevé de citoyens. Les chefs d’Etat et de gouvernement ont cependant estimé indispensable de trouver un accord sur cette décision en même temps qu’ils adoptaient le traité, afin que les élections de 2009 puissent se dérouler sans qu’y interfère une question âprement débattue entre les Etats membres.
Le Parlement européen a adopté, le 11 octobre 2007, un rapport présenté par MM. Alain Lamassoure et Adrian Severin relatif à la nouvelle répartition des sièges par Etats membres. La difficulté de leur tâche tenait évidemment à l’imprécision du concept de « proportionnalité dégressive » qui se prête d’autant moins à l’application de formules mathématiques intangibles que le traité prévoit un plafond de 96 membres pour l’Etat le plus peuplé et un plancher de six membres pour le moins peuplé. Ces deux dispositions induisent nécessairement une représentation très disproportionnée. Ainsi, un député maltais doit représenter 67.000 habitants, un allemand 860.000 lorsqu’en moyenne un député européen correspond à 660.000 citoyens. Les deux rapporteurs ont d’ailleurs choisi, sagement, d’encadrer un peu plus leurs travaux en excluant toute nouvelle diminution de membres par Etats. Il faut en effet rappeler que le traité de Nice prévoit une réduction de 785 à 736 du nombre de députés européens entre les mandatures 2004-2009 et 2009-2014. La France, le Royaume-Uni et l’Italie verraient en particulier leurs effectifs réduits de six députés chacun.
Les rapporteurs ont choisi d’accorder quatre sièges supplémentaires par rapport à la répartition prévue pour 2009 à l’Espagne, deux à la France, la Suède et l’Autriche et un aux Pays-Bas, à la Pologne, au Royaume-Uni, à la Bulgarie, à la Lettonie et à la Slovénie.
Cependant, afin de faire droit à la demande de l’Italie, très affectée par la perspective de perdre sa traditionnelle parité avec la France et le Royaume-Uni, de disposer d’un parlementaire européen de plus que proposé dans la résolution adoptée par le Parlement européen, le Conseil européen des 18 et 19 octobre 2007 a relevé d’un membre le plafond du nombre de députés européens de 750 à 751 (l’article 14 du TUE modifié disposant désormais que « leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante, plus le président »). Cela ne modifie en rien le droit de vote du président, dont la coutume veut qu’il en fasse un usage modéré. Ainsi, la composition du Parlement européen à partir de 2009 serait définie selon le tableau ci-dessous.
Etat membre |
Habitants en millions (Données Eurostat) |
Nombre de membres actuels |
Nombre de membres à partir de 2009 selon le traité de Nice |
Nombre de membres selon le projet de décision du Conseil agréé à Lisbonne |
Rapport popula-tion par député |
Coeffi-cient de pondéra-tion (rapport à la moyenne) |
Allemagne |
82,438 |
99 |
99 |
96 |
858.729 |
1,3 |
France |
62,886 |
78 |
72 |
74 |
849.814 |
1,3 |
Royaume-Uni |
60,422 |
78 |
72 |
73 |
827.697 |
1,3 |
Italie |
58,752 |
78 |
72 |
73 |
815.996 |
1,2 |
Espagne |
43,758 |
54 |
50 |
54 |
810.339 |
1,2 |
Pologne |
38,157 |
54 |
50 |
51 |
748.178 |
1,1 |
Roumanie |
21,610 |
35 |
33 |
33 |
654.855 |
1,0 |
Pays-Bas |
16,334 |
27 |
25 |
26 |
628.238 |
1,0 |
Grèce |
11,125 |
24 |
22 |
22 |
505.691 |
0,8 |
Portugal |
10,570 |
24 |
22 |
22 |
480.436 |
0,7 |
Belgique |
10,511 |
24 |
22 |
22 |
477.791 |
0,7 |
Rép. Tchèque |
10,251 |
24 |
22 |
22 |
465.959 |
0,7 |
Hongrie |
10,077 |
24 |
22 |
22 |
458.027 |
0,7 |
Suède |
9,048 |
19 |
18 |
20 |
452.390 |
0,7 |
Autriche |
8,266 |
18 |
17 |
19 |
435.047 |
0,7 |
Bulgarie |
7,719 |
18 |
17 |
18 |
428.822 |
0,7 |
Danemark |
5,428 |
14 |
13 |
13 |
417.500 |
0,6 |
Slovaquie |
5,389 |
14 |
13 |
13 |
414.554 |
0,6 |
Finlande |
5,256 |
14 |
13 |
13 |
404.308 |
0,6 |
Irlande |
4,209 |
13 |
12 |
12 |
350.750 |
0,5 |
Lituanie |
3,403 |
13 |
12 |
12 |
283.583 |
0,4 |
Lettonie |
2,295 |
9 |
8 |
9 |
255.000 |
0,4 |
Slovénie |
2,003 |
7 |
7 |
8 |
250.375 |
0,4 |
Estonie |
1,344 |
6 |
6 |
6 |
224.000 |
0,3 |
Chypre |
0,766 |
6 |
6 |
6 |
127.667 |
0,2 |
Luxembourg |
0,460 |
6 |
6 |
6 |
76.667 |
0,1 |
Malte |
0,404 |
5 |
5 |
6 |
67.333 |
0,1 |
TOTAL |
492,881 |
785 |
736 |
751 |
657.174 |
1,0 |
De toute évidence, la répartition retenue est beaucoup plus « dégressive » que « proportionnelle ». Un député européen allemand représentera ainsi treize fois plus d’habitants qu’un maltais, un français deux et demi fois plus qu’un irlandais. En outre, de nouvelles négociations devront être engagées pour définir la représentation des membres des Etats qui adhéreront à l’Union après 2009 sans qu’un principe légitime et pérenne n’ait pu être défini. Le Parlement européen s’est engagé à se saisir de cette question durant sa prochaine législature pour trouver un point d’équilibre qui établisse clairement qu’il représente des citoyens, pas des Etats.
2) Le président du Conseil européen, le haut représentant, le président de la Commission : l’Europe incarnée
Un autre changement fondamental susceptible au sens propre comme au figuré de changer le visage de l’Europe est la création, proposée par la Convention de 2002, d’un président pour l’Europe.
a) L’Europe aux vingt-sept visages : les limites des présidences tournantes
L’Union souffre d’être désincarnée. Dans un monde où l’incarnation du pouvoir tend à s’imposer comme le fondement ultime de la légitimité démocratique en ce qu’elle induit une responsabilité claire et identifiable lorsque les politiques poursuivies atteignent un niveau de complexité presque inabordable par les citoyens, l’absence de référent clair, de « président », nuit à la lisibilité démocratique des institutions et affaiblit la cohérence – ou la perception d’une cohérence – de l’action publique.
Le système d’une rotation semestrielle des présidences entre chaque Etat membre mis en place à l’origine de la Communauté trouve ici sa limite. S’y ajoute la brièveté du mandat qui obère la continuité des travaux du Conseil et fractionne la représentation internationale de l’Union.
L’élargissement de l’Europe a accentué ces défauts. Les Etats n’assument plus la présidence que tous les quatorze ans. La tentation devient presque irrésistible d’en faire un temps fort de la vie politique nationale en privilégiant à la poursuite des projets communs le lancement d’initiatives spectaculaires répondant plus aux priorités internes qu’aux besoins et aux possibilités réels de l’Union. Parallèlement, avec l’accroissement de ses membres, le Conseil se rapproche d’une assemblée délibérative aux intérêts variés. Le présider dans la culture du consensus qui inspire ses travaux depuis le traité de Rome relève dans ce contexte de la gageure.
Des progrès ont certes été accomplis. Le haut représentant pour la politique extérieure et de sécurité commune porte désormais efficacement la voix de l’Europe sur la scène internationale. La nomination d’envoyés spéciaux dans les régions à risque contribue elle aussi à incarner l’Union là où son intervention doit être cohérente et efficace. La pratique des « troïkas » grâce auxquelles les trois présidences successives s’associent pour organiser la continuité des travaux et représenter l’Union au plus haut niveau, joue un rôle sans doute utile.
Mais ces corrections ne changent pas fondamentalement les choses : la rotation des présidences ne permet pas à l’Europe d’intégrer la durée au cœur de ses préoccupations et nuit à son identification auprès de ses partenaires internationaux et de ses citoyens.
b) Le rôle délibérément imprécis du président du Conseil européen
En réponse à ce problème, l’article 15 du TFUE modifié crée la fonction de président du Conseil européen élu par les chefs d’Etat et de gouvernement à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi renouvelable une fois.
Le rôle du président de l’Europe est encore débattu. Deux modèles sont souvent opposés. Celui d’une présidence « chairman », axée prudemment sur les figures du « facilitateur de compromis », d’« honnête courtier » et de garant des grands équilibres institutionnels. Et celui d’une présidence « leader » responsable ultime du destin de l’Union aux yeux de ses citoyens. Aucun des termes de l’alternative n’est pleinement réaliste.
■ De toute évidence, le 6 de l’article 15 du TFUE pare le président des attributs traditionnels des « chairmen » en disposant qu’il :
« a) préside et anime les travaux du Conseil européen ;
b) assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec le président de la Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales ;
c) oeuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen ;
d) présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil européen. »
En outre, le « président du Conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, la représentation extérieure de l’Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, sans préjudice des attributions du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ».
Ces compétences sont celles traditionnellement dévolues au Premier ministre ou au chef de l’Etat membre assurant la présidence tournante du Conseil.
■ Le rôle du président ne peut cependant pas se limiter à celui de « chairman ». D’abord, parce qu’il anime l’institution chargée par le traité de définir les orientations fondamentales de l’Union. L’article 15 du TUE modifié assigne en effet au Conseil européen, promu au rang d’institution de l’Union, la mission de donner « à l’Union les impulsions nécessaires à son développement », d’en définir « les orientations et les priorités politiques générales » sans cependant exercer « de fonction législative ». L’essence du Conseil européen n’est donc pas d’arbitrer mais de donner des impulsions à l’Europe. Cela s’accommode mal d’une présidence discrète et effacée.
A l’inverse, l’institution étant gouvernée par la règle du consensus, il est peu probable que son président, soumis à réélection par ses pairs dès deux ans et demi de mandat, s’arroge un pouvoir par trop exclusif et directif.
La personnalité du premier titulaire de cette charge sera décisive pour en modeler les contours et en découvrir les potentialités. L’une des tâches de la présidence française de l’Union au second semestre 2008 sera d’ailleurs de préparer ce choix difficile.
Il n’en reste pas moins que l’Europe, ainsi incarnée à son plus haut niveau, devrait profiter de l’élan et de la visibilité qu’offre la désignation d’une personnalité exceptionnelle pour porter le projet européen. Les citoyens pourront ainsi percevoir le « visage » de l’Europe.
c) Les risques de concurrence des pouvoirs
Les vraies difficultés d’application se concentrent plutôt sur l’articulation de l’action du président du Conseil européen avec celle des autres institutions européennes.
(1) Une rupture de la chaîne de commandement ?
Il existe un vrai risque de rupture de ce que l’on peut qualifier de « chaîne de commandement » au sein du Conseil.
Le Conseil européen est en effet chargé de définir les grandes orientations qu’il appartient ensuite au Conseil de mettre en œuvre. Les deux institutions doivent donc travailler « la main dans la main ». Dans le modèle actuel des présidences tournantes, leur coopération harmonieuse est aisément garantie par l’autorité directe qui subordonnent au chef d’Etat ou de gouvernement de l’Etat membre qui préside l’Union ses ministres chargés de présider les différentes formations « spécialisées » du Conseil (le ministre des Affaires étrangères pour le Conseil des affaires générales et les ministres techniques pour les autres).
Or le traité de Lisbonne ne met pas fin à la présidence tournante. Les ministres de l’Etat membre qui président l’Union pour chaque semestre continueront de présider les formations du Conseil. Dans ce contexte, comment le président du Conseil européen pourra-t-il s’assurer du suivi des « impulsions » données par le Conseil européen au sein en particulier du Conseil des affaires générales (CAG) chargé par l’article 16 du TUE modifié d’assurer la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil ? Dans le cas de la politique étrangère et de sécurité commune, le problème de coordination est compliqué par le fait que le Conseil des affaires étrangères sera présidé par le futur haut représentant.
Une nouvelle chaîne de commandement devra être mise en place. Elle passera sans doute par l’organisation d’une relation particulière entre le président du Conseil européen et les chefs d’Etat et de gouvernement de la troïka qui assument la présidence tournante. Cela laisse cependant entier le problème des relations entre le président de l’Union et le Haut représentant, duo auquel s’ajoute le président de la Commission pour nourrir un risque réel de concurrence entre les présidences.
Trois personnalités émergent du nouvel équilibre institutionnel dessiné par le traité de Lisbonne : le président du Conseil européen, le haut représentant et le président de la Commission. Or, leurs prérogatives tendent dans les faits à se croiser. Passera-t-on d’une troïka (des présidents « tournants » de l’Europe) à l’autre (des présidents permanents) ?
■ Dans les faits, l’institution de « rang » le plus élevé est le président du Conseil européen, qui contribue à donner à l’Union ses orientations fondamentales. Dans le même temps, seule la Commission dispose, sauf exceptions, du droit d’initiative législative. La « concrétisation » des impulsions du Conseil européen relève donc du président de la Commission. Cela n’est pas nouveau et, dans les faits, ne soulève guère de difficulté dès lors que la Commission joue loyalement son rôle.
D’un point de vue politique en revanche, surtout dans l’hypothèse où la politisation de l’Union progresse grâce l’émergence d’un président de Commission procédant de la majorité élue au Parlement européen, les deux légitimités pourraient devenir conflictuelles.
Conscient de ce danger, le rapporteur avait exprimé sa préférence, durant la Convention de 2002, pour une présidence unique fusionnant la présidence du Conseil européen et celle de la Commission. Cela aurait cependant rendu nécessaire de renforcer sa légitimité, par exemple grâce à son élection par un Congrès parlementaire associant parlementaires nationaux et européens. Si les textes ne prévoient pas explicitement cette possibilité, il faut remarquer que la Convention a souhaité qu’ils ne l’interdisent pas expressément.
La perspective d’une présidence « unique » n’étant cependant évidemment pas à l’ordre du jour, il conviendra de veiller à ce qu’aucune des deux institutions n’« étouffe » l’autre en encourageant dès leur mise en place la définition d’une répartition claire des responsabilités. Le calendrier pourrait faciliter les choses. Si le traité est ratifié par tous les Etats membres durant l’année 2008, un président du Conseil européen pourra être désigné pour le début 2009, avant que la nouvelle Commission ne soit mise en place au lendemain des élections européennes du printemps 2009.
■ Un autre modus vivendi devra être trouvé moins entre le président du Conseil européen et le haut représentant, la répartition des compétences en matière de PESC étant clairement balisée par les traités, qu’entre le haut représentant et le président de la Commission européenne.
L’article 17 du TUE modifié reprend en effet les dispositions de la Constitution européenne relatives au ministre des affaires étrangères, renommé « haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité », chargé de conduire la politique étrangère, de sécurité et de défense commune. Toujours aux fins de renouer les fils dispersés de la cohérence de l’action extérieure de l’Europe, le traité dispose :
– d’une part, qu’il joue un rôle clef au sein du Conseil, en lui soumettant des propositions, en présidant le Conseil des affaires étrangères et en exécutant ses actes « en tant que mandataire du Conseil » ;
– d’autre part, qu’il est chargé des relations extérieures au sein de la Commission et y coordonne, en tant que vice-président, les « autres aspects de l’action extérieure de l’Union ».
Son double statut au sein de la Commission et au cœur du Conseil dont il présidera les réunions principales mais au sein duquel il ne disposera pas d’un droit de vote pourrait poser des difficultés d’application selon que l’usage fait pencher le haut représentant du côté de l’une ou l’autre des institutions. Le président de la Commission devra ainsi s’accommoder de la présence d’un commissaire qui ne procède pas de lui mais du Conseil européen statuant à la majorité qualifiée, qu’il peut contraindre à présenter sa démission mais qui reste totalement autonome dans ses relations avec le Conseil.
Dans le même esprit, sa responsabilité devant le Parlement pourrait se révéler problématique en ce qu’il est investi et peut être censuré en tant que membre du collège tout entier et non en sa qualité propre. Ainsi, à la demande des représentants du Parlement européen au sein de la CIG, la déclaration no 12 annexée au traité de Lisbonne précise que si un haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sera bien nommé pour la période allant de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne à la fin du mandat de la Commission en exercice, ce sera après que des « contacts appropriés » auront été pris avec le Parlement européen.
a) Une règle légitime et pérenne pour débloquer les décisions : la double majorité.
■ L’une des principales impasses du traité de Nice est l’inefficacité manifeste du système de décision au sein de l’institution pivot de l’Union, le Conseil qui rassemble les ministres des Etats membres. Rappelons que la majorité qualifiée aujourd’hui en vigueur est subordonnée à trois critères cumulatifs :
– une décision doit rassembler 255 (73,9 %) des 345 droits de votes distribués aux Etats membres selon une répartition complexe issue des compromis les plus âpres ;
– ces Etats membres doivent constituer 62 % de la population de l’Union ;
– ces Etats membres doivent être majoritaires.
Cette règle est non seulement complexe mais aussi instable. Le poids respectif des Etats membres doit en effet être renégocié à chaque élargissement. Deux autres défauts achèvent de discréditer la procédure.
– Les seuils de décision sont fixés à un niveau trop élevé (74 %) pour permettre une prise de décision dans les domaines les plus sensibles, en particulier la justice et les affaires intérieures.
– Les pouvoirs réels d’influence des Etats (traditionnellement mesuré par l’indice dit de Banzhaf qui indique la probabilité d’un Etat d’être le pivot permettant la formation d’une majorité) sont disproportionnés au détriment en particulier des Etats les plus peuplés, le pouvoir d’influence de l’Allemagne par exemple étant le double de celui des Etats moyens comme la Grèce, le Portugal, la Belgique ou la République tchèque pourtant huit fois moins peuplés.
■ L’article 238 du TFUE modifié par le traité de Lisbonne introduit la règle de la double majorité selon laquelle, à partir du 1er novembre 2014 (sous réserve d’une application des règles du traité de Nice jusqu’en 2017 à la demande d’un Etat membre), les décisions seront adoptées si elles réunissent 55 % des Etats membres participants réunissant au moins 65 % de la population de ces Etats.
La probabilité d’adoption des actes en serait grandement renforcée, par l’effet mécanique de la réduction des seuils. La puissance d’entraînement devrait même dépasser la seule logique mathématique. Comme il a été vu supra, les négociations informelles au sein du Conseil dépendent, en dernière analyse, de la perception que se fait chaque Etat de pouvoir bloquer ou à défaut influencer les décisions. Or, le pouvoir de blocage, infiniment plus révélateur de l’influence réelle des Etats dans les négociations, serait réduit pour tous les Etats membres d’en moyenne 50 %. Sa répartition serait par ailleurs fortement affectée, au bénéfice en particulier de l’Allemagne ainsi que, dans une moindre mesure, de la France, du Royaume-Uni et de l’Italie, et au détriment des Etats à la population moyenne autour de 10 millions d’habitants. Le tableau ci-après permet d’apprécier ces mutations dans les pouvoirs d’influence respective des Etats membres.
Nice et actes d’adhésion (jusqu’en 2014) |
traité de Lisbonne (double majorité) |
gain/perte de poids | |||
Pondération |
en pourcentage |
Pourcentage de la population de l’UE (2006) |
Pourcentage du nombre d’Etats (1/27e) |
Population/ Pondération Nice | |
Allemagne |
29 |
8,4 % |
16,7 % |
3,7 % |
+8,3% |
France |
29 |
8,4% |
12,8% |
3,7% |
+4,4% |
Royaume-Uni |
29 |
8,4% |
12,3% |
3,7% |
+3,9% |
Italie |
29 |
8,4% |
11,9% |
3,7% |
+3,5% |
Espagne |
27 |
7,8% |
8,9% |
3,7% |
+1,1% |
Pologne |
27 |
7,8% |
7,7% |
3,7% |
-0,1% |
Roumanie |
14 |
4,1% |
4,4% |
3,7% |
+0,3% |
Pays-Bas |
13 |
3,8% |
3,3% |
3,7% |
-0,5% |
Grèce |
12 |
3,5% |
2,3% |
3,7% |
-1,2% |
Portugal |
12 |
3,5% |
2,1% |
3,7% |
-1,3% |
Belgique |
12 |
3,5% |
2,1% |
3,7% |
-1,3% |
Rép. Tchèque |
12 |
3,5% |
2,1% |
3,7% |
-1,4% |
Hongrie |
12 |
3,5% |
2,0% |
3,7% |
-1,4% |
Suède |
10 |
2,9% |
1,8% |
3,7% |
-1,1% |
Autriche |
10 |
2,9% |
1,7% |
3,7% |
-1,2% |
Bulgarie |
10 |
2,9% |
1,6% |
3,7% |
-1,3% |
Danemark |
7 |
2,0% |
1,1% |
3,7% |
-0,9% |
Slovaquie |
7 |
2,0% |
1,1% |
3,7% |
-0,9% |
Finlande |
7 |
2,0% |
1,1% |
3,7% |
-1,0% |
Irlande |
7 |
2,0% |
0,9% |
3,7% |
-1,2% |
Lituanie |
7 |
2,0% |
0,7% |
3,7% |
-1,3% |
Lettonie |
4 |
1,2% |
0,5% |
3,7% |
-0,7% |
Slovénie |
4 |
1,2% |
0,4% |
3,7% |
-0,7% |
Estonie |
4 |
1,2% |
0,3% |
3,7% |
-0,9% |
Chypre |
4 |
1,2% |
0,2% |
3,7% |
-1,0% |
Luxembourg |
4 |
1,2% |
0,1% |
3,7% |
-1,1% |
Malte |
3 |
0,9% |
0,1% |
3,7% |
-0,8% |
TOTAL |
345 |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Majorité qualifiée |
255 |
73,9% |
65,0% |
55,0% |
|
■ Il faut enfin noter qu’un pas de plus est fait dans la transparence des travaux du Conseil grâce au 8 de l’article 16 du TFUE modifié qui dispose qu’il « siège en public lorsqu’il délibère et vote sur un projet d’acte législatif. À cet effet, chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs de l’Union et aux activités non législatives ».
b) Un rôle d’appel reconnu au Conseil européen
Le traité de Lisbonne met par ailleurs en place des procédures originales de renvoi au Conseil européen des décisions suscitant les plus forts blocages. Ces formules sont protectrices des États membres parce que le Conseil européen, en dehors des très rares cas particuliers définis par les traités (1), « se prononce par consensus ». Remarquons au passage que le consensus diffère de l’unanimité en ce qu’il n’est pas le fait d’être d’accord, mais celui de ne pas être en désaccord, ce qui est plus qu’une nuance sémantique si l’on considère qu’oser l’isolement implique de faire preuve d’un courage politique supérieur à celui d’acquiescer formellement à un projet.
La pratique n’est guère nouvelle, les principaux arbitrages remontant traditionnellement jusqu’au niveau des chefs d’État et de gouvernement lorsque sont en jeu des options fondamentales. La nouveauté est la définition d’un mécanisme plus formel permettant aux États qui estiment qu’un projet en matière de sécurité sociale (article 48 du TFUE modifié) « porte atteinte à des aspects importants de son système de sécurité sociale » ou un projet en matière pénale (articles 82 et 83 du TFUE modifié) « aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale », de renvoyer la décision au Conseil européen (clause dite « de frein »).
Dans les quatre mois, le Conseil européen peut soit, « en cas de consensus », renvoyer le projet au Conseil soit, à défaut, le suspendre. Cette dernière hypothèse ouvre ensuite la voie à une coopération renforcée automatique entre les États désireux d’avancer.
C’est bien un pouvoir d’appel qu’organise ici le traité. Mais il ne donne pas un droit de veto aux États réticents puisque l’absence de consensus entraîne automatiquement, dès lors que le seuil de neuf États participants est franchi – ce qui devrait être le cas s’agissant d’une décision adoptée à la majorité qualifiée – une coopération renforcée. En outre, l’existence d’un délai modéré de quatre mois garantit que cet appel ne compromette pas l’adoption des décisions en temps utile.
4) Une Commission plus efficace
L’article 17 du TUE modifié ne modifie pas les compétences de la Commission. Il lui incombe en particulier de promouvoir « l’intérêt général de l’Union » et de veiller à « l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci ». L’originalité de l’institution au cœur de la méthode communautaire, qui n’est ni un Gouvernement, ni un simple « Secrétariat général » chargé d’apporter de l’huile dans les rouages des institutions, en sort même renforcée.
■ Son monopole du pouvoir d’initiative est clairement affirmé. Ce monopole est la clef de voûte de la Communauté. Il permet d’assurer que toutes les mesures adoptées sont jugées à l’aune de l’intérêt général de l’Union et il préserve les chances de la recherche systématique d’un consensus aussi large que possible auquel veille efficacement la Commission. Relevons cependant que dans le domaine de la coopération pénale et policière les Etats membres continueront de bénéficier d’un droit d’initiative dérogatoire.
De manière plus importante encore, la Commission se voit reconnaître un rôle décisif dans le déclenchement des coopérations renforcées. Aux termes de l’article 329 du TFUE modifié, ces dernières ne peuvent être mises en place que sur sa proposition. De même, elle se voit reconnaître la faculté en dernier ressort d’exclure le Royaume-Uni ou l’Irlande des mesures de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ou de l’Europe sans frontière lorsque ces États refusent de participer aux mesures de développement (voir supra).
Ainsi, presque rien ne peut se faire dans l’Union sans l’aval de la Commission.
■ Des efforts sont parallèlement fait pour consolider la légitimité et l’autorité de la Commission.
À cette fin, son président, dont le poids politique sera considérablement renforcé par le fait qu’il procédera désormais plus directement du résultat des élections européennes (voir supra), se voit doté des moyens d’un réel « leadership ». Il lui appartient déjà de répartir les portefeuilles des commissaires qui sont cependant choisis par le Conseil avec son accord. Il pourra désormais, sans l’approbation du collège exigée par le traité de Nice, contraindre un commissaire à démissionner et nommer librement ses vice-présidents à l’exception du haut représentant.
Surtout, afin de donner à la Commission des effectifs plus propres à une action efficace et coordonnée, le nombre des commissaires sera limité à partir de 2014 aux deux tiers du nombre des États membres sous réserve que le Conseil européen décide à l’unanimité de modifier ce nombre. Le deuxième alinéa du 5 de l’article 17 du TFUE modifié précise que « les membres de la Commission sont choisis parmi les ressortissants des États membres selon un système de rotation strictement égale entre les États membres permettant de refléter l’éventail démographique et géographique de l’ensemble des États membres. Ce système est établi à l’unanimité par le Conseil européen ».
En pratique, cette précision permet à chaque État membre d’une Union à vingt-sept d’être nécessairement représenté dans deux commissions sur trois. La notion d’éventail démographique et géographique est plus incertaine. Remarquons seulement qu’elle vise à s’assurer que les États membres de taille modeste seront toujours représentés dans la Commission, la présence de la majorité des « grands » États allant de soi.
■ De toute évidence, le traité de Lisbonne, qui reprend en la matière le compromis de la CIG de 2004, s’attache à restaurer l’autorité de la Commission quelque peu affaiblie par les difficultés politiques de la fin des années 90, par l’inflation spectaculaire de ses tâches d’exécution qui tendent parfois à l’empêcher de se consacrer à son rôle essentiel de moteur de l’Union et par l’explosion de ses effectifs après les élargissements des années 2000.
Il est cependant difficile aujourd’hui de mesurer les chances réelles de remplir cet objectif.
« Moteur de l’Union », la Commission le deviendra indéniablement si l’Europe se politise. De même, l’utile clarification des tâches législatives et exécutives opérée par le traité va dans la direction d’une Commission mieux concentrée sur l’essentiel.
En revanche, l’émergence d’un président du Conseil européen fort et l’incarnation de la dimension extérieure de l’Union par le haut représentant pourraient faire de l’ombre à une institution qu’une culture parfois obsessionnelle du consensus prépare mal aux initiatives spectaculaires. De même, le fait que certains États membres puissent ne pas y être représentés pendant cinq ans pourrait nuire à la fragile légitimité de la Commission auprès des opinions publiques nationales concernées. Le traité de Lisbonne, là comme ailleurs, est riche de potentialités sans qu’il soit permis de voir clairement dans quelle direction elles vont amener l’Europe. Mais, en tout cas, elles la remettent en mouvement là où le traité de Nice l’immobilise dans l’impuissance.
1) L’extension du champ de la majorité qualifiée : l’Europe dotée des moyens d’agir
L’extension de la majorité qualifiée est le plus sûr curseur des progrès de l’intégration européenne. Le renoncement à l’unanimité permet dans les faits d’accélérer très fortement le rythme de la mise en œuvre des politiques de l’Union et se traduit en règle générale par un enrichissement considérable des textes. Ici réside l’un des piliers de ce que l’on appelle la méthode communautaire. Cette méthode diverge de la coopération inter-gouvernementale en ce que les États membres acceptent deux contraintes décisives qui limitent leur autonomie : ils abandonnent leur droit de veto au profit d’une majorité certes exigeante (près de deux tiers des voix) et ils se prononcent sur la base de propositions élaborées par la Commission et en accord avec le Parlement européen.
Depuis que l’Acte unique de 1986 a relancé la Communauté en étendant la majorité qualifiée à toutes les mesures nécessaires à l’établissement du marché commun, l’ensemble des traités a contribué à l’élargissement de cette procédure de décision. Le traité de Lisbonne donne une nouvelle impulsion étendant la majorité qualifiée à plus de cinquante nouveaux domaines.
a) Un nouvel élan vers un espace européen de liberté, de sécurité et de justice
(1) L’entrée de la justice et des affaires intérieures dans la « méthode communautaire »
L’espace de liberté, de sécurité et de justice concentre les innovations les plus importantes. Le traité de Maastricht avait lancé le mouvement en donnant compétence à l’Union pour intervenir dans les matières touchant à la justice et aux affaires intérieures. Mais pour préserver la souveraineté des États membres sur des matières touchant au cœur de leurs pactes sociaux, les initiatives européennes se sortaient pas du champ intergouvernemental, c’est-à-dire de l’unanimité. Dans la même logique, les actes adoptés (positions et actions communes) restaient privés de valeur normative. Le traité instituait à cette fin un troisième pilier de l’Union à côté du pilier communautaire et du pilier de la politique étrangère et de sécurité commune, lui aussi intergouvernemental.
Il est cependant rapidement apparu que les besoins d’harmonisation en matière de sécurité et de justice induits par la libre circulation des personnes et des biens qui entame l’efficacité des politiques de sécurité conduites à la seule échelle nationale progressaient beaucoup plus vite que la capacité de l’Union à trouver des réponses communes freinées par le droit de veto reconnu à chaque État membre.
Les traités d’Amsterdam et de Nice ont ainsi fait rentrer dans le champ communautaire des pans entiers de la construction de l’espace européen de justice et de sécurité. Aujourd’hui, les visas, l’asile, l’immigration et les autres politiques liées à la libre circulation des personnes sont intégrés dans les politiques de la Communauté relevant du TCE. Seules la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière demeurent dans le troisième pilier. Cela permet concrètement à l’Union d’adopter des actes normatifs. Mais cela ne signifie pas pour autant que l’ensemble de ces politiques soit passé à la majorité qualifiée. Aujourd’hui, seules certaines mesures relatives à l’immigration (l’unanimité gouvernant l’immigration légale) et à la politique des visas (le Conseil européen ayant adopté une législation définissant les règles communes et les principes généraux préalables) ainsi que l’ensemble des mesures de coopération judiciaire en matière civile, à l’exception du droit de la famille, sont prises à la majorité qualifiée.
Le saut en avant du traité de Lisbonne est dès lors considérable, comparable en certains points à celui réalisé pour l’achèvement du marché commun par l’Acte unique. L’ensemble de la justice et des affaires intérieures rentre dans le champ des politiques de l’Union (elles sont « communautarisées »), formant le titre IV « L’espace de liberté, de sécurité et de justice » de la troisième partie du TFUE modifié consacrée aux « politiques et actions internes de l’Union ». La méthode communautaire y subit cependant deux tempéraments importants :
– la Commission doit partager son droit d’initiative avec les États membres dans la coopération pénale et policière, sous réserve de l’instauration d’un seuil fixé à un quart des États membres ;
– un droit d’appel au Conseil européen (« clause de frein » décrite supra), qui équivaut à un droit de veto puisque cette institution statue par consensus, est reconnu aux États membres en contrepartie de l’accélération des coopérations renforcées pour ceux qui souhaitent aller de l’avant.
(2) Des moyens pour avancer : l’extension des compétences de l’Union et de la majorité qualifiée
(a) Vers une politique commune d’immigration
La politique des frontières, de l’asile et de l’immigration rentre entièrement dans le champ commun des politiques européennes. La Commission y retrouve son monopole d’initiative législative tandis que la majorité qualifiée est étendue à tous les domaines concernés.
Le traité consacre la notion de système intégré de gestion des frontières extérieures et intègre celle de système européen commun d’asile impliquant, pour les ressortissants des pays tiers, un statut uniforme et des procédures communes d’octroi et de retrait de l’asile et de la protection subsidiaire. Une seule exception notable est aménagée : les mesures européennes relatives aux passeports, aux titres d’identité et aux titres de séjour rendues nécessaire pour garantir la libre circulation des personnes ne pourront être prises qu’à l’unanimité des membres du Conseil.
En matière d’immigration, le traité se fixe pour objectif de développer une « politique commune d’immigration » visant à assurer une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier et la prévention et une lutte efficace contre l’immigration illégale et de la traite des être humains. L’Union peut même, à la majorité qualifiée, établir des mesures pour encourager et appuyer l’action des États membres visant à favoriser l’intégration des immigrants légaux, à l’exclusion cependant de toute mesure d’harmonisation des législations nationales. Une seule limite est clairement fixée à l’action de l’Europe dans ce domaine : elle ne doit pas affecter le droit des États membres de fixer librement les volumes d’entrée des immigrants venant rechercher un emploi.
L’article 80 du TFUE modifié reprend enfin le principe de solidarité affirmé par la CIG de 2004 selon lequel les politiques de l’Union dans ce domaine sont régies « par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier », qui inspire déjà le fonctionnement du Fonds européen pour les réfugiés financés par tous selon les capacités contributives et attribués à chacun en fonction du nombre des demandeurs d’asile qu’il doit gérer.
(b) Peu de progrès dans la coopération judiciaire civile, fortement encadrée mais déjà communautarisée
La coopération judiciaire en matière civile reste limitée aux matières civiles ayant une incidence transfrontière dans la seule mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.
Le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires est pleinement réaffirmé. Le traité permet en outre d’adopter des mesures de rapprochement dans des domaines plus nombreux en donnant à l’Union pour objectif d’assurer un niveau élevé d’accès à la justice, d’éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, de développer des méthodes alternatives de résolution des litiges et de soutenir la formation des personnels de justice. Cependant, dans les faits, les compétences de l’Union ne sont guère élargies.
La pierre d’achoppement des progrès de l’intégration dans la matière demeure le droit de la famille, que la Constitution européenne « protégeait » déjà en la soumettant à l’unanimité. A la demande de l’Allemagne, la CIG de 2007 a encore durci le régime applicable en accordant un droit de veto à tout parlement national, dans les six mois, à l’encontre des propositions de décision déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière.
(c) Une impulsion décisive à la coopération judiciaire en matière pénale
Le traité de Lisbonne bouleverse les règles applicables à la coopération judiciaire en matière pénale. Les normes adoptées auront désormais un effet normatif direct. Elles relèveront des procédures habituelles d’adoption des actes de l’Union (directives, règlements, décisions).
■ Rentre ainsi dans le champ de la majorité qualifiée (et de la codécision) l’adoption des mesures nécessaires à la concrétisation du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale. Le traité offre même la possibilité de rapprocher les législations dans les domaines de la procédure pénale (admission des preuves, droits des personnes dans la procédure, droit des victimes) dans la mesure cependant où cela est nécessaire et en tenant compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres.
Ce rapprochement des législations pénales est également possible s’agissant du droit pénal matériel, afin de définir les infractions pénales et les sanctions portant sur des crimes graves et transfrontaliers dans certains domaines visés (terrorisme, trafic de drogue, criminalité organisée, traite des êtres humains, exploitation sexuelle des femmes et des enfants, trafic d’armes, blanchiment d’argent, corruption, contrefaçon de moyens de paiements, criminalité informatique, cette liste pouvant être élargie par le Conseil statuant à l’unanimité après approbation du Parlement européen).
D’un point de vue opérationnel, le traité élargit également les compétences opérationnelles d’Eurojust, qui pourra, de lui-même, déclencher des enquêtes pénales, coordonner des enquêtes et poursuites et proposer aux autorités nationales le déclenchement de poursuites pénales.
■ Cependant, comme il a été vu, ce pas audacieux vers un espace de justice commun est limité par un mécanisme de frein/accélérateur permettant :
– à un Etat qui estime qu’un projet d’acte porte atteinte aux aspects fondamentaux de son système judiciaire pénal de faire appel auprès du Conseil européen, qui statue par consensus, dans les quatre mois ;
– aux Etats désireux d’avancer de bénéficier en contrepartie du recours automatique et assoupli aux coopérations renforcées, dont l’autorisation est réputée accordée dès que le seuil d’un tiers des Etats membres est atteint.
Dans le mouvement de renforcement des protections des Etats membres qui a présidé à la négociation du traité de Lisbonne, la CIG de 2007 a étendu ces clauses de frein et d’accélérateur à la quasi-intégralité du domaine (décisions européennes sur la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, sur les règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions, sur le Parquet européen et sur la coopération policière), transformant ce qui était conçu dans la Constitution européenne comme une exception de sauvegarde en régime de droit commun des décisions.
■ Des pistes d’avenir sont également tracées, mais encore balisées par l’exigence d’unanimité.
Ainsi le Conseil pourra adopter des règles relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables lorsque le rapprochement des législations s’avère indispensable pour assurer la mise en œuvre efficace d’une politique de l’Union dans un domaine qui a déjà fait l’objet de mesures d’harmonisation (notamment la lutte contre le racisme et la xénophobie, contre la fraude affectant les intérêts financiers de l’Union, contre l’évasion fiscale, les crimes environnementaux et la falsification de l’euro).
La création d’un Parquet européen est également rendue possible, sur décision du Conseil statuant à l’unanimité et après approbation du Parlement européen, afin de combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Conseil européen pourra même étendre ces attributions à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontalière.
(d) La coopération policière peu modifiée, sous le respect de la souveraineté des Etats membres
Les dispositions relatives à la coopération policière sont peu modifiées par rapport aux traités actuels, le traité reprenant cependant la distinction proposée par la Constitution européenne entre les aspects non opérationnels (mesures relatives à l’échange d’informations pertinentes, au soutien aux formations des personnels de sécurité et aux techniques d’enquête communes concernant la détection des formes graves de criminalité, tâches dévolues à Europol), traités à la majorité qualifiée, et les aspects opérationnels (en particulier les conditions et les limites des interventions communes des forces de police des Etats membres), qui demeurent subordonnées à l’unanimité du Conseil.
b) La capacité de répondre aux défis de notre temps
(1) De nouvelles missions pour l’Europe : la création de nouvelles bases légales
Reprenant les dispositions afférentes du traité établissant une Constitution pour l’Europe, le traité de Lisbonne procède à la création de bases légales permettant – ou encourageant, lorsque le domaine était déjà exploré en application de l’ancien article 308 du TCE qui permet au Conseil, à l’unanimité, d’étendre les compétences de la Communauté afin de satisfaire aux objectifs des traités – à l’Union de mener une action dans différents domaines.
(a) L’Europe de demain : la sécurité et l’efficacité énergétique, la politique spatiale et la recherche
■ L’article 194 du TFUE introduit par le traité de Lisbonne crée une base juridique spécifique pour une politique européenne de l’énergie, qui s’est aujourd’hui modestement déployée dans le cadre de la clause de flexibilité de l’article 308 du TCE, donc sous le carcan de l’unanimité. Désormais, l’Union pourra agir, à la majorité qualifiée, en adoptant des règlements ou des directives visant à « assurer le fonctionnement du marché de l’énergie [et] la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union », « promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables [et] l’interconnexion des réseaux énergétiques ». Deux limites sont cependant posées. D’une part, la législation européenne ne pourra affecter le droit des Etats membres de déterminer les « conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique ». D’autre part, les mesures « essentiellement de nature fiscale » resteront soumises à l’unanimité.
■ De même, l’espace apparaît explicitement dans les compétences partagées de l’Union. Jusqu’alors, la politique spatiale européenne relevait soit d’une coopération intergouvernementale spécifique (politique commune élaborée entre la Commission et l’Agence spatiale européenne (ESA), composée des 15 « anciens » Etats membres et de la Norvège et la Suisse, et adoptée par le Conseil Espace réunissant le Conseil compétitivité de l’Union et le Conseil ministériel de l’ESA) soit du développement d’une autre base juridique (le projet de règlement sur l’application des programmes européens de radionavigation par satellite Egnos et Galileo repose ainsi sur l’article 156 du TCE actuel relatif aux réseaux transeuropéens). Désormais, l’article 189 du TFUE modifié fixe pour objectif à l’Union la création d’une politique spatiale européenne, en liaison utile avec l’ESA. Les décisions, qui ne pourront pas comporter des mesures d’harmonisation, seront prises à la majorité qualifiée.
■ Dans le même esprit, les compétences de l’Union en matière de recherche – aujourd’hui concentrées principalement sur la coopération transfrontalière entre les entreprises, les instituts de recherche et les universités et sur les programmes cadres de recherche pluriannuelle dotés de près de 20 milliards d’euros – sont étendues à la « promotion de la coopération des chercheurs par delà les frontières » tandis que le champ des initiatives que peut prendre la Commission est précisé (définition d’indicateurs, échanges de bonnes pratiques).
(b) L’Europe au plus près de ses citoyens : sport, tourisme, protection civile
Par ailleurs, le traité de Lisbonne prévoit que l’Union peut agir, à la majorité qualifiée, mais seulement pour des mesures d’« appui, de coordination ou de complément » des actions nationales et à l’exclusion de toute mesure d’harmonisation des législations internes, dans les domaines :
– du sport, afin de « développer la dimension européenne du sport, en promouvant l’équité et l’ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu’en protégeant l’intégrité physique et morale des sportifs, notamment des plus jeunes d’entre eux » ;
– du tourisme, afin de promouvoir « la compétitivité des entreprises dans ce domaine », notamment par « l’échange de bonnes pratiques » ;
– de la coopération civile, dans le but d’encourager « la coopération entre les États membres afin de renforcer l’efficacité des systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou d’origine humaine et de protection contre celles-ci » notamment en mettant en place une « coopération opérationnelle rapide et efficace à l’intérieur de l’Union entre les services de protection civile nationaux ».
En revanche, la CIG de 2007 a vidé de leur substance l’essentiel des avancées prévues en matière de protection de la santé par la Constitution européenne, en excluant du champ des mesures qui peuvent faire l’objet d’une harmonisation (expressément exclue dans le reste du domaine) les « mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l’alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celle-ci » (susceptibles d’une acceptation particulièrement large si elles étaient comprises comme couvrant les maladies contagieuses), ne retenant, comme innovation, que les « mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments ».
(2) L’extension de la majorité qualifiée à une cinquantaine de domaines clefs
Le traité de Lisbonne étend enfin le champ de la majorité qualifiée conformément aux dispositions agréées en 2004 à de très nombreux domaines afin de « fluidifier » et d’encourager la prise de décision. En relèveront ainsi désormais :
– les constats de déficit excessif dans la zone euro établis par le Conseil ;
– la définition des missions, des objectifs et de l’organisation des fonds structurels ;
– l’adoption des mesures relatives aux transports transeuropéens (déjà très largement soumises à la codécision et à la majorité qualifiée) ;
– celles relatives à la coopération administrative ;
– à la culture ;
– à l’aide humanitaire ;
– à l’administration de l’Union ;
– à la propriété intellectuelle, à l’exception cependant du régime linguistique des titres de propriété qui concentre l’essentiel des difficultés.
2) Des progrès mesurés dans la politique étrangère et de défense commune
La politique étrangère et de défense est confortée par le traité de Lisbonne, qui reprend en la matière les innovations de la CIG de 2004 sans sortir toutefois du champ intergouvernemental. Par souci de cohérence, une place particulière lui est donc aménagée dans le Traité sur l’Union européenne et non dans le TFUE, contrairement à la Constitution européenne qui l’intégrait dans les politiques de l’Union décrites dans sa troisième partie.
a) Une politique incarnée : l’Europe, un seul numéro de téléphone ?
Comme il a été vu supra, un effort important est consenti pour incarner la politique étrangère de l’Union, au plus haut niveau avec le président du Conseil européen et au plus près de la gestion quotidienne des politiques avec le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
A la différence du haut représentant dans sa configuration actuelle, il dispose d’un droit d’initiative qu’il peut exercer seul ou avec la Commission. D’ailleurs, lui seul, conjointement cependant avec la Commission, peut proposer de déclencher des sanctions concrètes à l’encontre d’Etats tiers ou de personnes physiques ou morales à la suite d’une décision unanime du Conseil en ce sens.
Il est le coordinateur des débats au sein du Conseil dont il préside la formation consacrée aux Affaires étrangères et qu’il peut convoquer en cas d’urgence ; par souci de cohérence, le comité politique et de sécurité, qui prépare les décisions du Conseil, sera présidé par l’un de ses représentants.
Il est le mandataire du Conseil pour la conduite de la PESC, chargé d’exécuter les décisions prises et de représenter l’Union notamment le cas échéant au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies lorsque ses membres permanents européens le demandent.
Enfin, il est le promoteur de la cohérence de l’action externe de l’Union grâce à la concentration à son profit des prérogatives extérieures de la Commission.
Le traité lui fournit les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions – qui devront être conséquents – grâce à la mise en place d’un service européen pour l’action extérieure composé de fonctionnaires des directions Relations extérieures du Conseil et de la Commission et de diplomates détachés par les Etats membres. Sa mise en place sera l’un des chantiers prioritaires de la présidence française de l’Union au second semestre 2008.
b) La politique étrangère commune, la stratégie des petits pas
La politique étrangère et de sécurité commune (PESC) reste cependant régie par l’unanimité, et le droit d’initiative demeure réservé aux Etats membres et au haut représentant, seul ou avec le soutien de la Commission.
Seules quatre exceptions à la règle de l’unanimité subsistent : les décisions définissant une action ou une position de l’Union sur la base d’une décision du Conseil européen, les mises en œuvre des actions ou positions communes, les nominations de représentants spéciaux et, seule nouveauté introduite par la CIG de 2004 puis confirmée par le traité, les positions européennes adoptées suite à une demande du Conseil européen.
La décision se substitue à l’ensemble des actes actuellement prévus par le TUE. La Cour de justice n’a toutefois pas compétence sur les actes relevant de la PESC.
Le rôle prééminent du Conseil européen est confirmé en ce qu’il lui revient d’adopter, à l’unanimité et sur proposition du Conseil, les décisions identifiant les intérêts et les objectifs stratégiques de l’Union, dont le Conseil assure le développement et la mise en œuvre.
c) Les premiers jalons d’une politique de défense commune
(1) L’objectif affirmé mais incertain d’une défense commune
■ La réelle nouveauté tient à la place particulière accordée par le traité de Lisbonne à l’objectif affirmé de parvenir à la « définition progressive d’une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune » (article 24 du TFUE modifié) lorsque le Conseil européen l’aura décidé à l’unanimité, qui reste la règle pour l’ensemble de la politique de défense, de même que l’adoption d’actes législatifs est expressément exclue.
L’ampleur des divergences des Etats membres sur leur conception des principes fondamentaux de la défense (entre le ralliement indéfectible au parapluie américain de l’OTAN et l’ambition d’une Europe puissante parlant d’une seule voix) et sur les efforts en terme de capacités militaires qu’ils sont prêts à consentir, voire sur la nature des menaces contre lesquelles se protéger efficacement, oblige à considérer avec une extrême prudence la probabilité des progrès dans ce domaine au cœur des identités nationales.
■ Des avancées sont cependant transcrites dans les traités en particulier sur la direction que pourrait prendre la défense commune européenne.
Le traité de Lisbonne actualise ainsi dans l’article 43 du TUE modifié la liste des missions de l’Union dans ce domaine, dites « de Petersberg », élaborée au pire moment de l’impuissance européenne à faire face au conflit yougoslave. Elles comportent les « actions conjointes en matière de désarmement, les missions humanitaires et d’évacuation, les missions de conseil et d’assistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits » (sont soulignées les actions nouvelles introduites par le traité de Lisbonne). Il est par ailleurs précisé que « toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire ».
Une autre innovation fondamentale concerne la « clause de défense mutuelle » introduite au 7 de l’article 42 du TUE modifié qui prévoit que, dans le cas où un État membre est l’objet d’une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui portent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir. Ce souci doit cependant s’exercer dans le respect de la politique de neutralité de certains Etats membres et du traité de l’OTAN comme fondement de la défense collective de ses membres. L’Europe de la défense apparaît ainsi intrinsèquement liée à l’OTAN.
(2) Un progrès opérationnel décisif : la coopération structurée permanente
C’est dans le concret que se trouvent les avancées les plus prometteuses.
■ Rapprochant la lettre des traités de l’esprit des actions d’ores et déjà mises en œuvre, l’article 44 du TUE modifié dispose que le Conseil pourra confier la mise en œuvre d’une mission militaire à un groupe d’États membres qui le souhaitent et disposent des moyens adéquats.
■ L’Agence européenne de défense sous l’autorité du Conseil créée par anticipation se voit dotée d’une base légale, afin d’identifier les objectifs de renforcement des capacités militaires nationales, de promouvoir l’harmonisation des besoins opérationnels, d’assurer la coordination des programmes et de soutenir la recherche technologique et le renforcement de la base industrielle et technologique du secteur de la défense.
■ Surtout, l’article 46 du TUE modifié prévoit la possibilité de mettre en place une coopération structurée permanente entre les États membres qui remplissent les critères et souscrivent aux engagements en matière de capacités militaires (« Schengen de la défense »). La procédure est considérablement assouplie par rapport aux autres coopérations renforcées puisqu’elle n’est pas soumise à un nombre minimal de participants. Afin de garantir l’efficacité opérationnelle de la coopération, les membres du Schengen de la défense pourront, à la majorité qualifiée, suspendre la participation des Etats qui ne remplissent plus les critères de capacités ou qui ne peuvent assumer les engagements qu’ils ont souscrits. Le noyau d’une Europe de la défense, qui ne peut exister que si elle est dotée de capacités respectables propres à garantir sa sécurité et asseoir son poids sur la scène internationale, est ainsi clairement et efficacement défini.
3) L’encouragement aux coopérations renforcées : permettre à l’Europe des pionniers d’avancer sans être bloquée par les plus réticents
■ Les années 1990 et 2000 ont permis à chacun de prendre la mesure de la difficulté de mener sur le même front l’élargissement de l’Union et l’approfondissement de ses politiques ainsi que de l’ampleur des divergences qui demeurent entre les Etats membres au moment où les compétences de l’Union se rapprochent des derniers bastions de la souveraineté (justice, sécurité, politique étrangère et de défense, environnement, énergie, fiscalité…).
Sous l’impulsion des plus lucides, au premier rang desquels la France, l’Allemagne et les Etats du Benelux, les chefs d’Etat et de gouvernement se sont attachés à partir du traité d’Amsterdam à permettre aux Etats volontaires d’avancer à leur pas sans être freinés par leurs partenaires.
Afin de ne pas abandonner la perspective nécessaire d’une Union intégrée et cohérente et de conjurer le risque d’une Europe à la carte qui pourrait bien signifier pas d’Europe du tout, les institutions communautaires ont cependant veillé à encadrer l’usage de ces « coopérations renforcées ». Le principe décisif est que les coopérations doivent recourir aux institutions et aux procédures traditionnelles de l’Union. De même, elles ont vocation à demeurer ouvertes à tous les Etats membres.
La conciliation difficile et parfois contradictoire des deux objectifs de « liberté d’avancer à son pas » et de rester dans le cadre – contraignant – communautaire peut expliquer qu’en dépit des dispositions des traités d’Amsterdam et de Nice, aucune coopération renforcée n’a aujourd’hui vu le jour, les coopérations empruntant d’autres voies (par exemple celle qui a mené au traité de Prüm).
Le traité de Lisbonne, reprenant l’essentiel des dispositions agréées en 2004, tend une nouvelle fois à encourager leur usage à travers trois innovations d’ampleur limitée.
– La « condition de dernier recours » posée par les traités d’Amsterdam et de Nice est clarifiée. Il doit certes être établi que les objectifs recherchés ne peuvent pas être atteints dans un délai raisonnable par l’Union dans son ensemble. Mais il ne sera plus nécessaire de faire la preuve que toutes les « dispositions pertinentes des traités » ont été épuisées.
– La décision d’autorisation prise par le Conseil à la majorité qualifiée n’est soumise à aucune autre condition.
– Surtout, en matière de coopération pénale et policière, la clause d’accélération décrite supra permet aux Etats participants de s’affranchir des critères d’autorisation, réputés remplis dès lors que la décision est bloquée dans le cadre des clauses d’appel au Conseil européen.
Le relèvement du seuil de participants de huit à un tiers des Etats membres ne devrait pour sa part guère soulever de difficulté, les coopérations renforcées n’ayant de sens que lorsqu’elles atteignent une masse critique suffisante pour justifier le recours aux méthodes communautaires plutôt qu’aux instruments traditionnels de coopération intergouvernementale.
■ Ces innovations suffiront-elles à encourager le recours aux coopérations renforcées ? Dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, c’est probable, le traité tendant à les rendre automatiques en cas de blocage des décisions. Dans les autres domaines, la réponse est plus incertaine. Des obstacles majeurs demeurent, à vrai dire inhérents à la formule.
Le poids des mécanismes communautaires est sans doute dissuasif : place incontournable de la Commission qui seule décide en dernier ressort de la coopération renforcée et y joue un rôle moteur décisif, participation du Parlement européen dans son ensemble, y compris les députés ressortissants des Etats membres n’appartenant pas au groupe pionnier. Par ailleurs, le fait que tous les Etats membres peuvent participer aux délibérations concernant la coopération renforcée, même si seuls les Etats participants prennent part au vote, leur donne un droit de regard qui peut attiser la méfiance des pionniers lorsque des matières sensibles sont en jeu.
4) Des procédures de révision simplifiées pour faire vivre les traités
Afin de proportionner les procédures de révision des traités à l’ampleur des modifications proposées, et ainsi de contourner l’usage systématique des conférences intergouvernementales, le traité de Lisbonne, reprenant les dispositions afférentes de la Constitution européenne, introduit à l’article 48 du TUE modifié divers « degrés » de révision.
a) Les révisions ordinaires des Traités démocratisées
■ La révision ordinaire « de droit commun », décidée par le Conseil européen à la majorité simple après consultation du Parlement européen et de la Commission, passera désormais par la réunion d’une Convention composée des représentants des parlements nationaux, des chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres, du Parlement européen et de la Commission sur le modèle des Conventions qui ont présidé à la rédaction de la Charte des droits fondamentaux ou de la Constitution européenne. La Convention adopte ensuite « par consensus » une recommandation à la CIG qui demeure l’institution souveraine pour adopter les modifications des traités. Ainsi, l’existence d’un préalable plus démocratique aux révisions est désormais clairement affirmée.
■ Pour les révisions ordinaires d’ampleur plus modeste, le Conseil européen, à la majorité simple mais cette fois avec l’approbation du Parlement européen – utile garde-fou à une conception par trop restrictive du seuil de déclenchement des conventions, pourra décider de ne pas convoquer une convention.
Enfin, des révisions simplifiées sont introduites pour ajuster avec plus de flexibilité les compétences de l’Union à l’évolution de ses besoins.
■ Le 7 de l’article 48 précité ouvre la possibilité de modifier, sans passer par la procédure ordinaire, les modalités d’adoption des actes de l’Union sur deux points :
– le passage de l’unanimité à la majorité qualifiée pour une décision au Conseil ;
– le passage d’une procédure législative spéciale à la procédure législative ordinaire (la codécision).
Ces « clauses passerelles » sont applicables à tous les actes de l’Union prévus par les Traités qui n’ont pas d’implications militaires ou de défense. La décision de mettre en œuvre la « clause passerelle » est prise par le Conseil européen à l’unanimité avec l’approbation du Parlement européen. Elle n’est pas soumise à ratification par les Etats membres.
Cependant, afin de sauvegarder le rôle constitutionnel des parlements nationaux dans la ratification des traités, il leur est reconnu un droit d’opposition. Ainsi, l’initiative d’un Conseil européen manifestant l’intention de recourir à la « clause passerelle » devra être immédiatement transmise aux parlements, qui disposeront d’un délai de six mois pour s’opposer à sa mise en œuvre. Le Conseil européen ne pourrait ensuite statuer qu’à l’expiration de ce délai et à la condition qu’aucun parlement national n’ait notifié son opposition.
■ Dans le même esprit, le 6 de l’article 48 précité définit une procédure de révision simplifiée permettant au Conseil, sur proposition de tout gouvernement d’un État membre, du Parlement européen ou de la Commission, et avec l’approbation du Parlement européen, de réviser à l’unanimité tout ou partie des dispositions relatives aux politiques et aux actions internes de l’Union définies dans la troisième partie TFUE à la condition de ne pas « accroître les compétences attribuées à l’Union dans les traités ».
Là encore, en reprenant la rédaction agréée par la CIG de 2004 selon laquelle « cette décision n’entre en vigueur qu’après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives », le projet de Traité modificatif accorde un droit de veto aux parlements nationaux qui disposent de la compétence constitutionnelle d’approbation des traités.
1) Des citoyens européens dotés d’un droit d’initiative novateur
■ Le traité de Lisbonne ne modifie guère les droits inhérents à la citoyenneté européenne introduite par le traité de Maastricht (droit de circulation et de séjour, droit de vote aux élections européennes et locales, droit à la protection diplomatique, doté cependant d’une nouvelle base juridique permettant au Conseil d’établir les directives établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires, droit de s’adresser aux institutions de l’Union dans sa langue).
Le projet initial résultant du mandat fixé par le Conseil européen des 21, 22 et 23 juin 2007 écartait même la définition de la citoyenneté européenne introduite par la Constitution. A la demande des représentants du Parlement européen cependant, sa mention a été introduite à l’article 9 du TUE qui dispose qu’« est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas », lorsque l’article 17 du TCE actuel se limite à préciser qu’elle « complète » la citoyenneté nationale. Cette modification permet de faire disparaître la subordination et la subsidiarité de la citoyenneté européenne. Par ailleurs, le Conseil européen, à l’unanimité et avec l’approbation (et non plus la simple consultation) du Parlement européen pourra décider de compléter les droits des citoyens, sous réserve de leur ratification par les Etats membres.
■ De manière beaucoup plus novatrice, le 4 de l’article 11 du TUE modifié reprend le droit d’initiative citoyenne permettant à un million de citoyens de l’Union, ressortissants d’un nombre minimal déterminé d’Etats membres, d’inviter la Commission à soumettre une proposition d’acte juridique européen nécessaire aux fins de l’application des traités. Le développement spectaculaire des nouveaux supports de communication pourrait rendre cette procédure beaucoup plus efficace qu’il n’est généralement prévu, bien que la Commission garde la faculté de statuer sur l’opportunité d’y donner suite.
2) Les parlements nationaux intégrés dans le processus décisionnel de l’Union
Le traité de Lisbonne accord une place décisive aux parlements nationaux en reprenant l’ensemble des nouvelles prérogatives que leur reconnaissait la Constitution européenne pour souvent, comme il a été vu supra, les renforcer.
Originellement absents du processus d’élaboration des normes européennes, qui repose sur le triangle constitué de la Commission, du Conseil et du Parlement européen, les parlements nationaux ont vu leur participation aux activités de l’Union croître au cours des années 1990. Le Traité de Maastricht s’est ainsi accompagné d’une déclaration relative aux parlements nationaux et à la coopération interparlementaire avant que le Traité d’Amsterdam consacre un protocole, dont la valeur normative est équivalente à celle des Traités, au « rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne ». La déclaration comme le protocole annexés limitaient cependant étroitement les prérogatives des parlements en reposant sur l’idée traditionnelle que la mission européenne de chaque parlement national est avant tout, si ce n’est exclusivement, de contrôler l’activité de son gouvernement au sein du Conseil.
Rompant avec le traditionnel cantonnement des parlements nationaux dans le simple contrôle de leurs gouvernements, maîtres exclusifs de l’agenda européen, la CIG de 2004 avait considérablement augmenté leurs prérogatives. Le traité de Lisbonne va plus loin encore, en consacrant un nouvel article 12 spécifique du TUE, au cœur des « principes démocratiques » régissant l’Union, à la reconnaissance du rôle des parlements nationaux dans « le bon fonctionnement de l’Union » au moyen de sept prérogatives ensuite énumérées.
a) Un droit à l’information reconnu et étendu
Un véritable droit à l’information est reconnu aux parlements nationaux.
■ En premier lieu, le droit d’information à caractère général des parlements dont dispose le protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union est amélioré grâce à :
– la transmission directe par la Commission (qui s’acquitte déjà de cette obligation depuis le 1er septembre 2006) de tous ses documents de consultation et ses projets d’actes législatifs européens ;
– la transmission directe et « dans les plus brefs délais » des ordres du jour et des résultats des sessions du Conseil ainsi que le rapport annuel de la Cour des comptes.
■ En second lieu, le protocole étend le délai minimum d’examen des textes européens accordé aux parlements en précisant qu’aucun accord politique ne peut intervenir au sein du Conseil sur un projet d’acte législatif au cours des huit semaines suivant sa transmission.
■ En dernier lieu, le Traité définit deux nouveaux droits à information dans des domaines décisifs :
– les parlements nationaux doivent être informés des demandes d’adhésion formulées par des États européens ;
– les projets de révision du Traité seront « notifiés aux parlements nationaux ».
b) La consécration de la coopération interparlementaire dans le corps des traités
L’article 12 du TUE modifié consacre la coopération interparlementaire « entre parlements nationaux et avec le Parlement européen », qui n’est aujourd’hui prévue que dans le cadre du protocole sur les parlements nationaux, certes de même valeur juridique mais avec une visibilité plus modeste. Par ailleurs, ce même protocole prévoit que la Conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l’Union (l’actuelle COSAC, qui se réunit chaque semestre), qui s’attache à promouvoir l’échange d’informations et de meilleures pratiques entre les parlements nationaux et le Parlement européen et jouit de la faculté de soumettre toute contribution appropriée à l’attention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, pourra désormais organiser des conférences interparlementaires « notamment pour débattre des questions de politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune ».
c) Un droit de veto sur les révisions simplifiées, extension du pouvoir souverain de ratification des traités
Dans le prolongement du pouvoir souverain de ratification des traités, il est ménagé aux parlements nationaux un droit de veto sur la nouvelle procédure de révision simplifiée décrite supra qui permet au Conseil, à l’unanimité, de décider d’étendre le champ de la majorité qualifiée ou de la codécision (« clauses passerelles »).
Dans le même esprit, la faculté accordée au Conseil de réviser à l’unanimité tout ou partie des dispositions relatives aux politiques et actions internes de l’Union sans convoquer une CIG est subordonnée à une ratification dans chaque Etat membre qui respecte la compétence souveraine des parlements.
d) Un contrôle original sur la construction de l’espace de liberté, de sécurité et de justice
Les parlements se voient parallèlement reconnaître un droit de contrôle plus étroit sur la construction de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, au cœur de leurs compétences naturelles.
Le traité de Lisbonne prévoit ainsi, de manière originale, que les parlements « participent aux mécanismes d’évaluation de la mise en œuvre des politiques de l’Union » dans ce domaine et sont associés « au contrôle politique d’Europol et à l’évaluation des activités d’Eurojust ».
Les modalités concrètes que pourraient revêtir ces dispositions sont encore imprécises. Elles n’en constituent pas moins l’ébauche d’une mission de contrôle à l’échelle européenne dont les perspectives sont audacieuses.
e) Les parlements nationaux, acteurs institutionnels de l’Union grâce à la mission de contrôle de la subsidiarité
L’innovation principale concerne évidemment le nouveau rôle des parlements nationaux dans le contrôle du respect du principe de subsidiarité.
L’article 11 du TUE modifié dispose ainsi que « les parlements nationaux contribuent activement au bon fonctionnement de l’Union […] en veillant au respect du principe de subsidiarité ». Un protocole (de même valeur juridique que les Traités) annexé est consacré à l’application du principe de subsidiarité et de proportionnalité.
Les parlements nationaux sont ainsi promus en « vigies » de la subsidiarité.
■ Destinataire, en même temps que le Conseil et le Parlement européen, de tous les projets d’actes législatifs présentés par la Commission, qui doit veiller à les motiver au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité, chaque parlement national peut, dans les huit semaines, adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un « avis motivé » exposant les raisons pour lesquelles il estime que le projet en cause n’est pas conforme au principe de subsidiarité.
Deux éléments doivent ici être relevés :
– L’avis est « négatif » : les parlements nationaux ne rendent des avis que lorsqu’ils estiment que la subsidiarité est enfreinte et non pour conforter les projets législatifs concernés. Cette limitation peut être regrettée en ce qu’elle enferme les parlements dans le rôle peu constructif d’opposant.
– Il ne porte que sur le respect du principe de subsidiarité, en vertu du duquel, selon le 3 de l’article 5 du TUE modifié, « l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union » et non sur celui, plus large, de proportionnalité selon lequel « le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités ».
En cela, le champ du contrôle est plus restrictif que la procédure informelle mise en place, à l’initiative de la Commission, à partir du 1er septembre 2006, grâce à laquelle 138 avis ont été émis par 24 parlements nationaux sur 27 propositions. Dans sa conclusion no 37, le Conseil européen des 15 et 16 juin 2006 avait en effet fixé des lignes directrices extrêmement larges en approuvant l’engagement de la Commission de rendre « directement accessibles aux parlements » toutes ses nouvelles propositions et ses documents de consultation et en offrant aux parlements nationaux la faculté de formuler dans ce cadre des observations « eu égard en particulier [donc pas seulement] aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ». L’étendue de l’objet de ce contrôle est cependant inversement proportionnelle à sa portée juridique. La Commission doit seulement examiner « avec toute l’attention requise » les avis parlementaires. Tel n’est pas le cas de la nouvelle procédure.
■ La nouveauté essentielle tient en effet à la portée juridique accordée aux avis parlementaires.
– Lorsqu’un tiers (un quart dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice) des parlements nationaux (une voix par chambre dans les parlements bicaméraux, deux voix dans les monocaméraux) émet un avis de non conformité, la Commission doit réexaminer son texte et motiver son éventuel maintien. C’est le « carton jaune ».
– Lorsque la moitié des parlements nationaux émet un avis de non-conformité, la Commission doit réexaminer son texte et motiver son éventuel maintien. Le cas échéant, le Conseil et le Parlement européen doivent, en première lecture, examiner si le projet est conforme au principe de subsidiarité et peuvent le rejeter à la majorité de 55% des membres du Conseil ou à la majorité des suffrages exprimés au Parlement européen. C’est le « carton orange ».
En toute fin de la procédure législative, le traité de Lisbonne, reprenant la Constitution européenne, accorde aux parlements nationaux la faculté de former, dans les deux mois qui suivent la publication d’un acte législatif, un recours motivé auprès de la Cour de justice de l’Union européenne pour non-conformité au principe de subsidiarité afin d’en demander l’annulation. C’est le « carton rouge ».
Des ratifications à mener dans des délais très brefs
Les Etats membres souhaitent remettre rapidement l’Europe en mouvement. Le 2 de l’article 6 du traité de Lisbonne dispose que « le présent traité entre en vigueur le 1er janvier 2009, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’Etat signataire qui procède le dernier à cette formalité ».
■ C’est la première fois qu’un traité devra être ratifié en moins d’un an. Le tableau ci-dessous, qui présente les dates de signature et d’entrée en vigueur des traités adoptés dans les vingt-cinq dernières années ainsi que les étapes de leur ratification en France, montre qu’en moyenne 20 mois auront séparé la signature formelle des traités de leur mise en œuvre, la France se situant traditionnellement parmi les Etats les plus diligents à s’acquitter de leurs ratifications.
Traités |
Signature |
Entrée en vigueur |
Délais |
Révision constitu-tionnelle en France |
Loi de ratification en France |
Acte unique européen |
Luxembourg, le 17 février 1986 La Haye, le 28 février 1986 |
1er juillet 1987 |
17 mois |
néant |
Loi no 86-1275 du 16 décembre 1986 |
Traité de Maastricht |
7 février 1992 |
1er novembre 1993 |
21 mois |
Loi no 92-1017 du 24 septembre 1992 adoptée par référendum le 20 septembre 1992 | |
Traité d’Amsterdam |
2 octobre 1997 |
1er mai 1999 |
19 mois |
Loi constitutionnelle no 99-49 du 25 janvier 1999 |
Loi autorisant la ratification no 99-229 du 23 mars 1999 |
Traité de Nice |
26 février 2001 |
1er février 2003 |
24 mois |
néant |
Loi no 2001-603 du 10 juillet 2001 |
Traité constitu-tionnel |
Rome, le 29 octobre 2004 |
Non ratifié. Date prévue : 1er novembre 2006 |
24 mois |
Loi constitutionnelle no 2005-204 du 1er mars 2005 |
Rejetée par le référendum du 29 mai 2005 |
Traité de Lisbonne |
13 décembre 2007 |
Prévue le 1er janvier 2009 |
12 mois |
Prévue début février 2008 |
Prévue début février 2008 |
■ Les procédures de ratification choisies par chacun des Etats membres devraient permettre de tenir ce délai ambitieux.
De manière générale, il appartient aux parlements des Etats membres, selon des seuils de majorité plus ou moins élevés (mais, le plus souvent, supérieurs à la majorité simple s’agissant des révisions constitutionnelles préalables lorsque sont en jeu des éléments de souveraineté), d’adopter les lois de ratification et, le cas échéant, les lois constitutionnelles qui doivent les précéder lorsque le traité rentre en conflit avec leur Constitution. Le recours au référendum est néanmoins possible, mais de manière facultative dans la majorité des Etats, la distinction entre les référendums à portée consultative et ceux juridiquement liants n’étant pas pertinente face au poids incontournable du verdict populaire.
Seule l’Irlande doit obligatoirement soumettre à référendum toute révision constitutionnelle. Au Danemark, le référendum est obligatoire pour tout transfert de souveraineté dans le cas où le projet ne parvient pas à réunir les cinq sixièmes des députés du Folketing. Dans le même esprit, le recours à la consultation populaire est obligatoire en Lituanie lorsque les principes fondamentaux de l’Etat sont mis en cause. En Slovénie, enfin, un tiers des membres de l’Assemblée peut demander que la révision constitutionnelle soit soumise à référendum. Ces trois derniers Etats, après avoir estimé que le traité de Lisbonne ne porte pas atteinte aux principes fondamentaux de leur Etat et qu’il n’entraîne pas, s’agissant du Danemark qui bénéficie d’une dérogation sur l’espace de liberté, de sécurité et de justice dans lesquelles les avancées sont les plus significatives, un transfert majeur de souveraineté, ont fait part de leur souhait de ne pas organiser de référendum. Dans ce contexte, seul le peuple irlandais devrait être appelé à s’exprimer sur le nouveau traité.
De toute évidence, l’absence de référendum permet d’accélérer fortement la procédure de ratification et réduit l’incertitude sur son résultat. Dès lors, les principaux obstacles susceptibles d’obérer l’entrée en vigueur du traité début 2009, sans préjuger de l’appréciation souveraine de chaque parlement national, sont liés à la complexité plus ou moins forte des procédures nationales. Les difficultés les plus importantes sont à cet égard concentrées sur la Belgique, dont la Constitution prévoit que les traités internationaux intervenant dans les compétences mixtes doivent être approuvés par les parlements des trois régions (Wallonie, Flandre et Bruxelles capitale) et des trois communautés (germanophone, française et commission communautaire commune de la région de Bruxelles capitale) avant d’être ratifiés par les deux chambres du Parlement fédéral, soit au total huit lectures dans les meilleurs des cas.
La brièveté du délai que s’imposent les Etats membres doit être expliquée. En quoi le traité de Lisbonne est-il urgent ?
Une première réponse relève de l’évidence : voilà quinze ans que l’Europe s’enferre dans un débat institutionnel qui l’empêche d’avancer dans des domaines où les besoins de ses citoyens et la pression de la conjoncture imposent d’aller vite. Il n’est guère possible d’attendre encore, sauf à compromettre la capacité et la légitimité de l’Union à répondre aux attentes de ses peuples.
Mais la date retenue de 2009 est plus impérieuse encore. Au printemps 2009 auront lieu les élections parlementaires européennes qui précèderont l’installation d’une nouvelle Commission au début de l’automne. Il est indispensable que les nouvelles dispositions institutionnelles soient mises en place avant cette échéance. A défaut, le programme législatif des prochaines mandatures risquerait d’être obéré par son fractionnement entre deux régimes dont il a été vu qu’ils sont profondément différents. En outre, le rapporteur a montré que l’apparition de nouveaux acteurs (le président du Conseil européen, le haut représentant aux pouvoirs renforcés, etc.) et de procédures améliorées (la procédure législative ordinaire généralisée, le contrôle de subsidiarité, etc.) changera radicalement la donne européenne et rendra nécessaire de procéder à de difficiles ajustements.
Il faut que les règles du jeu soient stables et bien comprises avant que le jeu ne débute, c’est-à-dire avant que les nouveaux Parlement et Commission ne commencent à travailler.
A. La France doit montrer l’exemple en étant l’un des premiers pays à ratifier le traité de Lisbonne
1) Le choix approuvé par les Français d’une ratification exemplaire parce que rapide passant par la voie parlementaire
Le Président de la République a choisi de mettre la France aux premiers rangs de l’Union en demandant au Parlement de ratifier aussi rapidement que possible le nouveau traité simplifié. Et il a su prendre ses responsabilités devant le peuple, dès avant la campagne électorale présidentielle, en s’engageant à procéder à une ratification par voie parlementaire. Les députés de la majorité, élus en juin 2007, l’ont été sur cette base. Ce choix respecte pleinement l’exigence démocratique et l’intérêt de la France comme celui de l’Europe.
■ C’est d’abord un choix clair, assumé et légitimé par l’autorité souveraine suprême qu’est le peuple. Les Français ont voté le 6 mai 2007 en pleine connaissance de cause et sans aucune ambiguïté. Conscient que relancer l’Europe impliquait d’aller vite et de faire un geste de confiance vers ses partenaires, le Président de la République a voulu que l’élection présidentielle permette aussi de trancher cette question lancinante depuis l’échec du référendum du 29 mai 2005.
■ C’est ensuite un choix responsable, lucide et efficace. Il faut rappeler ici le rôle décisif que l’annonce rapide du choix de la ratification parlementaire par le candidat Nicolas Sarkozy a joué dans le déblocage de la situation. Nos partenaires européens, en particulier les dix-huit qui avaient ratifié le traité constitutionnel, ne pouvaient en effet s’engager dans un nouveau processus de négociation d’un traité qu’à la condition que la France, qui avait largement inspiré la démarche constitutionnelle et l’avait ardemment soutenue, ne manque pas cette fois à sa signature.
■ Enfin, c’est un choix équilibré et respectueux du verdict du peuple. Le traité de Lisbonne diffère profondément, comme il a été vu, de la Constitution européenne, dont il n’a pas la force symbolique même s’il préserve l’efficacité de son équilibre institutionnel. L’Europe sociale a été renforcée. Les droits des Etats membres mieux protégés, au prix de l’abandon de la démarche constituante et des prémisses d’un Etat fédéral. Les objectifs ultimes de l’Union ont été adaptés aux attentes exprimées par les peuples. Leur est enfin reconnu au niveau de l’Union un besoin de protection dans la mondialisation. Leur droit à des services publics de qualité, défini et fourni par leurs Etats pour assurer une qualité correspondant à leurs exigences est désormais garanti. La concurrence est enfin ravalée au rang de moyen et non de fin en soi de l’action publique. Il appartiendra aux élus du peuple de juger de la qualité des résultats obtenus. Leur légitimité est entière pour apprécier les avancées réalisées, sous le regard attentif de ceux qui ont choisi d’indiquer à l’Europe une autre direction au printemps 2005.
2) Des délais serrés pour réviser la Constitution et ratifier le traité avant la mi-février
Le calendrier législatif relatif à la ratification du traité de Lisbonne tire les conséquences de cette volonté d’exemplarité et de célérité. Le Parlement doit, en effet, conformément aux articles 53, 54 et 89 de la Constitution, examiner deux projets de loi relatifs respectivement à la révision constitutionnelle préalable à la ratification du traité et à la ratification proprement dite du traité de Lisbonne. Une lecture du projet de loi constitutionnelle est prévue dans chaque assemblée, avant que le Congrès ne se réunisse début février pour, le cas échéant, l’approuver, à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le projet de loi de ratification pourrait ensuite être adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat dans des délais brefs après une seule lecture dans chaque chambre.
Pour répondre aux impératifs de diligence qu’impose un calendrier aussi serré, le Gouvernement a fait le choix de limiter le projet de loi constitutionnelle aux seules dispositions rendues indispensables par le traité de Lisbonne, en renvoyant l’amélioration – nécessaire – du dispositif parlementaire de contrôle des affaires européennes à l’ambitieux projet de réforme constitutionnelle issu des travaux du comité de modernisation et de rééquilibrage des institutions de la Ve République présidé par M. Edouard Balladur.
a) Une révision nécessaire de la Constitution
Dans sa décision DC no 2007-560 DC du 20 décembre 2007, le Conseil constitutionnel a subordonné l’autorisation de ratifier le traité de Lisbonne à une révision préalable de notre Constitution d’ampleur cependant modérée et essentiellement technique. Il a en effet estimé que le traité comporte de nouveaux transferts de compétences non prévus dans les traités antérieurs, auxquels la France, aux termes de l’article 88-1 de la Constitution, a consenti, sans que la mise en œuvre du principe de subsidiarité les empêche de revêtir une ampleur ou d’intervenir selon des modalités telles que puissent être affectées les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale. Par ailleurs, il a jugé nécessaire de donner une base constitutionnelle aux trois nouvelles procédures d’intervention du parlement prévues dans le traité.
(1) Les transferts de souveraineté
Le Conseil constitutionnel, reprenant la typologie des transferts de souveraineté qu’il avait pour la première fois formalisée dans sa décision no 2004-505 DC du 19 octobre 2004 sur le traité établissant une Constitution sur l’Europe, a identifié trois catégories de dispositions du traité de Lisbonne appelant une révision préalable de la Constitution.
■ Les premières sont les transferts de compétence intervenant dans des matières nouvelles.
Sont concernées, d’une part, les dispositions du traité qui font relever de la procédure législative ordinaire de l’Union, donc de l’ancienne codécision, et surtout de la majorité qualifiée des matières nouvelles inhérentes à l’exercice de la souveraineté nationale. Les mesures visées interviennent dans l’espace de liberté, de sécurité, s’agissant en particulier des nouvelles dispositions du traité relatives aux contrôles aux frontières, à la coopération judiciaire en matière civile, à la coopération judiciaire en matière pénale.
En outre, d’autres dispositions, indépendamment de la procédure décisionnelle suivie, c'est-à-dire même lorsqu’elles restent soumises à l’unanimité, sont estimées contraires à la Constitution en raison de leur portée qui affecte de manière décisive l’exercice de la souveraineté nationale. Est en particulier concernée la création possible d’un parquet européen, pourtant subordonnée par l’article 86 du TFUE modifié à une décision unanime du Conseil.
■ La deuxième catégorie de transferts porte sur la définition de modalités nouvelles et immédiatement applicables d’exercice de compétences déjà transférées par les traités antérieurs. Sont concernées en particulier les changements procéduraux applicables à Europol et Eurojust ou à l’ensemble de la coopération policière.
■ Enfin, le Conseil constitutionnel anticipe en quelque sorte sur les transferts de souveraineté futurs en relevant l’incompatibilité avec la Constitution des diverses « clauses passerelles » d’application particulière (possibilité de faire passer à la majorité qualifiée, par décision unanime du Conseil, certains aspects du droit de la famille, de la procédure pénale voire de la politique étrangère et de sécurité commune) ou générale (selon la procédure de révision simplifiée introduite par l’article 48 du TUE modifié).
De toute évidence, le nombre et la diversité de ces dispositions plaident en faveur d’une clause générale validant l’ensemble des transferts de compétences consentis par la France à l’Union européenne dans le nouveau traité.
(2) Les nouvelles procédures d’intervention du Parlement
Comme il a été vu, le traité de Lisbonne accroît de manière très significative l’implication des parlements nationaux dans la construction européenne en leur donnant, pour la première fois, une place au sein du processus décisionnel de l’Union. Les trois pouvoirs décisionnels reconnus aux parlements nationaux, déjà décrits en détail supra, peuvent être rapidement évoqués.
– Le premier est le droit de veto qui leur est accordé à l’encontre des révisions simplifiées permettant au Conseil de décider à l’unanimité d’étendre le champ de la majorité qualifiée et/ou de la procédure législative ordinaire (ancienne codécision) sans convoquer au préalable une Conférence intergouvernementale et sans les soumettre à la ratification des Etats membres. Le traité de Lisbonne institue par ailleurs un mécanisme comparable de veto accordé à chaque parlement national dans les six mois qui suivent la transmission d’une proposition « déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l'objet d'actes adoptés selon la procédure législative ordinaire » que le Conseil peut adopter, à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.
– Le second est leur nouveau pouvoir de contrôle de la subsidiarité a priori grâce auquel ils peuvent émettre des avis motivés sur les projets qu’ils estiment non conformes au principe de subsidiarité. Comme il a été vu supra, la Commission devra réexaminer les projets contestés par un tiers des parlements nationaux (un quart dans l’espace de liberté, sécurité et de justice) et le Parlement européen et le Conseil se prononcer sur ceux mis en cause par la moitié des parlements.
– Le troisième et dernier pouvoir décisionnel des parlements nationaux est leur droit de former des recours auprès de la Cour de justice de l’Union européenne pour violation du principe de subsidiarité.
Dans la mesure où le Parlement dispose, sous la cinquième République, d’une compétence d’attribution, il ne peut exercer ces nouvelles prérogatives qui si la Constitution les lui confère expressément. Par ailleurs, l’exercice concret de ces nouvelles compétences impose d’en établir clairement le fondement constitutionnel pour pouvoir ensuite en renvoyer le détail au règlement de chaque assemblée.
(a) Les droits de veto sur les révisions simplifiées et sur l’intervention de l’Union dans le droit de la famille
La procédure de révision simplifiée définie au 7 de l’article 48 du Traité sur l’Union européenne tel que modifié par le traité de Lisbonne, en permettant de faire rentrer dans le champ de la procédure législative ordinaire et/ou de la majorité qualifiée tous les actes de l’Union à la seule exception de ceux ayant des implications militaires ou de défense, peut clairement mettre en cause « les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté ». Il en serait ainsi, pour choisir un exemple paroxysmique, d’une éventuelle décision faisant passer les actes européens harmonisant la fiscalité ou les sanctions pénales à la majorité qualifiée. Or, afin d’assouplir la procédure, ces révisions ne sont pas soumises à ratification par chaque Etat membre – mais restent évidemment conditionnées par l’accord unanime de tous les membres du Conseil. Elles ne pourront donc pas faire l’objet d’un contrôle préalable de constitutionnalité en France. Il était dès lors indispensable de préserver la compétence des parlements nationaux en leur accordant un droit de veto absolu. Le traité précise cependant que l’opposition des parlements doit être notifiée dans les six mois qui suivent la transmission du projet de révision.
Le raisonnement est le même s’agissant du dernière alinéa de l’article 81 du traité de Lisbonne, ajouté par la CIG de 2007 à l’initiative de l’Allemagne, qui permet aux parlements nationaux de s’opposer, dans le même délai, à une proposition de la Commission qui tend à permettre au Conseil, à l’unanimité et après consultation du Parlement européen, de déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontalière susceptibles de faire l’objet d’une législation européenne.
Il faut remarquer que le traité confère ces droits d’opposition à chaque « parlement national » sans autre précision et non à chacune de leur chambre. Les procédures emportant des conséquences d’ordre constitutionnel, pour lesquelles l’article 89 de notre Constitution prévoit une adoption « en termes identiques » par les deux assemblées, les motions de rejet des révisions simplifiées ou des propositions d’extension du champ législatif européen dans le droit de la famille devront être votées dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat.
(b) Le recours auprès de la Cour de justice
Dans le même esprit, une nouvelle base constitutionnelle doit être introduite pour mettre en place, conformément au protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité de Lisbonne, le droit donné aux parlements nationaux de former un recours pour violation du principe de subsidiarité, transmis par le Gouvernement à la Cour de justice. C’est en effet la première fois que notre Parlement est habilité à saisir le juge de Luxembourg.
Il convient de remarquer que l’article 8 du protocole précité précise que la CJUE est compétente pour se prononcer sur les recours formés par un Etat membre « ou transmis par celui-ci conformément à son ordre juridique interne au nom de son parlement national ou d’une chambre de celui-ci ». Le droit de recours doit ainsi être accordé, dans les mêmes conditions, à l’Assemblée nationale et au Sénat.
(c) Le contrôle de subsidiarité
Enfin, la procédure d’alerte précoce définie par les articles 6 et 7 du protocole précité impose elle aussi d’en préciser les modalités constitutionnelles respectant les quatre contraintes qui l’entourent.
– Le droit d’émettre un avis de non respect de la subsidiarité étant enserré dans un délai de huit semaines à compter de la transmission de l’acte, il est nécessaire de permettre aux assemblées de s’exprimer en dehors des sessions afin de ne pas faire échapper à leur contrôle des pans entiers de l’activité législative européenne.
– Ce droit d’alerte porte sur les « projets d’actes législatifs » européens auxquels il est nécessaire de faire référence dans notre Constitution.
– Ce droit est accordé par l’article 6 précité à « toute chambre » des parlements nationaux.
– Les avis doivent être « motivés », ce qui les distingue des motions d’opposition aux révisions simplifiées évoquées supra.
b) Un projet de loi constitutionnelle limité aux dispositions indispensables pour pouvoir ratifier le traité
Les dispositions du traité de Lisbonne imposant une révision préalable de la Constitution sont les mêmes que celles qui avaient motivé l’adoption de la loi constitutionnelle no 2005-204 du 1er mars 2005 préalable à la ratification du traité établissant une Constitution pour l’Europe.
Les transferts de souveraineté sont certes très légèrement modifiés entre la Constitution européenne et le traité de Lisbonne, sans que la nécessité d’une autorisation préalable et générale les autorisant n’en soit réellement affectée. De même, si les procédures d’implication parlementaire sont renforcées dans le traité de Lisbonne, c’est exclusivement pour en renforcer la portée sans en modifier ni les principes ni les modalités.
Le Rapporteur rappelle que le législateur constituant avait choisi, en 2005, afin de ne pas inscrire dans la Constitution des dispositions hypothétiques puisque subordonnées à la ratification par tous les Etats membres de la Constitution européenne, d’adopter une révision constitutionnelle en deux volets.
■ Le premier, d’application immédiate, comportait l’autorisation générale de transferts de compétence, la « clause d’immunité constitutionnelle » accordée à la Constitution européenne, grâce à l’insertion d’un deuxième alinéa à l’article 88-1 qui fixe le principe de la participation de la France « aux Communautés européennes et à l’Union européenne constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Ce nouvel alinéa dispose que la France « peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004 ».
Dans le même esprit, l’obligation de soumettre chaque nouvel élargissement – à l’exception des adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er janvier 2004 – à référendum, posée par l’article 88-5, a été inscrite dès la promulgation de la loi constitutionnelle dans le titre XV de la Constitution.
■ En revanche, les autres dispositions, visées à l’article 3 de la loi constitutionnelle de 2005, ont été subordonnées et différées jusqu’à l’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe. Sont ainsi concernées et « périmées » puisque la Constitution européenne n’entrera pas en vigueur :
– l’autorisation générale des transferts de compétences de l’article 88-1 dans sa rédaction suspendue à l’entrée en vigueur du traité constitutionnel, qui prenant acte de la disparition de la Communauté européenne et de la fusion des traités fondateurs en un texte unique en disposant que « dans les conditions fixées par le traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004, la République française participe à l'Union européenne, constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences » ;
– les nouvelles procédures parlementaires de contrôle de la subsidiarité (article 88-5 dans sa nouvelle rédaction) et d’opposition aux révisions simplifiées (nouvel article 88-6), l’obligation de soumettre à référendum les nouveaux élargissements étant transférée, sans modification, à un nouvel article 88-7.
A cette occasion, le législateur constituant avait décidé d’harmoniser le dispositif de l’article 88-4 avec la nouvelle procédure de contrôle de la subsidiarité.
Aujourd’hui, en effet, le second alinéa de l’article 88-4 permet à l’Assemblée nationale et au Sénat de voter des résolutions sur les seuls documents que leur transmet le Gouvernement. Or, le premier alinéa n’oblige le Gouvernement qu’à soumettre aux assemblées « dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative », une simple faculté lui étant aménagée pour « également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne ». Or, l’article 88-5 permet aux assemblées d’émettre un avis motivé sur les « projets d’acte législatif européen ». Le maintien de deux références portant sur des domaines différents, le champ législatif français délimité par l’article 34 de la Constitution et le champ législatif européen défini par les traités, est apparu inopportun et source de complexité. Par ailleurs, la limitation du droit de regard « obligatoire » du parlement aux seuls textes de nature législative au sens français contrevenait manifestement au souci du Gouvernement et des deux assemblées d’étendre le pouvoir de résolution parlementaire à l’ensemble des sujets importants intéressant l’Europe dont la notion d’acte législatif européen semble plus proche.
Cependant, toujours par souci de cohérence, il a été décidé de rassembler la nouvelle rédaction de l’article 88-4 avec l’ensemble des dispositions subordonnées à l’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe, qui introduisait la notion d’ « acte législatif européen » inconnue par le TUE et le TCE dans leur rédaction actuelle.
(2) Le projet de loi constitutionnelle de 2008
Seule la nouvelle rédaction de l’article 88-4 évoquée supra n’est pas strictement nécessaire pour rendre le traité de Lisbonne compatible avec notre Constitution. Les autres dispositions doivent en revanche être reprises pour que le Parlement puisse ratifier le traité simplifié. Dans ce contexte, le Gouvernement propose de recourir à l’option la plus efficace et la plus rapide en proposant une modification des seuls articles de la Constitution qui doivent être amendés pour permettre la ratification du traité.
Ainsi, sur le modèle du dispositif adopté en 2005, le projet de loi constitutionnelle est constitué de deux étapes.
La première, d’application immédiate, permet au législateur de consentir aux transferts de compétences nécessaires à la ratification du traité. L’article 1er modifie à cette fin le second alinéa de l’article 88-1 de la Constitution en disposant que la France « peut participer à l’Union européenne dans les conditions prévues par le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne signé le 13 décembre 2007 ».
En revanche, l’article 2 du projet de loi constitutionnelle subordonne à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne la modification de l’ensemble du titre XV de la Constitution afin, d’une part, de tirer les conséquences de la disparition de la Communauté européenne remplacée par l’Union européenne et, d’autre part, de définir les procédures applicables aux nouvelles prérogatives parlementaires.
Ainsi, l’article 88-1 sur l’autorisation générale de transfert de compétences est ainsi rédigé : « la République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du Traité sur l’Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé le 13 décembre 2007 ». L’article 88-2 reprend, sur le modèle de la révision constitutionnelle de 2005, l’énoncé selon lequel « la loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l’Union européenne ».
Dans le même esprit, après l’article 88-5 relatif aux référendums sur les adhésions seraient insérés deux articles 88-6 et 88-7 relatifs aux nouvelles prérogatives parlementaires.
Le droit d’alerte précoce prévu à l’article 88-6, similaire aux dispositions votées en 2005, permet ainsi à l’« Assemblée nationale ou [au] Sénat [d’] émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité. L'avis est adressé par le président de l'assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé ». De même, son deuxième alinéa autorise « chaque assemblée [à] former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le Gouvernement ». Pour garantir que le Parlement français sera en mesure d’intervenir tout au long du calendrier européen, son troisième alinéa précise qu’« à ces fins, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée ».
Dans le même esprit, l’article 88-7, sur le modèle de l’article 3 de la loi constitutionnelle de 2005 précitée, organise l’exercice du droit parlementaire de veto aux révisions simplifiées et l’étend aux mesures européennes relatives au droit de la famille en disposant que « par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus au titre de la révision simplifiée des traités ou de coopération judiciaire civile », tels qu’ils résultent du traité signé le 13 décembre 2007 sur l’Union européenne.
En conséquence, la révision constitutionnelle, clairement balisée par les choix effectués en 2005 qui restent pertinents, pourrait être rapidement examinée par les deux assemblées et soumises au Congrès dès le début du mois de février 2008.
Le Rapporteur se félicite que le projet de loi constitutionnelle prévoit parallèlement, comme en 2005, de moderniser
l’article 88-4 en étendant le champ des documents obligatoirement soumis au Parlement par le Gouvernement aux « projets d’actes législatifs européens » tout en conservant les « autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne comportant des dispositions qui sont du domaine de la loi ». Cela constitue un premier pas important. Il est cependant possible d’aller plus loin dans la voie d’une meilleure implication du Parlement français dans la construction européenne. La révision constitutionnelle issue des travaux du Comité présidé par M. Edouard Balladur offre précisément l’opportunité d’investir ce champ prometteur.
La mise en place du nouveau traité nous invite à faire le point sur la qualité de l’implication de l’Assemblée nationale dans la construction européenne. La nouvelle place faite aux parlements nationaux dans les processus décisionnels européens, l’investissement par l’Union de nouveaux domaines au cœur des compétences traditionnelles de nos assemblées, en particulier l’édification d’un espace européen de liberté, de sécurité et de justice, le programme ambitieux que les chefs d’Etat et de gouvernement assignent à l’Europe en lui donnant enfin les moyens d’agir efficacement et rapidement sont autant d’avancées qui appellent une meilleure appropriation par les élus du peuple des enjeux communs. A cet égard, le Rapporteur veut souligner un aspect souvent négligé de la question. La qualité de la contribution d’un Etat membre à l’édification de la politique de l’Union est très significativement liée à la force de l’implication de son Parlement dans les affaires européennes. La capacité des Etats scandinaves, par exemple, à défendre efficacement leurs intérêts tout en contribuant activement à l’élaboration d’une législation commune de qualité n’est pas indifférente à l’exemplarité de l’association de leurs parlements au contrôle de l’Union.
1) Une implication moins dépendante des procédures que des pratiques
Il importe de relever, en préalable, que la qualité de l’implication des parlements nationaux dans les affaires européennes dépend, selon le Rapporteur, moins des procédures que des habitudes.
a) Les deux modèles par mandat et par résolution
La distinction traditionnelle des contrôles parlementaires entre le modèle par « mandat », propre aux pays scandinaves et à quelques Etats de l’Europe centrale et orientale, et le modèle par « résolution », qui inspire la législation de la majorité des Etats membres, en particulier les pays latins, est en effet moins pertinente qu’il n’y paraît. Dans la forme, les différences sont majeures.
■ Le premier modèle permet aux parlements de donner à leurs gouvernements un mandat impératif de négociation, dont il ne peut s’écarter sauf à mettre en cause sa responsabilité devant la représentation nationale. Il est généralement associé à une implication très étroite des parlementaires, passant par des auditions presque hebdomadaires des ministres par les commissions compétentes en préalable à chaque Conseil. L’absence de publicité de ces débats, comme c’est le cas par exemple en Suède, permet une coopération très poussée et peu formelle qui évite d’handicaper le Gouvernement dans les négociations européennes. Le plus souvent, ce modèle implique l’existence d’une commission des affaires européennes (CAE) aux prérogatives étendues (allant jusqu’à une délégation générale du pouvoir du Parlement pour toutes les questions européennes dans le cas de la « Grande commission » finlandaise). Il ménage cependant de manière systématique une forte association des autres commissions spécialisées, soit en prévoyant qu’elles examinent les textes européens avant la commission des affaires européennes, soit en assurant leur représentation au sein de la commission des affaires européennes, grâce à la l’appartenance simultanée de ses membres aux commissions spécialisées, poussée dans le cas du Danemark jusqu’à la présence coutumière dans la première des présidents des secondes.
■ A l’inverse, le modèle par résolutions prévoit que les avis exprimés par les parlements ne sont pas juridiquement liants. Généralement, ce modèle fait une part plus grande à l’autonomie du Gouvernement dans les négociations, suivie de moins près par les commissions concernées, et concentre les initiatives parlementaires sur les projets d’actes européens les plus importants et les plus symboliques. De manière paradoxale, ce modèle est souvent associé à un examen exhaustif et formalisé des documents communautaires, comme c’est notamment le cas en France où la délégation pour l’Union européenne émet une opinion sur tous les textes européens qui sont transmis au Parlement par le Gouvernement.
b) Une distinction moins opérante qu’il n’y paraît
Cependant, dans les faits, l’appartenance à l’un ou l’autre des modèles ne préjuge en rien de la qualité et de l’influence du travail parlementaire sur la construction européenne. La portée réelle des avis adoptés par le Parlement dépend en effet moins de leur nature juridique que de leur poids politique. Le critère déterminant à cet égard est plutôt la solennité de l’opinion exprimée : une résolution adoptée en séance publique, par exemple, sur un sujet fortement médiatisé « lie » infiniment plus le Gouvernement qu’un mandat, même impératif, défini discrètement dans le cénacle policé d’une commission parlementaire. De même, l’incapacité à contraindre juridiquement le Gouvernement dans la position qu’il prend au sein du Conseil n’empêche pas les parlementaires de mettre en place un suivi développé des dossiers en auditionnant régulièrement les ministres concernés.
2) Les voies de progrès du contrôle parlementaire de l’Union
Le Rapporteur dégage ainsi deux grands critères qui permettent à ses yeux de mesurer l’étendue de l’influence d’un Parlement sur les affaires européennes.
a) L’appropriation de l’Europe par les parlementaires
Le premier, et le plus important, est l’appropriation par un nombre aussi élevé que possible de parlementaires des sujets européens. Ainsi, l’intensité du contrôle parlementaire découle, presque naturellement, de l’étendue concrète du nombre de députés concernés par les affaires de l’Union.
Cette implication est nécessaire parce que la dimension européenne irradie et contraint l’ensemble des questions nationales dont se saisissent les parlementaires. Sa méconnaissance affaiblit ainsi considérablement la qualité du travail législatif national en l’enfermant dans une optique trop strictement interne. Ainsi, comment examiner avec lucidité et pertinence un budget national sans tenir compte des contraintes que nous imposent inéluctablement l’appartenance à l’Union économique et monétaire ? Dans le même esprit, les stratégies nationales en matière d’immigration sont vouées à l’échec lorsqu’elles ne sont pas solidement relayées par une coopération européenne étroite ou, à tout le moins, par une observation approfondie des politiques suivies par nos partenaires.
Surtout, l’appropriation de l’Europe par les parlementaires est la condition sine qua non de l’appropriation de l’Europe par le peuple, dont ils sont les meilleurs relais et avec lesquels ils sont en contact permanent. Aux yeux du Rapporteur, l’Union souffre essentiellement auprès de ses peuples moins d’une excessive modestie de ses politiques (une monnaie unique aujourd’hui, une politique d’immigration demain, un rôle dès à présent décisif dans la lutte contre le changement climatique ne relève pas de politiques techniques et discrètes !) que de leur insuffisante lisibilité liée à leur apparente « dépolitisation » qui donne à penser qu’elles ne relèvent pas des choix démocratiques explicites tranchés par le peuple. Or, quelle enceinte est mieux adaptée à la « politisation » des enjeux que notre Parlement, le lieu de la construction et de la vie démocratique ? L’appropriation de l’Europe par les parlementaires, c’est aussi la coloration de ses enjeux pour faire naître et animer un vrai débat démocratique portant aussi sur cette dimension essentielle de notre destin collectif.
(2) Des progrès récents en France mais des avancées possibles
L’appropriation de l’Union par les députés français est-elle satisfaisante ? La réponse doit être nuancée, mais il importe de faire la part des progrès accomplis dans cette direction.
■ Une réelle appropriation implique tout d’abord de faire venir l’Europe dans le cœur de l’activité parlementaire que sont les commissions permanentes. C’est l’une des tâches les plus importantes de la délégation pour l’Union européenne, dont les membres appartiennent systématiquement à l’une des six commissions permanentes, que d’assurer un rôle de veille, d’alerte et d’expertise à l’attention des commissions soumises à l’ampleur et à l’urgence du travail législatif. A cette fin, outre bien sûr la procédure de résolution qui permet aux commissions concernées d’examiner les propositions de résolution que la délégation juge opportun de déposer sur les textes décisifs de l’action européenne, ont été désignés dans les commissions permanentes des « correspondants européens » chargés de suivre l’actualité législative européenne.
■ Mais mieux rapprocher l’Europe des parlements, c’est aussi la faire rentrer dans la séance publique, le cœur de la vie parlementaire et démocratique et l’enceinte du débat public national. Beaucoup a déjà été fait, en témoigne notamment la réception du président de la Commission européenne M. José Manuel Barroso le 24 janvier 2006 ou l’organisation désormais systématique d’un débat préalable à chaque réunion du Conseil européen. En revanche, force est de regretter que l’examen en séance publique des résolutions déposées par la délégation et adoptées par les commissions permanentes soit aujourd’hui tombé en quasi-désuétude, en raison de l’« encombrement de l’ordre du jour ». Seules six résolutions ont été votées par l’Assemblée nationale dans son ensemble depuis 2002.
b) Peser au quotidien sur l’Europe et réagir mieux en amont des décisions
(1) Se saisir des enjeux européens dès le stade de leur préparation
Un autre critère décisif de la qualité de l’implication parlementaire peut être constitué par la capacité à se saisir des enjeux européens suffisamment tôt et avec constance pour pouvoir peser sur les choix des institutions européennes. Cette capacité permet, d’une part, de mieux faire émerger les dimensions politiques des options retenues par Bruxelles pour mieux s’assurer qu’elles n’enfreignent pas la volonté populaire. L’identification précoce des enjeux politiques est d’autant plus décisive que l’essentiel de la « bataille » législative européenne se joue très en amont du processus décisionnel, dont la mécanique tend ensuite à rendre les options retenues de plus en plus contraintes et encadrées. D’autre part, en prenant part au débat dès le stade préparatoire, elle permet au Parlement d’influencer la décision finale dans un sens mieux favorable à l’intérêt national.
(2) Les opportunités du traité de Lisbonne
Là encore, si du chemin a été fait, il est possible d’aller beaucoup plus loin. Le traité de Lisbonne nous en fournit les moyens.
■ La délégation pour l’Union européenne, qui examine de manière systématique tous les textes européens que le Gouvernement lui transmet, s’attache à identifier et éclairer les questions très en amont du processus décisionnel communautaire. Dans cet esprit, elle a désigné dès sa mise en place au début de l’été 2007 des rapporteurs chargés de suivre dans la durée les principales questions à l’agenda de l’Union, afin de constituer un « pôle d’expertise » apte à éclairer l’Assemblée tout au long de la préparation puis de la négociation des grands projets de l’Europe.
■ Le nouveau droit d’alerte précoce en matière de subsidiarité, qui intervient dans les huit semaines qui suivent le dépôt des projets d’actes législatifs, devrait offrir l’occasion de se saisir tôt des textes susceptibles de poser des difficultés. La réussite de l’expérience dépendra, aux yeux du Rapporteur, de la qualité de sa mise en œuvre.
– Il conviendra en ce sens de veiller, sur le modèle de la procédure informelle mise en place depuis le second semestre 2006 pour contrôler la conformité des projets aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, à ce que la capacité de l’Assemblée nationale à s’exprimer ne soit pas compromise par l’encombrement de l’ordre du jour des commissions permanentes en prévoyant que le projet d’avis adopté par la Délégation devienne, dans un délai déterminé, l’avis de l’Assemblée lorsque la commission permanente concernée ne s’en saisit pas.
– Dans le même esprit, il faudra sans doute aménager la faculté d’un débat en séance publique sur les projets d’avis les plus importants, par exemple à la demande du président de la délégation, des présidents de commissions ou des présidents de groupe.
– Enfin, il importe de s’attacher à conjurer le risque que la procédure ne s’émousse et n’épuise pas ses potentialités en en faisant un usage avisé et pertinent. Le Rapporteur remarque à cet égard que les institutions européennes accorderont d’autant moins d’attention et de poids aux avis nationaux qu’ils seront utilisés de manière formaliste et systématique dans le seul but, stérile, de protéger jalousement les prérogatives nationales et freiner la construction européenne. A l’inverse, des avis plus rares mais mieux motivés et nuancés pourraient donner aux parlements un moyen exceptionnel de peser sur les choix européens en identifiant très vite les obstacles et en dégageant des options alternatives. A cette condition, le contrôle de subsidiarité, outre qu’il constituera un instrument essentiel d’appropriation, par les parlementaires nationaux et, partant, par les opinions publiques, des enjeux et débats européens, pourrait se révéler une arme décisive pour encadrer et renforcer la position de négociation de la France lorsque ses intérêts nationaux sont en jeu. En outre, les « eurosceptiques » ne pourront plus contester les décisions prises au niveau européen dans la mesure où elles auront été validées par les parlements nationaux dans le cadre de la subsidiarité.
■ Mais le contrôle de subsidiarité, outre le fait qu’il soit limité aux seuls projets d’actes législatifs européens, intervient à vrai dire un peu tard. Un projet d’acte législatif est en effet déposé après que les options fondamentales de l’intervention de l’Union aient été fixées par la Commission. A cet égard, comme à tant d’autres, le Rapporteur ne peut que regretter l’anachronisme de
l’article 88-4 de notre Constitution qui limite le champ d’expression « garanti » du Parlement aux seuls actes communautaires intervenant dans le domaine législatif français, en disposant que seuls ces derniers soient obligatoirement transmis par le Gouvernement. Sa lettre est même contraire à la pratique du Gouvernement de désormais transmettre aux assemblées la quasi-intégralité des documents de l’Union. Si l’on veut que notre Parlement puisse s’approprier la construction européenne et peser sur la direction qu’elle prend, il faut de toute évidence lui permettre de s’exprimer sur tous les sujets européens dont il lui appartient de juger l’importance.
La Délégation s’est réunie le mardi 8 janvier 2008, sous la présidence de M. Pierre Lequiller, Président et rapporteur, pour examiner le présent rapport d’information.
Un débat a suivi l’exposé du rapporteur.
M. Daniel Garrigue, après avoir salué le travail du Président Pierre Lequiller dont il a rappelé la très grande implication dans les problèmes européens, a considéré que si ce traité répondait à beaucoup d’attentes, trois problèmes devaient néanmoins être soulignés.
Avec ce traité, l’Union européenne peut agir et décider notamment face à la mondialisation. Il s’est cependant interrogé sur le délai de mise en œuvre de la double majorité en s’interrogeant sur la possibilité d’abréger ce délai.
L’Union européenne va bénéficier de la personnalisation du pouvoir avec l’élection d’un Président du Conseil européen stable mais se pose la question de sa coexistence avec les présidents du Conseil « tournants » et de l’articulation de leurs pouvoirs respectifs.
Il y a une montée en puissance des Parlements nationaux longtemps tenus à l’écart de la construction européenne. Il a plaidé pour que soit relancée l’idée d’une seconde chambre européenne composée des représentants de ces Parlements nationaux.
M. Marc Laffineur a apporté son soutien aux conclusions du Président Pierre Lequiller en estimant que le redémarrage de l’Europe était indispensable après l’échec de 2005 et que la France sortait ainsi de l’isolement où elle était depuis cette époque.
Après avoir souhaité que la ratification intervienne le plus vite possible avant les élections européennes de 2009, il a reconnu, à l’instar de M. Daniel Garrigue, que des interrogations importantes demeuraient mais qu’il était primordial d’aller de l’avant afin que l’Union européenne puisse s’organiser pour pouvoir peser en faveur de la paix dans un monde de plus en plus inquiétant.
M. Thierry Mariani a estimé que le rapport du Président Pierre Lequiller pouvait constituer un bon argumentaire pour expliquer aux citoyens en quoi ce traité était différent du projet de Constitution et pour les convaincre de le soutenir.
M. André Schneider a souligné la qualité de ce rapport qui expliquait simplement un problème complexe. Néanmoins il faudra encore faciliter l’abord de ce traité dit « simplifié » pour les citoyens tant il apparaît, sur la forme, fort complexe. Il apporte son soutien à ce texte qui permet à l’Europe de se remettre en marche.
M. Jean Dionis du Séjour a rappelé sa profonde déception lors de la victoire du « non » en 2005 et qu’il avait été favorable à l’organisation d’un nouveau référendum. Saluant le courage du Président de la République préconisant une ratification parlementaire lors de la campagne électorale, il a fortement déploré l’impossibilité actuelle d’obtenir une ratification populaire sur ce type de texte dans tous les pays d’Europe simultanément. Il a estimé que le cœur du problème était que l’on ne pouvait pas, à l’heure actuelle, entraîner les peuples européens dans une marche en avant dans ce domaine. Il a conclu en indiquant qu’il soutiendrait ce texte qui était, actuellement, le meilleur compromis.
M. Christophe Caresche a estimé que, même si chacun avait dans le passé, défendu ses propres positions, pour ou contre la Constitution européenne, on pouvait considérer que le traité de Lisbonne marquait la fin d’une crise très grave pour l’Europe. On ne peut pas savoir comment les Français réagiraient si une consultation était organisée aujourd’hui. On risquerait de retrouver les mêmes arguments et la crise ne serait pas terminée.
Les motivations du « non » au référendum de 2005 étaient diverses. Certaines critiques ont été entendues et le traité de Lisbonne est bien différent du traité constitutionnel. En particulier, il ne reprend pas la troisième partie qui était consacrée à la définition et au contenu des politiques européennes. Cette troisième partie n’avait d’ailleurs pas fait l’objet de débats à la Convention et son inclusion a été une erreur.
Pour ces différentes raisons, le Parti socialiste s’est prononcé en faveur du traité de Lisbonne.
M. Christian Paul a estimé qu’on ne dissiperait pas par l’adoption parlementaire un trouble profond dans l’opinion. Il est très dangereux de considérer que l’élection présidentielle équivaut à un référendum sur tous les sujets, en particulier sur l’Europe. C’est une profonde erreur que de miser sur l’amnésie des peuples. S’il est possible d’adopter de nouvelles règles de fonctionnement de l’Union européenne, on ne peut oublier le référendum de 2005.
Il est difficile de savoir si ce traité va permettre un nouveau départ ou si au contraire c’est un traité « pour solde de tout compte ». Cette difficulté est renforcée par le fait qu’à travers les positions exprimées par le Président de la République, il est impossible de savoir quelle Europe il souhaite, puisqu’il oscille entre un discours très libéral et un discours très national.
Le Président Pierre Lequiller, rapporteur, a apporté les éléments de réponse suivants :
- les délais prévus par le traité pour l’application des règles de majorité qualifiée ne peuvent être abrégés. On peut regretter à cet égard que les élections en Pologne aient eu lieu trois jours après l’accord politique sur le traité, puisqu’à présent le nouveau premier ministre est considéré comme très européen et qu’il n’aurait probablement pas eu les mêmes exigences que son prédécesseur. Il aurait évidemment été préférable que les nouvelles règles de majorité, d’ailleurs plus simples que celles du traité de Nice, s’appliquent dès l’entrée en vigueur du traité ;
- sur la question des futures relations entre le Président du Conseil européen et le président de la Commission, le rapporteur a indiqué qu’il avait proposé lors de la Convention qu’une seule personne incarne ces deux fonctions mais que cette proposition n’avait pas été expressément retenue. Il existe en effet un risque de concurrence entre les deux, même si les fonctions sont différentes. Là encore, la pratique aura un rôle déterminant ;
- les parlements nationaux ne peuvent pas devenir une deuxième chambre. Celle-ci existe d’ailleurs déjà, à travers le Conseil des ministres. L’idée d’un congrès réunissant les parlements nationaux et le Parlement européen, proposée lors de la Convention, était très intéressante mais elle n’a pas été retenue. Dans la pratique, les réunions entre le Parlement européen et les parlements nationaux, organisées régulièrement sur différents grands sujets européens, sont une très bonne chose. La position du Parlement européen sur le rôle des parlements nationaux a d’ailleurs beaucoup évolué ;
- le choix des hommes et la pratique seront probablement aussi importants que les dispositions du traité lui-même. Le Président du Conseil européen n’exercera certainement pas son pouvoir comme le fait par exemple le Président de la République. Il aura à négocier avec les chefs d’Etat et de gouvernement, avec la Commission ;
- le traité de Lisbonne est bien différent de la Constitution européenne. Cette différence réside d’abord dans le fait qu’il amende les traités existants, à l’instar du traité d’Amsterdam et de Nice. Ensuite, par rapport à la Constitution européenne, les symboles disparaissent, ainsi que la troisième partie. Le rôle des parlements nationaux est renforcé. Les services d’intérêt général font l’objet d’un protocole, le rôle de l’Europe dans la protection de ses citoyens est affirmé et la concurrence est ravalée au rang des moyens et non plus des fins de l’action européenne.
M. Daniel Garrigue a estimé qu’il n’existait aucune différence de nature entre le traité de Lisbonne et la Constitution européenne, qui sont tous deux des traités.
Le rapporteur a répondu que la Constitution européenne reprenait dans un document unique tous les traités, auxquels elle avait vocation à se substituer, ce qui la distinguait du traité de Lisbonne.
Il a ensuite salué la foi européenne de M. André Schneider, puis souscrit aux propos de M. Jean Dionis du Séjour et regretté que l’Europe ne se construise pas assez avec le peuple. Quelle que soit leur appartenance politique, les parlementaires nationaux doivent s’efforcer de parler de l’Europe sur le terrain et dans leurs parlements. Il faut souligner qu’actuellement, selon les sondages, l’idée européenne est populaire. C’est un signe très encourageant, même s’il faut relever qu’il en allait de même à la veille du référendum de 2005.
Comme l’a exprimé M. Christophe Caresche, il est nécessaire de fermer la parenthèse ouverte par le « non » français de 2005 et d’engager des politiques nouvelles.
En réponse à M. Christian Paul, le rapporteur a souligné que, pour pouvoir manifester une volonté, quelle qu’elle soit, encore faut-il que les institutions puissent fonctionner. Le Président de la République a donné cinq axes principaux pour la présidence française : l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, l’énergie, l’immigration, la réforme de la politique agricole commune et la défense. La présidence française tournera donc autour de ces cinq objectifs, et obtenir des progrès dans ces cinq domaines serait un succès.
Ayant rappelé que la réforme constitutionnelle, qui constitue le premier acte, sera suivie de la ratification du traité, dont la discussion devrait avoir lieu le 6 février à l’Assemblée nationale, le rapporteur a conclu en proposant à la Délégation que le rapport d’information soit distribué à l’ensemble des députés.
La Délégation a autorisé à l’unanimité la publication du rapport.
1 () Le Conseil européen statue à la majorité qualifiée pour l’élection du président du Conseil européen et la désignation du président de la Commission, du haut représentant, du président, du vice-président et des membres du directoire de la Banque centrale européenne