

TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 décembre 2010
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement des économies,
Président
M. Henri EMMANUELLI,
Rapporteur
M. Jean-François MANCEL,
Députés
——
La commission d’enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement des économies est composée de : MM. Henri Emmanuelli, président ; Jean-François Mancel, rapporteur ; Dominique Baert, Yves Censi, Louis Giscard d'Estaing, Hervé Mariton, vice-présidents ; Mme Martine Aurillac, MM. Jean-Pierre Brard, Paul Giacobbi, Nicolas Perruchot, secrétaires ; Élie Aboud, Mme Françoise Branget, M. Jean-Yves Cousin, Mme Aurélie Filippetti, MM. Franck Gilard, Jean-Pierre Gorges, Marc Goua, François Goulard, Mmes Arlette Grosskost, Élisabeth Guigou, M. Sébastien Huyghe, Mme Marietta Karamanli, MM. Jean Launay, Richard Mallié, Jean-Claude Mathis, Mmes Sandrine Mazetier, Marie-Anne Montchamp (1), MM. Pierre-Alain Muet, Michel Sapin, François Scellier.
AVANT-PROPOS DE M. HENRI EMMANUELLI, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE 11
INTRODUCTION 15
PREMIÈRE PARTIE – LA SPÉCULATION : UN MAL NÉCESSAIRE ? 19
I.– UN LARGE CONSENSUS SUR L’UTILITÉ, VOIRE LA NÉCESSITÉ, DE LA SPÉCULATION DANS UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ 19
A.– LA THÉORIE ÉCONOMIQUE 19
B.– UN CONSENSUS PARTAGÉ PAR LES PERSONNALITÉS DIVERSES ENTENDUES PAR LA COMMISSION, AVEC CEPENDANT DES RÉSERVES 22
1.– Toutes les personnalités entendues par la commission considèrent que la spéculation est un phénomène incontournable, voire utile 23
2.– La plupart en dénoncent toutefois certains excès et les conséquences néfastes, autant de pistes de réflexion que la commission d’enquête s’est efforcée d’explorer 25
a) Le défaut de transparence 25
b) Le mimétisme et les dynamiques incontrôlables 27
c) La déconnexion entre les marchés et l’économie réelle 29
II.– LE REVERS DE LA MÉDAILLE : SPÉCULATION ABUSIVE, « BULLES SPÉCULATIVES » ET VOLATILITÉ DES MARCHÉS 32
A.– LES SOUPÇONS NÉS DE LA CRISE DE LA DETTE GRECQUE 32
1.– La crise de la dette grecque est d’abord une crise de solvabilité 33
a) Les marchés financiers ont réagi à une véritable crise de confiance. 33
b) Les responsabilités internes au pays sont primordiales dans cette crise. 35
2.– Cependant, la spéculation financière a joué un rôle non négligeable. 37
a) L’ambivalence de certains acteurs 37
b) Des rumeurs déstabilisatrices, voire des soupçons de spéculation abusive 37
c) L’enquête menée par l’Autorité des marchés financiers 38
d) Des mouvements liés aux tendances naturelles du marché. 39
3.– La récente crise de la dette irlandaise réplique les enchaînements de la crise grecque 41
B.– DES CAS PATENTS DE SPÉCULATION MALVEILLANTE OU ABUSIVE 44
1.– Un exemple emblématique : Georges Soros, « l’homme qui fit sauter la Banque d’Angleterre » 44
2.– Certaines enquêtes actuellement menées par l’Autorité des marchés financiers (AMF) illustrent la diversité des procédés utilisés par les spéculateurs 46
C.– LES « BULLES SPÉCULATIVES », PHÉNOMÈNES PATHOLOGIQUES ET DESTRUCTEURS 52
1.– Les bulles spéculatives, phénomènes inhérents à la vie des marchés 52
2.– Une bulle aux effets dévastateurs : l’emballement du marché immobilier aux États-Unis, cause première de la « crise des subprimes » 59
D.– SPÉCULATION ET VOLATILITÉ DES MARCHÉS : DES MOUVEMENTS PERTURBANTS POUR LES PRODUCTEURS, LES INDUSTRIELS ET LES CONSOMMATEURS 60
1.– Le marché du pétrole 62
2.– Les matières premières agricoles : dissensions sur le rôle de la spéculation 63
E.– UNE LOGIQUE DES MARCHÉS QUI N’ABOUTIT PAS NÉCESSAIREMENT À UNE AUTORÉGULATION 66
1.– La remise en cause des théories des « marchés efficients » 67
2.– La prévalence croissante de comportements mimétiques 67
3.– Le caractère autoréalisateur des anticipations et les phénomènes de spirale 70
DEUXIÈME PARTIE – UNE SENSIBILITÉ ACCRUE DES ÉCONOMIES AUX EFFETS NÉFASTES DES PHÉNOMÈNES SPÉCULATIFS 73
I.– LA FINANCIARISATION DE L’ÉCONOMIE MONDIALE : UN PROCESSUS QUI S’ACCÉLÈRE 73
A.– UNE DÉCONNEXION CROISSANTE ENTRE L’ÉCONOMIE FINANCIÈRE ET L’ÉCONOMIE RÉELLE 73
1.– Les indicateurs définis par le Centre national de l’information statistique 73
a) Un ratio entre le PIB et le volume de transactions financières exorbitant 73
b) Un coefficient de capitalisation des bénéfices trop élevé, signe d’une croyance dans une croissance infinie 74
c) Un rapport entre les contrats sur instruments dérivés et le PIB en augmentation tendancielle 74
d) Dans ces conditions, se dessine une économie plus financiarisée 74
2.– Le marché des changes traduit également cette déconnexion 75
3.– Le cas éclairant du marché pétrolier : l’explosion de la sphère financière 75
B.– UNE SURABONDANCE DE LIQUIDITÉS EN QUÊTE D’OPPORTUNITÉS 77
1.– La surabondance de liquidités alimente les bulles spéculatives 77
2.– Mais l’injection de liquidités est considérée comme la seule réponse possible à court terme, même si son efficacité est douteuse. 79
C.– UNE CRISE DE L’ENDETTEMENT PRIVÉ TRANSFORMÉE EN CRISE DE L’ENDETTEMENT PUBLIC QUI INQUIÈTE LES MARCHÉS 82
1.– Les mesures de soutien et les plans de relance étaient nécessaires pour éviter un effondrement des économies 82
2.– Mais ils ont creusé les déficits et accru les dettes publiques 83
II.– DES ACTEURS, DES OUTILS ET DES MÉCANISMES AGGRAVANT LES EFFETS NÉFASTES DE LA SPÉCULATION SUR DES MARCHÉS INSUFFISAMMENT RÉGULÉS 85
A.– DES ACTEURS PEU OU MAL ENCADRÉS 85
1.– Les fonds alternatifs : une nébuleuse d’intervenants dont la raison d'être est la spéculation 85
2.– Les agences de notation : un pouvoir exorbitant 87
a) Des méthodes de notation défaillantes alimentant des soupçons de conflits d’intérêts 88
b) L’incohérence du processus de formation de la note et une forte dépendance des investisseurs par rapport à la notation 90
c) Une insuffisante responsabilité des agences 91
d) Le règlement communautaire du 16 septembre 2009 assure un premier encadrement 92
3.– Le rejet du risque par les banques : titrisation et hors-bilan 94
a) Qu’est-ce que la titrisation ? 94
b) Les dangers de la titrisation 94
c) Le danger est d’autant plus grand que le marché de la titrisation est en pleine expansion 97
d) La titrisation responsable d’une crise de la liquidité 98
e) Les autres formes d’engagement hors-bilan 99
f) La réglementation par le Comité de Bâle 100
g) La révision des directives relatives aux fonds propres des banques 104
B.– DES OUTILS PARFOIS DÉVOYÉS 106
1.– Le trading algorithmique et le trading à haute fréquence 106
a) Les algorithmes peuvent être détournés au profit de stratégies manipulatoires 108
b) Le trading algorithmique et le trading à haute fréquence favorisent une opacité accrue des marchés 109
c) Les incidences du trading algorithmique sur l’intégrité des marchés : du risque opérationnel au risque systémique. 110
2.– Les ventes à découvert : l’utilisation abusive d’un outil par ailleurs indispensable 112
3.– Les produits dérivés : un usage potentiellement dévoyé 114
a) Les risques inhérents aux produits dérivés 115
b) Un cas typique de produit dérivé hautement spéculatif : les couvertures de défaillance (credit default swaps – CDS), mis en lumière lors de la crise grecque 119
4.– Une pratique qui démultiplie les effets des opérations spéculatives : l’effet de levier 122
a) L’effet de levier pemet de « gonfler la mise » des acteurs de marché 122
b) Le rachat par effet de levier (LBO) : une fréquente fragilisation des entreprises 123
C.– DES MARCHÉS PEU TRANSPARENTS 125
1.– Les effets pervers de la directive sur les marchés d’instruments financiers (MIF) 125
a) Les modifications apportées au mode de fonctionnement des marchés par la directive MIF 125
b) Une directive qui a manqué ses objectifs et fortement perturbé les marchés 126
2.– La part prépondérante des transactions de gré à gré dépourvues de transparence 134
D.– DES RÉGULATEURS NATIONAUX RELATIVEMENT DÉSARMÉS 138
1.– Les limites de l’action de l’Autorité des marchés financiers (AMF) 138
a) Une compétence territorialement limitée 138
b) Une capacité d’investigation matériellement restreinte 140
c) L’absence de dispositif de déclaration des ordres (reporting) pour les CDS 140
d) La difficulté de contrôler le trading à haute fréquence et le trading algorithmique 141
e) Le contrôle des carnets d’ordres est variable d’un pays à l’autre 142
f) Des moyens humains insuffisants qui seront augmentés en 2011 142
g) Des moyens financiers en baisse, fragilisés par la réduction de l’activité du marché 142
h) Les solutions prévues par le projet de loi de finances pour 2011 145
i) L’AMF semble sous-dotée par rapport à ses homologues européennes 146
2.– Des appréciations divergentes sur l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) 147
a) Un contrôle exercé sur les établissements et non sur les transactions 149
b) Le rôle protecteur du contrôle de l’ACP 149
c) Des moyens en cours d’augmentation 149
d) Des compétences qui restent limitées 150
e) Une autorité qui se distingue positivement de ses homologues étrangères 151
3.– Les facteurs techniques qui limitent l’efficacité des régulateurs 151
a) L’opacité grandissante des marchés financiers 151
b) L’absence de contrôle du « système bancaire fantôme » 152
c) La concurrence entre régulateurs 152
d) Le cas particulier du marché des couvertures de défaillances (credit default swaps – CDS) 153
e) L’absence de régulateur pour les marchés à terme agricole 153
f) Le manque de capacités informatiques des régulateurs 153
4.– La perfectible coopération entre régulateurs nationaux 154
a) Les limites techniques de la coopération internationale 154
b) Des échanges fondés principalement sur les bonnes relations bilatérales 154
c) Une coopération ralentie par l’absence d’harmonisation juridique 155
E.– L'ABSENCE DE SUPERVISION À L'ÉCHELON EUROPÉEN : UNE CARENCE ESSENTIELLE POUR LAQUELLE DES STRUCTURES SONT EN COURS DE MISE EN PLACE 158
1.– L’adoption du « paquet supervision » 159
2.– Le Comité européen du risque systémique (CERS) 159
3.– Les autorités européennes sectorielles de supervision 162
F.– LE RÔLE AMPLIFICATEUR DES MÉDIAS 164
TROISIÈME PARTIE – POURSUIVRE RÉSOLUMENT, À TOUS LES ÉCHELONS PERTINENTS, L’ACTION ENTREPRISE APRÈS LA CRISE FINANCIÈRE DE 2008 167
I.– TROUVER LE BON ÉCHELON D’INTERVENTION ET ÉVITER L’ANGÉLISME 167
A.– LES LIMITES ET LES ÉVENTUELS EFFETS PERVERS D’UNE ACTION RÉGULATRICE MENÉE AU SEUL ÉCHELON NATIONAL N’ONT PAS CONDUIT AU RENONCEMENT 167
1.– Les limites et les éventuels effets pervers d’une action régulatrice menée au seul échelon national 167
2.– Avec la loi de régulation bancaire et financière, les pouvoirs publics français ont assumé leurs responsabilités 168
a) Le projet initial : un renforcement de la supervision des acteurs et des marchés financiers 169
b) Un texte musclé par l’Assemblée nationale 170
c) Un texte adapté par le Sénat 172
B.– LE G20, LIEU D’IMPULSION PRIVILÉGIÉ 174
C.– L’UNION EUROPÉENNE : UNE INDISPENSABLE SÉRIE DE RÉFORMES AMBITIEUSES À METTRE EN œUVRE ET À PROLONGER 179
1.– Un préalable, restaurer le rôle du politique : politique monétaire et gouvernance économique 179
2.– Des avancées très importantes ont été réalisées dans la mise en œuvre des engagements pris au G20 et des « chantiers » législatifs essentiels sont en cours ou annoncés 181
a) Les réflexions du Parlement européen 182
b) Les travaux législatifs 183
D.– UNE PRÉOCCUPATION SANS DOUTE INSUFFISAMMENT PRISE EN COMPTE : LA COORDINATION TRANSATLANTIQUE 184
II.– FAVORISER LA TRANSPARENCE ET LE CONTRÔLE DES MARCHÉS 197
A.– UNE PRIORITÉ : LA RÉVISION DE LA DÉSASTREUSE DIRECTIVE MIF 197
1.– Améliorer de la transparence des marchés 198
2.– Favoriser une concurrence équitable entre plates-formes de négociation 200
3.– Standardiser les déclarations des ordres (reporting) et permettre une identification des clients 200
B.– AU-DELÀ DE LA RÉVISION DE LA MIF, D’AUTRES MESURES POURRAIENT FAVORISER LA TRANSPARENCE, PARTICULIÈREMENT SUR LES MARCHÉS DE GRÉ À GRÉ 201
1.– Introduire de la transparence sur les marchés de gré à gré : information, clarté, sécurité 201
2.– Le projet de règlement du 15 septembre 2010 sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux 204
a) Le champ d’application du projet de règlement 205
b) Les contreparties centrales 206
c) Les référentiels centraux 206
C.– ENGAGER LES MARCHÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES DANS LA VOIE DE LA TRANSPARENCE 207
1.– Les spécificités des marchés dérivés des matières premières supposent l’élaboration de textes européens dépassant la révision de la directive MIF 207
2.– Organiser des marchés à terme de matières premières en Europe 208
D.– LA « TAXE TOBIN » : OUTIL DE TRANSPARENCE ? 211
III.– RÉGLEMENTER, SI NÉCESSAIRE, AVEC DISCERNEMENT 213
A– FONDS ALTERNATIFS : UN COMPROMIS EUROPÉEN QUI DEMEURE INSATISFAISANT 213
1.– Les principales dispositions de la proposition de directive d’avril 2009 213
2.– Une proposition de directive très controversée 214
3.– Les travaux au Conseil et au Parlement européen 215
4.– Le texte adopté le 11 novembre 2010 216
B.– VENTES À DÉCOUVERT, CDS : L'UNION EUROPÉENNE EST ENFIN ENTRÉE EN ACTION 218
1.– Les atermoiements de la Commission européenne 218
2.– Le projet de règlement du 15 septembre 2010 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit 219
a) Des obligations de transparence en ce qui concerne les actions, les émissions de dette souveraine et les CDS liés à la dette souveraine d’un État de l’Union européenne 219
b) Les ventes à découvert « à nu » 221
c) Les pouvoirs d’intervention des régulateurs en cas de situations d’urgence : un rôle-clé pour la nouvelle Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) 222
d) Réduire le délai de règlement-livraison pour les ventes à découvert 223
C.– TRADING ALGORITHMIQUE ET TRADING À HAUTE FRÉQUENCE : CONTENIR DES PRATIQUES PEU UTILES ET PORTEUSES DE RISQUES 224
D.– AGENCES DE NOTATION : COMPLÉTER LE RÉCENT DISPOSITIF COMMUNAUTAIRE 227
1.– Inverser le modèle économique ? 227
2.– Se « désintoxiquer » des notes 227
3.– Renforcer le régime de responsabilité 228
E.– ENCADRER RIGOUREUSEMENT LES BANQUES ET LES ACTIVITÉS DE NATURE BANCAIRE 230
1.– Encadrer le risque systémique par la taxation du secteur financier 230
2.– Mieux responsabiliser les dirigeants 232
3.– S’interroger sur l’intérêt d’une meilleure distinction entre les activités de banque de dépôt et de banque d’investissement 236
4.– Suivre avec vigilance l’application, notamment aux États-Unis, des règles prudentielles du Comité de Bâle 240
5.– Empêcher le développement de la banque parallèle (shadow banking) 241
6.– Surveiller attentivement les effets de la mise en œuvre des règles de « Bâle III » sur le financement par les banques des entreprises et des particuliers 242
IV.– ASSURER UN CONTRÔLE EFFICACE DES RÈGLES EN VIGUEUR 246
A.– DOTER LES RÉGULATEURS DES MOYENS D’EFFECTUER LEUR MISSION 246
B.– RENDRE OPÉRATIONNEL TRÈS RAPIDEMENT LE COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE 247
C.– PROMOUVOIR LA COOPÉRATION DES AUTORITÉS DE RÉGULATION 248
CONCLUSION 251
TRAVAUX EN COMMISSION 253
LISTE DES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 269
1) Les questions préalables à aborder à l’occasion de la présidence française du G20 : système monétaire international et politique monétaire 269
2) Union européenne et zone euro : tirer les conséquences de l’union monétaire 269
3) Une coordination transatlantique à promouvoir 270
4) Un développement de la transparence sur tous les marchés 270
5) Un meilleur encadrement des fonds alternatifs 271
6) Une réglementation plus contraignante de certaines opérations à risque 271
7) Une élimination du trading à haute fréquence 271
8) Un recadrage des agences de notation 272
9) Une responsabilisation du secteur financier 272
10) Une application correcte des règles prudentielles et comptables 273
11) Une adaptation des moyens des autorités de régulation et de supervision 274
CONTRIBUTIONS 275
– Contribution de M. Paul Giacobbi, député, membre de la commission d’enquête 275
– Contribution de M. Jean-Pierre Brard, député, membre de la commission d’enquête 289
– Contribution des députés du groupe SRC membres de la commission d’enquête 293
– Contribution de Mme Elisabeth Guigou, députée, membre de la commission d’enquête 297
GLOSSAIRE DES SIGLES UTILISÉS 299
ANNEXE 1 : COMPTES RENDUS DES AUDITIONS 303
ANNEXE 2 : GRAPHIQUES 591
AVANT-PROPOS DE M. HENRI EMMANUELLI,
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE
Le 8 juin 2010, les membres du groupe socialiste, radical, citoyens et divers gauche déposaient une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement des économies.
Cette proposition était directement motivée par la crise de la dette souveraine grecque, qui a agité les marchés depuis la fin de l'année 2009, pour culminer au printemps 2010.
L'objectif dépassait cependant largement l'analyse de cette crise et le libellé de la résolution adoptée le 24 juin 2010 par notre Assemblée permettait de mener des investigations larges, articulées autour des questions suivantes :
– Qui se livre aux attaques spéculatives, et à partir de quelles zones ou marchés ?
– Quelles sont les méthodes employées ? En quoi l’automatisation des décisions de ventes ou d’achats amplifie-t-elle les mouvements spéculatifs ?
– Quel est le rôle des agences de notations dans les prises de positions des fonds spéculatifs et des acteurs de marché ?
– Peut-on considérer qu’il y a eu « délit d’initiés » ? Certains acteurs étaient-ils au courant de la réalité de solvabilité grecque en amont du déclenchement de la crise ?
– Deux ans après la crise des subprimes, les bonnes décisions ont-elles été prises par les acteurs compétents pour prévenir de nouvelles crises ?
La commission d’enquête s'est efforcée de recueillir le témoignage non seulement des autorités des marchés monétaire et financier et de représentants des secteurs d'activités concernés, mais aussi d'universitaires, qui ont exprimé des points de vue parfois en décalage avec ceux des acteurs « institutionnels », et de collègues députés européens, qui nous ont apporté de précieuses indications sur l'élaboration de la nécessaire réglementation communautaire. Point d'orgue de nos travaux, les auditions de Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et de M. Michel Barnier, commissaire européen chargé du marché intérieur et des services, ont permis de faire le point sur l'action entreprise aux échelons national et communautaire.
Le président de la commission se plaît à souligner l'esprit constructif qui a animé à la fois les personnalités entendues et les membres de la commission, tous partageant le souci de rechercher les moyens de mettre le système financier au service de la production de richesses.
Ce n'est hélas pas le cas aujourd'hui ! Certains chiffres donnent le vertige. 4 000 milliards de dollars s'échangent quotidiennement sur le marché des changes. L'encours des produits dérivés – plus de 600 000 milliards de dollars – représente plus de 10 fois le PIB mondial. Les liquidités disponibles dans le monde progressent de quelque 15 % l'an, soit près de quatre fois plus vite que le PIB. Dès lors que les liquidités n’ont plus d'usage dans l'économie réelle, elles alimentent la formation de bulles spéculatives dont l'éclatement est à l'origine de crises dévastatrices : crise des subprimes aux États-Unis en 2007, mais aussi, plus proche de nous, la bulle immobilière en Irlande.
Un autre facteur explique et conditionne grandement l'instabilité sur laquelle prospèrent tous les phénomènes spéculatifs : l’état de ce que l'on nomme encore le système monétaire international, bien qu'il s'agisse davantage d'un état de fait que d'un système organisé. Sa reconstruction sera sans doute difficile, mais il faut l’entreprendre.
Ces causes structurelles et profondes n'exonèrent cependant pas les autorités politiques de leurs responsabilités.
En cédant, à la fin du siècle dernier, aux sirènes de la dérégulation, les responsables politiques s'en sont remis à des marchés dont chacun s'accorde aujourd'hui à reconnaître qu'ils sont totalement opaques : les agents de l'économie réelle ne peuvent y trouver les bons signaux ; les autorités de régulation, réduites à la portion congrue, ne peuvent y faire respecter la moindre règle du jeu. D'où un fonctionnement erratique, à la merci de quelques opérateurs avides de gains faciles et, surtout, de mécanismes favorisant les comportements moutonniers et les opérations à court terme.
À titre d'exemple, avec la désastreuse directive du 30 avril 2004 sur les marchés d'instruments financiers, les autorités européennes, en cherchant à développer la concurrence, n'ont réussi qu'à faire voler en éclats le marché, au point que d'aucuns en viennent à comparer les marchés financiers à un casino qui fonctionnerait sans croupier.
Dans ces conditions, bien des outils financiers ont été dévoyés : on peut vendre sans les posséder des contrats assurant des risques qui n'existent pas ! C'est la logique folle des ventes de credit defaut swaps - CDS à découvert et à nu qui ont mis en péril l'euro au printemps dernier. On peut de même passer des ordres d'achat ou de vente d'un montant démesuré, pour les annuler quelques millisecondes plus tard, tout en ayant déséquilibré le marché l'instant de raison qui suffit pour empocher de substantiels bénéfices.
Notre commission a tenté de mettre en lumière quelques-uns de ces phénomènes.
Face à des instruments socialement inutiles et potentiellement dangereux, il ne faut pas être trop timoré et ne pas hésiter à utiliser l'arme de la réglementation, voire l’interdiction.
Mais en premier lieu, la tâche qu'il est urgent d'entreprendre est d’établir la transparence sur les marchés, financiers mais aussi des matières premières. Nul ne doit pouvoir détenir un monopole de l'information ni procéder en toute impunité à des actions déstabilisantes. Il faut, en outre, remettre sur les rails les activités financières. Le rôle traditionnel de banquiers est d'identifier le risque et de l'assumer et non pas de le masquer puis de le disperser, comme cela était fait à l'envi dans le cadre de la titrisation.
Organisation de la transparence, interventions des « gendarmes » des bourses et des marchés, prévention des risques par une véritable supervision nationale et internationale, réglementation des techniques susceptibles de dérive, tels sont les outils qu'il appartient aujourd'hui à la puissance publique de mettre résolument en œuvre. Il en va de la stabilité de l'économie mondiale, de la croissance et de l'emploi, et donc de la vie quotidienne de chacun.
Modestement, notre commission d'enquête a essayé de contribuer à la réflexion et à tracer des pistes qui pourraient permettre d'atteindre un objectif que l'on espère largement partagé : mettre la finance au service du progrès économique et social.
INTRODUCTION
Le présent rapport conclut les travaux de la commission d’enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement des économies. Cette commission avait été créée par la résolution n° 498 adoptée par l’Assemblée nationale le 24 juin 2010 dans les conditions prévues par l’article 141 de son Règlement, lequel permet à un président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire de demander un débat sur une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête, celle-ci ne pouvant être alors rejetée qu’à la majorité des trois cinquièmes des membres de l’Assemblée.
Même si l'on pouvait s'interroger sur l'adaptation de la procédure de la commission d'enquête, dont les pouvoirs sont territorialement limités, face à des phénomènes inscrits dans la mondialisation de la finance, qui aurait pu contester cette volonté de donner un coup de projecteur sur des pratiques souvent diabolisées, mais jamais véritablement analysées, susceptibles d'être à l'origine ou du moins d'accélérer des crises dévastatrices pour nos économies ?
C’est à M. Henri Emmanuelli, deuxième signataire de la proposition de résolution ayant conduit à la création de la commission d’enquête, qu’est revenue la présidence de cette instance, en application de l’article 143 du Règlement.
La commission d’enquête, composée de trente représentants de tous les groupes politiques de l’Assemblée, a procédé à vingt-huit auditions entre le 8 septembre et le 1er décembre 2010 pour entendre trente-sept personnalités de tous horizons : économistes, représentants des activités financières, responsables des autorités de régulation, ainsi que des responsables politiques, Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l’industrie, et M. Michel Barnier, commissaire européen chargé du marché intérieur et des services, sans oublier des élus français au Parlement européen.
C'est avec beaucoup d'humilité que nous nous sommes efforcés d'aborder un sujet où les autorités de contrôle françaises, et peut-être plus encore, européennes, éprouvent beaucoup de difficultés à établir des certitudes.
Beaucoup d'humilité aussi s'agissant des propositions, car l’interconnexion des marchés ne permet guère d'envisager des solutions purement nationales.
En outre, bien des réflexions ont déjà été engagées dès le lendemain de la crise dite « des subprimes » qui fut à l'origine d'une crise économique sans précédent depuis les années 1930.
Les institutions responsables ne sont pas restées inertes. Les États ont assumé leurs responsabilités et, s'agissant de la France, le président Nicolas Sarkozy a lancé la nécessaire et fructueuse dynamique du G20, tandis que la récente loi de régulation bancaire et financière colmatait les premières brèches et, sur quelques points sensibles, s'efforçait de prêcher d’exemple aux yeux de nos partenaires. De son côté, l'Union européenne, sur la base du pénétrant rapport du groupe de travail constitué autour de M. Jacques de Larosière, a engagé une action qui doit être analysée comme résolue, compte tenu des intérêts souvent divergents de certains États membres.
Pour leur part, nos assemblées parlementaires avaient déjà engagé analyses et réflexions. La commission des finances de l'Assemblée nationale a lancé, dès le 2 octobre 2007, une série d'auditions lui permettant de présenter, en novembre 2008, des « pistes de réforme » (2) relatives aux normes comptables, à la titrisation et aux produits dérivés, aux acteurs de marché ainsi qu'à l'appréhension du risque et à la coordination des régulateurs.
De même – initiative sans précédent –, l'Assemblée nationale et le Sénat, sous l'impulsion des présidents Bernard Accoyer et Gérard Larcher, ont constitué, le 29 octobre 2008, un groupe de travail commun sur la crise financière internationale, dont la mission est de formuler des propositions pour faire face à la situation financière et économique internationale, ainsi qu’à ses répercussions sur l’économie française, et notamment apporter une contribution parlementaire à la position de la France, dans le cadre des réunions du G20.
Éclairée par les réflexions antérieurement menées, la commission d'enquête a d'abord cherché à cerner la notion même de spéculation.
Le mandat de notre commission d'enquête était assez large. Même si la résolution adoptée par l'Assemblée nationale était motivée par la crise de la dette souveraine grecque du printemps 2010, son libellé permettait des investigations plus générales, portant sur l'ensemble des phénomènes spéculatifs. L'essentiel de notre travail a, bien sûr, porté sur les marchés financiers, mais nous ne nous sommes pas interdit de nous intéresser aussi aux marchés des matières premières, où sont à l'œuvre des mécanismes identiques à ceux observés sur les marchés financiers.
Consubstantielle à l'existence des marchés, la spéculation ne saurait être diabolisée, à la condition toutefois que les marchés fonctionnent correctement, que ses excès soient contenus et qu'elle ne devienne pas pathogène. Mais il reste difficile de « séparer le bon grain de l’ivraie ». Peut-on faire grief à un fonds de pension de chercher à optimiser les cotisations que cadres, employés et ouvriers lui confient en vue de se constituer une retraite ? S'il est vrai qu'à la lisière des marchés, quelques prédateurs sont à l'affût de la moindre occasion de profit, ce qui est en cause, ce sont surtout des mécanismes conduisant à des comportements mimétiques et court-termistes, générateurs de spirales ascendantes ou descendantes que rien, en l'état, ne peut enrayer.
La commission d'enquête a, dans un deuxième temps, cherché à déterminer les raisons pour lesquelles les économies deviennent de plus en plus sensibles aux effets néfastes des phénomènes spéculatifs. La financiarisation croissante de l'économie mondiale, qui aboutit une grande déconnexion entre l'économie financière et l'économie réelle, est sans doute la cause première. La surabondance de liquidités accumulées dans le monde a permis à des acteurs peu ou mal encadrés, utilisant des outils sophistiqués et parfois dévoyés, sur des marchés peu transparents, de prendre des risques que superviseurs et régulateurs n'ont pu ni prévenir ni mesurer.
Notre recherche, modeste, de solutions s'est articulée autour de trois thèmes.
Quel est tout d'abord le bon niveau d'intervention face à des phénomènes qui débordent largement les frontières ? Le G20 est sans doute, en l'état, l'instance la plus appropriée pour formuler des orientations au niveau mondial. Mais celles-ci doivent être relayées par les États et l'Union européenne, qui peuvent aussi avoir un rôle d'impulsion.
Ensuite, il nous est apparu que le premier moyen de prévenir les phénomènes spéculatifs pathogènes est sans doute d'établir une plus grande transparence sur les marchés : elle est nécessaire à l'établissement du « juste prix » et à sa bonne perception par les agents économiques ; elle est également indispensable aux autorités publiques pour identifier les risques de dérive.
Enfin, même si toute réglementation peut avoir des effets pervers
– l'exemple de la réglementation prudentielle du comité de Bâle est significatif s'agissant de l'incitation à une titrisation excessive –, il ne faut pas s'interdire de réglementer, si nécessaire, avec discernement et en prenant garde au risque d'arbitrage réglementaire auquel conduit nécessairement la disparité des réglementations nationales.
Par ailleurs, même si tel n'était pas l'objet direct de notre commission, elle a dû se rendre à une évidence : le désordre monétaire international, ainsi que des politiques monétaires trop peu attentives à l'évolution des masses de liquidités disponibles dans le monde, constituent le terreau sur lequel ont pu se développer des phénomènes spéculatifs pathogènes. Au-delà donc de la régulation des marchés et du contrôle des acteurs, c'est à ces causes premières qu'il est nécessaire de porter remède.
Votre Rapporteur peut se prévaloir de l’unanimité qui a présidé à l’adoption du présent rapport pour considérer que les propositions, consensuelles, de notre commission d’enquête constituent une contribution de la Représentation nationale dans le cadre de la présidence française du G20 et des négociations en cours et à venir au sein de l’Union européenne.
PREMIÈRE PARTIE – LA SPÉCULATION : UN MAL NÉCESSAIRE ?
I.– UN LARGE CONSENSUS SUR L’UTILITÉ, VOIRE LA NÉCESSITÉ, DE LA SPÉCULATION DANS UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ
La définition de la spéculation donnée par Nicholas Kaldor en 1939 fait référence. Il s’agit de l’achat ou la vente de biens avec intention de revente (ou de rachat) à une date ultérieure, lorsque l’action est motivée par l’espoir d’une modification du prix en vigueur et non un avantage lié à l’usage du bien, une transformation quelconque ou le transfert d’un marché à un autre.
Les économistes distinguent la spéculation du jeu de hasard (gambling) par le fait que le jeu comporte la création délibérée de nouveaux risques. Lorsqu’un joueur place un pari sur un cheval, il crée un risque, tandis qu’un spéculateur qui achète une action est simplement impliqué dans le transfert d’un risque existant. Le spéculateur se caractérise toutefois par une « préférence pour le risque », nettement plus élevée que la moyenne des acteurs économiques.
Il est communément admis que la spéculation a un intérêt pratique sur deux points :
– elle permet à certains agents économiques de se couvrir contre le risque en le transférant vers les « spéculateurs » ;
– elle assure la liquidité des marchés en augmentant les volumes traités et le nombre de transactions.
Le premier exemple de spéculation rapportée par l’histoire concerne le mathématicien et philosophe grec Thalès (624 – 547 av JC), marchand de profession, qui, remarquant à la sortie d’un hiver rigoureux que la récolte d’olives s’annonçait prometteuse, acheta tous les pressoirs de la région puis les loua à prix d’or aux producteurs.
Le terme de spéculation n’est employé en économie que depuis la fin du XVIIIème siècle. Adam Smith dans La richesse des nations (1776) définit le « marchand spéculateur », non pas comme un opérateur financier, mais comme un entrepreneur qui n’exerce pas son activité dans une seule et même branche. Il est « marchand de maïs une année, ou marchand de thé l’année suivante. Il s’essaye à chaque commerce dans lequel il prévoit qu’il fera un profit supérieur, et il délaisse ce commerce dès qu’il prévoit que le profit va revenir au même niveau que celui réalisé dans les autres secteurs. ». Adam Smith définit donc le spéculateur par sa propension à saisir les opportunités de court terme pour réaliser des profits : ses investissements sont mouvants, alors que ceux des entrepreneurs conventionnels sont plus ou moins fixes.
Dans les années 1850, les volumes négociés sont multipliés par 2,5 avec l’émergence la bourse parisienne, tandis que l’activité de gré à gré explose, faisant naître une très forte critique de la spéculation financière et de ses excès. Pierre-Joseph Proudhon expose alors, dans Manuel du spéculateur, les abus de la spéculation pour conclure à la nécessité d’une moralisation de la bourse. Il perçoit le passage qui s’amorce d’un capitalisme foncier vers un capitalisme financier. Il dénonce les opérations à terme, et plus particulièrement celles faites à découvert, qui avec quelques sophistications mathématiques en moins par rapport à aujourd’hui, constituent déjà les instruments privilégiés de la spéculation financière et représentent alors la plus grande partie des transactions sur les marchés financiers internationaux. Proudhon essaie de distinguer les opérations « sérieuses » de celles qui ne le sont pas. L’aléa inscrit dans la nature même de la spéculation est nécessairement porteur d’un risque dont la rémunération est toujours un « agio ». Celui-ci est légitime s’il compense uniquement le risque que toute combinaison spéculative liée à la production génère, mais si, au contraire, il est recherché pour soi, comme dans les opérations différentielles (3) sans transfert d’actif, il entre dans la catégorie du pari et du jeu. Il serait alors non seulement sans aucune valeur sociale, mais il détournerait surtout les capitaux de leur emploi productif.
Pour approfondir la théorie classique sur la spéculation, et répondre à la condamnation morale qui entoure cette activité, Léon Walras, le fondateur du marginalisme, étudie en 1898 la spéculation financière dans son ouvrage Études d’économie politique appliquée (théorie de la production de la richesse sociale). Selon cet auteur, la spéculation permet de diriger l’épargne vers des capitaux neufs, autrement dit elle est « l’instrument de la capitalisation ».
En effet, en raison du progrès technique et économique, la liste des valeurs est en constante croissance. Mais une distinction doit cependant être opérée entre les valeurs anciennes, connues et appréciées, émises par des États, des organismes de crédit ou des entreprises industrielles, et les valeurs nouvelles en voie de création et à l’avenir incertain. Or, ce sont ces dernières qui donnent matière à spéculation. En effet, les épargnants, généralement prudents et réservés, préfèrent les valeurs anciennes dont le revenu est assuré plutôt que des valeurs nouvelles avec un revenu aléatoire. Les spéculateurs n’ont pas d’épargne mais des titres qu’ils achètent et vendent constamment en compensant les pertes par des bénéfices. Dès qu’ils ont vendu des capitaux formés, ils en rachètent d’autres en formation. Les actions et obligations émises passent ainsi par deux phases distinctes. Elles sont d’abord achetées par des institutions de crédit, les banquiers et les spéculateurs qui se les échangent pendant toute la période de construction d’une affaire nouvelle. Ces titres sont alors des titres de spéculation dont le prix s’établit à la bourse. La période de construction une fois terminée, les titres deviennent alors des titres de placement dont le prix s’établit selon le revenu. « L’œuvre de la spéculation est finie ; son bénéfice est réalisé ou sa perte faite . Voilà comment la spéculation est l’intermédiaire entre les épargnes et les capitaux nouveaux. ».
Léon Walras distingue la spéculation de l’agiotage, qui est l’excès de spéculation. Il condamne l’excès, qui nuit non seulement à la petite industrie, privée de ressources, mais également à la grande industrie, sommée de distribuer de gros dividendes afin d’amener à une hausse des cours la plus prompte possible. Cette pression aboutit à négliger toutes les règles d’une bonne et saine administration, « en sacrifiant toujours l’avenir au présent ». L’agiotage est une opération stérile qui se réduit à un simple transfert de propriété et qui de surcroît constitue « une atteinte à la morale » : « Deux individus font un marché à terme : l'un vend des valeurs qu'il n'a point et qu'il ne veut pas livrer ; l'autre achète des valeurs que, faute d'argent, il ne prétend point lever ; la différence seule des prix au moment du marché et à l'époque de la liquidation doit être payée et reçue ; les combinaisons d'escompte et de prime interviennent ou sont écartées ; c'est de l'agiotage ».
Toutefois, étant donné que la distinction entre spéculation et agiotage, claire du point de vue théorique, se heurte dans la pratique à des problèmes insurmontables, Walras exclut toute intervention réglementaire. La vraie cause, prétend Walras, réside dans le désordre moral de la société et c’est donc sur ce plan qu'il faut agir « en faisant circuler partout l'atmosphère salubre de la liberté et de l'égalité économique » et non pas en introduisant de nouvelles lois. L’auteur considère que la production et la capitalisation, « si elles ne sont pas éclairées, averties, tantôt stimulées et tantôt contenues par une discussion approfondie fondée à la fois sur les vérités de l’économie pure et sur les données statistiques, instituée à tous les instants dans les assemblées d’actionnaires et dans la presse, risquent fort de marcher toujours de crise en crise. »
On attribue également à la spéculation un rôle dans la stabilisation des prix qui reste à ce jour un sujet controversé.
Durant les années 1970 et 1980, les économistes libéraux ont repris la théorie néoclassique selon laquelle la spéculation est fondamentalement stabilisatrice. D’éminents économistes, dont de nombreux prix Nobel, comme Milton Friedman, la nouvelle école classique (Buchanan, Barro, Romer), l’école des choix publics (Buchanan et Tullock) ont influencé les réformes mises en place dans les pays développés pour libéraliser les marchés financiers. Celles–ci ont été qualifiées de « 3D » pour : déréglementation, décloisonnement, désintermédiation.
Selon ces auteurs, les marchés financiers sont supposés rester efficients malgré la présence d’investisseurs irrationnels. L’écart entre un cours boursier et sa valeur fondamentale ne sera jamais durable. Les interventions des investisseurs irrationnels s’élimineront d’elles-mêmes ou seront corrigées par les arbitragistes (4). La spéculation ne peut donc pas provoquer de décalage important par rapport à la valeur fondamentale. Les crises ne sont que des événements momentanés liés à un événement imprévu, mais en aucun cas la conséquence d’une quelconque irrationalité des investisseurs.
Cette évolution allait à l’encontre des réflexions menées dans les années 1930 par les économistes keynésiens. L’un d’entre eux, Nicholas Kaldor, dans son ouvrage Spéculation et stabilité économique, paru en 1939, démontre que seules des conditions particulières, habituellement non satisfaites, permettent à la spéculation d’avoir un rôle stabilisateur. Conformément au célèbre apologue du concours de beauté cher à Keynes (5), le jeu n’est pas de prévoir le prix régulateur, mais la prévision moyenne que forment les autres opérateurs. La spéculation peut ainsi n’avoir plus qu’elle-même comme référence et sa généralisation peut ainsi devenir déstabilisatrice des prix.
B.– UN CONSENSUS PARTAGÉ PAR LES PERSONNALITÉS DIVERSES ENTENDUES PAR LA COMMISSION, AVEC CEPENDANT DES RÉSERVES
Ces débats théoriques conservent une résonance très actuelle. Les problèmes posés aujourd'hui par la spéculation ont certes changé de degré par rapport aux crises qui se sont produites au cours du XX ème siècle, compte tenu des évolutions technologiques et de l’augmentation du volume des échanges, notamment sur les marchés dérivés, mais ils sont de même nature. Comme l’a souligné Mme Catherine Lubochinski, professeure à l’Université Panthéon-Assas, lors de son audition par la commission d'enquête : « Rien n’a été inventé en matière financière durant ces dernières années ! » (6). M. Dominique Cerutti, directeur général de NYSE-Euronext, a ainsi résumé la problématique : « Les crises, depuis que le monde est monde, résultent certes toujours d’une suite de dérives macroéconomiques, de la prise de risques insensés, mais avant tout de la cupidité humaine [avec] l’accumulation excessive de dérives macroéconomiques, des investissements excessivement risqués consentis dans l’espoir d’un rendement toujours plus élevé et financés en jouant sur l’effet de levier » (7).
1.– Toutes les personnalités entendues par la commission considèrent que la spéculation est un phénomène incontournable, voire utile
Les principales déclarations sur ce point des diverses personnalités entendues portent la marque d’un consensus très large sur le caractère incontournable et utile de la spéculation.
« En temps normal, la spéculation joue un rôle équilibrant : des acteurs financiers mieux informés que d’autres, découvrant que les prix de certains produits ne correspondent pas à leur valeur réelle, jouent sur le retour des prix à cette valeur. » (M. Michel Aglietta, conseiller au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII) (8)) ;
« Sans spéculateurs, il n’y aurait pas de marché. Pour qu’une transaction se fasse, il faut un acheteur et un vendeur, chacun considérant qu’elle est dans son intérêt. De même, les entreprises ne pourraient pas se protéger aussi facilement contre les fluctuations des prix des matières premières, des devises ou des taux d’intérêt s’il n’existait pas des « spéculateurs », ou plutôt des intermédiaires financiers, prêts à faire le pari inverse pour quelques heures, quelques mois, voire quelques secondes. La spéculation est consubstantielle au marché. » (M. Jean-Pierre Jouyet, président de l'Autorité des marchés financiers (9)) ;
« La spéculation est quelque chose de relativement envahissant. Elle est toutefois, pour les économistes, une catégorie d’opérations comme les autres, répondant à une nécessité du marché. » (M. Henri Bourguinat, professeur à l’université Bordeaux-IV (10)) ;
« Un certain volume de spéculation est nécessaire. » (M. Philippe Mills, directeur général de l’Agence France Trésor (11)) ;
« (…) la suppression de la spéculation relève quant à elle d’un vœu pieux, à moins de prétendre vouloir clôturer définitivement l’ensemble des marchés financiers. (…) les acteurs économiques les plus traditionnels spéculent. » (M. Marc Touati, directeur général délégué de Global Equities (12)) ;
« Il existe au départ, pas nécessairement à l’arrivée, une spéculation normale, inévitable. (…) il y a toujours des gens qui veulent se couvrir sur un marché. » (M. Christian de Boissieu, professeur à l’université de Paris I (13)) ;
« La spéculation, qui consiste à prendre des positions sur l’avenir, est parfois le seul moyen de faire de la performance, notamment quand les taux d’intérêt sont aussi bas qu’aujourd’hui. » (Mme Nicole El Karoui, professeur à l’Université Paris VI (14)) ;
« (…) spéculer, c’est essayer d’anticiper l’avenir : un épargnant qui achète des actions ne le fait pas dans l’idée qu’elles vont baisser. Tout le monde est donc peu ou prou spéculateur, financièrement ou intellectuellement. » (M. Bertrand Jacquillat, professeur à l’Institut d’études politiques de Paris, président-directeur général et cofondateur d'Associés en Finance (15)) ;
« Il est utopique d’interdire la spéculation, car elle est nécessaire. Au moins, elle apporte de la liquidité et de la contrepartie aux acteurs. » (M. Philippe Chalmin, professeur à l'Université Paris-Dauphine, président de CyclOpe (16)) ;
« La spéculation (…) est indispensable au marché. Sans elle, la liquidité des marchés serait insuffisante ; on ne pourrait pas réaliser d’opérations de couverture – qui sont la justification économique de l’existence des produits « dérivés ». Par ailleurs, les spéculateurs achètent lorsque les prix sont bas et vendent lorsqu’ils sont élevés, afin de maximiser leur profit. On peut donc considérer qu’ils contribuent au bon fonctionnement du mécanisme de formation des prix – à la formation de prix « justes ». » (Mme Catherine Lubochinski, professeur à l’Université Panthéon – Assas) (17) ;
« (…) il est très difficile de tracer une frontière entre les opérations de « trading » nécessaires et celles qui sont purement spéculatives. Les marchés à terme de biens ne fonctionnent que grâce aux spéculateurs : les opérateurs professionnels s’orientent tous dans le même sens au même moment. (…) pour qu’il y ait marché, il faut pouvoir trouver des contreparties, en l’occurrence des « traders » ou des « hedge funds ». (18)» (M. Patrick Artus, directeur de la recherche et des études économiques de Natixis (19)) ;
« Il faut toutefois souligner que tout le monde spécule sur ces marchés, notamment les producteurs et les industriels lorsqu'ils essaient d'anticiper un niveau de prix. Mais il est vrai que les motivations ne sont pas les mêmes : les opérateurs de l'économie réelle le font dans le cadre de projets économiques de production et de commercialisation, tandis que ceux qui n'ont pas vocation à intervenir sur le marché physique poursuivent des objectifs différents. » (M. Bernard Valluis, expert de l'Association nationale des industries alimentaires (ANIA) (20)) ;
« La prise de positions ouvertes est nécessaire à la liquidité des marchés. » (M. Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France (21)).
2.– La plupart en dénoncent toutefois certains excès et les conséquences néfastes, autant de pistes de réflexion que la commission d’enquête s’est efforcée d’explorer
Les réserves sont nombreuses et diverses.
Les premières réserves s’attachent à souligner le caractère nocif d’une spéculation qui s’exercerait sans transparence, voire de façon frauduleuse : « le problème, ce n’est pas son existence, mais celle d’une spéculation excessive, que l’on pourrait qualifier de pathogène, porteuse de risques systémiques ou susceptible de porter atteinte à l’intégrité des marchés, ou celle d’une spéculation frauduleuse, passant par la manipulation des cours, la diffusion de fausses rumeurs, voire les manquements d’initiés » (M. Jean-Pierre Jouyet, président de l'Autorité des marchés financiers (22)) ;
« (…) en cas d’incertitude radicale, c'est-à-dire en l’absence de repères permettant d’évaluer les différences, la spéculation ne consiste plus à retrouver un prix d’équilibre entre les variations liées aux chocs du marché » (M. Michel Aglietta, conseiller au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII) (23)) ;
« La spéculation entendue au sens de la manipulation du marché, de la déformation de la réalité économique, est évidemment nuisible au bon fonctionnement du marché et contraire à sa logique. (…) La spéculation entendue au sens de la manipulation du marché nuit au bon processus de formation des prix. Or, si les prix sont mal formés, l’épargne ne se dirige pas vers les bons investissements. Il est donc essentiel de faire en sorte que le marché soit le plus ouvert, le plus transparent, le plus liquide possible afin que les prix puissent se former correctement. Pour cela, le marché doit être développé. » (M. François Pérol, président de la Fédération bancaire française (24)) ;
« (…) le plus important, sur les marchés financiers, c’est la qualité de l’information. » (M. Philippe Mills, directeur général de l’Agence France Trésor (25))
« La spéculation est l’acte par lequel les hommes tentent de prévoir l’avenir pour gagner de l’argent. Cependant, conjuguée à une mauvaise information qui vient la perturber – c’est tout le problème des agences de notation –, elle peut déstabiliser l’ensemble du système économique, et ce même en France, où la sphère financière ne représente que 6 à 7 % du PIB. Or certains hommes d’affaires ou financiers peuvent manipuler l’information pour accroître leurs bénéfices : le problème est donc le lien entre l’acte de spéculer, que tous les économistes présentent comme normal, et l’information, en amont comme en aval » (M. Augustin de Romanet, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (26)) ;
« Pour ce qui est de la spéculation, j’insisterai sur le concept de transparence. En effet, alors qu’un marché ne peut fonctionner que dans la transparence (…), les acteurs s’ingénient à y échapper et à multiplier les conflits d’intérêts. Le rôle du législateur est donc, selon moi, d’organiser les moyens de cette transparence. » (Mme Pervenche Berès, présidente de la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen, rapporteure de la commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale du Parlement européen (27)) ;
« (…) il faut de la transparence, laquelle peut être assurée par le développement de plates-formes permettant une compensation entre les risques des différents acteurs. (…) Certains acteurs peuvent être tentés de faire circuler des rumeurs pour provoquer ne serait-ce que des petits mouvements de cours. » (M. Frédéric Oudéa, président-directeur général de la Société Générale (28)) ;
« Le progrès technologique a en outre permis la spéculation à haute fréquence, qui ne serait pas critiquable en soi, si elle ne donnait la possibilité d’utiliser une information privilégiée ; pour caricaturer, lorsqu’on sait qu’une opération va avoir lieu sur un produit, on va passer juste avant un ordre à grande vitesse et écrêter le marché » (Mme Catherine Lubochinski, professeur à l’Université Panthéon – Assas (29)) ;
« Pour nous, gestionnaires d’actifs, et dans l’intérêt de nos clients, il est fondamental que soit garantie la transparence… » (M. Philippe Marchessaux, administrateur-directeur général de BNP Paribas Investment Partners (30)) ;
« (…) si la réglementation avait assuré une meilleure transparence des opérations et obligé les investisseurs à faire des « due diligences » – comme il est prévu dans la directive – pour savoir ce qu’ils achetaient, dans quel but et comment, les risques auraient été réduits. » (M. Jean-Paul Gauzès, député européen, rapporteur de la proposition de directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs au Parlement européen (31)) ;
« Un effort de moralisation et de transparence m’apparaît donc nécessaire. (…) Le développement des produits OTC est porteur d’un certain nombre de risques, en particulier de risques de contreparties. Ces risques sont d'autant plus élevés que le marché est opaque : nous ne savons pas qui y est présent et nous ignorons les volumes des opérations traitées ». (M. Bernard Valluis, expert de l'Association nationale des industries alimentaires (ANIA) (32)) ;
« (…) nous luttons contre les prises de positions directionnelles importantes, accompagnées en général de rumeurs propagées pour faire bouger les marchés dans le sens de l’intérêt de ceux qui détiennent lesdites positions. Ce type de comportement déstabilise les marchés, d’autant que la sophistication des techniques financières, le caractère mondial de ces marchés et la place prépondérante des activités non régulées ont rendu la prévention, la détection et la sanction plus difficiles. (…) Le plus gênant aujourd'hui, c’est de n’avoir aucune idée précise de la taille du marché, ni des prises de position nettes » (M. Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France (33)) ;
« (…) nous devons faire en sorte que les marchés financiers, qui sont un des poumons de l’économie, soient de plus en plus transparents pour les régulateurs, et résilients, alors qu’ils sont, en réalité, de plus en plus opaques et fragmentés, autrement dit de moins en moins capables d’amortir une secousse. (…) Pourquoi faut-il lutter contre l’opacité ? Tout simplement parce qu’elle ruine le mécanisme fondamental en économie de marché qui est la découverte du prix. » (M. Dominique Cerutti, directeur général de NYSE-Euronext (34)) ;
b) Le mimétisme et les dynamiques incontrôlables
D’autres intervenants ont mis l’accent sur le fait que la spéculation, à défaut de transparence, peut conduire à des comportements mimétiques et engendrer des dynamiques incontrôlables :
« (…) privés de tout déterminant objectif, les acteurs prennent leurs décisions en fonction d'heuristiques qui consistent, finalement, à imiter les autres. Chacun étant à la même enseigne, il se produit une convention de méfiance à l’égard de toutes les valeurs, sauf de la liquidité absolue : c’est une convention de peur. » (M. Michel Aglietta, conseiller au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII) (35)) ;
« (…) il convient d’éviter de se lancer dans des mouvements incontrôlés. Il n’en est pas moins vrai que de tels mouvements parsèment l’histoire économique, (…) on observe une accélération de ces mouvements, ce qui ne peut que nous inquiéter : 1987, 1991, 2001 avec la spéculation sur la « nouvelle économie », et, enfin, 2007.(…) Si la spéculation connaît périodiquement des dynamiques incontrôlables, c’est notamment en raison du comportement panurgéen des opérateurs et des spéculateurs et d’anticipations qui, pour être erronées, n’en sont pas moins autoréalisatrices du fait que tous les opérateurs les développent en même temps. » (M. Henri Bourguinat, professeur à l’université Bordeaux-IV (36)) ;
« (…) phénomène d’anticipation qui est à la base des marchés, comme Keynes l’avait montré dès 1936 avec l’analogie du concours de beauté : l’important, c’est d’anticiper ce que les autres anticipent, même s’ils se trompent. » (M. Christian de Boissieu, professeur à l’université de Paris I (37)) ;
« Les activités spéculatives, rendues possibles par l’absence ou par l’inefficacité de la régulation, procèdent d’une logique d’arbitrage, et visent à exploiter les opportunités immédiates de marché et à tirer parti de la volatilité, volatilité qu’elles peuvent d’ailleurs contribuer à créer. (…) les opérateurs court-termistes ont suivi un même mouvement en vendant leurs actifs, entretenant et aggravant le mouvement baissier. » (M. Bernard Spitz, président de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) (38)) ;
« La spéculation ne fait en rien problème lorsqu’elle repose sur une analyse approfondie de la valeur des actifs, mais il en va tout autrement lorsque les agents, réagissant de façon mimétique à certains signaux, en extrapolent un envol ou une chute des prix et achètent ou vendent pour en tirer profit. » (M. Augustin de Romanet, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (39)) ;
« (…) les traders étant pour la plupart assez jeunes, ils ne possèdent aucune culture économique et cèdent à la panique dès que quelque chose les inquiète (…) Les régulateurs ont commis une erreur fondamentale, en croyant que le concept de discipline de marché avait un sens. On est revenu de l’autorégulation, dans un environnement où la maximisation du profit à court terme est la seule stratégie qui compte » (Mme Catherine Lubochinski, professeur à l’Université Panthéon – Assas (40)) ;
« Certains mécanismes ont pu accélérer ou amplifier la crise, comme les ventes automatiques consécutives à la dégradation des notes. » (M. Philippe Marchessaux, administrateur - directeur général de BNP Paribas Investment Partners (41)) ;
« Certes, les hedge funds ne sont pas à l’origine de la crise, mais la masse de finances transitant par ces fonds est telle qu’on ne peut nier le risque d’amplification. C’est d’autant plus vrai qu’aujourd’hui, le « trading automatique » permet de nouer et de dénouer des opérations financières en moins d’une seconde (…) que faire face à des innovations technologiques qui font que la finance échappe progressivement à la maîtrise humaine ? (…) Là où, naguère, les mouvements s’atténuaient parce que telle banque adoptait une stratégie différente de celle de telle autre, aujourd'hui tous les établissements suivent le même mouvement. (…) Je pense cependant qu’il arrive un moment où il faut rétablir le pouvoir de l’homme sur les machines, auxquelles on ne peut laisser tout faire. » (M. Jean-Paul Gauzès, député européen, rapporteur de la proposition de directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs au Parlement européen (42)) ;
« (…) il y a d’autres mécanismes à l’œuvre dans la formation des prix : par exemple, le mimétisme forcené d’investisseurs qui ne sont pas des spéculateurs – les fonds d’investissement, les gérants de SICAV, les assureurs-vie, les caisses de retraite… (…) la chute des prix provient des ventes effectuées par des investisseurs institutionnels parfaitement conservateurs, mais qui jugent que ces actifs sont devenus trop dangereux. Et le phénomène est entièrement « auto-réalisateur » : si tous les assureurs-vie européens vendent leur dette irlandaise, elle va chuter au point de forcer ceux qui voulaient la garder à la vendre. C’est ce à quoi on assiste en ce moment. » (M. Patrick Artus, directeur de la recherche et des études économiques de Natixis (43)) ;
(…) En cas d’accident de marché, la panique s’installe. Comme il faut très longtemps avant d’évaluer les pertes, les ventes s’accélèrent.» (M. Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France (44)) ;
c) La déconnexion entre les marchés et l’économie réelle
Certains intervenants soulignent également la déconnexion des marchés avec l’économie réelle et ses dangereux effets sur celle-ci :
« La spéculation peut donc avoir des effets délétères tout à fait impressionnants : le Bureau international du travail estime à 51 millions le nombre de chômeurs engendrés par la crise que la spéculation a provoquée. C’est un chiffre effrayant. » (M. Henri Bourguinat, professeur à l’université Bordeaux-IV (45)) ;
« L’origine de cette crise s’explique par la tentative de suppression de l’une des règles de base de l’économie et de la finance : la proportionnalité du rendement et du risque. Tout d’abord, depuis une dizaine d’années, l’illusoire modélisation mathématique de la finance a induit une déconnexion croissante d’avec les réalités économiques » (M. Marc Touati, directeur général délégué de Global Equities (46)) ;
« Ainsi, si j’anticipe que les autres vont continuer à acheter du blé, je continuerai aussi à acheter du blé, même si sa valeur après ce qui s’est passé cet été en Russie n’a déjà plus aucune mesure avec les fondamentaux. » (M. Christian de Boissieu, professeur à l’université de Paris I (47)) ;
« Si je devais définir la spéculation, je dirais qu’il s’agit d’opérations financières réalisées dans le but de maximiser un profit à court terme, sans considération des conséquences négatives susceptibles de peser sur le reste des acteurs économiques et de la société. » (M. Bernard Spitz, président de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) (48)) ;
« (…) de sorte que les banques et l’ensemble des intermédiaires aient des pratiques saines, c'est-à-dire vérifient la capacité de remboursement de l’emprunteur, laquelle ne doit pas reposer sur des anticipations spéculatives sur des actifs » (M. Frédéric Oudéa, président-directeur général de la Société Générale (49)) ;
« (…) le Parlement européen se demande s’il ne faut pas fixer un minimum, par exemple en interdisant les opérations à la nanoseconde. On est, là, très loin des besoins de l’économie réelle : c’est du jeu de casino. (…) Qu’apporte à l’économie réelle le fait que des opérations se réalisent à la nanoseconde, alors que pour constituer un dossier de crédit, il faut plusieurs mois, et pour monter un atelier relais, un an de démarches administratives et un an de construction? (…) Quant aux hedge funds, bon nombre d’entre eux ont perdu la mise que les banques et les investisseurs leur avaient apportée. C’est autant d’argent qui a été perdu pour le financement plus classique de l’économie » (M. Jean-Paul Gauzès, député européen, rapporteur de la proposition de directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs au Parlement européen (50)) ;
« Les conséquences des comportements spéculatifs peuvent être particulièrement néfastes au fonctionnement des marchés et aux économies. » (Mme Danièle Nouy, secrétaire générale de l'Autorité de contrôle prudentiel (51)) ;
« Le risque est grand dès lors de voir se généraliser ce qui se passe au Japon ou en Allemagne depuis quinze ans : une très forte déformation du partage de la valeur ajoutée au détriment des salariés, parce que les entreprises ne veulent plus recourir au crédit ou aux marchés financiers. » (M. Patrick Artus, directeur de la recherche et des études économiques de Natixis (52)) ;
« Compte tenu de ce que je viens d'indiquer du développement des produits traités de gré à gré, je ne suis pas certain que l'on puisse dire de manière aussi catégorique qu’il n’y a pas à terme de risque systémique sur les marchés des matières premières, en particulier celui des matières premières agricoles. (…) Je pense que, compte tenu des positions très importantes à l'importation, en particulier de la Chine, il peut y avoir demain un risque systémique majeur : si de gros opérateurs ne pouvaient plus faire face à leurs obligations, cela entraînerait des défaillances en chaîne, donc une crise. (…) Pour les industriels, tout cela se traduit par une déstabilisation et une véritable perte de repères, la volatilité instantanée des cours ne leur permettant plus d'arbitrer les positions et les contrats dans des conditions normales au regard de l'horizon économique d'une entreprise. (…) Le pas de temps des opérateurs physiques n'est absolument pas le même que celui des opérateurs financiers. (…) La très grande rapidité des variations de prix empêche les producteurs et les utilisateurs de jouer dans la même cour que des opérateurs autrement plus puissants. » (M. Bernard Valluis, expert de l'Association nationale des industries alimentaires (ANIA) (53)) ;
« Le trading à haute fréquence est difficile à contrôler. (…) Je partage les interrogations sur l’utilité sociale de cette activité. En revanche, j’en vois bien les risques, en particulier pour l’intégrité du marché. » (M. Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France (54)) ;
Toutefois, d’autres intervenants ont estimé que l’économie réelle influence aussi directement l’état des marchés :
« Notre politique constante consiste à ajuster nos positions en fonction de notre analyse macroéconomique et des prix de marché. » (M. Philippe Marchessaux, administrateur, directeur général de BNP Paribas Investment Partners (55)).
« (…) la politique économique doit jouer son rôle, mais ce n’est pas le cas puisque les taux d’intérêt sont à 0 % aux États-Unis et à 1 % dans la zone euro, ce qui ouvre grand les portes à la spéculation. (…) Les CDS ne sont pas à l’origine de la crise grecque. (…) Le CDS est le symptôme d’une crainte sur un segment de marché. Dans le cas de la Grèce, il y a eu de vraies craintes quant à la capacité du pays à rembourser » (M. Frédéric Oudéa, président-directeur général de la Société Générale (56)) ;
La « crise grecque » du printemps 2010 a ravivé ces interrogations sur le rôle et les effets néfastes de la spéculation.
II.– LE REVERS DE LA MÉDAILLE : SPÉCULATION ABUSIVE, « BULLES SPÉCULATIVES » ET VOLATILITÉ DES MARCHÉS
A.– LES SOUPÇONS NÉS DE LA CRISE DE LA DETTE GRECQUE
Fin 2009, la Grèce fait face à une grave crise de sa dette. La révélation de la réalité de ses difficultés budgétaires et financières fait craindre en particulier un défaut de paiement de l’État. La sanction des marchés financiers est immédiate : la Grèce voit le coût de refinancement de sa dette souveraine flamber, au point de rendre prohibitifs de nouveaux emprunts et d’aggraver ainsi la menace de sa faillite.
La défiance des investisseurs atteint bientôt d’autres pays européens ; les marchés se mettent à parier sur l’explosion de la zone euro. Jusqu’à ce qu’en mai 2010, l’action conjointe de l’Union européenne et du Fonds monétaire international (FMI), avec l’adoption d’un plan d’aide à la Grèce et la création d’un mécanisme financier de soutien aux États, finisse par calmer, au moins neutraliser, cette spirale.
Depuis lors, si les incertitudes persistent sur la capacité de la Grèce à faire face à ses échéances à moyen terme, maintenant des taux de refinancement sur le marché à un niveau record (jusqu’à 10 % pour les obligations à 10 ans en juillet-août 2010), l’accès à des prêts européens à taux préférentiel conséquents a offert une accalmie à l’État grec, en lui permettant de couvrir ses engagements les plus proches et de retrouver une certaine marge d’action.
Cet épisode s’inscrit dans une crise internationale plus large où les marchés financiers, émergeant à peine des plus vives inquiétudes concernant les capacités de refinancement et de crédit des établissements bancaires, ont découvert qu’une entité publique apparemment prospère comme Dubaï pouvait faire faillite.
La crise financière grecque est cependant remarquable par son ampleur, ses développements financiers et ses répercussions sur l’économie réelle de la Grèce, comme sur le reste de l’Union européenne. Pour rassurer les investisseurs et répondre aux exigences du plan d’aide, la Grèce est entrée dans un important plan d’austérité. Plus largement, les pays de la zone euro ont pris conscience de la nécessité d’améliorer la gouvernance économique de l’union monétaire et la coordination de leurs politiques budgétaires pour consolider leur croissance économique tout en réduisant les risques que font peser des endettements nationaux trop importants.
Selon divers observateurs, cet épisode serait également représentatif de certaines dérives, en partie consubstantielles, de la spéculation financière. Car si les marchés ont répondu logiquement à une véritable crise de solvabilité, leurs réactions ont été aggravées par l’enchaînement de responsabilités mal maîtrisées voire niées et de mécanismes auto-réalisateurs.
La crise grecque représente une sorte de cas d’école des excès de la spéculation tout autant que de la violence de leur impact sur les équilibres nationaux et internationaux, et plus seulement individuels. À ce titre, elle a pu servir de catalyseur à une révision des théories sur le fonctionnement des marchés financiers. Elle a d’ailleurs constitué une des motivations de la création de notre commission d’enquête.
1.– La crise de la dette grecque est d’abord une crise de solvabilité
a) Les marchés financiers ont réagi à une véritable crise de confiance.
La crise s’est déclenchée quand les marchés ont découvert une situation économique et financière beaucoup plus dégradée que prévu, et anticipé logiquement des risques de défaut de paiement accrus.
Le 5 novembre 2009, le nouveau gouvernement grec annonce un déficit représentant 12,7 % du PIB au lieu des 6 % déclarés par son prédécesseur. Trois jours plus tard le projet de budget prévoit que la dette grecque atteigne 121 % du PIB (quelques 300 milliards d’euros) contre 113,4 % en 2009.
Échaudés par les mensonges des précédents gouvernements, qui ont falsifié (au moins à deux reprises en 2001 et 2009) les statistiques économiques pour donner l’illusion d’un déficit bas, et par les chiffrages résultant d’un appareil statistique national encore peu fiable, les marchés persistent à s’interroger sur l’ampleur des difficultés, comme sur la capacité du pays à assumer ses dettes à court terme (il doit régler 30 milliards d’euros dès 2010) et à reconstruire sa solvabilité.
QUELLE RESPONSABILITÉ D’EUROSTAT DANS LA CRISE GRECQUE ? Quand les marchés se sont affolés en découvrant l’ampleur réelle de la dette publique grecque, des voix se sont élevées pour dénoncer la responsabilité de l’office européen des statistiques qui, selon elles, devait être au courant de la situation ou aurait du opérer des contrôles. De fait, jusqu’au milieu des années 2000, les États membres pouvaient recourir à certaines techniques d’optimisation comptable pour réduire leur dette ou leur déficit. Ainsi, au moment de son entrée dans la zone euro, la Grèce pouvait-elle légalement échanger (swap) des paiements d’intérêts futurs sur sa dette libellés dans une devise pour des paiements dans une autre devise. Il semble cependant qu’elle ait utilisé un taux de change plus faible que la normale. Au demeurant, ces pratiques ont été progressivement rendues impossibles à partir de 2004 ou ont conduit à des réajustements des niveaux des dettes et des déficits publics. Or, la Grèce est le seul pays à ne pas avoir corrigé en conséquence ses chiffres. Il est apparu par ailleurs que l’État grec ne s’est pas contenté de recourir à ces techniques d’optimisation comptable, mais aurait systématiquement falsifié ses statistiques pendant des années. Dans son rapport d’information n° 374 du 31 mars 2010, la commissions des finances du Sénat en conclut : « Eurostat n’avait alors pas juridiquement accès aux documents de « comptabilité publique » utilisés par les États pour élaborer les statistiques utilisées pour l’application du pacte de stabilité, exprimées selon les règles de la « comptabilité nationale », définies par le SEC 95 (57). Dans ces conditions, il ne lui était pas possible de déceler la fraude grecque. » Au Mardi de l’Ifri du 29 juin 2010, les responsables de l’unité « Finances publiques » d’Eurostat ont indiqué que « l’organisation essaie, depuis 15 ans d’accéder à toutes les informations concernant les comptes publics grecs, notamment les dépenses militaires. (…) Les comptes grecs ont fait souvent l’objet de « réserves » publiques d’Eurostat, et renvoyées pour révision par l’office statistique de la Grèce. Eurostat n’a pas de pouvoir de faire pression sur les gouvernements des pays membres pour exiger la qualité des rapports ». Constatant les limites du dispositif, l’Union européenne lui permet désormais d’aller contrôler les comptes publics des États membres, avec notamment un droit d’inspection dans les pays. |
L’endettement public grec est en effet un problème structurel bien antérieur à la crise. Le pays a été admis dans la zone euro en 2001 avec un ratio dette publique/PIB qui avoisinait les 100 %, mais sa stabilité a permis de passer outre un des critères de convergence du traité de Maastricht. Toutefois, la Grèce n’a pas tiré parti de la période de forte croissance qu’elle a connue entre 1997 et 2007 (4,2 % par an en moyenne) pour réduire cet endettement, profitant au contraire de taux de refinancement convergeant vers ceux, très bas, de l’Allemagne qui ont longtemps servi de référence pour les pays membres de la nouvelle zone monétaire.
Au cours de cette période, les dépenses publiques se sont sensiblement accrues, alors que les recettes fiscales ont diminué en raison d’une évasion fiscale et d’une économie souterraine conséquentes (58).
Enfin, la croissance reposait sur des bases fragiles : un faible taux d’exportation (moins de 20 %) et un taux d’endettement individuel très élevé. Quand la crise éclate à compter de 2007, elle secoue particulièrement la Grèce dont les deux principaux secteurs économiques, le tourisme et le transport maritime, ont vu leur revenu chuter de 15 % en 2009, et le PIB grec diminue de 2 %.
Dans ce contexte, le pays présentant par ailleurs un des taux d’épargne privée et une des richesses financières des ménages les plus faibles de la zone euro, ainsi que des perspectives lourdes de vieillissement de sa population, la soutenabilité de sa dette publique alimente de fortes inquiétudes(59), d’autant qu’un refinancement devenu très coûteux ne peut qu’aggraver le poids du déficit grec.
Face à la perte de confiance des marchés, voire au pari de certains spéculateurs sur son possible défaut, le gouvernement grec annonce à partir de janvier 2010 des mesures d’austérité budgétaire et l’engagement d’une lutte contre les fraudes fiscales. Il est contraint de les renforcer progressivement au cours de l’année, pour récupérer des marges de progrès et rassurer les investisseurs sur sa volonté de faire face à ses engagements, puis ultérieurement en contrepartie des aides de l’Union européenne et du FMI.
b) Les responsabilités internes au pays sont primordiales dans cette crise.
On peut s’étonner que les acteurs des marchés comme les responsables de la zone euro ne se soient pas interrogés bien avant sur l’incohérence entre la situation économique grecque, mal évaluée mais notoirement contrastée, et des taux de refinancement alignés sur ceux du « meilleur élève » de la zone, des taux dont la faiblesse n’ont pas encouragé la Grèce à plus de discipline.
Enfin, les « hésitations » de l’Union européenne quant à la réaction à adopter n’ont pas manqué d’accentuer la fragilité de la situation grecque. Elles ont révélé plus globalement les difficultés de l’Union à définir une réponse concertée. Sans même se prononcer sur l’opportunité des choix européens et sur les obstacles juridiques qui les ont freinés (60), force est de constater que cette indécision et son prolongement sur plusieurs mois ont alimenté à leur tour les inquiétudes et incertitudes des marchés financiers.
De fait, ces derniers ont fini par se stabiliser (relativement) et à perdre une partie de leur impact négatif quand la Banque centrale européenne (BCE) et les États de la zone euro ont engagé une action forte et concertée en mai.
Après la mission menée conjointement en Grèce par l’Union européenne et le FMI, en février 2010, le principe d’une aide avait été posé par les ministres des finances le 15 mars, mais sans en donner les détails. Le plan n’est présenté que le 11 avril. Reposant sur des prêts bilatéraux d’un montant de 30 milliards d’euros accordés sur trois ans à un taux de 5 %, inférieur aux taux du marché, il s’avère insuffisant à calmer les peurs de marchés, qui commencent par ailleurs à s’alerter de l’éventuelle insolvabilité de l’Espagne, du Portugal, voire de l’Italie. L’annonce, dès le 25 mars, par la Banque centrale européenne qu’elle acceptait comme collatéral des obligations grecques notées BBB– (la limite antérieure étant A–), puis son soutien au plan d’aide ne suffisent pas non plus.
Aussi, le 3 mai, la BCE dit accepter de « prendre en pension » ces obligations quelle que soit leur note. Le 7 mai, après plusieurs semaines de débats et de messages assez brouillés, le Conseil européen valide le plan d’aide à la Grèce pour un montant porté à 110 milliards. Enfin, dans la nuit du 9 au 10 mai, l’Union européenne annonce sa décision de se doter d’un fonds de stabilisation de 750 milliards d’euros, en coopération avec le FMI, afin d’éviter la contagion de la crise à d’autres pays fragiles. Parallèlement, la BCE permet aux banques centrales de la zone d’acheter des titres obligataires sur les marchés secondaires pour alléger le marché de la dette – ce qui a pour conséquence immédiate de faire baisser les taux grecs sur les obligations à 10 ans de 400 points de base.
À ces différents niveaux, l’épisode de la crise grecque montre le poids de la parole publique dans le fonctionnement des marchés.
Mais quoi qu’il en soit, on peut considérer que les réactions des marchés avaient, pour une large part, des fondements concrets, assez objectifs même si l’appréciation de leur ampleur, de leur durée et de leur impact fait encore appel à des interprétations et anticipations spéculatives. La responsabilité de la crise de la dette grecque a été, de fait, largement portée par des protagonistes « extérieurs » aux marchés financiers.
2.– Cependant, la spéculation financière a joué un rôle non négligeable.
a) L’ambivalence de certains acteurs
Quand, un mois après l’annonce de la réalité de la situation financière de l’État grec, les trois principales agences de notation (Standard & Poor’s, Fitch et Moody’s) ont notablement dégradé leurs notes financières pour la Grèce, puis les ont réduites à nouveau en juin malgré la mise en œuvre du programme d’aide de l’Union européenne, l’affolement des marchés a repris de plus belle.
Divers commentateurs ont reproché à ces agences de notation, censées être des observateurs experts, de ne pas avoir anticipé la crise, d’avoir notamment négligé l’incohérence entre la réalité, même sous-estimée, de la situation économique grecque et son recours excessif à l’endettement ; puis d’avoir essentiellement suivi l’emballement des marchés, peut-être trop soucieuses de ne pas répéter leur mauvaise performance dans la crise dite des subprimes, par une rétrogradation assez brutale des notes qui ne prend pas suffisamment en compte la solidarité de la zone euro ; et d’avoir, au final, contribué à l’aggravation des difficultés de la Grèce. D’aucuns les ont qualifiées de « pompiers pyromanes ». On peut à tout le moins constater le rôle procyclique des agences de notation.
b) Des rumeurs déstabilisatrices, voire des soupçons de spéculation abusive
En découvrant l’étendue des mensonges de l’État grec, les responsables européens ont été amenés à s’interroger sur le rôle joué par la banque Goldman Sachs, qui aurait aidé le précédent gouvernement à maquiller son déficit budgétaire et la valeur de sa dette (61), tout en étant la première à spéculer contre la Grèce. On a ainsi soupçonné la banque d’affaires d’avoir propagé fin janvier une fausse rumeur pour faire gonfler les primes de risque. Elle a seulement reconnu avoir conseillé à ses clients (pour l’essentiel des hedge funds) d’acheter des instruments de couverture de défaillance ou credit default swaps – CDS – (62) grecs, avouant implicitement anticiper une hausse de leurs prix et, partant, une dégradation de la valeur de la dette associée, alors qu’elle avait été chargée par le gouvernement grec d’en « rassurer » les acheteurs potentiels et avait permis de placer avec succès un emprunt public de 8 milliards d’euros les jours précédents. Bien que rapidement démentie, cette rumeur n’a pas manqué de semer la panique auprès des investisseurs.
Des opérateurs ont également déclaré que Goldman Sachs aurait été un des plus gros spéculateurs contre la dette grecque dans les premiers temps de la crise, sans que cela ait pu cependant être prouvé, en raison de l’opacité des marchés dérivés qui ont servi de cadre à ces opérations.
Au-delà de cet acteur privilégié, des responsables européens suspectent des hedge funds visant des profits à court terme d’avoir parié sur le défaut de l’État grec. Ils auraient acheté des volumes de CDS sur titres grecs non négligeables pour un marché étroit afin de faire monter artificiellement la valeur de ces contrats, et ce, avant que les agences de notation ne dégradent leur appréciation de la dette grecque. Ils ont pu le faire avec d’autant plus de facilité qu’ils ne prêtaient pas eux-mêmes, se contentant d’agir via les produits dérivés.
Des opérations de spéculation misant sur l’éclatement de la zone euro sont également soupçonnées. Ainsi, par exemple, entre le 26 janvier et le 2 février, des fonds spéculatifs et des banques d’investissement ont, d’après les autorités américaines, vendu massivement des euros contre des dollars, liquidant 43 741 contrats en euros (environ 5,5 milliards d’euros), soit autant de contrats qu’en septembre 2008, au plus fort de la crise.
Dans ces différents cas, les interrogations ont été exacerbées par de nombreuses rumeurs véhiculées par la presse.
c) L’enquête menée par l’Autorité des marchés financiers
Alertée par l’ampleur des mouvements observés au plus fort de la crise, l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’organe régulateur français, a mené une enquête auprès des prestataires de service d’investissement (PSI) français pour évaluer leurs comportements à l’égard de la dette grecque.
Il faut rappeler au préalable qu’aucune des obligations souveraines émises par la Grèce n’est admise sur le marché réglementé français et que par ailleurs, le marché des dérivés opérant de gré à gré (over the counter), dont font partie les CDS, ne fait l’objet d’aucun reporting (compte rendu – notamment sur les transactions prévues et réalisées) auprès des régulateurs de marché. Ces enquêtes ont donc été réalisées à partir des déclarations des PSI – après recoupements et soumission à des tests de vraisemblance par l’AMF.
Ses investigations ont, selon M. Jean-Pierre Jouyet, son président, montré que le « volume [de transactions réalisées par les principaux intervenants français sur les CDS grecs de novembre 2009 à février 2010] s’avère relativement faible au regard des transactions sur les obligations souveraines grecques. Autrement dit, le marché des CDS est resté limité à l’aune du marché de la dette grecque elle-même. (…) Les deux principaux établissements français actifs sur ce secteur de marché semblent s’être protégés davantage au fur et à mesure que les craintes sur la solvabilité de la Grèce, donc le prix des CDS, augmentaient. Plus généralement, [elle n’a] pas relevé d’indices suffisants de comportements spéculatifs susceptibles de déstabiliser les marchés, comme des ventes à découvert en début de période, suivies de rachats après la baisse des cours ». L’AMF n’a « pas trouvé de smoking gun, d’indice manifeste de flagrant délit, mais [elle ne peut] exclure que des acteurs étrangers ou des acteurs finaux non identifiés, dont les ordres auraient été noyés dans la masse, aient pu avoir un comportement spéculatif » (63).
L’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a également récolté sur plusieurs semaines des informations sur l’exposition des établissements français. Leur analyse a montré que « les positions prises par les banques françaises dans le cadre de leurs opérations pour compte propre [sur la dette souveraine grecque à travers des CDS] étaient très mesurées. (…) En février-mars, puis en avril-mai 2010, les grandes banques françaises avaient globalement une position nette longue, c’est-à-dire vendeuse de protection et acheteuse de risque », représentant une faible part du volume total des transactions effectuées sur les marchés pendant les périodes considérées. (64)
d) Des mouvements liés aux tendances naturelles du marché.
Quoi qu’il en soit, sans aller jusqu’à la théorie d’un complot mené par des spéculateurs cupides, il suffit que les marchés financiers aient suivi leurs tendances naturelles pour que la crise se diffuse et s’aggrave dans des proportions très excessives au regard des risques réels (cf. ci-après E).
D’abord, la dynamique des marchés est en elle-même auto-réalisatrice : quand ils anticipent une aggravation des risques de défaut, la demande de protection sur les titres croît ; les primes de risque ou la valeur des CDS montent ; corrélativement, les marchés exigent des taux de rémunération supérieurs pour les nouveaux prêts. Le refinancement se renchérissant, la charge d’intérêt s’alourdit, les déficits des emprunteurs se creusent, nécessitant l’émission de plus de titres de dette, et les risques d’insolvabilité s’accroissent. Les taux montent alors encore plus et ainsi de suite.
Le risque d’un effet domino (ou l’enchaînement de déséquilibres cumulatifs) reste sous contrôle si la hausse des taux relève d’un sur-ajustement transitoire et si les politiques de consolidation budgétaire mises en œuvre suscitent ensuite une détente des conditions de refinancement. Cependant, le fonctionnement naturel des marchés ne garantit pas un tel scénario. En cas de perte de confiance, les investisseurs peuvent exiger des primes de risque déconnectées de l’état des fondamentaux et, surtout, ne prenant pas en compte les critères objectifs de soutenabilité. La conjugaison de cette tendance à l’autoréférentialité des marchés (qui choisissent de suivre l’opinion moyenne plutôt que de considérer la réalité des situations) et de comportements fortement « moutonniers » quand les incertitudes croissent viennent alors accentuer la déviation des prix, créant une véritable spirale destructrice.
Certaines personnes entendues par la commission d’enquête, notamment M. Christian de Boissieu, professeur à l’Université de Paris I, soulignent également le problème particulier que poseraient les CDS souverains « parce qu’ils accentuent les écarts et creusent les spreads (65). C’est à cause de l’effet boule-de-neige de ces CDS souverains que la Grèce a des taux à dix ans supérieurs à 10 % alors que l’Allemagne est à 2,3 % (…) le reste des CDS ne pose que des problèmes de transparence » (66).
Tout en permettant le maintien d’une offre de prêt, les assurances prises par les prêteurs sur les marchés dérivés, notamment par le biais des CDS, ont dans un premier temps encouragé la Grèce à accumuler de la dette, puis amplifié le développement de la crise, en nourrissant d’abord la hausse des primes de risques qui se répercutent sur les taux d’intérêt des prêts pour entrer dans la spirale précédemment décrite. Plus simplement, elles ont pu alimenter la panique des marchés par les signaux négatifs que leurs évolutions renvoient sur les perspectives de remboursement de la dette et partant, sur la valeur des titres sous-jacents. Une mise de fonds limitée sur le marché dérivé peut ainsi avoir un effet démultiplicateur sur le marché obligataire supérieur aux montants mobilisés. Or, des études de l’AMF montrent que l’évolution sur le premier a précédé d’au moins quinze jours celle sur le marché du sous-jacent.
Un mouvement sur le marché des CDS est déjà « plus facile à déclencher qu’un mouvement sur les marchés des taux lorsque des montants importants sont en jeu. (…) Le phénomène se renforce si le marché de la dette n’est pas liquide » (67).
En outre, alors que sur les marchés des actions, les positions courtes (vendre à découvert en pariant sur dépréciation des actifs que l’on emprunte ou que l’on livre tardivement) présentent un risque supérieur (par conséquent plutôt dissuasif) aux positions longues (celle d’un acheteur qui détient l’action et parie sur la hausse de son prix – la perte ne pouvant excéder la valeur initiale de l’encours), les CDS offrent non seulement un moyen d’avoir une position courte sur les obligations, mais ils peuvent inciter les spéculateurs à parier sur le défaut des émetteurs et exercer une pression à la baisse sur les obligations sous-jacentes. Car acheter la protection (position courte) c’est prendre le risque de faibles pertes pour des profits potentiellement élevés (a fortiori si l’acheteur ne détient pas le titre sous-jacent porteur du risque) tandis, que vendre de la protection conduit à des profits limités pour des pertes potentiellement très élevées (on achète le risque sous-jacent).
Dans les premiers temps de la crise, la hausse des rendements sur le marché secondaire qui a découlé de la forte demande d’assurance sur la dette grecque a pu ainsi encourager les spéculateurs à jouer à la hausse sur le prix des CDS et à la baisse sur les titres souverains (quand les taux de rémunération à l’échéance augmentent, ou plus spécifiquement les spreads, les prix des obligations baissent), amplifiant les tendances au point de contrarier le mécanisme de formation des prix. L’essentiel des profits est ensuite réalisé soit sur le marché des obligations, qu’il est possible de vendre « à découvert » (68), soit sur le marché des changes du fait de la pression sur l’euro.
Toutefois, à partir de février 2010, les volumes de transaction de titres obligataires grecs ont tellement chuté qu’il suffisait d’une opération à la marge pour faire décaler le marché. Quand les nouvelles notes de la dette grecque sont venues « confirmer » leurs craintes, les investisseurs se sont en effet mis à vendre plus substantiellement les titres publics grecs, ou du moins à les éviter. Cette tendance s’est encore aggravée quand les dégradations de note en juin ont fait sortir les titres souverains grecs de la catégorie des investissements de qualité (investment grade) et que, partant, les règles de gestion des actifs et les dispositifs de contrôle des risques pratiqués par la grande majorité des gestionnaires d’actifs leur ont pratiquement imposé de vendre. « Ces mouvements amplifient les mouvements de marché, sans être à proprement parler des manœuvres spéculatives », a remarqué M. Philippe Mills.
Comme l’a rappelé M. Jean-Pierre Jouyet, président de l’Autorité des marchés financiers, « il suffit qu’il n’y ait plus d’acheteurs. (…) La raréfaction des acheteurs et les ventes de titres de plus en plus dépréciés peuvent suffire à expliquer la hausse des taux grecs » (69)...
3.– La récente crise de la dette irlandaise réplique les enchaînements de la crise grecque
Ces enchaînements se retrouvent dans l’actuelle crise de la dette souveraine irlandaise : « Si l’on considère les flux, on s’aperçoit que la chute des prix provient des ventes effectuées par des investisseurs institutionnels parfaitement conservateurs, mais qui jugent que ces actifs sont devenus trop dangereux. Et le phénomène est entièrement « auto-réalisateur » : si tous les assureurs-vie européens vendent leur dette irlandaise, elle va chuter au point de forcer ceux qui voulaient la garder à la vendre », a observé devant la commission d’enquête M. Patrick Artus, directeur de la recherche et des études économiques de Natixis (70). Les écarts de taux (spreads) montant corrélativement, la soutenabilité de cette dette paraît menacée, « si bien que les marchés sont confortés dans la conviction qu’il faut [s’en] débarrasser ».
Or, comme l’a rappelé devant la commission d’enquête Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie : « La crise grecque nous a rappelé qu’un frémissement provoqué sur le marché très étroit des CDS souverains suffisait à décaler le prix des obligations souveraines, permettant à ceux qui s’étaient positionnés à découvert d’empocher des profits importants, même si la preuve précise que ces mouvements ont été opérés fera toujours défaut. » (71)
M. Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, est resté aussi prudent, tout en n’excluant pas certaines manœuvres spéculatives : « Il n’est pas exclu que les mouvements aient été amplifiés par des opérations spéculatives utilisant des instruments sophistiqués comme les CDS ou les ventes à découvert. » (72)
LA CRISE DE LA DETTE IRLANDAISE (novembre-décembre 2010) Avant la crise de 2008, l’Irlande avait des finances publiques saines. Mais ce pays a été l’un des plus durement touchés par la crise financière. Sa vulnérabilité provient essentiellement, comme aux États-Unis, de l’éclatement de bulles immobilières assorties d’un surendettement des ménages encouragé par une expansion accélérée du crédit bancaire. Celui-ci s’attachait moins à la capacité de remboursement des acquéreurs qu’à la valeur des actifs sous-jacents, misant sur l’augmentation continue des prix de l’immobilier. Le processus constaté en Irlande n’est pas sans analogie avec la crise des supbrimes aux États-Unis : selon M. Frédéric Oudéa, président directeur général de la Société Générale, « L’endettement des ménages et des entreprises y est passé d’environ 120 % du PIB en 2004 à environ 220 % du PIB en 2008-2009. Autrement dit, il a quasiment doublé en cinq ans. Avant la crise, l’Irlande était le pays en Europe où le PIB par tête était le plus élevé ; mais c’était une fausse richesse, fondée sur l’immobilier commercial et le crédit.» (73) Pendant un temps, cette spirale inflationniste des prix immobiliers et l’essor de l’activité de construction ont alimenté les dépenses intérieures dans leur ensemble. Ce cycle s’est retourné de façon spectaculaire avec la crise financière et les difficultés bancaires qui s’en sont suivies. L’immobilier et la consommation ont brusquement cessé de tirer la croissance économique. L’activité économique a ainsi connu une chute record de 7,1 % en 2009. Cette récession a été aggravée en Irlande par une fuite des capitaux qui s’étaient massivement portés sur le pays, attirés notamment par des taux d’imposition sur les sociétés très bas. Afin de freiner cette fuite des capitaux, le Gouvernement irlandais a fait le choix, dès l’automne 2008, de venir au secours de son système bancaire en nationalisant totalement ou partiellement cinq des plus grands établissements, en aidant d’autres à se recapitaliser, mais aussi en garantissant leurs dettes par l’intermédiaire d’une agence nationale de gestion des avoirs, la National asset management agency (NAMA), créée pour racheter les actifs toxiques qu’ils ont accumulés. On rappellera ci-dessous, pour mesurer les conséquences potentielles de cette crise, l’exposition du système bancaire au risque irlandais. Exposition des banques des principaux pays en Irlande Royaume Uni : 148,5 Allemagne : 138,6 États-Unis : 68,7 Belgique : 54 France : 50,1 Japon : 27,3 Autres : 244 Toutefois, ces rachats de titres de dette n’empêchent pas les principales banques du pays de demeurer fragiles en raison d’un endettement et d’une exposition sur l’immobilier qui restent importants. L’injection de 45 milliards d’euros publics, soit 27 % du PIB, dans le système bancaire a seulement réussi à le maintenir sous perfusion, tout en creusant le déficit à 32 % du PIB au lieu des 11,6 % prévus en décembre 2009. Aussi, si les difficultés de financement de l’État irlandais qui ont suivi ne sont pas la conséquence directe de la spéculation, mais de fondamentaux macroéconomiques détériorés (ainsi que de l’incertitude créée par l’absence de transparence sur les intentions du gouvernement après le constat de ces difficultés), il n’en reste pas moins que l’éclatement de la bulle immobilière a été la cause première de cette dégradation. |
Ces différents exemples illustrent une des principales caractéristiques de la plupart des acteurs intervenants sur les marchés financiers : le mimétisme fort des investisseurs, qu’il s’agît de suivre l’effervescence haussière sur certains produits ou de fuir le risque.
Il semble cependant que certaines évolutions récentes dans les produits, les instruments, les conditions de fonctionnement des marchés et les comportements des acteurs ont vraisemblablement accentué ces comportements mimétiques (cf. deuxième partie, II), notamment en concourant à fausser la lisibilité des situations réelles.
B.– DES CAS PATENTS DE SPÉCULATION MALVEILLANTE OU ABUSIVE
1.– Un exemple emblématique : Georges Soros, « l’homme qui fit sauter la Banque d’Angleterre »
Parmi les récents avatars de la spéculation, l’attaque réussie du fonds spéculatif Quantum fund de Georges Soros contre la livre sterling en septembre 1992 a marqué les esprits pour s’ériger en modèle de spéculation malveillante, et peut être aussi faire progresser les réflexions ayant abouti à la fin du Système monétaire européen et à la création d’une monnaie unique. Le hedge fund de Georges Soros, fonds alternatif créé dans les années 1960 et domicilié dans le paradis fiscal du Curaçao, réussit alors à faire plier une banque centrale, en forçant la Banque d’Angleterre à dévaluer la livre sterling le 16 septembre 1992. Georges Soros devint ainsi « The man who broke the Bank of England ».
Le mécanisme de stabilisation des taux de change entre les monnaies européennes créé en mars 1972, connu sous le nom de « serpent monétaire européen », prévoyait de limiter les marges de fluctuation entre les monnaies à 2,25 %. Celui-ci se transforma en mars 1979 en Système monétaire européen (SME), liant les monnaies européennes entre elles et à la nouvelle unité de compte, l’écu (Europan currency unit) par des parités et des cours-pivots définis, afin d’éviter la concurrence déloyale entre pays par la dépréciation compétitive d’une monnaie. Les taux de change pouvaient fluctuer librement sur le marché avec une marge de 2,25 % autour de ce cours-pivot ; en cas d’écart, les autorités monétaires devaient intervenir soit sur le marché des changes, soit en ajustant les taux d’intérêt. Chaque monnaie nationale avait ainsi une parité définie avec les autres monnaies du système ainsi qu’avec l’écu. Comme aujourd’hui, ce système ne pouvait fonctionner que si les pays coordonnaient leurs politiques économiques, et toute différence de taux d’intérêt ou d’inflation impliquait l’intervention des banques centrales pour acheter la monnaie faible et la défendre contre les spéculateurs.
Or, à l’époque, l’économie britannique était en pleine crise sidérurgique et minière, et le cours-pivot de la livre sterling était manifestement surévalué au regard, notamment, du solde de sa balance des paiements, déficitaire à l’égard des pays du SME. Le Royaume-Uni était donc contraint de maintenir des taux d’intérêt très élevés (13,5 % en septembre 1992). La situation était intenable à long terme, les taux de change et d’intérêt étant décorrélés des fondamentaux, et Georges Soros choisit de parier sur une dévaluation inéluctable des monnaies faibles. Avant le 15 août 1992, son fonds Quantum s’assura des lignes de crédit de 15 milliards de livres adossées à seulement un milliard de livres, s’assurant ainsi un considérable effet de levier.
Par la vente massive de 7 milliards de livres sterling et l’achat de 6 milliards de deutschemark, 500 millions de francs et 500 millions d’actions de sociétés britanniques dont le cours était supposé monter en cas de dévaluation, le fond de Georges Soros, bientôt suivi par d’autres hedge funds (Caxton Corp, Jones investment), des fonds de pension et des banques internationales comme JP Morgan, Citicorp, Chase Manhattan et Bank of America, attaqua la livre sterling. La Banque d’Angleterre dut dépenser 50 milliards de réserves pour soutenir le cours de la livre, puis décida de laisser celle-ci flotter et de baisser ses taux. Georges Soros put ainsi réaliser un bénéfice évalué à un milliard de dollars ; les autres fonds et les banques qui avaient suivi Soros firent un bénéfice de l’ordre d’1,3 milliard de dollars. La livre sterling se stabilisa à un cours inférieur de 15 % à sa valeur antérieure, le deutschemark et le franc s’apprécièrent brutalement de 7 % et les marges de fluctuation des monnaies du SME furent élargies de 2,25 % à 15 % en 1993.
Pour la première fois, un hedge fund était identifié comme le principal responsable de l’instabilité du marché des changes. Si de telles opérations bénéficient aux spéculateurs lorsque les autorités politiques et économiques cèdent à la pression, les conséquences macroéconomiques pour le pays attaqué sont ambiguës. Sa monnaie est dévaluée, ce qui renchérit ses importations. Cependant, l’industrie britannique profita de la dévaluation : le « black Wednesday » se mua en « white Wednesday » et l’économie britannique profita d’une reprise.
Si la constatation de forts déséquilibres macro-économiques peut susciter des espoirs de gains faciles et attire la spéculation, cette stratégie peut dans certains cas, s’avérer « perdante ». Tel fut le cas de la spéculation contre le franc français lancée en 1993 par le même fonds spéculatif de George Soros. Convaincu du décalage entre la situation économique française et la politique monétaire de la Banque de France, rivée sur la parité du franc français avec le deutschemark, devise du premier partenaire économique de la France, Georges Soros a appliqué la même stratégie que pour la livre sterling. Cependant, « non bis in idem », Georges Soros s'est retrouvé perdant, car la Bundesbank a accepté de prêter à la Banque de France les deutschemark dont elle avait besoin pour maintenir son taux de change, et la France a soutenu sa monnaie, dans le cadre d’une politique résolument pro-européenne ayant pour objectif la mise en place d’une monnaie unique.
Si l’opération de 1992 est bien connue, cette notoriété doit cependant plus à la présence médiatique de son auteur qu’aux interventions d’une quelconque autorité publique. (74)
En tout état de cause, il faut souligner que de telles opérations ne sont possibles que dans la mesure où la politique économique présente des failles que les spéculateurs peuvent exploiter. Comme l’a souligné devant la Commission d’enquête M. Marc Touati, directeur général délégué de Global Equities : « la spéculation ne tombe pas du ciel ; M. Soros ne se réveille pas un beau matin en se disant qu’il va attaquer la livre sterling ou la Grèce ! Elle n’entre en jeu que lorsque la situation économique est propice.(…) Les phénomènes spéculatifs (…) ne tomberont pas du ciel mais seront les conséquences financières de nos manquements économiques. (75) »
2.– Certaines enquêtes actuellement menées par l’Autorité des marchés financiers (AMF) illustrent la diversité des procédés utilisés par les spéculateurs
À la fin du premier semestre 2010, l’AMF menait des investigations dans le cadre de 35 enquêtes en cours concernant des dossiers d’initiés, de manipulation de cours et d’information financière. Parmi ces trois grandes catégories d’enquêtes, certaines visent plus particulièrement des dossiers illustrant des mécanismes ou techniques de spéculation susceptibles d’être qualifiée de malveillante ou délictueuse, sans prétendre à l’exhaustivité, dans une matière où l’imagination des opérateurs est débridée.
ENQUÊTE D’INITIÉS SUR DES DÉRIVÉS SUR ÉVÉNEMENT DE CRÉDIT AYANT POUR OBLIGATION DE RÉFÉRENCE DES TITRES DE CRÉANCES ÉMIS PAR LA SOCIÉTÉ X (CREDIT DEFAULT SWAPS – CDS) Début 2009, la société X, dont les actions sont cotées sur le compartiment A d’Euronext Paris, a annoncé son intention de réaliser une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). Cette opération avait pour finalité d’augmenter les capitaux propres de l’émetteur et de renforcer sa structure financière. Dans la mesure où la prime attachée au CDS d’une société varie en fonction du risque de crédit attaché à l’entité de référence, il a été constaté une forte baisse, d’environ 100 points de base (1 %), de la prime attachée aux CDS de la société X à la suite de l’annonce du projet d’augmentation de capital, le risque de crédit ayant diminué. Le Secrétaire général de l’AMF a décidé l’ouverture d’une enquête lorsque son service de la surveillance des marchés a porté à sa connaissance les transactions opportunes (vente du dérivé de crédit) conclues par deux fonds d’investissements (hedge funds) sur les CDS de la société X, préalablement à l’annonce de l’augmentation de capital, ces opérations ayant pu être réalisées sur la base d’une information privilégiée. Les investigations menées s’attachent à mettre en lumière l’information dont disposaient les investisseurs visés, deux fonds offshore dont les gérants sont basés à Genève et à Paris. Ces investigations ont permis de confirmer les ventes de CDS réalisées par deux fonds d’investissement avant l’annonce de l’augmentation de capital de la société X, mais également d’identifier à partir des informations transmises par la DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation) des cessions opportunes réalisées en février 2009 sur le marché des CDS de X par : – des fonds d’investissement dont les gérants sont basés à Londres, Monaco et Israël. Des demandes d’informations ont été adressées à ces intervenants par l’entremise des régulateurs locaux afin de connaître notamment les motivations qui les ont conduits aux prises de positions sur les CDS quelques jours avant l’annonce de l’augmentation de capital de la société X ; – des banques dont les équipes en charge du marché primaire actions localisées à Paris et à Londres ont été impliquées dans les discussions avec la société X sur son projet d’augmentation de capital en tant que chefs de file de l’opération. Les investigations en cours s’attachent à vérifier que les opérateurs ayant initié des transactions sur des CDS de l’émetteur X en février 2009 n’ont pas agi en situation de détention d’informations sur le projet d’augmentation de capital de X, qui auraient pu leur être transmises par les équipes chargées de l’arrangement et de l’exécution de ladite opération. Les enquêteurs ont également mis en lumière que le prestataire de services d’investissements Y aurait particulièrement bien anticipé les modalités de la restructuration financière de la société X à travers la publication de plusieurs notes d’analyse au cours de la période sous enquête. Or, il a été établi que des personnes au sein d’Y avaient été informées avant l’annonce que X allait procéder au lancement d’une augmentation de capital. Les investigations en cours s’attachent à s’assurer que la rédaction des notes d’analyse a été réalisée indépendamment de toute détention d’information privilégiée. Source : AMF. |
ENQUÊTE DE MANIPULATION DE COURS SUR LES ORDRES TRANSMIS PAR UN PRESTATAIRE SUÉDOIS Entre juin 2009 et janvier 2010, des analyses ont été menées sur des opérations réalisées sur Euronext, sur 27 valeurs du CAC 40. Les unes concernaient un membre de marché suédois qui s’est avéré agir pour le compte de donneurs d’ordres faisant partie d’un groupe dont la maison-mère est domiciliée aux États-Unis ; les autres concernaient un membre de marché londonien. Les pratiques ne sont pas identiques pour ces deux typologies de donneurs d’ordres. Le cas du groupe dont la maison-mère est américaine : La méthode manipulatoire utilisée est celle dénommée « layering ». Elle consiste à : – insérer un grand nombre d’ordres à des limites proches de la meilleure limite d’un côté du carnet d’ordres, par exemple à la vente, et en parallèle, d’entrer un ordre d’achat ; – les ordres de vente exercent une pression vendeuse sur le carnet d’ordres et conduisent les autres vendeurs (algorithmiques ou manuels), mais également les acheteurs, à réajuster leurs ordres sur des cours moins élevés, d’où un décalage de la fourchette de cours à la baisse, qui permet au manipulateur de voir son ordre d’achat exécuté ; – une fois l’ordre d’achat exécuté, les ordres de vente sont annulés et le procédé est reproduit à l’inverse pour faire monter la fourchette de cours et revendre plus cher les titres achetés en première période, et donc de réaliser une plus-value. Les enquêteurs ont relevé que ce schéma se déroulait en quelques secondes et était répété plusieurs fois par heure. Chaque plus-value est très faible (500-1 000 € par heure) mais la manipulation est répétée plusieurs fois sur une valeur et est effectuée simultanément sur un grand nombre de titres. Les traders interviennent sur plusieurs plates-formes : Euronext, CHI-X, Quote MTF (MTF hongrois créé en septembre 2009), et de façon plus marginale, XETRA et MTAA (Mercato Telematico Azionario). Le groupe concerné comprend une maison-mère située aux États-Unis et au moins quatre filiales, enregistrées notamment au Canada et aux États-Unis, sous lesquelles se trouvent des « day trading companies » avec lesquelles les différentes filiales ont signé des contrats d’« access agreement » (il s’agit de contrats de mise à disposition de moyens contre versement de 17 % du bénéfice à la holding du groupe). À l’occasion d’échanges avec les homologues de l’AMF, il s’est avéré que plusieurs régulateurs (notamment FSA, BAFIN, CMVM, AFM) travaillaient ou avaient travaillé sur cette possible manipulation qui concerne aussi des titres cotés sur leur marché. La difficulté réside dans le fait que la structure a été suffisamment opacifiée pour que les entités interrogées par les régulateurs ne se soumettent pas à ces demandes. Le gain total réalisé sur les 27 valeurs sous enquête s’élève à 2,3 millions d’euros, réalisé par 447 traders localisés dans 74 « day trading companies » différentes situées dans trente pays à travers le monde (notamment Chine, Canada, Europe, Vietnam, Bangladesh, Tunisie, Liban). Les structures les plus représentatives sont : – une structure située en Chine qui réalise 780 000 euros de gain ; – une structure italienne, dont les douze traders réalisent un gain de 561 000 euros. D’une façon générale, les cas de « layering » sont essentiellement observés sur sept structures chinoises localisées dans différentes provinces chinoises. Les agissements des italiens ne sont pas des cas de « layering » (achat/vente de titres au fixing, sans manipulation apparente, mais un gain important réalisé sur 2/3 des journées. L’analyse de cette pratique est encore à l’étude mais les enquêteurs soupçonnent à ce stade que les traders italiens ne soient pas à l’origine d’une manipulation de cours, mais en soient les bénéficiaires). Le cas du trader algorithmique basé à Londres : Entre le 15 février 2009 et le 15 février 2010, le trader algorithmique londonien a saisi, sur le titre SANOFI sur Euronext Paris plus de 47 % des ordres, soit plus de 18 millions d’ordres sur les 40 millions d’ordres entrés dans le carnet d’ordres. Très peu de ces ordres ont donné lieu à transaction, puisque les volumes vendus ou achetés représentaient moins de 1,3 % des volumes échangés. Des volumes similaires (et même supérieurs pour ce qui concerne les ordres) ont également été observés sur CHI-X. Par ailleurs, les ordres de ce membre du marché ont été très rapidement annulés, puisqu’en moyenne, ils ne sont restés que 7 secondes dans le carnet (parmi les ordres à validité jour saisis par les autres intermédiaires, la durée de vie moyenne des ordres est de 7 minutes). En outre, les enquêteurs ont relevé que 62 % de ces ordres étaient restés moins d’une seconde dans le carnet, et plus de 400 000 ordres saisis par ce membre ont été annulés moins d’une milliseconde après avoir été saisis. Certains de ces ordres ont été annulés 25 micro-secondes après avoir été entrés en carnet. Le membre du marché concerné clôture souvent ses positions (acheteuses ou vendeuses) en moins d’une seconde. Il est par ailleurs fréquent que des ordres, situés à la troisième, quatrième, cinquième… meilleure limite, soient créés, modifiés, annulés plusieurs fois au cours de la même seconde, sans qu’il y ait eu d’autres interventions dans le carnet que celles de ce membre. À ce stade, et bien que toutes les données qui devraient permettre, le cas échéant, de qualifier les agissements du prestataire visé de manipulation de cours, n’aient pas encore été reçues, les enquêteurs suspectent le membre du marché de brouiller le carnet d’ordres pour empêcher les autres membres de se positionner à bon escient dans celui-ci. Source : AMF. |
ENQUÊTE DE MANIPULATION DE COURS ET D’INITIÉS SUR LA DIFFUSION Les services de l’AMF ont été alertés par la propagation d’une rumeur qui aurait circulé le 30 mars 2010 concernant un abaissement de la notation de la France. Cette rumeur s’inscrivait quelques jours après l’annonce de la confirmation de la note du Portugal et l’avant-veille d’une émission d’OAT par l’Agence France Trésor (AFT). Elle a entraîné dans la matinée du 30 mars une augmentation brutale de l’écart de rendement (spread) des obligations françaises par rapport aux obligations allemandes. Alertée par les banques spécialistes en valeurs du trésor (SVT), l’AFT a pris contact avec l’agence de notation Fitch Ratings, lui demandant la publication de son communiqué en préparation. Ce communiqué, publié à 15 h 30 par Fitch a confirmé la meilleure note (AAA) avec une perspective stable de la France et a entraîné un retour à la normale des niveaux de spreads. Après avoir constaté que l’impact de la rumeur pouvait être estimé à 2 points de base (soit plusieurs dizaines de millions d’euros), l’AMF a ouvert, en juin 2010, une enquête sur les manipulations de marché réalisées sur les titres de créances émis par l’État français et sur tout instrument financier qui leur sont liés, à compter du 1er janvier 2010, ainsi, le cas échéant, que sur d’éventuels manquements aux obligations d’abstention d’utiliser une information privilégiée. En octobre 2010, les enquêteurs ont obtenu des informations qui pourraient laisser penser que la rumeur sur la dégradation par Fitch de la note de la France aurait été inventée puis véhiculée par la même personne que celle qui aurait annoncé une semaine avant (le 23 mars 2010) la dégradation de la notation du Portugal. Or cette dernière rumeur s’était avérée exacte le lendemain de sa propagation, la note du Portugal ayant été abaissée par Fitch. Cette indication était de nature à renforcer la véracité de la rumeur sur la dégradation de la note de la France auprès des intervenants du marché. À cet égard les enquêteurs disposent notamment d’un message Bloomberg adressé par un trader d’une grande banque à l’un de ses collègues, le 30 mars 2010 à 10 h 50, dans lequel le premier indique au second : « (…) rumours doing the rounds this morning about a possible France downgrade ; (…) totally agree… came from the same source that spoke of the Portugal downgrade the day before it happened » [les rumeurs circulant ce matin au sujet d’un possible abaissement de la note de la France : (…) j’approuve totalement… elles proviennent de la même source qui avait parlé d’un abaissement de la note du Portugal le jour précédant cet abaissement.] Source : AMF. |
ENQUÊTE SUR DES VENTES À DÉCOUVERT RÉALISÉES PAR DES ARBITRAGISTES SUR LE TITRE D’UN ÉMETTEUR BANCAIRE FAISANT L’OBJET D’UNE OPÉRATION FINANCIÈRE En 2008, un établissement financier français coté sur le SBF 120 a lancé une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) par l’émission d’actions nouvelles assimilables aux actions existantes. À l’issue de la période de souscription, les actions nouvelles ont été souscrites par l’exercice des DPS et ont été réglées. Il a été relevé par le service de la surveillance des marchés de l’AMF que plusieurs prestataires étaient intervenus à la fin de la période de souscription en vendant l’action et en achetant le DPS, les ventes d’actions ayant entraîné des suspens face à la chambre de compensation, LCH Clearnet. Dans ce contexte, une enquête a été ouverte, afin de vérifier si des intervenants n’auraient pas dérogé à la règle du J+3 c'est-à-dire la date de dénouement et de transfert de propriété des négociations qui doit intervenir au terme d’un délai de trois jours de négociation après la date d’exécution des ordres. Le rapport d’enquête présenté à la commission spécialisée du collège de l’AMF a mis en lumière les agissements de trois hedge funds enregistrés dans des centres offshore et au Royaume-Uni, qui ont cédé les actions de l’émetteur à découvert (sans avoir la provision titres) aux mêmes dates, sans avoir procédé à la livraison des titres dans les trois jours. Ils ont tous trois réalisé des opérations d’arbitrage en achetant les DPS le dernier jour de cotation de ceux-ci et en vendant les actions existantes. Le gain enregistré par chacun des trois fonds d’investissement s’est élevé entre 1,5 et 2 millions d’euros. Ces opérations ont généré des suspens chez le teneur de compte et l’adhérent compensateur des trois intervenants, car la date de dénouement des ventes qui ont été conclues était antérieure à celle de mise à disposition des actions nouvelles résultant de l’exercice des DPS. En outre, il est apparu que les adhérents de la chambre de compensation LCH Clearnet, chargés notamment de compenser les opérations des trois fonds, n’ont pas été en mesure de faire face à leurs engagements vis-à-vis de la chambre de compensation et sont restés en suspens jusqu’à ce que leurs clients aient livré les actions. La commission spécialisée du collège de l’AMF à laquelle a été présentée le rapport d’enquête a décidé d’ouvrir une procédure de sanction et de notifier des griefs à l’encontre des trois hedge funds sur le fondement des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier, en raison d’un éventuel manquement aux dispositions des articles 570-1 et 570-2 du règlement général de l’AMF. La commission a également décidé d’adresser une notification de griefs aux trois membres adhérents de la chambre de compensation LCH Clearnet SA, en raison d’un éventuel manquement aux dispositions des articles 542-1 du règlement général de l’AMF et 2.2.3.5 et 3.4.1.17 des règles de fonctionnement de LCH Clearnet SA approuvées par l’AMF. Source : AMF. |
Ces quatre dossiers illustrent à la fois la sophistication des moyens employés, le caractère transfrontalier des opérations réalisées, ainsi que la difficulté de la tâche du régulateur.
C.– LES « BULLES SPÉCULATIVES », PHÉNOMÈNES PATHOLOGIQUES ET DESTRUCTEURS
1.– Les bulles spéculatives, phénomènes inhérents à la vie des marchés
Il y a formation d’une « bulle » lorsque le prix d’un actif dépasse durablement sa valeur dite « fondamentale », c’est-à-dire la somme actualisée des flux de revenus que l’actif rapportera. Les actifs en question peuvent être financiers (actions, obligations…), immobiliers ou des matières premières… Sur le marché des actions par exemple, une « bulle » se gonfle lorsque tous les acteurs sont persuadés que les cours des actions vont continuer de monter, jusqu’au moment où les anticipations s’inversent et où les détenteurs d’actions abandonnent leur espoir de plus-value et vendent. Contrairement aux cas de spéculation malveillante ou frauduleuse évoqués précédemment, il s’agit là d’enchaînements macroéconomiques impliquant des acteurs de bonne foi – du moins pour la plupart d’entre eux.
Ces « fièvres » s’entretiennent en décalage avec les fondamentaux de l’économie, et peuvent finir par porter atteinte à ceux-ci. M. Michel Aglietta a expliqué devant la commission d’enquête que « c’est dans l’euphorie que les fragilités sous-jacentes se développent. Les comptes font apparaître une très bonne rentabilité et l’on développe un discours affirmant que cette situation euphorique est normale et correspond à des changements profonds (…) Dans cet état d’euphorie, on ne voit rien car on ne construit pas les indicateurs ». (76)
Comme l’a indiqué M. Augustin de Romanet au cours de son audition par la commission d’enquête, la « bulle Internet » de la fin des années 1990 illustre bien ce phénomène : la spéculation ne reposait pas sur une analyse approfondie de la valeur des actifs, sur l’actualisation des flux de trésorerie (cash flows), mais sur des réactions mimétiques à certains signaux, à partir desquels les agents ont extrapolé un envol des prix et ont acheté massivement pour tirer profit de celui-ci. Et « si personne n’évaluait les entreprises selon des critères raisonnables, c’est que chacun avait intérêt à entretenir la bulle : les entrepreneurs, qui levaient des capitaux selon des multiples extraordinaires ; les banquiers, qui percevaient des commissions tout aussi extraordinaires ; les particuliers, enfin, dont le titre souscrit en bourse doublait du jour au lendemain »(77). M. Christian de Boissieu a indiqué à la commission d’enquête qu’à l’époque de cette bulle, entre 1995 et 2000, le cours des actions de certaines start-ups dans le domaine des nouvelles technologies « capitalisait trois cents ou quatre cents fois les bénéfices annuels – l’entreprise fît-elle des pertes ! » (78).
Selon M. Marc Touati, également entendu par la commission d’enquête, « tôt ou tard, la réalité des marchés rejoint l’économie réelle, les bulles spéculatives constituant en définitive des phases temporaires » (79).
Mais la chute est d’autant plus sévère que la hausse a été déconnectée de la valeur économique réelle des titres. Une bulle traduit des comportements mimétiques et est liée à une expansion des crédits.
Selon M. Patrick Artus, directeur de la recherche et des études économiques de Natixis, les politiques de taux d’intérêt bas, combinées aux innovations financières, favorisent le développement de bulles immobilières notamment. Il estime que la combinaison entre la recherche de rendements trop élevés par les investisseurs et une croissance mondiale trop rapide des liquidités à investir favorise la reproduction des bulles spéculatives, et que la crise financière qui a commencé à l’été 2007 n’a pas fait disparaître ces deux facteurs (80).
Les « bulles » favorisent l’activité économique tant qu’elles ne se dégonflent pas, tant par le biais d’un effet de richesse que par la distribution de liquidités qu’elles favorisent. L’éclatement des bulles ne débouche pas toujours sur une crise économique générale, mais peut se répercuter sur l’économie réelle par plusieurs canaux, notamment en provoquant un effet de richesse inversé qui pénalise la consommation et (ou) l’investissement, et donc la croissance. Comme l’a souligné M. Christian de Boissieu au cours de son audition, les bulles « ont un coût social important, d’abord lorsqu’elles se forment, parce que l’économie peut s’emballer, et surtout lorsqu’elles explosent. La chute de l’immobilier et des marchés actions pèse sur la consommation des ménages, mais de façon très inégalement répartie en fonction des catégories socioprofessionnelles. Les économistes sont conscients de ces coûts, mais encore loin de pouvoir les quantifier » (81).
La localisation des bulles, c’est-à-dire les actifs sur lesquels elles portent, se déplace d’une catégorie d’actifs à l’autre : achats d’actions (en particulier dans le secteur des nouvelles technologies) à la fin des années 1980, puis d’actifs immobiliers après la crise boursière de 2001-2002 (bulle de l’immobilier résidentiel), et depuis la crise de 2007, matières premières (énergie, métaux précieux, produits alimentaires) et actions des pays émergents… M. Augustin de Romanet a fait observer au cours de son audition que les bulles, qui reviennent par intervalles, « se succèdent de plus en plus rapidement : sept ans seulement ont séparé la bulle Internet de celle des subprimes ». M. Christian de Boissieu a également évoqué devant la commission d’enquête le fait que « l’inflation a eu tendance à se déplacer des biens et services vers les marchés d’actifs » et que les bulles qui se succèdent touchent à des catégories d’actifs différentes (secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), immobilier, énergie, marchés obligataires…).
Dans son « Histoire de la spéculation financière » (82), Edward Chancellor dresse une liste non exhaustive de mouvements spéculatifs et de « bulles », en concentrant son étude principalement sur les cas de spéculation qui se sont produits dans le ou les pays qui comptaient, à l’époque considérée, parmi les plus grandes puissances économiques : l’empire romain, les cités-États italiennes à la fin du Moyen Âge, la Hollande au XVIIème siècle, la Grande-Bretagne au XIXème siècle, les États-Unis et le Japon au XXème siècle.
Il évoque également, comme première « bulle » ayant affecté l’économie de pays émergents, celle qui a touché les pays d’Amérique du Sud dans les années 1822-1825, liée à la spéculation sur l’exploitation minière et à un contexte de crédit « facile » ; il note que les pays en développement ont ensuite été régulièrement affectés par des « bulles » sur les marchés d’actions, avec une fréquence sans précédent pendant les années 1990 (Chili, Bangladesh…).
La première « bulle » qu’il présente est bien sûr la « tulipomanie » en Hollande dans les années 1630 – même si le terme de « bulle », relève-t-il, n’a été utilisé pour la première fois pour qualifier un tel phénomène d’engouement collectif qu’en 1720 à propos de la « bulle des Mers du Sud » en Angleterre (à partir d’un engouement pour les actions de la Compagnie des Mers du Sud).
De nombreuses autres illustrations sont données : la « bulle » sur les actions des compagnies de chemin de fer en 1845 en Grande-Bretagne, l’apogée de la spéculation sur l’or aux États-Unis au début de 1864 et la « bulle » sur les actions des compagnies pétrolières en 1865… Pour la période récente, le principal exemple choisi est l’« économie de bulle » japonaise des années 1980, car à l’époque de la rédaction de l’ouvrage la constitution de la « bulle Internet » (ou bulle des nouvelles technologies de l’information et de la communication – NTIC) n’était pas achevée.
LA « TULIPOMANIE » DES ANNÉES 1630 EN HOLLANDE La prospérité économique de la Hollande à partir des années 1590 a créé des conditions propices à un phénomène de spéculation. Les Hollandais, avec les revenus les plus élevés d’Europe, devinrent une « nation de consommateurs ». Avec la tulipe, ils trouvèrent à satisfaire à la fois un désir d’ostentation et la recherche de profits. Les variétés de tulipes furent traitées comme des actifs financiers en étant négociées tout au long de l’année et non plus seulement pendant la période de floraison : un marché à terme apparut pour les bulbes de tulipe à la fin de 1636. À l’apogée du phénomène, la majorité des transactions portaient sur des tulipes qui ne pourraient jamais être effectivement livrées et qui étaient payées au moyen de crédits qui ne pourraient jamais être réellement remboursés. Le salaire annuel moyen de l’époque en Hollande variait entre 200 et 400 florins, une petite maison de ville coûtait environ 300 florins. En quelques semaines, le prix d’un bulbe de la variété « Gouda » passa de 20 à 225 florins, et pour la variété jaune « Croenen », d’environ 20 florins à plus de 1 200. La variété qui atteignit le prix le plus élevé, « Semper Augustus », se vendit jusqu’à 2 000 florins. Le 3 février 1637, le marché de la tulipe s’effondra brutalement. Il n’y eut pas de cause claire à cette panique, si ce n’est la proximité de l’arrivée du printemps et donc des échéances obligeant à la livraison effective des fleurs. À Haarlem, centre du commerce des fleurs, des rumeurs circulèrent, annonçant qu’il n’y avait soudain plus d’acheteurs, et dès le lendemain il n’y eut effectivement plus aucune vente. Les contrats conclus ne furent pas honorés, et des défaillances se succédèrent. Toutefois cet effondrement ne provoqua pas de crise économique générale. Les individus qui avaient hypothéqué leur patrimoine et cédé leurs biens mobiliers dans l’espoir d’un profit rapide subirent une perte définitive de richesse, mais les gros marchands professionnels furent peu affectés. Le « tumulte » sur le marché des tulipes dura jusqu’en mai 1638, quand le gouvernement décréta que les contrats sur les tulipes seraient annulés par simple paiement de 3,5 % du prix convenu. Suite à cette crise, la « manie des tulipes » fut remplacée par une « phobie des tulipes » – une aversion similaire à l’aversion du public envers les actions après la Grande Crise de 1929. Source : « Devil Takes the Hindmost – A History of Financial Speculation » (E. Chancellor). |
Selon les observations d’Edward Chancellor, de même que la « tulipomanie » a été initialement stimulée par une hausse des prix pour des bulbes rares qui a attiré de nouveaux entrants sur ce marché, les « booms » sur les marchés d’actions sont communément déclenchés par une hausse forte du cours des actions dans un secteur précis – qu’il s’agisse des chemins de fer dans les années 1840 ou de l’automobile dans les années 1920 – qui incite des acteurs extérieurs à y spéculer.
Une autre caractéristique des périodes d’euphorie sur les marchés est que, au fur et à mesure que l’engouement augmente, la qualité des actifs qui font l’objet de la spéculation diminue.
Plusieurs autres caractéristiques de la « tulipomanie » se sont retrouvées dans les « bulles » ultérieures portant sur des actions : la diffusion de rumeurs qui alimentent l’expansion, le rapide accroissement des effets de levier par l’usage d’options et de crédits, des pratiques de consommation ostentatoire par les spéculateurs, des prix augmentant considérablement avant de s’effondrer du fait d’une panique aux causes imprécises, et une certaine passivité initiale des autorités suivie par une intervention tardive.
Le film « Le sucre » de Jacques Rouffio et Georges Conchon a familiarisé, aux yeux du grand public, la formation et les effets de la bulle spéculative sur le sucre de 1974.
L’« ÉCONOMIE DE BULLE » - JAPON, ANNÉES 1980 Le Japon fut, dans les années 1980, affecté par des phénomènes massifs de spéculation, dans des proportions telles que, en quelques années, l’ensemble du système économique japonais fut gravement touché. Il existe un certain nombre de points communs entre la « bulle » japonaise des années 1980 et le « boom » qu’ont connu les États-Unis au début du XXème siècle. Comme le Japon des années 1980, les États-Unis en 1900 avaient une balance commerciale très largement excédentaire. New York s’efforçait alors de détrôner Londres comme capitale financière du monde, et dans les années 1980 Tokyo était en train de devenir une place financière d’importance mondiale. Dans les deux cas, le phénomène massif de spéculation à l’intérieur du pays se traduisit par des acquisitions extravagantes d’actifs à l’étranger : dans les années 1900, des Américains acquirent pour plus de 100 millions de dollars d’actions britanniques, notamment dans le domaine maritime. Tout comme les acquisitions d’actifs par des entreprises japonaises aux États-Unis dans les années 1980 (l’immeuble Exxon et le Rockefeller Center à New York, Columbia Pictures…), ces achats provoquèrent de violentes réactions dans la population britannique, et dès que le « boom » prit fin, des acteurs britanniques rachetèrent ces actifs, tout comme les entreprises japonaises durent revendre à perte beaucoup de leurs « trophées » acquis aux États-Unis pendant la « bulle ». Avant les années 1980, le système économique japonais présentait les caractéristiques suivantes : le rôle des pouvoirs publics était traditionnellement important ; les taux d’intérêt étaient maintenus à un niveau très bas, les compagnies ne versaient en général que de faibles dividendes, et en conséquence les rendements perçus par les investisseurs japonais étaient assez bas. Les importations étaient soumises à d’importantes restrictions. À la suite du krach boursier et des nombreuses faillites bancaires des années 1930, les autorités japonaises avaient déclaré qu’elles ne laisseraient plus de telles faillites se produire. Dans le cadre de la « révolution financière » qui suivit la fin du système de changes fixes de Bretton Woods, en 1971, le Japon libéralisa son contrôle des changes en 1980 et fut amené à réformer ses marchés financiers afin de permettre le placement des capitaux surabondants accumulés du fait de son excédent commercial considérable et d’un taux d’épargne national élevé. En 1984, les banques japonaises furent autorisées pour la première fois à fixer librement leurs taux d’intérêt. Les produits financiers se développèrent, avec la création de marchés à terme à Tokyo ; au début des années 1980, les entreprises japonaises commencèrent à compléter de manière systématique leurs revenus par les profits considérables liés aux innovations financières. La totalité des capitaux disponibles ne fut pas consacrée à de la spéculation : dans le même temps eut lieu un investissement très important dans de nouvelles capacités de production. Mais l’« économie de bulle » fut avant tout un « boom » immobilier. Entre 1956 et 1986, les prix des terrains augmentèrent de 5 000 %, et les banques japonaises agissaient sur la base de la conviction que les prix de l’immobilier ne baisseraient jamais. La hausse du prix des terrains fut le moteur de l’expansion du crédit pour l’ensemble de l’économie, de la même façon qu’aux États-Unis dans les années 1920. D’autre part, du fait des nouvelles règles internationales en matière de fonds propres des banques adoptées par le « Comité de Bâle » fin 1987, les banques japonaises furent obligées d’accroître leur ratio de capital à 8 %, mais ont obtenu à Bâle une concession : ces banques détenaient un grand nombre d’actions d’autres entreprises, et ont obtenu qu’une certaine part des profits réalisés grâce à ces actions puisse être incluse dans le calcul du ratio. Il en résulta que la capacité des banques japonaises d’accroître les crédits était liée à la hausse du cours des actions en Bourse. L’expansion du crédit pouvait donc continuer aussi longtemps que les cours de la Bourse de Tokyo s’élevaient. Suite aux accords du Plaza (septembre 1985), dont l’objectif était de faire baisser le dollar par rapport aux autres monnaies et en particulier face au yen, le pouvoir d’achat de la monnaie japonaise augmenta de 40 % en quelques mois, tandis que les produits japonais devenaient soudain presque deux fois plus cher sur les marchés internationaux. La menace pour l’économie japonaise amena les autorités à réduire les taux d’intérêt pour stimuler l’économie, mais c’est une inflation des prix de l’immobilier qui s’ensuivit, suscitant l’intérêt d’un large public pour l’évolution financière et économique. Pendant la deuxième moitié des années 1980, le marché boursier vit entrer environ huit millions de nouveaux investisseurs. La privatisation de la compagnie nationale du téléphone (NTT) en octobre 1986 marqua le déclenchement d’une bulle spéculative sur le marché des actions, les spéculateurs étant persuadés que le gouvernement ne permettrait pas aux cours des actions de chuter (à plusieurs reprises dans le passé – en 1931, 1950 et 1965 – et à la suite du krach boursier mondial d’octobre 1987, les autorités japonaises sont intervenues pour venir au secours du marché d’actions en chute). À la fin des années 1980, les cours des actions japonaises augmentèrent trois fois plus vite que les bénéfices des sociétés, même en incluant dans ceux-ci les profits réalisés grâce à l’utilisation par ces entreprises, des produits financiers dérivés. Les fondamentaux de l’économie étaient largement négligés : les cours continuaient à grimper alors même que les profits des exportateurs diminuaient. Le « boom » immobilier se poursuivait, atteignant des proportions extraordinaires : en 1990, le marché immobilier japonais était estimé à une valeur équivalente à quatre fois la valeur de l’ensemble du marché immobilier américain. Le marché des actions était caractérisé par de profondes asymétries d’information : le grand public réalisait relativement peu de profits malgré la hausse continue des cours, tandis que des clients favorisés avaient accès à des informations cruciales en violation des règles existantes sur les délits d’initiés. Mais l’expansion de la consommation et du crédit immobilier était généralisée. Fin 1989, l’indice Nikkei approchait des 40 000 points, en hausse de près de 500 % en une décennie. Le marché ne s’effondra pas en une seule journée, mais de manière progressive, à partir d’un resserrement de la politique monétaire (la Banque centrale révisa ses taux d’intérêt à la hausse à six reprises entre fin 1989 et août 1990) et d’une série de scandales financiers à l’été 1990. La chute de la Bourse se poursuivit, l’indice atteignant 14 309 points en août 1992. L’économie japonaise entra en récession : les capacités de production étaient excédentaires, les dépenses de consommation ralentirent, une grave crise bancaire eut lieu, les prix de l’immobilier chutèrent, les caractéristiques fondamentales du système économique japonais furent remises en question. Source : « Devil Takes the Hindmost – A History of Financial Speculation » (E. Chancellor) |
Les personnalités entendues par la commission d’enquête ont évoqué, outre la « bulle » qui s’était constituée autour des prêts immobiliers dits « subprimes » aux États-Unis et dont l’éclatement a servi de déclencheur à la crise financière mondiale à partir de l’été 2007, plusieurs « bulles » en cours de formation et particulièrement préoccupantes, notamment des matières premières comme le pétrole ou le blé, une partie des marchés obligataires, et, en France, le marché immobilier.
2.– Une bulle aux effets dévastateurs : l’emballement du marché immobilier aux États-Unis, cause première de la « crise des subprimes »
Si la crise des subprimes a été l’élément déclencheur de la crise financière de l’automne 2008, elle a eu elle-même pour origine une bulle spéculative sur le marché immobilier américain, génératrice d’une « bulle de crédit ».
Entre 1997 et 2007, le taux de croissance des prix de l’immobilier cumulés aux États-Unis a été de 171 % (83). Cette bulle spéculative a été le ressort de la distribution d’une masse considérable de prêts immobiliers, d’abord à la clientèle classique, puis à des personnes peu solvables (subprime loans, prêts en dessous du « premier choix »), démarchées par des intermédiaires souvent peu scrupuleux. Entre 2000 et 2006, l’encours des crédits immobiliers est ainsi passé de 4 800 milliards de dollars à près de 9 800 milliards de dollars, croissant en moyenne de 13 % l’an. Les prêteurs ont été d’autant moins regardants sur la solvabilité de leurs clients que les prix des biens hypothéqués étaient supposés « monter jusqu’au ciel », pour reprendre la formule d’usage, et que le risque de crédit était largement transféré à d’autres investisseurs par le biais de la titrisation (cf. deuxième partie, II, A, 3) de plus de la moitié des créances subprime, essentiellement par deux organismes financiers privés mais bénéficiant du soutien étatique (government sponsored enterprises) connus sous les surnoms de « Fannie Mae » (Federal national mortgage association) et « Freddie Mac » (Federal home loan mortgage corporation).
M. Michel Aglietta, conseiller au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII), a, devant la commission d’enquête, analysé les mécanismes spéculatifs ayant conduit à la crise des subprimes : « Une telle dérive spéculative est fonction d’une heuristique bien précise : les prix immobiliers sont censés monter indéfiniment pour l’ensemble d’un territoire donné, hypothèse que les grandes banques d’affaires et les agences de notation n’ont pas hésité à formuler pour le territoire américain. La demande de crédit ne peut dès lors qu’augmenter avec le prix, au lieu de baisser. En effet, la bulle financière permettant de réaliser l’anticipation, si la bulle est appelée à durer indéfiniment, la valorisation s’accroît avec elle : la demande de crédit augmente puisqu’elle finance l’anticipation. L’offreur fait le même raisonnement, espérant, en cas de difficultés du débiteur, revendre avec profit le collatéral [bien hypothéqué]. Dans une telle logique, l’offre et la demande sont corrélées dans le même sens, si bien que le taux d’intérêt ne peut plus équilibrer le marché : on aboutit dès lors à un processus de dérive systématique. En l’absence de toute régulation, ce processus a atteint un niveau historique » (84).
Phénomène pourtant classique, le retournement du marché immobilier, perceptible dès 2006, a surpris des opérateurs qui en avaient exclu l’éventualité, jusqu’aux agences de notation, qui, selon M. Augustin de Romanet (85), directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, non démenti par Mme Carol Sirou (86), présidente de Standard & Poors France, « avaient fait l’hypothèse que la chute des cours de l’immobilier ne pouvait se produire dans plus de dix États simultanément, ni dépasser 10 % dans chacun d’entre eux ». Si, de fait, cela ne s’était jamais produit, le développement inconsidéré des acquisitions et des prêts a, au cas particulier, amplifié le phénomène de chute des prix. Fondé sur des anticipations de défaillance des emprunteurs de 1 % à 2 %, le mécanisme des subprimes explosa : le taux de défaillance atteignit 5 % en 2006 et dépassa 20 % à l’été 2007. Ce phénomène dessilla les yeux des détenteurs de produits comportant des subprimes, acquis sans discernement, au bénéfice de leurs forts rendements, pendant la constitution de la bulle. D’où la paralysie rapide du marché interbancaire, chacun des opérateurs soupçonnant les autres de détenir des actifs « pourris », ce qui a provoqué les premières faillites bancaires.
Ainsi, ce qui n’aurait pu être qu’un banal et récurrent retournement du marché immobilier généra la plus grande crise que nos économies ont affrontée depuis 1929.
D.– SPÉCULATION ET VOLATILITÉ DES MARCHÉS : DES MOUVEMENTS PERTURBANTS POUR LES PRODUCTEURS, LES INDUSTRIELS ET LES CONSOMMATEURS
Il suffit de se référer au graphique ci-après, présentant l’évolution récente des indices des cours des matières premières, pour mesurer l’extrême instabilité de ceux-ci au cours de la période récente.
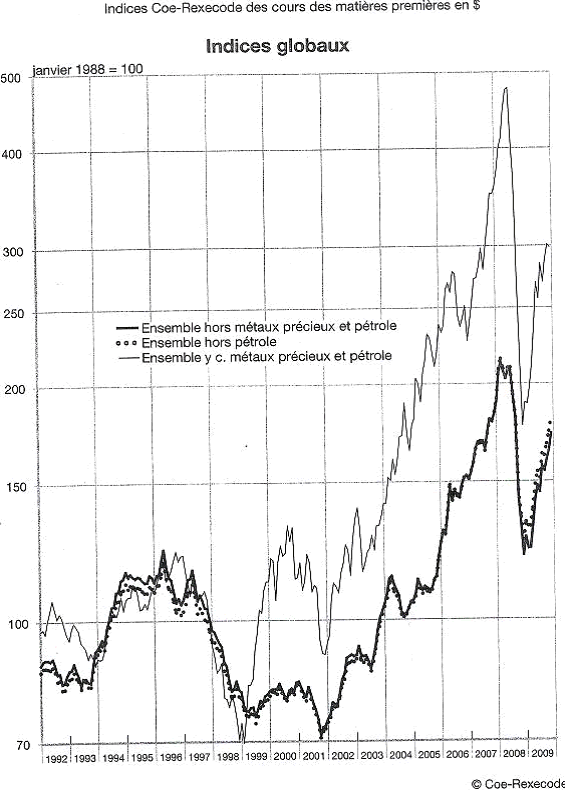
L’étude d’un marché symbolique comme celui du pétrole et l’analyse des marchés agricoles montrent que l’incertitude sur le prix et les anticipations pour chaque matière première incitent les acteurs de chaque filière à recourir à un marché à terme de couverture. L’importance croissante du marché à terme et des produits financiers liés aux matières premières conduit parfois à la formation de bulles lorsque l’attraction pour l’actif augmente, produisant de vives variations de prix paraissant déconnectées, pour un temps, des fondamentaux. Le processus est le même qu’il s’applique au sucre, au blé, aux terres rares ou bien au pétrole. En l’absence de bulle, la responsabilité ou l’effet de contagion des marchés dérivés des matières premières sur la volatilité des prix de celles-ci ne fait pas l’objet d’un consensus.
À la fin des années 1970, les échanges de pétrole reposaient sur la base de contrats à long terme à prix fixe. Les transactions par cargaison spot (ponctuelles) ont progressivement supplanté les contrats à long terme et à prix fixe pour répondre aux besoins de flexibilité des producteurs et des consommateurs. Les prix spots étant naturellement plus volatils que ceux des contrats à long terme, c’est pour permettre aux opérateurs de se couvrir contre cette volatilité que sont apparus les marchés dérivés et les bourses pétrolières, le Nymex à New York, l’Ipe à Londres et le Tocom de Tokyo. Les premiers contrats à termes (futures) du pétrole apparaissent en 1980, suivis en 1990 par les swaps ou options, pour répondre à la volatilité de l’actif sous-jacent.
En 1998, le prix du pétrole était tombé à 10 dollars le baril, soit le plus bas niveau depuis 1971 en dollars constants. En réaction à un prix inacceptable pour les producteurs, les pays de l’Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) ont défini une zone de variation variant entre 22 et 28 dollars par baril, admise comme « juste » par les pays producteurs et exportateurs comme par les pays importateurs et le reste de l’économie mondiale, de 1999 jusqu’à 2003, période d’assez grande stabilité du prix du pétrole et de croissance mondiale. Le rapport de M. Jean-Marie Chevalier sur la volatilité des prix du pétrole, publié en février 2010, rappelle que l’explosion de la demande des pays émergents (Chine, Inde, Brésil) comme celle des États-Unis, soutenue par une forte croissance de 2004 à 2007, a poussé le prix du pétrole aux alentours de 60 dollars en 2007. Puis, alors même que la croissance ralentit, son cours flambe, culminant à quelque 145 dollars à l’été 2008.
M. Marc Touati, directeur général délégué de Global Equities, a ainsi analysé cette évolution devant la commission d’enquête : « Nous savons qu’il existe une corrélation entre la croissance mondiale et le prix du baril, l’un et l’autre augmentant de concert. En toute logique, l’inverse devrait être également vrai ; or, en 2008, année de la crise, le baril flamba jusqu’à 150 dollars. […] Au mois de juillet 2008, la plupart des experts soutenaient qu’un tel prix n’était pas très élevé et qu’il grimperait jusqu’à 300 dollars le baril alors que cela était économiquement insensé ! Même eux ont donc participé au « jeu spéculatif » faute de faire preuve du discernement nécessaire ! Lorsque je disais, en tant qu’économiste, que le prix du baril devait baisser à 100 dollars – à proportion, donc, de la croissance mondiale –, j’étais considéré comme un fou ! Le plus grave, ce sont les conséquences économiques d’une telle situation. Air France ayant cru que le baril atteindrait des sommes encore plus astronomiques, a acheté à terme des barils à 150 dollars ; or, leur prix ayant ensuite chuté à 34 dollars, elle a dépensé des millions inutilement. Conclusion provisoire : les acteurs économiques les plus traditionnels spéculent. J’ajoute qu’aujourd’hui la remontée du baril à 85 dollars me semble envisageable car conforme à une croissance mondiale qui devrait être de 4 % » (87).
Depuis lors, le prix du baril est retombé à 36 dollars en décembre 2008 pour remonter à 80 dollars en 2009-2010.
La multiplication des acteurs, des produits financiers, des places de marché, parfois régulées (marchés organisés) parfois non (marchés de gré à gré ou over the counter) a pour conséquence qu’aujourd’hui les prix du pétrole se forment essentiellement à partir des marchés organisés de contrats à terme (futures) (Pétrole WTI américain et Brent européen) et obéissent autant aux fondamentaux physiques que financiers. La très faible élasticité-prix à court terme de l’offre et de la demande augmente encore les conditions favorables à la volatilité (88). La demande de pétrole physique coexiste désormais avec la demande de pétrole papier, qui croît avec la volatilité des taux de change, la faiblesse des taux d’intérêt aux États-Unis et du dollar, l’arrivée des fonds indexés en matières premières, la demande croissante des pays émergents.
2.– Les matières premières agricoles : dissensions sur le rôle de la spéculation
Le XXIème siècle est loin d’avoir résolu, malgré les immenses progrès des techniques de production, les questions de l’alimentation humaine et de la maîtrise de l’organisation des marchés de matières premières. Du côté de la demande, les nouveaux besoins alimentaires des pays émergents, la position désormais dominante de la Chine sur les marchés mondiaux, ainsi que l’apparition d’une forte demande supplémentaire pour les agro-carburants, ont changé la donne sur les marchés de matières premières agricoles. Du côté de l’offre, le développement de la titrisation et des marchés dérivés, le démantèlement de la politique agricole européenne et la disparition des interventions directes sur le marché américain, l’instabilité des changes et un aléa climatique persistant, conduisent à une forte volatilité des prix à la hausse depuis le milieu des années 2000. La hausse des prix et leur volatilité pour la quasi totalité des denrées alimentaires de base, céréales, sucre et oléagineux, après des années de baisse tendancielle qui avaient conduit à réduire les stocks, gêne les décisions des acteurs de la filière.
Les marchés à terme agricoles ont été les premiers marchés à terme du monde. M. Philippe Chalmin, professeur à l'Université Paris-Dauphine, président de CyclOpe, a rappelé en préambule de son audition par la commission d’enquête (89) le « Dialogue sur le commerce des blés » de l’abbé Galiani au milieu du XVIIIème siècle, l’ancienneté du premier marché à terme du riz au Japon, qui date du milieu du XVIIème siècle, ou celui de Chicago, du milieu du XIXème siècle pour les céréales. Les outils ainsi développés pour certains produits agricoles ont ensuite été appliqués aux commodities (produits de base, selon la traduction littérale du terme anglais, mais qui ne se définissent plus par les caractéristiques physiques d’un produit, mais par leur mode d’ajustement par l’instable sur le marché), c'est-à-dire à l’ensemble des marchés : le marché du pétrole, de l’énergie, des métaux et des matières précieuses et désormais l’ensemble des matières premières agricoles, ainsi que des certains services comme le fret maritime ou des droits comme le « permis-carbone ».
Selon M. Philippe Chalmin la logique éminemment spéculative des marchés de commodités n’aurait pas d’impact sur la situation réelle, et les marchés dérivés fonctionnent pratiquement sans rien ponctionner sur la filière économique elle-même : « Le fait qu’il y ait un rapport d’un à dix, voire un à vingt entre le volume total d’un marché à terme et la production mondiale des produits concernés peut paraître choquant, mais c’est oublier que les marchés dérivés sont des jeux à somme nulle. C’est comme une table de poker sur laquelle tous les joueurs ont mis leurs jetons : ils seront perdus ou gagnés, mais il y en aura le même nombre à la fin ». Pour lui, la spéculation financière n’aggraverait pas l’instabilité. Il donne pour exemple la forte dimension financière du marché du blé, coté à Chicago, et le marché purement physique du riz, qui n’a pas de marché dérivé et dont la volatilité des prix fut supérieure à celle du blé pendant la crise de 2007-2008.
M. Patrick Artus, directeur de la recherche et des études économiques de Natixis, va dans le même sens en rappelant que ni le FMI ni l’OCDE n’ont pu prouver que les marchés à terme ont un impact sur le prix au comptant, que s’il y a lien, celui-ci n’a rien de systématique, autrement dit, que la spéculation sur les matières premières ne passe pas par les marchés dérivés. C’est le stockage physique qui serait à l’origine de l’envolée des prix. Les spéculateurs ne seraient pas les acteurs financiers, mais les États producteurs des pays d’Asie ou les producteurs comme des compagnies pétrolières : « depuis deux mois, certains métaux et des matières premières agricoles enregistrent des hausses très fortes, sans aucune augmentation du nombre des contrats à terme. Le FMI conclut à l’impossibilité de prouver que les marchés à terme ont un impact sur le prix du comptant. Le lien en tout cas n’a rien de systématique. Assez curieusement, la seule matière première où les prises de position à terme se soient accumulées récemment, c’est le riz… dont le prix ne bouge pas. Autrement dit, la spéculation sur les matières premières ne passe pas par les marchés dérivés. C’est le stockage physique qui serait à l’origine de l’envolée des prix. Et les spéculateurs ne sont pas forcément ceux qu’on pense : ce sont des États – les pays d’Asie ont d’énormes stocks de matières premières – ou les producteurs eux-mêmes – les compagnies pétrolières stockent du pétrole dans des tankers. Les acteurs financiers ne sont pas en cause »(90).
Selon lui, les fortes hausses du coton, du sucre, du maïs ou du fer coexistent avec des hausses modérées pour le pétrole, le zinc, le plomb, le riz, le gaz naturel. Il n’y aurait pas spéculation généralisée sur les matières premières, mais progression du nombre de positions ouvertes sur les métaux précieux (or, platine, palladium), pour le riz et pour le maïs.
Toutefois, il n’en demeure pas moins que le rapport entre les contrats à terme et les quantités physiques qui est de l'ordre de 40/1 pour le blé, assez proche de celui du pétrole, est perturbant et comporte un risque systémique selon les professionnels de la filière.
En 2008, le total de la production de blé tendre aux États-Unis était de 66 millions de tonnes, et le volume de contrats de blé négociés était de près de 2,6 milliards de tonnes. En Europe, où la situation est très différente, ce ratio n’est que de 0,52. La production européenne de blé tendre est de 140 millions de tonnes et le volume des contrats de 73 millions de tonnes. France AGRIMER, dans une analyse d’octobre 2010 sur les facteurs de la volatilité des marchés à terme de marchandises agricoles, n’hésite pas à citer l’intervention des investisseurs financiers comme les hedge funds dès 1972-1973, au moment des premières flambées de prix.
M. Patrick Artus a contredit cette analyse en faisant valoir que les hedge funds prennent très peu de positions courtes sur ces marchés et que leur levier a baissé de 5, 4, ou 3 à 0,5 aujourd’hui, pour un encours d’épargne de 1 863 milliards de dollars Si le coton et le blé atteignent des niveaux record, ce serait principalement en raison de facteurs physiques.
Le rapport de MM. Jean-Pierre Jouyet, Serge Guillon et Christian de Boissieu sur l’instabilité des marchés agricoles rappelle à la fois le retard des marchés à terme agricoles en Europe, avec la mise en place du premier marché à terme du colza en 1993 sur le MATIF, et la multiplication par six de l’encours des marchés de gré à gré de 2001 à 2008. Le prix des produits agricoles et des dérivés sur produits agricoles, en particulier ceux des céréales, ont connu une forte volatilité au cours des années 2007 et 2008, provoquant des hausses de cours spectaculaires et des émeutes de la faim dans quarante pays d’Afrique et d’Asie. Le prix du contrat à terme sur le blé coté sur Euronext NYSE Life a ainsi été multiplié par deux en l’espace de six mois au début de l’année 2007.
Lors de son audition par la commission d’enquête le 17 novembre 2010, M. Bernard Valluis, expert de l’Association nationale des industries alimentaires, a rappelé que la volatilité des cours est aujourd’hui très difficile à gérer, alors que les prix des matières premières agricoles étaient auparavant régulés en Europe dans le cadre de la politique agricole commune. Aujourd'hui, dans la même journée, sur le marché intérieur, les variations de cotation du blé sont de l’ordre de 10 à 20 euros sur un prix à la tonne de l’ordre de 200 euros.
E.– UNE LOGIQUE DES MARCHÉS QUI N’ABOUTIT PAS NÉCESSAIREMENT À UNE AUTORÉGULATION
Tout en défendant l’utilité de la spéculation financière et des marchés sur lesquelles elle s’exerce, plusieurs des personnalités auditionnées, observateurs attentifs de leur fonctionnement ou acteurs, ont souligné les dérives auxquelles certains de leurs ressorts naturels peuvent les conduire.
Dans des conditions offrant une lisibilité correcte de la solvabilité d’un émetteur de titres, de la qualité des instruments financiers ainsi que des positions des investisseurs, ces marchés, en facilitant la rencontre de la demande et de l’offre de capitaux, permettent à l’économie réelle de trouver la liquidité dont elle a besoin pour se développer tout en favorisant la détermination d’un prix adapté à la réalité des situations.
Les mécanismes porteurs des excès reprochés aux marchés financiers sont déjà à l’œuvre ; mais dans des circonstances « normales », ils restent modérés dans le jeu des équilibres qui se construisent chaque jour. Ils constitueraient même certains des ressorts nécessaires au fonctionnement de ces marchés quand ils favorisent par exemple une bonne circulation des capitaux ou permettent de différencier les situations rentables et celles qui sont excessivement risquées.
En revanche, quand apparaît ce que M. Michel Aglietta, conseiller au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII), nomme une « incertitude radicale » (91), certains mécanismes internes – et parfois spécifiques – à la spéculation et au fonctionnement des marchés financiers deviennent pathogènes, s’accentuant au point de réagir de manière disproportionnée et de s’emballer sans plus être capables de s’arrêter. Comme plusieurs des personnes entendues l’ont observé, quand ils suivent leur propre logique, les marchés financiers ne sont pas nécessairement « autorégulateurs ».
Les bulles illustrent la capacité d’emballement des spéculateurs, mais ils savent généralement qu’elles finissent par retomber ; le jeu est alors d’essayer de deviner quand s’en retirer à temps. Cependant, la crise financière récente et, plus particulièrement, les crises des dettes souveraines grecque et irlandaise ont démontré que se produisent également des baisses anormales, et que les marchés ne parviennent pas toujours à des prix que la considération des fondamentaux économiques sous-jacents permet de qualifier de « raisonnables », avec, au surplus, des risques de contagion sur d’autres marchés et des menaces de déstabilisation pour d’importants acteurs de l’économie réelle, voire des États.
1.– La remise en cause des théories des « marchés efficients »
Pour nombre d’observateurs, ces crises remettent fondamentalement en cause les théories des « marchés efficients » qui se sont développées au début de la libéralisation financière dans les années 1980. Selon celles-ci, a rappelé M. Michel Aglietta, « les marchés efficients étant réputés autorégulateurs, il [convenait] de réduire au minimum le rôle des instances publiques de régulation puisque les actionnaires et les marchés boursiers sont la boussole de l’économie. Le risque systémique [ou l’échec général de la coordination des marchés] est évidemment un scandale pour cette théorie. En sapant le paradigme sur lequel est fondé, depuis trente ans, le lien entre les marchés, les autorités, les agents financiers et le reste de l’économie, il impose de recourir à un autre paradigme, selon lequel la finance n’est pas intrinsèquement instable mais connaît, l’histoire l’a montré depuis des siècles, des périodes récurrentes d’instabilité. »
Les dernières crises ont, par-dessus tout, montré le caractère illusoire de la croyance absolue en la rationalité des marchés qui avait cours ces dernières décennies.
2.– La prévalence croissante de comportements mimétiques
Ainsi que M. Patrick Artus, directeur de la recherche et des études économiques de Natixis (92), l’a observé devant la commission d’enquête : « le plus compliqué est d’identifier la raison pour laquelle le prix d’un certain type d’actifs monte de façon manifestement déraisonnable. Le plus souvent, les nombreux investisseurs savent pertinemment qu’ils achètent trop cher et on a beaucoup de mal, malgré des études nombreuses et précises, à comprendre pourquoi ils le font néanmoins. »
Et M. Patrick Artus de s’interroger : « Quel est le mécanisme qui se cache derrière la hausse effrénée des prix, suivie d’une baisse tout aussi déraisonnable ? (…) La tentation est grande, pour expliquer ces phénomènes, de plaquer sur eux le modèle le plus simple de spéculation : j’achète un actif en sachant très bien qu’il est trop cher, mais en espérant le revendre encore plus cher avant que ne se révèle la vérité des prix. Ce qui rend la question extrêmement compliquée, c’est que, en sus de la spéculation, il y a d’autres mécanismes à l’œuvre dans la formation des prix : par exemple, le mimétisme forcené d’investisseurs qui ne sont pas des spéculateurs – les fonds d’investissement, les gérants de SICAV, les assureurs-vie, les caisses de retraite… Toutes les études montrent depuis trente ans qu’ils achètent toujours tous ensemble quand les actifs sont trop chers, et vendent toujours tous ensemble quand les actifs sont trop bon marché. De tels comportements sont totalement destructeurs pour les clients de ces intermédiaires financiers et provoquent des mouvements de prix extrêmement violents sur tous les marchés – actions, obligations d’entreprise, changes… ».
Ce mimétisme dont les ressorts naturels sont aisés à comprendre (« cupidité » (93) dans la recherche des rendements les plus lucratifs, peur de pertes trop lourdes, voire aversion aux risques, obligation de rendre des comptes à leurs clients…) est, comme les premiers temps de la crise grecque l’ont montré, tout particulièrement sensible à l’incertitude.
« La brusque dégradation de [la] dette souveraine [irlandaise] est en partie liée à l’absence de transparence sur les intentions du gouvernement de ce pays », constate par exemple M. Patrick Artus.
M. Michel Aglietta, conseiller au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII), a ainsi précisé : « Il convient tout d’abord de ne pas confondre les notions d’incertitude et de risque. Le risque est une évaluation : de même que le marché évalue le prix relatif des biens, il évalue le prix relatif des promesses sur le futur, que sont les créances et les actifs. (…) L’incertitude radicale se caractérise, elle, par une perte des repères : les agents ne savent plus évaluer les différences, qui s’exprimaient par des primes de
risques – des spreads. Dans la mesure où ils ne savent plus différencier les produits, les agents se réfugient vers la liquidité absolue, considérée comme le dernier refuge. »
« En temps normal, la spéculation joue un rôle équilibrant : des acteurs financiers mieux informés que d’autres, découvrant que les prix de certains produits ne correspondent pas à leur valeur réelle, jouent sur le retour des prix à cette valeur. Au contraire, en cas d’incertitude radicale, c'est-à-dire en l’absence de repères permettant d’évaluer les différences, la spéculation ne consiste plus à retrouver un prix d’équilibre entre les variations liées aux chocs du marché : privés de tout déterminant objectif, les acteurs prennent leurs décisions en fonction d'heuristiques qui consistent, finalement, à imiter les autres. Chacun étant à la même enseigne, il se produit une convention de méfiance à l’égard de toutes les valeurs, sauf de la liquidité absolue (…). La spéculation devient, de ce fait, déséquilibrante et finit par provoquer des processus destructeurs. »
En effet, « pour créer un prix d’équilibre, il convient que les positions des acteurs du marché sur un même produit soient différentes : certains cherchent à vendre parce qu’ils pensent que le produit va baisser tandis que d’autre souhaitent acheter pour la raison inverse. Au contraire, en raison des mouvements collectifs que crée l’incertitude radicale, on assiste à la disparition de tout prix d’équilibre et donc à un défaut généralisé de coordination (…) des comportements privés. » (94)
Ces mécanismes montrent à tout le moins l’importance fondamentale pour tout spéculateur-investisseur de l’accès à l’information, en amont comme en aval, et de sa lisibilité (cette information doit non seulement permettre de suivre les positions et transactions sur les différents marchés, de retracer l’évolution des titres, mais aussi d’en éclairer la complexité), facteurs les plus à même de réduire l’incertitude des marchés, et partant, de tempérer leurs sur-réactions.
Même s’il n’est pas toujours assuré que les acteurs en fassent usage. M. Augustin de Romanet, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, a confirmé devant la commission d’enquête que : « la spéculation ne fait en rien problème lorsqu’elle repose sur une analyse approfondie de la valeur des actifs, mais il en va tout autrement lorsque les agents, réagissant de façon mimétique à certains signaux, en extrapolent un envol ou une chute des prix. (95) » S’agissant de la bulle Internet par exemple, il a observé que « les comparables boursiers, qui faisaient pousser les arbres jusqu’au ciel, ont alors supplanté l’actualisation des cash flows, des flux de trésorerie ». Mauvaises analyses, utilisation de modèles de gestion des portefeuilles procycliques, manques d’expertise, excès de crédulité, pression de la concurrence… ou appât du gain, les raisons restent nombreuses pour ne pas se démarquer des tendances des marchés.
M. Christian de Boissieu, professeur agrégé d’économie à l’Université de Paris I et président du Conseil d’analyse économique, a considéré dès lors que si la transparence est une des mesures nécessaires pour réduire la spéculation déstabilisatrice, elle ne saurait être suffisante face au « phénomène d’anticipation mimétique qui est à la base des marchés », cette tendance à l’auto-référentialité des marchés qui fait que les prix peuvent décrocher des fondamentaux. « Comme Keynes l’avait montré dès 1936 avec l’analogie du concours de beauté : l’important, c’est d’anticiper ce que les autres anticipent, même s’ils se trompent ». (96)
Ce mimétisme est favorisé par la tendance au court-termisme des spéculateurs qui sont naturellement attirés par les marchés financiers parce qu’il est plus facile de jouer sur des capitaux quand les marchés mondiaux leur sont largement ouverts, qu’ils sont aisément accessibles pour des placements nomades et parce qu’ils présentent des opportunités variées (de lieux, de titres, de types de placements) qui se sont démultipliées ces dernières années et offrent des rendements plus élevés que les investissements dans l’économie réelle.
Or, ce court-termisme touche désormais largement des investisseurs dont les horizons de placement sont pourtant naturellement longs, en raison de divers biais et incitations qui seront évoqués en deuxième partie, accentuant les mouvements de marchés.
3.– Le caractère autoréalisateur des anticipations et les phénomènes de spirale
Comme cela a été montré précédemment à propos de la crise de la dette souveraine grecque, « si la spéculation connaît périodiquement des dynamiques incontrôlables, c’est notamment en raison du comportement panurgéen des opérateurs et des spéculateurs et d’anticipations qui, pour être erronées, n’en sont pas moins auto-réalisatrices du fait que tous les opérateurs les développent en même temps », ainsi que l’a noté M. Henri Bourguinat, professeur à l’Université de Bordeaux IV (97). Quand les marchés s’affolent, ils vont souvent accélérer la survenance des risques qu’ils se sont mis à craindre.
Parfois, ils peuvent être eux-mêmes à l’origine des déséquilibres initiaux.
Les prises de position « à découvert à nu » sur des credit default swaps (CDS), qui constituent un « usage potentiellement dévoyé », selon M. Augustin de Romanet, de ces produits dérivés destinés à l’origine à couvrir le risque de défaut d’un émetteur, en sont un exemple des plus frappants. Elles sont non seulement de nature à accroître la volatilité des taux (parce qu’elles se prêtent aisément à des sur-ajustements à court terme), mais également susceptibles de générer une spirale déstabilisatrice en activant le jeu des enchaînements mimétiques et auto-réalisateurs précédemment évoqués. En effet, dès lors qu’il est possible d’acheter des protections contre des risques souverains que l’on n’a pas à couvrir parce qu’on ne possède ni n’emprunte les titres sous-jacents, un investisseur peut avoir intérêt à ce que la situation de l’émetteur concerné se dégrade puisque son actif se valorise à proportion. Il viendra donc accentuer, voire provoquer cette tendance par l’achat, dans un premier temps, de contrats de garantie à un prix un peu surévalué. Les conditions de refinancement se détériorant, la demande d’assurance augmente et l’investisseur peut alors revendre son actif avec bénéfice sans l’avoir réellement assumé ; ce faisant, il confirme les craintes du marché sur le niveau des risques sous-jacents.
Certains mécanismes des marchés du crédit, si le contexte les encourage à négliger la contrainte réelle, peuvent même aboutir à faire évoluer offre et demande dans le même sens, créant un processus de dérive systématique sans qu’une crise ne l’ait provoqué.
M. Michel Aglietta, conseiller au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII), a ainsi rappelé notamment que « le marché du crédit contre collatéral n’est pas un marché ordinaire (…). Dans le cadre du marché ordinaire, en cas de hausse importante du prix d’un bien, on assiste à une diminution de la demande et à une augmentation de l’offre, ce qui crée un nouvel équilibre. Au contraire, dans le cadre d’un crédit contre collatéral, la garantie repose sur l’anticipation de la hausse de la valeur du bien, qui sera saisi en cas de faillite du débiteur. On n’a donc pas à s’intéresser aux revenus du débiteur par rapport au montant de sa dette si on anticipe la poursuite de la hausse du prix de l’actif financé par le crédit. (…) La demande de crédit ne peut dès lors qu’augmenter avec le prix, au lieu de baisser. En effet, la bulle financière permettant de réaliser l’anticipation, si la bulle est appelée à durer indéfiniment, la valorisation s’accroît avec elle : la demande de crédit augmente puisqu’elle finance l’anticipation. L’offreur fait le même raisonnement, espérant, en cas de difficultés du débiteur, revendre avec profit le collatéral. Dans une telle logique, l’offre et la demande sont corrélées dans le même sens, si bien que le taux d’intérêt ne peut plus équilibrer le marché (…). En l’absence de toute régulation, ce processus a atteint un niveau historique » (98) dans le cas des crédits immobiliers américains.
Aussi, conclut-il plus généralement : « il existe des situations dans lesquelles le marché dérive par sa propre logique ».
Or, les évolutions qu’ont connues les marchés financiers ces trois dernières décennies ont aggravé les risques de dérives :
– parce qu’elles ont accentué l’illusion de la rationalité des marchés avec l’introduction des instruments de calcul mathématique des risques et des outils informatisés de gestion des transactions,
– et qu’elles ont artificiellement renforcé le sentiment de sécurité/confiance, voire d’impunité, des acteurs,
– tout en démultipliant, largement hors contrôle, les opportunités de spéculer, avec une forte incitation en faveur du court-terme.
Comme, dans le même temps, d’autres phénomènes (automatisation des transactions, règles comptables incitatives, abus de complexité et opacification des marchés et des produits, sur-développement de la sphère financière etc.) sont venus accentuer la radicalité des réactions et l’amplitude de leurs effets, les économies apparaissent aujourd’hui plus exposées que jamais aux risques portés par la spéculation et les marchés financiers.
Ainsi, comme le montre notamment l’exemple grec, si les responsabilités sont multiples et débordent largement les acteurs financiers, l’accentuation des comportements spéculatifs, dans un cadre réglementaire inexistant ou inadapté, a contribué à créer les conditions des crises financières récentes, en ont aggravé l’impact, puis dilué l’efficacité des réponses apportées pour en limiter les effets néfastes sur l’économie réelle.
Ainsi que l’a exprimé Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, lors de son audition par la commission d’enquête (99) : « Fin 2008, j’avais analysé la crise financière comme celle de tous les excès : excès de crédit, de volatilité, de sophistication et de cupidité. »
Elle a rajouté : « Au vu de ce qui s’est passé au cours des derniers mois, on peut y ajouter l’excès de naïveté, qui n’est pas le moindre des facteurs ayant conduit à la crise. Il a entraîné les régulateurs, les banquiers centraux, les autorités publiques et certains acteurs de bonne volonté, commissaires aux comptes ou agents travaillant aux bordures de certaines transactions, à se laisser bercer par la fable qui voudrait que les marchés soient parfaits, liquides, profonds, efficients et régis par une force centrifuge corrigeant spontanément les déséquilibres. La recherche académique et universitaire a contribué à la diffusion de ce mythe si largement enseigné. Or la crise a révélé que cette croyance était une illusion d’optique, la réalité étant beaucoup plus crue. »
« Utilité ne doit pas rimer avec naïveté : ce n’est pas parce qu’il est utile que le marché sait s’organiser lui-même en évitant de produire des dégâts considérables. »
DEUXIÈME PARTIE – UNE SENSIBILITÉ ACCRUE DES ÉCONOMIES AUX EFFETS NÉFASTES DES PHÉNOMÈNES SPÉCULATIFS
I.– LA FINANCIARISATION DE L’ÉCONOMIE MONDIALE : UN PROCESSUS QUI S’ACCÉLÈRE
Les effets de ce processus n’ont fait l’objet que de très rares analyses, notamment pour une raison que M. Jean-Hervé Lorenzi, professeur d’économie à l’université de Paris-Dauphine, président du Cercle des économistes a ainsi exposée devant la commission d’enquête: « (…) l’une des raisons pour lesquelles nous avons tant de mal à comprendre précisément ce qui s’est passé au cours des trois dernières années est la séparation entre, d’une part, les économistes du réel, qui examinent ce qui se passe sur les marchés des biens et services ou sur le marché du travail et, d’autre part, les économistes spécialisés dans l’analyse des marchés financiers (…). Les économistes du réel, dont je fais partie, sont assez étrangers à cet univers de la finance. » (100)
A.– UNE DÉCONNEXION CROISSANTE ENTRE L’ÉCONOMIE FINANCIÈRE ET L’ÉCONOMIE RÉELLE
Nombre des personnes entendues par la commission d’enquête ont mis l’accent sur la déconnexion croissante entre l’économie réelle – la production et les échanges de biens et services – et la sphère financière, pourtant censée être à son service, qui brasse des masses sans commune mesure avec les richesses réelles. Existe-t-il toutefois des indicateurs permettant de mettre en évidence cette déconnexion ?
1.– Les indicateurs définis par le Centre national de l’information statistique
À la suite de la crise boursière de 1987, le Centre national de l’information statistique (CNIS) a défini quelques indicateurs de cette déconnexion.
a) Un ratio entre le PIB et le volume de transactions financières exorbitant
Ce ratio se fonde sur une approche quantitative. Il mesurerait l’ampleur de la sphère financière par rapport à la base réelle de l’économie fondée sur le PIB.
En 2007 – soit juste avant la crise financière – le volume des transactions financières était, selon la Banque des règlements internationaux, douze fois plus élevé que le PIB mondial : 700 000 milliards de dollars contre 60 000 milliards de dollars. En dynamique, le volume des transactions financières a crû cinq fois plus vite que le PIB mondial depuis 1950. Il est certes difficile de déterminer quel est le « bon » niveau de ces ratios. Cependant comme l’observait Joan Robinson (101), collègue de Keynes à Cambridge, « même si on ne sait pas définir un éléphant, lorsqu’il est dans la pièce, on le reconnaît ».
b) Un coefficient de capitalisation des bénéfices trop élevé, signe d’une croyance dans une croissance infinie
Le coefficient de capitalisation des bénéfices ou price earning ratio d’une action est égal au rapport du cours de cette action sur le bénéfice par action. On l’appelle également multiple de capitalisation des bénéfices.
Il dépend essentiellement de trois facteurs : la croissance future des bénéfices de la société concernée, le risque associé à ces prévisions et le niveau des taux d’intérêt.
Par exemple, entre 1995 et 2000, époque de la bulle Internet, certaines start up – dont on avait la certitude qu’elles croîtraient fortement – avaient un price earning ratio de 300 ou 400, c'est-à-dire que le cours capitalisait 300 ou 400 fois le bénéfice annuel. Un tel chiffre est un signe d’euphorie, manifestement déraisonnable, qui conduit à s’interroger sur le caractère rationnel de certaines décisions des acteurs de marché.
c) Un rapport entre les contrats sur instruments dérivés et le PIB en augmentation tendancielle
En 2007, selon le Banque des règlements internationaux, l’encours des produits dérivés, qui avait doublé depuis 2005 pour atteindre 620 000 milliards de dollars, représentait plus de dix fois le PIB mondial.
Depuis 2007 la crise financière a interrompu cette montée tendancielle. Il reste que l’encours des produits dérivés s’établissait à 605 000 milliards de dollars à la fin de l’année 2009. De plus, les marchés de gré à gré représentent toujours les neuf-dixièmes du total des marchés des instruments dérivés, ce qui laisse peu de place aux marchés organisés.
L’appétence pour ces marchés de gré à gré – ou over the counter (OTC) – résulte du fait que la finance mondiale veut des contrats sur mesure qu’elle ne trouve pas toujours sur les places de marché organisées.
d) Dans ces conditions, se dessine une économie plus financiarisée
Si la part du secteur financier dans le PIB européen reste modeste, on peut noter que dans certains pays, il a pris une part considérable, pouvant atteindre un quart du PIB au Luxembourg, par exemple, et 7,4 % en Irlande, ce facteur n’étant d’ailleurs pas sans incidence sur la crise qui secoue le pays à l’automne 2010.
ESTIMATION DE LA PART DU SECTEUR FINANCIER DANS LE PIB EN 2009
(en %)
Allemagne |
1,3 |
France |
1,4 |
Grèce |
0,3 |
Irlande |
7,4 |
Luxembourg |
24,5 |
Royaume Uni |
4,9 |
UE 27 |
2,0 |
Source : Eurostat.
2.– Le marché des changes traduit également cette déconnexion
Selon le dernier rapport (102) de la Banque des règlements internationaux, les volumes négociés chaque jour sur le marché mondial des changes atteignent 4 000 milliards de dollars, ce qui signifie qu’en quatre jours, ces marchés voient circuler l’équivalent de la valeur des exportations mondiales annuelles de marchandises et de services commerciaux, qui avoisinent les 16 000 milliards de dollars, alors même que la justification de ces transactions financières est avant tout d’accompagner les échanges de biens et services.
3.– Le cas éclairant du marché pétrolier : l’explosion de la sphère financière
Si le troisième choc pétrolier de la fin des années 2000 était fondé, au départ, sur un déséquilibre réel entre une offre limitée et l’explosion de la demande, il a été très fortement accru par la montée de la sphère financière depuis le milieu de l’année 2008 : les fondamentaux physiques comme les nouveaux marchés financiers du pétrole poussent à des tensions fortes sur les cours et induisent des risques systémiques difficilement contrôlables. En 2008, sur les marchés organisés du pétrole aux États-Unis les agents non commerciaux représentaient plus de 50 % des positions ouvertes sur les marchés des contrats à terme (futures) du pétrole, contre 20 % avant 2002. Avec l’intervention des swaps dealers, des hedge funds et des traders, la proportion dépasse aujourd’hui 80 %. L’introduction des instruments dérivés a, par ailleurs, modifié les modalités de fixation des prix du pétrole brut : le prix de la matière première est désormais fixé en référence au prix des futures, avec donc une forte interaction entre la sphère financière et le prix du brut acheté sur le marché physique. Sur les marchés dérivés, la croissance des contrats à terme négociés sur le Nymex (New York mercantile exchange, bourse de l’énergie et des métaux) a été de 70 % de 2006 à 2007, auxquels il faut ajouter les contrats négociés sur l’ICE de Londres, les contrats sur les autres types de pétrole brut et les produits raffinés, sans compter les contrats passés sur les marchés de gré à gré.
Le développement des produits dérivés financiers, créés pour répondre à un besoin de couverture, s’est appuyé sur la multiplication des plates-formes d’échange et des marchés de gré à gré (over the counter – OTC), sans transparence et non régulés.
Pour le pétrole, le volume des transactions sur les marchés financiers du pétrole brut et des produits pétroliers représente aujourd’hui à peu près trente-cinq fois celui de la sphère du pétrole physique.
En ce qui concerne la part de la spéculation, le rapport précité de M. Jean-Marie Chevalier avance que le déterminant principal du prix étant l’anticipation des professionnels et des investisseurs sur les équilibres à venir, les stocks, la flexibilité du raffinage, la spéculation est liée à la structure des marchés qui sont eux-mêmes porteurs de volatilité. Celle-ci a été exceptionnelle sur la période 2008-2009. En effet, alors que le prix moyen du baril sur la période
1988-2009 était de 32 dollars, il a atteint 145 dollars en juillet 2008, pour retomber à 36 dollars en décembre 2008 et remonter à 80 dollars en 2009-2010. Ainsi que l’a rappelé M. Christian de Boissieu, professeur à l’Université de Paris I (103), devant la commission d’enquête, ces mouvements de prix seraient typiques d’un phénomène de bulle.
La question reste cependant controversée. Il faut noter que la période de forte hausse des prix coïncidait, paradoxalement, avec une phase où les capacités de production étaient en expansion et la demande décroissante. La progression, constatée, des « positions longues », caractéristique d’une anticipation de hausse des cours, est en corrélation avec la hausse des prix. À l’inverse l’absence apparente de stockage spéculatif ne permet pas de conclure que la spéculation est la cause principale de la hausse du pétrole dans les années 2000.
Le rapport de M. Jean-Marie Chevalier conclut qu’il est impossible d’ignorer la relation entre les positions ouvertes des agents financiers sur le pétrole et la volatilité des prix, en clair, l’influence de la spéculation, et préconise le renforcement de la régulation des marchés de produits dérivés du pétrole.
B.– UNE SURABONDANCE DE LIQUIDITÉS EN QUÊTE D’OPPORTUNITÉS
1.– La surabondance de liquidités alimente les bulles spéculatives
Le ratio entre la base monétaire (104) et le PIB en valeur n’a cessé d’augmenter et ce, de manière quasi linéaire entre 1996 et 2009 passant de 8 à plus de 15.
RATIO ENTRE LA BASE MONÉTAIRE ET LE PIB EN VALEUR
(EN % - MONDE)

Dans le même temps, alors que selon la théorie économique classique, cette écart aurait dû générer une forte inflation, celle-ci a été quasi nulle excepté sur une courte période entre 2006 et 2007 – période où l’on voit d’ailleurs le ratio légèrement diminuer.
L’absence d’inflation s’explique par la mondialisation des échanges. Selon M. Patrick Artus, directeur de la recherche et des études économiques de Natixis, « le lien entre monnaie et inflation n’est pas automatique. La création de monnaie ne se transforme en inflation que si elle fait augmenter la demande de biens, et que l’offre ne peut pas suivre la demande. Or, avec la mondialisation, la production de biens est devenue extraordinairement flexible. En revanche, l’offre d’actifs est bel et bien rigide. L’inflation s’est donc transférée des biens vers les actifs : le stock d’actions, de maisons qui sont en quantité limitée à court terme… Le taux d’utilisation des capacités de production est de 60 % en Chine ; il y a de la marge avant d’arriver à saturation (105)».
Les deux graphiques ci-après montrent bien que cette augmentation de la masse monétaire a généré de l’inflation non pas sur les biens mais sur les actifs : actions et immobilier.
BOURSES MONDIALES ET ÉMERGENTES EN DOLLAR
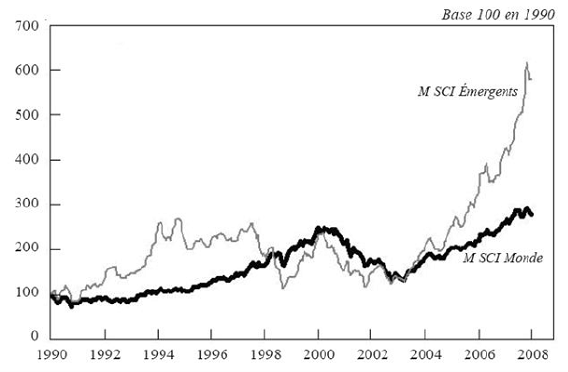
ÉVOLUTION DES PRIX DE L'IMMOBILIER
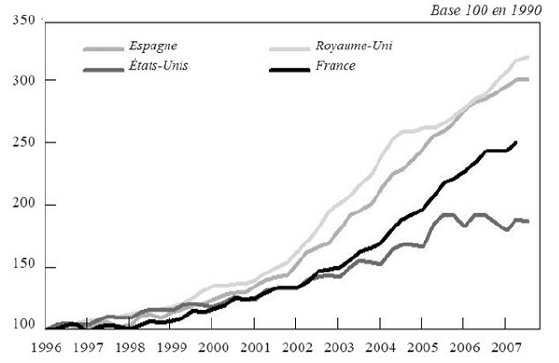
Source : Conseil d’analyse stratégique.
C’est donc la surabondance de liquidités qui est le carburant nécessaire à la formation de plus en plus rapprochée de bulles dont l’éclatement provoque des crises à répétition.
Pour illustrer la nocivité de l’excès de liquidités, M. Edouard Tétreau, auteur du livre Analyste : au cœur de la folie financière, a affirmé devant la commission d’enquête que les banques « ont argué d’un besoin vital pour l’économie d’assurer la liquidité sur les marchés pour obtenir un plan de sauvetage aux États-Unis et en Europe ; mais au lieu d’allouer cette masse de liquidité à l’économie réelle, elles se sont empressées de la rediriger vers les activités spéculatives. Il faut dire que pour certaines banques de marché, les retours sur investissement étaient de 40 voire 70 % entre 2006 et 2007, pouvant même atteindre un pic supérieur à 100 % : à part le trafic de drogue, aucune autre activité n’offre de tels rendements ! (…) Où va cette liquidité ? L’injecter dans l’économie réelle n’intéresse plus les banques, car les marges sont plus attractives côté des hedge funds ou des activités à fort effet de levier (106) »
2.– Mais l’injection de liquidités est considérée comme la seule réponse possible à court terme, même si son efficacité est douteuse.
M. Patrick Artus, directeur de la recherche et des études économiques de Natixis, a décrit de façon très précise devant la commission d’enquête le dilemme de l’administration américaine :
« La réalité américaine, ce sont 12 millions d’Américains en faillite à cause de leurs crédits immobiliers, devenus plus chers que leurs maisons, et 45 % des demandeurs d’emploi qui sont maintenant des chômeurs de longue durée parce que leurs qualifications ne leur permettent pas de retrouver un travail, en raison de la destruction de 50 % des emplois dans la construction et de 30 % dans l’industrie. Vous aurez beau injecter toute la liquidité que vous voudrez – et les banques américaines n’en manquent pas, avec leurs 1 000 milliards de dollars de cash –, vous n’y changerez rien. Le problème, comme chez nous, c’est l’économie réelle : inadaptation des formations aux emplois qui se créent et insolvabilité des ménages surendettés. Le remède ne réside pas dans la création monétaire, d’autant que l’argent va se placer dans les pays émergents. L’effet est nul. D’ailleurs, les Américains le reconnaissent plus ou moins. C’est une politique par défaut : l’administration ne peut plus utiliser l’arme budgétaire à cause du déficit public – 11 % du PIB – ni celle des taux – ils sont à 0,25 %. Comme elle ne veut pas ne rien faire, il ne lui reste plus que l’injection de liquidité, mais ce sera vain (107). »
La surabondance de liquidités est la conséquence de plusieurs facteurs convergents :
– un environnement de taux d’intérêt très favorables qui perdure depuis plusieurs années ;
– un accès au crédit très ouvert notamment aux États-Unis afin de soutenir la consommation intérieure dès lors que les salaires n’augmentent plus du fait de la concurrence internationale, résultat selon M. Michel Aglietta, conseiller au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII), de « l’extension fantastique du marché du travail, avec l’entrée de la Chine et de l’Inde dans l’économie mondiale : l’offre de travail est devenue élastique, l’augmentation des salaires s’est trouvée bloquée du fait de la concurrence venant du monde entier, il s’en est suivi la déformation du partage des revenus… Les ménages ont donc baissé leurs taux d’épargne (jusqu’à zéro aux États-Unis) et augmenté leur endettement pour compenser des revenus qui ne croissaient pas assez vite (108) ». Comme l’a souligné notre collègue M. Paul Giacobbi, au cours d’une audition de la commission d’enquête, « les prêteurs avaient perdu de vue la capacité de remboursement des emprunteurs et s’étaient convaincus que la valeur des biens immobiliers financés augmenterait quoi qu’il arrive ; d’où les crédits NINJA – no job, no income, no asset – attribués à des gens qui n’avait rien… Bernanke ou Greenspan considéraient que la meilleure façon de guérir l’alcoolisme était de continuer à servir à boire (109) » ;
– la globalisation des opérateurs financiers qui met en concurrence les pourvoyeurs de crédit.
Ces mouvements de liquidités sont grégaires et extrêmement volatils. Ils jouent donc un rôle procyclique dans la formation des bulles et dans leur éclatement.
Ainsi, entre 1995 et 2000, les liquidités se sont massivement portées sur l’économie virtuelle et l’Internet avant de s’en retirer au premier signe de fragilité, accélérant l’éclatement de la « bulle Internet ». Elles se sont ensuite reportées sur l’immobilier, créant une nouvelle bulle aux États-Unis, mais aussi en Irlande et en Espagne.
Actuellement, l’économie mondiale est en situation de forte aversion pour le risque. La liquidité en surabondance ne gonfle donc plus autant qu’auparavant le crédit et les prix des actifs risqués, et est transférée vers la détention d’actifs liquides et monétaires et de titres publics alors même que les taux de financement des États comme l’Allemagne et la France sont à un niveau historiquement bas.
Dans ce contexte, les récentes décisions tendant à injecter de nouvelles liquidités dans l’économie prises par la Réserve fédérale des États-Unis (Fed) ne laissent pas d’être préoccupantes.
Quantitative easing : une avalanche de liquidités La reprise économique reste erratique aux États-Unis : stagnation du marché immobilier, consommation atone et exportation insuffisante. La croissance américaine au troisième trimestre, selon les chiffres publiés par l’administration américaine, n’a été que de 2 % en rythme annuel ce qui est largement insuffisant pour permettre une décrue du chômage qui atteint 9,6 % de la population active au 30 septembre 2010 (110). À ces chiffres alarmants s’ajoute une inflation de 0,8 %, bien en deçà de la cible fixée autour de 2 %. L’économie américaine est donc menacée d’une spirale déflationniste – la baisse des prix entraînant une baisse des salaires décourageant la consommation et l’investissement – dont elle aurait beaucoup de mal à s’extraire. Les déficits budgétaires abyssaux – 1 294 milliards de dollars au 30 septembre 2010 – interdisant un nouveau plan de relance et le taux d’intérêt historiquement bas à 0,25 % ne permettant plus d’agir sur ce levier, la Réserve fédérale (Fed) n’a plus qu’une seule option : la création monétaire ou le quantitative easing (QE2). La Fed a donc annoncé le 3 novembre 2010 l’acquisition pour 600 milliards de dollars de bons du Trésor en huit mois. Il s’agit d’un recours à la « planche à billets » sans précédent après les rachats de 1 700 milliards de dollars au plus fort de la crise. La Fed souhaite encourager le crédit en vue de stimuler l’investissement et la consommation. Elle vise également à faire remonter les prix afin d’éviter à la déflation de s’installer. Il y a fort à craindre cependant que ces efforts soient vains. Le sous-investissement ne s’explique pas par un manque de liquidité mais par un manque de confiance. La politique de QE2 ne relancera donc pas l’activité économique mais ira gonfler les réserves de liquidité. De plus, ces liquidités continueront à rechercher des opportunités et iront massivement se placer sur une nouvelle catégorie d’actifs générant une nouvelle crise financière. En outre, l’inflation est le résultat d’une augmentation de la demande et d’une offre rigide. Or, l’offre de biens et de services n’est pas rigide du fait de la mondialisation et de la libéralisation du commerce donc il n’y a que peu de chance d’éviter une déflation grâce à la politique de QE2. En outre, si cette politique n’aura que peu d’incidence positive, elle n’est pas dénuée de risque pour le reste du monde. Suite à l’annonce de M. Ben Bernanke, directeur de la Fed, l’euro s’est apprécié, atteignant 1,42 dollar, handicapant d’autant les exportations européennes hors de la zone euro. La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie Mme Christine Lagarde a regretté avec raison que « l’euro porte le poids » de la décision de la Fed. Cette politique entraînant également une appréciation des monnaies des pays émergents et en premier lieu du réal brésilien et du yuan chinois, ces pays risquent de procéder à une politique de contrôle de capitaux et d’intervention sur le marché des changes. L’euro étant encore une fois la variable d’ajustement. |
En effet, il apparaît que ces masses de liquidités ne vont guère alimenter la croissance de l’économie réelle, quand elles ne reviennent pas, purement et simplement, à la banque centrale. Selon M. Jean-Claude Gruffat, directeur général de Citigroup, « Paradoxalement, quand les grandes banques centrales, au premier rang desquelles la Fed, injectent de la liquidité dans l’économie, les banques redéposent cette liquidité dans les banques centrales. À titre d’exemple, le dépôt de Citigroup auprès des banques centrales s’élève en permanence à 250 milliards de dollars. Le rôle des banques est-il de prêter aux banques centrales ? » (111).
Les banques centrales ne doivent pas se voiler la face, mais doivent s’interroger sur leurs responsabilités dans les phénomènes spéculatifs. Ainsi que l’a souligné devant la commission d’enquête M. Patrick Artus, directeur de la recherche et des études économiques de Natixis : « À la fin du programme Quantitative Easing 2, la Réserve fédérale aura créé, de 2008 à juin 2011, trois fois plus de monnaie qu’entre sa fondation et 2008. Cela donne une idée de l’ordre de grandeur du phénomène et il est évident qu’il faut y voir une des causes profondes de la crise. On peut incriminer les spéculateurs, le trading pour compte propre dans les banques, l’effet de levier des hedge funds, le comportement mimétique des investisseurs, mais c’est la liquidité déversée à profusion par les banques centrales qui leur a permis à tous de s’endetter. Pourtant, les banques centrales n’ont jamais mis en cause leur action. La BCE ne s’est même pas posé la question, focalisée qu’elle est sur les objectifs d’inflation – et dès lors que ceux-ci sont respectés, les prix de l’immobilier peuvent bien augmenter de 15 % par an ! » (112)
C.– UNE CRISE DE L’ENDETTEMENT PRIVÉ TRANSFORMÉE EN CRISE DE L’ENDETTEMENT PUBLIC QUI INQUIÈTE LES MARCHÉS
1.– Les mesures de soutien et les plans de relance étaient nécessaires pour éviter un effondrement des économies
Face à la crise financière, les mesures de soutien au secteur financier ont été massives : leur montant cumulé aurait atteint quelque 14 000 milliards de dollars, près du quart du PIB mondial, pour les États-Unis, le Royaume-Uni et la zone euro, selon une étude publiée en novembre 2009 par la Banque d’Angleterre (113).
Dans l’Union européenne, les mesures que les gouvernements ont dû prendre pour venir en aide aux établissements bancaires en grande difficulté (augmentations de capital, sauvetages des actifs, garantie d’actif et de passif et maintien de la liquidité) ont permis d’éviter l’effondrement du système financier puis de le stabiliser.
Mais elles ont un coût énorme pour les finances publiques : les engagements pris par les autorités des États membres représentaient, à la fin de l’année 2009 – mais le compteur tourne encore, notamment du fait de la crise irlandaise – quelque 30 % du PIB de l’Union, l’aide effectivement utilisée en représentant environ 13 %.
En outre, la crise économique consécutive à la crise financière a profondément affecté les économies des pays développés bien que de manière très différenciée. La France a été moins touchée que d’autres pays européens en raison notamment de l’importance de ses stabilisateurs automatiques – importance de la fonction publique et des transferts sociaux – et de son absence de spécialisation sectorielle. La baisse du PIB y a été de 2,5 % en 2009 contre 4,2 % pour l’ensemble de la zone euro et 0,5 % aux États-Unis.
En conséquence et contrairement à ce qui s’était produit dans les années 1930, les États ont réagi de manière coordonnée et rapide : des mesures de soutien budgétaire importantes – le plan de relance français a représenté 35 milliards d’euros et le plan de relance américain 787 milliards de dollars – ont été adoptées, tandis que les banques centrales ont abaissé leur taux d’intérêt
– la Fed a baissé son taux directeur de 5 % en 2007 à 0,25 % aujourd’hui, tandis que la BCE abaissait le sien de 4,25 % à 1 % à partir de 2009 – et l’importance du libre-échange a été réaffirmée.
2.– Mais ils ont creusé les déficits et accru les dettes publiques
Ces mesures étaient nécessaires pour éviter un effondrement généralisé des économies. Elles ont eu néanmoins des effets pervers, principalement l’explosion des déficits et des dettes publiques – la dette publique dans l’Union européenne s’élève à 85 % du PIB ; elle est de 83 % du PIB en France, soit un niveau équivalent à la dette publique américaine – et l’aggravation de l’excès de liquidité susceptible de créer de nouvelles bulles sur d’autres catégories d’actifs.
La crise des finances publiques a ainsi succédé à la crise des finances privées. En effet, de sérieux doutes ont commencé à apparaître sur la capacité de certains États lourdement endettés à honorer leur signature. Les conditions d’emprunt se sont alors durcies parfois à la suite de la dégradation de la note par les agences de notation mais aussi, dans une certaine mesure, en conséquence de mouvements spéculatifs sur les produits dérivés adossés à la dette souveraine, puis affectant l’euro.
M. Jean-Claude Gruffat, directeur général de Citigroup France a clairement exposé, devant la commission d’enquête, quelle était l’opinion des marchés face à cette situation : « Ces dettes sont-elles remboursables ? Cette question nous renvoie à celle de la spéculation. S’il existe une spéculation sur les dettes des États, c’est parce que l’on perçoit une vulnérabilité croissante de
ceux-ci, qui, à quelques exceptions près, ont vu leur endettement aggravé par leurs déficits structurels puis par la crise. La situation ne peut être réglée par les méthodes traditionnelles, à savoir l’inflation, la dévaluation ou la croissance. L’inflation est faible, la dévaluation est exclue. Pour ce qui est de la croissance (…) des études menées en particulier par les économistes de Citigroup indiquent que, pour revenir à la règle de 3 % de déficit public, les États devraient générer d’ici à 2030 un surplus budgétaire annuel de l’ordre de 4 % avant paiement des intérêts de la dette ! Faute donc de pouvoir compter sur les méthodes traditionnelles, on n’échappera pas à des phénomènes de « restructuration », étant entendu que le terme « défaut » est banni du vocabulaire – la distinction entre les deux reposant sur le fait que le défaut se définit par son caractère unilatéral alors que la restructuration implique une décision bilatérale. » (114)
Pour éviter d’atteindre le point où la dette ne sera plus maîtrisée, la plupart des pays européens, et notamment la France, ont engagé une politique budgétaire restrictive qui risque de retarder la reprise, la demande privée n’étant pas encore susceptible de prendre le relais de la demande publique.
II.– DES ACTEURS, DES OUTILS ET DES MÉCANISMES AGGRAVANT LES EFFETS NÉFASTES DE LA SPÉCULATION SUR DES MARCHÉS INSUFFISAMMENT RÉGULÉS
A.– DES ACTEURS PEU OU MAL ENCADRÉS
1.– Les fonds alternatifs : une nébuleuse d’intervenants dont la raison d'être est la spéculation
La gestion alternative est un mode de gestion de portefeuille appliqué par certains fonds d’investissement dits « fonds alternatifs » dont les plus connus sont les « fonds de couverture », ou hedge funds (115). La définition économique de ceux-ci est difficile. « On ne peut en effet qu’en indiquer les caractéristiques – jeu contracyclique, utilisation de méthodes telles que le short selling [vente à découvert] pour obtenir la meilleure rentabilité en prenant le moins de risques possible » (116).
Du point de vue juridique, la notion de « fonds alternatifs » recouvre tous les fonds d’investissement qui ne sont pas régis par les directives dites « OPCVM » (117). La Commission européenne a proposé de fixer par un texte unique le régime de tous les gestionnaires de fonds alternatifs, et notamment ceux de deux catégories de fonds très différentes : les fonds de capital-investissement et les hedge funds.
Les fonds de capital-investissement (« private equity ») investissent dans des sociétés en les achetant pour les revendre à un prix plus élevé (cf. ci-après 4, b)) ; les fonds de couverture (hedge funds) sont des véhicules d’investissement qui exploitent les imperfections des marchés afin d’obtenir des retours sur investissement même lorsque les marchés sont moins performants.
Les caractéristiques communes de tous ces types de fonds sont : la recherche de très forts rendements décorrélés des évolutions des marchés, une liberté totale de style de gestion, l’utilisation de la vente à découvert (118), le recours intensif à des effets de levier (119), une rémunération de leurs gérants basée sur la performance. Ils visent en particulier à optimiser les performances de leur portefeuille d’actifs en intervenant sur les différents marchés : actions, obligations, devises, matières premières, immobilier. Les hedge funds jouent un rôle économique positif en offrant aux investisseurs une source de diversification des risques, et comme pourvoyeurs de liquidités.
La surface financière de ces fonds est variable, mais chacun des cinq plus importants du monde dispose d’actifs allant de 26 milliards de dollars à plus de 38 milliards de dollars pour le plus important d’entre eux, Bridgewater Associates (120). Localisés pour la plupart dans des « paradis fiscaux », les hedge funds ont souvent été accusés de déstabiliser les marchés par leurs stratégies opaques ou par leur quête de gains rapides. Ces fonds ont, en effet, joué un rôle non négligeable dans les attaques spéculatives sur les taux de change, accélérant et aggravant par exemple la crise au Mexique en 1992 ou la crise asiatique en
1997-1998, contribuant certes à ramener le taux de change à un niveau reflétant mieux les équilibres macroéconomiques, mais de manière brutale. Bien que ces fonds n’aient pas été déterminants pour le déclenchement de la crise financière de 2008, certains économistes considèrent qu’ils ont pu l’aggraver. Le rapport présenté en février 2009 par le groupe de travail présidé par M. Jacques
de Larosière sur la supervision financière dans l'Union européenne estime, pour sa part, qu’ils n’ont pas joué un rôle majeur dans le déclenchement de la crise de 2008, mais qu’ils ont joué un rôle de transmission, notamment par la cession massive d’actifs et par des ventes à découvert.
Selon M. Bertrand Jacquillat, président directeur général d’Associés en Finances, il ne faut effectivement ni s’exagérer le rôle des hedge funds, dont les profits demeurent quantitativement marginaux, ni les diaboliser, car ils contribuent à la définition du « juste prix » sur les marchés. Il a ainsi rappelé devant la commission d’enquête que : « Steve Ross, professeur au MIT, emploie à propos de l’efficience des marchés une autre image que celle de la « main invisible » qui, selon Hayek, ferait converger les prix vers la valeur fondamentale : il compare les noise traders, qui par leur comportement polluent les prix, à des milliers de « brebis erratiques, peu informées, peu rationnelles » achetant et vendant un peu au hasard en Bourse ; ce qui fait la justesse des prix, ce n’est pas le fait que les brebis, sous l’effet d’une inspiration collective, restent dans le droit chemin – et se substituent à la machine à calculer géante de Hayek –, mais le fait que les loups sautent sur les brebis quand elles s’écartent trop du chemin. D’après les calculs de Steve Ross, le rapport entre les profits dégagés par tous les hedge funds qui investissent dans les marchés d’actions et la capitalisation boursière des sociétés cotées aux États-Unis n’est que de 1 %. Les hedge funds ont une utilité parce qu’ils sont les loups qui sautent sur les brebis ; ils sont les seuls à s’efforcer de détecter, dans la limite de leurs règles de fonctionnement, les écarts de prix par rapport à ce que seraient les valeurs fondamentales. » (121).
En tout état de cause, de tels établissements, ne bénéficiant pas de dépôt
– et c’est heureux –, peuvent être très vulnérables lorsque la liquidité disparaît, avec des conséquences de grande ampleur pour l’économie réelle.
Les fonds alternatifs étaient, jusqu’à présent, peu réglementés, ce qui leur a permis de réaliser des investissements et de prendre des risques que les autres acteurs ne peuvent pas prendre.
Certains fonds très performants sont aussi très opaques et cette faible transparence peut dissimuler des pratiques extrêmement risquées. De plus, le développement des placements en fonds alternatifs leur fait jouer un rôle d’aiguillon : de plus en plus de gérants sont à la recherche des mêmes opportunités d’investissements en disposant de beaucoup plus de liquidités que par le passé, générant ainsi un risque systémique.
La crise financière a soulevé la question de la réglementation de ces acteurs du système financier.
Dès le 23 septembre 2008, le Parlement européen a adopté une résolution sur les fonds alternatifs, exigeant de la Commission européenne qu’elle présente rapidement une ou plusieurs propositions législatives « couvrant tous les acteurs et participants pertinents des marchés financiers, y compris les fonds alternatifs ». Cette résolution résulte d’une initiative du Parlement européen lui-même, avec un rapport d’initiative de M. Poul Nyrup Rasmussen (PSE - Danemark).
Le G20, lors du Sommet de Londres du 2 avril 2009, a, pour sa part, décidé « d’étendre la régulation et la surveillance à tous les instruments et à tous les marchés d’importance systémique. Cela inclura, pour la première fois, les fonds spéculatifs d’importance systémique. ».
Ce « chantier » reste en cours et les hedge funds ont encore quelques beaux jours devant eux, compte tenu notamment des périodes de transition prévues par le texte récemment adopté (cf. troisième partie, III, A).
2.– Les agences de notation : un pouvoir exorbitant
Les agences de notation financière sont des entreprises privées qui apprécient le risque de solvabilité financière d’une entreprise, d’un État, d’une collectivité publique ou les risques d’une opération financière.
Le rôle de ces agences est d’évaluer le risque de non-remboursement des emprunts que contracte l’emprunteur. À cette fin, elles construisent des scénarios financiers prévisionnels et évaluent la probabilité que chacun de ces scénarios se réalise à partir de l’examen de la structure future des coûts et des revenus de l’emprunteur. Pour une entreprise, elles prennent en compte notamment les perspectives d'activité et de développement. Pour un État les critères sont les perspectives de croissance, ses prévisions de recettes, notamment fiscales, et l’évolution prévisible de ses dépenses compte tenu de sa politique budgétaire.
Le marché de la notation présente les caractéristiques d'un oligopole : trois agences contrôlent plus de 90 % du marché mondial ; il s'agit de deux groupes américains, Standard & Poor’s et Moody’s, qui, à eux deux, s'adjugent près de 80 % du marché, et une agence à capitaux français, Fitch, qui en représente un peu plus de 10 %. Ces agences ont élaboré des systèmes de notation relativement proches, les notes s’établissant de A à D avec des échelons intermédiaires
(+ ou – ; 1 ou 2).
Plus la note est élevée, plus le risque est faible. Les notes AAA traduisent une bonne solvabilité, les notes BBB correspondent à une solvabilité moyenne, les CCC signalent un risque très important de défaillance, la note D sanctionnant une situation de faillite.
La crise des subprimes a mis en lumière l'importance du rôle des agences de notation et entraîné bien des interrogations et des soupçons tant sur les conflits d'intérêts susceptibles d'affecter leurs notations que sur la qualité de notes dont l'influence sur les marchés est considérable.
Sous l’impulsion de la présidence française du second semestre 2008, l’Union européenne avait décidé, dès juillet 2008, d’instaurer par voie législative un enregistrement et une supervision des agences de notation. Un projet de règlement a été adopté en 2009. Au niveau international, l’Union européenne a obtenu, lors du G20, le principe d’un enregistrement systématique des agences de notation et d’une publication de leurs performances, ainsi que l’obligation de respecter le « code de conduite » établi par l’Organisation internationale des commissions de valeur (OICV). Au niveau européen, les travaux se poursuivent.
a) Des méthodes de notation défaillantes alimentant des soupçons de conflits d’intérêts
Cause majeure de la crise des subprimes, les agences de notation ont réduit la perception par les investisseurs du risque de crédit en donnant les meilleures notes de leur échelle de notation (AAA) aux tranches supérieures (senior) des produits financiers structurés tels que les obligations adossées à des actifs (collateralized debt obligation – CDO), soit la même note que celle donnée aux obligations classiques des États et des entreprises.
Cette sous-estimation des risques de défaut liés aux produits adossés à des subprimes s'explique dans une large mesure par des défaillances de méthode. Le rapport du groupe de travail sur la supervision financière dans l'Union européenne présidé par M. Jacques de Larosière pointe ainsi « le manque de données historiques concernant le marché subprime des États-Unis, la sous-estimation des corrélations entre les défauts qui risquent de se produire en période de récession et l'incapacité de prendre en compte le relâchement significatif des normes de souscription de la part de certains émetteurs », tous éléments ayant contribué à des erreurs manifestes dans la notation des produits structurés pour les années ayant précédé la crise.
En outre, les agences de notation ont tardé à corriger ces appréciations surévaluées, ainsi que l’a souligné M. Michel Aglietta, conseiller au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII) : « Alors que les prix de l’immobilier baissaient depuis l’automne 2006 mais que l’on continuait à titriser abondamment, [les agences de notation] n’ont dégradé massivement les crédits qu’en avril 2007 » (122) Il convient de se demander la raison d’un tel retard dans la prise de conscience de la dangerosité et de la fragilité des crédits subprime. En tout état de cause, ces constatations ont amené les pouvoirs publics à se pencher sur le rôle des agences de notation, d'autant qu’elles s’accompagnaient de soupçons de conflit d'intérêts.
En effet, depuis les années 1970, les agences de notation ne sont plus rémunérées par les investisseurs qui utilisent la notation dans leur stratégie d’investissement, mais par les émetteurs des produits soumis à notation. D’où le risque de conflit d’intérêt, les agences pouvant être tentées de fournir à leurs clients des notations accommodantes ou complaisantes.
Ce modèle économique de l'« émetteur-payeur » paraît avoir eu des effets particulièrement néfastes dans le domaine de la finance structurée. Dès lors que les produits structurés sont conçus pour tirer profit des différents degrés d'aversion au risque des investisseurs, ils sont structurés de manière à ce que chaque tranche obtienne une note spécifique. Or, il n'était pas rare que les implications de la notation des différentes structures soient débattues entre l'émetteur et l'agence de notation. Selon le rapport du groupe de travail présidé par M. Jacques de Larosière, « les émetteurs ont fait le tour des agences pour s'assurer d'obtenir une note AAA pour leurs produits ».
M. Jean-Pierre Jouyet, président de l'Autorité des marchés financiers, a, en outre, rappelé un épisode, remontant au printemps dernier, qui ne laisse pas d'alimenter le soupçon : « Certaines pratiques, comme la dégradation de la note de l’Espagne quinze minutes avant la clôture des bourses, sont inacceptables. Les agences doivent faire preuve d’à-propos » (123).
Cette question a fait l’objet de l’échange suivant au cours de l’audition par la commission d’enquête, le 17 novembre 2010, des responsables de l’une des grandes agences de notation :
ANNONCE DES CHANGEMENTS DE NOTE « M. le président Henri Emmanuelli. Le président de l’Autorité des marchés financiers a exposé à la Commission d’enquête avoir trouvé anormale la dégradation de la note de l’Espagne par une agence un soir à 17 heures 45. Qu’en pensez-vous ? Mme Carol Sirou (124). Nos procédures sont très claires. Dès lors qu’un comité a pris une décision, nous en informons l’émetteur. Aux termes du règlement européen actuel, en vigueur depuis le 7 septembre, l’émetteur doit ensuite disposer d’au moins douze heures pour faire, s’il le souhaite, des commentaires sur des éléments factuels. Ensuite, nous publions la notation. L’objectif est une information des marchés aussi rapide que possible. C’est le facteur temps qui a fait que l’annonce du changement de notation de l’Espagne a été publiée juste avant la clôture des marchés. M. Jean-Michel Six (125). Ou plutôt avant la clôture des marchés européens. Les marchés américains étaient encore ouverts. Les marchés asiatiques s’apprêtaient à ouvrir. La difficulté est qu’au-delà des douze heures, les risques de fuites – de la part de l’émetteur – sont réels. Nous ne pouvons donc pas continuer à garder pour nous une décision qui vient d’être prise. M. le président Henri Emmanuelli. Venez-vous de dire qu’attendre le lundi matin n’était pas possible ? M. Jean-Michel Six. Nous n’étions pas un vendredi. Mme Carol Sirou. C’était un mercredi, je crois. M. Jean-Michel Six. Pour autant, eu égard aux critiques qui nous ont été faites à la suite de cet épisode très particulier, nous avons décidé de nous efforcer de ne pas publier nos décisions au-delà d’une heure avant la fin des marchés européens. Il reste que les risques de fuites susceptibles de perturber les marchés ne doivent pas être sous-estimés. » |
Il est clair que la question du moment choisi par les agences de notation pour modifier une note, et notamment celle d’une dette souveraine, ne doit pas être laissée à la libre appréciation de celles-ci et qu’un engagement oral n’est pas suffisant. Les agences doivent faire preuve d’à propos et cela pourrait faire l’objet d’une règle qui compléterait utilement le règlement européen.
b) L’incohérence du processus de formation de la note et une forte dépendance des investisseurs par rapport à la notation
Lors de son audition par la commission d'enquête, M. Jean-Pierre Jouyet, président de l'Autorité des marchés financiers, a, dans une formule synthétique, exprimé des exigences reflétant bien les reproches communément adressés aux agences de notation « Le processus de formation de la note doit être cohérent, transparent et stable » (126).
S’agissant plus particulièrement de la dette souveraine, il a mis en lumière des pratiques de notation dont les effets peuvent être dévastateurs : « il faut s’en tenir aux fondamentaux de l’économie. Si la notation prend en compte les hoquets du marché, elle risque d’entretenir un cercle vicieux : les dégradations de la note d’un État vont entraîner mécaniquement l’augmentation de son coût de financement, ce qui va amener l’agence de notation à dégrader à nouveau la note. C’est un peu ce qui s’est produit dans le cas de la Grèce » (127).
Les agences de notation jouent donc un rôle procyclique du fait d’une externalisation de l’expertise des investisseurs. Les investisseurs sont véritablement « intoxiqués » aux agences de notation. « Nombreux sont ceux qui les utilisent, y compris parmi les plus hautes autorités publiques. On peut [donc] difficilement reprocher au marché d’y recourir alors que la Banque centrale européenne l’a fait pendant très longtemps, ou que d’autres banquiers centraux leur délèguent l’appréciation des risques pour les actifs qu’ils acceptent en refinancement » (128). M. Augustin de Romanet, président de la Caisse des dépôts et consignations a souligné, pour sa part, que : « la communauté des gestionnaires d’actifs applique des normes qui imposent qu’un pourcentage x de leurs actifs bénéficie de la note AAA, un pourcentage y de la note AA, et un pourcentage z de la note A. Ainsi si une collectivité passe de la note AAA à la note AA, elle est aussitôt exclue de plusieurs milliers de portefeuilles d’actifs dans le monde. En d’autres termes, les conséquences de la dégradation d’un émetteur important, en particulier d’un émetteur souverain, sont systémiques : cette dépendance vis-à-vis des agences me paraît l’un des problèmes essentiels pour les années qui viennent » (129).
c) Une insuffisante responsabilité des agences
Face à leur mise en cause dans le déclenchement de la crise des subprimes, comme l’a souligné notre collègue M. Jérôme Chartier, « de nombreuses agences de notation ont défendu le point de vue de l’éditorialiste ne délivrant qu’un avis parmi d’autres. Cependant, imaginons que la vie politique mondiale soit analysée par 3 éditorialistes à l’écoute desquels seraient la totalité des électeurs, et qui auraient de surcroît une tendance à la convergence de point de vue. Chacun convient que leur impact resterait certes celui de l’éditorialiste sur la conscience individuelle, mais atteindrait un niveau considérable. Si comparaison n’est pas raison, rappelons néanmoins que les notations délivrées par les agences figurent dans la détermination des conditions de refinancement [comme nous l’avons vu] des acteurs auprès des banques centrales, ce qui accorde de fait aux notations un pouvoir normatif (130) ».
À ce titre, la question de la responsabilité des agences de notation ne peut manquer d’interpeller les pouvoirs publics.
Sur plusieurs de ces points, la réaction de l'Union européenne a été rapide.
d) Le règlement communautaire du 16 septembre 2009 assure un premier encadrement
Le règlement n° 1060/2009 du 16 septembre 2009, directement applicable sans mesures de transposition nationales, reprend largement la teneur des normes définies par l’OICV, mais leur donne un caractère juridiquement contraignant. Il est entré, pour la majeure partie de ses dispositions, en vigueur le 7 novembre 2009.
Au sens de son article 3, la notation de crédit est une opinion reposant sur un système de classification défini et émise relativement à la qualité du crédit d’une entité, d’une dette ou obligation financière, d’un titre de créance, d’actions privilégiées ou d’autres instruments financiers équivalents. Une agence de notation est définie comme une personne morale qui a pour activité l’émission de notations de crédit sur une base professionnelle.
Toutes les agences de notation qui souhaitent que leurs notations soient utilisées dans l'Union européenne doivent désormais demander leur inscription, en s’adressant au Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM), et leur demande d’enregistrement fera ainsi l’objet d’une décision collégiale des régulateurs nationaux concernés. Ce collège participera également à la surveillance au quotidien des agences enregistrées.
En matière de surveillance, les autorités compétentes – la loi française de régulation bancaire et financière a désigné l’AMF en tant qu’autorité compétente – sont dotées de prérogatives leur permettant d’enquêter sur l’activité des agences, d’accéder à tout document produit par elles, d’exiger des informations de toute personne et d’inspecter sur place. Elles peuvent engager des sanctions, retirer l’enregistrement et imposer une interdiction temporaire de notation avec effet dans toute l’Union européenne.
Les agences de notation inscrites devront se soumettre à des règles strictes afin de garantir :
– que les notations qu’elles émettent ne sont pas influencées par des conflits d’intérêts ;
– que les agences restent vigilantes quant à la qualité de la méthode de notation et des notations elles-mêmes ;
– qu’elles agissent de manière transparente.
Le règlement prévoit notamment :
– l’interdiction pour les agences de fournir des services de conseil ;
– l’interdiction de noter des produits financiers si elles ne disposent pas d’informations de qualité en quantité suffisante pour fonder leur notation ;
– l’obligation de rendre publics leurs modèles, leurs méthodes et les principales hypothèses sur lesquelles elles se fondent, et de veiller à la qualité de l’information, qui devra être pertinente au regard des modèles de notation utilisés ;
– l’obligation de différencier les notations des produits les plus complexes en ajoutant un symbole spécifique, afin de distinguer la notation classique dite « corporate » de la notation dite « structurée » relative aux produits structurés (par exemple, les titres adossés à des actifs ou asset backed securities) (131) ;
– l’obligation de publier un rapport de transparence annuel ;
– l’obligation de mettre en place un système de contrôle interne de la qualité de leurs notations ;
– l’obligation d’inclure dans la composition de leur conseil d’administration au moins deux membres indépendants dont la rémunération ne sera pas subordonnée aux performances économiques de l’agence, l’un d’eux au moins devant être un spécialiste de la titrisation et du crédit structuré.
S'agissant de la prévention du risque de conflit d’intérêt et de la transparence du processus de notation, ce dispositif impose à l’agence de notation qu’elle assure :
– l’indépendance des parties prenantes dans le processus de notation ;
– la rotation des analystes ;
– l’absence de conflit d’intérêt avec la fourniture de services annexes tels que l’analyse financière ou l’évaluation de la note.
Malgré les avancées importantes réalisées par ce texte, il continue de peser un soupçon sur l’indépendance des agences de notation du fait de leur modèle économique : le principe émetteur–payeur, qui reste en usage, continue à faire peser un sérieux doute sur l’objectivité d’une notation émanant d'un organisme qui tire sa rémunération de l’établissement noté, mais il est vrai que c’est également le système en usage pour la rémunération des commissaires aux comptes.
Par ailleurs, le règlement imposant la publication de méthodes, il s’agit à présent de prévoir que le non-respect par les agences de notations de leur propre méthode engage leur responsabilité.
3.– Le rejet du risque par les banques : titrisation et hors-bilan
On a observé ces dernières années, dans la pratique bancaire, un changement profond du modèle de crédit. Dans le modèle traditionnel, les banques évaluent le risque individuel des candidats emprunteurs, puis, en cas d’acceptation du dossier, portent ce risque jusqu’à échéance du prêt. Comme elles prennent elles-mêmes le risque, elles ont tout intérêt à l’évaluer correctement. « Or nous sommes passés à un modèle où le risque n’est plus évalué par les offreurs de crédits initiaux, mais transféré à d’autres dans un processus de titrisation et de création de produits dérivés » (132). De plus, le marché étant supposé efficient, le rôle des instances publiques de régulation avait été réduit au minimum. « Ce type de crédit n’a pas été supervisé alors que même que les banques qui pratiquent le crédit traditionnel le sont, puisque les risques qu’elles prennent peuvent mettre en cause leur bilan » (133).
a) Qu’est-ce que la titrisation ?
La titrisation est une technique financière qui transforme des actifs peu liquides, c'est-à-dire pour lesquels il n’y a pas de véritable marché, en valeurs mobilières facilement négociables comme les obligations. Chaque investisseur acquiert une fraction du portefeuille d’actifs titrisés, sur la base des flux financiers futurs des actifs, qui garantissent le remboursement des obligations.
Née aux États-Unis dans les années 1970, cette technique a d’abord été utilisée par les banques pour consentir davantage de crédits. Plus tard, elle a permis aux banques de se débarrasser partiellement des mauvais risques.
b) Les dangers de la titrisation
Ils sont de deux ordres :
– Le premier inconvénient de la titrisation tient au transfert et à la dissémination des risques. La titrisation, en sortant des actifs à risque du bilan, a pour objet de permettre de transférer le risque de crédit aux marchés. L’opérateur bancaire ou financier qui cède les risques n’a pas ainsi besoin de constituer des fonds propres en fonction du volume des crédits accordés. Les exigences prudentielles qui sont destinées à créer un mécanisme stabilisateur de l’expansion du crédit ne s’appliquent pas aux acheteurs des titres, et elles n’ont plus lieu de s’appliquer aux opérateurs régulés dès lors qu’ils ont cédé les crédits.
La titrisation permet donc un contournement des exigences prudentielles. La dissémination du risque ne s’accompagne pas d’une traçabilité de ce risque.
Cette pratique concourt donc à ce qu’il est convenu aujourd’hui d’appeler l’« aléa moral », ce qu’en langage répondant moins à l’exigence ambiante de « correction » on pourrait tout simplement qualifier d’irresponsabilité.
TITRISATION ET ALÉA MORAL Avec la titrisation, la vigilance des banques et des courtiers immobiliers qui ont initié les crédits aux ménages a été moins importante sur la capacité de ces derniers à rembourser correctement leur emprunt. Les banques qui « titrisent » portent moins les crédits. Elles se rémunèrent à la commission, puis revendent le crédit. Elles font de la quantité et peuvent être moins regardantes sur la qualité. Ce qu’on appelle l’aléa moral. L’aléa moral consiste dans le fait qu’une personne ou une entreprise assurée contre un risque peut, de ce fait, se comporter de manière plus risquée que si elle était totalement exposée au risque. Exemple : si le propriétaire d’une maison qui s’assure contre le vol ne verrouille plus sa porte au prétexte que s’il est cambriolé il sera remboursé, il fait jouer l’aléa moral. Dans le cas des banques, se considérant comme non pénalisées en cas d’imprudences dans leurs opérations, elles prennent plus de risques lors de l’octroi de crédits ou de l’exécution d’opérations de marché. Le cadre de la réglementation et de la régulation des activités bancaires et d’assurance s’efforce d’empêcher de tels mécanismes. Mais il peut parfois perdre de son efficacité. Ainsi, la politique monétaire doit veiller à empêcher les crises générales qui pourraient provenir des effets en chaîne de faillites bancaires sur l’ensemble du système et de l’économie. Mais pour les banques une telle garantie de « socialisation des pertes », alimentée par le « too big to fail » (trop gros pour faire faillite), peut réentraîner un mécanisme d’aléa moral. |
– le second risque lié à la titrisation réside dans la séparation entre l’origination (134) des crédits et le risque de crédit. L’originateur des crédits fait l’analyse des risques et, éventuellement, leur suivi, mais il ne supporte pas ces risques. Par ailleurs, ces risques sont ensuite restructurés de façon à fournir des produits à haut rendement. L’originateur n’est donc pas incité à la prudence, les agences de notation et les rehausseurs de crédits se faisant fort de confirmer la transformation des crédits risqués, donc supposés à haut rendement, en produits répondant à l’aversion au risque. Il est évident que plus l’ingénierie financière est censée transformer des actifs sous-jacents subprimes en titres AAA, plus elle est rémunératrice comme le montre l’exemple d’Abacus.
LE CDO ABACUS : Le CDO – collaterized debt obligation – Abacus était un CDO synthétique adossé sur des créances immobilières diversifiées. Il a été créé en 2007, avant la crise des subprimes. Un CDO regroupe en général une centaine d’actifs différents. Il s’agit donc d’une structure de titrisation. Un CDO synthétique se distingue d’un CDO physique par le fait qu’aucun prêt immobilier n’a réellement été conclu ni même reconditionné – les titres CDO Abacus ont simplement suivi les performances des produits financiers dérivés de prêts hypothécaires. Abacus était fondé sur la performance de quelque 90 titres adossés à des prêts immobiliers subprime. Ce paquet d’emprunts avait obtenu initialement la note BBB des agences Standard & Poor’s et Fitch et Baa2 chez Moody’s, soit des notes de mauvaise qualité. Comme le CDO physique, le CDO synthétique est structuré en trois classes de souscripteurs par niveau de risque : equity, mezzanine et senior, les souscripteurs senior étant affectés si les défauts se révèlent nombreux et importants. Dans le cas du CDO Abacus, Goldman Sachs était le souscripteur « equity ». La banque allemande IKB, souscripteur « mezzanine », misait sur la bonne tenue des subprimes. ACA, structureur du CDO, s’est porté acquéreur du produit en tant que souscripteur « senior », ce qui a entraîné la notation AAA de ce produit. En effet, dans la mesure où ACA a structuré ce produit puis s’en est porté acquéreur prenant le risque le plus élevé, le CDO a été considéré par les agences de notation comme méritant la meilleure note. Les agences de notation sont donc au cœur de cette alchimie qui a permis de transformer des titres notés BBB en un seul titre « collatéral » noté AAA. Le fonds spéculatif John Paulson, qui avait anticipé la crise des subprimes, a souhaité prendre des positions « short » à l’encontre d’Abacus, c'est-à-dire miser en bourse sur sa baisse. Le CDO Abacus a permis aux acheteurs (IKB et ACA) et au vendeur John Paulson de miser selon leurs intuitions opposées. Neuf mois après, les titres regroupés dans ce CDO ont vu leur taux de défaut de paiement atteindre un pourcentage record en dépit de la note AAA du produit. ACA a démantelé sa division de gestion des CDO et la banque allemande IKB a perdu 150 millions de dollars, alors que le fonds spéculatif Paulson a gagné un milliard de dollars dans l’opération. La Securities and Exchange Commission (SEC) a commencé son enquête en août 2008. Elle reproche à la banque Goldman Sachs de n’avoir pas spécifié que ce produit structuré lancé en février 2007 et composé de financements immobiliers dont elle proposait des parts à ses clients avait été monté avec l’aide du gérant de hedge fund John Paulson qui en même temps pariait sur son écroulement. Le 15 juillet dernier, Goldman Sachs a signé un accord avec la SEC stipulant le versement de 550 millions de dollars pour refermer le dossier (300 millions de dollars d’amende et 250 millions versés à IKB et Royal Bank of Scotland, autre investisseur « mezzanine »). La banque a reconnu que les documents de promotion du produit contenaient une information incomplète et que son silence sur le rôle joué par le fonds Paulson dans la sélection du portefeuille d’Abacus était une erreur. Cet accord pourrait servir de modèle au règlement d’affaires similaires : de nombreux CDO ont été structurés de la même manière, à la demande de hedge funds qui souhaitaient parier à la baisse sur l’évolution de certains titres à travers des produits dérivés de crédit. |
M. Jean-Claude Gruffat, directeur général de Citigroup France a ainsi résumé devant la commission d’enquête le double inconvénient de la titrisation : « Le sens du risque s’est trouvé émoussé dans la mesure où les institutions financières ne portaient plus le crédit jusqu’à son terme. Sans doute se
montrent-elles bien plus responsables lorsqu’elles savent qu’elles seront affectées par leurs décisions mais, lorsqu’elles se contentent de structurer un crédit et de le distribuer à des investisseurs qui, eux, n’ont pas forcément effectué toutes les analyses nécessaires pour apprécier la pertinence et la sûreté de tels actifs, il en va autrement. » (135).
c) Le danger est d’autant plus grand que le marché de la titrisation est en pleine expansion
Le développement de la titrisation a été particulièrement rapide. L'encours des obligations garanties par une hypothèque ou CMO – collateralized mortgage obligation – et des titres adossés à des actifs ou ABS – asset backet security – obligataires a atteint 10 000 milliards de dollars aux États-Unis à la fin 2007. Il a été multiplié par trois en dix ans. Le marché de la titrisation représente ainsi 40 % du marché obligataire, alors que celui des obligations émises par les entreprises représente 5 800 milliards de dollars et celui du Trésor américain 4 500 milliards de dollars.
En Europe les émissions d'ABS ont atteint 100 milliards de dollars contre 238 milliards de dollars aux États-Unis sur la même période.
Une part importante des acheteurs de produits de titrisation a été constituée par les hedge funds, à la recherche de rendements élevés, ainsi que les banques d'investissement.
EXPOSITIONS ET PERTES LIÉES AUX « SUBPRIMES » AMÉRICAINS
(en Mds de dollars et en %)
|
Expositions |
Pertes | ||||
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
20072 | |
Total (en milliards de dollars) | ||||||
Banques |
155,3 |
263,9 |
126,5 |
–8,8 |
–62,8 |
–28,8 |
Hedge funds |
69,8 |
98,1 |
77,6 |
–6.7 |
–26,9 |
–20,4 |
Compagnies d’assurance |
78,4 |
105,9 |
83,7 |
–1,6 |
–20,8 |
–15,1 |
Compagnies financières |
24,6 |
30,2 |
23,8 |
–0,6 |
–4,8 |
–3,6 |
Fonds de pension |
14,8 |
18,2 |
14,3 |
–0,4 |
–2,5 |
–1,9 |
Total |
342,9 |
516,3 |
325,9 |
–18,1 |
–117,8 |
–69,8 |
|
En pourcentage | |||||
Banques |
45,3 |
51,1 |
38,8 |
48,6 |
53,3 |
41,3 |
Hedge funds |
20,4 |
19 |
23,8 |
37 |
22,8 |
29,2 |
Compagnies d’assurance |
22,9 |
20,5 |
25,7 |
8,8 |
17,7 |
21,6 |
Compagnies financières |
7,2 |
5,8 |
7,3 |
3,3 |
4,1 |
5,2 |
Fonds de pension |
4,3 |
3,5 |
4,4 |
2,2 |
2,1 |
2,7 |
Total |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
d) La titrisation responsable d’une crise de la liquidité
La liquidité est un concept difficilement appréhendable, car elle repose essentiellement sur un phénomène de confiance. Elle dépend notamment de l'appréciation par les agents du niveau de risque, c'est-à-dire de leurs anticipations concernant la résilience de l'économie et des contreparties face aux chocs. De même, elle est influencée par la crédibilité des interventions des pouvoirs publics, en particulier des banques centrales. Elle dépend également de la transparence du système économique et financier, c'est-à-dire de l'existence ou non d'une véritable « traçabilité » des risques et de la capacité à les évaluer.
Or, dès la chute de Lehman Brothers, les primes de risques de contrepartie observée sur le marché interbancaire, qui étaient de 50 points de base, ont vu leur spread monter à 350 (source Bloomberg). Cette subite évolution est le signe d’une profonde aversion au risque notamment du fait de la dilution du risque liée à la technique de la titrisation. Cet état de fait a engendré une crise de liquidité provoquant notamment la faillite de la banque britannique Northern Rock, alors même que la banque était solvable, mais elle s’est retrouvée dans l’impossibilité de lever des fonds sur le marché.
LE MARCHÉ INTERBANCAIRE ET LA LIQUIDITÉ Le marché interbancaire permet à une banque de prêter de l'argent à ses pairs ou au contraire de leur en emprunter, quand le montant de ses dépôts est supérieur ou inférieur à la demande de crédits de ses clients. C'est un marché non réglementé, dit de gré à gré, sur lequel les banques sont présentes quotidiennement afin d'équilibrer leurs comptes. Tous les prêts d'une banque doivent être constamment compensés par des actifs correspondants. La circulation des liquidités sur ce marché est essentielle au bon fonctionnement du système bancaire et financier. Néanmoins, les échanges créant une interdépendance entre les banques, la faillite d'une entre elles, hypothèse d'ordinaire très théorique, peut entraîner les autres banques. La crise financière a ainsi débuté par une paralysie du marché interbancaire due à la crise des subprimes et principalement à la titrisation – la défiance s’est installée du fait de l’opacité entretenue sur la qualité des actifs échangés. La crainte qu'un établissement emprunteur fasse défaut est devenue plus réaliste au point de paralyser le marché interbancaire, ce qui a conduit les banques centrales à se substituer aux banques prêteuses, tandis que plusieurs États ont accepté de garantir les emprunts de leurs banques afin de faciliter leur refinancement. Si cette politique était nécessaire afin de sauver le système financier de l’effondrement, elle a eu et continue d’avoir des effets pervers. En effet, le monde ne sera réellement sorti de la crise que lorsque le marché interbancaire fonctionnera convenablement. Cependant, tant que les banques centrales continueront à assumer le rôle de prêteur en dernier ressort et ce à des coûts très faibles, les banques ne seront pas incitées à prendre un quelconque risque sur le marché interbancaire. Le retour à un fonctionnement normal du marché interbancaire est essentiel pour assurer le financement de l’économie, c’est-à-dire le crédit aux particuliers et aux entreprises. |
e) Les autres formes d’engagement hors-bilan
Dans les banques, la technique de gestion du hors-bilan a pris plus d’importance depuis les années 1990.
En effet, d’un côté, l’environnement concurrentiel les a obligées à rechercher de façon plus agressive des profits en s’engageant dans des activités hors-bilan, comme :
– la cession de prêts ;
– les engagements de financement (lignes de crédit, autorisations de découvert pour les particuliers) ;
– les garanties données sur des prêts ;
– l’émission de titres adossés à des prêts hypothécaires ;
– les opérations de marché du type swaps ou opérations à terme.
f) La réglementation par le Comité de Bâle
Elle vise à imposer des règles prudentielles aux banques notamment pour faire face aux risques liés à une titrisation excessive.
LE « COMITÉ DE BÂLE » Le Comité de Bâle sur le contrôle prudentiel bancaire est une institution créée en 1974. Il regroupe les banques centrales et des organismes de réglementation et de surveillance bancaires des principaux pays industrialisés (France, Belgique, Canada, Italie, Japon, Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Espagne, Suède, Royaume-Uni et Les représentants se rencontrent à la Banque des règlements internationaux à Bâle pour examiner tous les enjeux liés à la surveillance prudentielle des activités bancaires. Le comité était initialement appelé le « Comité Cooke », du nom de Peter Cooke, un directeur de la Banque d’Angleterre qui avait été un des premiers à proposer sa création et fut son premier président. Le comité se réunit quatre fois par an et se compose actuellement de représentants des banques centrales et des autorités prudentielles des pays membres. L’objectif de ce comité est de stimuler la coopération et de promouvoir l’harmonisation internationale en termes de contrôle prudentiel bancaire. Mais il faut noter que le comité de Bâle ne possède aucune autorité particulière et que ses conclusions n’ont pas force contraignante. |
« Bâle II » et la titrisation Le pilier 1 de « Bâle II » permet de prendre en compte les actifs titrisés figurant aux bilans des banques au titre des risques de marché. Le pilier 3 de « Bâle II » exige des informations sur les opérations de titrisation. La banque doit expliquer les objectifs de ces opérations et décrire la nature de son implication. Elle doit préciser les approches retenues pour estimer l'impact des titrisations sur les fonds propres réglementaires et décrire les traitements comptables appliqués. Les informations quantitatives requises portent sur : – l'encours total des expositions résultant d'actifs titrisés ; – le montant des actifs titrisés qui ont dû être dépréciés et des actifs titrisés impayés ; – le montant des expositions de titrisation conservées ou acquises avec l'exigence de fonds propres qui en découle selon l'approche retenue (approche standard ou selon les modèles internes). |
La crise des subprimes a cependant montré la faiblesse de la réglementation issue de « Bâle II ».
FAIBLESSE DE LA RÉGLEMENTATION ISSUE DE « BÂLE II » En premier lieu, elle est apparue procyclique. En effet, en période d'euphorie financière, les banques ajustent leurs fonds propres de telle sorte qu'elles ne détiennent que le minimum de fonds imposé par la réglementation. À l'inverse, lorsque la situation se détériore, elles doivent augmenter leurs fonds propres pour respecter le ratio de solvabilité, alors même que les fonds deviennent de plus en plus rares et chers, contribuant ainsi à précipiter les banques dans un état « d'asphyxie financière ». En second lieu, les produits les plus complexes, et donc, le plus souvent, les plus risqués, ne sont pas suffisamment bien pris en compte dans les modalités de calcul du ratio. Les banques n'ont pas été en mesure d'apprécier correctement les risques qu'elles prenaient lorsqu'elles menaient des opérations complexes, en particulier de titrisation et de retitrisation. Par conséquent, leur niveau de fonds propres s'est retrouvé en inadéquation avec la réalité des risques encourus. Avec la déclaration sur le renforcement du système financier, adoptée lors du deuxième sommet du G20 à Londres, le 2 avril 2009, il a été décidé d'améliorer les aspects quantitatifs et qualitatifs ainsi que la cohérence internationale des fonds propres dans le système bancaire. Le sommet du G20 de Pittsburgh, le 25 septembre 2009, a confirmé cette orientation en affirmant que « le cadre de " Bâle II " doit intégrer des exigences en capital plus élevées pour les produits à risque et les activités hors bilan ». Le Comité de Bâle a notamment proposé de réduire le recours aux estimations de fonds propres fondées sur un modèle de valeur en risque (« value at risk » ou VaR) et de renforcer la couverture des risques pour les instruments de retitrisation et la couverture des risques de défaut pour les produits de crédit non titrisés. |
La réglementation a en outre eu des effets qualifiés de « pervers » par M. Michel Aglietta, conseiller au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (136) : en aggravant la sous-évaluation du risque. D’une part, la réglementation, limitée aux banques commerciales, ne concernait pas les banques d’investissement pur – ce qui n’a pas joué pour la France qui a des banques universelles ; d’autre part, le capital n’intervenant que dans le calcul du portefeuille bancaire, qui reste au bilan, un tel mode de calcul du ratio de solvabilité a représenté « un véritable pousse-au-crime », puisque ce qui était hors bilan n’avait pas à être assuré en termes de capital. À partir de 2004, la perspective de l’entrée en application des recommandations de « Bâle II » a ainsi incité les banques à titriser au maximum, afin de se débarrasser des crédits en les intégrant dans des structures hors bilan.
Dans ces conditions de nouvelles discussions ont été engagées au sein du Comité de Bâle visant à promouvoir un cadre prudentiel et réglementaire plus robuste pour le secteur bancaire et comportant cinq éléments fondamentaux :
– le renforcement du dispositif réglementaire d'adéquation des fonds propres ;
– l'accroissement des réserves de liquidité des banques ;
– l'optimisation de la gouvernance, de la gestion du risque et de la supervision des banques ;
– l'amélioration de la transparence du marché ;
– l'approfondissement de la coopération transfrontière en matière de supervision des banques internationales.
Le nouvel accord de Bâle du 12 septembre 2010 dit « Bâle III » prévoit un ratio de capital propre pondéré en fonction des risques de 4,5 %, soit plus du double du taux actuel qui est de 2 %, plus un nouvel amortisseur de 2,5 %. Les banques dont les capitaux tomberaient à l’intérieur de cette zone tampon se verront imposer des restrictions sur le paiement des dividendes et des bonus. La nouvelle réglementation fixe donc un montant effectif de fonds propres de 7 %. Cependant, les nouvelles normes ne seront mises en œuvre qu’en 2019, une décennie pendant laquelle de nouvelles crises peuvent probablement à nouveau secouer la sphère financière.
Ce ratio, bien qu’il constitue une avancée non négligeable, reste bien en dessous de celui que les investisseurs imposeraient s’ils n’avaient pas l’assurance que les gouvernements viendront au secours des banques en cas de difficultés.
Cette réforme a suscité une appréciation pour le moins nuancée de M. Henri Bourguinat, professeur à l’université Bordeaux-IV, analyse qui mérite réflexion : « on se focalise sur les fonds propres, ce qui conduit déjà les banques à développer, sur cette question, leur lobbying. Elles proclament que 450 milliards d’euros devront être trouvés sur le marché dont, si on en croit un honorable banquier de la place de Paris, 150 milliards pour les seules banques françaises. Ce lobbying, qui fait partie du jeu, vise à faire passer, en matière d’exigences de fonds propres, un message de modération aux régulateurs de Bâle. Je pense toutefois que la régulation des fonds propres n’apportera pas une sécurité totale. Lehman Brothers avait en effet plus de 12 % de fonds propres. J’enseigne depuis des décennies la réglementation des fonds propres aux étudiants : elle m’a toujours laissé circonspect. Certes, les ratios imposés sont fonction de la nature des crédits. Toutefois, imposer le même ratio de fonds propres à une banque du secteur mutualiste et à une banque d’affaires n’est pas nécessairement de bonne méthode.
« De plus, nous l’avons souligné avec Éric Bryis dans le livre que j’ai évoqué, les fonds propres peuvent être aisément manipulés. Lors de la crise de 2007, les banques américaines ont émis des obligations « convertibles contingentes », qui se transforment à point nommé en actions : les fonds propres augmentent automatiquement. En France, on a utilisé le procédé de la dette subordonnée, qui n’est pas éloigné de celui utilisé par les banques américaines. Il existe donc des ersatz de fonds propres. L’accord de Bâle III modifiera-t-il la donne puisqu’il prohibe les fonds propres hybrides ? La vérité est que Bâle III ne proscrira que certains fonds propres hybrides, de plus à un horizon de cinq ans. C’est loin. Par ailleurs, les États-Unis n’ont pas encore mis en œuvre Bâle II, alors qu’ils tiennent pour une bonne part la finance internationale. Il serait mieux de faire les choses dans l’ordre et d’appliquer Bâle II avant de penser à Bâle III. » (137)
En conclusion, il convient non seulement de veiller à faire respecter le ratio de fonds propres, mais aussi que ce ratio signifie bien quelque chose en prenant en compte l’ensemble des activités de la banque et notamment les engagements hors-bilan.
On observera que des dispositions dont l’objet est de même nature que celles du Comité de Bâle sont prévues pour le secteur des assurances. Elles sont connues sous le nom de « Solvabilité II » et font l’objet d’une directive communautaire.
« SOLVABILITÉ II » La réglementation dans le secteur des assurances fait l’objet de la directive communautaire n° 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice, dite « Solvabilité II ». « Solvabilité II » repose sur 3 piliers ayant chacun un objectif : Le premier pilier a pour objectif de définir les normes quantitatives de calcul des provisions techniques et des fonds propres. Ces niveaux règlementaires sont définis pour les fonds propres : MCR (138) et SCR (139) : – le MCR représente le niveau minimum de fonds propres en dessous duquel l'intervention de l'autorité de contrôle sera automatique ; – le SCR représente le capital cible nécessaire pour absorber le choc provoqué par un risque majeur (par exemple : un sinistre exceptionnel, un choc sur les actifs...). Le deuxième pilier a pour objectif de fixer des normes qualitatives de suivi des risques en interne aux sociétés et comment l'autorité de contrôle doit exercer ses pouvoirs de surveillance dans ce contexte. L'identification des sociétés « les plus risquées » est un objectif et les autorités de contrôle auront en leur pouvoir la possibilité de réclamer à ces sociétés de détenir un capital plus élevé que le montant suggéré par le calcul du SCR et/ou de réduire leur exposition aux risques. Le troisième pilier a pour objectif de définir l'ensemble des informations détaillées auquel le public aura accès, d'une part, et auquel les autorités de contrôle pourront avoir accès pour exercer leur pouvoir de surveillance, d'autre part. La directive « Solvabilité II » peut être vue comme le pendant des accords de Bâle pour les banques. |
g) La révision des directives relatives aux fonds propres des banques
Les directives européennes relatives aux exigences de fonds propres (ou capital requirement directives – CRD) applicables aux banques
– correspondant à la mise en œuvre, au niveau européen, des normes du Comité de Bâle – ont été plusieurs fois modifiées au cours des derniers mois.
● Une modification intervenue en 2009 a notamment introduit des règles sur l’encadrement des pratiques de titrisation.
Il s’agissait, parallèlement à l’adoption du règlement de 2009 sur les obligations des agences de notation, de renforcer les obligations de vigilance des entreprises financières, pour qu’elles analysent elles-mêmes les produits qu’elles diffusent. Les dispositions de la directive concernent cinq thèmes :
– renforcement de la supervision des groupes bancaires transfrontaliers ;
– meilleur encadrement des pratiques de titrisation, avec un renforcement des exigences relatives à la diligence et à la transparence imposées aux initiateurs des opérations de titrisation et aux investisseurs, afin d’assurer que ceux-ci soient capables d’analyser les risques des produits structurés au-delà des seules notations données par les agences. Le texte introduit notamment l’obligation pour l’initiateur de conserver dans son bilan au moins 5 % des risques transférés ou vendus aux investisseurs, l’obligation pour les établissements de crédit d’effectuer régulièrement leurs propres simulations de crise adaptées à leurs positions de titrisation… Il s’agit de responsabiliser les banques en les obligeant à conserver dans leurs bilans financiers au moins 5 % des créances qu’elles émettent et revendent selon les techniques de titrisation ;
– harmonisation de la classification des fonds propres de première catégorie (« Tier 1 ») et des capitaux hybrides ;
– introduction de règles relatives à l’encadrement du risque de liquidité (constitution de réserves d’actifs liquides, simulations de crise de liquidité, plans de continuité…) ;
– encadrement accru des expositions sur une seule contrepartie (grands risques) : un établissement de crédit ne pourra assumer une exposition d’une valeur dépassant 25 % de ses fonds propres à l’égard d’un client ou d’un groupe de clients liés.
Le délai de transposition de la directive est fixé au 31 octobre 2010. La loi de régulation bancaire et financière française comporte des dispositions de transposition de cette directive.
● Une nouvelle série de modifications a été adoptée le 11 octobre 2010, introduisant des règles supplémentaires sur la titrisation et sur les politiques de rémunération.
Le Parlement européen a adopté le 7 juillet 2010 cette nouvelle proposition de modification de la directive 2009/111/CE du 16 septembre 2009 dite directive « Fonds propres » (CRD 4). L’accord a été entériné par le Conseil lors de sa réunion du 11 octobre 2010. La nouvelle directive est en attente de publication au Journal officiel de l’Union européenne et les nouvelles règles doivent prendre effet en janvier 2011. Les modifications portent sur plusieurs points :
– les exigences de fonds propres liées au portefeuille de négociation des banques ;
– une augmentation des exigences de fonds propres en cas de pratique de retitrisation, et un renforcement des conditions de diligence et de la surveillance pour les retitrisations particulièrement complexes ;
– des exigences accrues de publicité portant sur les expositions de titrisation, principalement pour les grands établissements, pour améliorer la compréhension que les investisseurs pourront avoir du profil de risque des banques ;
– la soumission à une surveillance prudentielle des politiques de rémunération, pour inscrire celles-ci dans une démarche de gestion des risques. L’actuel cadre juridique n’exige pas explicitement que les politiques de rémunérations des établissements financiers soient soumises à une surveillance prudentielle. Il s’agit de donner force juridique plus contraignante à de précédentes recommandations relatives aux rémunérations des membres du personnel dont les décisions peuvent influer sur le niveau de risque pris par l’établissement, et de faire en sorte que les autorités de surveillance puissent imposer des sanctions financières et non financières aux entreprises qui ne s’y conformeraient pas.
Les principes posés par la Commission européenne ne visent pas à fixer ni la forme, ni le montant des rémunérations, et les établissements resteront responsables de la conception et de l’application de leur propre politique de rémunération. Le Parlement européen a souhaité – et il a été suivi dans ce sens par le Conseil – que la future directive aille dans un sens beaucoup plus contraignant, en préconisant :
– que la rémunération variable due sous forme de liquidités et versée d’avance soit plafonnée à 30 % du bonus total, et à 20 % dans le cas de montants particulièrement élevés ;
– qu’entre 40 et 60 % des bonus doivent être reportés et ne soient pas dus si les investissements effectués ne produisent pas les résultats escomptés ;
– qu’au moins 50 % du total de la rémunération variable soit payée sous forme de capital « conditionnel » et d’actions ;
– que le texte couvre les indemnités de départ à la retraite.
La nouvelle directive renforcera la régulation et limitera la prise de risque en encadrant de manière plus importante les rémunérations. À cet égard, l’arrêté du ministre des finances français du 3 novembre 2009 sur les rémunérations des personnels des établissements de crédit imposait simplement qu’une « part importante [soit] différée sur plusieurs années ». De même, tandis que la directive oblige à verser au moins 50 % de la part non différée de la rémunération variable sous forme d’actions, l’arrêté n’émet pas d’obligation chiffrée et prévoit uniquement qu’« une part importante de la rémunération variable soit versée en actions ». Autre modification opérée, la directive obligera à rendre public le détail des rémunérations individuelles des dirigeants siégeant au conseil d’administration. Aujourd’hui, en droit français, seule une publication des données agrégées est prévue. Des plafonds seront également fixés pour la part variable des rémunérations, limitation non prévue par le droit interne actuel.
Dans la mesure où le cadre européen reste le plus pertinent pour avancer vers plus de stabilité du secteur financier, il semblerait que cet accord aille dans la bonne direction. Il demeure toutefois nécessaire d’en évaluer rapidement toutes les conséquences, en particulier s’agissant de l’augmentation des exigences de fonds propres, afin d’éviter que cette nouvelle réglementation ne handicape nos établissements face à des établissements extracommunautaires non soumis aux mêmes règles.
Par ailleurs, il conviendra de veiller à ce que les règles contraignantes touchant aux politiques de rémunérations ne soient pas contournées et que les bonus et autres rémunérations variables ne ressurgissent sous une autre dénomination, l’imagination des professionnels n’ayant pas de limite dans ce domaine, comme en témoigne l’apparition des welcome bonus, ou primes d’arrivée, comme substitut aux parachutes dorés ou primes de départ.
B.– DES OUTILS PARFOIS DÉVOYÉS
1.– Le trading algorithmique et le trading à haute fréquence
En raison d’une influence toujours plus importante sur la structure même des marchés, le trading (140) algorithmique est actuellement au centre d’interrogations quand à son utilité et aux risques qu’il représente pour la stabilité financière.
Le trading algorithmique est devenu un phénomène majeur, représentant environ 35 % du volume des échanges financiers en Europe (avec une forte croissance annuelle) et déjà près de 66 % aux États-Unis (141).
Pourtant, comme le précise l’Autorité des marchés financiers, le trading algorithmique « n’obéit pas à une définition claire. Il implique essentiellement la forte utilisation de l’outil informatique pour automatiser les tâches de prise de décision d’investissement et/ou d’exécution, dans un but de vitesse ou d’optimisation » (142).
Initié il y a une vingtaine d’années aux États-Unis, le recours aux outils informatisés de cotation et de trading a été rendu nécessaire par une décimalisation des ordres. Progressivement, l’apparition d’algorithmes plus sophistiqués, la fragmentation des marchés (143) et l’innovation financière, avec le développement de produits plus complexes, ont conduit à une pression concurrentielle exacerbée sur les marchés. Celle-ci s’est traduite par une recherche constante de la baisse des « pas de cotation » (écart minimum autorisé entre deux cotations d’une même valeur), par le développement de techniques d’accès direct aux marchés (144)et enfin par une volonté de réduire drastiquement le temps de latence entre la prise de décision et son exécution. Ces éléments ont favorisé l’essor du trading algorithmique dont le trading « à haute fréquence », (high frequency trading – HFT) est une notion proche mais pas totalement identique (145).
L’utilisation d’algorithmes, et du trading à haute fréquence en particulier, a modifié la structure des marchés. On observe ainsi, depuis quelques années, une augmentation considérable du volume d’ordres (146), mais également une réduction concomitante de la taille moyenne des transactions. Le trading algorithmique permet donc d’accroître la liquidité, c'est-à-dire la capacité des titres à être achetés ou vendus rapidement ou dans des conditions optimales.
Le recours à des algorithmes est pratiqué tant au stade de la décision d’investissement qu’au stade des modalités d’exécution d’un ordre, une fois la décision d’investissement prise. Ainsi, l’outil informatique peut, d’une part, se substituer à l’intervention humaine dans la prise de décision, en tant que stratégie de gestion, et, d’autre part, permettre l’amélioration de la vitesse d’exécution des ordres (au millième de seconde près).
Avec le développement de la passation automatique des ordres et l’augmentation notable de leur vitesse d’exécution via des algorithmes
– jusqu’à 33 000 opérations par seconde, soit près de 2 millions par minute –, des risques nouveaux apparaissent et d’autres, déjà existants, tels que la manipulation des carnets d’ordres, peuvent désormais prendre un caractère quasi industriel.
a) Les algorithmes peuvent être détournés au profit de stratégies manipulatoires
Les stratégies de gestion algorithmiques communément mises en œuvre se distinguent en quatre catégories :
– L’arbitrage sans risque (riskless arbitrage) permet de tirer profit des écarts de cours existant à un moment donné entre plusieurs marchés, en achetant ou en vendant une valeur sur une bourse, tout en effectuant simultanément l’opération inverse sur une autre bourse.
– Les stratégies de retour à la moyenne (mean reverting) consistent à profiter du décalage de prix temporaire d’une valeur, à la suite de la diffusion d’informations telles que la dégradation d’une notation ou la recommandation d’un courtier.
– Les stratégies de suivi de tendance (trend following) tendant à identifier sur une valeur une tendance de court terme assez robuste pour profiter du mouvement.
– La tenue de marché (market making) consiste à se positionner aux meilleures limites simultanément à l’achat et à la vente pour des quantités données de valeurs, servant la liquidité dans les deux sens, pour réaliser comme gain l’écart de la fourchette. Un teneur de marché (market maker) est donc un acteur financier dont le rôle principal est d’assurer la liquidité des titres en proposant de façon régulière et continue des prix à l’achat et à la vente.
La profitabilité de ces stratégies repose essentiellement sur la multiplication d’opérations générant de faibles marges, d’où le recours à des mécanismes de passation automatique des ordres. En effet, ces opérations se caractérisant par un faible gain et un faible risque pour le passeur d’ordre, l’intérêt de l’opérateur réside dans la grande répétition des transactions. Les quatre stratégies citées sont légales et admises par la jurisprudence de l’AMF, mais l’utilisation d’algorithmes peut rendre ténue la différence entre stratégie autorisée et pratique manipulatoire.
Si les opérations de suivi de tendance (trend following) et de retour à la moyenne (mean reverting) ne nécessitent pas un temps de latence extrêmement réduit, l’arbitrage sans risque (riskless arbitrage) et la tenue de marché (market making) se fondent, pour leur part, sur une utilisation poussée du trading à haute fréquence. En outre, ces deux dernières stratégies offrent une possibilité de dérive manipulatoire qu’il n’est pas possible d’ignorer.
Selon M. Thierry Francq, secrétaire général de l’AMF (147), l’un des grands risques concernant l’utilisation d’algorithmes réside dans la manipulation des carnets d’ordres, profitant du système de priorité en fonction du prix (148)et du temps (149).
Le spoofing (terme dont la traduction française pourrait être « canular » ou « leurre ») est ainsi « une technique agressive et manipulatoire d’exécution d’ordres rendue possible par la réduction des temps de latence […]. Il s’agit de placer des ordres de gros montant dans le carnet avec un rang de priorité permettant d’éviter leur exécution, pour donner l’illusion d’un intérêt de ce côté du carnet, faire décaler la fourchette, et favoriser ainsi l’exécution d’ordres en sens inverse à un meilleur prix. Aussitôt, les ordres de gros montants fictifs sont annulés » (150).
L’AMF a eu à connaître d’autres cas de manipulations comme l’annulation et le remplacement en permanence d’ordres « barrières » destinés à bloquer durablement un carnet d’ordres ou encore d’autres cas de tenues de marchés (market making) opportunistes.
Si l’usage de ses techniques manipulatoires reste, en France, encore artisanale, l’AMF identifie leur possible industrialisation via des algorithmes comme une menace sérieuse. « Le risque principal lié à la gestion algorithmique est le développement d’algorithmes de gestion prédateurs qui réaliseraient de manière industrielle des stratégies de market making [tenue de marché] abusif ou de spoofing [leurre] ». Il semblerait néanmoins que ce risque doit être quelque peu relativisé. En effet, « les transactions sont l’interaction d’algorithmes de toute nature, de gestion ou d’exécution, et il paraît difficile que l’un d’entre eux pourrait être durablement capable de réaliser des profits aux dépens de tous les autres sans être à son tour repéré et arbitré (151).»
b) Le trading algorithmique et le trading à haute fréquence favorisent une opacité accrue des marchés
Au-delà de l’automatisation de la décision d’investir, le trading algorithmique, avec notamment le trading à haute fréquence, permet d’augmenter la qualité et la vitesse d’exécution des ordres.
Pour réduire l’écart qui existe entre le prix sur lequel s’est basé l’investisseur pour prendre sa décision et le prix effectivement obtenu après exécution de cette décision, se sont développés des algorithmes d’exécution. Ces derniers permettent ainsi de passer de très nombreux ordres au millième de seconde près grâce à l’amélioration du temps de latence. Mais ces automates donnent également la possibilité de découper les engagements d’un investisseur en plusieurs ordres de plus faible montant émis sur une période désirée (152). C’est pourquoi on assiste aujourd’hui à l’augmentation significative du nombre d’ordres et à la réduction de leur taille.
Cette très grande quantité de petits ordres, exécutés plus rapidement, crée une opacité sur les marchés. Comme l’a expliqué M. Jean-Pierre Jouyet (153), Président de l’AMF, cette évolution complique la détection des manipulations de cours. La surveillance des marchés est rendue moins aisée, car le trading haute fréquence démultiplie les volumes de données à traiter et brouille la lecture des carnets d’ordres en amplifiant les mouvements de titres.
Le problème est d’autant plus important que l’utilisation des algorithmes d’exécution est le fait d’un très grand nombre d’acteurs financiers, contrairement à la gestion algorithmique, qui reste l’apanage d’un nombre assez restreint de gérants.
Le trading à haute fréquence rend donc le marché illisible pour le régulateur, mais également pour les investisseurs eux-mêmes. En effet, la rapidité de transmission des ordres permet aux utilisateurs de ces logiciels de se repositionner en permanence au gré des évolutions du marché. Il devient dès lors plus difficile d’interpréter les tendances du marché.
c) Les incidences du trading algorithmique sur l’intégrité des marchés : du risque opérationnel au risque systémique.
L’automatisation des techniques de gestion et de traitement des ordres peut créer un risque accru concernant l’intégrité des marchés.
L’absence d’intervention humaine dans le processus de décision peut, en effet, aboutir à des erreurs dont les conséquences seraient démultipliées face à la simple erreur humaine. De plus, la vitesse de traitement des données par les automates est telle que de très nombreux ordres erronés peuvent être transmis entre le moment de la constatation d’un dysfonctionnement et celui de sa résolution.
Dans ce contexte d’automatisation, les risques opérationnels (154)peuvent avoir une importance croissante. Mais au delà des erreurs n’impliquant que le courtier utilisant l’algorithme incriminé, d’autres peuvent avoir une importance plus globale et concerner l’ensemble d’une place d’échange. La performance technologique semble donc avoir pour corollaire un risque systémique accru.
À titre d’exemple (155), le Crédit Suisse (156) avait opéré une modification inappropriée d’algorithme en 2007. Cet algorithme avait alors généré près de 600 000 ordres erronés en 20 minutes faussant les carnets d’ordres et ralentissant considérablement l’accès aux systèmes de gestion des ordres du marché. C’est pourquoi, le New York Stock Exchange a infligé au Crédit Suisse, le 13 janvier 2010, une sanction pécuniaire de 150 000 dollars motivée par un « manque de supervision du développement et de l’exécution d’un algorithme ».
Le trading algorithmique est aussi soupçonné d’avoir joué un rôle dans le « flash crash » du 6 mai 2010 à Wall Street qui a entraîné la baisse du Dow Jones de 1000 points en quelques minutes.
M. Dominique Cerutti, directeur général de NYSE-Euronext, a ainsi décrit l’enchaînement ayant conduit à cet incident : « Le mini-krach du 6 mai est la conséquence type d’une hyper-fragmentation des marchés. Les procédés sur les différentes places boursières ne sont pas les mêmes. Chez nous, les choses sont revenues très rapidement dans l’ordre car nos coupe-circuits ont fonctionné. Sur les plateformes qui n’en avaient pas, le choc a été violent. Dans un climat de nervosité, sur fond de crise européenne, la volatilité des cours était très accentuée et, à un moment donné, les marchés se sont emballés sur quelques titres. Tous les traitements sont automatisés sur les marchés, même les ordres, avec le trading algorithmique, et les signaux de prix ont provoqué, à des fins de couverture, des ordres de vente pour limiter les pertes. Sur les marchés régulés, à la vue des écarts de cours, les opérateurs présents ont arrêté les programmes, pris leur téléphone pour demander aux courtiers si le cours était vraiment celui auquel ils voulaient négocier. Dans la négative, ils ont suspendu les cotations. Quelques secondes, au pire quelques minutes, suffisent pour revenir à l’équilibre. Mais, là où les procédures étaient entièrement automatisées, sur les MTF, les ordinateurs ont, faute de personnel suffisant, continué à tourner une dizaine de minutes de trop. Il a donc fallu détricoter les ordres aberrants qui avaient été exécutés. Pas chez nous. » (157)
Dans l’attente du rapport du régulateur américain (Securities and Exchange Commission – SEC) sur les causes de ce crash éclair, M. Jean-Pierre Jouyet a considéré que le trading à haute fréquence avait sans doute une responsabilité dans les événements du 6 mai (158). Par ailleurs, la SEC a validé le 10 septembre 2010 l’élargissement du nombre de valeurs soumises aux systèmes de coupe-circuit visant à éviter des effondrements de cours tels que celui observé lors du crash éclair.
Pour ses défenseurs, l’informatisation des échanges a amélioré la stabilité, la précision et la vitesse des plates-formes financières en permettant l’analyse simultanée de plusieurs marchés. Une plus grande vitesse d’action « est en fait un signe de santé, de vitalité et de concurrence sur le marché », explique M. Cameron Smith, responsable de Quantlab, une société spécialisée dans les transactions à haute fréquence basée à Houston (159). Le trading algorithmique est ainsi un pourvoyeur important de liquidité.
Cependant, on peut d’abord s’interroger sur le caractère durable de cette liquidité et sur une possible dégradation de la qualité des prix. En outre, le trading algorithmique est porteur de nombreux risques. Il peut entraîner une généralisation des manipulations de carnets d’ordres. Il rend les compétences de surveillance et de contrôle du régulateur difficiles à mettre en œuvre. Il contribue à l’illisibilité des marchés et renforce également les possibles conséquences d’une erreur de manipulation pour l’intégrité de ces mêmes marchés.
Néanmoins, peu d’études poussées ont été menées à ce jour sur le trading algorithmique malgré l’importance croissante de l’utilisation de ces techniques. Ce manque de données est le résultat de l’opacité entourant la création et le fonctionnement des algorithmes qui sont la propriété des développeurs et apparaissent comme un avantage concurrentiel dont les rouages ne sont pas divulgués. L’absence de données quantitatives et qualitatives pertinentes pourrait certes favoriser une vision alarmiste de ces techniques nouvelles. Mais la plupart des risques potentiels, analysés notamment par l’AMF, apparaissent très sérieux.
2.– Les ventes à découvert : l’utilisation abusive d’un outil par ailleurs indispensable
La technique de la vente à découvert (short selling) consiste à vendre des titres à terme sans les détenir en portefeuille dans l'espoir de les racheter à un cours inférieur et de réaliser ainsi une plus-value. Il s’agit d’une technique spéculative dont l’usage excessif est sans doute l’une des causes de la faillite de la banque Lehman Brothers à l'automne 2008. Le dispositif français actuel n’interdit pas les ventes à découvert.
LES VENTES À DÉCOUVERT Tout intervenant en bourse peut vendre une action qu’il ne possède pas. Il devra néanmoins livrer les titres à J+3. À cette fin, il aura soit recours à l’emprunt de titres, soit rachètera les titres vendus au prix du marché à J+3 : – si le cours du titre baisse : une plus-value sera réalisée ; – si le cours du titre augmente : une moins-value sera réalisée. Le recours à l’emprunt de titres permet de se couvrir contre le risque de non livraison, mais seulement contre ce risque. |
L'article 570-1 du Règlement général de l'AMF impose seulement que, sur les marchés réglementés, à la date de livraison, l'investisseur dispose des titres pour être en mesure de les livrer. L'intermédiaire financier peut également exiger de son client la constitution d’une provision dans la mesure où il est responsable du règlement-livraison, mais ce n’est pas systématique.
Rien n’interdit, en revanche, sur les marchés de gré à gré, la pratique des ventes à découvert « à nu » (naked shortselling) non approvisionnées et non sécurisées, dans lesquelles le vendeur n’a ni la provision au moment de la transaction, ni les titres pour la livraison.
Cette technique est utilisée par les spéculateurs de deux manières : la première consiste à emprunter un titre dont on pense que le cours va baisser sur le marché et à le vendre aussitôt. L’idée est d’empocher une forte plus-value lorsqu’on achètera à un cours beaucoup plus bas pour le rendre au prêteur. Dans certains cas, la propagation de rumeurs contribue à fragiliser opportunément le titre, comme cela semble avoir été le cas lors de la crise de la dette grecque.
La deuxième pratique, dite vente à découvert « à nu » consiste à vendre un titre, avec un règlement différé, sans même l’emprunter. Au moment de le livrer à l’acheteur, l’opérateur se le procure au plus bas sur le marché en gagnant la différence si le cours du titre a effectivement baissé.
Doit-on interdire les ventes à découvert « nu » dans tous les cas ? Il apparaît que ce ne serait pas la vente à découvert à nu en elle-même qui pose problème, mais l’usage qui en est fait par les spéculateurs.
En effet, M. Philippe Mills, directeur général de l’Agence France Trésor, a clairement affirmé l’importance de la vente à découvert « à nu » dans le placement des émissions françaises : « Les spécialistes en valeur du trésor (SVT) sont des intermédiaires : l’objectif n’est pas qu’ils achètent en propre toute la dette de l’État : le volume de titres émis est beaucoup trop important. Cela consommerait une part importante de leurs ressources et les mettrait en danger, tout en fragilisant considérablement la sécurité des émissions de l’État, car la base d’investisseurs serait trop réduite. Leur rôle est d’assurer la sécurité et la fluidité de la mise sur le marché des titres de l’État français. Lorsqu’un SVT reçoit un ordre d’achat, il est obligé d’effectuer une vente à découvert – par définition, les SVT vendent des titres qu’ils ne peuvent pas posséder puisque ceux-ci n’ont pas encore été émis – et « à nu » – il est impossible aux SVT d’emprunter sur le marché du prêt-emprunt de titres (repurchase agreements ou Repo), dans le laps de temps qui sépare la négociation de la vente et le règlement de celle-ci, les titres qui ne seront mis sur le marché qu’à la livraison qui suit l’adjudication… Sans la technique de la vente à découvert « nu », la fluidité de la mise sur le marché des titres de l’État français serait donc moindre et l’État paierait plus cher les capitaux qu’il emprunte ». (160)
Cette situation n’est d’ailleurs pas propre à la France.
Cet exemple montre qu’il est inutile, voire dangereux, de pointer du doigt une technique, mais qu’il convient plutôt d’encadrer l’utilisation qui en est faite. L’utilisation de cette technique pourrait, en effet, comme on l’a vu, avoir favorisé la spéculation sur la dette grecque à travers les CDS, ce qui a amené, le 19 mai dernier, l'autorité allemande des marchés financiers (Bafin) à interdire, jusqu'en mars 2011, aux investisseurs de vendre des obligations d'État et des CDS contre le risque de défaut d'un État portant sur des titres qu'ils ne détiennent pas, et dont ils ne sont pas assurés de la disponibilité (c’est-à-dire leur vente à découvert).
Les actions de dix banques et sociétés d'assurances allemandes sont aussi concernées (Allianz, Deutsche Bank, Commerzbank, Deutsche Postbank, Munich Re, Hannover Rück, Deutsche Börse, Generali Deutschland, Aareal Bank et MLP).
M. Augustin de Romanet, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, a d’ailleurs clairement exposé devant la commission les limites d’une telle mesure prise dans le seul cadre national : « Nos amis allemands ont décidé seuls, sans nous en informer au préalable, d’interdire les ventes à découvert sur les titres de dette souveraine cotés en Allemagne. En pratique, ne sont concernées que les dettes allemande et autrichienne ; et cette interdiction, aussi spectaculaire soit-elle, et dont on sait bien qu’elle a été dictée par des considérations de politique intérieure, est, pour brider la spéculation, aussi efficace qu’un emplâtre sur une jambe de bois ! La succursale de la Deutsche Bank à Londres n’est pas soumise à la règle » (161).
3.– Les produits dérivés : un usage potentiellement dévoyé
Les produits dérivés représentent des opérations financières reposant sur d’autres opérations qui peuvent elles-mêmes être des dérivés d’autres opérations. Les produits dérivés, qui font l’objet de marchés, s’analysent comme des contrats qui consistent en des droits à terme ou des droits conditionnels résultant de contrats ou de promesses de contrats. Ils sont liés à des actifs ou indices dits « sous-jacents » et leur évolution dépend de l’évolution de ces actifs ou indices entre la conclusion du contrat et son dénouement. La valeur du produit est ainsi dérivée de celle des actifs sous-jacents qui peuvent être un taux d’intérêt, un taux de change, une valeur mobilière.
On distingue plusieurs catégories de produits dérivés :
– les contrats à terme (futures), qui sont des contrats d'achat ou de vente d'un actif à une échéance et à un prix fixé. Ces contrats à terme peuvent porter sur des actifs monétaires ou financiers (effets, valeurs mobilières, indices ou devises ou instruments équivalents) ou sur des marchandises. Il s'agit par exemple de contrats de vente de devises ou de contrats de vente de pétrole ;
– les contrats d'échange (swaps), qui sont des contrats d'échange d'actifs ou de flux financiers (ils peuvent porter par exemple sur des devises ou sur des taux) ;
– les contrats d'option, par lesquels l'acheteur de l'option paie une prime contre la faculté d'acquérir (option d'achat) ou de vendre (option de vente) une quantité déterminée d'instruments financiers à un prix et à une date ou pendant une période donnée.
a) Les risques inhérents aux produits dérivés
Ces produits ont été développés comme instruments de couverture. Ils ont cependant évolué et sont utilisés notamment pour prendre des positions spéculatives à tel point qu’ils ont été qualifiés par le milliardaire américain Warren Buffet « d’armes de destruction massive ».
L’innovation financière a créé des produits dérivés de plus en plus complexes. Le développement se fait autour de deux axes : transformation des caractéristiques des contrats et extension de la nature du sous-jacent. L’innovation financière est particulièrement active sur les marchés de gré à gré. Des nouveaux contrats y sont sans cesse créés : contrats sur l’inflation, le chômage, la volatilité des marchés financiers ou les prix de l’immobilier.
Les produits dérivés ont été présentés comme des instruments, permettant une allocation optimale des risques. En pratique, on constate qu’ils favorisent la volatilité des marchés sous-jacents en permettant de prendre des positions à fort effet de levier. La complexité des produits et la concentration des risques sont elles-mêmes des sources de nouveaux risques. L’effet déstabilisant est en particulier lié au fait que les marchés dérivés encouragent les agents à choisir les stratégies les plus risquées. De ce fait, plus d’un tiers du chiffre d’affaires d’Euronext ou de la Deutsche Börse provient de la négociation de produits dérivés.
Deux exemples récents apportent jusqu'à l'absurde la démonstration des risques liés à un usage immodéré des produits dérivés : les profits que l'on peut en tirer sont à la mesure des pertes potentielles, en particulier si des opérateurs indélicats, auxquels les responsables ont laissé « la bride sur le cou », au prétexte de leur belle performance, interviennent dans le processus.
LE CAS DE LA BARINGS BANK La chute, le 26 février 1995, de la Barings Bank, est une illustration des conséquences d'une mauvaise gestion des risques liés aux produits dérivés. La faillite de la banque a été causée par les actions d'un trader, nommé Nick Leeson, basé dans un petit bureau de Singapour, Baring Securites (Singapore) Limited (BSS) qui avait à l'origine une activité liée aux actions, mais dont le volume d'intervention sur le marché des futures sur le SIMEX (maintenant le Singapore Exchange) était en développement. Nick Leeson fut mis à la tête de ce bureau, avec le pouvoir d'engager des traders et les employés du back office. En fait, Nick Leeson se vit confier tous les rôles : general manager, head trader et, de fait, responsable du back office. Nick Leeson et ses traders étaient autorisés à effectuer deux types d'opérations : – transactions sur les futures et options pour le compte de clients ou pour compte propre pour les entités du groupe Barings ; – arbitrage entre les indices Nikkei sur le Singapore international monetary exchange (SIMEX) et sur l'Osaka Exchange. Leeson prit des positions spéculatives sur les produits dérivés liés à l'indice Nikkei 225 et aux obligations de l'État japonais (JGB) ainsi que des options sur le Nikkei. Il inscrivait ses positions sur un compte erreur de la BSS non utilisé, le compte n° 88888 (8 étant un nombre porte-bonheur en Asie). Il perdit de l'argent quasiment dès le début, et augmenta sa perte en voulant se refaire. À la fin de l'année 1992 le compte 88888 était en débit de 2 millions de livres sterling. Un an plus tard la perte était de 23 millions de livres sterling. À la fin de 1994 elle était de 208 millions de livres sterling. Le 23 février 1995, Nick Leeson s'envola pour Kuala Lumpur en laissant derrière lui un trou de 827 millions de livres sterling. Le tremblement de terre de Kobé allait également avoir des conséquences financières importantes. Convaincu que le marché allait repartir, Leeson continua à acheter des contrats pour couvrir ses premières pertes, cherchant à contrôler l’indice Nikkei dans l’espoir de limiter sa baisse. Les pertes sont alors estimées à 860 millions de livres sterling soit plus de deux fois le montant des capitaux propres de la banque. À cette date il avait une position qui représentait 50 % des positions sur les produits dérivés liés au Nikkei et 85 % de celles sur celles liées au JGB. Il avait accumulé ces positions sans que la direction de la Barings s'en aperçoive. Il avait répondu aux appels de marge sur le SIMEX en falsifiant des comptes appartenant à diverses entités du groupe Barings et des comptes clients. La Barings était dans un processus de fusion entre deux entités et le processus d'intégration a focalisé l'attention des dirigeants, qui n'ont pas contrôlé, en particulier, le bureau de Singapour. Nick Leeson enregistrait des profits dans certains comptes d'arbitrage dont il se targuait en occultant le compte 88888. Il en tirait une autorité qui le rendait intouchable. À Londres personne n'osait lui poser des questions de peur de paraître incompétent. |
LE CAS KERVIEL/SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Le 24 janvier 2008, la Société Générale annonce une dépréciation d'actifs de 2 milliards d’euros et indique qu'elle a été "victime d'une fraude au sein de son activité de courtage évaluée à 4,9 milliards d’euros". La cotation de ses actions est suspendue. Une augmentation de capital de 5,5 milliards d’euros garantie par JP Morgan et Morgan Stanley est annoncée. La Société Générale porte plainte pour « faux en écritures de banque, usage de faux en écritures de banque et intrusions informatiques ». Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire, confiée à la brigade financière, après des plaintes d'actionnaires pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, complicité et recel. L’affaire dite « Jérôme Kerviel » commence. Nature des activités de trading au sein desquelles la fraude a eu lieu Au sein de la direction Actions et dérivés actions (GEDS) de la Banque de financement et d’investissement, les structures dites « de trading », où s’est produite la fraude, effectuent deux grands types d’activité, selon qu’elles sont directement liées ou non aux opérations avec la clientèle. Les premières consistent à réaliser sur les marchés des transactions visant à réduire voire à supprimer le risque résultant pour la banque des opérations réalisées pour ses clients. Les secondes, dites « d’arbitrage » ou de « trading pour compte propre » consistent à tirer parti d’écarts de valorisation entre des actifs liés par des corrélations. Par exemple, acheter un portefeuille d’instruments financiers et vendre au même moment un portefeuille d’autres instruments financiers présentant des caractéristiques extrêmement proches mais dont la valeur est légèrement différente. Le fait que les caractéristiques des portefeuilles soient très proches et qu’elles se compensent a pour conséquence que de telles activités présentent peu de risques de marché. Les écarts de valeur étant le plus souvent faibles, les opérations doivent être nombreuses et porter sur des nominaux parfois élevés pour que l’activité dégage un résultat significatif. L’auteur de la fraude faisait partie d’une équipe qui travaillait dans cette activité. Dans les deux cas, ces activités de trading n’ont pas vocation à la prise de positions, à la hausse ou à la baisse, sur les marchés (« risque directionnel ») si ce n’est de manière résiduelle, pour une courte durée, et dans des limites strictement définies. Nature de la fraude reprochée à Jérôme Kerviel L’intéressé est sorti du cadre de son activité normale d’arbitrage et a constitué des positions « directionnelles » réelles sur des marchés réglementés, en les masquant par des opérations fictives de sens contraire. Les diverses techniques utilisées ont consisté principalement en : – des achats ou ventes de titres ou de warrants à date de départ décalée ; – des transactions sur futures avec une contrepartie en attente de désignation (pending) ; – des forwards avec une contrepartie interne au Groupe. Il a commencé à prendre ces positions directionnelles non autorisées, en 2005 et 2006 pour des montants faibles, de manière importante à compter de mars 2007. Ces positions ont été découvertes entre le 18 et le 20 janvier 2008. La perte totale résultant de ces positions frauduleuses a été identifiée et s’élève à 4,9 milliards d’euros, après leur débouclement du 21 au 23 janvier 2008. Et maintenant ? Selon M. Frédéric Oudéa, président-directeur général de la Société Générale, « M. Kerviel a pris des positions totalement en dehors de son mandat et les a masquées par de fausses transactions. Des contrôles étaient effectués mais ils portaient sur les positions nettes, s’agissant d’opérations d’arbitrage. Il y avait eu des alertes, mais cela n’avait pas conduit à détecter la fraude avant le fameux week-end du début janvier 2008. Nous avons donc, en totale transparence, renforcé nos contrôles. Premièrement, nous avons instauré des limites sur les nominaux portant sur chacun des arbitrages, et non plus seulement sur la position nette. Deuxièmement, nous avons créé un département spécial de lutte contre la fraude, opérant de manière transversale : Jérôme Kerviel faisait basculer ses fausses opérations d’une entité à l’autre, si bien que les incidents n’apparaissaient pas de manière récurrente dans un même département ; le département que nous avons créé examine tous les incidents de manière transversale, en essayant à chaque fois de « tirer les fils », au-delà de notre structure d’organisation. Troisièmement, nous avons réorganisé nos back-offices en créant un département appelé product control group, qui regroupe des acteurs d’horizons différents – middle office, finance, back-office – pour comprendre la constitution du résultat dans ses moindres détails, alors que jusque-là tout était noyé dans la masse des opérations ; désormais, nous pouvons avoir une vision quotidienne fiable de nos résultats. J’ajoute que le nombre d’auditeurs et d’inspecteurs n’a cessé d’augmenter depuis trois ans ; 1 700 personnes, soit environ 1 % de nos effectifs, se consacrent aujourd'hui exclusivement au contrôle de second niveau, effectué périodiquement, en plus du contrôle de premier niveau exercé de façon permanente par chaque opérateur ou manager. Une autre affaire Kerviel est-elle possible ? À mon avis, non. La fraude existe, dès lors qu’il y a manipulation d’argent – sur les marchés financiers, mais aussi bien dans une agence pour détourner 1 000 euros – et nous ne sommes pas capables de l’éviter totalement. En revanche, à mon sens, une fraude de cette ampleur et de cette durée ne peut se reproduire à la Société Générale (162). » |
Ces deux affaires fortement médiatisées ne sont pas les seules impliquant d’importantes pertes liées à une prise de risques excessifs sur des produits dérivés. La Banque centrale américaine estime que, depuis 1980, les institutions financières ont dû faire face à plus de 100 cas de pertes d’un montant supérieur à 100 millions de dollars, causé par une mauvaise gestion de ce risque. Les pertes opérationnelles les plus élevées – outre les exemples cités – ont été enregistrées par Sumitomo Corporation en 1996 (2,9 milliards de dollars), Orange County en 1994 (1,7 milliard de dollar), Daiwa Bank en 1995 (1,1 milliard de dollars).
La plupart de ces pertes ont par ailleurs été enregistrées dans les années 1990 alors que l’encours sur produits dérivés était relativement faible. Avec l’explosion de cet encours illustré par les tableaux ci-dessous, le risque lié à ces produits se trouve accru d’autant.
ENCOURS SUR PRODUITS DÉRIVÉS
(en milliards de dollars)
1986 |
1 083 |
1990 |
5 771 |
1995 |
27 175 |
Fin 2005 |
315 000 |
Fin 2006 |
415 000 |
Fin 2007 |
620 000 |
Fin 2008 |
520 000 |
Fin 2009 |
605 000 |
Source : Banque des règlements internationaux.
ENCOURS PAR NATURE DE PRODUITS DÉRIVÉS EN JUIN 2009
(en milliards de dollars)
Dérivés de taux |
437 000 |
Dérivé de change |
49 000 |
Risques de crédits (CDS) |
36 000 |
Dérivés sur les marchandises |
3 700 |
Dérivés sur les actions |
6 600 |
Source : Banque des règlements internationaux.
Ces exemples de pertes abyssales et l’augmentation exponentielle de l’encours sur les produits dérivés font craindre une multiplication de nouvelles « affaires », en l’absence de régulations fortes.
b) Un cas typique de produit dérivé hautement spéculatif : les couvertures de défaillance (credit default swaps – CDS), mis en lumière lors de la crise grecque
La couverture de défaillance ou credit default swap (CDS) est un contrat d’assurance contre la défaillance d’un émetteur. En lui-même, ce type d’instrument n’est pas condamnable : comment interdire à un investisseur de se prémunir contre le risque en se couvrant ? M. Frédéric Oudéa, président-directeur général de la Société Générale, l’a clairement illustré, à propos d’un type de contrat où la corrélation avec l’actif sous-jacent n’est pas très apparente : « Imaginez que nous souhaitions aider une entreprise française à construire un pont dans un pays lointain. L’opération nous expose à trois types de risque : un risque d’exécution – il faut savoir construire le pont – ; un risque d’exploitation – il faut que le projet soit rentable – ; enfin, le risque attaché au pays. Il peut nous être utile de conclure un CDS sur le pays concerné pour nous protéger de ce troisième risque et de lui seul. Mais ce CDS va-t-il être qualifié de nu ? Je doute que le régulateur puisse distinguer les CDS vraiment nus des autres. Le CDS peut ne pas être corrélé directement à un actif sous-jacent, mais être néanmoins parfaitement légitime » (163).
Dans le cas de la Grèce, l’écart de taux (spread) de l’obligation souveraine est fortement corrélé avec les CDS sur cette même obligation. Reste la question essentielle : qui donne le tempo, l’obligataire ou le CDS ?
Le premier facteur réside dans la taille du marché des CDS souverains qui, s’il devient trop important face à celui de la dette souveraine, peut, en effet le déstabiliser.
TAILLE DU MARCHÉ CDS PAR RAPPORT
À CELUI DU MARCHÉ OBLIGATAIRE
(en %)
Italie |
14 |
Espagne |
18 |
Grèce |
18 |
Allemagne |
5 |
Portugal |
45 |
France |
4 |
Irlande |
30 |
Royaume-Uni |
3 |
Belgique |
8 |
Suède |
15 |
Source : Natixis Special Report 2 mars 2010.
La vulnérabilité du Portugal mais aussi de l’Irlande vis-à-vis d’une attaque spéculative via les CDS souverains est donc importante au regard de ce critère. Ces pays se situent en effet, bien au-delà de la moyenne mondiale qui est de l’ordre de 19 % – la taille du marché des CDS souverains étant de 1 761 milliards de dollars en juin 2009 contre une dette souveraine mondiale de l’ordre de 9 200 milliards de dollars. De plus, la taille du marché des CDS souverains est négligeable eu égard au marché total des CDS (36 000 milliards de dollars).
Il apparaît donc clairement que le marché obligataire reste le marché dominant concernant la valorisation des dettes souveraines. Toutefois, le volume des CDS augmente naturellement avec la dégradation de la dette, qui attire les positions jouant contre le pays en question et accentuant ses difficultés.
L’utilisation des CDS à des fins spéculatives peut ainsi être destructrice pour l’économie. Il est en effet possible d’acheter des CDS nus, soit une assurance contre un risque que l’on n’a pas à couvrir. Selon M. Augustin de Romanet, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations : « Dès lors, un investisseur qui achèterait un CDS nu sur une obligation assimilable au Trésor (OAT) française à dix ans sans posséder ladite OAT espère une dégradation de la situation économique de la France, puisque son actif se valorise à proportion de cette dégradation : c’est un peu comme si on autorisait BetClic ou le PMU à ouvrir des paris sur la situation budgétaire des États. Le même investisseur pourrait faire courir les pires rumeurs sur l’économie française : cela aurait pour effet d’augmenter la valeur de son titre, tout en détériorant les conditions de financement de la France. » (164)
La Revue de la stabilité financière de la Banque de France de juillet 2010 révèle un exemple de l’utilisation des CDS à des fins spéculatives :
« Le spéculateur commence par vendre à découvert un volume important de l’obligation sous-jacente, avant de surpayer un petit volume de protection par CDS. Le signal est clair : il faut s’attendre à une dégradation de la situation économique de l’émetteur induisant les investisseurs en erreur au point que les prix des obligations chutent fortement. Le manipulateur sort ensuite rapidement aussi bien de sa position sur l’obligation que de celle sur le CDS en dégageant un gain net avant que de meilleures informations sur les prix ne parviennent jusqu’au marché. En période de tension sur la situation financière des États, de tels comportements peuvent être déstabilisateurs ».
Il reste qu’une réglementation trop rigoureuse des CDS, et plus généralement, de l’ensemble des produits dérivés pourrait cependant avoir pour effet secondaire d’assécher la liquidité du marché. En conséquence, il convient d’agir avec mesure.
Le second facteur – au-delà de la quantité de CDS – est l’opacité de ces produits. Ainsi que là indiqué devant la commission d'enquête M. Frédéric Oudéa, président directeur-général de la Société générale « En l’absence de marché organisé, c’est-à-dire de place centralisant les achats et les ventes, ils [les CDS] ont été conclus de manière bilatérale. Une banque A, se jugeant trop exposée à un risque sur une entreprise, mais ne souhaitant pas mettre fin à ses relations avec elle, se protège en passant un contrat de CDS avec une banque B. Si celle-ci accumule les contrats de ce type, elle pourra décider à son tour de se protéger en passant un contrat avec une banque C. C’est ainsi que la multiplication des contrats bilatéraux a abouti à une estimation de 60 000 milliards de dollars, bien supérieure à la somme des crédits sous-jacents. Car il n’existe pas de marché pour annuler les opérations de sens inverse, ce qui gonfle artificiellement la « bulle » apparente.
« Y a-t-il trop de CDS ou pas assez ? Je ne sais pas juger. Pour notre part, nous soutenons l’idée de créer des places de marché, afin d’avoir une meilleure vision des volumes en question, de comprendre l’ensemble des risques et d’assurer une compensation entre les risques et les différents acteurs. La Société Générale n’est pas un acteur important en matière de CDS : nous ne vendons pas de la protection, nous n’assurons pas les autres. Nous avons tout intérêt à avoir moins de contrats bilatéraux et plus de standardisation, en passant par une place de marché. (165) »
4.– Une pratique qui démultiplie les effets des opérations spéculatives : l’effet de levier
L’effet de levier permet aux opérateurs de maximiser leur espérance de profit. Il est utilisé sur les marchés, ainsi que pour des opérations d’une nature particulière de rachat d’entreprises.
a) L’effet de levier pemet de « gonfler la mise » des acteurs de marché
Les acteurs qui interviennent sur les marchés peuvent prendre des risques, donc réaliser des profits ou des pertes, très largement supérieurs à leur mise de fonds, par un recours à l’« effet de levier », qui, à la faveur de la surabondance des liquidités, donne une ampleur encore plus grande aux effets de la spéculation, comme on en a vu un exemple précis dans les cas de l’attaque lancée, en septembre 1992, par Georges Soros contre la livre sterling (cf. première partie, II, B, 1) : avec un « pécule » de départ d’un milliard de livres sterling, il put s’engager, en empruntant plus d’une quinzaine de milliards de livres, dans une opération qui, compte tenu des interventions suivistes réalisées par d’autres opérateurs, coûta quelque 50 milliards de livres à la Banque d’Angleterre.
UTILISATION DE L’EFFET DE LEVIER DANS LA SPÉCULATION ● L’effet de levier d’un établissement L'effet de levier est une technique consistant à recourir à l'endettement pour augmenter la rentabilité des capitaux propre de l'entreprise. L'effet de levier est la différence entre la rentabilité des capitaux propres et la rentabilité économique. Si cette différence est supérieure au coût de l'endettement l'effet de levier est positif, sinon il est négatif. Les risques des opérations à effet de levier sont généralement limités par l'utilisation d’un financement sans recours (166) isolé dans une société ad hoc. L'utilisation d'un effet de levier important a été une des façons pour les dirigeants de satisfaire aux exigences de la valeur actionnariale. L'effet de levier démultiplie les profits qui peuvent être tirés grâce aux plus-values d'un actif. L'effet de levier a permis des rentabilités très élevées dans toute la période de croissance de valeur des actifs. Cependant, il occasionne des pertes considérables en cas de retournement du marché. Les banques d'investissement ont augmenté de plus en plus l'effet de levier. Les comptes publiés en mai-juin 2008 par les banques d'investissement de Wall Street – alors que, par des ventes d'actifs, elles avaient commencé à réduire l'effet de levier – montrent que le levier utilisé par Lehman Brothers était de 23,3 – il était encore de 30,7 en novembre 2007 (167) – celui de Morgan Stanley était de 30,0, celui de Goldman Sachs de 24,3 et celui de Merril Lynch de 44,1. Si le profit peut être élevé, le risque potentiel l’est tout autant : une institution qui a un effet de levier de 30 voit ses fonds propres effacés avec une baisse de 3,3 % de la valeur de ses actifs. ● Le trading à effet de levier Le principe du trading à effet de levier est d’acheter ou de vendre un instrument financier en réalisant un levier. Ce mécanisme permet aux clients d’ouvrir des positions en déposant moins de fonds que ce qui peut être demandé habituellement par d’autres courtiers. Par exemple pour acquérir au comptant pour 100 000 euros d’un titre, il est nécessaire d’immobiliser la totalité des fonds. En comparaison, pour une position équivalente avec un effet de levier, il suffit de déposer 10 000 euros en dépôt de garantie – si le taux du dépôt de garantie est de10 %. Le dépôt de garantie est le montant initial demandé pour qu’un investisseur puisse prendre une position. Il varie selon la classe d’actif et il est le reflet de la nature du produit, de sa liquidité et enfin de la volatilité du sous-jacent. L’effet de levier varie selon les niveaux de ces taux de garantie. De par la nature du mécanisme, les profits et les pertes potentiels peuvent être très supérieurs à l’investissement initial. |
b) Le rachat par effet de levier (LBO) : une fréquente fragilisation des entreprises
Originaire des États-Unis, le leverage buy-out (LBO) ou « rachat par effet de levier » s’est fortement développé dans les années 1980 en Europe pour connaître un essor exponentiel après l’an 2000. En France, les investissements en LBO représentaient 2,6 milliards d’euros début 2005 et 5,5 milliards d’euros en 2007.
Le LBO est un dispositif qui permet le rachat d’une entreprise par des fonds d’investissement avec un fort recours à l’emprunt, dont le remboursement est assuré par l’entreprise elle-même. Le LBO se porte donc sur des entreprises financièrement solides. Elles doivent donc générer suffisamment de bénéfices pour couvrir les charges de l’emprunt. Elles ont donc tendance à comprimer les salaires et réduire l’investissement afin de donner la priorité à la charge de l’emprunt.
M. Augustin de Romanet, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, a porté un jugement sévère sur cette pratique, considérant qu'elle traduit « une dérive du « court-termisme » dans la mesure où [les LBO] valorisent les entreprises en stoppant les investissements. Lorsque j’ai pris la direction de la Caisse des dépôts, j’ai été frappé de ce que plusieurs entreprises étaient en situation de « Capex holidays », c’est-à-dire d’arrêt des capacités d’investissement : le fonds LBO, en achetant une société à un prix x qui correspond à un multiple du bénéfice, accroît fortement ce dernier en stoppant les investissements ; si bien que, quatre ans plus tard, la société est revendue à un prix augmenté d’autant, l’arrêt des investissements, qui tue l’entreprise et menace ses emplois, n’étant pas détectable à court terme » (168).
En période de crise, les faillites d’entreprises sous LBO ont tendance à se multiplier. Les fonds d’investissement ne sont plus en mesure d’injecter de la liquidité dans les entreprises et leur intérêt est moins la survie de celles-ci que de vendre leurs titres de dette à des conditions favorables. Certaines banques ont pratiqué ce type d’opérations avec une certaine ampleur, ce qui, combiné à l’exposition au risque résultant de la titrisation, a été un facteur de fragilité lors de la survenue de la crise : on sait par exemple ce qu’il est advenu aux banques Bear Stearns et Lehman Brothers, qui ont assez largement pratiqué le LBO.
EXPOSITION DES BANQUES AUX MÉTIERS DE TITRISATION ET AU FINANCEMENT LBO
(en % du résultat du groupe, en 2006)
Banques |
Titrisation |
LBO |
Combiné |
Bear Stearns |
23 |
6 |
29 |
Deutsche Bank |
11 |
10 |
21 |
Crédit Suisse |
9 |
10 |
19 |
Lehman Brothers |
12 |
6 |
19 |
Merrill Lynch |
9 |
4 |
13 |
Morgan Stanley |
6 |
4 |
12 |
Goldman Sachs |
4 |
5 |
8 |
RBS |
4 |
2 |
7 |
UBS |
3 |
2 |
6 |
Barclays |
4 |
2 |
6 |
BNP Paribas |
3 |
3 |
6 |
Natixis |
4 |
1 |
6 |
ABN AMRO |
4 |
3 |
6 |
Crédit Agricole SA |
3 |
1 |
5 |
Société Générale |
3 |
1 |
4 |
HSBC |
1 |
0 |
1 |
Source : JP Morgan (Les Échos du 13 août 2007).
C.– DES MARCHÉS PEU TRANSPARENTS
1.– Les effets pervers de la directive sur les marchés d’instruments financiers (MIF)
La directive européenne 2004/39 sur les Marchés d’instruments financiers (MIF), désignée aussi par les professionnels sous son nom anglais Markets in financial instruments directive (MiFiD), du 21 avril 2004, constitue avec les quatre directives adoptées en 2003-2004 (« abus de marché », « prospectus », « OPA » et « transparence ») le corpus juridique du grand marché financier intégré au niveau européen.
La directive MIF avait pour objet d’instaurer un cadre réglementaire communautaire applicable à l’ensemble des transactions sur instruments financiers exécutées sur les places financières européennes. Il s’agissait d’assurer la libre prestation des services financiers sur l’ensemble du marché unique, tout en garantissant aux investisseurs un niveau élevé de protection.
Elle est aujourd’hui très critiquée par la communauté financière, comme étant un des facteurs ayant contribué à la crise de 2008. Dans le cadre d’une refonte de la législation financière européenne, avec la future réglementation des produits dérivés, la refonte de la directive « abus de marché » et la création de l’AEMF, la directive MIF devra donc impérativement être révisée significativement courant 2011, conformément au processus de révision qu’elle prévoit elle-même.
a) Les modifications apportées au mode de fonctionnement des marchés par la directive MIF
Avant l’entrée en vigueur de la directive au 1er novembre 2007, les ordres de Bourse ne pouvaient être exécutés en France que sur un marché réglementé (type Euronext). Dans le cadre d’une dynamique mondiale de privatisation des marchés boursiers et de mise en concurrence des bourses entre elles, mais également avec leurs utilisateurs pour l’intermédiation, la MIF a ainsi créé un « marché pour les marchés » (a market for markets), sur lequel « les marchés sont devenus des acteurs privatisés de la concurrence privée » (169).
La directive a mis en place un cadre juridique unique pour les trois nouveaux modes d’exécution des ordres de Bourse, à savoir :
– un marché réglementé qui est un système multilatéral agréé (Euronext Paris, MONEP, MATIF pour la France) ;
– des systèmes multilatéraux de négociation (SMN ou MTF – multileral trading facilities) qui sont exploités par une entreprise de marché. Ce sont des plates-formes spécialisées dans la négociation de titres admis ou non admis sur un marché réglementé (Alternext en France) ;
– des internalisateurs systématiques (IS) qui sont des entreprises d’investissement négociant pour compte propre et exécutant les ordres de leurs clients en dehors d’un marché réglementé ou d’un SMN. Il s’agit d’un mode de négociation de gré à gré (over the counter – OTC) par lequel l’intermédiaire se porte systématiquement contrepartie de son client.
En contrepartie de cette libéralisation, la MIF impose un certain nombre d’obligations en matière de transparence pré- et post-négociation, et notamment la règle de « meilleure exécution » à laquelle sont tenus les intermédiaires vis-à-vis de leurs clients.
b) Une directive qui a manqué ses objectifs et fortement perturbé les marchés
Cette institutionnalisation de la concurrence entre les différents types de marchés devait permettre non seulement de développer l’innovation mais également de réduire les coûts de transaction. Or, pour la majorité des spécialistes des questions financières, la directive a eu des résultats plus que décevants et serait même une des causes de la crise financière de l’automne 2008.
Ainsi, selon M. Jean Pierre Jouyet (170), président de l’Autorité des marchés financiers (AMF), la transformation du marché des actions résultant de l’entrée en vigueur de la directive MIF, a de fait contribué à aggraver la spéculation excessive ou frauduleuse.
● La fragmentation des marchés financiers et de la liquidité
Un des défauts de la MIF a été de mettre en concurrence les marchés réglementés, les MTF et les internalisateurs, alors que ces systèmes de négociation n’ont pas les mêmes caractéristiques. Les MTF ont ainsi par nature la possibilité de s’enregistrer dans l’État membre de leur choix. Ils ont donc tous privilégié celui qui offrait le moins de contraintes règlementaires et qui autorisait les nouveaux entrants à opérer à perte : le Royaume-Uni. De même, des personnes qui ne sont pas des institutions financières, qui ne sont donc soumises à aucun agrément et n’ont aucune obligation envers les autres opérateurs, ont le droit d’être membres de ces marchés financiers.
Ainsi, le marché unique européen des instruments financiers est un marché d’échanges simultanés sur des plates-formes multiples, un marché totalement fragmenté. En voulant instaurer plus de transparence par la concurrence, la MIF a en réalité contribué à brouiller l’information pour les opérateurs et le régulateur.
● La dispersion de l’information et l’émergence de nouvelles plates-formes d’échanges opaques
Les failles de la réglementation européenne ont permis le développement très rapide des plates-formes de négoce anonyme (dark pools) et autres réseaux croisés (crossing networks), lieux d’échanges totalement « noirs », opaques, qui ne donnent aucune information sur leurs carnets d’ordres. Ces marchés opaques représenteraient selon M. Dominique Cerruti, directeur général d’Euronext (171), 40 % du volume des transactions, dont l’essentiel est constitué de transactions OTC (over the counter – de gré à gré) qui sont des contrats sur mesure.
Les premiers (7 % de l’opacité) sont des MTF qui ont proliféré à la faveur des dérogations prévues par la directive MIF aux obligations de transparence de pré-négociations. Selon M. Dominique Cerruti, ces nouveaux lieux d’échanges avaient un but légitime en ce qu’ils permettaient de protéger l’investisseur pratiquant le négoce par blocs (block trading). Les négociations de blocs servent en effet à exécuter des transactions qui excèdent un volume prédéfini sur la majorité des contrats sur dérivés d’actions traités sur le marché. Elles sont nécessairement non transparentes, de manière à éviter un effondrement brutal des prix. Cependant, les plates-formes anonymes (dark pools) ont peu à peu traité des volumes plus petits, de la taille individuelle, créant une totale confusion et un risque énorme pour les investisseurs non professionnels.
UN EXEMPLE DE DARK POOL : CHI-X Plate-forme d’échanges alternative, la branche européenne de CHI-X Global a été créée au printemps 2007 et est présente dans 16 pays européens, dont la France. Filiale à 34 % de l’agence de courtage Instinet et d’autres groupes (notamment UBS, Citigroup, Crédit suisse, Merill Lynch et Morgan Stanley), CHI-X est devenu en trois ans un acteur incontournable des marchés financiers européens (CHI-X Europe) et américain (CHI-X Canada). Depuis l’été 2010 offre également ses services sur les places de Singapour, d’Australie et du Japon. Récemment, des rumeurs ont circulé sur un achat de la société par Nasdaq OMX et la Deutsche Börse, illustrant les convoitises dont elle fait l’objet. Sur le marché européen, ce « dark pool of liquidity » offre la possibilité de traiter des ordres de blocs à un prix inscrit dans la fourchette moyenne pondérée, et des ordres à quantité cachée (iceberg orders). Ils affichent des tarifs compétitifs par rapport aux marchés réglementés, favorisant ainsi de gros volumes de transactions. La négociation représente ainsi 83 % du coût avec un opérateur classique, alors qu’elle est de 41 % pour CHI-X. Ainsi, cette plate-forme a enregistré 482 milliards d’euros de transactions au deuxième trimestre 2010, portant sur 58,1 milliards d’actions. Elle représentait fin septembre 2010 25 % de part de marché sur l’indice britannique et 20 % sur le CAC 40. La plate-forme alternative est devenue le troisième opérateur boursier du Vieux continent avec 13 % de part de marché derrière le London Stock Exchange (24,2 %) et Nyse Euronext. Autre raison de ce succès fulgurant, CHI-X a su utiliser les avancées technologiques permettant de fractionner les ordres et de les envoyer à très haute vitesse. Ses ordinateurs sont capables de traquer des différentiels de prix ou des séquences d’ordre pour proposer un large choix de produit aux investisseurs. CHI-X est une filiale non cotée, qui ne publie pas ses comptes, mais qui, selon son porte-parole, dispose de 18 millions d’euros de livres à son bilan, et emploie uniquement 45 collaborateurs, fonctionnant comme un véritable low cost de la finance. |
Les crossing networks sont des systèmes d’appariement des ordres entre clients d’un même prestataire de service d’investissement ou d’un ensemble de prestataires. Dans les faits, ils opèrent donc un système commun de croisement des ordres d’achat et de vente transmis par les clients, sans aucune contrainte de publicité préalable. Les investisseurs ont peu à peu délaissé les IS au profit des crossing networks (10 % de l’opacité), qui sont en croissance constante.
LES RÈGLES DE TRANSPARENCE ET LEURS DÉROGATIONS La transparence pré-négociation Règle La transparence pré-négociation permet de connaître les intérêts acheteurs et vendeurs sur les titres négociés sur les trois types de marché, réglementé, MTF ou IS. L’investisseur peut ainsi connaître en continu le spread entre le prix à l’achat et à la vente, c'est-à-dire pour quel prix et pour quelle quantité les autres opérateurs sont prêts à acheter ou vendre. Dérogations (articles 17 à 20 du Règlement n° 1287/2006 de la Commission) Elles devaient permettre aux ordres sur bloc de demeurer secrets afin de limiter l’impact de ce type de transactions sur la formation des prix. Quatre dérogations sont prévues : – en cas d’exécution sur la base d’un prix emprunté à d’autres plates-formes ; – en cas d’ordres de taille importante (bloc) ; – en cas de transactions négociées, les prix doivent se situer à l’intérieur d’une fourchette courante pondérée ; – lorsque les ordres sont placés dans un système de gestion des ordres avant leur diffusion au marché (iceberg orders, ordres à quantité cachée). La transparence post-négociation Règle La transparence post-négociation permet de connaître les conditions d’éxécution des transactions, une fois celles-ci effectuées, c'est-à-dire « en temps réel ». Dérogations Elles consistent en des autorisations de diffusion en différé lorsque l’intervenant exécute en compte propre des transactions de taille importante : de 60 minutes à trois jours. Ces différés de publication doivent permettre de déboucler les positions prises par l’intervenant et d’ainsi réduire les impacts de marché. |
Contrairement à son objectif, la directive n’aurait pourtant pas permis de réduire les coûts globaux des transactions. Certes, le coût de négociation a diminué face à la concurrence des MTF. Ainsi, sur les trois premiers trimestres 2008, le coût moyen d’exécution d’un aller-retour se situait entre 0,25 et 0,30 point de base sur les MTF et de 0,80 à 2,90 sur les marchés réglementés. Par la suite, ces derniers ont été contraints de baisser leurs tarifs d’environ 30 % pour continuer à générer de gros volumes de négociation.
En revanche, rien ne démontre une baisse du coût global, c'est-à-dire du coût direct (relevant des coûts pré et post-marché) et du coût indirect (parmi lesquels on compte les investissements technologiques ou encore les frais supplémentaires liés à la dispersion de l’information). Aussi, certains spécialistes considèrent qu’il existe des « coûts cachés de la fragmentation, dans la mesure où celle-ci peut accroître les opportunités manquées en cas de non-connexion aux systèmes de négociation les plus performants. » (172)
La désagrégation de l’information induite par la fragmentation des marchés a nécessité d’importants investissements dans l’informatique pour la reconstituer, la traiter et l’exploiter.
C’est pourquoi, les opérateurs se sont lancés dans le trading algorithmique ou HFT, permis par des avancées informatiques sans précédent. Ces nouveaux mécanismes de passation automatique des ordres compliquent la lisibilité du marché, le rendant totalement opaque pour les opérateurs et pour les régulateurs. Le danger du HFT est de permettre en toute impunité la manipulation des carnets d’ordres, puisqu’ils ne sont pas contrôlés par les autres régulateurs européens.
Selon certains spécialistes (173), on a assisté à « une concentration de l’intermédiation financière ». « Seuls les plus grands opérateurs internationaux (…) ont pu soutenir les coûts très élevés liés aux technologies les plus avancées ». Ce mouvement d’« abus de position systémique » risque de s’accentuer à l’avenir, « alors même que les régulateurs et les Pouvoirs publics expriment leur suspicion à l’encontre d’institutions financières trop grosses pour ne pas être sauvées par la collectivité en cas de défaut (les fameux too big to fail) ».
Face à cette concurrence accrue pour générer un volume important de transactions, les marchés réglementés font depuis peu supporter les coûts de leurs obligations de surveillance et de transparence par les émetteurs. Afin de rester compétitifs, ils développent également de plus en plus des SMN et des dark pools, tandis que « les MTF créent des pools de liquidité uniques qui mêlent leurs dark pools à leur carnet d’ordres ». De ce fait, « le mélange de transactions opaques et transparentes rend également opaques celles qui ne l’étaient pas » (174).
MÊME LES PLATES-FORMES RÉGLEMENTÉES DÉLOCALISENT LEUR ACTIVITÉ POUR PARTICIPER À LA COURSE DE VITESSE QUE CONSTITUE LE TRADING HAUTE FRÉQUENCE « La meilleure façon d’avoir quelques millisecondes d’avance est encore d’installer ses machines au plus près du cœur informatique des marchés. Les grandes bourses officielles, pour survivre dans un monde où les plates-formes alternatives se multiplient, encouragent ce phénomène. NYSE Euronext a ainsi investi 500 millions d’euros pour construire à Malwah, aux États-Unis, et à Basildon, en Grande-Bretagne, de gigantesques centres informatiques que les adeptes du THF se partagent en colocation… » Irène Inchauspé, La Vérité sur le Trading haute fréquence. Challenges n° 236 – 9 décembre 2010. |
Le paysage boursier européen est ainsi en train de se recomposer autour de ces plates-formes alternatives, parfois créées par les bourses traditionnelles elles-mêmes. Après l’émergence d’une multitude de nouveaux acteurs qui ont profité de la directive MIF, l’heure est aujourd’hui à la concentration. En effet, le modèle économique de ces MTF n’est rentable que lorsque leurs parts de marché atteignent au moins 10 %. Aussi, les petits acteurs ont vocation à se faire racheter, notamment par les marchés réglementés. Le MTF Turquoise a été racheté par le LSE, qui ambitionne d’en faire la plate-forme la plus rapide du monde, grâce au système MillenniumIT, traitant les ordres en 126 microsecondes (contre 175 microsecondes pour CHI-X).
De fait, on ne peut que partager le constat sévère présenté devant la commission d’enquête par Mme Pervenche Bérès, présidente de la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen, rapporteure de la commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale du Parlement européen : « La MIF repose sur un pari consistant à ouvrir les bourses à la concurrence, notamment à celle des brokers, en échange de la transparence sur les prix. En réalité, cette transparence ne s’est pas faite et les « dark pools », qui sont des mécanismes d’internalisation, se soustraient à toute visibilité pour développer des stratégies potentiellement spéculatives (…) les « credit default swaps », ou CDS (…) qui ne faisaient l’objet d’aucune surveillance, échappaient à la règle de la transparence, qui est à la base du fonctionnement sain d’une économie de marché (…) » (175).
Le bouleversement de l’architecture des marchés boursiers européens devrait encore s’accélérer avec la refonte de la directive MIF courant 2011.
Même si notre Assemblée avait, dans une certaine mesure, lors de la préparation de la directive du 21 avril 2004, pris conscience des enjeux, elle n’a pu, dans notre cadre institutionnel, aller au-delà de ce simple constat.
L’examen du projet de directive MIF par les Assemblées : En application de l’article 88-4 de la Constitution, les Assemblées ont été saisies de la proposition de directive concernant les services d’investissement et les marchés financiers (document E 2513) ● Au cours de l’examen de la proposition de directive par la délégation pour l’Union européenne de l’Assemblée nationale, le 11 juin 2003, le commentaire du rapporteur, M. Pierre Lequiller, fut le suivant : « La directive imposera à tous les États membres d'autoriser les transactions de gré à gré au sein d'une institution financière (« internalisation »), pratique déjà en vigueur au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays-Bas mais interdite en France, en Italie, en Espagne, en Grèce ou en Belgique où les ventes de titres doivent être centralisées par les bourses. En contrepartie de cette ouverture, la Commission a proposé des règles de transparence obligeant en particulier les « grandes » institutions financières à annoncer les prix avant les transactions et à informer leurs clients sur leurs décisions d'investissement après les transactions (règles de « best execution »). La définition des « grandes » institutions devrait être précisée dans une législation dérivée adoptée par la procédure de comitologie. Ces règles de transparence (article 20 et 25 de la directive) constituent la principale pierre d'achoppement entre le Royaume-Uni qui s'y oppose, les jugeant inapplicables, et la France ou l'Italie notamment, pour qui ces règles sont la condition sine qua non pour abandonner la « centralisation » boursière. La France peut accepter la disparition de la concentration, mais si les prix ne sont pas affichés par les intermédiaires financiers, il y a un risque de fragmentation du marché. » Des divergences subsistaient aussi au sein du Conseil sur l'article 32 de la directive portant sur l'accès aux chambres de règlement et compensation qui gèrent le paiement et la livraison des titres (clearing settlement system). Plusieurs États membres et la majorité des parlementaires s'opposaient à cet article et auraient souhaité que la Commission présente, comme elle l'avait annoncé, son projet de directive sur les règlements et compensations, avant de se prononcer sur ce point de la directive. La délégation a ensuite « approuvé » le projet de directive. ● Au Sénat, la délégation pour l’Union européenne a examiné le projet de directive le 16 septembre 2003 sous le bénéfice des observations suivantes : « La place financière européenne est devenue plus complexe, gommant la frontière entre marchés et intermédiaires. Grâce à l'informatique, les opérateurs sont plus nombreux, ils sont plus réactifs et offrent un plus large éventail d'options de négociation. La concurrence entre bourses ou entre systèmes de négociation s'est renforcée. Un certain nombre d'entreprises d'investissement exécutent les ordres de leurs clients « en interne » sans l'intermédiaire d'une bourse de valeur : dans les pays qui autorisent cette « internalisation », entre 15 et 30 % des flux d'ordres des grandes institutions sont effectués en « interne ». La France, la Belgique ou l'Italie ont instauré une concentration obligatoire qui n’autorise pas ce système. Outre certains dispositifs techniques, les discussions portent principalement sur « l'internalisation » des ordres, les règles de transparence ou l'accès aux chambres de règlement et compensation qui gèrent le paiement et la livraison des titres. Plusieurs délégations, dont la France et l'Italie, pourraient accepter la fin de l'obligation de concentration de l'exécution des ordres par les bourses de valeurs, en contrepartie de règles de transparence plus fortes que le Royaume-Uni conteste. » ● Après l’adoption de la directive, le Rapporteur général de la Commission des Finances du Sénat appela à la vigilance quant aux mesures d’application restant à prendre (176). « 1. L'impact majeur de la directive sur les marchés d'instruments financiers a) Des garanties savamment dosées mais qui n'effacent pas les risques de réduction de la liquidité et de la transparence (…), la directive sur les marchés financiers, adoptée le 21 avril 2004 après force débats techniques, induit une remise en cause de l'architecture des marchés financiers avec l'abandon du principe de concentration des ordres. Il n'est pas assuré que la consécration de la concurrence entre trois principaux modes de négociation des ordres ne conduise pas à une fragmentation étendue des bassins de liquidité, mais un certain nombre de garde-fous ont été mis en place, notamment sous l'influence française, pour assurer un fonctionnement conforme aux intérêts des investisseurs et en particulier aux moins aguerris d'entre eux : encadrement des agents liés, encadrement du service d'exécution simple sans conseil (execution only), régime des investisseurs professionnels et des contreparties éligibles, règles de transparence pré et post-négociation, règle de meilleure exécution. Le fossé pourrait néanmoins s'accroître entre le « marché de gros » constitué de professionnels investissant essentiellement par le canal des internalisateurs, et le « marché de détail » des particuliers positionnés sur les places réglementées. La baisse des coûts de transaction, fonction de la taille des ordres, se ferait dès lors essentiellement au bénéfice des teneurs de marché (autrement dit des grandes banques, et au premier rang de celles-ci les banques anglo-saxonnes), et éventuellement des investisseurs professionnels et des entreprises, si les « internalisateurs » acceptaient de ne pas traduire cette baisse de leurs coûts par une augmentation équivalente de leur marge. b) Au-delà de la directive, l'enjeu stratégique des mesures d'application Après d'âpres débats, le texte final représente un compromis relativement favorable aux intérêts des marchés continentaux, traditionnellement régis par les ordres à la différence des marchés anglo-saxons, habitués au rôle des market makers. Il faut toutefois se garder d'entretenir de trop grandes illusions sur le résultat final, car nombre de points déterminants restent à préciser, dans le cadre des mesures de niveau 2 de la procédure Lamfalussy. Les travaux de comitologie portent en particulier sur la règle de meilleure exécution, les règles d'admission des instruments financiers aux négociations sur les marchés réglementés, et sur l'application du principe de transparence de pré négociation, qui passe par la définition du seuil de « taille standard » d'un ordre, au-delà duquel la transparence n'est plus requise. Ainsi qu'il a été précisé, l'AMF est fortement impliquée dans les travaux de comitologie relatifs à cette directive puisque M. Michel Prada préside le groupe d'experts sur les questions de surveillance des marchés et de coopération. Votre rapporteur général relève toutefois que les deux autres groupes d'experts portent sur des enjeux très stratégiques, la transparence des marchés et les dispositions relatives aux intermédiaires, et sont respectivement présidés par un membre du conseil de l'autorité de régulation hollandaise et le président de la FSA britannique. Il s'agirait donc d'éviter que les mesures techniques de niveau 2 ne fournissent un moyen détourné aux grandes banques anglo-saxonnes d'imposer à nouveau leurs conceptions et leurs intérêts, et que ne soit ainsi rompu dans les faits, mais pas dans les principes, le délicat équilibre atteint par la directive. Votre rapporteur général espère que l'expérience du président de l'AMF saura prévenir des dérives subreptices, mais se montrera néanmoins vigilant sur le contenu des mesures d'application qui seront décidées au cours des prochains mois. » Les pouvoirs limités des assemblées en matière européenne ne leur permettent guère, en tout état de cause, de peser sur la négociation. |
2.– La part prépondérante des transactions de gré à gré dépourvues de transparence
L’expression anglaise « over the counter » – OTC exprime mieux que la traduction officielle « de gré à gré », les caractéristiques qui s’attachent à des transactions représentant une large part des opérations réalisées sur les divers marchés, particulièrement ceux des produits dérivés.
Un contrat de gré à gré est un contrat négocié de façon bilatérale, sur mesure, les marchés OTC étant organisés directement par les opérateurs, en dehors des bourses institutionnelles, sur des réseaux de télécommunications électroniques.
Si les évaluations des encours de produits dérivés varient selon les sources, l’ordre de grandeur – 600 000 à 700 000 milliards de dollars – paraît démesuré par rapport au PIB mondial, dont il représente au moins le décuple. Or, les neuf-dixième des transactions portant sur ces instruments sont effectués over the counter selon des modalités qui échappent à toute régulation et sont caractérisées par une grande opacité (on parle alors de « dérivés OTC »).
Comme le notait M. Jean-Pierre Jouyet, président de l’Autorité des marchés financiers, en juillet 2010, dans la Revue de la stabilité financière de la Banque de France, « historiquement tournée vers les marchés actions, la régulation des marchés financiers a tardé à tirer les conséquences de l’explosion des encours de produits dérivés ».
La crise financière a attiré, un peu tard, l’attention des régulateurs, puis du public, sur les produits dérivés OTC, avec la chute de la banque Lehman Brothers le 15 septembre 2008. Sur les marchés de dérivés OTC, Lehman Brothers était à la fois un acteur de premier plan et une entité de référence. Plus d’un mois après la faillite de la banque, les paiements nets correspondants au règlement des positions des principaux opérateurs sur CDS sur la contrepartie Lehman représentaient 5 milliards de dollars. Le graphique ci-dessous, qui retrace l’évolution des encours notionnels, enregistre, en décembre 2008, les conséquences de la faillite de Lehman Brothers (177).
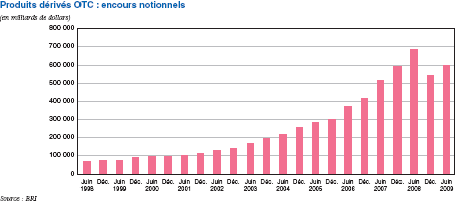
Compte tenu du caractère bilatéral des opérations sur dérivés OTC, il est beaucoup plus difficile, pour les autorités publiques (banques centrales, autorités de surveillance des marchés et contrôleurs bancaires) comme pour les intervenants de marché, de suivre correctement l’accumulation des expositions et d’évaluer les risques potentiels pour la stabilité financière et l’intégrité du marché que lorsqu’on a affaire à des opérations financières effectuées sur un marché organisé et/ou faisant l’objet d’une compensation centrale. C’est ainsi, par exemple, que, pour l’instant, l’AMF n’a aucun accès aux transactions OTC sur produits dérivés. Cela pèse naturellement sur la capacité des autorités publiques et des opérateurs de marché d’agir en temps utile face à l’apparition de vulnérabilités financières. En outre, l’opacité des marchés de dérivés OTC fait obstacle à une gestion efficace du risque et crée également de l’incertitude, avec un risque significatif d’érosion de la confiance des marchés, notamment en période de difficulté.
D’après les statistiques publiées par la Banque des règlements internationaux en novembre 2010, le montant notionnel des marchés dérivés de gré à gré, ou OTC se montait à 582 665 milliards de dollars fin juin 2010. Le flux effectif de paiements présentant un risque s’élevait seulement à 24 673 milliards de dollars en valeur brute de marché, mesure de la contrepartie du risque financier. Cette étude statistique observe que le montant notionnel des marchés de gré à gré a augmenté de 15 % de juin 2007 à juin 2010, alors que le montant des marchés OTC en valeur brute de marché a augmenté de 125 %. Sur la période 2004-2007, les hausses respectives étaient de 32 % en notionnel et de 74 % en valeur brute de marché.
Dans son rapport d’octobre 2010 sur la réforme des marchés OTC, le Conseil de stabilité financière, émanation des gouverneurs de banque centrale institué au G20 de Londres en 2009, reconnaît le caractère systémique et l’opacité de ces marchés, même s’ils participent à la liquidité en donnant un prix au risque. Les raisons de leur succès tiennent à ce que ces marchés proposent des contrats sur mesure, très utiles, notamment dans le secteur de l’assurance, pour gérer la diversité des passifs. On peut noter également qu’en France, par exemple, l’essentiel des transactions sur les marchés dérivés du gaz et de l’électricité fait l’objet de négociations de gré à gré. La communauté financière et l’ensemble des intervenants entendus par la commission d’enquête considèrent que les marchés de dérivés OTC présentent des carences structurelles fondamentales auxquelles il est nécessaire de remédier sur l’ensemble des catégories d’actifs, qui sont très divers, comme le montre le tableau ci-après.
MONTANT DES DÉRIVÉS OTC PAR CATÉGORIE DE RISQUE ET D’INSTRUMENTS
(en milliards de dollars US)
Catégories de risques et instruments |
Notionnel |
Valeurs de marché | ||||||||
Juin |
Déc |
Juin |
Déc |
Juin |
Juin |
Déc |
Juin |
Déc |
Juin | |
Total des contrats |
672 558 |
598 147 |
594 495 |
603 900 |
582 655 |
20 340 |
35 281 |
25 314 |
21 542 |
24 673 |
Contrats en devises |
62 983 |
50 042 |
48 732 |
49 181 |
53 125 |
2 262 |
4 084 |
2 470 |
2 070 |
2 524 |
Forward et forex swaps |
31 966 |
24 494 |
23 105 |
23 129 |
25 625 |
802 |
1 830 |
870 |
683 |
925 |
Devises swaps |
16 307 |
14 941 |
15 072 |
16 509 |
16 347 |
1 071 |
1 633 |
1 211 |
1 043 |
1 187 |
Options |
14 710 |
10 608 |
10 555 |
9 543 |
11 153 |
388 |
621 |
389 |
344 |
411 |
Contrats en taux d’intérêts |
458 304 |
432 657 |
437 228 |
449 875 |
451 831 |
9 263 |
20 087 |
15 478 |
14 020 |
17 533 |
Forward rate agreements |
39 370 |
41 561 |
46 812 |
51 779 |
56 242 |
88 |
165 |
130 |
80 |
81 |
Swaps de taux d’intéret |
356 772 |
341 128 |
341 903 |
349 288 |
347 508 |
8 056 |
18 158 |
13 934 |
12 576 |
15 951 |
Options |
62 162 |
49 968 |
48 513 |
48 808 |
48 081 |
1 120 |
1 764 |
1 414 |
1 364 |
1 501 |
Contrats actions |
10 177 |
6 471 |
6 584 |
5 937 |
6 260 |
1 146 |
1 112 |
879 |
708 |
706 |
Forwards et swaps |
2 657 |
1 627 |
1 678 |
1 652 |
1 754 |
283 |
335 |
225 |
176 |
189 |
Options |
7 521 |
4 844 |
4 906 |
4 285 |
4 506 |
863 |
777 |
654 |
532 |
518 |
Matières premières |
13 229 |
4 427 |
3 619 |
2 944 |
2 852 |
2 213 |
955 |
682 |
545 |
457 |
Or |
649 |
395 |
425 |
423 |
417 |
72 |
65 |
43 |
48 |
44 |
Autres matières premières |
12 580 |
4 032 |
3 194 |
2 521 |
2 434 |
2 141 |
890 |
638 |
497 |
413 |
Forward et swaps |
7 561 |
2 471 |
1 715 |
1 675 |
1 551 |
|||||
Options |
5 019 |
1 561 |
1 479 |
846 |
883 |
|||||
CDS |
57 403 |
41 883 |
36 046 |
32 693 |
30 261 |
3 192 |
5 116 |
2 987 |
1 801 |
1 666 |
Non précisé |
70 463 |
62 667 |
62 285 |
63 270 |
38 327 |
2 264 |
3 927 |
2 817 |
2 398 |
1 788 |
Source : Banque des règlements internationaux.
Une question importante soulevée par les dérivés OTC est celle du risque de contrepartie. À cet égard, l’infrastructure ICE Clear Europe, située au Royaume-Uni, soulève quelques questions. Cette chambre située au Royaume-Uni, et créée en juillet 2009, traite la plupart des CDS libellés en euros, alors qu’elle se situe en dehors de la zone, et l’on ignore si un dispositif approprié a été mis en place pour répondre à des besoins potentiels de liquidité dans des situations extrêmes, mais plausibles.
Pour réduire l’opacité inhérente aux marchés OTC, les dépositaires centraux de données sont un outil efficace, et l’enregistrement de toutes les opérations auprès des dépositaires centraux, s’il était généralisé à l’échelle mondiale, représenterait un progrès certain. Par ailleurs, il conviendrait d’améliorer la gestion du risque bilatéral pour les contrats non éligibles à la compensation centrale, par exemple par l’utilisation de contrats de garantie qui se sont certes développés sans encore assez se généraliser. Selon la profession, 70 % des transactions OTC ont fait l’objet de contrats de garantie en 2009.
D.– DES RÉGULATEURS NATIONAUX RELATIVEMENT DÉSARMÉS
Le jugement du professeur Bertrand Jacquillat, président directeur général d’Associés en Finance, est sans appel : « Les régulateurs n’ont pas fait leur travail. » (178). Selon lui, la crise, issue du marché immobilier américain et de la trop grande facilité avec laquelle ont été attribués les prêts immobiliers, a révélé les faiblesses des autorités de régulation américaines. Des banques ont accordé des crédits « sans faire le moins du monde attention à la qualité des emprunteurs – les fameux NINJA, no income, no job or asset – que l’on aidait même à tricher pour qu’ils obtiennent leurs crédits. Il y a là une faillite de la régulation ».
La Commission européenne, dans une communication du 27 mai 2009 sur la surveillance financière, porte un regard tout aussi sévère en ce qui concerne les régulateurs en Europe : « le dispositif de surveillance n’a pu ni prévenir, ni gérer, ni résoudre la crise. Les systèmes de surveillance ayant une base nationale se sont avérés dépassés par rapport à la réalité intégrée et interconnectée des marchés financiers européens actuels. »
La commission d’enquête se devait donc d’examiner le fonctionnement des deux autorités de régulation françaises : l’Autorité des marchés financiers (AMF), compétente en matière de marchés et de transactions, et l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP), plus particulièrement chargée de contrôler les établissements bancaires et les sociétés d’assurance.
1.– Les limites de l’action de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
Créée par la loi n° 2003-706 de sécurité financière du 1er août 2003, l'Autorité des marchés financiers est issue de la fusion de la Commission des opérations de bourse (COB), du Conseil des marchés financiers (CMF) et du Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF).
a) Une compétence territorialement limitée
L’Autorité des marchés financiers est un organisme public indépendant, doté de la personnalité morale et disposant d'une autonomie financière, qui a pour missions de veiller :
– à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers ;
– à l'information des investisseurs ;
– au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers.
Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international. L’Autorité des marchés financiers est organisée autour d’un collège de seize membres, d’une commission des sanctions de douze membres, ainsi que de commissions spécialisées et de commissions consultatives.
AMF : DES MISSIONS PRÉCISES ASSORTIES DE LARGES COMPÉTENCES L’Autorité des marchés financiers a pour mission de réglementer et de surveiller les marchés financiers, d’autoriser les acteurs à y intervenir et de sanctionner les comportements fautifs. Ses compétences portent sur : – les opérations et l'information financière : l’AMF réglemente les opérations financières et l'information diffusée par les sociétés cotées. Ces sociétés ont l'obligation d'informer le public de leurs activités, de leurs résultats et de leurs opérations financières. L’AMF supervise et contrôle l'information délivrée, en veillant à ce qu'elle soit précise, sincère, exacte et diffusée à l'ensemble de la communauté financière ; – les produits d'épargne collective : l’AMF autorise la création de SICAV et de Fonds communs de placements (FCP). Elle vérifie notamment l'information figurant dans le prospectus simplifié de chaque produit qui doit être remis au client avant d'investir. S'agissant des produits complexes (fonds à formule, etc.), l'AMF veille à ce que les spécificités des produits et leurs conséquences soient clairement présentées aux épargnants ; – les marchés et leurs infrastructures : l’AMF définit les principes d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les entreprises de marché (comme Euronext Paris qui organise les transactions sur les marchés des actions, des obligations et des produits dérivés), les systèmes de règlement-livraison et les dépositaires centraux (comme Euroclear France). L'AMF approuve également les règles des chambres de compensation (comme Clearnet) qui centralisent chaque jour les transactions et déterminent les conditions d'exercice de leurs adhérents ; – les prestataires (établissements de crédit autorisés à fournir des services d'investissement, entreprises d'investissement, sociétés de gestion, conseillers en investissements financiers, démarcheurs, etc.) : l’AMF fixe les règles de bonne conduite et les obligations que doivent respecter les professionnels autorisés à fournir des services d'investissement. Elle agrée les sociétés de gestion, les associations professionnelles chargées de la représentation collective, de la défense des droits et des intérêts des conseillers en investissements financiers et contrôle ces conseillers en investissements financiers. L’AMF surveille enfin les démarcheurs agissant pour le compte des sociétés de gestion. L’Autorité des marchés financiers peut également procéder à des contrôles et à des enquêtes et, en cas de pratiques contraires à son règlement général ou aux obligations professionnelles, la Commission des sanctions peut prononcer des sanctions. Lorsque les faits paraissent constitutifs d’un délit, le Collège de l’Autorité des marchés financiers transmet le rapport de contrôle ou d’enquête au procureur de la République. Pour venir en aide aux investisseurs non professionnels, l’AMF met à la disposition des particuliers et des associations son service de médiation. Outre sa mission d'information et de pédagogie auprès du public, le Service de la médiation reçoit les réclamations portant sur l'information financière, l'exécution des ordres, le transfert de comptes-titres, la gestion pour compte de tiers. Il propose également un règlement à l’amiable en cas de litige entre un particulier et un professionnel. |
Toutefois, la compétence de l’AMF est limitée aux opérations comportant un élément de territorialité, c’est-à-dire sur celles relatives aux titres cotés en France ou réalisées par des opérateurs français. Compte tenu du caractère international des transactions bancaires, cette limite territoriale réduit considérablement la portée de son action.
b) Une capacité d’investigation matériellement restreinte
De toute évidence, la capacité de l’AMF à surveiller les marchés de dettes souveraines est encore trop limitée face à la créativité et à l’inventivité illimitées des spéculateurs : les enquêtes sont lourdes et nécessitent en général des investigations européennes, voire internationales. Limitées par les compétences territoriales des différents régulateurs, elles n’offrent qu’une vision partielle du marché en l’absence d’une collecte systématique des informations sur les transactions réalisées sur les produits dérivés de gré à gré (over-the-counter
– OTC), en France et hors de France. Cette difficulté à surveiller les transactions sur les marchés dérivés de gré à gré n’est d’ailleurs pas limitée aux marchés de dette souveraine.
En outre, l’Europe est en retard dans ce domaine crucial de la surveillance. C’est pourtant un sujet fondamental : selon M. Jean-Pierre Jouyet, président de l’AMF, les autorités régulatrices ont besoin « d’une vision consolidée à l’échelle européenne, ce qui suppose l’adoption de législations appropriées à ce même échelon, avec des mécanismes d’enquête et d’échanges d’information– nous en sommes loin » (179).
c) L’absence de dispositif de déclaration des ordres (reporting) pour les CDS
Aujourd’hui, l’AMF ne collecte pas la totalité des données relatives aux transactions sur les marchés de dette souveraine. Les informations concernant les transactions sur les titres de dettes cotés en France – marchés organisés, marchés obligataires, marchés de titres d’État – lui sont transmises automatiquement, mais il n’existe à ce jour aucun dispositif de déclaration des ordres (reporting) équivalent pour les CDS.
Un tel dispositif n’aurait d’ailleurs un sens que s’il était européen, compte tenu de l’importance de certaines places financières, en particulier celle de Londres ; or pour l’instant, les régulateurs européens ne se sont mis d’accord que pour un échange organisé des données sur les titres eux-mêmes. La seule possibilité de l’AMF est donc de s’adresser directement et individuellement aux intermédiaires financiers ayant réalisé des opérations sur les CDS. C’est ce qu’elle a fait en interrogeant systématiquement les principaux intervenants français réputés actifs sur ce marché au moment de la crise grecque.
Par ailleurs, en l’état actuel de la législation, l’AMF peut sanctionner les délits d’initiés relatifs aux CDS mais pas une manipulation de cours fondée, par exemple, sur une rumeur. Cette lacune a été corrigée par les dispositions de la loi de régulation bancaire et financière, adoptée le 22 octobre dernier.
d) La difficulté de contrôler le trading à haute fréquence et le trading algorithmique
La concurrence entre plates-formes s’est accompagnée d’avancées technologiques spectaculaires, qui opacifient encore plus les marchés. Un tiers des transactions en Europe – deux tiers aux États-Unis – sont aujourd’hui réalisées, comme on l’a vu, par des traders utilisant des programmes informatiques de passation automatique des ordres. Ces techniques, « à l’utilité sociale douteuse », selon M. Jean-Pierre Jouyet, compliquent la détection des manipulations de cours, tout en perturbant les investisseurs, qui n’arrivent plus à lire le marché ; elles engendrent des risques opérationnels, des risques systémiques et des risques pour la stabilité financière.
M. Jean-Pierre Jouyet le reconnaît : « Cette accélération des échanges a compliqué la surveillance du marché (...). Nous avons, c’est vrai, un train de retard sur les technologies financières. En quelques années, les marchés ont beaucoup évolué. C’est un point que n’avait pas anticipé la directive [MIF] » (180)
En 2003, une firme américaine a fait faillite en seize secondes parce qu’un employé avait déclenché par erreur un mécanisme algorithmique. Et le crash éclair de Wall Street, le 6 mai dernier, est en partie imputable au trading de haute fréquence ; l’événement fut si soudain qu’il n’est pas sûr que l’on sache jamais ce qui s’est passé, non en raison d’une quelconque mauvaise volonté, mais parce qu’il est impossible au régulateur américain de réunir la totalité des données : aujourd’hui, certains ordres ne restent que quelques dizaines de microsecondes dans le carnet d’ordres !
Comme l’a souligné M. Ben Bernanke, président de la Fed, cet incident doit être pris comme un sérieux avertissement : « Ce qui s’est produit à la Bourse est seulement un petit exemple de la façon dont les choses peuvent s’enchaîner ou dont la technologie peut interagir avec la panique du marché. »
La transformation actuelle des marchés complique beaucoup la mission de surveillance des autorités de régulation. Les observateurs s’accordent pour dire que, si l’on veut établir la confiance dans un marché, il faut le surveiller correctement, afin qu’il n’y ait ni manipulations ni délits d’initiés. Or aujourd’hui, sur certains marchés, le régulateur n’est techniquement pas à même de remplir ses tâches de surveillance.
e) Le contrôle des carnets d’ordres est variable d’un pays à l’autre
L’un des risques du trading à haute fréquence, c’est la manipulation des carnets d’ordres. Principalement pour des raisons de moyens, la plupart des autres régulateurs européens ne les surveillent pas.
L’AMF déploie des efforts, au niveau européen, pour avoir accès à ces carnets d’ordres. Mais il est extrêmement difficile de remonter les réseaux internationaux. Même si la coopération internationale est bonne, les régulateurs n’ont aucune garantie que l’enquête aboutira, car il existe aujourd’hui des opérateurs isolés : en sus des institutions financières ou des hedge funds, interviennent des individus qui recrutent des armées de traders à travers le monde, qui se trouvent en Chine ou ailleurs et sont quasiment impossibles à repérer, d’autant que ces individus peuvent utiliser un ordinateur dans un pays tiers sans que l’on retrouve jamais l’adresse IP…
En outre, les informations auxquelles les opérateurs ont accès varient d’un pays à l’autre. Ainsi, en France, l’AMF peut avoir connaissance de la totalité des carnets d’ordre, y compris des ordres annulés, souvent au dernier moment, et qui, sans avoir été exécutés, ont néanmoins produit leurs effets sur le marché. Ce n’est pas le cas au Royaume-Uni, où les autorités de régulation ne sont autorisées à prendre connaissance que des ordres effectivement réalisés.
f) Des moyens humains insuffisants qui seront augmentés en 2011
L’AMF rassemble, en 2010, 390 agents dont les compétences ne sont pas en cause mais qui, manifestement ne sont pas suffisamment nombreux pour assurer la surveillance de l’ensemble des marchés financiers. L’annonce par Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du recrutement de 60 agents supplémentaires en 2011, « à la demande de son président » (181), est révélatrice des efforts qui restent à accomplir en la matière. En cette période de rigueur où un fonctionnaire sur deux partant à la retraite n’est pas remplacé, cette hausse des effectifs de plus de 15 % mérite d’être soulignée.
g) Des moyens financiers en baisse, fragilisés par la réduction de l’activité du marché
En 2009, les recettes de l’AMF ont couvert 72 % de ses charges, ce qui a conduit à un déficit de 16,7 millions d’euros. En 2010, le déficit est prévu à hauteur de 24 millions d’euros et le besoin de financement, compte tenu des investissements (6 millions d’euros) déduction faite des amortissements (4 millions d’euros), à hauteur de 26 millions d’euros. La trésorerie de l’AMF ne pourra pas absorber un besoin de financement de même ampleur une troisième année consécutive. À fin 2010, la trésorerie est estimée à 40 millions d’euros et couvrirait cinq à six mois d’exploitation.
Les ressources nouvelles accordées en 2009 par voie réglementaire dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de l’AMF ne suffisent pas à couvrir ce besoin de financement. L’AMF a également engagé un plan d’économie de 2 millions d’euros pour l’année 2010, mais qui sera insuffisant pour couvrir la baisse de ses recettes.
Cette situation trouve une double explication.
L’essentiel des ressources de l’AMF est aujourd’hui assis sur des contributions dont le niveau dépend de l’activité financière de la place de Paris. Ses revenus sont, en effet, constitués de contributions acquittées par les professionnels, de prélèvements assis sur les encours de produits d’épargne et de contributions acquittées par les émetteurs à l’occasion d’opérations financières. En raison de la crise, les ressources de l’AMF ont diminué de près de 30 % entre 2006 et 2009.
Dans le contexte d’un renforcement de la régulation financière, l’AMF voit encore ses missions se développer, notamment dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi de régulation bancaire et financière, avec la compétence donnée sur les agences de notation ou la nouvelle mission de surveillance du marché des quotas de CO2. Par ailleurs, l’AMF est confrontée à l’obligation de développer de nouveaux instruments de surveillance face aux nouvelles techniques de négociation sur les marchés, notamment le trading automatisé, qui nécessite le développement de moyens informatiques importants. Les projets informatiques liés au plan stratégique 2010-2012 représentent, par exemple, 5,1 millions d’euros d’investissements dont 2,9 millions d’euros pour la seule activité de surveillance.
Les ressources de l’AMF demeurent, de plus, inférieures à celles de ses homologues étrangers. À périmètre comparable de supervision, tant en termes de surveillance, de contrôles et de représentativité que de protection de l’épargnant, les effectifs de l’AMF peuvent être de deux à cinq fois inférieurs à ceux de ses homologues. On constate par exemple que la Securities Exchange Commission et la Financial Services Authority (en cours de réorganisation au Royaume-Uni) ont été autorisées à recruter massivement dès 2010.
L’AMF bénéficie d’une fiscalité affectée en application de l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, dont l’apparente complexité (14 taxes différentes...) n’est que le reflet de la diversité des tâches de l’opérateur et de la variété des acteurs et opérations du secteur financier.
Ces taxes sont de deux ordres :
– des droits fixes dus par les personnes soumises au contrôle de l’AMF ;
– des contributions dont le montant varie selon l’importance de l’opération et selon le service rendu à la personne soumise au contrôle de l’AMF.
TAXES AFFECTÉES À L’AMF La perception de droits fixes est prévue à l’occasion : – d’une déclaration de franchissement de seuils ou de pactes d’actionnaires ; – de l’examen de l’obligation de dépôt d’une offre publique ; – du contrôle du document de référence annuel ou du document de base établi par une société cotée ; – de l’autorisation de commercialisation en France d’un OPCVM étranger ; – de la soumission par un émetteur d’un document d’information sur un programme de titres de créances à l’enregistrement préalable de l’AMF ; – de l’émission de chaque tranche de warrant sur le fondement d’un document d’information soumis au visa de l’AMF ; – du dépôt d’un document d’information relatif à un projet de placement en biens divers. Les contributions sont dues dans les cas suivants : – à l’occasion d’une procédure d’offre publique d’achat ou de retrait ou de garantie de cours ; – à l’occasion d’une offre au public de titres ou admission de titres sur un marché réglementé ou rachat de titres par un émetteur ; – par les prestataires de service d’investissement (PSI) par service d’investissement pour lequel ils sont agréés ; – par les personnes autorisées à exercer l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers ; – par les autres membres des marchés réglementés ; – par les dépositaires centraux et les gestionnaires de règlement-livraison, les entreprises de marchés et les chambres de compensation d’instruments financiers ; – par les prestataires de services financiers habilités à effectuer la gestion de portefeuille pour compte de tiers ainsi que par les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion ; – par les conseillers en investissements financiers. |
Le montant ou le taux de la plupart de ces taxes sont définis par décret dans une fourchette ou sous un plafond légal. Le montant de certaines d’entre elles est plafonné ou, au contraire, soumis à un minimum légal.
h) Les solutions prévues par le projet de loi de finances pour 2011
Le projet de loi de finances pour 2011 intègre des mesures relatives aux ressources de l’AMF. L’objet de ces dispositions est de donner à l’opérateur de nouveaux moyens pour faire face à ses missions en restructurant son modèle de ressources pour le rendre davantage pérenne. L’objectif principal est de s’assurer que chacune des catégories d’acteurs assujetties à la surveillance du « gendarme boursier » (gestionnaires, émetteurs et activités de marché) contribuera à l’activité de surveillance qu’elle génère.
Dès lors que les activités de gestion supportent aujourd’hui l’essentiel du financement de l’AMF, il est apparu nécessaire de mettre en place de nouvelles ressources dont les principaux redevables seront les sociétés émettrices d’une part, et les activités de prestation de services d’investissement pour compte propre, qui impliquent des charges de surveillance particulièrement lourdes, d’autre part.
Le projet de loi de finances modifie des taxes existantes et crée des contributions nouvelles.
Parmi les modifications de taxes existantes, le relèvement de 2 000 à 4 000 euros du plafond légal du droit fixe perçu à l’occasion de l’autorisation de la commercialisation en France d’un OPCVM étranger pourrait apporter une recette estimée à 4 millions d’euros ; en contrepartie, la suppression de certaines redevances concernant principalement les PME, notamment celles qui publient des documents de référence et œuvrent ainsi pour une plus grande transparence, entraînera une minoration de recette d’environ 0,8 million d’euros. Les modifications de taxes aboutiront donc à une recette nette supplémentaire de l’ordre de 3,2 millions d’euros.
Par ailleurs, deux nouvelles contributions annuelles seront créées :
– une redevance forfaitaire due par les sociétés cotées dont la capitalisation est supérieure à un milliard d’euros. Cette contribution, inspirée d’un prélèvement similaire mis en place au Royaume-Uni au bénéfice de l’équivalent britannique de l’AMF, pourrait rapporter jusqu’à 10 millions d’euros ;
– une contribution annuelle assise sur le montant de leurs actifs des prestataires de services d’investissement exerçant une activité de négociation d’instruments financiers pour compte propre. Cette contribution pourrait concerner cinq établissements, pour un impact financier moyen compris entre 1,3 et 3 millions d’euros par redevable. Le produit annuel de cette contribution serait donc compris entre 6,5 et 15 millions d’euros par an.
i) L’AMF semble sous-dotée par rapport à ses homologues européennes
Le tableau ci-joint, qui apporte quelques éléments de comparaison chiffrés entre quatre régulateurs européens, confirme la faiblesse des moyens de l’AMF, en 2009, par rapport à ses homologues étrangers.
Alors que le marché français est largement plus important que les autres marchés étudiés (italien, néerlandais et espagnol), tant par le nombre de sociétés cotées (650) que par la capitalisation boursière (1 057 milliards d’euros), l’AMF était, l’an dernier, le régulateur dont les effectifs (388 agents) et le budget (51 millions d’euros) étaient les plus faibles.
TABLEAU COMPARATIF DES MOYENS DES RÉGULATEURS EUROPÉENS
La comparaison avec la FSC britannique et la BAFIN allemande n’est pas pertinente en raison des différences de périmètre
AMF France |
CONSOB Italie |
AFM Pays-Bas |
CNMV Espagnole | ||
1 |
Taille du marché régulé |
||||
Nombre de sociétés cotées |
650 (182) |
277 |
211 |
155 | |
Nombre d’entreprises de services d’investissement |
385 |
108 |
137 | ||
Nombre de sociétés de gestion |
567 |
215 |
|||
Nombre d’OPCVM |
12 200 |
82 |
6 294 | ||
Nombre de sociétés cotées par collaborateur |
12,1 |
2,5 |
1,8 |
1,5 | |
Nombre d’entreprises de services d’investissement par collaborateur |
7,6 |
1,7 |
1,1 | ||
Nombre de sociétés de gestion par collaborateur Prestataires |
11,2 |
3,3 |
|||
Nombre d’OPCVM par collaborateur |
242 |
0,5 |
50 | ||
2 |
Effectifs au 31/12/2009 |
388,2 |
556 |
456 |
406 |
Prestataires, infrastructures de marché et surveillance des marchés |
140 |
163 |
253 |
127 | |
dont Prestataires |
51 |
65 |
172 |
127 | |
dont Contrôle et Surveillance |
89 |
98 |
81 |
||
Émetteurs |
54 |
111 |
116 |
103 | |
Affaires juridiques |
38 |
48 |
33 | ||
Affaires internationales |
28 |
44 |
|||
Administration, Finances, RH et Informatique |
77 |
120 |
87 |
126 | |
Autres |
51 |
70 |
17 | ||
3 |
Données financières |
||||
Recettes en millions d’euros |
51 |
99 |
81 |
54 | |
Dépenses en millions d’euros |
68 |
130 |
77 |
43 | |
Investissements en millions d’euros |
5 |
||||
Recettes par collaborateur en milliers d’euros |
132 |
178 |
177 |
132 | |
Dépenses par collaborateur en milliers d’euros |
175 |
233 |
169 |
106 | |
4 |
Capitalisation boursière |
||||
Capitalisation boursière en milliards d’euros (a) |
1 057 |
457 |
279 |
550 | |
Recettes Émetteurs en millions d’euros (b) |
51 |
99 |
81 |
54 | |
Nombre de sociétés cotées |
650 (1) |
277 |
211 |
155 | |
Effectifs Emetteurs au 31/12/2009 |
54 |
111 |
116 |
103 | |
Capitalisation moyenne par Sociétés cotées en millions d’euros |
1 626 |
1 650 |
1 322 |
3 547 | |
Capitalisation par collaborateur en milliards d’euros |
19,6 |
4,1 |
2,4 |
5,3 | |
Capitalisation boursière moyenne en milliers d’euros pour 1 euro de recette facturée par les autorités de contrôle (a)/(b) |
20,6 |
4,6 |
10,3 |
5 |
Encours sous gestion hors OPCVM européens |
||||
Encours sous gestion hors OPCVM européens en milliards d’euros |
1 388 |
248 |
66 |
186 | |
Recettes PPE en millions d’euros |
38 |
40 | |||
Encours sous gestion hors OPCVM européens par milliers d’euros pour 1 euro de recette facturée par les autorités de contrôle |
37 |
5 | |||
6 |
Résultat d’exploitation des infrastructures de marché en millions d’euros |
||||
Résultat d’exploitation des infrastructures de marché (a) |
543 |
317 | |||
Recettes totales des autorités de contrôle (b) |
51 |
99 |
81 |
54 | |
Recettes PPE (d) |
38 |
30,7 |
40 | ||
Résultats d’exploitation des infrastructures de marché pour 1 euro de recette totale facturée par les autorités de contrôle (a)/(b) |
11 |
6 | |||
Résultats d’exploitation des infrastructures de marché pour 1 euro de recette PPE facturée par les autorités de contrôle (a)/(d) |
14 |
8 |
Par comparaison, l’autorité italienne, qui ne gère que 277 sociétés cotées représentant une capitalisation boursière de 457 milliards d’euros, compte 556 agents et un budget presque double de celui de l’AMF : 99 millions d’euros.
2.– Des appréciations divergentes sur l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP)
L’Autorité de contrôle prudentiel est issue de la fusion, au début de l’année 2010, de la Commission bancaire et de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM). Il s’agit d’une autorité administrative indépendante adossée à la Banque de France, chargée de l’agrément et de la surveillance des établissements bancaires et d’assurance dans l’intérêt de leurs clientèles et de la préservation de la stabilité du système financier.
L’ACP : PROTÉGER À LA FOIS LES INSTITUTIONS ET LES CONSOMMATEURS La réforme du système français de supervision répond à trois objectifs : accroître la stabilité financière, renforcer la sécurité des consommateurs et mieux faire entendre la voix de la France en Europe et dans les négociations internationales. 1° La stabilité financière L’ACP est une autorité de supervision qui a pour objet de surveiller les risques dans l’ensemble du secteur financier, banques et assurances. Ce rapprochement offre une visibilité élargie en rapprochant les analyses micro et macro prudentielles. L’adossement à la Banque de France fait bénéficier l’ACP de l’expertise économique et financière de la banque centrale, ce qui constitue un atout pour garantir la stabilité de l’ensemble du système financier. Pour autant, les métiers de l’assurance et de la banque ont chacun leur technicité. C’est pourquoi les questions propres à chaque secteur sont traitées dans des sous-collèges sectoriels. 2° La sécurité des consommateurs La crise a renforcé le besoin de sécurité chez les assurés et les clients bancaires. La nouvelle autorité a pour mission de veiller au respect par les entreprises soumises à son contrôle, et leurs intermédiaires, de leurs obligations en matière de pratiques commerciales à l’égard de leurs clientèles : dispositions législatives et réglementaires, bonnes pratiques de la profession, constatées ou résultant de ses recommandations. Une coopération renforcée est prévue entre la nouvelle autorité prudentielle et l’Autorité des marchés financiers (AMF). Cette coopération est notamment motivée par l’imbrication croissante entre les produits d’épargne (assurance-vie et OPCVM notamment) et le développement d’acteurs à même de distribuer toute la gamme des produits d’assurance et bancaires. 3° Une voix pour la France dans les négociations internationales Cette réforme renforce l’influence de la France sur la scène internationale pour peser dans les réformes de la régulation financière. Alors que notre réglementation nationale est en grande partie issue de normes ou standards supranationaux, l’autorité unique représentera la France dans les instances internationales de l’assurance et de la banque. En unissant les forces de la banque et de l’assurance, elle devrait peser encore plus lourd dans les négociations. |
a) Un contrôle exercé sur les établissements et non sur les transactions
L’ACP est en charge non pas du contrôle des opérations, mais de celui des établissements. À ce titre, elle vérifie que les risques sont convenablement mesurés et gérés, et que les fonds propres sont suffisants. Pour ce qui concerne le trading haute fréquence (HFT), l’ACP interroge les banques. Ces dernières répondent.
« Je ne vous dis pas que l’autorité de contrôle peut contrôler l’utilisation de formules et le résultat desdites formules, a précisé la secrétaire générale de l’ACP, Danièle Nouy, mais si j’interroge un établissement, il me fournira une réponse. » (183)
L’ACP exerce un contrôle sur pièces et sur place que M. Bernard Spitz, président de la Fédération française des sociétés d’assurances, qualifie, pour sa part, de « tout à fait efficace » (184). Elle peut prendre des mesures de police administrative coercitives lorsque la solvabilité d’un assureur, ou l’intérêt des assurés, se trouve compromis. Durant la crise financière, l’ACAM avait conduit des enquêtes ciblées ou générales sur les placements des assureurs et sur le comportement des assurés.
b) Le rôle protecteur du contrôle de l’ACP
Les responsables de l’ACP considèrent que le contrôle mené sur les établissements bancaires et d’assurance a évité à ces derniers de tomber dans les travers de certaines grandes banques anglo-saxonnes.
Les banques françaises, selon Mme Danièle Nouy, « n’ont pas spéculé sur la dette grecque avec des CDS. Elles étaient même exposées à une dégradation de la qualité de la signature de l’État grec. Le fait que l’autorité de contrôle bancaire ait de longue date surveillé étroitement l’activité des banques françaises sur les dérivés de crédit n’est sans doute pas étranger à cette situation ».
« Nous avons été des contrôleurs rigoureux là où parfois nos collègues l’étaient moins, ne serait-ce que parce que l’étendue du contrôle n’est pas la même partout ». En France, la définition des opérations de banque est, en effet, extrêmement large, ce qui n’est pas le cas dans tous les pays, notamment aux États-Unis.
c) Des moyens en cours d’augmentation
Mme Danièle Nouy considère que l’ACP dispose « d’excellents spécialistes des opérations de marché.(...) Cela tient même du miracle compte tenu des rémunérations qui pourraient leur être offertes dans le privé. Avant l’affaire Kerviel, nous avions mené dix-sept contrôles à la Société Générale, portant sur les secteurs les plus difficiles et les plus novateurs. Nous sommes présents sur place et nous comprenons ce que font les établissements, même s’il y a toujours des nouveautés ».
La Cour des comptes ayant toutefois trouvé les moyens de l’ACP un peu limités, ceux-ci vont être renforcés. Une centaine de personnes devraient être embauchées en deux ans. L’effectif actuel tourne autour de 950 agents, contre 920 au moment de la fusion entre la Commission bancaire et l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Par comparaison, la Commission bancaire ne disposait que de 600 à 650 personnes, en y comprenant les 70 qui se consacraient à l’agrément des banques, dans un autre département de la Banque de France.
La secrétaire générale de l’ACP concède toutefois qu’« une partie du renfort devra bénéficier au secteur de l’assurance dont le contrôle doit s’étoffer car, ces dernières années, le contrôleur des assurances a eu du mal à recruter. » Dans la perspective de la mise en oeuvre de « Solvabilité II », l’ACP tente d’y remédier, y compris en faisant appel à des actuaires très « pointus ».
d) Des compétences qui restent limitées
Mais d’autres observateurs comme Mme Nicole El Karoui, professeur à l’université de Paris V, mathématicienne spécialisée en algorithmes financiers, émettent une analyse plus critique.
Selon elle, l’Autorité de contrôle prudentiel ne dispose pas de moyens suffisants. « Le personnel n’est ni assez nombreux ni assez renouvelé pour suivre l’évolution du marché » (185). Ce personnel compte certes des personnes compétentes mais, selon Mme Nicole El Karoui, cette autorité aurait gagné à essayer de recruter, au lendemain de la crise, les personnels désabusés en rupture avec leurs établissements bancaires « car on surveille toujours mieux ce que l’on connaît de l’intérieur ».
M. Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, mesure pour sa part la marge de progression potentielle de l’autorité de régulation : « la montée en puissance se poursuit pour parvenir à un contrôle plus robuste dans le domaine des assurances et pour assumer la mission nouvelle confiée par l’État – la surveillance de la commercialisation des produits financiers. » (186). Ayant demandé à la Représentation nationale de ne pas être tentée de réaliser des économies dans ce domaine, il a ajouté : « La difficulté est plutôt de trouver les ressources humaines, en quantité et en qualité. La petite équipe de mathématiciens de haut niveau qu’avait la Commission bancaire doit être encore renforcée. À cet égard, l’apport de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est précieux puisque, grâce à elle, nous avons récupéré des polytechniciens, des ingénieurs et des normaliens de grand talent. Cela étant, les effectifs devront être accrus ».
e) Une autorité qui se distingue positivement de ses homologues étrangères
M. Frédéric Oudéa, président-directeur général de la Société Générale, adresse de son côté un satisfecit à l’ACP : « le régulateur français peut être pris en exemple, la crise ayant clairement montré qu’il existait deux types de régulation. Il y a celle qui conduit à mener un travail en profondeur dans les banques, à travers des audits et des inspections impliquant des moyens humains : notre régulateur passe fréquemment du temps au sein des établissements pour décortiquer un sujet donné. D’autres régulateurs ont une approche plus distante : ils posent des principes, sans aller nécessairement vérifier dans le détail s’ils sont respectés. La tendance est aujourd’hui au renforcement des moyens et des vérifications, eu égard aux défaillances observées face à la situation de certains établissements et aux risques systémiques. En France, le régulateur est resté confiant dans la nature des risques pris par les banques » (187).
Il reste que le satisfecit sur le contrôleur doit être relativisé, lorsqu’il émane du contrôlé.
3.– Les facteurs techniques qui limitent l’efficacité des régulateurs
Au-delà des faiblesses propres à chacune des autorités régulatrices, AMF et ACP, des failles liées à l’organisation même des marchés et à certaines pratiques financières sont apparues lors des auditions auxquelles la commission d’enquête a procédé. Ces failles ont été développées précédemment. On les rappellera brièvement ici en soulignant particulièrement leur incidence sur l’action des régulateurs.
a) L’opacité grandissante des marchés financiers
Selon M. Dominique Cerutti, directeur général d’Euronext, l’opacité des marchés financiers augmente – on l’a vu – de manière régulière. Elle aurait quasiment doublé en deux ans et demi et ce fait serait attesté par les travaux du Parlement européen. M. Dominique Cerutti a ainsi précisé : « en deux ans et demi, au lieu de diminuer, l’opacité a quasi doublé. Toutes les études convergent. Sur le marché des actions, elle dépasse 40 % ; sur celui des dérivés, elle atteint 85 % ; sur celui des obligations 95 % ; et, sur le marché des changes, elle est proche de 100 %. » (188). Outre que cette opacité nuit à la formation naturelle des prix, fonction première du marché, elle restreint les possibilités de contrôle.
Des dizaines de millions d’opérations sont réalisées chaque jour en Europe, portant sur un montant global moyen de 32 milliards d’euros par jour. Compte tenu de ces taux d’opacité, les régulateurs s’avèrent en grande partie démunis.
b) L’absence de contrôle du « système bancaire fantôme »
En matière de risque systémique, le danger le plus important est la propagation des chocs et des instabilités d’un acteur à tous les autres, avec effet de retour (feedback). Pour cette raison, les autorités de régulation doivent examiner non seulement le bilan des acteurs, mais aussi leurs interconnections.
Pour M. Michel Aglietta, conseiller au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII), « un acteur systémiquement important n’est pas nécessairement de grande taille, mais ses interconnections créent un risque de contreparties s’enchaînant les unes aux autres » (189)C’est ainsi que la société AIG abritait en son sein une banque d’investissement cachée, « véritable bombe à retardement », qui était la contrepartie des marchés dérivés du crédit du monde entier. La Fed ne pouvait laisser AIG faire faillite le lendemain de la faillite de Lehman Brothers : comme l’a souligné M. Ben Bernanke, si rien n’avait été fait, l’économie mondiale aurait connu un effondrement généralisé.
En conséquence, M. Michel Aglietta considère comme nécessaires l’identification et la supervision plus rigoureuses des entités systémiquement importantes : des banques traditionnelles mais aussi des hedge funds de grande taille, des banques d’investissement, des investisseurs institutionnels développant des activités d’intermédiation de marché. Ce « système bancaire fantôme » (shadow banking system) est, selon lui, à l’origine de la plupart des dérives qui ont mené à la crise. « Puisqu’il n’était regardé par personne, il est logique que l’on n’y ait rien vu ! ». C’est pour répondre à ce danger que le Comité européen du risque systémique a été créé (cf. ci-après, E, 2).
c) La concurrence entre régulateurs
La défaillance des autorités de régulation, qualifiée par certains de « myopie généralisée », s’explique aussi par le fait que les régulateurs ne contrôlaient pas le cœur du mécanisme. Aux États-Unis, chacun des régulateurs est en concurrence avec les autres et, selon M. Michel Aglietta, « veille à sa chasse gardée ». En Europe, cette concurrence se retrouve au niveau national : alors que beaucoup de banques sont transnationales, les régulateurs nationaux, jaloux de leurs informations sensibles, ne semblent pas coopérer de manière irréprochable. À l’avenir, il appartiendra d’ailleurs au Comité européen du risque systémique de rendre obligatoire ces coopérations.
d) Le cas particulier du marché des couvertures de défaillances (credit default swaps – CDS)
Le marché des CDS est un marché « aveugle », qui n’est pas régulé et pour lequel n’existe pas de statistiques. Sur ce marché, « le régulateur ne dispose que des éléments transmis par les acteurs concernés » a indiqué M. Philippe Mills, directeur général de l’agence France Trésor (190). L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), en cours de création, devrait permettre de combler cette lacune.
e) L’absence de régulateur pour les marchés à terme agricole
Certains sujets ne sont pas couverts par les compétences des régulateurs français ou européens. Ainsi, comme le fait remarquer M. Christian de Boissieu, professeur à l’université de Paris I, il n’existe « aucune institution compétente pour la régulation des marchés à terme agricoles » (191) contrairement aux États-Unis où la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a compétence sur l’ensemble du domaine des matières premières (physiques et leurs dérivés) pour des raisons historiques.
f) Le manque de capacités informatiques des régulateurs
À Wall Street, les deux tiers des transactions boursières sont exécutés par des algorithmes, c’est-à-dire des robots, qui fractionnent les ordres au millième de seconde. Quelle autorité de marché, même supra-équipée, peut contrôler des flux si rapides ? Comment, dans ces conditions, détecter des pratiques dites de « front running » (192) ? Si un client donne l’ordre d’acheter pour 100 millions d’actions, rien n’empêchera sa banque, avec un bon algorithme, d’acheter le titre sur ses fonds propres juste avant ! Selon M. Edouard Tétreau, gérant de Mediafin, « aucune autorité de marché dans le monde ne dispose de l’équipement nécessaire pour contrôler et sanctionner une manœuvre de ce type ».(193)
M. Fabrice Péresse, directeur des opérations de marché chez NYSE-Euronext, souligne les opportunités nouvelles ouvertes aux fraudeurs par la fragmentation des marchés : « Nous constatons chaque jour des dérives de ce type. Par exemple, nous avons plusieurs fois décelé, juste avant la clôture, une variation brutale – de l’ordre de 5 % – du cours d’un titre. Puis, aussitôt, tout rentre dans l’ordre. C’est troublant, surtout quand nous apprenons après coup que, tout de suite après, un gros bloc de titres a été négocié sur une dark pool. Manifestement, il y a des tentatives de manipulation de cours, mais, ne contrôlant pas ce qui se passe ailleurs que chez nous, nous avons beaucoup de mal à les identifier. L’AMF aussi, d’ailleurs. Même si elle a accès aux informations, il faut qu’elle ait les moyens matériels de les traiter ; en outre, elles ne lui sont transmises qu’a posteriori. Ces anomalies nouvelles obligent à repenser le dispositif de contrôle. La fragmentation conjuguée avec la diversité des contraintes imposées aux différentes plates-formes rend le contrôle plus compliqué » (194).
4.– La perfectible coopération entre régulateurs nationaux
Les marchés financiers et la spéculation étant désormais totalement mondialisés, la coopération entre les autorités de régulation nationales, en particulier européennes, est devenue primordiale.
a) Les limites techniques de la coopération internationale
Lorsqu’elle mène une enquête, l’AMF peut demander aux régulateurs d’autres pays de fournir un certain type de données. Le président de l’Autorité des marchés financiers, M. Jean-Pierre Jouyet, a insisté sur le fait qu’« en matière d’enquête, la coopération internationale fonctionne bien, y compris avec les Américains (195)». Pour autant, le fait ne pas pouvoir obtenir directement les informations recherchées, sans intermédiaire, empêche les autorités de régulation de mener une surveillance efficace.
La masse de données à échanger et à analyser constitue également un frein. Ainsi, pour certaines investigations, l’AMF a besoin d’un ordinateur dédié dont les capacités se comptent en téraoctets. Sans éléments permettant de faire le tri dans les opérations afin de déceler les mouvements suspects, on ne peut espérer déceler quoi que ce soit. Mais beaucoup de régulateurs de pays partenaires, notamment parce qu’ils manquent de moyens financiers, sont réticents à se lancer dans des enquêtes trop compliquées.
b) Des échanges fondés principalement sur les bonnes relations bilatérales
La coopération entre régulateurs nationaux prend deux formes principales :
– la coopération au niveau de la surveillance de marché, qui doit permettre au régulateur compétent d’avoir un accès rapide et efficace à l’ensemble des données nécessaires, soit sur requête ad hoc, soit par échange de flux quotidiens ;
– la coopération en phase d’enquête, qui comprend également des aspects de collecte de données ad hoc, mais aussi des aspects opérationnels tels que l’organisation d’auditions ou de visites domiciliaires concernant des ressortissants étrangers. CESR-Pol, l’instance qui réunit au niveau de l’Union européenne les responsables des services d’inspection et de surveillance des autorités nationales, n’est qu’un forum de discussion sur des thèmes d’intérêt général et ne conduit pas directement à une coopération accrue au plan opérationnel sur des cas d’espèce ; il n’est cependant pas envisagé à ce stade que cette organisation soit modifiée.
Les échanges d’information ad hoc (notamment les demandes d’identification des donneurs d’ordres), en phase de surveillance ou d’enquête, prennent beaucoup de temps (un à deux mois). Il est difficile à l’AMF d’exercer des pressions sur ses homologues afin de raccourcir ces délais. L’introduction d’un identifiant client dans les déclarations des ordres (reportings), en discussion à l’occasion de la révision de la directive MIF, permettrait d’améliorer la détection des cas suspects et la rapidité des investigations, en réduirait très significativement le besoin de requêtes ad hoc.
L’AMF considère que l’amélioration de la coopération en phase d’enquête (auditions, visites domiciliaires…) demeure d’abord tributaire des bonnes relations bilatérales qu’elle entretient avec ses homologues.
c) Une coopération ralentie par l’absence d’harmonisation juridique
Les échanges d’informations quotidiens, au stade de la surveillance, sont régis par la directive MIF (marchés d’instruments financiers). Ils reposent sur une collecte de données sur les transactions effectuées par chaque régulateur national auprès des intermédiaires sous sa juridiction ; les données sont ensuite réparties électroniquement en fonction du régulateur compétent sur le titre considéré. Ceci soulève deux difficultés :
– les standards de reporting nationaux n’étant pas harmonisés, la consolidation des données reçues des différents régulateurs relatives aux transactions sur un même titre est malaisée et donne lieu à des erreurs. Il serait préférable d’avoir un système de reporting basé sur un standard unique, centralisé au niveau de l’AEMF (Autorité européenne des marchés financiers), et accessible à chaque régulateur. Une modification de la directive MIF serait nécessaire.
– la directive MIF ne prévoit pas l’échange des informations sur les ordres mais seulement sur les transactions. Or la surveillance de l’activité des traders à haute fréquence passe par une analyse fine non pas seulement de leurs transactions mais de leurs ordres, même s’ils ne sont pas réalisés.
Mais les enquêteurs de l’AMF se heurtent parfois à un défaut de standardisation des pouvoirs d’investigation des autorités : dans certains pays, les enquêtes sont transmises beaucoup plus vite qu’en France aux autorités pénales et/ou à la police, les régulateurs étant alors dessaisis des enquêtes à un stade préliminaire. De plus, toutes les autorités n'ont pas les mêmes pouvoirs que l’AMF, comme celui de la visite domiciliaire (y compris dans des domiciles privés) ou même celui d’obtenir des informations de la part des opérateurs téléphoniques ou Internet.
Enfin, certains régulateurs ont des pouvoirs très limités hors la sphère professionnelle des banques et autres prestataires de services d'investissement. Au final, les perspectives de poursuivre à l’étranger les investigations entreprises en France en recourant à la coopération internationale, et donc à la mise en jeu des pouvoirs propres aux autres autorités, peuvent être, selon les cas, singulièrement amoindries. Des progrès dans l’harmonisation des pouvoirs des régulateurs seraient donc nécessaires, garantissant notamment la réalisation de visites domiciliaires ou l’obtention des relevés téléphoniques dans d’autres juridictions.
Ces difficultés des autorités de régulation ne sont pas propres à la France. Elles sont sans doute plus importantes encore chez nombre de nos partenaires européens. Le même phénomène a également été mis en lumière par la crise aux États-Unis.
AUX ÉTATS-UNIS, LES FAILLES DES AUTORITÉS DE RÉGULATION Il n’existe pas de régulateur unique aux États-Unis, mais un grand nombre d’acteurs. Ainsi, la régulation du secteur bancaire est partagée entre la Réserve fédérale (Fed), l’Office du Contrôleur de la monnaie (OCC) la Federal Deposit Insurance Corporation (qui garantit les dépôts des clients des banques) et la supervision des caisses d’épargne. La Securities and Exchange Commission (SEC) est chargée de superviser les marchés boursiers. La régulation des activités de courtage en actions est assurée par la Financial Industry Regulatory Authority. La régulation des marchés de matières premières est assurée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Les assurances ne sont pas régulées à l’échelle fédérale mais au niveau des États. Les limites de la régulation, cruellement mises en évidence par la crise des subprimes, ont conduit le Congrès à adopter, le 15 juillet 2010, le « Dodd-Frank Act », d’après les noms du sénateur Christopher Dodd et du représentant Barney Frank, élus démocrates. Cette réforme a été lancée par le président Barack Obama pour rendre plus efficace la régulation du système financier américain et éviter une nouvelle crise après le désastre de l’année 2008. Afin d’éviter désormais la faillite des géants du secteur comme Lehman Brothers, les grandes banques seront davantage surveillées et ne devront pas dépasser une certaine taille. La spéculation sera également mieux encadrée, les banques commerciales ne pouvant plus spéculer qu’à hauteur de 3 % de leurs fonds propres dans des activités à risques. Elles devront également provisionner des fonds propres pour faire face elles-mêmes aux perturbations boursières et freiner leurs pratiques commerciales abusives, grâce à la création d’un Bureau of Consumer Financial Protection (bureau de protection financière du consommateur). L’objectif est d’obliger les banques à mieux informer les consommateurs et de ne plus leur laisser la possibilité d’accorder de prêts dont elles savent que les clients ne pourront jamais les rembourser. Par ailleurs, la Securities and Exchange Commission (SEC), accusée d'avoir ignoré plusieurs signaux d’alarme dans l’affaire Madoff, a récemment proposé de rétribuer davantage les informateurs qui la préviendraient de comportements frauduleux. Jusqu’à présent, la SEC ne pouvait payer ses informateurs que dans les cas de délit d’initiés et pour un montant plafonné à 10 % des sanctions financières prononcées. Le montant de la récompense sera désormais plus librement « basé sur les sommes récoltées à la suite des poursuites ». Le programme comprend toutefois plusieurs restrictions, visant à éviter par exemple de récompenser un individu impliqué dans une fraude qui dénoncerait lui-même l’affaire ou un employé qui contournerait les procédures de contrôle interne de sa société. |
E.– L'ABSENCE DE SUPERVISION À L'ÉCHELON EUROPÉEN : UNE CARENCE ESSENTIELLE POUR LAQUELLE DES STRUCTURES SONT EN COURS DE MISE EN PLACE
Au-delà du constat sur l’insuffisance de la régulation, il y a lieu de considérer que les autorités publiques ont failli dans leur mission de surveillance globale des marchés et de prévention des risques, particulièrement à l’échelon européen, incontestablement plus pertinent que l’échelon national pour appréhender les phénomènes en cause.
Comme le note le rapport du groupe de travail présidé par M. Jacques de Larosière sur la supervision financière, publié en février 2009, les autorités de réglementation et de surveillance se sont concentrées sur la surveillance microprudentielle des établissements financiers pris individuellement – action dont on a vu par ailleurs les limites – et pas assez sur les risques macrosystémiques.
Quant aux rares instances qui ont vu clair, force est de constater qu’elles ont « prêché dans ce désert ». M. Michel Aglietta, conseiller au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII), a ainsi relevé ainsi que « la Banque des règlements internationaux (BRI) tirait la sonnette d’alarme au sujet de la dérive du crédit depuis la première crise immobilière des années 1990, qui avait mis en faillite les banques scandinaves » (196). Mais les autorités ont ignoré ces mises en garde.
La crise financière, en particulier à partir du moment où elle a pris un caractère systémique, a ainsi constitué un constat d’échec pour les superviseurs nationaux et pour le dispositif embryonnaire existant à l’échelle européenne, celui des « comités de niveau 3 » de la procédure dite « Lamfalussy » (197). Comme l’a relevé la Commission européenne dans une communication du 27 mai 2009 sur la surveillance financière, « le dispositif de surveillance n’a pu ni prévenir, ni gérer, ni résoudre la crise. Les systèmes de surveillance ayant une base nationale, se sont avérés dépassés par rapport à la réalité intégrée et interconnectée des marchés financiers européens actuels. »
L’Europe ne disposait donc pas, au moment de la crise financière, et ne dispose toujours pas, à l’heure actuelle, des mécanismes indispensables de prévention et de gestion des crises. La Banque centrale européenne n’a pas cette compétence et les « comités de niveau 3 » n’ont pas de pouvoir décisionnel.
Ce constat a conduit la Commission européenne à jeter les bases d’un mécanisme européen de supervision qui n’est cependant, à ce jour, ni complet ni opérationnel.
1.– L’adoption du « paquet supervision »
La Commission européenne a présenté, le 23 septembre 2009, un « paquet législatif » de six textes pour créer un nouveau système européen de supervision des activités financières au niveau macro- et micro-économiques, sur la base des recommandations du rapport du groupe de travail présidé par M. de Larosière et des orientations définies par le Conseil européen de juin 2009.
La Commission européenne a proposé la création :
– d’un Comité européen du risque systémique (CERS), chargé de la surveillance macroprudentielle, compétent pour l’ensemble du système financier (marchés financiers, banques, assurances) ;
– et d’un Système européen de surveillance financière (SESF), pour la surveillance microprudentielle, formé par un réseau reliant les autorités nationales de surveillance et trois Autorités européennes.
Au terme de négociations très difficiles entre les États membres au Conseil, puis entre celui-ci et le Parlement européen, un accord politique a été atteint le 2 septembre 2010, confirmé formellement par le Conseil le 7 septembre et par le Parlement européen en plénière le 22 septembre. Les nouvelles autorités vont ainsi pouvoir être mises en place en janvier 2011.
Le commissaire Michel Barnier a résumé ainsi le progrès que représente ce « paquet supervision » : « Nous avons désormais : une tour de contrôle et des écrans radar pour identifier les risques, des moyens pour mieux contrôler les acteurs financiers, la faculté d’agir rapidement et de manière coordonnée ». La supervision au quotidien des institutions financières continuera d’être principalement du ressort des superviseurs nationaux, mais les États transfèrent pour la première fois de réels pouvoirs de supervision à l’échelon européen : les trois Autorités européennes auront le pouvoir de prendre des décisions contraignantes à l’encontre d’un superviseur national ou d’une institution financière, dans certaines circonstances.
2.– Le Comité européen du risque systémique (CERS)
Le CERS sera chargé d’alerter sur les risques macro-économiques pesant sur la stabilité financière – par exemple l’existence d’une « bulle » dans un État membre. Il siègera à Francfort, et pendant les cinq premières années, il sera présidé par le président de la BCE.
Les destinataires de ses alertes et recommandations (l’Union européenne, un État membre, l’une des trois Autorités de supervision européennes) devront s’y conformer ou expliquer pourquoi ils ne le font pas. Non doté de la personnalité juridique, le CERS ne prendra pas de décisions juridiquement contraignantes. Néanmoins, compte tenu de sa composition (gouverneurs des 27 banques centrales, président et vice-président de la BCE, un membre de la Commission européenne, représentants des États membres, personnalités du secteur privé ou du monde universitaire), ses alertes et recommandations pourront difficilement rester lettre morte, d’autant que le CERS pourra décider, au cas par cas, de rendre publique une alerte ou une recommandation, et tiendra informé le Conseil, le Parlement européen et la Commission européenne.
En collaboration avec les trois Autorités européennes de supervision, il dressera également une liste d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant d’attribuer une note prudentielle aux groupes transfrontaliers susceptibles de présenter un risque systémique.
Il y a lieu de noter que les États-Unis viennent également de se doter d’un outil équivalent.
Par ailleurs, lors du sommet du G20 à Londres en avril 2009, a été décidée la création du Conseil de stabilité financière (Financial stability board) qui rassemblera toutes les autorités nationales des États du G20 contribuant à la stabilité financière, dans les domaines de la monnaie, du crédit, de l’assurance, des marchés financiers, et de la comptabilité.
Cette instance remplacera le Forum de stabilité financière, créé en 1999 à la suite des secousses provoquées par la faillite du fonds spéculatif LTCM, et qui regroupait les représentants des pays avancés ainsi que ceux de Hong Kong et Singapour. Comme la plupart des instances ayant cette fonction, ce forum n’a guère vu venir la crise.
La nouvelle instance, élargie à tous les membres du G20, aura un rôle de supervision s’étendant à toutes les institutions financières, produits et marchés ayant une importance systémique. Le Conseil devra également s’intéresser aux « places offshore » non coopératives et aux paradis fiscaux.
Il exercera ses fonctions en concertation avec le FMI.
Ce Conseil devrait permettre de confronter les analyses européenne et américaine avec celles des grands pays émergents et notamment du monde asiatique. En effet, la prochaine crise n’aura sans doute pas pour cause un phénomène issu du monde occidental comme les subprimes, mais peut-être un dysfonctionnement ayant l’Asie pour origine.
3.– Les autorités européennes sectorielles de supervision
Le Système européen de supervision financière est conçu par la Commission européenne comme un réseau composé des entités suivantes :
– les autorités nationales de supervision des 27 États membres, qui continueront de contrôler au quotidien les institutions financières actives sur leur territoire ;
– des collèges regroupant au cas par cas les superviseurs des pays d’origine et d’accueil, s’agissant de la quarantaine de groupes financiers paneuropéens ;
– trois Autorités européennes de supervision (AES), dotées de pouvoirs contraignants, succédant aux trois comités actuels :
1. l’Autorité bancaire européenne se substituera au Comité européen des contrôleurs bancaires (CECB), dont le siège est à Paris ;
2. l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles succèdera au Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP), qui siège à Francfort ;
3. l’Autorité européenne des marchés financiers remplacera le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM), installé à Londres.
Les trois AES auront pour missions d’assurer une application uniforme de la législation européenne, de contribuer à la protection des consommateurs (198) et de faire converger les pratiques nationales de contrôle prudentiel au sein de l’Union européenne. Le budget annuel des AES sera alimenté à hauteur de 60 % par les États membres et de 40 % par le budget européen. D’ici deux ou trois ans, elles disposeront, au total, en tout d’un personnel d’une centaine de collaborateurs.
Les AES devront assumer de nombreuses tâches. Elles devront tout d’abord identifier, en vue de leur élimination, les exceptions et dérogations nationales existant dans la législation financière, pour progresser dans la mise en place d’un corpus de règles uniformes dans l’ensemble de l’Union européenne. Les domaines concernés feront l’objet de propositions de normes techniques de réglementation ou d’exécution – qui devront toutefois être endossées par la Commission européenne pour avoir force de loi (un processus est cependant mis en place pour permettre au Conseil et au Parlement européen d’exprimer des objections et d’empêcher ces normes d’entrer en vigueur).
Les AES auront le pouvoir d’obliger un superviseur national à respecter ses obligations en application du droit communautaire ; par exemple, si un superviseur national omet d’imposer à une banque de renforcer ses fonds propres conformément à la législation européenne, l’Autorité bancaire européenne pourra obliger la banque en question à respecter les ratios de solvabilité. Les AES auront également un rôle à jouer en cas de désaccord entre superviseurs nationaux et de situation de crise sur les marchés. Elles pourront aussi lancer des exercices de simulation de crise à l’échelle de l’UE.
Conformément aux décisions prises par le Conseil européen, une clause de sauvegarde a été introduite de manière à ce que les décisions des trois Autorités européennes de supervision, en cas de désaccord entre superviseurs nationaux ou liées à des situations d’urgence, n’empiètent pas sur les compétences et responsabilités budgétaires d’un État membre. L’exemple le plus fréquemment cité pour illustrer l’application de cette clause concerne la décision de recapitaliser par des deniers publics une institution financière en difficulté : cette décision restera du ressort des gouvernements nationaux.
Il reviendra au seul Conseil des ministres de déclarer une situation d’urgence ou de crise financière. Le Conseil réexaminera une telle décision au moins une fois par mois. Dans ce cas de figure, le CERS et les AES sont habilités à adresser une recommandation confidentielle au Conseil accompagnée d’une analyse de la situation.
L’adoption de ce « paquet supervision » ne constitue cependant qu’une première étape. Les véritables pouvoirs des trois AES devront être inscrits au cas par cas dans la législation sectorielle.
Un certain nombre d’expériences récentes – dont celle de la MIF – conduisent votre commission à inviter les représentants de la France auprès de l’Union européenne à redoubler d’efforts pour que les avancées réalisées ne soient pas amoindries par les dispositions d’application. D’aucuns de nos partenaires excellent, en effet, dans l’exercice...
Avec les autorités sectorielles de supervision et le Comité européen du risque systémique, l’Europe devrait disposer effectivement, selon l’image utilisée par M. Michel Barnier, commissaire européen chargé du marché intérieur et des services, de trois « écrans radars » et d’une « tour de contrôle » (199).
F.– LE RÔLE AMPLIFICATEUR DES MÉDIAS
Le spéculateur accompagne souvent ses opérations de la diffusion d’informations ou de rumeurs susceptibles d’influencer le marché dans un sens conforme à ses intérêts ou met à profit de telles informations ou rumeurs d’une autre origine. Ces informations ou rumeurs auront d’autant plus de poids qu’elles seront véhiculées par les médias et, de ce fait, ceux-ci, sans doute le plus souvent involontairement, peuvent jouer un rôle non négligeable dans les mécanismes de spéculation.
Il y a lieu de noter à cet égard que la circulation de l’information économique et boursière s’est significativement accélérée depuis la fin du siècle dernier et qu’elle est diffusée à destination d’un public très large : les télévisions et radios de grande audience, notamment, ont pris l’habitude de présenter et de commenter, parfois en temps réel, les moindres fluctutations du CAC40, du Nasdaq ou du Nikkei.
Certains médias – même parmi ceux jugés les plus sérieux – ne se contentent pas de relayer la rumeur, mais peuvent également la lancer pour une raison ou pour une autre.
Un exemple, parmi d’autres, est particulièrement démonstratif, même si l’origine de l’information n’est pas connue.
MANIPULATION PAR LES MÉDIAS : LE FINANCIAL TIMES ET L’EURO Le Financial Times du jeudi 27 mai 2010, a fait état, dans un article intitulé : « La Chine envisage de réduire son exposition à l’euro », d’une série de rencontres qui auraient eu lieu à Pékin entre des représentants de la Safe – State Administration of Foreign Exchange, organisme qui gère les réserves de devises sous l’autorité de la Banque centrale chinoise – et des banquiers étrangers, au cours de laquelle les autorités monétaires chinoises auraient évoqué leur intention de se désengager substantiellement de la zone euro, voire de mettre fin à la diversification de leurs réserves de change d’un montant de 2 450 milliards de dollars soit 1 994 milliards d’euros, dont environ 630 milliards en euros. Les dates de ces réunions ne sont pas mentionnées et un « investisseur » anonyme est seul cité sans aucune autre précision. Cependant, la conclusion du journal est claire : c’est un virage majeur qui montre que Pékin ne croit plus en l’avenir de la zone euro. La réaction des marchés a été immédiate : les investisseurs ont vendu massivement de l’euro au profit du dollar. L’euro a atteint son point le plus bas en quatre ans dans la journée du jeudi, entraînant les bourses dans son sillage. Les autorités monétaires chinoises ont alors réagi vivement : « la Chine est un investisseur responsable et de long terme dans l’investissement des réserves de change et nous suivons toujours le principe de diversification (…) L’Europe a été, est et restera l’un des principaux marchés d’investissement pour les réserves de change de la Chine ». Après cette mise au point, les marchés ont retrouvé une certaine sérénité et l’euro est remonté au dessus de 1,23 dollar. La rumeur a été éteinte rapidement par une parole institutionnelle claire. |
Cet exemple donne la mesure de l’importance des médias dans les mouvements moutonniers qui peuvent conduire à une catastrophe financière. Or, comme l’a souligné devant la commission, Mme Catherine Lubochinsky, professeur à l’Université Panthéon – Assas, « les médias financiers, d’une part, manipulent sciemment et, d’autre part, se font manipuler » (200).
Le remède n’est bien évidemment pas de contrôler les médias, mais il revient aux autorités compétentes d’utiliser la caisse de résonance qu’ils constituent pour distiller, en tant que de besoin, une parole publique et institutionnelle responsable.
C’est ainsi par exemple que l’Agence France Trésor prépare soigneusement et médiatise ses émissions de façon à faire en sorte que toutes les adjudications de l’État français soient couvertes, ce qui a toujours été le cas depuis le début de la crise, la demande étant, en général, deux fois supérieure à l’offre, selon M. Philippe Mills, directeur général de l’Agence France Trésor : « Chaque premier jeudi du mois, nous émettons des OAT, à dix ans et plus. La semaine qui précède, nous avons une réunion avec les représentants de chacun des SVT, qui nous demandent d’émettre tel montant sur tels titres. Nous en discutons en interne, et le lendemain, à onze heures, nous publions un communiqué annonçant que l’Agence France Trésor émettra trois à quatre titres pour une valeur comprise à l’intérieur d’une fourchette, l’ampleur de cette fourchette étant généralement comprise entre 1 et 1,5 milliard. Les SVT préparent l’adjudication en avertissant leurs clients. Nous suivons leurs démarches et nous faisons le point avec chaque SVT le matin même de l’adjudication » (201).
TROISIÈME PARTIE – POURSUIVRE RÉSOLUMENT, À TOUS LES ÉCHELONS PERTINENTS, L’ACTION ENTREPRISE APRÈS LA CRISE FINANCIÈRE DE 2008
I.– TROUVER LE BON ÉCHELON D’INTERVENTION ET ÉVITER L’ANGÉLISME
La crise financière de 2008 a été et reste mondiale. Il serait illusoire de croire que chaque État a encore le pouvoir, seul, de corriger utilement les dysfonctionnements qu’elle a mis en lumière au sein d’une économie et d’une finance de plus en plus mondialisées.
Mais il ne faut pas renoncer ! Les remèdes susceptibles de prévenir la survenue d’une nouvelle crise, répliquant celle qui affecte encore nos économies ou d’une autre nature, ne pourront résulter que d’une alchimie subtile où les autorités de tous les échelons – national, européen, international, à savoir le G20 - ont leur rôle à jouer.
A.– LES LIMITES ET LES ÉVENTUELS EFFETS PERVERS D’UNE ACTION RÉGULATRICE MENÉE AU SEUL ÉCHELON NATIONAL N’ONT PAS CONDUIT AU RENONCEMENT
1.– Les limites et les éventuels effets pervers d’une action régulatrice menée au seul échelon national
Les mouvements financiers, flux de capitaux et services fournis par toutes les catégories d’acteurs des marchés financiers, ont toujours eu une forte dimension transfrontalière et sont désormais très majoritairement « déconnectés » de toute considération de frontières. L’activité financière est bien l’une des illustrations les plus abouties de la « mondialisation », à tel point que l’on peut se demander s’il est encore possible pour la puissance publique étatique - contrainte par le principe de territorialité – d’exercer sur ces acteurs et sur ces flux quelque influence que ce soit, quand bien même il n’y aurait pas, de la part des opérateurs financiers, de volonté de faire jouer la « concurrence réglementaire » ou de contourner toute forme de règle nationale qui leur serait adverse.
Ce constat a priori décourageant ne saurait bien sûr justifier l’inaction des États, mais impose une certaine lucidité : qu’il s’agisse de l’édiction de règles (réglementation) ou du contrôle de leur mise en œuvre (supervision), les actions nationales doivent être étroitement concertées, voire coordonnées. L’objectif à cet égard ne saurait être d’aboutir à des mesures nationales identiques : malgré la mondialisation des échanges financiers, on constate que les situations nationales et (ou) régionales ont des caractéristiques différentes, appelant des mesures appropriées. Toute la difficulté de la démarche est d’identifier les problèmes communs et de décliner les solutions de manière différenciée et appropriée à chaque contexte national, de manière à ce que, si les méthodes nationales – voire les calendriers – diffèrent, les résultats du moins soient similaires.
L’exemple, souvent cité par les personnes entendues, des mesures unilatérales prises par des autorités nationales pour interdire ou limiter temporairement les ventes à découvert (en particulier les déclarations unilatérales des autorités allemandes) montre bien que, dans l’urgence, c’est évidemment au seul niveau national que des mesures peuvent être prises, mais que celles-ci sont immédiatement contournées, et donc privées de tout ou partie de leur impact, si elles ne sont pas relayées rapidement au niveau international.
La posture du « chevalier blanc » est, compte tenu de la mondialisation de la finance, irrémédiablement vouée à l’échec.
Par ailleurs, parallèlement à toute démarche nationale ou internationale de modification des réglementations existantes, il doit être rendu plus difficile pour les opérateurs de profiter de zones de « non-règlementation » ou de règlementation minimale (et d’opacité maximale). À cet égard, on peut noter que la lutte contre les « paradis fiscaux » n’est donc pas dépourvue de liens avec la lutte contre les formes de spéculation qui s’appuient sur un contournement des règles existantes. C’est d’ailleurs l’un des axes d’action choisis par le G20, et qui a déjà porté ses fruits. Cette action doit être résolument poursuivie.
2.– Avec la loi de régulation bancaire et financière, les pouvoirs publics français ont assumé leurs responsabilités
La loi de régulation bancaire et financière n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, au-delà des mesures de transposition en droit national d’orientations définies par le G20 et de directives communautaires, participe à la mobilisation internationale et européenne engagée à la suite de l’élan donné par le G20, en lui inspirant des mécanismes inédits.
En 2008-2009, face à la plus grave crise financière depuis 1929, la priorité du Gouvernement a été d’en limiter les conséquences pour l’économie réelle avec les nécessaires mesures de soutien au secteur bancaire de l’automne 2008 et le plan de relance de l’économie engagé dès le début de l’année 2009.
Le projet de loi de régulation bancaire et financière déposé le 16 décembre 2009 avait pour objet de prolonger cette action du Gouvernement. Dans sa première partie, il présentait la mise en œuvre de premières décisions de la communauté internationale pour renforcer la régulation du secteur financier et visait à renforcer nos dispositifs nationaux de prévention et de gestion des crises.
L’Assemblée nationale, tout comme le Sénat se sont efforcés, au cours des débats, d’en renforcer la portée.
a) Le projet initial : un renforcement de la supervision des acteurs et des marchés financiers
Le titre Ier du projet, intitulé « Renforcer la supervision des acteurs et des marchés financiers », comprenait initialement sept articles.
L'article 1er crée le Conseil de régulation financière et du risque systémique (COREFRIS) qui vient se substituer à l'actuel Collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier, dont le mode de fonctionnement apparaît aujourd'hui inadapté. Le COREFRIS, composé des présidents des autorités de régulation françaises et du ministre de l'économie, sera doté de deux missions principales. Il devra tout d'abord veiller à la stabilité financière et analyser tout élément qui serait susceptible de la menacer (surveillance macroprudentielle du risque systémique). L'installation de ce conseil s'inscrit dans le prolongement de la création, au niveau de l'Union européenne, du Comité européen du risque systémique qui exercera un rôle similaire. Ensuite, il constituera un lieu de concertation sur les positions internationales de la France au sein des différentes enceintes économiques et monétaires internationales.
L'article 2 accorde à l'Autorité des marchés financiers (AMF) de nouveaux pouvoirs de restriction des conditions de négociation des instruments financiers, pour une durée limitée et en cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier.
Les articles 3 et 4 résultent de la déclinaison en droit français du règlement européen n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation. Lesdites agences devront désormais suivre une procédure d'enregistrement (auprès de l'AMF pour la France) et respecter un ensemble d'obligations liées à cet agrément. L'AMF pourra sanctionner tout manquement dans l'application des obligations du règlement européen.
Les articles 5, 6 et 7 constituent la transposition en droit français des modifications, introduites dans la législation européenne par la directive n° 2009/111/CE du 16 septembre 2009 relative à la réglementation bancaire, relatives au contrôle des groupes bancaires européens. En particulier, l'article 5 permet un meilleur échange d'informations entre autorités financières européennes tandis que les articles 6 et 7 autorisent la création de collèges de superviseurs qui rassemblent, sous l'égide du superviseur de la société-mère, tous les superviseurs d'un même groupe possédant des filiales dans l'Union européenne. L'application de la réglementation bancaire, notamment prudentielle, devrait ainsi être mise en œuvre de façon plus cohérente.
b) Un texte musclé par l’Assemblée nationale
Les modifications apportées en première lecture par l’Assemblée nationale s’articulaient autour de trois thèmes : renforcer les autorités de régulation, lutter contre les « trous noirs » de la régulation, accroître la responsabilisation des acteurs.
● Des autorités de régulation fortifiées.
Dans le champ de la régulation, l’Assemblée nationale a introduit cinq articles relatifs à l'AMF.
Le premier précise la dimension européenne des missions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), par parallélisme avec le mandat confié à l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP).
Le deuxième accorde à un secrétaire général adjoint de l'AMF le pouvoir d'ouvrir des enquêtes.
Le troisième soumet l'activité de conseil en gestion de patrimoine au contrôle de l'AMF.
Le quatrième améliore et modernise les procédures répressives de l'AMF, selon trois axes : la représentation du collège aux audiences, le relèvement du plafond des sanctions pécuniaires et une publication systématique des décisions, et la faculté pour le président de l'AMF d'exercer un recours principal ou incident contre ces décisions.
Enfin, le cinquième étend à l'ensemble des infrastructures de marché le champ des structures habilitées à transmettre, sous le contrôle des autorités de régulation française, des informations à leurs homologues et aux régulateurs étrangers. Cet échange est également conditionné à l'existence d'un accord de coopération entre autorités.
Par ailleurs, six articles relatifs aux compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) ont été introduits dans le projet de loi. Le premier ratifie l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance.
Le deuxième prévoit que l'ACP est soumise à un contrôle parlementaire, à l'instar des dispositions en vigueur pour l'AMF.
Le troisième dispose que le président de l'AMF est membre de droit du collège de l'ACP. Par ailleurs, deux nouveaux membres, nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, seront appelés à siéger au sein de ce collège. Enfin, le vice-président de l'ACP sera nommé après avis des commissions des finances des deux assemblées.
Le quatrième rehausse, à hauteur de 100 millions d'euros, le montant des sanctions pécuniaires que l'ACP peut prononcer à l'encontre d'une personne qu'elle supervise. Le principe d'une publicité des sanctions de l'ACP, sauf exceptions limitativement énumérées, est, tout comme pour l'AMF, affirmé.
Le cinquième oblige les personnes soumises au contrôle de l'ACP à rassembler dans un code de déontologie les règles de bonne pratique relatives à l'information et la protection de leur clientèle. Ce code doit être mis à la disposition de leur clientèle et de leurs collaborateurs.
Enfin, le dernier demande à l'ACP de transmettre, une fois par trimestre, un rapport sur les négociations menées au sein du Comité de Bâle sur les nouvelles normes prudentielles, dites « Bâle III ». Un rapport ponctuel sur l'impact de cette révision sur l'offre de financement de crédit et le financement de l'économie française doit également être remis d'ici le 31 mars 2011.
● L'introduction de dispositions visant à lutter contre les « trous noirs » de la régulation
Au sein du titre Ier, l'Assemblée nationale a introduit un nouveau chapitre V « Encadrer les produits dérivés et les ventes à découvert » comprenant six articles.
Elle a étendu les compétences de l'AMF aux produits dérivés en matière de sanction et de déclaration des opérations suspectes. Elle a étendu également cette obligation de déclaration aux opérations relatives à Alternext.
Elle a confié à l'AMF le soin de préciser, dans son règlement général, les mesures d'information de l'Autorité et du marché sur les positions courtes afférentes à des instruments financiers.
Elle a inscrit dans la loi des dispositions du règlement général de l'AMF, afin de consacrer les engagements réciproques de règlement et de livraison des parties à une transaction boursière, et de réduire de trois à un jour de négociation le délai dans lequel intervient l'inscription en compte et le transfert de propriété des titres.
Elle a prévu que le Gouvernement doit remettre au Parlement quatre rapports portant respectivement sur :
– la possibilité d'interdire dans la zone euro la vente de contrats d'échange sur défaut (CDS) portant sur des titres de dette souveraine sans que l'investisseur soit exposé à ce risque ;
– la possibilité d'interdire le recours aux ventes à découvert par les filiales de fonds spéculatifs ;
– les modalités de mise en œuvre d'une régulation européenne et nationale du capital-investissement ;
– la possibilité de « répercuter » le coût de la crise sur les banques européennes.
● Vers une plus grande responsabilisation des acteurs
L'Assemblée nationale a tout d'abord introduit d'importantes dispositions sur la responsabilité des agences de notation en précisant qu'elles sont responsables des fautes et manquements par elles commis dans l'application du règlement européen. De même, le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale prévoit que les clauses limitatives et exonératoires de responsabilité dans les contrats que les agences signent avec leurs clients sont interdites et réputées non écrites.
Elle oblige les établissements financiers à se doter, au sein de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance, d'un comité des risques qui fonctionne selon les mêmes modalités que le comité d'audit.
De même, elle crée, au sein des organes délibérants des établissements financiers, des comités spécialisés en matière de rémunérations, dont la mission est essentiellement cantonnée à l'examen des rémunérations des opérateurs de marché.
c) Un texte adapté par le Sénat
Le Sénat a supprimé les demandes de rapport qui aurait été pourtant utiles notamment pour mesurer l’impact d’une éventuelle interdiction des ventes à découvert « à nu » sur les CDS. La seconde chambre s’est néanmoins attachée à poursuivre l'œuvre d'amélioration de l'efficacité de la supervision financière, à renforcer la transparence, la responsabilité et la lutte contre certains abus, le cas échéant en anticipant le droit européen pour l'influencer.
Le Sénat s'est en premier lieu attaché à améliorer le fonctionnement des deux autorités de régulation, l'ACP et l'AMF, par les mesures suivantes :
– la faculté pour l'AMF de déléguer ses contrôles aux associations de conseillers en investissements financiers qu'elle a agréées, et de sanctionner lesdites associations ;
– un principe d'ouverture au public des audiences de la commission des sanctions de l'AMF, auquel il peut être dérogé, sur demande du président de la formation ou d'une personne mise en cause, pour préserver l'ordre public, la sécurité nationale ou le secret des affaires. La fonction de « commissaire du Gouvernement » au sein du collège et de la commission des sanctions a également été supprimée au profit d'une présence du directeur général du Trésor ou de son représentant ;
– l'introduction d'une procédure de transaction (qualifiée de « composition administrative ») pour les infractions non constitutives d'abus de marché, mise en œuvre par le collège de l'AMF et qui donne lieu à un accord homologué par sa commission des sanctions ;
– l'instauration d'un rapporteur au sein de la commission des sanctions de l'ACP, sur le modèle procédural existant à l'AMF.
Le champ de la régulation a en outre été étendu par :
– la mise en place d'un nouveau régime juridique pour la fonction de centralisation des ordres portant sur des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), activité essentielle pour la sécurité de la gestion collective, mais qui n'était curieusement pas régie par des dispositions légales ;
– un encadrement et une précision de l'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs, afin que soit bien prise en compte la protection des épargnants et des investisseurs ;
– la possibilité désormais offerte à la Banque de France de pouvoir communiquer des informations avec les autorités étrangères homologues sur les systèmes de règlement-livraison ;
– l'habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance la directive 2009/110/CE sur l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et la surveillance prudentielle de ces établissements ;
– la présence affirmée du directeur général du Trésor au sein du Haut conseil du commissariat aux comptes ;
– et la création d'un régime d'encadrement du marché au comptant des quotas d'émissions de gaz à effet de serre (« quotas de CO2 »), sous compétence conjointe de l'AMF et de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Il s'agit notamment de montrer, par cette disposition essentielle, que notre pays peut être précurseur dans la régulation d'un secteur à forts enjeux économiques et juridiques.
Sur ce dernier point, le Sénat a introduit des dispositions permettant d'appliquer aux quotas de CO2 les règles pertinentes qui régissent déjà les échanges d'instruments financiers. Ces actifs pourront ainsi être négociés sur un marché réglementé, supervisé par l'AMF. En outre, les principales règles applicables aux actifs financiers (en particulier celles relatives à l'accès au marché et à la sanction des abus de marché) les régiront également. Enfin, la répartition des rôles entre les deux régulateurs concernés, l'AMF et la CRE, fait l'objet de dispositions particulières.
B.– LE G20, LIEU D’IMPULSION PRIVILÉGIÉ
Les sommets du G20 depuis le déclenchement de la crise financière de 2007 doivent-ils être simplement regardés comme des « grand’messes » solennelles décevantes, ou constituent-ils une réponse appropriée et efficace aux défis résultant de la crise financière ?
Il faut, à cet égard, souligner que la France a joué un rôle important pour promouvoir le G20 comme « le » forum international où se dessinent les réponses à la crise, et notamment pour accroître la légitimité de cette instance en élargissant sa composition., C’est en effet le 23 septembre 2008, huit jours après la faillite de Lehman Brothers, que le Président de la République a invité, depuis la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, les chefs d'État et de gouvernement à se réunir avant la fin de l'année 2008 « pour réfléchir ensemble aux leçons à tirer de la crise financière qui est la plus grave qu'ait connue le monde depuis celle des années 30 ». Après son discours, en conférence de presse, le Président a appelé les membres du G8 à intégrer les pays émergents au futur sommet et proposé une réunion dès novembre.
C’est ainsi que, le 15 novembre 2008, à Washington, le G20 a tenu, pour la première fois, le rôle actif qu’on lui reconnaît aujourd’hui. Depuis cette date, les chefs d'État et de gouvernement se réunissent très régulièrement (Londres en avril 2009, Pittsburgh en septembre 2009, Toronto en juin 2009, Séoul en novembre 2010).
Les membres du G20 représentent 85 % du commerce mondial, les deux tiers de la population mondiale et plus de 90 % du produit mondial brut, d’où la portée effective que peuvent prendre les orientations définies au sein de cette instance.
Même si certains sommets semestriels du G20 ont déçu les observateurs, même si certaines déclarations solennelles sont restées partiellement « lettre morte » (on pense notamment aux engagements d’amener les banques à faire rapidement et exhaustivement toute la transparence sur le contenu de leurs bilans, pour connaître l’étendue de leurs « actifs toxiques » – force est de constater qu’à cet égard, on n’en sait guère plus aujourd’hui qu’il y a deux ans !), il faut souligner combien la « parole publique » exprimée ainsi au niveau politique international le plus élevé a constitué une réponse appropriée face aux mouvements de panique sur les marchés financiers. Le G20 n’a cependant aucun pouvoir de décision. Il n’adopte pas de règles, il n’impose pas de sanctions.
Mais il constitue une enceinte d’expression de la volonté politique commune d’États aussi différents que la France, les États-Unis, le Canada, les principaux pays émergents. Les déclarations finales des sommets constituent une véritable « feuille de route » commune malgré les intérêts souvent contradictoires des parties. Bien que dépourvues en elles-mêmes de portée impérative pour les acteurs privés, ces déclarations ont permis, notamment, d’éviter la reproduction des protectionnismes des années 1930, de relancer efficacement la lutte à l’échelle internationale contre les « juridictions non coopératives » (« paradis fiscaux ») et d’établir une liste claire des champs d’action des réformes – à charge ensuite pour chaque État (et pour l’Union européenne qui constitue le « vingtième membre ») de les concrétiser.
La présidence française du G20, ouverte le 12 novembre 2010, offre à la France une chance de peser, à un moment crucial, sur les orientations de ce qui est l’instance la plus appropriée pour définir les moyens de prévenir la survenance de nouvelles crises, et fait donc peser sur notre pays une responsabilité particulière.
La France maîtrise, au moins en partie, l’ordre du jour et peut, par le choix des thèmes, amener la réflexion sur les terrains qu’il lui paraît opportun de privilégier. À cet égard, les priorités de la présidence française ont été ainsi définies par le Président de la République : la réforme du système monétaire international ; la régulation du marché des matières premières ; la gouvernance mondiale, « afin de garantir une fois encore la prévisibilité et, surtout, la coordination dont nous avons impérieusement besoin pour organiser nos politiques macroéconomiques et pour éviter d’être les victimes permanentes d’un capitalisme débridé, sans règles […] et qui pénalise généralement les plus fragiles et les plus faibles » (202).
Les deux premières priorités – et votre Rapporteur s’en réjouit – sont en lien avec l’objet de notre commission d’enquête. Et, de fait, la réforme du système monétaire international paraît être « la question préalable » à résoudre pour casser ce qui est l’un des ressorts majeurs de la spéculation, l’extrême instabilité chronique des changes.
LA RÉFORME DU SYSTÈME MONÉTAIRE INTERNATIONAL : UNE ARDENTE NÉCESSITÉ « La France va prendre, dans quelques semaines, la double présidence du G20 et du G8, la France proposera d’ouvrir de nouveaux chantiers. (…) Mais quels sont ces chantiers décisifs qu’il nous faut faire avancer dès l’année 2011 ? Le premier, c’est celui de la réforme du système monétaire international. Qui, aujourd’hui, pourrait se lever pour me dire que l’instabilité des changes ne fait pas peser une lourde menace sur la croissance mondiale ? Est-ce que l’on va continuer à se faire des reproches, à s’envoyer des anathèmes, à dénoncer des attitudes unilatérales alors que ne nous sommes pas capables de définir un système multilatéral ? Nous nous en sortirons tous ensemble ou nous échouerons tous ensemble. (203) » En novembre 2010, les dirigeants du G20 ont indiqué pour la première fois à Séoul que leur objectif était de « construire un système monétaire international plus stable et plus résistant » et ont demandé au FMI d’y travailler. On ne peut, à cet égard, que partager le constat présenté devant la commission d’enquête par M. le professeur Philippe Chalmin : « la première des instabilités est monétaire. Il est utopique de chercher à stabiliser quelque marché que ce soit si l’unité dans laquelle s’expriment toutes les valeurs de ce bas monde, c’est-à-dire le dollar, est instable. Le premier chantier est donc la stabilisation du système monétaire international. La seule solution serait une devise mondiale. À une époque, le cartel des banques centrales a tout de même réussi à encadrer le marché des changes, grâce aux accords du Louvre. Aujourd’hui, le rapport euro/dollar se promène entre 0,8 et 1,6, sachant que la parité de pouvoir d’achat tourne autour de 1,15 ou 1,20. C’est l’instabilité fondamentale dont toutes les autres découlent (204). » L’importance d’une réforme du système monétaire international est largement admise dans son principe. Cette question – bien qu’elle n’entre pas directement dans le champ de la commission d’enquête – ne peut être éludée, car le désordre monétaire international alimente une spéculation qui se nourrit de l’instabilité des taux de change, et, par là même accentue le désordre. Il s’agit certes d’une question difficile, mais il faut être conscients que cette instabilité est une des raisons de la surabondance de liquidités dont les effets néfastes ne sont plus à démontrer. Une des pistes à explorer pourrait mener à la création d’un « serpent monétaire » international. La création d’un étalon monétaire international constitué d’un « panier » des principales monnaies (dollar, euro, yen, yuan, réal,…) constitue une autre piste. Un tel étalon éviterait les manipulations de cours et les dévaluations compétitives. On en peut qu’encourager le Gouvernement dans cette recherche d’un nouvel ordre monétaire international. |
Pour avancer réellement sur ce dossier, il paraît nécessaire d’avancer des solutions concrètes susceptibles de permettre une stabilisation des taux de change.
Proposition n° 1 : Mettre à profit la présidence française du G20, qui offre l’occasion d’avancer dans la réforme du système monétaire international, pour faire progresser l’idée d’une stabilisation des taux de change au moyen de mécanismes tels qu’un « serpent monétaire » encadrant les principales devises mondiales ou la création d’un étalon monétaire constitué d’un « panier » de ces devises. |
De même, compte tenu de l’impact de la surabondance de liquidités sur les phénomènes spéculatifs, la tribune du G20 devra appeler les banques centrales à veiller à ne pas alimenter la spéculation par des politiques monétaires trop laxistes.
Nous avons vu (cf. deuxième partie, I, B) que la politique monétaire des États-Unis portait une lourde responsabilité dans cette situation. Force est de constater que, dans la période récente, la politique monétaire de la zone euro est loin, pour l’instant, d’être exempte de toute critique.
ZONE EURO : « On a beaucoup critiqué le conservatisme de la France et de l’Allemagne, leur reprochant d’avoir continué à suivre la masse monétaire M3 – billets, pièces, dépôts et instruments négociables sur le marché monétaire. Le suivi est en fait beaucoup plus sophistiqué que cela. Nous nous appuyons sur des enquêtes, auprès des entreprises pour mesurer leur trésorerie et leurs besoins de financement ; auprès des banques pour connaître leurs conditions sur les différents segments de l’offre de crédit et l’évolution des taux. Nous donnons une grande importance au crédit, ce qui a valu à la France de faire un peu office de pionnière dans le développement des instruments de suivi. Nous avons notamment distingué les crédits aux grandes entreprises susceptibles d’être remplacés par des financements de marché, les crédits aux PME, elles-mêmes subdivisées entre les filiales de groupes et les entreprises indépendantes, de façon à surveiller l’évolution des différents compartiments de crédit. Cette analyse fine nous a conduits parfois à prendre des mesures de politique monétaire que n’aurait pas justifiées la seule analyse économique. Nous avons ainsi amorcé un cycle de remontée des taux parce que nous estimions que la masse monétaire augmentait beaucoup trop vite et qu’à défaut d’intervenir, l’inflation ressurgirait dans les deux ans même si les prévisions économiques ne l’anticipaient pas (205). » Cette affirmation du Gouverneur de la Banque de France souligne en creux que la surveillance de la quantité de monnaie en circulation n’était plus une préoccupation des banques centrales et notamment n’entrait pas dans la logique de la doctrine expansionniste de MM. Greenspan et Ben Bernanke. Cette surveillance de la masse monétaire M3 par la Banque centrale européenne (BCE) ne se faisait cependant pas dans un souci d’éviter d’alimenter les bulles spéculatives, mais uniquement afin de garder l’inflation sous la barre des 2 %. Elle a eu toutefois pour effet d’éviter d’alimenter la « chaudière » spéculative. En revanche, en réaction à la crise financière, la BCE mène une politique monétaire beaucoup plus expansive : baisse de son taux directeur à 1 %, mais aussi programme d’achat de titres d’État sur le marché secondaire – au total, les banques centrales de l’eurosystème en ont acheté pour 67 milliards d’euros depuis le déclenchement de la crise grecque en mai 2010. Ce programme de rachat déroge au mandat de la BCE – article 104 du Traité – et ne devrait de ce fait pas se prolonger au-delà du premier trimestre 2011. |
Proposition n° 2 : Mettre l’accent, dans le cadre du G20, sur l’arbitrage permanent que doivent effectuer les banques centrales entre, d’une part, une politique expansive et de création monétaire de court terme afin de soutenir l’économie ou de venir en aide à des États en difficulté et, d’autre part, une politique plus restrictive de long terme afin de ne pas alimenter la croissance de la masse monétaire susceptible de favoriser la constitution de bulles spéculatives. À cette fin, les banques centrales devront prêter une attention plus grande au suivi de la masse monétaire et exercer pleinement un pouvoir monétaire actuellement inhibé par la priorité donnée à la stabilité des prix. |
Notre pays disposera, enfin, à l’occasion de sa présidence du G20, d’une information privilégiée sur le suivi de la mise en œuvre des orientations des sommets précédents dans chaque pays. À cet égard, le Gouvernement devra communiquer de manière très détaillée cette information en direction des parlementaires et des citoyens.
Il pourra également relancer la dynamique du G20 qui semble s’être quelque peu « essoufflée » : il est impératif de ne pas ne pas relâcher la « pression », ne pas laisser les nouveaux thèmes – par ailleurs absolument légitimes – faire basculer les précédents dans un relatif oubli.
La présidence française du G20 devra donc être consciente de la nécessité, outre d’y évoquer, comme le Gouvernement en a déclaré l’intention, des sujets étroitement liés aux domaines d’action privilégiés de la spéculation que sont le marché des changes et les marchés de matières premières, de poursuivre le travail de suivi sur la mise en œuvre effective des engagements pris lors des précédents G20 : la discussion de nouveaux sujets ne doit pas donner à penser que les précédents engagements ont tous été concrétisés – c’est loin d’être le cas – ou ne sont plus des priorités.
Une attention particulière devra être portée à la lutte contre les paradis fiscaux, tant il est vrai que nombre de cas de spéculation abusive font apparaître, à diverses étapes du processus, des intervenants localisés dans des lieux où le taux de prélèvement obligatoire est inversement proportionnel au taux d’ensoleillement…
Actuellement, le suivi de la mise en œuvre des engagements pris par les membres du G20 est assuré par le Conseil de stabilité financière créé en avril 2009 dont la mission principale est de conduire les observations permettant, le cas échéant, une alerte précoce sur les risques macro économiques et financiers, et aussi de mesurer les progrès réalisés dans la concrétisation des actions prévues par le G20.
Il y a lieu de s’interroger également sur l’opportunité de doter le G20 d’une structure, nécessairement légère compte tenu du caractère informel de cette instance, pouvant pérenniser un suivi de ces actions selon une approche moins technique, sous la responsabilité directe des politiques.
Proposition n° 3 : Assurer, dans le cadre de la présidence française du G20, un suivi attentif de la mise en œuvre effective de l’ensemble des engagements pris lors des précédents G20, en particulier s’agissant de lutter contre les paradis fiscaux (juridictions non coopératives). La mise en place d’une structure permanente – légère – pourrait permettre de pérenniser cette nécessaire procédure de suivi. |
C.– L’UNION EUROPÉENNE : UNE INDISPENSABLE SÉRIE DE RÉFORMES AMBITIEUSES À METTRE EN œUVRE ET À PROLONGER
L’Union européenne est, en tant que telle, membre du G20, aux côtés des États européens (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni) qui en sont individuellement membres, et a démontré sa capacité de surmonter ses divergences internes pour se présenter unie à chaque sommet du G20, le Conseil européen des chefs d’État et de gouvernement adoptant, avant chaque G20, ce qui constitue « la position de l’Union » en vue du G20.
Mais l’Union a un rôle propre à jouer. Certes, les processus de décision européens sont par nature lents et basés sur la recherche de compromis ; pour autant, elle constitue un échelon d’action indispensable. Tout d’abord, elle doit prévenir et traiter des phénomènes spéculatifs qui visent spécifiquement l’Europe, tels que ceux ayant conduit à la mise en place du plan de sauvetage pour la Grèce puis pour l’ensemble de la zone euro au printemps 2010 et à une activation du Fonds européen de solidarité financière (FESF) au profit de l’Irlande en novembre 2010. D’autre part, elle doit s’efforcer d’exercer, en mettant en valeur les solutions trouvées et adoptées à 27, une influence sur les travaux conduits au niveau mondial.
1.– Un préalable, restaurer le rôle du politique : politique monétaire et gouvernance économique
L’Union doit avant tout s’interroger sur les causes des deux crises de dette souveraine – grecque et irlandaise – qu’elle vient de traverser.
« La spéculation ne tombe pas du ciel ; elle n’entre en jeu que lorsque la situation économique est propice. » Cette citation de M. Marc Touati, directeur général délégué de Global Equities (206), traduit le fait que c’est par les failles ouvertes par les politiques économiques nationales, mal coordonnées, que se sont engouffrés les mouvements spéculatifs. Les disparités entre les politiques économiques et fiscales, le dumping industriel aggravé par le dumping fiscal mené par certains pays, au premier rang desquels force est de remarquer l’Irlande, ont ouvert une voie royale aux spéculateurs.
Une plus grande coordination des politiques économiques des pays membres de l’Union européenne et, surtout, de ceux membres de la zone euro, semble indispensable. Les fonds structurels européens doivent y participer. Il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont, par le passé, ont été orientés les fonds structurels européens, notamment en Grèce ou en Irlande. Quelle est la partie de ces fonds qui s’est orientée vers la spéculation ? En Grèce, au lieu de contribuer à l’entretien des ports et donc de soutenir les armateurs, ces fonds auraient sans doute été plus utiles pour moderniser l’administration, notamment les services fiscaux, ainsi que l’a souligné notre collègue Mme Elisabeth Guigou, au cours des travaux de notre commission. Leur attribution devra se faire, à l’avenir, de manière plus sélective, plus intelligente et sous un contrôle strict des instances européennes.
La création de la monnaie unique n’ayant été accompagnée ni d’un gouvernement économique unique, ni d’une politique fiscale coordonnée, la situation nous oblige à regarder d’un œil particulièrement vigilant l’orientation de la politique économique de nos partenaires.
Le 1er juin 2010, dans un entretien au journal Le Monde, M. Jean-Claude Trichet, président de la BCE, déclarait : « Nous sommes une fédération monétaire. Nous avons maintenant besoin d’avoir l’équivalent d’une fédération budgétaire en termes de contrôle et de surveillance de l’application des politiques en matière de finance publique ». Selon lui, une « surveillance multilatérale attentive », indispensable pour garantir les critères du pacte de stabilité et de croissance tout en conservant la responsabilité de chacun des États membres, « a été terriblement négligée ». Le fédéralisme budgétaire, en ce sens, serait une réponse pragmatique pour huiler les mécanismes financiers, fiscaux et monétaires et réduire l’intérêt de toute spéculation au détriment d’un des pays membres.
Une union monétaire garantit à ses membres une stabilité des taux de change mais, en contrepartie, ne peut laisser intactes leurs marges de manœuvre dans la conduite de la politique économique, sous peine de créer des distorsions, propices à toutes les spéculations. Une coordination entre les politiques économiques et fiscales doit donc être mise en place pour éviter ce phénomène. Il y a lieu de méditer la conclusion de M. Jean-Claude Trichet : « Nous sommes interdépendants : la mauvaise gestion d’un seul provoque des problèmes pour tous les autres. ». Il est encore plus urgent d’en tirer les conséquences.
Proposition n° 4 : Tirer les conséquences de l’union monétaire en matière de conduite des politiques économiques et fiscales, en assurant un véritable contrôle, une « surveillance multilatérale » par les instances européennes appropriées, des politiques définies par les États membres et de leur mise en œuvre, particulièrement s’agissant des États ayant bénéficié des interventions du Fonds européen de solidarité financière. |
2.– Des avancées très importantes ont été réalisées dans la mise en œuvre des engagements pris au G20 et des « chantiers » législatifs essentiels sont en cours ou annoncés
L’ensemble des travaux européens en cours sur la création d’un véritable gouvernement économique européen, non seulement pour la zone euro mais pour l’UE-27, va dans le sens d’une plus grande crédibilité de la « coordination des politiques économiques » proclamée dans les traités, mais peu réelle jusqu’à présent. Toute orientation tendant à rendre plus crédible et plus lisible l’action de l’Europe en matière économique constitue un signal fort destiné aux acteurs des marchés, pour réduire le champ de l’incertitude et restaurer la confiance – et donc mécaniquement dissuader une possible spéculation notamment sur les dettes souveraines. À cet égard, la question encore pendante de la pérennisation, au-delà de 2013, du FESF, sera cruciale.
L’inquiétude collective face aux mouvements spéculatifs susceptibles de constituer un risque de perturbation de la stabilité financière en Europe a été très présente tout au long des premiers travaux européens en réponse aux différentes phases de la crise financière. Trois illustrations : l’action de la Banque centrale européenne depuis l’été 2007 (notamment sa concertation étroite avec les autres banques centrales du monde), la tâche confiée au nouveau Comité européen du risque systémique de signaler l’apparition d’éventuelles bulles spéculatives affectant un ou plusieurs États membres, la toute nouvelle procédure qui va se mettre en place – en complément de la procédure de surveillance centrée sur les données budgétaires – pour surveiller, et même le cas échéant sanctionner, les « déséquilibres macroéconomiques excessifs » dans la zone euro, tous les responsables européens citant spontanément comme exemple de tels déséquilibres les bulles spéculatives, notamment immobilières.
a) Les réflexions du Parlement européen
S’agissant du champ législatif, on n’aurait garde d’omettre de faire état des travaux de la commission spéciale du Parlement européen sur la crise financière, économique et sociale, qui témoigne d’une forte implication d’un organe parlementaire sur le thème de la crise financière et de ses conséquences. (207)
Constituée en octobre 2009, cette commission comprend 45 eurodéputés et devait en principe clôturer ses travaux à l’automne 2010, mais elle est prolongée jusqu’en juillet 2011. La rapporteure est Mme Pervenche Bérès.
Mme Pervenche Bérès a présenté un rapport d’étape au début du mois de mai 2010, portant sur les causes et les conséquences de la crise et formulant des propositions. Ce rapport a fait l’objet de 1 625 amendements, montrant la sensibilité des eurodéputés sur ce thème, mais un compromis a pu être trouvé entre les membres de la commission et le rapport a été adopté en commission le 29 septembre 2010, puis en plénière le 29 octobre 2010. La commission spéciale présentera un rapport final en juillet 2011.
Dans son analyse des causes de la crise, Mme Pervenche Bérès mentionne notamment « la politique monétaire américaine expansionniste », le développement d’innovations financières, particulièrement « la complexité et l’opacité des produits financiers », « un manque de valeurs et d’éthique », les conflits d’intérêt, les asymétries d’information, « un excès de liquidités en quête de rendement », « l’oligopole des agences de notation », « l’absence d’une réglementation adéquate et d’une surveillance digne de ce nom »…
Parmi les propositions présentées par Mme Pervenche Bérès et adoptées par le Parlement européen, le rapport :
– recommande la mise en place d’une taxe sur les transactions financières, dont le produit améliorerait le fonctionnement du marché en réduisant la spéculation et en contribuant à financer les biens publics mondiaux et à diminuer les déficits publics ; considère qu’une telle taxe devrait être établie sur la base la plus large possible, mais qu’à défaut, elle devrait être introduite dans un premier temps au niveau de l’Union européenne ; invite la Commission européenne à produire rapidement une étude de faisabilité intégrant la notion des conditions égales au niveau mondial et à présenter des propositions législatives concrètes dans les meilleurs délais ;
– demande à la Commission européenne de lancer une étude de faisabilité et d’incidence sur la création d’une agence européenne publique et indépendante de notation de crédit ;
– considère que le modèle d’entreprise des agences de notation de crédit peut conduire à des conflits d’intérêt et propose d’examiner la fiabilité d’un système où les investisseurs et les épargnants paieraient pour avoir accès aux informations dont ils ont besoin ;
– suggère que les règles du Comité de Bâle entrent en vigueur sous forme de traités internationaux, mais estime qu’une réglementation doit être proposée sur la base d’études approfondies de son impact en ce qui concerne la mesure dans laquelle les établissements financiers servent l’économie réelle et la société.
On observera que sur la plupart de ces questions, la procédure législative applicable est la codécision, qui attribue au Parlement européen un pouvoir équivalent à celui du Conseil.
Les travaux législatifs menés au niveau de l’Union européenne en réponse à la crise sont à un stade d’avancement variable. Ils concernent notamment :
– le « paquet supervision » tendant à la mise en place d’une nouvelle architecture de supervision à l’échelle européenne), qui a été adopté le 22 septembre 2010 (cf. deuxième partie, II, E) ;
– la proposition de directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs, concernant essentiellement – mais pas uniquement – les hedge funds, qui a été adoptée le 11 novembre 2011 (cf. ci-après, III, A) ;
– les agences de notation, qui font l’objet du règlement du 16 septembre 2009 (cf. deuxième partie, II, A, 2) ;
– La titrisation et les rémunérations, qui ont fait l’objet d’une proposition de directive adoptée le 11 octobre 2010 par le Conseil (cf. deuxième partie, II, A, 3) ;
– les produits financiers dérivés, dont les CDS, pour lesquels deux projets de règlement ont été présentés le 15 septembre 2010, l’un concernant les chambres de compensation et les référentiels centraux, et l’autre les CDS (et les ventes à découvert (cf. ci-après, III, B).
Plusieurs nouveaux textes devant être présentés par la Commission européenne d’ici fin 2010 ou début 2011 :
– Pour les agences de notation, en complément du règlement adopté en 2009, une proposition vient d’être présentée, en juin 2010, et la Commission réfléchit à des mesures structurelles, dont la création d’une agence de notation européenne, qui feront l’objet d’un texte au printemps 2011 ;
– une quatrième révision de la directive sur les fonds propres (décembre 2010) ;
– une révision de la directive de 2003 sur les abus de marché (décembre 2010), pour que son champ d’application s’étende au-delà des marchés réglementés et englobe les marchés de produits dérivés ;
– une prochaine révision de la directive dite « MIF » (marchés d’instruments financiers – en anglais MiFiD), en vue de laquelle une consultation est en cours (cf. ci-après, II, A) ;
– la définition d’un cadre européen pour la gestion des crises dans le secteur financier (la Commission européenne a présenté un programme d’action en octobre 2010 et présentera des propositions législatives au printemps 2011) (cf. ci-après, III, E).
D.– UNE PRÉOCCUPATION SANS DOUTE INSUFFISAMMENT PRISE EN COMPTE : LA COORDINATION TRANSATLANTIQUE
Les États-Unis, où la crise financière actuelle trouve ses racines, et l’Europe, ont pris les mêmes engagements dans le cadre du G20, mais n’ont bien sûr pas effectué ensuite les mêmes choix ni suivi le même calendrier dans leur mise en œuvre. Outre le fait que la mise en œuvre de ces engagements, en Europe, constitue une compétence partagée entre le niveau national et le niveau communautaire, la démarche a été différente aux États-Unis, l’administration Obama ayant choisi de présenter un texte législatif unique regroupant un grand nombre de dispositifs (loi Dodd-Frank), désormais adopté mais dont la mise en application effective demandera encore un temps considérable. En Europe, compte tenu de la méthode communautaire de décision, il a fallu ouvrir les « chantiers » un par un.
Pour autant, il importe peu de faire valoir que les partenaires européen et américain seraient « en avance » ou « en retard » l’un par rapport à l’autre, puisque la « feuille de route » est la même. En revanche, et sans ignorer l’importance des réformes à mener chez les autres membres du G20, on peut s’inquiéter du degré réel de coordination transatlantique. Elle est absolument indispensable sur de très nombreux terrains, qu’il s’agisse des normes comptables, des normes relatives aux fonds propres des banques, de la concertation quotidienne entre superviseurs nationaux, des règles à imposer aux acteurs qui jusqu’à présent étaient largement « à l’abri » de la réglementation… Est-elle suffisamment considérée comme une priorité, tant aux États-Unis que dans les capitales européennes ?
Proposition n° 5 : Développer la coordination transatlantique sur l’ensemble des dossiers et actions touchant à la lutte contre la spéculation : normes comptables, normes relatives aux fonds propres des banques, réglementation des acteurs et des institutions financières… En particulier, compte tenu des carences manifestées avant la crise par les instances internationales compétentes, les organismes récemment créés en Europe et aux États-Unis, pour assurer la prévention du risque systémique, devront confronter régulièrement leurs données et leurs analyses. |
La France ne peut agir seule de manière déterminante, mais doit tirer parti de l’opportunité majeure que constitue sa présidence du G20, et continuer à exercer une influence résolue dans les négociations européennes.
*
* *
Les tableaux ci-après présentent, pour les principaux thèmes retenus par le G20, l’état d’avancement des actions de mise en oeuvre dans l’Union européenne et en France. |
ENCADREMENT DE LA RÉMUNÉRATION DES OPÉRATEURS DE MARCHÉ | ||
G20 |
Union européenne |
France |
Londres (Avril 2009) |
Novembre 2009 | |
Décision : règles sur la rémunération des opérateurs : ● interdiction des bonus garantis ● versement différé de 40 à 60 % des bonus ● création d’un malus en face des bonus ● versement en actions de 50 % des bonus |
|
La France est le premier pays à mettre en œuvre les règles du G20 avec l’arrêté du 5 novembre 2009 ● prise en compte du risque dans les politiques de rémunération |
| ||
Automne 2010 | ||
Directive 2010/76/UE du 24 novembre 2010 (directive bancaire « CRD3 ») introduisant notamment une surveillance prudentielle des politiques de rémunération. Un encadrement prudentiel de ces politiques est également prévu, s’agissant des « fonds alternatifs » (hedge funds…), par la directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs adoptée par le Conseil le 19 octobre et par le Parlement européen le 11 novembre 2010. |
La loi de régulation bancaire et financière (22 octobre 2010) prévoit ● la création d’un comité spécialisé en matière de rémunération au sein des opérateurs ● l’examen par l’ACP des politiques et pratique de rémunération | |
RÉGULER, CONTRÔLER ET SANCTIONNER LES AGENCES DE NOTATIONS | ||
G20 |
Union européenne |
France |
Washington (novembre 2008) |
Septembre 2009 |
|
Décision : les agences doivent faire l’objet d’un agrément et d’une régulation. |
Adoption du règlement européen 1060/2009 : les activités de notation de crédits doivent s’effectuer dans « le respect des principes d’intégrité, de transparence, de responsabilité et de bonne gouvernance » è agrément, è indépendance, è transparence. | |
Juin 2010 |
Juin 2010 | |
Les articles 10 et 11 de la loi de régulation bancaire et financière reprennent le dispositif du règlement européen 1060/2009. – l’AMF est chargée de l’enregistrement et de la supervision des agences de notation ; – principe de la responsabilité extracontractuelle des agences à l’égard de leurs clients et des tiers ; – création d’un droit d’enregistrement. | ||
Projet de règlement européen pour confier le contrôle à la nouvelle autorité des marchés financiers (AEMF-ESMA) : L’AEMF sera dotée d’un ensemble de pouvoirs de surveillance, sera habilitée à prendre les mesures de contrôle appropriées en fonction de l’infraction constatée, voire dans les cas les plus graves, d’imposer une amende. Une nouvelle modification du règlement de 2009 sur les agences de notation est attendue pour début 2011. | ||
RÉGULER LES MARCHÉS DÉRIVÉS | ||
G20 |
Union européenne |
France |
Washington (novembre 2008) |
Projet de Règlement présenté par la Commission européenne le 15 septembre 2010 : – Afin d'améliorer la transparence sur les marchés de dérivés, obligation d'enregistrer des opérations sur produits dérivés, notamment ceux présentant des risques systémiques, dans des référentiels centraux qui seront supervisés par la nouvelle autorité de supervision des marchés (AEMF). – Création de chambres de compensation centralisées de manière à réduire les risques systémiques en limitant l'impact d'une défaillance de l'une des parties engagées dans une opération sur produit dérivé. |
Automne 2010 |
Décision : Transparence : obligation d’enregistrer les transactions dans les bases de données Sécurité : obligation de recourir à des chambres de compensation | ||
Loi régulation bancaire et financière (22 octobre 2010) sur le transfert de propriété : – les deux parties sont engagées dès l’exécution de l’ordre – interdiction des ventes d’instruments financiers sans disposer sur un compte des instruments financiers appelés à être cédés ou si les mesures nécessaires ne sont pas prises auprès d’une tierce personne (assurance raisonnable) – le transfert de propriété résulte de l’inscription au compte de l’acheteur à la date de dénouement effectif de la négociation L‘AMF reçoit le pouvoir d’encadrer les ventes à découvert ; elle peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée limitée ; | ||
Décembre 2010 | ||
Création à Paris d’une chambre de compensation sur CDS : LCH Clearnet, régulée par la Banque de France. | ||
RÉGULER ET INTERDIRE LES VENTES À DÉCOUVERT | ||
G20 |
Union européenne |
France |
Washington (novembre 2008) |
Projet de règlement présenté le 15 septembre 2010 : Les ventes à découvert à nu d’actions ou de titres de dettes souveraines et les CDS à nu resteront autorisées. Toutefois, sera applicable la locate rule , obligeant les vendeurs, avant de conclure la vente, à s’assurer qu’ils disposeront bien du titre lorsqu’ils devront le livrer. Les CDS à nu pourront être interdits temporairement par les régulateurs. |
Les ventes à découvert à nu avaient été interdites par l’AMF en septembre 2008, puis autorisées à nouveau depuis le 9 novembre 2010. Loi de régulation bancaire et financière (23 octobre 2010) – l‘AMF reçoit le pouvoir d’encadrer les ventes à découvert ; elle peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée limitée ; – pouvoir de sanction de l’AMF. |
Décision : Tous les marchés, produits, acteurs doivent faire l’objet d’une régulation et d’une supervision appropriées. | ||
RÉGULER, CONTRÔLER ET SANCTIONNER LES HEDGES FUNDS | ||
G20 |
Union européenne |
France |
Londres (avril 2009) |
Automne 2010 | |
Les hedge funds doivent faire l’objet d’un agrément et diffuser des informations notamment sur leur levier. |
Adoption en novembre 2010 de la directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs ● application des règles du G20 aux gérants de fonds dont le portefeuille est supérieur à 100 millions d'euros pour les hedge fiunds ou 500 millions d'euros (groupes de capital investissement) ; ● obligation de s’enregistrer auprès des superviseurs nationaux et d’obtenir une autorisation d’opérer dans l’Union européenne ; ● obligation de transparence ; ● effet de levier encadré par la future AEMF ; |
Loi régulation bancaire et financière (22 octobre 2010) – l‘AMF reçoit le pouvoir d’encadrer les ventes à découvert ; elle peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée limitée ; – pouvoir de sanction de l’AMF contre les abus de marché sur les produits dérivés et des ventes à découvert : |
LUTTER CONTRE LES PARADIS FISCAUX | ||
G20 |
Union européenne |
France |
Londres (avril 2009) |
Révision des directives qui organisent la coopération entre les États membres. Négociation d’accords de lutte contre la fraude et d’échange de renseignements fiscaux. |
Depuis décembre 2009 |
- Rappel de l’exigence d’appliquer la norme internationale en matière d’échange d’information entérinée par le G20 en 2004 et reprise dans le modèle de Convention fiscale des Nations Unies ; - Propositions de sanctions contre les États non coopératifs qui n’adhèrent pas aux normes internationales dans les domaines prudentiel et fiscal et pour l’application des normes LCB/FT ; - L’OCDE établira une liste grise pour les paradis fiscaux sur le point de coopérer, et une liste noire pour les juridictions non coopératives qui ne lèvent pas le secret bancaire. (Recommandations morales). |
Loi de finances rectificatives de décembre 2009 : quatre volets – l’introduction d’une liste française d’États ou territoires non coopératifs (ETNC) à laquelle un certain nombre de mesures fiscales, voire non fiscales, pourront désormais se référer ; – l’introduction ou l’alourdissement d’une fiscalité pénalisante pour les flux en provenance ou en direction des ETNC ainsi listés ; – le renforcement des dispositifs anti-abus dont dispose la France dès lorsque sont en jeu des sommes, revenus ou opérations en lien avec les ETNC ainsi listés ; – la création d’une nouvelle obligation de documentation en matière de prix de transfert, avec un niveau d’exigences supplémentaire en présence d’entités dans ces ETNC. Arrêté du 12 février 2010 : liste des ETNC auxquels des sanctions sont désormais applicables. | |
RENFORCER LES EXIGENCES EN FONDS PROPRES DES BANQUES | ||
G20 |
Union européenne |
France |
Pittsburg (septembre 2009) |
Les directives européennes 2006/48 et 2006/49, qui composent la directive « Capital requirement directive » (CRD) ou « fonds propres réglementaires », reprennent les propositions du comité de Bâle. |
Les directives CRD2 et CRD3 doivent être transposées en droit français. |
À partir du 1er janvier 2011 : – exigences en capital plus strictes, – réserves de capitaux anticycliques, – exigences en capital plus importantes pour les produits à risques et les activités hors bilan (Bâle II). De même, sont posées des exigences relatives aux risques de liquidité et au provisionnement dynamique. L’objectif est d’inciter les banques à prendre des risques raisonnables, et de fait, créer un système financier apte à résister aux chocs d’une éventuelle crise. | ||
Septembre 2009 | ||
Adoption de la directive CRD2 (relative à l’accès à l’activité des établissements de crédits et son exercice) - rétention de 5 % des titrisations au bilan ; - supervision des groupes transfrontaliers | ||
Automne 2010 | ||
Adoption de la directive CRD3 (relative à l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit) è multiplication par 3 des 3 exigences en fonds propres pour le trading. | ||
La Commission européenne a lancé courant 2010 une consultation modifiant la CRD pour renforcer la résilience du secteur bancaire et du système financier et garantir l’égalité des conditions de concurrence. Attente de la proposition de directive « CRD4 ». | ||
RENFORCER L’EFFICACITÉ DU CONTRÔLE DU SECTEUR FINANCIER | ||
G20 |
Union européenne |
France |
Washington (novembre 2008) |
2010 |
Janvier 2010 |
Création en avril 2009 du Conseil de stabilité financière (CSF- Financial stability board), qui remplace le Forum de stabilité financière et rassemble toutes les autorités nationales contribuant à la stabilité financière, dans les domaines de la monnaie, du crédit, de l'assurance, de la bourse ou de la comptabilité (pour la France : la Banque de France, l'Autorité des marchés financiers et le Ministère de l’économie et des finances). Création de collèges de superviseurs pour la supervision des groupes transfrontaliers |
Adoption du « paquet législatif » sur la supervision, qui crée, en remplacement des trois collèges de superviseurs à rôle purement consultatif, trois Autorités européennes chargées du contrôle des banques, des assurances et des marchés ; celle chargée des marchés financiers (la nouvelle AEMF) aura notamment des pouvoirs de contrôle sur les agences de notation lorsque la proposition modifiant le règlement de 2009 sur les agences de notation aura été adoptée. Les trois Autorités entreront en fonctions en janvier 2011. |
– Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 : création de la nouvelle Autorité de contrôle prudentiel (ACP) : autorité administrative indépendante adossée à la Banque de France, est chargée de l’agrément et de la surveillance des établissements bancaires et d’assurance dans l’intérêt de leurs clientèles et de la préservation de la stabilité du système financier. |
Automne 2010 | ||
– loi de régulation bancaire et financière : Création du Conseil de régulation financière et du risque systémique (COREFRIS) qui se substitue à l'actuel Collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier. Composé, des présidents des autorités de régulation françaises et du ministre de l'économie, le COREFRIS sera doté de deux missions principales : – veiller à la stabilité financière et analyser tout élément qui serait susceptible de déstabilisation (surveillance macroprudentielle du risque systémique). – concertation sur les positions internationales de la France au sein des différentes enceintes économiques et monétaires internationales Création de collèges de superviseurs qui rassemblent, sous l'égide du superviseur de la société-mère, tous les superviseurs d'un même groupe possédant des filiales dans l'Union européenne. | ||
LUTTER CONTRE LES RISQUES SYTÉMIQUES | ||
G20 |
Union européenne |
France |
Pittsburg (septembre 2009) |
Décembre 2009 |
Automne 2010 |
|
Le G20 a posé le principe selon lequel les établissements financiers de taille importante ou « systémique », doivent élaborer des plans d’urgence et de règlement de crise au niveau international. Les autorités doivent définir un cadre légal et mettre en place des groupes de gestion des crises pour les établissements transfrontaliers. L’objectif est d’assurer un meilleur échange d’informations et l’élaboration de mesures d’urgence. Cette position de principe se traduit en deux mesures : - Mise en place de collèges de superviseurs, de plans d’urgence et de règlement et de groupes de gestion de crise pour les firmes multinationales. - Adoption d’outils et de cadres pour un règlement efficace des faillites. |
Mise en place de collèges de superviseurs pour chacun des groupes européens |
Loi de régulation bancaire et financière (22 octobre 2010) : – Création Conseil de la régulation financière et du risque systémique, composé des représentants des autorités micro-prudentielles et de la Banque de France. Il est chargé, en lien avec les travaux du CERS, de conseiller le ministre en charge de l’économie en matière de prévention et de gestion du risque systémique. – Création de collèges de superviseurs qui rassemblent, sous l'égide du superviseur de la société-mère, tous les superviseurs d'un même groupe possédant des filiales dans l'Union européenne. |
Début 2011 | ||
Entrée en fonctions du Comité européen du risque systémique (CERS), créé par les textes du « paquet législatif » sur la supervision adopté fin 2010. | ||
CONTRIBUTIONS DES BANQUES | ||
G20 |
Union européenne |
France |
Pittsburg (septembre 2009) |
Décembre 2008 |
Janvier 2010 |
Le FMI est mandaté pour proposer des solutions visant à faire supporter par le secteur financier le coût des crises. Les fonds de garantie de dépôts remboursent un montant limité de dépôts aux déposants dont la banque a fait faillite. Du point de vue des déposants, il s’agit de protéger une partie de leurs richesses de la faillite d’une banque. Du point de vue de la stabilité financière, il s’agit d’éviter que les déposants en viennent à retirer massivement leurs dépôts et, partant, d’empêcher des conséquences économiques sévères. Les sommets récents du G20 ont évoqué l’éventualité d’imposer une taxe sur le secteur bancaire, mais les membres du G20 sont divisés sur cette question. |
Le plafond de la garantie des dépôts est harmonisé à 100 000 euros au lieu de 20 000 euros. | |
Juillet 2010 |
L’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 prévoit une contribution pour frais de contrôle acquittée par les établissements de crédits et les entreprises d’investissement au bénéfice de l’Autorité de contrôle prudentiel (entre 100 000 et 150 000 euros par an). | |
Une proposition modifiant la directive sur les systèmes de garantie des dépôts est en cours d’examen au Parlement européen et au Conseil. Selon la Commission, ces nouvelles dispositions «garantiront aux titulaires de comptes en banque, en cas de défaillance de leur banque, une restitution plus rapide de leurs fonds (dans les sept jours), une meilleure couverture (jusqu'à 100 000 euros) et des informations plus détaillées sur les modalités d'application de la garantie. Quant aux investisseurs qui utilisent les services d'investissement, ils seront indemnisés plus rapidement si leur entreprise d'investissement est incapable de leur restituer leurs actifs (en raison d'une fraude, d'une faute professionnelle ou d'une erreur de gestion). Le niveau d'indemnisation sera porté à 50 000 euros (contre 20 000 euros actuellement). » |
Mai 2010 | |
L’instruction fiscale n° 51 du 10 mai 2010, 4-L-2-10 : crée une taxe exceptionnelle sur les bonus des traders à hauteur de 50 % par an. | ||
Automne 2010 | ||
L’article 16 du projet de loi de finances pour 2011 prévoit une taxe de risque systémique sur les banques. Son rendement est estimé à 504 millions d'euros pour 2011, 555 millions d'euros pour 2012 et 809 millions d'euros pour 2012. | ||
II.– FAVORISER LA TRANSPARENCE ET LE CONTRÔLE DES MARCHÉS
A.– UNE PRIORITÉ : LA RÉVISION DE LA DÉSASTREUSE DIRECTIVE MIF
Une profonde révision de la directive MIF, à propos de laquelle une des personnalités auditionnée a utilisé le mot de « tragédie » (208) est, on l’a vu, indispensable. On ne peut que partager la thèse selon laquelle il faut « confier aux marchés réglementés une mission de service d’intérêt général (…) [qui] consisterait à centraliser, homogénéiser et diffuser l’information pré et post- négociation, qui constitue, dans toute économie de marché, un quasi-bien public » (209).
Dans un rapport présenté à Mme Christine Lagarde, alors ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, en février 2010 en vue de la révision de la directive, M. Pierre Fleuriot résume ainsi les problèmes soulevés par ce texte :
« Si l’accroissement de la complexité des marchés résultant d’une multiplication des plates-formes de négociation et de la fragmentation de leur liquidité était prévisible, en revanche le sentiment, dominant chez les différents intervenants, d’une dégradation de la qualité de la transparence sur les ordres ainsi que sur les transactions effectuées l’était moins. Les coûts supplémentaires d’accès à l’information et surtout la mauvaise qualité des données post-négociation constituent un véritable échec de la directive. Les émetteurs portent un jugement particulièrement sévère sur la difficulté croissante pour eux de suivre les mouvements qui affectent la vie de leurs titres. Les investisseurs finaux, eux, n’ont pas confirmé avoir bénéficié des baisses de prix unitaires sur la négociation et la compensation ».
La Commission européenne a lancé une consultation publique pour tirer un bilan de l’application de la directive, et présentera au printemps 2011 une proposition de réforme du texte. Au cours d’une audition publique organisée par la Commission le 20 septembre 2010, le commissaire Barnier a exposé les éléments suivants qui recoupent largement, même s’il paraît plus nuancé, le constat de la commission d’enquête :
– La MIF a introduit certains principes-clé : la libre concurrence entre les différents lieux de négociation, des règles de transparence uniformes pour la négociation des actions, des obligations renforcées en matière d’organisation et d’information, une application élargie à des activités telles que le conseil en investissement ; après deux ans d’application, il est clair que cette directive a bouleversé le paysage financier européen, avec notamment l’émergence de lieux de négociation pan-européens, l’apparition de nouveaux services, une transformation des intermédiaires financiers, mais le bilan de la MIF est contrasté et discuté.
– Certains font valoir les éléments de succès : des monopoles ont été cassés, le coût des transactions a diminué ; d’autres appréciations sont plus négatives : la diminution des coûts n’a pas bénéficié à tous les investisseurs, l’émergence de nouveaux lieux de négociation a engendré une fragmentation de la négociation des actions, et une progression de l’opacité.
– Le texte doit de toute façon être révisé pour prendre en compte des évolutions majeures : l’ampleur des progrès technologiques et notamment informatiques, de nouvelles innovations financières, le fait que la crise a révélé combien les investisseurs, notamment les particuliers, n’ont pas su et pas pu détecter les pièges de certains produits financiers qui leur étaient proposés, les fluctuations lourdes de conséquences sur les marchés de matières premières…
– Le commissaire Barnier a terminé son intervention en présentant les principes qui vont guider la Commission dans l’élaboration de sa proposition de révision de la MIF :
● « Des acteurs financiers responsables : personne ne doit échapper à la surveillance. La prise de risques excessifs doit être éliminée » ;
● Mettre fin à l’opacité qui règne sur une partie des marchés, des acteurs et des activités aujourd’hui non couvertes par la directive, surtout les marchés de produits dérivés ;
● « Des principes de concurrence équitables » ;
● « Restaurer la confiance des acteurs économiques dans les marchés et les intermédiaires financiers » : renforcer la protection des investisseurs, instaurer une plus grande rigueur dans le comportement des intermédiaires financiers, faciliter l’utilisation des marchés financiers par les PME ;
● Ne laisser de côté aucun marché, et surtout pas les marchés de matières premières.
Cette révision devrait, aux yeux de votre commission, suivre plusieurs axes de réflexion précis :
1.– Améliorer de la transparence des marchés
Concernant la transparence pré-négociation, la directive MIF devrait s’efforcer de trouver un juste équilibre entre les obligations de découverte des prix et les dérogations nécessaires pour limiter les volumes de transactions ne participant pas à la formation du prix.
La dérogation à raison du prix de référence emprunté à d’autres plates-formes qui s’applique à l’heure actuelle à tous les ordres, devrait s’appliquer aux ordres d’une taille minimum, inférieure à celle des ordres de montant important (large in scale orders). Il conviendrait également de suspendre les systèmes utilisant des prix importés quand les volumes de transactions bénéficiant d’une dérogation sont supérieurs à un seuil défini par le régulateur européen.
Concernant la dérogation pour les transactions de blocs (210), il conviendrait de réduire la limite au-delà de laquelle un ordre n’a pas à être rendu public. Toutefois, cette position n’est pas partagée par tous les spécialistes. Certains considèrent qu’il faudrait maintenir les seuils applicables actuellement, en confirmant qu’ils regroupent l’ordre initial et les ordres résiduels.
Certains financiers plaident en faveur de la création d’un carnet d’ordre sur le modèle américain du consolidated quote plan, permettant d’afficher en temps réel le meilleur prix d’achat et de vente sur les actions européennes, quel que soit le lieu de leur négociation.
Le principe de meilleure exécution (best execution) sur lequel repose la transparence post-négociation ne peut souffrir que de très rares exceptions, car celle-ci est essentielle à la confiance sur les marchés. Sur ce point, la révision de la directive MIF devrait instaurer des dérogations en s’inspirant du modèle américain de consolidated tape (211). Il s’agit d’un système électronique qui reporte en flux constant les dernières données sur les prix et volumes des ventes d’actifs cotés sur les différents systèmes de négociation.
À ce titre, il conviendrait de réformer les différés de publication autorisés, à l’heure actuelle de trois jours pour les transactions de taille importante exécutées en compte propre, pour les réduire à la fin de journée. Pour ce qui est des actions négociées sur les marchés réglementés, la directive en vigueur impose une publication « dans la mesure du possible en temps réel », soit dans les trois minutes suivant la transaction, selon le règlement européen d’application. Aussi, certains spécialistes proposent d’imposer une publication des transactions en temps réel, en ramenant le délai de publication maximal à soixante secondes, à compter de la réalisation de la transaction lorsque celle-ci n’est pas complètement électronique.
Afin de mieux comprendre toutes les composantes du marché, les informations concernant l’origine des transactions effectuées par les internalisateurs et les crossing networks devraient être publiées de manière générique, comme cela se fait sur les marchés réglementés et les systèmes multilatéraux de négociation (MTF). La directive devrait également permettre une harmonisation des flags (drapeaux), outils développés de manière éparse par chaque plate-forme et indiquant la nature de la transaction (par exemple indiquant qu’il s’agit d’une transaction négociée).
2.– Favoriser une concurrence équitable entre plates-formes de négociation
La directive MIF a créé une distorsion de concurrence entre d’un côté les marchés réglementés et les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) gérés par ceux-ci, et d’un autre coté les MTF gérés par les prestataires de services d’investissement (PSI). En effet, elle soumet ces opérateurs à des exigences organisationnelles différentes, tout en leur imposant des règles communes pour l’exécution des ordres. Cela crée une distorsion de concurrence pour la négociation d’actions, fondée sur le statut de la plate-forme. Or, cette distinction institutionnelle n’a pas lieu d’être car un MTF géré par un PSI ou par un marché réglementé sont semblables en tout point. Aussi, il paraît plus cohérent de soumettre les MTF, quel que soit leur opérateur, aux mêmes exigences d’organisation pour la fonction de négociation.
Il pourrait être envisagé d’imposer une obligation de déclaration des MTF en faveur de l’émetteur au moment où son titre est négocié, ainsi qu’aux marchés réglementés (MR) qui admettent à la négociation les titres d’un émetteur sans l’accord de celui-ci.
Il conviendrait par ailleurs de créer un statut pour les crossing networks et d’encadrer leurs pratiques. L’idée serait de plafonner les volumes pouvant être échangés, à 0,25 % des volumes traités pour une valeur donnée, et d’assimiler ces opérateurs à des MTF dès lors qu’ils excèdent ce seuil. Ils seraient donc soumis à l’obligation de transparence pré-négociation.
Afin de créer un environnement de concurrence juste entre les différents lieux d’exécution d’ordres, les internalisateurs devaient se voir soumis à l’obligation de publier les prix pour une quantité minimale, tandis que les MTF seraient surveillés, comme cela est le cas pour les marchés réglementés.
3.– Standardiser les déclarations des ordres (reporting) et permettre une identification des clients
Les marchés financiers et la spéculation ayant atteint une taille mondiale, la coopération entre les autorités de régulation nationales, en particulier européennes, est devenue primordiale. Or, il ressort des auditions menées par la commission d’enquête, notamment avec les responsables de l’AMF, que la coopération entre les autorités régulatrices s’avère largement perfectible.
Ces échanges, qui semblent encore fondés principalement sur les bonnes relations bilatérales des différents régulateurs, prennent beaucoup de temps (un à deux mois) notamment en phase de surveillance ou d’enquête. Ces délais semblent peu compatibles avec le souci d’efficacité d’une enquête.
En outre, les standards de reporting nationaux n’étant pas harmonisés, la consolidation des données reçues des différents régulateurs relatives aux transactions sur un même titre est malaisée et donne lieu à des erreurs. L’AMF propose de mettre en place un système de reporting basé sur un standard unique, centralisé au niveau de l’AEMF, et accessible à chaque régulateur.
À défaut d’une telle réforme, l’autorité régulatrice française considère que l’introduction d’un identifiant client dans les reportings, en discussion à l’occasion de la révision de la directive MIF, permettrait d’améliorer la détection des cas suspects et la rapidité des investigations, en réduirait très significativement le besoin de requêtes ad hoc.
Les négociateurs français devront veiller à ce que le texte adopté assure des avancées significatives dans ces trois domaines.
Proposition n° 6 : Assurer, par la révision de la directive MIF au printemps 2011, un retour à la transparence des marchés, l’établissement d’une concurrence équitable entre plates-formes de négociation, une standardisation des déclarations des ordres (reporting) et une meilleure identification des intervenants. |
B.– AU-DELÀ DE LA RÉVISION DE LA MIF, D’AUTRES MESURES POURRAIENT FAVORISER LA TRANSPARENCE, PARTICULIÈREMENT SUR LES MARCHÉS DE GRÉ À GRÉ
1.– Introduire de la transparence sur les marchés de gré à gré : information, clarté, sécurité
Les produits dérivés échangés de gré à gré ont été fort justement pointés pour leur rôle dans le déclenchement et la propagation de la crise financière. Il est donc nécessaire d’engager une régulation appropriée de ces marchés pour en conserver tout de même les bienfaits, essentiellement l’accroissement de la liquidité.
Face au risque systémique présenté par les marchés de gré à gré, les responsables politiques et les régulateurs adoptent la même démarche volontariste : inciter au maximum les opérateurs à quitter les marchés de gré à gré pour les rapatrier vers des chambres de compensation, améliorer la transparence du marché, développer le recensement et l’identification des intervenants dans des registres afin, comme l’a indiqué M. Michel Barnier, commissaire européen chargé du marché intérieur et des services, au cours de son audition par la commission d’enquête du ler décembre 2010 « de savoir qui fait quoi sur ces marchés ».
Les chefs d’État et de gouvernement réunis dans le cadre du G20 en septembre 2009 se sont engagés à ce que les produits dérivés négociés de gré à gré – c’est-à-dire de manière bilatérale, hors des bourses – fassent, à partir de la fin 2012, l’objet d’une compensation par une partie tierce, afin qu'ils n'échappent plus à tout contrôle et qu'il existe un intermédiaire pour gérer les défauts de paiement (212).
Parallèlement, le secteur concerné a pris un certain nombre d’initiatives, comme par exemple le lancement, sur la place de Paris, par plusieurs grandes banques françaises, d’une plate-forme de compensation pour les dérivés de crédit en euros (mars 2010).
Dans cette perspective, il est fondamental d’encourager la standardisation des instruments dérivés, même s’il est exclu d’éliminer totalement les contrats ad hoc. Comme l’évoquait M. Dominique Cerutti, directeur général de Nyse-Euronext, lors de son audition par la commission d’enquête le 24 novembre 2010, lorsqu’une entreprise française veut construire une usine au Brésil, financer son investissement en monnaie locale, acheter ses matières premières en dollars et revendre le produit fini en yuans, elle fera appel au marché des dérivés pour se couvrir grâce à un produit sur mesure conçu exclusivement pour elle par des « structureurs ». Mais l’extension du périmètre des contrats standardisés échangés sur des plates-formes transparentes facilitera la tâche des régulateurs et réduira l’incertitude pour les intervenants, donc les risques systémiques.
On notera la convergence générale entre régulateurs : les priorités affichées par la Financial Service Authority britannique pour réformer les marchés OTC sont les mêmes : standardisation des contrats, recours aux chambres de compensation et aux registres de commerce, accords internationaux et échange d’informations entre chambres de compensation et régulateurs, en établissant un équilibre entre les exigences de la transparence et le respect de la liquidité du marché.
L’AMF, dans son plan stratégique publié le 22 juin 2009, a réaffirmé parmi ses priorités la prévention des risques et la surveillance des marchés et des acteurs ; pour répondre à ces objectifs, l’AMF doit étendre le champ de sa surveillance aux marchés de gré à gré – dérivés mais aussi obligataires – en vue de faire respecter les règles de conduite et prévenir les abus de marché.
Plus précisément, pour son Président, il apparaît nécessaire de prévoir l’utilisation obligatoire des chambres de compensation pour les contrats de dérivés de gré à gré standardisés. « En effet, en plus de contribuer à réduire l’exposition nette de l’ensemble du système financier, une utilisation étendue de la compensation centralisée modifierait la manière dont le risque est diffusé sur le marché. Le modèle de la gestion bilatérale des risques de contrepartie, qui correspond à la situation actuelle sur les marchés dérivés de gré à gré, est vanté par certains pour la flexibilité qu’il offre aux acteurs de marché pour la gestion de leurs risques. Mais dans ce cadre, le niveau et la qualité du collatéral sont déterminés entre les contreparties, avec des critères susceptibles de varier d’un établissement à l’autre. Il existe donc un risque que la couverture ne soit pas en adéquation parfaite avec les risques générés par la transaction. » (213)
Le modèle de compensation centralisée permettra l’établissement d’un régime harmonisé d’exigences minimales pour la gestion des risques et le calcul des marges. L’ensemble des membres d’une chambre de compensation bénéficiera alors de pratiques rigoureuses de gestion des risques, en complément de la réduction de leur exposition globale à la chambre.
Les chambres de compensation pour les dérivés standardisés pourront honorer l’ensemble des contrats compensés en cas de défaut afin de limiter les risques de défaut et l’aléa moral. L’Autorité des marchés financiers suggère de renforcer la robustesse des chambres en leur donnant le statut d’établissement de crédit ou un statut ad hoc. Cela suppose aussi que la future Autorité européenne des marchés financiers, qui définira les types de contrat soumis à compensation, ait des pouvoirs de régulation de ces chambres de compensation, et que les chambres soient situées dans la zone monétaire de la devise de libellé des contrats qu’elles compensent pour faciliter leur accès au refinancement de la Banque centrale.
Proposition n° 7 : Promouvoir toutes mesures techniques permettant d’introduire la transparence sur les marchés de gré à gré en favorisant, notamment par la standardisation des produits, un transfert de l’essentiel des transactions vers des chambres de compensation. |
Pour les marchés résiduels de gré à gré, il faut insuffler de la transparence en créant des registres des transactions effectuées et pallier l’absence de consolidation adéquate à l’instar des transactions d’actions, où la transparence est la règle. Pour les marchés de titres financiers, comme les obligations, où il n’existe à ce stade aucune exigence de transparence, les paramètres de transparence doivent être adaptés à chaque type d’instrument, obligations ou produits structurés. Le comité européen des régulateurs a déjà transmis ses premières propositions à ce sujet à la Commission européenne, dans la perspective de réforme de la MIF.
Pour ces produits, échangés sur des marchés pour lesquels n’existe ni obligation de reporting, ni transparence, ni d’ailleurs de régulateur, la commission d’enquête soutient la proposition de l’Autorité des marchés financiers, qui préconise l’établissement de bases centrales de données des transactions suffisamment détaillées, localisées sur le territoire européen, c'est-à-dire de trade repositories sur le modèle des bases existant déjà aux États-Unis, pour repérer d’éventuels abus de position dominante. L’obligation de reporting précis et universel n’existe actuellement qu’aux États-Unis depuis la loi Dodd-Franck et il convient de transposer cette innovation en Europe. La mission des bases centrales de données des transactions ne figure pas dans la proposition de règlement de la Commission du 15 septembre 2010. Or, cette mention est nécessaire pour conforter l’obligation de transparence. Le seul moyen de garantir au régulateur européen un accès automatique aux données est de localiser ces bases de données en Europe. Cette localisation est importante pour garantir un accès juridiquement incontestable aux données qui y sont entreposées.
Proposition ° 8 : Insuffler de la transparence pour les marchés de gré à gré résiduels, avec la mise en place de registres des transactions et de bases centrales de données des transactions localisées en Europe, et en prévoyant une déclaration des ordres (reporting) précise et universelle. |
Malgré la convergence des propositions « mises sur la table », la Commission européenne a tardé à réagir sur un sujet qui, pourtant, ne peut guère être efficacement traité qu’à l’échelon communautaire.
2.– Le projet de règlement du 15 septembre 2010 sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux
Le projet de règlement présenté par la Commission européenne le 15 septembre 2010 vise à concrétiser, dans l’Union européenne, les engagements formulés dans le cadre du G20. Il se présente aussi, explicitement, comme le « pendant » européen du Dodd-Frank Act, récemment adopté aux États-Unis, pour ce qui concerne les dérivés.
La proposition de texte de la Commission européenne comporte trois volets : standardisation accrue des produits, enregistrement des entités financières actives dans l’UE sur ces marchés, et harmonisation des règles encadrant les chambres centrales chargées de compenser les produits dérivés standardisés. Parmi les titres financiers (actions, obligations) seules les grosses transactions échapperaient au principe de transparence et resteraient conclues de gré à gré. Toutes les autres seraient rassemblées sur des plates-formes, comme les contrats financiers (les dérivés), conformément aux préconisations du G20.
Quant aux transactions sur produits dérivés non standardisés, elles feraient l’objet d’obligations supplémentaires en termes de détention de capital. Une proposition de texte distincte porte sur les ventes à découvert et les CDS (cf. ci-après, III, B, 2).
a) Le champ d’application du projet de règlement
Les règles prudentielles prévues concernent d’une part, les contreparties centrales (en conséquence de l’obligation prévue en matière de compensation centrale) et d’autre part, les référentiels centraux (en conséquence des obligations de déclaration prévues). Des exemptions sont prévues pour les banques centrales, pour les organismes publics qui gèrent ou interviennent dans la gestion de la dette publique et pour les banques multilatérales de développement.
Le G20 ayant décidé d’imposer une obligation de compensation pour tous les dérivés de gré à gré normalisés, reste à déterminer quels contrats seront concernés. Afin de garantir que le plus grand nombre possible de contrats dérivés de gré à gré sera compensé de manière centralisée, le projet de règlement prévoit deux approches qui seront combinées :
– une approche ascendante (« bottom-up ») : une contrepartie centrale décidera de compenser certains contrats et y sera autorisée par son autorité compétente, qui sera tenue d’en informer l’Autorité européenne des marchés financiers. L’AEMF aura alors le pouvoir de décider si l’obligation de compensation centrale doit s’appliquer à tous ces contrats dans l’Union européenne ;
– une approche descendante (« top-down ») : l’AEMF décidera, en collaboration avec le Comité européen du risque systémique, quels contrats devraient potentiellement être soumis à l’obligation de compensation.
Quant aux entreprises non financières, elles ne seront, en principe, pas soumises aux dispositions de ce règlement, à moins que leurs positions sur dérivés de gré à gré n’atteignent un certain seuil leur conférant une importance systémique. La Commission européenne estime que les opérations sur dérivés conduites par les entreprises industrielles ne relèvent généralement pas de la spéculation, mais sont une conséquence directe de leur activité commerciale.
Par ailleurs, dès lors que tous les dérivés de gré à gré ne seront pas considérés comme éligibles à une compensation centrale, il est aussi nécessaire d’améliorer la sécurité pour les contrats qui continueront d’être gérés sur une base dite « bilatérale ». Le projet de règlement comporte donc des dispositions sur l’utilisation de moyens électroniques, l’application de procédures de gestion des risques et la détention d’un capital approprié et proportionné.
b) Les contreparties centrales
Leur agrément sera subordonné à la condition qu’elles aient accès à une liquidité suffisante, celle-ci pouvant provenir d’un accès à la liquidité d’une banque centrale, ou d’une banque commerciale, ou des deux. Les autorités nationales compétentes resteront responsables de l’agrément et de la surveillance des contreparties centrales, mais, étant donné l’importance systémique de celles-ci et la nature transfrontalière de leur activité, la future Autorité européenne des marchés financiers jouera un rôle dans la procédure d’agrément (notamment s’agissant de la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers).
Le règlement vise à garantir la solidité et une bonne régulation des contreparties centrales. Il contient des dispositions relatives à leur gouvernance (présence d’administrateurs indépendants, comité des risques…), et des exigences prudentielles.
Les entreprises financières, et les entreprises non financières qui dépassent le seuil, devront notifier les détails de tout contrat dérivé qu’elles ont conclu et toute modification de celui-ci à un référentiel central enregistré. Ces obligations de déclaration devraient permettre de renforcer la transparence.
Puisque les référentiels centraux détiendront de ce fait des informations intéressant un grand nombre de régulateurs nationaux, le projet de règlement charge l’Autorité européenne des marchés financiers de leur enregistrement et de leur surveillance. Comme les contreparties centrales, les référentiels devront respecter des exigences organisationnelles et opérationnelles et devront assurer la sauvegarde et la transparence des données.
Il y aura lieu de suivre de près la négociation de ce texte où, là encore, des intérêts contraires animent les États membres : notamment, le rôle qu’il est prévu de donner à l’AEMF ne fera sans doute pas l’unanimité.
C.– ENGAGER LES MARCHÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES DANS LA VOIE DE LA TRANSPARENCE
On a évoqué, dans les première et deuxième parties, les perturbations affectant les marchés des matières premières, notamment agricoles, en ce début de XXIème siècle, nouvelle illustration de la loi de Gregory King (214), frappé dès 1696 par l’extrême sensibilité des prix agricoles aux variations de la production : « on observe que suite à une récolte dont le volume est d’un dixième inférieur à sa valeur habituelle, les prix augmentent de trois dixièmes. » Compte tenu de la part des produits agricoles dans la consommation quotidienne des ménages (les matières premières agricoles représentent 15 % du prix de vente des produits alimentaires selon l’Insee), il est essentiel de prévenir et de contenir la succession des crises qui affectent les marchés des matières premières agricoles depuis les années 60, malgré l’instabilité des taux de change. Entre 2007 et 2008, la contribution des produits alimentaires à l’inflation totale a été d’environ 30 %.
En avril 2010, Mme Christine Lagarde, alors ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, s’est ainsi prononcée en faveur de la création d’une agence européenne dédiée à la régulation des dérivés des matières premières. Depuis lors, la régulation de ce secteur, pourtant inscrite à la pointe des priorités du G20, en raison notamment de la tendance haussière persistante de l’ensemble des matières premières agricoles, n’a pas progressé.
1.– Les spécificités des marchés dérivés des matières premières supposent l’élaboration de textes européens dépassant la révision de la directive MIF
Les travaux engagés pour la révision de la directive MIF auront naturellement des implications sur la régulation des marchés dérivés de matières premières.
Dans le cadre de la procédure de révision de la directive MIF, la question des matières premières fait l’objet d’un chapitre spécifique, avec la possibilité d’imposer des limites de position sur le modèle de la CFTC. Cette révision est doublée par la révision de la directive « abus de marché » pour prendre en compte les abus et renforcer les sanctions applicables.
Mais le sujet mérite toutefois des textes spécifiques pour les marchés de matières premières, adaptés à la réalité de chaque matière première, à l’image du projet de règlement sur les marchés énergétiques présenté en décembre 2010 par la Commission européenne. Une obligation ou une action se différencie, en effet, d’un contrat à terme en raison du moindre risque systémique que présentent les acteurs intervenant sur ces marchés par rapport aux acteurs financiers classiques, ainsi que des interactions complexes entre marchés physiques et marchés dérivés, qui nécessitent un accès concomitant aux données du marché physique et une bonne coopération entre régulateur du marché dérivé et régulateur physique, quand il existe. La directive MIF a laissé de côté les intermédiaires en matières premières, en raison de l’incapacité des États membres à se mettre d’accord sur le régime de fonds propres applicable. Profitant du retard de la réaction européenne, un vaste mouvement de délocalisation des grandes maisons de négoce vers Genève s’est déjà organisé.
Actuellement la directive MIF ne concerne que les instruments financiers et non les contrats commerciaux à terme. Les échanges de gré à gré de dérivés de matières premières doivent rentrer dans le périmètre des marchés organisés, y compris ceux bénéficiant des exemptions créées par cette directive pour les entités intervenant sur les dérivés de matières premières n’appartenant pas à un groupe financier, qui ne sont ni soumises à agrément, ni aux obligations de fonds propres. Il existe, en effet, actuellement quatre régimes de régulation applicables aux intervenants sur les marchés dérivés de matières premières : soumission, partielle ou non, à la directive MIF, exemption totale, exemption totale européenne doublée de dispositions nationales spécifiques.
On observera cependant que les produits agricoles ne sont pas tous standardisables, les 100 000 variétés de riz recensées rendent ce produit réfractaire à la création d’un marché à terme mondial du riz.
2.– Organiser des marchés à terme de matières premières en Europe
Dans le contexte actuel de domination des marchés américains de matières premières, il y a urgence à développer des marchés à terme européens en particulier pour les produits agricoles.
En vue de les réguler, il semble indispensable de créer une agence européenne de régulation des marchés agricoles, sur le modèle de la Commodity futures trading Committee (CFTC), dont la loi Dodd-Franck du 21 juillet 2010 a sensiblement accru les pouvoirs. L’Union européenne a une vocation tout aussi naturelle et ancienne que les États-Unis à devenir une instance de proposition et d’action sur la gestion des déséquilibres agricoles.
LA COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION (CFTC) L’Agence américaine des marchés à terme de matières premières a été instituée par un Trade act de 1974 (loi du 3 janvier 1975) comme une agence indépendante pour réguler l’ensemble des marchés de matières premières. Ses membres sont nommés pour cinq ans par le Président des États-Unis, après accord du Sénat. La création de la CFTC s’insère dans l’histoire de l’organisation des marchés à terme des céréales et des matières agricoles aux États-Unis, où les premières bourses et chambres de compensation sont apparues dès le XIXème siècle avec la Bourse de Chicago pour le blé en 1848, la naissance de marché à terme du coton au New York Stock Exchange en 1870 et la première chambre de compensation en 1883. En 1936 fut créée la première « Commodity Exchange Commission » où siégeaient les secrétaires d’État à l’agriculture et au commerce et le Procureur général de la Cour suprême. Des moyens incontestables… Face aux hausses périodiques des prix des matières premières, et aux accusations de manipulation des marchés, le Congrès des États-Unis a progressivement accru les pouvoirs de la CFTC qui a comme mission de garantir l’intégrité des marchés de l’ensemble des matières premières, physiques, et futures, y compris les marchés OTC de gré à gré et l’énergie, dans un contexte de rivalité croissante avec la SEC. La Commission doit identifier les menaces de manipulation des marchés, les abus de position dominante et engager des actions préventives. Face à la spéculation, le Commodity Exchange Act autorise la Commission à imposer des limites sur la taille des positions spéculatives sur les marchés à terme. La CFTC publie également chaque semaine toutes les données agrégées des positions de tous les intervenants physiques ou financiers, en les distinguant par catégories, dans des trade repositories (bases centrales de données) essentiels à la transparence des marchés et cités en exemple par les intervenants européens. Elle peut instruire des plaintes déposées contre un professionnel enregistré auprès de la CFTC pour violation de la loi ou des règlements émis par elle. Son budget pour 2010 est de 168 millions de dollars et elle emploie 687 agents. …qui n’éteignent pas les critiques Le Président des États-Unis Barack Obama a accusé la CFTC de laxisme à l’égard de la spéculation avérée sur les marchés du pétrole en 2008. La CFTC est sous pression constante du Congrès et accusée de sous-régulation des marchés. Face à la hausse de matières premières agricoles de 2008, la CFTC a introduit de nouveaux lieux de livraison du blé « soft white » et majoré les primes de stockage de plus de 50 %. Un rapport du Sénat de 2009 analysant la spéculation excessive sur ce même marché, a enjoint la CFTC de limiter l’emprise des opérateurs non commerciaux, comme les fonds indiciels, sur les marchés à terme. Le secrétaire d’État au Trésor, M. Henry Paulson, de son côté, avait suggéré la fusion de la CFTC avec la SEC, qui a compétence sur les marchés boursiers et obligataires, avec l’appui de Wall Street. La loi Dodd-Frank de juillet 2010 a cependant accru les pouvoirs de la CFTC pour instaurer de la transparence sur les marchés OTC, notamment avec la publication des transactions swaps de matières premières et les blocs de titres standardisés, tandis que la SEC a été appelée à renforcer la régulation des fonds d’investissement et des hedge funds. |
La régulation des marchés de matières premières suppose de doter les régulateurs nationaux et européens de pouvoirs de définition de limites de position à l’instar de la CFTC ou des autorités chinoises qui interviennent actuellement pour limiter les hausses de prix. Il paraît nécessaire de donner au régulateur le pouvoir de définir des limites de position, par exemple en pourcentage maximum de contrats, comme en dispose actuellement la CFTC, qui partage ce rôle avec les bourses d’échanges, comme le Nymex sur les contrats à terme pétroliers. Actuellement, en France, les limites de position sont établies par la chambre de compensation LCH-Clearnet pour les dérivés de produits agricoles négociés sur Euronext. Ces limites de position ont pour objet de permettre à la chambre de compensation de corriger une situation aberrante. Ce recours à des limites de position serait en cohérence avec l’approche de régulation américaine et préviendrait la constitution de positions dominantes. Elle ne doit cependant pas aboutir à pénaliser les petits acteurs dans les filières agro-alimentaires.
Le texte européen devra également définir un régime de sanction et de répression des abus de marché, car la directive « abus de marché » (MAD) n’est applicable qu’aux instruments dérivés financiers et admis sur des marchés réglementés, et le texte actuel ne permet pas de réprimer les manipulations portant à la fois sur les dérivés de produits de base, et sur les marchés et actifs physiques (marchés du gaz et de l’électricité), ni les stratégies de squeeze consistant à faire artificiellement monter les prix en achetant une position très importante qui crée la rareté ou l’impression de rareté.
Il convient également de prévoir des dispositions permettant d’éviter les conflits d’intérêts entre analystes et courtiers de matières premières, sur le modèle des règles existant sur les marchés d’actions ou d’imposer la séparation totale entre les activités sur matières premières exécutées sur compte propre et les activités réalisées pour des clients extérieurs.
Il paraît aussi nécessaire d’accroître la transparence par la création de bases centrales de données sur transactions (trade repositories) dans la zone euro, utilisables pour la surveillance systémique et le contrôle des abus de marché. Entendu par la commission d’enquête le 17 novembre 2010, M. Bernard Valluis, expert de l’Association nationale des industries alimentaires, a critiqué le défaut de transparence des marchés, notant que l’on ignore la nature des intervenants, commerciaux ou financiers, sur Euronext à Londres. Il a évoqué les risques d’abus de position dominante sur ce marché, alors que le marché de Chicago a des règles beaucoup plus strictes de publication des positions ouvertes par catégorie d’opérateur, grâce aux règles très exigeantes sur la transparence des marchés édictées par la CFTC. Il est, en effet, indispensable de distinguer les opérateurs commerciaux (commercials) qui interviennent sur les marchés physiques, des négociants en options d’échange (swap dealers) et des hedge funds qui interviennent sur les produits dérivés. D’après M. Valluis, la situation est d’ailleurs encore plus opaque sur les produits dérivés de matières premières traités de gré à gré, dits OTC.
L’autorité de surveillance européenne à créer devrait également pouvoir mettre en place des limites de variation des positions journalières et de s’assurer que, dans les contrats à terme, une livraison physique est réellement possible.
Proposition n° 9: Créer une agence européenne de régulation des marchés agricoles sur le modèle de la Commodity futures trading committee et prévoir une réglementation en matière de : – limites de position et limite des variations des positions journalières ; – sanction et répression des abus de marché ; – prévention des conflits d’intérêt ; – création de bases centrales de données sur transactions ; – garantie de livraison. |
Par ailleurs, le rapport de MM. Jean-Pierre Jouyet, Christian de Boissieu et Serge Guillon sur l’instabilité des marchés agricoles souligne le déficit de gouvernance mondiale pour une approche globale des problèmes agricoles et remarque que la crise de 2007-2009 n’a pas été prévue. Il envisage la mise en place d’un Forum de stabilité agricole composé d’experts mis à disposition par les instituts statistiques nationaux, ayant vocation à définir des systèmes d’information, les politiques à risque, et des niveaux d’alerte pour les crises, en concertation avec les États et les organisations internationales. Cette proposition mérite d’être soutenue.
Enfin, un code de bonne conduite pour les stocks agricoles pourrait être mis en place sous l’égide du G20, afin d’engager une approche globale en cas de crise mondiale grave des marchés se manifestant par une importante volatilité.
D.– LA « TAXE TOBIN » : OUTIL DE TRANSPARENCE ?
S’agissant de la taxation des opérations financières, il convient de rappeler que James Tobin, prix Nobel d’économie en 1981 et professeur d’économie à l’université de Yale jusqu’en 1988, proposa, en 1972, une taxe sur les échanges monétaires internationaux. D’un taux proche de 0,1 % et prélevée sur les opérations d’achat et de ventes de devises, elle a pour objectif principal d’atténuer les fluctuations des taux de change et restaurer ainsi une fraction de l’autonomie de la politique monétaire menacée par la mobilité sans cesse croissante des capitaux.
Une taxe, assimilable à la taxe Tobin, a été introduite dans le droit positif français lors du vote de la loi de finances pour 2002, par la voie d’un amendement de la commission des finances de l’Assemblée nationale, à l’initiative de M. Henri Emmanuelli, président de notre commission d’enquête. Toutefois, la prise d’effet du dispositif a été conditionnée à l’intégration dans leur droit interne par l’ensemble des États membres de la Communauté européenne des mesures arrêtées par le Conseil quant à l’instauration d’une taxe sur les transactions sur devises. Le taux de la taxe doit être fixée par décret en Conseil d’État, dans la limite maximum de 0,1 %.
À cet égard, on peut noter les propos tenus devant la commission d’enquête par Mme Pervenche Berès, présidente de la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen, rapporteure de la commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale de cette assemblée. Selon elle, la taxation des transactions financières réglerait le problème du trading haute fréquence tout en assurant la transparence des acteurs ; elle a également évoqué la position de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen qui considère qu’« une taxe sur les transactions financières à l'échelle mondiale, qui dissuaderait les institutions financières de s'engager dans la prise de risque excessive et qui responsabiliserait le secteur face à la crise, devrait être envisagée. Si la taxe à l'échelle mondiale devait s'avérer irréalisable, l'UE pourrait envisager de prendre seule cette initiative. » Le Parlement européen a adopté une résolution invitant la Commission et le Conseil à examiner la possibilité d’utiliser cette taxe pour venir en aide, financièrement, aux pays en développement dans la lutte contre le changement climatique, pour financer la coopération au développement, mais également contribuer au budget de l'UE.
Une telle taxation ne peut certainement pas constituer un remède à la spéculation. En effet, les prix intégreront probablement le coût de cette taxation. En revanche, elle instaurerait sans doute plus de transparence des mouvements de capitaux et des opérations spéculatives puisqu’elle permettrait d’avoir connaissance de l’ensemble des transactions constituant son assiette et de mieux identifier les opérateurs. En outre, elle procurerait des ressources qui pourraient alimenter des fonds en faveur, par exemple, de l’aide au développement ou des autorités de contrôle.
Mme Pervenche Berès a cependant observé qu’une telle taxe générerait un produit déséquilibré selon le volume des transactions effectuées dans les différents pays. Le Royaume-Uni, où s’effectuent la plupart des transactions, serait à cet égard particulièrement concerné. Même si cette circonstance ne facilitera pas la négociation, n’est-ce pas là la logique même de la taxe ?
III.– RÉGLEMENTER, SI NÉCESSAIRE, AVEC DISCERNEMENT
A– FONDS ALTERNATIFS : UN COMPROMIS EUROPÉEN QUI DEMEURE INSATISFAISANT
Sous l'impulsion du Parlement européen, la Commission européenne a présenté le 30 avril 2009 une proposition de directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs (ou « directive AIFM » – Alternative Investment Fund Managers). En dépit des intérêts divergents des États membres, un compromis a été trouvé, qui laisse subsister des zones d'ombre.
1.– Les principales dispositions de la proposition de directive d’avril 2009
Les gestionnaires d’un ou plusieurs fonds alternatifs devront demander aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils sont installés une autorisation pour pouvoir commercialiser et gérer ces fonds dans l’Union. Ils ne pourront commercialiser des fonds alternatifs qu’auprès d’investisseurs professionnels (et non pas auprès de particuliers), seuls en mesure de comprendre et d’assumer les risques liés à ce type d’investissements.
Grâce à l’autorisation obtenue auprès des autorités d’un pays européen, ces gestionnaires pourront s’adresser aux investisseurs d’autres pays de l’Union, sur le modèle du « passeport européen » mis en place pour les OPCVM.
Pour obtenir l’agrément dans un État membre, les gestionnaires seront tenus de fournir des informations détaillées sur leur activité, l’identité et les caractéristiques des fonds gérés, leur gouvernance… Ils devront aussi détenir un certain niveau de fonds propres et prouver qu’ils sont dotés de mécanismes internes solides en ce qui concerne la gestion des risques. Une fois l’agrément obtenu, ils seront aussi tenus de communiquer sur une base régulière des informations sur les principaux marchés où ils sont actifs, leurs performances et les concentrations de risques.
La Commission européenne envisageait donc d’imposer un enregistrement obligatoire des gestionnaires (considérés comme responsables des décisions-clés) et une information des superviseurs sur leurs activités, mais pas de régulation directe des fonds eux-mêmes.
Les hedge funds d’un montant inférieur à 100 millions d’euros ne sont pas couverts par la proposition de directive ; pour les fonds de capital investissement (private equity), ou fonds LBO, le seuil est de 500 millions d’euros.
S’agissant de fonds domiciliés dans des pays tiers, ils pourront être commercialisés dans l’UE par un gestionnaire établi dans un État de l’Union, après un délai de trois ans, et à condition que le pays tiers concerné ait conclu avec l’État membre sur le territoire duquel le fonds va être commercialisé, un accord d’échange bilatéral de renseignements à des fins fiscales.
La proposition prévoit également la possibilité pour les États membres d’autoriser des gestionnaires établis dans des pays tiers à commercialiser des fonds dans l’Union, à condition que cinq exigences soient remplies :
– équivalence des législations européenne et du pays tiers en matière de réglementation prudentielle et de surveillance ;
– accès comparable pour les acteurs établis en Europe au marché de ce pays tiers ;
– fourniture par le gestionnaire d’un certain nombre d’informations sur le fonds ;
– existence d’un accord de coopération entre les autorités de l’État membre où le gestionnaire demande l’agrément et l’autorité de surveillance du gestionnaire ;
– et signature d’un accord entre le pays tiers et l’État membre garantissant un échange d’informations en matière fiscale.
2.– Une proposition de directive très controversée
Cette proposition de directive a été très critiquée, notamment au sein du Parlement européen. Or, il s’agissait d’un texte soumis à la procédure de codécision, pour lequel le Parlement européen a donc joué un rôle essentiel.
Pour certains, l’enregistrement proposé n’était qu’une formalité sans réel contenu contraignant, et les exigences de fonds propres étaient insuffisamment élevées. Selon Mme Pervenche Berès, présidente de la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen, « En enregistrant les seuls gestionnaires de fonds (…), on fait à la fois échapper les fonds à toute régulation et on leur permet d’agir dans les États membres même si ces fonds sont domiciliés dans des paradis fiscaux, ce qui est le cas de la très grande majorité d’entre eux. Aucune règle prudentielle ne s’applique à eux et ils échapperaient même à l’obligation d’enregistrement s’ils ne dépassent pas 100 millions d’euros [seuil prévu pour les hedge funds] ».
La Commission européenne a elle-même admis que son texte ne couvrirait que 30 % des gestionnaires de hedge funds et environ la moitié des gestionnaires d’autres fonds alternatifs. Elle a souligné également, à juste titre, que ce texte ne sera pleinement efficace que s’il est accompagné d’initiatives parallèles dans d’autres pays, notamment les États-Unis.
En sens inverse, pour de nombreux représentants du secteur financier concerné, ce texte était, dans sa forme initiale, protectionniste et susceptible de porter gravement préjudice à l’industrie européenne concernée, dont des places financières situées hors de l’Union européenne (Suisse, États-Unis, pays d’Asie) s’empresseraient d’attirer l’activité ainsi découragée. C’est un argument repris par le Gouvernement britannique, qui s’est au départ fortement opposé au texte, et les acteurs de la City de Londres – la grande majorité des gérants européens de hedge funds y sont basés. Le Secrétaire américain au Trésor, Tim Geithner, a adressé plusieurs courriers à ses homologues européens pour s’opposer au projet, craignant de possibles répercussions négatives sur l’industrie financière américaine.
Quelques observateurs sont plus nuancés : ils estiment que soumettre tous les hedge funds, y compris américains, à l’obligation de s’enregistrer en fournissant un certain nombre d’informations et à se soumettre à un suivi (obligation d’actualiser régulièrement les informations fournies) constituera déjà un progrès non négligeable. C’est notamment l’opinion de M. Jacques de Larosière.
3.– Les travaux au Conseil et au Parlement européen
Le rapport de M. Jean-Paul Gauzès, présenté le 23 novembre 2009, a approuvé le choix de la Commission européenne de soumettre à une procédure d’agrément et à une supervision tous les gestionnaires établis et opérant dans l’Union européenne, et qui gèrent des fonds alternatifs quelle que soit la domiciliation de ceux-ci. Pour autant, le rapport se fait l’écho des inquiétudes et des critiques, et a appelé à des modifications importantes de la proposition de la Commission européenne.
Certains amendements qu’il a proposés avaient pour objet de faire de la directive un texte plus strict envers les fonds que le texte initial :
– il a préconisé la suppression des deux seuils (100 millions et 500 millions d’euros), afin de soumettre tous les fonds alternatifs aux règles communautaires ;
– il a souhaité aussi introduire des limites plus strictes quant à l’utilisation des effets de levier.
D’autres amendements de M. Gauzès visaient à assurer une meilleure cohérence entre les textes communautaires existants (en particulier les « directives OPCVM ») et cette future directive.
La position de départ du Gouvernement français dans la négociation a consisté à mettre l’accent sur la nécessité d’appliquer la transparence à tous les fonds, qu’ils soient basés dans l’Union européenne ou hors de celle-ci, et sur l’opposition à l’octroi d’un « passeport européen » aux fonds non européens. Le Gouvernement considérait la proposition de directive comme un progrès, mais estimait que les hedge funds représentent un risque plus important que les autres fonds alternatifs.
La position française a ensuite évolué : le 6 octobre 2010, la France a indiqué pouvoir accepter la création du passeport pour les fonds de pays tiers à condition que celui-ci soit délivré non pas par un superviseur national mais par l’Autorité européenne des marchés financiers, qui va entrer en fonctions en janvier 2011. La France a souhaité que l’application des règles européennes par les gestionnaires et les fonds des pays tiers soit vérifiée non pas par leur superviseur local mais par l’Autorité.
Sur la proposition française de créer, à l’issue d’une période transitoire, un véritable passeport européen pour les acteurs des pays tiers à condition que ce passeport soit délivré par l’AEMF, la France était soutenue notamment par l’Italie et la Pologne, mais s’opposait à l’Allemagne, au Royaume-Uni et au Luxembourg (qui refusaient l’attribution de nouveaux pouvoirs à l’AEMF). Le Royaume-Uni soutenait la formule de la création immédiate et automatique d’un passeport européen pour les fonds des pays tiers, et s’appuyait sur cette question sur plusieurs pays, comme les Pays-Bas, la Suède, la République tchèque.
4.– Le texte adopté le 11 novembre 2010
Au final, au bout de dix-huit mois de négociation, les 27 gouvernements ont atteint un compromis adopté à l’unanimité au Conseil le 19 octobre 2010. L’accord a été atteint entre les États membres sur les points suivants : l’application de la directive à tous les types de fonds alternatifs, les conditions d’octroi de l’agrément par un État, l’exigence de fonds propres (215), les obligations de transparence vis-à-vis des investisseurs, la nature des informations que les gestionnaires devront fournir régulièrement aux superviseurs. Sur la question de la libre circulation dans l'Union européenne (passeport), les États ont décidé qu’en 2013 le passeport européen sera accordé aux fonds européens tandis que les régimes nationaux différents subsisteront pour les fonds des pays tiers ; pour ceux-ci, une période transitoire est prévue, en trois étapes : en 2015, et sur la base d’une recommandation de l’Autorité européenne des marchés financiers, la Commission européenne prendra une décision sur la question du passeport pour les pays tiers ; entre 2015 et 2018, les fonds de pays tiers pourront soit obtenir un passeport européen octroyé par un des 27 superviseurs nationaux, soit continuer à être autorisés au cas par cas dans chaque pays membre s’ils ne se mettent pas en conformité avec la directive, et c’est l’AEMF qui vérifiera notamment que le marché local et aussi ouvert aux gestionnaires européens que l’inverse et que le pays tiers en question offre toutes les garanties nécessaires (supervision, règles prudentielles et fiscales…) ; après 2018, seules les règles relatives à l’agrément européen seront d’application.
La France n’a donc pas obtenu que ce soit l’AEMF qui délivre elle-même le passeport européen, mais celle-ci sera systématiquement informée de toute demande de passeport à un superviseur national, et centralisera ainsi la liste des fonds de pays tiers qui auront vu leur demande rejetée. Et elle pourra demander aux superviseurs nationaux d’interdire ou de suspendre la commercialisation d’un fonds qui menacerait la sécurité des investisseurs ou la stabilité financière en Europe. Dans ces conditions, il sera permis aux gestionnaires de choisir le pays d’enregistrement en fonction de son degré de complaisance…
Le Conseil a poursuivi sur la base de cet accord ses négociations avec le Parlement européen, qui a adopté le texte le 11 novembre 2010. Celui-ci reflète le compromis obtenu avec le Conseil. Outre la question du passeport et celle des compétences de l’AEMF, l’accord porte sur les moyens de lutte contre le démembrement des actifs. À cette fin, il limite les possibilités de répartition du capital dans les premières années suivant la reprise de l’entreprise par un fonds alternatif. Des exigences d’information et de publicité sur la stratégie prévue pour la société sont également imposées aux investisseurs de capital-investissement, vis-à-vis des actionnaires et des employés.
La responsabilité du dépositaire a été renforcée. Le texte adopté prévoit que si un dépositaire délègue ses tâches, il pourra fournir un contrat permettant au fonds ou à son gestionnaire de réclamer des dommages à l’entité qui a obtenu la délégation.
Ce texte ne répond pas véritablement aux attentes françaises. Constitue-t-il même un progrès ? Il conviendra de suivre attentivement ses effets pour apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires s’il s’avère que le passeport, tel qu’il est conçu, permet d’ouvrir le marché européen à des fonds insuffisamment contrôlés. Il y a lieu d’observer à cet égard que, compte tenu du tropisme des hedge funds pour la City, l’autorité de délivrance sera, dans les quatre cinquièmes des cas, le superviseur britannique. La cruelle expérience de la MIF doit nous servir de leçon et il conviendra d’éviter que le passeport européen ne soit, en réalité, une « passoire ».
Proposition n° 10 : Assurer un suivi attentif des conséquences de la possibilité offerte à tous les fonds alternatifs de se voir délivrer un « passeport européen », en matière d’ouverture de marché européen à des fonds insuffisamment contrôlés, pour être en mesure de proposer rapidement les correctifs nécessaires. |
En particulier, alors que l’on sait que l’effet de levier de ces fonds leur offre une capacité d’intervention démultipliée sur les marchés, le texte communautaire ne comporte aucune disposition contraignante permettant de limiter le levier.
Les gestionnaires de fonds sont certes soumis à une obligation de déclarer un levier d’endettement maximum. Cette information sera transmise au régulateur national du pays européen où le gestionnaire est inscrit. Mais, rien, dans la directive, n’oblige ce dernier à réagir lorsque le levier est trop important. Quant à l’AEMF, elle n’aura pas non plus le pouvoir de contraindre le régulateur national à réagir. La directive ne prévoit donc pas les moyens de contrôler un élément qui est à l’origine du risque systémique présenté par les fonds spéculatifs.
Proposition n° 11 : Agir en vue de compléter la directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs par des dispositions permettant de mieux contrôler ces fonds et de limiter l’effet de levier des détenteurs du nouveau passeport européen. |
B.– VENTES À DÉCOUVERT, CDS : L'UNION EUROPÉENNE EST ENFIN ENTRÉE EN ACTION
La crise financière a révélé, comme on l’a vu, un certain nombre de problèmes sur les marchés de produits financiers dérivés, notamment sur le marché des contrats d’échange sur défaut (credit default swaps – CDS), en matière de transparence, de concentration des marchés et d’accroissement des risques.
1.– Les atermoiements de la Commission européenne
Dans un premier temps, l’Union européenne n’a pas engagé d’action législative dans ce secteur, le commissaire Charlie McCreevy (au sein de la Commission « Barroso I ») s’en étant remis aux acteurs de ces marchés pour engager eux-mêmes des réformes allant dans le sens de la création, en Europe, de chambres de compensation, comme il en existe déjà aux États-Unis pour certains dérivés.
Les démarches d’« autorégulation » entreprises par les acteurs des marchés s’étant révélées insuffisantes, le Parlement européen et la Commission européenne ont lancé une réflexion au niveau européen spécifiquement consacrée à la régulation des dérivés, dans le courant de l’année 2009, démarche dont l’importance a été encore amplifiée par la crise grecque – puis la crise de la zone euro toute entière – lorsque l’attention s’est portée sur une catégorie particulière de dérivés, ceux adossés aux dettes souveraines. La spéculation sur ces marchés a été, en effet, lourdement stigmatisée, car elle aurait accru artificiellement les coûts du financement de la dette grecque, mettant en danger la stabilité de la zone euro.
L’inaction de la Commission européenne « Barroso I », ou du moins son retard à lancer ce travail au niveau européen, a fait l’objet de vives critiques. Certains responsables ont pris des initiatives pour souligner l’urgence de progresser en ce domaine, notamment le Président Nicolas Sarkozy, la Chancelière Angela Merkel, et le Premier ministre luxembourgeois (et président de l’Eurogroupe), M. Jean-Claude Juncker. En mars 2010, le Président de la République et Mme Angela Merkel ont affiché une volonté commune d’encadrer étroitement les CDS (instaurer une période minimale de détention pour éviter que des spéculateurs n’en achètent pour les revendre rapidement…), d’établir un enregistrement obligatoire de tous les produits négociés de gré à gré, et des chambres de compensation (localisées dans la zone euro) qui serviraient obligatoirement d’intermédiaire entre vendeurs et acheteurs. Puis, en juin 2010, le Président Nicolas Sarkozy et Mme Angela Merkel ont adressé au président de la Commission européenne une lettre commune demandant d’envisager la possibilité d’une interdiction au niveau européen des ventes à découvert à nu de toutes ou certaines actions et obligations et de certains CDS à nu sur titres souverains.
2.– Le projet de règlement du 15 septembre 2010 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit
L’objectif du texte est d’harmoniser les obligations relatives à la vente à découvert dans toute l’Union européenne, d’harmoniser les pouvoirs dont les autorités de régulation disposent en cas de situation exceptionnelle menaçant gravement la stabilité financière ou la confiance des marchés, et d’assurer une plus grande coordination et une plus grande cohérence entre États membres dans ce type de situation.
La réglementation proposée s’appliquerait à toutes les personnes physiques ou morales qui pratiquent la vente à découvert, dans tous les secteurs du marché (y compris les marchés obligataires souverains), qu’elles fassent ou non l’objet d’autres dispositions réglementaires en matière de services financiers (banques, entreprises d'investissement, hedge funds, etc.).
Ses principales dispositions sont relatives à la transparence en ce qui concerne les actions, les émissions de dette souveraine et les CDS liés à la dette souveraine d’un État de l'Union européenne, aux ventes à découvert « à nu » et aux pouvoirs d’intervention des régulateurs en cas de situations d’urgence.
a) Des obligations de transparence en ce qui concerne les actions, les émissions de dette souveraine et les CDS liés à la dette souveraine d’un État de l’Union européenne
La notion-clé est celle de « position courte nette » d’un acteur sur les actions d’une entreprise ou sur la dette souveraine d’un État membre admises à la négociation dans l’UE, c’est-à-dire la position restante après avoir déduit toute position longue (détenue par cet acteur sur l’action ou la dette) des positions courtes détenues par ce même acteur (216). Le calcul des positions courtes et des positions longues en rapport avec la dette souveraine inclut les contrats d’échange sur risque de crédit (CDS) relatif à une obligation d’État ou à un événement de crédit en rapport avec un État membre ou avec l’Union.
Les obligations de transparence prévues par le projet de règlement concernent les positions courtes nettes :
● Sur les actions d’entreprises :
– notification aux autorités de régulation des positions courtes nettes importantes sur des actions ; « importante » s’apprécie lorsqu’une position franchit à la hausse ou à la baisse l’un des seuils de notification prévus par le texte : 0,2 % de la valeur en capital en actions émises de l’entreprise concernée, puis chaque palier de 0,1 % au-delà de ce seuil ;
– publication, par les personnes physiques ou morales qui détiennent une position courte importante sur les actions d’une entreprise, d’« informations détaillées » sur cette position à chaque fois que celle-ci franchit à la hausse ou à la baisse l’un des seuils suivants : 0,5 % de la valeur du capital en actions émis de l’entreprise concernée, puis chaque palier de 0,1 % au-delà de ce seuil ;
– marquage obligatoire, par tous les marchés organisés (marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation), des ordres qui constituent des ventes à découvert d’actions.
L’obligation de notification doit permettre aux autorités de régulation de contrôler les ventes à découvert et d’enquêter sur celles qui sont potentiellement porteuses de risques systémiques ou constitutives d’abus. L’obligation de publication à l’intention du marché vise à renseigner les autres participants.
● Sur la dette souveraine et les CDS :
– notification aux autorités de régulation, également basée sur des seuils, de toute position courte nette en rapport avec la dette souveraine émise d’un État membre ou de l’Union ;
– de même, en fonction de seuils, notification des positions non couvertes sur les CDS en rapport avec une obligation d’un État membre ou de l’Union.
Toutefois, s’agissant de ces deux cas de figure, le texte du projet de règlement ne fixe pas les seuils de notification, qui seront fixés ultérieurement par actes délégués (217). Et en matière de dette souveraine et de CDS sur dette souveraine, les obligations de notification aux régulateurs ne s’accompagnent pas d’obligations de publication à l’intention des autres participants du marché.
Toutes ces obligations de transparence s’appliquent non seulement aux opérations effectuées sur des plates-formes de négociation, mais aussi aux positions courtes découlant de négociations de gré à gré et aux positions courtes nettes constituées au moyen de dérivés liés à des actions ou à des obligations souveraines.
Ce régime de transparence et de marquage devrait améliorer la transparence du marché et faciliter le travail des régulateurs. Il sera toutefois source de coûts pour les entreprises financières, qui devront assumer des coûts de développement technologique.
b) Les ventes à découvert « à nu »
Le texte limite considérablement – sans aller jusqu’à les interdire complètement – la possibilité de procéder à des ventes à découvert « à nu », en cherchant à éliminer le risque de non-règlement qui leur est lié : les personnes physiques ou morales qui vendent à découvert une action ou un instrument de dette souveraine devront soit avoir emprunté l’action ou l’instrument, soit avoir conclu un accord d’emprunt de l’action ou de l’instrument, soit avoir pris d’autres dispositions pour s’assurer que l’instrument ou l’action puisse être emprunté de sorte que le règlement puisse avoir lieu dans le délai prévu.
Cette triple obligation, ou « locate rule », s’inspire de la législation américaine. La loi française de régulation bancaire et financière impose également ce type d’obligation. La règle vise à prévenir la situation où un vendeur « à nu » est potentiellement en situation de céder un nombre a priori illimité de titres, source potentielle d’abus de marché et de risque systémique : le dispositif permettrait de limiter les ventes à découvert « à nu » puisque le vendeur devra au moins avoir localisé et réservé les actions ou obligations pour lesquelles il est en position courte.
L’opérateur devra désormais s’assurer qu’il pourra livrer effectivement dans les trois jours le titre qu’il vend. Sans quoi, a indiqué le commissaire Michel Barnier, « il sera obligé à un règlement en cash le quatrième jour », sous peine d’amende (astreintes journalières), pour dédommager l’acheteur à hauteur de ses pertes en cas de défaut de livraison.
Cette mesure va dans le bon sens et doit être soutenue, mais il paraît nécessaire d’aller plus loin et de prévoir une interdiction pure et simple des CDS sur des dettes souveraines.
La crise grecque a montré les effets perturbants de la spéculation sur les CDS. Il apparaît dès lors légitime de se poser la question de l’utilité sociale d’un instrument permettant de se couvrir contre un risque auquel on n’est pas exposé.
S’agissant plus particulièrement de la vente à découvert à nu de tels produits, la condamnation est sans appel, ainsi que l’a clairement exprimé devant la commission d’enquête M. Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France : « les ventes à découvert sont utiles à la formation des prix et à la fluidité du marché. En revanche, lorsqu’elles se pratiquent à nu, du fait qu’elles ne connaissent aucune limite puisqu’il n’y a pas besoin d’emprunter le support de l’opération, elles autorisent des prises de position directionnelles très déstabilisantes pour les marchés sans améliorer la liquidité. » (218)
L’interdiction des ventes à découvert à nu par la Bafin le 19 mai dernier, même si elle demeure grandement inapplicable, montre la résolution allemande pour aller vers une interdiction sur l’ensemble du continent d’opérations de cette nature sur les produits dérivés de dettes souveraines. Cette résolution pourrait être relayée par la France dans le cadre de sa présidence du G20.
Une telle interdiction ne doit néanmoins pas se décider sans préavis, afin de laisser aux acteurs de marché le temps de s’adapter aux nouvelles règles. Elle doit également s’accompagner des moyens nécessaires aux régulateurs de faire appliquer effectivement l’interdiction.
Proposition n° 12: Interdire les ventes à découvert « à nu » de produits dérivés de dette souveraine sur un périmètre le plus large possible. |
c) Les pouvoirs d’intervention des régulateurs en cas de situations d’urgence : un rôle-clé pour la nouvelle Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)
Le projet de règlement comporte des dispositions relatives au pouvoir des autorités nationales, en situation exceptionnelle, d’imposer des restrictions sur les ventes à découvert et des restrictions sur les CDS, et à leur pouvoir de restreindre temporairement la vente à découvert en cas de baisse significative des prix.
Les régulateurs nationaux garderont donc la responsabilité, en cas de crise, d’exiger temporairement (trois mois, renouvelables) plus de transparence ou d’imposer provisoirement des restrictions sur les ventes à découvert ou les transactions sur des CDS, voire de les interdire. Mais ils devront désormais agir en concertation avec l’Autorité européenne des marchés financiers qui entrera en fonction en janvier 2011.
L’AEMF pourra recommander de telles restrictions à l’échelle européenne, sans pouvoir bloquer une décision unilatérale prise dans un État membre. En revanche, dans certaines conditions, le pouvoir de l’AEMF ira jusqu’à se substituer à celui des autorités nationales en cas de carence de celles-ci, si elles « n’ont pas pris de mesure pour parer à la menace, ou bien les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes pour y faire face ».
L’AEMF sera notamment chargée de veiller à ce que les situations d’urgence ayant des implications transfrontalières soient, dans la mesure du possible, traitées partout de la même façon. Et le projet de règlement la dote d’un pouvoir d’enquête, sur demande d’une autorité nationale ou de sa propre initiative.
L’objectif de la Commission européenne est que le règlement puisse être adopté par le Parlement européen et les États membres de manière à entrer en vigueur en 2012. À ce stade, le gouvernement français soutient pleinement la proposition de la Commission, notamment s’agissant du renforcement du pouvoir de l’AEMF ; d’ailleurs, la plupart des dispositions de ce texte correspondent aux dispositions votées dans le cadre de la loi de régulation bancaire et financière.
d) Réduire le délai de règlement-livraison pour les ventes à découvert
Les conditions de livraison des titres sont, on l’a vu (cf. deuxième partie, II, B, 2) un élément important des mécanismes spéculatifs dans le cadre des ventes à découvert.
S'il n'est ni réaliste ni opportun d’entendre proscrire systématiquement les ventes à découvert, qu'elles s'apparentent ou non à des ventes à nu, il est en revanche possible d’en décourager un usage abusif, au moins sur les marchés réglementés, notamment en réduisant le délai de règlement-livraison.
Cependant, les marchés réglementés ne prennent en charge qu'une très faible partie – en volume des transactions – des négociations. La plupart des négociations importantes dites « bloc » s'effectuent de gré à gré avec des délais de règlement-livraison qui peuvent être librement fixés entre les parties.
Cette proposition n’aura donc une pleine efficacité qu’accompagnée de la réduction des transactions s’effectuant de gré à gré ou dans des plates-formes de négoce anonymes (dark pools).
La loi de régulation bancaire et financière a réduit ce délai à J+2 mais a conditionné l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif à un accord européen. Il paraît nécessaire que ce nouveau délai de règlement-livraison puisse être repris dans l'ensemble de l'Union européenne, afin de mettre un terme à l'extrême dispersion en la matière (219). Il appartiendra donc aux négociateurs français de faire accepter cette limitation par nos partenaires européens. La force d’un accord européen aura plus de chance d’emporter la nécessaire adhésion de pays extra-européens dans le cadre du G20. De plus, il paraît nécessaire que la France soit plus offensive dans ce domaine en soutenant la position plus contraignante d’un délai à J+1.
Par ailleurs, il est également indispensable de faire respecter les règles existantes en matière de règlement-livraison des titres, car, comme l’a souligné devant la commission d’enquête M. Jean-Pierre Jouyet, président de l’Autorité des marchés financiers : « Trop de pays européens tolèrent les défauts de livraison, ce qui fait le jeu des spéculateurs (220). »
L'article 570-1 du Règlement général de l'AMF impose qu'à la date de livraison, l'investisseur dispose des titres pour être en mesure de les livrer, l’intermédiaire pouvant d’ailleurs exiger une provision. La loi de régulation bancaire et financière précitée a légalisé ce dispositif qui n’existe pas encore partout en Europe. La France doit encourager un accord européen allant dans ce sens.
L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) serait alors en mesure de faire respecter l’obligation de livrer selon un délai harmonisé sur l’ensemble de la zone européenne.
Proposition n° 13 : Réduire, pour les ventes à découvert, le délai de règlement-livraison des titres à J+1 et proscrire en les sanctionnant les défauts de livraison. |
C.– TRADING ALGORITHMIQUE ET TRADING À HAUTE FRÉQUENCE : CONTENIR DES PRATIQUES PEU UTILES ET PORTEUSES DE RISQUES
Le consensus des différentes personnes auditionnées – universitaires, praticiens, autorités de régulation… – fait apparaître l’inutilité sociale du trading algorithmique et du HFT.
Même si selon M. Dominique Cerrutti, « le high frequency trading ne peut être diabolisé, qui n’est que la convergence de moyens technologique très poussés et de la fragmentation des marchés consécutifs à la directive MIF (221)», le bilan coût-avantage est clairement négatif. Certes, le HFT pousse à la réduction des écarts de prix d’un même produit sur deux marchés différents. Il joue donc un rôle d’uniformisation. Cet unique rôle positif deviendra cependant inutile si la révision annoncée de la directive MIF parvient à unifier les marchés. L’interdiction du trading à haute fréquence pourrait alors s’opérer sans dommage.
Dans cette attente et suite à l’analyse qui en a été faite, il convient de s’interroger sur l’opportunité d’un encadrement du trading à haute fréquence. Toutefois, il est important de préciser que la prise de conscience en Europe des risques spécifiques à cette forme d’activité est inégale et que la plupart de nos partenaires ne partagent pas, à ce stade, nos interrogations.
Or, un consensus européen serait nécessaire pour traiter efficacement le sujet. En effet, comme l’a souligné l’AMF en réponse au questionnaire qui lui a été transmis par la commission d’enquête, les opérations des traders à haute fréquence étant une source de revenus pour les infrastructures de marché, si des mesures nationales les découragent d’intervenir sur Euronext Paris, leurs interventions se rabattront sur les plates-formes concurrentes d’Euronext à l’étranger où peuvent être négociés les titres français.
Dans un premier temps, il convient d’observer très précisément le fonctionnement du trading à haute fréquence. Mme Danièle Nouy, secrétaire générale de l’Autorité de contrôle prudentiel, a précisé devant la commission d’enquête la surveillance que cette autorité était en mesure d’assurer : « Ce que nous pouvons faire, c’est, premièrement, regarder ce que font les établissements ; deuxièmement, vérifier comment ils gèrent leur risque ; troisièmement, évaluer la qualité du contrôle interne et les moyens qui lui sont alloués ; quatrièmement, demander le cas échéant une couche de fonds propres supplémentaire ». (222)
Il apparaît nécessaire que cette surveillance soit activement exercée.
Proposition n° 14 : Assurer une surveillance effective par l’Autorité de contrôle prudentiel des activités de trading à haute fréquence : ampleur du phénomène, gestion du risque, contrôle interne, et le cas échéant, demande de renforcement des fonds propres. |
S’agissant de l’encadrement de ces activités, plusieurs options techniques paraissent déjà possibles, qui présentent toutes des impacts variés en termes de concurrence entre places, de rémunération des infrastructures de marché, de possibilité de contournement. Certains professionnels estiment par exemple qu’une latence minimale des ordres pourrait être contournée par l’entrée toujours possible d’ordres en sens contraire, que la réglementation des annulations d’ordres ne serait pas justifiée, car les stratégies de tenue de marché (market making), celles qui, à leurs yeux, ont le plus d’effets positifs, nécessitent précisément de fréquents repositionnements d’ordres. À supposer qu’un consensus se forme sur la nécessité de restreindre l’emprise du trading algorithmique, des études approfondies seraient donc nécessaires pour déterminer les modalités d’une telle réglementation.
Proposition n° 15 : Encadrer, voire interdire, de manière concertée, au moins à l’échelon européen, le trading algorithmique et le trading à haute fréquence, pratiques dépourvues d’utilité sociale, et, à cette fin engager dès à présent les études techniques permettant de déterminer les solutions appropriées (latence minimale des ordres, réglementation des annulations, facturation ou taxation des ordres annulés, interdiction de certains logiciels…). |
Outre les mesures possibles évoquées ci-dessus, il existe des arguments en faveur d’un élargissement des pas de cotation (tick size), qui ont été très réduits au cours des dernières années.
LE PAS DE COTATION OU TICK SIZE Il y a quelques années, le pas de cotation – c’est-à-dire l’écart minimum de cotation admis entre deux cours consécutifs – dépendait du cours de l’action considérée. En dessous de 50 euros, le pas de cotation était de 0,01 euro. Au-dessus de 50 euros, il était de 0,05 euro. Puis ce pas a été uniformisé, passant à 0,01 euro pour tous les titres, quel que soit leur cours. À partir de 2008, NYSE-Euronext a progressivement développé la décimalisation avec des pas de cotation de 0,005 ou 0,001 euro au lieu de 0,01 euro auparavant. Dans un communiqué du 1er septembre 2008, NYSE-Euronext annonçait clairement que cette mesure avait pour objet de favoriser le trading algorithmique : « Cette mesure sera particulièrement bien accueillie par les traders algorithmiques, qui dorénavant représentent 40 % de notre activité. Des pas de cotation plus fins permettent aux traders de se positionner à l’intérieur du spread et de fragmenter plus finement leurs ordres. Cette mesure encourage le développement de la négociation algorithmique : les ordinateurs réagissant à la milliseconde à des micro-mouvements sur des prix. » |
Cet élargissement présenterait l’avantage de redonner un véritable prix à la priorité temporelle dans le carnet d’ordres : en effet, la réduction des pas de cotation permet en pratique à un intervenant de ne pas dévoiler ses intentions et de réagir au dernier moment en prenant la priorité temporelle dans le carnet, moyennant un surcoût très réduit, en s’insérant à une limite de prix qui n’est pas déjà occupée substantiellement, ce qui est fréquent lorsque les pas de cotation sont très faibles. Élargir les pas de cotation permettrait ainsi de limiter les opportunités d’arbitrage infimes qui n’améliorent pas significativement l’efficience du marché et forment l’essentiel des interventions du trading haute fréquence, tout en rapprochant le mécanisme de formation des prix de sa logique fondamentale, dans lequel chacun dévoile ses attentes pour permettre la découverte du prix.
Proposition n° 16 : Élargir le pas de cotation des valeurs afin de limiter l’intérêt du trading à haute fréquence. |
D.– AGENCES DE NOTATION : COMPLÉTER LE RÉCENT DISPOSITIF COMMUNAUTAIRE
Le règlement communautaire n° 1060/2009 du 16 septembre 2009 représente, on l’a vu, une avancée intéressante pour assujettir les agences de notation à un minimum de règles en matière de transparence, de méthode et de prévention des conflits d’intérêts (cf. ci-dessus II, A, 2, d)). Il reste cependant quelques marges de progression s’agissant de leur modèle économique, de l’usage qui est fait de leurs notes et de leur responsabilité. D’où les trois propositions suivantes.
1.– Inverser le modèle économique ?
Les agences fonctionnent selon un modèle économique qui ne favorise pas leur indépendance : elles sont, comme nous l’avons vu, rémunérées par les sociétés émettrices qu’elles sont chargées de noter. Elles sont également soumises à un problème de rentabilité : la notation est une activité complexe, très consommatrice de temps, et les agences doivent donc sélectionner les clients sur lesquels elles peuvent se concentrer. Elles notent donc en priorité les émissions les plus simples à analyser. D’autre part, il est de pratique courante que les émetteurs, sur la base de notations préliminaires, achètent la meilleure.
Un autre modèle est possible, basé sur une rémunération par les investisseurs, puisque la note est faite pour éclairer ceux-ci. Il serait donc logique, en première analyse, qu’un investisseur souhaitant connaître la note donnée à une émission paie le service demandé. Ce modèle pourrait cependant présenter l’inconvénient de ne pas mettre les notes sur la place publique et de réserver ainsi aux seuls investisseurs des informations agrégeant des données souvent difficiles à obtenir.
Proposition n° 17 : Analyser les conséquences d’un passage au modèle économique « investisseur-payeur », et, à tout le moins, définir les modalités juridiques permettant de restreindre la pratique d’achat, par les émetteurs, de la meilleure notation (publicité des notations préliminaires, transparence des prix des notations). |
2.– Se « désintoxiquer » des notes
Les agences considèrent généralement que les notes qu’elles émettent constituent seulement des avis d’éditorialistes alors que, dans les faits, elles ont une incidence normative, étant utilisées notamment par des fonds d’investissements et par des banques centrales dans leurs politiques d’évaluation des garanties au titre du refinancement.
L’utilisation des notes, y compris par les plus hautes autorités publiques, donne un pouvoir exorbitant aux agences de notation et accentue leur rôle procyclique. Il est donc nécessaire de se « désintoxiquer » (223) des agences de notation, en demandant notamment aux banques centrales de s’abstenir de faire référence à leur jugement, de façon que celui-ci n’influe pas mécaniquement sur les arbitrages rendus par les fonds d’investissement. Il serait plus conforme à leur rôle de constituer leurs propres cellules d’analyse des risques, ainsi que le suggère d’ailleurs le FMI dans son rapport d’octobre 2010 sur la stabilité financière dans le monde.
Proposition n° 18 : Demander aux banques centrales d’éviter toute référence aux notes des agences de notation et d’établir ou renforcer leurs propres cellules d’analyse de risque. |
3.– Renforcer le régime de responsabilité
Par ailleurs, il faudrait instituer une responsabilité de l’agence à raison de la note qu’elle produit. Un régime spécifique de responsabilité pourrait être appliqué, sans exception, à l'ensemble des agences de notation placées dans le champ du règlement européen n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit.
En effet, le cadre classique de la responsabilité civile contractuelle et délictuelle n’est pas adapté au rôle spécifique des agences de notation
Entre l'émetteur et l'agence de notation, le cadre naturel est celui du contrat lorsque la notation est sollicitée, la référence étant les contrats de louage d'ouvrage et d'industrie définis au 3° de l'article 1779 du code civil.
Toutefois, dans le cadre contractuel, des clauses limitatives de responsabilité sont systématiquement insérées par les agences de notation ; or, en droit français, seule une faute lourde permet d'écarter de telles clauses, ce qui est particulièrement protecteur pour les agences.
Entre l'agence et les utilisateurs de la notation, le régime de responsabilité correspond au cadre général, dit délictuel, défini par l’article 1382 du code civil. Dans ce cadre, tout destinataire de l'information émise par une agence de notation qui estime avoir subi un dommage peut engager une action. Il faut cependant que soient réunies trois conditions : une faute, un dommage et un lien de causalité.
En pratique, la principale difficulté consiste à établir l’existence d’une faute. Ainsi peut être invoquée notamment la méconnaissance par une agence
– dès lors constitutive d'une faute – de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier qui interdit la diffusion d'information mensongère ; cela supposerait néanmoins d'établir l'intention frauduleuse de l'agence à l'origine de la notation.
Grâce aux nouvelles obligations qu’il impose aux agences de notation de crédit, le règlement européen du 16 septembre 2009 ouvrira quelques possibilités supplémentaires de mise en cause de la responsabilité. En effet, la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, y compris d’un règlement européen d’effet direct, est constitutive d’une faute. Il sera donc possible, sur la base du droit positif, d’attraire les agences de notation devant une juridiction civile, en cas de manquement caractérisé dans la mise en œuvre des obligations définies dans le règlement précité.
La loi de régulation bancaire et financière – bien qu’elle ait introduit le principe de la responsabilité des agences – a maintenu, à l’initiative du Sénat, la possibilité de clauses limitatives de responsabilité, ce qui revient à vider les dispositions introduites d’une bonne partie de leur effectivité.
Il apparaît nécessaire de proposer – à l’instar de M. Jérôme Chartier, rapporteur du projet de loi de régulation bancaire et financière à l’Assemblée nationale – de prévoir un régime spécifique de responsabilité.
Il reposerait sur une extension de la notion de faute jusqu'à englober les erreurs de notation se caractérisant par une légèreté, une imprudence, c'est-à-dire un manque de diligence dans l'établissement de la note. La transparence des méthodes et modèles des agences de notation, imposée par le règlement communautaire, devrait faciliter la tâche du demandeur. La responsabilité de l’agence ne serait naturellement engagée que si celle-ci n’a pas respecté son propre modèle.
Cependant, le demandeur devra, comme aujourd'hui, démontrer qu'il a subi un dommage et établir le lien de causalité entre l'erreur et le dommage.
Proposition n° 19 : Instituer un régime de responsabilité pour faute des agences de notation en cas de non respect des modèles de notation déposés en vue de l’agrément communautaire. |
Parallèlement, le cadre contractuel de responsabilité entre l'émetteur et l'agence de notation ne devrait pouvoir prévoir aucune clause limitative de responsabilité et donc soumettre les agences au droit commun de la responsabilité.
Proposition n° 20 : Interdire aux agences de notation de s’exonérer de leur responsabilité par voie contractuelle. |
E.– ENCADRER RIGOUREUSEMENT LES BANQUES ET LES ACTIVITÉS DE NATURE BANCAIRE
Comme le note le Fonds monétaire international (FMI) dans son rapport sur la stabilité financière dans le monde d’octobre 2010 : « la confiance dans le secteur financier n’a pas été entièrement rétablie ». Même si les ratios de fonds propres réglementaires des banques se sont améliorés, il faut avoir présent à l’esprit que les dépréciations bancaires liées à la crise entre 2007 et 2010 sont de l’ordre de 2 200 milliards de dollars.
Il est donc nécessaire, à la lumière des effets de la crise, de mieux encadrer l’activité d’acteurs dont le rôle s’est très sensiblement accru à la faveur de la financiarisation de l’économie.
Cependant, les propositions de réforme touchant le secteur bancaire doivent être de bon sens, la réglementation bancaire antérieure n’ayant pas été dénuée d’effet pervers. La titrisation, par exemple, était encouragée par la réglementation bancaire, car le coût en fonds propres d’un prêt immobilier détenu en portefeuille était plus élevé que le coût d’un prêt immobilier détenu hors bilan.
Dans son rapport d’avril 2006 sur la stabilité financière, le FMI estimait d’ailleurs que « la dispersion du risque de crédit par les banques au sein d’un groupe d’investisseurs plus large et plus diversifié a contribué à rendre le système bancaire et financier plus résilient. »
1.– Encadrer le risque systémique par la taxation du secteur financier
Les avancées réalisées en matière de supervision du risque systémique ne sauraient, à elles seules, répondre aux problèmes que la crise financière a mis en lumière.
Il convient aussi de dissuader la prise de risque excessif par les établissements du secteur financier et de compenser le coût éventuel de la résolution des crises bancaires.
La Commission européenne a annoncé des intentions à cet égard, recommandant d’« envisager une taxe sur les activités financières [ciblant] les bénéfices et les rémunérations du secteur financier ». (224)
Le Conseil européen du 17 juin 2010, préparatoire du sommet du G20 de Toronto, s’était, pour sa part, montré plus précis, déclarant « que les États membres devraient instaurer des systèmes de prélèvements et de taxes sur les établissements financiers afin d’assurer une répartition équitable des charges et d’inciter les parties concernées à contenir les risques systémiques ».
Il est à noter que, dans ce cadre, les gouvernements britannique, allemand et français se sont fortement engagés, par une initiative conjointe qui a le grand mérite de permettre d’éviter l’arbitrage réglementaire et la concurrence fiscale entre les principales places financières européennes.
DÉCLARATION COMMUNE DES GOUVERNEMENTS FRANÇAIS, « Prenant acte des résultats du G20, au cours duquel les participants sont convenus que le secteur financier devrait contribuer de manière juste et substantielle à la couverture des charges liées aux interventions publiques permettant de restaurer le système bancaire ou de financer la résolution des crises financières, et au vu des travaux très attendus engagés par le FMI en réponse à ce constat (et des conclusions du Conseil européen du 17 juin), les gouvernements français, britannique et allemand proposent l’instauration de prélèvements sur les banques, assis sur leur bilan. «La future taxe bancaire britannique qui sera incluse dans le budget sera annoncée ce jour, mardi 22 juin, à l’occasion de la présentation de ce dernier. La France présentera quant à elle les modalités détaillées de sa taxe bancaire dans son prochain projet de loi de finances. « L’Allemagne a annoncé dès la fin mars le cadre dans lequel s’inscrira le prélèvement sur les banques qu’elle compte instaurer et présentera un projet de texte en conseil des ministres au cours de l’été. Ces taxes visent toutes les trois à garantir que les établissements bancaires contribuent à la hauteur des risques auxquels ils exposent le système financier et l’économie en général et à les encourager à apporter les ajustements nécessaires à leur bilan pour réduire ces risques. Les modalités précises de chaque taxe pourront varier en fonction du contexte et de la fiscalité de chaque pays mais le niveau de prélèvement tiendra compte dans tous les cas de la nécessité de garantir des conditions équitables. « Les gouvernements français, britannique et allemand sont résolus à mettre en œuvre le programme ambitieux de réforme du secteur financier défini par le G20 dans tous ses aspects et se réjouissent à la perspective de débattre plus avant de ces propositions avec leurs partenaires internationaux lors du Somment du G20 à Toronto le 24 juin. » |
En France, l’article 16 du projet de loi de finances pour 2011 assure la concrétisation de cette intention. On renverra, sur ce point, à l’analyse détaillée du texte par les commissions des finances des deux assemblées. (225)
Cet article prévoit la création d’une taxe dite « de risque systémique » assise sur les risques encourus par les principaux établissements de crédit, entreprises d’investissement et établissements de paiement, affectée au budget général. Une telle affectation parait préférable à l’affectation à un fonds de résolution des crises qui aurait accrédité l’idée d’un droit des contributeurs à un « retour » en cas de difficultés.
Son produit brut pourrait être de l’ordre de 500 millions d’euros pour 2011 et de 800 millions d’euros pour 2013, l’évolution des normes prudentielles devant accroître l’assiette de la taxe.
Ce dispositif de dissuasion de la prise de risque excessif doit être salué, car elle s’inscrit dans une démarche concertée au plan européen. Il reste qu’il faudra être attentif à ce que l’industrie bancaire européenne ne reste pas seule à supporter le coût, nécessaire, d’une telle mesure : si le président des États-Unis a annoncé, en janvier dernier, la création d’une « taxe de responsabilité » sur le secteur financier, ce projet reste encore dans les limbes… Les membres du G20 demeurent, à ce stade, divisés sur cette question.
2.– Mieux responsabiliser les dirigeants
La crise ayant été le fruit d’une prise de risque excessif des banques, notamment, et plus généralement des acteurs financiers, la mise en place d’instruments simples réduisant les tentations de prise de risque incontrôlée semble nécessaire. En analysant les crises bancaires et financières depuis les années 1930, on ne peut que constater l’intervention systématique des autorités monétaires et de l’État pour limiter les pertes. Comme on l’a vu, l’aide cumulée du Royaume-Uni, des États-Unis et des États membres de la zone euro à leur système bancaire se serait montée au cours de la dernière crise à 14 000 milliards de dollars, soit près du quart du PIB mondial, d’après l’étude précitée de la Banque d’Angleterre. Selon les auteurs de cette étude qui dépeint le retournement du statut de prêteur entre les banques et les États depuis le Moyen-âge, aujourd’hui « les banques doublent la mise du risque, les autorités publiques ouvrent le filet de sécurité tout en répétant : « Plus jamais », et le scénario se renouvelle indéfiniment. »
Dans ces conditions, il convient d’encourager la responsabilité des actionnaires afin d’éviter l’aléa moral ou la sous-estimation systématique du risque par les banquiers, qui sont toujours « sauvés » par l’État-providence selon la logique souvent dénoncée de « privatisation des profits » et de « socialisation des pertes ». En Europe comme aux États-Unis, la responsabilité limitée n’a été introduite dans le système bancaire qu’au XIXème siècle. Jusqu’à la crise des années 1930, les activités bancaires et financières ne bénéficiaient d’aucune garantie de la part des États. Si Goldman Sachs a résisté à la crise, il convient de rappeler que cette banque d’investissement est une société à responsabilité illimitée, comme d’ailleurs les établissements de hedge funds dont l’activité s’est développée hors réglementation et sans aucun soutien de l’État.
Sous l’actuel régime de responsabilité limitée, le contrôle des risques incombe majoritairement aux seuls créanciers, d’où une perte de contrôle dans un système devenu opaque, incontrôlable et d’une sophistication telle que la situation a échappé aux investisseurs « avertis » comme aux régulateurs. Ne peut-on pas envisager un dispositif tendant à restaurer cette sanction, de fait disparue en raison tant du « too big to fail » – trop gros pour faire faillite – que du chantage potentiel que permet souvent l’adossement à des structures recevant les économies des particuliers ?
Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, a exposé sans ambage devant la commission d’enquête la problématique qu’il convient de retenir : « Dans les années qui ont précédé la crise, les acteurs du système financier ont dégagé des profits immédiats, en laissant à d’autres une ardoise sans précédent. Un système dans lequel les investisseurs peuvent transmettre leur passif, sans assumer les conséquences de leurs décisions, invite à la plus nocive des spéculations.» (226). Elle a annoncé l’engagement d’une réflexion sur « la résolution des situations de crise, afin d’organiser les mécanismes de redressement et de réorganisation qui s’appliquent quand la situation est désespérée ».
La Commission européenne a également engagé des réflexions en ce sens, et récemment proposé un cadre européen pour la gestion des crises dans le secteur financier.
LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE La Commission a présenté, le 20 octobre 2010, un dispositif visant à coordonner les activités de surveillance financière menées par les autorités de régulation et les gouvernements de l’Union européenne, afin de mieux détecter les banques en difficulté et de prendre les mesures appropriées. « Aucune banque ne devrait être si grande ou si interconnectée que sa faillite ne puisse être envisagée », selon M. Michel Barnier, commissaire chargé du marché intérieur. Les banques présentes dans plus d'un pays de l'Union européenne feraient l'objet d'une plus grande vigilance. La nouvelle Autorité bancaire européenne apporterait son aide aux autorités de régulation nationales en cas de crise. Les banques seraient tenues d'alimenter un fonds national permettant de couvrir le coût des faillites bancaires. D'autres mesures sont également proposées : – préventives : obliger les établissements et les autorités à préparer des plans prévoyant l'éventualité d'une faillite ou de graves difficultés financières ; – curatives : habiliter les autorités de régulation à obliger les banques en déroute à remplacer leurs cadres dirigeants, à mettre en œuvre un plan de relance ou à réduire la part de leurs activités présentant un risque excessif ; – et de résolution des défaillances : permettre aux autorités d'ordonner la reprise d'une banque ou d'une entreprise défaillante par un autre établissement, ou de transférer tout ou partie de ses activités vers une « banque relais » temporaire. Cette mesure permettrait d'assurer la continuité des services essentiels d'une banque tout en gérant correctement sa faillite. Toutes ces propositions seront précisées au printemps 2011, dans le cadre d'un « paquet » législatif consacré à la gestion des crises du secteur bancaire et des sociétés d'investissement. |
Ces démarches convergentes et complémentaires aux échelons national et communautaire méritent d’être soutenues.
Proposition n° 21 : Prévoir les dispositifs appropriés pour faire en sorte que les pouvoirs publics ne se voient plus, en cas de crise, acculés au renflouement d’établissements financiers qui ont pris des risques excessifs. |
Dans le même ordre d’idées, il y a lieu de signaler que la France et l’Allemagne ont trouvé, le 26 novembre 2010, un accord sur une proposition tendant à assurer une participation des investisseurs privés à d’éventuelles défaillances de dette souveraine.
UN MÉCANISME DE GESTION DE CRISE POUR APRÈS 2013 : Le 22 novembre 2010, face à la crise irlandaise, la chancelière allemande, Mme Angela Merkel, déclare que la situation de la zone euro est « exceptionnellement grave » et réaffirme sa détermination à faire participer les investisseurs privés à d’éventuelles défaillances de dette souveraine pour les titres émis après 2013 – date à laquelle prendra fin l’actuel fonds de stabilisation. Le 23 novembre 2010, face à l’aggravation de la défiance vis-à-vis des « pays périphériques » de la zone euro, et singulièrement de l’Irlande, l’Allemagne et la France déclarent vouloir finaliser le plus rapidement possible le plan de sauvetage de l’Irlande, mais aussi engager sans délai les discussions sur le futur mécanisme de gestion des crises. Le 24 novembre 2010, la presse se fait l’écho des propositions allemandes et notamment la mise à contribution des investisseurs en cas de difficultés concernant les futures émissions obligataires. Les « spreads » sur les obligations d’État irlandaises et portugaises atteignent des records. Le 28 novembre 2010, face aux réticences de la France, qui craignait qu’un tel dispositif ne constituât un signal négatif pour les marchés, et après quatre jours de négociation, la France et l’Allemagne parviennent à un accord : l’Allemagne accepte de renoncer à une participation « automatique » du secteur privé au profit d’un traitement au cas par cas lors des crises de liquidité ou de solvabilité des États membres de la zone euro. En vertu de ce mécanisme, il sera demandé aux banques de continuer à participer au financement des États en difficulté en cas de fourniture de liquidités par les pays partenaires et le Fonds monétaire internationale (FMI). En cas de crise de solvabilité, s’il y a restructuration de la dette de l’État concerné, elle sera décidée en vertu de clauses d’action collectives qui devront être adoptées à la mi-2013. Il s’agit à ce stade d’une proposition conjointe franco-allemande qui doit encore être soumise aux autres États membres et être formalisée. |
Cette proposition paraît aller dans le bon sens. En effet, les marchés ont souvent un intérêt objectif à attaquer une monnaie. Il est bon que la parole publique contribue à les convaincre qu’à continuer ce jeu, ils courent le risque d’une restructuration de dettes souveraines, dont ils ne sortiront pas indemnes.
Proposition n° 22 : Développer une parole publique, appuyée sur des dispositifs concrets tels que la proposition franco–allemande du 28 octobre 2010, pour persuader les opérateurs spéculatifs que d’éventuelles attaques ne peuvent que conduire à des restructurations de dettes souveraines susceptibles d’entraîner, pour eux, une pénalisation financière substantielle. |
Si les banques, et plus généralement, les établissements réalisant des opérations de même nature, étaient désormais véritablement exposées au risque de faillite, l’adoption d’un statut de responsabilité élargie des conseils d’administration, suggéré par M. Jean-Claude Gruffat, directeur général de Citigroup France, lors de son audition par la commission d’enquête, pourrait être une piste intéressante. Prenant l’exemple de Citigroup, il évoque d’abord la sanction du marché : « le Trésor américain a fourni un soutien de 45 milliards de dollars, en deux tranches de 20 et de 25 milliards, et la Federal Deposit Insurance Corporation – la FDIC, l’organisme fédéral qui assure les dépôts des particuliers – a garanti un portefeuille d’actifs dits toxiques de plus de 300 milliards. Sur sept trimestres consécutifs, les pertes du groupe ont atteint 110 milliards de dollars. Mais la recapitalisation, par dilution massive des actionnaires, est telle aujourd'hui que nous sommes mieux capitalisés qu’avant la crise. Les actionnaires antérieurs ont été « lessivés », les dirigeants ont été changés : on a donc une équipe nouvelle et des actionnaires nouveaux, situation que l’on a peu vue en Europe. La sanction du marché a été effective. » (227)
Puis, il suggère d’aller plus loin : « la première chose à faire est de responsabiliser les conseils d’administration. (...) En France, les « dirigeants responsables » des établissements bancaires font l’objet d’une procédure d’accréditation (…) par l’Autorité de contrôle prudentiel. Les autorités de place ont donc un interlocuteur qui répond de la conformité des opérations à la réglementation. Mais aucune procédure de ce type n’existe pour les conseils d’administration, devant lesquels les « dirigeants responsables » sont pourtant eux-mêmes responsables. (…) Ce qui est maintenant souhaitable, c’est une responsabilité sur le plan civil, voire sur le plan pénal. Cela devrait changer les comportements. » (228)
Ces propositions méritent en effet réflexion.
Proposition n°°23 : Engager une réflexion sur les conditions dans lesquelles la responsabilité des membres des conseils d’administration des établissements bancaires et financiers pourrait être engagée en cas de manquement à leurs obligations et de « mauvaise gestion » (retrait d’agrément, amendes, interdiction d’exercer…). |
3.– S’interroger sur l’intérêt d’une meilleure distinction entre les activités de banque de dépôt et de banque d’investissement
Dans le cadre de l’examen des dispositions à prendre pour mieux réguler l’activité bancaire, il convient de se pencher sur l’idée, chère au Président de notre commission d’enquête, tendant à une séparation des activités de banque de dépôt et de banque d’investissement ou « d’affaires », qui pourrait permettre, ainsi qu’il l’a souligné lors de nos travaux, de limiter à la fois les risques encourus par les particuliers et les moyens dont dispose la spéculation.
Lors de son audition par la commission d’enquête, M. Jean-Claude Gruffat, directeur général de Citigroup France, branche française d’un groupe mondial dont les actifs financiers se montent à quelque 2 200 milliards de dollars, a également avancé cette idée : « Alors qu’un régulateur de marché est tenté de réguler en demandant plus de capital et de liquidité, il me semble qu’une première règle doit s’imposer : si spéculation il y a, elle ne doit pas être menée avec l’argent du public. C’est ce que les Américains ont tenté d’imposer avec la « règle Volcker » et le Dodd-Frank Act, qui visent à s’assurer que la spéculation se fasse avec des fonds propres ou des fonds ayant fait l’objet d’un emprunt à risque, non avec ceux des déposants. » (229)
Cette idée est inspirée du Glass-Steagall Act pris en 1933 aux États-Unis.
LE GLASS-STEAGALL ACT Glass-Steagall Act (du nom de ses promoteurs, le sénateur Carter, et le représentant Henry Steagall) est l'appellation généralement utilisée pour désigner le Banking Act de 1933 aux États-Unis. Motivé par les paniques provoquées par le krach de 1929 chez les déposants qui craignaient se voir spoliés à la suite de la faillite des banques qui avaient enregistré de lourdes pertes, ce texte a établi une incompatibilité entre les activités de banque de dépôt et de banque d'investissement ; seules habilitées à effectuer des opérations sur titres et valeurs mobilières, et mis en place un système fédéral d'assurance des dépôts bancaires. Privant les sociétés se livrant aux activités d’investissement de la surface financière que leur offrait précédemment l'adossement à des structures de dépôt et de la possibilité de « chantage à la faillite » qui en résultait, ce texte, parfois contourné, a été opportunément abrogé, le 12 novembre 1999, dans un contexte de dérégulation systématique, par le Financial Services Modernization Act (Gramm-Leach-Bliley Act), permettant ainsi la fusion de la banque Citicorp et de la compagnie d'assurances Travelers group, donnant naissance à Citigroup, l'une des plus puissantes structures financières mondiales. Nombre d'observateurs estiment que le maintien de la législation conçue après la crise de 1929 eût sans doute limité la course effrénée au risque à laquelle se sont livrées les banques américaines dans la première moitié de la décennie. En état de cause, on peut noter que, lors de la crise des subprimes, le Trésor américain a dû fournir à Citigroup, né de l'abrogation du Glass-Steagall Act, un soutien de 45 milliards de dollars, tandis que la Federal Deposit Insurance Corporation garantissait un portefeuille d’actifs « toxiques » de plus de 300 milliards de dollars. Sur sept trimestres consécutifs, les pertes du groupe ont atteint 110 milliards de dollars. Dans le cadre de la discussion de la nouvelle régulation bancaire américaine (loi Dodd-Frank), l’ancien gouverneur de la Réserve fédérale Paul Volcker a avancé l’idée d’un retour au Glass-Steagall Act, se heurtant à un lobbying bancaire intense. Le texte finalement adopté se borne à poser des limites au capital que les banques peuvent consacrer aux activités risquées (investissement dans les hedge funds, trading pour compte propre, spéculation sur les marchés dérivés). Concrètement il leur est interdit d'y consacrer plus de 3 % de leurs fonds propres de première catégorie. |
Une telle suggestion, qui bat en brèche le modèle français de banque universelle, a fait l’objet d’une réponse prudente, mais ouverte, de la part de M. Jean-Pierre Jouyet, président de l’AMF : « En ce qui concerne [cette] question (…), je vais voir aux États-Unis si la réponse qui y est apportée dans le cadre de la Volcker Rule et de la loi Dodd-Frank me paraît bonne, en examinant aussi les exceptions prévues. Une réflexion est également en cours au Royaume-Uni. Quel que soit notre propre modèle d’organisation bancaire et financière, le fait que d’autres s’orientent dans cette voie doit nous conduire à nous interroger. » (230)
M. François Pérol, président de la Fédération bancaire française, s’est pour sa part montré pour le moins réservé : « la distinction entre compte propre et compte de tiers est en pratique difficile à effectuer pour les banques qui veulent rendre à leurs clients, et notamment aux grandes entreprises, tous les services qu’ils attendent, du crédit au financement de marché – puisque les entreprises connaissent toutes désormais, elles l’ont appris de la crise, la nécessité de diversifier leurs modes de financement. Nous attendons donc de voir comment la Volcker Rule sera appliquée en pratique. Chacune des banques de notre fédération a sans doute un pourcentage différent d’opérations pour compte propre dans le total de ses activités, sans compter les divergences d’interprétation. Chacune décide aussi de ce qu’elle veut faire de son bilan. À titre d’exemple, mon établissement a décidé de placer en gestion extinctive les activités de compte propre lorsque ce n’était pas utile à nos clients, d’abord parce que ces activités mobilisent des fonds propres importants, ensuite, il faut bien le dire, parce que nous n’avons pas été brillants par le passé en ce domaine et, enfin, parce que ces activités ne répondent pas à notre vocation. Mais d’autres peuvent faire des choix différents. » (231)
D’autres intervenants se sont montré plus allants sur le sujet. Ainsi, M. Michel Aglietta, conseiller au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII), a-t-il estimé : « il faut séparer [l’activité de compte propre des banques] dans des filiales capitalisées séparément, qui ne contaminent pas la banque, qui ne soient pas « subventionnées » par elle et qui ne mettent pas les dépôts en danger. » (232). M. Édouard Tétreau, auteur du livre Analyses : au cœur de la folie financière, a également partagé cette analyse (233).
Cependant, il ne faut pas négliger l’argument de poids avancé par Mme Danièle Nouy, secrétaire générale de l’Autorité de Contrôle Prudentiel : « Si nous ne sommes pas partisans en France de l’amendement Volcker, c’est précisément parce qu’il va pousser en dehors du champ du contrôle des opérations susceptibles de mettre le système financier en grave danger. Je vous renvoie au cas du hedge fund LTCM. » (234) (235)
On observera, en tout état de cause, qu’une certaine opacité règne sur la part de l’activité des banques françaises consacrée au « compte propre ». M. François Pérol, a indiqué que, pour le groupe Banque Populaire Caisses d’Épargne qu’il dirige, les activités pour compte propre représentent 20 % des activités de marché. La Fédération bancaire française ne dispose pas de statistiques, ni même l’Autorité de contrôle prudentiel, dont la secrétaire générale, Mme Danièle Nouy, a indiqué à la commission d’enquête qu’« il est très difficile de distinguer, parmi les opérations de trading, celles qui sont faites pour le compte de la clientèle et celles qui sont faites pour compte propre. Il suffit qu’une banque tarde à couvrir une opération pour le compte de sa clientèle pour que le doute soit possible (…) Nous pouvons interroger les établissements, mais je ne peux pas vous fournir un tableau de chiffres qui ferait clairement la part entre les deux. » (236)
Il semble que l’on peut raisonnablement situer cette part à au moins 10 %, étant précisé que le produit net bancaire provient, à raison de 60 à 65 % des opérations de la clientèle, pour 20 à 25 % des opérations de marché, le reste, 10 à 15 %, étant imputable à la gestion d’actifs.
Même si les arguments militant contre la séparation des deux activités, qui peut en outre faire l’objet de contournements, ne manquent pas de pertinence, du moins est-il légitime que soit engagé, dans notre pays, un débat qui se développe dans les pays accueillant les principales places bancaires – États-Unis et Royaume-Uni (237).
Proposition n° 24 : Engager une réflexion sur l’intérêt et les moyens d’établir une distinction entre les activités de banque de dépôt et celles de banque d’investissement. |
En tout état de cause, ces deux types d’activités doivent être mieux identifiées et mieux suivies. Les établissements devraient, en particulier, porter une plus grande attention aux résultats et aux risques liés aux activités de marché, et communiquer davantage sur ces données.
Proposition n° 25 : Assurer une meilleure identification et un meilleur suivi, par les établissements eux-mêmes et les régulateurs, des opérations, des résultats et des risques liés aux activités de marché, sur lesquelles règne une opacité certaine. |
4.– Suivre avec vigilance l’application, notamment aux États-Unis, des règles prudentielles du Comité de Bâle
Même si l’on peut, comme on l’a vu, s’interroger sur la pertinence des règles prudentielles dites de « Bâle II » (cf. deuxième partie, II, A, 3, f)) il reste que cette « loi » internationale doit être appliquée par l’ensemble des établissements, sous peine à la fois de distorsions de concurrence et de la persistance de risques systémiques.
Or, les États-Unis ont pour le moins « traîné les pieds » pour appliquer les règles de « Bâle II », appliquées en Europe depuis quatre ans : on en est simplement à la promesse d’une application outre-Atlantique en 2011.
L’échange intervenu en commission d’enquête lors de l’audition de M. Jean-Claude Gruffat, directeur général de Citigroup France (238), est significatif à cet égard :
LES RÉTICENCES AMÉRICAINES À APPLIQUER M. Jean-François Mancel, rapporteur. Vous avez évoqué Bâle II mais nous en sommes maintenant à Bâle III. À cet égard, certains de vos confrères craignent que les Européens ne se tirent une balle dans le pied en faisant des efforts pour apporter plus de capital, alors que les Américains n’appliquent même pas Bâle II. M. Jean-Claude Gruffat. C’est inexact pour deux raisons. En premier lieu, dans les pays autres que les États-Unis, les banques américaines fonctionnent dans le cadre de filiales assujetties au droit de ces pays (…) Depuis le 1er janvier 2008, toutes les banques opérant en Europe sont soumises aux règles de Bâle II. Seules les entités américaines opérant sur le territoire des États-Unis ne sont pas tenues par ces règles (…). En second lieu, les dix-huit ou dix-neuf principales banques américaines qui opèrent sur les marchés internationaux et qui représentent environ 90 % du marché bancaire intérieur – les quelques milliers d’autres banques étant de taille locale ou régionale – seront soumises à Bâle II à partir d’avril 2011. Nous sommes donc dans une logique de pré-Bâle II. M. le président Henri Emmanuelli. Et Bâle III ? M. Jean-Claude Gruffat. L’application sera progressive. On est en train d’en définir les règles. M. le président Henri Emmanuelli. Il est cependant étonnant que l’on travaille sur Bâle III en Europe alors que Bâle II ne s’appliquera aux États-Unis qu’en avril prochain. M. Jean-Claude Gruffat. Le blocage, en l’occurrence, ne vient ni de la Fed, ni du Trésor, ni de la FDIC, mais du Congrès. Celui-ci considère que le système bancaire américain doit rester éclaté, pour protéger les banques locales contre les monstres de Wall Street. Or les règles de Bâle I réclament plus de capital. Celles de Bâle II établissent une différenciation des exigences de capital en fonction des types d’activité et représentent pour les très grandes banques, je le répète, une diminution de ces exigences. Du reste, la preuve que le système de Bâle II n’est pas satisfaisant est que l’on élabore déjà un Bâle III, alors que l’on a conservé Bâle I pendant vingt ans. Bâle II n’est en application en Europe que depuis janvier 2008. M. Jean-François Mancel, rapporteur. Mais les Américains ne l’adopteront qu’à partir d’avril 2011... M. Jean-Claude Gruffat. Parce qu’ils en ont assez de s’entendre dire qu’ils ne l’appliquent pas et que la concurrence s’en trouve faussée. |
Cette expérience doit inciter les autorités françaises et européennes à la plus grande vigilance sur l’application des règles de « Bâle III » aux États-Unis et à s’efforcer d’en obtenir l’application la plus large possible au niveau mondial.
Proposition n° 26 : Être vigilant sur les conditions dans lesquelles les États-Unis appliqueront les règles prudentielles élaborées par le Comité de Bâle et s’efforcer d’obtenir l’application le plus large, au niveau mondial, de ces règles, peut-être, ainsi que le suggère le Parlement européen, en les intégrant dans des traités internationaux. |
5.– Empêcher le développement de la banque parallèle (shadow banking)
Il conviendrait également d’être particulièrement attentif à ce que le durcissement de la régulation des banques ne favorise pas le développement de ce qu’il est convenu d’appeler le shadow banking (banque parallèle ou activité hors bilan des banques) – mouvement déjà observé à l’occasion de la mise en œuvre de « Bâle II » – avec le transfert d’activités financières à des acteurs parabancaires tels que les fonds d’investissement, voire les assureurs.
M. François Pérol, président de la Fédération bancaire française, a évoqué ce risque, ou cette tentation, devant la commission d’enquête : « On demande aux établissements de changer le numérateur de leur ratio de solvabilité, en ayant la sagesse de leur laisser le temps de s’adapter. Mais il ne faut pas oublier qu’il y a aussi un dénominateur – les risques qu’ils prennent ! Si la contrainte sur le numérateur est encore accentuée, les établissements devront ajuster le dénominateur, c’est-à-dire prendre moins de risques ou les sortir de leur bilan. Cela débouchera sur un modèle de banque moins intermédié que ce qu’il est aujourd’hui en France, avec plus de marché, plus de titrisation et moins de crédit ». (239)
On ne peut que souscrire à cet égard aux déclarations faites le 2 décembre 2010 par M. Axel Weber, président de la Bundesbank : « tout ce qui ressemble à une banque et se comporte comme une banque doit être soumis aux mêmes règles et aux mêmes contrôles qu’une banque ».
Naturellement, une telle surveillance ne pourrait avoir de véritable portée qu’au niveau international. Or, force est de constater qu’il y a eu peu d’avancées sur ce point.
Proposition n° 27 : Mettre en œuvre, au niveau international, les moyens, juridiques et opérationnels, nécessaires pour assurer un suivi et une sanction des activités dites de shadow banking (banque parallèle), dont le développement est susceptible de vider de sa substance le système prudentiel résultant de « Bâle III ». |
Il conviendrait, en outre, de profiter de la stabilisation du système financier mondial et de la remontée de la profitabilité des banques pour envisager de remédier à quelques faiblesses de « Bâle III », en particulier :
– s’interroger sur le maintien, dans les fonds propres, des actifs incorporels, dont – il est vrai – le montant se trouvera limité par « Bâle III » (plafonnement à 15 %) ;
– voir s’il est possible de comprimer la phase de transition.
Proposition n° 28 : Remédier, dès que la situation du secteur bancaire le permettra, à deux faiblesses de « Bâle III » : le maintien, dans les fonds propres, d’actifs incorporels et la durée excessive de la phase de transition. |
6.– Surveiller attentivement les effets de la mise en œuvre des règles de « Bâle III » sur le financement par les banques des entreprises et des particuliers
Comme on l’a vu, la réglementation de « Bâle II » a eu d’incontestables effets pervers. Il faudra veiller à ce que la mise en œuvre de « Bâle III » ne provoque pas de tels inconvénients.
Il est clair que ces nouvelles règles risquent de modifier sensiblement le paysage bancaire. D’où la nécessité de conserver une capacité d’intervention s’il apparaît, à l’usage, que ces règles prudentielles font obstacle au développement des activités de financement des entreprises et des particuliers.
En particulier, plusieurs des personnalités entendues par la commission d’enquête ont craint que les règles de « Bâle III », comme les règles de « Solvabilité II », n’aient pour effet de dissuader les investisseurs institutionnels de se porter sur le marché des actions.
Selon M. Patrick Artus, directeur de la recherche et des études économiques de Natixis, « la règlementation des banques et des assurances prend une orientation inquiétante. Loin de moi l’idée de critiquer les efforts faits pour la renforcer, mais ce travail est mené en réaction à la crise qui a précédé. Aujourd’hui, les règles en matière de fonds propres incitent tous les intermédiaires à augmenter leurs portefeuilles de titres publics au détriment de leurs portefeuilles de titres privés, au moment même où des doutes surgissent à propos de cette dette (...). Solvabilité II exige 0,41 euro de fonds propres par euro d’action détenue ; 0,23 euro par euro d’obligation d’entreprise et zéro centime par euro de titre public détenu. L’incitation est très forte à réduire la part des titres d’entreprise (...). Pour les banques, il en va de même, les titres publics sont considérés comme des réserves de liquidité en cas de crise. Je crois que l’on va un peu loin dans la pénalisation relative de la détention de titres d’entreprise (...). Les banquiers américains ou européens, empêchés par la nouvelle réglementation, et les assureurs européens, contraints par Solvabilité II, laisseront la place aux « non-banques » ou aux banques qui ne sont pas régulées, aux acteurs offshore et aux fonds divers et variés. L’industrie des hedge funds est d’ailleurs en train de se transférer en Asie (240)».
M. Augustin de Romanet, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, a tenu un discours similaire : les « futurs accords Bâle III, de Solvabilité II et des normes IFRS – International financial reporting standards –, (...) rendent la détention d’actions fort « inamicale » pour l’ensemble des opérateurs financiers (...) », ce qui l’a conduit, avec d’autres investisseurs de long terme européens, à présenter au commissaire européen M. Michel Barnier, à la fin du mois de septembre 2010, un mémorandum qui « recommande d’aménager les règles applicables aux investisseurs à long terme, statut qu’il faut d’ailleurs promouvoir dans la sphère privée : aménagement de la règle comptable de marquage au marché d’une part, assouplissement des règles relatives aux liquidités et à la solvabilité de l’autre ; faute de quoi il ne sera plus possible d’investir en actions (241) ».
M. Bernard Spitz, président de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), évoquant le rôle d’« amortisseur » des assureurs pour l’économie réelle, a estimé que ce modèle était menacé par « Solvabilité II », ainsi que par l’adoption des règles comptables IFRS : « Les assureurs français, du fait de l’histoire et de la structuration de l’épargne nationale, seront davantage touchés que d’autres par les exigences posées en matière de fonds propres, s’agissant des actions, jugées potentiellement plus volatiles que d’autres actifs. Ils devront réévaluer leur portefeuille d’actifs, ce qui ne leur permettra plus de jouer leur rôle naturel d’investisseurs à long terme dans l’économie (...). La méthode de la juste valeur (fair value) est contraire à notre logique de long terme, puisque les actifs doivent être valorisés à leur valeur de marché à la date de clôture du bilan. Cette réforme aura pour conséquence d’introduire davantage de volatilité dans les résultats des assureurs [qui] seront tentés, avec l’adoption des normes IFRS et de la méthode de la juste valeur, de se détourner des actions ou de les vendre, ce qui accentuera l’effet procyclique (242) ».
Quant à M. Édouard Tétreau, auteur du livre Analyste : au cœur de la folie financière, gérant de MEDIAFIN, il a insisté sur l’enjeu de « Solvabilité II » : « N’oublions pas les « mains longues » (investisseurs de très long terme) privées et donnons-leur une réglementation adéquate. (...) Solvency [Solvabilité] II revient à accepter que les plus grandes entreprises européennes soient contrôlées par le reste du monde. Je ne crois pas que ce soit bénéfique (243) ».
Répondant à une question du Président de la commission d’enquête, Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, a partagé, devant la commission d’enquête, ces analyses convergentes :
« M. le président Henri Emmanuelli. À cet égard, [règlementation de Bâle III] les actions ne sont pas bien traitées, ce qui hypothèque l’avenir des entreprises.
Mme la ministre. Le reproche vaut aussi pour la réglementation Solvabilité II, qui oblige à décoter les actions pour prendre en compte le risque lié à leur détention. Nous travaillons à améliorer les textes d’application européens sur ce point, qui présentent une vraie difficulté (244) ».
Il s’agit là effectivement d’un problème crucial, d’autant qu’il conditionne aussi, à terme, la question de la détention des entreprises. Or, on ne saurait admettre que celle-ci, par l’effet d’une nécessaire règlementation, ne se concentre entre les mains d’investisseurs non régulés, qui plus est souvent localisés dans des juridictions qui ne « jouent pas le jeu » des règles internationales.
Proposition n° 29 : Veiller à ce que la mise en oeuvre des nouvelles règles prudentielles élaborées par le Comité de Bâle (« Bâle III ») et leur pendant en matière d’assurances (« Solvabilité II ») ne conduisent pas les investisseurs à se détourner des placements en actions, particulièrement en prévoyant des dispositions spécifiques aux investisseurs de long terme. |
On peut enfin s’étonner, s’agissant de « Solvabilité II », que les fonds de pension britanniques soient exclus de son champ d’application (245) ce qui conduit la commission d’enquête à formuler une recommandation de portée générale s’agissant du champ d’application de la réglementation issue du Comité de Bâle et de « Solvabilité II ».
Proposition n° 30 : Veiller, lors de la mise en oeuvre des réglementations prudentielles des banques (« Bâle III ») et des assurances (« Solvabilité II ») que leur champ d’application n’exclue ni certaines opérations, ni certains opérateurs, ni certains territoires, au risque de favoriser l’arbitrage réglementaire et le développement de la « banque parallèle ». |
La question des normes comptables doit également retenir l'attention. Elle n'est en effet pas sans lien avec certains mécanismes entraînant des mouvements que l'on peut qualifier de perturbateurs, à défaut d'être en droit de les qualifier de spéculatifs. Ces mécanismes ont été évoqués, comme on vient de voir, par M. Bernard Spitz, président de la Fédération française des sociétés d'assurances, et leur logique perverse exposée par M. Patrick Artus, directeur de la recherche et des études économiques de NATIXIS : « le mimétisme est favorisé par la combinaison de la réglementation comptable et de la façon dont sont jugés ces investisseurs. Depuis plusieurs années, on mesure les performances des investisseurs à long terme avec des instruments de court terme, par exemple en affichant les résultats des produits d’assurance-vie ou des caisses de retraite tous les mois ou tous les trimestres alors que leur horizon naturel est de cinq, dix ou trente ans. Cette évolution les incite à prendre des décisions qu’ils ne prendraient sans doute pas sinon, par exemple à acheter ce qui monte pour être aussi performants que les autres à court terme (…)Ainsi, l’appareil de mesure de la performance des investisseurs souffre d’un biais court-termiste systématique. Il n’est pas normal de juger la gestion d’un fonds de pension d’après sa performance trimestrielle plutôt que sur sa capacité à payer des retraites dans trente ans. Mais, dans le contexte actuel, il est obligé, à l’intérieur de chaque intervalle de temps, de commettre les mêmes bêtises que les autres pour être sûr de faire comme eux. Il y a un désajustement très profond entre l’horizon naturel des investisseurs et l’aune à laquelle ils sont jugés. Les normes comptables ont encore aggravé les choses puisque les fonds de pension, y compris publics et à horizon long, doivent produire des comptes trimestriels en valeur de marché. » (246)
À cet égard, il convient de souligner que la commission des finances de notre Assemblée a eu le mérite de se pencher très tôt sur cette situation, avec le rapport d’information (n° 1508) de nos collègues MM. Dominique Baert et Gaël Yanno relatif aux enjeux des nouvelles normes comptables, publié dès le mois de mars 2009.
L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET LES NORMES COMPTABLES Depuis une dizaine d’années, la comptabilité a connu des évolutions considérables, tant au plan international qu’au plan national, avec des conséquences importantes sur les entreprises et sur l’économie tout entière. Or, la reprise des normes IFRS (International financial reporting standards) par l’Union européenne et la modernisation du plan comptable général sont intervenues dans l’indifférence, sans intervention du politique, qui s’en est remis aux seuls experts. Alors que la comptabilité est, depuis la crise financière de l’été 2007, mise au banc des accusés, le rapport d’information (n° 1508 du 10 mars 2009) de MM. Dominique Baert et Gaël Yanno a eu le mérite de réintroduire le politique dans la matière comptable et d’apporter un éclairage sur les enjeux et les conséquences des nouvelles normes comptables. Si le rapport considère que les normes comptables seules, en particulier la « juste valeur », ne sont pas à l’origine de la crise financière, il observe cependant que, combinées aux normes prudentielles, elles ont eu incontestablement un effet procyclique. Dès lors que le prix des actifs évalué en « juste valeur » s’est effondré, les dépréciations que les banques ont été obligées d’inscrire dans leurs comptes ont réduit leurs fonds propres. Parallèlement, comme les agences de notation ont considérablement abaissé la note des produits structurés que les banques détenaient dans leur bilan – dès lors classés parmi les actifs « risqués » – leur besoin de fonds propres s’est accru encore afin de respecter les normes prudentielles. Les banques ont donc été contraintes de trouver très rapidement de l’argent frais, et pour ce faire, ont cédé des actifs afin de restaurer le niveau de fonds propres ; ces ventes sont intervenues alors que les marchés étaient déprimés et les acheteurs rares, et donc à un prix bradé qui a pesé plus encore sur les cours. |
Nul doute qu'il convient de corriger cette situation.
Proposition n° 31 : Réviser les normes comptables, notamment celles relatives à l'évaluation des titres à leur valeur ponctuelle de marché, afin d'éviter, pour les investisseurs de long terme, la nécessité d'adopter des comportements court-termistes susceptibles de déstabiliser les marchés. |
IV.– ASSURER UN CONTRÔLE EFFICACE DES RÈGLES EN VIGUEUR
A.– DOTER LES RÉGULATEURS DES MOYENS D’EFFECTUER LEUR MISSION
Durant toutes les auditions, est apparue l’asymétrie des moyens humains et technologiques entre les spéculateurs et les autorités chargées de les contrôler et de les sanctionner.
Dans un contexte budgétaire contraint, grande peut être la tentation de réduire les crédits destinés aux autorités administratives indépendantes. Si cette préoccupation peut être légitime, il convient toutefois de ne pas procéder à une réduction uniforme qui priverait l’Autorité des marchés financiers des moyens de remplir ses missions.
Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie finances et de l’industrie, a déclaré devant la commission d’enquête : « Je considère aujourd’hui que l’AMF est prioritaire et qu’elle doit posséder les moyens de prévenir les risques financiers. » (247)
Il est, en effet, vital de permettre à l’AMF d’avoir les moyens de surveiller efficacement les marchés car, sans autorité de régulation efficace, toute réglementation serait vaine.
Proposition n° 32 : Adapter les moyens de l’Autorité des marchés financiers en fonction de l’importance des tâches nouvelles qui lui sont confiées dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de prévention des crises financières définies depuis 2008 par le G20. |
B.– RENDRE OPÉRATIONNEL TRÈS RAPIDEMENT LE COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE
La création du Comité européen du risque systémique (CERS) constitue une avancée importante dans la prévention des crises. La crise mondiale née de la crise des subprimes a bien montré que le risque le plus important qui pèse sur le système financier international est la propagation des difficultés d'un acteur ou d'une catégorie d'acteurs à tous les autres. Il est donc nécessaire d'examiner non seulement la situation des acteurs pris individuellement, mais aussi des liens établis entre eux et des interactions qui en résultent. En outre, il y a lieu de ne pas se limiter aux acteurs « institutionnels » tels que les banques, traditionnellement régulées, mais aussi à l'ensemble du « système bancaire fantôme » qui a, de fait, été à l'origine d'une grande partie des dérives ayant mené à la crise.
Selon votre commission d'enquête, il appartiendra au CERS d'élaborer, en liaison avec les banques centrales et comme le prévoit le règlement qui le crée, des indicateurs d'alerte permettant identifier les situations dangereuses (dérapage des prix de certains actifs, évolution « anormale » des spreads, dérapage du volume du crédit par rapport au PIB…).
Il lui reviendra également d'établir une méthodologie de stress tests permettant d’identifier notamment les risques de contrepartie. La médiatisation de ces tests n'est d'ailleurs pas forcément indispensable. On peut, en outre, s'interroger sur la pertinence de tests qui ont été passés avec succès par deux banques irlandaises il y a quelques mois (248)… On comprend bien les raisons de la publicité donnée aux tests réalisés à la fin du mois de juillet dernier – il s'agissait de rassurer les marchés –, mais l'objet de ces tests doit plutôt être d’identifier les risques très en amont pour tenter de leur porter remède avant que la spéculation ne puisse en tirer profit, le plus souvent en les accentuant, ce qui suppose, bien sûr, une extrême confidentialité.
Proposition n° 33 : Rendre opérationnel très rapidement le Comité européen du risque systémique : – en lui donnant la possibilité effective de superviser l'ensemble du système financier y compris le « système bancaire fantôme » ; – en prévoyant l'élaboration d'indicateurs d’alerte (dérapage des prix de certains actifs, évolution « anormale » des écarts de taux (spreads), dérapage du volume du crédit par rapport au PIB…) ; – en perfectionnant la méthodologie des stress tests dont la réalisation devra être entourée d'une plus grande confidentialité. |
C.– PROMOUVOIR LA COOPÉRATION DES AUTORITÉS DE RÉGULATION
« L’innovation est le produit de l’imagination d’une centaine de forts en thème et il est très difficile aux régulateurs nationaux de comprendre, d’anticiper le risque qui en découle. Cela exigerait de leur part une coordination internationale sans précédent – et des moyens au moins équivalents à ceux des grandes banques qu’ils doivent surveiller bien plus importants que ceux dont ils disposent aujourd’hui – des moyens au moins équivalents à ceux des grandes banques qu’ils doivent surveiller. » Le constat de M. Dominique Cerutti, directeur général de NYSE-Euronext (249), met en évidence le manque de moyens des régulateurs nationaux, mais aussi la nécessité de développer leur coopération. Sur le premier point, la commission d’enquête a pu constater la volonté d’augmenter les moyens aussi bien humains que financiers des autorités de régulation françaises.
En revanche, la coordination des autorités nationales demeure, comme on l’a vu, (cf. deuxième partie, II, D, 4), largement perfectible. La coopération internationale est insuffisante pour avoir un effet sur la spéculation. M. Jean-Pierre Jouyet, président de l'Autorité des marchés financiers, confirme que cette coopération doit être approfondie en matière d’échange d’information : « les enquêteurs de l’AMF se heurtent parfois à un défaut de standardisation des pouvoirs d'investigation des autorités » ; mais la coordination semble également améliorable en matière de sanctions. En effet, a souligné Mme Pervenche Bérès (250), présidente de la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen, rapporteure de la commission spéciale sur la crise financière et économique du Parlement européen, « les opérateurs de marché définissent leurs stratégies de localisation en fonction des sanctions applicable. »
La commission d’enquête considère primordiale la bonne coopération entre les autorités de régulation nationales. Heureuse innovation, la mise en place du Comité européen du risque systémique ne doit pas occulter le travail réalisé au quotidien par les autorités nationales de régulation. Ce travail, indispensable, doit être facilité par un échange d’information international rapide et harmonisé, au moins parmi les pays de l’Union européenne, mais si possible au-delà.
Les principales améliorations doivent concerner :
– la réduction du temps de réponse aux demandes de renseignement, notamment pour les demandes d’identification des donneurs d’ordres. Actuellement, la réponse aux demandes parvient au bout d’un ou deux mois ;
– la standardisation des déclarations des ordres (reporting) de façon à faciliter la consolidation des données reçues des différents régulateurs et portant, par exemple, sur un même titre ;
– l’harmonisation des pouvoirs des différentes autorités en matière d’enquête, garantissant notamment la réalisation de visites domiciliaires ou l’obtention des relevés téléphoniques dans d’autres juridictions.
Proposition n° 34 : Promouvoir la coopération des autorités de régulation, notamment dans les domaines suivants : – la réduction du temps de réponse aux demandes de renseignement ; – la standardisation des déclarations des ordres (reporting) ; – l’harmonisation des pouvoirs des différentes autorités en matière d’enquête. |
Face à la crise financière et économique la plus grave que le monde ait connue depuis les années 1930, crise que personne n'avait vraiment vu venir, les autorités responsables, au niveau du G20, de l'Union européenne et à l'échelon national, ont engagé un processus dont on peut espérer qu'il permettra de prévenir le retour d'un tel désordre, dévastateur pour nos économies.
Nombre de dispositifs ont été mis en place ou sont en cours d'élaboration, afin de mieux encadrer et contrôler des acteurs à qui l'on a trop laissé la bride sur le cou dans un contexte de dérégulation marqué par une foi trop absolue dans le caractère autorégulateur du fonctionnement des marchés.
Un mouvement est également lancé pour développer sur les marchés la transparence, qui est la condition indispensable à leur bon fonctionnement, ainsi que pour réglementer certains instruments dont le dévoiement a parfois permis le développement d'une spéculation débridée.
Il faut mettre fin à ce que d'aucuns ont appelé l’« économie de casino ».
Mais surtout – et c'est sans doute le plus difficile –, il est nécessaire de s'attaquer aux vrais maux qui ont permis à des acteurs, cédant à une pulsion sans doute inhérente à la nature humaine – la cupidité –, de mettre à profit l'opacité des marchés en utilisant les outils sophistiqués conçus par une ingénierie financière à l'imagination trop fertile.
Ces vrais maux sont le désordre financier international, qui prive de véritables repères producteurs et consommateurs et offre des perspectives de gains faciles sans véritable justification économique, et la déconnexion totale entre l'économie réelle et l’économie financière, alimentée par des politiques monétaires trop laxistes.
Les politiques semblent avoir pris conscience, à tous les niveaux, de leurs responsabilités. Mais le défi n'est pas mince et chacun devra veiller à ce que l'élan ne retombe pas. D’autant plus que les peuples eux-mêmes n’ont pas été exempts de ce laxisme qui alimente la spéculation.
Il faudra aussi que les États qui ont pris leurs responsabilités, notamment dans le cadre du G20, sachent persuader ou dissuader les États qui seraient tentés de rester ou de devenir des zones de « non droit », de rentrer dans le rang ou de ne pas en sortir, et évitent, pour eux-mêmes, le double discours. Il faut en effet se garder tout angélisme face à des intérêts qui renonceront difficilement à ce qu'il est convenu d'appeler le « business as usual ».
Modestement, votre commission d'enquête a cherché à donner quelques « coups de projecteur » sur certains phénomènes qui se sont manifestés dans la crise financière et de baliser quelques pistes pour l'avenir en invitant responsables et citoyens à la réflexion et à la vigilance.
Mais ne nous leurrons pas. La prochaine crise – et, hélas, elle viendra – ne prendra sans doute pas la même forme que celle que nous venons de subir. Gardons-nous donc des illusions : la ligne Maginot qu’à tous les niveaux – G20, Union européenne, États – nous sommes en train de bâtir, n’est sans doute pas à l’épreuve d’une éventuelle Blitzkrieg. Sachons aussi imaginer les outils qui permettront d’éviter une nouvelle débâcle financière et anticiper ses signes avant-coureurs…
La commission d’enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement des économies se réunit le mardi 14 décembre 2010 à 17 heures, sous la présidence de M. Henri Emmanuelli, pour examiner le rapport d’enquête de M. Jean-François Mancel, député.
M. le président Henri Emmanuelli. Nous voici arrivés au terme de nos travaux, notre commission n'ayant d'existence juridique que jusqu'au 24 décembre.
Après deux débats d'orientation et vingt-huit auditions, dont beaucoup étaient tout à fait passionnantes, notre rapporteur, M. Jean-François Mancel, a élaboré un projet de rapport.
Ainsi que vous en avez été avisés individuellement par courriel, il a, comme c'est la règle, mis ce projet à la disposition des membres de la commission d'enquête dès le jeudi 9 décembre au matin et je sais que certains d'entre vous en ont pris connaissance.
Nous sommes appelés aujourd'hui à nous prononcer sur ce projet de rapport. S'il est adopté, il fera l'objet d'un dépôt au Journal officiel et, sauf décision contraire de l'Assemblée constituée en comité secret – procédure il est vrai exceptionnelle –, il sera imprimé et distribué.
Les délais de procédure conduisent à une possibilité de distribution à compter du mardi 21 décembre au matin. Ce jour-là, M. Jean-François Mancel et moi-même tiendrons une conférence de presse à 11 heures. Naturellement, les collègues qui souhaiteront se joindre à nous seront les bienvenus.
D'ici là, les textes prévoient que le rapport demeure confidentiel. C’est pourquoi je vous remercie de bien vouloir restituer l'exemplaire qui vient de vous être remis, lorsque vous quitterez cette salle.
Je vous rappelle que vous aviez été invités à présenter, si vous l'estimiez nécessaire, des contributions écrites qui devaient être remises au secrétariat au plus tard hier à 17 heures. Les contributions dont j'ai été saisi seront publiées – à l’exclusion toutefois des documents annexés qui, conformément à l’usage, ne peuvent y être insérés.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. Je tiens tout d’abord à remercier M. Henri Emmanuelli pour la qualité de sa présidence, notamment pour son dynamisme, pour son efficacité et pour son ouverture d’esprit.
Le sujet était complexe : nous avons pu le mesurer au cours de ces vingt-huit auditions qui nous ont permis de rencontrer, en l’espace de trois mois, trente-sept personnalités très différentes mais toutes importantes dans le monde de l’économie et de la finance. Ces échanges nous ont montré qu’il est très difficile de réduire le problème de la spéculation à quelques idées simples, et les solutions en la matière au « y a qu’à ».
Le projet de rapport, dans sa première partie, décrit la spéculation, en s’appuyant à la fois sur des références historiques et sur les appréciations portées par les personnes que nous avons entendues. Pour résumer, il s’agit d’un phénomène utile, voire nécessaire, pour faire fonctionner les marchés, mais qui présente des risques, et peut même constituer un danger véritable, lorsqu’il prend une ampleur excessive. Toute la difficulté étant alors de savoir où placer le curseur : quand peut-on être certain que la spéculation devient négative, non seulement pour les marchés, mais également pour l’ensemble des acteurs économiques et pour nos concitoyens ?
La deuxième partie du rapport vise à montrer pourquoi elle a plus d’incidence que par le passé sur la vie économique, c'est-à-dire pourquoi, depuis plusieurs décennies, nous observons une sensibilité accrue des économies aux effets néfastes des phénomènes spéculatifs.
Dans la troisième partie, nous avons cherché à dégager des propositions. Certes, des réponses partielles ont déjà été apportées, notamment par le G20 précédent – le prochain G20 en apportera encore d’autres –, à quoi s’ajoutent les décisions prises par l’Union européenne ainsi que la loi de régulation bancaire votée par le Parlement français. Le rapport rassemble toutes ces mesures dans un tableau et, par ailleurs, mentionne également la loi adoptée sur le sujet aux États-Unis. En ce sens, il donne une photographie assez complète de la situation aujourd’hui. J’indique au passage qu’il comportera aussi, dans sa version définitive, un glossaire des nombreux sigles utilisés.
Nous avons émis trente-quatre propositions, ce qui n’est pas négligeable, compte tenu de la difficulté à trouver notre place à l’intérieur des dispositifs déjà prévus tant au plan européen qu’au plan mondial. Les deux premières mettent l’accent sur un sujet abordé dans la contribution de notre collègue Paul Giacobbi, à savoir la création de grandes masses de liquidités mondiales, lesquelles ont favorisé la spéculation. C’est pourquoi la première proposition vise à mettre à profit la présidence française du G20 pour avancer dans la réforme du système monétaire international, tandis que la deuxième souligne la contradiction actuelle des banques centrales européenne et américaine dont les dirigeants considèrent, d’un côté, qu’une masse trop importante de liquidités circule dans le monde mais, de l’autre, alimentent la croissance de cette même masse monétaire pour refinancer les banques : comme ces dernières, en effet, ne se font toujours pas confiance, les prêts interbancaires sont quasiment bloqués.
La proposition n° 3 aborde notamment la question soulevée par notre collègue Elisabeth Guigou à propos des mesures prises lors d’un précédent G20 en vue de résorber les paradis fiscaux, lesquels ne sont pas non plus étrangers à la spéculation. Nous proposons, dans le cadre de la présidence française du G20, la création d’une structure légère, mais permanente, garantissant, de présidence en présidence, l’indispensable suivi de ces actions.
La proposition n° 4 vise à tirer les conséquences de l'union monétaire en matière de conduite des politiques économiques et fiscales, en assurant un véritable contrôle des moyens que l’Europe attribue à certains pays. Je pense évidemment à l’Irlande, qui a bénéficié de fonds structurels représentant une part non négligeable de son PIB, ce qui lui a permis de faire du dumping fiscal. Or, celui-ci a provoqué le départ vers ce pays des sièges de nombreuses entreprises installés dans les autres États membres. Cette proposition vise donc notamment à permettre à l’Union d’assurer une « surveillance multilatérale » des crédits qu’elle alloue à certains de ses membres afin que ces crédits ne se retournent pas contre le bon fonctionnement du système économique et financier européen.
La proposition n° 5, quant à elle, vise à développer la coordination transatlantique sur l'ensemble des dossiers et actions touchant à la lutte contre la spéculation, en particulier la coopération des organismes dont se sont récemment dotés l’Europe et les États-Unis pour prévenir le risque systémique. En effet, si ces deux « tours de contrôle » ne confrontent pas régulièrement leurs données et leurs analyses, on aura du mal à déterminer ce qui se passe dans le trou noir qui en résultera. Par ailleurs, un paragraphe sur le monde asiatique a été ajouté, car la prochaine crise n’aura pas certainement plus pour cause les subprimes américains mais, peut-être, un dysfonctionnement ayant ce continent pour origine. Le G20 doit donc assurer un échange régulier d’informations entre les différents organismes qui seront mis en place.
Les propositions nos 6, 7 et 8 concernent plus particulièrement l’Europe. Lors de sa dernière audition devant la commission des affaires européennes, ouverte aux membres de notre commission, M. Michel Barnier a évoqué la révision en cours de la directive sur les marchés d’instruments financiers (MIF) de 2004, qui a complètement raté son objectif. Comment en effet réguler les marchés, si, comme M. Dominique Cerutti l’a souligné au cours de son audition, près de 95 % des transactions se déroulent en dehors des marchés régulés, dans le cadre des OTC – over-the-counter –, sans qu’on puisse savoir qui fait quoi ni comment ? Il est donc nécessaire de réintégrer dans des marchés contrôlés et régulés l’essentiel des transactions et, lorsque cela n’est pas possible, pour des produits hors normes, de prévoir une vérification pour éviter que des produits dérivés toxiques en trop grand nombre ne provoquent, comme en 2008, une nouvelle crise. Il faut donc, en bref, que la révision au printemps 2011 de la directive MIF assure un retour à la transparence des marchés.
La proposition n° 9 vise à créer une agence européenne de régulation des marchés agricoles sur le modèle du Commodity futures trading committee américain. Il convient, en effet, de ne pas s’en tenir au domaine financier strict, mais de nous occuper également des marchés de matières premières.
Les propositions nos 10 et 11 traitent des fonds alternatifs. L’Europe, vous le savez, a décidé de mieux les contrôler, grâce à l’octroi d’un « passeport européen ». Je suis rapporteur spécial de la mission « action extérieure de l’État » : sur la question des visas, j’avais observé une différence d’implication des pays membres de l’Union. Or, après un long débat au niveau européen, il a été décidé que le passeport des fonds alternatifs serait, lui aussi, attribué, non pas par une seule autorité, mais par les différents États membres. Même si ce doit être en fonction de critères définis par la Commission européenne, je crains qu’on ne retombe dans le même travers que pour les visas, et qu’en raison d’une implication différente des pays, les milieux intéressés n’apprennent très rapidement dans lequel il sera plus facile d’obtenir un passeport. Un vrai conflit a opposé les États membres sur le sujet et le compromis auquel on est parvenu n’est certainement pas le plus satisfaisant. C’est la raison pour laquelle la proposition n° 11 vise notamment à compléter la directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs par des dispositions permettant de mieux contrôler ces fonds et de limiter l'effet de levier des détenteurs du nouveau passeport européen.
La proposition n° 12 est très claire : elle vise à interdire les ventes à découvert « à nu » de produits dérivés de dette souveraine, ce dans un périmètre aussi large que possible. Je ne suis pas certain que nous obtenions satisfaction sur le sujet : toutefois, la proposition aura été formulée. Nous devons effectivement avoir le courage de dire certaines choses, même si elles ne font pas consensus sur les marchés financiers.
La proposition n° 13 vise, quant à elle, à aller plus loin en matière de délai de règlement-livraison pour les ventes à découvert. Ce délai est très variable selon les États-membres de l’Union européenne. En France, le délai est à J +3. La loi de régulation bancaire et financière a réduit ce délai à J +2 sous réserve d’un dispositif d’harmonisation équivalent au niveau européen ; nous proposons de passer à J+1 et de sanctionner tout retard. Actuellement, en effet, lorsque le délai n’est pas respecté, il y a rarement sanction : il convient de mettre un terme à une telle facilité.
Les propositions nos 14, 15 et 16 abordent la question du trading à haute fréquence. La proposition n° 15 ne tend à rien de moins qu’à encadrer, voire à interdire, de manière concertée, au moins à l'échelon européen, le trading algorithmique et le trading à haute fréquence, pratiques dépourvues d'utilité sociale. La proposition n° 16 est une proposition de repli qui vise à élargir le pas de cotation des valeurs – tick size en anglais – afin de limiter l'intérêt du trading à haute fréquence. Quant à la proposition n° 14, elle est d’application immédiate, puisqu’elle vise à assurer une surveillance effective de ces activités par l'Autorité de contrôle prudentiel.
Les propositions nos 17, 18, 19 et 20 concernent les agences de notation. La première, relative aux modalités de leur rémunération, vise à passer au modèle économique « investisseur-payeur », et, à tout le moins, à éviter que les émetteurs ne puissent choisir la meilleure des notes dont ils peuvent bénéficier. La proposition n° 18 a pour objet de demander aux banques centrales d'éviter toute référence aux notes des agences de notation et d'établir ou de renforcer leurs propres cellules d'analyse de risque.
M. Dominique Baert. De quels risques s’agirait-il en l’occurrence ? Les appréciations des banques centrales peuvent en effet porter sur la dette souveraine ou sur les dettes privées. De quelles dettes s’agit-il ?
M. le rapporteur. Il s’agit des risques liés aux conditions de refinancement.
M. Dominique Baert. Soit, mais les banques centrales peuvent se refinancer sur papier privé. Quelle est donc la nature précise des analyses de risque en question ?
M. le président Henri Emmanuelli. Elles porteraient sur l’ensemble des titres que les banques prennent en pension.
M. le rapporteur. C’est également mon avis.
M. Dominique Baert. C’est très vaste.
M. le rapporteur. C’est certain. Toutefois, il est difficile de faire la distinction entre papier public et papier privé parce que le résultat peut être le même.
M. Dominique Baert. La Banque centrale européenne intervient sur du papier financier normalisé. Or, lorsque le papier fourni pour l’économie française, et qui passe par la Banque de France, concerne le secteur privé, la cotation Banque de France sert de référence. C’est pourquoi la cellule d’analyse de risque pourra analyser les papiers financiers servant aussi bien au refinancement – dette souveraine et dettes privées – qu’à l’amélioration du mécanisme de cotation des entreprises françaises, de façon à renforcer encore la valeur de la norme de cotation. Un débat a du reste traversé les milieux autorisés pour savoir s’il ne fallait pas réduire le nombre des entreprises cotées. D’aucuns se sont même demandé s’il fallait maintenir les cotations Banque de France, voire s’il ne fallait pas qu’une autorité – la Banque de France a été citée – serve de base de cotation pour les collectivités territoriales – communes, départements et régions –, partant du principe que ce n’est pas du ressort des chambres régionales des comptes.
Ne conviendrait-il pas d’affiner la notion de « cellule d’analyse de risque » ?
M. le rapporteur. L’objet de cette proposition est de faire échapper les dettes traitées par les banques centrales à la seule appréciation des agences de notation.
M. le président Henri Emmanuelli. Nous souhaiterions que la banque centrale procède à ses propres cotations et à ses propres analyses plutôt que de s’en remettre aux agences de notation, du moins pour les titres qu’elle prend en pension.
M. Dominique Baert. L’approche ne peut pas être homogène.
M. le rapporteur. Les institutions publiques ne doivent pas être soumises aussi fortement qu’elles le sont aujourd'hui aux agences de notation. Cependant, on peut préciser la proposition : on ne saurait en effet imposer aux banques centrales de se doter d’énormes cellules d’analyse.
La proposition n° 19 vise à instituer un régime de responsabilité pour faute des agences de notation, en cas de non-respect des modèles de notation déposés en vue de l'agrément communautaire, et la proposition n° 20 à leur interdire de s'exonérer de leur responsabilité par voie contractuelle.
M. le président Henri Emmanuelli. Elles ne sont évidemment pas d’accord.
M. le rapporteur. Les deux propositions suivantes sont plus politiques, puisque la proposition n° 21 demande l’élaboration de dispositifs évitant aux pouvoirs publics d’être acculés, en cas de crise, au renflouement d'établissements financiers qui auraient pris des risques excessifs, tandis que la proposition n° 22 suggère de « développer une parole publique », en s’appuyant notamment sur la proposition franco-allemande du 28 octobre 2010, en vue de persuader les opérateurs spéculatifs que d'éventuelles attaques ne peuvent que conduire à des restructurations de dettes souveraines susceptibles d'entraîner, pour eux, une pénalisation financière substantielle. Les spéculateurs doivent courir un risque ! Ils doivent comprendre que les États ne seront pas toujours là pour éponger systématiquement les dettes.
Il est vrai que l’argument est difficile à utiliser dans la mesure où il peut instiller le doute, lequel peut aussi bien avoir pour effet de rappeler à la raison que d’inciter les investisseurs à se méfier des dettes souveraines et à faire monter les taux de la prime de risque. Cependant, comme nous ne sommes pas aux commandes, notre parole est plus libre que celle de la ministre de l’économie et des finances…
La proposition no 23 nous a été suggérée par M. Jean-Yves Cousin, à la suite de la remarque d’un banquier, M. Jean-Claude Gruffat, qui, lors de son audition, a invité à faire peser la responsabilité pleine et entière des décisions prises par les établissements financiers non pas seulement sur les présidents, mais également sur les membres des conseils d'administration.
La proposition n° 24 a, quant à elle, été suggérée par plusieurs remarques de M. le président de la commission d’enquête : elle vise à rouvrir la réflexion sur l'intérêt et les moyens d'établir une distinction entre les activités de banque de dépôt et de banque d'investissement. En Chine, les deux types de banques sont bien distincts et ne paraissent pas avoir excessivement souffert de la crise. Il semble cependant que la tendance actuelle soit plutôt en faveur de la banque universelle.
La proposition n° 25 est de repli, puisqu’elle demande simplement aux établissements de mieux identifier les opérations liées aux activités de marché, afin d’en assurer un meilleur suivi.
La proposition n° 26 est la première d’une série concernant les travaux du comité de Bâle. Elle recommande de se montrer vigilant sur les conditions dans lesquelles les États-Unis appliqueront les règles prudentielles élaborées par ce comité. Il est fort bien, en effet, de passer à « Bâle III » : encore faudrait-il que « Bâle II » fût appliqué aux États-Unis !
M. Yves Censi. C’est essentiel.
M. le rapporteur. Les États-Unis seraient décidés, dit-on, à appliquer « Bâle II » au début de l’année 2011 mais l’Union européenne se « tirerait une balle dans le pied » si elle s’imposait des règles que nos amis américains n’appliqueraient pas. Il convient du reste de noter que la proposition n° 26 vise à obtenir l'application la plus large, au niveau mondial, de ces règles, « peut-être, ainsi que le suggère le Parlement européen, en les intégrant dans des traités internationaux ». J’ignore si le Congrès américain, tel qu’il est actuellement composé, ratifierait un tel traité…
M. le président Henri Emmanuelli. Non !
Mme Arlette Grosskost. Une telle proposition suppose de partager les mêmes normes comptables.
M. le rapporteur. C’est l’objet de la proposition n° 31.
Les propositions nos 27 et 30 visent à lutter contre les activités des banques parallèles – le shadow banking. La première recommande la mise en place d’un suivi international et de sanctions pour éviter que le développement de ce secteur n’aboutisse à vider de sa substance le système prudentiel résultant de « Bâle III ». La seconde demande de veiller à ce que certains établissements n’échappent pas aux réglementations prudentielles des banques (« Bâle III ») et des assurances (« Solvabilité II »).
Quant à la proposition n° 29, elle met en garde contre le risque de voir l’application de ces mêmes règles prudentielles conduire les investisseurs à se détourner des placements en actions, ce qui ne serait pas sans conséquences sur l’économie réelle : c’est un réel sujet de préoccupation, selon Mme Christine Lagarde elle-même.
La proposition n° 31 concerne la révision des normes comptables, à savoir l’adoption des nouvelles normes IFRS – normes internationales d'information financière, en anglais international financial reporting standards. S’agissant notamment des normes relatives à l'évaluation des titres à leur valeur ponctuelle de marché, il s’agit « d’éviter, pour les investisseurs de long terme, la nécessité d'adopter des comportements court-termistes susceptibles de déstabiliser les marchés ».
Mme Arlette Grosskost. Très bien.
M. le rapporteur. Nous avons en effet constaté les conséquences funestes de ces modes d’évaluation, qui amplifient les mouvements spéculatifs.
La proposition n° 32 est à mettre en rapport avec un tableau, que vous trouverez dans le rapport, où l’on compare les moyens dont disposent différentes autorités agissant sur les marchés financiers. Or, autant l’Autorité de contrôle prudentiel paraît à même d’assumer ses tâches, autant l’Autorité des marchés financiers manque toujours de personnel, en dépit des augmentations d’effectif prévues, et peut-être – c’est plus difficile à mesurer – de moyens techniques. Il convient donc de faire un effort supplémentaire en faveur de l’AMF.
La proposition n° 33 insiste sur la nécessité de rendre très rapidement opérationnel le Comité européen du risque systémique, si on veut anticiper les crises à venir. Quant à la dernière proposition, n° 34, elle vise à promouvoir la coopération des autorités de régulation afin d’harmoniser leurs références pour l’observation des marchés. C’est un problème que M. Jean-Pierre Jouyet, le président de l’AMF, a largement évoqué lors de son audition. Il a en particulier signalé que le régulateur britannique ne notait que les transactions effectuées alors que le régulateur français note également les ordres qui ne se traduisent pas par une transaction concrète. Or, chacun sait qu’à travers le trading à haute fréquence, les carnets d’ordres peuvent représenter un formidable moyen d’agir sur la cotation d’une valeur.
Telles sont les trente-quatre propositions du rapport.
M. le président Henri Emmanuelli. Ce rapport, en raison de sa qualité, sera lu avec intérêt par les spécialistes. Les auditions ont d’ailleurs déjà donné lieu à certains articles de presse, dont un, tout à fait remarquable, dans Challenge, consacré au high frequency trading. Son auteur démontre d’ailleurs que M. Dominique Cerutti a oublié de nous dire beaucoup de choses ! Si nous en avions eu le temps, je l’aurais sans doute invité à revenir nous parler de cette salle informatique que sa société a construite aux États-Unis, en y consacrant quelque 500 millions de dollars : elle est destinée à ceux qui se livrent au HFT et l’on comprend dès lors mieux pourquoi il est hostile à l’interdiction de cette pratique : non seulement NYSE-Euronext en tire de 40 % à 50 % de son chiffre d’affaires mais, de plus, elle a investi pour louer ses services en la matière !
Je tiens également à souligner que ce rapport atteint presque à l’exhaustivité s’agissant des propositions que nous pouvons faire. Reste évidemment à déterminer où, pour telle ou telle, placer le curseur, pour ne pas mentionner l’éternelle question de savoir s’il convient d’attendre pour agir que tous les pays se soient mis au diapason, de peur d’hypothéquer la compétitivité de notre secteur bancaire. Le rapport a au moins le mérite d’ouvrir la réflexion sur à peu près tous les sujets, sans nécessairement conclure à chaque fois, ce qui laisse une marge de liberté. Il me convient donc, je le dis sans plus attendre, d’autant qu’il contient quelques propositions osées. Fallait-il les formuler alors qu’elles ont peu de chance d’être reprises ? Ne pas le faire, c’était s’exposer à être accusé d’aveuglement le jour où tel ou tel risque se concrétiserait. Ce rapport réalise donc un bon compromis : sans nécessairement conclure, il identifie tous les problèmes.
Il conviendrait toutefois d’éclairer la question du high frequency trading de quelques chiffres supplémentaires : 2,8 millions de transactions en une minute, « cela parle », comme on dit, plus qu’une longue démonstration !
Quant à la question de la distinction des activités de dépôt et d’investissement, les avis sont, ici même, partagés. Toutefois, les partisans d’une séparation stricte seraient sans doute minoritaires, en raison du sérieux des contrôles dans notre pays. De plus, cette séparation n’empêcherait peut-être pas les dommages collatéraux pour l’économie causés par un effondrement des banques d’investissement, compte tenu de leur taille – too big to fail. Néanmoins, il convenait certainement d’ouvrir, ou de rouvrir, ce débat aussi.
Je le répète : j’approuve ce rapport et je vous remercie, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Yves Cousin. Je tiens également à souligner la qualité de ce projet de rapport et je remercie tous ceux qui y ont contribué. S’agissant d’un sujet qui me tient à cœur, la responsabilité, les propositions n°s 20 à 23 en traitent successivement pour les agences de notation, pour les opérateurs spéculatifs et pour les banques. En règle générale, la responsabilité peut être engagée sur trois terrains : financier, civil et, éventuellement, pénal. J’aurais aimé, si possible, que le rapport soit plus précis, même si c’est difficile. La question de la responsabilité civile et pénale n’est abordée qu’à propos des membres des conseils d’administration des banques, mais celles-ci ne sont pas seules en cause. Je conviens que le sujet est très vaste, mais plus on responsabilisera, plus les risques seront circonscrits.
M. Dominique Baert. Après avoir feuilleté le rapport, je souscris aux compliments qui ont été faits. Il s’agit d’un superbe travail d’analyse et de mise en perspective des auditions. J’aurai cependant quelques remarques à faire.
Sur la forme, tout d’abord. Ces propositions s’adressent-elles aux autorités françaises et constituent-elles une feuille de route qui les guidera dans les discussions à venir ? Ou bien s’agit-il de déclarations d’intention plus générales ? Vous avez fait le choix, monsieur le rapporteur, de ne pas classer vos recommandations selon leur destinataire mais votre rapport ne gagnerait-il pas en lisibilité en les hiérarchisant ? Et leur formulation ne pourrait-elle pas être simplifiée pour les rendre plus percutantes ?
Quant au fond, si je partage le diagnostic et si j’approuve, en particulier, les pistes indiquées en ce qui concerne les agences de notation, il reste à définir qui doit s’affranchir de celles-ci. Et quels mécanismes de substitution ou de complément prévoir pour avoir partout un système de notation fiable et uniforme, ce dont la Banque centrale européenne, en particulier, a besoin ? Les agences de notation font de cet avantage – une présence très étendue permettant une évaluation homogène – leur fonds de commerce. Par ailleurs, notre collègue Gaël Yanno et moi-même avions fait, dans le cadre d’un rapport d’information de la commission des finances, des propositions sur les normes comptables internationales, destinées à aider les autorités françaises dans leurs négociations européennes et internationales. Il serait sans doute bon d’en rappeler au moins quelques-unes dans votre rapport. Vous suggérez, dans la proposition n° 31, de réviser ces normes, mais le faire ne dépend pas de nous. Tout au plus pouvons-nous soutenir l’idée auprès des instances appropriées. L’Europe a déjà fait ce travail pour les banques, mais, au-delà, il faut discuter avec les Américains. Pendant des années, le Parlement a négligé ces sujets et une piqûre de rappel ne serait sans doute pas inutile.
M. Yves Censi. À mon tour, je salue la qualité du rapport : sur ce sujet vaste et complexe, le travail de clarification qui a été accompli est vraiment remarquable et je ne doute pas qu’il fasse avancer la réflexion générale.
Le rapport évoque la séparation entre la banque de dépôt et la banque d’investissement. Le sujet mérite d’être fouillé mais a priori je ne suis pas sûr que l’étanchéité soit une protection suffisante en cas de cataclysme. En France, c’est plutôt la réglementation qui a permis d’éviter la catastrophe et, de ce fait, le cloisonnement entre les deux activités y apparaît moins utile que dans d’autres pays. La question des avantages de la banque universelle mériterait donc, à mon avis, d’être étudiée.
Nous sommes tous d’accord sur la nécessaire responsabilisation des agences de notation, mais elles ne doivent pas non plus devenir les boucs émissaires de la crise. Il ne suffit pas de casser le thermomètre pour faire tomber la fièvre et il ne faudrait pas les accabler pour mieux dédouaner les acteurs financiers eux-mêmes de leurs comportements délibérément myopes, sinon de leur cécité volontaire. Même si les remarques faites dans le rapport à propos de ces agences sont très justes, nous devons nous garder de tout excès à leur égard.
Enfin, je suis impressionné par la clarté des exposés et des propositions qui sont faites. Elle témoigne des qualités d’écoute de la commission d’enquête. Deux enjeux se dégagent de ce travail : l’indispensable harmonisation au niveau international tant des normes comptables et prudentielles que des moyens de la régulation ; et l’allongement de la durée des placements. Le rapport vise à juste titre le trading à haute fréquence, et suggère des solutions concrètes. Il insiste aussi sur la responsabilisation, qui passe tout d’abord par l’identification des acteurs et leur désignation. À cet égard, les propositions sont très intéressantes.
Le travail théorique étant maintenant achevé, le politique doit prendre le relais. Or, nous voyons bien combien il est difficile de partager une même vision et de parler le même langage, sur la scène internationale comme entre nous. C’est la première fois que, sur la question de la crise financière et sur les propositions de réforme, il nous est proposé un ensemble aussi cohérent, autour duquel il me semble possible de nous rassembler. Il importera donc de diffuser ce rapport auprès de nos collègues.
M. Dominique Baert. Dans les préconisations, aucune ne tend à interdire un produit spécifique, à l’exception des ventes à découvert « à nu » de produits dérivés de dette souveraine. Or, au début de nos travaux, nous nous étions interrogés sur le point de savoir si c’étaient les produits qui étaient dangereux ou les utilisations qui en étaient faites. Faut-il en déduire que le débat est tranché ?
M. le rapporteur. Sans qu’ils soient cités explicitement, les CDS « à nu » sont visés. La difficulté vient de la créativité en matière de produits dérivés, qui est infinie. Aussitôt que l’un d’entre eux est interdit, un autre apparaît. Nous avons donc opté pour un renforcement du contrôle de la part des autorités compétentes, en les laissant décider des produits qu’elles agréeront et de ceux qu’elles refuseront à cause de leur opacité.
S’agissant de la responsabilité, nous ne pouvons pas aller aussi loin que le souhaitait M. Cousin. Ajouter un article à notre code pénal n’aurait que peu d’effet à l’échelle mondiale. Nous recommandons d’engager une réflexion sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des membres des conseils d’administration. La commission d’enquête a conscience des limites de ses compétences et des difficultés à proposer un texte qui puisse être adopté par toutes les instances internationales. Nous ne pouvons qu’inciter à aller plus loin dans la réflexion.
La première question de M. Baert est embarrassante. Nous nous adressons à tout le monde en général, donc à personne en particulier… De façon plus précise, nous souhaitons appeler l’attention du Président de la République qui préside le G20 pour une année. Plusieurs des propositions énumérées dans le rapport peuvent être défendues dans ces négociations. Autres interlocuteurs immédiats : l’ensemble des institutions européennes. Par exemple, quand nous recommandons de modifier la directive sur les marchés d’instruments financiers, nous voulons être entendus de M. Barnier, de M. Barroso et du Conseil des ministres. Le Gouvernement français lui aussi est concerné : avec la loi de régulation bancaire et financière, il a certes fait son devoir, mais la portée de ce texte restera très limitée si les grandes lignes n’en sont pas reprises au niveau international. En définitive, nous nous adressons à tout le monde dans la mesure où le rapport, analysant l’intérêt et les dangers de la spéculation, appelle à une prise de conscience.
M. Dominique Baert. C’est une adresse au président du G20.
M. le rapporteur. Pas seulement.
M. le président Henri Emmanuelli. Soit nous classions les propositions en fonction des autorités auxquelles elles s’adressent, soit nous les classions par thème, ce que nous avons fait, d’où l’impression que nous nous adressons à tout le monde. Par exemple, nous avons auditionné M. Barnier et nous avons été favorablement surpris de voir qu’il abordait tous les sujets. Je l’ai trouvé exagérément optimiste, car il va trouver en travers de son chemin la place de Londres armée jusqu’aux dents, mais il est de fait que la Commission a vu où le bât blesse. Au-delà, c’est à la politique de reprendre ses droits.
M. le rapporteur. Pour améliorer la visibilité des propositions, il serait sans doute possible, sinon facile, de les présenter par thème. D’ailleurs, c’est plus ou moins ce que nous avons voulu faire en commençant par la liquidité internationale, puis en passant à la question de la transparence, à la coordination et ainsi de suite. Sans doute peut-on expliciter ce plan, comme je l’ai fait dans la présentation orale.
Je bats ma coulpe pour n’avoir pas évoqué le rapport sur les normes comptables. C’est très important d’y faire référence et nous remédierons à cet oubli.
Je suis d’accord avec ce qu’Yves Censi a dit sur les agences de notation. Elles ont leurs défauts, il faut les responsabiliser, mais elles ne sont pas coupables de tout. Le rapport ne dit pas autre chose. Il cite d’ailleurs M. Marc Touati : « La spéculation ne tombe pas du ciel ». Elle est déclenchée par une situation économique réelle. Ainsi, la crise grecque provient de ce que les chiffres transmis étaient faux, ce qui a miné la confiance et provoqué une hausse vertigineuse des taux d’intérêt. L’introduction du rapport mentionne le laxisme général, y compris des dirigeants et des peuples qui ont accepté la facilité ayant mené aux dérèglements globaux.
En ce qui concerne la séparation entre banque d’investissement et banque de dépôt, nous suggérons seulement de réfléchir au sujet, sachant que le point de vue de la France n’est pas partagé par tous.
M. Pierre-Alain Muet. Je salue également ce travail impressionnant, par l’usage qu’il fait des auditions comme par la façon dont il organise la réflexion et les propositions. Il est prévu de publier les auditions en annexe et je m’en réjouis, car elles ont été d’une très grande richesse. Le rapport reprend les mesures qui font désormais consensus, mais il avance aussi des propositions novatrices, en particulier concernant le trading à haute fréquence, sur lequel la littérature disponible est mince.
Je suis très sensible à la proposition n° 24 qui invite à réfléchir à la séparation entre activités de dépôt et activités d’investissement. La présentation qui en est faite dans le rapport montre que les autorités de régulation ne ferment pas la porte à cette éventualité, même si, généralement, on invoque le caractère universel des banques françaises pour expliquer qu’elles aient mieux résisté à la crise. Une perspective historique pourrait amener à conclure différemment. J’ai beaucoup étudié les conséquences, pendant les soixante années qui ont suivi, des mesures prises par Roosevelt. Et, si l’on est passé d’une économie dominée par les marchés financiers, dans les années 1920, à une économie d’intermédiation après la Seconde Guerre mondiale, c’est en grande partie grâce au Glass-Steagall Act qui a structuré le système financier de l’après-guerre en permettant au métier traditionnel de banquier de prendre le pas sur celui de financier. Laisser la question ouverte me paraît donc important pour aller au-delà d’une réponse toute faite et d’une vision à court terme.
M. Yves Censi. Pour revenir à la question judicieuse de savoir à qui ce rapport s’adresse, et de son exploitation politique, il me semble important que la commission d’enquête partage ses conclusions avec les autres parlements nationaux.
M. le président Henri Emmanuelli. D’après les informations reçues de Bruxelles, il semble que peu d’entre eux ont travaillé sur ce sujet.
M. Yves Censi. Il nous arrive d’accueillir des collègues de commissions des finances d’autres pays et je crois qu’il serait possible de faire passer le message par leur intermédiaire.
M. Pierre-Alain Muet. Pourquoi ne pas avoir repris la taxe Tobin dans les propositions, sachant qu’elle fait désormais consensus entre les Allemands et les Français ?
M. le rapporteur. Nous avons voulu éviter les redondances. Dès lors que les gouvernements étaient d’accord, pourquoi l’ajouter à nos préconisations ? Nous n’avons pas repris non plus toutes les propositions que Michel Barnier a faites pour corriger la directive MIF. Nous avons essayé de faire preuve d’un peu d’originalité.
M. Pierre-Alain Muet. Certains risquent de s’interroger sur les raisons de cette absence…
M. le rapporteur. Le rapport mentionne la taxe Tobin ! Il y est aussi question d’un prélèvement sur les banques, faisant l’objet d’un accord entre la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne, et destiné à garantir que ces établissements « contribuent à la hauteur des risques auxquels ils exposent le système financier ». Mais il est vrai que ce n’est pas une taxation des transactions financières.
M. Pierre-Alain Muet. Il me semblait que ce dernier sujet était plus consensuel qu’autrefois.
M. le président Henri Emmanuelli. La taxe Tobin, le Parlement français l’a votée, avec le Canada. Mais à taux zéro, pour le principe et dans l’attente de décisions semblables dans d’autres pays. Elle était conçue pour favoriser le développement international et - je n’ai d’ailleurs jamais compris comment - freiner la spéculation. Sans doute la renchérit-elle, mais de façon infinitésimale, compte tenu de l’effet de levier.
M. Yves Censi. Ce serait dommage de faire une commission d’enquête pour aboutir à proposer de nouveau la taxe Tobin ! En termes de nouveauté, ce rapport est plus riche. Notre objectif est bien d’imaginer comment se protéger des conséquences néfastes de la spéculation ; la taxe Tobin ne correspond qu’à un transfert de richesse.
M. Pierre-Alain Muet. Le père de cette taxe n’est autre que Keynes, même si elle a été attribuée à Tobin. L’idée de départ était de taxer les allers-retours pour limiter les mouvements purement spéculatifs. Le principe pourrait être efficace, appliqué au trading à haute fréquence.
M. le président Henri Emmanuelli. Tout dépend du bénéfice attendu.
M. Pierre-Alain Muet. Je m’interroge seulement sur l’effet que produira l’absence de mention, dans ces propositions, d’une taxe qui fait consensus.
M. Yves Censi. La taxe Tobin, bien qu’elle ne soit pas en contradiction avec les propositions de ce rapport, n’a pas de visée prudentielle. Elle est d’ailleurs comparée à la taxe sur les billets d’avion.
M. Pierre-Alain Muet. La taxation est, comme la régulation, un moyen de freiner les transactions. Un libéral pourrait même juger un signal prix plus efficace qu’une règle.
M. le président Henri Emmanuelli. Au lieu de taxer les transactions, ne vaudrait-il pas mieux, pour freiner la spéculation, taxer les plus-values à 30 ou 50 % ? À vouloir freiner la circulation des fluides en rétrécissant le diamètre du tuyau, on risque plutôt, me semble-t-il, de faire monter la pression.
M. Pierre-Alain Muet. Je ne suis pas d’accord s’agissant du trading à haute fréquence qui profite de petites différences de cours. L’avantage de la taxe Tobin est précisément de ne pas freiner les transactions à long terme et de s’attaquer seulement aux mouvements purement spéculatifs.
M. le président Henri Emmanuelli. Il faut bien faire la différence entre les ordres donnés et ceux qui sont exécutés : sur les 2 800 000 ordres traités à la minute, 170 seront dénoués. C’est donc l’ordre qu’il faudrait taxer, mais comment y parvenir ? De toute façon, je pense qu’il faudrait purement et simplement interdire le high frequency trading parce que je n’en vois pas l’utilité. Presque personne, même parmi ceux qui ont un portefeuille, ne connaît ce mécanisme pour le moment, mais quand les épargnants sauront, ils seront nombreux à se détourner de la bourse compte tenu du rapport des forces. On nous a parlé de distorsion d’information, mais cela va bien au-delà. Il y a aussi la démesure des moyens. C’est l’art de plumer le petit porteur ! Rien que pour cette raison, je suis hostile au HFT. M. Cerruti a invoqué l’arbitrage entre le marché et les dark pools et l’unicité du prix réalisée par ce biais, mais s’il n’y avait pas de dark pools, le HFT serait inutile. Il n’existe que parce qu’il y a opacité.
M. le rapporteur. Sur la taxe Tobin, je vous renvoie aux pages 205 et 206 du projet de rapport, où vous retrouverez les arguments que nous venons d’échanger et les mêmes hésitations quant à son efficacité. Il m’a semblé qu’il n’y avait pas accord entre nous en faveur d’une telle proposition.
M. le président Henri Emmanuelli. En outre, plus de la moitié des transactions sont faites sur des plateformes non répertoriées, sans aucun reporting. Comment les taxerait-on ?
M. le rapporteur. Paradoxalement, on ne taxerait que ceux qui jouent le jeu.
M. Pierre-Alain Muet. Je rappelle seulement qu’un marché peut aussi être régulé par les prix et que ce type d’intervention peut être efficace.
M. le rapporteur. Reste l’épineux problème du titre. Nous sommes à la recherche d’un titre raisonnable mais accrocheur, comme Spéculation : faire gagner la croissance et l’emploi plutôt que les joueurs. Mais la nuit portant conseil, nous pouvons surseoir jusqu’à demain.
M. le président Henri Emmanuelli. En l’absence de demandes d’explication de vote, je mets aux voix le rapport de M. Jean-François Mancel.
La Commission adopte le rapport de M. Jean-François Mancel à l’unanimité.
La séance est levée à 18 h 50.
LISTE DES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION
1) Les questions préalables à aborder à l’occasion de la présidence française du G20 : système monétaire international et politique monétaire
Proposition n° 1 : Mettre à profit la présidence française du G20, qui offre l’occasion d’avancer dans la réforme du système monétaire international, pour faire progresser l’idée d’une stabilisation des taux de change au moyen de mécanismes tels qu’un « serpent monétaire » encadrant les principales devises mondiales ou la création d’un étalon monétaire constitué d’un « panier » de ces devises. |
Proposition n° 2 : Mettre l’accent, dans le cadre du G20, sur l’arbitrage permanent que doivent effectuer les banques centrales entre, d’une part, une politique expansive et de création monétaire de court terme afin de soutenir l’économie ou venir en aide à des États en difficulté et, d’autre part, une politique plus restrictive de long terme afin de ne pas alimenter la croissance de la masse monétaire susceptible de favoriser la constitution de bulles spéculatives. À cette fin, les banques centrales devront prêter une attention plus grande au suivi de la masse monétaire et exercer pleinement un pouvoir monétaire actuellement inhibé par la priorité donnée à la stabilité des prix. |
Proposition n° 3 : Assurer, dans le cadre de la présidence française du G20, un suivi attentif de la mise en œuvre effective de l’ensemble des engagements pris lors des précédents G20, en particulier s’agissant de lutter contre les paradis fiscaux (juridictions non coopératives). La mise en place d’une structure permanente – légère – pourrait permettre de pérenniser cette nécessaire procédure de suivi. |
2) Union européenne et zone euro : tirer les conséquences de l’union monétaire
Proposition n° 4 : Tirer les conséquences de l’union monétaire en matière de conduite des politiques économiques et fiscales, en assurant un véritable contrôle, une « surveillance multilatérale » par les instances européennes appropriées, des politiques définies par les États membres et de leur mise en œuvre, particulièrement s’agissant des États ayant bénéficié des interventions du Fonds européen de solidarité financière. |
3) Une coordination transatlantique à promouvoir
Proposition n° 5 : Développer la coordination transatlantique sur l’ensemble des dossiers et actions touchant à la lutte contre la spéculation : normes comptables, normes relatives aux fonds propres des banques, réglementation des acteurs et des institutions financières… En particulier, compte tenu des carences manifestées avant la crise par les instances internationales compétentes, les organismes récemment créés en Europe et aux États-Unis, pour assurer la prévention du risque systémique, devront confronter régulièrement leurs données et leurs analyses. |
4) Un développement de la transparence sur tous les marchés
Proposition n° 6 : Assurer, par la révision de la directive MIF au printemps 2011, un retour à la transparence des marchés, l’établissement d’une concurrence équitable entre plates-formes de négociation, une standardisation des déclarations des ordres (reporting) et une meilleure identification des intervenants. |
Proposition n° 7 : Promouvoir toutes mesures techniques permettant d’introduire la transparence sur les marchés de gré à gré en favorisant, notamment par la standardisation des produits, un transfert de l’essentiel des transactions vers des chambres de compensation. |
Proposition ° 8 : Insuffler de la transparence pour les marchés de gré à gré résiduels, avec la mise en place de registres des transactions et de bases centrales de données des transactions localisées en Europe, et en prévoyant une déclaration des ordres (reporting) précise et universelle. |
Proposition n° 9: Créer une agence européenne de régulation des marchés agricoles sur le modèle de la Commodity futures trading committee et prévoir une réglementation en matière de : – limites de position et limite des variations des positions journalières ; – sanction et répression des abus de marché ; – prévention des conflits d’intérêt ; – création de bases centrales de données sur transactions ; – garantie de livraison. |
5) Un meilleur encadrement des fonds alternatifs
Proposition n° 10 : Assurer un suivi attentif des conséquences de la possibilité offerte à tous les fonds alternatifs de se voir délivrer un « passeport européen », en matière d’ouverture de marché européen à des fonds insuffisamment contrôlés, pour être en mesure de proposer rapidement les correctifs nécessaires. |
Proposition n° 11 : Agir en vue de compléter la directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs par des dispositions permettant de mieux contrôler ces fonds et de limiter l’effet de levier des détenteurs du nouveau passeport européen. |
6) Une réglementation plus contraignante de certaines opérations à risque
Proposition n° 12: Interdire les ventes à découvert « à nu » de produits dérivés de dette souveraine sur un périmètre le plus large possible. |
Proposition n° 13 : Réduire, pour les ventes à découvert, le délai de règlement-livraison des titres à J+1 et proscrire en les sanctionnant les défauts de livraison. |
7) Une élimination du trading à haute fréquence
Proposition n° 14 : Assurer une surveillance effective par l’Autorité de contrôle prudentiel des activités de trading à haute fréquence : ampleur du phénomène, gestion du risque, contrôle interne, et le cas échéant, demande de renforcement des fonds propres. |
Proposition n° 15 : Encadrer, voire interdire, de manière concertée, au moins à l’échelon européen, le trading algorithmique et le trading à haute fréquence, pratiques dépourvues d’utilité sociale, et, à cette fin engager dès à présent les études techniques permettant de déterminer les solutions appropriées (latence minimale des ordres, réglementation des annulations, facturation ou taxation des ordres annulés, interdiction de certains logiciels…). |
Proposition n° 16 : Élargir le pas de cotation des valeurs afin de limiter l’intérêt du trading à haute fréquence. |
8) Un recadrage des agences de notation
Proposition n° 17 : Analyser les conséquences d’un passage au modèle économique « investisseur-payeur », et, à tout le moins, définir les modalités juridiques permettant de restreindre la pratique d’achat, par les émetteurs, de la meilleure notation (publicité des notations préliminaires, transparence des prix des notations). |
Proposition n° 18 : Demander aux banques centrales d’éviter toute référence aux notes des agences de notation et d’établir ou renforcer leurs propres cellules d’analyse de risque. |
Proposition n° 19 : Instituer un régime de responsabilité pour faute des agences de notation en cas de non respect des modèles de notation déposés en vue de l’agrément communautaire. |
Proposition n° 20 : Interdire aux agences de notation de s’exonérer de leur responsabilité par voie contractuelle. |
9) Une responsabilisation du secteur financier
Proposition n° 21 : Prévoir les dispositifs appropriés pour faire en sorte que les pouvoirs publics ne se voient plus, en cas de crise, acculés au renflouement d’établissements financiers qui ont pris des risques excessifs. |
Proposition n° 22 : Développer une parole publique, appuyée sur des dispositifs concrets tels que la proposition franco–allemande du 28 octobre 2010, pour persuader les opérateurs spéculatifs que d’éventuelles attaques ne peuvent que conduire à des restructurations de dettes souveraines susceptibles d’entraîner, pour eux, une pénalisation financière substantielle. |
Proposition n° 23 : Engager une réflexion sur les conditions dans lesquelles la responsabilité des membres des conseils d’administration des établissements bancaires pourrait être engagée en cas de manquement à leurs obligations et de « mauvaise gestion » (retrait d’agrément, amendes, interdiction d’exercer…). |
Proposition n° 24 : Engager une réflexion sur l’intérêt et les moyens d’établir une distinction entre les activités de banque de dépôt et celles de banque d’investissement. |
Proposition n° 25 : Assurer une meilleure identification et un meilleur suivi, par les établissements eux-mêmes et les régulateurs, des opérations, des résultats et des risques liés aux activités de marché, sur lesquelles règne une opacité certaine. |
10) Une application correcte des règles prudentielles et comptables
Proposition n° 26 : Être vigilant sur les conditions dans lesquelles les États-Unis appliqueront les règles prudentielles élaborées par le Comité de Bâle et s’efforcer d’obtenir l’application le plus large, au niveau mondial, de ces règles, peut être, ainsi que le suggère le Parlement européen, en les intégrant dans des traités internationaux. |
Proposition n° 27 : Mettre en œuvre, au niveau international, les moyens, juridiques et opérationnels, nécessaires pour assurer un suivi et une sanction des activités dites de shadow banking (banque parallèle), dont le développement est susceptible de vider de sa substance le système prudentiel résultant de Bâle III. |
Proposition n° 28 : Remédier, dès que la situation du secteur bancaire le permettra, à deux faiblesses de Bâle III : le maintien, dans les fonds propres, d’actifs incorporels et la durée excessive de la phase de transition. |
Proposition n° 29 : Veiller à ce que la mise en oeuvre des nouvelles règles prudentielles élaborées par le Comité de Bâle (Bâle III) et leur pendant en matière d’assurances (Solvabilité II) ne conduisent pas les investisseurs à se détourner des placements en actions, particulièrement en prévoyant des dispositions spécifiques aux investisseurs de long terme. |
Proposition n° 30 : Veiller, lors de la mise en oeuvre des réglementations prudentielles des banques (Bâle III) et des assurances (Solvabilité II) que leur champ d’application n’exclue ni certaines opérations, ni certains opérateurs, ni certains territoires, au risque de favoriser l’arbitrage réglementaire et le développement de la « banque parallèle ». |
Proposition n° 31 : Réviser les normes comptables, notamment celles relatives à l'évaluation des titres à leur valeur ponctuelle de marché, afin d'éviter, pour les investisseurs de long terme, la nécessité d'adopter des comportements court-termistes susceptibles de déstabiliser les marchés. |
11) Une adaptation des moyens des autorités de régulation et de supervision
Proposition n° 32 : Adapter les moyens de l’Autorité des marchés financiers en fonction de l’importance des tâches nouvelles qui lui sont confiées dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de prévention des crises financières définies depuis 2008 par le G20. |
Proposition n° 33 : Rendre opérationnel très rapidement le Comité européen du risque systémique : – en lui donnant la possibilité effective de superviser l'ensemble du système financier y compris le « système bancaire fantôme » ; – en prévoyant l'élaboration d'indicateurs d’alerte (dérapage des prix de certains actifs, évolution « anormale » des écarts de taux (spreads), dérapage du volume du crédit par rapport au PIB…) ; – en perfectionnant la méthodologie des stress tests dont la réalisation devra être entourée d'une plus grande confidentialité. |
Proposition n° 34 : Promouvoir la coopération des autorités de régulation, notamment dans les domaines suivants : – la réduction du temps de réponse aux demandes de renseignement ; – la standardisation des déclarations des ordres (reporting) ; – l’harmonisation des pouvoirs des différentes autorités en matière d’enquête. |
CONTRIBUTION DE M. PAUL GIACOBBI,
DÉPUTÉ DE HAUTE CORSE (APPARENTÉ AU GROUPE SRC)
ET MEMBRE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
Paris, le 23 novembre 2010
Commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation
affectant le fonctionnement des économies
Pour une approche structurelle de la crise financière
L'essentiel de ce qui est aujourd'hui proposé, avec les meilleures intentions du monde, et souvent avec beaucoup de pertinence pour lutter contre la spéculation financière, s'apparente à ce que la médecine appelle les traitements symptomatiques qui se contentent de pallier les manifestations de la maladie sans avoir le moindre effet sur ses causes.
Aussi, avant d'aborder le débat des remèdes symptomatiques, il est essentiel de rappeler, en reprenant des analyses désormais classiques sur le plan académique les causes premières de la crise qui secoue l'Occident : les déséquilibres structurels qui ne cessent de s'aggraver dans nos économies depuis bientôt un demi-siècle.
On rappellera donc en premier lieu que la cause première de la crise n'est aucunement la spéculation, mais qu'à l'inverse, c'est la spéculation qui est née tout naturellement et comme toujours de l'excès de liquidités lui-même imputable aux déséquilibres structurels de l'économie mondiale et au laxisme des autorités monétaires et bancaires. C'est ce que l'on pourrait appeler une approche quantitative de la crise (I).
Nous ferons ensuite un point très sommaire de la situation du moment, c'est-à-dire très exactement celui où les marchés regorgent de liquidités251 fournies gratuitement par les banques centrales qui ont le pouvoir de les créer. C'est aussi le moment où la communauté internationale s'efforce de réglementer, notamment par des ratios prudentiels renforcés, les banques, alors que le problème est né, et continue d'exister, « hors banque ». Le moment enfin où les Etats-Unis appellent au rééquilibrage des comptes extérieurs et à l'organisation du système monétaire international alors qu'ils organisent la faiblesse du dollar par une création monétaire débridée, et qu'ils font tout pour conserver le rôle international de leur devise (II).
Dans de telles circonstances, il serait encore possible, même si c'est pour nos gouvernements difficile et improbable, de pratiquer une politique de contrôle de l'offre de monnaie dont la théorie a été rappelée et développée par Andrew Smither252 et dont Paul Volcker avait donné, aux Etats-Unis, un exemple pratique de courage et d'efficacité il y a plus de trente ans (III).
Enfin, ces thérapeutiques fondamentales n'excluent nullement d'envisager, en complément de la cure elle-même, des traitements symptomatiques qui consisteraient premièrement à limiter l'usage de la haute fréquence dans les mécanismes automatisés de transaction financières (« Ban the Quants! »)253, deuxièmement à interdire les transactions pour lesquelles l'acheteur ne dispose pas de la capacité financière de son acquisition et ne peut revendiquer aucun usage direct ou indirect de ce qu'il acquiert, ni aucune utilité sociale de son intervention, troisièmement à séparer clairement la prise de risques et la gestion des dépôts par les banques, quatrièmement à réglementer les opérations financières hors bilan en méditant l'analyse descriptive et historique de Gillian Tett254 et celle, théorique mais lumineuse, de Hyman P. Minsky255, cinquièmement enfin à accroître la connaissance s'agissant des données quantitatives, de la réalité après compensation, de la mesure des fréquences, et de la qualité des instruments et véhicules financiers (IV).
I. L'excès de liquidité, cause première de la crise
J'avais rappelé dans une note du 12 novembre 2008 ci-jointe (« Réduire l'océan des liquidités spéculatives pour prévenir le tsunami financier ») que ce n'était pas la spéculation qui était la cause première de la crise mais tout simplement l'excès de liquidités, lui-même imputable au déséquilibre structurel de l'économie mondiale et au laxisme des autorités monétaires et bancaires.
La spéculation est une conséquence de l'excès de liquidités et, à l'inverse, il n'y a guère de spéculation lorsqu'il n'y a pas de liquidités256.
Pour prendre l'exemple du marché des matières premières, j'avais observé dans la note précitée, en page 2, que les variations récentes du cours du pétrole, qui ont dépassé 150$ le baril pour revenir aujourd'hui aux environs de 80$257 n'ont que très marginalement été influencé par l'offre et la demande mais qu'en revanche on pouvait établir une certaine corrélation entre l'exagération spéculative du cours et la présence massive d'opérateurs sur le NYMEX258 étrangers aux matières premières qu'ils vendent et achètent et qui peuvent donc être considérés comme de purs spéculateurs.
Le lien avec la liquidité peut être démontré jusqu'à la caricature en observant que lorsque ces spéculateurs ont eu besoin de liquidités, ils ont dû massivement vendre leurs stocks virtuels ce qui a aussitôt ramené le marché aux alentours d'un prix représentatif de l'offre et de la demande. Cet exemple nous amène à exposer le paradoxe selon lequel la cause fondamentale de la crise est l'excès de liquidités, alors même que celle-ci a éclaté au moment précis où le monde financier s'effondrait par un assèchement sans précédent de liquidités.
Deux observations s'imposent pour éclairer le lecteur.
En premier lieu, le fait que la liquidité en question ne repose sur aucune base réelle, c'est-à-dire une création objective de richesses mais sur une base purement virtuelle liée notamment à la valeur spéculative donnée à un certain nombre de biens, essentiellement les biens immobiliers mais aussi les valeurs mobilières et quelques matières premières tels que le pétrole ou l'or.
Pour prendre un exemple relativement simple, il faut observer que le fait pour un bien donné, par exemple un immeuble bien placé à New York, de connaître une appréciation considérable de son prix, entraîne ipso facto, un accroissement de la liquidité potentielle de son propriétaire, étant entendu d'ailleurs que lorsqu'un marché devient spéculatif, la confiance des financiers fait que l'on accepte comme une donnée irréversible la montée des prix de telle sorte que l'on constate à la fois un accroissement de la valeur du bien et une augmentation des possibilités de le transformer très rapidement en liquidités, soit par vente, soit par emprunt.
On peut donc considérer que dans une phase spéculative de l'économie, lorsque se forment, ce que l'on appelle des bulles spéculatives (asset bubbles), la spéculation entraîne par elle-même une augmentation des liquidités disponibles.
Ce décalage entre l'économie réelle, celle de la production de biens et de services, et l'économie virtuelle peut être quantifié : de 2000 à 2007, la masse monétaire globale a augmenté au rythme d'environ 15% par an tandis que la croissance mondiale se contentait de 5%.
En second lieu, il est important de remarquer que depuis le début de la crise, c'est-à-dire depuis le début de l'été 2007, rien n'a été fait ni au plan national, ni au plan international, pour maîtriser la liquidité mais au contraire, l'assèchement de liquidités qui aurait dû résulter de l'effondrement d'un certain nombre de valeurs spéculatives, notamment immobilières, a été compensé par une fourniture, sans précédent historique, de liquidités par les banques centrales qui les ont abondamment fournies aux banques commerciales et même, très directement aux Etats.
Il faut rappeler les modalités différentes mais massives qui ont été utilisées par les banques centrales pour fournir ces liquidités massives et surabondantes depuis 2007 :
- la Fed s'est distinguée, dès les premiers jours de la crise, lorsque les marchés interbancaires se sont effondrés provoquant une montée extrême de taux d'intérêt interbancaires, en accordant des facilités d'escompte non conventionnelles qui permettaient à une entreprise d'obtenir de la liquidité sans passer par sa banque en s'adressant directement à la succursale de la banque centrale sur la base de papiers commerciaux dont plus personne n'examinait sérieusement la qualité.
- Bien entendu, toutes les banques centrales ont abaissé leur taux à 0 ou à 1% mais comme cela n'a eu que très peu d'effets directs259, elles se sont toutes peu ou prou orientées vers des mesures non conventionnelles consistant par exemple à proposer des facilités sans contreparties. Ainsi, la BCE a-t-elle procuré de l'ordre de 900 milliards d'euros aux banques européennes, à 1% et à un an, sous forme d'avances sans aucun mécanisme d'escompte ou de réescompte, et ces facilités immenses ont été jusqu'à ce jour régulièrement renouvelées sous une forme ou sous une autre, jusqu'à devenir une sorte de « crédit revolving » parfaitement assimilable à ceux que l'on offre aux particuliers à la différence importante que celui dont bénéficient les banques est à un taux voisin de zéro tandis que ceux dont sont victimes les ménages montent rapidement à des taux usuraires.
- Enfin, les banques centrales constatant, il y a quelques mois, une tendance inexorable à la montée des taux d'intérêt sur les obligations publiques (le taux des obligations du Trésor public américain à dix ans dépassait alors les 4%) se sont mises à acheter massivement des bons du Trésor. La Fed a ouvert la marche de manière assez spectaculaire en achetant de l'ordre de 300 milliards de dollars de ces bons et la BCE a suivi en mettant en place de telles facilités pour les Etats, notamment la Grèce, qui n'arrivaient plus à trouver, même à des taux extravagants preneurs pour ses obligations publiques sur les marchés.
Globalement aujourd'hui, les bilans des banques centrales ont été multipliés au moins par deux, les liquidités détruites par l'éclatement de bulles spéculatives ont été reconstituées par ces politiques monétaires de « quantitative easing », de telle sorte que si l'économie mondiale était intoxiquée par un excès chronique d'absorption de liquidités, sa crise « de manque » a été soignée par la fourniture illimitée de l'objet de son addiction.
II. La situation du moment (Automne 2010)
Aujourd'hui, dans un moment où l'on peut estimer que la situation globale de la liquidité est probablement assez proche de ce qu'elle était avant la crise, nous observons deux phénomènes :
- le premier est que malgré cette immense création de liquidités par les banques centrales, malgré les milliers de milliards de dollars des plans de relance financés par le « spending deficit » des Etats, eux-mêmes refinancés par les émissions obligataires publiques de plus en plus souscrites par les banques centrales, l'économie ne repart que très modestement, à l'exception des pays émergents, de telle sorte que progressivement, toutes les banques centrales commencent à replonger dans une politique débridée de « quantitative easing » qui commence à ressembler à ce que l'on appelle classiquement une fuite en avant.
- Par ailleurs, nous constatons, au grand étonnement d'un certain nombre d'observateurs qui réagissent aux données de la conjoncture comme le chien de Pavlov réagissait aux stimuli que la création massive de monnaies ne conduit pas à l'inflation et ne parvient même pas à éviter la déflation, tandis que pratiquement dans aucun pays du monde occidental, les très légers progrès de la conjoncture ne parviennent à améliorer de manière structurelle et durable la situation de l'emploi.
Ces deux phénomènes sont évidemment liés puisque la création monétaire n'a que marginalement stimulé la consommation, l'investissement et l'emploi, mais a seulement servi à reconstituer le monde financier tel qu'il était avant la crise.
De même, est-il intéressant de noter que les banques américaines, qui ont pratiqué le prêt immobilier dans les conditions que l'on sait et qui ont bénéficié de concours immenses et gratuits pour les sauver des conséquences de leurs folies, se remettent à pratiquer à grande échelle des saisies immobilières.
Dans la mesure où la reconstitution de la liquidité ne profite ni à l'investissement, ni à la consommation, elle ne saurait évidemment conduire à aucune tension inflationniste puisque l'offre globale effective se situe sans difficulté au niveau de la demande solvable tandis que l'offre pourrait aisément répondre à toute augmentation de la demande dans une période de sous-utilisation des facteurs de production.
Dans un tel contexte cependant, l'équation quantitative de la monnaie, c'est-à-dire la relation tautologique entre la masse monétaire et le niveau des prix exposé par Irving Fischer260, reste exacte. Simplement la masse des liquidités supplémentaires vient gonfler non pas les prix à la consommation ou ceux des biens de production mais tout simplement la spéculation qui s'incarne pour le moment :
- dans l'or qui atteint et dépasse aujourd'hui 1400$ l'once, alors même qu'il y a quelques mois le niveau de 1 000$ l'once paraissait un plafond infranchissable et que la valeur historique de l'or, c'est-à-dire le niveau de convertibilité externe du dollar en or, se situait, jusqu'au 15 août 1971, à 35$ l'once !
- dans l'immobilier des pays émergents, par exemple les beaux quartiers de Shangaï et de Mumbaï (pour Mumbaï les transactions tendent à dépasser le niveau de 15 000 euros par m2 sur Marine Drive et Malabar Hills...);
- dans les valeurs mobilières des pays émergents où l'on voit par exemple la bourse de Mumbaï monter régulièrement depuis deux ans grâce à des afflux de capitaux non résidents;
- dans toutes sortes d'autres spéculations, puisque l'on sent se reconstituer un grand marché obligataire privé et que certaines obligations publiques dans les pays « menacés par la dégradation de leur note » deviennent de véritables « public junk bonds » que ne dédaignent pas des investisseurs institutionnels aussi avisés que la République populaire de Chine.
Dans cette situation où l'on voit bien que la pathologie n'est pas traitée et que la situation est structurellement semblable à celle qui préexistait à la crise et qui l'a provoquée, la réaction de la communauté internationale ou des institutions spécialisées, se résume à deux propositions :
- la première consiste à renforcer et à rendre plus exigeant le ratio de capital pour les banques. Il s'agit très sommairement du ratio, inventé par Peter Cooke et qui fixe le niveau de capital propre requis dans le bilan d'une banque pour assurer la sécurité d'un porte-feuille donné de créances.
- D'un point de vue global, le gouvernement américain ne cesse de défendre sous des formes diverses l'idée d'une coordination internationale destinée à réduire les déséquilibres structurels des balances des paiements courants, la dernière trouvaille en date étant celle proposée par M. Geithner à Séoul, consistant à dire qu'il faudrait limiter à 4% du PIB d'un pays donné la marge de fluctuation, excédentaire ou déficitaire, de sa balance des paiements courants.
S'agissant du ratio Cooke261, nous devons rappeler premièrement que cette réglementation est particulièrement inadaptée si elle ne prend pas en compte le mécanisme par lequel les banques, et en particulier les banques des Etats-Unis, ont externalisé leurs portefeuilles de créances transmis à des instrument financier ad hoc, lesquels se sont financés par l'émission en contrepartie d'obligations. C'est ce que l'on a appelé sommairement la titrisation. Le fait de ne pas avoir exigé des banques le même niveau de capital pour les créances correspondant aux prêts consentis figurant à leur bilan et pour celles qui ont été externalisées, a privé le ratio Cooke d'alors de toute signification réelle. C'est d'ailleurs l'existence de tels ratios qui a conduit les banques à inventer cette mécanique d'externalisation qui leur permettait de reconstituer leur capacité à prêter sans pour autant avoir à augmenter corrélativement leurs fonds propres. C'est ce qu'a remarquablement exposé Gillian Tett dans son ouvrage déjà cité Fool's gold. Les nouvelles règles de Bâle prévoient désormais que le hors bilan sera pris en compte pour le calcul du capital requis.
A l'heure actuelle, et c'est la seconde remarque, l'instauration d'un ratio de capital plus exigeant pour les banques pénalisera gravement les banques européennes et en particulier françaises, dans la mesure où celles-ci ont beaucoup moins recours que leurs homologues américaines à l'externalisation des créances tandis qu'aux Etats-Unis bien des établissements financiers, qui seraient soumis à la réglementation bancaire en France, y échappent totalement. Ainsi, cette règle ne renforcera pas du tout la sécurité financière dans le monde mais réduira simplement la capacité de prêt des banques européennes, ce qui revient en définitive à punir d'autant plus sévèrement que l'on est moins coupable et inversement. Le ratio Cooke sous sa dernière version serait un instrument prudentiel adapté, mais il ne sera pas imposé à toutes les institutions financières notamment à l'essentiel du « hors banque » aux Etats-Unis.
Par ailleurs, l'idée de M. Geithner de réduire les déséquilibres structurels de paiements courants a l'avantage de pointer du doigt le problème fondamental, celui qui est véritablement à l'origine de la crise comme l'avaient démontré en leur temps très justement Jean Denizet ou Richard Duncan dans leurs ouvrages respectifs The Dollar crisis et Histoire du dollar précités.
En revanche, c'est une approche particulièrement injuste et volontairement irréaliste et qui a d'ailleurs été écartée par le G20 sachant qu'elle avait simplement pour objet d'éviter que l'on aborde le seul vrai sujet, à savoir le statut du dollar et sa suprématie de facto et la réforme du système monétaire international qui pour le moment n'a fait l'objet d'aucune proposition sérieuse, encore moins de décisions.
Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui les banques centrales, confrontées aux risques évidents de remontées des taux d'intérêt sur les obligations publiques, s'apprêtent, à l'initiative de la Fed, à une deuxième phase d'une politique massive de création monétaire baptisée « QE2 » c'est-à-dire « quantitative easing 2 ».
En substance, les commentateurs, à l'exception tout de même d'un nombre croissant d'observateurs avisés, raisonnent toujours en disant que l'on peut continuer massivement à créer de la monnaie dans la mesure où cela n'a eu aucun effet négatif et a permis en revanche de sauver le système financier tandis qu'il n'y a manifestement aucun risque d'inflation et qu'il faut impérativement continuer à stimuler la croissance et l'emploi par la création monétaire.
On ne répétera jamais assez que ces politiques n'auront qu'un effet limité sur la croissance puisqu'elles créent de la monnaie qui alimente le système financier sans permettre aux entreprises et aux ménages d'investir et de consommer plus ce qui serait le seul moyen de stimuler la croissance. La seule chose que l'on puisse dire, c'est qu'en permettant aux Etats de financer partiellement leur déficit par la création monétaire, ces mesures pourraient théoriquement permettre à la dépense publique de stimuler la croissance à travers des plans de relance. Or, il n'en est rien puisque dans le même temps, la plupart des Etats tentent de rééquilibrer leurs comptes par des politiques budgétaires restrictives, ce qui aura évidemment l'effet inverse262.
Ces politiques de « quantitative easing » sont de plus en plus ouvertement critiquées, en témoignent deux articles remarquables publiés récemment dans le Financial Times263. Robin Harding remarque simplement : « Forcing investors into other assets – from foreign currencies to equities – could risk creating price bubbles ». Michael Mackenzie souligne quant à lui : « Critics say cheque writing in the trillions is no cure for the flagging economy ».
Nous nous trouvons donc dans un de ces moments étonnants où des politiques qui ont démontré leur inefficacité et leur perversité continuent à être défendues et vont même connaître une nouvelle phase encore plus impressionnante que la première.
Cette approche que l'on pourrait qualifier de « fuite en avant » est caractéristique aussi du syndrome bien connu que j'ai appelé « positivation de la chute du cinquantième étage » qui consiste pour celui qui s'est jeté du cinquantième étage à constater qu'arrivé au vingtième ou au trentième, il est toujours en vie et connaît même des sensations agréables voire enivrantes...
Quelle que soit l'issue de ce saut dans l'inconnu, il est évident qu'il va permettre à tout le moins à la spéculation de connaître un nouvel âge d'or, aux déséquilibres structurels de s'amplifier, et aux économies émergentes d'Asie, lesquelles reposent sur l'économie réelle et non pas sur les mirages spéculatifs, de confirmer définitivement leur suprématie par rapport à l'Occident.
III. Seul un ajustement raisonnable de l'offre de monnaie peut prévenir la formation de bulles spéculatives.
Le débat actuel, on le voit bien, est biaisé : ceux qui justifient le « quantitative easing » le font sur la base de l'absence de risque inflationniste alors même que le plus grand risque est celui de susciter non pas l'inflation mais de nouvelles bulles spéculatives, c'est-à-dire fondamentalement ce qui est à l'origine de la crise. Nous nous trouvons dans une situation très différente de celle de l'époque Volcker où il s'agissait de juguler l'inflation. Ce combat a été gagné mais aujourd'hui la bulle spéculative est devenue la forme moderne de l'inflation dans les sociétés développées, peut-être parce que la notion d'équilibre entre l'offre et la demande de biens et services se pose en termes très différents ou plutôt que l'excès de liquidités n'alimente plus la consommation des ménages ni même vraiment les entreprises productrices mais plutôt très directement la spéculation financière. Comme de bien entendu la monnaie créée ne va pas aux agents qui en ont le plus besoin et qui l'utiliseraient pour générer de la croissance, mais à ceux qui spéculent et qui en ont le moins besoin.
Il fut un temps où le contrôle de l'offre de monnaie par les banques centrales était pratiqué avec courage, maîtrise, intelligence et pragmatisme. Un exemple peut en être donné dans le document historique : Meeting of the Federal Market Committee, November 26, 1980, disponible sur le site de la Réserve fédérale américaine264.
Je n'ai pas trouvé de meilleure présentation de la réponse que les banquiers centraux devaient apporter en matière de prévention des bulles spéculatives (assets bubbles) que l'ouvrage d'Andrew Smithers précité.
Il est très difficile de résumer un texte qui représente déjà une synthèse de la pensée de l'auteur, exposée longuement et en termes très rigoureux dans le cadre d'une analyse macro-économique de haut niveau et de démonstrations exemplaires sur la base de données chiffrées, le tout émanant d'un praticien de la finance ayant parfaitement réussi dans son métier, et ayant maintenu largement sa performance au coeur de la crise économique265. En substance, Andrew Smithers remarque que les marchés boursiers ont connu des appréciations spéculatives de leur valeur (au-delà de 50% de ce qui aurait été raisonnable) à cinq occasions depuis le début du XXème siècle : 1906, 1929, 1936, 1968 et 2000.
Il indique – et cette affirmation est véritablement démontrée dans le corps de l'ouvrage – que les banquiers centraux ont le devoir d'apprécier si les marchés financiers ont atteint un niveau de prix excessif et qu'ils doivent y répondre. Il indique que le même raisonnement peut être fait en matière de prix immobiliers et de prix des obligations à risques, et qu'en conséquence ces trois niveaux de prix (marchés financiers, liquidité et prix immobiliers) doivent être considérés par les banquiers centraux pour conduire leur politique monétaire au-delà de la seule considération des prix à la consommation.
Nous sommes ici au coeur du débat : actuellement, les banquiers centraux ont une politique d'expansion massive de l'offre de monnaie et répondent à toutes critiques – notamment celles qui portent sur le risque d'effet spéculatif – en indiquant qu'il n'y a aucun risque d'inflation sur les prix à la consommation.
Il expose ensuite les politiques de réglage des taux d'intérêt à court terme et remarqué qu'avec cet instrument bien utilisé, on aurait pu limiter les bulles spéculatives des années 2000, en « manoeuvrant contre le vent » (« leaning against the wind »). Même si cela aurait eu un effet de récession, celui-ci aurait été bien plus limité que celui des récessions qui ont suivi les explosions des bulles spéculatives que les banques centrales ont laissé grossir.
Cependant, l'auteur considère ensuite que les banques centrales devraient pouvoir en fait disposer de deux instruments : les taux d'intérêt qui seraient plutôt destinés à lutter contre l'inflation et les ratios de capital des banques qui pourraient être augmentés ou diminués, par pays ou zone monétaire, pour lutter contre les bulles spéculatives, lesquelles sont variables selon les pays. Ainsi l'auteur remarque-t-il que les prix immobiliers en Allemagne ont été stables de 1997 à 2007 alors qu'ils ont presque doublé en France sur la même période.
L'auteur tient à distinguer cette utilisation du ratio de capital par les banques centrales comme outil de politique monétaire, et de la définition de ratios prudentiels par les autorités destinées à veiller à la sécurité du système. Bien entendu, ceci ne vaut que si les mesures de contrôle s'appliquent à tous les établissements distribuant un crédit (comme en France par exemple) et non aux seules banques dans l'acception des Etats-Unis.
Le lecteur anglophone de cette note aurait avantage à lire, s'il en a le courage, le livre d'Andrew Smithers dont l'autorité académique et la compétence pragmatique sont exceptionnellement vivifiants !
Force est de constater qu'à l'heure actuelle, ni le courage d'un Paul Volcker, ni la lucidité des meilleurs observateurs académiques ne sont de mise. Le G20 de Séoul se termine sur fond de guerre monétaire, où les Etats-Unis prêchent la stabilité et reprochent à la Chine de sous-évaluer leur devise, au moment même où la Fed lance la plus grande opération de création monétaire de l'histoire, laquelle aura pour conséquences immédiates une dévaluation compétitive du dollar et la recrudescence de la spéculation.
IV. Les traitements symptomatiques
Dans la mesure où il est très vraisemblable que le monde ne s'engagera pas dans une politique globale de prévention de la spéculation par un contrôle raisonnable de l'offre de monnaie, il faut évoquer les traitements symptomatiques, ceux qui soulagent provisoirement sans jamais guérir, mais qui ne sont jamais totalement inutiles, tandis que leur utilisation exhaustive et rigoureuse peut limiter considérablement les effets du mal.
En premier lieu, l'usage de la Haute-Fréquence dans les transactions financières doit être banni. Aucune utilité collective, aucun intérêt général ne s'attachent à ce genre de mécanismes qui au mieux génèrent des fortunes acquises indûment au détriment de la communauté financière, au pire provoquent des accidents redoutables.
J'ai cité à ce titre l'ouvrage de Scott Patterson, The Quants, qui est tout à fait instructif sur la réalité de ces parasites, véritables sangsues sur le corps de la planète financière.
Notre commission pourrait recommander qu'un groupe de travail, au moins au niveau européen, propose des moyens concrets de limiter, voire de prohiber, ces pratiques.
En second lieu, il convient non pas d'interdire totalement les ventes à découvert, ou plus grave encore les opérations à termes, mais de réglementer l'accès aux marchés en le réservant aux seuls opérateurs solvables (dont les garanties sont en rapport avec l'ampleur des opérations qu'ils réalisent sur le marché) et intéressés directement aux produits qu'ils achètent et vendent.
On ne devrait pas pouvoir lancer des ordres d'achat et de vente en centaines de millions de dollars si le donneur d'ordre n'offre pas les garanties financières correspondantes.
Autrefois, il existait les monopoles de courtage sur les marchés, qui n'ont pas empêché les faillites chez les agents de change mais qui garantissaient au moins le professionnalisme et un certain niveau de solvabilité des intervenants.
De même que l'accès à la profession de banquier est réglementée, celle d'intervenant sur les marché devrait l'être, c'est la moindre des choses dans un monde où les opérations OTC (over the counter) représentent plus que les opérations classiques...
Par ailleurs, s'il est parfaitement légitime266 qu'il y ait un marché pour chaque type de produit (financier ou non). Il est aberrant que quelqu'un qui n'a aucune activité liée au pétrole, qui n'a aucune expérience même du monde pétrolier, puisse « jouer » sur le marché et bouleverser son évolution.
Ainsi, l'accès au marché doit être restreint sur des critères de professionnalisme et de solvabilité. Bien entendu, toute réglementation supplémentaire induira la tentation de créer des dispositifs clandestins pour échapper à la réglementation.
Par ailleurs, aucune réglementation sérieuse ne peut être limitée à un seul pays ou même à un groupe de pays, c'est-à-dire à quel point elle est ici évoquée pour mémoire, toutes ces mesures simples et de bon sens n'ayant aucune chance de voir le jour.
Troisièmement, la séparation des activités à risques et des dépôts bancaires a été déjà proposée aux Etats-Unis par Paul Volcker. Mais, comme nous l'a rappelé le professeur Bourguinat, la loi Dodd-Frank du 15 juillet 2010 a seulement limité pour les banques le droit de faire des opérations pour compte propre, ce qui ne leur interdit pas vraiment de « jouer au casino avec l'argent des clients »...
Là encore, toute réglementation française ou européenne, si elle n'est pas généralisée au monde, aura pour seul effet de pénaliser les places financières qui l'auront mis en oeuvre au profit des places qui demeureront « dérégulées ».
N'oublions jamais que l'essentiel du financement des entreprises est, dans un pays comme la France, assuré par les banques, mais qu'à l'inverse aux Etats-Unis, il est assuré par les marchés financiers. De même que beaucoup d'établissements qui tomberaient en France sous le coup de l'incrimination « d'exercice illégal de la profession bancaire » prospèrent dans de colossales activités de crédits aux Etats-Unis...
Quatrièmement, la réglementation des opérations hors bilan est effectivement au coeur du problème. Il faut toujours avoir présent à l'esprit que les phénomènes de titrisation ont été en partie la conséquence des ratios prudentiels qui exigent du capital en contrepartie des prêts consentis. Plus généralement, toute réglementation génère, si elle n'est pas mondialisée ou si elle comporte des failles, des phénomènes pervers bien plus graves que ceux que l'on veut éviter. On se souviendra que pour éviter l'accumulation excessive de dépôts dans les banques, les autorités américaines avaient réglementé la rémunération des dépôts (« regulation Q »). Cela a eu pour effet d'inciter les opérateurs à ne pas rapatrier leurs avoirs en dollars sur des comptes résidents aux Etats-Unis mais à les conserver, avec rémunération, dans des pays autres que les Etats-Unis.
C'est une des causes de la prolifération historique des « euro-dollars »267, laquelle est liée à l'histoire de l'expansion planétaire de la liquidité spéculative.
A ce titre, la réglementation des ratios prudentiels risque fort de ne pénaliser que les banques européennes et, en particulier françaises, et de favoriser les établissements financiers aux Etats-Unis qui vraisemblablement l'appliqueront très différemment.
Avant d'imposer des ratios prudentiels exigeant des fonds propres en rapport avec la valeur des prêts consentis, il faut réglementer efficacement les opérations hors bilan et les échanges de produits titrisés.
Lord Turner a rappelé cette évidence le 17 novembre 2010 dans le Financial Times : « Although a lot of the problems came from the shadow banking system, most of our response so far has been focused on the banking institutions ».
Cinquièmement, il faut être conscient de ce que le contrôle n'est possible que si l'on connaît et que l'on mesure les phénomènes dans le cadre de marchés relativement transparents. Aujourd'hui, personne au monde n'a une vision claire du volume de CDS en valeur compensée. Personne au monde ne peut donner un chiffre relativement précis de l'ampleur des créances illiquides des banques : le FMI a parlé d'abord de centaines de milliards de dollars, puis de deux mille, de quatre mille et les estimations les plus réalistes évoquent le chiffre de 12 000 milliards de dollars268.
Les sources les plus fiables sont actuellement celles de la BIS (Bank of International Settlements ou BRI en français), mais force est de constater que la conjonction d'une grande liberté d'accès au marché, de la pratique des opérations de gré à gré ou hors-bilan, des Dark-pools, et de la Haute-Fréquance font que les chiffres publiés et officiels, qui ne tiennent pas compte des phénomènes de compensation et d'une grande partie des activités « cachées » ne sont ni fiables, ni véritablement significatifs.
* *
*
Il faut simplement souligner en conclusion que la réglementation serait relativement inefficace si l'on n'entreprend pas de limiter la liquidité aux besoins de l'économie réelle.
Imaginer que l'on pourrait efficacement contrôler la spéculation uniquement par des mesures réglementaires n'a aucun sens, et de surcroît, si les mesures ne sont pas universellement appliquées et qu'elles ne procèdent pas d'une vision globale des phénomènes, elles auront des effets pervers.
269270271272273274275276277278279280281282283284285286287
CONTRIBUTION DE M. JEAN-PIERRE BRARD,
DÉPUTÉ DE SEINE SAINT DENIS (GROUPE GDR)
ET MEMBRE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
Si les travaux de la commission d’enquête ont permis d’approfondir les connaissances des parlementaires sur un certain nombre de points précis, cela n’a pas permis de réviser le constat global que les députés du groupe GDR dressent depuis le début de la crise : les mécanismes spéculatifs expliquent en grande partie la récurrence et l’importance des crises économiques. Cependant, la spéculation n’est qu’un des éléments constitutifs d’un paradigme économique, celui de « l’efficience des marchés », qui n’est que le dernier avatar du modèle capitaliste. Les mécanismes de spéculation actuels n’en restent pas moins particulièrement destructeurs pour l’économie dite réelle, l’emploi, l’environnement et, de manière générale, ils symbolisent l’échec fracassant des théories du marché libre apte à répondre aux défis du progrès humain.
Selon le Bureau international du travail, le nombre de chômeurs engendrés par la crise a bondi de 51 millions. Presque toutes les personnalités auditionnées n’ont pas trouvé de mots assez durs pour qualifier les dégâts provoqués par la spéculation : selon Michel Aglietta, par exemple, elle a « mis à mal l’équilibre monétaire et financier », enclenché un « processus de dérive systématique », provoqué une « dérive massive du crédit et donc un surendettement massif ». Enfin, la spéculation a mis en lumière « l’échec général de la coordination des marchés ». Et ce dernier de conclure qu’il « faut maintenant changer la doctrine ».
Les promesses de changement ont été particulièrement nombreuses depuis le début de la nouvelle étape de la crise, à l’automne 2008. Du « retour de la régulation », à la « refondation » du capitalisme, en passant par sa « moralisation », les dirigeants de la France et du monde n’ont pas hésité à proclamer la fin du paradigme actuel. Or, jamais suivies d’effets, ces déclarations n’induisent qu’une chose : l’arrivée d’une prochaine étape de la « crise ». Depuis le triomphe des théories du « marché efficient » à partir de la fin des années 1970, l’on ne peut qu’observer une accélération extrêmement inquiétante des crises économiques dues aux mouvements spéculatifs incontrôlés : 1987, 1991, 2001 avec la spéculation sur la « nouvelle économie », et, enfin 2007. Du reste, cette dernière « crise », celle initiée par la crise des subprimes, clairement anticipée par Jacques Mistral, ministre conseiller à l’ambassade de France à Washignton et que le gouvernement n’a pas entendu à l’époque, n’est toujours pas finie alors que nous sommes engagés dans sa troisième année. Il est d’ailleurs fort à craindre que nous n’en soyons qu’au début. Les auditions menées dans le cadre de la commission d’enquête n’ont pas manqué de renforcer cette crainte.
Beaucoup de propositions ont été faites pour mieux réguler les marchés financiers et pour améliorer la supervision de ses acteurs. Parmi celles-ci, il y en a beaucoup qui auraient dû être mises en œuvre depuis au moins deux ans. Ainsi, la titrisation à outrance devrait être interdite. Concrètement, il ne devrait pas être possible de titriser plus d’une fois afin de lutter conter l’opacité des marchés financiers. La transparence des opérations financières est en effet une question clé si l’on veut permettre aux États de reprendre le contrôle sur cette zone de non-droit qu’est devenue la finance. En ce sens, il est urgent de créer des bases de données centralisées d’enregistrement de toutes les transactions sur l’ensemble des dérivés de gré à gré en Europe. Nous passerions ainsi d’un mécanisme de surveillance délibérément artisanal et fonctionnant sur une base volontaire à un système automatisé, obligatoire et efficace. Cela permettra également de rendre enfin effective la taxation des transactions financières.
En ce qui concerne l’automatisation croissante des transactions, il convient également de prendre des mesures énergiques. Un tiers des transactions en Europe, et deux tiers aux États-Unis, sont aujourd’hui réalisées par des traders utilisant des programmes informatiques de passation automatique des ordres. Ces techniques, dont même Jean-Pierre Jouyet, président de l’Autorité des marchés financiers, a évoqué « l’utilité sociale douteuse », compliquent la détection des manipulations et « perturbent les investisseurs ». Rappelons ainsi l’histoire de cette firme américaine qui, en 2003, a fait faillite en seize secondes parce qu’un employé avait déclenché par erreur un mécanisme algorithmique. En d’autres termes, la trading algorithmique doit être interdit.
Quant au cloisonnement des activités des banques de dépôt et des banques d’investissement, il faut enfin briser la résistance du lobby bancaire afin d’imposer les restructurations nécessaires. Il en est de même en ce qui concerne le problème du too big to fail : il faut imposer une taille maximum aux banques privées et créer un grand pôle public du crédit.
Les agences de notation, autre sujet abondamment discuté, doivent, elles aussi, disparaître au profit d’entités publiques qui garantissent l’impartialité de leurs évaluations. Il est en effet inutile de rappeler les nombreux conflits d’intérêts entre les agences de notation et les autres acteurs de la finance – par exemple dans la crise grecque - ; conflits ayant pu déboucher sur des notations aussi absurdes que celles attribuant aux subprimes la fameuse note triple A.
Cette liste des mesures à prendre est très loin d’être exhaustive, mais une énumération complète n’a guère de sens dans la mesure où l’essentiel est ailleurs : si l’on veut réellement réguler les marchés financiers, il faut d’abord changer de paradigme. Il faut en finir avec le dogme des « marchés efficients » et changer radicalement d’approche. Le collectif des « économistes atterrés » l’a écrit avec beaucoup de force : « en tant qu'économistes, nous sommes atterrés de voir que ces politiques sont toujours à l’ordre du jour et que leurs fondements théoriques ne sont pas remis en cause. Les arguments avancés depuis trente ans pour orienter les choix des politiques économiques européennes sont pourtant mis en défaut par les faits. La crise a mis à nu le caractère dogmatique et infondé de la plupart des prétendues évidences répétées à satiété par les décideurs et leurs conseillers ». Lors de son audition par la commission d’enquête, monsieur Aglietta a d’ailleurs rappelé que la Banque des règlements internationaux a tiré la sonnette d’alarme au sujet de la dérive du crédit depuis la première crise immobilière des années 1990 (!). Or, selon monsieur Aglietta, « les autorités ont ignoré ces mises en garde ». Un autre exemple emblématique de ce dogmatisme destructeur est la manière dont la liberté de circulation des capitaux a été conçue et mise en place dans l’Union européenne. En effet, comment peut-on concevoir celle-ci sans procéder, en même temps, à la mise en place d’une autorité de surveillance européenne si ce n’est la théorie, ou plutôt le dogme, des « marchés efficients » et de la concurrence « libre et non faussée » qui a présidé à cette politique ? Une fois de plus, l’Union européenne a été un agent particulièrement zélé de cette doctrine dont la crise a démontré tout le potentiel destructeur. L’emprise de ce dogme dans les instances européennes explique également l’incapacité totale de celle-ci à répondre aux défis posés par la crise actuelle. Encore une fois, pour que la régulation puisse être efficace, un changement de paradigme est indispensable. Ce changement ne pourra donc se limiter aux seuls mécanismes de spéculation, mais il devra concerner l’ensemble de l’économie.
Celle-ci fonctionne en effet selon une logique totalement pervertie où les risques sont pris par ceux qui n’ont rien à gagner, à savoir l’immense majorité des salariés et contribuables. Monsieur Aglietta a très justement insisté sur le fait qu’il faut « avant tout comprendre les deux ressorts fondamentaux de la nouvelle logique qui a animé les entreprises. D’une part, celle-ci n’a plus eu pour objectif de redistribuer la richesse créée par l’ensemble de la société, mais de maximiser la valeur boursière en vue de maximiser les gains des actionnaires ». Cette valeur est une valeur fictive qui n’est pas adossée à une richesse effectivement créée dans le processus de la production des marchandises. D’autre part, poursuit monsieur Aglietta, « dans le cadre de la libéralisation financière, les actionnaires se sont mis à exiger des entreprises des taux de profit bien supérieurs au rendement réel du capital productif ». En conséquence, « ce ne sont pas les ménages qui financent les entreprises, mais les entreprises qui financent les actionnaires ».
Cette logique a fini par créer une fragilité financière du côté des entreprises, du côté des ménages, mais aussi du côté des États, dont les revenus ont reculé sous l’effet d’une réduction systématique de la fiscalité sur le capital. C’est cette logique qu’il convient de renverser afin de remettre l’économie au service du développement humain et du progrès social.
CONTRIBUTION DES DÉPUTÉS DU GROUPE SRC
MEMBRES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
La commission d'enquête sur la spéculation dont la création résulte d'une initiative du groupe des députés SRC a accompli un travail utile d'auditions dont le présent rapport constitue une synthèse fidèle.
Ce rapport devrait permettre d'éclairer l'opinion publique sur la réalité et l'ampleur des phénomènes spéculatifs et les menaces qu'ils font peser sur la stabilité financière internationale et sur l'économie réelle.
La description des principales dérives constatées sur les marchés financiers, légitime les critiques portées de longue date par les députés SRC à la fois sur leur fonctionnement et sur leur régulation pour le moins lacunaires.
La plupart des causes de fragilité des marchés sont présentées avec pertinence. L'insuffisante transparence des transactions, le rôle trouble des agences de notation, le risque permanent de survenue des bulles spéculatives, notamment en période d'abondance de la liquidité sont ainsi pointés du doigt. De même, les failles de la régulation des marchés sont soulignées, de même que le caractère inadapté de nombreuses règles, en matière d'encadrement des fonds propres ou de comptabilité notamment.
Il ressort clairement des analyses que la thèse du caractère efficient et autorégulateur des marchés financiers, à laquelle a longtemps adhéré l'actuelle majorité, ne peut être défendue. Le court termisme des acteurs, leurs comportements moutonniers, l'absence de transparence des différents marchés et leur caractère pro-cyclique et déstabilisant, sont clairement démontrés.
Néanmoins, le groupe SRC regrette que certains aspects n'aient pu être approfondis, faute de temps, durant les travaux de la commission d'enquête. Cela plaiderait pour que ces travaux soient poursuivis au sein de l’Assemblée nationale.
Le rôle central joué par les paradis fiscaux et réglementaires n'est que mentionné, alors qu'il apparaît clairement que ces territoires jouent un rôle déterminant en offrant des conditions au développement de l'activité des acteurs les plus importants en matière de spéculation. La localisation de la plupart des fonds spéculatifs dans ces entités, et le recours systématique des plus grands établissements financiers à des montages reposant sur les paradis fiscaux auraient dû faire l'objet d'une attention plus forte durant les travaux.
De même, les moyens permettant d'éviter que les acteurs de la spéculation bénéficient des mesures de sauvetage du secteur financier initiées par les pouvoirs publics alors même qu'ils sont à l'origine de sa déstabilisation ne sont pas mis en avant.
Il faut une nouvelle fois souligner que la thèse selon laquelle les établissements financiers français n'auraient été en rien acteurs de la crise financière n'est pas recevable, comme le démontrent d'ailleurs les analyses du rapport : la crise n'est pas seulement le produit de dérives sur les marchés des prêts hypothécaires aux États-Unis.
De même, les mesures de stabilisation décidées par les pouvoirs publics ont été clairement bénéfiques pour ces établissements, qui auraient été très négativement impactées en l'absence de réaction des gouvernements. Enfin, le choix fait par le gouvernement français de ne pas faire peser sur ces établissements et leurs actionnaires une part du coût de leur sauvetage reste très critiquable. Une intervention qui aurait pris la forme d'une prise de participation de l'État dans ces établissements aurait eu un effet positif direct sur leur rétablissement, et permis à l'État de bénéficier réellement des fruits de son intervention.
Paradoxalement, ce choix n'a été fait que pour un seul établissement, le plus fortement menacé, entraînant à ce jour des pertes potentielles pour les finances publiques. Les établissements plus solides ont été au contraire volontairement exemptés d'une juste participation financière au coût du sauvetage systémique. Ce choix reste incompréhensible pour nos concitoyens qui aujourd'hui sont appelés à des efforts massifs pour permettre le redressement de nos finances publiques.
La perspective de mise en œuvre d'une taxation spécifique des acteurs financiers, motivée par le coût très important des interventions étatiques lors des crises financières doit être évoquée. La multiplication des crises récentes, et le constat lucide fait par le rapport de la difficulté de mise en œuvre d'une régulation efficace à brève échéance, laissent penser que les États seront certainement amenés à intervenir de nouveau pour limiter les dégâts causés par de nouvelles crises financières. Sans que cela soit assimilable au paiement d'une prime d'assurance, il serait juste que les acteurs de ces crises soient contraints de reconnaître leur dette actuelle et future à l'égard des pouvoirs publics.
Le groupe SRC ne partage pas le jugement exagérément enthousiaste du rapporteur sur les mesures prises ou envisagées pour remédier aux phénomènes spéculatifs.
Les responsabilités des pouvoirs publics actuels dans le développement de la spéculation sont ainsi largement minimisées. S'agissant par exemple de la directive sur les marchés d'instruments financiers (MIF), aux conséquences qualifiées aujourd'hui de « désastreuse » puisqu'elle a favorisé le développement de l'opacité et de pratiques telles que le « trading à haute fréquence » (HFT), il faut ainsi rappeler le fait que l'actuelle majorité a procédé, malgré les critiques portées par les députés SRC, à sa transposition en arguant de l'utilité des marchés de gré à gré.
De même, on rappellera que quelques mois seulement avant l'éclatement du marché des subprimes aux États-Unis en 2007, l'actuel Président de la République proposait le développement d'un marché des prêts immobiliers hypothécaires pour permettre à tous les Français d'accéder plus largement au crédit.
Enfin, il est clairement apparu pour les années récentes que la majorité actuelle légiférait le plus souvent « à reculons » et sous la pression des crises successives, ce qui la force souvent à proposer avec retard des dispositions qu’elle avait précédemment repoussées lorsqu’elles lui étaient soumises, notamment par le groupe SRC. Ce fut le cas pour la régulation des agences de notation et plus récemment ce sont les difficultés apparues dans le cadre de la tentative de prise de contrôle du groupe Hermès qui conduisent le gouvernement à envisager, sous la pression, une modification de la réglementation relative aux franchissements de seuils.
L'insuffisance criante des réponses apportées aux problèmes mis en lumière par la crise financière est également minimisée.
Les réponses apportées par le gouvernement restent largement embryonnaires, comme le démontre le décalage entre les propositions faites par le rapport et les dispositions prises très récemment dans le cadre de la loi dite de « régulation bancaire et financière » du 22 octobre 2010.
De même, si le manque de moyens matériels dont disposent les autorités de régulation françaises pour accomplir de façon satisfaisante leur mission est souligné, le rapport se contente de mettre en avant les timides augmentations proposées récemment en matière de financement de l'Autorité des Marchés Financiers. Il faut pourtant rappeler que, comme nous l'avions souligné lors de la discussion de la loi de régulation bancaire et financière n'envisageait récemment la création que d'un seul emploi supplémentaire au sein de l'AMF pour assurer la mission de régulation des agences de notation. Pire, il est apparu au cours des débats parlementaires que ce poste était vacant puisque son titulaire avait rejoint le régulateur européen. Le rapport ne relève pas non plus que la régulation des marchés de matière première et de leurs dérivés, qu'il appelle pourtant de ses vœux et qui est actuellement confiée à l'AMF, n'a pas conduit à l'affectation de moyens nouveaux à cette autorité.
Des propositions lourdes font l'objet de développements trop limités. Ainsi, la perspective d'une plus forte séparation des activités de banque de dépôt et de banque d'investissement, reprise récemment aux États-Unis à travers la règle dite « Volker », sur laquelle le rapport ne prend pas clairement position, reste d’actualité. Cette organisation du secteur a pourtant structuré le système financier de Bretton Woods.
De même la proposition de mise en place d'une taxe sur les transactions financières n'est que brièvement évoquée, alors même que plusieurs des personnes auditionnées ont souligné son impact potentiellement positif pour freiner la spéculation.
Enfin, on ne peut que regretter que la mise en place de la commission d'enquête n'ait pas permis d'approfondir certains cas concrets de manœuvres spéculatives. Il appartiendra à la représentation nationale de suivre avec attention les enquêtes menées par l'Autorité des marchés financiers ou ses homologues étrangères. Est notamment visée l'action des établissements financiers conseils de la Grèce pour « optimiser » sa politique d'endettement, et leur comportement ultérieur dans la crise de confiance qui frappe ce pays.
Ainsi, si le rapport fait œuvre pédagogique utile, il reste parfois au milieu du gué sans doute par souci de ne pas pointer trop directement la responsabilité propre des pouvoirs publics au cours des années antérieures et les insuffisances des projets actuels de régulation.
CONTRIBUTION DE MME ÉLISABETH GUIGOU,
DÉPUTÉE DE SEINE-SAINT-DENIS (GROUPE SRC)
ET MEMBRE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
Je souhaite appeler l’attention sur le rôle de structures qui permettent au véritable bénéficiaire des actifs, le bénéficiaire économique, de ne pas apparaître : il s’agit des « trusts » et « fiducies ». À cet égard, le rapport d’information (n° 1834 du 15 juillet 2009) « En finir avec les trous noirs de la finance mondiale : du G20 de Londres au G20 de Pittsburgh » que j’ai co-signé avec M. Daniel Garrigue, dans le cadre des travaux de la commission des Affaires européennes, présentait notamment les propositions suivantes :
– Fixer une norme universelle fondée sur la centralisation dans chaque État des bénéficiaires des comptes bancaires comme des sociétés, fondations, fiducies ou trusts ;
– Promouvoir une centralisation des comptes bancaires, avec la constitution d’un fichier semblable au « fichier national des bancaires et assimilés » (Ficoba) en vigueur en France ;
– Une même centralisation est souhaitable avec un fichier des bénéficiaires des entités actuellement utilisées comme écrans : les trusts, les fiducies, les fondations, sociétés, notamment de type Anstalt, Stiftung ou IBC. L’existence d’un registre du commerce à jour, clair et transparent fait partie des principes de base de l’organisation du monde des affaires.
Or, j’observe que l’évolution de la législation française depuis 2007 a constamment élargi la possibilité de créer des fiducies, sans aucun progrès de la transparence.
GLOSSAIRE DES SIGLES UTILISÉS (1)
ABS : |
Asset backed security – Valeur mobilière adossée à des actifs |
ACAM : |
Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles |
ACP : |
Autorité de contrôle prudentiel |
AEMF : |
Autorité européenne des marchés financiers |
AES : |
Autorité européenne de supervision |
AMF : |
Autorité des marchés financiers |
AFT : |
Agence France Trésor |
AIFM : |
Alternative Investment Fund Managers – Directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs |
ANIA : |
Association nationale des industries alimentaires |
BAFIN: |
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht –Agence fédérale de supervision des marchés (Allemagne) |
BCE : |
Banque centrale européenne |
BRI : |
Banque des règlements internationaux |
CDO: |
Collaterized debt obligation – Obligation adossée à des actifs |
CDS : |
Credit default swaps – Contrat d’échange sur défaut |
CECEI : |
Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement |
CECB: |
Comité européen des contrôleurs bancaires |
CEPII : |
Centre d’études prospectives et d’information internationale |
CERS : |
Conseil européen du risque systémique |
CERVM: |
Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières |
|
______________________________ (1) La définition des termes techniques est donnée dans le corps du rapport, à l’occasion de leur première occurrence. | |
CFTC : |
Commodity futures trading commission – Agence fédérale de régulation des bourses d’échanges de matières premières |
CMF : |
Conseil des marchés financiers |
CMO: |
Collateralized mortgage obligation – Obligation parallèle sur hypothèque |
COB : |
Commission des opérations de bourse |
COREFRIS : |
Conseil de régulation financière et du risque systémique |
CRD : |
Capital requirement directives – Directive sur les fonds propres |
DPS: |
Droit préférentiel de souscription |
ESMA: |
European financial market authority – Autorité européenne des marchés financiers |
FCP : |
Fonds commun de placement |
FDIC : |
Federal Deposit Insurance Corporation – Organisme federal assurant les dépôts des ménages |
Fed : |
Federal reserve – Banque fédérale des États-Unis |
FESF : |
Fonds européen de solidarité financière |
FFSA : |
Fédération française des sociétés d’assurance |
FMI : |
Fonds monétaire international |
FSA : |
Financial services authority – Autorité des services financiers |
FSOC : |
Financial stability oversight council – Conseil du risque systémique (États-Unis) |
HFT : |
High frequency trading – Trading à haute fréquence |
ICE : |
Intercontinental exchange Londres – Marché intercontinental de Londres |
IS : |
Internalisateurs systématiques |
LBO : |
Leverage buy out – Financement d'acquisition par emprunt |
MATIF : |
Marché à terme international de France |
MIF/ MIFID : |
Markets in financial instruments directive – Directive européenne sur les marchés d’instruments financiers |
MR : |
Marchés réglementés |
MTF : |
Multileral trading facilities – Systèmes multilatéraux de négociation |
NTIC : |
Nouvelles technologies de l’information et de la communication |
NYSE : |
New York Stock Exchange |
OAT : |
Obligation assimilable du Trésor |
OCDE : |
Organisation de coopération et de développement économique |
OICV : |
Organisation internationale des commissions de valeurs |
OPCVM : |
Organisme de placement collectif de valeurs mobilières |
OPEP : |
Organisation des pays exportateurs de pétrole |
OTC : |
Over the counter – De gré à gré |
PSI : |
Prestataires de services d’investissement |
QE2 : |
Quantitative easing 2 – Politique monétaire américaine d’assouplissement quantitatif 2 |
SEC : |
Securities and exchange commission – Commission de sécurité des transactions |
SESF : |
Système européen de surveillance financière |
SICAV : |
Société d’investissement à capital variable |
SME : |
Système monétaire européen |
SMN : |
Systèmes multilatéraux de négociation |
SVT : |
Spécialistes en valeur du Trésor |
ANNEXE 1 : COMPTES RENDUS DES AUDITIONS
Les auditions sont présentées dans l’ordre chronologique des séances tenues par la commission d’enquête (toutes les auditions ont été ouvertes à la presse).
SOMMAIRE DES AUDITIONS
___
Pages
Audition de M. Michel Aglietta, conseiller au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII) (Procès-verbal de la séance du mercredi 8 septembre 2010) 305
Audition de M. Jean-Piere Jouyet, président de l’Autorité des marchés financiers, accompagné de M. Thierry Francq, secrétaire général (Procès-verbal de la séance du mercredi 15 septembre 2010) 317
Audition de M. Henri Bourguinat, professeur à l’université de Bordeaux-IV (Procès-verbal de la séance du mercredi 15 septembre 2010) 329
Audition de M. François Pérol, président de la Fédération bancaire française (Procès-verbal de la séance du mercredi 15 septembre 2010) 339
Audition de M. Philippe Mills, directeur général de l’Agence France Trésor (Procès-verbal de la séance du mercredi 29 septembre 2010) 347
Audition de M. Marc Touati, directeur général délégué de Global Equities (Procès-verbal de la séance du mercredi 6 octobre 2010) 363
Audition de M. Christian de Boissieu, professeur à l’université de Paris I (Procès-verbal de la séance du mercredi 6 octobre 2010) 375
Audition de M. Édouard Tétreau, auteur du livre Analyste : au cœur de la folie financière, gérant de MEDIAFIN (Procès-verbal de la séance du mercredi 6 octobre 2010) 383
Audition de M. Jean-Hervé Lorenzi, professeur d’économie à l’université de Paris-Dauphine, président du Cercle des économistes (Procès-verbal de la séance du mercredi 13 octobre 2010) 389
Audition de Mme Nicole El Karoui, professeur à l’Université de Paris VI (Procès-verbal de la séance du mercredi 13 octobre 2010) 397
Audition de M. Bertrand Jacquillat, professeur à l’Institut d’études politiques de Paris, président directeur général et cofondateur d'Associés en Finance (Procès-verbal de la séance du mercredi 20 octobre 2010) 407
Audition de M. Bernard Spitz, président de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), accompagné de M. Jean-François Lequoy, délégué général (Procès-verbal de la séance du mercredi 27 octobre 2010) 415
Audition de M. Augustin de Romanet, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, accompagné notamment de M. Alain Minczeles, responsable de la gestion des actifs pour compte propre, au département gestion financière (Procès-verbal de la séance du mercredi 27 octobre 2010) 421
Audition de M. Philippe Chalmin, professeur à l'Université de Paris-Dauphine, président de CyclOpe (Procès-verbal de la séance du mercredi 27 octobre 2010) 431
Audition de Mme Pervenche Berès, présidente de la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen, rapporteure de la commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale du Parlement européen (Procès-verbal de la séance du mercredi 27 octobre 2010) 441
Audition de M. Frédéric Oudéa, président-directeur général de la Société Générale (Procès-verbal de la séance du mercredi 3 novembre 2010) 451
Audition de M. Jean-Paul Gauzès, député européen, rapporteur de la proposition de directive visant à encadrer les fonds d'investissement alternatifs au Parlement européen (Procès-verbal de la séance du mercredi 3 novembre 2010) 467
Audition de M. Philippe Marchessaux, administrateur-directeur général de BNP Paribas Investment Partners, accompagné de MM. Christian Dargnat, responsable de la gestion, et de M. François Delooz, responsable de la conformité, chez BNP-Paribas Investment Partners (Procès-verbal de la séance du mercredi 10 novembre 2010) 477
Audition de M. Jean-Claude Gruffat, directeur général de Citigroup France (Procès-verbal de la séance du mercredi 10 novembre 2010) 485
Audition de Mme Catherine Lubochinsky, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Procès-verbal de la séance du mercredi 10 novembre 2010) 497
Audition de Mme Danièle Nouy, secrétaire générale de l'Autorité de contrôle prudentiel (Procès-verbal de la séance du mercredi 17 novembre 2010) 507
Audition de M. Patrick Artus, directeur de la recherche et des études économiques de Natixis (Procès-verbal de la séance du mercredi 17 novembre 2010) 517
Audition de Mme Carol Sirou, présidente de l’agence de notation Standard and Poor’s Paris, zone francophone, accompagnée de M. Jean-Michel Six, chef économiste Europe (Procès-verbal de la séance du mercredi 17 novembre 2010) 527
Audition de M. Bernard Valluis, expert de l'Association nationale des industries alimentaires (ANIA), accompagné de Mme Diane Doré, chef de projet affaires européennes et échanges extérieurs, et de Mme Elsa Chantereau, responsable des relations institutionnelles (Procès-verbal de la séance du mercredi 17 novembre 2010) 535
Audition de M. Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France (Procès-verbal de la séance du mercredi 24 novembre 2010) 547
Audition de M. Dominique Cerutti, directeur général de NYSE-Euronext, accompagné de M. Fabrice Péresse, directeur des opérations de marché de NYSE-Euronext. (Procès-verbal de la séance du mercredi 24 novembre 2010) 557
Audition de Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie (Procès-verbal de la séance du jeudi 25 novembre 2010) 569
Audition de M. Michel Barnier, commissaire européen chargé du marché intérieur et des services (réunion de la Commission des Affaires européennes ouverte aux membres de la commission d’enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement des économies) (extrait du compte rendu de la séance du 1er décembre 2010) 581
Audition de M. Michel Aglietta,
conseiller au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII)
(Procès-verbal de la séance du mercredi 8 septembre 2010)
(Présidence de M. Henri Emmanuelli, président de la commission d’enquête)
La séance est ouverte à dix-sept heures trente
M. le président Henri Emmanuelli. Monsieur le professeur, la commission d’enquête souhaite notamment comprendre comment on est passé, sur les marchés financiers, de mécanismes destinés à sécuriser les opérations à des mécanismes déstabilisants.
Pourriez-vous nous présenter une synthèse de cette difficile question ?
(M. Aglietta prête serment.)
M. Michel Aglietta, conseiller au Centre d’études prospectives et d’informations internationales. Je tenterai, dans un premier temps, de vous exposer le processus spéculatif ayant conduit à la crise financière, avant d’analyser, dans un second, les raisons profondes qui ont empêché de prévoir l’ampleur de l’instabilité qui a fini par toucher les marchés.
La crise que nous avons connue est la conséquence de ce que les économistes appellent le risque systémique, qui est l’échec général de la coordination des marchés. Ce phénomène remet en cause l’idéologie de la contre-révolution monétariste des « marchés efficients », qui s’est développée au début de la libéralisation financière dans les années 80. Les marchés efficients étant réputés autorégulateurs, il convient de réduire au minimum le rôle des instances publiques de régulation puisque les actionnaires et les marchés boursiers sont la boussole de l’économie.
Le risque systémique est évidemment un scandale pour cette théorie. En sapant le paradigme sur lequel est fondé, depuis trente ans, le lien entre les marchés, les autorités, les agents financiers et le reste de l’économie, il impose de recourir à un autre paradigme, selon lequel la finance n’est pas intrinsèquement instable mais connaît, l’histoire l’a montré depuis des siècles, des périodes récurrentes d’instabilité.
Il convient tout d’abord de ne pas confondre les notions d’incertitude et de risque. Le risque est une évaluation : de même que le marché évalue le prix relatif des biens, il évalue le prix relatif des promesses sur le futur, que sont les créances et les actifs. Comme ce sont des différences qui sont évaluées – les notes des agences de notations ne traduisent que des différences, la note absolue n’a aucun sens –, l’évaluation est établie selon une échelle ordinale.
Le niveau de risque général, qui sert de référence à la mesure des différences, est dès lors déterminé par le prix de la liquidité, qui est fixé par la banque centrale au moyen de sa politique monétaire. Il y a donc au moins un taux d’intérêt qui n’est pas déterminé par le marché, mais par une autorité qui lui est extérieure.
L’incertitude radicale se caractérise, elle, par une perte des repères : les agents ne savent plus évaluer les différences, qui s’exprimaient par des primes de risques – des spreads. Dans la mesure où ils ne savent plus différencier les produits, les agents se réfugient vers la liquidité absolue, considérée comme le dernier refuge. On notera que seuls les bons du trésor allemands, français ou américains, ceux des pays les plus sûrs, étaient recherchés durant la crise, d’où une explosion des spreads pour tous les autres produits financiers dont personne ne voulait plus, quelles qu’ait été par ailleurs la valeur des entreprises ou la qualité des agents économiques.
En temps normal, la spéculation joue un rôle équilibrant : des acteurs financiers mieux informés que d’autres, découvrant que les prix de certains produits ne correspondent pas à leur valeur réelle, jouent sur le retour des prix à cette valeur. Au contraire, en cas d’incertitude radicale, c'est-à-dire en l’absence de repères permettant d’évaluer les différences, la spéculation ne consiste plus à retrouver un prix d’équilibre entre les variations liées aux chocs du marché : privés de tout déterminant objectif, les acteurs prennent leurs décisions en fonction d'heuristiques qui consistent, finalement, à imiter les autres. Chacun étant à la même enseigne, il se produit une convention de méfiance à l’égard de toutes les valeurs, sauf de la liquidité absolue : c’est une convention de peur. La spéculation devient, de ce fait, déséquilibrante et finit par provoquer des processus destructeurs.
Le phénomène peut être fulgurant : le 8 août 2007, en annonçant qu’elle n’était plus capable d’évaluer certaines SICAV dynamiques, la BNP a mis « le feu aux poudres ». Les marchés se sont gelés d’un coup et les banques centrales ont été contraintes d’intervenir immédiatement : tel est le paroxysme d’un processus de spéculation destructeur. Pour créer un prix d’équilibre, il convient que les positions des acteurs du marché sur un même produit soient différentes : certains cherchent à vendre parce qu’ils pensent que le produit va baisser tandis que d’autre souhaitent acheter pour la raison inverse. Au contraire, en raison des mouvements collectifs que crée l’incertitude radicale, on assiste à la disparition de tout prix d’équilibre et donc à un défaut généralisé de coordination.
C’est donc bien en raison de la perte de tous les repères et de l’indifférenciation des valeurs que cette perte entraîne, que l’incertitude radicale se traduit par l’échec de la coordination des comportements privés et l’apparition de comportements collectifs : statistiquement parlant, on peut du reste observer une très forte corrélation des opinions individuelles tournées vers la méfiance.
Je vous l’ai dit en commençant : le socle fondamental, sur lequel reposent les évaluations différenciées, dépend d’au moins un taux d’intérêt déterminé non pas par les marchés, lesquels ne peuvent déterminer que des valeurs relatives, mais par les banques centrales : lorsque l’incertitude radicale touche ce socle, il appartient aux banques centrales, qui sont le dernier régulateur, de tenter de calmer l’angoisse généralisée des opérateurs de marché en garantissant un prix plancher des actifs. Elles le font en injectant des liquidités dans le marché interbancaire afin d’assurer un taux d’intérêt. C’est ce qu’elles ont fait dès le mois d’août 2007.
Lorsque la crise est d’une importance relative – je pense à la crise que Long Term Capital Management a connue en 1998 ou à la crise de liquidités qui a suivi le 11 septembre 2001 –, une seule action spectaculaire de la banque centrale concernée suffit à rendre la confiance aux marchés. La convention de méfiance se transforme alors d’un seul coup en convention de confiance. Dans le cas qui nous occupe, nous avons au contraire assisté à une récurrence de crise, en raison d’un autre phénomène : une dérive massive du crédit et donc un surendettement massif. Ce phénomène a nourri de manière permanente la crise de liquidités.
Il convient d’expliquer une accumulation aussi grande de dysfonctionnements. De fait, la crise que nous avons connue ne relève pas de la seule finance : elle a des racines plus profondes.
En ce qui concerne la finance, on a observé un changement profond du modèle de crédit. Dans le modèle traditionnel, les banques évaluent le risque individuel des candidats emprunteurs, puis, en cas d’acceptation du dossier, portent ce risque jusqu’à l’échéance des prêts. Comme elles prennent elles-mêmes le risque, elles ont tout intérêt à l’évaluer correctement. Or, nous sommes passés à un modèle où le risque n’est plus évalué par les offreurs de crédits initiaux, mais transféré à d’autres dans un processus de titrisation et de création de produits dérivés. Un tel processus incite fortement à la sous-évaluation, laquelle n’aurait pu être évitée que par un renforcement de la supervision. Mais les marchés étaient supposés efficients, le rôle des instances publiques de régulation avait été précisément réduit au minimum. Ce type de crédit n’a pas été supervisé, alors même que les banques qui pratiquent le crédit traditionnel le sont, puisque les risques qu’elles prennent peuvent mettre en cause leur bilan.
De fait, en pratiquant le crédit dans le seul but de le revendre instantanément à ces arrangeurs que sont les grandes banques d’affaires internationales, on a permis à des courtiers, qui n’appartiennent pas au secteur bancaire, de proposer du crédit, voire de démarcher de manière agressive les éventuels emprunteurs : ce fut le cas surtout dans les pays anglo-saxons, mais non en France, heureusement. Le moindre surendettement des ménages français explique en partie que la crise soit moins profonde dans notre pays.
Les courtiers étant rémunérés à la commission, ils n’avaient aucun intérêt à évaluer le risque, celui-ci retombant de toute façon sur le dernier acheteur du titre. C’est pourquoi, les banques d’affaires tirant profit des transactions de gré à gré, les intermédiaires de la finance avaient intérêt à allonger les chaînes de crédits, le risque se trouvant transféré en cascade de manière indéfinie.
Cette sous-évaluation du risque a été aggravée par les effets pervers de la régulation de Bâle : d’une part, celle-ci, limitée aux banques commerciales, ne concernait pas les banques d’investissement pur – ce qui n’a pas joué pour la France qui a des banques universelles ; d’autre part, le capital n’intervenant que dans le calcul du portefeuille bancaire, qui reste au bilan, un tel mode de calcul du ratio de solvabilité a représenté un véritable pousse-au-crime, puisque ce qui était hors bilan n’avait pas à être assuré en termes de capital. À partir de 2004, la perspective de l’entrée en application des recommandations de Bâle II a incité les banques à titriser au maximum, afin de se débarrasser des crédits en les intégrant dans des structures hors bilan.
À cela s’est ajouté le fait que le mécanisme de la titrisation, en termes d’incitation, n’a pas été compris.
Enfin, on ne peut que souligner la naïveté ou la crédulité des investisseurs qui ont acheté les titres. Je pense non seulement aux fonds de pension ou aux fonds souverains, mais également aux compagnies d’assurance et aux banques secondaires, notamment les Landesbanken allemandes : sous la pression de la Commission européenne, au nom du principe de concurrence, les garanties publiques pour les Landesbanken qui financent les collectivités locales ont disparu en 2005. Pour pallier les effets de l’augmentation du coût du crédit que cela entraînait, elles ont cherché à améliorer leur rentabilité. Cela les a conduites à acheter des subprimes, si bien qu’elles se trouvent aujourd'hui dans une situation très préoccupante.
N’oublions pas non plus que l’encadrement macroéconomique a encouragé la crédulité de certaines banques, des fonds de pension ou de certains investisseurs collecteurs d’épargne : c’était en effet une période de très bas taux d’intérêt obligataire et un portefeuille standard ne permettait plus, notamment à une caisse de retraite, de réaliser des profits correspondant aux engagements de passifs. Il convenait donc de chercher des actifs alternatifs mais, faute d’une expertise suffisante, le risque n’a pas été maîtrisé.
La même crédulité a du reste été partagée par tous les investisseurs ainsi que par les agences de notation, qui ont recommandé l’achat des tranches seniors des crédits hypothécaires titrisés en leur affectant la note triple A. Personne ne s’est alors demandé comment on pouvait donner une même note à des obligations d’État et à des titres comportant forcément un risque plus élevé, puisqu’ils rapportaient un intérêt très supérieur. Les investisseurs ont cru réaliser ce qu’on appelle dans le jargon financier de l’« alpha », c'est-à-dire obtenir plus de rendement sans prendre plus de risque. Même la Banque centrale de Chine s’y est fait prendre.
Le mécanisme de spéculation s’est donc enclenché et généralisé sans rencontrer aucun obstacle, ce qui a entraîné un surendettement massif et la création d’une bulle par une augmentation absurde du prix des actifs. Or le propre de la bulle spéculative, c’est de ne pas pouvoir soutenir les prix : aussi l’effondrement devient-il inéluctable. Toutefois, comme personne ne connaît la date de cet effondrement – c’est l’incertitude radicale –, la concurrence pousse les spéculateurs, qui espèrent pouvoir tirer à temps leur épingle du jeu, à poursuivre leur fuite en avant.
L’apparition de bulles boursières est un phénomène récurrent – rappelez-vous celles ayant touché le secteur des hautes technologies ou les économies asiatiques. Ce qu’il faut savoir, dans le cas présent, c’est que le marché du crédit contre collatéral n’est pas un marché ordinaire - ce que trop d’économistes orthodoxes oublient. Dans le cadre du marché ordinaire, en cas de hausse importante du prix d’un bien, on assiste à une diminution de la demande et à une augmentation de l’offre, ce qui crée un nouvel équilibre. Au contraire, dans le cadre d’un crédit contre collatéral, la garantie repose sur l’anticipation de la hausse de la valeur du bien, qui sera saisi en cas de faillite du débiteur. On n’a donc pas à s’intéresser aux revenus du débiteur par rapport au montant de sa dette si on anticipe la poursuite de la hausse du prix de l’actif financé par le crédit.
Une telle dérive spéculative est fonction d’une heuristique bien précise : les prix immobiliers sont censés monter indéfiniment pour l’ensemble d’un territoire donné, hypothèse que les grandes banques d’affaires et les agences de notation n’ont pas hésité à formuler pour le territoire américain. La demande de crédit ne peut dès lors qu’augmenter avec le prix, au lieu de baisser. En effet, la bulle financière permettant de réaliser l’anticipation, si la bulle est appelée à durer indéfiniment, la valorisation s’accroît avec elle : la demande de crédit augmente puisqu’elle finance l’anticipation. L’offreur fait le même raisonnement, espérant, en cas de difficultés du débiteur, revendre avec profit le collatéral. Dans une telle logique, l’offre et la demande sont corrélées dans le même sens, si bien que le taux d’intérêt ne peut plus équilibrer le marché : on aboutit dès lors à un processus de dérive systématique. En l’absence de toute régulation, ce processus a atteint un niveau historique.
J’en viens à mon second point : la nature du capitalisme financier qui est apparu dans les années 80, et s’est développé depuis les années 90.
Ce capitalisme a entraîné des déséquilibres structurels parce qu’il a mis fin au modèle antérieur, dont l’objectif était le développement des entreprises en vue de créer une valeur réelle et d’en partager le fruit. La logique de la grande croissance reposait sur un partage entre profit et salaire réel qui assurait à celui-ci une croissance au même rythme que la productivité. Quant au taux de profit, il était stable. Le processus inflationniste des années 70 – ce fut la première crise – a perturbé ce modèle de manière radicale. L’inflation et la spéculation participent de la même logique. En quelque sorte, on a remplacé, dans les années 2000, le processus d’emballement par l’inflation sur les marchés des biens, qui était celui des années 70, par un processus d’inflation sur les marchés des dettes.
Mais il convient avant tout de comprendre les deux ressorts fondamentaux de la nouvelle logique qui a animé les entreprises. D’une part, celle-ci n’a plus eu pour objectif de redistribuer la richesse créée par l’ensemble de la société mais de maximiser la valeur boursière en vue de maximiser les gains des actionnaires. D’autre part, dans le cadre de la libération financière, les actionnaires se sont mis à exiger des entreprises des taux de profit bien supérieurs au rendement réel du capital productif. Il a donc fallu recourir à l’effet de levier en augmentant la dette relativement aux fonds propres : cette exigence a entraîné une nécessaire déformation des bilans, laquelle nécessite le recours à l’endettement. Les entreprises ont donc été incitées, d’une part, à réaliser des fusions-acquisitions plutôt qu’à développer leur capital productif, et, d’autre part, à s’endetter massivement pour augmenter leur rendement financier par rapport à leur taux de profit intrinsèque. Cette logique de la valeur actionnariale a donc entraîné une dérive très profonde du rendement financier par rapport au rendement intrinsèque du capital productif.
Il faut également se rappeler que, selon la théorie financière classique, en cas de hausse importante de la Bourse, la valeur des actions, et donc de l’entreprise – la Bourse évalue l’entreprise en tant qu’entité économique – croît plus vite que le coût de reproduction du capital lorsqu’on achète les biens matériels. Il convient donc d’émettre des actions, afin de rendre la part des actions dans le financement de l’entreprise supérieure à celle des dettes. Or c’est le contraire qui a été fait, puisqu’on a procédé à des rachats massifs d’actions pour augmenter les dividendes. De cette façon, le rendement de l’actionnaire ne repose plus seulement sur le paiement régulier du dividende : ce que l’actionnaire gagne, c’est le montant du dividende qui lui est versé en termes de revenus augmenté de l’appréciation du coût de l’action.
En conséquence, ce ne sont pas les ménages qui ont financé les entreprises, mais les entreprises qui ont financé les actionnaires ! Telle est la logique sur laquelle ont reposé les processus spéculatifs que j’ai évoqués.
Pourquoi les ménages s’endettent-ils ? En baissant le niveau du capital (« destruction » d’actions par les rachats, relèvement du levier), on réduit le dénominateur du ratio que l’on veut maximiser. Mais on peut également être tenté d’augmenter le numérateur en exerçant une pression sur le partage entre salaire et profit. Cette pression a été facilitée par l’extension fantastique du marché du travail, avec l’entrée de la Chine et de l’Inde dans l’économie mondiale : l’offre de travail est devenue élastique, l’augmentation des salaires s’est trouvée bloquée du fait de la concurrence venant du monde entier, et il s’en est suivi la déformation du partage des revenus à laquelle nous avons assisté. La part des salaires dans la valeur ajoutée n’a fait que baisser – phénomène encore accentué dans les pays anglo-saxons, où le processus avait le plus d’amplitude – et le niveau du salaire moyen s’est déconnecté de la productivité, devenant insuffisant pour que la masse des salariés maintienne ses modes de consommation. Les ménages ont donc baissé leur taux d’épargne (jusqu’à zéro aux États-Unis) et augmenté leur endettement pour compenser des revenus qui ne croissaient pas assez vite.
On a ainsi créé une fragilité financière du côté des entreprises, du côté des ménages, mais aussi du côté des États, dont les revenus ont reculé sous l’effet d’une réduction systématique de la fiscalité sur le capital : entre 1992 et 1996, le taux moyen de l’impôt sur les sociétés est passé de 45 à 35 % dans les pays du G7. Du fait des difficultés rencontrées pour honorer leur service public, on a assisté à une dérive de l’endettement d’abord faible en raison d’une croissance satisfaisante, puis à une explosion au moment de la crise.
M. le président Henri Emmanuelli. Au regard de la déstabilisation que vous avez décrite dans la première partie de votre exposé, avez-vous le sentiment que les régulateurs ont failli ? Si oui, lesquels ?
Concluez-vous de vos observations qu’il serait bon d’interdire, ou de limiter, le rachat par une société de ses propres actions ?
M. Jean-François Mancel, rapporteur. Je vous remercie, monsieur le professeur, d’avoir décrit clairement les maux. Qu’en est-il des remèdes ? Comment prévenir la répétition de tels phénomènes ? Les autorités compétentes ont-elles, à vos yeux, pris le bon chemin ?
M. Paul Giacobbi. Vous avez évoqué le rôle des banques centrales après l’éclatement de la bulle spéculative. Pourriez-vous revenir sur leur rôle avant cet éclatement ? La Fed semble avoir eu un rôle amplificateur. L’ouvrage Wall Street Revalued : Imperfect Markets and Inept Central Bankers, notamment, montre le lien entre les bulles spéculatives et la politique monétaire des banques centrales.
En matière de titrisation, je partage votre analyse. Le problème n’est pas la première titrisation, où l’on arrive à déterminer à peu près de quoi il s’agit, mais la titrisation en cascade, où le risque augmente et où la rémunération est couverte par le recours à de nouveaux souscripteurs (c’est le Ponzi scheme, analysé notamment par Hyman Minsky).
Enfin les autorités, notamment en Europe, ne se trompent-elles pas à nouveau de débat en invoquant une augmentation du ratio de Bâle alors que les titrisations, y compris les titrisations en cascade qui ne sont nullement interdites, se poursuivent ? Cette mesure est tout à fait inopérante dès lors que le phénomène se déroule essentiellement « hors banque » (over the counter) et échappe, comme vous l’avez rappelé, au ratio de Bâle. Au vu des réflexes que nous conservons, on peut se demander si nous avons beaucoup avancé dans l’analyse des solutions. Augmenter le ratio de Bâle, c’est appliquer un cautère sur une jambe de bois !
M. Jean-Pierre Gorges. Tout le monde réclame de la régulation. Or je constate que, lorsqu’il y a des régulateurs, c’est le bazar ! Somme toute, les choses ne se seraient-elles pas mieux passées s’il n’y avait pas eu de régulation ? Ne pourrait-on privilégier des mécanismes légaux simples, telles la limitation du rachat d’actions par une entreprise ou l’interdiction de vendre une chose que l’on ne détient pas ?
Votre autopsie du système est remarquable. Mais où étiez-vous à cette époque-là ? Avez-vous vu le coup venir ?
M. Yves Censi. J’ai beaucoup apprécié la limpidité de votre explication, monsieur le professeur. La valeur se rapporte au risque. Aussi, lorsqu’il devient impossible d’identifier le périmètre du risque, elle devient aberrante.
Vous avez insisté sur le contraste entre la valeur réelle d’une entreprise, fondée sur sa production, ses actifs, ses ressources humaines, et sa valeur boursière, beaucoup plus volatile et sujette à emballements. Estimez-vous que cette distorsion est liée aux nouvelles normes comptables fondées sur la valeur boursière ? Faut-il remettre ces normes en question ou la cause principale n’est-elle pas la myopie des acteurs financiers ? On a vu certaines entreprises perdre toute leur valeur boursière alors qu’elles étaient tout à fait viables !
M. le président Henri Emmanuelli. Ou l’inverse : on a pu racheter très cher des entreprises parce que l’on obtenait du crédit pour le faire.
M. Yves Censi. Ce qui est grave, c’est qu’une entreprise puisse s’effondrer parce que l’on dit, à tort, qu’elle ne vaut plus rien.
M. Michel Aglietta. La loi adoptée aux États-Unis vise à traiter les problèmes globalement. En Europe, on a des directives séparées. La vision d’ensemble que proposait le rapport de M. de la Rosière s’est trouvée éclatée, du fait de mécanismes de négociation renvoyant soit aux hedge funds, soit aux marchés dérivés, soit aux assurances, etc. D’une certaine manière, les Américains ont repris le dessus et l’on peut se demander si leur législation ne va pas avoir des effets sur l’ensemble des instances de négociations internationales – le G20, le FMI et le Comité de Bâle, qui est désormais investi d’un rôle de proposition considérable et devient le lieu de coordination entre tous les banquiers centraux et superviseurs.
Bien entendu, il faudra prendre ce qu’il y a de meilleur aux États-Unis. L’Europe dispose déjà, mais sans la même force décisionnaire, d’un Comité du risque systémique. Jusqu’à présent, le postulat (celui de Bâle, notamment) était qu’une régulation individuelle suffisait : un comportement raisonnable des banques était censé garantir la robustesse du système. Or l’échec est bien celui de cette coordination par les marchés. J’y reviens, les marchés du crédit ne fonctionnent pas comme des marchés ordinaires : il existe des situations dans lesquelles le marché dérive par sa propre logique.
Voilà pourquoi on n’y a rien vu. C’est dans l’euphorie que les fragilités sous-jacentes se développent. Les comptes font apparaître une très bonne rentabilité et l’on développe un discours affirmant que cette situation euphorique est normale et correspond à des changements profonds. This time is different, pour reprendre le titre d’un récent ouvrage de Rogoff et Reinhart : avant chaque crise, la communauté financière et académique explique que les enseignements des crises passées ne sont pas pertinents parce que l’on n’est plus dans le même monde. Dans cet état d’extrême euphorie, on ne voit rien car on ne construit pas les indicateurs.
Si l’on a créé le Comité du risque systémique, c’est que le danger le plus important est la propagation des chocs et des instabilités d’un acteur à tous les autres, avec effet de feedback. Il faut examiner non seulement le bilan des acteurs, mais aussi leurs interconnections. Un acteur systémiquement important n’est pas nécessairement de grande taille, mais ses interconnections créent un risque de contreparties s’enchaînant les unes aux autres. C’est ainsi qu’AIG abritait en son sein une véritable bombe, à savoir une banque d’investissement cachée qui était la contrepartie des marchés dérivés du crédit du monde entier. La Fed ne pouvait laisser AIG faire faillite le lendemain de la faillite de Lehman Brothers : comme l’a dit Ben Bernanke, si l’on n’avait rien fait, l’économie aurait connu un effondrement généralisé.
Bref, il faut identifier et superviser de façon plus rigoureuse les entités systémiquement importantes : des banques traditionnelles mais aussi des hedge funds de grande taille, des banques d’investissement, des investisseurs institutionnels développant des activités d’intermédiation de marché. Ce « système bancaire fantôme » (shadow banking system) est à l’origine de la plupart des dérives qui ont mené à crise. Puisqu’il n’était regardé par personne, il est logique que l’on n’y ait rien vu !
J’en viens la question plus personnelle qui m’a été posée. Dans un livre paru en avril 2007, j’affirmais qu’une crise immobilière aux États-Unis était certaine en raison de la dérive des prix. Je n’étais d’ailleurs pas le seul à le dire. Mais on ne pouvait discerner la nature du processus de transmission de risques, dans la mesure où le phénomène était totalement opaque et caché par les banques d’affaires. C’est à mon retour de vacances, le 15 août 2007, que j’ai commencé à reconstituer le puzzle à partir des informations qui arrivaient.
Les agences de notation, en particulier, ont dû s’expliquer : alors que les prix de l’immobilier baissaient depuis l’automne 2006 mais que l’on continuait à titriser abondamment, elles n’ont dégradé massivement les crédits qu’en avril 2007.
La myopie généralisée s’explique aussi par le fait que les régulateurs ne contrôlaient pas le cœur du mécanisme. Aux États-Unis, chacun des régulateurs est en concurrence avec les autres et veille à sa chasse gardée. En Europe, cette concurrence se retrouve au niveau national : alors que beaucoup de banques sont transnationales, les régulateurs nationaux, jaloux de leurs informations sensibles, ne veulent pas coopérer. Le Conseil du risque systémique obligera à coopérer. Il appartiendra aux banques centrales, qui seront le pivot du Conseil, d’élaborer des indicateurs d’alerte, d’abord assez simples pour détecter le moment où les choses commencent à mal tourner.
Il faut d’ailleurs noter que la Banque des règlements internationaux (BRI) tirait la sonnette d’alarme au sujet de la dérive du crédit depuis la première crise immobilière des années 1990, qui avait mis en faillite les banques scandinaves. Les autorités ont ignoré ces mises en garde.
Le principal progrès, aujourd'hui, est que l’on se rend compte enfin que les marchés ne sont pas toujours capables de fonctionner et qu’il faut s’en occuper par une régulation macroprudentielle.
Les indicateurs simples peuvent donner une première alerte. Si l’on constate un dérapage des prix d’actifs, un écrasement des spreads de crédit traduisant une évaluation incorrecte du risque, une augmentation rapide du volume du crédit par rapport au PIB, la configuration est dangereuse. Il faut dans un second temps que la banque centrale organise des tests de stress macroéconomique, à l’avance (et non pas après coup) et avec une certaine périodicité. Ces tests permettent de déterminer où sont les risques de contrepartie les plus importants. Si on les avait pratiqués avant la crise, on aurait sans nul doute identifié AIG.
Par ailleurs, en dépit de l’opposition du lobby bancaire, il faudrait interdire certaines activités très dangereuses au sein des banques. C’est ce que l’on appelle la règle Volcker : le compte propre des banques investi pour rechercher des rentabilités extrêmement importantes constitue un facteur de fragilité considérable ; il faut donc séparer cette activité dans des filiales capitalisées séparément, qui ne contaminent pas la banque, qui ne soient pas « subventionnées » par elle et qui ne mettent pas les dépôts en danger.
L’Europe ne mettra pas œuvre cette règle car on considère que le modèle de la banque universelle donne un avantage comparatif. Les États-Unis, en revanche, vont dans cette direction.
Autre sujet de réflexion, le fameux principe du too big to fail, qui fait que des entités financières se considèrent comme tellement importantes d’un point de vue systémique qu’en cas de menace de faillite, elles prennent en otage les régulateurs et les autorités politiques, obligés de les sauver de peur d’un effondrement de l’ensemble du système.
Comment résoudre la question de la faillite, c'est-à-dire de la sanction nécessaire pour les banques, tout en évitant la propagation ? Un système de marché capitaliste où tout un secteur s’exonère de la loi de la faillite est en danger de mal fonctionner. Il faut trouver le moyen de rétablir une possibilité de résolution des faillites bancaires avec sanction des dirigeants, des actionnaires et des gros obligataires, qui ont le pouvoir de faire de la « discipline de marché » mais qui ne le font pas. Les faillites, puis les restructurations, doivent pouvoir se faire. Une manière d’y répondre serait de casser les banques en réduisant leur taille (on a vu, par exemple, les effets favorables de la réduction du monopole de AT&T dans le domaine des communications). Le lobby bancaire a été capable de s’y opposer jusqu’à présent.
Plusieurs questions ont porté sur les incitations. On s’aperçoit que de nombreux dispositifs (rachat d’actions, stock-options, rémunération de certaines professions...), mis en place en vue d’aligner les intérêts des actionnaires et ceux des dirigeants, peuvent avoir des effets pervers, y compris pour les actionnaires eux-mêmes.
S’agissant des stock-options et de la rémunération des professions qui agissent sur le risque, une mesure simple serait de suivre l’opération jusqu’au bout et de rémunérer les personnes une fois qu’elle est bouclée, au lieu de distribuer des stock-options avec possibilité de revente immédiate. On s’accorde à dire que les stock-options ne devraient pas être exercées avant 3 à 5 ans, en n’étant rémunératrices que si l’entreprise a réalisé une surperformance par rapport à la Bourse. Il s’ensuivrait un véritable alignement sur l’intérêt des actionnaires, et non la constitution de fortunes invraisemblables à laquelle on a assisté.
Quant aux rachats d’actions, ils ne devraient pas être possibles s’ils ne sont pas fondés sur une logique d’entreprise et ne servent que d’expédient pour créer une plus-value à court terme. Sur le plan comptable, le rachat engendre une fragilité du passif qu’il est nécessaire de justifier par l’utilité que peut avoir la hausse du cours pour l’entreprise (réalisation d’acquisitions ou de fusions dans de meilleures conditions, par exemple). On ne peut interdire systématiquement cette pratique dans une économie de marché, mais on a besoin de plus de transparence et d’argumentation.
En matière de titrisation, il faut également séparer le bon grain de l’ivraie. La titrisation peut être une très bonne chose. Dans le contexte actuel, par exemple, ce serait une bonne chose de titriser les crédits aux PME, et de vendre ces titres aux investisseurs institutionnels. Cela étant, une supervision est nécessaire pour éviter le travers consistant à ne pas évaluer le risque. Une première manière de faire est d’obliger les initiateurs du crédit à en conserver une partie. Mais c’est insuffisant. Il faut y ajouter, soit le contrôle indirect des agences, soit le contrôle direct de régulateurs de marché comme la SEC, l’AMF, etc. En outre, la structure du transfert de risque doit se faire le plus possible dans le cadre de marchés organisés, ce qui implique la normalisation de ce qui est titrisable. Les titrisations en chaîne permettent de prélever des commissions et d’échapper aux règles de Bâle ; en revanche, elles n’ont strictement aucun intérêt économique. Le jeu aurait pu se cantonner aux seules banques d’affaires, mais des fonds de pensions ont acheté des titres et, du fait de leurs pertes, n’arrivent plus à payer les retraites.
M. le président Henri Emmanuelli. Concrètement, il devrait être possible de titriser une fois mais pas deux...
M. Michel Aglietta. Les titrisations en chaîne doivent être interdites. La titrisation simple, elle, doit être standardisée pour pouvoir accéder à des marchés avec chambre de compensation.
M. Yves Censi. Le problème semble venir davantage des mélanges que des reventes.
M. Michel Aglietta. En effet. Lorsqu’il y a eu mélange, il devient impossible de contrôler les corrélations. On croyait diversifier le risque en créant des « paniers », or, lorsque les prix d’actifs sous-jacents ont connu des chocs, une corrélation considérable s’est produite et a entraîné une explosion du risque que les concepteurs des titres eux-mêmes n’avaient pas prévue.
Une autre idée serait de dissuader les investisseurs institutionnels de prendre dans leurs portefeuilles des produits qu’ils ne connaissent pas ! La discipline de marché dépend de la capacité des acteurs de bout de chaîne à évaluer le risque que contient le produit et, le cas échéant, à ne pas l’acheter, donc à faire peser une contrainte sur les émetteurs.
En résumé, si l’on dispose d’un pivot macroprudentiel (le Conseil du risque systémique), si l’on dissocie de l’activité bancaire proprement dite des activités qui doivent relever d’entités capitalisées séparément, si l’on arrive à faire régresser le problème du too big to fail, si enfin on réforme le marché des dérivés, on disposera d’un ensemble qui devrait rendre la finance plus stable.
J’en viens aux questions relatives aux responsabilités des banques centrales.
Ceux qui critiquent Alan Greenspan sont des détracteurs a posteriori. Auparavant, ses capacités « surnaturelles » faisaient l’unanimité ! Quoi qu’il en soit, son idéologie était celle du marché efficient : l’économie fonctionne avec des chocs dont les banques centrales doivent gérer les conséquences après coup. Théoriquement, les crises doivent rendre les acteurs plus responsables, le banquier central évitant quant à lui des pertes trop importantes en injectant la liquidité nécessaire (ce qui a eu pour conséquence, après 2001, de relancer la spéculation sur l’immobilier).
Plus précisément, la Fed a commencé à remonter ses taux à partir de mai 2004, alors que l’on était à 1 % depuis le début de 2001. La remontée a été rapide puisque, au printemps 2007, on est arrivé à 5,25 %. Or, pendant tout ce temps, les taux longs n’ont pas bougé. « L’énigme des taux longs », pour reprendre l’expression de Greenspan, est facile à résoudre : c’est la globalisation. Les déficits massifs des États-Unis sont rachetés par la Chine et les pays pétroliers, lesquels réinvestissent dans les obligations américaines. Dès lors, le marché obligataire n’est pas entraîné par la hausse des taux courts, ce qui favorise les déséquilibres globaux et la spéculation. Le manque de concertation entre les banques centrales et les antagonismes entre préférences nationales sont à l’origine de ces phénomènes.
M. le président Henri Emmanuelli. Le FMI n’a rien vu ?
M. Michel Aglietta. C’est la BRI qui a donné l’alerte. Le FMI, qui est hors du jeu sur le plan monétaire, retient de la globalisation que le marché du travail devient plus fluide et que la baisse des coûts salariaux permet de produire davantage. Et force est de constater que la croissance s’accélère, en particulier dans les pays émergents, dans un contexte d’inflation basse.
Ce point me conduit à revenir au rôle des banques centrales. La stabilité financière doit devenir un de leurs objectifs – c’était d’ailleurs le motif de leur création au XIXe siècle. À partir des années 1980, on a pris un virage à 180 degrés en leur assignant pour seul objectif la stabilité des prix au sens strict (c'est-à-dire les prix des biens et services). Les prix des actifs n’étant pas compris dans l’inflation, ils leur échappent.
C’est un problème de doctrine difficile. Jan Tinbergen, prix Nobel d’économie, a démontré que l’on ne pouvait, avec un seul instrument, gérer deux objectifs si ceux-ci ne sont pas parfaitement corrélés. Il faut donc chercher d’autres instruments d’ordre macroprudentiel, permettant le contrôle de l’offre agrégée de crédit. Les banques centrales doivent s’occuper également du volume du crédit en rapport avec les prix d’actifs.
M. le président Henri Emmanuelli. À une époque, la Banque de France avait une vision exacte du volume de crédit à tout moment.
M. Michel Aglietta. Néanmoins, elle ne menait pas de politique de crédit. De même, la BCE peut observer le volume de crédit. Mais, dans les années 2000, elle n’a fait que constater que ce volume augmentait très vite, sans jamais agir en fonction de cette donnée.
M. Jean-Pierre Gorges. En somme, nous disposons de tous les éléments pour évaluer les symptômes.
M. Michel Aglietta. Oui. Il faut maintenant changer la doctrine.
M. le président Henri Emmanuelli. La BCE craignait peut-être, en pointant l’accélération du crédit, de casser la croissance.
M. Michel Aglietta. En effet, d’autant que le phénomène est très difficile à juguler lorsque l’inflation est très basse. À l’instar de la norme d’inflation, il faudrait se doter d’une règle générale, d’un benchmark de l’évolution du crédit. La norme d’inflation à 2 ou 3 % a quelque chose d’arbitraire mais son existence contraint les anticipations des agents. De même, on pourrait indiquer que le crédit n’augmentera que d’un certain volume. C’est ce que faisait autrefois la Bundesbank, en vue notamment des négociations salariales dans les entreprises. Une telle règle permettrait d’acclimater l’idée qu’il est très dangereux que le crédit dérape.
M. le président Henri Emmanuelli. Nous vous remercions infiniment, monsieur le professeur. Si vous le voulez bien, nous vous interrogerons encore par écrit sur quelques sujets que nous n’avons pu aborder aujourd'hui.
M. Michel Aglietta. Je répondrai volontiers.
L’audition s’achève à dix-huit heures quarante-cinq.
*
* *
Audition de M. Jean-Pierre Jouyet, président de l'Autorité des marchés financiers, accompagné de M. Thierry Francq, secrétaire général
(Procès-verbal de la séance du mercredi 15 septembre 2010)
(Présidence de M. Henri Emmanuelli, président de la commission d’enquête)
La séance est ouverte à dix-huit heures cinquante cinq
M. le président Henri Emmanuelli. Monsieur le président, je vous remercie d’avoir répondu à l’invitation de notre commission d’enquête. La crise grecque a suscité de nombreuses interrogations, notamment sur la sensibilité des marchés financiers aux rumeurs, sur les conflits d’intérêts affectant des opérateurs à la fois conseils des émetteurs de titres souverains et acteurs sur les marchés des dettes souveraines, sur le mécanisme des couvertures de défaillance – ou « credit default swaps » (CDS) –, et sur les effets déstabilisants des outils permettant les ventes à terme et à découvert de certains produits financiers.
La commission d’enquête souhaite déterminer quand, comment et pourquoi des mécanismes conçus initialement pour exercer une action stabilisatrice, comme les ventes à terme, en sont venus à produire l’effet inverse. En quoi l’automatisation des décisions de vente et d’achat amplifie-t-elle les mouvements spéculatifs ? Quel est le rôle joué par les agences de notation dans les prises de position des fonds spéculatifs et des acteurs de marché ? Peut-on considérer qu’il y a eu, à l’occasion de la crise grecque, « délits d’initiés » ? Qui se livre aux attaques spéculatives, et à partir de quelles zones ou de quels marchés ? Quel a été le rôle des fonds alternatifs – les « hedge funds » ?
À titre personnel, je souhaiterais également connaître votre avis sur l’idée de revenir à une séparation des activités de banque de dépôt et de banque d’affaires – séparation réalisée partiellement, par des moyens comptables, par la loi de régulation financière américaine.
(M. Jouyet prête serment.)
M. Jean-Pierre Jouyet, président de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Monsieur le président, je tiens tout d’abord à saluer le choix du thème de cette commission d’enquête.
Permettez-moi, en commençant mon propos, d’être une peu provocateur. Acheter un actif financier en espérant que son prix augmentera et que l’on touchera un bénéfice quand on le revendra, suscite une condamnation morale de plus en plus vive. Pourtant, les financiers ne sont pas les seuls à se livrer à ce type d’activité. En quoi est-ce différent de la réalisation d’une plus-value immobilière, escomptée par tout un chacun à la revente de son bien ? Sans spéculateurs, il n’y aurait pas de marché. Pour qu’une transaction se fasse, il faut un acheteur et un vendeur, chacun considérant qu’elle est dans son intérêt. De même, les entreprises ne pourraient pas se protéger aussi facilement contre les fluctuations des prix des matières premières, des devises ou des taux d’intérêt s’il n’existait pas des « spéculateurs », ou plutôt des intermédiaires financiers, prêts à faire le pari inverse pour quelques heures, quelques mois, voire quelques secondes. La spéculation est consubstantielle au marché.
Le problème, ce n’est pas son existence, mais celle d’une spéculation excessive, que l’on pourrait qualifier de pathogène, porteuse de risques systémiques ou susceptible de porter atteinte à l’intégrité des marchés, ou celle d’une spéculation frauduleuse, passant par la manipulation des cours, la diffusion de fausses rumeurs, voire les manquements d’initiés - autant de pratiques contre lesquelles nous avons pour mission de lutter.
Aujourd’hui, les principaux acteurs du mauvais feuilleton du printemps sont montrés du doigt. Vous les avez identifiés dans votre rapport sur la proposition de résolution tendant à la création de la commission d’enquête, monsieur le président, et vous cherchez aujourd’hui à savoir quelle est la responsabilité respective des agences de notations, des États, des banques, des hedge funds.
Il est pour moi plus compliqué qu’il n’y paraît de vous répondre car l’AMF n’est pas le régulateur de tous les marchés de dettes souveraines en Europe ; elle n’est compétente que sur les opérations comportant un élément de territorialité, c’est-à-dire sur celles relatives aux titres cotés en France ou réalisées par des opérateurs français. Aux termes de la loi, c’est le secrétaire général, M. Thierry Francq, ici présent, qui est habilité à ouvrir et à instruire les enquêtes. Je ne saurais me substituer à lui. Aussi centrerai-je mon propos sur trois sujets que vous avez évoqués, et dont deux furent au cœur de la crise grecque : les ventes à découvert, les agences de notation et le trading algorithmique.
Les ventes à découvert, dont le rôle avait déjà été contesté lors de la crise bancaire, ont été une nouvelle fois mises en cause dans la crise grecque qui s’est développée à partir de novembre 2009. Celle-ci s’est concrétisée par la flambée des cours des CDS souverains et des écarts de crédit – spreads – des obligations d’État émises par la Grèce, ainsi que par une forte chute du taux de change euro-dollar.
Soyons clairs : cette crise provient, au premier chef, des mensonges publics grecs sur certaines statistiques. Lorsque, le 4 octobre 2009, M. Georges Papandréou arrive au pouvoir, il décide de faire la vérité sur le déficit budgétaire du pays, qui s’avère être de 12,7 % du produit intérieur brut (PIB), et non de 6 %. Les marchés perdent confiance. Nul besoin de spéculateurs pour faire chuter les cours et monter les taux : il suffit qu’il n’y ait plus d’acheteurs. Plus personne n’a confiance dans les données statistiques diffusées par les Grecs, ni dans la capacité de la Grèce à rembourser ses dettes ; plus personne ne veut acheter de la dette grecque. Les taux grimpent. Le pays emprunte à des coûts de plus en plus élevés. Ceux qui détenaient de la dette grecque cherchent alors à la céder ou à se protéger grâce à des CDS contre la dépréciation de leur portefeuille.
La raréfaction des acheteurs et les ventes de titres de plus en plus dépréciés peuvent suffire à expliquer la hausse des taux grecs durant cette période. Il est néanmoins possible que des spéculateurs aient tenté d’anticiper les mouvements en vendant « à découvert » – ce qui signifie que l’on emprunte des titres pour les vendre, dans l’objectif de les racheter une fois leur cours déprécié, avant de les rendre à leur propriétaire d’origine, en empochant dans l’intervalle la différence entre le prix d’achat et le prix de vente. Si ces opérations amplifient les tendances au point de contrarier le mécanisme de formation des prix, ou si elles sont accompagnées de rumeurs visant à alimenter la spirale baissière, on peut parler de manipulation des marchés. Qui plus est, si le vendeur ne prend même pas la précaution d’emprunter le titre qu’il vend, il court le risque de ne pas pouvoir le livrer, se mettant ainsi potentiellement en infraction avec les règles de marché ; on parle alors de « vente à découvert à nu ».
Compte tenu de l’ampleur des mouvements observés à l’acmé de la crise grecque, les services de l’AMF ont cherché à déterminer si des interventions spéculatives avaient aggravé les mouvements de marché. Je tiens à souligner qu’à l’heure actuelle, les manipulations de cours sur des produits dérivés échangés de gré à gré ne peuvent donner lieu à des sanctions, faute de base légale ; le projet de loi de régulation bancaire et financière va y remédier en donnant à la commission des sanctions de l’AMF la possibilité de sanctionner des abus de marché, notamment les manipulations de cours portant sur des instruments dérivés échangés sur des marchés de gré à gré et dont le sous-jacent est coté sur un marché réglementé.
Aujourd’hui, l’AMF ne collecte pas la totalité des données relatives aux transactions sur les marchés de dette souveraine. Les informations concernant les transactions sur les titres de dettes cotés en France – marchés organisés, marchés obligataires, marchés de titres d’État – lui sont transmises automatiquement, mais il n’existe à ce jour aucun dispositif de reporting équivalent pour les CDS. Un tel dispositif n’aurait un sens que s’il était européen, compte tenu de l’importance de certaines places financières, en particulier celle de Londres ; or pour l’instant, les régulateurs européens ne se sont mis d’accord que pour un échange organisé des données sur les titres eux-mêmes. Notre seule possibilité est donc de nous adresser directement et individuellement aux intermédiaires financiers ayant réalisé des opérations sur les CDS. L’AMF a donc interrogé systématiquement les principaux intervenants français réputés actifs sur ce marché.
Ceux-ci nous ont fourni les informations demandées sur les transactions réalisées sur les CDS grecs de novembre 2009 à février 2010. Leur volume s’avère relativement faible au regard des transactions sur les obligations souveraines grecques. Autrement dit, le marché des CDS est resté limité à l’aune du marché de la dette grecque elle-même.
S’agissant de la chronologie des opérations, les deux principaux établissements français actifs sur ce secteur de marché semblent s’être protégés davantage au fur et à mesure que les craintes sur la solvabilité de la Grèce, donc le prix des CDS, augmentaient. Plus généralement, nous n’avons pas relevé d’indices suffisants de comportements spéculatifs susceptibles de déstabiliser les marchés, comme des ventes à découvert en début de période, suivies de rachats après la baisse des cours. Je rappelle par ailleurs que seules les autorités grecques sont compétentes pour collecter une information exhaustive sur les transactions relatives à la dette grecque – et elles ont diligenté une enquête –, de même que seule l’AMF est compétente pour les obligations émises par le Trésor français et cotées en France.
Les enseignements à tirer des investigations que nous avons menées en matière de ventes à découvert sont de trois ordres.
Tout d’abord, nous n’avons pas trouvé de « smoking gun », d’indice manifeste ou de flagrant délit, mais nous ne pouvons exclure que des acteurs étrangers ou des acteurs finaux non identifiés, dont les ordres auraient été noyés dans la masse, aient pu avoir un comportement spéculatif.
Ensuite, la capacité du régulateur à surveiller les marchés de dettes souveraines est encore trop limitée. Les enquêtes sont lourdes – elles nécessitent en général des investigations européennes, voire internationales –, elles sont limitées par les compétences territoriales des différents régulateurs, et notre vision du marché reste partielle en l’absence d’une collecte systématique des informations sur les transactions réalisées sur les produits dérivés « over-the-counter » – OTC, « sous le comptoir » –, en France et hors de France. Cette difficulté à surveiller les transactions sur les marchés dérivés de gré à gré n’est d’ailleurs pas limitée aux marchés de dette souveraine.
Enfin, l’Europe est en retard dans ce domaine crucial de la surveillance. C’est pourtant un chantier sur lequel il faut avancer vite, compte tenu des enjeux systémiques des dérivés, notamment des dérivés de crédit, et des enjeux de surveillance micro-prudentielle. Nous avons besoin d’une vision consolidée à l’échelle européenne, ce qui suppose l’adoption de législations appropriées à ce même échelon, avec des mécanismes d’enquête et d’échanges d’information efficaces – nous en sommes loin.
M. le président Henri Emmanuelli. Les régulateurs européens ne communiquent-ils pas entre eux ?
M. Jean-Pierre Jouyet. Si, mais uniquement sur ce qui est organisé.
Quels sont les remèdes possibles ?
Tout d’abord, il faut organiser très rapidement le reporting systématique aux régulateurs des transactions sur les CDS, afin de faciliter l’analyse des données et de rendre le contrôle plus efficace. Dans le courant de l’année prochaine, devrait être instauré au niveau européen, sur une base volontaire, un système de reporting standardisé des dérivés échangés de gré à gré ; mais à vingt-sept, et compte tenu de la complexité technique des travaux, cela prend du temps…
Ensuite, il faudrait, suivant l’exemple des États-Unis, créer des bases de données centralisées d’enregistrement des transactions – « trade repositories » – sur l’ensemble des dérivés de gré à gré en Europe. Nous passerions ainsi d’un mécanisme de surveillance artisanal et fonctionnant sur une base volontaire à un système automatisé, obligatoire et efficace.
En troisième lieu, nous militons pour la création d’un identifiant client. Aujourd’hui, on doit passer par les intermédiaires financiers ; si l’on connaissait le nom du client final, les services de l’AMF n’auraient pas à interroger individuellement chaque prestataire. Cela ferait gagner beaucoup de temps.
S’agissant enfin de l’encadrement des ventes à découvert, l’AMF propose plusieurs mesures.
Premièrement, il conviendrait de faire respecter les règles existantes en matière de règlement livraison des titres. Trop de pays européens tolèrent les défauts de livraison, ce qui fait le jeu des spéculateurs.
Deuxièmement, il faudrait doter les régulateurs de pouvoirs d’urgence leur permettant de restreindre les conditions de négociation des instruments financiers en cas de circonstances exceptionnelles ; c’est ce que prévoit le projet de loi de régulation bancaire et financière.
Troisièmement, il serait souhaitable d’établir des règles permettant de s’assurer que celui qui procède à une vente à découvert dispose bien du titre qu’il devra livrer – ce que les marchés anglo-saxons appellent une « locate rule ». Ce système, qui revient de fait à interdire les ventes à découvert à nu, semble préférable à une interdiction permanente des ventes à découvert. En effet, d’une part, les ventes à découvert peuvent dans certains cas contribuer à la liquidité du marché, d’autre part, des titres peuvent être en apparence vendus à découvert alors que l’opération vise à se protéger contre un risque à court terme – par exemple, contre un risque de défaillance d’une banque grecque non cotée. La Commission européenne réfléchit à une mesure en ce sens.
Enfin, on pourrait envisager au niveau européen, en s’inspirant de l’exemple américain, une interdiction des ventes à découvert au-dessous d’un certain plancher – par exemple, lorsque la valeur d’un titre a diminué de plus de 10 % depuis le début de la journée –, afin d’éviter que les vendeurs à découvert ne dictent la tendance du marché et n’amplifient la baisse.
De telles mesures n’ont de sens que si elles sont prises au niveau européen : on ne gagnera pas grand-chose à prendre des dispositions en France si rien ne change à Londres.
J’en viens – deuxième sujet – aux agences de notation.
De fait, la dégradation brutale des notes de certains pays a pu susciter des mouvements de panique sur les marchés.
Il ne fait pas de doute que les agences de notation doivent être mieux encadrées et leurs modèles d’évaluation revus. Certaines pratiques, comme la dégradation de la note de l’Espagne quinze minutes avant la clôture des bourses, sont inacceptables. Les agences doivent faire preuve d’à-propos. Cela pourrait faire l’objet d’une règle qui compléterait utilement le dispositif européen.
Par ailleurs, le processus de formation de la note doit être cohérent, transparent et stable. À titre personnel, j’estime que, lorsqu’il s’agit de la dette souveraine, il faut s’en tenir aux « fondamentaux » de l’économie. Si la notation prend en considération les hoquets du marché, elle risque d’entretenir un cercle vicieux : les dégradations de la note d’un État vont entraîner mécaniquement l’augmentation de son coût de financement, ce qui va amener l’agence de notation à dégrader de nouveau la note. C’est un peu ce qui s’est produit dans le cas de la Grèce ; de même, regardez aujourd’hui ce qui se passe sur les titres irlandais !
Il reste que les notations des agences sont des thermomètres utiles. Elles ont le mérite de dire tout haut ce que le marché pense tout bas et de mettre chacun devant ses responsabilités. Ainsi, les deux tiers de la dette française étant détenus par des investisseurs étrangers, il paraît légitime que ceux-ci veuillent recueillir un avis sur l’évolution de nos finances publiques.
Il convient néanmoins de se « désintoxiquer » collectivement des agences de notations. Nombreux sont ceux qui les utilisent, y compris parmi les plus hautes autorités publiques. On peut difficilement reprocher au marché d’y recourir alors que la Banque centrale européenne l’a fait pendant très longtemps, ou que d’autres banquiers centraux leur délèguent l’appréciation des risques pour les actifs qu’ils acceptent en refinancement.
J’en arrive – troisième sujet – à la transformation du marché des actions.
Elle est trop souvent passée sous silence lorsqu’on cherche à identifier les facteurs aggravant la spéculation excessive ou frauduleuse. Elle résulte de la modification de l’environnement réglementaire, en particulier de l’entrée en vigueur en 2007 de la directive européenne sur les marchés d’instruments financiers (MIF), qui a fait voler en éclats le monopole des bourses traditionnelles.
Désormais, les titres sont échangés simultanément sur des plateformes multiples. De ce fait, le régulateur ne dispose plus d’informations aussi précises sur les ordres. Cette fragmentation des marchés s’est accompagnée de la création de plateformes de négociation alternatives dites « noires », les « dark pools », qui ne dévoilent pas leur carnet d’ordres au public. Une poignée de grandes institutions financières tirent profit de cette opacité et de la fragmentation croissante des marchés. À mon avis, elles ne devraient pas pouvoir faire en Europe ce qu’elles ne pourraient plus faire aux Etats-Unis, où mon homologue, Mme Shapiro, présidente de la Securities and Exchange Commission (SEC), que je dois rencontrer demain, s’inquiète d’une dérive comparable.
M. le président Henri Emmanuelli. Une fragmentation, là aussi ?
M. Jean-Pierre Jouyet. Oui, et les autorités américaines essaient de réagir. C’est plus facile à faire aux États-Unis qu’en Europe, celle-ci étant elle-même fragmentée.
Soyons clairs : il n’y aura pas de véritable régulation européenne des marchés tant que la directive MIF ne sera pas revue en profondeur. Sa révision est programmée pour 2011. Comme vous l’avez souligné dans votre rapport, la concurrence entre plateformes instaurée par la directive s’est accompagnée d’avancées technologiques spectaculaires, qui opacifient encore plus les marchés. Un tiers des transactions en Europe – deux tiers aux États-Unis – sont aujourd’hui réalisées par des traders utilisant des programmes informatiques de passation automatique des ordres. Ces techniques, à l’utilité sociale douteuse, compliquent la détection des manipulations de cours, tout en perturbant les investisseurs, qui n’arrivent plus à lire le marché ; elles engendrent des risques opérationnels, des risques systémiques et des risques pour la stabilité financière. En 2003, une firme américaine a fait faillite en seize secondes parce qu’un employé avait déclenché par erreur un mécanisme algorithmique. Et le krach éclair de Wall Street, le 6 mai dernier, est en partie imputable au trading de haute fréquence ; l’événement fut si soudain qu’il n’est pas sûr que l’on sache jamais ce qui s’est passé, non en raison d’une quelconque mauvaise volonté, mais parce qu’il est impossible au régulateur américain de réunir la totalité des données.
De part et d’autre de l’Atlantique, nous avons donc les mêmes préoccupations. Au niveau européen, il faudrait nous entendre pour hausser nos moyens réglementaires et techniques au niveau des nouvelles technologies. Cela suppose des investissements très importants, ainsi qu’une ambition commune qui n’existe pas encore.
À défaut de permettre au gendarme de courir aussi vite que les voleurs, en d’autres termes si le régulateur ne peut pas surveiller efficacement les marchés, certaines pratiques, comme le trading algorithmique, devraient être strictement encadrées, voire interdites. Il ne faut pas exclure de limiter la vitesse des transactions, d’imposer une durée minimale avant l’annulation d’un ordre – aujourd’hui, certains ordres ne restent que quelques dizaines de microsecondes dans le carnet d’ordres – ou de tarifer les ordres annulés.
M. le président Henri Emmanuelli. On joue aujourd’hui avec la fragmentation.
M. Jean-Pierre Jouyet. En effet. Le but de ce trading algorithmique, c’est qu’à la fin de la journée, les opérateurs et les traders n’aient rien perdu, et si possible qu’ils aient gagné. Il leur faut donc sans cesse revenir sur l’ordre qui vient d’être passé.
La transformation actuelle des marchés complique beaucoup notre mission de surveillance. Tout le monde s’accorde pour dire que, si l’on veut établir la confiance dans un marché, il faut le surveiller correctement, afin qu’il n’y ait ni manipulations ni délits d’initiés. Or aujourd’hui, sur certains marchés, le régulateur n’est pas à même de remplir ses tâches de surveillance. Voilà pourquoi il me paraît important que la transformation des marchés d’actions soit inscrite à l’ordre du jour du prochain G 20 – même si cela ne fait pas consensus.
Permettez-moi, en conclusion, de revenir sur un épisode récent. Nos amis allemands ont décidé seuls, sans nous en informer au préalable, d’interdire les ventes à découvert sur les titres de dette souveraine cotés en Allemagne. En pratique, ne sont concernées que les dettes allemande et autrichienne ; et cette interdiction, aussi spectaculaire soit-elle, et dont on sait bien qu’elle a été dictée par des considérations de politique intérieure, est, pour brider la spéculation, aussi efficace qu’un emplâtre sur une jambe de bois ! La succursale de la Deutsche Bank à Londres n’est pas soumise à la règle.
De telles mesures ne peuvent être efficaces que si elles sont adoptées par les Vingt-sept. Bien plus, une interdiction isolée risque de provoquer le déplacement des transactions visées – sans doute vers Singapour, Hong-Kong et Dubaï : il ne s’agit pas seulement de transferts entre Paris, Londres, Francfort ou New-York.
Une plus grande intégration de l’Europe financière, assortie de la création d’un véritable gendarme européen, paraît donc nécessaire. Je me réjouis des progrès réalisés ces derniers jours, mais nous devons rester très ambitieux quant à la définition précise du champ de compétence de la future Autorité européenne des marchés financiers (ESMA). Il faut que celle-ci dispose des pouvoirs les plus étendus si nous voulons mettre fin aux abus que j’ai décrits.
En ce qui concerne la question que vous m’avez posée à titre personnel, je vais voir au Etats-Unis si la réponse qui y est apportée dans le cadre de la Volcker Rule et de la loi Dodd-Frank me paraît bonne, en examinant aussi les exceptions prévues. Une réflexion est également en cours au Royaume-Uni. Quel que soit notre propre modèle d’organisation bancaire et financière, le fait que d’autres s’orientent dans cette voie doit nous conduire à nous interroger.
M. le président Henri Emmanuelli. Merci. Monsieur le secrétaire général, je vous donne la parole avant que nous en venions aux questions.
(M. Thierry Francq prête serment.)
M. Thierry Francq, secrétaire général de l’AMF. Quelques mots sur les enquêtes que nous menons sur ce qui s’est passé.
Nous avons analysé toutes les opérations réalisées par tous les grands opérateurs français sur tous les titres liés à la dette grecque, CDS et contrats à terme – futures – inclus. Au bout du compte, nous n’avons pas trouvé d’indice significatif d’une spéculation pathogène – mais notre champ d’observation étant limité aux opérateurs français, nous n’avons pas une vision globale du marché. Le régulateur grec continue d’enquêter, et nous l’aidons dans la mesure du possible.
Nous enquêtons aussi sur des mouvements suspects observés sur d’autres marchés de dettes souveraines, y compris celui de la dette française, qui a été perturbé par une rumeur.
Les enquêtes sur les mouvements provoqués par des rumeurs sont particulièrement difficiles. On peut essayer de déterminer qui a vendu ou acheté au bon moment, mais cela n’en fait pas pour autant un coupable ; il faut aussi savoir qui a diffusé la rumeur.
M. le président Henri Emmanuelli. Si vous réussissez à l’identifier, le responsable peut-il être sanctionné ?
M. Thierry Francq. Actuellement, on peut sanctionner la manipulation de cours par une rumeur si elle porte sur la dette. Ce n’est pas le cas si l’opération concerne les seuls CDS. Cette lacune va être corrigée par la loi de régulation bancaire et financière. Dans le cas des dettes souveraines, le marché des CDS n’est pas extrêmement important, mais cela permettra d’accroître nos pouvoirs sur d’autres types de marchés.
M. le président Henri Emmanuelli. Actuellement, vous n’avez aucune compétence sur les CDS ?
M. Thierry Francq. Nous pouvons sanctionner un délit d’initiés, mais pas une manipulation de cours.
Il faudrait apporter une correction identique au niveau européen, sans quoi des problèmes de coopération se poseront.
M. Jean-Pierre Jouyet. C’est pourquoi il importe de réviser la directive MIF, pour pouvoir collecter les données uniformément en Europe, et la directive Abus de marché, pour pouvoir sanctionner de manière cohérente et garantir la coopération !
M. le président Henri Emmanuelli. Les conclusions de vos enquêtes sont-elles rendues publiques ?
M. Jean-Pierre Jouyet. Ce point fait actuellement débat dans le cadre de la discussion du projet de loi de régulation bancaire et financière. Actuellement, la publicité peut être un élément de la sanction.
M. le président Henri Emmanuelli. Le système est donc analogue à celui d’une décision de justice, dont le juge apprécie si elle doit ou non être rendue publique.
M. Jean-Pierre Jouyet. En effet. À l’AMF, nous serions plutôt favorables à un élargissement de la publicité.
M. Thierry Francq. Le principe est aujourd’hui que la sanction n’est pas rendue publique, sauf décision contraire de la commission des sanctions. Nous souhaiterions que l’on fasse au contraire de la publicité la règle, les éventuelles exceptions devant être motivées.
S’agissant de la surveillance des marchés, je pense que la principale fraude qui risque de se développer, du fait de la fragmentation des marchés, c’est la manipulation de cours, qui s’apparente à de la spéculation frauduleuse. À la Bourse de Paris, nous avons accès à tous les carnets d’ordres, mais aujourd’hui, une partie des transactions du CAC 40 ont lieu sur une autre plateforme, Chi-X, située à Londres.
Sur cette bourse, un seul opérateur réalise en effet la moitié des transactions ; c’est un trader à haute fréquence. L’un des risques du trading à haute fréquence, c’est la manipulation des carnets d’ordres. La plupart des autres régulateurs européens ne les surveillent pas.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. Pourquoi ?
M. Jean-Pierre Jouyet. Parce qu’ils ne veulent pas s’engager trop loin. Pour sa part, Thierry Francq se bat, au niveau européen, pour avoir accès à ces carnets d’ordres. Mais il est extrêmement difficile de remonter les réseaux internationaux ; même si la coopération internationale est bonne, les régulateurs n’ont aucune garantie que l’enquête aboutira car il existe aujourd’hui des opérateurs isolés : en sus des institutions financières ou des hedge funds, interviennent des individus qui recrutent des armées de traders à travers le monde, qui se trouvent en Chine ou ailleurs et sont quasiment impossibles à repérer.
M. le président Henri Emmanuelli. D’autant que ces individus peuvent utiliser un ordinateur en Sibérie sans que l’on retrouve jamais l’adresse IP…
M. Jean-Pierre Jouyet. En effet.
M. Thierry Francq. On peut essayer de régler le problème en redonnant des responsabilités aux intermédiaires. Il faut savoir que la directive MIF permet à des personnes qui ne sont pas des institutions financières d’être directement membres de marchés. Avant, c’était impossible. On peut penser ce que l’on veut des institutions financières, mais du moins sont-elles agréées et ont-elles des devoirs envers nous.
Dans le cadre de notre enquête, nous demandons aux régulateurs de rechercher ces données et nous finissons par les obtenir. Mais le fait de ne pas les avoir directement nous empêche de faire de la surveillance. Pour pouvoir détecter des abus, il faut avoir les données : on ne peut pas lancer sa ligne au hasard. Ainsi, pour mener notre enquête, nous avons besoin d’un ordinateur dédié dont les capacités se comptent en téraoctets ! Sans éléments permettant de faire le tri dans les opérations afin de déceler les mouvements suspects, on ne peut espérer trouver quelque chose. Mais beaucoup de régulateurs, notamment parce qu’ils manquent d’argent, sont réticents à se lancer dans des enquêtes trop compliquées.
M. le président Henri Emmanuelli. Comme pour la douane, il faudrait instituer un prélèvement en pourcentage.
M. Jean-Pierre Jouyet. C’est précisément ce que nous avons proposé au ministère des finances.
M. Thierry Francq. La coopération européenne est bonne, mais les régulateurs ne disposent pas toujours des moyens nécessaires pour remplir correctement leur mission. L’AMF est l’un des mieux outillés. Je crains que certains régulateurs ne soient sur le point de renoncer devant l’ampleur de la tâche. De mon point de vue, une forte impulsion politique leur redonnerait de l’appétence pour affronter ces sujets, certes complexes, mais essentiels. C’est aussi l’intérêt de la finance – du moins, de la finance utile –, dans la mesure où cela permettra d’établir un climat général de confiance et de déterminer quelles sont les pratiques qui peuvent être autorisées et quelles sont celles qui, dangereuses, doivent être bridées, voire interdites. Aujourd’hui, on ne peut pas répondre précisément à cette question, faute d’avoir tous les outils nécessaires.
M. le président Henri Emmanuelli. Comment les régulateurs sont-ils financés ?
M. Jean-Pierre Jouyet. Nous sommes, comme tous les régulateurs, financés par un système de contribution de la part des professionnels, comme les sociétés de gestion, et par des prélèvements sur les opérations, telles que les émissions, les introductions en bourse ou les fusions acquisitions. S’y ajoute le produit des amendes ou de nos prestations. Il s’agit de ressources privées fondées sur des contributions parafiscales.
Le système fonctionne correctement à condition que les ressources soient pérennes. Le problème, c’est qu’un certain nombre de régulateurs, dont l’AMF, connaissent actuellement des problèmes de financement : du fait de la crise, la fréquentation des marchés diminue, les opérations sont moins nombreuses, et nos ressources déclinent. Nous devons trouver une solution plus stable.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. Comment se fait-il que la directive MIF ait été adoptée sans que l’on ait anticipé les risques ?
Le combat contre la technologie semble perdu d’avance… Ne faudrait-il pas vous doter de moyens supplémentaires ?
Certains considèrent que les Américains ont pris de l’avance en matière de régulation, grâce au texte qu’ils viennent d’adopter. Êtes-vous d’accord ?
Les orientations du dernier G20 et le projet de loi de régulation bancaire et financière répondent-ils à vos attentes, ou estimez-vous qu’il faudrait aller plus loin ?
S’agissant enfin des retards de la coopération européenne, constatez-vous des différences, notamment entre l’Europe continentale et les pays anglo-saxons ? Pensez-vous qu’il soit possible d’avancer rapidement sur certains points ?
M. Sébastien Huyghe. J’avais eu le plaisir de vous auditionner le 10 juin 2009 dans le cadre de la mission d’information de la commission des lois sur les défaillances de la régulation bancaire et financière. Vous aviez préconisé à cette occasion, pour les produits dérivés de crédits de la zone euro, la mise en place d’une chambre de compensation et la création d’une base de données centralisée. S’est-on engagé dans cette voie ?
Le fait que les agences de notation utilisent une même échelle de notation pour un produit financier complexe et pour un titre émis par un État n’est-il pas source de confusion ? Ces agences apparaissent comme l’alpha et l’oméga de l’information financière ; comment encourager les investisseurs à diversifier leurs sources d’information ?
M. Dominique Baert. Au cœur de la crise financière, des macro-économistes ont relevé l’inefficience des marchés et leurs difficultés à fonctionner selon les mécanismes classiques. Certains préconisent de distinguer les produits financiers adossés à des actifs ou à des biens et ceux adossés à des prix ou à des indices. Qu’en pensez-vous ?
Par ailleurs, les mesures adoptées au niveau européen pour éviter que la crise qui a touché la dette souveraine ne se répète vous semblent-elles suffisantes ?
M. Jean-Pierre Jouyet. Monsieur le rapporteur, je crois savoir que les autorités françaises ont tout fait pour mettre en garde leurs partenaires sur les conséquences de la directive MIF. On ne gagne pas tous les combats…
L’idée initiale était d’apporter davantage de concurrence et de permettre une meilleure exécution. Notre mission n’est certainement pas de défendre les monopoles boursiers ; en revanche, nous devons veiller à la bonne organisation des marchés. On a de toute évidence sous-estimé les effets conjugués des avancées technologiques, de la fragmentation et de l’opacification des marchés. Les nouveaux outils ont été utilisés par de grandes institutions financières à leur profit, il y a eu concentration des ordres et mainmise sur certains marchés, évinçant les petites et moyennes entreprises, les épargnants, les investisseurs individuels. Depuis mon arrivée à ces fonctions, j’ai été frappé de voir que de grands dirigeants d’entreprise n’étaient plus capables de dire comment leurs titres évoluaient et pourquoi.
Nous sommes toujours considérés en Europe comme excessivement prudents et dirigistes en matière financière. En l’espèce, je crois que nous avions raison ; ce qui est arrivé est encore pire que ce que nous redoutions. C’est pourquoi il importe de réviser en profondeur la directive MIF.
Vous dites que le combat technologique est perdu d’avance, mais il dépend des autorités politiques et des régulateurs de fixer des règles. Même si certaines automobiles sont capables de faire du 260 kilomètres à l’heure, il existe un code de la route et des limitations de vitesse ! Nous pouvons décider de mettre un terme à certains excès, tout comme on tente de réguler ce qui se passe sur Internet. Certes il faut que le gendarme dispose d’outils performants, mais il est également possible d’interdire certaines pratiques. Cela relève de la décision politique ; c’est dire l’importance de votre travail et la nécessité d’aborder ces questions dans le cadre du G20.
Quant au projet de loi de régulation bancaire et financière, il apporte les principales corrections que nous souhaitions en termes de régulation nationale – nous sommes encore en discussion avec les parlementaires sur quelques points – mais il ne répond pas à toutes nos préoccupations dans la mesure où il se situe dans le cadre national.
S’agissant de la coopération européenne, sans doute les échanges d’informations sont-ils plus faciles avec certains pays sur certains sujets, mais il ne serait pas exact de dire que la coopération est meilleure avec les Allemands qu’avec les Anglais.
M. Thierry Francq. Dans le cadre de nos enquêtes, la coopération est objectivement satisfaisante, non seulement avec les pays européens, mais avec presque tous les pays du monde.
M. le président Henri Emmanuelli. Même le Luxembourg ?
M. Thierry Francq. Oui, lorsqu’il s’agit d’enquêtes visant à prouver qu’une personne a commis un manquement d’initié. Beaucoup de pays sont sensibles à ce sujet, ont besoin de notre propre coopération en la matière et, de surcroît, savent qu’il ne serait pas bon pour leur image de tolérer des pratiques qui relèvent de la fraude – crime, en anglais. Le degré de coopération est plus hétérogène en matière de régulation.
M. Jean-Pierre Jouyet. S’agissant de cette coopération d’ordre réglementaire, il faut – pour résumer – trouver un équilibre entre les Français, les Anglais et les Allemands. En matière d’enquêtes, la coopération internationale fonctionne bien, y compris avec les Américains – à tel point que notre activité dans ce domaine se partage à égalité entre enquêtes nationales et participation à des enquêtes internationales.
Monsieur Huyghe, un projet de directive doit être déposé dans les prochains jours par la Commission européenne. J’espère qu’il nous donnera satisfaction, tant au sujet de la chambre de compensation qu’en matière de base de données : non seulement il faut mutualiser les risques sur les ordres d’achat et de vente, mais il est nécessaire de répertorier l’ensemble des données. Il reste à déterminer où cela se fera, qui en sera le propriétaire et quelle coopération se mettra en place à l’échelon européen : la question industrielle et opérationnelle est la plus délicate. L’Europe a du retard par rapport aux Etats-Unis dans ce domaine et doit impérativement progresser.
S’agissant des agences de notation, vous avez raison : on ne peut pas tout noter de la même façon. Le règlement européen demande de faire des différenciations et de préciser les échelles de notation. Il faudrait par ailleurs compléter les dispositions relatives au « timing », afin d’éviter le renouvellement de ce qui s’est passé notamment avec l’Espagne.
La diversification des sources d’information est très importante. Comme je l’ai dit, il faut se désintoxiquer. On peut se tourner vers de nouvelles agences de notation, mais il n’est pas facile d’en monter une : cela demande beaucoup de capitaux, de valeur ajoutée et de capacité d’expertise.
M. le président Henri Emmanuelli. Et il faut asseoir sa notoriété.
M. Jean-Pierre Jouyet. En effet. Il faudrait donc que les opérateurs et les autorités publiques investissent davantage dans l’analyse de risques. Dans les entreprises, les institutions publiques, les autorités de régulation, on a trop délégué ces fonctions. Il faut réapprendre à évaluer un risque en interne.
M. le président Henri Emmanuelli. Certes, mais les investisseurs ne recourent-ils pas aux agences de notation parce que cela leur coûte moins cher ?
M. Jean-Pierre Jouyet. Sans doute, l’expertise nécessitant indéniablement des compétences très spécialisées. Il reste qu’il faut non seulement surveiller et encadrer les agences de notation, mais aussi être plus responsable face à elles – et c’est pourquoi nous appelons à la « désintoxication ».
Monsieur Baert, je dois approfondir la distinction entre produits financiers adossés à des actifs et produits financiers adossés à des indices. A priori, le fait que le produit financier soit adossé à un actif, comme le pétrole, ou à un indice ne change rien à la spéculation ou à la manipulation ; il y en a autant dans les deux cas. Ce n’est pas un hasard si l’organisation des marchés de matières premières est à l’ordre du jour du G20.
S’agissant de l’Europe, autant j’ai été sévère concernant les retards sur la régulation et l’organisation des marchés, autant je crois, à titre personnel, que ce qui a été fait cette année sera très utile et permettra de s’organiser pour prévenir les risques systémiques – au point d’ailleurs que, sachant ce que l’Europe couvre, certaines personnes pensent pouvoir acheter des titres d’État sans aucune crainte.
Toutefois, pour ramener la confiance, rien ne remplace le retour à de bons fondamentaux en Europe : le nécessaire doit être fait en matière de finances publiques.
M. le président Henri Emmanuelli. Merci beaucoup pour cet échange. Lorsque nous aurons avancé dans nos travaux, il est fort possible que nous sollicitions à nouveau votre éclairage.
La séance est levée à vingt heures quinze.
*
* *
Audition de M. Henri Bourguinat, professeur à l’université de Bordeaux-IV
(Procès-verbal de la séance du mercredi 15 septembre 2010)
(Présidence de M. Henri Emmanuelli, président de la commission d’enquête)
La séance est ouverte à dix-sept heures trente
M. le président Henri Emmanuelli. Monsieur le professeur, je vous remercie d’avoir répondu à l’invitation de la commission d’enquête parlementaire sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement des économies.
Depuis des années, vous avez multiplié les mises en garde contre les dérives du système financier dans des ouvrages aux titres évocateurs : Les Vertiges de la finance en 1987, La Tyrannie des marchés en 1995, L’Arrogance de la finance en 2009 et, il y a quelques jours, Marchés de dupes : pourquoi la crise se prolonge.
Vous êtes donc pour nous un témoin précieux car vos analyses et vos préoccupations recoupent parfaitement les nôtres.
Notre mission a en effet pour origine la crise financière et, à la suite de celle-ci, la crise grecque qui a suscité de nombreuses interrogations, notamment sur la sensibilité des marchés financiers aux rumeurs, sur les conflits d’intérêts affectant certains opérateurs à la fois conseils des émetteurs de titres souverains et acteurs sur les marchés des dettes souveraines, sur le mécanisme des credit default swap (les CDS) ou sur les effets déstabilisants des outils permettant les ventes à terme et à découvert de certains produits financiers.
Notre commission d’enquête cherche donc à répondre aux questions suivantes : quelles sont les méthodes employées par les spéculateurs ? En quoi l’automatisation des décisions de vente ou d’achat amplifie-t-elle les mouvements spéculatifs ? Qui se livre aux attaques spéculatives et à partir de quelles zones de marché – nous avons conscience qu’il sera difficile de répondre à cette question – ? Quel est le rôle des hedge funds ? Quel est celui des agences de notations dans les prises de position des fonds spéculatifs et des acteurs de marché ? Peut-on considérer qu’il y a eu, à l’occasion de la crise grecque, « délit d’initiés » ? Enfin, deux ans après la crise des subprimes, les bonnes décisions ont-elles été prises par les acteurs compétents au bon moment pour stopper ces mouvements spéculatifs ?
Nous souhaitons établir les responsabilités des différents acteurs et, in fine, faire des propositions afin d’éviter qu’une telle crise ne se reproduise. Nous avons besoin, à cette fin, de vos lumières.
(M. Henri Bourguinat prête serment.)
M. Henri Bourguinat, professeur à l’université de Bordeaux-IV. Monsieur le président, Monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, je tiens, par pédagogie, à faire précéder mon propos d’une brève analyse du concept de spéculation, qui est difficile car il est connoté.
Pour un grand nombre de nos compatriotes, la spéculation, c’est le diable. En 1964, le ministre britannique des affaires étrangères, George Brown, avait évoqué « les gnomes de Zurich », qu’on considérait à l’époque comme les artistes de la spéculation. Je crains que les mêmes artistes n’aient essaimé aujourd'hui : j’en vois dans les paradis fiscaux, du côté de Londres, des Îles Anglo-normandes ou de l’État américain du Delaware ou encore en Chine. La liste n’est pas exhaustive. La spéculation est quelque chose de relativement envahissant. Elle est toutefois, pour les économistes, une catégorie d’opérations comme les autres, répondant à une nécessité du marché.
Spéculer, c’est tenter de réaliser un gain en prenant le risque d’anticiper une variation du prix d’un actif. La spéculation est aujourd'hui de plus en plus « à découvert » : on spécule sur un actif sans le posséder. Il s’agit d’une spéculation pure puisqu’elle ne fait pas intervenir un processus de transformation ou de mise en valeur de l’actif. Spéculer, c’est donc chercher à gagner de l’argent en « voyant au loin » (speculare, en latin), c'est-à-dire en essayant de deviner l’évolution du prix du marché.
La spéculation a fait l’objet depuis longtemps de l’attention des meilleurs économistes. Je pense non tant à Keynes qu’à Milton Friedman, l’apôtre de l’école de Chicago, pour lequel la spéculation est vertueuse car elle doit être gagnante : on spécule pour réaliser un gain. À cette fin, il faut acheter quand les prix sont bas et vendre quand ils sont hauts. La spéculation aurait une vertu stabilisatrice. Cette démonstration était toutefois un peu trop simple car on s’est aperçu, depuis, que la spéculation dépendait notamment des anticipations : elle peut donc également conduire à acheter quand le prix monte ou à vendre quand il baisse.
Un autre économiste, néo-keynésien, a également mis en valeur à la fin des années trente les vertus de la spéculation : il s’agit de Nicholas Kaldor. Pour lui, la spéculation est nécessaire parce que, dans toute société économique, deux catégories d’opérateurs s’opposent : ceux qui prennent des risques et ceux qui ne souhaitent pas en prendre. La spéculation a dès lors un caractère stabilisateur car elle permet de transférer le risque des seconds sur les premiers. Le mécanisme de la spéculation se rapprocherait ainsi de celui de l’assurance. C’est en partie vrai. S’il existe une face sombre de la spéculation – celle qu’on retient aujourd'hui –, il n’en existe donc pas moins une face positive puisque la spéculation peut participer de la croissance et du bien-être économique.
Le seul problème tient au dosage car il convient d’éviter de se lancer dans des mouvements incontrôlés. Il n’en est pas moins vrai que de tels mouvements parsèment l’histoire économique, du XVIIe siècle, avec la folie des tulipes en pays batave, bien avant la crise de 2007, en passant par la spéculation des Mers du Sud au XVIIIe, le mouvement des chemins de fer aux États-Unis en 1905, le krach de 1929. Or, depuis cette date, on observe une accélération de ces mouvements, ce qui ne peut que nous inquiéter : 1987, 1991, 2001 avec la spéculation sur la « nouvelle économie », et, enfin, 2007. Du reste, cette dernière crise n’est toujours pas finie en 2010 : nous sommes engagés dans sa troisième année.
Si la spéculation connaît périodiquement des dynamiques incontrôlables, c’est notamment en raison du comportement panurgéen des opérateurs et des spéculateurs et d’anticipations qui, pour être erronées, n’en sont pas moins autoréalisatrices du fait que tous les opérateurs les développent en même temps. Il ne faudrait pas non plus oublier les « bulles », qu’on évoque parfois à tort et à travers : en effet, il ne saurait y avoir de bulle financière sans prix d’équilibre, ce qui ne fut pas le cas, par exemple, lors de la très forte hausse du prix du pétrole. Il n’y a donc pas eu, à proprement parler, de bulle pétrolière.
En août 2007, ces divers phénomènes ont débouché sur un quasi-blocage du système financier. Le marché interbancaire a presque été stoppé, puisque les banques ne se sont plus prêtées entre elles. Il convient d’ajouter à cette situation la tendance à développer des chaînes d’opérations très longues et très fournies, de ce fait incontrôlables. J’avais essayé à l’époque de mettre en garde contre la perte de contrôle des dérivés de crédits, en raison de leur absence de traçabilité : dans la plupart des cas, ils sont liés en effet à des opérations non pas de couverture du risque mais spéculatives, de prise de risque : songez aux événements récents relatifs à la dette souveraine grecque.
La spéculation peut donc avoir des effets délétères tout à fait impressionnants : le Bureau international du travail estime à 51 millions le nombre de chômeurs engendrés par la crise, que la spéculation a provoquée. C’est un chiffre effrayant.
Cette crise a donné lieu à des plans de sauvetage qui étaient inévitables. Comme l’a noté Martin Wolf, on a fait décoller les « hélicoptères » des banques centrales. Des « torrents de liquidités » ont été versés et on a réussi à colmater les brèches avec beaucoup de difficultés. Nous payons aujourd'hui en termes de déficit budgétaire le prix des politiques mises en œuvre de lutte contre la spéculation. Or les endettements sont de plus en plus difficiles à gérer, ce à quoi il convient d’ajouter un nouveau phénomène : la dépossession des États. Ce qui s’est passé en Grèce à partir de mars et d’avril derniers montre qu’un mouvement de spéculation, une fois amorcé, est difficilement gérable et qu’il peut mettre en cause jusqu’au sort d’une grande monnaie, en l’occurrence l’euro. Il a fallu mettre en œuvre deux plans de sauvetage : 110 milliards d’euros tout d’abord avant quelque 500 milliards du côté de l’Union européenne et 250 pour le FMI.
Nous en sommes donc à une période charnière : nous pouvons en effet nous interroger sur les possibilités déstabilisatrices profondes du système actuel, que peut emporter la spéculation. Le marché des obligations commence lui-même à être touché. Les banques centrales, je le répète, ne pouvaient pas ne pas intervenir mais les traites de cette intervention sont désormais tirées sur notre avenir. Or ces traites sont très lourdes et certains gouvernements travaillent aujourd'hui, comme nous l’avons souligné dans notre dernier livre, « sous bracelet électronique ». Les hommes politiques ont désormais l’œil fixé, du reste fort légitimement, sur la note du triple A, du fait que nous dépendons de l’endettement international et que la spéculation a mis à mal l’équilibre monétaire et financier. Hier, c’était le secteur public qui renflouait le secteur privé des banques ; demain, qui, le cas échéant, sera capable de renflouer le secteur public si la situation des États s’aggrave ?
M. le président Henri Emmanuelli. Monsieur le professeur, nous sommes tout à fait conscients de l’ambiguïté de la spéculation. Son rôle peut être positif lorsqu’elle facilite la liquidité et agit comme un mécanisme d’assurance.
Nous voudrions savoir à partir de quel moment la spéculation devient dangereuse et si des mécanismes doivent être prohibés pour éviter de nouveaux dérapages incontrôlés.
L’Allemagne a pris et maintenu des dispositions, notamment l’interdiction des ventes à terme sur les titres souverains. Certaines autorités ont également décidé d’interrompre temporairement les marchés pour éviter des dérapages.
Qu’en est-il également de la spéculation en haute fréquence, à la nanoseconde ? Est-elle utile à l’économie ?
Quels sont les mécanismes qui vous paraissent devoir être éradiqués ou, du moins, contrôlés ?
M. Jean-François Mancel, rapporteur. Monsieur le professeur, vous nous avez dit qu’en matière de spéculation tout n’est finalement qu’une question de dosage : lorsque celui-ci est mauvais, il enclenche des dynamiques « incontrôlables », mot inquiétant car nous pouvons nous demander si ces dynamiques peuvent être contrôlées.
Voyez-vous dans les dispositifs qui se mettent actuellement en place, aux plans français, européen ou américain, des avancées susceptibles de faire disparaître le caractère « incontrôlable » des processus engendrés par la spéculation ? Auriez-vous des suggestions à faire pour compléter les politiques mises en œuvre ?
M. Henri Bourguinat. La crise a bien montré qu’à partir d’un moment donné le processus de spéculation n’est plus contrôlable. La réaction de bon sens serait d’éviter l’enclenchement de tels processus, c'est-à-dire de conduire une politique de prévention, en mettant au point un système robuste. Il conviendrait de sérier les causes de la crise véritablement « extra-ordinaire » que nous avons subie afin de proposer des remèdes qui leur correspondent.
Ces causes, nous les connaissons. Les Anglo-saxons ne sont pas les seuls responsables : nous avons également participé au déclenchement de la crise. Selon l’image de la Semeuse, des crédits ont été transformés en titres, ce qui, reconnaissons-le, est tout de même une pratique assez étonnante ! Comment un banquier peut-il ouvrir un crédit à des représentants du secteur immobilier ou à des ménages et transférer le risque, c'est-à-dire, en quelque sorte, « passer le mistigri » à d’autres ? Cela met en cause le processus de titrisation, lequel revient, pour le banquier, à changer la psychologie qui était encore celle de la banque au début des années 1980. La perte de traçabilité de ces dérivés du crédit et de ces montages proliférants que personne ne contrôlait plus est la première origine de la crise. Dans un livre précédent, L’Arrogance de la finance, Éric Briys, ancien professeur d’HEC et opérateur durant dix ans sur la place de Londres, et moi-même avons souligné que la scientificité de la théorie financière n’était peut-être pas aussi avérée qu’on aimait bien le dire. Il ne faut certes pas jeter le bébé avec l’eau du bain : toute théorie financière n’est pas à écarter, toutefois ses présupposés et ses conclusions ne se révèlent pas toujours exacts.
Un modèle d’activité – un business model – qui consiste à faire émerger des crédits et à distribuer le risque est un modèle dangereux. L’idée de faire porter le risque à d’autres que des banquiers ou des assureurs était en soi intéressant. Toutefois, en projetant trop loin le risque, on en a perdu complètement le contrôle. Il conviendrait donc de réfléchir tout d’abord à la titrisation.
Or la loi financière américaine de juillet dernier prévoit que 5 % seulement du risque devraient être conservés par les banques : c’est dérisoire. Il aurait fallu aller plus loin. Les dérivés de crédit sont utiles pour permettre à une banque de se protéger en partie lorsqu’elle ouvre un crédit. Ce faisant, elle étend la base du financement. Les banques devraient toutefois retrouver une partie du contrôle du risque qu’elles ont elles-mêmes ouvert. Je ne discerne non plus aucun progrès sensible du côté de l’Union européenne en la matière.
J’appelle votre attention sur le fait qu’on savait que le processus de titrisation était potentiellement très dangereux : la crise grecque a permis d’en vérifier de nouveau la capacité déstabilisatrice du fait que les crédits sur la dette souveraine grecque étaient négociés naked, c'est-à-dire « nus », sans que même les spéculateurs possèdent les obligations de la dette grecque, ce qui a pu mettre en question jusqu’à la monnaie européenne. Même si la croissance a effectivement besoin d’une finance dynamique, celle-ci n’a pas lieu pour autant de transférer 70 % à 80 % du risque créé. La titrisation étant une des origines de la crise, il conviendrait, je le répète, de la contrôler.
En ce qui concerne la haute fréquence, le fait qu’en quelques millisecondes des opérations se développent sur la base de programmes automatiques, loin d’aller dans le sens d’une appréciation diversifiée des tendances des marchés, va dans celui de la concentration des anticipations. De ce point de vue, la « haute fréquence » est dangereuse. Il est toutefois difficile de l’empêcher car, derrière ce phénomène, il y a l’achat par les banques à un prix élevé d’algorithmes développés et d’ordinateurs surpuissants. Je ne vois pas quelle banque accepterait de modérer la puissance de ses ordinateurs puisqu’il s’agit d’un avantage comparatif évident.
Le dosage, Monsieur le président, est, lui aussi, difficilement contrôlable. En période de calme des marchés, la proportion entre les opérations spéculatives et les opérations non spéculatives est acceptable. De plus, parmi les opérations spéculatives, certaines vont dans le sens de la hausse et d’autres dans celui de la baisse. Cet équilibre relatif disparaît dès l’instant qu’un mouvement de fond est déclenché : tous les opérateurs vont alors dans le même sens et la situation devient difficilement contrôlable.
En 1987, les banques américaines avaient été contraintes de débrancher leur programme automatique – ou program trading. Le G 20 ne devrait-il pas prendre, au moins temporairement, une mesure comparable ? Sans être pessimiste, je tiens à constater que les décideurs ne mettent pas suffisamment l’accent sur les mécanismes qui ont dérapé, si bien qu’on se focalise sur les fonds propres, ce qui conduit déjà les banques à développer, sur cette question, leur lobbying. Elles proclament que 450 milliards d’euros devront être trouvés sur le marché, dont, si on en croit un honorable banquier de la place de Paris, 150 milliards pour les seules banques françaises. Ce lobbying, qui fait partie du jeu, vise à faire passer, en matière d’exigences de fonds propres, un message de modération aux régulateurs de Bâle. Je pense toutefois que la régulation des fonds propres n’apportera pas une sécurité totale. Lehman Brothers avait en effet plus de 12 % de fonds propres. J’enseigne depuis des décennies la réglementation des fonds propres aux étudiants : elle m’a toujours laissé circonspect. Certes, les ratios imposés sont fonction de la nature des crédits. Toutefois, imposer le même ratio de fonds propres à une banque du secteur mutualiste et à une banque d’affaires n’est pas nécessairement de bonne méthode.
De plus, nous l’avons souligné avec Éric Bryis dans le livre que j’ai évoqué, les fonds propres peuvent être aisément manipulés. Lors de la crise de 2007, les banques américaines ont émis des obligations « convertibles contingentes », qui se transforment à point nommé en actions : les fonds propres augmentent automatiquement. En France, on a utilisé le procédé de la dette subordonnée, qui n’est pas éloigné de celui utilisé par les banques américaines. Il existe donc des ersatz de fonds propres. L’accord de Bâle 3 modifiera-t-il la donne puisqu’il prohibe les fonds propres hybrides ? La vérité est que Bâle 3 ne proscrira que certains fonds propres hybrides, de plus à un horizon de cinq ans. C’est loin. Par ailleurs, les États-Unis n’ont pas encore mis en œuvre Bâle 2, alors qu’ils tiennent pour une bonne part la finance internationale. Il serait mieux de faire les choses dans l’ordre et d’appliquer Bâle 2 avant de penser à Bâle 3.
M. Jean-Yves Cousin. Monsieur le professeur, vous avez expliqué que le processus de spéculation avait des effets délétères – il aurait à lui seul engendré 51 millions de chômeurs supplémentaires. Ce chiffre fait froid dans le dos. De plus les États se sont endettés alors même qu’on ne sait pas qui pourrait renflouer un secteur public défaillant.
Il existe des responsables. Il est certes difficile de les identifier mais peut-on imaginer la création d’un tribunal international pour juger ceux qui ont des responsabilités dans la crise ? Des tels procès auraient peut-être un effet dissuasif, ce qui aurait pour conséquence de responsabiliser davantage les opérateurs.
Mme Marietta Karamanli. Monsieur le professeur, vous avez analysé les origines de la crise financière. Certains économistes, notamment américains, mettent également en cause la taille des établissements financiers et évoquent le caractère frauduleux de nombreuses opérations. Qu’en pensez-vous ?
Par ailleurs, la crise ne devrait-elle pas nous inciter à travailler sur le cloisonnement des activités des banques de dépôt et des banques d’investissement ?
Enfin, que pensez-vous des règles à appliquer pour limiter ou éradiquer les comportements à risques ? Convient-il, comme aux États-Unis, d’en édicter le principe et, dans ces conditions, doit-on en confier l’élaboration à des hommes de qualité ? Si on en croit Paul Krugman, faire confiance à la qualité des hommes ne permet pas toujours de préserver la bonne santé de l’économie. La constitution d’un groupe de travail intergouvernemental ne présenterait-elle pas, elle aussi, des risques ?
M. Henri Bourguinat. Votre proposition, monsieur Cousin, est intéressante et généreuse. Elle est fondée en équité. Toutefois, vous connaissez suffisamment les comportements des milieux financiers pour savoir que la mesure serait très difficile à mettre en œuvre alors même qu’on arrive à peine à faire juger par un tribunal international les crimes de sang. Du reste, qui verriez-vous comme juges ? Ils risqueraient d’être très liés à ceux qui ont déclenché les événements.
Ceux-là même qui élaborent actuellement la réglementation de Bâle sont en très grand nombre d’anciens banquiers, certains liés à Goldman Sachs, ce qui se conçoit très bien en raison du caractère technique des mesures à édicter. Je ne me risquerai pas non plus à prévoir un jury populaire car cette même technicité le décrédibiliserait très vite.
Madame Karamanli, vous avez eu raison d’évoquer la taille des établissements : c’est un des problèmes majeurs, que j’ai étudié en détail dans le dernier livre qu’Éric Briys et moi-même avons signé, Marchés de dupes : pourquoi la crise se prolonge. La règle too big too fail – « trop gros pour faire faillite » – est omniprésente dans le débat actuel.
Ce sont principalement les grandes banques d’affaires qui ont été à l’origine de la crise. Mais comme la finance a horreur du vide, elles ont été reprises – je nommerai simplement Merrill Lynch à l’initiative de Bank of America, ou Wachovia qui a été reprise par Wells Fargo. La crise a renforcé la concentration des banques et l’exigence de développer les fonds propres est une incitation considérable à poursuivre la concentration. Or celle-ci est une des causes de la crise. Le remède me paraît donc loin d’être adéquat.
Paul Volcker, qui connaît bien le milieu de la finance, a compris que la seule façon de dégonfler la bulle spéculative était de casser l’oligopole bancaire et donc de séparer les activités de financement et celles de dépôt. Or la loi américaine Dodd-Frank du 15 juillet dernier réformant Wall Street n’a presque rien prévu en la matière. La proposition dite « Volcker », de scinder les deux régimes, empêchait, dit-on, les banquiers américains de dormir : eh bien, pour finir, la loi interdit aux banques de faire des opérations pour compte propre, sauf si elles le font en relation avec un client. On comprend dès lors la mine réjouie des banquiers américains sortant des auditions : il m’étonnerait qu’on ne trouvât pas aux États-Unis un certain nombre de clients prêts à apparaître dans ces opérations ! C’est donc un coup pour rien et j’attends de voir les décisions que prendra Bruxelles en la matière, car elles ne me semblent pas encore très claires. Si on veut écarter le risque de nouvelles dérives, il faut, en premier lieu, interdire la titrisation et en, deuxième lieu, renoncer au principe du too big too fail, en empêchant la concentration bancaire.
En ce qui concerne la France, vous avez entendu parler, comme moi, de projets de fusion de grandes banques françaises : de tels projets ressurgiront dans les mois à venir. L’Assemblée nationale aura alors un rôle de prudence à jouer car il s’agit-là de procédés antiéconomiques.
M. Paul Giacobbi. Vous avez évoqué Nicholas Kaldor : il a défendu la spéculation et enseigné à Harvard dans les années 1980 l’imperfection des marchés et l’inadéquation de l’offre et de la demande pour produire un prix rigoureux.
J’ai lu, plus jeune, François Perroux, Jean Denizet ou Henri Bourguinat, qui s’inquiétaient du déséquilibre structurel de la balance des paiements américaine et de la croissance autonome des eurodollars – des dollars non-résidents – et des masses flottantes et spéculatives, alors que les chiffres étaient à l’époque, par rapport à ce qu’ils sont aujourd'hui, très bas – 80 milliards de dollars de déficit des balances américaines de paiement courant. Aujourd’hui, de tels chiffres feraient presque rire.
J’attendais la crise depuis des années : sans oublier vos ouvrages, un livre de Richard Duncan, The Dollar Crisis, l’annonçait. Elle est arrivée en avril 2007.
Aujourd'hui, les masses en cause représentent des dizaines de milliers de milliards. De plus, au cours des années précédentes, pour remédier aux bulles successives, on a baissé les taux d’intérêt et augmenter les liquidités, ce qui revient à soigner un alcoolique en lui faisant ingurgiter massivement du whisky – cela présente l’avantage d’éviter le sevrage mais ne fait qu’aggraver le mal.
À l’heure actuelle, chacun se focalise sur la réglementation : or, comme je l’ai déjà écrit, elle sera inefficace tant qu’on n’aura pas réfléchi à une approche quantitative. C’est en effet la quantité du problème qu’il convient de diminuer en limitant notamment les masses de capitaux flottants grâce à des politiques structurelles de balances des paiements, qui empêcheraient, en particulier les États-Unis, de demeurer perpétuellement en déficit. Ceux-ci injectent en effet chaque année dans la masse spéculative 200 à 300 milliards, qui, de plus, s’autoreproduisent avec le mécanisme des eurodollars. Quelles que soient les règles fixées, elles seront incapables d’agir sur des masses qui augmentent sans cesse.
Il convient également de conduire des politiques de taux d’intérêt qui préviennent, par une hausse justifiée, la bulle spéculative. Paul Volcker a su imposer des taux d’intérêt réels à 17 % : il a été décrié, il n’en reste pas moins que l’économie américaine s’en est mieux portée durant des années et que le dollar a été restauré. Il aurait mieux valu continuer de suivre ses conseils plutôt que ceux de MM. Bernanke et Greenspan.
S’agissant des ratios de Bâle, chacun sait que personne ne saurait connaître les fonds propres d’une banque à partir du moment où elle titrise massivement. Elle devrait diminuer ses fonds propres en fonction des provisions du haut risque : elle ne le fait pas. Les fonds propres annoncés sont dès lors évidemment faux. A-t-on une idée de la quantité de crédit qu’elle garantit ? Non, puisqu’elle en a quatre fois plus hors banque que chez elle. Un rapport de 7 % ou 8 % entre des fonds propres dont on ignore la quantité exacte parce qu’ils ne sont pas provisionnés comme il le faudrait et un portefeuille de créances qui s’élève au quart de ce qu’il est en réalité, cela n’a aucune signification. C’est de surcroît désavantageux pour les entreprises.
Je terminerai par une anecdote : la titrisation était entièrement garantie par une seule société d’assurance, AIG (American international group). Lorsque cette société a été sur le point de faire faillite, le trésor américain, pour l’éviter, a envoyé un message aux banquiers de la place en leur annonçant que cette société avait à elle seule générer un risque à hauteur de 600 milliards de dollars : les banques ont cru que le trésor américain s’était trompé d’un ou deux zéros. Il ne s’était pas trompé ! Face à des systèmes pouvant engendrer des pertes aussi considérables, comment croire à l’efficacité de la réglementation ?
M. Jean-Pierre Gorges. Le problème, à mes yeux, c’est que le système est normalement régulé mais qu’on ne le laisse jamais fonctionné librement. Contrairement aux États-Unis, la France n’a pas osé laisser les banques faire faillite. Il n’aurait pas fallu mettre un kopek dans Dexia ! Tout système économique se régule naturellement : c’est une loi de la nature. C’est l’intervention des hommes, ou plus exactement des politiques, qui interdit chaque fois au système de se réguler.
Il en est de même des pays en état de faillite : fallait-il aider la Grèce ? On aurait dû la laisser tomber. On ne l’a aidée qu’en raison de son histoire, du risque qu’une faillite aurait représenté pour sa démocratie, des Jeux olympiques. En revanche, on envisage de punir le Portugal si le risque de faillite de ses finances publiques se concrétise.
Les politiques sont-ils bien raisonnables de voter des budgets dont le déséquilibre peut atteindre 250 milliards d’euros ? Ils espèrent qu’une croissance à deux chiffres permettra d’éponger la dette, mais un tel niveau de croissance n’est jamais atteint. Ce sont les politiques eux-mêmes qui pervertissent un système qui, je le répète, est naturellement équilibré. C’est une loi qui a toujours été vérifiée : les échanges sont un jeu à somme nulle.
Plutôt que de monter des mécanismes aussi complexes qu’inefficaces, ne serait-il pas plus raisonnable d’envisager quelques solutions simples ? Je vous en proposerai trois : abolition de la titrisation ; interdiction de vendre ce qu’on ne possède pas, car la belle spéculation consiste à assumer le risque qu’on prend ; interdiction pour un Gouvernement, comme c’est d’ores et déjà le cas des collectivités territoriales, de présenter des budgets en déséquilibre – il conviendrait du reste d’en faire un principe constitutionnel.
Les déficits engendrent la spéculation et c’est le contribuable qui, finalement, paiera l’addition.
M. Henri Bourguinat. Il est vrai, Monsieur Giacobbi, que la recherche des origines de la crise ne saurait ignorer le volume des capitaux en jeu et l’excès de liquidités. Il y a une relation de cause à effet entre, d’une part, les déficits américains du compte courant et du budget et, d’autre part, la crise financière. Durant des décennies, les États-Unis ont à ce point répandu des liquidités à travers le monde qu’il a fallu, à un moment donné, démultiplier les liquidités primaires en passant aux dérivés du crédit et aux obligations classées triple A. Nous subissons aujourd'hui les retombées de cette politique. S’il arrivait, un jour, qu’on se mît à douter de la capacité des États-Unis à faire face à leurs dettes, les conséquences seraient très lourdes. La situation est donc sérieuse.
Je citerai Adair Turner, ancien président de la FSA (Financial services authority). Il a surpris son monde en soulignant que les chiffres devaient donner à réfléchir : entre 650 000 et 950 000 milliards pour les dérivés de crédit, et 100 000 milliards pour les crédits bancaires. À ses yeux, on peut douter de l’utilité sociale d’une partie de la finance actuelle. Il a raison : une partie importante de la finance est en surplomb. Toutefois, je ne vois pas très bien comment on pourrait la faire rentrer dans une dynamique d’utilité sociale.
En ce qui concerne la régulation, Monsieur Gorges, je pense que votre orientation est rationnelle mais elle suppose que les banques ne dépassent pas un quantum déterminé. Le bilan de la plus grande banque française dépasse 1 600 ou 1 700 milliards d’euros. Imaginez-vous un Premier ministre annonçant un soir aux Français qu’il accepte la faillite d’un tel mastodonte ? L’effet serait « cataclysmique ». Lorsque Lehman Brothers a fait faillite, les conséquences ont été très lourdes. On ne doit donc recourir à un tel remède qu’avec la plus grande prudence. Il est vrai en revanche que les banquiers doivent toujours avoir présent à l’esprit le risque de ruine. Le hasard moral permet au spéculateur de se sentir protégé des conséquences des bêtises qu’il commet, ce qui l’incite à récidiver. Certes, les banquiers ne font pas exprès de tomber en faillite. Toutefois, s’ils savent qu’ils seront sauvés, ils ne réagiront pas avec la même acuité que dans le cas contraire. Le drame, c’est qu’à la suite de la crise, le « hasard moral » a été légitimé. Vos solutions sont certainement efficaces et de bon sens mais on ne pourra y recourir qu’avec réticence.
Vous avez également raison : on ne devrait pas avoir le droit de vendre ce qu’on ne possède pas. Toutefois, lorsque le chancelier d’Allemagne, Mme Angela Merkel, a pris une telle décision, ce fut un tollé épouvantable, y compris au sein des instances européennes, notamment à l’instigation des Britanniques : l’Europe protesta qu’il était inadmissible qu’une telle décision pût être prise à l’échelle d’un seul pays. Or, mesdames et messieurs les députés, nous n’obtiendrons jamais le consensus de nos voisins européens pour prendre une telle mesure. Seule une décision a minima sera prise à la demande des pays qui désireront réagir le moins possible à l’encontre du secteur financier. Les incertitudes en la matière sont donc nombreuses et la bataille est loin d’être gagnée.
Des travaux sont actuellement menés et on voit se dessiner quelques progrès, y compris sur le plan européen. Toutefois, tant qu’on n’aura pas touché à la titrisation et à la dimension des banques et traité la question de la séparation des opérations de banques de dépôt et de banques d’affaires, la réforme financière ne partira pas sur de bonnes bases. Espérons que d’ici à un an ou deux, une prise de conscience s’opérera permettant d’évoluer vers de véritables solutions.
M. François Scellier. Vous l’avez souligné, monsieur le professeur, la spéculation peut être une nécessité du marché ; le problème est d’arriver à en contrôler les excès.
Les rumeurs n’exacerbent-elles pas la spéculation ? La propagation d’informations plus ou moins exactes, accompagnée de la méconnaissance d’informations réelles, ne sont-elles pas à l’origine de dérives ? Avant de penser à des mécanismes de contrôle ou de sanction, ne conviendrait-il pas de commencer par améliorer l’organisation de l’information afin de la rendre la plus fiable et la plus complète possible ? Ce serait peut-être le meilleur remède aux effets déstabilisateurs de la spéculation.
Mme Arlette Grosskost. Quelle est votre vision de la spéculation sur les matières premières, notamment alimentaires ?
Par ailleurs, que pensez-vous du taux de couverture actuel de nos comptes de dépôt ? Monsieur Barnier envisage la création d’un compte d’épargne européen : l’organisation d’une caisse de dépôt européenne vous paraît-elle une bonne idée ?
M. Henri Bourguinat. Il est vrai, Monsieur Scellier, que spéculation déstabilisatrice et rumeurs vont de pair. Il convient dès lors de porter notre regard sur les organismes qui créent les rumeurs. Selon Le Temps de Genève, qui est un journal sérieux, c’est la réunion à Londres, au mois d’avril, de deux hedge funds et d’une grande banque américaine qui a déclenché la spéculation sur la dette grecque. Une conscientisation des intéressés serait nécessaire et un tribunal devrait pouvoir juger ceux qui répandent les rumeurs.
Les agences de notation elles-mêmes sont devenues des boutefeux d’autant plus influents qu’elles ne sont qu’au nombre de trois : je pense aux avertissements que ces jours derniers Moody’s a donnés à la France et à d’autres grands pays. Il conviendrait, pour réduire leur influence, à la fois de diversifier les organes chargés d’opérer la notation et d’en augmenter le nombre. Certaines agences devraient faire une grande place aux organismes gouvernementaux ou internationaux d’expertise. Il est tout de même surprenant que quelques personnes à Londres, New York ou Paris décident du devenir d’un État.
En ce qui concerne les matières premières, Madame Grosskost, il y a beaucoup à faire ! En tant qu’économiste, je ne peux que regretter que les travaux en France sur le sujet soient si rares et insuffisamment poussés. Il conviendrait de réaliser des études systématiques sur l’évolution des prix du blé, du maïs ou plus généralement des céréales. Il se passe en la matière des choses étonnantes.
Les marchés à terme doivent exister. Toutefois, aujourd’hui, c’est le « papier » qui détermine de plus en plus le prix du « physique », trop souvent sur la base de pratiques de manipulation. J’aimerais que l’autorité des marchés financiers se penchât sur ces pratiques dans ce secteur particulier. Encore faudrait-il arriver à les isoler, les expliquer et, éventuellement, les neutraliser.
M. le président Henri Emmanuelli. Je vous remercie, monsieur le professeur.
L’audition s’achève à dix-huit heures quarante.
*
* *
Audition de M. François Pérol, président de la Fédération bancaire française
(Procès-verbal de la séance du mercredi 15 septembre 2010)
(Présidence de M. Henri Emmanuelli, président de la commission d’enquête)
La séance est ouverte à dix-huit heures quarante
M. le président Henri Emmanuelli. Merci, monsieur François Pérol, d’avoir répondu à notre invitation pour faire profiter notre commission d’enquête de votre riche expérience, d’abord de haut fonctionnaire en charge des questions économiques et financières, puis de secrétaire général adjoint de la Présidence de la République et, enfin, de banquier. Vous êtes en outre président, depuis peu, de la Fédération bancaire française.
(M. François Pérol prête serment.)
M. le président Henri Emmanuelli. L’objet de nos travaux, qui semble assez large, sera resserré progressivement. Nous savons bien sûr que la spéculation peut être aussi utile que dangereuse pour les économies.
Quels ont été à votre sens les acteurs de la crise actuelle et que peut-on faire pour éviter qu’elle ne se reproduise ?
M. François Pérol, président de la Fédération bancaire française. La spéculation entendue au sens de la manipulation du marché, de la déformation de la réalité économique, est évidemment nuisible au bon fonctionnement du marché et contraire à sa logique. Le marché doit être au service de l’économie, notamment pour assurer son financement. C’est un outil central : il fait le lien entre l’épargne et l’investissement, privé et public, il permet aux entreprises et aux États de lever des capitaux et aux épargnants de placer les leurs. Il est le lieu de la formation des prix. Il convient donc que toutes les données et informations dont il dispose soient justes, et il est normal que ces informations entraînent des fluctuations des prix.
La spéculation entendue au sens de la manipulation du marché nuit au bon processus de formation des prix. Or, si les prix sont mal formés, l’épargne ne se dirige pas vers les bons investissements. Il est donc essentiel de faire en sorte que le marché soit le plus ouvert, le plus transparent, le plus liquide possible afin que les prix puissent se former correctement. Pour cela, le marché doit être développé.
Le prix dépend à la fois de l’évaluation des risques et de la liquidité du marché. Plus le marché est liquide, ce qui signifie que les acteurs sont nombreux, plus ces acteurs considèrent que le risque, et donc leur coût d’intervention, est faible. Les règles du marché doivent viser à établir de telles conditions.
La crise grecque, qui a été à l’origine de votre réflexion, s’est déclenchée bien avant que les choses ne s’emballent sur les marchés. La situation économique et financière de la Grèce était déjà unanimement considérée comme préoccupante, mais l’élément déclencheur a été d’apprendre que les gouvernements successifs avaient communiqué aux marchés des informations inexactes sur l’endettement du pays et le niveau de son déficit rapporté à sa production intérieure. C’est l’incertitude qui en est résultée et la perte de confiance dans l’émetteur de la dette qui ont entraîné les mouvements des marchés, les acteurs se rendant compte qu’ils avaient été trop optimistes sur la situation des finances publiques et que leurs informations étaient inexactes. Dans ce genre de cas, l’inquiétude est amplifiée par l’incertitude : ainsi, dès qu’il apprend qu’une entreprise a communiqué des données inexactes au marché, un investisseur ne croit plus à rien sur sa santé financière et la gravité réelle de la situation, ce qui ne peut aboutir qu’à une forte dégradation du marché.
Il est possible que certains acteurs de très court terme aient vu là une possibilité de profits, en anticipant une dégradation très prononcée de la situation, mais ce ne sont pas leurs mouvements qui ont créé la crise : tout au plus ont-ils pu l’aggraver ou l’entretenir.
Aujourd’hui, l’inquiétude persiste sur la situation de la Grèce en tant qu’émetteur, ce qui se traduit dans l’écart de taux avec les autres pays européens.
L’exposition des banques françaises en Grèce est relativement faible sur la dette de l’État et un peu plus élevée sur le reste de l’économie. Au total – en comptant l’État, les banques et les agents privés –, elle s’élève à 53 milliards d’euros, dont 9,5 milliards sur la dette souveraine à fin avril 2010. Lors de l’annonce du plan de soutien à la Grèce, nous avons pris l’engagement de conserver nos positions et nous l’avons tenu. Mais, encore une fois, ce n’est pas la spéculation qui a déclenché la crise : c’est l’annonce, grave en tant que telle, que l’émetteur avait communiqué de fausses informations.
Il est possible d’agir pour que le marché remplisse au mieux sa mission, c’est-à-dire finance l’économie. La réflexion s’organise autour de plusieurs axes. Le premier axe concerne la réglementation des agences de notation, notamment en matière de conflits d’intérêts. Un autre porte sur les marchés dérivés : il s’agirait de mettre en place une standardisation et une compensation centrale systématique des produits dérivés, afin de limiter au maximum le risque systémique. Une réforme de la directive sur les services financiers est aussi à l’étude, qui devrait améliorer la transparence des marchés, c’est-à-dire permettre la connaissance des interventions de chaque acteur et réduire la fragmentation des marchés. L’ensemble de ces réformes permettrait de rendre le marché plus transparent et plus liquide. Les banques françaises les appuient et contribuent à leur élaboration. Ces réformes sont nécessaires pour corriger les dysfonctionnements des marchés.
M. le président Henri Emmanuelli. Quelles sont les conséquences des accords de Bâle III sur vos fonds propres ?
M. François Pérol. L’accord de dimanche dernier entre les gouverneurs de banques centrales est la traduction exigeante des engagements pris par les chefs d’État et de gouvernement au G20. Il impose aux banques un renforcement très significatif de leur capital : au final, si l’on tient compte d’une définition plus restrictive et de l’augmentation du niveau minimum de capital, le ratio minimal de capital est de 5 à 6.
Les banques françaises ont la capacité de s’adapter à ces nouvelles normes : elles sont solides, ainsi que l’ont démontré les tests de résistance de juillet dernier. Elles ont déjà commencé à renforcer leur capital – leurs fonds propres durs, ou fonds propres tier one, ont été augmentés de 30 % depuis deux ans – et leur modèle est assez solide pour leur permettre de respecter sans difficulté le nouveau ratio.
La conséquence de l’accord est que, toutes choses étant égales par ailleurs, il faut plus de capital pour exercer la même activité. Cela influe sur la capacité des banques à distribuer du crédit. Si les accords Bâle III ont défini un cadre très clair en matière de ratio minimal, plusieurs points très importants restent en discussion. C’est le cas du ratio de levier, qui n’est pas une mesure de risque et devrait à notre sens rester un indicateur de surveillance prudentielle, pas une norme dont le respect est sanctionné. Une autre réflexion a cours sur les établissements dits systémiques, et surtout sur l’opportunité de leur imposer une surcharge en capital. Nous ne pensons pas que cela soit nécessaire. En effet, d’autres moyens existent pour diminuer le risque systémique, à commencer par le renforcement de la supervision et une meilleure régulation des marchés. Enfin, les résultats de la discussion sur les ratios de liquidités pourraient modifier fondamentalement la façon dont les banques financent leurs activités et peser sur leur rentabilité.
Tous ces sujets restent ouverts. Les accords de Bâle traduisent un dosage déjà exigeant, et il ne faut pas aller au-delà. On demande aux établissements de changer le numérateur de leur ratio de solvabilité, en ayant la sagesse de leur laisser le temps de s’adapter. Mais il ne faut pas oublier qu’il y a aussi un dénominateur – les risques qu’ils prennent ! Si la contrainte sur le numérateur est encore accentuée, les établissements devront ajuster le dénominateur, c’est-à-dire prendre moins de risques ou les sortir de leur bilan. Cela débouchera sur un modèle de banque moins intermédié que ce qu’il est aujourd’hui en France, avec plus de marché, plus de titrisation et moins de crédit.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. On a beaucoup entendu, pendant la crise, que les établissements de grande taille constituaient un risque majeur – parce qu’on ne les laissera jamais tomber. Mais l’augmentation des fonds propres ne pousse-t-elle pas justement à la concentration ? Par ailleurs, quelle est la part que vous attribuez à la titrisation dans la crise financière ? Considérez-vous que les tests de résistance, qui ont fait l’objet de critiques, soient efficaces ou qu’ils doivent être améliorés ? Enfin, que pensez-vous de l’idée d’interdire ou de limiter les ventes à découvert à nu ?
M. François Pérol. S’il faut limiter la taille des établissements, cela ne doit être que dans l’objectif de maintenir la concurrence sur les marchés. De ce point de vue, c’est une décision parfaitement légitime. Pour le reste, la taille n’est pas en tant que telle un indicateur de la qualité de la gestion, de la supervision, de la régulation d’un établissement. Sur le marché français, par exemple, aucun des grands établissements qui seraient qualifiés de systémiques si l’on parvenait à s’entendre sur une définition finale n’a fait faillite ni n’a mis l’économie française en danger. En Irlande, en revanche, des établissements de moindre taille ont mis en danger l’ensemble de l’économie du pays. Quant aux États-Unis, si certains très grands établissements bancaires ont montré des défaillances fondamentales, de nombreuses faillites ont aussi été le fait de petits établissements. La taille n’est donc aucunement un critère de prévention du risque et il ne servirait à rien de la limiter a priori plutôt que de s’intéresser à la qualité professionnelle des établissements.
La titrisation peut jouer un rôle utile dans le financement de l’économie si elle est correctement appréhendée. Dans le cas américain, il y avait un très grand nombre d’intermédiaires entre la prise de risque initiale et la vente finale aux investisseurs, ce qui a conduit à une déconnexion totale entre l’appréciation du risque et le portage final. Ce sont ces véhicules de titrisation, qui comportaient un grand nombre d’instruments de crédit dont le risque avait été mal apprécié et qui étaient souvent proposés par des établissements non bancaires – les plus nombreux dans la distribution des subprimes – qui ont conduit aux difficultés que nous avons connues. Sur les marchés européens, où les crédits immobiliers sont attribués selon une analyse « toute bête » de la capacité de remboursement de l’emprunteur, les véhicules de titrisation sont parfaitement sécurisés. Nous les avons peu développés, parce que nous préférons conserver ces crédits dans nos bilans, mais ils peuvent être utiles au fonctionnement de l’économie. Si les normes de Bâle sont appliquées de façon stricte, ce qui devrait être le cas, elles conduiront les établissements à diminuer la taille de leur bilan et à développer la titrisation. Il faudra donc absolument veiller, sur ce marché, à ce que la prise de risque ne soit pas complètement déconnectée du portage final. Dans ce but, nous défendons l’idée d’un label européen pour les véhicules de titrisation.
Pour ce qui est des tests de résistance, nous sommes heureux que les vingt-sept régulateurs européens se soient livrés ensemble à l’exercice, et publient l’intégralité de ses résultats. Il ne me semble désormais pas possible de ne pas reconduire ce genre d’opération. Ces tests ont été critiqués, notamment par le Wall Street Journal, en des termes assez peu amicaux d’ailleurs. Mais l’objet des tests tels qu’ils ont été conçus par les régulateurs était d’apprécier l’impact d’une crise de la dette souveraine sur le niveau de solvabilité des banques, et la méthode qu’ils ont définie nous semble parfaitement adaptée à cet objectif. Ils ont eu l’occasion de préciser publiquement le pourquoi et le comment de l’opération.
Enfin, le mécanisme de la vente à découvert à nu peut présenter un intérêt dans certains cas particuliers. Lorsque vous vous portez candidat à une adjudication de titres d’État, par exemple, vous devez vous couvrir pour ne pas exposer votre bilan à une position directionnelle. Par définition, vous n’avez pas encore les titres mais vous les vendez à découvert à nu parce que vous êtes quasiment certain de les obtenir. Le délai entre l’adjudication et le dénouement de l’opération n’est que de quelques jours. Le risque final est pris par les investisseurs, qui, eux, prennent des positions directionnelles sur les marchés, mais généralement pas par les banques adjudicatrices.
Dans d’autres cas, les ventes à découvert à nu sont beaucoup plus contestables : elles peuvent créer des distorsions importantes et présenter un risque considérable pour l’acteur, qui n’est pas assuré de trouver sur le marché les titres qui lui sont nécessaires.
Mais si certaines de ces ventes sont nuisibles au bon fonctionnement du marché, il ne faut pas oublier celles qui sont utiles. C’est pourquoi il me semble bien préférable de les réglementer, comme c’est en cours en Europe, plutôt que de les interdire absolument. D’autant que, dans ce dernier cas, les États, qui procèdent en ce moment à des émissions importantes, trouveraient des marchés moins liquides et que les banques spécialistes de la dette auraient plus de mal à remplir leur mission.
En 2008, les régulateurs ont interdit, aux États-Unis puis ailleurs, les ventes à découvert à nu sur certains titres. C’était nécessaire sur le moment, mais il faut garder à l’esprit que de telles mesures ne peuvent être efficaces que si elles sont internationales – tout comme la réglementation d’ailleurs.
M. Louis Giscard d’Estaing. Les établissements bancaires français ont-ils participé à la spéculation sur la dette souveraine grecque ? Dans l’affirmative, par quels mécanismes ? On sait que l’Allemagne avait quant à elle pris la décision de stopper les possibilités d’intervention spéculative sur la dette souveraine…
Les établissements bancaires français sont-ils satisfaits des conditions de transparence et d’information dans lesquelles s’effectue le portage d’actions ?
Que pensez-vous de l’application de la Volcker Rule dans le modèle bancaire français ?
Enfin, nous avons été surpris de constater que les banques françaises n’étaient pas aussi solides que nous le pensions et que de grands établissements espagnols obtenaient de meilleurs résultats aux tests de résistance, alors qu’ils sont très exposés au marché immobilier domestique. Comment l’expliquez-vous ?
M. François Pérol. Les banques françaises ne sont pas des acteurs majeurs sur le marché de la dette souveraine grecque, avec des positions de 9,5 milliards d’euros – elles sont plutôt exposées sur le marché économique, surtout par le biais de leurs filiales en Grèce. J’imagine donc difficilement qu’elles aient pu contribuer à la spéculation sur la dette grecque, d’autant qu’elles veillent à respecter l’ensemble de la réglementation. À titre d’exemple, l’exposition de l’établissement que je préside n’atteint pas 100 millions d’euros, ce qui est dérisoire pour une dette de plusieurs centaines de milliards.
À propos du portage d’actions, vous faites référence aux opérations par lesquelles des établissements financiers acquièrent des titres pour le compte d’opérateurs qui souhaitent demeurer discrets. À titre personnel, je pense que le marché doit avoir la meilleure connaissance possible des opérateurs qui interviennent sur chaque titre, y compris dans les opérations de portage. C’est une information utile pour les autres investisseurs.
La Volcker Rule établit une distinction entre les activités pour compte propre de la banque et ses activités pour le compte de sa clientèle. En pratique, c’est difficile. Certaines opérations relèvent clairement du compte propre : des positions directionnelles prises par une banque sur son bilan, par exemple. Mais la banque peut aussi utiliser son compte propre pour le service d’un client. Ainsi, la banque chargée d’une émission obligataire est le teneur de marché pour ce titre : elle intervient sur le marché pour contribuer à la formation du prix. C’est son compte propre et son bilan qui sont mobilisés pour cela, mais c’est indispensable pour proposer un service de qualité à son client – l’émetteur. Pour lui obtenir un bon prix de marché, il faut intervenir sur ce marché et, pour cela, il importe d’avoir des « livres » et d’être capable de vendre et d’acheter. Il en est de même pour une couverture de change : vous devez être capable de proposer un prix à votre client, et donc de prendre position sur le marché, le tout sur votre compte propre.
Voilà pourquoi la distinction entre compte propre et compte de tiers est en pratique difficile à effectuer pour les banques qui veulent rendre à leurs clients, et notamment aux grandes entreprises, tous les services qu’ils attendent, du crédit au financement de marché – puisque les entreprises connaissent toutes désormais, elles l’ont appris de la crise, la nécessité de diversifier leurs modes de financement. Nous attendons donc de voir comment la Volcker Rule sera appliquée en pratique. Chacune des banques de notre fédération a sans doute un pourcentage différent d’opérations pour compte propre dans le total de ses activités, sans compter les divergences d’interprétation. Chacune décide aussi de ce qu’elle veut faire de son bilan. À titre d’exemple, mon établissement a décidé de placer en gestion extinctive les activités de compte propre lorsque ce n’était pas utile à nos clients, d’abord parce que ces activités mobilisent des fonds propres importants, ensuite, il faut bien le dire, parce que nous n’avons pas été brillants par le passé en ce domaine et, enfin, parce que ces activités ne répondent pas à notre vocation. Mais d’autres peuvent faire des choix différents.
Je pense que, si une banque – ce n’est le cas d’aucune banque française – réalise l’essentiel de ses profits sur des activités de compte propre, un peu comme le fait un fonds d’investissement mais dans le cadre, pour ce qui le concerne, du mandat donné par ses clients, ses dirigeants doivent être confrontés à des décisions difficiles lorsqu’il leur faut intervenir dans l’intérêt de leurs clients. Mais ce n’est qu’une opinion personnelle. Pour le reste, nous attendons avec un grand intérêt de voir de quelle façon les États-Unis appliqueront la Volcker Rule.
Je ne suis pas très bien placé pour commenter la situation des banques espagnoles. Elle est contrastée : un certain nombre a parfaitement passé les tests de résistance, d’autres ont besoin d’une recapitalisation. Cela s’explique par le fait qu’elles sont très diversement exposées à l’économie domestique, parce que les très grandes banques espagnoles sont de très grandes banques internationales et qu’une grande part de leurs activités se fait hors d’Espagne.
Quant aux banques françaises, les tests ont montré qu’elles disposaient d’un « coussin » de fonds propres important, y compris dans le scénario le plus tendu, celui d’une double récession aux États-Unis. C’est dû au fait qu’elles ont déjà considérablement renforcé leurs fonds propres.
M. Dominique Baert. Pensez-vous qu’il faille réguler de façon différente les produits financiers selon qu’ils sont adossés à des actifs ou à des indices ? Avez-vous étudié leur volatilité selon cette distinction ? Autrement dit, la sensibilité aux risques est-elle différente selon que les produits sont adossés à l’économie réelle ou à l’économie virtuelle ?
Par ailleurs, que pensez-vous de l’idée du Centre d’analyse stratégique de renforcer les ratios prudentiels des vendeurs de CDS (Credit Default Swaps), qui, s’ils provisionnent mal le risque qu’ils assurent, pourraient devenir les maillons de transmission d’une crise systémique ?
M. François Pérol. J’avoue humblement n’avoir jamais pensé à une régulation différenciée selon que les produits sont adossés à des actifs ou à des indices. Mes services n’ont jamais étudié la question. Au premier abord, je ne suis pas sûr que les indices se rattachent davantage à l’économie virtuelle : ils ne font que refléter des actifs. Quoi qu’il en soit, nous allons approfondir la question et vous transmettrons nos réflexions.
Pour ce qui est des CDS, les accords de Bâle III ont prévu un renforcement considérable des fonds propres exigés pour mener les activités considérées comme les plus risquées. Les régulateurs ont fait de ce principe un élément important de la définition des risques moyens pondérés. La préoccupation que vous évoquez est donc prise en compte. En revanche, d’un point de vue plus global, il nous semble que le dispositif gagnerait en sécurité si ce type de produits faisait l’objet d’une compensation systématique, avec une chambre centrale de compensation permettant aux acteurs d’avoir connaissance de l’ensemble des transactions, comme cela se fait déjà dans d’autres domaines. Ce serait la solution la plus structurante, qui améliorerait la transparence et le bon fonctionnement du marché.
M. le président Henri Emmanuelli. Pourrez-vous nous faire savoir quelle est la part des opérations de crédit et des opérations de marché dans les résultats des banques, et parmi ces dernières, la part des opérations pour compte propre et pour compte de tiers ?
M. François Pérol. La Fédération ne dispose pas de données de ce type. À ma connaissance, les banques ne les calculent pas. Ce serait plutôt du ressort de la Commission bancaire. Pour ce qui concerne le groupe que je dirige, nous considérons que nos activités pour compte propre représentent 20 % de nos activités de marché, mais ce n’est pas une estimation standardisée.
M. le rapporteur. Toutes les critiques qui ont été portées contre les agences de notation pendant la crise vous paraissent-elles justifiées ?
Les opérations de marché connaissent des évolutions technologiques constantes qui mettent les autorités de contrôle face à un défi permanent, et très coûteux. La course aux meilleurs équipements est-elle sans fin, ou faut-il interdire certaines évolutions technologiques ?
Pensez-vous que le projet de loi sur la régulation bancaire et financière, actuellement examiné au Sénat et auquel Mme Lagarde veut apporter des compléments, répondra aux principales questions soulevées par la crise ?
Enfin, qu’attendez-vous de la présidence française du G8 et du G20 ?
M. François Pérol. Lorsque les agences notent des émetteurs pour le compte des investisseurs et donnent leur analyse de la solvabilité d’une entreprise ou d’un État, elles jouent un rôle indispensable. Ce que l’on peut dire, c’est qu’elles n’ont pas toujours été très heureuses dans le choix du moment de leurs interventions.
M. le président Henri Emmanuelli. Les agences ne sont-elles pas, pour les banques, un moyen d’externaliser le travail d’expertise ? Ces dernières ne renoncent-elles pas à mener leurs propres analyses ?
M. François Pérol. Nous effectuons toujours nos propres expertises sur le risque de chaque émetteur. Elles sont appuyées sur nos relations avec nos clients. C’est une approche différente de celle des agences de notation, qui travaillent pour le compte des investisseurs. C’est pourquoi leur analyse de la solvabilité des émetteurs est utile.
En revanche, pour ce qui est de la notation des produits, l’expertise des agences n’a pas résisté à l’épreuve des faits et de nombreuses questions se sont fait jour sur leurs conflits d’intérêts ou sur la qualité de leur expertise. Lorsqu’un véhicule de titrisation perd vingt-sept crans de notation en une semaine, on peut se poser des questions… C’est pourquoi les règles européennes sur le fonctionnement des agences me semblent aller dans le bon sens, même si elles ne peuvent jamais être parfaites.
Quant aux avancées technologiques, il me semblerait dommage de les interdire par principe.
M. le président Henri Emmanuelli. Quelle est leur utilité économique ? Le high frequency trading, notamment, suscite des critiques.
M. François Pérol. Il est vrai que des dysfonctionnements peuvent se produire, comme il y en a eu en mai sur le marché américain, mais ce mécanisme ne me paraît pas avoir créé de si graves problèmes sur le marché des actions. Les innovations technologiques sont utiles si elles contribuent à la liquidité du marché sans le dérégler. Pour ma part, j’hésiterais à les interdire par principe ; c’est de toute façon au régulateur qu’il appartient de se prononcer.
Le projet de loi de régulation financière me paraissait déjà extrêmement complet. Je ne sais pas ce qui doit y être ajouté mais, en tout état de cause, il faut bien garder à l’esprit que, sur ces sujets, l’évolution est permanente.
Enfin, l’agenda fixé pour la présidence française du G20 me semble extrêmement ambitieux, et à juste titre.
M. le président Henri Emmanuelli. Les régulateurs semblent s’inquiéter de l’application de la directive européenne sur la fragmentation des marchés, notamment pour ce qui est de certains grands opérateurs à Londres. Les annonces de Mme Lagarde visent à prendre en compte cette préoccupation.
M. François Pérol. La directive sur les services financiers va être révisée. Elle avait fait le choix d’introduire une concurrence entre différentes plateformes de négociation, en pensant provoquer une baisse des coûts qui profiterait aux émetteurs. Je ne suis pas sûr que cet objectif ait été atteint. Le fonctionnement des marchés « actions » français était, auparavant, fondé sur une règle de concentration des ordres, l’inconvénient étant qu’il n’y avait qu’une plateforme, l’avantage que toute la liquidité se faisait sur cette plateforme – sous réserve des grandes opérations qui ne se traitent de toute façon qu’en dehors des marchés. Cela ne fonctionnait pas si mal. La révision de la directive sera précédée d’un bilan des avantages et des inconvénients du système actuel pour tous les acteurs. Nous verrons ce qu’il en sortira.
M. le président Henri Emmanuelli. Merci, monsieur le président, pour toutes ces informations. Nous transmettrons ultérieurement à vos services quelques questions plus techniques.
L’audition s’achève à dix neuf heures cinquante.
*
* *
Audition de M. Philippe Mills, directeur général de l’Agence France Trésor
(Procès-verbal de la séance du mercredi 29 septembre 2010)
(Présidence de M. Henri Emmanuelli, président de la commission d’enquête)
La séance est ouverte à seize heures trente
M. le président Henri Emmanuelli. Monsieur le directeur général, je vous remercie d’avoir répondu à l’invitation de notre Commission d’enquête parlementaire.
L’Agence France Trésor assure la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État. À ce titre, elle est un acteur particulièrement important sur les marchés financiers. En 2009, elle a levé quelque 165 milliards d’euros à moyen terme et son programme pour 2010 est de l’ordre de 188 milliards. Elle gère également la charge d’intérêts avec un portefeuille de contrats d’échange de taux. Elle est en quelque sorte un établissement financier de service public et, à ce titre, suit avec attention l’évolution des marchés.
Notre commission d’enquête cherche à comprendre ce qui se passe sur les marchés financiers, en étudiant les mécanismes spéculatifs et le développement des produits dérivés, et en tachant de distinguer ce qui est utile de ce qui ne l’est pas. Dans cette perspective, nous aimerions connaître le sentiment de l’observateur averti que vous êtes.
La spéculation, au sens originel du mot, n’est pas une activité étrangère à votre mission, dans la mesure où elle peut avoir des effets équilibrants. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Qu’est-ce qui vous paraît dangereux dans la situation actuelle ? Avez-vous observé des mouvements spéculatifs anormaux sur le marché de la dette souveraine ? Si oui, que préconisez-vous pour y remédier ?
(M. Philippe Mills prête serment.)
M. Philippe Mills, directeur général de l’Agence France Trésor. Le sujet est complexe, et les apparences sont parfois trompeuses.
En tant que Directeur général de l’Agence France Trésor, je suis en contact quotidien avec certains marchés financiers. À ce titre, je peux vous apporter mon éclairage sur le fonctionnement du marché de la dette souveraine et des marchés de produits dérivés qui s’y rapportent directement ; en revanche, je ne suis pas en mesure de vous apporter des éléments concernant d’autres marchés, comme ceux des matières premières, des changes ou des actions.
L’actualité récente a été émaillée d’épisodes de tension extrême sur les marchés de la dette souveraine, qui ont suscité des inquiétudes quant à certaines manœuvres spéculatives, pouvant aller jusqu’à remettre en cause la capacité des États à honorer leurs engagements financiers.
Mon propos liminaire comportera trois parties. Dans un premier temps, je décrirai les rouages de ces marchés, de manière à identifier les niches abritant de potentiels acteurs spéculatifs, au sens péjoratif du terme. Ensuite, j’analyserai les événements récents ayant suscité des rumeurs de spéculation abusive sur ces marchés. Enfin, j’évoquerai les marchés de produits dérivés liés au marché de la dette, et leur rôle dans les tensions récentes.
Le marché de la dette souveraine est structuré de manière à minorer à la fois les coûts de fonctionnement de l’État et le coût de sa dette. L’Agence France Trésor – comme les autres agences de la dette – est un petit service, qui regroupe moins de quarante personnes. Si le système réussit à fonctionner, c’est parce qu’il existe un marché intermédié de dix-neuf établissements bancaires, les « spécialistes en valeurs du Trésor » (SVT), qui ont un accès privilégié aux adjudications de titres de dettes.
M. le président Henri Emmanuelli. Ce sont vos opérateurs ?
M. Philippe Mills. En quelque sorte. Ce sont des « grossistes », qui retransmettent à chaque adjudication les ordres de leurs clients : banques centrales, investisseurs institutionnels, gérants de fonds de pension, assureurs.
Ce mécanisme d’intermédiation assure à l’Agence France Trésor une très grande sécurité de ses transactions, les SVT étant garants de la bonne exécution des opérations et devant, avant d’accepter qu’un client passe un ordre sur les titres souverains, mener les investigations nécessaires afin de s’assurer du sérieux et de la solvabilité du candidat. Si l’État devait négocier directement avec les clients finaux, le coût de gestion serait rédhibitoire.
Par ailleurs, une telle organisation permet de minorer les coûts et les risques en termes d’émission de titres et de financement de la dette. En effet, les SVT ont pour fonction d’informer en permanence l’Agence sur l’évolution des besoins des investisseurs finaux, que ce soit en termes de maturité des titres – de deux ans jusqu’à cinquante ans – ou de type de produits. Grâce à ce flux d’informations, nous pouvons adapter en continu l’offre de titres à la demande.
La politique d’émission de l’Agence est très appréciée des investisseurs, car elle est prévisible, transparente et régulière. L’Agence publie à l’avance les dates de mises sur le marché de bons du Trésor à taux fixe (BTF), de bons du Trésor à intérêt annuel (BTAN) et d’obligations assimilables du Trésor (OAT) et abonde régulièrement des souches de référence, qui représentent entre 80 et 85 % des émissions de l’Agence et constituent des références de taux très appréciées par les investisseurs. Ceux-ci sont ainsi assurés de pouvoir disposer, quand ils le souhaitent, d’un titre français de quelque maturité que ce soit, du BTF de trois mois jusqu’à l’OAT de cinquante ans. Cela garantit en outre à l’Agence une demande structurelle des investisseurs, ce qui réduit considérablement le taux auquel l’État se finance.
Par ailleurs, les SVT ont l’obligation contractuelle de concourir à la liquidité des titres français. Ils doivent donc être capables d’intervenir en permanence comme contreparties, avec des marges strictement encadrées et contrôlées par l’Agence. C’est pourquoi les titres d’État français sont considérés comme une référence en matière de liquidité, et qu’ils sont très demandés sur le marché secondaire.
De surcroît, les SVT étant présents à la fois sur le marché primaire et sur le marché secondaire, ils peuvent réaliser des arbitrages entre les deux ; de ce fait, les prix demandés aux adjudications organisées par l’État sont très proches de ceux auxquels s’échangent les titres sur le marché secondaire. Cela concourt également à réduire le taux de financement de l’État : comme on peut facilement les échanger, on ne demande pas une prime de liquidité pour les émettre.
Cette organisation intermédiée du marché primaire de la dette – qui, sans que ce soit une particularité française, est particulièrement organisé dans notre pays – permet donc de garantir que l’État bénéficie, de manière structurelle, des meilleures conditions de financement possibles. Or, son bon fonctionnement nécessite l’utilisation par les SVT de techniques financières comme la vente à découvert « à nu », qui permet de mettre sur le marché les titres de l’Agence France Trésor. C’est pourquoi il ne faut pas faire d’amalgame entre les techniques financières utilisées et les fins spéculatives de certains acteurs : ce n’est pas la technique qui fait la spéculation, mais son utilisation.
Les SVT sont des intermédiaires. L’objectif n’est pas qu’ils achètent en propre toute la dette de l’État : le volume de titres émis est beaucoup trop important. Cela consommerait une part trop importante de leurs ressources et les mettrait en danger, tout en fragilisant considérablement la sécurité des émissions de l’État, car la base d’investisseurs serait trop réduite. Leur rôle est d’assurer la sécurité et la fluidité de la mise sur le marché des titres de l’État français.
Lorsqu’un SVT reçoit un ordre d’achat, il est obligé d’effectuer une vente « à découvert » – par définition, les SVT vendent des titres qu’ils ne peuvent pas posséder, puisque ceux-ci n’ont pas été encore émis – et « à nu » – il est impossible aux SVT d’emprunter sur le marché du prêt-emprunt de titres (repurchase agreements ou Repo), dans le laps de temps qui sépare la négociation de la vente et le règlement de celle-ci, les titres qui ne seront mis sur le marché qu’à la livraison qui suit l’adjudication. Si les SVT ne disposaient pas de ce mécanisme, ils devraient de toute façon honorer leurs ordres vis-à-vis de l’État, sans quoi ils perdraient leur statut.
En outre, afin de garantir la sécurité des adjudications françaises, la charte qu’ils ont signée avec l’AFT les contraint à être présents à chaque adjudication et à acquérir un montant minimal de 2 % sur chaque ligne et sur chaque adjudication, et de 2,5 % sur l’ensemble des émissions de l’année. Ils doivent alors se couvrir en amont de la mise sur le marché des titres, en trouvant l’équivalent d’un client. Pour cela, ils vendent à découvert des titres français, soit ceux qu’ils vont réellement acheter s’il s’agit de souches existantes, soit des papiers de maturité proche.
Sans la technique de la vente à découvert à nu, la fluidité de la mise sur le marché des titres de l’État français serait donc bien moindre et l’État paierait plus cher les capitaux qu’il emprunte. Cette situation n’étant pas propre à la France, il importe que la proposition de règlement européen sur l’encadrement des ventes à découvert et des dérivés de crédits souverains, qui vise, de façon parfaitement légitime, à imposer des obligations de transparence pour les positions courtes, ne grippe pas les rouages du marché primaire. Ce constat fait l’unanimité parmi les agences de la dette des Vingt-sept, et les dispositions nationales prises sur le sujet – qu’elles soient ou non liées à la proposition de règlement européen – doivent tenir compte de cette contrainte.
J’en viens maintenant à mon deuxième point : les tensions dont a fait l’objet le marché de la dette souveraine, et le rôle joué par certains acteurs et certains instruments financiers.
Des tensions sur le marché de la dette souveraine existaient déjà à la fin de 2007 et au début de 2008, mais la situation est devenue préoccupante à partir de novembre 2009, quand les marchés ont commencé à s’intéresser à la situation budgétaire grecque.
Le facteur déclenchant fut l’annonce en novembre 2009, par le nouveau gouvernement grec, que les statistiques publiées sur les finances publiques étaient erronées, et que le déficit pour l’année 2009 serait de 12 %, au lieu des 6 % attendus. L’écart de taux de financement relatif entre la Grèce et l’Allemagne s’est alors creusé. Les appels au marché sont devenus de plus en plus difficiles pour l’État grec, les marchés ayant des incertitudes croissantes sur sa capacité à ramener son déficit à un niveau compatible avec sa situation économique. En conséquence, l’écart moyen entre le taux de financement de la Grèce et celui de l’Allemagne a connu plusieurs pics, le premier, fin janvier 2010, à près de 400 points de base, le dernier, le 7 mai 2010, à plus de 1 000 points de base.
C’est alors qu’est intervenu le plan coordonné de stabilisation financière de l’Union européenne, adopté au cours du week-end du 7 au 9 mai 2010. Les éléments de ce plan ont permis de faire bénéficier les pays « périphériques » d’une accalmie, avec une diminution régulière des écarts de taux de financement, jusqu’au moment où, le 14 juin 2010, l’agence de notation Moody’s a dégradé à nouveau la note de l’État grec, de A3 à Ba1. Compte tenu des précédentes dégradations de la note par Standard & Poor’s et Fitch, cette décision a eu pour conséquence de faire sortir les titres grecs de la catégorie des titres dits « Investment grade », c’est-à-dire des investissements de qualité, ce qui a amorcé un mouvement de vente dans les lignes de portefeuilles tenus par des gestionnaires d’actifs contraints par leurs règles de gestion et leurs dispositifs de contrôle des risques, à ne détenir que des titres de qualité maximale. Les écarts de taux entre la Grèce et la moyenne de la zone euro et entre la Grèce et l’Allemagne se sont accrus à nouveau.
M. le président Henri Emmanuelli. Jusqu’à quel niveau ?
M. Philippe Mills. Un écart de 1 000 points de base – avant une diminution progressive.
À l’heure actuelle, la situation est toujours tendue, avec une forte aversion pour le risque de la part des intervenants de marché, qu’illustrent les écarts de taux et les niveaux très faibles des taux demandés aux États considérés comme les plus sûrs ; fin août, le taux à dix ans allemand a atteint son minimum historique, à 2,11 %, suivi en septembre par le taux à dix ans français, à 2,47 %.
Cette aversion pour le risque est entretenue par les incertitudes concernant la capacité des États à mener leurs politiques de consolidation budgétaire, la santé des grandes banques – bien que certaines d’entre elles aient été balayées par la publication des tests de résistance bancaires (stress tests) –, et l’évolution de la réglementation des instruments financiers, notamment en Europe.
Dans ce contexte, les investisseurs traitent les États de manière de plus en plus différenciée. Si la Grèce est devenue un cas particulier, d’autres pays sont jugés vulnérables, comme le Portugal et l’Irlande : si ces pays réussissent leurs émissions, ils le font au prix de concessions significatives sur les taux d’adjudication, pouvant aller jusqu’à plusieurs dizaines de points de base.
Dans ce contexte, y a-t-il des mouvements pouvant être qualifiés de spéculatifs et si oui, comment peut-on les contrer ?
L’évolution des conditions de financement des États dépend d’un petit nombre de facteurs. Premièrement, le taux de court terme auxquels se financent les États est forcément supérieur au taux auquel leur banque centrale rémunère les fonds déposés par les établissements bancaires : dans la zone euro, le taux plancher est de 0,25 %, ou 25 points de base. Dans le cas contraire, les banques pourraient réaliser un arbitrage entre les titres d’État et les fonds de la banque centrale, ce qui ferait monter les taux d’État de court terme.
S’agissant des titres de plus long terme, leur taux est déterminé essentiellement par les anticipations d’évolution des taux directeurs, elles-mêmes liées aux anticipations de l’inflation, et par une prime de risque qui dépend, entre autres, de la notation de l’émetteur. Il paraît difficile que ces éléments soient sujets à spéculation, dans la mesure où ils sont structurels et s’imposent à tous les acteurs.
Le deuxième facteur est l’appréciation que porte le marché sur un émetteur – et les craintes qu’il fasse défaut. Ce facteur a pris une place nouvelle depuis la faillite de Lehman Brothers en 2008 : alors qu’auparavant, les gestionnaires de portefeuille estimaient que les obligations d’État étaient par définition un produit sans risque, certains les considèrent désormais comme des titres de crédit, dont le paiement peut être incertain, notamment lorsque l’émetteur rencontre des difficultés économiques et budgétaires, et dont la volatilité est bien trop élevée pour les normes d’investissement auxquelles ils sont contraints. Ces investisseurs doivent vendre automatiquement une partie de leurs positions sur les États jugés « à risque », sous peine de voir les épargnants réclamer une gestion plus sûre de leurs fonds ou le comité de suivi des risques exiger la réduction de leur exposition. Ces mouvements amplifient donc les mouvements de marché, sans être à proprement parler des manœuvres spéculatives : il s’agit d’une conséquence plutôt que d’une cause.
À cet égard, les notes attribuées par les agences de notation financière sont déterminantes, car elles servent fréquemment de base aux critères d’éligibilité des titres souverains dans les portefeuilles. La sécurité de ceux-ci est fonction, non seulement de la probabilité qu’un État fasse défaut, mais aussi de la volatilité estimée du titre, effet de marché indépendant de la capacité dudit État à honorer ses engagements financiers. Or, si les agences de notation doivent en théorie privilégier une vision à long terme prenant en considération les effets des cycles financiers et économiques, il s’avère qu’elles suivent assez rapidement les anticipations du marché, ce qui a un effet pro cyclique en accentuant les mouvements erratiques des marchés obligataires, au lieu de rassurer ceux-ci. Là est, à mon avis, le cœur du problème.
Dans un monde de marchés, l’accès à l’information est capital. S’il y a eu des tentatives de manipulation du marché, c’est bien plus par la diffusion d’informations erronées ou biaisées que par l’utilisation d’une technique financière particulière. Certains investisseurs peuvent tirer parti de la crédulité du marché en diffusant, après avoir pris une position, une rumeur afin de rendre cette dernière gagnante, les investisseurs « grégaires » orientant le marché dans le sens souhaité.
Ces abus font aujourd’hui l’objet d’une attention pointilleuse de la part des régulateurs. Pour les combattre, il convient d’encadrer au maximum les marchés et d’accroître la transparence et la fiabilité des données.
J’en viens maintenant à mon troisième point. Le marché de la dette est lié par des relations d’arbitrage et de couverture à des marchés d’instruments financiers, tels que les marchés de contrats d’échange de taux d’intérêts, et le marché des contrats d’échange de risque de défaut de titres, dits « CDS ». De ce fait, il existe des possibilités de spéculation et, surtout, des risques de contagion des phénomènes d’instabilité d’un marché à l’autre. C’est pourquoi ces marchés doivent être encadrés ; il convient de mettre en place une obligation de déclaration centralisée des transactions, afin que les autorités prudentielles puissent évaluer la situation, et une obligation de compensation, de manière à assurer leur stabilité. À cet égard, les propositions faites par la Commission européenne vont dans le bon sens.
Le cas du marché des CDS est particulièrement intéressant. Le paradoxe de ces instruments, c’est qu’ils sont à l’origine destinés à couvrir le risque de défaut, mais, en pratique, ils sont utilisés à d’autres fins.
Qu’est-ce qu’un CDS ? Prenons l’exemple – théorique ! – d’un risque de défaut sur l’État allemand. En signant un contrat d’une durée de cinq ans, portant sur un montant d’1 million d’euros, on s’engage à payer pendant cinq ans une prime d’assurance annuelle de quarante points de base, soit 4 000 euros. En échange, si l’État allemand échoue à honorer l’un des engagements pris sur ses titres de dettes, restructure un montant significatif de sa dette, la répudie ou la repousse à une date ultérieure sans passer par des échanges de titres sur le marché, on reçoit le montant précité à titre de dédommagement.
Les limites de ce type de produits, lorsqu’ils portent sur un État souverain, sont évidentes. D’abord, comment un établissement financier pourrait-il être en mesure de pallier, dans les cinq ans, un défaut de l’Allemagne ? Ensuite, ne faudrait-il pas imposer un plafond à l’encours notionnel des CDS, dans la mesure où le degré de risque contre lequel on s’assure risque de déséquilibrer les bilans ? Les limites que rencontrent les acteurs de marché à la constitution de positions nettes importantes sur un émetteur donné devraient être régulées, afin de s’assurer qu’elles ne fragilisent pas l’ensemble du système financier.
Ces questions prudentielles, fort délicates, relèvent de la compétence du régulateur. Néanmoins, je juge urgent d’encadrer de très près ce marché et de pousser les établissements détenteurs de ces positions à contrôler leur degré d’exposition au risque.
Venons-en à la pratique. Les CDS étant des instruments de marché, ils sont soumis à la loi de l’offre et de la demande. Des arbitrages pouvant être faits avec le marché des obligations, leurs cours suivent assez naturellement, avec des délais et des amplitudes variables, l’évolution des écarts de taux entre les pays. Les acteurs de marché les utilisent avant tout pour cette propriété et non contre un très hypothétique défaut de l’Allemagne avant 2015 !
M. le président Henri Emmanuelli. Si l’on prend l’exemple précédent, que se passe-t-il ?
M. Philippe Mills. Il faut trouver une contrepartie. Généralement, sur le marché des CDS, les intervenants majoritaires sont des banques, lesquelles interviennent par ailleurs sur le marché des obligations souveraines, qui essaie d’anticiper l’évolution des taux allemands.
M. le président Henri Emmanuelli. La valeur du coupon va donc fluctuer en fonction de l’évolution des taux ?
M. Philippe Mills. Exactement : elle variera en fonction du lien qui peut être établi entre les deux. Le problème, c’est que, si l’on ne veut pas être exposé à un risque trop important, il faut être certain qu’il existe un lien stable, ce qui n’est pas nécessairement le cas !
On s’est demandé si des positions prises sur le marché des CDS avaient été utilisées pour influer sur le prix des titres grecs. Pour l’heure, il est impossible d’établir avec certitude que le marché a été manipulé en défaveur de la Grèce – je crois d’ailleurs que cela vous a été confirmé par le président de l’Autorité des marchés financiers (AMF). En revanche, les deux marchés sont liés, d’autant plus que le marché de la dette grecque est peu liquide : les investisseurs qui détiennent de la dette grecque échangent relativement peu de titres, et le niveau des prix peut être influencé par un mouvement relativement faible. L’en-cours notionnel brut des CDS sur l’État grec est actuellement d’environ 79 milliards de dollars et l’en-cours négociable de la dette grecque de quelque 276 milliards de dollars : le rapport entre les deux montants est tel qu’un mouvement sur le marché des CDS – plus facile à déclencher qu’un mouvement sur le marché des taux lorsque des montants importants sont en jeu – influence directement le marché de la dette concernée.
Le phénomène se renforce si le marché de la dette n’est pas liquide : certains investisseurs devenant attentistes, les volumes échangés sur le marché se réduisent et l’on peut modifier encore plus rapidement les prix et les taux. Il est avéré que le marché des CDS peut alors dominer celui des titres. Dans le cas grec, même s’il n’y a pas de « smoking gun », c’est-à-dire de preuve tangible, on ne peut exclure que certains investisseurs aient tenté d’en tirer avantage, en vendant à découvert des titres d’État et en achetant massivement des CDS, de manière à rendre le marché favorable aux positions courtes, mais défavorable à l’émetteur.
Pour les pays dont la dette est très liquide, comme la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni ou les États-Unis, la situation est différente. L’en-cours notionnel brut de CDS sur l’émetteur France est de 67 milliards de dollars, pour un en-cours total de titres négociables de près de 1 600 milliards de dollars. Dans ce cas, le marché des CDS suit celui de la dette, bien plus profond et massif.
Tous ces éléments me conduisent à répéter que ces marchés doivent être encadrés et surveillés de près. En particulier, les liens entre le marché de la dette et ceux des instruments dérivés doivent faire l’objet d’une attention soutenue. Il faut veiller à ce que les régulateurs disposent de moyens suffisants pour lutter contre d’éventuelles manipulations du marché de la dette, que ce soit par des ventes à découvert de titres d’État dans un marché peu liquide ou par la manipulation de celui-ci via le marché des CDS.
M. le président Henri Emmanuelli. En d’autres termes, les CDS sur les dettes souveraines, conçus pour sécuriser la créance, sont devenus un instrument de spéculation. Comment est-ce possible ?
M. Philippe Mills. Il ne s’agit pas toujours d’une spéculation négative : certains les utilisent comme un moyen de se couvrir contre la volatilité d’un titre.
M. le président Henri Emmanuelli. Mais ce n’est pas fait pour ça !
M. Philippe Mills. En effet. Mais c’est un problème surtout pour les États fragiles, dont le ratio entre les deux marchés est équilibré, tandis que la liquidité du marché de la dette est faible.
M. le président Henri Emmanuelli. Toujours est-il que l’utilisation des CDS n’a rien à voir avec leur objectif initial ! Comment appelle-t-on cela, dans le jargon financier ? Un leurre ?
M. Philippe Mills. C’est un simple constat, partagé par l’ensemble des émetteurs souverains et des agences de la dette. Mes collègues allemands, anglais ou américains vous diraient qu’ils ne se préoccupent pas du marché des CDS.
M. le président Henri Emmanuelli. Les Grecs et les Portugais n’ont pas le choix !
M. Philippe Mills. C’est pourquoi il est nécessaire d’aller plus loin en matière de réglementation et de transparence.
Résumons. Premièrement, il convient de distinguer les techniques financières et les comportements spéculatifs. Deuxièmement, une bonne information est essentielle : tout ce qui contribuera à améliorer sa transparence et sa diffusion renforcera la lutte contre les mouvements spéculatifs. Troisièmement, le marché des produits dérivés de la dette pouvant participer à l’instabilité du système financier, les régulateurs doivent avoir les moyens de combattre d’éventuels abus. Sans casser les mécanismes de ces marchés, il convient donc de s’assurer qu’ils sont encadrés et contrôlés, et que les prix y ont une vraie signification.
M. le président Henri Emmanuelli. Dans l’hypothèse où le montant des CDS dépasserait une certaine quotité du montant global de la dette, faudrait-il prendre des mesures particulières ?
M. Philippe Mills. Le problème n’est pas tant de maintenir un certain rapport entre les deux valeurs que d’être bien informé de ce qui se passe sur ces marchés. Pour l’heure, on en est loin, puisqu’il n’y a pas de chambre de compensation et que le degré d’information est faible.
M. le président Henri Emmanuelli. De quelles informations le régulateur dispose-t-il sur le marché des CDS ?
M. Philippe Mills. Il dispose des éléments transmis par les acteurs concernés.
M. le président Henri Emmanuelli. Il n’existe pas de statistiques officielles ?
M. Philippe Mills. Non.
M. le président Henri Emmanuelli. Il s’agit par conséquent d’un marché aveugle.
M. Philippe Mills. C’est un marché qui n’est pas régulé.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. Vous avez évoqué essentiellement les aspects négatifs des CDS. Peut-on imaginer de les supprimer ?
Pensez-vous que les régulateurs ont les moyens d’assumer pleinement leurs missions, eu égard aux évolutions en cours ? Les mesures actuellement en projet vont-elles dans le bon sens ? Faudrait-il remédier à d’éventuelles lacunes avant leur mise en œuvre ?
S’agissant des rumeurs, qui vous semblent si dangereuses, le président de l’AMF nous a fait part de son scepticisme concernant leur détection, l’identification de leur source et leur éventuelle sanction. Quelle est votre opinion sur le sujet ?
Quel jugement portez-vous sur les agences de notation, dont le rôle a été vivement critiqué ces derniers temps, et sur les hedge funds ?
M. Philippe Mills. Le rôle des hedge funds est de prendre des positions à court terme, donc de faire des arbitrages entre les titres ou les marchés. Leur intervention est nécessaire pour assurer la fluidité du marché, mais si elle est excessive, elle risque de générer une volatilité excessive. Il en faut un peu, mais pas trop.
Par exemple, lorsque nous avons émis l’OAT 2060, nous n’avons réservé que 3 % des titres aux hedge funds.
M. le président Henri Emmanuelli. C’est l’émetteur qui régule, en quelque sorte.
M. Philippe Mills. Pour que ce soit possible, il faut être un émetteur fiable, régulier et prévisible. On attire de ce fait des investisseurs prudents, comme les compagnies d’assurance, les fonds de pension, les banques commerciales, les banques centrales ou les gestionnaires de fonds, qui conservent généralement les titres jusqu’à leur maturité et dont les processus d’allocation sont transparents et réguliers, ce qui garantit une base d’investissement diversifiée.
Toutefois, il ne me semble pas bon de refuser de servir les hedge funds, comme l’a fait la Grèce au début de l’année : cela n’a pas été perçu de manière positive et, au final, cela a desservi l’État grec en tant qu’émetteur.
S’agissant des rumeurs, les États y sont plus ou moins sensibles. Depuis le début de la crise, les agences de la dette ont pris conscience de la nécessité d’une communication régulière et cohérente à destination des investisseurs.
Pour les petits émetteurs, un changement de situation peut être source de difficultés. Certains, comme l’Irlande, avaient très peu de contacts directs avec les investisseurs, du fait de la bonne santé de leurs finances publiques. En arrivant sur le marché, ils ont montré aux investisseurs que leur situation n’était pas très bonne. Il faut donc communiquer de manière continue.
Même s’il est impossible de circonscrire totalement une rumeur, il ne faut pas hésiter à se montrer offensif et à contester toute information erronée ou biaisée, par exemple en publiant un communiqué, avec des chiffres certifiés par une autorité indépendante.
Les agences de notation remplissent une fonction indispensable et la méthode qu’elles appliquent est éprouvée. Le problème, c’est quand une agence procède à un ajustement trop brutal de la note d’un État, en la dégradant d’un seul coup de plusieurs niveaux. Il faut le faire de manière prévisible et progressive, sous peine de provoquer des mouvements spéculatifs et de renforcer la situation dénoncée – ce qui est paradoxal.
M. le président Henri Emmanuelli. Lorsqu’une agence de notation baisse la note d’un État, elle sait parfaitement quel mécanisme elle enclenche. C’est une énorme responsabilité !
M. Philippe Mills. Qu’elle juge nécessaire de modifier cette note, cela se comprend : si elle ne le faisait pas, elle serait mal jugée par les investisseurs ; en revanche, il ne faut pas qu’elle le fasse de manière trop brutale. Je ne sais pas s’il existe une solution à ce dilemme. Le véritable problème, c’est que certaines agences se soient mises dans cette situation et n’aient pas anticipé l’évolution de la situation de certains pays.
M. le président Henri Emmanuelli. Peut-être y a-t-il une part de suivisme ?
M. Philippe Mills. Les agences n’utilisent pas toutes la même méthode, mais elles s’observent. Sur l’Espagne, par exemple, les évaluations divergent.
S’agissant des CDS, le problème, c’est que le marché existe déjà et que l’outil est utilisé partout.
M. le président Henri Emmanuelli. Que représente, globalement, le marché des CDS ?
M. Philippe Mills. Plusieurs centaines de milliards de dollars – nous vous communiquerons le chiffre exact.
Il paraît délicat d’interdire les CDS en tant que tels. D’abord, cela ne ferait que déplacer le problème. Ensuite, les CDS sont émis sur des plateformes financières centralisées, dans des pays qui, par définition, n’ont pas envie de les interdire.
M. Hervé Mariton. On pourrait envisager de les réguler !
M. Philippe Mills. C’est précisément ce que prévoit le projet de règlement européen. Il faut répertorier les CDS, pouvoir obtenir les éléments d’information nécessaires ainsi qu’une vision consolidée des mouvements, donner au régulateur la capacité d’exiger des informations complémentaires, et substituer l’autorité européenne de régulation à l’autorité nationale si celle-ci ne réagit pas assez vite. Si ces dispositions sont mises en œuvre, on aura déjà bien progressé !
Mme Françoise Branget. L’autorité européenne existe déjà ?
M. Philippe Mills. Oui : il s’agit de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
M. le président Henri Emmanuelli. Est-elle opérationnelle ?
M. Philippe Mills. Non, elle est en cours de création. Mais on va dans la bonne direction.
M. le rapporteur. Les régulateurs ont-ils les moyens de faire face à la complexité de ces marchés et à la technologie utilisée par les acteurs financiers ?
M. Philippe Mills. Disons qu’ils sont plus habitués au marché des actions qu’à ce type de marché. Une phase d’apprentissage sera nécessaire. Toutefois, ce n’est pas très compliqué, et si une impulsion politique claire est donnée à l’échelle européenne, voire au-delà, le retard sera rapidement rattrapé.
M. Dominique Baert. Les agences de notation ont pour fonction d’assurer la notation la plus objective possible. Leur expertise relève d’une évaluation ex post, fondée sur l’analyse des fondamentaux économiques, qui comporte toutefois une dose de prospective, dans la mesure où il faut tenir compte des évolutions prévisibles. Or, l’action de certaines agences a eu des effets pro cycliques, ce qui suggère que leur analyse des fondamentaux était erronée. Pourtant, on n’a pas beaucoup entendu d’autocritique de leur part… Les liens financiers de certaines agences de notation avec certains groupes ont-ils pu jouer un rôle dans les mouvements spéculatifs ?
M. Philippe Mills. Ce qui s’est passé est plus simple.
La crise a débuté en 2007 sur d’autres marchés que celui de la dette souveraine. Les notations de certains produits dérivés avaient alors été jugées inadéquates – l’évaluation avait été particulièrement complexe en raison de l’absence d’éléments comparatifs dans l’espace et dans le temps. Une part importante des problèmes a découlé de la disparition de la liquidité des marchés, dans la mesure où leurs détenteurs ne pouvaient pas vendre ces produits, dont la valeur était devenue de facto quasi nulle. Les investisseurs ont reproché aux agences de notation de ne pas avoir été suffisamment réactives.
Pour noter les États, les agences tiennent compte de deux éléments : les fondamentaux économiques et la capacité de financement. Quand elles vantent les mérites de la France ou de l’Allemagne, elles mettent explicitement en avant ce dernier point, sur lequel joue le degré de liquidité du marché de la dette.
Lorsque des incertitudes concernant la politique budgétaire et les statistiques grecques sont apparues, les agences ont dû réviser leur note en pondérant les fondamentaux de l’économie grecque, qui n’avaient pas beaucoup évolué, et la capacité de financement effective du pays. Le problème n’est pas tant le résultat – inévitable – que la manière : la brutalité de la dégradation a accentué les mouvements en cours.
M. Dominique Baert. Vous avez évoqué tout à l’heure la possibilité que certains opérateurs aient pu profiter de l’occasion pour se livrer à des mouvements spéculatifs. Avez-vous identifié des lieux ou des opérateurs particulièrement actifs en la matière ?
M. Philippe Mills. Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’il n’y a pas de preuves de l’implication de tel ou tel acteur ou de tel ou tel lieu.
M. le président Henri Emmanuelli. Des noms circulent-ils ?
M. Philippe Mills. Il y a des rumeurs, mais ce n’est pas mon rôle d’y donner corps ! Il est difficile de dire si ces noms ont circulé parce qu’ils étaient effectivement à l’origine de mouvements spéculatifs ou s’ils ont fait l’objet d’une opération de déstabilisation.
M. Dominique Baert. Depuis une dizaine d’années, de nombreuses dettes souveraines sont détenues, directement ou indirectement, par des banques centrales, notamment d’Extrême-Orient. Cela vous paraît-il être un facteur de stabilisation des marchés ? Quel est le comportement des banques centrales par rapport à ces titres ?
M. Philippe Mills. Les banques centrales sont parmi les investisseurs les plus contrôlés. Elles doivent gérer leur portefeuille avec prudence, ce qui explique que nombre d’entre elles achètent surtout des titres AAA.
Depuis le début de la crise, en 2007, elles ont acquis moins de titres de crédit et plus de titres d’État – et, au sein de ces derniers, plus de titres AAA –, afin de renforcer la sécurité de leur portefeuille. Il existe en général au sein de chaque banque centrale des procédures d’agrément des émetteurs : une fois qu’elles ont choisi de détenir un titre, elles le gardent longtemps.
M. le président Henri Emmanuelli. Cela n’a-t-il pas un effet pro cyclique ?
M. Dominique Baert. Ont-elles toutes le même comportement ?
M. Philippe Mills. Non, certaines sont plus prudentes que d’autres. Toutes ne détiennent pas que des titres AAA. Les combinaisons risque-rendement varient. Par ailleurs, elles n’ont pas toutes la même taille, ni la même capacité à influer sur un marché.
M. le président Henri Emmanuelli. Globalement, elles agissent toutes dans le sens de la sécurité ?
M. Philippe Mills. Oui, mais sans choc, de manière lente et prévisible.
M. Dominique Baert. On sait le rôle joué par les banques centrales chinoise et japonaise dans le financement de la dette américaine. Qu’en est-il en Europe ?
M. Philippe Mills. Elles sont présentes depuis plusieurs années.
M. le président Henri Emmanuelli. Ont-elles accru cette présence ?
M. Philippe Mills. Comme les autres banques centrales, elles ont accru leur présence sur les titres d’État et sur les États notés AAA.
M. Dominique Baert. Ces dernières années, la part des non-résidents parmi les détenteurs de la dette française s’est accrue, ce qui ne laisse pas de nous préoccuper. Quelle est leur proportion actuellement ?
M. Philippe Mills. Selon la Banque de France, les non-résidents représentent 70 % des détenteurs de la dette française, mais cette statistique inclut les investisseurs membres de la zone euro. Or, ceux-ci ne connaissent pas de risque lié au change, la liberté de circulation de leurs capitaux n’est pas entravée, et leurs règles budgétaires financières et comptables sont proches des nôtres. Leur situation est donc comparable à celle des investisseurs français.
En réalité, la dette française est détenue pour un tiers par des Français, pour un tiers par des investisseurs de la zone euro, et pour un tiers par des investisseurs extérieurs à cette zone. On peut donc estimer qu’il s’agit, pour les deux tiers, d’un marché domestique.
Par ailleurs, plus une dette est considérée comme sûre et liquide, plus elle est détenue à l’extérieur de sa zone domestique. En Europe, c’est d’ailleurs la dette allemande qui arrive en première position dans ce domaine, suivie, dans l’ordre, par la France, les Pays-Bas, l’Italie et l’Espagne. Qu’une part importante de la dette soit détenue hors de la zone euro est un indice de la qualité de l’émetteur français.
M. le président Henri Emmanuelli. Cela n’a donc pas que des inconvénients ?
M. Philippe Mills. Non, mais cela crée aussi des devoirs.
M. le rapporteur. S’agissant des ventes à découvert à nu, la tentation est grande de les réglementer, voire de les interdire. Or, vous avez montré que cette technique était utile, et même indispensable, sur les marchés de la dette souveraine. Où est le juste milieu ?
M. Philippe Mills. Le point d’équilibre me semble avoir été atteint par le projet de règlement de la Commission européenne, qui vise à localiser et à encadrer les ventes à découvert, formule des exigences de transparence et d’information, mais prévoit, à l’article 15, une exemption pour les activités de teneur de marché.
M. le président Henri Emmanuelli. N’y a-t-il pas un risque de fragmentation ?
M. Philippe Mills. En l’occurrence, l’exemption est parfaitement justifiée et circonscrite. Le groupe des SVT est défini avec précision dans chacun des États membres – il existe d’ailleurs des recoupements.
M. le président Henri Emmanuelli. Que pensez-vous de la décision allemande d’interdire certaines ventes à découvert ?
M. Philippe Mills. Il s’agit d’une proposition, non d’une décision.
M. le président Henri Emmanuelli. Elle n’a pas été mise en œuvre ?
M. Philippe Mills. Pour qu’elle le soit, il faudrait l’accord explicite du Land de Hesse, où se trouvent les marchés. Cela me paraît difficile… Il s’agit d’une proposition, qui sera examinée dans le cadre de la proposition de règlement de la Commission européenne.
M. le président Henri Emmanuelli. Vous êtes un bon observateur de la vie financière, au-delà du marché de la dette souveraine. Avez-vous des choses à nous signaler, concernant certains produits ou certaines procédures ? Le trading haute fréquence se pratique-t-il sur les marchés de la dette souveraine ?
M. Philippe Mills. Je m’abstiendrai de répondre, faute d’information suffisante. Je dirai juste que le plus important, sur les marchés financiers, c’est la qualité de l’information. Or, il existe d’autres marchés où la circulation de l’information est incomplète – comme celui des matières premières. Des propositions ont été faites dans le cadre du G20 pour y remédier.
M. le rapporteur. Peut-on classer les marchés en fonction du niveau de spéculation ?
M. Philippe Mills. J’en suis incapable, faute d’avoir en tête les données nécessaires. En outre, il faudrait définir ce que l’on entend par « spéculation ». Un certain volume de spéculation est nécessaire.
M. le président Henri Emmanuelli. Certains investisseurs, qui ne recherchent que le profit à très court terme, peuvent déstabiliser les marchés !
M. Philippe Mills. Plus le marché est profond, plus il est liquide, et moindre est le risque.
M. le président Henri Emmanuelli. J’ai le souvenir d’avoir entendu, au cœur de la crise, des déclarations visant à expliquer que les dettes souveraines étaient un facteur de stabilisation. Partagez-vous ce point de vue ?
M. Philippe Mills. Ce qui est sûr, c’est que la dette souveraine est la matière première, le noyau du marché obligataire. C’est toujours par rapport à l’État que les autres émetteurs, publics ou privés, se positionnent. Il est donc nécessaire que le marché de la dette de l’État fonctionne correctement. C’est en ce sens qu’il joue un rôle pivot et c’est pourquoi il faut faire en sorte qu’il soit le mieux organisé, le mieux intermédié et le plus liquide possible.
M. le président Henri Emmanuelli. Comment fait-on s’il n’y a plus de déficit ?
M. Philippe Mills. Certains pays nordiques ont été pendant plusieurs années en situation d’excédent budgétaire. Ils ont réfléchi à la façon de modifier la structure de la dette, en abandonnant notamment certains types de maturité pour conserver de la liquidité sur les maturités restantes. Quand, il y a dix ans, les États-Unis étaient également en situation d’excédent budgétaire, le Trésor américain a abandonné la maturité à trente ans. Le Trésor néerlandais se pose actuellement la question.
M. le rapporteur. Pourriez-vous nous remettre une note décrivant la façon dont vous sélectionnez les spécialistes en valeur du Trésor ?
M. Philippe Mills. Ce sera fait.
M. le président Henri Emmanuelli. Ils sont tout de même nombreux !
M. Philippe Mills. Leur nombre a oscillé entre dix-sept et vingt et un.
M. le président Henri Emmanuelli. Qui sont-ils ?
M. Philippe Mills. Il s’agit uniquement de grandes banques internationales : quatre banques françaises, des banques européennes, des banques américaines, une banque japonaise… Cela permet d’atteindre des investisseurs divers.
M. le président Henri Emmanuelli. Chaque SVT touche-t-il un pourcentage fixe lors des adjudications ?
M. Philippe Mills. Non, ils ont juste l’obligation d’acquérir un montant minimal d’émissions. Pour le reste, cela dépend de la demande.
Chaque premier jeudi du mois, nous émettons des OAT, à dix ans et plus. La semaine qui précède, nous avons une réunion avec les représentants de chacun des SVT, qui nous demandent d’émettre tel montant sur tels titres. Nous en discutons en interne, et le lendemain, à onze heures, nous publions un communiqué annonçant que l’Agence France Trésor émettra trois à quatre titres pour une valeur comprise à l’intérieur d’une fourchette, l’ampleur de cette fourchette étant généralement comprise entre 1 et 1,5 milliard. Les SVT préparent l’adjudication en avertissant leurs clients. Nous suivons leurs démarches et nous faisons le point avec chaque SVT le matin même de l’adjudication.
M. le président Henri Emmanuelli. Il ne faut pas qu’il y ait de couac !
M. Philippe Mills. Une des règles auxquelles nous sommes soumis et que le Parlement contrôle, c’est que toute adjudication de l’État français doit être couverte. Cela a toujours été le cas. Depuis le début de la crise, la demande est en général deux fois supérieure à l’offre.
M. le président Henri Emmanuelli. Les SVT échangent-ils les titres entre eux ?
M. Philippe Mills. Ils peuvent le faire, de même qu’un investisseur peut répartir son offre entre plusieurs SVT. Mais il ne s’agit pas d’une enchère à prix unique. S’ils veulent être sûrs d’avoir un titre, il faut qu’ils surenchérissent. Ils placent donc leurs ordres à différents niveaux de prix.
M. le président Henri Emmanuelli. Concrètement, cela signifie qu’ils baissent les taux ?
M. Philippe Mills. En effet. Ils essaient de se situer juste au-dessus du prix plancher vers lequel nous portons le montant de l’adjudication.
M. le président Henri Emmanuelli. Ces dernières semaines, on a eu le sentiment qu’il y avait des liquidités « demandeuses ». Des offres intéressantes et plutôt surprenantes ont été faites aux collectivités territoriales. Comment l’expliquez-vous ?
M. Philippe Mills. Depuis quelques semaines, le contexte international est morose. Les perspectives de croissance et d’inflation sont faibles. Les rendements des actions sont jugés plutôt mauvais, notamment du fait des interrogations sur l’économie américaine, ce qui déporte l’épargne du marché des actions vers le marché des obligations et, pour encore plus de sécurité, vers les titres publics. Comme, pour les émetteurs, une petite différence de taux est intéressante, cela peut expliquer ce genre de démarches.
M. le président Henri Emmanuelli. Que pensez-vous de la forte pression exercée actuellement par les marchés sur la gouvernance démocratique ?
M. Philippe Mills. C’est une question complexe. Il faudrait savoir d’où vient la pression. L’important, c’est de conserver la crédibilité de la parole publique, de prouver que l’on fait ce que l’on dit et d’annoncer de bonnes nouvelles. De ce point de vue, ce qui s’est passé en Grèce est dévastateur.
En revanche, les États, dans leur ensemble, ont plutôt bien réagi lors de la crise des marchés financiers. Ils ont fait preuve d’une certaine prudence dans l’estimation des déficits. Du coup, les révisions se font plutôt à la baisse, ce qui est positif.
L’exigence de crédibilité de la parole publique me paraît normale. En retour, il importe d’utiliser à plein la puissance publique. La crise de la zone euro a mis en évidence les lacunes concernant la gouvernance de la zone.
M. le président Henri Emmanuelli. La crédibilité d’Eurostat en a pris un coup !
M. Philippe Mills. C’est pourquoi il est prévu de renforcer ses moyens. Eurostat n’avait pas de pouvoir d’enquête ; de ce fait, ses investigations étaient relativement limitées.
M. le président Henri Emmanuelli. J’ai rencontré récemment, dans un État membre, un sidérurgiste qui m’a expliqué qu’il payait l’électricité au noir. Eurostat n’est pas au courant ?
M. Philippe Mills. Ses moyens d’investigation se limitent à des rencontres avec les fonctionnaires de quelques ministères. Ses statistiques s’appuient sur les données des instituts nationaux.
Pour ce qui le concerne, le gouvernement grec a donné une plus grande indépendance à l’Institut de statistique, dont il a renouvelé les cadres, et a pris des mesures pour que les déclarations fiscales soient plus en accord avec la réalité du patrimoine et des revenus.
Le grand atout de la France, c’est la solidité de son administration fiscale et la fiabilité des statistiques qu’elle produit. D’ailleurs les investisseurs internationaux en sont convaincus.
M. le président Henri Emmanuelli. Sur les CDS, nous avez-vous tout dit ?
M. Philippe Mills. Oui.
M. le président Henri Emmanuelli. En nous faisant part de toutes vos appréciations ?
M. Philippe Mills. L’important, c’est de mettre en œuvre des propositions réalistes. Actuellement, il y a un engagement collectif au niveau européen, avec une impulsion franco-allemande et un projet équilibré de la Commission européenne.
M. le président Henri Emmanuelli. Certes, mais il y a eu un précédent, dont M. Jouyet ne nous a pas dit que du bien…
M. Philippe Mills. Il est certainement plus qualifié que moi pour en parler. Toutefois, le projet du commissaire Barnier me semble devoir être défendu, dans la mesure où, quoi qu’en disent certains États membres, il est équilibré.
M. le président Henri Emmanuelli. Monsieur le directeur général, je vous remercie.
La séance est levée à dix-huit heures.
*
* *
Audition de M. Marc Touati, directeur général délégué de Global Equities
(Procès-verbal de la séance du mercredi 6 octobre 2010)
(Présidence de M. Henri Emmanuelli, président de la commission d’enquête)
La séance est ouverte à dix-sept heures trente
M. le président Henri Emmanuelli. Je vous remercie, monsieur Touati, d’avoir accepté notre invitation. Vous avez été pendant une dizaine d’années, directeur de la recherche économique et financière des groupes Banques populaires et Natixis et vous êtes depuis trois ans directeur général délégué de la société d’investissement Global Equities. Auteur de plusieurs ouvrages et intervenant dans plusieurs émissions, vous faites également profession de « spéculer », mais au sens philosophique du terme puisque vous vous efforcez de déterminer les perspectives qui s’offrent à nous, en l’occurrence sur un plan économique et financier.
Notre commission d’enquête vise donc à répondre à un certain nombre de questions : où s’arrête la spéculation nécessaire à l’équilibre économique et où commence celle qui lui est nuisible ? Quelles sont les méthodes employées en la matière – par exemple, en quoi le trading électronique est-il bénéfique à l’ensemble de notre économie et non pour de seuls et rares acteurs ? En outre, quel est le rôle des agences de notation ? Enfin, deux ans après la crise des subprimes, les bonnes décisions vous semblent-elles avoir été prises ?
(M. Marc Touati prête serment.)
M. Marc Touati, directeur général délégué de Global Equities. En guise de préambule, j’insiste sur le fait que nous avons connu une crise sans précédent depuis celle des années trente, tout en ayant su éviter le pire, même si tout le monde n’en est pas encore convaincu. J’ajoute que les crises sont inhérentes au capitalisme et que la suppression de la spéculation relève quant à elle d’un vœu pieux, à moins de prétendre vouloir clôturer définitivement l’ensemble des marchés financiers.
(M. Marc Touati présente et commente les tableaux annexés au compte rendu – cf. annexe 2).
Si, depuis 2000, les crises se sont succédé – krach Internet, 11-Septembre, Enron, WorlCom… – la planète n’a pas pour autant arrêté de tourner. La crise des subprimes, plus particulièrement, résulte d’une succession d’erreurs – et pas uniquement de malversations –, dont la principale a été de laisser Lehman Brothers faire faillite du jour au lendemain, générant ainsi un mouvement de panique global dont nous faisons encore aujourd’hui les frais.
Par ailleurs, l’évolution de l’indice Dow Jones – lequel reflète la croissance mondiale – au cours des quatre dernières grandes crises, soit celles du krach de 1929, de la crise pétrolière, de la crise dite des NTIC ou de la « bulle Internet » et, enfin, de la crise actuelle, montre que le 9 mars 2009 nous nous situions exactement dans la configuration de 1929 sans toutefois que des erreurs comparables aient été commises : je songe, en particulier, à l’abandon des banques à la faillite, au refus de baisser les taux d’intérêt et à l’absence de plan de relance. Nous avons donc toutes les raisons de penser que nous nous apprêtons à renouer avec les fondamentaux économiques.
En outre, il est notable que, pour la première fois dans l’histoire récente, la récession touche les pays riches et non les économies émergentes telles que la Chine, l’Inde ou le Brésil. Les États-Unis et l’Europe jouent les seconds rôles ! Il s’agit là d’un élément important puisque la puissance économique implique un pouvoir financier, et donc spéculatif, qu’il est d’autant plus difficile de maîtriser qu’il s’exerce géographiquement très loin de nous.
Autre élément essentiel : contrairement à ce que l’on croit de prime abord, la bourse suit l’évolution de la croissance mondiale et reflète donc les réalités économiques. Tôt ou tard, la réalité des marchés rejoint l’économie réelle, les « bulles » spéculatives constituant en définitive des phases temporaires.
Le problème majeur, depuis la dernière crise, demeure, selon moi, notre manque de visibilité, lequel engendre un mimétisme de mauvais aloi : ce sont alors les animal spirits ou « instincts animaux » qui prédominent, suscitant des phénomènes spéculatifs beaucoup plus facilement qu’en période de croissance forte– cela explique d’ailleurs les raisons pour lesquelles nous nous sommes fait « balader » et « arnaquer ». Je prends l’exemple du pétrole. Nous savons qu’il existe une corrélation entre la croissance mondiale et le prix du baril, l’un et l’autre augmentant de concert. En toute logique, l’inverse devrait être également vrai ; or, en 2008, année de la crise, le baril flamba jusqu’à 150 dollars.
M. le président Henri Emmanuelli. C’est précisément cela qui est intéressant.
M. Marc Touati. C’est en effet l’essence même de la spéculation.
Au mois de juillet 2008, la plupart des experts soutenaient qu’un tel prix n’était pas très élevé et qu’il grimperait jusqu’à 300 dollars le baril alors que cela était économiquement insensé ! Même eux ont donc participé au « jeu spéculatif » faute de faire preuve du discernement nécessaire ! Lorsque je disais, en tant qu’économiste, que le prix du baril devait baisser à 100 dollars – à proportion, donc, de la croissance mondiale –, j’étais considéré comme un fou ! Le plus grave, ce sont les conséquences économiques d’une telle situation. Air France ayant cru que le baril atteindrait des sommes encore plus astronomiques, a acheté à terme des barils à 150 dollars ; or, leur prix ayant ensuite chuté à 34 dollars, elle a dépensé des millions inutilement. Conclusion provisoire : les acteurs économiques les plus traditionnels spéculent. J’ajoute qu’aujourd’hui la remontée du baril à 85 dollars me semble envisageable car conforme à une croissance mondiale qui devrait être de 4 %.
Deuxième exemple : le prix du sucre a également flambé au début de l’année ; or, les récoltes ayant été moins mauvaises que prévu, les prix ont été divisés par deux…
Heureusement, l’achat de produits financiers dits optionnels permet de se prémunir contre pareilles fluctuations. Par exemple, une entreprise estimant que le prix du baril repartira à la hausse peut acheter le droit d’en acquérir au cours actuel. Si, par exemple, le prix monte jusqu’à 100 dollars alors qu’il en coûte 80, c’est ce prix qu’elle paiera ; s’il chute à 60 dollars, l’option sera abandonnée. La responsabilisation de chacun des acteurs constitue donc un enjeu fondamental même si ces produits financiers sont parfois utilisés eux-mêmes pour alimenter la spéculation.
M. le président Henri Emmanuelli. La différence entre les deux pratiques est tout de même notable.
M. Marc Touati. Assurément.
Troisième exemple, enfin. L’or, dont l’once coûte 1 300 dollars, fait partie des « bulles » actuelles ignorées de tous. Par rapport aux 2 000 dollars et plus qu’elle coûtait dans les années quatre-vingt à dollar constant – hors inflation –, ce prix n’est pas élevé. Or, en quelques mois, le prix de l’or a été divisé par deux et le niveau du cours de 1980 en dollar courant n’a été retrouvé qu’en 2006. En dollar constant, celui qui a investi dans l’or en 1980 n’a pas encore retrouvé sa mise. L’or constitue certes toujours une valeur refuge, mais contre quoi ? Une récession mondiale, un krach boursier dramatique, une inflation importante, tous risques dont nous sommes actuellement préservés !
En revanche, la Banque centrale européenne (BCE) commet l’erreur de sur-pondérer le risque inflationniste, ce qui conduit à une survalorisation de l’euro par rapport au dollar. On en arrive à ce que j’appelle l’« euro-killer », destructeur de croissance qui constitue à son tour une « bulle » : une appréciation de 10 % de notre monnaie entraîne une chute de 0,4 % de point de croissance. Là encore, nous avons besoin de revenir aux fondamentaux économiques, le taux de change naturel dit natrex se situe à 1,20 dollar pour un euro. Comment pourrions-nous donc faire pour arrêter une fluctuation monétaire telle que nous l’avons connue en 2008 où l’euro valait 1,60 dollar ?
M. Paul Giacobbi. Il conviendrait de diminuer l’offre de monnaie.
M. Marc Touati. C’est en effet une solution possible, puisque les liquidités sont très importantes et qu’elles sont insuffisamment présentes sur les marchés boursiers ou pour les investissements – d’où une focalisation sur des valeurs refuge telles que l’or, l’euro ou le dollar, les États-Unis gagnant ainsi plusieurs dixièmes de point de croissance. C’est précisément là que la politique économique doit jouer son rôle, mais ce n’est pas le cas puisque les taux d’intérêt sont à 0 % aux États-Unis et à 1 % dans la zone euro, ce qui ouvre grand les portes à la spéculation.
Autre solution possible : les marchés des changes réagissant souvent aux seuls effets d’annonce, l’éventualité d’accords internationaux, particulièrement dans le cadre du G20, dont l’objet serait de limiter la flambée de l’euro, ce qui suppose un accord entre l’Europe, les Etats-Unis et la Chine.
Je le répète : la spéculation ne tombe pas du ciel ; M. Soros ne se réveille pas un beau matin en se disant qu’il va attaquer la livre sterling ou la Grèce ! Elle n’entre en jeu que lorsque la situation économique est propice.
Par ailleurs, chaque État paie des intérêts sur sa dette publique et plus il est crédible, plus les taux d’intérêt sont bas – ce qui est le cas de l’Allemagne. Le spread mesure l’écart entre le taux d’intérêt allemand et celui des autres pays : or, depuis que la Grèce est entrée dans la zone euro, en 2001, et jusqu’à 2008, ce spread était inexistant : la Grèce se situait donc au niveau de l’Allemagne – ce qui n’incitait pas à faire les réformes nécessaires ! Lorsque M. Papandréou a décidé d’augmenter les déficits publics en engageant de nouvelles dépenses au lieu de réaliser les réformes qui s’imposaient, l’Allemagne a refusé de l’aider…
M. le président Henri Emmanuelli. M. Papandréou n’a pas dit qu’il voulait creuser les déficits : il a révélé la vérité des déficits.
M. Marc Touati. Mais sans aucun engagement de les réduire, d’où le mouvement de panique. L’Allemagne laissant s’installer le doute – elle n’est pas intervenue comme l’a fait Abu Dhabi vis-à-vis de Dubaï –, les taux d’intérêt ont flambé.
De la même manière, le spread de l’Italie et de l’Espagne par rapport à l’Allemagne, par exemple, est-il encore très important. Ce sont là autant de situations génératrices de spéculation que nous avons laissé s’installer alors que les pouvoirs publics ont les moyens d’orienter et d’encadrer ces mouvements.
De plus, la spéculation ne concerne pas les seuls marchés financiers. Le secteur de l’immobilier, en France, constitue également une « bulle » spéculative illustrant cet écart cumulatif auto-entretenu entre la valeur financière d’un actif et sa valeur réelle. En 1991, l’écart entre le prix des logements anciens et le PIB en valeur était de 1 à 3,5 ; en 2007, la « bulle » s’est reconstituée, puis les prix ont baissé, mais, depuis un an, ils augmentent à nouveau régulièrement. De surcroît, l’écart entre le prix des logements et le revenu des ménages se creuse considérablement depuis les années 2000, ce qui ne manque pas de susciter de graves inquiétudes – notamment en cas d’augmentation des taux d’intérêt.
Par ailleurs, si la France ne paie que 2,5 % d’intérêt sur une dette publique qui s’élève à 83 % du PIB, c’est en raison de sa note AAA, laquelle relève presque du miracle. Que nous venions à rétrograder et le danger sera extrême ! En effet, si 26 % seulement de nos 20 % de dette publique, dans les années quatre-vingt, étaient détenus par des non-résidents, ces derniers détiennent aujourd’hui plus de 70 % de nos 83 % ! En cas de dégradation de la note, les phénomènes spéculatifs risqueront donc de s’exercer contre nous ; une fois de plus, ils ne tomberont pas du ciel mais seront les conséquences financières de nos manquements économiques.
La spéculation fait partie de la vie des marchés, mais il est possible de la limiter. Ainsi, deux grands changements ont été apportés, non pas depuis l’affaire Kerviel – il est excessif de penser qu’un seul trader puisse tromper durant deux ans tout un système de contrôle –, mais depuis la faillite de Lehman brothers, et ce afin de réduire l’exposition aux risques. L’origine de cette crise s’explique par la tentative de suppression de l’une des règles de base de l’économie et de la finance : la proportionnalité du rendement et du risque. Tout d’abord, depuis une dizaine d’années, l’illusoire modélisation mathématique de la finance a induit une déconnexion croissante d’avec les réalités économiques – les traders n’ont d’ailleurs pas pris le pouvoir mais il leur a été donné par les banques – alors que l’économie et la finance sont des sciences humaines, lesquelles supposent erreurs et failles. Fort heureusement, après ce véritable abus de confiance, les banques ont accru le contrôle des risques afin de les limiter et, surtout, de réduire l’emprise excessive de ces pseudo-modèles. Ensuite, elles ont réduit au maximum le prop-trading, lequel consistait à spéculer avec leurs fonds propres. Ces deux évolutions dureront-elles ? Pas forcément. La spéculation n’a pas disparu ; elle s’est déplacée sur le marché de l’or, sur celui des changes…
Au final, le meilleur rempart contre la spéculation consiste, me semble-t-il, à accroître la transparence bancaire et à promouvoir un meilleur contrôle des risques.
M. le président Henri Emmanuelli. Si nous savons fort bien qu’il existe une spéculation en quelque sorte « assurantielle » dès lors qu’elle tend à couvrir un certain nombre de risques et que, comme telle, elle peut avoir un intérêt économique, qu’en est-il de la « bulle » spéculative sur le marché des changes ?
Par ailleurs, si la spéculation est aussi intense, c’est que l’effet de levier est considérable pour les hedge funds, qui, s’ils disposent de cinq millions en empruntent cent ! N’est-il donc pas possible de limiter cela et d’éviter ainsi les dérapages lorsque l’enjeu principal consiste à se mettre à l’abri de catastrophes systémiques ?
M. Marc Touati. L’interdiction des ventes à découvert constitue une première piste.
M. le président Henri Emmanuelli. A-t-elle été utilisée lors de la crise ?
M. Marc Touati. Absolument.
M. le président Henri Emmanuelli. Selon l’Agence France Trésor, l’Allemagne a dit qu’elle utiliserait cette possibilité mais elle ne l’a pas fait.
M. Marc Touati. Les États-Unis l’ont fait.
M. le président Henri Emmanuelli. Sur le marché d’actions !
M. Marc Touati. Oui, puisque c’est là qu’il convenait d’agir au premier chef.
La limitation de l’effet de levier implique d’identifier plusieurs paramètres : une entreprise exportatrice souhaite se couvrir quant au risque de change du dollar et achète une option ; l’effet de levier est dès lors patent. Tout le problème vient de ce que les options peuvent être utilisées aussi pour des raisons spéculatives. La difficulté, dès lors, réside dans la distinction des deux pratiques, laquelle est particulièrement délicate dès lors que le prop-trading a été limité et que les banques agissent pour le compte de clients privés.
M. le président Henri Emmanuelli. Qu’en est-il lorsque la spéculation contre l’euro peut rapporter jusqu’à vingt fois la mise ? Je le répète, une limitation de l’effet de levier n’est-elle pas envisageable afin d’éviter les tsunamis que nous avons connus ?
M. Marc Touati. Comment aller à l’encontre de la nature même du produit optionnel ? Quel exportateur accepterait d’acheter une couverture à un prix exorbitant ?
M. le président Henri Emmanuelli. Une couverture à trois mois n’implique aucun risque de change.
M. Marc Touati. Tel n’est pas le cas lors d’un achat à terme.
M. le président Henri Emmanuelli. Telle est la limite qui sépare les opérations commerciales des opérations spéculatives.
M. Marc Touati. Comme nous l’avons vu avec le cas d’Air France, une entreprise a intérêt à se couvrir plutôt que d’acheter à terme.
M. le président Henri Emmanuelli. En l’occurrence, Air France a fait une erreur.
M. Marc Touati. La suppression de l’effet de levier reviendrait à supprimer l’option et à n’effectuer que des achats à terme, ce qui constitue un danger autrement plus grave.
M. le président Henri Emmanuelli. Il ne s’agit pas de supprimer l’option mais de limiter la capacité de spéculation.
M. Marc Touati. Cela revient à augmenter le coût de l’option, laquelle sera peut-être moins attractive.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. Parmi les dispositifs mis en place ou qui le seront et qui visent à limiter la spéculation négative ou nuisible, certains vous semblent-t-il plus efficaces que d’autres ?
En outre, est-il possible de hiérarchiser les marchés sujets à la spéculation ou cette dernière évolue-t-elle de l’un à l’autre en fonction des hausses et des baisses ?
Enfin, en quoi la note AAA de notre pays vous paraît-elle relever du miracle ?
M. le président Henri Emmanuelli. Je ne vois là aucun mystère : c’est que nous la méritons. J’ajoute que d’autres pays bénéficient de la même note alors que non seulement leurs finances publiques ne sont guère plus reluisantes que les nôtres mais que leur épargne privée est bien moindre.
M. Marc Touati. Les notes sont élaborées à partir d’un certain nombre d’indicateurs. En l’occurrence, depuis une dizaine d’années, la France devrait, selon ces ratios, être notée AA. Si les agences de notation assurent qu’elles font confiance à notre pays pour éviter des dérapages excessifs, je considère plutôt qu’elles agissent ainsi parce qu’une dégradation de notre note mettrait en péril l’ensemble de la zone euro : je le répète, un tiers des 70 % de détention non-résidente de notre dette publique étant entre les mains de non-résidents, le risque de fuite des capitaux serait immense. C’est précisément cela qui s’est passé en Grèce : les taux d’intérêt ont augmenté, la croissance a diminué, le chômage et les déficits ont crû.
M. le président Henri Emmanuelli. Il faut raison garder ! Les recettes fiscales de la Grèce sont inexistantes ! Nous n’en sommes pas là !
M. Marc Touati. Pas encore, en effet.
M. le président Henri Emmanuelli. Prenez garde à ces parallèles ! Si la note de la France est dégradée, celle de nombreux autres pays devrait l’être également !
M. Marc Touati. Très peu de pays sont notés AAA : la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne...
M. le président Henri Emmanuelli. Le Royaume-Uni n’est pas mieux loti que nous le sommes ; au contraire, il dispose de bien moins d’épargne privée.
M. Marc Touati. Certes mais, aujourd’hui, une part considérable de notre dette publique est détenue hors d’Europe.
M. le président Henri Emmanuelli. Les investisseurs étrangers savent fort bien que notre épargne privée s’élève à 16 % du PIB.
M. Marc Touati. Oui, mais ils veulent surtout savoir s’ils auront un retour sur leur capital.
M. le président Henri Emmanuelli. En cas de catastrophe, nous ne manquerons pas de ressources.
M. Marc Touati. Outre qu’avec 2,5 % sur dix ans le taux de rendement d’une obligation française n’est pas énorme, le risque de moins-value sur le cours de l’obligation est patent en cas de hausse des taux. La note AAA est donc de ce point de vue-là particulièrement déterminante.
M. Nicolas Perruchot. Je vous remercie, Monsieur Touati, pour cet exposé fort intéressant.
Suite aux évolutions du prop-trading, les traders les mieux rémunérés semblent fuir vers les hedge funds et des places financières qui, à Singapour ou à Hong-Kong, font peut-être preuve d’un peu moins de scrupules que leurs homologues américaines. Sachant que si la puissance publique peut intervenir, dans une certaine mesure, au sein des banques et qu’il n’en va pas de même avec les hedge funds, faut-il craindre à terme un mouvement spéculatif encore plus difficile à maîtriser ?
Enfin, si vous présidiez le prochain G 20 qui s’ouvrira le 12 novembre, quelles seraient vos priorités ?
M. Jean-Claude Mathis. En ce qui concerne le secteur de l’immobilier, n’est-ce pas la faiblesse des taux d’intérêt qui entraîne une hausse disproportionnée des prix par rapport aux revenus des ménages ?
M. Marc Touati. Pendant la dernière crise, 60 % des hedge funds ont rendu l’âme mais il est vrai que certains sont en train de ressusciter. Des banques parisiennes délocalisent ainsi une partie de leur salle de marchés à Londres, Genève ou en Asie du sud-est pour échapper notamment à des contraintes fiscales. Si, de surcroît, la taxation à 50 % des bonus bancaires devait être prolongée sans que nos partenaires immédiats ne nous imitent, le risque serait grand de voir la place financière de Paris se réduire comme peau de chagrin.
Par ailleurs, comment maîtriser les 4 000 milliards de dollars de cash des fonds souverains et privés des pays émergents ? Non seulement ce n’est pas possible mais nombre d’entreprises françaises se font aujourd’hui racheter par ces fonds, ce qui ne manquera pas, à moyen terme, de soulever le problème de notre indépendance économique. Nous avons donc urgemment besoin d’un accord international.
Le véritable enjeu du G 20, selon moi, concerne les parités de change. Je crois que nous pouvons atteindre une croissance de 2 % l’an prochain ; toutefois, avec un euro à 1,40 dollar, elle ne sera dans le meilleur des cas que de 1,50 %.
La « bulle » immobilière, quant à elle, a été en effet entretenue par des taux d’intérêt extrêmement bas mais la demande de logements neufs demeurant soutenue, un effondrement des cours est exclu. En la matière, il importe que les prix soient corrélés avec le PIB et il me semble préférable que cela soit le fait d’une hausse de ce dernier. Un fine tuning ou réglage millimétré réussi voudrait que les taux d’intérêt augmentent modérément afin de dégonfler la « bulle » tout en évitant le krach.
Je le répète : depuis la création de la zone euro, la sur-pondération du risque inflationniste et la sous-pondération des risques pesant sur la croissance me semblent dommageables. De surcroît, 3 % d’inflation n’ont jamais mis en danger quelque pays que ce soit. C’est un fait que, si depuis quinze ans tous les gouvernements annoncent quasiment les mêmes prévisions à n + 1 – 2,5 % de croissance –, cette dernière n’a été en moyenne depuis 2001 que de 1,2 % en France et dans toute la zone euro.
M. le président Henri Emmanuelli. N’oubliez pas, Monsieur Touati, que la France a été le pays du franc-or puis du franc fort et qu’aujourd’hui nous avons l’euro fort à Francfort !
M. Marc Touati : Excellente formule ! Je me permettrai, si j’ose dire, de vous l’emprunter !
M. Jean-Pierre Gorges. Les déficits ne suffisent pas à caractériser les différents pays : la dette de la France est certes importante mais sa capacité à la rembourser ne l’est pas moins, même si depuis trente ans nous avons décidé pour des raisons politiques de financer à crédit le pouvoir d’achat des ménages. Si on craignait de perdre le triple A, on arrêterait ce système pervers.
Il convient, en outre, de tenir compte de l’épargne de nos compatriotes, laquelle s’élève chaque année à 17 % de leur revenu : notre bas de laine est donc considérable !
Enfin, les 70 milliards que coûtent les niches fiscales, que je sache, sont également disponibles. Je suis persuadé que nous nous montrerions un peu plus raisonnables en cas de risque de dégradation de notre note en mettant fin à ce système pervers. Parce que la France dispose des moyens nécessaires pour ce faire, elle mérite son triple A !
M. Paul Giacobbi. La seule signification du sigle AAA est en fait « Amateur d’Andouilles Authentiques » dès lors que la corrélation n’est pas aussi forte que jadis entre la note et le spread comme nous le voyons par exemple avec l’Espagne ou même la France. Je rappelle, en outre, que les banques qui ont fait faillite étaient fort bien notées.
Par ailleurs, la crise venue des États-Unis a d’abord été immobilière puisque les banques de ce pays ont accordé des crédits remboursables sur cinquante ans à des personnes qui répondaient à l’acronyme « NINJA », No Incom, No Job or Asset. Parce que les prix étaient censés augmenter, on a fabriqué pour les deux géants du crédit hypothécaire, Fannie Mae et Freddie Mac, 6 000 milliards de dollars garantis par le Trésor public, soit la moitié du PIB annuel !
S’agissant du secteur pétrolier, je partage votre analyse, Monsieur Touati. Au mois de novembre 2008, j’avais remarqué ici même que si la corrélation entre l’offre et la demande était inexistante dans la fluctuation du prix du baril entre 150 et 70 dollars, elle l’était en revanche sur le New York Mercantile Exchange (Nymex) dès lors que 80 % des acteurs du marché n’entretenaient aucun lien avec le secteur pétrolier lorsque le prix était à son maximum. Ces derniers avaient alors besoin de liquidités en raison des erreurs qu’ils avaient faites ailleurs, puis ils se sont retirés brutalement et le marché est revenu au prix d’équilibre de 70 dollars tel que l’Agence internationale de l’énergie a défini ce dernier.
Enfin, je note que si les crises d’antan étaient sans doute mal gérées, elles avaient des vertus purgatives et je ne suis pas certain que l’injection de masses monétaires telle que nous la pratiquons aujourd’hui soit un remède adapté. Alors que les banques centrales s’apprêtent à se lancer dans du quantitative easing en achetant des centaines de milliards de dollars de bons du Trésor à des taux qui sont sans rapport avec le marché, je ne peux que constater que les problèmes sont loin d’être réglés et que l’inflation n’est pas tant redoutée que l’on veut bien le dire. La BCE a ainsi injecté sur le marché 1 000 milliards de dollars au taux de 1 % ; après un premier remboursement, elle a réinjecté une somme équivalente et elle s’apprête à acheter de nouveaux bons du Trésor ; la Federal Reserve (FED) a quant à elle fait de même et a doublé son bilan en deux ans. Comment la spéculation pourrait-elle cesser dans ces conditions ?
M. le président Henri Emmanuelli. Vous parliez de purge mais, le problème, c’est que ce ne sont pas les responsables de la crise qui paient !
M. Paul Giacobbi. Pour quelle raison celui qui a l’argent ou qui peut l’avoir pour 0 % ou 1 % n’achèterait-il pas des bons du Trésor grec dont le taux institutionnellement garanti par toutes les autorités possibles et imaginables sera de 8 % ou 9 % ?
J’espère, enfin, que nous aurons l’occasion d’entendre M. Andrew Smithers dont les travaux sont particulièrement importants quant au rôle des banques centrales et à l’articulation entre les taux d’intérêt et les asset bubbles.
M. Marc Touati. Le principal danger auquel nous sommes confrontés n’est pas tant la dette elle-même qu’une charge d’intérêt supérieure à la croissance économique. De ce point de vue-là, perdre la note AAA pourrait avoir des effets dévastateurs.
En outre, nous souffrons d’une vision à court terme qui interdit toute purge, laquelle serait d’ailleurs délicate.
M. Paul Giacobbi. En effet, d’où ma préférence pour le fine tuning.
M. Marc Touati. Avec 3 % de croissance aux États-Unis, les taux d’intérêt devraient être au moins de 2,5 % quand ils sont de 0 %. C’est le courage qui fait parfois défaut pour affronter une situation économique délicate !
En ce qui concerne les matières premières, nous savons fort bien que des sommes deux ou trois fois plus élevées que ne le sont les valeurs réelles du marché sont parfois échangées. Afin de faire cesser cette pratique inacceptable, il est possible, comme le propose M. Pascal Lamy sur le plan européen, de ne faire intervenir que les investisseurs patentés de ces marchés.
M. le président Henri Emmanuelli. Si nous sommes impuissants à lutter contre la spéculation, monsieur Giacobbi, pensez-vous que nous n’avons plus qu’à nous en remettre à la Providence – pour ceux qui y croient, bien entendu ?
M. Paul Giacobbi. Les statistiques de la Bank for International Settlements l’attestent, monsieur le président : les masses monétaires émises continuent d’augmenter ainsi que la hot money. Tant qu’il en sera ainsi, il sera illusoire de vouloir élever des digues contre la spéculation.
M. le président Henri Emmanuelli. Mais une déréglementation massive entraînerait des désordres tels que nous vivrions Apocalypse now !
M. Marc Touati. C’est l’excès de réglementation qui est partiellement à l’origine de la crise que nous avons connue.
M. le président Henri Emmanuelli. Ah ? Vous trouvez que les subprimes…
M. Marc Touati. Non ! En l’occurrence, leur crise fut une conséquence directe du programme économique de Bill Clinton.
Les banques se sont vues enjoindre de respecter un ratio de solvabilité…
M. le président Henri Emmanuelli. Un amendement relatif aux banques d’affaires et de dépôts a tout d’abord contribué à faire sauter la réglementation !
M. Marc Touati. Non ! On a dit aux banques octroyant des crédits à des acteurs notés AAA que cela revenait à n’en réaliser aucun – d’où l’introduction de modèles de plus en plus complexes. S’agissant des « subprimes », le danger est né de l’introduction des dettes dans des produits financiers notés AAA.
M. le président Henri Emmanuelli. Parce que la dérégulation a fait son œuvre !
M. Marc Touati. La déréglementation qui a eu lieu dans les années quatre-vingt et 90 était logique mais la re-réglementation…
M. le président Henri Emmanuelli. Laquelle ?
M. Marc Touati. Celle des fonds propres déterminée par le ratio Cooke puis par Bâle II.
M. le président Henri Emmanuelli. Elle n’a servi à rien dès lors qu’il était possible de placer les produits dérivés hors bilan !
M. Marc Touati. C’est précisément l’incitation à développer des produits de plus en plus complexes qui a amené à placer ces produits hors bilan afin de contourner la réglementation !
M. le président Henri Emmanuelli. Vous inversez tout ! L’aberration n’est pas la règle mais son contournement !
M. Marc Touati. Mais une réglementation excessive… ne règle rien ! C’est de transparence dont nous avons besoin !
M. le président Henri Emmanuelli. Je ne partage pas votre analyse.
M. Paul Giacobbi. Faisons un peu d’histoire. Le ratio Cooke…
M. le président Henri Emmanuelli. …avant, il y eut le Glass-Steagall Act.
M. Paul Giacobbi. C’est J.-P. Morgan qui a créé des techniques dérivées afin de contourner un certain nombre d’obligations. Nous avons eu ensuite la faiblesse, en dérégulant, d’accepter que des titrisations ne soient pas intégralement reprises dans les bilans et d’autoriser l’assurance de la part minimale des risques à l’American International Group (AIG). Nous avons à la fois régulé et dérégulé. N’oublions pas que l’extension du marché des euros-dollars naquit naguère de la régulation Q sur la rémunération des livrets bancaires aux États-Unis.
M. le président Henri Emmanuelli. Ce n’est pas possible de récrire l’histoire ! On dénombre pas moins de trois dérégulations successives !
M. Marc Touati. La réglementation peut être contre-productive et cela peut être dangereux.
M. Henri Emmanuelli. Cela revient à justifier la fraude fiscale parce que les impôts existent !
M. Paul Giacobbi. Le raisonnement est imparable.
M. le président Henri Emmanuelli. C’est un point de vue assez particulier qui n’est pas politiquement neutre !
Je vous remercie, monsieur Touati.
L’audition prend fin à dix huit heures quarante.
Les graphiques présentés lors cette réunion sont annexés en fin de rapport.
Audition de M. Christian de Boissieu, professeur à l’université de Paris I
(Procès-verbal de la séance du mercredi 6 octobre 2010)
(Présidence de M. Henri Emmanuelli, président de la commission d’enquête)
La séance est ouverte à dix huit heures quarante cinq
M. le président Henri Emmanuelli. Merci, monsieur le professeur, d’avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur agrégé d’économie à l’université de Paris I et, depuis 2003, président délégué du Conseil d’analyse économique. Vous avez beaucoup écrit sur les questions monétaires et financières, et venez de remettre au Gouvernement, avec MM. Jouyet et Guillon, un rapport d’étape sur l’instabilité des marchés agricoles. Vous êtes donc un témoin particulièrement précieux pour cette commission d’enquête sur la spéculation, qui n’a pas pour objet, comme on l’entend parfois, d’empêcher la spéculation, mais d’arriver à séparer le bon grain de l’ivraie.
(M. Christian de Boissieu prête serment.)
M. Christian de Boissieu, professeur à l’université de Paris I. Il existe au départ, pas nécessairement à l’arrivée, une spéculation normale, inévitable. Conserver ses dollars quelques semaines avant de les changer parce qu’on pense que le dollar va monter, c’est spéculer – autrement dit, prendre une position ouverte. Et il y a toujours des gens qui veulent se couvrir sur un marché. Mais parfois, trop c’est trop, et une bulle se crée, le problème étant qu’on ne sait pas bien déterminer quand commence le trop.
Une remarque, pour commencer, sur les liens entre spéculation et inflation. L’inflation a eu tendance à se déplacer des biens et services vers les marchés d’actifs : depuis quinze ans, on passe d’une bulle à l’autre et je pense que cela va continuer, d’autant que les banques centrales ont beaucoup de mal à tenir compte de ce phénomène. Il y a eu la bulle Internet, puis la bulle immobilière, puis la bulle énergétique – le prix du baril à 150 dollars, c’était un effet de la spéculation. Aujourd’hui, il y a une bulle sur une partie des marchés obligataires, concernant les titres des États bien notés. Aux États-Unis, le taux à dix ans sur les titres d’État est de 2,5 % en nominal, avec une inflation de 1,5 à 2 % par an, ce qui fait des taux réels à long terme très bas. C’est une bulle. On sait qu’elle éclatera un jour, mais on ne sait pas quand.
Je traiterai successivement deux points. Existe-t-il des indicateurs permettant de déceler une déconnexion entre la finance et l’économie réelle ? Quelles mesures prendre pour l’endiguer ?
Une des approches de la crise est quantitative. Ainsi, après le krach boursier de 1987, il y a eu un sentiment général de déconnexion entre la finance et l’économie réelle. Le Conseil national de l’information statistique (CNIS) m’a demandé alors d’animer un groupe de travail en vue de créer des indicateurs de déconnexion – pour savoir à partir de quand trop c’est trop, à partir de quand la finance tourne sur elle-même. Un premier indicateur peut être fondé sur la comptabilité nationale : un ratio entre les transactions financières et le PIB national par exemple. Difficile, certes, de définir un « niveau normal », mais on sent bien en revanche si les chiffres sont anormaux. Comme le disait Mrs Joan Robinson, collègue de Keynes à Cambridge, on ne sait pas forcément définir un éléphant, mais lorsqu’il est dans la pièce, on le reconnaît ! Ces ratios mesureraient l’ampleur de la sphère financière par rapport à la base réelle de l’économie, fondée sur le PIB.
Un deuxième axe serait l’utilisation des multiples de valorisation comme le price earning ratio, ou coefficient de capitalisation des bénéfices. Entre 1995 et 2000, époque de la bulle Internet, certaines start-ups des nouvelles technologies avaient des price earnings de 300 ou 400, c’est-à-dire que le cours capitalisait trois cents ou quatre cents fois les bénéfices annuels – l’entreprise fît-elle des pertes ! Là non plus, on ne peut pas déterminer de valeur normale du ratio mais il y a une fourchette acceptable, au-delà de laquelle, à la hausse ou à la baisse, une correction est inévitable. Ainsi, on savait qu’un price earning ratio de 2 est a priori trop bas, alors qu’une valeur de 40 serait probablement trop élevée.
Troisième indicateur : le rapport entre les contrats sur instruments dérivés dans le monde et le PIB mondial. Le PIB mondial est évalué à 60 000 milliards de dollars par an, et la valeur des contrats sur instruments dérivés à 700 000 milliards (chiffre de la Banque des règlements internationaux) – environ douze fois plus. Je ne sais pas quelle serait la bonne valeur, mais je sais que douze fois, c’est trop ! Or, la crise n’a rien changé : on aurait pu croire que les problèmes des CDS, les credit default swaps, auraient calmé les investisseurs et les marchés, mais non : depuis août 2007, la montée tendancielle de ce rapport ne s’est pas interrompue et les marchés de gré à gré représentent toujours les neuf-dixièmes du total des marchés des instruments dérivés, ce qui laisse peu de place aux marchés organisés comme le MATIF. Pourtant, les marchés OTC – over the counter, ou de gré à gré – sont plus dangereux : le risque de contrepartie joue à plein, alors qu’il est pris en charge par la chambre de compensation sur un marché organisé. Pourquoi ont-ils un tel succès ? À mon sens, parce que la finance mondiale veut des contrats sur mesure. Il y a des produits, des swaps, certaines options qui ne se trouvent pas sur les marchés organisés. Alors certes, il faut chercher à faire migrer les marchés OTC vers les marchés organisés – c’est l’objectif depuis le G20 de Londres – mais si l’on ne répond pas en même temps à la demande de « sur mesure » des opérateurs, on ne fera que déplacer le problème.
Quelques mots à présent sur la problématique de la spéculation. À l’occasion de notre rapport sur les moyens de réduire la volatilité des prix agricoles – ce sera l’une des priorités de la présidence française du G20, à partir du 12 novembre – je me suis rendu compte qu’il y a des questions spécifiques à chaque marché, mais aussi des questions transversales. Ainsi, une grande partie des recommandations du G20 peuvent s’appliquer en matière agricole, notamment celles relatives aux hedge funds, parce que ces derniers interviennent sur tous les marchés, aussi bien des produits agricoles que de l’immobilier ou du pétrole. Un exemple de particularité tenant à la nature du produit, en revanche, est la problématique du stockage des produits agricoles. C’est pourquoi cette étude de la volatilité des prix des marchés agricoles est pour une large part aussi bien valable en matière de pétrole, d’immobilier ou de taux de change – ce qui m’amène, au passage, à parler du risque de guerre des monnaies qui se profile : des bulles sont en train de se créer, qui feront très fortement augmenter certaines monnaies, alors que d’autres devises vont connaître une « descente aux enfers ». En tout état de cause, le débat sur la spéculation soulève un autre débat transversal sur la financiarisation des marchés.
Alors, que faire pour réduire la spéculation ? Il n’y a pas de recette miracle, et il faudra combiner plusieurs mesures. On parle beaucoup de transparence et d’information. Je crois à la transparence, elle est nécessaire, mais elle ne sera pas suffisante. Certains disent que ramener les marchés OTC vers des chambres de compensation permettra de régler 80 % du problème. À mon sens, cela permettra d’y voir plus clair et de mieux surveiller les intervenants, mais ne réglera pas la question de la spéculation. L’idée qui sous-tend Bâle 3 est d’inciter les banques à intervenir sur les marchés dérivés organisés, où les charges en fonds propres seront plus faibles que sur les marchés OTC. Mais cela ne changera rien au phénomène d’anticipation qui est à la base des marchés, comme Keynes l’avait montré dès 1936 avec l’analogie du concours de beauté : l’important, c’est d’anticiper ce que les autres anticipent, même s’ils se trompent. Ainsi, si j’anticipe que les autres vont continuer à acheter du blé, je continuerai aussi à acheter du blé, même si sa valeur après ce qui s’est passé cet été en Russie n’a déjà plus aucune mesure avec les fondamentaux. Le fait d’améliorer la transparence ne change rien à cette anticipation mimétique qui fait que les prix décrochent des fondamentaux du marché.
Il va donc falloir choisir parmi toute une panoplie de mesures. Faut-il interdire les ventes à découvert à nu ? Fixer des limites de positions, comme le fait la CFTC américaine, sur les marchés à terme de matières premières ? S’inspirer de la réforme bancaire américaine en limitant les possibilités de spéculation des banques via les hedge funds ? Quelles mesures prendre d’ailleurs à l’égard de ces derniers ? Les hedge funds peuvent favoriser la liquidité des marchés et donc réduire la volatilité, mais ils jouent aussi un rôle dans la formation des bulles, comme sur le pétrole en 2008, en accentuant les écarts avec les valeurs fondamentales de l’économie. Et il y a bien sûr la taxe Tobin…
Il me semble que la régulation des hedge funds doit être indirecte. Leur imposer des règles prudentielles voisines de celles des banques ou des assurances ne saurait être efficace. Aujourd’hui, 1 400 milliards de dollars sont investis en hedge funds. S’ils étaient régulés comme les banques et assurances, j’ai l’intuition que ces 1 400 milliards partiraient ailleurs. C’est pourquoi il faut toujours, en élaborant une régulation, chercher à garder une longueur d’avance, à prévoir son effet sur le comportement des opérateurs, sans quoi elle peut se transformer en incitation au contournement. Une partie des innovations financières qui ont fait parler d’elles pendant la crise ont été introduites depuis trente ans pour contourner la réglementation. Si j’ai été régulateur bancaire en France pendant quinze à vingt ans, c’est que je crois à la régulation et à la réglementation, qui est une de ses formes, mais il faut toujours garder à l’esprit qu’elle peut être contournée
Comme je l’ai dit, je crois qu’on n’arrivera pas à éradiquer les bulles. En effet, si les banques centrales savent bien que l’inflation est beaucoup plus présente dans les prix d’actifs que dans les biens et services, elles n’arrivent pas à en tirer les conséquences. Elles sont mal à l’aise dans ce domaine, elles ne contrôlent pas le prix de l’immobilier ni de bien d’autres actifs. Mais on peut tout de même chercher à limiter les écarts vis-à-vis de l’économie réelle en combinant deux politiques, l’une monétaire, l’autre prudentielle, pour contenir les bulles et limiter leurs conséquences sur l’économie, la croissance et l’emploi. Je ne suis pas contre l’interdiction des ventes à nu à découvert, si elle est mondiale. J’étais contre la taxe Tobin il y a vingt ans parce que cela n’avait pas de sens de l’appliquer dans une seule partie du monde, mais je suis d’accord si le contexte politique y est plus favorable aujourd’hui. Mais attention : un accord au G20 serait insuffisant, pour la taxe Tobin comme pour une régulation indirecte des hedge funds. Il faut beaucoup plus de monde. L’Europe doit prendre l’initiative, mais sans se tirer une balle dans le pied. Si elle est seule à prendre des mesures restrictives, elles seront inefficaces au plan mondial et constitueront un handicap pour nous dans la concurrence bancaire et financière mondiale.
Nous sommes à un moment rare, et passionnant. Il y a une fenêtre de tir du côté américain. La réforme bancaire américaine est assez audacieuse, les Américains sont plutôt en avance sur nous, et je ne suis pas sûr que leur envie de resserrer les boulons dure longtemps. Nous verrons déjà ce qui se passe aux élections de mi-mandat, et le président Obama a en tout état de cause bien fait de faire voter la réforme avant. Mais il y a une occasion d’avancer ensemble maintenant, dans le cadre du G20 et au-delà, alors que dans dix-huit mois ou deux ans nous serons sans doute revenus, si nous n’y prenons garde, au business as usual…
M. le président Henri Emmanuelli. J’admets que la transparence ne soit pas suffisante, mais ce serait tout de même un grand progrès que de savoir ce qui se passe ! Nous sommes frappés de l’obscurité qui règne dans certains secteurs. Comment est-il possible que la dette grecque soit évaluée à 279 milliards d’euros par le directeur de l’Agence France Trésor et à 330 milliards par la presse ? La différence est trop grande, et on a l’impression que même les régulateurs sont dans le noir. Une meilleure information permettrait d’avoir une idée de la nature de la menace, ce qui serait déjà beaucoup.
Par ailleurs, il est vrai qu’il ne sert à rien de réguler sans veiller en même temps à empêcher le contournement. Quelle logique y avait-il à imposer des ratios prudentiels aux banques tout en leur permettant de faire des opérations hors bilan ? Il était visible, avant la crise, que l’essentiel des opérations sur produits dérivés était hors bilan. Il semble qu’une certaine passivité ait régné, sur la base d’accords tacites.
Enfin, ne croyez-vous vraiment pas que la taxe Tobin – qui a été votée en France, à taux zéro – pourrait fonctionner si le G20 le décidait, même si les autres pays ne suivaient pas ? Si l’Europe, les États-Unis, la Chine, le Japon et quelques autres États comme le Brésil se mettent d’accord et qu’ils imposent des sanctions à ceux qui ne jouent pas le jeu, ce ne sont pas le Luxembourg et Singapour qui vont faire la loi !
M. Jean-François Mancel, rapporteur. Vous parlez d’une fenêtre de tir mais y a-t-il une véritable cohésion au niveau européen, et une entente avec les Britanniques ? Les États-Unis sont-ils vraiment prêts à jouer le jeu, et tous les autres pays qui comptent aussi ?
Par ailleurs, peut-on imaginer un système qui stoppe un marché en cas de spéculation exagérée, si l’on parvient à définir un indice approprié, afin de laisser refroidir la situation ?
Enfin, quelles sont vos propositions pour ce qui concerne les marchés des denrées agricoles ?
Mme Arlette Grosskost. Pour ce qui est de la régulation, nous disposons déjà de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel, et nous allons mettre en place un conseil de la régulation. Est-ce suffisant, ou faut-il en rajouter une couche ?
M. Jean-Yves Cousin. Vous paraît-il nécessaire de réglementer la titrisation ?
M. Dominique Baert. Vous n’avez pas parlé de la titrisation, que beaucoup ont pourtant présentée comme l’instrument privilégié de la crise. Quels sont les modes d’encadrement possibles ? Et que penser des CDS, qui ont une forte capacité à diffuser la crise ?
Enfin, les crises sont assises sur différents produits. Pour la dernière, il s’agit des dettes souveraines et il existe encore des tensions alarmistes sur ces marchés. La dette souveraine de certains États peut-elle être le déclencheur de nouvelles crises spéculatives ?
M. le président Henri Emmanuelli. Autre chose, à propos des bulles : ce ne sont pas ceux qui les font qui les payent ! Et cela crée un problème considérable, d’ordre politique. Cela peut-il durer éternellement, que des gens ou des secteurs créent des bulles et que ce soit la population qui paye l’addition ?
M. Christian de Boissieu. Je n’avais pas parlé de titrisation parce qu’on m’avait demandé un exposé sur la spéculation, pas sur la crise en général. Il me semble que la titrisation pose davantage le problème de la traçabilité des risques que celui de la spéculation en tant que telle. Les CDS sont une manière pour les banques de refiler le mistigri à d’autres. Le grand problème, c’est qu’on ne sait pas qui porte le risque in fine, ni donc si ce porteur est capable de faire face à un retournement du marché. Le coût systémique de la titrisation me semble dû à cette difficulté d’identification, et donc au manque de transparence du système.
M. le président Henri Emmanuelli. On en revient à cette espèce d’accord tacite sur les possibilités de contournement.
M. Christian de Boissieu. Améliorer la transparence, c’est réduire la complexité du système, au bénéfice du régulateur certes, mais aussi du client. Hier, j’ai participé à un débat où quelqu’un soutenait que la crise avait tué l’innovation financière. Je pense au contraire que si la crise a certes provoqué un report vers des produits simples, cela ne va pas durer longtemps et que l’imagination financière va reprendre ses droits. C’est ce qu’il faut garder à l’esprit dès qu’on veut faire un peu de prospective.
Ce n’est pas parce que toute régulation peut être contournée qu’il faut rester les bras croisés. Il faut resserrer les boulons et essayer d’anticiper les contournements, de leur couper la voie. Une partie non négligeable de la titrisation, avant 2007, a été faite par les banques pour contourner les règles prudentielles, et les régulateurs, comme d’ailleurs les superviseurs, ont montré du laxisme dans ce domaine. C’est pourquoi, en dessinant le système de régulation bancaire et financière de demain, il faut garder en tête un kit de mesures complémentaires contre le contournement.
Ce qui m’inquiéterait, si le G20 était seul à décider une taxe Tobin, c’est le risque d’évasion vers les pays non coopératifs en matière fiscale, qui figurent sur les listes de l’OCDE. Je ne sais pas quel serait alors notre levier d’action, politique ou autre. Il est vrai que la démarche de l’OCDE a été assez efficace : de nombreux territoires sont sortis de la liste grise et ont signé des memorandums of understanding bilatéraux.
M. le président Henri Emmanuelli. La Suisse avait beau considérer son secret bancaire comme intangible, lorsque les États-Unis se sont fâchés, le problème a été réglé en deux jours !
M. Christian de Boissieu. C’est vrai, et c’est ce qui a ouvert le front des territoires non coopératifs.
Y a-t-il accord sur ces sujets réglementaires en Europe ? Il me semble qu’il y a une assez forte convergence franco-allemande, qui s’est vue notamment après la faillite de Lehman Brothers à propos des propositions sur la surveillance des agences de notation. Quant aux Britanniques, il me semble que c’est le moment d’agir. Lord Turner, le patron de la FSA, l’autorité bancaire britannique, a lancé un pavé dans la mare en août 2009 en proposant de taxer les banques. Certes, il s’est fait mal voir par la City, mais il est toujours à son poste ! Selon lui, la taxation permettrait de réduire la proportion des banques et de la finance, qui ont pris trop d’importance par rapport à l’économie réelle. La crise a été telle au Royaume-Uni que les Britanniques sont sans doute prêts à accepter ce qu’ils n’auraient pas accepté dans des temps plus calmes. Mais l’Europe doit maintenant compter avec ses nouveaux pays membres. La Pologne par exemple prend souvent des positions assez libérales. Lors des discussions à vingt-sept, est-elle difficile à convaincre ? Une position commune ne pourra se faire qu’en concertation avec ces pays de l’Est.
Il existe déjà des règles visant à stopper les marchés. En période de krach, elles sont très utiles… Le 19 octobre 1987, comme lors de plusieurs séances en 1989, la Bourse a été fermée pendant quelques heures pour laisser aux gens le temps de réfléchir. Le système est fondé sur une limite de cours plutôt qu’une limite de position, mais cela revient au même.
Pour ce qui est des institutions, j’ai apprécié la création de l’Autorité de contrôle prudentiel, qui simplifie le système et améliore la coordination entre les institutions en mettant les banques et les assurances sous le même toit, mais je ne pense pas qu’il faille créer d’autres instances. En revanche, peut-être faut-il revoir leurs attributions, car certains sujets ne sont pas couverts. Ainsi, nous n’avons aucune institution compétente pour la régulation des marchés à terme agricoles, comme cela existe aux États-Unis avec la CFTC, Commodity Futures Trading Commission, qui agit dans le domaine des matières premières. Cette compétence pourrait être explicitement conférée à l’Autorité des marchés financiers, plutôt que de créer une nouvelle instance.
Pour ce qui est de l’innovation financière, des mesures réglementaires sont nécessaires, qui doivent être prises plutôt par le G20 qu’au niveau européen. Certaines sont déjà dans les tuyaux : il est notamment prévu qu’une banque, lorsqu’elle fait de la titrisation, conserve 5 % du crédit qu’elle a engendré – ce qui me semble trop faible pour être efficace. Quant aux CDS, leur encours tourne aujourd’hui autour de 35 000 milliards de dollars, sur un marché total de dérivés de 700 000 milliards. Le G20 se focalise sur eux parce qu’ils s’échangent entièrement sur des marchés de gré à gré, mais c’est un vingtième du sujet !
M. le président Henri Emmanuelli. Le directeur de l’Agence France Trésor nous a tout de même dit que dans la dette grecque, qui tourne donc autour de 300 milliards d’euros, il y avait 70 milliards de CDS. C’est absolument déraisonnable.
M. Christian de Boissieu. Cela me choque aussi, mais il s’agit des CDS souverains, qui posent des problèmes particuliers parce qu’ils accentuent les écarts et creusent les spreads. C’est à cause de l’effet boule-de-neige de ces CDS souverains que la Grèce a des taux à dix ans supérieurs à 10 % alors que l’Allemagne est à 2,3 %. Le reste des CDS ne pose que des problèmes de transparence. Il faut donc deux types de propositions différentes, avec des mesures particulières pour les CDS souverains.
Du reste, la Banque des règlements internationaux ne dit pas combien représentent les CDS souverains dans l’ensemble des CDS. Ce n’est pas la seule lacune de notre information. À l’occasion de notre travail sur les marchés agricoles, j’ai essayé pendant deux mois de trouver des chiffres sur les marchés OTC des instruments dérivés agricoles : les banques ne m’en ont pas donné, les données du site de la CFTC américaine me paraissent incompréhensibles et la BRI n’a qu’une seule ligne pour l’ensemble des marchés des matières premières. Elle dispose pourtant des données séparées : il faut lui demander de les communiquer.
Pour ce qui est de la dette souveraine, je suis bien persuadé qu’elle constitue une bulle. Un krach obligataire se prépare, qui n’aura peut-être pas lieu en 2010 ni en 2011 mais qui est inévitable, étant donné l’accumulation d’investissements sur les titres d’États considérés comme sans risques tels que les Etats-Unis, la France ou l’Allemagne. Elle se traduira par une remontée des taux d’intérêt à long terme dans le monde.
Enfin, ces bulles ont un coût social important, d’abord lorsqu’elles se forment, parce que l’économie peut s’emballer, et surtout lorsqu’elles explosent. La chute de l’immobilier et des marchés actions pèse sur la consommation des ménages, mais de façon très inégalement répartie en fonction des catégories socioprofessionnelles. Les économistes sont conscients de ces coûts, mais encore loin de pouvoir les quantifier. Ils savent quels sont les effets d’une hausse ou d’une baisse de la bourse ou de l’immobilier sur la consommation des ménages, mais votre question va plus loin : c’est celle du coût social de cette instabilité.
Pour conclure, je crains qu’on continue de passer d’une bulle à l’autre et j’espère que la combinaison de politiques monétaires plus adaptées et de politiques prudentielles plus resserrées permettra d’en restreindre l’ampleur et d’en réduire le coût.
M. le président Henri Emmanuelli. Je vous remercie.
La séance est levée à dix neuf heures quarante cinq.
*
* *
Audition de M. Édouard Tétreau, auteur du livre Analyste :
au cœur de la folie financière, gérant de MEDIAFIN
(Procès-verbal de la séance du mercredi 6 octobre 2010)
(Présidence de M. Henri Emmanuelli, président de la commission d’enquête)
La séance est ouverte à dix-sept heures quarante
M. le président Henri Emmanuelli. Monsieur Tétreau, je vous remercie d’avoir répondu à l’invitation de la commission d’enquête parlementaire sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement des économies.
Professionnel de la finance, vous avez exercé des fonctions d’analyste dans divers établissements bancaires à Paris, Londres et New York, et vous avez été administrateur de la Société française des analystes financiers. En 2005, vous avez publié Analyste : au cœur de la folie financière, ouvrage qui donne votre vision, plutôt critique, du fonctionnement des marchés financiers et des bulles spéculatives. Votre dernier livre, Vingt mille milliards de dollars, paraît aujourd’hui même.
Qu’est-ce ce qui vous paraît le plus aberrant dans la spéculation actuelle ? Avez-vous des suggestions pour y remédier ?
(M. Édouard Tétreau prête serment.)
M. Édouard Tétreau. J’aborderai ce vaste sujet en partant de l’actualité.
J’ai le sentiment que « l’affaire Kerviel » a servi à escamoter le véritable procès, qui aurait dû être celui de l’un des deux principaux mécanismes de spéculation, à savoir la finance de marché. Cette finance-là, je la connais particulièrement bien, puisque j’ai été analyste financier au Crédit lyonnais durant les années de la bulle Internet – j’ai suivi, à cette occasion, l’évolution de la valeur des titres Vivendi Universal et l’on a dit que mes notes avaient anticipé les dérapages ultérieurs ; par ailleurs, je viens de travailler durant trois ans, à New York, avec des fonds d’investissement.
Même si Jérôme Kerviel parvenait à payer la somme qui lui est réclamée, cela ne réglerait pas pour autant le vrai problème, puisque le coupable multirécidiviste a été remis en liberté il y a deux ans : je veux parler des banques d’investissement, qui ont été refinancées par les États – c’est-à-dire vous et moi. Ces banques sont aujourd’hui dans la confusion des genres. Elles ont argué d’un besoin vital pour l’économie d’assurer la liquidité sur les marchés pour obtenir un plan de sauvetage aux États-Unis et en Europe ; mais au lieu d’allouer cette masse de liquidités à l’économie réelle, elles se sont empressées de la rediriger vers les activités spéculatives. Il faut dire que, pour certaines banques de marché, les retours sur investissement étaient de 40 voire 70 % entre 2006 et 2007, pouvant même atteindre un pic supérieur à 100 % : à part le trafic de drogue, aucune autre activité n’offre de tels rendements !
Le refinancement des banques a atteint des niveaux démesurés : le plan de sauvetage américain s’élève à 700 milliards de dollars et, en additionnant les différents plans nationaux, on dépasse ce niveau en Europe. Où va cette liquidité ? L’injecter dans l’économie réelle n’intéresse plus les banques, car les marges sont bien plus attractives du côté des hedge funds ou des activités à effet de levier. Dans le cadre des échanges sur les devises – le currency trading (échanges sur les devises) –, une banque commerciale obtiendra une marge bien supérieure en armant un hedge fund pour une opération d’aller-retour, plutôt qu’en aidant une entreprise à se couvrir contre un risque de change.
Les banques sont dans la confusion des genres depuis la suppression du Glass-Steagall Act. On a amalgamé des activités essentielles pour nos économies avec les activités dites « d’investissement », dont beaucoup relèvent de la pure spéculation – même si certaines sont indispensables au bon fonctionnement des entreprises : ainsi, une société qui doit aller sur les marchés pour financer sa dette aura besoin d’arrangeurs de dette ; de même, les opérations de fusion-acquisition sont indispensables.
Paul Volcker a donc engagé l’administration Obama à élaborer un nouveau Glass-Steagall Act, mais il a échoué en raison du lobbying de Wall Street – il faut savoir que les deux industries qui ont le plus versé d’argent en lobbying à Washington en 2009 sont la santé, avec 900 millions de dollars, et la finance, avec 600 millions de dollars. Résultat : la Volcker Rule a été enterrée.
La partition entre ces deux types d’activité ne sera pas simple, mais elle est vitale. Malheureusement, je crains qu’il ne faille attendre une nouvelle crise pour qu’on finisse par l’admettre.
Dans son dernier rapport semestriel, le FMI, s’inquiétant de la fragilité du système financier mondial, recommande aux États de continuer à renflouer les banques, afin qu’elles puissent irriguer davantage les économies. Mais avec quel argent ? Vingt mille milliards de dollars, titre de mon dernier livre, reprend l’estimation, fondée sur des hypothèses très optimistes, de la dette publique américaine en 2020 ! Car, contrairement à ce que l’on a voulu nous faire croire au moment de la crise de l’euro, la situation des finances publiques est encore plus dramatique aux États-Unis qu’en Europe.
M. le président Henri Emmanuelli. Mais ils ont la première armée du monde !
M. Édouard Tétreau. Surtout, ils ont le dollar ! Le jour où l’euro sera une alternative crédible au dollar, les choses changeront pour le meilleur.
Pour bien comprendre les mouvements de spéculation actuels, il faut remonter à la source, c'est-à-dire au désordre des monnaies. Selon la Banque des règlements internationaux, il s’échange, chaque jour, plus de 4 000 milliards de dollars sur le marché des devises, ce qui représente, sur une année, un volume de transactions de près de 1 500 000 milliards de dollars, soit quasiment vingt-cinq fois le PIB mondial. C’est n’importe quoi ! Le marché des devises ne répond plus aux besoins de l’économie réelle : il s’agit d’une pure création monétaire, qui entretient de nombreuses bulles.
Prenons l’exemple du « yen carry trade » : les investisseurs internationaux achètent en masse une devise dont les taux d’intérêt sont extrêmement bas, puis placent cette « piscine de liquidité » dans une devise qui rapporte davantage. Pendant deux ou trois ans, ils font « travailler » l’argent sur des actifs immobiliers ou des actifs d’entreprise ; le jour où ils estiment que leur plus-value est suffisante, ils s’en vont. Les agents économiques locaux pensaient que la valeur du marché intérieur avait augmenté, les banques avaient accordé des prêts, bref, il y avait eu un effet de richesse – et voilà que, du jour au lendemain, l’argent disparaît. Voilà comment l’on fait « tomber » un pays. C’est ce qui s’est produit en Asie du sud-est en 1997-1998.
Les États commencent à percevoir le danger. Aujourd’hui, ce n’est plus le yen, mais le dollar qui porte des taux d’intérêt extrêmement bas, inférieurs à 0,25 %. Les investisseurs en achètent pour faire des placements au Brésil, où les taux d’intérêt sont plus élevés en raison de l’inflation. C’est pourquoi le Brésil, voyant ce phénomène se développer, a décidé de revenir à une forme intelligente de contrôle des changes.
Est-ce une hérésie ? Il est évident que vous ne pouvez pas mettre en œuvre une telle politique si votre marché intérieur est insuffisant. Mais ce n’est pas le cas de l’Europe, dont le PIB est supérieur à celui des États-Unis et dont le marché intérieur est d’une profondeur et d’une vitalité que l’on a tendance à oublier !
Le FMI a tiré, avec raison, la sonnette d’alarme en faisant le diagnostic d’une possible « guerre des devises ». Le prochain G20 aura pour objectif de proposer des solutions crédibles pour remettre de l’ordre dans ce qui est pour moi la principale source de déstabilisation des économies dans le monde. Les mêmes causes risquant de produire les mêmes effets, il y a urgence. N’attendons pas une nouvelle crise pour admettre cette évidence que la banque est une activité tellement importante qu’il en faut deux : d’un côté, la banque nourrie par les dépôts des épargnants, qui irrigue nos économies, et, de l’autre, la banque d’investissement et de spéculation.
C’est ce que nous avions suggéré l’année dernière dans la première note de l’Institut Montaigne, rédigée dans la perspective du G20. Vu le contexte de crise, nous avions même proposé de compléter ce dispositif par des incitations fiscales, sous la forme d’une exonération temporaire des impôts sur les résultats des banques commerciales et d’un taux d’imposition de 60 à 80 % sur ceux des banques d’investissement, de manière à hausser les marges des premières. Malheureusement, aucune de nos propositions n’a été retenue.
Je reviens des États-Unis. En 2008, j’avais eu le sentiment d’une prise de conscience que le système était en train d’imploser, mais, deux ans plus tard, on retrouve les mêmes ingrédients à l’œuvre. Les banques ont reconstitué très vite leurs niveaux de profit sur leurs activités de spéculation. Rien n’a changé – à une exception près : le jour où la prochaine crise éclatera, les États n’auront plus les moyens d’intervenir.
M. le président Henri Emmanuelli. Votre exposé est désespérant !
M. Édouard Tétreau. Il ne s’agit pas de faire du catastrophisme : bien qu’aucun des problèmes de stabilité bancaire mondiale n’ait été réglé durant ces deux dernières années, il n’est pas trop tard pour agir.
La réponse ne saurait être nationale. En revanche, il me semble que l’on a sous-estimé le potentiel de l’Europe, qu’il s’agisse de la profondeur et de l’importance de son marché comme de sa capacité à se doter d’instruments de protection efficaces et d’édicter des règles conformes à ses projets économiques et sociaux.
M. le président Henri Emmanuelli. Personnellement, j’abonderai dans votre sens : j’ai l’impression que la principale occupation des élites européennes est de sous-estimer l’Europe – et pas seulement en matière monétaire. Dans le domaine commercial, il est difficile de trouver plus naïfs et plus accommodants que nous !
M. Jean-François Mancel, rapporteur. Un écrivain peut le faire plus facilement qu’un membre d’une grande institution ou qu’un professeur d’université, mais vous avez très clairement désigné les banques comme les coupables de la crise financière ; vous avez également évoqué les conséquences de la spéculation sur le marché des changes. Au-delà de ce constat, pensez-vous qu’il existe des solutions, sachant que même M. Volcker a échoué à séparer de nouveau les métiers bancaires – une idée chère également au président Emmanuelli ?
Par ailleurs, il ne faudrait pas tomber dans la simplification, en évoquant le jeu de forces obscures ou la fatalité de la cupidité. Ne peut-on pas identifier les blocages et les résistances ? Le pouvoir des banques est-il tel que l’on ne puisse rien faire ? Pourquoi ne pourrait-on pas mieux réguler le marché des changes ?
Français, Européens, Américains, institutions diverses, actuellement, chacun y va de sa proposition. Pensez-vous que ce soit une bonne chose ou n’est-ce qu’un rideau de fumée ?
M. Édouard Tétreau. Monsieur le rapporteur, je ne suis pas un écrivain : j’écris des livres, mais mon activité principale est de conseiller des dirigeants d’entreprises et des institutions financières dans leurs stratégies d’investissement. À la différence des acteurs « court-termistes », les institutions pour lesquelles je travaille sont proches des entreprises, qui créent des emplois et de la valeur durable.
M. le rapporteur. Notre commission cherche précisément à savoir comment ramener vers l’économie réelle les liquidités égarées dans les activités de spéculation.
M. Édouard Tétreau. Par ailleurs, je n’ai pas dit que les banques étaient coupables, mais qu’elles étaient dans la confusion des genres depuis que l’on avait levé la barrière indispensable entre leurs deux grands types d’activités.
Du fait des lois du marché, des obligations de rendement et de la pression des actionnaires, les banques sont incitées à spéculer sur le court terme. Le dirigeant d’une grande banque française l’avait expliqué au moment de la crise : pour reconstituer leurs profits et disposer de liquidités, les banques ont besoin de se livrer à des activités de marché rentables ; ce n’est qu’ensuite qu’elles peuvent investir dans l’économie réelle.
Le problème, c’est que les actuelles incitations fiscales ne sont pas pertinentes. Si un investisseur sait qu’en agissant sur le court terme, il ne courra aucun risque et obtiendra des rendements de l’ordre de 60 à 80 %, mais qu’en agissant sur le long terme, sa marge sera faible et le risque maximal, il ne faut pas s’étonner que les banques se transforment progressivement en courtiers, organisant des opérations sur les marchés pour répercuter le risque sur d’autres secteurs de l’économie, en utilisant des dérivés de crédit.
M. le président Henri Emmanuelli. Peut-on dire qu’en raison de la disparition de la distinction entre banques d’investissement et banques de dépôt, les banques aient été incitées, pour des raisons de rendement, à spéculer sur leurs fonds propres plutôt qu’à accorder aux agents économiques du crédit à moyen et à long terme ?
M. Édouard Tétreau. C’est tout à fait exact. Le problème, c’est que le phénomène se reproduit à nouveau.
Ce qui se passe n’a rien à voir avec une quelconque théorie du complot. Le 6 mai 2010, lors du « flash krach » à la Bourse de New York, 1 000 milliards de dollars ont été effacés en valeur boursière en l’espace de vingt minutes. Après quatre mois d’enquête, la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont conclu qu’il n’y avait eu aucune erreur technique, mais que le krach était la conséquence de l’exécution très rapide d’un ordre de transaction massive ; à Wall Street, les deux tiers des transactions boursières sont en effet exécutées par des algorithmes, c’est-à-dire des robots, qui fractionnent les ordres au millième de seconde. Quelle autorité de marché, même supra-équipée, peut contrôler des flux si rapides ? Comment, dans ces conditions, détecter des pratiques de front running ? Si un client donne l’ordre d’acheter pour 100 millions d’actions, rien n’empêchera sa banque, avec un bon algorithme, d’acheter le titre sur ses fonds propres juste avant ! Aucune autorité de marché dans le monde ne dispose de l’équipement nécessaire pour contrôler et sanctionner une manœuvre de ce type.
M. le président Henri Emmanuelli. Je suis stupéfait par la vitesse avec laquelle les banques ont reconstitué leurs profits, qui est sans commune mesure avec la croissance de l’économie. Lorsque nous auditionnerons les membres de l’Autorité de contrôle prudentiel, qui vient de remplacer la Commission bancaire, il serait intéressant de leur demander s’ils distinguent les bénéfices qui proviennent des opérations de banque classique et ceux qui proviennent des activités de spéculation.
M. Édouard Tétreau. Devant une commission américaine similaire à la vôtre, M. John Paulson, qui est devenu une star aux États-Unis pour avoir anticipé la crise des subprimes et celle de l’euro, a souligné que sa société financière avait multiplié par dix le nombre de ses employés en trois ans et en a conclu qu’elle contribuait à la bonne santé de l’économie américaine. J’ai vérifié les chiffres : de fait, les effectifs de Paulson & Co. sont passés de 7 à 70 personnes…
On parle beaucoup de jobless recovery. Les banques centrales ont réagi à bon escient, en n’hésitant pas à prendre des risques ; les banques commerciales étaient prêtes à faire leur travail. Le problème, c’est que la masse de liquidités disponibles a été très vite siphonnée et placée au mauvais endroit.
Je ne suis pas d’accord avec le FMI quand il recommande aux États de continuer à recapitaliser les banques. Les États n’en ont plus les moyens et, de toute façon, le problème n’est pas là : il est urgent de restructurer l’industrie financière, de rétablir des barrières entre les activités, voire de mettre en place des incitations fiscales – même si je reconnais que celles que nous avions préconisées dans la note de l’Institut Montaigne peuvent paraître extrêmes. Sinon, nous irons droit à une nouvelle crise.
M. Jean-Yves Cousin. Quels outils pourrait-on utiliser pour éviter les mouvements spéculatifs sur les monnaies ?
Mme Arlette Grosskost. Les activités de spéculation correspondent essentiellement à des investissements à trop court terme. Or il existe en France une institution, la Caisse des dépôts et consignations, dont la fonction est de réaliser des investissements à long terme. Ne serait-il pas envisageable de créer un tel outil à l’échelle européenne ?
M. Édouard Tétreau. Madame la députée, l’histoire économique nous enseigne que le guichet unique ne fonctionne pas. Les effets pervers potentiels sont très forts.
En revanche, il existe en abondance, en France et en Europe, des investisseurs privés de très long terme : les compagnies d’assurance. Malheureusement, la nouvelle réglementation européenne les incite à investir à court terme, puisque les ratios de solvabilité imposés par Solvency II les obligent à réduire leur exposition sur les marchés d’actions et à acquérir davantage d’obligations d’État. De ce fait, elles ne peuvent plus remplir leur rôle naturel d’investisseur de long terme pour les entreprises.
N’oublions pas les « mains longues » privées et donnons-leur une réglementation adéquate. Il me semble que c’est un combat que la représentation nationale peut mener en Europe. Je vous renvoie, sur ce sujet, à l’interview qu’Henri de Castries a accordée il y a quelques semaines au journal Les échos.
M. le président Henri Emmanuelli. M. de Castries est très impliqué ! Nous n’avons pas tout à fait la même optique…
M. Édouard Tétreau. S’il y avait plus d’Henri de Castries à la tête des institutions financières françaises et européennes, nos économies se porteraient mieux !
M. le président Henri Emmanuelli. La réglementation actuelle ne vise qu’à empêcher ces acteurs de s’exposer sur des marchés dangereux. Les obligations rapportent moins, mais elles sont moins risquées.
M. Édouard Tétreau. Certes, mais il y a un effet pervers : les entreprises du CAC 40 et du SBF 120 ne pourront plus trouver d’investisseurs « long-termistes » en Europe.
M. le président Henri Emmanuelli. Ils peuvent aller sur le marché obligataire !
M. Édouard Tétreau. Cela ne remplace pas les actions ! Qui détient le capital détient le pouvoir ; or Solvency II revient à accepter que les plus grandes entreprises européennes soient contrôlées par le reste du monde. Je ne crois pas que ce soit bénéfique.
S’agissant du marché monétaire, j’ai longuement étudié plusieurs propositions.
Un retour à l’étalon-or me semble impossible. Quelles seraient les parités de change des monnaies ? Cela provoquerait une terrible bataille économique ! De surcroît, les grands détenteurs d’or bénéficieraient d’un avantage indu.
Le FMI a envisagé la possibilité de créer une monnaie de synthèse mondiale à partir des droits de tirages spéciaux. L’idée est intéressante, mais le FMI étant incapable de négocier une nouvelle répartition marginale des droits de vote pour laisser davantage de place aux pays émergents, je ne crois pas qu’elle soit réalisable !
En revanche, le Bancor est une idée géniale de Keynes, qui a été balayée à Bretton Woods car jugée utopique. Il s’agit de créer un panier d’une trentaine de matières premières et de lier les droits de tirage à la situation de la balance des paiements. Ce mécanisme tend structurellement à l’équilibre. Le principal problème actuel, c’est le déséquilibre chronique entre les pays excédentaires, comme la Chine, et les pays déficitaires, comme les États-Unis, ou la France.
M. le président Henri Emmanuelli. Monsieur Tétreau, je vous remercie.
L’audition s’achève à vingt heures quarante.
*
* *
Audition de M. Jean-Hervé Lorenzi, professeur d’économie à l’université de Paris-Dauphine, président du Cercle des économistes
(Procès-verbal de la séance du mercredi 13 octobre 2010)
(Présidence de M. Henri Emmanuelli, président de la commission d’enquête)
La séance est ouverte à seize heures trente
M. le président Henri Emmanuelli. Monsieur le professeur, je vous remercie d’avoir répondu à l’invitation de la commission d’enquête. Vous êtes professeur agrégé d’économie à l’université Paris-Dauphine et, depuis 1995, président du Cercle des économistes. Vous avez écrit de nombreux ouvrages et articles sur les questions monétaires et financières, notamment sur la crise financière, les divers acteurs de la finance et les phénomènes de bulle spéculative. Vous exercez des responsabilités au sein de plusieurs compagnies financières, après diverses expériences dans le monde industriel et administratif. Vous êtes donc pour nous un témoin particulièrement précieux.
La crise grecque a ravivé de nombreuses interrogations, à propos notamment de la sensibilité des marchés financiers aux rumeurs, des conflits d’intérêt affectant certains opérateurs, du mécanisme des Credit Default Swaps, les CDS, et des effets déstabilisants des outils permettant les ventes à terme et à découvert de certains produits financiers. Notre commission cherche donc à répondre à un ensemble de questions. Qui se livre aux attaques spéculatives, et à partir de quelles zones ou marchés ? Quel est le rôle des hedge funds ? Quelles sont les méthodes employées ? Quel est le rôle des agences de notation ? Trois ans après la crise des subprimes, les acteurs compétents ont-ils pris les bonnes décisions, et au bon moment, pour stopper les mouvements spéculatifs ? Bref, nous essayons de comprendre ce qui s’est passé et, bien sûr, nous aimerions savoir quelles sont vos recommandations.
(M. Jean-Hervé Lorenzi prête serment.)
M. Jean-Hervé Lorenzi, professeur à l’université Paris-Dauphine, président du Cercle des économistes. Il est difficile de parler de la spéculation sans donner son sentiment sur la crise – tant sur son origine que sur sa capacité à se résorber. C’est un sujet particulièrement complexe : depuis quinze jours, en vue de cette audition, je me suis plongé dans tous les travaux portant sur la spéculation, mais il est peu de domaines aussi flous et malaisés à aborder. Je ne suis donc pas certain de vous apporter une contribution très significative, ni dans l’analyse ni en termes de propositions, mais je me dis, pour me donner du courage, que mes collègues n’y parviendraient sans doute pas davantage.
Pour adopter une démarche intellectuelle rigoureuse, il faut évidemment commencer par définir la spéculation, mot qui peut être employé dans de nombreux sens. Nicholas Kaldor, économiste britannique d’origine hongroise qui a été, en matière de croissance, l’un des interprètes de Keynes, avait rédigé en 1951, à la demande du Parti travailliste, un rapport sur la productivité et la compétitivité de l’économie britannique. Spécialiste de l’économie réelle – j’avais eu moi-même l’occasion de le rencontrer –, il connaissait également très bien les mécanismes de la spéculation. Il l’a définie comme « l’achat (ou la vente) de marchandises en vue d’une revente (ou d’un rachat) à une date ultérieure, là où le mobile d’une telle action est l’anticipation d’un changement des prix en vigueur, et non un avantage résultant de leur emploi, ou une transformation ou un transfert d’un marché à un autre ». En somme, le mobile qui pousse le spéculateur à agir n’est pas le développement de l’activité réelle, mais l’anticipation de l’évolution d’un prix. Bien qu’elle émane d’un économiste de grand talent, cette définition reste un peu floue.
Au demeurant, l’une des raisons pour lesquelles nous avons tant de mal à comprendre précisément ce qui s’est passé au cours des trois dernières années est la séparation entre, d’une part, les économistes du réel, qui examinent ce qui se passe sur les marchés des biens et services ou sur le marché du travail et, d’autre part, les économistes spécialisés dans l’analyse des marchés financiers – non pas du marché de la monnaie, lequel est pour nous un point de passage naturel, mais des marchés de titres financiers, caractérisés par des mécanismes et des comportements spécifiques, notamment le mimétisme. Les économistes du réel, dont je fais partie, sont assez étrangers à cet univers de la finance.
Je retiendrai quatre mots pour rendre compte de la situation présente : incertitude, incompréhensible, inconnu, ambiguïté de la régulation.
Incertitude, d’abord.
Il me faut à ce sujet évoquer brièvement mon interprétation de la crise. Il s’agit en fait, comme toujours, d’une crise de l’économie réelle. Elle frappe par sa rapidité et sa brutalité. En dix ans, entre 5 % et 10 % – 7 % d’après mes calculs – de la valeur ajoutée des pays de l’OCDE – essentiellement les États-Unis et les pays européens – ont été transférés, directement ou indirectement, vers les pays émergents. C’est un mouvement de délocalisation sans précédent. Dans le rapport que j’avais rédigé en 2005 pour le Conseil d’analyse économique, j’avais montré que les délocalisations passées, qui détruisaient environ un emploi industriel sur dix, étaient gérables ; ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Les conséquences sont de trois ordres, et en lien avec les phénomènes spéculatifs. Aucune n’a trouvé de solution aujourd'hui. C’est pourquoi il est difficile de parler de fin de crise.
Il s’agit, premièrement, de la création de liquidités à l’échelle mondiale, dans des conditions non régulées. Quelles que soient les méthodes de calcul retenues, le taux de croissance des liquidités a été, de 2002 à 2008, de l’ordre de 15 % par an, pour un taux de croissance de l’économie réelle compris entre 4 % et 5 %. Ce décalage incite nécessairement à une utilisation des liquidités sans rapport avec l’économie réelle, c'est-à-dire spéculative. À cet égard, les déclarations des banquiers centraux japonais, américain et anglais, favorables à la création de liquidités en contrepartie d’achats de titres – ce qui a évidemment l’avantage pour eux de faire baisser le taux de change de leur monnaie vis-à-vis de l’euro –, sont très dangereuses car c’est ainsi que l’on fabrique des bulles spéculatives, l’argent mis en circulation trouvant à s’utiliser sur les marchés des matières premières ou de l’immobilier – dans les pays émergents comme dans ceux de l’OCDE. Nous sommes, donc, en train d’assister à la mise en place des conditions de la spéculation à venir.
Deuxièmement, la crise d’origine réelle entraîne, de fait, une répartition des revenus dans les pays développés – au sein desquels la France présente quelques particularités – qui n’est pas à l’avantage des salariés, dont le nombre diminue du fait de la concurrence des pays émergents, laquelle pèse également sur le niveau des salaires. Il en résulte que le seul moyen de maintenir l’activité est de distribuer du crédit aux ménages, ce qui aboutit au surendettement. Se pose alors la question de la répartition du risque. Dans une petite étude intitulée 2007-2010 : une seule crise, j’ai tenté de montrer que, qu’il s’agisse des mécanismes de titrisation ou de la volatilité des prix des matières premières, le problème était toujours le non-contrôle de cette répartition et du contenu même de ce risque. Il ne s’agit pas exactement de spéculation telle que définie par Kaldor, mais les produits qui sont vendus ne le sont pas dans des conditions de transparence et de véracité des prix.
Troisièmement, la brutalité des transferts d’activité a eu pour conséquence une demande très fluctuante de ressources rares, à commencer par les matières premières. La volatilité des prix constatée depuis 2007, et qui a gagné les marchés de l’énergie et de l’agroalimentaire, est pour partie de nature spéculative ; mais intuitivement, je pense que ce sont les déséquilibres de marché qui déclenchent la spéculation, laquelle rétroagit à son tour sur les marchés. Je ne pense pas que la spéculation soit à l’origine de la volatilité des marchés – mais je n’ai aucune certitude, même après avoir lu tous les travaux sur le sujet. Patrick Artus et moi-même, il y a quelques jours, avons ainsi constaté ensemble que les spreads sur les dettes souveraines avaient significativement augmenté ces dernières semaines et que parallèlement, la volatilité des prix des matières premières s’était accrue ; nous pensons que la spéculation n’est pas en cause et qu’il faut plutôt chercher l’explication dans le fait que beaucoup d’investisseurs institutionnels ont décidé de se retirer des marchés de dette souveraine, au moins pour l’instant, et que la demande de stockage a augmenté sur les marchés de matières premières. L’origine des mouvements spéculatifs, donc, me semble plutôt à rechercher dans l’économie réelle.
Sur ces trois éléments d’incertitude que sont l’abondance des liquidités, l’endettement des ménages et la volatilité du prix des matières premières, il n’y a aujourd’hui pas l’amorce d’une solution. Les propositions du Président de la République pour le G20 sont intéressantes, en particulier sur la volatilité du prix des matières premières. Il y a également celles sur les taux de change, mais je lui souhaite bon courage.
Deuxième mot que je retiens : incompréhensible.
Ce qui est incompréhensible, c’est d’abord le rôle de la spéculation. Dans un travail que je viens de réaliser pour le Cercle des économistes sur les équilibres agro-alimentaires mondiaux, j’ai consacré une partie à la financiarisation des marchés, sujet sur lequel j’ai donc répertorié les études qui avaient été faites. Beaucoup de travaux ont été consacrés aux CDS des dettes souveraines, pour tenter d’isoler la composante spéculative. Concernant le prix du pétrole, un rapport de Jean-Marie Chevalier, Patrick Artus et Philippe Chalmin montre la difficulté du sujet, en étant prolixe sur les prévisions de prix et très peu disert sur la spéculation. En ce qui concerne les produits dérivés, les transactions porteraient sur 600 000 milliards par an – chiffre repris par Michel Barnier –, soit l’équivalent de dix fois le PIB mondial. Ce rapport ne paraît pas très surprenant, s’agissant d’un côté de transactions financières et de l’autre de production de richesses réelles ; mais il conduit à l’idée que les chiffres de la spéculation sont moins impressionnants que l’on imagine, même si l’on ne peut nier son rôle perturbateur et accélérateur et sa contribution à l’opacité du système.
Les travaux effectués sur les CDS de dette souveraine, sur les denrées alimentaires et sur le pétrole vont dans tous dans le même sens. Environ 10 % seulement des transactions sur CDS de dette souveraine seraient de nature spéculative. Pour les produits agricoles, la situation est variable selon les produits et les périodes. Concernant les produits pétroliers, Jean-Marie Chevalier observe que le baril valait 42 dollars en septembre 2007, 102 dollars fin janvier 2008 et 147 dollars à la fin juin ; sur un peu plus de 100 dollars d’augmentation, la spéculation stricto sensu en expliquerait 30. En outre, si la spéculation explique 30 % à 50 % du prix à terme, le marché à terme lui-même détermine totalement le marché au comptant.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. Quels critères retient-on pour calculer ces pourcentages ?
M. Jean-Hervé Lorenzi. Tous les calculs qui ont été faits au cours des cinq dernières années se fondent sur une distinction entre les auteurs des transactions : venant d’un hedge fund, la transaction sera classée comme spéculative ; venant d’une banque, elle ne le sera qu’éventuellement.
Troisième mot : inconnu.
La plupart des valorisations des produits dérivés sont faites à partir de modèles comme celui de Black et Scholes, souvent un peu incompréhensibles mais qui donnent une « base scientifique » à l’idée que la spéculation ne serait qu’un marché parmi d’autres, obéissant à des règles rationnelles. Les difficultés rencontrées sur les marchés financiers ont été l’occasion de mettre en évidence ce qui pose problème dans cette modélisation, qu’il s’agisse du mimétisme des acteurs ou, surtout, comme Nicole El Karoui vous l’expliquera mieux que moi, de ce qui se passe en « queue de distribution » sur la courbe de probabilités.
Comment agir dans un univers incertain ?
Le discours sur les produits dérivés est toujours le même. On dit qu’ils sont utiles, ce qui est vrai, parce qu’ils contribuent à stabiliser le comportement des acteurs, qu’il s’agisse de producteurs de pétrole ou de produits agro-alimentaires ou des investisseurs qui souhaitent, par exemple, acheter de la dette souveraine – et qu’il est bon de rassurer au moment de leur décision d’investissement. On dit, ensuite, qu’ils donnent aux marchés beaucoup plus de liquidité. Ce à quoi nous avons assisté en matière financière, c’est avant tout une crise de liquidité. Les produits dérivés offrent aux acteurs de marché la garantie de pouvoir en sortir.
Mais il faut aller au-delà. Keynes, qui avait le sens de la formule, écrivait dans La théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie : « Les spéculateurs peuvent être aussi inoffensifs que des bulles d’air dans un courant régulier d’entreprise. Mais la situation devient sérieuse lorsque l’entreprise n’est plus qu’une bulle d’air dans le tourbillon spéculatif. Lorsque, dans un pays, le développement du capital devient le sous-produit de l’activité d’un casino, il risque de s’accomplir dans des conditions défectueuses. » L’idée d’une économie de casino n’est pas nouvelle ! Comment les choses se présentent-elles aujourd’hui ?
Nous connaissons la conjoncture macroéconomique des trois prochains semestres : la croissance devrait être de l’ordre de 1,5 ou 1,6 % en France, de 1,1 ou 1,2 % en Europe, et approcher 2 % aux États-Unis. Même si on n’est pas capable de déterminer précisément le coefficient multiplicateur négatif des restrictions budgétaires, nul ne peut nier leur impact ; on restera donc très en deçà de la croissance potentielle. L’Allemagne elle-même verra sa croissance très largement déterminée par sa politique budgétaire, et donc probablement maintenue légèrement en dessous de 2 %. Le contexte est donc difficile, même s’il ne s’agit pas de récession. S’il n’y a pas de crise des changes – et c’est une épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de l’économie mondiale –, néanmoins les problèmes d’équilibre des marchés de biens et services et du marché du travail ne seront pas résolus. Il va bien falloir songer à compenser le transfert d’au moins 5 % de notre valeur ajoutée – ce qui représente un très grand nombre d’emplois – vers les pays émergents ; or personne n’a la moindre idée des activités nouvelles qui pourraient prendre le relais. On parle beaucoup des emplois dans les maisons de retraite, mais cela ne représente pas plus de 0,1 % du PIB et des emplois. Dans ces conditions, il est difficile de prévoir, et même d’imaginer ce qui se passera en 2012 ou 2013.
Pour concevoir la régulation, il faut se poser quatre questions.
Tout d’abord, en quoi les produits dérivés – futures, options, collars, caps,… – nous aideront-ils à financer les investissements nécessaires – que j’évalue à 150 milliards d’euros – dans un monde qui aura radicalement changé ? Je passe sur le problème des changes, en sommeil tant que l’Europe n’a pas la capacité d’afficher une position ; le jour où elle en aura une, on entrera dans un jeu à trois, extrêmement compliqué à gérer. La donnée essentielle est que les pays émergents vont devoir financer leurs infrastructures et répondre à la demande de biens et services des centaines de millions de personnes arrivées sur le marché du travail. Cela ne sera possible qu’avec une baisse de leur taux d’épargne et l’arrêt des flux d’épargne qui vont aujourd'hui des pays émergents vers les États-Unis.
De même, l’Europe a une balance des paiements courants à peu près équilibrée, mais elle a besoin d’investir dans un système productif nouveau. Nous avons beaucoup d’épargne, mais comment surmonter l’aversion au risque des épargnants dans des pays marqués par le vieillissement ? Ce qui est vrai pour la France l’est aussi pour l’ensemble des pays européens. Il faut organiser un transfert de l’épargne vers le long terme, afin de changer la trajectoire de notre croissance. Dans un rapport que je suis en train de rédiger avec trois collègues du Conseil d’analyse économique sur la croissance potentielle en France, trois hypothèses sont identifiées : retrouver les 2 % de croissance potentielle en récupérant ce qui a été perdu pendant trois ans – mais ce n’est pas réaliste ; ne pas récupérer, mais parvenir à retrouver le même niveau de croissance ; ne pas récupérer et avoir une croissance potentielle plus faible.
Les produits dérivés seraient-ils capables de favoriser la prise de risque par l’épargnant ? C’est une question qu’il faut impérativement se poser. Pour ma part, j’imagine par ailleurs que, pour les 150 milliards que j’évoquais, l’État pourrait jouer un rôle d’assureur ou de réassureur ; cela permettrait de réduire l’aversion au risque – qui est une question macroéconomique majeure de notre pays.
En second lieu, peut-on accepter que de grands pays comme l’Espagne – qui a la perspective de quatre ou cinq années difficiles – soient à la merci des décisions d’intervenants comme M. Soros, dont personne n’a oublié la stratégie sur la livre sterling ? Les propositions qui ont vu le jour – réforme Dodd-Frank, préparation du sommet de Séoul, projet de directive Barnier – sont pleines de bonnes intentions mais il faudrait, me semble-t-il, décider – les Allemands l’ont fait pour la vente à découvert de CDS sur dette souveraine – que la dette souveraine doit rester en dehors du champ des CDS.
En troisième lieu, et alors que le marché des CDS est passé de 1 500 milliards de dollars en 2001 à 60 000 milliards en 2008, croissance sans rapport avec celle du sous-jacent, il serait indispensable d’imposer le passage par des chambres de compensation. Tout le monde en parle, mais encore faudrait-il le décider.
Enfin, comment mutualiser les risques ? Il faudrait prévoir des mécanismes, comme pour les calamités agricoles. Je vous laisse en parler avec Mme El Karoui.
Le sujet étant très complexe, ces quatre propositions ne résolvent pas tous les problèmes mais je crois qu’elles vont dans le bon sens.
M. le président Henri Emmanuelli. Ma conviction profonde est que la première chose à faire est d’obtenir les informations. Est-ce votre avis ?
M. Jean-Hervé Lorenzi. Oui. Il ne faut pas oublier que la stratégie des hedge funds repose sur deux paramètres : l’asymétrie d’information et la volatilité.
L’information est nécessaire, mais à cet égard n’oublions pas que nous avons vécu pendant trente ans sur l’hypothèse, chère à M. Fama, de l’efficience des marchés, y compris celle des marchés financiers. Les valeurs étaient censées intégrer l’ensemble de l’information disponible... Il faut se résoudre au constat que, dans leur immense majorité, les marchés financiers ne sont pas efficients, et que, le plus souvent, l’information contenue dans les prix n’est pas complète. Je demande que l’on inverse la charge de la preuve : que ceux qui affirment que les marchés sont efficients nous le prouvent, de manière concrète, sur le fonctionnement des marchés dans les vingt dernières années !
M. Paul Giacobbi. Pour avoir une information sur le volume des marchés, il suffit d’aller sur le site de la Banque des Règlements Internationaux, mais ce sont des chiffres bruts. Et avec le trading à haute fréquence, il est impossible de savoir ce qui se passe : à 10 000 opérations par seconde, personne ne voit où va l’argent. S’agissant de la qualité des créances, j’ignore quel peut être le montant des créances irrécouvrables dans le système financier mondial. On a parlé de 800 milliards, de 80 milliards – chiffre qu’avait avancé M. Strauss-Kahn –, aujourd’hui certains vont jusqu’à 12 000 milliards... Le manque d’information est terrifiant.
M. Jean-Hervé Lorenzi. Le premier chiffre date du 8 août 2007, dans le contexte de la crise des subprimes : 30 milliards de dollars de créances douteuses. C’était déjà beaucoup. En septembre, l’OCDE avançait le chiffre de 300 milliards. Un mois et demi après, le FMI annonçait 700 milliards. Le chiffre admis aujourd'hui est de 4 000 à 4 500 milliards, dont la moitié n’est pas vraiment localisée. D’aucuns avancent le chiffre de 12 000 milliards.
M. Paul Giacobbi. Quand on a lancé l’alerte pour AIG, on a parlé de 600 milliards…
Notre commission se donne pour but de trouver des mesures régulatrices de la spéculation. C’est mission impossible. Sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX) et les marchés pétroliers, on ne connaît pas réellement l’identité des intervenants : quand une banque intervient, on ne sait pas si c’est pour le compte d’un opérateur ou d’un spéculateur. Quand le prix du baril est monté jusqu’à 150 dollars, entre 70 % et 80 % des intervenants n’étaient pas identifiés comme pétroliers ; le surlendemain, pour répondre à un besoin de liquidités, les spéculateurs ont vendu – et le prix du baril est retombé à 70 dollars en quelques semaines. C’était, comme par hasard, le prix d’équilibre évalué par l’Agence internationale de l’énergie. Jusqu’à présent, nous avons soigné l’addiction à la liquidité par des injections massives ; si on n’agit pas en sens inverse, de nouvelles bulles spéculatives éclateront.
M. Jean-Hervé Lorenzi. Entre 2001 et 2003, le prix du brent a varié dans une fourchette de 21 à 27 dollars. En prenant ne serait-ce qu’un prix cible, autour de 75 dollars par exemple, nous ferions un grand pas. Le débat est avant tout un débat d’idées. Prétendre que les marchés sont efficients quand le baril atteint 150 dollars, c’est nier l’évidence. Introduire une fourchette de prix reviendrait déjà à remettre un peu de rationalité dans l’univers des marchés.
M. le président Henri Emmanuelli. La seule chose qui ne soit pas compliquée, et qui dépend de la volonté des politiques, c’est d’exiger la transparence des transactions. Je ne dis pas qu’il faut interdire quoi que ce soit, mais qu’il faut commencer par savoir qui fait quoi. Que chaque pays exige que les contrats soient enregistrés dans une chambre de compensation ne me paraît pas un objectif hors de portée, même si je mesure la difficulté pour y parvenir.
Il me reste à vous remercier.
L’audition s’achève à dix sept heures trente cinq.
*
* *
Audition de Mme Nicole El Karoui,
professeur à l’Université de Paris VI
(Procès-verbal de la séance du mercredi 13 octobre 2010)
(Présidence de M. Henri Emmanuelli, président de la commission d’enquête)
La séance est ouverte à dix-sept heures trente
M. le président Henri Emmanuelli. Madame le professeur, je vous remercie d’avoir répondu à l’invitation de la commission d’enquête. Vous êtes professeur à l'Université Paris VI, où vous dirigez le master « probabilités et finances », qui a formé des générations de traders. Vous avez en effet été, à la fin des années quatre-vingt, une pionnière du développement des mathématiques financières. Vous êtes donc pour nous un témoin particulièrement précieux pour notre étude sur les mécanismes spéculatifs.
Notre commission cherche à comprendre ce qui se passe dans la sphère financière. Elle voudrait apprécier la place qu’y occupe la spéculation, son utilité et sa dangerosité, avant de formuler éventuellement des propositions pour améliorer la situation, si tant est que ce soit possible.
(Mme Nicole El Karoui prête serment.)
Mme Nicole El Karoui, professeur à l’Université Paris VI. Aujourd’hui professeur à l’Université Paris VI, j’ai été pendant dix ans professeur à l’École Polytechnique. Fondamentalement, je suis une mathématicienne.
M. le président Henri Emmanuelli. Pour vous, les mathématiques sont-elles rationnelles ?
Mme Nicole El Karoui. En mathématiques, quand on part de A, là où on arrive ne peut être contesté, sauf si on remet en cause A. Ce qu’il y a avant A et ce qu’il y a après là où on arrive sont des questions tout aussi importantes, comme je l’ai découvert en faisant de la finance.
Votre commission d’enquête étudie l’impact de la spéculation sur l’économie, sujet sur lequel tous ceux que vous avez auditionnés ont des compétences que je n’ai pas. Puisqu’on ne parle bien que de ce que l’on connaît, je vous ferai part de mon expérience. En matière de théorie financière, je me définis comme une autodidacte qui s’est progressivement intéressée à de plus en plus de sujets.
Je connais assez bien la banque d’investissement, particulièrement les produits dérivés, la gestion des risques et la mise en place de quantités réglementaires. Ainsi, j’ai directement participé, au Crédit lyonnais, à la mise en place de la value at risk (valeur sous risque), expérience qui exigeait beaucoup plus de technique que de connaissances financières. Je peux donc exposer un point de vue personnel issu de cette expérience, mais sans en tirer de conclusions au niveau de l’économie globale. Je me contenterai d’évoquer les risques que j’ai identifiés et les réflexions que cela m’inspire, en tentant d’adopter une approche quantitative.
Le mathématicien français Louis Bachelier avait rédigé sous la direction d’Henri Poincaré une thèse très novatrice intitulée Théorie de la spéculation, soutenue en 1900 à la Sorbonne. Considérant que tout intervenant sur les marchés est un spéculateur, il s’est intéressé au mécanisme de formation des prix des produits dérivés. Il a affirmé que le marché – c’est-à-dire l’ensemble des spéculateurs – ne croit, à un instant donné, ni à la hausse ni à la baisse du cours vrai, car pour chaque cours coté, il y a autant d’acheteurs que de vendeurs. Sur ce principe, il a construit une théorie mathématique du prix et, par ailleurs, développé des outils qui s’avèreront très utiles notamment en physique, concernant le mouvement brownien.
C’est sur cette base et les développements auxquels elle a donné lieu que j’ai commencé à travailler dans les années quatre-vingt-dix sur les produits dérivés, en m’intéressant non à la détermination du prix des produits, mais au calcul des stratégies de couverture. Le marché à terme international de France (MATIF) avait été ouvert peu de temps auparavant, les banques françaises se développaient beaucoup dans ce domaine. J’ai donc suivi le développement des produits dérivés, d’abord standard, puis plus compliqués.
Première question concernant la spéculation : qui sont les spéculateurs ? Selon la définition de Bachelier, ce sont tous ceux qui participent aux marchés financiers. Mais ce sont plus particulièrement les intervenants des sociétés de gestion, des hedge funds et des fonds de pension, les opérateurs des salles des marchés, ceux qui mènent des activités de trading pour compte propre à l’intérieur des banques d’investissement – et il existe sans doute d’autres catégories. Pour ma part, je connais mieux ce qui relève des salles de marché que du trading pour compte propre et des hedge funds, et encore moins bien les sociétés de gestion et les fonds de pension.
La spéculation, qui consiste à prendre des positions sur l’avenir, est parfois le seul moyen de faire de la performance, notamment quand les taux d’intérêt sont aussi bas qu’aujourd’hui. Ses effets sur l’économie dépendent de la taille et de la capacité d’intervention des acteurs : en 1992, quand il a attaqué la monnaie anglaise, George Soros a joué un milliard de livres. Tous les acteurs ne disposent pas de la même force de frappe.
M. le président Henri Emmanuelli. Ce chiffre prend-il en compte l’effet de levier ? En d’autres termes, George Soros a-t-il engagé un milliard de livres ou seulement le vingtième de cette somme ?
Mme Nicole El Karoui. Je ne saurais pas vous répondre, mais en tout cas il a joué gros.
Au moins dans les activités que je connais le mieux, on constate que les marchés liquides sont très bien arbitrés, mais que les gains retirés de chaque activité sont limités. C’est pourquoi, pour réaliser une performance suffisante, il faut prendre des grandes pauses. La taille des pauses me paraît un élément stratégique, qui a été peu surveillé lors de la dernière crise financière et auquel il faudrait sans doute réfléchir. L’autre solution est le déplacement vers des marchés moins liquides, plus risqués mais aussi plus rentables – d’où ce qui s’est passé en matière de crédit.
Un vieil adage dit qu’on ne peut pas avoir de rendement sans prendre de risques. Mais s’il s’agit de surveiller les marchés et de comprendre où sont les risques, il faut inverser la problématique : là où il y a du rendement, a priori il y a du risque, voire beaucoup de risque. D’où mon étonnement quand j’ai constaté que dans la période 2005-2007, les banques obtenaient une rentabilité de l’ordre de 30 ou 35 % sans que personne ne se demande pourquoi. Un tel résultat vient nécessairement d’un investissement important sur des produits à fort effet de levier ou sur des produits à forte rentabilité mais très risqués, sans que ce risque ait été très bien analysé.
Par ailleurs, le risque augmente avec la taille des pauses de manière exponentielle. Pourtant, quand un trader réalise des gains importants, on a tendance à miser encore davantage sur lui, en repoussant les limites de risque. Or les lois de la probabilité devraient au contraire conduire à exercer une surveillance accrue sur ce trader, non par suspicion, mais parce que, dans un marché qui offre peu d’opportunités réelles à très long terme, il a probablement trouvé une niche et que les niches ne résistent pas au volume. Les grandes pertes ont souvent résulté de la concentration de flux sur des opportunités temporaires.
M. le président Henri Emmanuelli. Diriez-vous que plus on gagne, plus le risque de perte augmente ?
Mme Nicole El Karoui. Des opportunités réelles sont détectées et utilisées mais, dans des marchés de mieux en mieux maîtrisés et arbitrés, elles ne peuvent pas durer éternellement. On ne sait pas quand cela va casser, mais la cassure se produit nécessairement. Or on constate qu’au niveau d’un trader, d’une salle ou même d’une banque, à partir d’un certain niveau de performance on mise comme au casino, en oubliant que la performance va structurellement de pair avec un plus haut niveau de risque, lequel peut produire des effets dramatiques. Ces phénomènes s’apparentent à ceux d’une bulle, mais il n’est pas nécessaire qu’il y ait une bulle pour les constater : on les observe à des niveaux variés de l’activité de marché. Le risque est amplifié par l’importance des liquidités et par les comportements moutonniers.
Sur les marchés de dérivés – et du côté des banques –, on a pu constater au cours des dix dernières années que les produits standards sur les actifs ou sous-jacents liquides ne permettaient plus de dégager des marges suffisantes : les marchés étant bien arbitrés, on ne peut attendre des produits dérivés, tels que les options, qu’une performance très faible. Dès lors, le rendement passe par le volume ; l’activité se développe donc sur des gros nominaux.
Par ailleurs, la diminution des marges sur les activités optionnelles standard incite à innover. Une partie des produits nouveaux sert à couvrir les risques induits par l’activité de forte taille sur les produits standard, les autres visant notamment à utiliser la complexité pour augmenter les marges. Mais selon les professionnels des marchés, un nouveau produit n’est rentable que pendant environ six mois ; au-delà de ce délai, la compétition fait retomber sa rentabilité à un niveau commun, ce qui conduit à créer de nouveaux produits de plus en plus complexes.
On a pu également constater la tendance à investir sur de nouveaux marchés ou sur des marchés à forte composante spéculative. La période 2000-2010 a vu l’émergence des produits dérivés de crédit. En France, il y a eu beaucoup de produits de ce type sur le risque de défaut des entreprises. Sur ce marché à forte composante spéculative, les dérivés de crédits étaient surveillés de manière assez légère. Il fallait des milliards en CDS pour couvrir les CDO, ce qui a créé un important déséquilibre de marché, face auquel les mathématiciens étaient quelque peu réservés. Bien qu’on ait été très loin des hypothèses de base qui auraient permis de couvrir les produits dans la vision de Bachelier ou de Black et Scholes, le marché s’est fortement emballé. Non seulement les banques ont vendu, mais les investisseurs ont acheté – puisque, il ne faut jamais l’oublier, il y a toujours deux parties dans un marché ; et il est un peu étonnant que des acquéreurs se soient ainsi portés sur des dérivés de crédit qui, structurellement, dès lors qu’ils présentaient une rentabilité nettement supérieure à celle des taux, comportaient un risque, même si celui-ci n’était pas instantané.
Les dérivés de crédit ayant quasiment disparu, le marché des dérivés se repositionne. Ces grands mouvements devraient être surveillés – je parle d’observation et non de sanction. Dans l’immédiat, il faut particulièrement s’intéresser au marché des matières premières, dont on imagine bien qu’il donnera lieu à une demande importante dans les prochaines années. Je connais plusieurs banques qui ont réduit leur activité standard sur les dérivés pour s’orienter vers le marché des matières premières. C’est un marché très complexe, notamment du fait d’une grande asymétrie d’informations, et par ailleurs stratégique pour l’économie réelle ; mieux vaut, donc, être vigilant.
Quant aux risques à venir, ils concernent entre autres l’assurance dans son département « vie ». L’allongement de l’espérance de vie crée un risque important pour les fonds de pension, les assureurs-vie et pour le financement des retraites. Une réflexion intéressante est menée sur le rôle des marchés financiers dans le financement de ce type de risque. En Angleterre, les fonds de pension seraient exposés à des pertes très importantes si l’espérance de vie de la population était retenue pour son chiffre réel, et non maintenue au niveau indiqué par des tables qui remontent à cinq ou six ans. Une réflexion intéressante est menée sur le rôle de la finance dans ce type de risque. Il faut être conscient que les volumes en jeu seront très importants et que, s’agissant d’enjeux de long terme, l’analyse des risques sera difficile. Existe-t-il un risque potentiel ? Faut-il exercer une surveillance ? Quel type de veille assurer ? Telles sont les questions qu’il faut se poser.
J’en viens, toujours sur le marché des dérivés, à la situation des investisseurs.
Pour le spéculateur, les produits dérivés sont des instruments à fort effet de levier. Les contrats à terme fixent le prix d’une opération qui n’interviendra que dans le futur. Il est très facile d’investir si l’on peut anticiper que le cours sera très éloigné de la valeur affichée, d’autant qu’il n’y a quasiment aucun échange d’argent sur le moment. Mais si l’on peut espérer un gain important, on doit néanmoins ne pas oublier que, si l’anticipation est fausse, on perdra beaucoup. Les produits dérivés, dont certains jouent un rôle d’assurance contre des hausses trop brutales de produits essentiels, sont des instruments privilégiés pour le spéculateur ; mais il reste à savoir comment on peut les gérer et les contrôler.
C’est une question importante car les sociétés de gestion utilisent de plus en plus ces produits, même si c’est dans des proportions variables, afin d’augmenter leur rentabilité. J’ai eu l’occasion d’observer le recours à des produits extrêmement compliqués, dont l’utilité – en dehors de la performance espérée – était peu claire et qu’il serait indispensable de mieux maîtriser. Il a été proposé par exemple de créer des plates-formes de valorisation indépendantes. Cela n’est pas sans danger car on ne détermine pas le prix d’un produit en soi, mais à travers un modèle, ce qui suppose de savoir comment on s’en sert, ce qui l’a motivé et pourquoi on peut obtenir deux prix différents pour un même produit dérivé. Les instruments d’analyse ne doivent pas être considérés comme fournissant une information de nature à garantir la sécurité des produits, faute de quoi ils produiront l’effet inverse de celui qu’on en attendait. Si l’on veut stabiliser les marchés financiers, il me paraît important d’éduquer l’acheteur et de lui faire comprendre les risques, pour éviter qu’il ne se laisse séduire par des produits qu’il ne maîtrise pas.
M. le président Henri Emmanuelli. Au cours d’un entretien récent, vous vous êtes montrée sévère envers la Commission bancaire, aujourd’hui intégrée dans l’Autorité de contrôle prudentiel. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Je m’interroge pour ma part sur la manière dont cette institution a rempli sa mission de surveillance des bilans bancaires, et notamment distingué les opérations en compte propre et sur mandat de clients – fort différentes en termes de risque. Quel jugement portez-vous sur les ventes à découvert ainsi que sur le projet de réglementation avancé par le commissaire Barnier ?
M. Jean-François Mancel, rapporteur. Si tous ceux qui interviennent sur les marchés financiers peuvent être considérés comme des spéculateurs, pour mettre un terme à la spéculation il faut purement et simplement supprimer les marchés financiers ! Sur le marché des produits dérivés, est-on capable de faire la distinction entre les bons et les mauvais produits ? Peut-on empêcher l’apparition des seconds et leur utilisation par les spéculateurs ? Qui pourrait le faire, et dans quelles conditions ?
Par ailleurs, on a beaucoup critiqué les modèles financiers, en leur reprochant d’avoir été à l’origine de certains dérèglements. Au moment de la crise, la Commission des finances avait auditionné des présidents de banque ; ils avaient dit avouer leur humilité devant la complexité des modèles mathématiques utilisés par certains de leurs collaborateurs, qu’ils étaient incapables de contrôler.
M. le président Henri Emmanuelli. « Je ne sais pas ce que fait ma salle des marchés », avait dit l’un d’eux.
M. le rapporteur. Comment réagissez-vous à cette affirmation ? Les modèles mathématiques utilisés sont-ils à l’origine de tous les maux du système financier ?
M. le président Henri Emmanuelli. Précisons quand même que les banquiers, même s’ils ne comprenaient pas très bien comment fonctionnaient ces modèles, savaient en revanche ce qu’ils leur avaient rapporté !
Mme Nicole El Karoui. La dissymétrie dans l’appréciation est incontestable : tant qu’on gagne, on ne parle pas des modèles, mais quand on perd, on les accuse…
La Commission bancaire devenue Autorité de contrôle prudentiel vient vérifier tous les ans le modèle interne utilisé par les banques pour calculer la value at risk, c’est-à-dire la perte potentielle, à un jour, de l’activité de la salle des marchés. J’ai pu constater qu’elle ne disposait pas de moyens suffisants. Le personnel n’est ni assez nombreux ni assez renouvelé pour suivre l’évolution du marché. Voilà vingt ans que j’étudie les produits dérivés. Dans les années 1990-2000, on était moins sûr de soi et donc plus critique. Ensuite, la machine s’est emballée : entre 2004 et 2007, l’activité de produits dérivés a augmenté de 30 % dans le monde. Il en est résulté des problèmes techniques : une salle des marchés effectue son bilan tous les soirs ; il est difficile d’évaluer un portefeuille quotidiennement, alors que les procédures sont complexes, si les moyens, et notamment le nombre d’ordinateurs, n’augmentent pas au même rythme que l’activité.
M. le président Henri Emmanuelli. Le personnel de l’autorité de contrôle est-il compétent ?
Mme Nicole El Karoui. Il compte des personnes compétentes, mais au lendemain de la crise, quand beaucoup de gens se sont demandé ce qu’ils faisaient dans la finance, sans doute la Commission bancaire aurait-elle dû essayer de les faire venir, car on surveille toujours mieux ce que l’on connaît de l’intérieur.
M. le président Henri Emmanuelli. Vous proposez en somme – je plaisante –d’embaucher des voleurs pour supprimer le vol…
Mme Nicole El Karoui. Je n’aime pas que l’on réduise l’activité des marchés à un vol organisé. En 1998, quand la value at risk a été créée, deux personnes y travaillaient contre trente aujourd’hui, dans une salle qui en comprend quatre-vingt. Les contrôleurs sont devenus nombreux, on valide les modèles, l’analyse des risques est beaucoup plus performante. Certes il reste toujours un aléa moral.
M. le président Henri Emmanuelli. Le personnel de l’autorité de contrôle a-t-il la formation nécessaire ?
Mme Nicole El Karoui. Ceux qui ont la formation ne sont pas assez nombreux. La Commission bancaire aurait dû repérer l’explosion des investissements dans les dérivés de crédit, et donc le risque que cela représentait. Les banques ont un modèle interne pour déterminer la value at risk, qui représente l’estimation la plus précise possible des pertes maximales à un jour – parce qu’il ne peut pas se passer trop de choses en une journée. Mais a-t-on les moyens de surveiller, compte tenu de la vitesse d’évolution des marchés ? Pour être efficace, un contrôle opérationnel doit être très réactif ; il ne peut être en complet décalage avec les marchés. Il faut aussi se demander comment récupérer une information pertinente.
Quant aux banques, elles gagnaient tant d’argent qu’elles préféraient fermer les yeux. Je trouve d’ailleurs que leurs présidents ont été bien peu mis en cause… S’ils ne sont pas capables de savoir ce qui se passe dans leur établissement, c’est que leur gouvernance est mauvaise. L’argument technique n’est pas recevable : ce n’est pas parce qu’on ne comprend pas le fonctionnement d’un instrument – c’est le cas quand nous nous servons d’un ordinateur –, qu’il ne faut pas se préoccuper de ce qu’on en fait. Quelle a été la surveillance des flux ? Certains ont reconnu avoir manqué de vigilance à cet égard. Où les marchés se déplacent-ils ? Comment la concentration va-t-elle se faire ? Où l’explosion se produira-t-elle ? Ces questions auraient dû être posées. Même si la finance s’inscrit dans un environnement économique qui pousse à certaines opérations et en facilite d’autres, on doit pouvoir effectuer des observations et tirer la sonnette d’alarme avant que la bulle ne se soit constituée. Il est important de sensibiliser les acteurs des marchés au fait que de grands mouvements s’effectuent dans telle ou telle direction.
M. le rapporteur. Faudrait-il prévoir des seuils d’alerte ?
Mme Nicole El Karoui. On le fait pour la météo : quand on observe un phénomène quelque part, on envoie un signal rouge avant qu’il ne se déplace. Un tel mécanisme serait un peu difficile à mettre en place, mais les banques seraient assez d’accord pour doter leurs produits d’une sorte de code barre, afin que le régulateur puisse ensuite centraliser l’information.
M. le président Henri Emmanuelli. Tout commence par l’information, on en revient toujours à cela…
Mme Nicole El Karoui. Il faut se demander comment constituer une information fiable et dynamique, c’est-à-dire en phase avec la vie des marchés. L’autorité de contrôle – ex-Commission bancaire – passe une fois par an dans les établissements, mais certaines informations devraient être recueillies plus fréquemment. On pourrait imaginer que ce soit le rôle d’une structure européenne.
M. le président Henri Emmanuelli. Que pensez-vous des propositions de M. Barnier en matière de régulation ?
Mme Nicole El Karoui. Je ne les connais pas précisément. La régulation et l’encadrement sont comme les freins d’un vélo, lesquels sont nécessaires quand on va vite, mais qui empêchent d’avancer – en l’espèce, de faire du business – si on s’en sert tout le temps. Il faut par conséquent trouver le bon équilibre, en se montrant contraignant sur les risques réels, même si cela commence par susciter des protestations, et par ailleurs en développant une information utilisable par les acteurs et en faisant passer des messages.
M. le président Henri Emmanuelli. Le « code barre » dont vous parliez permettrait, si j’ai bien compris, de disposer d’une information en temps réel.
Mme Nicole El Karoui. Les banquiers ne seraient pas hostiles à ce que le régulateur dispose d’une vision d’ensemble. En revanche, ils ne croient pas à l’idée de classer les produits pour déterminer ceux qui rentreront dans les chambres de compensation. S’ils ne sont pas opposés à l’existence de chambres de compensation et reconnaissent qu’il faut un tant soit peu réguler le marché, ils jugent que la description trop précise de certains produits inciterait, par réaction, à introduire dans les contrats des changements minimes uniquement destinés à les faire sortir du système.
M. le président Henri Emmanuelli. Sauf si on interdit les voies de contournement… Beaucoup d’intervenants nous ont dit qu’il existait une régulation, mais que rien n’empêchait de la contourner. C’est ainsi que les banques ont utilisé le hors-bilan pour contourner la régulation qui s’applique aux bilans bancaires. D’ailleurs, le président de l’Association française des banques a considéré que, si Bâle 3 risquait de contracter le crédit, il y avait toujours la solution du hors-bilan... C’est un peu atterrant.
Mme Nicole El Karoui. J’ai trouvé qu’on avait été très indulgent avec les dirigeants des banques, qui ont eu une responsabilité majeure.
M. le président Henri Emmanuelli. Il y a à l’Assemblée nationale un débat politique là-dessus…
Mme Nicole El Karoui. L’argument selon lequel ils ne comprenaient pas ce qui se passait n’est pas recevable. Quand un dirigeant ne dispose pas d’une chaîne hiérarchique pour l’informer, c’est que quelque chose ne va pas. Les mathématiciens étaient très réservés à l’égard de la méthodologie – très statique – utilisée pour les dérivés de crédit. Tous les dérivés doivent avoir un modèle de risque. Il aurait fallu se demander s’il était raisonnable de prendre des positions d’une telle importance. Je répète que la question de l’échelle est toujours fondamentale : pour qu’un outil reste intéressant, il ne faut pas que la taille des opérations fasse entrer dans un risque démesuré.
M. Paul Giacobbi. M. Lorenzi a rappelé tout à l’heure qu’entre 2000 et 2007, la masse monétaire a globalement augmenté de 15 % par an, tandis que la croissance du PIB était de l’ordre de 4 %. N’était-ce pas le signe que quelque chose n’allait pas ? Andrew Smithers parle des inept central bankers, en faisant remarquer qu’il aurait peut-être été intelligent d’avoir à l’époque une régulation globale. Quels que soient les efforts en matière de régulation fine, c’est-à-dire de contrôle des instruments, il reste que, lorsqu’une grande masse d’argent ne va ni à la consommation des ménages ni à l’investissement productif, elle est nécessairement employée à la spéculation. On aura beau inventer tous les systèmes possibles pour interdire l’entrée des casinos, les gens joueront sur le trottoir ! Cette approche quantitative me semble fondamentale.
Nous avons discuté l’autre jour avec M. Touati à propos du ratio de Bâle, anciennement ratio Cooke, qui a eu un effet direct en termes de création d’instruments hors bilan. Au titre du ratio Cooke, il faut avoir, pour cent de créance, sept ou huit de capital propre. Or, une fois que les banques avaient approuvé un produit, on plaçait les cent de créance dans un instrument financier, on faisait appel à des mathématiciens pour calculer le risque grâce à un algorithme que personne ne comprenait, une agence de notation l’évaluait et, une fois l’opération accomplie, on la recommençait en joignant quatre instruments financiers pour en faire un cinquième, un special investment vehicle. De quelle traçabilité dispose-t-on, au terme de cette titrisation en cascade ? J’ai peine à croire qu’une approche régulatrice permettrait un contrôle sérieux, surtout si l’on songe que 10 000 opérations sont réalisées chaque jour.
Je partage votre sentiment sur la responsabilité des banquiers. Mais rappelons-nous ce qui s’est passé quand le Trésor américain, en la personne de M. Paulson, a appelé les grandes banques pour signaler le problème rencontré par AIG. Un mèl a été adressé aux gens de la place pour signaler qu’il manquait quelque 600 milliards de dollars et les priant de se réunir le jour même à 14 heures. Tous ont répondu par l’affirmative, en signalant que le message contenait une faute de frappe : il ne pouvait s’agir, dans leur esprit, que d’un montant de 60 ou de 6 milliards ! Personne n’avait conscience de l’ampleur du désastre.
M. Lorenzi vient de nous rappeler ce qu’il en était des créances irrécouvrables. Sur mon blog, j’ai ironisé à leur sujet, en disant que les montants annoncés étaient très inférieurs à la réalité – on parlait de 80, de 100 ou de 300 milliards de dollars. On avance aujourd’hui le chiffre de 4 000. Nous en serons peut-être demain à 12 000. Personne ne peut connaît précisément l’ampleur des créances irrécouvrables. Que peut-on contrôler en matière de haute fréquence ? Rappelez-vous le krach éclair du 6 mai : Wall Street a chuté de 18 à 20 % parce qu’un algorithme a passé par erreur en vingt minutes des ordres de vente pour plus de 4 milliards. Il a fallu des mois pour comprendre ce qui s’était passé.
M. le président Henri Emmanuelli. Que pensez-vous de ces ordinateurs qui remplacent les traders ?
Mme Nicole El Karoui. Tant pis si ma réponse vous paraît naïve : ces ordinateurs existent. Ils nourrissent des interrogations récurrentes dans le monde de la finance. La puissance des calculateurs augmente de 1,95 % tous les deux ans et la masse investie dans les marchés augmente pratiquement en parallèle. J’ai entendu parler des données haute fréquence dès 1995, quand une petite société essayait de les traiter. C’est souvent par le biais des stages que nous avons été au courant de ce qui se préparait. Les premiers stages avec des données de haute fréquence, destinées au trading pour compte propre, sont apparus entre 2000 et 2002. Où était le régulateur à cette époque ?
J’ai proposé d’associer des techniciens à la veille technologique de la surveillance. Si l’on ne peut pas toujours anticiper, il faut du moins accompagner les développements technologiques.
La finance est devenue le premier utilisateur de temps de calcul, dont une très grande part est consacrée à la surveillance des risques. Le nombre de calculs à opérer pour générer la value at risk à un an sur le risque de contrepartie, que nous venons d’introduire, est faramineux. Au sein d’un établissement pour lequel je fais du conseil, seule une astuce a permis d’éviter d’acheter quelque deux cents ordinateurs, qui, autrement, auraient été nécessaires. Chaque fois qu’on augmente la surveillance, on utilise les opportunités qu’offre l’évolution.
M. le président Henri Emmanuelli. Faut-il une interdiction ?
M. Paul Giacobbi. On peut interdire la haute fréquence.
Mme Nicole El Karoui. Il aurait mieux valu interdire avant que cela ne commence.
M. Paul Giacobbi. Il n’est jamais trop tard pour bien faire. Les promoteurs d’un certain nombre d’algorithmes de haute fréquence ont gagné des milliards de dollars ; qu’est-ce qui empêche d’interdire d’acheter et de vendre plus de cinq cents fois par seconde ? Il y a beaucoup de choses que la technologie permet et qui sont absolument interdites…
Mme Nicole El Karoui. Ma réponse n’est pas qu’il ne faut pas interdire, mais que les ordinateurs existent depuis longtemps.
M. le président Henri Emmanuelli. Nous vous concédons que le réveil est tardif !
Mme Nicole El Karoui. Voyons si d’autres secteurs comportent des risques et appellent une vigilance particulière. On peut imaginer une veille, ce qui suppose de construire une information pertinente permettant au régulateur de définir des limites.
M. le président Henri Emmanuelli. Y a-t-il des spécialistes d’informatique à l’ex-Commission bancaire ? Ce n’est pas certain.
Mme Nicole El Karoui. Quand j’ai rencontré M. Barnier, il y a une quinzaine de jours, il m’a confié que même à Bruxelles, on manquait de scientifiques, car les statuts ne permettent pas d’en recruter. Or les autorités de contrôle doivent disposer de personnel qui connaisse ces risques, et non faire appel à des consultants, qui ont toujours moins d’impact sur les équipes.
M. le président Henri Emmanuelli. Il serait intéressant que vous nous transmettiez vos propositions.
Mme Nicole El Karoui. En voici quelques-unes.
Pourquoi attendre les problèmes pour se préoccuper des risques technologiques ? Les problèmes posés par les données haute fréquence sont-ils spécifiques ou semblables à ceux que pose de manière récurrente l’explosion des moyens de calcul ? La haute fréquence rend l’accès au marché très inégalitaire, puisqu’avec 2 % d’activité de données haute fréquence, on gère une grande partie des transactions. Cela dit, la technologie avancée est toujours inégalitaire. On le mesure d’ailleurs quand on vieillit…
A-t-on réfléchi à la sécurisation des risques informatiques ? La fiabilité de nos systèmes est très inférieure à celle qu’on rencontre par exemple dans l’aviation. Si l’on utilise la haute fréquence, il n’est pas question qu’un bogue de développement puisse anéantir tout un système pendant plusieurs jours. C’est d’ailleurs une question que se posent les banques, car on sait que des bogues se produisent partout.
Enfin, en termes de régulation, on ne pose pas toujours la question de l’échelle temporelle. On travaille en haute fréquence. Les salles de marché fonctionnent à la journée. Le gestionnaire a lui-même une autre unité de temps. Il faudrait une réponse différenciée suivant les cas.
Demain après-midi, une table ronde est organisée à l’Assemblée nationale sur « les apports des sciences et technologies à l’évolution des marchés financiers », ce qui permettra d’aborder la spéculation sous l’angle technique.
M. le président Henri Emmanuelli. Ce qui est en cause est peut-être moins la technologie que l’usage qu’on en fait.
Mme Nicole El Karoui. Oui, mais le fait que ces technologies existent implique que l’on prenne position. Il faut réfléchir dès qu’on les voit apparaître. Moi qui ne suis pas une experte de la haute fréquence, j’en ai entendu parler en 1995. Dès lors qu’on aperçoit des signaux, il y a des gens qui savent ce qu’on en fera. Il ne faut pas penser nécessairement haute fréquence, mais réfléchir globalement à l’impact des nouvelles technologies, à la manière de les gérer et de les prévoir, pour organiser le marché en les prenant en compte.
Au sujet de la haute fréquence, il faut encore poser la question des dark pools, que l’on a créés sans leur fixer de règles de fonctionnement, ce qui laisse la place au dumping et aux flash orders. Dans ces conditions, comment parler de « meilleur prix » ? Il n’y a même plus de prix. Il faut le vérifier en même temps sur dix marchés, mais le marché ne joue même plus son rôle, qui est justement de finir par générer un prix.
Lors du krach du 6 mai, le New York stock exchange (NYSE) a fermé, mais pas les autres places. Or on ne peut pas prendre une initiative ponctuelle sur les marchés financiers sans anticiper, même partiellement, ses conséquences. La création de ces places est peut-être une bonne chose, mais il n’est pas possible de les laisser mener la même activité que les marchés en les dotant de règles de fonctionnement différentes.
M. le président Henri Emmanuelli. Peut-on coter un titre sur plusieurs dark pools ?
Mme Nicole El Karoui. On peut envoyer des ordres sur plusieurs dark pools.
M. le président Henri Emmanuelli. Dans ce cas, on ignore quel est le prix, et a fortiori le meilleur prix ?
Mme Nicole El Karoui. Voilà deux ou trois ans que Charles-Albert Lehalle, qui travaille pour Lyxor, a posé certaines questions : comment gère-t-on les dark pools ? Comment sert-on le client au mieux ? En tout cas, leur existence n’a pas diminué les frais d’exécution pour le client, puisqu’il faut désormais des ordinateurs pour surveiller des données haute fréquence en temps réel sur sept places en même temps. En outre, les lieux d’exécution n’obéissent pas tous aux mêmes règles de fonctionnement. Ces établissements ont recruté à prix d’or des spécialistes qu’ils tradent chez eux. Bref, il existe beaucoup de biais...
M. le président Henri Emmanuelli. Merci infiniment pour cet échange. Nous avons été très honorés de votre présence, étant donné ce que vous représentez dans l’histoire de la finance.
Mme Nicole El Karoui. Il est évidemment un peu curieux que la France soit apparue comme le pays où l’on formait le mieux les ingénieurs quantitatifs en finance.
La finance a recruté beaucoup de jeunes très brillants, dont l’objectif n’était pas nécessairement de gagner des millions, mais qui ont pu être fascinés par les marchés. Moi-même, voilà vingt ans que je les étudie, alors qu’ils ne m’attiraient pas a priori.
M. le président Henri Emmanuelli. Certains secteurs déplorent que les ingénieurs les plus brillants aient déserté les laboratoires pour les salles de marché.
Mme Nicole El Karoui. Pendant les dix années durant lesquelles j’ai enseigné à l’École Polytechnique, on me l’a vivement reproché. Mais que proposait-on aux étudiants dans les autres disciplines ? Ceux qui venaient chez nous ne le faisaient pas sans raison. Nous travaillons sur le high-tech, en mathématiques comme en informatique. Il y a beaucoup à comprendre. Il y a des risques à couvrir. Et je suis certaine qu’il existe aujourd’hui un potentiel humain important à utiliser dans la régulation du système. En tout état de cause, les risques de marché sont beaucoup mieux évalués maintenant qu’il y a vingt ans.
M. le président Henri Emmanuelli. Merci encore.
L’audition s’achève à dix huit heures quarante cinq.
Audition de M. Bertrand Jacquillat, professeur à l’Institut d’études politiques de Paris, président directeur général et cofondateur d'Associés en Finance
(Procès-verbal de la séance du mercredi 20 octobre 2010)
(Présidence de M. Henri Emmanuelli, président de la commission d’enquête)
La séance est ouverte à seize heures trente
M. le président Henri Emmanuelli. Monsieur le professeur, je vous remercie d’avoir répondu à l’invitation de la commission d’enquête.
Nous observons aujourd'hui une financiarisation accrue de l’économie, en particulier un développement surprenant de la titrisation. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de la spéculation financière et ce que vous préconiseriez pour la maîtriser, étant entendu que la commission d’enquête ne peut s’en tenir à un simple diagnostic.
Comme vous êtes professeur à Sciences Po, président directeur général d’Associés en Finance et spécialiste du high frequency trading ou HFT, nous souhaiterions connaître votre point de vue sur cette technique, qui nous intrigue, sur les produits dérivés en général et sur la façon dont on peut organiser leur supervision.
(M. Bertrand Jacquillat prête serment.)
M. Bertrand Jacquillat, professeur à l’Institut d’études politiques de Paris, président directeur général et cofondateur d’Associés en finance. Pour traiter du sujet qui vous occupe, il faut commencer par se demander ce qu’est un spéculateur.
La question de l’impact de la spéculation sur les économies, c’est-à-dire de ses effets éventuellement déstabilisants, n’est pas nouvelle. Ce vieux débat, qu’il est difficile de trancher, a notamment opposé, dans la littérature économique, Nicholas Kaldor qui en 1930, dans son article Speculation and Economic Stability, affirmait que la spéculation avait des effets déstabilisateurs et Milton Friedman qui, trente ans plus tard, dans un article intitulé In Defence of Stabilizing Speculation, prenait la position inverse.
Vous vous interrogez aussi, vous l’avez dit, sur la financiarisation de l’économie. Sur ce thème, je me souviens d’un article paru dans Le Monde en 1987 sous la plume d’un jeune journaliste qui s’est fait connaître par la suite, Éric Izraelewicz, et dont le titre était « L’industrie malade de la finance ». Reprocher à la finance de ne pas faire ce pour quoi elle est faite, c'est-à-dire la distribution de crédit aux entreprises, et de jouer au casino ne date pas d’hier. Là encore, il y avait eu un controverse dans les années vingt ou trente, opposant deux universitaires de Cambridge. L’une, Joan Robinson, amie de Keynes, était en Angleterre et écrivait : « When industry leads, finance follows. » – « l’industrie commande, la finance suit. » Elle considérait donc que la finance n’est destinée qu’à mettre de l’huile dans les rouages de l’économie. L’autre, outre-Atlantique – à Harvard –, Schumpeter, affirmait que les services rendus par les intermédiaires financiers sont essentiels pour provoquer, faciliter, accompagner les innovations technologiques et le développement économique.
Plus récemment, Jean-Marie Chevalier, un de mes collègues à Dauphine, spécialiste de l’énergie, a rédigé à la demande de Mme Lagarde un rapport examinant les effets déstabilisants de la spéculation sur le prix du pétrole. Il en a également cosigné un avec trois autres économistes du Conseil d’analyse économique, intitulé « Les effets d’un prix du pétrole élevé et volatil », qui vient d’être publié et qui, malgré la disposition d’esprit de ses auteurs, ne parvient pas à démontrer que les marchés à terme – financiers, donc – des produits pétroliers accroissent la volatilité des prix. Beaucoup d’études pousseraient à conclure que ce n’est pas le cas. Bref, le sujet est difficile et le débat n’est pas tranché.
Pour cerner le phénomène de la spéculation, on peut s’intéresser au fonctionnement et au rôle de certaines organisations ou mécanismes du système financier qu’on pense propices à la spéculation, ou qui permettent aux anticipations d’être formulées aisément. Spéculer est en effet un terme particulièrement ambigu – on parle par exemple de spéculations intellectuelles ; spéculer, c’est essayer d’anticiper l’avenir : un épargnant qui achète des actions ne le fait pas dans l’idée qu’elles vont baisser. Tout le monde est donc peu ou prou spéculateur, financièrement ou intellectuellement.
Trois cas ont été au cœur des discussions sur la régulation financière : les marchés à terme ; les ventes à découvert, qui ont été interdites au second semestre ou au dernier trimestre de l’année 2008, dans trente pays dont la France ; les hedge funds – que, même avant la crise, un ministre des finances allemand comparait à des criquets qui dévorent l’économie.
S’agissant des marchés à terme, je vous renvoie aux bons auteurs. Voici ce qu’écrivait Proudhon en 1847 dans son Manuel du spéculateur : « Pour interdire les marchés à terme, il faudrait arrêter les oscillations de l’offre et de la demande, c'est-à-dire garantir à la fois au commerce la production, la qualité, le placement et l’invariabilité du prix des choses ; annuler toutes les conditions aléatoires de la production, de la circulation et de la consommation des richesses ; en un mot, supprimer toutes les causes qui excitent l’esprit d’entreprise : chose impossible, contradictoire. L’abus est donc indissolublement lié au principe, à telle enseigne que, pour atteindre l’abus, par toutes voies de prévention, coercition, répression, interdiction, exception, on fait violence au principe ; pour se guérir de la maladie, on se tue. » J’ai choisi un auteur qui n’était pas de mon bord… Mais je ne suis pas aussi inquiet que vous, monsieur le président, sur les effets de la spéculation.
En ce qui concerne les ventes à découvert, je prendrai l’exemple de Michelin, qui a 150 millions de titres en circulation et qui vient de réaliser une augmentation de capital. À la suite de l’annonce de l’opération, le titre a chuté de près de 10 %. Après enquête, il est apparu que, aussitôt la nouvelle connue, 40 millions de titres avaient fait l’objet de ventes à découvert. Finalement, les vendeurs à découvert se sont brûlé les doigts puisque le cours est aujourd'hui légèrement supérieur à ce qu’il était avant l’annonce.
Les ventes à découvert ont été particulièrement vilipendées au moment de la crise grecque. Là non plus, rien de nouveau. Le comte Mollien, ministre des finances de Bonaparte, rapporte dans ses Mémoires d’un ministre du Trésor public les propos que tenait Bonaparte en 1799 : « Je me demande si l’homme qui offre de livrer dans un mois à 38 francs des rentes à 5 % qui se vendent aujourd’hui à 40, ne proclame pas et ne prépare pas le discrédit, s’il n’annonce pas que, personnellement, il n’a pas confiance dans le gouvernement et si le gouvernement ne doit pas regarder comme son ennemi celui qui se déclare tel lui-même. » Ces propos entrent en résonance avec ceux tenus en 2010 par certains chefs de gouvernement des pays de la zone euro à l’encontre des vendeurs à découvert de la dette souveraine des États.
Quant au président de la Security Exchange Commission, la SEC, voici comment il justifiait la décision d’interdire, de juillet à décembre 2008, les ventes à découvert de titres d’institutions financières américaines : « Ces restrictions ont été prises dans l’intérêt public et pour la protection des investisseurs, pour qu’ils puissent disposer de marchés d’actions équitables et ordonnés, et pour éviter de substantielles perturbations des marchés ». Mais au moment de la levée de l’interdiction, il déclarait : « Connaissant tout ce que nous connaissons maintenant, je pense que, tout bien pesé, la SEC n’aurait pas dû interdire les ventes à découvert. Les coûts des restrictions de celles-ci sur les valeurs financières semblent supérieurs à leurs avantages. »
Il y a donc toujours débat sur les ventes à découvert. Il y a eu des excès, souvent dus non à l’action des spéculateurs, qui jouent leur rôle, mais à l’opacité des bourses. Ainsi en 2009, lors de la tentative d’OPA de Porsche sur Volkswagen – qui aboutit aujourd’hui à la situation inverse –, Volkswagen est devenue, l’espace de quelques heures, la plus grosse capitalisation boursière mondiale. Le flottant sur le marché n’était que de 30 % du capital et on ignorait que Porsche avait acquis des options d’achat sur cette part ; si bien que, quand les vendeurs à découvert ont voulu acquérir les titres pour les livrer, les prix ont grimpé mécaniquement. La Bourse de Francfort a réglé le problème, mais celui-ci ne tenait pas tant à la spéculation qu’à l’absence, à l’époque, de règles de franchissement de seuil sur les marchés d’options. Depuis, elles ont été instaurées. Parmi les mesures qui pourraient être prises pour tenter d’immuniser l’économie contre les excès évidents de la spéculation, figurent toutes celles qui contribuent à l’information et à la transparence.
Autre exemple : à Tokyo, le 8 décembre 2005, le courtier Mizuho, par erreur, procède à la vente à découvert de 607 000 titres de la société JCom, récemment introduite en bourse avec un flottant de 14 500 titres. Il s’agit là encore d’un défaut de contrôle des bourses qui ne justifie pas d’interdire les ventes à découvert, dont toutes les études montrent qu’elles améliorent la liquidité, qu’elles permettent de détecter les sociétés voyous telles qu’Enron et de faire converger les prix des titres vers leur valeur fondamentale.
J’en arrive aux hedge funds.
Ce sont en quelque sorte des SICAV, avec beaucoup moins de contraintes – parce qu’ils ne s’adressent pas à l’épargne publique, le nombre d’investisseurs étant inférieur à 200. Ils peuvent vendre à découvert, intervenir sur les marchés d’options ou de futures... Steve Ross, professeur au MIT, emploie à propos de l’efficience des marchés une autre image que celle de la « main invisible » qui, selon Hayek, ferait converger les prix vers la valeur fondamentale : il compare les noise traders, qui par leur comportement polluent les prix, à des milliers de « brebis erratiques, peu informées, peu rationnelles » achetant et vendant un peu au hasard en Bourse ; ce qui fait la justesse des prix, ce n’est pas le fait que les brebis, sous l’effet d’une inspiration collective, restent dans le droit chemin – et se substituent à la machine à calculer géante de Hayek –, mais le fait que les loups sautent sur les brebis quand elles s’écartent trop du chemin. D’après les calculs de Steve Ross, le rapport entre les profits dégagés par tous les hedge funds qui investissent dans les marchés d’actions et la capitalisation boursière des sociétés cotées aux États-Unis n’est que de 1 %. Les hedge funds ont une utilité parce qu’ils sont les loups qui sautent sur les brebis ; ils sont les seuls à s’efforcer de détecter, dans la limite de leurs règles de fonctionnement, les écarts de prix par rapport à ce que seraient les valeurs fondamentales.
Venons-en maintenant à l’énorme déséquilibre que l’on constate entre les transactions sur les produits physiques et les transactions sur les produits financiers ayant pour sous-jacent ces produits physiques, le rapport allant de 1 à 40 ou 100, voire 1 000 dans certaines circonstances. On pense en particulier au rapport entre le volume du commerce mondial et celui des transactions sur les marchés des changes, ou encore au rapport entre le stock de dettes souveraines, quel que soit l’émetteur et quelles que soient les maturités, et les transactions sur le marché à terme d’instruments financiers.
C’est une réalité évidemment troublante. Mais il faut comprendre qu’il y a beaucoup de transactions d’arbitrage. On peut construire un bon du Trésor synthétique en achetant une option de vente sur Pernod-Ricard, en vendant une option d’achat sur Pernod-Ricard et en achetant des titres Pernod-Ricard, afin de constituer un portefeuille sans risque. Les arbitragistes vont ainsi construire des produits répliquant les bons du Trésor mais rapportant un taux légèrement supérieur à celui auquel ils se financent. Ces constructions financières sont extrêmement nombreuses et, même si elles peuvent paraître inutiles, conduisent à une situation d’équilibre entre les prix.
L’importance des transactions financières par rapport aux transactions physiques peut, par ailleurs, faire craindre un risque systémique. Cela nous amène à la question des systèmes de contrôle – lequel ne peut cependant pas porter sur les opérations de gré à gré. Malgré l’affaire Kerviel – il y en a eu d’autres –, on peut dire que les choses se passent plutôt bien. Les systèmes de contrôle au sein des intermédiaires financiers ont été considérablement renforcés depuis la crise et depuis cette affaire. Mais on ne peut jamais tout comprendre : comme me le disait un collègue de Los Angeles, on prend l’avion sans savoir exactement comment fonctionne son moteur, en faisant confiance aux fabricants et aux pilotes.
Enfin, il est désormais patent que le krach d’octobre 1987 – la plus forte baisse enregistrée dans l’histoire des bourses, aussi bien en Asie qu’aux États-Unis et en Europe, puisque la chute a été de plus de 20 % en une seule journée, sans raison apparente – était un dérèglement financier dû à des techniques de gestion de portefeuille parfaitement légales, qu’on appelait autrefois l’assurance de portefeuille ou la gestion garantie, laquelle rétroagit sur les prix. Certains modèles vont ainsi à l’encontre de l’idée selon laquelle on achète ce qui est bon marché et on vend ce qui est cher : ils tendent au contraire à renforcer les positions en actifs risqués au fur et à mesure que leurs prix montent et, lorsque ces prix baissent, à augmenter la part des bons du Trésor. Si, comme c’était le cas en 1987, ces techniques ne sont pas connues, les autres opérateurs pensent que le mouvement résulte d’informations qu’ils ignorent et, par imitation, l’amplifient. De la même façon, dans les banques, les modèles de prévention des risques, dits value at risk, sont procycliques : ils conduisent, quand le prix des actifs risqués monte, à s’endetter pour continuer à acheter ; mais quand le mouvement s’inverse, des problèmes de liquidités apparaissent.
En conclusion, je voudrais vous lire un extrait de L’Argent d’Émile Zola. Saccard a fait acheter à Hamelin des actions, ce dont la sœur du second, Caroline, se plaint. Saccard répond : « - Oui, la spéculation. Pourquoi ce mot vous fait-il peur ?... Mais la spéculation, c’est l’appât même de la vie, c’est l’éternel désir qui force à lutter et à vivre… » Et Zola poursuit : « Puis il osa tout de même, volontiers brutal devant les femmes : « Voyons, pensez-vous que, sans…comment dirai-je ? sans la luxure, on ferait beaucoup d’enfants ? Sur cent enfants qu’on manque de faire, il arrive qu’on en fabrique un à peine. C’est l’excès qui amène le nécessaire, n’est-ce pas ? […] Eh bien, sans la spéculation, on ne ferait pas d’affaires, ma chère amie ! ».
M. le président Henri Emmanuelli. Que pensez-vous du HFT ? D’après ce que nous avons compris, cette technique représenterait une partie non négligeable du profit des salles de marché, et elle serait en forte croissance. Or le 6 mai à Wall Street, l’erreur d’un courtier a entraîné une baisse de 10 % et il a fallu six mois pour comprendre ce qui s’était passé. La firme à l’origine de l’opération n’avait pas les moyens de contrôler ce qu’elle avait déclenché. Faut-il autoriser ou interdire ce système ?
M. Bertrand Jacquillat. Ce que l’on appelle l’algorithmic trading consiste à effectuer des transactions à partir de programmes informatiques qui, sur la base de modèles très complexes, détectent des anomalies de valorisation, lesquelles entraînent des ordres d’achat – d’une valeur sous-évaluée – et de vente – d’une valeur surévaluée. D’après ce que je lis dans la presse, cela représenterait au moins 50 % des transactions aux États-Unis, et sans doute de l’ordre de 30 % en Europe. Je ne vois pas pourquoi on interdirait une méthode de gestion qui, en elle-même, ne met pas en péril le système. Si ces opérations représentent un risque systémique, il faut bien entendu intervenir ; mais je ne vois pas d’obstacle à ce que certains, pour leurs opérations d’achat et de vente, préfèrent se fier à des programmes informatiques sophistiqués plutôt qu’aux études de Value Line.
Les choses se sont compliquées avec la directive européenne MIF, qui a son équivalent aux États-Unis. Les bourses traditionnelles ont ainsi perdu des parts de marché considérables au profit des nouveaux entrants – BATS, Chi-X, Turquoise… – sans parler du problème des dark pools. Ces plateformes alternatives sont ce que l’on appelle en économie des passagers clandestins : elles offrent à moindres frais des services équivalents à ceux des opérateurs historiques, sur les infrastructures desquels elles se greffent sans avoir à en supporter le coût. NYSE Euronext a riposté – cela a d’ailleurs fait scandale il y a quelques mois – en déplaçant ses systèmes informatiques à Londres, pour se rapprocher des opérateurs qui s’adonnent, plus qu’en France, au HFT et gagner ainsi quelques microsecondes, tout en permettant aux opérateurs d’avoir accès à ses ordinateurs. Plus que les dangers du HFT lui-même, les problèmes me paraissent être l’organisation du marché et celle de la concurrence – puisqu’on offre à des acteurs importants, qui sont toujours des institutionnels, la possibilité d’accéder aux informations avant les autres, à commencer par les personnes physiques.
En ce qui concerne le 6 mai, je n’ai pas encore compris ce qui s’est passé exactement. Je pense qu’il y a eu une conjonction de facteurs. Déjà, on a mis longtemps à comprendre que le krach de 1987 avait été provoqué par l’utilisation de techniques tout à fait nouvelles, affectant les cours d’une façon inexplicable aux yeux des autres opérateurs, lesquels ont réagi en adoptant des comportements moutonniers. L’accident du 6 mai n’a pas été extrêmement grave, mais il l’est néanmoins quant à ses conséquences. Comme à propos des problèmes de concurrence que j’évoquais à l’instant, les autorités de régulation craignent que les épargnants s’éloignent des bourses, pourtant faites pour les rapprocher de ceux qui ont des besoins de financement.
M. le président Henri Emmanuelli. Dans l’affaire du 6 mai, plusieurs milliards de dollars sont partis en fumée. Au bout de la chaîne, il y a bien quelqu’un qui a fait les frais de l’opération, même si des annulations sont intervenues pour limiter la casse. Peut-on laisser des machines faire courir un risque systémique de cette ampleur ?
M. Bertrand Jacquillat. On ne peut pas revenir sur l’utilisation de l’informatique, qui est un fait. Par ailleurs, l’accident du 6 mai ne relève pas à mes yeux du risque systémique. En revanche, j’insiste sur le risque grave de désaffection de l’épargnant de base, de plus en plus convaincu que les bourses et les marchés financiers sont désormais l’affaire des professionnels.
M. le président Henri Emmanuelli. Mme El Karoui nous a expliqué que les organismes chargés de la supervision étaient incapables de contrôler.
M. Bertrand Jacquillat. Tous les organismes de régulation américains ont failli. Ils ont été des acteurs importants de la crise.
M. le président Henri Emmanuelli. Et on ne s’est pas aperçu que les liquidités augmentaient de 15 % par an…
M. Bertrand Jacquillat. Je vous renvoie au comte Mollien. Qu’on le veuille ou non, il y a une sorte de confrontation entre les marchés d’un côté et les États de l’autre.
M. le président Henri Emmanuelli. Nous venons de vivre une crise grave qui aura des conséquences lourdes, y compris sur le plan social, et pendant longtemps. Le rôle des acteurs publics est d’essayer de faire en sorte que cela ne se reproduise pas… Que préconisez-vous ?
M. Jean-François Mancel, rapporteur. Peut-on définir la « mauvaise » spéculation, la détecter sur les marchés, l’anticiper pour l’éviter ?
Pour vous, les régulateurs ont-ils accompli leur mission ? Les réformes annoncées leur apporteront-elles les moyens de mieux l’exercer ?
Que pensez-vous du passeport européen à destination des hedge funds ?
M. Bertrand Jacquillat. Les régulateurs n’ont pas fait leur travail. La crise vient des Etats-Unis, du marché immobilier et d’une organisation bancaire qui avait profondément changé de modèle : d’un système dans lequel la banque conservait dans ses livres le crédit consenti après une enquête approfondie sur la solvabilité de l’emprunteur, et veillait à son suivi, on avait basculé dans celui de la titrisation, où plus personne n’était responsable. Il a donc été décidé d’obliger les banques à garder dans leurs livres un certain pourcentage des crédits qu’elles accordent, de façon à les inciter à être plus vigilantes. Quand tous les intervenants touchaient leur commission avant de se débarrasser des titres, on croyait que le risque avait disparu ; mais il est revenu en boomerang sur les banques, que le rapatriement de leurs mauvaises créances a souvent menées au bord de la faillite.
La crise américaine a également révélé le comportement de Freddie Mac et Fannie Mae, qui concentraient 60 % des crédits immobiliers et les titrisaient sans faire le moins du monde attention à la qualité des emprunteurs – les fameux NINJA, no income, no job or asset – que l’on aidait même à tricher pour qu’ils obtiennent leurs crédits. Il y a là une faillite de la régulation, mais aussi du système d’incitation, dont tout le monde pâtit encore. L’origine, spécifiquement américaine, vient de l’idéologie dominante aussi bien chez les Républicains que chez les Démocrates, selon laquelle l’accès à la propriété est un droit pour tout Américain.
M. le président Henri Emmanuelli. Concrètement, cela signifie qu’il faut mettre des limites à la titrisation.
M. Bertrand Jacquillat. La titrisation est une bonne chose pourvu que le système contienne des incitations à ne pas faire n’importe quoi. On peut titriser toutes sortes de crédits, mais à condition que les organismes prêteurs en gardent une partie suffisante dans leurs livres pour que, en cas de défaut de l’emprunteur, ils en pâtissent.
M. le président Henri Emmanuelli. Et pourquoi seulement une partie ?
M. Bertrand Jacquillat. Parce que la titrisation a des mérites.
M. le président Henri Emmanuelli. On peut en tout cas s’interroger sur le pourcentage…
Traditionnellement, le rôle du banquier est de mesurer et prendre des risques ; il est rémunéré pour cela. À partir du moment où il est rémunéré sans garder la responsabilité du risque pris, le système ne peut que disjoncter. Que faut-il faire ?
M. Bertrand Jacquillat. La titrisation, dont je répète qu’elle a des mérites, ne doit pas faire disparaître les incitations. Je ne sais pas si le pourcentage à retenir est 5, 10, 15 ou 20 %, mais il faut faire en sorte que la banque ait intérêt à examiner les dossiers de crédit et à les suivre.
Mme Élisabeth Guigou. Nous avons tous le même souci : éviter que tout recommence comme avant. Nos démocraties n’y résisteraient pas. La dernière fois, les gouvernements avaient les moyens de payer. La prochaine fois, ils ne les auront plus. À voir monter les populismes, les nationalismes et les extrémismes en Europe, nous avons de quoi être très inquiets, d’autant plus que chaque fois que nous rencontrons des spécialistes, nous découvrons que, depuis le déclenchement de la crise en août 2007, il n’y a eu quasiment aucun progrès. Le texte européen sur les hedge funds revient à accorder une bénédiction aux paradis fiscaux, dont on nous avait dit, lors d’un G20, qu’ils avaient disparu. Bâle III a certes introduit certaines régulations, mais elles n’entreront en vigueur que dans quelques années. Et surtout, à quoi bon des règles nouvelles si l’opacité et la fragmentation demeurent ? Comment réintroduire de la transparence et assurer une certaine globalité du contrôle et de la régulation, afin d’assurer, sans empêcher des activités permettant de se couvrir contre les risques, une visibilité sur le risque pris ?
M. Bertrand Jacquillat. Il est nécessaire de renforcer les infrastructures de marché. Beaucoup de transactions, les opérations OTC – over the counter –, sont conclues de gré à gré. À propos des CDS, dont l’encours atteignait 60 000 milliards de dollars au moment de la faillite de Lehman Brothers, j’avais recommandé dans un article que ces transactions de gré à gré passent par les marchés organisés. Cela permettrait que des chambres de compensation centralisent les risques, ce qui accroîtrait la sécurité du système. Cela va prendre du temps, mais le processus est en marche.
M. le président Henri Emmanuelli. Pourquoi faut-il du temps ?
M. Bertrand Jacquillat. Parce qu’il y a un lobby bancaire puissant et que les banques y sont très hostiles, les opérations de gré à gré leur rapportant beaucoup plus ; et parce qu’il y a des conflits de nationalité : les Américains voudraient que la chambre de compensation mondiale soit aux Etats-Unis, en Europe les Anglais de la City s’opposent aux continentaux…
M. le président Henri Emmanuelli. Les difficultés sont donc politiques.
M. Bertrand Jacquillat. Elles sont aussi techniques car tout ne peut pas passer par les marchés organisés. Si une entreprise veut acheter une option sur le dollar, à une échéance très précise, correspondant à une transaction physique particulière, elle s’adresse à une banque parce qu’il lui faut du sur-mesure, ce que procure le gré à gré, à charge pour la banque de se couvrir sur les marchés organisés. Mais parmi les transactions de gré à gré, beaucoup ne sont pas du sur-mesure et pourraient passer par les marchés organisés ; dans ce cas, le frein est politique.
M. le président Henri Emmanuelli. Pourquoi tout ne passerait-il pas par un marché organisé ?
M. Bertrand Jacquillat. Pour qu’un marché organisé fonctionne, il faut qu’il soit liquide, ce qui suppose que les produits soient relativement standardisés.
M. le président Henri Emmanuelli. À l’époque où les produits étaient très standardisés, nous avions 6 % de croissance par an, alors que depuis l’avènement du sur-mesure, on patine à 1,5 % ou 2 %...
M. Bertrand Jacquillat. C’était à la fin des Trente glorieuses… Le monde a changé. Vous établissez une relation de cause à effet entre la prospérité de cette époque et la simplicité d’un système centralisé et très contrôlé, mais corrélation ne veut pas dire causalité.
M. le président Henri Emmanuelli. En tout cas, l’organisation n’a pas été un frein à la croissance.
Nous vous remercions de votre contribution à nos travaux.
L’audition s’achève à dix sept heures ving cinq.
*
* *
Audition de M. Bernard Spitz, président de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), accompagné de M. Jean-François Lequoy, délégué général
(Procès-verbal de la séance du mercredi 27 octobre 2010)
(Présidence de M. Henri Emmanuelli, président de la commission d’enquête)
La séance est ouverte à seize heures quarante-cinq
M. le président Henri Emmanuelli. Monsieur le président Bernard Spitz, je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation. Vous assurez depuis deux ans la présidence de la Fédération française des sociétés d’assurances. La spéculation ne revêt sans doute pas les mêmes formes dans votre secteur que dans celui des banques, ne serait-ce que parce qu’il est soumis à une réglementation différente, mais nous avons tous en tête l’exemple d’AIG. Avez-vous le sentiment que certains ont pu franchir la ligne jaune ? Quels sont les dispositifs que vous souhaiteriez voir mis en place pour diminuer le risque systémique et sécuriser l’ensemble des opérations ?
(M. Bernard Spitz prête serment.)
M. Bernard Spitz, président de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA). En tant que président de la FFSA, je m’en tiendrai aux liens entre les activités spéculatives et le secteur des assurances, en tant que secteur financier spécifique, obéissant à un modèle économique et à une logique de gestion qui lui sont propres.
Si je devais définir la spéculation, je dirais qu’il s’agit d’opérations financières réalisées dans le but de maximiser un profit à court terme, sans considération des conséquences négatives susceptibles de peser sur le reste des acteurs économiques et de la société.
Les activités spéculatives, rendues possibles par l’absence ou par l’inefficacité de la régulation, procèdent d’une logique d’arbitrage, et visent à exploiter les opportunités immédiates de marché et à tirer parti de la volatilité, volatilité qu’elles peuvent d’ailleurs contribuer à créer. Elles reposent sur des techniques et des produits complexes, dont l’utilisation est facilitée par l’informatisation, par la possibilité d’intervenir massivement sur le marché et par l’existence de zones grises de la régulation.
Ces mécanismes sont totalement étrangers au métier d’assureur, qui repose sur la couverture d’engagements longs, sur la maîtrise du risque et, en France, sur un environnement réglementaire efficace. Le comportement des assureurs lors de la crise financière de 2007-2010 l’a démontré.
L’année 2008 a été marquée par des dépréciations très importantes des actifs financiers : les opérateurs court-termistes ont suivi un même mouvement en vendant leurs actifs, entretenant et aggravant le mouvement baissier. Au lieu de se désengager massivement, les assureurs français, pour leur part, ont conservé leurs portefeuilles d’actions, qui représentent environ 18 % de leurs actifs. De la même manière, ils ont continué à souscrire massivement aux émissions obligataires des entreprises et ont maintenu globalement stable la part d’obligations d’État non françaises. Loin de chercher à tirer parti de la situation, le monde de l’assurance a donc observé un comportement contracyclique et joué in fine un rôle de stabilisateur.
Le modèle économique assurantiel ignore la logique de maximisation à court terme, car les engagements auprès des assurés sont pris à long terme. La gestion des encours financiers, même si elle nécessite des arbitrages, est à horizon lointain : tout ce qui contribue à des activités spéculatives va à l’encontre de l’intérêt même des assureurs. Victimes des mouvements spéculatifs au travers de la baisse de leurs actifs, les assureurs ont, par ailleurs, en matière de marché obligataire, un intérêt évident à la stabilité du système. Enfin, la maîtrise du risque est au cœur même du métier d’assureur : un bon professionnel veillera à éviter tout placement aventureux.
La réglementation et la régulation du secteur sont cohérentes avec ce modèle économique. La régulation garantit aux assurés que la gestion des actifs respecte la logique de long terme : les stratégies d’allocation d’actifs des compagnies d’assurance sont strictement encadrées par le code des assurances, qui édicte toute une série de règles contraignantes en termes de diversification des placements et d’adéquation de ces placements en représentation des engagements pris par les assureurs. Ainsi, les articles R. 332-1 et suivants établissent le principe de congruence monétaire : un engagement en euros doit être représenté par des actifs en euros. L’article R. 332-2 énumère limitativement les actifs – actions, obligations – admis en représentation des engagements réglementés. L’article R 332-3 détermine des seuils maxima de détention par classe d’actifs, très bas pour les actifs risqués. L’exigence légale d’adéquation entre actifs et passifs oblige les compagnies d’assurance à procéder en permanence et de manière très précise à l’évaluation de leurs risques financiers. Enfin, l’utilisation de produits dérivés est très encadrée et limitée à la seule couverture des risques financiers.
M. le président Henri Emmanuelli. Y a-t-il une limite en pourcentage des actifs pour les produits dérivés ?
M. Jean-François Lequoy, directeur général de la FFSA. Les produits dérivés ne peuvent être détenus que dans l’optique de couverture d’un risque – hausse ou baisse des taux, défaut de crédit. Ils ne sont pas admis en représentation des engagements réglementés, ce qui en limite de facto l’utilisation.
M. Bernard Spitz. Issue au début de cette année de la fusion de la Commission bancaire et de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) exerce un contrôle sur pièces et sur place tout à fait efficace. Elle peut prendre des mesures de police administrative coercitives lorsque la solvabilité d’un assureur, ou l’intérêt des assurés, se trouve compromis. Durant la crise financière, l’ACAM a conduit des enquêtes ciblées ou générales sur les placements des assureurs et sur le comportement des assurés : cela a permis de constater la stabilité des portefeuilles et la confiance des assurés dans l’assurance-vie, un produit qu’ils jugent simple et accessible.
Aucune société d’assurance française n’a fait défaut lors de la crise financière car l’exposition aux produits risqués est demeurée très marginale. Vous avez évoqué le cas d’AIG, une compagnie américaine qui a voulu développer des activités purement bancaires et spéculatives à Londres, sur les mauvais marchés et au mauvais moment, prenant des risques considérables. De l’avis général des observateurs, l’existence d’AIG n’aurait pas été compromise si la société s’en était tenue à la stricte activité d’assurance. Et aux Pays-Bas, ce sont les filiales d’assurance des banques qui se sont trouvées en difficulté.
Certes, les assureurs ont été affectés par la crise, puisque certains de leurs actifs ont été touchés, mais ces difficultés n’ont pas remis en cause la solidité du secteur, ni même d’aucune société prise individuellement. Aucun euro public – c’est notre fierté – n’a été dépensé pour notre secteur.
Dépassant les leçons de la crise financière de 2008 et de l’épisode grec, on peut considérer que l’assurance n’est pas porteuse de risques financiers systémiques. Son modèle économique et ses méthodes de gestion financière la tiennent à l’écart de ceux-ci et même lui permettent d’exercer un rôle stabilisateur, à la fois dans la sphère financière et dans celle de l’économie réelle, en contribuant à lisser les fluctuations de marché.
Jean-François Lepetit, dans son rapport sur le risque systémique paru en avril, constate que « les assureurs conduisent à l’actif une stratégie d’investissement de long terme pouvant jouer un rôle contracyclique dans le secteur financier » et que « peu sensibles aux variations de court terme des marchés, [ils] jouent en principe un rôle d’absorbeur de chocs. ». Et de conclure : « Cela ne veut pas dire que les assureurs sont protégés des chocs, mais par construction leur business model ne les conduit pas à prendre des positions spéculatives risquées ».
En augmentant pendant la crise, contre toute attente, la part de leurs 1 600 milliards d’actifs investie dans les entreprises – celle-ci est passée de 51 % à 54 %, répartie entre un tiers d’actions et deux tiers d’obligations –, les assureurs ont joué un rôle d’amortisseur pour l’économie réelle. L’autre part des actifs est très majoritairement destinée à financer la dette de l’État, et a donc également un effet stabilisateur. En outre, le fait qu’il s’agisse d’une épargne nationale est perçu très positivement par les marchés.
Ce modèle, toutefois, est menacé. En premier lieu, la pression fiscale s’accentue, faisant porter au secteur un fardeau sans relation avec son poids économique, et bien supérieur à l’effort demandé aux banques, par exemple. Plus de 5 milliards sont prélevés sur les compagnies d’assurances, dont 1,7 milliard au titre de la taxe sur la réserve de capitalisation, laquelle revient à priver les assureurs d’une partie de leurs fonds propres. Cette décision les lèse gravement vis-à-vis de leurs concurrents européens, au moment même où la directive Solvency II vise à élever le niveau d’exigence en matière de fonds propres.
La deuxième menace vient précisément de Solvency II, mais aussi de l’adoption des normes comptables IFRS, qui risquent d’avoir des effets procycliques. La méthode de la juste valeur (fair value) est contraire à notre logique de long terme, puisque les actifs doivent être valorisés à leur valeur de marché à la date de clôture du bilan. Cette réforme aura pour conséquence d’introduire davantage de volatilité dans les résultats des assureurs. Qui sait si ceux-ci, pour compenser cette volatilité, ne s’exposeront pas à des risques de marché en prenant des produits de couverture ?
Chacun des acteurs du secteur financier a une spécificité. Les assurances visent à apporter une sécurité en prenant des engagements auprès des assurés selon une logique de long terme. Tout ce qui concourt à fragiliser ces engagements est contraire à la culture assurantielle et prohibé par le droit de l’assurance. Les assureurs ne sont donc pas responsables de la spéculation. Ils en sont les témoins, et souvent les victimes.
M. le président Henri Emmanuelli. Précisément, la discipline de fer à laquelle vous êtes astreint devrait vous permettre de promener un regard plus libre sur la spéculation.
M. Bernard Spitz. Les assureurs français ont été touchés par des produits toxiques parce que les réglementations étrangères n’étaient pas adaptées et parce que les agences de notation ont classé AAA des produits qui ne méritaient pas de l’être. Cela étant, leur degré d’exposition est peu élevé.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. Le secteur des assurances n’a donc pris aucune part dans cette crise ; il en serait seulement la victime, dites-vous. Pensez-vous que les dispositifs récemment mis en place ou annoncés sont adéquats ? Pouvez-vous nous en dire davantage sur la directive Solvabilité II, qui a été conçue pour des systèmes bien moins contrôlés et bien moins sûrs que le système français ?
M. Bernard Spitz. La directive, qui devrait s’appliquer à partir de 2013, comporte un grand nombre de dispositions, dont certaines sont très positives. Mais elle comporte aussi des risques, à commencer par celui d’une asymétrie entre les intérêts des différents acteurs européens – ainsi, les fonds de pension anglais ont été exclus de son champ. Les assureurs français, du fait de l’histoire et de la structuration de l’épargne nationale, seront davantage touchés que d’autres par les exigences posées en matière de fonds propres, s’agissant des actions, jugées potentiellement plus volatiles que d’autres actifs. Ils devront réévaluer leur portefeuille d’actifs, ce qui ne leur permettra plus de jouer leur rôle naturel d’investisseurs à long terme dans l’économie.
M. le président Henri Emmanuelli. Mais ces dispositions n’auront pas pour effet de diminuer l’investissement global des assureurs ?
M. Bernard Spitz. Il nous faudra mobiliser davantage de fonds propres, ce qui coûte cher. De plus, les assureurs seront tentés, avec l’adoption des normes IFRS et de la méthode de la juste valeur, de se détourner des actions ou de les vendre, ce qui accentuera l’effet procyclique.
M. le président Henri Emmanuelli. Les contrats d’assurance-vie en unités de compte n’ont-ils pas subi d’importantes dépréciations pendant la crise ?
M. Jean-François Lequoy. Leur valeur dépend de l’évolution des marchés. Comme les unités de compte sont assez composites – actions, obligations, un peu de monétaire –, le recul moyen de leur valeur en 2008 n’a été que de 24 %, quand, dans le même temps, le CAC baissait de 42 %.
M. le président Henri Emmanuelli. Il s’agit d’une moyenne, certains de ces contrats ont perdu plus de 50 % !
M. Bernard Spitz. Leurs détenteurs – des investisseurs souvent avisés – avaient accepté en connaissance de cause des produits à risque, mais avec des rendements plus élevés. Cela étant, nous avons observé ces deux dernières années un phénomène de basculement massif vers les contrats en euros.
M. Louis Giscard d’Estaing. Les contrats en unités de compte avaient déjà connu une baisse de leur valeur dans les années 2000, lors de l’éclatement de la bulle Internet. Cela avait donné lieu aux premiers recours contre les compagnies d’assurance, engagés par des assurés estimant ne pas avoir eu tous les éléments d’information sur l’éventualité d’une baisse de la valeur du contrat par rapport à la valeur de souscription. J’avais d’ailleurs fait voter en 2005 un amendement au projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, ramenant de trente à huit ans le délai de recours contentieux en cas de défaut d'information. L’information délivrée aujourd’hui sur ces contrats est-elle meilleure ?
M. Bernard Spitz. Vous remarquerez que les personnes se sont manifestées après une période de baisse, et non de hausse !
M. le président Henri Emmanuelli. Pour en avoir reçu à ma permanence, je peux vous dire que, souvent, elles pensaient avoir affaire à un contrat verrouillé, sans risque. Leur compréhension du monde de la finance ne leur permet pas de saisir toutes les conséquences de la souscription d’un contrat en unités de compte, malgré les informations qui ont pu leur être données.
M. Bernard Spitz. De grands progrès ont été faits en matière de transparence et de conseils au consommateur. Cependant, il nous arrive aussi de rencontrer des assurés, avisés et très au fait des pratiques financières, qui prennent des positions risquées puis, lorsqu’ils perdent, prétendent avoir été abusés ou mal informés. Mais nous faisons la part entre ceux-là et des gens qui peuvent être de bonne foi.
M. Jean-François Lequoy. Beaucoup de dispositions ont été prises ces quinze dernières années pour améliorer l’information et le conseil. La qualité de la commercialisation a été démontrée lors de la dernière crise, puisque la baisse de la valeur des contrats en unités de compte n’a pas donné lieu à une critique globale, comme cela a pu être le cas dans d’autres pays.
Les contentieux introduits avant la loi de 2005 l’ont été par des assurés qui étaient en réalité bien informés, puisqu’ils avaient très bien su utiliser ces contrats, mais qui ont exploité une faille formelle : les conditions générales et la notice d’information étaient regroupées en un seul document, contrairement à une disposition du code des assurances. Ils ont obtenu de pouvoir renoncer au contrat, ce qui leur a permis de se voir restituer les primes versées.
M. Louis Giscard d’Estaing. Pensez-vous que la création de l’Autorité de contrôle prudentiel permettra de mieux connaître le contenu des OPCVM, présents dans les contrats d’assurance-vie, et de s’assurer de l’absence de tout produit toxique ? En d’autres termes, quid de la traçabilité ?
M. Jean-François Lequoy. La mécanique de titrisation, cautionnée par les agences de notation, a déresponsabilisé toute une chaîne d’acteurs. Les souscripteurs de contrats ne croyaient plus au risque, les produits étaient échangés sans qu’on sache ce qu’ils contenaient. En août 2007, on s’est aperçu que le marché était inondé par les actifs toxiques, sans savoir pour autant qui en détenait. La paralysie a alors gagné le marché du crédit. Parmi toutes les mesures prises depuis, les plus prometteuses sont celles qui relèvent de la supervision macroprudentielle, à l’échelle européenne et française.
M. le rapporteur. Pensez-vous que l’on puisse mieux contrôler la titrisation ?
M. le président Henri Emmanuelli. L’appréciation du risque est au fondement de votre profession. La titrisation, qui est un moyen de dissimuler le risque, ne devrait-elle pas être étrangère à votre secteur ?
M. Jean-François Lequoy. La mécanique de titrisation en tant que telle n’est pas condamnable. L’important est de savoir ce que contient un produit que l’on achète.
M. Bernard Spitz. Nous avons beaucoup insisté, avec les autres assureurs européens, sur l’idée que la supervision ne devait pas être assurée uniquement par les banquiers centraux, mais ouverte à des regards variés et diversifiés.
M. le rapporteur. Que pensez-vous des CDS ?
M. Bernard Spitz. Ce produit dérivé permet de couvrir un risque de crédit – un éventuel défaut de l’entreprise dans le cas d’une obligation d’entreprise, par exemple.
M. le président Henri Emmanuelli. Qui, dans la pratique, émet les CDS ?
M. Bernard Spitz. Il s’agit d’un contrat entre un acheteur et un vendeur, dans le cadre d’un marché de gré à gré – et s’il est question de mieux organiser ces pratiques, elles ne concernent guère notre secteur.
M. le président Henri Emmanuelli. Vos gestionnaires de portefeuilles pratiquent-ils, comme dans les banques, le high frequency trading, la négociation à la seconde ?
M. Bernard Spitz. Non, ce n’est pas notre métier.
M. Jean-François Lequoy. Les actifs que nous détenons ne sont que la représentation des engagements à long terme pris auprès de nos assurés. Notre principe directeur est de les conserver.
M. le président Henri Emmanuelli. Mais vous les faites travailler ! Vous n’êtes pas des compagnies philanthropiques.
M. Bernard Spitz. Ce n’est pas de l’angélisme que de dire que notre modèle économique a le mérite de nous mettre à l’abri de ce genre de tentation. Nos autorités, par ailleurs, verraient cela d’un mauvais œil.
M. le président Henri Emmanuelli. Je vous remercie.
L’audition s’achève à dix sept heures trente.
*
* *
Audition de M. Augustin de Romanet, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, accompagné notamment de M. Alain Minczeles, responsable de la gestion des actifs pour compte propre, au département gestion financière
(Procès-verbal de la séance du mercredi 27 octobre 2010)
(Présidence de M. Henri Emmanuelli, président de la commission d’enquête)
La séance est ouverte à dix-sept heures trente
M. le président Henri Emmanuelli. Monsieur le directeur général, la raison d’être de cette commission d’enquête est d’affiner notre compréhension de la crise financière, afin d’avancer des propositions pour réguler la spéculation et sécuriser les marchés. L’institution que vous dirigez étant un opérateur important, nous aimerions entendre votre point de vue de praticien et vos éventuelles recommandations.
(M. Augustin de Romanet prête serment.)
M. Augustin de Romanet, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Mes collaborateurs m’ont préparé de brillants exposés sur l’utilité ou l’inutilité de la spéculation, mais je m’exprimerai, comme vous l’avez suggéré, à titre personnel.
La spéculation est l’acte par lequel les hommes tentent de prévoir l’avenir pour gagner de l’argent. Cependant, conjuguée à une mauvaise information qui vient la perturber – c’est tout le problème des agences de notation –, elle peut déstabiliser l’ensemble du système économique, et ce même en France, où la sphère financière ne représente que 6 à 7 % du PIB. Or certains hommes d’affaires ou financiers peuvent manipuler l’information pour accroître leurs bénéfices : le problème est donc le lien entre l’acte de spéculer, que tous les économistes présentent comme normal, et l’information, en amont comme en aval.
M. le président Henri Emmanuelli. À cela s’ajoute qu’en matière financière, tout est pro cyclique, et non contra cyclique.
M. Augustin de Romanet. C’est vrai, même si, en principe, le prix résulte d’un ajustement entre l’offre et la demande.
En matière de spéculation, je citerai trois exemples de comportements excessifs ayant eu un impact négatif sur l’économie : le mimétisme, l’abus de complexité et le « court-termisme ».
La spéculation ne fait en rien problème lorsqu’elle repose sur une analyse approfondie de la valeur des actifs, mais il en va tout autrement lorsque les agents, réagissant de façon mimétique à certains signaux, en extrapolent un envol ou une chute des prix et achètent ou vendent pour en tirer profit. La bulle Internet illustre parfaitement ce phénomène, auquel André Orléan a consacré en 1999 un ouvrage intitulé Le Pouvoir de la finance, qui est à mes yeux la meilleure étude sur le sujet. En 1999-2000, les plans d’affaires et la valorisation des sociétés créées sur Internet reposaient sur l’idée que nous passerions désormais l’essentiel de notre temps sur la toile et y effectuerions tous nos achats. Les comparables boursiers, qui faisaient pousser les arbres jusqu’au ciel, ont alors supplanté l’actualisation des cash flows, des flux de trésorerie. Je m’occupais à l’époque d’introductions en bourse de sociétés de la « nouvelle économie ». Lorsque je disais à mes collègues que je ne souhaitais pas valoriser les entreprises au-delà d’un montant correspondant à l’actualisation de leur cash flow, ils se moquaient en me rappelant qu’en tant qu’introducteur en bourse, j’étais rémunéré à proportion des capitaux levés, d’autant plus élevés que la valorisation initiale était forte.
Si les phases de fort mimétisme et les bulles qui en résultent reviennent par intervalles – après la bulle des tulipes, il y a eu celle des chemins de fer, etc. –, elles se succèdent désormais de plus en plus rapidement : sept ans seulement ont séparé la bulle Internet de celle des subprimes. Et lors de la première, si personne n’évaluait les entreprises selon des critères raisonnables, c’est que chacun avait intérêt à entretenir la bulle : les entrepreneurs, qui levaient des capitaux selon des multiples extraordinaires ; les banquiers, qui percevaient des commissions tout aussi extraordinaires ; les particuliers, enfin, dont le titre souscrit en bourse doublait du jour au lendemain. D’ailleurs, l’un des effets pervers pour les banques était que, selon qu’elles allouaient le titre à Pierre ou à Paul, c’était l’un ou l’autre qui raflait la mise.
Le même excès de mimétisme s’est observé lorsque tous les gestionnaires d’actifs, dans le monde, ont considéré qu’il était possible d’acheter des titres représentatifs d’actifs subprimes notés AAA pour augmenter à la marge le rendement de leurs SICAV monétaires : phénomène directement lié à une information défaillante puisque, aux États-Unis, les agences de notation avaient fait l’hypothèse que la chute des cours de l’immobilier ne pouvait se produire dans plus de dix États simultanément, ni dépasser 10 % dans chacun d’entre eux : de fait, cela ne s’était jamais produit. Mais il s’est trouvé que l’administration américaine a encouragé l’octroi de prêts à des personnes à faibles revenus, et pour des montants qui excédaient le prix initial de l’actif ; de sorte que le marché de l’immobilier s’est effondré simultanément dans bien plus de dix États. Non seulement les agences de notation avaient donné de mauvaises informations, mais elles ne les ont pas corrigées, les gouvernements ayant exercé des pressions lorsqu’elles ont voulu dégrader les titres subprimes à l’origine desquels ils étaient. Cela nous renvoie au problème de la notation des États : alors même qu’une information défaillante, ex ante, peut conduire à de mauvaises anticipations, les agences, dont le barème n’est pas discret, n’osent plus dégrader les titres par crainte de « surréactions ».
M. le président Henri Emmanuelli. Se défaire des titres ne bénéficiant pas de la notation AAA est d’ailleurs une règle de gestion appliquée par certaines institutions financières.
M. Augustin de Romanet. C’est en effet un sujet de grande préoccupation : la communauté des gestionnaires d’actifs applique des normes qui imposent qu’un pourcentage x de leurs actifs bénéficie de la note AAA, un pourcentage y de la note AA, et un pourcentage z de la note A. Ainsi, si une collectivité passe de la note AAA à la note AA, elle est aussitôt exclue de plusieurs milliers de portefeuilles d’actifs dans le monde. En d’autres termes, les conséquences de la dégradation d’un émetteur important, en particulier d’un émetteur souverain, sont systémiques : cette dépendance vis-à-vis des agences me paraît l’un des problèmes essentiels pour les années qui viennent.
Ce point m’amène au deuxième problème, celui de l’usage potentiellement dévoyé des produits financiers, que j’illustrerai par l’exemple des credit default swaps (CDS), contrats d’assurance contre la défaillance d’un émetteur qui, me semble-t-il, peuvent être destructeurs pour l’économie. Il est en effet possible d’acheter des CDS nus, c’est-à-dire des assurances contre des risques que l’on n’a pas à couvrir. Dès lors, un investisseur qui achèterait un CDS nu sur une obligation assimilable du Trésor (OAT) française à dix ans sans posséder ladite OAT espère une dégradation de la situation économique de la France, puisque son actif se valorise à proportion de cette dégradation : c’est un peu comme si l’on autorisait BetClic ou le PMU à ouvrir des paris sur la situation budgétaire des États. Le même investisseur pourrait faire courir les pires rumeurs sur l’économie française : cela aurait pour effet d’augmenter la valeur de son titre, tout en détériorant les conditions de financement de la France. Une comparaison un peu caricaturale illustrera ce propos technique : si la prime d’assurance de votre Rolls-Royce est de 5 000 euros, et qu’une rumeur se répand sur un défaut des roues, votre prime passera à 10 000 euros, ce que vous accepterez dès lors que vous souhaitez assurer votre voiture contre le risque ; mais si vous possédez une prime d’assurance sans posséder la voiture, vous pouvez faire courir le bruit que les roues sont défaillantes, et revendre votre prime d’assurance au double du prix auquel vous l’avez achetée.
Je suis conscient de la gravité de telles affirmations. Mais une note d’un professeur de Stanford, publiée par la Revue de la stabilité financière de la Banque de France en juillet 2010, révèle à mes yeux – bien qu’elle recommande de n’interdire ni la spéculation sur les dettes souveraines, ni les CDS – l’impérieuse nécessité d’une réglementation. La manipulation, explique l’auteur, reste très marginale ; toutefois, « une variante de ce dispositif de manipulation consiste pour le manipulateur à commencer par vendre à découvert un volume important de l’obligation sous-jacente, avant de surpayer un petit volume de protection par CDS. Si cette opération particulière sur CDS effectuée à un taux élevé ne passe pas inaperçue et induit les investisseurs obligataires en erreur au point que les prix des obligations chutent fortement, le manipulateur pourrait sortir rapidement aussi bien de sa position sur l’obligation que de celle sur le CDS en dégageant un gain net avant que de meilleures informations sur les prix ne parviennent jusqu’au marché. Même si ce dispositif fonctionnait, il est peu probable qu'il déclencherait le défaut de l’entité souveraine. Les prix pourraient être faussés, mais seulement pendant une courte période. »
En d’autres termes, on pourrait absoudre qui ne pèche que peu de temps. À ceci près qu’en période de tension sur la situation financière des États, de tels comportements peuvent être déstabilisateurs…
Second cas de figure cité dans l’article : « le détenteur d’un CDS nu peut préférer que l’emprunteur fasse défaut. Cet argument tient si le détenteur de CDS nu est en position de rendre plus probable le défaut de l’emprunteur. Étant donné que, comme nous venons de le voir, le spéculateur sur CDS n’est vraisemblablement pas en mesure d’influencer notablement le niveau de dépenses ou d’épargne d’un État, l’argument de l’absence d’intérêt à assurer ne me convainc guère. »
C’est, pour ma part, cette dernière phrase qui ne me convainc guère : j’en veux pour preuve l’enchaînement observé dans l’affaire Dexia. Un vendredi, j’avais reçu le président de la banque, qui m’avait assuré que la situation était sous contrôle ; cependant, le soir même, l’un de mes collaborateurs me faisait part de sa préoccupation. Une réunion fut donc organisée le lendemain, au cours de laquelle les dirigeants de Dexia nous confirmèrent ne disposer de liquidités que pour trois mois. Un conseil d’administration est donc organisé le dimanche soir, par téléphone ; le délai est ramené à trois semaines. Nous décidons, dans ces conditions, de nous revoir le lundi soir. Or, le lundi matin, Le Figaro annonce qu’un conseil d’administration de Dexia s’est tenu la veille au soir. Cette information ne laisse pas d’alerter les marchés : durant la journée de lundi, les spéculateurs vendent de nombreux titres à découvert, faisant chuter le cours de l’action ; à telle enseigne qu’à dix-huit heures, le délai n’était plus que de trois heures. Le gouverneur de la Banque de France nous avait d’ailleurs appelés une heure auparavant pour nous informer que Dexia ne passerait pas la nuit.
La recapitalisation de 6 milliards, décidée dans la nuit de lundi à mardi, s’est révélée un peu excessive par rapport aux besoins de solvabilité de Dexia, dont le problème était avant tout un problème de liquidité. Reste que les possesseurs de CDS de Dexia, et ceux qui ont spéculé sur son titre, ont gagné des sommes considérables à l’occasion de cette manipulation de l’opinion des marchés.
Ce qui vaut pour Dexia pourrait valoir, un jour ou l’autre, pour les États ; c’est ce qui conduit l’universitaire américain à conclure : « En tout état de cause, la meilleure façon de traiter l’instabilité financière générée par une prise de risque excessive sur le marché des dérivés consiste à relever les obligations de collatéraux, les exigences de fonds propres pour les établissements d’importance systémique et le recours à la compensation centrale, comme l’analysent Duffie, Li et Lubke (2010). Ces réformes des marchés de gré à gré, et d’autres réformes en préparation, amélioreront la sécurité et la solidité de ces marchés. Des bases de données donneront finalement au régulateur la possibilité de contrôler les éventuels manipulateurs de ces marchés, ou de prendre des positions dont les risques sont trop importants par rapport aux fonds propres qui les soutiennent. […] Une réglementation qui limiterait fortement la spéculation sur les marchés des CDS pourrait avoir pour effet secondaire d’assécher la liquidité du marché […]. »
M. Jean-François Mancel, rapporteur. S’agissant de Dexia, qu’aurait-il fallu faire pour éviter les événements du lundi ?
M. Louis Giscard d’Estaing. Que Le Figaro ne sorte pas en kiosque ! (Sourires.)
M. Augustin de Romanet. Je ne cesserai jamais de me poser cette question taraudante : n’avons-nous pas, en tirant la sonnette d’alarme par la réunion du conseil d’administration, accéléré les événements ?
M. le président Henri Emmanuelli. Vous ne pouviez pas agir autrement.
M. Augustin de Romanet. Quinze jours plus tard, les États se portaient garants pour les banques : si nous avions attendu, nous n’aurions pas eu à recapitaliser Dexia. Mais nous étions prisonniers d’un dilemme car la banque, si nous n’avions pas réagi, aurait pu chuter. Lors de la fameuse nuit du lundi au mardi, le gouvernement belge craignait une panique bancaire (bank run) ; dans les agences de Dexia, les personnels du back office ont dû descendre au rez-de-chaussée pour accueillir les clients, afin d’éviter, à l’entrée des agences, des files d’attente qui auraient déclenché la ruée vers les guichets !
À mes yeux, c’est vraiment le CDS nu qui pose problème, la spéculation en ce domaine s’apparentant, je le répète, aux paris chez un bookmaker. On ne parie pas ainsi sur la situation financière des entreprises ou des États !
Les rachats de dettes avec fort effet de levier, les LBO, constituent plutôt une dérive du « court-termisme » – ce sera mon troisième point–, dans la mesure où ils valorisent les entreprises en stoppant les investissements. Lorsque j’ai pris la direction de la Caisse des dépôts, j’ai été frappé de ce que plusieurs entreprises étaient en situation de « Capex holidays », c’est-à-dire d’arrêt des capacités d’investissement : le fonds LBO, en achetant une société à un prix x qui correspond à un multiple du bénéfice, accroît fortement ce dernier en stoppant les investissements ; si bien que, quatre ans plus tard, la société est revendue à un prix augmenté d’autant, l’arrêt des investissements, qui tue l’entreprise et menace ses emplois, n’étant pas détectable à court terme. C’est pourquoi nos équipes examinent les informations, y compris et notamment extra-financières, pour apprécier la valeur réelle des entreprises : en ce sens, l’article 225 du Grenelle, qui obligera les entreprises à établir un rapport de développement durable certifié, est un progrès important.
M. le président Henri Emmanuelli. Celui qui rachète la société au fonds LBO devrait connaître la situation, et ajuster son prix d’achat en conséquence.
M. Augustin de Romanet. En effet ; mais, en pratique, on constate que ce n’est pas le cas.
Cet exemple illustre à mes yeux le rôle central de l’information, ou plutôt sa dissymétrie entre ceux qui ont intérêt à la cacher et ceux qui en ont besoin : dans les différents secteurs d’activité où j’ai pu exercer, j’ai toujours observé que, plus le langage était complexe et inaccessible au profane, plus il dissimulait de rentes.
Dernière illustration des dérives du « court-termisme » : le trading à la seconde, ou « haute fréquence » (spot trading), à l’origine du krach du 6 mai 2010.
M. le président Henri Emmanuelli. Que pensez-vous de ces pratiques ?
M. Augustin de Romanet. C’est toute la tragédie de la directive sur les marchés d’instruments financiers, dite « MIF », qui, en libéralisant les marchés réglementés, visait à y rendre les transactions moins coûteuses. Résultat : les pratiques de spot trading se sont multipliées, avec des taux de commission tellement ridicules que plus personne ne gagne d’argent, cela sans parler des fameuses chambres de compensation « sauvages », les dark pools. Bref, on ne contrôle plus rien, et l’opérateur particulier n’y a rien gagné.
Voilà trois domaines dans lesquels la régulation pourrait être améliorée. Je vous ai, comme promis, épargné les développements sur la nécessité de la spéculation au regard de la liquidité des marchés, de la délivrance gratuite de l’information et de l’ajustement des prix. Je ne citerai qu’un exemple, qui intéresse la Caisse des dépôts, pour illustrer le fait que des marchés organisés peuvent être le moyen – et peut-être le seul – d’atteindre certains objectifs de politique publique : l’exemple du marché carbone. Aux États-Unis, la pollution atmosphérique urbaine au dioxyde de soufre a été résorbée grâce au « cap and trade », système de plafonnement et d’échange de quotas que l’on essaie de mettre en place au niveau mondial pour le CO2. Cette spéculation, bien organisée et à condition de se prémunir contre les fraudes à la TVA, me semble bénéfique au regard des objectifs de diminution des émissions de gaz à effet de serre ; les pouvoirs publics, qui ont confié un rapport à Michel Prada, ainsi que l’AMF, en sont d’ailleurs conscients.
J’ajouterai un mot sur une question à laquelle, en tant que président du directoire du Fonds de réserve des retraites, je n’ai jamais eu de réponse bien que je l’aie souvent posée : l’achat de matières premières agricoles – sous forme de produits dérivés, bien entendu – a-t-il un impact négatif sur les prix ? J’avais l’intuition que oui ; mais aucune des études que nous avons commandées ne l’a confirmée.
La seule spéculation qui me semble devoir nous inquiéter est celle qui porte sur les terres agricoles en Amérique latine et en Afrique : que diraient les paysans de la Beauce si le fonds souverain chinois y achetait des hectares de blé ? L’intérêt de celui qui possède des actifs agricoles sur un continent étranger ne me paraît pas nécessairement convergent avec celui des populations ou des exploitants locaux : si par exemple les seconds peuvent avoir intérêt à développer une culture respectueuse de l’environnement, le premier peut tirer avantage de cultures polluantes, qui nuisent à ces populations.
M. le président Henri Emmanuelli. De telles situations ne me semblent guère vouées à perdurer : elles posent quand même beaucoup de problèmes politiques.
M. Augustin de Romanet. Les investisseurs institutionnels de long terme que nous sommes s’orientent naturellement vers les actions. Il y a dix ans, leur durée de détention moyenne était de sept ans ; elle est aujourd’hui de sept mois. La possession des entreprises sera un sujet essentiel dans les dix prochaines années, compte tenu notamment des futurs accords Bâle III, de Solvabilité II et des normes IFRS – International financial reporting standards –, qui rendent la détention d’actions fort « inamicale » pour l’ensemble des opérateurs financiers.
Nous avons, en ce qui nous concerne, créé le Club des investisseurs à long terme, avec la Cassa depositi e prestiti italienne, la Kreditanstalt für Wiederaufbau allemande, la Banque européenne d'investissement et quelques autres établissements financiers dans le monde, dont la Banque pour le développement de Russie et celle de Chine. Le mémorandum que nous avons remis au commissaire européen Michel Barnier à la fin du mois de septembre recommande d’aménager les règles applicables aux investisseurs à long terme, statut qu’il faut d’ailleurs promouvoir dans la sphère privée : aménagement de la règle comptable de marquage au marché d’une part, assouplissement des règles relatives aux liquidités et à la solvabilité de l’autre ; faute de quoi il ne sera plus possible d’investir en actions. D’autres mesures incitatives en faveur de l’actionnariat à long terme peuvent aussi être envisagées : des chercheurs réfléchissent par exemple aux loyalty shares, sur le modèle des actions à dividende prioritaire d’Air liquide, assimilables à des primes à la fidélité.
M. le président Henri Emmanuelli. Je vous remercie de cet éclairage particulièrement direct et intéressant.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. Je souscris au jugement de notre président : en plus de vous exprimer avec franchise et courage, vous nous avez suggéré de nombreuses pistes de réflexion.
S’agissant de l’information dont vous avez souligné le rôle essentiel, les mesures proposées aux niveaux français, européen et international vous semblent-elles suffisantes ? Un consensus est-il envisageable, ou faut-il compter avec de fortes résistances ?
M. Augustin de Romanet. La question est difficile, car j’ai du mal à discerner les propositions concrètes.
Quant à l’autorité européenne de surveillance des agences de notation, tout dépendra de la volonté politique, et de la conscience qu’on prendra de ce que l’information relative aux finances publiques des États est un enjeu de sécurité nationale. Si le Président Reagan a fait voter en 1985 le Gramm-Rudman-Hollings Act qui tend à plafonner le déficit budgétaire, c’est que le président du conseil de sécurité américain l’avait averti que la situation des finances fédérales mettait en péril l’indépendance des États-Unis. En Europe aussi, l’indépendance financière est une question de sécurité pour les États.
La question de l’information nous renvoie donc à la volonté politique de faire des projections lucides sur la situation financière des États et des collectivités locales. Aux États-Unis, le Congressional Budget Office, équivalent de notre Cour des comptes, propose des projections à soixante-quinze ans pour le budget de la sécurité sociale et à trente ans pour celui de l’État. Si nous faisions de même, nous observerions des tendances de nature à nous faire réfléchir. Pour répondre à votre question, je ne crois qu’à la volonté politique de celui qui pilote l’organisme bureaucratique.
S’agissant par exemple des agences de notation, il est pour ainsi dire impossible, compte tenu du caractère discret de leur barème, de passer du point où nous sommes à celui qui les conduirait à s’exprimer librement et en temps réel sur la situation des États, et ce sans risquer d’être manipulées : la transition serait bien trop coûteuse.
M. Alain Minczeles, responsable de la gestion des actifs pour compte propre, au département gestion financière. L’existence des agences de notation arrange tout le monde, car elle permet de faire endosser la responsabilité de l’information à quelqu’un d’autre. Lors d’une conférence récente, l’Association française des investisseurs institutionnels a d’ailleurs recommandé de ne pas intégrer leurs notations dans les mécanismes de régulation. En effet, lors de la crise des subprimes, les investisseurs ont pu arguer de la notation AAA des agences pour justifier le fait qu’ils n’aient pas analysé la valeur des titres. Les banques faisaient de même en transférant le risque, si bien que, passez-moi l’expression, tout le monde « se repassait le bébé ». La solution me semble être que les établissements mènent eux-mêmes, en interne, des expertises sur les titres dans lesquels ils souhaitent investir.
M. Augustin de Romanet. Les agences de notation ont un rôle comparable à celui des analystes financiers pour les entreprises. Or, les grandes entreprises internationales sont suivies par une quarantaine d’analystes de par le monde, lesquels établissent un prix qui peut s’étager de l’indice 20 à l’indice 40 : leurs avis sont tellement différents que l’on en est souvent réduit à miser sur une moyenne, en l’occurrence 30. Mais peut-être que tout le monde se trompe !
La rareté des agences de notation fait en quelque sorte leur impunité, puisqu’il n’y a personne pour les contredire. Certaines études universitaires préconisent de les rémunérer en fonction de la performance de leur notation ; mais cette proposition, habile, suppose une concurrence entre les agences, concurrence qui, à mes yeux, est mieux assurée par les experts des finances publiques ; ainsi, les ministères et commissions des finances en Europe me semblent tout aussi légitimes et compétents pour analyser les perspectives financières des États. Il est un peu décevant, je le dis avec une certaine gravité, que l’on puisse se fier davantage à une agence de notation qu’à un ministère ou à une commission des finances. Ce sujet sera, je pense, d’actualité dans les dix ans qui viennent.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. En ce domaine, la Grèce n’a pas montré l’exemple.
M. Augustin de Romanet. Certes, mais elle avait intégré l’Union avec un écart important.
M. le président Henri Emmanuelli. En effet, et elle n’est pas la seule à ne pas avoir montré l’exemple.
Les agences de notation ayant été un peu malmenées, elles font un effort de relations publiques. J’ai ainsi été amené à rencontrer un de leurs représentants à qui je n’ai pu m’empêcher de dire qu’il devrait diriger le gouvernement du pays dont nous parlions : il semblait à l’écouter le connaître beaucoup mieux que les dirigeants ! Tout cela est un peu surréaliste et irrationnel.
M. Dominique Baert. On souligne souvent la force de frappe de la Caisse des dépôts. Mais quel rôle défensif peut-elle jouer lors de mouvements spéculatifs tels que celui qui a touché Dexia ? De quels instruments de régulation et de défense disposez-vous ? Avez-vous parfois eu le sentiment que votre force de frappe était insuffisante au regard de la mission qui vous est confiée ? Si oui, quelles dispositions jugeriez-vous nécessaires, qu’elles intéressent la possibilité de lever des fonds, la régulation des marchés ou l’encadrement de produits hautement spéculatifs ?
M. Louis Giscard d’Estaing. Ma question est très complémentaire. Quelle est la capacité de résistance de la Caisse des dépôts à l’effet de mimétisme ? Les mécanismes que vous avez décrits génèrent en effet une pression, dans la mesure où vos exigences de rentabilité vous placent en situation de concurrence avec des établissements qui n’appliquent pas forcément les mêmes règles de prudence.
D’autre part, comment les filiales de la Caisse des dépôts se protègent-elles de mouvements très spéculatifs sur les capitaux des entreprises ? Y a-t-il eu, par exemple, des prises de participation dans des entreprises ayant alimenté la bulle Internet ?
Mme Arlette Grosskost. Faut-il supprimer les produits dérivés, ou simplement mieux les réguler ? Si oui, à quelle échelle ? Nationale, européenne ou mondiale ?
Par ailleurs, ne risque-t-on pas une bulle sur le marché obligataire souverain ?
M. le président Henri Emmanuelli. Cette rumeur circule, en effet.
M. Augustin de Romanet. Lorsqu’un investisseur de long terme investit dans une entreprise, monsieur Baert, c’est après avoir mené une analyse approfondie de la situation de celle-ci : on y voit donc, en général, le signe que l’entreprise est fiable – c’est là une qualité que le monde économique reconnaît aux choix des fonds souverains.
La Caisse des dépôts étant assimilée, notamment grâce au Fonds stratégique d’investissement (FSI), à un fonds souverain, elle peut envoyer de tels signaux sur la qualité des entreprises, mais aussi, compte tenu de l’affectio societatis qui l’attache à elles, dissuader les prises de contrôle inamicales. Le FSI peut en ce sens contribuer à stabiliser le capital des entreprises françaises.
Nous n’avons pas acquis de subprimes.
Les dispositifs dont nous aurions besoin sont décrits dans le mémorandum dont j’ai parlé, et que je vais vous remettre. Quant au droit actuel, il ne nous pose pas de problème particulier, à l’exception des règles comptables qui nous obligent à afficher des pertes extravagantes lors d’une chute boursière, alors même que nous n’avons pas vendu un seul titre.
M. Alain Minczeles. On ne peut parler de « force de frappe » qu’à l’échelle de milliards d’euros. Cette question ne se pose plus pour nous.
M. Augustin de Romanet. En tout cas plus au niveau de la section générale. M. Delmas-Marsalet me disait, en 1980, qu’on lui passait parfois un coup de téléphone le matin pour lui demander d’acheter tel ou tel titre qui baissait en bourse ; mais ces habitudes n’ont plus cours. Nous ne possédons plus, au demeurant, que 2 % de la capitalisation boursière de la place de Paris.
En revanche, la Caisse des dépôts gère, pour le compte de l’État, le fonds d’épargne, dont les dépôts, fiscalement avantageux et garantis par l’État, se montent à 220 milliards d’euros. Ainsi, 63 % des livrets A et assimilés sont déposés à la Caisse des dépôts, le reste étant décentralisé dans les banques. L’État peut donc utiliser cette liquidité comme bon lui semble, au profit de l’intérêt général : au moment où s’ouvre le débat sur la centralisation du livret A, il est bon, je crois, de le rappeler. Mon propos n’a rien de désobligeant pour les banques : elles souhaitent augmenter leurs liquidités, c’est tout à fait naturel. Mais n’oublions pas que, grâce au livret A, l’État octroie des prêts pour le logement social, les infrastructures, les universités, les hôpitaux ou l’assainissement des eaux usées ; bref, il a de plus en plus besoin de cette liquidité, et d’autant plus que les banques ne prêtent plus à long terme. L’an dernier, la Caisse des dépôts a ainsi financé, sur les fonds de la section générale, le programme Exceltium, qui a permis à des producteurs électro-intensifs d’investir 2,2 milliards dans un EPR. Je pourrais d’ailleurs citer d’autres exemples de financement d’infrastructures, comme le tunnel Lyon-Turin.
Le fonds d’épargne est donc un bien public, que le Gouvernement est libre d’utiliser comme tel ; s’il le décentralise vers les banques, il se privera d’un outil essentiel au financement d’infrastructures ou de politiques utiles à l’intérêt général.
Quant à nos capacités de résistance au mimétisme, monsieur Giscard d’Estaing, restons modestes et ne jurons de rien ; cependant, la supériorité de la Caisse des dépôts tient selon moi à une chose : le président de sa commission de surveillance vient chaque année, avec votre serviteur, rendre des comptes à la représentation nationale. Le simple fait d’avoir, par là même, l’obligation d’appliquer des règles de bon sens et de long terme permet d’éviter le mimétisme et le « court-termisme ». Je ne viendrai jamais vous expliquer que la Caisse a décidé d’acheter de l’or parce que celui-ci a atteint un cours de 1 600 dollars l’once. Si cette politique fait rater de bonnes affaires à court terme, elle est assurément payante à long terme.
Dans le cadre du programme « France investissement », nous injectons 450 millions d’euros par an dans 180 fonds d’investissements – dont 80 en province. Le taux de rendement est, là, souvent inférieur à 10 %, mais cela ne nous empêche pas du tout de dormir et nous entendons bien maintenir cet effort en faveur du capital-développement dans les régions.
Quant à notre filiale Qualium investissement, nous essayons d’y développer la notation extra-financière et d’appliquer une logique de long terme.
Je ne me souviens pas de ce qu’a fait la Caisse des dépôts lors de la bulle Internet, mais elle investissait moins de façon directe, en raison de l’existence de sa filiale Ixis…
M. le président Henri Emmanuelli. Pour le coup, la Caisse n’était pas seule, en effet.
M. Augustin de Romanet. Une meilleure régulation des CDS est sans doute nécessaire ; pour les autres produits dérivés, les transactions doivent passer par des chambres de compensation, et non par les marchés de gré à gré, over-the-counter (OTC). De deux choses l’une : soit le secret sur une opération comporte des avantages et j’aimerais les connaître ; soit elle n’en comporte pas et, dans ce cas, ce secret n’a pas lieu d’être. Je ne vois donc pas l’utilité d’opérations effectuées hors des chambres de compensation.
Si j’affirmais qu’il existe une bulle obligataire, cela reviendrait à dire que les États feront faillite demain matin. Or ce n’est pas mon opinion. Pas demain matin ! (Sourires.) En ces matières je reste prudent.
M. le président Henri Emmanuelli. M. de Boissieu nous a donné des chiffres qui ont de quoi terroriser : si le PIB mondial annuel s’élève à 60 000 milliards de dollars, la valeur des contrats sur instruments dérivés atteint 700 000 milliards, dont 90 % passent par les marchés de gré à gré. On peut se poser des questions sur le contenu de ces transactions ; je ne suis pas sûr que la Banque des règlements internationaux elle-même en sache beaucoup.
Il me reste à vous remercier, monsieur le directeur général, pour cet exposé si intéressant.
L’audition s’achève à dix huit heures quarante.
*
* *
Audition de M. Philippe Chalmin, professeur à l'Université de Paris-Dauphine, président de CyclOpe
(Procès-verbal de la séance du mercredi 27 octobre 2010)
(Présidence de M. Henri Emmanuelli, président de la commission d’enquête)
La séance est ouverte à dix-huit heures trente
M. le président Henri Emmanuelli. Merci, monsieur le professeur, d’avoir répondu à notre invitation. Cette commission d’enquête essaye de comprendre ce qui s’est passé lors de la dernière crise financière, sous l’angle particulier de la spéculation. Plusieurs auditions nous ont déjà familiarisés avec le sujet – l’intérêt de la spéculation, ses dangers, la liquidité, la sécurisation… Notre but est d’établir si des excès se sont produits, ou s’il y a des instruments dangereux, afin de faire des suggestions en matière de régulation et de sécurisation, s’agissant des marchés financiers, mais aussi des matières premières
(M. Philippe Chalmin prête serment)
M. Philippe Chalmin, professeur à l’Université Paris-Dauphine, président de CyclOpe. Mon expertise, dans le domaine de la spéculation, se circonscrit à un domaine bien précis, mais important : les matières premières, en particulier agricoles. Les prix de celles-ci ont connu, ces derniers mois, des flambées violentes, qui ont amené leur lot d’articles sur le scandale que représenterait la spéculation sur les prix agricoles – il semble que l’on supporte mieux l’idée de spéculer sur des instruments financiers dématérialisés que sur le blé, avec toute sa valeur symbolique. Je conçois que l’on puisse être choqué par l’idée de jouer au casino avec la nourriture des hommes. Mais tout ce dont les gamins de la finance sont venus vous parler – produits dérivés, options, swaps – a été inventé au départ pour gérer la seule véritable instabilité : celle des marchés agricoles. Toutes les techniques des marchés dérivés trouvent leurs racines dans les problématiques agricoles.
Le principe de base du fonctionnement d’un marché est l’équilibre, à un moment donné, entre une offre et une demande. Lorsque la dernière tonne produite et la dernière tonne demandée se rencontrent sur le marché, un prix se forme. S’il est possible, grâce notamment à la diligence des États, de stabiliser le rapport entre l’offre et la demande, on crée un univers de prix stables qui pourra éventuellement même, en fonction des rapports de force, se fixer sur un prix rémunérateur – je ne sais pas trop ce qu’est un « juste prix ». Mais si, pour une raison ou une autre, le rapport entre l’offre et la demande est instable, les prix le seront aussi.
Pendant des siècles, le principal facteur d’instabilité des économies a été agricole. En effet, si la demande de produits agricoles est globalement stable, liée au trend démographique – sauf faibles variations saisonnières – l’offre, elle, dépend largement des aléas climatiques. Je ne vous referai pas le coup de l’invention des cycles économiques dans la Bible, avec les vaches maigres et les vaches grasses de Joseph, mais c’est le principe. L’instabilité des marchés agricoles est naturelle et sa gestion a de tout temps été l’un des principaux problèmes des gouvernements – je songe aux textes des Gracques à l’époque romaine, ou à l’admirable Dialogue sur le commerce des blés de l’abbé Galiani, au XVIIIè siècle. Enfin, les dernières étincelles qui provoquèrent les révolutions – 1789, 1830, 1848 – furent des accidents climatiques et de mauvaises récoltes.
Très tôt donc, les opérateurs du secteur agricole – négociants, industriels, transformateurs – ont été amenés à développer des outils techniques d’anticipation : car la stabilité n’est pas seulement le constat d’un rapport entre l’offre la demande, c’est aussi la somme des anticipations des opérateurs sur ce que ce rapport sera demain. D’où le concept de marché à terme – marché pour le futur. Ce n’est pas un hasard si le premier marché à terme du riz fut créé au Japon, dans la plaine du Kansai, au milieu du XVIIè siècle, si les premières techniques d’options et de swaps furent développées au moment de la grande crise des tulipes à Amsterdam en 1637, ou si le premier marché à terme de l’ère moderne fut créé à Chicago au milieu du XIXè siècle.
Cette instabilité a longtemps été une particularité dans un monde où les marchés étaient globalement stables par ailleurs. Jusqu’au milieu des années 1970, on se levait le matin en étant sûr de trouver le dollar, le pétrole et les principaux métaux – et même les produits agricoles au sein de la politique européenne – exactement au même prix que la veille en se couchant. Cela a totalement changé. Pour gérer cette instabilité devenue générale, on est allé récupérer les outils développés pour l’agriculture.
Le système économique mondial est aujourd’hui caractérisé par l’instabilité, qu’il s’agisse des changes ou des grandes matières premières – pétrole, minerais, métaux, produits agricoles. Même l’agriculteur des Landes la vit dorénavant au quotidien : du fait de l’effacement des politiques agricole nationales du type de la PAC, son maïs lui est payé sur la base du prix de Chicago. Et une autre grande famille de produits vient d’entrer aussi dans l’instabilité : celle du minerai de fer et de la sidérurgie, dont les systèmes d’encadrement du marché viennent d’éclater. Je ne vois pas de matière première ni de produit financier dont le marché aujourd’hui ne soit pas instable. Pour désigner ce fait, nous avons dû franciser le terme le plus approprié, celui de commodities. Les commodités ne se définissent pas par les caractéristiques physiques d’un produit, mais par leur mode d’ajustement par l’instable sur le marché. Ainsi, les devises et les taux sont des financial commodities. Il y a des commodités agricoles ou énergétiques. Des services comme le fret maritime ou le permis carbone, ou même la température font l’objet de marchés dérivés.
La seule certitude aujourd’hui est donc que demain sera différent. Or, l’instabilité suppose l’incertitude, qui est facteur de risque. Pour réduire ces risques, il faut anticiper. L’instabilité débouche donc de façon totalement naturelle sur la spéculation. Ce vilain mot vient en fait du latin speculare, regarder en avant, se projeter au loin. Les légions de César envahissant les Gaules étaient précédées par des speculatores, des éclaireurs. On peut aussi se livrer à des spéculations philosophiques. Et au XIXè siècle, lorsqu’un agriculteur décidait de son emblavement – qu’il se demandait s’il allait cultiver du blé ou de l’orge – il faisait un choix de spéculation agricole. Le terme a pris depuis un sens péjoratif mais dès que l’on est dans un environnement instable et que l’on doit anticiper, on entre dans un raisonnement spéculatif.
Aujourd’hui, un producteur de maïs des Landes est forcément un spéculateur : il sait qu’il va livrer à sa coopérative, mais il a toute liberté pour fixer son prix. Si le prix actuel lui convient, il peut décider de le conserver pour la récolte à venir. Ainsi le blé, qui valait 120 euros la tonne en juin, se balade aujourd’hui – après les problèmes russes, ukrainiens et kazakhs – entre 210 et 225 euros la tonne. L’agriculteur doit donc se demander s’il bloque son prix pour la récolte de 2011. C’est un raisonnement spéculatif. S’il ne fait rien, c’est qu’il pense que le prix va encore monter. Sinon, il bloque son prix – ce que je ferais à sa place. Nous sommes tous des spéculateurs. Si l’on veut aller passer Noël aux États-Unis, soit on achète des dollars tout de suite, soit on joue la baisse : on attend un peu, en espérant en avoir plus pour le même nombre d’euros. C’est conscient ou inconscient, mais si l’on est sûr que demain sera différent d’aujourd’hui, on ne peut pas échapper à une attitude spéculative.
C’est un point fondamental. La seule manière de supprimer la spéculation serait de revenir à la stabilité totale : avec l’euro, il n’y a plus de spéculation possible sur les changes intra-européens – même s’il y a des gens qui jouent à la marge sur les différentiels de taux en pensant que l’euro pourrait éclater. Mais sur des marchés instables, on ne peut échapper à une spéculation naturelle, qui n’est ni bonne ni mauvaise, ni juste ni injuste. Là où les choses se corsent, c’est que cette situation d’instabilité est extrêmement difficile à apprécier et à vivre au quotidien. Si l’on signe un grand contrat de vente de chars d’assaut aux Émirats en dollars – on achète donc, en quelque sorte, des dollars – et qu’on ne se couvre pas, on prend le risque de la fluctuation entre le dollar et l’euro. Cela a coûté très cher à feu GIAT Industrie. Dans cette situation de risque, on a donc cherché des outils pour se couvrir, comme ceux qui avaient été développés pour la malheureuse agriculture. C’est ce qui a donné lieu au développement des marchés à terme et plus largement des marchés dérivés.
Le paradoxe difficile à accepter, c’est que ce sont des gens extérieurs qui interviennent sur ces marchés, des spéculateurs professionnels – je vous rassure, tout à fait respectables. La Préfon-retraite, par exemple, est un investisseur institutionnel. Elle gère ses sous – ceux de ses cotisants – en fonction de ses objectifs, dans une logique de spéculation totale qui l’amène à envisager toute la gamme des produits financiers. Or, les commodités sont des produits financiers. Pour qu’un marché dérivé fonctionne bien, qu’il soit proche de la concurrence pure et parfaite, il faut une atomicité totale de l’offre et de la demande : plus il y a d’échange de papier par rapport au physique susceptible d’être arbitré, plus le marché est efficient. Le fait qu’il y ait un rapport d’un à dix, voire un à vingt entre le volume total d’un marché à terme et la production mondiale des produits concernés peut paraître choquant, mais c’est oublier que les marchés dérivés sont des jeux à somme nulle. C’est comme une table de poker sur laquelle tous les joueurs ont mis leurs jetons : ils seront perdus ou gagnés, mais il y en aura le même nombre à la fin. Les marchés dérivés fonctionnent ainsi pratiquement sans rien ponctionner sur la filière économique en elle-même.
L’économie qui s’est développée pour gérer l’instabilité est donc une économie de spéculation, ce qui n’implique aucun jugement qualitatif. Certains considèrent qu’il était normal que le prix du blé augmente à l’été 2010, du fait d’un choc sur les fondamentaux du marché, mais que la hausse a été excessive. C’est faire une différence entre une bonne et une mauvaise spéculation, ce qui me semble erroné ; car il ne faut pas oublier que sur nos marchés de commodités, à la dernière heure de la dernière échéance, il peut toujours y avoir livraison physique du produit, à la différence des marchés financiers. La logique éminemment spéculative des marchés de commodités n’a pas d’impact sur la situation réelle. Les travaux académiques internationaux récents ont d’ailleurs généralement conclu que la spéculation financière n’aggravait pas l’instabilité. On peut faire des comparaisons en grandeur réelle entre les marchés de matières premières qui ont des marchés dérivés et ceux qui n’en ont pas. Ainsi, le blé est coté à Chicago – c’est un marché à forte dimension financière – alors que le riz n’a pas de marchés dérivés – c’est un marché purement physique. Or, la volatilité des prix du riz, lors de la crise de 2007-2008, a été plus importante que celle du blé. La comparaison marche aussi entre le pétrole et le charbon : lorsque les prix de l’acier ont été multipliés par quatre ou cinq, en 2008, il n’y avait pas encore de marché dérivé.
Les grands marchés de la planète, financiers ou de matières premières, voire de produits transformés comme l’acier ou le papier, sont confrontés à une instabilité des fondamentaux plus marquée qu’auparavant, probablement parce que, du fait de la complexité de la mondialisation, le temps des cartels et des politiques protectionnistes est quelque peu révolu. L’instabilité est mondiale, l’économie de spéculation aussi. Que cette spéculation soit limitée à quelques acteurs physiques est une possibilité. Qu’elle soit amplifiée par les mouvements de capitaux financiers émanant de gens très respectables comme les investisseurs institutionnels est relativement neutre. Dans mon champ d’analyse, celui des matières premières et des commodités, je ne pense pas que l’on puisse dire que la financialisation des marchés – c’est le terme – de ces dernières années ait aggravé particulièrement la volatilité.
Que peut-on faire face à cette situation ? Je rappelle que l’économie de marché n’a rien à voir avec la loi de la jungle. Quand on va au casino, il y a un croupier. Les dés ne sont pas pipés et les règles du jeu sont appliquées. Il en est de même pour les marchés dans un certain nombre de grands pays, aux États-Unis avec la Securities and exchange commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) par exemple, ou chez nous avec l’Autorité des marchés financiers (AMF). Mais les Britanniques sont beaucoup plus laxistes. Ils ont toujours été partisans du laisser-faire et sont en train de supprimer la Financial Services Authority. Je suis également un peu dubitatif sur les marchés dérivés de Chine : c’est là que sont aujourd’hui les plus gros marchés à terme de produits agricoles et je n’y mettrais pas le moindre yuan, faute de confiance dans les capacités de régulation des autorités chinoises. Bref, nombre de ces marchés sont incontrôlés – je ne parle pas d’interdire la spéculation, mais d’assurer la transparence. Et surtout, il n’y a pas d’autorité de régulation au niveau mondial. Les seules règles sont celles de l’accord de Bâle III. Or, de plus en plus de grands acteurs financiers font purement et simplement commerce de spéculation – il faut appeler un chat un chat : le modèle Goldman Sachs, c’est de la spéculation institutionnalisée – ce qui entraîne un risque systémique, c’est-à-dire celui de la chute d’un acteur essentiel comme Lehman Brothers. Leurs activités doivent être suivies. Ce n’est pas le cas dans un très grand nombre de pays et rien n’est prévu au niveau international.
Outre la réglementation, on peut aussi essayer de travailler sur la source de l’instabilité, c’est-à-dire les rapports entre l’offre et demande. La première des instabilités est monétaire. Il est utopique de chercher à stabiliser quelque marché que ce soit si l’unité dans laquelle s’expriment toutes les valeurs de ce bas monde, c’est-à-dire le dollar, est instable. Le premier chantier est donc la stabilisation du système monétaire international. La seule solution serait une devise mondiale. À une époque, le cartel des banques centrales a tout de même réussi à encadrer le marché des changes, grâce aux accords du Louvre. Aujourd’hui, le rapport euro/dollar se promène entre 0,8 et 1,6, sachant que la parité de pouvoir d’achat tourne autour de 1,15 ou 1,20. C’est l’instabilité fondamentale dont toutes les autres découlent. La plus difficile à gérer restera l’instabilité agricole, mais pour cela, il n’y a pas grand-chose à faire.
Il est utopique d’interdire la spéculation, car elle est nécessaire. Au moins, elle apporte de la liquidité et de la contrepartie aux acteurs. Mais il faut garder à l’esprit, pour en parler, l’image de l’écume et de la vague : lorsque la tempête fait rage, il y a de l’écume sur la vague, mais ce n’est pas une raison pour en conclure que c’est l’écume qui fait la vague.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. La spéculation n’aurait donc pas de conséquences pour les marchés sur lesquels vous êtes expert.
M. Philippe Chalmin. Elle n’aggrave pas la situation – ce qui ne veut pas dire que l’instabilité ne soit pas dure à vivre. Les marchés alimentaires – et je pense que l’enjeu majeur pour la planète n’est pas le défi climatique, mais alimentaire – ont connu des prix extraordinairement déprimés à la fin du XXè et le début du XXIè siècle, ce qui a créé une sorte d’illusion de l’abondance. Puis les marchés ont flambé en 2007-2008 et en 2010, et tout le monde crie haro sur les spéculateurs, à commencer par un eurodéputé dont le prénom est José, dans un article paru dans le Monde cet été. Mais si le chien aboie parce que la maison brûle, il ne sert à rien de tuer le chien. En poussant le bouchon un peu loin, je dirais donc que les marchés jouent un rôle d’alerte. En tout cas, leur fonction anticipatrice est essentielle. Lorsque le pétrole est arrivé à 100 dollars le baril, Thierry Breton, ministre de l’économie et des finances, a déclaré que le prix juste était de 60 dollars et que le reste n’était que spéculation – ce qui, au passage, n’avait aucun fondement scientifique. Mais ce que nous disaient les marchés lorsque le baril est monté à 147 dollars le 10 juillet 2008, c’est que le pétrole allait manquer, qu’il fallait préparer l’avenir et que si nous tenions à faire rouler des camions, il fallait payer le prix de la rareté et de la pollution. De la même manière, la flambée des prix de 2008 a été suivie du premier sommet alimentaire mondial de la FAO. La Banque mondiale est venue expliquer qu’il fallait remettre l’agriculture au cœur de nos stratégies de développement. Cela avait été totalement oublié !
En poussant le raisonnement à l’extrême donc, je pense qu’il faut écouter les marchés. Certes, sur le très court terme, les entrées ou sorties de capitaux spéculatifs peuvent provoquer un déséquilibre, surtout sur les marchés de commodités qui sont nettement plus étroits que les marchés financiers. Mais puisqu’il existe toujours la possibilité de livrer le physique, ils ne durent pas longtemps. Ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est qu’il n’y a de spéculateurs que si des marchés dérivés se développent, et qu’il n’y a de marché dérivé que s’il y a instabilité. Mais je conviens qu’ensuite il soit plus difficile de revenir à la stabilité. C’est pourquoi l’un des événements les plus fascinants de l’histoire économique est pour moi la rupture des années 1970 entre le stable et l’instable. En 1970, un banquier n’aurait jamais cru que le système des changes fixes allait exploser deux ans plus tard. Au début des années 1980, feu André Giraud, ministre de l’industrie, me disait que jamais le pétrole ne deviendrait une commodité, ne serait coté sur un marché à terme, parce que l’économie mondiale ne pourrait pas supporter de telles fluctuations. Cette révolution culturelle du passage du stable à l’instable, c’est ce que vivent aujourd’hui les agriculteurs.
M. le rapporteur. Quels sont les régulateurs, sur vos marchés ?
M. Philippe Chalmin. On a tous en tête l’image du type à Chicago en train de gueuler à la corbeille le cours du maïs. C’est fini, sauf pour montrer aux touristes. Maintenant, tout est électronique. Le marché n’est donc plus localisé. Seul l’est le croupier, c’est-à-dire la caisse de compensation, qui gère les dépôts de garantie.
M. le président Henri Emmanuelli. Tout se fait-il dans le marché, ou y a-t-il des dark pools ?
M. Philippe Chalmin. La fin de la localisation du marché pose le problème de la nationalité de la compagnie qui opère. Nous avons vu se développer au travers d’Euronext tout un pôle de marchés à terme. Or, la filiale des marchés à terme de marchandises d’Euronext est à Londres. De ce fait, je ne suis même pas sûr que le marché du blé, qui est le plus important dans nos marchandises, soit régulé par l’AMF.
M. le président Henri Emmanuelli. Il ne l’est pas. Il est question de le lui confier.
M. Philippe Chalmin. Nous avions autrefois une Commission pour les opérations des marchés à terme. Créée à la suite du scandale du sucre de 1974, lorsque toute l’architecture des marchés à terme avait été revue, c’était l’équivalent de la Commission des opérations boursières. Elle a disparu, mais j’avais cru comprendre que ses responsabilités avaient été reprises par la nouvelle AMF. Si ce n’est pas le cas, c’est inquiétant, connaissant le laisser-faire britannique. Le marché européen est loin du niveau de transparence qui existe aux États-Unis où les deux grands marchés, le CME Group et l’ICE, ainsi que les autres qui y sont localisés, au moins par leur caisse de compensation, sont régulés par la CFTC.
Avec l’électronisation se sont développés des marchés de gré à gré, les marchés OTC – over the counter. Ceux-ci ont toujours existé : le plus grand marché de gré à gré au monde, c’est le marché interbancaire ! Mais ils posent un gros problème.
M. le président Henri Emmanuelli. Mais le marché interbancaire est encadré. Les banques ont tout de même des règles prudentielles.
M. Philippe Chalmin. La différence entre les marchés organisés de futures et les marchés OTC, c’est que les seconds n’ont pas de croupier, ce qui crée un risque majeur : le risque de contrepartie. Certes, le marché interbancaire est constitué des cinquante plus grandes banques mondiales, mais leur degré d’insubmersibilité peut toujours être discuté.
Des marchés OTC très importants se sont développés en matière de commodités, sur le fret maritime, le minerai de fer ou le charbon par exemple. Il est intéressant de noter que, confrontés au risque de contrepartie, un certain nombre d’entre eux se sont appuyés sur des caisses de compensation – mais elles sont privées et il n’y a pas de régulation. Ce ne sont pas des dark pools, car le secteur est un peu moins sophistiqué que les marchés financiers, mais le niveau de transparence reste tout de même inférieur à celui des marchés organisés. D’autre part, la nature de la spéculation financière est différente. L’une des grandes nouveautés, depuis trois ou quatre ans, c’est que les commodités sont en tant que telles devenues une classe d’actifs. Des investisseurs aussi conservateurs que le Fonds de retraite des instituteurs californiens ont aujourd’hui de l’ordre de 10 % de leurs placements en commodités. Et comme ils ne sont pas très bons dans ce domaine, ils achètent des indices. Ce mouvement a sans doute été quelque peu perturbateur dans la mesure où lorsqu’on achète un indice, le gérant de l’indice doit prendre les positions correspondantes, c’est-à-dire des positions longues. Sur certains marchés restreints, cela peut représenter des parts importantes. C’est là qu’intervient la CFTC, en demandant par exemple à la Deutsche Bank de limiter ses positions sur le blé à Kansas City. Bref, elle joue un rôle de suivi et de régulation très actif, qui n’existe pas en Europe. Or, il est clair que pour être efficient, le marché doit être transparent et avoir un gendarme.
M. le rapporteur. Comment jugez-vous l’évolution des marchés de matières premières en la matière ? La transparence tend-elle à s’atténuer ? L’absence de gendarme européen porte-t-elle vraiment préjudice ?
M. Philippe Chalmin. Ces marchés sont relativement nouveaux. Les États-Unis ont toujours eu une bonne régulation, une CFTC efficiente. Le premier degré de la régulation est l’autorité de marché. Lorsqu’elle constate une situation anormale, par exemple la position d’un très gros spéculateur, elle a un moyen très facile de le ramener à l’ordre : l’augmentation du déposit. C’est ce qui s’est passé au début des années 1980 lors de la grande spéculation des frères Hunt sur l’argent. Ces derniers avaient mal évalué les stocks d’argent et ont été dépassés par tout ce qui est sorti – l’argenterie des grand-mères par exemple – mais in fine, c’est l’augmentation du déposit qui les a tués. Le second degré est la CFTC. Elle est souvent critiquée, mais le niveau de transparence du système américain est beaucoup plus élevé que ce que nous connaissons. La nomination des cinq commissaires de la CFTC passe devant le Congrès, qui épluche leur indépendance de manière extrêmement stricte. C’est tout de même autre chose que pour les commissaires européens.
En Europe, le gros des marchés à terme est britannique, c’est-à-dire est dans le laisser faire le plus total. Les squeeze – un acteur se débrouille pour mettre la main sur tout le physique disponible à une échéance et s’assoit dessus en attendant que les autres soient suffisamment étranglés pour faire monter artificiellement les prix – sont chose courante, sur le café, le cacao l’étain ou le nickel par exemple. Jamais cela ne se passerait comme ça aux États-Unis. En France, la question est relativement nouvelle. Pendant longtemps, on n’y a rien compris – on a tout de même fermé le marché à terme de Paris en 1974, le ministre de l’époque n’ayant jamais rien compris à ce qui s’y passait. Ensuite, les marchés à terme ont vivoté, sauf le MATIF (qui veut dire maintenant marché à terme international de France) qui a connu un développement extraordinaire, mais qui était contrôlé par la COB.
M. le rapporteur. C’était le MATIF qui avait un système d’arrêt des opérations en cas de surchauffe.
M. Philippe Chalmin. Les limit up et limit down existent toujours : en cas de tension trop forte, le marché ferme pour une heure. Si cela ne suffit pas, on attend le lendemain. Cela a l’avantage de laisser du temps – pour reprendre l’image du poker, il faut attendre que les joueurs blindent à nouveau. Car c’est un jeu à somme nulle ! Il y a autant d’argent gagné que perdu. Le marché ne peut pas faire crédit.
M. le président Henri Emmanuelli. Mais la spéculation n’est pas toujours à somme nulle, on est en train de s’en apercevoir. Elle coûte cher.
M. Philippe Chalmin. Il y a des gagnants et des perdants, mais il y a toujours autant de positions dans un sens que dans l’autre. Si l’on vend, c’est qu’il y a quelqu’un pour acheter. Sur le marché, le jeu est à somme nulle. Mais il y a d’autres acteurs. Le producteur très content d’avoir vendu en juillet son blé à 130 euros la tonne, alors qu’on était à 110 deux mois plus tôt, se mord les doigts aujourd’hui. La coopérative qui le lui a acheté y gagne, sauf si elle s’est couverte immédiatement. Celui qui est sûr de gagner, in fine, c’est le meunier ou le boulanger, qui répercute immédiatement la hausse du prix alors qu’il a acheté trois mois plus tôt. La hausse de la baguette pouvait s’expliquer lorsque le blé est passé de 120 à 300 euros la tonne en 2007-2008, mais il n’y a pas eu de baisse lorsqu’on est retombé à 120 euros en 2009 et mon boulanger vient de m’expliquer qu’il allait encore augmenter de cinq centimes le prix de la baguette…
Dans le chemin qui va du producteur au consommateur final, le spéculateur en lui-même ne prélève rien. Dans un marché très concurrentiel, il peut même permettre aux professionnels de fonctionner à contre-marge. L’Égypte, par exemple, est le premier importateur mondial de blé : entre 6 et 9 millions de tonnes par an. Son principal acheteur est public : le General Authority for Supply Commodities. Lorsqu’il fait un appel d’offres, il doit calculer le prix du blé. Ce n’est pas compliqué : le prix du marché à terme, le différentiel entre ce prix théorique et le marché physique, le coût du fret et des assurances… Tout le monde peut faire le même calcul au même moment. Or, lorsque j’ai travaillé avec le GASC, le prix concrètement obtenu était de 3 ou 4 % inférieur à ce calcul optimal : l’immense transparence du marché permettait en fait aux négociants d’optimiser toutes les petites spéculations nécessaires pour couvrir leurs risques. Cela ne fait pas baisser les prix : cela fait que le coût d’intermédiation normal du négociant est quasiment pris en charge par le marché. Les choses étaient très différentes pour le riz, dénué de marché dérivé. Lorsqu’un négociant remplit un bateau de riz à Bangkok et l’amène au large de l’Afrique avant d’appeler les gros importateurs locaux, il prend le risque de deux mois d’incertitude sur le prix du riz. C’est un jeu extrêmement risqué et il est obligé de vendre avec une marge.
M. Louis Giscard d’Estaing. Lorsque j’ai rencontré à Washington l’un des cinq commissaires de la CFTC, Mme Sommers, je lui ai demandé ce qui empêchait la fusion avec la SEC. Le fait est que la CFTC a été créée pour contrôler les marchés des matières premières, pour l’essentiel agricoles. Lorsque les produits dérivés sont apparus, dont certains sont purement financiers, la question de qui allait les contrôler s’est posée. C’est la CFTC qui a gardé cette compétence. Or, la CFTC relève toujours de la commission de l’agriculture au Congrès américain. Une des raisons pour lesquelles il n’y a pas fusion est que la commission de l’agriculture ne veut pas renoncer à cette compétence.
M. Philippe Chalmin. La commission de l’agriculture du Sénat américain est un lieu de pouvoir important, notamment du fait de son mode d’élection. Nous sommes plus ou moins en train de saborder notre politique agricole commune, mais aux États-Unis, les farm acts ne sont pas près de disparaître. La commission des affaires européennes du Sénat français, qui m’a auditionné sur l’avenir de la politique agricole commune, me demandait pourquoi nous ne pouvions pas faire comme eux. C’est simple : avec deux représentants par État, le sénateur du Dakota du sud pèse aussi lourd que celui de New York : les intérêts agricoles deviennent donc essentiels. C’est pour cela que les États-Unis ont pu faire un bras d’honneur à l’OMC à propos des condamnations concernant le coton.
M. le président Henri Emmanuelli. La prime de la PAC n’a pas baissé avec la hausse du blé et du maïs. Mais c’est un autre sujet…
M. Philippe Chalmin. Cela dépend de l’objet qu’on donne à la prime de la PAC. Si l’on admet qu’il s’agit d’une rémunération par la société, découplée du marché, de tout ce que l’agriculture apporte de positif à la nature…
M. le président Henri Emmanuelli. Les jardiniers de la nature ? Mais il y avait des forêts, avant les champs ! Dans mon village, il y avait quatorze agriculteurs il y a trente ans. Il n’en reste que deux, mais pas un seul hectare n’a été abandonné.
M. Philippe Chalmin. Dans la grande Lande peut-être, mais dans le sud du Massif central par exemple, la désertification est un réel problème.
M. le président Henri Emmanuelli. Je n’ai tout de même jamais trouvé que c’était un bon argument.
M. Louis Giscard d’Estaing. Pourquoi n’y a-t-il pas de marché organisé du lait ?
M. Philippe Chalmin. Parce que les grands producteurs de lait ont toujours eu des marchés nationaux organisés. Il y a très peu d’échanges internationaux. Le marché mondial du lait est marginal : beurre, poudre, fromages de garde… Le prix mondial est le prix de revient du producteur le plus efficient, c’est-à-dire la Nouvelle-Zélande. Les États-Unis ont un système organisé, avec une loi laitière. L’Europe avait les quotas laitiers. Il existe une cotation du lait à Chicago, mais sans grande importance parce que, pour qu’un marché dérivé fonctionne, il faut des spéculateurs et que cela ne s’est jamais développé dans le lait. Le 18 octobre s’est ouvert à Euronext un marché à terme de la poudre de lait écrémé. À mon avis, cela ne fonctionnera jamais. En revanche, certains marchés à terme nous seraient très utiles, même si je doute qu’ils se mettent en place. Aux États-Unis, les grandes productions animales ont des marchés dérivés : longe de porc congelée, carcasse de bovin, bétail vivant… L’Europe gagnerait à avoir un marché à terme du porc, car on voit toutes les limites du marché au cadran. Le marché à terme permet presque d’éteindre les tensions sur les marchés physiques, parce que sa fonction anticipatrice permet de donner un prix pour l’avenir.
M. le président Henri Emmanuelli. Le marché au cadran, quelle catastrophe…
M. Philippe Chalmin. Les éleveurs de porcs subissent une double incertitude. Un porc, c’est du maïs et du soja mitonnés pendant trois mois. Il existe donc un risque sur l’approvisionnement en maïs et en soja et un autre sur le prix du porc, les deux n’étant absolument pas liés. C’est différent pour la volaille : le prix d’un poulet est à peu près directement lié au prix de son alimentation.
M. le président Henri Emmanuelli. Merci, monsieur le professeur.
La séance est levée à dix neuf heures cinquante.
*
* *
Audition de Mme Pervenche Berès, présidente de la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen, rapporteure de la commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale du Parlement européen
(Procès-verbal de la séance du mercredi 27 octobre 2010)
(Présidence de M. Henri Emmanuelli, président de la commission d’enquête)
La séance est ouverte à dix-neuf heures trente
M. le président Henri Emmanuelli. Madame la présidente, je propose que vous nous livriez les conclusions de l’important rapport que vous avez rédigé pour le Parlement européen, après quoi nous débattrons très librement.
(Mme Pervenche Berès prête serment)
Mme Pervenche Berès. Le mandat de la commission spéciale créée voici un an par le Parlement européen excédant le champ de la seule spéculation financière, je me limiterai ce soir aux questions qui relèvent de la compétence de votre commission d’enquête.
La première question qui se pose – et à laquelle ont peut-être déjà répondu, dans le cadre de vos auditions, des personnalités plus compétentes que moi en la matière – est celle de la définition même de la spéculation. Après la crise grecque, de nombreuses autorités m’ont déclaré, d’une manière assez surprenante, qu’elles ne parvenaient pas à observer sur les marchés de mécanismes de spéculation. Il semblerait donc souhaitable de définir ce qu’on entend par « mouvement spéculatif ».
M. le président Henri Emmanuelli. Face au caractère ambivalent de la spéculation – qui a des aspects nécessaires en ce qu’elle équilibre le marché –, le travail de notre commission d’enquête se limite aux aspects liés à la régulation et à la sécurisation.
Mme Pervenche Berès. Le rapport du Parlement européen exprime d’abord une inquiétude face aux orientations de la Commission européenne. Celle-ci, qui a fait un travail intelligent sur la base du rapport de M. Jacques de Larosière consacré au paquet supervision, a franchi une étape, même s’il ne s’agit pas encore d’interdire la vente à découvert. Je tiens à vous alerter sur un point : alors que la Banque centrale européenne s’est vu donner les moyens d’être quasiment la première banque centrale du monde – de fait, elle était la seule à intervenir le 9 août 2007 –, la mise en place d’autorités qui n’auraient pas les moyens requis en termes d’expertise et de personnel peut conduire à un grave déséquilibre et à de grandes désillusions. Gardons-nous de créer une usine à gaz inefficace.
Pour l’heure, et sous réserve d’examen de la capacité des États membres à se mobiliser pour rendre ces autorités opérationnelles, le paquet supervision a été bien mené, avec une perspective d’ensemble. Cependant, bien des mesures préconisées par le rapport Larosière ne sont pas encore mises en œuvre, notamment en matière d’anticipation des crises et de sanctions. En effet, faute d’harmonisation des sanctions, les opérateurs de marché définissent leurs stratégies de localisation en fonction des sanctions applicables. Après l’adoption du paquet supervision, nous sommes aujourd’hui engagés dans un paquet régulation pour lequel le commissaire égrène un catalogue de propositions définies en vue du seul objectif de stabilité des marchés financiers. La question de savoir comment ces régulations permettront le financement de l’économie et comment en optimiser les effets n’est jamais posée.
J’en viens aux deux points qui vous intéresseront sans doute particulièrement à l’échelle européenne : l’avenir de la directive relative aux marchés financiers – la MIF – et les chambres de compensation.
La MIF repose sur un pari consistant à ouvrir les bourses à la concurrence, notamment à celle des brokers, en échange de la transparence sur les prix. En réalité, cette transparence ne s’est pas faite et les « dark pools », qui sont des mécanismes d’internalisation, se soustraient à toute visibilité pour développer des stratégies potentiellement spéculatives.
L’autre aspect, plus criant durant la crise, en particulier lors de la chute de Lehman Brothers, est l’apparition d’un produit « miracle » inconnu cinq ans plus tôt : les « credit default swaps », ou CDS. Ces produits, qui ne faisaient l’objet d’aucune surveillance, échappaient à la règle de la transparence, qui est à la base du fonctionnement sain d’une économie de marché. Les CDS recouvrent une concurrence transatlantique considérable. De fait, ces segments de marché peuvent fragiliser certains de nos opérateurs et appeler, en dernier ressort, une intervention de la banque centrale ou les autorités publiques nationales pour aider les éventuelles victimes des CDS. La cohérence d’une chambre de compensation est absolument cruciale. Cependant, les grands artisans de la titrisation excessive sont toujours en très bonne santé et s’emploient à éviter une telle avancée.
M. le président Henri Emmanuelli. Vous pensez aux Britanniques ?
Mme Pervenche Berès. Non, aux Américains. Les Britanniques ont cependant partie liée avec eux, car une partie du marché se passe à Londres – notamment les swaps sur les CDS.
M. le président Henri Emmanuelli. Ils sont hostiles à toute forme de chambre de compensation.
Mme Pervenche Berès. L’idée que nous avions eue d’une chambre de compensation pour la zone euro…
M. le président Henri Emmanuelli. N’est pas bonne pour la City !
Mme Pervenche Berès. Cette idée a fait l’objet d’une lettre de la ministre française à toutes les autorités européennes.
M. le président Henri Emmanuelli. C’est une idée à laquelle je suis très favorable, mais je serais étonné qu’elle soit acceptée de l’autre côté de la Manche. Et comme nous sommes toujours très faibles avec les Britanniques…
Mme Pervenche Berès. Dans le contexte de ce bras de fer, le Parlement européen a voté pour la première fois la proposition d’une taxation des transactions financières, qui aurait quelques vertus, notamment en termes de régulation du marché et de plus grande maîtrise de la transparence des mouvements de capitaux et des mouvements spéculatifs. Dans le débat politique européen, on entend de plus en plus souvent l’argument selon lequel une taxation générerait un produit déséquilibré selon le volume des transactions effectuées dans les différents pays. Bien évidemment, le Royaume-Uni, où s’effectuent la plupart des transactions, est particulièrement concerné.
M. le président Henri Emmanuelli. Existe-t-il des chances réelles de voir disparaître les dark pools ? Quelles sont les propositions de M. Barnier à ce propos ?
M. Jean-François Mancel, rapporteur. Quel est, sur cette question, le rapport de forces au sein de l’Union européenne ? Voit-on s’opposer les continentaux et les Britanniques, ou les courants sont-ils plus complexes ? Peut-on imaginer des accords a minima qui pourraient être utiles et efficaces, dans le cadre notamment du G8 et du G20 ?
Mme Pervenche Berès. Il y a certes une opposition entre l’Europe continentale et le Royaume-Uni, mais le mécanisme est plus compliqué. En effet, une telle opposition supposerait que nous ayons une capacité naturelle d’alliance forte avec l’Allemagne. Or, dans ce débat, l’Allemagne est souvent perdue. De fait, ce pays ne possède pas de grande banque nationale – la seule, qui est la Deutsche Bank, a installé à Londres la moitié de son comité directeur et agit sur le marché britannique comme un acteur de la City. Lors de la négociation de la MIF, toutes les autorités françaises – le Trésor, Bercy et l’AMF – étaient mobilisées derrière Michel Prada pour réfléchir à cette législation. Il me semble toutefois que nous avons fait preuve d’une certaine naïveté en échangeant la mise en concurrence des bourses et des brokers contre la transparence, laquelle a donné lieu à un véritable bras de fer quand il s’est agi de définir des seuils – ce qui s’est traduit par la mise en place des dark pools. Dans ce bras de fer, j’ai toujours cherché l’alliance des collègues allemands – et cela d’autant plus naturellement que la commission économique et monétaire était alors présidée par une camarade appartenant au SPD, avec laquelle je m’entendais bien –, mais il était très difficile d’anticiper leurs souhaits. Cette même difficulté se retrouve aujourd’hui dans la négociation sur les fonds alternatifs et les private equities, dont M. Jean-Paul Gauzès est rapporteur.
M. le président Henri Emmanuelli. Les Allemands sont tiraillés.
Mme Pervenche Berès. Exactement. Il s’agit d’un domaine dans lequel l’industrie allemande n’a pas d’objectifs très clairs, alors que – disons-le honnêtement – les Français ont autant d’appétence que les Britanniques à intervenir sur ces marchés, même si c’est avec d’autres méthodes, d’autres objectifs et d’autres résultats. Le système bancaire allemand est quant à lui dans une situation très difficile, avec un acteur fort installé à Londres.
M. le président Henri Emmanuelli. Le Luxembourg et les autres acteurs comparables interviennent-ils dans ce domaine, ou se font-ils discrets ?
Mme Pervenche Berès. C’est un vieux tour de passe-passe : quand un acteur intervient, l’autre n’a pas besoin de le faire, comme on l’a bien vu à propos de la directive sur la fiscalité de l’épargne. Avec le Luxembourg, le point difficile est la question fiscale.
M. le président Henri Emmanuelli. Et en matière de régulation ?
Mme Pervenche Berès. M. Gauzès vous dira que, dans la négociation sur les fonds alternatifs, il n’a pas eu trop de difficultés avec son collègue luxembourgeois, rapporteur fictif socialiste.
Pour ce qui est des dark pools, on distingue certes un camp britannique fort, mais certains Britanniques rédigent aussi des amendements qui vont dans notre sens et prennent acte du fait que l’existence de ces structures mine la base sur laquelle a été élaborée la MIF.
M. le président Henri Emmanuelli. M. Barnier a-t-il fait des propositions ?
Mme Pervenche Berès. Il va en faire.
M. le président Henri Emmanuelli. Est-il prévu un arbitrage ou une hiérarchisation ? Si je comprends bien, M. Barnier tâte le terrain.
Mme Pervenche Berès. Il met quotidiennement des législations sur la table. À ce propos, j’attire d’ailleurs votre attention sur Bâle III, même si la question ne relève pas directement de la spéculation. Dans le rapport sur la crise, mes collègues ont accepté de demander que les accords conclus à Bâle fassent l’objet de traités internationaux. En effet, dans la situation actuelle, la stratégie d’influence des grandes banques d’investissement américaines les rend omniprésentes au comité de Bâle, alors qu’elles n’en appliquent jamais les accords.
M. le président Henri Emmanuelli. Pour la loi Dodds-Frank, elles ont consacré 800 millions de dollars au lobbying. Elles pourraient faire un petit effort.
Mme Pervenche Berès. L’instigateur du processus de Bâle II, destiné à optimiser la stratégie de gestion des risques pour les fonds propres des banques, était le patron de la Réserve fédérale de New York et le secrétaire général du comité de Bâle est aujourd’hui encore un Américain. Nous sommes les seuls à appliquer ce dispositif, qui est conçu dans une chambre opaque et sans aucun mandat.
M. le président Henri Emmanuelli. Il en va de même pour les normes comptables.
Mme Pervenche Berès. C’est même pire !
M. le président Henri Emmanuelli. Les pouvoirs publics ont laissé des intérêts très corporatistes se réunir et décider. En matière de normes comptables, la méthode de valorisation retenue aura une incidence positive ou négative.
Mme Pervenche Berès. Pour ce qui est de ces normes, je pourrais vous suggérer les noms de personnes que votre commission souhaitera peut-être entendre. En effet, un groupe de chercheurs français publie dans ce domaine des travaux remarquables, qui bousculent bien des idées reçues.
M. le président Henri Emmanuelli. Les banques et les compagnies d’assurance françaises ne sont pas très enclines à adopter la méthode américaine.
Mme Pervenche Berès. Les International Financial Reporting Standards, ou normes IFRS, intègrent toutefois la « juste valeur ».
M. le président Henri Emmanuelli. C’est très procyclique et parcellaire.
M. Louis Giscard d’Estaing. Quelle est cette équipe française ?
Mme Pervenche Berès. Je vous en communiquerai les coordonnées. Elle a une approche pluridisciplinaire et a notamment travaillé sur la notion de « juste valeur ».
M. Jean-François Mancel, rapporteur. C’est intéressant.
M. le président Henri Emmanuelli. Votre rapport formule-t-il des conclusions à propos des agences de notation ?
Mme Pervenche Berès. Lors de la dernière révision de la directive, alors que Jean-Paul Gauzès était rapporteur, nous avions obtenu que, pour pouvoir intervenir à l’échelle européenne, les agences de notation soient enregistrées auprès du CESR. Il était également prévu que cet enregistrement se ferait à terme auprès de l’ESMA, l’autorité européenne des marchés financiers, établie à Paris, qui succèdera au CESR.
Le mode de financement des agences de notation conduit structurellement au conflit d’intérêts. C’est là un aspect auquel M. Barnier est sensible. Notre rapport évoque la faisabilité d’un autre mode de financement, assuré par l’investisseur, ainsi que la création d’une agence publique européenne. Il envisage aussi la possibilité de noter la dette souveraine comme un produit financier normal. L’Assemblée nationale française pourrait peut-être travailler en ce sens. De fait, tous les pays de l’Union européenne ne disposent pas d’institutions possédant la même expertise ou la même fiabilité en matière d’analyse de la dépense publique que la Cour des comptes – c’est du reste auprès de celle-ci, je le rappelle, que les agences de notation viennent prendre leurs informations.
On doit se demander où doit être faite cette notation et si elle doit se faire selon les mêmes critères que pour une entreprise cotée sur le marché.
Ces questions, que j’ai commencé à poser voilà quatre ans sans grand écho, commencent à se généraliser et j’entendais d’ailleurs aujourd’hui même l’un de nos collègues irlandais, député chrétien démocrate, renchérir sur le même sujet. La situation de conflit d’intérêts des agences de notation qui notent des produits qu’elles vont revendre à leurs clients, lesquels leur passent commande sur leur propre stratégie d’entreprise, est inacceptable.
M. le président Henri Emmanuelli. N’a-t-il pas été suggéré aussi de rémunérer les agences de notation en fonction de la performance des produits ?
Mme Pervenche Berès. C’est une idée qui circule, mais c’est compliqué.
M. le président Henri Emmanuelli. La dette souveraine, quant à elle, pose d’emblée un problème politique, auquel les solutions ne sont pas seulement techniques.
Mme Pervenche Berès. On voit bien la difficulté. C’est d’ailleurs tout le problème de la logique de l’accord franco-allemand : pour ne pas alerter les marchés, on a voulu imiter le bon élève, mais on s’est privé ainsi des marges de manœuvre qui auraient permis de se poser les bonnes questions – comme celle du rôle des agences de notation dans la notation des dettes souveraines. Chaque pays coupable vis-à-vis des marchés doit se débattre seul, sans pouvoir organiser une coalition des pays coupables qui permettrait de poser ces questions.
M. le président Henri Emmanuelli. Nous ne sommes coupables de rien.
Mme Pervenche Berès. Je ne parlais pas de la France.
M. Louis Giscard d’Estaing. Le cas de l’Irlande est intéressant. M. Charlie Mc Creevy, membre irlandais de la Commission européenne, a notamment mis en place, dans ses fonctions antérieures de ministre des finances de son pays, des mesures de libéralisation des marchés des capitaux. Quelle est, selon vous, l’interaction entre la Commission européenne – particulièrement M. Mc Creevy – et l’exposition de l’économie irlandaise à la crise bancaire ?
Mme Pervenche Berès. L’Irlande est, à l’échelle européenne, un cas exemplaire d’organisation de la spéculation. À la veille de l’explosion de la crise, Londres s’inquiétait de la délocalisation de nombreux fonds alternatifs et autres acteurs vers Dublin.
M. le président Henri Emmanuelli. Pour des raisons fiscales.
Mme Pervenche Berès. En effet.
M. le président Henri Emmanuelli. Comment les Irlandais vivent-ils cette situation ?
Mme Pervenche Berès. Ils sont conscients d’être victimes d’une stratégie qui leur a profité pendant un certain temps. J’ai eu un certain écho vendredi dernier en leur rappelant que l’importance des investissements étrangers n’était pas forcément un critère de bonne santé. Les Irlandais, qui sont champions de l’accueil de ces investissements, ont conscience que leur capacité de rebond est inexistante. De fait, les investisseurs traitent l’Irlande comme un atelier. Les investissements les plus importants en termes de production ont été ceux de Dell, mais la stratégie de cette multinationale américaine est encore pire que celle de Procter & Gamble, traitant l’Irlande comme une place off-shore. La capacité à recréer de la valeur ajoutée est aujourd’hui très limitée.
M. le président Henri Emmanuelli. D’autant plus que ce genre d’activité se délocalise très vite.
Mme Pervenche Berès. Dell a licencié 1 500 salariés lorsque l’entreprise a cessé la production d’ordinateurs de bureau pour délocaliser l’activité en Pologne, où elle bénéficiait d’aides d’État pour la production d’ordinateurs portables. Le même jour, Dell rachetait à New York une entreprise de softwares et voyait son cours en Bourse monter en flèche, tandis qu’en Irlande, aucun interlocuteur syndical n’a participé aux négociations entourant les 1 500 licenciements.
M. le président Henri Emmanuelli. Les Irlandais ont-ils conscience que cette facilité se paie cher ?
Mme Pervenche Berès. Près de la moitié du débat auquel j’ai participé en Irlande – certes avec des progressistes – a été consacrée à la question fiscale. Les progressistes irlandais admettent que le pays ne sortira pas de la situation présente sans reconstruire une base fiscale qui a été entièrement défaite. L’impôt sur les sociétés est officiellement de 20 %, mais les prélèvements réels sont quasi-insignifiants du fait de la multiplication des niches fiscales.
M. le président Henri Emmanuelli. J’ai lu que les activités de Google en France et en Allemagne étaient soumises à 2,5 % d’impôts, car tous les bénéfices remontaient vers deux holdings, l’une en Irlande et l’autre aux Pays-Bas, avant d’être directement transférés vers les Bermudes. Ces sociétés gagnent beaucoup d’argent et pourraient se dispenser de tels agissements. Mais tant que les décisions en matière fiscale exigeront l’unanimité à l’échelle européenne, on ne progressera guère.
Mme Pervenche Berès. J’ai été déçue que le rapport du commissaire Monti ne saisisse pas l’occasion de poser la question. Au départ, pour M. Monti, le marché intérieur était fragilisé du fait que les partisans de ce marché risquaient de se trouver face à des adversaires développant en période de crise des réflexes protectionnistes. Ces partisans avaient d’autant plus besoin de donner des gages qu’ils devaient reconstruire leur base fiscale : une obligation européenne en la matière engagerait un mécanisme donnant-donnant.
M. le président Henri Emmanuelli. Un début d’harmonisation…
Mme Pervenche Berès. En présentant son programme politique au Parlement européen, M. Barroso n’a même pas mentionné l’harmonisation de l’impôt sur les sociétés. Il me semble toutefois que cette question figure aujourd’hui à nouveau dans le texte mis sur la table par M. Barnier. Un accord sur cette question aurait été préférable à celui qui a été conclu à Deauville.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. Quelles sont les priorités essentielles qui se dégagent des conclusions de votre rapport et devraient être mises en œuvre ?
Mme Pervenche Berès. La principale proposition du rapport n’a pas trait aux marchés financiers, mais à l’exercice par l’Union européenne de compétences partagées avec les États membres, par exemple dans le domaine de l’énergie, où l’Union s’est contentée d’organiser le marché intérieur au lieu d’être pleinement un acteur qui se mobiliserait à l’intérieur en vue de l’interconnexion des réseaux et pèserait à l’extérieur dans la négociation avec ses partenaires.
Pour ce qui est de la spéculation, j’insisterai sur le concept de transparence. En effet, alors qu’un marché ne peut fonctionner que dans la transparence – ce qui est précisément le pari sur lequel repose la MIF –, les acteurs s’ingénient à y échapper et à multiplier les conflits d’intérêts. Le rôle du législateur est donc, selon moi, d’organiser les moyens de cette transparence.
M. le président Henri Emmanuelli. Toutes les personnes auditionnées par la commission d’enquête ont du reste défini la transparence comme la priorité numéro un.
Mme Pervenche Berès. N’oublions pas le conflit d’intérêts.
M. le président Henri Emmanuelli. Pour détecter le conflit d’intérêts, la transparence est indispensable. D’où le rôle des chambres de compensation.
Mme Pervenche Berès. Lors de la chute de Lehman Brothers, le 15 septembre 2008, un vent de panique s’est mis à souffler comme s’il y avait un virus dans l’air.
Il y avait des cas d’infection, mais on ne savait pas comment le virus se transmettait. M. Ackermann, président de la Deutsche Bank, a déclaré immédiatement que tous les acteurs devaient faire connaître l’état de leur contamination, mais il ne s’est rien passé – la Deutsche Bank étant du reste la dernière à pratiquer la transparence sur son livre de comptes. En mars 2009, le Forum de stabilité financière recommandait, en vue du G7 suivant, de laisser 100 jours aux banques pour faire la transparence sur la présence de produits dits toxiques dans leurs comptes, mais sans demander aux superviseurs compétents de procéder à des vérifications sur pièces et sur place.
M. le président Henri Emmanuelli. Le vrai problème est que bon nombre de banques ignoraient leur niveau d’exposition. Même une banque vertueuse aurait été incapable d’une telle transparence. L’une des personnes auditionnées tout à l’heure expliquait à ce propos comment, entre le samedi et le lundi soir, la situation d’une banque était passée du simple soupçon à la catastrophe – les réserves de liquidités étaient évaluées à trois mois le samedi, à trois semaines le dimanche, puis à trois heures le lundi !
Mme Pervenche Berès. Même s’il n’est pas question de l’aborder au Parlement européen, où il est actuellement impossible de réunir une majorité à ce propos, la question de la titrisation mérite d’être posée.
M. le président Henri Emmanuelli. Certains proposent aujourd’hui d’interdire les CDS nus.
Mme Pervenche Berès. Paul Jorion prône même l’interdiction totale de la titrisation.
M. le président Henri Emmanuelli. Moi qui me souviens du temps où il y avait des banques de dépôt et des banques d’investissement, cela ne me dérangerait pas.
Mme Pervenche Berès. La séparation des banques de dépôt et des banques d’investissement est une question qu’on n’a pas le droit d’aborder en France.
M. le président Henri Emmanuelli. En effet, cette perspective ne semble pas séduire l’Association française des banques – l’AFB. Il est vrai que, jadis, les banques de dépôt ne faisaient pas les mêmes bénéfices.
Mme Pervenche Berès. Le paysage bancaire français est très particulier en Europe. La banque française est en effet très concentrée, sur le modèle de la « banque universelle ».
M. le président Henri Emmanuelli. La concentration s’est faite très vite dans les années 1970-1980, à la faveur d’achats et de fusions.
Mme Pervenche Berès. Cela donne aux banques françaises une force de frappe dans certains domaines, mais l’augmentation des fonds propres qu’exigera le Conseil de stabilité financière leur posera un problème.
M. le président Henri Emmanuelli. Un autre problème est que, comme l’expliquait à la commission des finances le président de l’AFB, les fonds propres coûtent très cher aux banques, car les actionnaires exigent une rémunération de 15 %.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. Il semble toutefois que notre système bancaire s’en soit moins mal tiré que beaucoup d’autres.
Mme Pervenche Berès. Je ne le nie aucunement, mais cela rend difficile d’envisager la séparation entre banques d’investissement et banques de dépôt, qui serait nécessaire dans certains pays.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. Que pensez-vous du trading haute fréquence ?
Mme Pervenche Berès. La taxation des transactions financières règlerait le problème tout en assurant la transparence des acteurs.
En cette période de sortie de crise, le « court-termisme » qui prévaut et la structure du capital des entreprises – avec des phénomènes tels que le prêt d’actions avant les assemblées générales – devraient nous pousser à évoquer la gouvernance des entreprises.
M. le président Henri Emmanuelli. Le directeur général de la Caisse des dépôts y a pensé : il crée un club d’investisseurs à long terme.
Mme Pervenche Berès. Cela lui donnera l’assurance de faire partie de l’élite, tandis que les autres poursuivront leurs pratiques.
M. le président Henri Emmanuelli. On saisit là l’incompatibilité entre la durée dans laquelle doit s’inscrire la croissance des entreprises et un court-termisme qui peut conduire à refuser l’investissement.
Mme Pervenche Berès. C’est la pratique des fonds de pension, qui gèrent pourtant de l’épargne longue.
M. le président Henri Emmanuelli. Le responsable du premier fonds de ce genre, destiné aux fonctionnaires de Californie et devenu gigantesque, qui était aussi chancelier de toutes les universités de Californie, m’a dit autrefois qu’il souhaitait que la France et l’Europe créent également des fonds de pension car, compte tenu de l’évolution prévisible de la démographie américaine, il aurait besoin d’acheteurs. Comme je faisais observer que ces acheteurs achèteraient aussi le pouvoir, il me répondit que ce n’était pas son problème.
Mme Pervenche Berès. Nous n’avons pas abordé la question des taux d’intérêt américains.
M. le président Henri Emmanuelli. Les travaux de notre commission d’enquête ne portent pas sur les questions monétaires. Je note des progrès en la matière, mais le débat sera difficile, car ni les Chinois, ni les Japonais, ni les Américains ne souhaitent voir monter la valeur de leur monnaie. Seuls les superbes Européens laissent faire – et cela va nous coûter un demi-pointe de croissance. Pour ma part, je suis résigné : depuis le franc-or, devenu « franc fort », puis « euro fort », j’ai compris que tout se passait à… Francfort. Cette conception européenne de la monnaie, qui est de tradition à l’inspection des finances, exprime en fait le choix de protéger l’épargne plutôt que de favoriser l’investissement.
Je rappelle pour conclure que, durant la crise, Mme Merkel avait déclaré qu’elle interdisait les ventes à terme en matière de dette souveraine. Dans la pratique, cette interdiction n’a jamais été appliquée.
Mme Pervenche Berès. La chancelière avait besoin de donner des gages à la CDU pour montrer qu’elle reprenait la main.
M. le président Henri Emmanuelli. Nous aurions dû être plus prudents avant de la donner en exemple à Mme Lagarde.
Mme Pervenche Berès. À Paris, l’interdiction des ventes à découvert a aussi des adversaires.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. À commencer par France Trésor, car c’est un mécanisme utile pour donner de la liquidité.
M. le président Henri Emmanuelli. Il faut distinguer les cas où ce mécanisme est utile et ceux où il pose problème, comme pour la dette souveraine.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. M. Augustin de Romanet s’est déclaré clairement opposé aux CDS à nu.
Mme Pervenche Berès. Mais tout le monde ne partage pas cette position.
M. le président Henri Emmanuelli. Le CDS peut se justifier pour couvrir un risque, mais le CDS à nu s’apparente au PMU ou au casino.
Mme Pervenche Berès. Il serait par ailleurs dangereux d’accréditer l’idée qu’il y aurait deux types de législation – l’une pour l’homme de la rue et l’autre pour les acteurs professionnels. La crise a en effet démontré que la titrisation avait fait disparaître cette barrière.
M. le président Henri Emmanuelli. On en revient à la distinction entre les banques de dépôt et les banques d’investissement.
Madame Berès, je vous remercie.
L’audition s’achève à vingt heures quarante.
*
* *
Audition de M. Frédéric Oudéa,
président-directeur général de la Société Générale
(Procès-verbal de la séance du mercredi 3 novembre 2010)
(Présidence de M. Henri Emmanuelli, président de la commission d’enquête)
La séance est ouverte à dix-sept heures
M. le président Henri Emmanuelli. Monsieur le président, je vous remercie d’avoir répondu à l’invitation de la commission d’enquête. Depuis maintenant dix-huit mois, vous êtes président-directeur général de la Société Générale. Votre établissement est un acteur majeur sur les marchés financiers. Aussi êtes-vous pour nous un témoin précieux, notamment au sujet de certaines pratiques des salles de marché.
La crise financière et plus particulièrement la crise grecque a suscité de nombreuses interrogations, notamment sur la sensibilité des marchés financiers aux rumeurs, sur les conflits d’intérêt affectant certains opérateurs, sur le mécanisme des Credit Default Swaps, les CDS, et sur les effets déstabilisants des outils permettant les ventes à terme et à découvert de certains produits financiers.
La spéculation, au sens originel du terme, n’est pas une activité étrangère à votre profession. Mais selon vous, où s’arrête la bonne spéculation, celle qui est nécessaire à l’équilibre et à la liquidité des marchés ?
Comment la contribution des activités pour compte propre a-t-elle évolué, depuis 2007, dans le produit net bancaire de la Société générale ?
Il est difficile de ne pas faire allusion à l’affaire Kerviel. Serait-elle encore possible aujourd’hui ? Quelles ont été les mesures prises en interne, en particulier au niveau de la supervision ?
Partagez-vous les conclusions de nombreux observateurs, selon lesquelles les récentes crises financières sont dues, en partie du moins, aux insuffisances de la régulation nationale, européenne et mondiale ?
Qui se livre aux attaques spéculatives, et à partir de quelles zones ou marchés ? Quel est le rôle des hedge funds ? Quelles relations la banque que vous présidez entretient-elle avec ce type de fonds ? Ont-elles changé depuis la crise financière ?
Pratiquez-vous le High Frequency Trading, le HFT, consistant à automatiser les décisions de vente ou d’achat, dont on affirme parfois qu’il amplifie les mouvements spéculatifs et peut, nous ont expliqué certains de ceux qui vous ont précédé ici, échapper à tout contrôle, a priori et en cours de séance - voire a posteriori, puisqu’il aura fallu plus de six mois pour savoir ce qui s’était passé le 6 mai dernier à Wall Street.
Devant notre commission, M. Jouyet a regretté la fragmentation du marché des actions résultant de la directive MIF. Quelle est à cet égard la pratique de la Société générale ? Autrement dit, recourez-vous aux dark pools ? Quelle est votre position sur la révision de cette directive ?
Quel est le rôle des agences de notation dans les prises de position de vos salles de marché ? Que pensez-vous du fonctionnement actuel de ces agences ?
Comment votre pratique a-t-elle évolué en matière d’octroi de stock-options ? Quel est votre sentiment à ce sujet ?
Enfin et surtout, quelles sont les propositions que vous pouvez faire pour assainir le fonctionnement des marchés financiers ?
(M. Frédéric Oudéa prête serment.)
M. Frédéric Oudéa, président-directeur général de la Société Générale. Vos questions balaient un domaine très large. En préalable, permettez-moi quelques mots sur la Société Générale et les activités qu’elle développe.
Créée en 1864, la Société Générale est présente dans quatre-vingt-trois pays et emploie 160 000 collaborateurs. Environ 60 000 personnes travaillent en France, où nous sommes l’un des principaux recruteurs du secteur privé. Nous avons tout d’abord des activités de banque de détail, à travers nos agences en France, mais aussi notre réseau à l’étranger, principalement en Europe de l’Est, en Afrique et dans le bassin Méditerranéen. Nous avons aussi des activités de services financiers d’assurance, de gestion d’actifs, de services titres et de banque privée. Enfin, notre banque de financement et d’investissement, qui représente à peu près le tiers de nos revenus et de nos capitaux, a elle-même différentes activités. Le financement, d’abord : nous aidons les entreprises à financer des projets d’infrastructure, à exporter, à investir. Les activités de marché, ensuite : nous aidons les entreprises à accéder aux marchés en servant d’intermédiaire entre elles et les investisseurs. Nous sommes ainsi, à ma connaissance et à date, le premier acteur pour les émissions d’actions d’entreprises françaises ; nous aidons également les entreprises à émettre des obligations. Et lorsqu’il n’y a pas de marché organisé, nous servons aussi d’intermédiaire entre les investisseurs en leur offrant de la liquidité quand ils veulent acheter ou vendre des actifs de toutes sortes – matières premières, devises… Nos activités de marché dans leur ensemble occupent 2 800 collaborateurs en front office dans le monde, et les activités pour compte propre stricto sensu représentent à peu près 3 % du revenu du groupe Société Générale.
Sur les marchés financiers, les banques ne sont que des acteurs parmi d’autres. Interviennent principalement des investisseurs de toutes sortes : les fonds de pension, les gestionnaires d’actifs qui collectent l’épargne dans les différents pays et les fameux hedge funds. Ces derniers, sans collecter systématiquement de l’épargne, disposent de capitaux qu’ils placent selon des stratégies d’investissement à plus ou moins court terme.
J’en viens à votre première question : où s’arrête la bonne spéculation ? Il est très difficile de répondre, surtout avec des chiffres. On connaît les volumes quand il y a des marchés. En revanche, on en est réduit, s’agissant des opérations OTC, de gré à gré, à des estimations faites à partir de statistiques pas forcément fiables. Spéculer, c’est anticiper, notamment un mouvement de prix, et prendre en conséquence une certaine position ; je ne vois donc pas comment vous apporter une réponse rationnelle et précise à cette question.
M. le président Henri Emmanuelli. Le rapport entre le PIB mondial et le volume des opérations OTC, c'est-à-dire 60 000 milliards contre 700 000 milliards selon la Banque des règlements internationaux, soit douze fois plus, est-il un critère pertinent ?
M. Frédéric Oudéa. Je ne sais déjà pas vérifier le second chiffre, la BRI a plus d’informations qu’une banque isolée. Prenons l’exemple des CDS, qui sont des contrats de protection contre le risque de crédit. En l’absence de marché organisé, c’est-à-dire de place centralisant les achats et les ventes, ils ont été conclus de manière bilatérale. Une banque A, se jugeant trop exposée à un risque sur une entreprise, mais ne souhaitant pas mettre fin à ses relations avec elle, se protège en passant un contrat de CDS avec une banque B. Si celle-ci accumule les contrats de ce type, elle pourra décider à son tour de se protéger en passant un contrat avec une banque C. C’est ainsi que la multiplication des contrats bilatéraux a abouti à une estimation de 60 000 milliards de dollars, bien supérieure à la somme des crédits sous-jacents. Car il n’existe pas de marché pour annuler les opérations de sens inverse, ce qui gonfle artificiellement « la bulle » apparente.
Y a-t-il trop de CDS ou pas assez ? Je ne sais pas juger. Pour notre part, nous soutenons l’idée de créer des places de marché, afin d’avoir une meilleure vision des volumes en question, de comprendre l’ensemble des risques et d’assurer une compensation entre les risques et les différents acteurs. La Société Générale n’est pas un acteur important en matière de CDS : nous ne vendons pas de la protection, nous n’assurons pas les autres. Nous avons tout intérêt à avoir moins de contrats bilatéraux et plus de standardisation, en passant par une place de marché.
Bref, je ne sais pas définir la bonne ou la mauvaise spéculation, mais je sais qu’il faut de la transparence, laquelle peut être assurée par le développement de plates-formes permettant une compensation entre les risques des différents acteurs.
Je sais aussi que nous avons été parfois victimes de rumeurs de marché, ce qui nous a conduits à demander à l’Autorité des marchés financiers (AMF) d’enquêter. Certains acteurs peuvent être tentés de faire circuler des rumeurs pour provoquer ne serait-ce que des petits mouvements de cours. Mais encore une fois, la frontière entre bonne et mauvaise spéculation n’est pas facile à tracer.
Quant aux activités pour compte propre, déjà marginales chez nous, il est très clair que, compte tenu des changements réglementaires qui interviennent, et notamment de l’augmentation considérable de capital – trois à quatre fois plus – qui va être demandée par les régulateurs pour exercer des activités de marché, elles vont se réduire encore.
Un bref rappel sur l’affaire Kerviel. M. Kerviel a pris des positions totalement en dehors de son mandat et les a masquées par de fausses transactions. Des contrôles étaient effectués mais ils portaient les positions nettes, s’agissant d’opérations d’arbitrage. Il y avait eu des alertes, mais cela n’avait pas conduit à détecter la fraude avant le fameux week-end du début janvier 2008. Nous avons donc, en totale transparence, renforcé nos contrôles. Premièrement, nous avons instauré des limites sur les nominaux portant sur chacun des arbitrages, et non plus seulement sur la position nette. Deuxièmement, nous avons créé un département spécial de lutte contre la fraude, opérant de manière transversale : Jérôme Kerviel faisait basculer ses fausses opérations d’une entité à l’autre, si bien que les incidents n’apparaissaient pas de manière récurrente dans un même département ; le département que nous avons créé examine tous les incidents de manière transversale, en essayant à chaque fois de « tirer les fils », au-delà de notre structure d’organisation. Troisièmement, nous avons réorganisé nos back-offices en créant un département appelé product control group, qui regroupe des acteurs d’horizons différents – middle office, finance, back-office – pour comprendre la constitution du résultat dans ses moindres détails, alors que jusque-là tout était noyé dans la masse des opérations ; désormais, nous pouvons avoir une vision quotidienne fiable de nos résultats. J’ajoute que le nombre d’auditeurs et d’inspecteurs n’a cessé d’augmenter depuis trois ans ; 1 700 personnes, soit environ 1 % de nos effectifs, se consacrent aujourd'hui exclusivement au contrôle de second niveau, effectué périodiquement, en plus du contrôle de premier niveau exercé de façon permanente par chaque opérateur ou manager.
Une autre affaire Kerviel est-elle possible ? À mon avis, non. La fraude existe, dès lors qu’il y a manipulation d’argent – sur les marchés financiers, mais aussi bien dans une agence pour détourner 1 000 euros – et nous ne sommes pas capables de l’éviter totalement. En revanche, à mon sens, une fraude de cette ampleur et de cette durée ne peut se reproduire à la Société Générale.
J’en viens à la question de la régulation, et d’abord à l’analyse de la crise – car si on ne fait pas le bon diagnostic, on risque d’apporter de mauvaises réponses et de provoquer de graves désillusions.
Pour moi, il s’agit d’une crise de compétitivité, profonde, des économies développées. À partir des années 2000 surtout, les économies développées sont entrées dans une compétition nouvelle avec les pays émergents ayant des populations éduquées avec un accès aux technologies. Elles ont préservé des modèles de croissance fondés sur la consommation des ménages et le surendettement. Le meilleur exemple, ce sont les États-Unis, dont le PIB était constitué à 70 % de consommation avec, à la clé, un endettement considérable des ménages à travers le crédit immobilier et les cartes de crédit. Mais il est un autre exemple, beaucoup plus près de chez nous : l’Irlande. L’endettement des ménages et des entreprises y est passé d’environ 120 % du PIB en 2004 à environ 220 % du PIB en 2008-2009. Autrement dit, il a quasiment doublé en cinq ans. Avant la crise, l’Irlande était le pays en Europe où le PIB par tête était le plus élevé ; mais c’était une fausse richesse, fondée sur l’immobilier commercial et le crédit. Et la bulle a explosé. La situation est très variable selon les pays européens : la France n’a pas connu la même spéculation immobilière que l’Irlande ou l’Espagne. Il reste que d’une manière générale, pour les pays développés, le défi à relever est de trouver un modèle de croissance s’appuyant sur l’innovation, la compétitivité des entreprises et la réduction de l’endettement, tant public que privé – on doit en effet considérer la somme des deux comme le meilleur indicateur de l’effort à réaliser.
Il est évident que les acteurs financiers, maillon-clé de la chaîne, ont collectivement une part de responsabilité ; mais là encore, la situation est très variable d’un pays à l’autre. Aux États-Unis, des pans entiers du système financier échappaient totalement à la régulation. Il n’y avait ainsi absolument aucun contrôle sur les subprimes : des courtiers, aux origines professionnelles diverses et variées, démarchaient des particuliers pour leur proposer des prêts, en leur disant de ne pas se soucier du remboursement du capital ni même du paiement des intérêts puisqu’il leur suffirait de revendre le bien deux ans plus tard avec une plus-value. Des gens ont ainsi acheté quatre ou cinq propriétés, en pensant devenir riches ; et on sait ce qu’il est advenu. Quant aux courtiers, ils se sont tournés vers des banques d’investissement qui ont titrisé les actifs et les ont protégés comme on sait. En Irlande, il n’y avait pas de subprimes, pas de produits de marché ; mais une petite banque, l’Anglo Irish Bank, qui ne faisait que de la banque de détail, va coûter à l’État irlandais 35 milliards d’euros. Il est donc clair qu’un système de régulation fragmenté ou défaillant, qu’il s’agisse de mécanismes de marché ou d’activités de crédit très classiques, peut conduire à la catastrophe.
C’est pourquoi il faut évidemment renforcer la régulation. Pour que celle-ci fonctionne, trois conditions sont nécessaires, mais aucune n’est suffisante. C’est en agissant sur les trois volets du triptyque qu’on peut assurer la solidité du système. Les exemples français, mais aussi canadien, australien, ou même italien, montrent que l’on parvient ainsi à surmonter les crises sans trop exposer le contribuable.
Premièrement, la distribution du crédit doit être elle-même contrôlée et saine. Avant d’accorder un prêt, nous nous assurons de la capacité du bénéficiaire à rembourser sur ses revenus. Aux États-Unis, les crédits étaient accordés sur la base de la valeur de l’actif : on partait de l’idée que le prix de cet actif ne cesserait de monter et que le crédit serait remboursé par la plus-value. L’outil informatique des courtiers américains, m’a-t-on dit, ne comportait pas de case où inscrire le salaire des clients. C’est ainsi que l’on crée des bulles et que, lorsque le prix s’effondre, la capacité de remboursement disparaît.
M. le président Henri Emmanuelli. Il faut donc des intermédiaires agréés.
M. Frédéric Oudéa. Il faut des lois et des contrôles par des régulateurs appropriés, de sorte que les banques et l’ensemble des intermédiaires aient des pratiques saines, c'est-à-dire vérifient la capacité de remboursement de l’emprunteur, laquelle ne doit pas reposer sur des anticipations spéculatives sur des actifs.
Le deuxième élément est la qualité du régulateur. À cet égard, le régulateur français peut être pris en exemple, la crise ayant clairement montré qu’il existait deux types de régulation. Il y a celle qui conduit à mener un travail en profondeur dans les banques, à travers des audits et des inspections impliquant des moyens humains : notre régulateur passe fréquemment du temps au sein des établissements pour décortiquer un sujet donné. D’autres régulateurs ont une approche plus distante : ils posent des principes, sans aller nécessairement vérifier dans le détail s’ils sont respectés. La tendance est aujourd’hui au renforcement des moyens et des vérifications, eu égard aux défaillances observées face à la situation de certains établissements et aux risques systémiques. En France, le régulateur est resté confiant dans la nature des risques pris par les banques.
Troisième volet du triptyque : les ratios de capital et de liquidité. C’est un enjeu déterminant. Désormais, les banques vont être « corsetées » par trois paramètres, dont la combinaison déterminera leur capacité à prêter et prendre des risques. Le premier, le tier one ou plutôt core tier one, consiste à rapporter le capital de la banque aux risques qu’elle prend, mais en les pondérant – car dans le système de Bâle, prêter à une collectivité locale ou faire du crédit immobilier ne revient pas au même que de s’engager sur un pays émergent ou de financer une PME. Le deuxième, appelé ratio de levier (ou leverage ratio) un rapport entre le capital et les engagements financiers globaux, indépendamment de leur nature, nous a été imposé de facto par les États-Unis, où il n’a pourtant pas empêché la catastrophe ; pour notre part, nous considérons qu’il n’est pas pertinent de traiter ainsi tous les types de risque de manière uniforme. Enfin, les ratios de liquidité, qui sont en cours de discussion, peuvent jouer un rôle essentiel. La grande leçon de la crise, c’est en effet que la liquidité, comme le capital, est une ressource rare et doit être gérée comme telle. Le monde où la liquidité était abondante et bon marché est révolu. La liquidité va conditionner notre capacité de prêt ; les ratios de liquidité peuvent être assez contraignants dans un paysage financier « désintermédié », comme en France, où sont proposés des SICAV monétaires, des produits d’assurance-vie, etc. Nous devrons résister à des crises et veiller à avoir dans notre bilan suffisamment de ressources longues pour prêter.
Entre 2007-2008, c'est-à-dire avant la crise, et début 2013, moment où le dispositif Bâle III entrera en vigueur, l’exigence minimale de capital va être multipliée par quatre ou cinq. Avant la crise, la Société Générale était au-dessus du seuil requis, mais nous allons néanmoins devoir multiplier par deux environ le montant de nos fonds propres : pour un même risque, il nous faudra en moyenne deux fois plus de capital. C’est un vrai changement et cela induira, à mon avis, des transformations fondamentales du système bancaire.
M. le président Henri Emmanuelli. Des concentrations ?
M. Frédéric Oudéa. Ce n’est pas à cela que je pense. On s’interroge beaucoup sur la taille critique des banques ; je considère pour ma part que les grandes entreprises européennes ont besoin de banques européennes d’une certaine taille pour les accompagner : si, paradoxalement, l’Europe décidait de fragmenter son système bancaire, face aux banques américaines qui sont désormais gigantesques, aux banques chinoises qui sont numéro un dans le monde, aux banques brésiliennes qui sont elles aussi très grandes, l’industrie bancaire européenne risquerait de ne plus être compétitive. Un exemple : nous accompagnons Sanofi dans son acquisition de Genzyme ; le pool est composé de trois banques, une américaine et deux françaises, pour 5 milliards de dollars chacune. Pour s’engager, il faut avoir une certaine taille ; si aucune banque européenne ne pouvait le faire, je ne suis pas sûr que Sanofi trouverait trois banques américaines. Il y a donc là un enjeu de compétitivité très fort pour l’économie européenne.
Quand je parle de transformations, je pense plutôt à la discipline financière, aux contraintes qui vont s’imposer à nous dans le futur, notamment en matière de liquidités. La collecte de dépôts est, durablement, un enjeu essentiel.
Mais les systèmes financiers ne se résument pas aux banques, et il faut continuer à avancer sur les autres sujets : les plates-formes de compensation, la transparence. Il faut avoir au moins une sorte d’entrepôts de données sur les transactions – ce que l’on appelle en anglais des repositories – auxquels le régulateur ait accès. Dans ce domaine, on a plutôt moins avancé que dans celui de la régulation bancaire. S’agissant des CDS, l’un des enjeux est de créer une plate-forme dans la zone euro – car s’il est bien de concentrer un risque sur une plate-forme, il faut aussi que celle-ci soit suffisamment robuste ; le garant en dernier ressort de la liquidité de cette plate-forme serait, pour les produits en euros, la Banque centrale européenne. Encore faut-il être en mesure de proposer ce type de services, et certains enjeux industriels ne sont pas réglés.
Qui se livre à des attaques sur les marchés ? Ne disposant pas d’informations statistiques permettant de vous répondre, je ne peux que vous livrer mon témoignage de praticien.
En juin, à un moment de turbulence pour la zone euro, nous étions aux États-Unis pour présenter notre stratégie à nos actionnaires. Ce ne sont pas des hedge funds, mais de grands fonds de pension français, anglais, américains, qui gèrent les retraites des épargnants. De réelles inquiétudes se sont manifestées quant à la capacité de certains États à rembourser leur dette, et les craintes étaient encore plus fortes aux États-Unis car les mécanismes qui ont permis de sauver le système ont été un peu longs à mettre en place ; pour les Américains, qui ont une monnaie unifiée, la problématique de construction de l’euro est un peu difficile à comprendre. Comme me l’a dit un investisseur, « on a toujours davantage peur de ce qui est loin et on est souvent trop confiant dans ce qui est proche ». De fait, au vu des interrogations sur les statistiques budgétaires de la Grèce et du temps mis à régler la crise, les fonds américains – qui ont des devoirs fiduciaires envers leurs clients – se sont demandé quel crédit ils pouvaient accorder à la dette grecque. Au cours de l’été, le phénomène s’est inversé : les craintes se sont focalisées sur l’économie américaine et le dollar ; les craintes concernant l’Europe se sont estompées dès lors que les mécanismes ont été mis en place. Les réactions de ce genre vont et viennent, elles sont difficiles à canaliser mais elles découlent d’interrogations fondamentales.
En ce qui concerne la zone euro, je pense que la situation n’est plus ce qu’elle était auparavant : désormais, la question de la solvabilité des États va demeurer dans la tête des investisseurs. Si la Grèce a été particulièrement affectée, c’est parce que sa dette est pour l’essentiel dans la main de non-résidents, l’épargne domestique étant faible – à l’inverse du cas du Japon, par exemple ; les étrangers qui ont le choix entre plusieurs dettes souveraines passent de l’une à l’autre selon les circonstances. La question de la solvabilité des États sera désormais omniprésente.
Quant aux hedge funds, il y en a de toutes sortes, du plus gros – probablement autour de 30 milliards de dollars sous gestion –, aux plus petits, qui ne dépassent pas 500 millions. Vous trouvez là des gérants ou d’anciens traders qui ont créé leur entreprise. Leurs stratégies sont extrêmement variées : à court ou à long terme, fondées sur des arbitrages, ou n’intervenant que sur une classe d’actifs. Je n’ai pas non plus de statistiques sur le sujet. Beaucoup ont disparu avec la crise, dont, j’y insiste, ils ne sont en rien responsables. D’autres se créent à nouveau. Le hedge fund peut avoir un fonctionnement risqué en raison de l’effet de levier : il peut investir dans un marché non pas seulement avec du capital, mais aussi en empruntant. Mais cet effet de levier s’est réduit : les pratiques sont devenues plus rigoureuses, l’endettement est moins utilisé pour financer les investissements – mais là encore, il est difficile d’avoir des statistiques. La nouvelle réglementation européenne devrait améliorer l’information dans ce domaine.
Pour notre part, nous n’avons pas d’activité de hedge fund, mais nous avons des hedge funds pour clients : comme tout gestionnaire d’actifs, ils peuvent acheter et vendre des actions par notre intermédiaire ; à certains d’entre eux, nous accordons des crédits, mais c’est une activité modeste chez nous ; enfin, nous avons une plate-forme de managed account. En effet, le principal inconvénient d’un hedge fund, pour un investisseur, est le manque de liquidité : l’investisseur n’a pas beaucoup de visibilité sur la performance, le hedge fund donnant une indication trimestrielle ; et il n’est pas sûr de pouvoir sortir à tout moment. Nous passons donc des contrats avec des hedge funds, en leur demandant de nous exposer leur stratégie, dont nous vérifions ensuite qu’elle est bien appliquée. Nous leur offrons une plate-forme technique, et dès lors que nous contrôlons, nous apportons aux investisseurs une plus grande visibilité ; si, au vu de l’information hebdomadaire, un investisseur veut sortir, nous offrons la liquidité – que nous trouvions ou non un autre investisseur.
J’en viens au trading haute fréquence (HFT).
Il présente des avantages et des inconvénients. On a mesuré les seconds, le 6 mai, sur le marché américain, mais je doute que l’erreur d’un seul gestionnaire de fonds ait pu avoir de telles conséquences ; d’autres paramètres ont nécessairement joué. Par ailleurs, le HFT apporte de la liquidité, ce qui est fondamental sur un marché : un investisseur ne va acheter un actif que s’il est assuré de pouvoir le vendre à tout moment. C’est d’ailleurs un problème pour les obligations d’État, dont on a pu se rendre compte qu’elles ne restaient pas toujours liquides. Sans doute le HFT pourrait-il être plus contrôlé, peut-être faudrait-il assurer plus de transparence sur les volumes, mais je n’ai pas de proposition technique à vous faire. On peut imaginer des règles de capital, ou des limitations à l’engagement des banques ou d’autres acteurs, mais je n’ai pas connaissance de dispositions en ce domaine, en particulier du côté des États-Unis.
Autre sujet sur lequel vous m’interrogez : la fragmentation des marchés d’actions.
Depuis quelques années, on a vu la création de différentes places de marché : il n’y a plus de monopoles boursiers, mais une concurrence entre les institutions traditionnelles et d’autres acteurs qui offrent de la liquidité – c’est la conséquence de la directive MIF. Les banques peuvent rapprocher les offres de vente et les offres d’achat formulées par leurs clients ; mais en la matière, la Société Générale n’est pas un très gros acteur dans le monde, notamment du fait qu’elle n’est pas présente aux États-Unis, où 50 à 60 % des volumes mondiaux d’actions sont échangés. Je ne crois pas que l’on puisse revenir à un monopole, à une place unique où convergeraient tous les ordres. En revanche, je pense nécessaire d’éviter une fragmentation trop forte. Des réglementations exigeant un certain niveau de capital et un certain niveau de technologie paraissent souhaitables ; de plus, il convient d’obtenir de ces plates-formes plus de transparence sur les ordres.
J’en arrive aux agences de notation.
Chez nous, leurs appréciations servent à notre département des risques : les dispositifs Bâle II et Bâle III nous imposant de noter nos contreparties, nous avons notre propre système de notation, mais nous confrontons nos résultats à ceux des agences ; c’est en quelque sorte un contrôle de qualité de notre propre système. Il me semble tout à fait nécessaire de ne pas nous reposer exclusivement sur notre appréciation interne. Il reste que plusieurs questions se posent au sujet des agences de notation.
En ce qui concerne les instruments subprime, les agences, en se fondant sur des modèles de perte, ont manifestement failli dans l’appréciation du risque. Elles n’ont pas été les seules, et je n’en suis pas surpris : étant mathématicien de formation, je n’oublie pas qu’un modèle repose sur des hypothèses ; dès lors que les hypothèses de corrélation des pertes sur différents actifs n’étaient pas les bonnes, fatalement le modèle a produit des informations erronées, lesquelles ont conduit les agences de notation à se tromper sur la résistance des outils en question. Peut-être y a-t-il eu par ailleurs des problèmes de conflits d’intérêt, mais ceux qui ont enquêté sont plus capables que moi d’en juger.
S’agissant de la dette des États, les agences de notation, d’une certaine manière, sont arrivées après la bataille : celle-ci était perdue dès lors que les chiffres du déficit public n’étaient pas les bons et que les mécanismes de solidarité de la Zone euro mettaient du temps à se mettre en place. Le scepticisme qui s’est manifesté aux États-Unis tient à cette double cause – et il demeure : un certain nombre d’acteurs de marché ont des doutes sur la capacité de la Zone euro à poursuivre son développement ; ils s’interrogent sur la possibilité d’avoir des taux de croissance différents et une politique monétaire commune, ainsi que sur le degré de solidarité entre les pays les plus solides et ceux en difficulté. Au total, donc, je ne pense pas que les agences de notation soient la cause des problèmes ; elles peuvent tout au plus accroître ponctuellement le stress, en dégradant une note.
Venons-en aux stock-options, sujet fort différent puisqu’il s’agit de la rémunération des dirigeants des banques.
M. le président Henri Emmanuelli. N’encouragent-elles pas certaines pratiques de la part des gestionnaires ?
M. Frédéric Oudéa. Je ne pense vraiment pas.
Quelques mots d’abord sur la rémunération des opérateurs de marché. Les dispositions qui ont été prises vont dans la bonne direction ; mon seul souhait est que les règles s’appliquent à tous, et avec la même rigueur qu’en France. Pour ma part, en tant que patron de banque, agissant pour le compte de mes clients et de mes actionnaires, je n’ai absolument aucun intérêt spécifique à verser des rémunérations très élevées aux opérateurs. Les dispositifs visant à différer la rémunération, à la verser pour partie sous forme d’actions ou, si une prise de risque inconsidérée est décelée, à pouvoir remettre en cause la rémunération différée, vont dans le bon sens. Mais, il ne suffit pas de régler la question de la rémunération pour régler celle du risque : chez Lehman, les collaborateurs étaient payés quasiment exclusivement en actions Lehman ; le fait qu’ils soient si directement exposés à l’évolution du cours de l’action n’a pas empêché la faillite.
S’agissant de la rémunération des dirigeants, les stock-options constituent-elles un outil efficace ? Elles sont à mon sens une assez bonne incitation, en ligne avec l’intérêt des actionnaires, dès lors que l’on s’inscrit dans la durée. On est loin de gagner à chaque fois : les stock-options de la Société Générale accordées au cours des années 2004 à 2008 ont des prix d’exercice qui reviennent à leur ôter leur valeur aujourd’hui. En outre, en ce qui concerne les dirigeants, l’exercice des stock-options est soumis à une double condition de performance : non seulement il faut, pour qu’il y ait rémunération, que le cours de l’action soit supérieur au prix d’exercice, mais il faut aussi que l’entreprise satisfasse à un critère de performance – par exemple, concernant la Société Générale, se trouver dans le premier quartile des banques européennes.
Par ailleurs, les dirigeants sont tenus de conserver un nombre important d’actions. J’ai moi-même l’obligation de conserver une fraction importante des actions levées dans le cadre du mécanisme de stock-options, et au total je dois garder un stock de 30 000 actions Société Générale. Mon patrimoine serait donc très directement exposé en cas d’accident sur l’action.
En pratique, en 2009 et en 2010, les mandataires sociaux de la Société Générale n’ont eu ni part variable en espèces ni stock-options. En ce qui me concerne, je suis un dirigeant sans filet de sécurité puisque j’ai appliqué strictement les règles du code AFEP-MEDEF : j’ai démissionné de mon contrat de travail. Je n’ai pas de retraite chapeau – c’est à moi d’épargner pour financer mon complément de retraite. Je pense qu’il serait sain, indépendamment de mon cas personnel, que je retrouve une incitation financière inscrite dans la durée, que ce soit sous forme de stock-options ou d’actions gratuites.
Enfin, vous me demandez mes propositions pour assainir les marchés financiers.
Au-delà de ce que j’ai déjà indiqué, il me paraît important d’avoir une vision exhaustive du sujet. Les banques ne sont pas les seuls acteurs. Enlever des activités aux banques, que l’on sait contrôler, pour qu’elles se déploient ailleurs ne me paraît pas être le meilleur moyen de renforcer la sécurité du système. Si l’on retient cette logique, il faut au moins faire en sorte que l’univers qui se développe hors des banques soit un peu contrôlé.
En ce qui concerne les banques, la réglementation qui se met en place est, je l’ai dit, extrêmement contraignante. Elle conduit la Société Générale à de profondes transformations, comme toutes les banques européennes. Il ne faut pas aller trop loin pour ne pas trop peser sur leur capacité à financer l’économie et pour ne pas aboutir, paradoxalement, à les pénaliser davantage alors que l’Europe s’en est mieux sortie que les États-Unis. Une stabilisation de la réglementation est en tout cas souhaitable, afin de redonner aux banques la visibilité nécessaire.
Enfin, il faut traiter le sujet des plates-formes de compensation et des mécanismes de transparence sur les transactions. La question prioritaire est celle des CDS, mais on peut s’intéresser aux swaps et à d’autres instruments. Encore une fois, il ne faut pas s’occuper seulement des banques.
M. le président Henri Emmanuelli. Êtes-vous, comme certains, pour l’interdiction des CDS nus ?
M. Frédéric Oudéa. Je ne partage pas ce point de vue parce que ce type de CDS peut servir. Imaginez que nous souhaitions aider une entreprise française à construire un pont dans un pays lointain. L’opération nous expose à trois types de risque : un risque d’exécution – il faut savoir construire le pont – ; un risque d’exploitation – il faut que le projet soit rentable – ; enfin, le risque attaché au pays. Il peut nous être utile de conclure un CDS sur le pays concerné pour nous protéger de ce troisième risque et de lui seul. Mais ce CDS va-t-il être qualifié de nu ? Je doute que le régulateur puisse distinguer les CDS vraiment nus des autres. Le CDS peut ne pas être corrélé directement à un actif sous-jacent, mais être néanmoins parfaitement légitime.
Les CDS ne sont pas à l’origine de la crise grecque. Dans le cas de la dette privée, le volume des CDS est très supérieur au crédit, mais pour la dette publique, c’est l’inverse.
M. le président Henri Emmanuelli. D’après nos chiffres, 70 milliards de CDS et 290 milliards de dette grecque.
M. Frédéric Oudéa. J’avais plutôt en tête une fourchette de 20 à 30 milliards de CDS. Le CDS est le symptôme d’une crainte sur un segment de marché. Dans le cas de la Grèce, il y a eu de vraies craintes quant à la capacité du pays à rembourser.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. La crise a provoqué une série de propositions en matière de régulation. Considérez-vous qu’elles vont à l’essentiel, ou bien qu’il faudrait s’intéresser à certaines autres ? Je pense notamment à ce que vous avez dit sur les contrats bilatéraux, en évoquant la possibilité de constituer plutôt des places permettant d’identifier les intervenants.
Avez-vous le sentiment que l’on s’achemine, au niveau mondial, vers une régulation différenciée, aboutissant à fausser, au détriment de l’Europe, la concurrence avec les États-Unis ou la Chine ?
Enfin, qu’attendez-vous du G20 et de la présidence française ?
M. Frédéric Oudéa. En matière de régulation européenne, un compromis a été trouvé, des chantiers ont été lancés. Sans aller jusqu’à la création d’un régulateur européen, on améliore la coordination entre régulateurs nationaux et l’anticipation du risque systémique.
En ce qui concerne le secteur bancaire, le chantier est très avancé. Il reste à traiter le cas des institutions dites « systémiques ». À nos yeux, la crise a clairement montré qu’on ne peut pas lier taille et risque : certaines grandes banques ont très bien résisté. Il ne faudrait donc pas « surtaxer » les grandes banques en termes de capital. L’Europe a besoin de banques puissantes, capables d’accompagner ses entreprises. Si pour un projet en Chine, en Afrique ou en Amérique latine, une entreprise européenne se trouve en concurrence avec une entreprise américaine, une banque américaine aura tendance à privilégier la seconde, pour des questions d’intérêts ; pour la compétitivité future des entreprises européennes, il faut donc un secteur financier fort en Europe. Réduire à néant les avantages – en termes d’économies d’échelle et de sécurité des contrôles, notamment – que procure la taille, en imposant des exigences supplémentaires en capital, risque fort de conduire à une fragmentation du secteur bancaire européen et d’avoir des conséquences négatives.
La liquidité est elle aussi un enjeu clé. Permettez-moi de démentir l’idée fausse, mais pourtant largement répandue dans la presse, que nous empruntons à la Banque centrale à 1 % à 3 mois pour financer des prêts immobiliers à quinze ans ou des prêts aux entreprises à cinq ans : c’est une absurdité. Pour accorder ces prêts, nous avons besoin de ressources longues – dépôts, parce qu’ils sont stables, et emprunts pour une durée de trois à sept ans que nous contractons sur le marché et qui coûtent, croyez-moi, autrement plus cher. Une banque comme Northern Rock a fait faillite non pour un problème de capital, mais parce qu’elle finançait des prêts immobiliers avec des ressources à trois mois : en cas de crise, quand arrive l’échéance, les investisseurs ne veulent plus prêter – et c’est la faillite. Tout l’enjeu de la liquidité est l’équilibre entre la durée des prêts et celle des ressources. Mais il ne faut pas aller trop loin dans la contrainte, faute de quoi, en obligeant les banques à se procurer des ressources très longues et très chères, on les dissuadera de prêter. D’ores et déjà, ce qui a été décidé va changer le paysage et les pratiques bancaires.
En matière de rémunérations des opérateurs de marché, le G20 a fixé des règles et la Commission européenne aussi. La réglementation des hedge funds vient d’être votée à Bruxelles.
S’agissant enfin de la constitution de chambres de compensation, nous progressons. Les Américains sont en avance parce qu’ils avaient déjà des plate-formes avec des outils informatiques disponibles. L’Europe doit se montrer capable de se doter de ce type de plate-forme, avec une sécurité suffisante, assurée probablement in fine par la Banque centrale européenne.
Si l’on va jusqu’au bout de la démarche, on aura, en très peu de temps, bouleversé la réglementation. Il serait alors sain de faire le bilan après deux ans d’application, pour éventuellement compléter ou amender le dispositif.
La concurrence entre banques, que vous évoquiez dans votre deuxième question, est un sujet fondamental. Aujourd'hui, dans les dix principales banques mondiales, vous trouvez trois banques chinoises et une banque brésilienne. Dans dix ans, vous aurez probablement encore plus de banques chinoises, peut-être deux banques brésiliennes, et il n’est pas impossible qu’il y ait une banque russe. L’Europe bancaire sera ce que sera l’Europe : je suis partisan, en tant que citoyen, d’une plus grande intégration européenne car c’est à mes yeux la seule façon pour l’Europe de peser politiquement et économiquement ; et si l’Europe va vers plus d’intégration, on devrait aller aussi vers une plus grande intégration bancaire. À l’inverse, si l’Europe se fragmente, on n’assistera sans doute pas à un mouvement de consolidation car la banque restera un outil de souveraineté nationale. La manière dont la nouvelle régulation sera appliquée peut éventuellement compliquer encore la position des banques européennes.
Aux États-Unis, la réforme adoptée est très ambitieuse mais il demeure des interrogations sur l’application des accords de Bâle III, au vu de certaines incohérences entre les textes. Peut-être, pourrait-on conditionner l’application de ces règles en Europe à l’assurance d’une réciprocité ? Quant aux pays émergents, ils sont dans des logiques très variées et, pour le moment, voient tout cela d’assez loin. La réglementation chinoise est assez spécifique. De toute façon, les marchés des pays émergents sont peu accessibles aux banques étrangères, et les banques chinoises, sollicitées par la croissance de leur pays, ne sont pas pour le moment dans une logique de développement international poussé – la question pourrait se poser ultérieurement.
Je le répète, il faut cesser de stigmatiser les banques. D’une part, la crise ne peut être résumée à une crise bancaire. D’autre part, une industrie bancaire solide est une force pour la compétitivité d’un pays.
Enfin, pour répondre à votre dernière question, sur le G20 et la présidence française j’en attends principalement deux choses. Tout d’abord, que les règles bancaires soient stabilisées, afin que nous puissions nous y adapter : il n’est pas bon de rester dans l’incertitude. Ensuite, que l’on parvienne aussi à régler la question des changes : la valeur de l’euro par rapport au dollar et par rapport aux monnaies asiatiques sera décisive dans la croissance à venir. Il ne faut pas que nous soyons pénalisés par un euro trop fort, et il ne faut pas qu’il y ait trop de volatilité, ingérable pour les entreprises. Tout ce qui ira dans le sens d’une meilleure coordination des politiques des banques centrales sera donc bienvenu. Les autres sujets sont la mise en œuvre des réglementations et la définition d’une stratégie de développement pour chacun des pays.
M. Paul Giacobbi. Vous avez raison de lier la spéculation à la liquidité, qui est la condition de son développement. C’est l’excès de liquidité qui provoque les bulles spéculatives. Or les États-Unis se lancent dans une seconde vague de quantitative easing. La Fed va créer 1 000 milliards de dollars en achetant des bons du Trésor américain à long terme, en vertu de la théorie du portefeuille, selon laquelle cela va nécessairement entraîner une réallocation des portefeuilles au profit d’obligations à long terme ou d’actions ; mais cette théorie, si intéressante qu’elle soit, ne se vérifie jamais complètement.
S’agissant du financement d’emplois longs par des ressources courtes, on connaît le cas d’AIG, dont la filiale d’activités sur dérivés refinançait des encours à dix ans au jour le jour : le désastre se compte en centaines de milliards de dollars. Quant à Freddie Mac et Fannie Mae, le rapport de la Federal Housing Finance Agency conclut qu’après avoir reçu 148 milliards de dollars du Trésor public, il leur faudra encore entre 221 à 363 milliards de dollars. Autrement dit, ces deux organismes publics, audités par le Congrès des États-Unis, vont coûter au total au moins 500 milliards de dollars aux contribuables américains !
En ce qui concerne les ratios, il faut d’abord s’entendre sur ce qu’est une banque. En France, nous avons une loi bancaire qui, en schématisant, prévoit que si l’on prête de l’argent on est une banque. Aux États-Unis, les banks ne sont pas forcément des banques : une grande partie d’entre elles dont l’activité les conduirait, en France, à être condamnées pour exercice illégal de la profession de banquier, brassent des centaines de milliards de dollars sans que personne ne dise rien. Le Comité de Bâle fixe de nouveaux ratios extrêmement exigeants, pleinement satisfaisants, qui vous obligeront soit à augmenter votre capital – et donc à répondre aux exigences des actionnaires –, soit à restreindre vos crédits. Mais si on n’applique pas les mêmes règles aux États-Unis, et si l’Europe continue à réglementer les banques sans se préoccuper de ce qui se fait en dehors d’elles – et qui tient d’ailleurs une place beaucoup plus importante hors d’Europe –, son action n’aura abouti qu’à punir les plus vertueux et à encourager ceux qui le sont le moins ! En Europe en général, et en France en particulier, nous ne nous défendons pas assez. Il faut dire aux Français que parce qu’ils ont voulu réglementer les banques, ils auront moins de crédit ou un crédit plus cher, sans avoir pour autant enrayé la spéculation – car une masse de liquidités qui ne s’emploie pas dans l’inflation alimente nécessairement la spéculation.
M. Frédéric Oudéa. Restons optimistes, c’est la condition pour agir. Néanmoins, je partage votre avis. En Europe, les banques financent les trois quarts de l’économie et le développement des marchés est assez limité ; si bien que ce qui affecte les banques en Europe a davantage d’impact sur l’économie réelle qu’aux États-Unis, où la proportion est inverse.
M. Paul Giacobbi. Et on n’imposera rien du tout aux Américains !
M. Frédéric Oudéa. Quelques précisions supplémentaires sur les raisons pour lesquelles il ne faut pas aller trop loin sur les exigences de capital.
À la Société Générale, nous avons dit à nos actionnaires que nous avions devant nous trois ou quatre années de discipline financière très rigoureuse, pendant lesquelles nous allions mettre en réserve l’essentiel de notre résultat, pour respecter les rendez-vous réglementaires ; nous allons distribuer un tiers du résultat, mais en proposant à nos actionnaires un paiement en actions. Dans la plupart des secteurs économiques, les actionnaires attendent du capital investi un rendement de 13 % à 15 %. Nous sommes tous d’accord pour augmenter le capital sur les activités de marché ; mais faut-il exiger beaucoup plus de capital, par exemple, pour financer les prêts immobiliers en France ? En Suisse, le régulateur a imposé 10 % de core tier one à deux grandes banques, qui sont avant tout des banques d’investissement et qui prêtent très peu en Suisse, où les besoins sont faibles. Appliquer la même règle aux bilans des banques françaises, alors qu’il y a une concentration, à hauteur de 50 à 80 %, sur le financement de l’économie française – à travers des prêts aux PME, des prêts immobiliers ou l’accompagnement des grandes entreprises à l’international – n’a pas de sens ; le risque constaté à l’occasion de la crise ne le justifie en aucune manière.
Nous sommes d’accord pour renforcer le système, mais si l’on va trop loin, nous serons bien obligés, pour nous adapter aux nouvelles règles, soit de prêter moins, soit de prêter plus cher – les deux pouvant être combinés.
Permettez-moi de profiter de ma présence devant vous pour évoquer la question du livret A. Le nerf de la guerre, pour nous, ce sont les ressources longues et le livret A en fait partie. À ma connaissance, aujourd’hui la Caisse des dépôts connaît plutôt un excès de liquidités. L’idée d’immobiliser des liquidités là où elles abondent, au détriment des banques qui en ont besoin pour financer l’économie, me paraît contre-productive. Nos prêts à l’économie française progressent de 4,9 % à fin septembre et il est utile d’avoir des dépôts pour y parvenir. Je souhaitais faire passer le message.
M. le président Henri Emmanuelli. Comment, alors que la croissance est faible, peut-on exiger un rendement du capital compris entre 13 et 15 % ?
M. Frédéric Oudéa. Pour calculer le taux de rendement attendu par les actionnaires, on part du taux sans risque – aujourd'hui 2 ou 2,5 %, mais il devrait augmenter – ; on ajoute la prime de risque attachée à l’investissement en actions – 4 à 4,5 % au moins – ; on multiplie par un facteur β, représentant le risque spécifique d’une activité par rapport à l’ensemble du marché. On aboutit ainsi au rendement minimum de 10 à 12 % pour les activités bancaires ; les actionnaires attendent généralement un peu plus.
Nous avons parfaitement intégré que le monde bancaire serait nettement moins rentable demain qu’hier. Les rendements pouvaient atteindre 18 à 20 %. Désormais, on attend entre 12 % et 15 % selon les modèles. Mais si nous descendions trop bas, nous aurions des problèmes avec nos actionnaires.
M. François Goulard. Le changement d’époque est réel. D’une part, on a découvert que les grandes banques étaient mortelles, ce que personne n’imaginait il y a dix ans – l’affaire du Crédit Lyonnais n’était qu’un épiphénomène. D’autre part, on s’était habitué à une croissance, sur longue période, de la valeur des actions ; ce que l’on ne récoltait pas des résultats de l’entreprise, on l’obtenait en plus-value sur le cours – le CAC est allé jusqu’à frôler les 7 000 points, alors que nous sommes aujourd’hui en dessous de 4 000 points.
Au-delà des questions de concurrence avec les autres systèmes bancaires, on a le sentiment que l’Europe est sérieuse, la France en particulier, mais que les États-Unis le sont moins – les pays émergents, quant à eux, étant en général prêteurs et moins exposés au risque d’illiquidité du système bancaire, véritable déclencheur de la crise. Pour l’adoption des règles de Bâle III, leur mise en œuvre et la surveillance de leur application, les États-Unis n’ont pas encore fait leur révolution culturelle. De fait, l’Europe a toujours régulé, de manière plus ou moins efficace, tandis que les États-Unis s’en sont plutôt gardés – et on m’a dit, à propos des défaillances d’organismes faisant des CDS, que parfois le rapport entre le capital et le risque pris était de 1 à 1 000…
Je vous ai trouvé plutôt confiant à propos des échanges de gré à gré, pour lesquels vous faites état de réels progrès dans la surveillance. Il me semble que nous sommes encore loin du compte et que, faute de règles, l’emballement peut reprendre à tout moment. Je m’étonne que les pays européens et leurs banques ne disent pas plus fort que l’on n’est pas sorti de ce monde extrêmement dangereux qui a provoqué une déflagration et qui coûte des centaines de milliards aux États, donc aux contribuables. Est-on suffisamment alarmiste dans le discours ? Les intérêts de votre entreprise sont en jeu, l’intérêt collectif l’est aussi.
Enfin, si l’Europe se dotait de règles véritablement harmonisées, pensez-vous qu’elle parviendrait à convaincre le reste du monde de la suivre dans son comportement vertueux ?
M. Nicolas Perruchot. Il est à souhaiter que les choses évoluent dans le bon sens en matière de régulation, même si l’on a l’impression que, comme d’habitude, les Européens veulent être « les meilleurs », ce qui peut nuire à la compétitivité de leur secteur bancaire.
La crise a aussi été l’occasion de s’interroger sur le rôle des paradis fiscaux. S’ils subsistent en l’état, c’est-à-dire en tant que zones de non droit – par lesquelles transite une grande partie de la finance mondiale, hors de toute régulation –, les efforts dont nous parlons auront-ils encore un sens ? En ce qui la concerne, la Société Générale a-t-elle des liens avec les paradis fiscaux ?
M. Frédéric Oudéa. Monsieur Goulard, je me suis sans doute mal exprimé. Les États-Unis affichent aujourd'hui leur volonté politique que les instruments du type CDS s’échangent sur des plates-formes. Techniquement, ces plates-formes existent déjà ; nous verrons si les actes sont conformes aux déclarations.
En ce qui concerne la nécessité de se faire entendre, je considère qu’en France le dialogue fonctionne bien entre le Gouvernement, le régulateur et les banques sur les enjeux de compétitivité, lesquels me paraissent très bien compris par le pouvoir politique. Faut-il que nous fassions plus ? Je ne sais pas, mais ces sujets sont régulièrement abordés dans les enceintes professionnelles. Une des difficultés vient de ce que, parmi les Vingt-sept, très peu de pays ont des banques très actives dans les grands métiers internationaux – la Grande-Bretagne, la France et, dans une moindre mesure, l’Espagne et l’Italie.
Pour répondre à votre dernière question – mais vous êtes beaucoup mieux placés que moi pour juger –, il me semble que, dans une période de contraintes et de croissance limitée, chacun se détermine en fonction de ses propres intérêts ; je ne suis pas sûr qu’il suffise de donner l’exemple pour entraîner les autres.
Enfin, je ne pense pas que les paradis fiscaux aient joué un rôle significatif dans la crise, au vu des masses qui ont été en jeu ; ils ne sont pas pour grand-chose dans ce qui s’est passé sur le marché des subprimes, en Irlande, ou encore en Espagne. En revanche, il me paraît parfaitement légitime de développer une logique de contrôle et de justice fiscale. Sachez que depuis dix-huit mois, nous nous sommes clairement engagés à mettre fin à nos activités dans ces zones, et nous respectons cet engagement.
M. le président Henri Emmanuelli. Monsieur le président, merci pour vos explications et pour l’éclairage que vous nous avez apporté.
L’audition s’achève à dix huit heures quarante.
*
* *
Audition de M. Jean-Paul Gauzès, député européen,
rapporteur de la proposition de directive visant à encadrer les fonds d'investissement alternatifs au Parlement européen
(Procès-verbal de la séance du mercredi 3 novembre 2010)
(Présidence de M. Jean-François Mancel, rapporteur de la commission d’enquête)
La séance est ouverte à dix-huit heures quarante
M. Jean-François Mancel, président et rapporteur. Monsieur le député européen, je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation et je vous prie de bien vouloir excuser le président Henri Emmanuelli. Vous faites partie des quatre députés nominés pour la désignation prochaine du « meilleur député européen ». Au Parlement européen, vous avez beaucoup travaillé sur les sujets qui intéressent notre commission d’enquête et remis plusieurs rapports importants.
(M. Jean-Paul Gauzès prête serment.)
M. le rapporteur, président. Pourriez-vous faire devant nous le point de ce qui se dit et de ce qui se fait, au Parlement européen et au niveau de l’Union européenne, en matière de réformes visant à tirer les conséquences de la crise financière ?
L’Europe avance-t-elle d’un même pas, ou relevez-vous des différences importantes – par exemple entre les Britanniques et les Français ? Pourra-t-on parvenir à des accords véritablement européens ?
Les positions de l’Union vous paraissent-elles justes, ou pensez-vous au contraire que l’on va trop loin, en faussant à notre détriment la concurrence, en particulier avec les États-Unis ?
M. Jean-Paul Gauzès. C’est un grand honneur d’être invité à témoigner devant votre commission. Le sujet est vaste et vos questions, monsieur le rapporteur, sont difficiles.
Je suis député européen depuis 2004. Lorsque, en 2004-2005, le Parlement avait demandé au commissaire chargé du marché intérieur et des services, M. Charlie McCreevy, de préparer des éléments de régulation, celui-ci avait fait la sourde oreille. En libéral convaincu, il pensait qu’il ne pouvait pas se produire de catastrophe dès lors que les marchés s’autorégulaient.
Nul ne pouvait prédire, même deux mois avant, la faillite de Lehman Brothers. Celui qui l’aurait fait aurait été qualifié de fou, bien qu’il y eût des signes. Toujours est-il qu’après cette faillite, M. McCreevy s’est converti et, comme tout nouveau converti, il est devenu empressé.
Il a demandé à ses services de préparer deux textes, l’un sur les agences de notation, l’autre sur la régulation des fonds alternatifs – à tort appelé « directive hedge funds » dans la mesure où les hedge funds ne représentent qu’environ 25 % de la masse.
Le premier, adopté en septembre 2009, est un règlement : comme il n’existait pas de législation dans les États membres, il était plus facile et plus efficace d’utiliser cette voie. J’en ai été le rapporteur – et je suis à nouveau rapporteur pour la mise en œuvre de cette supervision européenne. Nous étions les premiers à appliquer la feuille de route du G20 ; la réglementation mise en place est pragmatique et, je crois, efficace, mais elle va être améliorée.
Conformément à mon souhait – mes collègues avaient bien voulu me suivre sur ce point –, le texte initial prévoyait que l’autorité européenne des marchés financiers, l’ESMA – european securities and markets authority – serait chargée de la supervision des agences. Nous travaillons maintenant à un règlement modifiant celui de 2009 afin de mettre en place la supervision européenne, puisque l’ESMA fonctionnera à partir du 1er janvier 2011. Dans l’intervalle, il y a eu des dispositions transitoires.
Par ailleurs, le Parlement européen – qui, je le rappelle, n’a pas de pouvoir d’initiative – est en train d’élaborer un rapport d’initiative. J’avais souhaité cette procédure pour éviter que d’autres questions surgies plus récemment, en particulier la notation des dettes souveraines, interfèrent avec la mise à jour du règlement. Quant à la Commission, elle devrait faire une proposition législative au premier semestre 2011. Cela dit, nous avions déjà réfléchi en 2009 à ces problèmes très difficiles et nous n’avions pas trouvé de solution.
Le deuxième texte est la directive sur les fonds alternatifs. À l’origine, il s’agissait de réguler les hedge funds, jusqu’à ce que la Commission s’aperçoive que ceux-ci ne pouvaient être définis. On ne peut en effet qu’en indiquer les caractéristiques – jeu contracyclique, utilisation de méthodes telles que le short selling pour obtenir la meilleure rentabilité en prenant le moins de risques possible. Au demeurant, la traduction littérale de hedge funds est « fonds de couverture ». Faute de définition des hedge funds, donc, la Commission a décidé que la directive viserait tout ce qui n’était pas OPCVM – organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou, en anglais, UCITS, undertaking for collective investment in transferable securities –, et par voie de conséquence les fonds immobiliers et le capital investissement, ou private equity.
De l’aveu même de ses rédacteurs, la directive, rédigée à la hâte, n’était guère satisfaisante et nécessitait d’être revue. C’est ce qu’a fait le Parlement, où j’ai été désigné rapporteur. Nous avons accordé la priorité aux problèmes qui touchent directement nos concitoyens, en recherchant la transparence au lieu de l’opacité et en essayant de faire en sorte que ces fonds servent à l’économie réelle, plutôt que de faire planer sur elle des risques considérables. Nous avons différencié les formes de fonds et introduit des dispositions qui, dans le cadre du « trilogue » – concertation, dans le cadre de la codécision, avec la présidence de l’Union et la Commission –, ont été retravaillées pour arriver à un compromis sur lequel le Parlement votera le 11 novembre.
Entre-temps a été adopté un autre texte, que l’on peut qualifier d’historique, organisant la supervision européenne de l’ensemble des acteurs financiers. La règle voulue par Mme Angela Merkel et par d’autres est devenue le leitmotiv du commissaire actuel, M. Michel Barnier : aucun acteur, aucun territoire ne doit échapper à la régulation et à la supervision dès lors qu’il s’agit d’activités financières. On n’en est plus à dire que l’on ne doit réguler que le risque systémique : il faut réguler le risque financier. Pour autant, la régulation doit être proportionnée – forte quant le risque est important, relativement légère quand il est faible.
Ce système de supervision a donné lieu à une bataille entre les États membres et le Parlement européen. En décembre 2009, après avoir négocié entre eux, les ministres de l’économie et des finances ont publié un communiqué aux termes duquel la supervision « européenne » serait nationale et, pour faire plaisir à la Grande-Bretagne, sans incidence sur le budget de l’Union. Dans les deux heures qui ont suivi, les coordinateurs des principaux groupes politiques de la commission des affaires économiques et monétaires – libéraux, socialistes, verts et Parti populaire européen, auquel l’UMP est rattachée et dont je fais partie – ont publié un communiqué rappelant que cette initiative était contraire au principe de codécision et que le Parlement souhaitait qu’il y ait de l’Europe dans la supervision. La négociation qui s’en est suivie, sous les présidences espagnole puis belge, a été difficile, mais finalement le texte de compromis a fait une part réelle à la supervision européenne. Si l’on n’est pas allé jusqu’à une supervision européenne des groupes transfrontaliers comme BNP-Paribas ou la Société générale, les trois agences européennes ont un réel pouvoir de décision, de coordination et d’injonction sur les régulateurs nationaux qui, dans chacun des trois secteurs, conservent une autonomie fonctionnelle.
Nous espérons, comme tout législateur, que les dispositions adoptées auront des effets bénéfiques. Les avancées me semblent significatives en matière de transparence et de clarté. Pour le capital investissement, il est prévu une information des salariés de l’entreprise cible, ainsi que des actions contre le dépeçage : un fonds ne doit pas « vampiriser » l’entreprise en mettant les salariés dehors quelques jours ou quelques mois après l’avoir achetée et en transférant les outils de production dans d’autres pays – le Parlement européen est peut-être plus attentif que les États membres aux images qui, même si seule une minorité de fonds fonctionne ainsi, ont frappé nos concitoyens. Quant à l’information des salariés de l’entreprise cible, elle ne découvrira rien de la vie de l’entreprise. Le lobbying contre la directive a été intense, on a fait courir l’idée que l’on allait tuer les PME, tarir les financements... Tout cela était évidemment faux.
Ces dispositions peuvent-elles nuire à la compétitivité ? Les tenants d’un libéralisme total vous réaffirmeront qu’il faut laisser faire le marché. On a vu ce qui pouvait en résulter ! Après treize mois passés sur ce dossier, j’estime que les règles nouvelles ne seront pas gênantes pour ceux qui travaillent correctement. Les autres seront obligés de réduire la voilure et ce n’est pas une mauvaise chose. L’économie réelle ne pourrait pas supporter une succession de crises : nous avons réussi à faire face une fois, nous ne le pourrons pas deux ou trois fois.
L’argument majeur que l’on nous oppose est que les fonds n’ont pas contribué à la crise et que, bien au contraire, ils permettent d’alimenter l’économie. Certes, les hedge funds ne sont pas à l’origine de la crise, mais la masse de finances transitant par ces fonds est telle qu’on ne peut nier le risque d’amplification. C’est d’autant plus vrai qu’aujourd’hui, le « trading automatique » permet de nouer et de dénouer des opérations financières en moins d’une seconde, à tel point que le Parlement européen se demande s’il ne faut pas fixer un minimum, par exemple en interdisant les opérations à la nanoseconde. On est, là, très loin des besoins de l’économie réelle : c’est du jeu de casino.
Notre objectif n’est nullement de détruire l’industrie financière européenne ou de réduire sa compétitivité, mais de donner des signaux. Ces mesures de régulation de la finance doivent être prises au moins au niveau européen, l’idéal étant bien sûr qu’elles le soient au niveau international ; encore faudrait-il qu’il existe une volonté politique pour cela, plutôt que – business as usual – l’envie de faire comme si rien ne s’était passé.
M. le rapporteur, président. La crise a été, pour une part non négligeable, importée des États-Unis. Quelle comparaison peut-on faire entre les mesures prises au niveau européen et celles prises outre-Atlantique ? Les États-Unis appliqueront-ils Bâle III ? N’ont-ils pas tendance à s’abstraire de certaines contraintes que, pour sa part, l’Europe s’efforce de mettre en place, s’exposant ainsi à une concurrence déloyale ? Une nouvelle bulle ne risque-t-elle pas de se créer et d’exploser aux États-Unis, avant de nuire une nouvelle fois aux économies européennes ?
M. Jean-Paul Gauzès. C’est un sujet fondamental.
Si, avant la crise des subprimes, des dispositifs avaient contraint les agences de notation à évaluer de façon plus correcte les produits sophistiqués, si la réglementation avait assuré une meilleure transparence des opérations et obligé les investisseurs à faire des due diligences – comme il est prévu dans la directive – pour savoir ce qu’ils achetaient, dans quel but et comment, les risques auraient été réduits.
Pour autant, il ne faut pas faire preuve de naïveté. L’Europe doit se garder d’essayer de faire « plus blanc que blanc » sans tenir compte de ce qui se passe ailleurs. Vous évoquez Bâle III, mais aux États-Unis les accords de Bâle II ne sont pas appliqués. Quant à la réglementation de 3 000 pages qui a été mise en place en juin, elle est quelque peu en trompe-l’œil puisqu’elle nécessite l’intervention des régulateurs de chaque État fédéré, ceux-là mêmes dont le mauvais fonctionnement a engendré les problèmes que l’on sait. Les Américains disposent aujourd'hui d’une base juridique pour affirmer qu’ils n’ont pas le droit d’appliquer des éléments externes tels que Bâle III. C’est pourquoi j’estime que l’Europe ne doit prendre dans Bâle III que ce qui est intrinsèquement utile au bon fonctionnement de son industrie financière.
Il y a une grande distance, dans les dispositions américaines, entre l’absence de protectionnisme affirmée et la réalité à laquelle on se heurte pour pénétrer le marché. J’ai participé, dans une vie antérieure, à l’acquisition par une banque française d’une compagnie d’assurances aux États-Unis : il a fallu demander une autorisation dans chaque État fédéré et l’opération a pris deux ans. Le système de protection est organisé de telle sorte que l’on a toujours de bonnes raisons de vous renvoyer à l’application de la réglementation.
Je le répète, il serait raisonnable de retenir, en matière de réglementation, tout ce qui permettra à l’industrie financière de mieux fonctionner en créant moins de risque, sans essayer de montrer que nous faisons tout mieux que les autres. C’est là que se situe, en partie, le débat européen.
Pour ce qui est des fonds alternatifs, non, tous les États n’avancent pas au même pas. Au Parlement, l’accord s’est fait très vite : mon rapport a été adopté en mai à une large majorité. C’est entre les États membres qu’il y a des divergences. On connaît l’opposition entre la France et la Grande-Bretagne, mais certains pays se cachent derrière l’une ou l’autre – ils ne disent pas ce qu’ils pensent, mais ils n’en pensent pas moins. Les Britanniques voulaient préserver la place financière de Londres et les opérateurs britanniques souhaitaient pouvoir continuer à fonctionner avec les îles Caïmans. Quant aux Français, ils ont dans un premier temps défendu l’idée d’une réglementation nationale ; puis, il y a quatre ou cinq semaines, la France s’est prononcée pour le passeport européen, mais à condition que l’ESMA ait une réelle autorité et qu’il ne soit pas possible à chaque État de délivrer ce passeport à sa façon. Ce revirement, que je conseillais depuis plusieurs mois, est à mes yeux un peu tardif ; arrivant en fin de parcours, il ne nous a pas permis de bénéficier de tous les avantages que nous aurions pu en tirer. Le bilan est néanmoins positif. Le pire aurait été que l’un des deux pays se retrouve isolé et que la position soit prise à la majorité qualifiée.
Le lobbying des gestionnaires de fonds a été très intense. J’ai eu exactement 198 entretiens avec des lobbyistes, toujours dans le même sens, à ceci près qu’au départ ils ne voulaient pas de directive et qu’ils se sont montrés par la suite un peu plus coopérants pour apporter des informations utiles. Les plus déloyaux se sont employés à faire courir des rumeurs selon lesquelle l’économie ne trouverait plus de financements si l’on régulait un tant soit peu les fonds de capital investissement.
Bien entendu, il serait préférable que les choses se passent au niveau du G20, mais il ne suffit pas de donner une feuille de route, il faut la mettre en œuvre.
M. le rapporteur, président. Le nouveau système de supervision européen se déclinera au niveau national. L’architecture est-elle suffisamment claire pour éviter complexité, lourdeur et, finalement, inefficacité ?
M. Jean-Paul Gauzès. Le Parlement européen, qui a adopté mon rapport à la quasi-unanimité, souhaitait un contrôle européen sur les groupes bancaires et d’assurance transfrontaliers. Ce sont surtout les nouveaux États membres qui s’y sont opposés. Les banques nationales y sont en effet très peu nombreuses et les banques et les assurances sont en général des filiales de groupes dont le siège est en Grande-Bretagne ou en France, si bien que les autorités nationales n’ont pas envie d’être dépossédées de tout contrôle au profit d’un régulateur européen transfrontalier. Mais cela viendra certainement un jour.
Aujourd’hui, l’organisation de la supervision est-elle claire et efficace ? Oui, en ce sens que l’on sait exactement quelles sont les compétences des agences. Leurs pouvoirs de coordination et d’injonction leur permettront de lutter efficacement contre d’éventuelles distorsions dans l’application des règles dans chacun des États. Alors que les ministres de l’économie et des finances n’en voulaient pas, le Parlement européen a finalement obtenu que des injonctions – et non de simples recommandations – puissent être adressées aux autorités nationales. En cas d’urgence ou de situation grave, les agences pourront même édicter des règles contraignantes. On ne peut pas réguler nationalement des activités qui se développent au niveau européen et même mondial ; sans être parfait, le système proposé est de bon sens.
M. le rapporteur, président. Plusieurs de nos interlocuteurs nous ont indiqué, de façon assez convaincante, que ce qui manquait était essentiellement une meilleure information sur les opérateurs et sur les transactions. Ils ont souvent mis en cause les opérations de gré à gré et souhaité la création de plates-formes, notamment pour les credit defaults swaps (CDS). Le Parlement européen a-t-il fait des propositions en la matière ? Quel est votre avis ?
M. Jean-Paul Gauzès. Dans ce domaine, attention à la schizophrénie. Il y a souvent de la distance entre ce que l’on dit souhaiter et ce que l’on permet de faire ensuite. Ce décalage existe aussi chez les gouvernants.
Le chantier ouvert devrait être européen mais on assiste à des interférences, par exemple en Allemagne avec l’interdiction des ventes à découvert, en France également. Il faudrait avoir la sagesse de coordonner les initiatives tendant à réguler le marché. Pour reprendre la formule de Michel Barnier, la supervision constitue un cadre et l’on doit maintenant placer les briques. La première est la directive encadrant les fonds d’investissement alternatif ; les suivantes seront la réglementation sur les ventes à découvert, qui est en route, et la réglementation sur les dérivés – avec le problème de l’information, celui de la compensation, de la création ou non d’une chambre de compensation pour les opérations en euros...
La Commission a fait des propositions législatives à ce sujet. Le Parlement, pour sa part, a adopté un rapport d’initiative de M. Werner Langen, également rapporteur de la proposition de règlement relatif aux produits dérivés. Donc, nous progressons ; et le niveau européen est celui qui convient. Mais la difficulté sera de coordonner les positions des États. Lorsque Mme Angela Merkel a voulu interdire le short selling pour certains produits, on a assisté à des manœuvres de contournement. Néanmoins les propositions de la Commission sont très sérieuses et le Parlement y travaille, dans le cadre de son rôle de codécision ; je pense donc qu’au premier semestre 2011, il y aura des textes dans ces domaines.
M. le rapporteur, président. S’agissant du trading « haute fréquence », le président de l’AMF a reconnu devant notre commission qu’il ne disposait pas, à l’heure actuelle, des moyens technologiques pour assurer un véritable contrôle. Qu’en est-il au niveau européen ? Faut-il s’orienter vers la limitation du développement et de la sophistication de ces échanges ?
M. Jean-Paul Gauzès. Il n’y a pas plus de moyens au niveau européen qu’au niveau national. Même avec la mise en place des trois agences, ce sont les autorités nationales qui assureront le travail opérationnel. Mais vous posez la vraie question : que faire face à des innovations technologiques qui font que la finance échappe progressivement à la maîtrise humaine ? Toutes les salles de marchés ont à peu près les mêmes logiciels. Là où, naguère, les mouvements s’atténuaient parce que telle banque adoptait une stratégie différente de celle de telle autre, aujourd'hui tous les établissements suivent le même mouvement. On a pris des mesures pour limiter la prise de risque par les opérateurs, en France mais aussi au niveau européen avec la directive sur les fonds propres réglementaires (CRD 3). Je pense cependant qu’il arrive un moment où il faut rétablir le pouvoir de l’homme sur les machines, auxquelles on ne peut laisser tout faire.
Certains demanderont si l’on a le droit d’empêcher l’innovation. Mais quand elle aboutit à des catastrophes, pourquoi la laisser se développer ? Maire d’une commune rurale, je plaide pour le bon sens… À cet égard, la Société générale, qui a le malheur de voir son nom spontanément associé à l’affaire Kerviel, est par ailleurs, il faut le souligner, l’une des rares banques à ne pas être tombée dans le piège Madoff, parce qu’elle avait fait les bonnes analyses. Après avoir été avocat, j’ai été pendant dix ans au comité de direction d’une banque : pour avoir vu fonctionner le système, je sais que certaines choses font un peu peur. Il faut rétablir un contrôle humain sur la machine. Qu’apporte à l’économie réelle le fait que des opérations se réalisent à la nanoseconde, alors que pour constituer un dossier de crédit, il faut plusieurs mois, et pour monter un atelier relais, un an de démarches administratives et un an de construction ?
N’appréciant pas beaucoup le droit anglo-saxon, je pense qu’il faut revenir à de saines notions de droit latin. Les financiers sont beaucoup plus créatifs que les juristes. Il faut donc donner aux autorités régulatrices des bases juridiques et des pouvoirs assez larges pour qu’elles puissent s’adapter aux variations de comportement des acteurs financiers. En matière pénale, l’infraction doit être précisément définie pour que la punition soit possible ; ce système rigide ne convient pas en matière financière. Il faut faire confiance au régulateur et lui donner compétence pour prendre des décisions chaque fois qu’il estime qu’il y a des dérapages inacceptables. Cette conception, j’en conviens, n’est pas très libérale...
M. le rapporteur, président. Peut-on imaginer des « limitateurs » sur les marchés ? Cela se pratiquait sur le MATIF, où, en cas de surchauffe, on arrêtait les transactions pour laisser les opérateurs reprendre leurs esprits – puis on redémarrait.
M. Jean-Paul Gauzès. Peut-être, mais les temps ont changé. La génération actuelle de traders est passée de la Game Boy à l’ordinateur de salle de marchés, sans transition et sans réflexion. Dans les sous-sols d’une banque, les plus grosses voitures ne sont pas celles des membres du comité de direction mais celle des traders.
Il faut donc limiter les incitations aux risques, ce que fait la loi. D’autre part, certaines rémunérations sont indécentes et nous n’avons pas hésité, au niveau européen, à les limiter à 500 000 euros dans les banques encore aidées par les États. Cela a fait des mécontents… Ce n’est pas avec son propre argent que l’opérateur joue dans une salle de marchés ; quand il perd, ce n’est pas lui qui perd, mais la banque. Quant aux hedge funds, bon nombre d’entre eux ont perdu la mise que les banques et les investisseurs leur avaient apportée. C’est autant d’argent qui a été perdu pour le financement plus classique de l’économie.
M. le rapporteur, président. En ce qui concerne les agences de notation, vous avez évoqué une première vague de réglementation européenne, puis une deuxième à venir.
M. Jean-Paul Gauzès. La première vague concernait l’enregistrement des agences, les obligations en matière de qualification, de ressources humaines, d’organisation, ainsi que la supervision. Dans un premier temps, celle-ci a été assurée par des collèges ; le texte qui sera voté en commission le 9 novembre et en séance plénière au cours du mois de décembre et qui sera applicable, je l’espère, au début de 2011, organise la supervision européenne de l’ESMA, mais guère plus.
Ce qui viendra au premier semestre est plus compliqué. Un premier débat concernera le schéma de financement des agences de notation. Aujourd'hui, c’est le client noté qui paie l’agence. Il y a donc, selon certains, conflit d’intérêts, comme pour un professeur payé par un élève – ce qui existe avec les leçons particulières, mais les professeurs ayant une éthique se refusent à en donner aux élèves qui sont dans leur classe. Cela étant, quel autre système retenir, dès lors que les agences exercent une activité commerciale, qu’il faut bien rémunérer ?
Le deuxième sujet concerne la fameuse agence européenne de notation. La conçoit-on comme une société dont les actionnaires seraient européens et qui serait plus « gentille » à l’égard des Européens ? En 2009, Mme Pervenche Berès avait proposé que les Cours des comptes assurent la notation des dettes souveraines ; le problème est qu’il n’existe pas de Cour des comptes dans tous les États membres et que celles qui existent ne sont pas toujours aussi indépendantes qu’en France : que vaudraient des notes données par des fonctionnaires dépendant de l’État qu’ils notent ? Mon collègue Wolf Klinz parle, lui, d’une fondation indépendante.
Pour ma part, je partage l’avis de Jean-Pierre Jouyet : il faut se désintoxiquer des agences de notation. Les agences, en particulier les trois grandes, affirment qu’elles ne donnent qu’une opinion et qu’il appartient à l’investisseur de se forger son avis. Ce n’est pas inexact, à ceci près que cette opinion coûte très cher, que les agences ont accès à des informations privilégiées et que la note est prise en compte, dans la réglementation bancaire, pour la détermination des fonds propres : suivant que le produit acheté par une banque est bien ou mal noté, on ne lui fera pas correspondre le même montant de fonds propres. Bref, tant que les notes seront intégrées dans la réglementation bancaire, l’intoxication se poursuivra.
Par ailleurs, les agences ont une légitimité à noter la dette des États, dès lors que cette dette est financée par des investisseurs – qui ont besoin d’indications. Pour autant, elles ne peuvent pas faire n’importe quoi et appliquer les mêmes schémas que pour les entreprises : une collectivité publique en difficulté se redresse beaucoup plus vite. Pour avoir été le rédacteur du protocole qui a suivi l’affaire d’Angoulême, je sais que les finances de la ville se sont rétablies rapidement, grâce à une bonne équipe municipale.
Les conditions de publication des notes posent un autre problème. Depuis dix ans, tout le monde savait que la Grèce avait des dettes et que son système fiscal était une passoire ; C’est bien pourquoi les Allemands ne voulaient pas qu’elle entre dans l’euro, au même titre que les autres pays « producteurs d’olives ». Ainsi s’explique la réaction de Mme Angela Merkel : « On vous l’avait bien dit ! » C’est la réaction de parents qui voient leur enfant tomber de l’arbre où il a grimpé, à ceci près que les parents se précipitent au secours de l’enfant et qu’il a fallu à Mme Angela Merkel une quinzaine de jours pour en arriver là, ce qui s’est révélé un peu coûteux.
Je ne crois pas que l’on puisse annoncer une demi-heure avant la clôture des marchés que l’on dégrade telle ou telle note. À mon avis, l’autorité de régulation des agences de notation devrait avoir son mot à dire sur les conditions de publication d’une note, dès lors que celle-ci pourrait perturber la vision que l’on a de la situation financière d’un État – de même que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a le pouvoir, dont il use très rarement, d’empêcher la diffusion d’une émission pouvant avoir des conséquences graves dans l’opinion. Bien sûr, il faut avancer avec prudence pour ne pas verser dans la censure. Le principe reste que la notation de la dette des États est légitime, mais elle ne doit pas être diffusée dans n’importe quelles conditions et à n’importe quel moment – d’autant que les dettes des États se constituent sur une longue période.
M. le rapporteur, président. Compte tenu de l’importance que ces agences ont prise, cette « modération » morale ne risque-t-elle pas d’affoler encore plus les marchés, en favorisant la rumeur ?
M. Jean-Paul Gauzès. La rumeur existe de toute façon. En outre, les agences précisent toujours que leur note s’applique à un moment donné et peut être modifiée le lendemain. Les investisseurs, en tout cas les institutionnels, devraient donc prendre un peu de recul par rapport à ces notes.
Dans la période antérieure, c’est la notation des produits structurés plus que celle des entreprises qui a engendré des difficultés. La note AAA était la condition pour bien vendre ces produits. Comme directeur juridique de banque, j’ai eu des contacts avec les agences de notation : soit les financiers répondaient à leurs questions, soit on produisait l’avis d’un cabinet d’avocats attestant la solidité du produit ; sans doute l’agence n’allait-elle pas jusqu’au bout des investigations nécessaires avant de délivrer sa note.
Aux États-Unis, dans l’affaire des subprimes, des courtiers non régulés ont vendu des prêts à des gens qui n’étaient pas solvables et qui n’avaient pas la mentalité de propriétaires. Aux termes des accords passés avec les banques, les incidents de paiement des échéances intervenant dans les six premiers mois étaient portés au bilan des banques – si bien que celles-ci se sont trouvées en difficulté ; au-delà de six mois, c’est le véhicule de titrisation lui-même qui était atteint.
Je crois vraiment qu’une réglementation raisonnable est nécessaire. Le fonctionnement quotidien de la finance a été largement opaque. Pour reprendre une formule de Michel Barnier, il faut mettre de la transparence là où l’on s’était habitué à l’opacité.
Dans la banque où je travaillais, mon visa était nécessaire pour les nouveaux produits financiers. Comme je manquais de compétences dans ce domaine, j’appliquais toujours la même méthode : je demandais à celui qui venait me présenter le dossier de me l’expliquer. Il arrivait toujours un moment où il me disait qu’il n’avait pas très bien compris un mécanisme, mais que les autres gagnaient beaucoup d’argent en l’appliquant. Je l’invitais alors à revenir me voir lorsqu’il aurait compris ce chaînon manquant. Ce n’était pas inefficace – mais pour cela il faut que le juriste ait une position forte dans la banque !
M. le rapporteur, président. Après avoir tant travaillé sur ces questions, qu’attendez-vous du G20 ?
M. Jean-Paul Gauzès. Le Président de la République, qui en assurera la présidence, a établi une feuille de route très ambitieuse. J’espère que les choses avanceront. Cependant la présidence du G20 n’est pas celle de l’Union européenne. : il n’existe pas de structure fixe, et par ailleurs il faut faire avancer un grand nombre de pays aux intérêts très différents. Pour obtenir des résultats concrets, il faut un gros investissement et une volonté politique. Je crains qu’au niveau mondial, cette volonté politique soit relativement faible. J’espère néanmoins que l’on poursuivra le travail engagé et que les Européens ne seront pas les naïfs qui ont fixé des règles là où les autres refusent d’en mettre. Je le répète, nous devons adopter les règles qui sont intrinsèquement utiles au fonctionnement de l’industrie financière européenne mais nous garder de vouloir faire « plus blanc que blanc ».
M. le rapporteur, président. Merci beaucoup pour votre contribution.
L’audition s’achève à dix neuf heures trente.
*
* *
Audition de M. Philippe Marchessaux,
administrateur-directeur général de BNP Paribas Investment Partners,
accompagné de MM. Christian Dargnat, responsable de la gestion, et de M. François Delooz, responsable de la conformité, chez BNP-Paribas Investment Partners
(Procès-verbal de la séance du mercredi 10 novembre 2010)
(Présidence de M. Henri Emmanuelli, président de la commission d’enquête)
La séance est ouverte à seize heures trente
M. le président Henri Emmanuelli. Nous accueillons aujourd'hui M. Philippe Marchessaux, administrateur-directeur général de BNP Paribas Investment Partners. Il est accompagné de M. Christian Dargnat, responsable de la gestion, et de M. François Delooz, responsable de la conformité. Monsieur Marchessaux, avez-vous des recommandations à faire pour éviter la spéculation « négative », celle qui n’apporte rien à l’économie, voire lui est nuisible ?
(M. Philippe Marchessaux prête serment.)
M. Philippe Marchessaux, administrateur-directeur général de BNP Paribas Investment Partners. En introduction, je rappellerai brièvement que le rôle d’un gestionnaire d’actifs est, non pas de faire de la spéculation pour compte propre, mais de gérer de l’argent qui lui est confié en le plaçant, ou de conseiller des clients. BNP Paribas Investment Partners gère ainsi 530 milliards d’euros d’actifs. Notre clientèle se recrute parmi les institutions financières – caisses de retraite en France ou fonds de pension –, parmi les grandes entreprises ou parmi les particuliers. Nous ne nous occupons pas des fonds propres de la banque, et n’avons pas d’autre intérêt lorsque nous investissons que celui de nos clients. Notre activité de société de gestion pour compte de tiers consiste à faire des choix d’investissement en fonction de nos analyses et de notre expertise, mais aussi dans le cadre que nous imposent la réglementation de l’Autorité des marchés financiers (AMF), les instructions du client et les statuts qui sont déposés auprès de la même AMF.
Ainsi, si un client nous donne mandat de n’investir que dans des obligations d’État qui sont notées investment grade, nous n’achèterons pas d’obligations grecques par exemple, quelle que soit par ailleurs notre opinion sur la qualité de ces titres.
Je précise que nous investissons à un horizon relativement long et que la rotation de nos portefeuilles est relativement lente, de sorte que nous sommes fort peu concernés par les problématiques du trading intraday, technique consistant à faire des allers-retours dans la journée, et du high frequency trading (HFT).
M. le président Henri Emmanuelli. Vous ne pratiquez pas du tout le HFT ?
M. Philippe Marchessaux. Non. En termes d’horizon de placement, beaucoup dépend des mandats qui nous sont confiés, et nous proposons aussi de la gestion monétaire, qui peut être au jour le jour mais n’a rien à voir avec du HFT. Les produits choisis doivent être adaptés à l’horizon de gestion qui nous a été fixé.
Notre préoccupation est de nous conformer aux orientations des produits et aux règles de protection du consommateur, qui sont destinées à assurer la transparence – il nous faut exposer de manière compréhensible par le client les caractéristiques des produits dans les plaquettes qui lui sont destinées, notamment la performance attendue, le niveau de risque et le prix –, à veiller à ce que ces produits soient conformes aussi bien à ce que nous annonçons qu’aux attentes des clients, et à prévenir les conflits d’intérêts.
La régulation porte aussi bien sur les produits, qui sont agréés et classifiés, que sur notre organisation interne – le programme d’activité détaillé est soumis au régulateur. Nous sommes soumis à des exigences en termes de contrôle de risque et de contrôle interne. En outre, des contrôleurs externes multiples veillent au respect du corpus réglementaire : le dépositaire, les commissaires aux comptes des fonds et des sociétés de gestion, les régulateurs.
Dans l’industrie de la gestion d’actifs, la France est leader européen et se place au deuxième rang mondial. Le secteur emploie directement et indirectement 70 000 personnes.
S’agissant de la spéculation, je partage le point de vue développé devant vous par Jean-Pierre Jouyet : il y a la bonne et la mauvaise spéculation. Pour nous, gestionnaires d’actifs, et dans l’intérêt de nos clients, il est fondamental que soient garanties la transparence, d’une part, et la liquidité, d’autre part. Pour différencier ce qui est acceptable de ce qui ne l’est pas, il faut distinguer l’usage et l’abus.
M. le président Henri Emmanuelli. Comment collectez-vous vos ressources ?
M. Philippe Marchessaux. De deux façons. D’une part, nous fabriquons des fonds dits collectifs que nous commercialisons – une SICAV par exemple –, y compris par l’intermédiaire de notre réseau bancaire, et dont nous assurons la liquidité sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, selon le type de produit. D’autre part, dans le cadre d’un mandat qui nous est confié par un institutionnel, les actifs nous sont apportés en une fois, ou en plusieurs, mais ils restent stables dans le temps. Si nous remportons un appel d’offre, la durée du contrat est fixée au départ. En revanche, dans le cas des produits collectifs, les clients achètent et vendent à leur guise.
Concernant la crise grecque, je voudrais témoigner de la façon dont nous l’avons vécue. Les obligations de la zone euro représentent une part importante, environ 20 %, de nos actifs sous gestion. Les gestionnaires prennent position en fonction d’indices de référence qui définissent leur cadre d’action. Si la Grèce est incluse dans l’indice, nous l’inclurons dans nos analyses fondamentales portant sur l’économie, sur les perspectives conjoncturelles, avant de décider d’investir ou non, et, si oui, de surpondérer ou de sous-pondérer par rapport à l’indice, en fonction des rendements attendus d’autres placements de même nature. Si l’on juge qu’une obligation rapportera plus qu’une autre, on en achètera proportionnellement plus que l’indice. Lorsque, fin 2009, les premières mauvaises nouvelles sont venues de Grèce, notamment les doutes à propos de la qualité des comptes, nous avons décidé de sous-pondérer ses titres. En nous détournant d’actifs devenus plus risqués, nous ne spéculons pas, nous protégeons les portefeuilles de nos clients. Inversement, nous avons choisi de revenir à une surpondération de la Grèce, après la forte baisse des titres, car nous avons considéré que le risque était intégré dans les cours. Notre politique constante consiste à ajuster nos positions en fonction de notre analyse macroéconomique et des prix de marché.
Il y a toutefois pour nous un critère qui peut être important en fonction des orientations du mandataire : la notation. Lorsque la dette grecque a été rétrogradée en dessous d’AAA, nous avons dû solder nos positions en vertu de plusieurs mandats, qui exigeaient de ne pas détenir de titres avec une notation inférieure.
M. le président Henri Emmanuelli. Comment se répartissent les 530 milliards que vous gérez ? Détenez-vous des CDS ?
M. Philippe Marchessaux. Non, et des CDO – collateralized debt obligations – non plus, sinon de façon marginale. Nous détenons des obligations, des actions et des produits diversifiés combinant les deux en proportion variable. Les portefeuilles obligataires représentent 25 % à 30 % de nos actifs, les portefeuilles monétaires 20 %, les portefeuilles actions 15 %, et nous arbitrons en fonction de nos anticipations de l’évolution des sous-jacents.
Ce qui, selon nous, a provoqué la crise grecque est, non pas la spéculation, mais la perte de confiance dans ce pays quand il est apparu que ses comptes publics n’étaient pas tout à fait exacts. Certains mécanismes ont pu accélérer ou amplifier la crise, comme les ventes automatiques consécutives à la dégradation des notes. À cet égard, une approche coordonnée au plan européen et même mondial serait utile.
Il est important pour nous, en tant qu’investisseur, d’avoir des marchés transparents, liquides, je l’ai dit, mais aussi cohérents, c'est-à-dire régulés de manière coordonnée. Les mesures prises au niveau européen sont une bonne chose, en particulier la création de l’European Securities Markets Authority, l’ESMA, qui supervisera les marchés. De notre point de vue, le dialogue transatlantique ne doit pas être négligé non plus car le bon fonctionnement des marchés financiers et les règles prudentielles à mettre en œuvre ne concernent pas que les pays européens. C’est un point capital. En Europe, la fragmentation réglementaire est source de dysfonctionnements car elle permet des arbitrages réglementaires. Tout ce qui va dans le sens d’une meilleure coordination est souhaitable, y compris la création d’un régulateur unique.
M. le président Henri Emmanuelli. Avant la crise grecque, il y a eu la crise financière. Comment expliquer pareille déflagration ?
M. Philippe Marchessaux. Cette crise, de notre point de vue, trouve son fait générateur dans la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008 car les investisseurs ont été extrêmement surpris que l’État américain n’intervienne pas. Je ne mets pas sur un même plan l’assèchement du marché interbancaire. Pour moi, la crise de confiance a alimenté la baisse des marchés financiers.
M. le président Henri Emmanuelli. Soit. Mais, auparavant, les produits dérivés avaient proliféré. Certains d’entre eux ne sont-ils pas dangereux ? Par ailleurs, en tant que filiale d’une grande banque, gérez-vous des fonds pour le compte propre de votre maison mère ? Enfin, en quoi un bureau au Luxembourg vous est-il utile ? Le Président de la République et le ministre des finances ont demandé aux banques françaises de quitter certaines places.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. Dans la mesure où la réglementation à laquelle vous êtes soumis est très stricte et où vous ne recourez pas aux techniques qu’emprunte la spéculation effrénée, on peut considérer que vous pourriez être victime de cette dernière. Quelles sont, dès lors, les principales réformes qui doivent selon vous être menées aujourd'hui pour apporter aux marchés toute la liquidité nécessaire tout en évitant les débordements spéculatifs qui affectent l’économie réelle ?
M. François Delooz, responsable de la conformité chez BNP Paribas Investment Partners. Concernant le Luxembourg, il n’y a pas eu de directive particulière puisqu’il s’agit d’un pays européen qui est soumis aux mêmes directives que les autres. Au Luxembourg, l’industrie de fonds est régulée sur les mêmes bases qu’en France. Mais ce pays s’est imposé par sa célérité à délivrer les passeports nécessaires à la commercialisation des produits dans l’ensemble européen. En transposant rapidement les directives, le Luxembourg a acquis un avantage qui le place en tête en termes d’actifs gérés sous forme de fonds. C’est la raison principale pour laquelle la plupart des grands acteurs de la gestion européens, voire américains quand ils sont implantés en Europe, sont installés au Luxembourg. Cette décision n’a rien à voir avec la spéculation.
M. le président Henri Emmanuelli. Ni avec la fiscalité ?
M. François Delooz. Pas spécialement.
M. François Scellier. Lors de la crise grecque, causée, selon vous, par une perte de confiance, vous avez dû procéder à des arbitrages dans l’intérêt de vos clients. Dans la mesure où les opérateurs s’observent les uns les autres, vos décisions n’ont-elles pas rétroagi sur les marchés et accentué cette perte de confiance ?
M. Philippe Marchessaux. Notre métier consiste à acheter et vendre sur les marchés, en l’occurrence des titres d’État, après avoir évalué en propre les perspectives dans chacun des pays, pour faire fructifier au mieux l’argent de nos clients. Nous sommes des investisseurs de long terme, la durée de détention variant selon les types de produits.
M. Christian Dargnat, responsable de la gestion chez BNP Paribas Investment Partners. Elle est plus courte pour les actions – un an en moyenne – que pour les obligations. Mais il existe d’autres intervenants, comme les hedge funds, qui font du trading intraday.
Je complète la réponse à propos du Luxembourg. Nous n’avons pas d’équipe de gestion là-bas. Nos produits étant, pour les raisons qui ont été données, de droit luxembourgeois, il nous faut cependant avoir du personnel sur place pour vérifier que les valorisations sont faites et les activités de dépositaire sont exercées conformément à la loi luxembourgeoise.
Tout à l’origine de la crise se trouve le surendettement des ménages américains. Il a miné la confiance et provoqué un reflux de la liquidité de certains marchés dont les acteurs ont, quand ils le pouvaient, joué à fond sur l’effet de levier. Les gérants comme nous ne peuvent agir de même, la réglementation les en empêche : nous ne pouvons pas investir plus que l’argent que l’on nous confie.
M. Paul Giacobbi. Au lieu de s’interroger sur la perte de confiance, ne faudrait-il pas plutôt se demander pourquoi la confiance s’est maintenue aussi longtemps alors que nous avions la certitude – je vous renvoie aux analyses académiques parues dès les années quatre-vingts – que, fatalement, la bulle exploserait ? Je rappelle que les prêts cumulés de Freddie Mac et Fannie Mae, placés sous le contrôle du Congrès des États-Unis en contrepartie de la garantie dont bénéficiaient ces organismes de la part du Trésor américain, représentaient près de la moitié du PIB américain, soit 6 000 milliards de dollars. Les « prêteurs » avaient progressivement perdu de vue la capacité de remboursement des emprunteurs et s’étaient convaincus que la valeur des biens immobiliers financés augmenterait quoi qu’il arrive ; d’où les crédits dits NINJA – pour no income, no job, no asset – attribués à des gens qui n’avaient rien. De même, comment avoir fait confiance aux produits OTC, over the counter, ou de gré à gré de certaines banques, ou plus exactement de certaines institutions financières américaines, en particulier AIG ? Plus tardive a été la prise de conscience, plus dure a été la chute, mais elle devait arriver. L’euphorie n’aurait pas duré aussi longtemps si les banquiers centraux, essentiellement la Fed, n’avaient pas, en vertu d’une théorie qui pourrait porter le nom de ses chantres, Bernanke ou Greenspan, considéré que la meilleure façon de guérir l’alcoolisme était de continuer à servir à boire !
Pour en revenir aux obligations grecques, les institutions européennes ont pourtant mis assez rapidement à disposition de l’État grec des mécanismes de garantie. Si vous avez sous-pondéré, est-ce parce que ceux-ci vous ont paru insuffisants ? Où en êtes-vous aujourd'hui ? Le Wall Street Journal fait état d’un avertissement lancé par M. Chopra, directeur adjoint du Fonds monétaire international, qui souligne que les prêts des banques britanniques à la Grèce, à l’Irlande, au Portugal et à l’Espagne sont pour elles un facteur de risque. Ces informations, jointes à la remontée des taux, vous ont-elles conduits à revoir vos décisions de gestion ?
M. Christian Dargnat. Abandonnons le terme de confiance et préoccupons-nous de rendement et de risque qui sont, pour un asset manager, l’avers et le revers d’une même médaille. Nous devons placer les fonds de telle sorte qu’ils produisent le meilleur rendement possible, mais à quel risque ? Nous sommes sans doute sortis trop tôt du marché des titres grecs, ou plutôt nous avons sous-pondéré trop vite, parce qu’il a continué dans un premier temps à enregistrer de bonnes performances. La crise a fini par nous donner raison, mais, ensuite, nous sommes revenus trop tôt sur ce marché car le ratio rendement/risque, dont nous pensions qu’il redevenait intéressant, a continué à se dégrader. Quant à la qualité des garanties apportées par les États, nous sommes aujourd'hui « surpondérés » sur les obligations grecques à un horizon de deux ans, voire de trois, mais pas au-delà, compte tenu des fondamentaux de l’économie grecque.
M. le rapporteur. Et quid des réformes en cours et à venir, que ce soit au niveau national, au niveau européen ou à celui du G20 ? Quant aux produits dérivés, ils sont indispensables, ne serait-ce que pour renforcer la sécurité d’autres produits, mais comment séparer le bon grain de l’ivraie ? La réglementation peut-elle éviter les dérapages ?
M. Philippe Marchessaux. Les propositions de réforme sont nombreuses, tant au plan national, avec la loi de régulation financière, qu’au niveau européen. Toutes celles, telles la création de l’ESMA ou la transformation de différents comités en autorités dotées de pouvoirs, qui visent à améliorer l’information sur les transactions au bénéfice des opérateurs, des clients et des régulateurs, vont dans le bon sens.
Le reporting en particulier est souhaitable. C’est pourquoi il y a des aménagements à apporter à la directive MIF, sur les marchés d’instruments financiers. Si elle a marqué des avancées en matière d’information et d’adéquation des produits aux besoins du client, les dispositions concernant les plateformes de passation d’ordres sont plus discutables. La concentration qui prévalait en France notamment était plus propice à une bonne connaissance des transactions.
Par ailleurs, les produits dérivés sont utilisés par nous, pour l’essentiel, dans un souci de couverture.
M. le président Henri Emmanuelli. Vous n’achetez ni ne vendez de CDS nus ?
M. Philippe Marchessaux. Non. L’AMF a publié aujourd'hui un projet d’instruction qui oblige, en cas de vente à nu, tout personne qui franchit un seuil en capital à le déclarer. Ainsi, si vous vendez pour plus de 0,5 % du capital d’une entreprise, vous devez le signaler. Toutes les mesures de ce type vont dans le bon sens. À l’inverse, toute interdiction risquerait d’être contre-productive. En voulant supprimer l’abus, on bloquerait l’usage et, partant, la possibilité d’accéder à des marchés liquides et transparents. Mais il faut pouvoir détecter l’abus, et telle est la raison d’être du reporting, et surtout des mesures de mise en cohérence des marchés.
La force des outils de régulation aux États-Unis réside dans l’infrastructure que représentent cinquante États coiffés par un État fédéral, à ceci près qu’elle n’a pas empêché la crise parce que des pans entiers de l’économie étaient hors régulation. En Europe, les choses sont plus compliquées, mais nous sommes sur la bonne voie.
M. le président Henri Emmanuelli. L’Autorité des marchés financiers conclut dans le même sens que vous, s’agissant du reporting, de la traçabilité et de la directive MIF. Elle nous a signalé par exemple que presque 40 % du high frequency trading (HFT) ne passait pas par les plateformes régulées. Êtes-vous au courant de pratiques qui vous paraîtraient choquantes ?
M. Philippe Marchessaux. Ce qui me choque, c’est l’excès en général. Nous nous efforçons quant à nous de ne pas peser sur le marché, pour limiter l’impact sur le prix.
M. Christian Dargnat. Ce type d’excès ne peut concerner un intervenant final sur le marché. Quand nous achetons une valeur, nous nous sommes fixé pour règle de ne pas dépasser un certain pourcentage des transactions quotidiennes si nous voulons pouvoir liquider la ligne en une journée. Les acteurs comme nous ne passent pas par les dark pools, ils préfèrent les plateformes régulées, pour une question de traçabilité. Je dois pouvoir prouver que je fais ce que je dis et que je dis ce que je fais.
M. le président Henri Emmanuelli. Vous êtes un des cinq plus gros intervenants en Europe ?
M. Philippe Marchessaux. Oui, selon que l’on considère ou non comme européen Black Rock, qui a racheté Barclays Global Investors.
M. le rapporteur. À quoi vous servent les agences de notation ?
M. Philippe Marchessaux. Elles sont utiles mais elles doivent être encadrées. Il faut distinguer la notation des émetteurs et celle des produits, et veiller ensuite au tempo. Les agences n’ont pas créé la crise, mais elles ont un effet nettement procyclique. Dès lors, la question de l’opportunité de leurs annonces se pose. La Commission européenne a prévu de demander aux agences de prévenir trois jours avant, au lieu de douze heures, les États dont elles envisagent de réviser la note.
M. le président Henri Emmanuelli. Trouvez-vous normal que l’émetteur rémunère le notateur ?
M. Philippe Marchessaux. L’agence de notation est un acteur du marché et elle permet aux investisseurs de mieux évaluer la solvabilité d’un émetteur. Si conflits d’intérêts il y a, il faut mettre en place le cadre et les règles nécessaires pour les prévenir.
M. le président Henri Emmanuelli. À un moment, il est apparu que l’existence de ces agences était la conséquence d’une externalisation de l’expertise. En ce qui vous concerne, vous avez sans doute maintenu celle-ci au sein de votre institution ?
M. Philippe Marchessaux. Oui. Nous employons cinquante analystes crédit, ce qui ne veut pas dire que nous nous désintéressons des évaluations des agences. Mais nos spécialistes se forgent leur propre opinion. En revanche, les statuts des fonds et les orientations données par les clients peuvent nous interdire d’investir dans des titres qui n’ont pas telle ou telle note, ou nous obliger à solder nos positions en cas de déclassement d’un émetteur.
M. le président Henri Emmanuelli. Et ces notations vont forcément dans le sens du vent…
M. Philippe Marchessaux. Le plus curieux, c’est que les notes peuvent être réduites de plusieurs crans en une seule fois. Dans ce cas, les agences suivent certainement le marché.
M. le président Henri Emmanuelli. Messieurs, nous vous remercions.
L’audition s’achève à dix sept heures vingt.
*
* *
Audition de M. Jean-Claude Gruffat, directeur général de Citigroup France
(Procès-verbal de la séance du mercredi 10 novembre 2010)
(Présidence de M. Henri Emmanuelli, président de la commission d’enquête)
La séance est ouverte à dix-sept heures trente
M. le président Henri Emmanuelli. Monsieur Gruffat, je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation.
Vous avez derrière vous trente-six ans de carrière dans la finance et êtes actuellement directeur général de Citigroup France, branche française d’un groupe mondial dont les actifs financiers se montent à quelque 2 200 milliards de dollars.
Notre commission s’efforce de déterminer si la spéculation – du moins dans certaines de ses formes – a contribué à la crise financière. Faut-il, comme un petit nombre de nos interlocuteurs l’ont suggéré, proscrire certains produits emblématiques d’une « économie-casino », tel le CDS – credit default swap – nu ? Quelles sont les recommandations à formuler pour éviter que ne se reproduise la crise financière et économique que nous avons connue, ou encore la crise grecque ?
Le 23 novembre 2008, les titres de Citigroup chutaient de près de 70 %...
M. Jean-Claude Gruffat, directeur général de Citigroup France. Ce fut même bien pire !
M. le président Henri Emmanuelli. Le gouvernement fédéral américain a garanti plus de 300 milliards de dollars de vos actifs en échange d’une prise de participation de 27 milliards. Vous avez donc été au cœur de la tourmente et, à ce titre aussi, votre point de vue nous intéresse.
(M. Jean-Claude Gruffat prête serment.)
M. Jean-Claude Gruffat. Je commencerai par quelques remarques sur les mécanismes de spéculation qui affectent le fonctionnement des économies, notamment sur ceux qui déstabilisent la monnaie et les titres souverains européens.
Première remarque : le monde croule sous la dette. L’excès de liquidité créé au cours des dernières décennies par les surplus des pays exportateurs a provoqué l’apparition de bulles spéculatives dans les pays dits développés. Les institutions financières, en dépit de quelques exceptions vertueuses, y ont contribué en prêtant de manière excessive sur des valeurs futures potentielles, et non conservatrices.
La crise trouve pour partie son origine dans un modèle qui s’est largement développé aux États-Unis et qui a provoqué une détérioration du sens du risque. Ce modèle consistait à « originer, structurer et distribuer ». En d’autres termes, les institutions financières prenaient des actifs financiers mais ne les gardaient pas : elles les distribuaient à un marché plus large que le marché bancaire, donc à un public d’investisseurs, si bien qu’on les retrouvait parfois dans les portefeuilles de particuliers sous la dénomination de « SICAV dynamiques », par exemple. De tels produits offraient un rendement supérieur aux taux du marché, moyennant, bien entendu, un profil de risque différent.
Le sens du risque s’est trouvé émoussé dans la mesure où les institutions financières ne portaient plus le crédit jusqu’à son terme. Sans doute se montrent-elles bien plus responsables lorsqu’elles savent qu’elles seront affectées par leurs décisions mais, lorsqu’elles se contentent de structurer un crédit et de le distribuer à des investisseurs qui, eux, n’ont pas forcément effectué toutes les analyses nécessaires pour apprécier la pertinence et la sûreté de tels actifs, il en va autrement.
Le recours à ce modèle s’est trouvé exacerbé aux États-Unis avec la crise des subprimes : des acquéreurs potentiels de biens immobiliers qui n’avaient pas les revenus suffisants pour souscrire un crédit hypothécaire classique ont eu accès à un crédit dit subprime, c'est-à-dire assorti d’un taux d’intérêt plus élevé mais aussi de facilités de remboursement, d’exonérations et d’exemptions pendant une période – par exemple de la possibilité de ne pas commencer à rembourser le principal tout de suite. Tous ces crédits étaient « originés » par des courtiers dont l’activité ne faisait l’objet d’aucune réglementation. Ils étaient ensuite achetés par des banques d’affaires qui les « structuraient » pour en faire des produits financiers découpés en tranches à risque dégressif. Après intervention des agences de notation, les mêmes banques d’affaires distribuaient ces crédits, qui se retrouvaient alors dans les portefeuilles d’investissement des institutionnels et des particuliers.
Pour assurer la liquidité de ces investissements, des lignes de support, ou back stop, étaient procurées puisqu’une partie des portefeuilles était financée par du papier commercial émis sur les marchés – ces lignes sont en effet destinées à refinancer un tel papier lorsqu’il ne trouve pas à se placer. Les banques ne supportaient donc ni le risque de liquidité ni le risque de crédit. Cela étant, lorsque la crise a éclaté à la fin de 2006 et au début de 2007, on a activé les lignes de back stop car les papiers commerciaux n’assuraient plus le refinancement. Il y a eu dès lors un effet boomerang sur le bilan des institutions financières, qui se sont trouvées confrontées à la fois au risque de liquidité et au risque de crédit qu’elles avaient cherché à écarter.
Cette crise a provoqué l’intervention des États et des banques centrales. Si les institutions financières américaines ont été plus fortement affectées que les autres, la plupart des États ont soutenu les établissements nationaux en procurant des garanties, tandis que les banques centrales injectaient de la liquidité et achetaient du papier. Du reste, avec son nouveau programme d’émission de 600 milliards de dollars, la Federal Reserve montre qu’elle poursuit cette politique de quantitative easing.
Dans certains cas, dont celui de Citigroup, l’intervention a dû aller plus loin. Certains établissements ont été purement et simplement nationalisés. Pour d’autres, les États ont garanti une partie du portefeuille et pris des actions de préférence qui, parfois, ont été converties en actions de droit commun.
Juste avant la crise, Citigroup était la première banque du monde en termes d’actifs, avec un total de bilan de l’ordre de 2 400 milliards de dollars, des fonds propres très importants et une capitalisation boursière d’environ 250 milliards de dollars. À la fin de 2006, la valeur du titre en bourse était de 56 dollars. Au pire moment de la crise, elle est tombée à 1 dollar – soit une baisse bien supérieure aux 70 % dont vous faisiez état, monsieur le président.
Les recapitalisations, massives, se sont faites de façon différente aux États-Unis et en Europe. La Société générale ou le Crédit agricole, par exemple, ont levé des fonds auprès de leurs actionnaires, qui ont répondu favorablement. Les établissements américains, parmi lesquels Citigroup, ont d’abord sollicité les fonds souverains – Abu Dhabi, Singapour, la Norvège, le Qatar, le Koweït, etc. –, puis, comme cela n’a pas suffi, se sont tournés vers leurs gouvernements. Ceux-ci ont pris des actions de préférence, avec des warrants attachés qui leur assuraient un bonus en cas de retour à meilleure fortune.
S’agissant de Citigroup, le Trésor américain a fourni un soutien de 45 milliards de dollars, en deux tranches de 20 et de 25 milliards, et la Federal Deposit Insurance Corporation – la FDIC, l’organisme fédéral qui assure les dépôts des particuliers – a garanti un portefeuille d’actifs dits toxiques de plus de 300 milliards. Sur sept trimestres consécutifs, les pertes du groupe ont atteint 110 milliards de dollars. Mais la recapitalisation, par dilution massive des actionnaires, est telle aujourd'hui que nous sommes mieux capitalisés qu’avant la crise. Les actionnaires antérieurs ont été « lessivés », les dirigeants ont été changés : on a donc une équipe nouvelle et des actionnaires nouveaux, situation que l’on a peu vue en Europe. La sanction du marché a été effective.
M. le président Henri Emmanuelli. Pour les Américains, c’était sans doute psychologiquement important.
M. Jean-Claude Gruffat. En effet. La question du too big to fail et du traitement des institutions systémiques fait désormais l’objet d’une réflexion sérieuse, par exemple dans le cadre du Fonds de stabilisation européen. Malheureusement, comme sur d’autres questions, la convergence de vues est insuffisante, entre Européens et Anglo-saxons comme entre Européens eux-mêmes.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. Les Américains ont donc jugé que la sanction du marché était une bonne chose. Mais celle qu’a subie Lehman Brothers n’a-t-elle pas été précisément une des principales origines de la crise ?
M. Jean-Claude Gruffat. Ma réponse sera strictement personnelle, la position de mon groupe pouvant être différente sur le sujet.
Je fais partie de la minorité qui pense que ce qui est arrivé à Lehman Brothers était justifié.
En septembre 2007, plusieurs institutions – Merrill Lynch, notamment – se trouvaient dans une situation délicate aux États-Unis. La question se posait au gouvernement Bush en fin de mandat, avec un secrétaire au Trésor qui était l’ancien patron de Goldman Sachs, de savoir s’il fallait sauver Lehman Brothers après avoir trouvé une solution en mars pour Bear Stearns et après avoir sauvé la compagnie d’assurance AIG. En bref, fallait-il une nouvelle fois faire appel au contribuable américain ?
Deuxième question : cette banque méritait-elle d’être sauvée ? Les sommes en jeu étaient considérables. Depuis des mois, Lehman Brothers avait frappé à toutes les portes dans le monde pour trouver des investisseurs disposés à renflouer la banque. Les derniers à avoir refusé étaient les Coréens. La seule institution encore intéressée, une banque britannique, réclamait une garantie complète du Trésor américain. Le rôle de ce dernier était-il de sauver une banque où l’effet de levier était de l’ordre de 50 – 2 dollars de capital pour 100 d’engagements, sachant que, dans ces engagements, il n’y avait pas que du bon et que beaucoup était illiquide ?
Enfin, pouvait-on liquider cette banque sans créer un risque d’effondrement du système ? Les Américains ont considéré que c’était possible, non sans dommages pour les financiers bien sûr : les banques qui traitaient avec Lehman Brothers et étaient contreparties dans les activités de marché ont subi des pertes importantes, mais pas d’un niveau tel que le système se soit trouvé dans une situation de faillite. En revanche, on a reproché aux Américains d’avoir créé une crise massive de liquidité et de confiance entre les institutions financières. En outre, la crise grecque est venue raviver la crise de confiance alors que celle-ci commençait à s’estomper en raison de l’amélioration des résultats des banques.
Bref, ce qui est arrivé à Lehman Brothers ne me surprend pas. Je peux le regretter, mais je peux le comprendre.
Soulignons également que les États qui ont pris des participations en capital en même temps qu’ils garantissaient la dette des établissements financiers n’ont pas perdu d’argent. Ils ont accordé leurs prêts dans des conditions de marché. En France, les prêts consentis via la Société de financement de l’économie française, la SFEF, ont été récupérés. Certains considèrent même que l’État aurait pu demander plus, sous formes de warrants par exemple.
M. le président Henri Emmanuelli. C’est mon point de vue. L’État aurait pu entrer dans le capital des banques, puis revendre.
M. Jean-Claude Gruffat. C’est ce qu’ont fait les Américains.
Les pertes sur AIG, seules pertes constatées, seront peut-être partiellement récupérées. Cette compagnie s’était lancée dans l’assurance-crédit et avait assuré massivement des portefeuilles bancaires d’institutions qui achetaient du papier de mauvaise qualité – dont, c’est bien connu, de grandes banques françaises et de grandes banques américaines, parmi lesquels Goldman Sachs, mais pas Citigroup. Quand les credit default swaps (CDS) ont été actionnés, on n’a pu que constater les pertes. Le gouvernement américain a pris le contrôle parce que plusieurs gouvernements européens ont demandé à ce que ces CDS soient honorés, mais aussi parce qu’il y avait 20 000 emplois à la clef à New York et que le gouverneur de l’État de New York était intervenu.
Le défaut d’AIG, celui de Fannie Mae et de Freddy Mac – les agences de refinancement de la dette hypothécaire américaine – et celui de GMAC – filiale de crédit de General Motors – ont abouti à 100 à 150 milliards de dollars de pertes. Cela étant, sur les 750 milliards prêtés au système bancaire américain, tout le reste a été remboursé avec des intérêts substantiels. Citigroup, par exemple, a remboursé toute la partie qui n’avait pas été convertie et le Trésor a déjà vendu quelque 15 des 27 % qu’il détenait sur le capital de l’établissement, et il continue à vendre au fil de l’eau en dégageant du profit.
Pour contestables ou regrettables que l’on puisse les juger, ces interventions qui ont mis en jeu le crédit de l’État ont donc été remboursées.
En même temps, puisque les banques ne se prêtaient plus entre elles, les États ont eu à assurer le financement du système bancaire et financier, en apportant leur garantie. Ainsi en Europe : les gouvernements belge, français et luxembourgeois ont garanti Dexia, la BNP a repris Fortis, etc. Cela a conduit à ce paradoxe que, si les banques n’ont pas été nationalisées, la dette du secteur financier l’a été, elle, assez largement, si bien qu’elle s’est transformée indirectement – ou directement, par le mécanisme des cautions – en dette des États.
Comme les remboursements ne sont pas toujours intervenus, ces sommes sont venues aggraver l’endettement des pays. Selon des chiffres récents, le rapport global de la dette au PIB dans l’Union européenne est de 85 %, en complet décalage avec la règle vertueuse des 60 % – et je passe sur celle des 3 % de déficit budgétaire par rapport au PIB ! À ces chiffres s’ajoutent ceux de l’endettement privé. Aux États-Unis, l’ensemble de la dette des ménages et des entreprises du secteur concurrentiel et du secteur public représente 300 % du PIB.
Ces dettes sont-elles remboursables ? Cette question nous renvoie à celle de la spéculation. S’il existe une spéculation sur les dettes des États, c’est parce que l’on perçoit une vulnérabilité croissante de ceux-ci, qui, à quelques exceptions près, ont vu leur endettement aggravé par leurs déficits structurels puis par la crise.
La situation ne peut être réglée par les méthodes traditionnelles, à savoir l’inflation, la dévaluation ou la croissance. L’inflation est faible, la dévaluation est exclue. Pour ce qui est de la croissance, alors que les taux de reprise de l’économie américaine après les crises précédentes – certes moins longues et moins sévères – étaient de 6 à 8 %, les taux actuels sont compris entre 1,5 et 2 % seulement. Et même si l’Europe connaît des taux de 2 %, c'est-à-dire la moyenne annuelle de la croissance des économies depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, cela ne permettra pas de rembourser la dette. Des études menées en particulier par les économistes de Citigroup indiquent que, pour revenir à la règle de 3 % de déficit public, les États devraient générer d’ici à 2030 un surplus budgétaire annuel de l’ordre de 4 % avant paiement des intérêts de la dette !
Faute donc de pouvoir compter sur les méthodes traditionnelles, on n’échappera pas à des phénomènes de « restructuration », étant entendu que le terme « défaut » est banni du vocabulaire – la distinction entre les deux reposant sur le fait que le défaut se définit par son caractère unilatéral alors que la restructuration implique une décision bilatérale.
Un exemple de défaut : celui de l’Argentine en 2001 – il en a coûté 2 milliards à Citigroup à l’époque. Du jour au lendemain, le gouvernement a annoncé que la monnaie était dévaluée et que les contrats de change à terme ne seraient pas honorés. La décision n’a fait l’objet d’aucune concertation, pas même avec le Fonds monétaire international.
Lors d’une restructuration, au contraire, le débiteur indique à ses prêteurs qu’il n’est pas en mesure de rembourser et demande des facilités de paiement : allongement de la durée du crédit, réduction du taux d’intérêt, etc.
Lorsque l’on observe les conditions auxquelles les pays qui posent problème actuellement dans la zone euro – Grèce, Portugal, Espagne, Irlande – empruntent sur les marchés et la façon dont leur dette se traite sur le marché secondaire, on constate des écarts très importants avec l’Allemagne, la France ou la Grande-Bretagne. Cette différence n’est rien d’autre que l’anticipation de restructurations se traduisant par un abandon de créances de 25 % à 30 %. C’est ce qui explique les phénomènes de spéculation : le marché s’attendant à une restructuration, il va shorter (vendre à découvert) le papier. Il ne croit pas les gouvernements ni le gouverneur de la Banque centrale européenne quand ceux-ci affirment que les dettes des pays souverains seront honorées.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. Pour le gouverneur de la BCE, n’est-ce pas le terme « restructuration » qui est banni ?
M. Jean-Claude Gruffat. Il ne peut s’exprimer autrement. Il en allait de même, autrefois, avec les dévaluations : jusqu’à l’instant précis où l’on dévaluait, on affirmait droit dans les yeux qu’on ne dévaluerait jamais. Je l’ai moi-même constaté lors d’une rencontre avec le gouverneur de la banque de Thaïlande à la veille de la dévaluation de 1997.
Bref, lorsque l’on jure aux marchés que la dette de ces pays ne sera pas restructurée, ils ne le croient pas et ils anticipent, d’où les phénomènes de spéculation.
Quelques pays ont interdit certaines techniques utilisées par les banques, notamment les ventes à découvert, ou CDS nus. Mais ces dispositions ne sont applicables qu’à l’intérieur des pays en question. L’interdiction, par Mme Merkel, de faire du « short » sur la dette des pays européens n’empêche en rien la Deutsche Bank ou toute autre banque allemande de le pratiquer à Londres.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. De toute façon, peu de transactions de ce type se font sur le territoire allemand.
M. Jean-Claude Gruffat. La mesure est vertueuse. Est-elle efficace ? C’est une autre question !
Quant aux vraies solutions, s’il y en a, c’est de cela qu’il conviendrait de débattre.
M. le président Henri Emmanuelli. Quelles sont-elles, pour vous ?
M. Jean-Claude Gruffat. Jean-Pierre Jouyet, qui est une personnalité que je respecte beaucoup, considère que la spéculation est utile en ce qu’elle permet de créer un marché. De fait, au cours de ma longue carrière, j’ai parfois constaté qu’il n’y avait rien de pire que l’absence de marché. J’étais à Hong Kong en 1987 lorsque, faute de moyens pour empêcher le décrochage, le président de la bourse avait décidé de fermer celle-ci. Le lundi 16 octobre, j’avais rejoint le marché à terme de Chicago. Les jeunes courtiers de la banque Indosuez, où je travaillais à l’époque, n’avaient jamais rencontré cette situation : il n’y avait que des vendeurs, personne n’achetait ! Le marché est la solution, mais encore faut-il qu’il y ait un marché. Que faire quand il n’existe pas ? Il y a, certes, des recettes boursières – franchissements de seuil, suspensions... –, mais le mécanisme des achats et des ventes est aujourd'hui totalement électronique et souvent déclenché par des algorithmes, comme on a pu le constater en mai dernier avec la réaction en chaîne du flash crash.
M. le président Henri Emmanuelli. Ces mécanismes sont-ils souhaitables ?
M. Jean-Claude Gruffat. Non, mais que pouvons-nous y faire ?
M. le président Henri Emmanuelli. Personne ne doute que la spéculation peut assurer la liquidité et qu’elle est parfois utile pour « couvrir ». Le problème est de savoir comment se prémunir contre les opérations « casino » dangereuses et sans intérêt pour l’économie réelle. Qu’apporte le high frequency trading, le HFT, à l’économie réelle ? Davantage de liquidité, diront les puristes, puisqu’il y a davantage de transactions...
M. Jean-Claude Gruffat. Mais non davantage de transparence.
M. le président Henri Emmanuelli. Et ces opérations présentent un risque énorme.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. Faut-il les limiter ou les interdire ?
M. Jean-Claude Gruffat. Tout d’abord, je crois qu’il n’existe pas de solution nationale, ni même régionale, car cela ne conduit qu’à des déplacements d’activité.
Ensuite, la responsabilité du contrôle des activités doit peser sur les dirigeants des firmes. Alors qu’un régulateur de marché est tenté de réguler en demandant plus de capital et de liquidité, il me semble qu’une première règle doit s’imposer : si spéculation il y a, elle ne doit pas être menée avec l’argent du public. C’est ce que les Américains ont tenté d’imposer avec la « règle Volcker » et le Dodd-Frank Act, qui visent à s’assurer que la spéculation se fasse avec des fonds propres ou des fonds ayant fait l’objet d’un emprunt à risque, non avec ceux des déposants.
Si cette responsabilité doit relever des firmes, la première chose à faire est de responsabiliser les conseils d’administration. C’est là une opinion personnelle. En France, les « dirigeants responsables » des établissements bancaires font l’objet d’une procédure d’accréditation, menée naguère par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) et aujourd'hui par l’Autorité de contrôle prudentiel. Les autorités de place ont donc un interlocuteur qui répond de la conformité des opérations à la réglementation. Mais aucune procédure de ce type n’existe pour les conseils d’administration, devant lesquels les « dirigeants responsables » sont pourtant eux-mêmes responsables.
À titre d’exemple, le conseil d’administration de la Société générale au moment de l’affaire Kerviel ne comportait qu’un assureur et un ancien banquier. Par la suite, la banque s’est empressée de nommer un membre qui a un passé de banquier de marché.
En général, les établissements rechignent à nommer des banquiers – sauf s’ils sont à la retraite depuis longtemps – à leur conseil d’administration, de peur, notamment, de conflits d’intérêts.
M. le président Henri Emmanuelli. Peut-être craignent-ils aussi que cela ne leur lie les ailes.
M. Jean-Claude Gruffat. Aux États-Unis, la situation de Citigroup n’était pas très différente : le conseil d’administration comprenait des industriels, des universitaires, des économistes, et même un ancien patron de la CIA et un ancien président des États-Unis, Gerald Ford, tous gens respectables et compétents à bien des égards, mais pas de banquiers. Après avoir été particulièrement atteint par la crise, le groupe a lui aussi fait entrer des banquiers au nombre de ses administrateurs.
Ce qui est maintenant souhaitable, c’est une responsabilisation sur le plan civil, voire sur le plan pénal. Cela devrait changer les comportements.
M. le président Henri Emmanuelli. Mais cela ne garantit pas contre le risque systémique.
M. Jean-Claude Gruffat. Le Fonds de stabilisation est en train de s’occuper des institutions systémiques et le G20 en débattra. Il sera notamment demandé d’apporter une couche supplémentaire de capital. En la matière, il n’y a pas de règle pour déterminer le bon niveau mais il est certain que plus on met de capital, mieux on se porte, surtout s’il s’agit d’actions de droit commun. Une des leçons de la dernière crise est aussi que la liquidité ne faisait pas l’objet de contrôles suffisants : il faut s’assurer que des actifs vraiment liquides existent, et qu’ils existent dans les juridictions où ils sont censés se trouver. Dans l’affaire Lehman Brothers, la liquidité qui se trouvait en Europe – et qui garantissait l’autosuffisance – a été siphonnée en quelques heures vers New York, juste avant la mise en œuvre du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Il serait donc de bonne politique de vérifier que la liquidité est cantonnée à l’endroit où l’on peut en avoir besoin.
Pour les institutions présentant un risque systémique, M. David Thesmar, membre du Conseil d’analyse économique, remarque à juste titre que la loi américaine est plus audacieuse que la nôtre. En effet, les États-Unis ont prévu que celles qui auront bénéficié de la protection du gouvernement fédéral pourront être liquidées s’il est impossible de les restaurer, et que tous les actionnaires et tous les types de créanciers supporteront la perte.
Auparavant, lors de la faillite de General Motors par exemple, les actionnaires, les personnels, les fonds de pension et les créanciers extérieurs ont subi un abandon de créance, ou « haircut ». Mais, dans le système américain, toutes les grandes banques ont bénéficié d’une garantie implicite, si bien que les créanciers obligataires des États-Unis, même pour les dettes subordonnées, ont vu leur créance honorée à 100 %. Au pire moment de la crise, la créance de dette subordonnée se traitait à 20 cents le dollar, or les hedge funds qui ont acheté ce papier pour ce montant ont été indemnisés à 100 !
Je crois beaucoup aux mécanismes de marché à condition qu’ils fonctionnent. Lorsque la garantie implicite d’un gouvernement permet à des spéculateurs de réaliser de telles opérations – sur des fonds levés précisément à des fins de spéculation –, il y a un problème. C’est pourquoi la nouvelle loi américaine dispose que toutes les catégories de créanciers seront mises à contribution lorsqu’une institution ne pourra faire face à ses engagements. La différence de traitement antérieure était incompréhensible pour les investisseurs.
M. le président Henri Emmanuelli. Néanmoins, la confiance entre les banques n’est pas revenue.
M. Jean-Claude Gruffat. C’est exact. Le problème des dettes souveraines s’est substitué au problème précédent. Paradoxalement, quand les grandes banques centrales, au premier rang desquelles la Fed, injectent de la liquidité dans l’économie, les banques redéposent cette liquidité dans les banques centrales. À titre d’exemple, le dépôt de Citigroup auprès des banques centrales s’élève en permanence à 250 milliards de dollars. Le rôle des banques est-il de prêter aux banques centrales ?
M. le président Henri Emmanuelli. Les taux ne sont pourtant pas rémunérateurs...
M. Jean-Claude Gruffat. Non, mais le dépôt est sécurisé. Auparavant, les grandes banques n’hésitaient pas à se prêter entre elles. Ce n’est plus le cas. Dans un premier temps, on craignait une nouvelle affaire Lehman Brothers. Puis, au printemps de cette année, les banques européennes, qui ont des engagements importants en dollars, ont rencontré des difficultés pour lever des dollars auprès des banques américaines en raison des chiffres qui circulaient au sujet des engagements des établissements allemands ou français vis-à-vis de la Grèce, de l’Espagne, du Portugal, etc.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. Comment expliquez-vous que les courtiers américains qui plaçaient les crédits subprimes ne faisaient l’objet d’aucune réglementation ni d’aucun contrôle ? Le système consistait, si vous me permettez l’expression, à se « repasser la patate chaude ». Comment des institutions financières de bon niveau et des responsables réputés compétents ont-ils bien pu acquérir des produits aussi nocifs, fondés sur l’espérance que les prix de l’immobilier ne cesseraient jamais de croître ?
M. Jean-Claude Gruffat. Dans un premier temps, les banques ont recueilli des actifs, les ont structurés et en ont fait des produits financiers qu’elles ont placés. Comme le système faisait gagner beaucoup d’argent à tout le monde et qu’elles ne conservaient pas ces actifs tout en empochant des commissions, elles ont voulu en faire plus. De ce point de vue, il y a lieu de mettre en cause les règles de Bâle II, qui ont eu pour conséquence de réduire les exigences en capital et, de ce fait, d’augmenter l’effet de levier – on pouvait faire davantage d’opérations sans avoir plus d’actifs, améliorant ainsi le return on equity, le retour sur capitaux propres.
Les produits étaient structurés en tranches selon un risque décroissant.
M. le président Henri Emmanuelli. Dette senior, dette mezzanine, etc.
M. Jean-Claude Gruffat. Exactement. Et certaines des tranches senior, protégées par des fonds propres, de la dette mezzanine, de la dette subordonnée, etc., sont apparues comme offrant des taux de rentabilité supérieurs : ce sont les fameux super triple-A, notion inspirée de la pratique des agences notation mais qui n’a aucune signification. Certaines institutions, dont malheureusement la mienne, se sont alors mis en tête de conserver ces produits. C’est alors que le système s’est grippé.
Paradoxalement, Citigroup n’a jamais originé de subprimes mais en a acheté pour en faire des produits financiers. Lorsque le jeu des chaises musicales a pris fin, au troisième trimestre de 2007, nous en détenions pour 40 milliards de dollars. D’un seul coup, cet inventaire n’a quasiment plus rien valu.
Il s’agit donc d’une défaillance des systèmes de risque. Certains établissements comme Goldman Sachs, se croyant plus malins, se sont rendu compte du phénomène et ont massivement « shorté » ces actifs dans le marché pour créer un hedge sur leurs positions. Bien entendu, cela a contribué à aggraver la situation.
M. le président Henri Emmanuelli. Et ils ont trouvé des acheteurs pour qui le seul nom de l’institution constituait une garantie ?
M. Jean-Claude Gruffat. Ce réflexe existe.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. D’où votre idée d’étendre la responsabilité aux conseils d’administration.
M. Jean-Claude Gruffat. En quelque sorte.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. Vous avez évoqué Bâle II mais nous en sommes maintenant à Bâle III. À cet égard, certains de vos confrères craignent que les Européens ne se tirent une balle dans le pied en faisant des efforts pour apporter plus de capital, alors que les Américains n’appliquent même pas Bâle II.
M. Jean-Claude Gruffat. C’est inexact pour deux raisons.
En premier lieu, dans les pays autres que les États-Unis, les banques américaines fonctionnent dans le cadre de filiales assujetties au droit de ces pays. Ainsi, Citigroup opère dans les 18 pays d’Europe occidentale via des succursales de la filiale britannique de la maison mère américaine.
M. le président Henri Emmanuelli. La succursale française est-elle agréée en droit français ?
M. Jean-Claude Gruffat. Oui, mais la supervision prudentielle, par exemple pour tout ce qui concerne le contrôle interne, revient à la FSA – Financial Services Authority – britannique et, pour ce qui concerne la liquidité et la lutte anti-blanchiment, à l’Autorité de contrôle prudentiel ou à l’Autorité des marchés financiers. En effet, les régulateurs se sont mis d’accord pour que le contrôle prudentiel s’exerce au niveau du siège. Mais la FSA est un régulateur européen et, depuis le 1er janvier 2008, toutes les banques opérant en Europe sont soumises aux règles de Bâle II. Seules les entités américaines opérant sur le territoire des États-Unis ne sont pas tenues par ces règles.
En second lieu, les dix-huit ou dix-neuf principales banques américaines qui opèrent sur les marchés internationaux et qui représentent environ 90 % du marché bancaire intérieur – les quelques milliers d’autres banques étant de taille locale ou régionale – seront soumises à Bâle II à partir d’avril 2011. Nous sommes donc dans une logique de pré-Bâle II.
M. le président Henri Emmanuelli. Et Bâle III ?
M. Jean-Claude Gruffat. L’application sera progressive. On est en train d’en définir les règles.
M. le président Henri Emmanuelli. Il est cependant étonnant que l’on travaille sur Bâle III en Europe alors que Bâle II ne s’appliquera aux États-Unis qu’en avril prochain.
M. Jean-Claude Gruffat. Le blocage, en l’occurrence, ne vient ni de la Fed, ni du Trésor, ni de la FDIC, mais du Congrès. Celui-ci considère que le système bancaire américain doit rester éclaté, pour protéger les banques locales contre les monstres de Wall Street. Or les règles de Bâle I réclament plus de capital. Celles de Bâle II établissent une différenciation des exigences de capital en fonction des types d’activité et représentent pour les très grandes banques, je le répète, une diminution de ces exigences.
Du reste, la preuve que le système de Bâle II n’est pas satisfaisant est que l’on élabore déjà un Bâle III, alors que l’on a conservé Bâle I pendant vingt ans. Bâle II n’est en application en Europe que depuis janvier 2008.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. Mais les Américains ne l’adopteront qu’à partir d’avril 2011...
M. Jean-Claude Gruffat. Parce qu’ils en ont assez de s’entendre dire qu’ils ne l’appliquent pas et que la concurrence s’en trouve faussée.
M. le président Henri Emmanuelli. Quelles sont, selon vous, les faiblesses de Bâle II ?
M. Jean-Claude Gruffat. Sans doute une différenciation des types de risque fondée sur des analyses statistiques. Dans cette démarche, on anticipe en fonction du passé en se fondant sur des séries statistiques et en les corrélant. Or, rien ne garantit que ce qui s’est passé se reproduira dans les mêmes conditions et que les corrélations observées antérieurement seront les mêmes.
Dans un récent ouvrage consacré aux crises, Kenneth Rogoff remarque que, jusqu’à une époque récente, aucune agence internationale ne disposait de série historique longue sur les dettes souveraines. Le Fonds monétaire international vient de décider de se saisir de ce problème afin de créer des séries statistiques longues. La modélisation de ces séries permettra de faire ensuite des projections en ce qui concerne les exigences de fonds propres.
M. le président Henri Emmanuelli. Un économiste que nous avons entendu s’est étonné de ce que, depuis 2003 ou 2004, les liquidités aient augmenté de 15 % par an alors que le taux de croissance moyen était de 4 %. On peut légitimement se demander jusqu’à quand cela durera. Pourtant, ni le FMI ni la Banque des règlements internationaux (BRI) n’ont donné l’alerte sur cette masse de liquidités qui ne trouvent pas à s’écouler dans l’économie réelle.
M. Jean-Claude Gruffat. Le même Kenneth Rogoff estime à 220 000 milliards de dollars la liquidité en circulation, alors qu’en additionnant les PIB de toutes les économies mondiales, on arrive à 60 000 milliards.
M. le président Henri Emmanuelli. Pour ce qui est de la valeur des contrats sur instruments dérivés, M. de Boissieu nous a parlé de 700 000 milliards de dollars.
M. Jean-Claude Gruffat. Le chiffre de M. Rogoff concerne les liquidités, celui de M. de Boissieu renvoie au hors-bilan.
M. le président Henri Emmanuelli. Ces 700 000 milliards représentant douze années de PIB, il est forcé que des bulles se créent...
M. Jean-Claude Gruffat. Le marché des CDS était équivalent, en notionnel, au PIB mondial, mais il y a beaucoup de double, triple ou quadruple emploi. N’oublions pas que les transactions journalières sur le change représentent 4 000 milliards de dollars, selon le dernier chiffre de la BRI.
M. le président Henri Emmanuelli. Je crois qu’il nous reste à vous remercier.
M. Jean-Claude Gruffat. Permettez-moi de remettre à votre commission trois de mes articles récents, le premier consacré à l’éventuel retour au Glass-Steagall Act – faut-il séparer les activités de banque commerciale et celles de banque d’affaires ? –, le deuxième consacré à la responsabilisation des directions générales et des conseils d’administration vis-à-vis des risques pris par les banques, le troisième consacré aux évolutions des bourses, notamment à la question du high frequency trading.
M. le président Henri Emmanuelli. Quelle est votre position sur ce dernier sujet ?
M. Jean-Claude Gruffat. Les bourses des valeurs, créées pour lever des fonds destinés au financement de l’économie, se sont elles-mêmes introduites en bourse ces dernières années. Il s’est immédiatement ensuivi pour elles des contraintes de résultat. De plus, la création de plateformes alternatives a accru la concurrence, ce qui les a contraintes à réduire leurs commissions au moment même où elles doivent réaliser des investissements technologiques de plus en plus importants. Leur situation est donc la pire qui soit.
De ce fait, elles se sont lancées dans des opérations de concentration. Le New York Stock Exchange rachète Euronext, le NASDAQ cherche à racheter le London Stock Exchange, etc. Pour faire face à la concurrence, elles cherchent également à créer elles-mêmes des plateformes alternatives, ou elles en rachètent. De plus, on s’engage dans une révision de la réglementation MiFID (Market in Financial Instruments Directive) mise en œuvre il y a trois ans.
Les intervenants souhaitant traiter des volumes plus importants, on retrouve ces volumes dans le high frequency trading, où les mouvements se font à la nanoseconde et sont déclenchés par des ordinateurs.
M. le président Henri Emmanuelli. N’est-on pas entré dans l’aberration ?
M. Jean-Claude Gruffat. Je pense que ce phénomène donnera lieu rapidement à une réflexion. Je sais que c’est un sujet de préoccupation pour M. Jean-Pierre Jouyet et qu’il en a parlé avec ses homologues européens et américain. Là encore, il n’existe pas de solution seulement nationale.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. N’aurait-il pas fallu conserver des bourses des valeurs plus institutionnalisées ?
M. Jean-Claude Gruffat. On ne l’a pas fait. On est sorti d’une logique de place de marché pour entrer dans une logique d’entreprise commerciale. La question est de savoir si le modèle d’une société introduite en bourse est bien celui d’une place de marché. Malheureusement, il est un peu tard pour se la poser !
M. le président Henri Emmanuelli. La place avait un rôle de régulation.
M. Jean-Claude Gruffat. Du moins y avait-il une plus grande symbiose entre les autorités de régulation et les places.
M. le président Henri Emmanuelli. Monsieur Gruffat, merci beaucoup.
La séance est levée à dix-huit heures quarante.
*
* *
Audition de Mme Catherine Lubochinsky,
professeur à l’Université Panthéon-Assas
(Procès-verbal de la séance du mercredi 10 novembre 2010)
(Présidence de M. Henri Emmanuelli, président de la commission d’enquête)
La séance est ouverte à dix-huit heures trente
M. le président Henri Emmanuelli. Madame, je vous remercie d’avoir répondu l’invitation de la Commission d’enquête. Vous êtes professeur à l’Université Paris II-Panthéon-Assas, où vous dirigez le master 2 « Finance ». Vous exercez par ailleurs des activités de consultante auprès d’établissements bancaires et financiers – notamment la Banque de France – et d’entreprises de marchés. Vous avez écrit de nombreux ouvrages et articles, notamment sur les hedge funds, sur la volatilité boursière et sur la gestion du risque.
Nous souhaitons savoir ce que vous pensez des mécanismes de spéculation et de leur rôle dans la crise financière. Certains d’entre eux vous paraissent-ils condamnables ? Faudrait-il prendre des mesures de régulation ?
(Mme Catherine Lubochinsky prête serment.)
Mme Catherine Lubochinsky. La spéculation est inséparable de l’effet de levier, que tout le monde utilise – à commencer par les ménages qui empruntent pour acquérir leur logement. Or, ce qui est déstabilisateur pour l’économie, ce n’est pas la spéculation, mais l’effet de levier. Les régulateurs devraient donc s’en préoccuper davantage.
La spéculation, quant à elle, est indispensable au marché. Sans elle, la liquidité des marchés serait insuffisante ; on ne pourrait pas réaliser d’opérations de couverture – qui sont la justification économique de l’existence des produits « dérivés ».
Par ailleurs, les spéculateurs achètent lorsque les prix sont sous évalués et vendent lorsqu’ils sont surévalués. On peut donc considérer qu’ils contribuent au bon fonctionnement du mécanisme de formation des prix – à la formation de prix « justes ». Cependant, les financiers et les économistes se plaisent à rappeler que, si les marchés sont efficients, il est, en moyenne, impossible d’y réaliser des profits. Peut-on estimer ces derniers ? M. Pérol a assuré que la Fédération bancaire française ignorait comment se répartissaient les profits bancaires entre ceux qui proviennent des activités classiques de distribution de crédit et ceux qui sont liés aux opérations de marché, et que, parmi ces dernières, aucune distinction ne pourrait être faite entre celles qui sont réalisées pour le compte de tiers et celles qui sont faites pour compte propre. De deux choses l’une : soit les banques ne collectent pas ces données, et c’est grave ; soit elles le font, mais elles ne les transmettent pas aux autorités compétentes – au premier rang desquelles l’Autorité de contrôle prudentiel. Et c’est un manque de transparence.
À titre personnel, j’aimerais bien connaître le montant des profits réalisés pour compte propre à moyen terme. On peut en effet se demander si les profits des activités de banque de financement et d’investissement – corporate investment bank ou CIB – ne résultent pas essentiellement des commissions prises sur les énormes volumes de transaction et des marges prélevées sur les produits dérivés complexes non standardisés, produits qui se caractérisent par leur opacité et sur lesquels les banques font des marges conséquentes. Cela expliquerait pourquoi les banques refusent d’échanger certains produits dérivés sur les marchés organisés ; le LIFFE (London International Financial Futures and options Exchange), le marché à terme britannique, a ainsi échoué à plusieurs reprises à introduire des swaps.
Ce ne sont ni les produits, ni les techniques qui posent problème, mais – je le répète – l’effet de levier, qui peut être utilisé avec des produits très simples. En 1929, les marchés de produits dérivés n’existaient pas ! On peut donc avoir des crises violentes sans cela, mais il est tellement plus simple de trouver un bouc émissaire…
Souvenez-vous de la faillite du fonds de pension des fonctionnaires du comté d’Orange, en 1994. À l’époque, son trésorier, Robert Citron, était persuadé que les taux d’intérêt allaient baisser. Il a donc mis ses obligations en pension auprès des banques afin de réaliser des plus-values sur les prix. Il prêtait les obligations contre des espèces, avec lesquelles il achetait de nouvelles obligations, qu’il mettait à leur tour en pension, et ainsi de suite. Une augmentation des taux, qui se traduit par une variation sept à huit fois supérieure des prix « grâce » à l’effet de levier, a mis le fonds en faillite. Il n’y a pas eu besoin de produits dérivés : tout s’est fait par des opérations de prise et de mise en pension, ce que font régulièrement toutes les banques centrales du monde.
Ne jetons donc pas la pierre aux produits dérivés. Je rappelle qu’il en existe de deux sortes : ceux qui sont échangés sur les marchés organisés et réglementés, dont les volumes et les prix sont connus, et ceux qui sont échangés sur les marchés de gré à gré, dont beaucoup sont standardisés – comme les swaps de taux d’intérêt –, mais pas tous. Il est difficile de connaître les volumes en jeu, mais les statistiques publiées par la Banque des règlements internationaux, la BRI, montrent qu’ils sont très importants.
Le problème de ces marchés réside dans leur opacité, en particulier pour les produits dits « exotiques ». Pour vous donner un exemple, une grande banque d’investissement propose un produit permettant de se couvrir contre le « biais de convexité » dû à l’inflation – en clair, la toute petite partie non linéaire, la dérivée seconde, dans l’évolution de la relation prix-rendement. C’est dire si l’imagination des financiers ne connaît pas de limite !
Pour remédier à cette opacité sur les dérivés de gré à gré, les régulateurs ont souhaité imposer le passage par une chambre de compensation centrale, afin de savoir qui a vendu et qui a acheté. Certains estiment que ce système est trop compliqué pour pouvoir s’appliquer aux produits dérivés non standardisés. Selon moi, la solution est simple : si les banques veulent vraiment continuer à vendre des produits exotiques, je préconise qu’on leur impose une couverture intégrale en fonds propres, afin de neutraliser le risque.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. Aujourd’hui, les établissements financiers sont-ils totalement libres de mettre sur le marché ce type de produits, ou doivent-ils en informer l’autorité de régulation ?
Mme Catherine Lubochinsky. S’ils veulent les proposer au grand public, ils doivent demander une autorisation à l’AMF, mais celle-ci n’est pas nécessaire dès lors qu’ils s’adressent aux investisseurs « avisés ».
Rien n’a été inventé en matière financière durant ces dernières années ! Dans la Rome antique, il existait déjà des contrats à terme sur l’huile ou sur les grains. À la Renaissance, alors que le prêt à intérêt était interdit par le droit canonique, les banques italiennes faisaient déjà des montages financiers en éditant des bons échangeables à Londres et en jouant sur le taux de change. Il existait même des produits structurés, grâce auxquels un investisseur pouvait acheter des actions, vendre le droit aux dividendes et s’assurer de la valeur des actions, ce qui correspond exactement, dans les stratégies actuelles en matière d’options, à l’achat d’un actif avec, simultanément, la vente d’un call at the money et l’achat d’un put at the money. Les instruments n’ont guère changé : en définitive, les credit default swap (CDS) ne sont qu’un outil classique d’assurance contre un défaut.
Ce qui a changé, en revanche, ce sont deux choses. D’abord la technologie. Les intervenants sur les marchés ont cru que les modèles mathématiques leur permettaient de calculer intégralement les risques et ont donc évacué le phénomène d’incertitude. Frank Knight avait pourtant mis en évidence, dans les années 1920, la différence entre le risque et l’incertitude : alors que le premier est calculable, la seconde ne l’est jamais. Quels que soient les mécanismes de régulation que l’on mettra en place, on ne pourra pas empêcher de nouvelles crises ; en revanche, il importe d’en limiter les conséquences.
Avec la hausse des marchés, les intervenants financiers ont pris excessivement confiance en eux et ont oublié les concepts de base – même des lauréats du prix Nobel comme Merton et Scholes, conseillers de Long Term Capital Management (LTCM), ont oublié le risque de liquidité… On pensait que les Collateralized debt obligations (CDO) étaient des produits miracles, qui permettaient d’obtenir un rendement plus élevé sans prendre un risque supplémentaire. Quelle erreur !
Le progrès technologique a en outre permis la spéculation à haute fréquence, qui ne serait pas critiquable en soi, si elle ne donnait la possibilité d’utiliser une information privilégiée ; pour caricaturer, lorsqu’on sait qu’une opération va avoir lieu sur un produit, on va passer juste avant un ordre à grande vitesse et écrêter le marché.
M. le rapporteur. Jean-Pierre Jouyet estime qu’il serait important que tous les régulateurs nationaux puissent contrôler les carnets d’ordres, car ils peuvent avoir une influence même s’ils ne se traduisent pas par une transaction.
Mme Catherine Lubochinsky. De fait, le progrès technique a favorisé l’émergence des plateformes électroniques de transaction, dont le fonctionnement est totalement opaque et qui font une concurrence déloyale aux marchés organisés, dans la mesure où elles ne traitent que les valeurs fréquemment échangées. Il ne reste aux marchés organisés que de petites valeurs, avec lesquelles ils ne peuvent guère faire de profits. Je suis d’accord avec M. Jouyet quand il critique la directive MiFID (Markets in Financial Instruments Directive).
L’autre changement, ce sont les « bulles médiatiques » : les médias financiers, d’une part, manipulent sciemment et, d’autre part, se font manipuler. Prenons l’exemple de la Grèce : il est vrai qu’elle rencontrait des problèmes structurels, mais le montant de sa dette n’était qu’une goutte d’eau par rapport aux ressources des fonds de pension. Il était aberrant de prétendre qu’elle ne pourrait pas se refinancer ! À aucun moment, les médias n’ont souligné que, 30 à 40 % de l’activité économique du pays n’étant pas comptabilisée, les chiffres relatifs au déficit budgétaire ou au niveau de la dette par rapport au PIB n’avaient aucun sens ! Or, les traders étant pour la plupart assez jeunes, ils ne possèdent aucune culture économique et cèdent à la panique dès que quelque chose les inquiète.
Autre exemple de manipulation, l’affaire LVMH. Si ce groupe avait utilisé des equity swaps pour attaquer Gucci, les médias français s’en seraient félicités ; à l’inverse, si un fonds chinois avait acheté Hermès, cela aurait tourné à la crise d’État ! Il faut pourtant savoir ce que l’on veut !
Se pose ici la question des conflits d’intérêts, qui existent à tous les étages et en permanence. Ainsi, tout le monde s’accorde à dire qu’il faut une coopération internationale efficace et une réglementation forte au niveau mondial, mais chacun s’évertue à ce que sa place financière soit la plus performante possible. La concurrence entre les places financières s’est traduite, durant les vingt dernières années, par une déréglementation compétitive ! De même, tout le monde appelle de ses vœux une chambre de compensation mondiale, mais chacun la veut chez lui !
Par ailleurs, il existe d’évidents conflits d’intérêts entre régulateurs et régulés : je vous renvoie sur ce sujet au film Inside Job.
Les régulateurs ont commis une erreur fondamentale, en croyant que le concept de discipline de marché avait un sens. On est revenu de l’autorégulation, dans un environnement où la maximisation du profit à court terme est la seule stratégie qui compte, aussi bien pour les entreprises que pour les banques. Les présidents de sociétés ont l’œil rivé sur le cours de leur action en bourse, et leur stratégie dépend de celui-ci. Quelle déperdition d’énergie !
En outre, la crise a mis en évidence l’insuffisante coopération entre régulateurs et leur manque de réactivité – il faut dire que, globalement, ils manquent de moyens, tant techniques qu’humains.
Il faudrait que les régulateurs évitent de commettre une autre erreur, qui serait de vouloir contrôler individuellement les produits et les techniques. Plus la régulation est complexe et précise, plus elle est aisée à contourner. Ainsi, la limitation des bonus liés aux performances a donné lieu à la création des primes de management. Les traders pour compte propre sont incités à fonder leur entreprise individuelle. De même, en réponse à Solvency II, qui augmente le coût de détention des actions, les banques vont proposer aux compagnies d’assurance des notes, c’est-à-dire des produits obligataires dont la performance sera indexée sur la performance boursière ! Quant à la réforme Dodd-Frank, elle n’empêchera pas le trading pour compte propre – qui a toujours existé –, car il sera toujours possible pour une banque de trouver un client, et nul ne pourra déceler quand un market maker quittera sa position neutre pour faire du trading pour compte propre. Cette réglementation donne l’impression d’un grand pas en avant, mais elle n’est, je le crains, qu’un écran de fumée.
Alors, existe-t-il des solutions ? Tout d’abord, il me semble indispensable de limiter l’effet de levier, tout en laissant les intervenants faire ce qu’ils veulent en dessous de ce plafond. Ensuite, pour limiter les distorsions de rémunération et les profits exorbitants, il serait bon de les taxer, plutôt que de tenter, en vain, de les interdire, en mettant en place une fiscalité très progressive au-delà d’un certain taux de rendement. En effet, l’interdiction des bonus pourra toujours être contournée par l’attribution de primes.
Une bonne mesure, c’est par exemple la décision que vient de prendre le comité de Bâle III de relever le core tier-one des banques et de n’autoriser que 15 % de titres « à gadget », sans chercher à les réglementer un à un. C’est seulement ainsi que l’on arrivera à réguler la finance.
M. le rapporteur. Pour maîtriser l’effet de levier, encore faudrait-il pouvoir contrôler tous les intervenants ; or certains échappent aux régulateurs !
S’agissant de la taxation des profits, vous avez raison de préférer un dispositif global à des mesures spécifiques. Toutefois, il ne faudrait pas se tirer une balle dans le pied en ne mettant pas en place un système véritablement international…
De même pour Bâle III : comment faire pour appliquer les nouvelles règles à l’échelle mondiale sans créer de distorsions de concurrence ? Que pensiez-vous de Bâle II ? Le nouveau dispositif vient-il compléter le précédent ou le transforme-t-il en profondeur ?
Mme Catherine Lubochinsky. Durant la crise financière, on s’est en effet aperçu que de nombreux établissements échappaient à toute régulation financière. Les autorités de régulation et les gouvernements tentent de remédier à ce problème. Il faut que tous ceux qui font des transactions financières, quels qu’ils soient – et ils sont de plus en plus nombreux –, soient soumis aux mêmes règles.
Pour maîtriser l’effet de levier, la principale difficulté est de s’accorder sur le niveau maximal autorisé. On peut tout simplement décider de réduire le niveau actuel, ou l’on peut prendre exemple sur ce qu’ont fait les Canadiens, qui y ont gagné de traverser la crise sans trop de déboires : ils ont fixé dans la réglementation un plafond au ratio entre actifs et fonds propres – au maximum égal à 20.
M. le président Henri Emmanuelli. C’est-à-dire qu’ils ont relevé le niveau de fonds propres exigé ?
Mme Catherine Lubochinsky. Non, ils exigeaient avant la crise des fonds propres plus élevés que ceux exigés par Bâle II, des fonds propres de meilleure qualité et un ratio entre actifs et fonds propres.
M. le président Henri Emmanuelli. Cela ne risquerait-il pas de réduire le crédit ?
Mme Catherine Lubochinsky. Les banques ont le choix : si elles réduisent le crédit, c’est uniquement parce qu’elles ne veulent pas renoncer aux opérations plus lucratives ! On peut y remédier en mettant en place une fiscalité progressive, qui inciterait les banques à remplir leur mission première, qui est de distribuer des crédits et de les conserver sans reporter le risque sur quelqu’un d’autre.
M. le rapporteur. Pensez-vous vraiment qu’une telle mesure permettrait de réinjecter dans l’économie réelle les liquidités dont disposent les banques – ce qui est l’objectif de notre commission ?
Mme Catherine Lubochinsky. Pourquoi existe-t-il sur les crédits immobiliers aux ménages une telle concurrence entre les banques, qui les conduit à réduire autant leur marge ? Elles doivent bien y trouver un intérêt !
M. le président Henri Emmanuelli. Probablement parce que le client reste captif jusqu’au remboursement du crédit, soit pendant au moins vingt ans, et que les banques bénéficient de la garantie hypothécaire.
Mme Catherine Lubochinsky. C’est en effet l’avantage des revenus récurrents. Et il serait bon que les banques développent davantage ce genre de produits, qui ont un effet stabilisateur.
Je ne crois pas que si l’on change la réglementation, les banques ne distribueront plus de crédit aux petites entreprises et aux ménages, le problème étant différent pour les grandes entreprises, pour lesquelles elles sont en concurrence avec le marché. Mais je me trompe peut-être...
Quant à Bâle II, que dire ? Cela avait toujours le mérite d’être mieux que Bâle I !
M. Jean-Pierre Gorges. On en revient toujours au même point ! À chaque audition, on nous dit que Bâle I n’était pas bon, Bâle II non plus et que tel ou tel s’est trompé. Et si l’on changeait de point de vue et que l’on partait du postulat que l’on a besoin de la spéculation et que le marché finit toujours par s’équilibrer ?
J’ai passé vingt-cinq années dans le milieu bancaire. Les banquiers gagnent beaucoup d’argent, mais sur les produits annexes, et très peu sur les masses monétaires elles-mêmes. À chaque fois qu’il y a eu un problème, c’est parce qu’on avait introduit un mécanisme de régulation ! Je me demande si, en réalité, ce n’est pas ce qui perturbe le système.
Prenons l’exemple grec : on aurait pu laisser les choses suivre leur cours. On nous a soutenu que cela aurait mis l’euro en danger, mais tout le monde sait que c’est faux. Voilà un pays où la moitié de l’activité économique échappe au système financier organisé ! Si on l’avait « laissé tomber », le mécanisme d’autorégulation du marché nous aurait permis de connaître son PIB réel. En définitive, en venant à son secours, on n’a fait qu’entretenir le problème.
Plus mon analyse s’affine, plus je mets en cause cette pseudo-régulation qui, au final, ne parvient pas à éviter les crises. Comme vous l’avez fait remarquer, les mêmes mécanismes sont à l’œuvre depuis des siècles, et cela s’est toujours régularisé !
Mme Catherine Lubochinsky. On a quand même changé d’échelle !
M. Jean-Pierre Gorges. Il faudrait donc que les banques conservent leurs profits quand tout va bien, mais que si elles commettent une erreur, l’État vienne à leur secours, quand bien même il supporterait une dette de 1 500 milliards d’euros et un déficit structurel de 100 milliards ? Je trouve cela parfaitement immoral ! Laissons faire ; si une banque se trompe, qu’elle tombe !
Mme Catherine Lubochinsky. Comme Lehman Brothers ?
M. Jean-Pierre Gorges. Oui.
Mme Catherine Lubochinsky. Cela ne vous poserait aucun problème ?
M. Jean-Pierre Gorges. Non : cela finirait par se réguler !
Mme Catherine Lubochinsky. Et les conséquences macroéconomiques et sociales ?
M. le président Henri Emmanuelli. Madame Lubochinsky, notre collègue n’exprime qu’un point de vue, qui n’engage pas la commission !
M. Jean-Pierre Gorges. En effet : je pars d’un autre postulat. On envisage toujours les scénarios possibles en se plaçant du point de vue de la régulation, mais jamais de celui de la non-intervention. Vous avez dit que les fonctions n’étaient pas continues et qu’il existait une zone d’incertitude : cela n’est jamais pris en compte dans les études.
Mme Catherine Lubochinsky. Mais, par essence, l’incertitude n’est ni modélisable ni probabilisable : cela correspond aux chocs exogènes !
M. Jean-Pierre Gorges. En effet, la fonction n’est pas continue. N’importe quel événement peut modifier la donne. Par exemple, sur le marché du pétrole, quelqu’un va s’énerver et le baril de Brent va passer à 150 dollars.
M. le président Henri Emmanuelli. Mon cher collègue, votre question ressemble fort à une théorie ! Je sais bien que certaines personnes soutiennent que la crise financière est due à la régulation, mais elles sont très minoritaires.
M. Jean-Pierre Gorges. Eh bien, j’en fais partie, monsieur le président !
M. le président Henri Emmanuelli. C’est la position du Tea Party !
M. Jean-Pierre Gorges. À chaque fois, on fait la démonstration que la régulation était mauvaise !
Mme Catherine Lubochinsky. Le problème, c’est d’adapter la régulation à un système en mutation permanente.
M. Jean-Pierre Gorges. Mais la régulation court derrière la technologie et sera toujours à la traîne ! Aujourd’hui, les transactions sont réalisées en quelques nanosecondes, par ordinateur.
Mme Catherine Lubochinsky. Sachons raison garder : il ne s’agit que d’une forme de trading bien particulière !
M. Jean-Pierre Gorges. Pour combien de temps ?
M. le président Henri Emmanuelli. Pour l’heure, cela ne concerne que quelques opérateurs dont tout le monde se demande à quoi ils servent !
Mme Catherine Lubochinsky. Vous dites qu’en Grèce rien n’a changé, mais la comptabilité s’est quand même améliorée…
M. Jean-Pierre Gorges. Vous savez bien que le problème est culturel ! Au lieu de chercher sans cesse le bon système, il vaudrait mieux se demander si la régulation n’a pas des effets néfastes.
Mme Catherine Lubochinsky. Les lobbies les mettent toujours en avant, mais ils ne parlent jamais des effets bénéfiques ! Personne n’aime être régulé : vous-même, j’en suis sûre, vous préféreriez rouler à plus de 130 heures kilomètres à l’heure !
M. Jean-Pierre Gorges. Comparaison ne vaut pas raison…
Mme Catherine Lubochinsky. Bâle II a consacré le rôle des agences de notation, en autorisant la prise en compte de leurs notes dans le calcul des risques. Aujourd’hui, tout le monde montre du doigt les agences, mais on oublie que les régulateurs les ont approuvées !
Par ailleurs, le risque de liquidité a été complètement évacué. Ce risque est connu depuis longtemps, mais avec l’essor des marchés il est passé au second plan, parce que l’on pensait que les volumes de transactions étaient tellement importants qu’il n’y aurait plus de problèmes de liquidité, d’autant que les crédits peuvent être titrisés et vendus. C’était une erreur. Le comité de Bâle s’est saisi du problème, et Bâle III va introduire un ratio de liquidité.
Je suis partisane d’une régulation globale. Il serait inefficace de vouloir réguler produit par produit. On a besoin d’instruments financiers ; ce qui fait problème, c’est que les produits au comptant et les produits dérivés représentent respectivement quatre et dix fois le PIB mondial. Cela étant, nul ne connaît le rapport idéal.
M. Jean-Pierre Gorges. On ne le connaîtra jamais !
Mme Catherine Lubochinsky. Certes, mais on peut essayer de réduire l’écart.
M. le président Henri Emmanuelli. Monsieur Gorges, les régulations ne sont pas apparues spontanément : à chaque fois, elles ont fait suite à une catastrophe financière.
Mme Catherine Lubochinsky. En effet : les régulateurs ont été introduits après la crise de 1929 et les coupe-circuit après le krach de 1987.
M. Jean-Pierre Gorges. Pourtant, on ne pourra jamais anticiper les prochaines fraudes. Les mécanismes de régulation ne se fondent que sur ce qui est connu. C’est pourquoi ils ne pourront jamais empêcher une nouvelle catastrophe.
Mme Catherine Lubochinsky. Mais ils n’en ont pas la prétention ! La régulation a pour but de faire en sorte que les conséquences d’une crise ne soient pas catastrophiques.
M. le président Henri Emmanuelli. Ou que cette crise ne se reproduise.
M. Jean-Pierre Gorges. Une crise ne se reproduit jamais à l’identique !
M. le président Henri Emmanuelli. Durant la dernière crise, contrairement à celle de 1929, on n’a pas vu des banquiers sauter par la fenêtre !
Mme Catherine Lubochinsky. Ni des millions de personnes ruinées !
M. le président Henri Emmanuelli. Sans parler des conséquences politiques !
M. Jean-Pierre Gorges. Il ne s’agissait pas de la même crise.
M. le président Henri Emmanuelli. Précisément : on a sauvé les banques.
M. Jean-Pierre Gorges. La comparaison n’est pas bonne.
Mme Catherine Lubochinsky. Je ne saurais trop vous conseiller la lecture de La Bourse de Max Weber, ouvrage publié pour la première fois en 1894, qui vient d’être réédité. Je vous en lis la conclusion : « Tant que les nations poursuivront la lutte économique inexorable et inéluctable pour leur existence nationale et la puissance économique, même s’il se peut qu’elles vivent en paix sur le terrain militaire, la réalisation d’exigences purement théorético-morales restera étroitement limitée dès lors qu’on se rend compte que sur le terrain économique également il est impossible de procéder à un désarmement unilatéral. Une Bourse forte ne peut pas être un club de culture éthique et les capitaux des grandes banques ne sont pas plus des institutions de bienfaisance que ne le sont les fusils et les canons. Pour une politique économique nationale qui poursuit des buts bien de ce monde, ils ne peuvent être qu’une seule chose : des moyens de puissance engagés dans ce combat économique. Elle ne pourra que se féliciter de voir ses institutions faire droit aussi à l’exigence éthique, mais elle a le devoir de veiller avant tout à ce que des fanatiques défendant leurs intérêts ou à ce que des apôtres ingénus de la paix économique n’aillent pas désarmer leur propre nation. »
M. le rapporteur. Une dernière question : me trompé-je si je dis que le marché des changes n’est pas régulé ?
Mme Catherine Lubochinsky. Qu’appelez-vous « réguler » ?
M. le rapporteur. Mettre en place une réglementation et vérifier qu’elle est appliquée.
Mme Catherine Lubochinsky. Parmi les 4,5 trillions de dollars cités comme volume de transactions quotidiennes sur le marché des changes, les opérations au comptant, qui sont des échanges spot, ne peuvent pas être régulées sauf à instaurer une réglementation des changes, comme avant les années 90 : on vérifie simplement que les devises sont bien livrées.
M. le président Henri Emmanuelli. Il existe pourtant de la spéculation sur les monnaies !
Mme Catherine Lubochinsky. Oui, mais elle joue essentiellement sur l’effet de levier, avec des opérations à terme.
M. le président Henri Emmanuelli. Un banquier nous a dit que l’effet de levier pouvait atteindre 50 sur le marché des changes : avec 2, on peut négocier 100.
Mme Catherine Lubochinsky. Et parfois plus, comme c’était le cas des hedge funds à l’origine : avec 1 million au départ, on levait 9 millions auprès de connaissances, puis on empruntait 90 millions à la banque et l’on utilisait l’effet de levier pour jouer sur 1 000 millions. C’est pourquoi il est si important de contrôler celui-ci.
M. le président Henri Emmanuelli. Madame, nous vous remercions.
La séance est levée à dix neuf heures trente.
*
* *
Audition de Mme Danièle Nouy,
secrétaire générale de l'Autorité de contrôle prudentiel
(Procès-verbal de la séance du mercredi 17 novembre 2010)
(Présidence de M. Henri Emmanuelli, président de la commission d’enquête)
La séance est ouverte à seize heures trente
M. le président Henri Emmanuelli. Je vous remercie, madame Danièle Nouy, d’avoir accepté l’invitation de notre commission d’enquête. Vous avez exercé des fonctions importantes au sein de la Commission bancaire avant d’en devenir, en 2003, la secrétaire générale, poste que vous occupez maintenant au sein de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP), issue de la fusion, au début de cette année, des autorités de contrôle des banques et des assurances. En 2006, vous avez présidé le Comité européen des superviseurs bancaires. Parallèlement, vous avez eu des responsabilités importantes dans le cadre du Comité de Bâle. Vous êtes donc pour nous un témoin particulièrement précieux.
Notre commission d’enquête cherche à déterminer la part de la spéculation dans le déclenchement et l’aggravation de la crise, notamment dans ses récents développements sur le marché de la dette souveraine des pays européens. La Fédération bancaire française a expliqué que la spéculation n’y était pour rien, mais nous ne sommes pas enclins à la croire, d’autant que, la veille du jour où la Commission européenne a infligé une énorme amende à ses membres, son président nous assurait que tout allait bien. Savez-vous qui se livre aux attaques spéculatives ? À partir de quelles zones ou marchés ? Et avec quelles méthodes ? Quel rôle attribuez-vous aux Credit Défault Swaps (CDS), comme instruments de couverture ou à nu ? Que pensez-vous de Bâle III et de Solvabilité II ?
Êtes-vous en mesure, en ce qui vous concerne, d’évaluer la part des opérations pour compte propre dans le résultat des banques ? Plusieurs dirigeants nous ont répondu que c’était impossible, mais des documents nous incitent à penser qu’ils ne disent pas toute la vérité. Quelle appréciation portez-vous sur le high frequency trading (HFT) ? Avez-vous les moyens de le contrôler ? Une mathématicienne de renom nous a fait part de son scepticisme à cet égard. Sachez d’ailleurs que, en tant que régulateur, l’ACP a été mise en cause par plusieurs des personnes auditionnées, qui se demandent comment les autorités de contrôle n’ont rien vu venir dans l’affaire Kerviel. Comment une position ouverte de 50 milliards d’euros peut-elle passer inaperçue ? Comment expliquer que le contrôle interne n’ait rien décelé ? Pourquoi le superviseur ne s’est-il pas rendu compte que les mécanismes de contrôle étaient défaillants ?
(Mme Danièle Nouy prête serment.)
Mme Danièle Nouy, secrétaire générale de l’Autorité de contrôle prudentiel. En introduction, je tiens à saluer votre décision d’enquêter sur ce thème riche et complexe. Les conséquences des comportements spéculatifs peuvent être particulièrement néfastes au fonctionnement des marchés et aux économies. Il importe donc de les identifier, de les prévenir et, le cas échéant, de les sanctionner.
Une première difficulté réside dans l’absence de définition réglementaire de la spéculation. S’agissant du concept lui-même, je souscris à l’analyse qu’en a faite le président de l’Autorité des marchés financiers, Jean-Pierre Jouyet : « Sans spéculateurs, il n’y aurait pas de marché, (…) la spéculation est consubstantielle aux marchés ». De même, M. Michel Aglietta a souligné qu’« en temps normal, la spéculation joue un rôle équilibrant puisque des acteurs financiers mieux informés que d’autres, découvrant que les prix de certains produits ne correspondent pas à leur valeur réelle, jouent le retour des prix à cette valeur ». D’ailleurs, lorsque les prix de marché sont déconnectés des fondamentaux économiques, en période d’exubérance irrationnelle des marchés, d’apparition de bulles ou de baisse vertigineuse des prix, on souhaiterait que des acteurs interviennent à rebours des autres, pour les ramener à la raison. Or ces acteurs, ce sont précisément des spéculateurs. Vous avez vous-même insisté, monsieur le président, sur le caractère ambigu de la spéculation et sur son rôle, tantôt néfaste, tantôt positif, vous demandant comment repérer ses excès et endiguer ses effets néfastes.
Les agissements frauduleux sont les premiers comportements à combattre, et ils sont passibles de poursuites et de sanctions. En ce qui concerne l’intégrité des marchés réglementés, la prévention et la sanction de telles pratiques relèvent de la responsabilité des autorités de contrôle des marchés, l’AMF en France. L’Autorité de contrôle prudentiel apporte son soutien, notamment en menant des enquêtes sur place, en veillant en permanence à la robustesse des dispositifs de contrôle de conformité et de contrôle interne. Les exigences réglementaires en la matière ont encore été durcies depuis la crise.
Une deuxième catégorie de comportements consiste à mener des opérations qui, bien que conformes à la réglementation, peuvent avoir des effets déstabilisants sur le système financier, parce qu’elles sont réalisées soit par des acteurs de très grande taille, soit simultanément par un grand nombre d’acteurs qui agissent tous dans le même sens, de façon moutonnière. La spéculation n’étant pas définie au plan réglementaire, il est difficile de discerner, parmi les opérations de marché, celles qui relèvent d’une logique spéculative et/ou celles qui ont des effets néfastes.
M. le président Henri Emmanuelli. Vos agents eux-mêmes ne font-ils pas la différence ? Les CDS à nu n’attirent-ils pas votre attention ?
Mme Danièle Nouy. Si, mais il est très difficile de distinguer, parmi les opérations de trading, celles qui sont faites pour le compte de la clientèle et celles qui sont faites pour compte propre. Il suffit qu’une banque tarde à couvrir une opération pour le compte de sa clientèle pour que le doute soit possible.
M. le président Henri Emmanuelli. Vous qui exercez un contrôle à la fois sur pièces et sur place, vous pouvez parfaitement le savoir.
Mme Danièle Nouy. Nous pouvons interroger les établissements, mais je ne peux pas vous fournir un tableau de chiffres qui ferait clairement la part entre les deux.
Les risques doivent être mesurés et surveillés en permanence. Ils ne doivent pas être disproportionnés par rapport à la surface financière des établissements. À la suite de la crise, plusieurs mesures ont été prises pour améliorer la quantité et la qualité des fonds propres, la couverture en fonds propres des opérations de marché – la France en avait dénoncé à plusieurs reprises l’insuffisance dans les instances internationales –, le contrôle interne, l’encadrement des rémunérations. Ces mesures vont entrer en vigueur progressivement, selon un calendrier international précis. Par ailleurs, d’autres mesures, comme le renforcement de la surveillance des institutions dites systémiques ou la mise en place de « coussins » contracycliques, parachèveront l’édifice de Bâle III, destiné à renforcer la sécurité des systèmes bancaire et financier.
S’agissant de la dette souveraine grecque, l’ACP a collecté sur plusieurs semaines des informations précises sur l’exposition des établissements français par le biais de dérivés de crédit. L’analyse des renseignements obtenus révèle, d’une part, que les positions prises par les banques françaises dans le cadre de leurs opérations pour compte propre étaient très mesurées, d’autre part que les grandes banques françaises ne semblent pas avoir déployé d’activité de spéculation sur la dette souveraine grecque. C’est d’ailleurs ce que M. Jouyet a dit devant votre commission.
M. le président Henri Emmanuelli. Il n’a pas encore tiré de conclusion définitive.
Mme Danièle Nouy. Les banques opèrent sur le marché des CDS dans trois cas : en tant qu’intermédiaires pour le compte de la clientèle, à des fins de couverture d’une position prise pour compte propre sur une contrepartie – elles achètent une protection sous la forme d’un CDS référencé sur cette contrepartie –, et pour prendre une position pour compte propre – achat ou vente d’une protection sous la forme d’un CDS. C’est cette dernière activité qui a pu être qualifiée de spéculative, dans la mesure où elle repose sur une anticipation de la dégradation ou de l’amélioration de la qualité de crédit d’un émetteur. Lors de la crise grecque, en février-mars puis en avril-mai 2010, les grandes banques françaises avaient globalement une position nette longue, c'est-à-dire vendeuse de protection et acheteuse de risque, pour un montant oscillant dans une fourchette de quelques dizaines à quelques centaines de millions d’euros, ce qui est très peu au regard des montants échangés pendant les périodes considérées. Elles n’ont pas spéculé sur la dette grecque avec des CDS. Elles étaient même exposées à une dégradation de la qualité de la signature de l’État grec. Aucune de ces banques n’avait de position significative courte acheteuse de protection, pariant sur une baisse des titres souverains grecs.
Le fait que l’autorité de contrôle bancaire ait de longue date surveillé étroitement l’activité des banques françaises sur les dérivés de crédit n’est sans doute pas étranger à cette situation. Très tôt, un traitement prudentiel rigoureux de ces instruments a vu le jour, pour tenir compte du risque de défaut de l’émetteur du sous-jacent et de l’adéquation au risque couvert, s’il s’agit d’une opération de couverture ; en même temps que des risques de marché et des risques de contrepartie sur le vendeur de protection, c'est-à-dire du risque que la contrepartie d’une opération soit défaillante avant le règlement définitif de l’ensemble des flux de trésorerie. Ce mécanisme existait déjà en partie dans Bâle II et il sera sensiblement durci dans Bâle III.
Par ailleurs, l’ACP soutient entièrement les initiatives internationales visant à sécuriser le marché des dérivés de crédit et des dérivés de gré à gré en général, au travers notamment d’une négociation sur des marchés organisés, d’une compensation dans des contreparties centrales, ce qui est prévu d’ici à fin 2012 au plus tard. Pour nous, il est important que les contreparties centrales traitant des contrats de CDS libellés en euros soient établies dans la zone euro.
M. le président Henri Emmanuelli. Tout cela nous a déjà été exposé. Nous voudrions connaître votre point de vue de praticienne. Et, à ce propos, en écoutant M. Jouyet, nous avons eu l’impression que l’autorité de contrôle contrôlait de moins en moins et qu’elle était littéralement dépassée.
Mme Danièle Nouy. Je ne crois pas que ce soit le cas.
M. le président Henri Emmanuelli. Vous considérez que vous maîtrisez bien les choses ?
Mme Danièle Nouy. Sans nier les conséquences d’une crise financière aussi grave, je tiens à souligner que les banques françaises ont été moins touchées que les autres. Ce n’est peut-être pas totalement le fruit du hasard. Nous avons été des contrôleurs rigoureux là où parfois nos collègues l’étaient moins, ne serait-ce que parce que l’étendue du contrôle n’est pas la même partout. En France, la définition des opérations de banque est extrêmement large. Aux États-Unis, des organismes peuvent distribuer des prêts immobiliers sans être considérés comme des établissements de crédit.
Nous sommes en parfait accord avec les demandes de M. Jean-Pierre Jouyet à propos des opérations de marché : CDS, ventes à découvert, surtout à nu. Cela étant, le directeur général de l’Agence France Trésor a souligné devant vous qu’il arrivait que des établissements spécialistes en valeurs du Trésor vendent des titres qu’ils n’avaient pas encore. Même s’ils ont d’excellentes raisons de le faire, ce sont des ventes à nu, que nous ne pouvons pas distinguer d’autres opérations de ce type qui seraient moins légitimes. Nous sommes aussi d’accord avec M. Jouyet sur les hedge funds, les opérations de marché, le trading à haute fréquence,…
M. le président Henri Emmanuelli. Vous arrivez à contrôler ce dernier ?
Mme Danièle Nouy. Nous sommes en charge non pas du contrôle des marchés, mais de celui des établissements. À ce titre, nous vérifions que les risques sont convenablement mesurés et gérés, et que les fonds propres sont suffisants. À chacun son métier : M. Jouyet est en charge du contrôle des marchés, à charge pour nous de collaborer avec lui dans le domaine qui est le nôtre.
Pour ce qui est du HFT, nous pouvons interroger les banques. Elles nous répondront.
M. le président Henri Emmanuelli. Il aura tout de même fallu un an pour savoir ce qui s’était passé le 6 mai à la bourse de New York. Par ailleurs, la mathématicienne qui a appliqué les algorithmes à la finance s’est demandée devant nous comment vous pouviez contrôler. Avez-vous le matériel nécessaire ? Et des personnels à même de comprendre ce qui se passe ?
Mme Danièle Nouy. Je ne vous dis pas que l’autorité de contrôle peut contrôler l’utilisation de formules et le résultat desdites formules dans une opération de marché, mais si j’interroge un établissement, il me fournira une réponse.
M. le président Henri Emmanuelli. Avez-vous constaté une forte augmentation de ce type d’opérations ?
Mme Danièle Nouy. Tous les établissements de la taille de nos grandes banques sont présents sur ces marchés.
M. le président Henri Emmanuelli. Ce n’est pas ce que ces banques nous ont dit ici.
Mme Danièle Nouy. Sans doute considèrent-elles que cette activité n’est pas significative dans leur bilan, mais leurs départements des transactions font des opérations dites de type quantitatif dont le développement est préoccupant, en effet. Et l’AMF milite pour limiter ces pratiques qui sont de son ressort. L’ACP, quant à elle, ne peut pas interdire du jour au lendemain le trading algorithmique.
M. le président Henri Emmanuelli. Vous pouvez tout de même mettre en garde les établissements contre les dangers qu’ils encourent.
Mme Danièle Nouy. Ce que nous pouvons faire, c’est, premièrement, regarder ce que font les établissements ; deuxièmement, vérifier comment ils gèrent leur risque ; troisièmement, évaluer la qualité du contrôle interne et les moyens qui lui sont alloués ; quatrièmement, demander le cas échéant une couche de fonds propres supplémentaire.
M. le président Henri Emmanuelli. D’après vous, les opérations du type HFT sont-elles parfaitement contrôlées par le management des banques ?
Mme Danièle Nouy. Ces opérations sont par nature très difficilement contrôlables. On peut se poser la question de savoir si elles devraient être autorisées. Mais je n’ai pas le pouvoir de les interdire.
M. Paul Giacobbi. La qualité du contrôle des établissements de crédit en France est probablement remarquable, au moins par comparaison. Dans le Financial Times de ce matin, Lord Turner, qui n’a rien d’un gauchiste puisqu’il a occupé outre-Manche les fonctions qu’occupe en France Mme Parisot, attirait l’attention sur le fait que les autorités de contrôle des pays européens se focalisaient sur les banques, alors que le plus grave s’est passé ailleurs – dans des établissements qui ne sont pas des banques au sens où nous l’entendons, nous. La batterie de ratios réglementaires est de plus en plus raffinée – le ratio Cooke en est à sa troisième ou quatrième version – mais elle ne s’appliquera que dans un nombre limité de pays situés de ce côté-ci de l’Atlantique, et à un nombre limité d’établissements. Résultat : un renchérissement du crédit en Europe tandis qu’ailleurs, tout va continuer comme si de rien n’était. Avant la crise, les activités à risque n’étaient pas le fait des banques et quand elles l’étaient, elles restaient en dehors du champ de la réglementation. Tout se passe comme si on s’acharnait fanatiquement à contrôler les grandes marques en laissant la contrefaçon se développer librement.
Le professeur Henri Bourguinat, qui mérite mon respect pour avoir anticipé la crise dès les années quatre-vingt, a mis en avant l’insuffisance de la loi Dodd-Frank car, même si elle a été inspirée par Paul Volcker dans le souci d’empêcher les banques de jouer au casino avec l’argent de leurs clients, elle se contente d’interdire aux banques les opérations pour compte propre. Et sera-t-elle seulement appliquée ?
Mme Danièle Nouy. Si nous ne sommes pas partisans en France de l’amendement Volcker, c’est précisément parce qu’il va pousser en dehors du champ du contrôle des opérations susceptibles de mettre le système financier en grave danger. Je vous renvoie au cas du hedge fund LTCM. Il ne suffit pas, pour empêcher les banques de jouer au casino, de leur interdire les opérations pour compte propre, d’autant qu’on ne sait pas du tout comment la loi sera appliquée. Des journaux sérieux rapportent que les opérateurs des salles de marché pour compte propre des grandes banques ont été versés dans les effectifs des sections qui s’occupent des opérations pour le compte de la clientèle. Le volume des opérations ne diminue pas. Or il est peu vraisemblable que l’appétit des clients se soit aiguisé au point de multiplier les volumes par deux ou trois… La France juge donc préférable de conserver ces opérations dans la sphère réglementée plutôt que de se voiler la face.
Quant aux ratios, le dispositif Bâle II se préoccupait surtout du dénominateur en procédant à une pondération des risques. En revanche, rien n’était prévu pour garantir la qualité des fonds propres figurant au numérateur. Bâle III remédie à cette insuffisance, contre laquelle la France s’est battue pendant des années. Lorsque j’étais en charge du comité des superviseurs bancaires européens, j’ai travaillé à obtenir une définition extrêmement rigoureuse des fonds propres de sorte qu’ils puissent réellement absorber les pertes en cas de défaillance. Or, à part aux États-Unis, pour les banques petites et moyennes les instruments hybrides se sont tous révélés incapables d’absorber les pertes avant que les États n’entrent au capital pour les sauver. Les États-Unis suivront-ils ? Probablement s’agissant de la qualité des fonds propres car ils font partie des pays les plus exigeants en la matière.
M. Paul Giacobbi. Prenons une analogie. Les maisons de jeu sont chez nous soumises à une législation sévère, mais, si celle-ci l’est trop, les joueurs invétérés joueront sur le trottoir. Et c’est ce qui est en train de se passer dans le domaine qui nous intéresse. À force d’imposer des ratios de plus en plus perfectionnés, on incite les banques à transférer leurs portefeuilles dans des véhicules d’investissement. Les ratios, même quand ils auraient dû s’appliquer, n’ont pas empêché les opérations de titrisation gigognes qui ont fait disparaître toute traçabilité des risques, ni la substitution aux fonds propres d’assurances contractées auprès d’AIG, qui a d’ailleurs fait faillite depuis. En somme, plus on réglemente, plus on découple le secteur bancaire du reste du système financier où chacun peut faire ce qu’il veut. Ces comportements sont décrits dans un ouvrage extrêmement instructif de Mme Gillian Tett, docteur en anthropologie et chroniqueuse au Financial Times, Fool’s Gold. Elle y explique comment certains produits dérivés et certains produits de titrisation, inventés chez JP Morgan, ont ensuite été pervertis pour contourner le ratio Cooke, si bien que la réglementation a eu l’effet inverse à celui qu’on espérait.
M. le président Henri Emmanuelli. Que la règle donne lieu à contournement n’implique pas qu’il ne faille pas réglementer.
Mme Danièle Nouy. La crise trouve en partie son origine dans la commercialisation par des courtiers de crédits immobiliers financés par des non-banques. Il ne s’agit même pas d’un contournement de la règle, mais plutôt d’un trou dans la raquette réglementaire. Or, depuis la crise, la raquette n’a pas été réparée. L’Europe n’a même pas une définition unique de l’opération de banque. Pourtant, dans de nombreux domaines, la réglementation est harmonisée.
En France, la titrisation des crédits par les banques représente entre 0,3 % et 2,7 %. C’est sans rapport avec ce qui s’est fait ailleurs. Le Trésor français a réussi au cours des négociations du dernier G20 à faire inscrire la réflexion sur le shadow banking, c'est-à-dire le hors-bilan et le « hors-hors-bilan », au nombre des chantiers à ouvrir, en vue d’intégrer ces opérations dans l’univers réglementé. Le problème est bien réel, mais, en ce domaine, la France est exemplaire.
M. Paul Giacobbi. Tout concourt à montrer que les banques françaises ont été, à une exception près, plutôt prudentes et bien contrôlées. Les autres banques européennes ont fait une consommation ahurissante des facilités de la Banque centrale européenne. L’Irlande doit en être à 129 milliards d’euros, l’Italie à une dizaine de milliards d’euros mais notre système, hormis le cas particulier de la Société Générale, a fait la preuve de sa robustesse. Toutefois, réglementer dans un seul groupe de pays, voire dans un seul pays, ne sert pas à grand-chose. Il vaut mieux une réglementation moins sophistiquée mais qui ratisse large. Sinon on encouragera les opérateurs à déserter les banques pour les établissements dérégulés, ou même les banques à s’installer dans des pays plus accommodants.
M. Jean-Pierre Gorges. Je suis tout à fait d’accord avec mon collègue. L’argent, comme l’eau, s’infiltre partout. Mieux vaut aménager un canal que lui opposer un mur qu’il contournera. Il ne suffit pas de réglementer, il faut aussi considérer les effets néfastes de la régulation. Si on se contente de poser quelques verrous ici ou là, ce que l’on cherche à contenir se déplacera, surtout avec la mondialisation. À cause de la hausse des prix du tabac, la part du marché parallèle est passée de 3 ou 4 % à 20 % sans que la consommation baisse. Voilà un exemple qui illustre les effets pervers de la régulation. Il serait regrettable que la commission d’enquête passe à côté du problème.
M. le président Henri Emmanuelli. Personne ne conteste qu’il faille une réglementation globale.
M. Jean-Pierre Gorges. Mais elle ne l’est pas. C’est tout le problème.
M. le président Henri Emmanuelli. Nous avons eu la même discussion à propos des paradis fiscaux. Tant que plus de la moitié des transactions financières empruntera le circuit des dark pools et que l’argent liquide transitera par les paradis fiscaux, dans lesquels les services de gestion de patrimoine des grandes banques sont solidement implantés – n’en déplaise à leurs dirigeants, qu’on peut renvoyer sur ce point à la lecture du dernier numéro du Canard enchaîné –, le contrôle ne sera pas très efficace. Mais, pour des raisons plus ou moins avouables, il n’y a pas de réelle volonté politique.
Sur une période de dix ou quinze ans, les opérations pour compte propre se sont accrues. La comptabilité analytique, quoi qu’en disent les banquiers, permet-elle d’isoler ces opérations de celles qui sont réalisées pour le compte de la clientèle ?
Mme Danièle Nouy. Je pense que la réponse est non. Il y a des cas simples, mais ce n’est pas toujours le cas. Il suffit de tarder, délibérément ou non, à couvrir une position prise en contrepartie d’une opération réalisée pour le compte d’un client, et elle deviendra alors une opération pour compte propre. Mais elle sera comptabilisée comme opération pour le compte de la clientèle, de qui provient la demande, d’autant que les deux types d’opération sont en général confiés à des unités distinctes.
M. le président Henri Emmanuelli. On pourrait peut-être améliorer la comptabilisation.
Mme Danièle Nouy. Sans doute, mais rien ne nous permet de l’exiger à l’heure actuelle, ni de dire que le suivi sera facile. En outre, on nous demandera ce qu’il faut entendre par « délai excessif ». Tout dépend des opérations, de la liquidité du marché, du montant…
M. le président Henri Emmanuelli. Et dans le compte de résultat ?
Mme Danièle Nouy. Le produit net bancaire se répartit entre 60 % à 65 % en provenance des opérations de la clientèle, 20 % à 25 % au titre des opérations de marché, et le reste, 10 % à 15 % est dû à la gestion d’actifs. Dans les opérations de marché, j’évalue à 10 % environ les opérations pour compte propre, mais il s’agit d’une appréciation personnelle. Aucune obligation réglementaire ne me permet de pousser l’analyse plus avant.
M. le président Henri Emmanuelli. Et comment différencier les opérations de marché de la gestion d’actifs ?
Mme Danièle Nouy. En général, les unités sont distinctes et chacune recense ses propres opérations.
M. le président Henri Emmanuelli. Venons-en à la Société Générale. Pour passer à côté d’une position ouverte de 50 milliards, le système de contrôle interne devait tout de même être défaillant. Un contrôle qui ne porte que sur les montants nets est-il fiable ?
Mme Danièle Nouy. Non, bien sûr. Si la banque avait surveillé les montants bruts, elle aurait pris la mesure des positions engagées. Mais seuls les soldes étaient examinés et les appels de marge sur les positions étaient noyés avec d’autres provenant d’autres opérations – la Générale est un très gros établissement. De plus, les manœuvres frauduleuses d’un opérateur formé au back-office, et sachant comment détourner l’attention des contrôleurs, ont dissimulé l’étendue des risques. Depuis, le contrôle du risque opérationnel a été considérablement renforcé.
M. le président Henri Emmanuelli. Avez-vous un pouvoir réglementaire en la matière ?
Mme Danièle Nouy. Il est dans les mains du directeur du Trésor, par délégation du ministre de l’économie, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. L’ACP peut prendre des mesures concernant des établissements individuels, mais, pour une mesure générale, il vaut mieux un règlement. Celui qui concerne le risque opérationnel, le règlement n° 97-02, a été considérablement durci et a demandé aux établissements des mises à niveau très lourdes, notamment des systèmes d’information, qui ont pris entre douze et dix-huit mois.
M. le président Henri Emmanuelli. Les moyens matériels et humains des autorités de contrôle ont-ils été renforcés depuis la crise ?
Mme Danièle Nouy. Oui. Je dis et je répète que nous avons d’excellents spécialistes des opérations de marché. Cela tient même du miracle compte tenu des rémunérations qui pourraient leur être offertes dans le privé. Avant l’affaire Kerviel, nous avions mené dix-sept contrôles à la Société Générale, portant sur les secteurs les plus difficiles et les plus novateurs. Nous sommes présents sur place et nous comprenons ce que font les établissements, même s’il y a toujours des nouveautés. La Cour des comptes ayant trouvé nos moyens un peu justes, nous avons pu, la crise aidant, les renforcer. Une centaine de personnes devraient nous rejoindre en deux ans ; certaines ont déjà été recrutées et notre effectif actuel tourne autour de 950 personnes, contre 920 au moment de la fusion – pour comparaison, la Commission bancaire ne disposait que de 600 à 650 personnes, en y comprenant les 70 qui se consacraient à l’agrément des banques, dans un autre département de la Banque de France. Cela étant, une partie du renfort devra bénéficier au secteur de l’assurance dont le contrôle doit s’étoffer car, ces dernières années, le contrôleur des assurances a eu du mal à recruter. Dans la perspective de Solvabilité II, nous sommes en train d’y remédier, y compris en faisant appel à des actuaires très « pointus ». Mais, que ce soit en qualité ou en quantité, nous disposerons des moyens adéquats.
Il ne faut pas oublier non plus le réseau des succursales de la Banque de France qui va nous aider dans le contrôle des pratiques commerciales, tombé récemment dans l’escarcelle de l’ACP.
M. le président Henri Emmanuelli. Où placez-vous l’urgence, pour le moment ?
Mme Danièle Nouy. Il faut que les transactions se fassent sur des marchés organisés. Je confirme les propos de M. Jean-Pierre Jouyet : la directive sur les marchés d’instruments financiers (MIF) a été une quasi-catastrophe. Nous l’avions pourtant dit, mais on se méfie toujours des Français qui veulent réguler et n’acceptent pas les règles du marché. Il faut des marchés organisés pour les produits dérivés plutôt que des transactions de gré à gré, des compensations avec des contreparties centrales ; et, quand les dérivés sont libellés en euro, les plates-formes doivent être dans la zone euro, près de la Banque centrale européenne qui doit pouvoir assurer la liquidité en cas de difficulté. De même, les registres où sont consignées toutes les opérations doivent être accessibles aux superviseurs. Nous les avons testés, pour connaître l’activité des banques françaises sur les dérivés de crédit liés à la dette grecque, et les chiffres étaient cohérents avec ceux que nous ont donnés les banques elles-mêmes. Mais, aujourd'hui, les communications qui nous sont faites reposent sur la bonne volonté des acteurs. C’est M. Jouyet qui est à la manœuvre sur ce point car faire reconnaître que la confidentialité ne joue pas vis-à-vis du superviseur demande un travail juridique.
M. le président Henri Emmanuelli. M. Christian de Boissieu estime que les opérations de gré à gré représentent douze fois le PIB mondial. Que vous inspirent ces chiffres ?
Mme Danièle Nouy. Ils sont très inquiétants, mais je pense qu’ils résultent d’un empilement des montants bruts de notionnels. Souvent, la seule façon d’annuler un contrat de ce type, c’est d’en créer un autre en sens inverse. Il faudrait mesurer la position nette ouverte pour se faire une idée plus exacte. On tomberait sans doute alors à six fois le PIB mondial, voire moins.
M. Paul Giacobbi. Le montant de 700 000 milliards de dollars, qui vient de la Banque des règlements internationaux, ne prend pas en compte les compensations, en effet. Cela étant, l’ordre de grandeur est de plusieurs fois le PIB mondial, mais tant qu’on n’aura pas des systèmes d’information en réseau, on n’en saura pas plus.
Mme Danièle Nouy. Je termine par les chiffres concernant la part des portefeuilles de transactions dans le bilan des banques. Ils représentaient en décembre 2008 et juin 2010 respectivement 38,3 % et 31,3 % des actifs du bilan des cinq plus grands groupes bancaires français, contre 33,6 % et 28,1 % du passif. Les stocks en juin dernier se montaient à 2 013 milliards d’euros à l’actif, dont 1 157 milliards sous forme de dérivés, et à 1 805 milliards d’euros au passif.
M. le président Henri Emmanuelli. Il ne me reste plus qu’à vous remercier.
L’audition s’achève à dix sept heures trente cinq.
*
* *
Audition de M. Patrick Artus,
directeur de la recherche et des études économiques de Natixis
(Procès-verbal de la séance du mercredi 17 novembre 2010)
(Présidence de M. Henri Emmanuelli, président de la commission d’enquête)
La séance est ouverte à dix-sept heures trente
M. le président Henri Emmanuelli. Nous accueillons M. Patrick Artus qui est directeur de la recherche et des études économiques de Natixis, professeur de sciences économiques à l’Université Paris-I et à l’École polytechnique, membre du Conseil d’analyse économique et auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur les marchés financiers.
Le sujet qui nous préoccupe vous est donc familier, monsieur le directeur : quel est votre point de vue sur la crise financière et sur le rôle qu’ont pu y jouer les mécanismes spéculatifs ?
(M. Patrick Artus prête serment.)
M Patrick Artus, directeur de la recherche et des études économiques de Natixis, professeur de sciences économiques à Paris-I et à l’École polytechnique. Nous assistons, depuis une vingtaine d’années, à une succession de crises qui présentent toutes la même configuration : une hausse anormale des prix d’une classe particulière d’actifs – les actions des nouvelles technologies dans les années quatre-vingt-dix, l’immobilier et les produits financiers connexes entre 2002 et 2008 –, suivie d’un retour à la normale qui révèle le surendettement des agents économiques ayant acheté ces actifs en phase d’ascension des prix. Il s’est agi, dans le premier cas, des entreprises ; dans le second, des ménages, surtout dans les pays anglo-saxons et en Espagne, et des banques qui ont acquis à des prix trop élevés des produits structurés fabriqués à partir de crédits immobiliers. Il importe donc de comprendre pourquoi ces crises se produisent et quels mécanismes y sont à l’œuvre.
Le plus compliqué est d’identifier la raison pour laquelle le prix d’un certain type d’actifs monte de façon manifestement déraisonnable. Le plus souvent, les nombreux investisseurs savent pertinemment qu’ils achètent trop cher et on a beaucoup de mal, malgré des études nombreuses et précises, à comprendre pourquoi ils le font néanmoins. Pourtant, c’est le nœud du problème.
Autre point qui fait question, mais qui n’a pas de rapport immédiat avec le sujet de votre commission d’enquête, c’est l’abondance de liquidités qui rend possible ce comportement. L’endettement nécessaire pour acheter des actifs n’est possible que si des agents financiers ont des ressources, donc de la liquidité. Il y a une relation évidente entre la politique monétaire et les phénomènes de bulle. Et, une fois que la bulle a explosé, que les prix ont baissé, se produisent des défaillances massives, d’où une crise bancaire. Le problème de la liquidité, j’y insiste, est central. Si cette liquidité avait été moins abondante, les crises auraient été moins violentes, faute de « munitions ». Mais, depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, les politiques monétaires sont chroniquement trop expansionnistes, ce qui a incontestablement été un facteur permissif. Et la récente décision prise aux États-Unis ne sera pas pour améliorer la situation.
Quel est le mécanisme qui se cache derrière la hausse effrénée des prix, suivie d’une baisse tout aussi déraisonnable ? Les crises sont souvent déclenchées par la correction des hausses anormales, mais, symétriquement, se produisent aussi des baisses anormales – ainsi, aujourd'hui, les dettes publiques irlandaise et grecque sont anormalement peu chères. La tentation est grande, pour expliquer ces phénomènes, de plaquer sur eux le modèle le plus simple de spéculation : j’achète un actif en sachant très bien qu’il est trop cher, mais en espérant le revendre encore plus cher avant que ne se révèle la vérité des prix. Ce qui rend la question extrêmement compliquée, c’est que, en sus de la spéculation, il y a d’autres mécanismes à l’œuvre dans la formation des prix : par exemple, le mimétisme forcené d’investisseurs qui ne sont pas des spéculateurs – les fonds d’investissement, les gérants de SICAV, les assureurs-vie, les caisses de retraite… Toutes les études montrent depuis trente ans qu’ils achètent toujours tous ensemble quand les actifs sont trop chers, et vendent toujours tous ensemble quand les actifs sont trop bon marché. De tels comportements sont totalement destructeurs pour les clients de ces intermédiaires financiers et provoquent des mouvements de prix extrêmement violents sur tous les marchés – actions, obligations d’entreprise, changes…
Paradoxalement, il s’agit d’investisseurs dont les horizons de placement sont très longs. La recherche faite en ce domaine montre que le mimétisme est favorisé par la combinaison de la réglementation comptable et de la façon dont sont jugés ces investisseurs. Depuis plusieurs années, on mesure les performances des investisseurs à long terme avec des instruments de court terme, par exemple en affichant les résultats des produits d’assurance-vie ou des caisses de retraite tous les mois ou tous les trimestres alors que leur horizon naturel est de cinq, dix ou trente ans. Cette évolution les incite à prendre des décisions qu’ils ne prendraient sans doute pas sinon, par exemple à acheter ce qui monte pour être aussi performants que les autres à court terme. Nous sommes loin de la spéculation, là.
Ainsi, l’appareil de mesure de la performance des investisseurs souffre d’un biais court-termiste systématique. Il n’est pas normal de juger la gestion d’un fonds de pension d’après sa performance trimestrielle plutôt que sur sa capacité à payer des retraites dans trente ans. Mais, dans le contexte actuel, il est obligé, à l’intérieur de chaque intervalle de temps, de commettre les mêmes bêtises que les autres pour être sûr de faire comme eux. Il y a un désajustement très profond entre l’horizon naturel des investisseurs et l’aune à laquelle ils sont jugés. Les normes comptables ont encore aggravé les choses puisque les fonds de pension, y compris publics et à horizon long, doivent produire des comptes trimestriels en valeur de marché.
Autre anomalie : on lit beaucoup que la hausse des taux des dettes grecque, irlandaise, portugaise, est liée à la spéculation, mais la taille des marchés dérivés – par exemple celui des crédit default swap, les CDS, qui représente entre 3 et 4 % de l’encours du sous-jacent – est trop réduite pour qu’ils aient déclenché des mouvements de prix visibles. Si l’on considère les flux, on s’aperçoit que la chute des prix provient des ventes effectuées par des investisseurs institutionnels parfaitement conservateurs, mais qui jugent que ces actifs sont devenus trop dangereux. Et le phénomène est entièrement « auto-réalisateur » : si tous les assureurs-vie européens vendent leur dette irlandaise, elle va chuter au point de forcer ceux qui voulaient la garder à la vendre. C’est ce à quoi on assiste en ce moment.
M. le président Henri Emmanuelli. Quels sont les spreads aujourd'hui ?
M. Patrick Artus. L’Irlande s’endette actuellement à 8,5 % à dix ans, la Grèce à 11,5 %, le Portugal à un peu moins de 7 %, et l’Espagne à 4,8 %. La brusque dégradation de la dette irlandaise est en partie liée à l’absence de transparence sur les intentions du gouvernement de ce pays. Aujourd'hui, ce sont des assureurs-vie bien tranquilles qui se demandent s’ils peuvent, pour leurs clients, prendre le risque de garder de la dette irlandaise en portefeuille. Et ils vendent progressivement, mais ils vendent tous. Ce n’est pas à proprement parler de la spéculation, au contraire puisque ces institutions agissent par aversion du risque, par crainte que l’affaire ne tourne mal. Et c’est ce qui va finir par arriver parce qu’il est pratiquement impossible à un pays européen de stabiliser son taux d’endettement public si le taux d’intérêt dépasse 6 %. Au-delà, il faudrait qu’il dégage un excédent budgétaire qui ne s’est jamais vu dans l’histoire, si bien que les marchés sont confortés dans la conviction qu’il faut se débarrasser de cette dette avant qu’il ne soit trop tard.
Par ailleurs, les mouvements sur le marché des matières premières sont extrêmement mystérieux. Le FMI et l’OCDE se sont penchés sur la question, moi aussi, et personne n’a pu prouver que les fluctuations observées sur les marchés à terme entraînent des hausses de prix. Depuis deux mois, certains métaux et des matières premières agricoles enregistrent des hausses très fortes, sans aucune augmentation du nombre des contrats à terme. Le FMI conclut à l’impossibilité de prouver que les marchés à terme ont un impact sur le prix du comptant. Le lien en tout cas n’a rien de systématique. Assez curieusement, la seule matière première où les prises de position à terme se soient accumulées récemment, c’est le riz… dont le prix ne bouge pas. Autrement dit, la spéculation sur les matières premières ne passe pas par les marchés dérivés. C’est le stockage physique qui serait à l’origine de l’envolée des prix. Et les spéculateurs ne sont pas forcément ceux qu’on pense : ce sont des États – les pays d’Asie ont d’énormes stocks de matières premières – ou les producteurs eux-mêmes – les compagnies pétrolières stockent du pétrole dans des tankers. Les acteurs financiers ne sont pas en cause.
Sur les marchés à terme, on essaie de faire la part entre les opérations commerciales et les autres. Mais cette distinction n’est pas très pertinente car il arrive aux industriels de prendre des positions spéculatives. En conclusion, les marchés dérivés de matières premières ne sont pas le support essentiel de la spéculation sur les matières premières. Et les variations très fortes de prix ne sont pas toujours dues à cette dernière. Elles peuvent s’expliquer par des facteurs physiques : pour le coton, dont le prix a très fortement monté ces derniers temps, par de mauvaises récoltes successives et par le fait que des agriculteurs indiens s’en détournent au profit de productions plus rentables ; pour le blé, par des conditions climatiques défavorables.
On incrimine souvent aussi les positions courtes prises par les hedge funds. J’ai donc cherché à savoir à quel moment et sur quels sous-jacents ceux-ci avaient pris de telles positions. Eh bien, globalement, ils n’en prennent pratiquement jamais, sauf un peu sur les actions, en 2005 puis après la faillite de la banque Lehman Brothers, et sur l’euro pendant la crise de la dette grecque en mai. Le reste est insignifiant. On n’a donc pas l’impression que ce soit ce qui pèse sur l’équilibre des marchés : ces positions courtes sont trop limitées à la fois dans le temps et dans leur ampleur. En outre, le levier des hedge funds a beaucoup baissé. D’après les chiffres collectés, cette industrie draine aujourd'hui 1 863 milliards de dollars, et le levier est de l’ordre de 0,5 – autrement dit, pour 100 d’épargne collectée, il y a 50 de dette – alors qu’il a pu atteindre 3, 4, voire 5 par le passé.
Il faut aller chercher également du côté de l’équilibre général des marchés. Natixis est en train de réexaminer son portefeuille de trading pour compte propre. Elle n’a jamais engagé des montants faramineux, mais il est très difficile de tracer une frontière entre les opérations de trading nécessaires et celles qui sont purement spéculatives. Les marchés à terme de biens ne fonctionnent que grâce aux spéculateurs : les opérateurs professionnels s’orientent tous dans le même sens au même moment. Si on anticipe une hausse des cours du pétrole, toutes les compagnies aériennes vont essayer de se couvrir et les seules contreparties qu’elles trouveront ne seront pas du côté des professionnels. De même, les agriculteurs qui couvrent leur récolte future sont tous vendeurs en même temps : pour qu’il y ait marché, il faut pouvoir trouver des contreparties, en l’occurrence auprès des traders ou des hedge funds.
Enfin, la réglementation des banques et des assurances prend une orientation inquiétante. Loin de moi l’idée de critiquer les efforts faits pour la renforcer, mais ce travail est mené en réaction à la crise qui a précédé. Aujourd'hui, les règles en matière de fonds propres incitent tous les intermédiaires à augmenter leurs portefeuilles de titres publics au détriment de leurs portefeuilles de titres privés, au moment même où des doutes surgissent à propos de cette dette. Les banques de la zone euro détiennent actuellement 4 500 milliards d’euros de titres publics…
M. le président Henri Emmanuelli. Quel est le montant de la dette publique dans cette même zone ?
M. Patrick Artus. 8 500 milliards d’euros environ. Mais il ne s’agit pas que de titres de la dette de la zone euro. Quoi qu’il en soit, le montant est considérable et c’est le résultat de la régulation. Ainsi, Solvabilité II exige 0,41 euro de fonds propres par euro d’action détenue ; 0,23 euro par euro d’obligation d’entreprise et zéro centime par euro de titre public détenu. L’incitation est très forte à réduire la part des titres d’entreprise, y compris les Collateralized Debt Obligations – les CDO –, les Asset-Backed Securities – les ABS –, et autres produits structurés qui ne sont pas étrangers à la crise. Pour les banques, il en va de même, les titres publics sont considérés comme des réserves de liquidité en cas de crise. On comprend bien la motivation du régulateur, mais il vaudrait mieux que la prochaine crise ne soit pas celle de la dette publique ! On ne peut pas ne pas s’en alarmer, et je crois que l’on va un peu loin dans la pénalisation relative de la détention de titres d’entreprise.
Si un assureur doit, quand il détient un euro d’action, se procurer 0,41 euro de fonds propres qu’il doit rémunérer 15 ou 16 %, le point d’équilibre se situera autour de 6,5 %. Le rendement des actions n’est pas suffisant pour couvrir ses frais et le comportement rationnel d’un assureur européen aujourd'hui, c’est donc d’éviter d’avoir des actions. Le retour de balancier est un peu excessif.
M. le président Henri Emmanuelli. Et comment les entreprises vont-elles se financer ?
M. Patrick Artus. C’est une bonne question. Pour l’instant, elles savent qu’elles auront du mal à lever des fonds. Elles ont donc décidé de s’autofinancer. Partout, les taux d’autofinancement remontent au-dessus de 100 %. Autrement dit, les entreprises ne financent leurs investissements qu’avec leur cash flow et, pour y arriver, elles baissent les salaires.
M. le président Henri Emmanuelli. Cela pèse aussi sur les investissements ?
M. Patrick Artus. Pas tellement, parce que les entreprises sont très rentables. La vitesse à laquelle elles ont retrouvé le chemin de la rentabilité après la crise est d’ailleurs surprenante. Partout dans le monde, nos entreprises clientes nous disent que, comme elles doivent dorénavant financer leurs investissements par elles-mêmes, elles ne distribuent pas les gains de productivité aux salariés, ce qui augmente les profits et permet de se passer de financements externes. Dès lors, le risque est grand de voir se généraliser ce qui se passe au Japon ou en Allemagne depuis quinze ans : une très forte déformation du partage de la valeur ajoutée au détriment des salariés, parce que les entreprises ne veulent plus recourir au crédit ou aux marchés financiers. Ce modèle, on le sait, est extrêmement néfaste pour la demande des ménages puisque les salaires sont structurellement comprimés. Dans votre revue des problèmes, il faut aussi examiner la régulation. La situation est confortable pour le régulateur qui sait que la part des papiers privés dans les portefeuilles va chuter fortement, et avec elle celle des papiers dangereux qui ont aggravé la crise. Si les règles de fonds propres avaient été les mêmes avant la crise, celle-ci en aurait été très atténuée. Mais les adopter aujourd'hui, c’est s’exposer à prévenir la crise passée !
Dans le cadre de Solvabilité II, on procède à des stress tests qui consistent à mesurer l’impact d’une chute des cours des actions de x %, et à évaluer les fonds propres nécessaires pour supporter les pertes correspondantes. On part de l’hypothèse que les assureurs risquent chaque année de devoir vendre la totalité de leurs actions à un prix très bas. Pourtant, un contrat d’assurance-vie dure plus de huit ans, en réalité onze à treize ans. Or, la régulation ne considère qu’un horizon d’un an.
Quant aux banques, on a reproché aux tests auxquels elles ont été soumises de ne pas être assez sévères. Dans leurs comptes, on distingue le livre de trading et le livre bancaire. Dans ce dernier, les obligations ne sont pas évaluées à leur valeur de marché parce qu’elles sont censées être conservées jusqu’à l’échéance. Les stress tests des banques ont porté uniquement sur les portefeuilles de trading, qui sont évalués à leur valeur de marché, en laissant de côté les portefeuilles d’investissement. D’où les critiques anglo-saxonnes, et notamment un article extrêmement sévère du Wall Street Journal, qui souligne que, en cas de défaillance de la Grèce, les banques perdraient y compris sur leurs obligations grecques comptabilisées dans leur livre bancaire. Le stress test reposait sur l’hypothèse qu’il n’y aurait pas de défaut, ni de restructuration de la dette publique des pays européens.
En revanche, les règles prévues dans Solvabilité II pour évaluer les besoins en fonds propres sont extrêmement pénalisantes pour les actions, les obligations privées et les fonds de private equities dans lesquels les assureurs ne pourront plus investir. L’immobilier est un peu mieux traité. Le renforcement de la régulation va dans le bon sens, mais elle comporte, à mon sens, un biais : une incitation exagérée à détenir de la dette publique.
M. le président Henri Emmanuelli. Empêcher les crises de se reproduire à l’identique fait partie des objectifs de la régulation.
Vous avez souligné l’abondance de liquidité. Selon l’un des intervenants qui vous a précédé ici, le volume en aurait crû, depuis le milieu des années 2000, de 15 % par an.
M. Patrick Artus. Et même plus. Il faut considérer la base monétaire, c'est-à-dire la monnaie émise par les banques centrales en contrepartie de leurs achats d’actifs, qui est échangée au sein du système bancaire, et qui correspond grosso modo à la taille de leur bilan. Avec le Quantitative Easing, on sort de ce modèle traditionnel puisque la Réserve fédérale américaine va acheter des obligations du Trésor directement sur les marchés financiers, à des fonds de pension, par exemple, qui recevront un dépôt bancaire, sous forme de masse monétaire classique. Mais en Europe ou en Asie, la banque centrale règle les banques en créditant leurs comptes dans ses propres livres, dans cette monnaie appelée tantôt monnaie banque centrale, tantôt base monétaire – dans les années soixante-dix, on parlait de high-powered money parce qu’elle permet aux banques de faire du crédit – et ces dépôts servent à ces banques à constituer leurs réserves obligatoires et à développer leurs activités de crédit. En 1994, cette base monétaire représentait 5 % du PIB mondial, aujourd’hui 22 %. Le taux de croissance annuel est donc de l’ordre de 18 ou 19 %, quand celui du PIB mondial tourne autour de 6 %. Si l’on raisonne en monétariste pur, la différence devrait correspondre au taux d’inflation. En réalité, il y a eu seulement une hausse des prix des actifs, avec formation de bulles, mais l’inflation des prix des biens ne s’est pas produite, contrairement à ce qui s’était passé dans les années vingt.
M. le président Henri Emmanuelli. Que penser d’un tel décalage ?
M. Patrick Artus. Il est tout de même surprenant que, dans les sommets internationaux, on n’entende jamais la moindre critique de la politique monétaire.
M. le président Henri Emmanuelli. On en parle assez peu.
M. Patrick Artus. On en parle dans les cercles économiques. Il me semble que le mécanisme de base est le suivant : les pays occidentaux, qui souffrent de la concurrence des pays émergents depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, ont compensé par une politique de création monétaire chronique. J’adhère à l’idée que la politique monétaire expansionniste a pallié la faiblesse des salaires. C’est vrai aux Etats-Unis et au Japon. La création monétaire a soutenu la demande, de logement surtout, mais aussi d’actifs de toute espèce. Mais la consommation est restée atone.
Juste un fait pour illustrer mon propos. À la fin du programme Quantitative Easing 2, la Réserve fédérale aura créé, de 2008 à juin 2011, trois fois plus de monnaie qu’entre sa fondation et 2008. Cela donne une idée de l’ordre de grandeur du phénomène et il est évident qu’il faut y voir une des causes profondes de la crise. On peut incriminer les spéculateurs, le trading pour compte propre dans les banques, l’effet de levier des hedge funds, le comportement mimétique des investisseurs, mais c’est la liquidité déversée à profusion par les banques centrales qui leur a permis à tous de s’endetter. Pourtant, les banques centrales n’ont jamais mis en cause leur action. La BCE ne s’est même pas posé la question, focalisée qu’elle est sur les objectifs d’inflation – et dès lors que ceux-ci sont respectés, les prix de l’immobilier peuvent bien augmenter de 15 % par an ! Outre-Atlantique, c’est une décision délibérée pour soutenir l’économie américaine en jouant sur l’effet de richesse que procurait l’augmentation des prix des actifs. Dans un moment de sincérité, Alan Greenspan a déclaré en 2003 qu’il avait bien été obligé de favoriser la bulle immobilière parce que la bulle des actions avait explosé.
Sur le plan monétaire, rien ne change donc. Et les mêmes causes produiront les mêmes effets. Une autre bulle va se former, ailleurs, sur une autre classe d’actifs, avec d’autres investisseurs… qui pourront emprunter une montagne de monnaie à 0,25 %. Et les premiers signes sont en train d’apparaître sur les bourses asiatiques : les gouverneurs des banques centrales de ces pays se plaignent d’être inondés par les capitaux, en provenance essentiellement des États-Unis, qui s’investissent en actions et un peu dans l’immobilier. Les bulles existent déjà sur certaines dettes publiques, en Allemagne, au Japon, aux États-Unis. Et il y aura vraisemblablement une bulle dans les pays émergents dont la croissance séduit les financiers qui jugent raisonnable d’y investir, au moins au début. Les banquiers américains ou européens, empêchés par la nouvelle réglementation, et les assureurs européens, contraints par Solvabilité II, laisseront la place aux « non-banques » ou aux banques qui ne sont pas régulées, aux acteurs offshore et aux fonds divers et variés. L’industrie des hedge funds est d’ailleurs en train de se transférer en Asie. Mais le résultat sera le même.
M. le président Henri Emmanuelli. La crise a-t-elle réduit l’effet de levier ?
M. Patrick Artus. Pour les hedge funds, la chute est spectaculaire puisque le coefficient est passé de 3 à 0,5 ; pour les banques aussi. Mais ce ne sont jamais les mêmes qui produisent deux crises de suite. Après les Américains et les Européens, ce sera le tour des institutions financières des pays qui n’appliquent pas la réglementation internationale, par exemple Singapour. Quoi qu’il en soit, il existe une interaction forte entre la politique monétaire et les positions spéculatives.
M. le président Henri Emmanuelli. Pensez-vous que cette politique monétaire était mûrement réfléchie ?
M. Patrick Artus. Cela dépend des pays. En Europe, c’est simplement du dogmatisme : la BCE ne s’inquiète pas de créer de la monnaie tant qu’il n’y a pas d’inflation.
M. le président Henri Emmanuelli. Et la BCE en a créé ?
M. Patrick Artus. Oui, et en très grande quantité. En 2002, année de la création du marché interbancaire européen, la base monétaire était de l’ordre de 400 milliards d’euros ; aujourd'hui, elle est de 1 300 milliards d’euros. La tendance est la même au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les pays émergents, eux, ont accumulé les réserves de change pour empêcher leur monnaie de s’apprécier. La Chine et le Brésil notamment sont obligés de créer de la monnaie à mesure qu’ils achètent des dollars pour enrayer sa chute.
Dans le cadre du Quantitative Easing 2, la Réserve fédérale achète des emprunts du Trésor américain à des investisseurs américains. Avec les dollars qu’ils reçoivent, ces derniers vont acheter des actions au Brésil, par exemple. Pour éviter la hausse de sa devise, la banque centrale brésilienne va créer des réals et, avec ceux-ci, acheter des dollars qu’elle investira dans des obligations du Trésor américain. Le circuit est tel que l’on finance deux fois le Trésor américain, une fois par la Réserve fédérale, une fois par la banque centrale brésilienne, et que l’on crée deux fois de la monnaie : aux États-Unis d’abord, au Brésil ensuite. Autrement dit, l’effet QE2 est multiplié par deux, du fait de la réaction du pays émergent.
M. le président Henri Emmanuelli. Et la Chine, qui est structurellement créditrice, comment se comporte-t-elle ?
M. Patrick Artus. La Chine détient 2 600 milliards de dollars de réserves de change, qui ont suscité la fabrication d’un montant équivalent de renminbi. D’ailleurs, la masse monétaire chinoise augmente de 25 % par an. Les exportateurs chinois sont payés en dollars. Pour éviter une baisse de la devise américaine sur le marché des changes, la banque centrale achète ces dollars contre des renminbi qui nourrissent l’inflation localement. Chaque fois que le monde émergent tente de contrecarrer la politique monétaire américaine pour stabiliser les taux de change, on double la création monétaire qui a eu lieu aux États-Unis.
Pour le moment, les choses empirent à cause de la politique américaine.
M. le président Henri Emmanuelli. On s’éloigne du thème de cette commission d’enquête, mais, sur le quantitative easing, les avis sont partagés.
M. Patrick Artus. Pas vraiment. Il n’aura aucun effet positif sur l’économie américaine.
M. le président Henri Emmanuelli. J’ai lu un avis contraire qui expliquait que les États-Unis y recouraient pour éviter une situation à la japonaise.
M. Patrick Artus. C’est ce que dit M. Bernanke, mais ce n’est pas vrai. La réalité américaine, ce sont 12 millions d’Américains en faillite à cause de leurs crédits immobiliers, devenus plus chers que leurs maisons, et 45 % des demandeurs d’emploi qui sont maintenant des chômeurs de longue durée parce que leurs qualifications ne leur permettent pas de retrouver un travail, en raison de la destruction de 50 % des emplois dans la construction et de 30 % dans l’industrie. Vous aurez beau injecter toute la liquidité que vous voudrez – et les banques américaines n’en manquent pas, avec leurs 1 000 milliards de dollars de cash –, vous n’y changerez rien. Le problème, comme chez nous, c’est l’économie réelle : inadaptation des formations aux emplois qui se créent et insolvabilité des ménages surendettés. Le remède ne réside pas dans la création monétaire, d’autant que l’argent va se placer dans les pays émergents. L’effet est nul. D’ailleurs, les Américains le reconnaissent plus ou moins. C’est une politique par défaut : l’administration ne peut plus utiliser l’arme budgétaire à cause du déficit public – 11 % du PIB – ni celle des taux – ils sont à 0,25 %. Comme elle ne veut pas ne rien faire, il ne lui reste plus que l’injection de liquidité, mais ce sera vain.
La crise n’est pas une crise de liquidité. C’est même le contraire. Les banques américaines ont 1 000 milliards de dollars en compte à la Réserve fédérale et elles ne savent déjà pas quoi en faire. À quoi bon leur en donner davantage ?
M. le président Henri Emmanuelli. Sans la crise de la dette souveraine, la politique américaine ferait monter l’euro.
M. Patrick Artus. La hausse de l’euro a été contrariée par la crise irlandaise. Mais il n’y a pas de vendeur de dollars contre euros. Depuis trois mois, on assiste à des ventes de dollars et à des achats des monnaies émergentes, si bien que le dollar baisse contre toutes les monnaies, y compris l’euro, mais il n’y a pas de spéculation contre l’euro. Supposons que l’on parvienne à régler la crise irlandaise, et que l’euro recommence à s’apprécier par rapport au dollar, il n’y aurait malheureusement pas grand-chose à faire. L’idée reçue selon laquelle la situation résulterait de l’absence de politique de change dans la zone euro n’est pas fausse, mais elle est vaine. En quoi cette politique de change consisterait-elle ? Comment empêcher concrètement l’euro de s’apprécier ? Par une baisse des taux ? Nous sommes à moins de 1 %. On pourrait faire comme les Chinois : acheter une montagne de dollars et alimenter la création monétaire mondiale. Cela marcherait sûrement, mais a-t-on envie que la BCE fasse comme la Chine ?
M. le président Henri Emmanuelli. Si la hausse de l’euro nous coûte un demi-point de croissance…
M. Patrick Artus. C’est la position des Chinois, qui jugent un excès de liquidité préférable à une perte de compétitivité. Mais il y a un risque. Si la BCE le prend, la zone euro sera inondée de liquidités.
M. le président Henri Emmanuelli. L’inflation n’a pas que des inconvénients…
M. Patrick Artus. Vous n’aurez pas d’inflation, vous aurez des bulles. Cela fait vingt ans que les Japonais font du quantitative easing et l’inflation est négative dans ce pays ! En effet, le lien entre monnaie et inflation n’est pas automatique. La création de monnaie ne se transforme en inflation que si elle fait augmenter la demande de biens, et que l’offre ne peut pas suivre la demande. Or, avec la mondialisation, la production de biens est devenue extraordinairement flexible. En revanche, l’offre d’actifs est bel et bien rigide. L’inflation s’est donc transférée des biens vers les actifs : le stock d’actions, de maisons qui sont en quantité limitée à court terme…
Le taux d’utilisation des capacités de production est de 60 % en Chine ; il y a de la marge avant d’arriver à saturation.
M. le président Henri Emmanuelli. La joie des investisseurs et la tristesse des épargnants ne sont pas pour demain.
M. Patrick Artus. Sauf peut-être dans quelques pays qui connaissent l’inflation, comme l’Inde où l’industrie ne trouve plus de gens qualifiés à embaucher, cependant que les salaires augmentent extrêmement rapidement. En Chine, l’inflation est circonscrite aux produits alimentaires, mais le problème qui s’était posé en 2007 se repose à nouveau avec force.
M. le président Henri Emmanuelli. Nous vous remercions, monsieur le directeur.
L’audition s’achève à dix huit heures vingt.
*
* *
Audition de Mme Carol Sirou,
présidente de l’agence de notation Standard and Poor’s Paris, zone francophone, accompagnée de M. Jean-Michel Six, chef économiste Europe
(Procès-verbal de la séance du mercredi 17 novembre 2010)
(Présidence de M. Henri Emmanuelli, président de la commission d’enquête)
La séance est ouverte à dix-huit heures trente
M. le président Henri Emmanuelli. Madame Sirou, je vous remercie d’avoir répondu à l’invitation de la Commission. Vous êtes la présidente directrice générale de la branche française de Standard & Poor’s, qui est l’une des trois principales sociétés mondiales de notation financière. Votre témoignage sera donc précieux pour notre commission.
J’indique que vous êtes accompagné de M. Jean-Michel Six, chef économiste Europe.
(Mme Carol Sirou et M. Jean-Michel Six prêtent serment.)
Mme Carol Sirou, présidente de l’agence de notation Standard and Poor’s Paris, zone francophone. Avec la crise, le grand public a découvert les agences de notation. Elles sont souvent méconnues ou présentées de manière erronée. Il faut souligner que les agences de notation ne sont pas des acteurs de marché mais fournissent à ceux-ci un outil : une opinion prospective sur la qualité du crédit futur d’un émetteur ou d’une émission.
Ce que mesure la notation, c’est le risque de crédit, c'est-à-dire la probabilité de remboursement à terme d’une obligation ou d’un emprunt. Son objet n’est ni la liquidité, ni la volatilité d’un titre, et encore moins l’opportunité de son achat ou de sa vente.
Si la notation est utilisée par les investisseurs, c’est qu’elle permet de comparer des classes d’actifs très différentes et dans des zones géographiques très éloignées. Un référentiel simple peut ainsi être créé pour l’information des investisseurs sur les marchés obligataires.
La notation est basée sur des méthodologies publiques et explicites, déclinées en fonction des différents secteurs. Cet exercice est avant tout comparatif. Il permet de classer de façon relative cette probabilité de défaut, elle-même mesurée par des statistiques que nous publions annuellement pour toutes les classes d’actifs.
Outre la comparabilité, la stabilité de la mesure de la qualité du crédit est essentielle. Les notes ne sont pas intangibles. Elles peuvent évoluer dans le temps. Elles mesurent la prévision du risque de défaut à un moment donné, en fonction de l’information dont nous disposons au moment de leur élaboration. Nous nous efforçons néanmoins de donner une opinion à travers le cycle et d’apprécier le risque de défaut à un horizon non de court terme mais de moyen terme, à échéance de deux à quatre ans.
Dès lors que nous estimons disposer d’assez d’éléments, nous modifions, si nécessaire, les notes, et ce en toute indépendance.
L’outil ainsi élaboré pour le marché obligataire est essentiellement utilisé par des investisseurs de long terme, des gestionnaires d’actifs institutionnels, qui ont en général pour objectif de conserver leurs titres jusqu’à l’échéance. D’où l’intérêt qu’ils portent à la stabilité des notes. Une volatilité excessive ne les intéresse aucunement.
En revanche, les acteurs dits spéculatifs, comme les hedge funds, ne sont pas les utilisateurs traditionnels des notes. Leur horizon de temps est très différent du nôtre. De même, les particuliers ont peu vocation à les utiliser.
Ne l’oublions pas, nos notes sont accompagnées d’analyses. Très largement diffusées, celles-ci permettent d’apprécier les facteurs d’évolution des notes, et, grâce aux perspectives qui les accompagnent, d’anticiper les changements futurs, et donc d’éventuels changements de notations.
Dans le Global financial stability report qu’il a publié en octobre dernier, le FMI a procédé à une analyse des notations souveraines et observé sur les trente dernières années l’évolution des notes et leur pouvoir d’information auprès du marché. Il conclut notamment que les perspectives attachées aux notes permettent aux acteurs de marché d’anticiper les évolutions futures des risques de crédit.
L’information que nous donnons sur la qualité de crédit et les probabilités de défaut futur n’est que l’un des paramètres susceptibles d’affecter le comportement et les prises de position des acteurs de marché. La qualité de crédit n’est en effet que l’une des composantes du prix, notamment du spread, c’est-à-dire l’écart entre le taux payé par l’émetteur et le taux de référence, c'est-à-dire le taux allemand à dix ans…
M. le président Henri Emmanuelli. Pourriez-vous aller au-delà d’une présentation générale du fonctionnement des agences de notation et de l’utilisation qui est faite des notes qu’elles accordent ?
Les utilisateurs des notations nous ont eux-mêmes exposé l’usage qu’ils en faisaient. Ils nous disent en effet que la notation n’est que l’un des paramètres du prix, l’un de leurs éléments d’appréciation en supplément de leur propre expertise. Cela dit, aucun ne veut avouer qu’il a externalisé l’expertise !
Mme Carol Sirou. L’exemple des États souverains montre que, dans certaines périodes, la notation peut n’avoir que peu d’impact sur les écarts de taux.
M. le président Henri Emmanuelli. Pour moi, l’appréciation des dettes souveraines dépend non seulement de l’appréciation des agences, mais aussi des projecteurs de l’actualité. L’accent mis par les médias sur une situation ne modifierait-elle pas radicalement l’appréciation portée sur elle ? Vous avez en mémoire, je suppose, des dettes souveraines ne figurant pas parmi les mieux classées et qui pourtant ne semblaient pas attaquées.
M. Jean-Michel Six, chef économiste Europe de l’agence de notation Standard and Poor’s Paris. Il arrive en effet que, à un instant donné, l’impact des changements de notes sur les marchés soit pratiquement nul.
Mme Carol Sirou. L’impact de l’information apportée par la notation sera plus ou moins fort selon le contexte, les anticipations des acteurs et leur perception du risque.
M. le président Henri Emmanuelli. L’Irlande est aujourd’hui le symbole d’un changement d’appréciation indépendant de la notation.
M. Jean-Michel Six. Les perturbations de la situation de ce pays sur les marchés n’ont en effet aucunement pour origine une baisse de notation. Aucune modification de ses notes n’a été effectuée récemment.
M. le président Henri Emmanuelli. Il se dit cependant partout que les agences s’apprêtent à baisser la note de l’Irlande.
Mme Carol Sirou. Si des rumeurs peuvent circuler sur les marchés, ce n’est pas nous qui les alimentons. Notre notation est publique. Nous avons mis en place des procédures d’information.
M. le président Henri Emmanuelli. Une rumeur aux termes de laquelle – cela arrive souvent – telle ou telle agence s’apprêterait à dégrader une note peut-elle avoir pour origine une préparation du terrain de votre part pour que le changement ne soit pas trop brutal ?
Mme Carol Sirou. Les rumeurs restent des rumeurs. La notation est accompagnée d’un raisonnement et de ce que nous appelons une perspective, laquelle donne les clés de lecture des évolutions possibles. Sur ces bases, le lecteur peut anticiper les évolutions possibles, à un horizon de temps dépendant des différents facteurs mis en avant.
M. le président Henri Emmanuelli. Hier, pourtant, tout l’Internet relayait l’annonce d’une prochaine dégradation de la note du Portugal par les agences.
Mme Carol Sirou. Il s’agit de rumeurs. Les comités se réunissent sur la base d’éléments précis en vue d’une actualisation sur les points mis en exergue dans la notation.
M. le président Henri Emmanuelli. Même si la note n’est pas modifiée, chacun peut comprendre qu’une mise en observation assortie d’une perspective négative signifie un risque de baisse de celle-ci…
Mme Carol Sirou. L’objet de nos outils consiste en effet, pour ne pas prendre le marché à contre-pied, à lui donner les clés de lecture des points susceptibles d’affecter la qualité de crédit.
M. Jean-Michel Six. Monsieur le président, vous remarquerez que les articles de presse que vous évoquez ne sont jamais accompagnés du moindre commentaire d’agence – notamment de la nôtre – susceptible d’appuyer la prétendue nouvelle ainsi dévoilée. Nous avons en effet pour politique de ne jamais effectuer de commentaires sur les rumeurs de marché ; entrer dans cette spirale ruinerait notre métier. À chaque appel d’un journaliste pour demander confirmation d’une rumeur, notre réponse systématique est que nous ne commentons jamais ni nos décisions futures, ni les rumeurs.
M. le président Henri Emmanuelli. Cependant – et il ne s’agit pas d’un reproche -, même si vous n’annoncez pas que vous allez diminuer une note, les formules spécifiques de votre méthodologie – mise sous surveillance, perspective négative – ne signifient-elles pas une future dégradation ?
M. Jean-Michel Six. Non. Elles signifient seulement un risque de future dégradation, au cas où certains événements devaient survenir ou des décisions précises ne pas être prises.
M. le président Henri Emmanuelli. Combien de fois une mise en observation assortie d’une perspective négative n’a-t-elle pas été suivie d’une dégradation de la note ?
Mme Carol Sirou. D’après les statistiques que nous avons publiées, sur l’ensemble des notes attribuées par nous durant les trente dernières années, la probabilité de dégradation après mise en perspective négative est de 30 %.
M. le président Henri Emmanuelli. Une fois sur trois environ. Voilà un élément parlant.
M. Jean-Michel Six. Une note ne peut pas non plus être laissée indéfiniment sous perspective négative. Les investisseurs le savent, l’appréciation ne vaut que pour un temps. Ensuite, nous réexaminons le dossier.
M. le président Henri Emmanuelli. Le président de l’Autorité des marchés financiers a exposé à la Commission d’enquête avoir trouvé anormale la dégradation de la note de l’Espagne par une agence un soir à 17 heures 45. Qu’en pensez-vous ?
Mme Carol Sirou. Nos procédures sont très claires. Dès lors qu’un comité a pris une décision, nous en informons l’émetteur. Aux termes du règlement européen actuel, en vigueur depuis le 7 septembre, l’émetteur doit ensuite disposer d’au moins douze heures pour faire, s’il le souhaite, des commentaires sur des éléments factuels. Ensuite, nous publions la notation. L’objectif est une information des marchés aussi rapide que possible. C’est le facteur temps qui a fait que l’annonce du changement de notation de l’Espagne a été publiée juste avant la clôture des marchés.
M. Jean-Michel Six. Ou plutôt avant la clôture des marchés européens. Les marchés américains étaient encore ouverts. Les marchés asiatiques s’apprêtaient à ouvrir. La difficulté est qu’au-delà des douze heures, les risques de fuites – de la part de l’émetteur – sont réels. Nous ne pouvons donc pas continuer à garder pour nous une décision qui vient d’être prise.
M. le président Henri Emmanuelli. Venez-vous de dire qu’attendre le lundi matin n’était pas possible ?
M. Jean-Michel Six. Nous n’étions pas un vendredi.
Mme Carol Sirou. C’était un mercredi, je crois.
M. Jean-Michel Six. Pour autant, eu égard aux critiques qui nous ont été faites à la suite de cet épisode très particulier, nous avons décidé de ne plus publier nos décisions au-delà d’une heure avant la fin des marchés européens. Il reste que les risques de fuites susceptibles de perturber les marchés ne doivent pas être sous-estimés.
M. le président Henri Emmanuelli. Comment expliquez-vous qu’après l’éclatement de la bulle due à la crise des subprimes, des produits structurés – Abacus par exemple – aient continué à bénéficier de la note AAA, la meilleure possible ? Est-ce lié à la proximité des agences avec certains émetteurs ? Ce sont tout de même eux qui les financent.
Mme Carol Sirou. La notation des opérations, y compris celles de titrisation, est effectuée par application de procédures très claires et de méthodologies publiques.
La non-validation de certaines hypothèses nous a amenés à repenser, pendant ces deux dernières années, l’ensemble de notre approche des opérations de titrisation.
M. le président Henri Emmanuelli. Comment expliquez-vous qu’aucune agence de notation n’ait vu venir la crise des subprimes ? Le volume de titres structurés émis à partir de ces prêts a été énorme. Il est aujourd’hui admis comme une évidence que ces prêts étaient consentis à des personnes qui ne disposaient absolument pas des moyens de les rembourser, et donc que leur remboursement était gagé sur la seule hausse continue de la valeur des actifs.
Mme Carol Sirou. Il faut savoir que les stress sont calibrés en fonction des hypothèses historiques. Or l’expérience historique sur laquelle étaient fondées non seulement nos hypothèses, mais aussi celles d’autres acteurs du marché immobilier américain, était que l’on n’avait jamais vu une crise d’ampleur nationale – il n’y avait eu que des crises d’ampleur régionale – ni un changement de comportement des émetteurs. Jamais une chute du marché immobilier de cette ampleur n’avait été observée aux États-Unis.
À la suite de cette crise, nous avons revu l’ensemble de notre méthodologie. Nous avons notamment fixé, pour l’attribution de notes élevées, des hypothèses de résistance au stress extrêmement fortes. Aujourd’hui, l’attribution de la note AAA à une opération suppose que son émetteur, quel qu’il soit, puisse résister à des chocs du type de celui qu’ont subi les États-Unis durant la crise de 1929.
Les opérations n’ont pas résisté à la gravité d’une crise d’une ampleur nettement supérieure à ce que l’historique des chutes des prix immobiliers permettait de prévoir.
M. le président Henri Emmanuelli. Des dossiers de prêts de subprimes ne comportaient même pas le montant du revenu de l’emprunteur ! Comment une telle attitude, d’une extraordinaire légèreté, est-elle possible ? Or, elle a été systématique. Nous sommes loin de la crise de 1929 ou de celle de trois des cinquante États des États-Unis. Comment peut-on prêter de l’argent à un emprunteur sans s’assurer de sa capacité de remboursement ? Que les courtiers, payés à la commission, aient pu se comporter comme ils l’ont fait est explicable. Mais qu’ensuite, la structuration, la titrisation de ces prêts aient été effectuées sans vérification est incompréhensible. Comment l’expliquez-vous ?
M. Jean-Michel Six. Des erreurs tout à fait claires ont été reconnues, y compris par nous. En ce qui concerne les agences de notations, nous basons nos notes sur des projections de cash-flow, et non sur des analyses du dossier de chaque client.
Comme leur nom l’indique, les produits structurés étaient formés – c’était bien connu – d’une hiérarchie de couches d’emprunts de qualité différente, du relativement sûr au plus risqué. C’était le travail du « structureur » de procéder à un tel assemblage. Des « réserves de surdimensionnement » étaient aussi ajoutés au nécessaire pour minimiser le risque.
Cependant, du fait de la simultanéité et de l’ampleur de la crise, ont été affectées non seulement des personnes ne disposant pas de ressources suffisantes, mais aussi des personnes disposant des revenus nécessaires mais qui se sont retrouvées au chômage. De ce fait, alors que l’hypothèse sous-jacente à la structuration était que seules les couches les plus risquées d’un produit structuré pourraient être affectées, c’est toutes les couches qui l’ont été.
L’étude de produits structurés comparables – et non pas exactement identiques – en Europe montre qu’ils se sont beaucoup mieux comportés que les produits américains. Leurs notes aussi sont restées bien meilleures.
M. le président Henri Emmanuelli. Des produits titrisés construits sur des prêts immobiliers accordés à des populations défavorisées ont-ils été commercialisés en Europe ?
Mme Carol Sirou. Oui, au Royaume-Uni. Ces opérations résistent à la crise sans défauts majeurs.
M. le président Henri Emmanuelli. Comment réagissez-vous aux propositions du commissaire européen chargé du marché intérieur et des services financiers, M. Michel Barnier, sur votre secteur d’activité ?
Mme Carol Sirou. Nous sommes très favorables, et depuis longtemps, à la proposition visant à retirer de certaines réglementations la référence aux notations. La situation actuelle nous donne un rôle qui n’est pas le nôtre. Nous souhaitons être jugés sur la qualité de nos notes. C’est à nous de prouver aux investisseurs les bénéfices que notre opinion peut leur apporter.
Nous sommes également très favorables à la proposition encourageant la concurrence. Nous souhaitons que l’entrée éventuelle de nouveaux acteurs puisse avoir lieu dans le cadre d’une concurrence ouverte sans distorsion.
M. le président Henri Emmanuelli. Les taux de rendement des fonds propres des agences devraient les amener à se démultiplier, par scissiparité. Les bénéfices seraient au rendez-vous.
M. Jean-Michel Six. Ce point n’est pas encore à l’ordre du jour.
M. le président Henri Emmanuelli. Le nombre réel d’agences est, je crois, très supérieur à l’idée commune. Quel est-il ?
M. Jean-Michel Six. Le FMI a répertorié une centaine d’agences environ. Cela étant, nombre d’entre elles, les plus petites, sont spécialisées sur une région ou un secteur, ce qui limite leur audience.
La principale difficulté pour le développement de la concurrence est que les analyses auxquelles nous procédons nécessitent un long historique. Fonder une analyse sur un recul de deux ou trois ans ne permet pas d’appréhender la stabilité de la gestion d’une entreprise sur le long terme. C’est en raison même de leur jeunesse que nombre d’agences de notation ne disposent pas du même écho que nous.
Mme Carol Sirou. De plus, l’exercice de notation est comparatif. Pour expliquer une notation et relativiser les différents niveaux de risques, disposer d’un échantillon assez fourni est nécessaire.
M. le président Henri Emmanuelli. Pouvez-vous compléter vos réponses sur les propositions de M. Michel Barnier ?
Mme Carol Sirou. Alors qu’aujourd’hui le règlement européen donne douze heures à une entreprise pour commenter le projet de communiqué de notation de l’agence, la Commission européenne propose d’étendre ce délai à trois jours. Pour nous, les risques de fuites, de délits d’initié, de manipulation de cours en seraient augmentés de façon sensible.
M. le président Henri Emmanuelli. La Commission européenne souhaite sans doute permettre la prise en compte des week-ends.
Mme Carol Sirou. Non, le délai proposé va au-delà. Il est trop long.
M. le président Henri Emmanuelli. Quelle est votre analyse sur le modèle économique de rémunération des agences ? Il ne leur est du reste pas propre : il s’applique aussi, par exemple, aux auditeurs ou aux laboratoires d’analyse.
Mme Carol Sirou. Tout modèle économique présente des risques de conflit d’intérêts. Pouvoir les gérer est donc essentiel.
Les trois grandes agences appliquent le même modèle, dit « émetteur-payeur ».
M. le président Henri Emmanuelli. L’une de ces « trois grandes agences » n’est-elle pas beaucoup plus petite que les deux autres ?
M. Jean-Michel Six. Elle offre elle aussi une couverture globale. Et sa réputation est tout aussi globale.
Mme Carol Sirou. Même si son volume d’affaires est plus faible, nous la considérons comme un acteur de premier rang.
Pour notre part, nous considérons que trois agences disposent d’un panel d’activités et d’une couverture mondiale. Elles appliquent toutes les trois le même modèle économique. La force de celui-ci est de permettre une information très large des marchés.
C’est à l’agence de gérer le fait qu’elle est rémunérée par l’émetteur. C’est à elle de parer aux risques de perte d’indépendance envers le client. À cette fin, les analystes – qui élaborent les notes – et les personnels commerciaux sont clairement séparés. Les analystes ne sont pas rémunérés sur la base des revenus tirés de l’émetteur. De plus – et c’est un point essentiel –, les décisions sont prises de manière collégiale. La capacité d’influence de l’émetteur est donc très limitée. Enfin, nos procédures sont très strictes et nous les suivons à la lettre.
M. le président Henri Emmanuelli. Une rémunération sur un pourcentage de la commercialisation du produit ne serait-elle pas envisageable ?
Mme Carol Sirou. Dans le marché obligataire, la rémunération n’est pas organisée sous cette forme, même dans le cadre du modèle « investisseur-payeur ». Sans doute faites-vous référence à des modèles mis en œuvre pour la rémunération des analystes du marché des actions ?
M. le président Henri Emmanuelli. Non. La difficulté se rencontre également dans d’autres secteurs comme celui de l’alimentaire ou dans des professions comme celles de commissaires aux comptes ou d’experts comptables : c’est le contrevenant potentiel qui paie l’autorité de régulation et de contrôle ! Que dirait-on si l’étudiant rémunérait le professeur qui lui fait passer l’examen ?
M. Jean-Michel Six. Mais ce ne sont pas quelques étudiants seulement qui paieraient leur professeur, mais tous ! Aujourd’hui, du reste, c’est le cas, à travers l’impôt consenti par l’ensemble des parents d’étudiants.
D’une comparaison entre le chiffre d’affaires et la note de chacune des sociétés que nous notons, il ressort que de grands groupes font l’objet de notes moyennes, voire des notes dans la catégorie dite « spéculative » (inférieures à BBB-), tandis que de plus petits bénéficient de notations favorables. On peut en conclure à l’absence de corrélation entre la taille d’une entreprise et sa note moyenne. Notre crédibilité se joue entièrement sur la confiance collective – des émetteurs et des investisseurs – que l’analyse qui est faite repose sur la qualité des émetteurs, leur bilan, leur stratégie et non sur la rémunération qu’ils offrent à l’agence de notation.
Mme Carol Sirou. Le grand nombre de nos clients empêche également la dépendance des agences envers un ou quelques clients. Le modèle « investisseur-payeur » s’adresse quant à lui à un nombre beaucoup plus restreint d’investisseurs – les grands gestionnaires d’actifs – avec un risque de concentration réel, les intérêts pouvant être divergents : un investisseur peut souhaiter que le niveau des notes corresponde à ses prises de positions.
Si nous sommes conscients des risques du modèle actuel, nous pensons aussi qu’une bonne gestion de celui-ci, selon des procédures très claires – sur lesquelles nous donnons aujourd’hui aux régulateurs des gages et des informations –, permet de les limiter. In fine, ce sont les utilisateurs de nos notes qui vont juger de leur qualité et de notre indépendance.
M. le président Henri Emmanuelli. Pour moi, ce système ne reste rationnel que de façon relative.
Mme Carol Sirou. Toutes les grandes agences ont construit leur développement sur un modèle « investisseur-payeur ». Dans les années 1970, une demande de modification est apparue aux États-Unis à la suite de la faillite de la compagnie Penn Central. Les émetteurs ont alors compris l’intérêt de donner plus d’informations aux agences, d’être dans une situation de dialogue avec elles. Si bien que le modèle « investisseur-payeur », fondé sur des informations publiques, a été remplacé par le modèle actuel, qui se caractérise par un travail interactif entre l’émetteur et l’agence. Mais peut-être reviendrons-nous sur cette évolution, sachant qu’aux États-Unis, plusieurs sociétés travaillent selon le modèle « investisseur-payeur ». À l’heure actuelle, la diversité existe.
M. le président Henri Emmanuelli. Qu’en pense l’Union européenne ?
Mme Carol Sirou. Les autorités européennes viennent de lancer une consultation pour savoir si un autre modèle, plus robuste, permettrait d’éviter les conflits d’intérêts et d’offrir des notations de meilleure qualité.
M. le président Henri Emmanuelli. Madame, monsieur, je vous remercie.
L’audition s’achève à dix-neuf heures trente.
*
* *
Audition de M. Bernard Valluis,
expert de l'Association nationale des industries alimentaires (ANIA),
accompagné de Mme Diane Doré, chef de projet affaires européennes et échanges extérieurs, et de Mme Elsa Chantereau, responsable des relations institutionnelles
(Procès-verbal de la séance du mercredi 17 novembre 2010)
(Présidence de M. Henri Emmanuelli, président de la commission d’enquête)
La séance est ouverte à dix-neuf heures trente
M. le président Henri Emmanuelli. Monsieur Valluis, je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation.
Vous représentez l'Association nationale des industries alimentaires, l’ANIA, au sein de laquelle vous exercez des responsabilités, tout comme vous l’avez fait dans nombre d’organisations professionnelles du secteur des céréales.
Vous connaissez les objectifs de notre commission d’enquête et vous comprendrez que nous souhaitions que vous nous parliez des marchés des matières premières, d’autant que nous sommes depuis peu abreuvés de documents destinés à nous montrer que la spéculation n’a jamais fait monter les prix dans ce secteur.
(M. Bernard Valluis prête serment.)
M. Bernard Valluis, expert de l'Association nationale des industries alimentaires (ANIA). Je vais essayer de tordre le cou à cette idée qui ne reflète pas la position des industriels.
Les industries alimentaires que je représente ici sont un secteur important de l'économie française, avec pas moins de 140 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je suis moi-même président délégué de la meunerie, qui réalise un chiffre d'affaires entre 2 et 3 milliards, selon la valeur de ses produits sur les marchés.
M. le président Henri Emmanuelli. C’est donc vous qui faites monter le prix de la baguette…
M. Bernard Valluis. J’y reviendrai.
L’ANIA couvre un secteur qui compte pas moins de 10 000 entreprises, dont un grand nombre de PME, qui transforment 70 % des matières premières agricoles françaises. Il s'agit donc d'un élément très important de la filière agro-industrielle de notre pays.
Mon expertise se rapporte principalement au marché des produits agricoles issus des principales grandes cultures des zones tempérées, en particulier des céréales, mais j'ai aussi été amené à travailler sur d'autres produits et je pourrais, si vous le souhaitez, vous indiquer les particularités d’autres marchés.
On sait depuis fort longtemps, avec la loi de King, que de faibles variations de l'offre de production peuvent se traduire par des variations importantes de cours avec un rapport de puissance au carré, voire supérieur. En effet, la demande des produits est fortement inélastique par rapport aux prix, tandis que l'offre varie grandement en fonction des récoltes. À ce propos, deux éléments interviennent : d'abord, le prix des périodes précédentes, qui influe, selon un pas de temps annuel, sur les surfaces mises en œuvre par les producteurs ; ensuite, l’aléa climatique, qui fait que, les rendements n’étant pas assurés, les cours varient de façon extrêmement importante.
C'est pour ces raisons que ces produits ont été très tôt à l'origine de la création d'instruments d'arbitrage. Dans un monde incertain, il a fallu recourir à des outils, et les produits dérivés sont donc nés de la création de marchés organisés de produits agricoles pour lesquels il était essentiel de pouvoir conclure, au-delà des marchés physiques qui font l’objet de contrats à prix fermes et à livraisons différées, des contrats à terme.
Dès lors, ces opérations sont apparues attractives à des opérateurs qui n'ont rien à voir avec les marchés physiques, c'est-à-dire qui n'ont pas eux-mêmes vocation à livrer des produits ou à en prendre livraison, mais qui sont attirés par la possibilité d’un gain. Ce sont eux que l'on appelle, peut-être à tort et de manière péjorative, des spéculateurs.
Il faut toutefois souligner que tout le monde spécule sur ces marchés, notamment les producteurs et les industriels lorsqu'ils essaient d'anticiper un niveau de prix. Mais il est vrai que les motivations ne sont pas les mêmes : les opérateurs de l'économie réelle le font dans le cadre de projets économiques de production et de commercialisation, tandis que ceux qui n'ont pas vocation à intervenir sur le marché physique poursuivent des objectifs différents.
Ce qui est aujourd'hui en cause, c'est sans doute moins la spéculation en tant que telle que la spéculation excessive sur les matières premières agricoles, car on considère implicitement que l'intervention de ces opérateurs peut avoir des conséquences déstabilisatrices sur la formation des prix, laquelle doit, selon ce que l'on appelle les fondamentaux, être fondée sur les conditions d'approvisionnement, les disponibilités et les utilisations. On a coutume, sur le marché des céréales, d'analyser ces fondamentaux grâce à des bilans de produits qui font apparaître, d'une part, les stocks au début de chaque campagne, la production et les importations, et, d'autre part, les utilisations du marché intérieur, les exportations et les stocks en fin de campagne. Ce sont les variations de ces différents éléments qui déterminent les équilibres de marchés et c’est leur analyse qui conduit à un prix attendu.
M. le président Henri Emmanuelli. Procède-t-on à cette analyse par pays ou par continent ?
M. Bernard Valluis. Par pays, par région et au niveau mondial.
C’est lorsqu'il y a un écart important entre les prix attendus en fonction de ces modèles et les prix qui se forment réellement que l'on a l’indice d'une spéculation excessive. Mais il s'agit, selon moi, davantage d’une intuition que d'une preuve scientifique.
On trouve un autre indice dans l'augmentation de la volatilité des cours, c'est-à-dire la variation instantanée du prix rapportée à ce prix – en termes mathématiques, c’est la dérivée première. Et l'on a constaté ces dernières années, notamment pour les prix des matières premières agricoles sur le marché européen, dont on sait qu'il était précédemment particulièrement régulé, une forte augmentation de cette volatilité, qui est passée de 10 à 30, 40, voire 50 %. Depuis la flambée des prix de cet été, nous avons connu, dans la même journée, sur le marché intérieur, des variations de cotation du blé très difficiles à maîtriser, de l’ordre de 10 à 20 euros sur un prix à la tonne désormais supérieur à 200 euros.
M. le président Henri Emmanuelli. À quoi cela tient-il ?
M. Bernard Valluis. Je vais essayer de donner des explications.
Il faut tout d'abord s'attarder sur les fondamentaux des marchés physiques des produits agricoles, qui recèlent d'importantes variations potentielles de cours et résultent tous de l’évolution de politiques économiques.
Sur la base d'un consensus libéral, les préconisations économiques de l’OMC, du FMI et de la Banque mondiale ont eu sur les politiques nationales ainsi que sur la politique européenne des conséquences qui se sont en particulier traduites par le démantèlement des politiques agricoles : des aides versées directement aux producteurs s'étant substituées à un soutien direct aux prix. Ainsi, il n'y a plus aujourd'hui de prix garantis aux producteurs et, par voie de conséquence, il n'y a plus de constitution de stocks permettant aux pouvoirs publics d'intervenir sur les marchés par stockage ou par déstockage.
Par ailleurs, la libéralisation des échanges a entraîné pour les importations, outre la suppression ou la réduction des droits de douane, une diminution des protections même en cas de contingentement et, pour les exportations, un arrêt de la régulation par l'octroi de licences avec subventions à l'exportation. Dans ces conditions, le marché est devenu de plus en plus global.
Enfin, dans les pays importateurs, notamment dans le Maghreb, en Afrique et au Moyen-Orient, dans le cadre de l’application de la doctrine de libéralisation des économies chère au FMI et à la Banque mondiale, on a remis en cause les politiques de subventions à la consommation qui permettaient, à des agences publiques, de fournir des denrées à prix bas à l'ensemble de la population.
Ces politiques ont au total conduit à une forte globalisation des marchés des matières premières et à une variation potentielle bien plus importante de l'offre de produits, laquelle était jusque-là plus ou moins régulée par les politiques agricoles. C'est bien évidemment le cas des céréales, qui étaient le pivot de ces politiques. En revanche, pour les oléagineux et les protéagineux, la libéralisation étant intervenue dès les années soixante, on observe depuis longtemps de fortes variations de cours, en particulier du soja et des tourteaux de soja.
Voilà pour ce qui concerne les marchés physiques.
Une autre grande nouveauté tient au développement des marchés financiers relatifs aux matières premières, qui a accentué la fluctuation des cours. Les besoins d'arbitrage et de fixation des prix contractuels ont conduit les opérateurs des marchés physiques à recourir à des instruments. On a ainsi créé – avec quelques difficultés au demeurant au niveau européen – des marchés à terme. Les prix des produits cotés sur le marché de Paris – l’ancien MATIF désormais géré par Euronext –, c’est à dire essentiellement le colza, le maïs et le blé, mais aussi d'autres produits comme l’orge de brasserie, sont gérés avec des contrats à terme d’une durée maximale de 18 mois.
Les conditions dans lesquelles ces marchés ont été créés ont conduit à un grand laxisme tant en matière de transparence – on ignore ainsi quels sont les opérateurs qui interviennent sur ces marchés et quelles sont leurs positions – qu’en matière de possibilités de positions ouvertes – je rappelle qu’une position ouverte est un contrat en cours pour lequel chacun a pris une position d'achat ou de vente en ce qui concerne des contrats à terme ou des options. Il y a donc un véritable risque d'abus de position dominante, et les comités consultatifs d'experts d’Euronext ne sont pas parvenus pour l'instant à modifier les règles appliquées sur ces marchés, ce que seule pourrait permettre l'intervention des autorités de tutelle – Commission bancaire ou Autorité des marchés financiers.
M. le président Henri Emmanuelli. Que reprochez-vous exactement à ces règles ?
M. Bernard Valluis. Les marchés à terme ne limitent pas les positions des opérateurs, si ce n'est douze jours avant l'échéance de chaque contrat. Cela signifie que si l'on traite aujourd'hui un contrat du mois de janvier ou du mois de mars, le volume de l'intervention d'un opérateur n'est pas limité par rapport à l'ensemble de la position ouverte. La seule contrainte intervient dans les douze jours qui précèdent l'échéance de la cotation.
M. le président Henri Emmanuelli. L’opérateur est totalement libre, sans même un dépôt de garantie ?
M. Bernard Valluis. Il y a bien un dépôt de garantie, mais le risque d'abus de position dominante est réel. Et c'est très important car, dans le cadre de la financiarisation du système, cela permet à un opérateur qui ne relève pas du marché physique d'intervenir sans que les opérateurs de ce marché sachent sur quel volume.
Par comparaison, le marché de Chicago a des règles extrêmement strictes de publication hebdomadaire des positions ouvertes par catégorie d'opérateurs. Nous demandons que l'on procède de même en Europe. Industriels, producteurs et utilisateurs de ces marchés souhaitent que l'on définisse des catégories d'opérateurs sur les marchés des matières premières, comme cela se fait aux États-Unis, où l’on distingue les commercials, qui interviennent sur les marchés physiques, des swap dealers, qui vendent des produits à risque et qui sont soit des institutions financières, soit des opérateurs des marchés physiques déclarés en tant que tels, soit des fonds de placement comme les hedge funds, soit ceux qui sont définis comme les « autres opérateurs ».
Les gérants de marchés prétendent qu'ils ne peuvent faire de même, faute d'une définition normalisée à l'échelle européenne, mais aussi par absence des outils informatiques nécessaires – ce qui semble étonnant puisqu'ils sont capables de demander aux opérateurs la réduction de leurs positions douze jours avant le terme.
Un effort de moralisation et de transparence m’apparaît donc nécessaire.
M. le président Henri Emmanuelli. Une position ouverte est-elle prise à découvert ?
M. Bernard Valluis. On l’ignore puisqu'on ne connaît pas la position d’un opérateur, on sait simplement la position qu'il a prise sur le marché. On ne sait pas si, dans son propre portefeuille, sa position est une position de vente ou d'achat, et on ne connaît pas non plus le volume des affaires qu'il traite.
Voilà pour le marché régulé.
Un autre problème très important tient au développement exponentiel des produits dérivés traités de gré à gré, dits OTC, over the counter.
M. le président Henri Emmanuelli. Qui émet de tels produits ? Les banques ?
M. Bernard Valluis. Tout le monde.
En fait, les organismes collecteurs acheteurs de céréales vendent des contrats à terme à des agriculteurs, c'est-à-dire des produits dérivés qui leur garantissent un prix, moyennant le paiement d'une prime. Il s'agit donc d'options d'achat, que les producteurs mettent dans leur portefeuille, et qui, comme tous les produits de gré à gré, comportent un risque de contreparties. Pour leur part, les banques rachètent les risques des collecteurs ou des industriels ; ces derniers peuvent aussi avoir entre eux des relations de ce type. Surtout, l'ensemble des intervenants financiers, banques et fonds de placement, ont développé de manière assez considérable, pour l'ensemble des matières premières, en particulier agricoles, des portefeuilles de produits dérivés OTC qui se trouvent en dehors de la régulation des marchés à terme. Selon toutes les estimations, le volume total de ces produits est aujourd'hui très supérieur à celui des opérations traitées sur les marchés régulés.
Dans la mesure où il n'y a pas d'obligation de reporting, c'est-à-dire de déclaration de ces opérations, il est extrêmement difficile d'avancer des chiffres. Toutefois, l'organisation internationale des utilisateurs de produits dérivés, l’ISDA (International Swaps and Derivatives Association), considère que les positions réalisées sur des produits dérivés atteignaient, fin juin 2009, un total de 604 millions de milliards de dollars. Les opérations sur les matières premières ne représentent que 2,7 % de cette masse, ce qui équivaut tout de même à douze fois le PIB mondial. Aujourd'hui, la masse des produits dérivés sur les matières premières en général dépasse très largement le volume des matières premières traitées sur l'ensemble des places réglementées.
Les conclusions tant du FMI que de la Banque mondiale dans un rapport sur la crise 2006-2008, que du rapport technique présenté par l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières IOSCO (International organisation of securities commissions) pour les besoins du G20, montrent que la spéculation financière ne joue pas un rôle caractéristique sur les marchés des matières premières, en particulier celui du pétrole. Nous pouvons toutefois nourrir un doute sérieux à cet égard, ne serait-ce que parce que seuls sont pris en compte les éléments relatifs aux marchés qui font l'objet d'un reporting, la majeure partie de l'énorme iceberg échappant donc à l'analyse.
Je crois qu'un expert vous a déclaré que les fondamentaux formaient la vague des prix et que la spéculation n'en était que l'écume. Je pense pour ma part que la financiarisation est une immense marée qui porte cette vague. De fait, nous manquons cruellement d'informations quant à l'ensemble des produits traités de gré à gré.
M. le président Henri Emmanuelli. De quels produits s’agit-il exactement ? De warrants ?
M. Bernard Valluis. Ce sont des options, des produits complexes qui peuvent combiner des options d'achat et de vente, et pour lesquels les acheteurs ne voient pas le niveau du risque qu'ils courent. Il s'agit d'objets mathématiques assez complexes, qui bénéficient sans cesse d'innovations. Ils permettent de jouer de manière instantanée sur la volatilité des cours, et de façon extrêmement rentable à très court terme. Avec la financiarisation de ce marché, les banques et fonds de placement jouent avec des outils qui ne sont bien évidemment pas ceux qu'utilisent les opérateurs commerciaux des marchés de produits physiques.
M. le président Henri Emmanuelli. Comment cela fonctionne-t-il exactement ?
M. Bernard Valluis. Un opérateur qui vend par exemple un bateau de 25 000 tonnes de blé à l'Égypte réalise une opération d'achat sur le marché à terme puis un achat physique avec la revente des produits à terme. C'est une opération classique d'arbitrage, et le bateau, vendu selon un contrat international avec des clauses particulières, n'est pas ensuite revendu à de multiples reprises. C'est donc en amont que les opérations auxquelles j'ai fait référence se réalisent, sur les places financières mais aussi en dehors.
On voit également apparaître de nouvelles places de négociations les « multilateral trading facilities » sur lesquelles des institutions financières créent leurs propres marchés internes, sans obligation de rendre des comptes aux autorités de marché. On sait aussi comment se sont constitués des dark pools qui permettent de gérer des blocs de position : c’est le cas pour les fonds indiciels travaillant sur les matières premières.
M. le président Henri Emmanuelli. Qui garantit la bonne fin de ces opérations ?
M. Bernard Valluis. Personne.
Pour l'ensemble des marchés de gré à gré, il y a un risque très fort de contreparties. C'est ce qui est apparu avec la crise de 2008. Et si les matières premières agricoles n'ont pas encore été touchées, ce pourrait être le cas demain compte tenu des positions qui sont prises. Lorsqu'est intervenue la crise des subprimes, des positions avaient été prises sur des sous-jacents que tout le monde considérait comme croissants. De la même façon, chacun fait aujourd'hui l'analyse que les prix des matières premières agricoles vont continuer de s'apprécier et qu’il est donc possible de prendre des positions longues sur ces produits. Mais lorsque le sous-jacent décroche par rapport à l'espérance des opérateurs, un certain nombre de contreparties ne peuvent plus répondre aux engagements pris vis-à-vis des produits. C'est bien ce risque majeur de contreparties que présentent les produits OTC.
L'ensemble des organisations internationales sollicitées – OCDE, Banque mondiale, FMI ainsi qu'un certain nombre d'universités – ont conclu qu'il n'y avait pas de risque systémique sur les marchés des matières premières agricoles. Compte tenu de ce que je viens d'indiquer du développement des produits traités de gré à gré, je ne suis pas certain que l'on puisse dire de manière aussi catégorique qu’il n’y a pas à terme de risque systémique sur les marchés des matières premières, en particulier celui des matières premières agricoles. Il y a bien déjà eu des bulles sur le marché du pétrole ainsi que pour un certain nombre de produits minéraux. Je pense que, compte tenu des positions très importantes à l'importation, en particulier de la Chine, il peut y avoir demain un risque systémique majeur : si de gros opérateurs ne pouvaient plus faire face à leurs obligations, cela entraînerait des défaillances en chaîne, donc une crise. Le développement des produits OTC est porteur d’un certain nombre de risques, en particulier de risques de contreparties. Ces risques sont d'autant plus élevés que le marché est opaque : nous ne savons pas qui y est présent et nous ignorons les volumes des opérations traitées.
M. le président Henri Emmanuelli. Toutes les banques accèdent-elles à ces marchés ?
M. Bernard Valluis. Toutes les grandes banques mondiales, européennes et françaises disposent de « desks matières premières » qui traitent ces produits. Si l'on ignore les volumes traités, on peut au moins connaître les effectifs des traders qui ont pour mission de rechercher des gains sur les matières premières en jouant sur la volatilité des cours.
On trouve désormais sur les marchés des matières premières deux types d'opérateurs, dont les objectifs sont plutôt divergents : d'un côté, sur les marchés physiques, des opérateurs qui travaillent sur les prix afin de commercialiser ou de transformer des produits ; de l'autre, des opérateurs qui ne travaillent pas sur les prix mais sur la volatilité, quel que soit le prix.
Il est bien évident que tous les instruments que je vous ai décrits ont des effets majeurs sur les conditions de formation des prix. C'est donc à ce phénomène que l'on doit aujourd'hui s'attaquer lorsque l'on entend réguler les marchés des produits dérivés.
Pour les industriels, tout cela se traduit par une déstabilisation et une véritable perte de repères, la volatilité instantanée des cours ne leur permettant plus d'arbitrer les positions et les contrats dans des conditions normales au regard de l'horizon économique d'une entreprise.
Vous évoquiez tout à l'heure le prix de la baguette. Les meuniers transformateurs de blé éprouvent de grandes difficultés à couvrir leurs besoins en prenant des positions sur un marché où le prix de la tonne peut varier de 15 ou 20 euros en une journée. Dans ces conditions, avec le goulet d’étranglement qui existe au niveau de la grande distribution, les négociations entre la grande distribution et les industriels sont extrêmement difficiles, la première faisant référence au prix le plus bas et les seconds à celui auquel ils ont réellement couvert leurs opérations. Cela a toutefois peu d'effet sur le prix de la baguette – de l’ordre d’un centime pour une variation de 30 euros du prix de la tonne –, prix qui tient bien davantage – pour plus de la moitié du prix de revient – aux salaires. Les indices de l'INSEE montrent que les évolutions sont lissées et ne font pas apparaître le lien que vous avez évoqué entre l'organisation du marché et le prix du pain.
M. le président Henri Emmanuelli. Le président de la chambre des métiers de mon département, lui-même boulanger, m'a dit que la boulangerie était l’activité artisanale la plus rentable, et de loin !
M. Bernard Valluis. Nous attendons d’importantes modifications dans la régulation du marché, à partir des défauts constatés.
Nous regrettons que l'Autorité française des marchés financiers n'ait pas joué son rôle de régulateur au moment où sont intervenues de très fortes tensions sur les marchés des matières premières. Certes, assez peu de contrats sont traités à Paris, mais aucune suspension de cours n'y est intervenue comme celle qui a été décidée aux États-Unis le 5 août dernier. On n’y pratique pas non plus de limitation journalière des cotations et l’on n’intervient pas au regard des positions qui sont prises par les différents opérateurs.
M. le président Henri Emmanuelli. Le régulateur français peut-il véritablement intervenir sur ce marché ?
M. Bernard Valluis. Il exerce la tutelle sur les marchés gérés par New York Stock Exchange Euronext.
Nous n'avons pas non plus, au niveau européen, d'équivalent de la CFTC, la Commodity futures trading commission, qui est aux États-Unis l'organisme régulateur des marchés des matières premières sur le Chicago mercantile exchange.
Au mois d'août, des opérateurs qui étaient régulés sur le marché américain se sont reportés sur le marché français qui l’était beaucoup moins et sur lequel il demeurait donc possible de réaliser des opérations. Aux États-Unis, pour réduire les effets de la hausse, les cours ont été suspendus et les conditions de cotation ont été limitées. En revanche, sur le marché français, les variations de cours et la volatilité ont été extrêmement fortes.
Il m'apparaît donc que, dans le cadre de la constitution de l'autorité européenne des marchés, un mandat devra lui être donné pour contrôler et surveiller les marchés des matières premières, en tenant compte de leurs spécificités. On est pour l'instant un peu dans le vague, et il serait donc utile que les parlementaires français soient porteurs d'une certaine exigence en la matière, d'autant que cette autorité va coordonner les autorités nationales, dont le rôle va perdurer alors que le marché européen est désormais global.
Il faut aussi que l’AMF dispose d'un mandat de régulation plus puissant qu’à l’heure actuelle afin de pouvoir suivre, surveiller et contrôler les marchés, en ce qui concerne tant les éventuels abus de position dominante que les limitations de position.
Nous faisons, pour les marchés à terme gérés par Euronext, un certain nombre de suggestions en faveur d'une plus grande transparence. Il faudrait pour le moins publier chaque semaine, comme aux États-Unis, les positions ouvertes par catégorie d'opérateurs – ce qui nécessite de définir les opérateurs ; limiter les possibilités de variations journalières de cours, qui est l’un des éléments grâce auxquels la règle de marché peut s’appliquer ; poser des limites individuelles de position, ce qui, à la différence des États-Unis, n’est pas fait en France si ce n'est dans les douze jours qui précèdent le terme. En clair, il serait interdit de détenir plus d'un certain pourcentage de la position ouverte du marché.
M. le président Henri Emmanuelli. Quelle est la limite posée aux États-Unis ?
M. Bernard Valluis. Elle varie selon les marchés, mais elle est de l'ordre de 20 %. Si un opérateur présente une position ouverte trop importante, l'autorité des marchés peut le rappeler à l'ordre.
Il conviendrait également de poser des limites collectives par catégorie d'opérateurs, par exemple pour les opérateurs non commerciaux, qui n'ont pas vocation à intervenir sur les marchés physiques ; l'autorité ayant, en cas de dépassement, la possibilité de demander de réduire les positions au prorata des positions ouvertes de chacun des opérateurs individuels.
Ce sujet extrêmement important est en discussion dans le cadre de la préparation à Bruxelles de la directive MiFID (Marchés d'instruments financiers et services d'investissement), mais il n’emporte pas, bien sûr, l'assentiment de nombreux opérateurs financiers qui interviennent sur ces marchés.
M. le président Henri Emmanuelli. Qui sont-ils ?
M. Bernard Valluis. Les banques, les fonds indiciels et les fonds de placement.
Des propositions sont également faites pour les marchés des produits OTC. Aux États-Unis, la loi Dodd-Frank, qui a été promulguée en juillet dernier et qui sera appliquée à l'issue d'un délai de 180 jours, prévoit l'enregistrement systématique des opérations réalisées sur les produits dérivés dits standards, leur passage obligatoire par des chambres de compensation et une possibilité d'intervention pour les autorités de marché, grâce à la connaissance qu'elles ont des répertoires de ces opérations. J'observe que l’on ne traite là que des opérations relatives aux produits OTC standards, ce qui ouvre la voie à la non standardisation de produits traités de gré à gré, qui se distinguent soit par leur objet mathématique, soit par la date d’échéance.
M. le président Henri Emmanuelli. Pourriez-vous définir plus précisément ce que sont les produits dérivés ? Il me semblerait également utile que vous nous fassiez ultérieurement parvenir un certain nombre de descriptifs.
M. Bernard Valluis. Prenons un exemple très simple. Je vends une tonne de blé sur le marché à terme pour une livraison à l'échéance du 10 janvier. En raison d'un marché particulier avec un utilisateur, j'ai besoin que cette opération se réalise en fait le 25 janvier. Je demande donc à une banque de chiffrer les conditions dans lesquelles elle peut garantir, moyennant le paiement d'une prime, un tunnel, c'est-à-dire un prix minimum et un prix maximum, dans lequel je pourrai faire évoluer le prix d'acquisition à l'échéance du 25 janvier. Ainsi, mon produit, au lieu d'être le produit standard défini dans le marché, répondra à un cahier des charges particulier. Il sera donc un produit non standard, sa personnalisation m'empêchant de l’échanger avec un autre opérateur. Mais il est évident que lorsqu'une banque vend un tel produit à un opérateur en le personnalisant, elle prend immédiatement une position pour se couvrir elle-même, au motif qu'elle prend un risque lié aux deux périodes de terme. Elle va donc essayer de trouver sur les marchés de produits régulés ou de produits standards des éléments lui permettant de couvrir le risque qu'elle prend avec ce produit non standard vendu de gré à gré.
Des discussions sont en cours aux niveaux communautaire et international sur la définition des produits standards et des produits non standards. Aux États-Unis, la loi Dodd-Frank limite l'utilisation de ces derniers. En Europe, on envisage de les rendre plus coûteux. Quoi qu'il en soit, les industriels sont persuadés de la nécessité de décrire plus précisément ces produits. À l’heure actuelle, lorsqu'une banque vend un produit dérivé non standard, l’opérateur ignore les risques qu'il prend. Cela s’est produit pour le rachat des dettes de collectivités locales ; cela se passe fréquemment sur les marchés des matières premières – l’opérateur pense être bien couvert contre un risque de fluctuation relativement limité, alors que le risque est en fait illimité en raison de celui couru par le sous-jacent.
Nous souhaitons donc que toute commercialisation d'un nouveau produit, qu'il soit standard ou non, soit accompagnée, pour protéger l'acheteur, d'une notice descriptive. Outre que les acheteurs des produits de couverture seraient ainsi éclairés, cela présenterait pour l'émetteur de l’ensemble de ces produits l'avantage de décrire plus précisément les risques liés à la commercialisation de produits OTC non standards.
Ce mécanisme complexe est abordé dans les discussions d'experts autour de la directive MiFID, mais la clarification n'est pas encore intervenue parce que les opérateurs qui se sont échappés des marchés régulés vers les marchés de gré à gré ne manifestent guère d'enthousiasme pour cela.
M. le président Henri Emmanuelli. Les opérateurs ne peuvent tout de même pas faire n'importe quoi avec des produits qui donnent lieu à une livraison physique !
M. Bernard Valluis. Ce qui intéresse l'opérateur qui travaille avec les produits de gré à gré, c'est, d’une part, de commercialiser des outils de gestion de risque, et, d'autre part, de pouvoir jouer, dans le cadre de son portefeuille, sur un sous-jacent de produits de matières premières afin de dégager à très court terme des profits reposant sur la volatilité des cours. Il veut donc jouer sur les variations de cours et non sur le niveau de cours lui-même. Toute une série d'opérations sont ainsi réalisées à très court terme par des opérateurs dont le métier est par exemple de travailler sur des variations instantanées de prix dans des périodes extrêmement courtes à partir de tableaux qui font apparaître des seuils de résistance.
M. le président Henri Emmanuelli. Font-ils du HFT, du high frequency trading ?
M. Bernard Valluis. Bien sûr, alors que, pour leur part, les opérateurs sur les marchés physiques ne disposent en aucun cas des moyens pour intervenir à la vitesse extrême à laquelle les opérations sont réalisées sur les marchés à terme des matières premières agricoles à Paris ou à Londres. Le pas de temps des opérateurs physiques n'est absolument pas le même que celui des opérateurs financiers. C'est un élément très important de la financiarisation actuelle, qu'il conviendrait sans doute de réguler. Mais les matières premières agricoles ne sont probablement pas les seuls produits auxquels vous serez amenés à vous intéresser sur ce sujet.
M. le président Henri Emmanuelli. Pensez-vous que cette financiarisation suscite du ressentiment chez les producteurs ?
M. Bernard Valluis. Tout le monde est un peu déboussolé. Les producteurs sont, comme tout un chacun, tentés par l'achat de produits risqués pour garantir leurs prix à terme.
La voie la plus simple serait de recourir à des éléments de régulation à partir du marché physique. C'est toute la question de la politique agricole en Europe. Mais je ne suis pas certain que l'on revienne à des outils qui ont été abandonnés, principalement pour des raisons budgétaires. Nous avons proposé des solutions qui permettraient, en évitant l’écueil budgétaire, de réaliser des opérations de stabilisation des matières premières par un portage financier opéré par le secteur privé pour le compte des autorités publiques. Cela consisterait en une mise en pension, comme on sait le faire pour les titres, des stocks publics auprès d’opérateurs financiers. Ce système de stockage et de déstockage serait relativement neutre dans la mesure où la spéculation ne serait pas possible. Je le rappelle, en raison du coût des systèmes d’intervention, il n'y a plus aujourd'hui de stocks publics de céréales et d’oléo-protéagineux aux niveaux mondial et européen. Nous préconisons que l'on réfléchisse à un nouveau système de régulation physique, d'autant que les rapports Prada et Chevallier sur le pétrole ont montré, dans d'autres domaines, qu'il serait très difficile d'obtenir des effets importants par la seule régulation financière et qu'il faudrait aussi jouer sur les fondamentaux, c'est-à-dire passer par la régulation des marchés physiques. Nous partageons cette conclusion et nous préconisons la création d'outils tant à l'échelle nationale qu’aux échelles européenne et mondiale.
M. le président Henri Emmanuelli. On saura de la sorte où sont les accapareurs et les affameurs…
M. Bernard Valluis. Un système de portage financier permettrait en outre à des pays en développement importateurs de constituer leurs propres stocks, ce qui marquerait une évolution positive par rapport à la situation antérieure.
M. le président Henri Emmanuelli. À un moment donné la situation a été très tendue en Asie…
M. Bernard Valluis. Les échanges mondiaux de riz représentent moins de 7 % de l'ensemble de la production. Il n'existait pas jusqu'à présent de marché à terme mais simplement un marché physique et des marchés de gré à gré. On a toutefois observé l'an dernier la constitution d'un marché à terme en Chine, qui permet désormais de traiter des positions à terme et des produits dérivés sur le riz.
Pour le blé, nous avons vécu longtemps avec des stocks importants en Europe et aux États-Unis, tandis qu’en Australie et au Canada les stocks étaient gérés par des organismes en situation de quasi-monopole. Il n'y a plus aujourd'hui de tels outils permettant de garantir les approvisionnements, et les fondamentaux de ces marchés sont ainsi beaucoup plus vulnérables.
M. le président Henri Emmanuelli. Il n’y a plus d’Office du blé.
M. Bernard Valluis. J’aimerais savoir si vous avez pu réunir une documentation sur le rôle des produits dérivés OTC ? Même s'il n'y a pas véritablement de reporting, un certain nombre d'indicateurs permettent d'en analyser l'évolution.
M. le président Henri Emmanuelli. On nous a fourni quelques chiffres de la BRI, la Banque des règlements internationaux.
M. Bernard Valluis. La BRI procède en effet une évaluation, sur la base de ce que lui déclare l’ISDA l’International swaps and derivatives Association à partir de ce que ses membres veulent bien lui confier.
M. le président Henri Emmanuelli. J’ai de plus en plus le sentiment que tout le monde est en la matière dans le pot-au-noir.
M. Bernard Valluis. Dans la mesure où elles ne reposent que sur les seuls éléments statistiquement repérables et non sur tous les éléments du problème, on peut nourrir un doute quant à la validité des affirmations péremptoires de certaines organisations internationales et d’experts pour qui le rôle de la spéculation non commerciale sur les marchés de matières premières est neutre par rapport à la formation des prix.
On peut également s'interroger sur les risques systémiques que le développement de ces produits fait courir aux marchés des matières premières : même s'il n'y a pas eu jusqu'à présent de bulle significative emportant un risque de défaillance de grands organismes, ce risque n'en existe pas moins sur l'ensemble du paquet des matières premières. En effet, les fonds indiciels ne travaillent plus sur un seul produit mais ont constitué des paquets de produits.
M. le président Henri Emmanuelli. Il existe donc des paniers dans lesquels on trouve du blé mais aussi du gaz ?
M. Bernard Valluis. Absolument. Ainsi que du zinc, du pétrole ou des quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Quels que soient les fondamentaux, ces produits évoluent ensemble, ce qui a des effets préjudiciables dès lors qu'un des produits connaît une hausse. C'est un des éléments du risque systémique.
M. le président Henri Emmanuelli. Qui achète cela ?
M. Bernard Valluis. En fonction de l'idée qu'ils se font de l'évolution des cours, les différents opérateurs se trouvent des contreparties. Mais ce système a bien évidemment des conséquences par ricochet sur le marché physique – ce n’est pas comme jouer sur les devises ou sur les taux d'intérêt –, et c’est là où le risque existe pour l’ensemble des opérateurs, qu’ils soient producteurs ou utilisateurs. Il n’est donc pas possible d’affirmer aujourd’hui qu'il n’existe pas de risque systémique sur les matières premières agricoles.
M. le président Henri Emmanuelli. Au total, on peut donc considérer que l'arrivée d'opérateurs financiers attirés par la volatilité des prix entraîne des distorsions préjudiciables sur ces marchés.
M. Bernard Valluis. Il y a en effet une déstabilisation dans la formation des prix. Qui plus est, la très grande rapidité des variations de prix empêche les producteurs et les utilisateurs de jouer dans la même cour que des opérateurs autrement plus puissants.
Je reviens un instant aux définitions. Dans un contrat à terme, le risque pris sur le produit est directement proportionnel à l'évolution du sous-jacent. Une option d'achat ou de vente, moyennant le paiement d'une prime, constitue un produit dit « asymétrique » : il donne un droit à l’achat et à la vente mais, en fait, c'est le risque pris par rapport à l'évolution du cours qui est asymétrique par rapport à l'évolution du prix. On verse une prime pour être certain que l'on va acheter à un certain niveau de prix et pour ne pas courir le risque d'une augmentation de ce prix. Mais l’opérateur qui vend ce produit se trouve dans une situation inverse puisque pour lui le risque est illimité. C'est donc la construction même de cet objet mathématique qui le rend asymétrique et qui fait que ces produits ne peuvent être équilibrés au sein d'un portefeuille d'opérations.
Ces mécanismes sont bien expliqués dans les cours de finances, mais les produits que vendent les opérateurs financiers sont assez complexes, notamment en ce qu'ils combinent options d'achat et de vente.
M. le président Henri Emmanuelli. Qui sont exactement les concepteurs de ces produits ?
M. Bernard Valluis. Ce sont de bons mathématiciens, d'ailleurs souvent issus de l'école française, qui traitent en fait les matières premières comme n'importe quels actifs.
M. le président Henri Emmanuelli. Monsieur Valluis, merci beaucoup. Nous comptons que vous nous ferez parvenir un certain nombre de documents précis et chiffrés, ainsi que des exemples des produits dérivés que vous nous avez décrits.
L’audition s’achève à vingt heures trente cinq.
*
* *
Audition de M. Christian Noyer,
gouverneur de la Banque de France
(Procès-verbal de la séance du mercredi 24 novembre 2010)
(Présidence de M. Henri Emmanuelli, président de la commission d’enquête)
La séance est ouverte à dix-sept heures trente
M. le président Henri Emmanuelli. Nous accueillons M. Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France.
Monsieur le gouverneur, à propos de la crise financière, mais aussi de la crise des dettes souveraines, notre intention est non pas de dresser un réquisitoire contre la spéculation, mais de tenter de la comprendre en vue de mieux la contrôler. Cependant, le gigantisme qui caractérise désormais la sphère financière ne la place-t-elle pas de fait en dehors de tout contrôle ? Nous sommes intéressés également par votre opinion sur les CDS et sur ce high frequency trading assimilé par certains de nos interlocuteurs à un jeu de casino qu’il faudrait interdire.
Par ailleurs, le président du Conseil d’analyse économique, M. de Boissieu, a remarqué que les liquidités augmentaient de 15 % par an alors que la croissance n’était que de 4 %. Une telle distorsion a débouché non pas sur de l’inflation mais sur des bulles touchant les actifs comme l’immobilier ou les nouvelles technologies. Le régulateur monétaire a-t-il vu venir l’excès ? En a-t-il tiré des conclusions ? Le superviseur bancaire a-t-il aujourd'hui les moyens de contrôler les opérations de gré à gré – les OTC – ou même seulement de comprendre ce qui se passe sur les marchés financiers ?
(M. Christian Noyer prête serment.)
M. Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France. Je m’efforcerai de répondre aussi précisément que possible à vos questions, tout en rappelant qu’un banquier central est tenu à toujours mesurer son expression.
Sur la spéculation, ma vision ne s’écarte pas de celle qui vous a été exposée jusqu’à présent. La prise de positions ouvertes est nécessaire à la liquidité des marchés. En revanche, nous luttons contre les prises de positions directionnelles importantes, accompagnées en général de rumeurs propagées pour faire bouger les marchés dans le sens de l’intérêt de ceux qui détiennent lesdites positions. Ce type de comportement déstabilise les marchés, d’autant que la sophistication des techniques financières, le caractère mondial de ces marchés et la place prépondérante des activités non régulées ont rendu la prévention, la détection et la sanction plus difficiles. Cela ne signifie pas pour autant que la spéculation ait joué un rôle décisif dans les crises récentes.
Dans la crise des dettes souveraines grecque et irlandaise par exemple, des mécanismes de marché tout à fait normaux expliquent des accélérations brutales, au moment de l’annonce de tel ou tel événement. Les marchés se sont inquiétés à propos de la Grèce après la révélation que les chiffres communiqués n’étaient pas les bons. Immédiatement, les investisseurs, qui n’étaient pas nécessairement des spéculateurs, ont allégé leurs positions. De la même façon, le dernier épisode irlandais a débuté quand il s’est avéré que les difficultés du secteur bancaire de ce pays étaient plus grandes que prévu. Mais il n’est pas exclu que les mouvements aient été amplifiés par des opérations spéculatives utilisant des instruments sophistiqués comme les CDS, ou des ventes à découvert.
L’interdiction est-elle une solution ? Éventuellement, lorsque des opérations sont extraordinairement déstabilisantes et dangereuses, telles les ventes à découvert à nu pour lesquelles il n’existe pas de mécanisme de rappel. En période normale – je ne parle pas des périodes exceptionnelles où des restrictions temporaires sont envisageables –, les ventes à découvert sont utiles à la formation des prix et à la fluidité du marché. En revanche, lorsqu’elles se pratiquent à nu, du fait qu’elles ne connaissent aucune limite puisqu’il n’y a pas besoin d’emprunter le support de l’opération, elles autorisent des prises de position directionnelles très déstabilisantes pour les marchés sans améliorer la liquidité.
Les CDS sont des instruments de couverture. S’ils n’existaient pas, les mouvements se reporteraient sur le marché au comptant, dont les fluctuations s’amplifieraient encore. D’où leur utilité. Le plus gênant aujourd'hui, c’est de n’avoir aucune idée précise de la taille du marché, ni des prises de position nettes. L’un des problèmes rencontrés au moment de la chute de Lehman Brothers a été précisément l’accumulation de positions qu’on ne savait pas comment déboucler. C’est pourquoi l’une des leçons fondamentales de la crise, et partant l’une des réformes essentielles que nous avons entreprises au niveau mondial, c’est de pousser les opérateurs des marchés OTC, premièrement, à inscrire leurs opérations sur des registres pour permettre aux régulateurs, dans le cadre d’une bonne coopération mondiale, de suivre les positions ; deuxièmement, à passer par des chambres de compensation, là aussi pour mieux appréhender les positions, et, le cas échéant, procéder à des appels de marge si les positions accumulées devenaient dangereuses ou les décalages de prix trop importants.
En ce qui concerne la liquidité, nous avons conservé depuis l’origine de l’Eurosystème, c'est-à-dire depuis 1998, la panoplie de nos instruments concourant à la stratégie de politique monétaire. L’une des conclusions auxquelles nous étions arrivés était que la politique monétaire devait reposer sur deux piliers.
Le premier est l’analyse économique, qui dépasse le cadre des prévisions d’inflation calculées d’après les modèles car il faut considérer l’ensemble de la marche de l’économie pour assurer la stabilité des prix. Une économie qui tourne vite a besoin de taux d’intérêt plus élevés pour que la croissance reste équilibrée.
Le deuxième est le pilier monétaire. On a beaucoup critiqué le conservatisme de la France et de l’Allemagne, leur reprochant d’avoir continué à suivre la masse monétaire M3. Le suivi est en fait beaucoup plus sophistiqué que cela. Nous nous appuyons sur des enquêtes, auprès des entreprises pour mesurer leur trésorerie et leurs besoins de financement ; auprès des banques pour connaître leurs conditions sur les différents segments de l’offre de crédit et l’évolution des taux. Nous donnons une grande importance au crédit, ce qui a valu à la France de faire un peu office de pionnière dans le développement des instruments de suivi. Nous avons notamment distingué les crédits aux grandes entreprises susceptibles d’être remplacés par des financements de marché, les crédits aux PME, elles-mêmes subdivisées entre les filiales de groupes et les entreprises indépendantes, de façon à surveiller l’évolution des différents compartiments de crédit. Cette analyse fine nous a conduits parfois à prendre des mesures de politique monétaire que n’aurait pas justifiées la seule analyse économique. Nous avons ainsi amorcé un cycle de remontée des taux parce que nous estimions que la masse monétaire augmentait beaucoup trop vite et qu’à défaut d’intervenir, l’inflation ressurgirait dans les deux ans même si les prévisions économiques ne l’anticipaient pas.
La crise a conduit à un réexamen des instruments de politique monétaire dans le monde. Le gouverneur de la Banque d’Angleterre a notamment reconnu qu’il fallait mener une analyse monétaire au sens large, portant notamment sur le crédit. En effet, si une liquidité trop abondante ne se retrouve pas dans l’évolution des prix des biens et services à court terme, la demande se reporte sur les actifs, donnant naissance à des bulles qui se répercutent ensuite sur le prix des biens et services, ou bien éclatent au risque de provoquer un retournement du cycle économique qui peut mener à la déflation. Or la déflation n’est pas la stabilité des prix, et les banques centrales la combattent autant que l’inflation. Ce que nous avons fait n’était sans doute pas parfait, mais nous avons été confortés dans l’idée qu’il fallait persévérer dans l’analyse monétaire des excès de liquidité, en cherchant encore à la perfectionner.
Je suis très confiant dans notre capacité à surveiller le système bancaire. Il n’est pas possible de mettre un gendarme derrière chaque citoyen ni un contrôleur bancaire derrière chaque trader, et un accident peut toujours arriver. Cela étant, nous disposons d’un système de contrôle opérationnel et il est bon. Nous procédons actuellement à son renforcement parce que le Parlement et le Gouvernement nous ont confié des tâches supplémentaires et que la crise nous a montré qu’il nous fallait être encore plus efficaces. Le contrôle des assurances doit s’étoffer pour devenir un outil aussi puissant que celui opérant dans le domaine bancaire. Nous commençons à avoir de bons instruments de surveillance directe et indirecte, notamment des systèmes de contrôle interne des banques. Les moyens matériels et humains augmentent. Je pense d’ailleurs répondre au Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques chargé de suivre le coût des autorités administratives indépendantes que le temps n’est pas à sous-dimensionner nos moyens : la crise dont nous sortons a montré qu’il s’agissait d’un investissement utile, et même nécessaire.
M. le président Henri Emmanuelli. Quelles suggestions nous feriez-vous pour renforcer encore la sécurité du système financier ? Que pensez-vous de la réglementation européenne des marchés ? Quelle est l’exposition des banques françaises à la crise irlandaise ? Il faut certes sauver l’Irlande, et l’euro, mais qu’en est-il de notre système bancaire ? J’insiste d’autre part sur la nécessité de doter l’Autorité de contrôle prudentiel de moyens adéquats, une mathématicienne célèbre que nous avons auditionnée s’étant interrogée sur vos capacités en termes de compétences et de matériels à contrôler des pratiques comme le HFT. L’ACP est-elle en mesure de le faire ? Par ailleurs, n’y a-t-il pas des progrès à accomplir pour tout ce qui touche les marchés de matières premières ?
M. Jean-François Mancel, rapporteur. L’ampleur de la spéculation rapportée au PIB mondial et la part des marchés non régulés dans les transactions font l’objet d’estimations très variables. La Banque de France pourrait-elle fournir des chiffres plus précis ? Sur le deuxième point, les discussions au niveau international progressent-elles ? Que faut-il faire pour améliorer l’information sans laquelle il ne peut y avoir de régulation ? Les pays ont-ils en ce domaine des positions compatibles entre elles ?
Y a-t-il des produits dérivés, autres que les ventes à découvert à nu, qui s’apparenteraient à ce que l’on nomme par facilité « l’économie de casino » et dont on pourrait dès lors véritablement se passer ?
Un des experts que nous avons auditionnés, un banquier, je crois, nous a suggéré comme piste de réflexion un renforcement de la responsabilité des administrateurs de banque. Il préconisait de les mettre à cet égard sur le même plan que le président du conseil d’administration. Qu’en pensez-vous ?
M. Christian Noyer. En France et dans de nombreux états européens qui font des opérations assimilées à des opérations de crédit sont enregistrés, réglementés et surveillés ; les organismes de placement collectif aussi. Aux États-Unis, les crédits immobiliers étaient distribués par des courtiers, souvent non régulés, adossés à des financements provenant d’institutions qui étaient surveillées non pas par le régulateur bancaire, mais par l’autorité de marché, c'est-à-dire la Securities Exchange Commission, au seul titre des opérations de marché. Logiquement, la SEC ne se préoccupait que très peu de leur solvabilité. Ensuite, étaient émis les fameux Special Purpose Vehicles, qui étaient vendus au monde entier. Les acheteurs ont eu l’impression d’investir dans un placement estampillé par les autorités américaines alors que la chaîne de fabrication échappait largement à celles-ci. Un tel édifice n’aurait pas été possible en Europe à cause de la réglementation applicable, a fortiori en France qui a encore étendu le champ de la surveillance.
M. le président Henri Emmanuelli. Sous l’impulsion de la MIF, misant sur la concurrence pour faire baisser les prix, les dark pools se sont multipliées avec pour résultat d’augmenter le nombre de transactions pratiquées dans l’opacité la plus totale, sans faire baisser les prix.
M. Christian Noyer. Casser les marchés était en effet une erreur. Pour introduire de la concurrence, il suffisait d’autoriser les bourses à traiter les produits des unes et des autres, par exemple à la bourse allemande de traiter des produits français. La concurrence se serait exercée entre institutions réglementées, surveillées et relativement homogènes. La multiplication des dark pools était une erreur tragique et je souhaite que l’on remette de l’ordre.
M. le président Henri Emmanuelli. L’Europe peut-elle y arriver ?
M. Christian Noyer. M. Jouyet est plus compétent que moi pour vous répondre puisque c’est lui qui participe aux instances de décision. D’après les échos que j’ai, il semblerait que beaucoup commencent à comprendre le problème, mais il faut convaincre tout le monde. Le renforcement de la réglementation bancaire est plutôt bien engagé avec Bâle III, mais le problème reste la zone non réglementée. Il faut y voir plus clair dans ce que font les institutions non régulées. Il ne s’agit pas de réglementer les hedge funds au même degré que les banques puisqu’ils ne collectent pas de dépôts et que leurs clients sont conscients de prendre des risques, mais il faut davantage de transparence, plus de règles, une meilleure gouvernance et une limitation de l’effet de levier, au pire par le biais de la réglementation bancaire. Si les banques prêtent à un client dont le coefficient de levier dépasse un certain seuil, on exigera une charge en capital dissuasive.
En ce qui concerne les transactions hors institutionnels, oui, les choses avancent. Au sein du G7, qui réunit les pays où les chambres de compensation peuvent se développer, nous avons un accord de principe pour pousser la standardisation aussi loin que possible. Elle est la condition nécessaire pour créer un marché institutionnel et une chambre de compensation. Parmi les instruments concernés, figureraient certainement tous les CDS souverains. Et il faudrait inciter les intervenants à passer par les chambres de compensation. En tout état de cause, toutes les transactions sur dérivés devront obligatoirement être consignées dans des trade repositories, des registres de comptabilisation.
Aux États-Unis, les principes sont fixés, et les moyens en cours de discussion. En Europe aussi. Il existe un chantier commun avec le comité de Bâle pour exiger une charge en capital différente selon que les titres sont négociés en chambre de compensation ou non – passer par ces chambres coûte plus cher à cause des frais, des appels de marge, etc., mais, en contrepartie, la charge en capital serait moins forte. Pour les entités régulées, il y a bon espoir même si la tâche est compliquée du fait de l’absence, aux États-Unis, d’une institution fédérale chargée de la surveillance des compagnies d’assurance. Reste la fameuse question des fonds alternatifs non réglementés. En Europe, nous pourrons sans doute imposer certaines mesures, mais ce sera plus difficile ailleurs. De toute façon, il faut y aller et commencer par les banques.
Je n’ai pas de chiffres avec moi sur l’exposition des banques françaises au risque irlandais. Elle est assez limitée, et près de la moitié des débiteurs sont des acteurs de l’économie réelle. Certes, ils ne sont pas à l’abri, mais certaines entreprises irlandaises continuent d’être florissantes. De mémoire, la dette souveraine ne représentait que 10 à 15 % de l’exposition totale, mais elle a augmenté du fait de la substitution de l’État aux banques. Je vous ferai parvenir l’information.
Le trading à haute fréquence est difficile à contrôler. Il est pratiqué à une moindre échelle par les grandes institutions financières, du type grandes banques d’investissement spécialisées, qui ne se trouvent pas en France, mais surtout par des entités non régulées comme les hedge funds. Je partage les interrogations sur l’utilité sociale de cette activité. En revanche, j’en vois bien les risques, en particulier pour l’intégrité du marché. Cette technique aboutit à donner à des investisseurs une information privilégiée, ne serait-ce que pendant quelques microsecondes. Le HFT peut conduire à des prix faussés et à des risques opérationnels très importants. Je serais donc pour qu’on remette en cause cette pratique, dont le mini-krach du 6 mai a montré qu’elle pouvait être dangereuse. Il y a sûrement des moyens d’en limiter les effets, comme les coupe-circuits, mais si une pratique est contestable, inutile et dangereuse pour l’intégrité des marchés, la question de son existence mérite d’être posée. Cela étant, la balle est plutôt dans le camp des superviseurs de marchés.
Dans le domaine des matières premières, c’est avant tout au manque de transparence qu’il faut remédier, avant de décider éventuellement des réglementations particulières. Il nous est aujourd'hui impossible d’établir une relation claire entre les opérations des marchés dérivés, qui sont très mal connues, et le marché au comptant. Phénomène nouveau, et qui n’est pas critiquable en soi, certaines matières premières – l’or n’est pas seul en cause, il y a aussi le pétrole et même des denrées agricoles – sont devenues de véritables classes d’actifs, ce qui change considérablement l’équilibre du marché. Dès lors, le simple fait qu’une compagnie d’assurance-vie ou un fonds de pension décide de placer 5 % des actifs qu’il ou elle gère dans les matières premières, ou de s’en dégager partiellement, aura un impact sur les prix de marché. Les dérivés seuls ne sont pas à l’origine de la plus grande volatilité des marchés. Je me réjouis que la France ait décidé de mettre le sujet à l’ordre du jour du G20, car il faut défricher le terrain même si la tâche n’est pas simple.
En ce qui concerne l’ampleur de la spéculation, on doit pouvoir vous fournir quelques chiffres significatifs. Les hegde funds représentent 15 000 milliards de dollars d’actifs gérés. La somme est considérable mais mérite d’être mise en perspective sur une longue période.
M. le président Henri Emmanuelli. On nous a donné une fourchette, entre 600 000 et 700 000 milliards de dollars pour un PIB mondial de 60 000 milliards, autrement dit entre dix et douze années de PIB. Certes, il s’agit d’une addition contestable...
M. Christian Noyer. Tant qu’on n’aura ni enregistrement, ni suivi même rudimentaire, on ne saura pas grand-chose. Mais, à une telle échelle, il s’agit d’un risque systémique. Le moins que l’on puisse faire, c’est tenter d’y voir plus clair.
M. le président Henri Emmanuelli. Si cet ordre de grandeur se confirme, les décisions qui seront prises auront-elles une réelle portée ?
M. Christian Noyer. À cette question, les autorités répondent traditionnellement qu’il faut commencer par se focaliser sur les banques qui refinancent : en agissant sur le levier, on arrivera à mieux contrôler. Cela étant, cette réponse n’épuise pas nécessairement le sujet. Bâle III, en augmentant considérablement la charge en capital pour les opérations de marché ou pour les refinancements risqués, devrait freiner le mouvement. Mais il faut aller plus loin. Ce premier train de mesures ne nous dispense pas de réclamer plus d’information, pour pouvoir intervenir rapidement si nécessaire.
M. Louis Giscard d’Estaing. Pourriez-vous préciser, monsieur le gouverneur, ce qui relevait respectivement de la banque centrale irlandaise et de la Banque centrale européenne ou de l’Eurozone dans le contrôle des banques irlandaises ? D’autre part, ayant participé à la mission sur les autorités administratives indépendantes, je souhaiterais savoir si vous considérez que l’ACP a besoin de moyens supplémentaires.
M. Pierre-Alain Muet. En France, la banque centrale a toujours exercé la fonction de supervision du système bancaire mais ce n’est pas l’option initialement retenue par l’Europe et je le regrette. Comment se partagent les responsabilités entre les autorités surveillant les marchés financiers et la BCE, qui seule sait immédiatement où se situent les difficultés ?
Et comment faire pour que les banques fassent leur métier ? De façon assez perverse, et c’est ce qui a conduit à la crise, la titrisation leur a permis de se défausser de leur responsabilité de prêteurs. Des règles leur ont certes imposé de conserver une faible partie de ces prêts en compte, mais nous sommes loin du schéma traditionnel selon lequel le banquier portait le risque. Les quelques avancées enregistrées suffiront-elles à remédier à l’extrême fragilité de l’édifice financier ? Comment limiter la titrisation ?
M. Jean-Pierre Brard. Nous avons visité ce matin, avec la commission des finances du Sénat, la salle de marché de BNP-Paribas qui s’occupe des obligations. J’ai été frappé de voir que le système de décision n’était pas exclusivement hiérarchique. Plusieurs circuits étanches entrent en jeu de sorte que le chef doit composer avec des contre-pouvoirs internes avant de trancher. Le principe est a priori rassurant. Est-il appliqué dans les autres grandes banques ?
Vous avez laissé entendre, monsieur le gouverneur, que le système grec était sauvé. De nos discussions avec les traders ce matin, il ressort que l’orage menace toujours dans ce pays, mais aussi en Irlande et au Portugal. Les dispositions prises au niveau européen suffiront-elles, y compris au cas où les cataclysmes s’additionneraient ?
M. Christian Noyer. Il faut en effet distinguer la fonction de supervision et celle de banque centrale. En Irlande, l’autorité de supervision était théoriquement adossée à la Banque centrale nationale irlandaise (BCN), mais en fait, la cloison entre les deux était assez étanche. Tirant les leçons de la crise et des graves défauts de ce modèle, l’Irlande a décidé de rétablir un adossement clair et une seule entité juridique comme en France. Dans ces conditions, il est difficile de démêler l’écheveau des responsabilités. Cependant, désormais, les choses sont claires.
Au niveau global, c’est le Conseil européen du risque systémique qui devra analyser les risques d’ensemble. C’est une instance nouvelle et les Américains mettent l’équivalent en place. L’idée est de déceler les évolutions anormales, de les signaler aux autorités nationales, voire de leur suggérer les mesures à prendre. C’est un enjeu capital.
Dans le cas irlandais, la distribution du crédit immobilier était de type anglo-saxon. Chez nous, le crédit immobilier a toujours été accordé en fonction de la capacité de remboursement, et non de la valeur du bien financé. En Irlande et au Royaume-Uni, la situation était cependant un peu moins outrée qu’aux États-Unis où, avec les crédits subprime, même le paiement des intérêts était reporté, l’augmentation du prix des actifs étant censée permettre à la fois de couvrir le coût du crédit et de dégager une plus-value au moment de la revente. Ces opérations without recourse sont inconnues chez nous. Voilà le type de réglementation nationale qu’il faut modifier pour éviter les excès. Dans ce cas de figure, la BCE ne peut pas intervenir directement, mais le Conseil européen du risque systémique pourra demander au gouvernement concerné d’intervenir ou au Comité de Bâle d’adapter ses propres règles.
Le refinancement de l’ensemble du système bancaire européen est assuré par l’Eurosystème, c'est-à-dire par la Banque centrale européenne et par les banques centrales nationales qui sont ses agents dans les pays membres de la zone euro – on parle de la seule BCE par simplification. Les prêts aux banques irlandaises passent par la banque centrale irlandaise, même si le processus est entièrement maîtrisé au niveau de la BCE qui suit les refinancements banque par banque, et pays par pays. Lorsqu’une banque ne peut plus emprunter dans le cadre des opérations de politique monétaire faute des garanties requises en contrepartie, il existe la procédure d’assistance de liquidité d’urgence. C’est la banque centrale nationale qui intervient, sous le contrôle de la BCE et, au-delà de certains montants, avec son feu vert. Le conseil des gouverneurs est informé régulièrement.
Au plus fort de la crise, plusieurs pays ont recouru à ce dispositif. La banque nationale décide puisque c’est elle qui supporte le risque, mais, comme la liquidité et l’équilibre du système sont affectés, l’opération se fait sous le contrôle du conseil des gouverneurs de la BCE.
En ce qui concerne les moyens de l’ACP, la montée en puissance se poursuit pour parvenir à un contrôle plus robuste dans le domaine des assurances et pour assumer la mission nouvelle confiée par l’État – la surveillance de la commercialisation des produits financiers. Cependant, comme l’ACP reste dans le giron de la Banque de France, nous ne demanderons aucun financement à l’État. Le Parlement a en effet prévu que nous puissions percevoir des frais de contrôle auprès des établissements contrôlés, et, le cas échéant, la Banque de France complétera. Mais, surtout, que le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques ne demande pas de faire des économies dans ce secteur !
M. le président Henri Emmanuelli. L’intention n’est sans doute pas celle-là. Il s’agissait bien plutôt de savoir si vous n’auriez pas besoin de moyens supplémentaires.
M. Christian Noyer. La difficulté est plutôt de trouver les ressources humaines, en quantité et en qualité. La petite équipe de mathématiciens de haut niveau qu’avait la Commission bancaire doit être encore renforcée. À cet égard, l’apport de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est précieux puisque, grâce à elle, nous avons récupéré des polytechniciens, des ingénieurs et des normaliens de grand talent. Cela étant, les effectifs devront être accrus.
Monsieur Muet, je pense comme vous que le métier de banque consiste avant tout à suivre les risques et que la titrisation est allée beaucoup trop loin. Faute d’investisseurs, les marchés sont revenus à la raison. Pour éviter que la situation ne redevienne dangereuse, il faut porter une attention accrue aux produits qui sont fabriqués. Le danger guette quand les produits rassemblent des actifs sans lien les uns avec les autres, et si complexes – du type dérivés de dérivés – que personne n’y comprend plus rien. En cas d’accident de marché, la panique s’installe. Comme il faut très longtemps avant d’évaluer les pertes, les ventes s’accélèrent.
M. le président Henri Emmanuelli. À quoi riment des dérivés sur indices boursiers ?
M. Christian Noyer. Si le produit est simple, il permet de réduire l’exposition de son portefeuille à l’évolution des cours de bourse, sans avoir à s’en débarrasser. Par exemple, si un gérant de SICAV désire réduire son exposition à l’indice CAC 40 pour investir dans les produits de taux ou en obligations, plutôt que vendre 5 % du portefeuille, il achètera des dérivés de taux de façon à modifier la sensibilité globale de son portefeuille. Les dérivés sur indices ont un intérêt pour les gestionnaires à condition qu’ils soient simples.
Monsieur Brard, oui, nous allons visiter les banques, avec la ferme intention de veiller à ce qu’il y existe des chaînes de contrôle croisé et, outre un contrôle hiérarchique, une surveillance à plusieurs niveaux. Derrière le front office où opèrent les traders, se trouvent successivement le middle office, qui contrôle les positions, et le back office qui dépouille la totalité des ordres pour vérifier que toutes les opérations sont enregistrées et les limites fixées par les instances de direction de la banque respectées. Après l’affaire Kerviel, nous avons obligé les banques à mettre en place des alertes à différents niveaux, y compris la direction générale, le conseil d’administration et le régulateur lui-même. Là encore, nous veillons à ce qu’il en soit partout ainsi et, lorsque nous détectons une défaillance, nous la faisons corriger séance tenante. Ce que vous avez vu à la BNP, nous l’exigeons de tout le monde.
La crise grecque a été déclenchée par la révélation que les déficits et la dette publics étaient beaucoup plus importants que prévu. Beaucoup d’opérateurs de marché en ont conclu que la Grèce serait incapable de s’en sortir seule et ils se sont méfiés. Notre action concertée de rachat de titres a empêché les taux d’atteindre des niveaux sans rapport avec les risques eux-mêmes. Nous sommes intervenus sur le marché secondaire parce que le mécanisme de transmission de la politique monétaire ne fonctionnait plus. Les taux d’intérêt sur la dette grecque montaient à des niveaux stratosphériques sous l’effet d’une défiance généralisée. Les banques grecques subissaient les mêmes variations sur leurs conditions de refinancement, qui se répercutaient sur les taux des crédits qu’elles proposaient.
Aussi bas qu’aient été les taux de la BCE, ils n’empêchaient pas les taux de refinancement de l’économie grecque de s’envoler à 20, 30 ou 50 %, si bien qu’il n’y avait plus de politique monétaire européenne en Grèce. Or la Grèce fait partie de la zone euro. C’est ce constat qui a fini par emporter l’adhésion du conseil des gouverneurs. Nous avons donc calmé le jeu provisoirement mais ce sont les États qui peuvent stabiliser durablement le marché. Le plus important a été fait par eux, avec la mise en place du Fonds de stabilisation, et par le FMI.
Je ne partage pas du tout l’opinion des traders que vous avez rencontrés, monsieur Brard. Selon le raisonnement traditionnel du FMI, quand un pays est confronté à des difficultés, il faut prendre des mesures de politique économique pour corriger la trajectoire, c'est-à-dire réduire le déficit budgétaire et renforcer la compétitivité de l’économie. D’où la conditionnalité de ses interventions. Il faut ensuite faire en sorte que le pays n’ait pas recours aux marchés, le temps que ses efforts portent leurs fruits et que son économie reparte en sorte qu’il soit ensuite capable d’honorer ses engagements. Ce n’est qu’après que, la confiance retrouvée, le refinancement normal par obligations d’État pourra reprendre. C’est pour cette raison qu’un programme du FMI s’étale toujours sur deux ou trois ans, parfois davantage. Indépendamment du jugement que l’on porte sur l’Union européenne, il n’y a pas de raison d’avoir moins confiance dans le FMI quand il intervient en Grèce que lorsqu’il intervient – avec succès – en Corée du Sud ou au Mexique.
Je combats fermement l’idée d’un enchaînement de cataclysmes car chaque pays est un cas particulier. En Irlande, le secteur bancaire qui avait été presque entièrement garanti par l’État a perdu l’équivalent de 20 points de PIB, ce qui, d’un coup, a fait gonfler d’autant la dette publique, sans compter les effets de la crise. Tout cela rendait inévitable une aide extérieure et c’est ce qui explique la réaction des marchés. Cela étant, je rappelle que, dans les années qui ont précédé la création de l’euro et jusqu’au déclenchement de la crise, l’Irlande a fait baisser son taux d’endettement public de 120 à 40 % du PIB. Elle a fait la preuve qu’elle pouvait suivre une politique budgétaire rigoureuse. Certes la conjoncture était différente, mais j’espère que le contribuable rentrera dans ses frais.
Mme Françoise Branget. Monsieur le gouverneur, vous conseillez à juste titre de proscrire les produits dérivés trop sophistiqués. Mais que faire de ceux qui sont encore en circulation ? Par ailleurs, dans la zone euro, ce sont les taux d’intérêt qui ont servi à limiter l’inflation. Les choix n’ont pas été partout les mêmes et d’autres pays affichaient des taux d’intérêt moins élevés, d’où une distorsion durable. Que pensez-vous des émissions d’obligations à taux négatif lancées aux États-Unis ?
Mme Arlette Grosskost. Le Fonds européen de stabilisation viendra à échéance en 2013. Que se passera-t-il ensuite ? Pouvez-vous, monsieur le gouverneur, nous assurer que le contrôle prudentiel est d’égale qualité dans toutes les banques, qu’elles soient publiques ou privées ?
M. Christian Noyer. Le stock de produits très sophistiqués circule peu. Rares sont les investisseurs finaux qui se risquent à les acheter. Certains sont dans des portefeuilles et ils ont été déclassés. D’autres ont été repris par les banques qui n’ont pas voulu laisser leurs OPCVM afficher des performances désastreuses. Nous avons été assez stricts sur les règles de provisionnement pour éviter de nouvelles déconvenues. Enfin, certains ont été repris par des hedge funds qui spéculent dessus – et qui ont assez souvent enregistré des pertes. Éviter une nouvelle crise doit être notre préoccupation, et il est clair que les choses se passeront d’autant mieux à l’avenir qu’on aura interdit ces produits opaques ou empêché leur utilisation.
Parmi les réformes importantes, il y a la décision américaine de placer les banques d’investissement, qu’elles soient adossées ou non à des grands groupes bancaires universels, sous la surveillance de la Fed, qui est un superviseur rigoureux.
Il faut savoir que, dans chaque pays, la politique monétaire cherche à s’adapter à la réalité économique nationale. Que certaines banques centrales se soient moins préoccupées des liquidités a pu les conduire à mener une politique monétaire plus accommodante qu’elle n’aurait dû être, à leur jugement d’aujourd’hui. La courbe très aplatie des taux n’est pas le fait des seules banques centrales. Les très importants déséquilibres de balance des paiements, notamment entre les États-Unis et la Chine, ont conduit à une accumulation de réserves de change dans les pays excédentaires. Ils les ont ensuite placées en bons du Trésor américain, contribuant ainsi à déprimer les taux à long terme aux États-Unis. Les investisseurs privés, trouvant les rendements insuffisants, se sont détournés des obligations d’État au profit de produits plus risqués, qui se sont développés avec les conséquences que l’on connaît. C’est cet enchaînement qui a fait dire au G20 que les déséquilibres mondiaux étaient en eux-mêmes un risque pour la stabilité financière mondiale, d’où la nécessité de les réduire et de les contrôler.
Aujourd'hui, le souci de la Fed, c’est l’économie réelle américaine. Elle cherche à faire redémarrer la demande interne, en particulier la demande de logement, en contribuant à stabiliser les prix et à faciliter la distribution de crédit. Le danger d’une spirale déflationniste aux États-Unis, où le marché est plus flexible, est plus grand qu’en Europe où, à quelques rares exceptions près, les salaires et les prix ne baissent pas. La Fed n’a pas du tout pour objectif de relancer l’inflation, elle veut revenir à son objectif de stabilité des prix, qui est pratiquement celui de la BCE – un peu moins de 2 %.
La question de Mme Grosskost sur le Fonds européen de stabilisation me permet de revenir un instant sur la spécificité de chaque cas en Europe. Aucun autre État que la Grèce n’a commis de telles erreurs sur le niveau des déficits et de telles défaillances dans le reporting à l’Union européenne. L’Espagne n’est pas l’Irlande car ses banques ont été bien gérées, bien capitalisées, et surtout bien provisionnées grâce au système de provisionnement dynamique mis en place par la Banque d’Espagne. Et c’est l’une des grandes leçons de la crise. Il faut modifier certaines règles comptables de façon à mieux prendre en compte les pertes attendues sur le cycle. Il vaudrait mieux provisionner de façon anticipée, sans attendre l’accident. Les caisses d’épargne ont des difficultés mais l’État est intervenu et le problème a été traité même si l’organisation administrative décentralisée a compliqué le processus. Le Portugal est encore un cas différent. L’idée de la contagion automatique ne me semble reposer sur rien ; c’est un effet de mode.
Quant au contrôle prudentiel, je tiens à vous rassurer. Toutes les banques, toutes les compagnies d’assurance et toutes les mutuelles sont contrôlées. Le contrôle s’exerce à la fois sur pièces et sur place. Dans le second cas, les petits établissements sont contrôlés en totalité, et, dans les grands, nous menons des inspections thématiques ou sectorielles. Nous allons chaque année dans toutes les grandes banques pour examiner telle ou telle activité. Nous nous attachons également à vérifier la qualité du contrôle interne. Si nous avons la preuve que l’inspection interne travaille bien dans un secteur, nous pouvons avoir un préjugé favorable pour le reste de son activité. À la Société Générale, nous avions ainsi vérifié sur une ligne de produit que ses recommandations sur le « doublonnage » des contrôles de sécurité avaient bien été mises en œuvre. Malheureusement pas dans le département où travaillait M. Kerviel et où elles ne l’avaient pas été.
M. le président Henri Emmanuelli. Monsieur le gouverneur, nous vous remercions.
L’audition s’achève à dix huit heures cinquante.
*
* *
Audition de M. Dominique Cerutti,
directeur général de NYSE-Euronext,
accompagné de M. Fabrice Péresse,
directeur des opérations de marché de NYSE-Euronext.
(Procès-verbal de la séance du mercredi 24 novembre 2010)
(Présidence de M. Henri Emmanuelli, président de la commission d’enquête)
La séance est ouverte à dix-huit heures cinquante
M. le président Henri Emmanuelli. Nous vous remercions, monsieur Cerutti, d’avoir répondu à l’invitation de notre commission d’enquête. Après avoir travaillé pendant vingt-deux ans chez IBM, vous êtes devenu le directeur général de NYSE-Euronext et responsable de la zone Europe.
Nous privilégierons avec vous une approche concrète de la crise et de la spéculation. Des informations que nous avons déjà obtenues, il ressort que la directive MIF a eu des effets négatifs en faisant éclater les marchés, et que les opérateurs historiques des bourses eux-mêmes se seraient dotés de dark pools, qui font pourtant l’unanimité contre elles. Pourrez-vous nous expliquer ce paradoxe ? D’aucuns s’inquiètent des effets de la fusion entre le New York Stock Exchange et Euronext, en particulier du transfert de votre carnet d’ordres à Londres. Quelles sont les conséquences de cette décision pour le régulateur français ? Par ailleurs, n’hésitez pas à nous faire toutes les suggestions que vous jugerez utiles et à nous donner votre avis sur les sujets qui vous préoccupent ainsi que, éventuellement, sur les produits qui se négocient par votre intermédiaire.
(M. Dominique Cerruti prête serment.)
M. Dominique Cerruti, directeur général de NYSE-Euronext. Une précision d’emblée, monsieur le président. Je suis patron de la branche européenne et, avant toute chose, numéro deux du groupe au niveau mondial. À la place qui est la mienne, je vous affirme qu’il n’y a pas de dichotomie entre NYSE et Euronext, et que nous ne considérons pas que la partie européenne du groupe soit sous le joug des Américains.
Issu de la fusion en 2007 du New York Stock Exchange – la plus grosse bourse de valeurs américaine – et d’Euronext qui réunissait les bourses de Paris, de Lisbonne, de Bruxelles, d’Amsterdam et celle des dérivés de Londres – le LIFFE –, NYSE-Euronext est le premier groupe boursier et le plus diversifié puisque nous sommes, et de loin, le premier opérateur pour les actions au comptant et la deuxième ou troisième bourse transparente pour les dérivés. Nous exploitons également des technologies sophistiquées pour notre compte et pour d’autres partenaires car l’univers des bourses s’est considérablement automatisé ces dernières années. Notre entreprise est cotée sur nos propres marchés à New York et à Paris.
M. le président Henri Emmanuelli. Et comment se comporte le titre ?
M. Dominique Cerruti. Nous avons fait beaucoup d’efforts et nous nous portons bien dans un univers devenu concurrentiel de façon excessivement brutale. Certes, le souci de mettre fin aux monopoles, aux États-Unis avec la loi « Reg NMS » – pour Regulation National Market System – puis en Europe avec la directive MiFID, procédait d’intentions louables, mais la mise en œuvre a été d’une rapidité et d’une brutalité telles que nous avons dû nous adapter à un train d’enfer. Reste que nous en retirons les fruits aujourd'hui.
Les crises, depuis que le monde est monde, résultent certes toujours d’une suite de dérives macroéconomiques, de la prise de risques insensés, mais avant tout de la cupidité humaine. La première crise de l’histoire moderne remonte à 1637. Elle est connue sous le nom de crise des tulipes parce que des milliers de familles hollandaises avaient investi leur fortune dans ces bulbes. Le cours a atteint vingt ou trente fois le salaire d’un artisan spécialisé avant de s’effondrer, entraînant la ruine de générations d’épargnants et d’investisseurs.
Accumulation excessive de dérives macroéconomiques, investissements excessivement risqués consentis dans l’espoir d’un rendement toujours plus élevé et financés en jouant sur l’effet de levier : le retour de ce qui fut à l’origine du krach de 1929 comme des bulles immobilières ne peut être exclu et il serait très présomptueux d’affirmer qu’aucune crise ne surviendra plus. Il faudrait plutôt se préparer à la suivante en cherchant comment détecter les prises de risque excessives et le moment où l’innovation se déconnecte de l’économie, et en essayant de localiser les risques. L’innovation est le produit de l’imagination d’une centaine de forts en thème et il est très difficile aux régulateurs nationaux de comprendre, d’anticiper le risque qui en découle. Cela exigerait de leur part une coordination internationale sans précédent et des moyens bien plus importants que ceux dont ils disposent aujourd’hui – des moyens au moins équivalents à ceux des grandes banques qu’ils doivent surveiller. La première priorité consiste donc à les en doter.
La deuxième est de prendre des dispositions pour que les effets de la crise soient aussi minimes que possible. En ce qui nous concerne, nous devons faire en sorte que les marchés financiers, qui sont un des poumons de l’économie, soient de plus en plus transparents pour les régulateurs, et résilients, alors qu’ils sont, en réalité, de plus en plus opaques et fragmentés, autrement dit de moins en moins capables d’amortir une secousse. J’insiste sur le fait que NYSE-Euronext est un marché transparent et régulé, qu’elle travaille main dans la main avec les régulateurs. Je suis accompagné de Fabrice Peresse, qui dirige les opérations de surveillance sur nos marchés. Il est français et basé à Paris où est installée notre équipe de surveillance de tous les marchés au comptant. C’est lui qui s’assure que les marchés sont efficaces, et surtout intègres, et qui détecte les anomalies de toute nature – erreur d’un opérateur ou abus de marché. Il les signale au régulateur concerné, avant d’enquêter pour savoir ce qui s’est passé et ce qu’il y a lieu de faire.
Les promoteurs de MiFID entendaient, dans un contexte de croissance, casser les monopoles afin d’abaisser le coût du capital pour les entreprises tout en protégeant les investisseurs. Paradoxalement, en deux ans et demi, au lieu de diminuer, l’opacité a quasi doublé. Toutes les études convergent. Sur le marché des actions, elle dépasse 40 % ; sur celui des dérivés, elle atteint 85 % ; sur celui des obligations 95 % ; et, sur le marché des changes, elle est proche de 100 %. Or il n’y a aucune raison pour que l’opacité prévale sur le marché des actions, ou des obligations. Christine Lagarde a d’ailleurs pris l’initiative de créer une plate-forme obligataire transparente pour pousser les émetteurs français à émettre en France et éviter, comme cela s’est passé au moment de la crise, que, faute de liquidité, les titres ne puissent même plus être valorisés. On ne savait même pas qui devait animer le marché.
L’opacité a gagné trois activités distinctes. La première est l’activité de gré à gré, qui a toujours existé, mais qui, dans l’esprit des autorités européennes, devait rester irrégulière ad hoc, c'est-à-dire réservée à la négociation de produits très spécifiques. Elle a pourtant augmenté passant de 26 % à 40 %. La deuxième activité, qui était à l’origine la raison d’être des dark pools – dénomination très malheureuse – est la négociation de blocs de titres, ou block trading, qui est destinée à protéger l’investissement. En effet, la vente ou l’annonce de la vente d’un très grand nombre d’actions risquant de peser sur les prix, il est sain de préserver une relative discrétion. Mais à coup d’exemptions, appelées waivers dans le jargon bruxellois, les dark pools ont dévoyé une règle pourtant utile et se sont mises progressivement à traiter de petits ordres, comparables à ceux d’un investisseur individuel. Or l’investisseur modeste n’a pas intérêt à voir ses ordres traités par un opérateur opaque, et appariés avec ceux d’un professionnel, ou même d’un teneur de marché, car il ne fait pas le poids. Pour protéger ces petits investisseurs, la transparence est la seule solution car elle assure la confrontation de l’offre et de la demande au sein d’un carnet d’ordres unique, qui garantit le bon prix.
La troisième activité touchée par l’opacité concerne les concurrents des opérateurs historiques, à qui MiFID offrait le choix entre trois statuts : celui de marché régulé ; celui de plate-forme alternative, autrement appelée Multilateral Trading Facility, ou MTF, également transparente ; et enfin celui de systematic internaliser, autorisé à rapatrier en interne la négociation des ordres et à les traiter hors marché en contrepartie d’une obligation de reporting et de transparence auprès du régulateur. La plupart des institutions financières ont commencé par opter pour ce dernier statut, mais ont fini presque toutes par l’abandonner pour adopter une formule que MiFID n’avait ni prévue ni autorisée, celle des crossing networks – de simples réseaux d’appariement des ordres, qui sont dispensés des contraintes de transparence. Or ces plateformes tendent à se multiplier.
L’opacité, limitée au départ à 26 % des transactions, dépasse donc désormais 40 % du volume des actions échangées en Europe, soit environ 32 milliards d’euros en moyenne chaque jour. Ce pourcentage augmente et échappe au regard des régulateurs. Ces 40 % se ventilent entre une part prépondérante pour le gré à gré, les dark pools qui captent maintenant des petits ordres et comptent pour 7 % à 8 %, et les crossing networks qui traitent 10 % des volumes hors marché, soit 4 % du total des transactions.
M. le président Henri Emmanuelli. Qui se cache derrière les crossing networks ?
M. Dominique Cerruti. Des banques, exclusivement, surtout anglo-saxonnes. Les banques françaises n’ont fait que leur emboîter le pas.
Pourquoi faut-il lutter contre l’opacité ? Tout simplement parce qu’elle ruine le mécanisme fondamental en économie de marché qui est la découverte du prix. C’est la confrontation de l’offre et de la demande en un lieu unique qui donne en permanence le juste prix, gage de l’efficience des marchés. Si le carnet d’ordres se vide de sa substance parce que l’opacité gagne, cette confrontation donnera des résultats de moins en moins pertinents.
M. le président Henri Emmanuelli. Constatez-vous des distorsions entre les prix des marchés transparents et les autres ?
M. Dominique Cerruti. Oui, d’autant que les marchés transparents eux-mêmes ont été fragmentés, ce qui a favorisé le High Frequency Trading, le HFT – je vais y venir. On ne sait pas ce qui se passe sur les marchés opaques. Les régulateurs font tout ce qu’ils peuvent pour obtenir l’information, au moins a posteriori, mais le mieux serait de faire revenir les flux sur les marchés classiques. En mon âme et conscience, je considère qu’il n’y a aucune raison pour tolérer 40 % d’opacité sur le marché des actions. Pourtant, quand mes équipes, des sociétés de bourse ou même des universitaires se sont exprimés sur le sujet, ils ont rencontré des résistances d’arrière-garde qui persistaient à nier la réalité ; jusqu’à ce que, récemment, une des commissions du Parlement européen valide les chiffres. L’ampleur du phénomène étant reconnue, MiFID II pourra y remédier.
M. Jean-François Mancel, rapporteur. Si, comme vous le dites, l’opacité n’a pas d’intérêt, pourquoi perdure-t-elle ?
M. Dominique Cerruti. Pour trois raisons. Premièrement, parce qu’elle permet aux professionnels des marges plus confortables. Deuxièmement, parce que certains produits très innovants et très spécifiques n’ont pas à être inscrits à la cote. Si, par exemple, une entreprise française veut construire une usine au Brésil, financer son investissement en monnaie locale, acheter ses matières premières en dollars et revendre le produit fini en yuans, elle fera appel au marché des dérivés pour se couvrir grâce à un produit sur mesure conçu exclusivement pour elle par des « structureurs ». Troisièmement, parce que, comme je l’ai dit, la négociation de blocs de titres a pour tout le monde un impact négatif, qu’il convient de neutraliser.
M. le président Henri Emmanuelli. Les négociations de blocs sont-elles soumises à une obligation de déclaration ?
M. Dominique Cerruti. La négociation se fait dans l’anonymat le plus complet. Ce n’est qu’ensuite qu’elle donne lieu à négociation, et de manière très floue puisque les règles de transparence qui s’appliquent aux blocs n’ont pas précisé les moyens de diffusion – certains intermédiaires diffusent cette information via leur site internet, dans des conditions qui ne facilitent pas forcément l’accès des investisseurs – et que la fiabilité et l’exhaustivité des données ne sont pas suffisantes – problème de devises, d’information manquante, ou en doublon. Mais la directive MIFID 2 traitera le sujet. Cela étant, la négociation de blocs elle-même n’est pas en cause, c’est à l’opacité appliquée à de petits ordres qu’il faut s’attaquer car elle n’est absolument pas justifiée. Pour conclure sur ce point, l’opacité n’est pas condamnable en elle-même, mais son doublement en deux ans est le signal d’un dysfonctionnement.
Deuxième sujet de préoccupation, la fragmentation des 56-58 % qui restent transparents sur les marchés actions. Là encore, sous couvert de concurrence, on a laissé se créer une série de plateformes alternatives, les MTF, auxquelles on a consenti des avantages destinés à compenser les handicaps que rencontrent les nouveaux entrants sur un marché. Malheureusement, leurs propriétaires n’avaient rien du petit Poucet. Les MTF sont toutes basées à Londres, et propriétés de puissants établissements financiers. Elles travaillent toutes à perte, à l’exception d’une qui déclare avoir atteint le point d’équilibre. À elles toutes, elles ont gagné une énorme part du marché, entre 30 % et 40 % du marché européen. Nous sommes pour la concurrence, à condition qu’elle soit équilibrée. Sinon, ce qui reste des marchés transparents sera mis à mal.
Parmi les avantages sur lesquels MiFID II devra revenir, on trouve l’autorisation de pratiquer de l’arbitrage de régulation. C’est pourquoi ces plateformes sont toutes à Londres tandis que NYSE-Euronext, en tant que marché transparent, est en contact avec cinq régulateurs européens à chacun desquels elle paie une redevance. D’autre part, là où Fabrice Peresse emploie cinquante personnes hautement qualifiées et outillées, ces plateformes n’en ont embauché que deux ou trois. Leurs effectifs ne dépassent pas cinquante personnes au total, sans doute à cause de la législation sociale britannique, alors que nous entretenons du personnel sur toutes les places de cotation : aux Pays-Bas, au Portugal, en Belgique, en France et en Angleterre. Enfin, mes contraintes informatiques de résilience, de garantie de reprise d’activité, mes dispositifs de sauvegarde sont infiniment plus lourds, parce que les superviseurs font tout pour éviter la défaillance d’un marché régulé. Pourtant, malgré tous ces avantages, malgré leurs actionnaires puissants, les MTF perdent de l’argent, à une exception près. La législation a introduit une concurrence qui risque de tuer les marchés régulés.
M. le président Henri Emmanuelli. Si ces plateformes perdent de l’argent, pourquoi persévèrent-elles ?
M. Dominique Cerruti. L’intérêt de leurs actionnaires est indirect. En forçant les marchés régulés à abaisser leur niveau de prix, ils misent sur une spirale négative qui entraînera tout le monde en enfer. En somme, ces actionnaires font le jeu de l’opacité et menacent les marchés transparents dont le besoin se fait sentir plus que jamais.
Il est très difficile aux régulateurs de surmonter la fragmentation. Le mini-krach du 6 mai est la conséquence type d’une hyper-fragmentation des marchés. Les procédés sur les différentes places boursières ne sont pas les mêmes. Chez nous, les choses sont revenues très rapidement dans l’ordre car nos coupe-circuits ont fonctionné. Sur les plateformes qui n’en avaient pas, le choc a été violent. Dans un climat de nervosité, sur fond de crise européenne, la volatilité des cours était très accentuée et, à un moment donné, les marchés se sont emballés sur quelques titres. Tous les traitements sont automatisés sur les marchés, même les ordres, avec le trading algorithmique, et les signaux de prix ont provoqué, à des fins de couverture, des ordres de vente pour limiter les pertes. Sur les marchés régulés, à la vue des écarts de cours, les opérateurs présents ont arrêté les programmes, pris leur téléphone pour demander aux courtiers si le cours était vraiment celui auquel ils voulaient négocier. Dans la négative, ils ont suspendu les cotations. Quelques secondes, au pire quelques minutes, suffisent pour revenir à l’équilibre. Mais, là où les procédures étaient entièrement automatisées, sur les MTF, les ordinateurs ont, faute de personnel suffisant, continué à tourner une dizaine de minutes de trop. Il a donc fallu détricoter les ordres aberrants qui avaient été exécutés. Pas chez nous.
Une fragmentation très favorable aux plateformes exclusivement électroniques doit au moins aller de pair avec une harmonisation des mécanismes d’alerte. Ceux-ci doivent prendre le pas sur la concurrence en cas d’emballement des marchés. Le 6 mai, quand nous avons dû nous arrêter quelques secondes, certaines plateformes ont sauté sur l’occasion pour récupérer du chiffre d’affaires.
M. Fabrice Peresse, directeur des opérations de marché de NYSE-Euronext. Nous constatons chaque jour des dérives de ce type. Par exemple, nous avons plusieurs fois décelé, juste avant la clôture, une variation brutale – de l’ordre de 5 % – du cours d’un titre. Puis, aussitôt, tout rentre dans l’ordre. C’est troublant, surtout quand nous apprenons après coup que, tout de suite après, un gros bloc de titres a été négocié sur une dark pool. Manifestement, il y a des tentatives de manipulation de cours, mais, ne contrôlant pas ce qui se passe ailleurs que chez nous, nous avons beaucoup de mal à les identifier. L’AMF aussi, d’ailleurs. Même si elle a accès aux informations, il faut qu’elle ait les moyens matériels de les traiter ; en outre, elles ne lui sont transmises qu’a posteriori. Ces anomalies nouvelles obligent à repenser le dispositif de contrôle. La fragmentation conjuguée avec la diversité des contraintes imposées aux différentes plateformes rend le contrôle plus compliqué.
M. le président Henri Emmanuelli. Les gros opérateurs habitués des « coups » à la limite de la légalité ont-ils perçu toutes les potentialités que leur offre la fragmentation ?
M. Fabrice Peresse. Sans doute. Quelques cas concrets le laissent penser.
M. Dominique Cerruti. L’équipe de surveillance repère les anomalies et les transmet à l’équipe chargée de l’intégrité des marchés qui, à son tour, après avoir fait des recherches, s’adresse au régulateur national. Le cas échéant, une enquête est diligentée pour savoir s’il s’agit d’un incident technique, d’une erreur matérielle – un « gros doigt » en jargon – ou d’une manipulation de cours.
À l’avenir, les gouvernements ne pourront plus venir à la rescousse des marchés, qui doivent désormais se prendre en charge. Ils doivent être stables, intègres et résilients. Dans ce contexte, il est préoccupant que l’opacité s’étende cependant que, sur ce qui reste de transparence, la fragmentation s’accentue encore, compliquant le travail du régulateur. La concurrence non faussée passe par l’uniformisation des droits et des devoirs – reporting, résilience… – des différentes plateformes, qui n’ont pas toutes les contraintes du marché régulé. Si j’annonçais à M. Jouyet que nos équipes de surveillance passent de cinquante à trois personnes pour nous aligner sur nos concurrents britanniques, il menacerait de me retirer ma licence. Puisque nous sommes tous d’accord sur la nécessité de surveiller les marchés, il vaudrait mieux demander aux MTF basées à Londres d’embaucher pour rendre le même service. Cependant, la distorsion de concurrence est perverse parce que, si ces plateformes devaient se conformer aux mêmes obligations que nous, leurs pertes s’accentueraient encore.
M. le président Henri Emmanuelli. Pourquoi les grandes banques acceptent-elles de perdre de l’argent ?
M. Dominique Cerruti. L’idée était de peser sur nos prix, et sur nos marges. Mais la plus grosse MTF est en vente, d’autres ont disparu. Le NASDAQ a fait fermer celle qu’il avait autorisée, mais il en reste une dizaine. L’opacité couplée à la fragmentation suscite l’inquiétude des régulateurs et MiFID II devrait y remédier. À ce propos, il y avait aussi une distorsion notoire à Bruxelles entre le lobbying des financiers et celui des marchés institutionnels. Il y a un an et demi, nous n’avions encore personne à Bruxelles pour faire valoir notre point de vue. Maintenant, nous y avons une petite équipe. Et la bonne nouvelle, c’est que le Parlement européen a fini par admettre les ordres de grandeur que nous avancions pour la proportion de transactions opaques et pour la ventilation entre gré à gré, dark pools et crossing network. De même en ce qui concerne la fragmentation. À toute chose malheur est bon : l’incident du 6 mai a plaidé en notre faveur, en montrant concrètement sur quel chemin l’Europe risquait de s’engager si rien n’était fait.
M. le président Henri Emmanuelli. Les angoisses européennes sont-elles partagées outre-Atlantique ?
M. Dominique Cerruti. Oui, absolument.
Venons-en au HFT, le high frequency trading. Il ne faut pas le diaboliser. S’y adonnent aussi des investisseurs institutionnels, des fonds de pension, des hedge funds… En quoi consiste-t-il ? Il exploite la fragmentation des marchés voulue par les régulateurs, en repérant les écarts de prix au moyen de technologies très sophistiquées. Constatant qu’un titre vaut ici 100, ailleurs 101, un opérateur achète à 100 pour revendre à 101. La technologie est nécessaire pour cela parce qu’il faut être extrêmement rapide. On peut certes douter de l’utilité économique du HFT mais il contribue à faire converger les prix et à fluidifier le marché. Autrement dit, le HFT, c’est de l’arbitrage. En fragmentant, on compartimente la liquidité et on rend les marchés moins efficients. La fonction d’arbitragiste n’est pas noble, sans doute, mais elle sert au moins à cela. En outre, il lui faut de la transparence et elle améliore la liquidité. Je vous renvoie au rapport publié il y a une quinzaine de jours par le régulateur hollandais, l’Autoriteit Financiële Markten, sur le HFT. Le superviseur, partant avec un préjugé défavorable, a finalement conclu qu’il fallait des règles de transparence mais que ces opérateurs étaient utiles. En revanche, il faut veiller à ce que le HFT ne puisse pas servir à décaler le marché, par exemple en donnant des milliers d’ordres et en les annulant avant leur exécution pour transmettre ensuite l’ordre au cours voulu. Le risque existe.
M. le président Henri Emmanuelli. Le gouverneur de la Banque de France semblait penser que le HFT nuisait à la transparence du marché en donnant aux détenteurs de cette technologie un avantage en termes d’information.
M. Fabrice Peresse. Aujourd'hui, toutes les grandes banques font du HFT. L’année dernière, une valeur a brusquement augmenté de 30 ou 50 % en l’espace de quelques secondes parce qu’une banque avait perdu le contrôle de son algorithme, faute de l’avoir convenablement testé. Elle a donc acheté tout ce qui se trouvait sur le marché, mais elle a été punie parce qu’elle n’a évidemment pas revendu au même prix. Nous avons eu quatre exemples de ce type l’année dernière et, renseignements pris, les fauteurs de trouble étaient non pas des professionnels du HFT, mais des banques de plus ou moins grande taille qui avaient joué les apprentis sorciers.
M. le président Henri Emmanuelli. Comment vérifiez-vous l’authenticité des ordres ?
M. Fabrice Peresse. Nous avons développé nos propres méthodes et mis au point, avec nos outils technologiques qui sont très puissants, un système de pilotage, avec des signaux d’alerte et des filtrages. Il permet de repérer en temps réel ce que l’on veut parmi les 50 à 100 millions d’ordres que nous traitons tous les jours. Nous disposons de mécanismes de prévention.
M. le rapporteur. On nous a dit que le régulateur du marché britannique n’obtenait pas d’informations sur les ordres qui n’étaient pas dénoués.
M. Fabrice Peresse. Tous les jours, nous envoyons à l’AMF tous les ordres, exécutés ou non. En Grande-Bretagne, l’organisation est différente : le régulateur obtient l’information directement auprès des intermédiaires financiers, et non auprès du marché institutionnel.
M. Dominique Cerruti. Je vous invite à lire le rapport de l’AFM néerlandais une fois qu’il aura été traduit : il est le premier consacré au HFT, et il le démystifie. Dans la conclusion, les auteurs recommandent un meilleur encadrement des intervenants pour mieux connaître leur action, mais soulignent qu’ils contribuent à rendre les marchés plus efficients.
NYSE-Euronext a bel et bien développé un dark pool et une MTF. Pourquoi ? Notre cœur de métier consiste à coter et à introduire en bourse des entreprises, y compris des PME, ce qui contribue au financement de l’économie. Nous sommes aussi en train de créer une plateforme obligataire sous l’égide de Christine Lagarde. C’est l’aspect sociétal de l’activité d’une bourse. Mais nous sommes soumis à une concurrence qui ne s’encombre pas de telles considérations. Notre objectif est de survivre, l’enjeu n’étant rien de moins que l’existence d’un marché transparent. Alors, nous nous adaptons. Si la régulation autorise les dark pools et les MTF, et si des petits malins veulent utiliser le système pour nous attirer en enfer, nous jouerons au même jeu qu’eux. C’est pourquoi nous avons suivi la plupart des clients et des banques à Londres, de façon à respecter les temps de réponse qu’ils exigent de nous. Nous n’avons pas eu le choix. Cela étant, nous avons tout de même une éthique et nous travaillons main dans la main avec les régulateurs. Que nous ayons une dark pool, dénommée SmartPool, ne nous empêche pas de militer pour que les dark pools se cantonnent à la négociation de blocs de titres. Mais nous ne voulons pas, pour n’avoir pas suivi les autres, pas investi dans la technologie, pas réduit nos dépenses de 500 millions, comme nous avons dû le faire, subir ce qu’ont subi des institutions mondialement connues. Notre stratégie nous a permis de maintenir notre part de marché à 73 % auprès des sociétés que nous cotons alors que, il y a deux ans, beaucoup d’observateurs nous prédisaient le pire. Et nous poursuivons nos activités de surveillance.
Quant à nos contrôles, il faut savoir qu’un centre informatique n’est rien d’autre que quatre murs réfrigérés autour d’un serveur informatique. La salle est scellée, seules les personnes chargées de la maintenance y pénètrent. Les centres informatiques sont près des clients à cause des temps de réponse. Mais nos cerveaux, nos effectifs – une soixantaine de personnes installées rue Cambon – sont à Paris où ils exploitent un carnet d’ordres unique, élaboré à partir des carnets d’ordres locaux, ce qui améliore la qualité du marché.
M. Fabrice Peresse. Le pilotage est à Paris. Nous sommes tous les jours en contact avec les quatre régulateurs nationaux, français, belge, néerlandais et portugais, bien que le marché soit unique.
M. Dominique Cerruti. Le seul endroit où le carnet d’ordres peut être consulté, analysé, piloté, c’est à Paris. À Londres, il n’y a que le serveur.
M. le président Henri Emmanuelli. Que pensez-vous des marchés de matières premières ?
M. Dominique Cerruti. Le sujet mérite qu’on s’y penche, surtout après les émeutes de la faim dont ont été le théâtre une quarantaine de pays il y a deux ans. En outre, nous sommes concernés puisque nous gérons un marché de dérivés de matières premières à Londres et à Paris. Encore une fois, c’est un marché transparent où s’échangent des produits référencés. Il existe des techniques pour éviter les excès de la spéculation, comme de limiter les positions. Nous sommes en train d’y travailler.
M. le président Henri Emmanuelli. Comment fixez-vous ces limites ?
M. Dominique Cerruti. Je ne peux pas fournir de réponse précise car cela dépend des produits. Aux États-Unis, il existe des plafonds, mais en Europe, pas encore. Le reporting aussi peut être efficace. Une déclaration peut suffire à prévenir les excès. Toutes les mesures qui concourent à plus d’encadrement, de transparence et d’information sont les bienvenues.
M. le rapporteur. Quelles sont les deux ou trois recommandations que vous feriez au G20 ?
M. Dominique Cerruti. Les thèmes choisis par la présidence française sont plus que pertinents. Je crains toutefois que l’on n’oublie les deux problèmes qui m’obsèdent – l’opacité et la fragmentation. La prochaine crise n’en serait que plus douloureuse s’ils ne sont pas traités.
Les marchés régulés et transparents ne sont pour rien dans le déclenchement de la crise de 2007-2008. Aucune chambre de compensation officielle n’a failli, tout autour de la planète, alors que leurs systèmes ont été sollicités pour des volumes considérables. Il n’a pas fallu plus de quelques semaines pour purger les opérations de Lehman enregistrées sur les marchés institutionnels. Les banques sont toujours en train d’ajuster leurs positions aujourd'hui…
M. le président Henri Emmanuelli. Vous ne détenez pas de portefeuille ?
M. Dominique Cerruti. Cela nous est interdit. Nous ne sommes pas des investisseurs, notre mission consiste à assurer l’intégrité et l’efficience des marchés.
M. le président Henri Emmanuelli. Qui sont vos actionnaires ?
M. Dominique Cerruti. La dérégulation nous a poussés à nous faire coter sur notre propre marché. Certes, il y a un tropisme américain car vous trouverez dans notre actionnariat beaucoup de fonds de pension américains, mais pas seulement. Il doit être comparable à celui d’Axa. Il est bien réparti – il doit falloir une bonne vingtaine d’actionnaires pour atteindre 50 % du capital – et se préoccupe plutôt du moyen et du long terme.
M. le président Henri Emmanuelli. Comment expliquer les déboires du London Stock Exchange ?
M. Dominique Cerruti. Il est toujours délicat de parler de ses concurrents directs, mais il y a un décalage considérable entre la puissance de la City, qui est le premier centre financier de la planète, devant New York, et le London Stock Exchange, qui a beaucoup souffert. Il est certain que le rachat du LIFFE par le concurrent français a été un coup dur. Ensuite, les investissements technologiques ont pris du retard. Nous nous portons mieux parce que nous ne nous sommes pas contentés de créer un centre informatique, nous avons réalisé un carnet d’ordres unique en fusionnant les carnets d’ordres nationaux, alors que ceux de Londres et Milan sont restés distincts. Nos investissements ont porté leurs fruits.
M. le président Henri Emmanuelli. Parmi les produits dérivés, aucun ne vous semble aberrant ?
M. Dominique Cerruti. Certains sont tellement sophistiqués que leurs concepteurs eux-mêmes ont perdu de vue ce pour quoi ils avaient été imaginés. Le risque réside dans l’absence de traçabilité et dans l’impossibilité d’évaluer le risque encouru. À l’origine, les produits répondaient à une demande. À cet égard, l’exemple des subprimes est très parlant. Au départ, quelqu’un a créé un produit reposant sur une promesse économique qui ne pouvait pas être tenue. Il s’est alors agi de sortir du bilan des risques qui ne pouvaient pas être assumés. D’où les opérations de titrisation en cascade, en supposant, à tort, que la planète serait assez résiliente pour supporter le risque. De titrisation en titrisation, les banques ont fini par ne plus savoir ce qu’elles avaient en portefeuille.
M. le président Henri Emmanuelli. Pour en revenir à des principes simples, le métier de financier ne consiste-t-il pas à apprécier le risque ? Inventer des produits pour ne plus pouvoir le faire n’est-il pas un contresens ?
M. Dominique Cerruti. Je n’ai pas à m’ériger en juge, mais il faut distinguer les forts en maths qui créent les produits et qui, à mon avis, étaient extrêmement lucides, au point d’imaginer la titrisation pour évacuer rapidement les risques du bilan et mieux les répartir, et les acheteurs qui, face à des produits aussi complexes, finissaient par perdre toute notion du risque réellement encouru. Poussée à l’extrême, la titrisation empêche toute traçabilité.
M. le président Henri Emmanuelli. On a bien vu ce qu’il en était avec le reportage du Monde consacré à Abacus. Le contrat était tellement long que, vraisemblablement, personne ne l’a lu en entier. Pourtant, le produit a marché. Et l’agence de notation a délivré un triple A.
M. Dominique Cerruti. On en revient à la crise des tulipes, à la cupidité qui aveugle.
M. le président Henri Emmanuelli. Et il y a de la crédulité là où il y a du désir. J’avais demandé à un banquier aguerri pourquoi les crises finissaient invariablement par se reproduire. Il m’avait répondu que c’était parce que les gens avaient « envie d’y croire ».
M. Dominique Cerruti. À côté des crédules qui pensent que le processus va continuer, il y a aussi les professionnels qui espèrent en profiter en sortant à temps – et parfois se laissent piéger…
En conclusion, il faut aider les régulateurs autant que faire se pourra. La seule manière de limiter les risques, c’est une meilleure coordination, au moins entre Européens, et si possible au-delà.
M. le président Henri Emmanuelli. Des chiffres cités par M. de Boissieu, président du Conseil d’analyse économique, m’obsède : alors que le PIB mondial se monte à 60 000 milliards de dollars, le volume du sous-jacent des produits dérivés en circulation atteindrait 600 000 ou 700 000 milliards de dollars. Qui sait ce que tout cela recouvre ?
M. Dominique Cerruti. La tâche est trop écrasante pour les régulateurs actuels. Le cadre national doit être dépassé. Des efforts sont faits dans ce sens en Europe, avec la création de l’ESMA, l’European Securities and Markets Authority – la nouvelle autorité européenne chargée de la surveillance des marchés – et il faudra tôt ou tard se lier avec les Américains pour avoir une vue globale. Avec le recul, on comprend qu’une banque centrale isolée n’aurait pu prendre la mesure du phénomène des subprimes.
M. le président Henri Emmanuelli. En tout cas, aucun établissement financier français n’aurait accordé de crédit immobilier sans demander les revenus de l’emprunteur.
M. Dominique Cerruti. Il faut donc lutter contre l’opacité et la fragmentation, y compris au G20, et être maximaliste en refusant d’écouter les sirènes qui justifient l’opacité. La transparence doit être le maître mot, et si fragmentation il y a, alors elle doit avoir pour corollaire l’harmonisation sous l’égide des régulateurs, de façon que les transactions puissent être contrôlées. En l’état actuel des marchés, une nouvelle crise serait un choc redoutable, d’autant que, paradoxalement, l’opacité et la fragmentation ont continué de s’aggraver.
M. le président Henri Emmanuelli. La dernière fois, on pouvait compter sur la résilience mondiale. Aujourd'hui, il n’en est rien et la panique serait bien pire.
M. Dominique Cerruti. Les gouvernements qui, en 2008, ont passé des week-ends de cauchemar à chercher comment sauver la planète, et suscité l’ire de la population qui ne comprenait pas bien l’enjeu, savent bien qu’ils ne pourront pas recommencer. L’endettement public ne le permet plus. Or la qualité de la signature des États constitue le dernier rempart de nos sociétés. L’Europe ne peut plus jouer le jeu. D’ailleurs, Christine Lagarde ajoute un troisième thème à mon diptyque : responsabilité. Il est tout de même frustrant de constater que certains acteurs refusent d’admettre que l’intérêt sociétal des marchés doit passer avant le leur. À défaut, il n’y aura pas de gagnant.
M. le président Henri Emmanuelli. La panique serait démultipliée.
M. Dominique Cerruti. Bien qu’optimiste, je ne m’aventurerais pas à dire que pareille crise ne se reproduira pas. Tôt ou tard, la cupidité, l’accumulation de risques, les dérives macroéconomiques provoqueront une nouvelle bulle qui, elle aussi, explosera. Si elle est petite, l’épreuve sera surmontée. Si la crise est grave, la structure des marchés ne permettra pas de l’absorber. Il y a réellement urgence à surmonter l’opacité et la fragmentation.
M. le président Henri Emmanuelli. Convaincre le G20 ne sera pas une mince affaire parce que certains ont tout intérêt à cette opacité et à cette fragmentation.
M. Dominique Cerruti. Et tous ne sont pas loin de chez nous.
M. le président Henri Emmanuelli. La crise n’a pas ébranlé leurs convictions ? Business as usual ?
M. Dominique Cerruti. C’est très difficile de convaincre quelqu’un qui a fait du gré à gré toute sa vie d’arrêter, surtout si ses marges doivent s’en trouver réduites. Autre exemple : il a fallu mener un combat de titans pour faire comprendre aux émetteurs de produits dérivés qu’à défaut de les coter, ou de les négocier sur des marchés transparents, il fallait au moins qu’ils puissent être compensés, pour réduire le risque de contrepartie et éviter la bombe à retardement que constitue la contagion systémique. Rude bataille !
M. le rapporteur. C’est une question de culture.
M. le président Henri Emmanuelli. Les lignes ont bougé, tout de même, et en peu de temps.
Monsieur Cerruti, monsieur Peresse, il ne me reste plus qu’à vous remercier.
L’audition s’achève à vingt heures quinze.
*
* *
Audition de Mme Christine Lagarde,
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie)
(Procès-verbal de la séance du jeudi 25 novembre 2010)
(Présidence de M. Henri Emmanuelli, président de la commission d’enquête)
La séance est ouverte à neuf heures trente
M. le président Henri Emmanuelli. Madame la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, je vous remercie d’avoir répondu à l’invitation de la commission d’enquête parlementaire sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement des économies. Votre audition est l’avant-dernière à laquelle nous procéderons.
Nous aimerions connaître votre point de vue sur la déconnexion entre la sphère financière et l’économie réelle. Selon le dernier rapport de la Banque des règlements internationaux, le volume négocié chaque jour sur le marché mondial des changes atteint 4 000 milliards de dollars, ce qui signifie qu’y circule en quatre jours l’équivalent de la valeur des exportations mondiales annuelles de marchandises et de services commerciaux. Le volume global des opérations de gré à gré (OTC : over the counter) en circulation dans le monde varierait entre 600 000 et 700 000 milliards de dollars, pour un PIB de 60 000 milliards.
Certains de ceux que nous avons entendus ont attiré notre attention sur la déconnexion constatée depuis 2003 entre l’augmentation des liquidités dans le monde, évaluée à 15 % par an, et la croissance, qui s’établit aux environs de 4 %. Dès lors que les liquidités n’ont plus d’application dans l’économie réelle, elles forment des bulles. Quelle est votre analyse à cet égard ?
Avez-vous le sentiment que les phénomènes spéculatifs aient aggravé les crises grecque et irlandaise ? M. Christian Noyer, que nous avons déjà interrogé, doit nous renseigner sur l’exposition des banques à la dette souveraine irlandaise, mais le chiffre de 30 milliards pour les banques françaises, contre 60 pour les banques allemandes et 55 pour les banques britanniques, est avancé. Dans ces conditions, le problème devient global : il s’agit moins de sauver l’Irlande que de nous sauver nous-mêmes.
S’agissant de l’instabilité du marché des changes et des opportunités de manœuvres spéculatives, quelles orientations doivent présider à la remise en ordre de ce qu’on nomme encore le système monétaire international, bien qu’il s’agisse davantage d’un état de fait que d’un système organisé ? Peut-on raisonnablement espérer que la situation évolue à court terme, compte tenu de la difficulté d’intervenir dans les négociations entre le Japon, la Chine et les États-Unis ?
Que pensez-vous de la MIF, directive concernant les marchés des instruments financiers, et du projet de révision ? Ceux que nous avons auditionnés s’accordent sur le fait que cette directive européenne, prise dans les meilleures intentions, s’est révélée catastrophique, puisqu’elle a favorisé l’éclatement du marché et l’apparition de zones non régulées, devenues très opératives, qui menacent les plateformes organisées et transparentes.
En cherchant à organiser la concurrence, nous n’avons pas réussi à diminuer les coûts, et nous avons augmenté le nombre de places !
Par ailleurs, où en est votre souhait d’organiser une plateforme obligataire ?
Enfin, pensez-vous qu’il faille en finir avec le HFT (High frequency trading), ce que, en dehors des dirigeants d’Euronext – qui réalise ainsi la moitié de son chiffre d’affaires –, tous semblent prêts à admettre ? Quelle est votre position sur les CDS (Credit default swaps) « nus » et, plus généralement, sur les produits dérivés, pour le moins dangereux, qui apparentent l’activité des marchés, même celui des matières premières, à celle d’un casino ?
(Mme Christine Lagarde prête serment.)
Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. Fin 2008, j’avais analysé la crise financière comme celle de tous les excès : excès de crédit, de volatilité, de sophistication et de cupidité. Au vu de ce qui s’est passé au cours des derniers mois, on peut y ajouter l’excès de naïveté, qui n’est pas le moindre des facteurs ayant conduit à la crise. Il a entraîné les régulateurs, les banquiers centraux, les autorités publiques et certains acteurs de bonne volonté, commissaires aux comptes ou agents travaillant aux bordures de certaines transactions, à se laisser bercer par la fable qui voudrait que les marchés soient parfaits, liquides, profonds, efficients et régis par une force centrifuge corrigeant spontanément les déséquilibres. La recherche académique et universitaire a contribué à la diffusion de ce mythe si largement enseigné. Or la crise a révélé que cette croyance était une illusion d’optique, la réalité étant beaucoup plus crue.
Là où certains pensaient que les marchés dérivés contribuaient à disperser les risques, on a découvert l’extraordinaire concentration du marché des CDS autour d’un acteur, AIG, représentant à lui seul la contrepartie d’un montant notionnel de 440 milliards d’euros. Là où d’autres pensaient que les marchés allouaient spontanément le capital de manière efficace, nous avons réalisé que la pratique américaine de la titrisation amenait agences de notation, banques et autres acteurs à se rémunérer par d’importantes commissions ayant pour seul effet de financer l’infinançable : c’est la définition même des subprimes, qui consistaient en réalité à doter certains prêts, rebaptisés prêts NINJA (no income no job and no assets : pas de revenu, pas de travail ni d’actifs), en contrepartie de risques inconsidérés. D’autres croyaient que la spéculation n’était qu’une force positive, dont l’action permettait d’ajuster le prix des actifs à une réalité économique sous-jacente. La crise grecque nous a rappelé qu’un frémissement provoqué sur le marché très étroit des CDS souverains suffisait à décaler le prix des obligations souveraines, permettant à ceux qui s’étaient positionnés à découvert d’empocher des profits importants, même si la preuve précise que ces mouvements ont été opérés fera toujours défaut.
Assurément, ces mythes ont vécu. Le laisser-faire a charrié son flot d’imperfections, à l’origine de spéculations qui, au mieux, n’apportent pas grand-chose à l’économie et, au pire, l’ont conduite au bord du gouffre. Soucieux de contrer cette dérive, révélée par une analyse trop tardive, les chefs d’État et de Gouvernement ont choisi de tourner le dos à une finance dérégulée, pour supprimer les occasions de spéculation dangereuses pour nos économies. Sous l’impulsion du Président de la République, la France a été le premier pays à appeler à une refondation du système financier international par l’instance qui représente le moins mal les économies du monde : le G20.
Qu’on ne juge pas mon propos excessif : je ne nie pas l’utilité du marché, que je ne cherche pas à remettre en cause de manière aveugle et catégorique, ce qui reviendrait à passer d’un excès à l’autre. Le marché remplit sa fonction quand il sert de pont entre des entreprises qui ont besoin de capitaux pour investir et des investisseurs à la recherche d’opportunités d’investissement. Il est utile lorsqu’il permet à Air France, par exemple, de s’assurer contre la hausse du prix des carburants ou la variation de la valeur de ses recettes en devises. Les produits dérivés permettent en effet aux entreprises de se couvrir contre des risques.
Mais utilité ne doit pas rimer avec naïveté : ce n’est pas parce qu’il est utile que le marché sait s’organiser lui-même en évitant de produire des dégâts considérables. Régulation, contrôle, surveillance et capacité de sanctionner sont nécessaires si l’on veut que les marchés travaillent utilement au service des ménages, des entreprises ou des collectivités locales ; ils sont indispensables pour éradiquer des phénomènes purement spéculatifs, qui devraient n’être que l’écume de la vague, mais qui ont constitué dans certains cas la vague tout entière.
Les principes de régulation, de contrôle et de sanction, auxquels je crois et qui me semblent être libéraux, doivent s’attacher à lutter d’abord contre l’irresponsabilité des acteurs, que le système a toléré à tort, puis contre l’asymétrie d’information, qui fait le lit de la spéculation, et, enfin, contre la volatilité.
Dans les années qui ont précédé la crise, les acteurs du système financier ont dégagé des profits immédiats, en laissant à d’autres une ardoise sans précédent. Un système dans lequel les investisseurs peuvent transmettre leur passif, sans assumer les conséquences de leurs décisions, invite à la plus nocive des spéculations. Quand un candidat sollicite un emploi, alors qu’il n’est jamais resté plus de deux ans à un poste, on s’en méfie, car une telle durée suffit sans doute pour commettre des erreurs, mais non pour en mesurer les conséquences ni les réparer. Il en va de même en matière financière. Si le système permet à un investisseur de percevoir le fruit d’une spéculation sans en assumer le passif, ce n’est pas bon signe.
Trois moyens permettront de lutter contre l’irresponsabilité des acteurs.
En septembre 2009, le G20 réuni à Pittsburgh a décidé que les banques devraient conserver dans leur bilan une fraction des produits qu’elles titrisent, au lieu de se contenter de les fabriquer, de les agréger et de les transférer à d’autres. Contraintes d’assumer les conséquences de leurs produits, elles les concevront probablement avec plus d’attention et de diligence. La mesure, intégrée à la « CRD 3 », c’est-à-dire la troisième directive européenne sur les exigences en fonds propres (Capital Requirements Directive), s’appliquera en France dès janvier 2011. Le pourcentage des actifs que les banques devront conserver dans leur bilan est fixé à 5 % ; il est déjà difficile de faire admettre ce taux à l’un de nos partenaires.
Au cours de la même réunion du G20, nous avons ferraillé pour obtenir l’encadrement de la rémunération des opérateurs de marché, auquel plusieurs États étaient farouchement opposés. La France ayant obtenu l’adhésion d’autres acteurs européens, elle a eu gain de cause : désormais, les bonus garantis sont interdits, le paiement d’une partie des bonus sera différé et une fraction de la rémunération devra intervenir sous forme de titres et non de cash. La part différée se sera versée qu’à la condition que les performances soient au rendez-vous. En mettant un malus en face des bonus, nos gouvernements ont décidé que les opérateurs peu soucieux des risques devaient en payer les conséquences.
Enfin, il faut éviter qu’en cas problème les États n’aient à lutter contre l’aggravation de la crise en soutenant les établissements bancaires. Désormais, en vertu des accords de Bâle 3, les établissements bancaires doivent relever le niveau de leurs fonds propres. De ce fait, ils seront plus solides. De même, la France, l’Angleterre, l’Allemagne et la Suède – mais malheureusement pas les États-Unis – ont mis en place une taxe bancaire, dite « taxe systémique » qui vise à inciter les banques à réduire leurs risques. Mais notre action ne se limitera pas à un dispositif de taxation. J’ai demandé à Jean-François Lepetit de rédiger un rapport sur la résolution des situations de crise, afin d’organiser les mécanismes de redressement et de réorganisation qui s’appliquent quand la situation est désespérée.
Outre les mesures destinées à faire échec à l’irresponsabilité, nous avons tenu à assurer ce qu’il faut bien appeler la transparence, quoique le terme soit parfois utilisé de manière abusive. Car une transparence qui se traduirait par une abondance d’informations que nul de comprendrait nous ferait retomber dans les mêmes errements que l’excès de sophistication. À quoi bon mettre toutes les informations sur la table si l’on n’est pas capable de faire le tri ? La transparence que je souhaite doit être associée à des mécanismes de lisibilité et d’identification des risques permettant surveillance, contrôle et, le cas échéant, sanction.
L’information est un des biens qui coûte le moins cher à partager. Toutefois, si on la conserve par devers soi, elle constitue un avantage compétitif, qui est un des fondements de la spéculation. Dès lors que l’on détient une information auquel le marché n’a pas accès, on se trouve en position privilégiée pour prendre une position et en tirer avantage. C’est pourquoi nous devons mettre en place une régulation visant à faire de l’information un bien public.
Jusqu’à la crise de 2008, les marchés de dérivés étaient totalement dérégulés et obscurs. Nul n’en avait de vision consolidée, en dehors de quelques acteurs suffisamment importants, qui en étaient les grands intermédiaires et organisaient les transactions. Pour éviter que quelques opérateurs ne se réservent l’information, le G20 a imposé deux principes forts : la transparence sur toutes les transactions, ce qui suppose leur passage obligatoire par les chambres de compensation, et le recensement de tous les contrats dérivés dans des bases de données accessibles aux régulateurs.
Le 15 septembre 2010, la Commission européenne a proposé un règlement qui met en œuvre les décisions du G20. La France l’a complété par la loi de régulation bancaire et financière, qui a étendu les pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en qualité de gendarme de la Bourse. L’AMF pourra sanctionner les abus de marché, comme les manipulations de cours sur les marchés dérivés. L’effet de la régulation est automatique : la disparition de l’asymétrie d’information réduit les occasions de spéculation et permet l’intervention des pouvoirs publics.
Parce que la transparence ne doit pas se limiter au marché des produits dérivés, la France a pris l’initiative de demander une ambitieuse révision de la directive concernant les marchés des instruments financiers. Car, contrairement à ce que nous souhaitions, la libéralisation de la négociation des actions en Europe est loin d’avoir été une bonne mesure : elle a produit une fragmentation des marchés et fait naître des places peu transparentes, peu régulées, à structure légère, qui doivent manifestement être encadrées. Actuellement, une action de France Télécom ou d’EADS est cotée simultanément sur cinq bourses, qui lui attribuent autant de prix. Pour résoudre le défaut de transparence imputable à la fragmentation des marchés, la France demande la création d’une infrastructure européenne permettant de consolider en un lieu unique et accessible aux autorités de contrôle ainsi qu’aux investisseurs les informations relatives à toutes les transactions intervenant sur les marchés, ce qui permettra d’en connaître le prix.
Un autre enjeu porte sur les dark pools et les crossing networks, plateformes opaques qui bénéficient de dérogations aux obligations de transparence prévues par la directive concernant les marchés des instruments financiers. J’ai demandé à M. Barnier de recenser toutes ces dérogations afin de les réduire au strict minimum, voire de les supprimer.
En matière d’information, le dernier chantier vise à réorienter vers des bourses transparentes les transactions réalisées aujourd’hui dans l’opacité des marchés de gré à gré. Le G20 a franchi une première étape en imposant aux banques de recourir à des chambres de compensation rendues nécessaires par la standardisation. La standardisation nécessaire ouvre la voie à la création de bourses.
La question comporte, outre un volet de régulation, un volet industriel sur lequel je me suis beaucoup engagée. À ce titre, je me réjouis de l’ouverture, en mars 2010, d’une chambre de compensation sur les dérivés de crédits à Paris et, l’an prochain, de deux bourses obligataires en France. Disposer de telles plateformes est indispensable si l’on veut avoir son mot à dire dans les enjeux de régulation au niveau international. Pour les ouvrir, il a fallu mener un rude combat.
M. le président Henri Emmanuelli. Contre qui ?
Mme la ministre. On nous a opposé le bénéfice de la simplicité : dès lors que de telles instances existaient à Londres, on s’est étonné que nous proposions d’en créer en France.
Dernière mesure en faveur de la transparence et de la lisibilité : la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 a créé pour l’AMF la possibilité d’intervenir, d’encadrer et, dans des circonstances déclarées exceptionnelles, d’interdire les ventes à découvert, afin d’éviter pratiques abusives et manipulations.
J’en viens aux mesures de lutte contre la volatilité dont pâtissent actuellement les marchés comme les entreprises. Ce sujet est lié au précédent, car l’asymétrie de l’information, source d’incertitude, entraîne la volatilité, elle-même propice aux mouvements de spéculation. La priorité était de renforcer la résistance du secteur financier. Le G20, qui a endossé les propositions du comité de Bâle pour renforcer la quantité et la qualité des fonds propres des banques, a également jugé que celles-ci doivent recourir à des chambres de compensation, ce qui renforcera la sécurité du système financier en réduisant les risques de contrepartie. Le 15 septembre 2010, la Commission européenne a proposé un règlement européen pour mettre en œuvre cette décision. Je veillerai tout particulièrement à ce que celui-ci garantisse la solidité des chambres de compensation, qui doivent être régulées comme des banques et disposer d’un accès à la liquidité des banques centrales.
La réduction de la volatilité figure parmi les priorités définies par le Président de la République pour l’année pendant laquelle la France présidera le G20. À l’heure où l’on constate une volatilité manifeste des devises, il est nécessaire de réformer en profondeur le système monétaire international. Certes, il ne suffira pas d’un claquement de doigts pour y parvenir : les intérêts en présence sont manifestes, significatifs, variés…
M. le président Henri Emmanuelli. Et volumineux !
Mme la ministre. Mais les mouvements très rapides de capitaux, qui entrent et sortent au gré des incertitudes, sont dévastateurs, notamment pour les pays émergents. Le Financial Time indiquait hier que la Russie constate une sortie massive de capitaux due aux appréhensions qu’inspirent les modifications politiques. Dans le même temps, le Brésil reçoit des flots de liquidités considérables qui, en s’investissant sur des valeurs brésiliennes et des titres d’État, font monter de manière extrêmement importante le cours de sa monnaie et mettent en péril son développement en partie fondé sur l’exportation.
Pour atteindre les trois grands objectifs que nous nous sommes fixés, nous devons absolument ouvrir des chantiers de réflexion afin d’agir sur les mouvements de devises, l’ordre monétaire international, les réserves constituées, le panier de monnaies sous-jacent, les droits de tirage spéciaux et leurs conditions d’utilisation. Je me réjouis que le G20 réuni à Séoul ait clairement identifié ces sujets comme prioritaires, ce qui implique que le Fonds monétaire international participe activement à nos travaux.
M. le président Henri Emmanuelli. Madame la ministre, il ressort de certaines auditions que l’encadrement de la rémunération des traders prévu par le G20 a été contourné. Sur certaines places, comme celle de Londres, leur situation se serait encore améliorée, puisqu’aux conditions existant auparavant s’ajouterait désormais une année de salaire de bienvenue. Mais comment encadrer ce secteur, dès lors qu’il existe des places financières opaques ?
Selon le directeur d’Euronext, pratiquement toutes les banques ont développé des plateformes alternatives. Est-ce le travail d’une banque que de générer des dark pools ou des MTF (Multilateral trading facilities) ?
Pensez-vous que les produits dérivés et le HFT (High frequency trading), qui semblent incontrôlables, doivent disparaître ? Mais peut-être ne se justifient-ils que par l’éclatement du marché, auquel vous tentez de mettre fin.
Enfin, les responsables de l’Autorité des marchés financiers, que nous avons interrogés, nous ont semblé dépassés par l’ampleur du problème, la masse des transactions et l’imagination toujours en alerte de ses acteurs. Pensez-vous qu’ils soient en mesure de maîtriser la situation ?
M. Jean-François Mancel, rapporteur. Madame la ministre, comment peut-on diminuer l’opacité de certains marchés ? Le directeur d’Euronext considère que le pourcentage des transactions qui s’effectuent sur les marchés institutionnalisés, et peuvent à ce titre être connues, est de 40 % pour les actions, contre seulement 5 %, pour les obligations. Avec quels instruments et quels partenaires, au niveau mondial, pourrez-vous rapatrier les transactions opaques vers des marchés lisibles, susceptibles d’être régulés, convenablement informés et accessibles aux régulateurs ? Comment corriger les effets pervers de la directive MIF ?
D’autre part, l’effet de levier joue un rôle majeur dans le développement d’une spéculation inutile et dangereuse. Pensez-vous qu’on puisse le réduire et faire accepter cette mesure par nos partenaires ?
La France a réagi à la crise en adoptant la loi de régulation bancaire et financière, qui donne de nouveaux outils à l’AMF. Mais les moyens financiers et techniques ainsi que le personnel dont celle-ci dispose lui permettent-ils de s’acquitter de sa mission ?
Enfin, la coordination entre les instances de régulation fonctionne-t-elle de manière satisfaisante au niveau européen et mondial ? Est-elle perfectible ? Est-ce un des axes d’action que vous souhaitez voir développer dans le cadre de la présidence française du G20 ?
M. Jean Launay. Madame la ministre, vous avez évoqué l’obligation pour les banques de conserver une part de leurs actifs titrisés. Parallèlement, peut-on relever les exigences en matière de fonds propres, en prélevant sur leurs bénéfices de quoi constituer des réserves correspondant, par exemple, à 10 % de leur passif ?
Pourquoi les pays membres du G20 refusent-ils de mettre en place un mécanisme de garantie financé par les banques elles-mêmes ? Cet instrument de prévoyance et de responsabilité, qui alimenterait un fonds mobilisable en cas de secousse du système financier, dépasserait les formes de précaution de chaque établissement. Cette solution, qui reviendrait à instaurer sur les banques une taxe modulable en fonction de leur profil, éviterait que l’on ne sollicite toujours les contribuables quand survient une crise financière dont ils ne sont en rien responsables.
Pourquoi la France, dont vous dites souvent qu’elle doit se rapprocher de l’Allemagne, voire s’aligner sur elle sur le plan financier, économique ou fiscal, n’interdit-elle pas elle aussi pas les ventes à terme ?
Enfin, en échange du soutien européen, pourquoi ne pas demander à l’Irlande de relever son taux d’imposition des sociétés, puisque celui qu’elle applique actuellement est pratiquement celui d’un paradis fiscal ?
M. Jean-Pierre Brard. Madame la ministre, je ne partage pas votre analyse, si intéressante qu’elle soit. Les cercles dirigeants n’ont pas seulement péché par excès de cupidité et de naïveté : s’ils méconnaissent les mécanismes fondamentaux de l’économie politique, c’est qu’ils sont atteints d’une sorte d’autisme ou de cécité intellectuelle.
Les mesures décidées par le G20 sont un cautère sur une jambe de bois. Elles sont à la crise ce que le préservatif est au sida : un moyen de se protéger, mais non de guérir.
Je ne partage pas non plus le point de vue de notre président, selon lequel sauver l’Irlande revient à nous sauver nous-mêmes. Vous ne disposerez jamais d’assez d’argent pour endiguer toutes les catastrophes. Or vous ne proposez pas d’autre solution que d’aligner les milliards.
Vous regrettez que, sur les marchés, l’information soit asymétrique. Mais n’est-ce pas toujours le cas ? En matière de production, c’est le fait de disposer de connaissances propres qui permet la plus-value – je vous renvoie au livre II du Capital.
Je vous accorde que les professeurs et les intellectuels – j’ajoute : les journalistes – ont fait preuve d’un esprit de mimétisme et de conformisme qui a fait disparaître la contradiction du champ de la réflexion. À quelques exceptions près, tous ceux qui appartenaient à une école de pensée différente ont été éliminés du paysage intellectuel. Cette paresse idéologique n’est-elle pas à l’origine de la situation actuelle ?
Enfin, puisque vous avez évoqué les États-Unis, pourquoi ne pas avoir mentionné le Far East, à mon sens plus important pour notre avenir ? Quelle est la position de la Chine, si tant elle qu’elle soit connue, sur les propositions du G20 ?
M. le président Henri Emmanuelli. À l’adresse de M. Launay, je rappellerai que Mme Lagarde a expliqué hier que la France demanderait à l’Irlande de remonter le taux d’imposition des sociétés.
Mme Arlette Grosskost. La position de la France a été présentée dans les mêmes termes par le Président de la République.
Est-il possible de comparer les banques entre elles, tant que nous n’aurons pas réglé le problème de leur différentiel comptable ? D’autre part, l’obligation de consolider les hauts de bilans ne risque-t-elle pas de surenchérir le coût du crédit, ce qui posera un problème à moyen et, surtout, à court terme ? Enfin, le Fonds de stabilisation financière de la zone euro arrivera à terme en 2013 mais, en l’absence de gouvernance européenne établie, comment pourrons-nous articuler un mécanisme permanent de gestion de crise ?
Mme la ministre. En matière de rémunération des opérateurs de marché, les établissements français ont comparé leurs pratiques avec celles d’autres pays (Grande-Bretagne, États-Unis, Japon) ou d’autres places financières (Hongkong, Singapour), où ils possèdent parfois des salles de marché. Ils ont constaté que certains acteurs ne respectaient pas les règles du G20, remplaçant par exemple les bonus garantis par des welcome bonus, qui leur sont comparables. Lors de la réunion du G20 à Pittsburgh, nous avions opté pour l’encadrement des rémunérations, et chargé le Conseil de stabilité financière de vérifier le suivi de cette décision. Il ressort de son premier rapport que les établissements d’Europe continentale ont appliqué à la lettre les principes de l’encadrement, alors que les autres se sont contentés d’en respecter l’esprit. Cette différence s’explique peut-être par l’attachement des premiers au code civil et des seconds à la common law, laquelle se développe selon la réalité quotidienne.
Nous avons obtenu que le Conseil de stabilité financière instaure en son sein un comité chargé du suivi permanent de l’encadrement de la rémunération des opérateurs de marché. Nous attendrons son prochain rapport pour prendre des décisions. Par ailleurs, quand nous savions que certains dérogeaient aux principes, l’Etat a demandé à leurs responsables de nous apporter la preuve qu’ils s’étaient mis en règle avant de continuer à travailler avec eux. Cette démarche n’a pas été inefficace.
Cependant, une fois qu’on a instauré un encadrement, assuré la lisibilité des produits, exigé l’information et prévu des sanctions, la tendance naturelle du secteur bancaire – sans doute le plus immédiat à appréhender, du fait que son activité est subordonnée à des licences et à des exigences en capital prévues par Bâle 2 – est de pratiquer le shadow banking, ce qui revient à sortir du lit du fleuve pour naviguer au large. C’est pourquoi régulateurs, parlements et gouvernements, attachés au bon fonctionnement de l’économie, devront constamment étudier le comportement des opérateurs de marché, des banquiers et des fonds alternatifs ou non. C’est ce qui permettra à la réglementation d’évoluer pour appréhender ces activités qui, compte tenu des volumes qu’elles déplacent et de l’effet de levier, exposent nos économies à des risques dont il faut les protéger.
Je ne suis pas convaincue que les banques aient vocation à développer les plateformes alternatives, mais il existe, dans ce domaine comme dans d’autres, un comportement moutonnier. Dès lors qu’un opérateur met en place de tels outils, il est imité. D’où la nécessité de les réglementer et de les superviser.
Les mécanismes du HFT sont peu connus. Compte tenu de la rapidité avec laquelle ils génèrent des mouvements de cotation artificiels, ma tendance première serait de les réglementer, de les encadrer strictement, voire, une fois comparés leurs avantages et leurs coûts, de donner à l’Autorité des marchés la possibilité de les interdire dans certaines circonstances. L’important est de disposer d’un mécanisme de régulation. Enfin, en matière de formation de prix et de rencontre entre l’offre et la demande, il faut exiger que les génies de l’algorithme qui travaillent sur le HFT mettent en place des coupe-circuits technologiques. À défaut, on verra se reproduire des krachs comme celui du 6 mai 2010, parce qu’un mécanisme n’aura pas fonctionné ou se sera emballé, soumettant les marchés à des mouvements erratiques. J’ai demandé au président de l’AMF que soient analysés les avantages et des inconvénients de ce dispositif particulièrement risqué. Il a engagé des travaux en ce sens.
Quant à savoir si l’AMF est dépassée par les missions qui lui sont confiées, elle seule peut le dire. À la demande de son président, nous avons débloqué des moyens supplémentaires. Elle disposera de 450 agents en 2011, soit 60 personnes de plus qu’en 2010. Il faut maintenir le dialogue très étroit, que permet le système français de supervision, entre le ministère des finances, l’AMF, l’Autorité de contrôle prudentiel et la Banque centrale, de manière à nous assurer au quotidien que nous sommes en mesure de répondre à la diversité des risques et à la diversification des sources de ces risques. J’ai longtemps pensé que l’Autorité de la concurrence devait être privilégiée pour réguler de manière appropriée le comportement des acteurs économiques, mais je considère aujourd’hui que l’AMF est prioritaire, et qu’elle doit posséder les moyens de prévenir les risques financiers.
Monsieur le rapporteur, vous m’avez demandé s’il était possible d’étendre au-delà du cadre national les efforts de régulation en vue d’une plus grande lisibilité. C’est ce qui se passe sur le plan européen. À cet égard, malgré la bonne volonté qu’affichait son prédécesseur, la nomination du nouveau commissaire au marché intérieur et aux services est une excellente nouvelle. Celui-ci aura à cœur de faire avancer les travaux concernant les agences de notation, le marché des instruments financiers et la réglementation applicable aux produits dérivés. Pourtant, si la France est pour lui un allié de poids, il devra compter avec vingt-sept États, dans lequel le secteur financier représente un poids différent. C’est un combat quotidien – nous l’avons mesuré pour la directive sur les fonds alternatifs. Parfois, il faut renoncer à sa position initiale pour obtenir une réglementation applicable à tous, même s’il n’est pas question de transiger sur certains principes fondamentaux.
Quand nous avons commencé de réfléchir plus profondément à la situation des établissements bancaires impliqués dans la crise, j’étais tentée par la position peut-être simpliste qui consistait à plafonner l’effet de levier, comme l’ont fait le Canada et, d’une certaine manière, l’Espagne. Il semble que les accords de Bâle 3 permettront d’atteindre cet objectif par un procédé moins rigide. Il faudra rester attentif pour vérifier qu’ils sanctionnent effectivement, par des exigences de capitaux propres, l’utilisation d’effets de levier démesurés.
Lors de la crise, le mécanisme de coordination nationale qui existait en France, et dont j’espère qu’il sera renforcé par la mise en place de l’Autorité de contrôle prudentiel, a plutôt bien fonctionné. Il est précieux, quand la situation se détériore, que les acteurs d’un secteur partagent le même sens de l’État. Pendant les mois les plus difficiles, entre septembre et novembre 2008, quand j’ai organisé tous les jours à sept heures du matin une conférence téléphonique, il était utile qu’ils se parlent et se comprennent de manière presque intuitive.
Au niveau européen, nous sommes en situation de test. Les instances de coordination que nous avons mises en place – les autorités bancaire, assurancielle, des marchés, le contrôle pour l’identification des risques et la fonction d’arbitrage tolérée par la Grande-Bretagne – devront fonctionner.
Monsieur Launay, la réglementation Bâle 3 et la CRD 3 répondront à l’objectif de conservation des produits titrisés et à l’exigence de fonds propres.
M. le président Henri Emmanuelli. L’exigence est diversifiée en fonction des titres.
Mme la ministre. En effet, l’exigence de capital ne sera pas identique pour tous.
M. le président Henri Emmanuelli. À cet égard, les actions ne sont pas bien traitées, ce qui hypothèque l’avenir des entreprises.
Mme la ministre. Le reproche vaut aussi pour la réglementation Solvabilité II, qui oblige à décoter les actions pour prendre en compte le risque lié à leur détention. Nous travaillons à améliorer les textes d’application européens sur ce point, qui présentent une vraie difficulté.
M. Launay a également plaidé pour la mise en place d’un mécanisme de prévoyance mobilisable au niveau international. On sait que la France dispose déjà d’un fonds de garantie des dépôts. Par ailleurs, nous avons instauré une taxation que nous avons préféré ne pas affecter à un fonds national. Une réflexion est menée au niveau européen. Toutefois, à court terme, je ne crois pas à la faisabilité ni à l’effectivité d’un mécanisme mondial, compte tenu de la difficulté de rassembler les volontés quand il faut trouver des financements ou assouplir des lignes de crédit, notamment au niveau du Fonds monétaire international. La mise en œuvre d’un tel projet, séduisant sur le papier, me semble irréaliste.
Quand l’Autorité fédérale allemande de surveillance des services financiers (BAFIN) a décidé d’interdire les ventes à découvert, elle a frappé les marchés de stupeur, d’autant que cette décision prise sans concertation ni avis préalable concernait même les titres relatifs à des dettes souveraines européennes de toute catégorie.
M. le président Henri Emmanuelli. À des dettes souveraines « de toute catégorie » ou uniquement à la dette autrichienne et allemande ?
Mme la ministre. D’abord de toute catégorie, avant que, mesurant les conséquences de sa décision, l’Allemagne ne réduise considérablement le champ d’application de la mesure. Dès lors, l’interdiction ne s’est plus appliquée qu’à des titres allemands et autrichiens détenus par des opérateurs allemands. Elle s’est donc réduite comme une peau de chagrin.
M. le président Henri Emmanuelli. La Deutsche Bank ne l’appliquait même pas sur sa plateforme de Londres, où elle réalise la plupart de ses opérations de marché. C’est dire si le dispositif était limité !
Mme la ministre. J’ai rappelé à la Commission des finances que nous avons interdit les ventes à découvert sur les valeurs financières dès le début de la crise. Mais de telles mesures ne peuvent être prises que de manière concertée et avec un avis préalable. D’ailleurs, en réduisant progressivement le champ d’application de sa décision, l’Allemagne en a reconnu implicitement le caractère excessif.
Lors du sommet de Lisbonne, le Président de la République a expliqué la position française à l’égard de l’Irlande. Il nous semble impératif que ce pays utilise l’outil fiscal pour limiter son déficit budgétaire. Pour l’heure, nous saluons la vigueur du plan annoncé par son gouvernement et la détermination courageuse dont il fait preuve. Nous suivrons attentivement le processus parlementaire qui s’engage à présent.
Monsieur Brard, je vous concède que les opérateurs comme la doctrine peuvent avoir un caractère moutonnier. La vertu de votre position consiste précisément à proposer des pistes d’amélioration et à exercer utilement certaines pressions. Mais, si important que soit le Far East, ouvrons grand la boussole : le PIB américain est encore trois fois plus important que le PIB chinois, et son montant par habitant dix fois supérieur. Si la Chine a pris rapidement son essor, on ne peut oublier la puissance financière de l’Ouest. D’ailleurs, dans toutes les discussions menées au G20, nos partenaires chinois se sont toujours montrés favorables aux propositions d’encadrement et de régulation. Nous avons rencontré quelques difficultés en ce qui concerne les juridictions non coopératives,…
M. le président Henri Emmanuelli. Notamment Hongkong !
Mme la ministre. …mais nous avons pu aboutir, et je m’en réjouis. Pour le reste, la Chine a toujours été au rendez-vous.
Madame Grosskost, vous avez raison de mentionner le différentiel comptable entre les banques. Tant que subsisteront des US GAAP (United States generally accepted accounting principles) et des IFRS (International financial reporting standards) avec, d’un côté, la préférence pour le mark to market et, de l’autre, la tentation de regarder la valeur historique des actifs, on comparera des carottes et des choux. De ce fait, quand nous édictons des principes ou définissons des règles, nous devons établir des tableaux de convergence ou faire œuvre de réconciliation en évaluant les quantités en US GAAP et en IFRS. Nous devrons nous livrer à cet exercice sur les ratios de capitaux propres. Ceux de la Deutsche Bank varient du simple au double selon la norme utilisée. En l’état, la détermination que nous avons réaffirmée dans le communiqué de Séoul tend à privilégier la convergence. J’espère que nous y parviendrons.
L’accord de Bâle 3 multipliant par 3,5 les exigences en capitaux propres pour les banques, je conviens que l’utilisation du bilan pèsera sur le financement des entreprises. C’est pourquoi nous nous sommes battus pour maintenir, entre 2013 et 2019, une longue période de transition, préférant un ajustement graduel à une montée en puissance brutale du dispositif.
M. le président Henri Emmanuelli. Les États-Unis y sont-ils favorables ?
Mme la ministre. Nous le leur avons demandé systématiquement à chaque réunion du G20 et, pour la première fois, le président des États-Unis a écrit à tous les membres pour fixer ses objectifs, en précisant que les Américains appliqueraient les règles de Bâle 3 en 2013.
M. le rapporteur. Est-ce à dire qu’ils appliqueront les règles de Bâle 2 en 2011 ?
Mme la ministre. À mon sens, ils passeront directement à Bâle 3 en 2013.
M. le président Henri Emmanuelli. Le Sénat américain a-t-il la possibilité de bloquer cette décision ?
Mme la ministre. Je ne le pense pas. De notre côté, nous appliquerons la CRD 3 au 1er janvier 2011. C’est un sujet sur lequel il ne faut rien lâcher pour que, même si l’on conserve des différences comptables, les grands principes de Bâle 3 soient les mêmes des deux côtés de l’Atlantique. À défaut, nos banques souffriraient de manière flagrante d’un désavantage compétitif.
Enfin, vous m’avez interrogée sur le Fonds de stabilisation européen, qui peut consentir des programmes d’assistance jusqu’en 2013. Ceux-ci étant conçus pour environ cinq ans, il a encore huit ans devant lui. Cependant, nous réfléchissons actuellement à son remplacement. L’autorité allemande a soumis un premier projet, mais nous défendrons certains principes. Le mécanisme, dans l’hypothèse où il engagerait le secteur privé, doit s’appliquer au cas par cas. Par ailleurs, ses règles doivent être conformes à celles du Fonds monétaire international, ce qui évitera qu’on réserve un traitement différent aux créanciers. Il va de soi que, dans un paquet conjoint, les termes et les conditions doivent être identiques pour tous.
M. Jean Launay. J’en reviens à ma question sur la conditionnalité du soutien de l’Union européenne à l’Irlande, dont le taux d’imposition sur les sociétés est de 12,5 %.
M. le président Henri Emmanuelli. À mon sens, l’audition étant publique, Mme Lagarde n’ajoutera rien à ce qu’elle vous a déjà dit.
M. Jean Launay. Y a-t-il eu discussion sur ce point ?
Mme la ministre. Le Gouvernement irlandais a soumis son projet au Parlement, et les négociations avec la Commission et le Fonds monétaire international se poursuivent.
M. le président Henri Emmanuelli. Le Gouvernement le sait, nos compatriotes auraient du mal à comprendre que nous nous portions au secours d’un pays qui nous a volé beaucoup de matière fiscale.
Madame la ministre, nous vous remercions.
L’audition s’achève à dix heures cinquante.
*
* *
Audition de M. Michel Barnier,
commissaire européen chargé du marché intérieur et des services
(réunion de la Commission des Affaires européennes ouverte aux membres de la commission d’enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement des économies – séance du 1er décembre 2010)
(Présidence de M. Pierre Lequiller, Président de la Commission des Affaires européennes
et de M. Henri Emmanuelli, Président de la Commission d’enquête)
Seuls les extraits du compte rendu concernant les sujets entrant dans le champ de compétences de la Commission d’enquête sont reproduits ci-dessous.
La séance est ouverte à dix-huit heures quarante
Le Président Pierre Lequiller. C’est avec un grand plaisir, Monsieur le commissaire, que nous vous accueillons, pour la première fois depuis votre nomination, M. le Président Emmanuelli, Président de la commission d’enquête sur les mécanismes de la spéculation et moi-même. Vous êtes chargé du marché intérieur et des services, domaine capital s’il en est. Premier Français à exercer ces responsabilités majeures au sein de la Commission européenne, vous avez enregistré des résultats concrets et rapides.
Les sujets européens à l’ordre du jour de notre réunion sont nombreux : la relance du marché unique après le rapport Monti, les chantiers législatifs dans le domaine financier – la surveillance financière et les agences de notation, les marchés de titres, les produits dérivés, les projets de taxe bancaire. Sur tous ces sujets, l’Europe parvient-elle à se coordonner avec les Etats-Unis ? Au sein du G20, en quoi consiste l’action de l’Union en matière de régulation économique et financière ? Comment l’Europe envisage-t-elle la gestion des crises bancaires ? Comment se déroulent les négociations sur la proposition de révision de la directive relative au fonds de garantie des dépôts bancaires ?
Le président Henri Emmanuelli. Je remercie le Président Lequiller d’avoir accepté d’ouvrir cette audition aux membres de notre commission d’enquête.
Vous êtes, Monsieur le commissaire, la dernière personne que celle-ci entendra, ce qui donne à cette réunion une importance particulière pour nous, d’autant qu’au fil des auditions, nous avons acquis la conviction que c’était à l’échelon européen que se trouvaient, sinon les solutions, du moins les moyens de combattre les phénomènes spéculatifs pathogènes – cela dit sans mésestimer pour autant le rôle du G20 puisque les mouvements de capitaux se sont internationalisés.
Nous voudrions donc savoir où en sont les chantiers ouverts par la Commission : produits dérivés, CDS et dette souveraine, et la révision de la désastreuse directive MIF, unanimement dénoncée devant nous pour avoir contribué à opacifier et fragmenter les marchés. Alertés par les représentants de l’industrie agroalimentaire, nous souhaiterions également connaître vos projets concernant les marchés de matières premières, qui ne font l’objet d’aucune réglementation européenne. S’y négocient désormais aussi des produits dérivés, dont certains sont très exotiques, voire nocifs. Par ailleurs, le trading algorithmique est-il dans votre ligne de mire ? La Commission envisage-t-elle de réglementer les ventes à découvert ? Bref, que pouvons-nous attendre de l’Europe pour endiguer la spéculation et prévenir les crises ?
M. Michel Barnier, commissaire européen en charge du marché intérieur et des services. Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les députés, je suis heureux d’avoir l’occasion de revenir à l’Assemblée nationale où j’ai eu l’honneur de siéger, à vos côtés, pendant une vingtaine d’années. Sachez que ma disponibilité pour dialoguer avec vous est totale, ici ou à Bruxelles, où il y a toujours intérêt à se rendre, pour rencontrer tel ou tel membre de la Commission européenne, ou tel ou tel directeur général. A toutes fins utiles, je rappelle que je ne représente pas la France, même si c’est la première fois en cinquante ou soixante ans qu’un Français est nommé à ce poste, et même si cette nomination a suscité un certain émoi, qui s’est d’ailleurs largement apaisé.
Le domaine qui m’est confié se divise en deux grands pôles : le pôle de la régulation et de la supervision financières, et celui du marché unique, qui se fonde sur les quatre libertés de circulation – des personnes, des marchandises, des services et des capitaux – et comprend aussi les marchés publics et la propriété intellectuelle. Depuis une dizaine de mois, je m’efforce d’œuvrer sur tous ces fronts en mettant au service de mon action une capacité d’enthousiasme, et éventuellement d’indignation, qu’il ne faut jamais perdre quand on fait de la politique – et les commissaires restent des politiques.
La construction européenne est arrivée à un moment de vérité. Elle est interpellée de l’extérieur par la montée de très grandes puissances, d’Etats à l’échelle d’un continent, qui ne demandent plus la permission – ainsi, les négociations de Doha ont été bloquées par l’Inde qui n’a pas hésité à afficher son désaccord avec les Etats-Unis – et qui n’ont besoin de personne, contrairement aux pays européens qui ont, eux, besoin d’être ensemble. Nous affrontons également des crises profondes telles que le changement climatique, la crise alimentaire qui se poursuit et, depuis deux ans, la crise financière, d’une violence inouïe.
Les défis internes ne manquent pas non plus, à commencer par le rejet de la Constitution européenne par le peuple français qui a clairement montré la divergence entre le projet européen tel qu’il se construit et les citoyens. C’est d’ailleurs une des raisons qui m’a poussé à demander à revenir à Bruxelles pour participer à un changement allant dans le sens d’une plus grande proximité avec les citoyens. Je me suis fixé deux objectifs stratégiques que j’ai exposés en janvier devant le Parlement européen : remettre les services financiers et les marchés au service de l’économie réelle ; et, en même temps, remettre l’économie réelle et le grand marché unique qui la sous-tend au service de la croissance et du progrès humain. Ce double objectif restera le mien jusqu’à la fin de mon mandat et c’est à cette aune que je vous demande de mesurer mon action.
Remettre les marchés au service de l’économie signifie remettre des règles, de la régulation, des limites, de la transparence et même de la morale, voire de l’éthique, là où elles avaient disparu. Très tôt, sous l’impulsion du Président de la République française et d’autres chefs d’Etat comme Mme Merkel, le G20 s’est saisi des problèmes en suspens. Souvenez-vous de Washington, Londres, Pittsburgh… Aucun marché financier, aucun acteur financier, aucun produit financier, aucun territoire ne doit rester à l’écart d’une régulation intelligente et d’une supervision efficace. Telle est la feuille de route du G20, qui est aussi la mienne. Je suis déterminé à la mettre en œuvre le plus rapidement possible mais sans improvisation compte tenu de la complexité du sujet. C’est l’occasion de rendre hommage à mon équipe, restreinte et compétente – un commissaire européen est épaulé par sept conseillers et un porte-parole –, en n’ayant garde d’oublier la direction générale du marché intérieur, qui travaille à flux tendus sur tous ces sujets.
J’ai passé beaucoup de temps à créer un cadre global pour la supervision. La crise que nous avons traversée a été une crise de liquidité, mais aussi de la supervision, qui a failli un peu partout. C’est la raison pour laquelle le Président Barroso avait demandé au groupe de travail présidé par Jacques de Larosière de faire des propositions pour une architecture européenne de la supervision. Elles ont ensuite été traduites en propositions législatives par la Commission et, il y a quelques semaines, le conseil des ministres à l’unanimité, et le Parlement européen à la quasi-unanimité de ses groupes politiques, ont approuvé la création des trois autorités européennes de supervision – pour les banques, les assurances et les marchés –, et, au-dessus de ces trois écrans radars, d’une tour de contrôle : le Conseil européen des risques systémiques. Le 1er janvier, nous disposerons enfin de cette architecture européenne et nous allons la meubler, élément par élément – produit par produit, secteur par secteur.
Je ne puis agir qu’avec l’accord conforme du conseil des ministres et du Parlement européen, dont vous savez qu’ils ont désormais une responsabilité équivalente. Or, à l’unanimité du premier et à une très large majorité du second, nous avons obtenu il y a quinze jours, un deuxième vote important. Il a porté, et c’était une première, sur un pan entier des marchés financiers : les hedge funds et le private equity.
Produit par produit, secteur par secteur, marché par marché, nous allons donc réguler partout où c’est nécessaire. J’ai proposé au mois de septembre deux régulations lourdes, dossiers qui avancent plutôt bien dans le circuit législatif : la régulation des produits dérivés – ce sont 600 000 milliards de dollars qui échappent à la régulation – et, parallèlement, la régulation et la supervision des ventes à découvert, notamment à nu. La deuxième étape de la régulation des agences de notation progresse assez rapidement et je viens d’ouvrir le débat public sur la régulation des sociétés d’audit. Au terme d’un débat, public également, nous réviserons au début de l’année prochaine la fameuse directive sur les marchés financiers qui, bien qu’utile, a eu des effets négatifs qui doivent être corrigés. En réexaminant prochainement la directive sur les abus de marché, nous renforcerons les sanctions. Etant attaché à la culture de la prévention des risques et de la prévoyance, j’ai fait au conseil des ministres des propositions pour prévenir les crises et faciliter leur résolution au sein des banques. Des outils d’alerte et des modalités d’intervention seront prévus en interne pour éviter, d’une part, le déclenchement d’une crise, d’autre part, que celle-ci ne se transforme en catastrophe que le contribuable doive finalement payer. C’est aux banques de payer pour les banques !
Autre domaine essentiel, la réglementation prudentielle. Le comité de Bâle, qui travaille en liaison avec le G20 et le Financial Stability Board, vient d’élaborer des normes de fonds propres qui s’appliqueront aux établissements bancaires. Ses propositions, qui auront à être traduites en directives, doivent assurer la sécurité du système financier sans peser sur la reprise de la croissance : en Europe en effet, contrairement à ce qui se passe aux Etats-Unis, ce sont les banques qui couvrent les deux tiers, voire les trois quarts, des besoins de financement de l’économie.
J’ai l’intention de déposer la totalité des textes pris en application des orientations du G20 sur le bureau du conseil des ministres et du Parlement européen à la fin du mois de juin prochain.
J’insiste sur la nécessité dans laquelle l’Europe se trouve d’agir en bonne intelligence et parallèlement avec les autres régions du monde parties prenantes au G20, en coopérant avec elles, en confiance mais sans naïveté. Je passe ainsi beaucoup de temps aux Etats-Unis pour veiller à la cohérence de notre action – le cadre législatif n’est pas le même – et à sa synchronisation. J’ai ainsi rencontré M. Geithner et les régulateurs américains. Je suis aussi allé à Chicago voir fonctionner les marchés à terme de matières premières. Nous devons impérativement traduire nos engagements du G20 dans des délais voisins pour ne pas créer de distorsion de concurrence ou encourager à nouveau l’arbitrage réglementaire, aux conséquences désastreuses. Pour le moment, nous avançons parallèlement même si nos méthodes ne sont pas les mêmes, les Américains ayant opté pour une loi globale, le Dodd-Frank Act, et, nous, Européens, pour des textes séparés.
Une fois le secteur financier remis au service de l’économie réelle, nous attaquerons le deuxième chapitre consacré au grand marché dont le bon fonctionnement doit servir le progrès humain et la croissance que les citoyens attendent.
Le professeur Monti, qui a été commissaire successivement au marché intérieur et à la concurrence, a dressé un constat très lucide sur le marché intérieur, pierre angulaire du projet européen. En 1950, Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer et quelques autres hommes politiques courageux ont compris que, pour assurer une paix et une démocratie durables, il fallait avoir non seulement envie d’être ensemble, mais aussi y trouver un intérêt ; d’où la première étape de la mutualisation des ressources en charbon et en acier. D’étape en étape, de 1957 à 1992, nous sommes parvenus au marché unique, sous l’impulsion notamment de Jacques Delors. Il ne faudrait pas que son vingtième anniversaire soit célébré dans la nostalgie et la mélancolie. C’est pourquoi nous avons décidé de le relancer en nous inspirant des propositions de Mario Monti, en débloquant les verrous qui empêchent les Européens de mieux échanger, de mieux créer, de mieux entreprendre ensemble.
Si le marché unique, qui compte 500 millions de consommateurs et 21 millions d’entreprises, fonctionnait mieux, nous pourrions trouver chez nous en Europe deux, trois, voire quatre points de croissance supplémentaires en quelques années. Nous n’avons pas le droit de ne pas les chercher là où ils sont et de décevoir les attentes des citoyens. Tel est l’objet du Single Market Act, de l’Acte pour le marché unique, que la Commission a approuvé le 27 octobre. Nous lançons le débat en adressant dans leur langue à tous les parlementaires nationaux, à toutes les régions, à toutes les forces économiques et sociales européennes, un petit livre bleu, et en demandant à tous de nous faire part de leurs remarques et de leurs idées pour améliorer le marché intérieur. Ce document décline nos propositions, d’inégale importance, en trois grands chapitres.
Le premier est consacré à la compétitivité des entreprises, à la capacité d’innovation. J’espère parvenir à débloquer le dossier du brevet européen, question en suspens depuis trente ans. Déposer un brevet européen coûte dix fois plus cher qu’aux Etats-Unis. La conséquence est que les porteurs d’innovation ne se protègent pas correctement, sauf dans quelques pays, ce qui laisse ailleurs le champ libre aux produits contrefaits grâce à nos inventions. Voilà un exemple des obstacles à lever pour libérer la compétitivité.
J’ai la conviction que, pour gagner la bataille de la croissance et de la compétitivité, chaque entreprise est nécessaire, mais aussi chaque citoyen. Le deuxième chapitre s’adresse donc à celui-ci, en tant qu’acteur – entrepreneur, artisan, travailleur ou consommateur, épargnant ou actionnaire – de la vie économique.
Le troisième chapitre concerne la gouvernance, le dialogue social, le partenariat avec les régions, la mise en œuvre de la législation européenne, les études d’impact.
De manière assez inhabituelle, nous mettons ce projet en débat pendant quatre mois, de façon que les parlements nationaux fassent remonter leurs idées. La Commission n’entend donc pas imposer ce texte. Au mois de février, nous arrêterons la liste définitive de nos propositions et les commissaires concernés par ces propositions s’engageront à leur donner corps en deux ans.
M. le président Henri Emmanuelli. Quelle est votre opinion à propos des CDS sur la dette souveraine ? L’article 104 du traité de Maastricht, qui interdit le financement des Etats par les banques centrales, ne met-il pas les pays de l’Union dans les mains du système bancaire, surtout en l’absence de budget européen ?
M. Jean-François Mancel, rapporteur de la commission d’enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement des économies. Existe-t-il aux Etats-Unis un pendant du Conseil européen du risque systémique ? Faut-il, à votre avis, limiter le trading à haute fréquence, voire l’interdire ? Comment s’y prendre pour réintégrer au sein des marchés régulés les transactions, considérables en volume, qui se dénouent aujourd'hui en dehors d’eux ? Enfin, est-il possible de n’autoriser à intervenir sur les marchés que les acteurs véritablement concernés en écartant les spéculateurs purs ?
M. Michel Barnier. S’agissant des ventes à découvert, Monsieur le président Emmanuelli, la régulation posera des obligations de transparence – notamment l’enregistrement des opérations – et la faculté pour les autorités de régulation nationales de les interdire de manière coordonnée. Aujourd'hui, elles peuvent le faire individuellement – l’Allemagne l’a fait, la France aussi – mais notre proposition comporte une procédure pour harmoniser et coordonner la décision. De même, est prévue pour les ventes à découvert à nu une obligation de couverture au-delà de trois jours. Cela étant, le Parlement et le conseil des ministres ont encore leur mot à dire sur ces sujets.
Par ailleurs, l’Autorité de régulation des marchés, l’ESMA – European Securities and Markets Authority – qui verra le jour le 1er janvier, aura le pouvoir d’interdire tel ou tel produit, telle ou telle pratique, ce qui constitue un réel progrès. Les trois superviseurs européens seront eux aussi dotés de véritables pouvoirs. N’oublions pas que, dans la moitié des Etats membres, la moitié des banques appartiennent à un autre pays, et même parfois beaucoup plus – la proportion est de 80 % en République tchèque. Les banques sont transnationales. Pourtant, jusqu’à présent, la régulation ne l’était pas. Elle va le devenir. Les superviseurs nationaux subsisteront parce qu’ils sont plus proches du terrain, mais ils travailleront de manière mutualisée grâce aux autorités européennes.
Aux États-Unis, un conseil des risques systémiques a été mis en place il y a quelques semaines. A quelques mois près, le parallélisme, auquel je suis, je vous l’ai dit, très attentif, sera donc respecté. De même, j’ai veillé à ce que les décisions prises de part et d’autre de l’Atlantique sur les produits dérivés et les ventes à découvert soient cohérentes. Je travaille aussi avec les Américains sur le sujet très compliqué du high frequency trading. Il ne s’agit pas de l’interdire, mais il est très préoccupant de voir les machines remplacer les hommes et la nanoseconde devenir l’unité de mesure temporelle des opérations. Dans ce domaine aussi, nous voulons introduire de la transparence et du contrôle. Je vous préciserai ultérieurement nos projets, mais nous nous concertons avec les Américains. C’est un des sujets qui sera traité dans la nouvelle directive MIF, comme la lutte contre la spéculation particulièrement scandaleuse qui opère sur le marché des matières premières agricoles.
Comment introduire de la transparence et de la régulation sur les marchés de gré à gré et lutter contre les dark pools ? Nous traitons les sujets un par un, sans aucun tabou. Je le répète : aucun acteur, aucun produit, aucun marché ne sera laissé de côté. Nous avons deux outils à notre disposition : la directive MIF qui imposera des exigences accrues, notamment aux dark pools, et des limites de position, comme il en existe aux Etats-Unis, pour lutter contre la spéculation sur les matières premières, notamment agricoles, et éviter les positions dominantes sur un marché particulier ; d’autre part, le règlement sur les produits dérivés qui généralisera la transparence en rendant obligatoire l’enregistrement des transactions, en incitant à la standardisation des produits et à la compensation. Cette orientation nous obligera à créer des infrastructures, les trade repositories et les chambres de compensation. Nous voulons savoir qui fait quoi sur ces marchés.
M. Jean Gaubert. Vous avez déclaré, Monsieur le commissaire, que les banques devraient payer pour les banques. Hormis les prêts qui leur ont été consentis, c’est ce qui s’est passé, mais il faudrait aussi éviter que les clients ne soient mis à contribution par le biais de l’augmentation des frais ou des marges bancaires, qui ont déjà servi à payer des bonus aux dirigeants – le directeur financier d’une grande banque française avec lequel je discutais tout récemment n’a pas pu me dire le contraire.
Que pensez-vous de la position des banques qui font valoir que Bâle III, en les obligeant à augmenter une nouvelle fois leurs marges, risque de freiner le financement des économies, un financement dont celles-ci ont terriblement besoin ?
Enfin, comment s’articulent vos attributions avec celles du commissaire chargé de la concurrence ?
[…]
M. Franck Riester. Comment s’articuleront le Conseil européen des risques systémiques et les trois autorités de supervision des banques, des assurances et des marchés ? Comment associer les Européens à la réflexion que vous menez sur le lien entre économie réelle et croissance ?
[…]
M. Louis Giscard d'Estaing. Je me réjouis des initiatives récentes de la Commission et de la tonalité différente que vous donnez à votre action par rapport à votre prédécesseur M. McCreevy. La régulation fait-elle désormais partie de vos fonctions au même titre que la libéralisation des marchés ? De qui relèvent les normes comptables, qui ne sont pas gérées en tant que telles au niveau européen ? Dans le domaine bancaire, quelles sont les responsabilités respectives de la BCE, des banques centrales nationales, de l’Autorité bancaire européenne et du commissaire chargé du marché intérieur ?
M. Daniel Garrigue. En situation de crise, la réactivité est déterminante, on l’a vu en 2008. Vous êtes en train de préparer, concernant les ventes à découvert, un train de mesures pouvant aller jusqu’à l’interdiction dans le cadre d’une procédure harmonisée. Mais comment concilier coordination et rapidité de réaction ? Qu’avez-vous prévu pour les chambres de compensation qui ne sont, malgré tout, qu’un instrument ? Ne faut-il pas aller au-delà ?
[…]
M. Didier Quentin. Toujours pour tirer les leçons de la crise, vous avez annoncé des mesures pour améliorer la surveillance et renforcer la transparence dans la notation du crédit. En quoi consistera le nouveau cadre réglementaire qui entrera en vigueur le 7 décembre ? De manière plus générale, vous nous avez exposé toutes les avancées en matière de régulation, de moralisation des marchés – en allant jusqu’à parler d’éthique. Tout cela va dans le bon sens. Mais comment en faire prendre conscience à une opinion publique défiante ou sceptique quant aux vertus de la construction européenne, quand elle ne s’en désintéresse pas ?
M. Jean-Yves Cousin. Comme vous l’avez rappelé, ce sont les marchés financiers qui, pour l’essentiel, financent l’économie américaine alors que, dans l’Union européenne, ce sont les banques. La loi Dodd-Frank a recentré les banques américaines sur leur mission. En Europe, le comité de Bâle y veille, et bientôt aussi les trois autorités de contrôle européennes. Comment s’articuleront les actions respectives des instances américaines et européennes de sorte qu’on ne revoie plus jamais ce qui s’est passé ?
Mme Arlette Grosskost. Vous avez parlé de mesures relatives aux CDS sur la dette souveraine. Mais est-il prévu quelque chose pour les CDS dits corporate, sur les titres privés ? S’agissant des ventes à terme, les sanctions actuelles sont-elles suffisamment dissuasives ? Et dernière question un peu provocante, que pensez-vous d’un retour à l’étalon-or ?
[…]
M. Pierre-Alain Muet. L’une des raisons majeures de la crise tient à ce que les banques ont pu, par le biais de la titrisation, se défausser en partie des risques qu’elles prenaient. Les obliger à conserver 5 % des crédits dans leurs comptes est-il suffisant ?
D’autre part, parmi les propositions de la Commission figure l’harmonisation de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce volet important de l’harmonisation fiscale ?
[…]
M. Michel Barnier. Vous ne voulez pas que les clients paient la facture, Monsieur Gaubert. Pour notre part, nous voulons éviter, avant tout, que ce ne soient les contribuables. C’est pourquoi nous nous employons à limiter les conséquences des risques. Notre « boîte à outils », qui a fait l’objet de trois débats au conseil des ministres et à laquelle je donnerai forme législative au printemps, procède d’une culture de la prévention.
Elle consiste à imposer une bonne supervision externe et interne à tous les établissements bancaires transnationaux présentant des risques systémiques. Ils devront se doter de comités de superviseurs au sein desquels les différents pays concernés seront représentés, et de comités de résolution ayant véritablement capacité d’agir lorsqu’un risque est diagnostiqué – un mauvais comportement, un conflit d’intérêts ou des erreurs. Ces deux comités devront être en mesure d’intervenir vigoureusement, par exemple en changeant le management, en interdisant certains produits ou certaines activités bancaires, en interdisant la distribution de dividendes ou en faisant appel aux créanciers – ce qu’on appelle le haircut.
Afin que les banques paient pour les banques, j’ai proposé également la constitution d’un « fonds de résolution » permanent, financé par les banques, à l’image de ce qui existe déjà en Suède et de ce qui va exister en Allemagne. Il s’agit d’instaurer, non pas une taxe alimentant le budget de l’Etat, mais une contribution affectée à un fonds spécifique, chargé d’intervenir afin d’éviter des catastrophes qui seraient finalement à la charge des Etats. L’adoption coordonnée d’un tel mécanisme au niveau européen devrait permettre de limiter le risque que les contribuables et les clients n’aient à payer l’addition.
Dans notre système concurrentiel, les clients doivent être bien informés. C’est pourquoi je crois beaucoup en une politique plus active en faveur des consommateurs : ils doivent être à même de vérifier ce qu’on leur demande de payer et de faire des comparaisons, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. J’ai donc interpellé les banques européennes sur leur manque de transparence et sur la disparité des frais qu’elles facturent. Donnant la préférence au contrat plutôt qu’à la contrainte, je leur ai donné un certain temps pour établir la transparence, mais ce temps ne sera pas infini : j’attends d’elles des progrès. Je prendrai également un certain nombre de dispositions, prévues dans l’Acte pour le marché unique, en ce qui concerne l’accès aux comptes bancaires et les prêts hypothécaires. Vous savez que je suis très soucieux de renforcer la protection des déposants – nous sommes déjà allés dans ce sens avec la garantie de 100 000 euros mise en place dans toute l’Europe ; il s’agit maintenant de renforcer la transparence des banques et l’information des clients.
S’agissant de Bâle III, nous ne donnons pas de leçons : nous voulons plutôt les tirer. Les assureurs nous disent qu’ils ne sont pas responsables de la crise, et nous pressent de ne pas les confondre avec les banquiers ; les responsables des hedge funds et des private equities prétendent qu’ils n’y sont pour rien, eux non plus ; les banquiers européens nous conjurent d’éviter tout amalgame entre eux et leurs homologues américains. Si on les écoutait tous, personne ne serait responsable de la crise ! Elle a pourtant eu lieu, et elle a conduit les Etats à intervenir pour sauvegarder le système bancaire et éviter que les citoyens et les clients des banques ne soient pénalisés. Nous devons en tirer les leçons en matière de supervision, de régulation, de transparence et de responsabilité : ce ne sera pas, Monsieur Gaubert, business as usual. Le problème est de bien calibrer les décisions et de s’assurer que toutes les régions du monde agissent de conserve.
Les mesures de Bâle III sont en train d’être finalisées au moment où je vous parle. Il me semble que le comité de Bâle, auquel nous avons participé activement en faisant valoir les spécificités européennes et les problèmes particuliers qui se posent dans tel ou tel Etat membre, est parvenu à un résultat assez réaliste et globalement équilibré. L’enjeu est maintenant de le mettre en œuvre en ménageant des périodes de transition et en veillant à un calibrage aussi intelligent que possible et au parallélisme des actions entre Américains et Européens. Je serai particulièrement attentif à ce dernier point, car les Etats-Unis n’appliquent toujours pas Bâle II. Je m’en suis entretenu, les 9 et 10 mai derniers, avec Tim Geithner, le secrétaire américain au Trésor. Nous avons adopté un communiqué commun prenant acte de l’engagement américain de mettre en œuvre totalement Bâle II au milieu de l’année 2011. Il restera ensuite à appliquer Bâle III, mais c’est un enjeu collectif.
[…]
Même s’il est difficile d’imaginer ce que le passé aurait pu être dans d’autres circonstances, Monsieur Giscard d’Estaing, il est probable que les banques auraient été mises en alerte en Irlande si nous avions disposé de la « boîte à outils » que j’évoquais tout à l’heure ; nous aurions pu diagnostiquer les risques à temps, ce qui nous aurait évité d’avoir à prendre des dispositions pour conjurer une catastrophe. Si nous allons instaurer une régulation intelligente, ce n’est pas pour le plaisir de réguler, mais parce qu’il faut des règles, de la transparence et des limites, y compris pour les rémunérations et les bonus, comme les autorités européennes l’ont décidé, sur proposition de la Commission, dans le cadre de la directive sur les fonds propres réglementaires, « CRD 3 ». Je ne crois pas, en effet, à l’autorégulation des marchés : nous avons besoin de règles. Cette leçon a été bien comprise, me semble-t-il.
Nous suivons très attentivement la question des normes comptables. Celles-ci sont élaborées dans le cadre de l’International Accounting Standards Board (IASB), qui se réunit régulièrement à Londres, à New York et bientôt à Tokyo. Je ne manque aucune de ses réunions, auxquelles je ne regrette jamais de participer. L’organisme est animé par un Board of Trustees, composé de personnalités éminentes du secteur privé, et par un Monitoring Board, qui regroupe des représentants des institutions, tels que Mary Schapiro, au nom de la Securities and Exchange Commission (SEC), ou moi-même, au titre de l’Union européenne. Les normes comptables sont un sujet essentiel, qui fait l’objet de débats. Nous élaborons ensemble ces normes, mais elles ne sont pas appliquées par tous. Je suis particulièrement désireux d’aboutir à une convergence, sans être naïf : je suis bien conscient que le débat avec les Américains pourrait conduire à une divergence. Je ne le souhaite pas, et je ferai tout pour que nous n’en arrivions pas là. Nous travaillons quotidiennement avec l’IASB. Un meilleur état d’esprit, marqué par davantage de confiance mutuelle, règne depuis quelques semaines. J’espère que cela nous permettra d’aboutir à des résultats utiles.
S’agissant de la Banque centrale européenne (BCE), dont je n’ai pas besoin de rappeler les compétences, je veux saluer son président et ses équipes pour leur rôle très positif depuis le début de la crise financière. Nous travaillons naturellement ensemble sur de nombreux sujets, en particulier sur les cartes paneuropéennes de crédit.
En matière de ventes à découvert, un très large ensemble de produits est concerné : les actions, les obligations des entreprises ou encore les titres souverains. Même si le temps des marchés sera toujours plus rapide que celui des démocraties, nous avons prévu des dispositifs extrêmement rapides : l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) disposera de vingt-quatre heures seulement pour assurer la coordination des décisions, ce qui est un vrai progrès.
Sans entrer dans les détails, je serai très attentif à ce que nous trouvions les moyens d’assurer la sécurité des chambres de compensation : puisque nous imposons une compensation des produits dérivés, il faudra des infrastructures dotées des normes prudentielles et des sécurités nécessaires pour limiter les risques.
[…]
La régulation des agences de notation, évoquée par Didier Quentin, se fera en trois étapes.
La première, qui a été engagée à l’initiative de mon prédécesseur, a fait l’objet d’une décision et sera totalement mise en œuvre à compter du 7 décembre. Elle consiste à demander à ces agences de s’inscrire auprès des régulateurs nationaux sur le continent européen, ce qui emportera soumission aux législations nationales et européenne. L’instauration de plus de transparence permettra de mieux comprendre leur méthodologie et de limiter les risques de conflits d’intérêts.
Une deuxième étape, que j’ai proposée il y a quelques mois, sera probablement franchie dans les jours qui viennent : il s’agit de placer toutes ces agences, y compris les agences américaines, au nombre de deux parmi les trois principales, sous l’autorité de l’ESMA à compter du 1er janvier prochain. L’ESMA jouera donc un rôle très important, comme les deux autres autorités européennes. A l’instar des Etats-Unis, nous allons imposer la transparence sur les produits financiers intégrés qui sont notés par les agences : les éléments utilisés pour la notation devront être communiqués aux autres agences. Notre volonté est de ne jamais être moins rigoureux que les Américains.
Après avoir ouvert une consultation, je travaille maintenant à une troisième phase qui consisterait à limiter encore les risques de conflits d’intérêts et à augmenter la diversité et la concurrence : il n’est pas normal qu’un marché aussi important que la notation soit concentré entre si peu de mains. Nous voulons favoriser la création d’une ou de plusieurs nouvelles agences, et nous allons probablement travailler sur la façon de noter le plus objectivement possible les dettes souveraines – ce n’est pas la même chose de noter une entreprise ou un produit que de noter un Etat. Une autre question est de savoir si l’on ne pourrait pas redéfinir la place de la notation dans le système financier : son utilisation systématique et généralisée, qui plus est dans un marché aussi peu concurrentiel, pose un problème.
En réponse à Jean-Yves Cousin qui m’interrogeait sur la convergence entre la loi Dodd-Frank et l’action engagée en Europe, je rappelle que nous mettons en œuvre un agenda décidé au plus haut niveau, à savoir celui des chefs d’Etat et de gouvernement du G20. Chacun a ses méthodes : les Américains ont adopté une « loi chapeau » ou « parapluie » de 1 500 pages, dont la mise en œuvre sera progressive ; notre méthode consiste à adopter des législations spécifiques ou sectorielles, que nous avons regroupées dans l’agenda du 2 juin dernier. Nous actualiserons celui-ci en janvier afin de mettre en évidence les progrès réalisés. Depuis juin, deux votes importants ont déjà eu lieu, l’un sur la supervision et l’autre sur les private equities et les hedge funds.
Je me garderai bien d’ouvrir le débat sur l’étalon-or, Madame Grosskost. Je dirai seulement que toutes les idées sont utiles. Le Président de la République, qui préside actuellement le G20, a bien fait de poser la question de la stabilité monétaire. Le rôle du G20 est de favoriser une meilleure gouvernance dans ce domaine. Il ne me semble pas que les Européens pourront durablement accepter de constituer la variable d’ajustement : je crois que la Chine, qui est un pays majeur, aura à cœur d’assumer ses responsabilités, comme le font les Américains, en vue d’assurer la stabilité sur les marchés financiers et monétaires. Cette stabilité est indispensable pour tout le monde, en particulier pour les entreprises.
[…]
Sur la question de l’harmonisation fiscale, posée par M. Muet, vous pourrez utilement saisir mon collègue Algirdas Šemeta.
Le Président Pierre Lequiller. Nous l’avons auditionné en Commission.
M. Michel Barnier. Dans ce cas, vous savez qu’il mène un travail très courageux et très déterminé sur deux chantiers : la simplification du cadre général de la TVA et l’harmonisation des bases de l’impôt sur les sociétés. Nous avons évoqué ensemble cette dernière question, qui est extrêmement sensible, dans le cadre de l’Acte pour le marché unique : il est extrêmement important que nous avancions dans ce domaine, même s’il faudra un vote à l’unanimité. Mon prédécesseur, M. Bolkenstein, avait d’ailleurs proposé de réaliser une coopération renforcée entre pays volontaires en matière d’impôt sur les sociétés.
[…]
J’ai essayé de répondre à toutes vos questions, mais je reste à votre disposition pour continuer le dialogue si vous le souhaitez.
Le Président Pierre Lequiller. Un très grand merci pour cette audition passionnante. Même si nous vous savons très occupé, nous serons naturellement très heureux de vous revoir de temps en temps.
La séance est levée à dix huit heures dix.
*
* *
ANNEXE 2
Graphiques présentés par M. Marc Touati,
directeur général délégué de Global Equities,
lors de son audition par la commission d’enquête,
le mercredi 6 octobre 2010
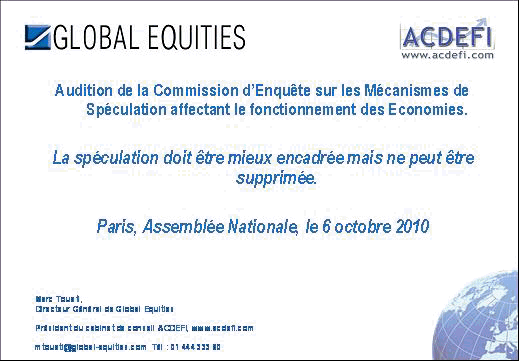
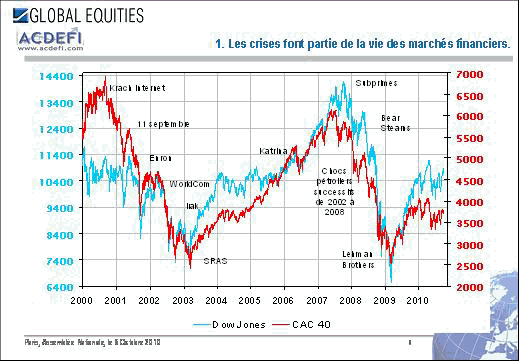
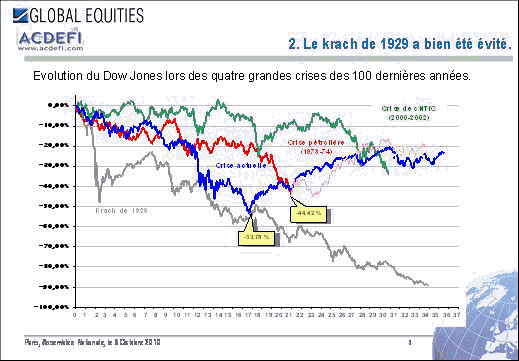
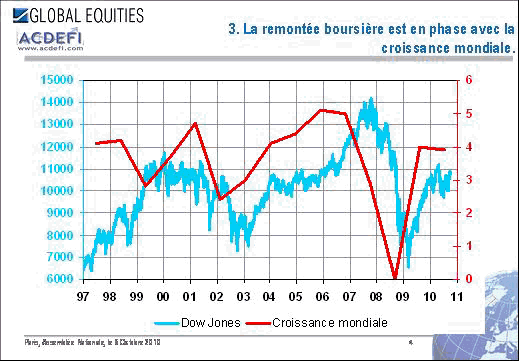
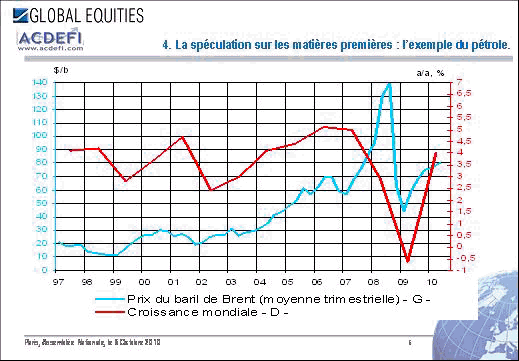
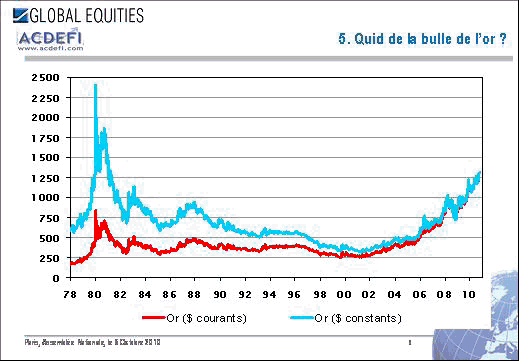
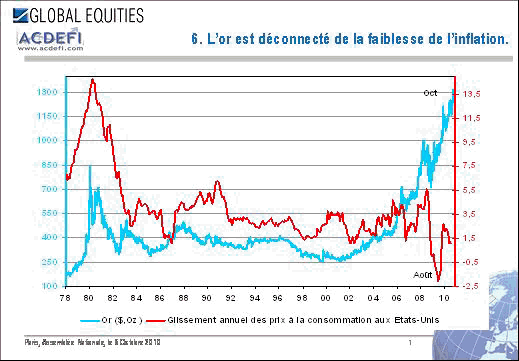
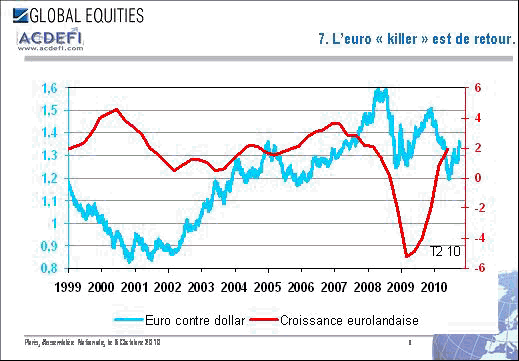
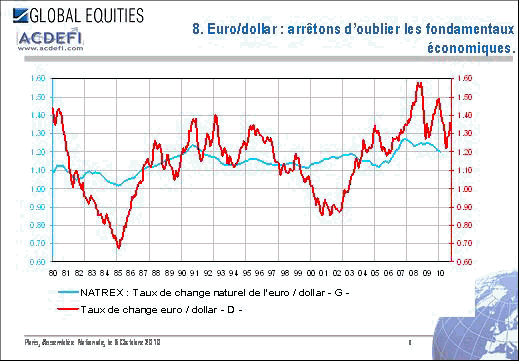
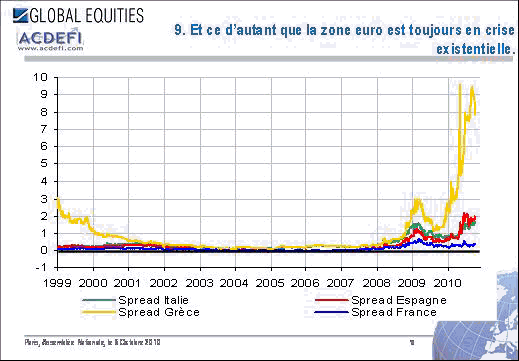
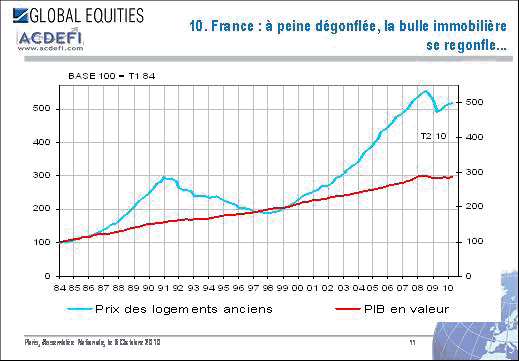
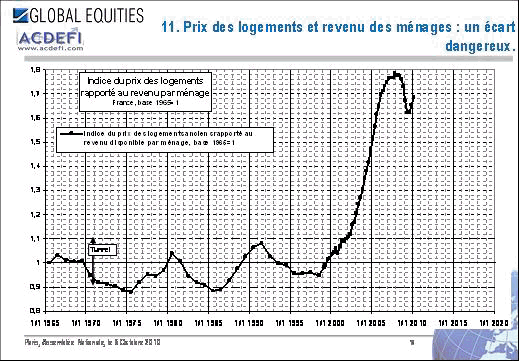
1 () Le mandat de député de Mme Marie-Anne Montchamp, nommée membre du Gouvernement le 14 novembre 2010, a cessé le 14 décembre 2010.
2 () Rapport d'information relatif à la crise financière internationale, présenté par MM. Didier Migaud, président, et Gilles Carrez, rapporteur général (n° 1235).
3 () Opérations pour lesquelles le vendeur n’a pas les titres au moment de la négociation. À échéance les parties ne décaissent ou n’encaissent que la différence entre prix d’achat et prix de vente.
4 () Intervenant qui prend des positions non risquées, en tirant profit des inefficiences du marché.
5 () Concours de beauté organisé par un journal londonien de l'époque, consistant à élire les plus belles jeunes femmes parmi une centaine de photographies publiées. Le gagnant est le lecteur dont la sélection se rapproche au mieux des cinq photographies les plus choisies. En d'autres termes, le gagnant est celui s'approchant au mieux du consensus global.
6 () Audition du 10 novembre 2010.
7 () Audition du 24 novembre 2010.
8 () Audition du 8 septembre 2010.
9 () Audition du 8 septembre 2010.
10 () Audition du 15 septembre 2010.
11 () Audition du 29 septembre 2010.
12 () Audition du 6 octobre 2010.
13 () Audition du 6 octobre 2010.
14 () Audition du 13 octobre 2010.
15 () Audition du 20 octobre2010.
16 () Audition du 27 octobre 2010.
17 () Audition du10 novembre 2010.
18 () Les hedges funds sont des fonds d’investissement dits « alternatifs » (cf. deuxième partie, II, A, 1). Compte tenu de son usage répandu, l’expression anglaise sera utilisée dans la suite du présent rapport.
19 () Audition du 17 novembre 2010.
20 () Audition du 17 novembre 2010.
21 () Audition du 24 novembre 2010.
22 () Audition du 8 septembre 2010.
23 () Audition du 8 septembre 2010.
24 () Audition du 15 septembre 2010.
25 () Audition du 29 septembre 2010.
26 () Audition du 27 octobre 2010.
27 () Audition du 27 octobre 2010.
28 () Audition du 3 novembre 2010.
29 () Audition du 10 novembre 2010.
30 () Audition du 10 novembre 2010.
31 () Audition du 3 novembre 2010.
32 () Audition du 17 novembre 2010.
33 () Audition du 24 novembre 2010.
34 () Audition du 24 novembre 2010.
35 () Audition du 8 septembre 2010.
36 () Audition du 15 septembre 2010.
37 () Audition du 6 octobre 2010.
38 () Audition du 27 octobre 2010.
39 () Audition du 27 octobre 2010.
40 () Audition du 10 novembre 2010.
41 () Audition du 10 novembre 2010.
42 () Audition du 3 novembre 2010.
43 () Audition du 17 novembre 2010.
44 () Audition du 24 novembre 2010.
45 () Audition du 15 septembre 2010.
46 () Audition du 6 octobre 2010.
47 () Audition du 6 octobre 2010.
48 () Audition du 27 octobre 2010.
49 () Audition du 3 novembre 2010.
50 () Audition du 3 novembre 2010.
51 () Audition du 17 novembre 2010.
52 () Audition du 17 novembre 2010.
53 () Audition du 17 novembre 2010.
54 () Audition du 24 novembre 2010.
55 () Audition du 10 novembre 2010.
56 () Audition du 3 novembre 2010.
57 () Soit le « Système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté » 1995 défini par le règlement CE n° 2223/96 du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté qui réunit l’essentiel des normes applicables. Il est en cours de révision. Dans le cas des finances publiques, ces normes sont précisées par le Manuel SEC 95 pour le déficit public et la dette publique et par le règlement CE n° 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.
58 () La première représenterait un manque à gagner de 26 % pour les recettes fiscales, soit 30 milliards de dollars par an ; la seconde équivaudrait à 25 % du PIB contre 14 % pour les pays de l’OCDE. Cf. « La fatalité grecque : un scénario prévisible ? » Céline Antonin, Lettre de l’OFCE n° 323 du 21 septembre 2010.
59 () On considère qu’à solde budgétaire nul, une dette n’est stabilisée que si le taux de croissance du PIB est égal au taux d’intérêt.
60 () L’article 103 du traité de Lisbonne (traité sur l’Union européenne) (comme l’article 104 du traité de Maastricht) prévoit qu’aucun État ne peut être considéré comme responsable des agissements d’un autre État membre, et toute intervention directe de l’Union européenne pour sauver un État en difficulté est interdite – à charge pour chaque pays de maîtriser son déficit public (conformément au pacte de stabilité de 1997). Par ailleurs, le traité de Maastricht interdit à la BCE de venir en aide au pays en difficulté en achetant des titres de sa dette. Plus globalement, la crise a montré que la zone euro était dépourvue de procédure institutionnellement forte de traitement de ses crises.
61 () Par l’anticipation de recettes futures dans le premier cas et par des opérations de swap de devises où la conversion en euros à un taux de change plus avantageux que la normale de dettes levées dans une autre devise a permis à la Grèce d’obtenir plus de fonds qu’elle n’en inscrivait dans ses comptes. Si ce mode de comptabilité était considéré comme légal en 2001, il est notamment reproché à la Grèce de n’avoir pas corrigé ses statistiques après qu’Eurostat eut modifié en 2008 les règles comptables applicables au sein de la zone euro.
62 () Le credit default swap (couverture de défaillance) – CDS est un contrat par lequel « l’acheteur » s’engage à payer périodiquement au « vendeur » une prime sous réserve que celui-ci l’assure, pour un certain montant, si survient un évènement de crédit (faillite de l’entreprise, défaut de paiement, restructuration de la dette ou moratoire sur les remboursements de la dette souveraine). Développé essentiellement à partir de 2000, ce produit acheté sur les marchés secondaires ou dérivés est censé associer une assurance au titre qui en est le sous-jacent. Pour faciliter la compréhension, cet instrument sera dans la suite du rapport, désigné par son acronyme anglais CDS.
63 () Audition du 15 septembre 2010.
64 () Audition de Mme Danièle Nouy, secrétaire générale de l’ACP, le 17 novembre 2010.
65 () Les écarts de taux de financement ou de rendements, en l’espèce avec l’Allemagne.
66 () Audition du 6 octobre 2010.
67 () Audition de M. Philippe Mills, directeur général de l’Agence France Trésor, le 29 septembre 2010.
68 () La vente « à découvert » consiste à emprunter les titres pour les vendre dans l’objectif de les racheter une fois leur cours déprécié, avant de les rendre à leur propriétaire d’origine, en empochant dans l’intervalle la différence entre le prix d’achat et le prix de vente. Quand le vendeur ne prend même pas la précaution d’emprunter le titre qu’il vend, courant le risque de ne pouvoir le livrer, on parle de « vente à découvert à nu ».
69 () Audition du 15 septembre 2010.
70 () Audition du 17 novembre 2010.
71 () Audition du 25 novembre 2010.
72 () Audition du 24 novembre 2010.
73 () Audition du 3 novembre 2010.
74 () M. Georges Soros a encore été récemment placé sous les feux de l’actualité : selon le Wall Street Jounal du 26 février 2010, alors que le cours de l’euro, fragilisé par la crise grecque était passé de 1,51 dollar en décembre 2009 à moins de 1,35 dollar en février, les dirigeants des plus grands et plus célèbres hedge funds, dont Georges Soros, se seraient réunis, en début de mois lors d’un dîner-débat à Manhattan, pour évoquer leur défi : faire glisser l’euro jusqu’à un niveau de parité avec le dollar. Dans une lettre, précisément datée du 26 février, le ministère de la justice américain, soupçonnant le délit de collusion, aurait demandé aux hedge funds SAC Capital Advisors, Greenlight Capital, Soros Fund management et Paulson & Co de conserver les registres d’opérations et les courriers électroniques qui auraient un lien avec l’euro.
75 () Audition du 6 octobre 2010.
76 () Audition du 8 septembre 2010.
77 () Audition du 27 octobre 2010.
78 () Audition du 6 octobre 2010.
79 () Audition du 6 octobre 2010.
80 () Patrick Artus, « La machine a fabriquer les bulles n’est pas arrêtée » (Flash Economie Natixis, 18 janvier 2008), et « La liquidité incontrôlable » (février 2010).
81 () Audition du 6 octobre 2010.
82 () Edward Chancellor, Devil Takes the Hindmost – A History of Financial Speculation (2000).
83 () Indice Case – Shiller pour dix villes.
84 () Audition du 8 septembre 2010.
85 () Audition du 27 octobre 2010.
86 () Audition du 17 novembre 2010.
87 () Audition du 6 octobre 2010. À l'appui de sa démonstration, M. Marc Touati a présenté un graphique reproduit en annexe au compte-rendu de son audition (graphique 4).
88 () Le Secrétaire général de l’Opep, le sheik Abdallah El Badri, a déclaré à Quito, le 10 décembre 2010, que l’Opep ne révisera pas ses quotas de production à la hausse, même si le baril de pétrole atteint les 100 dollars sous l’effet de la spéculation.
89 () Audition du 27 octobre 2010.
90 () Audition du 17 novembre 2010.
91 () Audition du 8 septembre 2010.
92 () Audition du 17 novembre 2010.
93 () Une dimension assez souvent évoquée par les personnes auditionnées.
94 () Audition du 8 septembre 2010.
95 () Audition du 27 octobre 2010.
96 () Audition du 6 octobre 2010.
97 () Audition du 15 septembre 2010.
98 () Audition du 8 septembre 2010.
99 () Cf. audition du 25 novembre 2010.
100 () Audition du 13 octobre 2010.
101 () Citée par M. Michel Aglietta, lors de son audition du 8 septembre 2010.
102 () Banque des règlements internationaux ; « Question à $ 4 000 milliards : qu’est-ce qui explique la croissance du marché des changes depuis l’enquête triennale de 2007 ? » ; Rapport trimestriel, 13 décembre 2010.
103 () Audition du 6 octobre 2010.
104 () La base monétaire (ou monnaie centrale) est la somme des engagements monétaires de la banque centrale vis-à-vis des agents non bancaires et des autres banques : billets en circulation, avoirs en monnaie scripturale dans les comptes de la banque centrale.
105 () Audition du 17 novembre 2010.
106 () Audition du 6 octobre 2010.
107 () Audition du 17 novembre 2010.
108 () Audition du 8 septembre 2010.
109 () Au cours de l’audition de M. Jean-Hervé Lorenzi, professeur d’économie à l’université de Paris-Dauphine, président du Cercle des économistes, le 13 octobre 2010.
110 () Source : Bloomberg.
111 () Audition du 10 novembre 2010.
112 () Audition du 17 novembre 2010.
113 () « Banking on the State », Piergiorgio Alessandri et Andrew G Haldane, Bank of England, novembre 2009. Cette étude présente « a snap-shot of the scale of intervention to support the banks in the UK, US and the euro-area during the current crisis. This totals over $14 trillion or almost a quarter of global GDP. It dwarfs any previous state support of the banking system. These interventions have been as imaginative as they have been large, including liquidity and capital injections, debt guarantees, deposit insurance and asset purchase. » [instantané de l’échelle d’intervention pour soutenir les banques au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans la zone euro au cours de la crise actuelle. Ce total dépasse 14 000 milliards de dollars, soit près d’un quart du PIB mondial. Il éclipse tout le soutien public antérieur au système bancaire. Ces interventions ont été aussi imaginatives qu’importantes incluant injections de liquidité et de capitaux, garanties d’emprunt, l’assurance-dépôts et l’achat d’actifs.]
114 () Audition du 10 novembre 2010.
115 () Les « fonds alternatifs » incluent aussi d’autres catégories de fonds d’investissement, consacrés à différents secteurs économiques : fonds immobiliers, fonds de matières premières, fonds d’infrastructures…
116 () M. Jean-Paul Gauzes, député européen ; audition du 3 novembre 2010.
117 () Directive n° 85/611/CE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, règlementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), plusieurs fois modifiée. Les OPCVM sont des portefeuilles de valeurs mobilières (actions, obligations…) gérés par des professionnels et détenus collectivement (sous forme de parts ou d’actions) par des investisseurs particuliers ou institutionnels. Les deux grandes catégories d’OPCVM sont les SICAV et les Fonds communs de placement (FCP).
118 () La vente à découvert correspond à la vente de titres que le vendeur ne possède pas mais qu’il se fait prêter ; pour déboucler l'opération le vendeur des titres à découvert rachète ultérieurement les titres sur le marché (en général la Bourse) et les restitue au prêteur.
119 () Effet de levier : mécanisme qui permet de prendre une position bien plus importante que les fonds dont on dispose, en ayant recours à des instruments financiers dérivés ou à l’endettement. L’effet de levier mesure la capacité d’un fonds à amplifier les mouvements des marchés. Si les marchés montent, la valeur du fonds pourra monter plus vite. En revanche, s’ils baissent, la valeur du fonds pourra baisser plus vite.
120 () Irène Inchauspé, Les cinq plus gros hedge funds, Challenges, n° 200, 18 février 2010.
121 () Audition du 20 octobre 2010.
122 () Audition du 8 septembre 2010.
123 () Audition du 8 septembre 2010.
124 () Présidente de l’agence de notation Standard & Poor’s zone francophone : audition du 17 novembre 2010.
125 () Chef économiste Europe de Standard & Poor’s.
126 () Audition du 8 septembre 2010.
127 () Audition du 8 septembre 2010.
128 () Ibid.
129 () Audition du 27 octobre 2010.
130 () Rapport n° 2550 déposé le 26 mai 2010 relatif au projet de loi régulation bancaire et financière.
131 () Dans le cadre d’opérations de titrisation, titres émis par le véhicule ad hoc afin de lui permettre d’acheter des actifs comme des stocks ou des créances clients auxquels ils sont donc adossés.
132 () M. Michel Aglietta, conseiller au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII), audition du 8 septembre 2010.
133 () Ibid.
134 () L’origination est une activité financière qui consiste à conseiller un client sur le choix d’instruments financiers, puis à assurer la conception et le lancement de l’opération sur le marché.
135 () Audition du 10 novembre 2010.
136 () Audition du 8 septembre 2010.
137 () Audition du 15 septembre 2010.
138 () Minimum capital requirement : capital minimum exigé par l'autorité de régulation.
139 () Solvency capital requirement : capital requis pour assurer la solvabilité.
140 () Curieusement, la Commission générale de terminologie et de néologie ne donne pas d’équivalent pour ce mot anglais.
141 () Rosenblatt Securities, 30 septembre 2009, “An in-depth look at High frequency trading”.
142 () J. Leprun, A. Oseredczuk. « Le trading algorithmique, Enjeux pour la surveillance des marchés de l’AMF ». Note de la Direction des Enquêtes et de la surveillance des Marché de l’AMF. 17 novembre 2009.
143 () Fragmentation en partie liée à la directive européenne « marchés d’instruments financiers » (MIF) du 1er novembre 2007.
144 () « Direct market access » dit « écrans délocalisés » qui permettent aux gérants d’avoir accès aux marchés grâce à la connexion autorisée d’un courtier membre.
145 () Selon l’AMF, le trading « à haute fréquence » est un concept qui ne recouvre que partiellement la notion de trading algorithmique. En effet, le HFT désigne uniquement « les stratégies pour lesquelles la vitesse d’exécution est fondamentale » alors que le trading algorithmique désigne plus généralement l’utilisation de l’outil informatique.
146 () Entre 2005 et 2008, le nombre annuel d’ordres sur Euronext est passé de 239 millions à 824 millions.
147 () Audition du 8 septembre 2010.
148 () La priorité est donnée aux ordres de montant supérieur.
149 () À montant égal, la priorité est donnée à l’ordre donné en premier.
150 () « Le trading algorithmique, Enjeux pour la surveillance des marchés de l’AMF » op.cit.
151 () C'est-à-dire que les compétiteurs peuvent anticiper son comportement à ses dépens.
152 () Cette période, qui est à la discrétion du courtier utilisant les algorithmes, peut aller du millième de seconde à une journée.
153 () Audition du 8 septembre 2010.
154 () Le comité de Bâle définit le risque opérationnel comme le "risque de pertes provenant de processus internes inadéquats ou défaillants, de personnes et systèmes ou d'événements externes".
155 () Exemple cité dans le rapport de l’AMF « Cartographie 2010 des risques et des tendances sur les marchés financiers et pour l’épargne ».
156 () Le Crédit Suisse est l’un des précurseurs en matière de trading algorithmique et reste encore aujourd’hui parmi les leaders dans ce domaine.
157 () Audition du 24 novembre 2010.
158 () Audition du 8 septembre 2010.
159 () Dépêche AFP du 9 septembre 2010, citée in « Les super courtiers de Wall Street dans le collimateur des régulateurs » , Webmanager.com.
160 () Audition du 29 septembre 2010.
161 () Audition du 27 octobre 2010.
162 () Audition du 3 novembre 2010.
163 () Audition du 3 novembre 2010.
164 () Audition du 27 octobre 2010.
165 () Audition du 3 novembre 2010.
166 () Le financement sans recours est un financement qui est fait sur la seule base d'un projet ou d'un actif. Le remboursement de la dette contractée est assuré par les seuls revenus générés par le projet ou l'actif.
167 () Il a même pu aller jusqu’à 50, soit 2 dollars de capital pour 100 d’engagements, selon les indications données par M. Jean-Claude Gruffat, directeur général directeur général de Citigroup France, lors de son audition par la commission d’enquête le 10 novembre 2010.
168 () Audition du 27 octobre 2010.
169 () « L’information boursière comme bien public. Enjeux et perspectives de la révision de la directive européenne « marchés d’instruments financiers », La Revue d’économie financière, 8 septembre 2010.
170 () Audition du 8 septembre 2010.
171 () Audition du 24 novembre 2010.
172 () Rapport au Ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur la révision de la directive MIF, p 18.
173 () L’information boursière comme bien public. Enjeux et perspectives de la révision de la directive européenne « marchés d’instruments financiers », La Revue d’économie financière, 8 septembre 2010.
174 () Ibidem.
175 () Audition du 27 octobre 2010.
176 () La loi de sécurité financière : un an après. Rapport d’information n° 431 de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (22 juillet 2007).
177 () Cf. Daniela Russo, directeur général des infrastructures de paiements et de marché, Banque centrale européenne, « Produits dérivés OTC : défis pour la stabilité financière et réponses des autorités », Revue de la stabilité financière de la Banque de France, juillet 2010.
178 () Audition du 20 octobre 2010.
179 () Audition du 15 septembre 2010.
180 () Entretien accordé au journal « Le Monde » du 9 décembre 2010.
181 () Audition du 25 novembre 2010.
182 () À cela s’ajoute 120 émetteurs inscrits sur Alternext Paris et 168 émetteurs obligataires dont les titres de créance sont cotés sur Euronext Paris (pas de cotisation du capital) soit au total 938.
183 () Audition du 17 novembre 2010.
184 () Audition du 27 octobre 2010.
185 () Audition du 13 octobre 2010.
186 () Audition du 24 novembre 2010
187 () Audition du 3 novembre 2010.
188 () Audition du 24 novembre 2010.
189 () Audition du 8 septembre 2010.
190 () Audition du 29 septembre 2010.
191 () Audition du 6 octobre 2010.
192 () Front running : expression que l’on pourrait traduire littéralement par « course en avant ». Il s’agit du délit d’initié consistant, pour un intermédiaire agréé, à utiliser sa connaissance d’un « gros » ordre – reçu d’un de ses clients – relatif à une action déterminée en vue de bénéficier de l’anticipation de la variation du prix de ladite action. Pour ce faire, avant d’exécuter l’ordre de son client susceptible d’entraîner une variation substantielle du cours, il exécute, pour son compte ou pour celui d’un autre donneur d’ordre, un ordre de même sens portant sur un plus petit paquet d’actions.
193 () Audition du 6 octobre 2010.
194 () Audition du 24 novembre 2010.
195 () Audition du 8 septembre 2010.
196 () Audition du 8 septembre 2010.
197 () Les trois « comités de niveau 3 » réunissent les superviseurs nationaux des 27 États membres respectivement dans les domaines « marchés financiers », « banque » et « assurances », mais n’ont qu’un rôle consultatif.
198 () On peut noter que, à la différence des États-Unis, il n’est pas prévu de créer en Europe une agence dédiée à la protection des consommateurs de produits financiers.
199 () Audition du 1er décembre 2010.
200 () Audition du 10 novembre 2010.
201 () Audition du 29 septembre 2010.
202 () Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ; Assemblée nationale, 1ère séance du mardi 2 novembre 2010.
203 () Discours de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République : XIIIe sommet de la francophonie à Montreux le 23 octobre 2010.
204 () M. Philippe Chalmin, professeur à l’Université de Paris-Dauphine, président de CyclOpe ; audition du 27 octobre 2010.
205 () M. Christian Noyer : Audition du 24 novembre 2010.
206 () Audition du 6 octobre 2010.
207 () Les auditions de Mme Pervenche Berès, député européen, et de M. Jean-Paul Gauzès, député européen, respectivement le 27 octobre 2010 et le 3 novembre 2010, ont confirmé l’engagement des parlementaires européens sur ces questions.
208 () M. Augustin de Romanet, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, audition du mercredi 27 octobre 2010.
209 () L’information boursière comme un bien public- Enjeux et perspectives de la révision de la directive européenne « marchés d’instruments financiers », in Revue d’économie financière, mars 2010, n° 98.
210 () La taille moyenne d’une transaction sur le New York Stock Exchange est passée de 2 096 actions à 531 en 2006 (source : NYSE Euronext).
211 () NYSE Euronext a annoncé le lancement courant 2011, d’une consolidated tape pour les marchés européens, offrant un service payant de données post-marché consolidées en temps réel, qui sera gratuit passé un délai de 15 minutes. Elle couvrira les données sur les actions des bourses, des MTF, des marchés de gré à gré, les crossing networks et les internalisateurs systématiques. Source AGEFI, 23 novembre 2010.
212 () Extrait des conclusions du G20 de Pittsburgh (septembre 2009) :
« Tous les contrats de produits dérivés de gré à gré normalisés devront être échangés sur des plates-formes d’échanges ou via des plates-formes de négociation électronique et compensés par des contreparties centrales d’ici la fin 2012 au plus tard. Les contrats de produits dérivés de gré à gré doivent faire l’objet d’une notification aux organismes appropriés (trade repositories). Les contrats n’ayant pas fait l’objet de compensation centrale devront être soumis à des exigences en capital plus élevées. »
213 () Jean-Pierre Jouyet, « La finance du 21ème siècle ne peut faire l’économie d’une bonne régulation des marchés de gré à gré », Revue de la stabilité financière de la Banque de France, juillet 2010.
214 () Gregory King (1648-1712), fonctionnaire de la Couronne, fut l’un des précurseurs de la statistique économique.
215 () Elle est équivalente à celle qui est imposée aux OPCVM : 125 000 euros + 0,02 % de la valeur du portefeuille au-delà de 250 millions d’euros.
216 () Position courte : résulte soit de la vente à découvert d’une action ou d’un instrument de dette souveraine, soit d’une transaction qui crée un instrument financier ou établit un lien avec un instrument financier lorsque l’effet de cette transaction est de conférer un avantage financier en cas de baisse du prix ou de la valeur de l’action ou de la dette.
Position longue : résulte soit de la détention d’une action ou d’un instrument de dette souveraine, soit d’une transaction qui crée un instrument financier ou établit un lien avec un instrument financier lorsque l’effet de cette transaction est de conférer un avantage financier en cas d’augmentation du prix ou de la valeur de l’action ou de la dette.
217 () En matière de réglementation financière européenne, les textes législatifs confient à la Commission européenne la compétence pour adopter des actes délégués, c’est-à-dire des mesures techniques permettant la mise en œuvre des textes, telles que des mesures qui fixent des montants ou des paliers. Les actes délégués ainsi adoptés prennent « force de loi » sauf si le Parlement européen ou le Conseil formulent des « objections » motivées contre eux dans un délai de quelques semaines – ce qui empêche alors leur entrée en vigueur.
218 () Audition du 24 novembre 2010.
219 () Par exemple, sur les marchés britanniques, le règlement-livraison s'effectue à J+7 et, par dérogation, dans certains cas, jusqu'à J+30.
220 () Audition du 15 septembre 2010.
221 () Audition du 24 novembre 2010.
222 () Audition du 17 novembre 2010.
223 () Selon la formule employée par M. Jean-Pierre Jouyet, président de l'Autorité des marchés financiers, lors de son audition du 15 septembre 2010.
224 () Communication de la Commission européenne COM (2010) 549 du 7 octobre 2010.
225 () Assemblée nationale, Rapport général sur le projet de loi de finances pour 2011, par M. Gilles Carrez, Rapporteur général (n° 2857) du 14 octobre 2010, tome II, pages 299 et suivantes.
Sénat, Rapport général sur le projet de loi de finances pour 2011, par M. Philippe Marini, Rapporteur général (n° 111) du 18 novembre 2010 ; tome II, volume 1, pages 213 et suivantes.
226 () Audition du 25 novembre 2010.
227 () Audition du 10 novembre 2010.
228 () Audition du 10 novembre 2010.
229 () Audition du 10 novembre 2010.
230 () Audition du 8 septembre 2010.
231 () Audition du 15 septembre 2010.
232 () Audition du 8 septembre 2010.
233 () Audition du 6 octobre 2010.
234 () Audition du 17 novembre 2010.
235 () Ce hedge fund fut constitué en 1994, par un responsable de la banque Salomon Brothers évincé après une manipulation de marché réalisée par un membre de son équipe. Appuyé par la plupart des grandes banques d’investissement, il remporta d’abord des succès fulgurants sur les marchés et prit des positions démesurées (jusqu’à 1 200 milliards de dollars). Son pari solitaire sur le défaut de la Fédération de Russie en septembre 1998 le conduisit au bord de la faillite. Le risque systémique fut écarté grâce à une recapitalisation par de grandes banques américaines et européennes, exposées au risque de contrepartie. Le dénouement des positions de LTCM provoqua de multiples soubresauts sur les marchés.
236 () Audition du 17 novembre 2010.
237 () La Chine a établi une séparation des activités bancaires avec la loi sur la banque commerciale de 1995 et la loi sur les sociétés de bourse de 1998.
238 () Audition du 10 novembre 2010.
239 () Audition du 15 septembre 2010.
240 () Audition du 17 novembre 2010.
241 () Audition du 27 octobre 2010.
242 () Audition du 27 octobre 2010.
243 () Audition du 10 octobre 2010.
244 () Audition du 25 novembre 2010.
245 () Audition de M. Bernard Spitz, président de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), le 27 octobre 2010.
246 () Audition du 17 novembre 2010.
247 () Audition du 25 novembre 2010.
248 () Les deux établissements irlandais soumis à l’exercice, Allied Irish Banks (AIB) et Bank of Ireland, avaient passé l’obstacle avec succès. D’après les observateurs les hypothèses retenues concernant l’évolution du marché immobilier irlandais étaient trop optimistes. La banque Anglo Irish, qui a été renflouée par l’État irlandais à hauteur de 29 milliards d’euros et pèse pour plus des deux-tiers de la « facture » totale de la crise pour l’État irlandais, n’avait pas été testée, car jugée non systémique.
249 () Audition du 24 novembre 2010.
250 () Audition 27 octobre 2010.
251 La base monétaire mondiale, c'est-à-dire la liquidité émise par les banques centrales, a plus que quadruplé depuis 2007.
252 Andrew SMITHERS, Wall Street Revalued : Imperfect Markets and Inept Central Bankers, 2009
253 Scott PATTERSON, The Quants
254 Gillian TETT, Fool's gold
255 Hyman P. MINSKY, Stabilizing an instable Economy
256 Il convient aussi de rappeler que le déséquilibre structurel des économies occidentales est très intimement lié à cette divergence extraordinaire, apparue dans les toutes dernières décennies du XXème siècle, entre les revenus du travail et ceux du capital, qui a massivement avantagé le dernier au détriment du premier. Dans un pays comme les Etats-Unis, le déséquilibre structurel des paiements courants a clairement précédé la divergence de revenus entre capital et travail, sans que cela suffise à éclairer sur les rapports complexes entre ces deux phénomènes macro-économiques.
257 c'est-à-dire à un niveau proche du « cours d'équilibre » prôné à ce moment par l'AIE.
258 NYMEX : New York Mercantile Exchange
259 En vertu d'un vieil adage économique selon lequel « on ne saurait faire boire un âne qui n'a pas soif » (« You can had a horse to water but you can't make him drink »).
260 MV=PT dans laquelle M est la masse monétaire, V la vitesse de circulation de la monnaie, P le niveau général des prix, T le volume des transactions.
261 Aujourd'hui appelé « ratio de Bâle », mais que je nomme du nom de son inventeur Peter Cooke.
262 Dans l'esprit de leurs promoteurs, et en particulier de la Fed, les mesures de quantitative easing (qui représentent au total des phases 1 et 2 pour la Fed de l'ordre du trillion de dollars, soit 1 000 milliards) ne sont pas du tout destinées à financer de nouveaux plans de relance économique par les Etats mais presque au contraire à contribuer, par la souscription massive de bons du Trésor par la Fed, au financement de la dette publique existante en maintenant un taux d'intérêt très bas et par là-même à l'assainissement des finances publiques. L'autre objectif consiste en faisant appel à la théorie du portefeuille en vertu de laquelle les investisseurs, détournés des bons du Trésor qui représenteront donc une part moins importante de leur portefeuilles, devraient théoriquement accroître corrélativement le volume des obligations privées à long terme qu'ils détiennent. Outre que l'on ne voit pas très bien pourquoi les masses financières libérées ne pourraient pas aller vers la spéculation pure et simple (l'or, les matières premières, l'immobilier émergent etc...), ce genre de théorie était balayé d'un revers de main par Paul Volcker à l'époque heureuse où les banquiers centraux ne s'embarrassaient pas de théories (Meeting of the Federal open market Committee, november 26, 1980, p.7). La presse économique ne s'y trompe pas non plus lorsqu'elle relie la création monétaire de six cents milliards de dollars et la spéculation sur le prix des matières premières : « Strong demand for raw materials from emerging markets and a flood of money promised by the US Federal Reserve are pushing commodity prices to new highs », Wall Street Journal, 10 novembre 2010.
263 Financial Times, 28 octobre 2010, Robin Harding, Some enchanted easing et FT 30 octobre 2010, Michael Mackenzie, Asset purchases like Ponzi scheme . S'agissant de ce dernier article, on remarquera que Hyman P. Minsky avait, dans son ouvrage précité, exposé une théorie amusante mais rigoureuse selon laquelle la titrisation repose sur un mécanisme au moins partiellement assimilable au « Ponzi scheme ».
264 A cette époque, les taux d'intérêt réels sont montés aux Etats-Unis à plus de 17%. Bien entendu, les réactions politiques ont été très fortes sur le moment. Mais les résultats sont incontestables : l'inflation a été jugulée, les équilibres macro-économiques se sont considérablement améliorés, le dollar a été rétabli dans sa crédibilité et sur les deux décennies qui vont de 1980 à 2000, le taux de chômage aux Etats-Unis a été divisé par deux.
265 Les meilleurs analystes et les plus grands théoriciens sont parfois, à titre personnel ou professionnel, des spéculateurs d'une exceptionnelle habileté. Le meilleur exemple en est John Maynard Keynes lui-même qui accumula une considérable fortune par son activité de spéculateur (voir Keynes and the market, Justyn WALSH, 2009). A l'inverse, Irving Fisher a mal réagi à la crise de 1929 et s'est trouvé complètement ruiné...
266 Dans son dernier ouvrage « Dealings », Félix Rohatyn, expose la crise de 1970 à Wall Street et la réglementation de la solvabilité des intervenants qui en a résulté...
267 « Euro-dollars » ne signifie pas étymologiquement « dollars européens » mais dollars détenus dans des comptes situés hors des Etats-Unis. Pour la petite histoire, l'expression est née à partir de la dénomination « Telex » (« EUROBANKDOLLAR ») des avoirs détenus en dollars par la banque commerciale pour l'Europe du Nord, laquelle appartenait à l'Union soviétique...
268 En février 2008, un livre remarquable a été publié par Charles R. Morris sous le titre « A trillion Dollar Meltdown ». Ce titre a paru exagéré et provocateur à beaucoup de commentateurs. Quelques mois plus tard dans une interview, Charles R. Morris parlait de 3 000 milliards de dollars et cela paraissait encore provocateur.
269 () Entre autres : Richard DUNCAN, The Dollar Crisis et Jean DENIZET, Histoire du Dollar.
270 () La base monétaire mondiale, c'est-à-dire la liquidité émise par les banques centrales, a plus que quadruplé depuis 2007.
271 () Andrew SMITHERS, Wall Street Revalued : Imperfect Markets and Inept Central Bankers, 2009.
272 () Scott PATTERSON, The Quants.
273 () Gillian TETT, Fool's gold.
274 ()Hyman P. MINSKY, Stabilizing an instable Economy.
275 () Il convient aussi de rappeler que le déséquilibre structurel des économies occidentales est très intimement lié à cette divergence extraordinaire, apparue dans les toutes dernières décennies du XXème siècle, entre les revenus du travail et ceux du capital, qui a massivement avantagé le dernier au détriment du premier. Dans un pays comme les États-Unis, le déséquilibre structurel des paiements courants a clairement précédé la divergence de revenus entre capital et travail, sans que cela suffise à éclairer sur les rapports complexes entre ces deux phénomènes macro-économiques.
276 () C'est-à-dire à un niveau proche du « cours d'équilibre » prôné à ce moment par l'AIE.
277 () NYMEX : New York Mercantile Exchange.
278 () En vertu d'un vieil adage économique selon lequel « on ne saurait faire boire un âne qui n'a pas soif » (« You can had a horse to water but you can't make him drink »).
279 () MV=PT dans laquelle M est la masse monétaire, V la vitesse de circulation de la monnaie, P le niveau général des prix, T le volume des transactions.
280 () Aujourd'hui appelé « ratio de Bâle », mais que je nomme du nom de son inventeur Peter Cooke.
281 () Dans l'esprit de leurs promoteurs, et en particulier de la Fed, les mesures de quantitative easing (qui représentent au total des phases 1 et 2 pour la Fed de l'ordre du trillion de dollars, soit 1 000 milliards) ne sont pas du tout destinées à financer de nouveaux plans de relance économique par les Etats mais presque au contraire à contribuer, par la souscription massive de bons du Trésor par la Fed, au financement de la dette publique existante en maintenant un taux d'intérêt très bas et par là-même à l'assainissement des finances publiques. L'autre objectif consiste en faisant appel à la théorie du portefeuille en vertu de laquelle les investisseurs, détournés des bons du Trésor qui représenteront donc une part moins importante de leur portefeuilles, devraient théoriquement accroître corrélativement le volume des obligations privées à long terme qu'ils détiennent. Outre que l'on ne voit pas très bien pourquoi les masses financières libérées ne pourraient pas aller vers la spéculation pure et simple (l'or, les matières premières, l'immobilier émergent etc...), ce genre de théorie était balayé d'un revers de main par Paul Volcker à l'époque heureuse où les banquiers centraux ne s'embarrassaient pas de théories (Meeting of the Federal open market Committee, november 26, 1980, p.7, ci-joint). La presse économique ne s'y trompe pas non plus lorsqu'elle relie la création monétaire de six cents milliards de dollars et la spéculation sur le prix des matières premières : « Strong demand for raw materials from emerging markets and a flood of money promised by the US Federal Reserve are pushing commodity prices to new highs », Wall Street Journal, 10 novembre 2010.
282 () Articles en copie ci-jointes : Financial Times, 28 octobre 2010, Robin Harding, Some enchanted easing et FT 30 octobre 2010, Michael Mackenzie, Asset purchases like Ponzi scheme . S'agissant de ce dernier article, on remarquera que Hyman P. Minsky avait, dans son ouvrage précité, exposé une théorie amusante mais rigoureuse selon laquelle la titrisation repose sur un mécanisme au moins partiellement assimilable au « Ponzi scheme ».
283 () À cette époque, les taux d'intérêt réels sont montés aux États-Unis à plus de 17 %. Bien entendu, les réactions politiques ont été très fortes sur le moment. Mais les résultats sont incontestables : l'inflation a été jugulée, les équilibres macro-économiques se sont considérablement améliorés, le dollar a été rétabli dans sa crédibilité et sur les deux décennies qui vont de 1980 à 2000, le taux de chômage aux États-Unis a été divisé par deux.
284 () Les meilleurs analystes et les plus grands théoriciens sont parfois, à titre personnel ou professionnel, des spéculateurs d'une exceptionnelle habileté. Le meilleur exemple en est John Maynard Keynes lui-même qui accumula une considérable fortune par son activité de spéculateur (voir Keynes and the market, Justyn WALSH, 2009). À l'inverse, Irving Fisher a mal réagi à la crise de 1929 et s'est trouvé complètement ruiné...
285 () Dans son dernier ouvrage « Dealings », Félix Rohatyn, expose la crise de 1970 à Wall Street et la réglementation de la solvabilité des intervenants qui en a résulté...
286 () « Euro-dollars » ne signifie pas étymologiquement « dollars européens » mais dollars détenus dans des comptes situés hors des Etats-Unis. Pour la petite histoire, l'expression est née à partir de la dénomination « Telex » (« EUROBANKDOLLAR ») des avoirs détenus en dollars par la banque commerciale pour l'Europe du Nord, laquelle appartenait à l'Union soviétique...
287 () En février 2008, un livre remarquable a été publié par Charles R. Morris sous le titre « A trillion Dollar Meltdown ». Ce titre a paru exagéré et provocateur à beaucoup de commentateurs. Quelques mois plus tard dans une interview, Charles R. Morris parlait de 3 000 milliards de dollars et cela paraissait encore provocateur.
© Assemblée nationale
