

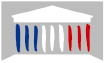
N° 1810
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 juillet 2009.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA MISSION D’INFORMATION COMMUNE
sur l’indemnisation des victimes d’infections nosocomiales
et l’accès au dossier médical (1)
ET PRÉSENTÉ
PAR M. Guénhaël HUET,
Député.
——
La mission d’information commune à la Commission des affaires sociales et à la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur l’indemnisation des victimes d’infections nosocomiales et l’accès au dossier médical est composée de : M. Guénhaël Huet, président-rapporteur ; M. Jean-Pierre Door, M. Henri Jibrayel (2), Mme Marietta Karamanli et Mme Catherine Lemorton (3).
INTRODUCTION 9
CHAPITRE PREMIER : RENFORCER L’EFFECTIVITÉ DU DROIT D’ACCÈS DU PATIENT À SON DOSSIER MÉDICAL 13
I. UN RÉGIME JURIDIQUE ÉQUITABLE 14
A. LES OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 15
1. Le contenu du dossier 15
a) Les documents non formalisés 15
b) Le dossier constitué par un établissement de soins 16
c) Le dossier tenu par un praticien libéral 16
2. La conservation du dossier 17
3. Le respect des délais de communication 18
B. LE DROIT D’ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL 18
1. Les patients 19
2. Les représentants des patients 19
a) Le mandataire 19
b) Les représentants légaux de la personne mineure 20
c) Le représentant ou les représentants de la personne sous tutelle 20
3. Les ayants droit en cas de décès du patient 20
4. Les tiers dûment autorisés par le patient ou par la loi 21
a) Les professionnels de santé concourant aux soins du patient 21
b) Les personnes concourant à une mission d’intérêt public 21
c) Les experts des contentieux liés à la responsabilité médicale 22
II. UN ACCÈS MALAISÉ AU DOSSIER MÉDICAL 23
A. LES FRÉQUENTS OBSTACLES RENCONTRÉS PAR LES PATIENTS 23
1. La nécessité d’une meilleure information des patients 23
a) Une information inefficace 23
b) Des mises en place progressives des commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge 25
2. Les réticences des professionnels de santé 26
a) Des réticences fondées sur la protection du patient 26
b) Des réserves liées à la crainte d’une contestation 27
3. La transmission difficile des éléments du dossier 28
a) Un délai de réflexion de 48 heures contestable 28
b) Des coûts variables de reproduction des dossiers 29
c) Des transmissions défectueuses de dossiers 31
B. UNE RÉELLE CONTRAINTE POUR LES PROFESSIONNELS ET LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 32
1. La forte augmentation des demandes 32
a) Des demandes variables selon les secteurs… 32
b) …et qui entraînent un surcroît de charges administratives dans les établissements de santé 33
2. La brièveté du délai de communication des dossiers les plus récents 35
3. Les problèmes posés par l’archivage des dossiers 36
a) Une gestion de plus en plus informatisée en cabinet libéral 36
b) Un approvisionnement constant de dossiers dans les établissements de santé 36
C. UNE ABSENCE DE SANCTION DES COMMUNICATIONS NON ACCOMPLIES INCOMPLÈTES OU TARDIVES 38
1. La conciliation 38
2. Les autres procédures 38
III. UNE ACCESSIBILITÉ RENFORCÉE AU DOSSIER MÉDICAL 40
A. DES COMMUNICATIONS DE DOSSIERS MIEUX ENCADRÉES 40
1. Remédier aux différences des modes de conservation des éléments du dossier 40
2. Unifier le régime des facturations des communications des dossiers : 42
3. Modifier les délais de communication des dossiers de moins de cinq ans 44
4. Améliorer les possibilités de recours d’un patient ou de ses ayants droit contre les refus ou les absences de réponse opposés à leur demande d’accès au dossier médical 45
B. DES DROITS DES PATIENTS PLUS AFFIRMÉS 47
1. Les droits des personnes majeures protégées 47
2. Les personnes ayant reçu un mandat exprès du patient 48
C. DES PRÉROGATIVES MIEUX DÉFINIES DES AYANTS DROIT D’UN PATIENT DÉCÉDÉ 50
1. La communication sans condition du dossier aux parents de l’enfant décédé qui n’a pas manifesté d’opposition 50
2. L’intégration du concubin et du partenaire d’un pacte civil de solidarité aux ayants droit du patient décédé 51
CHAPITRE II : RENDRE PLUS JUSTE LE RÉGIME D’INDEMNISATION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES 53
I. UN DISPOSITIF EFFICACE DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES 53
A. INFECTION NOSOCOMIALE ET INFECTION ASSOCIÉE AUX SOINS 53
B. UN DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES À L’EFFICACITÉ AVÉRÉE 56
1. Les structures de la lutte contre les infections nosocomiales 56
a) Les structures locales : le comité de lutte contre les infections nosocomiales et l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière 56
b) Les structures interrégionales : les centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales 57
c) Les structures nationales : le comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins et le réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections nosocomiales 57
2. Les instruments de mesure de la lutte contre les infections nosocomiales 58
a) Les indicateurs 58
b) Les enquêtes de prévalence 60
3. Des progrès incontestables dans les taux de prévalence des infections nosocomiales 61
4. Les limites de la lutte contre les infections nosocomiales 63
C. LES LACUNES DE LA CONNAISSANCE DES INFECTIONS CONTRACTÉES EN MÉDECINE DE VILLE 65
II. UN RÉGIME D’INDEMNISATION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES GLOBALEMENT SATISFAISANT 66
A. LE RÉGIME JURISPRUDENTIEL ANTÉRIEUR À LA LOI DU 4 MARS 2002 66
1. Un régime différent selon le lieu de survenance de l’infection 66
2. Un régime jurisprudentiel favorable aux victimes 68
B. LE RÉGIME LÉGAL D’INDEMNISATION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ISSU DES LOIS DU 4 MARS ET DU 30 DÉCEMBRE 2002 68
1. Un régime fruit d’un compromis entre protection des victimes, responsabilisation des établissements de santé et sauvegarde de l’assurabilité des établissements 68
2. Des règles légales d’indemnisation des infections nosocomiales ayant une apparence de grande complexité mais unifiées 70
3. Une procédure simplifiée et accélérée 74
a) Le choix par la victime de la voie d’indemnisation 74
b) La procédure de règlement amiable devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation 76
C. UN JUGEMENT GLOBALEMENT FAVORABLE DU RÉGIME D’INDEMNISATION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES 78
1. Des règles de définition des régimes de responsabilité jugées globalement satisfaisantes 78
2. La procédure des commissions régionales de conciliation et d’indemnisation : une procédure largement utilisée constituant un progrès largement reconnu 79
a) L’incontestable succès de la procédure de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation 79
b) Les avantages du choix de la voie de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation 81
III. UN RÉGIME D’INDEMNISATION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ENCORE PERFECTIBLE 84
A. UNE DÉFINITION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES INDEMNISABLES INSUFFISAMMENT PRÉCISE 85
B. UN CHAMP D’APPLICATION DU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DE PLEIN DROIT TROP RESTREINT 88
C. UN CHAMP DE COMPÉTENCE DES COMMISSIONS RÉGIONALES DE CONCILIATION ET D’INDEMNISATION DANS LEUR MISSION DE RÈGLEMENT AMIABLE PROBLÉMATIQUE 91
1. Des critères d’accès aux commissions régionales de conciliation et d’indemnisation trop restrictifs 91
a) Le critère de l’incapacité permanente partielle 92
b) Le critère de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou du déficit fonctionnel temporaire 93
c) Les critères exceptionnels de l’incapacité à exercer son activité professionnelle antérieure et des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence 95
2. L’échec de la fonction de conciliation des commissions régionales de conciliation et d’indemnisation 97
3. Vers une suppression des seuils d’accès aux commissions régionales de conciliation et d’indemnisation ? 99
D. UN ACCOMPAGNEMENT INSUFFISANT DES VICTIMES 101
E. UNE QUALITÉ DES EXPERTISES TROP VARIABLE 106
F. UNE MISE EN œUVRE DES AVIS DES COMMISSIONS RÉGIONALES DE CONCILIATION ET D’INDEMNISATION PARFOIS DÉFICIENTE 108
EXAMEN EN COMMISSION 111
SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS DE LA MISSION 121
CONTRIBUTION DE MMES MARIETTA KARAMANLI ET CATHERINE LEMORTON, MEMBRES DU GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE 123
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES ET DES RÉUNIONS ORGANISÉES PAR LA MISSION 125
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LA MISSION AU COURS DE SES DÉPLACEMENTS 129
COMPTE RENDU DES DÉPLACEMENTS DE LA MISSION 133
GLOSSAIRE DES SIGLES UTILISÉS 143
La santé est, très naturellement, l’une des préoccupations majeures de nos concitoyens, et le droit à la santé l’une de leurs aspirations les plus fortes. Les progrès de la science médicale au cours du siècle passé ont permis un allongement de la durée de vie sans précédent dans l’histoire et la prise en charge de pathologies jusque-là incurables. Cependant, malgré cette révolution dans la prise en charge de la santé des patients, les droits de ces derniers sont pendant longtemps restés dans un état embryonnaire. La relation entre le médecin et le patient était une relation fondamentalement inégalitaire, dans laquelle un sachant pratiquait son art sur un sujet n’ayant que très marginalement voix au chapitre.
Si la deuxième moitié du XXe siècle a vu s’affirmer en doctrine, en jurisprudence et dans des dispositifs législatifs épars la notion de droits des malades, la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a constitué une avancée majeure dans l’affirmation de ces droits : « La proclamation, par un projet de loi, des droits des malades (…) a quelque chose de révolutionnaire, tant reste ancrée dans les mentalités l’image d’un malade non seulement diminué physiquement mais aussi amoindri juridiquement face au pouvoir médical auquel il s’en remet entièrement » (4). Parmi ces droits reconnus aux malades, figuraient notamment le droit à l’information et le droit à l’indemnisation en cas d’intervention médicale ayant engendré un dommage.
Le droit à l’information comprend plusieurs facettes : il inclut le droit d’être informé sur son état de santé, le droit d’être informé des conséquences d’un acte médical proposé, ou encore le droit d’être informé d’un événement indésirable survenu au cours d’une prise en charge thérapeutique. Ce droit s’exerce en premier lieu dans la prise en charge « quotidienne » des patients par les médecins, à travers l’information que le praticien doit donner à son patient à l’occasion du colloque singulier. Mais ce droit peut aussi s’exercer par l’accès du patient aux informations écrites concernant sa santé, contenues dans ce qui est communément qualifié de « dossier médical ». La reconnaissance par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique d’un droit d’accès direct du patient au dossier médical a indéniablement constitué une révolution, tant pour les patients que pour les professionnels de santé.
La loi du 4 mars 2002 a également affirmé le droit à indemnisation des patients et de leurs ayants droit en cas de dommage survenu dans le cadre d’une prise en charge thérapeutique. En cette matière, le législateur est intervenu dans un contexte jurisprudentiel particulier, la dernière décennie du XXe siècle ayant été marquée par une évolution rapide et foisonnante du droit de la responsabilité médicale, tant devant le juge judiciaire que devant le juge administratif. Les juridictions avaient en particulier eu à se prononcer sur le droit à indemnisation des patients en cas d’infection survenue au cours d’un séjour dans un établissement de santé, dite « infection nosocomiale ». Ces infections ont pris une place importante dans les débats sur la qualité du système de santé et les risques sanitaires, en raison d’un certain nombre de situations ayant suscité l’attention des médias, mais aussi du caractère choquant qu’elles peuvent avoir pour les patients en raison du lieu même et du contexte dans lesquels elles surviennent. Il peut en effet être difficile pour un patient de comprendre pourquoi et comment il a pu contracter une infection, dont les conséquences peuvent être graves, à l’occasion de soins réalisés dans un établissement de santé, a fortiori si ces soins visaient à prendre en charge une affection relativement bénigne.
L’intervention du législateur de 2002 visait donc à répondre à cette légitime aspiration des victimes à obtenir réparation des préjudices subis en cas d’infection nosocomiale, tout en cherchant à éviter les conséquences négatives des évolutions jurisprudentielles intervenues au cours des années précédentes, ce qui nécessita d’ailleurs une « retouche » législative par loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale. La loi du 4 mars 2002 a également instauré une procédure originale de règlement amiable des litiges en matière médicale, ayant vocation à s’appliquer notamment aux demandes d’indemnisation faisant suite à une infection nosocomiale, dont l’objectif était de simplifier, d’accélérer et de pacifier le traitement des demandes en matière de responsabilité médicale.
Près de sept ans après l’affirmation législative d’un droit d’accès au dossier médical et d’un droit à indemnisation en cas d’infection nosocomiale, les commissions des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République et des Affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale ont souhaité évaluer la mise en œuvre effective de ces deux droits, en créant une mission d’information commune sur l’indemnisation des victimes d’infections nosocomiales et l’accès au dossier médical (5).
Dans quelles conditions les patients ont-ils accès à leur dossier médical ? Les délais de communication prévus par la loi sont-ils respectés ? Des difficultés matérielles compliquent-elles la mise en œuvre du droit d’accès ? En matière d’indemnisation des infections nosocomiales, les patients victimes peuvent-ils bénéficier effectivement de la réparation des dommages à laquelle ils ont droit ? Les fondements du régime de responsabilité retenu et la répartition de la charge de l’indemnisation sont-ils satisfaisants ? La procédure ad hoc créée par la loi du 4 mars 2002 a-t-elle atteint ses objectifs de simplification, d’accélération et de pacification du règlement des différends ? Telles sont quelques-unes des principales questions auxquelles la mission a eu à répondre au cours de ses travaux.
Bien que son intitulé vise d’abord l’indemnisation des infections nosocomiales puis l’accès au dossier médical, la mission a estimé plus logique de traiter la question du droit d’accès au dossier médical avant celle de l’indemnisation des infections nosocomiales : en effet, l’accès au dossier médical est la porte d’entrée à tout dispositif d’indemnisation. Sans les éléments de preuve que contient le dossier médical, il serait impossible de déterminer si l’infection contractée était nosocomiale et si, dans une telle hypothèse, le patient est en droit de prétendre à une indemnisation. En résumé, l’effectivité de l’exercice du droit d’accès au dossier médical conditionne le droit à indemnisation.
Après quatre mois de travaux, au cours desquelles elle a organisé neuf auditions et six tables rondes, et effectué six déplacements dans des établissements de santé de différents types (6), la mission est parvenue à la conclusion que, si les apports des lois du 4 mars et du 30 décembre 2002 peuvent être considérés comme globalement positifs pour les droits des patients, l’effectivité du droit d’accès au dossier médical peut encore être renforcée (Chapitre premier), tandis que le régime d’indemnisation des infections nosocomiales peut être rendu plus juste (Chapitre II). Un droit d’accès au dossier médical plus effectif, un régime d’indemnisation des infections nosocomiales plus juste : telles sont les conditions, pour la mission, d’une confiance renforcée entre patients et professionnels de santé.
CHAPITRE PREMIER : RENFORCER L’EFFECTIVITÉ DU DROIT D’ACCÈS DU PATIENT À SON DOSSIER MÉDICAL
Pendant des siècles, le dossier médical se définissait comme un outil personnel permettant à un médecin de mémoriser aisément l’histoire d’un de ses patients, en y insérant le descriptif des soins prodigués, les résultats des différents examens pratiqués, diverses correspondances – avec d’autres confrères, son patient ou ses proches, etc. – ainsi que ses observations personnelles.
À compter des années 1970 (7), alors qu’il n’était jusque-là soumis à aucune réglementation, le dossier médical va faire l’objet d’un encadrement législatif et réglementaire de plus en plus conséquent, suivant ainsi l’évolution de la société qui a fait passer le patient du statut de sujet médical à celui d’usager responsable, et le médecin du statut d’autorité paternaliste à celui d’interlocuteur et d’informateur privilégié.
Succédant à la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale qui instituait « un dossier de suivi médical » auquel le patient ne pouvait accéder que par l’intermédiaire d’un médecin, la loi
n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a posé le principe général d’un droit du patient à être informé sur son état de santé ; cette information lui est délivrée soit par le biais d’un professionnel de santé (article L. 1111-2 du code de la santé publique) soit par son accès direct à l’ensemble des informations formalisées de santé le concernant et « détenues à quelque titre que ce soit par des professionnels et établissements de santé » (article L. 1111-7 du même code).
Réclamé au nom de leurs droits fondamentaux de citoyens et d’usagers du système de santé par les patients et les associations de malades, cet accès direct au dossier médical participe tout à la fois à la continuité et à l’efficacité des soins, à une responsabilisation du patient et à une transparence de son information « sur ce qui le concerne au premier chef, c’est-à-dire sur son état de santé, sur les soins qui lui sont proposés et sur les risques qu’il encourt, y compris le droit de savoir ce qui s’est réellement passé en cas d’accident » (8).
Il est opposable à tous les professionnels de santé dont la définition est donnée par la quatrième partie du code de la santé publique : sont des « professions de santé », les professions médicales – médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes –, les professions de pharmaciens – pharmaciens et préparateurs en pharmacie – et les auxiliaires médicaux – infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-pédologues, ergothérapeutes, orthoptistes, psychomotriciens, orthophonistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale, audioprothésistes, prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées, opticiens-lunetiers et diététiciens (9).
Depuis la promulgation de la loi du 4 mars 2002 précitée, les demandes des patients désireux d’accéder à leur dossier se sont multipliées. Toutefois, si le bilan des sept années de mise en pratique de ce droit est globalement positif (I), diverses difficultés respectivement rencontrées par les professionnels de santé, les patients et leurs ayants droit ont été portées à l’attention de la mission (II) dont diverses propositions tendront à maintenir un équilibre entre un renforcement de l’effectivité du droit d’accès d’une personne à un dossier médical et l’allègement des contraintes pesant sur les professionnels et les établissements de santé (III).
I. UN RÉGIME JURIDIQUE ÉQUITABLE
Alors que la loi précitée du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale reconnaissait au patient un droit de propriété sur son dossier, d’aucuns regrettent que la loi du 4 mars 2002 ne se prononce pas sur ce sujet. Dès lors, la propriété du dossier est revendiquée par les patients puisque les éléments contenus dans ce document concernent leur personne et par les professionnels de santé parce que ce sont eux qui le nourrissent de leurs réflexions et de leurs thérapeutiques.
En réalité, le silence de la loi établit un équilibre entre les établissements, les professionnels de santé et les patients. Créant de fait une « propriété indivise » (10), la loi offre :
– aux premiers, un droit de détention qui leur permet d’utiliser tout dossier comme un objet de recherche et d’enseignement, notamment dans les centres hospitaliers universitaires ;
– aux deuxièmes, un outil de décision dans une thérapie et un moyen d’évaluation de leurs méthodes quant à leurs résultats et parfois, leurs coûts ;
– aux troisièmes une information et la possibilité de demander un second avis médical, ou de recueillir d’éventuels éléments de preuve nécessaires à une contestation des soins délivrés, notamment lorsqu’ils ont contracté une infection nosocomiale.
Opposable à tous les établissements et professionnels de santé soumis de ce fait à certains impératifs (A), le droit d’accès à un dossier médical est ouvert à un nombre restreint de personnes, pour des raisons de confidentialité (B).
A. LES OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Si le code de la santé publique impose une procédure unique de communication de certains éléments des dossiers médicaux détenus par tout professionnel et établissement de santé, il n’édicte des normes relatives au contenu et à la durée de conservation des dossiers que pour les seuls établissements de santé.
Constitué par le professionnel de santé, le dossier médical ne fait l’objet d’aucune définition légale en tant que tel : c’est par son contenu qu’il est appréhendé par les textes légaux et réglementaires.
L’article L. 1111-7 du code de la santé publique précise que les informations délivrées au patient sont formalisées ou font l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé tels « les résultats d’examen, les comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, les protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre ». Ces informations s’opposent aux documents non formalisés qui ne sont pas communicables.
a) Les documents non formalisés
L’arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement de cet accès, définit comme documents non formalisés « les notes des professionnels de santé (qui) ne sont pas destinées à être conservées, réutilisées ou le cas échéant échangées, parce qu’elles ne peuvent contribuer à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou à une action de prévention ». Considérées comme « personnelles », elles sont alors intransmissibles et inaccessibles à la personne concernée comme aux tiers.
Par ailleurs, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a précisé que les notes personnelles ne se caractérisaient pas par leur caractère manuscrit (avis n° 2004-1645 du 15 avril 2004). Son rapporteur, M. Alexandre Pascal (11) a indiqué à la mission que la CADA fonde aujourd’hui la définition de ces documents en fonction d’un critère de détention : si une pièce se trouve matériellement dans le dossier, elle ne peut pas être considérée comme une note personnelle ; à l’inverse, si le médecin l’a conservée en sa possession, elle peut avoir ce caractère et être non communicable.
Pour Maître Cyril Clément (12), avocat au barreau de Paris, spécialiste de droit médical, l’absence d’une véritable réglementation sur les notes personnelles constitue un facteur d’insécurité juridique car certains professionnels de santé sont parfois tentés de transformer en notes personnelles diverses pièces du dossier, dont ils ne souhaitent pas qu’elles puissent fonder une éventuelle action judiciaire de leur patient.
b) Le dossier constitué par un établissement de soins
Aux termes des articles R. 1112-1 et suivants du code de la santé publique, un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dont il comporte l’identification, ainsi que les noms éventuels de la personne de confiance ou de la personne à prévenir.
Trois parties distinctes, dont les contenus font l’objet de listes non exhaustives, le composent :
– les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l’établissement, lors de l’accueil au service des urgences ou au moment de l’admission et lors du séjour hospitalier tels les motifs d’hospitalisation, recherche d’antécédents et de facteurs de risques, nature des soins dispensés et prescriptions établies lors de la consultation, informations relatives à la prise en charge au cours de l’hospitalisation, dossier d’anesthésie, compte rendu opératoire ou d’accouchement, dossier de soins infirmiers ou informations relatives aux soins infirmiers… ;
– les informations formalisées établies à la fin du séjour : compte rendu d’hospitalisation, lettre rédigée à l’occasion de la sortie, prescription de sortie, doubles d’ordonnance de sortie, modalités de sortie et fiche de liaison infirmière ;
– les informations recueillies auprès de personnes n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers.
Seules les deux premières catégories d’informations sont communicables.
Chaque pièce du dossier est datée et comporte l’identité du patient (nom, prénom, date de naissance ou numéro d’identification) ainsi que l’identité du professionnel de santé qui a recueilli ou produit les informations.
Les prescriptions médicales sont datées avec indication de l’heure et signées, le nom du signataire devant être mentionné en caractères lisibles.
c) Le dossier tenu par un praticien libéral
En 1996, l’Agence nationale pour le développement de l’évaluation médicale (ANDEM) (13) avait élaboré des recommandations sur la « Tenue du dossier médical en médecine générale » qui se traduisaient par des objectifs précis : disposer à tout moment d’une histoire médicale actualisée et synthétique, expliciter les arguments qui sous-tendent les décisions, planifier et assurer un suivi médical personnalisé, minimiser le risque iatrogène et favoriser la transmission à un autre soignant. Une liste énonçait les éléments devant y figurer : données d’identification – nom, sexe, date de naissance...–, informations administratives, données d’alerte et données concernant la dernière rencontre.
Excepté ces recommandations, aucun texte ne définit ni les formalités éventuelles de constitution d’un tel dossier ni le contenu de ce dernier :
– l’article 45 du code de déontologie médicale, repris à l’article R. 4127-45 du code de la santé publique, évoque son existence, en incise et par rapport à la fiche d’observation : « Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle. » Confidentielle, cette fiche comporte des éléments actualisés nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
Bien qu’elles appartiennent au médecin qui les a établies, les fiches d’observation doivent comme « toutes les informations et documents utiles à la continuité des soins (être transmises), à la demande du patient ou avec son consentement, aux médecins qui participent à sa prise en charge ou à ceux qu’il entend consulter » ainsi qu’au nouveau médecin traitant choisi par le patient (article R. 4127-45 précité) ;
– le code de déontologie des chirurgiens-dentistes et le code de déontologie des sages-femmes, évoquant le secret professionnel, indiquent, sans autre précision, que ce dernier s’applique aux « fiches cliniques, documents et supports électroniques (…) concernant des patients » détenus par un chirurgien dentiste (article R. 4127-208 du code de la santé publique) et aux « dossiers médicaux et tout autre document (…) concernant ses patientes » détenus par une sage-femme (article R. 4127-303 du même code).
Pourtant, quel que soit son contenu, le dossier du praticien libéral doit être communiqué au patient qui en fait la demande.
Alors que l’article R. 1112-7 du code de la santé publique réglemente précisément la durée de conservation des dossiers détenus par les établissements de santé publics ou privés, il n’existe aucune disposition particulière pour les professionnels de santé libéraux.
● Dans les établissements de santé, les dossiers sont conservés pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de l’intéressé dans l’établissement ou de sa dernière consultation externe. Toutefois :
– lorsque la durée de conservation d’un dossier s’achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu’à cette date ;
– lorsque la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l’établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès.
À l’issue de ces délais, les dossiers peuvent être éliminés sur décision du directeur de l’établissement après avis du médecin responsable de l’information médicale. Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l’administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d’intérêt scientifique, statistique ou historique.
● Les médecins libéraux sont tenus de conserver les dossiers médicaux et leurs notes personnelles, sous leur « responsabilité » (article R. 4127-45 précité) mais aucun texte ne fixe la durée de conservation de ces documents.
Dans une note parue en mai 2009 (14), le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) préconise, par précaution, d’aligner la durée de conservation des archives médicales sur celle retenue pour les établissements de santé.
3. Le respect des délais de communication
Quelle que soit sa qualité, la personne qui souhaite obtenir communication d’un dossier médical ne peut accéder aux informations demandées qu’après un délai de réflexion de 48 heures et « au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande » (article L. 1111-7 du code de la santé publique).
Ce dernier délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été constituées ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie.
Dans sa note précitée de mai 2009, le CNOM recommande de noter la date du jour de réception de la demande et de conserver l’enveloppe pour que le cachet postal fasse foi, en cas de contestation ultérieure des conditions dans lesquelles la communication du dossier a été effectuée.
B. LE DROIT D’ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL
Avant tout traitement d’une demande d’accès à un dossier, le destinataire de la demande (responsable de l’établissement, professionnel de santé ou hébergeur) doit s’assurer de l’identité du demandeur.
En effet, bien que les informations de santé soient couvertes par le secret médical, plusieurs personnes peuvent désormais exciper d’un droit d’accès : les patients, leurs représentants, les ayants droit du patient décédé ainsi que divers médecins ou experts.
Sans avoir à motiver sa demande, tout patient peut demander à accéder à la totalité de son dossier médical ou à certains de ses éléments, soit directement, soit – comme avant la promulgation de la loi du 4 mars 2002 – par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne.
La communication du dossier peut se faire sur place ou par envoi de reproductions des pièces du dossier, sous réserve de leur examen préalable par le médecin ou le chef de service qui les ont établies. La loi prévoit en effet que ces derniers puissent recommander la présence d’un tiers, librement choisi par le demandeur, afin d’atténuer, lors de la consultation du dossier, les effets de la découverte brutale de certaines des informations ainsi divulguées. Néanmoins, le refus opposé par le demandeur à cette assistance ne fait pas obstacle à la communication desdites informations.
Au contraire, lorsqu’il existe « des risques d’une gravité particulière » pour la consultation de leur dossier par des personnes hospitalisées sous contrainte en raison de leurs troubles psychiques, l’assistance d’un médecin désigné par le demandeur, peut être rendue obligatoire (article L. 1111-7 du code de la santé publique).
2. Les représentants des patients
Instituée par les recommandations de bonnes pratiques homologuées par l’arrêté du 5 mars 2004, la possibilité pour un patient (ou pour ses représentants légaux ou ses ayants droit lorsqu’il est décédé) de confier un mandat à un tiers afin qu’il accède à son dossier médical, a été reconnue par le Conseil d’État, à la double condition que la personne mandatée, « dispose d’un mandat exprès, c’est-à-dire dûment justifié » et qu’elle puisse « justifier de son identité » (15).
En application de cette jurisprudence, la CADA (16) a estimé que l’intention du patient de désigner un mandataire pour accéder à son dossier médical pouvait prendre diverses formes telles un « regard soutenu » dans le cas d’une personne atteinte d’un syndrome d’enfermement (« locked-in syndrom »).
b) Les représentants légaux de la personne mineure
Dans le cas d’une personne mineure (article L. 1111-7 du code de la santé publique), « le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale » à l’exception des cas où l’enfant :
– n’autorise l’accès à son dossier que « par l’intermédiaire d’un médecin » ;
– ayant précédemment décidé de garder le secret sur des soins qui lui ont été prodigués, persiste à s’opposer à toute transmission d’informations à ses parents, malgré les efforts que le professionnel de santé aura dû déployer pour obtenir son consentement.
c) Le représentant ou les représentants de la personne sous tutelle
Alors qu’il vise expressément le cas des incapables mineurs, l’article L. 1111-7 précité n’exige pas une représentation des incapables majeurs pour accéder à leur dossier, semblant les intégrer dans sa première phrase : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé. »
Pourtant, si en matière de curatelle ou de sauvegarde de justice, la personne protégée exerce effectivement elle-même son droit d’accès, en matière de tutelle, l’article R. 1111-1 lui impose de passer par l’intermédiaire de son tuteur.
3. Les ayants droit en cas de décès du patient
Les ayants droit, expressément définis par l’arrêté du 3 janvier 2007 (17), doivent être considérés « aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé » comme étant les « successeurs légaux du défunt, conformément au code civil ».
Leur accès au dossier médical d’un défunt est subordonné à trois conditions :
– ils doivent prouver leur qualité de successeurs du défunt au sens des articles 731 et suivants du code civil ou en tant que successeurs désignés par une libéralité ;
– le patient décédé ne doit pas avoir manifesté d’opposition à la consultation de son dossier médical ;
– leur demande doit être fondée sur l’un des objets visés par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : les informations recherchées doivent leur permettre « de connaître les causes de la mort », ou « de défendre la mémoire du défunt » ou enfin « de faire valoir leurs droits ». Par conséquent, afin que seules les pièces répondant à l’objet visé soient communiquées aux ayants droit, le Conseil d’État a estimé qu’il appartenait au médecin saisi de la demande de les déterminer (18).
4. Les tiers dûment autorisés par le patient ou par la loi
a) Les professionnels de santé concourant aux soins du patient
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique autorise les équipes médicales à s’échanger « des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible », sauf si l’intéressé dûment averti s’y oppose.
Par conséquent, au sein d’un même service ou d’un même établissement, tout médecin – de l’étudiant hospitalier au chef de service – et toute équipe médicale prenant en charge un patient, aura accès à l’ensemble des informations relatives à toutes ses précédentes hospitalisations.
De même, lorsqu’un patient est hospitalisé dans un autre établissement, son dossier peut y être transféré, sauf opposition de sa part. Dans cette hypothèse, après une discussion avec un médecin, soit les éléments dont le patient refuse la transmission sont retirés du dossier, soit le médecin explicite par écrit à son confrère les mesures nécessaires au suivi du patient.
Le médecin traitant ou le médecin prescripteur de l’hospitalisation peuvent également avoir accès au dossier détenu par un établissement de santé, à condition de justifier de l’accord de l’intéressé ou de son représentant.
b) Les personnes concourant à une mission d’intérêt public
Dans l’intérêt de la santé publique ou du contrôle médical, les informations contenues dans un dossier médical détenu par un établissement de santé sont accessibles, « dans le respect des règles de déontologie », aux médecins membres de l’Inspection générale des affaires sociales (article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire), à l’Institut de veille sanitaire (article L. 1413-5 du code de la santé publique), aux médecins inspecteurs de santé publique et aux médecins conseils des organismes d’assurance maladie « lorsqu’elles sont nécessaires à leurs missions » (article L. 1112-1 du même code).
Par ailleurs, afin de leur permettre de faire des propositions ciblées sur l’accueil et la prise en charge des personnes accueillies dans leurs établissements, les commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQ) (19) sont informées « de l’ensemble des plaintes ou réclamations formées par les usagers de l’établissement ainsi que des suites qui leur sont données ». À cette fin, elles peuvent avoir accès « aux données médicales relatives à ces plaintes ou réclamations, sous réserve de l’obtention préalable de l’accord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal » (article L. 1112-3 du code de la santé publique).
c) Les experts des contentieux liés à la responsabilité médicale
Diverses instances ou personnes, n’ayant pas obligatoirement la qualité de médecins, sont habilitées par la loi à demander la communication des pièces d’un dossier médical utiles à la détermination de l’indemnisation d’un patient.
Il en est ainsi du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (paragraphe III de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001), du Fonds d’indemnisation des victimes contaminées par le virus du sida (article L. 3122-2 du code de la santé publique) et des commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (article L. 1142-9 du même code).
De même, le médecin nommé pour mener l’expertise du dossier saisi pour les besoins d’une instruction pénale et le magistrat instructeur ont accès aux seuls éléments d’information contenus dans le dossier médical strictement nécessaires aux besoins de l’enquête pénale.
Protectrice des droits des patients qui peuvent obtenir plus aisément les informations concernant leur santé quels que soient les établissements ou les professionnels de santé qui les ont établies, les dispositions applicables à l’accès au dossier médical n’entravent pas pour autant les praticiens dans l’exercice de leur profession puisqu’elles leur offrent la maîtrise et l’usage du dossier en affirmant leur droit de le détenir.
Malgré cet équilibre du dispositif, l’exercice pratique de ce droit ne va pas sans difficulté tant pour les patients que pour les établissements et professionnels de santé.
II. UN ACCÈS MALAISÉ AU DOSSIER MÉDICAL
Alors que l’ensemble des témoignages reçus par la mission tend à prouver que les patients sont de plus en plus nombreux à demander un accès direct à leur dossier, l’exercice de ce droit est freiné par les divers obstacles rencontrés par les personnes intéressées (A), par les contraintes qu’il fait peser sur les professionnels de santé (B) et par l’absence de toute sanction des actes tendant à contrarier son application (C).
A. LES FRÉQUENTS OBSTACLES RENCONTRÉS PAR LES PATIENTS
Encore mal connu des patients, le droit d’accès des malades et de leurs ayants droit au dossier médical suscite diverses réticences de la part des professionnels de santé.
1. La nécessité d’une meilleure information des patients
● Au cours de son audition du 24 avril 2009, le Docteur Walter Vorhauer, secrétaire général du Conseil national de l’Ordre des médecins, a indiqué que l’un des principaux obstacles à l’exercice du droit d’accès au dossier médical réside dans le fait que les patients ne sont pas informés de ce droit de manière satisfaisante. Bien que la plupart des livrets d’accueil remis aux patients lors de leur hospitalisation en précisent les conditions d’exercice, cette information est inefficace car elle est donnée à un moment où le patient demande avant toute chose à être soigné et ne se soucie guère de ses droits.
De même, en menant une enquête flash sur l’accès au dossier médical (20), le centre téléphonique « Santé Info Droit » du Collectif interassociatif sur la santé (CISS) a constaté que seuls 30,9 % des appelants savaient pouvoir accéder directement à leur dossier alors que 37 % pensaient devoir passer par l’intermédiaire d’un médecin et que 30 % n’avaient pas donné de réponse.
Conscients de cette insuffisante connaissance de leur droit par les patients, divers intervenants auditionnés par la mission ont proposé qu’à l’issue de toute prise en charge, le médecin :
– demande à chaque patient s’il souhaite consulter son dossier médical (21) ;
– remette à son patient les éléments pertinents concernant sa santé (22);
– remette au patient hospitalisé, les éléments principaux de son dossier nécessaires à une prise en charge ultérieure (23). Sur ce point, il doit être rappelé que la remise de différents documents au patient sortant d’une hospitalisation, organisée par l’article R. 1112-1 du code de la santé publique (cf. supra) n’englobe ni le compte rendu opératoire, ni les éléments relatifs à la prescription médicale et à son exécution.
● Si les établissements de santé ont aujourd’hui bien compris (24) la nécessité de donner une information sur la nature et les conditions d’exercice du droit d’accès, nombre d’entre eux ont constaté qu’une autre information était essentielle : celle portée, en amont, au cours de l’hospitalisation, par le médecin ou l’équipe médicale prenant en charge le patient. De fait, une demande d’accès à un dossier recèle bien souvent une insatisfaction du patient liée à la mauvaise qualité ou à la quasi-inexistence de son colloque singulier avec son médecin et à un soupçon concomitant de mauvaises pratiques professionnelles.
Ce constat est confirmé par les résultats de l’enquête menée fin 2007 par l’Observatoire des droits et responsabilités des personnes en santé de l’université Paris-Descartes (Paris V) en collaboration avec l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) : « L’accès au dossier médical apparaît (…) comme un instrument d’effectivité du droit à l’information et laisse apparaître que si l’information préalable avait été donnée au patient avec plus d’attention, cela aurait sans doute conduit à une diminution du nombre de demandes d’accès au dossier médical » (25).
De même, M. Patrick Hontebeyrie, directeur du centre chirurgical Marie Lannelongue (26) a rapporté à la mission le cas d’un patient qui, extrêmement révolté par les séquelles qu’il conservait de sa très longue hospitalisation, entendait poursuivre l’établissement pour ne pas l’avoir préservé d’une infection nosocomiale. Reprenant avec lui tout son lourd dossier, le médecin qui l’avait pris en charge, lui a alors rappelé l’état critique dans lequel il avait été hospitalisé, l’a informé de toutes les occasions où il avait failli mourir et lui a expliqué quelles thérapeutiques, malgré leurs séquelles éventuelles, l’avaient sauvé. Après cet entretien, ses lettres de remerciements au centre et à ses équipes ont heureusement remplacé ses courriers de réclamation.
Cet exemple illustre clairement la nécessité de renforcer la formation des praticiens sur les vertus d’un véritable dialogue avec leurs patients et, lorsque ce dernier a manqué, de définir des procédures d’écoute ou de médiation des patients mécontents au sein de l’établissement de santé. Ces procédures, qui constituent un des facteurs les plus certains d’une amélioration de l’information des patients, sont progressivement mises en place par les commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
b) Des mises en place progressives des commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
● Dans tout établissement de santé, la commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQ), instituée par la loi du 4 mars 2002 précitée, est composée a minima du représentant légal de l’établissement, d’un médiateur médecin, d’un médiateur non médecin et de deux représentants des usagers.
Elle a pour mission, de veiller au respect des droits des usagers, de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil et de la prise en charge des personnes malades et de leurs proches et, le cas échéant, de permettre à ces personnes d’exprimer leurs griefs auprès des responsables de l’établissement, d’entendre les explications de ces derniers et d’être informées des suites de leurs demandes (article L. 1112-3 du code de la santé publique).
Dans les différents établissements visités par la mission (27), ont été maintes fois soulignés les effets positifs des médiations mises en place. Ont notamment témoigné sur ce sujet :
– M. Patrick Robic, médiateur suppléant et cadre infirmier du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes qui a observé combien le temps consacré à l’écoute de la plainte du patient et les explications adaptées qui lui sont apportées, lui permettent de ressentir qu’il est pris en considération et suffisent généralement à lever ses incompréhensions et à mettre fin à ses griefs ;
– le Docteur Emmanuel Piednoir, chef du service d’hygiène hospitalière du centre hospitalier d’Avranches-Granville, a également constaté que la doléance principale des patients concerne le manque de communication médicale et paramédicale et que l’organisation d’une rencontre avec un professionnel de santé qui prenne le temps de les écouter et de dialoguer suffit bien souvent à mettre un terme à leur réclamation.
● Aux termes d’une enquête (28) de la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS), les CRUQ ont été mises en place dans 95 % des établissements de santé et disposent pour 96 % d’entre elles d’un médecin médiateur titulaire et pour 80 % d’un médecin médiateur suppléant.
Cependant, leur rythme de réunion est insuffisant : 23 % se réunissent d’une fois à moins d’une fois par an, 22 % une fois par semestre et 53 % d’une à plusieurs fois par trimestre.
L’enquête révèle également les difficultés que rencontrent les établissements de santé pour recruter des représentants des usagers, alors que leur intégration ne peut que conduire ces établissements à mener des politiques d’information des patients de plus en plus ciblées.
2. Les réticences des professionnels de santé
La reconnaissance d’un droit d’accès direct du patient à son dossier médical a suscité et continue de susciter les critiques d’un certain nombre de professionnels de santé qui, soit s’inquiètent des répercussions que pourrait entraîner la révélation à leurs patients de certaines informations les concernant, soit se sentent injustement remis en cause par leurs demandes d’accès et craignent qu’elles ne précèdent une action contentieuse.
a) Des réticences fondées sur la protection du patient
● En reconnaissant à toute personne le droit d’être informée sur son état de santé, le code de la santé publique admet en corollaire « sa volonté d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic » (article L. 1111-2) et réserve au médecin une faculté de ne pas informer son patient d’un diagnostic ou d’un pronostic graves « dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience » (article R. 4127-35).
Mais lorsqu’une personne ainsi tenue dans l’ignorance de son état de santé souhaite accéder à son dossier, aucun refus ne peut lui être opposé. Le médecin qui lui communique les informations qu’il détient peut, certes, recommander la présence d’une tierce personne et en particulier d’un médecin, mais il ne peut pas l’imposer. De plus, dans un grand nombre d’établissements de santé, un tel accompagnement ne semble pas avoir été réellement mis en œuvre, ainsi que le déplorait devant la mission, Mme Erell Pencreac’h (29), adjointe au chef du bureau droits des usagers et du fonctionnement général des établissements de santé de la DHOS.
Bien souvent, le contenu du dossier sera incompréhensible pour le patient mais, parfois, ce dernier accédera brutalement à une vérité peut-être douloureuse. Cependant, comme l’indiquait M. Bernard Kouchner, alors ministre délégué à la santé, lors de sa présentation du projet sur les droits des malades devant l’Assemblée nationale : « les malades présument parfois de leur capacité à connaître leur état. Mais la personne malade est d’abord une personne. C’est à elle d’apprécier ce qu’elle souhaite. L’accès direct, n’oblige personne à affronter la vérité s’il ne le désire pas. »
Il ressort de la responsabilité de chacun de choisir d’accéder directement à son dossier médical et de refuser l’accompagnement éventuellement proposé.
● Cette responsabilité ne peut cependant pas être imputée aux patients les plus fragiles. C’est pour cette raison qu’en cas de risques d’une gravité particulière, le législateur impose un accompagnement par un médecin qu’elles désignent, aux personnes hospitalisées d’office ou sur demande d’un tiers (article L. 1111-7 du code de la santé publique).
Nombre de médecins regrettent que cette obligation ne soit pas étendue à tous les malades psychiquement atteints qui pourraient être considérés comme particulièrement sensibles. De ce fait, des réticences de communication de dossier médical sont souvent plus fréquemment constatées parmi les praticiens de la santé mentale.
Toutefois, il convient de noter que, contrairement aux multiples discussions dont elle avait fait l’objet lors de l’adoption de la loi du 4 mars 2002, la nécessité d’une protection du patient face aux conséquences de son accès direct au dossier médical n’a été que très peu évoquée par les différentes personnes rencontrées par la mission.
b) Des réserves liées à la crainte d’une contestation
● La reconnaissance d’un droit d’accès direct du patient au dossier médical a fait craindre aux professionnels de santé une hausse des demandes de consultation des dossiers motivées par une volonté de mettre en cause leur savoir faire professionnel et de rassembler les preuves nécessaires à un engagement de leur responsabilité.
Si l’augmentation des demandes est réelle, le risque, tant annoncé, d’une extrême judiciarisation des relations entre les praticiens et leurs patients ne s’est pas réalisé. L’expérience de ces dernières années et les résultats des différentes études menées sur ce sujet démontrent en effet que les mises en cause des praticiens n’ont pas spécialement augmenté et demeurent même assez faibles :
– en 2008, ainsi que l’a rappelé M. Olivier Jardé (30), député de la Somme et auteur de la proposition de loi tendant à organiser l’information et la conciliation dans le règlement des conflits et litiges en matière de responsabilité médicale (n° 589), sur 14 millions de personnes hospitalisées et sur 400 millions d’actes médicaux prodigués, 20 000 demandes d’explications ont été adressées aux professionnels et établissements de santé, et 5 000 se sont terminées par le dépôt d’une plainte – soit un peu plus d’un plaignant pour 3 000 patients ou pour 80 000 actes, dont certains sont aujourd’hui extrêmement complexes ;
– selon l’enquête précitée de Paris V et de l’AP-HP, les demandes directement motivées par un contentieux ne représentent que 7 % du total des 371 personnes ayant répondu à l’enquête (31) ; si l’on y ajoute les demandes motivées par une transmission à un médecin expert (16 %) et à une compagnie d’assurance (6 %), le total de ces demandes atteindrait 29 %. Mais, outre le fait que les trois motivations précitées apparaissent souvent dans une même réponse et ne concernent qu’une même personne, seuls 10 % des patients ont fait suivre leur demande de renseignements d’une demande d’indemnisation amiable (6 %) ou contentieuse (4 %).
● Les réticences des médecins à partager les informations de santé qu’ils détiennent demeurent cependant un phénomène culturel important selon l’analyse de Mme Hélène Logerot, médecin en santé publique (32), puisqu’il a été constaté que certains patients n’osent pas leur demander un dossier, même dans le cas d’un deuxième avis médical.
3. La transmission difficile des éléments du dossier
D’autres freins à la communication du dossier ont également été relevés par les représentants des associations de patients et d’usagers du système de santé (33), qu’ils résultent des dispositions mêmes de la loi ou qu’ils soient manifestement suscités par les détenteurs des dossiers.
a) Un délai de réflexion de 48 heures contestable
Instauré par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, un délai de 48 heures doit être observé par le patient entre sa demande et sa consultation du dossier. Il a pour double objectif d’éviter des demandes inopinées et de réduire le risque, éventuellement suicidaire, des patients venant d’apprendre un pronostic grave et consultant leur dossier pour en connaître l’issue.
Ce délai est manifestement ignoré d’une large majorité de chefs de service (61 %) et de patients (73 %) (34) et quand il ne l’est pas, son utilité est contestée. De fait, dans les – rares - cas où une personne vient sur place consulter son dossier, il lui sera difficile d’accepter d’être renvoyée chez elle pendant 48 heures notamment lorsqu’elle ne réclame que quelques documents aisés à retrouver tels des comptes rendus opératoires ou de consultations, des ordonnances ou des résultats d’examens.
Le refus opposé à sa demande risque en réalité de faire naître un sentiment de défiance à l’égard des professionnels de santé l’ayant prise en charge et de compromettre la qualité de ses relations avec l’établissement. Il paraît évident que, dans cette hypothèse, une demande ultérieure de consultation de l’ensemble du dossier ne manquera pas de parvenir à cet établissement alors que cette procédure plus lourde aurait pu être évitée par la communication directe et immédiate des pièces demandées.
b) Des coûts variables de reproduction des dossiers
● Le coût des copies du dossier médical facturées au patient peut constituer un obstacle important à l’exercice de son droit d’accès à ce document d’autant qu’il n’est que peu encadré :
– les recommandations de bonnes pratiques homologuées par l’arrêté du 5 mars 2004 invitent l’établissement à informer le patient sur les coûts « liés à la reproduction et à l’envoi des documents, du fait de la nature et du volume du dossier » (Paragraphe IV-1). Sauf à avoir pris en considération « la situation personnelle des demandeurs démunis », ne doivent être facturés que « les coûts de reproduction et d’envoi » lesquels se limitent « au coût du consommable et de l’amortissement du matériel » (Paragraphe IV-3) ;
– l’article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques(35), permet de mettre à la charge du demandeur d’un document « le coût du support fourni au demandeur, le coût d’amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d’affranchissement » ;
– l’article 3 de l’arrêté du 1er octobre 2001 (36) relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copies d’un document administratif fixe le prix de la page de format A4 en impression noir et blanc à 0,18 euro, celui de la disquette à 1,83 euro et celui du cédérom à 2,75 euros ;
– la reproduction des clichés d’imagerie médicale n’étant pas encadrée, Mme Erell Pencreac’h (37), adjointe au chef du bureau droits des usagers et du fonctionnement général des établissements de santé de la DHOS et M. Alain-Michel Ceretti (38), chargé de mission sur la santé auprès du Médiateur de la République, ont regretté que les établissements aient tendance à pratiquer une facturation assez onéreuse.
● Au sein des établissements visités par la mission, cette diversité des coûts se trouve parfaitement illustrée comme en témoigne le tableau suivant :
Coûts facturés pour les copies de pièces du dossier médical
dans les établissements de santé visités par la mission
Copie A4 |
Imagerie |
Coût moyen |
Coût minimal de mise en recouvrement |
Divers | |
CHU Rennes |
0,1 € |
5 € |
5 € |
||
Clinique du Pré |
0,01 € |
0 € (remise au patient) |
5 à 30 € |
||
CH Le Mans |
0 |
0 |
0 |
Aucune facturation des reproductions | |
CH Avranches Granville |
0,152 € |
1,377€ 3,002 € |
|||
CH La Pitié Salpêtrière |
0,18 € |
0 € |
Pas de frais d’envoi | ||
CC Marie Lannelongue |
0,18 € |
3 € |
66 € |
5 € |
Facturation des feuilles de réanimation 3€ |
Source : Tableau établi par la mission
● Quant aux difficultés que ces coûts peuvent représenter pour certains usagers du système de santé, Mme Roselyne Bachelot-Narquin (39), ministre de la santé et des sports, a rappelé qu’outre la gratuité de toute consultation d’un dossier sur place, les établissements de santé avaient toute latitude pour prendre en compte les situations matérielles difficiles de certains patients et décider d’une transmission gratuite du dossier.
Par ailleurs, reconnaissant que la reproduction des imageries médicales pouvait être relativement onéreuse, la ministre de la santé et des sports a indiqué qu’elle avait mis en place sur ce sujet un groupe de travail ; constitué de représentants de radiologues, d’usagers et de fédérations hospitalières, il a pour mission d’harmoniser les pratiques des établissements et des professionnels de santé. Peuvent d’ores et déjà être notés les progrès apportés par la numérisation des données – totalement accomplie pour les imageries par résonance magnétique (IRM) et les scanners – laquelle permet de communiquer à un patient certaines de ses imageries médicales à un coût moindre qu’auparavant.
c) Des transmissions défectueuses de dossiers
● Si des cas de pertes de dossiers ont parfois été évoqués devant la mission, aucune étude ne semble avoir réellement quantifié ce phénomène.
Dans ses statistiques sur le suivi de ses décisions sur l’accès au dossier médical, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) fait apparaître un taux important de décisions « sans objet », lequel recouvre tout à la fois les demandes non poursuivies, les dossiers légalement détruits au terme des vingt ans de leur durée obligatoire de conservation, ceux non assez détaillés, ceux déjà communiqués et les dossiers perdus, dont le rapporteur M. Alexandre Pascal n’a pas le souvenir qu’ils soient très nombreux.
Par ailleurs, si l’enquête flash précitée (40) du CISS révèle que 20 % des personnes interrogées n’ont pas eu accès à leur dossier en raison de la perte de ce dernier (41), l’enquête précitée menée par Paris V et l’AP-HP fait état de 11 % de dossiers non transmis (42), sans en préciser le motif. Or, la mission a pu constater que souvent ses interlocuteurs englobaient indifféremment sous les termes « dossiers non transmis », les dossiers perdus, les dossiers non réclamés ainsi que les dossiers légalement détruits au terme de leurs vingt ans obligatoires de conservation.
● Outre la perte des dossiers, les patients peuvent se heurter à des refus de transmission ou à des transmissions tronquées ou comportant des éléments de dossier manifestement raturés ou surchargés.
Mme Marie-Solange Julia (43), présidente de la Fédération des associations d’aide aux victimes d’accidents médicaux, a particulièrement souligné devant la mission le cas de certaines cliniques d’activités purement libérales qui ont tendance à retarder la communication du dossier afin de décourager les patients et les pousser à abandonner leur demande.
De même, Mme Sabine Gibert (44), responsable juridique à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), indiqué que l’office rencontrait les mêmes difficultés que les patients s’agissant de l’étendue des pièces communicables. Elle a notamment fait état de difficultés dans la communication des dossiers médicaux connexes, nécessaires à l’établissement du caractère nosocomial d’une infection.
Par ailleurs, l’ensemble des représentants des syndicats de médecins (45) a fait état de difficultés en matière de communication des clichés d’imagerie médicale détenus par les établissements publics de santé, alors qu’une telle communication pourrait se trouver aujourd’hui facilitée par l’enregistrement sur cédérom ou la consultation des clichés via internet.
Déplorant que la communication du dossier ne soit pas toujours complète ni fidèle à l’existant et désireux d’y remédier, le Docteur Walter Vorhauer (46), secrétaire général du Conseil national de l’Ordre des médecins, a considéré que la duplication du dossier devrait être envisagée dès sa constitution et que lorsqu’un patient demande son dossier, l’intégralité de l’original de celui-ci devrait lui être communiqué, les copies étant conservées par le médecin ou l’établissement de soins. À l’inverse de la situation actuelle, une telle situation emporterait sans doute moins de contraintes pour les professionnels ou les établissements de santé.
B. UNE RÉELLE CONTRAINTE POUR LES PROFESSIONNELS ET LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Permettre à une personne d’accéder dans de bonnes conditions à un dossier médical exige, du temps, de l’espace, du personnel ainsi que des moyens financiers. Depuis qu’un droit d’accès direct a été reconnu aux patients, les professionnels de santé doivent faire face à une forte augmentation des demandes, inscrire leur réponse dans un délai de huit jours à deux mois et organiser au mieux l’archivage de leurs dossiers.
1. La forte augmentation des demandes
a) Des demandes variables selon les secteurs…
Alors que les cabinets libéraux n’ont pas rencontré les mêmes difficultés, les établissements de santé ont dû faire face à une augmentation régulière et reconnue des demandes de dossiers médicaux depuis 2002.
À titre d’exemple, dans les établissements visités – ou dont un responsable a été reçu – par la mission, les demandes (47) sont passées de :
– 100 à 500 pour l’hôpital européen Georges Pompidou, entre 2002 et 2008 ;
– 635 à 1 095 pour le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, entre 2003 et 2008 ;
– 458 à 651 pour le groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière (GHPS), entre 2004 et 2008 ;
– 74 à 98 pour le centre hospitalier (CH) d’Avranches Granville de 2005 à 2008.
Les services les plus sollicités sont par ordre décroissant la chirurgie, la réanimation, les urgences et l’ophtalmologie (48). Par ailleurs, les taux de demandes d’accès au dossier médical sont bien plus importants dans les établissements publics que dans les établissements privés ; cette différence peut sans doute s’expliquer par le fait que, dans les établissements privés, la remise des comptes rendus opératoires et des clichés d’imagerie en fin d’hospitalisation est systématique.
Ces constatations se reflètent dans le tableau ci-dessous qui, pour les établissements retenus par la mission, établit une comparaison fondée sur deux critères applicables à tous : le nombre de séjours effectués en 2008 dans les services maladie, chirurgie et obstétrique (MCO) et le nombre de dossiers demandés au cours de la même année.
Demandes d’accès au dossier médical - Année 2008
Nombre de demandes d’accès au dossier médical |
Nombre de séjours MCO |
Taux de demandes d’accès au dossier médical pour 1 000 séjours MCO | |||
En hospitalisation complète |
En hospitalisation de jour |
Total | |||
CHU Rennes |
1 095 |
56 892 |
33 624 |
90 516 |
12,10 |
Clinique du Pré |
46 |
13 245 |
9 100 |
22 345 |
2,06 |
CH Le Mans |
644 |
42 492 |
13 028 |
55 520 |
11,60 |
CH Avranches-Granville |
98 |
15 276 |
3 871 |
19 147 |
5,12 |
Groupe hospitalier La Pitié Salpêtrière |
2 000 (*) |
52 516 |
42 310 |
94 826 |
21,09 |
Centre chirurgical Marie Lannelongue |
63 |
6 512 |
297 |
6 809 |
9,25 |
Hôpital européen Georges Pompidou |
500 |
23 979 |
15 856 |
39 835 |
12,55 |
(*) Évaluation : le nombre précis de demandes d’accès au dossier médical n’est pas connu.
Source : Tableau établi par la mission
b) …et qui entraînent un surcroît de charges administratives dans les établissements de santé
Afin de pouvoir répondre de façon efficace à la demande du patient, les articles R. 1111-1 et suivants du code de la santé publique mettent en place une procédure centralisée par le responsable de l’établissement ou la personne qu’il a désignée à cet effet, lesquels doivent veiller à ce que :
– l’identité de la personne soit vérifiée, ainsi que sa qualité de successeur lorsque le demandeur se qualifie d’ayant droit d’un patient décédé ;
– le dossier archivé soit transmis au médecin concerné par la demande
– ou à son successeur dans le service – afin qu’il détermine si un accompagnement du patient lors de sa consultation du dossier doit être préconisé, qu’il définisse les pièces du dossier communicables et qu’il sélectionne celles répondant à l’objet de la demande d’un ayant droit (49) ;
– les éléments sélectionnés du dossier ou le dossier dans son entier soient dupliqués.
Au sein des établissements visités par la mission, la procédure semble bien organisée et chaque étape en est suivie par un responsable. Le CHU de Rennes, par exemple, a créé un logiciel qui, calqué sur le déroulement de la procédure, prend en compte les spécificités de chaque type de demande, assure le suivi des demandes et transmet des courriers normalisés aux demandeurs et services concernés.
Néanmoins, tous les responsables ont rappelé que la procédure avait un coût en matériels et en moyens humains : une nouvelle charge de travail est imposée aux équipes médicales qui doivent prendre le temps d’examiner les dossiers demandés ainsi qu’aux personnels administratifs chargés de les transmettre d’un service à l’autre puis de les photocopier.
Au sujet des photocopies, il a été indiqué (50) à la mission que nombre de patients ne mesurent pas ce que représente en volume un dossier médical et qu’à ce titre, il est préférable de leur demander de préciser leur demande. Mme Nicole Besnier (51), référente du service central des dossiers médicaux du centre hospitalier du Mans, a notamment témoigné du temps passé à désagrafer et ragrafer de très nombreux documents, à les reclasser et à maîtriser la manipulation complexe des feuilles de très grand format de réanimation (52).
Soulignés par M. Jérémie Sécher (53), directeur de cabinet de la Fédération hospitalière de France, les nombreux efforts d’adaptation et d’organisation des hôpitaux pour aménager l’accès du patient au dossier médical en dépit de l’importance de leurs structures, de la fréquente multiplicité des sites, de la complexité des pathologies ou des parcours des patients tant en interne qu’en externe, n’ont jamais fait l’objet d’études précises. A ce propos, Mme Hélène Logerot(54), médecin en santé publique, a regretté qu’aucune retombée positive ne soit prévue en faveur des professionnels de santé qui mènent des actions de qualité
Il pourrait donc être recommandé de rechercher quelles sont les incidences réelles du dispositif du droit d’accès aux dossiers médicaux sur les budgets des établissements de santé. Une première indication a été donnée sur ce point à la mission par le service du département d’information médicale du CHU de Rennes : en 2008, la communication et la consultation sur place de plus de 1 000 dossiers ont conduit à l’exécution de 36 500 photocopies, de 2 750 contretypes de clichés d’imagerie médicale, et de 1 600 heures de travail, soit un équivalent temps plein annuel travaillé.
2. La brièveté du délai de communication des dossiers les plus récents
Jugé « irréaliste » (55) par M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République, et par le Docteur Walter Vorhauer, secrétaire général du Conseil national de l’Ordre des médecins, le délai de huit jours imposé pour la communication des dossiers médicaux des personnes hospitalisées moins de cinq ans avant leur demande a été contesté par la quasi-unanimité des personnes auditionnées.
Englobant le délai de transmission de la demande au chef de service compétent, le délai d’examen du dossier par ce dernier et le délai nécessaire aux photocopies, les huit jours sont de fait difficilement respectés, à l’exception des cas d’urgence ou de coordination de soins. Ainsi, l’enquête précitée de Paris V et de l’AP-HP fait apparaître qu’en 2006-2007, les établissements de l’AP-HP n’avaient transmis les dossiers demandés dans le délai légal que dans 6 % des cas, ayant plutôt observé un délai compris entre huit jours et deux mois (61 %) voire même au-delà de deux mois (17 %) (56).
Il est donc quelque peu étonnant de constater l’importante différence de ces pourcentages avec celui qui, mentionné à plusieurs reprises par divers interlocuteurs de la mission, crédite 59 % des établissements publics et privés d’une transmission du dossier demandé dans le délai imparti. Résultant de l’enquête de la DHOS sur la mise en place des CRUQ (57), ce taux doit, de fait, être corrigé par la prise en considération de trois biais : le nombre des établissements contactés qui ont répondu à l’enquête (60,1 % des 2 815 établissements contactés, soit 1 689 établissements) ; le nombre des établissements ayant répondu et dont la CRUQ a effectivement rédigé un rapport annuel (75 % des 1 689 établissements, soit 1 267 établissements) ; le nombre des rapports ainsi rédigés qui ont précisé quels étaient leurs délais de communication (46 % des 1 267 établissements, soit, 583 établissements). Par conséquent, le taux susvisé de 59 % d’établissements respectant le délai de communication de huit jours ne s’applique qu’aux seuls 583 établissements publics et privés dont le rapport annuel de leur CRUQ comprend des données sur les accès de leurs patients aux dossiers médicaux (soit un total de 343 établissements, représentant un peu plus de 12 % de l’ensemble des établissements).
Au cours de ses déplacements, la mission a elle-même pu constater combien les délais moyens de communication des dossiers médicaux peuvent varier d’un établissement à un autre (58).
3. Les problèmes posés par l’archivage des dossiers
Les problèmes rencontrés en matière d’archivage par les professionnels de santé ne sont pas spécifiquement liés au droit d’accès des personnes à leur dossier mais ils ont un effet direct sur l’exercice de ce droit.
Soumis à une obligation de conservation des dossiers au titre de leur responsabilité civile ou des dispositions du code de la santé publique (59), les professionnels de santé devront gérer différemment les difficultés nées de cette obligation selon qu’ils exercent en cabinet libéral ou dans un établissement de santé.
a) Une gestion de plus en plus informatisée en cabinet libéral
Pour leur archivage, les médecins libéraux ont une préoccupation essentielle : celle de la surface disponible. Par conséquent, la conservation de leurs dossiers sera plus ou moins aisée, selon qu’ils exercent dans un cabinet de grande ou de petite taille, en milieu urbain – où le prix du mètre carré peut être élevé – ou en milieu rural.
Toutefois, les progrès de l’informatisation des cabinets médicaux devraient simplifier et unifier les situations des uns et des autres. Le rapport d’information sur le dossier médical personnel (60) estime que « 8 % des médecins libéraux sont actuellement équipés d’un ordinateur » en raison de la généralisation de la télétransmission des feuilles de soins aux organismes de sécurité sociale. L’utilisation de plus en plus fréquente de l’informatique par les médecins libéraux pour gérer leurs dossiers (50 à 88 % des médecins équipés) devrait progressivement leur permettre d’échapper aux contraintes de la détention de dossiers « papier » ; un ordinateur emmagasinant une masse de données considérables, il devrait être d’une grande utilité pour les aider à conserver leurs dossiers par un classement automatique, un repérage aisé des informations accumulées depuis de nombreuses années ou une détermination facile de la dernière visite d’un patient – une date essentielle à connaître avant de décider de l’élimination d’un dossier.
b) Un approvisionnement constant de dossiers dans les établissements de santé
Les archivages des établissements se construisent en parallèle avec les activités propres de l’établissement : par exemple, le site d’Avranches qui, avec le site de Granville, comptait plus de 19 000 séjours en « maladie, chirurgie, obstétrique » (MCO) en 2008, augmente chaque année ses archives de 70 mètres linéaires ; dans le même temps, le groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière (GHPS), qui comptait près de 99 000 séjours MCO en 2008, ajoute un kilomètre linéaire.
En outre, selon M. Pierre Jakès Idée, directeur adjoint du pôle information et pilotage du CHU de Rennes, l’observation des délais de conservation des dossiers de vingt ans après la dernière consultation ou hospitalisation et de 10 ans après le décès d’une personne hospitalisée moins de dix ans avant ce décès, conduit à une augmentation d’un tiers du stock d’archives conservées.
Le manque de place conduit nombre d’établissements à constituer des archivages différents en fonction des délais qu’ils doivent respecter pour répondre à une demande d’accès à un dossier médical :
– les dossiers de moins de cinq ans qui doivent être communiqués dans un délai de huit jours sont généralement conservés sur place tandis que les dossiers plus anciens, dont le délai de communication est de deux mois, sont le plus souvent externalisés auprès d’un hébergeur agréé alors que le code de la santé publique n’autorise expressément que le dépôt des seules données informatisées (article L. 1111-8 du code de la santé publique) ;
– au GHPS, le stockage des dossiers se fait en fonction de leur statut : plus ils sont actifs, plus ils restent dans des locaux proches, plus ils sont passifs, plus ils sont éloignés.
La centralisation de l’archivage est une avancée importante lorsque l’établissement s’étend sur plusieurs sites ou que le nombre de ses services est important : le CH du Mans dispose d’un service central des dossiers médicaux se trouvant sur son site ; le GHPS, en raison de son caractère pavillonnaire, constitue un archivage au sein de ses sites, soit 120 locaux mais l’archivage d’un tiers des dossiers est actuellement centralisé par une procédure informatique. Ainsi, quels que soient le jour ou l’heure, le professionnel de santé qui a besoin de consulter un dossier peut aisément le retrouver et aller le chercher.
Au sein des hôpitaux de Paris, l’élimination des dossiers médicaux constitués dans un établissement public de santé ne peut se faire qu’après l’autorisation par visa du conservateur des archives de l’Assistance publique –Hôpitaux de Paris, lequel l’accorde lorsque le dossier ne présente pas un intérêt pour l’histoire de la médecine, de l’établissement ou de la région parisienne – le service des archives conserve ainsi près de 210 mètres linéaires de dossiers datant de 1872 à 1993 – ou qu’il n’appartient pas à l’échantillonnage qui doit être versé au service des archives.
Après avoir été répertoriés sur une liste, les dossiers sont confiés à un prestataire spécialisé dans l’élimination des archives publiques.
C. UNE ABSENCE DE SANCTION DES COMMUNICATIONS NON ACCOMPLIES, INCOMPLÈTES OU TARDIVES
Affirmant le droit d’accès de toute personne à l’ensemble des informations concernant sa santé, l’article L. 1111-7 du code de la santé publique n’a prévu aucune sanction à l’encontre de ceux qui en bafoueraient, volontairement ou implicitement, l’exercice. Par conséquent, le patient qui se trouve confronté à un refus explicite de communication, à une inobservance des délais de communication non expliquée par le détenteur du dossier ou à une communication manifestement édulcorée ou mensongère du dossier se doit d’entamer une procédure pour obtenir satisfaction.
Un premier règlement du conflit peut être tenté par une demande de conciliation adressée à la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI), laquelle est notamment compétente pour connaître tout litige entre usagers et professionnels ou établissements de santé (article L. 1142-5 du code de la santé publique).
Après avoir entendu les intéressés, la CRCI tente la conciliation dont les termes, si elle y réussit, font l’objet d’un document de conciliation signé par les parties en présence et par le président de la CRCI (article R. 1142-22 du code précité).
Toutefois, cette procédure semble inconnue de la plupart des intéressés puisque, en présentant cette compétence des CRCI dans son rapport 2007-2008, la Commission nationale des accidents médicaux note qu’elle « n’est pratiquement pas utilisée : une seule demande a été enregistrée » (61).
Une personne ne parvenant pas à obtenir les renseignements relatifs à sa santé devra suivre des procédures différentes selon que le refus lui est opposé par un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier ou par un praticien libéral ou un établissement de santé privé.
● Les dossiers médicaux, « produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public » par les établissements de santé, sont des documents administratifs dont la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal garantit le libre accès.
À l’exception des « demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique », les établissements de santé précités doivent donc répondre dans les délais impartis aux demandes de consultation, partielle ou intégrale, d’un dossier médical. En cas de refus, le demandeur doit, préalablement à tout recours devant un juge administratif, saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) pour obtenir un avis. Lorsque ce dernier est favorable, l’établissement de santé se doit de mettre le dossier à disposition du plaignant lequel, en cas de nouveau refus, est alors en droit de saisir le juge administratif, la CADA n’étant qu’un organisme consultatif sans pouvoir de coercition.
Les statistiques communiquées à la mission par la CADA indiquent que depuis 2003, le nombre de demandes qui lui sont adressées à propos d’un accès au dossier médical a tendance à décroître. De 450 en 2003, il est passé à 306 en 2005 puis à 238 en 2008 (sur un total de 5 000 demandes), comme le montre le tableau ci-dessous :
Accès aux informations médicales
Année |
Nombre de dossiers |
Sens des avis |
Suivi des avis favorable par l’établissement |
2002 |
Conseil : 28 Avis : 263 Total : 291 |
Favorable : 158 Défavorable : 9 Sans objet : 79 Incompétence : 14 Irrecevable : 3 |
Sans réponse : 26 Avis suivi : 125 Avis non suivi : 3 Autre: 7 |
2003 |
Conseil : 45 Avis : 409 Total : 454 |
Favorable : 274 Défavorable : 22 Sans objet : 101 Incompétence : 8 Irrecevable : 4 |
Sans réponse : 20 Avis suivi : 222 Avis non suivi : 2 Autre: 30 |
2004 |
Conseil : 45 Avis : 340 Total : 385 |
Favorable : 186 Défavorable : 15 Sans objet : 115 Incompétence : 10 Irrecevable : 14 |
Sans réponse : 14 Avis suivi : 142 Avis non suivi : 5 Autre: 25 |
2005 |
Conseil : 35 Avis : 271 Total : 306 |
Favorable : 140 Défavorable : 18 Sans objet : 113 Incompétence : 3 Irrecevable : 4 |
Sans réponse : 4 Avis suivi : 110 Avis non suivi : 3 Autre: 23 |
2006 |
Conseil : 29 Avis : 281 Total : 310 |
Favorable : 136 Défavorable : 28 Sans objet : 92 Incompétence : 13 Irrecevable : 12 |
Sans réponse : 8 Avis suivi : 107 Avis non suivi : 3 Autre: 18 |
2007 |
Conseil : 19 Avis : 265 Total : 284 |
Favorable : 136 Défavorable : 23 Sans objet : 90 Incompétence : 6 Irrecevable : 10 |
Sans réponse : 2 Avis suivi : 108 Avis non suivi : 4 Autre: 22 |
Source : Commission d’accès aux documents administratifs
● En cas de refus de communication d’un dossier opposé par un médecin libéral ou par un établissement privé de santé, le litige se caractérisant par son caractère privé ne peut être porté que devant une juridiction de l’ordre judiciaire.
III. UNE ACCESSIBILITÉ RENFORCÉE AU DOSSIER MÉDICAL
Une meilleure accessibilité au dossier médical d’une personne suppose que chacun des protagonistes reconnaisse les droits de l’autre et respecte ses propres obligations :
- les demandeurs doivent admettre que le contenu d’un dossier médical, protégé par un secret censé défendre leur intimité, ne peut être communiqué qu’en suivant des procédures spécifiques dont le respect ne correspond pas à une mauvaise volonté du professionnel de santé ;
- les professionnels de santé doivent gérer leurs dossiers non seulement pour leur usage personnel mais en gardant à l’esprit qu’ils peuvent devoir, à tout instant, les communiquer à ceux auxquels ils sont consacrés ;
- les établissements de santé doivent veiller au respect des règles relatives à la communication des dossiers dans des conditions supportables de délais.
De ce fait, la mission entend proposer des mesures tendant à définir plus précisément les conditions de la communication d’un dossier médical (A), à protéger davantage la confidentialité des éléments d’information qu’il contient (B) et à autoriser l’accès au dossier d’une personne décédée à ceux qui partageaient quotidiennement son existence (C).
A. DES COMMUNICATIONS DE DOSSIERS MIEUX ENCADRÉES
1. Remédier aux différences des modes de conservation des éléments du dossier
Malgré les recommandations de la Haute Autorité de santé (62) et du Conseil national de l’Ordre des médecins (63), le droit d’accès des patients à leur dossier pose à de nombreux professionnels de santé des problèmes de tenue du dossier, de détermination des documents qu’il doit contenir et d’archivage puisque tous les dossiers doivent être conservés entre vingt et dix ans – vingt ans après la dernière hospitalisation ou consultation et dix ans après le décès d’un patient décédé moins de dix ans après sa dernière hospitalisation.
● Particulièrement contraignant en exercice libéral compte tenu de la petite taille des locaux professionnels, l’archivage est également difficile à gérer pour les établissements de santé qui doivent trouver les capacités de stockage suffisantes – les établissements de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris produisent en moyenne 17 km linéaires de nouveaux dossiers chaque année –, faire face aux difficultés de manipulations qu’il nécessite – au centre hospitalier du Mans, ont été effectuées 280 000 extractions annuelles de dossiers pour des besoins médicaux et 644 pour des communications de dossiers – et mettre en place l’organisation matérielle qui doit l’accompagner.
Ces difficultés devraient toutefois s’atténuer prochainement, ainsi que l’a rappelé avec satisfaction Mme Roselyne Bachelot-Narquin (64), ministre de la santé et des sports : l’adoption de l’article 21 du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (65), autorise désormais les professionnels et les établissements de santé à externaliser auprès d’un hébergeur agréé leurs dossiers médicaux « quel qu’en soit le support, papier ou informatique ». Ainsi, en s’adressant à un professionnel de l’archivage doté d’un personnel suffisant et d’un matériel adéquat, les usagers du système de santé pourront accéder, plus rapidement et dans de meilleures conditions, à leurs données de santé tandis que les professionnels et établissements de santé pourront être délivrés, en partie, d’une charge coûteuse en personnel, en temps et en espace.
En outre, l’informatisation des données qui a déjà contribué à améliorer la situation des cabinets médicaux qui s’en sont dotés, devrait progressivement produire de mêmes effets dans les établissements de santé. Mais en attendant que cette informatisation devienne effective en leur sein, la mission a pu constater au cours de ses déplacements que les établissements de santé ont mis en place différentes stratégies qui leur sont propres : remise des clichés d’imagerie médicale aux patients de l’AP-HP, reclassement des dossiers au centre hospitalier d’Avranches-Granville (66).
● La bonne tenue d’un dossier est une des conditions essentielles d’une information complète et pertinente de la personne qui en demande communication. En attendant que les progrès de l’informatisation et la formation et l’information des professionnels de santé sur une gestion efficace de ces documents (éliminer les doublons, rédiger les comptes rendus, classer …) produisent tous leurs effets, il convient d’inciter les professionnels à s’engager dans une telle démarche.
Ainsi, depuis quelques années, la Haute Autorité de santé (HAS) conduit une politique tendant à parvenir à ce résultat. Engagée dans la généralisation d’indicateurs de qualité (67) en coopération avec le ministère de la santé, la HAS a lancé, en 2007, une expérimentation de recueil de trois procédures de qualité – dont une est relative au dossier médical – auprès d’une centaine d’établissements de santé ayant une activité MCO (68) ; elle a ensuite généralisé le recueil des indicateurs de qualité de ces procédures auprès de tous les établissements MCO.
Aujourd’hui, afin de rendre plus efficiente la procédure de certification des établissements de santé et de permettre un meilleur suivi de leur qualité, la HAS entend y intégrer lesdits indicateurs de qualité.
De ce fait, « la gestion du dossier du patient » et « l’accès du patient à son dossier » constitueront, à compter de 2010, deux des critères présidant à la certification des établissements de santé par la HAS (69). Aux termes du manuel de certification et guide de cotation (70), les établissements concernés devront :
– mettre en place un protocole relatif aux règles de tenue du dossier ainsi qu’une information des professionnels concernés sur ce protocole ;
– actualiser l’information contenue dans le dossier du patient tout au long de sa prise en charge et également après sa sortie, ce qui implique une traçabilité des actes thérapeutique et des informations ainsi qu’une organisation pour intégrer dans le dossier du patient les informations fournies après sa sortie par les professionnels concernés – médecins, secrétariats, personnel des archives et correspondants externes à l’établissement ;
– rendre accessible cette information en temps utile, aux professionnels en charge du patient, notamment par une organisation permettant sa localisation en temps réel et une permanence d’accès à son archivage ;
– organiser l’accès au dossier du patient et des personnes habilitées par une procédure de vérification des identités et par l’observation de délais compatibles avec leurs besoins.
Qualifiés par la HAS de pratiques exigibles prioritaires (PEP), les deux critères relatifs à la tenue du dossier médical bénéficieront d’une approche standardisée et seront systématiquement étudiés par l’équipe d’experts visiteurs, comme toute PEP. En effet, l’absence de l’atteinte d’un niveau de conformité important sur ces exigences conduit systématiquement à une décision de certification péjorative ou à une non-certification.
C’est donc avec satisfaction que la mission prend acte de ces futures conditions de la certification des établissements de santé.
2. Unifier le régime des facturations des communications des dossiers :
Le coût des copies du dossier médical facturées au patient peut, dans certains cas, constituer un obstacle important à l’exercice de son droit d’accès à ce dossier car il n’existe pas de tarification homogène applicable à tous les professionnels de santé.
Interrogée sur ce sujet par la mission, Mme Roselyne Bachelot-Narquin (71) , ministre de la santé et des sports, a jugé préférable de ne pas « rigidifier un système qui marche bien ». Dès lors, plutôt que d’imaginer un nouveau dispositif législatif et réglementaire comportant différents barèmes, elle a souhaité que dans chaque établissement ce sujet fasse l’objet d’une concertation avec les représentants des usagers au travers des commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQ).
Si la mission reconnaît le bien fondé des propos de la ministre de la santé et des sports, il n’en demeure pas moins que des inégalités de traitement existent entre les usagers du système de santé, selon qu’ils se sont adressés à un professionnel de santé libéral, à un établissement de santé privé ou à un établissement de santé public. Ainsi :
– les dossiers détenus par les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l’exécution du service public hospitalier sont des documents administratifs, aux termes de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
À ce titre leur sont applicables (72) les dispositions de l’article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, et celles de l’article 3 de l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copies d’un document administratif. Or, si ces textes fixent effectivement le coût des supports de la reproduction fournie au demandeur – photocopie A4, disquette, et cédérom –, ils n’encadrent pas le coût de certains supports spécifiques aux dossiers médicaux telles les imageries médicales ou les feuilles de réanimation ;
– la reproduction des dossiers détenus par les établissements privés de santé ou par les praticiens libéraux ne fait l’objet d’aucune réglementation, laissant la porte ouverte à des abus dont a témoigné auprès de la mission Mme Marie-Solange Julia (73), présidente de la Fédération des associations d’aide aux victimes d’accidents médicaux.
C’est pourquoi, la mission recommande l’adoption d’un décret spécifique applicable à tous les détenteurs d’informations relatives à la santé d’une personne et fixant en fonction de chaque support, les tarifs qui peuvent être appliqués pour la reproduction de ces données. Par ailleurs, afin de ne pas faire supporter aux patients victimes de lourdes pathologies des frais excessifs dus à l’ampleur de leur dossier, le texte règlementaire susvisé devrait également fixer un plafond dont le montant pourrait être de 150 euros par dossier.
Proposition n° 1
Par voie réglementaire, harmoniser les tarifs des supports de reproduction des éléments d’un dossier médical qui peuvent être exigés par les professionnels de santé et les établissements de santé des secteurs public et privé, et fixer un coût plafonné par dossier.
3. Modifier les délais de communication des dossiers de moins de cinq ans
Devant faire face à une forte augmentation des demandes des patients, les professionnels de santé doivent en outre respecter un délai de réponse qui, à compter de la date de réception de la demande, ne peut ni être inférieur à 48 heures ni dépasser huit jours, sauf dans les cas où il est porté à deux mois parce que les informations médicales datent de plus de cinq ans ou que la commission départementale des hospitalisations psychiatriques a été saisie.
La mission s’est tout d’abord interrogée sur l’opportunité de maintenir le délai de 48 heures. Ignoré d’une grande majorité des professionnels et des patients, son observation stricte conduirait par ailleurs à des situations véritablement aberrantes puisque la loi n’a prévu aucune exception à son principe, pas même celle de l’urgence médicale. Une telle obligation, pour le moins excessive, ne saurait être justifiée par la nécessaire protection du patient contre lui-même, qui semble être à l’origine de la création de ce délai de réflexion.
De même, la brièveté du délai de huit jours a été dénoncée par la majorité des personnes rencontrées par la mission (74). La proposition d’un allongement de ce délai, également peu respecté par les professionnels de santé, n’a pas rencontré de véritable opposition de la part des représentants d’associations de patients ou d’usagers du système de santé. Au cours de la table ronde organisée par la mission (75), ces derniers ont reconnu que l’actuel délai était trop court mais ils ont estimé préférable de ne pas en modifier la durée, craignant qu’un allongement du délai maximal légal de communication n’entraîne un allongement du délai moyen réel.
Par ailleurs, au regard de la législation comparée, la France se situe parmi les pays européens les plus exigeants (76):
– en Allemagne et aux Pays-Bas, il est respectivement nécessaire de répondre « dans un délai raisonnable » et « le plus rapidement possible » soit, en pratique dans un délai de deux à quatre semaines ;
– en Belgique, il est donné suite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande du patient ;
– en Grande-Bretagne, les délais varient en fonction de l'ancienneté et de la nature du dossier. Il est de vingt et un jours si les données dont la consultation est souhaitée ont été intégrées à un dossier « papier » moins de quarante jours avant la demande et il est de quarante jours pour les fichiers automatisés ou pour les dossiers « papiers » dont les données demandées datent de plus de quarante jours ;
– au Danemark, la demande d'accès doit être satisfaite le plus rapidement possible et, si tel n'est pas le cas, le demandeur doit être informé du refus ou du retard dans les dix jours suivant la réception de la demande.
Prenant acte de ces comparaisons et du fait que la plupart des actuels retards de transmission ne sont pas l’expression d’une véritable mauvaise volonté, la mission entend aider les établissements de santé à respecter plus aisément leur obligation d’une bonne communication des dossiers médicaux, en assouplissant le régime des délais applicables à cette communication.
Proposition n° 2
Modifier les délais de communication des informations contenues dans un dossier médical :
– en supprimant le délai de réflexion de quarante-huit heures ;
– en fixant à quinze jours la durée du délai au cours duquel les informations demandées doivent être communiquées, à l’exception des demandes motivées par une urgence médicale ou par la sollicitation d’un deuxième avis médical.
4. Améliorer les possibilités de recours d’un patient ou de ses ayants droit contre les refus ou les absences de réponse opposés à leur demande d’accès au dossier médical
Les réticences des professionnels de santé à communiquer un dossier que ce soit en retardant ou en refusant sa remise ou encore, en l’expurgeant de certaines pièces, ne sont pas sanctionnées.
Par ailleurs, dans de telles hypothèses, une disparité de situation existe entre les secteurs public et privé : dans le premier cas, le demandeur doit saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), tandis que dans le second cas, il n’a d’autre choix que de saisir le juge judiciaire.
Cette absence de sanction en cas de retard ou de réticences dans la transmission du dossier produit des effets négatifs sur l’effectivité du droit d’accès au dossier médical. C’est pourquoi, diverses personnes auditionnées par la mission ont proposé l’adoption de différentes mesures destinées à mettre fin à cette situation :
– M. Jean-Paul Delevoye (77), Médiateur de la République, a envisagé la possibilité d’une sanction consistant en une obligation de délivrer gratuitement les copies du dossier demandé en cas de dépassement du délai de communication. Cette proposition se heurte toutefois au fait que les remboursements demandés par les établissements de santé sont majoritairement symboliques, voire inexistants dans certains cas (78) ;
– Maître Gisèle Mor (79), avocate spécialiste du droit des victimes et du droit corporel, ancien bâtonnier du Val-d’Oise, après avoir rappelé que la seule sanction possible d’un retard ou d’un refus de communication de dossier est le prononcé d’une obligation sous astreinte – qu’il est cependant plus simple d’obtenir devant le juge judiciaire que devant le juge administratif – a souhaité que le dispositif d’accès au dossier médical soit assorti d’une sanction pénale, telle une amende ;
– Mme Françoise Avram (80), présidente de la CRCI d’Île-de-France, a estimé qu’une sanction adaptée pourrait consister en un renversement de la charge de la preuve en l’absence de transmission du dossier médical mais cette pratique est déjà utilisée par certaines commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI).
Préférant maintenir un équilibre entre les droits et les obligations des professionnels de santé, aucune de ces solutions n’est apparue pleinement satisfaisante à la mission.
Refusant de voir sanctionnés pénalement des personnels dont la vocation première est de soigner, elle rappelle que la prochaine procédure de certification des établissements de santé comportera deux critères relatifs à la tenue du dossier d’un patient et que leur inobservation pourra conduire à une décision de certification péjorative ou à une non-certification. Une telle mesure lui paraît être la sanction la plus adaptée à l’égard des établissements de santé qui, demandeurs de leur certification, portent une attention extrême aux résultats de cette dernière ;
Cependant, afin de mettre fin aux réticences ou aux refus de tout professionnel de santé de communiquer un dossier médical, la mission propose d’élargir l’actuelle compétence de conciliation (81) des CRCI, en chargeant ces dernières de veiller au respect de la liberté d'accès au dossier médical.
Les CRCI pourraient être saisies pour avis par toute personne à qui un professionnel de santé ou un établissement public ou privé de santé oppose un refus tacite ou exprès de communication d’un dossier. Leur saisine serait un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux devant les juridictions administrative ou judiciaire. Les avis rendus par les CRCI auraient la même valeur que les actuels avis de la CADA rendus sur des demandes d’accès aux dossiers médicaux détenus par des établissements publics de santé, c’est-à-dire une valeur non contraignante mais dont le caractère incitatif est indéniable.
Une telle mesure permettrait d’accorder les mêmes droits au demandeur d’un dossier détenu par un praticien libéral ou un établissement de santé privé qu’au demandeur d’un dossier détenu par un établissement public. En conséquence, la CADA perdrait sa compétence en matière de communication de dossiers médicaux détenus par des établissements publics, ces dossiers étant certes des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 précitée, mais dont la nature particulière justifie une unification de la compétence en matière de droit d’accès au profit des CRCI.
Proposition n° 3
En cas de refus d’accès à un dossier médical ou de non-respect de ses délais légaux de transmission et préalablement à tout contentieux judiciaire ou administratif, confier aux commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) une compétence générale de contrôle du respect du droit d'accès au dossier médical.
En conséquence, exclure du champ de compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) les demandes de communication de dossier médical.
B. DES DROITS DES PATIENTS PLUS AFFIRMÉS
Alors que certains patients incapables majeurs n’ont aucun accès direct à leur dossier, des tiers de plus en plus nombreux peuvent obtenir une communication directe des informations relatives à la santé d’une personne soit du fait de cette personne elle-même soit du fait de la loi.
1. Les droits des personnes majeures protégées
Les droits d’accès à leurs dossiers médicaux des personnes majeures protégées ne font pas l’objet de dispositions législatives spéciales, contrairement aux droits des mineurs. Cependant, l’article R. 1111-1 du code de la santé publique évoque « le tuteur » au nombre des personnes pouvant demander la communication des informations de santé d’une autre personne.
Saisie de ce sujet, la CADA a estimé qu’un patient sous curatelle peut adresser lui-même sa demande et accéder directement à son dossier médical alors qu’un majeur sous tutelle doit obligatoirement être représenté par son tuteur (Avis du 11 septembre 2003, n° 20033517).
Or, la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs tend à affirmer l’autonomie de ces derniers. L’article 459 du code civil autorisant désormais la personne protégée à prendre « seule les décisions relatives à sa personne, dans la mesure où son état le permet », le droit d’accéder, directement ou indirectement à son dossier médical lorsque son état le permet, doit être réaffirmé.
Proposition n° 4
Affirmer le droit du majeur autonome sous tutelle à consulter son dossier.
2. Les personnes ayant reçu un mandat exprès du patient
À la différence de tous ceux qui, détenant des informations de santé, veillent à en préserver la confidentialité vis-à-vis de tiers, un patient n’a pas toujours pleine conscience du caractère strictement personnel des informations de santé qu’il va détenir. Soucieuse des conséquences d’un tel comportement, la Haute Autorité de santé (82) recommande « de l’informer des risques, notamment du fait de la sollicitation de tiers qui sont exclus du droit de réclamer directement ces informations aux professionnels, aux établissements de santé ou aux hébergeurs. Ces tiers peuvent plus facilement exercer des pressions illégitimes pour que la personne leur transmette directement des informations de santé qui la concernent et dont elle doit préserver le caractère confidentiel ».
Cette mise en garde est aujourd’hui plus que jamais nécessaire. En effet, la confidentialité des informations contenues dans le dossier du patient risque d’être affectée par une récente décision du Conseil d’État – Ordre national des médecins, 26 septembre 2005 – qui autorise tout patient à accéder à son dossier médical par l’intermédiaire d’un mandataire de son choix, à la double condition de lui confier un mandat dûment motivé et de lui demander de justifier de son identité. Considérant que cette interprétation va au-delà du texte légal, Maître Cyril Clément (83), avocat au barreau de Paris, spécialiste de droit médical, estime que les établissements de santé saisis d’une demande formulée par un tel mandataire ne devraient pas lui donner de réponse positive.
Dans un même esprit, rappelant qu’afin de rendre plus efficace sa prise en charge, un patient donne naturellement à son médecin, au fil de ses consultations, diverses données sensibles le concernant (données socio-économiques, religion, orientations ou comportement sexuels, séropositivité…), le Docteur Grégoire Moutel (84), directeur adjoint du Laboratoire d’éthique médicale et de médecine légale, s’inquiète des atteintes graves à la vie privée que constitueraient les intrusions intempestives de tiers dans les dossiers médicaux et notamment « du risque de la communication à des tiers qui n’en sont pas destinataires, par exemple, au conjoint qui s’en servirait dans une procédure de divorce ; du risque d’être confronté à la demande abusive d’une autorité (d’un employeur, une administration...) qui exigerait la prise de connaissance du dossier médical de son salarié ; et du risque encore plus grave exercé par les compagnies d’assurances, contournant l’obstacle que leur constitue le secret médical ».
La mission partage ces inquiétudes et souhaite effectivement protéger le patient des pressions que des tiers et plus particulièrement des cocontractants – assureurs, banquiers, organismes de crédit ou employeurs - pourraient lui faire subir pour obtenir diverses informations. Afin d’y parvenir, il lui a semblé qu’il était inutile de dresser une liste des personnes ne pouvant pas prétendre représenter un patient pour accéder à son dossier médical – le législateur ne pouvant pas envisager tous les cas d’espèces – ni d’interdire toute possibilité de donner un mandat à un tiers. Elle préconise par conséquent un encadrement du droit pour un patient de donner mandat à un tiers pour accéder à son dossier médical en réservant son exercice à ses seuls ayants droit ou à la personne de confiance qu’elle aura désignée en application de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique et en l’interdisant, sous peine de sanctions pénales, à tout cocontractant du patient.
Après s’être interrogée sur la possibilité de permettre à un patient de désigner un de ses proches comme son mandataire exprès, la mission a considéré que cette possibilité lui était déjà offerte par la désignation de la personne de confiance laquelle « peut être un parent, un proche ou le médecin traitant » (85).
Proposition n° 5
Permettre à toute personne d’accéder à son dossier médical par l’intermédiaire d’un mandataire, à condition que ce dernier :
– dispose d’un mandat exprès et puisse justifier de son identité ;
– ait la qualité d’ayant droit du patient ou ait été désigné par lui comme sa personne de confiance ;
– n’entretienne ni ne soit susceptible d’entretenir des relations contractuelles avec le patient sous peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
C. DES PRÉROGATIVES MIEUX DÉFINIES DES AYANTS DROIT D’UN PATIENT DÉCÉDÉ
L’accès des ayants droit au dossier médical d’un patient décédé est subordonné à trois conditions :
– le patient décédé ne doit pas avoir manifesté d’opposition à la consultation de son dossier médical ;
– le demandeur doit avoir la qualité de successeur légal du défunt conformément aux articles 731 et suivants du code civil ;
– la demande de communication du dossier doit être motivée par la nécessité de connaître les causes de la mort du défunt, d’en défendre la mémoire ou de faire valoir les droits des ayants droit.
La mission reconnaît le bien fondé d’une réglementation protectrice de la confidentialité des dossiers des personnes décédées, mais elle estime que des modifications devaient lui être apportées afin de prendre en compte les intérêts légitimes des plus proches du patient décédé.
1. La communication sans condition du dossier aux parents de l’enfant décédé qui n’a pas manifesté d’opposition
Sauf dans le cas où elle s’y est opposée, le droit d’accès à l’ensemble du dossier médical d’une personne mineure est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale.
Or lorsque leur enfant est décédé, il est mis fin à ce droit d’accès des parents. Devenus les ayants droit d’un patient défunt, ils sont soumis aux mêmes conditions que les autres ayants droit : ils doivent fonder leur demande sur l’un des trois motifs prévus par la loi86 et n’auront accès qu’aux seuls documents s’y rapportant et non plus à la totalité du dossier..
La mission considère comme difficilement soutenable l’obligation ainsi faite aux parents d’un enfant décédé de motiver leur demande, dès lors qu’une telle obligation n’existait pas du vivant de l’enfant et qu’elle n’apparaît qu’au moment de son décès.
Proposition n° 6
Maintenir aux parents d’un enfant décédé leur droit d’accéder librement à l’ensemble de son dossier médical, à l’exception des éléments d’information pour lesquels la personne mineure s’était préalablement opposée à leur communication.
2. L’intégration du concubin et du partenaire d’un pacte civil de solidarité aux ayants droit du patient décédé
Considérant qu’aucune raison objective ne justifie l’exclusion de celui qui partageait la vie du patient décédé du droit d’accéder au dossier du défunt, la mission préconise d’accorder l’exercice de ce droit au concubin ou au partenaire pacsé d’un patient défunt dans les mêmes conditions que les ayants droit.
Proposition n° 7
Ouvrir au concubin ou au partenaire d’un pacte civil de solidarité d’un patient décédé le droit d’accéder au dossier médical de ce patient dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les ayants droit.
CHAPITRE II : RENDRE PLUS JUSTE LE RÉGIME D’INDEMNISATION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
Le régime actuel d’indemnisation des infections nosocomiales est issu de deux lois adoptées au cours de la même année : la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, d’une part, et la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, d’autre part. Avant d’examiner ce régime d’indemnisation, une brève présentation du dispositif de lutte contre les infections nosocomiales apparaît nécessaire, afin de mesurer dans quel contexte s’inscrivent la survenance et l’indemnisation de ces infections, ainsi que de souligner l’efficacité de ce dispositif (I). À l’issue de ses travaux, la mission d’information commune sur l’indemnisation des victimes d’infections nosocomiales et l’accès au dossier médical considère que le régime d’indemnisation peut être jugé globalement satisfaisant (II). Toutefois, ces travaux ont permis de mettre en évidence un certain nombre de lacunes et carences de ce régime, qu’il serait nécessaire de gommer afin de le rendre plus juste pour les victimes d’infections nosocomiales (III).
I. UN DISPOSITIF EFFICACE DE LUTTE
CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
Bien que le terme d’infection nosocomiale désormais passé dans le langage courant soit assez bien connu du grand public, la mission estime important de revenir sur la notion d’infection nosocomiale, ainsi que sur celle qui lui est liée d’infection associée aux soins (A). Les travaux de la mission, notamment au cours de ses déplacements dans des établissements de santé (87), ont mis en évidence que l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales avait une efficacité avérée (B). Cependant, la mission a également relevé des lacunes dans la connaissance des infections contractées en médecine de ville (C).
A. INFECTION NOSOCOMIALE ET INFECTION ASSOCIÉE AUX SOINS
L’adjectif « nosocomial » vient du grec « nosokomeion », signifiant « hôpital », et désigne ce « qui se rapporte à l’hôpital » selon le dictionnaire Le Robert ou ce « qui est relatif aux hôpitaux » selon le dictionnaire Littré. Le sens courant de l’infection nosocomiale est donc une infection contractée dans un établissement de santé.
Dans sa dimension médicale, la définition de l’infection nosocomiale a été précisée une première fois en 1999 par le Comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins (CTINILS), cette première définition ayant été réactualisée en 2007 (88), en liaison avec la Commission nationale des accidents médicaux et après consultation d’experts de plusieurs disciplines. Seule concernée à l’origine par les études épidémiologiques sur les infections contractées en milieu médical, l’infection nosocomiale telle que définie par le CTINILS est désormais intégrée dans une catégorie plus large dénommée « infections associées aux soins » (IAS). Une infection est considérée comme IAS si elle survient au cours ou au décours d’une prise en charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative) d’un patient, et si elle n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge.
Quand l’état infectieux au début de la prise en charge n’est pas connu précisément, un délai d’au moins quarante-huit heures ou un délai supérieur à la période d’incubation est couramment accepté pour définir une IAS. Pour les infections du site opératoire, on considère habituellement comme associées aux soins les infections survenant dans les trente jours suivant l’intervention ou, s’il y a mise en place d’un implant, d’une prothèse ou d’un matériel prothétique, dans l’année qui suit l’intervention.
Le critère principal définissant une IAS est constitué par la délivrance d’un acte ou d’une prise en charge de soins au sens large (à visée diagnostique, thérapeutique, de dépistage ou de prévention primaire) par un professionnel de santé ou par le patient ou son entourage, encadrés par un professionnel de santé. Pour l’IAS, aucune distinction n’est faite quant au lieu où est réalisée la prise en charge ou la délivrance de soins, à la différence de l’infection nosocomiale, catégorie spécifique d’IAS dont la particularité est d’avoir été contractée dans un établissement de santé. Cette distinction entre l’IAS et l’infection nosocomiale a son importance, seule cette dernière catégorie étant soumise à un régime de responsabilité de plein droit favorable aux victimes, les autres IAS, c’est-à-dire celles contractées en médecine de ville, étant soumises à un régime de responsabilité pour faute (89).
Parmi les IAS, il est d’usage de distinguer deux catégories principales : d’une part, les infections d’origine endogène que le patient contracte en s’infectant avec ses propres micro-organismes à l’occasion d’un acte invasif ou en raison d’une fragilité particulière ; d’autre part, les infections d’origine exogène que le patient contracte en étant infecté soit par des micro-organismes provenant des autres malades (transmission croisée entre malades ou par les mains ou matériels des personnels), des personnels ou de la contamination de l’environnement hospitalier (eau, air, équipements, alimentation…).
Quel que soit son mode de transmission, la survenance d’une infection nosocomiale est favorisée par la situation médicale du patient qui dépend de plusieurs facteurs que sont son âge, sa pathologie, le traitement qu’il suit et les actes médicaux réalisés. Ainsi, sont particulièrement vulnérables face aux infections nosocomiales les personnes âgées, les personnes immunodéprimées, les nouveau-nés et plus particulièrement les prématurés, les polytraumatisés, les grands brûlés, et les personnes suivant des traitements immunosuppresseurs ou des traitements antibiotiques, ces derniers ayant pour effet de déséquilibrer la flore bactérienne des patients et de sélectionner les bactéries résistantes. Le risque d’infection est également élevé lorsque sont réalisés des actes invasifs nécessaires au traitement du patient : sondage urinaire, pose d’un cathéter, ventilation artificielle ou intervention chirurgicale.
Les progrès médicaux permettant de prendre en charge des patients de plus en plus fragiles qui cumulent souvent de nombreux facteurs de risque, il convient de garder à l’esprit que tout risque de survenance d’infections nosocomiales ne saurait être entièrement éliminé. Pour autant, la France a mis en place un dispositif de lutte contre ces infections dont l’efficacité est aujourd’hui avérée, notre pays se classant parmi les pays européens ayant les taux les plus bas d’infections nosocomiales.
Enfin, les notions d’infection nosocomiale et d’IAS doivent être distinguées de celles d’« affection iatrogène » et d’« accident médical », également susceptibles comme l’infection nosocomiale d’ouvrir droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale lorsque certaines conditions sont remplies, en vertu du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique (90). L’affection iatrogène peut être définie comme un dommage, subi par un patient, directement lié aux soins délivrés. Alors que l’infection nosocomiale suppose une hospitalisation, l’affection iatrogène peut être contractée à la suite de tout acte de soins, qu’il ait donné lieu ou non à une hospitalisation. En cela, la notion d’affection iatrogène apparaît très proche de celle d’IAS, mais cette dernière n’a pas d’existence légale. La mention de l’affection iatrogène dans l’article L. 1142-1 du code de la santé publique a donc son utilité dès lors que ce texte vise non pas l’IAS mais l’infection nosocomiale ; en revanche, on pourrait s’interroger sur la pertinence de maintenir cette notion d’affection iatrogène si la notion d’IAS était substituée à celle d’infection nosocomiale dans le texte légal (91).
La notion d’accident médical peut être définie comme un événement imprévu causant un dommage accidentel ayant un lien de causalité certain avec un acte médical ; telle est la définition qu’avait retenue le Sénat dans le texte du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé, mais qui n’a pas été conservée dans le texte définitif (92). Cette notion permet d’englober dans le champ de couverture de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale ce qui est couramment dénommé « aléa thérapeutique », que l’on peut définir comme la réalisation en dehors de toute faute d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé (93).
B. UN DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES À L’EFFICACITÉ AVÉRÉE
Le dispositif français de lutte contre les infections nosocomiales se caractérise par la mise en place de structures et d’instruments de mesure, qui ont permis d’aboutir à des progrès incontestables dans les taux de prévalence des infections nosocomiales. Cependant, les progrès dans la lutte contre les infections nosocomiales ne doivent pas conduire à oublier que, en la matière, le « risque zéro » n’existe pas.
1. Les structures de la lutte contre les infections nosocomiales
La première prise en considération par les autorités sanitaires de la nécessité de lutter contre les infections nosocomiales date de 1988, année de l’instauration par décret des comités de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) dans les établissements publics de santé. En 1995, un premier plan coordonné d’actions de lutte contre les infections nosocomiales était lancé par le ministère de la santé, avec l’objectif de réduire significativement le nombre d’infections nosocomiales et la fréquence des bactéries multi-résistantes aux antibiotiques. Ce plan s’articulait autour de cinq axes principaux : la mise en place de structures de lutte contre les infections nosocomiales à trois niveaux : local, interrégional et national ; l’édiction de recommandations nationales de référence, en vue de promouvoir une culture de bonnes pratiques commune à l’ensemble des établissements de santé ; une prise en compte de l’hygiène hospitalière dans la formation initiale et continue des professionnels de santé ; la mise en place d’un réseau national de surveillance épidémiologique, dénommé Réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections nosocomiales (RAISIN) ; enfin, un dispositif de signalement et de gestion des événements sentinelles.
L’appréhension de l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales requiert une brève description des rôles des différentes structures de lutte contre les infections nosocomiales aux trois niveaux : local, interrégional et national.
a) Les structures locales : le comité de lutte contre les infections nosocomiales et l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière
Chaque établissement de santé doit disposer d’un comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) et doit élaborer un programme d’actions. En 2007, 98,8 % des établissements ont déclaré un CLIN, tandis que 96 % des établissements de santé ont déclaré avoir élaboré un programme d’actions. Le rôle du CLIN est de coordonner la surveillance, la prévention et la formation continue en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
Le CLIN est composé de médecins, pharmaciens, personnels infirmiers, directeurs d’établissement et autres professionnels de l’établissement et se réunit au moins trois fois par an. En 2007, 89 % des établissements ont déclaré au moins trois réunions par an, contre 64,7 % en 2003. Des représentants des usagers peuvent participer à certaines séances du CLIN ; cette présence des usagers est systématique au sein du CLIN du groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière, que la mission a visité.
L’action du CLIN est relayée au plus près des services par une équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH) chargée de la mise en œuvre du programme de lutte contre les infections nosocomiales. Elle est principalement composée d’un médecin ou pharmacien hygiéniste, d’un infirmier hygiéniste et de techniciens biohygiénistes. En 2007, 93 % des établissements de santé déclaraient disposer d’une EOHH, contre 69 % en 2004. Ces 2 599 EOHH sont composées de 2 956 équivalents temps plein (ETP), dont 722 ETP de médecins et pharmaciens et 1 561 ETP d’infirmiers.
b) Les structures interrégionales : les centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales
Il existe cinq centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales (CCLIN), regroupés en cinq pôles interrégionaux (Est, Ouest, Paris-Nord, Sud-Est, Sud-Ouest). Ils apportent un appui technique aux établissements de santé dans la mise en place de la politique définie au niveau national et dans l’animation de la coopération inter-hospitalière (réseau de surveillance et d’audit, formation, documentation, études...).
Des antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales ont été constituées afin de développer une plus grande proximité entre les structures interrégionales d’expertise et de coordination et les établissements de santé. Le renforcement des antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales a été aidé par un financement de mission intérêt général et d’aide à la contractualisation à hauteur de 1,685 million d’euros entre 2007 et 2008.
c) Les structures nationales : le comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins et le réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections nosocomiales
Le comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins (CTINILS) a été créé par un arrêté du 23 septembre 2004. Intégré au Haut conseil de la santé publique par un arrêté du 1er octobre 2007, le CTINILS est en cours de restructuration suite à l’arrêté du 6 octobre 2008 relatif aux commissions spécialisées composant le Haut Conseil de la santé publique. Cette instance nationale a pour mission de fournir une expertise en matière d’évaluation et de gestion du risque infectieux chez l’homme en milieu de soins.
A également été créé, dans le cadre d’un partenariat entre l’Institut de veille sanitaire (InVS) et les CCLIN, un réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections nosocomiales (RAISIN), dans le but d’harmoniser au plan national les méthodes de surveillance des infections nosocomiales et de coordonner les actions des CCLIN en matière d’alerte et de surveillance.
Le RAISIN a créé cinq réseaux thématiques nationaux de surveillance de l’incidence des infections nosocomiales : infections du site opératoire, bactéries multi-résistantes, bactériémies nosocomiales, accidents avec exposition au sang des professionnels de santé et infections en réanimation. Ces réseaux thématiques permettent de disposer de données épidémiologiques de qualité issues d’un nombre important d’établissements. Lors de son audition par la mission d’information, le docteur Bruno Coignard, responsable des maladies infectieuses, nosocomiales et résistantes aux antibiotiques, au département des maladies infectieuses de l’InVS, a indiqué que ce réseau, spécifique à la France, réunissait sur la base d’une adhésion volontaire des établissements privés et publics de santé autour d’enquêtes de prévalence (94). Ces enquêtes ont pour objectif, d’une part, de décrire, selon un protocole standardisé, les infections nosocomiales dont sont atteints un jour donné les patients en hospitalisation complète, et, d’autre part, de classer ces infections en fonction des établissements, des sites, de la gravité des infections et des agents d’infection.
Le dispositif ainsi mis en place à tous les niveaux du territoire permet d’allier une connaissance de plus en plus fine des infections nosocomiales à une lutte au plus près du terrain soutenue par les structures interrégionales et nationales. L’efficacité de l’action de ces différentes structures est en outre désormais très bien évaluée par les différents instruments de mesure de la lutte contre les infections nosocomiales.
2. Les instruments de mesure de la lutte contre les infections nosocomiales
Les instruments de mesure de la lutte contre les infections nosocomiales sont au nombre de deux : il s’agit des indicateurs de chaque établissement, renseignés annuellement, et des enquêtes nationales de prévalence, réalisées à un rythme quinquennal.
Depuis 1999, le ministère de la santé a mis en place un tableau de bord de la lutte contre les infections nosocomiales, qui comporte cinq indicateurs ainsi qu’un score agrégé attribué à chaque établissement. Les indicateurs sont calculés par le ministère chargé de la santé pour chaque établissement à partir des données des bilans standardisés annuels de l’année précédente. Trois des cinq indicateurs donnent lieu au calcul d’une classe de performance allant de A, correspondant aux structures les plus performantes, à F. La classe E correspond aux structures les moins performantes, tandis que la classe F correspond à l’absence de transmission, par l’établissement, de tout ou partie des informations nécessaires à l’élaboration de l’indicateur.
Les résultats des établissements de santé sont rendus publics annuellement et consultables sur le site Internet du ministère de la santé (95). Lors de son audition par la mission, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports, a souligné l’importance de la transparence en matière de lutte contre les infections nosocomiales (96) : la publicité donnée à ce tableau de bord et aux scores des établissements de santé apparaît en effet comme une condition de l’efficacité de la lutte contre les infections nosocomiales.
– L’indicateur ICALIN (indicateur composite d’activités de la lutte contre les infections nosocomiales) rend compte de l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans l’établissement, des moyens qu’il a mobilisés et des actions qu’il a mises en œuvre. Ce score sur 100 points reflète le niveau d’engagement de l’établissement de santé et de ses personnels dans la lutte contre les infections nosocomiales, en particulier de sa direction, de son comité de lutte contre les infections nosocomiales et de son équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière.
– L’indicateur ICSHA (indicateur de consommation de solutions ou de produits hydroalcooliques) est un marqueur indirect de la mise en œuvre effective de l’hygiène des mains, mesure-clé de prévention des infections nosocomiales. Il est élaboré par la comparaison entre la consommation déclarée de l’établissement en solutions hydroalcooliques et la consommation théorique qu’il devrait avoir au regard du nombre d’actes pratiqués et des recommandations en matière d’hygiène des mains.
– L’indicateur SURVISO (surveillance des infections du site opératoire) rend compte de la mise en place par l’établissement d’une surveillance épidémiologique des patients après leur opération chirurgicale. Il permet donc de mesurer la fréquence des infections du site opératoire.
– L’indicateur ICATB (indice composite de bon usage des antibiotiques) mesure l’organisation mise en place dans l’établissement pour promouvoir le bon usage des antibiotiques, les moyens qu’il a mobilisés et les actions qu’il a mises en œuvre. Ce score sur 20 points reflète le niveau d’engagement de l’établissement de santé dans une stratégie d’optimisation de l’efficacité des traitements antibiotiques.
– L’indicateur SARM (Staphyloccocus aureus résistant à la méticilline) permet de refléter l’écologie microbienne de l’établissement pour le SARM, bactérie multi résistante aux antibiotiques fréquemment en cause dans les infections nosocomiales. Il est calculé sur les trois années précédant sa publication, pour les seuls établissements de plus de 100 lits ou ayant réalisé plus de 30 000 journées d’hospitalisation (97). Cet indice ne peut avoir qu’une valeur indicative, puisqu’il dépend, d’une part, du nombre d’hospitalisations de patients (le risque d’être colonisé par un SARM augmente avec le nombre d’hospitalisations), du nombre de patients transférés d’un autre hôpital (la colonisation ou l’infection par un SARM a pu avoir lieu dans un autre hôpital) et, d’autre part, de la politique mise en œuvre dans l’établissement en matière de bon usage des antibiotiques et de prévention de la diffusion des SARM.
– Le score agrégé, élaboré à partir des résultats de quatre des cinq indicateurs (à l’exception du SARM) et publié depuis la parution du tableau de bord 2006, permet de faciliter la lecture du tableau de bord. Il offre pour les usagers un affichage simplifié des indicateurs sous forme d’une classe de A à E et d’une note sur 100 par catégorie d’établissements.
Par ailleurs, Mme la ministre de la santé et des sports a indiqué lors de son audition par la mission que ces indicateurs de moyens seront prochainement complétés par des indicateurs de résultat (98). Si l’utilité et l’efficacité des indicateurs de moyens sont avérées, comme en attestent les résultats déjà obtenus dans la diminution des taux de prévalence des infections nosocomiales, la mise en place d’indicateurs de résultat sera une incitation encore plus forte pour les établissements de santé à s’engager avec la résolution la plus forte dans la lutte contre les infections nosocomiales.
Trois enquêtes nationales de prévalence des infections nosocomiales ont été réalisées en 1996, en 2001 et en 2006. L’enquête nationale de prévalence 2006 a été réalisée en collectant les caractéristiques de 358 353 patients dans 2 337 établissements de santé. Avec une couverture globale représentant 95 % des lits d’hospitalisation en France, elle a été proche de l’exhaustivité et a constitué la plus importante enquête de ce type jamais réalisée. Cette forte participation permet une description précise des caractéristiques un jour donné des patients hospitalisés, des dispositifs invasifs auxquels ils sont exposés et de leurs infections nosocomiales éventuelles. Elle constitue une source d’informations essentielle pour identifier les infections les plus fréquentes et les groupes de patients les plus exposés au risque nosocomial, et prioriser les mesures de prévention tant au niveau local que national.
L’enquête, réalisée le même jour pour l’ensemble des établissements participants, a concerné tous les services d’hospitalisation complète et tous les patients hospitalisés depuis au moins vingt-quatre heures. Pour chaque patient ont été recueillis les caractéristiques de l’établissement (type, statut et taille), la spécialité du service d’accueil, les caractéristiques du patient (âge, sexe, statut immunitaire,...), les informations sur l’hospitalisation du patient et les facteurs de risques liées à sa prise en charge (intervention chirurgicale dans les 30 derniers jours, présence de dispositifs invasifs...). Pour chaque infection nosocomiale ont été documentés la localisation infectieuse, l’origine (acquise dans l’établissement ou importée d’un autre établissement), la date de diagnostic, les micro-organismes identifiés et certaines caractéristiques de résistance aux antibiotiques.
Outre les indicateurs et les enquêtes de prévalence désormais bien établies, des initiatives scientifiques importantes sont développées pour mieux connaître les infections nosocomiales et notamment leur mode de propagation : ainsi, un projet de recherche dirigé par des équipes de l’INSERM et de l’Institut Pasteur avec l’AP-HP et l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) a été entamé en juin 2009 sur plus de 800 personnes, afin de comprendre pourquoi certaines bactéries (staphylocoques dorés et entérobactéries) arrivent plus facilement que d’autres à se transmettre parmi les personnes qui sont hospitalisées ou travaillent à l’hôpital. Le programme de recherche d’une durée de six mois démarre ce mois-ci à l’AP-HP sur le site de l’Hôpital Maritime de Berck sur Mer.
De telles initiatives ne peuvent que conforter les progrès constatés dans les taux de prévalence des infections nosocomiales et améliorer encore l’efficacité de la lutte contre les infections nosocomiales.
3. Des progrès incontestables dans les taux de prévalence des infections nosocomiales
La dernière enquête de prévalence de 2006, dont il faut rappeler qu’elle a eu un taux de couverture des établissements proche de l’exhaustivité, a mis en évidence d’incontestables progrès dans la lutte contre les infections nosocomiales. Le taux de prévalence global des infections nosocomiales a ainsi reculé de 7,7 %, comme le montre le tableau ci-dessous.
Comparaison des enquêtes de prévalence 2001 et 2006
Catégorie d’établissement de santé |
Enquête de prévalence de 2001 |
Enquête de prévalence de 2006 |
Évolution en % | ||||
Nombre de patients |
Nombre de patients infectés |
Taux de patients infectés (en %) |
Nombre de patients |
Nombre de patients infectés |
Taux de patients infectés (en %) | ||
CHR/CHU |
59 360 |
3 822 |
6,44 |
57 708 |
3 489 |
6,05 |
-6,1 |
CH/CHG |
121 683 |
5 705 |
4,69 |
116 430 |
5 055 |
4,34 |
-7,4 |
CHS/Psychiatrie |
24 567 |
484 |
1,97 |
24 066 |
441 |
1,83 |
-7 |
Hôpital local |
8 682 |
466 |
5,37 |
7 216 |
335 |
4,64 |
-13,5 |
Clinique MCO |
38 286 |
1 240 |
3,24 |
38 361 |
1 190 |
3,10 |
-4,2 |
SSR/SLD |
18 882 |
753 |
3,99 |
19 320 |
630 |
3,26 |
-18,2 |
CLCC |
2 066 |
182 |
8,81 |
2 092 |
175 |
8,37 |
-5 |
Total |
273 526 |
12 652 |
4,63 |
265 193 |
11 315 |
4,27 |
-7,7 |
Source : ministère de la santé
Dans un dossier publié sur son site Internet, le ministère de la santé indique que « le taux d’infections nosocomiales en France est parmi le plus faible par rapport à celui observé dans les autres pays européens (…). Le jour de l’enquête 2006, 17 820 patients étaient infectés soit une prévalence de patients infectés de 4,97 %. Entre 2001 et 2006, on a noté une diminution de 12 % de la prévalence des patients infectés, de 40 % de ceux infectés par un staphylocoque multi-résistant aux antibiotiques. (…) Le rapport du groupe travail "Hospital in Europe Link for Infection Control through Surveillance" (HELICS) de mars 2006 sur les infections du site opératoire pour les données 2004 montre que les chiffres de la France sont "très compétitifs". La France y participe pour 278 établissements sur 628 du pool de 11 pays (Belgique, Finlande, Allemagne, Grèce, Hongrie, Lituanie, Pays Bas, Pologne, Espagne et Grande Bretagne). La France présente notamment les taux d’incidence des infections du site opératoire parmi les plus faibles pour les cholécystectomies (1,0 %) et les poses de prothèses de hanche (2,1 %) tandis qu’elle se situe dans la moyenne pour les césariennes (2,6 %) » (99).
Concernant le nombre de décès imputables à une infection nosocomiale, M. Alain Vasselle, rapporteur de l’Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé (OPEPS), soulignait en 2006 que « la mesure précise du nombre de décès directement dus à une infection nosocomiale reste un exercice délicat », puisque « les patients entrent en effet souvent à l’hôpital avec une pathologie grave et dans un état de fragilité générale ». Cependant, « plusieurs études récentes estiment que 6,6 % des décès qui interviennent chaque année à l’hôpital ou à la suite d’une hospitalisation surviendraient en présence d’une infection de ce type. (…) Les infections nosocomiales seraient donc en cause pour 9 000 décès par an, dont 4 200 concernent des patients pour lesquels le pronostic vital n’était pas engagé à court terme à leur entrée à l’hôpital. Pour la moitié de ces 4 200 décès, aucune autre cause de décès n’est détectée. L’apparition d’une infection multiplie ainsi le risque de décès par trois » (100).
Pourtant, en dépit de cette réduction indéniable du risque nosocomial en France, sa perception par la population reste élevée, comme en atteste une enquête réalisée par l’InVS en 2005 et 2006 (101). En effet, si la crainte de contracter une infection nosocomiale est relativement faible, les infections nosocomiales n’étant citées que par 3,6 % des 4 112 personnes interrogées et se classant en septième position des maladies les plus craintes, en revanche 46 % des personnes interrogées considéraient que le risque de contracter une infection nosocomiale était en augmentation et 37 % que ce risque était stable ; seules 12 % des personnes interrogées considéraient ce risque comme en diminution. Dès lors, il semble nécessaire que le ministère de la santé accentue et adapte sa communication sur les résultats de la lutte contre les infections nosocomiales, afin de rapprocher la perception des infections nosocomiales de la réalité de l’évolution épidémiologique et d’éviter le maintien de perceptions fausses, susceptibles de perpétuer une relation faussée et empreinte d’une certaine méfiance entre certains patients et les établissements et professionnels de santé.
4. Les limites de la lutte contre les infections nosocomiales
Les données présentées précédemment révèlent une très nette amélioration des taux de prévalence des infections nosocomiales. Ce résultat est le fruit d’une politique résolue de lutte contre les infections nosocomiales, qui a permis de faire entrer la culture hygiéniste dans les établissements de santé. Les CLIN et les EOHH sont parvenus, dans la très grande majorité des établissements de santé, à affirmer leur rôle et à faire évoluer les pratiques des professionnels de santé. La mise en place d’indicateurs a également joué un rôle déterminant, en fournissant aux établissements des données objectives sur leur situation au regard des bonnes pratiques en matière d’hygiène et de lutte contre les infections nosocomiales, et en leur permettant de se fixer des objectifs d’amélioration. Lors des déplacements de la mission, les directeurs des établissements visités et les présidents des CLIN ont unanimement salué cet outil comme un facteur d’évaluation de la performance et de motivation des équipes.
Les avis des professionnels de santé étaient en revanche plus nuancés sur la publicité donnée aux tableaux de bord, en raison du risque de mauvaise interprétation des données, non seulement par les patients mais aussi par certaines publications de presse qui réalisent annuellement des classements des établissements de santé en fonction des taux d’infections nosocomiales. En effet, une lecture hâtive de ces tableaux de bord pourrait laisser penser que les centres hospitaliers universitaires (CHU), dont le taux d’infections nosocomiales est supérieur à celui des établissements privés de santé, ont une hygiène pouvant prêter à discussion. Or, il convient de rappeler que le risque de développer une infection nosocomiale est facteur de la pathologie du malade et des actes réalisés, et que les CHU traitent souvent des malades plus sérieusement atteints que la majorité des établissements privés de santé et réalisent davantage d’actes invasifs lourds. Cependant, en dépit de ce risque de mauvaise lecture, dont les conséquences peuvent être limitées par un effort de pédagogie des établissements et du ministère de la santé en direction des patients, la publicité des tableaux de bord apparaît comme une mesure dont l’efficacité ne saurait être mise en doute, un établissement ne pouvant – s’il souhaite conserver voire développer sa patientèle – accepter de demeurer « mal noté » dans les tableaux de bord annuels.
Cette amélioration continue de la prévention des infections nosocomiales ne doit cependant pas faire oublier qu’une part non négligeable des infections nosocomiales est considérée par les spécialistes de l’infectiologie comme inévitable. Ainsi, M. Alain Vasselle signalait-il en 2006 qu’« on estime à 70 % la proportion de celles qui ne pourraient pas être évitées par une meilleure prévention (mesures d’hygiène, locaux adaptés, etc.), notamment en raison de leur origine endogène » (102). Même si elle est souvent difficile à accepter pour un patient qui se rend dans un établissement de santé pour être soigné et non pour contracter une nouvelle maladie, l’infection nosocomiale fait partie de la vie de l’hôpital. Même une hygiène irréprochable ne saurait prévenir toutes les infections, et toute infection nosocomiale ne saurait être considérée comme relevant ni du fait ni de la faute de l’établissement dans lequel elle a été contractée.
Malgré les efforts nécessaires de prévention, il est donc important d’être conscient du fait qu’il est possible que les taux de prévalence cessent de baisser dans les années à venir. En effet, d’une part, le développement de nouvelles techniques invasives, qui maintiennent en vie des personnes très fragiles, augmente la proportion de patients risquant de contracter une infection. D’autre part, le vieillissement de la population conduira à une augmentation de l’âge moyen des patients admis à l’hôpital. Or, le risque d’infection nosocomiale s’accroissant avec l’âge, leur développement peut devenir de plus en plus difficile à combattre. La mission reviendra sur cette question de l’inévitabilité de certaines infections, le caractère inévitable d’une infection pour l’établissement dans lequel elle est survenue pouvant conduire à s’interroger sur la justification de l’engagement de plein droit de sa responsabilité.
Or, comme pour l’évolution du risque de contracter une infection nosocomiale, la perception par la population de la possibilité de maîtriser le risque nosocomial apparaît faussée, comme le révèle l’étude précitée de l’InVS (103) : « Près des deux tiers (60 %) des personnes interrogées pensaient qu’il était possible de maîtriser complètement le risque nosocomial. Les moyens les plus fréquemment évoqués pour y arriver étaient la propreté des locaux (27 %), l’augmentation des effectifs en personnel (16 %), la stérilisation des dispositifs médicaux (10 %) et le lavage des mains du personnel (9 %) ». En outre, cette étude a également mis en évidence que seule une minorité des personnes interrogées avaient connaissance du lien entre la fragilité et le risque d’infection nosocomiale, 3 % seulement des personnes pensant que les personnes hospitalisées sont fragiles et plus sensibles aux infections. Dès lors, s’il est parfaitement légitime et indispensable de continuer à assigner aux établissements de santé des objectifs ambitieux et exigeants en termes de politique de lutte contre les infections nosocomiales, afin que la part des infections évitables continue de régresser, il semble également indispensable de mieux communiquer pour rappeler que le « risque zéro » ne saurait exister en ce domaine.
C. LES LACUNES DE LA CONNAISSANCE DES INFECTIONS CONTRACTÉES EN MÉDECINE DE VILLE
Si l’efficacité de la politique de lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé doit être soulignée, il convient également de noter que la connaissance des infections contractées en médecine de ville apparaît beaucoup plus lacunaire. En effet, tant les représentants des syndicats de médecins que ceux des assureurs médicaux (104) ont indiqué que la connaissance des infections contractées en médecine de ville était à l’heure actuelle largement empirique, et, partant, très imprécise.
Or, si les actes les plus invasifs et donc les plus susceptibles de donner lieu à une infection sont indéniablement réalisés en établissement de santé, il n’en demeure pas moins que les praticiens libéraux sont quotidiennement amenés à réaliser des actes de soins invasifs, par exemple en matière de chirurgie dentaire ou de dermatologie. Seules des études partielles existent, par exemple une étude réalisée en 2009 par l’InVS dans le domaine de la chirurgie dentaire, qui a montré les risques induits de transmission croisée de virus hématogènes (VIH, VHB ou VHC) par les défauts de stérilisation lors des soins dentaires (105).
S’il ne paraît pas possible, compte tenu du nombre de cabinets libéraux, de réaliser des enquêtes épidémiologiques systématiques ou des enquêtes de prévalence à l’image de celles désormais réalisées tous les cinq ans dans les établissements de santé, une évaluation du risque infectieux en cabinet de ville, qui pourrait être réalisée par sondage représentatif, serait nécessaire et devrait permettre la mise en place d’une politique de lutte contre ce risque. Une telle évaluation du risque infectieux en médecine libérale apparaît indispensable préalablement à toute évolution du régime de responsabilité des professionnels de santé en cas d’infection, qui pourrait sembler souhaitable pour mettre fin à la différence de traitement des victimes d’une infection contractée dans un cabinet libéral et de celles ayant été infectées en établissement de santé.
Proposition n° 8
Mettre en place une évaluation du risque infectieux en cabinet libéral et une politique de lutte contre ce risque.
II. UN RÉGIME D’INDEMNISATION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES GLOBALEMENT SATISFAISANT
Avant de décrire le régime actuel d’indemnisation issu des deux lois du 4 mars et du 30 décembre 2002 – codifiées dans le code de la santé publique aux articles L. 1142-1 et suivants –, il importe de rappeler le régime jurisprudentiel antérieur d’indemnisation des infections nosocomiales, dont les défauts – tant pour les victimes que pour les professionnels et établissements de santé – avaient rendu nécessaire l’intervention du législateur (A). À l’opposé du régime antérieur, le régime légal issu de ces deux lois apparaît simplifié et unifié (B) et fait l’objet d’un jugement plutôt positif largement partagé par les personnes intéressées (C).
A. LE RÉGIME JURISPRUDENTIEL ANTÉRIEUR À LA LOI DU 4 MARS 2002
Avant l’intervention du législateur en 2002, le régime d’indemnisation des infections nosocomiales était – comme d’ailleurs l’essentiel du droit de la responsabilité – d’origine jurisprudentielle, avec l’existence de deux régimes d’indemnisation différents selon le lieu de survenance de l’infection : un régime administratif, d’une part, et un régime judiciaire, d’autre part. Cependant, même si l’évolution ne se fit pas complètement au même rythme, les années 1990 furent marquées par une évolution rapide et importante des jurisprudences en matière de responsabilité médicale en général et d’indemnisation des infections nosocomiales en particulier, dans un sens favorable aux victimes.
1. Un régime différent selon le lieu de survenance de l’infection
Compte tenu de l’organisation du système de santé en France, caractérisé par l’existence d’une médecine publique (dispensée dans les établissements publics de santé) et d’une médecine privée (dispensée dans les établissements privés de santé et dans les cabinets des praticiens libéraux), une demande d’indemnisation présentée pour une même infection relève, selon le lieu où elle a été contractée, du juge administratif ou du juge judiciaire. De façon peu surprenante, mais problématique en termes d’égalité de traitement des victimes, cette division du contentieux avait abouti à des règles d’indemnisation différentes selon l’ordre de juridiction compétent. Mais en dépit de ces différences de régime, les jurisprudences des juges administratif et judiciaire connurent une évolution similaire dans un sens favorable à l’indemnisation des victimes, mais à des périodes différentes et en retenant des solutions juridiques différentes.
Traditionnellement, la responsabilité médicale n’était engagée qu’en cas de faute, aussi bien devant le juge administratif que devant le juge judiciaire. Le plus prompt à évoluer dans un sens favorable à l’indemnisation des victimes d’infections nosocomiales fut le juge administratif. Dans une décision Cohen en date du 9 décembre 1988, le Conseil d’État décida en effet que la survenance d’une infection nosocomiale permettait de présumer l’existence d’une faute dans l’organisation du service : « Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que l’infection méningée compliquée d’une lésion de la moelle dorsale dont M. Cohen a été victime a eu pour cause l’introduction accidentelle dans l’organisme du patient d’un germe microbien lors de la sacco-radiculographie qu’il a subie le 18 août 1976 au groupe hospitalier de la Pitié-Salpétrière à Paris ou de l’intervention chirurgicale de cure de la hernie discale confirmée par cet examen qu’il a subie le 19 août 1976 dans le même établissement, alors qu’il résulte des constatations des experts qu’aucune faute lourde médicale, notamment en matière d’asepsie, ne peut être reprochée aux praticiens qui ont exécuté cet examen et cette intervention ; que le fait qu’une telle infection ait pu néanmoins se produire, révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service hospitalier à qui il incombe de fournir au personnel médical un matériel et des produits stériles ; que, dès lors, M. Cohen est fondé à demander à l’administration générale de l’assistance publique à Paris, réparation du préjudice qu’il a subi du fait de cette faute » (106).
L’évolution de la jurisprudence judiciaire fut plus lente, puisque la preuve d’une faute contractuelle, conformément à l’arrêt Mercier du 20 mai 1936 de la première chambre civile de la Cour de cassation définissant le contrat médical et l'obligation de moyens pesant sur le médecin de prodiguer des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, demeura longtemps exigée pour les dommages subis dans des établissements privés de santé ou chez des professionnels de santé. De cette jurisprudence traditionnelle, il résultait qu’il appartenait au patient s’estimant victime d’une infection nosocomiale d’apporter la preuve d’un manquement du médecin à son obligation de sécurité qui n’était que de moyens.
L’évolution de la jurisprudence judiciaire se fit en deux temps : par un arrêt du 21 mai 1996, la première chambre civile de la Cour de cassation avait substitué à l’obligation de moyens une présomption de faute inspirée de la solution retenue par le juge administratif, en décidant qu’une clinique devait être « présumée responsable d’une infection contractée par un patient lors d’une intervention pratiquée dans une salle d’opération, à moins de prouver l’absence de faute de sa part » (107). Puis, par un arrêt en date du 29 juin 1999, le juge judiciaire retint une solution plus favorable encore aux victimes en substituant à cette présomption de faute une obligation de sécurité de résultat : « un médecin est tenu, vis-à-vis de son patient, en matière d’infection nosocomiale, d’une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère » (108).
2. Un régime jurisprudentiel favorable aux victimes
Cette évolution jurisprudentielle favorable aux victimes a permis de répondre aux attentes compréhensibles d’indemnisation de victimes d’infections nosocomiales, à juste titre choquées par le fait d’avoir subi un dommage grave à l’occasion d’un acte de soins et demandeuses de reconnaissance et de compensation de leur souffrance.
Cependant, cette évolution a créé de réelles difficultés pour les professionnels et établissements de santé à contracter les assurances professionnelles nécessaires à l’exercice de leur activité : compte tenu de l’augmentation du risque de voir la responsabilité de leurs clients engagée non seulement pour des infections nosocomiales mais aussi pour des cas d’« aléa thérapeutique », les assureurs ont, selon les cas, fortement augmenté les primes d’assurance dues, voire refusé d’assurer certaines spécialités jugées trop « à risques ». Or, s’il était fondamental de permettre une juste indemnisation des victimes d’infections nosocomiales, il n’était toutefois pas souhaitable que l’évolution des règles d’indemnisation conduise à un recul de l’offre de soins qui se serait révélé extrêmement préjudiciable à la qualité du système de santé français.
C’est donc pour remédier au double inconvénient de la dualité de régimes juridiques d’indemnisation des victimes d’infections nosocomiales et d’une évolution préjudiciable à l’assurabilité des établissements et professionnels de santé que le législateur intervint, par deux fois, en 2002.
B. LE RÉGIME LÉGAL D’INDEMNISATION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ISSU DES LOIS DU 4 MARS ET DU 30 DÉCEMBRE 2002
Avant de décrire le régime légal d’indemnisation des infections nosocomiales issu des lois du 4 mars et du 30 décembre 2002, il importe de bien comprendre que celui-ci est le fruit d’un compromis entre plusieurs intérêts divergents que sont la protection des victimes, la responsabilisation des établissements de santé et la sauvegarde de l’assurabilité des établissements. Cette présentation de la genèse du régime légal permettra de mieux appréhender les raisons de son apparente complexité malgré l’unification des règles d’indemnisation, tout en mesurant la difficulté à tenter de le rendre plus simple et plus juste. Enfin, le régime d’indemnisation des accidents médicaux et donc des infections nosocomiales est caractérisé par la mise en place d’une procédure ad hoc simplifiée et accélérée.
1. Un régime fruit d’un compromis entre protection des victimes, responsabilisation des établissements de santé et sauvegarde de l’assurabilité des établissements
Pour remédier aux difficultés précédemment décrites soulevées par le double régime jurisprudentiel d’indemnisation des infections nosocomiales, le législateur est intervenu par deux fois au cours de la même année 2002, avec un triple objectif :
– uniformiser les régimes applicables par les juges judiciaire et administratif, afin que la situation des victimes ne soit pas différente selon le lieu où l’infection a été contractée. En effet, comme l’avaient relevé les rapporteurs à l’Assemblée nationale du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé, « pour les victimes les différences de procédures et de jurisprudence n’ont pas de fondement en terme d’équité. Ainsi deux victimes ayant subi le même dommage dans des circonstances semblables sur le plan strictement technique, l’une dans un hôpital public, l’autre dans une clinique privée, ne pourront obtenir la même réparation au motif que le lieu dans lequel a eu lieu l’intervention n’a pas le même statut juridique » (109).
– favoriser la responsabilisation des établissements de santé dans la lutte contre les infections nosocomiales ;
– concilier le droit à indemnisation des victimes avec la nécessité de garantir l’accès à l’assurance des établissements et professionnels de santé.
La double intervention du législateur fut justifiée par la difficulté particulière à trouver un juste équilibre entre ces trois considérations, dont aucune ne pouvait être négligée. Or, la première intervention du législateur par la loi du 4 mars 2002 ne parvint pas à trouver le juste équilibre entre ces différents éléments. L’objectif d’uniformisation des régimes fut atteint par cette première loi pour les règles d’indemnisation : fut en effet consacrée pour l’ensemble des établissements de santé la solution retenue par la jurisprudence judiciaire, par l’institution d’une responsabilité de plein droit des établissements de santé pour les infections nosocomiales, sous réserve qu’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. La principale modification apportée par la loi du 4 mars 2002 au régime d’indemnisation des infections nosocomiales concernait les professionnels libéraux de santé, pour lesquels une faute est à nouveau exigée, au rebours de la solution antérieurement dégagée par le juge judiciaire pour les infections nosocomiales contractées en médecine de ville.
Cependant, la solution retenue ne parvint pas à régler le problème d’assurabilité des établissements de santé et, au contraire, aggrava même la situation, comme le releva M. Jean-Pierre Door dans son rapport sur la proposition de loi qui aboutit à la loi du 30 décembre 2002 : « Au 1er janvier prochain, notre système de soins risque d’être paralysé par l’impossibilité pour les professionnels et les établissements de santé de s’assurer contre les risques que comporte immanquablement leur activité. Le marché de l’assurance en responsabilité civile médicale est en effet aujourd’hui tellement sinistré que la plupart des compagnies d’assurance non mutualistes ont préféré s’en retirer. Il faut donc rétablir au plus vite les conditions de la confiance, ce que devrait permettre cette proposition de loi (…) Cette loi [du 4 mars 2002], attendue depuis trop longtemps par les victimes, a cependant imposé des obligations juridiques sans se préoccuper de leur faisabilité économique, c’est-à-dire concrètement de l’assurabilité des nouveaux risques. Compte tenu de ce qu’ils ont considéré comme de nouvelles contraintes inassurables financièrement – en raison de l’absence de visibilité à long terme sur l’évolution des contentieux en responsabilité civile médicale et de la future jurisprudence des nouvelles commissions régionales de conciliation et d’indemnisation – un certain nombre d’assureurs (ACE, Saint Paul, Gerliney, Lloyd’s…) ont préféré annoncer qu’ils se désengageraient totalement du marché. Il y avait donc un risque grave que plus de la moitié des cliniques privées et un certain nombre de spécialistes (notamment en anesthésie et en gynécologie obstétrique) ne trouvent pas d’assureurs dès l’année prochaine » (110).
La loi du 30 décembre 2002 fut donc adoptée afin de tenter de parvenir à un juste équilibre entre le droit à indemnisation des victimes et la sauvegarde de la possibilité pour les professionnels et établissements de santé de s’assurer, en transférant la charge de l’indemnisation des dommages les plus graves à la solidarité nationale, via l’Office national de l’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Cette difficulté à concilier différents intérêts contradictoires, matérialisée par la succession de deux interventions législatives en moins d’un an, a abouti à l’instauration de règles légales d’indemnisation des infections nosocomiales ayant certes une apparence de grande complexité, mais présentant l’avantage d’être unifiées.
2. Des règles légales d’indemnisation des infections nosocomiales ayant une apparence de grande complexité mais unifiées
Le régime d’indemnisation résultant des lois du 4 mars 2002 et du 30 décembre 2002 dépend de deux facteurs principaux que sont le lieu où a été contractée l’infection et la date où celle-ci a été contractée. De ce fait, il a indéniablement une apparence de très grande complexité, qui ne doit cependant pas masquer le principal avantage du régime légal institué, à savoir l’unification des règles de fond appliquées par les deux ordres de juridiction.
– Si les soins ayant causé l’infection sont antérieurs au 5 septembre 2001, s’applique le régime jurisprudentiel antérieur à la loi du 4 mars 2002 : présomption de faute pour le juge administratif, obligation de sécurité de résultat pour le juge judiciaire. En effet, l’article 101 de la loi du 4 mars 2002 a expressément prévu que ses dispositions relatives à l’indemnisation « s’appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l’objet d’une instance en cours, à moins qu’une décision de justice irrévocable n’ait été prononcée » (111).
Cette survivance d’un régime jurisprudentiel constitue indéniablement un facteur de complexité, même si, comme l’a souligné l’ensemble des personnes auditionnées par la mission, les cas d’infections nosocomiales antérieures à cette date non encore indemnisées deviennent marginaux et vont disparaître sous peu.
– Si les soins ayant causé l’infection sont postérieurs au 4 septembre 2001, quatre régimes d’indemnisation existent :
1° Si l’infection a été contractée chez un professionnel de santé en médecine de ville, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée qu’en cas de faute, en application du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
2° Si l’infection a été contractée dans un établissement de santé (qu’il soit public ou privé), le deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que l’établissement est responsable sans que la victime soit tenue d’établir une faute. L’établissement ne peut s’exonérer que s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère ;
3° Si aucun de ces deux premiers régimes n’est applicable (soit que le professionnel de santé n’ait pas commis de faute, soit que l’établissement de santé ait pu établir une cause étrangère), le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit une indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) au titre de la solidarité nationale, à condition que le dommage subi réponde à trois conditions :
● le dommage doit être directement imputable à des actes de soin ;
● il doit avoir des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient ou de son évolution prévisible ;
● il doit présenter un caractère de gravité suffisant fixé par décret. Ce seuil de gravité a été défini par l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, qui requiert soit une incapacité permanente partielle (IPP) supérieure à 24 %, soit un arrêt temporaire des activités professionnelles ou un déficit fonctionnel temporaire (112) de six mois consécutifs ou de six mois non consécutifs sur une période de douze mois, soit une incapacité définitive à exercer sa profession antérieure, soit des troubles d’une particulière gravité dans les conditions d’existence. Cependant, le texte de l’article D. 1142-1 prévoit que ces deux derniers critères ne peuvent être admis qu’« à titre exceptionnel »
4° Enfin, la loi du 30 décembre 2002 a créé, dans le code de la santé publique, un article L. 1142-1-1 instituant un second cas de prise en charge de l’indemnisation par la solidarité nationale : pour les dommages les plus graves et uniquement pour les soins réalisés à partir du 1er janvier 2003 dans un établissement de santé, l’indemnisation est prise en charge au titre de la solidarité nationale même si les conditions d’indemnisation au titre de l’un des deux premiers régimes sont remplies, à condition que l’infection ait causé une incapacité permanente partielle supérieure à 25 % ou le décès de la victime. Toutefois, un recours subrogatoire de l’ONIAM à l’encontre l’établissement est possible en cas de faute (113).
La description de ces différents cas d’indemnisation révèle donc une indéniable complexité, soulignée par M. Michel Germond, directeur de la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) : « Ce système d’indemnisation des accidents médicaux, et en particulier des infections nosocomiales, est assez complexe. Selon qu’il y a une cause étrangère ou pas, selon la gravité du dommage, on voit que la personne chargée de supporter le coût du dommage n’est pas la même. C’est donc assez compliqué et c’est vrai que le système n’est pas très satisfaisant de ce point de vue-là » (114).
Le tableau ci-dessous synthétise les différents cas d’indemnisation issus des deux lois du 4 mars et du 30 décembre 2002, applicables aux dommages contractés postérieurement au 4 septembre 2001 – les dommages antérieurs restant quant à eux soumis aux règles jurisprudentielles d’indemnisation décrites précédemment.
Infection contractée dans un établissement de soins |
Infection contractée chez un professionnel de santé | |
Régime de droit commun |
Responsabilité de plein droit sauf preuve de cause étrangère (Art. L. 1142-1, 2ème alinéa du I) |
Responsabilité pour faute (Art. L. 1142-1, 1er alinéa du I) |
Régimes d’indemnisation par la solidarité nationale |
Solidarité nationale si la responsabilité d’aucun professionnel ou établissement ne peut être engagée et si : — le dommage est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soin ; — il a des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient ou de son évolution prévisible ; — il présente un caractère de gravité suffisante défini par décret (soit 24 % d’incapacité permanente partielle, soit 6 mois d’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de déficit fonctionnel temporaire, soit une incapacité définitive à exercer sa profession antérieure, soit des troubles d’une particulière gravité dans les conditions d’existence). (Art. L. 1142-1, II ; art. D. 1142–1) | |
Pour les infections nosocomiales postérieures au 1er janvier 2003, indemnisation au titre de la solidarité nationale, même si les conditions d’indemnisation du régime de droit commun sont remplies, si l’infection a causé un dommage supérieur à 25 % d’incapacité permanente partielle ou un décès. En cas d’indemnisation sur ce fondement, un recours subrogatoire peut être exercé par l’ONIAM contre l’établissement à l’origine du dommage en cas de faute établie de celui-ci (Art. L. 1142-1-1 et L. 1142–17, dernier alinéa) |
||
Toutefois, en dépit de cette indéniable complexité, qu’expliquent l’histoire de sa mise en place et les intérêts divergents dont le législateur a dû rechercher la conciliation, ce régime d’indemnisation des infections nosocomiales possède un grand mérite salué par l’ensemble des personnes entendues : celui d’avoir unifié les règles de fond relatives à l’indemnisation des infections nosocomiales. Cette unification ne signifie pas que des règles différentes ne peuvent pas régir des situations jugées différentes par le législateur : ainsi, les règles d’indemnisation sont-elles différentes si l’infection a été contractée en médecine de ville ou en établissement de santé. Mais dès lors que l’infection a été contractée au sein du même type de structure, à savoir un établissement de santé, après la date du 5 septembre 2001, les lois des 4 mars et 30 décembre 2002 ont mis en place un régime unique, que l’établissement dans lequel l’infection a été contractée soit un établissement public ou un établissement privé. Si l’infection n’atteint pas l’un des seuils de gravité prévus par l’article L. 1142-1 ou l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, la charge de l’indemnisation repose de plein droit sur l’établissement. En revanche, si l’infection a engendré un dommage atteignant l’un des seuils de gravité visés par les articles précités, la charge de l’indemnisation pèse sur la solidarité nationale.
En sus de cette unification bienvenue des règles de fond, la loi du 4 mars 2002 a créé pour l’indemnisation des dommages résultant d’actes médicaux une procédure originale simplifiée et accélérée par comparaison aux procédures juridictionnelles contentieuses.
3. Une procédure simplifiée et accélérée
En sus de la modification des règles de fond relatives à l’indemnisation des infections nosocomiales, la loi du 4 mars 2002 a eu pour objectif de tenter de déjudiciariser le traitement des demandes d’indemnisation, afin d’en pacifier mais aussi d’en accélérer le règlement. Pour ce faire, elle a créé de nouvelles instances, dénommées « Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales » (CRCI), commissions de nature administrative qui ont reçu une double mission de conciliation et de règlement amiable des litiges. Les personnes s’estimant victimes d’une infection nosocomiale disposent donc désormais d’un choix entre plusieurs voies possibles d’indemnisation, la voie de la CRCI présentant de nombreux avantages.
a) Le choix par la victime de la voie d’indemnisation
Désormais, une personne s’estimant victime d’une infection nosocomiale dispose d’un choix entre trois solutions pour obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi :
1° Tout d’abord, comme avant la loi du 4 mars 2002, la victime peut toujours transiger directement avec l’assureur de l’établissement ou du professionnel de santé qu’elle estime responsable pour être indemnisée de son préjudice. Si cette voie peut présenter l’avantage d’une certaine rapidité liée à son caractère non contentieux, elle présente cependant l’inconvénient de mettre en présence deux « parties » dotées de moyens financiers et juridiques très inégaux, avec le risque d’aboutir à l’acceptation par la victime d’une indemnisation incomplète du préjudice qu’elle a réellement subi ;
2° La victime peut également demander réparation par la voie juridictionnelle, soit devant le juge administratif si l’infection a été contractée dans un établissement public de santé, soit devant le juge judiciaire si elle a été contractée dans un établissement privé de santé ou chez un praticien libéral.
Toutefois, cette solution présente un triple inconvénient lié à son caractère contentieux :
– la procédure juridictionnelle a un coût pour la victime, qui devra obligatoirement être assistée par un avocat et payer, dans un premier temps au moins, les frais d’expertise ;
– elle est lente : la durée moyenne de traitement en première instance des affaires de responsabilité est de dix-neuf mois devant le juge judiciaire, tandis que le délai de traitement moyen constaté pour l’ensemble des affaires est de deux ans et trois mois devant le juge administratif (115) ;
– enfin, elle ne permet pas d’apaiser les conflits, par son déroulement formalisé et sa procédure essentiellement écrite. Lors de la table ronde des représentants des fédérations hospitalières organisée par la mission, M. Cédric Lussiez, directeur de la communication de la Fédération hospitalière de France (FHF), a souligné que les mises en cause juridictionnelles – a fortiori lorsqu’elles ont lieu devant le juge pénal – étaient particulièrement pénibles pour les professionnels de santé et s’accompagnaient généralement d’un fort ressentiment entre les soignants et les soignés (116) ;
3° La victime peut saisir une commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI). En effet, pour remédier aux inconvénients des deux voies d’indemnisation existantes jusque-là, la loi du 4 mars 2002 a institué les CRCI, qui peuvent jouer deux rôles :
– d’une part, en application de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique, la CRCI peut être saisie d’une demande de conciliation par toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou par les ayants droit d’une personne décédée à la suite d’un tel acte. Cette mission de conciliation peut être exercée quelle que soit la gravité du dommage subi par la victime (117) ;
– d’autre part, lorsque le dommage subi remplit les conditions visées au II de l’article L. 1142–1 du code de la santé publique pour bénéficier du premier cas d’indemnisation au titre de la solidarité nationale (118), la victime peut saisir la CRCI afin d’engager une procédure de règlement amiable.
La saisine de la CRCI est toujours facultative pour la victime. Elle ne constitue pas un préalable nécessaire à l’introduction d’une instance judiciaire ou administrative. Les deux actions peuvent d’ailleurs même être concomitantes, l’article L. 1142–7 prévoyant que « la personne informe la commission régionale des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours » et que « si une action en justice est intentée, la personne informe le juge de la saisine de la commission ». La saisine de la CRCI ne peut en outre pas porter préjudice à la victime, le dernier alinéa de l’article L. 1142-7 disposant que « la saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure » devant la CRCI.
Leur composition, fixée par les articles L. 1142-6 et R. 1142-5 du code de la santé publique, a été pensée pour en faire un lieu de concertation où les différents points de vue peuvent s’exprimer dans un contexte non contentieux. Y sont ainsi représentées toutes les catégories de personnes intéressées par les demandes d’engagement de la responsabilité en matière médicale : six représentants des associations d’usagers du système de santé, deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral, un praticien hospitalier, un responsable d’établissement public de santé, deux responsables d’établissements de santé privés, le président du conseil d’administration et le directeur de l’ONIAM ou leurs représentants, deux représentants des entreprises pratiquant l’assurance de responsabilité civile médicale ainsi que quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels.
Vingt-trois CRCI ont été créées, leurs secrétariats étant regroupés au sein de sept pôles interrégionaux : Bagnolet (Ile-de-France), Bagnolet-Ouest (Basse-Normandie, Bretagne, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire, La Réunion), Bagnolet-Nord (Centre, Nord - Pas-de-Calais, Picardie), Bordeaux (Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes), Lyon (Auvergne, Bourgogne, Rhône-Alpes), Lyon-Sud (Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur), Nancy (Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Guadeloupe-Martinique, Guyane).
b) La procédure de règlement amiable devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation
La procédure devant la CRCI, prévue par les articles L. 1142-4 à L. 1142-24 du code de la santé publique, est composée de cinq étapes successives, dont la durée totale ne doit en principe pas dépasser onze mois. La première phase est celle du dépôt de la demande : la saisine s’effectue par l’envoi au secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’un formulaire de demande d’indemnisation, accompagné d’un certain nombre de pièces justificatives : tout document médical ou administratif établissant le lien entre le dommage et un acte médical, un certificat médical décrivant la nature précise et la gravité du dommage, tout document indiquant la qualité d’assuré social, tout document permettant d’apprécier la nature et l’importance des préjudices, tout document justifiant les sommes éventuellement reçues ou à recevoir au titre de l’indemnisation du dommage par un organisme autre que la sécurité sociale. Dans son rapport annuel pour 2007-2008, la Commission nationale des accidents médicaux (CNAMed), instance chargée de l’harmonisation des pratiques des CRCI et de l’élaboration d’une liste nationale des experts en accidents médicaux, a souligné que « la majorité des dossiers envoyés à la commission sont incomplets ; il manque souvent des pièces indispensables, concernant notamment le dossier médical, qu’en outre certaines victimes peinent à obtenir. Or, la commission a besoin de disposer des éléments permettant d’apprécier la recevabilité initiale de la demande, préalable qui conditionne le passage à l’étape suivante. Le délai moyen entre la date du premier enregistrement et celle de la constitution d’un dossier complet a été de l’ordre d’un mois et demi, avec d’importantes différences entre les pôles (de l’ordre de huit jours pour celui de Lyon à plus de trois mois pour celui de Bagnolet-Ouest). Au-delà d’un certain délai et après plusieurs courriers de rappel, par lettres simples puis recommandées, le dossier finit par faire l’objet d’une conclusion négative sans expertise, s’il n’est pas complet » (119).
La deuxième étape est constituée par l’examen de la recevabilité de la demande. Si le dossier ne remplit manifestement pas les conditions d’accès à la commission, il est rejeté sans examen au fond ; s’il existe un doute sur les conditions d’accès à la commission, le dossier est transmis à un expert qui se prononcera sur sa recevabilité après examen des pièces.
Si le dossier est recevable, la troisième phase est constituée par l’expertise au fond. La commission régionale désigne aux fins d’expertise un collège d’experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux établie par la CNAMed, en s’assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. Elle peut toutefois, lorsqu’elle l’estime suffisant, désigner un seul expert choisi sur la même liste. La commission régionale fixe la mission du collège d’experts ou de l’expert, qui généralement consiste, après examen de la victime, à évaluer ses préjudices et à déterminer l’origine des dommages.
Dans le cadre de sa mission, le collège d’experts ou l’expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel. Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le collège d’experts ou l’expert doit s’assurer du caractère contradictoire des opérations d’expertise, qui se déroulent en présence des parties ou, à défaut, après que celles-ci ont été dûment appelées. Les parties peuvent se faire assister d’une ou de plusieurs personnes de leur choix.
L’avant-dernière phase est celle de l’avis rendu par la commission. Celle-ci dispose d’un délai de six mois à compter de la réception d’un dossier complet pour rendre son avis, au vu du rapport d’expertise, sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages subis ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable. Cet avis est rendu lors d’une réunion de la commission au cours de laquelle le demandeur peut être présent, représenté ou assisté par une personne de votre choix.
Enfin, la dernière étape est constituée par l’offre d’indemnisation et le paiement de cette indemnisation à la victime. Si l’avis de la CRCI conclut à une obligation d’indemnisation à la charge de l’assureur du professionnel ou de l’établissement de santé ou de l’ONIAM, selon le cas, une offre d’indemnisation doit être adressée à la victime dans un délai maximal de quatre mois. Si la victime accepte l’offre qui lui est faite, le débiteur disposera d’un délai maximal d’un mois à compter de cette acceptation pour verser le montant de l’indemnisation convenue. En cas de refus de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable du dommage n’est pas assuré, l’office est substitué à l’assureur et doit alors formuler une offre puis, si celle-ci est acceptée, dédommager la victime. Il dispose toutefois d’une action récursoire contre l’assureur ou l’établissement défaillant. Si l’offre est refusée par la victime en raison de son insuffisance, celle-ci peut saisir le juge compétent (administratif ou judiciaire), qui pourra condamner l’assureur à verser à l’ONIAM à titre d’indemnité une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée.
C. UN JUGEMENT GLOBALEMENT FAVORABLE DU RÉGIME D’INDEMNISATION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
De l’ensemble des auditions menées par la mission sur le régime d’indemnisation des infections nosocomiales issu des lois du 4 mars et du 30 décembre 2002, il ressort que le jugement porté par la majorité des personnes intéressées – représentants des usagers du système de santé, représentants des établissements et professionnels de santé, représentants des assureurs médicaux, professionnels du droit et de l’indemnisation – est globalement très positif, tant sur les règles de définition des régimes de responsabilité que sur la procédure des CRCI.
1. Des règles de définition des régimes de responsabilité jugées globalement satisfaisantes
L’équilibre issu des deux lois du 4 mars et du 30 décembre 2002 a conduit à instaurer un régime de responsabilité de plein droit des établissements de santé pour les infections nosocomiales contractées en leur sein, sous réserve des infections ayant causé les dommages les plus graves qui relèvent de la solidarité nationale. Par ailleurs, revenant sur la jurisprudence judiciaire précédemment décrite, elle a instauré une distinction entre établissements de santé, soumis à un régime de responsabilité de plein droit, et professionnels de santé libéraux, soumis à un régime de responsabilité pour faute. La majorité des personnes entendues par la mission a estimé globalement satisfaisantes ces règles de définition des régimes de responsabilité, qui permettent d’atteindre effectivement le but recherché par le législateur de concilier le droit à indemnisation des victimes, l’assurabilité des professionnels et établissements de santé et la prévention des infections nosocomiales.
La principale crainte que pouvait susciter le nouveau dispositif était celle d’une déresponsabilisation des établissements de santé, déchargés de l’obligation d’indemniser dès lors que les dommages dépassent les seuils légaux et réglementaires de gravité. Ce risque ne semble pas s’être réalisé, notamment en raison de l’exercice vigilant par l’ONIAM de son droit d’action récursoire en cas de faute de l’établissement : « Doit-on pour autant conclure à une "déresponsabilisation" des établissements de santé du fait de ce nouveau dispositif ? Il semblerait que non, si l’on se réfère au dernier alinéa de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique. Ce texte institue au profit de l’ONIAM un recours subrogatoire contre l’établissement de santé, en cas de faute établie de la part de ce dernier à l’origine du dommage, notamment, le manquement caractérisé aux obligations prévues en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Il aurait été fâcheux qu’en cherchant à alléger les obligations des assureurs, le législateur ait contribué à démobiliser les équipes hospitalières dans cette lutte » (120).
Deux réserves ont toutefois été formulées au sujet des règles d’indemnisation des infections nosocomiales. La première réserve concerne la définition même des infections nosocomiales susceptibles de donner lieu à indemnisation : les représentants des assureurs médicaux ont en effet fait valoir que l’absence de définition légale des infections nosocomiales indemnisables posait problème et que certaines définitions jurisprudentielles retenues étaient trop extensives, conduisant à faire assumer aux établissements de santé un risque qu’ils ne pouvaient pas maîtriser. La seconde réserve concerne la différence de régime entre les établissements de santé et les professionnels de santé : si les associations de victimes ont souhaité que le régime de responsabilité de plein droit soit étendu aux infections contractées en médecine de ville, certains représentants des assureurs ont contesté la pertinence de la distinction tout en soulignant les difficultés soulevées par une éventuelle extension du régime de responsabilité de plein droit. Prenant acte de ces réserves sur le régime d’indemnisation des infections nosocomiales, la mission reviendra sur ces deux points, en abordant les aspects perfectibles du régime d’indemnisation des infections nosocomiales.
2. La procédure des commissions régionales de conciliation et d’indemnisation : une procédure largement utilisée constituant un progrès largement reconnu
L’utilisation très large de la procédure – simplement facultative, il convient de le rappeler – de la CRCI permet d’estimer que cette procédure emporte un incontestable succès, qu’expliquent les indéniables avantages du choix de cette voie, non seulement pour les victimes mais également pour les professionnels et établissements de santé mis en cause.
a) L’incontestable succès de la procédure de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation
Les CRCI peuvent être saisies pour tout litige relatif à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins : leur compétence n’est donc pas limitée aux infections nosocomiales et elles se prononcent donc également – et même principalement – sur des accidents médicaux et des affections iatrogènes. Sur l’ensemble de ce champ de compétence, et à la différence de la mission de conciliation dont l’échec est patent, le succès de la fonction de règlement amiable des CRCI est net : saisies de plus de 3 000 dossiers en 2004 et 2005 pour leurs deux premières années de fonctionnement plein, les CRCI ont vu le nombre de demandes décroître légèrement en 2006 et 2007 (respectivement 2 661 et 2 987 demandes) avant que 2008 ne marque une nette remontée du nombre de saisines (3 534 demandes).
Concernant plus spécifiquement l’indemnisation des infections nosocomiales, les CRCI ont rendu, en 2008, 1 321 avis d’indemnisation, dont 317 (soit 24 %) concernaient des infections nosocomiales. Parmi ces 317 avis, 232 concluaient à une indemnisation par l’assureur seul, 83 à une indemnisation par la solidarité nationale seule et 2 à un partage de la charge de l’indemnisation.
Les deux tableaux ci-dessous, réalisés à partir des données figurant dans les rapports annuels de la CNAMed, présentent l’évolution du nombre des avis d’indemnisation des CRCI concernant les infections nosocomiales et la répartition de la charge de l’indemnisation des avis concernant des infections nosocomiales :
Avis d’indemnisation des CRCI de 2005 à 2008
2005 |
2006 |
2007 |
2008 | |||||
Nombre |
Taux |
Nombre |
Taux |
Nombre |
Taux |
Nombre |
Taux | |
Propositions d’indemnisation des CRCI... |
655 |
100,00 |
1012 |
100,00 |
1097 |
100,00 |
1320 |
100,00 |
… hors infections nosocomiales |
452 |
69,01 |
696 |
68,77 |
818 |
74,57 |
982 |
74,39 |
… dont infections nosocomiales |
203 |
30,99 |
316 |
31,23 |
279 |
25,43 |
338 |
25,61 |
Source : Tableau établi par la mission à partir des données des rapports de la CNAMed
Répartition de la charge de l’indemnisation par les avis d’indemnisation des CRCI concernant des infections nosocomiales de 2005 à 2008
2005 |
2006 |
2007 |
2008 | |||||
Nombre |
Taux |
Nombre |
Taux |
Nombre |
Taux |
Nombre |
Taux | |
Indemnisation par l’assureur seul |
138 |
67,98 |
205 |
64,87 |
190 |
68,10 |
247 |
73,08 |
Indemnisation par solidarité nationale seule |
57 |
28,08 |
91 |
28,80 |
75 |
26,88 |
84 |
24,85 |
Indemnisation avec partage de la charge de l’indemnisation entre assureur et solidarité nationale… |
8 |
3,94 |
20 |
6,33 |
14 |
5,02 |
7 |
2,07 |
Total |
203 |
100,00 |
316 |
100,00 |
279 |
100,00 |
338 |
100,00 |
Source : Tableau établi par la mission à partir des données des rapports de la CNAMed
Ces tableaux révèlent que, si la part des avis positifs concernant des infections nosocomiales au sein de l’ensemble des avis positifs a décru, passant de 31 % en 2005 à 24 % en 2008, le nombre total des avis d’indemnisation au titre d’infections nosocomiales s’est accru, passant de 203 en 2005 à 338 en 2008. Le nombre d’avis d’indemnisation faisant peser la charge de l’indemnisation sur la solidarité nationale a augmenté en valeur absolue (57 en 2005, 84 en 2008), mais la part de ces avis au sein de l’ensemble des avis positifs concernant des infections nosocomiales a décru (28,08 % en 2005, 24,85 % en 2008). Cette tendance pourrait révéler une insuffisante connaissance du droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale par les victimes : en effet, les représentants des fédérations hospitalières entendues par la mission ont estimé que le nombre d’avis d’indemnisation pour des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale demeurait faible par rapport au nombre probable d’infections nosocomiales ayant des conséquences présentant le caractère de gravité permettant de prétendre à une indemnisation par la solidarité nationale (121). Lors de son audition par la mission, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports, a également estimé que la communication sur le rôle et le fonctionnement des CRCI était perfectible et a indiqué que le site Internet du ministère de la santé contiendrait, à compter du mois de juillet 2009, une rubrique consacrée aux CRCI (122). La procédure des CRCI reste encore insuffisamment connue des victimes de dommages causés par des actes médicaux, une information plus claire et plus largement diffusée sur l’existence et le fonctionnement de cette procédure et sur les droits des victimes dans ce cadre procédural particulier étant sans doute nécessaire. Cette communication accrue et améliorée sur le dispositif des CRCI doit être non seulement le fait des acteurs institutionnels que sont le ministère de la santé et l’ONIAM, mais aussi des établissements de santé et des associations de patients. Si le remarquable travail d’information sur les droits des victimes réalisé depuis 2002 par les associations de patients doit être souligné, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans l’amélioration de la connaissance du rôle et du fonctionnement des CRCI.
Malgré cette dernière réserve, l’évolution des avis d’indemnisation rendus par les CRCI en matière d’infections nosocomiales atteste du succès incontestable de cette procédure. L’audition par votre rapporteur de représentants des associations des usagers du système de santé et des victimes d’infections nosocomiales a permis à la mission de mesurer le rôle essentiel joué par ces associations en matière d’information des victimes. Mais si les CRCI sont à ce point plébiscitées, cela est principalement dû aux avantages évidents que présente la procédure devant les CRCI par comparaison avec une procédure juridictionnelle.
b) Les avantages du choix de la voie de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation
Le sentiment général des personnes entendues par la mission, et notamment des associations de victimes, sur la procédure des CRCI est extrêmement positif. Alors que les règles d’indemnisation sont – à juste titre – perçues comme complexes, les règles de procédure sont considérées comme simples et efficaces : « Les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation constituent la pièce maîtresse de la procédure de règlement amiable. Elles permettent aux victimes d’obtenir une indemnisation d’accès facile, rapide et gratuit. Bien que soumis à un certain formalisme, ce dispositif reste simple en comparaison des voies contentieuses administratives ou civiles » (123). Comme l’a souligné lors de son audition par la mission Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports, il importe de bien distinguer le dispositif procédural d’indemnisation – qui est simple – du régime d’indemnisation – qui est d’une indéniable complexité (124).
Les avantages du choix de la voie de la CRCI pour les personnes s’estimant victimes d’une infection nosocomiale par comparaison avec une procédure juridicitionnelle sont au nombre de trois : la rapidité, la gratuité et le caractère amiable du règlement.
– La rapidité de la procédure devant la CRCI résulte dans le fait que chaque phase de la procédure est assortie d’un délai maximal relativement bref : six mois pour l’avis de la CRCI, quatre mois pour l’offre d’indemnisation, un mois pour le paiement. Si l’on additionne ces différents délais, la victime peut obtenir une indemnisation dans un délai de onze mois à compter de la réception de son dossier complet par la CRCI.
Ce jugement mérite toutefois d’être quelque peu nuancé au regard de la réalité des délais de traitement des affaires par les CRCI : dans son rapport annuel pour 2007-2008, la CNAMed a relevé que le délai moyen dans lequel les CRCI rendent leurs avis positifs concluant à une indemnisation était de 10,7 mois, le délai le plus court étant de 8,9 mois pour le pôle de Bagnolet-Nord et le délai le plus long étant de 14,2 mois pour le pôle de Bagnolet-Ouest. Cet allongement des délais est regretté par M. Dominique Martin, directeur de l’ONIAM, qui estime que « la principale difficulté rencontrée aujourd’hui, au sein des CRCI, tient au non-respect du délai de six mois fixé par la loi. Depuis la mise en place du dispositif, ce délai s’est régulièrement allongé pour s’éloigner progressivement du seuil légal » (125).
Cependant, bien que ce délai réel de traitement soit devenu supérieur au délai légal de six mois, force est de reconnaître qu’il demeure toutefois nettement inférieur aux délais contentieux devant le juge administratif (deux ans et trois mois en moyenne) ou judiciaire (dix-neuf mois en moyenne) (126).
– Le deuxième avantage de la procédure devant la CRCI est celui de la gratuité. En effet, à la différence de la voie contentieuse, la victime n’est pas tenue d’être assistée par un avocat. De plus, l’expertise est gratuite pour la victime, le coût des missions d’expertise étant pris en charge par l’ONIAM, ce dernier pouvant toutefois obtenir le remboursement du coût de l’expertise par l’assureur de l’établissement ou du professionnel responsable.
– Enfin, le dernier avantage de la procédure réside dans son caractère de règlement amiable, qui permet, à la différence des instances contentieuses d’apaiser les conflits entre patients et professionnels ou établissements de santé. Comme l’a souligné Mme Françoise Avram, présidente de la CRCI d’Ile-de-France, le fonctionnement des CRCI apporte « de grandes satisfactions, non seulement dans l’"aiguillage" des indemnisations, mais aussi dans l’apaisement des conflits entre soignés et soignants, tant il est vrai que ces conflits se nourrissent souvent d’un réel manque de communication entre ceux-là et ceux-ci » (127).
Lors de leur audition par la mission, les représentants des fédérations hospitalières ont salué le caractère très positif de la mise en place par la loi du 4 mars 2002 de la procédure non juridictionnelle des CRCI pour permettre le règlement amiable de différends en matière d’indemnisation des infections nosocomiales. Ainsi, M. Cédric Lussiez, directeur de la communication de la FHF a estimé que la procédure des CRCI, non contentieuse et rapide tout en respectant le principe du contradictoire, était particulièrement adaptée au traitement des affaires de responsabilité médicale. M. Thierry Béchu, délégué général de la branche médecine-chirurgie-obstétrique de la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP), a regretté que certains assureurs fassent parfois le choix de la judiciarisation et du temps, choix qu’il a estimé dommageable dans certaines affaires. Or les établissements de santé étant tenus de suivre les avis de leur assureur en cas de litige, ils se trouvent parfois engagés dans des procédures juridictionnelles longues et pénibles alors que leur intérêt aurait pu être de rechercher une solution amiable. Mme Hélène Logerot, médecin en santé publique auprès de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratif (FEHAP), a quant à elle insisté sur le fait que les procédures non juridictionnelles favorisaient la culture du signalement des événements indésirables, parmi lesquels figurent les infections nosocomiales. À l’inverse, la judiciarisation est davantage propice à la recherche de l’enfouissement de la vérité. Or le développement de la culture du signalement est une condition essentielle de l’amélioration de la lutte contre les infections nosocomiales (128).
Le docteur Jean-Marc Rehby, membre du bureau de la Fédération des médecins de France, a également salué le fait que le dispositif amiable mis en place par la loi du 4 mars 2002 avait mis un terme aux risques de dérive judiciaire et de mise en cause systématique des médecins libéraux en matière d’infections nosocomiales (129).
La mission partage cette analyse sur l’adaptation et l’utilité du traitement amiable par une instance non juridictionnelle des cas d’infections nosocomiales, tant dans l’intérêt de la victime que dans celui de la prévention des événements indésirables. Mais malgré son caractère globalement satisfaisant, le régime d’indemnisation des infections nosocomiales n’en est pas moins perfectible sur certains points.
III. UN RÉGIME D’INDEMNISATION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ENCORE PERFECTIBLE
Compte tenu des différents avantages qu’il présente pour les victimes (régime de responsabilité de plein droit, procédure spécifique de règlement amiable), le régime d’indemnisation des accidents médicaux et, par conséquent, des infections nosocomiales fait l’objet d’un jugement globalement positif, en dépit de certaines imperfections, de la part des représentants des associations de victimes, résumé en ces termes par Mme Claude Rambaud, présidente du LIEN : « Le dispositif d’indemnisation des accidents médicaux, même imparfait, est considéré comme une bonne démarche par les représentants des usagers et des associations. Il donne accès à l’indemnisation par une procédure simplifiée. Gratuit, il permet une indemnisation très rapide au regard des procédures contentieuses. Rien n’oblige la victime à accepter une proposition insuffisante. Par ailleurs, sans CRCI, nombreuses sont les victimes qui n’auraient jamais eu réparation de leurs préjudices. Appelé à améliorations – il faut lui reconnaître sa jeunesse – , nous ne doutons pas qu’il devienne un outil performant pour une juste indemnisation de victimes, nous l’espérons, de moins en moins nombreuses » (130).
Lors de l’examen par l’Assemblée nationale de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, le rapporteur du texte et membre de la mission, M. Jean-Pierre Door, avait insisté sur le fait que « ce texte d’urgence, de compromis également entre les demandes des uns et des autres, permet de sauvegarder l’essentiel et devrait permettre de conserver une continuité de la couverture assurancielle du secteur de la santé au 1er janvier prochain. Il ne règle pas pour autant au fond l’ensemble des questions qui se posent, tant économiquement que juridiquement, en matière de responsabilité civile médicale. Il devra donc être revu dès l’an prochain, pour assurer sa viabilité à plus long terme » (131).
Si le souhait de révision à bref délai du dispositif d’indemnisation des infections nosocomiales de notre collègue n’a pas été exaucé, le travail d’évaluation du dispositif qu’il avait estimé nécessaire a pu être réalisé par la mission d’information commune sur l’indemnisation des victimes d’infections nosocomiales et l’accès au dossier médical, avec un recul suffisant pour juger de la pertinence du dispositif mis en place. Les travaux de la mission ont ainsi permis de faire apparaître six aspects du dispositif d’indemnisation des infections nosocomiales pouvant mériter un réexamen à la lumière des six années de fonctionnement de celui-ci :
– la question de la définition des infections nosocomiales indemnisables (A) ;
– la question du champ d’application du régime de responsabilité de plein droit, que la mission estime aujourd’hui trop restreint (B) ;
– la question du champ de compétence des CRCI dans leur mission de règlement amiable (C) ;
– l’accompagnement des victimes, qu’un grand nombre des personnes entendues par la mission s’est accordé à trouver insuffisant (D) ;
– la question du déroulement des expertises et de l’évaluation des préjudices (E) ;
– les difficultés de certaines victimes à obtenir la mise en œuvre des avis d’indemnisation des CRCI (F).
A. UNE DÉFINITION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES INDEMNISABLES INSUFFISAMMENT PRÉCISE
Le régime d’indemnisation des infections nosocomiales qui a fait l’objet des travaux de la présente mission a été défini par la loi du 4 mars 2002. Mais s’il a défini à quelles conditions ces infections pouvaient être indemnisées, le législateur s’est abstenu de donner une définition des infections nosocomiales. Cette abstention a résulté d’un choix délibéré du Parlement. En effet, alors que le Sénat avait introduit dans le projet de loi des définitions des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (132), M. Claude Évin, rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale, avait obtenu leur suppression au stade de la commission mixte paritaire, en faisant valoir que ces définitions « risquent d’être trop restrictives et donc d’être défavorables tant aux victimes qu’aux médecins. Il s’agit d’une définition médicale qui n’a pas sa place ici, dans une logique contentieuse, où la jurisprudence devra statuer compte tenu des cas concrets » (133). Lors de son audition, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports, a défendu ce choix de ne pas définir dans la loi une notion médicale, car une définition légale de l’infection nosocomiale aurait eu le grave inconvénient d’enfermer le droit à indemnisation des victimes dans les limites des connaissances scientifiques au jour de l’adoption de la loi (134).
Cependant, plusieurs des personnes entendues par la mission ont estimé que le régime d’indemnisation des infections nosocomiales souffrait de cette absence de définition légale. En effet, cette absence de définition légale a conduit naturellement la jurisprudence à faire œuvre créatrice. Or, en jurisprudence, le problème n’est pas de savoir ce qui est nosocomial ou non : il est couramment admis qu’est nosocomiale l’infection développée dans les quarante-huit heures suivant un séjour dans un établissement de santé. La définition la plus généralement retenue de l’infection nosocomiale est la définition de l’infection associée aux soins (IAS) émise par le Comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins (CTINILS) : « Une infection est dite associée aux soins si elle survient au cours ou au décours d’une prise en charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative) d’un patient, et si elle n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge. (…) L’infection associée aux soins (IAS) englobe tout événement infectieux en rapport plus ou moins proche avec un processus, une structure, une démarche de soins, dans un sens très large. L’IAS comprend l’infection nosocomiale, au sens de contractée dans un établissement de santé, et couvre également les soins délivrés en dehors des établissements de santé. Le critère principal définissant une IAS est constitué par la délivrance d’un acte ou d’une prise en charge de soins au sens large (à visée diagnostique, thérapeutique, de dépistage ou de prévention primaire) par un professionnel de santé ou le patient ou son entourage, encadrés par un professionnel de santé » (135).
En revanche, l’incertitude porte sur la question de savoir quelles infections nosocomiales sont indemnisables et lesquelles ne le sont pas : les représentants des assureurs ont fait valoir que la définition retenue par la jurisprudence était trop extensive en ce qu’elle ne distinguait pas les infections nosocomiales selon qu’elles sont résistibles ou irrésistibles. De ce fait, est mis à la charge des établissements de santé un risque qu’ils ne peuvent pas maîtriser, sachant que près de 70 % des infections nosocomiales seraient irrésistibles (136). En conséquence, les assureurs ont souhaité un recentrage de la définition des infections nosocomiales aux seules infections qui sont la conséquence des soins, à l’exclusion de celles uniquement développées à l’occasion d’une hospitalisation. Le docteur Benoît Guimbaud, responsable de la direction médicale et des sinistres de la SHAM a en outre proposé que les infections nosocomiales irrésistibles soient prises en charge par la solidarité nationale, au titre de ce qui pourrait être qualifié d’« aléa nosocomial » (137).
Par ailleurs, M. Nicolas Gombault, directeur général du Sou médical, a souligné l’existence d’une divergence de définition des infections nosocomiales entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif : alors que le juge administratif refuse d’indemniser les infections nosocomiales d’origine endogène, c’est-à-dire causées par un germe dont le patient était porteur et développées à l’occasion d’une hospitalisation en considérant qu’elles relèvent de la cause étrangère exonératoire, le juge judiciaire accepte d’indemniser toute infection nosocomiale, qu’elle soit d’origine endogène ou exogène (138). Cette différence d’appréciation de la notion de cause étrangère et, par conséquent, du caractère indemnisable ou non indemnisable d’une infection nosocomiale, selon le lieu où celle-ci a été contractée apparaît choquante. Elle est d’autant plus choquante que l’un des buts du législateur de 2002 était d’unifier le régime d’indemnisation applicable aux infections nosocomiales, afin qu’une victime ne soit pas différemment traitée selon le caractère public ou privé du lieu où elle a été hospitalisée.
La mission a été particulièrement attentive à ces critiques concernant la définition des infections nosocomiales : elle considère que l’absence de définition légale des infections nosocomiales indemnisables crée indéniablement une difficulté, cette difficulté étant aggravée par la dualité d’ordres de juridictions compétents.
Si la mission considère que la question de la définition des infections nosocomiales pouvant donner lieu à indemnisation doit être posée, elle n’a en revanche pas estimé justifié de revenir sur la répartition de la charge de l’indemnisation des infections nosocomiales entre les assureurs et la solidarité nationale. En effet, la répartition actuelle attribuant la charge de l’indemnisation aux établissements de santé pour les infections nosocomiales les moins graves et à la solidarité nationale pour les dommages les plus graves apparaît comme satisfaisante : l’indemnisation de l’aléa au titre de la solidarité nationale ne peut se concevoir que pour les dommages les plus graves. Or, l’idée de transférer la charge de dommages de faible gravité liés à un « aléa nosocomial » conduirait à alourdir excessivement la charge pesant sur la solidarité nationale, dont la vocation n’est d’intervenir que pour les dommages les plus handicapants.
En revanche, la mission a estimé nécessaire de remédier aux incontestables difficultés créées par l’absence de définition légale des infections nosocomiales indemnisables et par la dualité des interprétations jurisprudentielles retenues. À cette fin, la mission préconise que les infections nosocomiales indemnisables soient plus clairement définies, en excluant explicitement du champ des infections nosocomiales indemnisables les infections irrésistibles. Une telle intervention législative aura un double intérêt :
— elle permettra de mettre fin aux incertitudes et à la dualité d’interprétations jurisprudentielles sur les infections nosocomiales pouvant donner lieu à indemnisation ;
— elle permettra de rééquilibrer le régime d’indemnisation des infections nosocomiales dans le sens de l’équité, en ne faisant pas supporter aux établissements et à leurs assureurs la charge de l’indemnisation d’infections irrésistibles qu’il leur était impossible d’empêcher, tout en préservant le droit à indemnisation des victimes pour toutes les infections directement causées par un acte de prévention, de diagnostic ou de soins que les établissements pouvaient et devaient prévenir par les mesures d’asepsie et d’hygiène adaptées.
Proposition n° 9
Clarifier et unifier la définition des infections nosocomiales indemnisables, en excluant de leur champ celles pouvant être considérées comme irrésistibles.
B. UN CHAMP D’APPLICATION DU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DE PLEIN DROIT TROP RESTREINT
La loi du 4 mars 2002 a soumis les établissements de santé et les professionnels de santé à un régime différent de responsabilité en matière d’infections nosocomiales. Alors que la jurisprudence judiciaire antérieure à la loi du 4 mars 2002 soumettait les cliniques et les praticiens libéraux au même régime de responsabilité objective pour manquement à une obligation de sécurité de résultat, les infections contractées en médecine de ville sont désormais exclues du régime de responsabilité de plein droit prévu par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et relèvent du régime de responsabilité pour faute. En l’absence de faute, une victime d’une infection associée aux soins (139) contractée au cours d’une intervention pratiquée dans un cabinet libéral ne pourra être indemnisée que si elle établit une faute, alors qu’elle aurait été indemnisée de plein droit si cette même intervention avait été réalisée dans un établissement de santé.
Cependant, certains actes médicaux invasifs ne nécessitant pas une hospitalisation – par exemple en dermatologie ou en matière de chirurgie dentaire – peuvent être réalisés indifféremment en médecine de ville ou dans un établissement de santé. Si une infection survient, la victime sera traitée différemment selon le lieu où l’intervention a été réalisée : très favorablement si l’intervention a eu lieu en établissement de santé par la mise en œuvre d’un régime de responsabilité de plein droit, très défavorablement si l’intervention a eu lieu dans un cabinet libéral par la nécessité d’établir une faute du praticien. Cette différence de traitement de victimes ayant subi un même acte a amené la mission à s’interroger sur la question de savoir si le champ d’application du régime de responsabilité de plein droit ne devrait pas être étendu aux infections contractées en médecine de ville.
M. Alain-Michel Ceretti, chargé de mission sur la santé auprès du Médiateur de la République, et le docteur Benoît Guimbaud ont tous deux jugé la différence de régime instituée par la loi du 4 mars 2002 sans fondement (140). Cependant, leurs conclusions et leurs préconisations sont, de façon aisément compréhensible, opposées. Alors que le docteur Benoît Guimbaud, responsable de la direction médicale et des sinistres de la SHAM, a estimé que l’application d’un régime de responsabilité de plein droit des établissements de santé à toutes les infections nosocomiales, y compris irrésistibles, était déraisonnable pour les établissements de santé et de nature à mettre en péril leur assurabilité, M. Alain-Michel Ceretti a estimé que cette distinction opérée par la loi était inéquitable pour les victimes d’une infection contractée dans un cabinet libéral et a plaidé pour la mise en place d’un régime unique de responsabilité de plein droit pour les établissements et les professionnels de santé. Il a particulièrement fait valoir que si les IAS restent rares en médecine de ville à l’heure actuelle, des difficultés risquaient d’apparaître dans les prochaines années avec le développement de l’hospitalisation à domicile (HAD). Il a estimé que l’obligation pour ces victimes de prouver une faute pour pouvoir prétendre à une indemnisation les soumettait à une « double peine », celle de l’infection elle-même et celle de l’impossibilité ou de la très grande difficulté à obtenir réparation. Le docteur Walter Vorhauer, secrétaire général du Conseil national de l’Ordre des médecins, a quant à lui qualifié cette situation d’anomalie (141).
Lors de la table ronde organisée par la mission avec les représentants des syndicats de médecins, ceux-ci se sont accordés sur le fait que la prévalence des infections associées aux soins en cabinet libéral était très faible, même si aucune mesure n’était en l’état disponible (142). Le docteur Jean-François Rey, président de l’Union syndicale des médecins spécialistes confédérés Confédération des syndicats médicaux français (U.M.E.SPE/CSMF), a indiqué que ce faible taux tenait pour une grande partie au fait que peu de gestes techniques et invasifs étaient réalisés en cabinet de ville. Malgré cette prévalence vraisemblablement faible, les représentants des syndicats de médecins ne se sont pas déclarés a priori hostiles à une extension du régime de responsabilité de plein droit aux infections contractées chez un professionnel de santé, une telle mesure leur ayant semblé pouvoir se justifier par souci d’équité entre les victimes (143). Le docteur Walter Vorhauer, secrétaire général du Conseil national de l’Ordre des médecins, a souligné que l’extension du régime de responsabilité de plein droit aux infections contractées en médecine de ville pourrait être justifiée par le fait que, dans la mesure où les actes réalisés en médecine de ville sont par définition moins invasifs que ceux réalisés en établissements de soins, la survenance d’une infection permettait généralement de présumer qu’une faute d’asepsie a été commise.
Cependant, les représentants des syndicats de médecins ont insisté sur le fait qu’une extension du régime de responsabilité de plein droit aux infections contractées en médecine de ville comportait un risque d’augmentation des primes d’assurance pour les médecins qui pourrait être sans commune mesure avec la réalité du risque nosocomial en cabinet libéral. Une telle augmentation serait en outre susceptible d’avoir des répercussions négatives en termes de démographie médicale, au détriment de la couverture médicale du territoire et de la densité du réseau de soins. Dès lors, quel intérêt auraient les patients à savoir qu’ils seraient indemnisés de plein droit en cas d’infection survenue dans un cabinet de ville, s’ils ne peuvent plus trouver de praticiens dans certaines spécialités ?
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la mission préconise d’étendre le régime d’indemnisation de plein droit aux infections associées aux soins contractées en médecine de ville, tout en soulignant que cette extension nécessite que deux conditions préalables soient remplies. Tout d’abord, il convient de mettre en place une évaluation du risque nosocomial en cabinet libéral et une politique de lutte contre ce risque, afin de permettre d’appréhender avec précision les conséquences que pourrait avoir une évolution du régime de responsabilité et de limiter autant que faire se peut ce risque : tel est l’objet de la proposition n° 8 formulée précédemment par la mission. En second lieu, pour que le risque d’augmentation excessive des primes d’assurance lié à l’extension du régime de responsabilité de plein droit ne devienne pas réalité, au détriment de la démographie médicale et de l’intérêt des patients, il apparaît nécessaire que les conséquences assurantielles de cette extension soient préalablement évaluées, en concertation avec les professionnels de santé, les établissements et les assureurs. Cette concertation devra permettre de régler définitivement le problème de la responsabilité civile professionnelle des soignants, afin de garantir la possibilité pour chaque professionnel de santé de s’assurer à un tarif raisonnable.
Proposition n° 10
Étendre le régime d’indemnisation de plein droit aux infections associées aux soins contractées en médecine de ville, sous réserve d’une concertation préalable sur les conséquences de cette extension en matière d’assurance.
C. UN CHAMP DE COMPÉTENCE DES COMMISSIONS RÉGIONALES DE CONCILIATION ET D’INDEMNISATION DANS LEUR MISSION DE RÈGLEMENT AMIABLE PROBLÉMATIQUE
Les CRCI peuvent exercer deux missions : une mission de conciliation, accessible à toutes les victimes d’un dommage subi du fait d’une intervention médicale et quelle que soit la gravité de ce dommage, d’une part, et une mission de règlement amiable, accessible uniquement aux victimes dont le dommage atteint une certaine gravité, d’autre part. Or, il est apparu que ce double rôle des CRCI posait une double difficulté : tout d’abord, ces critères d’accès aux CRCI dans leur mission de règlement amiable apparaissent trop restrictifs ; ensuite, la fonction de conciliation est présentée par l’ensemble des personnes entendues par la mission comme un échec.
1. Des critères d’accès aux commissions régionales de conciliation et d’indemnisation trop restrictifs
Ces seuils de gravité, dont l’existence est prévue par la partie législative du code de la santé publique (article L. 1142-1), sont définis dans la partie réglementaire du même code (article D. 1142-1). Pour pouvoir saisir la CRCI, la victime doit avoir subi :
– soit une incapacité permanente partielle supérieure à 24 % ;
– soit un arrêt temporaire des activités professionnelles ou un déficit fonctionnel temporaire de six mois consécutifs ou de six mois non consécutifs sur une période de douze mois ;
– soit, « à titre exceptionnel », une incapacité définitive à exercer sa profession antérieure ou des troubles d’une particulière gravité dans les conditions d’existence.
Initialement, l’institution de ces seuils trouvait sa justification dans la raison d’être des CRCI lors de leur création : améliorer la situation des victimes des dommages médicaux les plus lourds, en leur réservant une voie procédurale simple, rapide, gratuite et non contentieuse. Cependant, ces seuils présentent l’inconvénient de toute mesure tendant à limiter le bénéfice d’un régime donné, celui d’exclure un nombre non négligeable de victimes ayant subi des dommages dont la réalité est incontestable et qui peuvent également ouvrir droit à indemnisation.
Les conditions d’accès aux CRCI dans leur mission de règlement amiable sont-elles trop restrictives ? Pour répondre à cette question, le premier point sur lequel il convient d’insister est l’indéniable effet d’exclusion des seuils de gravité retenus, effet relevé par la CNAMed dans chacun de ses rapports annuels. Ainsi, en 2008, sur les 3 534 demandes de règlement amiable reçues par les CRCI, 962 ont été rejetées sans expertise, dont plus de la moitié (523) parce que le seuil de gravité requis n’était manifestement pas atteint. À ces cas de rejet sans expertise, viennent s’ajouter 405 rejets après expertise également motivés par le fait que le seuil de gravité exigé n’est pas atteint. Un quart des demandes présentées aux CRCI (928 sur 3 534, soit 26 %) sont donc rejetées en raison d’une gravité insuffisante au regard des critères légaux et réglementaires (144).
Indiscutable, car voulu pour assurer aux CRCI une efficacité maximale dans leur mission auprès des victimes des dommages les plus graves, cet effet de seuil soulève néanmoins la question de sa légitimité. Tout au long des travaux de la mission, la question « où faut-il placer le curseur de l’accès aux CRCI ? » a été l’une de ses principales interrogations.
Les critiques à l’encontre des seuils retenus concernent chacun des critères prévus par l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, qu’il convient d’examiner successivement.
a) Le critère de l’incapacité permanente partielle
Le critère le plus largement critiqué est, sans doute possible, celui de l’incapacité permanente partielle. Ce critère est tout d’abord contesté, sur un plan de logique et de cohérence du droit, en raison du taux de 24 % retenu. En effet, alors que l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique prévoit que le préjudice résultant d’une infection nosocomiale peut être indemnisé au titre de la solidarité nationale s’il a entraîné une incapacité permanente partielle supérieure à 25 % et que le II de l’article L. 1142-1 prévoit que l’accès aux CRCI est ouvert aux victimes ayant subi une incapacité permanente partielle supérieure à un taux fixé par décret « au plus égal à 25 % », le pouvoir réglementaire a retenu un taux d’accès aux CRCI de 24 %, inférieur d’un point au cas d’indemnisation par la solidarité nationale prévu par l’article L. 1142-1-1. Ainsi, si le fait d’avoir retenu ce taux de 24 % se révèle favorable à une victime ayant perdu l’usage d’un œil, préjudice dont le taux d’incapacité permanente partielle est fixé à 25 % par l’annexe 11-2 du code de la santé publique (145), puisqu’il lui permet de saisir la CRCI d’une demande de règlement amiable, il la conduit à devoir demander indemnisation non pas au titre de la solidarité nationale mais auprès de l’assureur de l’établissement responsable. Cette différence d’un point peut sembler anecdotique, mais elle apparaît comme une source supplémentaire de complexité du régime qu’il serait extrêmement souhaitable, a minima, de gommer.
Outre cette bizarrerie, le seuil d’incapacité permanente partielle retenu est surtout critiqué car il conduit à exclure du bénéfice de l’accès aux CRCI un certain nombre de victimes de dommages qu’il paraît difficile de ne pas considérer comme graves. Par exemple, la perte totale du grip fin de la main dominante ou une amputation des quatre derniers doigts sans perte du pouce de la main dominante, qui apparaissent indéniablement comme fortement handicapantes dans la vie quotidienne, ne sont évalués, aux termes du barème précité, qu’à une incapacité permanente partielle de 20 %. M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République, a estimé que le seuil actuel était beaucoup trop élevé et écartait la majorité des victimes, rappelant par exemple que, parmi les 60 victimes de la clinique du sport, seules 2 avaient une incapacité permanente partielle supérieure à ce seuil (146).
b) Le critère de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou du déficit fonctionnel temporaire
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, l’article L. 1142–1 prévoyait que le caractère de gravité du préjudice pouvant donner accès au dispositif des CRCI devait être fixé par décret et « apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail » Le deuxième critère pouvant ouvrir accès aux CRCI était donc celui de l’incapacité temporaire de travail (ITT). En application de cette disposition, l’article D. 1142–1 prévoit qu’« un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l’article L. 1142-1 lorsque la durée de l’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois ».
Ce critère de l’incapacité temporaire de travail n’apparaissait en soi pas contestable, puisque l’arrêt de travail a été de longue date un mode traditionnel et commode d’évaluation des préjudices en droit français. Ainsi, en matière pénale, la peine encourue en cas de violences est-elle fonction de la durée de l’incapacité temporaire de travail subie par la victime. En revanche, en matière d’accès aux CRCI, le problème n’est pas tant venu du choix d’utiliser l’incapacité temporaire de travail comme critère d’accès mais plutôt de l’interprétation restrictive qui a été retenue de cette notion : « Dès l’origine, cette référence [à l’incapacité temporaire de travail] a fait l’objet d’interprétations différentes selon les CRCI, certaines la considérant comme une incapacité personnelle, d’autres la considérant comme une notion à caractère professionnel. En définitive, c’est l’interprétation restrictive qui a prévalu, son application étant limitée aux seules personnes qui ont une activité professionnelle, qu’elles soient ou non salariées ; celle-ci exclut les personnes à la retraite, les chômeurs, les enfants, les femmes au foyer… » (147).
Les associations se sont montrées extrêmement critiques à l’égard de cette interprétation sévère de l’incapacité temporaire de travail faite par les CRCI : « Le seuil relatif à l’incapacité de travail totale ne permet d’accéder au dispositif d’indemnisation qu’aux seuls cas d’incapacités temporaires de travail, excluant ipso facto un grand nombre de victimes : une femme au foyer, un étudiant ou un retraité n’ont pas droit à l’incapacité temporaire de travail ! » (148). En conséquence, le Collectif interassociatif pour la santé (CISS) a considéré que « l’incapacité de travail totale [devait] s’entendre au sens fonctionnel du terme, c’est-à-dire une incapacité temporaire totale ».
La mission d’information commune sur l’indemnisation des victimes d’infections nosocomiales et l’accès au dossier médical a entièrement partagé l’appréciation faite par les associations de victimes du caractère injuste de cette interprétation restrictive de la notion d’incapacité temporaire de travail. Cependant, ces critiques pleinement fondées n’ont pas même eu besoin d’être relayées par la présente mission pour trouver rapidement un écho auprès du législateur avant même la fin de ses travaux, puisque l’article 112 de la loi du 12 mai 2009 précitée a remplacé, dans l’article L. 1142–1 du code de la santé publique, les mots : « durée de l’incapacité temporaire de travail » par les mots : « durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles [ou] du déficit fonctionnel temporaire ». Dans son rapport, notre collègue Étienne Blanc avait souligné que cette modification permettrait « d’harmoniser la prise en compte des différents postes de préjudice corporel par les commissions régionales ou interrégionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI et CICI), en conférant valeur législative aux catégories de préjudices proposées en 2005 par le rapport du groupe de travail présidé par M. Jean-Pierre Dintilhac chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels » (149). Ajoutons que cette modification terminologique permettra de ne plus limiter l’accès aux CRCI aux seules personnes disposant d’un travail et subissant une incapacité temporaire de travail de plus de six mois, mais d’inclure dans le dispositif les personnes n’exerçant pas ou plus d’emploi.
La modification de l’article L. 1142–1 du code de la santé publique qui conduit à la disparition de la notion d’incapacité temporaire de travail devra être relayée sans délai dans l’article D. 1142–1, afin d’éviter tout flottement dans la mise en œuvre par les CRCI des nouveaux critères. Les membres de la mission s’assureront que le décret nécessaire soit pris avant la fin de l’année 2009, à défaut de quoi ils saisiront le ministre de la santé d’une demande officielle en ce sens.
c) Les critères exceptionnels de l’incapacité à exercer son activité professionnelle antérieure et des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence
Outre ces deux critères principaux de l’incapacité permanente partielle et de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou le déficit fonctionnel temporaire, l’article D. 1142-1 a prévu deux critères supplémentaires que l’ensemble des personnes intéressées entendues par la mission a présentés comme des critères de « rattrapage ». Conscient des inévitables effets de seuil induits par la mise en œuvre des deux critères précédents et de l’injustice de l’exclusion de certaines victimes de l’accès aux CRCI, le pouvoir réglementaire a ouvert une marge de manœuvre aux CRCI pour permettre à des victimes ne remplissant pas l’une des conditions susvisées de les saisir, voire de bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale. Le caractère subsidiaire de ces critères est attesté par les termes mêmes de l’article D. 1142-1, qui prévoit que « À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
« 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
« 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. »
Le premier de ces deux critères, l’inaptitude définitive à exercer son activité professionnelle antérieure, n’appelle que peu de commentaires et n’a suscité que peu de remarques au cours des travaux de la mission, en raison de son caractère objectif : la question de savoir si la victime est ou n’est pas définitivement inapte à exercer son activité professionnelle antérieure n’appelle a priori pas de discussion. Si la réponse est oui, elle peut saisir la CRCI et bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; dans le cas contraire, elle ne pourra saisir la CRCI et, le cas échéant, être indemnisée au titre de la solidarité nationale, que si elle satisfait à l’un des autres critères prévus par les textes. En outre, la faiblesse du nombre de cas où ce critère est utilisé explique sans doute le peu d’intérêt qu’il suscite : en 2008, seuls 12 dossiers d’accidents médicaux largo sensu (accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale) ont donné lieu à un avis d’indemnisation fondé sur l’incapacité à exercer son activité professionnelle antérieure sur un total de 1 321 avis positifs, soit 0,9 % des avis positifs.
En revanche, le second critère subsidiaire, celui des « troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence » a suscité beaucoup plus d’attention au cours des travaux de la mission, en raison de la subjectivité qui préside nécessairement à sa mise en œuvre. Ainsi, la CNAMed a-t-elle pu écrire que ce critère est celui laissant « la plus grande marge d’appréciation aux CRCI (…). Outre leur caractère de gravité, pour être reconnus, [les troubles] doivent être liés aux soins et entraîner des répercussions physiques – nécessité de réinterventions nombreuses, traitement lourd durant plusieurs années –, matérielles – éloignement du domicile, changement de cadre de vie, aménagements nécessaires du domicile – ou psychologiques, telles que dépression réactionnelle (par exemple à la suite de la perte d’un enfant avant la naissance, à la suite d’une incontinence anale…), désocialisation, etc. » (150).
Lors de son audition par la mission, M. Alain-Michel Ceretti, chargé de mission sur la santé auprès du Médiateur de la République a estimé que la fonction de rattrapage que ce critère était censé jouer n’était pas assurée, à cause des termes de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique prévoyant que ces deux critères ne peuvent être mis en œuvre qu’« à titre exceptionnel ». Or, selon lui, ce caractère exceptionnel ne serait que trop rarement admis par les CRCI, ce qu’attesterait le taux global de rejet des demandes par les CRCI : sur 3 512 avis rendus en 2008, 1 321 (soit 37,6 %) sont des avis positifs, mais 2 550 (soit 63,4 %) sont des avis négatifs, dont 962 sans expertise et 1 229 après expertise (151). M. Marc Morel, directeur du Collectif interassociatif sur la santé (CISS) a également estimé que si certaines CRCI se montrent relativement souples dans l’appréciation de ce critère des troubles particulièrement graves dans l’existence, d’autres se montrent très restrictives et rejettent le rôle d’harmonisation de la CNAMed en la matière (152).
De façon strictement objective, cette critique n’apparaît pas entièrement fondée au vu de l’examen des avis d’indemnisation rendus par les CRCI : si les données fournies par les CRCI et assemblées par la CNAMed ne permettent pas de savoir sur le fondement de quel critère une CRCI a admis la recevabilité d’une demande, ils permettent en revanche de connaître la répartition des critères de gravité admis pour rendre un avis d’indemnisation. Certes, en théorie, le motif ayant conduit à ouvrir l’accès de la CRCI à une victime peut être différent de celui conduisant à son indemnisation : une victime peut voir sa demande examinée au titre d’une incapacité permanente partielle supérieure à 24 % mais ne pas être indemnisée sur ce fondement s’il apparaît après expertise que l’incapacité permanente partielle n’a été que partiellement causée par l’infection nosocomiale ; elle pourra toutefois être indemnisée sur le fondement de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou du déficit fonctionnel temporaire – antérieurement à la loi du 12 mai 2009, de l’incapacité temporaire de travail – si, entre le dépôt de la demande et son examen au fond, la condition de six mois d’arrêt ou de déficit a été réalisée, ou au titre des troubles graves dans les conditions d’existence. Mais en pratique, le motif d’indemnisation est fréquemment le même que celui qui avait conduit la CRCI à estimer la demande recevable. Ainsi, en 2008, 251 des 1 321 avis d’indemnisation, soit 19 % du total, ont été rendus au titre de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence. Le critère des troubles graves dans les conditions d’existence est certes moins utilisé que ceux du décès (18 %), de l’incapacité permanente partielle (25 %) et de l’incapacité temporaire de travail (36 %), mais il ne semble pas possible d’estimer que ce critère ne soit qu’exceptionnellement utilisé.
Au vu de ces données chiffrées, il semble donc que ce critère des troubles particulièrement graves soit bel et bien fréquemment utilisé par les CRCI, pour permettre leur saisine par des victimes ne remplissant pas les conditions objectives de l’un des autres critères mais pour lesquelles l’accès à la CRCI apparaît, en équité, justifié au regard des troubles qu’elles ont à endurer. Mais la question de savoir si ce critère pourrait être plus largement utilisé ne peut être tranchée par le seul examen des statistiques des dossiers traités par les CRCI. Le ressenti des victimes a aussi, en la matière, son importance : la mission conçoit que l’emploi des termes « à titre exceptionnel » soit susceptible de faire naître le sentiment que les critères qu’il prévoit ont vocation à n’être mis en œuvre que selon le bon vouloir des CRCI, alors même qu’une réelle jurisprudence de ce que sont les troubles graves dans les conditions d’existence s’est mise en place.
2. L’échec de la fonction de conciliation des commissions régionales de conciliation et d’indemnisation
Les critères de gravité fixés par le code de la santé publique pour l’accès aux CRCI dans leur fonction de règlement amiable jouent bien une fonction d’exclusion des victimes des préjudices les moins graves. Les victimes de ces préjudices qui soit ne saisissent pas la CRCI en sachant qu’elles ne remplissent pas les critères requis, soit voient leur demande déclarée irrecevable par la CRCI, sont donc confrontées à une alternative :
– saisir une juridiction pour obtenir réparation, mais l’on a vu que nombre d’entre ces victimes hésitaient à utiliser cette voie en raison de sa lenteur et de ses coûts ;
– ou saisir la CRCI d’une demande de conciliation.
L’existence de seuils de gravité pour l’accès à la fonction de règlement amiable ne poserait pas, en soi, de difficulté, si la fonction de conciliation permettait aux victimes d’obtenir effectivement une indemnisation à laquelle elles peuvent légitimement prétendre : en effet, ce n’est pas parce que le préjudice n’atteint pas le seuil de gravité pour être indemnisé au titre de la solidarité nationale qu’il n’est pas indemnisable par l’assureur de l’établissement, au titre du régime de responsabilité de plein droit. Cependant, cette fonction de conciliation est considérée par tous comme un échec : les victimes, sachant que leurs chances d’obtenir une indemnisation par la voie de la conciliation sont faibles, s’en détournent naturellement. Seule la fonction de règlement amiable des CRCI a, aujourd’hui, une réalité, mais pour les seules victimes qui remplissent les conditions d’accès.
Ainsi, le nombre de demandes de conciliation initiales est extrêmement faible comme l’a souligné la CNAMed dans son dernier rapport annuel : « Au total, 3 534 demandes de règlement amiable en vue d’indemnisation et 45 demandes initiales de conciliation ont été reçues. Il se confirme donc, d’une part, que dans la quasi-totalité des cas, les demandeurs saisissent les CRCI en vue d’une indemnisation pour un accident médical dont ils estiment être victimes et, d’autre part, que les demandes initiales de conciliation représentent moins de 1 % de ces demandes d’indemnisation » (153). Ce faible nombre de demandes de conciliation reçues en 2008 confirme la pente des années précédentes : 12 demandes en 2004, 57 en 2005, 19 en 2006, 24 en 2007.
En outre, lorsqu’une conciliation est engagée après rejet d’une demande d’indemnisation en règlement amiable, très peu aboutissent à une transaction : « Lorsqu’une commission estime la demande irrecevable parce que les dommages ne présentent pas le caractère de gravité prévu par la loi (…), elle doit informer le demandeur de la possibilité qu’il a de saisir la formation de conciliation (…). Celle-ci a été sollicitée dans 222 cas (contre respectivement 193 et 259 en 2007 et 2006). Il s’agissait presque exclusivement d’une demande d’indemnisation (98 %), les autres litiges (…) n’ayant donné lieu qu’à 6 demandes. Il a été fait appel à un médiateur extérieur dans 64 % des cas, à un ou plusieurs membres de la commission dans 29 % des cas, à l’ensemble de la commission dans 7 % des cas ; contrairement à l’an dernier, aucun dossier n’a été transmis à un conseil départemental de l’ordre des médecins. Les conclusions sont connues pour 114 dossiers : 15 accords totaux, 5 accords partiels et 94 constats de non-conciliation » (154).
Quant aux raisons de cet échec, M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République, a estimé que la fonction de conciliation que la loi attribue aux CRCI ne fonctionne pas parce que les assureurs ne jouent que trop rarement le jeu de la conciliation. M. Martial Mettendorff, secrétaire général de la direction générale de la santé, a quant à lui estimé que la difficulté provenait d’un problème d’identification de cette fonction de conciliation par les victimes, les CRCI étant avant tout perçues comme des instances devant rendre un avis sur un droit à indemnisation et non jouer un rôle de conciliation (155).
Plus mesuré sur le constat d’échec de la fonction des CRCI, le docteur Benoît Guimbaud, responsable de la direction médicale et des sinistres de la SHAM, a indiqué qu’il était fréquent que les assureurs, après qu’une expertise a conclu à la responsabilité d’un établissement mais que la CRCI a rendu un avis d’incompétence en raison d’une gravité insuffisante du préjudice subi, transigent directement avec la victime sans conciliation de la CRCI. À l’opposé, si l’expertise conclut à l’absence de responsabilité, il s’est interrogé sur le sens que pourrait avoir une conciliation. Il a estimé que la volonté systématique de faire intervenir un tiers par le biais d’une conciliation n’était pas opportune, les assureurs ayant intérêt à la transaction pour éviter les contentieux à chaque fois que le droit à indemnisation de la victime ne fait pas de doute à la lumière de l’expertise (156).
M. Olivier Jardé, député de la Somme, a dressé ce même constat d’échec de la fonction de conciliation des CRCI : dans l’exposé des motifs d’une proposition de loi qu’il a déposée pour développer la fonction de conciliation, il estime que les CRCI « ont échoué dans leur mission de conciliation, et n’ont en rien ralenti la prolifération désordonnée du contentieux, ce qui est non seulement préjudiciable aux intérêts des usagers, contraints d’emprunter la voie judiciaire pour faire reconnaître leurs droits, mais expose en outre les professionnels de santé à une insécurité juridique peu propice à l’exercice de leur mission » (157). Afin de donner un réel contenu à cette fonction de conciliation, il a proposé que la conciliation soit un préalable obligatoire à toute saisine d’une juridiction.
Cette solution, que la mission a considérée avec intérêt, risquerait cependant de se heurter aux mêmes difficultés que celles existant aujourd’hui : en effet, quand bien même la conciliation serait obligatoire avant toute saisine, les assureurs pourraient être tentés de miser sur un renoncement de la victime à saisir une juridiction après échec de la conciliation et de ne pas s’impliquer dans la conciliation davantage qu’aujourd’hui.
3. Vers une suppression des seuils d’accès aux commissions régionales de conciliation et d’indemnisation ?
Compte tenu des inconvénients présentés par l’existence des seuils de gravité et de l’échec de la fonction de conciliation, la mission s’est interrogée sur la question de savoir si la solution la plus adaptée ne serait pas la suppression pure et simple de tout seuil d’accès aux CRCI.
La principale revendication des personnes entendues en matière de seuils d’accès n’est pas aussi radicale : en effet, les représentants des associations de patients et d’usagers du système de santé ainsi que le Médiateur de la république ont indiqué à la mission qu’ils souhaitaient que le seuil d’accès aux CRCI soit abaissé de 24 à 20 %. Cependant, Mme Françoise Avram, présidente de la CRCI d’Île-de-France, s’est quant à elle prononcée en faveur de la suppression de tout seuil d’accès aux CRCI (158).
Avant d’examiner cette question, la mission souhaite rappeler que, si un abaissement voire une suppression des seuils de gravité requis devait in fine être décidé, il ne devrait concerner que l’accès aux CRCI et non la répartition de la charge de l’indemnisation entre les établissements et la solidarité nationale : de l’avis général des personnes entendues, l’équilibre de la répartition de la charge de l’indemnisation entre la solidarité nationale et les assureurs est satisfaisant. En outre, M. Dominique Martin, directeur de l’ONIAM, a estimé qu’un abaissement du seuil d’indemnisation au titre de la solidarité nationale engendrerait un choc économique important (159). L’évolution dont il est ici question ne concerne donc que le seuil d’accès aux CRCI et non le seuil de prise en charge au titre de la solidarité nationale.
Cette précision apportée, la mission considère naturellement que la mesure d’abaissement ou de suppression du seuil d’accès aux CRCI proposée apparaît a priori comme une mesure équitable. En pure équité, qui pourrait se dire défavorable à une amélioration du sort de victimes d’infections nosocomiales ayant subi des préjudices sévères, mais pas assez au regard du droit positif pour pouvoir bénéficier du dispositif rapide, gratuit et amiable des CRCI ? Cependant, la mission s’est interrogée sur la question de savoir s’il ne s’agissait pas d’une « fausse bonne idée ». En effet, l’abaissement ou la suppression de ce seuil amènerait inévitablement un surplus de dossiers aux CRCI. Sachant que le délai de traitement des dossiers par les CRCI s’est déjà, avec leur champ actuel de compétence, éloigné du délai légal maximal de six mois (le délai moyen était de 10,7 mois en 2008), quel serait l’impact d’un afflux de nouveaux dossiers devant les CRCI ? Or, les statistiques actuellement disponibles ne permettent pas d’évaluer avec précision le nombre de ces dossiers supplémentaires. Lors de son audition par la mission, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports, a exprimé des craintes qu’un abaissement ou une suppression du seuil d’accès aux CRCI ne conduise à allonger les délais de traitement des dossiers par ces commissions, au détriment des victimes des dommages les plus graves (160). Lors de la table ronde des représentants des fédérations d’établissements de santé organisée par la mission, M. Cédric Lussiez, directeur de la communication de la Fédération hospitalière de France, a exprimé les mêmes réserves, ajoutant qu’un tel abaissement pourrait se révéler préjudiciable au public prioritaire des CRCI, à savoir les victimes des dommages les plus lourds. Mme Coralie Cuif, secrétaire générale de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratif, a estimé que les seuils retenus semblaient raisonnables et que la priorité était moins d’étendre la compétence des CRCI que de faire en sorte que le plus grand nombre de patients pouvant y avoir accès fasse usage de cette faculté (161).
La mission partage les inquiétudes exprimées par les personnes entendues d’un engorgement des CRCI, au détriment de la rapidité de traitement des dossiers des victimes des préjudices les plus sérieux. Cependant, compte tenu du succès et de l’efficacité des CRCI dans leur mission de règlement amiable, la mission estimerait justifié que ces avantages soient rendus accessibles à toutes les victimes de dommages liés à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, quelle que soit la gravité des dommages subis. Elle considère en effet qu’un simple abaissement des seuils ne ferait que déplacer le problème en modifiant le curseur de l’effet de seuil, et ne règlerait pas le problème de l’inefficacité de la fonction de conciliation, dont la conséquence est la très grande difficulté pour les victimes des dommages considérés comme légers à obtenir une indemnisation à laquelle elles peuvent prétendre. En conséquence, elle propose de supprimer tout seuil d’accès aux CRCI dans leur fonction de règlement amiable. Une telle solution permettra de réduire l’importance du contentieux en matière médicale et d’aboutir à un règlement amiable d’un nombre accru de dossiers, un tel règlement étant souvent préférable à une procédure contentieuse longue, coûteuse et parfois pénible à vivre tant pour la victime que pour le professionnel de santé mis en cause.
En revanche, pour que cette évolution ne se fasse pas au détriment de l’ensemble des victimes par un allongement des délais de décision des CRCI, la mission préconise que soit menée au préalable une évaluation approfondie de ses conséquences au regard du nombre annuel prévisible de dossiers supplémentaires et que les moyens nécessaires pour absorber ces nouveaux dossiers soient attribués aux CRCI.
Proposition n° 11
Après évaluation des conséquences au regard du nombre annuel prévisible de dossiers supplémentaires et attribution des nouveaux moyens nécessaires, supprimer tout seuil d’accès aux CRCI dans leur mission de règlement amiable.
D. UN ACCOMPAGNEMENT INSUFFISANT DES VICTIMES
Comme la mission l’a indiqué précédemment, le regard porté sur la procédure des CRCI est globalement extrêmement positif, notamment en raison de sa simplicité et de son caractère amiable. Le sentiment général sur cette procédure est parfaitement résumé par M. Dominique Martin, directeur de l’ONIAM : « La procédure mise en place par la loi de 2002 est une procédure amiable. Elle n’a donc pas, ni elle-même ni les institutions qui la composent, de caractère juridictionnel. Elle présente plusieurs caractéristiques qui vont toutes dans le sens de la simplification pour les demandeurs. Elle est pour l’essentiel gratuite, les frais d’expertise notamment ne sont pas à la charge du demandeur. Elle est également rapide, et en tout cas plus rapide que les procédures contentieuses. Enfin, elle est simple : la commission régionale d’indemnisation constitue le guichet unique auquel s’adressent les demandeurs, quel que soit le lieu de l’accident, un établissement de santé privé, un établissement public ou un cabinet médical » (162).
Cependant, l’une des conséquences de cette recherche de la simplicité de la procédure et de l’absence de caractère juridictionnel de la CRCI est que, à la différence d’une procédure juridictionnelle, l’assistance par un avocat n’est pas obligatoire devant la CRCI. Pour autant, une assistance peut s’avérer dans un grand nombre de cas indispensable pour permettre à la victime de faire valoir efficacement ses droits. Ainsi, Maître Alain Garay estime que si « l’accès gratuit aux CRCI constitue un atout de taille (…), cette situation ne doit pas faire illusion dans le cas de dossiers complexes qui appellent, même en cas de saisine de la CRCI, l’intervention d’un avocat, conseil et représentant du demandeur ou du professionnel de santé. Cette intervention a un coût et un prix qui demeurent à la charge des victimes » (163).
L’accompagnement des victimes peut s’avérer nécessaire lors de deux phases essentielles de la procédure devant la CRCI : lors du dépôt de la demande, d’une part, et au cours de l’expertise médicale, d’autre part. Comme l’a souligné Maître Alain Garay, bien qu’elle soit indéniablement plus simple et moins formelle que la saisine d’une juridiction, « la souscription même de la demande est source de technicité. Elle appelle (…) la mise en forme des pièces médicales et hospitalières, objet elle-même d’une difficile recherche en raison des conditions de délivrance du "dossier" du malade (…). D’autre part, nul doute que l’élaboration et l’envoi de la demande à une CRCI seront souvent sources de lacunes et d’insuffisances. (…) De nombreux va-et-vient interviendront entre les parties à la procédure administrative qui ne manqueront pas d’entraîner des retards et des malentendus » (164).
Peut-être davantage encore que pour le dépôt de la demande, l’accompagnement des victimes peut se révéler indispensable lors de la phase de l’expertise, moment clé de la procédure, qui déterminera le droit à indemnisation. Le risque pour le patient de se trouver perdu dans un vocabulaire médical et juridique qui ne lui est pas familier est réel : « Un des points faibles des CRCI réside dans l’accompagnement insuffisant des victimes en expertise ou devant la commission. Cet accompagnement est souhaitable car les victimes ne sont pas toujours aptes à se faire entendre ou à comprendre ce qui leur est dit » (165). L’inégalité des armes entre la victime et l’assureur, représenté par des juristes ou des médecins formés aux questions de responsabilité civile médicale, peut entraîner une perte de chance d’indemnisation sur laquelle il sera difficile de revenir. Ce risque a été parfaitement mis en évidence par la CNAMed dans son rapport annuel 2006-2007 : « Au-delà du respect formel du principe du contradictoire, la question se pose d’assurer l’égalité des armes entre les parties. L’assistance des demandeurs est une question récurrente soulevée chaque année par les présidents [de CRCI]. En effet, tous observent le déséquilibre entre le demandeur et les parties mises en cause, ces dernières étant généralement assistées par un médecin-conseil ou par un avocat. Certes, la procédure devant les CRCI ne requiert pas le ministère d’un avocat et ce sont souvent des proches qui sont aux côtés de la victime ; cette aide qui constitue un appui psychologique précieux ne saurait se substituer aux conseils de professionnels compétents, les présidents s’accordant sur le fait que le demandeur non assisté est démuni pour faire des observations pertinentes aussi bien en matière d’imputabilité que d’évaluation des dommages » (166).
Pour répondre à cette situation, le Médiateur de la République – qui exerce depuis le début de l’année 2009, en vertu d’une convention signée avec la Haute autorité de santé, de nouvelles compétences en matière de santé et de sécurité des soins – formule sur son site Internet des mises en garde et recommandations à destination des victimes de dommages résultant d’actes médicaux : « L’expertise devant la commission est gratuite et la victime n’est pas obligée de recourir à un professionnel du droit (avocat en particulier). Le patient peut effectuer tout le parcours seul, ou assisté d’une association de patients (la loi le prévoit expressément). Ce principe est évidemment louable, mais il appartient à chacun de bien mesurer ses limites et les risques d’assumer, seul, une telle démarche. En effet, peu de victimes sont en mesure de chiffrer leurs préjudices ou de discuter, pied à pied, avec un expert. Comment apprécier une offre d’une compagnie d’assurance, sans aucune référence ? De même, un poste de préjudice « oublié » par un expert et/ou par la commission, c’est plusieurs milliers d’euros, voir plusieurs dizaines de milliers d’euros, qui peuvent s’évanouir. C’est pourquoi, il nous semble important que les victimes qui ne supportent pas les coûts de la procédure amiable s’entourent de professionnels afin de défendre au mieux leurs intérêts » (167).
Nécessaire dans un certain nombre de dossiers, l’assistance des victimes lors de l’expertise ou devant la CRCI est certes possible, comme l’écrit M. Dominique Martin, directeur de l’ONIAM : « Les droits des personnes sont préservés. (…) Si la représentation par un avocat n’est pas obligatoire, contrairement à ce qui se passe devant les juridictions, elle est cependant possible. Dans tous les cas, le contradictoire est respecté, notamment au moment crucial de l’expertise. Enfin, les demandeurs peuvent se faire accompagner, soit par des professionnels, soit par des proches » (168). Mais cette possibilité de représentation reste théorique pour une majorité de victimes dès lors que « seules celles qui en ont les moyens sont assistées par un avocat ou un médecin-conseil. » (169).
Pour faire face à cette difficulté, une mesure d’équité a été prise par l’ONIAM à la demande de M. Xavier Bertrand, alors ministre de la santé, depuis une délibération du conseil d’administration du 28 mars 2007 : désormais, les frais d’assistance des victimes indemnisées au titre de la solidarité nationale sont pris en charge, à concurrence de 700 euros, par l’ONIAM. Cette prise en charge des frais d’assistance est accordée sur présentation de justificatifs ; elle peut concerner aussi bien les médecins conseils que les avocats, mais elle exclut cependant les associations afin d’éviter les risques de subventions déguisées. Pour utile qu’elle soit, cette mesure présente cependant un double inconvénient : d’une part, elle intervient a posteriori, après reconnaissance par la CRCI de la qualité de victime pouvant prétendre à une indemnisation, alors que la victime a déjà pu être dans l’obligation de verser une rémunération au professionnel qui l’a conseillée ; d’autre part, son champ d’application apparaît très restreint, seules les victimes indemnisées au titre de la solidarité nationale pouvant y prétendre.
Pour la grande majorité des victimes qui ne peuvent bénéficier de cette mesure, la difficulté provient du fait que l’aide juridictionnelle ne peut pas être accordée pour l’introduction d’une demande devant une CRCI. En effet, l’article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que « L’aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense, devant toute juridiction (...). Elle peut être accordée pour tout ou partie de l’instance ainsi qu’en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance ». Par ailleurs, l’article 53 de la même loi prévoit que « L’aide à l’accès au droit comporte : (…) 2° L’aide dans l’accomplissement de toute démarche en vue de l’exercice d’un droit ou de l’exécution d’une obligation de nature juridique et l’assistance au cours des procédures non juridictionnelles ».
Si la demande formulée devant une CRCI a indéniablement pour objet de « parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance », ce qui pourrait laisser penser que l’article 10 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridictionnelle pourrait trouver à s’appliquer, cette demande constitue cependant une « procédure non juridictionnelle », qui plus est formulée devant une commission administrative et non une « juridiction » au sens de l’article 10, relevant de ce fait du champ d’application de l’aide à l’accès au droit. En conséquence, l’aide juridictionnelle ne peut pas être accordée aux victimes d’infections nosocomiales à l’occasion de la saisine de cette commission.
À la différence de l’aide juridictionnelle qui relève exclusivement du budget de l’État (crédits de la mission Justice), le financement de l’aide à l’accès au droit est partenarial, reposant sur l’État, les collectivités territoriales et les professions judiciaires. Or ce mode de financement n’a pas permis de mettre en œuvre cette aide à l’assistance d’un avocat dans le cadre des procédures non juridictionnelles telles que celle de la CRCI. Cette carence a d’ailleurs été relevée par la commission de réflexion sur les professions du droit présidée par Maître Jean-Michel Darrois : « Cette politique d’accès au droit ne s’est pas encore traduite, comme le prévoyait le législateur, par la mise en place en lien avec les barreaux d’une assistance effective au cours de procédures non juridictionnelles, notamment devant les commissions administratives ou devant les administrations en vue d’obtenir une décision ou d’exercer un recours préalable obligatoire » (170).
Pour pallier cette impossibilité de bénéficier de l’aide juridictionnelle, des propositions d’amélioration de l’accompagnement des victimes ont été formulées par les associations : « Pour parfaire ce dispositif et le rendre équitable, outre la mise en place des propositions de Xavier Bertrand, notamment celle du versement d’une aide de 700 euros aux victimes reconnues devant l’ONIAM, il serait souhaitable que les plus démunis puissent disposer d’une aide de type judiciaire pour se faire accompagner dès l’expertise » (171). Cette idée de l’assistance des personnes les plus démunies dans les procédures non juridictionnelles a également été formulée par la commission de réflexion sur les professions du droit présidée par Maître Jean-Michel Darrois : « La commission estime que la mise en œuvre d’une assistance effective au cours de procédures non juridictionnelles constitue aujourd’hui un enjeu majeur de la politique d’aide à l’accès au droit susceptible de favoriser le règlement amiable des litiges » (172). Quant au financement de cette aide, la proposition de la commission présidée par Maître Darrois consisterait à créer un fonds d’aide à l’accès au droit géré par un Haut conseil des professions du droit.
Ces propositions de pure équité ne peuvent que recevoir le soutien de la mission, qui préconise en conséquence la mise en place d’une aide à l’assistance devant les CRCI pour les personnes les plus démunies. Compte tenu de la spécificité des demandes formulées devant les CRCI, qui peuvent nécessiter un accompagnement juridique mais aussi un accompagnement par un professionnel de santé qualifié afin de pouvoir répondre aux éléments présentés par les médecins-conseil des compagnies d’assurance, cette aide à l’assistance ne devra pas couvrir uniquement des frais d’assistance par un avocat, mais aussi des frais de conseil médical. Les modalités concrètes de financement de cette aide pourront s’inspirer des propositions formulées par la commission présidée par Maître Darrois, en recherchant un consensus entre les différents financeurs, dans l’intérêt des victimes dont le droit à indemnisation pourra grâce à cette mesure devenir effectif. Une concertation avec les professionnels concernés et une évaluation préalable des conséquences financières de ce dispositif devront naturellement précéder sa mise en place.
Proposition n° 12
Après concertation avec les professionnels concernés et évaluation des conséquences financières, mettre en place une aide à l’assistance juridique et médicale devant les CRCI pour les personnes les plus démunies.
E. UNE QUALITÉ DES EXPERTISES TROP VARIABLE
Comme la mission l’a déjà souligné précédemment, la phase de l’expertise est une phase déterminante dans le traitement d’une demande d’indemnisation. En effet, du déroulement et des conclusions de l’expertise dépend presque intégralement la reconnaissance du droit à indemnisation de la victime. Si la définition des missions d’expertise dépend de la CRCI ou de la juridiction qui la prononce, ces missions demandent généralement à l’expert ou aux experts de se prononcer sur l’existence d’une infection, sur son caractère nosocomial, sur l’imputabilité du dommage à l’infection, sur la détermination du régime d’indemnisation applicable ainsi que sur l’évaluation poste par poste des différents préjudices. Lors de leur audition, M. Nicolas Gombault, directeur général du Sou médical, et le docteur Benoît Guimbaud, responsable de la direction médicale et des sinistres de la SHAM, ont indiqué que la plupart des refus de suivi étaient motivés par des expertises jugées de mauvaise qualité et par des avis de CRCI s’écartant des conclusions d’expertises, preuve du caractère déterminant de l’expertise (173).
La question de la qualité de l’expertise est donc une question essentielle dans l’indemnisation des infections nosocomiales. Or la mission n’a pu que constater au cours de ses travaux que le jugement de la majorité des personnes entendues (victimes, magistrats, avocats, assureurs…) sur la qualité des expertises était plus que mitigé. Lors de la table ronde sur l’expertise médicale organisée par la mission, le Docteur Bertrand Gachot, expert en infectiologie exerçant pour les juridictions et pour les CRCI, a souligné que la réalisation d’une bonne expertise nécessitait une formation de qualité, une grande rigueur méthodologique ainsi qu’une recherche de l’argumentation (174). S’il n’appartient pas à la mission d’émettre un jugement sur la qualité des expertises, il appartient en revanche au législateur de mettre en place les conditions nécessaires à la réalisation d’expertises de qualité. Or ses travaux ont mis en évidence une contrainte législative de nature à entraver le recrutement des experts et, partant, à nuire à la qualité des expertises.
L’article L. 1142-10 du code de la santé publique, qui institue la Commission nationale des accidents médicaux, dispose que celle-ci « prononce l’inscription des experts sur une liste nationale des experts en accidents médicaux après avoir procédé à une évaluation de leurs connaissances » et qu’elle « contribue à la formation de ces experts en matière de responsabilité médicale ». L’article L. 1142-11 du même code fixe deux conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes demandant leur inscription sur la liste d’experts de la CNAMed. Tout d’abord, elles doivent être inscrites sur les listes d’experts judiciaires prévues par l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Ensuite, elles doivent justifier « d’une qualification dont les modalités, comportant notamment une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles, sont fixées par décret en Conseil d’État ». L’inscription sur la liste de la CNAMed est accordée pour cinq ans et peut être renouvelée. Une disposition transitoire prévue par l’article 105 de la loi du 4 mars 2002 avait toutefois autorisé les personnes qui, sans être experts judiciaires, justifiaient d’une « qualification particulière en accidents médicaux » de faire acte de candidature à l’inscription sur la liste de la CNAMed, mais cette disposition, initialement prévue pour deux ans puis prorogée de deux ans par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, n’est plus applicable depuis le 24 décembre 2008.
L’article L. 1142-12 du même code prévoit que la CRCI « désigne aux fins d’expertise un collège d’experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s’assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence », mais permet toutefois à la CRCI de déroger à cette règle de la collégialité en désignant, « lorsqu’elle l’estime suffisant, (…) un seul expert choisi sur la même liste ». Cependant, le même article permet également à la CRCI, « à défaut d’expert inscrit sur la liste des experts en accidents médicaux compétent dans le domaine correspondant à la nature du préjudice, [de] nommer en qualité de membre du collège d’experts un expert figurant sur une des listes instituées par l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée ou, à titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes ».
L’ensemble de ces règles a été mis en place avec l’objectif de conférer un niveau de qualité élevé aux expertises réalisées à la demande des CRCI, ce qui révèle la pleine conscience qu’avait le législateur de 2002 de l’importance de l’expertise dans la reconnaissance du droit à indemnisation. Cependant, le Professeur André Lienhart, vice-président de la CNAMed, a indiqué que la règle exigeant l’inscription préalable sur les listes d’experts judiciaires pour pouvoir postuler à une inscription sur la liste de la CNAMed constituait un frein au recrutement des experts (175). Du fait du trop faible nombre des experts, les CRCI n’ont d’autre choix que de nommer des experts en dehors de la liste de la CNAMed et de déroger au principe de la collégialité. Dans son dernier rapport annuel, la CNAMed a ainsi relevé que si la loi fait de la désignation d’un collège d’experts la règle de principe et de l’expert unique l’exception, « la pratique s’en éloigne puisque, dans les faits, en moyenne seules 43 % des expertises sont collégiales ». Même si la part des expertises collégiales tend à augmenter (27 % en 2005, 39 % en 2006), l’on ne peut que déplorer que l’expertise par un expert non inscrit et « à expert unique », qui aurait dû être l’exception afin de garantir le plus haut niveau de qualité possible aux expertises, soit devenue la règle, au détriment de la qualité des expertises.
Pour remédier à cette dérive, la CNAMed a ainsi proposé la suppression de la nécessité d’être inscrit sur une liste d’experts judiciaires pour être inscrit sur la liste de la CNAMed, en faisant valoir que cette suppression « permettrait d’ouvrir l’accès à la liste nationale à un panel plus important de demandeurs déjà impliqués sur le terrain, mais non encore inscrits sur une liste d’experts judiciaires. Les dommages dus à des accidents liés au système de santé sont de plus en plus diversifiés et font de plus en plus appel à des compétences acquises récemment ; les victimes ont besoin qu’une expertise de qualité détermine leurs préjudices. Or, les listes d’experts judiciaires ne constituent que l’un des viviers où peuvent se trouver ces compétences ; une ouverture plus grande permettrait de mieux répondre aux besoins des victimes » (176).
En conséquence, pour redonner de la souplesse à un système auquel le législateur a conféré, avec une intention louable au départ, une rigueur excessive, la mission préconise de supprimer la condition d’inscription préalable sur les listes d’experts judiciaires pour pouvoir postuler à l’inscription sur la liste de la CNAMed.
Proposition n° 13
Supprimer la condition d’inscription préalable sur les listes d’experts judiciaires pour pouvoir postuler à l’inscription sur la liste de la Commission nationale des accidents médicaux.
F. UNE MISE EN œUVRE DES AVIS DES COMMISSIONS RÉGIONALES DE CONCILIATION ET D’INDEMNISATION PARFOIS DÉFICIENTE
La procédure des CRCI a été conçue pour permettre à la victime d’un dommage contracté à la suite d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins d’obtenir une indemnisation par une voie simple, rapide et non contentieuse. L’une des conséquences du caractère non contentieux de cette procédure est que les avis des CRCI n’ont pas de force contraignante à l’égard de la personne qu’ils désignent comme responsable. En outre, à la différence des jugements et arrêts des juridictions civiles ou administratives, les avis des CRCI se contentent de définir poste par poste les préjudices subis par la victime et d’en quantifier la gravité en pourcentage, mais ne chiffrent pas le montant des dommages et intérêts dus par le responsable. À la suite d’un avis de CRCI, il incombe donc à la personne tenue d’indemniser – ONIAM, assureur ou établissement lui-même s’il est son propre assureur – de formuler une offre d’indemnisation à la victime dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis (177).
De ce caractère non contraignant des avis des CRCI, il résulte que la personne désignée comme responsable peut refuser de les suivre. Relativement fréquent au début du fonctionnement des CRCI, le refus de suivi des avis est en net recul et ne concerne plus, assureurs, APHP et ONIAM confondus, qu’environ 5 % du total des avis d’indemnisation des CRCI. Lors de leur audition, M. Nicolas Gombault, directeur général du Sou médical, et le docteur Benoît Guimbaud, responsable de la direction médicale et des sinistres de la SHAM, ont indiqué que la plupart des refus de suivi étaient motivés par des expertises jugées de mauvaise qualité et par des avis de CRCI se détachant des conclusions d’expertises (178).
Le législateur a envisagé cette situation de refus de suivi de l’avis d’indemnisation avec pragmatisme. D’une part, il a souhaité ne pas laisser la victime privée d’indemnisation et contrainte d’engager seule une procédure juridictionnelle contre l’assureur : c’est la raison pour laquelle l’article L. 1142-15 a prévu que « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, (…) l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur ». D’autre part, la loi a estimé qu’il appartenait dans cette situation au juge de trancher le différend, en prévoyant, dans le même article, que l’ONIAM « est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur » et qu’il peut « obtenir remboursement des frais d’expertise ». Par ailleurs, une sanction financière a été prévue pour le cas où le juge donnerait tort à l’assureur d’avoir refusé de suivre l’avis d’indemnisation rendu par la CRCI en permettant au juge de condamner « l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue ».
La même sanction est prévue par l’article L. 1142-14 du code de la santé publique dans le cas où l’assureur a formulé une offre que la victime a contestée en engageant une procédure juridictionnelle et que le « le juge compétent (…) estime que cette offre était manifestement insuffisante ». Mais le parallélisme entre le refus d’offre et l’offre manifestement insuffisante s’arrête là, puisque à la différence du cas de l’absence d’offre, l’ONIAM ne peut pas, aux termes des dispositions du code de la santé publique, se substituer à l’assureur en cas d’offre manifestement insuffisante.
Cette impossibilité pour la victime ayant reçu une offre manifestement insuffisante d’obtenir une indemnisation par l’ONIAM, sous réserve de la possibilité pour ce dernier d’exercer une action récursoire contre l’assureur ou l’établissement responsable, constitue non seulement une iniquité pour la victime mais également une faille dans le dispositif prévu par le législateur de 2002. En effet, le dispositif actuel permet à un assureur qui voudrait ne pas suivre un avis de CRCI tout en se prémunissant contre une action de l’ONIAM d’adresser une offre très faible à la victime, en pariant sur les hésitations que pourrait avoir celle-ci à saisir une juridiction. Lors de son audition par la mission, M. Dominique Martin, directeur de l’ONIAM, a ainsi fait état d’offres dérisoires adressées à des victimes, allant de 1 à 100 euros, avec un objectif manifeste de contournement de la procédure de subrogation de l’ONIAM (179). Lors de la table ronde de représentants des assureurs médicaux qu’a organisée la mission, ces derniers ont indiqué n’avoir pas connaissance de telles offres, dont la mission est persuadée qu’elles ne représentent pas la pratique habituelle de la part des membres de cette profession (180). Il n’en demeure pas moins que de telles pratiques peuvent exister, la faille législative précédemment décrite pouvant constituer une tentation pour certains assureurs peu scrupuleux.
Face à une offre dérisoire, l’ONIAM a – en dépit de la lettre des articles L. 1142-14 et L. 1142-15 du code de la santé publique qui ne le permettent pas – fait le choix de se substituer à un assureur ayant formulé une offre considérée comme manifestement insuffisante par la victime, en demandant au juge saisi d’assimiler l’offre manifestement insuffisante à un refus d’offre. L’ONIAM a été suivi dans ce raisonnement par le tribunal de grande instance d’Angers dans un jugement non publié du 23 mars 2009, qui a retenu que « le fait pour [l’assureur] d’avoir présenté aux consorts P. une offre d’indemnisation manifestement insuffisante, par l’application d’un coefficient de 0,10 pour tenir compte d’une perte de chance évaluée de manière arbitraire et injustifiée à 10 %, doit être assimilé à un refus d’offre au sens de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ». Cependant, cette assimilation de l’offre manifestement insuffisante au refus d’offre semble constituer une interprétation contra legem de dispositions législatives claires, dans la mesure où le législateur a expressément prévu le cas de l’offre manifestement insuffisante en instituant la même pénalité que pour le cas du refus d’offre, mais n’a pas ouvert à l’ONIAM la même possibilité de se substituer à l’assureur.
Afin de combler cette faille du dispositif de la loi du 4 mars 2002, susceptible de conduire à de choquantes injustices pour les victimes et à des stratégies de formulation d’offres très insuffisantes par certains assureurs peu scrupuleux, la mission préconise de permettre expressément à l’ONIAM de se substituer à l’assureur en cas d’offre manifestement insuffisante, l’ONIAM étant alors subrogé dans les droits de la victime afin de pouvoir se retourner contre l’assureur défaillant.
Proposition n° 14
Permettre à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de se substituer à l’assureur en cas d’offre manifestement insuffisante, sous réserve de la possibilité de l’exercice d’une action récursoire.
La Commission des affaires sociales et la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République procèdent à l’examen des conclusions du rapport de la mission d’information commune sur l’indemnisation des victimes des maladies nosocomiales et l’accès au dossier médical, au cours de leur réunion conjointe du mercredi 8 juillet 2009.
M. Georges Colombier, secrétaire de la Commission des affaires sociales, remplaçant le président Pierre Méhaignerie. Je tiens à excuser le président Pierre Méhaignerie qui me charge de le suppléer pour coprésider avec M. Jean-Luc Warsmann cette réunion destinée à autoriser la publication du rapport d’information sur l’indemnisation des victimes d’infections nosocomiales et l’accès au dossier médical.
M. le Président Jean-Luc Warsmann. Je suis très heureux que la Commission des lois et la Commission des affaires sociales soient conjointement réunies pour examiner ce rapport d’information. C’est un moment symbolique car il montre que nous savons dépasser les limites des compétences des commissions permanentes pour mener des travaux en commun. C’est également un moment symbolique car cette mission d’information de quatre membres était doublement paritaire, deux appartenant à la Commission des affaires sociales – MM. Jean-Pierre Door et Henri Jibrayel, remplacé à compter du 1er juillet par Mme Catherine Lemorton – et deux à la Commission des lois – M. Guénhaël Huet et Mme Marietta Karamanli – avec une représentation égale et symétrique de la majorité et de l’opposition.
C’était une mission d’intérêt général que de se pencher sur cette question et je me félicite que le président Pierre Méhaignerie ait répondu positivement à la demande que j’avais formulée de constituer une mission d’information commune, après avoir été interpellé par des victimes d’infections nosocomiales.
Les infections nosocomiales concernent nombre de nos concitoyens et si la loi du 4 mars 2002 a apporté diverses innovations, la complexité du dispositif d’indemnisation et de l’accès aux commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’une part et les difficultés d’accès au dossier médical d’autre part justifiaient ce travail d’information.
Je crois que notre devoir commun sera ensuite d’assurer un suivi des conclusions de la mission, en interrogeant le Gouvernement lors de l’examen des projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale, et également en proposant des amendements quand les supports législatifs pertinents le permettront.
M. Georges Colombier, président. Je tiens à remercier les membres de la mission et je souscris pleinement à la proposition du président Jean-Luc Warsmann d’assurer un suivi des préconisations de la mission.
Les droits des patients sont récents et ils demeurent souvent méconnus. Dès lors qu’un dialogue peut s’instaurer entre médecins et patients, il n’y a pas à craindre que l’utilisation de tels droits conduise à des conflits.
M. le rapporteur. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a fondé les bases d’une nouvelle relation entre les usagers du système de santé, d’une part, et les professionnels et les établissements de santé, d’autre part.
Près de sept ans après l’affirmation législative de ces droits, la Commissions des lois et la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales ont souhaité évaluer leur mise en œuvre effective, en créant, en décembre et janvier derniers, une mission d’information commune sur l’indemnisation des victimes d’infections nosocomiales et l’accès au dossier médical, deux des aspects les plus importants des droits d’information et d’indemnisation.
Bien que son intitulé vise d’abord l’indemnisation des infections nosocomiales puis l’accès au dossier médical, la mission a choisi de traiter la question du droit d’accès au dossier médical avant celle de l’indemnisation des infections nosocomiales, dans un souci logique et chronologique. En effet, l’accès au dossier médical est un préalable à toute demande d’indemnisation.
La mission a conduit ses travaux à partir de plusieurs questions : dans quelles conditions les patients ont-ils accès à leur dossier médical ? Les délais de communication prévus par la loi sont-ils respectés ? Des difficultés matérielles compliquent-elles la mise en œuvre du droit d’accès ? En matière d’indemnisation des infections nosocomiales, les patients victimes peuvent-ils bénéficier effectivement de la réparation des dommages à laquelle ils ont droit ? Les fondements du régime de responsabilité retenu par le législateur en 2002 et la répartition de la charge de l’indemnisation sont-ils satisfaisants ? La procédure ad hoc de règlement amiable des litiges en matière médicale devant les commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI), créées afin de simplifier, d’accélérer et de pacifier le traitement des demandes en matière de responsabilité médicale a-t-elle atteint ses objectifs ?
Ce rapport s’inscrit ainsi dans la culture d’évaluation promue par le président Jean-Luc Warsmann et désormais bien ancrée dans notre assemblée.
Au cours des cinq derniers mois, la mission a organisé neuf auditions et six tables rondes, et effectué six déplacements dans des établissements de santé de taille et de type différents, qui ont été choisis en raison de leur situation proche des circonscriptions des membres de la mission mais également en raison de leur caractère représentatif de la réalité hospitalière française.
La mission a constaté que le législateur de 2002 a modifié les relations entre les patients et les professionnels de santé et créé un nouvel équilibre. Mais elle considère, d’une part, que l’effectivité du droit d’accès au dossier médical peut encore être renforcée et, d’autre part, que le régime d’indemnisation des infections nosocomiales peut être rendu plus juste et plus simple.
La mission a ainsi été surprise de constater que le système d’indemnisation était jugé satisfaisant par les médecins mais trop complexe par les juristes.
L’une des légitimités de la mission était liée à l’ampleur du problème abordé. On recense 700 000 à 800 000 cas d’infections nosocomiales chaque année. La France se situe pourtant parmi les pays ayant les meilleurs résultats, avec un taux de prévalence inférieur à 5 %, contre une moyenne européenne supérieure à 6 %.
On dénombre 9 000 décès par an parmi les patients atteints d’une infection nosocomiale, et l’on évalue à 2 000 le nombre de décès directement imputables à cette infection.
À l’issue de ses auditions et déplacements, la mission formule quatorze propositions, sept étant relatives à l’accès au dossier médical et sept relatives à l’indemnisation.
La première proposition est d’harmoniser les tarifs des supports de reproduction des éléments d’un dossier médical. La mission a en effet constaté que la communication du dossier pose des problèmes matériels et que le coût financier constitue un obstacle à la communication pour certaines personnes. Nous proposons donc une unification des tarifs ainsi que la fixation d’un coût maximal par dossier déterminé par voie réglementaire.
La deuxième proposition porte sur les délais de communication des informations contenues dans un dossier médical. La loi du 4 mars 2002 prévoit que le dossier doit être communiqué dans un délai de huit jours s’il date de moins de cinq ans, et dans un délai de deux mois dans le cas contraire. Or, le délai de huit jours est rarement respecté et le patient n’obtient parfois pas de communication du dossier ou une communication partielle dans ce délai, sans que cela puisse être sanctionné. Dans un souci de réalisme, et afin de ne porter préjudice à personne, nous proposons de porter ce délai de huit à quinze jours.
Mme Catherine Génisson. Il n’y a aucune raison !
M. le rapporteur. Une proposition subséquente consiste à confier aux CRCI la compétence pour contrôler le respect du droit d’accès au dossier médical, et notamment le respect du délai de communication de quinze jours. Aujourd’hui, en cas de non-respect des délais ou d’absence de transmission du dossier, le patient doit saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), puis éventuellement le juge administratif, s’il s’agit d’un dossier conservé par un établissement public de santé, et il doit saisir directement le juge judiciaire, s’il s’agit d’un dossier conservé par un établissement privé. Les CRCI seraient des instruments plus souples qui permettraient un meilleur contrôle du respect des conditions de communication des dossiers.
La quatrième proposition consiste à affirmer le droit du majeur autonome sous tutelle à consulter son dossier. Il s’agit de mettre en adéquation le droit de la santé et le droit civil, lequel reconnaît aujourd’hui davantage d’autonomie aux majeurs protégés.
La cinquième proposition vise à permettre à toute personne d’accéder à son dossier médical par l’intermédiaire d’un mandataire, à la triple condition que ce dernier dispose d’un mandat exprès, justifie son identité et ait la qualité d’ayant droit du patient ou ait été désigné par lui comme sa personne de confiance. La mission a par ailleurs également proposé d’interdire à ce mandataire d’entretenir ou d’être susceptible d’entretenir des relations contractuelles avec le patient afin d’éviter que certaines personnes, tels l’employeur ou l’assureur du patient, puissent ainsi avoir accès au dossier médical.
La sixième proposition tend à maintenir aux parents d’un enfant décédé leur droit d’accéder librement à l’ensemble de son dossier médical, à l’exception des éléments d’information dont la communication avait fait l’objet d’une opposition préalable de la personne mineure.
Il a également paru nécessaire à la mission d’ouvrir au concubin ou au partenaire d’un pacte civil de solidarité d’un patient décédé le droit d’accéder au dossier de ce patient dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les ayants droit. Tel est le sens de la septième proposition.
Ainsi, sur ce premier thème de l’accès au dossier médical, la philosophie de la mission est de faciliter cet accès, de permettre la transmission du dossier dans un délai raisonnable, tout en protégeant les droits du patient.
Dans sa huitième proposition, la mission suggère la mise en place d’une évaluation du risque infectieux en cabinet libéral et une politique de lutte contre ce risque. Malgré la rareté des cas dans les cabinets libéraux, une telle évaluation est cependant nécessaire pour mieux connaître la prévalence de ces infections en milieu ambulatoire.
La neuvième proposition a pour objectif de clarifier et d’unifier la définition des infections nosocomiales indemnisables. En effet, aujourd’hui, les litiges relatifs aux infections contractées dans un hôpital public relèvent du juge administratif, alors que ceux concernant des infections contractées dans une clinique privée sont de la compétence du juge civil. Or la mission a constaté des différences de jurisprudence entre les deux ordres : le juge administratif, par exemple, accepte la « cause étrangère » comme motif d’exonération de la responsabilité d’un établissement de santé, alors que le juge civil ne l’accepte pas. La mission propose donc, non pas d’unifier les deux contentieux, mais d’ajouter à la cause étrangère, qui permet aujourd’hui à l’établissement de s’exonérer, une autre cause d’exonération qui serait le caractère irrésistible de l’infection. Il existe effectivement des cas dans lesquels un patient très affaibli contracte inévitablement une infection. La mission a préféré retenir la notion de « cause irrésistible » plutôt que celle de « cause inévitable » car la première est bien connue de la jurisprudence.
En contrepartie de cette légère restriction aux possibilités d’indemnisation des patients, la mission suggère, dans une onzième proposition, de supprimer tout seuil d’accès aux CRCI sans ouvrir pour autant un droit systématique à indemnisation par la solidarité nationale dont les seuils restent inchangés. Une étude d’impact devra néanmoins être menée au préalable afin d’évaluer les conséquences de cette proposition au regard du nombre annuel prévisible de dossiers supplémentaires et les nouveaux moyens qui seraient nécessaires. Il ne faudrait pas qu’une telle réforme aboutisse à une augmentation exagérée des délais puisque son objectif est de permettre un accès à l’indemnisation plus souple et plus simple que la voie juridictionnelle.
La dixième proposition consiste à étendre le régime d’indemnisation de plein droit aux infections associées aux soins contractés en médecine de ville. Une concertation préalable devra, néanmoins, être menée pour déterminer les conséquences de cette extension en matière d’assurance.
La douzième proposition concerne la mise en place d’une aide à l’assistance juridique et médicale pour les personnes les plus démunies devant les CRCI. Cette nouvelle aide serait le corollaire d’un accès élargi à ces commissions. Une concertation préalable avec les professionnels concernés et une étude d’impact sur les conséquences financières seraient également utiles pour évaluer l’impact de cette mesure.
Les deux dernières propositions sont des ajustements techniques : il s’agit pour la première de supprimer la condition d’inscription préalable sur les listes d’experts judiciaires pour pouvoir postuler à une inscription sur la liste de la Commission nationale des accidents médicaux et, pour la seconde, de permettre à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de se substituer à l’assureur en cas d’offre manifestement insuffisante, sous réserve de la possibilité de l’exercice d’une action récursoire.
Mme Michèle Delaunay. Mon expérience professionnelle me rend particulièrement sensible à la qualité du travail fourni par la mission.
S’agissant de l’accès au dossier médical, il doit sans doute être facilité sauf si le patient, dûment informé, émet un avis contraire. Le délai de huit jours de communication du dossier médical semble satisfaisant. Le dossier existe et il y a aujourd’hui des moyens pour le reproduire. Si des résultats d’examen interviennent après la transmission du dossier, une communication complémentaire peut être ultérieurement effectuée. La proposition de la mission d’étendre l’évaluation des infections nosocomiales au secteur libéral est pertinente. S’agissant des causes d’exonération en matière d’indemnisation des infections nosocomiales, il est nécessaire de prendre en compte certains cas qui sont « non qualifiables ». Ainsi, certains traitements de chimiothérapie peuvent favoriser certaines infections ; il serait dommage d’en freiner l’utilisation en ouvrant trop largement le droit à indemnisation.
M. Jean-Pierre Door. Je tiens à souligner l’intérêt des auditions et des déplacements organisés par la mission et à rappeler l’ambiance sereine et constructive qui y régnait. Notre mission a dû concilier les points de vue médical et juridique. La législation sur les infections nosocomiales a pour socle la loi « Kouchner » du 4 mars 2002. Le rapport de la mission définit ce que sont les infections nosocomiales et constate les disparités existant entre les secteurs hospitaliers public et privé, notamment concernant l’accès au dossier médical. Il pose la question de la frontière entre la solidarité nationale et l’intervention de l’assurance des professionnels de santé. La question du délai de huit jours pour la transmission du dossier médical apparaît tranchée. Je crois, en la matière, aux progrès induits par le dossier médical personnel et le développement informatique. Le rapport propose par ailleurs des avancées pertinentes comme l’évaluation des infections nosocomiales en milieu ambulatoire et l’élargissement de la saisine des CRCI, plus rapide que la voie juridictionnelle. Au total, je suis favorable à l’ensemble des quatorze propositions avancées dans le rapport.
Mme Catherine Génisson. Je voudrais féliciter le président-rapporteur et les membres de la mission pour la qualité de leur travail. C’est l’honneur de notre assemblée que de mener une telle démarche non partisane afin de résoudre les difficultés que rencontrent nos concitoyens.
S’agissant de la proposition n° 1, je me demande s’il est vraiment utile d’harmoniser les coûts d’accès au dossier médical dans la perspective de l’arrivée du dossier médical personnel qui appartiendra au patient !
En ce qui concerne le délai de transmission du dossier, le délai actuel de huit jours me semble tout à fait suffisant.
La proposition n° 8, sur l’évaluation des risques en cabinet libéral, est très bonne. Pour autant, elle ne doit pas être présentée comme stigmatisant l’activité libérale de la médecine, mais comme relevant d’une démarche d’égalité dans la prévention des infections nosocomiales.
La proposition n° 9 est très complexe. Certes, il est très important de reconnaître le principe d’une indemnisation, même en l’absence de faute médicale. Cependant, je comprends les objections de notre collègue Michèle Delaunay, compte tenu notamment de son expérience professionnelle. On sait en effet que, dans certaines situations, quelles que soient les précautions prises, on ne peut échapper à la survenue d’une infection, notamment quand le patient est totalement privé de défenses immunitaires. Cette proposition est donc très importante et méritera d’être approfondie car il est impératif que le risque juridique ne conduise pas à un arrêt du progrès médical.
Enfin, la proposition n° 13 traite des expertises médicales. J’ai eu à plusieurs reprises l’occasion de m’entretenir de ce sujet avec le Médiateur de la République qui insiste sur la nécessaire exigence qualitative dans ce domaine. Face à ce défi, nous avons un boulevard devant nous !
Mme Marietta Karamanli. En préambule, je voudrais saluer le travail effectué par la mission d’information, et notamment par le président-rapporteur. J’ai eu grand plaisir à travailler au sein de cette mission.
Sur la proposition n° 1, je me félicite de l’évolution intervenue. J’étais en effet réservée sur l’idée de faire varier le coût de communication des pièces en fonction de la nature de celles-ci. La solution d’un coût plafonné par dossier va dans le bon sens.
S’agissant de la question du délai de réponse, nous pensons qu’allonger les délais n’est pas nécessaire. Si dans 40 % des cas, le délai est dépassé, il ne semble pas juste de donner une « prime » aux établissements mal organisés qui ne respectent pas les délais. J’ai d’ailleurs compris que Mme la ministre de la santé et des sports souhaitait faire des propositions afin de faire mieux respecter le délai de huit jours, notamment par la dématérialisation du dossier et une amélioration de l’archivage.
Sur cette question de l’archivage, M. Jean-Pierre Door a évoqué la différence entre secteurs privé et public. On peut se demander s’il est vraiment opportun de confier le dossier au patient comme cela se pratique dans le secteur privé : cela risquerait de poser des problèmes pratiques pour le suivi de certains patients.
La proposition n° 3 me semble essentielle. Nous proposons que les établissements mettent en place des procédures de conciliation avec les patients dans l’accès au dossier médical. En effet, il est préférable de favoriser la conciliation plutôt que de favoriser les recours contentieux.
Sur la proposition n° 5, il est important de définir très précisément la personne qui a accès au dossier. La qualité d’ayant droit du patient ou de personne de confiance n’est pas suffisante car elle ne prend pas en compte l’existence de liens affectifs.
Enfin, la proposition n° 9 mérite réflexion. En restreignant le champ de l’indemnisation, on revient sur l’esprit de la loi Kouchner. Exclure l’indemnisation des infections endogènes est un problème ; je pense qu’il faut préserver la possibilité d’indemnisation d’une infection dans une telle hypothèse, même sans faute.
Compte tenu de ces remarques, nous nous abstiendrons globalement sur les propositions de la mission d’information.
M. Georges Colombier, président. Je signale que le rapport contient une contribution de Mmes Marietta Karamanli et Catherine Lemorton.
Mme Catherine Lemorton. Je commencerai par faire une clarification sur le dossier médical personnel. Je considère que le DMP ne remplacera jamais le dossier médical tel qu’il est archivé dans les hôpitaux et qui comprend tout. En effet, certaines informations seront masquées dans le DMP ; ce document ne sera donc pas équivalent au dossier conservé par l’hôpital.
J’estime aussi qu’il n’est pas justifié de faire passer le délai de transmission du dossier médical de huit à quinze jours. Pour raccourcir les délais, il faut miser sur les avancées technologiques liées à la dématérialisation.
Sur la proposition n° 9, je suis opposée à la limitation proposée du champ d’indemnisation des infections nosocomiales. À partir du moment où un médicament est administré à un patient et que ses effets secondaires sont connus et répertoriés, le médecin n’est pas mis en cause ! Ce qui pose un problème, c’est lorsque survient une infection non envisagée ! Je crains des dérives : prenons, par exemple, le cas d’un toxicomane qui doit se faire opérer et qui n’est pas porteur du virus de l’hépatite C en entrant à l’hôpital. Si celui-ci contracte cette maladie, on lui rétorquera que cela s’explique par son appartenance à un groupe à risque alors qu’il a peut-être contracté cette maladie à l’hôpital ! La notion d’« irréversibilité » apparaît donc bien douteuse.
Compte tenu de ces remarques, je m’abstiendrai également sur les propositions.
M. Jean-Luc Préel. M. le Président de la Commission des lois nous a indiqué qu’il s’agissait d’une mission d’information très importante et pluraliste. Pourtant, deux des groupes de l’Assemblée nationale n’y sont pas représentés ! Quand la Commission des affaires sociales crée une mission d’information, elle désigne onze membres afin de permettre la représentation de tous les groupes.
Sur le fond, on ne peut que se féliciter de l’ensemble du rapport. Le dossier médical est une question très complexe : le patient y a accès mais les informations qui y figurent doivent être expliquées. C’est pourquoi je pense qu’il n’est pas utile de donner à un patient ou à sa famille toutes les informations qui s’y trouvent. En revanche, il est essentiel qu’il y ait un dialogue continu avec l’équipe médicale, seul moyen de désamorcer les conflits. De même, en cas de plainte, le dossier est confié à des experts médicaux, mais il faudrait également assister les patients.
La question du délai de transmission du dossier a été évoquée à plusieurs reprises. Parmi les établissements visités, il apparaît que seul celui du Mans respecte, tout juste, le délai de huit jours et que ce délai est de dix-huit jours à Rennes. Dans ces conditions, il ne me semble pas absurde d’allonger légèrement le délai, même si chacun doit continuer à faire des efforts pour raccourcir les délais de transmission.
Sur la proposition n° 9, je partage l’avis de Mme Michèle Delaunay. Il est indispensable de distinguer les infections évitables de celles qui sont endogènes et qui font partie de la maladie, comme souvent dans le cas d’une hémorragie digestive. On ne peut pas indemniser dès qu’il y a infection car, avec une telle logique, il nous faudrait prévoir d’indemniser le fait même d’être malade !
Je voterai en faveur des propositions du rapport.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Je rappelle que le nombre de membres de la mission a été fixé à quatre, deux appartenant à la Commission des lois et deux à la Commission des affaires sociales, avec une représentation paritaire de la majorité et de l’opposition.
M. le rapporteur. En réponse aux différents intervenants, je soulignerai que les propositions du rapport, en particulier les propositions n°s 2 et 9, s’inscrivent dans l’esprit même de la loi du 4 mars 2002 qui tendait à mettre en place un système équilibré de droits entre les patients et les professionnels de santé. Il n’est donc pas question de remettre en cause le principe de la responsabilité sans faute, et le lien de causalité entre l’acte et le dommage doit toujours être établi ; on risquerait, sinon, de voir certains établissements de santé multiplier les décisions de refus d’admission des personnes dont l’état très grave ne peut que conduire à la contraction d’une infection nosocomiale. Enfin, il est apparu souhaitable, comme le prévoit la proposition n° 6, de maintenir l’exception au droit d’accès des parents à celles des informations du dossier médical dont leur enfant décédé se serait préalablement opposé à leur communication. Cette disposition vise notamment à permettre aux mineures de garder le secret sur une interruption volontaire de grossesse.
Puis la Commission des affaires sociales et la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République autorisent conjointement, en application de l’article 145 du Règlement, le dépôt du rapport d’information en vue de sa publication.
SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS
DE LA MISSION
Proposition n° 1 : Par voie réglementaire, harmoniser les tarifs des supports de reproduction des éléments d’un dossier médical qui peuvent être exigés par les professionnels de santé et les établissements de santé des secteurs public et privé, et fixer un coût plafonné par dossier.
Proposition n° 2 : Modifier les délais de communication des informations contenues dans un dossier médical :
– en supprimant le délai de réflexion de quarante-huit heures ;
– en fixant à quinze jours la durée du délai au cours duquel les informations demandées doivent être communiquées, à l’exception des demandes motivées par une urgence médicale, par la sollicitation d’un deuxième avis médical ou par une injonction.
Proposition n° 3 :
En cas de refus d’accès à un dossier médical ou de non-respect de ses délais légaux de transmission et préalablement à tout contentieux judiciaire ou administratif, confier aux commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) une compétence générale de contrôle du respect du droit d'accès au dossier médical.
En conséquence, exclure du champ de compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) les demandes de communication de dossier médical.
Proposition n° 4 : Affirmer le droit du majeur autonome sous tutelle à consulter son dossier.
Proposition n° 5 : Permettre à toute personne d’accéder à son dossier médical par l’intermédiaire d’un mandataire, à condition que ce dernier :
– dispose d’un mandat exprès et puisse justifier de son identité ;
– ait la qualité d’ayant droit du patient ou ait été désigné par lui comme sa personne de confiance ;
– n’entretienne ni ne soit susceptible d’entretenir des relations contractuelles avec le patient sous peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Proposition n° 6 : Maintenir aux parents d’un enfant décédé leur droit d’accéder librement à l’ensemble de son dossier médical, à l’exception des éléments d’information pour lesquels la personne mineure s’était préalablement opposée à leur communication.
Proposition n° 7 : Ouvrir au concubin ou au partenaire d’un pacte civil de solidarité d’un patient décédé le droit d’accéder au dossier médical de ce patient dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les ayants droit.
Proposition n° 8 : Mettre en place une évaluation du risque infectieux en cabinet libéral et une politique de lutte contre ce risque.
Proposition n° 9 : Clarifier et unifier la définition des infections nosocomiales indemnisables, en excluant de leur champ celles pouvant être considérées comme irrésistibles.
Proposition n° 10 : Étendre le régime d’indemnisation de plein droit aux infections associées aux soins contractées en médecine de ville, sous réserve d’une concertation préalable sur les conséquences de cette extension en matière d’assurance.
Proposition n° 11 : Après évaluation des conséquences au regard du nombre annuel prévisible de dossiers supplémentaires et attribution des nouveaux moyens nécessaires, supprimer tout seuil d’accès aux CRCI dans leur mission de règlement amiable.
Proposition n° 12 : Après concertation avec les professionnels concernés et évaluation des conséquences financières, mettre en place une aide à l’assistance juridique et médicale devant les CRCI pour les personnes les plus démunies.
Proposition n° 13 : Supprimer la condition d’inscription préalable sur les listes d’experts judiciaires pour pouvoir postuler à l’inscription sur la liste de la Commission nationale des accidents médicaux.
Proposition n° 14 : Permettre à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de se substituer à l’assureur en cas d’offre manifestement insuffisante, sous réserve de la possibilité de l’exercice d’une action récursoire.
CONTRIBUTION DE MMES MARIETTA KARAMANLI ET CATHERINE LEMORTON, MEMBRES DU GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE
Les députées SRC membres de la mission d’information approuvent l’approche générale du rapport, sous deux réserves importantes qui ne leur permettent pas de lui donner un avis favorable. La première réserve est relative au délai de communication du dossier médical (proposition n° 2), la seconde concerne le champ d’application du régime de responsabilité de plein droit pour les infections nosocomiales (proposition n° 9).
● Sur le délai de communication du dossier médical (proposition n° 2)
En l’état, les dossiers apparaissent pour une majorité d’entre eux communiqués dans le délai légal de huit jours.
Allonger le délai légal de communication risquerait d’allonger le délai moyen actuellement constaté, alors même que ce délai paraît s’allonger en fonction de l’ancienneté des soins, de la complexité du dossier et de l’organisation adoptée (ou non) par l’établissement de santé pour répondre aux demandes des patients.
Une évaluation concrète des conditions de traitement des demandes, l’établissement de bonnes pratiques d’organisation et le développement des techniques nouvelles de conservation et de standardisation des dossiers sont de nature à améliorer le délai.
Dans ces conditions, il apparaît prioritaire de faire évoluer les pratiques avant d’envisager que le délai légal ne soit allongé.
● Sur le champ d’application du régime de responsabilité de plein droit pour les infections nosocomiales (proposition n° 9)
Exclure du champ de l’indemnisation les infections « irrésistibles », c’est rouvrir la discussion sur le champ d’application de la loi du 4 mars 2002 alors même qu’aujourd’hui la distinction n’est pas faite par la loi.
Il existe alors un risque que ne soit exclue l’indemnisation de certaines infections dites endogènes où le malade est contaminé par ses propres germes et où l’asepsie apparaît moins maîtrisable. Pourtant, c’est bien l’acte diagnostique ou thérapeutique, par exemple invasif, qui fera évoluer ou rendra dangereux un tel germe. C’est sur cette base que les juridictions judiciaires ont maintenu un champ large à l’indemnisation. Par ailleurs une telle limitation tend à circonscrire l’infection nosocomiale alors même qu’en matière médicale, il doit être tenu compte des progrès scientifiques rapides et constants.
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
ET DES RÉUNIONS ORGANISÉES
PAR LA MISSION
Mardi 3 mars 2009
Ministère de la santé et des sports
— M. le Professeur Didier Houssin, directeur général de la santé
— M. Martial Mettendorff, secrétaire général de la direction générale de la santé
— Docteur Valérie Salomon, chef du bureau qualité et organisation des soins et de la cellule infections nosocomiales (DHOS)
— Mme Lætitia May-Michelangeli, chargée de mission auprès de la DHOS sur les infections nosocomiales
— Mme Erell Pencreac’h, adjointe du chef du bureau droits des usagers et fonctionnement général des établissements de santé (DHOS)
Médiature de la République
— M. Jean-Paul Delevoye, Médiateur de la République
— M. Alain-Michel Ceretti, chargé de mission sur la santé auprès de M. le Médiateur de la République, administrateur de l’ONIAM
Mardi 10 mars 2009
Institut de veille sanitaire
Docteur Bruno Coignard, responsable des maladies infectieuses, nosocomiales et résistantes aux antibiotiques au sein du département des maladies infectieuses
Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
— M. Dominique Martin, directeur
— Mme Sabine Gibert, responsable juridique
Mardi 24 mars 2009
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
— M. Jean-Patrick Lerendu, secrétaire général
— M. Alexandre Pascal, rapporteur
Maître Cyril Clément, avocat au barreau de Paris, spécialiste de droit médical
M. Jean Wils, chargé de la mission « droits des usagers et des relations avec les associations » à l’Hôpital Européen Georges Pompidou
Mardi 7 avril 2009
Table ronde de représentants d’associations de patients
et d’usagers du système de santé
— Collectif interassociatif sur la santé : Mme Marianick Lambert, présidente, et M. Marc Morel, directeur
— Fédération des associations d’aide aux victimes d’accidents médicaux : Mme Marie-Solange Julia, présidente
Mardi 28 avril 2009
Table ronde de représentants des syndicats de médecins :
— Docteur Jean-François Rey, Président de l’Union syndicale des médecins spécialistes confédérés Confédération des syndicats médicaux français (U.M.E.SPE/CSMF)
— Docteur Jean-Marc Rehby, membre du bureau de la Fédération des médecins de France (FMF)
— Docteur Roger Rua, secrétaire général du Syndicat des médecins libéraux (SML)
— Mme le Docteur Marie-Laure Alby, vice-présidente de la Fédération française des médecins généralistes (MG France)
Conseil national de l’Ordre des médecins
Docteur Walter Vorhauer, secrétaire général
Mardi 5 mai 2009
Table ronde de représentants des fédérations d’établissements de santé :
— Fédération hospitalière de France (FHF) : M. Jérémie Sécher, directeur de cabinet, et M. Cédric Lussiez, directeur de la communication
— Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) : M. Thierry Béchu, délégué général de la branche médecine-chirurgie-obstétrique (MCO)
— Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratif (FEHAP) : Mme Coralie Cuif, secrétaire générale, Mme Hélène Logerot, médecin en santé publique, et M. Antoine Audouin, juriste
Mardi 12 mai 2009
Table ronde de représentants des assureurs médicaux :
— Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) : Mme Claudine Quillevere, sous-directrice des assurances de biens et de responsabilité, et Mme Annabelle Jacquemin, attachée parlementaire
— Le Sou médical, groupe MACSF : M. Nicolas Gombault, directeur général
— Société hospitalière d’assurances médicales (SHAM) : Docteur Benoît Guimbaud, responsable de la direction médicale et des sinistres
— Medical Insurance Company, SAS François Branchet : Mme Valérie Evenou, courtier en assurances, responsable du développement étranger et des relations publiques
— Bureau central de tarification (BCT) : Mme Françoise Dauphin, responsable du secrétariat
Mardi 26 mai 2009
Table ronde de professionnels du droit et de la réparation des préjudices corporels :
— Mme Françoise Avram, présidente de la CRCI d’Île-de-France
— Mme Marguerite Pélier, présidente de la CRCI Ouest
— M. Frédéric Puigserver, conseiller à la 6ème section du tribunal administratif de Paris
— Mme Florence Lagemi, présidente de la chambre civile (3ème section) du TGI de Paris
— Maître Alain Garay, avocat près la Cour d’appel de Paris, spécialiste de droit médical
— Maître Patrick de la Grange, avocat près la Cour d’appel de Paris, spécialisé dans la réparation du préjudice corporel et le droit de la santé
— Maître Gisèle Mor, avocate spécialiste du droit des victimes et du droit corporel, ancien bâtonnier du Val d’Oise
Table ronde de professeurs de droit :
— Mme Claudine Bergoignan Esper, professeur de droit médical et de droit de la santé à l’Université Paris V
— M. Jacques Moreau, professeur de droit public à l’Université Paris II
— M. Didier Truchet, professeur de droit public à l’Université Paris II, ancien président de l’Association française de droit de la santé
Mercredi 17 juin 2009
Table ronde sur l’expertise médicale :
— M. le Professeur André Lienhart, vice-président de la CNAMed
— Docteur Bertrand Gachot, expert judiciaire et expert inscrit sur la liste de la CNAMed ;
— Docteur Hélène Hugues Béjui, Déléguée générale de l’Association pour l’Étude de la Réparation du Dommage Corporel (AREDOC).
M. Olivier Jardé, député de la Somme, praticien hospitalier
Mardi 30 juin 2009
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LA MISSION
AU COURS DE SES DÉPLACEMENTS
22 avril 2009
Centre Hospitalier Universitaire, Rennes
— M. André Fritz, directeur général
— M. Yannick Malledant, président de la CME
— M. Patrick Plassais, directeur délégué auprès des pôles
— Professeur Christian Michelet, président du CLIN
— Professeur Michel Cormier, vice président du CLIN
— M. Maurice Mlekuz, directeur de la qualité et de la relation avec les usagers
— Mme Marie-Christine Montréal, directrice adjointe - direction qualité et relation avec les usagers
— Docteur Josette Dassonville, médiateur médical suppléant
— M. Patrick Robic, médiateur non médical suppléant
— Mme Michèle Delabrosse, représentante des usagers au conseil d’administration
— Mme Chantal Rousseau, Attachée d’administration hospitalière - direction qualité et relation avec les usagers
— M. Pierre Jakès Idée, directeur adjoint du pôle information et pilotage
— Docteur Françoise Riou, responsable des dossiers médicaux
— Docteur Annie Fresnel, médecin au DIM
— Docteur Anita Burgun, responsable du pôle information et pilotage
— Mme Marie-Paule Ferron, attachée d’administration hospitalière, chargée du recueil des informations médicales
— Mme Aurélie Frangeul, archiviste
Clinique du Pré, Le Mans
— M. Claude Le Bars, directeur général
— Mme Floriane Vieuze, directrice administrative et financière
— Docteur Jean-Claude Meynet, médecin DIM
— Docteur Jean-Patrick Rakover, chirurgien orthopédiste,
— Docteur René Kaswin, chirurgien viscéral, président du Conseil de l’Ordre des médecins de la Sarthe
— Mme Stéphanie Grandrémy, assistante qualité
— Mme Yannick Olivo, infirmière hygiéniste
Centre Hospitalier, Le Mans
— Mme Marie-Joëlle Condé, directrice de la qualité, de la gestion des risques, de la relation à la clientèle et de l’évaluation des pratiques professionnelles
— Docteur Marc Philippo, Président du CLIN, responsable du service des préventions des infections nosocomiales
— Mme Nicole Besnier, référente du service central des dossiers médicaux
— M. Gilles Paumier, président de l’association des usagers du Centre Hospitalier du Mans, membre de la CRUQPC
— M. Luc Juhel, représentant de l’association des usagers du Centre Hospitalier du Mans au conseil d’administration
— M. Philippe Rouillon, représentant de l’association des usagers du Centre Hospitalier du Mans à la commission des plaintes
7 mai 2009
Centre hospitalier d’Avranches-Granville
— M. René Le Berre, directeur du centre hospitalier Avranches-Granville
— Docteur Emmanuel Piednoir, chef du service d’hygiène hospitalière
— Mme Jocelyne Le Berre, directrice adjointe chargée de l’hospitalisation et de la qualité
— Mme Clotilde Tanguy, ingénieur qualité, en charge de l’archivage des dossiers médicaux
— M. Pierre Deschamps, représentant des usagers au conseil d’administration et à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
28 mai 2009
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris
— M. Jacques Léglise, directeur
— M. Philipe Grenier, président du CCM
— Professeur Philippe Cornu, président du CLIN
— Mme Michèle Tchemenian, directrice de la clientèle
— Mme Agnès Petit, directrice de la qualité et gestion des risques
— Mme Valérie Boniface, coordonnateur des relations avec les usagers
— M. Marc Dupont, directeur adjoint, direction des affaires juridiques et des droits du patient (AH-HP)
— Mme Magali Richard-Piauger, chef du bureau de la responsabilité médicale et du contentieux du personnel (AP-HP)
— Docteur Sandra Fournier, responsable de l’EOH (AP-HP)
— Mme Brigitte Macé, responsable du service de gestion des dossiers médicaux
— Professeur Serge Herson, médecin conciliateur
— Docteur Jérôme Robert, médecin responsable de l’EOH
— Mme Jocelyne Paute, cadre hygiéniste
— Mme Nathalie Osinski, cadre hygiéniste
— M. Gérard Berlureau, représentant des usagers
— Mme Maryse Weil, représentante des usagers
18 juin 2009
Centre chirurgical Marie Lannelongue, Le Plessis Robinson
— M. Patrick Hontebeyrie, directeur général
— Docteur Olivier Vallet, médecin DIM
— Docteur Jean-Marie Libert, président du CLIN
COMPTE RENDU DES DÉPLACEMENTS DE LA MISSION
Outre les auditions et tables rondes qu’elle a conduites, la mission d’information commune sur l’indemnisation des victimes d’infections nosocomiales et l’accès au dossier médical a choisi d’effectuer six déplacements dans le cadre de ses travaux. Ces établissements ont été choisis afin de donner à la vision des membres de la mission la plus grande représentativité possible des différentes structures de santé existantes et concernées par l’indemnisation des infections nosocomiales et l’accès au dossier médical. Ont ainsi été visités :
● deux établissements publics de dimension universitaire : les CHU de Rennes et de Paris-La Pitié Salpêtrière (GHPS) ;
● deux établissements publics non universitaires : les centres hospitaliers du Mans (CHM) et d’Avranches-Granville (CHAG) ;
● un établissement relevant du secteur privé à but lucratif : la Clinique chirurgicale du Pré au Mans ;
● un établissement relevant du secteur privé à but non lucratif : la Clinique chirurgicale Marie Lannelongue (CCML) au Plessis-Robinson.
Ces déplacements, qui ont permis aux membres de la mission de rencontrer les acteurs de terrain de différents types d’établissements de santé, avaient un triple objectif :
— sur l’accès au dossier médical, évaluer la mise en œuvre pratique de ce droit des patients, à travers une présentation des organisations mises en place dans les établissements pour assurer l’exercice de ce droit et des difficultés pratiques et juridiques rencontrées par les établissements de santé dans sa mise en œuvre ;
— sur la lutte contre les infections nosocomiales, apprécier la mise en œuvre concrète des dispositifs généraux de prévention et recueillir le sentiment des professionnels de santé sur la politique de lutte contre les infections nosocomiales ;
— sur l’indemnisation des infections nosocomiales, recueillir le sentiment des praticiens et des juristes des établissements de santé sur le régime d’indemnisation des infections nosocomiales, à l’aune des cas de demandes d’indemnisation ayant pu être formulées à l’encontre de l’établissement dans lequel ils exercent.
1. Accès au dossier médical
— Constitution des dossiers et organisation de l’archivage
▪ L’archivage des dossiers du CHU de Rennes est centralisé pour les deux sites composant le CHU (Pontchaillou et Hôpital Sud). Les dossiers de l’Hôpital Sud de plus de 5 ans sont archivés par un prestataire externe.
▪ La Clinique du Pré constitue un dossier pour chaque hospitalisation. Elle envisage pour l’avenir de constituer un dossier par patient et d’y regrouper les différents dossiers constitués pour chaque hospitalisation. Les archives des dossiers sont stockées sur le site de la Clinique, sans externalisation.
▪ Le CH du Mans dispose d’un service central des dossiers médicaux se trouvant sur le site du CH. Les archives sont constituées de 13 kilomètres de rayonnages. Près de 280 000 mouvements de dossiers (extraction et rangement) sont effectués chaque année pour les besoins médicaux.
▪ Pour le CHAG, l’archivage des dossiers de moins de cinq ans est centralisé sur chacun des deux sites d’Avranches et de Granville. Les dossiers les plus anciens sont confiés à un prestataire extérieur.
À Avranches, chaque service garde ses dossiers en cours. L’archivage des autres dossiers fait l’objet d’une réforme en cours de mise en œuvre : les dossiers sont conservés dans un nouveau bâtiment, sous la responsabilité d’une ingénieure qualité et d’un agent à temps plein faisant le lien avec les services hospitaliers. Une année d’hospitalisation remplit 70 mètres linéaires de rayonnage.
▪ Au GHPS, en raison du caractère pavillonnaire du site, l’archivage des dossiers n’est pas centralisé mais est constitué au sein de chaque service dans un ou deux lieux qui lui sont dédiés, soit un total de 120 locaux représentant une surface de 7 000 m² et des rayonnages de 30 km, qui s’accroissent d’1 km, chaque année. Chaque patient possède un dossier par spécialité.
Le stockage des dossiers se fait en fonction de leur statut : plus ils sont actifs, plus ils restent dans des locaux proches, plus ils sont passifs, plus ils sont éloignés. L’externalisation est très peu utilisée en raison de son coût ; elle représente 3 700 mètres linéaires.
▪ Au CCML, les archives sont stockées sur place depuis sa création en 1954. Le CCML ne connaissant pas pour l’heure de problème d’espace de stockage, il n’est pas envisagé de recourir à une externalisation de l’archivage.
— Information des patients
Tous les établissements visités informent les patients de leur droit d’accès au dossier médical dans leur livret d’accueil et par des affichages dans les locaux.
— Traitement des demandes
▪ Le traitement des demandes d’accès au dossier médical adressées au CHU de Rennes est centralisé au sein du Département d’information médicale (DIM). Lorsqu’un service du CHU reçoit directement une demande d’accès au dossier médical, il la transmet au DIM ; cette organisation a nécessité un certain temps pour être efficacement mise en œuvre, mais la procédure est désormais connue et bien appliquée dans tous les services. Les demandes sont traitées par une secrétaire et un agent du DIM, sous la responsabilité d’un médecin. Les services de soins et les médecins responsables des séjours sont systématiquement avisés de la demande et interrogés sur la nécessité d’un accompagnement et sur un éventuel refus de la personne décédée en cas de demande émanant d’ayants droit. L’intranet du CHU contient une page décrivant l’intégralité de la procédure.
Un logiciel créé à l’intérieur du CHU permet d’assurer le suivi des demandes et de transmettre des courriers normalisés aux demandeurs et services concernés. Son fonctionnement est calqué sur le déroulement de la procédure et prend en compte les spécificités de chaque type de demande.
▪ Lorsqu’elle reçoit une demande d’accès au dossier médical, la Clinique du Pré adresse au demandeur un formulaire tendant à lui permettre de formaliser sa demande. Le médecin DIM vérifie la validité de la demande, et particulièrement, si la demande est formulée par un ayant droit, l’absence d’opposition du patient avant son décès.
Après validation par le médecin DIM, le dossier est sorti des archives et photocopié par des personnels des services administratifs. Une copie de réserve est faite pour le cas où un contentieux serait ultérieurement introduit.
▪ Lorsqu’un patient ou un ayant droit écrit pour demander son dossier médical, le CHM adresse un accusé de réception standard l’informant des démarches à effectuer et de ses droits. Les demandes peuvent être adressées à la direction, à un service de soins ou au service central des dossiers médicaux ; toutes les demandes sont in fine transmises à ce dernier. La principale difficulté dans le traitement des demandes réside dans la réalisation des copies, aucun personnel n’étant spécifiquement affecté à cette tâche. Pour limiter le volume des copies à réaliser, le service central des dossiers médicaux insiste auprès des demandeurs pour qu’ils précisent les pièces dont ils demandent communication. Les clichés d’imagerie médicale ne sont pas reproduits mais prêtés aux patients, mais ces derniers ne les ramènent à l’hôpital que rarement.
▪ Lorsqu’un patient écrit pour demander son dossier médical, le CHAG vérifie que le courrier est accompagné d’une photocopie d’une pièce d’identité et de la carte vitale. Lorsqu’il s’agit d’un ayant droit, il vérifie en outre la justification de la qualité de l’intéressé ainsi que la raison exacte de sa demande. Après avoir envoyé la demande au médecin chef du service concerné, le dossier est généralement envoyé avec accusé de réception aux frais du demandeur plutôt que consulté sur place.
▪ Au GHPS, le traitement des demandes d’accès au dossier médical n’est pas centralisé ; les demandes sont donc susceptibles d’être adressées soit directement aux services de soins, soit au responsable des archives médicales qui transmet alors le dossier aux services de soins pour communication au patient, soit au service des relations avec la clientèle ou à la direction de l’établissement.
▪ Au CCML, la demande doit être adressée à la direction générale, à laquelle les services médicaux adressent les demandes qui ont été formulées directement auprès d’eux. Un formulaire est fourni au patient pour lui permettre de préciser sa demande et le mode de communication souhaité. Après avoir vérifié la recevabilité de la demande, la direction générale fait évaluer le coût de la transmission par le service des archives et adresse un devis au demandeur. Les copies du dossier médical sont envoyées au patient à réception du paiement.
— Nombre annuel de demandes
Le nombre de demandes d’accès au dossier médical varie en fonction du nombre des hospitalisations. Le point de comparaison utilisé sera le nombre total de séjours de MCO (médecine, chirurgie, obstétrique) en hospitalisation complète et de jour en 2008 (181) :
▪ En 2008, le CHU de Rennes a reçu 1 095 demandes de communication pour 90 516 séjours, soit 12,1 demandes pour 1 000 actes. Le nombre de demandes est en augmentation : il y en avait 635 en 2003 et 994 en 2005.
▪ En 2008, la Clinique du Pré a reçu 46 demandes de communication pour 22 345 séjours, soit 2 demandes pour 1 000 actes. 50 demandes avaient été formulées en 2007.
▪ En 2008, le CH du Mans a reçu 644 demandes de communication pour 55 520 séjours, soit 11,6 demandes pour 1 000 actes. 612 demandes avaient été formulées en 2007.
▪ En 2008, le CHAG a reçu 98 demandes de communication pour 19 147 séjours, soit 5,1 demandes pour 1 000 séjours. Le nombre de demandes qui était de 74 en 2005, est passé à 100 en 2006 et à 120 en 2007.
▪ AU GHPS, sur environ 1 250 courriers de réclamations par an, 650 concernent des demandes d’accès au dossier médical. Néanmoins, ce chiffre ne rend compte que des demandes formulées auprès du service de la clientèle de la Pitié-Salpêtrière, soit seulement 30% du total estimé des demandes d’accès au dossier médical. Le nombre de demandes d’accès au dossier médical est donc de l’ordre de 2 000 par an pour 94 826 séjours de MCO, soit 21 demandes pour 1 000 séjours.
▪ Le CCML a reçu 55 demandes de communication en 2006, 80 en 2007 et 63 en 2008, pour 6 809 séjours, soit 9,2 demandes pour 1 000 actes. Chaque année, environ 35 % des demandes ne sont pas suivies d’une communication du dossier médical, la plupart du temps parce que le demandeur abandonne sa demande, plus rarement parce que la loi ne lui permet pas d’obtenir communication du dossier médical. 36 dossiers ont été communiqués en 2006, 51 en 2007 et 39 en 2008.
— Délais de communication
▪ En 2008, les délais moyens de communication par le CHU de Rennes étaient de 18 jours pour les dossiers de moins de 5 ans et de 21 jours pour les dossiers de plus de 5 ans. Ces délais étaient respectivement de 36 et de 32 jours en 2006. Pour les dossiers de moins de 5 ans, le pourcentage de demandes satisfaites dans le délai légal de 8 jours a diminué, passant de 45 % en 2006 à 37 % en 2008.
▪ Le délai moyen de communication par la Clinique du Pré est de 7,8 jours en 2008. Ce délai était de 9 jours en 2007.
▪ Le délai moyen de communication par le CHM est de 16,5 jours en 2008. 61 % des dossiers sont transmis dans le délai de 8 jours.
▪ Au CHAG, pour les dossiers de moins de 5 ans, le respect du délai de communication de 8 jours dépend des services. Il est toutefois difficilement respecté, à l’exception des demandes fondées sur des expertises. Dans cette hypothèse, une veille sur le suivi de la demande au sein de l’établissement et sur l’envoi du dossier est instituée par le service de réception des demandes.
▪ Au GHPS, s’agissant des 650 demandes adressées à la direction de la clientèle, le délai moyen de communication des dossiers médicaux est de 60 jours. Quant au délai moyen de communication pour les demandes adressées directement aux services de soins, il n’existe aucune donnée statistique à ce jour.
▪ Au CCML, le délai moyen de communication des dossiers de moins de 5 ans est de 28 jours en 2008, contre 31 en 2006. Le délai moyen de communication des dossiers de plus de 5 ans est de 33 jours, contre 21 en 2006. En 2008, 28 % des demandes concernant des dossiers de moins de 5 ans ont été satisfaites dans le délai légal, contre 86 % pour les dossiers de plus de 5 ans.
— Coût des copies
▪ Au CHU de Rennes, le coût de chaque copie est de 0,1 euro et celui de chaque reproduction d’images (contretype) est de 5 euros. Le montant total facturé en 2008 a été de 10 000 euros pour 900 dossiers transmis, soit un coût moyen de 11 euros. Toutefois, les dossiers dont le coût de reproduction est inférieur à 5 euros ne sont pas facturés.
▪ À la Clinique du Pré, le coût de chaque copie est de 0,1 euro. La fourchette des tarifs des dossiers communiqués va de 5 à 30 euros. Les clichés d’imagerie médicale, remis au patient après chaque hospitalisation, n’ont pas à être reproduits.
▪ Le CH du Mans est le seul établissement visité par la mission qui ne facture pas les copies des dossiers médicaux. Les clichés d’imagerie médicale ne sont pas reproduits mais prêtés au demandeur contre signature d’une décharge.
▪ Au CHAG, le coût de chaque copie est de 0,152 euro et celui de chaque reproduction de clichés radiologiques varie selon le format allant de 1,377 euros (24x30) à 3,002 euros (36x43). Lorsqu’un patient demande une copie de ceux de ses examens qui ont été numérisés, le CD lui est donné gratuitement.
▪ Au GHPS, chaque copie est facturée 0,18 euro ; pour ce qui concerne l’imagerie médicale, les radios sont remises au patient, qui doit préalablement signer une décharge. Le montant total facturé en 2008 a été de 2 677 euros, les frais d’envoi restant à la charge de l’hôpital. Toutefois, le montant recouvré reste en deçà de celui des copies facturées, puisqu’en 2008, 2 104 euros auront été encaissés. Quant aux demandes de dossiers adressées directement aux services de soins, elles ne font pas l’objet de facturation.
▪ Au CCML, chaque photocopie est facturée 0,18 euro, chaque cliché radiographique 5 euros et chaque feuille de réanimation 3 euros. Les dossiers dont le coût de reproduction est inférieur à 5 euros ne sont pas facturés ; en 2008, 41 % des dossiers transmis n’ont pas été facturés. Le coût moyen de reproduction des dossiers médicaux était de 35 euros en 2006, 32 euros en 2007 et 66 euros en 2008. Les montants les plus importants facturés sont de l’ordre de 200 euros.
2. Prévention des infections nosocomiales
Tous les établissements visités possèdent un Comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) et une équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH). Les scores des tableaux de bord de lutte contre les infections nosocomiales publiés par le ministère de la santé sur son site Internet (182) sont signalés pour mémoire.
▪ Au CHU de Rennes, les actions du CLIN et de l’EOHH sont relayées dans chaque unité par trois correspondants (médecin, infirmier et aide-soignant). Le rapport de certification du CHU de Rennes par la Haute Autorité de santé (HAS) en novembre 2008 souligne les points suivants : le CHU met en œuvre des formations régulières à l’hygiène de tous les professionnels (nouveaux arrivants, personnels temporaires et permanents) ; les recommandations de bon usage des antibiotiques sont respectées ; le dispositif de signalement des infections nosocomiales est organisé et opérationnel, même si la HAS souligne qu’il existe une faible déclaration des infections nosocomiales.
Le score agrégé du CHU de Rennes est en classe A. En 2008, le CHU a connu 338 événements indésirables dont 7 infections nosocomiales.
▪ Le CLIN existe à la Clinique du Pré depuis 1995. Il définit annuellement un programme d’actions de prévention, de formation et de surveillance. Une sensibilisation des personnels est faite mensuellement par un journal interne « Qualité – Hygiène », transmis avec le bulletin de salaire.
En 2008, la Clinique du Pré a déclaré 148 événements indésirables. La Clinique du Pré ne figurait pas dans le classement du ministère de la santé fondé sur le score agrégé publié en janvier 2009, en raison de l’absence de renseignement de l’indicateur SURVISO. M. Claude Le Bars, directeur général, a indiqué que l’absence de surveillance du site opératoire en 2007 s’expliquait par le fait que cette surveillance n’était pas prise en compte dans le calcul du score agrégé avant 2007. Pour les autres indicateurs, la Clinique est en classe C pour l’indicateur ICALIN et pour l’indicateur ICSHA (consommation des solutions hydroalcooliques), et en classe E pour l’indicateur ICATB (bon usage des antibiotiques). Le taux de SARM était de 0,24 pour 1 000 journées d’hospitalisation.
▪ Au CHM, les actions du CLIN et du service des préventions des infections nosocomiales (SPIN) sont relayées dans chaque unité par des correspondants médicaux et paramédicaux et par des référents qualité. Le SPIN emploie 7 personnes à temps plein. Il élabore et met à jour des recommandations de bonnes pratiques d’hygiène, forme les professionnels du CH à la prévention des infections nosocomiales, joue un rôle de vigilance à travers la gestion des événements précurseurs et sentinelles du risque infectieux nosocomial, et évalue les pratiques professionnelles ayant un impact sur la prévention des infections nosocomiales.
Le score agrégé du CHM est en classe B.
▪ Le CLIN du CHAG conduit plusieurs actions contre les infections nosocomiales tendant à améliorer la prévention – par l’élaboration de référentiels et de recommandations et la mise en place de nombreuses formations internes – et la veille épidémiologique – par une investigation en interne des cas signalés (soit 5 à 7 % des patients) et par un suivi des incidents les plus graves ou des incidents qui auraient pu être évités. Avec les services techniques, une veille environnementale a par ailleurs été mise en place.
L’EOHH met en œuvre la politique du CLIN. Chaque semaine, elle fait le point sur les difficultés rencontrées, sur les axes de priorités et la mise à jour du plan d’actions. Un module spécifique informatisé lui permet de suivre les deux sites, de définir ses domaines d’intervention les plus importants, de répertorier les services qui la contactent le plus souvent et de sauvegarder les avis donnés ou les comptes rendus de réunion.
De 2007 à 2008, le taux des staphylocoques dorés résistants à la méthicilline (SARM) est passé de 0,46 à 0,31 pour 1 000 journées d’hospitalisation et la consommation des solutions hydroalcooliques a augmenté de près de 50 %.
Le score agrégé du CHAG est en classe B.
▪ Le CLIN du GHPS bénéficie d’une expertise ancienne en matière de prévention des infections nosocomiales, puisqu’il a été créé avant même que la loi n’oblige les établissements de santé à se doter d’une telle structure de prévention. Il se réunit au rythme de trois réunions par an, et associe à l’ensemble de ses travaux les représentants des usagers, la loi n’imposant en principe leur présence qu’au moment de la présentation du rapport annuel du CLIN.
L’EOHH a également mis en place des formations régulières à destination des personnels paramédicaux (sur 4 601, 30% ont été formés sur l’année) et des personnels médicaux (sur 744 personnels, seuls 16% ont été formés). Ces formations ne présentent aucun caractère obligatoire, mais néanmoins certains obstacles sont apparus pour les mettre en œuvre : le personnel paramédical et surtout médical manque de temps pour se former ; la culture hygiéniste n’est aujourd’hui pas encore partagée par tous ; il est difficile en pratique de former les personnels travaillant la nuit. Le score agrégé du GHPS est en classe A.
▪ Le CLIN du CCML se réunit trois à quatre fois par an, tandis que l’EOHH se réunit au minimum une fois par mois et ponctuellement sur des sujets spécifiques. Le CCML a connu en 2008 une augmentation des infections du site opératoire au cours du premier semestre, ce qui l’a conduit à mettre en place différentes actions pour tenter d’enrayer cette évolution. En 2008, le CLIN a organisé 29 journées de formation à destination de ses personnels.
Le score agrégé du CCML est en classe B.
3. Indemnisation des infections nosocomiales
▪ Le CHU de Rennes a reçu, en 2008, 338 réclamations, dont 7 concernaient des infections nosocomiales. Les réclamations sont de plus en plus souvent formulées directement devant la CRCI ; en 2008, la proportion des contentieux présentés devant la CRCI et de ceux présentés devant le tribunal administratif s’est pour la première fois inversée en faveur de la CRCI (60 % des recours). Au 22 avril 2009, 14 dossiers contentieux en cours concernent des suspicions d’infections nosocomiales. La commission de médiation de l’établissement, qui existe depuis 3 ans et a traité 50 dossiers, n’a eu à connaître qu’un seul dossier concernant une infection nosocomiale.
▪ La Clinique du Pré a reçu, en 2008, 24 réclamations, dont 7 concernaient un problème suite à une intervention et 2 un décès. Le nombre de réclamations liées à une infection nosocomiale n’est cependant pas comptabilisé en tant que tel.
▪ Le CHM a reçu, en 2008, 144 plaintes, dont 3 concernaient des infections nosocomiales. 3 dossiers de 2006 concernant des infections nosocomiales ont donné lieu à une indemnisation en 2007 ou 2008. 16 dossiers contentieux en cours concernent des suspicions d’infections nosocomiales.
▪ Le CHAG a reçu, depuis 2005, 20 réclamations, dont 3 concernaient des suspicions d’infections nosocomiales ; 2 de ces dossiers sont encore en cours.
▪ La direction de la clientèle du GHPS reçoit environ 1 250 réclamations par an. S’agissant précisément des réclamations pour infections nosocomiales, de 2007 à 2009, 22 réclamations ont été comptabilisées : pour 3 d’entre elles, les CRCI ont émis des avis favorables ; 2 vont aboutir sur des reconnaissances de responsabilité ; 8 ont été rejetées soit par les CRCI, soit par la direction des affaires juridiques de l’AP-HP ; 8 demandes sont en cours.
▪ Le CCML a reçu en moyenne de 1996 à 2008 8 demandes de réparation par an. De 1996 à 2006, les infections nosocomiales représentaient en moyenne 25 % du total des demandes de réparation. En 2007 et 2008, le nombre de demandes d’indemnisation au titre d’infections nosocomiales a doublé pour représenter 50 % du nombre total des demandes, qui est resté inchangé (4 sur 8).
En 2008, 25 % des demandes d’indemnisation adressées au CCML ont été formulées devant la CRCI. Compte tenu de la lourdeur des actes pratiqués au CCML, le seuil d’accès aux CRCI n’est que rarement une difficulté pour les demandeurs, le dommage invoqué étant souvent un décès ou un handicap lourd. De ce fait, le CCML oriente largement les réclamations vers la CRCI. Malgré cela, la voie judiciaire reste privilégiée : sur les 15 demandes concernant des décès ou des séquelles permanentes handicapantes formulées à l’encontre du CCML depuis 1996, 8 ont donné lieu à une procédure juridictionnelle (dont une devant le juge pénal), 5 ont été portées devant la CRCI et 2 ont donné lieu à un règlement amiable avec l’assureur.
AP-HP |
Assistance publique – Hôpitaux de Paris |
CADA |
Commission d’accès aux documents administratifs |
CCLIN |
Centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales |
CH |
Centre hospitalier |
CHU |
Centre hospitalier universitaire |
CISS |
Collectif interassociatif sur la santé |
CLIN |
Comité de lutte contre les infections nosocomiales |
CNOM |
Conseil national de l’Ordre des médecins |
CNAMed |
Commission nationale des accidents médicaux |
CRCI |
Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales |
CRUQ |
Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge |
CTINILS |
Comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins |
DHOS |
Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins |
EOHH |
Équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière |
HAS |
Haute Autorité de santé |
IAS |
Infection associée aux soins |
ICALIN |
Indicateur composite d’activités de la lutte contre les infections nosocomiales |
ICATB |
Indice composite de bon usage des antibiotiques |
ICSHA |
Indicateur de consommation de solutions ou de produits hydroalcooliques |
InVS |
Institut de veille sanitaire |
IPP |
Incapacité permanente partielle |
ITT |
Incapacité temporaire de travail |
MCO ONIAM |
Maladie, chirurgie, obstétrique Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales |
RAISIN |
Réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections nosocomiales |
SARM |
Staphyloccocus aureus résistant à la méticilline |
SURVISO |
Indicateur de surveillance des infections du site opératoire |
1 () La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
2 () Jusqu’au 30 juin 2009.
3 () À compter du 1er juillet 2009.
4 () Rapport (n° 3263, XIème législature) de MM. Claude Évin, Bernard Charles et Jean-Jacques Denis au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé (n° 3258), Volume I, p. 8.
5 () Réunion de la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République du mardi 16 décembre 2008 ; réunion de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales du 30 janvier 2009.
6 () Voir, infra, l’annexe « Compte rendu des déplacements de la mission d’information ».
7 () La loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière évoquait incidemment le dossier d’un malade en imposant aux établissements d’hospitalisation publics de le communiquer au médecin traitant.
8 () Rapport (n° 3263, XIe législature) de MM. Claude Évin, Bernard Charles et Jean-Jacques Denis au nom de la Commission des Affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé (n° 3258), Volume I, p. 9.
9 () Pour des raisons de simplification des énoncés, les termes : « professionnels de santé », « praticiens » et « équipes médicales » seront indifféremment employés dans le texte de ce rapport.
10 () Selon les termes employés devant la mission, par le Docteur Walter Vorhauer, Secrétaire général du Conseil national de l’Ordre des médecins, lors de son audition du 28 avril 2009.
11 () Audition du 24 mars 2009.
12 () Audition du 24 mars 2009.
13 () Remplacée aujourd’hui par la Haute Autorité de santé.
14 () Publiée sur le site Internet : www.web.ordre.medecin.fr/actualite/dossiersmedicaux2009.pdf.
15 () Décision Ordre national des médecins du 26 septembre 2005.
16 () Audition du 24 mars 2009 de MM. Jean-Patrick Lerendu, secrétaire général de la Commission d’accès aux documents administratifs, et Alexandre Pascal, rapporteur.
17 () Arrêté portant modification de l’arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement de cet accès.
18 () Décision précitée Ordre national des médecins du 26 septembre 2005.
19 () Voir, infra, le paragraphe « Des mises en place progressives des commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ».
20 () Du 6 au 29 décembre 2007, les 85 appelants de « Santé Info Droit » ont été interrogés sur ce sujet par le biais d’un questionnaire. Ce centre téléphonique, créé et mis en œuvre par le CISS, est composé d’avocats et de juristes spécialisés, soumis au secret professionnel ; il s’adresse à toute personne confrontée à des difficultés, des doutes, des interrogations et plus spécialement aux représentants des usagers du système de santé, aux usagers eux-mêmes et aux professionnels médico-sociaux et/ou aux intervenants associatifs.
21 () Docteur Walter Vorhauer – Audition du 28 avril 2009.
22 () Ensemble des représentants des syndicats de médecins - Table ronde du 28 avril 2009.
23 () M. Jean Wils, chargé de la mission « droits des usagers et des relations avec les associations » à l’Hôpital Européen Georges Pompidou – Audition du 24 mars 2009.
24 () Ainsi, au cours de ses visites - dont le nombre est limité mais dont les exemples sont probants - la mission a constaté que les d’établissements indiquaient effectivement dans leur livret d’accueil les procédures d’accès au dossier médical et les coordonnées du responsable ou du service compétent et qu’ils doublaient cette information par un affichage dans différents locaux ouverts aux usagers.
25 () Rapport sur les droits des malades -2007/2008, p. 31 (Presses de l’EHESSP).
26 () Visité par le mission le 18 juin 2009.
27 () Voir annexe infra.
28 () Cette enquête, fondée sur les 1 692 déclarations des 2 815 établissements publics et privés sollicités (soit un taux de réponse de 60,1 %), peut être consultée sur le site Internet :
www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cru_faq/document.ppt
29 () Audition du 3 mars 2009.
30 () Audition du 17 juin 2009.
31 () Sur un échantillon de 3 800 patients, soit 100 patient, choisis au hasard parmi ceux qui avaient demandé la communication de leur dossier en 2006, par chacun des 38 établissements concernés.
32 () Table ronde organisée par la mission, le 5 mai 2009.
33 () Table ronde organisée par la mission, le 7 avril 2009.
34 () Rapport précité sur les droits des malades -2007/2008, p. 36.
35 () Applicable dans les seuls les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier.
36 () Pris en application de l’article 2 du décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 qui a été abrogé par le décret précité n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs, cet arrêté est resté en vigueur, l’article 35 du nouveau décret reprenant les dispositions mêmes de l’article 2 susvisé.
37 () Audition du 3 mars 2009.
38 () Audition du 3 mars 2009.
39 () Audition du 30 juin 2009.
40 () Voir, supra, le paragraphe « Une information inefficace ».
41 () Ce taux doit néanmoins être utilisé avec prudence car les personnes interrogées par le centre d’appel sont par définition en difficulté avec le système de santé.
42 () Rapport précité sur les droits des malades -2007/2008, p. 35.
43 () Table ronde de représentants d’associations de patients et d’usagers du système de santé du 7 avril 2009.
44 () Audition du 10 mars 2009.
45 () Audition du 28 avril 2009.
46 () Audition du 28 avril 2009.
47 () A l’HEGP et au GHPS, cette quantification ne concerne que les demandes adressées à la direction de l’hôpital, les demandes de communication de documents médicaux formulées directement auprès des services n’étant pas comptabilisés.
48 () Rapport précité sur les droits des malades -2007/2008, p. 31.
49 () Voir, supra, « Les ayants droit en cas de décès du patient ».
50 () Audition de M. Jean Wils, chargé de la mission « droits des usagers et des relations avec les associations » à l’Hôpital Européen Georges Pompidou du 24 mars 2009.
51 () Visite du 30 avril 2009.
52 () Au centre chirurgical Marie Lannelongue, cette difficile reproduction est confiée à un prestataire extérieur.
53 () Audition du 5 mai 2009.
54 () . Représentant la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratif (FEHAP) lors de la table ronde de représentants des fédérations d’établissements de santé du 5 mai 2009.
55 () Auditions des 3 mars et 28 avril 2009.
56 () Rapport précité sur les droits des malades -2007/2008, p. 35.
57 () Cette enquête précitée de la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) peut être consultée sur le site Internet : www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cru_faq/document.ppt
58 () Voir, infra, l’annexe « Compte rendu des déplacements de la mission d’information ».
59 () Voir, supra, le paragraphe « La conservation du dossier ».
60 () Rapport d’information n° 659, déposé par M. Jean-Pierre Door – janvier 2008.
61 () Sur un total de 3 534 demandes de règlement amiable en vue d’indemnisation et 45 demandes initiales de conciliation - Cf. p. 14 du rapport.
62 () Recommandations pour la pratique clinique : accès aux informations concernant la santé d’une personne – Décembre 2005.
63 () Information du patient dans la loi du 4 mars 2002 : accès aux informations de santé – Août 2003, mis à jour en octobre 2008.
64 () Audition du 30 juin 2009.
65 () Adopté définitivement par le Parlement le 24 juin 2009.
66 () Voir, infra, l’annexe « Compte rendu des déplacements de la mission d’information ».
67 () Mise en place du tableau de bord des infections nosocomiales (2006) et mise en ligne par le ministère de la santé de « Platines », plate-forme d’informations sur les établissements de santé ( 2007).
68 () Maladie, chirurgie, obstétrique.
69 () Autoévaluation de tous les établissements publics ou privés volontaires. Intégrant un dispositif de suivi, elle tend à faire travailler au mieux l’ensemble des personnels d’un établissement afin d’assurer une prise en charge de qualité.
70 () Edité sur le site Internet de la HAS : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_713085/les-guides-manuels-supports-a-lire-v2010.
71 () Audition du 30 juin 2009.
72 () Voir, supra, le paragraphe « Des coûts variables de reproduction ».
73 () Table ronde de représentants d’associations de patients et d’usagers du système de santé du 7 avril 2009.
74 () Voir, supra, le paragraphe « La brièveté du délai de communication des dossiers les plus récents ».
75 () Le 7 avril 2009.
76 () « L'information des malades et l'accès au dossier médical » - Étude de législation comparée- Sénat, n° 78 (octobre 2000).
77 () Audition du 3 mars 2009.
78 () M. André Fritz, directeur général du CHU de Rennes a indiqué à la mission que les dossiers dont le coût de reproduction est inférieur à 5 euros ne sont pas facturés car le Trésor public ne recouvre pas les sommes inférieures à ce montant.
79 () Table ronde de professionnels du droit et de la réparation des préjudices corporels du 26 mai 2009.
80 () Ibidem.
81 () Aux termes de l’article L. 1142-5 du code de la santé publique, tout litige entre usagers et professionnels ou établissements de santé peut être porté devant les CRCI à des fins de conciliation.
82 () Recommandations pour la pratique clinique : Accès aux informations concernant la santé d’une personne - Modalités pratiques et accompagnement (décembre 2005).
83 () Audition du 24 mars 2009.
84 () « Évolution du dossier médical, nouveaux enjeux de la relation médecins-soignants-patients : approche historique, médicale, médicolégale et éthique » - Document publié sur le site Internet de l’Inserm : http://infodoc.inserm.fr/ethique/ethique.nsf/397fe8563d75f39bc12563f60028ec43/1779cae1c5135608c1256cbf005ef437?OpenDocument.
85 () Article L. 1111-6 du code de la santé publique.
86 Connaître les causes de la mort, « défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits (article L. 1111-7 du code de la santé publique).
87 () Voir, infra, l’annexe « Compte rendu des déplacements de la mission d’information ».
88 () CTINILS, Définition des infections nosocomiales, mai 2007.
89 () Sur cette différence de régime, voir, infra, B du III.
90 () Sur les différents régimes d’indemnisation des infections nosocomiales et le régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, voir, infra, B du II.
91 () Voir, infra, B du III.
92 () Sur la question de la définition légale des infections nosocomiales et autres notions médicales visées par la loi, voir, infra, A du III.
93 () Pierre Sargos, L’aléa thérapeutique devant le juge judiciaire, JCP, 2000, I, 202 ; Geneviève Viney, L’indemnisation des accidents médicaux, LGDJ, 1997.
94 () Audition du 10 mars 2009.
95 () http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/nosoco/tab_bord/accueil.htm
96 () Audition du 30 juin 2009.
97 () La mesure d’une maîtrise des SARM n’a pas de sens dans les établissements qui en identifient très peu en raison de la nature ou du volume de leur activité.
98 () Audition du 30 juin 2009.
99 () http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/nosoco/dossier.pdf
100 () Rapport de M. Alain Vasselle, sénateur, au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé, n° 3188 (Assemblée nationale), juin 2006, p. 10.
101 () Isabelle Poujol, Christine Jestin, Arnaud Gautier, Marie Jauffret-Roustide, Bruno Coignard, Perception du risque nosocomial dans la population française, 2005-2006, Bulletin épidémiologique hebdomadaire, nos 12-13, 3 avril 2007, p. 101.
102 () OPEPS, op. cit., p. 10.
103 () Isabelle Poujol, Christine Jestin, Arnaud Gautier, Marie Jauffret-Roustide, Bruno Coignard, op. cit., p. 101.
104 () Tables rondes des 28 avril et 12 mai 2009.
105 () Analyse du risque infectieux lié à la non stérilisation entre chaque patient des porte-instruments rotatifs en chirurgie dentaire, éditée sur le site Internet : http://invs.sante.gouv.fr.
106 () CE 9 décembre 1988, Cohen, Recueil Lebon n° 65087.
107 () Bulletin civil 1996, I, N° 219 p. 152.
108 () Bulletin civil 1999, I, N° 222 p. 143.
109 () Rapport (n° 3263, XIe législature) de MM. Claude Évin, Bernard Charles et Jean-Jacques Denis au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé (n° 3258), Volume I, p. 14.
110 () Rapport (n° 464, XIIe législature) de M. Jean-Pierre Door, au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la responsabilité civile médicale, p. 7.
111 () Rapport (n° 3263, XIe législature) de MM. Claude Évin, Bernard Charles et Jean-Jacques Denis au nom de la Commission des Affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé (n° 3258), Volume I, p. 14.
112 () L’article 112 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures a substitué ces deux notions d’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de déficit fonctionnel temporaire à celle d’interruption temporaire de travail (ITT), dont l’interprétation restrictive avait donné lieu à de vives critiques. Sur ce point, voir infra, C du III.
113 () Le septième alinéa de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique dispose : « Si l’office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d’un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1142-14 est engagée, il dispose d’une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l’office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l’article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l’assuré à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. ».
114 () M. Michel Germond, directeur de la SHAM, intervention lors du colloque « La lutte contre les infections nosocomiales : une urgence hospitalière », Les cahiers de la convention démocrate-L’Harmattan, p. 159.
115 () Annuaire statistique de la justice, édition 2008, p. 75 ; Projet annuel de performances 2009 de la mission « Conseil d’État et autres juridictions administratives », p. 29.
116 () Table ronde du 5 mai 2009.
117 () Cependant, cette mission de conciliation est très peu utilisée. L’ensemble des CRCI n’a reçu en 2008 que 45 demandes de conciliation, alors que 3 534 demandes de règlement amiable ont été adressées. Sur l’échec de la fonction de conciliation, voir infra, C du III.
118 () Pour que la victime puisse saisir la CRCI, le dommage subi doit :
— être directement imputable à des actes de soin ;
— avoir des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient ou de son évolution prévisible ;
— présenter une gravité suffisante : soit 24 % d’incapacité permanente partielle, soit six mois d’incapacité totale de travail, soit une incapacité définitive à exercer sa profession antérieure, soit des troubles d’une particulière gravité dans les conditions d’existence.
119 () CNAMed, Rapport annuel au Parlement et au Gouvernement, année 2007-2008, p. 16.
120 () Danièle Cristol, Infections nosocomiales : entre responsabilité hospitalière et solidarité nationale, Revue de droit sanitaire et social, p. 847.
121 () Audition du 5 mai 2009.
122 () Audition du 30 juin 2009.
123 () Claude Rambaud, Point du vue d’une association de défense des victimes, La revue hospitalière de France, n° 520, dossier spécial « Indemnisation des accidents médicaux », janvier-février 2008, p. 69.
124 () Audition du 30 juin 2009.
125 () Dominique Martin, Indemnisation : la voie du règlement amiable, La revue hospitalière de France, n° 520, dossier spécial « Indemnisation des accidents médicaux », janvier-février 2008, p. 50.
126 () Annuaire statistique de la justice, édition 2008, p. 75 ; Projet annuel de performances 2009 de la mission « Conseil d’État et autres juridictions administratives », p. 29.
127 () Françoise Avram, Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation : Faciliter l’indemnisation des victimes, La revue hospitalière de France, n° 520, dossier spécial « Indemnisation des accidents médicaux », janvier-février 2008, p. 40.
128 () Table ronde du 5 mai 2009.
129 () Table ronde du 28 avril 2009.
130 () Claude Rambaud, Point du vue d’une association de défense des victimes, La revue hospitalière de France, n° 520, dossier spécial « Indemnisation des accidents médicaux », janvier-février 2008, p. 69.
131 () Rapport (n° 464, XIIe législature) de M. Jean-Pierre Door, au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la responsabilité civile médicale, p. 10.
132 () Article 58 du projet de loi (n° 3582), adopté par le Sénat après déclaration d’urgence, relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé :
« Art. L. 1142-1-A (nouveau). - On entend par :
« 1° Accident médical, tout événement imprévu causant un dommage accidentel ayant un lien de causalité certain avec un acte médical ;
« 2° Affection iatrogène, tout dommage subi par un patient, directement lié aux soins délivrés ;
« 3° Infection nosocomiale, toute infection qui apparaît au cours ou à la suite d’une hospitalisation alors qu’elle était absente à l’admission dans l’établissement de santé.
133 () Rapport (n° 3587, XIe législature) de M. Claude Évin au nom de la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi après déclaration d’urgence, relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé (n° 3582), p. 48.
134 () Audition du 30 juin 2009.
135 () CTINILS, Définition des infections nosocomiales, mai 2007, p. 3. Les représentants des assureurs entendus par la mission ont cependant critiqué l’utilisation à des fins d’indemnisation de cette définition, faisant valoir que le CTINILS avait explicitement indiqué que la définition donnée avait un objet exclusivement épidémiologique et non d’indemnisation : « Ce document a pour objectif de définir le champ de l’ensemble des infections associées aux soins et de présenter une actualisation des définitions de l’infection nosocomiale dans un but opérationnel de surveillance épidémiologique, de prévention et de gestion du risque infectieux par les professionnels de santé ».
136 () OPEPS, op. cit., p. 10.
137 () Table ronde du 12 mai 2009.
138 () Domitille Duval-Arnould, Les infections nosocomiales, point de jurisprudence, Recueil Dalloz 2007, p. 1675.
139 () On rappellera que les infections nosocomiales sont une catégorie d’infection associée aux soins dont la particularité est d’être contractée dans un établissement de santé ; en cas d’infection contractée en médecine de ville, il convient donc d’utiliser l’expression « infection associée aux soins » et non celle d’« infection nosocomiale ». Sur la définition des infections nosocomiales et des IAS, voir supra,
140 () Audition du 3 mars 2009 et table ronde du 12 mai 2009.
141 () Audition du 28 avril 2009.
142 () Sur l’absence de données épidémiologiques sur les IAS en médecine de ville, voir supra.
143 () Table ronde du 28 avril 2009.
144 () Voir CNAMed, Rapport annuel au Parlement et au Gouvernement, année 2007-2008, p. 19 et annexe n° 3 p. 83.
145 () Annexe de la première partie : barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales mentionné à l’article D. 1142-2.
146 () Audition du 3 mars 2009.
147 () CNAMed, Rapport annuel au Parlement et au Gouvernement, année 2006-2007, p. 41.
148 () Jean-Luc Bernard, Comment améliorer le dispositif d’indemnisation des accidents médicaux ?, La revue hospitalière de France, n° 520, dossier spécial « Indemnisation des accidents médicaux », janvier-février 2008, p. 56.
149 () Rapport (n° 1145) de M. Etienne Blanc, au nom de la commission des Lois sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann (n° 1085) de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, p. 120.
150 () CNAMed, Rapport annuel au Parlement et au Gouvernement, année 2006-2007, p.s 41 et 42.
151 () Audition du 3 mars 2009.
152 () Table ronde du 7 avril 2009.
153 () CNAMed, Rapport annuel au Parlement et au Gouvernement, année 2007-2008, p.s 14 et 15.
154 () CNAMed, Rapport annuel au Parlement et au Gouvernement, année 2007-2008, p. 27.
155 () Auditions du 3 mars 2009.
156 () Table ronde du 12 mai 2009.
157 () Proposition de loi (n° 589, XIIIe législature) tendant à organiser l’information et la conciliation dans le règlement des conflits et litiges en matière de responsabilité médicale.
158 () Table ronde du 26 mai 2009.
159 () Audition du 10 mars 2009.
160 () Audition du 30 juin 2009.
161 () Table ronde du 5 mai 2009.
162 () Dominique Martin, Indemnisation : la voie du règlement amiable, La revue hospitalière de France, n° 520, dossier spécial « Indemnisation des accidents médicaux », janvier-février 2008, p. 50.
163 () Alain Garay, La mission de l’avocat devant les commissions régionales, Manuel des Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sous la direction de Gérard Mémeteau, Les études hospitalières, 2004, p. 126.
164 () Alain Garay, La mission de l’avocat devant les commissions régionales, Manuel des Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sous la direction de Gérard Mémeteau, Les études hospitalières, 2004, p. 120.
165 () Claude Rambaud, Point du vue d’une association de défense des victimes, La revue hospitalière de France, n° 520, dossier spécial « Indemnisation des accidents médicaux », janvier-février 2008, p. 69.
166 () CNAMed, Rapport annuel au Parlement et au Gouvernement, année 2006-2007, p. 38.
167 () http://www.securitesoins.fr/
168 () Dominique Martin, Indemnisation : la voie du règlement amiable, La revue hospitalière de France, n° 520, dossier spécial « Indemnisation des accidents médicaux » janvier-février 2008, p. 50.
169 () Claude Rambaud, Point du vue d’une association de défense des victimes, La revue hospitalière de France, n° 520, dossier spécial « Indemnisation des accidents médicaux », janvier-février 2008, p. 69.
170 () Rapport sur les professions du droit, commission de réflexion présidée par Maître Jean-Michel Darrois, mars 2009, p. 88.
171 () Claude Rambaud, Point du vue d’une association de défense des victimes, La revue hospitalière de France, n° 520, dossier spécial « Indemnisation des accidents médicaux », janvier-février 2008, p. 69.
172 () Rapport sur les professions du droit, commission de réflexion présidée par Maître Jean-Michel Darrois, mars 2009, p. 91.
173 () Table ronde du 12 mai 2009.
174 () Table ronde du 17 juin 2009.
175 () Table ronde du 17 juin 2009.
176 () CNAMed, Rapport annuel au Parlement et au Gouvernement, année 2007-2008, p. 62.
177 () Articles L. 1142-14 et L. 1142-17 du code de la santé publique.
178 () Table ronde du 12 mai 2009.
179 () Audition du 10 mars 2009.
180 () Table ronde du 12 mai 2009.
181 () Données fournies sur le site Internet du ministère de la santé et des sports relatif à l’activité des établissements de santé : http://www.platines.sante.gouv.fr/
182 () http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/nosoco/tab_bord/accueil.htm
© Assemblée nationale