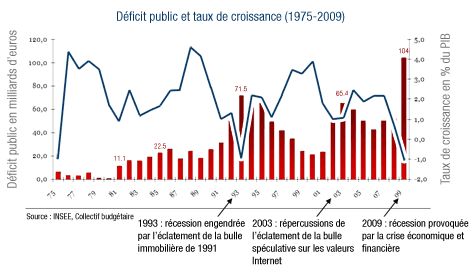N° 1978
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2009.
RAPPORT D’INFORMATION
déposé
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, en conclusion des travaux
d’une mission d’information(1) sur l’optimisation de la dépense publique,
ET PRÉSENTÉ
PAR M. Jean-Luc WARSMANN,
Député
——
La mission d’information sur l’optimisation de la dépense publique est composée de : M. Jean-Luc Warsmann, président-rapporteur ; MM. Gilles Bourdouleix, Bernard Derosier, René Dosière, Didier Quentin, Jérôme Lambert, Pierre Morel-A-L’Huissier, Jacques Valax, François Vannson.
INTRODUCTION 9
PREMIÈRE PARTIE : VERS UNE CRISE HISTORIQUE DES FINANCES PUBLIQUES 13
I. UN NIVEAU DE PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES ÉLEVÉ INCAPABLE DE FINANCER L’AUGMENTATION CONTINUE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE 13
A. UN NIVEAU DE PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES PROBLÉMATIQUE DANS UN CONTEXTE DE CONCURRENCE FISCALE EXACERBÉE 13
1. Une forte augmentation des prélèvements obligatoires depuis la fin des Trente Glorieuses 14
2. La France est, parmi les pays industrialisés, celui où la pression fiscale et sociale est la plus forte 15
3. Un contexte de concurrence fiscale dont la France doit tenir compte 17
B. UNE AUGMENTATION ININTERROMPUE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS 18
1. La dépense publique : des champs d’action et des réalités très différents 18
2. Une augmentation continue de la dépense publique depuis le premier choc pétrolier 19
3. Une dépense publique telle que les prélèvements obligatoires, pourtant déjà élevés, ne suffisent pas à la financer 21
C. FACE À LA CRISE, LES EFFORTS POUR MOBILISER PROVISOIREMENT LA DÉPENSE PUBLIQUE AFIN DE RELANCER LA CROISSANCE ET L’INVESTISSEMENT 22
1. L’injection de nouvelles dépenses pour relancer la création de richesses et d’emplois 22
2. Le choix de dynamiser l’économie immédiatement et de garder la maîtrise des finances publiques à long terme 22
II. DES DÉFICITS RÉCURRENTS DEPUIS TRENTE-CINQ ANS QUI N’ONT DE CESSE D’ALIMENTER LA DETTE PUBLIQUE 23
A. UNE FRANCE QUI VIT À DÉCOUVERT DEPUIS 1974 24
1. Des déficits récurrents même en période de croissance 24
2. Un déficit qui bondit sous l’effet de la crise 25
3. Un accroissement du déficit principalement imputable à l’État 25
B. UNE FRANCE QUI VIT À CRÉDIT DEPUIS 1974 26
1. Recourir à la dette pour financer le train de vie de l’État 26
2. Un risque d’emballement de la dette sous l’effet de la crise 27
III. UN RISQUE DE DÉCLASSEMENT DE LA FRANCE EN EUROPE À CAUSE DE FINANCES PUBLIQUES DÉGRADÉES 29
A. UN ÉTAT DONT LE DÉFICIT RESTE NETTEMENT PLUS DÉFAVORABLE QUE CELUI DE SES VOISINS EUROPÉENS 30
B. LE QUATRIÈME ÉTAT LE PLUS ENDETTÉ DE LA ZONE EURO 32
C. UN ÉTAT AYANT UNE CAPACITÉ MOINDRE QUE SES PARTENAIRES À REDRESSER SES COMPTES PUBLICS 33
D. LA FRANCE EN EUROPE : LE RISQUE D’UNE PERTE IRRÉVERSIBLE DE LEADERSHIP 33
IV. LE MODÈLE SOCIAL FRANÇAIS : UN FONDEMENT DU PACTE RÉPUBLICAIN PLUS QUE JAMAIS MENACÉ 34
A. UN MODÈLE SOCIAL À L’ÉPREUVE DES FAITS 35
1. La protection sociale : un poids économique incontournable 35
2. Quand les déficits s’ajoutent aux déficits… 35
a) Des déficits massifs et récurrents 35
b) Une solution originale en réponse à l’accroissement continu de la dette sociale : la CADES 36
B. UN MODÈLE SOCIAL À L’ÉPREUVE DE LA CRISE 39
1. 2009 : vers un déficit sans précédent du régime général de la sécurité sociale 39
2. 2009 : une date importante dans l’histoire de la dette sociale 40
C. UN MODÈLE SOCIAL À L’HEURE DES CHOIX 42
1. Une belle réussite du modèle français de protection sociale… 42
2. … dont l’assainissement financier ne peut plus être différé. 42
DEUXIÈME PARTIE : POUR UNE MOBILISATION NATIONALE 45
I. STIMULER LES RECETTES ET OPTIMISER LES DÉPENSES DE L’ÉTAT 45
A. DÉFENDRE LA RESSOURCE FISCALE DE L’ÉTAT ET AMÉLIORER SA COLLECTE 46
1. Prélever à la source l’impôt sur le revenu 46
a) La nécessité de pallier l’inefficacité du mode de recouvrement actuel 46
b) Les retombées macroéconomiques positives de la retenue à la source 47
c) Des difficultés à lever 47
2. Généraliser le télépaiement et la télédéclaration des impôts pour les entreprises 48
a) Déclaration de résultats des entreprises 48
b) Télédéclaration et télérèglement de la TVA 49
c) Télérèglement des impôts des entreprises hors TVA 50
3. Mieux plafonner les niches fiscales 51
a) Un plafonnement des niches fiscales rapportant seulement 22 millions au budget de l’État 51
b) Il faut continuer à raboter les niches 51
4. Fiscaliser l’économie souterraine 53
a) Un phénomène aux dimensions multiples 53
b) Un poids controversé mais significatif dans le produit intérieur brut 54
c) Le dispositif actuel permet de taxer en partie l’économie grise 55
d) Des obstacles à la taxation de l’économie grise persistent 56
e) Haro sur l’économie informelle 57
B. STIMULER L’INVESTISSEMENT EN FRANCE ET SANCTIONNER LES COMPORTEMENTS ABUSIFS 58
1. Maintenir le crédit d’impôt recherche 58
2. Offrir des opportunités d’amortissement plus rapide 60
a) L’amortissement dégressif : une incitation fiscale à l’investissement 60
b) L’amortissement exceptionnel : avantager fiscalement certains secteurs économiques 62
c) Étendre les règles d’amortissements dégressif et exceptionnel aux secteurs prioritaires du grand emprunt 64
3. Orienter les aides vers les entreprises citoyennes 64
a) Un dispositif étoffé d’aides publiques aux entreprises 65
b) Conditionner les aides publiques aux entreprises au respect de critères sociaux et environnementaux 65
C. UN ÉTAT EXEMPLAIRE 68
1. Un État prudent dans l’élaboration de son budget 68
2. Taxer les voitures et logements de fonction 70
a) L’exemplarité de l’État dans le projet de loi de finances pour 2010 70
b) Taxer de manière forfaitaire la valeur des voitures et logements de fonction de l’État 72
D. UN ÉTAT QUI S’ORGANISE MIEUX ET QUI RÉDUIT LE COÛT DE L’ACTION ADMINISTRATIVE 73
1. Limiter l’inflation normative, source de surcoûts budgétaires 73
a) Un flux croissant de normes… 73
b) … sources de charges supplémentaires pour la collectivité 75
c) Assouplir 1 000 normes d’ici le 31 décembre 2010 76
d) Un moratoire sur l’aggravation des normes 76
2. Mesurer et réduire la charge administrative pour les entreprises 76
3. Mutualiser les fonctions support des administrations déconcentrées de l’État au niveau de chaque région 78
4. Mettre en place une incitation financière à l’assiduité dans la fonction publique 80
a) Un absentéisme élevé dans la fonction publique comparativement au secteur privé 80
b) Renforcer le contrôle des arrêts de travail et mettre en œuvre une incitation financière à l’assiduité 81
5. Inciter l’État au paiement rapide de ses dépenses grâce au mécanisme de l’escompte 81
E. INTÉRIEUR, JUSTICE ET IMMIGRATION : DES MESURES CONCRÈTES POUR LES MINISTÈRES SUIVIS PAR LA COMMISSION DES LOIS 83
1. Ministère de l’Intérieur : de nombreux défis à relever 83
2. Ministère de la Justice : réduire le contentieux et repenser l’organisation pour une meilleure administration de la justice 85
a) Réduire le contentieux familial grâce au recours accru à la médiation familiale 86
b) Fusionner la justice de proximité et la justice de première instance 90
c) Supprimer les transfèrements inutiles de détenus grâce au recours plus systématique à la visioconférence et, chaque fois que possible, à la télémédecine 92
d) Alléger la procédure de suspension du permis de conduire, en supprimant la phase administrative 98
3. Ministère de l’Immigration : améliorer l’exécution des mesures d’éloignement et systématiser la visioconférence 99
a) Créer un ajournement de peine avec injonction de quitter le territoire français pour les étrangers en situation irrégulière 100
b) Limiter les escortes des retenus entre les centres de rétention administrative et les salles d’audiences grâce à la systématisation de la visioconférence 103
II. MIEUX ORGANISER LES COLLECTIVITÉS LOCALES 105
A. RÉDUIRE LES DOUBLONS QUI CONDUISENT À MULTIPLIER LES INTERVENTIONS COÛTEUSES 105
1. Mutualiser les services entre communes et communautés 106
a) Des économies d’échelle potentiellement considérables 106
b) Des possibilités juridiques désormais sécurisées 108
c) Une volonté souvent défaillante, qui doit être compensée par des incitations fortes 109
2. Mettre fin aux doublons entre l’État et les collectivités locales 110
B. POUR DES COLLECTIVITÉS LOCALES EXEMPLAIRES 112
1. Taxer les dépenses de communication des collectivités locales 113
2. Mieux encadrer les subventions aux associations 114
a) Dans les faits, les associations sont soumises à une série de contrôles et d’obligations législatives et réglementaires 115
b) Renforcer l’encadrement des subventions accordées aux associations 116
3. Mettre fin à la dérive des financements croisés entre collectivités 117
III. UN PLAN D’ACTIONS POUR GARANTIR L’AVENIR DU SYSTÈME FRANÇAIS DE SÉCURITÉ SOCIALE 119
A. ASSUMER DÈS AUJOURD’HUI LE FARDEAU DE LA DETTE SOCIALE : UN DEVOIR MORAL 119
1. Pour un traitement préventif de la dette 120
a) Transférer de droit tout déficit constaté à la CADES et affecter une recette nouvelle nécessaire à son apurement 120
b) Affecter à la CADES les excédents des organismes de sécurité sociale après le retour à la croissance et le rétablissement des comptes sociaux 124
c) Établir une procédure d’alerte précoce plus stricte en cas de risque sérieux de dépassement de l’ONDAM 126
d) Permettre à l’ACOSS de gérer la trésorerie disponible d’un plus grand nombre d’organismes de la sécurité sociale 127
2. Élargir et garantir le champ des ressources de la sécurité sociale pour lutter contre la dette sociale 128
a) Retirer la CRDS des impositions directes prises en compte pour l’application du bouclier fiscal 128
b) Élargir le champ de la CSG aux revenus des jeux et aux produits de la vente de métaux précieux 130
c) Accroître fortement la contribution assise sur les retraites chapeaux, les stock-options et les administrations non exemplaires 132
d) Imposer à l’État le paiement d’intérêts en cas de retard dans la compensation effective des exonérations de cotisations dues à la sécurité sociale 135
B. UTILISER DE MANIÈRE RESPONSABLE LES RESSOURCES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 137
1. Rendre plus efficace l’organisation de la sécurité sociale 137
a) Mieux évaluer le coût des procédures 137
b) Poursuivre la rationalisation du réseau des caisses primaires d’assurance maladie du régime général de la sécurité sociale 138
c) Évaluer l’efficacité du fonctionnement des caisses de congés payés 140
d) Développer la déclaration sociale nominative 141
e) Permettre l’affiliation de droit de l’assuré social à la caisse la plus proche de son domicile 143
f) Dégager des économies d’échelle en mutualisant les moyens à l’échelon régional 144
g) Permettre aux caisses de sécurité sociale d’effectuer contre rémunération le paiement des prestations couvertes par les organismes de complémentaire santé 145
2. Développer les procédures et récompenser les comportements économes des deniers publics 148
a) Favoriser des modes de garde du jeune enfant plus économes en permettant aux familles de jouer un plus grand rôle et en rendant plus attractive la garde par les assistantes maternelles 148
b) Susciter une prise de conscience et inciter à modifier les comportements pour préserver leurs droits sociaux 153
CONCLUSION : POUR UN SOMMET NATIONAL DE LA DETTE PUBLIQUE 157
EXAMEN DU RAPPORT 159
SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS 161
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 175
ANNEXE : AUDITION, EN PRÉSENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN, PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DES COMPTES, DE MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES 178
Mesdames, Messieurs,
Cette année, pour la première fois depuis plus de cinquante ans, la moitié des dépenses de l’État français va être financée à crédit. Ainsi que chacun l’admet, cette dégradation accélérée des finances de l’État s’explique ces derniers mois par la crise économique sans précédent à laquelle nous sommes confrontés, comme le reste du monde.
Des dépenses ont dû être engagées pour préserver notre économie du chaos, éviter son effondrement, et on ne peut que se satisfaire de la décision qui a été prise de relancer les investissements par un plan rapide et ambitieux. Parallèlement, les recettes publiques se sont taries ; pour preuve l’impôt sur les sociétés ne devrait rapporter à l’État, en 2009, que la moitié de ce qu’il avait rapporté en 2008. L’impact de la crise sur nos finances publiques est donc bien tangible et explique l’accroissement soudain et brutal du déficit de l’État de 2008 à 2009 : de 3,4 % à 8,2 % du PIB.
Mais les crises – celle-ci comme les autres – ont souvent un effet révélateur puissant. Outre la nécessité de réformer profondément la manière dont fonctionne notre système de marché au plan mondial, celle que nous vivons nous ouvre les yeux sur un défi qui est maintenant clairement devant nous. Nous mesurons désormais à quel point la situation de nos finances publiques est devenue insoutenable.
Cette situation, mise en lumière par la crise, n’est pas nouvelle : elle est, au contraire, le fruit d’une lente et irrésistible dérive de nos comptes publics depuis la fin des Trente Glorieuses.
Sans doute des voix se sont-elles déjà élevées contre une telle dérive, mais l’écho qu’elles ont suscité est demeuré trop faible. Par ses effets immédiats, par ceux qu’elle laisse présager à long terme, cette crise, la plus grave à laquelle la France est confrontée depuis des décennies, nous oblige aujourd’hui à déciller les yeux. Notre pays ne peut vivre dans l’illusion que seront éternellement – et presque miraculeusement – financés, demain, les déficits d’aujourd’hui. Cette prise de conscience est la condition d’un sursaut. Chacun à sa place doit y contribuer. C’est tout le sens du présent rapport.
À l’origine de cette démarche, il faut rappeler les mots du Président de la République devant le Congrès du Parlement, à Versailles, le 22 juin dernier. Le chef de l’État a alors exhorté les députés et les sénateurs à s’emparer de ce débat en demandant au Parlement « de se mobiliser pour identifier tous les dispositifs inutiles, toutes les aides dont l’efficacité n’est pas démontrée, tous les organismes qui ne servent à rien », en ajoutant que « la question centrale c’est celle de la qualité de la dépense publique ».
Forte de cette invitation inédite à la mobilisation, l’Assemblée nationale devait agir. Par une lettre en date du 1er juillet 2009, le Président de l’Assemblée nationale, M. Bernard Accoyer, a souhaité, que chaque commission contribue à la réflexion sur « l’optimisation de la dépense publique et la traque des dépenses inutiles ou des organismes dont l’utilité ne se justifie plus ».
La commission des Lois a décidé, dès le 15 juillet 2009, de créer une mission d’information sur l’optimisation de la dépense publique – composée de neuf membres – chargée d’établir un diagnostic clair et partagé sur l’état de nos finances publiques et de présenter des mesures susceptibles d’être mises en application dans les meilleurs délais.
L’ambition de la mission a été, dans ce court laps de temps, de définir des moyens permettant de rendre la dépense publique plus efficace en traquant les dépenses inutiles. Elle a cherché toutes les pistes, de manière pragmatique, pour économiser l’argent public sans pour autant que l’État, les collectivités locales ou la sécurité sociale cessent de remplir ces missions de service public auxquels les Français ont droit. En cela, la mission s’inscrit dans la continuité des réflexions menées l’an passé et qui ont abouti, par exemple lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2009, à rationaliser les frais de gestion des autorités administratives indépendantes. La mission s’est en cela concentrée sur les départements ministériels qui relèvent de sa compétence : l’intérieur, la justice et l’immigration.
Mais la mission a également perçu les limites de cet exercice si on n’envisage pas la situation d’un point de vue global, en s’interrogeant sur la dette publique, son évolution très inquiétante et ses conséquences qui pourraient être dramatiques non seulement pour notre économie mais aussi pour notre modèle de société. La commission des Lois a depuis longtemps exprimé cette préoccupation : c’est elle qui, à l’initiative de votre rapporteur, a cherché, en 2005, à limiter l’accumulation de la dette sociale, en prévoyant que tout transfert de dette à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) devait être systématiquement accompagné d’une ressource nouvelle.
Enfin, face à la crise, la mission a cherché les moyens d’assurer de meilleures rentrées fiscales afin d’équilibrer nos finances publiques tout en stimulant l’investissement qui est la clé des réussites futures.
La mission a réalisé tout au long du mois de septembre de très nombreuses auditions, lui permettant de recueillir le témoignage de responsables de collectivités locales, des administrations financières, des administrations sociales ou bien encore des ministères relevant du champ de compétences de la commission des Lois mais aussi d’économistes, de fiscalistes, d’associations de contribuables.
Il ressort clairement de ces auditions que la France est à l’aube d’un choc budgétaire et financier sans précédent.
On ne cédera pas au pessimisme. L’idée n’est pas de dresser un tableau décourageant qui inhibe les bonnes volontés. La France peut réagir énergiquement ; elle a su le faire par le passé afin de restaurer l’équilibre de ses comptes.
La Cour des comptes, par la voix de son Premier président, M. Philippe Séguin, que la mission a entendu, a rappelé la situation dans laquelle se trouvait notre pays au lendemain de la Grande Guerre. Un pays vainqueur mais exsangue dont la dette représentait deux fois le montant du PIB. Pourtant en dépit du fardeau de cette dette et des déficits qui pesaient sur l’avenir du pays et de la reconstruction, des hommes politiques, comme Raymond Poincaré, ont su prendre les décisions qui s’imposaient afin de garantir la survie financière de notre pays. Ce fut le temps des décisions, des efforts, du courage.
Même si la situation de la France d’aujourd’hui et celle de 1918 ne sont évidemment pas en tout point comparables, nous pouvons nous inspirer de l’esprit de responsabilité qui a prévalu à l’époque.
Devant une situation budgétaire et financière proche de la saturation, l’objectif est finalement assez simple à énoncer. Nous avons la responsabilité d’assurer aux jeunes Français qui voient le jour en 2009 qu’ils pourront vivre à l’âge adulte dans une société où trouvent encore à s’exprimer les valeurs qui font notre pays – la liberté d’agir, de créer, la solidarité, l’égalité, l’accès aux soins, aux services publics. Ils ont également le droit de ne pas connaître une France qui aura subi un déclassement en Europe et dans le monde, en raison de l’état de ses finances publiques.
Le présent rapport entend d’abord faire un état des lieux clair et simple pour que chacun sache à quoi s’en tenir. C’est un véritable appel à la lucidité qui est ainsi lancé.
Ce rapport propose ensuite des pistes pour optimiser la dépense publique, tenter de juguler le cycle infernal de la dette et, en particulier, sociale, et améliorer notre système de recettes publiques tout en soutenant l’investissement et l’innovation.
Ces pistes sont de tous ordres, de la mesure la plus vaste concernant, par exemple, la dette sociale, à celles plus modestes consistant à trouver quelques moyens d’économies, poste par poste, dans les ministères. Derrière s’affichent une ambition et une préoccupation : l’ambition d’ouvrir ce grand débat national que nous appelons de nos vœux pour faire face à ce choc des finances publiques ; la préoccupation de rendre l’État et tous les acteurs publics exemplaires à un moment où le plus grand nombre souffre profondément de la crise. C’est au prix de cette exemplarité que chacun acceptera le poids de l’effort à consentir pour surmonter cette épreuve. C’est aussi à cela que l’on mesure la vitalité d’une société et d’un pays.
PREMIÈRE PARTIE : VERS UNE CRISE HISTORIQUE DES FINANCES PUBLIQUES
Si la crise économique et financière a mis en lumière la dégradation plus qu’inquiétante de nos finances publiques, il faut reconnaître que cette situation n’est guère nouvelle et ne doit en aucun cas occulter la lente dérive dont elle est le fruit. Une prise de conscience est absolument indispensable, mais ne risque-t-elle pas d’être trop tardive au regard des enjeux majeurs auxquels notre pays est aujourd’hui confronté ?
Depuis plus de trois décennies, la dépense publique n’a cessé de croître, sans que les recettes, en dépit d’un niveau de prélèvements obligatoires parmi les plus élevés de l’OCDE, ne parviennent à faire face, creusant ainsi chaque jour un peu plus le déficit public. Pour financer l’ensemble de ces déficits accumulés au fil du temps, le recours à l’emprunt et à la dette s’est tout naturellement imposé, jetant un voile d’illusion sur la gravité de la situation : la France a fait le choix de financer ses dépenses courantes par la dette, repoussant à demain le retour à l’équilibre budgétaire.
I. UN NIVEAU DE PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES ÉLEVÉ INCAPABLE DE FINANCER L’AUGMENTATION CONTINUE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE
L’équilibre des finances publiques suppose qu’à chacune des dépenses réalisées pour le compte des administrations publiques corresponde une recette adéquate. Or, les comptes publics de la France présentent cette originalité que, depuis la fin des Trente Glorieuses, les dépenses sont systématiquement supérieures aux recettes : bien que le niveau de prélèvements obligatoires soit élevé, il s’avère dans les faits incapable de financer l’ensemble de la dépense publique.
A. UN NIVEAU DE PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES PROBLÉMATIQUE DANS UN CONTEXTE DE CONCURRENCE FISCALE EXACERBÉE
Depuis la fin des années 1990, on assiste en Europe à une forte concurrence fiscale entre États, chacun d’eux cherchant à attirer les particuliers et les entreprises par une fiscalité avantageuse. La fiscalité est ainsi devenue un atout privilégié de la compétitivité économique d’un pays.
Or, il ressort des auditions réalisées par votre rapporteur que, dans ce contexte de concurrence fiscale exacerbée, la France présente un profil atypique, puisqu’elle connaît un niveau de prélèvements obligatoires relativement élevé par rapport aux autres grands pays développés. Au nombre de ces prélèvements obligatoires, on trouve aussi bien les impôts perçus par l’État et les collectivités locales que les cotisations sociales versées par les assurés sociaux et leurs employeurs. Les prélèvements obligatoires s’élèvent en France à 43,2 % du PIB en 2008 (2) et devraient se maintenir au même niveau en 2009.
1. Une forte augmentation des prélèvements obligatoires depuis la fin des Trente Glorieuses
L’évolution des prélèvements obligatoires depuis le début des années 1970 se décompose en trois phases. Tout d’abord, au cours des années 1970 et dans la première moitié des années 1980, le taux de prélèvements obligatoires a très fortement augmenté, passant ainsi de 34 % à 42 %. Puis, il s’est stabilisé jusqu’au début des années 1990, où il a repris sa progression jusqu’au taux historiquement le plus élevé de 44,9 % en 1999. Depuis cette date, le taux de prélèvements obligatoires s’est légèrement replié pour se stabiliser entre 43 et 44 % du PIB.
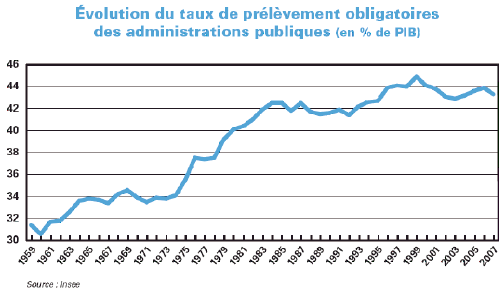
Au-delà de l’évolution globale du niveau de prélèvements obligatoires en France, il est utile d’examiner de quelle manière, au cours du temps, la répartition des prélèvements obligatoires entre administrations publiques a évolué. Comme l’indique le tableau ci-après, la part de l’État dans les prélèvements obligatoires a eu tendance à reculer, alors que celle des organismes de sécurité sociale et des administrations locales a progressé.
S’agissant des prélèvements obligatoires perçus par les organismes de sécurité sociale, leur augmentation ne fait que refléter la tendance générale à la hausse des dépenses sociales, en particulier l’augmentation des dépenses consacrées aux risques vieillesse et santé. Ainsi, les dépenses de retraite sont passées de 10,7 % du PIB en 1981 à 13,1 % en 2006. Sur la même période, les dépenses de santé sont passées de 6,1 % du PIB à 10,3 % en 2006.
Pour une part, la hausse des prélèvements obligatoires au profit des collectivités territoriales s’explique par des transferts successifs de compétences aux collectivités territoriales depuis les premières lois de décentralisation.
TAUX DE PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES (PO) ENTRE 1980 ET 2009
1980 |
1985 |
1990 |
1995 |
2000 |
2005 |
2008 |
2009 | |
Montant en milliards d’euros |
178,5 |
316,3 |
429,3 |
510,3 |
636 |
753 |
845,7 |
873,2 |
Taux de PO (en % du PIB) |
40,1 % |
42,5 % |
41,6 % |
42,7 % |
44,1 % |
43,6 % |
43,2 % |
43,2 % |
Dont perçus par : |
||||||||
État |
18,6 % |
18,4 % |
16,9 % |
15,9 % |
16,5 % |
16,1 % |
14 % |
13,8 % |
Organismes divers d’administration centrale |
0,2 % |
0,3 % |
0,3 % |
0,4 % |
0,7 % |
0,9 % |
0,9 % |
1 % |
Administrations de sécurité sociale |
17,3 % |
18,7 % |
18,7 % |
20,2 % |
21,1 % |
20,8 % |
22,3 % |
22,3 % |
Administrations publiques locales |
3,4 % |
4,3 % |
4,8 % |
5,4 % |
5,2 % |
5,5 % |
5,7 % |
5,8 % |
Union européenne |
0,6 % |
0,8 % |
0,9 % |
0,8 % |
0,6 % |
0,3 % |
0,3 % |
0,3 % |
Source : Rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution, Projet de loi de finances pour 2009
2. La France est, parmi les pays industrialisés, celui où la pression fiscale et sociale est la plus forte
Il ressort des comparaisons internationales que le niveau de prélèvements obligatoires en France demeure élevé par rapport aux autres grands pays développés. En 2006, l’OCDE estimait que le taux de prélèvements obligatoires s’élevait ainsi à 43,6 % en France (3), contre 36,5 % au Royaume-Uni, 34,8 % en Allemagne, 27,3 % aux États-Unis, 27,4 % au Japon et 36,2 % en moyenne dans l’OCDE.
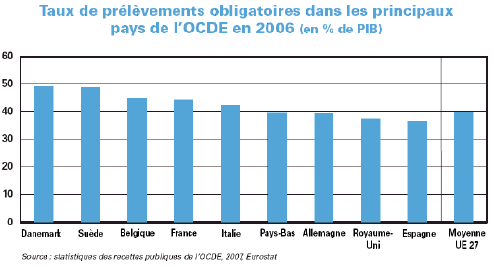
En définitive, trois modèles fiscaux peuvent être distingués :
— le modèle des pays scandinaves qui, à l’image de la Suède ou du Danemark, ont des taux de prélèvements obligatoires proches de 50 % du PIB ;
— les pays européens comme l’Allemagne et le Royaume-Uni, dont les taux s’établissent entre 35 et 40 % ;
— les États-Unis et le Japon, où les taux fluctuent entre 25 et 30 % suivant la situation économique.
Dans cet ensemble, la France affiche un profil atypique. Avec un taux de 43,2 % en 2009, elle est, parmi les grands pays industrialisés, celui où la pression fiscale et sociale est la plus forte, sans toutefois atteindre le niveau des pays scandinaves.
Comme l’a très justement indiqué l’Association des maires de France lors de son audition, si le taux de prélèvements obligatoires est évidemment un élément central du débat sur la place de l’État dans l’économie et qu’il est souvent mis en exergue, en France, pour critiquer notre organisation sociale, il convient toutefois de ne pas exagérer sa portée. En effet, ces taux n’ont de signification que si on les met en regard des services offerts par les administrations publiques. Or, le champ couvert par ces dernières est très variable d’un pays à l’autre. Ainsi, aux États-Unis et au Japon – deux pays où ces taux sont particulièrement bas –, une grande partie du système de la protection sociale est prise en charge par les employeurs dans le cadre des contrats de travail, avec les difficultés que cela implique surtout outre-Atlantique. Même dans un pays comme l’Allemagne, dont les structures fiscales et sociales sont plus proches de celles de la France, le périmètre des administrations publiques n’est pas exactement comparable : ainsi, alors que la formation professionnelle est financée par les employeurs sur une base volontaire en Allemagne, elle l’est par une cotisation en grande partie obligatoire dans notre pays.
Le niveau élevé de prélèvements obligatoires en France correspond aussi à un choix constant qu’a fait la société française, un choix clairement assumé depuis 1945. Néanmoins, dans le contexte international d’aujourd’hui, ce niveau de prélèvements obligatoires n’est pas sans poser des difficultés.
3. Un contexte de concurrence fiscale dont la France doit tenir compte
En révélant des distorsions fiscales importantes au niveau international, la mondialisation et l’intégration européenne engendrent une pression à la baisse des fiscalités nationales portant sur les facteurs les plus mobiles de l’économie. Dans un contexte de concurrence économique accrue, le développement ou simplement le maintien de l’attractivité du territoire constitue de fait un enjeu primordial alors que les agents économiques cherchent à s’établir dans les zones où la fiscalité est la plus faible. Avec un taux de prélèvements obligatoires parmi les plus élevés de la zone euro, la France occupe une position relativement défavorable et semble particulièrement vulnérable, dans la mesure où la structure de sa fiscalité combine des assiettes étroites et des taux d’imposition élevés.
Si, comme cela a été mentionné, les comparaisons internationales doivent être interprétées avec précaution, il n’en demeure pas moins que les entreprises en ont connaissance lorsqu’elles décident de la localisation de leurs activités. Qu’on le regrette ou non, la fiscalité est à l’évidence devenue un instrument majeur de la compétitivité d’une économie.
Lors de son audition, M. Patrick Dibout, spécialiste des questions fiscales, avait souligné que l’Union européenne en intégrant des pays à faible fiscalité sur les sociétés et en autorisant la libre circulation des capitaux, est particulièrement soumise à la concurrence fiscale. Les États membres sont ainsi tentés de mettre en œuvre des régimes préférentiels d’impôt sur les sociétés afin d’attirer les entreprises et les ménages les plus aisés sur leur territoire. Certains pays, à l’instar de l’Irlande, ont fait le choix de baisser significativement la fiscalité pesant sur les entreprises. D’autres, comme la France, n’ont pas suivi le mouvement général conduisant à une baisse des taux. Alors que les premiers ont attiré de nouvelles activités créatrices d’emplois, les seconds ont perdu de leur force d’attraction sur la scène européenne.
Le Conseil des impôts (4) puis le Conseil d’analyse économique (5) ont notamment mis l’accent sur les faiblesses du système fiscal français qui concentre les prélèvements obligatoires sur les facteurs les plus mobiles et les plus dynamiques de l’économie, mais également les plus réactifs dans une économie mondialisée. La France se distingue tout particulièrement par son manque de compétitivité en matière de fiscalité des entreprises : alors qu’en 2007, l’Union européenne et l’OCDE offrent respectivement un taux moyen d’impôt sur les sociétés de 24,2 % dans l’Union européenne et 27,8 %, la France a un taux d’imposition sur les sociétés de 33 %, soit près de 10 points de plus par rapport à la moyenne européenne (6).
En effet, si la formule bien connue, « trop d’impôts tue l’impôt », est volontairement simplificatrice, elle a un fond de vérité : lorsque le niveau de prélèvements obligatoires est jugé excessif par les agents économiques, toute hausse de la fiscalité peut conduire à une baisse des recettes fiscales sous l’effet de l’évasion fiscale ou bien encore de la désincitation au travail. Au XVIIIe siècle, Jean-Baptiste Say affirmait déjà qu’« un impôt exagéré détruit la base sur laquelle il porte ». Ainsi, la stratégie de la France, affichant une pression fiscale parmi les plus élevées au sein de l’OCDE, ne s’est probablement pas avérée gagnante en termes de localisation sur le territoire national des capitaux et autres facteurs de production.
B. UNE AUGMENTATION ININTERROMPUE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS
Si le débat sur la dégradation des comptes publics tend naturellement à se focaliser principalement sur la question de la réduction des seules dépenses de l’État, il convient, pour maîtriser les termes de ce débat, de cerner plus précisément la notion de dépense publique et tâcher non seulement de mesurer son poids effectif, mais aussi ses fonctions et partant, connaître son utilité, car en soi la dépense publique n’est pas mauvaise. Il importe simplement qu’elle soit efficace au moindre coût pour la collectivité.
1. La dépense publique : des champs d’action et des réalités très différents
Si la notion de dépense publique est souvent utilisée pour parler tantôt des dépenses de l’État, tantôt de celles des administrations sociales, tantôt de celles administrations locales, c’est que le périmètre de ce qu’on désigne communément « la dépense publique » recouvre dans les faits des champs d’action et des réalités très différents. En fait, la dépense publique a une triple dimension : elle comprend les dépenses de l’État et des organismes divers d’administration centrale (établissements publics…), les dépenses des administrations publiques locales (collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale…) et les dépenses des régimes de sécurité sociale.
Toute étude centrée sur les dépenses publiques ne peut plus aujourd’hui se focaliser sur les seules dépenses de l’État et omettre désormais cette référence aux autres administrations publiques que sont les collectivités locales et les régimes de sécurité sociale. Alors qu’au XIXe siècle, en effet, les dépenses de l’État représentaient la quasi-totalité de la dépense publique, elles n’en constituent plus aujourd’hui qu’une part minoritaire : la dépense sociale représente 25 % du PIB, contre moins de 18 % pour la dépense étatique, quand la dépense locale dépasse désormais les 10 %. Si le poids de la protection sociale comme les politiques de décentralisation expliquent largement ce phénomène, leur appréhension s’avère plus que jamais nécessaire si l’on veut porter un regard complet et exact sur le poids et la place de la puissance publique dans l’économie ou la société.
Si l’on s’intéresse à la décomposition de la dépense publique entre chaque sous-secteur, on constate, comme l’indique le tableau ci-dessous, que les dépenses de protection sociale occupent une place prépondérante, puisqu’elles représentent près de la moitié de la dépense publique :
DÉCOMPOSITION DE LA DÉPENSE PUBLIQUE EN 2008
Dépense publique totale |
1 027 milliards d’euros |
Dont : |
|
— Sécurité sociale |
45 % |
— État |
28 % |
— Organismes divers d’administration centrale |
7 % |
— Collectivités locales |
20 % |
À la lecture de ce tableau, on doit reconnaître que la place qu’occupent les dépenses de l’État n’est pas aussi importante que le débat public peut le laisser penser. En effet, lors de son audition, M. Philippe Josse, directeur du budget, avait rappelé que, lorsqu’il est question de maîtrise de la dépense publique, le débat tend naturellement à se focaliser sur la seule dépense de l’État, sans tenir compte des masses budgétaires que représentent les collectivités locales et la sécurité sociale.
C’est une vieille tradition française que de contester le poids de l’État tout en souhaitant bien souvent et de manière paradoxale qu’il intervienne dans bien des domaines. Or, l’État représente aujourd’hui un peu plus du quart de la dépense publique, quand les collectivités locales en représentent 20 % et la sécurité sociale 45 %. Aussi la question de la maîtrise et de l’optimisation de la dépense publique fait certes référence aux dépenses de l’État, mais surtout aux dépenses sociales et locales.
2. Une augmentation continue de la dépense publique depuis le premier choc pétrolier
Sur les trente dernières années, la dépense publique au sens large (État, collectivités territoriales et sécurité sociale) a augmenté de manière très marquée : la dépense publique s’élève en 2009 à 53 % du PIB, contre 44 % en 1980. Une part plus importante de la richesse nationale produite par le pays – évaluée à 9 points de PIB – est aujourd’hui absorbée par la dépense publique.
Sur longue période, l’évolution est encore plus vertigineuse : à l’échelle du XXe siècle, la seule dépense de l’État, en francs constants, a été multipliée par 20. Cette hausse de la dépense a une double origine : d’une part, l’extension des missions de l’État, qui intervient désormais en dehors de ses seules missions régaliennes, et, d’autre part, par la croissance de la population française.
L’examen en longue période de l’évolution de la dépense publique en France met en évidence trois phases.
La première, du début du XIXe siècle jusqu’à la Première Guerre mondiale, se caractérise par la stabilité du rapport entre les dépenses publiques et le PIB, qui s’établit à un niveau légèrement supérieur à 10 % : les dépenses publiques sont alors essentiellement consacrées aux domaines liés à la défense ainsi qu’aux charges de la dette publique, ces deux postes représentant plus de la moitié du budget.
La deuxième phase, correspondant à l’entre-deux-guerres, est marquée par le maintien des dépenses publiques à un niveau proche de 30 % du PIB, une progression qui s’explique à la fois par le coût de la reconstruction dans les années 1920 et la montée progressive des dépenses sociales et d’intervention économique (dépenses d’enseignement, aide au logement, soutien des prix de certaines productions agricoles, mise en place d’une politique familiale).
La troisième phase, qui commence au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est pour sa part caractérisée par la vive augmentation du niveau des dépenses publiques et la modification de leur nature : alors que la part des dépenses de l’État dans le PIB reste à un niveau proche de celui atteint dans l’entre-deux-guerres (25 % du PIB environ), le poids financier des collectivités locales et, plus encore, celui de la sécurité sociale s’accroissent nettement.
LE RAPPORT DÉPENSES PUBLIQUES/PIB (EN %) ENTRE 1789 ET AUJOURD’HUI (7)
1789 |
1815 |
1872 |
1912 |
1920 |
1938 |
11 % |
11,5 % |
11 % |
12,6 % |
32,8 % |
26,5 % |
1947 |
1974 |
1980 |
1995 |
2005 |
2009 |
40,8 % |
39,3 % |
45,5 % |
53,5 % |
53,9 % |
53 % |
Cette augmentation continue de la dépense publique sur longue période n’est pas sans inconvénient. Une fois les dépenses nouvelles mises en œuvre, elles ont tendance à se cristalliser et à être pérennisées d’un budget à l’autre, sans qu’aucun mécanisme ne permette de remettre en cause la pertinence et l’utilité de ces dépenses : c’est l’effet « cliquet » de la dépense publique, qui joue toujours à la hausse et très rarement à la baisse.
Ces dix dernières années, la part de la dépense publique dans le PIB est restée relativement stable, autour de 53 % de la richesse nationale. Cependant, la dépense publique en volume a augmenté à un rythme moyen de 2,2 % par an. Le tableau ci-dessous détaille la contribution de chaque administration publique à l’augmentation, en volume, de la dépense publique :
CONTRIBUTIONS À LA CROISSANCE EN VOLUME DE LA DÉPENSE PUBLIQUE (8)
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 | |
Augmentation de la dépense publique (en volume, en %) dont : |
+ 3,8 % |
+ 2,3 % |
+ 2,2 % |
+ 2,6 % |
+ 1,6 % |
+ 2,5 % |
+ 2,3 % |
Contribution de l’État |
0,9 % |
0,2 % |
0,5 % |
0,5 % |
0 % |
0,2 % |
0,4 % |
Contribution des ODAC |
0 % |
0,2 % |
- 0,4 % |
0,1 % |
0,3 % |
0,1 % |
0 % |
Contribution des administrations publiques locales |
1 % |
0,8 % |
0,7 % |
0,7 % |
0,7 % |
0,9 % |
0,7 % |
Contribution des administrations de sécurité sociale |
1,9 % |
1,3 % |
1,3 % |
1,1 % |
0,8 % |
1,2 % |
1,2 % |
Source : Rapport sur la dépense publique et son évolution, Projet de loi de finances pour 2009.
À la lecture de ces données, il apparaît très clairement que l’État n’est pas le principal responsable de l’augmentation de la dépense en France. En effet, les dépenses sociales et locales expliquent à elles seules la quasi-totalité de l’augmentation de la dépense. Maîtriser et optimiser la dépense publique exigent donc de s’intéresser davantage au dynamisme de ces dépenses.
3. Une dépense publique telle que les prélèvements obligatoires, pourtant déjà élevés, ne suffisent pas à la financer
Comme votre rapporteur l’a déjà souligné, le niveau de prélèvements obligatoires en France est parmi l’un des plus élevés au sein des pays de l’OCDE. En dépit de cette pression fiscale marquée, les recettes ne parviennent pas à faire face à l’ensemble de la dépense publique. Quelques chiffres suffisent pour établir ce constat : les prélèvements obligatoires ont permis en 2008 de faire rentrer dans les caisses 873,2 milliards d’euros, alors que la dépense publique s’élevait pour sa part à 1 027 milliards d’euros, soit un écart de près de 300 milliards d’euros entre recettes et dépenses.
La France se trouve donc dans une situation pour le moins paradoxale : la compétitivité de son économie est pénalisée par un taux de prélèvements obligatoires jugé excessif, qui, dans le même temps, s’avère insuffisant pour financer l’ensemble des dépenses publiques.
C. FACE À LA CRISE, LES EFFORTS POUR MOBILISER PROVISOIREMENT LA DÉPENSE PUBLIQUE AFIN DE RELANCER LA CROISSANCE ET L’INVESTISSEMENT
La crise économique que traversent le monde et notre pays depuis 2008 et ses conséquences en termes de destruction de richesses et d’emplois ont conduit le Gouvernement, avec l’approbation du Parlement, à mettre en œuvre un vaste plan de relance de l’économie par la dépense publique.
1. L’injection de nouvelles dépenses pour relancer la création de richesses et d’emplois
Face à l’ampleur prise par la crise, le Gouvernement a annoncé en décembre 2009 le lancement d’un plan de relance, consistant à injecter dans l’économie 26 milliards d’euros sous forme de dépenses publiques nouvelles.
Ce plan de relance comportait notamment : des mesures de trésorerie en faveur des entreprises (remboursements anticipés d’impôts, comme la TVA ou le crédit d’impôt recherche…) qui sont par nature temporaires ; une accélération des programmes d’investissement qui devrait se traduire par un pic d’investissement autour de 2010 ; des mesures ponctuelles en faveur de certains secteurs (automobile avec la prime à la casse, immobilier…) et des ménages les plus défavorisés (prime de solidarité active…). Enfin, certaines dépenses sont à la charge d’entreprises publiques (SNCF, La Poste…). Si ces dernières se situent hors du champ des administrations publiques, en raison de ces dépenses exceptionnelles qu’elles auront à supporter, elles devront sans doute à l’avenir soit verser moins de dividendes à l’État, soit lui demander plus de subventions. Ces dépenses seraient néanmoins elles aussi temporaires.
Dans une étude récente, l’OCDE a estimé que le plan de relance français permettra d’injecter dans l’économie 0,6 % de la richesse nationale sous forme de dépense publique, cette dernière progressant de 3,2 % en volume sur la seule année 2009. Mais, plus que le seul montant du plan de relance, c’est la nature des dépenses mises en œuvre qui importe.
2. Le choix de dynamiser l’économie immédiatement et de garder la maîtrise des finances publiques à long terme
Fortement contraintes, la définition et la mise en œuvre du plan de relance français ont dû concilier deux exigences contradictoires. À court terme, l’injection de dépense publique a pour objectif de relancer la croissance économique et l’emploi. À long terme, ces dépenses nouvelles ne doivent en aucun cas compromettre la soutenabilité des finances publiques, c’est-à-dire la capacité d’une économie à rester solvable et à conserver des marges de manœuvre budgétaires suffisantes pour couvrir tant le niveau de la dette que le dynamisme des dépenses.
Afin de relancer à court terme et préserver la soutenabilité budgétaire à long terme, le gouvernement a choisi de faire des dépenses d’investissement réversibles et temporaires ayant pour seul effet de nous écarter provisoirement de la trajectoire de retour à l’équilibre des comptes publics.
Nombre de professionnels auditionnés par la mission ont souligné la qualité et la réussite de ce plan de relance. En effet, si le choix avait été fait de relancer l’économie par la demande, une des solutions possibles aurait pu consister, par exemple, à embaucher de nouveaux fonctionnaires. Or, à court terme, ces recrutements auraient eu un impact faible sur le pouvoir d’achat et, à long terme, ils auraient gravement compromis la maîtrise de nos finances publiques : recruter un fonctionnaire, c’est faire le choix de verser un traitement pendant quarante années ainsi qu’une pension de retraite, voire d’une pension de réversion, au-delà. Cette décision engage ainsi les finances publiques pour des décennies, sans aucune garantie sur le retour de la croissance économique à court terme.
À l’inverse, à l’instar des orientations arrêtées par le Gouvernement, privilégier des dépenses d’investissement, réversibles et temporaires, offre le double avantage, d’une part, d’accroître les capacités de notre pays à produire de nouvelles richesses et, d’autre part, de préserver le caractère soutenable des comptes publics sur longue période.
II. DES DÉFICITS RÉCURRENTS DEPUIS TRENTE-CINQ ANS QUI N’ONT DE CESSE D’ALIMENTER LA DETTE PUBLIQUE
Comme votre rapporteur l’a déjà indiqué, le niveau de dépense publique en France est tel que les prélèvements obligatoires, bien qu’étant fortement élevés, ne suffisent pas à la financer dans son intégralité. Une telle situation emporte dans les faits deux conséquences majeures.
Tout d’abord, depuis 1974, le solde budgétaire des administrations publiques au sens large (État, collectivités locales et sécurité sociale) est négatif, les recettes étant inférieures aux dépenses. À la fin de chaque année, la France est en déficit, tel un ménage qui, à la fin de chaque mois, serait à découvert.
Ensuite, afin de financer ce déficit, il revient à l’État de trouver de nouvelles sources de financement : puisque les recettes fiscales ne suffisent pas, les déficits accumulés chaque année seront donc financés par le recours à l’emprunt. La dette publique va alors se substituer aux recettes manquantes pour financer les dépenses courantes et le train de vie des administrations publiques. La France vit à crédit, tel un ménage qui, pour consommer, contracte des prêts auprès de sa banque.
En définitive, faute de recettes suffisantes, la France est contrainte d’enregistrer chaque année des déficits budgétaires, qu’elle ne peut financer que par le recours à la dette : la dépense publique nourrit le déficit qui, en retour, ne manque pas d’alimenter la dette.
Or, le recours au déficit et à la dette n’est pas illimité. Avec la monnaie unique, la conduite de la politique économique des pays membres de la zone euro a été profondément modifiée : l’euro est un bien collectif, dont la stabilité passe par des politiques budgétaires vertueuses dans chaque État membre. Les finances publiques françaises devront désormais être gérées à l’équilibre, sans que le déficit ne puisse dépasser 3 % du PIB et la dette 60 %. Ce sont les fameux critères fixés par le Traité de Maastricht. Ces normes de déficit et de dette ont été créées pour éviter une déstabilisation financière dans un pays, déstabilisation qui mettrait en péril tout le système monétaire et économique européen.
A. UNE FRANCE QUI VIT À DÉCOUVERT DEPUIS 1974
1. Des déficits récurrents même en période de croissance
Depuis 1974, la France a connu sans discontinu trente-cinq années de déficit budgétaire de l’État. Si l’on conçoit aisément que ce déficit se creuse en période de crise afin de relancer l’économie, il est, en revanche, pour le moins paradoxal que le budget de l’État n’ait pas été ramené à l’équilibre en période de forte croissance.
Or, ces dix dernières années, le solde public a oscillé avec la conjoncture, sans jamais atteindre l’équilibre ni même s’en rapprocher, y compris en phase haute du cycle économique (1998-2000). Cette situation, intervenue en dépit des engagements de retour à l’équilibre pris dans le cadre des programmes de stabilité successifs, contraste avec celle observée dans les autres grands États membres de l’Union européenne sur la même période (1996-2006).
Source : La situation des finances publiques – Cour des Comptes – 2009.
Cette singularité française résulte de choix contestables dans la conduite des politiques budgétaires au long du cycle économique. D’un côté, la période de forte croissance (1998-2000) n’a pas été suffisamment mise à profit pour rééquilibrer les comptes publics : pour l’essentiel, les surcroîts de recettes collectés pendant cette période ont été utilisés pour financer des allégements d’impôts et, dans une moindre mesure, des dépenses nouvelles, au détriment de l’assainissement durable des déficits. De l’autre côté, la phase de ralentissement de la croissance (2001-2003) s’est accompagnée d’une progression des dépenses publiques (+ 1,8 point de PIB) et de mesures d’abaissement des prélèvements obligatoires qui ont accentué la dégradation spontanée des comptes publics.
En définitive, depuis 1996, le déficit public a excédé le plafond de 3 % du PIB fixé par le Traité de Maastricht plus d’une année sur deux en moyenne.
2. Un déficit qui bondit sous l’effet de la crise
Si la période récente, allant de 2004 à 2007, a connu une réduction lente mais progressive des déficits, permettant à la France de respecter les critères de Maastricht en matière de déficits, la crise économique a temporairement enrayé ce mouvement d’assainissement des comptes publics : sous l’effet du plan de relance et de la contraction exceptionnelle des recettes fiscales, le déficit public devrait ainsi être supérieur à 8,2 points de PIB en 2009 et en 2010.
LE DÉFICIT PUBLIC (EN % DU PIB) ENTRE 2004 ET 2012
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 | |
Déficit |
- 3,6 |
- 2,9 |
- 2,3 |
- 2,7 |
- 3,4 |
- 8,2 |
- 8,5 |
Source : Projet de loi de finances pour 2010.
En effet, en période de récession économique, le pays produit moins de richesses et, par conséquent, les revenus imposables des particuliers, comme des entreprises, sont moins importants qu’en période de forte croissance économique. La base taxable s’étant contractée, le rendement de l’impôt sera moindre. Ce phénomène est particulièrement marqué pour les entreprises, puisque, sous l’effet de la crise, leurs bénéfices, soumis à l’impôt sur les sociétés, se sont fortement réduits. L’impôt sur les sociétés devrait donc être divisé par deux en 2009 et ne rapporter qu’entre 20 et 25 milliards d’euros, contre près de 50 milliards d’euros en 2008. C’est un phénomène d’une incroyable ampleur qui donne une idée de la profondeur de la crise qui frappé notre économie et nos entreprises.
3. Un accroissement du déficit principalement imputable à l’État
Afin de déterminer qui de l’État, des collectivités locales ou de la sécurité sociale est responsable de la dégradation des déficits sur la période récente, le tableau ci-après décompose le déficit public par sous-secteur :
RÉPARTITION DU DÉFICIT PUBLIC ENTRE LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 | |
Solde public (en % du PIB) dont : |
- 3 |
- 2,3 |
- 2,7 |
- 3,4 |
- 8,2 |
- 8,5 |
État |
- 3 |
- 2,6 |
- 2,1 |
- 2,8 |
- 6,5 |
- 5,8 |
ODAC |
0,4 |
0,6 |
- 0,2 |
- 0,1 |
0,1 |
0,1 |
Administrations de sécurité sociale |
- 0,2 |
- 0,1 |
0 |
0 |
- 1,4 |
- 2,3 |
Administrations publiques locales |
- 0,2 |
- 0,2 |
- 0,4 |
- 0,4 |
- 0,4 |
- 0,5 |
Source : INSEE, Projet de loi de finances pour 2010.
À la lecture de ce tableau, il apparaît clairement que l’accroissement du déficit sur la période récente est essentiellement imputable à l’État : en 2009, il sera responsable de plus de 80 % de la détérioration du déficit. Mais il convient également de noter qu’à partir de 2011, la responsabilité de l’État devrait progressivement s’effacer au profit de celle des administrations de sécurité sociale.
Lors de son audition par la mission, M. Philippe Josse, directeur du budget, a rappelé que le déficit budgétaire a gagné, entre 2008 et 2009, quatre points de PIB, qui s’expliquent par l’effondrement de la croissance (2,2 points), la baisse des recettes fiscales (1 point) et le plan de relance (0,8 point).
B. UNE FRANCE QUI VIT À CRÉDIT DEPUIS 1974
1. Recourir à la dette pour financer le train de vie de l’État
Depuis la fin des Trente Glorieuses, la dette publique a littéralement explosé : alors qu’elle était en 1978 de 187 milliards d’euros (21 % du PIB), elle atteindra en 2009 près de 1 414 milliards d’euros (74 % du PIB). En trente ans, la France a multiplié sa dette publique par six.
Aujourd’hui, chaque Français naît avec une dette d’environ 23 700 euros à rembourser. À chaque heure qui passe, ce sont 16 millions d’euros de dettes publiques supplémentaires qu’il faut payer.
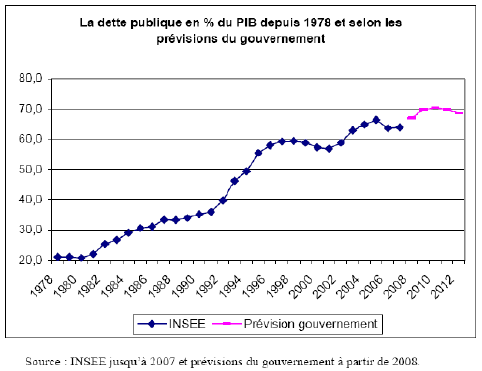
Cette explosion de la dette publique française depuis trente ans s’explique par les déficits qui s’accumulent chaque année : puisque les recettes ne suffisent par pour les financer, l’État est alors contraint d’emprunter sur les marchés financiers. Or, l’accroissement de la dette ainsi que la nécessité de la rembourser à terme (moyennant le paiement d’un taux d’intérêt) restreignent d’autant la faculté de l’État à financer et mettre en œuvre de nouvelles politiques publiques.
2. Un risque d’emballement de la dette sous l’effet de la crise
Il ressort des auditions conduites par la mission que, si la crise économique (chute des recettes et plan de relance) aura un impact temporaire sur le déficit, l’effet sur l’endettement public sera, à l’inverse, massif et durable.
En 2008, l’endettement s’est déjà fortement accru : la dette des administrations publiques approchait les 1 300 milliards d’euros à la fin de l’année 2008, soit 50 000 euros par actif occupé contre 47 000 à la fin de l’année 2007. Étant donné que le déficit de la France devrait représenter en 2009 plus de 8 % de la richesse nationale, la dette publique dépassera probablement 77 % du PIB cette même année.
ÉVOLUTION DE LA DETTE PUBLIQUE (EN % DU PIB) ENTRE 2004 ET 2012
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
Dette |
64,9 |
66,4 |
63,7 |
63,8 |
68,1 |
77 |
84 |
86 |
88 |
Source : La situation des finances publiques – Cour des Comptes – 2009.
N.B. : Pour 2009 et 2010, cette estimation a paru avant la présentation du PLF pour 2010 et les nouvelles estimations présentées par le Gouvernement
Or, il ne s’agit là que d’un simple prélude, puisqu’en réalité cette explosion de la dette devrait se poursuivre dans les décennies à venir : la Cour des comptes considère en effet que l’endettement public pourrait atteindre 100 % du PIB en 2018, puis 130 % en 2026 et 200 % avant 2040.
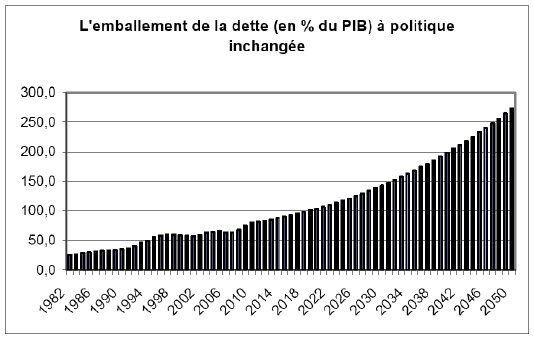
Source : La situation des finances publiques – Cour des Comptes – 2009.
La dette publique est un critère déterminant pour apprécier la situation des finances publiques. En effet, à long terme, si rien n’est fait pour l’arrêter, la dette pourrait s’emballer et faire peser sur l’économie française un triple risque.
Le premier risque que fait courir au pays cet emballement de la dette est, à terme, un poids financier à assumer de plus en plus élevé pour les Français. En effet, l’augmentation de l’endettement a pour principale conséquence une hausse du montant des intérêts devant être versés aux créanciers. Plus le niveau d’endettement augmente, plus les intérêts consomment une part importante des ressources publiques. En 2008, la charge d’intérêt sur la dette publique s’élevait à 2,8 % du PIB en France. Il convient de garder à l’esprit que ce montant a été multiplié par quatre en 25 ans et que la hausse devrait vraisemblablement se poursuivre. En effet, à taux d’intérêt constant, le paiement des intérêts sur la dette pourrait atteindre 3,7 % du PIB en 2012 si la dette atteint 90 % du PIB, ce qui représente 750 euros par actif de plus qu’en 2008.
Avec un taux d’intérêt de 4 % (9), la charge des intérêts serait portée à 4 % du PIB en 2018 et à 8 % avant 2040. Presque 20 % des prélèvements obligatoires serviraient alors à payer ces intérêts, soit plus que le produit de la TVA. De manière générale, plus les taux d’intérêt augmentent, plus la charge des intérêts est élevée, plus le fardeau de la dette s’alourdit. L’augmentation de la charge de la dette est elle-même à l’origine d’un accroissement de l’endettement : c’est l’effet « boule de neige » de la dette. Celle-ci ne peut toutefois pas augmenter indéfiniment et l’effort nécessaire pour arrêter cet engrenage sera d’autant plus important qu’il sera longtemps différé. Une dérive incontrôlée de l’endettement aboutira inévitablement à un appauvrissement des Français et, pour ce qui concerne la dette sociale, pourrait remettre en cause la pérennité des régimes sociaux auxquels est attaché l’ensemble de nos concitoyens. Il faut donc arrêter au plus vite cet enchaînement qui pourrait se révéler dramatique.
Le deuxième risque dont est porteur l’emballement de la dette est une dégradation de la qualité de la signature de l’État. En effet, en mobilisant une part aussi importante des ressources publiques, le paiement des intérêts deviendrait insupportable et, si un ajustement drastique n’était pas opéré suffisamment vite, il pourrait être imposé par les créanciers de l’État. Une hausse inconsidérée de la dette et de la charge des intérêts pourrait laisser croire aux investisseurs que l’État ne sera bientôt plus en mesure d’honorer ces engagements financiers. Le remboursement de la dette ne pouvant pas mobiliser une part indéfiniment croissante des ressources publiques, les créanciers de l’État finiraient par refuser tout nouveau prêt et la menace de la cessation des paiements imposerait un ajustement drastique. Si la France n’est pas aujourd’hui confrontée à cette situation, un tel scénario ne peut être complètement écarté si rien n’est fait à l’avenir.
Le troisième et dernier risque associé à un emballement de la dette est celui d’une remise en cause du succès de la politique de relance. Si le creusement des déficits publics est inévitable en phase de récession, il est tout aussi nécessaire de montrer que l’endettement est sous contrôle et que des mesures appropriées permettront de stabiliser puis de réduire la dette pour maintenir la confiance indispensable à une reprise durable de la croissance. À défaut, les ménages et entreprises pourraient augmenter leur épargne de précaution, ce qui pèserait sur l’évolution de la consommation et sur la croissance. Une étude récente du FMI conclut, pour cette raison, que l’impact des politiques de relance budgétaire sur l’activité est d’autant plus limité que la dette publique est élevée (10).
III. UN RISQUE DE DÉCLASSEMENT DE LA FRANCE EN EUROPE À CAUSE DE FINANCES PUBLIQUES DÉGRADÉES
Bien que faisant partie des pays européens les moins touchés par la crise, la France aura l’un des déficits publics les plus élevés en 2009 et 2010. Autre fait majeur : en 2008, pour la première fois depuis la création de la zone euro, la dette française est devenue plus importante, en points de PIB, que la dette allemande.
Ces niveaux de déficit et d’endettement parmi les plus élevés en Europe ne manqueront pas de mettre la France en délicatesse au regard des critères de Maastricht, y compris lorsque l’on se sera éloigné de la crise actuelle. En effet, avant la création de l’euro, la politique budgétaire en France était conduite sans contraintes institutionnelles a priori : en particulier, et contrairement à certains États, aucune norme d’équilibre ou d’endettement ne s’imposait au gouvernement, qui déterminait discrétionnairement ses objectifs en fonction des circonstances politiques et de l’environnement économique du moment.
Or, comme votre rapporteur l’a, d’ores et déjà, souligné, la création de l’euro oblige les États à conduire une politique budgétaire vertueuse répondant à certaines normes, plus connues sous le nom de « critères de Maastricht » : la conduite de la politique budgétaire reste libre, mais le déficit ne doit pas dépasser 3 % du PIB et la dette 60 %. Ne pas respecter durablement ces normes européennes conduirait la France à une évidente perte d’influence sur le continent et de capacité à entraîner ses partenaires : comment la France pourra-t-elle faire prévaloir ses vues dans une Europe dont elle ne respecte plus les règles budgétaires ?
A. UN ÉTAT DONT LE DÉFICIT RESTE NETTEMENT PLUS DÉFAVORABLE QUE CELUI DE SES VOISINS EUROPÉENS
Nombre de professionnels auditionnés par la mission ont rappelé qu’au sein des pays de la zone euro et de l’OCDE, la France restait un pays pour le moins atypique. Alors que les premiers ont réduit de manière sensible leurs dépenses publiques depuis le début des années 1990, notre pays les a maintenues à un niveau élevé. Ainsi, alors que le niveau des dépenses publiques s’établissait en 1993 à 54,3 % en France et à 52 % dans la zone euro, il est passé respectivement à 53 % et 44 % en 2008, traduisant une quasi-stagnation dans notre pays et une réduction assez nette de la dépense publique dans les différents pays de la zone euro. Ce maintien des dépenses publiques françaises à un niveau élevé s’est sans conteste accompagné d’un déséquilibre budgétaire croissant.
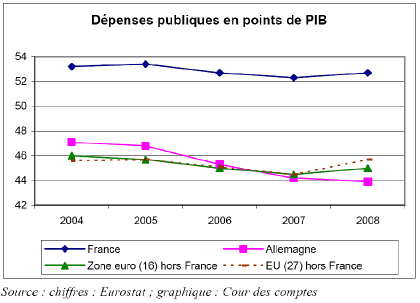
Ces dernières années, l’écart avec l’Allemagne s’est fortement creusé, car le niveau des dépenses publiques outre-Rhin, en points de PIB, a poursuivi en 2008 sa forte baisse des années passées. Au niveau de 43,8 % du PIB, les dépenses publiques allemandes, en 2008, faisaient ainsi apparaître un écart, jusqu’ici jamais atteint, de près de 9 % du PIB avec la France.
Si l’écart avec les moyennes européennes s’est légèrement réduit, la France a néanmoins été en 2008 le seul État de la zone euro dont les dépenses publiques ont été supérieures à 50 % du PIB. Il y en avait deux autres en 2004 (l’Autriche et la Finlande) et cinq autres dix ans plus tôt (les deux précédents plus l’Italie, la Belgique et les Pays-Bas).
La Suède a conservé en 2008 un niveau de dépenses publiques légèrement supérieur au niveau français (53,1 % du PIB) mais elle a encaissé parallèlement un niveau de recettes publiques suffisant pour faire apparaître, pour la cinquième année consécutive et malgré une croissance légèrement négative (- 0,2 %), un solde budgétaire excédentaire (2,5 % du PIB) en 2008, ce qui est très éloigné du cas français.
Le niveau des dépenses publiques n’est pas en soi un élément défavorable pour une économie – comme on l’a déjà souligné auparavant – mais si ce niveau est élevé, les marges de manœuvre pour réduire le déficit sont plus étroites. De ce point de vue, la France souffre nettement de la comparaison avec la plupart de ses voisins européens.
En 2008, la croissance est restée légèrement positive dans la majorité des États de la zone euro et de l’Union européenne. Cependant, son ralentissement (+ 0,8 % contre + 2,7 % en 2007 en moyenne pour la zone euro) a entraîné, sauf rares exceptions (Allemagne notamment), une dégradation des soldes publics.
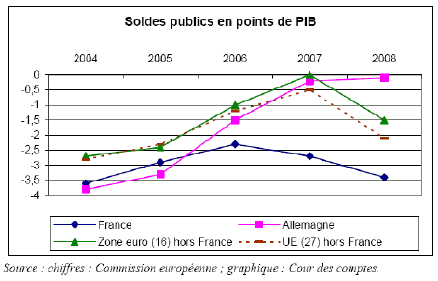
Les excédents budgétaires sont devenus plus rares et, le plus souvent, de moindre ampleur (Finlande, Danemark, Suède et Pays-Bas notamment) tandis que les déficits devenaient plus fréquents. Pour cinq États de la zone euro (France, Espagne, Italie, Malte, Grèce, Irlande), ils ont dépassé le seuil de référence de 3 % du PIB, alors qu’en 2007 seule la Grèce était dans ce cas. Dans certains États, le déficit public a pris une dimension inhabituelle (Royaume-Uni, dont le déficit s’établira à 12,4 % du PIB en 2009) et, dans d’autres, la situation excédentaire antérieure s’est brutalement inversée du fait de la crise (l’Irlande et l’Espagne, qui verra son déficit s’envoler à 10 % du PIB en 2009).
En 2008, la position budgétaire de la France s’est encore davantage éloignée de la position allemande et c’est ce qui est le plus préoccupant : alors que la France a vu son déficit public s’alourdir de 0,7 % du PIB par rapport à 2007, l’Allemagne a réussi à stabiliser son solde public au voisinage de l’équilibre
(- 0,1 % du PIB en 2008).
Si le déficit moyen, hors France, de la zone euro (- 1,5 % du PIB), comme celui de l’Union européenne (- 2,1 % du PIB), s’est rapproché de celui de la France, ce dernier reste néanmoins nettement plus défavorable (- 3,4 %).
B. LE QUATRIÈME ÉTAT LE PLUS ENDETTÉ DE LA ZONE EURO
La France est devenue en 2008, derrière l’Italie, la Grèce et la Belgique, le quatrième État le plus endetté, en pourcentage du PIB, de la zone euro et après la Hongrie, le cinquième de l’Union européenne. Elle était, en 2004, à la huitième place de la zone euro et de l’Union. Parmi les dix États les plus endettés de l’Union, la France a été la seule avec Malte à avoir connu une situation de déficit primaire, c’est-à-dire avant paiement des intérêts sur la dette publique.
La dette publique a augmenté en 2008 de 3,3 % du PIB dans la zone euro et de 2,6 % dans l’Union européenne, hors France. Avec une augmentation de 4,3 %, le ratio « dette publique/PIB » de la France a continué à croître plus vite en 2008 que les moyennes communautaires. Atteignant 68,1 % du PIB, il a dépassé, pour la première fois depuis la création de l’euro, le niveau de dette allemand (65,9 % du PIB).
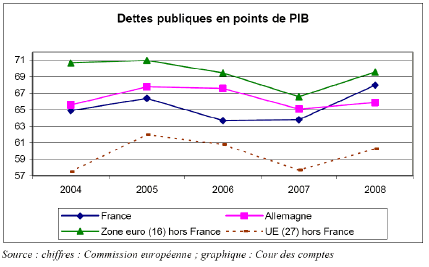
En 2008, les charges d’intérêt sur la dette publique sont passées en France de 2,7 à 2,8 % du PIB. Elles ont ainsi rejoint le niveau allemand, stable à 2,8 % du PIB depuis 2004 et dépassé la moyenne de l’Union européenne (2,7 %).
C. UN ÉTAT AYANT UNE CAPACITÉ MOINDRE QUE SES PARTENAIRES À REDRESSER SES COMPTES PUBLICS
Aussi longtemps que cette tendance se poursuivra, il en résultera pour les finances publiques françaises un désavantage comparatif grandissant (diminution des marges de manœuvre et plus grande rigidité des dépenses incompressibles) par rapport à la plupart des autres pays européens. Ce constat a été partagé de manière unanime par l’ensemble des personnes entendues par la mission dans le cadre de ses travaux.
Le niveau d’endettement de la France est certes proche de la moyenne des pays de la zone euro ou de l’OCDE, mais la capacité de notre pays à redresser ses comptes publics est moindre pour plusieurs raisons.
En premier lieu, le niveau de ses prélèvements obligatoires est quasiment le plus élevé de l’OCDE et toute hausse de ces prélèvements présente en conséquence des risques pour la compétitivité et l’attractivité de l’économie française, alors même que sa balance des paiements courants est déjà fortement déficitaire.
En second lieu, contrairement à la plupart des autres pays, la France n’a pas montré une réelle aptitude à une réduction significative du poids de ses dépenses publiques, dont la croissance moyenne est restée supérieure à 2 % par an sur les dix dernières années.
D. LA FRANCE EN EUROPE : LE RISQUE D’UNE PERTE IRRÉVERSIBLE DE LEADERSHIP
En définitive, contrairement à ses voisins européens, la France s’est montrée incapable, depuis une trentaine d’années, de redresser ses comptes publics. Alors que la monnaie unique exige que chaque pays mène une politique budgétaire vertueuse dans les limites fixées par le Traité de Maastricht, la France risque, dans les années à venir, d’être accusée de jouer un jeu non coopératif.
En effet, la dégradation des comptes publics du pays constitue un signal négatif envoyé par la France à ses partenaires. Alors que le déficit allemand sera inférieur à 3 % de la richesse nationale à la fin de 2009, celui de la France côtoiera les 8 % : comment la France pourra-t-elle encore faire entendre sa voix au sein du concert européen, si elle ne respecte pas elle-même les règles que tous se sont fixés ? Si l’écart de situation entre l’Allemagne et notre pays venait à s’accroître de manière excessive, on peut se demander quel serait l’avenir du couple franco-allemand qui a été à l’origine de tous les grands progrès de l’Europe.
La sortie de crise va être déterminante : si, à ce moment précis, la France ne se conforme pas à ses obligations, la Commission européenne pourra alors engager une procédure pour déficit excessif. La France pourra ainsi faire l’objet d’une procédure d’avertissement puis, si la situation persiste, se voir infliger des sanctions financières. Mais plus que ces hypothétiques sanctions, c’est le risque de déclassement politique qui est le plus inquiétant, et ce d’autant plus que pourrait également se profiler une remise en cause de notre modèle social qui est au fondement même de l’unité du pays.
IV. LE MODÈLE SOCIAL FRANÇAIS : UN FONDEMENT DU PACTE RÉPUBLICAIN PLUS QUE JAMAIS MENACÉ
La protection sociale recouvre l’ensemble des systèmes qui ont pour finalité de protéger les individus contre les conséquences financières des « risques sociaux » : maladie, invalidité, maternité, vieillesse, chômage, coût des enfants, exclusion… Le modèle social français se distingue par son haut niveau de protection sociale, puisqu’il représente 29,5 % du PIB, contre 26,3 % en moyenne dans les pays de l’Union européenne.
À la Libération, la première ordonnance portant organisation de la sécurité sociale (4 octobre 1945) prend place dans une longue histoire qui témoigne des liens de solidarité unissant les membres de la société. Si l’État se fait « instituteur du social », selon l’expression de Pierre Rosanvallon, c’est en raison du constat selon lequel, face au développement du « paupérisme » depuis la révolution industrielle, les réponses individuelles ou privées sont inadéquates. L’État intervient pour tenter de résoudre ce que l’on appelle la « question sociale », plus pressante que jamais au moment de la reconstruction.
En 1945, un Français sur deux bénéficie donc, déjà, d’une sécurité sociale qui sera progressivement étendue, par la suite, à toute la population, tandis que les droits seront constamment améliorés. Les prestations versées, permettant à certains d’éviter la pauvreté, contribueront aussi fortement à soutenir la croissance économique. Mais les ressources disponibles se réduisent à la fin des années 1970, l’impact grandissant du chômage entraînant simultanément une diminution des recettes et une augmentation du nombre de bénéficiaires sous conditions de ressources.
Dans une économie de plus en plus mondialisée, la question du coût de la protection sociale se pose avec d’autant plus d’acuité que se précisent les menaces qui pèsent sur elle : accumulation de déficits structurels, détérioration du rapport entre actifs et inactifs, croissance non maîtrisée des dépenses de santé…
Si nous souhaitons préserver notre modèle social qui constitue l’une des bases du pacte républicain, il faut aborder cette question avec lucidité.
A. UN MODÈLE SOCIAL À L’ÉPREUVE DES FAITS
1. La protection sociale : un poids économique incontournable
Le financement de la protection sociale constitue aujourd’hui un secteur clé des finances publiques nationales. La part des dépenses de prestations sociales dans la richesse nationale a régulièrement crû depuis 1945. Face à ce besoin de financement, les ressources affectées à la protection sociale ont non seulement crû, mais se sont diversifiées.
La protection sociale constitue aujourd’hui le premier secteur public bénéficiaire de prélèvements obligatoires. Ainsi, en 2007, les administrations de sécurité sociale (soit les régimes obligatoires de base de sécurité sociale, l’assurance-chômage et les régimes obligatoires de retraite complémentaire) ont reçu 50,7 % de l’ensemble des prélèvements obligatoires. Par comparaison, l’État n’en perçoit que 33,5 %. Depuis 1983, le niveau des ressources sociales est supérieur à celui de l’État. En raison de leur poids, les finances de la protection sociale constituent aujourd’hui un enjeu majeur pour assurer l’équilibre financier de la sphère publique.
Les comparaisons internationales soulignent cette spécificité de la France mais aussi des pays européens par rapport aux autres pays développés. Le niveau important des dépenses publiques et, corrélativement, le niveau élevé de prélèvements obligatoires est le reflet du choix de systèmes publics de prise en charge des risques de l’existence.
2. Quand les déficits s’ajoutent aux déficits…
a) Des déficits massifs et récurrents
Jusqu’en 1970, le financement des dépenses de protection sociale a pu être assuré sans tension excessive tant au niveau de l’endettement public que des revenus des ménages ou des comptes des entreprises.
En revanche, après le premier choc pétrolier, l’équilibre des comptes sociaux a été menacé : le ralentissement de la croissance a conduit à une contraction de la masse salariale, assiette principale des recettes de la sécurité sociale. Or, au moment où diminuaient les recettes de la protection sociale, les dépenses continuaient pour leur part de croître, notamment à partir de 1975, sur un rythme plus rapide qu’auparavant.
De la même manière, la première moitié des années 1980 a confirmé le déséquilibre apparu entre recettes et dépenses : en raison de nouvelles formes d’exonération de cotisations sur les rémunérations considérées comme annexes, notamment l’intéressement, la participation ou les contrats de protection sociale complémentaires et surcomplémentaires, les recettes de la sécurité sociale (assises sur la masse salariale) ont progressé moins vite que le PIB.
L’ajustement entre les recettes et les dépenses de la sécurité sociale a alors été recherché par l’augmentation des recettes (augmentation de cotisations et affectation à la sécurité sociale de nouvelles ressources fiscales, comme la CSG) et la diminution des dépenses.
Au milieu des années 1990, la situation est cependant devenue progressivement insupportable pour les comptes publics, qu’il s’agisse du budget de l’État jusque-là financeur des déficits sociaux ou des comptes de la sécurité sociale eux-mêmes. Dès 1990, la sécurité sociale est entrée dans une spirale d’endettement qui ne se démentira jamais : la dérive financière de la protection sociale n’a jamais cessé. Si le régime général de la sécurité sociale a certes connu en 2000 et 2001 des excédents, le ralentissement économique des années 2002-2003 a ouvert la voie à un nouvel approfondissement du déficit. Celui-ci s’est stabilisé autour de 10 milliards d’euros ces dernières années, ce qui constitue un précédent particulièrement inquiétant dans le contexte de crise économique que traverse actuellement notre pays.
SOLDES PAR BRANCHE DU RÉGIME GÉNÉRAL SUR LA PÉRIODE 2004-2008
(en milliards d’euros)
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 | |
Maladie |
- 11,6 |
- 8 |
- 5,9 |
- 4,6 |
- 4,4 |
- 11,5 |
- 14,6 |
Accidents du travail |
- 0,2 |
- 0,4 |
- 0,1 |
- 0,5 |
0,2 |
- 0,6 |
- 0,8 |
Vieillesse |
0,3 |
- 1,9 |
- 1,9 |
- 4,6 |
- 5,6 |
- 8,2 |
- 10,7 |
Famille |
- 0,4 |
- 1,3 |
- 0,9 |
- 0,2 |
- 0,3 |
- 3,1 |
- 4,4 |
Total régime général |
- 11,9 |
- 11,6 |
- 8,7 |
- 9,5 |
- 10,1 |
- 23,5 |
- 30,6 |
Source : rapport d’information (n° 544, session extraordinaire de 2008-2009) de M. Alain VASSELLE, au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur l’état des comptes de la sécurité sociale en vue de la tenue du débat d’orientation des finances publiques pour 2010.
Pour la première fois depuis 1983, le déficit de la caisse nationale d’assurance vieillesse (retraites) a dépassé en 2008 celui de l’assurance maladie, tandis que la branche accidents du travail-maladies professionnelles est la seule à dégager un léger excédent.
b) Une solution originale en réponse à l’accroissement continu de la dette sociale : la CADES
Contrairement à l’État, la sécurité sociale ne disposait pas jusqu’en 1996 d’une structure permanente de consolidation de ses déficits. Or, sous l’effet des dérapages financiers de l’assurance maladie au début des années 1990, les déficits présents sont venus s’ajouter aux déficits passés, donnant progressivement naissance à une dette sociale colossale.
La gestion de ces déficits n’était guère satisfaisante : c’est l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), en charge de la trésorerie des régimes de sécurité sociale, qui s’est trouvée dans les faits investie de la tâche de refinancer les déficits accumulés au fil du temps. Alors que la mission de l’ACOSS est en principe de couvrir à court terme un besoin de trésorerie courant, elle a été contrainte de financer à moyen et long terme, grâce à divers jeux de trésorerie, un déficit structurel provenant du décalage entre les dépenses et les recettes de sécurité sociale.
Afin de remédier à cette situation financière menaçant les fondements de la sécurité sociale, a été créée en 1996 une entité autonome, dotée de ressources propres – notamment la CRDS (11) – et destinée à amortir la dette sociale : la caisse d’amortissement de la dette sociale.
Initialement créée pour reprendre les 44,7 milliards d’euros de dettes constatées dans les comptes des régimes de sécurité sociale en 1996, la CADES s’est vue depuis transférer, par la loi et de manière régulière, les déficits de l’assurance maladie.
REPRISE DE LA DETTE PAR LA CADES DEPUIS L’ORIGINE
(en milliards d’euros)
Année |
Nature de la dette reprise |
Montant |
1996 |
Déficits cumulés des exercices 1994 et 1995 et déficit prévisionnel 1996 du régime général. |
20,886 |
Déficits 1995 et 1996 de la Canam. |
0,457 | |
Emprunt ACOSS, repris par l’État en 1994. |
23,380 | |
1998 |
Déficits cumulés du régime général depuis 1996 (après déduction de la fraction déjà prise en charge en 1996) et déficit prévisionnel de 1998. |
13,263 |
2003 |
Dette du Forec (12) (première moitié régime général et autres régimes). |
1,283 |
2004 |
Dette du Forec (deuxième moitié régime général). |
1,097 |
Déficits cumulés de la branche maladie du régime général au 31 décembre 2003 et déficit prévisionnel 2014. |
35 | |
2005 |
Déficit prévisionnel de la branche maladie en 2005. |
6,61 |
2006 |
Déficit prévisionnel de la branche maladie en 2006 et régularisation de la reprise de dette opérée en 2005 (- 0,3 milliard d’euros) |
5,7 |
2007 |
Revalorisation de la reprise de dette opérée en 2006. |
- 0,065 |
2008 |
Premier versement pour la reprise des déficits cumulés à la fin 2008 des branches maladie et vieillesse du régime général ainsi que du fonds de solidarité vieillesse (FSV). |
10 |
2009 |
Versements complémentaires pour la reprise cumulée – dans la limite de 27 milliards d’euros – des déficits cumulés à la fin 2008 des branches maladie et vieillesse du régime général ainsi que du fonds de solidarité vieillesse (FSV). |
17 |
TOTAL |
134,611 | |
Source : rapport d’information (n° 544, session extraordinaire de 2008-2009) de M. Alain VASSELLE, au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur l’état des comptes de la sécurité sociale en vue de la tenue du débat d’orientation des finances publiques pour 2010.
Comme l’a indiqué à la mission, M. Patrice Ract Madoux, président de la CADES, au 31 décembre 2009, compte tenu des nouvelles reprises de dette intervenues ou à intervenir au titre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, l’ensemble des dettes transférées depuis 1996 devrait s’élever à 134,6 milliards d’euros, dont 93 milliards restant à amortir. Selon les informations fournies par la CADES, l’horizon de remboursement médian espéré est actuellement de douze ans (2021). Il existe 5 % de risques de ne pas avoir remboursé avant quatorze ans (2023) et 5 % de chances d’avoir terminé avant onze ans (2020).
La création d’une entité autonome a une vertu pédagogique, car elle permet d’identifier précisément le montant des déficits sociaux, financés par une ressource propre, à savoir la CRDS. La dette, legs aux générations actuellement en activité ou amenées à entrer sur le marché du travail, est ainsi connue de tous.
De plus, en 2005, à l’initiative de votre rapporteur, l’article 20 de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale a modifié l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour prévoir qu’à toute nouvelle reprise de dette par la CADES doivent être associées les ressources supplémentaires nécessaires pour ne pas allonger la durée estimée de son mandat. Ce dispositif, dont le Conseil constitutionnel a estimé qu’il revêtait un caractère organique, vise à empêcher le report de la dette sociale sur les générations futures.
B. UN MODÈLE SOCIAL À L’ÉPREUVE DE LA CRISE
1. 2009 : vers un déficit sans précédent du régime général de la sécurité sociale
La récession que connaît la France depuis plus d’un an est venue anéantir l’ensemble des prévisions relatives aux résultats des comptes du régime général de la sécurité sociale.
Celui-ci devrait enregistrer en 2009 un déficit sans précédent de 23,5 milliards d’euros, soit un doublement par rapport aux niveaux déjà inédits atteints ces dernières années.
Les premières projections évoquées par le gouvernement et la Cour des comptes font état d’une nouvelle dégradation en 2010, le déficit risquant d’approcher les 30 milliards d’euros.

La masse salariale du secteur privé et les recettes qui lui sont liées (soit environ trois quarts des recettes du régime général) se sont effondrées à la fin de 2008 et au début de 2009. Face à cette chute des recettes de la sécurité sociale, les dépenses paraissent heureusement à ce stade relativement contrôlées – sous réserve d’un dépassement de 0,3 à 0,5 milliard d’euros de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) –, ce qui ne suffit naturellement pas à empêcher une dégradation profonde du solde des différentes branches, singulièrement de l’assurance maladie.
La question du traitement des déficits accumulés par le régime général se pose une nouvelle fois, dès maintenant et avec une gravité sans précédent. Or on l’a vu, en application de la loi organique du 2 août 2005, les transferts de dettes à la CADES doivent s’accompagner d’une augmentation des recettes de la caisse permettant de ne pas allonger la durée d’amortissement de sa dette.
2. 2009 : une date importante dans l’histoire de la dette sociale
En 1996, lorsque le gouvernement d’Alain Juppé a décidé de mettre en œuvre un plan ambitieux de sauvegarde de la sécurité sociale, l’ordonnance créant la CADES a assigné à celle-ci la mission d’apurer les déficits cumulés par le régime général sur une période de treize ans et un mois qui devait s’achever en conséquence en 2009 au plus tard. Treize ans plus tard, non seulement la CADES existe toujours, mais le montant de la dette qu’elle doit encore rembourser est beaucoup plus élevé que celui de la dette initiale reprise en 1996.
Dans le même temps, une nouvelle dette est en cours de constitution sous la forme de déficits massifs du régime général de la sécurité sociale. Dans ces conditions, le risque est désormais grand de voir disparaître toute perspective d’extinction de la dette sociale, alors même que le système de gestion de cette dette avait été précisément conçu pour éviter cette pérennisation et le report de la dette sur les générations futures.
En effet, alors que la CADES vient à peine de reprendre 27 milliards d’euros de dette au régime général de la sécurité sociale en 2008 et 2009, la reconstitution immédiate, sous l’effet de la crise, d’un déficit massif en 2009 (20 milliards) et vraisemblablement en 2010 (30 milliards) repose, dès à présent, la question du sort de cette nouvelle dette. D’après les prévisions de la commission des comptes de la sécurité sociale, le déficit du régime général atteindra 23,5 milliards d’euros en 2009 et plus de 30 milliards en 2010. Ainsi, d’ici à la fin de l’année 2010, une nouvelle dette sociale de plus de 50 milliards d’euros pourrait s’être reconstituée.
Or, en l’état, l’ACOSS ne pourra probablement pas gérer par de simples jeux de trésorerie ce déficit structurel. Ce n’est d’ailleurs nullement sa vocation. Face à la reconstitution d’un déficit considérable, elle devra recourir plus largement à deux types de financement, dans la limite du plafond de 18,9 milliards d’euros qui lui est fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 :
— un financement par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre d’une convention signée en 2006 par les deux organismes, qui permet à l’ACOSS de bénéficier à hauteur de 31 milliards d’euros d’un financement moins coûteux que celui qui pourrait lui être consenti par les banques. Cependant, lors de son audition par votre rapporteur, M. Pierre Burban, président du conseil d’administration de l’ACOSS, a indiqué que le financement de l’ACOSS par la Caisse des dépôts et consignations n’était en réalité plus garanti au-delà de 25 milliards d’euros. En effet, en 2008, la Caisse des dépôts et consignations a notifié à l’ACOSS que les conditions conventionnelles de financement ne s’appliqueraient qu’à hauteur de 25 milliards d’euros. Au-delà de ce plafond, les avances de trésorerie de la Caisse des dépôts et consignations devraient se faire aux conditions de marché (13), en général plus coûteuses que les conditions définies par la convention signée en 2006 entre l’ACOSS et la Caisse des dépôts et consignations ;
— l’émission de billets de trésorerie dans la limite d’un plafond de 11,5 milliards d’euros. En réalité, l’ACOSS n’a jamais jusqu’à présent placé sur le marché plus de 5 milliards d’euros de billets de trésorerie. Le recours à l’émission de billets de trésorerie n’est pas sans limites, dès lors que le marché de ces billets est relativement étroit et que l’ACOSS en est déjà le principal acteur.
En définitive, les ressources de l’ACOSS destinées en principe à couvrir un besoin de trésorerie courant vont devoir prendre en charge le déficit structurel provenant du décalage entre les dépenses et les recettes de sécurité sociale. Dans ces conditions, il est indispensable de réfléchir au sort de la nouvelle dette sociale en cours de constitution du fait des déficits prévisibles en 2009 et 2010.
C. UN MODÈLE SOCIAL À L’HEURE DES CHOIX
L’ampleur des défis financiers que connaît le modèle français de protection sociale depuis la fin des Trente Glorieuses impose cependant des choix clairs et courageux. En effet, les défis financiers sont aujourd’hui plus que jamais au cœur des problématiques sociales : l’équilibre des comptes est une condition de la pérennité du système collectif de solidarité instauré en France en 1945.
1. Une belle réussite du modèle français de protection sociale…
Les principes fondamentaux, qui gouvernent encore aujourd’hui l’organisation de la protection sociale, ont été posés après la Seconde Guerre mondiale, dans la lignée du programme du Conseil national de la Résistance.
Ce plan français de sécurité sociale, élaboré en 1945 par Pierre Laroque, a permis une extension et une amélioration progressives des différents régimes, si bien qu’aujourd’hui toute la population est peu ou prou couverte contre les risques de la vie grâce à la sécurité sociale. La société française, en son entier, en a bénéficié.
Ce modèle de protection sociale, fondé sur la solidarité nationale, a notamment permis un net recul de la pauvreté, dont le taux (14) est passé de 17 % environ dans les années 1970 à 12 % en 2005. C’est pourquoi, les Français restent très attachés à un modèle de sécurité sociale. Il ne saurait être question de le remettre en cause. C’est notre capacité à parvenir à une maîtrise régulée et pérenne de la dépense, qui constitue l’enjeu auquel notre pays est confronté.
2. … dont l’assainissement financier ne peut plus être différé.
Si le modèle français de protection sociale apparaît aujourd’hui être une belle et indéniable réussite, c’est au prix d’un coût croissant et de déficits élevés, reportés sur les générations futures. Lors de son audition par votre rapporteur, l’économiste Christian Saint-Étienne a rappelé que jamais la génération des 25-35 ans n’avait été aussi maltraitée dans notre pays : elle va, en effet, devoir supporter l’ensemble des ajustements qui, bien que nécessaires, n’ont pas été faits par le passé.
Il faut également prendre conscience, dès à présent, que le retour de la croissance aux niveaux qu’elle a connus avant la crise permettra seulement de stabiliser le déficit au niveau qui sera atteint à l’issue de la récession, soit peut-être plus de 30 milliards. Il est clairement ressorti des auditions auxquelles la mission a procédé que le retour d’une croissance modérée des recettes de la sécurité sociale assortie d’une croissance également modérée des dépenses ne permettra en aucun cas – ou de manière marginale – de résorber les déficits massifs qui auront été atteints.
Or, si la sécurité sociale a pu supporter depuis 2003 des déficits annuels voisins de 10 milliards d’euros au prix d’un accroissement important de la dette sociale, elle ne résistera pas à plusieurs années d’un déficit qui se stabiliserait à 30 milliards d’euros.
Par conséquent, compte tenu du temps qu’elles mettront à produire leurs effets sur les comptes de la sécurité sociale, les réformes ne peuvent plus être différées. Il en va de la pérennité de la protection sociale.
* *
*
Le tableau qui vient d’être dressé n’est pas pessimiste. Il est réaliste. C’est cette vérité qu’il nous appartient de regarder en face pour mieux réagir en lançant une mobilisation générale. Le sauvetage de nos finances publiques est sans doute la grande cause des toutes prochaines années.
C’est pourquoi la mission propose des pistes pour lutter tous azimuts contre les dépenses inutiles, faire face à l’accumulation de notre dette et améliorer notre système de recettes publiques.
DEUXIÈME PARTIE : POUR UNE MOBILISATION NATIONALE
Le retour à l’équilibre budgétaire et l’assainissement des comptes publics doivent être envisagés aujourd’hui de manière globale. Il serait en effet vain de vouloir prétendre mettre fin à la dégradation de nos finances publiques en ne s’intéressant qu’à une seule partie de la sphère publique.
La mission a fait le choix d’avoir une vision cohérente de ce que doit être une véritable stratégie de résorption des déficits et de la dette. C’est pourquoi, elle a souhaité faire des propositions aussi bien pour l’État et les collectivités territoriales qu’en matière de protection sociale.
Aucun de ces acteurs ne peut être tenu responsable à lui tout seul de la situation budgétaire de notre pays. C’est une responsabilité collective, que tous doivent partager et qui plaide pour une mobilisation nationale sans précédent. C’est tout le sens des propositions qui suivent.
I. STIMULER LES RECETTES ET OPTIMISER LES DÉPENSES DE L’ÉTAT
La dégradation de la situation budgétaire est aujourd’hui telle que l’État ne peut plus espérer financer ses dépenses courantes par la dette, repoussant sans cesse à demain le retour à l’équilibre budgétaire.
On vient de le voir, si, depuis la fin des Trente Glorieuses, la France présente cette originalité d’avoir des dépenses systématiquement supérieures aux recettes, la crise sans précédent des finances publiques, vers laquelle se dirige irrémédiablement notre pays, nécessite des réponses courageuses et énergiques, seules capables d’assainir durablement les comptes de la Nation.
Afin d’y parvenir, la stratégie de l’État se doit d’être double : stimuler les recettes, d’une part, et optimiser les dépenses, d’autre part.
En premier lieu, stimuler les recettes signifie que demain l’État devra non seulement prélever l’impôt au moindre coût et défendre la ressource fiscale, mais également soutenir l’activité économique et l’investissement du pays. Sans production de richesses nouvelles, les recettes fiscales ne seront jamais à la hauteur des enjeux financiers, auxquelles la France est confrontée.
En second lieu, optimiser les dépenses implique que l’État se doit dès aujourd’hui, d’être exemplaire dans toutes ses composantes, grâce à une réduction des dépenses inutiles et à une meilleure organisation tant de ses services que de ses procédures administratives. Les ministères régaliens, que sont la Justice, l’Intérieur et l’Immigration, devront à cet égard consentir tous les efforts nécessaires.
A. DÉFENDRE LA RESSOURCE FISCALE DE L’ÉTAT ET AMÉLIORER SA COLLECTE
Si, comme le rappelle la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à son article 13, « pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable », l’État, dans son souci de maîtriser la dépense publique, se doit de défendre la ressource fiscale et de la prélever au moindre coût pour le contribuable.
Des marges de manœuvre en la matière doivent encore être exploitées grâce à la retenue à la source de l’impôt sur le revenu ou bien encore la généralisation du télépaiement et de la télédéclaration des différents impôts auxquels les entreprises sont soumises. Un plafonnement accru des niches fiscales ainsi une meilleure fiscalisation de l’économie souterraine ne pourront de la même manière que diminuer le coût de prélèvement de l’impôt en France
1. Prélever à la source l’impôt sur le revenu
En garantissant une meilleure adaptation aux revenus du contribuable, l’extension de la retenue à la source à l’impôt sur le revenu (IR), maintes fois annoncées et maintes fois reportées, permettrait de diminuer le coût de prélèvement de l’impôt en France et de générer d’importantes économies.
La retenue ou prélèvement à la source consiste en effet à faire prélever le montant de l’impôt sur le revenu par un tiers payeur – généralement l’employeur – au moment du versement des revenus au contribuable. Ce mode de recouvrement, mieux adapté à la réalité du revenu, s’applique d’ores et déjà à la CSG et à la CRDS.
a) La nécessité de pallier l’inefficacité du mode de recouvrement actuel
Contrairement à la plupart des pays de l’OCDE (15) où l’impôt sur le revenu est retenu à la source, la France maintient un système conduisant un foyer fiscal à payer en 2010 l’impôt sur ses revenus de 2009. Or, chaque année, environ cinq millions de foyers imposables connaissent en cours une forte variation de leurs revenus (décès, maladie, divorce, naissance d’une enfant, perte d’emploi, etc.). Le dispositif actuel peut donc conduire, dans certaines situations, à des difficultés de paiement de l’impôt pour les contribuables.
L’avantage déterminant de l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu serait la meilleure prise en compte de la réalité économique via la suppression du décalage de plus d’un an entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt. Cet ajustement salutaire peut se décliner en deux volets : ajustement à la réalité de la situation des contribuables et ajustement à la réalité de la vie économique du pays.
b) Les retombées macroéconomiques positives de la retenue à la source
● Un surplus de recettes fiscales de 0,5 milliard d’euros par an
Avec le système du prélèvement à la source, le tiers payeur – c’est-à-dire l’employeur – garantirait un paiement en temps réel des différentes mensualités. Les formalités entre contribuables et administration fiscale seraient donc simplifiées, réduisant d’autant le risque des incidents de paiement. Le surcroît de recettes fiscales est ainsi estimé entre 0,2 et 0,5 milliard d’euros par an (16). La déclaration de revenus devrait toutefois être maintenue dans le cadre d’une régularisation en fin d’exercice, permettant de s’assurer de la corrélation effective entre l’impôt dû et la somme des prélèvements.
● Un effet contracyclique renforcé par le biais des stabilisateurs automatiques
Rapprocher l’encaissement des recettes de l’impôt sur le revenu de son fait générateur et, surtout, mieux ajuster le montant prélevé à l’assiette, ne peut qu’améliorer le rôle de stabilisateur automatique joué par l’impôt sur le revenu : les recettes seraient plus dynamiques en phase de croissance et le prélèvement serait allégé plus tôt en creux de cycle. Cela permettrait, en phase de croissance, de contenir l’inflation et d’améliorer plus rapidement le solde budgétaire pour désendetter l’État. En creux de cycle, la ponction serait moindre sur le revenu des ménages, permettant un soutien plus opportun à la consommation.
À ce jour, la retenue à la source pourrait être mise en œuvre à législation constante, puisqu’elle n’est pas incompatible avec la règle de l’imposition par foyer fiscal. L’organisation du contrôle devrait toutefois être repensée puisqu’il s’agirait de contrôler le respect des obligations fiscales non seulement du contribuable salarié mais aussi de son employeur. En outre, la retenue à la source doit être subordonnée au respect de deux principes majeurs :
— un principe de confidentialité : le caractère confidentiel des données relatives à la vie privée, nécessaires à la détermination et à l’ajustement du taux d’imposition, doit être préservé, notamment à l’égard de l’employeur chargé de prélever à la source l’impôt sur le revenu ;
— un principe de simplicité tant pour le contribuable que pour l’employeur : le contribuable devrait être en mesure de comprendre aisément le calcul de la retenue mensuelle opérée sur son salaire, le montant total de l’impôt prélevé sur une année et de voir son solde final rapidement régularisé. Pour l’employeur, prélever l’impôt sur le revenu ne doit pas constituer une charge trop importante, qu’il s’agisse du calcul des prélèvements individuels ou des modalités de reversement mensuel à l’administration fiscale.
Parce que la retenue à la source de l’impôt sur le revenu permettrait de dégager un surplus de recettes fiscales de près de 0,5 milliard d’euros par an et qu’elle permettrait de simplifier le prélèvement de cet impôt, votre rapporteur propose qu’à partir de 2011, l’impôt sur le revenu soit prélevé à la source. Une telle mesure conduirait à ce que les revenus perçus en 2010 ne soient pas taxés à l’impôt sur le revenu. En effet, en 2010, les ménages paieront l’impôt sur les revenus perçus en 2009 et, en 2011, ils paieront l’impôt sur les revenus perçus en 2011. Autrement dit, les revenus de 2010 ne seront pas imposés.
Proposition n° 1 : un État qui collecte l’impôt sur le revenu au moindre coût par la retenue à la source dès 2011
À partir de 2011, prélever l’impôt sur le revenu à la source, permettant une baisse du coût de collecte de cet impôt et pour un gain de recettes fiscales estimé entre 0,2 et 0,5 milliard d’euros par an.
2. Généraliser le télépaiement et la télédéclaration des impôts pour les entreprises
Réduire le coût de collecte de l’impôt nécessite un recours accru aux nouvelles technologies et à la dématérialisation. Afin de mieux appréhender les pistes qui peuvent être explorées en la matière, il apparaît nécessaire de rappeler au préalable le champ, tel qu’il existe actuellement, des obligations de recours aux téléprocédures pour les déclarations et les paiements des impôts professionnels.
a) Déclaration de résultats des entreprises
Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles et libérales peuvent télédéclarer leur déclaration de résultat, liasses et annexes grâce à la procédure TDFC (17) mise en œuvre par l’administration fiscale.
Aux termes de l’article 1649 quater B et quater I et II du code général des impôts, ont l’obligation de recourir à cette procédure les entreprises :
— soumises à l’impôt sur les sociétés et dont le chiffre d’affaires de l’exercice précédent est supérieur à 15 millions d’euros hors taxes ;
— les entreprises relevant de la gestion de la direction des grandes entreprises (18), quel que soit leur chiffre d’affaires.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1649 quater E et quater H du code général des impôts, les centres de gestion agréés et les associations de gestion agréées ont l’obligation de s’assurer que leurs adhérents télédéclarent leurs résultats via la procédure TDFC.
À ce jour, moins de 3 % des 1,6 million d’utilisateurs de TDFC relèvent de l’obligation, dont les deux tiers appartiennent au périmètre de la direction des grandes entreprises.
Afin de simplifier les démarches administratives des entreprises et générer des économies de gestion, votre rapporteur propose de généraliser, à partir du 1er janvier 2011, aux entreprises, dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 2 millions d’euros, l’obligation de télédéclarer leurs résultats via la procédure TDFC. Ce seuil de 2 millions d’euros, retenu par votre rapporteur, semble pertinent dans la mesure où, aux termes de l’article R. 227-1 du code de commerce, les entreprises ont l’obligation de désigner un commissaire aux comptes, dès lors qu’elles remplissent deux des trois critères suivants : un total du bilan supérieur à 1 000 000 euros, un montant hors taxes du chiffre d’affaires supérieur à 2 000 000 euros ou un nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice supérieur à vingt.
Proposition n° 2 : généraliser l’obligation de télédéclarer les résultats des entreprises à partir de 2011
À partir du 1er janvier 2011, obligation sera faite aux entreprises, dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 2 millions d’euros, de télédéclarer leurs résultats.
b) Télédéclaration et télérèglement de la TVA
Les entreprises peuvent télédéclarer, télérégler et transmettre leurs demandes de remboursement de crédit de TVA par la procédure TéléTVA, en mode EDI (transfert de fichiers) ou EFI (saisie en ligne sur Internet).
L’obligation de recourir à cette procédure couvre le télérèglement (art. 1695 quater du code général des impôts) et la télédéclaration (art. 1649 quater B quater III du code général des impôts). Elle concerne les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’exercice précédent est supérieur à 760 000 euros hors taxes ainsi que les entreprises relevant de la gestion de la direction des grandes entreprises.
À ce jour, plus de 80 % du montant de la TVA est collecté par TéléTVA et plus de 55 % des 730 000 utilisateurs de TéléTVA ont recours à cette procédure volontairement. La direction des grandes entreprises représente 11,9 % des entreprises relevant de l’obligation (5,32 % du total des télédéclarantes).
Afin d’amplifier les économies générées par la dématérialisation des démarches administratives des entreprises, votre rapporteur propose de généraliser aux entreprises, dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 380 000 euros (soit la moitié du seuil actuel qui est de 760 000 euros), l’obligation de télédéclarer et de télépayer la TVA à partir du 1er janvier 2011.
Proposition n° 3 : généraliser l’obligation de télédéclarer et télépayer la TVA à partir de 2011
À partir du 1er janvier 2011, obligation sera faite à toutes les entreprises, dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 380 000 euros, de télédéclarer et de télépayer la TVA.
c) Télérèglement des impôts des entreprises hors TVA
Aux termes de l’article 1681 septies du code général des impôts, les entreprises relevant de la gestion de la direction des grandes entreprises ont pour obligation de télérègler les impôts suivants : impôt sur les sociétés ; imposition forfaitaire annuelle ; taxe professionnelle ; taxe sur les salaires ; cotisation minimale de taxe professionnelle ; taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés ; taxe sur les conventions d’assurances et contributions assimilées ; impositions supplémentaires de taxe professionnelle. Elles peuvent, en outre, opter pour le télérèglement de la taxe foncière.
Seul le télérèglement de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires est, à ce jour, proposé sur option aux entreprises hors direction des grandes entreprises.
57 % des utilisateurs du télérèglement de l’impôt sur les sociétés et 48 % des utilisateurs du télérèglement de la taxe sur les salaires sont des entreprises relevant de la compétence de la direction des grandes entreprises.
Afin de réaliser de plus grandes économies, votre rapporteur propose qu’à partir du 1er janvier 2011, soit généralisée à toutes les entreprises l’obligation de télépayer les différents impôts auxquels elles sont soumises : impôt sur les sociétés, imposition forfaitaire annuelle, cotisation économique territoriale, taxe sur les salaires, taxe foncière, etc.
Proposition n° 4 : généraliser l’obligation de télépayer les impôts des entreprises à partir de 2011
À partir du 1er janvier 2011, obligation sera faite aux entreprises, dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 2 millions d’euros, de télépayer les différents impôts auxquels elles sont soumises.
3. Mieux plafonner les niches fiscales
Alors qu’il en existe près de 500, le coût des niches fiscales pour la collectivité dépasse aujourd’hui les 70 milliards d’euros par an, contre 45 milliards de recettes pour l’impôt sur le revenu. Ce coût devrait même s’alourdir en 2010, puisque le projet de loi de finances pour 2010 prévoit que le montant des niches fiscales atteindra 75,5 milliards d’euros. Face au coût que représentent pour la collectivité ces avantages fiscaux, certaines mesures ont été prises dans la période récente afin d’en limiter la portée.
a) Un plafonnement des niches fiscales rapportant seulement 22 millions au budget de l’État
Le projet de loi de finances pour 2009 a instauré un mécanisme de plafonnement des niches fiscales, afin d’alléger le coût qu’elles représentent dans le budget de l’État. Désormais les avantages procurés par les niches fiscales sont limités à 25 000 euros, plus 10 % du revenu imposable du foyer fiscal. Par exemple, un couple qui déclare 200 000 euros de revenus doit normalement s’acquitter d’un impôt de 50 474 euros. Le maximum qu’il peut déduire de cet impôt à payer est donc de (200 000/10) + 25 000, soit 45 000 euros. Il paiera donc 5 474 euros d’impôt, alors qu’auparavant, en cumulant diverses niches fiscales, il pouvait ne rien payer du tout.
Certaines évaluations estimaient que cette mesure aurait pu générer un surplus de recettes fiscales pour l’État d’environ 200 millions euros, soit 0,4 % de recettes en plus dans le budget de l’État. Or, l’examen du projet de loi de finances pour 2010 met en évidence le très faible rendement de ce dispositif. En effet, Bercy a chiffré à seulement 22 millions d’euros le rendement attendu du plafonnement global des niches fiscales, tel qu’il a été instauré par le projet de loi de finances pour 2009.
b) Il faut continuer à raboter les niches
Votre rapporteur estime que le niveau retenu pour le plafonnement global de ces niches fiscales est trop élevé pour être véritablement opérant. Si la chasse aux niches fiscales se poursuit dans le projet de loi de finances pour 2010 (fiscalisation au premier euro des indemnités de départ à la retraite volontaire, doublement des prélèvements sur les retraites chapeaux, taxation des plus-values mobilières au premier euro), votre rapporteur estime qu’il faut aujourd’hui franchir une étape décisive dans le plafonnement des niches fiscales. Il propose pour ce faire de reprendre les propositions faites à l’été 2009 par M. Gilles Carrez, rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale et M. Pierre Méhaignerie, président de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.
Deux pistes avaient ainsi été proposées. La première consisterait à baisser uniformément tous les taux de réduction, par exemple de 10 %. Ainsi, la réduction de 50 % pour l’emploi à domicile passerait à 45 %. La seconde, plus technique, revient à appliquer une franchise (par exemple de 1 %) sur le montant total des avantages fiscaux cumulés par ménage. Par conséquent, un contribuable bénéficiant de 3 000 euros de réduction d’impôt verrait son avantage ramené à 2 970 euros.
Sur la base de ces deux propositions, votre rapporteur souhaite qu’un « coup de rabot » décisif soit porté aux niches fiscales lors de l’examen au Parlement du projet de loi de finances pour 2010, en réduisant uniformément de 10 % l’ensemble des taux de réduction qu’offre chaque niche fiscale. Une telle proposition pourrait conduire à une baisse de 5 à 7 milliards du coût total des niches fiscales, coût qui s’élève aujourd’hui à plus de 70 milliards (19). Votre rapporteur souhaite toutefois exclure de cette proposition le crédit d’impôt recherche, qui, à l’épreuve de la crise, a montré toute son efficacité. En effet, nombre de personnes auditionnées par votre rapporteur ont souligné que le dispositif français d’incitation à la recherche et à l’innovation était parmi les performants au monde.
Proposition n° 5 : raboter les niches fiscales
Réduire uniformément de 10 % les taux de réduction qu’offre chaque niche fiscale, à l’exception du crédit d’impôt recherche, afin de baisser de 5 à 7 milliards le coût total des dépenses fiscales en France.
Cependant, votre rapporteur considère que des efforts particuliers doivent être entrepris à l’égard du dispositif « Girardin ». Lors de son audition par la commission des Lois (20), M. Alain Pichon, président de la quatrième chambre de la Cour des comptes, a souligné qu’on peut légitimement « s’interroger sur le coût et l’efficience de plusieurs dispositifs relatifs à l’outre-mer, notamment le dispositif dit « Girardin » applicable aux investissements industriels et aux bateaux de plaisance. Quand on rapporte le nombre d’emplois créés à leur coût pour l’État et que l’on sait à quel point certains contribuables sont habiles, on peut se demander s’il est bien opportun de maintenir de telles dispositions ».
Lors de cette même audition, M. Gérard Ganser, conseiller maître à la Cour des comptes, a indiqué que le projet de loi de finances pour 2010 évalue les dépenses fiscales rattachées à la mission Outre-mer à 2,9 milliards d’euros – soit plus que le budget de ladite mission –, dont 1,18 milliard au titre de la TVA à taux réduit et 800 millions au titre du dispositif « Girardin industriel ».
Les travaux de la Cour sur le « Girardin immobilier » ont conduit le Premier président à adresser un référé aux ministres concernés ; l’un d’eux a d’ailleurs répondu et n’a pas contesté les constatations de la Cour : ce dispositif conduit l’État à s’endetter sur cinq ans à un taux supérieur à 10 % et l’administration reconnaît qu’une subvention directe coûterait sensiblement moins cher.
Par ailleurs, la Cour des comptes a pu constater l’absence d’effets du « Girardin industriel » à Wallis et Futuna notamment : devant le nombre considérable de dossiers et l’absence totale de contrôle, la Cour a été amenée à saisir la justice.
Fort de ces constats, votre rapporteur propose, d’une part, de supprimer le dispositif « Girardin » immobilier et de le remplacer par des subventions moins coûteuses, et, d’autre part, d’exclure du dispositif « Girardin » industriel les investissements réalisés dans la navigation de plaisance.
Proposition n° 6 : rationaliser le dispositif « Girardin » relatif à l’outre-mer
Supprimer le dispositif « Girardin » immobilier, qui doit être remplacé par des subventions moins coûteuses et exclure du dispositif « Girardin » industriel les investissements réalisés dans la navigation de plaisance.
4. Fiscaliser l’économie souterraine
Alors qu’elle constitue un manque à gagner important pour le budget de l’État, l’économie souterraine crée aussi une somme de distorsions inacceptables pour la société. Elle reporte la charge des impôts et des prélèvements obligatoires sur l’économie officielle, elle perturbe l’équilibre social des secteurs touchés, elle déséquilibre le jeu de la concurrence, elle suscite des conditions de travail anormales, elle lèse les consommateurs qui ne disposent d’aucun moyen de recours ou de garantie. Dans ses manifestations les plus graves, elle peut être une atteinte à la personne ou à la dignité humaine, voire conduire au crime.
a) Un phénomène aux dimensions multiples
L’économie souterraine est communément comprise par les instances internationales (Union européenne, ONU…), comme comportant, d’une part, l’ensemble des activités productrices licites non déclarées et, d’autre part, l’ensemble des activités illicites, productrices de biens ou de services. L’économie souterraine revêt donc différents aspects, selon les secteurs et l’intention de ses promoteurs : fraude (partielle ou totale) ou évasion fiscale, travail « au noir » ou illégal, commercialisation de productions non déclarées, mais aussi production et commerce clandestins d’alcool, de stupéfiants, d’animaux, trafics d’armes, proxénétisme, blanchiment de l’argent sale… Le phénomène agglomère donc deux réalités dont la portée économique diffère : la petite économie souterraine, plutôt axée sur la prestation de services individuels, et la grande, généralement organisée en réseaux nationaux ou transnationaux.
b) Un poids controversé mais significatif dans le produit intérieur brut
L’évaluation du poids de l’économie souterraine est par définition difficile et contestée. La difficulté d’appréciation quantitative du phénomène se ressent à la lecture des différentes études publiées sur ce thème au cours des dix dernières années.
Dans une communication relative au travail non déclaré (21), la Commission européenne estimait que la taille de l’économie souterraine « était comprise entre 7 et 16 % du PIB de l’UE, soit 7 à 19 % du total des emplois déclarés ».
Les deux extrémités de la fourchette seraient, d’une part, les pays « transparents », où l’économie souterraine avoisinerait 5 % du PIB (pays scandinaves, Irlande, Autriche, Pays-Bas) et, d’autre part, les pays « opaques » où l’économie souterraine dépasse 20 % (Italie et Grèce). À mi-chemin entre ces extrêmes se situent la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Les études économiques les plus récentes ne corroborent pas toutes cet ordre de grandeur pour la France : entre 9 et 13 % ou 7 et 14 %, selon le cas.
CE QUE GAGNE VRAIMENT UN DEALER DE CANNABIS (22)
La première « estimation des gains des dealers » a été remise en décembre 2007 à la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (Mildt). Selon cette étude, le cannabis rapporterait jusqu’à 550 000 euros par an à un semi-grossiste, soit le salaire moyen d’un patron d’une entreprise de plus de 2000 salariés. Or, les trafiquants à ce stade seraient peut-être déjà un millier.
Selon le président de la Mildt, M. Étienne Appaire, « les enquêtes sont trop axées sur les actes et pas assez sur les bénéfices du trafic ». Informé de cette étude, le Président de la République a rappelé que « l’économie souterraine est devenue une menace pour nos sociétés », réclamant le renforcement de la répression destinée à « frapper les trafiquants au portefeuille ».
L’auteur de ce rapport, M. Christian Ben Lakhdar, chercheur à l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, estime qu’en France, « un garçon sur six et une fille sur quinze » disent être « fumeurs réguliers à 17 ans ». Le nombre de consommateurs de cannabis est désormais estimé à 1,2 million d’usagers réguliers, dont 550 000 quotidiens. Le volume du marché serait donc de 208 tonnes pour un chiffre d’affaires annuel de 832 millions d’euros.
Sur cette base, on peut considérer que l’importateur s’appuie sur au moins 700 semi-grossistes, peut-être même plus du double. Le semi-grossiste gagne à lui seul « de 253 000 à 552 000 euros » annuellement. Il écoule « de 132 à 308 kg » de drogue. Son premier intermédiaire diffuse, pour sa part, de 16 à 35 kg, pour un gain estimé « entre 35 000 et 76 000 euros par an ». À ce stade, le cannabis fait déjà vivre entre 6 000 et 13 000 fournisseurs.
En dessous, « le commerce de cannabis n’est que peu profitable », assure le rapport. Estimé « entre 58 000 et 127 000 revendeurs », ces acteurs de quartier gagnent « entre 4 500 et 10 000 euros annuellement ». Ils distribuent, tout au plus, 3,6 kg de cannabis en moyenne par an. Le revendeur de rue de dernier niveau n’écoule, pour sa part, guère plus de 1 à 2,5 kg.
Pour le dealer, le risque d’être arrêté représente une « taxe judiciaire » à intégrer dans le prix. Cette menace conditionne, par exemple, « 23,6 % du prix final» de la cocaïne. «La concurrence, appréhendée par le degré de violence entre dealers, façonne aussi le bénéfice net de ces derniers», poursuit le chercheur. Elle compte pour 33 % dans le prix final. Pour connaître les montants du trafic de cannabis susceptibles d’être blanchis, il faudrait encore intégrer le coût du stockage, du transport, des rabatteurs et autres guetteurs. Seule certitude : entre le semi-grossiste et le consommateur final, le prix du gramme de cannabis est multiplié au moins par trois.
c) Le dispositif actuel permet de taxer en partie l’économie grise
Afin de taxer au mieux l’économie souterraine, les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) interviennent en utilisant l’ensemble des procédures de recherche et de contrôle qui s’offrent à eux.
Des dispositifs spécifiques existent afin de lutter contre ces agissements. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 135 L du livre des procédures fiscales (LPF), les officiers et agents de police judiciaire doivent transmettre aux agents de l’administration fiscale les éléments susceptibles de comporter une implication de nature fiscale se rattachant à une activité lucrative non déclarée portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique. Réciproquement, l’administration fiscale doit répondre aux demandes des officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature fiscale.
D’autres dispositifs, plus généralistes, permettent de lutter contre l’économie souterraine dans les conditions de droit commun. Ainsi, les services de recherche et de contrôle de la direction générale des finances publiques :
— collectent de l’information auprès d’autres administrations : la justice (en application des articles L. 82 C et L. 101 du LPF) et les organismes sociaux (en application des articles L. 97 à L. 99 du LPF) ;
— procèdent au contrôle fiscal des auteurs de trafics, afin de fiscaliser le produit de leurs infractions. Il peut s’agir aussi bien d’un contrôle sur pièces que d’un contrôle sur place. Dans ce dernier cas, le contrôle donne lieu à une vérification de comptabilité (article L. 13 du LPF), à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (article L. 12 du LPF), examen qui permet à l’administration d’accéder aux comptes bancaires d’une personne physique afin de s’assurer de la cohérence entre les revenus qu’il a déclarés et sa situation de trésorerie, sa situation patrimoniale ou son train de vie.
À l’issue de ces contrôles, l’assiette de l’impôt sera alors établie dans les conditions suivantes :
— taxation des bénéfices industriels et commerciaux résultant de l’activité d’achat et de revente que constitue le trafic (article 34 du code général des impôts), dans le cadre des contrôles sur pièces ou des vérifications de comptabilité ;
— taxation sous condition des revenus d’origine indéterminée lorsque le contribuable n’aura pas pu justifier de l’origine et de la nature des sommes transitant sur ses comptes bancaires (articles L. 16 et L. 69 du LPF), dans le cadre des examens contradictoires de situation fiscale personnelle ;
— évaluation forfaitaire selon les éléments de train de vie (article 168 du CGI) lorsque l’administration établit une disproportion marquée entre les revenus déclarés et un barème établi à partir des éléments de train de vie dont dispose le contribuable (notamment les motocyclettes, les voitures), dans le cadre des contrôles sur pièces ou des examens contradictoires de situation fiscale personnelle.
d) Des obstacles à la taxation de l’économie grise persistent
Divers obstacles empêchent néanmoins de mener à bien les contrôles dans un certain nombre d’hypothèses et donc de fiscaliser de manière optimale l’économie informelle.
En premier lieu, ces contribuables sont fréquemment inconnus des fichiers de l’administration. Ainsi, seule une transmission d’informations par les services de police et de gendarmerie ou par l’autorité judiciaire permet de les identifier et d’initier un contrôle.
En deuxième lieu, la période au cours de laquelle est constatée l’infraction est disjointe de celle de la taxation : ainsi le constat d’un trafic et du produit afférent ne pourra faire l’objet d’une taxation que l’année suivante lors de l’arrivée à l’échéance d’une obligation déclarative.
En troisième lieu, les règles d’assiette permettent imparfaitement d’appréhender les revenus issus de ces agissements répréhensibles : les flux financiers transitent fréquemment sur le compte de tiers et les investissements résultant des infractions ne sont pas effectués au nom des contribuables.
Enfin, l’action en recouvrement de l’administration fiscale peut être mise en échec pour l’ensemble des raisons qui viennent d’être évoquées.
Afin d’améliorer la lutte contre ces agissements, diverses initiatives ont toutefois été entreprises par le ministère du budget. D’un point de vue opérationnel, un protocole relatif à la lutte contre l’économie grise a été conclu le 23 septembre 2009 entre le ministère de l’intérieur et le ministère du budget. Ce protocole a vocation à coordonner l’action de ces deux administrations en donnant une suite pénale et fiscale à ces agissements, chaque fois que les conditions en sont réunies. Il a également pour objectif de fluidifier les échanges d’informations, afin de permettre l’obtention et l’exploitation par l’administration fiscale des informations susceptibles d’être détenues par les services de police et de gendarmerie.
e) Haro sur l’économie informelle
Or l’économie souterraine et les trafics qu’elle génère sont sources de bénéfices considérables qui mettent en péril l’équilibre social. Il convient donc d’aller plus loin et d’élaborer de nouveaux outils juridiques, seuls capables d’enrayer ce phénomène.
En premier lieu, il est urgent de réformer le dispositif de taxation forfaitaire selon les éléments de train de vie tel qu’il est actuellement régi par l’article 168 du code général des impôts. Cet article permet aux services fiscaux d’évaluer forfaitairement le revenu imposable du contribuable en vue de son imposition. À ce jour, l’administration fiscale ne peut mettre en œuvre cette procédure que si le revenu forfaitaire imposable, tel qu’il est évalué par l’administration fiscale, est supérieur à 43 938 euros. Afin de donner toute son effectivité à ce dispositif, votre rapporteur propose que le seuil d’engagement de la procédure, actuellement fixé à plus de 43 938 euros, soit supprimé.
Proposition n° 7 : taxer l’économie grise dès le premier euro
En cas de disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus, autoriser l’administration fiscale à taxer forfaitairement ces revenus dès le premier euro.
En outre, parce que la traque contre l’économie souterraine nécessite une expertise aguerrie en la matière, votre rapporteur propose que l’administration fiscale mette en place, à compter du 1er juillet 2010, onze brigades interrégionales d’enquête et d’investigation, chargées de taxer l’économie grise. Ces brigades seraient constituées d’équipes resserrées et mobiles.
Proposition n° 8 : taxer l’économie grise en créant onze brigades interrégionales d’enquête et d’investigation
À compter du 1er juillet 2010, créer onze brigades interrégionales d’enquête et d’investigation, investies d’une mission de lutte contre l’économie informelle et composées, pour ce faire, d’équipes resserrées et mobiles.
B. STIMULER L’INVESTISSEMENT EN FRANCE ET SANCTIONNER LES COMPORTEMENTS ABUSIFS
L’impact de la crise a rappelé avec force combien les recettes fiscales étaient dépendantes de la conjoncture économique. Pour preuve l’impôt sur les sociétés ne devrait rapporter à l’État, en 2009, que la moitié de ce qu’il avait rapporté en 2008.
En effet, si notre pays se montre incapable de produire durablement de nouvelles richesses, alors les recettes fiscales ne seront jamais à la hauteur des enjeux financiers, auxquelles la France est aujourd’hui confrontée. C’est pourquoi, le retour à l’équilibre budgétaire ne peut raisonnablement se concevoir sans une stimulation énergique de l’économie et de l’investissement.
Le maintien du crédit d’impôt recherche, les opportunités d’amortissement accéléré constituent autant d’outils au service des pouvoirs publics pour soutenir durablement la croissance et l’investissement et donc générer de nouvelles recettes. La stimulation de l’investissement en France, pour être efficace, doit cependant s’accompagner de sanctions plus fortes à l’égard des comportements abusifs.
1. Maintenir le crédit d’impôt recherche
Mesure fiscale créée en 1983, pérennisée et améliorée par la loi de finances pour 2004 et à nouveau modifiée par la loi de finances pour 2008, le crédit d’impôt recherche a pour but de soutenir les efforts de recherche et développement des entreprises, afin d’accroître leur compétitivité.
Depuis le 1er janvier 2008, le crédit d’impôt recherche consiste en un crédit d’impôt correspondant :
— à 30 % des dépenses de recherche et développement (R&D) pour une première tranche de dépenses jusqu’à 100 millions d’euros ;
— à 5 % des dépenses de recherche et développement au-delà de ce seuil de 100 millions euros de dépenses.
La réforme introduite par la loi de finances pour 2008 a constitué une avancée majeure dans l’attractivité du territoire pour les activités de R&D grâce au triplement de la réduction d’impôt et la modification de l’assiette, reposant désormais sur le volume des dépenses plutôt que sur leur progression.
LA RÉFORME DE 2008
Plus simple, le nouveau crédit d’impôt recherche est assis sur le volume des dépenses annuelles de R&D (dépenses de personnel et de fonctionnement, travaux de R&D sous-traités), et non plus sur la progression de ces dépenses. Il est octroyé sous la forme d’une réduction d’impôt sur les sociétés. Celle-ci a été portée de 10 à 30 % des dépenses de R&D déclarées, jusqu’au seuil de 100 millions d’euros. Elle est réduite à 5 % au-delà, mais sans plafond. Le taux de la première tranche est majoré à 50 % pour les entreprises qui entrent dans le dispositif la première année et à 40 % la deuxième année. Pour les entreprises qui s’associent à des chercheurs publics, le crédit d’impôt est porté à 60 %.
Fortement remanié par la loi de finances pour 2008, le crédit d’impôt recherche, dit « nouvelle génération » a bénéficié d’un formidable succès, unanimement reconnu. En effet, nombre de personnes auditionnées par votre rapporteur ont souligné que le dispositif français d’incitation à la recherche et à l’innovation était parmi les performants au monde. En effet, en 2008, malgré la crise, qui contraint en règle générale les entreprises à ajourner leurs programmes de recherche, tous les secteurs – hormis l’automobile et l’aéronautique – ont augmenté leurs dépenses de R&D à hauteur de 2 % en moyenne.
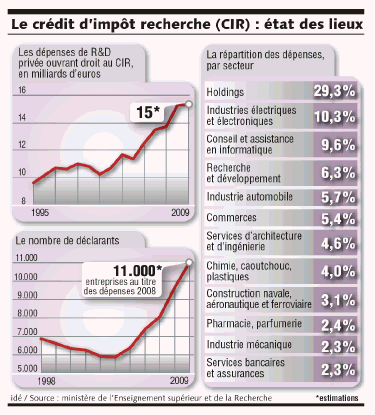
Le crédit d’impôt recherche devrait, en définitive, profiter en 2009 à près de 11 000 entreprises. Selon un sondage réalisé cet été, un tiers des entreprises affirme avoir été incité à recruter grâce au crédit d’impôt recherche. De manière générale, le nombre de nouvelles entreprises déclarantes (1 400) devrait doubler cette année. Ces dernières déclarent, en outre, une dépense moyenne de R&D deux fois supérieure aux nouveaux entrants de l’année précédente (304 000 euros contre 137 000 euros).
L’ENTREPRISE GASCOGNE REMISE SUR PIED GRÂCE AU CIR
Plus gros acteur français de la filière bois, papier et emballage, présent dans 70 pays, le groupe Gascogne illustre bien la volonté d’un secteur traditionnel de se réinventer pour perdurer. Comme en témoigne son PDG, François Vittoz : « Il faut innover pour continuer à exister, nous ne pouvons plus nous contenter de faire des produits de commodités. Nous investissons en recherche et développement pour transformer le bois en produits de décoration toujours plus sophistiqués et en papiers très spécifiques, vendus deux fois plus chers. »
Avec un budget de R&D actuel de 3 millions d’euros, le groupe bénéficie du crédit d’impôt recherche depuis trois ans. Si la réforme du CIR a changé favorablement la donne pour Gascogne, la possibilité d’obtenir un remboursement anticipé l’a vraiment aidé dans une passe financière épineuse. « Nous avons demandé en janvier la restitution du crédit d’impôt recherche pour l’année 2008 et nous avons eu l’agréable surprise de voir notre compte crédité de 1 million d’euros, à peine quinze jours plus tard », s’étonne encore François Vittoz. De l’argent bien placé, car le groupe a inauguré, vendredi dernier, une installation innovante flambant neuve sur son site de Mimizan, dans les Landes, pour la production de papiers couchés très haut de gamme, qui représente un investissement de 10 millions d’euros.
Source : Chantal Houzelle, CIR 2008 : Gascogne récupère un million d’euros en quinze jours, Les Échos, 21 septembre 2009.
La compétitivité de la France qui, comparée à l’Allemagne, pâtit principalement d’une insuffisance de PME innovantes, pourrait donc se renforcer progressivement sous l’effet du crédit d’impôt recherche. C’est pourquoi, votre rapporteur tient à rappeler son attachement à la pérennisation de ce dispositif, qui contribue incontestablement à l’attractivité de notre pays.
2. Offrir des opportunités d’amortissement plus rapide
Selon Mme Mathilde Lemoine, économiste en chef de HSBC France, le retour à l’équilibre des finances publiques passe par la priorité donnée à la croissance et à l’investissement : « Le meilleur outil d’avenir serait d’accélérer l’amortissement fiscal des investissements, ce qui est une aide puissante » (23).
Sans retour durable de la croissance et de l’investissement, les recettes fiscales ne seront jamais à la hauteur des enjeux financiers et budgétaires auxquels est aujourd’hui confronté notre pays. C’est pourquoi, afin d’inciter les entreprises à investir et à produire de nouvelles richesses, existent dans notre droit fiscal l’amortissement dégressif ainsi que l’amortissement exceptionnel, auxquels il convient de donner une portée plus large.
a) L’amortissement dégressif : une incitation fiscale à l’investissement
À côté du régime de droit commun qu’est l’amortissement linéaire, il existe le régime d’amortissement dégressif. Permettant de constater une dépréciation plus forte au cours des premières années de la durée de vie du bien, il consiste à appliquer un taux d’amortissement majoré sur la valeur résiduelle du bien restant après amortissement. Ce taux d’amortissement majoré s’obtient en multipliant le taux d’amortissement linéaire par un coefficient fiscal. Plus ce dernier est élevé, plus l’amortissement se fait rapidement et plus l’incitation fiscale à l’investissement est forte.
Taux d’amortissement dégressif = taux d’amortissement linéaire x coefficient fiscal
AMORTISSEMENT DÉGRESSIF (24) | |||
Année |
Valeur comptable au début de l’exercice |
Annuité d’amortissement |
Amortissements cumulés |
1 |
10 000 € |
4 000 € |
4 000 € |
2 |
6 000 € |
2 400 € |
6 400 € |
3 |
3 600 € |
1 800 € |
8 200 € |
4 |
1 800 € |
1 800 € |
10 000 € |
Le recours à l’amortissement dégressif est facultatif, ce qui permet à l’entreprise, dès l’acquisition du bien, d’opter pour l’amortissement dégressif ; mais une telle faculté existe également en cours d’amortissement. Ainsi une entreprise qui a opté pour le régime de l’amortissement dégressif peut, après avoir pratiqué des annuités d’amortissement dégressif, revenir à l’amortissement linéaire, et inversement. Les nouveaux calculs se feront alors, pour les annuités suivantes, à partir de la valeur résiduelle du bien.
Pour que l’entreprise puisse opter pour l’amortissement dégressif, encore faut-il que les biens ainsi amortis présentent certains caractères. Compte tenu de l’incitation recherchée au renouvellement rapide du matériel, l’amortissement dégressif est réservé au matériel ayant une certaine durée d’utilisation. Aussi, les biens qui relèvent de l’amortissement dégressif doivent avoir une durée normale d’utilisation d’au moins trois ans. D’autre part, s’agissant d’inciter l’entreprise à la modernisation de ses équipements, les biens amortis de façon dégressive doivent avoir été acquis à l’état neuf. Ainsi, sont exclus les biens d’occasion.
Enfin, l’entreprise ne peut recourir à l’amortissement dégressif que pour certains équipements, limitativement énumérés par la loi (CGI, annexe II, article 22) : matériels et outillages utilisés pour les opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; matériels de manutention ; installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ; installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ; installations de sécurité et installations à caractère médico-social ; équipements informatiques et machines de bureau, à l’exclusion de machines à écrire ; matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ; installations de magasinage et de stockage, à l’exclusion des locaux servant à l’exercice de la profession. L’article 39 A-2 du code général des impôts complète cette liste en ajoutant les investissements hôteliers meubles et immeubles et les bâtiments industriels dont la durée normale d’utilisation n’excède pas quinze années (seuls des bâtiments provisoires de construction légère peuvent répondre à cette condition).
b) L’amortissement exceptionnel : avantager fiscalement certains secteurs économiques
Grâce au recours à l’amortissement exceptionnel, principalement utilisé pour des raisons fiscales, le bien est amorti plus rapidement que ne le justifie l’usure économique.
En effet, pour des raisons politiques, économiques ou sociales, les autorités politiques peuvent souhaiter avantager fiscalement telles catégories d’entreprises ou tels secteurs économiques. Aussi, donne-t-il la possibilité aux entreprises de pratiquer un amortissement exceptionnel pour certains biens limitativement énumérés et pour les immobilisations utilisées par certaines professions.
En comptabilité, de tels amortissements sont qualifiés de dérogatoires. Il s’agit de permettre à l’entreprise de pratiquer, dès la première année d’utilisation d’une immobilisation, un amortissement massif sans qu’il y ait besoin de constater une dépréciation extraordinaire équivalente. L’amortissement exceptionnel constitue ainsi une subvention fiscale temporaire qui sera « remboursée » par l’entreprise étant donné que les annuités d’amortissement suivantes s’en trouveront diminuées. Le choix du mode d’amortissement constitue une décision de gestion de telle sorte que si l’entreprise n’a pas pratiqué l’amortissement exceptionnel dans le délai prévu, elle perd le droit de l’utiliser ultérieurement (25).
L’amortissement exceptionnel consiste, en principe, en une dotation supplémentaire, exprimée en pourcentage du prix de revient, qui vient en déduction des résultats imposables de l’exercice au cours duquel les biens considérés entrent dans l’actif de la société. Les amortissements sont ensuite calculés sur la valeur résiduelle des biens, c’est-à-dire sur leur prix de revient diminué de l’amortissement exceptionnel.
Actuellement, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service :
— les matériels et équipements destinés à économiser l’énergie, acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2011, qui figurent sur une liste établie par arrêté et peuvent être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables (CGI, article 39 AB – CGI, annexe IV, article 02) (26) ;
— les matériels acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2011 destinés à réduire le niveau acoustique d’installations existantes au 31 décembre 1990, qui figurent sur une liste établie par arrêté et peuvent être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables (CGI, article 39 quinquies DA – CGI, annexe IV, article 06) (27) ;
— les immeubles achevés avant le 1er janvier 2011 destinés à l’épuration des eaux industrielles à condition qu’ils s’incorporent à des installations de production existantes (CGI, article 39 quinquies E) (28) ;
— les immeubles achevés avant le 1er janvier 2011 conçus pour lutter contre les pollutions atmosphériques et les odeurs à condition qu’ils s’incorporent à des installations de production existantes (CGI, article 39 quinquies F) (29) ;
— les constructions réalisées avant le 1er janvier 2011 qui s’incorporent à des installations de production agricole et qui sont destinées à la mise aux normes de celles-ci (CGI, article 39 quinquies FC) (30) ;
— les véhicules neufs (hors location) qui fonctionnent, exclusivement ou non au moyen de l’énergie électrique ou du gaz naturel (CGI, article 39 AC) (31) ;
— les immeubles construits en vue de réaliser des opérations de recherche scientifique ou technique (CGI, article 39 quinquies A) (32) ;
— les immeubles professionnels construits avant le 1er janvier 2014 dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine par des entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros (CGI, article 39 quinquies D) (33).
c) Étendre les règles d’amortissements dégressif et exceptionnel aux secteurs prioritaires du grand emprunt
Au regard des retombées positives de l’amortissement dégressif et exceptionnel sur l’investissement et donc la croissance, votre rapporteur considère que la priorité doit être donnée à l’extension de ces dispositifs fiscaux dans les secteurs clés pour l’avenir de l’économie de notre pays.
Or, en août 2009, le Président de la République a installé la commission du « grand emprunt » national, chargée de définir les secteurs stratégiques de l’économie française, dans lesquels il convient d’investir pour le bien-être des générations futures. Trois grands secteurs semblent d’ores et déjà se dégager : l’économie de la connaissance, la compétitivité des entreprises et les équipements industriels innovants.
S’appuyant sur les travaux de cette commission, qui seront rendus publics en novembre prochain, votre rapporteur propose que les régimes de l’amortissement dégressif et exceptionnel soient étendus aux secteurs identifiés comme prioritaires par la commission présidée par MM. Alain Juppé et Michel Rocard. Ainsi, non seulement ces secteurs indispensables à la croissance économique de long terme du pays bénéficieront des sommes investies via le « grand emprunt », mais ils se verront de surcroît appliquer des règles d’amortissement favorables à l’investissement. La portée du « grand emprunt » se verra ainsi renforcée de manière décisive.
Proposition n° 9 : soutenir l’investissement dans les secteurs prioritaires par des règles permettant un amortissement plus rapide
Étendre le régime des amortissements dégressifs et exceptionnels, qui constituent autant d’incitations fiscales à l’investissement, aux secteurs économiques que la commission sur le « grand emprunt » définira comme prioritaires pour le soutien de la croissance de long terme de l’économie française.
3. Orienter les aides vers les entreprises citoyennes
Afin de stimuler la croissance et l’investissement, les pouvoirs publics ont instauré, depuis de nombreuses années, un ensemble d’aides publiques aux entreprises, destinées à les soutenir et à les accompagner financièrement.
Or, votre rapporteur estime que ces aides, lorsqu’elles sont dévoyées de leur vocation originelle, permettent à l’entreprise d’engranger un gain, sans que le bénéfice ne rejaillisse sur l’économie dans son ensemble. Ainsi, l’installation d’une filiale dans un paradis fiscal par entreprise, bénéficiant d’aides publiques, constitue une indéniable perte de recettes pour l’État.
Ainsi ces aides publiques ne stimulent réellement la croissance et l’investissement que si leur versement est conditionné au respect de certaines règles par les entreprises bénéficiaires.
a) Un dispositif étoffé d’aides publiques aux entreprises
On estime aujourd’hui à près de 65 milliards d’euros l’ensemble des aides publiques aux entreprises, dont 90 % sont financées par l’État, et à au moins 6 000 le nombre cumulé des dispositifs d’aides, dont 22 aides européennes, 730 aides nationales et, par exemple, 650 pour l’ensemble des collectivités de la seule région Ile-de-France (34).
Ce total de 65 milliards d’euros représente un peu plus que le total du budget de l’éducation nationale, près de deux fois le budget de la défense, le même ordre de grandeur que le total des dépenses hospitalières, plus de trois fois le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche. Certes, faire ce type de rapprochement ne vaut pas démonstration, mais cela souligne l’importance du sujet au regard de l’efficience des politiques publiques(35).
b) Conditionner les aides publiques aux entreprises au respect de critères sociaux et environnementaux
Conformément aux engagements du Président de la République, dans son contrat de législature, adopté en novembre 2008, la majorité actuelle avait proposé de conditionner le versement de certaines aides publiques au respect de certaines règles : « Pour compenser le fait que la grille des rémunérations s’est beaucoup contractée vers le bas au cours des dix dernières années, nous réserverons les allègements de charges aux branches qui actualisent la grille de leurs salaires et nous plafonnerons ceux qui sont alloués à des entreprises dont les bénéfices sont excessifs par rapport aux augmentations de salaires consenties aux salariés ».
Dans le respect de ces engagements, a été adoptée la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail. Ce texte lie le bénéfice des exonérations patronales de sécurité sociale au respect d’un certain nombre de conditions en matière salariale, tant à l’échelon de l’entreprise qu’à celui de la branche, avec pour finalité d’assurer le respect de l’obligation annuelle de négocier sur les salaires :
— au niveau de l’entreprise, lorsqu’un employeur n’a pas rempli, au cours d’une année civile, l’obligation annuelle d’ouvrir une négociation sur les salaires, le montant de certaines exonérations de cotisations sociales patronales dont il bénéficie est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année ;
— au niveau de la branche, le dispositif est plus complexe : il consiste à calculer les allègements généraux de charges à partir du premier niveau de classification applicable dans la branche dans les cas où celui-ci est inférieur au SMIC. Ainsi, dans les branches où les minima conventionnels demeureraient inférieurs au SMIC, ce minimum conventionnel se substitue au SMIC comme base de calcul de la réduction générale de cotisations sociales patronales.
Si ces mesures constituent des avancées majeures, votre rapporteur estime que l’ampleur de la crise exige d’aller plus loin dans cette démarche. D’autres critères, plus ambitieux, doivent être pris en compte pour conditionner les aides publiques versées aux entreprises. En effet, au regard des sommes élevées qui sont en jeu, les pouvoirs publics se doivent d’avoir une vision large de ce qu’est la responsabilité économique, sociale et environnementale d’une entreprise. Aussi convient-il de définir des critères robustes et vérifiables pour conditionner l’octroi d’aides publiques aux entreprises.
Pour ce faire, votre rapporteur propose que soit mis en place, avant le 31 décembre 2009, un groupe de travail chargé de définir les critères conditionnant l’octroi d’aides publiques. Seules les entreprises dites « citoyennes », c’est-à-dire respectant l’ensemble des critères ainsi définis, ne verraient pas diminuer le montant des aides publiques dont elles sont bénéficiaires. Si la définition de ces critères doit faire l’objet d’une large concertation, dont le groupe de travail proposé par votre rapporteur aura la responsabilité, il est toutefois possible à ce stade d’en donner quelques exemples : caractère excessif de certaines rémunérations de dirigeants, dépollution de certains sites, etc.
Parmi ces critères que devra définir le groupe de travail, les engagements pris en matière de respect de l’environnement devront avoir toute leur place. Or, afin de mesurer ces engagements, il faudra fixer des critères vérifiables, incontestables et robustes, qu’offre notamment la mise en place au sein des entreprises d’un système de management de l’environnement, certifié ISO 14001.
LE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT
Le système de management environnemental (SME), certifié ISO 14001, est un outil de gestion de l’entreprise et de la collectivité qui lui permet de s’organiser de manière à réduire et maîtriser ses impacts sur l’environnement. Il inscrit l’engagement d’amélioration environnementale de l’entreprise ou de la collectivité dans la durée en lui permettant de se perfectionner continuellement.
Les établissements s’engagent progressivement dans une démarche de mise en place d’un SME à partir d’un premier diagnostic (analyse environnementale) qui va permettre de réaliser l’inventaire des aspects et impacts associés comme : gestion des déchets banals et dangereux ; pollution de l’air ; pollution l’eau ; pollution sonore ; pollution visuelle ; consommation énergétique ; consommation matières premières ; respect de l’environnement (faune, flore…).
Cet inventaire est réalisé par site d’activité et s’applique aux activités de production comme aux activités administratives. Les aspects environnementaux significatifs (AES) seront ensuite hiérarchisés par rapport au contexte réglementaire, à la politique de l’établissement, …
Pour les aspects environnementaux significatifs retenus comme prioritaires, l’établissement établit ensuite un programme d’intervention (objectifs et cibles définis et accepté au plus haut niveau de l’établissement) avec un responsable désigné, des moyens affectés, et des délais d’obtention sur les résultats attendus.
S’agissant de la mise en place d’un SME (système de management environnemental) certifié ISO 14 001, des études auprès d’utilisateurs révèlent : son efficacité comme outil de management ; une meilleure gestion des consommations de fluides et des impacts environnementaux ; éventuellement une réduction des consommations de matières premières ; son incitation à l’innovation ; son renforcement de la culture environnementale interne et notamment de celle des risques environnementaux ; son effet levier de performance pour l’entreprise,
Les résultats d’une étude européenne expliquent que « plus de 80 % des 500 entreprises interrogées sur leur expérience de la mise en œuvre de systèmes de management environnemental ont souligné sa rentabilité et plus de 60 % d’entre elles citent des temps de retour sur investissement de moins de 12 mois » (36). C’est pourquoi, la mise en place d’un SME pourra constituer un critère pertinent pour conditionner les aides publiques aux entreprises.
Proposition n° 10 : réserver les aides publiques directes aux entreprises citoyennes
Mettre en place un groupe de travail chargé de définir les critères conditionnant l’octroi d’aides publiques. Seules les entreprises dites « citoyennes », c’est-à-dire respectant l’ensemble des critères ainsi définis, pourraient recevoir des aides publiques. Ces critères seraient à la fois sociaux et environnementaux.
Cependant, sans attendre les conclusions de ce groupe de travail, il est d’ores et déjà possible de mettre en œuvre un critère simple de conditionnalité des aides publiques : la présence d’une entreprise, sous forme de filiales ou de prises de participation dans des sociétés locales, au sein d’un des paradis fiscaux, tels qu’ils sont à ce jour recensés et identifiés sur les listes grise et noire de l’OCDE. Ainsi, toute entreprise française, présente dans ces paradis fiscaux, perdra de plein droit le bénéfice de toute exonération de cotisations sociales patronales.
Proposition n° 11 : mettre fin au bénéfice des exonérations de cotisations sociales patronales pour les entreprises présentes dans des paradis fiscaux
À partir du 1er juillet 2010, toute entreprise française, présente dans un des paradis fiscaux, identifiés et recensés par l’OCDE, perdra de plein droit le bénéfice des exonérations de cotisations sociales patronales.
Si jusqu’à présent votre rapporteur s’est efforcé de montrer que le rétablissement des comptes publics ne pouvait se concevoir sans une véritable stimulation des recettes, il convient à présent de s’intéresser à la maîtrise et à l’optimisation des dépenses. En effet, il serait vain de vouloir prétendre assainir les comptes publics en occultant la rationalisation des dépenses de l’État, qui s’élèvent à plus de 280 milliards d’euros dans le projet de loi de finances pour 2010.
En la matière, le premier devoir qui s’impose à l’État, a fortiori en période de crise, est de se montrer en tout point exemplaire et irréprochable aux yeux du contribuable. Les articles 14 et 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ne prétendent rien d’autre lorsqu’ils affirment que « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi » et que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ».
1. Un État prudent dans l’élaboration de son budget
Nombre de critiques adressées au budget de l’État portent sur le manque de sincérité des diverses prévisions économiques (croissance, inflation, épargne, etc.) sur lesquelles il est fondé. Dans l’élaboration du projet de loi de finances, le gouvernement est soumis à une obligation de sincérité budgétaire, définie et précisée par l’article 32 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances : « Les lois de finances présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de l’État. Leur sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ».
Ce principe de sincérité budgétaire, d’abord dégagé (37) puis précisé par une jurisprudence constitutionnelle importante, conditionne l’effectivité du contrôle du Parlement sur les finances publiques. Le principe de sincérité doit ainsi se traduire par :
— l’inclusion effective dans le budget de l’État de l’ensemble des ressources et des charges de l’État, sans dissimulation ni artifice comptable. La jurisprudence constitutionnelle sur les « charges permanentes » de l’État développée à la suite de la décision « FSV » du 29 décembre 1994 a ainsi pu se traduire par l’injonction adressée au gouvernement de réintégrer au sein du budget de l’État les fonds de concours alimentés par des recettes de nature fiscale ;
— une évaluation correcte des dépenses et des recettes, sans surévaluation ni sous-évaluation, et l’absence de volonté délibérée du gouvernement de fausser les grandes lignes de l’équilibre. Le contrôle du Conseil constitutionnel en la matière est toutefois un contrôle minimal, celui de l’erreur manifeste d’appréciation ;
— la cohérence et l’exactitude des informations financières fournies au Parlement : « les documents annexés au projet de loi de finances, notamment le rapport économique et financier, doivent permettre aux parlementaires de discuter et de voter la loi de finances en disposant des informations nécessaires à l’exercice du pouvoir législatif » (38).
Si la jurisprudence du Conseil constitutionnel et la consécration du principe de sincérité par la LOLF constituent des avancées notables, votre rapporteur estime qu’il convient d’aller plus loin dans cette démarche volontariste de sincérité.
L’exemple des Pays-Bas est à cet égard éclairant. En effet, lors de l’élaboration du projet de budget annuel, le gouvernement fonde ses prévisions de recettes et de dépenses sur des hypothèses économiques prudentes. Il s’agit là d’une « politique d’assurance », atténuant le risque de voir l’exécution du budget donner un résultat plus défavorable que prévu.
Au cours des négociations budgétaires, le Bureau central de planification, organisme public totalement indépendant, bénéficiant du respect de tous les partis politiques et du public dans son ensemble, présente deux scénarios économiques. Le premier propose ce qu’il considère comme étant le niveau le plus vraisemblable de croissance économique. Le second est ce qu’il considère comme une hypothèse prudente de croissance économique qu’il conviendra d’adopter pour les besoins de la politique budgétaire. Le gouvernement et le parlement décideront dès lors de se fonder sur le scénario le plus prudent. En termes politiques, les partis politiques préfèrent être confrontés à de « bonnes surprises » lors de l’exécution du budget (plus-values fiscales, baisse des dépenses sociales…).
Lorsque la situation budgétaire se révèle être plus favorable que ne le prévoyait le gouvernement, c’est-à-dire que la croissance économique est plus forte, le mécanisme suivant joue. Si le déficit est supérieur à 0,75 % du PIB, 75 % de la prime est dédiée à la réduction du déficit et 25 % à des réductions d’impôt. Si le déficit est inférieur à 0,75 % du PIB, 50 % de la prime est dédié à la réduction du déficit et 50 % à des réductions d’impôt.
Ainsi, sur le modèle de ce qui existe aux Pays-Bas, votre rapporteur propose que, dans le cadre de l’élaboration de la loi de programmation des finances publiques, le gouvernement fonde ses prévisions budgétaires sur les hypothèses économiques les plus prudentes. L’Institut national de la statistique et des études économiques, organisme public indépendant, serait ainsi chargé de présenter plusieurs scénarios, le gouvernement ne devant tenir compte que du plus pessimiste. Cette règle offre un double avantage : inciter l’État à la vertu budgétaire, d’une part, et ne réserver en cours d’année que des « bonnes surprises », d’autre part.
Proposition n° 12 : un État prudent dans l’élaboration de son budget
Obliger le gouvernement, dans l’élaboration des lois de programmation pluriannuelle des finances publiques, à fonder ses prévisions budgétaires sur les prévisions économiques – notamment de croissance – les plus prudentes, sur le modèle de ce qui se fait au Pays-Bas
2. Taxer les voitures et logements de fonction
En période de crise, une réduction du train de vie de l’État, souhaitée par les Français, est plus que jamais indispensable. Dans le projet de loi de finances pour 2010, l’État a donc engagé une action de rationalisation de son parc automobile et de révision des modalités d’attribution des logements de fonction. Les véhicules et les logements de fonction doivent en effet être des instruments de travail, et non des attributs de prestige.
a) L’exemplarité de l’État dans le projet de loi de finances pour 2010
● La rationalisation du parc automobile de l’État
Le parc automobile de l’État compte environ 72 000 véhicules de service ou de fonction, en dehors des véhicules opérationnels (police, gendarmerie, douane, équipement), auxquels s’ajoutent environ 17 000 véhicules dans les établissements publics administratifs.
Comme le note le ministre du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, « ce parc est inadapté aux besoins de l’État, comme aux objectifs du Grenelle de l’environnement. En effet, les véhicules sont trop puissants, trop nombreux et trop anciens (21 000 véhicules ont plus de sept ans). Ils sont donc trop polluants, plus chers à l’achat puis en maintenance. Ce parc automobile est en outre sous-utilisé : plus de la moitié des véhicules parcourt ainsi moins de 10 000 km par an. Cette situation est notamment liée au grand nombre de véhicules individuels ».
Comme cela avait été réalisé au ministère de la Défense, une gestion plus professionnelle et plus unifiée du parc automobile de l’État sera donc mise en place dès 2010. Elle permettra de faciliter l’évolution vers un parc automobile plus resserré, plus récent, moins puissant, moins polluant et moins coûteux en entretien.
Comme dans les entreprises et conformément aux décisions de la révision générale des politiques publiques, une gestion de flotte externalisée a été mise en place. Ce dispositif s’étendra progressivement à tous les véhicules civils de l’État d’ici à 2011. Parallèlement, le nombre de véhicules de fonction sera réduit, au profit de « pools » de voitures, plus efficaces et moins coûteux. L’attribution des véhicules individuels sera mieux contrôlée et fondée sur une grille unique de modèles par fonction, pour tout l’État.
Afin d’accélérer le renouvellement du parc au profit de véhicules rejetant moins de 130 grammes de CO2 par km, l’État se séparera tous les véhicules de plus de sept ans (soit environ 21 000 véhicules). Seuls deux sur trois seront remplacés, en achetant prioritairement des petits modèles, moins coûteux à l’achat et en entretien, et des véhicules électriques.
● La révision des modalités d’attribution des logements de fonction
Comme l’a rappelé le ministre du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2010, l’État a attribué à ce jour près de 95 000 logements pour « nécessité absolue de service » (dont environ 80 000 au profit de la gendarmerie). Ces logements ne donnent lieu au paiement d’aucune redevance d’occupation.
Par ailleurs, près de 7 000 logements, domaniaux ou locatifs, ont été attribués pour « utilité de service » et donnent lieu au versement d’une redevance calculée selon des critères anciens et en partie déconnectés de la valeur locative réelle. La totalité de ces redevances ne représente qu’environ 50 % des loyers de marché correspondants.
L’attribution des concessions de logements doit être revue pour vérifier qu’elles sont toutes effectivement justifiées par la nécessité d’assurer la permanence d’une mission de service public.
Tout d’abord, le projet de loi de finances pour 2010 prévoit que les occupations de logements réalisées sans base juridique appropriée seront remises en cause.
Ensuite, l’État doit loger les fonctionnaires qui ont l’obligation de résider dans le logement mis à leur disposition, pour assurer la permanence de leur service, comme par exemple les gendarmes, les préfets ou les gardiens d’immeubles administratifs. Les bénéficiaires des nécessités absolues de service devront effectivement répondre à ce critère. S’agissant des bénéficiaires de logements pour utilité de service, cette catégorie a vocation à disparaître et la situation des bénéficiaires devra être réexaminée à la lumière de ce même critère.
Les concessions de logements non nécessaires au service seront ainsi supprimées, au prochain changement de titulaire du poste.
Les logements dont les concessions seront supprimées feront ensuite l’objet de ventes (logements domaniaux) ou de résiliations de bail (logements loués). Si les logements ne peuvent être vendus ou ne peuvent être intégrés dans une opération de rationalisation immobilière de l’État, leurs occupants se verront proposer d’y demeurer sur la base d’une convention d’occupation, les amenant à payer un loyer de marché, en tenant compte de la précarité de l’occupation.
Cette réforme porte sur les logements mis à disposition de fonctionnaires par l’État. Elle ne concerne donc ni les logements mis à disposition par des collectivités locales, notamment au profit d’enseignants, ni les logements sociaux dont bénéficient des fonctionnaires auprès de bailleurs sociaux.
b) Taxer de manière forfaitaire la valeur des voitures et logements de fonction de l’État
Parce que les efforts initiés par le projet de loi de finances pour 2010 sont nécessaires, mais insuffisants, parce que la réduction du train de vie de l’État doit être une préoccupation constante des pouvoirs publics, s’ils veulent réellement se montrer exemplaires aux yeux des citoyens, votre rapporteur propose d’aller plus loin dans cette démarche de rationalisation des voitures et logements de fonction de l’État.
Pour ce faire, votre rapporteur propose que l’État paie une taxe forfaitaire sur chaque logement et voiture de fonction dont il est propriétaire. Une telle taxe aurait une double vertu : d’une part, affecter une nouvelle recette à la CADES et donc à la résorption de la dette sociale et, d’autre part, permettre à l’État d’avoir conscience en permanence du coût que lui impose son train de vie. Ainsi, cette taxe agirait comme une force de rappel et un frein, prévenant tout emballement du train de vie de l’État. En effet, si celui-ci venait à croître dans de fortes proportions, l’État, sous le poids de cette taxe, serait contraint de s’interroger sur la pertinence de son parc automobile et immobilier.
Cette taxe forfaitaire sur les voitures et logements de fonction de l’État, dont le rendement serait de plein droit affecté à la CADES et à la réduction de la dette sociale, constituerait une forte incitation à la vertu et à l’exemplarité. Conformément aux souhaits exprimés par l’un des membres de la mission, il convient également de s’interroger sur la nécessité des mises à disposition d’agents des forces de police et de gendarmerie auprès d’anciennes personnalités.
Proposition n° 13 : taxer de manière forfaitaire les voitures et les logements de fonction et affecter ces recettes à la CADES pour rembourser la dette sociale
Taxer de manière forfaitaire les voitures et logements de fonction dont l’État est propriétaire, afin de dégager une nouvelle ressource au profit de la CADES et de prévenir tout risque d’emballement du train de vie de l’État à l’avenir.
D. UN ÉTAT QUI S’ORGANISE MIEUX ET QUI RÉDUIT LE COÛT DE L’ACTION ADMINISTRATIVE
Optimiser et réduire la dépense implique que l’État repense en profondeur l’organisation de l’ensemble de ses services comme des procédures administratives, dont il assure la mise en œuvre. En effet, au-delà de l’indispensable exemplarité, les efforts entrepris par l’État doivent conduire à des réformes structurelles de son organisation afin de dégager des économies de gestion pérennes. Pour y parvenir, plusieurs chantiers doivent être ouverts dans les meilleurs délais : limiter l’inflation normative à l’origine de surcoûts budgétaires, mesurer et réduire la charge administrative pour les entreprises, mutualiser les fonctions supports des administrations déconcentrées de l’État au niveau de chaque région et mettre en œuvre une incitation financière à l’assiduité dans la fonction publique.
1. Limiter l’inflation normative, source de surcoûts budgétaires
Dans son rapport public de 1991 consacré à la sécurité juridique, le Conseil d’État attirait l’attention du gouvernement sur l’instabilité et l’inflation normatives. Citant le doyen Carbonnier qui avait écrit que « l’inflation se grossit de l’enflure », il utilisait un langage imagé en indiquant que « lorsque la loi bavarde, le citoyen ne lui prête qu’une oreille distraite ». Près de vingt ans plus tard, la situation ne s’est pas améliorée. Le Conseil d’État a intitulé son rapport public de 2006 « sécurité juridique et complexité du droit ». Plaçant en exergue de ce rapport la phrase de Montesquieu selon laquelle « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », il recommandait des mesures contraignantes pour moins et mieux légiférer.
On le sait, la commission des Lois s’est engagée avec vigueur dans ce qui constitue un vrai combat contre la force des habitudes et les inerties de notre système administratif. Elle a ainsi pesé pour renforcer considérablement l’obligation de fournir des études d’impact dignes de ce nom lors de la présentation des projets de loi, en application de l’article 39 de la Constitution ; elle a également ouvert, dès le début de la législature, un vaste chantier de simplification de notre droit. Ce combat doit être poursuivi à tous les niveaux.
a) Un flux croissant de normes…
Cette logorrhée normative, qui est un phénomène commun à la plupart des pays développés, s’explique, d’une part, par la multiplication des sources du droit, notamment communautaires, et, d’autre part, par un flux croissant de normes législatives et réglementaires en droit interne.
En premier lieu, l’importance du droit communautaire, notamment dérivé, est devenue aujourd’hui considérable. Une étude récente du Secrétariat général des affaires européennes (39) évalue le droit dérivé des traités en vigueur à quelque 17 000 règlements, directives et décisions du pilier communautaire de l’Union européenne.
Sur les 34 104 règlements communautaires adoptés entre 1990 et 2005, seuls 5 191, soit un peu plus d’un septième, sont encore en vigueur (40). Sur les 1 516 directives adoptées depuis 1990, 1 244 sont encore en vigueur aujourd’hui. Elles ont nécessité ou impliquent une transposition, c’est-à-dire l’adaptation des textes normatifs nationaux. Ces chiffres restent cependant d’ampleur limitée par rapport au stock des 10 500 lois et 120 000 décrets réglementaires en vigueur en France, et leur impact sur l’activité normative nationale doit être apprécié à sa juste mesure.
En termes de flux, le nombre de règlements communautaires s’élève en moyenne annuelle à 600 pour la législature 1999-2004. Le nombre de directives communautaires s’élève annuellement à 96 pour la période allant de 1990 à 1999 inclus, et à 99 pour la période allant de 2000 à 2004 inclus (41).
En second lieu, l’inflation normative s’explique par un flux croissant de normes législatives et réglementaires en droit interne. À peu près constants en nombre si on raisonne hors projets de loi autorisant la ratification de traités internationaux (48 lois en 2005, 40 lois en 2004, 54 lois en 2003), les projets de loi se caractérisent par une longueur et une complexité accrues.
Ainsi, par exemple, parmi les lois adoptées au cours de la période allant du 21 avril au 13 août 2004, publiées au Recueil des lois de l’Assemblée nationale, plusieurs dépassent les 100 pages, comme la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (218 pages avec 158 articles et un rapport annexé), la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (231 pages et 203 articles), la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie (119 pages soit 76 articles), la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (101 pages avec 58 articles), la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique (99 pages soit 40 articles) ou la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (99 pages avec 103 articles et un rapport annexé) (42).
D’une longueur moyenne de 15 000 pages par an au cours des années 1980, le Journal officiel comporte plus de 23 000 pages annuelles au cours des dernières années. Le Recueil des lois de l’Assemblée nationale est passé de 433 pages en 1973 à 1 067 pages en 1983, 1 274 pages en 1993, 2 400 pages en 2003 et 3 721 pages en 2004 (43).
b) … sources de charges supplémentaires pour la collectivité
Or, cette inflation normative, tant sur le plan législatif et réglementaire n’est pas sans inconvénient. Comme le souligne le rapport du Gouvernement sur les mesures de simplification de l’année 2003 : « La complexité croissante de notre droit est devenue une source majeure de fragilité pour notre société et notre économie. [...] Elle peut détruire la lisibilité des décisions prises par le Gouvernement et le Parlement et ainsi conduire les Français à douter de l’efficacité de la décision politique » (44).
Ainsi, les multiples normes, législatives et réglementaires, applicables à l’action publique sont aujourd’hui devenues des sources majeures de surcoûts budgétaires, notamment pour les collectivités locales (équipements sportifs, équipements pour les personnes handicapées, etc.). S’il s’agit dans l’absolu de dépenses publiques utiles à la collectivité, le rapport coût-utilité peut parfois apparaître excessif. Lors de leur audition, tous les représentants des collectivités territoriales ont souligné que l’inflation des normes induisait des surcoûts financiers importants pour les communes, les départements ou les régions.
Créée par la loi de finances rectificative n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, la commission consultative d’évaluation des normes (CCEN) est une instance chargée d’émettre un avis sur l’impact financier des mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales et leurs établissements, ainsi que sur l’impact technique et financier des propositions de textes communautaires sur les collectivités territoriales et leurs établissements. M. Alain Lambert, président de la commission consultative d’évaluation des normes, juge le bilan de cette instance « très positif » : « nous pouvons désormais mesurer très clairement combien les décisions de l’exécutif coûtent aux budgets des collectivités territoriales. Dans le passé nos malentendus n’étaient pas chiffrables, désormais ils le sont. Ceci fournit aussi un très bon instrument de mesure de la prolifération de la norme réglementaire française » (45).
Depuis un an, la commission consultative d’évaluation des normes, dont la création constitue un indéniable progrès et dont votre rapporteur salue l’excellent travail, a examiné plus de 200 projets instituant de nouvelles normes. Si la commission a réussi, par exemple, à obtenir l’abandon des normes visant à modifier l’équipement des 5 000 dojos français, des efforts plus importants doivent être accomplis dans ce domaine. Ainsi, les normes d’encadrement des enfants, sans remettre en cause leur sécurité, pourraient être assouplies.
c) Assouplir 1 000 normes d’ici le 31 décembre 2010
Au regard de l’impact financier majeur que la production de normes dans notre pays fait peser sur les collectivités locales, votre rapporteur estime urgent de repenser dès aujourd’hui l’équilibre coût-sécurité qui sous-tend l’édiction de normes et, partant, de mettre un terme à cette inflation de textes, qui pénalise en dernier ressort le contribuable. Pour ce faire, votre rapporteur demande au Gouvernement d’assouplir, d’ici le 31 décembre 2010, 1 000 normes, dont il aura été démontré que les coûts qu’elles induisent sont bien supérieurs aux gains espérés en termes d’utilité et de sécurité collectives.
Proposition n° 14 : réduire le stock de normes en assouplissant 1000 normes d’ici le 31 décembre 2010
Avant le 31 décembre 2010, le Gouvernement devra assouplir 1 000 normes, dont il aura été démontré que les coûts qu’elles induisent sont supérieurs aux gains espérés en termes d’utilité et de sécurité collectives.
d) Un moratoire sur l’aggravation des normes
Au regard de la production excessive de normes intervenue ces dernières années, votre rapporteur demande un moratoire de cinq ans sur toute nouvelle norme, dès lors que les coûts financiers qu’elle induit ne sont pas intégralement compensés pour la collectivité en charge de l’appliquer. Ainsi, demain, les collectivités locales ne pourront plus se voir obliger d’appliquer de nouvelles normes, qui constitueraient pour elles une charge financière supplémentaire.
Cette proposition de votre rapporteur s’inspire en partie de la démarche entreprise par la Commission européenne en 2005 : dans un souci de qualité de la réglementation, elle a, en effet, décidé de ralentir le flux normatif communautaire et a en conséquence retiré en septembre 2005 plus d’un tiers des propositions en instance devant le Conseil ou le Parlement, soit 68 textes sur 183.
Proposition n° 15 : limiter le flux de normes par un moratoire de cinq ans sur toute nouvelle norme induisant des coûts pour les collectivités territoriales si ces coûts ne sont pas compensés
À compter du 1er janvier 2010, le Gouvernement devra mettre en place un moratoire de cinq ans sur toute nouvelle norme, dont les coûts financiers induits ne sont pas intégralement compensés au profit de la collectivité en charge de l’appliquer.
2. Mesurer et réduire la charge administrative pour les entreprises
L’impôt papier, aussi appelé charge administrative, représente les coûts induits par les différentes procédures administratives pour les entreprises ou les particuliers. Il comprend donc l’ensemble des formalités administratives que doit accomplir une entreprise ou un particulier pour le compte de l’État. Ces formalités sont assimilées à un impôt dans la mesure où elles sont obligatoires et allègent la charge de travail de l’appareil administratif public en alourdissant celle des entreprises et des particuliers. En France, l’impôt papier représente une charge annuelle de 60 milliards d’euros pour les entreprises, soit 3 % de la richesse nationale produite chaque année par notre pays. En Europe, les études évaluent de même le coût de celui-ci à environ 3 % du PIB.
Afin d’y remédier, quatre mois après le lancement de la révision générale des politiques publiques le 20 juin 2007, le Président de la République a réuni l’ensemble des membres du conseil de modernisation des politiques publiques le 12 décembre 2007 pour annoncer plusieurs mesures concrètes, fixer les orientations et les prochaines étapes de la démarche. À cette occasion, le plan de mesure et de réduction de la charge administrative pesant sur les entreprises a été intégré comme un chantier prioritaire de la RGPP. L’allègement des charges administratives doit permettre de renforcer l’efficacité des entreprises, de libérer le temps qu’elles consacrent aux procédures administratives et de faciliter leurs démarches.
Lors de ce conseil de modernisation des politiques publiques, le plan de réduction de l’impôt papier s’est vu assigner un double objectif d’ici à 2012 en vue de réinjecter près de 15 milliards d’euros dans l’économie :
— réduire de 25 % les charges administratives qui pèsent sur les entreprises ;
— réduire la charge des 1 000 procédures les plus lourdes pour les entreprises (soit 10 % du total des procédures identifiées).
LES PAYS-BAS FONT FIGURE D’EXEMPLE ET DE PRÉCURSEUR
EN MATIÈRE DE RÉDUCTION DE LA CHARGE ADMINISTRATIVE
Confronté à une importante crise budgétaire au milieu des années 1980, le gouvernement néerlandais s’est alors lancé dans une série de réformes et d’innovations visant à améliorer la performance publique et à contrôler la charge administrative de ses lois. Pour ce faire, les Pays-Bas ont créé l’unité de projet interministériel pour les charges administratives (IPAL), dont la mission était de coordonner la mesure des charges administratives et du degré de réalisation des objectifs de réduction de la charge fixé par le gouvernement.
Dans le même temps, ce pays a mis en place un Conseil consultatif pour l’examen des coûts administratifs (ACTAL) en direction des entreprises. Ce dernier s’appuie sur près de 500 groupes d’entreprises ou d’experts ainsi que des commissions. Celles-ci sont composées de fonctionnaires des ministères et de chefs d’entreprises et fournissent des recommandations aux ministres sur les moyens de réduire les charges liées à chaque ministère. Pour réduire les charges qui pèsent sur les entreprises, les Pays-Bas ont également fortement mis l’accent sur les technologies de l’information et de la communication (TIC) avec le développement d’outils électroniques d’échanges d’informations entre les entreprises et l’administration.
En définitive, le bilan est très positif, puisque ce sont près de 95 millions d’euros qui ont été économisés en un an. Le gouvernement néerlandais a également annoncé une réduction de 25 % de la charge administrative imposée aux entreprises d’ici la fin de 2007, cet objectif ayant été très largement atteint.
Or, lors des différentes auditions réalisées par la mission, votre rapporteur a pu constater avec beaucoup de surprise que la mesure et la réduction de la charge administrative étaient à ce jour au « point mort » dans les différents ministères rencontrés. Si constat il doit y avoir, ce ne peut être à ce jour d’un constat de carence. Alors même que la réduction de « l’impôt papier » devait être un chantier prioritaire de la révision générale des politiques publiques, la dynamique semble s’essouffler et ne plus susciter la mobilisation que l’inflation normative majeure dans notre pays imposerait. Ainsi, à titre d’exemple, l’administration n’est pas aujourd’hui en état de mesurer le coût que représente pour le contribuable une procédure de délivrance d’un permis de construire ou d’une simple carte d’identité.
Si l’ensemble des acteurs concernés ne se mobilise pas dès aujourd’hui, les objectifs ambitieux que la France s’était fixée pour 2012 ne seront pas atteints. C’est pourquoi, votre rapporteur estime plus que jamais nécessaire de contraindre les ministères, dans la deuxième phase de la révision générale des politiques publiques, à chiffrer et à mesurer le coût de chacune des catégories de procédures administratives, dont ils assurent la mise en œuvre. En effet, comment peut-on vouloir prétendre réduire la charge administrative des entreprises et générer d’importantes économies budgétaires, si l’administration n’est pas en mesure de chiffrer le coût des différentes procédures dont elle a la charge ?
Proposition n° 16 : évaluer le coût de chaque catégorie de procédures administratives pour mieux en réduire le poids pour les entreprises
Demander dès aujourd’hui à l’ensemble des ministères de chiffrer le coût de chacune des procédures administratives, dont ils assurent la mise en œuvre, afin de satisfaire d’ici 2012 le double objectif fixé par le Président de la République : réduire de 25 % les charges administratives qui pèsent sur les entreprises et réduire la charge des 1 000 procédures les plus lourdes pour les entreprises.
3. Mutualiser les fonctions support des administrations déconcentrées de l’État au niveau de chaque région
Après une période d’expérimentation dans les régions Pays de la Loire et Limousin, il a été décidé de généraliser la régionalisation des budgets opérationnels de programme (BOP) (46). Les dotations accordées à chaque préfecture sont désormais accordées dans le cadre de BOP régionaux, dont les enveloppes de crédit sont réparties entre les départements de la région concernée par le préfet de région.
Cette régionalisation des budgets opérationnels de programme (BOP) des préfectures constitue aujourd’hui une incitation forte à la mutualisation, au niveau régional, des fonctions support de l’ensemble des administrations déconcentrées de l’État. En effet, la mutualisation des enveloppes budgétaires au niveau régional doit se traduire dans les faits par une mutualisation des fonctions support (achats, immobilier, gestion des ressources humaines, parc automobile, formation et recrutement,…) ainsi que des fonctions techniques transversales (pôles juridiques, communication, représentation de l’État…), afin de diminuer le coût de l’action administrative.
Par exemple, dans le cadre de l’expérimentation de BOP régionaux dans la région Limousin, les réflexions des trois préfectures de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze ont abouti à une mutualisation de certaines fonctions support, tout en maintenant des implantations de services supports dans les trois départements. C’est ainsi que la Creuse a regroupé les compétences en matière de formation, tandis que la Haute-Vienne assure la préliquidation des rémunérations et la Corrèze la gestion des dossiers de retraite. La poursuite de ces expériences de mutualisation et leur extension à de nouveaux domaines (tel que la passation de marchés groupés par bon de commande) sont envisagées.
Si la régionalisation des BOP peut ainsi permettre de promouvoir une mutualisation à l’échelon régional de nombreuses fonctions, votre rapporteur considère que le partage géographique des fonctions mutualisées entre les différents départements d’une même région doit répondre à une exigence très forte d’aménagement du territoire. Pour ce faire, ce partage devra tout particulièrement veiller à garantir une présence forte des services de l’État dans les départements ruraux ou les moins peuplés de la région, afin que la mutualisation des moyens à l’échelle régionale n’accélère pas la désertification de certains territoires.
C’est pourquoi, votre rapporteur propose que, d’ici 2012, soient mutualisées, au niveau de chaque région, toutes les fonctions support de l’ensemble des administrations déconcentrées de l’État, éducation nationale comprise, mais à l’exception de ceux de la Justice afin d’en respecter l’indépendance, tout en veillant à maintenir une présence forte des services de l’État dans les départements ruraux ou les moins peuplés.
Proposition n° 17 : mutualiser d’ici 2012, au niveau de chaque région, les fonctions support des administrations déconcentrées de l’État
Mutualiser d’ici 2012, au niveau de chaque région, les fonctions support de l’ensemble des administrations déconcentrées de l’État, éducation nationale comprise, en y installant les services mutualisés, tout en garantissant la présence des services de l’État dans les départements ruraux en y installant les services mutualisés, afin de concilier révision générale des politiques publiques et aménagement du territoire.
4. Mettre en place une incitation financière à l’assiduité dans la fonction publique
a) Un absentéisme élevé dans la fonction publique comparativement au secteur privé
Selon certaines études, le taux d’absentéisme pour raisons de santé atteint 5,5 % dans le privé, contre 7,3 % dans la fonction publique d’État (FPE), 11 % dans la fonction publique hospitalière (FPH) et 11,3 % dans la fonction publique territoriale (FPT). Il y aurait donc eu en 2006, pratiquement deux fois plus d’arrêt de travail pour raison de santé dans le public que dans le privé, alors que chez les fonctionnaires, le niveau de qualification est en moyenne plus élevé que dans le privé, ce qui, en règle générale, entraîne un risque de maladie nettement inférieur.
Certains se sont risqués à un calcul, se fondant sur un principe appliqué dans le secteur privé selon lequel 1 % d’absentéisme coûte 1 % de la masse salariale. En 2004, l’absentéisme dans la fonction publique aurait coûté pas moins de 10,7 milliards d’euros à la France. « Avec un taux équivalent au secteur privé, remarque l’IFRAP, ce coût n’aurait été que de 5,5 milliards d’euros, soit un surcoût pour le contribuable de 5 milliards d’euros ».
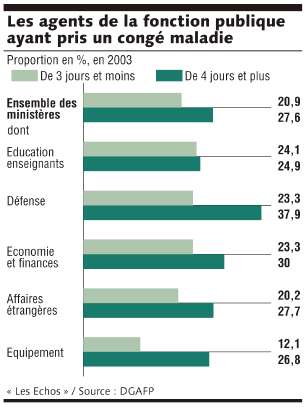
La direction générale de l’administration et de la fonction publique estimait pour sa part en 2003 (dernières données disponibles (47)) que les agents de l’État avaient pris, en moyenne, 13 jours d’arrêts maladie. Ce chiffre est jugé élevé, même s’il doit être relativisé, dans la mesure où 43 % de l’ensemble des jours pris se sont concentrés sur les personnes arrêtées en raison de maladies graves (plus d’un an) ou d’accidents du travail. Pour les congés maladie de moindre durée, un agent sur cinq a bénéficié au moins une fois dans l’année d’un arrêt de 3 jours ou moins et un agent sur trois d’un arrêt de 4 jours ou plus.
b) Renforcer le contrôle des arrêts de travail et mettre en œuvre une incitation financière à l’assiduité
Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, le ministre du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État a annoncé que les médecins de l’assurance-maladie seraient autorisés à effectuer des visites de contrôle auprès des fonctionnaires, comme cela se pratique déjà dans le secteur privé.
Plutôt que de contrôler et de sanctionner les agents publics, votre rapporteur estime qu’il faut aujourd’hui étudier la mise en œuvre d’une démarche financière incitative, intéressant les agents publics à leur propre assiduité. Ainsi, afin de limiter le recours aux arrêts de travail dans la fonction publique, votre rapporteur propose qu’une prime positive d’assiduité soit versée à chaque agent n’ayant pris aucun arrêt maladie. Par ailleurs, à la suite des propositions faites par les membres de la mission, votre rapporteur souligne la nécessité de rechercher les causes de l’absentéisme dans la fonction publique, afin d’identifier les problèmes pouvant être liés au fonctionnement du service lui-même.
Proposition n° 18 : mettre en œuvre une incitation financière à l’assiduité dans la fonction publique
À compter du 1er janvier 2011, mettre en place une prime positive d’assiduité à chaque agent, n’ayant bénéficié d’aucun arrêt de travail, afin de l’intéresser à sa propre assiduité.
5. Inciter l’État au paiement rapide de ses dépenses grâce au mécanisme de l’escompte
Alors que les dépenses de l’État s’élèveront en 2010 à plus de 280 milliards d’euros, leur incidence sur l’économie et les finances publiques, notamment via les délais de paiement, est majeure. En effet, plus l’État paie avec retard ses fournisseurs, plus les intérêts moratoires sont élevés et plus le coût pour les finances publiques est important.
Une dépense rapide de l’État peut donc être source non négligeable d’économies pour le budget de l’État. C’est le sens des mesures qui ont été prises par le Gouvernement, notamment dans le cadre du plan de relance. En effet, l’article 98 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics, prévoit désormais que « Le délai global de paiement d’un marché public ne peut excéder 30 jours pour l’État et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial. […] Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai ».
Ces efforts semblent avoir porté leurs fruits, puisque le délai de paiement a connu une amélioration sensible depuis 2007, passant de plus de trente jours en 2005 à vingt jours en 2008.
DÉLAI GLOBAL DE PAIEMENT DE L’ÉTAT
2005 |
2006 |
2007 |
31/07/2008 |
32,3 jours |
41,5 jours |
23,9 jours |
20,1 jours |
Source : Direction générale des finances publiques, service de la comptabilité de l’État.
Votre rapporteur estime toutefois qu’il faut d’aller plus loin et qu’il est, pour ce faire, nécessaire d’intéresser davantage l’État au paiement rapide de ses dépenses. Parce que l’État se doit d’être exemplaire, surtout en période de crise, à l’égard des entreprises, parce qu’aucun fournisseur ne doit être mis en difficulté financière, à cause de retards de paiement de la part de l’État, parce qu’une dépense rapide est source d’économies pour les finances publiques, il convient, dès aujourd’hui, d’appliquer aux dépenses de l’État le mécanisme de l’escompte.
Cette remise financière accordée à un client pour paiement anticipé des factures par rapport à la date d’échéance initialement fixée n’est aujourd’hui pas prévue lorsque, dans le cadre d’un marché public, l’État s’acquitte de ses dettes à l’égard de ses fournisseurs et de ses sous-traitants.
La proposition de votre rapporteur est simple : lorsque, dans le cadre d’un marché public, l’État paie dans un délai de cinq jours, la dépense se voit appliquer un taux d’escompte de 1,5 %. S’il s’acquitte de cette dépense dans un délai compris entre six et quinze jours, le taux d’escompte ne sera que de 0,75 %. Entre seize et trente jours de délai de paiement, le mécanisme d’escompte cesse de jouer, sans que l’État ne soit pour autant contraint de verser des intérêts moratoires. C’est seulement au-delà de 30 jours qu’il sera soumis au paiement de ces intérêts de retard, tels qu’ils sont actuellement prévus par le code des marchés publics.
TAUX D’ESCOMPTE SUIVANT LE DÉLAI DE PAIEMENT DE LA DÉPENSE DE L’ÉTAT
Entre 0 et 5 jours |
Entre 6 et 15 jours |
Entre 16 et 30 jours |
Au-delà de 30 jours |
1,5 % |
0,75 % |
0 % |
Intérêts moratoires |
Ainsi, prenons l’exemple d’un marché public de fournitures d’une valeur de 100 000 euros, l’État bénéficiera d’une économie de 1 500 euros s’il s’acquitte de sa créance dans les cinq jours. Cette économie ne sera que de 750 euros s’il paie son fournisseur dans un délai compris entre six et quinze jours. Au-delà, le gain pour l’État devient nul.
Proposition n° 19 : inciter l’État au paiement rapide de ses dépenses grâce au mécanisme de l’escompte
Dans le cadre des marchés publics, les dépenses de l’État bénéficieront du mécanisme de l’escompte : le taux d’escompte sera de 1,5 % pour tout délai de paiement inférieur ou égal à cinq jours et seulement de 0,75 % pour tout délai de paiement compris entre six et quinze jours. Au-delà, le mécanisme de l’escompte cessera de jouer.
E. INTÉRIEUR, JUSTICE ET IMMIGRATION : DES MESURES CONCRÈTES POUR LES MINISTÈRES SUIVIS PAR LA COMMISSION DES LOIS
Parce que les missions régaliennes de l’État, que sont l’intérieur, la justice ou bien encore l’immigration, fonde sa légitimité, elles ne peuvent rester à l’écart de la mobilisation générale, qui se fait jour afin de faire barrage à une crise sans précédent de nos finances publiques.
Ces trois ministères régaliens, qui tous relèvent du champ de compétences de la commission des Lois, se doivent aujourd’hui plus qu’hier d’être les fers de lance d’une gestion vertueuse et équilibrée des deniers publics. Quel crédit pourrait en effet porter les citoyens à la permanence de l’État, à l’exercice de la justice et à la maîtrise de l’immigration, si les ministères chargés d’accomplir ses missions n’étaient pas en tout point exemplaires ?
1. Ministère de l’Intérieur : de nombreux défis à relever
La mission « Administration générale et territoriale de l’État », dont l’enveloppe globale dans le projet de loi de finances pour 2010 représente 2,1 milliards d’euros (48) aussi bien en crédits de paiement qu’en autorisations d’engagements, est mise en œuvre par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. Grâce à cette mission, ce ministère régalien, assure deux de ses responsabilités fondamentales : garantir la présence et la continuité de l’État sur l’ensemble du territoire de la République, et assurer la mise en œuvre locale des politiques publiques nationales.
Afin de mieux apprécier l’adéquation des moyens budgétaires aux missions dévolues à ce ministère, la mission a auditionné M. Henri-Michel Comet, secrétaire général du ministère de l’intérieur (49). Celui-ci a attiré l’attention de votre rapporteur sur la nécessité de mutualiser au niveau régional les fonctions support des différentes administrations déconcentrées. Cette préoccupation, partagée par votre rapporteur, a fait l’objet d’une proposition dans les développements qui précèdent (cf. proposition n° 17).
Le ministère de l’intérieur est par ailleurs confronté à d’autres enjeux majeurs. À ce titre, lors de son audition par la commission des Lois (50), M. Alain Pichon, président de la quatrième chambre de la Cour des comptes, a rappelé que la question du rapprochement entre police et gendarmerie était à l’ordre du jour du programme de travail de la Cour : « nous avons prévu de vérifier si toutes les conséquences ont été tirées du rapprochement entre la police et la gendarmerie. Il y a certainement des économies d’échelle à réaliser en matière d’achats, de coordination, de frais d’hébergement et de déplacement ». La commission des Lois suivra avec attention le résultat de ces travaux.
Fort de ce constat, la mission a examiné d’autres actions, participant d’une gestion vertueuse et équilibrée des comptes publics, comme la mise en place de préfets bi-départementaux.
En effet, les missions de ce ministère régalien, qu’est l’intérieur, ne peuvent se concevoir sans le rôle fondamental joué par les préfets. Institués par Napoléon en 1800 (51), les préfets de département ont vu leur rôle profondément transformé par la décentralisation. Jusqu’en 1982, ils remplissaient une double mission à la tête du département : ils représentaient l’État et détenaient le pouvoir exécutif. En 1982, ils ont dû céder ce pouvoir aux collectivités territoriales. Leurs attributions ont été alors redéfinies, puis précisées par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ainsi que plus récemment par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et le décret n° 2009-176 du 16 février 2009.
Représentant direct du Premier ministre et de chaque ministre dans le département, le préfet est le dépositaire de l’autorité de l’État dans le département et à ce titre responsable de l’ordre public. Aux termes des articles 9 et 10 du décret précité du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, il met en œuvre dans le département les politiques nationales et communautaires et contrôle a posteriori les actes des collectivités territoriales.
Au 1er mars 2009, 106 préfets territoriaux étaient en exercice. Afin d’optimiser la dépense publique, sans porter atteinte à la permanence et à la continuité de l’État sur le territoire, votre rapporteur a étudié la possibilité de mettre en place des préfets bi-départementaux, c’est-à-dire ayant autorité sur deux départements contigus. Si plusieurs arguments plaidaient en ce sens, la mission n’a toutefois pas retenu cette proposition.
2. Ministère de la Justice : réduire le contentieux et repenser l’organisation pour une meilleure administration de la justice
La justice, fonction régalienne par excellence, se doit d’être exemplaire tant dans son exercice que dans sa gestion administrative. Parce que les attentes des citoyens à l’égard de la justice n’ont jamais été aussi fortes, parce que les exigences des contribuables à l’égard de la maîtrise de la dépense publique n’ont elles aussi jamais été aussi évidentes, la justice est aujourd’hui le point de convergence de toutes les préoccupations : offrir une justice de qualité au moindre coût.
En 2010, les crédits budgétaires alloués au ministère de la Justice (52) représenteront 2,5 % du budget général de l’État, contre 1,69 % en 2002. Si la priorité de l’actuelle législature en faveur de la Justice marque sa volonté de poursuivre l’effort entrepris pour renforcer les fonctions régaliennes de l’État, cela n’exonère pas en retour la Justice de rationaliser et d’optimiser sa dépense.
Afin de mieux appréhender les efforts d’ores et déjà réalisés ainsi que les difficultés à venir, la mission a auditionné M. Gilbert Azibert, secrétaire général du ministère de la justice (53). À ce titre, elle se félicite que le ministère se soit engagé dans une démarche ambitieuse et volontariste de maîtrise de la dépense, tant en matière de frais de justice que de mutualisation des fonctions support.
Cependant, il est nécessaire que de nouvelles actions soient mises en œuvre rapidement. Lors de son audition par la commission des Lois (54), M. Alain Pichon, président de la quatrième chambre de la Cour des comptes, a rappelé le poids excessif qu’occupent encore aujourd’hui les procédures papier au sein de la justice : « L’achat du papier, par exemple, coûte aujourd’hui des fortunes ». Comme votre rapporteur l’a déjà souligné dans les développements qui précèdent, il est impératif que les administrations évaluent systématiquement le coût de chaque catégorie de procédure pour mieux en réduire le poids (cf. proposition n° 16). C’est un devoir d’autant plus important pour la justice dont les procédures sont nombreuses et complexes.
Votre rapporteur considère cependant que, s’agissant des économies qui doivent être dégagées en matière de justice, il convient d’aller bien au-delà, grâce à la mise en œuvre rapide de nouvelles actions : réduire le contentieux familial grâce au recours accru à la médiation, fusionner la justice de proximité et la justice de première instance, faire de la visioconférence la règle et des extractions judiciaires l’exception, limiter les transfèrements médicaux manifestement inutiles grâce au recours, chaque fois que cela est possible, à la télémédecine et, enfin, allégement de la procédure de suspension du permis de conduire, en supprimant la phase administrative, au profit d’une seule et unique phase judiciaire.
a) Réduire le contentieux familial grâce au recours accru à la médiation familiale
La médiation familiale doit à l’avenir prendre une place plus importante qu’aujourd’hui, dans la mesure où le contentieux familial est un contentieux massif : un peu plus de 360 000 affaires sont soumises chaque année aux juges affaires familiales. Sur ces 360 000 affaires, près du tiers – soit 110 000 affaires – concernent l’autorité parentale et le droit de visite. Le développement de la médiation en matière familiale revêt donc un enjeu majeur, puisqu’elle est susceptible de désengorger massivement les tribunaux.
● La médiation familiale : une démarche juridique permettant de pacifier les conflits familiaux
Introduite dans le code civil par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, la médiation familiale a pour objectif, avec l’aide d’un tiers indépendant, d’aider les parents à l’exercice consensuel de l’autorité parentale en prévenant les conflits (médiation extrajudiciaire) ou en atténuant leurs effets dans l’intérêt des enfants (médiation judiciaire). La médiation en matière familiale est aujourd’hui régie par deux articles du code civil :
— l’article 255 du code civil relatif au divorce, qui dispose que « le juge peut notamment : 1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation » ;
— l’article 373-2-10 du code civil relatif à l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés, qui dispose qu’« en cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure ».
Conformément à la définition adoptée par le Conseil national consultatif de la médiation familiale le 22 avril 2003, « la médiation familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial axé sur l’autonomie et la responsabilité des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation dans lequel un tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision, le médiateur familial, favorise, à travers l’organisation d’entretiens confidentiels, leur communication, la gestion de leur conflit dans le domaine familial entendu dans sa diversité et dans son évolution ».
La médiation familiale fait l’objet d’un partenariat entre les ministères chargés de la justice et de la famille et la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) pour financer et structurer, au niveau départemental, un maillage territorial suffisant. Un processus de professionnalisation des médiateurs a abouti en 2003 à la création d’un diplôme d’État spécifique de médiateur familial.
Nombreuses sont aujourd’hui les voix qui appellent de leurs vœux un renforcement de la médiation familiale, tant judiciaire qu’extrajudiciaire, afin, de pacifier les conflits familiaux, qui viennent le plus souvent engorger les prétoires. Pour d’évidentes motivations budgétaires, il convient donc de tarir ces contentieux familiaux. Pour ce faire, deux voies doivent être privilégiées : d’une part, développer le champ de la médiation extrajudiciaire obligatoire et, d’autre part, conforter et soutenir la médiation familiale judiciaire.
● Systématiser le recours à la médiation familiale extrajudiciaire pour les actions tendant à faire modifier les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, précédemment fixées par une décision de justice
Aujourd’hui, nombre de praticiens considèrent à juste titre que le champ familial constitue le terrain de prédilection de la médiation en matière civile. La responsabilité et le dialogue qu’impose l’exercice quotidien de l’autorité parentale, surtout en cas de séparation, justifient que l’on s’interroge sur la systématisation de la médiation familiale préalablement à la saisine du juge aux affaires familiales. L’expérience menée depuis plus de dix ans au Québec est à cet égard très éclairante.
LE DISPOSITIF DE MÉDIATION FAMILIALE EXTRAJUDICIAIRE AU QUÉBEC
La loi instituant la médiation préalable en matière familiale au Québec est entrée en vigueur le 1er septembre 1997. Son objectif est de permettre aux membres d’un couple, mariés ou non, de recourir aux services d’un médiateur accrédité destiné à les aider à trouver une solution à leurs différends et à parvenir à un accord écrit. cet accord a vocation à entériner les décisions relatives à leur demande de séparation, de divorce, de garde des enfants, de pension alimentaire ou de révision de jugement.
Le dispositif québécois repose en substance sur trois règles essentielles : la prise en charge par l’État du coût de la médiation ; la constitution d’un maillage complet de médiateurs compétents ; l’interdiction de statuer sur une demande en justice sans qu’au préalable les parties aient au moins assisté à une réunion d’information.
Depuis septembre 1997, environ 115 000 couples ont fait appel à la médiation familiale gratuite, les deux tiers en dehors de toute procédure judiciaire. Le nombre d’affaires familiales soumises à la Cour supérieure du Québec dans le champ couvert par ce dispositif a subi une baisse constante depuis sa mise en place, passant de 38 758 à 30 254 en 2007. Le taux de satisfaction des personnes qui y ont recours atteint 82 %.
Source : extraits du rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par M. Serge Guinchard, L’ambition d’une justice apaisée, La Documentation française, juin 2008.
Adhérant aux propositions faites en la matière par la commission sur la répartition des contentieux (55), votre rapporteur suggère que la médiation préalable à toute action en justice devienne obligatoire pour les actions tendant à modifier les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, précédemment fixées par une décision de justice, ce qui concerne plus de 85 000 affaires par an (fixation et modification des modalités de visite et d’hébergement ou de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant). Systématisée pour toutes les actions récurrentes tendant à modifier une décision du juge aux affaires familiales portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, la médiation familiale préalable obligera les parents, avant toute saisine du juge, à s’inscrire, avec l’aide d’un médiateur, dans une démarche de dialogue leur permettant d’ajuster eux-mêmes les modalités d’exercice de leur autorité parentale dans le seul intérêt de leur enfant.
L’encouragement au dialogue et au pragmatisme, que favorise la médiation préalable aux actions tendant à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, peut trouver deux terrains d’élection privilégiés : le partage de cette autorité parentale et la définition des actes usuels et importants.
Cependant, il semble pertinent de réserver la médiation familiale préalable obligatoire aux seules actions visant à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et non à les déterminer d’emblée. En effet, « ces demandes concernent des problématiques plus complexes, n’intéressant pas seulement l’enfant et justifiant bien souvent, dans un contexte conflictuel, qu’une décision intervienne rapidement pour régler les modalités de la séparation des parents ». Dans ce cadre, la médiation aurait vocation à régler essentiellement des problèmes pratiques sans avoir un champ d’application trop large. On peut donc estimer qu’en dehors des actions visant à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, les parties doivent simplement être incitées à recourir à la médiation, grâce notamment à la procédure dite de « double convocation » ou bien à la permanence d’information de la médiation familiale auprès de chaque tribunal de grande instance (cf. infra).
Enfin, votre rapporteur propose que la médiation familiale préalable visant à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale soit obligatoire, sauf si le demandeur est en mesure de justifier d’un motif grave interdisant tout recours à la médiation (contexte de violences, urgence, défaut de présentation d’une partie devant le médiateur, etc.).
Proposition n° 20 : systématiser le recours à la médiation familiale extrajudiciaire pour les actions tendant à faire modifier les modalités de l’exercice de l’autorité parentale à partir du 1er janvier 2011
Afin d’améliorer la qualité ainsi que la rapidité des décisions de justice et de désengorger les tribunaux, rendre obligatoire, à partir du 1er janvier 2011, la médiation familiale préalable à toute action en justice visant à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, ce qui représente plus de 85 000 affaires par an.
● Encourager le recours à la médiation familiale judiciaire grâce à la consécration la pratique de la « double convocation »
En novembre 2008, le Tribunal de grande instance de Paris a mis en place une procédure dite de « double convocation ». Ainsi, en cas de saisine du juge aux affaires familiales, non précédée d’une tentative de médiation, les parties, dès saisine de la juridiction, sont renvoyées devant un médiateur familial, sans recueil formel de leur accord, tout en leur donnant une date d’audience, soit aux fins d’homologation de leur accord, soit aux fins de jugement (56).
Soulignant l’intérêt d’engager les parties dans une logique de médiation en parallèle de la procédure judiciaire, Mme Danièle Ganancia, vice-présidente et juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Paris a précisé que « souvent les personnes trouvent un accord dès l’entretien d’information chez le médiateur. Dès la première audience, le juge peut homologuer l’accord ». Cette expérimentation a également été menée avec profit au Tribunal de grande instance de Bobigny, en matière familiale, où, pour les affaires sélectionnées par les magistrats, elle a abouti dans la moitié des cas à un accord, total ou partiel. Toutefois, comme l’a fait observer M. Serge Guinchard, « le succès de la double convocation passe par un lien étroit entre la juridiction et les services de médiation concernés, à l’effet d’assurer une permanence de médiateur ».
Par conséquent, pour les actions ne relevant pas du champ de la médiation obligatoire préalable à toute action en justice (cf. supra) et à l’exclusion du divorce, il serait nécessaire de consacrer et de systématiser les pratiques existantes de double convocation. En pratique, le juge aux affaires familiales pourrait, pour toute affaire, inviter les parties à rencontrer un médiateur avant même l’audience, voire dès l’enrôlement de l’acte introductif d’instance. Dans l’hypothèse de l’adoption de cette seule disposition, l’ensemble de la matière familiale serait concerné, à l’exclusion des divorces, soit 177 756 affaires en 2007. Combinée à la médiation préalable obligatoire en amont du juge, cette mesure concernerait encore 92 066 dossiers.
Les modalités selon lesquelles une médiation pourrait être proposée s’en trouveraient assouplies, permettant ainsi que le développement de la médiation judiciaire n’induise pas un allongement de la durée des procédures. La souplesse autorisée par ce mécanisme permettrait d’apporter une réponse adaptée à chaque affaire soumise au juge.
Proposition n° 21 : systématiser, à partir, du 1er janvier 2011, la procédure dite de la « double convocation » invitant les parties à rencontrer un médiateur avant l’audience
Afin d’améliorer la qualité ainsi que la rapidité des décisions de justice et de désengorger les tribunaux, systématiser, à partir du 1er janvier 2011, la procédure dite de la « double convocation » invitant les parties à rencontrer un médiateur avant l’audience. Combinée à la médiation préalable obligatoire en amont du juge, cette mesure concernerait plus de 90 000 dossiers chaque année.
b) Fusionner la justice de proximité et la justice de première instance
La création des juridictions de proximité par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice a permis d’intégrer des personnes issues de la société civile dans le fonctionnement de la justice au quotidien.
LES JUGES DE PROXIMITÉ
Le juge de proximité statue sur les petits litiges de la vie quotidienne et sur les petites infractions aux règles de la vie en société.
En matière civile, la juridiction de proximité statue en premier et dernier ressort : pour les litiges personnels et mobiliers n’excédant pas 4 000 euros ; pour tout litige relatif à l’action en restitution d’un dépôt de garantie (dans le cadre d’un bail d’habitation) d’un montant maximum de 4 000 euros. Elle statue à charge d’appel sur toutes demandes indéterminées, qui ont pour objet l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4 000 euros. Cette juridiction est par ailleurs chargée de l’exécution des procédures : d’injonction de payer (pour les litiges liés à des difficultés de paiement) et d’injonction de faire (pour obtenir la livraison, la réparation ou le remplacement d’un bien).
En matière pénale, la juridiction de proximité est compétente pour la plupart des infractions, commises par les mineurs ou les majeurs, sanctionnées par les contraventions des quatre premières classes. Le juge de proximité traite notamment des infractions commises en matière de circulation routière, de dégradations et de violences légères. Il peut également être délégué pour valider les compositions pénales visant les auteurs d’infractions commises dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel est située la juridiction de proximité. Enfin, il peut être désigné par le président de ce même tribunal pour siéger en qualité d’assesseur aux audiences correctionnelles collégiales.
En 2006, les juridictions de proximité ont été saisies de 272 895 requêtes en injonction de payer et de 102 178 affaires en matière civile, alors que, par exemple, les conseils de prud’hommes se voyaient soumettre 154 928 affaires nouvelles. Le stock d’affaires non traitées par les juridictions de proximité était de 45 705 affaires au 31 décembre 2007.
Au 1er juillet 2009, 636 juges de proximité sont en fonction dans 328 juridictions de proximité. Parmi les juges de proximité, les membres des professions juridiques et judiciaires (42 %) et les juristes d’entreprises (42 %) sont très largement majoritaires, tandis que les anciens magistrats représentent 9 % de l’effectif.
L’intégration dans le paysage judiciaire de ces nouveaux juges de proximité a pris la forme de la création d’un nouvel ordre de juridiction : la juridiction de proximité. Pourtant, le rapport parlementaire rédigé par MM. Jean-Pierre Schosteck et Pierre Fauchon au nom de la commission des Lois du Sénat relatif au projet de loi sur la juridiction de proximité (57) relevait que le choix, pour intégrer ces nouveaux juges, de créer un ordre de juridiction, n’était que l’une des solutions envisageables, qui risquait « de rendre plus complexes encore les règles de compétence entre juridictions ». Après sept années de fonctionnement de la juridiction de proximité, ce constat d’une organisation judiciaire rendue plus confuse et moins lisible est aujourd’hui vérifié. L’organisation judiciaire en matière civile conduit à des situations que certains auteurs qualifient d’ubuesques ou de kafkaïennes.
Il apparaît ainsi que ce nouvel ordre de juridiction n’a pu, au-delà des qualités humaines des juges de proximité qui le composent, atteindre les objectifs ambitieux qui lui étaient assignés, d’une justice réconciliée avec les usagers. Parallèlement, en juxtaposant une juridiction de proximité au tribunal d’instance et au tribunal de grande instance, la réforme présentait une différence notable avec les juridictions échevinales, qui conduisent les magistrats professionnels à travailler avec des personnes issues de la société civile (tribunal pour enfants, formation de départage du conseil de prud’hommes, tribunal des affaires de sécurité sociale). Ainsi, ce faisant, elle n’a pas permis la création d’une équipe dans laquelle le juge de proximité serait venu compléter par son expérience les compétences juridiques et procédurales des magistrats professionnels. Il est à cet égard caractéristique de relever que le seul domaine dans lequel l’intervention des juges de proximité fait l’unanimité est leur participation aux audiences correctionnelles, en qualité d’assesseurs. Ils forment alors, avec le président de la formation et l’assesseur professionnel, une équipe et apportent à la formation leur expérience, les magistrats professionnels se chargeant de la direction du procès, suivant des règles au demeurant de plus en plus complexes.
Nombre d’observateurs soulignent également les difficultés d’adaptation des compétences des juges de proximité à la technicité du contentieux civil. Le rapport de la commission Guinchard rappelle à ce titre que « malgré l’évidente bonne volonté des juges de proximité, leur manque de formation, notamment en matière de conduite de la procédure et de prise de décision, ainsi que leur temps d’investissement limité du fait du caractère accessoire de leurs fonctions, ne leur permettaient pas d’apporter en matière civile un niveau de qualité équivalent à l’intervention d’un juge professionnel ».
Fort de ces constats, M. Serge Guinchard, dans son rapport, a fait des propositions intéressantes, destinées à remédier à ces difficultés. Dans le double souci d’une bonne administration de la justice et d’une optimisation de la dépense publique, votre rapporteur souhaite que ces propositions soient mises en œuvre rapidement. Les mesures proposées visent à supprimer la juridiction de proximité en tant qu’ordre de juridiction, mais à maintenir les juges de proximité en les intégrant au tribunal de grande instance. Ainsi, les juges de proximité devraient être nommés dans un tribunal de grande instance et affectés auprès du juge chargé de la direction et de l’administration d’un tribunal d’instance. Cela aurait pour effet de leur permettre de participer pleinement à l’activité et à l’organisation de ces deux juridictions de première instance.
Concernant leurs attributions, seraient maintenues celles relatives au jugement des contraventions des quatre premières classes ainsi que celle relatives à la validation des compositions pénales. De même, ils conserveraient leur participation aux formations de jugement en qualité d’assesseurs des chambres correctionnelles.
Par ailleurs, il semble souhaitable que les juges de proximité puissent aider et décharger les juges professionnels en se voyant déléguer certaines tâches incombant à ces derniers. Ainsi, les juges de proximité pourraient désormais être assesseurs des chambres civiles et se voir déléguer l’examen des injonctions de payer, la vérification des comptes de tutelles, des missions d’instruction civiles (transports sur les lieux, auditions des parties ou de témoins, conciliations).
Parce que le contentieux de masse ne peut être traité qu’au prix d’une forte rationalisation des pratiques, elles-mêmes génératrices d’économies budgétaires, la fusion de la justice de proximité avec la justice de première instance est aujourd’hui une nécessité. Alors que la dépense afférente à la justice de proximité s’élèvera à 6 millions d’euros en 2009 pour 636 juges de proximité en exercice et à un peu plus de 7 millions d’euros pour 700 juges de proximité en exercice, la suppression des juridictions de proximité comme ordre de juridiction et l’intégration des juges de proximité aux tribunaux d’instance et de grande instance avant le 1er janvier 2011 présentera le double avantage d’offrir une justice de première instance de meilleure qualité et ce à moindre coût.
Proposition n° 22 : fusionner la justice de proximité et la justice de première instance avant le 1er janvier 2011
Avant le 1er janvier 2011, supprimer la juridiction de proximité en tant qu’ordre de juridiction, mais maintenir les juges de proximité, qui seraient nommés dans un tribunal de grande instance et affectés auprès du juge chargé de la direction et de l’administration d’un tribunal d’instance. Cela aurait pour effet de leur permettre de participer pleinement à l’activité et à l’organisation de ces deux juridictions de première instance. Cette réforme simplifierait la procédure et dégagerait du temps pour les magistrats.
c) Supprimer les transfèrements inutiles de détenus grâce au recours plus systématique à la visioconférence et, chaque fois que possible, à la télémédecine
À ce jour, on recense trois grands types de transfèrements qui rythment le travail quotidien de la justice et de l’administration pénitentiaire : les transfèrements administratifs de détenus entre deux établissements pénitentiaires ou vers des pays étrangers, les transfèrements médicaux de détenus entre un établissement pénitentiaire et des établissements de santé et les extractions judiciaires entre un établissement pénitentiaire et un tribunal.
Afin d’optimiser la dépense publique et de garantir une bonne administration de la justice dans notre pays, votre rapporteur propose, d’une part, de mettre fin aux extractions judiciaires inutiles grâce au recours systématique à la visioconférence, et, d’autre part, d’éviter les transfèrements médicaux, manifestement inutiles, grâce au recours, chaque fois que cela est possible, à la télémédecine et à la vidéo-consultation.
● Mettre fin aux extractions judiciaires inutiles grâce au recours systématique à la visioconférence
Aux termes de l’article D. 57 du code de procédure pénale, les extractions judiciaires sont normalement assurées par les services de gendarmerie ou de police. Ces extractions judiciaires, entendues comme l’exécution par la police et la gendarmerie nationales des réquisitions émises par l’autorité judiciaire aux fins de se faire présenter, dans le cadre d’une activité juridictionnelle, une personne détenue dans un établissement pénitentiaire, mobilisent chaque année un nombre important de militaires et fonctionnaires évalué, selon des données concordantes, à environ 1 270 ETPT, pour 155 000 extractions réalisées en 2008, toutes activités juridictionnelles confondues.
Il a longtemps été envisagé le transfert complet de cette charge au personnel pénitentiaire. Deux rapports ont été rédigés sur ce thème, l’un par le M. Guy Fougier en 1995, l’autre par M. Emmanuel Belluteau en 2004. Tous deux ont rendu des conclusions convergentes mettant en évidence le fait que le transfert de cette charge à l’administration pénitentiaire serait contraire à une bonne gestion des deniers publics. Fort de ce constat, le conseil de modernisation des politiques publiques du 12 décembre 2007 a écarté le principe d’un transfert de l’ensemble des extractions judiciaires à l’administration pénitentiaire.
Le conseil de modernisation a néanmoins relevé qu’un certain nombre d’extractions judiciaires n’était pas nécessaire et pouvait de ce fait être évité. En effet, s’il est normal qu’un détenu soit extrait afin d’être présenté à un juge pour les audiences publiques et pour certaines audiences de cabinet, certaines extractions ne sont pas utiles et peuvent donc être évitées : comparution comme simple témoin, audiences d’application des peines, appels sur le maintien en détention...
Le législateur a pris conscience des potentialités du recours à la visioconférence et a permis, par plusieurs modifications législatives successives, l’utilisation de ce mode de communication pour un certain nombre d’actes juridictionnels. L’usage juridictionnel de la visioconférence a été consacré pour la première fois par l’article 32 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, qui a introduit dans le code de procédure pénale un nouvel article 706-71. Cette première consécration concernait l’audition ou l’interrogatoire de personnes en cours d’enquête ou d’instruction, le recours à des interprètes ainsi que l’exécution de demandes d’entraide émanant d’autorités judiciaires étrangères. Dans un deuxième temps, la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice a étendu la possibilité d’utilisation de la visioconférence pour ordonner les prolongations de garde à vue ou de retenue judiciaire lors d’une enquête ou d’une instruction.
Après ces phases d’« expérimentation législative », l’étape la plus décisive dans la consécration de la visioconférence dans le cadre de l’activité judiciaire est venue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. L’article 17 de cette loi a complété l’article 706–71 du code de procédure pénale pour étendre le champ de la visioconférence judiciaire dans trois domaines :
— Depuis cette loi, le recours à la visioconférence est possible pour certains actes devant les juridictions de jugement. Désormais, l’audition des témoins, des parties civiles et des experts est possible devant toute juridiction de jugement par le biais de la visioconférence. L’interrogatoire d’un prévenu, y compris si celui-ci est détenu pour autre cause, est également possible, mais uniquement devant le tribunal de police et – depuis la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance – devant la juridiction de proximité.
— Le recours à la visioconférence a également été élargi dans le cadre de l’instruction. Sont désormais possibles l’audition ou l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une personne détenue, ainsi que l’assistance de l’interprète dans l’impossibilité de se déplacer, au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation. Le débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour autre cause, le débat contradictoire de prolongation de détention provisoire et le contentieux de la détention provisoire (58) peuvent également donner lieu à des audiences en visioconférence. La loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit a rendu applicable la visioconférence, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie Française et dans les Îles Wallis-et-Futuna, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne libre, tenu par le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Nouméa.
— Enfin, la loi du 9 mars 2004 a permis de recourir à ce dispositif dans le cadre des décisions relatives à l’exécution des peines (décisions prises par le tribunal correctionnel, sur les demandes de confusions de peine notamment) ainsi qu’en matière d’application des peines pour entendre un détenu devant les juridictions de l’application des peines (juge de l’application des peines, tribunal de l’application des peines, chambre de l’application des peines de la cour d’appel) (59).
Afin de responsabiliser les magistrats, le conseil de modernisation des politiques publiques a fixé au ministère de la justice pour objectif de réduire de 5 % le nombre des extractions judiciaires (60) en 2009 par rapport à 2008, grâce au recours intensif à la visioconférence. En 2010, le ministère de la justice devra à nouveau atteindre cet objectif de 5 % par rapport aux réquisitions effectuées en 2009.
Parce que la réalisation de cet objectif implique la responsabilisation financière du ministère de la justice à l’égard du ministère de l’intérieur, un mécanisme d’intéressement financier a été mis en place.
En cas de non atteinte, totale ou partielle, de l’objectif de 5 % en 2009, le ministère de la justice devra rembourser le ministère de l’intérieur au prorata des extractions non évitées et donc des ETPT que le second a engagés pour les réaliser. La performance des cours d’appel sera ainsi appréciée au regard du nombre de visioconférences qui ont été réalisées dans le cadre de l’activité juridictionnelle en vue d’éviter des extractions inutiles.
En revanche, si la mobilisation des juridictions permet de dépasser cet objectif de 5 %, le ministre de la justice bénéficiera d’un intéressement financier et disposera à ce titre d’un transfert d’emplois sous forme de crédits de vacataires de la part du ministère de l’intérieur. Ces crédits de vacataires seront affectés aux cours d’appel les plus performantes.
Pour mettre en œuvre ce dispositif, le ministère de la justice a déployé des équipements de visioconférence dans l’ensemble des juridictions ainsi que dans les nouveaux établissements pénitentiaires du programme « 13 200 » (61).
À ce jour, l’ensemble des cours d’appel et des tribunaux de grande instance sont dotés du matériel et du logiciel de visioconférence : les 181 tribunaux de grande instance et les 35 cours d’appel sont dotés de 503 matériels de visioconférence, soit une moyenne de 2,3 équipements de visioconférence par juridiction. Le taux d’équipement des services judiciaires, qui est ainsi de 100 %, témoigne de l’effort réalisé.
Le bilan de l’équipement des établissements pénitentiaires peut apparaître, à première vue, moins satisfaisant que pour les juridictions. En effet, à la date du 1er mai 2009, 113 établissements pénitentiaires sur les 194 que compte notre pays, soit 3 établissements sur 5, disposent d’un équipement de visioconférence. 61 établissements pénitentiaires restent donc à équiper. Si ce niveau d’équipement est inférieur à celui des juridictions, toutes équipées, ces 113 établissements pénitentiaires couvrent près de 80 % de la population détenue. Selon les informations communiquées, la poursuite de l’équipement des établissements est programmée pour les années 2009 à 2011.
Depuis le début de l’année 2009, on a observé une forte augmentation de l’utilisation de la visioconférence. Ainsi, entre janvier et juin 2009, l’activité de la visioconférence a augmenté de 400 %, soit plus de quatre sessions par mois dans les établissements pénitentiaires équipés.
Interrogé sur ce point par votre rapporteur, M. Gilbert Azibert, secrétaire général du ministère de la justice, estime que cet objectif de diminution du nombre d’extractions judiciaires de 5 % sera tenu en 2009.
Cependant, l’indispensable rationalisation des moyens de l’État exige aujourd’hui une mobilisation encore plus forte des magistrats et des fonctionnaires du ministère de la justice pour intégrer pleinement le recours à la visioconférence dans leur pratique professionnelle. C’est pourquoi, votre rapporteur estime que, dans le champ d’application que la loi lui assigne actuellement, la visioconférence doit devenir la règle et les extractions judiciaires doivent rester l’exception. Seul le président du tribunal de grande instance ou de cour d’appel pourrait, dans les seuls cas où le recours à la visioconférence apparaît manifestement inadapté, autoriser une extraction judiciaire.
Proposition n° 23 : faire de la visioconférence la règle et des extractions judiciaires l’exception
Prévoir que, dans le champ d’application que lui assigne actuellement la loi, la visioconférence soit désormais la règle de droit commun et les extractions judiciaires l’exception. Seul le président du tribunal de grande instance ou de cour d’appel aurait le pouvoir d’autoriser une extraction judiciaire.
● Limiter les extractions médicales lorsqu’elles sont manifestement inutiles grâce au recours, chaque fois que possible, à la télémédecine et à la vidéo-consultation
Conformément aux règles pénitentiaires européennes, qui prévoient que « les détenus malades nécessitant des soins médicaux particuliers doivent être transférés vers des établissements spécialisés ou vers des hôpitaux civils, lorsque ces soins ne sont pas dispensés en prison » (62), la règle en détention est que les consultations de spécialistes impossibles à organiser en prison et les hospitalisations de prisonniers s’effectuent au sein des structures hospitalières de rattachement ou des unités spécialisées.
Or, comme M. Étienne Blanc, député de l’Ain, l’a rappelé dans son rapport sur la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes majeures sous main de justice (63), ces extractions médicales – environ 55 000 chaque année – s’avèrent particulièrement coûteuses – 1 300 euros en moyenne en Île-de-France (64) – et restent un point de blocage persistant entre l’administration pénitentiaire et les personnels médicaux. En effet, du côté de l’administration pénitentiaire, la gestion des extractions mobilise un nombre important d’agents. La circulaire n° 2004-07 du 18 novembre 2004 relative à l’organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l’objet d’une consultation médicale prévoit que l’escorte pénitentiaire est composée au minimum de deux agents et d’un chauffeur, qui peut également être un personnel pénitentiaire. Ainsi, le plus souvent, trois agents sont nécessaires pour organiser l’extraction médicale d’un seul détenu.
Les sorties médicales sont également difficiles à organiser puisqu’elles relèvent de plus en plus de la responsabilité unique de l’administration pénitentiaire conformément au programme de transfert en trois ans (2007-2009) à l’administration pénitentiaire de la mission de garde et d’escorte des détenus hospitalisés, autrefois dévolue à la police et à la gendarmerie nationales. Cependant, les escortes impliquent encore ces services selon des modalités variables localement. Le rapport de la mission d’audit et de modernisation de juillet 2007, consacré à la mission de garde et d’escorte des détenus hospitalisés, estimait le coût total des sorties pour hospitalisation à au moins 41 millions d’euros dont 17 supportés par l’administration pénitentiaire.
Afin de limiter les extractions médicales qui peuvent être évitées et de réserver ces dernières aux situations d’urgence ainsi qu’aux hospitalisations indispensables, votre rapporteur propose de densifier la prise en charge sanitaire dans les unités de consultation en soins ambulatoires (UCSA) grâce au recours, chaque fois que cela est possible, à la télémédecine et à la vidéo-consultation. Ainsi, comme le notait M. Nicolas About dans son avis sur le projet de loi pénitentiaire (65), « la télémédecine reste à développer, et notamment dans l’optique d’améliorer les soins en prison en raison de la difficulté des extractions pour consultation à l’hôpital. Ainsi, le coût initial d’investissement dans les dispositifs de télémédecine devrait être rapidement compensé par la réduction rapide des frais liés aux sorties, tant pour l’administration pénitentiaire que pour l’hôpital. » La télémédecine peut prendre une vraie place dans deux cas : la lecture des radios et la transmission des résultats de sérologie d’une part, les consultations à distance (cardiologie, dermatologie…) d’autre part.
Proposition n° 24 : limiter les extractions médicales lorsqu’elles sont manifestement inutiles grâce au recours, chaque fois que possible, à la télémédecine et à la vidéo-consultation
Densifier la prise en charge sanitaire dans les unités de consultation en soins ambulatoires grâce au recours plus intensif à la télémédecine et à la vidéo-consultation, afin de limiter les extractions médicales qui peuvent être évitées. Le coût initial d’investissement dans les dispositifs de télémédecine sera rapidement compensé par la réduction rapide des frais liés aux extractions, tant pour l’administration pénitentiaire que pour l’hôpital. Cela permettrait le recours plus simple à des médecins spécialistes.
d) Alléger la procédure de suspension du permis de conduire, en supprimant la phase administrative
Actuellement, la décision de suspension du permis de conduire peut être prise tant par l’autorité administrative que par l’autorité judiciaire. En pratique, dans une même affaire, cette décision est souvent prise par ces deux autorités de manière successive. Ainsi, lors de la constatation d’une conduite en état alcoolique par les forces de l’ordre, le mis en cause fait l’objet d’une suspension administrative immédiate de son permis de conduire par le préfet. La suspension judiciaire intervient postérieurement de manière relativement automatique. Le tableau ci-dessous détaille le nombre de suspensions judiciaires du permis de conduire entre 2002 et 2006.
NOMBRE DE MESURES RESTRICTIVES DU DROIT DE CONDUIRE PARMI L’ENSEMBLE DES CONDAMNATIONS POUR CRIMES, DÉLITS ET CONTRAVENTIONS DE 5È CLASSE INSCRITES AU CASIER JUDICIAIRE ENTRE 2002 ET 2006
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
En % | |
Total des mesures de substitution ou complémentaire |
224 009 |
245 781 |
248 941 |
265 776 |
276 216 |
100 % |
Dont : Suspension du permis de conduire |
129 459 |
141 034 |
134 015 |
135 157 |
140 627 |
50,9 % |
Interdiction du permis de conduire |
24 916 |
28 318 |
27 070 |
26 190 |
27 099 |
9,8 % |
Source : annuaire statistique de la justice, édition 2008.
À la lecture de ce tableau, il ressort très clairement que la suspension du permis de conduire constitue un contentieux de masse, puisqu’elle représente plus de la moitié des peines de substitution ou complémentaires prononcées en 2006 pour crimes, délits et contraventions de cinquième classe.
Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, la question du cumul entre suspension administrative et suspension judiciaire du permis de conduire a été examinée. Il n’a alors pas été envisagé de transférer la totalité des suspensions administratives à l’autorité judiciaire.
Or, parvenir à limiter les hypothèses dans lesquelles se cumulent suspension administrative et suspension judiciaire reste une préoccupation majeure, qui fait l’objet d’une attention particulière de votre rapporteur. En effet, la véritable difficulté pour le justiciable est l’apparente incohérence pouvant résulter des deux décisions : une personne interpellée pour conduite en état alcoolique voit son permis suspendu immédiatement par l’autorité préfectorale pour une durée de quatre mois ; elle comparaît devant le tribunal correctionnel cinq mois plus tard et se voit contrainte de restituer à nouveau son permis, parce qu’est prononcée une suspension du permis de six mois à titre de peine. Dans ces conditions, cette double procédure, administrative et judiciaire, reste le plus souvent incomprise du justiciable.
C’est pourquoi, afin d’éviter toute contradiction de décision en matière de suspension de permis, votre rapporteur propose d’aller plus loin, en supprimant la suspension administrative du permis de conduire et donc en ôtant la possibilité actuellement offerte à l’autorité préfectorale de prononcer une telle mesure. Il n’y aurait désormais qu’une seule procédure, contre deux actuellement : la suspension judiciaire du permis. Ainsi, lors de la constatation d’une infraction, pour laquelle la suspension est encourue, l’officier de police judiciaire pourra confisquer, pour un délai de quinze jours, le permis de conduire. Une décision judiciaire devrait alors nécessairement intervenir dans le délai de la suspension provisoire.
La mise en place d’une procédure unique de suspension du permis de conduire permettra d’éviter les coûts inhérents à tout processus trop complexe, faisant intervenir plusieurs autorités. Elle aura aussi l’insigne mérite de permettre une meilleure compréhension et acceptation de ces sanctions par les personnes en cause.
Proposition n° 25 : alléger la procédure de suspension du permis de conduire, en supprimant la phase administrative au profit d’une seule et unique phase judiciaire
Lors de la constatation d’une infraction pour laquelle la suspension du permis de conduire est encourue, le préfet ne pourra plus prononcer de suspension administrative provisoire.
Il ne subsistera donc qu’une seule procédure, contre deux actuellement : la suspension judiciaire du permis de conduire. Ainsi, lors de la constatation d’une infraction, pour laquelle la suspension est encourue, l’officier de police judiciaire pourrait confisquer, pour un délai de quinze jours, le permis de conduire. Une décision judiciaire devrait alors nécessairement intervenir dans le délai de la suspension provisoire.
3. Ministère de l’Immigration : améliorer l’exécution des mesures d’éloignement et systématiser la visioconférence
La création, au 1er janvier 2008, d’un ministère régalien de plein exercice, en charge de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire répond à une volonté de donner à la France une nouvelle politique en matière d’immigration et d’intégration.
Bien que de création récente, ce nouveau ministère, à l’instar des ministères régaliens, se doit d’être exemplaire dans sa gestion des deniers publics. Avec un budget de 560 millions d’euros en 2010, tant en crédits de paiement qu’en autorisations d’engagement, le poids financier de ce ministère reste certes faible au regard de la dépense totale de l’État, qui s’élèvera l’année prochaine à plus de 258 milliards d’euros. Cela n’exonère cependant pas en retour ce ministère de rationaliser et d’optimiser l’ensemble des moyens que l’État met à sa disposition.
Afin de mieux comprendre quelles sont les contraintes et les potentialités de cette jeune administration, la mission a auditionné M. Stéphane Fratacci, secrétaire général du ministère de l’immigration (66). À ce titre, elle se félicite que l’administration de ce ministère soit essentiellement tournée vers les politiques publiques, avec des fonctions support volontairement plus resserrées. Cependant, des gisements d’économies peuvent encore être exploités et il convient pour ce faire de mettre en œuvre deux actions fortes : la création d’un ajournement de peine avec injonction de quitter le territoire pour les étrangers en situation irrégulière et la fin des escortes coûteuses des retenus entre les centres de rétention administrative et les salles d’audiences grâce à la systématisation de la visioconférence.
a) Créer un ajournement de peine avec injonction de quitter le territoire français pour les étrangers en situation irrégulière
Il est ressorti des travaux réalisés par la mission que le taux d’exécution des mesures d’éloignement, encore trop faible à ce jour, devait être significativement amélioré. En effet, en 2008, moins d’une mesure d’éloignement sur cinq est exécutée.
EXÉCUTION DES MESURES D’ÉLOIGNEMENT FORCÉ 2002-2008 EN MÉTROPOLE (67)
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 | |
Mesures prononcées |
16 406 |
55 938 |
69 580 |
73 705 |
80 946 |
112 010 |
101 539 |
Mesures exécutées |
10 067 |
12 482 |
15 660 |
19 841 |
22 412 |
19 885 |
19 724 |
Taux d’exécution |
62,1 % |
22,3 % |
22,5 % |
26,9 % |
27,7 % |
17,8 % |
19,4 % |
Source : Cour des comptes à partir des données du ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.
Or, chaque fois qu’une mesure d’éloignement est prononcée, mais non exécutée, c’est l’autorité de la puissance publique qui s’affaiblit. C’est pourquoi, votre rapporteur juge nécessaire de favoriser tous les moyens concourant à l’amélioration de l’exécution des mesures d’éloignement.
Dans cette perspective, votre rapporteur considère que la rencontre entre la justice et une personne sous le coup d’une mesure d’éloignement constitue une opportunité à saisir pour favoriser l’exécution d’une telle mesure et, dans le même temps, maîtriser la dépense publique, en limitant les coûts liés à l’exécution d’une peine.
Ainsi, une personne, à l’encontre de laquelle a été prononcée une mesure d’éloignement (interdiction du territoire français, reconduite à la frontière, expulsion, obligation de quitter le territoire français) commet sur le territoire français une infraction. Deux cas de figure sont alors envisageables.
En premier lieu, pour les infractions les moins graves, le Procureur devrait pouvoir suspendre les poursuites, avec injonction faite au prévenu de quitter le territoire français. L’exécution de la mesure d’éloignement permettrait seulement de différer, et non d’abandonner, les poursuites. Si l’auteur des faits venait de nouveau à entrer de manière irrégulière sur le territoire français, alors le Procureur engagerait les poursuites qui s’imposent. L’objectif de cette proposition est double : rendre effective une mesure d’éloignement et éviter toutes les dépenses liées à l’engagement de poursuites, à la tenue d’un procès et, en dernier ressort, à l’exécution d’une peine.
Proposition n° 26 : permettre au Procureur de la République de suspendre les poursuites avec injonction de quitter le territoire pour les étrangers en situation irrégulière ayant commis une infraction de faible gravité
Pour les infractions les moins graves, permettre au Procureur de la République de suspendre les poursuites avec injonction de quitter le territoire français, lorsque le prévenu est sous le coup d’une mesure d’éloignement et qu’il accepte de quitter le territoire. Si celui-ci entre de nouveau sur le territoire français, sans y être autorisé, alors le Procureur de la République engagera les poursuites. Celles-ci sont donc simplement différées et non abandonnées. Cette proposition entend rendre effective une mesure d’éloignement et, dans le même temps, éviter toutes les dépenses liées à l’engagement de poursuites, à la tenue d’un procès et, en dernier ressort, à l’exécution d’une peine.
En second lieu, si la gravité de l’infraction est telle qu’elle justifie l’engagement de poursuites par le Procureur de la République, la juridiction de jugement, après avoir reconnu le prévenu coupable, devrait pouvoir ajourner, pendant un mois, le prononcé de la peine, afin de permettre, pendant cet ajournement, l’exécution effective de la mesure d’éloignement. À l’audience de renvoi, deux hypothèses méritent d’être distinguées. Tout d’abord, si la mesure d’éloignement n’a pas été exécutée pendant la période d’ajournement du procès, la juridiction de jugement prononce la sanction prévue par la loi. Ensuite, si la mesure d’éloignement a été exécutée pendant la durée de l’ajournement, la juridiction de jugement dispense le prévenu de peine pour autant qu’il n’entre pas de nouveau et sans autorisation sur le territoire français. Si tel était le cas, alors la peine serait prononcée et exécutée.
L’objectif de cette proposition de votre rapporteur est double : rendre effective une mesure d’éloignement par un départ volontaire du prévenu et éviter les dépenses liées à l’exécution d’une peine. En effet, l’exécution d’une peine a toujours un coût pour la collectivité, coût que celle-ci ne saurait ignorer. Alors qu’une journée de prison coûte en moyenne soixante euros par détenu à l’administration pénitentiaire, le coût du placement sous surveillance électronique est pour sa part d’environ 30 euros par jour. L’ajournement de peine avec injonction de quitter le territoire français permettra ainsi de limiter les coûts liés à l’exécution d’une peine et de rendre effective une mesure d’éloignement. Le gain pour la société est double : aux économies budgétaires ainsi réalisées, viendra s’ajouter une meilleure maîtrise de l’immigration irrégulière.
COÛT PAR JOURNÉE DE DÉTENTION PAR TYPE D’ÉTABLISSEMENT EN 2007
Centre de détention |
Centre pénitentiaire |
Maison d’arrêt |
Maison centrale |
Coût moyen | |
Gestion publique |
81,06 € |
75,40 € |
65,35 € |
163,24 € |
71,81 € |
Gestion déléguée |
69,81 € |
68,40 € |
67,56 € |
– |
68,49 € |
Source : direction de l’administration pénitentiaire
Cependant, il convient à ce stade de préciser que cet ajournement de peine avec injonction de quitter le territoire français ne peut s’appliquer indifféremment à toutes les infractions. Votre rapporteur propose donc qu’il soit limité aux infractions pour lesquelles les peines encourues sont limitées. En effet, au-delà d’un certain seuil de peines, la gravité de l’infraction commise est telle qu’il semble difficilement possible de reconduire une personne en situation irrégulière dans son pays d’origine, sans qu’elle ait exécuté cette peine et sans avoir non plus la garantie qu’elle l’exécutera dans son pays d’origine.
Par ailleurs, cet ajournement de peines avec injonction de quitter le territoire ne doit pas en retour léser le droit à réparation de la victime. Afin de garantir effectivement ce droit, il convient de limiter son application aux cas où la victime a été indemnisée ou pourra être indemnisée en dépit du départ de l’auteur des faits du territoire français. S’il apparaît que la mise à exécution de la mesure d’éloignement entraînerait une atteinte au droit à indemnisation de la victime, l’ajournement avec injonction de quitter le territoire devra être exclu.
Ce dispositif visant à favoriser l’éloignement des personnes, qui ont en parallèle commis une infraction, s’inspire en partie de l’article 132-70-1 du code pénal, créé par la loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration et abrogé par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile. Cet article prévoyait un ajournement de peine avec rétention judiciaire : la juridiction pouvait – après avoir déclaré le prévenu coupable de s’être soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement ou d’avoir pénétré de nouveau et sans autorisation sur le territoire, après en avoir été expulsé – ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de présenter à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution de la mesure d’éloignement.
Proposition n° 27 : créer un ajournement de peine avec injonction de quitter le territoire pour les auteurs d’infraction sous le coup d’une mesure d’éloignement
Si la gravité de l’infraction est telle qu’elle justifie l’engagement de poursuites par le Procureur de la République, la juridiction de jugement, après avoir reconnu le prévenu coupable, pourra ajourner, pendant un mois, le prononcé de la peine, afin de permettre, pendant cet ajournement, l’exécution effective de la mesure d’éloignement par un départ volontaire du prévenu.
Il semble opportun de réserver cet ajournement de peine avec injonction de quitter le territoire français aux infractions pour lesquelles les peines encourues sont limitées.
S’il apparaît que la mise à exécution de la mesure d’éloignement entraînerait une atteinte au droit à indemnisation de la victime, l’ajournement avec injonction de quitter le territoire devra être exclu.
L’objectif de cette mesure est double : rendre effective une mesure d’éloignement et éviter les dépenses liées à l’exécution d’une peine.
b) Limiter les escortes des retenus entre les centres de rétention administrative et les salles d’audiences grâce à la systématisation de la visioconférence
Dans son rapport sur la gestion des centres de rétention administrative (68), M. Pierre Bernard-Reymond, sénateur, a souligné que « le coût des escortes des retenus entre les centres de rétention administrative et les salles d’audiences était particulièrement élevé : 1,3 million d’euros par an » hors temps d’attente et d’audience. À ce jour, l’opportunité de recourir plus systématiquement aux dispositifs de visioconférence, qui réduiraient sensiblement ces coûts, ne semble pas suffisamment exploitée par les pouvoirs publics.
La Cour des comptes, dans son enquête relative à la gestion des centres de rétention administrative, notait à ce titre que « les dépenses consacrées aux escortes sont importantes. Les efforts entrepris pour réduire ces coûts, salles d’audience délocalisées ou visioconférence, ont jusqu’à présent eu des résultats assez minces ».
À cet égard, il convient de rappeler que l’article L. 552-12 du code d’entrée et séjour des étrangers et droit d’asile ouvre la possibilité pour l’autorité administrative compétente de proposer au juge l’utilisation des moyens de communication audiovisuelle – visioconférence – sous réserve du consentement de l’étranger.
Pour en faciliter le recours, la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile a assoupli les conditions de recueil du consentement du retenu en prévoyant que ce dernier est supposé consentir à la visioconférence sauf si, dûment informé dans une langue qu’il comprend, il s’y oppose.
Dans les faits, les réticences à un recours accru de la visioconférence s’appuient sur les difficultés d’organiser un vrai débat sans la présence, simultanée et active, des acteurs concernés. Seul le centre de rétention administrative de Lyon utilise la visioconférence à titre expérimental pour les auditions des demandeurs d’asile retenus en CRA. Du bilan établi par le CRA de Lyon, il ressort que du 1er février au 1er décembre 2008, 215 demandes d’asile ont été faites, 39 personnes ont eu accès à la visioconférence pour 48 convoquées à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à Paris (69).
La Cour note ainsi dans son enquête que « ce bilan est mince alors que certains tribunaux disposent désormais d’équipements de visioconférence ». Les CRA en sont certes le plus souvent dépourvus, mais le coût de ces dispositifs, évalués globalement par la police aux frontières, pour une implantation dans tous les CRA, à 660 000 euros la première année (équipement) et à 84 000 euros par année suivante (fonctionnement) rend l’investissement très rentable au vu du coût des escortes, estimé à 1,3 million d’euros. En définitive, une fois l’équipement de tous les CRA réalisé, l’économie réalisée les années suivantes serait d’un peu plus d’un million d’euros.
Fort de ce constat, votre rapporteur propose de faire de la visioconférence la règle et les escortes l’exception, en systématiser avant le 1er janvier 2011 le recours à la visioconférence, afin de limiter les escortes trop coûteuses des retenus entre les CRA et les salles d’audience.
Proposition n° 28 : systématiser avant le 1er janvier 2011 le recours à la visioconférence, afin de limiter les escortes entre les centres de rétention administrative et les salles d’audience
Systématiser avant le 1er janvier 2011 le recours à la visioconférence, afin de limiter les escortes des retenus entre les centres de rétention administrative et les salles d’audience.
II. MIEUX ORGANISER LES COLLECTIVITÉS LOCALES
Si l’État doit être l’initiateur et le catalyseur d’une politique ambitieuse de maîtrise de la dépense publique, il ne saurait être seul à mener ce combat. Tous ces efforts entrepris par celui-ci seraient, en effet, vains s’ils n’étaient pas efficacement relayés par les collectivités locales.
La réduction de la dette et du déficit, qu’exige la crise sans précédent vers laquelle notre pays se dirige, est un « fardeau » que l’État ne peut, ni ne doit supporter seul. Aussi les collectivités territoriales sont-elles aujourd’hui appelées à s’engager dans une démarche volontariste de gestion vertueuse et équilibrée des deniers publics.
Forte de ce constat, la mission avait souligné, lors de sa réunion constitutive du 22 juillet 2009, la nécessité de rencontrer chacune des grandes associations d’élus locaux (assemblée des départements de France, association des régions de France, association des maires de France et association des communautés de France) et de travailler de concert avec eux. C’est ce à quoi s’est employée la mission tout au long de ses travaux.
Lors de son audition par la commission des Lois, le 7 octobre 2007, nombre de commissaires ont souhaité interroger M. Philippe Séguin, premier président de la Cour des comptes, sur des questions ayant trait aux finances locales. Parce que celles-ci sont au cœur de la compétence de la commission des Lois, la mission se devait de faire des propositions sur le sujet.
À l’issue de ses travaux, il apparaît de manière très claire que la maîtrise de la dépense publique locale nécessite l’engagement immédiat de deux chantiers prioritaires : réduire l’ensemble des doublons qui conduisent à multiplier les interventions coûteuses et faire des collectivités des acteurs publics exemplaires.
A. RÉDUIRE LES DOUBLONS QUI CONDUISENT À MULTIPLIER LES INTERVENTIONS COÛTEUSES
Source d’inefficacité publique, l’enchevêtrement des compétences diminue la compétitivité de notre économie. Le rapport de la commission pour la libération de la croissance française, présidée par M. Jacques Attali, notait ainsi que « l’enchevêtrement des compétences entre les collectivités territoriales elles-mêmes, et entre celles-ci et l’État, crée des surcoûts ». Les deux principaux effets négatifs de cet enchevêtrement sur l’économie française sont, d’une part, son impact négatif sur la maîtrise des finances publiques et, d’autre part, son impact diffus mais certain sur la compétitivité des entreprises.
C’est pourquoi votre rapporteur estime que le retour à l’équilibre des comptes publics ne peut raisonnablement se concevoir sans la suppression des doublons qui subsistent entre collectivités territoriales et entre ces dernières et l’État. Afin d’y parvenir, deux actions prioritaires doivent être mises en œuvre : la mutualisation systématique des services entre communes et communautés, d’une part, et la suppression des doublons entre l’État et les collectivités locales, d’autre part.
1. Mutualiser les services entre communes et communautés
La chasse aux doublons doit être l’un des chantiers prioritaires de tout projet d’optimisation de la dépense publique locale. Or, si la pluralité des niveaux territoriaux est indispensable à la bonne administration de la France, celle-ci ne doit pas entraîner un dédoublement des moyens matériels et humains. À cet égard, l’encouragement de l’intercommunalité a constitué la première étape dans la perspective d’une meilleure efficacité de la dépense publique. En effet, en mutualisant les moyens à l’échelon supracommunal, des économies d’échelle ont pu être effectuées.
Cependant, une deuxième étape doit désormais être franchie, afin que les intercommunalités ne deviennent pas un échelon territorial supplémentaire, qui se superposerait aux communes qui en sont membres. C’est pourquoi les représentants des associations d’élus locaux ont plaidé pour que soit facilitée la mutualisation des moyens entre communes et communautés. Ainsi, les représentants de l’association des Communautés de France, MM. Daniel Delaveau et Michel Piron, ont estimé durant leur audition que la mutualisation des services constituerait le moyen de dégager des économies et de mieux gérer les ressources humaines (70).
En effet, les estimations disponibles concernant les communautés qui ont mis en œuvre cette mutualisation montrent à quel point les avantages qui en découlent sont considérables, tant d’un point de vue financier, que de celui de la qualité du service rendu. De surcroît, les possibilités juridiques de mutualisation ont été développées et clarifiées, rendant plus sûr le recours à cette pratique. Mais seules des incitations fortes permettront de compenser le manque de volonté de certains, afin de généraliser les économies d’échelle qui découlent de la mutualisation des moyens.
a) Des économies d’échelle potentiellement considérables
La mutualisation des services communaux et intercommunaux présente trois avantages principaux, relevés par le rapport de Pierre Richard sur la maîtrise des dépenses publiques locales (71), qui permettent, à terme, de réaliser des économies substantielles pour les finances locales :
— Supprimer les doublons entre niveau d’administration locale et intercommunale. Regrouper les services « fonctionnels » intercommunaux avec ceux de la commune-centre (par exemple les services informatiques, juridiques, de gestion des ressources humaines ou des archives) permet incontestablement de rationaliser la dépense locale. Par exemple, dès 2002, l’ensemble des services fonctionnels de la ville de Brest sont devenus communs à la ville et à la communauté urbaine.
— Favoriser la cohérence de l’action locale. En effet, la superposition de moyens équivalents peut induire des politiques publiques non-coordonnées voire concurrentes entre niveau communal et niveau intercommunal. Ainsi, la mutualisation des services de la ville de Mulhouse et de la communauté d’agglomération de Mulhouse Sud Alsace (CAMSA) a-t-elle permis de mettre en œuvre des projets concourant à l’attractivité de l’agglomération dans son ensemble (72).
— Accroître la qualité du service rendu. Dans la mesure où les services sont mutualisés, leur efficacité est décuplée. En effet, ils sont alors en mesure, d’une part, d’apporter l’expertise nécessaire à la ville-centre, par une spécialisation accrue des activités et, d’autre part, de donner un niveau d’accès satisfaisant à ces mêmes services pour les communes de taille plus réduite. De même, la communauté bénéficie alors des compétences des services de la ville-centre tout en maîtrisant l’évolution de ses coûts de fonctionnement.
Or, chacun de ces avantages, découlant de la mutualisation des services, entraîne des économies substantielles, qui, de surcroît, sont réalisées sur le long terme : les exemples chiffrés issus des bonnes pratiques existantes le montrent.
700 000 € ÉCONOMISÉS CHAQUE ANNÉE PAR LA MUTUALISATION DES SERVICES AU BÉNÉFICE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE PAU-PYRÉNÉES
D’après le rapport de la Cour des comptes de 2005 consacré à L’intercommunalité en France, la communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées a bénéficié de la mise en commun d’un grand nombre de services de la ville centre. La communauté prend en charge les indemnités accessoires des agents qui travaillent pour elle au-delà de leur temps normal de service et elle rembourse à la ville de Pau une partie de la masse salariale des agents mis à disposition. ¨
Ainsi, les économies générées ont été évaluées à 700 000 euros. En effet, la mise en place d’une structure propre à la communauté aurait coûté 960 000 euros par an, alors qu’elle ne verse à la commune que 260 000 euros par an.
De surcroît, le service rendu à la communauté et à la commune est de meilleure qualité puisque le prix unitaire du repas de cantine a baissé de 12,6 % suite au regroupement des moyens et des achats de denrées.
Sources : Cour des comptes, L’intercommunalité en France, 2005, p. 125 et Pierre Richard, Solidarité et performance. Les enjeux de la maîtrise des dépenses publiques locales, 2006, p. 66.
512 000 € DE FRAIS DE FONCTIONNEMENT ÉCONOMISÉS CHAQUE ANNÉE À BLOIS,
SELON LA TRIBUNE
« Les services administratifs de Blois et de l’agglomération ont donc été fusionnés et sont chapeautés par un même directeur général, Olivier Grégoire. De même, l’action sociale a été communautarisée, avec le regroupement des CCAS (centres communaux d’action sociale) au sein d’un Cias (centre intercommunal d’action sociale) le plus important de France avec 240 agents. Cette mutualisation vise d’abord à accompagner le développement d’Agglopolys et à réaliser des économies d’échelle, en évitant les " doublons ". L’objectif a été atteint après un an de mutualisation avec une économie de 512 000 euros de frais de fonctionnement. D’autres réflexions arrivent également à leur terme. Ainsi dans le tourisme, Agglopolys s’est associé à 23 autres communes pour créer une force de 108 000 habitants et un office du tourisme intercommunal, chargé de promouvoir les richesses touristiques du Blaisois. »
Source : La Tribune, « Blois refuse les usines à gaz », 11 octobre 2006.
b) Des possibilités juridiques désormais sécurisées
Si la mutualisation des services pouvait être juridiquement risquée à ses débuts, le contexte juridique a été progressivement clarifié, tant par l’intervention du législateur national que par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE). Elle peut donc être mise en œuvre par toutes les communautés dans un contexte juridique sécurisé.
Depuis la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et celle du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un cadre juridique explicite régit la mutualisation des services entre communes et communauté. En effet, le paragraphe II de l’article L. 5211-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ouvre la possibilité aux communautés et aux communes de conclure des conventions par lesquelles des services peuvent être mis à disposition de l’une ou l’autre des parties. Des conventions types ont été élaborées pour faciliter la mise en œuvre de cette procédure (73).
L’ARTICLE L. 5211-4-1 OFFRE UN CADRE JURIDIQUE À LA MUTUALISATION DES SERVICES
« II.-Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services. Une convention conclue entre l’établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service.
« Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les services d’une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’un établissement public de coopération intercommunale pour l’exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services. […] »
Ce cadre a néanmoins été contesté par la Commission européenne, qui estimait que la mutualisation des services pouvait être considérée comme un marché public, entrant par conséquence dans le champ d’application des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE relatives aux marchés publics et nécessitant que soit lancée une procédure d’appel d’offres. Elle menaçait de surcroît de saisir le juge communautaire si la législation française n’était pas modifiée en ce sens. La France a contesté cette position, arguant du fait que la mise à disposition de services n’était qu’une modalité d’organisation interne de l’administration locale.
Or, la jurisprudence de la CJCE a évolué dans un sens favorable à la mutualisation de services et donc à la position française. Dans un arrêt récent, du 6 juin 2009 (74), la Cour a en effet estimé qu’une convention de prestations de services conclue entre des communes pouvait échapper aux directives régissant les marchés publics. Cette décision intervient à la suite d’un autre arrêt où la Cour avait jugé qu’une commune belge avait pu attribuer, sans appel public à la concurrence, la gestion d’un service public à une société coopérative intercommunale dont tous les affiliés étaient des autorités publiques (75). Le Conseil d’État avait suivi cette analyse dans un arrêt du 4 mars 2009 (76).
c) Une volonté souvent défaillante, qui doit être compensée par des incitations fortes
Le contexte juridique a donc été largement clarifié et les économies réalisables ont été quantifiées. Dans ce contexte, comment expliquer le faible développement de la mutualisation des services entre communes et communautés ?
Les représentants d’élus locaux auditionnés par la mission ont indiqué que cette mutualisation des services se heurtait souvent à un manque de volonté politique locale. Ainsi, M. Michel Piron, membre de l’association des communautés de France, a-t-il estimé que la mutualisation des moyens entre les communes et les structures intercommunales était très inégale selon les territoires du fait des traditions et des cultures politiques locales. Cette opinion a été confirmée par M. Philippe Laurent (77), président de la commission des finances de l’association des maires de France, qui a précisé que des blocages persistants étaient observés (78). Ce constat n’est pas isolé. Il avait déjà été fait par les nombreux rapports publiés ces dernières années sur les collectivités locales, qui encourageaient tous le renforcement de la mutualisation des services.
Devant l’ampleur des économies réalisables, qui contraste avec la « spirale inflationniste » (79) que connaissent les effectifs communautaires, il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures incitatives fortes conduisant communautés et communes à mutualiser leurs services. Deux propositions avaient à ce titre étaient formulées dans des rapports précédents :
— « Introduire dans le calcul de la DGF des EPCI à fiscalité propre un nouveau critère appelé « le coefficient d’intégration fonctionnelle » mesurant le degré de mutualisation des services entre l’EPCI et ses communes membres » (80) ;
— « Pour les EPCI, rendre obligatoire à échéance de cinq ans la mise en œuvre d’un plan de rationalisation des structures administratives communales et intercommunales permettant de dégager des économies d’échelle à compétences constantes. Le calcul de la dotation globale de fonctionnement des EPCI et de leurs communes membres tiendra compte de cette rationalisation. Rendre public les gains en coût et en qualité de services résultant de cette réorganisation » (81).
Votre rapporteur propose pour sa part d’aller plus loin en donnant, avant le 1er janvier 2011, compétence obligatoire aux établissements publics de coopération intercommunale pour mutualiser les structures administratives communales et intercommunales. Afin de faciliter l’exercice de cette compétence destiné à réaliser des économies d’échelle et à délivrer un service public local de meilleure qualité, il devrait pouvoir se faire sur la base un vote à la majorité simple de l’assemblée intercommunale, alors qu’actuellement les décisions des intercommunalités ne peuvent être prises qu’à la majorité des deux tiers.
Proposition n° 29 : réduire les doublons entre communes et intercommunalités en donnant, avant le 1er janvier 2011, compétence obligatoire aux structures intercommunales pour mutualiser les services
Afin de réaliser d’importantes économies d’échelle, donner compétence obligatoire aux établissements publics de coopération intercommunale pour mutualiser les structures administratives communales et intercommunales. L’exercice de cette compétence obligatoire des EPCI se fera sur la base d’un vote à la majorité simple des assemblées intercommunales.
2. Mettre fin aux doublons entre l’État et les collectivités locales
Au cours des travaux réalisés par la mission, il est apparu plus que jamais nécessaire de mettre fin aux doublons de compétences existant entre l’État et les collectivités territoriales.
En effet, les associations d’élus locaux entendues par la mission ont souligné que, plus d’un quart de siècle après les grandes lois de décentralisation, l’État n’en a pas encore tiré les conséquences en termes d’organisation de ses services déconcentrés et n’a pas supprimé certains de ses services déconcentrés intervenant en doublons dans le champ de compétences des collectivités locales. Le rapport du comité pour la réforme des collectivités locales, présidé par M. Édouard Balladur, a ainsi rappelé que « l’État n’a pas achevé la déconcentration qui était supposée être le corollaire de la décentralisation et que les doublons administratifs sont encore nombreux, ce qu’illustre le fait que la fonction publique locale a connu un accroissement sensible de ses effectifs depuis 25 ans, sans qu’en aient été véritablement affectés les effectifs de la fonction publique de l’État » (82).
En effet, lorsque l’État procède à des transferts de compétences, il ne réorganise pas toujours la structure administrative qui assurait auparavant l’exercice de cette compétence, si bien que le doublonnement des structures peut persister. En 1990, un auteur s’étonnait déjà : « Il est tout de même remarquable que les transferts de compétences aux collectivités territoriales, sources de nouvelles structures à l’échelon local pour exercer les nouvelles missions confiées à ces dernières, n’aient guère eu d’incidence sur l’administration centrale. » (83)
Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, certaines missions d’audit de modernisation ont porté sur l’impact de la décentralisation sur certaines administrations d’État. Le rapport sur le ministère de l’Équipement (84) fait ainsi apparaître que, si la décentralisation a été accompagnée d’une réduction de l’effectif des services déconcentrés du ministère d’environ 25 %, en revanche l’effectif de l’administration centrale est resté relativement stable depuis 1981. En ce qui concerne le ministère de la Santé et le ministère de l’Emploi, un autre audit fait apparaître de la même manière une relative inertie de la structure des emplois des administrations d’État. Cet audit signale également la persistance d’interventions directes de l’État dans les matières transférées, qui entraîne des pertes d’efficacité et des surcoûts (85).
Lors de son audition par votre rapporteur, M. Philippe Laurent, maire de Sceaux et président de la commission des finances de l’association des maires de France, a partagé ce constat suivant lequel l’État n’a pas à ce jour tiré toutes les conséquences de la décentralisation en matière d’organisation de ses services, ce qui a pu conduire à l’apparition de doublons entre l’administration de l’État et celles des collectivités locales. Il en est ainsi dans certains services de l’équipement, par exemple. Il convient donc de réaliser dans ces domaines des économies de personnels, en transférant ces compétences très ponctuelles de l’État vers les collectivités.
Or, l’existence de ces nombreux doublons n’est pas sans effet sur la maîtrise de la dépense publique, dans la mesure où ils compliquent les procédures de décision et en alourdissent le coût. La réforme annoncée des collectivités locales et la révision générale des politiques publiques doivent être l’occasion pour l’État de tirer enfin toutes les conséquences des lois de décentralisation et d’éliminer tous les doublons de compétences entre services déconcentrés et administrations décentralisées. C’est pourquoi, votre rapporteur propose qu’à l’occasion du dépôt au Parlement du projet de loi sur la réforme des collectivités territoriales, le Gouvernement dresse, dans l’étude d’impact afférente, désormais rendue obligatoire par l’article 39 de la Constitution et l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 (86), un inventaire exhaustif et chiffré de tous les doublons administratifs qui subsistent entre l’État et les collectivités territoriales.
Proposition n° 30 : appeler le Gouvernement à dresser un bilan exhaustif et chiffré des doublons administratifs entre État et collectivités locales à l’occasion de l’examen de la réforme des collectivités locales
Lors de l’examen au Parlement du projet de loi sur la réforme des collectivités territoriales, le Gouvernement devra dresser, dans l’étude d’impact jointe au projet, un bilan exhaustif et chiffré des doublons administratifs qui existent entre l’État et les collectivités territoriales.
B. POUR DES COLLECTIVITÉS LOCALES EXEMPLAIRES
Comme votre rapporteur l’a précédemment souligné, la dépense publique locale occupe désormais une place majeure au sein de nos finances publiques, puisqu’elle représente en 2009 plus de 10 % de la richesse nationale produite par notre pays. En outre, un euro de dépense publique sur cinq est aujourd’hui le fait des collectivités locales.
Parce que la mission est pleinement consciente que prétendre vouloir assainir les comptes publics en occultant la maîtrise de la dépense locale serait un vœu pieux, elle considère qu’à l’instar des efforts exigés de l’État, les collectivités locales doivent se montrer exemplaires dans la gestion qu’elles font des deniers publics.
Pour ce faire, trois chantiers prioritaires sont au cœur des préoccupations de la mission : taxer les dépenses de communication des collectivités dans leur propre ressort, mieux encadrer les subventions accordées par les collectivités aux associations et, enfin, mettre fin à la dérive des financements croisés entre collectivités.
1. Taxer les dépenses de communication des collectivités locales
Au cours de ces dernières années, nombre de parlementaires ont attiré l’attention des pouvoirs publics sur l’inflation des dépenses de communication des collectivités territoriales. Ainsi, dans une question écrite du 2 novembre 2006, le député Alain Suguenot rappelait la forte hausse des dépenses de communication observées dans certaines collectivités : « Ainsi, en Bourgogne, l’augmentation a été de 176 % pour la seule année 2005, comme le relève M. Hervé Mariton, député de la Drôme, dans son rapport (n° 2436) au nom de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur l’évolution de la fiscalité locale ». Il soulignait également combien ces dépenses étaient « difficiles à mesurer car elles sont rarement appréhendées comme telles dans les budgets des collectivités » (87).
Dans sa réponse (88), le ministre de l’Intérieur avait estimé que « dans le souci légitime de maîtrise de la dépense publique, les dépenses de communication doivent pouvoir faire l’objet d’une évaluation de leur efficacité et de leur efficience ». Le rapport de la Commission d’enquête parlementaire sur l’évolution de la fiscalité locale présenté en 2005 par notre collègue Hervé Mariton fait ainsi état des résultats d’un questionnaire spécifique de la commission auprès des régions sur le montant de leurs dépenses de représentation et de communication. Des 17 réponses recueillies, il ressort que ces dépenses représentent 0,38 % de la dépense réelle totale pour l’année 2005. Les rubriques ventilant les dépenses par fonction dans les instructions budgétaires et comptables ne font apparaître qu’imparfaitement ces dépenses, le plus souvent imputées aux services généraux des administrations publiques locales, mais qui peuvent également relever par exemple de l’action économique (promotion du territoire) ou des interventions sociales et santé (information des bénéficiaires, prévention).
De même, la nature des dépenses engagées est hétérogène puisqu’il peut s’agir de frais de personnels de la collectivité affectés – éventuellement partiellement – à ces fonctions, de frais d’impression ou d’achat d’espace, comme de rémunération de prestations extérieures plus ou moins complètes en matière de communication. Ainsi, si l’analyse dans les budgets locaux des dépenses exécutées au chapitre budgétaire « publicité, publications, relations publiques » permet d’identifier certaines dépenses de communication, elle ne permet toutefois qu’une analyse partielle de ces dépenses.
Par conséquent, il n’existe pas à ce jour de données centralisées permettant d’appréhender sur plusieurs années les dépenses consacrées à ces actions dans toutes leurs dimensions et pour toutes les collectivités territoriales. Or, maintes initiatives ont été entreprises ces dernières années afin de limiter les dépenses de communication des collectivités territoriales. Ainsi, M. Pierre Morel-À-L’Huissier, membre de la présente mission d’information, a déposé en 2008 une proposition de loi visant à encadrer ces dépenses, soumettant les différentes collectivités au respect d’une règle vertueuse : les dépenses annuelles de communication des collectivités territoriales ne doivent pas excéder 0,3 % de leur budget local (89).
Au regard de la cause nationale qu’est aujourd’hui devenue la maîtrise de la dépense publique, une telle situation ne saurait perdurer plus longtemps. C’est pourquoi, votre rapporteur propose que les dépenses de communication soient désormais appréhendées comme telles dans les budgets locaux, dans un souci de transparence démocratique à l’égard du contribuable local.
Proposition n° 31 : identifier précisément dans les budgets des collectivités territoriales les dépenses de communications
Dans un souci de lisibilité et de transparence démocratique à l’égard du contribuable local, obliger les collectivités territoriales à identifier, de manière exhaustive, l’ensemble des dépenses de communication dans leurs budgets.
En outre, il convient de s’interroger sur l’utilité et l’efficacité de telles dépenses. En effet, si les collectivités exercent depuis longtemps de nombreuses compétences au service de leurs populations et leur offrent à ce titre des services publics de qualité, la communication ne fait pas partie en tant que telle des missions incombant aux collectivités. Puisque l’argent public est devenu rare et que notre pays se dirige irrésistiblement vers une crise majeure des finances publiques, la dépense publique doit permettre aux acteurs publics d’accomplir dans de bonnes conditions leurs missions fondamentales. Aussi les dépenses de communication des collectivités locales dans leur propre ressort, dépenses qui ne constituent pas le cœur de métier des collectivités, doivent être taxées, le rendement de cette taxe étant affecté à la CADES et à la réduction de la dette sociale.
Proposition n° 32 : taxer les dépenses de communication des collectivités locales, dans leur propre ressort, au profit de la CADES
Taxer les dépenses de communication des collectivités locales, dans leur propre ressort, le rendement de cette taxe étant affecté de plein droit à la CADES et à la réduction de la dette sociale.
2. Mieux encadrer les subventions aux associations
Afin de soutenir la vitalité du tissu associatif français, les différents niveaux de collectivités publiques peuvent verser aux différentes associations de leur choix des subventions. Celles-ci ont une double portée, financière et symbolique : en même temps qu’elles permettent aux structures associatives de fonctionner, les subventions sont perçues comme une reconnaissance par la collectivité de l’utilité des activités qu’elles mènent ou bien des services qu’elles offrent.
Ainsi, les associations déclarées peuvent recevoir des subventions de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Ces subventions sont le plus souvent octroyées sous forme financière, mais rien ne s’oppose à ce qu’elles le soient en nature (fourniture de biens ou de personnes).
Le versement d’une subvention à une association est toutefois soumis à un certain nombre de conditions d’attribution et d’utilisation. En tout état de cause, la subvention doit être sollicitée et les collectivités publiques disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour l’accorder ou la refuser.
a) Dans les faits, les associations sont soumises à une série de contrôles et d’obligations législatives et réglementaires
Lorsqu’elle accorde une subvention sous certaines conditions (aide directe, réalisation d’un projet, organisation d’une manifestation...), l’administration peut en contrôler l’utilisation. Ce contrôle peut être financier (justificatifs comptables de l’association), administratif (vérification du bon emploi de la subvention) ou juridictionnel (en cas de gestion de fait de fonds publics notamment).
Ainsi, l’autorité administrative qui attribue une subvention dépassant 23 000 euros doit conclure une convention avec l’organisme privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.
Par ailleurs, l’article 22 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif impose aux personnes morales de droit public de tenir à la disposition du public le montant des subventions versées aux associations et de publier un bilan annuel consolidé chaque année.
Si les obligations liées à la gestion financière des associations, recevant des subventions de la part de collectivités publiques, ne sont pas récentes, elles ont vu leur effectivité renforcée ces dernières années.
L’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 a modifié en profondeur les obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels.
En premier lieu, les associations ayant reçu un montant global annuel de subventions ou de dons qui excède un seuil fixé par décret de 153 000 euros ont l’obligation de tenir des comptes certifiés (bilan, compte de résultats, annexe comprenant éventuellement le compte d’emploi des ressources, rapport du commissaire aux comptes).
En second lieu, ces documents comptables doivent faire l’objet d’une publication au Journal officiel. À cette fin, le décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels entraîne l’obligation pour l’association de publier ses comptes sur le site Internet de la direction des journaux officiels.
De manière générale, les associations ont tout intérêt à assurer par elles-mêmes la publicité de leurs comptes annuels (envoi aux adhérents et partenaires, mise en ligne sur le site de l’association…) et à mettre en valeur les efforts faits en termes de communication financière.
b) Renforcer l’encadrement des subventions accordées aux associations
Parce que le dynamisme du tissu associatif français ne se dément pas avec 73 000 associations créées en 2008 et plus d’un million d’associations en activité, les associations ont plus que jamais besoin de la reconnaissance des collectivités territoriales, qui sont des acteurs de terrain et de proximité. Mais, parce que la dépense publique doit être maîtrisée dans toutes ses composantes, y compris dans le soutien financier apporté aux acteurs associatifs, votre rapporteur propose de mieux encadrer l’octroi de subventions aux associations.
Concilier reconnaissance des associations et maîtrise de la dépense publique : tel est aujourd’hui l’enjeu auquel sont confrontées les collectivités locales, lorsqu’elles accordent des subventions aux associations. Pour les aider dans cette démarche, votre rapporteur propose que les collectivités ne pourront pas accorder à une association une subvention supérieure à 200 euros pour financer des dépenses de fonctionnement, lorsque cette association dispose de réserves financières supérieures à un an de fonctionnement. Il convient toutefois de préciser qu’une telle proposition ne peut concerner que les subventions qui relèvent d’une décision discrétionnaire de l’autorité décisionnaire. Sont en conséquence exclues les subventions versées en vertu d’une loi ou d’un règlement qui crée un droit pour l’association ou la fondation qui remplit tous les critères d’éligibilité légaux ou réglementaires dans une logique de guichet.
Proposition n° 33 : interdire à toute collectivité locale d’accorder à une association une subvention supérieure à 200 euros pour financer des dépenses de fonctionnement, lorsque cette association dispose de réserves financières supérieures à un an de fonctionnement
Encadrer les subventions aux associations, en interdisant à toute collectivité locale d’accorder à une association une subvention de plus de 200 euros, pour financer des dépenses de fonctionnement, lorsque cette association dispose d’une épargne bancaire supérieure à une année de budget de fonctionnement.
Sont exclues de ce dispositif les subventions versées en vertu d’une loi ou d’un règlement qui crée un droit pour l’association ou la fondation qui remplit tous les critères d’éligibilité légaux ou réglementaires dans une logique de guichet.
Mais la maîtrise de la dépense publique nous impose d’aller encore plus loin. C’est pourquoi, outre l’octroi de subventions, il faut également s’intéresser aux associations, qui, sans avoir été officiellement dissoutes, n’ont plus d’activité. En effet, dans ce cas, ces associations peuvent conserver des avoirs bancaires, restant inutilisés.
Une situation analogue s’était présentée pour les contrats d’assurance-vie non réclamés. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a cherché à remédier à cette situation : désormais les avoirs des contrats d’assurance-vie, non réclamés après trente ans, sont affectés au fonds de réserve des retraites. Sur le modèle de ce qui a été fait pour les assurances-vie non réclamées, votre rapporteur propose que les avoirs bancaires des associations, qui, sans être officiellement dissoutes, n’ont plus d’activité depuis dix ans, soient affectés de plein droit au fonds de réserve des retraites.
Proposition n° 34 : affecter au fonds de réserve des retraites les avoirs financiers des associations qui n’ont plus d’activité
Affecter au fonds de réserve des retraites les avoirs bancaires des associations, qui, sans être officiellement dissoutes, n’ont plus d’activité depuis dix ans.
3. Mettre fin à la dérive des financements croisés entre collectivités
Cause et conséquence de l’enchevêtrement des compétences entre collectivités, les financements croisés sont aujourd’hui une pratique courante, qui conduit dans les faits à multiplier les interventions coûteuses dans les domaines les plus divers et, du même coup, à une certaine surenchère inflationniste entre collectivités. Or, comme le faisait remarquer le rapport de la mission d’information de la commission des Lois sur la clarification des compétences des collectivités territoriales (90), « un projet important se conduit difficilement s’il n’y a pas tous les partenaires ».
Si certains estiment que l’interdiction de participer au financement de certaines compétences est susceptible de pénaliser des catégories de collectivités, et notamment les communes, d’autres, en revanche, considèrent qu’une restriction apportée aux possibilités de financements croisés ne serait pas pénalisante, dans la mesure où les crédits dispersés par une même collectivité entre de nombreuses actions pourraient être recentrés sur les compétences centrales exercées par cette collectivité. M. Pierre Richard, dans son rapport sur les enjeux de la maîtrise des dépenses publiques locales (91), avait suggéré en décembre 2006 que la loi limite à 50 % la participation des collectivités qui ne sont pas le maître d’ouvrage au financement d’un projet.
La mission d’information, co-rapportée par MM. Didier Quentin et Jean-Jacques Urvoas, suggérait en octobre 2008 d’aller plus loin pour responsabiliser financièrement les acteurs locaux et ainsi mettre fin à la dérive des financements croisés. Pour ce faire, la mission avait préconisé de n’autoriser qu’un seul niveau de collectivités territoriales à participer au financement d’un projet conduit par une autre collectivité. Il convient de souligner qu’une telle disposition n’encadrerait que le recours aux cofinancements pour les collectivités locales, mais n’interdirait pas à l’État ou à l’Union européenne de participer au financement des opérations concernées.
Votre rapporteur souscrit pleinement à cette proposition de la mission d’information sur la clarification des compétences des collectivités territoriales et souhaite qu’elle soit mise en œuvre rapidement. Il convient à cet égard de souligner que l’ensemble des propositions issues des travaux de cette mission est le fruit d’un consensus entre majorité et opposition, la commission des Lois ayant adopté à l’unanimité ce rapport.
Reprenant les réserves qu’avait émises à l’époque la mission, votre rapporteur ne souhaite pas que la règle proposée soit appliquée de manière indifférenciée à l’ensemble des communes. Il convient bien davantage de prévoir une dérogation en faveur des plus petites communes, dont les ressources sont souvent peu importantes et qui pourraient se voir ainsi pénalisées, en étant incapables de mobiliser les fonds nécessaires au financement de certains équipements.
Le critère de la population communale ne serait pas à lui seul suffisant, dans la mesure où la richesse d’une commune ne dépend pas de la population de cette commune mais des bases fiscales, lesquelles peuvent être parfois très importantes en dépit de la faible taille de la commune. Il serait donc préférable de combiner ce critère avec celui du potentiel financier, qui permet de mesurer l’écart de richesse par rapport à une moyenne de strate, en incluant dans le calcul non seulement les bases fiscales mais également l’ensemble des ressources financières stables et récurrentes de la collectivité.
Proposition n° 35 : mettre fin à la dérive des financements croisés entre collectivités
Pour que chaque citoyen puisse identifier la collectivité responsable et afin de réduire les financements croisés, prévoir qu’un seul niveau de collectivités locales peut participer au financement d’un projet conduit par une autre collectivité.
Permettre une dérogation à cette limitation au profit des communes dont la population est inférieure à un certain seuil de population et dont le potentiel financier est inférieur à la moyenne de leur strate.
III. UN PLAN D’ACTIONS POUR GARANTIR L’AVENIR DU SYSTÈME FRANÇAIS DE SÉCURITÉ SOCIALE
En raison de leur importance parmi les facteurs d’accroissement des dépenses publiques et de la dette nationale, les finances de la sécurité sociale ne sauraient être exonérées des mesures de salut public que requiert l’état des finances du pays.
Dans cet état d’esprit, la mission s’est donné deux axes majeurs de réflexion qui portent à la fois sur les dépenses et sur les recettes : en premier lieu, assumer, dès aujourd’hui, sans attendre, le fardeau de la dette sociale pour éviter cet effet « boule-de-neige » que l’on a évoqué et parce que c’est le devoir moral des générations actuelles vis-à-vis des générations à venir ; en second lieu, utiliser de manière responsable les ressources de la sécurité sociale afin de sauvegarder un fondement du pacte républicain auquel les Français apparaissent particulièrement et justement attachés.
A. ASSUMER DÈS AUJOURD’HUI LE FARDEAU DE LA DETTE SOCIALE : UN DEVOIR MORAL
La question de la dette sociale est apparue lancinante tout au long des auditions auxquelles la mission a procédé. Cette dette est clairement perçue comme une forme de scandale car elle va peser sur les générations à venir alors que seules les générations actuelles bénéficient immédiatement des dépenses sociales qui l’alimentent sans cesse.
Il a semblé à votre rapporteur que nous avions, aujourd’hui, un devoir moral : celui d’exposer les faits tels qu’ils sont ; celui aussi de proposer des solutions qui ne peuvent trouver leur aboutissement que dans un effort commun de notre pays convaincu de la nécessité d’agir et de s’unir pour cette action.
Il faut absolument prendre le problème à sa racine et essayer d’éviter le plus en amont possible la constitution de cette dette par la noria de dépenses sans cesse renouvelées. C’est pourquoi il est proposé des moyens puissants de prévention de cette dette sociale en imposant des mécanismes d’alerte plus rigoureux et de traitement préventif plus drastiques.
Il importe aussi de trouver de nouvelles ressources qui soient directement affectées au traitement de la dette. Le dispositif introduit par votre rapporteur en 2005 qui prévoyait l’affectation de recettes à la CADES en proportion des nouvelles dettes qui lui étaient transférées a montré son utilité ; mais il doit être renforcé afin d’éviter de simples jeux comptables qui consistent à affecter, d’une main, des recettes à la CADES tout en réduisant, de l’autre main, les ressources de la sécurité sociale, créant à terme mécaniquement une nouvelle dette.
1. Pour un traitement préventif de la dette
a) Transférer de droit tout déficit constaté à la CADES et affecter une recette nouvelle nécessaire à son apurement
L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale a institué une caisse d’amortissement de la dette sociale chargée de reprendre et d’éteindre la dette cumulée du régime général de la sécurité sociale correspondant au financement des déficits des exercices 1994 et 1995 à hauteur de 18,3 milliards d’euros et au financement prévisionnel de l’exercice 1996 pour 2,6 milliards d’euros. Pour l’accomplissement de cette mission, la CADES disposait initialement de treize ans et un mois.
● Une dette à amortir sans cesse croissante, des échéances constamment repoussées
Or, malgré cet engagement initial, le législateur, à la demande de gouvernements successifs, a étendu à plusieurs reprises la durée et le montant de l’amortissement que la caisse était chargée d’assurer.
Ainsi, dès le 1er janvier 1998, il a été procédé au transfert d’un montant de 13,2 milliards d’euros, montant correspondant à la dette accumulée au titre des exercices 1996 et 1997 ainsi qu’à la couverture par anticipation du déficit prévisionnel de 1998 et reportant l’extinction de la CADES de janvier 2009 à janvier 2014.
En application de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, la couverture des déficits cumulés de la branche maladie arrêtés au 31 décembre 2003 et celle du déficit prévisionnel au titre de 2004 ont donné lieu à transfert à la CADES dans la limite de 35 milliards d’euros.
Le même procédé a été utilisé afin d’assurer la couverture des déficits prévisionnels de la branche maladie au titre des exercices 2005 et 2006 (dans la limite de 15 milliards d’euros).
Enfin, le législateur a autorisé (92) de nouveaux transferts de dette à la CADES en 2009 dans la limite de 27 milliards d’euros, dettes correspondant aux déficits cumulés au 31 décembre 2008 des branches maladie et vieillesse ainsi que du fonds de solidarité vieillesse. Ce transfert s’est accompagné de l’attribution d’une nouvelle ressource à la CADES, avec un prélèvement de 0,2 point de CSG pris sur les recettes affectées initialement au Fonds de solidarité vieillesse (FSV).
Le montant total des dettes reprises par la CADES depuis sa création s’élevait ainsi, au 31 décembre 2008 (93), à 134,5 milliards d’euros. Le montant de l’amortissement a atteint 40 milliards d’euros au 30 juin 2009, l’endettement net se réduisant à 94,5 milliards d’euros.
D’après les études de la CADES confirmées lors de son audition par son président M. Patrice Ract-Madoux (94), du fait des montants restant à amortir, l’extinction de la dette sociale actuelle ne saurait être envisagée avant l’année 2021 et à la condition que les pouvoirs publics n’accroissent pas le stock de dettes remis à la CADES. Rappelons qu’à l’origine, la CADES devait avoir achevé l’amortissement de la dette sociale le 24 février 2009 suivant les dispositions de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.
Or, selon M. Patrice Ract-Madoux (95), si l’objectif demeure l’extinction de la dette en 2021, la reprise de toute nouvelle part de la dette sociale par la CADES rendra nécessaire une augmentation de la CRDS d’autant plus importante que la reprise de la dette sera tardive.
Ainsi, par tranche de 10 milliards d’euros de dette, sa reprise nécessiterait l’augmentation du taux de CRDS de 0,077 point en 2010, de 0,085 point en 2011, de 0,095 point en 2012. On mesure ici la nécessité de ne pas attendre pour traiter la dette sociale. Plus nous attendons, plus l’addition sera élevée.
● L’ACOSS n’a pas vocation à gérer la dette structurelle de la sécurité sociale
Par ailleurs, compte tenu de l’importance des déficits transférés à la CADES et de la perspective d’une nouvelle dégradation de l’équilibre des finances sociales en 2010 et 2011, il ne semble guère envisageable de maintenir durablement les nouveaux déficits de la sécurité sociale dans la comptabilité de l’ACOSS.
En premier lieu, depuis sa création en 1967, la mission fondamentale de l’ACOSS consiste essentiellement à assurer la gestion centralisée des ressources et de la trésorerie du régime général de la sécurité sociale. Certes, il n’existe pas a priori d’obstacle juridique à la conservation des déficits de la sécurité sociale dans les comptes de l’ACOSS. Toutefois, ainsi que l’a rappelé au cours de son audition M. Pierre Burban (96), président du conseil d’administration de cette agence, l’ACOSS n’a pas vocation à financer le déficit structurel de la sécurité sociale et il n’entre pas dans ses missions de trouver des financements à l’échelle des déficits dont souffre actuellement la sécurité sociale.
En second lieu, les instruments dont dispose l’ACOSS afin d’assurer la trésorerie du régime général se révèlent insuffisants à l’aune des déficits de la sécurité sociale dont on lui confie la charge.
Afin de combler un déséquilibre temporaire ou permanent entre les recettes et les dépenses des régimes de base, l’ACOSS consent à la sécurité sociale des avances de trésorerie dans la limite d’un plafond fixé par la loi de financement de la sécurité sociale ou, en cas d’urgence, par décret.
Ainsi, le décret n° 2009-939 du 29 juillet 2009 a porté le plafond des avances à la sécurité sociale à 29 milliards d’euros contre 18,9 milliards d’euros dans le cadre de la loi de financement pour 2009, 18,5 milliards d’euros pour l’exercice 2006, 28 milliards d’euros pour l’exercice 2007 et 36 milliards pour l’exercice 2008. Or, du fait de l’impact de la crise financière sur la liquidité des marchés de capitaux, l’ACOSS voit ses sources de financement parfois fragilisées.
D’une part, ainsi que l’a indiqué M. Pierre Burban lors de son audition (97), l’agence a rencontré des difficultés à l’été 2008 dans le placement de ses billets de trésorerie en raison de la faible activité du marché et de sa taille modeste eu égard aux besoins de l’ACOSS. Celle-ci s’impose en effet comme le premier investisseur, ses billets de trésorerie représentant près de 10 % du marché français. Selon les estimations de la Cour des comptes (98), avec la CADES, l’ACOSS détenait, d’ores et déjà, en mars 2009 près de 18 % de l’encours total des émetteurs résidents de billets de trésorerie, soit 45,2 milliards d’euros.
D’autre part, l’ACOSS ne peut prétendre bénéficier d’une avance illimitée de la part de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Par une lettre datée du 20 décembre 2008, le président de la CDC a, en effet, informé l’ACOSS de sa volonté de limiter à 25 milliards d’euros le montant des avances consenties aux conditions de taux prévalant dans le cadre de la convention signée entre les deux organismes le 21 septembre 2006. Cette décision s’explique par les pertes financières enregistrées par la caisse au titre des avances consenties à l’ACOSS, pertes résultant de l’écart exceptionnel constaté entre le taux servant de base à la tarification des avances à l’ACOSS (taux au jour le jour : EONIA) et les taux auxquels la caisse se refinance (taux à 2 et 3 mois : EURIBOR). Ainsi que le relèvent nos collègues, Didier Migaud, Pierre Méhaignerie, Yves Bur et Marie-Anne Montchamp, dans le rapport d’information consacré à la gestion des découverts de trésorerie et de la dette sociale (99), l’écart entre l’EONIA et l’EURIBOR, en général inférieur à 10 points de base dans une situation de marché normale, a dépassé depuis le déclenchement de la crise 40 à 50 points de base. D’après les chiffres communiqués lors de son audition par la commission des Finances de l’Assemblée nationale (100) par le directeur général de la caisse, M. Augustin de Romanet, l’accès permanent à la liquidité accordé à l’ACOSS a entraîné un manque à gagner en 2008 de 20 millions d’euros.
Cette perte nouvelle explique la volonté exprimée par la CDC d’obtenir un rééquilibrage de sa relation avec l’ACOSS qui s’est traduit par la conclusion d’un avenant à la convention de septembre 2006 et par l’ouverture de négociations portant sur le montant et le coût des avances consenties à l’ACOSS.
Tout en soulignant l’importance du résultat des négociations avec la caisse des dépôts et des consignations, M. Pierre Burban (101) a appelé l’attention des membres de la mission sur l’impossibilité pour l’ACOSS de conserver durablement dans ses comptes les déficits de la sécurité sociale d’une telle ampleur et indiqué son souhait de voir le nouveau stock de dette repris par la CADES.
● Traiter immédiatement tout déficit constaté et tout déficit prévisionnel
Depuis la modification en 2005, à l’initiative de votre rapporteur au nom de la commission des Lois, de l’ordonnance organique n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale (102), « tout nouveau transfert de dette à la Caisse d’amortissement de la dette sociale est accompagné d’une augmentation des recettes de la caisse permettant de ne pas accroître la durée d’amortissement de la dette sociale ».
Cette disposition visait à empêcher la perpétuation de la dette sociale par le transfert récurrent de nouvelles dettes à la CADES qu’elle ne serait pas en mesure d’amortir.
Néanmoins, nonobstant l’adoption de cette règle vertueuse dont plusieurs personnes auditionnées ont souligné la portée (103), le traitement des déficits sociaux demeure problématique, ainsi que l’illustrent les modalités du transfert à la CADES de 27 milliards d’euros en 2009. Ce dernier exemple plaide en faveur de l’adoption de règles plus contraignantes favorisant sans délai supplémentaire l’apurement de la dette sociale.
L’ACOSS doit gérer une trésorerie d’un montant raisonnable et couvrant des besoins de court terme. Au-delà de dix milliards d’euros, votre rapporteur estime que tel n’est plus le cas.
Dans cette optique, il importe de prévoir que tout déficit constaté, au titre d’un exercice passé, par la loi de financement de sécurité sociale sera transféré de droit à la CADES et que celle-ci percevra une ressource nouvelle de nature à assurer l’apurement de ce déficit.
Dès lors que le montant du déficit prévisionnel dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale dépasse 10 milliards d’euros, la fraction de ce déficit supérieure à ce seuil de 10 milliards sera de droit transférée à la CADES avec une ressource nouvelle assurant la couverture de ce déficit prévisionnel dès l’année où sa constitution est prévue.
Le supplément de ressources envisagé ici pourra être procuré par des produits nouveaux tirés de la taxation des retraites chapeaux, des stock-options ainsi que des taxes dont pourraient devoir s’acquitter les administrations moins exemplaires en matière de véhicules et de logements de fonction (104). Ce supplément pourra provenir également, le cas échéant, d’un surcroît de recettes généré par l’extension de l’assiette de la CSG sur les jeux et les métaux précieux (voir ci-après).
Proposition n° 36 : transférer de droit tout déficit constaté au titre d’un exercice achevé à la CADES et lui affecter une ressource nouvelle propre à en assurer l’apurement. Prévoir que si le montant du déficit prévisionnel inscrit dans la loi de financement de la sécurité sociale dépasse 10 milliards d’euros, le déficit au-delà de ce montant sera de droit transféré à la CADES avec une recette nouvelle propre à assurer la couverture de ce déficit prévisionnel.
Les recettes nouvelles seront fournies par des produits nouveaux tirés de la taxation des retraites chapeaux, des stock-options ainsi que des taxes dont pourraient devoir s’acquitter les administrations moins exemplaires en matière de véhicules et logements de fonction (105). Le supplément de recettes pourra provenir également, le cas échéant, du surcroît de recettes généré par l’extension de l’assiette de la CSG sur les jeux et les métaux précieux
b) Affecter à la CADES les excédents des organismes de sécurité sociale après le retour à la croissance et le rétablissement des comptes sociaux
Au cours de son audition (106), M. Dominique Libault, directeur de la sécurité sociale, a souligné tout l’intérêt qu’il y aurait à gérer les dépenses et les recettes de la sécurité sociale en prenant en considération l’ensemble du cycle économique. Il s’agirait notamment de pouvoir utiliser les excédents dégagés dans la phase haute du cycle afin de compenser la réduction des recettes de la sécurité sociale provoquée par le ralentissement de la croissance en phase basse. Ce n’est malheureusement pas la situation que nous vivons actuellement mais il faut explorer cette voie pour l’avenir.
Les dispositions actuellement en vigueur du code de la sécurité sociale prévoient qu’il appartient au législateur de déterminer les « modalités d’emploi des excédents ou de couverture du dernier exercice clos […] » (107). De fait, cette disposition ne vaut pas obligation de consacrer un surplus de recette au désendettement ou à l’amélioration de l’équilibre financier de la sécurité sociale.
Or, un déséquilibre persistant des finances de la sécurité sociale se révèle difficilement justifiable compte tenu de la nature des dépenses concernées. En effet, ainsi qu’a pu l’expliquer M. Christian Saint-Étienne lors de son audition (108), les dépenses de santé en général constituent par leur nature des dépenses de consommation immédiate dont le financement ne doit pas incomber aux générations futures. Ce fut également le sens des propos de M. Dominique Libault lors de son audition (109).
Dans ces conditions, même si ces excédents demeurent largement hypothétiques à ce jour, la mission propose d’institutionnaliser l’affectation des excédents de recettes des régimes de la sécurité sociale à la caisse d’amortissement de la dette sociale.
A minima, ce mécanisme pourrait être inspiré par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie qui dispose en son article 76 : « la part des recettes de la branche maladie supérieure aux dépenses de la branche est affectée prioritairement à la CADES dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale ».
La loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 fournit un autre exemple de dispositif plus contraignant puisqu’elle prévoit en son article 9 le principe suivant lequel « […] les éventuels surplus constatés par rapport aux évaluations de la loi de finances de l’année, du produit des impositions de toute nature établie au profit de l’État, sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire ».
Il reviendra au législateur de fixer les modalités exactes de ce mécanisme d’affectation et notamment de se prononcer sur la part de l’excédent des recettes devant être versée à la CADES.
Proposition n° 37 : après le retour de la croissance et lorsque les organismes de sécurité sociale seront à nouveau en mesure de retrouver l’équilibre de leurs comptes, affecter à la CADES les excédents de recettes des régimes de sécurité sociale.
Lorsque les régimes de sécurité sociale seront en mesure de dégager des excédents, ils devront être affectés au remboursement de notre dette sociale.
Mais au stade actuel, il importe d’éviter que la dette ne s’alourdisse en se montrant encore plus vigilant sur l’évolution des dépenses sociales. La prévention est ici essentielle.
c) Établir une procédure d’alerte précoce plus stricte en cas de risque sérieux de dépassement de l’ONDAM
Dans le cadre des dispositions de loi de financement de la sécurité sociale (110), le Parlement fixe chaque année un objectif national de dépense d’assurance maladie (ONDAM). Cet agrégat de six sous-objectifs (exprimés en milliards d’euros) vise à fixer une limite à la progression des dépenses de la médecine de ville, des établissements de soins (hôpitaux et cliniques), ainsi que des établissements accueillant des personnes âgées et des handicapés.
Outre l’information des commissions parlementaires compétentes au sein des deux assemblées, le législateur a entendu créer ainsi un dispositif propre à permettre aux caisses et aux pouvoirs publics de réagir rapidement en cours d’exercice face au constat d’un risque de dépassement de l’ONDAM. Ainsi, en application de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et du décret n° 2004-1077 du 12 octobre 2004, le Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses d’assurances maladie doit rendre chaque année, au plus tard le 1er juin, un avis sur le respect de l’objectif national de dépenses maladie pour l’exercice en cours. Par ailleurs, « lorsque le Comité considère qu’il existe un risque sérieux que les dépenses d’assurances maladies dépassent l’ONDAM avec une ampleur supérieure à un seuil fixé à 0,75 %, il le notifie au Parlement, au Gouvernement et aux caisses nationales d’assurance maladie » ainsi qu’à l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire afin que ces organismes proposent des mesures de redressement.
Depuis l’entrée en vigueur de ce dispositif, le Comité n’a déclenché la procédure d’alerte que pour l’exercice 2007 (111), du fait notamment de la croissance soutenue des dépenses du poste « soins de ville ». Ainsi que le montre l’étude publiée par la Commission des comptes de la sécurité sociale et intitulée Regard sur 12 ans d’ONDAM (1997-2008), par comparaison avec le début de la décennie 2000, les exercices se caractérisent de fait par la réduction continue du rythme de progression des dépenses de l’ONDAM et un respect croissant de ses prescriptions.
Néanmoins, alors que les déficits se creusent et que la dette s’alourdit, on doit faire preuve de plus de vigilance encore et il est apparu nécessaire à la mission de renforcer le dispositif d’alerte de sorte de prévenir au plus tôt tout dérapage des dépenses par rapport aux prévisions de l’ONDAM. En effet, ainsi qu’en témoigne l’exemple de la procédure suivie en 2007, les éventuelles mesures de redressement prises au début du second semestre ne produisent pleinement leurs effets correctifs qu’au début de l’exercice suivant. Ainsi, en 2007, le Comité d’alerte relevait que « l’ensemble des mesures proposées […] représente un montant total compris entre 1,6 et 2,4 milliards d’euros en année pleine et entre 430 et 800 millions d’euros sur l’année 2007 ».
Dans ces conditions, nonobstant les incertitudes d’ordre statistique entourant les données disponibles à la fin du premier semestre, la mission estime nécessaire de proposer l’abaissement du seuil de déclenchement de la procédure d’alerte de 0,75 % à 0,5 %.
Cette mesure doit permettre aux pouvoirs publics de prendre et de mettre en œuvre dans les meilleurs délais les mesures destinées à contenir tout dépassement éventuel dès l’exercice en cours.
Proposition n° 38 : abaisser le seuil de déclenchement de la procédure d’alerte en cas de risque sérieux de dépassement de l’ONDAM de 0,75 % à 0,5 %.
Afin de traiter encore plus en amont la constitution de déficits qui alimenteront la dette, il importe que les mécanismes d’alerte soient encore plus précoces pour prendre toutes les mesures nécessaires et les mettre en œuvre le plus rapidement possible.
d) Permettre à l’ACOSS de gérer la trésorerie disponible d’un plus grand nombre d’organismes de la sécurité sociale
La mission estime, enfin, nécessaire d’envisager de donner l’autorisation à l’ACOSS de gérer la trésorerie disponible d’un plus grand nombre d’organismes sociaux.
Cette possibilité devrait permettre d’assurer la couverture optimale de l’ensemble des dépenses des régimes. L’intervention de l’ACOSS assure indéniablement une couverture financière à moindre coût des besoins de trésorerie des organismes de sécurité sociale.
L’agence dispose, en effet, de la garantie implicite de l’État et peut plus aisément lever des fonds sur les marchés à des taux non prohibitifs. L’agence se distingue en outre par la grande efficacité et le coût très faible de sa branche recouvrement. Ainsi, selon les chiffres communiqués par les services de la direction de la sécurité sociale du ministère du Travail, le coût de l’euro encaissé en 2008 par l’ACOSS s’élevait à 0,32 centimes contre 0,36 centimes en 2003.
Par ailleurs, dans le cadre des mesures de simplification des circuits de recouvrement, les URSSAF assurent déjà l’encaissement des cotisations des travailleurs indépendants pour le compte du RSI.
Néanmoins, la gestion d’une trésorerie plus massive offrirait une certaine latitude afin de faire face à des besoins supérieurs aux prévisions pour certains régimes plus déficitaires et d’être moins tributaire du financement offert par les marchés financiers. Outre une gestion à moindre coût, cette centralisation permettrait de faire face plus efficacement aux besoins ponctuels de trésorerie qui apparaissent dans l’année, permettant, là encore, d’éviter l’alourdissement des frais financiers que peut supporter l’ACOSS.
Dans ces conditions, la mission estime qu’il convient d’envisager la possibilité d’autoriser l’ACOSS à utiliser la trésorerie disponible d’un plus grand nombre d’organismes sociaux.
Dans cette optique, elle a pris note avec intérêt de la suggestion présentée par M. Pierre Burban (112) et tendant à confier la gestion de la trésorerie de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) à l’ACOSS et celles des régimes de retraite complémentaire et de l’assurance-chômage aux URSSAF.
Proposition n° 39 : autoriser l’ACOSS à gérer la trésorerie disponible d’un plus grand nombre d’organismes sociaux.
Cette facilité doit notamment permettre d’éviter le renchérissement des frais financiers supportés par l’ACOSS ainsi qu’une gestion plus fine et cohérente.
2. Élargir et garantir le champ des ressources de la sécurité sociale pour lutter contre la dette sociale
La question de la dette sociale nous semble d’une telle importance qu’elle suppose des mesures exceptionnelles qui passent par de nouvelles ressources et par une sorte de contrat de confiance entre l’État et la sécurité sociale.
C’est pourquoi la mission propose de prendre plusieurs mesures fortes en « sortant » la CRDS – dont la vocation est le remboursement de la dette sociale – du champ du bouclier fiscal, en élargissant l’assiette de la CSG à des revenus tels que ceux provenant du jeu ou de la vente de métaux précieux, en créant de nouvelles ressources – certes moindres – mais qui auront la vertu de l’exemplarité pour bien montrer que la gestion de la dette sociale est une véritable cause nationale. Enfin, il importe que l’État rembourse régulièrement et sans retard les montants qu’il doit à la sécurité sociale au titre des exonérations de cotisations sociales qu’il a décidé d’instituer.
a) Retirer la CRDS des impositions directes prises en compte pour l’application du bouclier fiscal
Institué dans la loi de finances pour 2006, qui pose comme principe qu’un contribuable ne peut avoir à acquitter plus de 60 % de ses revenus en impôts directs, puis aménagé par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 (113), ce dispositif plafonne le montant des impôts directs dont doivent s’acquitter les particuliers domiciliés en France selon le principe consacré à l’article 1er du code général des impôts : « les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus ». Le montant des impôts directs supérieur à cette part du revenu peut donner lieu, sur la demande de l’intéressé, à une restitution par le service des impôts.
D’après un récent rapport d’information de la commission des Finances de l’Assemblée nationale (114), le montant des restitutions effectuées par les services fiscaux au titre du bouclier fiscal renforcé atteignait, au 31 mai 2009, la somme de 578 millions d’euros. L’instauration de ce bouclier fiscal a fait l’objet de débats très tranchés. Depuis sa création puis son extension, ces débats ont perduré selon des clivages très nets même si des initiatives de tous bords ont pu être prises pour adapter ce mécanisme, à la marge ou plus largement. Il n’est pas question ici de revenir sur ces débats et de s’interroger sur la pertinence en soi du bouclier fiscal.
Le propos est plutôt de voir dans quelles mesures la situation exceptionnelle de nos finances sociales pourrait conduire à prendre des dispositions elles-mêmes exceptionnelles.
En application de l’article 1649-0 A du code général des impôts, comme contributions directes, la CSG et la CRDS figurent parmi les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution.
On connaît la vocation de la CRDS. Créée par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et affectée à la caisse d’amortissement de la dette sociale, cette contribution a, de l’avis de tous, une nature spécifique qui la distingue des autres types de contributions directes. La CRDS se distingue également de l’impôt. Sa seule raison d’être est le remboursement de la dette sociale. Or, la situation de cette dette est suffisamment grave pour devoir justifier une mesure exceptionnelle concernant cette cotisation : retirer la CRDS des impositions directes prises en compte pour l’application du bouclier fiscal.
Même si à la connaissance de votre rapporteur, aucune étude actuelle ne fournit un chiffrage précis des recettes de CRDS entant dans le champ du bouclier fiscal, ce serait là un signe important en direction de toutes les catégories de la population qui, solidaires, doivent s’associer dans cet effort commun que doit être la lutte contre la dette sociale.
Proposition n° 40 : retirer la CRDS des impositions directes prises en compte pour l’application du « bouclier fiscal ».
Cette mesure exceptionnelle est justifiée par la situation elle-même exceptionnelle de la dette sociale. Lutter contre cette dette est une cause nationale qui suppose la solidarité de tous. La CRDS se distingue également de l’impôt. Sa seule raison d’être est le remboursement de la dette sociale.
b) Élargir le champ de la CSG aux revenus des jeux et aux produits de la vente de métaux précieux
La CSG peut également constituer un levier pour permettre de disposer de nouvelles ressources destinées à abattre la dette sociale.
Instaurée par la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, la contribution sociale généralisée (CSG) se présente comme la principale ressource des branches maladie et famille. Elle complète aussi le financement de certains organismes de la sécurité sociale telle que le Fonds de solidarité vieillesse (FVS) et la caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES).
En 2009, le produit attendu de la CSG devrait s’élever à 72,2 milliards d’euros. Cet impôt affecté, dû par les personnes fiscalement domiciliées en France, se caractérise de fait par un rendement très élevé dont le niveau s’explique par l’étendue de son assiette qui est extrêmement large. En effet, à la suite d’extensions successives, la CSG porte :
— sur les revenus d’activité et de remplacement : traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions (115) dont 95 % à 97 % des salaires bruts et l’allocation chômage ;
— les revenus du patrimoine (116) ;
— les revenus de placement, tels que les jetons de présence et autres rémunérations des membres des conseils d’administration ou de conseils de surveillance des sociétés, certaines plus-values (117) ;
— le montant des sommes misées dans les jeux exploités par la Française des jeux (à hauteur de 23 % de ces sommes), le Pari mutuel (à hauteur de 14 %) et le produit de certains jeux réalisés dans les casinos (68 % du produit des jeux automatiques – à un taux de 9,5 % – et tous les gains supérieurs ou égaux à 1500 euros – à un taux de 12 %).
Ainsi, la CSG couvre la quasi-totalité des revenus d’activité et de remplacement ainsi qu’un nombre croissant de revenus de placement. Par exemple, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a institué un prélèvement de 2 % sur les dividendes en remplacement de deux prélèvements de 1 % destinés à la CNAF et à la CNAV.
Néanmoins, l’assiette de la CSG apparaît plus étroite que celle de la CRDS.
Comme la CSG, celle-ci est ainsi prélevée (avec un taux de 0,5 %) sur les revenus d’activité et de remplacement, les revenus du patrimoine, les revenus de placement. En revanche, par rapport à l’assiette de la CSG, la CRDS est perçue également sur :
— l’aide personnalisée au logement, l’allocation de logement à caractère social et les prestations familiales (à l’exception de l’allocation de parent isolé et l’allocation d’éducation spéciale qui ne sont pas davantage soumises à la CSG) ;
— certains revenus d’activité d’origine étrangère perçus par des personnes fiscalement domiciliées en France mais ne relevant pas de la sécurité sociale française ;
— les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d’arts, de collection et d’antiquité ;
— les revenus de remplacement des personnes non imposables à l’impôt sur le revenu mais assujetties à la taxe d’habitation.
Par ailleurs, la CRDS porte sur 70 % des sommes misées au Pari mutuel sur et hors hippodrome et sur 58 % des sommes misées dans les jeux de la Française des jeux ; elle porte aussi sur la totalité du produit brut des jeux exploités dans les casinos cette fois à un taux de 3 % et non de 0,5 %. L’étendue de son assiette explique tout naturellement le rendement exceptionnel de cette contribution. En 2007, d’après les chiffres fournis par la CADES, le rendement de la CRDS s’est élevé à près de 5,614 milliards d’euros.
À l’heure où les déficits sociaux continuent de s’accroître et où les recettes fiscales affectées aux dépenses sociales voient leur rendement diminuer en raison de la crise, il paraît souhaitable de solliciter un peu plus la CSG pour, une fois encore, combattre la dette sociale. À cette fin, une solution pourrait consister non pas à augmenter le taux de cette contribution mais à élargir son assiette à certains revenus qui y échappent actuellement en tout ou partie.
S’il ne semble pas souhaitable, pour des raisons évidentes, d’étendre la CSG à des catégories de revenus de remplacement, ce qui pourrait avoir pour conséquence de toucher des populations fragiles à un moment où la crise les frappe souvent très durement, la mission préconise en revanche l’alignement de l’assiette de la CSG sur celle de la CRDS concernant la fraction des sommes misées dans les jeux soumise à prélèvement et d’introduire dans l’assiette de la CSG le produit de la vente des métaux précieux. Ce surcroît de recettes devrait être affecté à la CADES de sorte à favoriser l’amortissement rapide de la dette sociale.
D’après les données communiquées par la CADES à votre rapporteur, le produit de la CRDS assise sur les jeux s’est élevé, en 2008, à 120,9 millions d’euros. Faute de disposer d’analyse plus précise permettant de distinguer le produit tiré des mises dans le cadre du Pari mutuel et de la Française des jeux (avec un taux de 0,5 %) et dans le cadre des casinos (taux de 3 %), il est difficile d’évaluer très exactement l’assiette taxable par la CRDS pour l’ensemble des jeux en 2008. Quant au prélèvement de CRDS assis sur les métaux précieux, le produit réel atteint quant à lui, d’après les chiffres également transmis à votre rapporteur par la CADES, 2,7 millions d’euros en 2008 par l’application d’un taux de 0,5 %.
Compte tenu des incertitudes sur les perturbations dont pourraient éventuellement souffrir les secteurs concernés, il s’avère indispensable d’opérer ce rapprochement entre l’assiette de la CSG et celle de la CRDS avec un certain discernement. Cela commande en particulier de ne pas imposer ex abrupto une telle extension de la CSG à un taux de 9,5 % sur les nouvelles matières taxables. La fixation d’un taux de 3 % correspondant à celui appliqué, dans le cadre de la CRDS, aux sommes misées dans les casinos, pourrait constituer un point de départ.
La mission demande que le Gouvernement puisse fournir dans les meilleurs délais une étude très complète sur ce sujet afin de mesurer à quel taux et selon quelles modalités une telle extension de l’assiette de la CSG devra être réalisée ultérieurement.
Proposition n° 41 : étendre l’assiette de la CSG en taxant à 3 % les sommes misées dans les jeux et les plus-values tirées de la vente de métaux précieux et affecter ce surcroît de recettes à la CADES.
L’alignement partiel de l’assiette de la CSG sur celle de la CADES sur les jeux et les plus-values de la vente de métaux précieux permettrait de dégager des recettes contribuant à combler la dette sociale.
c) Accroître fortement la contribution assise sur les retraites chapeaux, les stock-options et les administrations non exemplaires
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 contient des dispositions tendant à la taxation de certaines niches sociales telles que celles dont bénéficient les plus-values de cessions de valeur mobilières (non taxées en dessous d’un seuil fixé à 25 000 euros) et les assurances-vie qui se concluent par un décès (exonérées des prélèvements sociaux). C’est une bonne chose.
D’après les chiffres rendus publics par le Gouvernement à l’occasion de la présentation de son projet, la taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières au premier euro pourrait engendrer une recette supplémentaire de 110 millions d’euros à partir de 2011, alors que la suppression de l’exonération de prélèvements sociaux sur les assurances-vie qui se concluent par un décès rapporterait 270 millions d’euros.
Le doublement du taux de prélèvement réalisé au titre du forfait social va également dans la bonne direction dans la mesure où l’élévation de 2 % à 4 % du taux de cette contribution assise sur les revenus de la participation, de l’intéressement et de l’épargne salariale devrait permettre, d’après les déclarations du Gouvernement, de dégager un surcroît de ressources affecté à la caisse nationale d’assurance maladie de l’ordre de 380 millions d’euros.
Au-delà des dispositions contenues dans le PLFSS pour 2010, la mission préconise l’affection de recettes nouvelles à la caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) par la taxation des retraites chapeaux et des stock-options ainsi que des logements et voitures de fonction de l’État.
● Imposer plus lourdement les « retraites chapeaux » et les stock-options
En premier lieu, il apparaît indispensable aux membres de la mission d’imposer plus lourdement les retraites dites « retraites chapeaux ».
Le versement de ce complément de retraite légal, dont le montant se calcule par l’application au salaire de fin de carrière d’un pourcentage librement négocié entre les parties au contrat, ne dépend pas du montant des cotisations versées par le bénéficiaire et son employeur mais des sommes provisionnées à cet effet par l’entreprise. Celle-ci doit en outre s’acquitter, depuis 2003, d’une contribution employeur libératoire dont le taux s’élève à 6 %, 8 % ou 12 % selon que la pension est versée par l’entreprise ou par un assureur et selon la date d’attribution (avant ou après 2003).
Les sommes ainsi versées apparaissent à bien des égards critiquables et il n’est pas normal que la constitution d’une retraite complémentaire échappe ainsi à cotisation de la part de l’employé comme de l’employeur. Dans le régime de l’ARRCO (pour tous les salariés) comme dans celui de l’AGIRC, employeurs et salariés cotisent afin de financer les pensions des retraités. Du reste, il convient de rappeler que normalement les salariés quittant leur entreprise avant l’échéance normale de leur cessation d’activité ne peuvent prétendre percevoir aucune fraction des sommes prévues par le contrat de retraite complémentaire qu’ils ont conclu.
Lors de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement a exprimé l’intention de doubler la contribution sur les retraites chapeaux. Les recettes résultant du doublement annoncé seraient de 25 millions d’euros et affectées au FSV.
La mission appelle à aller plus loin et à affecter le produit de cette imposition au remboursement de la dette sociale.
• Augmenter sensiblement le taux de la contribution sur les stock-options et modifier les modalités de fixation de leur valeur
En second lieu, la mission préconise également d’envisager une forte augmentation du taux de la contribution sur les stock-options.
Ainsi que l’a rappelé un rapport d’information de l’Assemblée nationale présenté par M. Philippe Houillon en conclusion des travaux d’une mission d’information présidée par votre rapporteur sur les rémunérations des dirigeants et mandataires sociaux et des opérateurs de marché (118), la France compte en effet parmi les pays qui accordent à ce dispositif un traitement plus avantageux que celui des revenus du travail. Dans un pays comme l’Allemagne, la fiscalité des stock-options est en revanche identique à celle des salaires.
En application de l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (119), et notamment grâce aux initiatives prises par le rapporteur de la commission des affaires sociales, M. Yves Bur, les employeurs et les salariés doivent s’acquitter d’une contribution assise sur l’attribution d’options de souscriptions ou d’achat d’actions et sur les attributions d’actions gratuites à compter du 16 octobre 2007. Le taux du prélèvement s’élève respectivement à 10 % pour la contribution patronale et 2,5 % pour la contribution salariale. Le produit de ces contributions est aujourd’hui affecté aux régimes obligatoires d’assurance maladie des bénéficiaires des stock-options.
En 2008, d’après les chiffres rendus publics en avril 2009 par l’ACOSS, le montant du produit de la contribution des employeurs sur la valeur estimée des actions gratuites et des stock-options au moment de l’attribution aux salariés et dirigeants a atteint 220 millions d’euros.
Pour mémoire, d’après le rapport sur la sécurité sociale publié en 2007 (120), la Cour des comptes estimait à près de 3 milliards d’euros le montant des recettes échappant à la sécurité sociale du fait de la non-taxation des stock-options distribués en 2005. Selon les calculs de la Cour, le montant de cette perte se réduisait à 2,2 milliards d’euros si le montant distribué, soit théoriquement 8,569 milliards d’euros en 2005, était amputé du montant des contributions sociales.
Même si le produit de la contribution assise sur les stock-options et les actions gratuites demeure tributaire de leur valorisation dans les états financiers des sociétés ainsi que du niveau de leur résultat, les estimations de la Cour des comptes tendent à démontrer l’importance relative de l’assiette encore taxable.
Aussi, afin d’affecter de nouvelles ressources à l’amortissement de la dette sociale, la mission invite le Gouvernement à alourdir sensiblement la taxation des stock-options par une augmentation du taux de prélèvement.
Proposition n° 42 : accroître fortement la taxation des « retraites chapeaux » et des stock-options pour financer la dette sociale.
L’augmentation de la contribution sur les retraites chapeaux et du taux de prélèvement sur les stock-options doit contribuer à assurer la diversification des ressources de la CADES.
● Mettre à contribution les administrations les moins exemplaires
Enfin, la mission préconise l’affectation à la CADES des taxes établies sur les logements et voitures de fonction de l’État (121) ainsi que sur les dépenses de communication des collectivités territoriales que nous avons évoquées au début de la seconde partie du présent rapport. L’affectation de cette ressource doit inciter l’ensemble des collectivités publiques à adopter des comportements exemplaires dans la gestion de leurs moyens de fonctionnement tout en complétant les ressources de la CADES.
Outre l’extension des recettes destinées à la CADES pour résorber la dette sociale, il importe aussi que l’État respecte ses engagements vis-à-vis de la sécurité sociale pour que celle-ci ne subisse pas les conséquences d’exonérations de cotisation qu’elle n’a pas décidées.
d) Imposer à l’État le paiement d’intérêts en cas de retard dans la compensation effective des exonérations de cotisations dues à la sécurité sociale
La mission appelle le Gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer sans attendre le remboursement des exonérations de cotisations dues à la sécurité sociale.
Les lois n° 94-637 du 25 juillet 1994 et n° 2004-810 du 13 août 2004 imposent, en effet, à l’État de compenser intégralement les mesures d’exonération, de réduction et d’abattement d’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale. En application de ces dispositions, l’État a procédé en octobre 2007 à l’apurement de l’intégralité du montant de sa dette envers la sécurité sociale, soit 5,1 milliards d’euros.
Cependant, ainsi que le relève la Cour des comptes dans son rapport annuel sur la sécurité sociale publié en septembre 2009, le stock de dette a été reconstitué en 2008 à hauteur de 7,4 milliards d’euros, montant ramené à 5,9 milliards d’euros en janvier 2009 (dont 5,2 milliards d’euros pour le régime général) à la suite de la promulgation de la loi de finances rectificative pour l’exercice 2008.
Selon les auteurs du rapport de la Cour, la reconstitution accélérée de cette dette de l’État à l’égard de la sécurité sociale tient pour l’essentiel à l’insuffisance des crédits budgétaires ouverts en loi de finances initiale pour les exercices 2007 et 2008.
En théorie, l’insuffisance des crédits résulte soit d’un défaut de prévision du montant global des exonérations pouvant être réalisées au cours de l’exercice suivant, soit du gel des crédits votés par le Parlement aux fins de remboursement des créances de la sécurité sociale. Dans son rapport précité, la Cour des comptes observe qu’en 2008, les crédits destinés à permettre le remboursement des montants dus aux organismes de sécurité sociale ont effectivement rempli leur objet mais cela n’était pas nécessairement le cas lors des exercices précédents.
Or, la non-compensation de l’exonération des charges et des contributions dues par l’État alimente, en partie, la dette sociale en aggravant le poids des charges financières liées à la gestion de trésorerie.
Ainsi, selon l’annexe n° 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (122), l’apurement de la dette de l’État aura permis au régime général de réaliser en 2007 une économie de l’ordre de 200 millions d’euros sur ses charges d’intérêt. A contrario, d’après le rapport du Sénat consacré à l’examen du projet de loi de financement pour 2009, en raison du relèvement du plafond d’avances de trésorerie de l’ACOSS, les frais financiers supportés par le régime général devraient atteindre 1,1 milliard d’euros, chiffre en forte croissance, ce qui illustre par ailleurs le degré d’exposition au risque d’une probable remontée des taux d’intérêts à court terme.
Dans ces conditions, afin d’établir une sorte de contrat de confiance entre l’État et les organismes de sécurité sociale, votre rapporteur propose d’imposer à l’État de payer des intérêts aux organismes de sécurité sociale dès lors qu’il aura versé avec retard la compensation effective des exonérations de cotisations et de contributions dues à la sécurité sociale au titre d’un exercice.
Proposition n° 43 : imposer à l’État le paiement d’intérêts en cas de retard dans la compensation effective de l’exonération des cotisations et contributions dues aux organismes de sécurité sociale.
Ces mesures doivent permettre d’établir un véritable contrat de confiance entre l’État et les organismes de sécurité sociale.
B. UTILISER DE MANIÈRE RESPONSABLE LES RESSOURCES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
1. Rendre plus efficace l’organisation de la sécurité sociale
Toutes branches confondues, d’après les chiffres de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale arrêtés au 31 décembre 2008 (123), les effectifs des caisses du régime général de la sécurité sociale s’élevaient au total à 169 174 agents dont 161 068 agents travaillant en contrat à durée indéterminée et 8 106 agents recrutés par un contrat à durée déterminée.
Pour mémoire, le nombre des seuls agents travaillant sous contrat à durée indéterminée et relevant de la convention collective atteignait 176 687 agents toutes branches confondues au 31 décembre 2000 (124).
D’après les chiffres communiqués par M. Dominique Libault (125), les dépenses de fonctionnement (dont les dépenses de personnel) représentent 4,5 % du total des dépenses de la sécurité sociale. Il s’agit là d’un poste de dépenses relativement modeste dont les caisses de sécurité sociale s’efforcent de conserver la maîtrise avec un certain succès.
Aussi, il importe de soutenir les efforts fournis par la sécurité sociale afin d’assurer la rationalisation du réseau des caisses, la mutualisation des moyens et la gestion optimale des ressources humaines, en particulier dans le domaine de l’assurance maladie.
a) Mieux évaluer le coût des procédures
Si les organismes d’assurance maladie du régime général s’acquittent indéniablement de leurs missions avec une grande efficacité, il apparaît néanmoins possible d’améliorer leurs performances en menant à bien la mise en place d’instruments de comptabilité analytique et la restructuration du réseau de l’assurance maladie.
Selon les informations transmises par la direction de la sécurité sociale du ministère du Travail en réponse aux interrogations de votre rapporteur, la constitution par les caisses d’une comptabilité analytique se révèle hétérogène entre les branches. Par conséquent, la connaissance des coûts horaires des processus de production des organismes de sécurité sociale demeure imprécise dans certaines branches et, en particulier, l’assurance maladie.
D’après les chiffres dont dispose la mission, la CNAMTS affiche en effet un coût moyen de l’ensemble de ses processus par bénéficiaire de 112,28 euros en 2008. Même si l’on peut se féliciter que ce coût baisse de 10,6 % par rapport à 2005, on doit en revanche souligner que ce chiffre moyen ne reflète pas nécessairement le coût des principales tâches incombant aux agents du régime général d’assurance maladie : la gestion des prestations en espèce, des prestations en nature et du dossier client, la relation client, la gestion du risque.
Or, la connaissance de ces données peut servir d’aiguillon non seulement pour la mise en œuvre et le respect du contrat d’objectif et de moyens mais également, d’un point de vue plus général, à l’adaptation des procédures et de l’organisation des services.
Dans cet esprit, la mission encourage les caisses d’assurance maladie à assurer dans les meilleurs délais le déploiement de l’outil OSCARR.
Développée par la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), cette application devrait permettre d’établir une véritable comptabilité analytique et connaître plus précisément les coûts de chacun des métiers de l’assurance maladie.
La mission estime tout aussi essentiel que les autres branches du régime général se dotent également d’une comptabilité analytique des coûts ou, comme la caisse nationale d’allocations familiales, achèvent les expérimentations entreprises dans ce même but.
b) Poursuivre la rationalisation du réseau des caisses primaires d’assurance maladie du régime général de la sécurité sociale
Le réseau du régime général pour l’assurance maladie quant à lui repose à l’échelon local sur 128 caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) en métropole (126).
Organismes de droit privé, les CPAM mettent en œuvre les orientations nationales de l’assurance maladie sous la houlette de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), organisme national de droit public. Leur mission consiste avant tout à affilier les assurés sociaux, gérer leurs droits à l’assurance maladie, à traiter les feuilles de soins et à assurer le service des prestations d’assurance maladie et d’accidents du travail–maladies professionnelles (remboursement des soins, paiement des indemnités journalières, avance des frais médicaux aux bénéficiaires de la CMU, etc.).
Il incombe également aux CPAM d’appliquer un plan d’action en matière de gestion du risque défini chaque année en collaboration avec les professionnels de santé, de développer une politique de prévention et de promotion de la santé (dépistage des cancers, des déficiences, etc.), de mener une politique d’action sanitaire et sociale par des aides individuelles aux assurés et des aides collectives au profit d’association.
Il convient aussi de mettre en exergue le rôle des unions régionales des caisses d’assurance maladie (URCAM) qui regroupent les trois principaux régimes d’assurance maladie avec un objectif commun : la gestion du risque maladie au niveau régional.
Le réseau local du régime général de l’assurance maladie traite les dossiers de 46 millions d’assurés et travaille en relation avec 250 000 professionnels de santé et des milliers d’entreprises.
Compte tenu des résultats déjà obtenus en termes de coûts de gestion, il importe d’encourager la poursuite de la rationalisation du réseau des organismes de sécurité sociale par le rapprochement des caisses d’assurances maladie.
Le processus de rapprochement, lancé par le conseil de la CNAMTS du 16 mars 2006, consiste à réaliser la mutualisation de certaines activités des caisses primaires, à mettre en place des équipes de direction communes entre les CPAM et à regrouper les caisses dans le souci d’ajuster au mieux les ressources aux fluctuations de l’activité et d’améliorer la qualité du service.
D’après la CNAMTS (127), deux principes doivent guider la conduite de ces opérations de fusion : le rapprochement doit permettre la création d’entités dont la taille correspond à un minimum de 250 000 bénéficiaires environ ; ces fusions doivent être opérées dans le cadre départemental afin de préserver l’équilibre entre la proximité et l’unité de l’assurance maladie.
Fin 2008, d’après le rapport d’activité de la CNAMTS, près des deux tiers des conseils des organismes avaient annoncé leur intention de s’engager dans ce processus. Au cours de son audition (128), M. Dominique Libault a indiqué aux membres de la mission que 48 organismes devraient avoir fusionné au 1er janvier 2010.
Cette rationalisation devrait mettre l’assurance maladie en situation d’améliorer l’efficience de ses moyens et de réduire ses coûts de gestion aux alentours de 4 % comme elle s’y est engagée en 2006, dans le cadre de la convention d’objectifs de gestion avec l’État.
Proposition n° 44 : poursuivre la rationalisation du réseau des organismes du régime général de la sécurité sociale par le rapprochement des caisses primaires d’assurance maladie et des organismes gestionnaires.
Le rapprochement entre les caisses doit permettre d’améliorer l’efficience de leurs moyens et rendre possible de nouvelles réductions des coûts de gestion.
Il importe également que l’organisation des services garantisse la qualité du service rendu et ne crée aucune lourdeur de gestion susceptible de porter préjudice tant à l’ensemble des assurés sociaux qu’aux entreprises.
c) Évaluer l’efficacité du fonctionnement des caisses de congés payés
Dans cette optique, la mission s’interroge sur les moyens d’améliorer l’exercice des missions assumées aujourd’hui par les caisses de congés payés.
Historiquement, ces organismes ont pour vocation de garantir la possibilité de prendre des congés payés pour certaines catégories de salariés travaillant dans des secteurs à l’activité discontinue et qui ont pu accomplir des périodes de travail auprès de plusieurs employeurs : entreprises du bâtiment et des travaux publics, entreprises employant des transporteurs intermittents, des dockers, entreprises de spectacles. La garantie du bénéfice des congés payés donne lieu soit au versement d’une indemnité de congés payés pendant la période effective de congés, soit au versement, au titre des congés payés, d’une indemnité valant 10 % de la rémunération en cas de rupture du contrat de travail ou si le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés pendant la durée de son contrat.
Pour ce faire, les caisses collectent une cotisation auprès des entreprises tout au long de l’année.
Certes, le panorama des caisses de congés payés offre un paysage d’une grande diversité et certaines caisses remplissent d’autres fonctions que le seul service de l’indemnité des congés payés. À titre d’exemple, les caisses du BTP assurent ainsi la gestion du régime intempéries (129) et de l’indemnité correspondante ainsi que la collecte pour le compte de tiers.
Toutefois, la très grande hétérogénéité des caisses ne semble pas devoir garantir l’efficacité et un moindre coût des procédures de versement des prestations. Le bilan établi par les services de la direction de la sécurité sociale au ministère du Travail en réponse aux interrogations de votre rapporteur laisse ainsi entrevoir l’existence de coûts de gestion variables mais relativement élevés selon les caisses concernées.
Cet écart peut s’expliquer en partie par la diversité de l’organisation des caisses et de leur réseau : pour le bâtiment, une caisse nationale coiffe un réseau de caisses régionales tandis que la Caisse congés spectacles constitue une caisse unique et qu’il existe une caisse dans 11 ports pour le réseau de la Caisse des congés payés des dockers. Par ailleurs, on constate de grandes disparités s’agissant de la population couverte : si par exemple le réseau congés intempérie BTP couvre environ 1,6 million de salariés ; seules 4 000 personnes sont couvertes par la caisse des dockers.
Il convient surtout de remarquer que les prélèvements réalisés par les caisses peuvent apparaître comme une charge de trésorerie difficilement justifiable pour les entreprises dès lors que les salariés sont employés dans certaines professions de manière quasi permanente et que les indemnités ne sont versées que tardivement, ainsi que le relève la Cour des comptes dans son rapport d’observations définitives consacré à la caisse des congés spectacles et daté du 26 novembre 2007 (130).
Dans ces conditions, il convient de réfléchir aux moyens d’améliorer l’exercice des missions assumées par les caisses de congés payés, soit par des mesures les incitant à rationaliser leur réseau telle que la conclusion d’un contrat d’objectifs et de gestion, soit par un rapprochement avec le régime général pour le service de certaines prestations.
Proposition n° 45 : évaluer l’efficacité du fonctionnement des caisses de congés payés.
Cette évaluation est une première étape pour déterminer quelles sont les améliorations qui pourraient être apportées à l’organisation de ces caisses avant d’adopter des mesures les incitant à rationaliser leur réseau.
d) Développer la déclaration sociale nominative
Le mouvement de rationalisation du réseau devrait inciter les caisses de sécurité sociale à tirer pleinement partie du développement de la dématérialisation des procédures.
Ainsi que l’a rappelé M. Dominique Libault aux membres de la mission lors de son audition (131), le développement des téléprocédures constitue l’un des axes d’amélioration du fonctionnement des organismes de sécurité sociale, notamment du point de vue de leurs relations avec les usagers.
La baisse du délai de remboursement des soins fournit un bon exemple des gains d’efficacité dégagés par l’assurance maladie grâce à la dématérialisation des procédures : d’après les chiffres cités par l’assurance maladie, le délai de remboursement pour les feuilles de soins électroniques (avec l’utilisation de la Carte Vitale) s’élève à 5 jours en moyenne contre près de 13 jours pour le traitement d’une feuille papier.
Du point de vue du fonctionnement interne des caisses, les CPAM devraient accroître l’efficacité de leurs services par le recours à la dématérialisation et à la gestion électronique des documents. C’est d’ailleurs l’un des objectifs du déploiement du logiciel DIADEME (132) qui devrait s’achever à la fin de l’année 2010. Cette application doit notamment favoriser un traitement plus fluide des dossiers et la diffusion instantanée de leur contenu auprès des services intéressés.
Dans ce contexte, il convient que l’État incite les caisses du régime général et, en particulier, les caisses d’assurance maladie à accentuer le développement des téléprocédures.
Leur développement devrait compléter utilement et donner une pleine efficacité aux mesures de simplification que la sécurité sociale s’efforce de prendre systématiquement et qu’a évoquées M. Dominique Libault lors de son audition : l’adoption d’une déclaration unique pour le régime social des indépendants, les efforts tendant à éviter de demander aux administrés des informations redondantes (comme par exemple pour le RSA) ou encore le projet de déclaration sociale nominative (DSN).
D’après les informations communiquées par la direction de la sécurité sociale du ministre du Travail, la DSN prendrait la forme d’une déclaration unique qu’enverraient les entreprises aux organismes de sécurité sociale de manière dématérialisée et qui permettrait de transmettre mensuellement, sans ressaisie, l’ensemble des données relatives à la rémunération des salariés mais également les informations relatives à certains événements tels que les mouvements de personnel (affiliation aux organismes de prévoyance ou radiation) ou la survenue d’un accident, d’une maladie du travail.
Même si la mise en place de la DSN exige des analyses complémentaires, afin notamment de mieux évaluer le coût prévisionnel global du projet, les possibilité techniques de l’application support et les économies potentielles, les acteurs de ce projet estiment à l’heure actuelle que cette procédure pourrait présenter beaucoup d’avantages tant pour les entreprises et les salariés que pour les organismes de sécurité sociale.
Du point de vue des entreprises, la DSN favoriserait l’allègement de la charge de gestion inhérente au traitement des actes administratifs puisque la DSN se substituerait à la quasi-totalité des déclarations actuellement remplies (133). Par ailleurs, la DSN permettrait de mieux assurer la fiabilité des données transmises et de mieux répartir la charge déclarative sur l’ensemble de l’année, les entreprises s’acquittant de cette obligation en même temps que l’établissement mensuel de leurs bulletins de paie. Selon une étude réalisée par Ineum Consultings, selon leur taille, l’étendue du périmètre de la DSN et après une phase d’appropriation et de réorganisation, certaines entreprises pourraient bénéficier d’une réduction de moitié de la charge que représentent les déclarations sociales.
Du point de vue des salariés, la DSN contribuerait également à réduire les formalités déclaratives actuellement effectuées, notamment pour la liquidation de la pension retraite, et à accélérer le versement de certaines prestations, par exemple les indemnités journalières d’assurance maladie.
Du point de vue des organismes sociaux, d’après les informations transmises à votre rapporteur par les services de la direction de la sécurité sociale du ministère du Travail, la DSN serait susceptible d’accroître la productivité des services en réduisant la charge liée au traitement des déclarations sur papier. Elle permettrait également d’augmenter la fiabilité des données déclarées et de limiter les risques de fraude. Certes, la mise en place de la DSN supposerait au préalable d’adapter les systèmes informatiques. D’après les informations fournies à votre rapporteur, le coût d’un tel investissement se situerait dans une fourchette de l’ordre de 12 à 14 millions d’euros, chiffre qui porte sur le seul déploiement du dispositif et n’inclut pas les coûts récurrents d’entretien.
Pour autant, compte tenu des gains de productivité que les organismes de sécurité sociale pourraient réaliser et de l’allègement de la charge que représente dans les entreprises le traitement de nombreuses déclarations, la mission préconise la mise en place de la déclaration sociale nominative d’ici 2012, en accordant néanmoins toute l’attention nécessaire aux besoins des entreprises et aux éventuelles difficultés qu’elles pourraient rencontrer dans l’adaptation de leur logiciel de paiement.
Proposition n° 46 : mettre en place d’ici 2012 la déclaration sociale nominative.
Cette déclaration serait de nature à alléger la charge que représente pour les entreprises le traitement de nombreuses déclarations.
e) Permettre l’affiliation de droit de l’assuré social à la caisse la plus proche de son domicile
Cela étant, le mouvement de rationalisation du réseau de la sécurité sociale pourrait être rendu plus dynamique. À cette fin, votre rapporteur préconise l’affiliation de droit des assurés sociaux à la caisse la plus proche de leur domicile, indépendamment de leur appartenance à tel ou tel régime.
Pour rappel, chaque assuré social relève de l’un des régimes de la sécurité sociale (régime général, régime de la mutuelle sociale agricole, régime social des indépendants, régimes des fonctionnaires et assimilés, régimes spéciaux) à raison de sa profession (par exemple, salarié du privé) ou de la particularité de son statut (par exemple, fonctionnaire de l’État ou agent des collectivités territoriales).
Cette disposition doit favoriser tout d’abord une meilleure proximité entre le réseau des caisses de la sécurité sociale et les assurés sociaux.
Ensuite, l’obligation pour l’assuré social de ne s’adresser qu’à une caisse relevant de son régime se révèle moins impérative et justifiée dès lors qu’existe un système de compensation inter-régimes.
Institué par la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 (134) qui en proclame le principe et modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, ce système vise à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les régimes obligatoires de sécurité sociale. Suivant le principe de compensation généralisée posé par l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, la compensation entre régimes porte sur les charges de l’assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature et de l’assurance vieillesse au titre des droits propres. Le système de compensation lie en outre plus particulièrement le régime général au régime de la mutuelle sociale agricole et, selon des modalités assez diverses concernant les prestations objets de la compensation (135), le régime général à des régimes spéciaux (régime de la SNCF, des gens de mer, des mineurs et des agents de la RATP).
Aussi, la mission recommande que soit appliquée l’affiliation de droit à la caisse la plus proche du domicile. A minima, ce droit à l’affiliation à la caisse la plus proche de son domicile devrait être ouvert en priorité pour les caisses d’assurance maladie, les conditions d’ouverture des droits et les prestations services tendant à se rapprocher entre les différents régimes de la sécurité sociale et à s’aligner sur le régime général. ..
Proposition n° 47 : permettre aux assurés sociaux de s’affilier de droit à la caisse la plus proche de leur domicile, indépendamment de tout critère fondé sur la profession ou le statut.
Cette mesure simplifiera les relations entre les usagers et les caisses.
f) Dégager des économies d’échelle en mutualisant les moyens à l’échelon régional
En dernier lieu, il convient d’encourager les initiatives prises par les caisses afin de mutualiser leurs moyens. Dans cette optique, la mission invite les caisses du régime général de sécurité sociale à renforcer le rôle de leur échelon régional afin de dégager des économies d’échelles dans la gestion des fonctions supports.
Au cours de son audition, M. Dominique Libault a attiré l’attention des membres de la mission sur les économies qui pouvaient être réalisées par la mutualisation des fonctions supports (gestion des ressources humaines, traitement de la paie des agents, organisation de l’achat des fournitures). Une réflexion serait en cours afin d’envisager la création d’accueils communs entre caisses de sécurité sociale.
Toutefois, aux yeux de votre rapporteur, l’organisation d’un accueil commun entre caisses de sécurité sociale se révèle problématique dans la mesure où les agents ne disposent pas nécessairement des compétences requises pour répondre précisément à des questions qu’ils ne traitent pas eux-mêmes quotidiennement.
En revanche, la création ou le renforcement d’un pôle régional semble mieux favoriser la répartition optimale des moyens et, éventuellement une gestion susceptible de dégager des économies d’échelles.
C’est dans cet esprit qu’après s’être engagées dans la départementalisation de leur réseau, l’ACOSS et les URSSAF mènent actuellement une réflexion sur le bien-fondé d’une mutualisation de leurs moyens au niveau régional tout en maintenant un dispositif de sécurité, ainsi que l’a expliqué M. Pierre Burban lors de son audition (136).
Dans le cas de l’assurance maladie, cette mutualisation des moyens du régime général pourrait être organisée à l’échelon des caisses régionales d’assurance maladie (CRAM), lesquelles se verraient ainsi renforcées dans la gestion du risque maladie.
Proposition n° 48 : organiser la mutualisation des moyens des caisses du régime général de la sécurité sociale par la création ou le renforcement du rôle de l’échelon régional d’ici 2012.
L’échelon régional doit favoriser la réalisation d’économie d’échelle dans la gestion des fonctions support.
g) Permettre aux caisses de sécurité sociale d’effectuer contre rémunération le paiement des prestations couvertes par les organismes de complémentaire santé
D’après les chiffres du dernier rapport du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie publié en juillet 2009 (137), près de 93 % de la population française disposent d’une assurance complémentaire santé. D’après un rapport d’information du Sénat consacré à la répartition du financement de l’assurance maladie depuis 1996 et sur les transferts de charges entre l’assurance maladie obligatoire, les assurances complémentaires et les ménages (138), on compte aujourd’hui entre 32 millions et 38 millions de bénéficiaires dans le pôle mutualiste, 13 millions dans les sociétés d’assurances et 11 millions dans les institutions de prévoyance.
Au-delà de l’intervention de la sécurité sociale et de l’État (essentiellement au titre de la CMU), les organismes complémentaires de santé assuraient en 2008 la prise en charge de 13,7 % des dépenses de santé des ménages (139). Grâce à diverses aides fiscales, et notamment l’aide à la complémentaire santé, le coût inhérent à l’acquisition d’une telle assurance a diminué depuis quelques années si bien que les complémentaires santé se présentent désormais comme des acteurs à part entière de la consommation de soins et de biens médicaux en France.
Dès lors que leur incombe la couverture d’une part notable des dépenses de santé, il ne semble pas illégitime de s’interroger sur l’efficacité de la gestion de ces organismes et des éventuelles économies que pourrait réaliser l’ensemble des Français sur ce poste de dépense.
Or, l’étude réalisée à la demande du Sénat par la Cour des comptes et annexée au rapport précité tend à démontrer l’importance des frais de gestion de ces organismes de santé complémentaire par rapport à ceux constatés au sein des organismes de sécurité sociale. Selon les résultats de cette étude confirmés devant la commission des Affaires sociales du Sénat par Mme Rolande Ruellan, présidente de la 6e chambre de la Cour des comptes, les frais de gestion atteindraient en moyenne 25,4 % pour les complémentaires santé contre seulement 5,4 % pour l’assurance maladie obligatoire.
Même si cette estimation a pu être contestée par l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire (UNOCAM) (140) et si la Cour des comptes présente ce chiffre comme une moyenne, un coût de gestion dans les organismes de complémentaire santé supérieur à celui des organismes de sécurité sociale n’apparaît pas inconcevable au plan théorique.
En effet, la micro économie enseigne que plus la taille d’une structure est importante, plus les coûts fixes représentent une faible part dans le coût global de production, ce qui favorise la réduction du prix de revient. Ce raisonnement peut valoir pour de grandes structures telles que l’assurance maladie qui, en l’espèce, traite une masse de dossiers incomparablement supérieure à celle des organismes de complémentaire santé, le nombre d’assuré sociaux s’élevant à près de 46 millions. En outre, les organismes de complémentaire santé supportent des dépenses de marketing d’autant plus importantes que le segment du marché de l’assurance sur lequel elles opèrent est concurrentiel. Il en résulte potentiellement des charges supplémentaires que ne connaît pas l’assurance maladie puisqu’elle est obligatoire et n’est pas tenue de défendre une part de marché.
Puisque les coûts de gestion de l’assurance maladie se révèlent plus faibles au sein des caisses du régime général, votre rapporteur estime qu’il conviendrait d’envisager de transférer aux caisses d’assurances maladie du régime général le paiement des prestations servies par les organismes de complémentaire santé et, en particulier, les mutuelles.
Cette mesure doit permettre avant tout de réduire le coût de la couverture assurée par les organismes de complémentaire santé en réduisant leurs frais de gestion et en les incitant, sous la pression également de la concurrence, à se réorganiser et à se recentrer sur leur cœur de métier. L’abaissement du coût de fonctionnement des mutuelles pourrait alors compléter utilement l’effort fourni par les pouvoirs publics afin de réduire la part de la population qui ne bénéficie pas encore d’une couverture complémentaire santé.
En contrepartie de la prise en charge du versement des prestations mutuelles, il conviendra d’organiser en conséquence la rémunération des caisses d’assurance maladie par les mutuelles.
Le calcul de cette rémunération devra tenir compte tout d’abord du surcoût que représente pour la sécurité sociale le traitement des dossiers de paiement des mutuelles. Il s’agit, en effet, de ne pas compromettre l’amélioration du service rendu à l’usager qui se traduit notamment par une baisse du coût et des délais de traitement des dossiers par l’assurance maladie. Pour mémoire, d’après les chiffres communiqués à votre rapporteur par la direction de la sécurité sociale au ministère du Travail, le coût moyen de l’ensemble des processus par bénéficiaire de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés a baissé de 10,6 % entre 2008 et 2005, s’établissant à 112, 28 euros en 2008 contre 125, 65 euros en 2005.
Le calcul de la rémunération due à la sécurité sociale devra également s’appuyer sur le coût réellement observé du traitement des dossiers de paiement par les mutuelles. Il conviendrait à cette fin de mener une étude approfondie et d’associer à sa réalisation les instances de l’UNOCAM de sorte que la fixation de cette rémunération repose sur la connaissance la plus fine possible des économies et du surcroît de bénéfices dont pourraient bénéficier les organismes d’assurance complémentaire santé.
Il importe que le coût de l’accès à une couverture complémentaire diminue afin que l’ensemble de la population bénéficie de cette protection complémentaire et sans que l’effort fourni à cette fin par les pouvoirs publics ne soit inutilement coûteux. D’après l’étude de la Cour des comptes précitée, outre le coût de la CMU complémentaire, le montant total des aides fiscales pour l’acquisition d’une couverture complémentaire atteint près de 7,6 milliards d’euros (141).
Compte tenu de la gravité de nos déficits, une telle dépense doit donner lieu à un examen scrupuleux de sorte que chaque euro investi par la puissance publique permette d’atteindre cet objectif fondamental : assurer à l’ensemble des Français un égal accès à la protection d’un organisme de complémentaire santé.
Proposition n° 49 : Permettre aux caisses d’assurance maladie du régime général de sécurité sociale d’effectuer contre rémunération le paiement des prestations servies par les organismes de complémentaire santé.
Cette mesure permettra au système de bénéficier de l’expérience, de l’organisation et des moyens – notamment les applications informatiques – des caisses d’assurance maladie. Il faudra, en contrepartie, prévoir la rémunération des caisses au titre de cette nouvelle fonction qui constituera une prestation de services à l’attention des mutuelles et en fixer le montant sur la base d’études approfondies et d’une concertation étroite avec l’UNOCAM.
2. Développer les procédures et récompenser les comportements économes des deniers publics
a) Favoriser des modes de garde du jeune enfant plus économes en permettant aux familles de jouer un plus grand rôle et en rendant plus attractive la garde par les assistantes maternelles
L’augmentation des prélèvements obligatoires liés à la création puis au développement du système de sécurité sociale participe du mouvement plus général de socialisation constatée dans la seconde moitié du XXe siècle au sein de nombreuses sociétés occidentales.
Par socialisation, il faut entendre la prise en charge d’un nombre croissant de tâches incombant autrefois à l’individu, son réseau familial, telle que la protection contre les risques inhérents à la maladie, la prise en charge des aînés ou des enfants en bas âge.
Or, cette croissante mise à contribution de la société peut, à bien des égards, se révéler problématique. Au plan financier, se pose évidemment la question de la couverture des dépenses rendues nécessaires par la création ou le maintien de prestations au bénéfice d’une population nombreuse. Au plan des relations sociales, on peut se demander si l’organisation de la solidarité par des organismes publics peut tout à fait remplacer les solidarités plus traditionnelles qui plaçaient l’individu au cœur de réseaux ou de cercles plus restreints telles que celui de la famille.
Dans cette optique, et sans proposer de revenir à un schéma social pré-moderne, il convient d’accorder une place toute particulière à la famille et de développer des modes de garde des jeunes enfants moins coûteux pour les finances publiques.
• Permettre à la famille de jouer un plus grand rôle, par exemple dans la garde des jeunes enfants
La structure familiale joue, en effet, un rôle essentiel pour le maintien des réseaux de solidarité privée mais également pour le dynamisme économique du pays par le biais du maintien d’une natalité forte.
En 2008, d’après les derniers chiffres de l’INSEE rendus publics en août 2009, la France a enregistré 828 404 naissances en 2008, ce qui la place en tête des pays européens en termes de taux de natalité, le taux de fécondité atteignant, quant à lui, le chiffre record de 2,07 enfants par femmes.
Cette vigueur de la natalité française s’explique à la fois par une politique familiale volontariste et par la relative souplesse des structures de la famille française qui laissent aux mères de famille la possibilité de poursuivre une activité professionnelle tout en élevant leur enfant.
Or, le développement du travail féminin, qui constitue au demeurant un impératif si l’on veut maintenir un haut niveau de croissance potentielle en France (142), peut être entravé par le manque de structures d’accueil des jeunes enfants pendant le temps de travail des parents. Par ailleurs, la création et l’ouverture de nouvelles places de garde dans des établissements publics exigent des délais assez longs.
Afin de remédier à ces situations, une solution originale pourrait consister à faire jouer un plus grand rôle aux grands parents dans la garde des jeunes enfants après l’école pendant le temps de travail des parents.
À cette fin, votre rapporteur suggère que les enfants puissent, par exemple, être inscrits de droit à l’établissement scolaire du ressort du domicile de leurs grands-parents.
Cette mesure vise à favoriser un mode de garde alternatif qui, d’une part, peut contribuer au resserrement des liens inter-générationels et, d’autre part, peut se révéler plus adapté aux rythmes de vie des familles que des structures collectives dont le coût se révèle du reste relativement important pour les finances publiques en général.
En l’état du droit actuel fixé par les dispositions des articles L. 131-5 et L. 212-7 du code de l’éducation pour les écoles maternelles et primaires, les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire sont tenues de l’inscrire dans l’école du ressort délimité par délibération du conseil municipal et dont dépend leur domicile ; les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par voie réglementaire.
Par ailleurs, les parents désireux d’inscrire leur enfant dans une commune autre que celle de leur résidence doivent s’adresser à la mairie de la commune d’accueil. Cet accueil peut être refusé s’il s’agit d’une première inscription, sauf en l’absence d’école dans la commune de résidence et dans certaines situations particulières.
Dans ces conditions, il conviendrait de modifier les dispositions précitées du code de l’éducation afin d’affirmer que l’inscription dans l’établissement du ressort dans lequel se trouve le domicile des grands-parents est de droit. La rédaction de ce nouvel alinéa pourrait s’inspirer des dispositions actuelles de l’alinéa 8 de l’article L. 131-5 du code de l’éducation selon lesquelles « la conclusion d’un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail ».
La prise en charge des jeunes enfants exige également le développement d’autres modes de garde afin d’aider les familles et de garantir un meilleur emploi des ressources publiques.
• Rendre plus attractive la garde des jeunes enfants par les assistantes maternelles
Au cours de son audition, M. Dominique Libault (143) a attiré l’attention des membres de la mission sur un paradoxe assez coûteux pour les finances publiques : alors que la garde d’un enfant par une assistante maternelle coûte moins cher à la collectivité qu’une prise en charge au sein d’une crèche municipale, les parents placent plus fréquemment leurs enfants dans des structures collectives de garde telles que la crèche municipale.
De fait, les chiffres annexés au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 montrent que la garde d’un enfant par un établissement d’accueil de jeunes enfants coûte en moyenne 50 % plus cher que la garde par une assistante maternelle (144). C’est pourquoi les politiques publiques se sont efforcées, dans la perspective de mise en œuvre en 2012 d’un droit opposable à la garde d’enfant, d’encourager la prise en charge des enfants par des assistantes maternelles, ainsi que l’a indiqué M. Dominique Libault, directeur de la sécurité sociale (145). Ainsi, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a-t-il porté le nombre d’enfants pour lesquels les assistantes pouvaient être agréées de trois à quatre (146).
Pourtant, la Cour des comptes constatait récemment que le nombre d’assistantes maternelles ne progressait que faiblement, suivant simplement le rythme de la natalité (+ 2,9 % par an en moyenne) (147). Deux facteurs principaux expliquent cette faible croissance, alors que les besoins de places pour la garde des jeunes enfants sont évalués entre 300 000 et 500 000 places par le rapport de Mme Michèle Tabarot (148) :
— un problème lié à l’offre : la profession est peu attractive. Le salaire mensuel net perçu était de 555 euros en 2006, seules 10 % des assistantes maternelles ayant perçu un salaire supérieur à 1176 euros. Ces derniers se plaignent du manque de reconnaissance qui entoure leur profession (149). De surcroît, Mme Michèle Tabarot, estime, dans son rapport au Premier ministre que « le vieillissement des assistant(e)s maternel(le)s fait peser un risque de pénurie pour cette profession. »
— un problème lié à la demande : les parents de jeunes enfants ne sont pas incités à utiliser ce mode de garde. En effet, outre le fait que la garde dans une structure municipale est vue comme plus sécurisante parce que plus professionnelle, la différence de coût pour les finances publiques entre les deux modes de garde n’est pas répercutée sur les familles : le coût mensuel d’une garde d’enfant en crèche ou par une assistante maternelle agréé est similaire, d’un montant moyen de 185 euros par mois et par enfant selon une note de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) (150).
Les efforts incitatifs doivent donc être dirigés à la fois en direction des parents et en direction des assistantes maternelles.
À cette fin, la mission préconise tout particulièrement le renforcement de la formation dont bénéficient les assistantes maternelles afin d’accroître leur professionnalisme et donc de rendre plus attractifs la profession d’une part, et, d’autre part, ce mode de garde aux yeux des parents.
Depuis le 1er juillet 2007, en application des dispositions des articles L. 421-14 et L. 421-15 du code de l’action sociale et des familles, les assistantes maternelles ayant obtenu un agrément doivent suivre une formation globale de 120 heures, formation comprenant un stage préparatoire à l’accueil d’enfants d’une durée de 60 heures avant la garde de tout enfant ainsi qu’une initiation aux gestes de secourisme.
Dans les deux ans qui suivent l’accueil des enfants, les assistantes maternelles doivent avoir accompli la totalité des heures de stage qu’elles sont tenues de suivre. La formation porte sur quatre grands thèmes : le développement, les rythmes et les besoins de l’enfant ; la relation parents-enfants autour de l’élaboration du projet éducatif ; les aspects éducatifs dont l’accès à l’autonomie, la découverte et la socialisation de l’enfant ; enfin, le cadre institutionnel de leur travail (connaissance du réseau local Petite enfance). Les assistantes maternelles déjà agréées relèvent de l’ancien système : elles suivent une formation de 60 heures dans les cinq ans suivant leur agrément, dont 20 heures au cours des deux premières années.
Or, du point de vue même de certaines assistantes maternelles, le volume horaire de la formation initiale peut apparaître insuffisant pour disposer de toutes les compétences nécessaires à la première prise en charge d’enfants et inspirer la confiance des parents dans ce mode de garde.
Dans ces conditions, votre rapporteur estime qu’il convient d’envisager la création d’un diplôme national sanctionnant la sortie d’une véritable filière de formation et ouvrant la perspective d’une poursuite de carrière dans les établissements publics accueillant les jeunes enfants.
Actuellement, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des assistants maternels, l’assistant maternel doit, pour valider sa formation, présenter une épreuve de l’unité professionnelle « prise en charge de l’enfant au domicile » du certificat d’aptitude professionnelle petite enfance.
La mesure que la mission suggère consiste soit à créer un diplôme distinct, soit à faire de la profession d’assistant maternel un débouché de la formation de puéricultrice.
L’obtention d’un diplôme attestera de manière objective des compétences de l’assistant maternel et de son aptitude à assurer la garde de jeunes enfants en toute sécurité. Ce faisant, la possession d’un diplôme permettra de ne plus recourir à la procédure d’agrément délivré par le conseil général. Cette procédure apparaît, en effet, source de lenteurs administratives et ne place pas les parents sur un pied d’égalité dans l’accès à ce mode de garde.
Proposition n° 50 : favoriser des modes de garde plus économes en permettant à la famille de jouer un plus grand rôle et en rendant plus attractive la garde par des assistantes maternelles.
Une plus grande place donnée aux familles peut par exemple se traduire par la possibilité d’inscrire les enfants à l’établissement scolaire du ressort dans lequel se trouve le domicile des grands-parents. D’autres pistes doivent être explorées afin que les familles jouent un plus grand rôle au bénéfice de la société tout entière.
Créer un diplôme sanctionnant la sortie d’une véritable filière de formation doit rendre plus attractive la garde par un assistante maternelle et ouvrir la perspective d’une véritable carrière dans les établissements publics accueillant les jeunes enfants.
b) Susciter une prise de conscience et inciter à modifier les comportements pour préserver leurs droits sociaux
Depuis plus de soixante ans, la population française témoigne au système de sécurité sociale un profond attachement qui ne se dément pas. La sécurité sociale constitue l’un des piliers fondamentaux du pacte républicain renouvelé par le programme du Conseil national de la résistance. En ces temps de crise économique et sociale, elle préserve la cohésion nationale et assure une certaine qualité de vie qui place la France à la huitième place du classement des pays établi par le Programme des Nations unies pour le Développement sur le fondement de l’indice de développement humain (151).
Toutefois, il importe que les Français prennent conscience que si notre système de protection sociale fait partie de « l’exception française », il ne relève pas en revanche de l’ordre naturel des choses. De la loi du 9 avril 1898 reconnaissant la responsabilité sans faute l’employeur pour les accidents du travail à celle du 28 juillet 1999 instituant la couverture maladie universelle, la création et l’affermissement de la sécurité sociale française a, en effet, exigé de nombreux efforts et bien des luttes. Notre système de protection sociale peut être menacé dans sa pérennité même.
Dans un contexte marqué par la concurrence internationale et alors qu’il n’apparaît ni souhaitable, ni même possible d’augmenter encore la dépense publique, le maintien des droits qu’il procure exige de parvenir à maîtriser la dépense sociale. Cet effort passe nécessairement par une réforme de l’organisation et des modalités de financement de la sécurité sociale qui incombe aux pouvoirs publics dans sa mise en œuvre. Toutefois, une telle réforme ne produira pleinement ses effets que si les pouvoirs publics s’assurent de l’adhésion et de l’entière participation des principaux intéressés : les assurés sociaux.
Si la consommation de biens et de soins médicaux procède en partie d’effets de structure telle que l’organisation d’un établissement de soins ou le niveau de remboursement décidé par une caisse, elle tient également aux comportements individuels, aux attentes exprimées vis-à-vis de la sécurité sociale.
Forte de cette conviction, la mission propose que soit lancée dans les médias une vaste campagne d’information et de sensibilisation incitant nos concitoyens à faire preuve de responsabilité dans leur consommation des prestations assurées par la sécurité sociale.
Dans l’esprit de votre rapporteur, cette campagne devra informer pleinement les assurés du coût potentiel pour la sécurité sociale du geste le plus anodin, démontrer le caractère sans doute excessif de certains comportements tels que la surconsommation de médicaments psychotropes. Sans stigmatiser ou dénoncer, cette campagne devra néanmoins inviter également à un examen de conscience, inciter chacune et chacun à ne demander un soin ou à user d’une prestation que si il ou elle répond à un véritable besoin pour sa santé. Il s’agit en somme de faire appel au civisme, au sens de la mesure et de la responsabilité par des messages faisant des Français la cheville ouvrière de l’entreprise de sauvegarde de la sécurité sociale sur le thème: « Permettre à la sécurité sociale de faire des économies, c’est prendre soin de sa santé et de son portefeuille ! ». Sans dramatisation inutile, il conviendra en effet de rappeler que l’existence de notre système public de protection sociale ne va pas de soi, tant d’un point de vue historique qu’au regard des choix faits par d’autres sociétés ; que seule la mobilisation résolue de la collectivité mais également de chacun de ses membres permettra de léguer notre sécurité sociale aux générations qui viennent.
La mission recommande que ces messages soient diffusés sur les ondes radio, sur les chaînes de télévision et relayés sur Internet en s’inspirant du modèle de la campagne menée par l’assurance maladie afin de limiter la prescription d’antibiotiques. D’après une étude publiée dans la revue Plos Medicine (152) et portant sur la période 2002-2007, cette campagne de sensibilisation, diffusée chaque hiver depuis 2001, a permis de réduire les prescriptions d’antibiotiques de 26,5 % par rapport aux deux hivers qui ont précédé son lancement. Ainsi, la réussite de cette campagne a dépassé les objectifs que s’assignaient les autorités sanitaires et l’assurance maladie et a provoqué un profond changement des comportements.
Le succès de ce type de communication tend ainsi à démontrer que par des messages clairs et ciblés, les pouvoirs publics peuvent faire évoluer les comportements dans le domaine de la santé publique et de la consommation de soins et de biens médicaux.
Proposition n° 51 : inciter les Français à modifier leurs comportements pour préserver leurs droits sociaux en lançant une campagne d’information et de sensibilisation dans les médias sur le coût potentiel des comportements individuels pour les dépenses de sécurité sociale.
Cette campagne devra faire l’objet d’une large couverture et donner lieu à la diffusion de messages clairs et ciblés sur le modèle de la campagne destinée à limiter la prescription d’antibiotiques.
CONCLUSION : POUR UN SOMMET NATIONAL DE LA DETTE PUBLIQUE
L’ambition constante de votre rapporteur, tout au long de ses travaux, a été d’inviter l’ensemble des acteurs concernés – État, collectivités territoriales, sécurité sociale – à un sursaut national pour le retour à l’équilibre des comptes publics. Le constat est aujourd’hui sans appel : si rien n’est fait dans les prochains mois, la France va devoir faire face à une crise sans précédent de ses finances publiques.
Comme votre rapporteur l’a déjà souligné, si la crise économique a mis en lumière la profonde dégradation de nos comptes, elle ne saurait être tenue pour seule responsable : la montée du déficit et de la dette est, au contraire, le fruit d’une lente et irrésistible dérive de nos finances publiques depuis la fin des Trente Glorieuses.
Or, parce que le risque de déclassement de la France en Europe est réel, parce la pérennité du modèle social français, qui au fondement de notre pacte républicain, peut être menacée, parce qu’il en va du sort des générations de demain, la France doit faire des choix à la hauteur des enjeux actuels, qui dépassent de loin le seul cadre budgétaire annuel.
Aussi ces choix doivent-ils s’inscrire au-delà des débats sur les projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2010, qui vont être prochainement discutés au Parlement et qui n’étaient pas l’objet de la mission. En effet, ces choix qui engagent l’avenir de la France et que celle-ci ne peut plus repousser à demain, ne sauraient être pris sans une mobilisation générale, invitant l’ensemble des acteurs à assumer leurs responsabilités. Si la France entend en particulier préserver son modèle de sécurité sociale, auquel elle est tant attachée, elle se doit de prendre dès aujourd’hui les mesures qui s’imposent.
Or, l’histoire de France nous enseigne que, face à des situations de crise majeure, le pays a su réagir énergiquement, en mobilisant au-delà des clivages traditionnels. Ainsi, au sortir de la Première Guerre mondiale, en dépit du fardeau de la dette et des déficits qui pesaient sur l’avenir du pays et de la reconstruction, un homme politique, comme Raymond Poincaré, a su rassembler et prendre les décisions qui s’imposaient afin de restaurer la confiance dans notre pays. La politique de rationalisation de la dépense publique qu’il avait menée avec force et conviction avait également été l’occasion de procéder à une importante réforme administrative : suppression d’un grand nombre d’organismes administratifs ; réorganisation des conseils de préfecture ; nouvelle répartition des compétences entre le pouvoir central et les pouvoirs locaux. C’était le temps des décisions, des efforts, du courage.
Votre rapporteur veut croire que cette époque n’est pas révolue. Parce que la France est aujourd’hui placée devant des choix de même ampleur, elle se doit à nouveau d’être exemplaire. Pour y parvenir, le pays doit se rassembler et votre rapporteur propose que se tienne, avant la fin du premier semestre 2010, un sommet national de la dette publique, qui regroupera l’ensemble des partis politiques représentés par un parlementaire national ou européen ainsi que l’ensemble des forces syndicales et organisations représentatives du monde de l’entreprise. Ce sommet doit permettre à l’ensemble des forces vives de la Nation de définir, de manière consensuelle, un agenda partagé de retour à l’équilibre des comptes publics. Sur la base de ce programme, les autorités politiques auront la responsabilité de proposer aux Français les différentes mesures permettant de respecter ce qui doit être un nouveau serment du Jeu de paume : le retour à l’équilibre de nos finances publiques.
Seule une mobilisation générale, au-delà des traditionnelles lignes de partage, permettra à chacun d’accepter et de partager le poids de l’effort à consentir pour surmonter cette crise.
Proposition finale : réunir, avant la fin du premier semestre 2010, un sommet national de la dette publique
Afin que chacun accepte le poids de l’effort à consentir pour surmonter la crise des finances publiques, réunir, avant la fin du premier semestre 2010, un sommet national de la dette publique, qui rassemblera l’ensemble des partis politiques représentés par un parlementaire national ou européen ainsi que l’ensemble des forces syndicales et organisations représentatives du monde de l’entreprise. L’objectif de ce sommet est de parvenir à la définition, de manière consensuelle, d’un agenda partagé de retour à l’équilibre des comptes publics, à charge pour chaque force politique de proposer aux Français les moyens qu’elle choisira pour respecter cet objectif commun.
Au cours de la réunion du mercredi 14 octobre 2009, la mission d’information sur l’optimisation de la dépense publique a examiné le rapport présenté par M. Jean-Luc Warsmann, président et rapporteur.
La première partie de ce rapport relative au constat de l’état des finances publiques de la France a fait l’objet d’un vote à l’unanimité des membres de la mission.
Après avoir émis des réserves sur les propositions figurant dans la seconde partie du rapport, les membres de la mission appartenant au groupe SRC se sont abstenus lors du vote sur cette partie, les membres appartenant au groupe UMP votant pour.
La mission d’information a ainsi adopté le présent rapport.
* *
*
A l’issue de la réunion de la mission, la commission des Lois a autorisé le dépôt du rapport d’information en vue de sa publication.
Défendre la ressource fiscale de l’Etat et ameliorer sa collecte
Proposition n° 1 : un État qui collecte l’impôt sur le revenu au moindre coût par la retenue à la source dès 2011
À partir de 2011, prélever l’impôt sur le revenu à la source, permettant une baisse du coût de collecte de cet impôt et pour un gain de recettes fiscales estimé entre 0,2 et 0,5 milliard d’euros par an.
Proposition n° 2 : généraliser l’obligation de télédéclarer les résultats des entreprises à partir de 2011
À partir du 1er janvier 2011, obligation sera faite aux entreprises, dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 2 millions d’euros, de télédéclarer leurs résultats.
Proposition n° 3 : généraliser l’obligation de télédéclarer et télépayer la TVA à partir de 2011
À partir du 1er janvier 2011, obligation sera faite à toutes les entreprises, dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 380 000 euros, de télédéclarer et de télépayer la TVA.
Proposition n° 4 : généraliser l’obligation de télépayer les impôts des entreprises à partir de 2011
À partir du 1er janvier 2011, obligation sera faite aux entreprises, dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 2 millions d’euros, de télépayer les différents impôts auxquels elles sont soumises.
Proposition n° 5 : raboter les niches fiscales
Réduire uniformément de 10 % les taux de réduction qu’offre chaque niche fiscale, à l’exception du crédit d’impôt recherche, afin de baisser de 5 à 7 milliards le coût total des dépenses fiscales en France.
Proposition n° 6 : rationaliser le dispositif « Girardin » relatif à l’outre-mer
Supprimer le dispositif « Girardin » immobilier, qui doit être remplacé par des subventions moins coûteuses et exclure du dispositif « Girardin » industriel les investissements réalisés dans la navigation de plaisance.
Proposition n° 7 : taxer l’économie grise dès le premier euro
En cas de disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus, autoriser l’administration fiscale à taxer forfaitairement ces revenus dès le premier euro.
Proposition n° 8 : taxer l’économie grise en créant onze brigades interrégionales d’enquête et d’investigation
À compter du 1er juillet 2010, créer onze brigades interrégionales d’enquête et d’investigation, investies d’une mission de lutte contre l’économie informelle et composées, pour ce faire, d’équipes resserrées et mobiles.
Stimuler l’investissement en France et sanctionner les comportements abusifs
Proposition n° 9 : soutenir l’investissement dans les secteurs prioritaires par des règles permettant un amortissement plus rapide
Étendre le régime des amortissements dégressifs et exceptionnels, qui constituent autant d’incitations fiscales à l’investissement, aux secteurs économiques que la commission sur le « grand emprunt » définira comme prioritaires pour le soutien de la croissance de long terme de l’économie française.
Proposition n° 10 : réserver les aides publiques directes aux entreprises citoyennes
Mettre en place un groupe de travail chargé de définir les critères conditionnant l’octroi d’aides publiques. Seules les entreprises dites « citoyennes », c’est-à-dire respectant l’ensemble des critères ainsi définis, pourraient recevoir des aides publiques. Ces critères seraient à la fois sociaux et environnementaux.
Proposition n° 11 : mettre fin au bénéfice des exonérations de cotisations sociales patronales pour les entreprises présentes dans des paradis fiscaux
À partir du 1er juillet 2010, toute entreprise française, présente dans un des paradis fiscaux, identifiés et recensés par l’OCDE, perdra de plein droit le bénéfice des exonérations de cotisations sociales patronales.
Un Etat exemplaire
Proposition n° 12 : un État prudent dans l’élaboration de son budget
Obliger le gouvernement, dans l’élaboration des lois de programmation pluriannuelle des finances publiques, à fonder ses prévisions budgétaires sur les prévisions économiques – notamment de croissance – les plus prudentes, sur le modèle de ce qui se fait au Pays-Bas.
Proposition n° 13 : taxer de manière forfaitaire les voitures et les logements de fonction et affecter ces recettes à la CADES pour rembourser la dette sociale
Taxer de manière forfaitaire les voitures et logements de fonction dont l’État est propriétaire, afin de dégager une nouvelle ressource au profit de la CADES et de prévenir tout risque d’emballement du train de vie de l’État à l’avenir.
Un Etat qui s’organise mieux et qui réduit le coût de l’action administrative
Proposition n° 14 : réduire le stock de normes en assouplissant 1000 normes d’ici le 31 décembre 2010
Avant le 31 décembre 2010, le Gouvernement devra assouplir 1 000 normes, dont il aura été démontré que les coûts, par exemple pour la mise aux normes des installations sportives, qu’elles induisent sont supérieurs aux gains espérés en termes d’utilité et de sécurité collectives.
Proposition n° 15 : limiter le flux de normes par un moratoire de cinq ans sur toute nouvelle norme induisant des coûts pour les collectivités territoriales si ces coûts ne sont pas compensés
À compter du 1er janvier 2010, le Gouvernement devra mettre en place un moratoire de cinq ans sur toute nouvelle norme, dont les coûts financiers induits ne sont pas intégralement compensés au profit de la collectivité en charge de l’appliquer.
Proposition n° 16 : évaluer le coût de chaque catégorie de procédures administratives pour mieux en réduire le poids pour les entreprises
Demander dès aujourd’hui à l’ensemble des ministères de chiffrer le coût de chacune des procédures administratives, dont ils assurent la mise en œuvre, afin de satisfaire d’ici 2012 le double objectif fixé par le Président de la République : réduire de 25 % les charges administratives qui pèsent sur les entreprises et réduire la charge des 1 000 procédures les plus lourdes pour les entreprises.
Proposition n° 17 : mutualiser d’ici 2012, au niveau de chaque région, les fonctions support des administrations déconcentrées de l’État
Mutualiser d’ici 2012, au niveau de chaque région, les fonctions support de l’ensemble des administrations déconcentrées de l’État, éducation nationale comprise, tout en garantissant la présence des services de l’État dans les départements ruraux en y installant les services mutualisés, afin de concilier révision générale des politiques publiques et aménagement du territoire.
Proposition n° 18 : mettre en oeuvre une incitation financière à l’assiduité dans la fonction publique
À compter du 1er janvier 2011, mettre en place une prime positive d’assiduité à chaque agent, n’ayant bénéficié d’aucun arrêt de travail, afin de l’intéresser à sa propre assiduité.
Proposition n° 19 : inciter l’État au paiement rapide de ses dépenses grâce au mécanisme de l’escompte
Dans le cadre des marchés publics, les dépenses de l’État bénéficieront du mécanisme de l’escompte : le taux d’escompte sera de 1,5 % pour tout délai de paiement inférieur ou égal à cinq jours et seulement de 0,75 % pour tout délai de paiement compris entre six et quinze jours. Au-delà, le mécanisme de l’escompte cessera de jouer.
Intérieur, Justice et Immigration : des mesures concrètes pour les ministères suivis par la commission des Lois
Proposition n° 20 : systématiser le recours à la médiation familiale extrajudiciaire pour les actions tendant à faire modifier les modalités de l’exercice de l’autorité parentale à partir du 1er janvier 2011
Afin d’améliorer la qualité ainsi que la rapidité des décisions de justice et de désengorger les tribunaux, rendre obligatoire, à partir du 1er janvier 2011, la médiation familiale préalable à toute action en justice visant à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, ce qui représente plus de 85 000 affaires par an.
Proposition n° 21 : systématiser, à partir, du 1er janvier 2011, la procédure dite de la « double convocation » invitant les parties à rencontrer un médiateur avant l’audience
Afin d’améliorer la qualité ainsi que la rapidité des décisions de justice et de désengorger les tribunaux, systématiser, à partir du 1er janvier 2011, la procédure dite de la « double convocation » invitant les parties à rencontrer un médiateur avant l’audience. Combinée à la médiation préalable obligatoire en amont du juge, cette mesure concernerait plus de 90 000 dossiers chaque année.
Proposition n° 22 : fusionner la justice de proximité et la justice de première instance avant le 1er janvier 2011
Avant le 1er janvier 2011, supprimer la juridiction de proximité en tant qu’ordre de juridiction, mais maintenir les juges de proximité, qui seraient nommés dans un tribunal de grande instance et affectés auprès du juge chargé de la direction et de l’administration d’un tribunal d’instance. Cela aurait pour effet de leur permettre de participer pleinement à l’activité et à l’organisation de ces deux juridictions de première instance. Cette réforme simplifierait la procédure et dégagerait du temps pour les magistrats.
Proposition n° 23 : faire de la visioconférence la règle et des extractions judiciaires l’exception
Prévoir que, dans le champ d’application que lui assigne actuellement la loi, la visioconférence soit désormais la règle de droit commun et les extractions judiciaires l’exception. Seul le président du tribunal de grande instance ou de cour d’appel aurait le pouvoir d’autoriser une extraction judiciaire.
Proposition n° 24 : limiter les extractions médicales lorsqu’elles sont manifestement inutiles grâce au recours, chaque fois que possible, à la télémédecine et à la vidéo-consultation
Densifier la prise en charge sanitaire dans les unités de consultation en soins ambulatoires grâce au recours plus intensif à la télémédecine et à la vidéo-consultation, afin de limiter les extractions médicales qui peuvent être évitées. Le coût initial d’investissement dans les dispositifs de télémédecine sera rapidement compensé par la réduction rapide des frais liés aux extractions, tant pour l’administration pénitentiaire que pour l’hôpital et permettrait le recours plus simple à des médecins spécialistes.
Proposition n° 25 : alléger la procédure de suspension du permis de conduire, en supprimant la phase administrative au profit d’une seule et unique phase judiciaire
Lors de la constatation d’une infraction pour laquelle la suspension du permis de conduire est encourue, le préfet ne pourra plus prononcer de suspension administrative provisoire.
Il ne subsistera donc qu’une seule procédure, contre deux actuellement : la suspension judiciaire du permis de conduire. Ainsi, lors de la constatation d’une infraction, pour laquelle la suspension est encourue, l’officier de police judiciaire pourrait confisquer, pour un délai de quinze jours, le permis de conduire. Une décision judiciaire devrait alors nécessairement intervenir dans le délai de la suspension provisoire.
Proposition n° 26 : permettre au Procureur de la République de suspendre les poursuites avec injonction de quitter le territoire pour les étrangers en situation irrégulière ayant commis une infraction de faible gravité
Pour les infractions les moins graves, permettre au Procureur de la République de suspendre les poursuites avec injonction de quitter le territoire français, lorsque le prévenu est sous le coup d’une mesure d’éloignement et qu’il accepte de quitter le territoire. Si celui-ci entre de nouveau sur le territoire français, sans y être autorisé, alors le Procureur de la République engagera les poursuites. Celles-ci sont donc simplement différées et non abandonnées. Cette proposition entend rendre effective une mesure d’éloignement et, dans le même temps, éviter toutes les dépenses liées à l’engagement de poursuites, à la tenue d’un procès et, en dernier ressort, à l’exécution d’une peine.
Proposition n° 27 : créer un ajournement de peine avec injonction de quitter le territoire pour les auteurs d’infraction sous le coup d’une mesure d’éloignement
Si la gravité de l’infraction est telle qu’elle justifie l’engagement de poursuites par le Procureur de la République, la juridiction de jugement, après avoir reconnu le prévenu coupable, pourra ajourner, pendant un mois, le prononcé de la peine, afin de permettre, pendant cet ajournement, l’exécution effective de la mesure d’éloignement par un départ volontaire du prévenu.
Il semble opportun de réserver cet ajournement de peine avec injonction de quitter le territoire français aux infractions pour lesquelles les peines encourues sont limitées.
S’il apparaît que la mise à exécution de la mesure d’éloignement entraînerait une atteinte au droit à indemnisation de la victime, l’ajournement avec injonction de quitter le territoire devra être exclu.
L’objectif de cette mesure est double : rendre effective une mesure d’éloignement et éviter les dépenses liées à l’exécution d’une peine.
Proposition n° 28 : systématiser avant le 1er janvier 2011 le recours à la visioconférence, afin de limiter les escortes entre les centres de rétention administrative et les salles d’audience
Systématiser avant le 1er janvier 2011 le recours à la visioconférence, afin de limiter les escortes trop coûteuses des retenus entre les centres de rétention administrative et les salles d’audience.
Mieux organiser les collectivités locales
Proposition n° 29 : réduire les doublons entre communes et intercommunalités en donnant, avant le 1er janvier 2011, compétence obligatoire aux structures intercommunales pour mutualiser les services
Afin de réaliser d’importantes économies d’échelle, donner compétence obligatoire aux établissements publics de coopération intercommunale pour mutualiser les structures administratives communales et intercommunales. L’exercice de cette compétence obligatoire des EPCI se fera sur la base d’un vote à la majorité simple des assemblées intercommunales.
Proposition n° 30 : appeler le Gouvernement à dresser un bilan exhaustif et chiffré des doublons administratifs entre État et collectivités locales à l’occasion de l’examen de la réforme des collectivités locales
Lors de l’examen au Parlement du projet de loi sur la réforme des collectivités territoriales, le Gouvernement devra dresser, dans l’étude d’impact jointe au projet, un bilan exhaustif et chiffré des doublons administratifs qui existent entre l’État et les collectivités territoriales.
Proposition n° 31 : identifier précisément dans les budgets des collectivités territoriales les dépenses de communication
Dans un souci de lisibilité et de transparence démocratique à l’égard du contribuable local, obliger les collectivités territoriales à identifier, de manière exhaustive, l’ensemble des dépenses de communication dans leurs budgets.
Proposition n° 32 : taxer les dépenses de communication des collectivités locales, dans leur propre ressort, au profit de la CADES
Taxer les dépenses de communication des collectivités locales, dans leur propre ressort, le rendement de cette taxe étant affecté de plein droit à la CADES et à la réduction de la dette sociale.
Proposition n° 33 : interdire à toute collectivité locale d’accorder à une association une subvention supérieure à 200 euros pour financer des dépenses de fonctionnement, lorsque cette association dispose de réserves financières supérieures à un an de fonctionnement
Encadrer les subventions aux associations, en interdisant à toute collectivité locale d’accorder à une association une subvention de plus de 200 euros, pour financer des dépenses de fonctionnement, lorsque cette association dispose d’une épargne bancaire supérieure à une année de budget de fonctionnement.
Sont exclues de ce dispositif les subventions versées en vertu d’une loi ou d’un règlement qui crée un droit pour l’association ou la fondation qui remplit tous les critères d’éligibilité légaux ou réglementaires dans une logique de guichet.
Proposition n° 34 : affecter au fonds de réserve des retraites les avoirs financiers des associations qui n’ont plus d’activité
Affecter au fonds de réserve des retraites les avoirs bancaires des associations, qui, sans être officiellement dissoutes, n’ont plus d’activité depuis dix ans.
Proposition n° 35 : mettre fin à la dérive des financements croisés entre collectivités
Pour que chaque citoyen puisse identifier la collectivité responsable et afin de réduire les financements croisés, prévoir qu’un seul niveau de collectivités locales peut participer au financement d’un projet conduit par une autre collectivité.
Permettre une dérogation à cette limitation au profit des communes dont la population est inférieure à un certain seuil de population et dont le potentiel financier est inférieur à la moyenne de leur strate.
Assurer le financement de la dette sociale : un devoir moral
Proposition n° 36 : transférer de droit tout déficit constaté au titre d’un exercice achevé à la CADES et lui affecter une ressource nouvelle propre à en assurer l’apurement. Prévoir que si le montant du déficit prévisionnel inscrit dans la loi de financement de la sécurité sociale dépasse 10 milliards d’euros, le déficit au-delà de ce montant sera de droit transféré à la CADES avec une recette nouvelle propre à assurer la couverture de ce déficit.
Les ressources nouvelles seront fournies par des produits nouveaux tirés de la taxation des retraites chapeaux, des stock-options. Le supplément de recettes peut provenir également, le cas échéant, du surcroît de recettes généré par l’extension de l’assiette de la CSG sur les jeux et les métaux précieux.
Proposition n° 37 : après le retour de la croissance et lorsque les organismes de sécurité sociale seront à nouveau en mesure de retrouver l’équilibre de leurs comptes, affecter à la CADES les excédents de recettes des régimes de sécurité sociale.
Lorsque les régimes de sécurité sociale seront en mesure de dégager des excédents, ils devront être affectés au remboursement de notre dette sociale.
Proposition n° 38 : abaisser le seuil de déclenchement de la procédure d’alerte en cas de risque sérieux de dépassement de l’ONDAM de 0,75 % à 0,5 %.
Afin de traiter encore plus en amont la constitution de déficits qui alimenteront la dette, il importe que les mécanismes d’alerte soient encore plus précoces pour prendre toutes les mesures nécessaires et les mettre en œuvre le plus rapidement possible.
Proposition n° 39 : autoriser l’ACOSS à gérer la trésorerie disponible d’un plus grand nombre d’organismes sociaux.
Cette facilité doit notamment permettre d’éviter le renchérissement des frais financiers supportés par l’ACOSS ainsi qu’une gestion plus fine et cohérente.
Proposition n° 40 : retirer la CRDS des impositions directes prises en compte pour l’application du « bouclier fiscal ».
Cette mesure exceptionnelle est justifiée par la situation elle-même exceptionnelle de la dette sociale. Lutter contre cette dette est une cause nationale qui suppose la solidarité de tous. La CRDS se distingue également de l’impôt. Sa seule raison d’être est le remboursement de la dette sociale.
Proposition n° 41 : étendre l’assiette de la CSG en taxant à 3 % les sommes misées dans les jeux et les plus-values tirées de la vente de métaux précieux et affecter ce surcroît de recettes à la CADES.
L’alignement partiel de l’assiette de la CSG sur celle de la CADES sur les jeux et les plus-values de la vente de métaux précieux permettrait de dégager des recettes contribuant à combler la dette sociale.
Proposition n° 42 : accroître fortement la contribution assise sur les « retraites chapeaux » et sur les stock-options pour financer la dette sociale.
L’augmentation de la contribution sur les retraites chapeaux et du taux de prélèvement sur les stock-options doit contribuer à assurer la diversification des ressources de la CADES.
Proposition n° 43 : imposer à l’Etat le paiement d’intérêts en cas de retard dans le remboursement des compensations d’exonérations des cotisations et contributions dues aux organismes de sécurité sociale.
Ces mesures doivent permettre d’établir un véritable contrat de confiance entre l’État et les organismes de sécurité sociale.
Proposition n° 44 : poursuivre la rationalisation du réseau des organismes du régime général de la sécurité sociale par le rapprochement des caisses primaires d’assurance maladie et des organismes gestionnaires.
Le rapprochement entre les caisses doit permettre d’améliorer l’efficience de leurs moyens et rendre possible de nouvelles réductions des coûts de gestion.
Proposition n° 45 : évaluer l’efficacité du fonctionnement des caisses de congés payés.
Cette évaluation est une première étape pour déterminer quelles sont les améliorations qui pourraient être apportées à l’organisation de ces caisses avant d’adopter des mesures les incitant à rationaliser leur réseau.
Proposition n° 46 : mettre en place d’ici 2012 la déclaration sociale nominative.
Cette déclaration serait de nature à alléger la charge que représente pour les entreprises le traitement de nombreuses déclarations.
Proposition n° 47 : permettre aux assurés sociaux de s’affilier de droit à la caisse la plus proche de leur domicile, indépendamment de tout critère fondé sur la profession ou le statut.
Cette mesure simplifiera les relations entre les usagers et les caisses.
Proposition n° 48 : organiser la mutualisation des moyens des caisses du régime général de la sécurité sociale par la création ou le renforcement du rôle de l’échelon régional d’ici 2012.
L’échelon régional doit favoriser la réalisation d’économie d’échelle dans la gestion des fonctions support.
Proposition n° 49 : permettre aux caisses d’assurance maladie du régime général de sécurité sociale d’effectuer, contre rémunération, le paiement des prestations servies par les organismes de complémentaire santé.
Cette mesure permettra au système de bénéficier de l’expérience, de l’organisation et des moyens – notamment les applications informatiques – des caisses d’assurance maladie. Il faudra, en contrepartie, prévoir la rémunération des caisses au titre de cette nouvelle fonction qui constituera une prestation de services à l’attention des mutuelles et en fixer le montant sur la base d’études approfondies et d’une concertation étroite avec l’UNOCAM.
Proposition n° 50 : favoriser des modes de garde du jeune enfant plus économes en permettant à la famille de jouer un plus grand rôle et en rendant plus attractive la garde par les assistantes maternelles
Faciliter la garde des enfants par leurs grands-parents en affirmant le droit à l’inscription du ou des enfant(s) dans l’établissement scolaire du ressort dans lequel se trouve le domicile des grands parents.
Créer un diplôme d’assistante maternelle qui sanctionnera la sortie d’une véritable filière de formation et pourra ouvrir la perspective d’une poursuite de carrière dans les établissements publics accueillant les jeunes enfants.
Proposition n° 51 : inciter les Français à modifier leur comportements pour préserver leurs droits sociaux en lançant une campagne d’information et de sensibilisation dans les médias sur le coût potentiel des comportements individuels pour les dépenses de sécurité sociale.
Cette campagne devra faire l’objet d’une large couverture et donner lieu à la diffusion de messages clairs et ciblés sur le modèle de la campagne destinée à limiter la prescription d’antibiotiques.
Proposition finale : réunir, avant la fin du premier semestre 2010, un sommet national de la dette publique
Afin que chacun accepte le poids de l’effort à consentir pour surmonter la crise des finances publiques, réunir, avant la fin du premier semestre 2010, un sommet national de la dette publique, qui rassemblera l’ensemble des partis politiques représentés par un parlementaire national ou européen ainsi que l’ensemble des forces syndicales et organisations représentatives du monde de l’entreprise. L’objectif de ce sommet est de parvenir à la définition, de manière consensuelle, d’un agenda partagé de retour à l’équilibre des comptes publics, à charge pour chaque force politique de proposer aux Français les moyens qu’elle choisira pour respecter cet objectif commun.
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
§ M. Yves CANNAC, président de la commission finances publiques au sein de l’Observatoire de la dépense publique de l’Institut de l’entreprise.
§ M. Patrick DIBOUT, directeur du Centre d’études sur la fiscalité des entreprises de l’Université Panthéon-Assas, professeur en droit communautaire, fiscalité européenne et fiscalité internationale.
§ M. Olivier FERRAND, président de la Fondation Terra Nova.
§ M. Alain MATHIEU, Président de l’association Contribuables associés.
§ M. Rémi PELLET, directeur d’études en questions sociales à l’Institut d’études politiques de Paris.
§ M. François RACHLINE, directeur général de l’Institut Montaigne.
§ M. Christian SAINT-ETIENNE, économiste, membre du Conseil d’analyse économique.
§ M. Philippe VALLETOUX, vice-président de Dexia Crédit local et membre du Conseil économique, social et environnemental.
Cour des Comptes
§ M. Philippe SÉGUIN, Premier président de la Cour des comptes.
§ M. Alain PICHON, président de la quatrième chambre de la Cour des comptes.
§ M. Gérard MOREAU, conseiller maître à la Cour des comptes.
§ M. Gérard GANSER, conseiller maître à la Cour des comptes.
Ministère de la Justice et des libertés
§ M. Gilbert AZIBERT, secrétaire général.
§ M. Mathieu HERONDART, secrétaire général adjoint.
Ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales
§ M. Henri-Michel COMET, secrétaire général.
Ministère de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire
§ M. Stéphane FRATACCI, secrétaire général.
Ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État
§ M. Philippe JOSSE, directeur du budget.
§ M. François-Daniel MIGEON, directeur général de la modernisation de l’État.
§ M. Philippe PARINI, directeur général des finances publiques.
§ M. Jean-Marc FENET, directeur, chargé de la fiscalité.
§ Mme Maxime GAUTHIER, chef du service de la gestion fiscale.
Ministère du Travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
§ M. Dominique LIBAULT, directeur de la sécurité sociale.
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
§ M. Pierre BURBAN, président du conseil d’administration.
§ M. Pierre RICORDEAU, directeur.
§ M. Benjamin FERRAS, directeur de cabinet.
§ M. Alain GUBIAN, directeur statistique et directeur financier.
Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)
§ M. Patrice RACT-MADOUX, président.
Association des maires de France
§ M. Philippe LAURENT, maire de Sceaux et président de la commission des finances de l’AMF.
§ M. Alain ROBY, responsable du département Finances.
§ M. Alexandre TOUZET, chargé des relations avec les pouvoirs publics.
Assemblée des communautés de France
§ M. Daniel DELAVEAU, président de l’ADCF, président de la communauté d’agglomération Rennes Métropole.
§ M. Michel PIRON, président de la communauté de communes des Coteaux-du-Layon.
Assemblée des départements de France
§ M. Thierry CARCENAC, vice-président de la commission finances et fiscalité locale, président du Conseil général du Tarn.
§ M. Guillaume DENIS, chef du service financier.
Association des régions de France
§ M. Alain ROUSSET, président, président du Conseil régional d’Aquitaine.
§ M. Martin MALVY, secrétaire, président du Conseil régional de Midi-Pyrénées.
ANNEXE : AUDITION, EN PRÉSENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN, PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DES COMPTES, DE MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES
Le mercredi 7 octobre 2009, sous la présidence de M. Jean-Luc Warsmann, la Commission a procédé, en présence de M. Philippe Séguin, Premier président de la Cour des comptes, à l’audition de M. Alain Pichon, président de la quatrième chambre de la Cour des comptes, et de MM. Gérard Moreau et Gérard Ganser, conseillers maîtres, responsables respectivement des secteurs « justice » et « intérieur ».
M. le président Jean-Luc Warsmann. Je suis heureux d’accueillir M. Philippe Séguin, Premier président de la Cour des comptes, ainsi que M. Alain Pichon, président de la quatrième chambre et MM. Gérard Moreau et Gérard Ganser, conseillers maîtres, responsables respectivement des secteurs « justice » et « intérieur ».
Compte tenu de l’état sans précédent des finances publiques, le président de notre assemblée a invité toutes les commissions permanentes à présenter des contributions en matière d’optimisation de la dépense publique, de traque des dépenses inutiles et de suppression d’organismes dont l’utilité ne serait plus établie. Pour sa part, la commission des Lois a créé, le 15 juillet dernier, une mission d’information sur l’optimisation de la dépense publique, dont le premier objectif est d’établir un diagnostic clair et partagé sur l’état de nos finances publiques ; il lui appartiendra ensuite de présenter des mesures applicables dans les meilleurs délais.
Sans préjuger le résultat de nos travaux, il me semble que nous devrons tout d’abord réfléchir aux moyens susceptibles de rendre la dépense publique plus efficace dans les domaines entrant dans la compétence notre Commission. Tel est précisément l’objet de cette audition, qui nous permettra d’entendre des magistrats appartenant à la quatrième chambre de la Cour des comptes, chargée de contrôler les secteurs « justice » et « intérieur ».
En deuxième lieu, on peut s’interroger sur le coût de la dette publique, notamment celui de la dette sociale – sujet dont nous avons eu à connaître en 2005 à l’occasion du projet de loi organique relatif aux lois de financement de la sécurité sociale. La dette accumulée risquant de réduire à néant les efforts entrepris, nous devrons veiller à appréhender la situation de façon globale.
En dernier lieu, je tiens à rappeler que nous ne pourrons pas raisonner de façon statique : il faudra également chercher à stimuler les recettes publiques et à encourager la croissance.
Cette audition nous permettra d’achever notre cycle d’auditions et de remettre rapidement, sans doute dès la semaine prochaine, notre contribution au Président de l’Assemblée.
M. Philippe Séguin, Premier président de la Cour des comptes. Si j’ai tenu à accompagner le président Pichon ainsi que MM. Moreau et Ganser, ce n’est pas seulement pour avoir le plaisir – bien réel – de m’exprimer pour la première fois devant votre Commission en tant que Premier président de la Cour des comptes ; je voulais également témoigner de l’intérêt et de l’estime que la Cour porte à votre démarche. Il me paraît tout à fait légitime que d’autres commissions que la commission des finances et celles des affaires sociales, qui me sont plus familières, je dois le reconnaître, se saisissent de cette question essentielle qu’est la maîtrise des finances publiques.
Je commencerai par vous présenter quelques éléments de portée générale dont j’ai déjà eu l’occasion de faire part, au cours des derniers mois, à la Commission des finances et à celle des affaires sociales.
Comme je l’avais indiqué devant le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, présidé par Édouard Balladur, la Cour produit de plus en plus de documents à destination du Parlement, mais il se trouve qu’elle est en relation, non pas avec chaque assemblée en tant que telle, mais seulement avec certaines commissions. Il y a probablement là un problème d’organisation qu’il serait bon de résoudre. On peut déplorer que certains des travaux que nous avons réalisés au cours des dernières années n’aient pas été portés à la connaissance de votre Commission.
La création du CEC, le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, constitue un progrès indéniable. Comme l’a indiqué le Conseil constitutionnel, il conviendra toutefois que la loi précise les conditions dans lesquelles le CEC peut demander son appui à la Cour. Mais on peut surtout regretter qu’il n’y ait pas en France de structure commune aux deux assemblées qui soit compétente en matière de finances publiques, comme c’est le cas dans d’autre pays, notamment au Royaume-Uni.
S’agissant de l’état de la dette et du déficit publics, je ne pourrais probablement rien vous dire que vous ne sachiez déjà. Je me contenterai donc de présenter un certain nombre de points qui mériteraient, selon la Cour, une attention particulière.
L’objectif d’optimiser la dépense impose que l’on garde à l’esprit les principaux facteurs de son évolution et que l’on adopte un point de vue global. Il faut tout d’abord veiller à distinguer les stocks et les flux : notre stock de dette – environ 1 400 milliards au moment où je vous parle – est essentiellement le fait de l’État et résulte de l’accumulation des déficits publics au fil des ans. En dépit de la relative maîtrise des dépenses de l’État, dont certains d’entre vous estimeront peut-être qu’elle a été réalisée à bon compte, la croissance des dépenses de la sécurité sociale et des collectivités territoriales reste dynamique.
L’État a adopté la bonne résolution de fixer une norme d’évolution de ses dépenses et pris l’initiative d’évaluer plus systématiquement son action, notamment dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP). La démarche entreprise est louable et je m’en voudrais de ne pas l’encourager, mais force est de reconnaître que les résultats sont encore très modestes. D’une certaine façon, nous nous trouvons dans la situation d’un individu qui aurait perdu ses clefs en pleine nuit et qui se bornerait à les chercher au pied du réverbère le plus proche. Si la norme de dépenses de l’État est peu ou prou respectée, de nombreuses autres dépenses explosent, notamment en raison du report de certaines charges sur les collectivités territoriales et sur les opérateurs, mais aussi en raison de la montée en puissance des niches fiscales – autant de domaines nécessitant, à mes yeux, une attention particulière.
Je précise tout de suite que mes propos ne tendent pas à stigmatiser les collectivités locales ou la sécurité sociale. Sur le plan local, par exemple, les collectivités cherchent à améliorer le service rendu à leurs administrés et l’on s’aperçoit que les dépenses transférées par l’État sont bien souvent dynamiques, contrairement aux recettes correspondantes. D’où un effet de ciseaux malheureusement bien connu des élus. D’autre part, les difficultés actuelles résultent en partie de la multiplication des centres de décision, de l’enchevêtrement croissant des compétences et de l’existence de nombreux doublons.
L’État porte une lourde responsabilité en la matière, car il n’a tiré que tardivement les conséquences de la décentralisation pour les services déconcentrés. Même s’il ne faut pas entretenir d’illusions sur la rapidité des résultats qu’on peut espérer, l’organisation administrative des collectivités territoriales et de l’État constitue un premier gisement d’économies. On peut donc se réjouir que l’administration territoriale de l’État ait commencé sa mue en 2008 et qu’une réforme des collectivités territoriales vous soit bientôt soumise.
Gardons toutefois en mémoire que les dépenses ne sont que faiblement élastiques : quels que soient les efforts de restructuration des services, qui sont aujourd’hui réels car c’est toute l’administration, dans les trois fonctions publiques, qui est en train de se réformer, il faudra des années pour atteindre un niveau d’effectifs correspondant aux besoins préalablement définis. Le principe de non-remplacement d’un agent sur deux partant à la retraite est la limite à laquelle se heurte la réduction des dépenses de personnel, lesquelles représentent plus de la moitié des engagements financiers de l’État. D’autre part, les effectifs ne se réduisent pas forcément là où les besoins seraient moindres.
Rien n’est plus désespérant et démobilisateur que de songer à quelle vitesse les quelques millions d’euros durement économisés ici ou là peuvent être dissipés par des allégements d’impôts ou par la création de charges nouvelles, dont l’utilité n’est pas nécessairement établie. L’optimisation de la dépense est un souci louable, mais il ne faudrait pas oublier, pour autant, la question de l’optimisation des recettes, laquelle suppose d’abord la sécurisation de celles-ci. Les dépenses fiscales, à savoir la part de la fiscalité à laquelle l’État renonce pour une raison ou pour une autre et qui peut donc s’analyser comme une dépense, s’élèvent aujourd’hui à 70 milliards d’euros environ, tandis que le montant des exonérations de charges dépasse les 30 milliards, soit une masse de 100 milliards au sein de laquelle de substantielles économies pourraient être réalisées.
Il conviendrait également de faire preuve d’une vigilance accrue à l’égard des conséquences financières de l’évolution du contexte normatif. Les études d’impact sont désormais obligatoires pour tous les projets de loi, ce qui constitue une avancée essentielle, et votre président a tenu à ce que cela puisse également être le cas pour les propositions de loi. C’est une excellente initiative, car il est essentiel de mieux évaluer d’emblée l’impact financier des mesures proposées. À ce sujet, la Cour est tout à fait disposée, non pas à réaliser elle-même les études d’impact, mais à apporter son expertise, notamment en ce qui concerne les méthodes retenues.
On peut se demander, par exemple, si l’on avait bien évalué la charge supplémentaire que représentera, pour les juridictions, la nouvelle procédure d’exception d’inconstitutionnalité, ou encore la charge qui a résulté de la loi du 15 juin 2000 sur le renforcement de la présomption d’innocence, laquelle a conduit les juridictions à réaliser, à leurs frais, des copies de toutes les pièces des dossiers à destination de l’ensemble des parties. Ainsi, certains agents passent aujourd’hui leur temps à faire des photocopies dont un très faible pourcentage sera effectivement utilisé.
M. Alain Pichon, président de la quatrième chambre de la Cour des comptes. Il est difficile de dégager des pistes d’économies, bien que cet exercice soit au cœur de l’activité de la quatrième chambre, qui a notamment compétence sur le ministère de la justice et sur celui de l’intérieur, dont le périmètre est désormais très étendu : il comprend en effet l’administration territoriale de l’État, les relations avec les collectivités locales, les missions de sécurité intérieure assurées par la police et par la gendarmerie, ainsi que les questions relatives à l’outre-mer, les structures du ministère correspondant ayant été réintégrées au sein du ministère de l’intérieur.
La quatrième chambre a eu l’occasion de réaliser un certain nombre de contrôles qui lui ont permis d’identifier des gisements d’économies dans les quelque 23,6 milliards d’euros de crédits alloués au ministère de l’intérieur. Je dois toutefois préciser que les évolutions dans le temps sont très délicates, car le ministère dépense l’essentiel de ses crédits sous la forme de dépenses de personnel et de dotations aux collectivités locales. Des économies sont certes possibles, mais à doses homéopathiques.
Les comparaisons internationales révèlent que le nombre de gendarmes et de policiers, rapporté à la population totale, au PIB ou encore à l’ensemble des dépenses budgétaires, est relativement élevé dans notre pays. On constate, en outre, une hausse sensible des effectifs et des coûts, notamment dans la police, du fait de la politique de revalorisation indiciaire et de revalorisation des carrières. Cette politique était sans doute justifiée, mais elle coûte cher à l’État. Au risque de paraître iconoclaste, on peut se demander si le nombre de policiers et de gendarmes correspond réellement aux besoins.
En outre, une fraction importante des personnels n’est pas affectée à des tâches correspondant à leurs missions premières. Un contrôle approfondi sur les compagnies républicaines de sécurité a ainsi démontré qu’un pourcentage substantiel des effectifs était affecté à des gardes statiques – les fameux « pots de fleurs ». Ayant tendance à vivre en vase clos, certains services confient également des tâches de nature administrative à des personnels chargés de la sécurité. Dans ces conditions, ne pourrait-on pas envisager une externalisation de ces missions – secrétariat, maintenance ou encore entretien –, qui pourraient être attribuées à des fonctionnaires spécialisés, voire à des partenaires privés ?
On pourrait également s’interroger sur le maillage territorial de l’administration de l’État – je pense notamment aux sous-préfectures. Chacun sait que la dernière grande réforme en la matière date de 1928. Compte tenu des moyens de communication et de travail aujourd’hui disponibles, on pourrait sans doute réfléchir au nombre, au rôle et à la structuration des sous-préfectures, sans remettre en cause la fonction de sous-préfet en tant que telle.
Une autre piste de travail concerne les dépenses fiscales, évoquées par M. le Premier président. On pourrait notamment s’interroger sur le coût et l’efficience de plusieurs dispositifs relatifs à l’outre-mer, notamment le dispositif dit « Girardin » applicable aux investissements industriels et aux bateaux de plaisance. Quand on rapporte le nombre d’emplois créés à leur coût pour l’État et que l’on sait à quel point certains contribuables sont habiles, on peut se demander s’il est bien opportun de maintenir de telles dispositions.
S’agissant toujours du ministère de l’intérieur, nous avons prévu de vérifier si toutes les conséquences ont été tirées du rapprochement entre la police et la gendarmerie. Il y a certainement des économies d’échelle à réaliser en matière d’achats, de coordination, de frais d’hébergement et de déplacement.
Depuis que je préside la quatrième chambre, le ministère de la justice a fait l’objet d’une quinzaine de contrôles portant sur l’administration pénitentiaire, la protection judiciaire de la jeunesse, la protection de l’enfance, la gestion des parquets, les frais de justice, la gestion de l’aide juridictionnelle par la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), la justice de première instance ou encore les conditions de mise en place de la réforme de la carte judiciaire.
Pour avoir suivi ces différents contrôles, mais également en tant que simple contribuable, j’ai l’impression que les moyens financiers dont dispose le ministère de la justice ne sont pas à la mesure de ce qu’exigeraient une démocratie et une République modernes. Les comparaisons internationales démontrent que les moyens ne sont pas très abondants – il ne s’agit pas tant des effectifs de magistrats que de l’environnement général de la justice : le nombre de greffiers, les crédits pénitentiaires, le nombre de places de prison, les crédits alloués à l’aide juridictionnelle, mais aussi les frais de justice. Une réflexion est d’ailleurs engagée sur les moyens alloués à l’aide juridictionnelle, qui sont bien plus faibles dans notre pays qu’en Angleterre ou en Allemagne.
Même si l’instauration d’une procédure d’exception d’inconstitutionnalité risque de multiplier les dossiers traités par les juridictions, il est certainement possible de trouver des gisements d’économies au sein du ministère de la justice. Quand une éponge est presque sèche, on peut encore la tordre pour en extirper quelques gouttes. On peut notamment considérer que la justice n’a pas encore réalisé son aggiornamento en matière de procédure : il y a trop de papiers et trop d’éléments inutiles. Il faudrait simplifier et moderniser les procédures afin de réduire les coûts de fonctionnement. L’achat du papier, par exemple, coûte aujourd’hui des fortunes.
Le ministère devra également veiller à tirer les conséquences de la réforme de la carte judiciaire en matière de ressources humaines et de gestion de l’immobilier, même s’il ne faut pas s’attendre à des merveilles. C’est que la réforme va coûter cher : entre 250 et 750 millions d’euros selon les estimations de la Chancellerie. Nous ne pourrons engranger les effets positifs des évolutions en cours qu’à moyen terme.
Ajoutons à cela que des plateformes interrégionales de gestion en matière d’achat sont en cours de constitution. Une meilleure organisation de cette fonction permettra sans doute d’économiser des moyens supplémentaires.
Au total, les économies susceptibles d’être réalisées par le ministère de la justice ne devraient pas dépasser une centaine de millions d’euros, montant qui, sans être négligeable, n’est malheureusement pas à la hauteur des déficits publics actuels.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Vous avez évoqué les conséquences du passage de la gendarmerie sous l’autorité du ministre de l’intérieur. Quelles sont les perspectives de gains en efficacité ?
M. Alain Pichon. On peut espérer que cette évolution permettra de mettre un terme à un certain nombre d’incohérences, notamment en ce qui concerne les systèmes informatiques, les moyens de communication par radio ainsi que les achats de matériel et d’uniformes. On peut en attendre des effets d’échelle. Une meilleure répartition des forces sur le territoire pourrait également contribuer à réduire les coûts, notamment en matière d’immobilier. Reste que ce patrimoine immobilier relève souvent des collectivités locales.
M. Jacques Alain Bénisti. Vous avez évoqué les gisements d’économies possibles dans le domaine des collectivités territoriales et vous avez appelé à une plus grande attention sur les dotations de l’État, mais vous n’avez pas dit un mot des inégalités territoriales. Certaines villes jouissent quasiment de « ressources naturelles », tandis que d’autres n’ont pas les moyens nécessaires pour faire face aux difficultés de leurs quartiers sensibles.
S’agissant des effectifs de police qui ne seraient pas utilisés à bon escient, selon vous, vous avez cité les CRS affectées à des gardes statiques. Or certains maires sont plus qu’heureux d’avoir des compagnies stationnés à proximité et qui apportent leur appui aux forces de police en cas de besoin.
En ce qui concerne le ministère de la justice, nous ne pouvons que prendre acte de votre suggestion d’augmenter son budget. D’autre part, force est de constater que le montant de 100 millions d’euros d’économies est assez faible par rapport au budget total du ministère.
M. Philippe Séguin. Si je n’ai pas évoqué les inégalités territoriales, c’est parce qu’il me semblait que tel n’était pas le sujet de cette audition. Mais vous savez que je peux être intarissable sur ce problème tout à fait essentiel.
Assumer la décentralisation tout en restant fidèle aux principes de la République n’a rien d’une évidence : il ne suffit pas de proclamer que la France est une République décentralisée.
D’autre part, je regrette que certains travaux qui nous ont conduits à aborder, par exemple, la question de la fiscalité locale, notamment par le biais du patrimoine des ménages, n’aient pas été portés à la connaissance de votre Commission. Il en va de même des travaux du Conseil des impôts sur le même sujet. J’ai donc pris l’initiative d’adresser au Président de chaque assemblée un exemplaire de tous les documents envoyés aux commissions permanentes avec lesquelles nous sommes en relation ; libre à lui, par la suite, de diffuser plus largement ces documents auprès des autres commissions.
Sur le fond, je rappelle que nous avons conclu à la nécessité de mener un certain nombre de réformes, notamment en ce qui concerne les bases de la fiscalité locale. Ce sont en effet les collectivités dont le potentiel fiscal est le plus faible qui doivent affronter les difficultés les plus graves. Nous avons également examiné la question des dotations de l’État : quelle part des ressources des collectivités doit venir des dotations et quelle part des ressources propres ? L’autonomie financière a-t-elle nécessairement pour corollaire l’autonomie fiscale ? Ce sont là de véritables questions.
M. Alain Pichon. Nous avons conduit une enquête approfondie sur les 85 milliards d’euros de dotations accordés par an par l’État aux collectivités territoriales. Bien qu’un principe de péréquation ait été posé, nous avons constaté que ces dotations servaient d’abord à garantir les ressources des collectivités locales, et que les effets de péréquation restaient très limités. Les communes pauvres demeurent pauvres, et les communes aisées ou riches demeurent aisées ou riches.
M. Jean-Jacques Urvoas. J’aimerais savoir si la Cour pourrait nous apporter son précieux appui en ce qui concerne les effectifs de la mission « Sécurité ». Nous avons, en effet, observé des divergences notables entre les rapports budgétaires produits par notre assemblée et ceux produits par le Sénat.
Mme Alliot-Marie, que j’avais interrogée sur ce sujet lorsqu’elle était ministre de l’intérieur, avait annoncé qu’elle me répondrait par écrit. N’ayant pas reçu de réponse, j’ai posé la question à son successeur, M. Hortefeux, qui a récemment cité le chiffre de 242 945 emplois lors d’une présentation de la mission « Sécurité » devant les préfets, alors qu’un document publié le même jour, et disponible sur Internet, faisait état de 243 057 emplois.
M. Alain Pichon. Comme vous, nous sommes confrontés en permanence à ce problème : l’État est incapable de mesurer ses effectifs à l’instant t. Il faut d’ailleurs distinguer, notamment, les équivalents temps plein et les emplois ouverts au budget.
Vos chiffres ne coïncident pas avec ceux dont je dispose. Pour 2009, le plafond d’emplois ministériel de la mission « Sécurité » s’élève à 245 689 agents, dont 146 000 pour la police et 99 509 pour la gendarmerie. Mais nous raisonnons à quelques centaines ou quelques milliers près. Il n’existe pas, hélas, d’observatoire ou de recensement fiable de l’emploi public, qu’il s’agisse de l’État ou des collectivités locales. Nous sommes fondés à appeler de nos vœux la mise en place d’un système informatisé moderne et efficient pour mieux connaître le volume et l’évolution des effectifs.
M. René Dosière. Pourquoi la présidence de l’Assemblée ne reçoit-elle pas plusieurs exemplaires des rapports de la Cour des comptes ? Celui relatif à l’exécution du budget de l’État, par exemple, qui intéresse tous les députés, n’est disponible qu’auprès de la Commission des finances. On nous explique qu’il est consultable sur le site Internet de la Cour, mais il n’est pas évident d’imprimer trois cents pages. Il fut un temps où ce rapport était disponible à notre « distribution », mais ce n’est plus le cas. Je me permets de vous signaler ce problème interne à l’Assemblée !
Le Gouvernement semble plus soucieux de réduire le nombre des élus locaux que celui de ses sous-préfets. Ancien rapporteur pour avis du budget de l’administration territoriale de l’État, je ferai observer que les effectifs de l’État sont mal répartis, certaines zones étant manifestement sous-dotées : des sous-préfectures de région parisienne, où vivent 500 000 habitants, se retrouvent avec 50 ou 60 agents de l’État, tandis que la préfecture et les sous-préfectures d’un département peuplé de 150 000 habitants en emploient cinq ou six fois plus. Il conviendrait de mieux doter les zones urbaines !
M. Alain Pichon. Dans notre travail sur l’évolution des effectifs de l’État, qui doit paraître prochainement, une carte est très révélatrice des différences de maillage territorial : des zones sont suradministrées alors que d’autres sont sous-administrées. Une meilleure répartition est sans doute souhaitable, mais elle se heurte au goût peu prononcé des fonctionnaires, en particulier des fonctionnaires d’État, pour la mobilité. Il conviendrait donc d’encourager la mobilité.
M. René Dosière. Il faut aussi compter avec la capacité des parlementaires à défendre leurs propres circonscriptions !
M. Philippe Séguin. Supprimer des sous-préfectures ne signifie pas automatiquement supprimer des sous-préfets ; ceux-ci restent « en stock », si j’ose dire, toujours animés par l’espérance de devenir préfets. La seule économie à espérer concerne l’immobilier, encore que les logements de province resteront à la charge de l’État, eu égard au contrat moral passé entre ce dernier et les fonctionnaires entrant dans le corps préfectoral. L’impact sera donc limité.
Quoi qu’il en soit, même lorsqu’un organisme perd sa vocation, on réinvente une fonction pour les effectifs en poste. C’est ce que j’appellerai le « syndrome Banque de France » : avec la mise en circulation de la monnaie unique, la Banque a perdu sa vocation, mais elle continue de s’occuper ; elle produit des rapports à destination des préfets, qui, même s’ils font sans doute doublon avec d’autres rapports, peuvent ne pas être inutiles, car il est toujours intéressant de recueillir plusieurs points de vue. Et son activité phare est désormais la gestion du surendettement. Napoléon aurait-il créé la Banque de France si sa seule utilité, à l’époque, avait été de gérer le surendettement ? Si la Banque de France n’existait pas, une autre formule n’aurait-elle pas pu être trouvée pour gérer le surendettement ? D’autant que – si je puis dire – le fonctionnement de la Banque de France n’est pas « donné »…
M. Bruno Le Roux. Après les derniers événements, les élus de banlieue n’ont pas réclamé l’augmentation du nombre de fonctionnaires au niveau national mais ont demandé s’ils sont bien affectés là où se concentrent les problèmes d’insécurité. En 1997, en superposant la carte de l’insécurité et celle de la répartition des effectifs, j’avais constaté que le rapport était souvent inversement proportionnel : les effectifs de police sont les plus faibles là où les problèmes d’insécurité sont les plus graves.
Je sollicite une information sur la question, mais je me heurte à quelques réticences de la part du ministère de l’intérieur. Pouvez-vous nous aider ? Avez-vous mené une étude répondant à mes interrogations ou nous encouragez-vous à persévérer pour obtenir que les effectifs de police soient répartis en fonction des problèmes d’insécurité ?
M. Gérard Ganser, conseiller maître, responsable du secteur « intérieur ». Monsieur Dosière, des directions départementales interministérielles sont en cours de création. Sous réserve des incertitudes statistiques relatives aux effectifs de l’État et à leur répartition, chacune de ces structures emploiera entre 35 et 250 fonctionnaires pour 100 000 habitants. Je vous indique ces chiffres sous toutes réserves, à titre d’ordres de grandeur, mais ils font apparaître un rapport de un à sept.
Monsieur Le Roux, nous travaillons régulièrement sur la police et notamment sur sa direction la plus importante en effectifs, la direction centrale de la sécurité publique (DCSP). Le dernier référé du Premier président relatif à ce domaine, qui a comme d’habitude été transmis à la Commission des finances de l’Assemblée nationale, faisait deux constats : la répartition des effectifs est sujette à une inégalité spatiale ; elle obéit à des lois totalement mystérieuses pour nous. Les effectifs de la DCSP sont affectés à la marge : les quelques milliers de policiers supplémentaires qui étaient recrutés chaque année en période de croissance étaient répartis d’abord par directions, puis par circonscriptions. Pour rééquilibrer les effectifs au sein de leur département, les directeurs départementaux sont même obligés de tricher un peu avec la règle en mettant à la disposition d’une circonscription des agents affectés dans une autre circonscription.
M. Daniel Vaillant. Je ne jetterai la pierre à personne car le problème des chiffres est ancien.
Quand un policier part à la retraite huit mois à l’avance pour récupérer ses heures non payées, est-il comptabilisé dans les statistiques ? De tels phénomènes contribuent à brouiller les chiffres, de même que le soin consacré par le Gouvernement à ne pas afficher la baisse de fonctionnaires qu’il a souhaitée, pour une raison que chacun comprend : la sécurité étant un sujet politique qui compte.
Existe-t-il des données internationales permettant de comparer le taux de présence policière, notamment avec les autres pays européens ? Compte tenu de la croissance démographique, du regroupement des populations dans les zones urbaines et des problèmes rencontrés dans le monde rural, je ne suis pas sûr que la dotation de la France en policiers soit excessive, ni qu’elle soit beaucoup plus élevée qu’en Italie. Il faut savoir assumer une politique !
Le problème des tâches administratives indues doit toujours être soulevé. Nous avons davantage besoin de policiers sur le terrain, en proximité, au service des citoyens, que de policiers affectés à des tâches étrangères aux missions de sécurité publique.
Grâce à la télématique et à la bureautique, les tâches des sous-préfectures peuvent certainement être allégées – cet allégement a d’ailleurs été déjà entrepris. En revanche, je doute que la recentralisation entraîne des économies. Le transfert de la responsabilité de la rénovation des lycées de l’État vers les régions a permis d’accomplir des économies. Ce n’est pas la proximité qui coûte cher : c’est la centralité !
M. Philippe Séguin. Le mouvement de recentralisation s’effectue vers la préfecture, pas vers Paris.
M. Jacques Valax. Une logique de réforme peut s’appuyer sur la volonté d’accomplir des économies. Or, hier, un texte relatif à la disparition de la profession d’avoué a été adopté. Alors que cette réforme avait initialement pour objet d’entraîner des économies pour le justiciable, la garde des sceaux a reconnu que son coût serait au minimum de 400 ou 450 millions d’euros, alors que nous estimons, pour notre part, qu’il atteindra 900 millions d’euros. Quelle est la cohérence entre la volonté d’économies affichée et une telle mesure qui génère de nouveaux coûts ?
M. Philippe Séguin. Sans parler de cet exemple précis, certaines réformes ayant pour objectif de produire des économies à terme peuvent s’avérer coûteuses dans un premier temps. La fusion des services de la comptabilité publique et des impôts sera porteuse de cohérence et d’économies dans le futur mais, dans l’immédiat, elle se traduit à l’évidence par des surcoûts, ne serait-ce que parce que les nouvelles rémunérations ont tendance à s’aligner sur les rémunérations les plus élevées des anciens corps. Il en a été de même à Pôle emploi et à France Télévisions. La logique est identique lorsqu’une tâche est automatisée : cela s’avère coûteux dans un premier temps, parce qu’il faut acheter les équipements et parce que les personnels concernés ne partent pas immédiatement à la retraite.
Monsieur Vaillant, il est au moins souhaitable que toutes les statistiques s’appuient sur les mêmes critères, que le policier partant en retraite huit mois à l’avance soit systématiquement comptabilisé ou systématiquement extrait des effectifs.
M. Serge Blisko. En dépit du dévouement du personnel des greffes et des autres agents judiciaires, certains tribunaux de grande instance sont totalement débordés. La vétusté de l’immobilier et des locaux est aussi frappante, de même que les erreurs gigantesques commises en matière d’informatisation, notamment. Les missions parlementaires ont constaté que le système fonctionne mal.
Les comparaisons internationales nous intéressent beaucoup, en particulier concernant les prisons. Nombre de prisons sont construites en plein champ, comme l’exigent les collectivités locales et les habitants, ce qui entraîne des coûts très lourds, notamment des coûts sociaux, pour les personnels, les détenus et leurs familles.
N’oublions pas que 73 % des personnes détenues en maison d’arrêt sont condamnées à moins d’un an d’emprisonnement. C’est pourquoi nous préconisons le recours à des systèmes alternatifs – aménagement de peine et bracelet électronique –, mais il importe que nous disposions de données fiabilisées relatives à leur coût et à leur montée en charge.
Enfin, j’ai pris connaissance du coût extraordinairement élevé de la construction, à Paris, d’un nouveau palais de justice. L’état du bâtiment actuel, certes vétuste, situé sur l’île de la Cité, me semble améliorable, en particulier si un effort est accompli pour perfectionner l’informatisation et les méthodes de travail. J’ai toujours mis en doute l’évaluation des besoins, qui date des années quatre-vingt-dix, c’est-à-dire d’une époque où la numérisation était moins développée qu’aujourd’hui. L’affaire est largement engagée, mais dépenser de 500 à 700 millions d’euros pour un second bâtiment serait excessif : il serait plus judicieux de consacrer ce surcoût à l’amélioration de la condition pénitentiaire.
M. Gérard Moreau, conseiller maître, responsable du secteur « justice ». Nous lisons et entendons que la Ville de Paris et le ministère de la justice envisagent une construction dans le quartier des Batignolles, par le biais d’une procédure de partenariat public-privé. Je n’en sais pas plus que vous. Le projet est suffisamment avancé pour arriver à nos oreilles, mais aucun contrat n’a été signé, aucun texte n’a été adopté. La Cour a simplement constaté – son rapport annuel 2008 en rend compte – que la problématique de la modernisation du tribunal de grande instance de Paris a été étudiée dès 1993 et qu’elle a été travaillée depuis lors, mais qu’une actualisation complète s’impose, eu égard aux évolutions possibles sur l’île de la Cité – le ministère de l’intérieur envisage de faire déménager ses fameux services du quai des Orfèvres. La Cour a donc demandé au ministère de la justice de reprendre son travail et de concevoir un projet global afin d’identifier le meilleur investissement, sans parler de la localisation, qui doit être déterminée conjointement par l’État et la ville, à supposer qu’une reconstruction se révèle nécessaire.
Créer un établissement public spécialisé n’est pas forcément la formule la plus économe. La vraie question est la suivante : est-il prioritaire de dépenser 600 ou 700 millions d’euros pour un tel investissement, alors que le ministère croule sous les besoins, tant dans le domaine pénitentiaire que dans le domaine judiciaire ?
M. Alain Pichon. Vous connaissez l’essentiel du roman à épisodes de l’EPPJP, l’établissement public du palais de justice de Paris. Après plusieurs avatars, l’option Batignolles, dont le coût est élevé, semble maintenant sur les rails.
J’attire l’attention de la Commission sur les opérations en partenariat public-privé (PPP). Loin d’être la pierre philosophale, cette méthode offre des solutions illusoirement moins coûteuses que le financement sur crédits publics.
Nous avons procédé à divers contrôles, portant sur le ministère des affaires étrangères, sur des prisons ou des palais de justice. Les universités et les collectivités locales seront sans doute aussi sollicitées et séduites par ces montages car il n’y a que des loyers à payer et le partenaire privé apporte le financement et supporte le risque. S’il s’agit d’une opération commerciale comme la construction d’une scène de spectacle, c’est sans doute intéressant ; s’il s’agit d’un équipement aussi régalien qu’une prison ou un hôpital, je suis un peu plus réservé. Un tel contrat est extraordinairement sophistiqué et il incombe au directeur de prison ou au président du tribunal de grande instance, qui n’est ni équipé ni organisé à cet effet, de surveiller son exécution. Autrement dit, la marge de manœuvre et de négociation du partenaire privé est considérable.
Enfin, le coût actualisé des loyers, qui courent souvent sur quarante années, est vertigineux. EUROSTAT, pour l’instant, n’assimile pas ces loyers à de la dette, mais cela ne saurait durer car le risque du partenaire privé est limité lorsque l’État apporte sa garantie pour une prison ou un tribunal. Il y a quelques années, la Hongrie, qui avait multiplié les PPP, a dû payer les pots cassés. Je ne suis pas adversaire des opérations en PPP, mais je préconise la parcimonie et la prudence en la matière.
Mme Marietta Karamanli. Lors de la discussion sur la loi de finances pour 2009, nous avons été plusieurs à noter la très grande variété des dotations financières de l’État aux collectivités territoriales, chaque concours obéissant à ses propres règles de calcul, certains servant de variable d’ajustement ou de compensation d’exonération.
En 2010, la masse de ces dotations augmentera de 0,6 à 0,7 %, soit deux fois moins que prévu. Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) devrait progresser de 1,2 % et le basculement de la taxe professionnelle vers la cotisation économique territoriale s’effectuera en deux temps.
Les collectivités assument des compétences de plus en plus étendues avec des ressources souvent précaires et des dotations en stagnation ou en régression. Que vous inspire la complexité des relations financières entre l’État et les collectivités territoriales, pour partie retracées dans la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ? Quels mécanismes seraient de nature à réduire la vulnérabilité des transferts entre l’État et les collectivités et donc à renforcer leur stabilité ?
M. Alain Pichon. Les dotations de l’État aux collectivités territoriales forment une alchimie de plus en plus complexe, défiant l’entendement de quiconque essaie de s’y retrouver. Ceux qui maîtrisent la totalité du système sont extrêmement rares : quelques parlementaires, le Comité des finances locales – instance décisionnelle en la matière –, des fonctionnaires de la direction générale des collectivités locales et du ministère des finances.
L’État s’essouffle et peine de plus en plus à alimenter ses dotations : les chiffres annoncés pour 2010 marquent un freinage très net des taux d’augmentation par rapport aux exercices précédents. Il ne m’appartient pas de porter une appréciation sur les choix politiques, mais j’estime qu’il faudra un jour ou l’autre installer des structures de dialogue et de concertation entre les élus locaux et les décideurs nationaux, afin d’assurer une programmation et une contractualisation à moyen terme.
Malgré le nombre de bénéficiaires – entre 50 000 et 60 000 communes et intercommunalités – et la coexistence d’une quinzaine de dotations avec des multicritères très sophistiqués, leur attribution donne lieu à peu de contentieux et de contestation. Les élus locaux reçoivent à peu près ce qu’ils attendaient : s’ils obtiennent 1 % de mieux que prévu, ils sont contents ; s’ils obtiennent 1 % de moins que prévu, on leur explique pourquoi. Cette gigantesque pompe aspirante et refoulante, actionnée par des agents préfectoraux peu nombreux mais très dévoués, réussit donc assez bien à irriguer les collectivités locales. Toutefois, l’enveloppe, qui s’élève aujourd’hui à 85 milliards d’euros, ne peut continuer de dériver au rythme des dernières années ; il convient d’organiser une concertation pour assurer une programmation à moyen terme.
M. le président Jean-Luc Warsmann. L’utilité des structures intercommunales est incontestable, mais leur création s’est traduite par l’ajout d’un niveau d’administration, avec un coût supplémentaire, souvent sans entraîner la moindre économie de fonctionnement pour les communes membres. Afin de remédier à ces dérapages, il convient de favoriser la mutualisation des services entre communes et intercommunalités. Quels travaux avez-vous conduits à ce sujet ? Savez-vous mesurer ce niveau de mutualisation ? Auriez-vous des pistes législatives à nous suggérer pour faire disparaître les doublons ?
M. Philippe Séguin. Nous faisions déjà ce constat dans notre rapport public de 2005 consacré à l’intercommunalité. Nous y chiffrions même à plusieurs dizaines de milliers le nombre d’emplois nets créés dans les intercommunalités, le personnel précédemment affecté aux matières intercommunalisées ayant été maintenu.
M. Alain Pichon. La Cour a traité le sujet de l’intercommunalité à deux reprises, dans le rapport cité par M. le Premier président, puis dans un rapport de suivi constatant des progrès en ce qui concerne le maillage du territoire et les économies d’échelle obtenues. Le vrai problème, c’est que beaucoup d’intercommunalités ont été créées par effet d’aubaine, pour profiter des bonifications de dotations proposées par l’État. Si cela s’est traduit par des créations nettes d’emplois, c’est parce que les communes voulaient conserver leur propre personnel et parce que les intercommunalités, qui voulaient apparaître comme des structures nouvelles, ont refusé de s’embarrasser de personnel ancien. Bref, même si les intercommunalités n’en ont pas le statut constitutionnel, nous avons assisté à la naissance d’un quatrième niveau de collectivités territoriales.
M. Gérard Ganser. Les intercommunalités ont recruté du personnel pour exercer leurs missions, ce qui est normal, mais, dans le même temps, les effectifs des communes membres, loin de baisser, ont eux-mêmes augmenté.
En outre, la plus grande part de la fiscalité levée par les intercommunalités – c’est-à-dire essentiellement la taxe professionnelle unique – est en fait rétrocédé aux communes membres. L’approche globale par les ressources démontre donc le caractère factice de certaines intercommunalités : la solidarité intercommunale a rapidement atteint ses limites. Mais chaque situation est unique et les chambres régionales des comptes ont procédé à des analyses locales détaillées pointant les défauts de mutualisation.
M. Alain Pichon. Nous venons d’observer l’évolution comparée, sur une période de vingt-huit ans, des effectifs de l’État et des collectivités territoriales : il est assez paradoxal que les collectivités locales où les effectifs ont le plus augmenté soient les communes et les intercommunalités, c’est-à-dire les moins concernées par les transferts de compétences liés à la décentralisation.
M. Alain Vidalies. Je vous remercie d’avoir déclaré que la dépense fiscale n’est pas un champ d’investigation interdit. Nous devrions parler davantage du dispositif Girardin, invention extraordinaire dont le coût pour le budget de l’État est considérable, à l’heure où il a tant besoin de ressources. On trouve sur Internet des explications si sophistiquées que la question pourrait être rattachée au projet de loi dont nous discuterons ce soir : le dispositif Girardin est un jeu, mais un jeu où l’on gagne à tous les coups, avec des gains énormes. Pouvez-vous préciser les chiffres en masse ?
Dans un certain nombre de juridictions, des pôles de l’instruction ont été créés : on a rassemblé des magistrats, regroupé des bureaux, démoli des locaux. Or voilà que la fonction de juge d’instruction va être supprimée. Ne serait-il pas intéressant que la Cour évalue le coût de ce « pas de deux » pour les finances publiques ?
Les meilleurs magistrats formés par la République sont employés à ce pas juger, affectés à toutes sortes d’activités administratives. Les tribunaux ne pourraient-ils pas être gérés par des directeurs, comme c’est le cas depuis longtemps pour les hôpitaux ?
Le partenariat public-privé n’est effectivement pas si merveilleux. Dans ma commune, une nouvelle prison a été construite dans ces conditions. Les coûts sont extravagants et le fonctionnement au quotidien pose d’énormes problèmes : les contrats prévoient une durée maximale d’intervention, par exemple, pour remplacer les ampoules usagées et l’opérateur privé, pour maximiser sa marge d’exploitation, intervient évidemment le plus tard possible. La Cour s’est manifestement engagée sur ce champ d’investigation ; l’Assemblée nationale devrait aussi s’y intéresser.
M. le président Jean-Luc Warsmann. J’aimerais pour ma part connaître les aspects du dispositif Girardin relatifs aux bateaux de plaisance.
M. Gérard Ganser. Le projet de loi de finances évalue les dépenses fiscales rattachées à la mission Outre-mer à 2,9 milliards d’euros – soit plus que le budget de ladite mission –, dont 1,18 milliard au titre de la TVA à taux réduit et 800 millions au titre du dispositif « Girardin industriel », issus principalement, sauf erreur de ma part, d’une opération exceptionnelle en Nouvelle-Calédonie.
Les travaux de la Cour sur le « Girardin immobilier » ont conduit le Premier président à adresser un référé aux ministres concernés ; l’un d’eux a d’ailleurs répondu et n’a pas contesté les constatations de la Cour : ce dispositif conduit l’État à s’endetter sur cinq ans à un taux supérieur à 10 % et l’administration reconnaît qu’une subvention directe coûterait sensiblement moins cher.
La Cour a pu constater l’absence d’effets du « Girardin industriel » à Wallis et Futuna notamment : devant le nombre considérable de dossiers et l’absence totale de contrôle, nous avons été amenés à saisir la justice. Les bateaux de plaisance, Monsieur le président Warsmann, relèvent de ce dispositif industriel.
Mme Sandrine Mazetier. L’existence de la préfecture de police de Paris est-elle, aux yeux de la Cour, un facteur d’économies ou cette structure fait-elle doublon pour certaines dépenses ?
Par ailleurs, le mécanisme imaginé par l’État pour compenser la suppression de la taxe professionnelle ne risque-t-il pas de figer à jamais les déséquilibres territoriaux existants ?
M. Philippe Séguin. Pour ce qui est de votre seconde question, la Cour ne saurait se prononcer sur le fond d’un projet soumis au Parlement. Après que la mesure aura été votée, promulguée et appliquée, nous ne manquerons pas de faire connaître nos observations, mais nous ne pouvons interférer dans une discussion qui n’appartient qu’à vous.
M. Alain Pichon. La Cour a procédé il y a quelques années à un contrôle approfondi de la gestion de la préfecture de police. Cette instance, vous le savez bien, est une sorte d’État dans l’État. Le préfet de police a un poids considérable au sein du ministère de l’intérieur. Il ne rend compte qu’au ministre, voire plus haut…
Or, notre contrôle avait mis au jour un grand nombre de dysfonctionnements, notamment en matière de gestion des effectifs, de durée du travail, de gestion des véhicules et des garages, d’accidentologie, d’informatique. Après nos critiques, plusieurs corrections ont été apportées. Nous reprendrons ce contrôle l’année prochaine.
Par ailleurs, la mise en œuvre de la réforme étendant les pouvoirs du préfet de police aux départements de la petite couronne semble difficile. Les techniques d’emploi des forces de sécurité et de police par les préfets départementaux s’en trouvent quelque peu déstabilisées.
Que la préfecture de police de Paris soit un bel outil, cela ne fait pas de doute ; un outil peu coûteux, c’est plus discutable.
M. Olivier Dussopt. La Cour a remarqué que les transferts de compétences de 2004 s’étaient accompagnés de transferts de moyens généralement statiques alors que la dépense est dynamique. Il est dommage que nous ne puissions profiter en amont de pareille expertise de la Cour en ce qui concerne la réforme de la taxe professionnelle – d’autant que vous laissez pressentir que votre intervention en aval ne plaira pas forcément à ses initiateurs !
Par ailleurs, la dépense fiscale s’élève aujourd’hui 70 milliards d’euros. Le dispositif Girardin ne représente qu’une part infime de ce montant. Quelles autres pistes la Cour suggère-t-elle ? On ne peut s’empêcher de mettre en regard les 100 milliards de dépenses fiscales et d’exonérations sociales avec les 115 milliards annoncés du déficit pour 2010 : dans un budget présenté comme contracyclique, l’impact ne sera que de 15 milliards de dépenses nouvelles.
Enfin, je suis surpris que l’on ne puisse évaluer le coût mobilier et immobilier de la réforme de la carte judiciaire. Il serait utile que notre commission soit régulièrement informée des estimations réalisées. Là encore, une étude d’impact et une concertation dépassant le seul rapport des présidents de cour – que la garde des sceaux n’a au demeurant pas pris en compte dans ses décisions – auraient dû précéder la réforme.
M. le président Jean-Luc Warsmann. En ce qui concerne les problèmes de diffusion interne, j’enverrai dès aujourd’hui, à la suite de l’intervention de plusieurs collègues, un courrier demandant au président de l’Assemblée nationale de transmettre à notre commission tout document de la Cour des comptes en relation avec nos domaines de compétences.
M. Philippe Séguin. Je vous confirme, Monsieur Dussopt, que les textes n’autorisent pas la Cour à intervenir en amont. Tout au plus pourrions-nous, lorsque l’étude d’impact existe – mais après la réforme constitutionnelle, le Gouvernement pourrait être de plus en plus tenté d’utiliser la voie de la proposition de loi –, apprécier la qualité de la méthodologie retenue.
M. Gérard Moreau. La réforme de la carte judiciaire s’est engagée le 1er janvier dernier et s’accentuera le 1er janvier prochain. Dans le cadre de l’élaboration de son rapport sur les résultats et la gestion budgétaire de l’État, qu’elle présentera au printemps prochain, la Cour étudie les chiffres annoncés. Certaines données commencent à se préciser, comme l’indemnisation des avocats et des personnels, ou encore l’évaluation des coûts immobiliers – dont certains sont inscrits dans le projet de loi de finances, mais avec une dispersion et des écarts qui amènent la Cour à engager actuellement un contrôle « post-étude d’impact » portant sur les bases sur lesquelles on a posé la réforme.
M. Jean-Paul Garraud. Le président Alain Pichon a souligné à juste titre que le ministère de la justice pourrait réaliser des économies en matière de procédure. Je remarque que la loi du 15 juin 2000, votée à l’unanimité par des parlementaires animés des meilleures intentions du monde, non seulement n’a pas renforcé la présomption d’innocence – il y a toujours autant de mises en détention provisoire –, mais a de plus engendré un formalisme considérable auquel il est urgent de remédier.
Par ailleurs, si le Gouvernement a fait valoir les économies qui découleraient de la réforme de la carte judiciaire, il engagera dans un premier temps – cinq à dix ans, selon le président Pichon – de fortes dépenses. Même s’il s’agit surtout de prospective, la Cour peut-elle fournir une estimation de ces dépenses et en préciser la durée ?
M. Alain Pichon. Il s’agit d’une réforme d’envergure, attendue et annoncée depuis longtemps. Elle touche aux hommes – juges, avocats pour lesquels on s’est empressé de trouver un système de dédommagement, etc. –, mais elle représente également un grand bouleversement immobiliser. Fermer un tribunal revient souvent à restituer le bâtiment, après remise en état, à la collectivité qui en était propriétaire – laquelle collectivité avait complètement perdu de vue cet aspect et n’a pas toujours envie de s’en embarrasser. Vendre un tribunal n’est pas forcément chose facile !
À ce problème de ressources s’ajoute celui de la construction des nouveaux tribunaux. Entre la décision et l’inauguration, il s’écoule rarement moins de quatre ou cinq ans.
Le ministère de la justice doit être bien conscient que cette réforme lourde suppose le recrutement d’experts en ressources humaines, en gestion et en opérations immobilières, etc. Il s’est doté d’un opérateur, l’agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ), qui peut se charger du travail, mais il a trop longtemps vécu en autarcie administrative, confiant à ses magistrats des tâches de gestion. De ce point de vue, l’idée d’instituer dans chaque tribunal un directeur ou un secrétaire général qui ne soit pas forcément un magistrat, mais une personne rompue aux techniques de gestion, représenterait un progrès.
Quoi qu’il en soit, on ne peut attendre d’effets positifs et d’économies qu’après le laps de temps que j’ai indiqué. Autrement dit, la réforme sera une charge nette pour le budget de l’État au moins pendant le premier lustre.
M. Jean-Christophe Lagarde. Il est surprenant que la Cour dénonce la « dérive » des dotations de l’État aux collectivités locales alors que l’augmentation n’est que 0,6 % cette année et de 1 à 1,5 % en règle générale. Je rappelle que l’État fixe aussi l’augmentation des rémunérations de nos salariés : 3,5 % cette année, pour une masse salariale qui représente 50 à 60 % de la dotation. La différence ne peut être comblée que par une augmentation de la richesse de la commune, elle-même fonction d’une taxe professionnelle qui va disparaître ! Ma commune ayant été classée comme la plus pauvre des villes de plus 50 000 habitants, je suis bien placé pour trouver excessif le terme de dérive.
Par ailleurs, la Cour est-elle en mesure d’aider les élus – en particulier ceux de la Seine-Saint-Denis – à avoir une meilleure connaissance de la répartition des effectifs des forces de sécurité ? Son intervention est toujours utile, au moins pour alerter l’opinion publique. Alors que les ministres de l’Intérieur ont des comptes à rendre aux citoyens sur ce point, ils se sont toujours montrés évasifs. Le tableau de la délinquance existe, celui des effectifs de policiers aussi, il est donc possible d’élaborer et de rendre public un tableau annuel de la répartition. Il est notoire que le rapport entre effectifs et délinquance est inversé, au prétexte que certains quartiers nécessitent plus de protection que d’autres.
Il serait également utile d’établir le rapport entre le nombre de policiers nationaux affectés dans une commune et le nombre de policiers municipaux. Il ferait apparaître que, plus une ville crée d’emplois de policiers municipaux – ce à quoi l’État l’incite fortement –, moins elle bénéficie de renforts de policiers nationaux. Il s’agit donc d’un réel transfert.
Par ailleurs, les conditions de rémunération des CRS sont sans commune mesure avec celles du reste de la police nationale. Puisque ces fonctionnaires ne sont pas employés, la plupart du temps, à leur mission originelle de maintien de l’ordre, n’y a-t-il pas moyen de combler quelque peu cette inégalité, d’autant que les gendarmes mobiles coûtent bien moins cher ?
Plus généralement, les effectifs des forces mobiles sont sensiblement plus élevés aujourd’hui que dans les années 1960, où pourtant les conflits sociaux étaient autrement plus nombreux et plus violents. Je me suis laissé dire que l’on pourrait économiser 30 à 40 % de ces emplois.
Enfin, si la Cour ne peut, a priori, nous aider dans le calcul des péréquations qui interviendront après la suppression de la taxe professionnelle, ne lui est-il pas possible d’assister les parlementaires pour étudier l’impact de leurs amendements ?
M. Philippe Séguin. Voilà une compétence supplémentaire qui m’aura échappé…
M. Jean-Christophe Lagarde. La péréquation entre collectivités est coûteuse et ses effets sont marginaux. Sans taxe professionnelle, les communes pauvres n’ont plus la perspective d’un impôt dynamique potentiel. Si l’on n’améliore pas l’outil de péréquation, on pérennise une usine à gaz. Au demeurant, Monsieur le président Pichon, je doute qu’il existe un seul haut fonctionnaire capable d’avoir une vision d’ensemble du système. On m’a expliqué à la direction générale des collectivités locales que ce système était devenu si complexe que l’on ne pouvait déterminer les effets de la modification d’une de ses données. C’est ainsi que le simple changement de strate démographique d’une autre ville a provoqué la suppression de la dotation de solidarité urbaine pour ma commune !
M. Alain Pichon. Comme vous le soulignez, Monsieur le député, la police municipale se développe : il y a actuellement 17 000 policiers municipaux. Mais la doctrine d’emploi et les modalités de recrutement, de formation et d’encadrement mériteraient examen ! Il est en effet paradoxal que, lorsqu’une commune fait l’effort de se doter d’une police municipale digne de ce nom, l’État ait tendance à réduire la voilure : la collectivité se retrouve victime de sa propre bonne volonté.
En ce qui concerne les dotations, je confirme que l’effet de la péréquation actuelle est dans l’épaisseur du trait au regard des enjeux. Seule une remise à plat complète permettrait d’envisager un système à l’effet péréquateur beaucoup plus important. Mais cela suppose un consensus global qui me semble loin d’être acquis.
M. Dominique Raimbourg. Une meilleure gouvernance peut-elle conduire à des améliorations dans la gestion de l’immobilier de la justice ?
Comment améliorer le mécanisme de l’aide juridictionnelle et augmenter le nombre de bénéficiaires ? Peut-on envisager des financements extérieurs ?
Enfin, un système plus satisfaisant de péréquation entre les collectivités locales est-il possible ?
M. Alain Pichon. À l’occasion du contrôle qu’elle a consacré à l’aide juridictionnelle et à son affectation aux avocats par le biais des caisses autonomes des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), la Cour a constaté une stabilisation du montant de l’aide à hauteur d’environ 300 millions. La comparaison avec les dispositifs en place à l’étranger est périlleuse car ceux-ci ne recouvrent pas les mêmes réalités. Cela dit, les crédits budgétaires consacrés par la France à cette aide ne sont pas considérables. Concernant les sources de financement extérieur, il existe un projet visant à augmenter le montant de l’aide de 100 à 200 millions en « taxant » certaines opérations.
Le financement des besoins en personnel des CARPA était couvert par les crédits de l’aide juridictionnelle. Il y avait 96 de ces caisses et ce chiffre n’a que peu baissé. Sans doute faudrait-il procéder au moins à un regroupement par cour d’appel. En outre, le système ne pouvait fonctionner que lorsque les coûts administratifs étaient faibles et que les rendements des placements étaient forts. Ce n’est plus le cas, si bien que l’on marche à front renversé : c’est le produit financier des dépôts privés des clients des avocats qui permet la gestion et la distribution de l’aide juridictionnelle.
Mme Delphine Batho. La Cour souligne le caractère mystérieux de la répartition des effectifs de policiers, d’autant plus paradoxal que la gestion des affectations est centralisée. La réforme consistant à adapter la répartition aux besoins, longtemps annoncée, n’a jamais vu le jour : on lui opposait un argument d’ordre technique, la différence entre effectifs théoriques et effectifs réels. Mais cet argument tombe avec la mise en place de la main courante informatisée, outil qui fournit tous les éléments en matière de gestion des ressources humaines.
En examinant la mission « Sécurité », on constate une augmentation des recrutements de personnels administratifs au cours des dix dernières années. La Cour estime-t-elle que cela a permis de libérer des personnels non-administratifs ?
En matière d’ordre public et de sécurité, n’existe-t-il pas des redondances, par exemple entre les CRS affectées à la sécurisation, les brigades anticriminalité et les compagnies de sécurisation ?
La Cour a-t-elle déjà évalué la réforme qui a conduit à la création de la direction centrale du renseignement intérieur (la DCRI), au-delà des remarques qu’elles avaient formulées au sujet du siège de Levallois-Perret ?
Jacques Alain Bénisti et moi-même avons analysé dans un rapport d’information la question des fichiers de police. En matière de police comme de justice, les systèmes informatiques représentent des enjeux considérables. Les procédures de marchés publics posent problème en raison d’un effet pervers de la logique d’externalisation : l’État ne détient plus les compétences pour mener un dialogue exigeant avec les prestataires privés.
Enfin, plusieurs pays, notamment le Canada, mènent des études non seulement sur les coûts directs de l’insécurité (police, justice), mais aussi sur ses coûts indirects, par exemple pour le système de santé ou en matière d’assurances. De telles réflexions seraient souhaitables en France.
M. Alain Pichon. Ces questions nous aideront à établir le programme de travail de la Cour pour les trois prochaines années, car nous n’avons pas encore mené toutes les investigations que vous évoquez.
Votre dernier point, celui des coûts indirects, constitue un enjeu d’avenir important, même s’il relève plus de l’évaluation que du contrôle.
En ce qui concerne la réforme du renseignement intérieur, nous ne sommes pas persuadés que le greffon prend bien. Ni l’installation dans l’immeuble en question ni la synergie et les économies escomptées ne semblent correspondre à ce que des esprits optimistes avaient envisagé.
M. Gérard Ganser. La Cour n’a pour l’instant exercé son contrôle que sur l’opération de construction du siège de Levallois-Perret, ainsi que sur la sécurité de cet immeuble et sur l’accroissement du parc automobile qui a suivi la réforme.
Elle a, par ailleurs, constaté que les effectifs administratifs se traduisaient en effet par des réaffectations de personnels sur le terrain. Il n’en reste pas moins que nos contrôles montrent toujours que des policiers actifs, qui n’ont pas les mêmes conditions de rémunération et de retraite que les personnels administratifs, continuent à occuper des postes de gestion sans justification opérationnelle.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Combien de postes cela représente-t-il ?
M. Gérard Ganser. Il est difficile de l’établir. Chaque loi de programmation fixe des objectifs de substitution de personnels qui se chiffrent en milliers et chaque bilan d’exécution montre que ces objectifs ne sont que partiellement atteints.
M. François Vannson. Ma question, à laquelle, je le crains, la Cour opposera son devoir de réserve, porte sur la réforme des grandes collectivités – départements et régions – qui s’annonce. Une éventuelle fusion ouvre-t-elle la perspective de réelles économies en matière d’effectifs, de dotations, de financements croisés, etc. ? Je regrette moi aussi que l’on ne puisse recourir davantage à l’expertise de la Cour avant de s’engager dans de tels débats.
M. Philippe Séguin. En émettant une opinion sur une réforme à venir, non seulement la Cour trahirait son devoir de réserve, mais elle ne respecterait pas le Parlement : tant que ce dernier ne s’est pas prononcé, il n’y a pas de réforme.
La réponse ne pourra résulter que d’un examen commune par commune, département par département, région par région. La seule certitude à l’heure actuelle, c’est qu’une meilleure cohérence de la gestion des ressources humaines entre les intercommunalités et les communes serait un réel gisement d’économies.
M. Manuel Valls. S’agissant de la police, il est certain que l’on pourrait trouver des gisements d’économie, ne serait-ce que par une évaluation de l’organisation et de l’efficacité des forces de l’ordre.
Dans la région parisienne, il existe entre la petite et la grande couronne de réelles inégalités, qui seront renforcées par la réforme dite du « Grand Paris » et qui se manifestent par l’intervention à des degrés variables de plusieurs agents publics : la police nationale, les polices municipales – toutes les communes ne choisissant pas d’en avoir une et ne pouvant y consacrer les mêmes moyens – et la gendarmerie. Dans la circonscription dont je suis l’élu, qui recouvre un secteur essentiellement urbain et relativement étroit, la zone police et la zone gendarmerie se superposent, ce qui pose des problèmes non seulement d’organisation, mais aussi de locaux, car les casernes de gendarmerie coûtent cher, aux collectivités territoriales comme à l’État. Il y aurait là, incontestablement, une source d’économie.
S’agissant de la justice, je fais bien évidemment mienne la proposition de mon collègue Vidalies sur l’organisation des palais de justice, et je juge moi aussi nécessaire une évaluation de la réforme de la carte judiciaire. Il faudrait, en revanche, examiner ce que cela pourrait apporter aux palais de justice, qui sont démunis et dont l’effectif est, comme dans l’Essonne, quasiment stable depuis vingt ans, malgré la forte augmentation de la population et des affaires à traiter. Les magistrats sont débordés par les problèmes immobiliers et administratifs, on manque de juges, il y a un turn-over très important : tout cela ne contribue pas à une justice sereine.
S’agissant de l’intercommunalité, il existe là aussi des gisements d’économie, comme l’avait d’ailleurs montré la Cour dans son rapport sur la politique de la ville, lequel soulignait l’enchevêtrement des responsabilités entre communes, intercommunalités et État. Aujourd’hui, tout le monde s’occupe de la politique de la ville !
S’agissant des partenariats public-privé, je signale que lorsque j’étais vice-président de la région Île-de-France, chargé des finances, j’ai mis fin, sous la houlette de Jean-Paul Huchon, aux marchés d’entreprise de travaux publics. De tels systèmes posent des problèmes de transparence, de concurrence et de coût : c’est de la dette – certes masquée, mais de la dette quand même.
Prenons l’exemple de la construction de l’hôpital d’Évry-Corbeil : si, dans un premier temps, il y a eu un effet d’aubaine pour l’État, on a aujourd’hui des difficultés à établir des prévisions sur plusieurs années concernant un programme appelé à évoluer en fonction des progrès de la médecine. Résultat : l’État va devoir abonder le budget, qui plus est sans véritable contrôle. Je ne vois pas où est l’économie !
Il faut donc être extrêmement prudent sur les dossiers de ce type, qui mettent en jeu des milliards et ne concernent que trois grandes entreprises françaises.
M. Philippe Séguin. Le terme « évaluation » prête à malentendu. Il convient de préciser de quoi l’on parle.
Le contrôle qui peut être utile au Parlement comporte trois stades : le contrôle de la régularité, qui consiste à vérifier que les textes sont bien appliqués ; le contrôle de l’efficience de la gestion – le stade actuel ; et l’évaluation proprement dite – le stade à venir. Certains parlent également d’« évaluation de niveau 1 » pour le deuxième stade et d’« évaluation de niveau 2 » pour le troisième.
C’est à ce dernier stade que sera évaluée l’efficacité de la réforme judiciaire ou du plan cancer. Au-delà des rapports que nous avons déjà rédigés, la seule question qui vaille est en effet de savoir si l’on dénombre moins de malades, davantage de guérisons, bref, si l’on note un progrès. À l’heure actuelle, nous sommes dans l’incapacité d’y répondre.
Aux termes de la Constitution, le Parlement est chargé de « l’évaluation des politiques publiques » – qui, à l’évidence, correspond à une évaluation de niveau 2. La politique de la ville sert-elle à quelque chose ? Ce choix stratégique est-il opportun ? En d’autres termes, il ne s’agit plus de savoir, lorsqu’un pont a été construit, si les marchés ont été passés régulièrement et si les délais d’exécution ont été respectés, mais si l’ouvrage est utilisé ! Si le Parlement est chargé de cette appréciation, c’est en raison de sa dimension politique ; le rôle de la Cour des comptes est de vous assister.
Cela ne se fera pas en un jour. D’abord, nous ne pourrons pas être les seuls à vous assister : si la Constitution mentionne la Cour des comptes, ce n’est pas de manière exclusive. De notre côté, nous devrons faire notre révolution, car nous aurons besoin de recourir à des spécialistes et de mettre en œuvre une pluridisciplinarité qui, à l’heure actuelle, n’existe pas chez nous.
Il faudra également remédier à de nombreuses bizarreries : non seulement les textes ne donnent pas à votre commission un accès direct à la Cour, mais, quand nous avons été saisis d’une demande d’assistance de la Commission des finances sur les services d’incendie et de secours, il nous a été impossible d’y répondre, car la Commission n’avait pas le droit de saisir les chambres régionales des comptes et nous, nous ne pouvions pas aller sur leur terrain. La question se réglera d’ailleurs devant votre commission, puisque nous viendrons vous présenter la réforme mise au point par le Gouvernement, laquelle reprend nombre des idées que nous avions avancées.
Enfin, cette nouvelle évaluation demandera du temps. Actuellement, nous devons répondre dans les huit mois aux présidents des commissions des Finances et des commissions des Affaires sociales des deux assemblées. Mais avant d’obtenir l’évaluation du plan cancer ou celle de la politique de la ville, il faudra s’armer de patience ! Probablement devrons-nous définir un rythme de travail dès le début de législature.
Pour l’heure, je le reconnais, nous sommes incapables de donner une réponse sur l’efficacité de certaines politiques publiques. Ainsi, six milliards sont dépensés par les collectivités territoriales au titre de l’aide aux entreprises, mais l’on ignore si c’est utile !
M. Pascal Terrasse. Pour rebondir sur ce dernier propos, je voudrais saluer l’excellent travail accompli l’année dernière par la Cour et les chambres régionales sur les collectivités territoriales. Cela nous a permis de vérifier que l’aide économique n’apporte pas grand-chose lorsqu’elle est individualisée, mais qu’elle est plus pertinente lorsqu’elle est attribuée de manière globale, par exemple via les filières.
S’agissant du rôle respectif de la Cour et des chambres, je suis d’accord avec vous, Monsieur le premier président : il faut qu’elles continuent à ne pas juger de l’opportunité des choix politiques. Nous, gestionnaires de collectivités territoriales, n’apprécierions pas que l’on sollicite les chambres régionales des comptes afin de juger une décision. En revanche, il est bien évident qu’une chambre régionale doit pouvoir porter à tout moment à la connaissance des élus et de la population les effets d’une politique publique.
La pratique de l’évaluation pratiquée outre-Atlantique sous le nom de reporting n’a pas servi à grand-chose, sinon à créer des bataillons de sociétés privées, qui n’ont fait que relayer les missions menées par d’autres entreprises ou par la puissance publique. Un humoriste a d’ailleurs dit que le reporting, cela revenait à dire : « Je te donne ma montre et tu me donneras l’heure ».
Ce qui importe, c’est de mesurer la pertinence et l’efficacité d’une politique publique – et c’est ce que nous faisons dans mon département. Il convient de savoir à qui et à quoi sert l’argent public. Tel est l’objet du débat sur les niches sociales et fiscales.
M. Philippe Séguin. Et sur les dépenses d’intervention !
M. Pascal Terrasse. Bien évidemment. Les dépenses d’intervention représentent 70 milliards d’euros, auxquels s’ajoutent 5 milliards de niches sociales fiscales, soit une dépense totale de 75 milliards d’euros, dont on ignore l’utilité.
Je souhaiterais par ailleurs vous poser quelques questions techniques. Vous ne répondrez probablement pas à toutes aujourd’hui, mais peut-être pourrez-vous transmettre ultérieurement des éléments d’information au président Warsmann.
Tout d’abord, quels sont les résultats des premières évaluations de la Cour sur la rationalisation des services de l’État dans les départements ? En tant que président de conseil général, j’ai le sentiment que cela se passe plutôt mal. Les préfets sont chargés de l’organiser, mais un certain nombre de ministères y échappent : ainsi la justice ou l’éducation nationale, dont les troupes sont pourtant importantes.
Cette rationalisation comporte en outre un volet immobilier. Il est compliqué de tout mettre en œuvre en même temps. France Domaine demande aux préfets de rationaliser les locaux à coûts constants. Or, si l’on veut vraiment rationaliser l’ensemble des actifs immobiliers de l’État, il faudrait admettre que c’est impossible à coûts constants.
Une grande partie des hauts fonctionnaires chargés de mettre en place la RGPP se trouvent démunis face aux coups de boutoir prononcés par les organisations syndicales, par les salariés et même par les collectivités territoriales – pourtant prêtes, le cas échéant, à accompagner le mouvement. Malgré notre bonne volonté, on note une discordance d’opinions entre, d’un côté, France Domaine, et, de l’autre, les préfets. Résultat : la RGPP se passe très mal sur le terrain.
Cela m’amène au rôle des sous-préfectures, que vous avez évoqué dans votre propos liminaire. Allons jusqu’au bout : compte tenu du lien de subordination existant entre le préfet de région et les préfets de département, les préfectures de département ne sont-elles pas devenues, de facto, des sous-préfectures ?
Par ailleurs, combien de préfets et de magistrats se trouvent aujourd’hui sans affectation ou mission, tout en étant payés – et chèrement – par le contribuable ? On va chercher des préfets au tour extérieur, alors que l’on a « en magasin » des gens compétents qui ne font rien !
Enfin, s’agissant des services de secours et d’incendie, il faut dire la vérité : leur gestion pose un problème de fond, dans la mesure où, à l’heure qu’il est, le payeur n’est pas le décideur.
Premier exemple : cette année, le préfet de mon département a mobilisé, dans le cadre de ses compétences, les services de secours et d’incendie pour déneiger des toits. Cette décision est à l’avantage des propriétaires des bâtiments et, surtout, des assureurs, qui n’auront pas à rembourser d’éventuels dégâts ; mais la facture, c’est le département qui la paie.
Deuxième exemple : un ancien ministre de l’intérieur – dont je ne citerai pas le nom – a jugé nécessaire que les pompiers volontaires disposent d’une pension de retraite. Fort bien, mais qui paie ? Le département.
Dernier exemple : les maires peuvent à tout moment solliciter l’intervention des pompiers, cela fait partie de leurs pouvoirs de police. Or, les contributions des communes sont bloquées ; le dispositif législatif de 1996 arrivant cette année à son terme, toute augmentation future des dépenses des services de secours et d’incendie sera entièrement à la charge des conseils généraux.
Bref, les deux institutions qui ont la capacité de faire appel aux pompiers ne sont pas les payeurs : c’est un facteur d’irresponsabilité ! D’autant plus qu’il existe un troisième décideur, invisible celui-là : l’assurance-maladie. Chaque fois que des services sanitaires ferment ou que la présence médicale est réduite, ce sont les pompiers qui servent de tampon, et les coûts augmentent.
Alors que nous sommes confrontés à des dépenses de plus en plus actives, nos ressources sont passives. La réforme de la fiscalité consiste en réalité à transformer une autonomie fiscale en autonomie financière. Sur le fond, cela se discute, mais il faudrait que nous puissions faire face à nos nouvelles dépenses.
Si l’on veut que l’État continue à être le garant de la sécurité des biens et des personnes, il faut centraliser, ou, tout au moins, régionaliser, les services qui l’assurent – dont les services de secours et d’incendie. Cela permettrait, pour le coup, de dégager de substantielles économies, car les départements ont engagé une « course à l’échalote » en recherchant les meilleurs équipements en matière de sécurité, quitte à acheter de grandes échelles qui ne servent que deux fois par an.
M. Jacques Alain Bénisti. Nous serons amenés dans les prochains mois à débattre à nouveau des nouvelles prérogatives de la Cour des comptes. Toutefois, je crois que, dans le cadre de ses avis sur les politiques publiques, elle devra tenir compte du fait que toute réforme visant à la diminution des effectifs de nos administrations, la rationalisation des bâtiments et l’optimisation des services suppose un investissement de départ. La Cour doit se concentrer sur l’objectif, à savoir la diminution des dépenses publiques.
M. Philippe Séguin. L’objectif ne doit pas être la diminution de la dépense publique, mais l’équilibre des recettes et des dépenses. Que l’on dépense 95 % du PIB n’est pas notre affaire : cela relève d’un choix politique. En revanche, si l’on veut éviter toute difficulté ultérieure, il vaut mieux équilibrer le budget. Pour ce faire, il n’existe que deux méthodes : soit la maîtrise de la dépense, soit l’augmentation de la recette – qui peut s’obtenir sans augmentation des prélèvements, par la suppression de certaines niches fiscales.
Par définition, nous n’avons pas de préférence. Tout ce que nous disons, sans avoir les moyens de l’imposer – ce qui est heureux, car sinon ce serait le gouvernement des juges –, c’est qu’il faut faire attention au déséquilibre du budget et à l’accumulation de la dette, sous peine que la capacité de manœuvre du Gouvernement ne se trouve progressivement réduite.
Monsieur Terrasse, quoi qu’on en dise, la réforme de l’administration territoriale de l’État, dans le cadre de la RGPP, ne peut pas, à titre principal, générer des économies. Peut-être que, par la suite, cela débouchera sur une meilleure organisation de l’État au plan territorial et assurera une plus grande réactivité. Mais du point de vue strictement budgétaire, réduire le nombre de directions ne changera rien, dès lors que les effectifs resteront constants. La seule source d’économie proviendrait du non-remplacement d’une personne sur deux – et encore, cela est contesté.
De ce fait, le problème ne se pose pas seulement, même si c’est un phénomène spectaculaire, pour quelques préfets désœuvrés – « hors cadre », « chargés de mission » ou « ambassadeurs » auprès d’organismes : il concerne aussi d’autres corps, dont les ambassadeurs.
M. Pascal Terrasse. Avez-vous des chiffres ?
M. Philippe Séguin. Nous pourrons vous les transmettre, si vous le souhaitez.
M. Alain Pichon. Il y a quelques années, nous avions réalisé deux contrôles, presque simultanés, d’une part sur les ambassadeurs, d’autre part sur les préfets qui n’avaient plus d’affectation officielle.
Administrativement, plusieurs cas de figure étaient possibles. Certains avaient été placés hors cadre, mais sans affectation, et continuaient à percevoir leur traitement indiciaire. D’autres étaient « haut-le-pied », mais avaient été mis au placard ou chargés de missions plus ou moins fictives. D’autres, enfin, étaient priés de rester chez eux à ne rien faire.
Nous avions dénoncé la situation auprès des deux ministres concernés, et s’agissant des préfets, des corrections ont été apportées : les préfets priés de rester chez eux à ne rien faire se comptent désormais sur les doigts des deux mains. En revanche, le problème des préfets hors cadre ou prétendument chargés de mission ne semble pas avoir été réglé.
S’agissant de la RGPP, l’immobilier de l’État, pour 95 % des surfaces et des immeubles, relève des administrations déconcentrées. Pourtant, jusqu’à présent, les opérations les plus spectaculaires de cession des biens de l’État n’ont concerné que des immeubles de prestige parisiens, qui ne représentent qu’une part infinitésimale du total. Parfois même, le solde s’avère globalement négatif. Ainsi, l’on a vendu l’immeuble de l’avenue Kléber à Paris pour acheter celui de la rue de la Convention. Résultat : le Président de la République a découvert un beau matin que l’on ne pouvait plus organiser de conférences internationales de niveau mondial dans des locaux d’État parisiens. Il faut aller ailleurs, et cela coûte cher !
Il convient de sortir de la logique notariale de France Domaine – vendre pour pouvoir acheter –, pour engager une réforme globale du parc immobilier de l’État ; celui-ci se montre à la fois mauvais propriétaire, mauvais bailleur et mauvais locataire.
Monsieur le président Jean-Luc Warsmann. Monsieur le premier président, monsieur le président, messieurs les conseillers maîtres, je vous remercie. Cette audition a été fort intéressante pour notre mission, et elle a permis de poser les bases de futurs échanges entre la Cour des comptes et la commission des Lois.
M. Philippe Séguin. Permettez-moi d’en faire le rapide inventaire.
Les rapports publics de la Cour ne posent aucun problème de communication ; j’ai pris bonne note des propos de M. Dosière à ce sujet.
L’article 58 de la loi organique relative aux lois de finances et l’article 2 de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale permettent aux deux commissions des finances, séparément, et aux deux commissions des affaires sociales, séparément, de nous commander des rapports. Le Conseil constitutionnel a émis une réserve en demandant que soit maintenue la capacité d’autonomie de programmation de la Cour. Toutefois, nous réalisons chaque année une quinzaine de rapports, destinés à la commission qui en a passé commande. Si l’un d’entre eux concernait une autre commission, peut-être pourrions-nous envisager qu’il lui soit transmis directement, après une période de trente jours et sous certaines conditions.
Nous adressons par ailleurs aux ministres des référés, qui ne sont pas destinés à être rendus publics, mais sont extrêmement utiles. Nous avons l’obligation de les transmettre à l’issue d’un délai de deux mois à la Commission des finances de chacune des deux assemblées. On pourrait imaginer que, dès lors que cela vous concerne, nous soyons également tenus de vous les envoyer dans un délai de deux à trois mois.
Il existe en outre des notes d’exécution du budget, dans lesquelles étaient d’ailleurs consignées les réponses à plusieurs de vos questions. Elles sont rédigées annuellement, à l’appui du rapport sur l’exécution de la loi de finances. Elles sont pour l’instant transmises aux seules commissions des Finances, mais vous gagneriez à en avoir une copie pour les missions et programmes qui vous concernent.
Enfin, vous disposerez bientôt, je l’espère, des rapports d’évaluation.
1 () La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
2 () Rapport sur la dépense publique et son évolution, Projet de loi de finances pour 2009.
3 () Il s’agit d’une estimation de l’OCDE qui peut différer de celle réalisée par l’INSEE.
4 () La concurrence fiscale et l’entreprise, Conseil des impôts, 2004.
5 () Christian Saint-Étienne et Jacques Le Cacheux, Concurrence équitable et concurrence fiscale, Conseil d’analyse économique, 2005.
6 () Source : Etude annuelle de KPMG consacrée aux taux d’imposition, juin 2007.
7 () Sources : pour la période 1789-1947 : C. André et R. Delorme, « Les dépenses publiques en longue période », Cahiers français, n° 261, p. 19, La Documentation française, 1993 ; OCDE à partir de 1974.
8 () Les contributions de chaque sous-secteur sont calculées hors transferts entre APU et à champ constant glissant.
9 () Le taux d’intérêt moyen sur la dette publique était de 4,3 % en 2008.
10 () Dans le « World Economic Outlook » d’octobre 2008.
11 () Les ressources de la CADES sont essentiellement constituées de la CRDS et de 0,2 point de CSG. Il convient à ce titre de rappeler qu’un point de CRDS représentait, en 2007, 11,5 milliards d’euros tandis qu’un point de CSG représentait 10,8 milliards d’euros.
12 () La CADES a été invitée à se substituer à l’Etat pour rembourser, en 2003 et 2004, la créance détenue depuis 2000 par les organismes de sécurité sociale sur le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (Forec), fonds centralisant les recettes destinées à compenser, pour le compte de l’Etat, les exonérations de cotisations sociales
13 () Les avances de la Caisse des dépôts et consignations se feront en fonction du taux des emprunts interbancaires à trois mois (taux Euribor), qui ne sont pas connus à l’avance et qui peuvent constituer une charge supplémentaire pour l’ACOSS.
14 () Le taux de pauvreté est évalué au seuil de 60 % du revenu médian.
15 () Sauf la Suisse, le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège, la Suède, l’Estonie et Singapour.
16 () Source : Direction générale du trésor et de la politique économique du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.
17 () Transfert de données fiscales et comptables.
18 () Créée le 1er janvier 2002, la direction des grandes entreprises est l’interlocuteur fiscal unique des grands groupes, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 400 millions d’euros.
19 () Ce « coup de rabot » pourrait avoir pour conséquences de rendre ces niches moins attractives dans des proportions inconnues ex ante ce qui explique la difficulté d’évaluer avec précision son impact financier in fine.
20 () Audition du 7 octobre 2009.
21 () Communication COM (1998) 219 final, du 7 avril 1998. Il ne faut toutefois pas prendre la définition du travail non déclaré pour équivalente de celle du travail illégal car la Commission indique qu’il faut entendre par « travail non déclaré », « toute activité rémunérée de nature légale, mais non déclarée aux pouvoirs publics, compte tenu des différences existant entre les systèmes réglementaires des États membres ». Cette définition, qui est proche de celle admise pour qualifier l’économie souterraine, exclut les activités criminelles ainsi que les travaux ne nécessitant pas de déclaration, tels que les travaux ménagers.
22 () Jean-Marc Leclerc, « Ce que gagne vraiment un dealer de cannabis », article paru dans Le Figaro, 3 décembre 2007.
23 () Le Monde Economie, « Aujourd’hui la dette, demain l’impôt ? », mardi 6 octobre 2009.
24 () Taux d’amortissement dégressif de 40 %, correspondant à un taux d’amortissement linéaire de 25 % et à un coefficient fiscal de 1,60 (25 % x1,60 = 40 %).
25 () CE 23 mai 1990, req. nos 44.764 et 70.180, RJF 1990, n° 7
26 () Disposition instituée par la loi du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991et reconduite successivement par les lois de finances pour 1993, 1995, 1996, 1999, 2001 2002, 2007, 2008 et 2009.
27 () Disposition instituée par la loi du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 et reconduite successivement par les lois de finances pour 1995, 1996, 1999, 2002, 2006, 2007, 2008 et 2009.
28 () Disposition instituée par la loi de finances pour 1979 et reconduite par différentes lois de finances successives.
29 () Disposition instituée par la loi de finances pour 1979 et reconduite par différentes lois de finances successives.
30 () Disposition instituée par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement et reconduite successivement par les lois de finances pour 1999, 2003, 2006, 2007, 2008 et 2009.
31 () Disposition instituée par la loi du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 et reconduite successivement par les lois de finances pour 1995, 1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2006 et 2007.
32 () Disposition instituée par la loi de finances pour 1979 et reconduite par différentes lois de finances successives.
33 () Disposition instituée par la loi de finances pour 1979 et reconduite par différentes lois de finances successives.
34 () Mission d’audit de modernisation, Rapport sur les aides publiques aux entreprises, janvier 2007.
35 () Ibid.
36 () Source : Daniel Lebègue et André-Jean Guérin, Grenelle de l’Environnement, Chantier 25, Comité opérationnel « Entreprises et RSE », Rapport final - 21 mars 2008, p. 36.
37 () Dans sa décision n° 93-20 DC du 21 juin 1993, le Conseil constitutionnel a accepté de vérifier la sincérité des recettes de privatisations. En matière de dépenses, le contrôle de la sincérité est apparu avec la décision n° 94-351 DC du 29 décembre 1994 relative à la loi de finances pour 1995.
38 () Décision n° 97-395 DC du 30 décembre 1997.
39 () Jean Maïa, « La contrainte européenne sur la loi », Pouvoirs, no 114, septembre 2005, p. 54.
40 () Données statistiques du Secrétariat général des affaires européennes au 1er septembre 2005.
41 () Ibid.
42 () Georges Hispalis, « Pourquoi tant de lois ? », Pouvoirs, no 114, septembre 2005, p. 109.
43 () Selon une étude du Secrétariat général du Gouvernement réalisée en 2005.
44 () Rapport du Gouvernement sur les mesures de simplification de l’année 2003, établi en application de l’article 37 de la loi du 2 juillet 2003.
45 () Alain Lambert, interview publiée dans Maires de France, numéro d’octobre 2009.
46 () Le budget opérationnel de programme regroupe la part des crédits d’un programme mise à la disposition d’un responsable identifié pour un périmètre d’activité (une partie des actions du programme par exemple) ou pour un territoire (une région, un département,…). Le BOP a les mêmes attributs que le programme : c’est un ensemble globalisé de moyens associés à des objectifs mesurés par des indicateurs de résultats. Les objectifs du budget opérationnel de programme sont définis par déclinaison des objectifs du programme.
47 () L’absence de statistiques plus récentes peut être perçue comme un signe du peu d’intérêt porté à cette question jusqu’à ce jour.
48 () Hors compte d’affectation spéciale « Pensions ».
49 () Audition du 22 septembre 2009.
50 () Audition du 7 octobre 2009.
51 () Les préfets ont été institués par la loi du 28 pluviôse an VIII (loi du 17 février 1800).
52 () Les crédits de paiement de la mission « Justice » dans le projet de loi de finances pour 2010 atteignent 6,859 milliards d’euros et progressent de 3,42 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2009 (+ 3,3 % à structure constante).
53 () Audition du 10 septembre 2009.
54 () Audition du 7 octobre 2009.
55 () L’ambition d’une justice apaisée, rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par M. Serge Guinchard, La Documentation française, juin 2008.
56 () Il convient de préciser qu’aucune conséquence ne peut être tirée par le juge d’un défaut de passage devant le médiateur familial, étant donné que l’accord des deux parties n’a pas été préalablement recueilli.
57 () Rapport (n° 370, session extraordinaire de 2001-2002) de MM. Jean-Pierre Schosteck et Pierre Fauchon au nom de la commission des Lois du Sénat relatif au projet de loi sur la juridiction de proximité
58 () La loi du 9 mars 2004 avait initialement limité le recours à la visioconférence à « l’examen des demandes de mise en liberté par la chambre de l’instruction et par la juridiction de jugement ». Ce champ a été élargi par la loi n° 2007–297 du 5 mars 2007 à l’ensemble du contentieux de la détention provisoire, champ qui correspondait à la volonté du législateur de 2004.
59 () Art. 712, dernier alinéa, du code de procédure pénale.
60 () Ce qui exclut les prolongations de garde à vue et les extractions médicales.
61 () Décidé par la loi d’orientation et de programmation pour la justice de 2002, le « programme 13 200 » prévoit la création de 13 200 places avec la construction d’une quinzaine d’établissements pénitentiaires et de sept établissements pour mineurs. Ces derniers ont été les premiers à ouvrir dès 2007. La livraison des établissements pour majeurs a débuté à l’automne 2008.
62 () Règle pénitentiaire européenne n° 46.1.
63 () Rapport d’information (n° 1811, session extraordinaire de 2008-2009) de M. Etienne Blanc au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale relatif à la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes majeures placées sous main de justice.
64 () Avis (n° 222, session ordinaire de 2008-2009) de M. Nicolas About, au nom de la commission des Affaires sociales du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire.
65 () Avis (n° 222, session ordinaire de 2008-2009) de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi pénitentiaire.
66 () Audition du 10 septembre 2009.
67 () Hors aide au retour volontaire.
68 () Rapport d’information (n° 516, session extraordinaire de 2008-2009) de M. Pierre Bernard-Reymond, au nom de la commission des Finances du Sénat sur l’enquête de la Cour des comptes relative à la gestion des centres de rétention administrative.
69 () La différence est due essentiellement au fait que l’OFPRA ne les a pas tous convoqués et a statué sur dossier, les désistements étant minimes.
70 () Audition du 16 septembre 2009.
71 () Pierre Richard, Solidarité et performance. Les enjeux de la maîtrise des dépenses publiques locales, 2006, p. 63 et suivantes.
72 () Ibid., p. 65.
73 () Voir par exemple Ponts Formation Edition, « Réussir la mutualisation des services : méthodes, enjeux et obstacles à surmonter », Paris, 24 septembre 2009 ou Assemblée des Communautés de France, « Quels enjeux pour la mutualisation des services entre communes et communauté ? », octobre 2009.
74 () CJCE, 6 juin 2009, Commission contre Allemagne.
75 () CJCE, 13 novembre 2008, Coditel Brabant.
76 () CE, 4 mars 2009, Syndicat national des industries d’information de santé. Pour une analyse détaillée de cette jurisprudence voir notamment Assemblée des Communautés de France, « Quels enjeux pour la mutualisation des services entre communes et communauté ? », octobre 2009 et Jean-David Dreyfus et Stéphane Rodrigues, « La coopération intercommunale confortée par la CJCE ? », AJDA, 28 septembre 2009, p. 1715.
77 () Audition du 16 septembre 2009.
78 () Audition du 16 septembre 2009.
79 () Assemblée des Communautés de France, « Quels enjeux pour la mutualisation des services entre communes et communauté ? », octobre 2009, p. 7.
80 () Proposition n° 10 du rapport du sénateur Philippe Dallier, Bilan et perspectives de l’intercommunalité à fiscalité propre, Observatoire de la décentralisation, 2006.
81 () Proposition n° 5 du rapport de M. Pierre Richard, Solidarité et performance. Les enjeux de la maîtrise des dépenses publiques locales, 2006.
82 () Comité pour la réforme des collectivités locales, « Il est temps de décider », rapport au Président de la République, mars 2009, p.61.
83 () M. Jean-Marie Pontier, « La décentralisation et le temps », in Revue de droit public, 1990, pages 1220-1221.
84 () MM. Bruno Durieux, Bertrand Meary, Jean-Yves Le Gallou, Jean-Baptiste Nicolas, Xavier Hemeury, David Revelin et Christophe Bertani, Rapport sur l’impact de la décentralisation sur les administrations d’État. Ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, juillet 2007.
85 () MM. Bruno Durieux, Jean-Baptiste Nicolas, Michel Gagneux, Jean-Yves Le Gallou, Laurent Chambaud, Nicolas Grivel, Rapport sur l’impact de la décentralisation sur les administrations d’État. Ministère de l’Emploi et de la cohésion sociale. Ministère de la Santé et des solidarités, janvier 2007.
86 () Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.
87 () Question écrite n° 87405 de M. Alain Suguenot publiée dans le JO Assemblée nationale du 28 février 2006.
88 () Réponse du Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire publiée dans le JO Assemblée nationale du 28 novembre 2006.
89 () Proposition de loi (n° 757, session ordinaire 2007-2008) tendant à limiter les dépenses de communication dans le budget des collectivités territoriales, déposée le 3 mars sur le bureau de l’Assemblée nationale par M. Pierre Morel-A-l’Huissier.
90 () Rapport d’information (n° 1153, session ordinaire 2008-2009) de MM. Didier Quentin et Jean-Jacques Urvoas fait au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur la clarification des compétences des collectivités territoriales.
91 () M. Pierre Richard, Rapport sur la maîtrise et le pilotage des dépenses locales, décembre 2006, proposition n° 13.
92 () Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008.
93 () Conclusion du conseil d’administration de la CADES réuni le 21 avril 2009.
94 () Audition du 22 septembre 2009.
95 () Audition du 22 septembre 2009.
96 () Audition du 10 septembre 2009.
97 () Audition du 10 septembre 2008.
98 () Rapport de la Cour des comptes sur la sécurité sociale, septembre 2009.
99 () Rapport d’information de l’Assemblée nationale, n°1933, déposé par la commission des Affaires sociales et la commission des Finances le 23 septembre 2009.
100 () Audition du 24 juin 2009 de la commission des Finances consacrée au bilan des activités de la Caisse des Dépôts et Consignations.
101 () Audition du 10 septembre 2009.
102 () Loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
103 () Auditions de M. Rémi Pellet du 10 septembre 2009 et de M. Patrice Ract-Madoux du 22 septembre 2009.
104 () Voir infra.
105 () Voir infra.
106 () Audition du 10 septembre 2009.
107 () Article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi n° 2005-881 du 2 août 2005.
108 () Audition du 10 septembre 2009.
109 () Audition du 10 septembre 2009.
110 () Créée par la loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996.
111 () Cf. avis n° 4 du comité d’alerte sur le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie publié le 29 mai 2007.
112 () Audition du 10 septembre 2009.
113 () Loi dite en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.
114 () Rapport d’information n° 1794 relatif à l’application des mesures fiscales dans les lois de finances et dans la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, déposé le 2 juillet 2009.
115 () Article L. 136-2 à L136-4 du code de la sécurité sociale.
116 () Article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
117 () Article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
118 () Rapport d’information n° 1798 publié en juillet 2009 par la commission des Lois de l’Assemblée nationale.
119 () Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007.
120 () Rapport de la Cour des comptes sur la sécurité sociale, septembre 2007, pp. 148.
121 () Voir supra.
122 () Projet de loi de financement de la sécurité sociale, Annexe n° 5, page 175.
123 () UCANSS, « Le personnel des organismes de sécurité sociale en 2008 – situation au 31 décembre 2008 ».
124 () UCANSS, «Le personnel des organismes de sécurité sociale –situation au 31 décembre 2000 ».
125 () Audition du 10 septembre 2009.
126 () Dans les départements d’outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion, les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) regroupent les services de l’assurance maladie, de l’assurance retraite et de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF).
127 () Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, Rapport d’activité 2008, Mieux organiser.
128 () Audition du 10 septembre 2009.
129 () Ensemble des règles destinées à assurer la couverture du risque de perte de revenus en cas d’intempéries (gel, chute de neige, pluies abondantes, vent violent ) rendant nécessaire l’interruption des travaux d’un chantier. Les salariés du BTP peuvent, sous certaines conditions, prétendre toucher une indemnité d’un montant égal à 75 % de leur salaire pendant une période de 55 jours par an (ou de 495 heures).
130 () Rapport d’observations définitives de la Cour des comptes sur la gestion de la Caisse des congés payés pour les exercices 2003-2005. Le rapport public annuel de la Cour des comptes (pp.131-139) fait état des réponses apportées à ses observations par le ministre de la Culture et de la Communication et le Président du Conseil d’administration de la Caisse des congés payés spectacles.
131 () Audition du 10 septembre 2009.
132 () Dématérialisation et indexation automatique des documents et messages électroniques.
133 () La Déclaration automatisée des données sociales unifiées (DADS-U) contenant les données individuelles relatives aux rémunérations et aux cotisations des salariés comprises dans la déclaration annuelle de données sociales (DADS) et les données destinées aux institutions de retraite complémentaire et de prévoyance ; la Déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS)qui permet de déclarer sous forme dématérialisée les cotisations sociales périodiques dues au régime général, au régime d’assurance chômage, aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance et, le cas échéant, à la caisse de congés intempéries du bâtiment et des travaux publics ; le Bordereau récapitulatif de cotisations (BRC), déclaration papier des cotisations sociales dues selon une périodicité mensuelle ou trimestrielle auprès des URSSAF.
134 () Loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français et instituant une compensation obligatoire entre régimes de base de sécurité sociale obligatoire.
135 () Articles L.134-4 et L.134-5 du code de la sécurité sociale.
136 () Audition du 10 septembre 2009.
137 () Rapport n°IV « Evaluation de la CMU »réalisée en application de l’article 34 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, pp. 7 e t 8.
138 () Rapport d’information n° 385 (2007-2008) de M. Alain Vasselle, sénateur, au nom de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale et de la commission des Affaires sociales du Sénat.
139 () Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des statistiques, « Les Comptes nationaux de la santé en 2008 », septembre 2009.
140 () L’UNOCAM a souligné que cette étude sous-estime les frais de gestion de l’assurance maladie obligatoire en omettant notamment de comptabiliser les frais de gestion hospitaliers, la dette transférée à la CADES et le poids du déficit.
141 () Ce montant recouvre, d’après l’étude de la Cour des comptes, le montant des aides fiscales et sociales versées pour les contrats collectifs en entreprise, les exonérations de taxe d’assurance, l’aide à l’acquisition d’une complémentaire pour les ménages dont les ressources se situent immédiatement au-dessus du plafond de la CMU, etc.
142 () Le taux d’activité des femmes âgées de 15 à 64 ans s’élève à 65,3 % en 2007 d’après les chiffres fournis par l’INSEE dans l’étude « Séries longues sur le marché du travail » (n° 82 – mai 2008).
143 () Audition du 10 septembre 2009.
144 () La première hypothèse coûtant aux finances publiques en moyenne 1366 euros par mois, quand la seconde revient à 895 euros par mois.
145 () Audition du 10 septembre 2009.
146 () Article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles.
147 () Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, 2008, chapitre X, « Les aides à la garde des jeunes enfants ».
148 () Michèle Tabarot, Carole Lépine, Le développement de l’offre d’accueil de la petite enfance, Bibliothèque des rapports publics, La Documentation française, 2008, p. 35 et suivantes.
149 () DREES, Études et résultats n° 636, « Le métier d’assistante maternelle », mai 2008.
150 () DREES, Études et résultats n° 695, « Les dépenses pour la garde des jeunes enfants. Crèche et assistante maternelle : un coût proche pour les familles après allocations et aides fiscales », juin 2009.
151 () Rapport mondial sur le Développement humain 2009, publié par le PNUD en octobre 2009.
152 () Plos Medicine, Significant reduction of Antibiotic Use in the Community after a Nationwide Campaign in France, 2002-2007.
© Assemblée nationale